Derniers articles

Plus que jamais, nous avons besoin d’un gouvernement solidaire

Presse toi à gauche publie cette lettre mais tient à souligner son désaccord avec le projet proposé par Gabriel Nadeau Dubois. Notre analyse de la situation ne pose pas la nécessité de devenir un parti de gouvernement ni de changer le programme du parti. Nous nous situons dans la nécessité d'un réel débat sur la démocratie dans le parti, la remise en question des pôles de pouvoir, le délestage du féminisme, la droitisation du programme. Nous tenons compte des propos de Catherine et d'Émilise.
Mais nous pensons qu'un réel débat oblige à bien connaître les différentes positions. C'est pourquoi nous publions ce texte.
« Nous croyons non seulement que Québec solidaire peut prendre le pouvoir, mais qu'il doit former le gouvernement », écrivent les signataires.
Milan Bernard, Élodie Comtois, Ludvic Moquin-Beaudry et Josée Vanasse
Les auteurs sont respectivement ancien candidat dans Gatineau (2018) et ancien membre de la Commission politique (2020-2023) ; militante solidaire dans Gouin et ancienne membre de la Commission politique, responsable culture (2020-2022) ; militant solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques et ancien responsable national aux élections (2016-2018) ; militante de Québec solidaire depuis 2006, première attachée politique d'Amir Khadir et directrice de plusieurs campagnes électorales, dont celles de Mercier en 2008 et Rosemont en 2018. Ils cosignent cette lettre avec 76 autres militants.*
Les dernières semaines ne furent pas de tout repos pour Québec solidaire (QS). Le départ de notre co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien et les circonstances qui y ont mené sont tristes et regrettables. Nous souhaitons de tout coeur qu'elle se remette sur pied et qu'elle nous revienne en santé. Sa voix est indispensable au succès de notre parti.
Nous souhaitons aussi que Québec solidaire continue à faire les efforts nécessaires pour éliminer les obstacles structurels à la participation des femmes. Nous sommes convaincus que le comité de coordination national actuel, mené par notre présidente, Roxane Milot, épaulée par la directrice générale du parti, Myriam Fortin, et incluant nos deux porte-parole, est à la hauteur de la situation. Ces personnes ont notre pleine confiance.
On a vu éclore au grand jour certains questionnements au sein de notre parti, portant sur la manière de réaliser notre projet de société. Pourtant, sans nier l'importance de cette tension, nous remarquons que la gravité de la situation a été quelque peu exagérée. Plusieurs observateurs de la joute politique ont présenté ces débats comme radicalement nouveaux ou complètement polarisés. Nous sommes en désaccord.
Ces débats ne sont pas nouveaux ; non seulement ils précèdent l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois comme porte-parole masculin, mais on les retrouve dans plusieurs autres partis de gauche à travers le monde, et ce, depuis des décennies. Depuis 2018, ces questionnements ont généré de plus en plus d'écho à mesure que Québec solidaire devait gérer sa croissance. Or, les différentes visions qui s'expriment ne sont pas incompatibles. Nous avons tous et toutes différentes sensibilités, mais nous savons que c'est ensemble, rassemblés, que nous pouvons mieux les exprimer.
Force politique incontournable et inédite dans notre histoire, Québec solidaire est le plus important instrument que la gauche québécoise a créé pour réaliser son projet de transformation sociale et d'émancipation nationale et populaire.
Nous croyons non seulement que Québec solidaire peut prendre le pouvoir, mais qu'il doit former le gouvernement. C'est une condition nécessaire pour mettre de l'avant notre projet de société rassembleur et novateur, et rompre avec les cycles de dépossession, de déconstruction et de division mis en place par les partis traditionnels.
Pour accomplir cet objectif, nous avons entrepris une modernisation du parti pour nous assurer que notre instrument est adapté à l'ampleur de la tâche. Il n'est nullement question de diluer ce qu'est Québec solidaire. Il s'agit plutôt de se concentrer sur l'essentiel et les urgences ; de canaliser nos forces et nos énergies dans la construction de nouvelles majorités sociales afin de prendre le pouvoir. Voilà ce qu'impose le fait d'être un « parti de gouvernement », les pieds bien plantés dans les mobilisations et les préoccupations des gens et des peuples du Québec, afin que nos aspirations collectives deviennent réalité.
Cette modernisation n'est pas l'oeuvre d'une seule personne. C'est un processus s'inscrivant dans les traditions démocratiques de Québec solidaire, avec des décisions prises par les délégués des associations de circonscriptions, des mandats confiés à diverses instances exécutives avec l'imputabilité qui y est associée, et suivant de larges consultations à travers les régions du Québec.
Par exemple, la Déclaration de Saguenay est le fruit d'une grande tournée, menée en collaboration avec les associations locales. Le résultat final de cette modernisation reste encore à déterminer, mais une chose est sûre, ce sera le produit de la démocratie participative de Québec solidaire. Nous parions que nous saurons éviter le faux dilemme qui consiste à choisir entre la marginalité d'une part et la trahison de nos idéaux et le social-libéralisme d'autre part. Notre imagination est plus puissante que cela : nous déterminerons ensemble la manière de passer à la prochaine étape.
Les solidaires ne seront jamais comme les autres, même au pouvoir. Nous sommes fougueux, audacieux, incisifs et ambitieux, toujours de colère et d'espoir. C'est dans ces caractéristiques que se trouvent la clé de notre victoire et le reflet de notre authenticité.
Former le gouvernement ne signifie en rien renoncer à l'ancrage solidaire dans les mouvements sociaux. Cet ancrage est aussi nécessaire que la victoire électorale pour mettre en oeuvre notre projet. Cela s'est notamment déployé depuis 2018 par de nombreux efforts de mobilisation de terrain, pour les luttes environnementales, dans les actions sur le logement et contre le Far West des claims miniers, de même que par la présence constante de membres de l'aile parlementaire dans les luttes citoyennes : dans la rue, sur les lignes de piquetage, avec ceux et celles que l'on réduit au silence.
L'état du monde et du Québec est grave. Les gouvernements successifs libéraux, péquistes et caquistes et leurs alliés à Ottawa ont ignoré la crise climatique, démantelé les services publics et attaqué les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois. Sur trop d'enjeux, ils ont fait reculer le Québec. Plus que jamais, nous avons besoin de Québec solidaire pour répondre aux crises multiples qui affligent le Québec.
Nous, membres de Québec solidaire, avons pris la résolution en instance nationale de préparer l'élection du premier gouvernement solidaire. Tous les jours, nos élus et des dizaines de bénévoles travaillent d'arrache-pied pour y arriver et nous rendre des comptes en même temps. Ces personnes méritent notre confiance et notre soutien. C'est ensemble que nous arriverons à la victoire
Ensemble, construisons le Québec de demain. Donnons-nous un gouvernement solidaire.
*Ont cosigné cette lettre : Monique Moisan, membre fondatrice de Québec solidaire et ancienne responsable nationale de la formation (2012-2014) ; Ghislain Pelletier, membre fondateur de Québec solidaire, ancien membre du comité de coordination national et ancien membre du comité de coordination de Mercier ; Katy Borges, coordonnatrice de l'association régionale de Montréal de Québec solidaire ; Simon Mongeau-Descôteaux, militant solidaire dans Sherbrooke, responsable du pointage dans Sherbrooke (2022) et membre du comité de coordination de Sherbrooke depuis 2023 ; Martin Godon, responsable du comité de coordination de Marie-Victorin ; Stéphane Morin, fier militant de terrain dans Gouin ; Annie Pouliot, membre fondatrice, Québec solidaire Montmorency ; Chantal Plamondon, militante dans Sainte-Marie–Saint-Jacques ; Vincent Courteau-Hébert, militant solidaire dans Gouin et membre de l'équipe des communications de la campagne de 2022 ; Joëlle Naud, militante de Québec solidaire, responsable des bénévoles pour Laurier-Dorion (2018) et responsable du Jour J pour Verdun (2022) ; Anne B-Godbout, candidate dans Terrebonne (2018) et LaFontaine (2022) ; Chloé Domingue-Bouchard, militante solidaire dans Gouin et ancienne membre de la commission politique, responsable éducation (2020-2022) ; Philippe Lapointe, militant solidaire dans Gouin et ancienne membre de la commission politique, responsable travail (2020-2022) ; Stéphane Thellen, ancien candidat (2008) et membre du comité de coordination dans Huntingdon ; Philippe Jetten-Vigeant, ex-candidat dans Iberville (2018 et 2022) ; Mario Jodoin, membre de la commission thématique sur l'économie, la fiscalité et la lutte à la pauvreté depuis 15 ans ; Pierre-Paul St-Onge, secrétaire général de 2013 à 2016, candidat en 2012, 2014 et 2018 ; Kévin St-Jean, militant dans Portneuf et ancien candidat dans Les Plaines (2018) ; Pierre Alarie, membre fondateur, militant dans Anjou–Louis-Riel et Hochelaga-Maisonneuve ; Anne-Marie David, responsable à la liaison avec les associations de 2016 à 2020, ex-coordonnatrice de QS Montérégie et présentement co-coordonnatrice de QS Verchères ; Léonie Thibault Rousseau, co-coordonnatrice de QS Verchères, étudiante au baccalauréat en géographie environnementale ; Jordan Raymond, militant solidaire dans Johnson ; Julie Dionne, responsable des élections au comité de coordination national ; Barbara Gagnon, responsable des communications dans Sherbrooke ; Steve McKay, militant solidaire dans Saint-François ; Marie-France Hétu, militante solidaire dans Sherbrooke ; Chantal Dubuc, militante solidaire dans Johnson ; Siham Zouali, militante solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques ; Simon Richer, bénévole dans la partielle Gouin (2017), responsable des communications au comité de coordination de Laurier-Dorion (2017-2018), responsable de l'accueil pour Laurier-Dorion (2018), bénévole pour Verdun (2022) ; Sophie Brochu, militante solidaire ; David Touchette, candidat dans LaFontaine (2018) et candidat dans Westmount–Saint-Louis (2022) ; Pierre Gauthier, porte-parole masculin de QS Verdun ; Lauréline Manassero, militante depuis 2014 et porte-parole femme de QS Marie-Victorin ; Amélie-Hélène Rheault, militante depuis 2006, anciennement membre de QS Estrie, membre du comité de coordination de QS Saint-François ; Marie Bélanger, cofondatrice de QS Verchères et militante dès la fondation de QS ; Catherine Ladouceur, militante solidaire dans Saint-François ; Claude Lefrançois, candidate dans Laporte aux élections de 2018 et de 2022 ; Gilles Sabourin, coordonnateur de l'association de Laporte ; Pierre-Luc Lavertu, candidat dans Saint-Jean en 2022 ; Christian Montmarquette, membre fondateur et militant de Québec solidaire depuis ses origines ; Jean-Léon Rondeau, militant solidaire dans Laporte ; Blanche Paradis, membre fondatrice de QS, ancienne responsable de la commission nationale des femmes et ancienne membre du comité de coordination nationale de Québec solidaire ; Myriam Leduc, membre des comités de direction de campagne dans Gouin en 2017 et Laurier-Dorion en 2018, codirectrice de campagne dans Verdun en 2022 et militante solidaire dans Mercier ; Manon Blanchard, co-porte-parole de QS Taillon, membre fondatrice et candidate dans Taillon ; Pierre Parker, coordonnateur de QS Verdun ; Luc Harbour, représentant officiel de QS Sherbrooke ; Anne Blouin, responsable des communications de l'association de QS Verdun ; Maïté Girard-English, militante solidaire dans Pontiac ; Nadine Beaudoin, co-organisatrice du congrès de fondation et coordonnatrice générale du parti 2006-2023, directrice des élections générales de 2008 à 2022 ; Gaétan Châteauneuf, co-organisateur du congrès de fondation de Québec solidaire, ex-porte-parole de l'association de QS Bourget (Camille-Laurin), candidat dans Bourget (Camille-Laurin) en 2014, secrétaire général de 2016 à 2020 au comité de coordination national, représentant officiel par intérim de l'association de QS Bertrand ; Ginette Langlois, militante au comité de coordination de QS Montérégie ; Mike Owen Sebagenzi, co-coordonnateur du Réseau militant jeunesse, militant dans Hull, candidat dans Pontiac en 2022 ; Maxime Larue, responsable à la mobilisation au comité de coordination national (2019-2023) ; William Lemieux, bénévole de campagne dans Blainville (2022), responsable aux communications du comité de coordination de Blainville (2023) ; Joëlle St-Arnault, responsable des bénévoles de QS Laporte ; Jacques Tanguay, représentant officiel de QS Laporte ; Danielle Champagne, militante solidaire dans Laporte ; Pascal Lavoie, militant solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques ; Nora Robichaud, militante solidaire dans Maurice-Richard ; Bernard Gauvin, ex-coordonnateur de QS Maurice-Richard ; Philippe Badenas, militant solidaire dans Maurice-Richard ; Thomas Poulin, militant depuis 2012, ancien membre du comité de coordination de Gouin, Porte-Parole du comité de coordination de Gaspé ; Geneviève Fortier-Moreau, membre du comité de coordination de Verdun et ex-candidate en 2012-2013-2014 dans Viau ; Brian Harvey, militant solidaire dans Abitibi-Ouest ; Suzanne Brais, militante solidaire dans Abitibi-Ouest ; Émile Bellerose-Simard, candidat dans Masson en 2022 ; Véronique Painchaud, militante solidaire dans Berthier ; Isabelle Gonthier, militante solidaire dans Mercier, ancienne attachée au bureau d'Amir Khadir et employée aux campagnes électorales de 2007 à 2022 ; Jérémie Vachon, militant solidaire ; Julien St-Pierre, militant solidaire dans Richmond ; Mathieu Sabourin, militant solidaire ; Michael Ottereyes, militant autochtone, ex-candidat dans Roberval ; Nika Deslauriers, militante depuis 2006, attachée politique d'Amir Khadir de 2011 à 2017 et présidente de Québec solidaire de 2017 à 2021 ; Jean-Bernard Rose, militant dans Sainte-Marie–Saint-Jacques ; Véronique Tessier, membre solidaire dans Taschereau ; Jordan Larochelle, membre du comité de coordination dans Hull.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un Musée d’histoire du Québec....une grosse blague

Le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière la création d'un Musée d'histoire du Québec...vraiment ?
Un Musée...vraiment ?
Monsieur Legault précise dans son annonce que le musée sera situé au Petit séminaire de Québec, Pavillon Camille Roy en plein dans la vieille ville de Québec et commencera avec l'histoire de Champlain. Des précisons ont été apportées expliquant que le Musée serait axé sur l'histoire de la nation québécoise. Plusieurs réticences ont été soulevées dont certaines en lien avec le Musée de la Civilisations à proximité de ce nouveau musée. D'autres visent clairement les conceptions historiques que présupposent une telle initiative.
Pourquoi partir de Champlain ? Et pas Jeanne Mance ?
Les hommes font l'histoire...pas les femmes...
En fait cette annonce c'est le symbole d'une conception d'hommes blancs coloniaux qui pour eux (et je dis bien eux, pour cette annonce) sont d'accord avec une approche identitaire de la nation québécoise. En fait monsieur Legault a voulu polir son image face au baisse dans les sondages en relançant les idéologies du « Québécois pure laine » et jouer ainsi sur le terrain politique du PQ en plein succès électoraux. Les personnes immigrantes ne seront certes pas au centre de cette conception historique. Pourtant Champlain et Jacques Cartier venaient de France.
C'est cette même approche qui l'empêche de reconnaître le génocide palestinien, d'accorder un appui inconditionnel à Israël et à ouvrir un bureau du Québec à Jérusalem.
Et les Nations autochtones ?
Elles font partie de la préhistoire ? Selon les propos de l'historien Éric Bébard, consultant sur le projet. Les Premières Nations ont évidemment émis des critiques d'une telle approche.
Et il y a un lien clair entre la marginalisation des nations autochtones et le refus du gouvernement Legault de reconnaître le racisme systémique et d'appuyer le Principe de Joyce.
TVA rapportait ainsi la nouvelle :
(https://www.tvanouvelles.ca/2024/05/08/nouveau-musee-lhistoire-de-la-nation-quebecoise-a-commence-avec-champlain-maintient-legault)
« Face aux critiques, François Legault assure qu'il sera question aussi des Autochtones au Musée national de l'histoire du Québec (MNHQ). Le premier ministre maintient toutefois que l'histoire de la nation québécoise « a commencé avec Champlain ».
Mardi, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a accusé François Legault d'essayer d'effacer les Premières Nations de l'histoire du Québec en affirmant que l'histoire de la nation québécoise a « débuté avec Champlain ».
M. Picard faisait référence à des propos tenus par le premier ministre lors de l'annonce de la création du MNHQ, le 25 avril dernier.
Lors de cette même conférence de presse, l'historien Éric Bédard, qui accompagne le Musée de la civilisation dans la préparation des premières expositions, a laissé tomber « que les Autochtones représentent un peu la préhistoire du Québec ».
« Nous sommes indissociables de l'histoire de cette terre, et l'arrivée de Champlain ne définit pas le Québec », a dénoncé le chef Picard, en dénonçant ces propos « inacceptables ».
Relancé à ce sujet, le chef caquiste a nuancé sa position, qu'il maintient. « Le Musée national de l'histoire du Québec, donc c'est le musée de la nation québécoise », a-t-il réitéré.
Et les écomusées…
Pourquoi favoriser d'immenses musées au lieu de financer et soutenir tout le réseau des écomusées. Toute cette chaîne de petits musées mettent en valeur des aspects intéressants de l'art, de l'artisanat, du folklore des régions. Elle participent à l'écotourisme. Ils sont bien implantés régionalement. Ils sont inclusifs de la nation québécoise et permettent aussi la visibilité des cultures autochtones.
La culture doit être partagée et non objet de consommation pour les personnes riches, blanches et coloniales.
Chloé Matte Gagné
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

S’unir pour gouverner autrement

Depuis 2006, les occasions de trébucher ont été quotidiennes, entre les pièges du jeu médiatique et la nature des institutions dans lesquelles nous avons choisi d'entrer. Malgré de nombreux obstacles, l'ascension promise par les solidaires s'est tranquillement concrétisée et Québec solidaire est devenu une organisation irremplaçable pour la gauche québécoise.
Le départ d'Émilise est un choc pour l'ensemble de notre parti et une perte immense. Son départ, suivi de celui de membres de la direction, soulève des questionnements profonds pour notre organisation.
Cette crise met au jour la nécessité pour notre parti de mener les débats pour nous entendre sur notre vision d'une gauche prête à gouverner sans renoncer à elle-même, sur nos objectifs et sur les moyens à déployer pour réussir. Ce besoin ne s'est jamais fait aussi pressant. Pour affronter cette tempête, il est important de se rappeler pourquoi notre projet politique est essentiel et décider comment adresser ces questionnements fondamentaux.
Une histoire qui dépasse notre seul parti
Québec solidaire s'inscrit dans une longue tradition au Québec de luttes, de défaites, mais aussi de victoires face au saccage de nos services publics, à la destruction de nos tissus sociaux et de nos milieux de vie. Ce Québec rêve d'une société plus juste, égalitaire et solidaire.
QS a permis de faire cheminer des idées dans la société et de faire la démonstration que les partis traditionnels sont incapables de proposer des solutions aux crises que nous traversons. QS a imposé des débats jusque-là ignorés par la classe politique. Pensons aux questions d'inégalité de classe, de féminisme, d'antiracisme et d'écologie.
QS n'a pas accompli ce travail seul, mais accompagné et porté par des mouvements sociaux. Notre lien avec la rue est historique et ce lien devra être encore plus important si nous voulons prendre le pouvoir. Sans l'appui et la participation active de mouvements sociaux forts, la gauche solidaire ne peut aspirer à gouverner.
En plus des questions de fond, notre parti se distingue par la forme de son organisation. Contrairement aux autres partis, QS s'est construit sur une culture démocratique ancrée dans notre volonté de donner la voix au peuple. Pour incarner cette culture démocratique, nous nous sommes doté·e·s d'une structure à l'image de nos convictions. C'est pourquoi encore aujourd'hui nous avons un co-porte-parolat qui implique une direction collective et un partage de responsabilités égal entre une femme et un homme.
C'est grâce à notre message et à cette façon de faire que nous avons su convaincre des dizaines de milliers de Québécois·e·s de nous rejoindre. Rompre avec notre héritage non-conformiste ne saurait profiter ni à notre parti, ni au Québec.
La force de notre ADN hybride
L'aventure de QS est celle de gens très différents qui s'assoient à la même table et qui aspirent ensemble au renversement du dogme de la résignation. À notre fondation, lorsqu'Option Citoyenne portée par Françoise a fusionné avec l'UFP d'où venait Amir, nous avons choisi d'additionner nos forces. Cette volonté profonde de changer les choses nous a amené·e·s à travailler ensemble et à réconcilier des discours jusque-là parallèles. Ceux et celles qui pensent aujourd'hui que certains d'entre nous n'ont pas leur place au sein de la grande famille solidaire se trompent. L'histoire de notre parti nous montre que QS a puisé sa pertinence dans sa capacité à rallier les gens, pas à les diviser. Notre mouvement doit s'élargir, notre organisation doit continuer d'accueillir ceux et celles qui ont envie de changement.
Le départ de notre première porte-parole issue de la ruralité est un signal d'alarme. Sa démission nous rappelle l'importance d'apporter des changements à certaines de nos pratiques organisationnelles pour leur plein réancrage féministe et démocratique. Nous avons besoin de revoir nos façons de concevoir et d'exercer le pouvoir à l'intérieur même de notre parti, pour qu'il soit mieux partagé, plus inclusif, afin de se faire plus créateur.
Un projet possible et nécessaire
Cela a le mérite d'être clair, nous avons besoin de changements pour passer à la prochaine étape. Ces changements passent notamment par le renouvellement de notre ancrage dans les mouvements sociaux et par notre détermination à mener et remporter des batailles d'idées dans le débat public. Si nous voulons engranger de nouvelles victoires électorales, il nous faudra également une bonne dose de réalisme pour saisir les rapports de force et travailler à les changer à notre avantage, faute de quoi nos efforts seront anéantis. Ce travail peut et doit se faire sans jamais perdre de vue nos objectifs de transformation de la société.
Pour faire rêver le Québec, nous devons lui proposer un projet rassembleur. Nous devons créer les conditions de convergence entre les différentes tendances qui composent notre parti, pas en évacuer l'une au profit de l'autre. À Québec solidaire, on est à la fois rêveur et lucide, réaliste et audacieux.
La gauche n'a pas le luxe de se diviser. Nous sommes plus forts lorsque nous luttons ensemble malgré nos différences. Oui, nous devons aspirer à plus qu'être un parti de gouvernement, mais nous devons aspirer à gouverner autrement.
Premiers et premières signataires :
Victor Beaudet-Latendresse, membre du comité de coordination nationale
Maïka Sondarjee, membre du comité de coordination de Hull
Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard
Royse Henderson, membre du comité de coordination nationale pour la Commission nationale des femmes
Amir Khadir, ancien porte-parole et député de la circonscription de Mercier de 2008 à 2018
François Saillant, membre fondateur et ex-membre du comité de coordination nationale
Émilie Poirier, ex-membre du comité de coordination nationale
Benjamin Gingras, candidat solidaire dans Abitibi-Est en 2022 et membre du comité de coordination nationale pour la Commission nationale autochtone
Kenza Sassi, ex-membre du comité de coordination nationale et candidate dans Orford en 2022
André Frappier, ancien président et co-porte-parole de Québec solidaire
Élisabeth Germain, candidate dans Charlesbourg en 2018
Alexandre Legault, candidat solidaire dans Brome-Missisquoi en 2018 et 2022
Pour signer la lettre 👉 https://forms.gle/CocGxH6DY5fWgsmv6
Signataires suivant.e.s :
Carol-Ann Kack, candidate 2018 et 2022 dans Rimouski, Pp femmes coco Rimouski
Katy Borges, Coordonnatrice de l'asso régionale de Montréal
Élisabeth Béfort-Doucet, Membre de comité de coordination de Bourassa-Sauvé
Amélie Drainville, Ex-membre du comité de coordination et candidate en 2022 dans la circonscription de Berthier
La Rocque, bénévole dans Maurice-Richard
Sylvain Benoit
Mario Jodoin, membre de la Commission thématique sur l'économie, la fiscalité et la lutte à la pauvreté
Hélène Cliche, membre du coco Lotbinière-Frontenac
Jimena Aragon, candidate dans Chauveau 2022
Laura Avalos, Candidate 2022 à Gatineau et 2014 à Chapleau, Outaouais
Louise Foisy
Patrick Laplante, ex porte-parole masculin circonscription Bourget (actuellement Camille Laurin)
Édith Laperle, ancienne candidate dans Outremont en 2012, 2013 et 2014.
Myriam St-Pierre, membre du comité de coordination de Papineau
Pier-Luc Brault, membre du comité de coordination, QS Saint-François
Michelle Corcos, responsable de la Commission thématique Santé, Conditions de vie et Services sociaux
Nadia Blouin, candidate en 2014 dans Lotbinière-Frontenac et membre du coco de Lotbinière-Frontenac
Marie-Claude Latourelle, membre du comité de coordination de Papineau et candidate de Papineau en 2022
Serge Bruneau, membre
Audrey Givern-Héroux, représentante de la Côte-Nord à la Commission nationale des femmes et candidate en 2022 dans René-Lévesque
Brigitte Morin, membre
Marie-Josée Doucet, membre de la Commission nationale des femmes (représentante régionale de l'Estrie)
Josiane Richer, membre
François Godbout, membre
Goulimine Cadoret, ex candidate Rivière du Loup, Témiscouata Les Badques
Alexandre Clément, Co-porte-parole de QS Papineau
Mathilde Moussu-Lussier, Membre de Québec solidaire Laval-des-Rapides
Michelle Sirois, Membre du comité de coordination Saint-Jean-Iberville
Antoine Côté, Membre du comité de coordination de Québec solidaire dans Mont-Royal–Outremont
Guillaume Lajoie, candidat dans Mille-Îles 2022, membre de la commission thématique économie, travail et lutte contre la pauvreté
Salem Tajeddine, Membre
Angélique Soleil Lavoie, Représentante femmes de la région de Montréal
Zachary Robert, Candidat de 2022 dans Chomedey et membre du comité de coordination de la région de Laval
André Querry, Membre
Karine Cliche, Candidate dans Sainte-Rose 2022 et membre du comité de coordination de Sainte-Rose et de Laval
David Poulin, Membre du coco Lotbinière-Frontenac
Jean Pierre Roy Valdebenito, Membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage, membre de la CT santé
Jonathan Durand Folco, Membre de Hull et ancien responsable des orientations
Gabriel Masi, Militant solidaire dans Vimont
Geru Schneider, Ex-membre du comité de coordination de Laval, membre
Flavie Achard, Membre de la CT éducation
Louis-Philippe Durbet, Membre bénévole de la circonscription de Verchères et du réseau militant jeunesse
Steven Roy Cullen, Candidat à Trois-Rivières en 2022 et co-porte-parole de l'Association de Québec solidaire Trois-Rivières
Daniel Di Raddo, Membre fondateur. Militant de la base.
Elie Presseault, membre et militant sourd
Ronald Cameron, membre de Mercier et du Réseau militant en solidarité internationale
Ananda Proulx, responsable des communications de la CNF
Ricardo Gustave, candidat 2022 et membre du comité de coordination de la circonscription de Bourassa-Sauvé
Alice Paquet, Bénévole dans la circonscription de Roberval en 2018
Marie-Josée Béliveau, Responsable de la CT Altermondialisation et solidarité internationale
Marie Céline Domingue, Candidate dans Charlesbourg en 2012 et 2014, ancienne responsable de la Commission nationale des femmes
Jocelyne Dupuis, membre fondatrice de QS, élue au premier CCN et membre active de berthier
Francine Boucher, CT Santé, conditions de vie, services sociaux
Danielle Adam, Membre du comité des femmes région Québec
France Cormier, Coporte-parole équipe régionale Mauricie pendant 10 ans et membre fondateur 4 circonscriptions.
Ismaël Seck, Candidat dans Jeanne-Mance-Viger en 2018
Stella Bourgon-Germain, Membre du comité de coordination de Laval
Jessica Squires, Membre du comité de coordination de QS-Hull, ancienne membre du comité démocratie participative de QS, ancienne responsable de la CT Justice
Benoit Renaud, Ancien membre du comité de coordination national (secrétaire général 2008-2010, mobilisation 2011-2012, orientations 2017-2019
Stéphane Thellen, Membre du comité de coordination de Québec solidaire Huntingdon
Benoît Landry, Candidat dans Borduas en 2022
Mathilde Chouinard, membre
Aeme Benali, Ex membre de Québec Solidaire et militant.e
Kim St-Pierre, Membre du comité de coordination de Rosemont et membre de la Commission thématique Culture
Jean-Pierre Daubois, Syndicaliste membre de QS
Adrien Guibert-Barthez, Candidat dans Chicoutimi en 2022
Gérard Séguin, Ex-coordonnateur Qs Huntingdon
André David, Coordonnateur de QS Louis-Hébert
Audrey Sigouin, Conseillère, comité local de Trois-Rivières
Isabelle Larrivée, Membre
Lucie Mayer, Responsable CT Agro (2013-2020) ; Responsable CT Culture (2018-2020) ; Candidate et co-porte-parole femme (Bertrand, 2014 et Prévost, 2018) ; Membre co-fondatrice Asso de circo de Prévost (2018-2024) ; Responsable Collectif Accessibilité universelle (2019-2021)
Philippe Jetten, candidat dans Iberville en 2018 et 2022
Pier-Yves Champagne, Membre de QS Jean Lesage
Bruno Apari Lauzier, Membre Coco Ste-Rose/Laval
Rabah Moulla, Membre du CCN entre 2020 et 2022 et ex-candidat en 2018
Marc Sarazin, Membre
Antoine Casgrain, Recherchiste et directeur du service de recherche parlementaire 2015-2024
Roger Rashi, Comité de coordination du Réseau militant intersyndical
Etienne Marcoux, Membre du comité de coordination de la circonscription de Saint-François
David Cormier, Membre du comité de coordination de la circonscription de Trois-Rivières
Matthew Brett, Membre
Josée Chevalier, Membre du comite de coordination de Laval. Cnf et RMI.
Joanne Boutet, membre du comité de coordination de Jean-Lesage
Ginette lewis, membre
Susan Caldwell
André Doucet, Membre dans Lafontaine
Daryl Hubert, Coordonnateur du Réseau militant intersyndical
Maude Laplante-Dubé, Membre du comité de coordination de Taschereau
Bernard Rioux, membre du Réseau Militant Écologiste (RMÉ)
Charles-Émile Fecteau, Militant dans la circonscription de Jean-Talon
Georges Goma, Porte-parole « H » QS Charlesbourg ; Candidat à l'investiture QS de Charlesbourg en 2022 et Candidat QS dans Lévis en 2018
Madeleine Ferland, Membre de QS Laval-des-Rapides
Marjolaine Bougie, Bénévole campagne électorale
Nicole Jetté, membre
Laurent Thivierge, Réseau militant intersyndical de QS
Rosa Pires, Militante et candidate dans Verdun en 2014
Émilie Lambert-Dubé, Membre de l'exécutif Régional de Qs Capitale-Nationale et membre du Comité des femmes de QS Capitale-Nationale
Isabelle Vallée, Ex-membre du comité de coordination Taschereau et ex-membre de la CT Altermondialiste
Pierre Dostie, Membre du comité de coordination de QS Chicoutimi, ancien porte-parole du RAP, ancien co-porte-parole de l'UFP, ancien membre du Comité de coordination national de QS, ancien candidat de l'UFP en 2003 et de QS en 2012, 2016 et 2018 dans Chicoutimi.
Charles Lantin, Membre du comité de coordination de Chicoutimi
Raphael Simard, Ex membre du comité de Hull
Francis Landry, Membre du comité de coordination de la circonscription de Sherbrooke
Lucas Bergeron, Membre du comité de coordination de la circonscription de Chicoutimi
Pierre-Louis Cauchon, Membre du comité de coordination de Taschereau
Josianne Dubé, Membre du comité de coordination de la circonscription de René Lévesque
Aurélie Chouinard, membre du comité de coordination de Taschereau
Louis Horvath, Membre
Gérard Pollender, Membre
Marie-Eve Rancourt, Membre de QS depuis sa fondation, ancienne candidate et ancienne membre du CCN et de la CP
Denis Roy, Comité coordination Laval-des-Rapides
Audrey Gosselin Pellerin, Membre de Québec solidaire dans Taschereau
Andrée-Anne Brillant, Ancienne candidate dans Dubuc, Saguenay
Marie Lauzon, Membre et bénévole
Mégane Tremblay, Membre du comité de coordination de Chicoutimi
Mike Owen Sebagenzi, Co-coordonateur du Réseau Militant Jeunesse, ancien candidat dans Pontiac
Michael Ottereyes, Ex-candidat dans Roberval, ex-coordonnateur de la CNA
Mario Diraddo, Militant de Mercier
Denis Casselot, ex membre de l'exécutif de mercier
Corinne Boutterin, Membre du comité de coordination Chicoutimi
Marie-Soleil Drouin, Coco trois-rivières
Réjean Fournier, Membre du comité de coordination Louis-Hébert
Catherine Cyr Wright, Représentante GÎM à la CNF et porte-parole femme de Bonaventure
Pierre Mouterde, Membre de la commission altermondialiste
Vincent Munger Simard, RO Papineau
Annie Pouliot, Membre fondatrice, QS Montmorency
Louise Constantin, Membre fondatrice, ancienne membre du coco de l'association de Verdun et membre de la commission sur l'altermondialiste et la solidarité internationale
Samuel Yergeau, Membre et militant
Philippe Badenas, Militant de Maurice-Richard
Thomas Poulin, Thomas Poulin, militant depuis 2012, ancien Porte-Parole du Comité de coordination de Gouin, Porte-Parole du comité de coordination de Gaspé
Catherine Browne, membre
Mireille Viau, Membre du comité de coordination de la circonscription Laval-des-Rapides
France Lussier, Membre
David-Alexandre, Représentant Officiel de Taschereau
Christian Montmarquette, Membre fondateur et militant de Québec solidaire depuis ses origines
Louise Morin, membre fondatrice et bénévole
Line Bouchard, Responsable régionale ATU de la CNF QS, Membre coco RNT, et RNt et nord du Québec, représentante CNF
Élise Brunet, Membre du coco de Ste-Rose
Victorien Pilote, Membre fondateur et candidat dans Lafontaine en 2007
Julie Francoeur, Candidate dans Bertrand aux élections 2022, membre du comité de coordination de Bertrand et de la commission thématique Économie
Pour signer la lettre 👉 https://forms.gle/CocGxH6DY5fWgsmv6
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Déclaration de Saguenay définit la crise de Québec solidaire

La crise du parti déclenchée par la démission de sa porte-parole s'étale sur la place publique alimentée par les déclarations et prises de position de la députation d'aujourd'hui et d'hier que relaient à l'interne médias sociaux, moult réunions formelles et informelles et finalement des lettres aux membres reproduites médiatiquement auxquelles répondent des lettres ouvertes dissidentes tout aussi médiatisées. La direction du parti n'a manifestement pas été capable de remettre dans la bouteille le (mauvais) génie de la contestation.
La partie, ou du moins sa première manche, se jouera au Conseil national (CN) de Saguenay à la fin mai. À moins d'un improbable revirement stratégique, la direction du parti tentera d'imposer cette orientation dite pragmatique qu'elle a été contrainte à étaler en plein jour plus vite qu'elle ne le souhaitait avant de la cristalliser par le détour de la Déclaration de Saguenay tenant lieu de programme jusqu'à sa révision. Sinon la crise va s'étendre jusqu'au congrès de l'adoption de ce programme en 2025, ce à quoi doit tendre la gauche contestataire du parti.
La direction du parti a vite compris que crise, en caractères chinois, combine les sinogrammes de menace et d'opportunité. Après avoir tenté de minimiser la crise sans succès, elle a vacillé paressant se diviser. Puis ce fut la grande manœuvre de Gabriel Nadeau-Dubois (GND) rentrant dans ses terres pour mieux rejaillir en transformant la menace en opportunité tout en tentant de balayer sous le tapis l'interprétation féministe de la crise par la nomination de la députée de Sherbrooke comme porte-parole intérimaire. Une fois son caucus réunifié, toutes femmes comprises, les intérêts matériels et le carriérisme y jouant peut-être un certain rôle, la direction avance à visage découvert pour faire de Québec solidaire (QS) un « parti de gouvernement » avec à l'avenant « une refonte complète de son programme » et « la structure du parti "plus efficace, moins lourde et plus simple" ».
Appelons cette orientation proposée la finalisation de la NPDisation de QS dont l'indépendance serait le cache-sexe. Elle est pleinement explicitée dans la Déclaration de Saguenay que doit adopter, une fois amendée, le prochain CN et laquelle doit tenir lieu de « discours politique lors des prochaines années ». C'est donc dire que cette Déclaration se substituera « pragmatiquement » au programme. Si, avant la crise, la meilleure tactique, étant donné le rapport de forces très défavorable à la gauche anticapitaliste, était de tenter d'amender cette Déclaration pour le ramener tant que faire se peut dans le chemin des points saillants du programme, le surgissement de la crise du parti permettrait maintenant de la supprimer de l'ordre du jour tout en lui substituant un débat de fond sur la crise.
Une panne démocratique-féministe qui a permis la centralisation pour recentrer
Ce qui est crucial et essentiel est de libérer la parole militante dans le parti afin de faire apparaître les fondements féministe et démocratique de la crise quitte à accepter et même à se réjouir d'une cacophonie momentanée quant à la remise sur table du programme du parti. C'est le succès relatif de l'inavouable politique chauvine et verticaliste de la direction du parti, au point d'autonomiser l'aile parlementaire, qui lui a permis de « recentrer » le message politique du parti jusqu'à tenter au CN de présenter un document qui a comme vocation de remplacer en catimini son programme. Ensuite, la direction prévoit de le chambouler de fond en comble en 2025 après que la structure du parti eut été, l'automne prochain, rendue plus « efficace » c'est-à-dire verticalisés par la refonte des statuts.
Le recentrage pragmatique est l'art politicien de la fuite en avant et du subterfuge dont l'aile parlementaire est déjà devenue experte. Pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, il suffit de considérer la prise de position du parti à propos du démantèlement ou non du camp pro-Palestine de l'université McGill. D'abord ce n'est pas le porte-parole qui porte la parole du parti sur ce point majeur de la conjoncture du moment tant nationale que mondiale mais son leader parlementaire. Bien campé au centre-gauche, le parti s'oppose au démantèlement « sauvage » du camp Palestine de McGill. Fort bien. Mais cette déclaration n'appuyait pas pour autant cette occupation ni ses demandes envers l'administration universitaire se contentant de porter ailleurs le regard vers le bureau de Tel-Aviv de la CAQ (ou les propos provocateurs du Premier ministre). Estce que cette déclaration signifiait que QS resterait silencieux face à un démantèlement « civilisé » ? Le site web du parti reste coi sur le camp. Le 11 mai à l'occasion de la commémoration de la Naqba, trois députés, mais non les porteparole, visitaient enfin le camp qu'ils disent appuyer, sans plus. Appelons ça une prise de position évolutive. On constate ici le même flottement que vis-à-vis le Front commun dont on visitait les lignes de piquetage mais sans jamais appuyer ses revendications salariales ou encore vis-à-vis le logement social mais sans appuyer la revendication-phare du FRAPRU de la construction de 50 000 logements sociaux sur cinq ans ce qui est pourtant largement insuffisant.
Moins d'électoralisme lors de la dernière campagne aurait peut-être permis d'éviter la présente crise. Québec solidaire aurait pu proposer, à l'encontre de la pollution par la fonderie Glencore de Rouyn-Noranda, en cas d'un refus ou de l'impossibilité de sa modernisation écologique que ce soit par l'entreprise elle-même ou par l'État suite à une nécessaire expropriation, une reconversion par exemple pour fabriquer du matériel pour la rénovation écoénergétique des bâtiments ou des pièces pour des moyens de transport en commun ou en cas de fermeture inévitable un recyclage des travailleurs vers la restauration écoénergétique des bâtiments existants financée par Hydro-Québec. Le syndicat local, au lieu de se ranger derrière le patron, se serait peut-être rallié à cette proposition entraînant derrière lui l'électorat travailleur de Rouyn-Noranda. La circonscription serait probablement restée dans le giron Solidaire… et la présente crise existentielle aurait pu être évitée. Cette heureuse issue aurait été causée par une radicalisation de la plateforme électorale à l'encontre de son centrisme pragmatique qui ne proposait aucune alternative à la menace de fermeture par la multinationale.
Amende honorable aux femmes pour mieux faire passer la Déclaration de Saguenay
On revient au problème de la démocratie interne dont le comité du même nom de quelques dizaines de membres, il y a quelques années, avait fini en queue de poisson à force de s'aplatir devant le Comité de coordination nationale (CCN) devenu le porte-parole de l'aile parlementaires au sein du parti. Le CCN a manœuvré ce comité en lui proposant un grandiloquent rapport débité en congrès sans débat ni vote lequel rapport ramasse la poussière quelque part sur une tablette. La crise démocratique du parti resurgit cette fois-ci par la porte de l'égalité femme-homme. Le malaise créé par la démission de la députée de Taschereau ne se représentant pas et à laquelle succéda un homme, suivi par l'élection en 2022 d'une députation à nette prédominance homme, dans un cadre de stagnation électorale, renforcée par l'élection d'un homme lors de la partielle subséquente, au lieu d'avoir choisi une candidate femme pour quelque peu rétablir l'équilibre, aboutit au livre-choc de Catherine Dorion osant nommer le problème. L'élection de la nouvelle porte-parole mit un baume sur la plaie. Par réaction sa démission fit publiquement éclater la crise.
La manœuvre de la direction (appel au pragmatisme, porte-parole intérimaire) s'étant fracassée contre le mur de la dissidence dont la déclaration de la Commission nationale des femmes (CNF) est l'épine dorsale, la lutte de tendances devient plus ouverte. Dans sa tentative de discréditer cette déclaration, la nouvelle porte-parole s'est tirée dans le pied. Dans son mot envoyé à tous les membres, conjointement avec la Déclaration de la CNF, elle souligne que le personnel rémunéré soutenant la députation, soit une majorité homme dirigée de facto par un homme ce qu'elle ne dit pas, est très majoritairement féminin. Elle révèle ainsi le syndrome bien connu de maintes organisations où les femmes servent les hommes. Bien sûr, pour mieux faire passer l'amère pilule du pragmatisme, elle avoue que l'égalité n'est pas atteinte — comment faire autrement ? — et elle invite les écorchées à « écrire au comité d'éthique » où elles seront suavement ramollies et surtout éloignées de tout groupe dissident.
L'aile parlementaire s'arcboute derrière sa « pragmatique » Déclaration de Saguenay tout en faisant les nuances récupératrices nécessaires pendant que la haute direction du parti y va d'une apaisante lettre aux membres promettant un bilan et un plan d'action soumis au prochain CN pour se sortir de cette « situation douloureuse ». Amende honorable faite, est réitérée « l'adoption de la Déclaration de Saguenay (issue de notre tournée des régions), la possible modernisation du programme et la révision de nos statuts nationaux […] essentiels […l]e départ d'Émilise, et les questionnements qui ont ensuite émergé, ne font que les rendre plus pertinents. » On aura compris que les deux derniers points servent d'alibi pour l'indispensable Déclaration de Saguenay, promue comme jamais sur le site web du parti, se transformant miraculeusement en remède à la démission de la porteparole élue. Tant qu'à y être cette longue lettre aux membres fait l'éloge du pragmatique parti de gouvernement comme si ses critiques étaient d'éternels rêveurs oppositionnels.
Une déclaration dissidente se démarquant et affrontant, l'autre se soumettant
La dissidence au départ inorganisée et qui tâche de se rejoindre en réseaux a jusqu'ici accouchée de deux déclarations fort différentes si ce n'est contradictoires.Celle des « quarante » plus médiatisée et, sauf erreur, malheureusement fermée se pose clairement en opposition à la direction Solidaire dans une perspective anticapitaliste :
Comme l'expliquait Émilise Lessard-Therrien, un gouvernement solidaire ainsi élu se retrouverait très faible face aux puissants lobbys qui attendent de pied ferme tous les gouvernements du Québec. Pour apporter des changements qui ne soient pas qu'une succession de « mesurettes » (le mot est d'Amir Khadir), il faudra donc absolument, derrière l'élection d'un gouvernement de QS, toute la puissance du « lobby du peuple » (Catherine Dorion) : un peuple bien mobilisé et bien réveillé, prêt à affronter la déroute capitaliste avec son gouvernement.
Parlant pragmatisme elle rappelle cet élément fondamental de la conjoncture politique mondiale. Elle aurait aussi pu rappeler que le pragmatisme abandonne au gauchisme la jeunesse québécoise en voie de radicalisation devant un monde en profonde crise dérivant vers la terre-étuve :
Or il faut se rappeler que la gauche « pragmatique », « efficace » et calculatrice, celle qui traite les autres de rêveurs et d'idéalistes – comme si c'était des défauts –, se fait doubler à l'heure qu'il est. Elle se fait doubler partout en Occident par une droite qui n'a pas peur de soulever des foules et de déplacer le cadrage du débat politique vers la droite. Bien sûr que nous voulons prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas pour l'occuper tranquillement en y passant les
quelques projets de loi que les élites dominantes voudront bien nous laisser passer.
D'un tout autre acabit est celle s'intitulant « S'unir pour gouverner autrement » qui pose le parti comme « irremplaçable » — hors du parti point de salut ! — coresponsable « de victoires face au saccage de nos services public » — ah oui, lesquelles ! — capable de « proposer des solutions aux crises que nous traversons » — comme la loi dite Françoise David ! — « se distingu[ant] par la forme de son organisation » — un chef réellement existant masqué par l'égalité formelle des deux porte-parole ! Cette déclaration veut « proposer un projet rassembleur » et « créer les conditions de convergence entre les différentes tendances » sur la base de « gouverner autrement ». Ce serait la moindre des choses de ne pas gouverner comme les partis de droite ! Cette déclaration de la grande réconciliation, signée autant par des défenseur-e-s mur-à-mur de la direction du parti que par des « révolutionnaires écosocialistes » annonce-t-elle la victoire de l'aile parlementaire lors du CN de la fin mai ?
Quant au « renouvellement de notre ancrage dans les mouvements sociaux », attention ! Nos députés et leurs bureaux de comté le font déjà et iels sont de plusieurs manifestations. Comme le montrent les exemples déjà cités (McGill, Front commun, logement social, Glencore), le parti appuie les mouvements en faisant le service minimum, parfois en relayant à l'Assemblée nationale, mais sans faire de critiques constructives et sans tenter de fédérer les luttes et revendications populaires sur de concrets objectifs communs. Et surtout sans allumer cette lumière au bout du tunnel, cette société alternative d'un Québec indépendant, sobre et solidaire libéré de la finance, des hydrocarbures et de la filière batterie, qui donne à la militance le courage d'entamer une lutte, d'encaisser les coups et de durer. En un mot, le parti est derrière mais jamais devant, plus préoccupé des urnes que de la rue ce qui implique de ne pas froisser petites et grandes bureaucraties et autres directions autoproclamées et au diable la base militante.
La manœuvre de la direction est à déjouer pour rejeterla Déclaration de Saguenay
Pour éviter l'implosion du parti, mais en acceptant d'avance un certain nombre de départs comme jadis certains fédéralistes à la couenne dure et certaines laïcistes ennemies jurées du voile, la direction du parti a astucieusement modifié substantiellement l'ordre du jour du CN en donnant au débat sur la crise du parti une place majeure mais sans aucunement supprimer les cruciaux débat et vote sur la Déclaration de Saguenay refoulés en fin d'après-midi. La tactique de la dissidence serait de quand même provoquer un débat d'ordre du jour pour déployer l'argumentaire quitte à suggérer un vote seulement après le point sur la crise du parti afin d'y voir plus clair, et ensuite susciter un débat sur la question dans les ateliers et plénière portant sur la crise du parti afin d'aboutir à une proposition de dépôt de la Déclaration à la Commission politique (CP) qui la prendrait en compte dans le processus de révision du programme. L'épine dorsale de l'argumentaire est le court-circuitage anti statutaire du processus de révision du programme par une Déclaration votée à la va-vite par un CN, et non par un congrès qui seul peut changer un programme, et que par euphémisme la direction définit comme « discours politique lors des prochaines années » … c'est-à-dire comme substitut au programme jusqu'au moins en 2025.
Bien sûr, comme politique de repli si le débat sur la Déclaration ne peut être évité, il sera nécessaire d'appuyer les amendements à la Déclaration qui l'inclinent plus à gauche. On pense en particulier aux amendements concernant la décroissance, la gratuité du transport en commun et que l'ensemble de la population puisse y accéder, le renforcement des pouvoirs du BAPE et des syndicats dans l'entreprise, contre la privatisation du système de santé, le développement des logements sociaux, une taxe sur la malbouffe, pour (l'imprécise) production végétale à défaut de mentionner l'agrobiologie, le rejet du monopole de l'UPA, la nationalisation de la filière batterie (je souligne à double trait), le non-financement des multinationales, (l'imprécise) nationalisation de l'industrie du logement.
Reste qu'il faudra se souvenir de la critique acerbe mais non moins essentiellement dans le mille du persifleur et revanchard Lisée mais non pas moins futé. En ce qui concerne le processus de modification du programme, substituer « actualisation » à « modernisation » envoie un signal de défense des éléments clefs du programme qui définissent sa radicalité. Une vingtaine de minutes est prévu pour un compte-rendu sur la révision des statuts. C'est court mais serait la bienvenue une claire intervention sur la nécessité de ramener dans le parti hors aile parlementaire sa direction réellement existante en renforçant le CN qui, par exemple, serait élu pour un an avec droit de rappel et se réunirait quatre fois l'an avec droit de constituer des comités de travail et même d'élire le CCN.
Il serait enfin temps de construire un pôle anticapitaliste qui a trop attendu
Peu importe la fin tôt ou tard de cette lutte des tendances sans doute la plus aiguisée que le parti ait connu depuis sa naissance il y a 18 ans, il ne faudra pas que la gauche anticapitaliste et radicale se débobine si elle ne se termine pas joyeusement. Le signal fort aura sonné, s'il n'est pas trop tard, pour la construction d'un pôle ACIDE dans le parti, Anti-Capitaliste, Indépendantiste Internationaliste, Démocratique radicale jusqu'à et y compris l'économie, Écosocialiste et Égalitaire dans ses dimensions genrées et nationales, l'acidité étant la méthode critique. Si cette construction avait débuté il y a plus de vingt ans, lors de la fondation de l'Union de forces progressistes (UFP), on en serait pas là aujourd'hui. Plus que jamais s'impose cette fédération des anticapitalistes et radicaux non sectaires que ce soit à l'intérieur de QS, en dehors ou un pied dedans et un pied dehors.
Marc Bonhomme, 12 mai 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réflexion sur trois tendances au sein de QS

Un départ soudain d'une porte-parole, une onde de choc, un point de presse de l'autre porte-parole qui invite à prendre un virage pragmatique pour créer un « parti de gouvernement », quelques démissions au passage, et différentes lettres ouvertes publiées cette semaine. Ça brasse pas mal au sein de Québec solidaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Cela dit, il ne faut pas non plus craindre les débats, la divergences de visions ou l'implosion potentielle du parti. Comme le disait Simonne Monet-Chartrand (je reprends la citation partagée hier par Carol-Anne Kack) : « À mon sens, les inévitables tensions et honnêtes affrontements entre les tenants d'idées, d'objectifs différents, tant au sein des couples que des groupes socio-politiques et nationaux peuvent avoir une fonction positive de déblocage, d'éclairage et de libération. »
Depuis la semaine dernière, trois tendances se distinguent au sein de Québec solidaire : 1) une tendance « gouvernementiste », mise de l'avant par Gabriel Nadeau-Dubois mais aussi plusieurs membres à l'interne (une lettre ouverte à ce sujet est en préparation) ; 2) une tendance « équilibriste » exprimée par la lettre d'Haroun Bouazzi et consignée par Amir Khadir) ; 3)une tendance « mouvementiste » rendue visible par la lettre ouverte publiée dans La Presse qui a fait beaucoup jaser, notamment en raison de la signature de Catherine Dorion.
La première tendance fait entièrement confiance à la direction du parti, invite les membres à embrasser les grands chantiers de QS et le virage modernisateur de la Déclaration de Saguenay, regrette le départ d'Émilise mais appelle surtout les membres à aller de l'avant avec l'objectif central de former le gouvernement. La deuxième tendance, plus critique, cherche à trouver un terrain d'entente entre l'aile modérée et l'aile radicale du parti, invite à ne pas oublier le besoin de garder un ancrage fort dans les mouvements sociaux, et reconnaît le besoin d'une introspection plus importante sur les problèmes organisationnels internes, sans remettre en question les chantiers de la Déclaration de Saguenay ou le leadership de GND. La troisième tendance, de son côté, met de l'avant la nécessité d'un virage plus radical au niveau du discours et des positions de QS, questionne plus frontalement la centralisation du pouvoir à l'interne et le discours pragmatique/modernisateur, et invite à retrouver un côté plus subversif sans se positionner clairement sur les enjeux du prochain CN.
Ces trois tendances peuvent-elles cohabiter au sein du même parti ? Elles ont réussi à le faire jusqu'à la plus récente crise, et maintenant on voit que les bouleversements internes créent une situation d'incertitude qui réactive les réflexion collectives et les mobilisations en courants distincts autour de textes co-signés. À mon avis, cela est un signe de « santé démocratique », et que l'unité autour de la vision de GND ne va plus de soi. Mais il y a bien des risques de déchirures internes et de membres déçu.e.s qui pourraient avoir envie de quitter le bateau.
Bien que le souhait de GND, de Manon et de plusieurs soit que cette crise interne se résorbe avec le prochain Conseil national à la fin mai, je crois plutôt que ces trois tendances continueront de coexister et de se chamailler dans les mois à venir ? Pourquoi ? Car même si on pourrait croire que la position de GND se trouve exprimée dans la Déclaration de Saguenay et que l'adoption de celle-ci serait l'indicateur de la victoire du camp « gouvernementiste », en réalité il y a bien des chances que cette déclaration soit amendée par des propositions des deux autres courants.
Par ailleurs, les autres grands chantiers, dont la révision/refonte du programme et la modification des statuts et règlements du parti, ne seront pas des enjeux réglés au prochain CN ; le processus ne fera que commencer. Pour ma part, me trouvant quelque part à mi-chemin entre le courant équilibriste et mouvementiste, je n'ai rien contre le fait de revoir le programme ou d'améliorer les structures démocratiques de QS. Mais tant qu'on n'aura pas de proposition claire, concrète et détaillée sous les yeux, il est difficile de prendre une position ferme sur ces dossiers.
Autrement dit, lors du prochain CN, rien ne sera définitivement réglé, bien que la crise et les tensions internes seront peut-être apaisées momentanément. Les membres de différents courants vont certainement prendre la parole, exprimer leur mécontentement, inquiétudes et espoirs pour la suite, les délégué.e.s débattront des amendements à la Déclaration de Saguenay, GND et Christine Labrie feront un appel à l'unité, et à mon avis il n'y aura pas de grandes décisions controversées, outre quelques prises de paroles qui seront doute plus senties.
Cela étant dit, la prochaine année pour QS sera haute en débats ; un procesus d'enquête interne et un plan d'action lié au départ interne d'Émilise seront mis en oeuvre, il y aura une course pour le poste de porte-parole féminin (la deuxième en deux ans), et un chaud débat sur la révision des statuts et structures de QS, avec en toile le fond la tension entre la critique de la centralisation du pouvoir (tendance mouvementiste) et le besoin d'allègement/efficacité (tendance gouvernementiste), avec des positions qui essayeront d'équilibrer ces deux tendances (tendance équilibriste).
Pour la suite des choses, je ne sais pas quelle tendance aura le dessus sur les autres. La tendance gouvernementiste a une certaine avance avec plusieurs cadres, élu.e.s et militant.e.s de longue date qui y adhèrent, mais le leadership de GND est légèrement affaibli depuis la crise. La tendance équilibriste aura un rôle certain à jouer, notamment avec la présence d'ancien.ne.s qui ont à coeur d'éviter l'éclatement de la gauche et de trouver des positions consensuelles qui rallient le plus grand nombre. Enfin, la tendance mouvementiste a un destin plus incertain, car elle inclut des gens très mobilisés à l'interne, mais aussi plusieurs personnes qui ont quitté le navire de QS dans les dernières années.
À mon humble avis, si un rééquilibrage doit avoir lieu pour éviter un virage gouvernementiste trop prononcé, il faudrait une sorte de coalition plus large entre la tendance équilibriste et mouvementiste, afin de créer un contre-pouvoir à la dynamique hyper-modernisatrice. Concrètement parlant, cela impliquera un travail sérieux d'amendement ou contre-proposition concernant la révision des statuts afin que l'impératif d'efficacité ne prenne pas trop le dessus sur le besoin de décentraliser le pouvoir. Le tout se complique par le fait que la tendance mouvementiste est composée de plusieurs ex-solidaires qui ne sont pas intéressés à revenir s'impliquer dans le climat actuel.
Par ailleurs, les gros débats viendront au moment de la refonte du programme, surtout si les membres décident de mettre de côté le programme actuel au profit d'une table rase, avec la réécriture d'un nouveau programme concis avec seulement 4 mois de consultation et un congrès pour adopter le tout.
De mon côté, pour le moment, j'ai besoin d'un pas de recul par rapport à tout ceci. J'ai été fortement impliqué dans les instances de QS de 2012 à 2016, j'ai ensuite pris mes distances, je suis revenu au dernier congrès de novembre 2023 au moment même où Catherine Dorion sortait son livre et qu'Émilise a été élue porte-parole. J'ai noué des amitiés plus fortes avec des gens de l'aile mouvementiste, même si j'ai aussi des liens de camaraderie et d'amitié avec des personnes de la tendance équilibriste, et un respect pour plusieurs personnes de le tendance gouvernementiste qui ne se résument pas à la seule figure de GND.
Mais il faut avouer que tous ces débats sont très prenants. De mon côté je ne pourrai pas être au prochain CN pour des raisons familiales et logistiques, bien que j'aurais aimé y être pour observer, écouter, m'exprimer et voir les choses évoluer de l'intérieur. Je reste membre du parti malgré tout, je ne suis pas du genre à déchirer ma carte pour une position ou un désaccord, bien que je sente pour l'instant que le virage gouvernementiste ne m'inspire guère confiance s'il se concrétise dans les deux prochaines années.
C'est pourquoi, à court terme du moins, je resterai en quelque sorte à la marge, comme sympathisant et observateur critique, et m'impliquerai davantage dans des projets et initiatives plus alignées avec mes orientations politiques : communs, municipalisme, décroissance, critique de l'IA, démocratie radicale. C'est aussi un phénomène étrange, car QS ne s'intéresse pas, ou très peu, à ces thématiques si chères à mes yeux, et qui sont essentielles à la construction d'une société postcapitaliste digne de ce nom.
Il y a là un certain paradoxe ou une tension que je vis en moi : je suis en quelque sorte un "social-démocrate radical" qui prône aussi le "communalisme", et je reste accroché à un parti de gauche à l'échelle nationale même si à chaque année je deviens de plus en plus critique de l'État et des dynamiques de centralisation du pouvoir qui sont inextricablement liées à la conquête de cet appareil bureaucratique.
Nous portons tous des contradictions en nous, je ne crois pas qu'il y a des gens purement "gouvernementistes" ou des personnes purement "mouvementistes" ; ces différents courants cohabitent à l'intérieur d'un parti comme QS et dans le cerveau de chaque militant.e. Cela dit, certaines tendances s'expriment plus fortement chez certaines personnes, GND et Dorion représentant les deux pôles d'un spectre entre lesquels il y a beaucoup d'entre-deux et de multiples milieux. Et les crises comme nous vivons en ce moment a tendance à mettre en lumière de façon plus nette ces différentes tendances qui coexistaient de façon souterraine.
Pour reprendre les mots de Monet-Chartrand, puisse cette crise servir à de « fonction positive de déblocage, d'éclairage et de libération ». Comme le pôle mouvementiste s'exprime davantage en moi depuis quelques années, je crois que cette tendance va continuer à s'exprimer tant dans l'aile gauche de QS, et de plus en plus à l'extérieur, dans d'autres initiatives, groupes et prises de parole plus décomplexées cherchant à expérimenter d'autres manières de voir, d'agir et de sentir au-delà des impératifs de la conquête des urnes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De l’interdiction du keffieh et de la fragilité des supporters de l’apartheid

La panique morale autour d'un simple morceau de tissu représente le caractère défensif et paranoïde de la réponse à l'isolation grandissante d'Israël.
Owen Schalk, Canadian Dimension, 27 avril 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Le 25 avril, durant la période de question au parlement ontarien, la députée indépendante Sarah Jama arborait un keffieh, un foulard porté traditionnellement dans certaines parties de Proche Orient. Le président de la législature, M. Ted Arnott, lui a demandé de sortir ; elle a refusé. Selon CBC, M. Arnott aurait dit qu'il n'était quand même pas prêt à utiliser la force pour être obéi.
Après l'incident, le président a signifié à Mme Jama, que : « pour le reste de la journée elle perdait son droit de vote sur tout sujet débattu dans l'assemblée, qu'elle n'avait plus droit de siéger à aucun comité, d'utiliser les installations médias du parlement, de faire reporter des résolutions, de rédiger des questions et des pétitions ». Mme Jama est députée d'Hamilton centre depuis 2023. Elle a été élue avec 54% des voix exprimées.
Cette opération punitive était justifiée par le bannissement du port du keffieh dans l'enceinte du parlement. Ce bannissement s'applique aux élus.es et au public. On a déjà refusé l'entrée à des visiteurs parce qu'ils portaient ce foulard.
Même s'il s'agit d'un symbole important de la culture palestinienne, le président Arnott affirme qu'il s'agit dans ce cas, « d'une prise de position politique » ce qui justifie le bannissement selon lui. Cette explication parait si douteuse que tous les chefs de partis y compris le Premier ministre conservateur Doug Ford lui ont demandé de retirer ce bannissement des règles de conduite. Mais, alors qu'il s'oppose publiquement à la règle, le Premier ministre Ford a aussi autorisé son caucus à s'opposer aux efforts du NPD pour la renverser à deux reprises.
Mais, il faut se rappeler que même si le NPD ontarien veut en finir avec ce bannissement, il a expulsé Mme Jama de son caucus parce qu'elle critiquait Israël pour ses attaques après celles du Hamas le 7 octobre (2023). Sa leader, Mme Marit Stiles lui a ordonné de retirer ses commentaires ce qu'elle a refusé. Doug Ford, dans la foulée, a affirmé faussement, qu'elle « soutenait publiquement le viol et les meurtres de juifs.ves innocents.es ». Mme Jama l'a poursuivi pour libelle.
À l'époque de ces faits, j'ai écrit : « Au lieu de soutenir ses membres, la direction du NPD ontarien a abandonné Mme Jama aux basses œuvres de D. Ford. Le Parti l'a expulsé parce qu'elle a eu l'audace de se défendre et de défendre ses positions. … Le NPD n'a pas le droit d'oublier cela alors qu'un génocide se produit probablement à Gaza. Il expulse une critique de la violence israélienne alors que sa cheffe converse avec un homme qui compare les Palestiniens.nes à de cafards. Il faut nous souvenir de qu'elles alliances le NPD valorise ou non ».
L'interdiction du port du keffieh à Queen's Park se situe dans une campagne plus importante dans le monde pour empêcher toute expression publique d'appui au peuple palestinien. C'est en Allemagne que la situation est la plus agressive. Le 12 avril, par exemple, la police allemande a arrêté et expulsé Ghassan Abu Sitta, un médecin anglais d'origine palestinienne qui a pratiqué bénévolement à Gaza. Il allait donner une conférence sur la Palestine à Berlin durant laquelle il prévoyait donner des exemples de génocide comme témoin direct. La conférence n'a pas eu lieu, la police de Berlin l'a interdite.
Aux États-Unis, des professeurs.es comme Jodi Dean et des étudiants.es comme Asna Tabassum ont été sanctionnés.es par les administrateurs.trices de leurs universités pour avoir pris parti en faveur des positions palestiniennes. Comme les protestations sur les campus se répandent à toute vitesse contre le génocide à Gaza, l'administration Biden, les gouvernements dans les États et les directions des collèges et universités ont répondu en diabolisant les protestataires et en envoyant la police lourdement armée sur les campus, mettant ainsi en danger le personnel et la population étudiante.
Le grand public est témoin de cette répression par l'État, sont visibles : l'utilisation des « Tasers » le poivre de Cayenne et les arrestations violentes. Mais ça n'affecte pas l'esprit des protestataires.
L'incapacité de l'État à mettre fin aux campements a suscité une marée de mensonges à propos des demandes des manifestants.es en plus de les accuser d'antisémitisme et de soutien aux terroristes ; ce qui est absurde. On les tient aussi d'idiots.es utiles des adversaires des États-Unis. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi a suggéré que le mouvement avait « des liens avec la Russie » et M. Jonathan Greenblatt, directeur de la Ligue contre la diffamation, proche d'Israël, a soutenu que les groupes étudiants étaient des « supplétifs de l'Iran sur les campus ».
En Occident, l'acharnement à empêcher l'expression publique de solidarité avec la Palestine s'accompagne d'autant d'efforts de la part des médias à chercher à masquer les épouvantables crimes d'Israël contre les Palestiniens.nes.
Une fuite nous a appris que le New York Times a donné instruction à son personnel de ne pas utiliser les termes « génocide, nettoyage ethnique et territoires occupés » dans leurs rapports sur Gaza, même si la Cour de justice internationale a trouvé plausible la preuve que c'est ce que fait Israël contre le peuple palestinien. Et même, malgré le fait que les Nations Unies considèrent Israël comme un pouvoir occupant à Gaza, en Cisjordanie et sur les hauteurs du Golan.
La situation est la même au Canada. Des personnes qui ont exprimé des vues en faveur de la Palestine ont été suspendues de leur travail ou de leurs écoles. Et la CBC a constamment invité dans ses programmes plus de personnes en faveur d'Israël que des Palestiniens.nes. Elle a utilisé un langage épuré pour décrire les tueries indiscriminées des Palestiniens.nes par l'armée israélienne. Mais en même temps, elle n'a cessé de décrire les attaques du Hamas le 7 octobre (2023) comme « brutales, vicieuses » motivées par « le barbarisme et l'inhumanité ».
Le 26 avril, le National Post publiait un article de Michael Higgins qui décrivait les corps de Palestiniens.nes trouvés dans des charniers découverts près de deux hôpitaux à Gaza (après qu'ils aient été attaqués par l'armée israélienne n.d.t.) comme « un mensonge éhonté de la part du Hamas ». Durant six jours, la Défense officielle palestinienne a creusé autour des hôpitaux Nasser et al-Shifa et découvert presque 400 cadavres, principalement de femmes, d'enfants et de personnes âgées. On a trouvé sur ces dépouilles, des traces de torture et d'exécution et il semble que certains.es aient été brulés.es vifs et vives.
Que révèle cet acharnement à diaboliser les Palestiniens.nes, leur culture et ceux et celles qui affichent leur solidarité devant tant de souffrances ? Le manque de sincérité de ceux et celles qui profèrent de telles accusations c'est sûr, mais aussi autre chose.
Ceux et celles qui soutiennent l'apartheid ont terriblement peur.
Qu'y a-t-il à craindre d'une conférence sur la Palestine à Berlin ? Et d'étudiants.es qui exercent leur droit à demander la fin d'un génocide ? Et d'un bout de tissu dans la législature ontarienne ?
Les Occidentaux qui soutiennent Israël savent que la bataille est perdue. Ils le savent malgré le carnage que l'armée israélienne pratique à Gaza qui n'est pas prêt de défaire le Hamas. Ils savent qu'Israël est en train de vite devenir un État paria et que sa réputation dans le monde sombre en emportant la crédibilité occidentale avec elle.
En plus, les gouvernements occidentaux savent que leurs populations s'objectent aux politiques qui s'attaquent aux Palestiniens.nes. La plupart des Canadiens.nes veulent que la tuerie cesse. La plupart des Américains.nes sont contre l'action israélienne à Gaza.
Que ce soit en Amérique du nord ou en Europe, les rassemblements sont toujours plus importants. Au Canada, cette mobilisation populaire a poussé la Chambre des Communes à voter une résolution en faveur de l'arrêt de la vente d'armes à Israël. Même si le texte original du NPD a été dilué par le gouvernement Trudeau et qu'il ait annoncé par la suite que les exportations d'armes déjà approuvées seraient expédiées. Elles se comptent par centaines.
Les gouvernements occidentaux et les supporters de l'apartheid ont peur parce que la plupart des peuples en Occident ne soutiennent pas leurs politiques et actions pro israéliennes. Cette peur les a poussés à commettre des actes brutaux comme les attaques contre les protestataires dans les Universités et à des tracasseries comme l'interdiction du keffieh au Parlement ontarien.
La simultanéité de la brutalité et des tracasseries de ceux et celles qui soutiennent l'apartheid révèle un fait déterminant : ils savent qu'il y a une majorité contre leur position et ils savent à quel point elle est fragile.
Mais fragilité ne veut pas dire faiblesse. Les supporters d'Israël ne sont pas faibles. Après tout ce sont la classe des médias et des appareils répressifs de la plupart des pays occidentaux qui les composent. Mais, néanmoins, ils sont fragiles. La majorité de la planète voit leur cruauté, leur inhumanité qui provoquent des fissures dans l'État israélien.
Au fur et à mesure que la pression publique s'exprime, que nous refusons de laisser la brutalité et les tracasseries non réduire au silence, ces fissures s'étendront.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Canada-Haïti : "Être le 2e plus gros bailleur de fonds en Haïti ne suffit pas"

Voici une copie de la lettre de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), la Concertation pour Haïti (CPH) et Coopération Canada adressée à différents ministres du gouvernement canadien impliqués dans les relations avec Haïti. La missive souhaite "présenter des recommandations pour contribuer de manière résolue, constructive et durable à la résolution de la crise en Haïti."
Le 8 mai 2024
Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada
justin.trudeau@parl.gc.ca
L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada
melanie.joly@parl.gc.ca
L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international du Canada
ahmed.hussen@parl.gc.ca
Objet : Réponse canadienne à la crise multidimensionnelle en Haïti
Monsieur le Premier ministre Trudeau,
Madame la Ministre Joly,
Monsieur le Ministre Hussen,
Suite à une rencontre spéciale organisée le 15 avril 2024 par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), la Concertation pour Haïti (CPH) et Coopération Canada pour consulter des représentant·e·s de la société civile haïtienne, nos trois réseaux souhaitent relayer au gouvernement canadien les enjeux majeurs entendus et présenter des recommandations pour contribuer de manière résolue, constructive et durable à la résolution de la crise en Haïti.
Plus de 70 participant·e·s à cette rencontre virtuelle, dont une vingtaine d'intervenant·e·s représentant plusieurs secteurs (droits des femmes, droits humains, santé, éducation, environnement, agriculture) directement d'Haïti et quelques membres de la diaspora haïtienne au Canada, ont exprimé leur désarroi face à cette énième crise, dont l'escalade depuis l'assassinat du Président Jovenel Moïse en 2021 a conduit le pays dans le chaos, avec aujourd'hui 80% de la ville de Port-au-Prince sous le contrôle de gangs armés, selon les Nations unies. La crise politique fait le lit d'une culture de violence, d'agressions sexuelles, d'insécurité alimentaire et de stagnation socio-économique.
Face à cette situation intenable pour des millions d'Haïtien·ne·s pris en otage, nous appelons le Canada à intervenir sur trois volets, notamment en appuyant le processus de transition politique, en prenant position contre le trafic d'armes vers Haïti et en déployant une aide humanitaire appropriée.
1. Appuyer le processus de transition politique
Le Canada devrait reconnaître et appuyer le Conseil présidentiel de transition qui vient d'être assermenté afin qu'il puisse mettre en œuvre l'« Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée », le plus rapidement possible. Cet accord, malgré ses imperfections, offre l'opportunité de restaurer la normalité constitutionnelle, le bon fonctionnement des institutions et l'ordre légal pour les Haïtien·ne·s.
Le Canada devrait insister pour la représentation large et effective de toutes les tranches sociales, particulièrement des femmes, des jeunes et de la diaspora, au sein des organes de transition prévus dans l'Accord politique. Les participant·e·s ont déploré la présence d'une seule femme (par ailleurs sans voix délibérative) parmi les neuf membres désignés du Conseil présidentiel. Par ailleurs, pour permettre aux Haïtien·ne·s de reprendre leur destinée en main, le Canada devrait aider à rappeler la place et le rôle du corps diplomatique en Haïti, dont l'ingérence, parfois excessive dans les affaires nationales, heurte la dignité nationale.
Le Canada devrait prendre acte des erreurs du passé et exercer une vigilance accrue pour restaurer l'intégrité et l'honnêteté dans la gouvernance tout en prévenant la violation des droits humains en Haïti.
2. Prendre position contre le trafic d'armes vers Haïti
Le Canada devrait engager un plaidoyer courageux et sans compromis avec les États-Unis pour mettre fin au trafic d'armes vers Haïti, sur la base du récent rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Le Canada doit impérativement encourager des réponses internationales guidées par la volonté du Conseil présidentiel de transition et les institutions de l'Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée afin de rétablir la sécurité, promouvoir l'application de la loi et soutenir la défense côtière haïtienne. Ceci exige de doter les forces de sécurité (police et armée) de soutien logistique et financier sans lequel la situation restera précaire, entravant tout avancement vers la démocratie. Pour sa part, le Canada doit être transparent et considérer des poursuites judiciaires ou l'imposition de sanctions (saisie de fonds ou interdiction de voyage) contre les personnes impliquées dans le transport.
3. Déployer une aide humanitaire appropriée
Toute solution durable pour le bien-être des Haïtien·ne·s requiert un changement de paradigme. Le Canada doit reconsidérer l'approche actuelle d'aide humanitaire basée sur des projets qui trop souvent n'atteignent pas les personnes les plus vulnérables et les territoires les plus touchés. Le Canada devrait initier avec les organisations de la société civile une nouvelle manière de coordonner les actions humanitaires et de développement afin de soutenir l'économie dans les territoires, promouvoir l'expertise locale et respecter la dignité des populations. À cet effet, le Canada devrait mettre en œuvre l'approche du triple nexus combinant interventions structurantes dans les domaines humanitaire, développement et paix (ce qui inclut la cohésion sociale).
Face à une crise multiforme et aux besoins humanitaires immenses, le Canada devrait également augmenter et diversifier son financement pour atteindre davantage de secteurs affectés (agriculture, santé, protection des civils, hygiène et assainissement, abris, éducation, soutien économique, etc.) tout en considérant la question de l'accès aux services offerts. Alors que les populations ont assisté au ballet aérien d'évacuation des diplomates, rappelons que près de 50% de la population risque de souffrir d'insécurité alimentaire aigüe d'ici juin 2024 (IPC, 2024), il est essentiel de veiller à ce que l'accès à l'aide soit facilité dans tout le pays.
Être le 2e plus gros bailleur de fonds en Haïti ne suffit pas. Les recommandations ci-dessus s'inscrivent dans une demande globale de plus de cohérence dans la politique étrangère du Canada vis-à-vis d'Haïti. Le Canada a l'opportunité de démontrer à nouveau ses valeurs et son approche féministe en matière de promotion de la paix et de la sécurité dans le monde en devenant un des champions de la cause d'Haïti dans la communauté internationale.
En demeurant à votre disposition pour discuter davantage des points soulevés et pour éventuellement organiser une rencontre avec la société civile canadienne et haïtienne, nous vous prions d'agréer, Monsieur le premier ministre Trudeau, Madame la ministre Joly, Monsieur le ministre Hussen, l'expression de nos respectueuses salutations.
Michèle Asselin
Directrice générale
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Marc-Édouard Joubert
Comité de coordination
Concertation pour Haïti (CPH)
Kate Higgins
Directrice générale
Coopération Canada
Organismes signataires du Canada
• Acted Canada
• Action-Haïti
• Amitié Gatineau-Monde
• Architecture sans frontières Québec
• Bureau international des droits des enfants (IBCR)
• Carrefour de solidarité internationale
• Centre d'étude et de coopération internationale (CECI)
• Centre interdisciplinaire de développement internationale en santé - CIDIS de l'Université de Sherbrooke
• Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
• Collaboration santé internationale
• Comité de solidarité/Trois-Rivières (CSTR)
• Confédération des syndicats nationaux (CSN)
• Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
• Développement et paix - Caritas Canada
• Développement international Desjardins
• Développement, expertise et solidarité internationale (DESI)
• Église unie
• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
• Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL)
• Fonds Solidarité Sud
• Humanité & inclusion Canada
• Ingénieurs sans frontières Québec
• Primate's World Relief and Development Fund
• Santé monde
• Société pour le reboisement d'Haïti(SRH)
• SOCODEVI
• Solidarité-Haïti en Estrie
• SUCO - Solidarité, Union, Coopération
• Terre sans frontières
• UPA Développement international
Organismes signataires d'Haïti
• Centre d'animation paysagère et d'action communautaire (CAPAC)
• Centre de formation pour l'entraide et le développement communautaire (CFEDEC)
• Commission épiscopale nationale Justice et paix
• Fanm Deside
• Institut culturel Karl Lévêque (ICKL)
• Kri Fanm Ayiti (KRIFA)
• Union pour le développement et le respect des femmes haïtiennes (UDREFH-Centre)
• Université épiscopale d'Haïti
• Kay Fanm

Plus de 40 organismes se joignent à l’AQOCI, Coopération Canada et la Concertation pour Haïti pour demander au Canada de réagir face à la crise multidimensionnelle en Haïti.

Nos recommandations découlent d'une rencontre de consultation avec plusieurs représentant·e·s de la société civile haïtienne et visent à contribuer de manière résolue, constructive et durable à la résolution de la crise en Haïti.
Nous avons envoyé la lettre « Réponse canadienne à la crise multidimensionnelle en Haïti <https://aqoci.qc.ca/reponse-canadie...> à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, et Ahmed Hussen, ministre du Développement international du Canada.
Objet : Réponse canadienne à la crise multidimensionnelle en Haïti
Monsieur le Premier ministre Trudeau,
Madame la Ministre Joly,
Monsieur le Ministre Hussen,
Suite à une rencontre spéciale organisée le 15 avril 2024 par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)<https://aqoci.qc.ca/>
, la Concertation pour Haïti (CPH)<https://aqoci.qc.ca/concertation-po...> et Coopération Canada<https://cooperation.ca/> pour consulter des représentant·e·s de la société civile haïtienne, nos trois réseaux souhaitent relayer au gouvernement canadien les enjeux majeurs entendus et présenter des recommandations pour contribuer de manière résolue, constructive et durable à la résolution de la crise en Haïti.
Plus de 70 participant·e·s à cette rencontre virtuelle, dont une vingtaine d'intervenant·e·s représentant plusieurs secteurs (droits des femmes, droits humains, santé, éducation, environnement, agriculture) directement d'Haïti et quelques membres de la diaspora haïtienne au Canada, ont exprimé leur désarroi face à cette énième crise, dont l'escalade depuis l'assassinat du Président Jovenel Moïse en 2021 a conduit le pays dans le chaos, avec aujourd'hui 80% de Port-au-Prince sous le contrôle de gangs armés, selon les Nations unies. La crise politique fait le lit d'une culture de violence, d'agressions sexuelles, d'insécurité alimentaire et de stagnation socio-économique.
Face à cette situation intenable pour des millions d'Haïtien·ne·s pris en otage, nous appelons le Canada à intervenir sur trois volets, notamment en appuyant le processus de transition politique, en prenant position contre le trafic d'armes vers Haïti et en déployant une aide humanitaire appropriée.
La lettre complète sur le web : https://aqoci.qc.ca/reponse-canadienne-a-la-crise-multidimensionnelle-en-haiti/
Stéphie-Rose Nyot Nyot
Responsable des communications
Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nous ne pouvons plus ignorer la bombe de GES émise par l’activité militaire

Les pays les plus riches de la planète émettent plus en bombardant les pauvres que les pauvres n'ont jamais émis. En 2012, l'éminent scientifique du climat, le docteur James Hansen publiait une lettre ouverte dans le New York Times intitulé : « Game Over for the Climate ». Il y mettait en garde contre l'extension du développement d'alors des sables bitumineux canadiens. Continuer l'exploitation de cette bombe de GES, écrivait-il, c'est sonner le glas, signaler la mort du climat. Un an plus tard, dans une entrevue il déclarait : « Pour laisser à nos enfants une situation gérable nous devons laisser toutes les énergies non conventionnelles dans le sol ».
Nick Gottlieb, Canadian Dimension, 24 avril 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Mais, d'une certaine façon, la « game » n'en finira jamais. Chaque tonne de GES de plus émise rend la vie sur terre plus difficile. Et inversement, chaque tonne non produite sauve des vies. Mais, le fait que le réchauffement dépasse les 1,5 degrés Celsius, sans signe de baisse des émissions grâce en grande partie à ce que J. Hansen qualifiait de « pétrole sale », ne veut pas dire que le jeu est terminé pour le climat.
La plus grande source des émissions vient des sables bitumineux, la troisième plus grande réserve du monde. Elle joue un rôle démesuré dans l'augmentation du réchauffement de la planète. Mais il existe une autre source dont la contribution est rarement examinée, c'est le complexe militaro-industriel. Il absorbe d'immenses ressources pour la production mondiale d'armes qui émet des GES tout en nous dirigeant vers la Troisième guerre mondiale.
Au moment d'écrire ces lignes, les pouvoirs occidentaux acquiescent aux attaques génocidaires d'Israël sur Gaza, maintiennent l'Ukraine dans une guerre par procuration, dévastatrice et prolongée avec la Russie, et font monter les tensions avec la Chine et Taïwan.
Faire monter en flèche les conflits mondiaux dans le contexte du réchauffement planétaire draconien qui augmente toujours, rend virtuellement impossible les progrès vers une diminution des émissions.
La machine de guerre mondiale a besoin d'un énorme montant de capacités de production et d'énergie qui produisent une quantité tout aussi énorme de GES. Comme le notait The Guardian en janvier, les émissions produites durant « les deux premiers mois de la guerre à Gaza étaient plus importantes que ce que produisent les pays les plus sensibles au climat en une année complète ».
Cette inégalité est plutôt cruelle : les pays les plus riches émettent plus de GES en bombardant les pauvres que ceux-ci n'en n'ont jamais émis. Les meilleurs estimés indiquent que plus de 5% des émissions mondiales annuelles sont attribuables aux activités militaires. Pourtant, elles sont négligées dans les rapports, on en tient peu compte dans la plupart des standards de compte rendus nationaux alors qu'elles représentent une empreinte carbone comparable à l'aviation et à l'industrie du transport réunies.
Pendant ce temps, les dépenses militaires ne cessent d'augmenter, particulièrement celles du plus important délinquant, l'armée américaine, qui est une des plus importantes productrices de GES de l'histoire. Les militaires revendiquent très souvent le « verdissement » mais même en leur accordant le bénéfice du doute, cette perspective impliquerait de faire une place plus importante à d'autres efforts de baisse des GES.
N'importe quelle banque de batteries qu'il faudrait utiliser pour « verdir » les tanks ne serait plus disponible pour l'électrification des autobus. Toute installation de panneaux solaires servant à la production « d'hydrogène vert » pour permettre les attaques aériennes moins dommageables pour le climat, ne pourrait plus servir à la réduction de la production électrique par le gaz et le charbon. Et tous les ingénieurs et chercheurs.euses travaillant au développement les technologies militaires qui utilisent les énergies renouvelables ne contribueraient pas aux activités de ce type nécessaires pour le mieux-être des humains, au lieu de les détruire.
Cette approche keynésienne de l'empire américain évince aussi des biens publics d'une autre façon : la réduction des GES (dans le secteur militaire) mène à une importante pression inflationniste qui affaibli les services publics. Le gouvernement américain dépense presque 900 milliards de dollars pour le secteur militaire chaque année. Il bloque ainsi une bonne proportion des dépenses qui pourraient aller vers le financement des énergies renouvelables et à la baisse de la demande en énergie. Sur une plus petite échelle, le Canada souffre des mêmes problèmes malgré son rôle auto attribué d'artisans mondiaux de la paix. Nos dépenses militaires atteignent presque 40 milliards par année et le gouvernement Trudeau vient de s'engager à ajouter dix milliards de plus. Nos dépenses militaires sont plus importantes que virtuellement toutes les autres dépenses du gouvernement.
Cela se passe pendant que les investissements dans énergies renouvelables et la baisse des émissions de GES n'arriveront manifestement pas aux niveaux que le Panel intergouvernemental sur le climat, l'Agence internationale sur l'énergie, les scientifiques sur le climat et la plupart des experts.es, promeuvent. Nicholas Stern, un économiste qui a présenté un rapport indépendant à la COP27, plaidait en faveur d'un investissement de 4 mille milliards de dollars américains par année en faveur des énergies renouvelables dont 2 mille milliards en faveur du sud de la planète. Il faut comparer cela avec les 2 mille milliards de dollars consacrés aux dépenses militaires par année dans le monde.
Le Président bolivien, M. Luis Arce, soulignait, moins d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que les pays occidentaux avaient déjà dépensé à peu près 20 fois plus en aide militaire à l'Ukraine que ce qu'ils s'étaient engagés à contribuer au Fonds des Nations Unies pour le climat qui doit assister les pays en développement dans leur adaptation aux changements climatiques et aux activités menant à la baisse des émissions. Le seul pays qui approche les niveaux acceptables d'investissements dans les énergies renouvelables, est la Chine proportionnellement à sa population et son économie. En 2023, elle compte pour presque le double de ce que les États-Unis et l'Union européenne réunis, ont investi.
Le sous-investissement dans les énergies renouvelables et la perpétuation de l'extraction des énergies fossiles, n'est pas qu'un résultat indirect d'évincement (des dépenses dans d'autres secteurs), il est provoqué directement par la fièvre guerrière. Les dépenses en énergies fossiles ont doublé en 2022 presque complètement à cause de ladite « crise énergétique » qui a suivi la guerre russo-ukrainienne. Ce fut en partie, une réponse nécessaire à la montée rapide des coûts de l'énergie en Europe. Mais, malgré la baisse de la demande européenne en gaz, l'industrie des énergies fossiles a réussi à saisir l'opportunité de faire du nationalisme, une arme. C'est un effet bien plus pernicieux.
L'invasion russe de l'Ukraine a permis à l'industrie de radicalement augmenter et réhabiliter son discours habituel : les énergies fossiles nord-américaines, américaines et canadiennes sont une importante partie des projets nationaux. Aux États-Unis, on a accusé « le programme vert du Président Biden » d'avoir un effet sur la guerre. En Colombie Britannique, les deux partis dominants, dont le NPD, se sont affrontés au parlement pour savoir qui soutiendrait le mieux la naissante industrie des GNLs dans la province. En Alberta, l'ancien Premier ministre Jason Kenney a appelé à l'extension de la production de pétrole avec son slogan : « Le pétrole albertain est mieux que celui des dictatures ». À Terre-Neuve et Labrador, le Premier ministre Furey a déclaré que le pétrole offshore était nécessaire à la province « pour aider nos partenaires dans l'OTAN à ne pas tomber sous la coupe de la Russie ».
Il n'y a pas que la droite qui ait tenu ce genre de propos. En août 2022, le Premier ministre Trudeau a déclaré que la guerre en Ukraine « a tout changé », malgré que le Canada n'exporte (aucune énergie) vers l'Europe. Il s'est servi de cet argument pour défendre ses efforts d'augmentation de la production de pétrole et de gaz. Son gouvernement a invoqué la « sécurité énergétique européenne » dans son discours d'approbation du projet pétrolier Bay du Nord. Ce lien est particulièrement absurde à sa face même. De la même manière, le Président Biden utilise ce type de discours national pétrolier. Il passe de « l'indépendance énergétique américaine » de l'ère George W. Bush à une nouvelle idée voulant que les États-Unis soient le fournisseur mondial d'énergies. Il est allé aussi loin, avec la Présidente de l'Union européenne, Mme Von der Leyen, jusqu'à proposer que : « que tous les pays plus importants producteurs d'énergies (fossiles) se joignent à nous pour assurer le monde que les marchés d'énergies soient stables et bien approvisionnés ».
La guerre en Ukraine et la campagne bien orchestrée du discours l'entourant, a virtuellement renversé tous les progrès de celui qui a prévalu au moins durant les deux dernières décennies et plus. Le pétrole et le gaz redeviennent une bonne chose et si vous n'êtes pas d'accord avec cela, ou bien vous êtes un.e agitateur.trice payé.e par la Russie ou un.e naïf.ve de gauche victime de la propagande du Kremlin.
Au Canada, la guerre a signifié le stade final du discours de Ezra Levant 2010 répandu dans les grands médias : Ethical Oil. Nous débattons maintenant de l'extension complète et continue des énergies fossiles, avec ces paramètres.
Les implications du coup de grâce que les capitaux investis dans les énergies fossiles sont en train de nous faire n'est pas à sous-estimer. Comme le rapportait le Guardian il y a quelques semaines : « les producteurs d'énergies fossiles seront bientôt proche de produire quatre fois plus de pétrole et de gaz vers la fin de la décennie grâce à des projets récemment approuvés ». Et pendant que nous gardons espoir et que nous combattons en vue d'un virage au cours des prochaines années, chaque nouvel investissement dans les infrastructures des énergies fossiles joue contre nous sous deux angles : 1- il empêche autant d'investissements dans les énergies renouvelables, perpétue et même fait augmenter la demande pour les énergies fossiles. 2- Il confine et ajoute encore plus de pouvoir au capital du secteur alors que nous sommes au moment précis où il faut le démanteler. Comme le dit l'historien Adam Toode : « pendant que cette situation persiste et que les investissements dans l'état actuel du secteur ne font qu'augmenter, il y a un risque que cela ouvre toute grande la porte aux forces réactionnaires qui se mettront à questionner la trajectoire de la transition ».
Les nouvelles infrastructures de l'énergie fossile donnent encore plus de poids aux forces de droite qui sont contre les politiques relatives au climat. La sortie des États-Unis de l'accord de Paris sous l'administration Trump a été un prélude à ce phénomène. Que fera-t-il s'il est élu en 2024 ? Que fera Pierre Poillièvre ? Que fera l'AFD en Allemagne ? Les projections sur le climat qui suggèrent, basées sur les politiques climatiques annoncées, que le monde progresse sont tout sauf significatives ; l'atmosphère politique ambiante montre que même ces politiques semblent être dans le couloir de la mort.
Si la guerre en Ukraine était suffisante pour renverser le progrès bien trop graduel et campé principalement dans les discours, qu'en sera-t-il d'une guerre avec l'Iran ? Je dois ajouter qu'une guerre ne sert aucun autre projet que de permettre à un État voyou de continuer à commettre un génocide sans opposition. Un État voyou dont l'histoire et la conduite actuelle sont, comme le présente l'académicien Andreas Malm récemment : « profondément lié à un empire des énergies fossiles ». Et que dire d'une guerre avec la Chine ?
Ces perspectives de guerre liées au climat, militent pour le meilleur scénario du type Franklin D. Roosevelt, pour une mobilisation centrée sur le développement de l'armée verte qui fera saigner les populations civiles à la fin des conflits, si jamais, cela arrive. Imaginez A Good War de Seth Klein mais avec moins d'analogies et plus de tueries de masse. L'idée qu'en même temps on puisse mener des conflits entre grandes puissances et travailler à l'amoindrissement des effets du climat en même temps, ne tient pas la route. Pourtant, c'est vers cela que nous poussent avec ardeur ceux et celles qui proclament leur « foi en la science ».
Les guerres même si elles sont contenues pour le moment, sont susceptibles d'encore encourager sérieusement le nationalisme pétrolier et pousser à l'abandon complet de toute prétention à un effort mondial pour agir sur les changements climatiques. C'est le monde dont Gaza est le « plan et devis » comme l'a dit le Président colombien, M. Gustavo Petro. Les murs vont continuer à grandir autour de l'Europe et de l'Amérique du nord pendant que la majorité mondiale sera abandonnée à elle-même pour faire face aux impacts de la crise écologique qui empire toujours. Les morts ne feront qu'augmenter également.
Même la dite « nouvelle guerre froide » avec la Chine menace de faire dérailler la coopération internationale sur le climat. La Secrétaire au trésor américain, Mme Jant Yellen n'a-t-elle pas mis en garde ouvertement contre la surproduction chinoise de panneaux solaires et de véhicules électriques. (Les empires) ne soumettrons aucun but géopolitique aux aspirations autour du climat. Si ça n'était pas évident jusqu'ici, ça devrait l'être maintenant.
Le mouvement moderne contre la guerre a eu ses hauts et ses bas. Actuellement, il gagne en force dans le contexte de l'assaut génocidaire d'Israël à Gaza. Mais pour le moment, le mouvement sur le climat ne s'est pas intéressé aux abondantes preuves qui démontrent que le militarisme est « le seul facteur humain de destruction écologique » comme le souligne le professeur Kenneth Gould. Il est temps que cela change.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les jeunes face à la transformation du marché du travail

Nul doute, le marché du travail subit de profondes mutations. Les jeunes se retrouvent souvent aux premières lignes de ces bouleversements socioéconomiques qui auront des répercussions durables et profondes sur leur réalité.
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
Lors du dernier Réseau des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le 4 mai dernier, Maria Eugenia Longo, cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, et Mircea Vultur, professeur titulaire à l'INRS, responsable de l'axe Travail et insertion professionnelle de l'Observatoire jeunes et société, ont présenté une conférence sur la dynamique de l'emploi des jeunes au Québec. Lumière sur les défis et les opportunités qui marqueront l'avenir des jeunes.
Moins nombreux, moins bien payés
Une statistique a fait réagir : la population jeune (15-34 ans) du Québec a diminué, passant de 35,3 % en 1986 à seulement 23 % en 2021. Parallèlement, la diversité culturelle augmente, avec une forte représentation des immigrants dans cette tranche d'âge. Ces derniers sont par ailleurs beaucoup plus nombreux (42 %) que la population native (23 %) à détenir un diplôme universitaire.
Bien que le taux d'activité et d'emploi des jeunes ait augmenté depuis 1976, atteignant respectivement 80,9 % et 76,2 % en 2023, les jeunes demeurent concentrés dans des emplois moins bien rémunérés. En 2023, 56 % des jeunes de 15 à 34 ans gagnaient moins de 25 $ l'heure.
Des jeunes très éduqués, mais peu employés
Les jeunes Québécoises et Québécois sont de plus en plus éduqués, avec une augmentation notable des diplômés universitaires depuis 2001, particulièrement chez les jeunes femmes, qui sont passées de 37 % d'entre elles à détenir un doctorat en 2001 à 56 % en 2021 ! Malgré cela, l'insertion sur le marché du travail reste un défi, particulièrement accentué par les effets de la pandémie, qui a vu une baisse dramatique de l'emploi chez les jeunes en 2020.
La pénurie de main-d'œuvre au Québec reflète une inadéquation entre les compétences des jeunes et les besoins du marché. En dépit d'une population jeune de plus en plus qualifiée, plus de la moitié des postes vacants exigent un faible niveau de scolarité. Ce sont d'ailleurs les jeunes moins scolarisés (avec et sans diplôme d'études secondaires) qui ont connu la plus importante augmentation relative du taux d'emploi.
Autre élément qui illustre la situation : à partir de 2016, on observe une progression du taux d'emploi plus marquée pour les jeunes de 15 à 19 ans (de 42,1 % en 2016 à 54,2 % en 2023) comparativement aux autres groupes d'âge dont le taux d'emploi est resté plutôt stable.
La pénurie de main-d'œuvre n'incombe pas aux jeunes
Malgré l'augmentation du taux d'emploi (des jeunes et en général), le nombre et le taux de postes vacants ont augmenté au Québec de 2015 à 2023. Un des problèmes est que les secteurs ayant des postes vacants ont également les conditions de travail et salariales les moins alléchantes.
Endettement et pressions financières
L'endettement des jeunes reste également un problème criant. Beaucoup entrent dans la vie adulte avec des dettes substantielles, ce qui compromet leur capacité à investir dans l'avenir. En 2016, presque 80 % des ménages menés par des jeunes de 34 ans et moins étaient endettés, un chiffre qui a probablement augmenté avec l'augmentation du coût de la vie.
Étonnamment, le principal moteur de l'endettement des jeunes n'est pas les dettes d'études (28,6 % des dettes), mais plutôt les dettes à la consommation (50,6 % des dettes). Ajoutons à cela la crise du logement (77 % des étudiantes et étudiants universitaires sont locataires) et nous avons un dangereux cocktail de factures qui viennent miner la santé financière de notre jeunesse.
Changement de mentalité
Le rapport au travail des 18-34 ans est très différent de celui qu'entretenaient leurs aïeux. Que ce soit l'importance du travail dans leur vie ou encore le sens que l'on retire du travail, les jeunes sont plus nombreux à placer le travail et leur vie professionnelle en dernière place de leurs sphères de vie, loin derrière la vie de couple et la vie familiale.
Nous assistons à un vaste changement de mentalité. Les jeunes sont en forte quête d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ils ne voient plus le travail comme un devoir moral et n'acceptent pas n'importe quel travail à n'importe quelle condition. Les employeurs gagneraient à miser sur la qualité de leurs milieux (interactions sociales, autonomie, place aux initiatives, à la réalisation personnelle et à l'utilité sociale, entre autres) pour les attirer et les retenir.
Nécessité d'une politique adaptée
Avec la place grandissante de l'économie numérique (automatisation, intelligence artificielle, pérennité des emplois, etc.), ainsi que l'émergence de plus en plus d'emplois en économie sociale ou dans l'économie verte, il faut, nous disent les chercheurs, intégrer des politiques publiques et mettre en place un cadre réglementaire plus robuste pour soutenir les jeunes travailleurs, notamment à travers des mesures ciblées qui tiennent compte de la diversité des parcours et des besoins spécifiques des 18-34 ans.
Les jeunes font face à un marché du travail en pleine évolution, où les défis abondent, mais où se dessinent également des opportunités de redéfinition des normes de travail pour une génération en quête de sens et d'engagement. La manière dont nous répondons à ces défis déterminera non seulement l'avenir économique des jeunes, mais aussi la dynamique sociale globale des décennies à venir.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mobilité Infra Québec Une réponse brouillonne à un faux problème

Québec, le 10 mai 2024 — À quelques semaines de la fin de la session parlementaire, le gouvernement veut faire adopter un projet de loi brouillon pour un faux problème, le tout à la vitesse grand V, avec la création de Mobilité Infra Québec, juge le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
Un faux problème
« La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, prétend que la création d'une nouvelle agence est nécessaire pour pallier le manque d'expertise interne et les salaires trop peu élevés. Ça ne tient pas la route. S'il manque d'expertise au ministère des Transports, il faut la développer et faire les embauches nécessaires. Si les salaires sont trop bas, et nous sommes totalement d'accord avec elle là-dessus, il faut les augmenter. Ça tombe bien, nous sommes en négociation depuis plus d'un an. Mme Guilbault devrait appeler sa collègue du Conseil du trésor pour lui exposer ses problèmes de recrutement. Nos membres ont été plus que patients et il est temps de faire des propositions sérieuses pour renouveler leur convention collective. Inutile de démanteler la fonction publique pour y arriver », lance Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.
Encore les mains dans les affaires syndicales
Le SPGQ est aussi exaspéré de voir un autre ministre jouer les apprentis sorciers dans les affaires syndicales. « Il est plutôt ironique que le ministre de la Santé, Christian Dubé, plaide l'importance de réduire le nombre d'accréditations syndicales en créant Santé Québec, alors que sa collègue, Geneviève Guilbault, fera l'inverse en les multipliant chez Mobilité Infra Québec. On peut se demander pourquoi le gouvernement tient autant à semer la pagaille dans les rangs syndicaux », lance M. Bouvrette.
Pour l'instant, le SPGQ ignore combien de ses membres seront transférés du ministère des Transports vers Mobilité Infra Québec.
Où est l'urgence ?
Par ailleurs, le syndicat s'étonne de l'empressement de la ministre à vouloir faire adopter son projet de loin d'ici la fin de la session parlementaire, dans moins d'un mois. « Après Santé Québec cet hiver, assisterons-nous à une autre adoption sous bâillon parce que le gouvernement a mal planifié son projet ? Qu'y a-t-il de si urgent ? Comment peut-on avoir confiance au processus de consultation dans un tel contexte ? » questionne M. Bouvrette.
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.
Source
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La FIQ exprime sa solidarité envers la population palestinienne

La situation à Gaza est alarmante. Cela fait des décennies que le peuple palestinien subit au quotidien les conséquences de guerre, et depuis octobre dernier, le tout s'est intensifié. Plus que jamais, leur identité en tant que peuple est menacée. Environ 35 000 personnes ont perdu la vie en quelques mois seulement, et plus de 70 000 autres ont été blessées. La majorité des infrastructures civiles ont été détruites, et environ 85 % des habitants sont désormais déplacés, vivant dans des conditions déplorables marquées par la faim, le froid, l'insalubrité et la propagation d'épidémies.
En tant qu'organisation syndicale engagée, la FIQ ne peut rester silencieuse et appelle à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à la reprise rapide de l'acheminement de l'aide humanitaire à travers toute la bande de Gaza. Nous demandons également au gouvernement canadien de cesser l'exportation de matériel militaire vers Israël, et nous espérons ardemment le retour de la paix dans la région.
Nous encourageons nos membres à soutenir les initiatives en faveur du peuple palestinien et à exprimer leurs préoccupations auprès de leur député fédéral. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site de Médecins Sans Frontières : https://www.msf.fr/gaza-nos-reponses-a-vos-questions.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Recherche en santé mentale : un projet novateur

L'objectif de revendiquer une meilleure intervention en santé psychologique dans le milieu scolaire avec une approche systémique et psychodynamique a mené la Fédération à négocier une entente avec la partie patronale lors de la négociation nationale de 2020.
En effet, le projet pilote de recherche-intervention portant sur la santé mentale du personnel enseignant résulte d'une entente nationale paritaire qui reconnaît la nécessité et l'importance de consacrer du temps et de développer des moyens concrets, à l'échelle locale, pour prévenir les situations de travail à risque et les problèmes de santé mentale qui peuvent en découler.
Ce projet novateur en matière de santé au travail a été développé spécifiquement pour le personnel enseignant, notamment pour favoriser la prévention concrète des situations à risque pour la santé mentale du personnel enseignant dans leur établissement scolaire. Il avait comme objectifs principaux de développer et d'expérimenter un dispositif organisationnel de prévention des problèmes de santé mentale au travail des enseignantes et enseignants dans les établissements scolaires, soit le comité santé mentale, qualité de vie et organisation du travail.
Dirigée par le chercheur, monsieur Simon Viviers, la recherche-intervention a été réalisée sous la responsabilité d'une équipe de huit chercheuses et chercheurs provenant de quatre universités québécoises, soit :
– M. Emmanuel Poirel et M. Frédéric Yvon (Université de Montréal) ;
– Mme Patricia Dionne et M. Frédéric Saussez (Université de Sherbrooke) ;
– M. David Benoit (Université du Québec en Outaouais) ;
– M. Simon Viviers, Mmes Mariève Pelletier et Louise St-Arnaud (Université Laval).
Notons que Madame Mariève Pelletier était initialement responsable du projet pour l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Comme elle a été embauchée le 1er juillet 2022 à l'École de counseling et d'orientation de l'Université Laval (UL), elle a rejoint l'équipe locale de recherche de l'UL. Par ailleurs, Madame Louise St-Arnaud a été impliquée seulement dans la phase de développement initiale du dispositif organisationnel, amorçant ensuite sa transition vers la retraite.
À la lecture du rapport final de recherche du projet de recherche-intervention vous pourrez constater tout le travail investi et l'envergure de ce projet qui, nous l'espérons, suscitera un grand intérêt et l'envie de promouvoir ce modèle dans les milieux, en favorisant son implantation. L'expérimentation du dispositif organisationnel aura permis de concrétiser une démarche collaborative pouvant être implantée par les personnes travaillant dans le secteur de l'éducation qui souhaitent agir favorablement sur la santé mentale au travail.
Pouvoir d'agir collectif
Ce projet aura permis au personnel enseignant d'exercer leur pouvoir d'agir collectif, concept cher à la FAE, puisqu'il permet d'adopter une posture d'affirmation et de prévenir les situations de travail à risque pour la santé mentale au travail. Plus spécifiquement, le pouvoir d'agir, c'est la capacité à être affecté et à affecter le monde par son initiative, d'une manière consciente et intentionnelle. C'est la capacité individuelle et collective de transformer son milieu, les éléments qui le conditionnent et l'organisent, en fonction de ce qui est important et qui a du sens pour soi, son métier et pour sa communauté. Ce pouvoir d'agir implique la possibilité de réaliser un travail bien fait selon les critères de qualité du métier.
Le dispositif organisationnel qui a été expérimenté, soit le Comité santé mentale, qualité de vie et organisation du travail, correspond tout à fait au véhicule approprié pour favoriser l'exercice du pouvoir d'agir collectif. Sa structure permet d'identifier, de documenter et de résoudre des situations de travail à risque pour la santé mentale. Le processus « d'arpentage » et la participation aux rencontres du comité redonnent du pouvoir aux enseignantes et enseignants sur l'organisation du travail et par le fait même, sur leur travail réel. Il permet de retrouver un sens au travail, ce qui est essentiel à la santé mentale au travail.
Continuer de paver la voie
L'expérimentation du projet pilote constitue l'aboutissement de travaux de plus d'une décennie menés par la FAE et ses membres. Maintenant, il faut penser à ses perspectives et s'assurer que tous les apprentissages des deux dernières années continuent de porter leurs fruits. En tant que pionnière dans le domaine, la FAE vous encourage à consulter le rapport final de recherche, le guide d'orientation ainsi que la synthèse du contenu pédagogique en soutien à l'appropriation et à l'implantation de la démarche afin de mettre de l'avant cette démarche collaborative sur l'organisation et la santé au travail. Le guide d'orientation explique, étape par étape, la démarche en commençant par l'identification des conditions favorables au sein du milieu de travail pour évaluer s'il est prêt à accueillir une telle initiative.
Cette démarche constitue un outil supplémentaire pour protéger et soutenir la santé mentale du personnel enseignant grâce au développement du pouvoir d'agir collectif sur l'organisation du travail.
Pour en savoir plus
Lisez le rapport final de recherche de l'équipe de recherche.
Lisez le guide d'orientations à l'implantation.
Lisez la synthèse des formations.
Consultez notre section sur la santé mentale des personnes enseignantes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand les droits des personnes LGBTQ+ reculent, c’est toute la société qui revient en arrière !

La Fondation Émergence a dévoilé cette semaine la thématique de la 22e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui souligne cette année le recul des droits des personnes LGBTQ+.
Tiré de Fugues
Par Caroline Lavigne, 4 mai 2024
La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (JICHT), organisée par la Fondation Émergence, soulignera le 17 mai prochain sa 22e édition. Cette année, l'organisme souhaite transmettre un message fort que lorsque les droits des personnes LGBTQ+reculent, c'est toute la société qui revient en arrière.
La Fondation Émergence tient à attirer l'attention sur le recul des droits des personnes LGBTQ+ partout à travers le monde. La campagne cherche notamment à mettre en lumière cet enjeu tout en invitant la population à dénoncer les actes discriminatoires dont elle est témoin.
« On entend souvent dire qu'il y a du progrès par rapport aux droits des communautés LGBTQ+ », déclare Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence. « Bien que cela soit vrai, il est également incontestable que la montée de la haine anti-LGBTQ+ est devenue plus apparente dans toutes les régions du monde. Que ce soit à travers des politiques publiques discriminatoires ou une augmentation des crimes haineux ciblant nos communautés, on comprend que ce recul est bien réel. Il est crucial, plus que jamais, de dénoncer ces reculs et de continuer nos actions de sensibilisation. »
Des chiffres probants
Bien que les Canadien.ne.s croient que les mentalités et les attitudes se sont améliorées au Canada (44 %), les propos haineux ont connu une hausse dans les dernières années au pays. En effet, ce sont 34 % des répondant.e.s qui affirment que ces discours ont augmenté au cours des 3 dernières années (d'après une étude menée par Léger en 2024)
Ce recul des droits peut se traduire de différentes manières : par une législation discriminatoire, de la violence et du harcèlement, des politiques publiques défavorables, ou encore des discours haineux ou de la désinformation qui alimentent les préjugés et la discrimination à l'égard des communautés LGBTQ+.
Des actions concrètes
Pour souligner la Journée internationale, plusieurs activités sont organisées par la Fondation, incluant une action de mobilisation le 17 mai, en plus d'un agenda LGBTQphobe répertoriant plus de 365 événements s'étant déroulés en 2023 partout dans le monde. Ces nombreux événements y sont présentés pour illustrer de façon concrète l'augmentation des crimes et la montée de la haine et de la violence visant les communautés LBGTQ+.
La Fondation encourage les allié.e.s des communautés à dénoncer ce recul des droits lorsqu'iels en sont témoins.
Un recul pour la société entire
Ce recul a de graves conséquences non seulement sur les personnes s'identifiant aux communautés LGBTQ+, mais aussi sur l'ensemble de la société. Même si les personnes LGBTQ+ représentent environ 1/10 de la population, 45 % des personnes au Canada ont des proches LGBTQ+.
De plus, 53 % des Canadien.ne.s affirment qu'un recul des droits des personnes LGBTQ+ au cours des 3 prochaines années, affecterait la société entière.
Cette Journée internationale a pour but de sensibiliser la population aux conséquences réelles de la lesbophobie, la transphobie, l'homophobie et l'ensemble des LGBTQphobies, mais également commémorer le jour où l'homosexualité fut retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé, le 17 mai 1990.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Fais un homme de toi » : troublant balado sur les thérapies de conversion

Les thérapies de conversion ne se limitent pas aux états américains ultra religieux ni à un passé lointain. La torture anti-LGBTQ+ existe encore au Québec au Canada. En donnant la parole à des survivant.e.s, à plusieurs expert.e.s, à des adeptes de ces thérapies et même à un jeune Québécois qui choisit chaque jour d'étouffer une part de lui-même, Jocelyn Lebeau propose une série balado aussi éclairante que bouleversante, Fais un homme de toi, disponible gratuitement sur OHdio.
Tiré de Fugues
Crédit photo : Alexis GR
Par Samuel Larochelle, 27 avril 2024
À quel point ces thérapies peuvent-elles causer des dommages ?
Jocelyn Lebeau : La première étude canadienne sur le sujet démontre que 10% des personnes LGBTQ+ en auraient subi, soit près de 100 000 personnes à travers le pays. Les impacts de ces thérapies, qui ont souvent lieu à l'adolescence, sont nombreux : hausse de l'anxiété, problèmes d'estime de soi, impact sur le parcours scolaire et socio-professionnel et suicides, tant certaines personnes en sont venues à se détester. L'expert Martin Blais dit qu'une thérapie de conversion est une entreprise de destruction massive de l'identité et de la confiance en soi.
Historiquement, ces thérapies ont pris plusieurs avenues : exorcisme, discussions avec des « spécialistes », lobotomie, LSD, greffes de testicules d'hommes hétéros, castration, électrochocs, viols correctifs, auto-punition de « reconditionnement ». Comment as-tu réagi en découvrant ça ?
Jocelyn Lebeau : Ça m'a choqué ! Dans le milieu médical, jusqu'en 1990, l'homosexualité
était un trouble de santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, alors que la transidentité était perçue comme une maladie jusqu'en 2019. Donc, la médecine tentait de répondre à cette vision. C'est long de faire changer la médecine partout sur la planète. Jusqu'à récemment, dans certains bureaux de psychologues reconnus par l'Ordre des psy du Québec, on suggérait subtilement de faire une thérapie de conversion.
En ce qui concerne le milieu religieux, il est plutôt question de rencontres avec un prêtre ou un pasteur, de lectures des versets de la Bible, de camps religieux comme dans le film Boy Erased ou . Ça existe encore, même si on sait que ça ne fonctionne pas.
Comment expliquer notre ignorance sur ces pratiques ?
Jocelyn Lebeau : Olivier Ferlatte, le chercheur de la grande étude, affirme que c'est un sujet tabou, même au sein de la communauté. C'est seulement en commençant à travailler là-dessus qu'il s'est rendu compte que certain.e.s collègues qu'il côtoyait depuis des années en avaient vécu et que ça se passait chez nous.
Le balado met la lumière sur le fait que ça s'est passé ici, que ça peut encore se produire et que c'est criminel au Canada depuis janvier 2022. La loi a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des élu.e.s, car c'est considéré comme une forme de torture. Seule une douzaine de pays interdit les thérapies de conversion sur la planète.
Même si le Québec a expulsé l'Église il y a six décennies, la religion occupe-t-elle plus de place qu'on le croit ?
Jocelyn Lebeau : Je tiens à préciser que le christianisme n'a pas le monopole de l'homophobie et de la transphobie, et qu'il existe des églises ouvertes aux personnes LGBTQ+. Il y a moyen de vivre sa foi en étant queer. Je ne veux pas démoniser la religion. Bien sûr, il y a moins de pratiques religieuses qu'à une certaine époque au Québec, mais ça existe encore. Pour certaines personnes, la religion, c'est toute leur vie : leurs croyances, une partie de leur éducation, leur cercle social, leur fun de fin de semaine.
Si ton entourage te propose une alternative pour te libérer du « démon de l'homosexualité », tu as tendance à les écouter, car ces gens partagent les mêmes valeurs que toi. Et lorsque tu réalises que ça ne fonctionne pas et que tu vas moins bien depuis que tu as subi les thérapies de conversion, si tu choisis de quitter ton groupe religieux, tu te détaches de tous tes cercles : tes amis, ta famille, ta gang.
Les thérapies de conversion viennent beaucoup de la volonté de maintenir une forme d'ordre social où les rôles sont très définis. D'où vient ce besoin de rigidité ?
Jocelyn Lebeau : La société a installé un système très binaire : le bien et le mal, les hommes et les femmes, etc. Il y a plusieurs choses qui sont séparées sans rien au milieu. Mais depuis quelques années, on se rend compte qu'entre les deux, il existe plusieurs choses et ça brasse la cage de certaines personnes. Ça bouleverse certaines visions du monde. Je crois qu'on est dans une période de changement positive, mais on assiste également à une remontée de l'homophobie et de la transphobie. C'est pour ça qu'il faut se faire entendre et donner des exemples de réussites publiquement.
Tu fais intervenir un homme pro-thérapies de conversion, qui prétend que ça ne crée pas de dommages et que l'homosexualité est une croix. Pourquoi lui offrir une tribune ?
Jocelyn Lebeau : On trouvait ça important d'avoir différents points de vue. Comme on demande aux gens de comprendre les réalités LGBTQ+, je crois qu'on doit nous aussi tendre l'oreille à ce que certaines personnes pensent. Cela étant dit, c'était la rencontre qui me stressait le plus. Je savais qu'on ne voyait pas l'orientation sexuelle et l'identité de genre de la même façon. Au final, ç'a été une discussion entre deux adultes qui essayaient d'entendre le point de vue de l'autre. Selon sa vision, l'homosexualité est un démon dont on peut se débarrasser. Je ne suis pas d'accord. Mais de l'entendre, ça m'a permis de réaliser que certaines personnes voient ça ainsi.
J'ai envie de vivre dans une société où tout le monde peut échanger pour faire avancer les choses. Il n'est pas le seul à penser comme ça. Il dit lui-même que s'il y avait des études plus poussées faites par d'autres spécialistes, il serait prêt à se rallier au consensus scientifique. Présentement, il croit qu'il y a un lobby gai et que des gens ne peuvent pas pousser les études aussi loin qu'ils le souhaiteraient. Nous lui avons partagé nos recherches. Je ne crois pas qu'on l'a fait changer d'idée, mais dans cet échange, peut-être qu'on peut espérer faire un peu changer les choses.
Les personnes comme lui trouvent souvent des raisons pour justifier que toutes les preuves qu'elles ont tort sont sans fondement. Ça vient entre autres d'une perte de confiance envers les institutions et ça semble justifier tous les comportements et tous les idéaux.
Jocelyn Lebeau : Lui-même reconnaît que certains de ses propos peuvent se rapprocher de théories conspirationnistes. Il nous l'a dit. Mais on entend l'échange au complet : ses propos, nos réponses et nos nuances. Ce segment-là permet de remettre en lumière certains faits sur les thérapies de conversion. C'est important de réagir et de rectifier les faits.
Le balado donne aussi la parole à un jeune Québécois qui affirme être passé d'homo à hétéro, qui dit avoir changé pour être ce que Dieu veut qu'il soit et qui s'abandonne chaque matin, dans le sens qu'il met de côté une part de lui-même pour être hétéro. Comment réagissais-tu à ses propos ?
Jocelyn Lebeau : Au début, ça confronte ! C'est une autre façon d'aborder son rapport à la vie. Il a l'air très heureux dans sa relation avec Dieu, sa femme et ses enfants. Il a choisi d'écouter ce que Dieu lui a envoyé comme message. Je respecte ses choix.
As-tu hésité avant de diffuser une parole qui pourrait permettre à d'autres personnes de se reconnaître et les encourager à écraser une part d'elles-mêmes ?
Jocelyn Lebeau : Pas du tout, car on donne aussi la parole à plusieurs spécialistes qui affirment n'avoir jamais rencontré une personne qui a réussi à changer son orientation sexuelle ou son identité de genre à l'aide des thérapies. On est tous libres d'écouter nos désirs ou non. Martin Blais dit espérer que les gens qui prennent cette décision ont un sentiment d'accord avec eux-mêmes chaque jour. Dr Richard Montoro explique que ce n'est pas nécessairement santé. Après ça, les gens peuvent tirer leurs conclusions.
Tout au long du balado, je t'ai senti à fleur de peau. Pourquoi ?
Jocelyn Lebeau : Parce que c'aurait pu être moi. À l'adolescence, si j'avais baigné dans un milieu religieux et qu'on m'avait proposé une thérapie de conversion, j'aurais embarqué à 100 milles à l'heure. Ça me faisait tellement chier d'être gai ! Donc, je me reconnais dans ces personnes-là. Je les trouve courageuses de nous parler. Elles ont fait preuve de tellement d'authenticité que je me devais d'en faire autant.
INFOS | Suivre le balado Fais un homme de toi sur Ohdio :https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guide sur les nouvelles « autorisations pour les travaux d’exploration à impacts »

Le 6 mai 2024 entrera en vigueur une modification réglementaire au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. Cette modification réglementaire vise à améliorer la prise en compte des préoccupations des populations affectées par la réalisation de travaux d'exploration dits « à impact ». Mais en quoi consistent ces changements concrètement ?
Télécharger le guide ici.
En bref :
– Les travaux d'explorations dits « à impacts » nécessiteront l'obtention préalable d'une autorisation (autorisation pour les travaux à impacts, ou ATI) ;
– Cette ATI nécessitera l'envoi, par le titulaire du titre minier (claim) à la direction-générale (DG) de la municipalité et/ou aux conseils de bande des communautés autochtones habitant le territoire concerné, d'une brève description des travaux qu'il souhaite réaliser. Sur réception de cet avis, la DG de la municipalité aura 10 jours et les communautés autochtones auront 30 jours pour faire parvenir leurs questions et commentaires au titulaire du titre minier. Le titulaire devra répondre à ces questions et commentaires, et recevra ensuite son ATI ;
– Aucune forme de « consultation » additionnelle n'est prévue, il ne s'agit que d'un échange d'informations sur certains travaux d'exploration. Au sein des municipalités, seule la direction générale recevra ces informations de la part de l'entreprise. Pas les citoyen-ne-s ni les propriétaires ou locataires. Pareillement au sein des communautés autochtones ;
– Les travaux d'exploration « à impacts » comprennent : « les travaux effectués avec de la machinerie utilisant la force hydraulique ou des travaux utilisant des explosifs » (excavation, décapage, échantillonnage en vrac, sondage, levés géophysiques sismiques de réfraction) et « les travaux effectués avec une pompe hydraulique à des fins d'orpaillage » (Analyse réglementaire, p.7). Ces travaux représentent à peine 3,75% des travaux d'exploration (ibid., p.6) sur l'ensemble de la province ;
– Les demandes de permis d'exploration seront potentiellement jumelées aux demandes de « permis d'intervention forestier[s] dans les forêts du domaine de l'État » (ibid., p.20), et le ministère mettra, à disposition de l'industrie, « une prestation électronique de services » (ibid.) pour l'ATI et son renouvellement ;
– Il est attendu qu'environ 130 demandes d'ATI réparties sur l'ensemble du territoire de la province soient déposées chaque année ;
– Ni les municipalités, ni les communautés informées de la tenue de ces travaux, ni même la ministre des Ressources naturelles n'auront le pouvoir de refuser la réalisation de ces travaux « à impacts ». La ministre peut seulement imposer des conditions pour encadrer les travaux. Ces demandes d'ATI ne seront qu'un simple partage d'information, sans pouvoir discrétionnaire octroyé aux acteur-trice-s concerné-e-s.
Bien qu'elles témoignent d'une volonté du ministère d'informer les populations locales de la réalisation de travaux miniers, ces modifications réglementaires ratent leur cible devant l'importance d'obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de toute population impactée par ces travaux à vocation économique. Considérant que les Premières Nations estiment que la Couronne contrevient à son obligation de les consulter dès le moment de l'émission des claims miniers, il est difficile d'affirmer que cette nouvelle procédure qui intervient après l'émission des claims miniers change la donne.
Voici ce que la description détaillée de chacun des travaux à impacts projetés par le promoteur doit inclure suivant le règlement :
– La nature des travaux et la méthode de réalisation ;
– La superficie visée et le volume de substances minérales à extraire ;
– Le nombre de forages planifiées le cas échéant ;
– La durée prévue des travaux et la période où ils seront réalisés ;
– Le lieu où seront réalisés les travaux ;
– Une description sommaire des mesures de restauration proposées le cas échéant.
Cependant, gardons à l'esprit qu'une consultation digne de ce nom devrait comprendre :
– La tenue d'assemblées publiques, ouvertes à tous et à toutes, tenues à plus d'une occasion et permettant la présentation d'informations détaillées et indépendantes (qui ne soient pas uniquement produites par l'entreprise) sur les impacts qu'auront ses travaux ;
– Une rétroaction transparente pour témoigner de l'intégration des commentaires et des questions dans la réalisation des travaux ;
– Des détails sur les mesures de mitigation qui seront appliquées pour adresser les impacts attendus, ainsi que sur les zones sensibles ou éléments d'intérêt du territoire qui doivent être considérés dans la planification des travaux ;
– Des détails sommaires sur la compagnie elle-même : de qui s'agit-il ? Quel minerai cherche-t-elle ? Son financement est-il de nature publique ou privée ?
En réponse à ces modifications, et en vue que ces échanges avec le promoteur soient le plus utiles possible, nous vous encourageons, selon votre intérêt ou vos besoins à :
– Communiquer à la direction générale de votre municipalité ou à votre conseil de bande votre besoin d'être consulté-e lors de la réception des informations relatives aux ATI que leur enverront les compagnies minières ;
– Communiquer au ministère (MRNF) votre intérêt à ce que des fonctionnaires de liaison soient mis à la disposition de la population pour obtenir le même niveau d'information et de réponses à vos questions et commentaires que l'industrie minière ;
– Revendiquer que ces communications soient systématiquement mises en ligne, puisque ces travaux auront des impacts sur des éléments du bien commun (l'eau, le territoire, la qualité de vie, etc.).
Compléments
Pour en savoir davantage sur le développement et les impacts sur l'eau d'un projet minier, ainsi que sur l'élaboration d'une saine mobilisation citoyenne, nous vous invitons à consulter notre Guide citoyen traitant de ces enjeux.
Voir aussi nos commentaires conjoints avec Eau Secours et MiningWatch Canada d'octobre 2023 sur le projet de règlement avant qu'il n'entre en vigueur.
Ainsi que la Directive concernant l'autorisation pour travaux d'exploration à impacts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts entrée en vigueur le 7 février 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aéroport de Saint-Hubert : une assemblée sans acceptabilité sociale

Longueuil, 9 mai 2024. - Plus d'une centaine de citoyen.ne.s s'étaient rassemblé.e.s hier soir au Centre
Labrosse de Saint-Hubert pour discuter du développement en cours à l'aéroport de Saint-Hubert, un
projet qui, rappelons-le, n'a jamais été déposé avec les études pertinentes (économiques, sanitaires,
environnementales et climatiques) pour être évalué publiquement, tel que l'avaient recommandé deux
rapports de consultation citoyenne en 2022 : le rapport Trudelet celui de l'Office de participation
publique de Longueuil(OPPL).
L'assemblée a d'abord entendu une présentation de la Coalition Halte-Air Saint-Hubert et du Comité
antipollution des avions Longueuil (CAPAL) sur les impacts de ce développement sur la santé, à cause
de la pollution sonore et atmosphérique que cela va entraîner, mais aussi sur la dépréciation des
maisons des riverain.e.s que causera cette pollution.
Les participant.e.s stupéfaits n'en revenaient toujours pas de la façon dont ce projet a été imposé sans
tenir compte des avis citoyens exprimés. La mairesse Catherine Fournier a affirmé lors du lancement,
et répète depuis, qu'il y a acceptabilité sociale du projet parce que, dans un sondage Léger/Léger, les
gens s'étaient déclarés favorables à une augmentation des vols. Or, il s'agit du résultat à une seule
question sur 18. Jamais elle n'a fait mention de toutes les autres questions qui montrent pourtant les
préoccupations et inquiétudes de la population (voir le tableau à la fin). Il n'y a pas d'acceptabilité
sociale, comme enont déjà témoigné les maire et mairesse de Saint-Bruno-de-Montarvile et de Saint-Lambert dans ce reportage de Radio-Canada.
Plusieurs des personnes présentes ont témoigné de l'enfer qu'elles vivent à longueur de journée et
même la nuit, dont le papa d'un bébé de quelques mois seulement dont le sommeil est régulièrement
interrompu.
La mairesse et DASHL ont beau se vanter que les vols nocturnes des Boeing 737-200 de CHRONO
Airlines sont maintenant interdits, la suspension ne concerne que ce seul appareil, et non les vols
nocturnes d'autres appareils. D'ailleurs, CHRONO Aviation s'est empressé d'annoncer que ses vols
nocturnes vont reprendre le 6 août,à raison de 4 fois/semaine, sur ses bruyants Boeing 737-800.
De plus, la direction de DASHL et la mairesse vante le fait que l'interdiction des vols de nuit s'applique
de 23h à 6h, ce qui a fait dire à un participant hier : « Ça fait pas des longues nuits, ça. T'es mieux de
t'endormir tout de suite ! »
TVA Nouvelles était sur place, et leur reportage, après avoir rendu compte des inquiétudes des
citoyen.ne.s, a donné la parole à la mairesse. La machine à désinformer s'est remise en marche, mais
le disque est de plus en plus rayé et notre connaissance du dossier nous permet désormais de balayer
facilement ses arguments.
Pour la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, il est plus que désolant que la mairesse s'entête à défendre ce
projet mortifère aux dépens de sa population.
Si le nouveau slogan de l'aéroport est « On est ailleurs ! », la mairesse, elle, n'est tout simplement
« pas là » pour ses citoyen.ne.s !
Note : La question dont la mairesse parle et celles dont elle ne parle jamais... (dans le
sondage LÉGER/Léger rapporté aux pages 24 à 26 du rapport de l'OPPL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Taxer les piscines : un symbole positif

Il n'existe pas grand monde pour défendre l'adoption par le conseil municipal de Sherbrooke le 9 avril dernier de la fameuse « taxe piscine ». À en croire les avis de nombreux citoyens et citoyennes sur les réseaux (dits sociaux) ainsi que les commentaires des médias généralistes, le choix du conseil municipal d'imposer une taxe de 80 $ aux personnes possédant une piscine sur leur propriété serait LE symbole du petit propriétaire à qui l'on fait toujours les poches ainsi que la preuve de l'idéologie décadente (on peut souvent lire « communiste ») de Sherbrooke Citoyen. « À l'impossible, nul n'est tenu », mais nous allons tenter le défi de donner un appui et de la valeur à ce genre de décision fiscale.
Tiré du Journal Entrée Libre
https://www.entreelibre.info/taxer-les-piscines-un-symbole-positif/
Sur le point de l'idéologie déjà, Sherbrooke Citoyen a eu l'intelligence de présenter cette taxe additionnelle non pas comme une taxe écologique, en liant la taxe avec un gaspillage de ressources (formel celui-ci) ou dans l'objectif de faire changer de comportement (utiliser les piscines municipales plutôt que les piscines privées), mais bien comme une taxe sur la richesse personnelle. La Ville ne pouvant évaluer les revenus de sa population sur la base des déclarations comme le font les gouvernements provinciaux et fédéraux, elle a fait la supposition que si vous possédez une maison avec une piscine, c'est que vos revenus sont probablement supérieurs à une personne qui n'a pas de maison ou à une personne qui n'a pas de piscine. Si plein de gros poissons peuvent passer à travers les mailles du filet, la supposition reste tout de même bonne pour éviter de surtaxer les personnes aux revenus les plus faibles. Et on pense en premier lieux aux locataires, car peu de locations viennent avec piscine, et si c'est le cas le 80 $ sera amorti par l'ensemble des locataires de l'immeuble.
Ainsi, cette taxe est faite pour apporter un surplus de revenus à la Ville de Sherbrooke en demandant une contribution supplémentaire à celles et ceux que l'on peut estimer en mesure de le faire. Pour cette tranche de la population, 80 $ en moins n'est pas censé mettre en péril le budget familial. Les personnes qui sont à 80 $ près sur un an n'ont très probablement pas de propriété et de piscine ! La Ville de Sherbrooke opère un nombre important de services, dont au moins 11 piscines publiques ouvertes gratuitement pendant la saison estivale. Le dernier budget a vu une augmentation de la taxe municipale de 3,13 %, soit en dessous de l'inflation estimée à 3,9 % en 2023. La taxe piscine permet aussi un rattrapage de l'année 2022 où l'inflation était de 6,8 % au Québec, et l'augmentation des taxes municipales de 3,0 %. Pour équilibrer un budget, on peut toujours diminuer dans les dépenses. Mais ceci implique nécessairement de perdre un service qui était disponible, que ce soit la gratuité des bibliothèques ou un tarif encadré du transport en commun, voire le déneigement et l'entretien des rues. Ou alors, on décide d'être créatif et d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Certains se plaisent à dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais si l'on secoue bien le bon cocotier, on pourrait avoir de quoi se nourrir sans faire crever l'arbre en question.
Un juste retour de balancier
Car c'est également à l'échelle nationale que cette taxe piscine est aussi un symbole important. Depuis 1999, le taux d'imposition effectif des ménages au Québec (incluant les impôts provinciaux et fédéraux) a globalement diminué de 2,7 points de pourcentage (voir le blog Jeanne Emard pour une analyse fouillée et chiffrée). Depuis le début des années 2000, c'est avant tout un recul de la part et de l'action de l'État dans nos vies que l'on observe. Pensons à l'accès à la médecine ou à la crise dans le système scolaire. Cette crise vient d'un manque de financement chronique et criant des structures étatiques, qui s'est organisé par une baisse régulière des impôts, baisse étant encore plus exacerbée lorsque les impôts touchaient le capital. Ainsi, la « taxe piscine » à Sherbrooke n'est qu'un minime frein à l'augmentation en capital de quelques-uns qui se fait sur le dos du développement collectif de notre communauté. On souhaite un retour de balancier encore plus salutaire.
Sylvain Vigier,
Rédacteur en chef
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le syndicat de la télévision belge remplace la diffusion d’Israël à l’Eurovision par des protestations pour Gaza

Le public de l'Eurovision a hué l'entrée d'Israël et scandé « Palestine libre » lors d'une répétition générale mercredi. La retransmission du concours Eurovision de la chanson en Belgique a été interrompue jeudi par des membres d'un syndicat pro-Gaza qui ont diffusé un message condamnant les « violations des droits de l'Homme » commises par Israël et soutenant les Palestiniens.
Tiré de France Palestine Solidarité.
L'action a eu lieu juste avant la participation d'Israël à la demi-finale du concours, en raison du massacre d'au moins 34 904 Palestiniens à Gaza et de la destruction d'une grande partie de l'enclave.
La candidate d'Israël avait déjà été huée par la foule en Suède lors d'une répétition générale, en raison de la guerre brutale menée par son pays contre Gaza, tandis que des manifestations ont eu lieu à l'extérieur du studio de Malmö, avec la participation de l'activiste Greta Thunberg.
Diffusé en direct sur la chaîne belge VRT, le message de protestation était le suivant : « Il s'agit d'une action syndicale. Nous condamnons les violations des droits de l'Homme commises par l'État israélien. Israël détruit également la liberté de la presse. C'est pourquoi nous interrompons temporairement la transmission. »
« Nous sommes convaincus que l'État d'Israël commet un génocide et il est donc scandaleux qu'un candidat israélien participe au concours de l'Eurovision. »
« Nous espérons envoyer un signal au gouvernement israélien pour qu'il arrête les combats et les tueries, qu'il permette aux observateurs internationaux et à la presse d'entrer [à Gaza] et qu'il s'assoie pour trouver une solution négociée ».
Cette interruption intervient alors que des manifestants pro-palestiniens s'insurgent contre la participation de la chanteuse israélienne Eden Golan au concours.
Plusieurs pétitions ont été adressées à l'Union européenne de radio-télévision (UER) pour demander l'exclusion d'Israël, notant que la Russie a été interdite suite à son invasion de l'Ukraine en 2022.
L'UER a défendu sa décision de maintenir Israël dans la compétition, le directeur général adjoint Jean Philip De Tender déclarant qu'une interdiction serait contraire à la nature apolitique de l'organisation.
Fin mars, des candidats de neuf pays, dont le favori suisse, Nemo, ont appelé à un cessez-le-feu durable.
En décembre, le candidat britannique, Olly Alexander, a signé une déclaration accusant Israël de génocide, à la suite des mesures provisoires de la Cour internationale de justice exigeant d'Israël qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher des actes génocidaires dans sa guerre contre Gaza.
À l'extérieur de la demi-finale organisée à Malmö, en Suède, quelque 10 000 manifestants se sont rassemblés sur la place principale de la ville pour protester contre la participation d'Israël.
« Je suis une fan de l'Eurovision et cela me brise le cœur, mais je boycotte » a déclaré à l'AFP une manifestante de 30 ans, Hilda, qui n'a pas voulu donner son nom de famille.
« Je ne peux pas m'amuser en sachant qu'Israël participe alors que tous ces enfants meurent. Je pense que ce n'est pas correct. »
Les manifestants ont également brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Libérez la Palestine » et « L'UER légitime le génocide ».
Une cinquantaine de manifestants se sont rendus devant la Malmo Arena, avant d'être dispersés par la police.
Les manifestants ont également pénétré dans le Village Eurovision, installé pour permettre aux spectateurs de regarder le spectacle sur des écrans géants.
Ailleurs à Malmö, une centaine de contre-manifestants se sont rassemblés sous la protection de la police pour exprimer leur soutien à Israël.
Outre les protestations à l'extérieur de la salle, des membres du public ont hué et scandé « free Palestine » pendant la répétition générale de la chanson « Hurricane » d'Eden Golan, mercredi.
Eden Golan a également été accueillie par des huées, mais aussi par des acclamations, de la part d'un public de 9 000 personnes lors de sa prestation de jeudi, qui lui a permis d'entrer dans le set final pour samedi.
La société israélienne de radiodiffusion a déclaré qu'elle s'était plainte à l'UER de ces huées et a demandé à l'organisation de les empêcher à l'avenir.
Avant la prestation de Mme Golan, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souhaité bonne chance à la chanteuse, déclarant qu'elle avait déjà gagné en défiant les manifestants, qu'il a accusés d'être antisémites.
La chanson originale d'Israël, intitulée « October Rain », a été modifiée après avoir été jugée trop politique par les organisateurs du concours pour avoir fait allusion à l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël.
Après son entrée en finale, Golan a déclaré : « C'est vraiment un honneur d'être ici, sur scène, de jouer et de montrer notre voix, de nous représenter avec fierté et d'arriver en finale, c'est quelque chose de fou. »
Israël a fait ses débuts à l'Eurovision en 1973 et a remporté le concours à quatre reprises. Il rejoindra 25 autres pays, dont les favoris des bookmakers, la Croatie et la Suisse, en finale.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’affaire Meurice vue depuis le Québec : excès de rire ou excès de condamnation ?

En temps de crise, l'humour est une vigile et un suspect. L'humour dénonce, mais il expose également son auteur. En dit-il trop, s'exprime-t-il trop mal ? Comment dénoncer sans se faire dénoncer ? Où situer la liberté d'expression ? Comment l'humour peut-il réformer, décrier, sans être emporté par l'interdit ? Le cas Meurice convie tous les acteurs du rire et ses contempteurs.
Tiré du blogue de l'auteur.
L'affaire Meurice cause confusion et convulsion. Quelques semaines après la barbarie funeste du Hamas et la riposte violente du gouvernement israélien, l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, se livre à une chronique à l'aube d'Halloween. Appelé à dresser l'inventaire de « déguisements pour faire peur », il laisse tomber : « Alors, en ce moment, il y a le déguisement Nétanyahou, qui marche pas mal pour faire peur, Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi, mais sans prépuce ».
Mesurée est la réponse initiale de la direction de la radio publique : sans condamner vertement l'humoriste, elle signale à raison sa sympathie envers le malaise ressenti par une partie des auditeurs. La direction procède également à une distinction : les propos prononcés n'ont pas outrepassé les balises posées par le droit tout en franchissant pourtant la limite « du respect et de la dignité ». Les secousses provoquées par l'éclat langagier de Guillaume Meurice amènent promptement une seconde salve plus percutante. En l'absence de contrition de l'humoriste, la direction de Radio France lui adresse un avertissement. L'humour ne saurait avoir pour vocation d'« ajouter de la division à la division », de professer la direction de la radio publique.
L'Arcom ne se tient pas en retrait et sert une mise en garde à Radio France pour les propos de son humoriste. Elle reproche à l'antenne nationale de s'être écartée de « ses missions » et d'avoir mis à mal « la relation de confiance qu'elle se doit d'entretenir avec l'ensemble de ses auditeurs ». Le réquisitoire se poursuit : « Les risques de répercussions sur la cohésion de notre société ne pouvaient être ignorés, tout particulièrement dans un contexte marqué par la recrudescence des actes à caractère antisémite ».
À l'inverse, la justice pénale ne trouve pas à redire et la plainte pour « provocation à la violence et à la haine antisémite » ainsi que pour « injures publiques à caractère antisémite » est classée sans suite.
Cette décision porte à conséquence : il n'y avait ni infraction, ni même matière à procès.
Ragaillardi – ou tout bonnement désireux de marquer le coup au nom de la liberté d'expression – l'humoriste reprend sitôt après les mêmes mots en ondes et est prestement convoqué par sa direction dans la perspective de nouvelles sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'affaire Meurice est, ni plus ni moins, le procès de l'humour.
Le rire, complice de la violence voire agitateur délétère délibéré ? Oui, parfois. La Cour européenne des droits de l'homme ne se défile pas au sujet de Dieudonné : un spectacle destiné à railler l'extermination des Juifs lors de l'Holocauste ne saurait bénéficier de la protection accordée à la liberté d'expression. Cet arrêt souligne à bon droit le travestissement de l'art en cause.
Il n'empêche : l'humoriste jouit, en temps normal, d'une latitude appréciable de manière à dénoncer, même de manière acerbe, des travers sociaux supposés ou avérés. La Cour suprême du Canada consacre ce droit constitutionnel à l'insolence artistique. Dans deux arrêts de principe, elle campe le décor avec précision et justesse. À moins d'être poussée à l'extrême, l'ironie ne saurait se prêter à une condamnation, sauf à entraver à l'excès la liberté d'expression (Whatcott). D'une part, l'humour « possède rarement l'effet d'entraînement requis pour susciter chez des tiers une attitude de haine et de discrimination » (Ward). D'autre part, la censure n'a pas lieu d'être, lorsque l'auditoire est en mesure de déceler le procédé humoristique à l'œuvre. En somme, la tentation de l'interdit est tout bonnement infondée lorsqu'elle mésestime le « discernement » de l'auditoire et sa capacité à « ne pas prendre tout ce qui est dit au pied de la lettre » (Ward).
Que reste-t-il, dès lors ? Des sentiments meurtris par certains propos jugés offensants. Or, ce préjudice émotionnel ne saurait suffire à museler quiconque : le droit de ne pas être offensé « n'a pas sa place dans une société démocratique », d'asséner sans ménagement la cour suprême canadienne.
Le contraste entre les réactions de l'ARCOM et de Radio France et les prises de position canadiennes en faveur de la liberté d'expression ne s'arrête pas là. À preuve cette affaire tranchée en 2023 par la magistrature canadienne à propos de l'emploi en ondes du titre d'un livre remarqué en son temps par la critique littéraire. Intitulé « Nègres blancs d'Amérique » ; le livre de Pierre Vallières paru en 1968 se faisait l'écho du prolétariat québécois francophone de l'époque. Ce titre est mentionné en ondes en 2020 dans une émission consacrée aux idées devenant taboues. Un auditeur s'en indigne et saisit l'équivalent canadien de l'ARCOM, le CRTC, qui fustige l'emploi répété de ce titre durant l'émission.
Dans le sillage du décès tragique de George Floyd, pareille mention en ondes, sans précaution aucune, ne contribuait pas « au renforcement du tissu culturel et social et au reflet du caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ». Partant, les radiodiffuseurs devaient redoubler de vigilance et instaurer « toutes les mesures nécessaires pour atténuer l'impact d'un propos pouvant être perçu comme offensant par son auditoire ». Ce raisonnement – qui n'est pas sans évoquer celui retenu par la direction de Radio France au nom de la nécessaire cohésion sociale – est salutairement invalidé par la Cour d'appel fédérale au motif qu'il occulte l'importance de la liberté d'expression ainsi que l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouissent les radiodiffuseurs. Au surplus, la cour estime que l'équivalent canadien de l'ARCOM a tenté de s'arroger « un pouvoir discrétionnaire illimité sur ce qui peut et ne peut être dit sur les ondes ». Autant un organisme régulateur peut à bon droit intervenir au sujet d'excès, autant les mesures prônées ne sauraient l'être sans égard à la liberté d'expression.
Cette mise au point est également une mise en perspective. Il serait étonnant de condamner l'humour au motif qu'il porte en son sein la division lorsque des instances officielles investissent l'arène publique et lancent elles-mêmes des cris d'alarme. Le 5 novembre, dans un geste symbolique comme exceptionnel, plus de dix têtes dirigeantes d'entités onusiennes signaient collectivement une tribune publique réitérant l'atrocité des basses œuvres du Hamas tout en stigmatisant une riposte jugée indigne (« outrage » en anglais) au vu du nombre de civils tués et de ceux et celles privés de ressources essentielles en raison de bombardements décrits comme « inacceptables », vu l'ampleur des lieux visés : hôpitaux, lieux de culte, abris, demeures. L'horreur est décriée, de part et d'autre, dans un camp comme l'autre, en toutes lettres. Il est à se demander en quoi une condamnation émanant de sources officielles, visiblement concertée et forcément destinée à marquer les esprits, est moins à même de remuer l'opinion publique qu'une saillie humoristique.
La position canadienne est sans ambiguïté : les effets soi-disant nocifs de l'humour ne sauraient être exagérés. De surcroît, les organismes régulateurs ne disposent pas d'une capacité débridée de proclamer des oukases langagiers. Sous le couvert de vouloir tuer dans l'œuf des polémiques jugées néfastes au climat social, il est à se demander si l'ARCOM et la direction de Radio France ne condamnent pas, en réalité, l'effet dénonciateur de l'humour tout en laissant indemnes des propos d'instances officielles non moins ravageurs.
Pierre Rainville, Professeur titulaire
Cotitulaire de la Chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression (FRQ / CNRS) - COLIBEX
Faculté de droit, Université Laval à Québec
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Crise à Québec solidaire Réinventer notre démocratie en faillite

Pour les cosignataires, le projet de Québec solidaire consiste à « se faire élire avec une véritable force démocratique qui souffle dans nos voiles, et opérer enfin de grandes transformations ».
Quarante cosignataires ayant milité ou travaillé activement pour Québec solidaire*
Qu'est-ce que le projet de Québec solidaire ?
Nous publions aujourd'hui cette lettre en réaction à la récente sortie de Gabriel Nadeau-Dubois pour une « gauche pragmatique », où il a laissé entendre qu'il existait à l'intérieur de Québec solidaire (QS) une autre gauche qui, elle, ne cherchait pas réellement à mettre le parti au pouvoir.
C'était induire le public en erreur, et il nous faut aujourd'hui démêler les pinceaux du porte-parole masculin de QS pour que le débat puisse se faire sur des bases intelligentes et respectueuses.
Rappelons qu'il y a sept ans, l'ancien leader étudiant, nouvellement élu porte-parole masculin du parti, s'exprimait ainsi : « Je pense que Québec solidaire, au moment où on se parle, ressemble encore un peu trop à un parti traditionnel et qu'il peut […] vraiment se transformer en un mouvement citoyen large, présent à la fois au Parlement et dans la société civile. »
Il se présentait à l'époque comme étant en phase avec ses prédécesseurs, Amir Khadir et Françoise David, qui écrivaient en 2009 dans le manifeste de QS : « Un autre monde est possible si l'on questionne sérieusement l'organisation et la culture capitalistes ; si l'on repense nos liens sociaux, nos solidarités ; si nous nous inscrivons dans des alternatives citoyennes et politiques. »
L'idée était que QS n'accède pas au pouvoir en s'appuyant uniquement sur les règles politiques habituelles, cette espèce de course de chevaux réglée par les sondages, le commentariat et le découpage du peuple en clientèles électorales et en microciblage.
Comme l'expliquait Émilise Lessard-Therrien, un gouvernement solidaire ainsi élu se retrouverait très faible face aux puissants lobbys qui attendent de pied ferme tous les gouvernements du Québec. Pour apporter des changements qui ne soient pas qu'une succession de « mesurettes » (le mot est d'Amir Khadir), il faudra donc absolument, derrière l'élection d'un gouvernement de QS, toute la puissance du « lobby du peuple » (Catherine Dorion) : un peuple bien mobilisé et bien réveillé, prêt à affronter la déroute capitaliste avec son gouvernement.
Se cantonner dans les institutions parlementaires actuelles ainsi que dans la soumission aux exigences médiatiques et algorithmiques, ça serait l'équivalent d'attendre par magie qu'un mouvement social fort se lève et que QS puisse simplement s'en faire le relais à l'Assemblée nationale. Ça serait attendre, encore une fois, des « conditions gagnantes » ou le « moment opportun » pour réaliser enfin ce projet de transformation sociale ambitieux qui est partagé par un très grand nombre de Québécoises et Québécois en quête de sens. Ça serait faire élire QS pour ensuite le mettre en mode stand-by… et faire en sorte que le parti patine à l'intérieur du système, déçoive et y perde son âme, et que tout soit à recommencer.
Le Québec a déjà joué dans ce film-là. La regrettée militante indépendantiste et féministe Hélène Pedneault racontait, dans La force du désir, « cette forme particulière d'énergie inébranlable qui monte quand on désire vraiment quelque chose ». Elle démolissait le faux pragmatisme du « moment opportun » péquiste en expliquant comment, « [q]uand on désire profondément, résolument quelque chose, on s'organise toujours pour “arranger” la conjoncture qui nous semble paresseuse ou hostile, afin qu'elle travaille pour nous et qu'elle devienne un outil et non un frein, une porte ouverte et non une porte blindée cadenassée à double tour, une permission d'être et de faire et non un rejet ».
« Arranger » la conjoncture pour dégager les possibles : c'est ça, depuis le tout début, le projet de QS. Utiliser une très grande partie de toutes les ressources gagnées via les élections (nos recherchistes, nos gens de comm, nos organisatrices et organisateurs, nos budgets) pour nourrir les luttes environnementalistes et sociales partout au Québec.
Se lier sincèrement, les manches retroussées et les deux mains dans la pâte, avec tout ce qui s'active en termes de mouvement social. Puis, une fois le peuple bien mobilisé avec nous, se faire élire avec une véritable force démocratique qui souffle dans nos voiles, et opérer enfin de grandes transformations.
C'est à ce parti-mouvement-là que nous avons été conviées et conviés, nous, signataires de cette lettre. C'est à ce parti-là que nous avons consacré temps, charge mentale, sueur, foi, et une grande quantité d'efforts résolus et sincères. Et si QS est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un outil capable d'espérer un jour prendre le pouvoir, c'est entre autres grâce à ce que nous avons travaillé à construire depuis 2006.
La gauche craintive se fait doubler partout en Occident
Le 1er mai dernier, journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, le point de presse que tenait Gabriel Nadeau-Dubois devait répondre à la crise qui faisait rage à QS depuis la démission d'Émilise Lessard-Therrien. Il devait répondre à la pluie de dénonciations sur les réseaux sociaux qui a suivi quant à la concentration du pouvoir entre les mains de ses proches et l'exode des femmes lié à un climat malsain. Il n'a pas répondu à ces dénonciations : il a plutôt fait diversion et changé de sujet, ce qui est précisément l'inverse de « se mettre à l'écoute ».
« La gauche pragmatique », le mot était lancé. Gabriel avait choisi son camp. Le mouvement citoyen à bâtir avait disparu de son discours – il n'y est plus depuis longtemps. Il faut donc arriver au gouvernement, peu importe les conditions. À d'autres de travailler à construire un mouvement populaire et à faire naître les « conditions gagnantes ».
Or il faut se rappeler que la gauche « pragmatique », « efficace » et calculatrice, celle qui traite les autres de rêveurs et d'idéalistes – comme si c'était des défauts –, se fait doubler à l'heure qu'il est.
Elle se fait doubler partout en Occident par une droite qui n'a pas peur de soulever des foules et de déplacer le cadrage du débat politique vers la droite. Si cela fait peur à bien du monde, cela devrait surtout faire en sorte que la gauche, pour reprendre l'expression de Gabriel, se « regarde chaque matin dans le miroir » sans complaisance aucune.
Où nous mènera ce choix craintif de se tenir dans les limites du « pragmatisme » dictées par les élites médiatiques et économiques ? Notre ambition est beaucoup plus grande que ça. Bien sûr que nous voulons prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas pour l'occuper tranquillement en y passant les quelques projets de loi que les élites dominantes voudront bien nous laisser passer.
C'est pour reprendre ce pouvoir à bras-le-corps et le faire redescendre vers le peuple ; c'est pour réinventer du tout au tout notre démocratie en faillite ; c'est pour réécrire à partir de zéro une Constitution nouvelle, celle d'un Québec indépendant qui soit en phase avec ce mouvement social chauffé à bloc auquel nous aurions œuvré au meilleur de nos capacités. En phase avec le peuple, pour une fois.
Et ça, ça ne se fera pas dans les limites de ce que les commentateurs média ou les évêques de la finance jugent « réaliste ». Ça ne se fera pas avec un seul discoureur habile ou avec une seule petite clique. Ça se fera avec beaucoup, beaucoup de monde. C'est au travail de rassembler cette immense gang-là pas seulement dans l'urne, mais aussi dans la vraie vie, qu'il faudrait que QS s'attèle.
Comme l'écrivait Émilise dans sa lettre de démission : il faut plonger les racines du parti dans toutes les régions du Québec, depuis là où le fleuve Saint-Laurent devient mer jusqu'au lac Abitibi, que partout on se reconnaisse en nous et pas juste là où on a des « chances de gagner ».
Autrement, si QS poursuit sa standardisation et continue à concentrer le pouvoir à sa tête, à l'image de ce système de domination qu'il avait été créé pour combattre, il faudra le considérer comme ce qu'il a manifestement été pour de trop nombreuses militantes et nombreux militants : un éteignoir plutôt qu'un catalyseur d'espoir.
* Signataires (en ordre alphabétique) : Jimena Aragon, candidate solidaire dans Chauveau en 2022 ; Gabrielle Arguin, attachée aux communications de l'aile parlementaire en 2022 ; Francis Baumans, membre du comité de coordination de Québec solidaire Mont-Royal–Outremont ; Vincent Boissonneault, membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage ; Sébastien Bouchard, candidat dans Jean-Lesage en 2012 et 2014, et ex-porte-parole régional de Québec solidaire dans la région de la Capitale-Nationale ; Joanne Boutet, membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage ; Alexandre Boutet-Dorval, membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage ; Pier-Luc Brault, militant de Québec solidaire dans Saint-François ; Rébecca Breton, militante et recherchiste à l'aile parlementaire en 2022 ; William Champigny-Fortier, militant de Québec solidaire dans Arthabaska ; Karine Cliche, candidate solidaire dans Sainte-Rose en 2022 ; Michelle Corcos, responsable de la Commission thématique Santé ; Antoine Côté, coordonnateur de l'association locale de Québec solidaire dans Mont-Royal–Outremont ; Catherine Cyr Wright, candidate dans Bonaventure en 2018 et 2022 ; Marie Dionne, membre du comité de coordination de Taschereau ; Catherine Dorion, députée de Québec solidaire de 2018 à 2022 et membre fondatrice d'Option nationale ; Amélie Drainville, militante solidaire et candidate dans Berthier en 2022 ; Jacynthe Drapeau, membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage ; Daniel Desputeau, attaché de circonscription dans Rosemont de 2018 à 2024 ; Charles-Émile Fecteau, militant de Québec solidaire dans Jean-Talon ; Jonathan Durand Folco, ancien responsable des orientations de Québec solidaire ; Pascale Fortin, candidate dans Arthabaska en 2022 et membre du comité de coordination de Québec solidaire Arthabaska ; André Frappier, ancien président et co-porte-parole de Québec solidaire ; Jonathan Gagnon, ancien employé de l'aile parlementaire et membre dans Roberval ; Christine Gilbert, membre du comité de coordination national et du comité exécutif de Québec solidaire en 2023, candidate solidaire dans Lotbinière-Frontenac en 2022 et candidate à l'investiture dans Jean-Talon en 2023 ; Carol-Ann Kack, candidate solidaire dans Rimouski en 2018 et 2022 ; Élisabeth Labelle, candidate solidaire dans Notre-Dame-de-Grâce en 2022 ; Raphaël Langevin, militant de Québec solidaire dans Verdun et économiste ; Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma place au travail et candidate solidaire dans Rivière-du-Loup–Témiscouata en 2022 ; Nicolas Lévesque, ex-directeur des communications de l'aile parlementaire de Québec solidaire ; Etienne Marcoux, militant solidaire dans Saint-François ; Eric Martin, responsable des communications de l'Union des forces progressistes (2004-2006) et au CCN de Québec solidaire (2006-2007), auteur, Un pays en commun, Écosociété ; Rabah Moulla, candidat solidaire dans Chomedey en 2018 et membre du comité de coordination national de Québec solidaire de 2020 à 2022 ; Philippe Pagé, candidat solidaire dans Richmond en 2022 ; Jean Pierre Roy Valdebenito, membre du comité de coordination de Québec solidaire Jean-Lesage ; Audrey Plamondon, membre du comité de coordination de Québec solidaire UdeM ; Terminal Smirnova, responsable de la mobilisation de l'association locale de Québec solidaire Mont-Royal–Outremont ; Victor Tardif, militant de Québec solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques ; Andrée-Anne Tremblay, membre du comité des femmes de la Capitale-Nationale et militante dans Taschereau ; Marie-Ève Turgeon, militante dans Prévost et illustratrice
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique du Sud : la xénophobie et le sexisme, un héritage de la colonisation et de l’apartheid

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/09/afrique-du-sud-la-xenophobie-et-le-sexisme-un-heritage-de-la-colonisation-et-de-lapartheid/
in Salim Chena & Aïssa Kadri, Routes africaines de la migration. Dynamiques sociales et politiques de la construction de l'espace africain, Paris : Éditions du Croquant, collection Sociétés et politique en Méditerranée, 7 mai 2024.
https://editions-croquant.org/societes-et-politique-en-mediterranee/990-routes-africaines-de-la-migration-dynamiques-sociales-et-politiques-de-la-construction-de-lespace-africain.html
En Afrique du Sud, les manifestations xénophobes sont récurrentes. En mai 2008, des émeutes racistes font soixante-deux morts. En 2015, des pillages à Johannesburg et à Durban visent des commerces tenus par des « étrangers » et font sept morts. En septembre 2019, le pays connaît une nouvelle flambée d'émeutes xénophobes. Les commentaires s'orientent vers les forts taux de chômage ou les niveaux élevés de pauvreté pour en expliquer la cause. Les images que renvoient ces mouvements – foule d'hommes armés de gourdins, de pierres, de machettes ou de haches, passant à tabac ou massacrant sur leur passage des « étrangers » (le plus souvent venus d'autres pays d'Afrique), détruisant leurs commerces ou brûlant des bâtiments – réfléchissent davantage les fortes violences de genre qui caractérisent le pays et qui se sont depuis accrues avec l'épidémie de Covid-19.
Extrait de l'introduction de l'ouvrage
par Salim Chena et Aïssa Kadri
Tandis que d'innombrables travaux traitent des migrations des Africains depuis l'Afrique vers l'Europe, peu évoquent les migrations intérieures au continent. Lorsque les migrations transsahariennes sont objets de recherches ou d'enquêtes, l'hypothétique destination européenne est habituellement au centre de la problématique. L'étude des migrations internationales, plus généralement, reste encore dominée par le paradigme des migrations Sud-Nord. Dans l'édition 2020 du rapport sur L'économie africaine, par exemple, le chapitre traitant de « la migration africaine », en dépit d'une volonté affichée de discuter les discours dominants, est consacré quasi-exclusivement aux pays de l'OCDE. Y compris lorsque l'impact sur les sociétés, économies et espaces d'émigration constitue un enjeu central de la recherche, le prisme des migrations en direction de l'Europe reste prégnant. Les récits qui traversent les constructions médiatiques et politiciennes des migrations des Africains sont, depuis longtemps, concentrés sur le présupposé d'une Europe menacée d'« invasion » par les traversées de la Méditerranée. Ce mot, « invasion », prononcé par Valery Giscard d'Estaing en 1991 s'est rapidement banalisé, et a été légitimé par sa reprise et sa diffusion. Il paraît bien faible à l'heure actuelle en comparaison du vocabulaire utilisé, de l'état du débat public, de l'orientation des politiques publiques et des résultats électoraux lorsqu'il est question des « immigrés » en Europe. La construction performative de l'invasion, de la menace migratoire, s'inscrit ainsi, à travers les caractéristiques des enjeux des mobilités interétatiques actuelles qu'elle révèle, dans un processus qui ressemble à une forme de « guerre ». Elle tend en tous les cas à travers des appropriations de la question migratoire, comme arme politique et symbolique, à l'établissement de nouveaux rapports de domination à l'échelle du monde. Il est nécessaire de mettre au jour comment se fabriquent, dans leurs interrelations et affichages publics, les assignations, dans un monde où l'exclusion vise de larges pans des sociétés. Il y a sans doute à revenir sur le prisme colonial et ses catégories, sur un certain ethnocentrisme « occidental » des sciences sociales dans la prise en compte et l'analyse des nouvelles migrations. Les thèmes et problèmes qui affichent de manière désinhibée le stigmate, deviennent récurrents, reproduits à l'envi, selon des schèmes et des stéréotypes qui font fi autant de l'histoire profonde, que des contextes actuels des circulations intra-régionales africaines, méditerranéennes et internationales.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
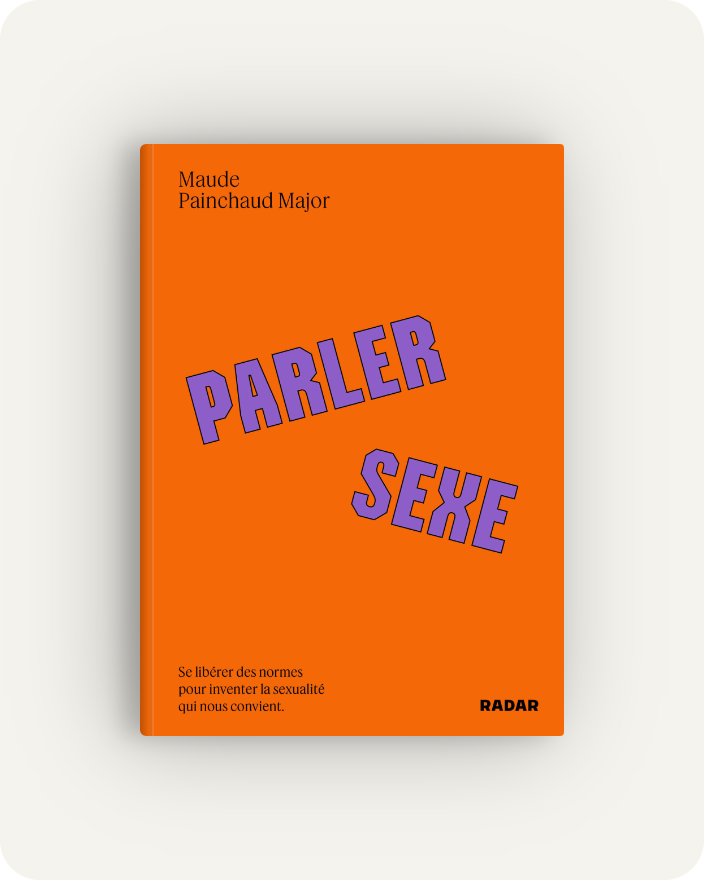
Parler sexe - Se libérer des normes pour inventer la sexualité qui nous convient
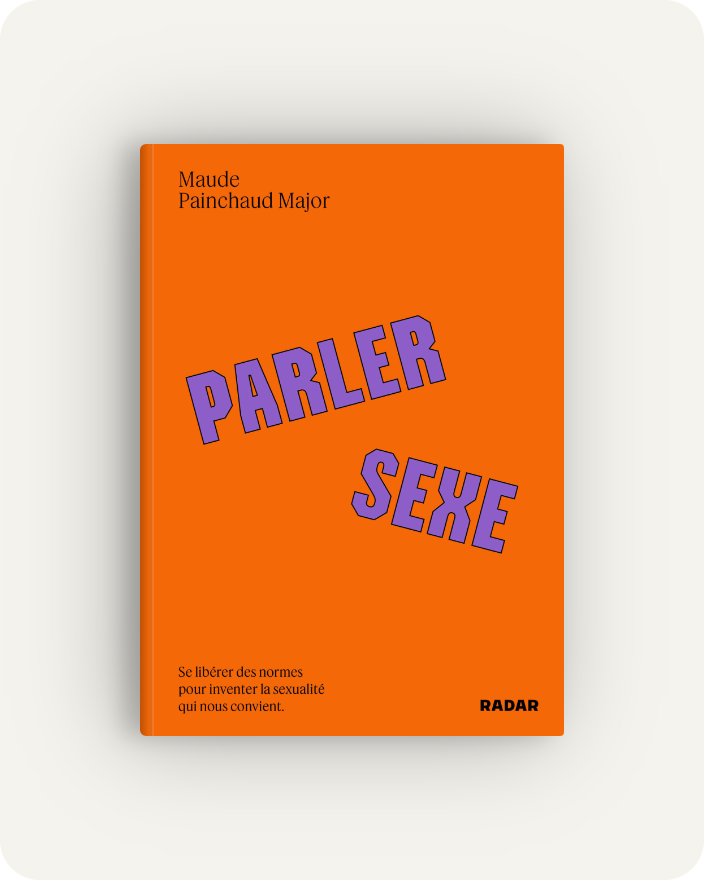
Construire sa sexualité sans se soucier des normes, avoir et donner du plaisir sans tabous, développer une intimité sexuelle loin des obligations de performance... Il est temps ! Par chance, la sexologue et tiktokeuse Maude Painchaud Major publie cette semaine un essai rafraîchissant, Parler sexe - Se libérer des normes pour inventer la sexualité qui nous convient, dans la collection Radar. Tous les détails se trouvent ci-bas dans l'infolettre.
Comment parler sexe aux jeunes en 2024 ? Forte de son expérience comme conférencière et animatrice d'ateliers en milieu scolaire, Maude Painchaud Major le fait avec le plus grand des tacts. Bien que le livre ne prétende pas remplacer un précieux cours d'éducation à la sexualité, il en incarne un complément particulièrement efficace, un rempart rassurant en ces temps où les sources d'informations ne sont pas toutes des mines d'or.
L'autrice offre une visite guidée généreuse et bienveillante des différents aspects de la sexualité auxquels est confronté·e un·e ado : pression de performance, désir, plaisir, consentement, stéréotypes de genre, orientation sexuelle, pornographie, contraception, masturbation, etc. Aux questions sans réponse, aux inquiétudes d'avant l'expérience, elle suggère la communication : parler entre partenaires, parler entre ami·es.
Ouvrage de référence à la fois concis et pratique, ce n'est toutefois pas le lieu d'une accumulation de statistiques. En effet, l'autrice prend davantage le parti de s'intéresser aux préoccupations d'ordre qualitatif que ressentent les élèves du secondaire. « La taille du pénis, est-ce que c'est important ? », « Peut-on avoir des relations sexuelles en étant menstruée ? », « Être beau, ou belle, qu'est-ce que ça veut dire ? », mais surtout : « Suis-je normal·e ? ».
« Le plaisir devrait être le pilier de la sexualité, la fondation sur laquelle tout le reste se bâtit. Le plaisir de se donner du plaisir à soi-même, de connecter intellectuellement, émotionnellement et physiquement avec d'autres êtres humains, de découvrir d'autres corps, d'avoir du plaisir à donner du plaisir, de partager son intimité, d'explorer toutes sortes de pratiques sexuelles, etc. »
– Maude Painchaud Major
Diplômée en sexologie, Maude Painchaud Major propose des ateliers et des conférences dans les écoles, centrés sur une éducation à la sexualité saine, positive et inclusive. Elle anime aussi une chaine Tiktok, pour répondre aux questions des ados sur la sexualité.
En librairie le 8 mai au Canada / 17 mai en Europe
Collection Radar (15 ans et +)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Israël interdit Al Jazeera afin de cacher la réalité de plus en plus embarrassante que cette chaîne dévoile
Ovide Bastien, professeur à la retraite, Collège Dawson
Le 5 mai, le gouvernement israélien ferme les bureaux d'Al Jazeera en Israël, confisque son matériel de diffusion, coupe cette chaîne de télévision des compagnies de câble et de satellite et bloque ses sites web.
Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou justifie ce geste en déclarant qu'Al Jazeera agit comme « porte-parole du Hamas, incite à la violence contre ses soldats, et porte atteinte à la sécurité d'Israël ».
Le 6 mai, le Hamas étonne le monde en annonçant qu'après de nombreuses semaines de négociations ardues, il accepte finalement une proposition de cessez-le-feu égypto-qatarie pour Gaza. Le lendemain, Nétanyahou annonce que la proposition ne rencontre pas ses exigences et que l'armée israélienne va envahir Rafah « afin d'éliminer complètement le Hamas ».
Le 8 mai, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin annonce que les Etats-Unis, en désaccord avec la décision d'Israël d'envahir Rafah, suspendent la livraison de milliers de grosses bombes à Israël.
Se pourrait-il que la pression énorme provenant des milliers d'étudiants qui manifestent dans de nombreuses universités aux Etats-Unis, appelant à un cessez-le-feu et au désinvestissement de leurs institutions de toute entreprise livrant des armes à Israël, commence à porter fruit ? Même si ces manifestants sont qualifiés par Nétanyahou « d'antisémites et ennemis d'Israël » et même « de nazis » ?
*************
Avant le début novembre dernier, j'obtenais mon information au sujet de l'invasion de Gaza par Israël, déclenchée à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, uniquement de médias comme le Devoir, Radio-Canada, CBC, le Guardian, El País, et BBC.
C'est grâce à Nadia Kanji, une étudiante du profil Les Études Nord-Sud du Collège Dawson que j'accompagnais lors du stage étudiant au Nicaragua en décembre 2010, que j'ai commencé à suivre aussi la chaîne de télévision Al Jazeera.
J'y suis devenu rapidement accro.
« Ovide, je réside présentement aux États-Unis et travaille pour l'émission Upfront d'Al Jazeera, » m'écrit-elle octobre dernier. « Voici le lien où tu pourras visionner notre dernier épisode. »
J'ouvre le lien. La qualité de cet épisode m'impressionne. Le reporter Marc Lamont interroge, pendant une demi-heure et sans annonce aucune, l'auteur d'un livre sur la question palestinienne.
Je décide de consulter le programme régulier d'Al Jazeera.
Je suis étonné de voir la qualité de sa couverture de la guerre à Gaza. Celle-ci dépasse, et de beaucoup, à la fois en profondeur et étendue, celle de toutes les autres sources que je consultais auparavant. En plus, je suis agréablement surpris de voir qu'il est possible de visionner toute la programmation en direct sur Internet, et ce gratuitement et avec fort peu d'annonces.
Je découvre éventuellement qu'Al Jazeera a plusieurs émissions-débats, de qualité similaire à Upfront – The Bottom Line, Inside Story, Listening Post, Witness, etc. – ainsi que plusieurs excellents documentaires. Ces émissions et documentaires portent sur les principaux sujets de l'actualité internationale, mais la question palestinienne, sans doute à cause de la guerre en cours, occupe la place d'honneur.
L'expertise des reporters qui animent ces émissions ainsi que leur maitrise de l'anglais m'étonnent. M'impressionnent aussi la diversité et grande compétence des personnes invitées à participer aux débats. Il n'est pas rare de voir parmi celles-ci des Juifs critiques du sionisme comme les historiens Norman Finkelstein et Ilan Pappé, l'autrice et activiste canadienne Naomi Klein, l'ex-négociateur israélien dans le cadre du processus de paix d'Oslo Daniel Levy, et l'écrivain israélien et membre de la direction du quotidien Haaretz Gideon Levy. Apparaissent aussi régulièrement de hauts placés, actuels ou passés, de divers gouvernements. Des États-Unis, du Royaume-Uni, et de divers pays arabes, mais aussi, assez étonnamment, du gouvernement israélien lui-même et de militaires des forces armées israéliennes.
Bien qu'Israël n'autorise aucun journaliste étranger à entrer dans la bande de Gaza à moins qu'il ne soit intégré à son armée, Al Jazeera a de nombreux reporters palestiniens là. Ces derniers, peu étonnamment, soulignent que leurs reportages proviennent d'un territoire occupé et s'acharnent à documenter méticuleusement la guerre, présentant au monde entier des images de chaque bombardement occasionnant la destruction massive de résidences, d'hôpitaux, d'universités, de mosquées, etc., de chaque carnage (présentement il y a 34 900 morts, 70% femmes et enfants, et 78 200 blessés), d'enfants affamés (31 en sont morts jusqu'à maintenant) par le blocage systématique d'aide humanitaire à Gaza, de fosses communes (celle découverte à l'hôpital Nasser, le principal établissement médical du centre de Gaza, contenait près de 400 cadavres)...
Ces images difficiles à regarder incommodent énormément le gouvernement Nétanyahou. Non seulement sapent-elles sa crédibilité lorsqu'il affirme faire tout ce qui est humainement possible afin de limiter le nombre de victimes civiles, mais elles noircissent aussi substantiellement son image dans l'opinion publique internationale.
Le simple fait que plus de 140 journalistes et employés des médias aient été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023 démontre le courage impressionnant dont ils font preuve. Mais aussi, malheureusement, la grande détermination du gouvernement israélien à faire taire leurs voix.
Doit-on vraiment s'étonner de voir le gouvernement Nétanyahou procéder à l'interdiction d'Al Jazeera en Israël ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Réaction à l’Infolettre de QS intitulée « La suite des choses pour notre parti » ─ 6 mai 2024.
Ce qui ressort le plus, à mon sens, dans les dernières déclarations de GND ainsi que dans les prises de position de la direction de QS, et qui est aussi le plus problématique, c'est le sentiment d'« urgence », voire de « panique » qui habite tout ce beau monde. Comme si les membres les plus influents du parti venaient de prendre conscience de l'ampleur de tous les problèmes soulevés (environnement, logement, services publics) et qu'il fallait, de ce fait, prendre le pouvoir à Québec « de toute urgence » pour remédier le plus tôt possible à la situation devenue alarmante. Comme si la volonté affirmée de résoudre au plus vite ces crises devenues « chroniques » allait pouvoir précipiter les événements en faveur d'un parti qui serait le seul à avoir les moyens d'en venir à bout. Comme si le fait, pour QS, de décréter l'« urgence » d'accéder au pouvoir parlementaire allait coïncider, comme par magie, avec ces autres « urgences » (climat, habitation, éducation, santé, etc.) Tout comme cette « foi » dans l'alignement favorable des planètes pour poser une action, prendre une décision, lancer un projet qu'on retrouve principalement dans l'ésotérisme ou l'astrologie, qui ne se sont pas des disciplines qui se démarquent particulièrement par leur caractère rigoureux, scientifique ou prédictif, on prend ses désirs pour la réalité et on veut une victoire électorale dans l'« immédiat ».
Pour quelqu'un qui veut faire prendre à QS un tournant « pragmatique », donc « réaliste », GND (appuyé semble-t-il par la nomenklatura du parti) fait preuve au contraire d'un très grand « idéalisme », pour ne pas dire d'un illusionnisme qui se détourne des fondements « idéologiques », « politiques » et « éthiques » de Québec Solidaire. Cet empressement subi à gravir les marches institutionnelles vers la gouvernance de la Belle Province est le symptôme, soit d'une perte de confiance dans le programme « progressiste » de QS, soit d'une montée de fièvre « politicienne », « partisane », « opportuniste » qui relègue au second rang les principes les plus élémentaires d'un mouvement social et populaire de « gauche ». Dans les deux cas, la seule réponse possible est la précipitation qui va toujours de pair avec l'improvisation. On s'interdit ainsi de mettre à profit le caractère potentiellement « rationnel » du libéralisme démocratique qui pourrait nous être favorable si on y adhère avec discernement.
Dans le contexte de cette démocratie libérale qui perd de plus en plus ses ancrages et d'un système parlementaire qui se fossilise en réaction au déclin du modèle (et du monde) occidental, ces tentatives de « recentrage », ce vocabulaire (« pragmatisme ») et cette méthode (« électoralisme »), directement inspirés du modèle stratégique « caquiste » (qui, comme on le sait, se démarque par ses « hauteurs de vue »), donnent l'impression d'une démission devant la lenteur du processus électoral qui n'est, somme toute, qu'un moyen parmi d'autres pour faire advenir la société à laquelle aspire la gauche québécoise. Avec la perspective pessimiste qui se fait jour depuis les dernières élections, le parti est confronté à faire des choix « difficiles », comme le disent notre chef, notre directrice et notre présidente, quoiqu'il faille interpréter ce constat en un sens fort différent de celui qu'ils veulent lui donner. Allons-nous nous enfoncer encore plus loin dans une optique « opportuniste » à partir de laquelle il faudra éternellement se questionner sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment le dire ou comment ne pas le dire, dans quelles circonstances il est bon d'affirmer ceci ou cela ou de ne pas l'affirmer (ou encore de l'affirmer sans vraiment l'affirmer), que maintient-t-on dans notre plate-forme électorale et que repousse-t-on aux calendes grecques ? Là est la question : comment se situer face au parlementarisme qui n'a pas que des qualités mais dont les militants progressistes ont accepté les règles en formant un parti en bonne et due forme (QS), quitte à redéfinir, en temps et lieu, au moment d'avoir en mains les rênes du pouvoir parlementaire, certains protocoles qui se sont empoussiérés depuis que l'Empire britannique nous a fait « cadeau » de son système électoral.
Étant donné la récente remontée du PQ dans les sondages qui pourrait se traduire par un retour au pouvoir du parti souverainiste et un déclassement de QS, avec comme conséquence une régression vers le troisième groupe d'opposition (ou peut-être même le quatrième), ce qui constituerait un recul encore pire qu'en 2022 où le pourcentage de votes en faveur du parti a diminué, il est compréhensible et même nécessaire de vouloir opérer un processus d'introspection (une sorte de « thérapie de groupe », si l'on veut), d'autant plus que les deux formations sollicitent à peu près le même électorat (une gauche plus ou moins modérée, souverainiste ou indépendantiste selon le cas, « progressiste » avec toutes les variantes sémantiques existantes qui peuvent qualifier cette expression).
Ceci dit, évitons de tomber dans l'auto-flagellation, la culpabilisation à outrance (mea culpa, mea maxima culpa), le remords de conscience, procédés que nous avons hérité de notre culture judéo-chrétienne (du moins, pour les plus vieux d'entre nous), car il semble bien que, déjà, nous ayons beaucoup d'éléments à portée de la main pour effectuer un questionnement « en-retour » sur les décisions (plus ou moins heureuses, plus ou moins pertinentes et avisées) prises depuis 2018 : a) Le résultat tangible de la stratégie de « recentrage » de la dernière campagne électorale, b) L'abandon du travail parlementaire par des éléments cruciaux du parti (Dorion, Lessard-Thérien), c) Les effets négatifs, perturbateurs, aliénants (et même « traumatisants ») de l'adoption, sans distance « critique », du rythme effréné imposé par l'appareil politico-médiatique qui dicte quasiment l'agenda du Parlement (ce qui constitue une entrave sérieuse à une démocratie parlementaire « libérée » des pressions extérieures indues exercées par des intérêts particuliers qui viennent en contradiction avec les intérêts de la Majorité, donc avec le Bien Commun) et, finalement, d) L'expérience, très parlante, de la surmédiatisation grandissante de GND qui a pour effet de concentrer l'attention sur le porte-parole masculin, au détriment, peut-être, des fondamentaux du programme, ce qui, de plus, nourrit faussement l'image d'un parti dirigé par un seul homme.
En résumé, même si la ferveur « citoyenne » (devrait-on dire « révolutionnaire » ?) est importante dans la militance, elle constitue une sorte de « carburant » pour se mobiliser, mener des actions, poser des gestes « concrets » et « significatifs », il faut garder la tête froide et prendre des décisions réfléchies à l'aune de nos valeurs, nos principes, notre sens de l'intégrité morale, éthique, politique. Dans ce qu'on peut lire, entendre, voir de la part des représentants « officiels » de QS (Internet, médias, réseaux sociaux), on perçoit assez bien une sorte d'irritation, de décontenance, d'impatience devant le piétinement que vit QS eu égard à la volonté populaire (toujours instable, il faut le dire) ; à l'inverse (comme on peut s'en rendre compte en consultant le site Presse-toi à gauche !), il ressort une vraie et grande sagesse venant de la base militante qui a à cœur de mener une réflexion rigoureuse en faisant la part des choses entre le réel « électoraliste » (dont il faut tenir compte) et la pureté « idéologique » (qu'on doit toujours garder à l'esprit). L'impasse dans laquelle semble se débattre actuellement le parti, autant au niveau des instances décisionnelles qu'au niveau du membership militant, va trouver sa résolution entre ces deux extrêmes…
Mario Charland
Shawinigan
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : Un salaire minimum de 250 euros en 2024, c’est toujours plus de pauvreté et de misère

D'après la résolution du Conseil suprême du travail, le salaire minimum augmenterait de 35,3% entre 2023 et 2024. Selon Sulat Mortazavi, le ministre des Coopératives, du Travail et de l'Etat social [depuis le 19 octobre 2022 – dans le gouvernement Ebrahim Raïssi], la rémunération minimum d'ensemble sera de 250 euros par mois en 2024.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les soi-disant représentants des salarié·e·s au Conseil suprême du travail affirment que cette augmentation du salaire minimum a été validée sans leur signature. Alors que ces « représentants syndicaux » avaient admis que pour faire face au « coût de la vie » 514 euros par mois étaient nécessaires, ils avaient néanmoins proposé pour 2024 un salaire minimum mensuel de 382 euros, soit 25% inférieur.
Le résultat est que, malgré l'inflation galopante et l'augmentation astronomique du coût de la vie, même 670 à 900 euros ne suffisent plus pour une famille de quatre personnes. Des millions de travailleurs doivent vivre avec des salaires trois fois inférieurs au seuil de pauvreté, ce qui n'est en aucun cas soutenable.
Le salaire minimum est déterminé chaque année par le Conseil suprême du travail, qui se compose de 9 à 10 représentants du gouvernement, des employeurs et de soi-disant représentants des travailleurs.
Au nom de ce tripartisme et sous prétexte que les travailleurs participent à la détermination du coût de leurs moyens de subsistance, les décisions anti-ouvrières du gouvernement et des employeurs sont imposées aux salarié·e·s dans le cadre de ce dispositif. Celui-ci et ces délégués fantoches, privent les travailleurs/euses de toute possibilité de s'opposer à la décision du Conseil suprême du travail. Résultat, le système capitaliste est plus fort d'année en année, et les salarié·e·s plus pauvres. En fait, ce Conseil suprême du travail tire vers la ruine des millions de travailleurs et travailleuses au début de chaque année.
Pour nous, le Conseil suprême n'est rien d'autre qu'une institution mensongère. Dans ce Conseil, les personnes représentant les travailleurs/euses n'ont aucun pouvoir de négociation, ils n'y sont présents que pour cautionner des décisions imposées.
Même s'ils avaient un pouvoir de négociation, le vote final appartiendrait de toute façon à la majorité des membres : si les représentants du gouvernement (le plus grand employeur du pays) et les représentants des organisations patronales privées ainsi que la chambre de commerce s'entendent sur un faible pourcentage d'augmentation des salaires, l'avis des faux représentants du travail n'a aucune valeur. Néanmoins ce Conseil fixe à sa convenance le montant du salaire minimum et l'impose aux salarié·e·s au nom du principe du tripartisme.
Les « représentants du travail » n'ont aucun pouvoir indépendant. Le gouvernement et les autres employeurs savent très bien qu'ils n'ont pas le soutien du peuple et des travailleurs qu'ils sont censés représenter. Ces représentants sont entrés dans ce Conseil grâce à des pots-de-vin et avec le soutien total du système. Ils ne disposent en conséquence d'aucune indépendance envers celui-ci.
Ils ne veulent pas recourir au pouvoir des travailleurs/euses, qui est celui de la rue, des manifestations et des grèves, contre les décisions anti-ouvrières du Conseil suprême des travailleurs.
Par conséquent, le Conseil suprême fait traîner en longueur ses travaux principalement pour maintenir l'apparence de ces réunions, et finalement, dans les derniers moments de l'année, il annonce sa décision anti-ouvrière à la population.
Le Conseil agit ainsi dans le but de montrer à la population que les « représentants du travail » étaient tous présents lors de ces réunions pour défendre les droits des travailleurs, et que ceux-ci ont participé à la décision du pourcentage d'augmentation du salaire minimum. Le but de cette manœuvre est de mieux pouvoir réduire au silence les travailleurs/euses en cas de mobilisations dans la rue.
Reste à comprendre pourquoi des travailleurs et des dizaines de millions de familles de travailleurs laissent leur sort entre les mains de ces représentants.
Le syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue (Vahed) condamne la fixation du salaire minimum à 247 euros par mois.
Il la considère comme inacceptable, et comme une attaque éhontée contre la vie, le corps et l'âme des travailleurs/euses et de leurs familles.
La seule façon de faire face à cette attaque contre les moyens de subsistance et la vie des travailleurs/euses de notre pays est l'unité, la mobilisation et la constitution d'organisations indépendantes.
La solution, c'est l'unité et l'organisation des travailleurs/euses ! (19 mars 2024)
Déclaration publiée en français par Echo d'Iran, Bulletin d'information sur le mouvement ouvrier en Iran, avril 2024)
http://alencontre.org/moyenorient/iran/iran-un-salaire-minimum-de-250-euros-en-2024-cest-toujours-plus-de-pauvrete-et-de-misere.html
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soldat ou soldate ?

Commençons dans l'ordre. Notre équipe défend les droits des femmes dans l'armée et après le service, et nous sommes tout à fait favorables à l'utilisation de titres féminins. Cela renvoie à la question de la visibilité des femmes et est plus profond qu'il n'y paraît à première vue.
Dans notre domaine professionnel, il est important d'utiliser des titres féminins, par exemple : vétéran et vétérane, défenseur et défenseuse. Il ne s'agit pas d'un usage artistique, mais si le cadre normatif ne précise pas la différence entre les sexes dans un groupe, il y a des risques de restriction des droits et de négligence dans les politiques destinées à ces groupes. Le langage façonne la conscience, la législation et les règlements sont tout ce qui guide une institution. Si vous n'avez pas mis le pain sur votre liste de courses, vous pouvez ou non vous en souvenir. C'est ainsi que cela fonctionne partout. Une fois que vous l'avez écrit, vous vous en souvenez.
Dans les professions militaires, il est également important d'utiliser des titres féminins. Il arrive que des enfants soient surpris de voir des femmes dans l'aviation, par exemple, parce qu'ils n'ont jamais entendu le féminin dans la bouche d'un pilote (messieurs les sexistes, nous vous avons laissé de la place pour des blagues dans les commentaires). Les mots façonnent notre vision du monde dès l'enfance, et c'est pourquoi les inégalités sont plus difficiles à éradiquer dans la société, car simplement au niveau du langage, les femmes n'existent pas dans certains domaines.
La présence de noms féminins normalise à long terme la présence des femmes dans diverses activités. Une femme de ménage, une princesse, une enseignante n'ennuient personne. Le mot directrice se banalise de plus en plus au fil des années. Pour une raison ou une autre, ce sont les professions militaires avec des titres féminins qui irritent le plus la communauté. Et est-ce une coïncidence si c'est dans l'armée qu'il existe encore des obstacles à l'évolution de la carrière des femmes ?
Les féministes ne résoudront pas les problèmes liés aux mécanismes de développement de carrière et ne créeront pas non plus un système de formation et de coordination de haute qualité. Cependant, les féminismes ont une approche différente : une approche qui prête attention aux besoins et à la diversité des personnes, et qui développe le potentiel et les capacités humaines pour renforcer le bien commun. C'est cette approche qui permet de construire des systèmes efficaces.
Dans une communication privée, il est normal que vous demandiez à être appelé d'une certaine manière et que votre interlocuteur se plie à votre demande au lieu d'argumenter. (...)
Féminiser n'est pas une raison de haïr. Gardez votre calme et respectez-vous les un.es les autres, car nous devons tous.tes gagner.
30 avril 2024
Veteranka - Жіночий Ветеранський Рух
Traduction : Patrick Le Tréhondat (9 mai 2024)
Image : Veteranka ("Vétéran(ne ?) du travail")

La privation de monde face à l’accélération technocapitaliste

La pandémie de COVID-19 a conduit à un déploiement sans précédent de l'enseignement à distance (EAD), une tendance qui s'est maintenue par la suite, et cela malgré les nombreux impacts négatifs observés. De plus, le développement rapide des intelligences artificielles (IA) dites « conversationnelles » de type ChatGPT a provoqué une onde de choc dans le monde de l'éducation. La réaction des professeur·e·s à cette technologie de « disruption[1] » a été, en général, de chercher à contrer et à limiter l'usage de ces machines. Le discours idéologique dominant fait valoir, à l'inverse, qu'elles doivent être intégrées partout en enseignement, aussi bien dans l'élaboration d'une littératie de l'IA chez l'étudiant et l'étudiante que dans la pratique des professeur·e·s, par exemple pour élaborer les plans de cours. Nous allons ici chercher à montrer qu'au contraire aller dans une telle direction signifie accentuer des pathologies sociales, des formes d'aliénation et de déshumanisation et une privation de monde[2] qui va à l'opposé du projet d'autonomie individuelle et collective porté historiquement par le socialisme.
7 mai 2024 | publié sur le site des Nouveaux Cahiers du socialisme
https://www.cahiersdusocialisme.org/la-privation-de-monde-face-a-lacceleration-technocapitaliste/
L'expérience à grande échelle de la pandémie
Les étudiantes, les étudiants et les professeur·e·s ont été les rats de laboratoire d'une expérimentation sans précédent du recours à l'EAD durant la pandémie de COVID-19. Par la suite, nombre de professeur·e·s ont exprimé des critiques traduisant un sentiment d'avoir perdu une relation fondamentale à leur métier et à leurs étudiants, lorsqu'ils étaient, par exemple, forcés de s'adresser à des écrans noirs à cause des caméras fermées lors des séances de visioconférence. Quant aux étudiantes et étudiants, 94 % d'entre eux ont rapporté ne pas vouloir retourner à l'enseignement en ligne[3]. Des études ont relevé de nombreuses répercussions négatives de l'exposition excessive aux écrans durant la pandémie sur la santé mentale[4] : problèmes d'anxiété, de dépression, d'isolement social, idées suicidaires.
Le retour en classe a permis de constater des problèmes de maitrise des contenus enseignés (sur le plan des compétences en lecture, en écriture, etc.) ainsi que des problèmes dans le développement de l'autonomie et de la capacité de s'organiser par rapport à des objets élémentaires comme ne pas arriver à l'école en pyjama, la ponctualité, l'organisation d'un calendrier, la capacité à se situer dans l'espace ou à faire la différence entre l'espace privé-domestique et l'espace public, etc.
D'autres études ont relevé, au-delà de la seule pandémie, des problèmes de développement psychologique, émotionnel et socioaffectif aussi bien que des problèmes neurologiques chez les jeunes trop exposés aux écrans. Une autrice comme Sherry Turkle par exemple note une perte de la capacité à soutenir le regard d'autrui, une réduction de l'empathie, de la socialité et de la capacité à entrer en relation ou à socialiser avec les autres.
Tout cela peut être résumé en disant qu'il y a de nombreux risques ou effets négatifs de l'extension des écrans dans l'enseignement sur le plan psychologique, pédagogique, développemental, social, relationnel. Le tout est assorti d'une perte ou d'une déshumanisation qui affecte la relation pédagogique de transmission en chair et en os et en face à face au sein d'une communauté d'apprentissage qui est aussi et d'abord un milieu de vie concret. Cette relation est au fondement de l'enseignement depuis des siècles ; voici maintenant qu'elle est remplacée par le fantasme capitaliste et patronal d'une extension généralisée de l'EAD. Or, il est fascinant de constater qu'aucun des risques ou dangers documentés et évoqués plus haut n'a ralenti le projet des dominants, puisqu'à la suite de la pandémie, les pressions en faveur de l'EAD ont continué à augmenter. À L'UQAM, par exemple, les cours en ligne étaient une affaire « nichée » autrefois ; après la pandémie, on en trouve plus de 800. L'extension de l'EAD était aussi une importante demande patronale au cœur des négociations de la convention collective dans les cégeps en 2023, par exemple. Il sera maintenant possible pour les collèges de procéder à l'expérimentation de projets d'EAD même à l'enseignement régulier !
Une société du « tele-everything »
Toute la question est de savoir pourquoi la fuite en avant vers l'EAD continue malgré les nombreux signaux d'alarme qui s'allument quant à ses répercussions négatives. Une partie de la réponse se trouve dans le fait que l'EAD s'inscrit dans un projet politique ou dans une transformation sociale plus large. Comme l'a bien montré Naomi Klein[5], la pandémie de COVID-19 a été l'occasion pour les entreprises du capitalisme de plateforme ou les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) de déployer le projet d'une société du « tele-everything » où tout se ferait désormais à distance grâce à une infrastructure numérique d'une ampleur sans précédent. Cela signifie non seulement un monde avec beaucoup moins d'enseignantes et d'enseignants, puisque les cours seront donnés en ligne ou éventuellement par des tuteurs-robots, mais cela concerne aussi un ensemble d'autres métiers dont les tâches sont d'ordre cognitif, puisqu'il s'agit précisément d'automatiser des tâches cognitives autrefois accomplies par l'humain. De nombreux métiers sont donc menacés : journaliste, avocat, médecin, etc. Désormais chacun pourra accéder, par exemple, au téléenseignement, à la télémédecine, au divertissement par la médiation d'un écran et depuis son foyer. Nous pouvons donc parler d'un projet politique visant à transformer profondément les rapports sociaux au moyen de l'extension d'un modèle de société technocapitaliste ou capitaliste cybernétique intercalant la médiation des écrans et de la technologie entre les sujets.
Vers une société cybernétique
Nous pouvons, en nous appuyant sur des philosophes comme le Québécois Michel Freitag ou le Français Bernard Stiegler, relever que la société moderne était caractérisée par la mise en place de médiations politico-institutionnelles devant, en principe, permettre une prise en charge réfléchie des sociétés par elles-mêmes. Plutôt que de subir des formes d'hétéronomie culturelles, religieuses ou politiques, les sociétés modernes, à travers leurs institutions que l'on pourrait appeler « républicaines », allaient faire un usage public de la raison et pratiquer une forme d'autonomie collective : littéralement auto-nomos, se donner à soi-même sa loi. La condition de cette autonomie collective est d'abord, bien entendu, que les citoyennes et citoyens soient capables d'exercer leur raison et leur autonomie individuelle, notamment grâce à une éducation qui les ferait passer du statut de mineur à majeur. Le processus du devenir-adulte implique aussi d'abandonner le seul principe de plaisir ou le jeu de l'enfance pour intégrer le principe de réalité qu'implique la participation à un monde commun dont la communauté politique a la charge, un monde qui est irréductible au désir de l'individu et qui le transcende ou lui résiste dans sa consistance ou son objectivité symbolique et politique.
D'après Freitag, la société moderne a, dans les faits, été remplacée par une société postmoderne ou décisionnelle-opérationnelle, laquelle peut aussi être qualifiée de société capitaliste cybernétique ou systémique. Dans ce type de société, l'autonomie et les institutions politiques sont déclassées au profit de systèmes autonomes et automatiques à qui se trouve de plus en plus confiée la marche des anciennes sociétés. De toute manière, ces dernières sont de plus en plus appelées à se dissoudre dans le capitalisme, et donc à perdre leur spécificité culturelle, symbolique, institutionnelle et politique. Ces transformations conduisent vers une société postpolitique. Elles signifient que l'orientation ou la régulation de la pratique sociale ne relève plus de décisions politiques réfléchies, mais se voit déposée entre les mains de systèmes – le capitalisme, l'informatique, l'intelligence artificielle – réputés décider de manière plus efficace que les individus ou les collectivités humaines. Bref, c'est aux machines et aux systèmes qu'on demande de penser à notre place.
Les anciennes institutions d'enseignement se transforment en organisations calquées sur le fonctionnement et les finalités de l'entreprise capitaliste et appelées à s'arrimer aux « besoins du marché ». Plus les machines apprennent ou deviennent « intelligentes » à notre place, et plus l'enseignement est appelé, suivant l'idéologie dominante, à se placer à la remorque de ces machines. Désormais, la machine serait appelée à rédiger le plan de cours des professeur·e·s, à effectuer la recherche ou à rédiger le travail de l'étudiante ou de l'étudiant ; elle pourra même, en bout de piste, corriger les copies, comme cela se pratique déjà en français au collège privé Sainte-Anne de Lachine. L'humain se trouve marginalisé ou évincé du processus, puisqu'il devient un auxiliaire de la machine, quand il n'est tout simplement pas remplacé par elle, comme dans le cas des tuteurs-robots ou des écoles sans professeurs, où l'ordinateur et le robot ont remplacé l'ancien maître. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évoque déjà dans ses rapports un monde où les classes et les écoles physiques auront tout bonnement disparu. Ce projet participe aussi d'un processus de délestage ou d'« extranéiation » cognitive qui est à rebours de la conception moderne de l'autonomie, et qu'il convient maintenant d'expliciter.
Délestage ou extranéiation cognitive
Le philosophe français Eric Sadin[6] estime qu'un seuil inquiétant est franchi à partir du moment où des facultés ou des tâches cognitives spécifiques à l'humain sont remises entre les mains de systèmes d'intelligence artificielle, par exemple l'exercice du jugement ou le fait de poser un diagnostic médical. Automatiser le chauffage d'une maison ou les lumières d'un immeuble de bureaux est beaucoup moins grave que de transférer le jugement humain dans un système extérieur. Certains intervenants et intervenantes du monde de l'éducation s'enthousiasment devant ce processus, estimant que le délestage cognitif en faveur des machines permettra de sauver du temps qui pourra être utilisé à de meilleures fins[7]. Il faut au contraire insister pour montrer que ce processus pousse la destruction de l'idéal du citoyen – ou de la citoyenne – moderne encore plus loin, puisque celui-ci est remplacé par un individu assisté ou dominé par la machine, réputée penser, juger ou décider à sa place. L'individu n'exerce plus alors la réflexivité, l'autonomie, la liberté : « il faut s'adapter », comme le dirait Barbara Stiegler.
Il est frappant de constater à quel point les technoenthousiastes prennent position sur les nouvelles technologies sans jamais se confronter à l'immense corpus de la philosophie de la technique ou la technocritique, ceci expliquant cela… La position technocritique est généralement ridiculisée en l'assimilant à quelque peur comique du changement semblable à la crainte des minijupes et du rock'n'roll dans les années 1950… Pourtant, les dangers relatifs à ce mouvement de délestage (Entlastung) ou d'extranéiation cognitive ont bien été relevés, et depuis longtemps, par les Arnold Gehlen, Günther Anders ou Michel Freitag, pour ne nommer que ceux-là.
Dès 1956, Anders développe dans L'Obsolescence de l'homme une critique du rapetissement de l'humain face à la puissance des machines. Le concept de « honte prométhéenne » désigne le sentiment d'infériorité de l'ouvrier intimidé par la puissance et la perfection de la machine qui l'a dépassé, lui, l'être organique imparfait et faillible. Le « décalage prométhéen » indique quant à lui l'écart qui existe entre la puissance et les dégâts causés par les machines d'un côté, et la capacité que nous avons de les comprendre, de nous les représenter et de les ressentir de l'autre. Les machines sont donc « en avance » sur l'humain, placé à la remorque de ses productions, diminué et du reste en retard, largué, dépassé par elles.
Anders rapporte un événement singulier qui s'est déroulé à la fin de la guerre de Corée. L'armée américaine a gavé un ordinateur de toutes les données, économiques, militaires, etc., relatives à la poursuite de la guerre avant de demander à la machine s'il valait la peine de poursuivre ou d'arrêter l'offensive. Heureusement, la machine, après quelques calculs, a tranché qu'il valait mieux cesser les hostilités. On a conséquemment mis un terme à la guerre. D'après Anders, c'est la première fois de l'histoire où l'humain s'est déchargé d'une décision aussi capitale pour s'en remettre plutôt à une machine. On peut dire qu'à partir de ce moment, l'humanité concède qu'elle est dépassée par la capacité de synthèse de la machine, avec ses supports mémoriels et sa vitesse de calcul supérieure – supraliminaire, dirait Anders, puisque débordant notre propre capacité de compréhension et nos propres sens. Selon la pensée cybernétique[8] qui se développera dans l'après-guerre, s'il s'avère que la machine exécute mieux certaines opérations, il vaut mieux se décharger, se délester, « extranéiser » ces opérations dans les systèmes. La machine est réputée plus fiable que l'humain.
Évidemment, à l'époque, nous avions affaire aux balbutiements de l'informatique et de la cybernétique. Aujourd'hui, à l'ère du développement effréné de l'intelligence artificielle et de la « quatrième révolution industrielle », nous sommes encore plus en danger de voir une part croissante des activités, orientations ou décisions être « déchargées » de l'esprit humain en direction des systèmes cybernétiques devenus les pilotes automatiques du monde. Il faut mesurer à quel point cela est doublement grave.
D'abord, du point de vue de l'éducation qui devait fabriquer le citoyen et la citoyenne dont la république avait besoin, et qui produira à la place un assisté mental dont l'action se limitera à donner l'input d'un « prompt[9] » et à recevoir l'output de la machine. Un étudiant qui fait un travail sur Napoléon en demandant à ChatGPT d'exécuter l'ensemble des opérations n'aura, finalement, rien appris ni rien compris. Mais il semble que cela n'est pas très grave et que l'enseignement doit aujourd'hui se réinventer en insistant davantage sur les aptitudes nécessaires pour écrire des prompts bien formulés ou en mettant en garde les étudiantes et étudiants contre les « hallucinations », les fabulations mensongères fréquentes des machines qui ont désormais pris le contrôle. « Que voulez-vous, elles sont là pour rester, nous n'avons pas le choix de nous adapter… », nous dit-on du côté de ceux qui choisissent de garnir les chaines de l'ignorance des fleurs de la « créativité », car c'est bien de cela qu'il s'agit : l'enseignement de l'ignorance comme l'a écrit Michéa[10], le décalage prométhéen comme programme éducatif et politique.
Deuxièmement, ce mouvement de déchargement vers la machine vient entièrement exploser l'idéal d'autonomie moderne individuelle et collective et réintroduire une forme d'hétéronomie : celle du capitalisme cybernétique autonomisé. Comme le remarque Bernard Stiegler, le passage du statut de mineur à celui de majeur, donc le devenir-adulte, est annulé : l'individu est maintenu au stade infantile et pulsionnel, puis branché directement sur la machine et le capital. Il y a donc complicité entre l'individu-tyran et le système une fois court-circuitées les anciennes médiations symboliques et politiques de l'ancienne société. Suivant une thèse déjà développée dans le néolibéralisme de Friedrich Hayek, notre monde serait, du reste, devenu trop complexe pour être compris par les individus ou orienté par la délibération politique : il faut donc confier au marché et aux machines informatiques/communicationnelles le soin de devenir le lieu de synthèse et de décision de la société à la place de la réflexivité politique. Or, ce système est caractérisé, comme le disait Freitag, par une logique d'expansion infinie du capital et de la technologie qui ne peut qu'aboutir à la destruction du monde, puisque sa logique d'illimitation est incompatible avec les limites géophysiques de la Terre, ce qui mène à la catastrophe écologique déjà présente. Cela conduit à une forme exacerbée de la banalité du mal comme absence de pensée théorisée par Hannah Arendt, cette fois parce que le renoncement à penser ce que nous faisons pour procéder plutôt à un délestage cognitif de masse mène dans les faits au suicide des sociétés à grande échelle à cause du totalitarisme systémique capitaliste-cybernétique. Nous passons notre temps devant des écrans pendant que le capitalisme mondialisé sur le « pilote automatique » nous fait foncer dans le mur de la crise climatique.
Accélérationnisme et transhumanisme
Ce mouvement de décervelage et de destruction de l'autonomie individuelle et collective au profit des systèmes ne relève pas seulement d'une dérive ou d'une mutation propre à la transition postmoderne. Il est aussi revendiqué comme projet politique chez les accélérationnistes, notamment ceux de la Silicon Valley. Une des premières figures de l'accélérationnisme est le Britannique Nick Land, ancien professeur à l'Université de Warwick, où il a fondé le Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) dans les années 1990. Land dit s'inspirer de Marx (!), de Deleuze et Guattari, de Nietzsche et de Lyotard pour conclure que l'avenir n'est pas de ralentir ou de renverser le capitalisme, mais d'accélérer son processus de déterritorialisation. Cette idéologie favorise ainsi l'accélération du capitalisme, de la technologie et se dit même favorable au transhumanisme, à savoir la fusion – partielle ou totale – de l'humain avec la machine dans la figure du cyborg[11]. Après avoir quitté l'université, Nick Land, notamment à cause de son usage de drogues, sombre dans la folie et l'occultisme. Il devient également ouvertement raciste et néofasciste. Il disparait pour refaire surface plusieurs années plus tard en Chine, une société qui, selon lui, a compris que la démocratie est une affaire du passé et qui pratique l'accélérationnisme technocapitaliste. Ses idées sont par la suite amplifiées et développées aux États-Unis par Curtis Yarvin, proche de Peter Thiel, fondateur de PayPal. Cela a engendré un mouvement de la néo-réaction ou NRx qui combine des thèses accélérationnistes et transhumanistes avec la promotion d'une privatisation des gouvernements, une sorte de technoféodalisme en faveur de cités-États gouvernées par les PDG de la techno. Il s'agit donc d'un mouvement qui considère que la démocratie est nuisible, étant une force de décélération, un mouvement qui entend réhabiliter une forme de monarchisme 2.0 mélangé à la fascination technique. On pourrait dire qu'il s'agit d'une nouvelle forme de technofascisme.
Ajoutons qu'une partie des idées de Land et de Yarvin nourrit non seulement l'« alt-right », mais aussi des mouvements ouvertement néonazis dont la forme particulière d'accélérationnisme vise à exacerber les contradictions raciales aux États-Unis pour mener à une société posteffondrement dominée par le suprémacisme blanc. Il existe également une forme d'accélérationnisme de gauche, associé à une figure comme celle de Mark Fisher, qui prétend conserver l'accélération technologique sans le capitalisme. Mais la majeure partie du mouvement est à droite, allant de positions anciennement libertariennes jusqu'à des positions néoautoritaires, néofascistes, transhumanistes ou carrément néonazies. Cette nébuleuse accélérationniste inspire les nouveaux monarques du technoféodalisme de la Silicon Valley, les Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreesen[12]. Ceux-ci pensent que l'humain doit fusionner avec l'IA pour ensuite aller coloniser Mars, la Terre étant considérée comme écologiquement irrécupérable. Il n'est donc pas suffisant de parler d'un projet de scénarisation de l'humain par la machine au moyen du délestage cognitif, puisque ce qui est en cause dans le projet accélérationniste et transhumaniste implique carrément la fin de l'humanité telle qu'on l'entendait jusqu'ici. L'anti-humanisme radical doit être entendu littéralement comme un projet de destruction de l'humanité. Il s'agit d'un projet de classe oligarchique et eugéniste qui entend bien donner tout le pouvoir à une nouvelle « race » de surhommes riches et technologiquement augmentés dont le fantasme est de tromper la mort par le biais de la technique pour pouvoir jouir de leur fortune éternellement, à tel point qu'ils modifient actuellement les lois aux États-Unis pour pouvoir déshériter leur descendance et contrôler leurs avoirs éternellement lorsque la technologie les aura rendus immortels…
L'oubli de la société
Ce délire se déroule aussi sur fond « d'oubli de la société », comme le disait Michel Freitag[13], à savoir qu'il implique la destruction des anciennes médiations culturelles et symboliques aussi bien que celle des anciennes sociétés, comprises comme totalités synthétiques ou universaux concrets. Marcel Rioux l'avait déjà remarqué dans les années 1960, l'impérialisme technocapitaliste étatsunien conduit à la liquidation de la langue, de la culture et de la société québécoise. Du reste, comme le souligne Freitag, le fait d'être enraciné dans un lieu et un temps concret est remplacé par un déracinement qui projette le néosujet dans l'espace artificiel des réseaux informatiques ou de la réalité virtuelle. Du point de vue de l'éducation, à quoi sert-il alors de transmettre la culture, la connaissance du passé, les repères propres à cette société concrète ou à son identité, du moment qu'on ne nait plus dans une société, mais dans un réseau ? La médiation technologique et les écrans, en tant que technologie de disruption, viennent contourner les anciennes médiations et le processus d'individuation qu'elles encadraient, produisant des individus socialisés ou institués par les machines. Il devient alors beaucoup plus important d'anticiper l'accélération future et d'enseigner à s'y adapter, beaucoup plus important que d'expliquer le monde commun et sa genèse historique. De ce point de vue, l'ancien instituteur, « hussard noir de la République[14] », doit être remplacé par un professeur branché qui s'empresse d'intégrer les machines à sa classe, ou carrément par ChatGPT ou par un quelconque tuteur-robot. Ainsi la boucle serait complète : des individus formés par des machines pour vivre dans une société-machine, où l'ancienne culture et l'ancienne société auraient été remplacées par la cybernétique.
Une aliénation totale
Nous l'avons dit : les jugements enthousiastes sur cette époque sont généralement posés sans égard au corpus de la théorie critique ou de la philosophie de la technique. Il nous semble au contraire qu'il faille remobiliser le concept d'aliénation pour mesurer la dépossession et la perte qui s'annoncent en éducation, pour les étudiants, les étudiantes, les professeur·e·s, aussi bien que pour la société ou l'humanité en général. L'aliénation implique un devenir étranger à soi. En allemand, Marx emploie tour à tour les termes Entaüsserung et Entfremdung, extériorisation et extranéiation. La combinaison des deux résume bien le mouvement que nous avons décrit précédemment, à savoir celui d'une extériorisation de l'humanité dans des systèmes objectivés à l'extérieur, mais qui se retournent par la suite contre le sujet. Celui-ci se trouve alors non seulement dépossédé de certaines facultés cognitives, mais en plus soumis à une logique hétéronome d'aliénation qui le rend étranger à lui-même, à sa pratique, à autrui, à la nature et à la société – comme l'avait bien vu Marx –, sous l'empire du capitalisme et du machinisme. Le sujet se trouve alors « privé de monde[15] » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Ce processus concerne aussi bien la destruction de la société et de la nature que celle de l'humanité à travers le transhumanisme. Nous pouvons ainsi parler d'une forme d'aliénation totale[16] – ou totalitaire – culminant dans la destruction éventuelle de l'humanité par le système technocapitaliste. Ajoutons que le scénario d'une IA générale (AGI, artificial general intelligence) ou de la singularité[17] est évoqué par plusieurs figures crédibles (Stephen Hawking, Geoffrey Hinton, etc.) comme pouvant aussi conduire à la destruction de l'humanité, et est comparé au risque de l'arme nucléaire. L'enthousiasme et la célébration de l'accélération technologique portés par les idéologues et l'idéologie dominante apparaissent d'autant plus absurdes qu'ils ignorent systématiquement ces mises en garde provenant pourtant des industriels eux-mêmes. Sous prétexte d'être proches des générations futures, soi-disant avides de technopédagogie, on voit ainsi des adultes enfoncer dans la gorge de ces jeunes un monde aliéné et courant à sa perte, un monde dont ils et elles ne veulent pourtant pas vraiment lorsqu'on se donne la peine de les écouter, ce dont semblent incapables nombre de larbins de la classe dominante et de l'accélérationnisme technocapitaliste, qui ont déjà pressenti que leur carrière actuelle et future dépendait de leur aplaventrisme devant le pouvoir, quitte à tirer l'échelle derrière eux dans ce qu'il convient d'appeler une trahison de la jeunesse.
Conclusion : réactiver le projet socialiste
Nous avons montré précédemment que l'extension du capitalisme cybernétique conduit à des dégâts : psychologiques, pédagogiques, développementaux, sociaux/relationnels. Nous avons montré que le problème est beaucoup plus large, et concerne, d'une part, le déchargement de la cognition et du jugement dans des systèmes extérieurs. D'autre part, il participe de la mise en place d'un projet politique technocapitaliste, celui d'une société postmoderne du « tout à distance » gérée par les systèmes, ce qui signifie la liquidation de l'idéal d'autonomie politique moderne. Cela entraine bien sûr des problèmes en éducation : formation d'individus poussés à s'adapter à l'accélération plutôt que de citoyens éclairés, fin de la transmission de la culture et de la connaissance, oubli de la société, etc. Plus gravement, cela participe d'une dynamique d'aliénation et de destruction du rapport de l'individu à lui-même, aux autres, à la nature et à la société. Ce processus culmine dans le transhumanisme et la destruction potentielle aussi bien de l'humain que de la société et de la nature si la dynamique accélérationniste continue d'aller de l'avant. Ce qui est menacé n'est donc pas seulement l'éducation, mais la transmission même du monde commun à ceux qu'Arendt appelait les « nouveaux venus », puisque ce qui sera transmis sera un monde de plus en plus aliéné et en proie à une logique autodestructive. Les Grecs enseignaient, notamment dans le serment des éphèbes, que la patrie devait être donnée à ceux qui suivent en meilleur état que lorsqu'elle avait été reçue de la génération antérieure. Les générations actuelles laissent plutôt un monde dévasté et robotisé, tout en privant celles qui viennent des ressources permettant de le remettre sur ses gonds.
Il convient évidemment de résister à ces transformations, par exemple en luttant localement pour défendre le droit à une éducation véritable contre la double logique de la marchandisation et de l'automatisation-robotisation. On peut encore réclamer de la régulation de la part des États, mais il est assez évident aujourd'hui que le développement de l'IA a le soutien actif des États – « comité de gestion des affaires de la bourgeoisie », disait Marx. Mais il faut bien comprendre que seule une forme de société postcapitaliste pourra régler les problèmes d'aliénation évoqués ci-haut. Il sera en effet impossible de démarchandiser l'école et de la sortir de l'emprise de la domination technologique sans remettre en question la puissance de ces logiques dans la société en général.
Depuis le XIXe siècle, la réaction à la destruction sociale engendrée par l'industrialisation a trouvé sa réponse dans le projet socialiste[18], qu'il s'agisse de la variante utopique, marxiste ou libertaire. On trouve aussi aujourd'hui des approches écosocialistes, décroissancistes ou communalistes[19]. Cette dernière approche, inspirée par l'écologie sociale de Murray Bookchin, préconise la construction d'une démocratie locale, écologique et anti-hiérarchique. Ce sont là différentes pistes pouvant nourrir la réflexion sur la nécessaire reprise de contrôle des sociétés sur l'économie et la technologie, dont la dynamique présente d'illimitation est en train de tout détruire. Cela laisse entière la question du type d'éducation qui pourrait favoriser la formation des citoyennes et citoyens communalistes dont le XXIe siècle a besoin. Chose certaine, il faudra, à rebours de ce que nous avons décrit ici, que cette éducation favorise l'autonomie, la sensibilité, la compassion, l'altruisme ; qu'elle donne un solide enracinement dans la culture et la société, qu'elle apporte une compréhension de la valeur et de la fragilité du vivant et de la nature. Bref, elle devra former des socialistes ou des communalistes enracinés au lieu de l'aliénation et du déracinement généralisé actuels.
Par Eric Martin, professeur de philosophie, Cégep St-Jean-sur-Richelieu
NOTES
1. Ce type de technologie cause un bouleversement profond dans les pratiques du champ où elle apparait. ↑
2. Franck Fischbach, La privation de monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin, 2011. ↑
3. Carolyne Labrie, « Les cégépiens ne veulent plus d'enseignement à distance », Le Soleil, 27 février 2023. ↑
4. Pour un développement détaillé de ces constats, voir Eric Martin et Sebastien Mussi, Bienvenue dans la machine. Enseigner à l'ère numérique, Montréal, Écosociété, 2023. ↑
5. Naomi Klein, « How big tech plans to profit from the pandemic », The Guardian, 13 mai 2020. ↑
6. Eric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Anatomie d'un anti-humanisme radical, Paris, L'Échappée, 2021. ↑
7. « L'intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l'enseignement ? », La tête dans les nuances, NousTV, Mauricie, 29 mai 2023. ↑
8. Céline Lafontaine, L'Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004. ↑
9. NDLR. Prompt : il s'agit d'une commande informatique destinée à l'utilisateur ou l'utilisatrice lui indiquant comment interagir avec un programme, ou dans le cas de ChatGPT, des instructions envoyées à la machine pour lui permettre de faire ce qu'on lui demande. ↑
10. Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Castelnau-le-Lez, Climats, 2006. ↑
11. NDLR. Cyborg (mot formé de cybernetic organism) : personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et de parties mécaniques. ↑
12. Marine Protais, « Pourquoi Elon Musk et ses amis veulent déclencher la fin du monde », L'ADN, 20 septembre 2023. ↑
13. Michel Freitag, L'oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité, Québec, Presses de l'Université Laval, 2002. ↑
14. En 1913, l'écrivain français Charles Péguy qualifie les instituteurs de « hussards noirs ». Combatifs et engagés, ils défendent l'école de la République.
15. Fischbach, La privation de monde, op. cit. ↑
16. Voir la présentation de Gilles Labelle lors du séminaire du Collectif Société sur l'ouvrage Bienvenue dans la machine, UQAM, 28 avril 2023. ↑
17. D'après Wikipedia, « La singularité technologique (ou simplement la Singularité) est l'hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligences artificielles qui s'auto-amélioreraient, de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement dans une « explosion d'intelligence », débouchant sur une puissante superintelligence qui dépasserait qualitativement de loin l'intelligence humaine ». Cette thèse est notamment défendue par le futurologue transhumaniste Ray Kurzweil. ↑
18. Jacques Dofny, Émile Boudreau, Roland Martel et Marcel Rioux, « Matériaux pour la théorie et la pratique d'un socialisme québécois », article publié dans la revue Socialisme 64, Revue du socialisme international et québécois, n° 1, printemps 1964, p. 5-23. ↑
19. Eric Martin, « Communalisme et culture. Réflexion sur l'autogouvernement et l'enracinement », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 24, automne 2020, p. 94-100. ↑
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Larissa Packer : capitalisme vert, agro-industrie et crise environnementale

L'avocate socio-environnementale explique comment l'économie verte sert les intérêts financiers, transformant les biens communs en actifs financiers
Tiré de Capiré
https://capiremov.org/fr/entrevue/larissa-packer-capitalisme-vert-agro-industrie-et-crise-environnementale/
03/05/2024 |
Par MST
Foto : Selma Farias
La crise environnementale de ce siècle est directement liée au modèle agro-industriel, basé sur les grandes propriétés et sur la monoculture de produits de base. La production intensive et prédatrice qui progresse dans les campagnes est pratiquement ancrée dans la déforestation de l'Amazonie et du Cerrado brésilien, deux des régions les plus riches en biodiversité de la planète. À l'heure où l'on s'inquiète de plus en plus du changement climatique et de la durabilité, l'économie verte, le capital vert et le marché du carbone sont apparus comme des « concepts » dans la recherche de solutions « viables » et respectueuses de l'environnement.
Le site internet du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil (MST) a interviewé Larissa Ambrosano Packer pour discuter de la dynamique entre l'agro-industrie et de l'environnement, en apportant des aspects liés aux nouvelles technologies capitalistes dans l'organisation de l'agriculture et de l'élevage et aux expressions de la financiarisation de l'économie dans les dynamiques agraire et environnementale. Packer est avocate socio-environnementale, titulaire d'un master en philosophie du droit et membre de l'équipe Grain pour l'Amérique Latine.
L'économie verte, qui semble aujourd'hui « à la mode », apporte-t-elle des solutions au problème de la crise environnementale mondiale ?
Cette relation entre les marchés de capitaux, l'agro-industrie et l'environnement s'inscrit dans cette tendance des investisseurs institutionnels qui cherchent à générer des milliards de dollars dans le monde, recherchant la rentabilité la plus élevée possible pour les « élites rentières », qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises. Je parle de BlackRock, Vanguard, State Street, Global Advisors, qui gèrent des billions de dollars, parfois beaucoup plus que le PIB des États-Unis et de la Chine. Ces investisseurs institutionnels professionnels, confrontés aux fluctuations des marchés financiers, aux mouvements inflationnistes et à la baisse des taux d'intérêt, recherchent des actifs physiques, des biens matériels tangibles tels que l'immobilier, les infrastructures de transport, les ports, les aéroports et les métaux précieux tels que l'or, les terres agricoles ou les ressources naturelles en général.
Cette alliance d'investisseurs institutionnels sur le marché financier et ces actifs physiques et matériels sont très présents en temps de crise, à la fois comme stratégie de protection de l'argent contre l'inflation et pour placer cette suraccumulation d'argent sur une base physique garantissant une rentabilité à long terme plus sûre que les actifs financiers traditionnels, tels que les actions ou les obligations d'État. Cela fait partie de ce moment de ruée vers l'or, vers le foncier, vers l'immobilier, qui s'est intensifiée au cours des 15 dernières années, depuis la crise hypothécaire de 2008 aux États-Unis, qui a également généré un énorme volume de capital financier sans ballast sur lequel reposer et qui a fini par conduire à plus ou moins trois mouvements majeurs.
Et quels sont ces mouvements ?
Grain a prouvé qu'il y avait eu une augmentation des transactions foncières internationales entre 2008 et 2009, passant de 4 à 45 millions d'hectares. La littérature parle de land grabbing, cette course aux terres agricoles à laquelle la Banque mondiale se réfère depuis 2011.
En 2012, par exemple, plusieurs investisseurs institutionnels ont cherché à acquérir des entreprises qui gèrent des terres agricoles aux États-Unis et à placer cette super accumulation de capital sur un marché foncier limité. Et cela a conduit à des prix stratosphériques de la valeur des terres, allant jusqu'à 67 000 dollars par hectare dans le Wisconsin. Pour vous donner une idée, ces actifs dits réels – qui sont en fait les marchés immobilier, commercial et résidentiel – correspondaient en 2021 à 51 % du total des actifs courants dans le monde, soit 290 billions de dollars.
Le deuxième marché le plus important est celui des instruments de dettes, qui représente moins de la moitié de ce montant (123 billions de dollars) et le troisième marché le plus important est celui de l'or. C'est également un actif très recherché en temps de crise, qui offre une plus grande sécurité et protection contre la corrosion de la monnaie en période d'inflation, et qui représente un marché de 12 billions de dollars.
Selon AGBI Real Assets, gestionnaire d'actifs immobiliers, les propriétés rurales représentent plus de 35 billions de dollars, soit environ 6 % des actifs de l'économie mondiale. Au cours des 20 dernières années, la valeur des terres agricoles a augmenté de 300 %.
Ensemble, ces fonds immobiliers qui investissent dans les propriétés commerciales, résidentielles et rurales totalisent plus de 320 billions de dollars, soit environ quatre fois le PIB mondial de 2020. Ainsi, l'alliance entre les investisseurs financiers, l'agro-industrie et les ressources naturelles s'inscrit dans ce moment d'intensification des crises financières, cherchant une protection contre la corrosion de l'argent face à l'inflation et aussi une plus grande rentabilité, une meilleure distribution de dividendes aux investisseurs et aux élites rentières.
Quel est l'impact de cette course au capital sur les terres et les biens communs des pays ?
Ce phénomène touche principalement les pays qui possèdent des terres agricoles et des ressources naturelles. Il y a un déplacement de cette suraccumulation de capital vers ces autres régions du Sud global, qui disposent de terres et de ressources naturelles en abondance. De nombreux investisseurs institutionnels cherchent à surévaluer ces actifs, augmentant ainsi le prix des terres et des produits agricoles, ce qui finit par avoir un impact sur la valeur des aliments, l'accès à la terre et les biens communs qu'elle fournit, tels que l'eau, la biodiversité, la végétation locale et la qualité et l'intégrité de l'environnement, qui sont des droits humains liés à la dignité de la vie et de la santé, à la fois des humains et des animaux et de la planète.
En période de crise financière, ces investisseurs financiers profitent de cet environnement de surconcentration et de rareté pour procéder à l'introduction de biens jusque-là courants dans le régime juridique de la propriété privée et, pire encore, dans le régime financier. Ils rapprochent ces biens communs non seulement du régime juridique des marchandises, mais des actifs financiers eux-mêmes. Ils subordonnent les biens autrefois communs, tels que la terre, l'eau et les ressources naturelles, aux intérêts des investisseurs de fonds en matière de distribution de dividendes. Cela signifie que plus l'expansion de l'agro-industrie est importante, produisant peu de produits de faible qualité nutritionnelle pour l'exportation, avec davantage de déforestation, d'appropriation des terres et de l'eau, plus la tarification de ces actifs réels qui deviennent des actifs financiers est élevée, et plus la distribution de dividendes à ces gestionnaires d'actifs et aux élites rentières mondiales est importante. Cela aboutit à subordonner les biens communs et les intérêts de la population à la stratégie de gains financiers de quelques familles, de quelques personnes super-riches dans le monde.
C'est ce que l'on appelle une économie verte ?
L'économie verte est un slogan de plus pour légitimer ou populariser un intérêt de classe, limité à une petite élite de rentiers et aux agents financiers qui travaillent pour elle. On fait donc intervenir des intérêts de classe et on les met en avant comme s'il s'agissait d'un intérêt global et plus large pour tout le monde.
Le discours hégémonique prétend vouloir une économie verte dans laquelle ces investisseurs aident la planète, aident toutes les populations à lever des fonds pour des projets environnementaux à faible impact. Mais il dit cela précisément pour dissimuler le fait qu'il s'agit d'une économie de rentiers, de capitalistes, d'investisseurs financiers, qui recherchent de plus en plus une rentabilité accrue basée sur l'augmentation de la valeur de la terre et de la valeur des marchandises et des denrées alimentaires.
Il en résulte une minorité de propriétaires et une majorité de personnes sans accès, sans toit, sans terres, de sorte que cet accès entre de plus en plus dans la composition de la valeur de ces actifs, de plus en plus par l'intérêt d'une plus grande rentabilité pour ces investisseurs.
On a beau dire que ces ressources seront utilisées pour le bien de la planète , la recherche d'une plus grande rentabilité est intrinsèque à la dynamique des investissements financiers. La rentabilité la plus élevée est liée aux transactions où les terres sont achetées à bas prix et vendues à un prix élevé.
Il n'est donc pas étonnant que de nombreux rapports fassent état de l'implication de ces gestionnaires d'actifs fonciers, y compris des fonds de pension, qui achètent des terrains très bon marché dans le Matopiba [acronyme désignant une région brésilienne comprenant les États de Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia], qui sont bon marché précisément parce que toute la chaîne de propriété est contaminée par des vices et des fraudes dus à l'accaparement de terres publiques et collectives. Après quelques années, les pâturages dégradés deviennent des monocultures de soja, dégradées pour d'autres raisons, afin de produire des marchandises destinées à l'exportation. Cela augmente la valeur de la terre et, lorsque celle-ci est vendue, les bénéfices sont distribués à quelques investisseurs financiers.
Il y a toute une dynamique d'augmentation du prix ou d'appréciation de ces terres et ceux qui n'ont pas d'argent sont poussés à vendre. On assiste à une concentration de ces terres, à l'expulsion de la population et des petits agriculteurs, des peuples et communautés traditionnels, à une déforestation accrue, etc. Quand on suit vraiment le phénomène du capital lié à ce qu'on appelle l'économie verte, ce qu'on voit c'est une économie brune, une économie qui conduit à une très grande violence contre les personnes et l'environnement.
En 2008, avec la suraccumulation de capital sans ballast sur lequel s'appuyer avec la crise hypothécaire aux États-Unis, il y a eu une fuite de capital et une recherche de nouveaux marchés, de nouveaux actifs, plus sûrs pour ces trillions de dollars. Trois phénomènes se sont plus ou moins produits : le land grabbing, avec une course mondiale à la terre, principalement dans les pays du Sud ; la spéculation financière sur les matières premières agricoles, avec une concentration par quelques fonds de futurs contrats d'achat et de vente de soja et de maïs, etc., générant un boum de l'indice des prix des denrées alimentaires ; et l'évaluation économique autonome, qui fait référence à la valeur des terres et aux valeurs environnementales.
Avant il y avait la qualité ou l'intégrité environnementale, qui relevait du régime juridique des biens communs. Ceux-ci étaient inappropriées pour une seule personne et ne pouvaient pas être échangés comme n'importe quelle autre marchandise, précisément parce qu'ils étaient destinés à tous, générations présentes et futures. Le régime de la propriété privée fait désormais l'objet d'une évaluation économique, autorisant certains acteurs à délivrer un titre de propriété sur ce qu'ils commencent à appeler les services environnementaux ou les services écosystémiques.
Vous pouvez nous expliquer plus en détail comment cela fonctionne ?
Il s'agit aujourd'hui d'un principe du droit de l'environnement, mais en réalité, tout un marché d'achat et de vente est en train de se construire à partir de la tarification et de l'autorisation des contrats et de la circulation de nouvelles marchandises autour des biens environnementaux, qui sont désormais considérés comme des actifs tangibles et peuvent faire l'objet d'échange comme n'importe quelle autre marchandise, en particulier dans l'environnement des actifs financiers.
Au Brésil, les quotas de réserve environnementale (CRA), qui représentent un hectare de végétation locale à n'importe quel stade de régénération, ne doit pas nécessairement être une forêt primaire ou secondaire, il peut s'agir d'une zone dégradée ou en cours de régénération. Ils fournissent un service environnemental de piégeage du carbone avec la croissance, permettant à cette zone de se régénérer et de se développer.
À partir de ces territoires, on peut émettre des titres financiers négociés en bourse et de gré à gré. De même, le Nasdaq et la Los Angeles Stock Exchange ont également inclus l'eau comme actif financier, qui se négocie donc également en bourse et dont le prix est fixé — d'où le terme de quotas d'eau.
Nous voyons des biens communs qui appartenaient à tout le monde passer au régime de la propriété privée et, en plus, devenir un actif financier. Cela peut entraîner la déforestation. Placer la gestion de l'environnement dans la logique de l'offre et de la demande, dans la logique des prix du marché, peut générer des mouvements spéculatifs très dangereux contre l'environnement. La logique est la suivante : plus il y a d'incendies en Californie ou dans le Pantanal, moins il y a d'eau disponible ; et plus elle est rare, plus la valeur du quota en bourse sera élevée. Et ceux qui détiennent ces actions auront une meilleure rentabilité, et pourront acheter et vendre ces actions à une valeur plus élevée sur le marché secondaire. De même, les quotas de réserve environnementale dans les régions où l'exploitation minière et l'agro-industrie se développent, avec la monoculture du soja, du coton et du maïs, auront moins de forêts ou de végétation locale et protégée, et la valeur des quotas sera plus élevée. Cela n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Nous parlons d'économie financière, qui n'a rien de vert.
Interview de Fernanda Alcântara éditée par Solange Engelmann
Révision de Helena Zelic
Traduction du portugais pas Claire Laribe
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pluies meurtrières au Brésil et en Afrique : le changement climatique a encore frappé

De nombreuses régions du monde font face à des pluies diluviennes meurtrières. Des événements extrêmes qui s'expliquent en partie par le réchauffement climatique causé par l'humain.
Tiré de Reporterre
6 mai 2024
Par Émilie Massemin
Des Kenyans regardent une voiture détruite qui a été emportée par des pluies torrentielles dans le village de Kamuchiri, au Kenya, le 29 avril 2024. - © AFP / Luis Tato
Au moins 188 décès au Kenya, 155 en Tanzanie, 28 000 foyers déplacés en République démocratique du Congo, 2 000 au Burundi... Des pluies meurtrières frappent plusieurs régions du monde, en particulier l'Afrique de l'Est. Pour toute la zone Kenya, Tanzanie, Comores, la situation pourrait s'aggraver dans les prochaines heures avec le passage du cyclone Hidaya.
Au sud du Brésil, le bilan des inondations dans l'État du Rio Grande do Sul s'établissait le 3 mai à 29 morts et 60 personnes portées disparues. En Chine, des pluies diluviennes ont frappé la province du Guangdong, la plus peuplée du pays avec ses 127 millions d'habitants. Elles ont provoqué le décès de quatre personnes et des dizaines de milliers d'évacuations. Mi-avril, des précipitations extrêmes ont frappé plusieurs pays du Golfe, tuant vingt-et-une personnes à Oman. Les Émirats arabes unis ont enregistré des niveaux de pluie jamais atteints en soizante-quinze ans de relevés météorologiques. Quatre personnes sont mortes.
Certains épisodes peuvent être liés à des phénomènes météorologiques locaux. Par exemple en Afrique de l'Est. « L'événement El Niño, dont un s'est produit récemment, a généralement un lien avec les précipitations », explique Benjamin Sultan, climatologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Cette année, il a été amplifié par le dipôle de l'océan Indien, une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer.
Mais pour les chercheurs interrogés par Reporterre, il ne fait aucun doute que ces événements climatiques extrêmes sont liés au changement climatiquecausé par l'humain. « Les précipitations associées à El Niño et au dipôle de l'océan Indien sont rendues plus fortes par le changement climatique », explique Benjamin Sultan. En cause, une élévation de la température des océans qui entraîne un surcroît d'évaporation, une augmentation du taux d'humidité dans l'atmosphère et, en bout de chaîne, des pluies plus abondantes. « 1 °C supplémentaire se traduit par une augmentation de 7 % de l'humidité atmosphérique, précise le chercheur. En conséquence, même si la probabilité de l'événement météorologique ne change pas, il peut devenir plus intense. »
Un lien que confirme Davide Faranda, directeur de recherche en climatologie au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) de l'Institut Pierre-Simon Laplace et coordinateur du consortium international ClimaMeter. « Aux tropiques, les océans sont particulièrement chauds, avec beaucoup d'évaporation. Cette chaleur humide se transfère à l'atmosphère et peut déclencher des pluies assez intenses, et donc des inondations », explique-t-il. En élargissant la focale, on observe même un lien entre les épisodes de chaleur extrême et ces inondations dévastatrices. « Au Sahel, en Chine et au Brésil, des records de température ont été battus dans plusieurs zones, contribuant à l'évaporation, rappelle le chercheur. Quand ces masses d'air chaud entrent en contact avec des zones d'air frais — ce qu'on appelle goutte froide dans la météorologie française —, elles déclenchent orages et précipitations. »
Inégalités face aux risques
Au niveau local cependant, difficile de lier tel ou tel épisode au changement climatique. Davide Faranda est spécialisé dans cette science en construction, baptisée « attribution ». « Pour Dubaï [aux Émirats arabes unis], les inondations sont tellement exceptionnelles que l'on n'a pas trouvé d'événement similaire dans nos bases de données. On ne peut donc pas vraiment dire si elles sont liées au changement climatique », précise-t-il. En revanche, son équipe a pu établir un lien entre les inondations en Chine et les émissions de gaz à effet de serre.
Les personnes mortes lors de ces récents épisodes d'inondations sont-elles donc des victimes du changement climatique ? Oui, mais d'autres éléments sont à prendre en considération. « Le risque n'est absolument pas naturel, rappelle la géographe Valérie November, directrice de recherche au CNRS. Si les pluies et les inondations font autant de dégâts, c'est parce que des populations vivent dans les endroits inondés. » D'autres facteurs, notamment économiques, peuvent jouer. « Une part du risque est fondamentalement injuste, il frappe les populations qui vivent le plus en marge, poursuit la chercheuse. Il est clair que les territoires et les populations sont inégaux face au risque. »
Le changement climatique viendra sans nul doute compliquer cette équation. « Il rend les phénomènes météorologiques plus intenses. Cette intensité produit des dommages dans des endroits qui n'étaient pas identifiés à l'avance, et prennent de court des personnes qui ne se pensaient pas exposées », explique Valérie November.
Benjamin Sultan, lui aussi, observe cette difficulté à anticiper les catastrophes climatiques et donc à limiter le nombre de décès qu'elles entraînent. « On sait que les pluies vont être un peu plus fortes, mais on ne sait pas exactement où. Souvent, les prévisions ne sont pas assez précises pour que les décideurs prennent les décisions associées, remarque le climatologue. On atteint aussi les limites de certains pays à gérer des événements extrêmes. Ces derniers sont parfois tellement extrêmes que même si l'on sait qu'ils vont arriver, cela dépasse les capacités d'adaptation du pays. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











