Nouveaux Cahiers du socialisme
Faire de la politique autrement, ici et maintenant...

La coopérative d’habitation : un modèle plus pertinent que jamais

L’ONU, après l’avoir fait en 2012, a proclamé 2025 Année internationale des coopératives sous le thème Les coopératives construisent un monde meilleur[1].
Le coopératisme, qui s’incarne dans une diversité de secteurs, fait partie de l’ADN du Québec. Et l’habitation occupe une place particulière dans le mouvement, car c’est le secteur qui compte le plus grand nombre de coopératives, soit 1300 regroupant 30 000 logements occupés par au moins 60 000 personnes. En outre, le chiffre d’affaires est évalué à 200 millions de dollars ($) alors que la valeur totale des actifs est de 1,5 G$, ce qui en fait l’un des plus importants parcs de logements locatifs au Québec. On retrouve des coopératives d’habitation dans toutes les régions du Québec[2].
Ayant pris leur élan dans les années 1970, les coopératives se sont rapidement implantées dans les quartiers populaires des milieux urbains, que l’on désigne aujourd’hui comme les quartiers centraux. Profitant des programmes gouvernementaux axés sur l’achat-rénovation d’immeubles existants, elles se sont multipliées dans de petits ensembles immobiliers regroupant le plus souvent de 6 à 24 logements. Les groupes de ressources techniques (GRT)[3] n’avaient pas de difficulté à l’époque à convaincre les locataires de former une coopérative d’habitation lorsque leur immeuble était mis en vente. La perspective de « se débarrasser du propriétaire », de contrôler son loyer, d’avoir un logement entièrement rénové et de disposer de la sécurité d’occupation – c’est-à-dire de ne plus avoir la crainte d’être évincé – emportait rapidement l’adhésion. Au fil du temps, d’autres avantages sont apparus, tels que le fonctionnement démocratique, l’entraide, la vie communautaire.
Pour les acteurs du mouvement pour le droit au logement, les coopératives permettaient de retirer des centaines, voire des milliers de logements du marché privé et même, espérait-on, d’avoir un effet stabilisateur sur l’ensemble des loyers. Certains y voyaient également une pratique émancipatrice et une rupture avec le dogme de la propriété privée dans le domaine immobilier[4].
Or, bien que les coopératives aient fait leur marque depuis au moins 50 ans, l’élaboration de nouveaux projets s’avère de plus en plus difficile aujourd’hui, principalement à cause d’un financement déficient, de la difficulté d’accès à des terrains, d’un marché hautement spéculatif, des coûts élevés de construction et des délais posés à la réalisation des projets. C’est ainsi qu’en 2023, les coopératives ne représentaient que 23,7 % des logements sociaux et communautaires dans l’agglomération de Montréal[5].
En pleine crise du logement, cette donnée est d’autant plus inquiétante que nous apprenions dernièrement qu’il y aurait aujourd’hui moins de logements sociaux[6] au Canada qu’il y a 30 ans, ceux-ci représentant 4,1 % du parc immobilier en 2021 contre 6,2 % en 1991[7]. Au Québec, selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec, cette proportion est encore plus faible, s’établissant à 3,5 % en 2021[8]. Dans le cas des seuls logements locatifs, ce pourcentage serait de 9,2 %[9].
Par ailleurs, inspiré par des pays européens, notamment l’Autriche et le Danemark, le milieu de l’habitation sociale et communautaire a fixé à 20 % du parc locatif la cible à atteindre pour le logement social d’ici 15 ans lors des journées d’étude Perspectives internationales sur le logement social et communautaire – S’inspirer de solutions pour le Québec tenues les 29 et 30 mai 2024. Élément encourageant, la Ville de Montréal a inscrit un objectif allant dans le même sens dans son Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 adopté en juin 2025. Elle y propose que le logement hors marché atteigne, d’ici 25 ans, 20 % de l’ensemble du parc de logements[10]. La Ville de Longueuil l’avait précédée en adhérant à une cible de 20 % de logements locatifs à but non lucratif sur son territoire dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’habitation, présentée en décembre 2023.
Les coopératives, quant à elles, doivent affronter divers défis, tels que le vieillissement du parc immobilier, la fin des conventions, un fardeau fiscal qui s’alourdit, le recrutement et la participation des membres ainsi que, dans certains cas, d’importantes hausses de loyer.
Dans cet article, mon objectif est de présenter le mouvement coopératif d’habitation au Québec afin de saisir son évolution et ses défis actuels. Tout en faisant appel à la recherche documentaire, mon propos repose également sur ma propre expérience des dernières décennies en tant que travailleuse et militante dans le secteur coopératif en habitation.
Un peu d’histoire
Les toutes premières coopératives d’habitation au Québec apparaissent à partir de 1941 à Asbestos, à l’initiative de l’Église qui voulait notamment faire obstacle au communisme. Il s’agissait de coopératives de maisons individuelles construites collectivement par les membres, de façon bénévole (système des corvées), dans le but de favoriser l’accès à la propriété pour les Canadiens français. Une fois toutes les maisons d’une coopérative bâties, cette dernière était dissoute. Entre 1941 et 1968, 200 coopératives construisent ainsi 10 000 maisons. En 1964, la Commission d’étude sur les coopératives d’habitation, aussi connue sous le nom de Commission Bouthillier du nom de son président, M. Fernand Bouthillier, recommande que le mouvement coopératif en habitation développe lui-même des logements qui seraient subventionnés par le gouvernement pour la population à revenu modeste. C’est cette commission qui introduit le principe de propriété collective perpétuelle où les membres de la coopérative sont à la fois locataires et propriétaires[11]. C’est ce qu’on désigne par modèle locatif à possession continue.
En vertu de ce modèle, les membres de la coopérative possèdent deux statuts :
– celui de membre, encadré par la Loi sur les coopératives adoptée en 1982, qui leur accorde les pouvoirs d’un propriétaire pour ce qui est de la gestion de la coopérative ;
– celui de locataire, encadré à partir de 1979 par la Loi sur la Régie du logement – maintenant le Tribunal administratif du logement –, avec les responsabilités correspondantes.
Un projet pilote expérimentant ce modèle avait déjà été tenté en 1965 à Winnipeg par la coopérative Willow Park. Au Québec, c’est à Montréal, dix ans plus tard, que la première coopérative de ce type, la coopérative Village Côte-des-Neiges, verra le jour. Il y a une autre distinction : il s’agit du premier projet d’achat-rénovation, lequel rompt avec les expériences précédentes de construction de maisons individuelles. C’est également le premier projet qui bénéficie du nouveau programme de soutien créé par le gouvernement fédéral en 1973. Ce programme sera suivi par deux autres. Le gouvernement Mulroney y mettra fin en 1992[12]. Par ailleurs, au Québec, le gouvernement du Parti québécois crée, en 1977, le programme Logipop, en vigueur jusqu’en 1987, ainsi que le réseau des groupes de ressources techniques (GRT). Malgré ces initiatives gouvernementales, le développement des coopératives d’habitation n’a pas été un long fleuve tranquille, loin de là.
Les coopératives d’habitation au cœur des luttes urbaines
Les années 1970 et 1980 sont marquées par une forte effervescence sociale dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l’aménagement urbain. Les opérations de rénovation urbaine dans les grandes villes du Québec à partir des années 1950 entrainent la démolition de milliers de logements ouvriers pour faire place à la construction de logements plus luxueux, d’immeubles de bureaux, d’hôtels ou d’autoroutes. Des quartiers entiers sont rayés de la carte comme le rappelle le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) à l’occasion de son quarantième anniversaire. Au milieu des années 1970, les gouvernements se lancent davantage dans l’embellissement des quartiers et la rénovation domiciliaire par la création du Programme d’amélioration de quartier (PAQ)[13].
Le FRAPRU constate : « Or la population ouvrière, qui aurait dû bénéficier de ces améliorations, en vit au contraire les conséquences, en particulier la hausse des loyers. […] 75 % des ménages locataires […] doivent déménager, parce qu’ils ne peuvent plus en défrayer le coût[14] ».
Cette situation donne lieu à des luttes importantes dont certaines sont emblématiques. Ainsi, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec et à Hull, aujourd’hui Gatineau, où les maisons de rues entières sont détruites, des locataires résistent pendant des années et réussissent à préserver un certain nombre de logements et à les transformer en coopératives[15].
Le centre-ville de Montréal, au milieu des années 1960, est lui aussi frappé par ce mouvement de « modernisation ». Le promoteur Concordia Estates Ltd. veut démolir le quartier Milton Parc caractérisé par de belles maisons victoriennes datant du XIXe siècle, habitées par des familles à revenu modeste et des membres de la communauté universitaire. La résistance de la communauté s’organise et aboutit à l’un des grands projets coopératifs et sans but lucratif au Québec, selon un modèle unique validé par une loi de l’Assemblée nationale[16].
Alors que la désindustrialisation frappe à Montréal comme ailleurs en Amérique du Nord, la requalification de secteurs industriels est également source d’affrontements sociaux importants. C’est ainsi que le déclin des activités ferroviaires aux ateliers Angus dans le quartier Rosemont ouvre la voie, à partir de 1974, à sa transformation en quartier résidentiel et commercial comprenant des services communautaires. Le Comité logement Rosemont, animé par son coordonnateur André Lavallée, qui deviendra plus tard conseiller municipal, organise la mobilisation en mettant sur pied, en 1981, le Comité du terrain des usines Angus. Il s’agit de la coalition la plus vaste et la plus diversifiée depuis celle qui s’était opposée à l’autoroute Est-Ouest dans les années 1970. Soulignons que la pression citoyenne amène pour la première fois la Ville de Montréal à tenir des consultations publiques sur un projet de développement. Après nombre de rebondissements, la lutte mène à la victoire avec la réalisation de plus de 1000 logements sociaux, dont 552 logements coopératifs, soit 40 % de l’ensemble immobilier[17].
Moins connue est la mobilisation des locataires du quartier Cloverdale à Pierrefonds dans l’ouest de Montréal. Pourtant, celle-ci a duré près d’un quart de siècle et a conduit à la constitution de la plus grande coopérative au Canada, la Coopérative Village Cloverdale. Celle-ci compte 866 logements répartis dans 58 immeubles où résident plus de 3500 personnes issues d’une cinquantaine de communautés culturelles. C’est la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui est propriétaire de l’ensemble immobilier de 1962 à 1980, comme de plusieurs autres complexes ailleurs au pays. Une réorientation politique la conduit à s’en départir, presque du jour au lendemain, car on juge que ce n’est pas le rôle de l’État d’être propriétaire et gestionnaire immobilier. En contrepartie, un nouveau programme fédéral permet à des groupes de locataires de constituer des coopératives. Même si les locataires de Cloverdale souhaitent procéder de la sorte, la SCHL décide de vendre le complexe, jugeant qu’ils n’ont pas l’expérience voulue pour gérer un ensemble aussi vaste.
C’est un désastre pour les locataires à faible revenu qui perdent la subvention au loyer précédemment accordée par la SCHL. Un grand nombre déménagent, ne pouvant plus payer les loyers. La détérioration des immeubles s’aggrave ainsi que le tissu social. En 1987, avec le soutien de Me Pierre Sylvestre, les locataires intentent contre la SCHL un recours collectif qui se règle par une entente hors cour : les subventions sont rétablies et la SCHL autorise, en 1998, l’acquisition de 243 unités par les locataires regroupés dans un OSBL. Celui-ci est constitué pour procéder à l’achat et aux rénovations, mais a également pour mission de travailler à la constitution d’une coopérative, selon le vœu initial des locataires, ce qui se concrétisera le 17 avril 2002. Au cours des années suivantes, la coopérative procédera à d’autres acquisitions et à de la construction neuve dans le secteur pour atteindre le nombre impressionnant de 866 logements. C’est tout un quartier qui a été « coopérativisé »[18].
La préservation du cadre bâti et du patrimoine
Les luttes urbaines menées par les coopératives ainsi que l’organisation des locataires avec le soutien des comités logement et des groupes de ressources techniques ont contribué à préserver et à rénover des milliers de logements dans les quartiers populaires, des logements datant de plusieurs décennies et souvent jugés insalubres, assurant ainsi le maintien en place des locataires occupants à revenu modeste. Dans les années 1980, il en coûtait 60 000 $ par logement pour acquérir et rénover au complet les immeubles. Aujourd’hui, il faut compter au moins 416 000 $[19].
Les coopératives ont aussi contribué à préserver des immeubles institutionnels désaffectés en les transformant avec un nouveau statut. Plusieurs écoles ont ainsi trouvé une nouvelle vie, par exemple l’Académie des Saints-Anges dans le Plateau Mont-Royal à Montréal, rendue célèbre par l’œuvre de Michel Tremblay Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges. Une église du quartier Villeray de Montréal fait place à la coopérative La Scala. Et l’histoire industrielle du quartier Hochelaga-Maisonneuve se perpétue grâce à la coopérative Station no 1 qui conduit à la requalification d’un immeuble patrimonial datant des années 1900, la station de relais d’électricité no 1 qui desservait la ville de Montréal. Cette coopérative de 74 logements a été en outre lauréate du Prix de la mise en valeur du patrimoine de l’Opération patrimoine architectural de Montréal 2011 et est en voie d’être certifiée LEED CN[20]. À Québec, le couvent des Sœurs du Bon Pasteur, situé sur la colline parlementaire, est transformé en un complexe de logements regroupant sept coopératives d’habitation.
La consolidation du tissu social
Le mouvement coopératif a toujours été fier d’affirmer que les coopératives ne font pas qu’offrir des logements. Elles constituent également des communautés. Et dans cette perspective, la mixité occupe une place incontournable. Or, le terme « mixité » prend un sens différent selon qui l’utilise. Il pourrait désigner un milieu de vie où se côtoient familles, ainé.es, étudiants et étudiantes, ménages issus de la diversité culturelle, personnes en situation de handicap…, soit un environnement varié et vivant. L’expérience nous apprend pourtant que, pour les décideurs politiques, il s’agit plutôt d’une mixité socioéconomique qui se traduit par l’implantation de ménages mieux nantis dans des quartiers centraux, ce qui conduit à en chasser la population d’origine à revenu modeste et à alimenter l’embourgeoisement. En d’autres termes, la mixité tant vantée représente un rapport inégalitaire d’appropriation de l’espace qui mène au déplacement ou au remplacement des populations[21].
Les coopératives exercent un frein à ce courant. Selon la plus récente enquête quinquennale réalisée par la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) en 2022[22], 70 % des ménages habitant en coopérative ont un revenu inférieur à 40 000 $ alors que 20 % gagnent plus de 60 000 $. Les femmes y représentent une proportion de 66 %, ce qui n’est pas étonnant puisqu’elles constituent 80 % des cheffes de familles monoparentales qui, elles, représentent 19 % des ménages coopérants. Malgré leurs responsabilités familiales, les femmes siègent au conseil d’administration de leur coopérative à raison de 65 % ! Signe que les coopératives suivent l’évolution démographique de la société, 73 % des membres ont plus de 55 ans et 35 % ont 65 ans et plus. Enfin, le quart des membres habitent leur coopérative depuis au moins 20 ans. Et en dépit des critiques que l’on entend parfois à l’égard des coopératives, 82 % des membres s’en disent satisfaits.
Si l’accès à un loyer abordable représente la première motivation pour adhérer à une coopérative, il demeure que les valeurs coopératives et la possibilité de participer aux décisions concernant son milieu de vie constituent aussi des facteurs de motivation. S’y ajoute la recherche de la sécurité d’occupation en cette époque où les rénovictions[23] et les reprises de possession chassent de plus en plus les locataires de leur logement.
Plus encore, une étude réalisée pour le compte de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec, publiée en mai 2025, met en évidence que le fait de vivre dans des logements sociaux et communautaires produit :
des effets positifs sur les finances des ménages, leur participation sociale et la cohésion du tissu communautaire. En s’ancrant dans des milieux de vie plus stables, les résident·es développent des liens sociaux durables et s’impliquent davantage dans la vie collective. Le logement devient ainsi un vecteur d’émancipation, mais aussi un facteur préventif contre l’itinérance, la stigmatisation et l’exclusion. […] Sur le plan économique, les revenus fiscaux et parafiscaux et les économies pour l’État sur les programmes sociaux s’additionnent et surpassent les investissements annuels de la SHQ en logement communautaire pour dégager, au net, environ 162,1 M$ en 2023-2024 de fonds publics[24].
Il importe ici de faire ressortir une retombée positive des coopératives dans leur environnement, pourtant rarement citée, soit la sécurité. L’augmentation de la violence fait régulièrement les manchettes et a même été un enjeu électoral lors du dernier scrutin fédéral. Or, l’existence de coopératives d’habitation a pour effet de réduire la violence, la délinquance et les incivilités. Citons deux exemples.
À Laval, dans les années 1970, le secteur Bois-de-Boulogne de Pont-Viau avait une réputation peu enviable. Surnommé le Bronx, il était habité par une population particulièrement défavorisée et était associé aux problèmes sociaux habituels : commerce de la drogue, délinquance, gangs de rue, interventions policières… Il n’était pas rare que des locataires déguerpissent en pleine nuit sans payer leur loyer. Dans une entrevue accordée à l’autrice, Chantal Dubé, coordonnatrice de la cellule du logement social et communautaire relevant de la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval et membre de longue date de l’une des coopératives, témoigne de l’amélioration spectaculaire qu’a connue le quartier à la suite de la constitution des Résidences Bois-de-Boulogne. Celles-ci regroupent 13 coopératives réparties dans 56 immeubles comptant 450 logements occupés par plus de 1000 personnes.
Le propriétaire du complexe ayant fait faillite en 1982 en raison de la crise économique, la société de gestion qui a repris les immeubles pense à la formule coopérative qui prenait son envol à l’époque et elle convoque des réunions de locataires. Le projet coopératif prend forme et se concrétise. Depuis lors, le secteur a trouvé la paix et est désormais recherché. On peut attribuer cette transformation à la stabilité résidentielle et au sentiment d’appartenance, les deux éléments les plus souvent évoqués. Mais on cite aussi la possibilité de sanctions dans le cas de comportements allant à l’encontre de l’intérêt collectif. Le territoire appartient à tous et toutes, ce qui incite à s’en occuper et à le surveiller. Dans un contexte de cohabitation intergénérationnelle, voisins et voisines se connaissent, se côtoient et réalisent des activités ensemble en plus d’assumer la gestion de leur coopérative. Les enfants ont accès à des loisirs. La Ville a même ouvert un parc à proximité. Les Résidences Bois-de-Boulogne illustrent ainsi comment la prise en charge collective contribue au bien commun.
Le deuxième exemple concerne la Coopérative Village Cloverdale de Pierrefonds dont on a déjà parlé. On a mentionné que le secteur était réputé dans les années 1990 pour n’être pas fréquentable. Au moment où l’OSBL prend possession des immeubles à la suite de l’entente avec la SCHL, le taux de vacance s’élève à 30 % ! Louer les logements afin de rentabiliser le complexe s’est évidemment imposé comme une priorité. Or, le fait d’établir des critères de sélection et de choisir des membres, et non seulement des locataires, a grandement contribué à améliorer le tissu social. La coopérative s’est dotée en outre d’un comité de sécurité. En collaboration avec le poste de police du quartier, elle participe à un projet-pilote communautaire novateur, le programme de surveillance de quartier. L’éclairage est amélioré et on procède à des adaptations sur le plan architectural. Ainsi, les nouvelles constructions sont orientées de façon à faciliter l’observation du site. De son côté, l’Arrondissement, à la suite de représentations de la coopérative, rénove les terrains de jeu sur le site et investit dans différentes infrastructures, notamment l’installation d’un terrain de ballon-panier et de jeux d’eau. L’été, la coopérative embauche des animateurs et des animatrices qui organisent des loisirs pour les jeunes. Au bout du compte, le secteur Cloverdale, de ghetto dont on le traitait, est devenu « un joyau dans une couronne » selon les mots de l’ancien député provincial, Pierre Marsan[25]25.
L’enjeu des loyers
À combien s’élèvent les loyers dans les coopératives ? La réponse courte serait : 596 $ pour un logement de deux chambres à coucher[26]. Mais ce montant représente une moyenne. Il reste que les loyers se situent de façon générale en dessous du prix du marché privé. Ce qu’il faut retenir toutefois, c’est que, même si le fonctionnement général des coopératives est similaire, étant encadré par la Loi sur les coopératives et les sept principes internationaux de l’Alliance coopérative internationale (ACI), leur gestion financière diffère en fonction du programme gouvernemental dont elles relèvent. Depuis les années 1970, 15 programmes ont soutenu le développement des coopératives : 5 fédéraux, 8 québécois et 2 montréalais. Chacun de ces programmes a établi ses règles pour la fixation du loyer. Ces dernières années, différents facteurs influent également sur la détermination des loyers et exercent une pression à la hausse.
Le programme fédéral 56.1 en vigueur dans les années 1980 se basait sur les droits acquis, c’est-à-dire sur les loyers en vigueur avant la création de la coopérative. Les coopératives qui en ont bénéficié établissent généralement des loyers plus faibles, ceux-ci étant décidés chaque année par les membres en fonction des dépenses prévues, y compris une réserve d’entretien futur, dont le montant est déterminé par la SCHL. Or, comme les coûts dans l’industrie de la construction ont explosé, cette réserve se révèle dans bien des cas insuffisante lorsque des travaux majeurs s’imposent. Par exemple, ceux-ci ont été évalués à près de 30 000 $ par logement en 2017[27]. En conséquence, lorsqu’une coopérative souhaite obtenir un prêt ou négocier une nouvelle hypothèque pour réaliser des travaux, elle se voit souvent obligée par le bailleur de fonds d’augmenter considérablement ses loyers. Les ménages à revenu modeste qui ne bénéficient pas d’une subvention au loyer en subissent de plein fouet les effets. Malgré tout, les membres conservent une part d’autonomie pour ce qui est de fixer leurs loyers.
Cependant, ce n’est pas le cas pour les programmes du gouvernement du Québec, AccèsLogis, en vigueur de 1997 à 2022, et le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) qui lui a succédé. En vertu de ceux-ci, les loyers doivent se situer entre 75 % et 95 % du loyer médian du marché. Les coopératives qui ont pour mission d’offrir des logements sans but lucratif principalement à des ménages à revenu faible et modeste se retrouvent donc assujetties à un marché qui est hautement spéculatif. En effet, « … alors que l’indice des prix à la consommation repassait sous la barre de 4,5 % en 2023, la hausse générale des loyers était de près de 7,5 %. En 2024, l’indice des prix à la consommation atteignait 2,3 % au Québec, mais l’augmentation moyenne des loyers, elle, était de 6,3 %[28] ».
Devant ces loyers beaucoup plus élevés que ceux retrouvés dans les coopératives des premières générations, la Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ), réunie en assemblée annuelle en 2024, réclame de la Société d’habitation du Québec (SHQ) qu’elle pondère l’effet de l’augmentation démesurée du loyer médian du marché sur les coopératives. Le dossier est en cours. Par ailleurs, le PHAQ ne comporte pas de supplément au loyer intégré, comme c’était le cas d’AccèsLogis. Cédant aux pressions du milieu, la SHQ permet toutefois aux organismes de recourir au Programme de supplément au loyer Québec.
De son côté, le gouvernement fédéral a créé en 2023 un nouveau programme, le Programme de développement de coopératives d’habitation (PDCH), qui s’adresse en exclusivité à celles-ci, une décision saluée dans le réseau. Or, le programme fixe les loyers à 110 % du loyer médian du marché dans les immeubles construits après l’an 2000 dans la zone visée ! Et, contrairement aux programmes précédents, il ne comprend pas non plus de composante intrinsèque permettant d’ajuster le loyer au revenu.
Pourtant, la crise de la fin des conventions[29] aurait dû servir d’avertissement. Les accords avaient une durée équivalente à celle de l’hypothèque, en général de 30 ans. Or, alors que les conventions conclues dans les années 1980 approchaient de leur échéance, le gouvernement conservateur de Stephen Harper annonça en 2011 que les subventions accordées en vertu du programme 56.1 ne seraient pas renouvelées. Cela signifiait que, du jour au lendemain, les ménages à faible revenu verraient leur loyer augmenter de façon draconienne, parfois de 200 $ ou plus. Au Québec, cette menace pesait sur 125 500 ménages dans toutes les catégories de logements sociaux. Nous ignorons à ce jour combien d’entre eux ont été concrètement affectés. Certains se sont vus contraints de déménager et ont ainsi perdu leur logement social. D’autres ont absorbé la hausse, ne trouvant pas à se loger à meilleur coût dans le marché privé. Cette mesure a aussi ébranlé la gouvernance et mis en péril le maintien des infrastructures dans les coopératives[30]30. Finalement, le Parti libéral, élu en 2015, rétablira les subventions aux ménages à faible revenu, mais jusqu’en 2028 seulement, dans le cadre de l’Initiative fédérale de logement communautaire (IFLC). L’énoncé économique de l’automne 2024 du gouvernement Trudeau prolongea cette mesure jusqu’en 2033. Il reste à voir ce qu’il en adviendra avec le gouvernement de Mark Carney car le droit au logement n’est jamais totalement assuré.
Enfin, la fiscalité municipale exerce un fardeau de plus en plus lourd sur le budget des coopératives et, par conséquent, sur les loyers. Une étude de la FHCQ a mis en lumière que les taxes municipales pouvaient représenter jusqu’à 19 % de leurs dépenses[31]31. Rappelons que les coopératives sont d’abord apparues dans les quartiers ouvriers des villes, à proximité des services et des transports. Ce sont ces quartiers qui aujourd’hui font l’objet d’embourgeoisement et de spéculation immobilière. En conséquence, les valeurs augmentent… et les taxes aussi. Or, les coopératives ainsi que les OSBL, qui poursuivent une mission sociale et qui ne peuvent être revendus à profit, sont traités sur le plan fiscal de la même façon que le secteur privé. Ici encore, la solution passe par le gouvernement du Québec. Le mouvement coopératif ainsi que le réseau des OSBL font depuis des années des représentations afin que la Loi sur la fiscalité municipale soit modifiée pour y créer une catégorie d’immeubles spécifique aux coopératives et aux OSBL en habitation de façon à ce que les municipalités puissent leur appliquer un taux de taxation différent.
L’émergence de grandes coopératives
Le secteur coopératif en habitation affiche depuis peu un nouveau visage : celui de grandes coopératives. Pendant plusieurs décennies, les programmes, axés sur la rénovation des immeubles existants, ont favorisé le développement d’une multitude de projets de faibles dimensions. L’apparition de coopératives de 100 logements et plus a donc soulevé des débats dans le mouvement. On entend souvent dire qu’il ne s’agit pas de « vraies coopératives », puisqu’elles font appel à du personnel ou à des firmes de gestion externes, y compris les fédérations et les GRT, pour accomplir les tâches courantes d’administration et d’entretien.
Pourtant, certaines coopératives avaient tracé la voie. Pensons à l’emblématique Coopérative des Cantons, à Sherbrooke, souvent perçue dans ses débuts comme un OVNI dans l’environnement coopératif, et qui célèbre ses 50 ans d’existence cette année. Au fil du temps, tout en se prévalant des différents programmes gouvernementaux, elle a misé sur la valeur libre de dette – l’équité[32] – de ses immeubles pour procéder à de nouvelles acquisitions. Aujourd’hui, elle regroupe 416 logements répartis dans 65 immeubles[33]. C’est aussi par ce modèle de financement que la Coopérative Village Cloverdale est passée de 243 à 866 logements depuis 2004. À Pierrefonds, on trouve aussi la Coopérative Terrasse Soleil, fondée en 1983, qui compte 228 logements. Pour sa part, la Coopérative Place du Collège de Longueuil, la plus ancienne datant de 1969, compte 104 logements.
Il y a déjà une dizaine d’années que l’on parle des grandes coopératives. « La Coopérative Bassins du Havre (182 logements), la Coopérative Fusion verte (247 logements) et la Coopérative Bois Ellen (166 logements) sont de parfaits exemples de ce nouveau phénomène[34]. » Le resserrement des programmes de financement est l’un des facteurs qui ont mené à l’augmentation du nombre de logements afin de rentabiliser les projets. Le virage de la rénovation vers la construction neuve a également joué, surtout dans les quartiers qui font l’objet de vastes réaménagements, par exemple Griffintown et Bridge Bonaventure à Montréal. Les règlements d’inclusion, comme le Règlement pour une métropole mixte à Montréal, ont aussi influé sur la dimension des immeubles. Enfin, la densification des quartiers est encouragée par la loi 31[35], adoptée en 2024, qui permet aux municipalités de déroger à leur plan d’urbanisme pour autoriser le dépassement des hauteurs réglementaires.
La participation des membres demeure une préoccupation dans la plupart des coopératives. Elle incite à l’innovation, notamment lorsque la coopérative engage du personnel. Mais la participation ne se limite pas à l’exécution de tâches courantes sur le plan de l’administration et de l’entretien. La gestion continue de reposer sur le fonctionnement démocratique, et les membres conservent leur pouvoir de décision et d’orientation à l’intérieur du conseil d’administration et de divers comités. La décentralisation de la structure de gouvernance est mise de l’avant. De fait, en étant libéré·e·s de certaines tâches, les membres peuvent s’engager dans d’autres projets collectifs, par exemple l’agriculture urbaine, les activités sociales, le soutien auprès des jeunes, l’échange de services, l’engagement dans le mouvement et dans la communauté, etc. Il reste que l’organisation et l’évaluation de la participation sont plus compliquées dans une grande coopérative. Certains modèles existent et il y aurait lieu de les diffuser.
Les grandes coopératives présentent d’autres avantages. On souligne notamment les économies d’échelle qu’elles sont en mesure d’effectuer et le poids politique qu’elles peuvent exercer dans leur milieu. Sur le plan architectural, ces coopératives ont la possibilité de disposer d’une salle communautaire et d’autres installations collectives. Et des immeubles en hauteur possèdent nécessairement des ascenseurs, ce qui favorise l’accessibilité universelle et des milieux de vie intergénérationnels.
Certains enjeux actuels
Le ralentissement marqué du développement des coopératives est l’une des principales sources de préoccupation du mouvement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, les restrictions budgétaires ont porté un dur coup au programme AccèsLogis qui n’a connu aucune indexation à partir de 2009 et qui n’était plus adapté aux coûts du marché, notamment à ceux des terrains et de la construction, ni aux taux d’intérêt[36]. La difficulté d’obtenir du financement a aussi imposé des délais excessifs à la réalisation des projets. La Montagne verte a dû attendre 15 ans avant d’ouvrir ses portes et la Pointe amicale 14 ans ! Les choses ne se sont pas améliorées avec le remplacement du programme AccèsLogis par le Programme d’habitation abordable Québec. Les chiffres sont éloquents : lors de sa première année de mise en œuvre, en 2023, seulement quatre coopératives faisaient partie des 41 projets retenus et, l’année suivante, on n’en trouvait aucune ! Et le dernier budget du gouvernement du Québec ne comportait aucune somme pour le développement futur.
Comme le développement de coopératives repose sur des groupes porteurs formés de ménages qui aspirent à court terme à améliorer leurs conditions de logement, on ne peut s’attendre qu’en pleine crise du logement des ménages qui ont des besoins impérieux de logement[37] soient motivés à s’engager dans un projet qui pourrait prendre des années à se réaliser.
Même si les OSBL font aussi les frais de compressions budgétaires, ils n’en subissent pas les mêmes contrecoups que les coopératives. Dans leur cas, les groupes porteurs sont des organismes qui ont la capacité de « durer dans le temps ». Les OSBL s’adressent souvent aussi à ce qu’on nomme des populations à besoins particuliers et ils peuvent bénéficier de sources de financement plus diversifiées. Il n’est évidemment pas question ici de promouvoir une tenure[38] aux dépens d’une autre. Les besoins en logement sont multiples et exigent des formules adaptées. Quant au nouveau programme fédéral qui s’adresse spécifiquement aux coopératives, il doit toujours faire ses preuves.
Ici, on peut peut-être parler d’une occasion manquée dans l’histoire du mouvement, celle qui l’aurait doté des moyens d’assurer son propre développement, sans nécessairement exclure le soutien gouvernemental. Il s’agit de la possibilité de mutualiser l’équité des coopératives pour en faire un levier de développement. Une idée semblable avait d’ailleurs fait l’objet de débats dans les congrès qui ont marqué les débuts de ce qui est aujourd’hui la FHCQ[39], mais elle n’avait pas été retenue[40]. Elle a toutefois refait surface avec l’initiative PLANCHER lancée en 2022 par le Centre de transformation du logement communautaire, mais celle-ci est toujours en cours d’élaboration[41].
Enfin, un nouvel enjeu risque fort de susciter de vives discussions dans les chaumières coopératives cet automne. Il s’agit du projet de loi 111 modernisant la Loi sur les coopératives, dont un article en particulier va alimenter les débats. Il prévoit qu’un membre qui démissionne ou est exclu de sa coopérative n’a pas droit au maintien dans les lieux. En d’autres termes, un locataire qui perd son statut de membre voit automatiquement son bail prendre fin. Nul doute que cette clause va susciter de profondes réflexions sur la nature du droit au logement !
Conclusion
Souvent présentées comme des microsociétés, les coopératives d’habitation sont plongées dans les enjeux sociétaux actuels, notamment le vieillissement de la population, l’inclusion et le vivre-ensemble, le leadership des femmes, la transition écologique, le maintien de l’actif immobilier, la transformation numérique… Pour traiter de tels enjeux, les membres des coopératives doivent avoir des compétences particulières. C’est pourquoi il importe que les coopératives assurent une formation continue à leurs membres car on ne nait pas coopérant ou coopérante, on le devient. Les fédérations offrent d’ailleurs tout un éventail d’ateliers à la disposition des coopératives. La création d’intercoops de quartier, à l’image de celle du Plateau Mont-Royal, est également une avenue prometteuse qui favorise le partage des bonnes pratiques et l’apprentissage par les pair·e·s.
Le financement, même s’il n’a été traité que brièvement, constitue le nerf de la guerre pour le développement de nouvelles coopératives. Les élections prévues en 2026 au Québec seront l’occasion de porter haut et fort la voix des coopératives. Pour leur part, les élections municipales qui les auront précédées à l’automne 2025 fourniront également une tribune pour revendiquer des politiques et des mesures en faveur du logement social et communautaire.
Du côté fédéral, la récente campagne électorale n’a pas vraiment fait de place au logement social et communautaire dans les engagements électoraux. Et le gouvernement nouvellement élu a reporté à novembre 2025 l’adoption de son premier budget. Qu’adviendra-t-il alors de la Stratégie nationale sur le logement adoptée en 2017 ? Le maintien des subventions au loyer sera-t-il au moins assuré jusqu’en 2033, comme l’avait annoncé le gouvernement Trudeau ? Le mouvement coopératif ne devra pas attendre l’échéance de 2028 pour s’en assurer !
Par Louise Constantin, travailleuse et militante dans le secteur coopératif en habitation
- Alliance Coopérative Internationale, Année internationale des coopératives 2025 des Nations unies.↑
- Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), Les coopératives en chiffres. ↑
- Les groupes de ressources techniques (GRT) sont des entreprises d’économie sociale qui accompagnent des organismes ou des groupes de citoyens et de citoyennes dans le développement de projets immobiliers communautaires, soit en coopérative ou en organisme à but non lucratif. Voir <https://agrtq.qc.ca/>. ↑
- Carol Saucier, Le quotidien pluriel. Étude de coopératives d’habitation du Québec, Montréal, Centre interuniversitaire de recherche, d’information et d’enseignement sur les coopératives, 1992. ↑
- Ville de Montréal, Service de l’habitation, Répartition des logements sociaux et communautaires sur l’île de Montréal, 31 décembre 2021. ↑
- Citons le Directeur parlementaire du budget : « Nous entendons par “logement social” un logement destiné aux ménages à faible revenu et proposé à un loyer inférieur à celui du marché […] Le logement social est généralement un logement public (détenu par le gouvernement) ou un logement communautaire (détenu par un organisme à but non lucratif ou une coopérative). […] Cependant, ce ne sont pas tous les logements publics et communautaires qui constituent des logements sociaux ». Ben Segel-Brown, Évolution du parc de logements sociaux au Canada, Bureau du Directeur parlementaire du budget, 6 mars 2025. ↑
- Vincent Brousseau-Pouliot, « Un graphique qui dit tout : On a moins de logements sociaux qu’il y a 30 ans », La Presse, 5 mai 2025. ↑
- Institut de la statistique du Québec, Portrait des logements sociaux et abordables au Québec. ↑
- Ibid. ↑
- Par contre, Montréal prévoit que seulement 75 % des 20 % de logements hors marché de son territoire en 2050 soient du logement social. Voir Véronique Laflamme et François Saillant, « Sauvegarder les acquis du logement social », dans ce n° 34 des Nouveaux Cahiers du socialisme. ↑
- André Fortin, Histoire du Mouvement québécois des coopératives d’habitation au Québec, Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), 2022. ↑
- Budget fédéral du 25 février 1992 : « Le Programme de logement coopératif prendra fin immédiatement, permettant d’économiser encore $25 millions sur l’ensemble du cadre financier. Les 14,000 unités d’habitation déjà construites dans le cadre de ce programme continueront de bénéficier d’un soutien ». ↑
- FRAPRU, Quarante ans au Front. Seule la lutte paie !, mars 2019, p. 3. ↑
- Ibid. ↑
- François Saillant, Lutter pour un toit. Douze batailles pour le logement au Québec, Montréal, Écosociété, 2018, p. 57-67 et 84-98. ↑
- Voir l’article de Robert Cohen, « Milton Parc » dans ce n° 34 des Nouveaux Cahiers du socialisme. ↑
- François Saillant, 2018, op. cit., p. 69-83. ↑
- Louise Constantin, La Coopérative d’habitation Village Cloverdale. Le défi d’une grande coopérative, Montréal, Groupe CDH, 2014, et Marie-Noëlle Ducharme, La coopérative d’habitation Village Cloverdale, copublication Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), Les Cahiers du CRISES, ES1402, 2013. ↑
- Maxime Bergeron, « Construire pas cher, ça se peut ! », La Presse, 16 mai 2025, ↑
- Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ), « 10e anniversaire de la Coopérative Station No 1 », CITÉCOOP, vol. 8, n° 14, printemps 2021, p. 6-18. ↑
- Hélène Bélanger, avec la coll. de Philippe Cossette, « Revitalisation, gentrification et mixité sociale : quelle place pour le logement social ? », document préparé pour la table Habiter Ville-Marie, 2014. ↑
- Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), Enquête socioéconomique sur le profil des membres de coopératives d’habitation 2022. ↑
- Le terme rénoviction fait référence à une pratique selon laquelle un propriétaire évince illégalement une ou un locataire de son immeuble sous prétexte qu’il souhaite faire des rénovations. ↑
- Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), Le logement social et communautaire : un investissement qui rapporte au Québec. Étude des retombées socio-économiques des programmes de la Société d’habitation du Québec, 2025, p. 6. ↑
- 25 Louise Constantin, 2014, op. cit., p. 38-41. ↑
- CQCH, 2022, op. cit. ↑
- Louis-Philippe Myre, « Projets pilotes de mutualisation des travaux », CITÉCOOP, vol. 4, no 7, printemps 2017, p. 38-39. ↑
- AGRTQ, 2025, op. cit., p. 20. ↑
- Accords entre le gouvernement fédéral et les coopératives précisant le financement accordé en contrepartie d’une reddition de comptes de la part de celles-ci. ↑
- 30 Gabriel Plante, Enjeux et défis des coopératives d’habitation au Québec dans un contexte marqué par la fin des conventions fédérales, mémoire de maitrise en géographie, Université du Québec à Montréal, 2023. ↑
- 31 Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain, Pour l’attribution d’un statut fiscal différencié aux coopératives d’habitation, mémoire présenté à la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal, 2019, ↑
- NDLR. Le terme équité dans le sens de capital ou d’avoir est un anglicisme qui s’est inséré dans le domaine de l’habitation. Le terme fait référence à la valeur marchande libre de dette d’un immeuble. ↑
- Voir Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est, Historique, <https://www.chce.coop/historique>. ↑
- FHCQ, « Voir grand : La réalité des nouvelles coopératives », CITÉCOOP, vol. 3, no 6, automne 2016, p. 19-23. ↑
- Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, 2024. ↑
- FRAPRU, Un budget pour le logement social… et pour contrer la pénurie de logement, mémoire prébudgétaire, 2019, <https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/MemoirePreBudgetaire2019.pdf>. ↑
- « Un ménage a des besoins impérieux en matière de logement s’il vit dans un logement “non acceptable” et s’il devrait consacrer 30 % ou plus de son revenu total avant impôt pour payer le loyer médian d’un autre logement acceptable dans sa collectivité » : Vitrine statistique sur le développement durable du Québec, 30 avril 2025, <https://statistique.quebec.ca/vitrine/developpement-durable/strategie-2023-2028/participation-de-tous/besoins-imperieux-logement?onglet=faits-saillants-et-graphiques>. ↑
- NDLR. Dans le domaine de l’habitation, le terme « tenure » fait référence au mode d’occupation du logement par un ménage ou une personne, indiquant si l’occupant est propriétaire de son logement, locataire ou bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation. Il peut aussi désigner des formes spécifiques de logement, comme les HLM, les coopératives d’habitation ou les OSBL, qui représentent différentes tenures de logement social. ↑
- La Fédération des coopératives d’habitation de l’Île de Montréal (FECHIM) est devenue la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM), puis la Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ). ↑
- Louise Constantin, « Des débats fondateurs », CITÉCOOP, vol. 10, no 18, hiver 2023, p. 12-15. ↑
- Voir : Centre de transformation du logement communautaire, Le Fonds PLANCHER, première assemblée générale. ↑

Les HLM, une vieille recette qui loge son monde

Malgré l’image négative des HLM[1] véhiculée par les médias, principalement en raison de la vétusté de certains immeubles, un sondage réalisé en 2024 pour le compte de la Société d’habitation du Québec (SHQ) auprès de 4 449 locataires indiquait un taux global de satisfaction de 73 % à l’égard de leurs conditions de logement[2].
Ce portrait ira en s’améliorant d’ici 2028 puisqu’une grande opération de remise en état du parc des HLM est en cours, principalement grâce à des investissements de 2,2 milliards de dollars ($) à partir de l’Entente Canada-Québec sur le logement, signée en 2020[3].
Le parc de logements publics HLM est constitué de 74 000 logements répartis dans 660 municipalités sur l’ensemble du Québec, incluant le territoire du Nunavik. Ce parc constitue 56 % du nombre total de logements sociaux[4] au Québec. Le patrimoine collectif, évalué à plus de 15 milliards $, comprend plus de 2 800 ensembles immobiliers. Il comporte quatre volets :
- le volet public régulier qui touche trois types de clientèle, à savoir les ménages à faible revenu (61 424 ménages), les personnes âgées en perte d’autonomie (455 ménages) et les personnes vivant en situation de handicap (1 007 ménages) ;
- le volet privé COOP/OBNL qui rejoint 6 214 ménages à faible revenu ;
- le volet privé Autochtones urbains et ruraux qui permet à 1 906 ménages autochtones hors réserve de se loger ;
- le volet public Inuit qui touche 2 522 ménages.
Ces habitations permettent à des ménages à faible revenu[5] de bénéficier d’un logement dont le loyer équivaut à 25 % de leur revenu, plus certains frais. Elles sont financées dans le cadre d’ententes conclues en 1971, 1979 et 1986 entre la SHQ et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Au Québec, la majorité de ces immeubles est administrée par un réseau de 108 offices d’habitation, des sociétés paramunicipales qui sont gérées par des élu·e·s municipaux, des représentantes et représentants socioéconomiques et des représentantes et représentants élus par les locataires.
En plus d’offrir un loyer que les locataires sont capables de payer, l’attribution des HLM se fait sans discrimination grâce à une réglementation stricte et à la présence obligatoire des comités de sélection. Il n’est donc pas étonnant que plus de 30 000 ménages soient dûment inscrits sur les listes d’attente des offices d’habitation à travers le Québec.
Ainsi, le HLM constitue une formule méconnue, voire mal aimée, mais qui a fait ses preuves, notamment en démocratisant l’accès au logement et sa gouvernance, et qui dans le contexte actuel de crise, mériterait d’être revalorisée plutôt que sous-financée.
Les retombées positives du parc public de logements
À la fin de l’exercice financier 2023-2024, le déficit d’exploitation des HLM se chiffrait à 527,9 millions $. Le déficit d’exploitation est la partie du budget nécessaire pour opérer et entretenir les HLM qui n’est pas couverte par les revenus de location. Cette facture était assumée à 50 % par la SCHL, 40 % par la SHQ et 10 % par les municipalités. La SHQ évalue que le coût moyen du déficit d’exploitation pour un logement HLM est de 8 035 $ par année[6].
Afin d’évaluer le rapport coûts-bénéfices de son principal programme, la SHQ a confié à la firme AECOM le soin de produire une étude sur les impacts sociaux des HLM[7]. Cette étude a mis en évidence les impacts positifs suivants :
- augmentation du revenu disponible des ménages pour se procurer des biens essentiels (90 millions $ de plus par année pour des produits alimentaires ; 18 millions $ de plus pour des produits vestimentaires et 44 millions $ de plus en frais de transport) ;
- création d’un environnement propice à l’insertion sociale et professionnelle ;
- amélioration de la réussite scolaire des enfants grâce à la stabilité résidentielle ;
- réduction des inégalités socioéconomiques, déconcentration de la pauvreté dans les communautés ;
- réduction des dépenses publiques associées aux coûts de la pauvreté (103,3 millions $).
Plus récemment, en 2023, le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) a commandé à AVISEO Conseil une nouvelle évaluation des impacts économiques et sociaux des investissements en logements sociaux[8]. Celle-ci arrive sensiblement aux mêmes conclusions que l’étude précédente. Elle affirme que vivre en HLM réduit les risques d’insécurité alimentaire, diminue la prévalence du diabète et du stress et favorise une meilleure santé globale. Les chercheurs concluent également que l’existence des logements sociaux a contribué à réduire de 1,5 % à 7,6 % le taux de criminalité. Ainsi, les HLM ne sont certainement pas parfaits mais ils ont des retombées positives importantes, surtout quand on y maintient une certaine mixité.
Finalement, les études indiquent que la contribution financière de la SHQ est largement compensée par les économies réalisées en santé et en matière de réduction de la criminalité.
L’histoire du parc public de logements
Au moment où le gouvernement libéral de Mark Carney propose de relancer la construction de 500 000 logements par année au Canada en invoquant les années d’après-guerre dans ses publicités électorales, il est intéressant de faire un bref retour en arrière.
Le Programme de logement sans but lucratif public, communément appelé « programme HLM public » a pris naissance en 1949 sous le gouvernement de Louis Saint-Laurent. Essentiellement, il s’agissait pour le gouvernement fédéral de fournir rapidement des logements au 1,1 million de soldats canadiens démobilisés.
Programme longtemps considéré comme une intrusion dans le champ de compétence des provinces par le premier ministre québécois Maurice Duplessis, il aura fallu attendre jusqu’en 1967 pour voir naitre un premier projet, les Îlots Saint-Martin, à Montréal. Au Québec, le programme de HLM public a été mis sur pied au même moment que la création de la Société d’habitation du Québec pour donner suite à des modifications apportées à la Loi nationale sur l’habitation par le fédéral permettant aux provinces de conserver la propriété des logements publics.
Entre 1970 et 1994, la réalisation des HLM se chiffrait au minimum à 2 500 logements par année sous les gouvernements Bourassa et Lévesque. Toutefois, quand les municipalités ont utilisé le programme HLM pour compenser les démolitions liées à la rénovation urbaine, la construction a explosé jusqu’à 5 000 logements par année. On a vu cette augmentation à Montréal sous le maire Jean Drapeau entre 1970 et 1978 et à Québec sous le maire Gilles Lamontagne entre 1969 et 1977. Cet engouement pour ces réalisations présentées comme progressistes visait souvent des objectifs moins nobles.
On se souviendra des démolitions de logements occasionnées par le passage de l’autoroute 40 à Trois-Rivières, la construction de l’immeuble de Radio-Canada dans le Faubourg à m’lasse à Montréal et la Place du Portage sur l’île de Hull. On peut aussi penser aux 18 villages de la Gaspésie fermés lors des « opérations relocalisation ». Dans chaque cas, afin d’éviter les protestations, on a invité toutes les personnes déplacées à venir vivre dans des HLM tout neufs à un loyer très bas. C’est donc la réponse aux besoins de ces populations qui a donné naissance aux logements publics qui garantissaient un droit au logement pour tous et toutes[9].
Dans les années 1980, les politiques sociales se durcissant, le gouvernement du Québec décide de réserver l’accès aux HLM aux populations les plus démunies. Par des modifications aux règlements sur la fixation des loyers et sur les règles d’attribution des logements, on a progressivement chassé les ménages travailleurs, si bien que de 1978 à 1989, la proportion de locataires déclarant un revenu de travail est passée de 20 % à 7 %.
Pour planter un clou supplémentaire dans le concept du logement social accessible à tous et toutes, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney a annoncé en 1993 que le fédéral se retirait unilatéralement de la construction de nouveaux HLM. Il fermait ainsi ses programmes et renvoyait la responsabilité aux gouvernements provinciaux. La pénurie de logement social au pays venait de commencer.
Une lutte de tous les jours pour la démocratie
À la création de la SHQ en 1967, les législateurs ne prévoyaient pas accorder une place « aux bénéficiaires » dans la gouvernance et dans la gestion du logement public. Les pressions des locataires pour exercer un contrôle sur leurs conditions d’habitation ont, malgré tout, jalonné l’histoire des HLM au Québec. Ces actions locales, multiples et diversifiées, ont culminé en 1993 par la création de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ).
Le thème du premier congrès de la FLHLMQ, tenu en 1995, Une plus grande place pour les locataires, reflétait particulièrement bien l’esprit de l’époque. Les locataires rapportaient que certains administrateurs de HLM, heureusement pas tous, agissaient comme si les locataires étaient « des moins que rien ». La gestion était au mieux paternaliste, au pire très autoritaire. Les locataires de HLM revendiquaient alors leur place comme citoyens et citoyennes à part entière, capables d’assumer des responsabilités dans leur milieu de vie.
La Fédération a obtenu sa première victoire en avril 1998, après avoir déposé une pétition de 30 000 noms pour obtenir la reconnaissance du droit d’association en HLM et tenu la plus grosse manifestation de locataires de HLM – 700 personnes – devant l’Assemblée nationale et devant le congrès du Regroupement des offices d’habitation du Québec.
En 1998, après trente années d’existence, la SHQ a émis pour la première fois une directive demandant aux offices d’habitation de reconnaitre, de financer et de consulter les associations. À l’époque, on espère une « véritable révolution tranquille dans les HLM ». En donnant la chance aux locataires qui le souhaitent de s’impliquer activement dans la gestion de leur immeuble, on vise l’amélioration de la qualité des services. En favorisant cette implication, on contribue à donner une image plus positive du logement public aux yeux des politiciens et politiciennes et de la population. Finalement, les locataires qui s’engagent sont revalorisé·e·s et retrouvent ainsi leur dignité.
Malgré ce premier gain, des locataires constatent à la dure que des offices d’habitation font fi de la directive administrative car celle-ci n’a pas force de loi. La FLHLMQ repart donc à l’offensive pour que le droit d’association des locataires soit inscrit dans la Loi sur la Société d’habitation du Québec.
En avril 2002, sous l’impulsion de la ministre péquiste Louise Harel qui procède à des fusions municipales, la Loi sur la Société d’habitation du Québec est modifiée pour inclure deux nouveaux droits pour les locataires de HLM :
- l’obligation pour les offices d’habitation de reconnaitre toutes les associations qui se conforment aux directives de la SHQ en leur déléguant la gestion des salles communautaires et en leur octroyant une subvention de fonctionnement ;
- l’obligation pour tous les offices d’habitation de créer un comité consultatif de résidents et résidentes (CCR) composé de délégué·e·s des associations et des locataires siégeant au conseil d’administration de l’office.
L’objectif est de changer le visage des HLM. Comme on le souhaitait, cette reconnaissance légale de la participation des locataires a effectivement facilité la mobilisation citoyenne dans la gestion des HLM. Plus de 300 associations et 70 comités consultatifs de résidents et résidentes sont actifs à travers les 108 offices d’habitation du Québec. Malheureusement, près d’une quarantaine d’offices n’ont toujours pas de CCR et contreviennent à la loi de la SHQ. Il est plus facile d’obtenir un changement législatif que d’obtenir un véritable changement d’attitude sur le terrain. Encore aujourd’hui, beaucoup de personnes actives craignent de subir des représailles : peur de perdre leur logement, peur de déplaire aux administrateurs et administratrices.
Même si occuper les espaces démocratiques reste un défi, la participation citoyenne en HLM est exemplaire. Ainsi, les associations de locataires et les CCR sont au cœur de 73 % des pratiques d’action communautaire[10]. Dans les milieux pour personnes âgées ou pour les milieux famille, les associations organisent l’entraide, des cuisines collectives, des clubs de petits déjeuners, des repas communautaires, des bingos, etc. Contrairement à une croyance populaire qui peut laisser croire que les coopératives et les OBNL misent plus sur la participation citoyenne, des milliers de bénévoles font vivre un vaste réseau d’entraide et de solidarité dans le parc public de logements.
L’exemple de la bataille pour la rénovation du parc des HLM
En 2020, l’Entente Canada-Québec sur le logement (ECQL) met à la disposition de la SHQ un montant de 3,6 milliards $ de fonds fédéraux pour soutenir ses propres plans et priorités. Les locataires de HLM ont obtenu, par leur mobilisation, un gain historique quant aux sommes réservées à la rénovation et à la modernisation des leurs immeubles et de leurs logements.
Pendant quatre semaines, grâce à la complicité d’une douzaine d’associations et des CCR de Montréal, de Trois-Rivières, de Gatineau, de Joliette, etc., des dizaines de bannières « SVP, rénovez nos HLM ! » et « Mon HLM est coté E » ont décoré les balcons de gros immeubles et attiré l’attention des médias. À la veille d’une manifestation devant les bureaux de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest à Québec, le 23 novembre 2022, cette dernière annonce qu’elle allait utiliser 2,2 milliards $ de l’ECQL pour poursuivre la modernisation des HLM du Québec.
Cet exemple illustre bien le niveau d’organisation et de mobilisation qui existe dans le parc des HLM, notamment grâce aux structures de participation gagnées de dures luttes par ceux et celles qui y habitent.
Rappelons également que si le Québec est une des seules provinces au Canada où les loyers des HLM sont toujours à 25 % des revenus, c’est exclusivement grâce la mobilisation des locataires de HLM. En 1996, ils ont fait reculer le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard qui voulait augmenter de 25 % à 30 % de leur revenu le coût des loyers.
Ce gain bénéficie, encore de nos jours, aux locataires de HLM, mais également aux locataires des coopératives et des OBNL qui ont des suppléments au loyer (PSL)[11]. Depuis les années 2000, les PSL ont été financés par les gouvernements successifs pour permettre à certains locataires admissibles à un HLM de bénéficier d’une aide au loyer dans leur logement privé ou dans leur coopérative. L’attribution des PSL et le calcul de la subvention sont encadrés par les mêmes règlements. Ainsi, un gain pour les locataires de HLM est aussi un gain pour les bénéficiaires du PSL.
Les conséquences de l’abandon du programme HLM
Lorsque le gouvernement fédéral conservateur de Bryan Mulroney a annoncé, en février 1993, la fin de la construction de nouveaux HLM au Canada, nous ne soupçonnions pas toutes les conséquences à long terme de cette décision.
Trente ans plus tard, nous évaluons que si la construction avait continué au même rythme, nous aurions 80 000 HLM de plus au Québec[12]. Les 30 000 ménages actuellement inscrits sur les listes d’attente auraient un HLM et les 49 895 personnes qui consacrent plus de 80 % de leur revenu au paiement du loyer auraient la perspective d’avoir un HLM plutôt que de craindre l’itinérance[13].
Les délais d’attente beaucoup trop longs pour obtenir un logement – 70,8 mois à Montréal, 43,4 mois à Magog, 27,1 mois en l’Outaouais, 24,3 mois à Rimouski, etc.[14] – ont convaincu des dizaines de milliers de ménages en difficulté de l’inutilité de s’inscrire à la liste d’attente, même s’ils sont admissibles. Dans son dernier rapport, le Vérificateur général du Québec indique que jusqu’à 580 000 ménages[15] pourraient être admissibles à un HLM en raison des augmentations faramineuses de loyer des dernières années.
La pénurie de HLM a aussi influencé les politiques publiques quant à l’attribution des logements. D’un programme plutôt généraliste au début des années 1970, nous sommes passés, au début des années 1990, à un programme réservé aux seuls ménages ayant les plus faibles revenus et ayant souvent d’autres vulnérabilités.
Cette obligation de gérer la rareté a conduit les mieux intentionnés à sacrifier la mixité économique dans le parc public au profit d’objectifs plus pressants. Au début des années 2000, la FLHLMQ a mené campagne, en parallèle, pour obtenir des améliorations à la règlementation sur les loyers, pour favoriser le maintien des ménages ayant des revenus de travail au sein des HLM et pour exiger que les femmes victimes de violence conjugale aient un accès prioritaire aux HLM. Dans bien des villes, un HLM sur deux est ainsi octroyé à une femme victime de violence. Les HLM sont devenus, à raison, une alternative concrète pour fuir les féminicides tout en s’éloignant du modèle généraliste ouvert à tous et toutes.
Une étude récente sur les effets du logement social en fonction du profil des locataires et des modes de tenure[16] l’explique ainsi :
Il ne fait aucun doute que les HLM accueillent les personnes qui présentent le profil le plus défavorisé. Comme les locataires ne sont pas choisis par les Offices, mais plutôt sélectionnés sur la base de leur vulnérabilité, le processus d’admissibilité laisse peu de place à la discrimination. Il s’agit d’une caractéristique positive très importante des HLM, car elles sont souvent la seule option de logement permanent pour les personnes qui sont en grande difficulté.
En outre, les particularités du cadre bâti (c.-à-d. de grands ensembles à forte densité, surtout en milieu urbain), leur construction plus ancienne basée sur des « critères de modestie » (c.-à-d. faible insonorisation, laveuses et sécheuses partagées) et la concentration de personnes aux prises avec des difficultés psychosociales importantes en font des milieux propices à l’insécurité et aux conflits[17].
Sur le plan de la mobilité résidentielle, la rareté de la ressource empêche les locataires du parc public de pouvoir exercer leur liberté de choisir leur lieu d’habitation. Les déménagements sont quasiment impossibles. Les offices d’habitation peinent même à effectuer les transferts obligatoires pour cause de surpeuplement[18] ou pour des raisons urgentes de santé et de sécurité. Le surpeuplement, la promiscuité, le sentiment de ne pas pouvoir améliorer son sort deviennent des petites bombes à retardement dans certains ensembles immobiliers.
L’arrêt du développement des HLM a aussi contribué à invisibiliser les HLM qui, maintenant, souffrent de sous-financement chronique. L’entretien parfois négligé, le retard dans l’amélioration et la modernisation des immeubles ont causé et causent encore des problèmes de salubrité et de sécurité dans les HLM. En plus, les locataires vivent de la stigmatisation, portant parfois le double stigmate de l’aide sociale et du logement social.
Enfin, l’abandon du modèle HLM a aussi eu des impacts sur les autres tenures qui doivent jouer le rôle des HLM sans en avoir les moyens. Certains ménages en attente d’un HLM vont, par dépit, accepter de s’impliquer dans une coopérative d’habitation, même si, par exemple, ils n’ont aucun temps à consacrer à la gestion collective. C’est la gouvernance et la pérennité des coopératives qui en pâtissent.
Un nécessaire retour à un programme HLM
Le Canada et le Québec sont pris avec une importante crise de l’abordabilité des logements. Non seulement il manque des logements mais surtout, il manque des logements à un loyer décent. Le FRAPRU publiait en 2023 sa 8e édition du Dossier noir sur la pauvreté et le logement[19] à partir des données du dernier recensement. Les logements vacants sont rares, surtout quand le loyer est inférieur à 1 000 $. Il faut dire que les loyers augmentent à un rythme effréné[20]. Le taux d’effort[21] des locataires à faible revenu ne cesse d’augmenter. Une conclusion s’impose : « Dans ces circonstances, l’augmentation de l’offre sans considération aux prix des loyers représente une fausse solution. Les nouveaux logements privés contribuent à pousser les prix vers le haut tout en étant inaccessibles aux locataires à faible et modeste revenus qui sont les plus touchés par la crise[22] ».
Pour répondre aux besoins des personnes les plus fragilisées par la crise et les plus éloignées du marché locatif privé, il faut développer une offre de logements où les loyers sont à 25 % des revenus. C’est la meilleure utilisation possible que nous pouvons faire des 5 839 suppléments au loyer (PSL) qui dorment actuellement à la SHQ[23]. En juillet 2023, La Presse rapportait déjà que 40 millions $ de fonds publics n’étaient pas utilisés à cause de la difficulté d’attribuer le PSL en dehors du logement public et du logement communautaire[24].
Ensuite, la crise du logement entraine une augmentation de la discrimination dans l’accès au logement. Certains locataires sont discriminés en fonction de leur origine[25], d’autres de leur genre[26] ou même de leur orientation sexuelle[27]. En matière de discrimination, les familles avec enfants, et en particulier les femmes cheffes de famille monoparentale, témoignent régulièrement de la difficulté à trouver un logement puisque même les logements 5 ½ sont annoncés comme « idéal pour un couple sans enfant[28] ». L’antidote à la discrimination reste l’encadrement de l’attribution des logements par un règlement. Le gouvernement n’a ni le pouvoir ni la volonté d’imposer des règles d’attribution non discriminatoires aux locateurs privés. Il peut au mieux espérer que les propriétaires respectent la Charte des droits et libertés. L’expérience montre que malgré les messages et les enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la discrimination perdure dans le privé. À l’opposé, l’octroi de fonds publics permet l’ajout de conditions comme celle d’utiliser le règlement sur l’attribution qui est en vigueur dans les HLM.
Les embûches à la construction de logements sociaux ont été largement montrées du doigt pour justifier la difficulté de construire vite et bien afin de résorber la crise. Par exemple, le « pas dans ma cour » et le manque de terrains disponibles sont régulièrement mis de l’avant. Pourtant, les offices d’habitation et les municipalités possèdent plus de 2 800 ensembles immobiliers situés sur des terrains publics, parfois dans des endroits très stratégiques. Certains de ces ensembles pourraient être densifiés rapidement[29]. Puisque les conseils d’administration sont composés d’une majorité de représentantes et représentants des municipalités, il ne devrait pas être compliqué de réserver ces sites à la densification pour y développer plus de logements sociaux quand c’est possible.
Les offices d’habitation sont en train de finaliser un processus d’optimisation en fusionnant les plus petits offices. En janvier 2025, il y a 108 offices d’habitation contre 538 en 2017. Trente de ces offices sont aussi des centres de services régionaux qui assurent « l’ensemble des services permettant de suivre l’état des immeubles dont ils ont la responsabilité et d’y faire réaliser les travaux majeurs nécessaires avec les budgets de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM)[30] ». Il existe donc une infrastructure ancrée dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les villes qui a déjà l’expertise d’un entrepreneur et qui pourrait mutualiser les plans et devis, fidéliser des professionnels de la construction pour optimiser les coûts.
Finalement, on devrait tout de suite améliorer la recette en prévoyant dès le début la participation des locataires et des collectivités dans les projets à construire. Si la participation démocratique des locataires à la gestion a été une lutte de tous les jours, elle est maintenant bien ancrée et même enchâssée dans la loi de la SHQ. Elle sert même de source d’inspiration aux OBNL qui entament un processus de mutualisation et de regroupement.
Alors, même si cela semble tentant de vouloir « sortir de la boîte », la SHQ devrait plutôt miser sur ce qui fonctionne déjà et l’améliorer. En mai 2025, l’Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) publiait une étude[31] démontrant sans équivoque que les investissements dans la construction et l’adaptation de logements sociaux et communautaires avaient d’importants effets sociaux et économiques. Le président de l’AGRTQ, Ambroise Henry, déclarait lors du dévoilement de l’étude que « dans une chaîne, c’est le maillon le plus faible qu’il faut réparer si on ne veut pas que la chaîne brise ». Les locataires inscrits sur les listes d’attente des offices sont ce maillon à consolider. Un nouveau programme HLM qui ciblerait ces ménages aurait un effet domino sur l’ensemble des besoins en logement. Résorber la crise du logement ne rime donc pas avec une construction massive de tous les types de logements, mais plutôt une concentration des investissements publics vers des logements publics qui seront abordables dès le jour 1 et pour toujours !
Par Patricia Viannay et Robert Pilon, respectivement coordonnatrice et organisateur communautaire de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
- HLM : Habitations à loyer modique. ↑
- Cible recherche, Sondage auprès des personnes qui demeurent dans une habitation à loyer modique, 25 mars 2024. ↑
- Entente Canada-Québec sur le logement, signée conjointement par la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, 6 octobre 2020. ↑
- Institut de la statistique du Québec, Nombre de logements sociaux, communautaires et abordables, été 2025.↑
- 96 % des ménages avaient des revenus inférieurs au plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI) de logement selon le rapport d’évaluation du programme HLM produit par la SHQ en 2011. ↑
- Selon les états financiers 2022 à 2025 de la Société d’habitation du Québec. ↑
- AECOM, Étude sur les impacts sociaux des activités de la Société d’habitation du Québec, rapport final, juin 2013. ↑
- AVISEO Conseil, Impacts économiques et sociaux des investissements en logements sociaux, rapport final, avril 2023. ↑
- Voir également l’article de Louis Gaudreau, « La remarchandisation discrète du logement social dans le logement abordable et hors marché », et celui de François Saillant et Véronique Laflamme, « Sauvegarder les acquis du logement social » dans ce numéro 34 des NCS. ↑
- Paul Morin, François Aubry, Yves Vaillancourt, Les pratiques d’action communautaire en HLM. Inventaire analytique, LAREPPS-UQAM, 2007, p. 79. ↑
- Le programme de supplément au loyer (PSL) couvre la différence entre la part payable par le locataire (le 25 %) et le loyer convenu avec le propriétaire. ↑
- François Saillant, Dans la rue. Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec, Montréal, Écosociété, 2024. ↑
- FRAPRU, Dossier noir. Logement et pauvreté au Québec, 8e édition, septembre 2023, p. 4. ↑
- Société d’habitation du Québec, Liste d’attente des HLM au 31 décembre 2023. ↑
- Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2024-2025, mai 2025. ↑
- Dans le domaine de l’habitation, le terme « tenure » fait référence au mode d’occupation du logement par un ménage ou une personne, indiquant si l’occupant est propriétaire de son logement, locataire, ou bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation. Il peut aussi désigner des formes spécifiques de logement, comme les HLM, les coopératives d’habitation ou les OSBL, qui représentent différentes tenures de logement social. ↑
- Janie Houle, Caroline Adam, Hélène Bélanger, Louise Potvin, Emmanuelle Bédard, Paul Morin et Jean-Marc Fontan, Logement social et ses effets, Rapport final de recherche, Montréal, Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, Université du Québec à Montréal, septembre 2023, p. 26. ↑
- Dans le cadre de la révision de sa politique de transferts, l’Office municipal d’habitation de Montréal a présenté au CCR les besoins de transferts pour surpeuplement : en mai 2025, 800 demandes sont en attente, soit 45 % des demandes actives de changement de logement. ↑
- FRAPRU, Dossier noir. Logement et pauvreté au Québec, 8e édition, septembre 2023, p. 4.
- Ibid, p. 5. ↑
- Le taux d’effort est la portion du revenu brut d’un ménage qui est consacrée au paiement du loyer. ↑
- FRAPRU, Prioriser le logement social pour préserver l’abordabilité de la métropole, mémoire déposé à l’Office de consultation publique de Montréal dans le cadre des consultations publiques sur le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050, 20 septembre 2024. ↑
- Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2024-2025, mai 2025 ↑
- Isabelle Lucas, « Programme de supplément au loyer. Quarante millions inutilisés, faute de logements », La Presse, 26 juillet 2023. ↑
- Anne-Sophie Poiré, « Des locataires discriminés sur leur origine ». Journal de Montréal, 9 juillet 2021. ↑
- FRAPRU, Femmes et crise du logement : cri du cœur de regroupements de défense des droits des femmes et du logement, pour la mise en place de mesures structurantes, communiqué, 1er mars 2024. ↑
- Clément Lechat, « Le logement, nouveau combat des aîné·es LGBT+ », Pivot, 27 septembre 2023. ↑
- RCLALQ, Discrimination et logement. Voir le 1er juillet avec horreur, juin 2019, p. 4. ↑
- Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ), Rénover et densifier nos HLM, communiqué, 19 février 2024. ↑
- Site de la SHQ : <https://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/centres-de-services/tous-les-services/programmes/centres-de-services/pour-plus-dinformations/faq/centre-de-services>. ↑
- Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ), Le logement social et communautaire : un investissement qui rapporte au Québec, mai 2025, <https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/Etude-de-retombees-des-programmes-de-la-SHQ_v4.pdf> et <agrtq.qc.ca/2025/05/01/a-venir-le-13-mai-2025-lagrtq-devoile-les-resultats-dune-nouvelle-etude-sur-les-retombees-economiques-et-sociales-des-investissements-publics-en-habitation/>. ↑

La remarchandisation discrète du logement social dans le logement abordable et hors marché

L’article de Véronique Laflamme et de François Saillant publié dans ce numéro[1] retrace l’histoire récente du financement du logement que l’on voulait financièrement accessible, et qui devait répondre aux besoins que le secteur privé était à lui seul incapable de satisfaire. Ce type de logement a longtemps été associé au modèle du logement social qui a depuis laissé sa place à celui du logement abordable, et auquel s’est récemment ajouté celui du logement hors marché. L’autrice et l’auteur soulignent que cette évolution est source d’une grande confusion, puisque les différentes appellations que l’on emploie aujourd’hui presque indistinctement et qui peuvent facilement passer pour des synonymes traduisent en réalité une transformation discrète, mais profonde, dans l’orientation des politiques publiques de soutien au logement. Ainsi, loin de se résumer à une simple évolution terminologique, le passage du logement social au logement abordable et hors marché résulte, plus fondamentalement, du virage néolibéral entrepris par les différents paliers de gouvernement, à partir des années 1990, dans le but de redéfinir le rôle de l’État dans ce secteur d’activité au profit du marché. Ce changement a pour effet de fragiliser les avancées en matière de démarchandisation du logement que des luttes populaires étaient parvenues à faire intégrer au modèle du logement social.
Le logement social se démarque en effet des deux formes qui lui ont succédé par son plus faible degré d’exposition au marché et au capitalisme. Son remplacement par le logement abordable et hors marché a donc aussi remis à l’avant-plan la question ancienne de la place du marché dans la réponse aux problèmes dont il est lui-même la cause. D’une certaine manière et à différents degrés, ces deux nouvelles formes résidentielles marquent le retour des logiques marchandes et rentières dans un secteur d’activité dont on avait auparavant jugé nécessaire de les exclure et auxquelles l’État avait encore l’ambition d’offrir une alternative.
Le problème de la propriété rentière pour le capital
Le marché de l’habitation est depuis longtemps au cœur des débats concernant sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de la population. Ces débats ont gagné en importance au tournant du XXe siècle alors que les conditions de vie dans les villes industrielles étaient devenues un objet de préoccupation et d’insatisfaction grandissantes, au point où les pouvoirs publics, au départ récalcitrants, ont dû se résoudre à intervenir dans ce secteur d’activité[2]. Les gouvernements ont certes été poussés à agir par des luttes populaires, mais aussi par une mobilisation importante au sein de l’élite de l’époque qui se montrait de plus en plus critique à l’égard du laisser-faire qui avait prévalu jusque-là dans le marché de l’habitation. Cette élite ne mettait pas directement en cause le principe de l’intégration du logement au marché, mais plutôt la déconnexion de ce marché des besoins du capitalisme industriel qui était en plein essor. Si les gouvernements devaient intervenir, ils devaient le faire de manière à harmoniser le fonctionnement du marché résidentiel avec les exigences de l’économie capitaliste. Ce principe a contribué de manière importante à structurer le champ des politiques du logement et à circonscrire le rôle que les pouvoirs publics seront appelés à jouer dans ce secteur d’activité.
Au risque de simplifier un peu, la déconnexion dénoncée par la frange réformiste de la bourgeoisie de l’époque tenait au fait que le marché de l’habitation était composé d’une multitude de propriétaires qui protégeaient avant tout leurs intérêts personnels et qui ne contribuaient pas, ou très peu, à la croissance économique, puisque leurs revenus provenaient de leur seule capacité à prélever, sous forme de rente, une partie de la richesse créée par les travailleuses et travailleurs et par les entreprises qui louaient et faisaient usage de leurs immeubles. Les rentiers étaient ainsi accusés de se comporter en parasites se préoccupant davantage de maximiser leurs revenus que des conditions économiques globales qui pourtant faisaient leur fortune. Cela les incitait, par exemple, à mettre en marché des logements insalubres, précaires et mal adaptés à la reproduction de la main-d’œuvre industrielle, et à exiger des loyers sans considération pour la pression qu’ils pourraient exercer sur le niveau des salaires, et donc des profits. On reprochait aussi aux rentiers de spéculer sur la valeur des terrains. Cela pouvait les conduire à en faire un usage mal avisé et incompatible avec l’essor d’une véritable industrie de la construction résidentielle et avec le développement cohérent des villes, qui exigeaient tous deux davantage de prévisibilité et de coordination[3].
Ainsi, d’un point de vue proprement capitaliste, le principal problème du marché du logement relevait surtout de sa dimension rentière et des risques auxquels elle exposait l’économie et la société lorsqu’elle était laissée à elle-même et devenait sa propre raison d’être. Les premières politiques publiques résidentielles adoptées à partir des années 1940 s’attaqueront à ce problème en tentant de contenir les effets potentiellement nuisibles de la rente sans pour autant l’abolir. Le logement social fera partie des solutions proposées, mais de façon marginale, puisque comme nous le verrons, il comportait la possibilité d’une rupture trop importante avec la logique de la rente et du marché que l’on souhaitait néanmoins préserver. Les plus importantes politiques, encore à ce jour, viseront à mettre la rente au service du capital en soutenant la création de deux grands secteurs d’activité, soit la finance résidentielle (composée des banques et plus tard des fonds d’investissement immobilier) et la promotion immobilière. Ces deux secteurs d’activités, qui sont aujourd’hui des piliers du marché de l’habitation, ont donné naissance à une industrie de la construction, d’abord spécialisée dans les maisons unifamiliales de banlieue, au sein de laquelle la rente n’était plus un frein, mais un facteur d’expansion du capital[4]. Les gouvernements interviendront également dans le marché de la location résidentielle, où la rente demeure la forme dominante de revenu. Cette fois, leur objectif était d’encadrer les rapports rentiers en introduisant des limites juridiques au droit de propriété, comme le droit des locataires au maintien dans les lieux et le contrôle des augmentations de loyer. Ces limites, qui n’ont jamais été pleinement efficaces, encore moins depuis le début des années 2000, visaient néanmoins à éviter les conditions abusives que les rentiers imposaient aux locataires dans les villes dont l’économie reposait par ailleurs en grande partie sur une main-d’œuvre qui n’avait pas accès à la propriété[5].
Enfin, afin de répondre aux besoins des ménages que la nouvelle industrie et le marché ne parvenaient toujours pas à loger convenablement, le gouvernement fédéral a, tel que le réclamaient de nombreux groupes de la société civile, créé les premiers programmes de logements sociaux. Il faudra attendre la fin des années 1940 pour que soient lancés les premiers chantiers, et le début des années 1960 pour que ceux-ci gagnent en importance. Conçus comme une mesure résiduelle destinée à compléter l’offre résidentielle privée plutôt qu’à lui faire concurrence[6], les logements sociaux présentaient une réponse tout à fait différente aux problèmes de l’époque. Sans abolir les revenus de la propriété (la rente), ils en éliminaient la portion lucrative et en limitaient considérablement l’exposition au marché et au capital. Ils constituaient en ce sens une forme de logement démarchandisé.
À des degrés divers, on retrouvait dans les premières formules de logements sociaux quatre caractéristiques qui participaient de leur relative démarchandisation. Premièrement, ils étaient soustraits au régime dominant de la propriété privée. Ils étaient soit de propriété publique, dans le cas des HLM (habitations à loyer modique), ou communautaire, dans les cas des coopératives et des OBNL (organismes à but non lucratif), et n’avaient pas de vocation lucrative. Ils n’étaient pas non plus destinés à la revente. Deuxièmement, les logements sociaux devaient respecter la capacité de payer des ménages qui devaient y habiter. Pour ce faire, les loyers d’une bonne partie d’entre eux étaient établis à 25 % des revenus des locataires. La référence pour fixer le coût mensuel de ces logements ne devait donc plus être les prix en vigueur dans le marché de la location privée, mais le niveau des salaires ou des revenus[7]. Troisièmement, pour qu’une telle méthode de calcul des loyers soit viable, il fallait également que ces derniers soient relativement indépendants des coûts d’exploitation de l’immeuble. C’est pourquoi, comme c’est le cas dans les HLM aujourd’hui, il était prévu que l’État subventionnerait les déficits d’exploitation des immeubles dans l’éventualité où les revenus générés par les loyers ne suffiraient pas en à couvrir tous les frais d’entretien et de gestion. Cette mesure avait ainsi pour effet de diminuer l’exposition du logement social à l’évolution des prix dans l’industrie de la construction et à celle des taux d’intérêt exigés par les banques. Quatrièmement, le logement social se caractérisait également par la place qu’il accordait à la participation des locataires dans la gestion de leur immeuble. Dans le cas des HLM, cette participation n’a été obtenue qu’en 2002, à la suite d’une mobilisation de longue haleine soutenue par la Fédération des locataires de HLM du Québec[8]. Il n’en demeure pas moins qu’elle est devenue avec le temps un critère distinctif du logement social qui se démarque aussi du logement marchandisé par le fait qu’il n’est pas entièrement soumis à l’autorité d’un propriétaire unique, qu’il soit privé, public ou sans but lucratif.
Le virage vers le logement abordable
La fin des programmes fédéraux de logement social alors que s’amorçait l’offensive néolibérale au milieu des années 1990 et, plus récemment en 2022, la fin de la seule initiative provinciale en la matière (Accès-logis) ont pavé la voie à leur remplacement par des mesures de soutien au développement du logement dit « abordable ». La principale caractéristique du logement abordable est de rompre avec le principe du loyer démarchandisé calculé en fonction du revenu des locataires. Il lui substitue, en la généralisant, une méthode qui était déjà appliquée à une partie des logements coopératifs et communautaires et qui consiste à établir le loyer en fonction des médianes de marché[9]. Selon celle-ci, un logement est abordable lorsque son prix mensuel de location est légèrement inférieur au loyer médian du secteur où il se trouve[10]. Les seuils d’abordabilité se définissent désormais exclusivement en fonction des prix de marché et du niveau général de la rente. Si les loyers de marché augmentent, comme ce fut le cas au cours des dernières années, les critères d’abordabilité s’ajusteront également à la hausse, indépendamment du revenu des locataires et de leur capacité de payer. En vertu de ce principe, la mesure de l’abordabilité sera également différente d’un secteur géographique à l’autre. Ainsi, dans ce type de logement, le marché devient la référence et en établit la principale condition d’accès, comme dans le reste du secteur de l’habitation.
La généralisation de cette méthode de calcul des loyers au sein du logement abordable a rendu possibles deux autres mesures qui ont, elles aussi, eu pour conséquence d’exposer davantage le logement subventionné par l’État aux aléas du marché et des dynamiques rentières. Elle a d’abord permis de renforcer la tendance qui avait déjà cours consistant à confier aux organismes gestionnaires de logements l’entière responsabilité de leurs coûts d’exploitation, c’est-à-dire la totalité de leurs frais de gestion et de remboursement de leur dette, qui varient quant à eux en fonction du niveau des taux d’intérêt. Les projets de logements abordables deviennent alors plus vulnérables à l’évolution des prix dans l’industrie de la construction et aux exigences des institutions financières. Sans aide publique comparable à celle que l’on retrouve dans les HLM et qui permet de combler d’éventuels écarts entre les dépenses et les revenus, il devient effectivement plus difficile de résister aux loyers plus élevés et mieux ajustés aux tendances de marché autorisées par les programmes de logement abordable. D’ailleurs, constatant que les contraintes financières rencontrées par les promoteurs de logements abordables étaient de plus en plus importantes, en raison notamment de la hausse récente des taux d’intérêt, des coûts de construction et des terrains, le gouvernement du Québec a amendé son programme au printemps 2025 afin de rendre admissible au financement public une nouvelle catégorie de logements, les « logements intermédiaires abordables », dont les loyers peuvent atteindre 150 % des seuils d’abordabilité établis[11]. Un logement est alors considéré comme abordable même s’il se loue significativement plus cher que le prix de référence permettant d’établir son abordabilité. Les conditions de marché sont donc désormais le seul critère à prévaloir dans le calcul des loyers. Il ne s’agit plus de construire moins cher que le marché, mais de s’y adapter.
L’autre possibilité créée par le calcul des loyers en fonction du marché est celle de la participation du secteur privé au développement et à la gestion du logement abordable financé publiquement, et d’y introduire une dimension lucrative. Cette possibilité avait d’ailleurs été prévue dès la création de l’Initiative pour le logement abordable de 2001 et elle a par la suite été réaffirmée dans les autres programmes du même type, tant à l’échelle fédérale que provinciale. Cependant, les développeurs privés ont jusqu’ici été peu nombreux à répondre à l’appel.
En 2023, le gouvernement du Québec s’est alors tourné vers d’autres acteurs, des fonds d’investissement (le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN) et la Fédération des caisses Desjardins du Québec, afin qu’ils fournissent l’apport en capitaux privés recherché. Ces derniers se sont vu confier la gestion de 395 millions de dollars en subventions publiques, auxquels ils ajouteront de leurs propres fonds pour financer la construction de 3000 logements abordables, dont 2000 seront des logements locatifs (communautaires ou privés) et 1000 seront détenus en copropriétés (condos). Les ententes particulières que le gouvernement a conclues avec ces acteurs financiers prévoient non seulement qu’ils seront les gestionnaires des fonds publics investis dans la construction du logement abordable, mais aussi qu’ils seront responsables de leur attribution, c’est-à-dire de la sélection des projets et des promoteurs qui bénéficieront de ce financement, une tâche qui relevait jusqu’ici des pouvoirs publics. Il est difficile de chiffrer les bénéfices que les trois partenaires financiers du gouvernement tireront de ces ententes, car de telles informations ne sont pas rendues publiques. Il est donc aussi difficile d’en évaluer précisément les répercussions sur les loyers. Ces bénéfices seront cependant de deux ordres. D’une part, les deux fonds d’investissement et Desjardins obtiendront un rendement sur leurs investissements directs dans les projets financés. D’autre part, ils pourront également faire fructifier pour leur propre compte les fonds publics administrés pour l’État québécois, avant qu’ils ne soient distribués aux porteurs des projets retenus. Sans doute s’agit-il d’une façon de compenser les rendements moindres qu’ils réaliseront avec ces investissements qui visent à loger des clientèles moins rentables.
Le logement hors marché
Au cours des dernières années, l’appellation « logement hors marché » s’est ajoutée au lexique des solutions à la crise du marché de l’habitation et elle gagne en popularité. Tout comme le qualificatif « abordable », sa signification relève à priori d’une quasi-évidence selon laquelle il s’agirait d’un type de logement soustrait au marché, et donc à son influence. Cependant, les initiatives auxquelles le logement hors marché est associé sont plus ambigües quant à la rupture qu’elles opèrent véritablement avec ce dernier. À certains égards, tel qu’il est aujourd’hui promu, le logement hors marché est aussi marchandisé, sinon plus, que le logement abordable.
On doit la popularité de l’expression « hors marché » à des acteurs qui sont aux premières loges de la crise du logement et qui, constatant l’insuffisance des programmes publics actuels pour y répondre, proposent une « troisième voie » qui s’ajouterait au logement social et abordable, tout en étant moins dépendante du financement provenant des gouvernements fédéral et provincial. Les grandes villes comme Montréal et Longueuil, où les prix ont atteint des niveaux si élevés qu’il devient difficile d’y construire des logements abordables, même selon les critères des programmes actuels, sont d’importantes promotrices de cette alternative. Par exemple, la Ville de Montréal propose d’utiliser le contrôle dont elle dispose sur le domaine foncier pour retirer des terrains du marché et pour les mettre au service de sociétés paramunicipales ou d’entreprises d’économie sociale afin qu’elles y construisent du logement qui, à défaut de réunir toutes les caractéristiques du logement social ou abordable – bien que cela ne soit pas exclu –, sera soustrait au régime de la propriété privée. Pour l’instant, ce modèle ne semble pas non plus prévoir de mécanisme de gouvernance démocratique ou de participation des locataires[12]. Ainsi, le logement hors marché se caractériserait d’abord et avant tout par le mode sous lequel il est détenu et dont est exclue la possibilité que des individus puissent en tirer un profit personnel. Selon toute vraisemblance, c’est même à cette seule caractéristique que pourrait se résumer le caractère « non marchand » de ce type d’habitation.
Les logements sociaux et abordables communautaires sont de fait des logements hors marché, mais la nouveauté de cette approche et l’intérêt de la distinguer des deux autres tiennent à la possibilité de construire des unités résidentielles à but non lucratif sans nécessairement recourir autant qu’auparavant au financement provenant des paliers fédéral et provincial pour compléter le montage financier des projets. Depuis peu, cette alternative est activement portée par des entreprises d’économie sociale spécialisées dans la construction ou l’acquisition de logements à but non lucratif qui, pour limiter leur dépendance à l’égard des fonds et des programmes publics, proposent de libérer la valeur des immeubles dont ils sont eux-mêmes propriétaires ou qui appartiennent à un ensemble de coopératives et d’OBNL – ce que l’on appelle aussi l’équité[13] –, afin de s’en servir comme levier d’investissement. Cette pratique est déjà bien établie dans le domaine de la promotion immobilière privée. Elle permet de convertir le potentiel de rente inutilisé des immeubles, celui que l’on en tirerait s’ils avaient pour vocation d’être commercialisés, en prêt pour financer la construction ou l’achat de nouveaux bâtiments. En d’autres termes, elle consiste à transformer en capacité de financement par emprunt la valeur marchande supposée d’un immeuble qui en principe ne devrait pas exister, puisque celui-ci n’a pas été conçu pour être vendu. Ainsi, tout en demeurant à l’intérieur du cadre de la propriété à but non lucratif, le logement existant peut donc être traité comme un actif porteur d’une valeur qui pourra être mise à contribution dans l’accroissement de la part du logement soustrait à la propriété privée. Selon les promoteurs de cette approche, une fois libéré, ce potentiel de développement serait d’autant plus important que les actifs immobiliers communautaires continueraient à gagner en valeur. En tirant profit de cette plus-value, il serait alors possible d’assurer au logement hors marché les conditions autonomes de son expansion[14].
Le retour du marché dans le logement social et ses effets négatifs
L’évolution du logement social vers le logement abordable et hors marché marque une transformation importante. Celle-ci se traduit par une reconnexion avec les dynamiques marchandes et rentières dont on avait pourtant souhaité s’éloigner, parce qu’elles étaient jugées incompatibles non seulement avec la reconnaissance du droit à un logement accessible, mais aussi, voire surtout, avec la croissance du capitalisme. Le retour en force de la logique du marché ne peut pas uniquement s’expliquer par l’adhésion aveugle des décideurs aux thèses néolibérales. Il est aussi indissociable de l’essor de la finance résidentielle et de la promotion immobilière qui, nous l’avons vu, ont effectivement proposé une réponse au problème que la propriété rentière présentait pour l’économie en favorisant – ou du moins en tentant de le faire – une meilleure harmonisation des pratiques immobilières avec les exigences du capitalisme. Grâce au soutien dont ils ont bénéficié de la part des pouvoirs publics, les banques, les fonds d’investissement et les entreprises de promotion immobilière sont aujourd’hui des acteurs de premier plan du marché de l’habitation et doivent leur succès à leur capacité à intégrer la rente à leur modèle d’affaires, à en faire un outil de développement et de croissance, plutôt qu’une nuisance à contrôler. On peut alors faire l’hypothèse que c’est dans le contexte de la consolidation et de la diffusion des pratiques de ces acteurs, pratiques qui étaient marginales il y a quelques décennies encore, qu’il est désormais plus facile d’envisager la production du logement à coût moindre autrement que sous la forme démarchandisée du logement social. On se tourne notamment vers le secteur financier pour investir dans le logement abordable, et en important au domaine du logement hors marché les pratiques de valorisation des actifs éprouvées par les entreprises de promotion immobilière.
Le degré de marchandisation et d’exposition aux processus rentiers des différentes formes de logement destinées aux personnes mal logées n’est pas seulement un enjeu conceptuel. Cette préoccupation ne relève pas non plus du simple attachement à un passé exagérément idéalisé. Elle soulève des questions très actuelles et concrètes. La première, qui n’est certes pas nouvelle, mais qui se manifeste avec plus d’acuité dans le présent contexte de crise, est celle de la déconnexion croissante entre la production du logement et les besoins auxquels il est censé répondre. Cette rupture s’observe avant tout sur le niveau des loyers qui, en étant déterminés par les conditions de marché – les coûts médians de location, de construction, d’exploitation ou d’acquisition des terrains –, tendent à s’éloigner du revenu disponible des ménages. De façon plus large, ce changement entraine une redéfinition du logement destiné aux personnes mal logées et de la mission des organismes qui le construisent. Ces derniers sont peut-être plus indépendants de l’État et même du droit de regard que les locataires pouvaient exercer dans les logements sociaux, mais ils le sont beaucoup moins à l’égard du marché qui influence de manière importante le type de logement à développer et les catégories de ménages auxquelles il devrait s’adresser. À terme, la réactivation de la rente dans le champ du logement abordable et sans but lucratif comporte le même risque que dans le secteur privé, c’est-à-dire qu’elle en vienne à se suffire à elle-même et à constituer le principal moteur du développement.
L’exposition plus grande au marché comporte aussi certains risques pour la viabilité de ces initiatives ainsi que pour la pérennité du logement financièrement accessible dans son ensemble. Il y a d’abord celui de saper ses propres bases, c’est-à-dire de nourrir la hausse des valeurs foncières, qui représente déjà un obstacle, avec pour conséquence de rendre encore plus coûteux le développement ultérieur de logements abordables et encore plus inadaptés les programmes publics créés pour le financer. La tendance actuelle au financement des projets par effet de levier qui misent sur la valeur de « l’actif » que représente le logement social et communautaire existant n’est pas non plus sans risque. Elle repose sur le pari que les immeubles gagneront en valeur dans le temps, ou du moins qu’ils la conserveront, ce qui est loin d’être assuré. S’il advenait qu’une crise immobilière, comme celle des années 1990 ou comme celle que les États-Unis ont connue à partir de 2008, ait pour effet de faire fondre drastiquement les valeurs immobilières, ce serait alors l’ensemble du parc de logements donné en garantie pour financer le développement du logement hors marché qui s’en trouverait mis à mal[15].
On peut enfin se préoccuper du fait que le processus de remarchandisation du logement à coût moindre semble faire l’objet d’une certaine normalisation dans les milieux où, il y a peu de temps encore, il aurait été accueilli de manière plus critique. Il est vrai que la conjoncture actuelle laisse peu de raisons d’espérer à court terme un changement d’orientation significatif dans les politiques publiques. On peut comprendre que, dans ce contexte, le logement abordable et hors marché puisse apparaitre comme un moindre mal et comme une alternative valant mieux qu’une absence totale de développement, d’autant plus qu’une telle éventualité signifierait probablement pour les organismes spécialisés dans la construction de logements à but non lucratif de cesser leurs activités. Cependant, aussi compréhensible soit-il, ce repli pragmatique comporte aussi le risque de détourner une partie grandissante du secteur du logement à but non lucratif de la mobilisation pour la démarchandisation du logement, celle-là même qui lui a donné naissance, et ainsi de rendre ce projet encore plus inaccessible. Les avancées des dernières décennies qui s’étaient concrétisées dans le logement social n’ont certes pas été à la hauteur des attentes et des besoins, mais si elles ont été réalisées et qu’une partie des élites économiques et politiques ont fini par se ranger derrière l’idée d’une démarchandisation du logement, même partielle et circonscrite, c’est d’abord parce qu’elle a fait l’objet d’une mobilisation large.
Par Louis Gaudreau, professeur à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
- François Saillant et Véronique Laflamme, « Sauvegarder les acquis du logement social » dans ce n° 34 des Nouveaux Cahiers du socialisme. ↑
- John C. Bacher, Keeping to the Marketplace. The Evolution of Canadian Housing Policy, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1993. ↑
- Michael Doucet et John C. Weaver, Housing the North American City, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1991 ; Marc Allan Weiss, The Rise of the Community Builders. The American Real Estate Industry and Urban Land Planning, Frederick (MD), Beard Books, 1987. Voir aussi le documentaire Horizon 2000 produit par le Service d’urbanisme de la Ville de Montréal en 1967. ↑
- Depuis une trentaine d’années, cette industrie a aussi investi le marché des grandes tours (de condos ou locatives). Pour plus de précisions à ce sujet, voir Louis Gaudreau, Marc-André Houle et Gabriel Fauveaud, « L’action des promoteurs immobiliers dans le processus de gentrification dans le Sud-Ouest de Montréal », Recherches sociographiques, vol. 62, n° 1, 2021. ↑
- C’est en ces termes qu’en 1973, le ministre Jérôme Choquette a présenté devant l’Assemblée nationale du Québec son projet de loi concernant le louage des choses : Assemblée nationale du Québec. Journal des débats, vol. 14, 1re session, 30e législature, Projet de loi no 2, deuxième lecture, 1973, p. 615. ↑
- Bacher, 1993, op. cit. ; Greg Suttor, Still Renovating. A History of Canadian Social Housing Policy, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2016 ; Lynn Hannley, « Les habitations de mauvaise qualité », dans John R. Miron (dir.), Habitation et milieu de vie. Évolution du logement au Canada, 1945 à 1986, Montréal, Ottawa, Mc Gill-Queen’s University Press, 1994, p. 229-247. ↑
- On peut alors parler d’une démarchandisation partielle, puisqu’il s’agissait de limiter l’influence du marché de l’habitation sur le prix des logements au profit d’une meilleure harmonisation avec les besoins d’un autre marché, celui du travail. ↑
- Voir l’article de Patricia Viannay et Robert Pilon, « Les HLM, une vieille recette qui loge son monde » dans ce numéro 34 des Nouveaux Cahiers du socialisme. ↑
- Il existe un autre programme provincial, le Programme de suppléments au loyer, qui en couvrant la différence entre la part payable par le locataire et le loyer convenu avec le propriétaire permet d’offrir des logements loués à 25 % du revenu des locataires dans les projets résidentiels financés par le Programme d’habitation abordable Québec. Il ne s’agit cependant pas d’une exigence, comme c’était le cas des derniers programmes de logements sociaux comme Accès-logis. Les développeurs ont le choix d’en faire la demande ou non. ↑
- Les premiers programmes établissaient généralement le seuil d’abordabilité autour de 85 % du loyer médian. ↑
- Isabelle Porter, « Québec financera des logements abordables… plus cher », Le Devoir, 5 juin 2025. ↑
- Ville de Montréal, Ce que fait la Ville en matière d’habitation, 4 août 2025. ↑
- Le terme équité dans le sens de capital ou d’avoir est un anglicisme qui s’est inséré dans le domaine de l’habitation. Le terme est parfois traduit par « avoir propre » qui fait référence à la valeur marchande libre de dette d’un immeuble. ↑
- Ce projet est évidemment de nature à plaire au gouvernement caquiste actuel. La ministre de l’Habitation de l’époque, France-Élaine Duranceau, l’a d’ailleurs accueilli très positivement, le qualifiant de « musique à [ses] oreilles ». Marie-Claude Morin, « Logement social : pour les coopératives, l’union fait la force », Radio-Canada, 8 mai 2025. ↑
- Ce scénario est d’ailleurs loin d’être fictif. La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) l’a appris à ses dépens alors que les immeubles locatifs qu’elle achetait à des propriétaires privés en ayant recours à cet effet de levier ont perdu, à l’occasion de la crise immobilière des années 1990, plus de 40 % de leur valeur. ↑

Sauvegarder les acquis du logement social

Peu utilisée jusqu’à récemment au Québec, la notion de logement hors marché est de plus en plus présente dans les discours de certains organismes communautaires et publics du milieu de l’habitation, ainsi que dans ceux de villes comme Montréal, Québec, Longueuil et Laval. Elle tend même à y remplacer l’expression « logement social et communautaire[2] » largement utilisée jusque-là. S’agit-il uniquement d’un changement de vocabulaire ? N’assistons-nous pas plutôt à une transformation profonde des approches en habitation, qui occultent à la fois leur mission sociale et le rôle que doivent y jouer les communautés ?
Le tournant du logement abordable
Pour bien comprendre cette transformation, il faut revenir en arrière. En 2001, le gouvernement libéral de Jean Chrétien, qui sept ans plus tôt avait officialisé le retrait complet du fédéral du financement de nouveaux logements sociaux[3], prend le tournant du « logement abordable ». Cette formule, volontairement ambigüe, ouvre la porte à toutes sortes d’utilisations de la part des provinces et des territoires, dont l’octroi de subventions au marché privé. La seule exigence est alors d’offrir, au moins pendant un certain temps, des logements dont le loyer est inférieur à celui du marché. De plus, le niveau de financement accordé par l’Initiative de logement abordable, créée expressément à cette fin, est nettement insuffisant pour générer des loyers réellement accessibles financièrement.
Pour utiliser les fonds fédéraux ainsi rendus disponibles, le gouvernement du Québec, alors dirigé par le Parti québécois, échafaude un nouveau programme baptisé Logement abordable Québec (LAQ). Même s’il comprend un volet autorisant des subventions à des promoteurs privés, il est principalement axé sur le financement de logements sociaux et communautaires[4]. Il vient, pendant quelques années, s’ajouter à AccèsLogis, créé en 1997 à la suite des pressions exercées par le milieu communautaire et des municipalités comme Montréal. Ensuite, tous les fonds fédéraux passent par ce dernier programme. Budget après budget, jusqu’en 2019, le gouvernement ajoute ses propres investissements à AccèsLogis, sans toutefois annoncer de plan de financement sur cinq ans, alors qu’il l’avait fait à deux reprises dans les premières années du programme.
Le Québec garde donc le cap sur le logement social, sous la forme de coopératives et d’OSBL d’habitation. La construction de HLM ne reprendra par contre jamais à la suite du désengagement d’Ottawa, alors qu’entre 35 000 et 40 000 ménages se retrouvent chaque année sur les listes d’attente des offices d’habitation, lesquels gèrent les HLM. Tout au plus, le gouvernement québécois permettra-t-il à ces derniers de présenter des projets de logements publics dans ses programmes. Ils ne sont toutefois pas entièrement destinés à des ménages à faible revenu, contrairement à la situation dans les HLM, où les locataires consacrent au loyer au plus 25 % de leur revenu. C’est pourquoi le FRAPRU et d’autres regroupements de défense collective des droits continuent à réclamer le retour de cette formule.
Malgré cette prédominance du logement social au Québec[5], le concept de logement abordable contamine désormais les interventions des gouvernements et des municipalités. Il jette aussi de la confusion dans la couverture médiatique du domaine de l’habitation, le thème « abordable » étant souvent utilisé à tort et à travers, y compris pour qualifier des logements à caractère clairement social. De plus, même dans le milieu communautaire de l’habitation, on tend à l’utiliser pour désigner des logements sociaux dont les locataires ne sont pas admissibles à un supplément au loyer, ce qui conduit à une dilution de la notion même de logement social.
L’adoption en 2017 de la Stratégie nationale sur le logement par le gouvernement libéral de Justin Trudeau pousse le bouchon encore plus loin. Les principales initiatives fédérales sont axées sur la construction massive de logements qualifiés d’abordables, ce qui n’empêche pas une bonne partie des réalisations financées sur le marché privé de se louer à des prix exorbitants alors qu’elles sont appuyées par des dizaines de milliards de dollars ($) en subventions et en prêts gouvernementaux. Les faibles exigences d’Ottawa et ses différentes définitions de l’abordabilité encouragent ouvertement cette pratique.
L’arrivée au pouvoir à Québec à l’automne 2018 de la Coalition avenir Québec (CAQ) sonne pour sa part le glas d’AccèsLogis qui bat de l’aile depuis quelques années en raison d’un sous-financement chronique et de l’indifférence des gouvernements successifs face aux améliorations demandées par le milieu. Durant les trois premières années de son premier mandat, le gouvernement de François Legault se contente de livrer les logements déjà annoncés antérieurement, refusant d’en ajouter de nouveaux[6], ce qui bloque l’émergence de projets de logements sociaux et communautaires qui auraient pourtant été nécessaires, compte tenu de la détérioration de la situation de l’habitation. Il préfère nier l’existence de la pénurie de logements locatifs qui s’aggrave pourtant année après année depuis 2018.
Le ton change à partir de 2022. Legault reconnait enfin l’existence d’une « crise du logement », sans considérer que ce sont les locataires et non le marché privé de l’habitation qui la vivent[7] et qui en subissent les autres dimensions : flambée des loyers, montée de pratiques spéculatives entrainant des évictions en nombre record, accroissement de la discrimination et de l’itinérance, etc. Sa nouvelle ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, officialise la disparition d’AccèsLogis et son remplacement par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ).
Ce programme ouvre le financement public, destiné auparavant au logement social, au marché privé pour lequel il semble conçu sur mesure. Après Ottawa, c’est au tour de Québec de prendre le virage du logement abordable.
Or, le PHAQ est tellement peu fonctionnel qu’il doit rapidement être complété par un appel à d’autres joueurs. C’est ainsi que le gouvernement Legault se tourne dans un premier temps vers des fonds fiscalisés : Fonds de solidarité FTQ, Mouvement Desjardins et Fondaction (CSN) – dans ce dernier cas, pour l’accès à la propriété par la voie coopérative. Par la suite, il instaure de nouveaux partenariats dont un avec la Fondation Luc Maurice, une société philanthropique mise sur pied par celui qui a fait fortune dans les résidences pour ainé·e·s. L’octroi des fonds publics par décrets gouvernementaux, puis la reconnaissance récente du statut de « développeur qualifié[8] » visant, selon les termes mêmes de la Société d’habitation du Québec, à « diversifier les interventions de la SHQ, réduire les coûts d’intervention dans le processus de réalisation et réduire les délais de mise en chantier de logements », viennent compléter le tout en 2024.
Tout cela explique que beaucoup plus de projets hors programmes soient actuellement en réalisation que de projets financés par l’entremise du PHAQ, et ce, même si Ottawa a injecté 992 millions $ pour l’accélération de la construction de logements et que ces sommes, tout comme celles équivalentes investies par Québec, auraient pu être utilisées à cette dernière fin.
AccèsLogis et le PHAQ
AccèsLogis
Mis sur pied par le gouvernement du Parti québécois en 1997 afin de financer le développement de coopératives, de logements gérés par des OSBL d’habitation et, plus tard, de logements publics gérés par des offices d’habitation. Destiné aux ménages à revenu faible et modeste, dont une partie est de la classe moyenne inférieure, ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation, il inclut du supplément au loyer pour celles et ceux qui ont le moins de moyens financiers. Le gouvernement caquiste a annoncé sa disparition en février 2023, mais les logements qui étaient alors en développement continuent d’être livrés. AccèsLogis a jusqu’ici permis la réalisation de quelque 41 000 logements sociaux.
Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ)
Créé par le gouvernement caquiste de François Legault dans le but de répondre aux mêmes besoins qu’AccèsLogis, tout en accélérant la réalisation de logements locatifs abordables, il est ouvert aussi bien aux promoteurs du marché privé qu’aux coopératives, OSBL et offices d’habitation. Il est moins complet qu’AccèsLogis puisqu’il ne prévoit pas une proportion minimale de logements dédiés à des ménages à faible revenu. Il n’inclut d’ailleurs pas de suppléments au loyer destinés à cette fin. De plus, il n’accorde pas de subventions de démarrage qui faciliteraient le développement des projets communautaires sans but lucratif. Il mise aussi sur des projets plus gros, ce qui défavorise les projets de coopératives et d’OSBL d’habitation ancrés dans leurs milieux, sans prévoir des balises minimales de participation des locataires comme c’était le cas dans AccèsLogis.
Par ailleurs, les promoteurs des projets subventionnés par le PHAQ ne sont plus tenus de maintenir des loyers abordables au bout d’un délai pouvant aller de 10 à 35 ans, fixé en fonction de la subvention accordée. Le programme fonctionne par appels de projets plutôt que par dépôts en continu, comme dans AccèsLogis, sauf pour des projets répondant aux besoins de personnes vulnérables. Le dernier appel de projets remonte à juin 2023. À l’automne 2025, ce programme n’avait jusqu’ici permis la livraison que de 459 logements.
Des impacts sur le mouvement communautaire
Tous ces bouleversements se répercutent sur les dynamiques en cours au sein du mouvement communautaire en habitation. Certaines de ses composantes, principalement le réseau des groupes de ressources techniques (GRT), qui est au cœur du développement de logements coopératifs et sans but lucratif depuis 1977, et plus tardivement de certains logements publics, doivent redoubler d’efforts pour s’adapter à ce nouvel environnement. À l’opposé, de gros OSBL d’habitation, dont certains se présentaient autrefois comme des sociétés acheteuses[9], souhaitent jouer un rôle plus important. En 2022, elles se regroupent au sein d’ACHAT (Alliance des corporations d’habitations abordables du territoire du Québec)[10]. Cette organisation se fait la porteuse d’un discours axé sur le « changement d’échelle » et la « professionnalisation » du secteur du logement sans but lucratif.
La taille de ces OSBL, la coopération qu’elles ont établie au sein d’ACHAT et leur capacité de recourir à des montages financiers complexes, qui font appel à une diversité de sources, leur permettent de se placer comme des acteurs incontournables, susceptibles de répondre aux exigences gouvernementales d’accélération et de réduction des coûts pour du logement abordable.
Coup sur coup, en 2023, trois organismes membres d’ACHAT acquièrent un nombre imposant de logements locatifs, avec l’aide plus ou moins substantielle des fonds fiscalisés et d’autres bailleurs de fonds. SOLIDES achète 363 logements à bas loyer de Drummondville. La corporation Mainbourg prend possession des 720 appartements du Domaine La Rousselière à Pointe-aux-Trembles. Interloge négocie l’achat des 91 logements du Manoir Lafontaine à Montréal, où les locataires ont victorieusement résisté à des rénovictions[11]. Pour sa part, UTILE, dont la première livraison de logements étudiants remonte à 2020, affirme pouvoir disposer dans les prochaines années de 13 projets regroupant un total de 2088 appartements dans plusieurs villes du Québec, le tout grâce à de nombreuses sources de financement dont des subventions gouvernementales.
Durant la même période, de nombreuses organisations partent en mission en Europe pour s’inspirer d’expériences qui ont cours en Autriche, au Danemark ou en France. Même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite des organisations à se joindre à la Ville pour examiner de plus près l’exemple de Vienne où le logement sans but lucratif représente autour de 45 % du parc locatif.
La perspective d’une plus grande socialisation du parc locatif date de 2006 au FRAPRU qui, dès ce moment, s’est donné comme premier objectif de doubler le nombre de logements sociaux dans un délai raisonnable. La nécessité que le logement social et communautaire représente au moins 20 % du parc locatif fait aujourd’hui consensus parmi les grands regroupements communautaires en habitation[12], contrairement à ce qui s’est alors passé.
C’est dans ce contexte que certaines composantes du mouvement apposent l’étiquette « hors marché » pour qualifier ces logements, au détriment des termes utilisés précédemment. Volontairement situé dans la continuité du logement abordable, le logement hors marché se présente comme la seule formule permettant d’assurer cette abordabilité de façon permanente et d’ainsi constituer un patrimoine collectif pour les générations à venir.
En 2024, la Ville de Montréal s’appuie sur le travail accompli au sein du Chantier Montréal abordable[13] pour se donner un objectif de 20 % de logements hors marché sur l’ensemble du parc de logements d’ici 2050. Cependant, son Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM), adopté en juin 2025, prévoit que seulement 75 % des 20 % de logements hors marché de son territoire en 2050 soient du logement social. D’ailleurs, le Plan présente le logement social simplement comme « une forme de logements hors marché[14] ». Cela vient clarifier que même si, au départ, les deux termes apparaissent comme des synonymes, ce n’est pas réellement le cas.
Le 10 juin 2025, la Ville de Montréal fait un pas de plus, en lançant au coût de 2 millions $, un appel d’offres lui permettant de contribuer à des projets de « changement d’échelle » de certains OBNL, de manière à ce qu’ils soient plus aptes à « développer du logement hors marché, qu’il soit social ou abordable », ce qui passe entre autres par la « mise sur pied de stratégies visant à accélérer la structuration et la professionnalisation de l’organisme[15] ». Les quatre organismes retenus sont annoncés à la fin septembre, sans aucune indication sur les contreparties exigées par la Ville quant à l’abordabilité réelle, l’implication des locataires et un nombre de membres suffisant pour agir comme chiens de garde de la mission sociale des logements gérés et développés par les organismes.
Vers la socialisation du parc de logements locatifs
Quoi qu’il en soit, la notion de logements hors marché rejoint au moins en partie l’opposition à la logique du profit et à celle de la spéculation qui sont les propres du marché privé de l’habitation, surtout avec les tendances exacerbées à la marchandisation et à la financiarisation du logement.
Ce sont ces tendances dévastatrices pour le droit au logement qui, au cours des dernières années, poussent le FRAPRU à remettre au premier plan sa perspective de socialisation, en réclamant de faire passer, sur une période de 15 ans, de 11 à 20 % la part du logement social sur l’ensemble du parc locatif. L’organisme fait largement campagne à ce sujet, en menant une tournée à travers le Québec et en diffusant une variété de publications, dont la brochure Mettre les bouchées doubles. Faire progresser la part du logement social au Québec (2024)[16].
Pour parvenir à son objectif, le FRAPRU met de l’avant une série de demandes, dont celle de nouveaux programmes complets, suffisamment subventionnés et permettant un développement accéléré de coopératives et d’OSBL d’habitation, mais aussi de HLM. L’acquisition de logements locatifs existants fait aussi partie de ses demandes de manière à sortir le maximum de logements du marché spéculatif et d’en préserver l’accessibilité financière. Il appuie aussi la réalisation de logements étudiants sans but lucratif, considérant qu’il s’agit d’un besoin qui a trop longtemps été ignoré par les autorités[17].
La volonté du FRAPRU de favoriser une progression accélérée du nombre de logements échappant à la logique du marché privé l’a convaincu de l’importance du rôle joué par les gros OSBL d’habitation et autres développeurs de logements dits hors marché, dont des sociétés publiques comme la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Il prend d’ailleurs en compte les logements déjà réalisés par ces acteurs dans son évaluation du nombre de logements sociaux au Québec qui tourne, autour de 170 000, selon des chiffres récents.
Le FRAPRU et ses groupes membres n’adhèrent pas pour autant à l’ensemble du discours tenu au nom du développement du logement hors marché. Ils s’opposent d’abord à ce que son financement se fasse au détriment de la mise sur pied et du financement adéquat de programmes de logements réellement sociaux. La crise du logement, c’est d’abord et avant tout l’érosion accélérée de logements pleinement accessibles financièrement aux ménages à faible et modeste revenu. Cette crise entraine toute une série de conséquences dont la plus dommageable est l’exacerbation de l’itinérance visible ou cachée et la multiplication de campements de sans-abri[18]. C’est donc vers la réponse à cette crise que doivent en priorité être dirigés les fonds publics de tous les paliers de gouvernement.
Le réseau FRAPRU insiste par ailleurs pour que tout le secteur du logement sans but lucratif reprenne les acquis développés au cours des décennies par les diverses formules de logement social quant à la place des ménages à plus faible revenu, à la gouvernance démocratique des ensembles de logements et à la réponse aux besoins exprimés par tous les milieux, y compris les moins populeux. Le FRAPRU craint aussi les répercussions que le recours à une multitude de sources de financement, dont des fonds privés qui exigent un rendement financier, peut avoir sur le prix des logements, sur leur pérennité à l’extérieur du marché privé et sur l’autonomie des groupes.
La place des ménages à plus faible revenu
L’un des acquis majeurs du logement social est la place qu’y ont toujours occupée les ménages à faible et souvent même très faible revenu, y compris dans des formules encourageant une certaine mixité sociale.
Les programmes de logement social financés par le passé comprenaient une aide additionnelle au loyer qui permettait aux ménages moins nantis de payer un loyer fixé en fonction de leur revenu, soit 25 % au maximum[19]. Ce n’est plus le cas avec les programmes de logement abordable comme le PHAQ (même quand leur octroi passe par un fonds fiscalisé) et les diverses initiatives fédérales. Les projets de logement peuvent chercher à se prévaloir du Programme de supplément au loyer Québec financé par la Société d’habitation du Québec[20], mais ce n’est ni obligatoire ni accordé automatiquement. De plus, ces aides financières ne sont pas réservées au secteur sans but lucratif et peuvent être utilisées par le privé, ce qui est inacceptable sauf dans les cas d’urgence. Il faut donc corriger ces lacunes.
Par ailleurs, le secteur hors marché doit viser une abordabilité immédiate des logements construits ou achetés. Il peut être tentant, dans l’objectif d’accroitre plus rapidement le parc de logements non spéculatifs ou encore de faire diminuer les contributions publiques (ce que le gouvernement Legault encourage fortement), de miser sur une « abordabilité à long terme ». Certains organismes sans but lucratif pourraient même opter pour la réalisation de « logements intermédiaires abordables », selon le nouveau concept introduit par le gouvernement de la Coalition avenir Québec[21]. Le loyer peut y atteindre « 150 % des loyers maximaux reconnus par la SHQ pour le PHAQ ou le loyer basé sur les coûts réels », comme le permet le Programme de financement en habitation adopté le 19 mars 2025[22].
La logique sous-tendant le discours sur « l’abordabilité à long terme » est que, même s’ils sont chers au départ, les loyers se distanceront progressivement de ceux du privé, en raison d’augmentations de loyer moins importantes. Cette hypothèse n’est pas totalement fausse, comme l’ont démontré les expériences antérieures de logement social et communautaire. Le problème, c’est que ce sont des ménages ayant davantage de moyens financiers qui pourront, dans un premier temps, accéder sans trop d’efforts aux logements réalisés et que cet état de fait risque de se prolonger.
Des groupes de locataires s’inquiètent de voir des logements qualifiés de hors marché se développer dans leurs milieux, alors que leurs loyers sont beaucoup trop élevés, et qu’ils peuvent avoir un effet d’embourgeoisement, contribuant à la hausse des loyers des logements environnants.
Garantir la gouvernance démocratique
Si la formule coopérative en habitation repose sur l’implication à tous les niveaux des membres locataires, la gouvernance démocratique et la participation des résidents et résidentes aux décisions qui les concernent n’ont pas toujours représenté des acquis dans les autres formules de logement social.
Dans les HLM, les relations entre les offices municipaux d’habitation et les locataires ont pendant des décennies été marquées au sceau de l’autoritarisme ou du paternalisme. Les longues et parfois difficiles luttes menées par des associations locales de locataires de HLM et, à partir de 1993, de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)[23], réussissent toutefois à faire bouger les choses.
À l’automne 2002, au moment de l’adoption du projet de loi 49, on peut carrément parler d’une « petite révolution dans les HLM ». La loi[24] reconnait les associations de locataires, de même que leur droit de choisir les locataires siégeant sur les conseils d’administration des offices. Une nouvelle structure démocratique, les comités consultatifs de résidents et résidentes (CCR), est également mise en place. Elle est invitée à se prononcer sur une série d’enjeux, dont les règlements d’immeubles et la planification des travaux majeurs de rénovation. Bien sûr, des réticences parfois très fortes existent toujours dans une partie des offices d’habitation, mais elles sont de plus en plus minoritaires. Ces acquis ne s’appliquent cependant pas dans les logements publics gérés par les offices ou par des sociétés paramunicipales comme la Société d’habitation et de développement de Montréal. Ce n’est pas non plus le cas dans le reste du Canada.
Les OSBL d’habitation ne sont soumis à aucune obligation légale en ce qui a trait à la participation démocratique des locataires et à leur place sur les conseils d’administration. Des programmes de financement peuvent toutefois exiger une telle participation. C’était le cas d’AccèsLogis qui obligeait « qu’un tiers des administrateurs soit élu par et parmi les locataires des immeubles (ou leur représentant) dont l’OBNL est propriétaire, lors d’une assemblée générale de ses membres convoquée à cette fin[25] ».
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) encourage l’implication des locataires : « Dans tous les cas, une vie associative dynamique, qui favorise la participation des membres, est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme[26] ». La forme de participation démocratique peut varier : présence aux conseils d’administration, formation de comités de locataires, possibilité pour les locataires d’être membres de l’organisme et de participer à ses assemblées générales.
L’enjeu de la gouvernance démocratique se pose de façon encore plus aigüe dans le contexte actuel : programmes de financement ne comprenant aucune exigence à cet égard ; volonté de « changer d’échelle », en favorisant la formation de plus gros organismes.
Certains faits récents alimentent les inquiétudes. Dans les premiers mois de 2022, deux conseils d’administration d’OSBL d’habitation, le Faubourg Mena’sen de Sherbrooke et Villa Belle Rivière de Richelieu, ont vendu leurs immeubles à des investisseurs privés, sans aucune forme de consultation des locataires qui ont été mis devant des faits accomplis[27]. Les pressions du RQOH et de la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) ont convaincu le gouvernement québécois de légiférer à ce sujet en juin 2022 en modifiant la Partie III de la Loi sur les compagnies. Toute vente ou aliénation d’immeuble « financé publiquement pour sa réalisation » doit dorénavant obtenir l’autorisation du Ministère. La RQOH ou les fédérations d’OSBL ont aussi la possibilité de s’exprimer sur une éventuelle transaction.
Malgré ces progrès, la porte n’est pas totalement fermée à des ventes d’immeubles appartenant à des OSBL, encore moins s’ils n’ont pas été financés par le gouvernement. Le statut sans but lucratif n’est donc pas encore protégé suffisamment.
Une tendance dangereuse commence par ailleurs à se manifester, soit la formation d’OSBL d’habitation par des intérêts privés. Le quotidien Le Soleil du 22 mars 2025[28] en fournit un exemple éloquent en révélant que quatre promoteurs privés, Biophilia, Cloriacité, Immostar et Maître Carré, ont mis sur pied un OSBL dans l’objectif de construire, à l’aide de subventions gouvernementales, 25 000 logements hors marché d’ici 10 ans dans l’ensemble des régions du Québec. En quoi la gestion d’un tel organisme est-elle démocratique et en quoi la place de ses locataires serait-elle différente de celle qui leur est accordée sur le marché privé ?
De plus, de nombreux offices d’habitation créent des OSBL affiliés, ce qui a pour effet volontaire ou non d’échapper aux obligations démocratiques qui encadrent désormais la gestion des HLM.
Dans un tel contexte, il est impératif de resserrer les règles entourant la participation des locataires dans les instances des OSBL et en particulier des plus gros qui ne se définissent pas comme des organismes d’action communautaire. Voilà un sujet sur lequel tous les organismes sans but lucratif en habitation souhaitant changer d’échelle et se professionnaliser devraient réfléchir impérativement en prenant connaissance des expériences positives que certains ont développées en ce sens.
Les différents paliers de gouvernement incluant les villes doivent également faire en sorte que tous leurs programmes de financement quels qu’ils soient (y compris s’ils transitent par des intermédiaires) et plus largement l’octroi d’autres ressources publiques (terrains, prêts, etc.) comprennent des balises claires sur la gouvernance et le contrôle démocratique des organismes dans l’objectif d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité du caractère sans but lucratif des logements financés.
Par exemple, chaque OSBL devrait disposer d’un membrariat actif, plus large que les membres de son conseil d’administration et ses gestionnaires. Les locataires devraient pouvoir en faire partie si c’est leur volonté, tout comme les organismes d’action communautaire autonome du territoire concerné. De plus, une majorité des sièges du conseil d’administration d’un OSBL devrait être occupée par des locataires ou des représentants et représentantes d’organismes communautaires. Des comités consultatifs de locataires pourraient aussi être mis sur pied, à l’image des CCR dans les HLM.
Des modifications devraient également être apportées à la section de la Loi des compagnies touchant les OSBL, ne serait-ce que pour interdire toute possibilité de vente d’immeubles à vocation sans but lucratif à moins que ce ne soit à un autre OSBL ou à un organisme public ou coopératif. Alors que la fin des conventions signées avant 1994[29] avec le fédéral va s’accélérer, il faudra aussi faire de même avec les HLM et les autres logements publics gérés par les offices d’habitation. Les expériences de privatisation de logements sociaux vécues en Grande-Bretagne dans les années 1980, puis dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, les Pays-Bas et la France[30], et même dans certaines provinces canadiennes, doivent nous convaincre de la nécessité de faire preuve de vigilance, même si, pour le moment, le Québec est très loin de ces réalités.
Répondre aux besoins des communautés
Une autre force du logement social est sa capacité à répondre à des besoins et des volontés du milieu.
De nombreux projets de coopératives, d’OSBL et même de HLM ont été réalisés au terme de luttes citoyennes visant à s’opposer à des démolitions massives, à s’assurer que des projets de développement immobilier répondent aux besoins de la population locale, à freiner la spéculation ou l’embourgeoisement, à obtenir la réalisation d’appartements à bas loyer où les locataires ont leur mot à dire sur leurs conditions d’habitation et de vie, etc.[31]
Les maisons de chambres sans but lucratif réalisées à partir de l’Année internationale du logement des sans-abri en 1987 visaient pour leur part à répondre aux inquiétudes et aux demandes exprimées par les organismes intervenant en itinérance. Il en est de même de plusieurs autres projets de logements avec support communautaire développés par la suite en vertu d’AccèsLogis[32].
De multiples projets d’OSBL répondant à une variété de besoins ont été réalisés à l’initiative d’organismes communautaires comme des groupes en santé mentale, des associations de personnes en situation de handicap, des centres de femmes, des organismes intervenant en violence conjugale ou auprès de jeunes en difficulté, des regroupements d’ainé·e·s, etc.
Grâce à leur présence partout au Québec et aux liens étroits qu’ils ont tissés avec leur communauté, la plupart des groupes de ressources techniques ont aussi réussi à mener des projets à terme dans toutes sortes de milieux, y compris les moins populeux. Ils ont ainsi pu jouer un rôle positif dans des villes et villages en voie de dévitalisation.
Comment cette capacité de répondre aux besoins des diverses communautés pourra-t-elle être assurée par des organismes de plus grande taille, à la recherche d’opportunités d’affaires, voulant développer à grande échelle et parfois dans plusieurs régions ? La question reste entière et mérite d’être abordée ouvertement.
De la collaboration, mais aussi des débats
Aussi essentiel soit-il, compte tenu de l’étendue et de la profondeur des problèmes de logement, l’objectif d’atteindre au moins 20 % de logements sociaux représente un défi considérable. Il exigera une vaste mobilisation de tous les acteurs de l’habitation sociale et communautaire, mais aussi d’autres milieux – syndicaux, municipaux, sociaux, économiques, politiques, etc. La population elle-même devra adhérer à une telle vision pour que celle-ci ait des chances de se matérialiser.
Cette vision nécessitera des investissements majeurs de la part des différents paliers de gouvernement. Nous savons que ces investissements ne sont pas de simples dépenses et qu’elles généreront des retombées économiques et sociales très significatives[33]. Les autorités politiques ne manqueront toutefois pas l’occasion d’en brandir les coûts en affirmant qu’il serait irresponsable d’aller de l’avant avec un objectif aussi ambitieux. Il faudra donc démontrer la faisabilité d’un tel chantier et les moyens de le financer sans renoncer à d’autres investissements eux aussi essentiels et sans augmenter tous les impôts. Un travail colossal a déjà été fait à ce sujet par diverses organisations, notamment par la Coalition Main rouge[34]. Elles devront être mises à contribution. Il faut par ailleurs rappeler que de ne pas financer de logement a aussi un coût et qu’il est énorme[35].
Il faudra également contraindre les gouvernements à cesser de mettre leurs investissements en habitation à la merci des arbitrages budgétaires annuels pour plutôt annoncer des plans à long terme, ce qu’a tenté de faire la Stratégie nationale sur le logement, mais en misant sur les mauvaises initiatives.
L’ampleur du travail à accomplir et des obstacles à surmonter exige une collaboration étroite entre l’ensemble des organisations concernées. Pour être fructueuse, elle ne pourra cependant pas faire l’économie de débats, francs et ouverts, ne serait-ce que pour s’entendre clairement sur les termes utilisés, par exemple sur ce qui est inclus ou non dans les expressions « logement hors marché », « logement sans but lucratif », « logement abordable » ou « logement social ». En ce sens, les préoccupations exposées dans ce texte devront entre autres être abordées, en évitant les consensus de surface et les formules alambiquées pouvant donner lieu à toutes sortes d’interprétations. Nous estimons, pour notre part, que le milieu communautaire en habitation a atteint une maturité suffisante pour y parvenir. D’ici là, le FRAPRU et ses membres continueront à promouvoir la nécessité de doubler le nombre de logements sociaux au Québec d’ici 2040.
Par Véronique Laflamme, organisatrice communautaire et porte-parole du FRAPRU et François Saillant, militant communautaire et politique et ex-coordonnateur du FRAPRU
- François Saillant est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Lutter pour un toit, Montréal, Écosociété, 2018 et Dans la rue. Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec, Écosociété, 2024. FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement urbain. ↑
- Cette expression date du tournant des années 2000. Elle répond alors à la volonté des organismes communautaires en habitation se réclamant de l’économie sociale de se distinguer du seul logement social, à tort identifié aux HLM (habitations à loyer modique) et à la seule réponse aux besoins des ménages à plus faible revenu. Longtemps réticents, les organismes de défense collective des droits, comme le FRAPRU, s’habituent à l’expression, tout en continuant pour leur part de ne parler que de logement social en y incluant les logements publics, les coopératives et les OSBL (organismes sans but lucratif) d’habitation, comme cela avait toujours fait consensus avant le retrait du gouvernement fédéral. ↑
- Jusque-là, tous les logements sociaux réalisés au Québec l’étaient majoritairement avec des fonds fédéraux. La décision d’Ottawa de se retirer du financement de nouveaux logements sociaux à partir du 1er janvier 1994 a été prise par le gouvernement progressiste-conservateur en avril 1993, mais des élections ayant eu lieu entretemps, c’est au Parti libéral, nouvellement élu, qu’est revenu l’odieux de la mettre en application. ↑
- Le volet social du programme permettra la réalisation de 5271 logements sociaux et communautaires, alors que son volet privé accordera des subventions pour 3180 appartements. ↑
- Ce n’était pas le cas dans toutes les provinces. ↑
- Ce fut le cas de tous les budgets présentés par le ministre des Finances, Éric Girard, à l’exception de celui de 2021-2022 qui annonça le financement de 500 nouveaux logements par AccèsLogis. ↑
- Lire à ce sujet les critiques de David Madden et Peter Marcuse, Défendre le logement. Nos foyers, leurs profits, Montréal, Écosociété, 2024 et Ricardo Tranjan, La classe locataire, Montréal, Québec Amérique, 2025. ↑
- Des conditions sont fixées pour l’obtention du statut de « développeur qualifié » dont une expérience minimale de 10 ans en développement, construction et exploitation de projets immobiliers, de même que la capacité financière de réaliser des projets. À l’automne 2025, sept organismes s’étaient vu accorder ce statut dont deux développeurs privés et des OSBL au statut douteux. Depuis le 7 mai 2025, les « développeurs qualifiés » font l’objet d’un volet spécifique du PHAQ. ↑
- C’est le cas d’Interloge et de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM), fondés respectivement en 1978 et 1988. ↑
- Formée au départ de 8 organisations membres, elle en compte maintenant 28 dont des membres associés. ↑
- Voir : Zacharie Goudreault, « Front commun pour protéger les locataires du Manoir Lafontaine », Le Devoir, 23 avril 2021 et Jeanne Corriveau, « Le Manoir Lafontaine mis à l’abri de la spéculation », Le Devoir, 12 juin 2023. Le terme rénoviction fait référence à une pratique selon laquelle un propriétaire évince illégalement une ou un locataire de son immeuble sous prétexte qu’il souhaite faire des rénovations. ↑
- Le consensus à ce sujet est clair lors des journées d’étude organisées par la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) en mai 2024 sur le thème Perspectives internationales sur le logement social et communautaire. ↑
- Ville de Montréal, Rapport final. Chantier Montréal abordable. Pour une ville abordable et résiliente, Montréal, 2024. ↑
- Projet de Plan d’urbanisme et de mobilité 2050, Partie 1 – Le cadre de référence, Chapitre 2 – La Stratégie montréalaise, Montréal, 2024, p. 67. ↑
- Ville de Montréal, Montréal investit dans les organismes à but non lucratif d’habitation pour stimuler le développement de logements hors marché, communiqué, 10 juin 2025. ↑
- < https://www.frapru.qc.ca/socialisation/>. ↑
- Selon le FRAPRU, la construction ou la rénovation de résidences étudiantes relève toutefois de la responsabilité des établissements d’enseignement et donc du ministère de l’Éducation. Elles sont présentement éligibles au PHAQ. ↑
- Malheureusement trop souvent démantelés par les autorités municipales au détriment des droits des personnes itinérantes. ↑
- La seule exception a été le volet social du programme Logement abordable Québec instauré en 2002, mais celui-ci n’a pas duré très longtemps et comprenait un pourcentage de subventions gouvernementales plus élevé qui, en théorie, devaient permettre d’abaisser le coût des loyers. ↑
- Contrairement à ce qui était le cas dans AccèsLogis, le supplément est géré séparément dans le PHAQ. ↑
- Le gouvernement Legault s’est inspiré d’une pratique présente en France. Elle y est qualifiée de logement social intermédiaire ou logement locatif intermédiaire et s’adresse à la classe moyenne. ↑
- Société d’habitation du Québec, Programme de financement en habitation, Cadre normatif 2025-2029, version administrative au 19 mars 2025, p. 2. ↑
- Ces luttes sont souvent appuyées concrètement par des membres du personnel des offices, ainsi que par des organismes communautaires. ↑
- Loi modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec. ↑
- Société d’habitation du Québec, Guide d’élaboration et de réalisation des projets – Programme AccèsLogis Québec, janvier 2020, p. 3. ↑
- Réseau québécois des OSBL d’habitation, Gestion locative en OSBL d’habitation. Manuel du participant, édition février 2021, p. 65. ↑
- Si ces deux cas ont été largement publicisés, on peut soupçonner qu’ils ne sont pas les seuls. Il est malheureusement extrêmement difficile de savoir ce qui est arrivé de tous les ensembles de logements financés par le gouvernement fédéral avant 1994. Même la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui les a subventionnés l’ignore. ↑
- Chloé Pouliot, « Quatre promoteurs aspirent à bâtir 25 000 logements accessibles », Le Soleil, 22 mars 2025. ↑
- Même si le gouvernement fédéral ne finance plus directement de nouveaux logements sociaux, il a dû respecter les ententes de financement à long terme prises avant 1994. Il devait donc continuer à les subventionner, mais aussi à les encadrer, pendant une période pouvant aller jusqu’à 35 ou même 50 ans. Or, ces ententes se terminent presque toutes d’ici la fin de la présente décennie. Dans le cas des HLM, ça signifie que le gouvernement québécois se retrouvera seul à assumer toute la facture d’un parc vieillissant de logements, ce qui pourrait le convaincre de hausser les loyers de leurs locataires ou de se départir d’une partie des ensembles de logements. ↑
- Ces expériences sont très différentes l’une de l’autre. Par exemple, dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher en 1980, il s’agissait d’utiliser le « right to buy » pour vendre aux locataires les mieux nanti·e·s des immeubles, ce qui en réduisait l’offre pour les ménages en besoin. En Allemagne, c’est à des investisseurs privés que des logements sociaux ont été cédés en grande quantité. ↑
- François Saillant, Lutter pour un toit. Douze batailles pour le logement au Québec, Montréal, Écosociété, 2018 et François Saillant, Dans la rue. Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec, Écosociété, 2024. ↑
- Logemen’occupe, Des logements qui font reculer l’itinérance, 2024. ↑
- En mai 2025, l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) a publié une étude convaincante à ce sujet : Le logement social et communautaire : un investissement qui rapporte au Québec. ↑
- Coalition Main rouge, Pour une société plus juste. Nous avons les moyens de faire autrement, automne 2021. ↑
- Ferdaous Roussafi, Manque de logements adéquats : quels coûts pour la prospérité économique ? La facture collective de la crise du logement au Québec, Montréal, Observatoire québécois des inégalités, 2025. ↑

Introduction au dossier du numéro 34 : Le droit au logement, vers la démarchandisation

Longtemps niée par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), la crise du logement persiste. Et rien n’indique qu’elle se résorbera prochainement. Les principaux indicateurs de cette crise, qui est largement documentée, sont au rouge depuis un certain nombre d’années déjà. Et ils se seraient aggravés depuis la pandémie de COVID-19 : hausse fulgurante des loyers, pénurie de logements abordables, faible taux d’inoccupation des logements locatifs, adoption de différentes pratiques plus ou moins légales, voire même frauduleuses, de la part des propriétaires qui veulent se débarrasser de locataires (les fameuses rénovictions), conversions en copropriété ou locations à court terme à des fins touristiques qui réduisent la taille du parc de logement locatif, et augmentation du phénomène de l’itinérance, notamment en raison du manque de logements.
Cette crise est dramatique pour des centaines de milliers de personnes ici et à travers le monde. Juste en France, pourtant un pays riche, le non-accès à un logement digne et abordable concerne une personne sur quatre, nous apprend Le Corre. Plus près de nous, dans les villes comme Montréal qui compte 63 % de locataires et Québec qui en compte 49 %, mais aussi dans les différentes régions du Québec, la pénurie de logements à prix décent entraine des répercussions sociétales dont les coûts risquent de se faire sentir à long terme. Le mal-logement est devenu chose courante avec tout ce que cela implique : stress, anxiété, peur, endettement, coupures dans le budget familial pour la nourriture (la demande d’aide alimentaire accuse une hausse vertigineuse) ou pour les médicaments parce que les ménages se voient obligés de consacrer plus de 30 % de leur revenu au loyer, et parfois même plus de 50 %. Cette pénurie de logements à prix décent fait en sorte que de nombreuses familles n’arrivent pas à quitter des logements insalubres, vétustes ou trop exigus dans lesquels elles vivent, au risque de leur santé et de celle de leurs enfants. Il arrive fréquemment que les relations propriétaires-locataires entrainent des tensions, voire de la violence verbale, et un climat de conflictualité, ce qui mine la santé mentale des locataires. Ajoutons à cela le phénomène de l’itinérance qui prend de l’ampleur, comme le souligne le texte de Latendresse, avec ce que cela signifie de se retrouver à la rue. Ce sombre tableau touche un nombre de plus en plus grand de personnes qui vivent la précarité et l’insécurité résidentielles pour reprendre les propos de Madden et Marcuse[1], d’où la nécessité de comprendre l’évolution du marché immobilier, un secteur majeur de l’économie capitaliste, néolibérale et mondialisée.
Si la crise du logement semble atteindre un sommet, il importe de comprendre pourquoi. Bien qu’en principe, on le reconnaisse comme un droit et une condition nécessaire à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes, le logement est aujourd’hui considéré pour sa valeur marchande plutôt que pour sa valeur sociale, du moins par les milieux d’affaires et les décideurs. Il est donc soumis à la logique de l’économie capitaliste néolibérale, mondialisée et financiarisée. Rappelons que le néolibéralisme peut être compris comme un processus de restructuration des formes de gouvernance et de régulation. Plus concrètement, cela se traduit par une phase de démantèlement des institutions, régulations et politiques associées au régime fordiste keynésien qui sont progressivement remplacées par de nouvelles règles, de nouvelles orientations et politiques qui font la part belle au secteur privé. Pour mieux comprendre les effets de ces transformations dans le domaine résidentiel, il faut lire les textes de Laflamme et Saillant, de Gaudreau et de Le Corre qui décortiquent et analysent les principaux changements apportés aux politiques de soutien au logement depuis le milieu des années 1990. Ces auteurs constatent que si le logement social ou le logement public, comme on le désigne en France, est encore sous le contrôle de l’État, ou du moins largement financé par ce dernier, la logique du marché a pénétré ce secteur d’activités au point que même le logement social et communautaire, pourtant à but non lucratif et en principe hors marché, est aujourd’hui soumis en partie à la logique du marché.
Laflamme et Saillant et Gaudreau constatent l’introduction relativement récente d’une nouvelle terminologie où l’on parle moins de logement social et davantage de logement abordable et hors marché. Pour eux, cette transformation n’est pas que sémantique, elle amène une confusion sur le financement du logement, sur les partenaires impliqués et sur la méthode de calcul du loyer. Cette confusion terminologique permet au gouvernement de dire qu’il répond à la demande sociale, en augmentant la construction de logements abordables, alors que, dans les faits, le prix de ces logements sera évalué en fonction de la médiane des prix du marché, et non en fonction des revenus des locataires. Gaudreau explique que l’État, par ses programmes de financement notamment, a induit une nouvelle conception du financement et de la production du logement, incluant le logement social, qui accorde une place plus importante au secteur privé. Même le logement dit hors marché, précise Gaudreau, « est aussi marchandisé sinon plus que le logement abordable ».
Parallèlement, nous assistions à l’introduction de nouvelles pratiques au sein même des projets de logement social portés par des organisations communautaires. Comme Louise Constantin l’explique, le programme de financement des nouvelles coopératives privilégie de grosses coopératives dont la gestion est transférée à des organisations à but non lucratif qui sont indépendantes de la coopérative. Cette nouvelle façon de faire nous questionne quant à la place et au pouvoir réservés aux locataires, qui, dans l’ancien modèle de coopératives, constituaient les acteurs de l’autogestion et de l’auto-organisation des coopératives. Pour certains militants et militantes du milieu des coops, le fait que la gestion soit transférée à une autre constituante indépendante du conseil d’administration de la coop est vu positivement dans la mesure où gérer de gros complexes de logement constitue toujours un défi en matière de gestion. Malgré ces défis auxquels font face les coopératives, il demeure que le parc de coopératives demeure un fleuron de l’habitation démarchandisée au Québec, et qu’il importe de le préserver.
Si le marché s’accapare davantage du secteur de l’habitation, et en particulier de la production et du financement du logement, dont le logement social et communautaire, quelles sont les options pour répondre aux besoins des locataires, et en particulier des locataires à faible ou modeste revenu ?
Deux types de réponses sont discutées au Québec. D’une part, il y a celles et ceux qui croient que le marché apportera des solutions. Pour les tenants de cette approche, le facteur responsable de la crise repose sur le déséquilibre entre l’offre et la demande, d’où l’idée de mettre en place les conditions nécessaires pour attirer davantage de promoteurs et de constructeurs dans le secteur immobilier, et pour multiplier les chantiers. Pour cela, il y a toutes sortes de mesures qui sont annoncées : accorder des mesures fiscales incitatives, faciliter l’obtention des permis de construction et les changements de zonage, etc. Plus on construira rapidement des unités de logement, plus vite la crise sera résolue. C’était du moins la position de l’ancienne ministre responsable de l’Habitation France Élaine Duranceau. Même s’il ne s’agit pas que de logements « abordables », l’augmentation de la construction de logements aurait un effet de ruissellement, pense-t-on, c’est-à-dire que les ménages qui emménageront dans de nouveaux logements à coût plus élevé laisseront derrière eux un appartement à loyer plus bas, accessible à des ménages à faible ou modeste revenu. Bref, tout le monde devrait y trouver son compte.
D’autre part, différentes options sont portées par des réseaux et organisations de défense du droit au logement ainsi que des organisations liées aux mouvements sociaux, et ce, depuis de nombreuses années. Au Québec, plusieurs ont déjà fait leurs preuves, c’est pourquoi nous avons demandé à des personnes qui militent et travaillent dans ces organisations ou réseaux de faire un état des lieux des changements apportés aux différents programmes de financement, notamment en termes de contraintes et d’opportunités.
Véronique Laflamme et François Saillant, tous deux actifs au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) depuis un bon nombre d’années, retracent l’histoire du développement du logement social et analysent les transformations apportées aux programmes de financement de logement social, ce qui leur permet de mettre en lumière les différences entre le logement social, le logement abordable et le logement hors marché. Pour Laflamme et Saillant, le logement social et communautaire demeure la clé principale, ou du moins l’une des clés les plus importantes pour répondre à la crise du logement. Pour leur part, Patricia Viannay et Robert Pilon, qui travaillent tous les deux à la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec, montrent en quoi la formule des HLM, qui semble un peu usée aux yeux de certains, a fait ses preuves. En effet, les HLM offrent du logement décent financé par l’État, mais plus encore, cette formule contribue à l’appropriation des enjeux d’habitation par les locataires, lesquels se sont battus au cours des années pour participer à la gouvernance des HLM. Certes, Viannay et Pilon conviennent que le parc de logement HLM a besoin de beaucoup d’amour, c’est pourquoi il importe d’y investir et de le préserver.
Le mouvement des coopératives d’habitation, apparu dans les années 1970, constitue l’un des fleurons du logement social et communautaire au Québec. Comme le rappelle Louise Constantin, qui a été longtemps très active au sein du mouvement des coopératives d’habitation : « Pour les acteurs du mouvement pour le droit au logement, les coopératives permettaient de retirer des centaines, voire des milliers de logements du marché privé et même, espérait-on, d’avoir un effet stabilisateur sur l’ensemble des loyers. Certains y voyaient également une pratique émancipatrice et une rupture avec le dogme de la propriété privée dans le domaine immobilier ». Aujourd’hui, cependant, les coopératives d’habitation, qui dépendent elles aussi de différents programmes de financement public, sont soumises à de nouvelles obligations qui ont pour effet de les fragiliser. Alors que sous l’ancien régime, elles avaient une autonomie pour la fixation du prix des loyers, ce n’est plus le cas avec le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) qui a succédé au programme Accès Logis. Pour Constantin, il est certain qu’en vertu de ces programmes, les loyers doivent se situer entre 75 % et 95 % du loyer médian du marché. Les coopératives, écrit-elle, se retrouvent donc à la remorque d’un marché hautement spéculatif.
Ces quatre textes permettent de saisir que le logement social et communautaire – qui comprend aussi les coopératives –, issu de luttes pour le droit au logement qui se sont menées depuis près de 75 ans, est aujourd’hui affaibli par l’introduction de nouveaux programmes qui ont ouvert la porte au secteur privé ou à la logique du secteur privé. On comprend qu’on assiste progressivement à une dénaturation de ce qu’a été le logement social, les HLM ou les coopératives d’habitation qui sont en voie de marchandisation, ce qui représente également une perte de contrôle démocratique des locataires à faible ou modeste revenu.
Parallèlement à ces attaques contre le logement social et communautaire, d’autres acteurs et actrices explorent des avenues comme les fiducies d’utilité sociale (FUS), ce dont nous parlent Raymond et Maass, de même que Michaud et Cohen. Robert Cohen, qui a été l’un des précurseurs de l’expérience menée par le Comité des citoyen·ne·s de Milton Parc, revient sur cette formidable aventure alternative au marché immobilier, qui loge un grand nombre de locataires dans des coopératives d’habitation situées au centre-ville de Montréal. Ghislaine Raymond et Barbara Maass, deux militantes qui ont joué un rôle majeur dans la création de l’Écoquartier Louvain dans l’arrondissement Ahunstic-Bordeaux-Cartierville à Montréal, expliquent ce que permettent les fiducies d’utilité sociale, notamment de pérenniser un parc de logement démarchandisé. Pour elles, il ne fait pas de doute que la FUS constitue un moyen concret de sortir du marché privé des logements qui seront ainsi véritablement hors marché. Enfin, Alexandre Michaud donne un exemple de ce à quoi peuvent mener des fiducies sociales si on les insère dans des environnements plus larges. Comme il l’explique, la Société de développement de l’Est (SDE), un organisme à but non lucratif, ne mise pas que sur le logement, elle vise plutôt à constituer des milieux de vie complets réunis dans des écoquartiers. Pour reprendre ses mots, la SDE a développé une approche innovante et émancipatrice qui s’appuie sur « trois principes : créer des milieux de vie centrés sur l’humain et la nature, participer à la démocratisation du territoire dans une perspective autogestionnaire, et inscrire la croissance de l’organisation dans une “stratégie anticapitaliste d’érosion” visant à lutter contre l’oppression sociale et économique à grande échelle ». La SDE propose non seulement l’idée d’une fiducie d’utilité sociale, mais elle va plus loin, en intégrant le projet dans un écosystème et à partir d’une perspective plus large de transformation sociale. Enfin, Valérie Allard nous rappelle la réalité régionale qui diffère de celles qui prévalent dans les grands centres urbains. Elle témoigne de l’expérience d’un petit collectif qui a mis sur pied une coopérative d’habitation aux valeurs écologiques et où les membres s’entraident et partagent des tâches quotidiennes et de construction. Depuis 18 ans, en modulant ses règles, la coopérative a su perdurer et attirer de nouveaux et nouvelles locataires.
En résumé, ce dossier pose les enjeux auxquels est confronté le logement social aujourd’hui au Québec, et rappelle qu’il existe des expériences et des mécanismes qui peuvent réellement mettre le logement à l’abri du marché et permettre aux citoyens et citoyennes de s’approprier leurs conditions d’habitation et de vie.
Par Anne Latendresse, membre du Comité de rédaction
- David Madden et Peter Marcuse, Défendre le logement. Nos foyers, leurs profits, Montréal, Écosociété, 2024. ↑

Le droit au logement, vers la démarchandisation

Longtemps niée par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), la crise du logement persiste. Et rien n’indique qu’elle se résorbera prochainement. Les principaux indicateurs de cette crise, qui est largement documentée, sont au rouge depuis un certain nombre d’années déjà. Et ils se seraient aggravés depuis la pandémie de COVID-19 : hausse fulgurante des loyers, pénurie de logements abordables, faible taux d’inoccupation des logements locatifs, adoption de différentes pratiques plus ou moins légales, voire même frauduleuses, de la part des propriétaires qui veulent se débarrasser de locataires (les fameuses rénovictions), conversions en copropriété ou locations à court terme à des fins touristiques qui réduisent la taille du parc de logement locatif, et augmentation du phénomène de l’itinérance, notamment en raison du manque de logements.
Cette crise est dramatique pour des centaines de milliers de personnes ici et à travers le monde. Juste en France, pourtant un pays riche, le non-accès à un logement digne et abordable concerne une personne sur quatre, nous apprend Le Corre. Plus près de nous, dans les villes comme Montréal qui compte 63 % de locataires et Québec qui en compte 49 %, mais aussi dans les différentes régions du Québec, la pénurie de logements à prix décent entraine des répercussions sociétales dont les coûts risquent de se faire sentir à long terme. Le mal-logement est devenu chose courante avec tout ce que cela implique : stress, anxiété, peur, endettement, coupures dans le budget familial pour la nourriture (la demande d’aide alimentaire accuse une hausse vertigineuse) ou pour les médicaments parce que les ménages se voient obligés de consacrer plus de 30 % de leur revenu au loyer, et parfois même plus de 50 %. Cette pénurie de logements à prix décent fait en sorte que de nombreuses familles n’arrivent pas à quitter des logements insalubres, vétustes ou trop exigus dans lesquels elles vivent, au risque de leur santé et de celle de leurs enfants. Il arrive fréquemment que les relations propriétaires-locataires entrainent des tensions, voire de la violence verbale, et un climat de conflictualité, ce qui mine la santé mentale des locataires. Ajoutons à cela le phénomène de l’itinérance qui prend de l’ampleur, comme le souligne le texte de Latendresse, avec ce que cela signifie de se retrouver à la rue. Ce sombre tableau touche un nombre de plus en plus grand de personnes qui vivent la précarité et l’insécurité résidentielles pour reprendre les propos de Madden et Marcuse[1], d’où la nécessité de comprendre l’évolution du marché immobilier, un secteur majeur de l’économie capitaliste, néolibérale et mondialisée.
Si la crise du logement semble atteindre un sommet, il importe de comprendre pourquoi. Bien qu’en principe, on le reconnaisse comme un droit et une condition nécessaire à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes, le logement est aujourd’hui considéré pour sa valeur marchande plutôt que pour sa valeur sociale, du moins par les milieux d’affaires et les décideurs. Il est donc soumis à la logique de l’économie capitaliste néolibérale, mondialisée et financiarisée. Rappelons que le néolibéralisme peut être compris comme un processus de restructuration des formes de gouvernance et de régulation. Plus concrètement, cela se traduit par une phase de démantèlement des institutions, régulations et politiques associées au régime fordiste keynésien qui sont progressivement remplacées par de nouvelles règles, de nouvelles orientations et politiques qui font la part belle au secteur privé. Pour mieux comprendre les effets de ces transformations dans le domaine résidentiel, il faut lire les textes de Laflamme et Saillant, de Gaudreau et de Le Corre qui décortiquent et analysent les principaux changements apportés aux politiques de soutien au logement depuis le milieu des années 1990. Ces auteurs constatent que si le logement social ou le logement public, comme on le désigne en France, est encore sous le contrôle de l’État, ou du moins largement financé par ce dernier, la logique du marché a pénétré ce secteur d’activités au point que même le logement social et communautaire, pourtant à but non lucratif et en principe hors marché, est aujourd’hui soumis en partie à la logique du marché.
Laflamme et Saillant et Gaudreau constatent l’introduction relativement récente d’une nouvelle terminologie où l’on parle moins de logement social et davantage de logement abordable et hors marché. Pour eux, cette transformation n’est pas que sémantique, elle amène une confusion sur le financement du logement, sur les partenaires impliqués et sur la méthode de calcul du loyer. Cette confusion terminologique permet au gouvernement de dire qu’il répond à la demande sociale, en augmentant la construction de logements abordables, alors que, dans les faits, le prix de ces logements sera évalué en fonction de la médiane des prix du marché, et non en fonction des revenus des locataires. Gaudreau explique que l’État, par ses programmes de financement notamment, a induit une nouvelle conception du financement et de la production du logement, incluant le logement social, qui accorde une place plus importante au secteur privé. Même le logement dit hors marché, précise Gaudreau, « est aussi marchandisé sinon plus que le logement abordable ».
Parallèlement, nous assistions à l’introduction de nouvelles pratiques au sein même des projets de logement social portés par des organisations communautaires. Comme Louise Constantin l’explique, le programme de financement des nouvelles coopératives privilégie de grosses coopératives dont la gestion est transférée à des organisations à but non lucratif qui sont indépendantes de la coopérative. Cette nouvelle façon de faire nous questionne quant à la place et au pouvoir réservés aux locataires, qui, dans l’ancien modèle de coopératives, constituaient les acteurs de l’autogestion et de l’auto-organisation des coopératives. Pour certains militants et militantes du milieu des coops, le fait que la gestion soit transférée à une autre constituante indépendante du conseil d’administration de la coop est vu positivement dans la mesure où gérer de gros complexes de logement constitue toujours un défi en matière de gestion. Malgré ces défis auxquels font face les coopératives, il demeure que le parc de coopératives demeure un fleuron de l’habitation démarchandisée au Québec, et qu’il importe de le préserver.
Si le marché s’accapare davantage du secteur de l’habitation, et en particulier de la production et du financement du logement, dont le logement social et communautaire, quelles sont les options pour répondre aux besoins des locataires, et en particulier des locataires à faible ou modeste revenu ?
Deux types de réponses sont discutées au Québec. D’une part, il y a celles et ceux qui croient que le marché apportera des solutions. Pour les tenants de cette approche, le facteur responsable de la crise repose sur le déséquilibre entre l’offre et la demande, d’où l’idée de mettre en place les conditions nécessaires pour attirer davantage de promoteurs et de constructeurs dans le secteur immobilier, et pour multiplier les chantiers. Pour cela, il y a toutes sortes de mesures qui sont annoncées : accorder des mesures fiscales incitatives, faciliter l’obtention des permis de construction et les changements de zonage, etc. Plus on construira rapidement des unités de logement, plus vite la crise sera résolue. C’était du moins la position de l’ancienne ministre responsable de l’Habitation France Élaine Duranceau. Même s’il ne s’agit pas que de logements « abordables », l’augmentation de la construction de logements aurait un effet de ruissellement, pense-t-on, c’est-à-dire que les ménages qui emménageront dans de nouveaux logements à coût plus élevé laisseront derrière eux un appartement à loyer plus bas, accessible à des ménages à faible ou modeste revenu. Bref, tout le monde devrait y trouver son compte.
D’autre part, différentes options sont portées par des réseaux et organisations de défense du droit au logement ainsi que des organisations liées aux mouvements sociaux, et ce, depuis de nombreuses années. Au Québec, plusieurs ont déjà fait leurs preuves, c’est pourquoi nous avons demandé à des personnes qui militent et travaillent dans ces organisations ou réseaux de faire un état des lieux des changements apportés aux différents programmes de financement, notamment en termes de contraintes et d’opportunités.
Véronique Laflamme et François Saillant, tous deux actifs au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) depuis un bon nombre d’années, retracent l’histoire du développement du logement social et analysent les transformations apportées aux programmes de financement de logement social, ce qui leur permet de mettre en lumière les différences entre le logement social, le logement abordable et le logement hors marché. Pour Laflamme et Saillant, le logement social et communautaire demeure la clé principale, ou du moins l’une des clés les plus importantes pour répondre à la crise du logement. Pour leur part, Patricia Viannay et Robert Pilon, qui travaillent tous les deux à la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec, montrent en quoi la formule des HLM, qui semble un peu usée aux yeux de certains, a fait ses preuves. En effet, les HLM offrent du logement décent financé par l’État, mais plus encore, cette formule contribue à l’appropriation des enjeux d’habitation par les locataires, lesquels se sont battus au cours des années pour participer à la gouvernance des HLM. Certes, Viannay et Pilon conviennent que le parc de logement HLM a besoin de beaucoup d’amour, c’est pourquoi il importe d’y investir et de le préserver.
Le mouvement des coopératives d’habitation, apparu dans les années 1970, constitue l’un des fleurons du logement social et communautaire au Québec. Comme le rappelle Louise Constantin, qui a été longtemps très active au sein du mouvement des coopératives d’habitation : « Pour les acteurs du mouvement pour le droit au logement, les coopératives permettaient de retirer des centaines, voire des milliers de logements du marché privé et même, espérait-on, d’avoir un effet stabilisateur sur l’ensemble des loyers. Certains y voyaient également une pratique émancipatrice et une rupture avec le dogme de la propriété privée dans le domaine immobilier ». Aujourd’hui, cependant, les coopératives d’habitation, qui dépendent elles aussi de différents programmes de financement public, sont soumises à de nouvelles obligations qui ont pour effet de les fragiliser. Alors que sous l’ancien régime, elles avaient une autonomie pour la fixation du prix des loyers, ce n’est plus le cas avec le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) qui a succédé au programme Accès Logis. Pour Constantin, il est certain qu’en vertu de ces programmes, les loyers doivent se situer entre 75 % et 95 % du loyer médian du marché. Les coopératives, écrit-elle, se retrouvent donc à la remorque d’un marché hautement spéculatif.
Ces quatre textes permettent de saisir que le logement social et communautaire – qui comprend aussi les coopératives –, issu de luttes pour le droit au logement qui se sont menées depuis près de 75 ans, est aujourd’hui affaibli par l’introduction de nouveaux programmes qui ont ouvert la porte au secteur privé ou à la logique du secteur privé. On comprend qu’on assiste progressivement à une dénaturation de ce qu’a été le logement social, les HLM ou les coopératives d’habitation qui sont en voie de marchandisation, ce qui représente également une perte de contrôle démocratique des locataires à faible ou modeste revenu.
Parallèlement à ces attaques contre le logement social et communautaire, d’autres acteurs et actrices explorent des avenues comme les fiducies d’utilité sociale (FUS), ce dont nous parlent Raymond et Maass, de même que Michaud et Cohen. Robert Cohen, qui a été l’un des précurseurs de l’expérience menée par le Comité des citoyen·ne·s de Milton Parc, revient sur cette formidable aventure alternative au marché immobilier, qui loge un grand nombre de locataires dans des coopératives d’habitation situées au centre-ville de Montréal. Ghislaine Raymond et Barbara Maass, deux militantes qui ont joué un rôle majeur dans la création de l’Écoquartier Louvain dans l’arrondissement Ahunstic-Bordeaux-Cartierville à Montréal, expliquent ce que permettent les fiducies d’utilité sociale, notamment de pérenniser un parc de logement démarchandisé. Pour elles, il ne fait pas de doute que la FUS constitue un moyen concret de sortir du marché privé des logements qui seront ainsi véritablement hors marché. Enfin, Alexandre Michaud donne un exemple de ce à quoi peuvent mener des fiducies sociales si on les insère dans des environnements plus larges. Comme il l’explique, la Société de développement de l’Est (SDE), un organisme à but non lucratif, ne mise pas que sur le logement, elle vise plutôt à constituer des milieux de vie complets réunis dans des écoquartiers. Pour reprendre ses mots, la SDE a développé une approche innovante et émancipatrice qui s’appuie sur « trois principes : créer des milieux de vie centrés sur l’humain et la nature, participer à la démocratisation du territoire dans une perspective autogestionnaire, et inscrire la croissance de l’organisation dans une “stratégie anticapitaliste d’érosion” visant à lutter contre l’oppression sociale et économique à grande échelle ». La SDE propose non seulement l’idée d’une fiducie d’utilité sociale, mais elle va plus loin, en intégrant le projet dans un écosystème et à partir d’une perspective plus large de transformation sociale. Enfin, Valérie Allard nous rappelle la réalité régionale qui diffère de celles qui prévalent dans les grands centres urbains. Elle témoigne de l’expérience d’un petit collectif qui a mis sur pied une coopérative d’habitation aux valeurs écologiques et où les membres s’entraident et partagent des tâches quotidiennes et de construction. Depuis 18 ans, en modulant ses règles, la coopérative a su perdurer et attirer de nouveaux et nouvelles locataires.
En résumé, ce dossier pose les enjeux auxquels est confronté le logement social aujourd’hui au Québec, et rappelle qu’il existe des expériences et des mécanismes qui peuvent réellement mettre le logement à l’abri du marché et permettre aux citoyens et citoyennes de s’approprier leurs conditions d’habitation et de vie.
Par Anne Latendresse, membre du Comité de rédaction
- David Madden et Peter Marcuse, Défendre le logement. Nos foyers, leurs profits, Montréal, Écosociété, 2024. ↑

Pas de paix sans justice : Présentation des choix éditoriaux de ce numéro 34 des NCS

Avant l’annonce du cessez-le-feu, première étape d’un plan de paix qui ne mentionne ni la colonisation, ni l’occupation israélienne, ni la création d’un État palestinien, le comité de rédaction des NCS avait décidé, au début de septembre, que ce numéro serait un support pour faire entendre les voix palestiniennes, non seulement par le choix des articles, mais aussi par la mise en page, qui donne une large place aux photos que l’on retrouve à la fin de plusieurs articles : elles racontent non pas toute l’histoire d’oppression des Palestiniens et Palestiniennes depuis la Nakba, mais le génocide depuis deux ans ainsi que différentes formes de résistance – nous faisons référence ici aux initiatives prises par la société civile palestinienne pour recréer ou maintenir des expressions collectives, par le biais d’institutions reconstruites avec divers appuis[1], par le travail des journalistes gazaoui·e·s qui ont payé un lourd tribu à ce titre[2], ou par la création artistique et littéraire. Par exemple, le maintien, tout au long de cet enfer, d’activités musicales pour les enfants, adolescents et adolescentes à Gaza par le Conservatoire national de musique Edward Saïd[3].
Ces choix éditoriaux donnent à voir, du moins l’espérons-nous, qu’il n’est plus possible de parler, de théoriser, de tracer des perspectives, en oubliant ou en marginalisant le fait que nous vivons dans le contexte d’un génocide qui s’est déroulé en direct pendant deux longues années. Parce qu’une partie de notre monde a voulu l’ignorer, sans même parfois se rendre compte que cette minimisation des évènements relevait – comme dans tout génocide – d’une déshumanisation d’une population en train d’être violentée et décimée. Parce qu’au-delà des États-Unis, qui ont choisi de ne pas cesser leur soutien militaire à un gouvernement israélien qui a sombré dans le fascisme et le suprémacisme, une grande partie des dirigeants occidentaux s’en sont rendus complices, soit passivement, par leur silence ou leur prise de position tardive, soit activement, en continuant de laisser des entreprises livrer des fournitures de guerre à Israël, comme c’est le cas du Canada qui s’est pourtant félicité en septembre dernier de reconnaitre l’État de Palestine.
Aujourd’hui, nos choix éditoriaux font écho au sentiment de profonde injustice que peuvent ressentir les Palestiniens et les Palestiniennes à l’annonce de ce qui est appelé un plan de paix, qui ne leur donne guère de place en tant que peuple qui a le droit d’avoir des droits, et en premier lieu d’avoir le droit à l’autodétermination. Bien sûr, pour les Gazaoui·e·s, tout vaut mieux aujourd’hui que la continuation de ce génocide qui a fait bien plus de 66 000 morts, en dénombrant tous ceux et celles que l’on sort à présent des décombres, sans parler des adultes et des enfants mutilés à vie. Mais qui peut croire qu’ils et elles sont dupes de ce qui s’inscrit en continuité avec la Nakba ? La plupart des Gazaoui·e·s n’ignorent probablement pas qu’ils n’ont pas été invités aux tables de négociation, si ce n’est comme figurants. En tout cas, pour l’instant. Car on peut espérer qu’ils et elles reprennent assez de forces pour mieux s’organiser collectivement, avec un appui qui doit venir de toute la planète, afin qu’ils et elles arrivent à se faire entendre. Et pour que les puissants de ce monde comprennent qu’ils ne pourront plus infliger de telles atrocités et ignorer la voix des peuples.
C’est aussi en septembre que nous avons fait le choix politique de publier à titre d’éditorial Quitter Gaza pour la venger. Cette chronique poétique écrite par une jeune femme de 22 ans, s’arrachant de Gaza en juin dernier en pensant ne plus revoir ses proches, est d’une actualité brûlante. Parce que comme toute création artistique, elle revêt de multiples significations et ouvre des horizons qu’atteignent rarement des discours politiques – tout le monde n’est pas l’auteur de I have a dream[4].
Parlant hier du déchirement et de la culpabilité de survivre que ressent toute personne qui échappe à un génocide, Quitter Gaza pour la venger peut être lu aujourd’hui comme l’anticipation du fait qu’il ne peut y avoir de paix tant qu’il n’y aura pas de justice. Que cette justice passe par la reconnaissance pleine et entière du peuple palestinien, de son droit à un État souverain et indépendant sur les terres de Palestine, de son droit à décider de sa vie et de la façon de la gérer. La justice passe aussi par le respect du droit international qui prévoit notamment le droit au retour des réfugié·e·s selon la résolution 194 des Nations unies. Elle demande à rendre effectivement imputable l’État israélien et ses dirigeants devant la Cour de justice internationale concernant son occupation illégale des territoires palestiniens et les crimes de génocide.
À défaut, il faut s’attendre à ce que se multiplient à l’avenir les mobilisations contre le sort infligé à Gaza, que se multiplient les récits, les peintures, les créations musicales et multidisciplinaires, permettant à Gaza torturée, à Gaza piétinée et niée, d’enfanter une autre vision du monde qui embrasse les rêves de toutes celles et tous ceux qui ploient aujourd’hui sous le joug de multiples dominations pour qu’elles et ils les combattent, ensemble.
Quitter Gaza pour la venger
La journaliste et poétesse palestinienne Nour Elassy vient d’être évacuée de Gaza. Dans sa chronique écrite à Paris, elle raconte la douleur extrême de quitter les siens ainsi que son périple jusqu’à la France. Elle fait une promesse : venger Gaza[5].
J’écris ceci depuis Paris, avec sa pluie de juillet qui arrose doucement mes joues. Comme si elle s’excusait pour moi de la douleur que je ressens. Comme si elle pouvait sentir à quel point je suis fragile, après avoir quitté tout mon monde pour poursuivre mon rêve.
Les jours précédant l’évacuation ont été les plus sanglants que nous ayons jamais vus. Le ciel brûlait plus fort. La terre s’est fissurée plus profondément. Le nombre de bombardements, d’ordres d’évacuation et de massacres a dépassé ce que l’on peut compter.
Le consulat français a déclaré qu’il était temps d’évacuer, pas parce que c’était sûr, mais parce qu’Israël avait finalement donné son autorisation, et nous avons déménagé à Deir al-Balah pour attendre le départ.
Je n’ai pas dormi. J’ai regardé ma famille respirer, mémorisant les voix des miens comme si elles allaient disparaître. Parce qu’elles allaient disparaître.
J’ai quitté Gaza sans rien d’autre que les vêtements que je porte, ma carte d’identité et la douleur insupportable de savoir que ma mère et ma petite sœur, tout mon monde, resteraient derrière, dans une guerre conçue pour nous effacer.
Les discussions sur un cessez-le-feu imminent et les grands espoirs de mettre fin à cette guerre m’ont rendue un peu plus calme, mais aujourd’hui, ces mensonges sont gelés. C’est un spectacle récurrent, et nous tombons dans le panneau à chaque fois. Non pas parce que nous sommes idiots, mais parce que nous sommes désespérés.
Le consulat de France nous a dit quelques jours avant : « Préparez-vous, si vous voulez toujours partir. » Pour poursuivre mes études, j’ai été admise à étudier les sciences politiques à l’EHESS (l’École des hautes études en sciences sociales) à Paris.
Mais comment préparer ses bagages pour l’exil ? Comment plier ses souvenirs dans un sac à dos que l’on n’a pas le droit de porter ?
Les cils de ma sœur, le regard de ma mère
La nuit précédant mon départ, j’ai essayé de mémoriser les cils de ma sœur. J’ai dormi entre elle et ma mère, toutes enlacées comme si c’était la dernière fois. Une grande partie de moi et d’elles voulait tellement le nier. Elle était silencieuse. Trop silencieuse. Ce genre de silence terrifiant que font les enfants lorsqu’ils en savent plus que ce que vous voulez qu’ils sachent. Elle ne m’a pas dit : « Ne pars pas ». Elle m’a juste regardée et m’a serrée encore plus fort dans ses bras. Et ce regard me suivra plus longtemps que cette guerre.
Quant à ma mère, je n’ai pas la force d’écrire cela : je ne peux pas oublier son regard et la façon dont elle a pleuré de tout son cœur en me poussant hors de la pièce pour partir.
Je suis partie comme une voleuse, non pas en volant, mais en laissant derrière moi tout ce que j’aimais.
Nous avons attendu à Deir al-Balah, où nous avons été forcés d’évacuer ; on nous a dit que le Sud était plus sûr. Au point de rencontre convenu par le consulat, nous nous sommes regroupés avec d’autres personnes choisies pour cette évacuation humanitaire. Trente d’entre nous, peut-être plus.
Chacun d’entre nous porte des histoires qu’il n’aura jamais fini d’écrire. Nous sommes montés dans les bus comme des fantômes portant des corps, chacun avec des yeux pleurant, bouffis de n’avoir pas dormi, plus tristes et plus confus les uns que les autres.
Je me suis assise près de la fenêtre et je me suis forcée à regarder, à assister à la mort de ce qui était ma maison. Khan Younès. Rafah. Ou ce qui était Khan Younès, Rafah. Tout avait disparu. Aplati dans une architecture de silence. Des os en béton. Du linge brûlé. Même les oiseaux volaient plus bas, comme s’ils étaient en deuil.
Les camions bloqués là
Je n’ai pas de mots pour décrire l’ampleur de la destruction – et la méconnaissance que j’en avais – sur la route menant à la frontière de Kerem Shalom-Abu Salem. Je n’en croyais pas mes yeux, on aurait dit un film sur la fin du monde, mais ce n’était pas le cas.
Puis nous sommes passés devant les camions, les camions d’aide humanitaire. Alignés comme des accessoires sur une scène de crime. Il y en avait des dizaines. Remplis de nourriture. De farine. D’eau. Parqués à quelques mètres du cadavre de Gaza, ils n’ont jamais été autorisés à y pénétrer. Le pain pourrit pendant que les enfants dans les tentes font bouillir de l’herbe pour le dîner.
Comment appelez-vous cela, si ce n’est un crime de guerre ? Ce n’est pas un siège. C’est la famine en tant que politique étrangère. C’est le meurtre par la paperasserie, signée à Washington, appliquée à Tel- Aviv et dont l’Europe est témoin.
Nous avons atteint le poste de contrôle. Après avoir vérifié nos identités, les soldats israéliens nous ont attendus, fusil à la main, comme si nous étions la menace et non les victimes. Ils nous ont dit : « N’apportez rien. » Pas d’ordinateurs portables. Pas de livres. Pas même des écouteurs.
Je n’ai même pas été autorisée à emporter le carnet de poésie que j’avais rempli pendant la guerre, celui que ma sœur m’avait offert pour mon anniversaire. Les mots, apparemment, sont trop dangereux pour l’occupant.
Ils nous ont fouillés comme si nous portions des bombes ; pas de chagrin. Ils ont touché notre dos, vérifié nos chaussettes, scruté nos yeux. Un soldat, si c’est ainsi que l’on peut décrire un criminel, a regardé un étudiant qui voyageait avec nous et a commencé à l’interroger sur l’endroit où il vit et sur ses connaissances.
L’équipe du consulat a vérifié nos noms à nouveau et a été si gentille et chaleureuse. Elle nous a donné de la nourriture et nous a informés que leur équipe de l’ambassade de France nous attendrait à notre arrivée en Jordanie.
Dans le bus pour la Jordanie, personne ne parlait. Mais le chagrin a son propre langage. Notre silence était un hymne. Un chant funèbre pour les familles que nous avons quittées. Pour les enfants que nous ne reverrons peut-être jamais. Pour la vérité qu’il nous était interdit de porter.
Deux sièges derrière moi, une fille a chuchoté. Elle ne m’a pas demandé mon nom. Je n’ai jamais demandé le sien, mais elle a dit : « Mon père est resté. Il a dit qu’il préférait mourir dans sa maison que dans une tente. Mon petit frère a 5 ans, je lui ai dit que je ramènerais du chocolat de France, il a souri. Il ne sait pas que c’est peut-être un adieu pour toujours »
Elle a tiré ses manches sur ses mains, a regardé le sol et a murmuré : « J’ai l’impression d’avoir laissé mon âme sous les décombres. Et maintenant, j’ai peur que quelqu’un marche dessus. » Mais une phrase me hante encore aujourd’hui. Lorsqu’elle m’a dit : « Je suis convaincue que je retournerai chez ma mère et que je lui expliquerai mon voyage, et qu’elle me dira : “Bonjour, ma fille, tu es en retard !” »
Pas de pleurs. Pas de sanglots. Juste le silence, et un silence si lourd qu’il pressait nos poumons. Comme moi, cette fille est quelque part en France maintenant. Mangeant du pain. Elle étudie le français, le droit ou une autre science. Mais une partie d’elle, une partie de nous tous, est toujours à Gaza, criant derrière un mur effondré que personne n’arrive à percer.
La découverte de la Palestine
Nous sommes passés dans les territoires palestiniens occupés. Quatre heures à travers une terre que je n’avais jamais vue. Parce que nous sommes de Gaza. Nous n’avons jamais vu notre propre terre. Le reste de la Palestine nous a toujours été interdit.
Et pourtant, c’était là : des montagnes. Des vignes. Des collines couvertes d’oliviers. La mer Morte et, enfin, les stations balnéaires. Les hôtels cinq-étoiles, les Européens qui bronzent en bikini alors qu’à trente kilomètres de là, des enfants sont enterrés à plusieurs sous une tente.
C’est le théâtre cruel de l’occupation : génocide en Méditerranée, cocktails dans la mer Morte.
Nous avons été installés dans un hôtel à Amman, à l’InterContinental Jordan, un hôtel magnifique, dont tous les frais étaient couverts par la France. Il y avait tout ce dont on pouvait avoir besoin, mais jamais ce que l’on voulait.
Nous y avons passé deux nuits, du mercredi 9 au vendredi 11 juillet à l’aube. Ce furent deux jours entiers de silence et de solitude dans une chambre d’hôtel très luxueuse. Nous avons été conduits de l’hôtel à l’aéroport, avec beaucoup d’attente et de vérifications, pour finalement être mis dans un vol pour Paris.
Le voyage était tellement bouleversant. C’était la première fois que je prenais l’avion. J’ai été très malade tout en m’émerveillant de l’immensité du monde. Et de la manière dont un minuscule morceau de terre a permis au monde entier de se réveiller et de comprendre à quel point il se trompait.
Nous avons atterri à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Nous avons été contrôlés une nouvelle fois et nous avons obtenu un visa d’étudiant. Mes grands amis m’attendaient avec les plus belles fleurs et une accolade très chaleureuse.
Me voilà à Paris désormais. En sécurité. Je dors dans un lit chaud très confortable. Et chaque nuit, je fixe le plafond et me demande : les ai-je trahis ? Ai-je abandonné ma mère, ma sœur, mon peuple ?
La culpabilité me brûle l’estomac et m’empêche de garder quoi que ce soit à l’intérieur, que ce soit de la nourriture ou des larmes. Partir était-il un acte de courage ou de désertion ? Mais je sais ceci : je n’ai pas quitté Gaza pour l’oublier. Je l’ai quittée pour la venger avec la langue, avec la politique, avec une mémoire plus vive que les balles.
Je suis partie pour apprendre la langue des tribunaux qui ne nous ont jamais sauvés. Pour utiliser leurs propres outils afin de graver notre nom dans l’histoire.
Vous, dans vos ambassades, vos salles de rédaction et vos studios de télévision, vous entendrez parler de moi. Je ne serai pas votre histoire à succès, je serai votre miroir. Et vous n’aimerez pas ce que vous y verrez.
J’ai quitté Gaza sans rien. Pas de sac. Pas de livres. Pas de cadeau d’adieu. Seulement de la rage.
Par Nour Elassy
- Voir dans ce numéro l’entrevue d’Ahmed A. R. Abushaban au sujet de la reprise des cours universitaires en ligne : « Maintenir notre identité et notre culture pour rebâtir un État palestinien ». ↑
- Plus de 210 journalistes palestiniens, hommes et femmes, sont morts à Gaza, souvent ciblés par la technologie militaire utilisée par l’armée israélienne (voir l’article de Rabih Jamil « Comment les GAFAM alimentent la machine algorithmique du génocide » dans ce numéro). Le magazine espagnol El Pais Semanal les a surnommés « les yeux et les oreilles du monde » : une reconnaissance bienvenue quoique tardive de leur travail, comme si le fait d’être palestinien amenait automatiquement à douter de leur professionnalisme. Les journalistes occidentaux ont été en tout cas très lents à se mobiliser contre l’hécatombe qui frappait leurs confrères et consœurs, ↑
- Edward Saïd était non seulement un penseur palestinien, auteur de L’orientalisme (1978), mais aussi un critique musical. ↑
- Il s’agit du titre du discours de Martin Luther King, le 28 août 1963, un des leaders du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, qui réclamait la fin de toutes les formes de ségrégation raciale dont celle inscrite dans les lois. ↑
- Cette chronique de Gaza a été publiée le 21 juillet 2025 dans le journal français Mediapart. Nous remercions chaleureusement Nour Elassy et Médiapart d’avoir accepté que la revue Nouveaux Cahiers du socialisme la publie. ↑
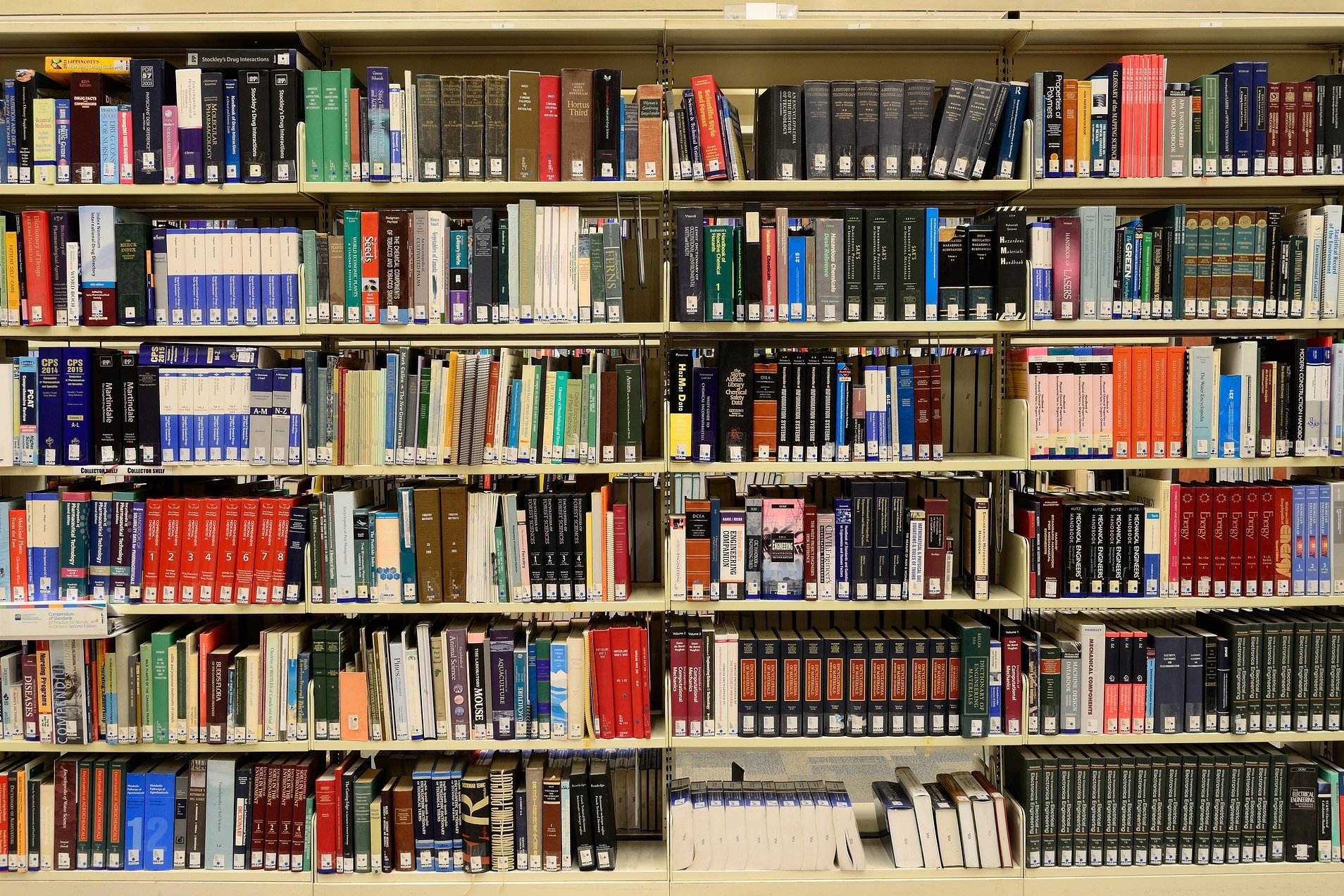
Notes de lecture (Hiver 2025)

Patrick Moreau, Écrire à contre-courant, Montréal, Somme Toute/Le Devoir, 2024
Patrick Moreau veut argumenter, mais avec qui ?
Le chroniqueur au Devoir et figure familière de l’antiwokisme québécois, Patrick Moreau, propose un recueil de textes déjà publiés, accompagné de courtes introductions et agrémenté de quelques inédits. Le titre, Écrire à contre-courant, en indique le ton et situe d’emblée l’auteur dans la position de celui qui se bat courageusement contre la pensée hégémonique, l’intellectuel singulier et libre face à la masse homogène hypnotisée.
En avant-propos (p. 9 à 15), il pose les termes de la joute polémique. Son adversaire n’est pas clairement identifié, mais on le devine aisément. Voici la liste complète d’exemples de sujets de débat : mot en N, écriture inclusive, censure, diversité sexuelle, pronoms, orthographe non genrée, lançage de soupe ; le woke, en somme, même s’il n’emploie pas le terme. Sa longue description de la bête n’est qu’une suite d’épithètes sans originalité aucune. C’est un « chœur de ventriloques » lançant des « procès d’intention », ceux-là s’imaginant tout savoir et qui « abusent sans vergogne des amalgames les plus tordus ». Le woke « confond toute nouveauté, même la plus insensée, avec un progrès supposé ». Il fait preuve d’un « simplisme idéologique », clame « une vérité décrétée une fois pour toutes, et sans discussion possible », vit dans « un moralisme de l’urgence, souvent irréfléchi, [qui tient] plus du signalement vertueux et du lynchage que d’une authentique quête de vérité et de justice ». Les membres de sa bande ne cessent de mettre de l’avant « leurs sentiments ou leur “ressenti” comme critère unique de la vérité ». Moreau, « au risque de passer pour réactionnaire », entend répliquer aux « groupes militants bruyants dont les prises de parole répétées essaient d’imposer un faux sentiment d’évidence et d’unanimité ». Envers autrui, il suggèrera « des arguments qui ne s’adressent pas à sa sensibilité, mais à son intelligence ».
Les trois premières parties de ce recueil de chroniques portent sur la censure, en particulier ce qu’il nomme la « néocensure “progressiste” » (p. 21). Moreau s’intéresse aux wokes et moins à la droite pour deux raisons : la droite est moins présente au Québec, et la censure de nature religieuse/traditionnelle est « plus attendue », donc moins intéressante (p. 21). Les anecdotes les plus populaires se succèdent : SLAV, Lieutenant-Duval, Tintins brûlés, La Petite Vie, François Blais, etc. Il s’attarde également à la réécriture de l’Histoire, mentionnant entre autres la statue de J.A. Macdonald et l’avenue Christophe-Colomb. Il a des mots durs et hyperboliques envers celles et ceux qui jugent le passé selon les valeurs de notre époque : « Cet anachronisme cache un présentisme, non exempt de narcissisme, qui nous fait juger le passé comme si nous étions infiniment supérieurs à nos prédécesseurs » (p. 117, je souligne). Dans la quatrième partie, Moreau s’intéresse à l’influence des écrans et d’Internet sur nos jeunes. Il y dénonce la « scandalite », la réaction épidermique aux événements, le déchainement contre des personnes ou des institutions sans réfléchir (p. 151). C’est la portion de l’ouvrage de loin la plus intelligente, notamment pour ses réflexions sur l’enseignement en ligne.
L’écriture inclusive est le « Moby-Dick » de Moreau depuis des années, et c’est le sujet de la cinquième partie. Les couteaux y volent bas. Il relève la contradiction entre rendre les femmes plus visibles, et les « invisibiliser » par des formules non genrées (p. 189). Il afflige les « inclusivistes » de plusieurs erreurs (p. 190-192) : la croyance que changer les mots va changer le monde est évidemment fausse ; celle que la domination du masculin est sexiste est une « lecture paranoïaque des faits de langue » ; celle qui fait de la langue une « simple construction sociale » est une « vision extrêmement réductrice », voire une « idée dangereuse » qui permet à des groupes d’imposer leurs « préférences idéologiques ». Pour Moreau, les institutions qui adoptent les règles inclusives font de l’« abus de pouvoir », et agissent comme les régimes autoritaires du passé : « Il faut donc refuser cette novlangue au nom de la démocratie » (p. 194). Dans ses chroniques, il attaque entre autres un texte d’Antonin Rossier-Bisaillon, doctorant en orthophonie à l’Université de Montréal, qui résume trois études scientifiques démontrant un effet de « biais masculin » sur le cerveau à travers l’emploi de la langue. C’est une hypothèse complètement fausse selon Moreau. Il soupçonne les chercheurs et chercheuses d’élaborer « des expériences qui ont pour unique but de valider leur hypothèse de départ » (p. 204). Il déclare « fausse » une conclusion qu’il attribue à Rossier-Bisaillon, mais qui provient en fait d’une étude universitaire. La fausseté lui apparait évidente, il ne s’appuie sur rien d’autre que sa raison. Ailleurs, il s’en prend à la professeure de traduction de l’Université de Moncton, Ariane Des Rochers, qui, dans Le Devoir, défendait les pronoms alternatifs. Peu impressionné, il déclare que celle-ci a « une conception bien à elle de l’histoire des langues », et que toute cette histoire de « iel » n’est qu’une « babelisation narcissique » (p. 208-210).
La dernière partie s’intéresse à l’Histoire, de manière plus éclectique que les parties précédentes. Il y traite entre autres des Jeux olympiques de Sotchi et du décès de la Reine Élizabeth. Un passage en particulier démontre le style Moreau, lorsqu’il affirme que l’on peut s’opposer à la loi 21, Loi sur la laïcité de l’État, mais « prétendre que la laïcité […] est liberticide et antidémocratique […] semble le fait d’esprits imbus d’eux-mêmes, ethnocentriques, intolérants et obtus » (p. 235-236). Il ne cite aucun exemple, mais on aimerait savoir qui, à gauche, rejette « la laïcité » au complet plutôt que l’interprétation très particulière de celle-ci dans la loi 21. Ailleurs, il traite de l’oubli de l’Holocauste, non pas pour dénoncer l’extrême droite (dont il admet au moins l’existence, c’est déjà ça), mais plutôt pour s’en prendre à celles et ceux qui emploient le mot « génocide » à tout vent, pour des choses comme le colonialisme et les Autochtones, ce qui constitue pour lui un « révisionnisme plus insidieux » encore (p. 251).
Pour rappel, Moreau nous offre une chronique sur l’éthique de l’argumentation, où il stipule que « [p]rendre le temps de s’opposer à l’opinion de quelqu’un, à la condition de le faire honnêtement, sans déformer ses dires ni déroger aux règles minimales du savoir-vivre, cela revient à l’entrainer avec soi dans le cercle de la raison ». Ceux qui nous contredisent, « [n]ous préférons les ignorer, les ridiculiser, les insulter, attitudes qui ne respirent que le sectarisme et le mépris » (p. 185). En entrevue au Devoir pour la parution de son ouvrage, le bon polémiste se définit de gauche « traditionnelle » et « humaniste », et s’en prend aux « gens qui, en défendant strictement et uniquement les minorités, se croient progressistes » (je souligne) ; il déplore également « l’absence de pensée » dans le débat public québécois[1]. De toute évidence, et cela suinte de tout son ouvrage, Moreau n’a aucun respect pour les gens de gauche qui ne pensent pas comme lui.
Par Learry Gagné, philosophe et chercheur indépendant

Sylvie Laurent, Capital et race. Histoire d’une hydre moderne, Paris, Seuil, 2024
Qu’ont en commun Karl Marx et Martin Luther King ? Voilà la question qui traverse de part en part ce livre, et à laquelle l’autrice tente de répondre en se référant à diverses écoles de pensée « critique », à commencer par le marxisme orthodoxe jusqu’aux approches plus contemporaines, en passant par l’École de Francfort, W.E.B. Du Bois, Frantz Fanon, etc. De ce fait, ce tour d’horizon constitue l’intérêt principal de l’ouvrage dans la mesure où, de prime abord, il faut passer par une rectification de l’explication marxiste traditionnelle quant aux causes des inégalités socioéconomiques générées par le capitalisme, en y ajoutant une dimension « culturelle » par l’entremise d’une analyse historique de la notion de « race », dont les prémisses conceptuelles (qui deviendront très vite opérationnelles) remontent aussi loin qu’en 1492, lors de la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb.
Comme le souligne le titre, Capital et race. Histoire d’une hydre moderne, l’idée centrale de l’ouvrage est que le concept de « race » – que l’on entend aujourd’hui non pas comme un fait biologique mais comme un fait social et culturel – est consubstantiel à l’émergence du capitalisme au début de la Renaissance. Au paradigme critique et théorique de la « lutte des classes », doit s’ajouter, si on peut dire, celui de la « lutte des races », chacun évoluant de façon parallèle ou transversale l’un par rapport à l’autre. En témoigne, entre autres, la montée du syndicalisme dans les années 1930 aux États-Unis, période pendant laquelle les travailleurs afro-américains doivent affronter à la fois les assauts du capital avec ses conséquences dramatiques (krach boursier de 1929) et le racisme des grands syndicats américains, comme l’American Federation of Labor (AFL), qui refusent leur adhésion dans leurs rangs et les excluent du mouvement ouvrier organisé « par » et « pour » les Blancs[2].
« Un problème avec le marxisme » (p. 19), tel est l’intitulé d’une partie de l’introduction de l’ouvrage qui, précisons-le, n’est pas un ouvrage « théorique » qui cherche à confronter l’idéologie marxiste, mais il se veut plutôt une réinterprétation de l’histoire du capitalisme à l’aune d’une dimension occultée, négligée, ignorée par la critique d’inspiration socialiste du libéralisme bourgeois depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’au milieu du vingtième. En approfondissant la genèse du capitalisme, ses origines, ses nombreuses tentatives de justification idéologique au fil des époques, son articulation toujours renouvelée pour finalement s’associer à une philosophie politique de type libéral, la notion de « classe » ne suffit plus à expliquer le phénomène dans sa globalité ; elle est inapte à rendre compte de certains aspects, autant sinon plus essentiels à comprendre afin de cerner et caractériser cette dynamique de prédation organisée et généralisée qu’est le système capitaliste.
Que ce soit par l’entremise d’une désignation comme celle du « sauvage », du « barbare », de l’« indigène », les colonisateurs européens classifient les groupements humains selon une logique d’appropriation des territoires étrangers, aux Amériques en particulier, d’exploitation d’une main-d’œuvre servile, autant africaine qu’amérindienne, et d’accumulation du capital. De toutes ces constructions prétendument scientifiques ou relevant même des « Lumières » de la Raison, celle de « race » se trouve être la plus emblématique.
Mais, au fait, qu’est-ce que la « race » ? « Idée, principe, concept, […] la race est comme le capital de Marx, une relation sociale. » Et, conséquemment : « Le racisme est […] appréhendé comme un ensemble de représentations, discours et pratiques discriminatoires qui visent à nuire, dégrader et subordonner un groupe de femmes et d’hommes au nom d’une race supposée » (p. 13). Et le capital ? « Le capital est un ensemble de biens et de liens susceptibles de produire des revenus et le capitalisme […] s’entend […] comme “le principe de valorisation des richesses qui n’a d’autre fin qu’elle-même” ou […] un mode d’activité humaine visant à la production toujours plus grande de marchandises à des fins de profits[3]. »
Une fois définis ces deux termes, il reste à les articuler pour démontrer que le capitalisme n’est pas qu’une affaire d’« argent », que l’aliénation qu’il génère n’est pas que d’ordre « économique » mais aussi d’ordre « moral », au sens où des considérations qui n’ont, au départ, rien à voir avec les principes libéraux tels que défendus par les philosophes des Lumières (« écossaises » en particulier) deviennent indispensables pour la pérennité du système capitaliste. Ces considérations s’articulent autour de cette notion de « race » comme justification des pratiques coloniales et des processus de différenciation anthropologique et de discrimination ethnique.
En introduisant ainsi le « racialisme » comme idéologie dans l’analyse critique du capitalisme (concomitant au colonialisme et à l’impérialisme), Sylvie Laurent élargit d’autant les horizons philosophiques et anthropologiques à partir desquels le libéralisme, tel qu’il a été pensé par les « classiques », dévoile sa face cachée lorsqu’il passe l’épreuve de son application coloniale et impériale. L’idée du « doux commerce », par exemple, vient couronner ce mariage entre « convictions » (morales, philosophiques, scientifiques) et « intérêts » (mercantiles, économiques, financiers). Selon l’autrice, Voltaire fut le parfait prototype de cette double posture ; reconnu pour ses idées avant-gardistes – il a rédigé un Traité sur la tolérance –, il n’a jamais renoncé pour autant à ses pratiques d’investisseur avisé dans les plantations sucrières des Antilles, nonobstant le fait que la marchandise produite, le sucre, a été le fruit d’un labeur inhumain assumé par des travailleurs extirpés de leur terre natale, l’Afrique, pour être vendus comme esclaves en Amérique, à mille lieues de leur terre d’origine.
À maints égards, l’autrice de Capital et race se prête à un exercice de démystification en règle de la culture occidentale qui, depuis les Lumières, se présente comme étant porteuse de rationalité, d’universalité, d’humanisme, alors que les progrès de la Raison, quoique réels, ont toujours été accompagnés de pratiques relevant peu du même idéal, se situant même à l’exact opposé : la traite négrière transatlantique, la colonisation « messianique » des Amériques, l’exploitation des territoires indigènes pour alimenter un marché européen avide de produits exotiques (café, cacao, sucre), l’enrichissement inédit des métropoles grâce à la servitude généralisée des peuples « inférieurs », à la mainmise des multinationales aux visées monopolistiques, à la connivence entre l’État et les entreprises privées spécialisées dans l’extraction (des matières premières), la transformation (des produits de la terre), la marchandisation (des biens ainsi transformés).
Que ce soit dans la philosophie politique ou économique de Locke, Hume, Voltaire, Kant, Hegel, le capitalisme s’avère pouvoir receler de vertus émancipatrices, non seulement pour les Européens et Européennes qui en assurent la destinée mondiale, mais aussi pour le reste de l’humanité qui n’a pas encore atteint le même degré de « civilisation » que les nations converties à l’économie de marché. Peu importe la condition précaire dans laquelle se retrouvent ces peuples « non civilisés » une fois qu’ils ont été réduits à l’esclavage, spoliés de leurs terres ancestrales, que leur économie locale ait été saccagée, l’esprit du libéralisme va faire son chemin et les convaincre du bien-fondé du nouveau mode de vie qui s’offre à eux. Encore faut-il qu’ils soient reconnaissants d’avoir été colonisés par une culture supérieure à la leur qu’ils finiront bien par intégrer en acceptant de renoncer à leur barbarie naturelle et primitive. Ainsi le veut la Raison qui parcourt l’Histoire de l’Homme, tendue vers un Idéal « universaliste » à l’image de la culture européenne…
Par Mario Charland, détenteur d’une maîtrise en philosophie de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Étienne Penissat, Classe, Paris, Édition Anamosa, 2023
Dès le début de l’ouvrage, l’auteur précise son objectif : « Redonner à la classe son tranchant comme concept et comme outil de combat » (p. 7). Un objectif pour le moins essentiel si l’on considère que la notion de classe, surtout aujourd’hui, est galvaudée et instrumentalisée par les courants d’extrême droite et néofascistes qui revendiquent « avec quelques succès électoraux, la défense des classes populaires blanches et natives » (p. 6). Il s’agit donc de comprendre, comme le propose l’auteur, comment le « langage de classe » qui historiquement a servi d’outil idéologique des classes exploitées « ne cristallise [plus] les oppositions politiques et sociales alors même que la domination capitaliste se radicalise depuis quarante ans » (p. 6). Pour saisir ce changement ou la transformation même de la notion de « classe », Penissat entreprend une analyse historique de cette notion qui se précise dès la seconde moitié du XVIIIe siècle comme étant « une construction intellectuelle pour penser les divisions économiques et les dynamiques de la production des richesses » (p 8).
La classe devient ainsi, surtout après la Révolution française, un « moyen de représenter les inégalités et conflits entre groupes sociaux » (p.10). Chez Marx, « la classe ne se réduit pas à des divisions économiques, elle s’ancre dans les formes de pensée et d’action des individus » (p. 11). Cette perception rend possible dans le « langage de classe » l’émergence de la « conscience de classe », étape essentielle dans la lutte de la classe ouvrière. Ainsi « [l]a classe devient un mot d’ordre des ouvriers et ouvrières en légitimant leur rôle dans la société, la défense de leurs intérêts et, au-delà, le projet politique de réappropriation du travail et de la production » (p. 20).
Toutefois, si la classe comporte, à ce stade, un projet politique de transformation sociale, elle n’en demeure pas moins un phénomène historique qui renferme certaines particularités dont, pour le sociologue, il faut tenir compte. La classe n’est pas en soi « unificatrice », c’est-à-dire, dans le cas de la classe ouvrière, qu’elle représenterait les intérêts non seulement de cette classe, mais de tous les groupes sociaux exploités et dominés par le capital. Elle comporte également des « frontières », car « [s]i le langage des classes s’impose comme représentation des groupes et des antagonismes sociaux, la définition de leurs frontières, de celles et ceux qu’elles incluent ou excluent devient un enjeu de luttes » (p. 23).
Ici survient une question fondamentale dont la compréhension reste essentielle dans l’histoire des luttes sociales : comment intégrer les groupes marginalisés et exclus du processus même de formation de la classe ouvrière dans les luttes politiques pour l’émancipation sociale ? L’exemple le plus frappant, particulièrement en Occident, est celui des « femmes […] marginalisées et assignées à une position dominée » à l’intérieur de la classe ouvrière où « les ouvrières de l’industrie textile […] sont précarisées, invisibilisées et subordonnées à leur mari » (p. 23). Comme le montre Penissat, les femmes ne sont pas les seules à être marginalisées et invisibilisées dans les luttes sociales ; le nationalisme chauvin marquant les périodes de guerre, particulièrement celle de 1914, constitue l’un des grands obstacles « du projet d’universalisation des solidarités ouvrières » (p. 27). Mais ce qui va constituer, sans doute, le plus important facteur de division au sein des groupes dominés et exploités est celui basé sur la notion de « race », ce que le grand sociologue américain W.E.B Du Bois appelle la ligne de couleur qui « n’est pas un simple reflet des antagonismes de classe puisqu’elle traverse la classe : les groupes racialisés sont exploités en tant que travailleurs mais aussi opprimés en tant que peuples colonisés et infériorisés » (p. 28).
Aujourd’hui, « les reconfigurations du capitalisme » qui prennent différentes formes, la financiarisation, la précarité de l’emploi, la sous-traitance, la privatisation des services publics, etc., font obstacle au développement de la conscience de classe, donc de « l’expérience de la domination ». Par ailleurs, d’autres groupes, qui historiquement ont connu l’exclusion, la discrimination et l’oppression, qui ont été marginalisés dans les luttes sociales, revendiquent leur singularité : les homosexuel·le·s, les transgenres, les personnes queers, etc. Par conséquent, la question des luttes sociales est décentralisée et ne peut être considérée comme uniquement un phénomène de classe.
L’auteur conclut en mettant l’accent sur l’importance des études effectuées par certains auteurs, dont Pierre Bourdieu, pour mettre en lumière les différents rapports de domination, « d’autant plus structurants qu’ils sont produits et reproduits par l’action de l’État » (p. 50). Le grand défi actuel est de « repolitiser le langage de classe », c’est-à-dire « la mise en lumière des “inégalités sociales” qui concernent l’ensemble des dimensions de la vie (santé, logement, scolarité, loisirs, etc.) » (p. 75).
Par Alain Saint Victor, historien et militant

Stanley B. Ryerson, Capitalisme et confédération, Montréal, M éditeur, 2024
Face à la résurgence récente du nationalisme québécois et de l’annexionnisme étatsunien, la lecture de Capitalisme et confédération s’impose pour quiconque souhaite remonter aux racines historiques des questions constitutionnelles canadienne et nord-américaine. Publiée en 1968 et traduite en français en 1972, cette étude de Stanley Bréhaut Ryerson est rapidement devenue un classique du marxisme canadien, mais elle n’a pas été rééditée depuis 1978. M éditeur et sa collection Recherches matérialistes nous offrent aujourd’hui l’occasion précieuse de renouer avec elle.
Couvrant la période de 1815 à 1873, l’ouvrage explique la genèse de l’État fédéral canadien suivant un matérialisme historique « souple » (p. 20), où cette genèse est rattachée autant à la naissance du capitalisme industriel et aux conflits de classe qui lui sont inhérents qu’à l’effectivité des facteurs « non économiques ». En résulte une « histoire du peuple » englobante, qui croise habilement les angles disciplinaires (histoire, politique, militaire, économique, sociale), les échelles d’analyse (locale, nationale, internationale) et les points de vue sociaux : les résistances populaires répondent systématiquement au jeu des intérêts des élites. Se retrouve au cœur du récit la centralité conjointe du phénomène « nationalitaire » et de la transition au capitalisme, retracée sous un angle matérialiste qui renvoie dos à dos les interprétations nationalistes et antinationalistes étroites de l’histoire du Canada (p. 20-21).
La structure du livre reflète les deux grands processus historiques menant à la création de l’État fédéral canadien. Premièrement, les chapitres 1 à 9 relatent les luttes des réformistes des deux Canadas pour l’obtention du gouvernement responsable (1815-1848). Par sa description parallèle des deux mouvements, Ryerson réussit à éclairer leur parenté. De part et d’autre, les réformistes sont divisés en une aile modérée, constituée par la bourgeoisie naissante, et une aile radicale/révolutionnaire, incarnée principalement par des cultivateurs et des ouvriers (p. 120). De part et d’autre, la lutte contre la domination des élites coloniales (la Clique du Château et le Family Compact) mène à des insurrections révolutionnaires qui font apparaitre l’aile radicale comme « le moteur » des protestations pré-1840 (p. 197).
Par ce récit, Ryerson s’oppose aux interprétations chauvinistes qui nient l’existence du « facteur démocratique » au sein des mouvements réformistes et qui font du mouvement des Patriotes un mouvement exclusivement « national » (p. 488). En éclairant les liens de solidarité entre les deux mouvements, il démontre que cette dimension nationale est loin d’effacer l’ancrage de leur lutte dans des revendications démocratiques partagées.
L’Acte d’Union répond à cette conjoncture subversive en noyant le Bas-Canada au sein d’une structure représentative à majorité anglaise, ce qui permet de faire d’une pierre deux coups. D’une part, les aspirations démocratiques au gouvernement responsable sont contournées par la compensation obtenue par le Haut-Canada (gains politiques et transfert de sa dette publique). D’autre part, on conjure du même coup « l’ascension politique de la race des vaincus » (p. 191). Cela n’empêche toutefois pas les ailes modérées des mouvements réformistes de s’allier pour obtenir, en 1848, un gouvernement responsable sous le leadership conjoint de Baldwin et de Lafontaine. Cela permet alors de maintenir les liens coloniaux, moyennant une concession supplémentaire : l’abrogation de l’interdiction du français et une certaine acceptation du facteur national au sein des structures politiques. Se cristallise alors une reconnaissance partielle de l’égalité entre les nations, dont le niveau est fixé par « les intérêts communs des milieux d’affaires canadiens-anglais, de l’Église du Bas-Canada et de la métropole impériale » (p. 225).
Deuxièmement, en partant de ces nouvelles bases politiques, les chapitres 10 à 20 relatent la façon dont l’essor du capitalisme industriel mène à la naissance d’un État fédéral bourgeois.
Ryerson situe l’envolée de l’industrialisation capitaliste au confluent d’une multiplicité de facteurs, tant endogènes qu’exogènes. D’un côté, il voit émerger les germes de l’industrialisation capitaliste dans le développement des manufactures locales et dans la formation d’une armée de réserve issue en partie des obstacles à la colonisation posés par les élites foncières. De l’autre côté, ces facteurs endogènes ne suffisent pas à expliquer la transition au capitalisme : la classe ouvrière naissante est largement alimentée par l’afflux massif d’immigrantes et immigrants irlandais, tandis que le développement manufacturier ne prend réellement son envol que dans le sillage d’un développement ferroviaire qui visait d’abord l’exportation de matières premières. Ce modèle de développement est d’ailleurs lui-même issu de la politique anglaise de libre-échange et de l’expansionnisme économique et politique américain. Au croisement de ces causes, les capitalistes des chemins de fer, sous l’hégémonie du « Grand Trunk » et de la Bank of Montreal, utilisent le gouvernement responsable pour s’affirmer comme la nouvelle classe dominante et développent progressivement un projet commun : l’abolition des douanes entre les provinces et l’établissement de tarifs protectionnistes afin « d’agrandir et d’unifier le marché interne de l’industrie canadienne » (p. 337). À ces intérêts nationaux en faveur de l’union des provinces s’ajoute « la stratégie impériale [britannique] qui exigeait l’unification non seulement pour empêcher les colonies d’être absorbées par les États-Unis, mais aussi pour renforcer les liens de l’Empire avec la zone du Pacifique et, de là, avec l’Asie » (p. 363).
Ryerson relate ensuite le jeu politique derrière la Confédération, montrant comment celle-ci a été imposée par le haut dans un esprit foncièrement antidémocratique. L’accent est alors placé sur le rôle crucial joué par Georges-Étienne Cartier pour intégrer le Québec au projet. Selon Ryerson, ce rôle démontre l’effectivité d’un certain pacte binational derrière la forme prise par l’union fédérale, bien que la reconnaissance de l’égalité nationale ait été d’emblée déformée et neutralisée par la réduction libérale de « la nation à un étroit particularisme religieux et linguistique » (p. 436).
Enfin, soucieux de décrire la tendance violemment néocoloniale de ce nouvel État face aux peuples autochtones, Ryerson se penche sur la lutte des Métis pour l’autodétermination, « seul exemple d’une intervention réelle des masses dans la question de la Confédération » (p. 442). À l’aune du reste de l’ouvrage, la répression et la reconnaissance déformée de cette lutte symbolisent l’essence même de la Confédération canadienne : le projet d’une élite capitaliste anglo-canadienne qui n’a pu réussir qu’en intégrant les revendications des minorités nationales de façon à en neutraliser la teneur démocratique et égalitaire.
En définitive, Capitalisme et confédération se démarque par une écriture précise et minutieuse qui demeure malgré tout accessible et didactique. Par une généreuse pratique de la citation (allant du plus petit pamphlet aux correspondances des élites coloniales), Ryerson nous fait plonger habilement dans l’esprit et les antagonismes politiques de l’époque, combinant avec brio l’accessibilité de l’histoire « des grands hommes » et les technicités de l’histoire politique et économique. Bien qu’abordée partiellement, la résistance des peuples autochtones à la domination coloniale fait tout de même partie intégrante du récit. Beaucoup plus regrettable est le silence complet de Ryerson sur l’effectivité historique des luttes féministes.
L’édition de 2024 a opté pour un format poche dépourvu des images qui parsemaient souvent inutilement l’édition de 1978, mais dont certaines (surtout des cartes) auraient tout de même pu être utiles. Cette perte est plus que compensée par la qualité des nouvelles préfaces et postface : très bien documentées ; elles synthétisent efficacement le parcours et la pensée d’un historien que la gauche d’aujourd’hui aurait avantage à mieux connaitre.
Par Olivier Samson, Doctorant en sciences sociales appliquées à l’Université du Québec en Outaouais
- Voir Christian Desmeules, « Humaniste cherche polémique », Le Devoir, 1er octobre 2024. ↑
- Le régime de plantation du Sud reposait aussi sur cette contradiction (qui met à mal une philosophie matérialiste de l’histoire) d’une classe laborieuse qui se retourne contre elle-même au nom d’une supposée supériorité « raciale » qui a pour effet de sublimer les rapports d’exploitation entre propriétaires terriens et non-propriétaires blancs : « Même exploité et incapable de posséder la terre, […] le “pauvre Blanc” reçoit pour “salaire” non monétaire la jouissance de sa valeur raciale, synonyme de préséance et d’une reconnaissance sociale inestimable » (p. 417). ↑
- « Il s’organise pour ce faire en un système autonome fondé sur la propriété privée et le marché » (p. 12). ↑

La réduction des lieux publics en temps de crise à Port-au-Prince

Vers la constitution de lieux publics en temps de crise sécuritaire[1]
Dans l’imaginaire populaire haïtien, la rue et les lieux publics sont perçus comme étant le salon du peuple[2]. L’investissement des lieux constitue une des modalités de la création d’espaces publics bien ancrée dans l’histoire urbaine d’Haïti. Dans une étude sur l’appropriation des lieux publics à Port-au-Prince, Thérasmé[3] a dressé le portrait des citoyennes et des citoyens qui occupent les lieux de manière informelle. Il a également voulu schématiser ce processus d’appropriation tout en essayant de comprendre le rôle du profil de l’individu et des ressources dont il dispose dans la détermination de sa position spatiale. En effet, le travail de Thérasmé rejoint une vaste littérature sur l’appropriation de l’espace public. C’est le cas par exemple de Fleury qui soutient que « l’espace public se définit par la présence physique de citadins et citadines[4] ».
Par ailleurs, l’organisation d’activités culturelles participe au renouvellement de la perception et des usages de la ville[5]. Organiser un concert constitue normalement une activité ordinaire dans une ville plus ou moins fonctionnelle. Dans le cas de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, les activités de loisirs sont de plus en plus rares au cours des dix dernières années. De surcroit, le contexte social explosif, marqué par la terreur des gangs, réduit considérablement les lieux publics où des artistes d’horizon divers pourraient performer. Le Champs de Mars qui constitue le lieu mythique des traditionnelles manifestations politiques et culturelles se transforme déjà en un non-lieu. Dépouillé de sa vitalité, il devient un espace répulsif pour les opérateurs culturels et les riverains.
Ce problème d’accès aux lieux publics ne se limite pas aux créatrices, créateurs et amateur·e·s d’art de la scène dans la mesure où les autorités politiques s’inscrivent dans la même démarche. Au lieu de mobiliser le pouvoir public pour assurer la sécurité des lieux, elles fuient, comme le commun des mortels, les principaux espaces publics. À plusieurs reprises, l’insécurité amène les officiels du gouvernement à annuler des activités en hommage aux héros au Champs de Mars[6]. Ils sont légion, les ministres et autres cadres supérieurs de la fonction publique qui abandonnent les locaux de leur ministère pour raison de sécurité. Sous l’effet de la violence, le festival annuel de Rara à Leogane est réduit à sa plus simple expression. Le carnaval, la plus grande manifestation culturelle du pays, a été reporté, voire annulé, à plusieurs reprises pour le même motif. Il en est de même du concert international de jazz organisé chaque année à Port-au-Prince.
Par ailleurs, la vie économique est presque complètement paralysée puisque la rue, lieu principal de circulation des marchandises, meurt à petit feu. Toutefois, le cycle d’accumulation ne semble pas s’interrompre pour certaines fractions de la bourgeoisie haïtienne[7]. Ce contraste accroit la crédibilité de l’hypothèse d’une économie souterraine criminelle florissante qui serait axée sur la vente d’organes, de drogue, d’armes et de minutions. L’état des recherches en sciences sociales ne permet pas encore d’approfondir cette piste de recherche.
Le phénomène de l’insécurité n’a rien de commun avec la rumeur du cheval blanc de Gary Victor qui ensorcelle la république[8]. Il est, en fait, un enjeu de société si on en croit les chiffres des organismes locaux et internationaux[9]. Sur une population de près 11 millions d’habitants à l’échelle du pays, le spectre de la mort violente a atteint environ 109 personnes par mois entre 2018 et 2022. Au cours des deux dernières années, la spirale de violence se déchaine pour atteindre plus de 500 à 600 homicides par mois. Le nombre de meurtres a augmenté de cinq à six fois en moins de 24 mois. Les victimes sont recensées dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans le département de l’Artibonite[10]. Le bilan des personnes blessées se chiffre également à plusieurs milliers. De surcroit, plus d’un million de résidentes et résidents ont dû fuir leur domicile. Les femmes et les hommes des classes populaires et de la petite bourgeoisie pauvre ont vécu et continuent à vivre cette violence innommable dans leur chair. Sous les décombres et dans les centres de leurs quartiers détruits, ils sont de ceux qui sont massivement tués. Parfois, ils sont brûlés vifs et leurs restes sont jetés en pâture aux chiens errants. C’est à ce prix que la ville cesse d’être un lieu de rencontre.
Ces données amènent plus d’un à penser que la peur semble triompher sur le communautaire. Grâce à la complicité des gouvernements successifs devant la prolifération des gangs, Port-au-Prince devient progressivement une ville morte[11]. Frappée dans son âme, elle cesse de plus en plus d’être un lieu de mémoire et de création[12]. La vie de quartier est réduite à sa plus simple expression. Les espaces culturels sont spoliés, comme en témoignent les saccages à répétition du Village de Nouailles, des bibliothèques, des universités, des écoles publiques et privées[13]. Les blessé·e·s sont poursuivis jusqu’à leur lit d’hôpital. Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), plus de 60 % du système sanitaire a subi l’assaut des gangs[14].
Dans ce texte, il n’est pas question de faire la sociologie de la violence des gangs dans le pays. En effet, plusieurs auteurs et autrices ont avancé des hypothèses d’explication[15], mais il y a encore du chemin à faire pour rendre intelligible cette crise sociale. Pour l’instant, nous nous intéressons à l’éviction des espaces publics et aux tentatives de réappropriation des lieux par certains acteurs du milieu culturel et du mouvement social. Toutefois, nous utilisons des données sur la violence des gangs pour mettre en lumière non seulement son effet perturbateur mais également la résistance de la population urbaine de Port-au-Prince.
Lieux publics dans la « ville morte » de Port-au-Prince
S’il n’y a presque plus d’espace de création artistique dans la « ville morte[16] » de Port-au-Prince, cela ne sous-entend pas qu’il n’y a pas de tentatives pour tisser des liens, créer de nouveaux lieux de rencontre, ne serait-ce que l’espace d’un cillement. Quoique décalée dans le temps, la grande foire Livres en folie a été quand même organisée à l’été 2024. Le festival Artisanat en Fête s’est finalement tenu l’automne dernier même si très peu de monde a fait le déplacement pour y participer[17].
Par ailleurs, les commerçantes et commerçants du secteur informel ont bravé et continuent de braver au quotidien la terreur des gangs pour essayer de mener leurs activités économiques. En jouant la carte stratégique, ils se sont concentrés dans certains espaces spécifiques leur permettant une plus grande possibilité de repli en cas de danger imminent. Dans cette résistance, de nouveaux lieux sont créés. Les activités effervescentes du centre-ville de Port-au-Prince se trouvent à présent à Lalue, à Pétion-Ville, à Haut-Delmas.
Ce processus de constitution de nouveaux espaces ne se limite pas à l’initiative des acteurs de l’économie informelle et des grands opérateurs culturels. D’autres acteurs du mouvement social y participent également. Le 17 décembre 2024, le Kolektif kont Ranson de 1825 a organisé une série d’activités de réflexion sur la longue histoire de dépossession d’Haïti par les forces impérialistes[18]. À cette occasion, on a fait appel à plusieurs espaces. D’un côté, le public était invité à venir en personne dans le centre culturel Pye Poudre ; d’un autre côté, des plateformes de communication virtuelle étaient utilisées pour des conférences-débats. Dans les deux cas, le public a été mobilisé pour participer aux échanges. Dans les discussions, les personnes intervenantes et participantes ont fait le lien entre plusieurs actes de dépossession, notamment l’indemnité (aussi appelée rançon) exorbitante imposée par le roi de France Charles X en 1825 pour reconnaitre l’indépendance d’Haïti, le vol de la réserve d’or entreposée à la Banque nationale de la République d’Haïti par les militaires étatsuniens le 17 décembre 1914, l’occupation étatsunienne d’Haïti entre 1915 et 1934 et les politiques d’ajustement structurel à l’ère du néolibéralisme triomphant. D’autres organisations progressistes ont, à certains moments, pris la rue pour revendiquer la fin des politiques de soumission aux puissances impérialistes, le rétablissement de la sécurité publique et la neutralisation des hordes de gangs criminels[19]. Face à la terreur des gangs, ces initiatives font partie d’un ensemble de tentatives pour créer de nouveaux espaces de rencontre dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.
À la différence de Paul, personnage principal de l’opéra Die tote Stadt (La ville morte) de Erich Wolfgang Korngold qui ne parvient pas à sortir de l’enfermement à la suite d’une tragédie, Port-au-Prince se caractérise par un contraste : d’un côté, la terreur des gangs procède à l’effacement des espaces de rencontre ; de l’autre, une résistance à la destruction des lieux publics se développe au quotidien. Cette résistance vient surtout d’en bas, elle est populaire. Elle se renforce alors que l’état de choc se poursuit. Au moment où nous écrivons cet article, les rapts, les massacres et les menaces s’abattent encore dans les coins et recoins de la ville[20]. Mais, Port-au-Prince semble refuser le statut de ville morte.
Kebert Bastien en concert dans la ville morte de Port-au-Prince
Le refus du silence, le refus de se taire exposé précédemment prend forme également dans le monde culturel. Cette pratique n’est pas seulement l’apanage des opérateurs culturels haïtiens. L’Institut français d’Haïti a programmé le 16 janvier 2025 un spectacle de l’artiste engagé Kebert Bastien (Keb). Comme l’indique l’affiche reproduite, le titre de l’événement est à la fois évocateur et symbolique : Spectacle 12 millions de vivants.

Crédit : Institut français d’Haïti
Ce chiffre renvoie à la totalité de la population de la République d’Haïti. Le terme « vivant » peut prendre une connotation qui va au-delà du contraste mort/vie. Désigner la population d’un pays comme « des vivants » met en lumière la précarité de l’existence. Il s’agit de la vie nue. Privés de presque tout, les habitantes et habitants d’Haïti seraient confinés à une simple logique de survie. Loin d’être abstrait, le drame social de Port-au-Prince témoigne de la pauvreté de la vie sociale. Vieux de deux décennies, les propos de l’écrivain franco-haïtien René Depestre peuvent s’appliquer au drame de la population haïtienne d’aujourd’hui lorsqu’il avançait en 2005 que « la mort dans l’esprit et dans le ventre, les Haïtiens et les Haïtiennes vivent au quotidien des expériences atroces d’une tragédie apparemment sans fin[21] ». En ce sens, les opérateurs culturels de l’Institut français ont fait preuve de réalisme en invitant le public au Spectacle 12 millions de vivants.
Au-delà du symbolisme du titre du spectacle, l’organisation de cet événement fait partie des tentatives pour inventer de nouveaux lieux de création artistique. Toutefois, il importe de reconnaitre que le jardin de l’Institut français ne constitue pas un espace d’expression libre. Étant un organe de diffusion des politiques culturelles de l’État français, il demeure un espace plus ou moins sous contrôle. Ou du moins, les différents invité·e·s y pratiquent le plus souvent l’autocensure par rapport à toute idée remettant en cause les intérêts de l’État français en Haïti. Cette règle non écrite est généralement suivie par beaucoup d’intellectuel·le·s haïtiens[22].
En rompant avec cette prudence, le spectacle du jeudi 16 janvier 2025 a été historique. Accompagné de plusieurs musiciens, Kebert Bastien a entrainé le public dans la spirale de son univers esthétique. Comme il l’a réussi dans ses cinq albums, sa performance était marquée par le mariage d’une variété de rythmes issus des cultures populaires haïtiennes[23]. Sous les applaudissements du public, la rencontre de sa voix et de sa guitare donne une nouvelle vitalité aux rythmes congo, banda, yanvalou, etc. Toutefois, la séquence la plus marquante de la soirée a été le morceau exécuté sous les rythmes rara, raboday et jazz. Rappelons que le raboday et le rara renvoient à la marche militaire. Dans l’histoire, « le Rabòday a constitué, dans le contexte de la guerre de l’Indépendance d’Haïti, une parodie de la musique militaire de l’armée coloniale française. Il se caractérise, entre autres, par des jeux de tête et des mouvements latéraux traduisant la vigilance du guerrier sur les scènes de combats[24] ».
L’invitation à la lutte ne se circonscrit pas au choix des mélanges de tonalité et des rythmes musicaux. En écho à la mélodie, le texte de la chanson évoquait un enjeu de combat. Il portait sur la demande de restitution de la rançon de 1825 à l’État français[25]. Sous les applaudissements d’un public chauffé à blanc, Keb a mis en chanson l’une des principales revendications des classes populaires haïtiennes contre l’impérialisme occidental. En le faisant dans le jardin de l’Institut français, le geste a cessé d’être une simple performance artistique de grande portée pour devenir un acte historique dans la mesure où l’artiste s’est démarqué de la traditionnelle pratique d’autocensure de nombreux politiciens, politiciennes et intellectuel·le·s haïtiens.
Dans les annales des activités du jardin de l’Institut français, le poète René Depestre a été de ceux qui ont le mieux illustré la parole sur mesure lorsqu’il a insisté en 2005 en ces termes :
J’ai cherché un jour avec Régis Debray qui est un grand normalien ; les Français sont très forts quand il faut inventer les concepts, surtout un normalien. Je lui ai dit, trouve un concept qui ménagerait la sensibilité légitime des Haïtiens en matière de souveraineté nationale et le sentiment patriotique haïtien. Qu’il ne soit pas tutelle surtout ! On ne peut pas parler de tutelle aux Haïtiens. On peut prendre accompagnement, ou intergouvernance, c’est un nouveau mot qui entre dans l’opinion actuellement. Pourquoi pas intergouvernance ou cosouveraineté pour que les Haïtiens avalent la pilule de la coopération parce qu’autrement, seul, on n’en sortirait pas[26].
À l’occasion, l’ancienne figure de la gauche haïtienne ne portait plus les idées révolutionnaires contre l’ordre des bourgeois locaux et internationaux. Au contraire, il voulait exceller dans la tâche de trouver la bonne stratégie pour la réussite de la mise sous tutelle de son pays d’origine[27]. À l’opposé de ces discours sur mesure, Kebert Bastien est sorti de la logique de la langue de bois au profit de la parole orthogonale. Ce faisant, il a choisi de donner une voix au mouvement du Kolektif kont ranson de 1825 dans le territoire même du bourreau.
La rançon de 1825 : le sens du discours de certains acteurs
La clarté des propos de Keb a un autre intérêt. Elle permet d’établir une différence d’avec les nombreux acteurs qui interviennent sur la question de la demande de restitution de la rançon de 1825. Certains représentants de l’État l’évoquent du bout des lèvres alors que, dans le choix de politiques publiques, la soumission aux directives des puissances impérialistes, dont la France, demeure une ligne directrice. En guise d’illustration : le président Jean Bertand Aristide a, d’une part, fait preuve de courage en soulevant la question de la restitution de la rançon de 1825 au début des années 2000, mais, d’autre part, il a engagé une compagnie privée étatsunienne pour assurer sa sécurité personnelle. De plus, son administration s’est embourbée dans l’application des programmes d’ajustement structurel dictés par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, comme en témoigne la loi de 2002 sur l’implantation de zones franches dans toutes les régions du pays. Cette ambivalence est encore d’actualité dans le positionnement du gouvernement de transition. Les conseillers-présidents Edgar Leblanc Fils et Leslie Voltaire ont respectivement demandé à la France de rembourser les fonds de la rançon de 1825 en même temps qu’ils se démarquent de toute démarche de construction d’un État souverain. Leur gouvernance repose essentiellement sur une demande d’assistance sur les plans financier, militaire, sécuritaire, humanitaire alors que les fonds publics sont souvent utilisés au profit d’intérêts particuliers[28].
C’est le cas également de certains acteurs de la société civile qui inscrivent la demande de restitution de la rançon de 1825 sous le signe de l’empathie. En ce sens, le géographe Jean Marie Théodat, membre de la commission de restitution de l’Université d’État d’Haïti a écrit dans les colonnes du journal Libération le 6 janvier 2025 :
En réponse aux insultes, c’est donc une invitation à l’empathie et à une réflexion d’ensemble sur les responsabilités françaises vis-à-vis de l’ancien empire que lancent les Haïtiens et les Mahorais unis dans la détresse et confondus dans le mépris du jeune monarque[29].
Cette position consiste à dépolitiser les enjeux néocoloniaux au profit d’une démarche compassionnelle. En effet, il importe de laisser les classes populaires en dehors du débat sur la restitution. Les tenants de cette approche ne souhaitent pas une appropriation de ce débat par les mouvements sociaux. Au contraire, ils se proposent désormais d’innover dans les rapports interétatiques en faisant abstraction de la dimension conflictuelle. Ces intervenants proposent ainsi la recherche de compassion dans les rapports entre Haïti et la France comme stratégie de résolution de problèmes géopolitiques.
Conclusion
Depuis une décennie, la terreur des gangs affecte considérablement la vie urbaine dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Elle y réduit les espaces de rencontre. La métaphore de la ville morte ne constitue plus un qualificatif de trop pour Port-au-Prince. Les résultats préliminaires de notre enquête ont mis en lumière certaines tentatives de création de nouveaux espaces publics qui s’inscrivent dans une logique de résistance à la mise à mort des lieux publics. Par ailleurs, si plusieurs secteurs de la société participent à ce processus de constitution de nouveaux lieux publics, l’initiative des mouvements sociaux ne se limite pas seulement à une simple résistance à la terreur des hordes de gangs criminels. Elle semble répondre à la mise en œuvre de nouvelles dynamiques de luttes sociales et politiques. Comme en témoignent les initiatives du Kolektif kont ranson 1825, les mouvements sociaux ne veulent pas se laisser abattre par la peur. Au contraire, ils participent à la constitution de nouveaux espaces de rencontre tout en soulevant les principales revendications des classes populaires haïtiennes. En ce sens, l’évocation dans l’espace public de la demande à la France de restituer la rançon de 1825 constitue une avancée intéressante. Loin d’être un simple ajout aux nombreuses revendications, elle témoigne d’une prise de conscience des classes populaires de la longue histoire d’expropriation et de dépossession dans le pays.
Par Renel Exentus, détenteur d’un doctorat en études urbaines de l’Institut national de recherche scientifique
- Une version de ce texte a été publiée sous le titre Esquisse d’une réflexion sur la réduction des lieux publics en temps de crise à Port-au-Prince. L’enjeu de la rançon 1825 et les mouvements sociaux en Haïti, Delmas, Haïti, AlterPresse, 5 mars 2025. ↑
- En créole, « lari a se salon pèp la ». ↑
- Kelogue Thérasmé, Dynamiques et appropriation informelle des espaces publics dans les villes du sud : le cas du centre-ville de Port-au-Prince, thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2011. ↑
- Antoine Fleury, Les espaces publics dans les politiques métropolitaines. Réflexions au croisement de trois expériences : de Paris aux quartiers centraux de Berlin et Istanbul, thèse de doctorat en géographie, Paris, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007. ↑
- Léna Aparis Jutard, « La création dans l’espace public, laboratoire artistique de pratiques altermétropolitaines », Bulletin de l’association de géographes français, vol. 101, n° 1, 2024. ↑
- Plusieurs études ont documenté la complicité des autorités politiques et des fractions de la bourgeoisie dans la prolifération des gangs. Voir notamment Jean-Baptiste Emerson, Violence et rapport social dans le milieu urbain haïtien : les cas de cité Soleil et de Martissant, 2004-2012, thèse de doctorat en sociologie, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2017 ; Renel Exentus, « Pour comprendre la crise sociopolitique haïtienne », Nouveaux Cahiers du socialisme, n 28, automne 2022. ↑
- À plusieurs reprises, les autorités admettent l’existence d’une économie criminelle puissante dans le pays. C’est le cas par exemple du président-conseiller Leslie Voltaire : Le président CPT Leslie Voltaire revient sur les enjeux de la visite du président colombien à Jacmel, 21 janvier2025. C’est le cas également de plusieurs rapports périodiques du Groupe d’experts sur Haïti présentés en application de la résolution 2700 (2023) de l’ONU, <https://docs.un.org/fr/S/2024/253>.↑
- Le récit traite de l’histoire d’un chien blanc qui a mis en branle toute la république. Étant associé au diable, l’animal a amené aussi bien des gens ordinaires que les autorités au plus haut niveau de l’État à fuir. Voir le roman de Gary Victor, Nuit Albinos, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016. ↑
- Voir les rapports des organismes locaux et internationaux suivants : Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), Assassinats, viols, pillages et incendies à carrefour et gressier sous le regard indifférent des nouvelles autorités étatiques, Haïti, et Couverture des réunions et communiqués de presse des Nations unies. ↑
- Soulignons que Port-au-Prince et l’Artibonite constituent deux entités territoriales distinctes. Port-au-Prince est la capitale du pays. L’aire métropolitaine de Port-au-Prince compte plus 1,2 million d’habitants en 2022 et s’étend sur 152,02 km2. Avec une superficie de 4 887 km2, l’Artibonite est un département de 1 571 020 habitants. Voir les données de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) : <https://ihsi.gouv.ht/>. ↑
- Plusieurs chercheurs ont documenté la complicité de plusieurs acteurs dans le développement des gangs. Voir notamment les travaux d’Emerson Jean-Baptiste, Violence et rapport social dans le milieu urbain haïtien, Londres, Éditions Universitaires européennes, 2018 et Exentus, 2022, op. cit ↑
- Pour plus de précision sur les dynamiques de création et de patrimonialisation dans les quartiers de Port-au-Prince, voir Bien-Aimé Kesler, Dynamiques de la patrimonialisation du paysage urbain historique de la ville de Port-au-Prince, thèse de doctorat en ethnologie et patrimoine, Québec, Université Laval, 2023 ; voir également l’entrevue de Olsen Jean Julien, dans AlterPresse le 5 juin 2024 et celle d’Érol Josué sur YouTube, le 26 février 2025 : <https://www.youtube.com/watch?v=cpsAk_nU6NY>. ↑
- Voir : <https://www.haitilibre.com/en/news-37935-haiti-flashthe-village-of-noailles-victim-of-the-gang-war-at-least-15-dead.html> ; <https://ayibopost.com/photos-des-facultes-du-bas-de-la-ville-de-p-au-p-ravagees-par-les-attaques-des-gangs/> ; <https://www.ledevoir.com/monde/834502/gangs-prennent-systeme-sante-haiti>. ↑
- UNICEF, « Haïti : le système de santé s’effondre face à la violence », 22 mai 2022. ↑
- Renel Exentus, 2022, op. cit. ; Georges Eddy Lucien et Walner Osna, « Gangstérisation d’Haïti. Du contrôle au démantèlement des mouvements populaires », Le Nouvelliste, 18 août 2023 ; James Darbouze, « Capitalisme du désastre. La formule de dieu et de notre avenir », AlterPresse, 4 juin 2022 ; Neptune Prince, Comprendre les gangs en Haïti. Quartiers-sécurité-médias, Port-au-Prince, Pro Éditions, 2023 et Montréal, CIDIHCA, 2024. ↑
- L’expression « ville morte » réfère au titre français de l’opéra « Die tote Stadt » d’Erich Wolfgang Korngold sur un livret du compositeur Paul Schott et de son père en 1892, d’après le roman Bruges-la-morte de Georges Rodenbach. ↑
- Pour avoir une idée sur les activités culturelles, consulter :<https://lenouvelliste.com/article/251982/artisanat-en-fete-une-vitrine-pour-la-creation-la-passion-et-la-tradition-haitienne> ; <https://lenouvelliste.com/article/252031/lartisanat-resiste-aux-balles> ; <https://lenouvelliste.com/article/248408/livres-en-folie-fixee-au-15-aout-2024> ; <https://www.alterpresse.org/spip.php?article30797>. ↑
- D’autres organisations ont aussi tenu, ce 17 décembre 2024, des activités de réflexion sur la rançon coloniale de 1825 et sur le vol de la réserve d’or de 1914. C’est le cas par exemple du Cercle Makandal. ↑
- Voir : « Haïti-crise : de nouvelles manifestations à Port-au-Prince et en province pour réclamer le départ d’Ariel Henry », AlterPresse, 31 janvier 2024 ; Associated Press, « Haïti : des milliers de manifestants réclament une protection contre les gangs », Radio-Canada, 8 août 2023 ; Roberson Alphonse, « Salaire minimum : nouvelle manifestation des ouvriers de la sous-traitance », Le Nouvelliste, 15 février 2022. ↑
- Comme les quartiers de Pernier et Nazon, Kenskoff est en train de tomber sous la tutelle des gangs criminels. Les bilans provisoires les plus conservateurs font état d’environ une centaine de morts et plusieurs personnes ont fui leur milieu de vie. Voir : « Haïti-criminalité : environ 3000 personnes de nouveau déplacées à Kenskoff et au centre-ville de Port-au-Prince, selon l’Oim », AlterPresse, 4 février 2025 ; Jean-Daniel Sénat, « Au moins 150 morts à Kenskoff, selon la FJKL », Le Nouvelliste, 5 février 2025. ↑
- Conférence de René Depestre à l’Institut français d’Haïti en 2005. ↑
- Ibid. ↑
- Claudy Bélizaire, « Kebert Bastien contre l’occupation américaine », Le Nouvelliste, 4 janvier 2016. ↑
- Voir Renel Exentus, « Causerie-Spectacle sur l’Art du Tambour haïtien et hommage au percussionniste Georges Rodriguez », Madinin’Art, 24 octobre 2024. ↑
- Le refrain de la chanson en créole est : « Vin peye, vin peye Lafrans ». ↑
- Voir Claude Bernard Sérant, « Institut français d’Haïti/conférence. La France joue la carte René Dépestre », Le Nouvelliste, 23 février 2005. ↑
- Les propos du converti s’inscrit dans le prolongement de la fameuse « initiative d’Ottawa sur Haïti » de 2003. Voir : Michel Vastel, « Haïti mise en tutelle par l’ONU ? », L’actualité, 15 mars 2003. ↑
- Salaire des conseillers-présidents, main basse sur les fonds de l’intelligence, tentative de braquage de la Banque Nationale de Crédit (BNC). Voir : Unité de lutte contre la corruption, Rapport d’enquête sur les allégations de sollicitations de cent millions de gourdes par trois membres du Conseil Présidentiel de Transition, Haïti, 2024. ↑
- Jean-Marie Théodat, « Haïti : la dette, le monarque et les “cons” », Libération, 6 janvier 2025. ↑
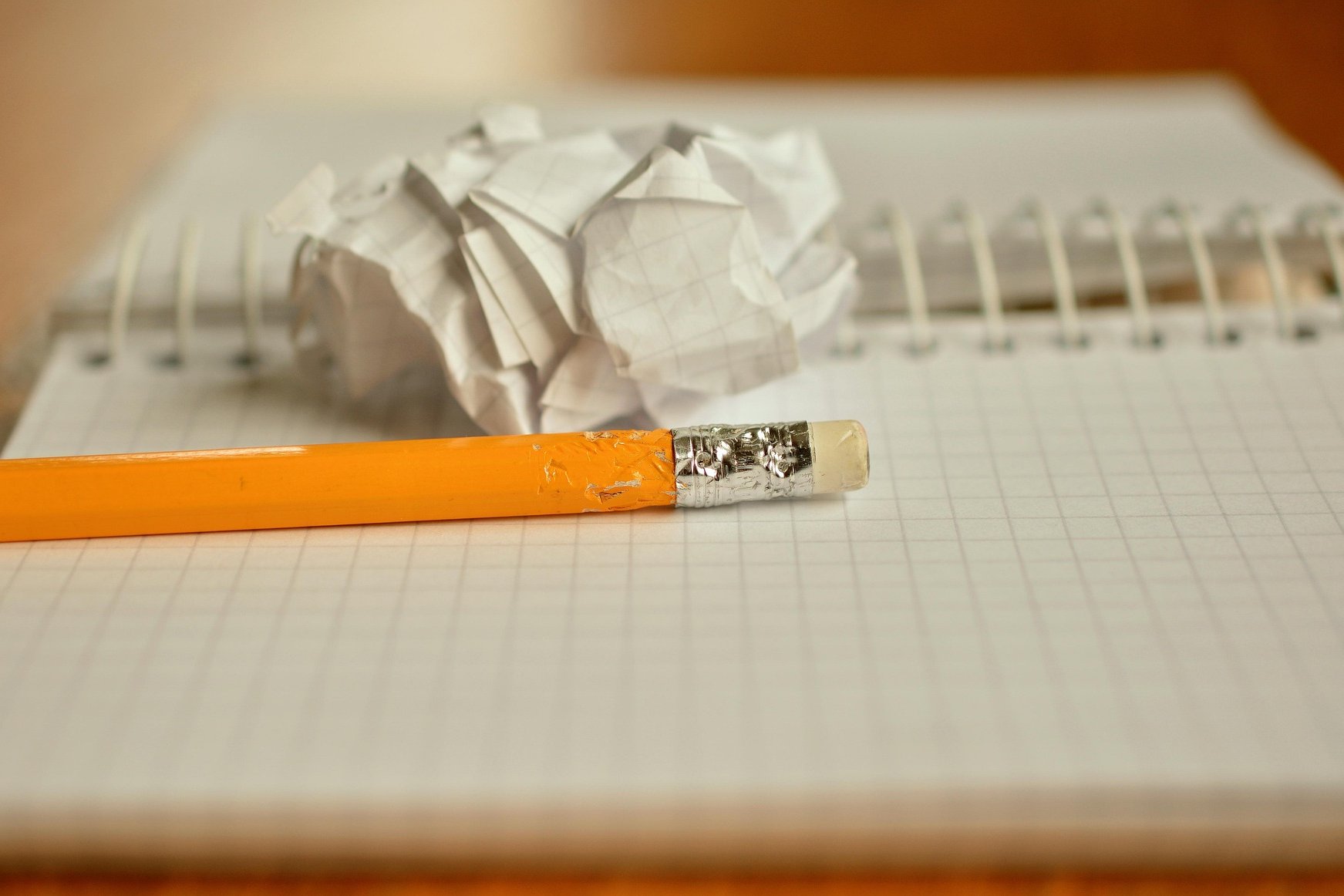
Des techniques légères pour reprendre le contrôle de la production

Il est difficile d’imaginer collectivement de quoi aurait l’air une société non capitaliste. D’abord parce que le capitalisme nous impose des ornières qui limitent notre capacité à imaginer les avenirs possibles, mais aussi parce qu’au sein même de la gauche, différentes visions – souvent implicites – de l’utopie se confrontent. La question de la place de la technique me parait être un bon point de départ pour penser l’avenir socialiste, dans la mesure où il s’agit d’une question qui touche à plusieurs sphères de la vie : temps de travail, « contenu » du travail, organisation politique, rapport à l’environnement, etc. Historiquement, la plupart des penseuses et penseurs socialistes qui se sont penchés sur la question ont adopté la position suivante : la machine, dans le monde actuel, contribue à asservir et à aliéner les êtres humains parce qu’elle est contrôlée par les capitalistes. Mais une fois ce système d’oppression renversé, elle pourra être mise au service de l’émancipation humaine[1].
Le communisme de luxe entièrement automatisé (Fully Automated Luxury Communism) envisagé par un groupe de militantes et militants britanniques est une incarnation récente et attrayante de cette approche[2]. Cette avenue mérite d’être explorée sérieusement, à tout le moins pour en examiner le potentiel et les risques. Je prendrai toutefois la direction inverse, en mettant de l’avant une proposition qui s’inscrit dans une perspective de décroissance. À mesure que les objets techniques qui nous entourent se complexifient, ils exigent souvent des infrastructures de plus en plus lourdes, des réseaux de production de plus en plus vastes et dispersés à travers le monde, ainsi qu’une division du travail de plus en plus poussée. Par conséquent, il devient extrêmement difficile d’envisager un véritable contrôle démocratique de l’économie. Pour remettre la production entre les mains des individus et des communautés, je propose donc de tendre vers une forme d’autosuffisance qui s’appuie sur le développement de techniques légères.
Le crayon de Milton Friedman
Dans un extrait vidéo disponible sur YouTube[3], on voit l’économiste Milton Friedman s’adresser à son public, l’air enthousiaste. Tenant un crayon à mine dans ses mains, il fait une déclaration provocatrice : « Personne sur cette planète ne sait comment fabriquer ce crayon ». En fait, Friedman s’inspire de l’économiste libertarien Leonard Read, dont le texte I, Pencil (1958) se veut une illustration de la puissance de la main invisible du marché. Dans ce court texte[4], le crayon prend la parole pour expliquer la complexité de son processus de fabrication. Il est fait de bois, de graphite, d’un peu de métal et d’une gomme à effacer, mais le bois vient des forêts de l’Oregon, le graphite est extrait des mines du Sri Lanka, tandis que la gomme est fabriquée à partir d’huile de colza provenant de champs indonésiens. À chaque étape de ce processus qui s’étale déjà à l’échelle du monde, des outils ont été employés et des individus ont contribué avec une part de leur force de travail. Les outils ont eux-mêmes dû être fabriqués quelque part, tandis que les travailleuses et travailleurs ont dû être logés et nourris. De plus, chacune des matières premières utilisées a dû être transportée sur de vastes distances, ce qui a nécessité l’usage de camions, de bateaux, d’un réseau de routes et d’installations portuaires. Rapidement, on comprend que la chaine de production prend une ampleur colossale, et que des milliers, voire des millions de personnes ont été mobilisées pour fabriquer ce « simple » crayon, chacune y consacrant une fraction de son temps de travail.
Ce qui fascine Friedman et Read, tous deux farouchement opposés aux mesures de planification économique souhaitées par les marxistes et par les keynésiens, c’est que tout cela s’est produit sans coordination centrale :
Il y a quelque chose d’encore plus étonnant : c’est l’absence d’un esprit supérieur, de quelqu’un qui dicte ou dirige énergiquement les innombrables actions qui conduisent à mon existence. On ne peut pas trouver trace d’une telle personne. À la place, nous trouvons le travail de la Main invisible. C’est le mystère auquel je me référais plus tôt[5].
Évidemment, cette affirmation est discutable. De nombreux aspects du processus reposent sur la planification étatique : construction du réseau routier, formation de la main-d’œuvre, recherche scientifique, etc. De plus, à toutes les étapes du processus, des cadres et des conseils d’administration d’entreprises ont orienté et coordonné le déploiement des ressources nécessaires, en s’appuyant notamment sur une certaine vision englobante de l’économie, provenant d’études de marché ou de prédictions économiques diffusées par les médias. On sait aussi qu’il a pu y avoir collusion entre l’État et les entreprises concernées pour réprimer dans la violence tout mouvement qui freinerait la bonne marche des affaires. Bref, il serait absurde de considérer ce processus comme la somme des actions individuelles, sans tenir compte de toutes les formes de direction et de concertation existantes.
Néanmoins, il est vrai qu’aucune organisation surplombante n’a dirigé l’ensemble du processus. Il est aussi avéré que seule une fraction des personnes impliquées a pu prendre part aux décisions concernant les différentes étapes de la production, d’où l’illusion d’un ordre spontané, « naturel ». Selon Friedman, le plus beau dans tout cela est que cet « ordre spontané » fonctionne alors même que chaque personne impliquée ignore presque tout des autres personnes impliquées et du processus lui-même. Or, ce que Friedman considère comme une vertu m’apparait extrêmement problématique. L’ignorance mutuelle des acteurs et actrices du réseau de production (et de consommation) contribue à perpétuer des situations affligeantes du point de vue social et environnemental. À titre d’exemple, beaucoup de consommatrices et consommateurs des pays occidentaux sont inconscients de la pollution et des conditions de travail exécrables associées à l’industrie électronique.
L’exemple du crayon à mine est intéressant parce qu’il s’agit d’un objet familier et relativement simple. L’affirmation selon laquelle personne au monde ne possède toutes les connaissances et les ressources requises pour en fabriquer un devient alors particulièrement frappante. Mais cette affirmation est d’autant plus vraie pour le nombre incalculable d’objets encore plus complexes qui nous entourent. La trajectoire technologique et socioéconomique empruntée par le monde au cours des dernières décennies a mené à l’approfondissement du modèle décrit par Friedman. De manière générale, le processus de production des objets qui peuplent nos vies est de plus en plus mondialisé et exige une division du travail de plus en plus poussée. Chaque travailleur et chaque travailleuse apparait alors comme un fil d’une vaste toile que personne ne peut saisir dans sa totalité[6].
La conséquence d’une telle division du travail à l’échelle de la planète est sans doute d’accroitre la productivité globale, mais aussi de placer chaque personne dans une situation de dépendance face à des réseaux de production et de distribution sur lesquels il devient pratiquement impossible d’exercer un véritable contrôle démocratique. En effet, comment envisager des mécanismes de participation et de prise de décision qui incluent un nombre considérable de personnes séparées par de vastes distances et par des barrières culturelles et linguistiques ?
C’est toutefois lorsque l’un des réseaux dont nous dépendons s’effondre que l’on prend le plus conscience de notre dépendance à son égard. Ainsi, durant la crise du verglas de 1998, en l’absence de sources d’énergie autonomes, des dizaines de milliers de familles québécoises ont dû assister, impuissantes, au chamboulement de leur mode de vie pendant plusieurs semaines à la suite de l’effondrement du réseau électrique[7]. Notre inscription dans des réseaux de production et de distribution nationaux, continentaux et planétaires peut aussi donner un pouvoir disproportionné aux individus et aux groupes qui contrôlent les maillons clés de ces réseaux. Pensons par exemple aux moments dans l’histoire où les pays producteurs de pétrole ou de gaz naturel ont restreint l’accès à ces deux ressources cruciales à des fins géopolitiques : le choc pétrolier de 1973 ou, plus récemment, en 2014, la coupure par la Russie de l’approvisionnement en gaz de l’Ukraine.
À une échelle plus locale, une coopérative de production qui se veut non capitaliste, mais qui dépend d’entreprises capitalistes pour l’accès à telle ou telle ressource risque d’être constamment forcée de se compromettre afin de maintenir cet accès. Pour réaliser et rendre durable l’idéal socialiste d’un contrôle démocratique de l’économie, il importe donc de maitriser l’ensemble des réseaux de production et de distribution, un objectif qui semble d’autant plus difficile que ces réseaux sont étendus et dispersés. Une autre voie possible consisterait à miser sur la création de réseaux courts, c’est-à-dire de circuits de proximité qui permettraient une production autosuffisante et qui garantiraient l’autonomie et l’indépendance des personnes concernées[8].
Entre l’ermite et le marché global, la « communauté vécue »
Lorsque l’on parle d’autosuffisance, l’image qui nous vient à l’esprit est souvent celle d’une microcommunauté formée de tout au plus quelques dizaines de personnes. L’indépendance économique doit pourtant être envisagée comme un continuum. À une extrémité, on trouve la figure de l’ermite ou de la survivaliste, qui cherche à combler seul·e l’ensemble de ses besoins. À l’autre extrémité, on peut concevoir une économie entièrement mondialisée, dans laquelle aucun besoin n’est comblé uniquement à partir de ressources locales. La « communauté vécue » représente une position intermédiaire possible.
Le politologue Benedict Anderson a inventé le concept de « communauté imaginée » pour décrire les nations, des sociétés au sein desquelles il est impossible, pour des raisons pratiques, que tous les membres se connaissent entre eux et aient des interactions en personne. À l’inverse, une « communauté vécue » en serait une où chaque personne serait à tout au plus deux degrés de séparation de toutes les autres, c’est-à-dire que chaque personne pourrait rencontrer n’importe quelle autre par l’intermédiaire d’une seule connaissance commune[9]. Partant de cette échelle, je propose le projet d’utopie suivant :
Que chaque communauté vécue détienne les moyens (ressources, compétences, connaissances) de produire ce qu’elle juge essentiel au maintien de son mode de vie et à sa reproduction dans le temps.
Il est impossible de définir a priori ce qu’une communauté jugerait essentiel à son mode de vie, mais il est certain que cela inclurait au minimum l’ensemble des tâches liées au fait de se nourrir, de se loger, de se vêtir et d’accomplir le travail de care. Une telle communauté, dont la taille correspondrait grosso modo à celle d’une petite ville, aurait l’avantage d’être suffisamment petite pour que des principes de démocratie directe puissent y être réalistement appliqués. Elle serait en même temps assez grande pour soutenir une certaine spécialisation du travail, ce qui contribuerait à la productivité générale. En supposant un système d’éducation qui enseignerait à chacune et chacun les rudiments des tâches essentielles, il serait possible, pour chaque individu, de parfaire ses connaissances en rencontrant personnellement les meilleurs artisans et artisanes de chaque tâche. Toute personne préserverait donc potentiellement la capacité de faire sécession de la communauté en apprenant auprès des autres ce qu’il lui faut pour assurer sa propre survie.
Techniques lourdes, techniques légères
Si l’on reprend l’exemple du crayon cité plus haut, et qu’on accepte que sa fabrication exige la mobilisation de millions de personnes comme Friedman et Read le suggèrent, comment peut-on penser qu’une communauté d’au plus quelques dizaines de milliers de personnes pourrait produire ce qu’il lui faut pour que tous ses membres mènent une vie décente ? Pour répondre à cette question, il faut s’attarder à une idée simple que Friedman et Read ne prennent pas en considération : le même objectif – fabriquer un outil servant à écrire – aurait pu être atteint par d’autres moyens.
Le capitalisme industriel s’est développé en misant sur la production de masse et sur l’élargissement constant des marchés. S’appuyant entre autres sur les structures coloniales, il a pris son essor en profitant d’une main-d’œuvre sous-payée et d’un accès facilité aux matières premières tirées des pays du « tiers-monde ». Le développement technique des deux derniers siècles a donc été en phase avec ces conditions socioéconomiques. D’une part, la division internationale du travail a favorisé l’émergence d’immenses plantations en monoculture, qui nécessitent des variétés de plantes adaptées, de la machinerie lourde et des apports constants d’engrais chimiques, d’herbicides et de pesticides[10]. D’autre part, elle a donné lieu à la construction d’usines de grande taille, souvent polluantes et aliénantes, qui utilisent des machines spécialisées pour produire en série des biens dont la durée de vie est limitée et dont la réparation est difficile.
L’expansion du capitalisme industriel a donc reposé sur le développement de techniques lourdes. À l’inverse, il serait possible d’utiliser le savoir existant et d’orienter la recherche vers le développement de techniques légères[11]. Il s’agirait de techniques qui amélioreraient le quotidien ou qui permettraient d’accroitre la productivité du travail, mais qui auraient une empreinte écologique réduite et qui préserveraient l’autonomie des individus et des communautés.
La différence entre l’automobile et le vélo constitue sans doute la meilleure illustration du contraste entre technique lourde et technique légère. La voiture exige un réseau étendu de routes larges capables de supporter un poids de plus d’une tonne et des vitesses élevées. Elle exige aussi une source d’énergie externe capable de faire fonctionner un moteur à explosion. Le vélo, nettement plus léger, n’a besoin que de l’énergie musculaire. De plus, on peut facilement apprendre à le réparer par soi-même et il peut être adapté pour faire face à différentes contraintes comme le vélo à trois roues pour plus d’équilibre ou le vélo à mains pour ceux et celles souffrant d’un handicap. Des exemples de techniques légères existent donc déjà. Quelques pistes peuvent être envisagées pour tendre vers un monde où elles prédomineraient, dont :
- Prendre en compte systématiquement l’ensemble du cycle de vie d’un objet pour connaitre à la fois son empreinte écologique et ses effets sur la capacité d’agir des individus et des communautés.
- Appliquer à tous les niveaux les principes de l’économie circulaire, selon laquelle les déchets issus d’un processus de fabrication servent de matières premières pour la conception d’un autre produit. Par exemple, une champignonnière peut produire de la nourriture à partir des drèches d’une microbrasserie locale et du marc de café des torréfacteurs du quartier. Le substrat obtenu peut ensuite servir à enrichir la terre d’un potager.
L’idéal de communautés largement autosuffisantes peut paraitre irréaliste, dans la mesure où il est en contradiction directe avec le modèle économique actuel. Pourtant, tout au long de l’histoire, une partie importante de l’humanité a vécu dans des communautés autarciques. Est-ce à dire que l’idéal proposé ici correspond en quelque sorte à un « retour au Moyen-Âge » ou au « communisme primitif » ? Non, dans la mesure où l’on peut profiter de l’esprit de découverte et d’innovation qui a toujours animé l’être humain et qui lui a permis de faire des bonds technologiques spectaculaires au cours des derniers siècles. Il s’agit cependant de canaliser cet esprit vers le développement de techniques légères, conviviales et adaptées à une échelle humaine.
Par Guillaume Tremblay-Boily, chercheur à l’IRIS
- Voir le livre de François Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014, particulièrement les pages 110-120, pour une analyse des positions des socialistes à l’égard des machines et de la technique.↑
- Pour une présentation succincte de cette vision, voir le texte de Brian Merchant, « Fully Automated Luxury Communism », sur le site du journal The Guardian. Pour une critique équilibrée, voir : « Fully Automated Luxury Communism : A Utopian Critique ». ↑
- Milton Friedman, Lesson of the Pencil, YouTube, 2009. ↑
- Pour la version originale du texte, voir Wikisource : <https://en.wikisource.org/wiki/I,_Pencil#cite_ref-1>. Pour une traduction française, voir le site de l’Institut Coppet, Le marché expliqué par la métaphore du crayon par Damien Theillier, 2012. ↑
- Traduction de : « There is a fact still more astounding : The absence of a master mind, of anyone dictating or forcibly directing these countless actions which bring me [the pencil] into being. No trace of such a person can be found. Instead, we find the Invisible Hand at work ». Leonard Read, « I, pencil », The Freeman, décembre 1958. ↑
- Même si, bien sûr, certains et certaines ont la possibilité de tirer davantage de ficelles. ↑
- La fréquence et l’intensité de ce type d’évènement extrême risquent d’augmenter en raison des changements climatiques. Il s’agit donc d’un facteur à prendre en considération dans notre réflexion sur la société postcapitaliste. ↑
- Ces deux voies – (1) remettre entre les mains des travailleurs et travailleuses les vastes réseaux de production et de distribution qui sont en ce moment entre les mains des capitalistes et (2) créer des communautés autosuffisantes – correspondent à deux « horizons utopiques » différents, mais dans le monde actuel, il est envisageable de combiner les deux « stratégies ». ↑
- Si l’on conçoit qu’une personne peut raisonnablement en connaitre 200 autres (la taille d’un petit réseau d’amis Facebook) et que chacune de ces personnes peut aussi en connaitre 200, la taille maximale d’une telle communauté serait d’environ 40 000 personnes. La communauté serait vraisemblablement plus petite en raison des contacts communs. ↑
- Ce type d’agriculture a généralement un rendement énorme, mais ses coûts sont faramineux : « La synthèse de tous ces herbicides, pesticides et engrais artificiels s’effectue en faisant usage de combustibles fossiles, qui alimentent également toute la machinerie agricole. En un sens, l’agriculture moderne peut donc se voir comme un processus de transformation du pétrole en nourriture […]. Elle consomme environ dix calories d’énergie fossile pour chaque calorie de nourriture effectivement mangée » : Lewis Dartnell, À ouvrir en cas d’apocalypse : petite encyclopédie du savoir minimal pour reconstruire le monde, Paris, Lattès, 2015, p. 97. ↑
- Pour désigner un ensemble d’idées semblables, d’autres auteurs ont parlé d’outils conviviaux (Yvan Illich, Tools for Conviviality, New York, Harper & Row, 1973), de techniques douces ou encore de basses technologies (Philippe Bihouix, L’âge des low tech, Paris, Seuil, 2013). ↑













