Archives Révolutionnaires
Diffuser les archives et les récits militants. Construire les luttes actuelles.
Comment la gauche doit répondre aux menaces de Trump contre le Canada ?
Archives Révolutionnaires a traduit cet article publié par le collectif Tempest. Face à la vague de soutien à l’administration libérale de Mark Carney et son appel à l’unité nationale, le texte met de l’avant un « gros bon sens socialiste » en matière stratégique. Ceci implique de construire une politique de classe autonome et internationale, sans soutien aux États bourgeois et aux patrons.
par David Camfield
La récente menace de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 100 % au Canada si celui-ci concluait un accord avec la Chine a ravivé les inquiétudes, au sein de l’appareil d’État canadien, face aux méthodes de pression de l’administration « America First ». Certains redoutent même qu’il puisse un jour tenter de concrétiser ses anciennes déclarations sur une intégration du Canada aux États-Unis.
Cette crainte peut aisément pousser des gens à soutenir le gouvernement fédéral libéral de Mark Carney qui a promis de « jouer du coude » contre l’administration Trump, malgré son programme d’austérité contre les services publics et les travailleurs qui les assurent, son appui à l’expansion des industries extractives, ses politiques anti-migrants et la hausse massive des dépenses militaires. Pour traverser cette période politique agitée, la gauche a besoin d’une boussole claire.
Même si Trump ne mettra probablement pas sa menace tarifaire à exécution, il faut s’attendre à d’autres tentatives — de sa part ou d’un futur gouvernement MAGA — d’utiliser la pression économique pour imposer ses conditions à Ottawa. Face à cela, comment la gauche doit-elle répondre aux guerres commerciales et aux tensions économiques entre les deux pays ?
John Clarke résume notre orientation de base :
La classe ouvrière agit dans un monde dominé par ses adversaires de classe. Elle n’a pas créé les rivalités entre États ni tracé leurs frontières, mais doit défendre ses intérêts dans ce cadre contraignant. Les travailleurs n’ont rien à gagner d’une guerre commerciale et n’ont pas à sauver le capitalisme canadien. Leur position devrait être guidée par l’hostilité envers « leurs » capitalistes et par une solidarité active avec les travailleurs des États-Unis et du Mexique.
Aux États-Unis comme au Mexique, il faut privilégier le même point de vue : l’hostilité contre les patrons et bâtir une solidarité de classe par-delà les frontières. Il nous faut une solidarité ouvrière internationale, et non la compétition ! Notre camp doit se bâtir dans l’animosité envers « nos capitalistes » et une ferme solidarité envers les travailleurs des États-Unis et du Mexique.
Soutenir « nos » entreprises et « notre » gouvernement dans la concurrence internationale mène presque toujours à une dégradation des salaires, des conditions de travail, des droits sociaux et environnementaux — en plus de nouvelles attaques aux droits des peuples autochtones. Dès que nous acceptons l’objectif capitaliste, tout ce qui fait obstacle à l’augmentation du profit est présenté comme un problème. La fièvre nationaliste attise plutôt la suspicion et souvent le racisme envers celles et ceux jugés « non patriotes » ou « étrangers ».
L’approche des libéraux fédéraux face à l’administration Trump, « bien qu’elle soit présentée comme une alternative à la domination américaine… reflète en fait des éléments centraux du trumpisme. Elle propose une économie militarisée qui exigera le démantèlement des services sociaux, d’éducation et de santé », comme le soulignent James Cairns et Alan Sears. Toute politique de gauche significative doit s’y opposer et s’organiser contre cela, en « refusant de reproduire le programme de Trump de militarisation, d’extraction des ressources et d’attaques contre les travailleurs ».
On ne répètera jamais assez que le rôle de la gauche n’est pas d’aider les propriétaires d’entreprises canadiennes ou peu importe qui siège à Ottawa. Notre tâche est plutôt de renforcer les syndicats et les mouvements sociaux pour défendre le peuple contre les patrons, en plus de se battre pour un meilleur monde, avec l’objectif ultime de révolutionner la société qu’ils gouvernent. Nous ne devrions pas proposer de mesure pour contribuer à la gestion du capitalisme. Au contraire, « la gauche doit développer et défendre une vision politique et économique alternative », comme le soutient Todd Gordon.
En période de crise économique, cela signifie défendre de meilleurs soutiens au revenu pour les travailleurs licenciés, contester les fermetures d’usines et s’inspirer d’exemples comme celui des travailleurs d’Ex-GKN en Italie, qui ont occupé leur usine et luttent pour la reconvertir en coopérative produisant des biens écologiques.
Il faut aussi revendiquer des emplois publics stables et bien rémunérés dans le cadre d’un Green New Deal radical, tout en promouvant des réformes qui réduisent les injustices sociales et écologiques. Dans les mots de Gordon : « un tel programme […] ne peut être réalisé que si nous développons une stratégie centrée sur la lutte de masse et seulement si nous refusons de limiter notre horizon collectif à la défense du Canada ». Voilà comment la gauche devrait répondre à l’intimidation économique des États-Unis. Mais qu’en est-il d’éventuelles tentatives futures des États-Unis d’annexer le Canada ?
La première chose à dire est que, malgré les rodomontades de Trump, il est très improbable que les États-Unis tentent d’annexer le Canada. Une annexion présenterait de nombreux inconvénients pour un gouvernement MAGA, même si le Canada obtenait un statut semblable à celui de Porto Rico, où les citoyens ne peuvent pas voter aux élections américaines. Les dirigeants MAGA ne voudraient certainement pas près de 30 millions de nouveaux électeurs admissibles, dont la plupart soutiendraient l’assurance maladie publique, le mariage entre personnes de même genre, le droit à l’avortement, les droits trans et d’autres droits que l’extrême droite déteste. Agiter la peur d’une invasion et d’une annexion américaines a des effets néfastes : cela attise le nationalisme canadien et rend les gens plus enclins à accepter tout ce que le gouvernement d’Ottawa prétend nécessaire pour le bien du Canada.
Un scénario moins improbable que l’annexion — mais tout de même peu vraisemblable — serait une tentative américaine future d’imposer une forme d’arrangement politique sans annexion formelle qui limiterait juridiquement les marges de manœuvre du gouvernement d’Ottawa, plutôt que de s’appuyer seulement sur la pression économique.
Même si ces scénarios sont peu probables, la gauche doit avoir une orientation à leur sujet étant donné le nombre de personnes dans l’État canadien qui en parlent. Aux États-Unis, la réponse est évidente : s’opposer à toute tentative de domination politique du Canada — une forme d’agression impérialiste contre un partenaire subalterne.
Au Canada, il faut partir d’un constat : l’État canadien est un État capitaliste colonial de peuplement, fondé sur la dépossession des peuples autochtones. De plus, il s’agit d’un État construit sur la conquête de ce qu’on appelle aujourd’hui le Québec, qui ne dispose toujours pas pleinement de son droit à l’autodétermination dans une fédération multinationale. Malgré les dénégations nationalistes, le Canada est également une puissance impérialiste dans l’ordre mondial capitaliste. En témoigne le bilan des compagnies canadiennes dans le Sud global qui est largement condamnable.
Fort heureusement, plus de personnes à gauche comprennent aujourd’hui – au moins partiellement – que le pays dans lequel nous vivons agit comme un prédateur envers la majorité des peuples du monde — plus que durant les décennies 1960 à 1980, âge d’or du nationalisme de gauche canadien. C’est lorsqu’on considère le Canada par rapport à la puissance beaucoup plus grande située au sud que cette perspective se perd souvent.
Le premier principe socialiste pertinent ici est que, dans les conflits entre puissances impérialistes comme les États-Unis et l’État canadien, la gauche ne devrait soutenir aucun des deux camps. Ce qui est vrai des conflits entre les États-Unis et la Chine ou la Russie pour les ressources et l’influence politique l’est aussi des conflits entre les États-Unis et l’État canadien.
Du point de vue de la classe ouvrière et des personnes opprimées à l’échelle mondiale, de tels conflits ne peuvent être que nuisibles. S’aligner sur les dirigeants canadiens dans leurs différends avec les États-Unis se fait toujours au détriment des travailleurs d’ici. Comme le dit le proverbe swahili : « Quand les éléphants se battent, c’est l’herbe qui souffre. »
Cela signifie que la gauche ne devrait pas défendre la « souveraineté canadienne ». Les gens ordinaires ne dirigent pas l’État canadien — ce sont les propriétaires des grandes entreprises et les hauts responsables de l’État qui constituent la classe dominante. La « souveraineté canadienne », c’est leur pouvoir, pas le nôtre. Elle s’exerce au détriment des nations autochtones, du Québec et des travailleurs de toutes les nations concernées.
S’opposer à l’annexion — l’intégration forcée d’un pays dans un autre — est aussi un principe socialiste. Il ne s’agit pas de défendre les États-nations, leurs frontières, leurs drapeaux ou leurs mythes. Toute personne opposée au pouvoir du capital devrait être internationaliste et viser à construire la solidarité entre les travailleurs de toutes les nations. L’opposition à l’annexion est une question démocratique fondamentale : la fusion de pays ne devrait se produire que lorsque les populations concernées décident démocratiquement de s’unir.
Toute tentative future des États-Unis de dominer directement l’État canadien — en modifiant la relation entre deux États aujourd’hui indépendants — ou de l’annexer devrait être combattue par la gauche. Pourquoi ? Parce que ses effets concrets incluraient davantage d’attaques contre les programmes sociaux, les droits syndicaux, les droits à l’égalité et d’autres acquis issus des luttes passées. Bien qu’insuffisants du point de vue socialiste, ces acquis sont, pour la plupart, plus solides au nord de la frontière canado-américaine qu’au sud.
De nombreux travailleurs, femmes, personnes queer, trans et racisées vivant au nord de la frontière savent que leurs conditions sont pires aux États-Unis. Ils ne veulent pas vivre dans un pays dirigé par le Parti conservateur du Canada, qui apprécie plusieurs aspects de la politique MAGA même s’il la juge en partie excessive. Ils ne veulent surtout pas vivre dans un pays encore plus subordonné aux États-Unis (ni dans des États-Unis élargis). La peur d’une détérioration de leurs conditions de vie peut facilement les pousser vers la feuille d’érable et soutenir les libéraux comme politique du moindre mal.
La gauche devrait répondre à cette peur en s’organisant contre ce que font aujourd’hui les libéraux pour gérer le capitalisme et en popularisant un programme alternatif radical. Mostafa Henaway a raison :
La question stratégique est maintenant de savoir comment construire une résistance de masse, multiraciale et ouvrière à Carney, à l’échelle requise, capable d’une confrontation soutenue.
Nous devrions aussi nous opposer, de manière internationaliste, à toute tentative future d’un gouvernement américain d’extrême droite d’imposer une domination directe ou une annexion. Si les États-Unis faisaient un tel pas, les populations au nord de la frontière devraient se soulever contre cette agression par des manifestations de masse, des grèves et des occupations, et lutter pour une société meilleure — non pour défendre le statu quo — tout en appelant celles et ceux aux États-Unis qui s’opposent à l’extrême droite à faire de même. Une telle opposition ne doit pas impliquer d’alliance avec les dirigeants canadiens. Elle devrait au contraire être menée dans un esprit internationaliste, pour un monde où les gens ordinaires peuvent s’épanouir — un monde de liberté et de rationalité écologique. Nos alliés sont les gens ordinaires aux États-Unis et ailleurs qui combattent l’extrême droite et le déclin du capitalisme libéral qui l’alimente.

Le parti comme articulateur
Qu’est-ce qu’un parti révolutionnaire et comment doit-il lutter ? C’est la question à laquelle tente de répondre Salar Mohandesi, dans un texte publié initialement chez Viewpoint Magazine. Contre la réduction de la politique aux calculs électoraux ou les groupes persuadés que la pureté de leur programme fera spontanément vibrer le peuple, le texte défend une conception du parti ancrée dans les luttes quotidiennes. Partant des conflits concrets, nés des expériences vécues de l’exploitation et de l’oppression, il vise à unifier des forces sociales dispersées et à transformer des résistances fragmentées en un rapport de force collectif. Le parti apparaît alors comme un outil de politisation et de prise de conscience pour celles et ceux qui luttent. En se construisant à même ces dynamiques, il donne une expression politique cohérente à des mobilisations qui, bien que rarement socialistes à leur origine, contiennent les éléments décisifs d’un projet socialiste à construire. Si le texte ne va pas au bout de la réflexion sur la question du pouvoir, il offre toutefois des outils précieux pour penser l’organisation révolutionnaire à l’ère de la fragmentation sociale, des soulèvements imprévisibles et de la crise durable de l’État.
/ / /
L’année dernière, la plus grande organisation socialiste des États-Unis a décidé d’appuyer la candidature de Bernie Sanders; certains de ses membres dirigeants sont allés jusqu’à affirmer qu’en l’absence d’un mouvement de masse radical dans ce pays, la candidature de Sanders s’imposait comme une étape clé d’une avancée socialiste. Accrocher le destin du DSA (Socialistes démocrates d’Amérique) à la candidature à la présidence du septuagénaire social-démocrate signifiait que l’effondrement de la campagne Sanders, ainsi que l’espoir de se saisir des rênes du pouvoir dans un avenir proche, a provoqué un débat important sur le futur du DSA.
Certains ont soutenu que, malgré le résultat, les DSA avaient tout de même beaucoup gagné, et que les socialistes devraient continuer à s’engager au sein du Parti démocrate, en particulier à travers ses lignes électorales, ce qui leur permettrait un jour de détacher une partie de ses soutiens afin de former la base d’un troisième parti. Pour d’autres, toute cette affaire prouvait exactement le contraire : qu’il était grand temps que les socialistes tournent le dos aux démocrates pour construire, le plus rapidement possible, un parti indépendant.
Malgré leurs différences réelles, les deux camps partagent de nombreuses similitudes. Tous deux veulent une organisation indépendante. Tous deux voient cette organisation comme une solution indispensable à leurs problèmes, comme l’horizon de toute réflexion stratégique. Et si l’un pense avant tout en termes d’un organe centralisé de militants disciplinés, prêts pour un scénario final de rupture, tandis que l’autre imagine une sorte de parti de masse démocratique développant lentement ses forces afin de devenir un jour un parti ouvrier indépendant capable de déjouer les manœuvres des démocrates et, à terme, de gouverner, tous deux en sont venus à ressusciter le même mot – « le parti » – pour désigner l’organisation qu’ils ont en tête, confondant ainsi de fait (au moins) deux expériences historiques très différentes. Cependant, les évènements des quelques derniers mois nous ont révélé un point commun entre les deux côtés. Alors qu’ils étaient occupés à débattre de différentes manières de bâtir « le parti » qui saurait diriger les masses, aucun n’a su anticiper le soulèvement, l’un des plus importants de l’histoire du pays, qui a explosé sous leur nez après le meurtre de George Floyd par la police en mai. En fait, il est indicatif que, sauf quelques exceptions notables, la majorité du DSA, surtout au niveau national, a été surprise.
Pendant que des milliers de personnes descendaient dans la rue, certains organisateurs aguerris se demandaient sur Twitter s’il fallait seulement soutenir la révolte. D’autres étaient complètement à côté de la plaque, se contentant de sortir des communiqués maladroits. Et puis il y en avait qui se sentaient tout de suite solidaires, mais qui ne savaient pas trop comment s’y prendre pour se connecter vraiment au mouvement en tant que socialistes assumés.
Au final, aucun de ces débats pourtant riches sur le parti n’avait vraiment préparé l’organisation à s’engager rapidement et efficacement dans le soulèvement. En réalité, je dirais que l’une des principales raisons pour lesquelles tant de socialistes, y compris en dehors des DSA, ont eu du mal, non seulement à lire la conjoncture, mais aussi à s’impliquer dans le mouvement, tient aux limites flagrantes des façons dominantes de penser ce que veut dire « s’organiser ». En particulier, la manière dont les organisations se rapportent à la diversité des mobilisations de masse, au caractère imprévisible du moment politique, et à l’attrait du pouvoir d’État.
Dans ce qui suit, je voudrais proposer une autre manière de penser le parti. Plutôt que de le considérer comme une entité unique et figée cherchant à conquérir le pouvoir d’État, que ce soit par l’insurrection ou par les élections, je propose de voir le « parti » comme une organisation parmi d’autres, définie par sa fonction d’articulation : celle qui met en relation des forces sociales disparates, relie les luttes dans le temps et facilite le projet collectif de construction du socialisme au-delà de l’État.



La composition
L’état fondamental de l’existence dans une société capitaliste est l’atomisation dépolitisée. La plupart des gens passent leur vie à bricoler toutes sortes de stratégies de survie individuelles, souvent en concurrence les unes avec les autres. Quand un problème surgit, il y a de fortes chances que quelqu’un réagisse en travaillant plus dur, en négociant un arrangement, en changeant de boulot ou en déménageant ailleurs.
Cet individualisme n’est pas l’expression d’une quelconque nature humaine, mais une réponse socialement acquise aux défis de la reproduction sociale sous le capitalisme. L’idéologie de l’État naturalise le statu quo au point où bon nombre se résigne à la croyance que rien ne changera jamais. Lorsqu’il y a une lueur d’espoir, nos vies précaires nous nous dissuadent d’entreprendre des actes risqués qui pourraient empirer les choses. Et même lorsque certains sont prêts à accepter ces risques, s’unir autour d’une cause commune exige de concilier tant d’intérêts, de personnalités et d’objectifs différents que plusieurs ont le sentiment que l’effort n’en vaut même pas la peine. Ainsi, lorsqu’il y a résistance, elle tend à rester individualisée : arriver en retard au travail, ou subtiliser quelques fruits à l’épicerie.
Cela dit, il est de ces moments tels que le soulèvement pour George Floyd où les gens changent leurs habitudes. Plutôt que de se considérer comme des individus impuissants, ils se réinventent en agents du changement. Au lieu de rêver à comment les choses devraient être, ils exigent qu’elles soient différentes. Plutôt que de poursuivre leur vieille routine, ils font l’expérience de nouvelles formes d’activités. Au lieu d’accepter passivement les catégories d’identité qu’on leur impose, ils construisent un nouveau type de subjectivité. Plutôt que de résoudre leurs problèmes indépendamment, ils cherchent d’autres personnes pour les aider à affronter un problème commun.
Le processus par lequel les individus se rassemblent en force sociale collective s’appelle la composition. Par le passé, on avait tendance à le voir surtout en termes de classe, en partant du principe que la seule véritable force sociale était celle fondée sur une position de classe objective. Mais la classe n’est pas le seul moyen pour les forces sociales de structurer leur subjectivité. En fait, lorsque les individus se rassemblent en collectif, ils s’agrippent à une multitude de déterminants compositionnels, en d’autres mots, d’aspects de leurs vies dont la majorité est hors de leur contrôle, mais qui peuvent néanmoins être activés subjectivement et réappropriés pour accomplir de nouvelles tâches. Cela peut tout inclure, du genre à la race, de l’occupation à l’âge, de la géographie à la mémoire, aussi bien que toute combinaison de ces déterminants.
En fait, au grand désarroi des socialistes dogmatiques qui ne peuvent penser qu’en termes de « conscience de classe », dans la plupart des cas, les individus ne se rassemblent pas sur la base d’un quelconque sentiment abstrait d’unité de classe. Cela ne les rend pas moins authentiques. Si des jeunes pauvres et noirs, terrorisés par la police, décident de se regrouper pour lutter contre la brutalité policière, et le font principalement sur la base de la race plutôt que de leur origine sociale, qu’il en soit ainsi. La composition se produit, que les socialistes le veuillent ou non. Et elle se produit souvent d’une manière sur laquelle les organisateurs socialistes ont peu de contrôle.
Cela ne veut toutefois pas dire que la composition est spontanée. Comme Rodrigo Nunes l’explique : « Pensez à la manière dont une action ‘spontanée’ se matérialise. Une personne parle à une autre, qui parle à une autre, qui parle à une autre. Soudain, une idée émerge qui circulera probablement avant qu’on puisse la verbaliser. Une assemblée est convoquée, l’idée est présentée : certains quittent la salle, d’autres trouvent des failles, puis quelqu’un propose une nouvelle idée. Un court texte est rédigé, une nouvelle réunion est organisée, et ainsi de suite. Notre exemple démontre que la spontanéité ne signifie pas que des comportements uniformes s’actualisent en même temps chez chacun : la spontanéité commence quelque part ; il y a toujours quelqu’un pour l’organiser. » Et ça ne veut pas dire qu’il faut toujours que ce soient les mêmes qui organisent, ou que cette organisation dépende du génie de quelques individus exceptionnels. La meilleure manière d’envisager ce phénomène provient encore de la microsociologie de Gabriel Tarde : il faut des « inventions » proposées par certains individus pour qu’il se passe quelque chose de nouveau, mais ces inventions ne sont rien d’autre que la recombinaison de tendances déjà présentes autour d’eux.
Autrement dit, la spontanéité pure n’existe pas. Derrière chaque initiative « spontanée » nous retrouvons des multitudes de couches d’organisation cachée. Certaines sont héritées et émulent d’autres modèles organisationnels, alors que d’autres se matérialisent dans le feu de la lutte, ce qui constitue alors des sauts novateurs. Dans tous les cas, les forces sociales sont organisées et fondées dans des organisations. Après tout, les forces sociales ne peuvent qu’exister en action, en lutte, en mouvement vers un but spécifique, en réponse à un problème politique commun. Et la seule manière de coordonner la capacité d’agir, de construire la force nécessaire à concrétiser une solution à ce problème, c’est l’organisation.



L’articulation
Bien sûr, les forces sociales n’existent pas en isolation. À tout moment, il y a des centaines, sinon des milliers, de forces sociales impliquées dans la lutte.
Mais tout comme les individus demeurent cloisonnés, les forces sociales se tiennent aussi à distance les unes des autres. C’est en partie parce qu’elles ont déjà tellement de difficultés à rester unies que même penser à se coordonner avec une autre force distincte dépasse simplement leurs capacités.
Les forces sociales divergent tellement en taille, style, composition, et objectifs qu’au premier coup d’œil elles peuvent sembler étrangères les unes aux autres. Différentes forces sociales peuvent vouloir lutter contre un nouveau projet de développement dans leur quartier, contre la brutalité policière dans leur ville, contre une loi d’état homophobe précise, contre le sexisme quotidien des hommes dans cette communauté, contre la politique d’admission de ce collège, ou encore contre les salaires déplorables de cette entreprise. Qu’est-ce que toutes ces réalités peuvent bien avoir en commun?
Cela dit, malgré l’inertie structurelle qui pousse à la méfiance, à l’atomisation et à la compétition, il arrive que des forces sociales diverses se rassemblent. Cela se produit parfois, par exemple, lorsque différentes forces adoptent des cadres de subjectivation similaires, affrontent un ennemi commun, agissent dans le même lieu, poursuivent des objectifs liés, ou partagent certains membres.
Si la composition désigne la manière dont des individus se rassemblent en forces sociales, l’articulation renvoie aux façons dont ces forces sociales se combinent pour former des unités. Et si la composition est un processus difficile, l’articulation représente un défi encore plus grand. Harmoniser une multitude d’intérêts, d’expériences, de parcours et d’objectifs sur une période prolongée, construire l’unité tout en prenant en compte les différences réelles, est un travail extrêmement ardu. C’est pourquoi ce type d’articulation est assez rare et ne dure souvent pas longtemps. Mais lorsqu’elle se produit, l’unité ainsi articulée accroît considérablement sa capacité à réaliser des transformations profondes.
En fait, ce rassemblement de multiples forces sociales est la plus grande menace à l’ordre capitaliste actuel. Il est plus terrifiant qu’une récession, qu’une pandémie virale, ou qu’une guerre. C’est en quelque sorte la seule chose qui saurait supplanter l’état actuel des choses, et le bloc dirigeant le sait. C’est pourquoi, comme Nicos Poulantzas l’a avancé il y a des années, l’une des fonctions principales de l’État n’est pas seulement d’articuler les forces sociales qui forment le bloc hégémonique, mais de désarticuler toute force sociale qui s’y oppose.
L’État parvient à accomplir cette tâche de toutes sortes de manières. En s’appuyant sur ses ressources supérieures, l’État peut tout simplement attendre que tout passe, en tenant ferme jusqu’à ce que cette unité articulée s’effondre d’elle-même. Mais s’il semble que cette unité des forces sociales s’avère persistante, l’État peut intervenir directement. Il sèmera des divisions entre les forces sociales constituantes en les montant les unes contre les autres, accordant ici des concessions, exerçant là un peu de répression. Il mobilisera toutes ses forces pour isoler le bloc d’opposition, l’empêcher de s’étendre ou de se lier à d’autres forces sociales. Il cultivera les soupçons, brandira le spectre d’agitateurs extérieurs et exacerbera toute division identitaire possible. Il récupérera l’agenda, contrôlera le discours, domestiquera les revendications et fera des promesses creuses, réduisant en définitive la lutte politique autonome à des solutions technocratiques inefficaces.
De ces manières, et plusieurs autres, l’État désarticulera l’unité des forces sociales, et ensuite décomposera les forces sociales elles-mêmes. Là où il y avait déjà une lutte unie, il y aura des forces sociales qui se battront entre elles. Là où il y avait des sujets collectifs luttant pour résoudre des problèmes communs, il n’y aura que des individus cloisonnés. Pour faire bonne mesure, l’État recomposera parfois ces individus atomisés en collectivités factices, telles que la « classe moyenne américaine », la « classe ouvrière blanche » ou encore la « communauté noire ». Contrairement aux forces sociales en lutte, ce sont des entités passives où tout le monde est divisé, où personne n’a de réelle autonomie, et où des leaders désignés par l’État disent aux autres quoi penser et, surtout, comment voter. Ce ne sont pas des groupes de personnes en train de construire de nouvelles subjectivités, mais des individus interpellés par l’État comme une identité statique. Ce ne sont pas des collectifs vivants travaillant à travers leurs différences, mais des abstractions homogènes qui cachent de vraies divisions internes. Les gens sont unis, mais uniquement dans leur séparation.
Voilà le plus important problème politique pour tous ceux qui souhaitent transformer le monde. La seule manière d’apporter des transformations profondes est d’articuler plusieurs niveaux d’unité. L’ordre établi est conçu pour imposer des solutions individuelles à des problèmes d’ordre social, pour décomposer les forces sociales lorsque le peuple s’unit en collectivité, pour désarticuler sans merci toute unité des forces sociales en quête d’un objectif plus large, et pour divertir l’aspiration sincère à une vie commune en catégories passives qui ne font que reproduire le statu quo. Si on laisse les choses suivre leur cours, la désunion, la séparation, l’atomisation et la concurrence deviennent la norme.
Devant cet ardent défi, des générations de socialistes se sont demandé, que faire? La réponse historique à cette question fut : « le parti ».


Le parti
Le « parti » – ou, le plus souvent, les partis – est une organisation comme une autre, mais avec des fonctions particulières.
Alors que toutes les organisations existent pour coordonner la capacité collective d’agir, les partis coordonnent le vaste champ d’organisations créées par l’auto-activité des forces sociales. En tant que facilitateur des efforts organisationnels de ces forces sociales diverses, le parti a été imaginé comme une sorte de méta-organisation. Pour le dire autrement : si l’État est le grand dés-articulateur, le parti est le grand articulateur.
Un parti peut certainement aider à catalyser la formation de forces sociales, mais comme tout organisateur expérimenté vous le dira, à moins qu’il n’y ait déjà un désir de changement, une volonté de se rassembler pour lutter, tout effort d’organisation restera lettre morte. En réalité, dans la plupart des cas, le rassemblement des individus en une force sociale se fait en grande partie indépendamment de tout parti, et dépasse souvent en créativité tout ce qu’un parti aurait pu imaginer. Les soviets, par exemple, n’ont pas été inventés par les Bolcheviks, mais par les forces sociales en lutte.
Pour cette raison, la tâche principale du parti n’est en réalité pas de créer des forces sociales, mais plutôt de faciliter leur regroupement en une unité plus large. Bien sûr, comme je l’ai déjà mentionné, certaines de ces forces sociales peuvent chercher à former des alliances de manière indépendante, mais leur convergence n’est pas automatique, et dans la plupart des cas, les efforts pour se coaliser échoueront. Le parti agit donc comme une sorte d’élément liant, cherchant à trouver un moyen de rassembler des forces sociales diverses et de les maintenir unies, malgré les nombreuses tendances qui les tirent dans des directions opposées. Et différents partis développeront différentes stratégies pour rendre cela possible.
Voilà un dur travail. Le parti doit trouver une manière créatrice d’unifier une énorme diversité d’expériences, de formes de lutte et de buts politiques en une unité qui persiste, tout en préservant les réelles différences. Comment cela est possible dépend de la conjecture spécifique, et il n’y a pas de formule abstraite que nous pouvons copier/coller à plusieurs endroits et moments. Mais une chose est sûre : l’unité ne se crée pas parce que le comité central du parti convoque tous les responsables de ces forces sociales dans une salle de conférence à moitié éclairée pour négocier des accords en coulisses. C’est ainsi que l’État articule un bloc hégémonique.
À l’inverse, l’unité du parti vient d’en bas, et uniquement par la lutte. Comme l’écrivait Amílcar Cabral il y a longtemps, la seule manière d’accroître sa capacité de lutter est de construire l’unité, mais « pour avoir l’unité, il est aussi nécessaire de lutter. » Les forces sociales ne se rejoignent que lorsqu’il y a un enjeu réel, lorsque leurs membres voient que s’allier à une autre force est indispensable pour atteindre leurs objectifs. La lutte forge la confiance, le respect et l’assurance; sans cela, il ne peut jamais y avoir de véritable articulation. Le rôle du parti est d’aider à rendre cette rencontre possible, comme l’agronome mène deux ruisseaux à s’unir en une puissante rivière.
Bien sûr, le parti fait cela en s’impliquant vraiment dans ces différentes luttes. Et par « s’impliquer », je ne parle pas d’entrisme cynique pour recruter, je parle de construire de vraies racines. Si un parti n’a pas d’ancrage, sa tentative d’unifier les forces sociales sera rejetée, et ses organisateurs seront tournés en dérision et expulsés en tant qu’acteurs externes sans emprise sur la réalité. C’est pour ça que, même s’il ne crée pas directement les forces sociales, un parti doit toujours s’engager avec elles, rejoindre leurs luttes, les prendre au sérieux, avec respect et patience, et surtout, apprendre d’elles. Plus un parti est ancré, mieux il comprend ces forces sociales, plus il est lié à des organisations autonomes, plus sa composition deviendra diversifiée, et plus il sera un articulateur efficace.
Et plus un parti est fort, plus sa capacité à articuler des forces à travers de grandes distances sociales est grande, de la ville à la région, jusqu’au pays entier, et à terme à travers plusieurs formations sociales. Après tout, l’articulation n’est pas seulement un problème local, c’est un problème global. Tout comme l’État cherche à désarticuler l’unité sur un terrain politique national inégal, l’impérialisme travaille à démanteler l’unité au-delà des frontières, isolant les mouvements et opposant les luttes les unes aux autres. C’est ça, le vrai sens de l’internationalisme : le processus par lequel des forces sociales distinctes issues de plusieurs formations sociales se rassemblent en une unité, parfois appelée une « internationale ».
La composition est un processus délicat, et les forces sociales sont fragiles, beaucoup d’entre elles apparaissant et disparaissant, comme des châteaux de sable construits le matin pour s’effondrer face au vent sec du soir. En combinant la force de plusieurs forces sociales, les luttes articulées deviennent plus durables, mais elles aussi finissent presque toujours par s’arrêter – atteignant leurs limites, perdant de l’élan, succombant à des tensions internes ou noyées sous une répression vigoureuse.
D’une certaine manière, ce schéma cyclique est à prévoir. « Il ne faut pas imaginer la révolution elle-même comme un acte singulier », écrivait Lénine. « La révolution sera une succession rapide d’explosions plus ou moins violentes, alternant avec des phases de calme plus ou moins profond. » Une insurrection populaire un mois, puis une démobilisation apparemment totale le mois suivant. Les luttes connaissent des va et viens, les organisations apparaissent et disparaissent.
Les forces sociales dominantes dans l’État, elles, cherchent à aller plus loin : non seulement faire échouer ces vagues de contestation, mais les effacer de l’histoire, comme si elles n’avaient jamais existé. Elles mobiliseront des ressources colossales pour réécrire l’histoire, falsifier les preuves, marginaliser tous les récits qui ne correspondent pas à leur version officielle. Leurs efforts sont si impressionnants qu’elles réussiront même à convaincre ceux qui ont participé à ces luttes merveilleuses qu’elles n’ont jamais eu lieu, ou qu’elles visaient des objectifs réformistes, ou qu’elles étaient mauvaises dès le départ. En quelques années, peut-être une décennie, le souvenir de ces exploits disparaîtra. L’histoire des communistes noirs internationalistes, effacée. L’histoire des syndicats ouvriers militants, pleins d’immigrants coopérant dans ce qui sont aujourd’hui des États rouges, effacée. L’histoire des luttes multi-raciales acharnées contre le racisme, effacée.
La deuxième fonction articulatoire du parti, alors, est de combattre cette révision en apportant un degré de continuité entre différentes luttes à travers du temps. Son action, écrivait John Watson, l’un des membres fondateurs de la Ligue des ouvriers noirs révolutionnaires (League of Revolutionary Black Workers), « pourrait offrir un pont entre les sommets d’agitation. » Cela aide à canaliser l’énergie de ces luttes, à préserver leur mémoire, à dresser des bilans, et à créer un espace de réflexion. Le parti est la mémoire historique de ces luttes, un dépositoire de toutes ses formes organisationnelles, un rolodex de ces vastes réseaux de contacts. C’est une archive vivante, remplie d’activistes intrépides qui se sont battus lors des vagues antérieures et qui se préparent pour la prochaine.
Le parti, alors, ne s’occupe pas seulement d’articuler des forces sociales diverses lors d’une montée d’agitation, dans la foulée des coups; il aide à garder le flambeau allumé pour la prochaine. Alors que la plupart des organisations de combat sont éphémères, surgissant pour résoudre un problème puis disparaissant, le parti s’efforce de rester toujours actif, pendant ces explosions où des milliers de personnes se retrouvent soudain à faire de la politique pour la première fois, et pendant ces périodes de relative stabilité, quand les choses reviennent, pour ainsi dire, à la normale.
Le parti joue une fonction d’articulation finale, qui est de donner une voix à un contenu politique précis. L’activité autonome des personnes en lutte identifie des problèmes sociaux importants, crée de nouvelles formes d’organisation, et dans certains cas même une vision positive du changement.
Hélas, dans la plupart des cas, ces formes organisationnelles n’avanceront pas spontanément un contenu socialiste cohérent. Leurs membres ne se sont probablement pas assemblés en tant que socialistes, mais en tant que travailleurs de la construction en colère, en tant que courageux activistes trans, en tant que jeunesse immigrante désespérée, ou en tant que mères inquiètes militant pour des revendications spécifiques.
En fait, si les forces sociales élaborent un projet politique, celui-ci n’est le plus souvent pas de nature socialiste. Les afro-américains peuvent s’insurger du racisme dans leur ville, mais le mouvement peut aussi s’orienter vers le support pour les capitalistes noirs. Les ouvriers d’une manufacture en Ohio peuvent être révoltés par leur licenciement, mais ils peuvent choisir d’en rejeter la faute sur les immigrants. Des immigrants récents peuvent s’unir pour agir face à la criminalité dans leur quartier, mais ensuite décider de soutenir un renforcement de l’intervention policière contre d’autres minorités. Il n’existe donc pas, autrement dit, de lien automatique entre la constitution d’une force sociale et la lutte pour le socialisme.
C’est en grande partie parce que nous n’existons pas dans un vide politique. Des courants concurrents font de leur mieux pour attirer les forces sociales vers leurs propres projets. Et derrière tout cela, les nombreux appareils idéologiques de l’État cherchent constamment, de notre naissance à notre mort, à neutraliser le potentiel politique de toutes les luttes possibles : transformer les initiatives autonomes en marches processionnelles, les revendications audacieuses de changements radicaux en appels modérés à la réforme, la critique systématique des structures en moralisme individualisé, l’auto-activité en simple vote. Un des objectifs centraux de tout cela est de détruire l’idée même de socialisme : la présenter comme de la violence terroriste, ou la domestiquer en assistanat social. Dans ces conditions, il y a peu de raisons pour que quelqu’un devienne automatiquement socialiste.
Le rôle du parti est d’avancer ce projet socialiste contre les tendances politiques concurrentes et, par-dessus tout, contre les méandres idéologiques des forces de l’ordre. À ce point, il est crucial de souligner d’où vient ce contenu socialiste. Il ne vient pas d’intellectuels déconnectés, mais des luttes quotidiennes des forces sociales elles-mêmes. Bien que le programme socialiste n’émerge pas automatiquement, tout prêt, de ces luttes, ses éléments fondamentaux ne peuvent se trouver qu’à cet endroit. La tâche du parti est d’écouter attentivement ces luttes, d’observer cet immense écosystème, d’apprendre profondément de ces nombreuses forces sociales pour en extraire les rudiments d’un programme politique historiquement approprié. Le parti rend ensuite ce contenu explicite, le clarifie, l’approfondit, le transforme en une forme plus systématique, puis le soumet de nouveau à ces forces sociales en lutte pour vérification. À travers leurs luttes, les forces sociales élaborent le programme, le rejettent ici, le révisent là, affinant le contenu que le parti réarticule, avant de le renvoyer à nouveau aux luttes, comme dans une sorte de spirale.
Il est maintenant clair que les trois fonctions articulatoires (rassemblement des forces sociales, la continuité dans le temps et donner voix à un contenu politique commun) sont tous connectées. L’une des principales façons pour un parti d’articuler des forces sociales diverses, par exemple, est d’élaborer un programme qui montre comment leurs luttes sont en réalité interconnectées. Mais la façon dont le parti arrive à articuler un programme cohérent est de le fonder sur les aspirations profondes des nombreuses forces sociales diverses qu’il cherche à aider à unifier.



Un instrument limité
Comme toutes les organisations, les partis n’émergent que par la lutte, et on ne peut donc jamais déterminer de manière abstraite à quoi ils ressembleront, ni comment ils réaliseront concrètement leurs fonctions d’articulation. Mais si l’on imagine le parti de cette manière, comme un articulateur, quelques conséquences s’imposent nécessairement.
Le parti n’est pas une entité fixe, mais la condensation de fonctions d’articulation en constante évolution. Devenir un parti ne consiste pas à franchir une limite numérique, à atteindre des critères structurels particuliers ou à être reconnu comme tel par l’État. Ce n’est pas une déclaration mais un acte.
Et c’est déjà en train de se produire : il y a déjà plusieurs organisations qui réalisent ces fonctions du parti à différent niveaux, même s’il ne se conçoivent pas comme un parti et ne désirent pas en devenir un. Par exemple, le syndicat des enseignants de Chicago ou les chapitres locaux de Black Lives Matter. Le DSA ne monopolise pas cette question à elle-seule.
Le parti ne peut pas s’obstiner à se concentrer sur une seule lutte, force sociale, ou forme organisationnelle. Bien que le parti devrait certainement se sentir libre de juger la conjecture et déterminer d’où émergent les luttes et y mobiliser des ressources, il ne peut pas non plus s’entêter sur une lutte unique, il doit demeurer attentif à toute agitation potentielle. Lénine l’exprimait clairement : « le communisme surgit de tous les points de la vie sociale; il fleurit résolument partout » et parfois « dans les lieux les plus inattendus ».
L’insurrection politique peut avoir une multitude de déclencheurs : des salles de classe sous-financées, le procès d’un violeur, un meurtre policier raciste, la construction d’un oléoduc sur des terres autochtones, la contamination de l’eau dans une ville désindustrialisée, un effondrement boursier, une fusillade dans une école, une pandémie. La vérité est que personne ne peut le savoir à l’avance, le parti doit être prêt à agir à n’importe quel moment. Au lieu d’attendre de manière myope l’émergence d’une lutte parfaite imaginée, ou de tordre les actions autonomes des personnes en mouvement pour les faire entrer dans un cadre préconçu, le parti doit rester à l’écoute du terrain. Comme l’écrivait Louis Althusser : « il ne s’agit pas d’“étendre” la politique existante, mais de savoir écouter la politique là où elle se fait. »
Pour cela, le parti doit demeurer très flexible. Il doit être prêt à abandonner une longue campagne et à se jeter dans une nouvelle explosion si nécessaire. Il doit être prêt à embracer immédiatement de nouvelles formes d’organisation, de nouvelles tactiques, de nouvelles formes de luttes. Il doit être prêt à sacrifier ses idées et en ramasser de nouvelles lorsque les conditions changent. Il doit être prêt à réécrire son programme dès que c’est nécessaire, si les développements l’exigent. Il doit être prêt à faire des compromis, à négocier, à donner aux mouvements sociaux le bénéfice du doute. Il doit être ouvert à toutes les tactiques et méthodes. Comme Daniel Bensaïd le disait pour reprendre Lénine, : « Agitez dans tous les milieux! Soyez à l’affût des solutions les plus imprévisibles! Restez prêts aux changements soudains de formes! Sachez manier toutes les armes! » Mais surtout, le parti doit être disposé à apprendre, à admettre ses erreurs et à réfléchir sur ses propres actions.
Dans ce contexte, bâtir le parti ne revient pas à accumuler graduellement ses forces selon un plan prédéterminé. Il ne s’agit pas d’attendre patiemment que les membres nous joignent et favorisent le partage du vote ainsi que notre influence législative. Cette conception d’une croissance lente suppose un progrès linéaire, une vision du temps selon laquelle on peut espérer que le futur soit plus ou moins le même que le présent, un temps vide, homogène, ponctué de rituels, de cycles électoraux qui porteraient le lent développement du parti. Ce temps du « progrè

Cinq questions pour comprendre la situation au Venezuela – Entretien avec Pierre Mouterde
Le cycle des nouvelles est chaque jour bouleversé par la stratégie du choc trumpiste. L’impérialisme américain a brutalement commencé l’année 2026 avec le kidnapping du président vénézuélien Nicolás Maduro. Depuis, les menaces et les tentatives de déstabilisation ont fusé de toute part : la Colombie, le Mexique et Cuba, jusqu’à la promesse d’annexion du Groenland par les États-Unis. Tentant de prendre un peu de hauteur face à l’imbroglio de la situation internationale, Archives Révolutionnaires s’est entretenu avec Pierre Mouterde, auteur de plusieurs livres sur le Venezuela, à propos de la récente agression impérialiste. Mouterde ne se gêne pas pour critiquer durement le régime de Maduro, bien qu’il condamne plus sévèrement encore l’histoire longue des interventions américaines au Venezuela. Celles-ci n’ont eu comme objectif que de s’approprier les ressources du pays et de saper tout projet d’émancipation sociale.
Entrevue réalisée par Nathan Brullemans
Pour commencer notre entretien, allons-y avec une question de repères historiques : quels sont les grands événements qui ont rythmé la vie politique vénézuélienne depuis le décès de Hugo Chávez jusqu’à l’enlèvement récent de Nicolás Maduro ?
Revenir à l’histoire est toujours important. Dans notre cas, ne serait-ce que pour bien faire la part des choses en ce qui concerne ce qu’on appelle le « Venezuela bolivarien ». Précisons d’abord que Nicolás Maduro n’est pas Hugo Chávez. La feuille de route de ce dernier n’est certes pas exempte de critiques ; Chávez avait lui-même évoqué avant de mourir en mars 2013 la nécessité d’effectuer « un coup de barre » pour lutter contre la bureaucratisation et relancer les conseils communaux. Néanmoins, il a été, en particulier de 1999 à 2007, à l’origine de transformations constitutionnelles, économiques, sociales et politiques extrêmement prometteuses pour les classes populaires du Venezuela : forte baisse des taux de pauvreté et d’extrême pauvreté, mise en place de formes embryonnaires de pouvoir populaire, développement d’échanges internationaux plus égalitaires à travers l’ALBA, etc.
Il en va tout autrement de Nicolás Maduro qui — quoiqu’élu démocratiquement en 2013 (mais avec tout juste 50,6% des voix) — ne suivra pas la voie alternative souhaitée par Chávez à la veille de sa mort ni celle de chercher à pactiser avec l’opposition, selon les règles démocratiques vénézuéliennes alors en vigueur. Mieux, Maduro s’enfermera chaque fois plus dans des politiques autocratiques, en multipliant au fil des ans les interventions et les législations répressives, y compris envers les forces de gauche (Parti communiste vénézuélien, Patrie pour tous, etc.). Certes, il héritera en même temps d’une situation économique difficile, marquée par une baisse drastique du prix du pétrole sur le marché mondial, et d’un contexte politique délétère dû à la désaffection d’une partie de l’électorat chaviste. Tout ceci le conduira à perdre les élections législatives de 2015, où l’Assemblée nationale passe aux mains de l’opposition.
En réponse, Maduro fera le choix d’approfondir la trajectoire probusiness de son gouvernement, en dépit d’une rhétorique radicale et anti-impérialiste de façade. Ce mouvement s’était amorcé dès 2014, lorsque son gouvernement créa des Zones économiques spéciales (ZES) pour libéraliser l’exploitation des ressources du sous-sol ou forestières dans l’Arc minier et pétrolier de l’Orénoque. Cet espace géographique est ainsi offert sur un plateau d’argent à des entreprises multinationales, alors que l’on abroge les droits sociaux des travailleurs, mais aussi ceux liés à la préservation de la nature et des peuples autochtones.
À partir de 2017, il accélère le cours manœuvrier et autocratique de son régime, concentrant chaque fois plus le pouvoir autour de sa personne et de ceux et celles qui lui resteront fidèles. L’une des stratégies privilégiées fut de mettre en place une seconde assemblée constituante (la première l’avait été en 1999 sous l’égide de Chavez), de telle manière à ce qu’elle puisse non pas améliorer les principes démocratiques de la constitution de 1999, mais demeurer étroitement soumise au pouvoir présidentiel et lui permettre de contourner l’Assemblée nationale. Cette dernière, il faut le noter, était contrôlée par une opposition qui se montrait de plus en plus agressive, prête à jouer de l’illégalité, en plus de rester activement soutenue par les USA (voir l’épisode de Juan Guaidó, devenu sous leur égide président autoproclamé du Venezuela en 2019).
Le reste, on le connait : dans un contexte de crise économique exacerbée par les mesures de rétorsion économique des États-Unis et par l’exil massif de millions de Vénézuéliens, on remarque l’aggravation du cours autoritaire et néolibéral maduriste. Ce dernier a non seulement multiplié les législations antidémocratiques – loi sur la haine (2017), sur le fascisme (2024), etc. –, mais surtout (et de nombreux experts et observateurs non partisans ont dû en arriver à cette conclusion) en manipulant frauduleusement le résultat des élections présidentielles de 2024 qui auraient sans doute pu permettre au candidat de l’opposition et colistier de Maria Corina Machado, Edmundo Gonzales Urrutia, de l’emporter.
En somme, on le voit : les choses ne sont pas simples avec le Venezuela. Et si beaucoup ont pris l’habitude de rappeler à son propos et avec raison le rôle décisif des échanges économiques inégaux entre le Nord et le Sud global ainsi que les indéniables prédations de l’impérialisme US, on ne peut pas non plus — quand on est de gauche — passer sous silence les dérives autocratiques de Maduro, car il rompt ainsi clairement avec les meilleurs acquis de l’héritage chaviste, et reste partie prenante, à sa manière, de la si rapide dégradation de la situation vénézuélienne !

Le mot pétrole est sur toutes les lèvres — en particulier sur celles de Donald Trump, qui a répété très explicitement qu’il entend en faire profiter les compagnies américaines. Y a-t-il plus à cela, ou l’évidence crève les yeux ?
Là encore, ça vaut la peine de revenir à l’histoire, d’autant plus si l’on sait que selon l’AIE, le sol du Venezuela renfermait en 2023 environ 303 milliards de barils (soit environ 17% des réserves mondiales). Le pétrole vénézuélien a été découvert à partir des années 1910, spécialement aux abords du magnifique lac Maracaibo, aujourd’hui écologiquement saccagé. Et ce sont pour une bonne part des entreprises états-uniennes et britanniques qui ont pu en exploiter les gigantesques ressources, grâce à la complicité du dictateur d’alors Vicente Gomez (1908-1935) et aux nombreux passe-droits qui leur conféra. Comme le rappelle Eduardo Galeano en citant l’économiste Domingo Alberto Angel, ces entreprises firent des profits considérables, « excédant les richesses que les Espagnols usurpèrent à Potosi et les Anglais à l’Inde[1] ». Galeano rappelle aussi qu’en 1970 — année dont rêve Donald Trump avec rapacité nostalgique — « la moitié des profits que les capitaux américains avaient extraits de l’Amérique latine provenait du Venezuela[2] », alors qu’à cette époque ce pays était à la fois un des plus riches, mais aussi un des plus pauvres et des plus violents de tout le sous-continent.
Il est bon d’ajouter ici aussi que les nationalisations de ces entreprises qui ont été effectuées un peu plus tard par le gouvernement social-démocrate de Carlos Andrés Pérez en 1975-1976, l’ont été avec indemnisation et non pas au détriment des entreprises étrangères. Celles-ci ont eu le loisir de s’orienter vers des secteurs plus profitables de transformation, pendant que la nouvelle compagnie vénézuélienne, la PDVSA prenait le relais de l’exploitation directe. Enfin, en 2001, Chávezn’a fait que s’assurer que les revenus de la PDVSA reviennent intégralement à l’État et ne tombent pas dans les mains de multiples intermédiaires corrompus. La même année, cela lui a valu une tentative de coup d’État, auquel s’était activement associée Maria-Corina Machado, néanmoins récipiendaire du prix Nobel de la paix 2025[3].
Il y a donc bien, depuis plus d’un siècle, la présence au Venezuela d’un impérialisme états-unien très actif qui a su piller à profit — notamment à travers les règles du soi-disant « libre » marché capitaliste — une bonne partie des richesses de ce pays. La réalité est que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir en 1998, il y avait encore dans son pays 49% de la population vivant en état de pauvreté et 27% en état d’extrême pauvreté[4].


Merci pour cette réponse. Allons maintenant plus profondément sur le thème de l’impérialisme. Même les médias mainstream utilisent aujourd’hui ce mot pour décrire le bellicisme de Trump, alors qu’il est d’ordinaire un concept privilégié de la tradition marxiste. L’Amérique latine a connu une longue liste d’interventions étrangères sur son continent. Qu’est-ce qui, dans le cas du Venezuela, est réellement « nouveau » ou « différent » ? Et, sous un autre angle, on peut aussi se demander l’intérêt d’un recours à la force brute afin de s’approprier des ressources. Certains pourraient en effet avancer que, sous le néolibéralisme, les traités de libre-échange et la discipline par la dette ont longtemps été suffisants pour soumettre économiquement l’Amérique latine.
Oui, c’est une bonne question, et elle nous oblige à réfléchir aux nouvelles coordonnées du monde dans lequel nous entrons. Car nous sommes en train de glisser dans une période de grandes turbulences. Et pour en comprendre toute la portée, il ne faut pas craindre de reprendre le concept traditionnel d’impérialisme mis en avant par la tradition marxiste. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’y a pas eu d’intervention impérialiste — tant économique que militaire — des USA en Amérique latine dans les dernières décennies. Il suffit de se rappeler l’invasion du Panama en 1989, ou encore l’occupation de l’île de Grenade en 1983, sans parler bien sûr du coup d’État au Chili parrainé par les USA en 1973. On peut aussi remonter plus en arrière, avec le renversement de Juan Bosch en 1965 à Saint-Domingue suivie d’une invasion militaire, ou encore au Guatemala, du renversement du président progressiste Jacobo Árbenz Guzmán en 1954. En somme, les exemples sont nombreux.
Mais à l’heure actuelle, il y a plus que la simple continuation de la politique habituelle des États-Unis, traditionnellement plus ou moins maquillée par de pseudos justifications d’ordre démocratique ou de lutte contre le communisme. Aujourd’hui, avec Trump, on ne prend même plus la peine de ces précautions oratoires ; on va droit au fait, et sans alibi aucun, revenant aux principes premiers de la doctrine Monroe qui, depuis 1823, scande « l’Amérique aux Américains ». Rebaptisée pour l’occasion doctrine « Donroe », cette politique impérialiste veut que l’Amérique latine soit d’abord et avant tout l’arrière-cour des USA, avec ce que cela signifie de pillages et d’accaparement des ressources matérielles et humaines disponibles.
Sans doute faut-il, pour comprendre ce changement de ton, faire appel aux nouveaux conflits inter-impérialistes qui sont en train de se nouer à l’échelle du monde, particulièrement entre les USA — la première puissance économique du monde, mais en difficulté et déclinante — et la Chine – la puissance économique montante, disposant de ressources humaines et matérielles potentiellement énormes et se posant d’ores et déjà comme sa concurrente directe. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut sans doute aussi replacer ces bouffées agressives et pleines de ressentiment des politiques trumpistes dans le contexte d’un capitalisme mondialisé (un « capitalisme de la finitude » disent certains[5]), secoué, traversé par d’importantes crises qui se combinent les unes aux autres et qui donnent l’impression que nous entrons dans une véritable « crise de civilisation », de portée anthropologique, faisant que toutes les dimensions de la vie humaine (économiques, sociales, politiques, sanitaires, techniques, culturelles, etc.) finissent par être questionnées, mais sans qu’apparaissent de véritables alternatives politiques émancipatrices susceptibles d’être mises en branle dans le court ou moyen terme.
En même temps, il faut aussi comprendre que les fractions et groupes dirigeants de ce capitalisme mondialisé (dont les GAFAM) sont en quête d’un second souffle. Ces derniers cherchent erratiquement — mais aussi cyniquement — des solutions à la crise de profitabilité du capital : tant du côté de l’IA que de la remise en cause drastique des acquis sociaux-démocrates des Trente glorieuses. D’autres options sont aussi sur la table, comme la recherche de nouvelles activités spéculatives et rentières profitables ou encore, bien sûr, du développement accéléré de l’industrie d’armement, voire de la guerre. On le voit, c’est toute l’architecture des rapports géopolitiques née au sortir de la Seconde Guerre mondiale mondiale (avec ses 50 millions de morts) et dans le sillage de la victoire des alliés contre le nazisme qui est en train de basculer et de se remodeler de fond en comble.
Redescendons de l’échelle globale au Venezuela, en touchant une question de conjoncture plus immédiate. Personne n’a de boule de cristal, mais une analyse informée reste un bon point de départ. En ce sens, à quoi faut-il s’attendre dans la situation actuelle du pays ? Une nouvelle intervention militaire américaine ? Le maintien du gouvernement de Delcy Rodríguez ? Jusqu’à preuve du contraire, l’opposition de droite représentée par Machado semble écartée du pouvoir. Bref, quels sont les scénarios plausibles ?
C’est difficile à dire, et vu les informations sûres dont on peut disposer, on ne peut qu’en rester aux hypothèses les plus probables. Sans doute, Trump a compris qu’envahir le Venezuela ne serait pas une simple partie de campagne. Il reste dans la population vénézuélienne, à cause même du chavisme et de son influence vivace dans les classes populaires, de forts sentiments anti-impérialistes, sentiments que Maduro a su reprendre à son compte en organisant, au sein des secteurs populaires qu’il contrôle, des milices d’autodéfense. Quant aux officiers des forces armées vénézuéliennes, bien des intérêts économiques — et pas seulement idéologiques ou patriotiques — les ont poussés à demeurer fidèles au régime maduriste et à rester relativement unis face aux appels de l’opposition comme aux menaces d’invasion états-uniennes. Entre autres choses, parce que l’armée a été très rapidement associée, non seulement aux tâches de gestion de grandes entreprises publiques, mais aussi aux profits générés par la CAMIPEG, compagnie militaire fondée en 2016 s’étant spécialisée dans l’extraction minière, pétrolifère et gazière, et œuvrant en particulier dans l’arc minier et pétrolier de l’Orénoque. Il y aurait ainsi, en tout, plus de 1600 officiers de haut rang de l’armée vénézuélienne directement investis dans la gestion et la direction d’entreprises privées et publiques vénézuéliennes[6]. Il s’agit donc d’un régime qui conserve, malgré toutes les crises auxquels il a dû faire face, des atouts solides, tant en termes économiques que militaires.
Aussi, si face à l’inégal rapport de force militaire existant entre les USA et le Venezuela, les troupes US pourraient évidemment occuper le Venezuela, cela ne se ferait pas du jour au lendemain, ni sans difficultés et pertes de soldats ; toutes choses que Trump cherche pour l’instant à éviter, notamment à cause des réticences du Congrès et des promesses faites à sa base électorale.
D’où l’intérêt pour l’administration Trump d’une intervention militaire prenant la forme d’un kidnapping du président (et de son épouse), et en sous-main d’une négociation déjà initiée en novembre 2025 avec Maduro lui-même, mais que, suite à son échec, il poursuit dorénavant — chantage militaire et économique en prime — avec certains secteurs maduristes plus dociles, et qui sans doute, d’une manière ou d’une autre, ont facilité la brutale exfiltration du président (avec plus de 30 morts de sa garde rapprochée, sans compter les pertes civiles).
Un des legs de la révolution bolivarienne est l’institution des conseils communaux (consejos communales). Depuis 2006, ceux-ci ont été implantés afin de favoriser l’essor d’une forme de pouvoir populaire « par le bas », en instituant des organes de démocratie directe. À l’heure actuelle, les conseils communaux sont-ils encore investis par la population ? Peuvent-ils représenter l’embryon d’une résistance populaire future ?
Sur ce dossier aussi il faut faire les nuances qui s’imposent, car ces conseils communaux ont été sous Chavez tout à la fois la pointe avancée d’une réforme populaire prometteuse et sa limite intrinsèque. Il s’agissait en effet — à partir de 2006 (date de création des conseils communaux) — de passer par-dessus les pouvoirs très conservateurs d’une administration municipale vénézuélienne toujours présente, en les doublant de nouveaux conseils communaux indépendants, organisés dans tel ou tel quartier ou espace de vie autour des champs d’intervention des organisations populaires ou de l’existence de communautés citoyennes données. Ils regroupaient généralement 200 à 300 familles qui pouvaient s’occuper de santé, d’éducation, de l’état des logements ou des rues. Celles-ci étaient reliées directement au gouvernement central qui fournissait les fonds nécessaires à son fonctionnement et à ses activités; des fonds provenant généralement de la rente pétrolière et qui étaient gérés par l’État.
Il s’agissait donc en principe d’encourager, depuis le bas, la participation et l’auto-organisation populaire. Et en 2006, portée par l’élan encore intact de la révolution bolivarienne, la loi sur les conseils communaux a donné naissance à une pléthore de conseils communaux, probablement plus de 35 000 ainsi que l’indiquait en 2017 le ministre de la Participation populaire et de la protection sociale de l’époque. Mais en même temps ces conseils communaux, tout en ne remplaçant pas l’administration municipale officielle qui s’emploiera souvent à bloquer leurs interventions, ne seront l’expression d’aucun projet politique global, et cela même s’ils avaient pour finalité de « rendre le pouvoir au peuple ». Relégués à s’occuper des besoins immédiats et locaux des communautés, ils resteront largement à l’écart des véritables centres de décision. Ce qui fait que leur rôle va être confiné à la petite gestion du quotidien, et cela d’autant plus que ces conseils n’auront aucun droit de regard et pouvoir effectif — par exemple dans les expériences de gestion participative brésilienne à Porto-Alegre — sur le type de budget qui leur sera alloué par l’État central. Même aux meilleurs moments de la révolution bolivarienne, on était donc loin encore d’une gestion participative et populaire, pleine et entière du pouvoir, et cela au-delà même des nobles intentions qui avaient présidé à ce projet et qui se combinait d’ailleurs à l’époque avec l’idée d’« un socialisme du 21ième siècle ». Il reste que sous Nicolás Maduro ces conseils communaux, auront de plus en plus tendance, soit tout simplement à disparaître, soit à se muer en de simples structures clientélistes d’encadrement des secteurs populaires encore favorables à Maduro.
Et enfin, face à la situation au Venezuela, un conseil à donner aux anti-impérialistes des pays du Nord global ?
Revenons une dernière fois à l’histoire, et ne pas oublier qu’il y a à peine 25 ans soufflait en Amérique latine un véritable vent d’espoir et de changement, porté en avant par les Zapatistes mexicains, le mouvement altermondialiste internationaliste et ses forums mondiaux si courus (y compris par bien des militants-es du Québec) ainsi que par les aspirations révolutionnaires et anti-néolibérales, bolivariennes du Venezuela, citoyennes de l’Équateur et autochtones de la Bolivie. Un autre monde était possible! C’est ce fil-là aujourd’hui brisé de luttes populaires ascendantes, prometteuses et victorieuses qu’il faut tenter de retrouver. Commençons de ne pas craindre de faire le bilan des bons coups comme des échecs passés, et en en tirant d’implacables leçons pour l’avenir.
Quant à l’impérialisme — et au capitalisme qui lui sert de terreau si fertile —, au moins avec Trump, on sait maintenant de quoi il en retourne vraiment. À nous d’en prendre acte!
[1] Eduardo Galeano, Las veinas abiertas de America latina, México, Siglo XXI Editores, 2004. p. 273
[2] Ibid.
[3] Pierre Mouterde, « Maria Corina Machado : vous avez dit… le prix Nobel de la paix 2025 ? ». Presse-toi à gauche, 14 octobre 2025.
[4] Patrick Guillaudat et Pierre Mouterde, Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, Promesses et défis d’un processus de changement social, Montréal, M éditeur, 2012
[5] Arnaud Orain. Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude XVIe-XXIe siècle. Paris, Flammarion, 2025.
[6] Voir Patrick Guillaudat et Pierre Mouterde, Les couleurs de la révolution, Paris, Syllepse, 2022. p. 134-135

Max Chancy, militant et pédagogue socialiste
Max Chancy (1928-2002), philosophe et militant socialiste, a consacré sa vie à la défense des droits démocratiques du peuple haïtien, à la construction d’une société égalitaire, ainsi qu’au développement d’une pédagogie émancipatrice. D’abord actif en Haïti, il est forcé à l’exil en 1965, en raison de la dictature de François Duvalier. Il s’installe alors au Québec d’où il organise un réseau de solidarité, tout en participant à la création de la Maison d’Haïti et en s’engageant dans la transformation du système d’éducation québécois. Après la chute de la dictature en 1986, il retrouve son pays qu’il faut dorénavant reconstruire[1].
Max Chancy est né en 1928 à Jacmel en Haïti, mais a principalement été élevé dans la famille de sa mère à Port-au-Prince[2]. Dans ce milieu intellectuel rassemblé autour de l’imprimerie du grand-père, il s’initie rapidement aux idées progressistes. Il est lauréat de la première promotion de l’École normale supérieure d’Haïti en 1947, tout en animant avec quelques ami·es un groupe de réflexion littéraire et sociale, appelé sobrement NOUS. C’est aussi l’époque où il se fiance avec Adeline Magloire qui deviendra sa compagne pour la vie. En 1950, grâce à ses excellents résultats, il obtient une bourse pour étudier à Paris, y découvrant le marxisme et les mouvements anti-coloniaux par l’entremise de militant·es français·es et ouest-africain·es. Après trois ans d’études, Chancy rentre en Haïti afin de participer à la construction d’un réseau scolaire laïc et démocratique. Mais le climat social est à l’affrontement entre les élites conservatrices et un mouvement populaire qui désire instaurer un état social. Dans ce contexte, le régime autoritaire de Paul Magloire (1950-1956) entrave les efforts des progressistes. Chancy profite donc d’une nouvelle bourse pour compléter un doctorat en philosophie à l’Université de Mayence (Allemagne).
Lutter contre la dictature, malgré la prison et l’exil
À son deuxième retour au pays, Max Chancy découvre un climat encore plus délétère, marqué par l’imposition de la dictature de Duvalier père (1957-1971). « Le choc fut brutal, nous avons compris d’un coup la répression sauvage, le traitement fait aux opposants, la milice des tontons macoutes en action. »[3] Max Chancy s’implique alors à tous les niveaux pour lutter contre le gouvernement. En plus de ses activités syndicales, il rejoint le noyau clandestin du Parti populaire de libération nationale (PPLN). Cette organisation marxiste-léniniste, fondée en 1954, s’inspire des différentes luttes révolutionnaires en cours ou victorieuses (comme à Cuba) pour lancer des opérations de déstabilisation du régime duvaliériste. Dès 1959, son action militante entraîne son licenciement de l’enseignement public, bien que son engagement révolutionnaire demeure secret. Privé de revenu, Chancy survit grâce à des contrats de tutorat, mais consacre le plus clair de son temps à l’organisation politique. Il contribue à la grève étudiante de 1960 et anime, à partir de 1962, le journal illégal Haïti demain, organe du PPLN. Adeline Magloire Chancy, pour sa part, participe au comité révolutionnaire Femme patriote. Tous deux travaillent aussi, avec des camarades de plusieurs groupes, à mettre sur pied un front démocratique unifié. L’arrestation de Max Chancy, en octobre 1963, interrompt le projet.
Après plusieurs mois d’incarcération et de tortures, Chancy est relâché, mais sa liberté est relative puisqu’il fait l’objet d’une surveillance particulière. À l’été 1965, une nouvelle vague de répression frappe le PPLN. Chancy est informé que la police le cherche pour l’exécuter. Lui et sa famille sont alors cachés par les réseaux du parti et exfiltrés du pays, avant d’arriver au Canada où ils demandent l’asile politique. Les Chancy s’installent à Montréal et sont rapidement embauchés dans le système scolaire québécois. Il n’empêche que la priorité demeure d’organiser la résistance, à quoi sert le fameux appartement du 798, avenue Champagneur, souvent considéré comme la « première Maison d’Haïti »[4]. Cet objectif implique l’envoi de fonds et d’imprimés aux militant·es resté·es en Haïti, le soutien aux prisonnier·ères politiques, l’aide envers les autres exilé·es et la dénonciation tous azimuts du régime de Duvalier. « Les grands enjeux de l’heure étaient la ligne politique face à la dictature et au terrorisme d’État qui ne laissaient d’autre voie que la lutte armée à ceux qui refusaient l’embrigadement et rêvaient d’une nouvelle Haïti. »[5] Le rôle de Max Chancy est déterminant puisqu’il demeure un cadre dirigeant du PPLN, devenu en 1969 le Parti unifié des communistes haïtiens (PUCH).

Démocratiser l’éducation pour établir une société juste
Bien que le gouvernement du Canada refuse de régulariser son statut jusqu’en 1982, Max Chancy s’investit dans plusieurs projets destinés aux communautés migrantes comme à l’ensemble des jeunes du Québec. En 1972, un groupe de militantes et de militants (Nirva Casséus, le couple Chancy, Charles Dehoux, Pierre Normil, etc.) fonde la Maison d’Haïti pour offrir des services aux nouveaux·elles arrivant·es et pour défendre les intérêts démocratiques du peuple haïtien. En sus, l’organisme se concentre sur l’éducation populaire pour aider les personnes ayant une faible scolarité, pour développer la conscience politique de la communauté et pour garder vivante la culture haïtienne auprès de la jeunesse. Max Chancy s’implique particulièrement dans la lutte contre les déportations de réfugié·es politiques et dans l’animation de cercles politiques destinés aux adolescent·es. Embauché comme professeur de philosophie au cégep Édouard-Montpetit (Longueuil), Chancy milite aussi dans son syndicat où il tente de rattacher les luttes économiques aux combats politiques. En compagnie de Michel Chartrand, il participe à l’organisation d’une Conférence internationale de solidarité ouvrière (juin 1975) à Montréal, qui rassemble plus de 600 personnes venues de trois continents avec l’objectif d’unir leurs forces pour lutter contre l’impérialisme.
C’est d’ailleurs comme enseignant progressiste et militant pour une éducation démocratique que Chancy se fait connaître dans les années 1980. Ayant mené plusieurs enquêtes sur l’intégration des immigrant·es dans le système scolaire, il est nommé au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) du Québec pour développer une politique à ce sujet. Il rédige un rapport intitulé L’école québécoise et les communautés culturelles, rendu public en février 1985. Parmi ses 61 recommandations, il suggère de réviser le matériel didactique pour qu’il tienne compte de la diversité culturelle et d’offrir des formations aux enseignant·es concernant les enjeux propres aux différentes communautés. Le rapport souligne aussi le lien entre l’immigration et la pauvreté, conséquence de la division raciale du travail. Cette situation implique une sous-scolarisation chez les migrant·es à laquelle le gouvernement est sommé de répondre par des programmes spécifiques. L’objectif est de briser le cercle vicieux qui renvoie de la pauvreté à l’éducation lacunaire, et vice-versa[6].

À la même époque, la situation commence à bouger en Haïti. En 1971, Jean-Claude Duvalier a succédé à son père, tout en maintenant son régime despotique. Mais, à partir des années 1980, plusieurs organisations politiques et syndicales défient le régime. À l’automne 1985, une révolte populaire s’étend depuis les campagnes jusqu’aux principales villes. L’année suivante, le dictateur est forcé de quitter le pouvoir et le pays. Max Chancy rentre immédiatement en Haïti pour participer à l’effort de reconstruction. Il reprend ses activités d’enseignement et, comme dirigeant du PUCH, il travaille à l’unité de la gauche haïtienne dans un contexte qui reste chaotique. Malheureusement, une maladie cérébrale ralentit considérablement ses activités à partir du début des années 1990, jusqu’à ce qu’il doive se retirer entièrement de la vie politique. Son combat pour une Haïti démocratique et socialiste est depuis poursuivi par ses camarades. Ceci dit, le parcours de Max Chancy demeure exemplaire et nous pouvons reprendre à son endroit les mots qu’il réservait à Jacques Stephen Alexis : « il est devenu ainsi pour le mouvement révolutionnaire haïtien le symbole du militant qui a vécu pleinement ce qu’il pensait et ce qu’il disait, qui a réalisé l’adéquation entre la théorie et la pratique »[7].
[Photo en couverture : Wikipedia]
Notes
[1] Cet article est d’abord paru dans À Bâbord ! no. 103 [En ligne]
[2] La principale source biographique demeure MAGLOIRE CHANCY, Adeline. Max Chancy (1928-2002), Port-au-Prince, Fondation Gérard Pierre-Charles, 2007.
[3] MAGLOIRE CHANCY. Max Chancy, 2007, page 17.
[4] NOËL, Julie. « Le 798, Champagneur ou la première Maison d’Haïti », 11 septembre 2018, en ligne : https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/le-798-champagneur-ou-la-premiere-maison-dhaiti
[5] MAGLOIRE CHANCY. Max Chancy, 2007, page 23.
[6] NOËL, André. « Québec reconnaît le besoin d’adapter l’école à la nouvelle réalité multiculturelle », La Presse, 23 février 1985, page A5.
[7] Cité dans MAGLOIRE CHANCY. Max Chancy, 2007, page 88.

Venezuela : l’agression impérialiste ouvre une boîte de Pandore
Archives Révolutionnaires a traduit cet article paru dans le Comentario Internacional concernant l’intervention américaine au Venezuela. Faisant une synthèse des faits importants, l’auteur, Marcelo Solervicens, fait un diagnostic des conséquences désastreuses qu’un impérialisme américain débridé aura pour l’Amérique latine et le monde entier.
Marcelo Solervicens, 4 janvier 2026
À l’aube du 3 janvier, des troupes américaines ont enlevé le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse Cilia Flores. En violation des principes fondamentaux du droit international, cet acte ne peut que présager un retour des agressions impérialistes américaines, dont l’objectif est de ressusciter la doctrine Monroe pour garantir la primauté des États-Unis sur leur arrière-cour.
Lors d’une conférence de presse à Mar-a-Lago, la résidence du 47e président, Donald J. Trump a confirmé à des journalistes dociles que des forces militaires d’élite des États-Unis avaient enlevé le président Maduro et son épouse, se vantant par le fait même de la puissance militaire immense et inégalée des États-Unis.
Trump a justifié cet enlèvement en prétextant que Maduro sera traduit en justice dans le district sud de New York par la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, pour répondre à des accusations de « conspiration narcoterroriste », de « conspiration pour importer de la cocaïne », de « possession et de complot pour détenir des mitrailleuses et dispositifs destructifs ».

Cependant, cette attaque ne présente aucun fondement sur le plan légal, comme l’a entre autres souligné le journal britannique The Guardian. La caractérisation du Venezuela en tant que « narco-État » est en effet absurde. Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), seulement 8% des produits illicites colombiens circulent par les Caraïbes et la Guajira colombienne, tandis que 87% transitent par le Pacifique, bien loin du Venezuela. Le Rapport européen sur les drogues de 2025 ne mentionne même pas le Venezuela comme un couloir du trafic de drogue international.
C’est sans oublier que l’administration Trump est responsable de la destruction de 35 embarcations et de plus de cent exécutions extrajudiciaires dans les Caraïbes, toutes contraires au droit international. Les conventions internationales exigent que les suspects soient arrêtés et dûment jugés en cas d’activité criminelle. Il est certain que l’administration Trump n’a jamais fourni de preuves établissant des liens entre ces embarcations et un trafic de drogue à destination des États-Unis. Elle n’a pas non plus prouvé l’existence du supposé Cartel de los Soles ou de liens entre Maduro et le groupe criminel Tren de Aragua.
L’acharnement de Trump contre le prétendu narcotrafic vénézuélien contraste avec sa décision paradoxale d’accorder la grâce présidentielle à Juan Orlando Hernández, l’ex-président du Honduras (2014-2022). Ce dernier avait été condamné à 45 ans de prison par la justice américaine pour narcotrafic et pour avoir justement transformé son pays en un « narco-État ». Lors de la conférence de presse, le secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, a insisté sur le fait que Maduro avait eu une chance de négocier, mais qu’il l’avait manquée, et était désormais tombé sous le long bras de la justice américaine. Cette attaque américaine confirme que le message de la politique « America First » est plutôt celui de « peace through strength ».
Donald Trump a ensuite caricaturé le sujet du narcotrafic, en répétant sa diatribe des dernières semaines, avant de révéler que l’objectif réel de Washington était de récupérer le pétrole que le Venezuela aurait volé il y a des décennies, sans que les précédents gouvernements américains n’aient réagi. Il a ainsi confirmé que le but ultime de Washington, illustré par le geste de piraterie internationale de capture de trois pétroliers vénézuéliens, ajoutés au blocus, aux sanctions et aux pressions pour la démission de Maduro, n’était pas d’attaquer le narcotrafic, mais de s’emparer des réserves pétrolières – les plus importantes du monde – pour les ouvrir aux entreprises pétrolières états-uniennes.

Enfin, il est devenu clair que pour atteindre cet objectif, Washington a besoin d’un changement de régime, c’est-à-dire l’installation d’un gouvernement docile. Ainsi, pendant la période de questions, Trump a précisé, en enlevant toute crédibilité à l’opposante María Corina Machado (qui porte l’odieux de lui avoir volé le Prix Nobel de la paix), qu’elle est « très gentille », mais qu’elle « ne dispose pas de soutien et n’inspire pas de respect dans son pays ». Et, dans un nouveau revirement, Trump a affirmé que Washington lui-même s’occupera de gouverner le Venezuela jusqu’à ce qu’une transition appropriée soit assurée, sans préciser comment ce gouvernement sera exercé. Cette déclaration s’est accompagné de menaces d’une autre attaque si des résistances venaient à se manifester au Venezuela, car la flotte, les avions et les troupes américaines restent en état d’alerte dans la région.
Trump a laissé entendre que son message est que tout l’hémisphère occidental est sous la domination de Washington et qu’il n’hésitera pas à réactiver l’histoire longue des agressions impérialistes en Amérique latine, toujours à des fins économiques. Il s’agit d’un renforcement de l’impérialisme, tel qu’exprimé dans sa Stratégie de sécurité nationale (NSS) publiée récemment, en tant que corollaire de la doctrine Monroe de 1823. Il a précisé qu’aucune puissance étrangère, notamment la Chine ou la Russie, ne serait autorisée à intervenir dans la région.
Lors de la conférence de presse, Trump et son secrétaire d’État, Marco Rubio, ont précisé que les interventions américaines en Amérique latine ne sont pas terminées, menaçant des pays comme Cuba, la Colombie et l’Iran. Il n’est pas surprenant que l’ex-allié de Trump, Elon Musk, ait soutenu ironiquement Marco Rubio, en le qualifiant de président du Venezuela, gouverneur de Cuba et monarque de l’Iran. À ce stade, il est évident que la décision de renverser le président vénézuélien par l’administration Trump ouvre une véritable boîte de Pandore dans la région et dans le monde.
D’une part, le changement de régime au Venezuela comporte de nombreux risques, comme le souligne notamment la BBC. L’avenir est incertain, car bien que Trump ait affirmé que la vice-présidente Delcy Rodríguez collaborerait avec son administration, cette dernière a répliqué en chaîne nationale : « Nous ne serons jamais une colonie d’aucun empire. » Elle a déclaré que « le seul président du Venezuela est Nicolás Maduro » et a activé le Conseil de Défense de la Nation, en remettant le décret de « commotion extérieure », signé par Maduro, au Tribunal suprême de justice (TSJ), pour lancer une lutte armée contre cette « agression impérialiste ».

De plus, l’effet de distraction du changement de régime au Venezuela pour expulser les migrants vénézuéliens ressemble à un « wag the dog », typique de la politique américaine, nécessaire face à la chute de popularité de Trump due à l’augmentation de l’inflation. Mais cela pourrait échouer. Plusieurs analystes estiment que la situation pourrait se retourner contre lui, en raison des coûts humains qu’impliquerait une invasion sur le territoire vénézuélien, notamment si le soutien du mouvement MAGA pour des guerres est insuffisant, selon The New York Times.
D’autre part, il est maintenant clair que le soft power censé caractériser la politique étrangère des États-Unis durant la mondialisation est désormais définitivement enterré. Ce pouvoir qui justifiait les interventions au nom de la défense de la démocratie a cédé sa place à un nouveau niveau de pouvoir global, sans restriction, qui ne respecte pas les règles du droit international établies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le problème – surtout pour un empire décadent et contesté par les BRICS dans un contexte international multipolaire –, c’est que cette agression encourage d’autres puissances à agir. Pour la Russie, elle permet la poursuite de la guerre en Ukraine, en imposant sa volonté géopolitique sur les territoires occupés, et à la Chine d’annexer Taïwan, refuge des troupes nationalistes après leur défaite face à Mao Tsé-Toung. Sans négliger le fait que cela pourrait encourager des actions sans restriction de la part de puissances régionales dans leur propre zone d’influence.
En effet, l’intervention militaire états-unienne au Venezuela justifie la loi du plus fort en politique étrangère, où tout est permis dans les zones d’influence des grandes puissances. Un exemple récent est la chaleureuse réception de Benjamin Netanyahu par Trump et leur disposition commune à attaquer l’Iran.
Cela signe-t-il l’arrêt de mort du droit international ? Chose certaine, tout indique que cela accroît l’obsolescence des institutions internationales. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé des préoccupations sur l’ignorance du droit international par les États-Unis, mais personne ne l’écoute. Peu d’espoir est placé dans la session du Conseil de sécurité de l’ONU ce lundi, obtenue par la Colombie avec le soutien de la Russie et de la Chine : il est fort probable que l’ambassadeur américain utilise son veto pour empêcher toute condamnation.
D’un autre côté, le ton des réactions des gouvernements dépend de la géopolitique des zones d’influence. Il est frappant de constater que la principale nouvelle qui parcourt le monde est que les États-Unis ont décidé de prendre le contrôle du Venezuela. De son bord, la Russie a condamné « l’agression armée » comme une « violation inacceptable de la souveraineté d’un État indépendant ». L’Iran a quant à elle dénoncé « une violation manifeste de la Charte des Nations unies ».
Par contre, l’Union européenne et les pays européens ont appelé au respect du droit international, sans exprimer de soutien au gouvernement du Venezuela, qu’ils considèrent pour la plupart comme illégitime. On note en particulier l’appel de l’Espagne au dialogue et à une solution pacifique et négociée de la crise. D’autres, comme le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, n’ont pas osé condamner l’attaque de Trump contre le Venezuela. De son côté, Emmanuel Macron a célébré la « libération » du Venezuela et appelé à une transition dirigée par Edmundo González, une perspective très éloignée des véritables plans de Trump.
La réalité est que, du point de vue européen, l’attaque de Trump visant à s’approprier le pétrole vénézuélien viole ouvertement les règles du droit international. C’est la goutte qui fait déborder le vase. Elle confirme la possible fin de l’ordre — ou du désordre — international issu de la Seconde Guerre mondiale et de la mondialisation, marquant le retour d’un monde multipolaire caractérisé par la rivalité entre zones d’influence.
En Amérique latine, l’intervention directe de l’administration Trump, mobilisant toute la puissance militaire de l’empire, rappelle les décennies de coups d’État et de destruction de la démocratie par des régimes militaires soutenus par les États-Unis au cours du XXᵉ siècle – depuis le premier coup d’État organisé par la CIA contre Jacobo Árbenz au Guatemala jusqu’à l’invasion du Panama, en passant par le coup d’État contre Salvador Allende au Chili.
À cette heure, il est évident qu’en Amérique latine l’usage sans restriction de la force par Trump remet en cause l’hégémonie du discours dominant autour de la démocratie, défendu aussi bien par les courants progressistes que par diverses droites traditionnelles. Depuis les années 1990, ce discours a permis d’éviter les coups d’État militaires — un progrès, même si ceux-ci ont été remplacés par des coups institutionnels ou par le lawfare, fondés sur l’État de droit.
C’est pourquoi les réactions en Amérique latine révèlent que l’agression américaine constitue un tournant dans la région. Comme on pouvait s’y attendre, Javier Milei a célébré la capture de Maduro, affirmant qu’il s’agit d’une « excellente nouvelle pour le monde libre » et que « la liberté avance ». Le président salvadorien Nayib Bukele, pour sa part, a réagi dans son style revanchard habituel en se moquant de Maduro à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, tandis que le président équatorien Daniel Noboa a salué l’enlèvement en déclarant que « l’heure de tous les narco-chavistes finit par arriver ».

Dans la même logique, le président élu du Chili, José Antonio Kast, a qualifié l’arrestation de Maduro de « grande nouvelle pour la région », et le président intérimaire du Pérou, José Jeri, a salué la capture du dictateur chaviste en affirmant que le Venezuela entre dans « une nouvelle ère de démocratie et de liberté ». Le président du Costa Rica, Rodrigo Chaves, a célébré l’arrestation de Maduro, qu’il accusait de fraude électorale, en affirmant « qu’il doit payer pour ses crimes ». D’autres représentants de la droite latino-américaine, comme le président récemment élu Rodrigo Paz, ont rappelé que « la Bolivie sera toujours du côté de la démocratie ». De son côté, le président paraguayen Santiago Peña, tout en critiquant la dérive insoutenable de « Nicolás Maduro, chef du Cartel de los Soles », a également appelé à privilégier les voies démocratiques garantissant une transition ordonnée. De même, le président panaméen José Raúl Mulino a réaffirmé son soutien à une transition démocratique au Venezuela après la capture de Maduro.
De leur côté, les différentes expressions du progressisme et de la gauche latino-américaine ont réagi en condamnant, avec des nuances diverses, le changement de cycle que représente l’attaque et la capture du président vénézuélien, en soulignant les violations du droit international. Le président colombien Gustavo Petro a condamné l’agression contre la souveraineté du Venezuela et ordonné le déploiement de troupes à la frontière. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a condamné l’attaque criminelle des États-Unis contre le Venezuela, la qualifiant de « terrorisme d’État ». Le président nicaraguayen Daniel Ortega a dénoncé l’agression militaire américaine, réaffirmé sa solidarité avec la révolution bolivarienne et exigé la libération de Maduro et de son épouse.
Le président chilien Gabriel Boric a condamné les actions militaires américaines et appelé à rechercher une issue pacifique. Le gouvernement de Claudia Sheinbaum au Mexique a condamné l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela, en soulignant « qu’avec les États-Unis, il y a coordination, pas subordination ». Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a affirmé que la capture de Maduro « franchit une ligne inacceptable », établissant un « précédent extrêmement dangereux », rappelant les pires moments d’ingérence dans la politique latino-américaine.
Le président du Guatemala, Bernardo Arévalo, a appelé à mettre fin à l’action militaire contre le Venezuela et à respecter les principes des Nations unies. Le président uruguayen Yamandú Orsi a rejeté l’intervention militaire au Venezuela, tandis que la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a condamné « l’agression militaire » comme une atteinte à la souveraineté des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes.
Quel sera le prochain pays à être agressé au nom du slogan « Rendre sa grandeur à l’Amérique » (Make America Great Again) ? Oui, l’incertitude règne. La stratégie de sécurité nationale en Amérique latine, l’adaptation régionale de l’America First et le corollaire trumpiste de la doctrine Monroe apparaissent parfaitement cohérents avec l’enlèvement du président Nicolás Maduro et les menaces visant d’autres pays.
La menace est réelle. Pour l’instant, rien ne vient contredire la perception selon laquelle, si le premier pays à subir l’agression américaine a été le Venezuela, les faucons qui hantent les couloirs de la Maison-Blanche, ainsi que les menaces persistantes de Trump et de Marco Rubio, laissent présager que les prochaines cibles pourraient être la Colombie, Cuba et d’autres pays qui déplaisent à l’administration Trump.
Certains évoquent une possible modération de ce spasme impérialiste du XXIᵉ siècle dans l’hypothèse incertaine de divisions au sein de la base sociale MAGA de Trump. Cependant, comme lors d’autres conjonctures historiques, la solidarité internationale, la mobilisation des peuples et la volonté des gouvernements seront essentielles pour faire face à la menace impériale, en agissant comme une région qui revendique l’Amérique latine et les Caraïbes comme Zone de Paix. L’heure est grave, et elle nous concerne tous : plus tard, il pourrait être trop tard, pour paraphraser Bertolt Brecht.

L’évolution des conflits de classe au Québec
Le collectif Temps Libre est un groupe de réflexion marxiste en activité à Montréal depuis 2017. Ses membres ont pour objectif de fournir à la fois des travaux de recherche et des propositions analytiques. Le dernier numéro de sa revue éponyme est paru à l’automne 2025 et s’intitule Portrait d’une société de classes : le Québec. Il se compose de quatre textes substantiels qui abordent successivement la recomposition néolibérale de l’économie, les classes sociales au Québec aujourd’hui, l’enjeu du colonialisme et, enfin, un panorama des luttes de classes au Québec dans les années 1970 et 1980.
C’est ce dernier texte, intitulé L’évolution des conflits de classe, que nous republions ci-dessous. Nous pensons qu’il présente avec justesse les luttes ouvrières des années 1970, le rôle central des organisations révolutionnaires à cette époque et les éléments structurels qui expliquent le ressac de la gauche dans les années 1980. Le texte se conclut sur l’hypothèse que les luttes concernant les conditions de vie des classes populaires risquent de dominer le XXIe siècle, tout en interrogeant le rôle que les révolutionnaires peuvent y jouer. Cette question demeure brûlante et nous espérons que de prochaines contributions tenteront d’y répondre à leur tour.
Photo en couverture : Manifestation pour la libération de Charles Gagnon. (BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Antoine Desilets, Grèves et manifestations, 1960-1980).

/ / /
On peut interpréter le cycle néolibéral comme une réponse à la crise structurelle des années 1970. Dans la mesure où cette réponse a sérieusement transformé la structure de classes de la société québécoise, il était en quelque sorte inévitable que le portrait brossé s’éloigne des derniers grands travaux marxistes entrepris sur les classes sociales au Québec. Or, le cycle d’accumulation introduit par la restructuration néolibérale a aussi pour corollaire le passage à un nouveau cycle de luttes. Au cours de cette restructuration, non seulement la division en classes de la société en sort bouleversée, mais il en va de même de la conflictualité entre les classes. Parler de la lutte des classes comme étant structurée par des cycles de luttes, c’est prendre acte du fait qu’elle s’inscrit nécessairement dans une configuration historiquement déterminée du mode de production capitaliste, laquelle définit ses possibilités et ses limites. Les outils pratiques permettant de résister à l’exploitation, les identités politiques mobilisées pour mener les luttes et, inversement, les moyens utilisés pour encadrer et réprimer celles-ci sont largement tributaires de ces configurations changeantes.
En ce qui concerne les pratiques de luttes, un véritable fossé sépare les modalités actuelles des conflits de classe et la situation précédant la restructuration néolibérale. Au tournant des années 1970, ce sont non seulement les comités populaires, les groupes révolutionnaires et féministes, mais également les organisations syndicales qui apparaissent comme les acteurs d’une dynamique de lutte en rupture avec le cadre revendicatif dans lequel la plupart des conflits étaient menés. Les revues ouvertement anticapitalistes, marxistes, anti-impérialistes et féministes révolutionnaires telles que Parti pris (1963-1968), Révolution Québécoise (1964-1965), Socialisme (1964-1974), Québécoises Debouttes ! (1971-1975), Les Têtes de pioche (1976-1979), Mobilisation (1972-1975), En Lutte ! (1972-1982) et Les Cahiers du socialisme (1978-1985) pullulent et marquent profondément le paysage politique québécois. Les thèses et analyses qui y sont défendues sont largement discutées, tandis que les appels à fonder un parti ouvrier révolutionnaire vont sans cesse croissant. Certains groupes influencés par les luttes de libération nationale sont alors convaincus que la lutte révolutionnaire armée est une tâche immédiate. C’est le cas du Front de libération du Québec (1963-1972) qui, après plusieurs années de sabotage et de cambriolage, enlève l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross et le ministre provincial du Travail Pierre Laporte, conduisant ainsi à la crise d’Octobre 1970. Deux ans plus tard, la mobilisation du Front commun de 1972 se transforme, à l’initiative de la base, en grève générale et s’étend à l’ensemble de la province. Aujourd’hui apparaissent bien loin les jours d’octobre 1970 où Michel Chartrand, président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CSN), pouvait discourir devant une foule de plusieurs milliers de personnes scandant leur appui au FLQ au moment même où le ministre du Travail était détenu en otage[1]. Comment cette conflictualité a-t-elle pu fléchir au point de faire paraître pour un révolutionnaire exalté quiconque formulerait aujourd’hui un lieu commun du syndicalisme de combat des années 1970 ?
Pour répondre à cette question, nous ne comptons pas présenter une histoire compréhensive des luttes passées, histoire à travers laquelle nous chercherions à identifier les bons coups, les erreurs et les trahisons des un·es et des autres. On pourrait par ailleurs s’étonner que notre focale ne soit pas toujours orientée vers les groupes et les courants ayant formulé les critiques les plus profondes ou ayant déployé les pratiques les plus radicales. Notre objectif n’est pas de trouver des modèles au sein des luttes passées ou encore de se découvrir une proximité idéologique avec des groupes dont on pourrait aujourd’hui calquer les activités. Il s’agit au contraire d’illustrer comment la base sur laquelle les luttes étaient menées a profondément changé, nous contraignant à repenser l’efficacité, la portée et l’actualité de certains moyens de lutte. C’est uniquement à partir de là qu’il sera possible d’envisager de façon lucide les développements potentiels des futurs conflits de classe. Pour ce faire, il est utile de commencer par l’étude de l’évolution des effectifs syndicaux, lesquels constituent un bon indicateur de la variation des formes de la conflictualité entre les classes.
1. L’évolution des effectifs syndicaux
On ne peut s’intéresser à cette question sans soulever le fait que le taux de syndicalisation est demeuré, au Québec, significativement plus élevé que dans le reste du Canada et qu’aux États-Unis[2]. On trouve ici un élément supplémentaire qui atteste de la singularité de la formation sociale québécoise et de ses dynamiques particulières. De 1935 à 1992, les effectifs syndicaux augmentent avec une impressionnante constance, de sorte qu’ils passent de 65 100 à 970 900. Si, en termes absolus, ces effectifs connaissent une forte croissance, le taux de syndicalisation oscille légèrement entre 27 et 30 % de 1946 à 1964. Les effectifs syndicaux suivent alors grosso modo les tendances démographiques de la population québécoise. À partir de 1964, le taux de syndicalisation repart à la hausse, jusqu’à atteindre 42,8 % en 1992[3]. Malgré quelques fluctuations depuis, le taux de présence syndicale se situait toujours à 38,9 % en 2023[4]. Si la persistance d’un taux de syndicalisation élevé est déjà un indice de la puissance des organisations syndicales, celui-ci ne nous indique pas pour autant qui est représenté par celles-ci. Or, la forte syndicalisation qui s’amorce à partir de la moitié des années 1960 – le taux de syndicalisation augmente de 7 points de pourcentage en 6 ans – est notamment déterminée par l’adoption du Code du travail du Québec en 1964 qui étend le droit de grève aux syndicats accrédités du secteur public[5]. Au début des années 1960, les réformes du gouvernement Lesage en santé et en éducation font exploser le nombre de salarié·es de l’État à qui on ne reconnaît pas encore le droit de grève et qui, par le fait même, doivent se soumettre à un arbitrage obligatoire. Le droit de grève dans le secteur public se place alors au cœur des revendications syndicales et des travailleur·ses recourent à la grève illégale pour mettre de l’avant leurs intérêts. C’est notamment le cas des infirmières de Sainte-Justine qui, au terme d’un débrayage illégal d’un mois à l’automne 1963, arrachent des augmentations salariales, un droit de regard sur la planification et la qualité des soins ainsi que la reconnaissance de leur ancienneté[6]. La pression pousse alors le gouvernement du Québec à étendre le droit de grève à ses employé·es, ce qui entraîne une forte syndicalisation et participe à une tendance significative dans la composition des effectifs syndicaux du Québec, à savoir une augmentation constante de la part des syndiqué·es issu·es du secteur public.
En 2023, le taux de présence syndicale s’élevait à 84,7 % dans le secteur public alors qu’il n’était que de 23 % dans le secteur privé. Pour la même année, il n’était que de 19,8 % pour les industries primaires, de 16,5 % pour le commerce et de 8,7 % pour l’hébergement et les services de restauration[7]. Notons également qu’au sein du secteur privé, ce sont les activités traditionnelles de la classe ouvrière qui connaissent les plus hauts taux de présence syndicale, à savoir 31,3 % pour la fabrication, 43,9 % pour le transport et l’entreposage et 56,9 % pour la construction[8]. À cela s’ajoute une professionnalisation des effectifs syndicaux qui s’observe par un plus haut taux de présence syndicale pour les employé·es ayant un diplôme d’études postsecondaires (41,9 %) que pour les employé·es qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (26,3 %) ou qui possèdent uniquement celui-ci (34,3 %)[9]. Ces données nous conduisent au constat du caractère de plus en plus interclassiste des organisations syndicales, en ce qu’elles représentent de plus en plus indistinctement les membres du prolétariat, de la classe moyenne subordonnée et de la classe moyenne subordonnante.
Si les syndicats ne peuvent plus être assimilés à des organisations de luttes proprement prolétariennes, alors la question se pose de savoir quel est le rapport qu’ils entretiennent aux différentes classes sociales. À ce titre, force est de constater que l’importance prise par la négociation centralisée des conventions collectives entre l’État et ses employé·es a déplacé le centre de gravité du discours et de l’action des grandes centrales syndicales. En effet, ces négociations ne portent pas sur la résistance à l’exploitation spécifiquement capitaliste, dont l’enjeu central demeure les modalités de l’appropriation de la plus-value. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelle mesure l’État et, par le fait même, les « contribuables » du Québec devraient débourser pour s’offrir des services publics de qualité et pour assurer des conditions de travail décentes à ceux et celles qui les fournissent. Cette situation n’est pas tout à fait nouvelle : l’histoire des luttes sociales des cinquante dernières années au Québec est notamment marquée par la formation de grands fronts communs intersyndicaux mobilisant des centaines de milliers de travailleur·ses des secteurs public et parapublic. En ce sens, l’interclassisme et la combativité syndicale du secteur public ne sont pas spécifiques au nouveau cycle de lutte. Ce qui est véritablement nouveau, c’est l’incapacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme actrices d’une potentielle transformation sociale radicale conforme aux intérêts des classes subordonnées. Pour mieux illustrer ce basculement, nous contrasterons les Fronts communs de 1972 et de 1982-1983. Nous verrons que ce n’est pas tant par l’ampleur des effectifs mobilisés qu’ils se distinguent, mais plutôt par le degré de combativité et de confiance qu’avaient ses participant·es de le voir déboucher sur une transformation sociale profonde.
2. De la fonction publique à la grève sociale : le Front commun de 1972
La décennie 1970 est marquée par des grèves et des lock-out qui atteignent une intensité inégalée dans l’histoire du Québec[10]. Dans ce contexte, le Front commun intersyndical de 1972 représente en quelque sorte le paroxysme du cycle de luttes précédent, le point où la conflictualité institutionnalisée propre au « compromis fordiste » atteint ses limites. Ce premier Front commun constitué par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) réunit plus de 200 000 employé·es des secteurs public et parapublic. Les premières négociations avec le gouvernement du Québec commencent au printemps 1971 alors qu’est toujours en vigueur la Loi sur les mesures temporaires d’ordre public qui prolonge certaines dispositions de la Loi sur les mesures de guerre mises en place lors de la crise d’Octobre[11]. En ce sens, les souvenirs des dizaines de milliers de perquisitions arbitraires et des centaines d’emprisonnements sans mandat sont encore très vifs lorsque débutent les négociations. Dans ce contexte, le discours ambiant se radicalise. Chacune des trois grandes centrales publie un manifeste qui n’hésite pas à dépeindre le capital en ennemi. Dans Ne comptons que sur nos propres moyens (1971), la CSN critique l’impérialisme américain et met de l’avant la nécessité d’une planification socialiste. La FTQ publie L’État, rouage de notre exploitation (1971) qui affirme sans détour que « la cause véritable des problèmes aigus qui écrasent chaque jour davantage les travailleurs, c’est le système capitaliste monopoliste organisé en fonction du profit de ceux qui contrôlent l’économie, jamais en fonction de la satisfaction des besoins de la classe ouvrière qui regroupe l’immense majorité de la population[12]». Quant à elle, la CEQ dénonce l’utilisation de l’école comme outil de reproduction des classes sociales dans L’école au service de la classe dominante (1972). Malgré les différences idéologiques qui distinguent les trois manifestes, ils expriment tous la volonté d’inscrire le mouvement syndical dans un projet de transformation sociale radical qui passe par la montée en puissance des organisations des travailleurs et des travailleuses[13].
Les trois grandes centrales syndicales se rendent alors à la table de négociation avec les revendications suivantes : une hausse du salaire minimum hebdomadaire à 100 $, un salaire égal pour un travail égal indépendamment du sexe et de la région, des augmentations salariales d’au moins 8 %, une sécurité d’emploi complète et une égalisation, par la hausse, des avantages sociaux[14]. La stratégie du Front commun consiste notamment à faire valoir que ses objectifs sont légitimes pour l’ensemble de la force de travail, qu’elle soit employée par un État au service du capital ou par la classe capitaliste elle-même. Les gains obtenus par les employé·es du secteur public pourraient donc servir de levier pour les revendications des travailleur·ses du secteur privé. C’est toutefois avec l’hésitation et la retenue qui caractériseront la direction du Front commun durant tout le conflit que le lien entre l’État québécois et la classe capitaliste est critiqué[15]. Cela n’empêche pas le Conseil du Patronat du Québec, dans un rapport publié après les négociations, d’établir lui-même le lien entre ses intérêts et celui du Gouvernement provincial :
« La rémunération offerte par le Gouvernement, en plus des effets d’entraînement qu’elle aura sur toute la structure des salaires et que l’on a eu tort de mésestimer à moyen et à long terme, rendra plus attrayant encore l’emploi dans le secteur public, créant ainsi à toutes fins pratiques une concurrence déloyale à l’endroit du secteur privé. Un deuxième effet sera l’obligation pour le secteur privé d’accroître ses salaires[16].»
Les négociations entre les centrales syndicales traduisent déjà la dynamique interclassiste du Front commun. La revendication phare du salaire minimum de 100 $ par semaine met de l’avant les intérêts de ses membres les plus mal payés et vise ainsi à créer une base suffisamment large pour coaliser les couches les plus pauvres des classes subordonnées. Dans le même sens, la proposition initiale de la CSN inclut une modification des échelles salariales visant à réduire les écarts entre les hauts et les bas salaires. Notons que cette proposition aurait précisément eu pour effet de réduire les avantages socio-économiques d’une classe moyenne subordonnante alors en plein développement au Québec. Or, dans les négociations entre les centrales, cette proposition est refusée par la CEQ, dont une bonne partie des membres – notamment les enseignant·es du secondaire – tirent avantage des écarts salariaux importants. La valorisation des diplômes est priorisée par la CEQ, et ce, contre une politique salariale s’attaquant de façon somme toute timide aux écarts de rémunération[17].
Disons maintenant quelques mots sur le déroulement de la lutte elle-même. Après une première journée de grève le 28 mars, la grève générale illimitée est déclenchée le 11 avril 1972. Face à celle-ci, le gouvernement Bourassa recourt alors à une série d’injonctions contraignant les employé·es d’Hydro-Québec et des hôpitaux à maintenir le travail. Ces injonctions ne sont pas respectées, ce qui conduit à l’arrestation de plus de 70 personnes parmi la direction syndicale. Les sanctions se veulent alors exemplaires et plusieurs peines d’emprisonnement sont prononcées. La stratégie gouvernementale est de contraindre les employé·es du secteur public à rentrer au travail en ayant recours aux tribunaux et à des dispositions législatives coercitives. Cette tentative culmine avec le dépôt du projet de loi 19 qui suspend le droit de grève pour les employé·es du secteur public. La loi prévoit également que le gouvernement fixera par décret les conditions de travail si les parties ne parviennent pas à s’entendre avant le 1er juin. Face à cette menace, la direction du Front commun consulte ses membres en urgence. La participation à la consultation est assez faible, mais plus de 60 % des participant·es votent en faveur de la désobéissance civile[18]. Contre ce vote et après hésitation, les dirigeants du Front commun appellent au retour au travail. Cette décision est vécue comme une trahison et la rancœur est exprimée dès le lendemain au sein du Conseil central de Montréal de la CSN[19]. Nonobstant quelques initiatives éparses, le retour au travail est généralisé.
Bien qu’ils aient appelé à respecter la suspension du droit de grève prononcée par la loi 19, les chefs syndicaux Marcel Pépin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ) sont arrêtés pour le non-respect des injonctions dans les hôpitaux et condamnés, le 8 mai, à la peine maximale d’un an d’emprisonnement. Ces condamnations marquent un tournant dans le Front commun qui déborde alors le cadre de la négociation syndicale pour devenir une véritable grève sociale. À partir de ce point, le prolétariat entre lui aussi dans la danse. Les ouvriers des ports et du Conseil des Métiers de la Construction de la FTQ initient un mouvement de grèves spontanées et illégales qui se propagent dans l’ensemble de la province. La grève dépasse maintenant largement les frontières du secteur public et la province est paralysée par plus de 300 000 grévistes qui exigent la libération des dirigeants syndicaux et l’abrogation de la loi 19. Dans des villes comme Montréal, Joliette, Thetford Mines et Saint-Jérôme, des usines sont occupées et dans plusieurs régions de la province, les radios passent momentanément sous le contrôle des grévistes. À Sept-Îles, de violents affrontements éclatent avec les forces policières, les commerces non essentiels sont fermés, la radio locale est occupée et la ville est proclamée sous le contrôle des travailleur·ses[20]. Néanmoins, l’occupation est de courte durée et sa fin est précipitée par une attaque à la voiture-bélier commise par un organisateur local du Parti libéral. Celle-ci fait des dizaines de blessé·es et tue le jeune travailleur Herman Saint-Gelais.
Face au développement incontrôlé de ce mouvement de grève, Robert Bourassa congédie le ministre de la Fonction publique Jean-Paul L’Allier et le remplace par Jean Cournoyer, quant à lui mandaté de reprendre les négociations avec le Front commun. Le 17 mai, les trois dirigeants syndicaux acceptent son offre et appellent – encore une fois – à reprendre le travail. Ils sont libérés provisoirement une semaine plus tard dans la foulée de l’appel de leur jugement, ce qui relance les négociations[21]. Le rapport de force instauré par la grève se manifeste à la table de négociation où le gouvernement accorde l’augmentation, étalée sur quatre ans, du salaire minimum à 100 $. Le Front commun parvient également à obtenir des augmentations salariales de 5 à 6 % ainsi que l’indexation partielle des salaires et des retraites sur l’inflation[22].
Au-delà des gains économiques, la grève générale de mai 1972 représente le point culminant d’une confrontation qui déborde du cadre syndical pour poser pratiquement, quoique très brièvement, la question du pouvoir ouvrier. Le fait que les dirigeants syndicaux aient dû appeler eux-mêmes deux fois à la reprise du travail montre bien que les limites d’une confrontation institutionnalisée ont effectivement été dépassées. Nous pouvons aussi parler de point culminant puisque la répression du Front commun et les divisions qu’il a fait naître ont empêché que cette dynamique conduise à une intensification de la lutte. Le lendemain de grève est particulièrement douloureux à la CSN, dont les syndicats d’hôpitaux cumulent des amendes d’environ 500 000 $[23]. Plus encore, la CSN subit une scission menée par Paul-Émile Dalpé, Jacques Dion et Amédée Daigle, trois membres du comité exécutif jugeant la ligne politique de Marcel Pépin trop radicale. Ils fondent alors la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui rassemble à ses débuts environ 30 000 membres, dont ceux des fédérations du textile et du vêtement qui passent en bloc de la CSN à la CSD[24]. La CSN perd alors une part importante de ses effectifs prolétariens issus du mouvement ouvrier traditionnel et se transforme graduellement en une centrale dominée par les salarié·es des secteurs public et parapublic. Dix ans plus tard, le mouvement syndical tentera de résister à une nouvelle confrontation entourant la négociation des conventions collectives. Mais ce n’est plus un gouvernement ouvertement et franchement bourgeois qui, cette fois, conduira les négociations du côté patronal : c’est face au gouvernement du Parti québécois de René Lévesque – parti ayant jusque-là entretenu le mythe d’un « préjugé favorable aux travailleurs » – que se trouveront les directions syndicales.
3. De la loi matraque au repli défensif : le Front commun de 1982-1983
Le Front commun de 1982-1983 survient dans un contexte radicalement différent. La crise économique et le chômage de masse créent des conditions de négociation largement défavorables aux employé·es de l’État. Au gouvernement, le Parti québécois en est à son deuxième mandat, lequel suit l’échec référendaire de 1980. Si ce mandat dissipera les doutes qui pouvaient subsister sur la nature de classe du PQ, celle-ci demeure l’objet de vifs débats durant la décennie 1970. L’exemple le plus frappant est probablement les trajectoires opposées suivies par Charles Gagnon et Pierre Vallières, deux anciens membres du FLQ. Alors que le premier rompt avec le nationalisme pour fonder En Lutte ! en 1972, le second publie L’Urgence de choisir où il récuse la violence révolutionnaire et la lutte immédiate pour le socialisme, tout en appelant à rejoindre les rangs du PQ. Les débats concernant le rapport à entretenir avec le PQ touchent également les centrales syndicales. Alors que la CSN apportera un appui « critique » au camp du « oui » pour le référendum de 1980, la FTQ, traditionnellement plus centriste, ira jusqu’à appeler à voter pour le PQ lors des élections de 1976 et de 1981[25]. Avant son deuxième mandat, le PQ pouvait encore se targuer d’avoir adopté certaines législations comme la loi 45 (adoption de la formule Rand) et la loi 17, qui répondent directement à certaines revendications syndicales, telles que l’interdiction d’embaucher des scabs ou encore l’adoption de mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail[26].
C’est donc face à un gouvernement réputé favorable aux revendications syndicales que s’amorcent, en 1982, les négociations avec un Front commun réunissant plus de 300 000 membres. Tel que mentionné, l’un des éléments centraux de la stratégie du Front commun de 1972 était d’arracher des gains pour les employé·es de l’État afin que ceux-ci puissent ensuite servir de levier pour les luttes du secteur privé[27]. Cette stratégie ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Pire, la partie patronale réussit le tour de force de se servir de l’écart salarial qui se creuse entre le secteur public et le secteur privé comme d’un prétexte pour justifier l’assainissement des finances publiques par des baisses salariales des employé·es de l’État. Cet argument devient central dans les décrets de 1982-1983 qui surviennent au moment où la récession économique du début des années 1980 fait bondir le taux de chômage, entraîne des pertes d’emplois massives dans le secteur manufacturier et aggrave l’endettement de l’État. Ce contexte rend difficile l’adoption d’une stratégie offensive pour un mouvement syndical déjà éreinté par les affrontements des années 1970.
Le gouvernement de René Lévesque décide alors de récupérer une part des augmentations salariales octroyées par la convention de 1979 en imposant aux employé·es de l’État une baisse salariale allant jusqu’à 20 % pour les trois premiers mois de 1983. Ces baisses salariales, confirmées par l’adoption sous bâillon de la loi 70, freinent la négociation et le Front commun tient une journée de grève illégale le 10 novembre 1982 afin d’obtenir son abrogation. Le gouvernement Lévesque décide alors d’enjamber la négociation en fixant par décret les conditions de travail de tous les employé·es de l’État et en révoquant au passage le droit de grève pour les trois années de la nouvelle convention collective[28]. Face à cette escalade, le Front commun voit la grève générale illimitée comme sa dernière arme et adopte une stratégie de grève « en cascade » qui intégrera progressivement différentes franges des secteurs public et parapublic à partir du 26 janvier 1983[29]. Devant une mobilisation timide, le gouvernement décide d’aller encore plus loin : le 17 février, le projet de loi 111 est adopté à l’Assemblée nationale. Cette « loi matraque » prévoit des mesures répressives sans précédent, dont l’augmentation des amendes quotidiennes, la perte de trois années d’ancienneté pour chaque jour de grève et la possibilité d’effectuer des congédiements sommaires. Le lundi 21 février, le retour au travail est généralisé et les négociations subséquentes n’apportent que des modifications mineures aux décrets gouvernementaux[30].
La répression du Front commun de 1982-1983 et plus particulièrement les dispositifs de la loi 111 représentent un tournant dans la conflictualité entre les classes sociales au Québec. En plus de pénaliser les élu·es des syndicats et les associations syndicales elles-mêmes, cette loi s’attaque aux syndiqué·es pris·es individuellement afin de les amener à se désolidariser de leurs organisations. Cette stratégie est énoncée explicitement par le ministre du Revenu Alain Marcoux qui défend « des sanctions touchant les individus plutôt que les syndicats, qui n’attendent que le contraire pour pouvoir se porter à la défense du syndicalisme » tout en affirmant que « la seule façon d’obtenir le retour au travail sera de mettre chaque individu devant une décision personnelle[31] ». L’arrestation « exemplaire » des dirigeants syndicaux en 1972 avait provoqué une intensification du conflit qu’on tente désormais d’empêcher par une logique de répression individuelle. Le gouvernement ouvre ici la voie pour une classe capitaliste qui tend à sortir d’une logique de confrontation institutionnalisée avec les organisations syndicales pour privilégier une négociation des conditions de travail de plus en plus individualisée.
Si le Front commun de 1972 représente le paroxysme du cycle de lutte précédent, on peut considérer que celui de 1982-1983 le clôture définitivement. Ce qui s’évanouit à ce moment, ce n’est pas tant la capacité des syndicats à organiser des salarié·es et à les mobiliser. Comme l’illustre l’exemple du Front commun de 2023, les mobilisations syndicales parviennent encore à arracher des gains au niveau des conditions de travail. Ce qui s’est radicalement transformé depuis, c’est avant tout la capacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme porteuses d’un projet de rupture. La création du Fonds de solidarité FTQ en 1983 en est peut-être la meilleure illustration. Au plus loin de s’inscrire dans une perspective subversive, la FTQ décide alors, avec l’appui du gouvernement provincial de René Lévesque et, ensuite, du gouvernement fédéral de Brian Mulroney, de créer un fonds d’investissement qui permettra de financer des entreprises afin de préserver ou de créer des emplois[32]. La dynamique qui s’ouvre à partir des années 1980 est ainsi axée sur un « partenariat », une « concertation » non contraignante où les organisations syndicales tentent de préserver les emplois des secteurs menacés par la restructuration et de minimiser la dégradation des conditions de travail[33]. Ce repli défensif est formulé explicitement par le comité exécutif de la CSN qui affirme, lors de son congrès de 1990, que « la résistance aux attaques et le maintien de nos acquis doivent être considérés comme des victoires[34] ».
Ce changement de paradigme s’exprime aussi statistiquement lorsqu’on s’intéresse à la moyenne annuelle des jours-personnes non travaillés. Alors qu’elle s’élève à 2 719 000 pour la décennie 1970, elle baisse à 1 878 000 pour la décennie 1980 et à 561 000 pour la décennie 1990. Durant la décennie suivante, elle remonte légèrement à 610 000[35]. Durant cette période, les conflits de travail tendent également à toucher de moins en moins de travailleur·ses par conflit et ils durent en moyenne plus longtemps, ce qui exprime une tendance à l’isolement et une difficulté à arracher des gains rapides[36].
Ce n’est pas qu’au niveau syndical qu’on peut mesurer le changement du rapport de force. Comme nous l’avons mentionné, les années 1960-1970 voient apparaître une véritable base favorisant l’activité subversive avec les comités d’action politique, les journaux et les groupes révolutionnaires, les librairies socialistes et les organisations féministes radicales. À partir de la seconde moitié des années 1970, ce sont principalement les groupes marxistes-léninistes qui parviennent à concentrer et à faire croître ce qu’on peut appeler les « forces révolutionnaires ». Le groupe marxiste-léniniste En Lutte ! s’exporte alors dans le reste du Canada, ses membres triplent et son journal hebdomadaire atteint un tirage moyen de 7 000 exemplaires[37]. En 1979, le groupe se constitue en organisation « préparti », considère que le moment est venu de rallier la classe ouvrière et d’unifier les marxistes-léninistes du monde entier. Seulement trois ans plus tard, l’organisation se dissout[38]. Le Parti communiste ouvrier (PCO, ex-Ligue communiste) connaît le même sort au début de l’année 1983. En seulement quelques années, des organisations qui diagnostiquaient l’imminence de la révolution et qui aspiraient à diriger celle-ci en sont venues à la conclusion qu’il était temps de mettre la clé sous la porte.
4. Quant à la suite…
Mesurer l’ampleur des changements structurels qui ont eu cours lors des dernières décennies nous pousse maintenant à tirer un certain nombre de conclusions sur les formes que risquent de prendre d’éventuels conflits de classe au Québec. Au nombre de ces conclusions, on peut confirmer que le prolétariat a en grande partie perdu le principal levier dont il disposait afin d’améliorer ses conditions d’existence et, plus particulièrement, afin d’améliorer ses conditions de travail. Bien qu’elles soient interclassistes depuis très longtemps, les centrales syndicales se distinguent désormais par la prépondérance des professionnel·les du secteur public, c’est-à-dire par celle des membres de la classe moyenne subordonnante. Dans ce contexte, la défense des avantages associés à certains emplois de la CMS tend à occuper une place de plus en plus centrale dans le discours et l’activité des centrales syndicales. On tente alors de faire reconnaître la valeur particulière de certaines professions, leur importance décisive pour les services publics québécois ou encore le décalage entre la rémunération de certaines professions traditionnellement féminines du secteur public et des professions analogues traditionnellement masculines du secteur privé. S’ils font voir, à juste titre, les effets des rapports sociaux de sexe sur la distribution des avantages sociaux, ces lignes d’argumentation reconduisent néanmoins l’idée qu’il est normal, bon et acceptable qu’il existe des écarts salariaux importants, des rapports hiérarchiques dans l’organisation du travail ou encore des privilèges réservés à certaines fonctions. On pourra encore lancer des appels sincères à la solidarité et à l’organisation de mobilisations interclassistes, mais il apparaît toujours naturel, au final, que certain·es s’en tirent mieux que d’autres.
Le Front commun de 2023 est un exemple illustratif de cette tendance, dans la mesure où ce sont d’abord les enseignant·es des niveaux préscolaire, primaire et secondaire qui ont réussi à capter l’attention médiatique et à se présenter comme un rempart contre « la détérioration du système public d’éducation québécois[39] ». La combativité dont ont fait preuve les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), en grève générale illimitée pendant plus d’un mois au courant de l’automne 2023 (et ce, sans fonds de grève), explique en grande partie l’importance qu’a prise la situation particulière de ces enseignant·es dans la négociation des conventions collectives. Ce qui est néanmoins digne de mention, c’est l’aisance avec laquelle leur propre discours, dans lequel la qualité du système d’éducation est directement identifié à l’obtention de bonnes conditions de travail pour eux et elles-mêmes, est parvenu à s’imposer. Ce lien n’est évidemment pas dépourvu de fondement. Toutefois, ce qui peut surprendre, c’est à quel point les enjeux liés à la préservation et aux fins du système d’éducation public ont été aussi rapidement écartés et réduits à une question de salaire : les revendications relatives à la composition des classes et à la lourdeur de la tâche ont été négligées et une bonification de l’échelle salariale s’ajoutant aux augmentations octroyées à l’ensemble des membres du Front commun a finalement été suffisante pour amener les enseignant·es à cesser ce qu’on a présenté comme une lutte pour la « survie du système public »[40]. Certes, à travers l’appui que les grévistes ont reçu de la population, il est clair que cette dernière sent que la qualité du système d’éducation public est plus ou moins étroitement liée aux conditions de travail des enseignant·es. Néanmoins, si ces conflits continuent de se régler presque exclusivement par des augmentations salariales, on peut présumer qu’un tel appui s’amenuisera et que les membres de la CMS des secteurs publics et parapublics auront de plus en plus de difficulté à se présenter comme les champions du « bien commun ».
En réalité, le fait que les effectifs syndicaux appartiennent à des classes diverses réduit la base commune sur laquelle de puissantes luttes syndicales peuvent être menées. Plutôt que de former un bloc relativement homogène capable de faire front contre un ennemi commun, les centrales syndicales sont, une fois les conflits parvenus à un certain degré de développement, placées devant la nécessité de favoriser l’un ou l’autre des groupes relativement antagonistes qu’elles représentent. Cela ne se manifeste pas nécessairement lorsque les revendications restent sur des positions défensives ou lorsqu’elles réclament des gains modestes. Toutefois, dès que les revendications de syndiqué·es issu·es des classes subordonnées en viendront à remettre en question la grandeur des écarts de salaire, la hiérarchie du travail ou encore les privilèges associés au travail intellectuel, elles ne manqueront pas d’entrer en conflit avec les intérêts d’une part importante des effectifs syndicaux. Si pour compenser la désaffection des membres des classes subordonnées, les centrales syndicales n’ont pas le choix de représenter les membres de la CMS – dont les privilèges sont le corollaire de la subordination des classes subordonnées –, elles doivent aussi se résoudre à mener une existence double et conflictuelle. À l’occasion des fronts communs, c’est précisément sur cela que peut jouer l’État afin de les faire plier.
Il faut par ailleurs voir que le poids grandissant que prennent les emplois précaires et atomisés au sein du prolétariat ne peut manquer d’affecter les formes que prennent ses luttes. Cette atomisation et cette précarité se traduisent notamment par un taux de syndicalisation plus faible, comme c’est le cas du secteur des services marchands. Les emplois qui appartiennent à ce secteur sont en effet considérés comme difficiles, voire impossibles à syndiquer[41]. Le taux de roulement élevé qui y prévaut renforce leur précarité qui, elle, affaiblit en retour la possibilité qu’ils ont d’être syndiqués, ce qui augmente encore leur taux de roulement et ainsi de suite. Mais il existe d’autres facteurs qui viennent affaiblir la capacité des prolétaires à se défendre à travers leur syndicat. Le cas des travailleur·ses temporaires étranger·ères est à cet égard particulièrement significatif. Dans certaines entreprises, ces travailleur·ses représentaient, jusqu’à la récente révision des seuils d’immigration, le cinquième des salarié·es[42]. Abstraction faite de la difficulté qui existe à s’organiser avec des collègues allophones, rappelons que les conditions dans lesquelles s’effectue le travail étranger temporaire sont tellement précaires qu’il est virtuellement impossible que ces travailleur·ses entrent dans un rapport confrontationnel avec leur employeur·e[43]. En effet, les contraintes sociales et matérielles qui accompagnent ce statut sont si fortes qu’elles affectent nécessairement de manière négative la capacité du reste des prolétaires de ces entreprises à lutter sur leur milieu de travail. Ce phénomène est notamment renforcé par le recours aux agences de placement de main-d’œuvre, pratique particulièrement répandue dans le secteur du transport et de l’entreposage. Non seulement cette main-d’œuvre est le plus souvent issue de l’immigration récente, voire de l’immigration informelle, mais sa gestion externalisée a pour effet de segmenter encore davantage les travailleur·ses au sein des milieux de travail : plutôt que de faire face, en masse, aux mêmes employeur·es, ces prolétaires d’origines diverses sont lié·es, par l’entremise de leur contrat de travail, à des employeur·es différent·es pour des taux de salaire différents[44]. La collectivisation des conflits de travail, « le passage au collectif » comme dirait Kergoat[45], est alors pratiquement bloqué.
À l’autre extrémité, la partie patronale fait manifestement preuve d’une virulence de plus en plus grande pour freiner les luttes. D’un côté, la Loi sur les services essentiels empêche, au Québec, toute forme de débrayage significatif des travailleur·ses du secteur public, même si pour l’heure, aucune mesure aussi systématique et « efficace » n’existe dans le secteur privé (bien que les associations patronales en fassent périodiquement la demande[46]). À toutes fins pratiques, les salarié·es concerné·es par cette loi n’ont pas le droit de grève. Du côté du secteur privé toutefois, les gouvernements sont de plus en plus enclins à voter des lois spéciales qui forcent le retour au travail en imposant une convention collective aux deux parties en litige. Dans le secteur de la construction, ces lois spéciales sont devenues rituelles et tendent à faire de même dans celui du transport et de la logistique. Ce qui se joue là est particulièrement significatif, en ce sens que l’outil de la grève apparaît avoir perdu son sens. À quoi bon perdre plusieurs jours de salaire à débrayer si l’on sait qu’à terme, une loi spéciale forcera le retour au travail et fixera ses conditions ? Lorsque le cadre légal au sein duquel les luttes peuvent être menées est aussi restreint, on peut douter de l’efficacité des organisations qui renoncent à outrepasser ce cadre.
Si les changements qui affectent les modalités de la lutte des classes depuis cinq décennies ne doivent pas être assimilés à son évanouissement pur et simple, il faut reconnaître qu’ils s’inscrivent dans une modification du rapport de force qui a lieu au profit du capital. D’une part, la difficulté à s’organiser à l’intérieur d’un cadre institutionnalisé réduit la probabilité pour le prolétariat et la classe moyenne subordonnée de voir leurs luttes déboucher sur des gains substantiels. Aussi critiquables soient les syndicats, la syndicalisation d’un milieu de travail permet le recours à certaines formes de lutte revendicative dont l’efficacité n’est plus à prouver. Or, ce sont ces formes qui sont de moins en moins accessibles aux membres des classes subordonnées. D’autre part, nous avons vu que même lorsque leurs luttes sont effectivement menées dans un cadre légal, elles sont renvoyées dans l’illégalité dès l’instant où elles semblent menacer la bonne marche de l’accumulation. Autrement dit, la modification des modalités de la lutte des classes coïncide, de façon plus ou moins étroite, avec l’incapacité grandissante des classes subordonnées à faire valoir leurs intérêts.
Pour toutes ces raisons, on peut d’autant moins s’attendre à ce que les centrales syndicales fonctionnent comme le catalyseur d’un projet de transformation sociale radicale qui prendrait en charge les intérêts spécifiques des classes subordonnées et, à plus forte raison, du prolétariat. Une telle affirmation peut avoir l’air d’une banalité. Néanmoins, il faut insister sur le fait que cette situation n’est pas imputable à un simple problème de discours, à un esprit de défaite endémique depuis les années 1980 ou encore à une perpétuelle trahison de la part d’une direction syndicale qui refoulerait sans cesse les désirs révolutionnaires de la base. Au contraire, les configurations sociales et matérielles nécessaires à la constitution d’organisations prolétariennes fortes (concentration de la force de travail prolétarienne dans de grandes unités de production et dans des quartiers socialement homogènes, prédominance de l’emploi à temps plein, existence d’une culture « ouvrière » nationale, etc.) ont été balayées avec la restructuration néolibérale. Le capital n’accepte tout simplement plus de voir en face de lui un prolétariat organisé, discipliné et prévisible. On ne se le soumet plus en l’encadrant et en adoucissant ses conditions d’existence, mais en lui cassant les reins : on ne permet plus que ses luttes débouchent sur sa confirmation en tant que classe et encore moins en tant que classe aspirant à gérer la société sur sa propre base. Le statut de classe, c’est précisément ce qu’on lui refuse. On peut certainement le déplorer, mais encore faut-il le reconnaître.
Cette situation de blocage nous force à porter une attention plus soutenue aux formes modifiées que prennent les luttes des classes subordonnées afin de résister à l’exploitation. En dépit de la résurgence relative des conflits de travail durant la dernière décennie[47], on peut s’attendre à ce que leurs luttes s’expriment de moins en moins directement sur les lieux de travail. Comme on l’a vu, non seulement les syndicats représentent très imparfaitement les classes subordonnées, mais la rigidité des contraintes à l’exercice du droit de grève et le recours aux lois spéciales ne peuvent que décourager de telles pratiques de lutte. Or, lorsqu’elles rompent avec la légalité, les confrontations directes sur les lieux de travail sont sujettes à une répression telle qu’en l’absence de mouvement social important, elles ne peuvent manquer de se limiter à des formes de résistance individuelles (vol, sabotage, absentéisme, etc.) qui sont, par le fait même, beaucoup moins efficaces.
Si les formes traditionnelles de résistance à l’exploitation semblent avoir peu d’avenir du point de vue de leur capacité à mobiliser de larges fractions du prolétariat et de la classe moyenne subordonnée, il semble tout à fait envisageable que la question des conditions de travail et de sa rémunération laisse de plus en plus la place à celle des conditions de vie[48]. Le problème du coût et de la qualité des logements, du prix des produits alimentaires, des frais associés au transport ou encore du profilage et des violences policières représentent tous des terrains où les conflits de classes peuvent s’exprimer intensément, quoiqu’indirectement. L’intensité de ces luttes peut croître rapidement puisqu’elles tendent, en recourant au pillage des magasins, au sabotage de moyens de transport et de communication ou à la prise d’assaut des lieux de pouvoir, à s’attaquer à ce que l’État d’une société capitaliste doit à tout prix protéger, à savoir : la propriété privée[49]. Et contrairement aux luttes qui naissent autour de conflits de travail, celles qui tournent autour des conditions de vie sont beaucoup moins faciles à organiser et à inscrire dans une stratégie à long terme. Elles éclatent, tout simplement.
Si la faiblesse ou la quasi-absence de structures organisationnelles déjà établies mine la capacité des protagonistes de ces luttes à se coordonner et à persévérer malgré la répression et les revers momentanés, elles sont aussi, par le fait même, beaucoup moins faciles à encadrer. Autrement dit, puisqu’il est plus difficile pour des « chefs » – pour ceux et celles qui sont à la tête d’organisations ou qui cherchent à en prendre la direction – de les canaliser dans un sens ou dans l’autre, elles apparaissent en retour plus difficile à saboter par le haut. En fait, il n’existe plus d’organisations disposant de l’autorité nécessaire pour freiner un mouvement de lutte sérieux. Ce serait idéaliser le cycle de luttes précédent que de fermer les yeux sur les dégâts que causait la mise sous tutelle du prolétariat par des « révolutionnaires professionnels » ou proclamés tels. Le principe de la représentation, celui de délégation de l’autonomie, l’idée selon laquelle un mouvement ne peut être efficace si les décisions importantes ne sont pas prises par un petit nombre de leaders, le respect de la discipline du parti, l’étapisme ou encore l’idée qu’il faille fonder un État ouvrier fort, sont tous des éléments définitoires du cycle de lutte précédent qui affectaient négativement la capacité des prolétaires à s’auto-transformer et à prendre les mesures qu’imposaient certaines situations critiques. Entendons-nous, nous ne soutenons pas que les prolétaires d’aujourd’hui sont à un poil de parvenir à une conscience communiste ou de lutter en ce sens de façon conséquente. Ce dont il s’agit, c’est de faire voir que les obstacles que nous avons énumérés ne sont plus immanents aux luttes du prolétariat. Par opposition au cycle de lutte précédent, la condition ouvrière n’est plus quelque chose qu’on cherche à éterniser, il n’y a plus de comité central auquel obéir aveuglément, plus de pseudo « patrie socialiste » au nom de laquelle les intérêts des mouvements de luttes locaux peuvent être sacrifiés. Ce qui est impliqué par là, c’est que l’idéologie du programme prolétarien ne s’interpose plus entre la conscience des prolétaires et ce qu’ils et elles doivent accomplir pour faire progresser la lutte dans un sens communiste.
Par rapport au cycle de luttes précédent, on peut donc s’attendre à ce que les luttes soient moins dépendantes de la puissance d’organisations révolutionnaires formelles. Il est évident qu’il s’agit encore ici d’une question de degré : le succès des luttes précédentes n’était pas suspendu à l’habileté de quelques chefs et, inversement, les luttes actuelles continueront d’être affectées par l’action de minorités agissantes et nécessiteront des formes d’organisation efficaces pour conduire à des transformations durables. Mais le cours des luttes présentes et à venir tendra vraisemblablement à être davantage déterminé par des facteurs structurels et conjoncturels « objectifs ». L’exemple des émeutes des Gilets jaunes en 2018-2019, des evasiones masivas dans le métro de Santiago au Chili en 2019 ou encore de la situation insurrectionnelle au Kazakhstan en 2022 illustrent bien cette tendance. Ni leur éclatement ni leur fin n’ont été dépendants de la volonté d’organisations quelconque[50]. Certes, au Québec, il n’existe pas encore de précédent nous permettant d’affirmer que cette tendance à l’éclatement soudain et violent de conflits de classes soit déjà à l’œuvre, bien que les conditions pour que de telles éruptions se produisent semblent être de plus en plus réunies.
Ces luttes qui, dans les dernières années, sont sorties d’un cadre strictement revendicatif et qui ont mobilisé des moyens d’action plus musclés ont bel et bien traduit des antagonismes de classes, mais de façon détournée. Si cette traduction est indirecte, c’est parce que les intérêts opposés qui s’affrontent le font dans un cadre extérieur au rapport qui les fait naître (le travail exploité et/ou subordonné). Dans ces luttes, prolétaires et capitalistes ne s’affrontent pas en tant que tel·les, même si c’est bien, en dernière instance, de leur rapport dont il est fondamentalement question. C’est parce que l’exploitation empêche les prolétaires et membres de la classe moyenne subordonnée de vivre convenablement qu’il y a lutte sur le terrain des conditions de vie. C’est parce que la classe capitaliste veut continuer à tirer de la plus-value du prolétariat qu’elle a intérêt à ce qu’on trouve une solution qui lui soit favorable, qu’elle a intérêt à ce que les conflits s’expriment « pacifiquement » et que les « violents casseurs infiltrés » soient traduits en justice. Or, dans une grève concernant les conditions de travail ou les salaires, on peut aisément identifier les agents qui s’affrontent et on comprend facilement que ce qui est perdu d’un côté est gagné de l’autre. Cela demeure vrai même lorsqu’il se crée un mouvement de grève massif qui s’étend et débouche sur des situations émeutières, voire insurrectionnelles : l’exploitation, le rapport de classe à classe, continue de représenter l’enjeu central. Mais dans une lutte contre la vie chère, il faut faire un effort supplémentaire pour identifier les antagonismes qui la sous-tendent et qui conditionnent son développement. Dans de pareilles luttes, c’est l’État qui est désigné comme l’interlocuteur privilégié, puisque c’est à lui qu’on impute la responsabilité de la situation à laquelle on s’attaque, ce qui, encore une fois, a pour résultat de voiler ce qui rend structurellement incompatible les intérêts des un·es et des autres.
Dans ces situations, on verra typiquement émerger des identités politiques générales comme le « 99 % », les « classes populaires », les « gens ordinaires » ou encore le bon vieux « peuple ». Ce qui est certain, c’est qu’on n’assistera pas au grand retour de la « classe ouvrière » ou du « prolétariat » en tant qu’identité politique portée massivement par des prolétaires. Certes, on trouvera toujours ici ou là des prolétaires capables de se reconnaître dans ces catégories, mais il faut admettre que le mot « prolétariat » se retrouve bien davantage dans la bouche des membres (ou aspirants membres) de la CMS friands de théorie marxiste que dans celles des travailleur·ses productif·ves subordonné·es. Cet état de fait n’est pas entièrement à déplorer. Il ne faut pas oublier que la reproduction d’une identité ouvrière à laquelle s’identifiait fièrement une partie du prolétariat était aussi un obstacle, dans le cours des luttes, à la reconnaissance du caractère imposé et contraignant de l’appartenance de classe, de même qu’à la nécessité de s’y attaquer en s’en prenant à la racine de l’exploitation capitaliste plutôt qu’à la stricte propriété des moyens de production. L’identité ouvrière, c’était aussi l’illusion selon laquelle la condition ouvrière est en elle-même porteuse d’un devenir communiste.
Après tout ce chemin parcouru, on pourrait ici poser la question suivante : ces constats ne sont-ils pas justement l’indice du fait que l’analyse en termes de classes est devenue caduque, en ce qu’elle serait en porte-à-faux avec la manière dont sont menées les luttes ? Ne devrait-on pas prendre celles-ci comme elles se donnent, avec le discours et les identités politiques qu’elles produisent ? Nous pensons que tous ces éléments conduisent précisément à la conclusion inverse. Les formes de lutte envisageables rassembleront nécessairement des membres de différentes classes, et ce, sous des étiquettes communes qui ont pour effet de rendre invisibles les rapports de force qui se jouent nécessairement au sein même des luttes. La confusion est donc inévitable. Lorsqu’on nous dit que « tout le monde est dans le même bateau », que « l’unité est nécessaire pour atteindre nos objectifs », il faut être en mesure de déterminer qui se trouve dans le bateau, qui est à ses commandes et à qui bénéficie le maintien de la lutte dans ses limites actuelles. Autrement dit, pour saisir ses potentialités, sa dynamique et ses obstacles inévitables, il faut nécessairement être en mesure de déterminer la composition de classe d’une lutte donnée. C’est ce à quoi cherche à contribuer un travail comme le nôtre. S’il est vrai que tout le monde n’a pas également intérêt à rompre avec l’organisation actuelle de la société, ceux et celles qui y ont effectivement intérêt ne peuvent que gagner à y voir plus clair.
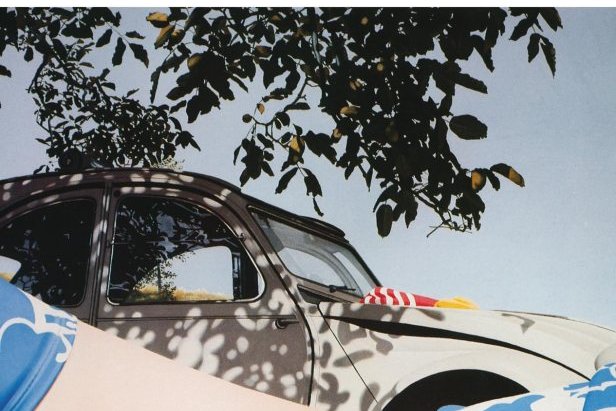
« Les années » d’Annie Ernaux et l’individualisme bourgeois
Raphaël Simard
Le récit Les années (2008) d’Annie Ernaux, écrivaine française détentrice du prix Nobel 2022 de littérature, tranche à première vue avec la littérature de témoignage, associée au récit subjectif, car selon plusieurs travaux elle laisserait tomber le point de vue individuel.[1] Pour voir ce qu’il en est de ce paradoxe, et en suivant la méthode de Lucien Goldmann, j’en passerai par les structures significatives de pensée les plus englobantes qui existent (selon Goldmann), qui sont les visions du monde. On verra en effet que contrairement aux apparences, et même si l’individu narrateur ne s’exprime jamais au « je[2] », Les années a tout à voir avec l’individualisme des Lumières et leur pensée mécaniste. Et que la structure de cette œuvre est une expression très cohérente de la bourgeoisie de l’époque où Annie Ernaux a formé le projet de celle-ci et où elle a reçu sa formation intellectuelle.
Bourgeoisie et individualisme mécaniste : les Lumières et l’après Deuxième guerre mondiale
Pour Lucien Goldmann, sociologue de la philosophie et de l’art, la pensée des Lumières est une des trois principales pensées individualistes du XVIIIe siècle.[3] Fruit d’une synthèse entre le rationalisme et l’empirisme des XVIe et XVIIe siècles[4], la pensée des Lumières conserve la base de la vision du monde individualiste : « considérer la conscience individuelle comme origine absolue de la connaissance et de l’action[5] ». Pour Goldmann, les individualismes en général sont l’expression de la pratique du marché et du projet de sa généralisation, qui sont ceux de la bourgeoisie européenne.[6] En effet, contrairement au féodalisme où des statuts de naissance assignaient à chacun une place bien précise et fixe dans l’ordre productif[7], avec le marché il n’y a plus aucune instance supra-individuelle qui échappe désormais à l’initiative de la production et des rapports entre humains :
Le processus global [de production] n’apparaît plus que comme le résultat mécanique et non concerté de l’action réciproque et juxtaposée d’une infinité d’individus autonomes qui ont un comportement aussi rationnel que possible par rapport à la sauvegarde de leurs intérêts, et règlent leur conduite d’après la connaissance qu’ils ont du marché et nullement en fonction d’autorités ou de valeurs supra-individuelles.[8]
Le marché, c’est ainsi, aux yeux des possesseurs de capitaux, une régulation provenant de l’initiative, du contrôle d’individus isolés. Gilles Bourque, sociologue québécois, précise cette thèse sur l’origine de l’individualisme en l’attribuant à la position dans laquelle se trouve la bourgeoisie dans les rapports de production capitalistes.[9] D’une part, en tant que propriétaire des moyens de production, cette classe tend à accentuer la division sociale (entre travail manuel et intellectuel) et technique (en des tâches spécifiques) du travail, dans le but de rationaliser ce dernier (le compartimenter pour mieux mesurer ses coûts et les réduire) et de réduire les coûts de production.[10] D’autre part, chaque capitaliste se trouve en concurrence avec les autres propriétaires.[11] Par conséquent, bien que la bourgeoisie détermine la forme des rapports sociaux à l’échelle de la classe, chaque capitaliste ne décide pour sa part qu’une parcelle de ceux-ci et en fonction de son propre capital.[12] Le processus d’ensemble n’est donc planifié par personne, mais bien le résultat de « la lutte des capitaux individuels », et le marché est nécessairement caractérisé par une « non-harmonisation du procès d’ensemble de la production.[13] » Les Lumières, qui écrivent à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècles, ont pour thème de base un individu guidé non plus seulement par sa raison (rationalisme) ou ses sens (empirisme) : elles intègrent ceux-ci à la recherche de son intérêt propre, ce qui signifie que dans toutes ses pensées et actions, l’individu utilise son expérience (sa connaissance du marché par exemple) et sa raison afin de maximiser ce qu’il peut obtenir.[14] D’ailleurs, les catégories fondamentales des Lumières — le contrat, « la liberté et l’égalité entre tous les hommes, l’universalité des lois, la tolérance et le droit à la propriété privée » — suivent toutes, comme le démontre longuement Goldmann, la relation dans l’échange entre deux capitalistes sur le marché.[15]

Qui plus est, l’individualisme des Lumières tend au mécanisme : le monde et l’humain lui apparaissent comme un rouage objectivable et assez stable, « statique » comme dirait Goldmann, sans « dimension historique[16] » . Selon Dominique Pagani, au fur et à mesure que se développe l’individu propre aux Lumières, celui qui suit son intérêt propre et objectif, les sciences de la nature et se développe aussi selon cette vision du monde, puis les philosophes de l’esprit intègrent peu à peu l’individu à la vision déterministe de la science ; si bien que l’individu devient paradoxalement avec les Lumières un élément du monde qui peut être analysé objectivement par diverses « sciences » de l’esprit, d’une manière semblable que la science de la nature étudie cette dernière.[17] La liberté de l’individu, selon cette vision, a une définition très limitée, selon Pagani[18], Corinne Doria[19] et Goldmann (les Lumières expliquent « la détermination de la volonté humaine par des facteurs naturels et sociaux[20] »). La liberté renvoie ainsi surtout à la non-contrainte extérieure à l’individu, à un comportement se pliant à des intérêts objectifs et universels, mais rattachés à l’essence ou nature de l’individu quand il n’est pas contraint, par conséquent des intérêts et comportements intemporels et difficilement changeables.[21] Les systèmes moraux s’en trouvent aussi ébranlés : l’ordre moral féodal faisait un avec l’ordre socio-économique (l’Église avait un rôle productif, et les statuts sociaux étaient l’ordre voulu par Dieu), mais le marché capitaliste produit un individu qui n’a pas besoin de valeurs pour se guider ; il en résulte une véritable neutralité axiologique (il ne peut démontrer logiquement aucun système moral) et une grande diversité des systèmes moraux de l’individualisme, et donc des Lumières.[22] Selon Goldmann, les Lumières ont fait plusieurs essais pour fonder la morale sur l’individu, qui posent tous une tension irrésolvable entre le bien individuel et le bien collectif dont elles doivent se revendiquer parce que leur classe émergente veut justifier son projet de marché.[23] L’absence de morale inhérente à leur vision du monde, en même temps que la nécessité pour la classe de penser un ordre moral justifiant son projet, explique le recours fréquent chez les Lumières à la religion, et encore à la nature universelle de l’individu dès lors limitée dans sa liberté ; c’est-à-dire dans les deux cas une compromission sur leur combat contre les autorités religieuses et sur leur catégorie fondamentale de liberté.[24] La vision politique des Lumières est également tributaire d’un individu éternel, aux intérêts anhistoriques : l’individu, la société, l’humanité ne peuvent pas être transformés dans leur nature.[25] Les vices du monde des Lumières ne peuvent donc être, aux yeux de celles-ci, que la conséquence d’une tromperie qui aurait empêché les individus de suivre leur nature ou de la suivre de manière efficace, souvent des préjugés.[26] L’éducation et la connaissance défendues par les Lumières pour éliminer les préjugés ne pouvant venir d’une société globalement malsaine, elles sont souvent apportées dans cette pensée par un gouvernement ou un éducateur supposé être capable de s’élever au-dessus de la société.[27] Ce projet politique et son argumentation remettent généralement en question l’égalité des intelligences, ce qui est une autre compromission à une de leurs catégories fondamentales.[28] En somme, le changement politique, de même que l’ordre moral, sont tellement impensables pour une pensée aussi fixiste qu’ils l’obligent à remettre en question ses catégories fondamentales (égalité, universalité), ou encore des prémisses logiques (car un individu bon dans un monde malsain n’est pas possible).
Mais pourquoi les Lumières, qui ne sont pas « plus » bourgeoises que ne l’étaient les premiers individualismes, en arrivent-elles à ce mécanisme, qui a des incidences sur la morale et la politique ? Pour Goldmann, le mécanisme de la pensée des Lumières provient de la situation spécifique de la bourgeoisie des Lumières : celle-ci ne peut pas penser à sa prise du pouvoir autonome.[29] De même, Samir Amin affirme que pendant les périodes des « origines du capitalisme (du XIIIe au XVIe siècles en Europe) » et une bonne partie de « l’époque mercantiliste (1600-1800)[30] » donc durant les trois premiers individualismes, la monarchie absolue rend généralement possible le progrès de la bourgeoisie et du marché, notamment par des « protections royales des manufactures et des compagnies marchandes[31] ». Amin rejoint les analyses d’Alain Bihr, pour qui la monarchie a permis le progrès du marché et de la bourgeoisie en Europe essentiellement pendant la période protocapitaliste qui s’étale selon Bihr du début du XVe siècle jusqu’aux deux tiers du XVIIIe siècle[32] :
Par leur appui [celui des politiques mercantilistes de l’État absolutiste] à l’expansion commerciale et coloniale, dont le rôle moteur dans l’accumulation du capital marchand [c’est-à-dire dont le profit provient de l’échange de marchandises] et industriel [dont le profit provient de la production industrielle de marchandises] au cours de l’époque protocapitaliste n’est plus à démontrer ; par ces stimulations que constituent l’ouverture des marchés publics, la concession de privilèges ou l’érection de barrières douanières ; par l’octroi de prêts à taux bonifié ou nul, de subventions ou même directement de dons ; par l’effort pour réaliser un marché intérieur (protonational) unifié matériellement, fiscalement, administrativement. Les différentes fractions [principalement : marchande, industrielle et d’État] de la bourgeoisie y trouvent toutes leur intérêt, directement ou indirectement.[33]
L’État absolutiste arrive à gagner la loyauté de la noblesse (ou aristocratie nobiliaire), dont il alimente pourtant le déclin[34], et de la bourgeoisie, même s’il entrave
le développement du capital à divers titres : par sa fiscalité directe (les privilèges fiscaux, même réduits, accordés au clergé et à la noblesse, font peser cette dernière essentiellement sur les classes roturières dont fait partie le gros de la bourgeoisie), par le maintien des reliquats de la féodalité (les droits seigneuriaux qui entravent l’unification administrative, juridique, fiscale du territoire), etc. Enfin, comme j’ai déjà eu l’occasion de le signaler, l’État absolutiste stérilise une partie du capital en offrant à la bourgeoisie des moyens de convertir ce dernier en titres nobiliaires par le biais de la terre et de l’office.[35]
Sorte d’entre-deux, l’absolutisme se place au-dessus de ces deux forces sociales principales incapables de prendre le pouvoir par elles-mêmes, trop faibles.[36] Mais Bihr va plus loin : il permet de comprendre ce qui différencie la situation de la bourgeoisie des Lumières vis-à-vis de l’État absolutiste, comparativement à celle de la bourgeoisie des deux premiers individualismes. En effet, le « bloc au pouvoir » dans l’État conduit, essentiellement au cours du XVIIe siècle, à une « fusion » d’une couche de chacune de ces deux classes, l’aristocratie nobiliaire (qui s’embourgeoise) et la grande bourgeoisie (qui s’anoblit et s’étatise) ; ce qui attache une partie de la bourgeoisie de la fin du XVIIe et du XVIIIe aux intérêts de la noblesse et au régime de la monarchie absolue qui les défend.[37] Cependant, le compromis entre noblesse et bourgeoisie n’est pas toujours le même, la bourgeoisie prenant très progressivement le dessus sur la noblesse, non seulement parce que la bourgeoisie que Bihr nomme « d’État » prend du temps à acquérir des postes dans celui-ci, mais aussi parce que les bourgeoisies marchande et industrielle ne se forment qu’avec l’aide substantielle du mercantilisme monarchique.[38] On comprend dès lors mieux le mécanisme des Lumières : celles-ci ont comme spécificité, entre tous les individualismes, d’être l’expression d’une bourgeoisie ayant obtenu (au cours d’une période qu’on peut situer du début du XVe à la fin du XVIIe) des positions et la facilitation de son développement dans un État absolutiste, État qui n’est encore pour elle qu’un frein relatif à ses affaires ; et une bourgeoisie anoblie, qui partage donc des intérêts, protégés par la monarchie, avec la noblesse. Cette classe n’a dès lors pas besoin de penser la transformation du régime et des institutions de l’État, d’où la défense fréquente chez les Lumières de monarques ou gouvernements non élus, mais « éclairés », comme étant seuls capables de s’élever au-dessus de la société (corrompue en entier) au profit du bien commun.[39] On trouve aussi là l’explication de leur tendance au réformisme, et de leur vision de la lutte politique et morale, qui s’arrête souvent à l’éducation permettant la lutte contre les préjugés ayant été suscités par des prêtres et des tyrans ; vision qui considère que le bien commun découle mécaniquement (directement ou indirectement) de la nature humaine que serait l’intérêt propre, si elle est exercée sans limitation (préjugés, privilèges, etc.).
Lucien Goldmann a décelé un renouveau de l’individualisme mécaniste, ou « rationalisme », à la fin de sa vie.[40] Dans un entretien de 1966, il rappelle qu’un irrationalisme dominait au début du XXe siècle à une époque de « crise fondamentale » pour le système capitaliste mondial.[41] Il rejoint en cela la périodisation de l’économiste Samir Amin selon lequel la première longue phase du capitalisme s’étend de « la révolution industrielle à l’après Première Guerre mondiale (1800-1920) », et dont la crise proviendra de ce que ce
système atténuait certaines contradictions sociales internes [« soit avec la paysannerie dans son ensemble (comme en France), soit avec l’aristocratie (Angleterre, Allemagne) », par des politiques économiques], mais en accusait d’autres, notamment la contradiction métropoles/colonies et le conflit des impérialismes. Ce sont ces dernières [contradictions] qui ont failli conduire à l’effondrement du capitalisme, à l’occasion de la Première Guerre mondiale, dont est sortie la révolution russe.[42]
Après la Première Guerre, la forte croissance surmonte certaines des anciennes contradictions, et en crée de nouvelles :
La nouvelle organisation du capital et du travail créait simultanément les conditions pour qu’apparaisse un système nouveau de régulation, devenu objectivement nécessaire du fait que la tendance spontanée du capitalisme à la surproduction s’exacerbait. La productivité du travail, relevée dans de fortes proportions par la rationalisation taylorienne, aurait généré une production excédentaire, non absorbable si les salaires réels étaient restés relativement stables.[43]
En effet, c’est pour contrer la tendance à la surproduction qu’un nouveau système de régulation est pensé et formé après la Deuxième Guerre, où « la politique salariale nouvelle vise tout simplement à lier la progression des salaires réels à celle de la productivité », l’État ayant notamment pour rôle de généraliser ces pratiques par son action sur ses partenaires oligopolistiques puissants, et de donner le rythme en tant qu’employeur massif.[44] Il absorbe aussi les surplus de production, surtout par des dépenses militaires accrues et constantes.[45] Dans ce modèle de régulation, les investissements sont planifiés, permettant une plus grande stabilité qu’à la phase précédente, marquée par des cycles moyens de 7 ans.[46] Cette époque de compromis entre capital et travail a participé à changer l’idéologie socialiste relativement répandue dans la classe ouvrière et acquise à la fin de la phase précédente (faite de révolutions et de mouvements ouvriers forts), pour l’idéologie de la consommation de masse.[47] Mais la démocratie s’y érode, car l’ancien débat d’idées droite-gauche et bourgeoisie-prolétariat se soumet plus directement au consensus de la rationalité économique, à la gestion bureaucratique des classes moyennes, essentiellement de cadres et d’administrateurs, dans l’entreprise et l’État.[48] Cette analyse sociale et idéologique rejoint sensiblement celle du sociologue Alain Bihr : l’État passe du « rôle de simple garant du marché » à celui de « véritable gérant de l’ensemble du procès de reproduction sociale[49] ». La société est marquée par un « renforcement de la concentration du pouvoir politique dans l’appareil d’État et la centralisation accrue de cet appareil », lui-même davantage soumis qu’auparavant aux exigences du marché.[50] Or, selon Goldmann, la bourgeoisie s’était éprise d’un irrationalisme pendant la crise de la première phase du capitalisme, car la promesse des valeurs formelles des Lumières de liberté, de propriété, d’égalité, de tolérance, etc. était devenue concrètement irréalisable avec la crise économique, a fortiori avec les révolutions, les guerres mondiales et les fascismes.[51] Mais avec la nouvelle phase capitaliste après la Deuxième guerre mondiale, la foi en la réalisation mécanique, automatique, simplement par le développement capitaliste, de certaines promesses des Lumières, notamment celles de propriété (« conditions progressivement améliorées d’existence aux hommes ») et de liberté (le choix dans la consommation de masse), — a permis un renouveau rationaliste et donc mécaniste dans la pensée occidentale après la Seconde Guerre mondiale.[52] Ce que Bihr dit sur la concentration du pouvoir dans l’État et sa centralisation, et Amin sur la gestion planifiée de l’économie par des classes moyennes, Goldmann en trouve donc la projection dans une vision du monde qui
tend à leur [aux individus] enlever toute responsabilité, tout souci de leur propre existence et du sens de leur vie ; et cela veut dire précisément […] [leur enlever] toute réflexion, tout intérêt pour la problématique de l’histoire, de la transcendance, et même tout simplement pour la signification.[53]
En France, Goldmann observe plus précisément en sciences sociales et humaines la domination d’un structuralisme qu’il dit « non génétique » (au sens de genèse, d’origine et d’évolution sociohistorique), chez Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser et Raymond Aron, plusieurs étant cités par la narratrice dans le livre que j’étudierai, structuralisme ressemblant énormément à l’individualisme mécaniste des Lumières :
Cette philosophie […] tend à chercher dans la compréhension de l’homme des formes universelles et générales [souvent appelées des structures], et à éliminer toute problématique d’ordre axiologique, toute problématique portant sur le contenu [par opposition à la forme], sur le devenir historique, sur les problèmes concrets et spécifiques qui se trouvent dans telle forme littéraire ou dans telle réalité sociale ou historique.[54]
En sciences sociales, cette pensée s’en tient pour Goldmann à décrire des structures spécifiques (par exemple la parentalité) par leur seule organisation interne, de manière atomisée et isolée, la plupart du temps sans expliquer leur fonction par rapport à d’autres structures plus englobantes (par exemple le mode de production, l’État, le système de nations, etc.), ce qui l’amène souvent à une compréhension ahistorique de la société, ou encore à une vision fixiste de l’histoire.[55] L’historien marxiste Pierre Vilar émet des critiques semblables en 1973 lorsqu’il identifie, comme prétention du structuralisme, l’« autonomie des champs de recherche : soucieux d’une auto-explication par ses structures internes propres, chaque champ proclame inutile, inefficace voire scandaleuse, toute référence à une insertion dans l’histoire des cas étudiés.[56] » Il ajoute que le « projet même [du structuralisme], retrouvant la vieille métaphysique [des Lumières] de la “nature humaine”, est un projet idéologique ; [le projet] propose d’étudier les sociétés à partir de leurs “atomes” [des structures spécifiques] avant de les avoir observées au niveau macro-économique, macro-social.[57] » Quant à la théorie de Pierre Bourdieu, sociologue fameux, grande influence d’Annie Ernaux, presque inconnue du temps de Goldmann, elle comporte, selon le chercheur en philosophie et science politique Tony Andréani (et bien d’autres chercheurs en sciences sociales), à tout le moins un même fixisme social, une détermination tendanciellement complète des individus et des groupes sociaux par une reproduction sociale très rigide.[58]
La structure individualiste dans Les années d’Annie Ernaux
Annie Ernaux (1940-) a fait ses études supérieures dans les années 60 puis a enseigné à partir des années 70, avant de commencer à publier des œuvres littéraires dans les années 70. Son récit Les années (2008) me semble construit sur la vision individualiste-mécaniste, dominante après la Seconde Guerre et particulièrement en sciences humaines et sociales, c’est-à-dire au moment et dans les domaines où l’autrice s’est formée intellectuellement. La structure générale de ce récit est de 14 photos (parfois un groupe de photos), ou image de film, ou film[59] (je les résumerai souvent sous le terme de « photo ») jalonnant chronologiquement la vie du personnage principal[60], chaque document étant décrit, puis analysé par la narratrice. Ces documents sont encadrés (précédés et suivis donc) par deux chapitres d’un autre genre[61], rappelant des souvenirs de la narratrice-personnage qui se perdront quand elle mourra. Toute cette division n’est pas explicitée par un chapitrage (à part le premier chapitre « sans photo », séparé par un saut de page), mais on peut la dégager à l’aide du contenu et de la forme du récit. En effet, dans chaque chapitre « à photo » (je les appellerai ainsi), le document est d’abord l’objet d’une description dans sa composition, la narratrice parlant d’elle-même, présente sur la photo, et des autres présents, mais d’un point de vue extérieur, en les objectivant. Dans les premiers chapitres, il y a une indistinction entre les figures humaines décrites, mais peu à peu, une petite fille, née au premier chapitre à photo, obtient une place prépondérante dans le récit : d’abord elle est fondue dans le groupe des enfants[62], que la narratrice rassemble de manière indistincte sous les pronoms « on » et « nous » (aucune trace grammaticale ou de l’histoire ne nous permet encore de dire à ce stade si ces pronoms réfèrent seulement au personnage principal[63]). On réserve bientôt pour la petite fille, personnage principal, le pronom « elle » dans un usage bien précis : quand on ne lui accorde aucun référent immédiat, disposant le pronom le plus souvent au début d’un paragraphe et juste après la référence du document (en italique ou entre parenthèses, sauf à quelques rares endroits, comme aux pages 55 et 162), de manière à ce qu’on détache ce personnage de la stricte description de la photo. Par exemple, au sixième chapitre à photo, en début de paragraphe, et malgré que le paragraphe précédent (appartenant à la description de la photo donc) ne décrive même pas la petite fille à elle seule, on a : « C’est elle au deuxième rang, la troisième à partir de la gauche.[64] » La première occurrence de cet usage est au deuxième chapitre à photo[65], mais l’usage se systématise, sans aucune exception ensuite, à partir du quatrième chapitre à photo.[66] La narratrice est identifiable au personnage revenant sur sa vie, notamment à cause du projet d’écriture mis en abîme[67] dès la page 56 et périodiquement jusqu’à la fin :
C’est elle, et non la blonde, qui a été cette conscience, prise dans ce corps-là, avec une mémoire unique, permettant donc d’assurer que les cheveux frisés de cette fille provenaient d’une permanente […]. Et c’est avec les perceptions et les sensations [empirisme] reçues par l’adolescente brune à lunettes de quatorze ans et demi que l’écriture ici peut retrouver quelque chose qui glissait dans les années cinquante.[68]
Et déjà dans le premier chapitre à photo, l’incertitude (« qui doit dater », « sans doute », « 1944, environ ») sur le premier groupe de photos s’explique par le fait que la narratrice ne peut en avoir le souvenir parce qu’elle était trop jeune.[69] Autrement dit, un processus d’individuation se produit au cours des premiers chapitres, et cet individu est en plus assumé comme étant la source de la connaissance et de l’action (recueillir la documentation, décrire, écrire), une vision tout à fait individualiste. Dans chaque chapitre à photo qui suit l’émergence de l’individu (aboutie au quatrième chapitre à photo), le pronom « elle » sépare donc la description de la photo, qui s’en tient généralement à sa composition (objets et figures humaines présents) par des formulations impersonnelles, de sa contextualisation dans la vie du personnage, opération que rend explicite souvent un marqueur de temps (« alors[70] », « maintenant[71] », « il y a deux ans à peine[72] », etc.). Par exemple, au septième chapitre à photo, on dit que celle-ci « a été prise dans la période séparant le passage des examens et les résultats. C’est un temps de nuits blanches […] De sommeils dans l’après-midi d’où elle sort avec l’impression coupable de s’être mise hors du monde[73] ». Les paragraphes racontant au pronom « elle » utilisent aussi la troisième personne et des formes impersonnelles pour détailler le contexte, mais par ce premier pronom, la répartition des souvenirs s’effectue clairement entre la mémoire individuelle, fruit de l’expérience vécue, et la mémoire collective, apprise implicitement ou explicitement par l’intermédiaire d’autres figures ou de la documentation. Par exemple, au neuvième chapitre à photo, la narratrice distingue bien la connaissance issue du vécu (« elle ») de celle issue de la consultation ultérieure de documents d’époque (troisième personne du singulier, formes impersonnelles) :
Selon les critères des journaux féminins, extérieurement elle fait partie de la catégorie en expansion des femmes de trente ans actives, conciliant travail et maternité, soucieuses de rester féminines et à la mode. Énumérer les lieux qu’elle fréquente dans une journée (collège, Carrefour, boucherie, pressing, etc.) […] ferait apparaître[74].
De cette façon, à partir de la subjectivation du personnage au quatrième chapitre à photo, chaque chapitre à photo effectue en lui-même une subjectivation du personnage, le séparant des autres.
La séquence des paragraphes entremêlant « elle » et troisième personne est séparée, par un changement de paragraphe, d’une autre séquence, marquée par l’arrivée d’un usage spécifique des pronoms « on » et « nous », en plus de l’usage de la troisième personne, notamment de la forme « les gens ». Cet usage se systématise à partir lui aussi du quatrième chapitre à photo ; à la seule exception du dernier chapitre à photo qui débouche directement sur le chapitre sans photo et sous-entend que suivra l’acte d’écriture du récit que l’on a lu. L’usage spécifique du « on » se distingue de son usage habituel, l’usage impersonnel. Par exemple, sur une même page où se suivent les deux séquences décrites, on a un premier usage ainsi : « [le souvenir de ] la première fois où on lui [pronom dont l’antécédent est le « elle »] a dit, devant la photo d’un bébé assis en chemise sur un coussin, parmi d’autres identiques, ovales et de couleur bistre, “c’est toi”, obligée de regarder comme elle-même cette autre de chair[75] ». Et un second usage ainsi : « La France était immense et composée de populations distinctes par leur nourriture et leurs façons de parler, arpentée en juillet par les coureurs du Tour dont on suivait les étapes sur la carte Michelin punaisée au mur de la cuisine.[76] » L’usage de la seconde séquence fait du « on » un pronom personnel, qu’on peut souvent, mais non toujours, attribuer à la narratrice-personnage principal ; parfois, on peut l’attribuer à un groupe. L’usage du « nous » dans la seconde séquence se distingue aussi du « nous » habituel, pronom personnel de la première personne du pluriel. Il est généralement opposé, avec « on », aux « gens » et autres formes de troisième personne du pluriel, ce qui en fait un pronom personnel attribuable à la narratrice-personnage. Par exemple, au cinquième chapitre à photo, on a : « Ils [les « gens »] ne croyaient que dans le général de Gaulle pour sauver tout, l’Algérie et la France. », puis plus bas : « Nous qui avions le souvenir d’un visage sec sous un képi, petite moustache d’avant guerre, sur les affiches de la ville en ruine, qui n’avions pas entendu l’appel du 18 juin, étions ahuris et déçus par ces joues pendantes […].[77] » Comme les exemples en donnent un aperçu, le « on » et le « nous », dans cet usage particulier qu’en fait la troisième séquence de toutes (après la séquence de la description et la séquence du « elle ») dans chaque chapitre à photo tendent à pouvoir être interprétés comme personnels et comme faisant référence à la narratrice-personnage, même s’ils conservent généralement une ambiguïté de par leur usage habituel, et dans certains cas leur sens est à interpréter ou reste indéterminé. En effet, en plus des cas innombrables, comme ceux des exemples, où les détails attribués au « on » et au « nous » sont trop singuliers pour ne pas être individuels, on compte aussi des cas qui rendent explicite la signification du pronom, par exemple : « On changeait les assiettes pour le dessert, assez mortifiée [féminin, donc le « on » fait référence à la narratrice-personnage principal] que la fondue bourguignonne, au lieu des félicitations attendues, n’ait reçu qu’un accueil de curiosité assortie de commentaires décevants […].[78] » Mais d’autres cas laissent place à l’interprétation, comme juste au-dessus du précédent extrait : « La contraception effarouchait trop les tables familiales pour qu’on en parle. L’avortement, un mot imprononçable » ; et quelques rares cas vont jusqu’à rendre explicite une référence à un groupe, par exemple au neuvième chapitre à photo :
Plus que jamais les gens rêvaient de campagne, loin de la « pollution », du « métro boulot dodo », des banlieues « concentrationnaires » et leurs « loubards ». […]
Et nous qui avions moins de trente-cinq ans, que la pensée de « faire son trou », vieillir et mourir dans la même ville moyenne de province rendait mélancoliques [ce terme s’applique d’ailleurs au « nous » et au « on » ; il pourrait renvoyer au couple de la narratrice-personnage principal], est-ce qu’on ne pénétrerait jamais dans ce qu’on se représentait comme une cuvette grondante et survoltée.[79]
Dans tous les cas, contrairement à la seconde, la troisième séquence, qu’on pourrait appeler celle de la construction de la mémoire collective à partir du point de vue de la narratrice-personnage, joue sur l’ambiguïté de ces pronoms, en donnant une portée collective au témoignage individuel, le collectif provenant de l’individu plus souvent qu’autrement (le « on » et le « nous » sont souvent attribuables à la narratrice-personnage). La connaissance collective part de l’individu, capable d’universalité ; c’est une vision individualiste.
Le mécanisme (social, historique, moral) dans Les années
D’un bout à l’autre du récit de Les années, la mémoire (la connaissance et l’action de remémoration, d’écriture) se fonde sur l’individu narratrice-personnage, qui, bien que les traces de sa subjectivité ne se perçoivent qu’après les premiers chapitres à photo, assume la description des photos, la contextualisation d’elle-même en alliant sa mémoire et la recherche documentaire, puis la construction de la mémoire collective à partir d’elle-même en se cachant derrière des pronoms habituellement collectifs. En même temps, comme la pensée individualiste des Lumières, la narratrice-personnage principal voit l’individu comme une bête poursuivant son intérêt propre, intérêt lui-même objectivable, car intrinsèque à l’individu, ce qui mène cette pensée à un mécanisme (au sens d’une vision mécaniste) tout au long du récit. La nature inhérente à l’individu dans ce récit est plus particulièrement sociale : les structures sociales le font tout entier, et ainsi réduisent sa liberté à néant. Autrement dit, on retrouve une contradiction inhérente à l’individualisme des Lumières : l’individu est la source de connaissance et d’action, mais il ne peut que suivre des traits inhérents à tout individu. Je décèle d’abord ce mécanisme dans la justification sociale présente en chacune des séquences de tous les chapitres à photo ; à part ceux de l’enfance et du début de l’adolescence, c’est-à-dire les quatre premiers chapitres à photo, comme si les rapports sociaux n’avaient, à ce point, pas encore assez eu d’effet sur la narratrice-personnage. On dit d’ailleurs au quatrième chapitre à photo qu’« il n’y a rien dans l’apparence de cette adolescente [le personnage principal] qui ressortisse à “ce qui se fait” alors et qu’on voit dans les journaux de mode et les magasins des grandes villes[80] » ; et ce n’est qu’au cinquième chapitre à photo que cette justification se fait systématique, chapitre au début duquel on dit d’ailleurs que le personnage principal « connaît maintenant le niveau de sa place sociale[81] ». Chaque séquence de description de photo des chapitres à partir du cinquième est donc expliquée ou comprise par au moins un facteur social ; par exemple, dès la première description de photo (on remarquera que d’ailleurs les rapports sociaux y concernent la famille et non encore l’enfant) : « Dans cette pièce d’archives familiales — qui doit dater de 1941 — impossible de lire autre chose que la mise en scène rituelle, sur le mode petit-bourgeois, de l’entrée dans le monde.[82] » Il en est de même pour chaque séquence de contextualisation de photo dans la vie de la personnage, par exemple dans le sixième chapitre à photo : la personnage principal fait partie des « ignorées » de la classe parce qu’elle a honte de sa personne, à cause de la classe sociale de ses parents, de son anorexie (haine de leur corps chez les femmes), du fait qu’elle a été mise enceinte sans le vouloir (tabou du sexe, rapports hommes-femmes), et de son manque d’argent qui l’empêche de se payer les mêmes vêtements que ses collègues aisées de classe.[83] Enfin, il en est de même pour chaque séquence de construction de la mémoire collective ; par exemple, au onzième chapitre à photo, le fatalisme politique de la narratrice-personnage, étendu possiblement à toute la population française ou à un autre groupe (le « on » laisse un doute), s’explique par l’influence des médias, les mauvais coups du gouvernement de gauche, les morts du sida (qui est un véritable tabou dans le monde du récit et dans la réalité), etc.[84] Ainsi, dans le récit, les individus et groupes apparaissent pris dans une reproduction sociale complète (rien n’y échappe) et constante, comme dans le structuralisme en sciences humaines après 1945, où les structures atomisées (étudiées à elles seules, sans rapport avec d’autres ni avec des aspirations de groupes sociaux, donc sans possible tension ni changement) débouchent sur un fixisme social et historique.
Le mécanisme se voit aussi dans la structure cyclique du récit, qui, en plus d’enchaîner toujours les séquences de la même manière, aborde les mêmes thèmes et situations à chaque chapitre, c’est-à-dire que le récit plie les histoires individuelle et collective au retour cyclique des thèmes. Par exemple, le repas de famille, la politique institutionnelle, la consommation, la langue, etc. reviennent presque à tous les chapitres, souvent chacun dans un segment clos, comme si en tant que « structures » transhistoriques elles pouvaient rendre compte de chaque époque, des transformations historiques, de leurs significations. La dynamique historique collective réelle à laquelle le récit fait clairement référence est par conséquent trahie (ce terme n’est pas péjoratif), car pliée aux cycles du récit, à son fonctionnement profondément statique : que dire en effet d’un thème sur lequel rien n’a changé ? ou au contraire comment conserver un thème structurant de l’œuvre à travers les époques du récit, si ce thème devient marginal dans la vie réelle à telle époque ? C’est le cas du thème de la consommation. Le premier chapitre à photo traite de l’époque tout juste après la Seconde Guerre mondiale[85] : le souvenir de cette dernière s’oppose à la consommation à cause du rationnement[86], et la pauvreté la limite encore[87] ; la consommation n’est pas encore réellement massifiée, mais en relance.[88] Le deuxième chapitre à photo, qui se passe autour de 1949, n’est pas différent.[89] La consommation ne semble devenir accessible de manière massive (on le sait, car les formulations sont à la troisième personne du pluriel…) et prendre une importance culturelle imposante qu’au troisième chapitre à photo, se passant environ entre 1949 et 1955 : « Les restrictions étaient finies et les nouveautés arrivaient, suffisamment espacées pour être accueillies avec un étonnement joyeux, leur utilité évaluée et discutée dans les conversations. […] Il y en avait pour tout le monde […].[90] » Cette mise en récit par la narratrice correspond à la réalité que pointait Samir Amin plus haut (idéologie de la consommation de masse), mais aussi que pointe Alain Bihr. Plus précisément, Bihr parle d’une « euphorie de la croissance économique, du milieu des années 1950 au milieu des années 1970 », et des « illusions propres au fordisme et à sa “société de consommation” » qui se dissiperont après cette période.[91] Encore au cinquième chapitre à photo, autour de 1957, la narratrice rend compte avec justesse du bonheur populaire de la consommation, même si elle l’attribue aux « gens[92] » et parle peu du jugement que porte le personnage principal sur celle-ci à ce moment.[93] Au sixième chapitre à photo, autour de 1958-1959, pour la première fois, la consommation est vécue chez le personnage principal comme une honte, à cause de la distinction sociale par la consommation qu’elle subit de ses collègues plus aisées[94] ; et pour la première fois, cette même distinction est perçue par la narratrice dans le repas de famille.[95] Au septième chapitre à photo, autour de 1963, donc au milieu des années 70, la fin de l’euphorie selon Bihr, le rapport du personnage avec la consommation n’est pas abordé.[96] Mais le rapport des gens à la consommation y est clairement dévalorisé et ironisé par la narratrice.[97] La mémoire supposément collective rapportée par la narratrice, autrement dit, est en avance sur le rapport réel à la consommation. Ce décalage, et la séparation précédente du personnage d’avec « les gens » adorant la consommation, de même que la honte vécue ensuite, montrent clairement que la dévalorisation de la consommation appartient au regard singulier de la narratrice, qui développe au cours de sa vie qu’elle raconte une aversion en même temps qu’une obsession pour ce thème. Dans les derniers chapitres du livre, cette obsession ne reflète plus du tout le rapport collectif à la consommation, mais celui de la narratrice. En effet, Bihr rappelle que l’austérité est imposée au début des années 80 « par l’ensemble des gouvernements occidentaux », provoquant une « désastreuse contraction de l’ensemble du marché mondial[98] » ; il souligne
l’impuissance de l’État face à l’ampleur et la complexité des tâches nées de la crise économique [crise de la fin 70 et du début 80] : reconversions industrielles, reconversion professionnelle des salariés, montée du chômage de masse, lutte contre l’aggravation des inégalités et des exclusions consécutives à la crise, etc.[99]
Quant à elle, la narratrice continue, au douzième chapitre, autour de 1992, de parler d’une croissance économique et d’une consommation accrue qu’elle trouve insignifiantes, même si elle note en passant la difficulté de consommer pour les couches pauvres de la classe ouvrière.[100] La pression à la consommation lui semble aussi forte qu’avant la crise, et ne pas consommer est montré comme un goût individuel plus qu’une conséquence du manque de moyens causés par une crise qui d’ailleurs se fait peu ressentir dans tout le livre.[101] De plus, la fascination pour la marchandise, que la narratrice-personnage remarque chez les gens tout au long du livre, alors qu’elle développe une aversion sans être totalement détachée de la fascination, ne suit pas la « crise de sens » présente en réalité selon Alain Bihr.[102] Ce dernier affirme que, d’abord masquée par l’euphorie de la croissance et de la consommation, cette crise est plus sensible avec le tournant néolibéral des années 70-80, et elle ne provient pas de la marchandise en elle-même, mais bien d’un défaut propre à la société capitaliste en général, ce que Goldmann appelait l’absence d’une instance supra-individuelle :
Cette crise chronique tient, je [Alain Bihr] l’ai montré, au défaut d’ordre symbolique propre aux sociétés capitalistes développées: à leur incapacité à élaborer et maintenir un système un tant soit peu stable et cohérent de référentiels, de normes, de valeurs à l’intérieur desquels les individus puissent à la fois hériter du passé et se projeter dans l’avenir, communiquer entre eux, se construire une identité, en un mot donner sens à leur existence. Le symptôme le plus massif de cette crise, en même temps que sa solution illusoire la plus courante, réside dans le développement, au cours de ces deux dernières décennies [80 et 90], d’une individualité personnalisée, narcissique, autoréférentielle, qui n’accepte d’autre principe ou règle d’existence que son propre accomplissement.[103]
Au contraire, la narratrice-personnage décrit les gens des années 90 comme encore aussi fascinés et enthousiasmés par la consommation qu’auparavant.[104] En somme, la narratrice ne déroge pas, quant au thème de la consommation, même devant un changement réel (dans les capacités de consommation et dans le rapport à celle-ci), de son opposition développée dans les premiers chapitres entre son personnage dégoûté par la consommation et les « gens » qui en seraient béatement et éternellement fascinés. Ce récit tronqué de la mémoire collective tient du mécanisme de la vision de la narratrice, mais aussi de son présupposé individualiste qui fonde la connaissance dans l’individu.
Un autre signe du mécanisme se trouve selon moi dans le traitement par la narratrice des mouvements et luttes sociopolitiques. Déjà au premier chapitre à photo, les luttes collectives, à savoir la lutte contre l’occupation allemande de la France[105] et les luttes ouvrières[106], sont du passé et n’ont aucun présent. Les luttes, tout au long du livre, seront l’exception, et la norme sera la reproduction sociale entière. Le rapport du récit aux mouvements réels prend plusieurs formes mécanistes. Une première forme est le passage sous silence de mouvements réels. Par exemple, à part le grand moment de lutte collective dans le récit qu’est mai 68, traité au huitième chapitre à photo[107], les chapitres à photo qui couvrent les années 60-70, les 6 à 9[108], ne traitent que très marginalement de ce que Bihr décrit comme un
mouvement ouvrier offensif, tel que celui qui se manifestait encore en Europe occidentale à la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsque la grève générale de mai-juin 1968 en France trouvait un écho dans le “mai rampant” italien et les “grèves sauvages” allemandes, scandinaves, britanniques et nord-américaines.[109]
Une autre forme de rapport avec les mouvements collectifs qui revient souvent dans ce récit s’observe dans le cas de mai 68, qui sera foncièrement imprévu pour la narratrice-personnage, même si elle travaille elle-même dans une université, où a commencé le mouvement.[110] Une autre forme est que les mouvements collectifs dans le récit restent inexpliqués ; ou expliqués partiellement par la seule oppression des structures sociales, sans que les groupes se révoltant aient une quelconque agentivité historique, une conscience ou une organisation se développant progressivement avec les années. Par exemple, pour la narratrice, les étudiants de 68 se révoltent seulement contre l’oppression et la répression des mouvements progressistes[111], mais pour elle, et c’est tout le paradoxe, Mai 68 survient de nulle part, ne semble pas avoir de cause, surtout pas d’organisation ou signe préalable.[112] Un autre exemple est l’absence de contextualisation (sur les luttes des années 60, l’état des organisations ouvrières et des syndicats, le leadership syndical, etc.) et en conséquence l’incompréhension de la dynamique historique qui a mené à l’échec du mouvement ouvrier en mai 68 :
On [usage spécifique de ce pronom ici encore] ne s’avisait pas qu’il n’émergeait aucun leader ouvrier. Avec leur air paterne, les dirigeants du PC et des syndicats continuaient à déterminer les besoins et les volontés. Ils se précipitaient pour négocier avec le gouvernement — qui ne bougeait pourtant presque plus — comme s’il n’y avait rien de mieux à obtenir que l’augmentation du pouvoir d’achat et l’avancée de l’âge de la retraite.[113]
Ce profond manque de compréhension des conditions subjectives (au sens collectif) qui mènent au mouvement social est tributaire d’une vision fixiste de la société et de l’histoire, rappelant le structuralisme, elle-même dépendante d’une vision individualiste des Lumières dans laquelle l’individu est guidé par une nature intrinsèque transhistorique. Il est tributaire aussi d’une vision fondamentalement individualiste où tel individu est jugé capable de rendre compte de l’histoire collective à partir de son point de vue, alors que celui-ci est forcément limité (comme ce récit en est l’exemple) ; ou encore jugé capable de se comprendre objectivement lui-même à partir de son point de vue, alors même qu’il n’arrive pas toujours à décrire la réalité collective objective sans faire intervenir son point de vue sur la société.
L’absence d’instance supra-individuelle dans une société de marché est source de préoccupation constante pour l’individu dans Les années, préoccupation sur la direction à prendre dans sa vie, sur un guide à trouver. Or, comme on l’a dit, cet individu ne se forme dans le récit qu’après un processus de subjectivation qui ne s’accomplit qu’au quatrième chapitre à photo[114], à l’adolescence vers les 14 ans du personnage principal (de 1941 à 1955[115]). Par conséquent, les préoccupations de sens de l’existence ne commencent qu’à partir de ce chapitre. En effet, au premier chapitre à photo, les enfants, dont fait partie le futur personnage principal, ne se posent pas la question de leur existence et de leur trajectoire.[116] Les « récit familial et récit social » décrits par la narratrice forment une instance supra-individuelle où les humains héritent de leur place, d’un sens à leur vie.[117] Au deuxième chapitre à photo, on montre que la compréhension de la place des individus dans le monde est donnée par la religion et les récits hérités.[118] Dans ce chapitre, la narratrice ne touche pas un mot sur d’éventuels questionnements par les adultes ou les enfants sur le sens de leur existence. Au troisième chapitre à photo, la religion est encore le guide de la vie pratique (rituels, messe, nourriture, etc.) et de la morale.[119] Mais dès le chapitre où se réalise la subjectivation du personnage principal, la narratrice commence à faire la distinction entre ce qu’on attend du personnage et ce que celui-ci fait en se cachant ; l’instance supra-individuelle n’est plus intégrée, mais hors de l’individu qui a désormais sa propre morale :
Constamment, elle s’irréalise dans des histoires et des rencontres imaginaires qui finissent en orgasmes le soir [il y a un tabou fort de la sexualité à cette époque] sous les draps. Elle se rêve en putain et elle admire aussi la blonde de la photo, d’autres filles de la classe au-dessus, qui la renvoient à son corps empoissé.[120]
Au chapitre suivant, l’absence de sens extérieur à la détermination de l’individu commence à susciter, chez le personnage, une recherche, l’écriture offrant déjà un sens :
Sans doute elle ne pense qu’à elle, en ce moment précis où elle sourit [sur la photo], à cette image d’elle qui fixe la fille nouvelle qu’elle se sent devenir […]
[il y a un réel retour à la ligne ici, comme dans un poème versifié] notant dans un calepin des phrases qui disent comment vivre — qu’elles soient dans des livres leur assure un poids de vérité, [exemple de phrase dans le calepin :] il n’y a de bonheur réel que celui dont on se rend compte quand on en jouit[121][.]
Autrement dit, dans le récit, l’émergence du questionnement sur la morale et la direction à suivre, comme distinction des autres individus et comme recherche, découle de la subjectivation du personnage, bref de la conscience individuelle. Peu à peu, l’écriture sera assimilée au sens de l’existence de la narratrice-personnage, à l’aboutissement naturel, convenable de sa vie, par exemple au huitième chapitre à photo.[122] Quant à lui, le quatorzième et dernier chapitre à photo rend explicite la signification globale du projet d’écriture dans le livre. En effet, l’approche de la mort et de la perte de mémoire annoncent la fin de la conscience individuelle, et donc la possibilité de la fin de l’individu :
C’est un sentiment d’urgence qui le [« son sentiment d’avenir »] remplace, la ravage. Elle a peur qu’au fur et à mesure de son vieillissement sa mémoire ne redevienne celle, nuageuse et muette, qu’elle avait dans ses premières années de petite fille [avant la subjectivation] — dont elle ne se souviendra plus. […] Peut-être un jour ce sont les choses et leur dénomination qui seront désaccordées et elle ne pourra plus nommer la réalité, il n’y aura que du réel indicible.[123]
Autrement dit, seule la conscience individuelle peut rendre compte objectivement de sa propre vie : c’est elle, et sa sauvegarde éventuelle par écrit, qui donne une réalité au « réel ». On retrouve la conscience individuelle comme fondement de la connaissance et de l’action. Mais le projet d’écriture conçu comme sauvetage de la vie individuelle a un présupposé qu’il faut examiner : l’individu n’existe pas à l’extérieur de lui-même, il n’existera plus à sa mort, et donc seule son œuvre d’écriture, biographique, le fera persister dans l’avenir. En effet, le personnage n’a à cet âge selon la narratrice plus de « sentiment d’avenir, cette sorte de fond illimité sur lequel se projetaient ses gestes, ses actes, une attente de choses inconnues et bonnes[124] ». Et les deux chapitres sans photo évoqués bien plus haut, qui encadrent le récit de vie (les chapitres à photo), expriment cette réduction de l’individu à sa vie intellectuelle. Le premier chapitre affirme que toutes les « images
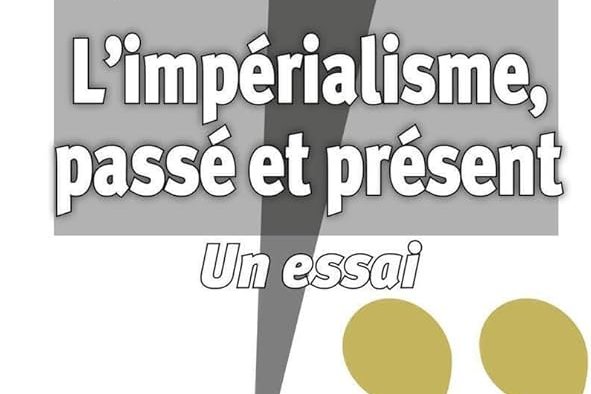
Reconsidérer l’impérialisme
Dans ce texte initialement paru dans la revue Traces (vol.62, no.3), l’historien Samir Saul cherche à produire une synthèse des grands débats entourant le concept d’impérialisme. Basé sur les résultats de son récent livre L’impérialisme, passé et présent (Éditions les Indes Savantes, 2023), l’article de Saul a pour objectif d’offrir une définition de l’impérialisme, sans pour autant s’enfermer dans un débat purement théorique. La question impériale est ainsi suspendue à un certain aléas des événements historiques. Ceci implique que, loin d’être une réalité figée, l’impérialisme se modifie selon les configurations historiques et les phases du capitalisme.
Samir Saul est professeur d’histoire à l’Université de Montréal. Il a co-rédigé avec Michel Seymour le livre Le conflit mondial du XXIe siècle (Éditions L’Harmattan, 2025).

Introduction
Comme concept, schéma explicatif et sujet de discussion, l’impérialisme était, il n’y a pas si longtemps, très répandu, voire surutilisé. Sans discontinuité, il a connu une belle fortune à la faveur de l’expansion coloniale du 19e siècle, des guerres mondiales du 20e siècle, de la diffusion du marxisme, de la décolonisation, puis de la lutte contre le sous-développement. De passionnants débats sur l’impérialisme et sur les lectures faites de ce phénomène étaient courants, des salles de classe aux conférences, et même sur la place publique. Sur le plan politique, l’impérialisme était le pain quotidien des marxistes et même de la gauche non marxiste.
Puis vint la crise économique systémique des années 1970 qui mit fin à la croissance continue des Trente Glorieuses. Le keynésianisme, l’interventionnisme de l’État dans l’économie et l’économie mixte ou concertée sont à bout de souffle. Alors même que se réalisent les prédictions des marxistes sur les tendances au fléchissement du taux de profit et à la stagnation économique sous le capitalisme, ils s’avèrent incapables de remplir le vide, se trouvant dépourvus de projet politique en prise avec la situation et accaparés par des luttes intestines, et parfois dans des disputes quasi théologiques sur des points de doctrine. L’ensemble de la gauche perd de son influence, recule et se marginalise. Paradoxalement, c’est le libéralisme, discrédité depuis la Dépression des années 1930, qui profite de la crise du capitalisme. Les années 1980 sont celles de l’offensive néolibérale qui reprend les positions perdues et vise à remettre à flot le capitalisme en misant sur le marché, l’endettement et la délocalisation de la production pour retrouver la rentabilité. La mondialisation devient la voie de salut et la libéralisation est mise de l’avant comme gage de la prospérité pour les pays développés et sous-développés.
Du coup, l’impérialisme est évacué du discours, y compris — fait à noter — de la gauche, ou de ce qu’il en reste. L’hégémonie idéologique du libéralisme et le discours idéaliste sur la mondialisation bénéfique à tous écartent le concept d’impérialisme, lequel tient compte de la domination, de l’exploitation et des conflits. Ainsi le vocable passe à la trappe, à telle enseigne que même des éléments se considérant de gauche ne le comprennent plus. Il se réduit aux Empires coloniaux du passé, lesquels sont démantelés par les décolonisations post-1945, ou à une « nouvelle histoire impériale », faite d’influences réciproques entre métropoles et colonies, entre centre et périphérie. Or, ces perspectives sur l’impérialisme s’apparentent à celle du libéralisme, ainsi qu’on le verra ci-dessous.
Passé de mode comme concept d’usage courant, l’impérialisme n’est pas moins une réalité tangible et observable à l’œil nu, tellement la domination, l’extraction de richesses, les rapports de force sur la scène internationale et la mise en place de systèmes internationaux de contrôle s’imposent à quiconque regarde même distraitement. Comment les expliquer ? Aseptisée, l’idée de la mondialisation écarte ces réalités. Les notions d’Empires et de colonies ne suffisent pas, d’autant plus que leur démantèlement n’a pas mis fin à ces phénomènes. Aux décolonisations a succédé une phase postcoloniale. De fait, l’impérialisme perdure, les Empires n’ayant été qu’un moment délimité de son histoire.
1. Historiciser l’impérialisme
D’où le recours au concept d’impérialisme, lequel englobe le colonialisme, tout en le dépassant. Mais la difficulté sur laquelle on bute est qu’aucune des interprétations existantes de l’impérialisme ne correspond pleinement à la situation. Aucune ne traite le présent, postcolonial, unipolaire, mondialisé. Toutes s’occupent d’une époque du passé. À l’aune de ces interprétations, il n’y aurait plus d’impérialisme, ce qui serait un non-sens vu la persistance de ses caractéristiques et de ses symptômes. L’obstacle est sérieux, car, sans une définition de l’impérialisme, il devient impossible de qualifier une situation, une relation ou une action d’impérialistes.
Par conséquent, il convient d’opérer un retour au concept pour vérifier ce qui peut en être récupéré. Cependant, le domaine est un univers foisonnant d’écrits, un terrain encombré d’interprétations contradictoires, issues du passé, surtout partielles, applicables à un cas, pas à d’autres, et encore moins au présent. Il faut revaloriser et actualiser le concept. De fait, c’est une nouvelle interprétation qui tienne compte du présent, tout en étant valable pour diverses époques, qu’il faut élaborer. On ne saurait se laisser égarer par l’équivalence établie entre l’impérialisme et le colonialisme ; ils sont à distinguer. Le colonialisme, autrement dit, les Empires coloniaux, n’est qu’une phase historique de l’impérialisme, une forme non dissimulée d’impérialisme. Reste la phase actuelle, postcoloniale et universelle, à prendre en compte.
Comment mettre à jour le concept ? Il est possible de se limiter à la théorie et d’essayer d’en tirer une autre théorie. Mais la démarche est circulaire et peut tourner à vide ou en vase clos. Mieux vaut remonter aux sources, aux faits historiques, passés et présents. L’entreprise – et c’est là où réside sa spécificité, voire son originalité – consiste à historiciser le concept impérialisme. L’intention est de produire une interprétation enracinée dans l’histoire. C’est le propos du livre récent dont le présent article est un abrégé[1].
2. Les théories existantes et leurs limites
Tout effort de reconstitution doit débuter par un bilan du savoir disponible, un tour d’horizon des contributions qui ont marqué la réflexion sur le thème de l’impérialisme. Favorables ou défavorables, une demi-douzaine de courants traite l’impérialisme, y apportant leur explication de ses causes, de ses forces motrices et de ses conséquences.
Au préalable, il importe de rappeler que le premier courant qui prône l’impérialisme apparaît avant l’utilisation du mot. Il s’agit du mercantilisme, un ensemble de prescriptions qui ont cours des 16e au 18e siècle, au moment où de nouveaux États dynastiques et territoriaux se mettent en place et se consolident en Europe occidentale. Les guerres sont récurrentes et les besoins pécuniaires pour payer les troupes sont un gouffre financier (lancinants). Le mercantilisme est bullioniste : il prône l’accumulation de métaux précieux, acquis par tous les moyens, dont un commerce extérieur toujours excédentaire (la différence entre exportations et les importations étant réglée par des rentrées d’or et d’argent). Porté vers l’autosuffisance dans une perspective de guerre, le pays doit viser à tout produire chez lui. Le mercantilisme est productiviste et protectionniste. Pour écouler sa production, il recommande l’acquisition de colonies comme formule pour se réserver des marchés à l’abri de la concurrence et comme lieu d’approvisionnement exclusif de produits primaires à transformer (ex. le sucre). La traite et l’esclavage sont des corollaires de cet impérialisme avant la lettre. Les Empires européens des 16e au 18e siècle sont régis par des principes mercantilistes.
Six grands courants abordent l’impérialisme explicitement. Le premier, le libéralisme, relève du mouvement historique d’affirmation des droits individuels contre l’autorité et la tradition. Son volet économique est l’économie politique classique qui se développe dès la fin du 18e siècle en Angleterre en particulier, mais en France aussi. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say en sont les chefs de file et les devanciers d’une longue lignée de successeurs. L’industrialisation de l’Angleterre consacre le magistère de l’économie politique classique, qui prend valeur de dogme. Le mot d’ordre est la liberté, y compris dans l’économie. Le libéralisme s’en remet au marché, à la liberté d’entreprise, au « laissez-faire », plutôt qu’à l’intervention de l’État. Il s’ensuit qu’il prend le contrepied du mercantilisme et le dénonce avec vigueur. La possession de colonies est critiquée, étant donné que l’ouverture des frontières tarifaires procure des marchés plus larges que les débouchés coloniaux. La pensée libérale est anti-impérialiste en principe. Pour elle, les Empires n’ont de motivations que politiques (nationalisme, soif de puissance, etc.). Ils sont une erreur économique, une méprise et un gouffre financier. Elle ne connaît pas l’exploitation économique. Toutefois, dans les faits, les pays libéraux ne s’interdisent pas de posséder et d’acquérir des colonies, en dépit de l’idéologie libérale dominante. Ainsi, les plus grands Empires appartiennent aux deux principaux pays libéraux, la Grande-Bretagne et la France. Une conception ayant peu de rapports avec le réel cesse d’être adéquate.
Le deuxième courant émerge en opposition à l’économie politique classique et son analyse voulant que les crises économiques se règlent d’elles-mêmes, que la demande et l’offre finissent par s’équivaloir, que l’appauvrissement se résorbe par l’extension de la production. Les critiques, dont Sismondi, rappellent que les acheteurs potentiels n’arrivent pas à consommer faute de pouvoir d’achat. La critique de ce courant sous-consommationniste est considérée comme « hétérodoxe », une hérésie par rapport à la sacrosainte économie politique classique. Pour ces contestataires, les maux dont souffre le capitalisme lui sont intrinsèques, pas passagers. Aux yeux de certains, par exemple les « réformateurs coloniaux », Paul Leroy-Beaulieu, Jules Ferry et Joseph Chamberlain, des mesures externes contre les crises sont à rechercher, notamment la réhabilitation des colonies. Soupapes pour les marchés métropolitains engorgés en l’absence de clients solvables, elles constitueraient des marchés réservés qui absorberaient les invendus, sans oublier que les pauvres pourraient y émigrer, réduisant le nombre de chômeurs et de bouches à nourrir, tout en éloignant le danger de révolution en métropole. Ce courant sous-consommationniste énonce en termes clairs l’intérêt économique des colonies. Pour la révolutionnaire Rosa Luxemburg, l’existence du capitalisme dépend de la disponibilité de régions sous-développées. Leur perte annoncerait sa fin. Le réformiste John Hobson pensait plutôt qu’il n’y aurait plus besoin de colonies si les marchés métropolitains étaient élargis par l’élévation du pouvoir d’achat. Hobson est le précurseur de John Maynard Keynes. Dans les faits, la possession d’Empires n’a pas prévenu les crises économiques et la hausse des revenus disponibles n’a pas rendu obsolète l’impérialisme. Le sous-consommationnisme est en décalage avec le réel.

À ses débuts, le marxisme, troisième courant, et le plus critique du capitalisme, ne se prononce pas sur l’impérialisme. Marx ne l’évoque pas, même si les Empires et « l’accumulation primitive » jouent un grand rôle dans la naissance du capitalisme. C’est à la fin du 19e siècle que les marxistes s’intéressent à l’impérialisme. Le social-démocrate Rudolf Hilferding observe la concentration du capital en Allemagne dans d’énormes sociétés mêlant l’industrie et la banque dans ce qu’il nomme « capital financier ». Le bolchevik Nikolaï Boukharine se focalise sur les affrontements internationaux de ces sociétés géantes, soutenues par leurs États respectifs. Comme Boukharine, Vladimir Lénine écrit durant la Première Guerre mondiale, que les deux comprennent comme une guerre interimpérialiste pour l’hégémonie mondiale. Lénine produit l’analyse la plus influente de toutes concernant l’impérialisme parce qu’elle traite tous les problèmes relatifs au sujet. Pour lui, l’impérialisme est le dernier stade du capitalisme avant l’avènement du socialisme. Ce stade suprême est celui de la prédominance du capital financier, selon la définition de Hilferding, et du repartage du monde par la guerre. L’analyse de Lénine devient celle du communisme international pendant des décennies en raison de sa construction cohérente et sa force explicative. Elle est si identifiable et répandue qu’elle tend à faire de l’impérialisme un sujet appartenant aux communistes. Opératoire pour la Première Guerre mondiale, elle l’est cependant moins sur d’autres points : le capital financier de Hilferding ne se retrouve vraiment qu’en Allemagne, les « monopoles » ne le sont pas complètement, l’idée qu’ils donnent lieu à un stade nouveau du capitalisme est problématique, le début de l’impérialisme au 20e siècle fait l’impasse sur le colonialisme des siècles précédents, etc. Enfin, l’évolution du capitalisme depuis 1917 appelle l’intégration de nombreuses transformations postérieures à Lénine.

Un quatrième courant, celui de l’« école de la dépendance », se focalise sur une des questions prioritaires de la période post -1945, à savoir le sort du « tiers-monde ». L’impérialisme était jusque-là étudié du côté des métropoles et des conflits entre elles. À la faveur des décolonisations, le regard s’étend sur le sous-développement du Sud, sa quête de développement Karl Marx en 1875, par John Jabez Edwin Mayall et les rapports Nord-Sud. L’idée commune voulant que l’impérialisme apporte le développement à des pays retardataires est rejetée. En réduisant les colonies à de simples compléments des métropoles, spécialisées dans quelques produits exportables, il aurait plutôt apporté le sous-développement et la dépendance. L’intégration au marché mondial serait antithétique au développement et à l’industrialisation. Il fallait s’en déconnecter pour avoir quelque espoir de s’extirper du sous-développement, ce qui va directement à l’encontre des prescriptions libérales. Partant de l’Amérique du Sud, les idées des dependentistas font le tour du monde, exerçant une forte influence dans les milieux universitaires et politiques, portées par le nationalisme anti-impérialiste des pays « en voie de développement ». Paul Baran, Harry Magdoff, André Gunder Frank, Arghiri Emmanuel et Samir Amin acquièrent une réelle notoriété. Si la part de vérité historique dans les analyses historiques de ce courant est incontestable, ses recommandations n’apportent pas les succès escomptés. La sortie du marché mondial n’est souvent pas possible pour les exportateurs de matières premières. Malgré la planification, le développement « autocentré » n’aboutit pas au développement, encore moins à l’industrialisation. Coup fatal : durant les années 1970, des pays de l’Asie de l’Est réalisent l’industrialisation par la voie de l’exportation et en pleine intégration dans le marché mondial. La clé est la présence d’un État fort qui veille à la cohésion de l’économie nationale et empêche sa désarticulation par les forces du marché, national et international. Dernière faiblesse de ce courant : son mutisme sur les pays du Nord et les rapports Nord-Nord. Une compréhension globale de l’impérialisme reste à atteindre.

Un cinquième courant, mettant l’accent sur l’action internationale du capital, renoue avec les analyses classiques, tout en les adaptant à la fin du 20e siècle. Il pallie ainsi aux manques du « dépendantisme » et éclaire des zones d’ombre. S’en prenant frontalement aux « dépendantistes », le marxiste britannique Bill Warren les accuse de nationalisme petit-bourgeois aveugle au rôle transformateur du capital que Marx avait souligné. À ses yeux, le capital international apporte le développement à des régions arriérées et ne doit pas être refusé par amour-propre. La charge est à fond de train et l’éloge du capital est tel que, sous couleur de marxisme, le propos se mue en reprise des idées libérales de modernisation par l’apport extérieur et l’imitation de l’Occident. Ce livre contribue au recul de l’« école », sans en être la raison principale. Pierre-Philippe Rey s’intéresse aux modes de production au sein des formations sociales des pays du Sud. Des modes de production différents — capitalistes et précapitalistes — peuvent coexister et s’articuler dans une même société. Enfin Christian Palloix explique comment s’internationalisent successivement les différents circuits du capital : capital-marchandises, capital-argent, capital productif. Cette conception de l’internationalisation du capital tend à ressembler à la mondialisation, à accorder au capital des métropoles le rôle moteur de la transformation du monde dans un mouvement unilatéral et unidirectionnel, et à laisser de côté l’impérialisme.
Le sixième et dernier groupe est hétéroclite, à l’image de la complexification de l’économie mondiale et de la moins grande lisibilité de l’impérialisme à l’ère de la mondialisation et de l’unipolarité étatsunienne. Marqués par le mondialisme et le postmodernisme triomphants, Michael Hardt et Antonio Negri, deux auteurs issus de la gauche, publient un pavé déconcertant qui reproduit les poncifs répandus par les chantres de la mondialisation : fin des États, monde homogénéisé et réseauté, Empire déterritorialisé et décentralisé, économie immatérielle, etc. La disparition des États, de la politique et de l’impérialisme sont des idées en vogue depuis l’offensive libérale des années 1980 et le pari fait sur la mondialisation néolibérale. Les affirmations des deux auteurs sont en phase avec le courant mondialisant, transnational, post- étatique qui règne sans partage au début des années 2000. Trois ans plus tard, il est rudement rappelé à la réalité par l’invasion étatsunienne de l’Irak. L’impérialisme « classique » et militarisé, l’hégémonisme traditionnel, l’État et la géopolitique se rappellent au bon souvenir du monde, balayant les rêveries et les spéculations idylliques sur un monde sans structures ou rapports de force. Aux commandes, les néoconservateurs parlent le langage désinhibé de la puissance militaire, rendu encore plus agressif par la démagogie sur la prétendue diffusion de la démocratie. La pensée sur l’impérialisme cherche désormais à (ré)intégrer le politique dans la mondialisation économique. C’est ce que font David Harvey, Helen Meiksins Wood et Alex Callinicos. D’autres, comme John Smith et Zak Cope, se refocalisent sur l’exploitation du Sud par le Nord à travers les délocalisations d’entreprises. Enfin, le thème fécond de la financiarisation de l’économie est développé par Pierre Chesnais, Michael Hudson et Costas Lapavitsas. Avancées appréciables, ces contributions laissent toujours pendante la question d’une interprétation d’ensemble de l’impérialisme dans ses composantes Nord-Sud et Nord-Nord, économique et politique, historique et actuelle.

3. Retour à l’histoire et reconceptualisation
L’impossibilité de se limiter à la théorisation disponible et la volonté de remonter à l’observation sans intermédiation du phénomène impérialiste commande d’esquisser un retour à l’histoire. L’histoire est appelée au secours de la théorie. La conception proposée de l’impérialisme par le livre est ancrée dans l’histoire. Il s’agit de l’élaboration d’une nouvelle interprétation de l’impérialisme, fondée sur une démarche historique. Avec l’histoire comme laboratoire de l’exercice, il est fait recours à l’empirisme comme approche et comme méthode de travail.
L’objectif est d’éviter une interprétation de plus qui soit valable pour un moment historique et pas pour un autre. L’intention est de repérer ce qu’il y a constant, récurrent à travers le temps, pour le phénomène impérialiste, sans ignorer les spécificités des époques. De l’Antiquité au Moyen-Âge à l’ère moderne à la période contemporaine, il y a un certain comportement qui représente ce qu’on pourrait comprendre comme l’impérialisme.
Il y a un besoin d’une définition qui concilie le phénomène général et ses manifestations particulières, et qui se prête à une périodisation selon les mécanismes propres à chaque époque, sans perdre son unicité. Par conséquent, il faut prendre un peu de recul et d’altitude pour recadrer (ou redessiner la grille de compréhension). Il importe d’articuler l’impérialisme, le colonialisme, et les Empires coloniaux.
L’exercice arrive à la définition suivante : l’impérialisme est un système de transferts économiques internationaux basé sur des moyens extra-économiques (principalement la force, la coercition politique et/ou militaire). C’est de l’appropriation (ou accaparement) économique sous pression non économique. Autrement dit, l’Impérialisme, c’est l’usage de moyens extra-économiques à des fins économiques. Ce n’est pas seulement des échanges et des relations économiques, même avantageux, mais un abus économique résultant de l’inégalité dans les rapports de force. Il a un caractère primaire, primitif, avec des modalités d’application qui se modernisent. C’est un comportement ancien, avec une mise en œuvre qui s’adapte au temps et au lieu.
Certains fils conducteurs se retrouvent à travers les époques :
- une ponction économique par des leviers non économiques,
- un passage de la rapine et du pillage primaires, bruts, non déguisés, à des systèmes plus complexes et voilés de siphonnage des richesses,
- certains modes d’accaparement privilégiés par chaque période historique, sans nécessairement rendre caducs les précédents.
Les deux points de repère dans cette l’analyse sont l’historicité de l’impérialisme (il est contextualisé) et la persistance de comportements primaires. Il y a autant continuité que de complexité croissante.
4. Les périodes
Les modèles impérialistes se succèdent chronologiquement, se complexifient et se déploient sur une échelle de plus en plus grande. L’analyse menée dans l’ouvrage identifie des périodes durant lesquelles l’impérialisme s’incarne dans des traits spécifiques et communs pour chacune des périodes. Quatre phases historiques émergent et sont présentées dans les quatre parties du livre. En bref, la phase ancienne s’apparente à un pillage non déguisé. Les deux suivantes, les plus connues, sont celles des empires coloniaux formellement constitués, sont tout aussi transparentes. Ces phases sont territorialement définies. L’actuelle, postcoloniale, est la plus voilée et pourtant la plus prégnante et la plus étendue sur le plan territorial, car universelle par vocation.
La première phase est celle de l’Antiquité et de ses prolongements dans l’ère médiévale. Elle recouvre les premiers États agricoles du Proche-Orient, de l’Inde et de la Chine. Les États de la Grèce ancienne et, surtout, l’Empire romain en sont des exemples aboutis. Des formes d’organisation étatique diverses, souvent éphémères, apparaissent suite à la disparition de l’Empire romain. L’impérialisme est dans sa préhistoire, primitif, élémentaire, rudimentaire, sommaire. Le transfert de la richesse s’effectue de manière primaire, par la force brute, sans l’intermédiation de mécanismes économiques. Il relève de la prédation et de la spoliation, du versement d’un tribut et comporte la quête d’une main-d’œuvre à réduire à l’esclavage. D’où le descriptif de cette phase comme étant celle de l’extraction coercitive.
Les deux prochaines phases couvrent l’ère moderne et l’ère contemporaine, soit un demi-millénaire du 15e au 20e siècle durant lesquels le capitalisme émerge et devient graduellement le mode dominant de production et d’organisation sociopolitique. Elles sont coloniales, c’est-à-dire que l’impérialisme s’y incarne dans des Empires coloniaux appartenant à des États, européens pour la plupart. Dans le cadre capitaliste, le pompage/siphonnage des richesses devient structurel et théorisé, notamment par les conceptions mercantilistes. Le centre de gravité se déplace vers l’Atlantique à partir de la « découverte » de l’Amérique et de l’essor des Empires ibériques. Suivront les Empires formés par les autres États de l’Europe occidentale qui étendront leur emprise petit à petit sur le monde entier et s’affronteront régulièrement pour s’imposer aux dépens des autres. L’impérialisme commercial est la première étape de l’impérialisme capitaliste. La recherche des métaux précieux, des épices, des produits tropicaux est effrénée. Les échanges sont forcés ; l’objectif est l’accaparement, le monopole et l’élimination de la concurrence ; le protectionnisme est la règle ; la traite et l’esclavage sont largement pratiqués comme méthodes pour générer revenus et profits. Le caractère structuré et contraint des transferts internationaux de richesses sous l’impérialisme colonial motive sa description comme étant celui de la captation par la force.
Propre à la période moderne (15e–18e siècles), cette description vaut aussi pour l’impérialisme de la période contemporaine (19e–20e siècles) qui est aussi la deuxième phase de l’impérialisme capitaliste. Au capital commercial s’ajoute désormais le capital industriel et son besoin de marchés plus larges pour les produits de la fabrication en masse. Le mercantilisme est abandonné et le protectionnisme desserré au profit de la liberté du commerce afin d’étendre les marchés étrangers, ouverts par tous les moyens, y compris les canonnières. Cette ère du libre-échange est censée élaguer les colonies et les Empires, car, selon les enseignements de l’économie politique classique, ils seraient trop étroits et coûteux à administrer. Or, il n’en est rien ; les Empires sont maintenus, voire agrandis. À la fin du 19e siècle, il y a même une ruée vers l’acquisition de possessions coloniales et l’apparition d’un néomercantilisme prônant le protectionnisme et les zones économiques réservées. Cette troisième phase, néomercantiliste, de l’impérialisme capitaliste ajoute, par l’exportation des capitaux, un volet financier aux objectifs commerciaux et industriels déjà établis. Durant cette phase, le monde entier se trouve partagé entre les Empires territoriaux d’une demi-douzaine de grandes puissances qui s’affrontent dans deux guerres qui entraînent l’implosion de l’impérialisme néomercantiliste.
La quatrième phase de l’impérialisme capitaliste débute après la Seconde Guerre mondiale. Elle est marquée par deux faits nouveaux. D’abord cet impérialisme est postcolonial parce que la décolonisation met fin à six siècles d’Empires coloniaux territorialement définis. Ensuite, une grande puissance, les États-Unis, surclasse toutes les autres et aspire à un impérialisme planétaire s’étendant au monde entier, englobant pays développés et moins développés, le Nord et le Sud. Cet impérialisme extrait les richesses de l’extérieur vers les États-Unis par l’exploitation d’une rente de situation, à savoir les privilèges associés au dollar. Les États-Unis ont la possibilité d’émettre de la monnaie en quantité quasi illimitée, sans tenir compte des règles élémentaires de l’économie, et de s’en servir pour importer des biens et services. Plus abstrait que le pillage d’autrefois, le transfert des richesses (de la valeur) emprunte la voie monétaire. L’absence de tutelle formellement reconnue, comme à l’ère coloniale, ne signifie pas la disparition de la coercition. Ce système est expansionniste par sa nature et tend vers l’absorption du monde entier. Le refus d’y être intégré équivaut à une contestation de la puissance hégémonique et entraîne un usage de la force se traduisant par des bombardements, des invasions ou des déstabilisations/changements de régimes. C’est pourquoi l’impérialisme postcolonial et planétaire actuel est caractérisé par l’incorporation contrainte.
Conclusion
Revisiter l’impérialisme répond à un besoin d’une notion qui permette de donner un sens à des phénomènes tangibles et persistants. La carence en la matière avait pratiquement évacué le terme impérialisme de la pensée ces dernières années. Y revenir exigeait un passage en revue des interprétations existantes, leur réévaluation et leur déconstruction. Était aussi nécessaire une extension à la période actuelle d’une analyse qui en était restée à des temps révolus.
Prendre en charge l’impérialisme dans sa globalité est un défi redoutable. Il ne peut être relevé par davantage de théorisation, sous peine de tourner en rond dans l’abstraction. Le parti est pris ici de fonder la reconstruction du concept sur l’histoire et de dégager une définition qui soit applicable sur toute la trame historique, sans pour autant négliger les conditions spécifiques à chaque époque. On dispose désormais d’un outil d’analyse utilisable pour le passé comme pour le présent.
Samir Saul
[1] Samir Saul, L’impérialisme, passé et présent. Un essai, Paris, Les Indes savantes, 2023.
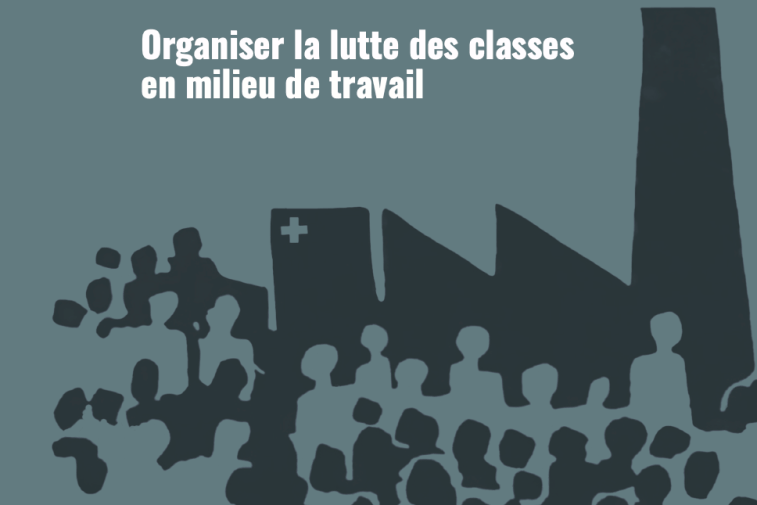
La revue Mobilisation et la lutte en milieu de travail : entrevue avec Guillaume Tremblay-Boily
Le tournant des années 1960-1970 est une période tumultueuse au Québec, qui voit naître de nombreux groupes ouvriers et révolutionnaires. Dans ce contexte, la revue Mobilisation (1971-1975) joue un double rôle de réflexion et d’organisation, faisant notamment la promotion de l’implantation en milieu de travail pour y organiser la lutte des classes. Cette expérience, aujourd’hui méconnue, propose une manière originale de rattacher les luttes politiques à l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. C’est pour la faire connaître que M Éditeur a récemment publié une anthologie des textes de Mobilisation portant sur cette pratique. Ces documents ont été sélectionnés et présentés par Guillaume Tremblay-Boily, auteur d’une thèse de doctorat sur l’implantation marxiste-léniniste au Québec dans les années 1970. Le collectif Archives Révolutionnaires l’a rencontré pour discuter de l’histoire de Mobilisation et de son intérêt dans le contexte des luttes contemporaines.
Entrevue réalisée par Alexis Lafleur-Paiement

Pour commencer, pourrais-tu me parler du contexte socio-politique des années 1960, puis de la Crise d’Octobre 1970 qui a ébranlé toute la gauche au Québec ?
À l’époque, on est dans un contexte de grande ébullition sociale, de grande mobilisation politique, militante, intellectuelle. La Révolution tranquille engendre un ensemble de réformes et de changements politiques. Il y a une montée en force du mouvement ouvrier et du mouvement syndical. À partir du milieu des années 1960, on voit une augmentation massive du nombre de conflits de travail. Il y a des grèves qui sont dures, les gens osent faire des grèves sauvages et débrayer pour de longues périodes. C’est un moment d’avancées pour le mouvement syndical. En parallèle, il y a une génération qui arrive à l’âge adulte et qui demande des transformations encore plus radicales, comme en témoignent les revues Parti Pris ou Révolution québécois.
Il y a aussi un foisonnement d’initiatives populaires, notamment à Montréal. Des comités de citoyens sont formés pour revendiquer toutes sortes de choses, comme la création d’un parc ou d’une école, le financement de coopératives d’habitation, etc. Ça marche assez bien, ils obtiennent souvent des gains, mais certains se demandent s’il ne faudrait pas être plus ambitieux, d’où l’idée de se transformer en Comités d’action politique (CAP). Éventuellement, l’idée émerge d’affronter le maire Jean Drapeau aux élections de 1970, lors des premières élections municipales au suffrage universel. C’est déjà quelque chose, parce qu’avant, les élections municipales étaient réservées aux propriétaires ! Donc, les Comités d’action politique, qui sont appuyés par la Confédération des syndicaux nationaux (CSN), s’unissent pour former le Front d’action politique, le FRAP. Le nouveau parti se présente aux élections, mais ça survient en même temps que la Crise d’Octobre, alors que le Front de libération du Québec (FLQ) a kidnappé deux hommes politiques et que l’armée canadienne occupe le Québec. Disons que le contexte est difficile pour la gauche… Jean Drapeau associe le FRAP au terrorisme du FLQ, ce qui lui nuit passablement. Pourtant, sans même présenter de candidat à la mairie, le FRAP obtient environ 18 % des voix. Mais les militants jugent que leur campagne n’a pas bien mar
Un grand débat éclate au sein du FRAP entre, d’une part, les gens qui croient qu’il faut poursuivre des campagnes de communication grand public, versus une autre tendance qui dit qu’il faut s’implanter dans les quartiers et dans les milieux de travail pour se lier à la classe ouvrière de manière organique. Ce sont des militantes et des militants de cette deuxième tendance qui vont former la revue Mobilisation. Ils sont donc issus des Comités d’action politique, ils ont des liens un peu avec le mouvement syndical pour cette raison, mais ils veulent aussi développer une relation plus directe avec les travailleurs, dans les quartiers et dans les usines.



Comment la revue Mobilisation émerge dans la foulée d’Octobre 1970 et quels sont ses objectifs ?
Les gens, à la fin des années 1960, les militants de gauche en général, ont une certaine sympathie pour le FLQ. Les militants sont très indépendantistes et ils appuient aussi un projet social. Lors de l’élection provinciale de 1970, le Parti québécois, qui affirme avoir un « préjugé favorable envers les travailleurs », obtient 23 % des voix. Par contre, il n’a que 7 députés sur 108 sièges… Cette distorsion amène beaucoup de militants et de militantes à conclure que le Parti québécois n’est pas une voie à suivre. Ils ne croient pas que le PQ peut prendre le pouvoir. Puis la Crise d’Octobre décime le mouvement de gauche, surtout à Montréal. Il y a plus de 500 arrestations et quelque chose comme 3000 perquisitions. Surtout, il n’y a pas de grande réaction populaire contre la répression. En résumé, on a une sympathie radicale, un blocage politique et une incapacité à résister à la répression lorsqu’elle se produit. Ça confirme l’analyse que beaucoup de militants faisaient déjà : que la gauche manque de structures pour s’organiser et pour réaliser un changement.
Plusieurs avaient l’impression d’être spontanéistes, de voguer de manif en manif sans construire quelque chose de solide et donc, d’être perçus par la population comme des activistes. Le sentiment s’installe qu’on manque de sérieux et de discipline. La Crise d’Octobre confirme qu’il faut être plus structuré et se doter d’organisations avec un programme, des membres, une stratégie, des objectifs à atteindre. Pour mettre en œuvre ce changement-là, les militants vont se tourner vers le marxisme qui apparaît comme une réponse au caractère dissipé des mouvements sociaux. En même temps, les gens vont de plus en plus débattre de la formation éventuelle d’un parti révolutionnaire, d’un parti communiste. Les militants vont s’implanter dans la classe ouvrière pour contribuer au développement de leurs organisations.
Les débuts de la revue Mobilisation sont caractéristiques de ce tournant. En fait, la revue a paru dans une première mouture en 1969-1970, comme organe du Front de libération populaire (FLP), une organisation activiste plus ou moins connectée au FLQ. À l’époque, le ton est complètement différent. On est encore dans une période où l’idée, c’est de multiplier les manifs, multiplier les occasions de contestation. Les gens du FLP participent à l’Opération McGill français, ainsi qu’aux émeutes de la Murray Hill, une compagnie anglophone qui détient le monopole du transport entre l’aéroport de Dorval et le centre-ville de Montréal. Lors des émeutes, il y a des gardiens de sécurité qui tirent sur les manifestants. Pierre Beaudet, un des fondateurs de Mobilisation, se retrouve à l’hôpital. Les militants commencent donc à se dire que ça suffit de juste aller de manif en manif, qu’il faut se doter de quelque chose de plus structuré. La Crise d’Octobre confirme ça. Quand la revue Mobilisation va renaître en 1971, elle a une autre idéologie, une autre apparence.
L’autre gros élément, c’est l’acquisition par Pierre Beaudet, André Vincent et d’autres camarades de la Librairie progressiste en 1972. Ils en font une sorte de pôle militant. Au sous-sol, il y a des presses et ils impriment le Petit livre rouge de Mao pour lequel ils ont obtenu les droits. La librairie devient aussi un lieu où tous les profs de cégep qui veulent mettre Marx ou d’autres penseurs communistes dans leur plan de cours viennent pour se fournir. Ça permet d’avoir des revenus, mais aussi de rencontrer des gens, d’avoir des discussions politiques. La Librairie progressiste vend toutes sortes de livres de gauche, avec une approche assez hétérodoxe. C’est dans ce contexte-là que la revue Mobilisation prend son essor. Dans le numéro 1, ils disent que l’objectif, c’est d’avoir une revue par et pour les militants, ils veulent que ce soit une revue de réflexion militante. Concrètement, ça va être un espace pour faire des bilans de pratique et débattre des meilleures approches de lutte.

À ce moment-là, c’est quoi au juste Mobilisation ? Pourquoi l’équipe de la revue met-elle de l’avant la tactique de l’implantation ?
Il y a une petite équipe, peut-être une dizaine de personnes. Chacune des personnes qui s’impliquent dans la revue est aussi associée à une autre organisation. On a Pierre Beaudet et André Vincent qui sont rattachés à la Librairie progressiste et qui impriment la revue. Il y a d’autres personnes qui viennent du CAP Saint-Jacques et du CAP Maisonneuve, qui sont encore actives au début des années 1970. Il y a des gens issus de l’Agence de presse libre du Québec (APLQ). Il y a aussi une collaboration avec les syndicats, surtout la CSN où on trouve plusieurs militants assez radicaux. Mobilisation se voit un peu comme l’organe de cette nébuleuse, alors que son équipe anime aussi des cercles de lectures marxistes et encourage les débats. Il y a des liens fraternels avec les premiers groupes marxistes-léninistes qui émergent, comme la Cellule militante ouvrière (CMO) ou l’Équipe du journal, qui va devenir EN LUTTE ! Les différents groupes de ce milieu partagent deux caractéristiques : l’adhésion au marxisme et la volonté de se lier davantage à la classe ouvrière.
L’idée de l’implantation, c’est donc de dire : comment on va mettre en contact les militants marxistes et la classe ouvrière ? Eh bien, d’abord en encourageant les gens à se trouver des jobs dans des milieux ouvriers. Et il ne faut pas juste avoir en tête les industries lourdes. Au départ, il y a deux secteurs d’interventions principaux pour les militants : les usines et les hôpitaux. L’idée d’aller dans les hôpitaux, c’est entre autres à cause du Front commun de 1972, durant lequel les infirmières et les préposées aux bénéficiaires, notamment, ont été vraiment combatives. Dans certains cas, il y a des militantes du Front commun, des syndiquées de la base qui ont dit : « Ben oui, venez travailler dans notre hôpital. Il y a de l’action, il y a des choses intéressantes qu’on peut faire. Il y a des gens mobilisés, qui sont prêts à se battre. » La jonction se faisait bien entre des travailleuses radicales et des militants marxistes. C’est comme ça que l’implantation a commencé. Et ça marchait simplement : des gens qui arrivent dans les usines ou dans les hôpitaux, qui commencent à travailler, ils apprennent tranquillement à connaître leurs collègues, à voir comment ça se passe dans l’endroit, à voir c’est quoi les rapports de pouvoir, qu’est-ce qu’on peut faire, c’est quoi le niveau de politisation des gens. Puis, au fil de leur acclimatation, ils finissent par se focaliser sur une lutte, un enjeu qui semble porteur.
Une des premières luttes à laquelle le groupe de Mobilisation participe, c’est l’usine de Rémi Carrier. Il n’y a pas d’implantés à proprement dit, mais les militants ont des liens forts avec les grévistes. La lutte, c’est pour syndiquer l’usine : un projet bien simple et bien concret, mais qui permet aussi de jaser de politique et même de révolution. Même chose à Saint-Michel où des militants s’implantent dans une petite usine de boîtes de métal pour essayer de la syndiquer. L’idée de Mobilisation, qui la distingue des autres groupes, c’est de dire qu’on ne peut pas juste arriver comme ça avec un discours socialiste tout fait, puis s’imaginer que les gens vont se rallier au socialisme. Ce qu’il faut, c’est mettre de l’avant des revendications concrètes puis les gagner. Obtenir des gains, c’est une manière de montrer la puissance collective, de montrer qu’on est capable de se battre, qu’on est capable d’être solidaire.
Justement, quelle est la pratique de Mobilisation, peux-tu donner des exemples ?
Souvent, le premier enjeu dans une shop, c’est que les travailleurs sont divisés. Le patronat instaure et profite de ces divisions-là. Donc, faire des luttes sur des choses concrètes, même parfois des choses toutes petites, c’est une manière de montrer qu’on peut être solidaires, qu’on peut travailler en commun. À travers ça, c’est déjà une préfiguration de nos capacités collectives et, pourquoi pas, du socialisme. À travers la lutte commune, on voit que c’est possible de travailler ensemble. L’idée d’une société où les gens travailleraient en commun, plutôt que d’être en compétition constante, apparaît déjà plus réaliste quand on a vécu la solidarité. D’autre part, la lutte est une occasion de politisation. C’est une occasion de jaser et de comprendre. Pourquoi le boss ne veut pas augmenter nos salaires ? Pourquoi le boss nous fait travailler à des cadences folles ? C’est à cause de la dynamique du capitalisme. C’est une occasion d’expliquer le capitalisme, comment ça fonctionne, puis comment on peut faire pour y résister. Les gens de Mobilisation parient sur le contact avec les travailleurs, contrairement aux militants qui restent aux portes de l’usine pour vendre leur journal. Cette méthode, ça ne marche pas tellement. Il n’y a pas énormément de monde qui va spontanément avoir le goût de lire un journal communiste.
Au contraire, si tu commences en parlant des besoins concrets des gens, tu peux tranquillement les amener à s’intéresser au socialisme et au communisme. Je reviens à l’exemple de l’usine de Saint-Michel, c’est intéressant. C’était un milieu non syndiqué, avec une quarantaine de travailleurs qui avaient une dizaine d’origines différentes, qui ne parlaient pas la même langue nécessairement. Il y en a beaucoup qui sont peu scolarisés, voire analphabètes. Dans ce contexte, c’est assez difficile de mettre de l’avant des idées plus abstraites comme le socialisme ou le communisme. Mais les militants s’implantent, tissent des liens avec leurs collègues. Ils réussissent à syndiquer la place et à mener une grève qui amène des améliorations significatives des conditions de travail. Tout ça en deux ans seulement. C’est un début prometteur, mais pour la suite, ça se complique. Il y a énormément de roulement. C’est souvent le cas dans les petites shops. Donc les militants ont l’impression que, finalement, ils n’ont pas réussi à construire une structure permanente, forte, qui peut persister dans le temps puis hausser régulièrement le niveau de politisation.
Ça amène les militants à délaisser les petites usines non syndiquées, pour aller plutôt vers des milieux plus gros qui sont déjà syndiqués. Dans ces milieux-là, ils vont pousser plus loin la combativité. Souvent, ils vont œuvrer à démocratiser le syndicat pour augmenter la participation et les revendications. Une pratique que les militantes et les militants adoptent souvent, c’est de créer un « journal d’usine » pour qu’il y ait une meilleure communication entre les travailleurs. On peut ainsi parler des problèmes de tous, discuter des luttes ou des enjeux actuels, et disséminer un contenu plus politique. Les enjeux de santé et de sécurité sont souvent pris en charge par les militants, car les protections sont très faibles ou même souvent inexistantes.


Nous avons abordé le contexte d’émergence de la revue et la pratique concrète de ses militants. Dans l’anthologie, tu parles aussi d’une « formule Mobilisation » qui lui permet d’élaborer une stratégie particulière. Peux-tu m’en dire plus ?
La « formule Mobilisation » consiste à prioriser la pratique puis à faire des bilans des tentatives concrètes pour en tirer des leçons. Par exemple, dans le cas de Rémi Carrier, les militants étaient en soutien à des travailleurs déjà en grève. Les militants étaient donc à « l’extérieur », ce qui s’est avéré plus ou moins fructueux. Les fois d’après, comme à Saint-Michel, ils se sont implantés pour lutter de l’intérieur. À partir de là, ils ont constaté qu’effectivement, être à l’intérieur, c’est plus efficace qu’être en soutien de l’extérieur. Cela dit, ils ont constaté qu’ils étaient complètement absorbés par la lutte syndicale et que c’était difficile de créer quelque chose de pérenne dans une petite place. La première leçon de la « formule Mobilisation », c’est se dire qu’il faut être à l’intérieur des milieux de travail, et que ceux-ci doivent être assez grands et déjà syndiqués, pour pouvoir radicaliser le syndicat et le rendre plus combatif. Comment on fait ça ? En formant des comités de travailleurs.
Les comités de travailleurs, c’est une manière de regrouper les gens combatifs dans un milieu de travail pour pousser plus loin la lutte dans ce milieu-là. L’idée, c’est que le comité n’est pas explicitement socialiste. Les gens s’y rallient parce qu’ils veulent pousser plus loin la lutte et la réflexion dans leur milieu de travail. Puis, le comité de travailleurs peut être en partenariat avec le syndicat ou critique du syndicat, selon les circonstances et les intérêts de la lutte. L’important, c’est que le comité de travailleurs demeure une instance où on peut jaser de politique, augmenter le niveau de conscience et de combativité, et d’avoir une base concrète à partir de laquelle s’organiser : une instance à soi. Concrètement, si notre syndicat est combatif et déjà mobilisé, le comité de travailleurs devient une sorte de force d’appoint, mais aussi une locomotive pour pousser plus loin, pour inciter le syndicat à être plus audacieux, plus ambitieux dans ses revendications. Si notre syndicat est corrompu, réactionnaire ou juste apathique, à ce moment-là, on peut être très critique du syndicat. Le comité de travailleurs, c’est la base des militants, qui s’adaptent alors au contexte, mais toujours dans le but de hausser le niveau de politisation et l’intensité de la lutte des travailleurs, de la lutte des classes.
Ça implique un travail d’observation, un travail de discussion avec les gens pour savoir ce qu’ils pensent, où ils se situent politiquement, c’est quoi les enjeux qu’ils vivent au quotidien, sur quoi on peut s’appuyer pour les mobiliser. J’ai parlé de Mao tantôt, et les gens de Mobilisation suivent un principe en particulier de Mao qu’on appelle « la ligne de masse ». Selon cette idée, il faut toujours partir de la situation concrète des gens, en s’assurant de ne pas être déconnecté à cause d’un discours trop radical, mais sans être à la remorque des moins combatifs non plus. Donc, peu importe d’où tu pars, ton objectif, c’est d’assumer la situation, puis d’emmener les gens vers l’avant, une étape à la fois. Il faut être un pas en avant des masses, et non pas dix pas en avant, ni un pas en arrière. Cette stratégie est complétée par le principe de partir des idées des masses, de les synthétiser, de les reformuler, puis d’en faire des propositions politiques claires, puis de les retourner aux masses. Le niveau de conscience vient alors de monter et tu peux lutter à un niveau plus élevé. C’est ça le vrai leadership, c’est comme ça que tu restes connecté aux gens, mais que tu es aussi une force pour les amener progressivement plus loin dans le combat.
Par exemple, si tout le monde est fâché par tel produit toxique qui cause des maux de tête, puis qui engendre des maladies respiratoires dans l’usine. On voit que tout le monde est affecté par ça, puis que ça choque, ça dérange, mais il n’y a personne qui a organisé de lutte là-dessus. Bien, l’approche de Mobilisation, ça va être de s’emparer de cet enjeu-là et de mener une lutte là-dessus. Puisque justement ça part d’un besoin réel, ça mobilise, ça motive les gens. Et pendant la lutte, tu peux mettre en évidence que le patron et les employés n’ont pas les mêmes intérêts, vu que le patron est prêt à empoisonner ses employés pour faire du profit. Tu ouvres la porte à une prise de conscience des ouvriers, et tu ouvres la porte à une lutte plus politique.
Un des exemples qui est abordé dans la revue, dans l’anthologie, c’est la lutte contre la silicose à la Canadian Steel Foundries, qui est une énorme usine dans l’Est de Montréal, une des plus grosses fonderies au Canada. C’est aujourd’hui l’endroit où il y a le projet de Ray-Mont Logistiques, donc encore un lieu de lutte, mais sous une autre forme. Les implantés qui sont sur place ont fait passer des tests pour la silicose à tous les employés. Ils se sont rendu compte qu’au moins le quart des ouvriers et ouvrières de la CSF étaient affectés par la silicose. Ç’a servi de base pour organiser une grève sur cette question-là, une grève sauvage pour le droit à la santé. Le combat a été un succès tactique, ils ont obtenu des gains en santé et sécurité au travail, et aussi un gain politique, avec un niveau de conscience plus élevé et une combativité plus grande.
La « formule Mobilisation » comprend aussi deux éléments indissociables, l’enquête et le bilan. Qu’est-ce qu’on entend par là et pourquoi est-ce important ?
La pratique des enquêtes est au cœur de la pratique de Mobilisation en tant que revue militante. Le travail d’enquête c’est, quand on s’installe dans un milieu, de vraiment prendre le temps de comprendre ce milieu. Sur le plan des relations humaines, il faut voir qui est ami avec qui, et au contraire qui a des tensions avec qui, comment les gens sont divisés ou pas dans leur milieu. Au niveau des relations économiques, l’enquête porte sur plusieurs niveaux. Par exemple, c’est quoi les départements les plus stratégiques ? Quel département va être un goulot d’étranglement si on le bloque ? Puis au niveau des relations économiques, comment l’entreprise en question s’inscrit dans le capitalisme plus largement ? Qu’est-ce qui va se passer si la production s’arrête ? Est-ce qu’ils vont pouvoir délocaliser ou fermer l’usine ? Est-ce qu’ils vont fermer tel département ? Tout ça, c’est important pour savoir comment on peut agir dans un milieu. Il y a toujours ce souci de bien comprendre le milieu, puis de discuter avec les gens pour mieux les connaître, pour créer des liens, mais aussi pour vraiment bien saisir la situation. C’est une enquête qualitative autant que quantitative. L’enquête a lieu surtout avant et pendant l’intervention.
L’autre aspect de leur travail, c’est celui du bilan qui vient après coup, à la fin d’une campagne. La revue Mobilisation publie souvent des dossiers sur leurs interventions, qui comprennent leurs éléments d’enquête, leurs réflexions pendant l’opération, puis un bilan des bons et des mauvais coups. C’est une sorte de synthèse de l’ensemble des phases d’une lutte. Au début, on va décrire le milieu de travail, ensuite on va montrer comment on est intervenu dans ce milieu, puis finalement discuter des résultats obtenus, qu’est-ce qui a marché, qu’est-ce qui n’a pas marché. Le bilan de pratique est vraiment intéressant pour faire la différence entre les erreurs tactiques et les limites plus structurelles de l’action. Les erreurs tactiques, ça peut être d’avoir fait des tracts trop jargonneux, d’avoir distribué des textes trop difficiles à lire, ou ça peut être de ne pas avoir formé dès le départ un comité d’orientation pour mener une grève. C’est une erreur classique, le manque de planification, d’avoir juste vécu la grève au quotidien sans vraiment réfléchir aux étapes suivantes et aux ressources nécessaires.
Les réflexions plus structurelles, ça va être ce que je disais tantôt sur le fait que les petits milieux de travail ont trop de roulement, donc on décide de s’orienter vers des milieux de travail plus grands. Ou le fait qu’on s’est trop collé sur la lutte syndicale, puis qu’on s’est même trop collé sur l’exécutif syndical, donc qu’on a été absorbé par leurs préoccupations et par leur vision politique réformiste. Les lieux d’intervention, le suivisme syndical, ce sont deux enjeux stratégiques pour les révolutionnaires. Au milieu des années 1970, les organisations marxistes-léninistes vont souligner ce problème-là, qu’ils nomment l’économisme, c’est-à-dire de trop se concentrer sur les luttes salariales et de ne plus se projeter dans un horizon révolutionnaire. Ça va contribuer à la dissolution de Mobilisation dont les membres se sont affirmés de plus en plus comme marxistes-léninistes.

À ce sujet, peux-tu me parler du débat sur l’économisme, et des tensions entre les luttes en milieu de travail et la lutte révolutionnaire ? Comment cela affecte les membres de Mobilisation ?
En fait, les gens de Mobilisation sont très réceptifs à la critique de l’économisme qui est faite par l’organisation EN LUTTE ! et son dirigeant Charles Gagnon. Les gens de Mobilisation vont progressivement accepter la critique de l’économisme, à savoir qu’il ne faut pas centrer la lutte sur les enjeux salariaux et économiques. Par contre, ils vont continuer de défendre l’implantation comme moyen de se lier à la classe ouvrière. La difficulté, c’est de trouver l’équilibre entre le fait de s’implanter, de partir des situations concrètes des gens, et de mener réellement la lutte à un niveau plus élevé, la lutte pour le socialisme. Les deux voies contraires sont incarnées par deux organisations de l’époque. D’un côté, EN LUTTE ! se concentre vraiment sur la diffusion idéologique, avec parfois des difficultés à connecter avec la classe ouvrière. D’un autre côté, le Regroupement des comités de travailleurs (RCT) est très implanté dans les milieux de travail, mais il a tendance à se contenter de luttes sectorielles, et même à faire du suivisme syndical. En 1975-1976, une nouvelle organisation va proposer une voie originale qui rattache l’idéologie communiste avec la pratique en milieu de travail. C’est la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada, qui va devenir plus tard le Parti communiste ouvrier (PCO).
La Ligue va mettre de l’avant l’idée qu’on fait des luttes sur des revendications concrètes, mais on a une cellule communiste dans l’usine qui s’assure que le combat se mène toujours dans une direction révolutionnaire. C’est aussi la conclusion que va faire Mobilisation et la majorité de ses membres va rejoindre la Ligue. En pratique, ils continuent avec la même logique d’implantation, mais en insistant plus sur la nécessité de diffuser la pensée marxiste-léniniste, d’avoir toujours la pensée marxiste-léniniste comme cadre d’action. Pour les membres de Mobilisation, il n’y a pas un gros changement organisationnel qui se fait. Ils arrêtent de publier leur revue, font un bilan critique de leur action (surtout les éléments économistes et parfois suivistes), puis ils entrent collectivement dans la Ligue. Leur expérience est la bienvenue et leur nouvelle organisation profite de leurs connaissances. L’implantation va rester un élément majeur de la pratique de la Ligue jusqu’à sa dissolution en 1983.
L’ancrage plus politique se fait, comme je disais, autour de la cellule communiste d’entreprise. On a un noyau d’implantés qui sont communistes et qui gèrent une cellule dans leur entreprise ou leur hôpital. Eux, ils sont membres de la Ligue, ils ont des rencontres politiques à l’extérieur et ils cherchent à ramener leurs idées dans leur milieu de travail. Et autour d’eux, ils constituent un cercle militant, des gens qui ne sont pas nécessairement communistes, mais qui sont prêts à mener des luttes. La cellule communiste planifie et dirige le travail, avec leur cadrage idéologique, mais toujours en se basant sur des enquêtes, en partant des situations concrètes et en étant sensible aux enjeux de tel ou tel milieu. Ils font des bilans et ils essayent de s’améliorer. Roger Rashi, qui dirigeait la Ligue communiste, m’a dit qu’il considérait que son organisation a réussi à faire la synthèse dialectique entre l’approche d’EN LUTTE ! et celle de Mobilisation, entre l’idéologie et la connexion avec la classe ouvrière. Je pense qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais d’un autre côté, avec la Ligue, il y a aussi une diminution de l’ancrage local. Les militants se mettent à distribuer La Forge au lieu d’un journal d’usine ou d’hôpital, donc le discours n’est pas toujours aussi bien adapté au contexte.
Un dernier élément peut-être sur la fin de Mobilisation, c’est que la Ligue n’est pas si grosse en 1976, quand elle absorbe Mobilisation. Elle a peut-être 200 membres, et tout le monde qui viennent de l’entourage de Mobilisation, c’est rendu 100 ou 150 personnes. Et surtout, le monde de Mobilisation, ce sont des implantés, des militantes et des militants chevronnés, qui ont de l’expérience et du leadership dans leur milieu de travail. Cette influence de Mobilisation sur la Ligue communiste, elle compte beaucoup. L’absorption de Mobilisation explique aussi, en partie, le fait que la Ligue devient la principale organisation marxiste-léniniste à ce moment-là.

J’aborderais finalement l’anthologie que tu viens de publier chez M Éditeur (automne 2025). J’aimerais t’entendre sur sa composition. Comment toi et l’équipe éditoriale avez choisi les textes ? Qu’est-ce qu’ils apportent dans le contexte actuel ?
On a choisi essentiellement les textes qui abordent l’implantation, notamment les bilans qu’ils ont faits de différentes luttes, en laissant de côté les textes plus théoriques ou ceux sur les enjeux internationaux. Des fois, c’était par exemple une republication d’un texte de Lénine ou d’autres penseurs marxistes. Puis, il y avait des textes sur la situation dans différents pays, sur la Chine ou sur l’Angola, ou sur les grèves aux États-Unis. Souvent, c’était des traductions de textes qui avaient été publiés dans d’autres revues comme la Monthly Review ou des textes qui venaient de la France, donc toutes sortes de choses. Ces textes sont intéressants, mais on estimait qu’ils étaient moins informatifs pour nous, souvent trop généraux ou éloignés des enjeux québécois.
On a mis de l’avant les textes concrets qui peuvent être utiles pour des militants aujourd’hui. On voulait quelque chose qui serve les personnes qui se posent des questions sur leur tactique et leur stratégie. Pour moi, le problème qui se posait à l’époque et qui justifiait de s’implanter, il se pose encore aujourd’hui. Ce problème, c’est le fait que les gens de gauche n’ont pas assez de liens concrets avec les ouvrières et les ouvriers. Que la gauche est parfois dans l’entre-soi et qu’elle a de la misère à rejoindre les travailleurs. Construire des liens entre militants et travailleurs, c’est hautement pertinent si on veut gagner, si on veut que nos idées et nos mouvements progressent. Il faut qu’on puisse rejoindre des gens en dehors de nos cercles pour obtenir un socle, pour instaurer un rapport de force contre les grandes industries ou l’État-employeur.
Un problème auquel on fait face aujourd’hui, c’est que les mouvements sociaux, parfois assez forts, demeurent populaires seulement dans certains secteurs de la population. On a de la misère à figurer des luttes qui recevraient l’appui d’une majorité de travailleurs, comme dans les années 1970 lorsque des grévistes affrontaient le gouvernement Bourassa ou United Aircraft. Aujourd’hui, beaucoup de gens se tournent vers la droite et l’extrême droite. Si on veut contrer ça, il faut créer des liens avec les gens, et donc apprendre à les connaître et gagner leur confiance. Ça se fait entre autres dans les milieux de travail et dans la lutte, c’est là que la solidarité et la politisation se produisent. Si on s’organise avec eux et avec elles autour de luttes concrètes qui les concernent et qui améliorent réellement leurs conditions, ces gens-là vont se rallier à des idées de gauche. C’est mon pari et celui de l’éditeur. On espère proposer une voie pour rapprocher la gauche et les travailleurs, et donc, une stratégie pour arrêter l’hémorragie de droite. Pour reprendre l’offensive collectivement contre nos vrais ennemis, le patronat et ses pantins. Si des gens peuvent reprendre la stratégie de l’implantation et porter des pratiques de gauche dans les milieux de travail, on sera mieux outillé collectivement pour lutter contre la droite et pour construire un avenir égalitaire.

Le CACV : 50 ans de luttes à Verdun
Cette exposition a été préparée par Archives Révolutionnaires et le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun. Elle a été présentée pour la première fois le 19 septembre 2025, à l’occasion du 50e anniversaire du CACV.

















