Derniers articles
L’État d’urgence en Nouvelle-Calédonie : une population divisée
Déclaration Urgence Palestine : exigeons des sanctions contre Israël !
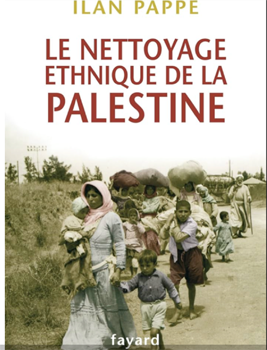
Censure d’un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza !
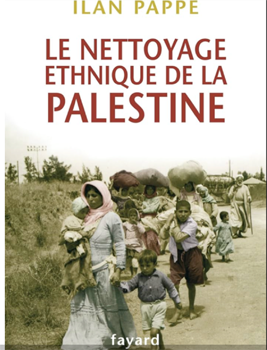
« Ce livre n'est plus disponible à la vente » : voilà l'indication sur le site de la maison d'édition Fayard (1) concernant cet ouvrage d'Ilan Pappé, célèbre historien israélien critique (2), publié en français en 2008. Ainsi, il n'est désormais plus disponible ! Parue initialement en anglais en 2006 (3), l'étude analyse la fondation de l'État d'Israël en 1948 et la catastrophe qu'elle entraîne pour le peuple palestinien.
Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 159 | 2024, 133-142.
https://journals.openedition.org/chrhc/23377
Une solide enquête d'Hocine Bouhadjera dans ActuaLitté (4), magazine littéraire en ligne, rend publique cette décision. Fayard justifie sa décision par un argument juridique : « le contrat était caduc depuis le 27 février 2022. La maison a donc acté, le 3 novembre dernier, sa fin d'exploitation ».
Ne disposant plus d'exemplaires, Patrick Bobulesco, célèbre libraire du Point du Jour à Paris, cherche à en commander sur Dilicom. Il découvre que l'ouvrage est en « arrêt définitif de commercialisation ». Le site ORB confirme que le livre est désormais épuisé en raison de l'arrêt de sa commercialisation depuis le 7 novembre 2023. « Craignant une censure », Patrick Bobulesco contacte par mail Isabelle Saporta, directrice de Fayard. Il explique l'importance de cette étude pour la compréhension des enjeux au Proche-Orient, qui émane d'une « voix érudite, mais non consensuelle ». Dans sa réponse, la responsable de la maison d'édition évoque « une pression croissante pour limiter l'expression de “voix discordantes” en France ».
Étrange et inquiétante situation, alors que l'intérêt pour le Proche et le Moyen-Orient est très important avec la tragique actualité. Hocine Bouhadjera précise que le « Que sais-je ? » Les Origines du conflit israélo-arabe (1870-1950) est en tête des ventes dans la catégorie « Essais et documents », loin des propos de « nos biens connus éditorialistes de plateaux télévisés, ou le jour et la nuit (5)... ».
Un historien israélien engagé désormais en exil
Né en 1954 à Haïfa, Ilan Pappé appartient aux « nouveaux historiens israéliens », ensemble hétéroclite de chercheurs qui réexaminent de façon critique l'histoire de l'État d'Israël et du sionisme, en particulier les conditions de sa création en 1948, le déplacement des Palestiniens, les politiques et les stratégies des dirigeants sionistes et israéliens (6). Ils rompent avec le discours dominant affirmant qu'en 1948 le « départ » des 750 000 Palestiniens environ correspond à une fuite suivant les consignes de dirigeants arabes.
Ces différents travaux iconoclastes reposent sur des archives britanniques et aussi israéliennes. Ils démontrent que la fuite des Palestiniens est avant tout le résultat du conflit de 1948 et d'opérations militaires israéliennes. Outre Ilan Pappé, les figures les plus connues sont Benny Morris, Avi Shlaïm, Simha Flapan ou Tom Segev (7).
Enseignant à l'université de Haïfa, membre un certain temps du Parti communiste israélien (8) Ilan Pappé va subir de violentes attaques autour de ses recherches historiques et de positions publiques. On mentionnera en particulier l'affaire « Tantura/Katz » : Teddy Katz consacre un mémoire de maîtrise à l'université de Haïfa au massacre du village palestinien de Tantura en 1948 ; ses travaux entraînent une virulente bataille avec des postures politique, médiatique et judiciaire (9) ; Ilan Pappé le soutient.
Ses différends avec des historiens de l'université de Haïfa s'approfondissent, en particulier avec Yoav Gelber et Benny Morris. À la racine de cette hostilité se trouvent ses analyses du départ des Palestiniens produit d'une épuration ethnique planifiée par les dirigeants du mouvement sioniste avant la guerre de 1948.
Ses options très critiques entraînent des réactions très hostiles. Il se déclare favorable à la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) (10) des universités israéliennes. Cette campagne promeut le boycott de l'État d'Israël dans les domaines académique, économique, culturel et politique. Très sévère sur le processus de paix, sa nature et ses limites, il caractérise comme « résistance » les actions du Hamâs (11) (« ferveur, zèle » en arabe et acronyme partiel de ḥarakaẗ ʾal-muqāwma ʾal-ʾislāmiyya, Mouvement de résistance islamique) contre l'occupation israélienne et définit la politique de l'État d'Israël comme « génocide » à Gaza et « nettoyage ethnique » en Cisjordanie.
Finalement, en 2007, devant la virulence des échanges et les procédures engagées contre lui, il part en Grande-Bretagne (12). Désormais, il enseigne à l'université d'Exeter et dirige le Centre européen d'études sur la Palestine.
Un livre sulfureux et dérangeant pour le mythe de 1948
Son étude est consacrée à la création de l'État d'Israël en 1948. Cet épisode, tragique et décisif, est désigné par les Palestiniens comme la Nakba (catastrophe ou désastre). Ce terme, employé au départ par Constantin Zureiq en 1948, s'est ensuite généralisé (13). La recherche s'appuie en particulier sur des archives sionistes, notamment celles de la Hagannah (14), des archives britanniques, la presse, des documents personnels, des témoignages.
Examinant le départ des Palestiniens entre 1947 et 1948, il démontre comment la fondation de l'État d'Israël repose sur l'expulsion de la population arabe, selon une politique de nettoyage ethnique organisée par les dirigeants sionistes (15). Son approche est aux antipodes de l'idée diffusée de l'accident dans le contexte d'un conflit armé. Bien avant le conflit, les responsables sionistes comprennent que la réalisation de leur projet fait face à la présence palestinienne. Le « transfert » de la population arabe n'est donc pas le produit des circonstances, mais est bien un élément clé du projet sioniste. De la fin 1947 à 1948, une politique volontaire d'expulsion et de destruction est donc mise en œuvre dans les villages et les villes de Palestine.
Fin 1947, l'ONU adopte un « plan de partage (sic) ». La Palestine compte alors un million huit cent mille habitants environ, avec un tiers de juifs et deux tiers d'Arabes. La résolution 181 décide de la partition en deux États. Un premier État est très majoritairement peuplé d'Arabes et dans le second État, les juifs seront légèrement majoritaires. La ville de Jérusalem et ses alentours sont placés sous contrôle international et relèvent d'un statut international particulier (16). D'un point de vue « qualitatif » (terres agricoles, ressources, zone désertique, accès aux côtes), ce « partage » est au détriment des Palestiniens.
L'État d'Israël qui émerge après la victoire des groupes armés sionistes en 1948 comprend une très forte majorité juive sur 78 % du territoire de la Palestine. Plus de 400 villages arabes sont détruits, de nombreuses villes sont vidées ou quasi vidées de leur population arabe. Environ 750 000 Palestiniens se retrouvent réfugiés hors de Palestine (17), ayant fui en raison des peurs, intimidations et violences. Le nouvel État « juif » comprend une substantielle minorité arabe de 160 000 personnes, des Palestiniens restés sur place.
Un contexte particulier
La décision de ne plus diffuser ce livre survient dans le contexte de la guerre à Gaza, à la suite de l'opération armée de l'organisation nationaliste intégriste Hamâs le 7 octobre 2023 contre des cibles militaires et des villages de civils au sein de l'État d'Israël.
En France, les autorités gouvernementales, les principales forces politiques et les grands médias affirment alors un large et inconditionnel soutien à l'État d'Israël et à Benjamin Netanyahu, à la tête d'un gouvernement de coalition d'extrême droite. Souvent avec véhémence, cet appui prend la forme de la diabolisation et de la condamnation de toute posture ou analyse différente ou critique. Quelques exemples de ce climat quasi maccarthyste : l'injonction généralisée de « la » question « condamnez-vous le Hamas comme terroriste ? » ; l'emploi systématique du terme Tsahal ; la généralisation de la prononciation hébraïque de Hamas avec un [KH] comme la jota espagnole ; le recours, pour justifier l'attaque israélienne contre Gaza et sa population, à l'argument du « droit à se défendre », pourtant inexistant en droit international… On pourrait en citer de multiples autres exemples.
La tenue de manifestations contre l'opération militaire israélienne qui touche les civils gazaouis est devenue très difficile et l'objet de batailles juridiques pour empêcher les interdictions. Tout cela se déroule dans un climat médiatique qu'on qualifiera d'« hystérique », à défaut de trouver un meilleur terme, et apologétique avec la reprise des éléments de langage et des analyses israéliennes, même les plus éculés.
Le virulent concert de refus de toute voix différente a entraîné de vicieuses et nauséabondes campagnes, en particulier contre les rares organisations politiques françaises comme LFI ou le NPA, qui ne s'inscrivent pas dans cette logique, avec différentes accusations : apologie du terrorisme ; agents du Hamas et/ou de l'intégrisme ; antisémitisme ; responsabilité des violences contre des juifs en France... L'ancien Premier ministre de droite Dominique De Villepin a aussi subi les foudres des « zélés démocrates » pour avoir dénoncé les médias et leur traitement orienté des développements au Proche-Orient.
Deux épisodes méritent d'être mentionnés. Le 6 décembre 2023, la conférence de la chercheuse états-unienne Judith Butler, intitulée « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine », est annulée par la Mairie de Paris en raison de « risques de troubles à l'ordre public » et la possibilité de « dérapages » dans les discours ! Une militante palestinienne du FPLP, Mariam Abu Daqqa, a non seulement vu son invitation à parler dans une réunion au sein de la Chambre des députés être annulée par la présidente du Parlement, mais elle a été arrêtée et expulsée. Avec en plus une vaste campagne médiatique sur la nature terroriste de son organisation et ses liens avec LFI.
Un étrange double langage est alors apparu, surtout si l'on compare avec l'Ukraine. Dans ce cas, les violences contre les civils et les infrastructures de la société ont toujours été dénoncées, mais non dans le cas de l'attaque israélienne contre Gaza... La tour Eiffel a été éteinte puis illuminée aux couleurs de l'État d'Israël le lundi 9 octobre 2023 en soirée, mais rien pour les Palestiniens malgré les intenses bombardements qui frappent essentiellement les civils gazaouis.
Le champ académique n'est pas épargné par cette fièvre qui affecte la société française. Plus de 1 300 chercheurs et universitaires dénoncent dans une tribune « intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique au sein des universités depuis les événements dramatiques du 7 octobre » et « un climat de menace qui engendre peur et autocensure, au détriment de la libre expression ». Dans certains cas, on parle de censure (18). « Le climat de pressions et d'intimidations » concerne les chercheurs français travaillant sur la Palestine et le monde arabe (19), avec, en particulier, une stigmatisation des défenseurs d'analyses critiques ou en rupture avec le discours dominant.
L'offensive Bolloré dans le secteur du livre, contexte et enjeux
Loin d'être un acte anodin, ce retrait des ventes du livre d'Ilan Pappé, qui représente une forme de censure, s'inscrit dans un contexte d'une vaste offensive idéologique réactionnaire. Cela se déroule aussi dans un moment particulier pour le marché du livre et de l'édition en France. Si ce marché se porte bien, il est en plein bouleversement (20).
Bolloré doit cependant céder le groupe Editis sous la pression de Bruxelles.
La prise de contrôle par Vincent Bolloré en 2022 du groupe Hachette va entraîner la constitution d'un mastodonte de l'édition (21). Au départ, Arnaud Lagardère fait appel à Bolloré pour préserver sa place à la tête de son groupe en difficulté, mais ce dernier va en faire la conquête.
Personnage important du capitalisme et du grand patronat français contemporain (22), Vincent Bolloré défend aussi des conceptions politiques catholiques intégristes et des options conservatrices et réactionnaires. Malgré ses dénégations, il affirme progressivement un véritable projet politique (23), qui comprend le rapprochement des droites et de l'extrême droite (24).
Industriel au départ, son empire s'implante de plus en plus dans les médias avec « la stratégie de l'araignée (25) », selon l'expression de Rosa Moussaoui. Sa présence est ainsi substantielle dans la radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio), la télévision (groupe Canal+, CNews, CStar et C8), la presse (Journal du dimanche, Paris-Match, France catholique) et Prisma Media (Voici, Gala, Géo, National Geographic, Capital, etc.), le cinéma (Studiocanal, production, acquisition, distribution), le jeu vidéo (Gameloft, premier éditeur mondial de jeux vidéos pour mobiles), la musique (Vivendi Village, organisateur de festivals de musique, propriétaire de salles à Paris, notamment le mythique Olympia). Ajoutons la publicité (Havas), la vente de billets électroniques avec See Tickets, anciennement Digitick, leader mondial, et des parts chez Universal ou Dailymotion.
Dans le secteur de la télévision, la chaine CNews et la radio Europe 1 sont les principaux organes de diffusion de ses conceptions. Cyril Hanouna occupe une place d'importance, véritable « chef de meute pour Bolloré (26) » suivant la formule de Julia Hamlaoui, « avatar populaire de l'idéologie d'un milliardaire (27) ».
Cet empire médiatique participe activement à la diffusion de thèmes et d'analyses ultraréactionnaires. Son orientation générale est marquée par un nationalisme chauvin, une xénophobie, une haine de l'islam, souvent sous couvert d'anti-intégrisme, une défense d'une « authenticité française » dans la lignée du Puy-du-Fou. Depuis le 7 octobre 2023 s'affiche une virulente ligne de soutien inconditionnel à l'État l'Israël et à Benyamin Netanyahu. Cette ligne sur fond islamophobe reprend le thème de « la guerre des civilisations », ressortant de la naphtaline l'opuscule de Samuel Huntington (28). Pour une critique du traitement médiatique par les principaux médias, au-delà du groupe Bolloré, nous renvoyons au site ACRIMED (29).
Les enjeux au sein des métiers du livre sont multiples. La prise de contrôle du groupe Lagardère, propriétaire d'Hachette-Livre, représente « un moment angoissant », car ce « véritable tsunami » engendre de graves inquiétudes chez Antoine Gallimard, patron des éditions Gallimard, avec la pénétration des secteurs parascolaire, scolaire et du livre de poche, désormais largement sous l'emprise de deux géants, Hachette et Editis (30).
Ces bouleversements ne se cantonnent pas à la seule sphère économique, mais représentent également de véritables enjeux démocratiques avec les dangers d'ingérence idéologique et de censure. En prenant pied à cette échelle dans ce secteur, Vincent Bolloré laisse transparaître « une volonté de contrôler une grande partie de la production intellectuelle française (31) » et de constituer un « pôle de diffusion de l'idéologie d'extrême droite (32). Il apparaît comme « l'artisan d'un Disney français d'extrême droite (33) ».
Sa place de numéro un de l'édition ne sera pas sans conséquence pour les salariés. Les craintes de casse sociale sont fondées, surtout si on examine ce qui s'est déroulé dans des médias Bolloré comme CNews, le JDD ou encore Europe 1. De véritables purges y ont imposé une ligne éditoriale clairement orientée à l'extrême droite (34).
Les conséquences concernent aussi les auteurs, qui risquent d'être davantage fragilisés face à ces monopoles. Les négociations sur le statut d'auteur seront complexes. L'affirmation du géant Bolloré affectera les lecteurs, tant en termes de catalogues de vente que d'accès aux livres dans les bibliothèques et les médiathèques.
Avec cette montée de la mainmise de Bolloré, la diversité du secteur de l'édition est donc menacée. Plusieurs maisons d'édition indépendantes dénoncent déjà ce « mégagroupe » en cours de constitution (35). La défense de l'édition indépendante constitue désormais un enjeu démocratique d'importance.
Conclusion
Désormais introuvable en version papier dans les magasins, le livre d'Ilan Pappé est pourtant réapparu : il a été mis en ligne et rendu accessible gratuitement sur le Net à la fin 2023. Une telle initiative est bien sûr illégale… Mieux encore, il est republié en mai 2024 par les Éditions La Fabrique.
Les menaces lourdes qui pèsent sur l'édition dépassent cet épisode inquiétant de censure, expression d'un raidissement antidémocratique. Elles vont bien au-delà de la question palestinienne. Il s'agit de l'expression, certes limitée à un ouvrage mais bien concrète et préoccupante, d'un « illibéralisme » en œuvre de manière plus générale.
Le livre LIlan Pappé est en vente aux éditions de la rue Dorion.
Notes
1- <https://www.fayard.fr/livre/le-nett...> .
2- Citons quelques exemples de ses travaux. En français : La Guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe, La Fabrique, 2000 ; Une terre pour deux peuples : histoire de la Palestine moderne, Fayard, 2004 ; Les Démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l'université israélienne, La Fabrique, 2004 ; Palestine : l'état de siège, Galaade, 2013 ; Les Dix légendes structurantes d'Israël, Les Nuits rouges, 2022. En anglais : The Israel-Palestine Question, Routledge, 1999 ; The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty : The Husaynis 1700-1948, Saqi Books, 2010 ; Out of the Frame : The Struggle for Academic Freedom in Israel, Pluto Press, 2010 ; The Bureaucracy of Evil : The History of the Israeli Occupation, Oneworld Publications, 2012 ; The Idea of Israel : A History of Power and Knowledge, Verso, 2014.
3- Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres, Oneworld, 2006.
4- Hocine Bouhadjera, « Fayard éclipse en catimini un de ses ouvrages sur la Palestine », ActuaLitté. Les univers du livre, 08/12/2023, <https://actualitte.com/article/1147...> .
5- Idem.
6- Dominique Vidal et Joseph Algazy, Le Péché originel d'Israël : l'expulsion des Palestiniens revisitée par les « nouveaux historiens » israéliens, Éditions de l'Atelier, 1998.
7- Citons quelques travaux : Tom Seguev, Le Septième million. Les Israéliens et le génocide, Liana Levi, 1993 ; Tom Segev, Les Premiers Israéliens, Calmann-Lévy, 1998 ; Simha Flapan, The Birth of Israel : myths and realities, NPantheon Books, 1987 ; Benny Morris, The Birth of the Palestinian refugee problem, 1947-1949, Cambridge University Press, 1987 ; Benny Morris, 1948 and after : Israel and the Palestinians, Clarendon Press, 1994 ; Benny Morris, Victimes : histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, Complexe et IHTP, 2003 ; Avi Shlaïm, Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist Movement and the Partition of Palestine, Columbia University Press, 1988 ; Avi Shlaïm, Le Mur de fer. Israël et le monde arabe, Buchet Chastel, 2008.
8- En 1996, il est candidat à la Knesset sur la liste du Hadash, front électoral animé par le Parti communiste israélien.
9- Le documentaire Tantura (2022) d'Alon Schwarz explique le massacre dans ce village le 23 mai 1948, perpétré par la brigade Alexandroni. Il s'appuie sur des témoignages, notamment audio, d'anciens soldats de l'unité d'élite israélienne enregistrés pour sa maîtrise par Theodore Katz.
10- Voir Omar Barghouti, Boycott, désinvestissement et sanctions, La Fabrique, 2010 ; Eyal Sivan et Armelle Laborie, Un boycott légitime, La Fabrique, 2016.
11- Issu des Frères musulmans palestiniens et fondé en 1987, il possède une branche armée, les brigades Izz al-Din al-Qassam, et est principalement actif dans la bande de Gaza.
12- Voir Ilan Pappé, « Je quitte Israël », Michele Giorgio (entretien), 26 mars 2007, Association France-Palestine Solidarité (AFPS), <https://www.france-palestine.org/Il...> .
13- Constantin Zureik (1909-2000), intellectuel syrien spécialiste d'histoire arabe moderne et un des principaux théoriciens du nationalisme arabe, est le premier à parler de « Nakba » (catastrophe ou désastre) dès l'été 1948, quand il rédige un livre intitulé Ma'na al_Nakba (signification de la catastrophe), consacré à la défaite des Palestiniens arabes face aux différents groupes armés sionistes et au départ de plus de 700 000 Palestiniens. Voir Constantin Zureiq, Ma'na al-Nakba ( معنى النكبة), Beyrouth, Dâr al-'Ilm lil-Malayîn, 1948 ; Akram Belkaïd, « النكبة Al-Nakba, Palestine. Un peuple, une colonisation », Manière de voir, n° 157, février-mars 2018.
14- Principale organisation paramilitaire sioniste dans la Palestine mandataire entre 1920 et 1948, elle fournit les éléments centraux de l'armée israélienne (« Tsahal », acronyme hébreu désignant les « forces de défense d'Israël » ou IDF, Israel Defense Forces en anglais) fondée officiellement le 26 mai 1948.
15- Pour une approche convergente, nous renvoyons aux très importants travaux de l'historien palestinien Nur Masalha, hélas toujours inaccessibles en langue française. Né en 1957, il est actuellement chercheur au St Mary's College et rédacteur en chef de la stimulante et critique revue Holy Land Studies and Palestine Studies (anciennement Holy Land Studies). Son travail de thèse est consacré à l'idée du « transfert » dans le sionisme : Expulsion of the Palestinians : the Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought, 1882-1948, Washington DC, Institute for Palestine Studies, 1992. Pour d'autres publications : Palestine, a Four Thousand Year History, Zed Books, 2020 ; Theologies of Liberation in Palestine-Israel : Indigenous, Contextual, and Postcolonial Perspectives, Pickwick Publications, 2014 ; The Zionist Bible : Biblical Precedent, Colonialism and the Erasure of Memory, Acumen, 2013 ; The Palestine Nakba : Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, Zed Books, 2012 ; Catastrophe Remembered. Palestine, Israel and the Internal Refugees, Essays in Memory of Edward W. Saïd, Zed Books, 2005 ; The Politics of Denial : Israel and the Palestinian Refugee Problem, Pluto Press, 2003 ; Imperial Israel and the Palestinians : the Politics of Expansion, Pluto Press, 2000 ; A land without a people, Faber and Faber, 1997. Le documentaire La Terre parle arabe, de Maryse Gargour, coécrit avec Sandrine Mansour, s'appuie sur ses recherches. Voir <https://www.youtube.com/watch?v=oyb...> .
16- Voir Dominique Vidal, Comment Israël expulsa les Palestiniens (1947-1949), Éditions de l'Atelier, 2009 ; Ilan Pappé, La Guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe, La Fabrique, 2000 ; Benny Morris, 1948 : A History of the First Arab-Israeli War, Yale University Press, 2008 ; Issa Khalaf, Politics in Palestine : Arab Factionalism and Social Disintegration, SUNY, 1991 ; William Roger Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951 : Arab Nationalism, the United States, and Postwar Imperialism, Oxford University Press, 1985.
17- Outre les titres mentionnés plus haut, voir Walid Khalidi, Pour ne jamais oublier : les villages de Palestine détruits par Israël en 1948 et les noms de leurs martyrs, Institut des études palestiniennes, 2001 ; 1948, la première guerre israélo-arabe, Actes Sud, 2013 ; Nakba, 1947-1948, Actes Sud, 2012 ; Sandrine Mansour, L'Histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953, Éditions Privat, 2013.
18- Raphaël Godechot, Mike Strachinescu et Thomas Lemahieu, « Palestine, censure dans les universités françaises », l'Humanité, mise à jour le 07/12/2023, <https://www.humanite.fr/societe/pal...> .
19- « “Sur la Palestine, il y a un climat de répression et d'intimidation des chercheurs”, dénonce le sociologue Sbeih Sbeih », Élisabeth Fleury, l'Humanité, mise à jour le 04/12/2023, <https://www.humanite.fr/societe/isr...> .
20- « Le monde de l'édition en plein bouleversement », France Culture, 7 novembre 2023, <https://www.radiofrance.fr/francecu...> .
21- Bolloré doit cependant céder le groupe Editis sous la pression de Bruxelles.
22- Nathalie Raulin, Vincent Bolloré : enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon ?, Denoël, 2000 ; Catherine Vuillermot, Michel Villette, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur, La Découverte, 2005 ; « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ? », Complément d'enquête, présenté par Nicolas Poincaré, France 2, 7 avril 2016, Prix Albert-Londres 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=xrd...> .
23- Cécile Prieur, « Bolloré, un projet politique », NouvelObs, 12 avril 2023, <https://www.nouvelobs.com/edito/202...> .
24- Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, « Vincent Bolloré, parrain d'une alliance entre la droite et l'extrême droite », Le Monde, 20 décembre 2023, modifié le 21 décembre 2023, <https://www.lemonde.fr/politique/ar...> .
25- Rosa Moussaoui, « Bolloré et les médias, la stratégie de l'araignée », l'Humanité, 14 septembre 2023, <https://www.humanite.fr/medias/aide...> .
26- Julia Hamlaoui, « Hanouna, chef de meute pour Bolloré », l'Humanité, 17 novembre 2022, <https://www.humanite.fr/politique/c...> .
27- A. Guilhem, « Hanouna, avatar populaire de l'idéologie d'un milliardaire », Mediapart, Billet de Blog, 12 novembre 2022, <https://blogs.mediapart.fr/leucha/b...> .
28- Samuel Huntington, The Clash of Civilisations and the Remake of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996, 368 p., trad. française : Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997, 402 p.
29- Voir ACRIMED : <https://www.acrimed.org/> .
30- Hugo Boursier, « Bolloré : main basse sur l'édition », Politis, n° 1678, 3 novembre 2021.
31- Idem.
32- Éditions Syllepse, « Bolloré : Main basse sur le livre », Hebdo L'Anticapitaliste, n° 604, 24 février 2022.
33- Martin Mendiharat, « Alerte : la terreur Bolloré plane sur 20 maisons d'édition en France », L'Insoumission, 21 janvier 2022, <https://linsoumission.fr/2022/01/21...> .
34- Idem.
35- « Des maisons d'édition indépendantes dénoncent le “mégagroupe” que prépare Vincent Bolloré », J. Br. avec AFP, 20 juin 2022, BFMTV, <https://www.bfmtv.com/economie/des-...> .
Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 159 | 2024, 133-142.
Référence électronique
Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En ligne], 159 | 2024, mis en ligne le 02 avril 2024, consulté le 18 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/23377 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.23377
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
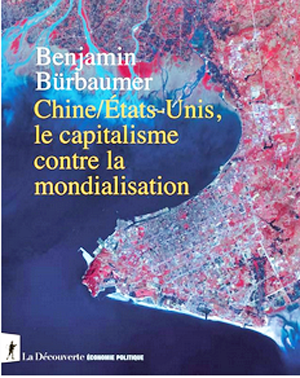
Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation
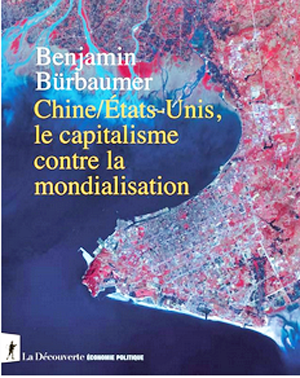
6 mai 2024 | tiré de regards.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ZFqhfF0Yr1A
« La Chine remet en cause la mondialisation sous supervision américaine qui lui a donné sa puissance »
Benjamin Bürbaumer, économiste et auteur "Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation" aux éditions La Découverte, est l'invité de #LaMidinale du site regards.fr.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Russie : L’attentat terroriste et l’élection ouvrent la voie à Poutine pour l’intensification de la répression et de la guerre

Dans un entretien avec Ashley Smith pour Truthout, le militant Ilya Budraitskis analyse l'attaque terroriste survenue le 22 mars 2024, les élections russes et l'évolution de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine tente déjà d'utiliser l'horrible attentat terroriste qui a eu lieu dans une salle de concert à Moscou pour alimenter ses objectifs impérialistes et autoritaires. Ilya Budraitskis dit craindre que Poutine n'aggrave bientôt « cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur ».
13 mai 2024 | tiré d'Inprecor | Photo : Des personnes font la queue pour entrer dans un bureau de vote vers midi, le dernier jour de l'élection présidentielle à Moscou, en Russie. « Pourquoi je suis là ? Je pense que tout le monde sait pourquoi je suis là ! » © Maxim Shemetov/Reuters.
Le groupe terroriste État islamique de la province de Khorasan (ISIS-K) a revendiqué la responsabilité de l'attentat, au cours duquel un groupe de terroristes a tué et blessé des centaines de personnes qui assistaient à un concert de rock dans la banlieue de Moscou. Des responsables américains ont également attribué la responsabilité de l'attentat à ISIS-K. Mais le président Poutine et d'autres responsables russes ont fait des déclarations prétendant que l'Ukraine était impliquée dans l'attentat – une manœuvre destinée à détourner l'attention de l'échec de son régime à empêcher l'attaque, et à attiser le soutien à l'escalade de sa guerre impérialiste.
Tout ceci se déroule au lendemain de l'élection présidentielle russe, truquée, au cours de laquelle tous les candidats de l'opposition ont été interdits et où Poutine a remporté une victoire écrasante. Son nouveau mandat devant durer jusqu'en 2030, il deviendra le dirigeant du pays à la plus grande longévité depuis le dictateur soviétique Joseph Staline. Présentant l'élection comme une confirmation du soutien populaire à son régime, Poutine est prêt à consolider son pouvoir réactionnaire en Russie et à étendre sa guerre impérialiste en Ukraine.
Dans l'entretien ci-dessous, le socialiste russe Ilya Budraitskis partage ses réflexions sur l'attaque terroriste, l'élection, le pouvoir de Poutine, la nature du régime de Poutine et la trajectoire de la guerre.
Que s'est-il passé lors de l'horrible attentat terroriste de Moscou ? Qui en est à l'origine ? Comment les autorités russes et Poutine ont-ils réagi ? Comment vont-ils utiliser l'attentat en Russie et dans leur guerre impérialiste contre l'Ukraine ?
Un groupe de terroristes est entré dans Crocus City, une salle de concert à Moscou, armé de mitrailleuses et d'engins explosifs. Ils ont attaqué les gardes de sécurité privés, tiré sur les personnes présentes et déclenché leurs engins, déclenchant un incendie et tuant au moins 133 personnes et en blessant plus de 100.
Les forces de sécurité russes ont arrêté 11 personnes, dont quatre qui tentaient de fuir le pays vers le Belarus ou l'Ukraine. Ces quatre personnes étaient des travailleurs migrants originaires du Tadjikistan, une république d'Asie centrale et une ancienne république soviétique. Ils ont avoué avoir commis l'attentat, affirmant qu'ils avaient reçu 5 000 dollars pour le mener à bien.
Immédiatement après l'attentat, sans la moindre preuve, les responsables russes et les médias ont accusé l'Ukraine et ont même laissé entendre que les États-Unis étaient impliqués 1 . Poutine a retardé son intervention publique dans l'espoir de trouver ou de fabriquer des preuves à utiliser contre l'Ukraine.
Lorsqu'il s'est exprimé à la télévision nationale (2), vingt heures plus tard, il a affirmé que l'Ukraine essayait d'aider les terroristes à fuir la Russie. Les commentateurs des médias officiels russes ont également dénoncé les travailleurs migrants issus d'Asie centrale, comme s'ils partageaient une sorte de culpabilité collective pour l'attentat.
Aucune de ces accusations n'est crédible. Juste après l'attaque, les porte-paroles ukrainiens ont nié toute implication et ont averti que Poutine blâmerait l'Ukraine et encouragerait le soutien à sa guerre. Il est évident que l'attaque contre les migrants n'est que racisme et xénophobie.
En ce qui concerne les allégations contre les États-Unis, Washington avait en fait informé la Russie d'une attaque imminente d'ISIS-K, une branche d'ISIS basée en Afghanistan, qui a ciblé la Russie 2 parce que celle-ci a décimé ses forces en Syrie et soutenu le dictateur du pays, Bachar el-Assad. Depuis l'attentat, Washington a accusé ISIS-K de l'avoir perpétré.
Ce groupe a effectivement revendiqué l'attentat 3 , et il est probablement le coupable. ISIS-K a pu passer par l'Afghanistan et le Tadjikistan voisin pour s'assurer les services des auteurs de l'attentat.
Poutine a d'abord rejeté les avertissements de Washington en les qualifiant de désinformation et d'alarmisme. Ses forces de sécurité ont toutefois arrêté plusieurs personnes accusées d'être des agents d'ISIS. Mais il est clair qu'elles n'ont pas pris l'avertissement au sérieux, qu'elles n'ont pas éliminé tous les agents d'ISIS à Moscou et qu'elles n'ont pas réussi à empêcher l'attentat.
Néanmoins, Poutine a persisté à essayer d'incriminer l'Ukraine. Il est clair qu'il a l'intention d'instrumentaliser l'attaque pour justifier la répression intérieure et la guerre impérialiste en Ukraine.
C'est ainsi qu'il a réagi à de précédents attentats terroristes. Par exemple, lorsque des militants tchétchènes se sont emparés d'une école à Beslan 4 et ont pris plus de 1 100 otages, il a inconsidérément lancé un raid sur l'école, entraînant la mort de centaines de personnes, mettant un terme aux élections démocratiques des gouverneurs régionaux et aggravant considérablement la guerre en Tchétchénie.
Je prédis que Poutine suivra le même scénario aujourd'hui. Il adoptera de nouvelles mesures répressives, non seulement à l'encontre des terroristes présumés, mais aussi de toute dissidence face à son pouvoir en Russie. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, a déjà proposé de rétablir la peine de mort.
Il est probable que Poutine attise également le soutien patriotique en faveur d'une éventuelle nouvelle offensive en Ukraine. Il pourrait ainsi aggraver cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur.
Passons maintenant aux résultats des élections russes. Ils sont, bien sûr, sans surprise. Poutine a obtenu 87 % des voix. Étant donné que l'opposition a été écrasée et que les candidats anti-guerre ont été interdits, comment devons-nous comprendre ce résultat (6) ? Dans quelle mesure ce résultat reflète-t-il le soutien populaire au régime, dans quelle mesure est-il le résultat d'un soutien forcé et dans quelle mesure est-il le résultat d'un acquiescement passif ?
Les résultats de l'élection sont en effet sans surprise. Comme tous les autres dans la carrière de Poutine, ce résultat était réglé d'avance et truqué. Mais cette fois-ci, il y a des différences. Il a obtenu un score de niveau nord-coréen, ce qu'il n'avait jamais obtenu par le passé.
En 2000, lorsqu'il a été élu pour la première fois à la présidence, il n'a obtenu que 52 % des voix (7). Lors d'autres élections, c'était moins de 70 %, et lors de la dernière en 2018, il a recueilli 76 % des voix (8).
Pour obtenir 87 % des voix, il a abandonné tout semblant de démocratie. Son régime a organisé l'une des élections les plus falsifiées de l'histoire (9). C'est la conclusion partagée par la plupart des analystes des élections russes (10), à l'exception des soutiens au régime et ses apologistes.
Le niveau de falsification défie toute concurrence : ils ont falsifié les résultats, en publiant des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité. Pour permettre ce trucage des élections, Poutine a détruit toute l'infrastructure des observateurs indépendants.
Par exemple, le régime a interdit l'organisation non gouvernementale Golos (« Voix ») (11), qui avait été la principale organisation à former des observateurs électoraux indépendants. La plupart de ses organisateurs ont été emprisonnés ou chassés du pays.
En conséquence, Poutine a eu les coudées franches pour produire un résultat électoral en totale contradiction avec les sondages pré-électoraux indépendants. Selon l'un d'entre eux (12), seuls 50 % des électeurs ont déclaré avoir l'intention de voter pour Poutine.
Par ailleurs, 40 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir pour qui elles allaient voter ou n'ont pas souhaité exprimer publiquement leur préférence. Il est donc clair qu'il ne bénéficie pas du soutien de 87 % de la population russe.
Ce qu'il faut comprendre de cette soi-disant élection, c'est qu'elle était planifiée et contrainte. Par exemple, les employeurs, en particulier dans le secteur public, ont non seulement exigé de leurs employés qu'ils votent, mais aussi qu'ils partagent une photo de leur bulletin de vote.
Évidemment, ils étaient menacés, s'ils ne votaient pas pour Poutine, de perdre leur emploi. L'élection a donc été le produit d'une combinaison dystopique d'une dictature totalitaire extrême et d'un capitalisme de surveillance. En ce sens, il n'y a pas lieu de parler d'élection.
Poutine s'en sert déjà pour consolider son emprise idéologique sur la société russe, en présentant les résultats comme la confirmation que tout le monde est à l'unisson de son projet national et impérial.
Dans les régions occupées de l'Ukraine, les élections ont été encore plus truquées et les résultats sont surréalistes (14). Dans la soi-disant République populaire de Donetsk, 95 % des électeurs ont soutenu Poutine (15). Les forces d'occupation ont fabriqué ce résultat sous la menace des armes (16).
Le résultat le moins crédible de tous est la « victoire » de Poutine à Avdiivka, une ville qui vient d'être détruite par l'armée russe, qui en a chassé la majeure partie de la population. Néanmoins, il a obtenu un soutien massif dans la ville.
Tant en Russie qu'en Ukraine occupée, cette élection était un simulacre. Les résultats sont le fruit de la coercition et de la falsification systématique.
Juste avant l'élection, Poutine a fait tuer Alexeï Navalny pour envoyer un signal à l'opposition nationale et internationale à son régime. Néanmoins, sa veuve, Ioulia Navalnaya, a appelé à des protestations dans les urnes. Quelle a été leur ampleur ? Quelle est leur importance ?
L'appel de Ioulia Navalnaya, que j'ai totalement soutenu, n'a jamais été conçu pour influencer le résultat de l'élection, qui, comme je l'ai dit, était complètement prédéterminé par le régime. L'idée était plutôt d'en profiter pour mobiliser l'opposition politique.
Rappelons que tout rassemblement public non autorisé a été interdit et que toute dissidence politique, en particulier contre la guerre en Ukraine, a fait l'objet d'une répression brutale (17). Un nombre incalculable de personnes ont été jetées dans les prisons de Poutine.
Navalnaya a profité de la pression du régime pour que tout le monde vote pour appeler l'opposition à se rendre aux urnes à midi, le 17 mars. Le résultat a été étonnamment favorable, un grand nombre de personnes ayant répondu à l'appel (18).
Les autorités russes ont eu très peur de cette protestation programmée. Dans les jours précédant l'élection, elles ont demandé à de nombreuses personnes de se présenter à des postes de police et ont menacé de les arrêter et ou de leur faire payer des amendes pour action de masse illégale si elles agissaient.
En outre, ils ont supprimé les informations relatives à l'appel. Il ne faut pas oublier que tous les sites web de l'opposition, comme Meduza, ont été bloqués. Néanmoins, selon un sondage indépendant, près d'un quart des Russes avaient entendu parler de l'action.
Bien sûr, les chiffres qui ont été publiés étaient loin d'atteindre ce pourcentage. Mais le fait que les gens soient venus en grand nombre démontre l'opposition à Poutine et à sa guerre impérialiste en Ukraine.
Les capacités de résilience du régime de Poutine et du capitalisme russe sont surprenantes, face à la guerre, à la tentative de coup d'État d'Evgueni Prigojine (19) et aux sanctions occidentales. Comment l'expliquez-vous ?
La principale raison de la stabilité économique de la Russie est son industrie pétrolière. Elle n'est pas sanctionnée 5 et, comme le prix du pétrole reste très élevé, la Russie a pu maintenir sa croissance économique et sa rentabilité.
Dans le même temps, le prix de la guerre est très élevé. On estime que l'armée absorbe environ 40 % du budget du régime (21). Cette économie de l'armement peut également alimenter la croissance, en particulier chez les fabricants d'armes, au cours des deux prochaines années, mais de telles dépenses ne sont pas viables à long terme 6 .
Cette économie pétrolière et guerrière n'a pas modifié le modèle économique néolibéral de Poutine. Il y a eu quelques nationalisations temporaires d'entreprises, mais les actifs saisis ont été rapidement vendus à d'autres propriétaires fidèles au régime.
En ce sens, il n'y a pas eu de nationalisation au sens traditionnel du terme. Il s'agissait simplement d'une redistribution de la propriété7 . Cela a entraîné une certaine recomposition de la classe dirigeante russe, mais sans modifier sa structure fortement privée.
Poutine a également utilisé la guerre pour s'assurer le soutien de militaires professionnels très bien payés 8 . Leurs salaires sont bien plus élevés que ceux des travailleurs ordinaires des autres secteurs publics et privés.
Mais cette économie de guerre n'est pas viable à long terme. Ses contradictions finiront par saper sa croissance et, avec elle, les contradictions du système politique réapparaîtront, provoquant un nouveau cycle d'instabilité et de crise.
Comment Poutine va-t-il utiliser sa victoire électorale truquée pour sa guerre néocoloniale en Ukraine ?
Avant même l'élection, Poutine s'est vanté dans un discours devant le Parlement que la majorité absolue des Russes soutenait son « opération militaire spéciale » 9 . Il interprétera donc le vote truqué comme une confirmation de son emprise idéologique sur le peuple russe.
Mais c'est son hubris10 . En réalité, le mécontentement à l'égard de la poursuite de la guerre est largement répandu, même parmi les partisans de Poutine. Nombre d'entre eux ont voté pour lui en pensant : « il a commencé cette guerre, il devrait y mettre fin ».
Poutine a ignoré ce sentiment. Pendant la campagne, il n'a jamais mentionné comment il comptait rétablir la paix. Au contraire, il n'a cessé de répéter que la Russie était engagée dans une guerre existentielle avec l'Occident, qu'elle devait la poursuivre et étendre le conflit à d'autres pays.
Une minorité de la société russe soutient ce projet, probablement 10 à 20 % (27). Mais la majorité souhaite que la paix soit rétablie. Bien sûr, ils ne veulent pas que la Russie soit militairement vaincue, mais ils veulent que cette guerre prenne fin à un moment ou à un autre.
Ces sentiments sont de plus en plus forts et pourraient créer à l'avenir une crise pour le régime. Mais pour l'instant, sa réponse consiste à ignorer ces sentiments ou à y répondre par des campagnes d'endoctrinement patriotique visant à susciter un soutien en faveur d'une guerre qui s'étend.
L'ancien président Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, a clairement exposé les objectifs de Poutine dans un discours (28) prononcé quelques jours avant l'élection. Il a déclaré que la Russie avait l'intention de « libérer » Odessa, d'en faire une ville russe et d'éliminer l'Ukraine en tant qu'État-nation.
Il a ensuite proposé sa propre formule de « paix » comme alternative à celle proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que l'Ukraine n'était pas une véritable nation, mais un territoire qui devrait être partagé entre la Russie, la Pologne et la Roumanie.
Bien entendu, le seul moyen de réaliser cela est la conquête totale et la saisie de l'Ukraine par la Russie. C'est le contraire de la paix. Ce sont les ingrédients d'une guerre impérialiste sans fin et d'une occupation coloniale.
Nombreux sont ceux qui s'attendent à une escalade de la guerre en Ukraine dans un avenir proche. Cela nécessitera-t-il une plus grande mobilisation des troupes russes ? Comment la population russe réagira-t-elle ? Cela suscitera-t-il une résistance ?
Il est difficile de dire si les autorités russes mobiliseront davantage de troupes russes. Jusqu'à récemment, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour éviter une deuxième vague de mobilisation.
Bien sûr, après les élections qui, selon elles, ont prouvé que les Russes soutiennent totalement la guerre, elles pourraient lancer une nouvelle mobilisation. En même temps, ils sont assez malins pour savoir que cela serait très impopulaire.
Il est donc probable qu'ils continueront à verser d'énormes salaires aux soldats prétendument volontaires. Mais s'ils ont l'intention de mener une offensive de plus grande envergure, ils devront mobiliser des conscrits.
Ils pourraient assortir cette nouvelle mobilisation d'une promesse de rapatrier ceux qui ont été enrôlés en 2022 et déployés sur le front au cours des deux dernières années. Cela pourrait calmer les appels de plus en plus nombreux des épouses et des parents qui réclament le retour de ces soldats 11 .
Mais les gens ne supporteront pas longtemps cette guerre et cette mobilisation. Et tout soldat rentrant au pays rapportera avec lui des récits de la boucherie en Ukraine, ce qui déstabilisera le régime.
Dans quelle mesure peut-on dire que le régime de Poutine et le capitalisme russe sont stables ? Quels sont les problèmes et les failles du système ?
Il y a un problème profond dans la construction politique même de ce régime. Dans l'un de ses récents discours, Poutine a trahi une certaine conscience de ce problème 12 . Il a déclaré que l'ancienne élite constituée à travers la privatisation des biens de l'État soviétique était dépassée et qu'une nouvelle élite devait être mise en place.
Il a ajouté qu'une nouvelle et véritable élite devrait être recrutée parmi les héros issus des lignes de front. En réalité, Poutine est en train de construire une nouvelle base sociale à partir des enfants de son cercle étroit d'amis qui contrôlent les grandes sociétés d'État et l'industrie privée.
Leurs parents vieillissent et Poutine sait qu'il est confronté à la difficulté de reproduire le régime et une clique dirigeante qui lui soit loyale. Il considère donc ces enfants comme ses futurs fidèles au sein de l'État et des entreprises russes 13 .
C'est le signe d'un régime profondément personnalisé, dans lequel Poutine ne fait confiance qu'aux personnes qu'il considère comme des amis. Mais le nombre d'amis du dictateur étant limité, le seul moyen pour étendre sa base sociale est de recruter les enfants qui lui sont loyaux pour occuper des postes dans la bureaucratie gouvernementale et les conseils d'administration.
Poutine intègre également ses gardes du corps personnels à des postes au sein de l'État. Ainsi, un certain nombre de gouverneurs dans diverses régions du pays sont issus de son équipe de sécurité personnelle.
Ces méthodes d'expansion et de consolidation du régime peuvent se retourner contre lui et créer de graves problèmes pour le maintien de son pouvoir. Par exemple, dans ce système, si des membres de l'appareil d'État veulent faire avancer leur carrière, ils se retrouvent dans une impasse, car au sommet de la bureaucratie se trouvent des loyalistes de Poutine nommés directement par le dictateur.
Si vous ne faites pas partie de ce cercle charmant, votre carrière est vouée à l'échec. Cela peut engendrer de l'apathie et même du mécontentement au sein de l'appareil d'État, ce qui mine le régime de l'intérieur.
Bien sûr, la couche supérieure de l'appareil d'État soutiendra Poutine jusqu'au dernier souffle, en appuyant l'escalade de sa guerre impérialiste. Mais, en dessous d'eux, il y a des couches parmi lesquelles le mécontentement et l'opposition peuvent se développer. La grande question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du régime, est donc de savoir combien de temps peut durer cette loyauté non seulement envers Poutine, mais aussi envers le système.
Un autre problème auquel le régime est confronté est la contradiction que j'ai décrite entre la vision imaginaire de Poutine d'une société russe loyale et unie derrière lui et les divisions réelles au sein de cette société, en particulier celles provoquées par la guerre. Cette contradiction ne peut pas durer longtemps.
Enfin, beaucoup de gens de gauche font pression pour que l'Ukraine s'engage dans des pourparlers de paix et accepte un accord « terre contre paix » avec Poutine, ce qu'ils n'exigeraient jamais des Palestinien·nes. Que pensez-vous de cet argument ? Pourquoi est-il irréaliste ? Que devrait dire la gauche à propos de la guerre et que devrait-elle exiger à la place ?
Il faut bien comprendre que Poutine a pris très au sérieux la décision de lancer cette invasion et qu'il est déterminé à ne pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs déclarés : l'élimination de l'Ukraine en tant qu'État-nation indépendant et la mise en place imposée d'un gouvernement fantoche à Kiev. S'il n'atteint pas ces objectifs, il considérera cela comme une défaite, ce qu'il n'est pas prêt à accepter.
Il considère le maintien d'un gouvernement indépendant à Kiev comme une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Il ne se contentera donc pas de s'emparer de certaines parties de l'Ukraine ; il veut s'emparer de l'ensemble du pays, comme première étape de la reconstruction de l'ancien empire russe.
Il l'a clairement exprimé lors d'une récente interview à la télévision russe (33), au cours de laquelle il a été interrogé sur la possibilité d'entamer des pourparlers de paix. Il a déclaré sans ambages qu'il n'était pas intéressé par de tels pourparlers, que ceux-ci n'étaient motivés que par le manque d'armes de l'Ukraine.
Il n'accepterait des pourparlers de paix que s'ils garantissaient les objectifs impérialistes de conquête et de régime qui sont les objectifs de son « opération militaire spéciale ». Par conséquent, à ce stade, il rejettera toute négociation et il est probable qu'au contraire il intensifiera la guerre.
Face à cette guerre impérialiste sans fin, la gauche doit soutenir l'Ukraine et sa lutte pour la libération. Si Poutine réussit à conquérir l'Ukraine, cela créera un précédent pour d'autres puissances et États impérialistes qui lanceront des guerres similaires de conquête coloniale.
La gauche internationale doit défendre le droit des nations opprimées à l'autodétermination sans exception et défendre leur droit à se procurer des armes pour se défendre. Seule une telle solidarité d'en bas peut mettre un terme à la poursuite de la guerre impérialiste.
Publié le 25 mars 2024
* Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe. Il est chercheur invité au sein du programme de théorie critique de l'université de Californie à Berkeley, et auteur de Dissidents parmi les dissidents : Idéologie, politique et gauche dans la Russie post-soviétique. Il est également membre du comité éditorial du site socialiste russe Posle.media.
Cet entretien a été publié par Truthout, qui indique qu'il a été « légèrement modifié pour plus de clarté ». Ashley Smith est un écrivain socialiste et un activiste de Burlington, dans le Vermont. Il écrit dans de nombreuses publications, dont Truthout, The International Socialist Review, Socialist Worker, ZNet, Jacobin, New Politics et bien d'autres publications en ligne et imprimées.
Notes
1. « Russia's Battle With Extremists Has Simmered for Years », Neil MacFarquhar, 24 mars 2024, The New York Times.
2. Why is ISIL targeting Russia ? », Kevin Doyle, 23 mars 2024, Al Jazeera.
3. « Four suspects in Moscow concert hall terror attack appear in court », Andrew Roth et Pjotr Sauer, 24 mars 2024, The Guardian
4. European Court Faults Russia's Handling of 2004 Beslan School Siege », Sewell Chan, 13 avril 2017, The New York Times. )
5. « Putin approves big military spending hikes for Russia's budget », 27 novembre 2023, Reuters.
6. « Ukraine – two years on, no end in sight », 22 février 2024,
7. « How Putin Turned a Western Boycott Into a Bonanza », Paul Sonne et Rebecca R. Ruiz, 17 décembre 2023, The New York Times.
8. « The Russian military is offering up to 10x an average salary to fill its ranks depleted by Ukraine invasion casualties », Bethany Dawson, 13 mai 2023, Business Insider.
9. « Putin lauds Ukraine gains, threatens West in annual speech », 29 février 2024, DW.
10. « Putin had to contrive a ‘landslide' – because he knows cracks are showing in Russian society », Samantha de Bendern, 18 mars 2024, The Guardian.
11. « Dozens detained as Russian soldiers' wives call for their return from Ukraine », 3 février 2024, AP.
12. « Vladimir Poutine a annoncé la préparation d'une “nouvelle élite” dans le pays à partir des participants à la guerre. », 29 février 2024, TVRain.
13. « Putin Has Russian Elite in a Frenzy Over Their Political Futures », Bloomberg News, 12 mars 2024.
Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel aux travailleurs et aux militants des peuples d’Europe et du monde. Justice pour les travailleurs ukrainiens !

Introduction
Cet appel aux travailleurs et aux militants à l'étranger émane des militants et dirigeants syndicaux ukrainiens de Kryvih Rih, ainsi que du soutien de diverses initiatives de la société civile. Il ne s'agit pas d'un appel officiel d'un syndicat. Mais il exprime très bien l'état d'esprit et les souhaits de nombreux syndicalistes et associations ukrainiens, ainsi que les sujets qu'ils souhaitent communiquer à leurs homologues d'autres pays, à moins d'un mois des élections au Parlement européen.
15 mai 2024 | tiré de aplusoc
https://aplutsoc.org/2024/05/15/appel-aux-travailleurs-et-aux-militants-des-peuples-deurope-et-du-monde-justice-pour-les-travailleurs-ukrainiens/
À la veille des élections au Parlement européen, les militants syndicaux de Kryvy Rih lancent un appel aux candidats et rappellent aux personnalités politiques que ce sont les salariés qui supportent le poids de la guerre contre l'agresseur. Ce sont eux qui manquent de munitions, et ce sont leurs intérêts qui doivent être discutés en haut lieu. En tant que syndicalistes ukrainiens, nous pensons qu'ignorer ces faits entraînerait des conséquences catastrophiques. Nous mettons en garde contre l'utilisation du soutien à l'Ukraine pour dissimuler des agendas égoïstes, ce qui est courant parmi certaines élites internationales.
Yuriy Samoilov, leader du Syndicat indépendant des mineurs, a déclaré : « Dans nos familles, toutes les conversations portent sur la guerre, sur ceux qui servent actuellement, sur la manière de les aider, car la grande majorité des personnes mobilisées sont des travailleurs ordinaires. C'est devenu la priorité du syndicat. Mais en même temps, la législation du travail est suspendue, les dépenses sociales sont réduites et les enfants d'hommes d'affaires et de fonctionnaires s'amusent à l'étranger.
Est-ce juste ? » interroge Yuriy.
Cet appel a déjà recueilli le soutien d'un groupe diversifié de militants syndicaux, civiques et étudiants de diverses régions d'Ukraine. Ils partagent une insatisfaction commune face au manque d'intérêt pour les enjeux des salariés et croient fermement que leur voix collective est la clé du changement. Ils considèrent ceux qui, en Europe et dans le monde, liront cet appel en tant qu'amis de l'Ukraine et alliés des travailleurs.
Oleksandr Skyba, dirigeant du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia, souligne que, depuis le début de la guerre, les droits du travail ont été considérablement restreints. Selon lui, la plupart de ces changements n'ont pas renforcé les capacités de défense, mais les ont plutôt affaiblies. « Permettre aux employeurs de suspendre arbitrairement les relations de travail et les dispositions des conventions collectives constitue un coup dur porté au rôle des syndicats et aux fondements de la démocratie », affirme-t-il. Oleksandr souligne sa confiance dans le pouvoir de l'unité et du soutien mutuel dans la lutte et compte sur la solidarité de ses camarades étrangers.
Source : RESU
Appel aux représentants politiques des peuples d'Europe et du monde
Étant donné que notre sort dépend souvent de vos décisions, nous, syndicalistes et militants ukrainiens, souhaitons nous adresser directement à vous et souligner ce qui suit :
Alors que la communauté internationale reste dans l'indécision, les troupes d'occupation russes intensifient volontiers leur offensive. Nos camarades meurent sur la ligne de front, sont obligés de se battre sans suffisamment d'armes, et en l'absence d'une défense aérienne adéquate, nos centrales électriques, nos usines et nos maisons sont touchées par des frappes dévastatrices. Avec un véritable « soutien inébranlable », cela n'aurait pas été inévitable. Cependant, pour l'instant, nous devons faire face à l'agresseur principalement par nous-mêmes.
La résilience de la société ukrainienne dépend des travailleurs ordinaires, qui constituent la majorité des forces armées et assurent le fonctionnement du front intérieur en matière de logistique, de production et d'entretien des infrastructures critiques. Dans le même temps, il existe une fracture sociale de plus en plus visible, où les biens publics n'existent que pour l'élite et le reste de la population n'a que des devoirs. Cela démoralise et menace la capacité de défense du pays et son avenir. Alors que nous continuons à être payés de miettes, à faire des heures supplémentaires et à vivre sous la menace constante d'être mis à la rue, notre gouvernement se préoccupe beaucoup plus de la déréglementation et de la création de conditions favorables aux propriétaires d'entreprises.
La sécurité et le bien-être de nos familles et amis sont pour nous des valeurs primordiales ; elles nous font tenir le coup. Pourtant, il est malheureusement clair que l'Ukraine d'après-guerre ne pourra pas offrir des possibilités d'une vie décente si les salariés ne disposent pas des moyens de pression nécessaires pour résoudre leurs problèmes. C'est avec horreur que nous réalisons que nous devrons probablement chercher une vie meilleure à l'étranger, ou en travaillant jour et nuit, en rivalisant pour obtenir des salaires de misère auprès de maîtres cupides.
Ce n'est également un secret pour personne que vos élites gèlent les salaires, augmentent les prix, annulent les congés et réduisent les dépenses sociales, justifiant tout cela comme une nécessité pour soutenir l'Ukraine tout en poursuivant un commerce mutuellement bénéfique avec la Russie ; votre argent et votre technologie soutiennent leurs capacités militaires. Cette politique est extrêmement dangereuse pour la solidarité et la confiance entre nos peuples.
Nous comprenons que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons défendre la démocratie et la justice sociale contre les invasions des impérialistes, la pression des dictateurs, les appétits des oligarques et la démagogie de l'extrême droite.
C'est pourquoi nous vous appelons à :
1. Arrêter les exportations d'armes vers des pays tiers et donner la priorité à la fourniture d'armes et de munitions nécessaires dès maintenant à la défense de l'Ukraine. Notre guerre ne doit pas devenir un prétexte pour profiter des profits des vendeurs de sécurité !
2. Faire en sorte qu'il soit impossible au régime de Poutine de contourner les sanctions. Cela nécessite, entre autres choses, de mettre un terme aux projets douteux utilisés par les oligarques russes, ukrainiens et autres. Chaque transaction et pièce de rechange fournie permettent à la Russie de continuer la guerre !
3. Annuler la dette injuste et assurez-vous que votre argent ne soit pas dépensé dans des expériences antisociales dans notre pays ! Le soutien international devrait contribuer à restaurer et à étendre les soins de santé et l'éducation universels, à reconstruire des logements abordables et des infrastructures publiques, et à garantir des emplois et des conditions de travail décents.
4. Établir des contacts avec les syndicats ukrainiens et les organisations de la société civile, faire pression pour leur implication dans la prise de décision à tous les niveaux et insister sur l'importance de la négociation collective et de la liberté d'association ! Dans un système politique déformé, c'est presque le seul moyen pour les citoyens ordinaires de revendiquer leurs droits.
5. Dénoncer le recours à la solidarité pour couvrir des intérêts particuliers ! Confisquez les avoirs russes, fermez les sociétés offshore et taxez les super-riches. Ne présentez pas à votre peuple le faux choix de sacrifier le sort des Ukrainiens ou d'éliminer les plus vulnérables du pays !
Adopté lors d'une réunion de militants syndicaux et étudiants à Kryvih Rih à l'occasion de la Journée internationale du travail, présidée par Yuriy Samoilov et à laquelle participaient des représentants des syndicats indépendants ArcelorMittal Kryvyi Rih, de l'usine de minerai de fer de Kryvyi Rih, Metinvest et Rudomine, du Free Trade de Kryvyi Rih. Syndicat des travailleurs de la santé, le Syndicat libre des éducateurs et des scientifiques de Kryvy Rih, le syndicat étudiant Action directe, Les Sorcières de Kryvbas, de Spravedlyvist et du Mouvement social.
Le 14 mai 2024 à 12h00, soutenu individuellement par :
1. Oleksandr Skyba, leader du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia
2. Natalia Zemlianska, Syndicat ukrainien des ouvriers, entrepreneurs et travailleurs migrants
3. Oksana Slobodiana, Sois comme Nina, présidente du syndicat régional de Lviv
4. Vasyl Andreyev, président de PROFBUD, Syndicat des travailleurs du bâtiment d'Ukraine
5. Liliia Vasylieva, directrice adjointe du Syndicat des travailleurs des grues de la région de Lviv
6. Katya Gritseva, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialniy rukh (Mouvement social), artiste
7. Vitalii Dudin, co-fondateur de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), docteur en droit du travail
8. Artem Tidva, responsable organisateur, FSESP
9. Oksana Dutchak, co-rédactrice en chef de Spilne/Commons Journal
10. Lidiya Luchyshyn, trésorière du Syndicat des grutiers de la région de Lviv
11. Taras Bilous, rédacteur
12. Andrij Pacan, tourneur
13. Pavlo Bryzhatyi, membre du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), étudiant de l'Université nationale de l'Académie d'Ostroh
14. Daria Selishcheva , psychologue
15. Volodymyr Skimira , grutier
16. Maksym Shumakov, militant du syndicat étudiant de Priama Diia
17. Iryna Strumeliak, ouvrière
18. Denys Pilash, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)
19. Dmytro Lypetskyi, grutier
20. Valerii Petrov, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), Ph.D, développeur de jeux
21. Ihor Duleba, grutier
22. Romanenko Maksym, médecin, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)
23. Ihor Vasylets, membre du syndicat étudiant Priama Diia (Action Directe)
24. Zakhar Popovych, activiste, Ph.D.
25. Mykhailo Zvir, grutier
26. Oleksandr Kyselov, travailleur migrant, membre du conseil d'administration de Skånes Industrisyndikat
27. Mariia Sokolova, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe)
28. Artem Remizovskyi, doctorant en études culturelles, Académie Kiev-Mohyla
29. Rouslana Mazurenok, présidente du syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital Derazhnyanska , militante de Sois comme Nina.
https://rev.org.ua/zakordonnim-politikam-pro-spravedlivist-dlya-ukra%D1%97nskix-pracivnikiv/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. L’UAW a perdu une bataille chez Mercedes en Alabama. Quelle suite ?

Les travailleurs et travailleuses de deux usines Mercedes-Benz près de Tuscaloosa, en Alabama, ont voté vendredi contre le droit de l'United Automobile Workers (UAW) de les représenter, un coup dur pour la campagne du syndicat visant à gagner du terrain dans le Sud des Etats-Unis, où il est historiquement faible [voir sur cette question l'article du même auteur traduit sur notre site le 17 mai 2024].
La défaite est intervenue après que Kay Ivey, la gouverneure de l'Alabama, et d'autres dirigeants républicains eurent fait valoir qu'un vote favorable au syndicat étoufferait les investissements qui ont transformé l'Etat en un grand producteur d'automobiles. Le revers essuyé par le syndicat réduit les chances qu'il soit en mesure de syndiquer rapidement les travailleurs et travailleuses de Hyundai et de Honda, qui ont également d'importantes usines en Alabama.
Ce vote revêtait une importance nationale, car il permettait de vérifier si l'UAW pouvait s'appuyer sur une série de victoires récentes et progresser dans un Etat dont les élu·e·s se sont montrés hostiles au syndicalisme. Le syndicat a déclaré vouloir organiser toutes les usines automobiles des Etats-Unis, en intégrant à ses membres les salarié·e·s d'entreprises telles que Toyota, Hyundai et Tesla.
Mais la défaite subie dans les trois usines Mercedes ralentira très certainement la campagne du syndicat et l'obligera probablement à faire davantage d'efforts pour s'assurer le soutien des travailleurs avant de chercher à organiser des élections dans d'autres usines automobiles. Les dirigeants syndicaux devront prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de contrer les arguments et campagnes, ainsi que les opérations tactiques des élus locaux et des cadres de l'entreprise.
« Cette défaite est douloureuse », a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW, au siège de la section locale du syndicat, situé à proximité des usines Mercedes de Vance et Woodstock, en Alabama. En fait, « la plupart d'entre nous ont perdu des élections au cours de leur vie. Nous en tirons des leçons. Nous continuerons à avancer, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. »
Les travailleurs de Mercedes ont voté à 56% contre 44% contre leur représentation par syndicat, selon le National Labor Relations Board, qui a supervisé l'élection. Près de 4700 bulletins de vote ont été déposés, ce qui représente une grande majorité des 5075 employés qui avaient le droit de voter.
***
Les dirigeants de l'industrie automobile et les élus conservateurs étudieront probablement de près le vote chez Mercedes afin de déterminer les meilleures approches pour contrer l'UAW et d'autres syndicats lors de futures élections et pour décourager les campagnes syndicales dès le départ.
« Les travailleurs de Vance se sont exprimés, et ils l'ont fait clairement ! » a déclaré Kay Ivey dans un communiqué. « L'Alabama n'est pas le Michigan [Etat où l'UAW est présent dans diverses usines], et nous ne sommes pas la patrie de l'UAW. » [1]
Le Sud est devenu un important champ de bataille. Des Etats comme la Géorgie, la Caroline du Sud et le Tennessee attirent une grande partie des milliards de dollars que les constructeurs automobiles et les sous-traitants investissent dans les usines de véhicules électriques et de batteries. L'UAW souhaite représenter les travailleurs et travailleuses de ces usines.
Mercedes produit des véhicules utilitaires sport (VUS) à Vance et des batteries pour véhicules électriques à Woodstock. Des votes ont été organisés toute la semaine [du 13 au 17 mai] dans les deux usines.
« Nous remercions tous les membres de l'équipe qui ont posé leurs questions, participé à des discussions et, en fin de compte, fait entendre leur voix sur ce thème important », a déclaré l'entreprise dans un communiqué vendredi.
Dans le cadre d'une campagne menée essentiellement de bouche à oreille, les militants syndicaux ont fait valoir qu'en plus d'une meilleure rémunération et de meilleures prestations sociales, l'UAW protégerait les travailleurs de Mercedes contre les changements d'horaires de travail au dernier moment et les longues heures de travail, y compris les week-ends.
« Si nous ne construisions pas ces voitures, vous ne pourriez pas vous mettre autant dans les poches », a déclaré Kay Finklea s'adressant à la direction. Elle travaille au contrôle de la qualité chez Mercedes et a fait campagne pour le syndicat. « Alors traitez-nous avec dignité, traitez-nous avec respect et payez-nous. »
Mais les syndicalistes ont reconnu que de nombreux travailleurs mécontents des conditions de travail chez Mercedes étaient également réticents à adhérer au syndicat, influencés par les menaces des dirigeants de l'entreprise et des hommes politiques selon lesquels l'adhésion entraînerait des cotisations syndicales élevées et une perte de contrôle sur leur travail.
Mercedes s'est efforcée de contrer le syndicat. Le mois dernier, dans une tentative apparente de répondre aux plaintes des salarié·e·s, l'entreprise a remanié la direction locale en nommant Federico Kochlowski au poste de directeur général de l'unité états-unienne de l'entreprise allemande.
Federico Kochlowski, qui a travaillé chez Mercedes pendant une vingtaine d'années à divers postes de responsabilité concernant la production en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis, a reconnu l'existence de problèmes dans les usines de l'Alabama et a promis d'apporter des améliorations. « Je comprends que beaucoup de choses ne vont pas bien », a-t-il affirmé dans une vidéo mise en ligne par Mercedes. « Donnez-moi une chance. »
Bart Moore, qui travaille à la manutention chez Mercedes et livre des pièces à la chaîne d'assemblage, a déclaré qu'il espérait que Federico Kochlowski tiendrait ses promesses. « Nous verrons ce qu'il proposera. On ne sait jamais. »
***
L'UAW a déposé six plaintes pour pratiques déloyales contre Mercedes auprès de la NLRB, affirmant que l'entreprise a pris des mesures disciplinaires contre des employés qui discutaient de la syndicalisation sur leur lieu de travail, qu'elle a empêché les syndicalistes de distribuer des feuilles d'information du syndicat, qu'elle a surveillé les travailleurs et qu'elle a licencié ceux qui soutenaient le syndicat.
« Cette entreprise, comme la plupart des autres, a fonctionné selon le même manuel : susciter la peur, lancer des menaces et faire de l'intimidation », a déclaré Shawn Fain vendredi 17 mai.
Mercedes nie ces allégations.
Les tentatives passées de l'UAW pour représenter les travailleurs et travailleuses de Mercedes et d'autres constructeurs automobiles [Hyundai en 2016] dans le Sud ont échoué. Mais l'UAW est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années, après avoir remporté un vote de syndicalisation le mois dernier dans une usine Volkswagen dans l'Etat du Tennessee, où il avait perdu deux élections auparavant. Le syndicat a également obtenu l'année dernière de fortes augmentations de salaire pour les travailleurs de Ford Motor, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, Jeep et Ram.
La campagne de Mercedes contre le syndicat « a eu beaucoup plus d'effet que nous ne l'avions prévu », a déclaré Robert Lett, qui travaille dans l'usine de batteries de Woodstock et qui a fait campagne pour le syndicat. Mais il a déclaré que le syndicat essaierait à nouveau. Selon Robert Lett, « la défaite ne change rien à notre détermination. La détermination est là pour un changement. » (Article publié dans le New York Times le 17 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
[1] Lauren Kaori Gurley, dans le Washington Post du 17 mai, insiste sur la dimension politique de cette défaite : « Le vote contre le syndicat marque également un coup dur pour le président Biden, qui a rivalisé avec l'ancien président Donald Trump pour obtenir les votes des ouvriers de l'automobile, mais avec des points de vue très différents. Donald Trump a critiqué les dirigeants du syndicat, tandis que Joe Biden a obtenu le soutien de l'UAW cette année et a participé à l'un de ses piquets de grève dans le Michigan l'année dernière. Cette défaite marque le premier revers important pour l'UAW depuis l'élection de Shawn Fain, son nouveau président flamboyant, qui a émergé sous les feux des projecteurs nationaux au cours de l'année écoulée suite à son programme audacieux visant à reconstruire le mouvement syndical états-unien et à remodeler l'image de son syndicat, ternie par des scandales de corruption. » (Réd.)

Lutte à l’inflation : quelle place pour les travailleuses et travailleurs ?

Après avoir surmonté les défis liés à la crise sanitaire, après avoir vu leur pouvoir d'achat s'éroder avec la poussée inflationniste qui a perturbé la reprise économique, les travailleuses et travailleurs doivent-ils s'attendre à subir une troisième épreuve ?
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
Si l'inflation semble avoir causé des dommages limités, au Québec comme au Canada et ailleurs dans le monde, le zèle prolongé des banques centrales, qui s'acharnent à rabattre l'inflation à une cible arbitraire de 2 % dans de courts délais, et la volonté des gouvernements de faire disparaître des déficits conjoncturels pourraient provoquer des souffrances inutiles chez les travailleuses et travailleurs. Chômage, faillites, pertes de revenus… à quoi peut-on s'attendre ?
Récession ou non ?
Le ministère des Finances du Canada prévoyait, en novembre dernier, une croissance du PIB nominal de 2 % en 2023 et de 2,4 % en 2024. Le résultat réel de 2023 a finalement dépassé de 0,7 % celui initialement prévu. Quant à la nouvelle prédiction pour 2024, elle s'élève à 3,8 %. Au Québec, on constate un léger recul en 2023, avec une croissance de 3,9 %, mais une reprise est attendue en 2024 avec une croissance de 4 %.
En 2023, le Canada a évité de justesse une récession. La situation du Québec, qui a connu des croissances négatives au deuxième, troisième et quatrième trimestre, répond cependant à la définition technique d'une récession. En effet, il y a récession lorsque, durant deux trimestres successifs, l'activité économique mesurée par l'évolution du PIB recule. Il est à noter toutefois que les luttes syndicales ayant mené à des grèves lors du dernier trimestre de 2023 expliquent en grande partie la croissance négative du quatrième trimestre au Québec.
Malgré cette récession « technique », le taux de chômage au Québec est demeuré stable, se situant entre 4,1 et 5 %. Au Canada, il est passé à 6,1 % en mars 2024 (et il est demeuré stable le mois suivant) en raison d'une création d'emplois peu dynamique et d'une population en forte croissance. Bien qu'il ne soit pas nouveau que le Canada performe moins que le Québec en matière d'emplois, c'est la première fois, depuis novembre 2017, que le taux de chômage est aussi élevé au pays, à l'exception des pires mois de la pandémie, en 2020 et 2021.
Un entêtement qui pourrait coûter cher
La Banque du Canada (BC) a réagi de manière agressive pour contrôler l'inflation élevée causée par la guerre et l'explosion des prix du pétrole en 2022, faisant passer son taux directeur de 0,25 % à 5,1% en seulement 4 mois. Cette hausse rapide a entraîné une augmentation des taux hypothécaires, passant de 2 à 6 % environ. La BC hésite encore à annoncer clairement une baisse des taux.
Si la lutte à l'inflation ne semble pas avoir provoqué trop de dommages à l'économie, il ne faudrait pas que l'entêtement de la BC à vouloir ramener l'inflation à 2 %, d'ici 12 à 18 mois, vienne exacerber le coût économique et social.
Cette hésitation soulève des questions au sujet de la vision économique et de la gouvernance de la BC. À titre d'exemple, les données de mars démontrent que 90 % de la surinflation (c'est-à-dire l'inflation qui dépasse la cible de 2 %) s'explique par l'augmentation de 7,6 % des coûts de logement entre mars 2023 et mars 2024. La hausse du taux directeur a découragé l'investissement dans les mises en chantier, alors que les besoins en habitations explosent.
Devant la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), qui annonce qu'elle retardera la baisse des taux, la BC préfère éviter de prêter le flanc à la critique pour une baisse trop rapide des taux. En absence de « vérificateur général » de la BC, son gouverneur a le loisir d'accorder une priorité absolue à la lutte à l'inflation, même si elle provoque chômage et faillites.
Comme le soulignent les économistes du Trade Union Advisory Committee (TUAC) qui regroupe les centrales syndicales d'une trentaine de pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les effets de la hausse des taux d'intérêt mettent autant de temps à se manifester qu'à s'estomper. Même dans une situation où les taux diminueraient en 2024, le cumul des renouvellements de prêts hypothécaires qui s'étalent sur plusieurs années continuera à faire augmenter le taux moyen. Les répercussions négatives de ces taux s'accentueront donc pour quelques années.
Un retour de l'austérité
En plus d'un ralentissement économique, les travailleuses et travailleurs feront peutêtre face à un retour des mesures d'austérité et du conservatisme fiscal. Cette philosophie économique, qui a dominé au cours des 40 dernières années, met l'accent sur des impôts faibles, des dépenses publiques réduites et une dette publique minimale.
Au Québec, le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé un déficit de 11 milliards $, qui comprend aussi une provision de 1,5 milliard $ pour des éventualités et un placement de 2,2 milliards $ dans le Fonds des générations. Selon plusieurs commentateurs, cela justifierait le recours par les gouvernements à des mesures d'austérité.
Or, le déficit réel prévu, calculé comme étant la différence entre les revenus et les dépenses, s'élève plutôt à 7,3 milliards $. Cela représente environ 1,2 % de du PIB du Québec, prévu à 590 milliards $ en 2024. Il est donc deux fois moins élevé que le déficit moyen enregistré par le gouvernement du Québec entre 1978 et 1997.
Au fédéral, le budget prévoit des revenus de 497,8 milliards $ et des dépenses de 537,6 milliards $, laissant un déficit de 39,8 milliards $. Malgré les déficits récurrents des dernières années, la dette du Canada en proportion de son PIB demeure la plus faible de tous les pays du G7, avec une moyenne d'endettement grimpant à 95 %, contre seulement 15 % pour le Canada. De plus, le budget déposé par le gouvernement fédéral affiche un recul de la dette relative au PIB, mettant en lumière la solidité financière du Canada comparativement à ses pairs du G7.
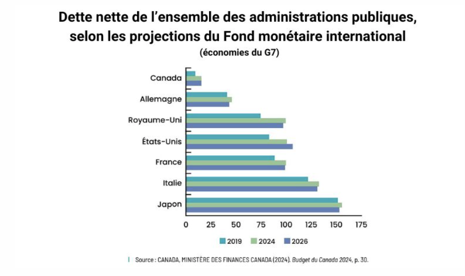
À la lumière de ces faits, il n'existe actuellement pas de crise des déficits et de l'endettement du Québec et du Canada qui justifierait un « incontournable » retour de l'austérité et du conservatisme fiscal.
Des luttes importantes à mener
Espérons que l'atterrissage de l'inflation se poursuivra en douceur et que les épouvantails de la crise des finances publiques ne triompheront pas. Pour y arriver, toutefois, nous devons exiger que la Banque du Canada soit davantage transparente et qu'elle considère d'autres critères que sa cible de 2 % d'inflation comme objectif de « prospérité économique et financière ».
Nous devrons valoriser les services publics et les interventions économiques des gouvernements et lutter contre la privatisation. Comme le disait Antoine de SaintExupéry, « il n'y a pas de solutions, il n'y a que des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent ».
Le ralentissement économique, l'austérité et le conservatisme fiscal ne sont pas inéluctables : ils peuvent être combattus. Les travailleuses et travailleurs risquent d'avoir d'importantes luttes à mener au cours des prochains mois, tant pour contrer les inégalités que pour défendre les services publics.

20 ans après son adoption, les syndicats canadiens exigent l’application de la loi Westray

Le 9 mai 1992, 26 travailleurs de la mine de Westray, dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, ont été tués dans une explosion souterraine, à la suite d'un mépris insensible de l'entreprise pour les lois en matière de santé et de sécurité.
Nous nous souvenons des 26 mineurs qui sont morts il y a 32 ans à cause de ce qu'un juge a appelé « une mosaïque complexe d'actions, d'omissions, d'erreurs, d'incompétence, d'apathie, de cynisme, de stupidité et de négligence », souligne Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous les pleurons et honorons leur mémoire, et ce, en luttant pour la sécurité du travail. »
En 2004, après une lutte de plus de dix ans menée par les Métallurgistes unis d'Amérique, la loi Westray a été adoptée, permettant aux employeurs négligents d'être poursuivis en vertu du Code criminel du Canada.
Chaque année, quelque 1 000 travailleurs sont tués et, depuis l'entrée en vigueur de la loi Westray, plus de 18 000 travailleurs sont morts en raison de leur travail.
« La loi constitue un outil important et permettrait de sauver des vies si elle était appliquée comme prévu. Même si tous les décès ne sont pas nécessairement le résultat d'une négligence criminelle, une application rigoureuse et transparente de la loi Westray est nécessaire afin de rendre le travail plus sûr aujourd'hui », poursuit Bea Bruske. « 20 ans, c'est beaucoup trop long pour les travailleurs afin d'attendre que la justice soit rendue. »
Le Congrès du travail du Canada demande ce qui suit :
– la nomination d'enquêteurs et de procureurs spécialisés dans les décès et les blessures survenus sur le lieu de travail, de même qu'une formation obligatoire et normalisée pour ces postes ;
– veiller à ce que les procureurs de la Couronne soient informés, formés et conseillés afin d'appliquer les amendements de la loi Westray au Code criminel du Canada ;
– une formation obligatoire pour les services de police et les organismes de réglementation en matière de santé et de sécurité, soutenue par les ressources nécessaires, sur l'application correcte des amendements de la loi Westray ;
– des procédures, des protocoles et une coordination obligatoires dans chaque province ou territoire pour les services de police, les procureurs de la Couronne et les organismes de réglementation en matière de santé et de sécurité.
« Cela fait 20 ans que les travailleurs plaident en faveur d'une application effective de la loi Westray », a indiqué Bea Bruske. « Il est grand temps que les employeurs qui font preuve de négligence à l'égard de la vie des personnes qui travaillent pour eux subissent de plein fouet les conséquences de cette loi ».

Amazon : le syndicat de l’entrepôt de Laval est officiellement accrédité

Un premier entrepôt d'Amazon est syndiqué au Canada : dans une décision rendue vendredi, le Tribunal administratif du travail (TAT) accrédite le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval–CSN.
13 mai 2024 | tiré du site de la CSN
« C'est toute une leçon de courage que les travailleuses et les travailleurs de DXT4 viennent de démontrer. »
Après avoir mené son enquête en vertu des pouvoirs que lui confère le Code du travail, le tribunal reconnaît qu'une majorité de salarié-es de l'entrepôt DXT4 ont fait le choix d'adhérer à leur syndicat afin d'entamer la négociation menant à une première convention collective, tel qu'Amazon en a maintenant l'obligation légale en vertu du caractère exécutoire de la décision.
« Il s'agit d'abord et avant tout d'une très grande victoire pour des femmes et des hommes venus d'Amérique latine, du Tchad, du Maghreb et d'Asie, qui n'ont pas eu peur de se tenir debout pour faire respecter leurs droits », d'affirmer la présidente de la CSN, Caroline Senneville.
« Au cours des derniers mois, Amazon aura tout essayé pour s'immiscer dans notre campagne de syndicalisation, n'hésitant pas à inonder les milieux de travail de messages alarmistes. C'est toute une leçon de courage que les employé-es de DXT4 viennent de démontrer. Nous espérons évidemment qu'elle fera boule de neige », de poursuivre Caroline Senneville.
Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 200 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat.
Selon les propos tenus par les employé-es, plusieurs facteurs expliquent leur insatisfaction à l'égard de leurs conditions de travail : des cadences de travail exagérées, des mesures de santé et de sécurité au travail totalement déficientes, sans parler des salaires nettement inférieurs à la rémunération offerte dans le secteur des entrepôts et des centres de distribution au Québec.
Amazon entend contester
Avant même que la décision du TAT ne soit rendue, les avocats nouvellement retenus par Amazon avaient annoncé, le 6 mai, leur intention de contester la constitutionnalité de l'article 28 du Code du travail du Québec. Dans une correspondance adressée au tribunal, à la CSN et au procureur général, Amazon prétend que la capacité du TAT de reconnaître le caractère représentatif d'un syndicat est contraire à la Charte des droits et libertés de la personne « car elle viole le droit de ses salariés à la liberté d'association en les privant potentiellement de choisir leurs représentants » [sic].
« On le constate depuis le début : Amazon n'a jamais voulu respecter le cadre légal qui prévaut en matière de relations de travail au Québec. Aujourd'hui, Amazon demande ni plus ni moins de suspendre le Code du travail le temps qu'elle engorge les tribunaux en s'acharnant à empêcher ses employé-es de se regrouper pour améliorer leur sort. Ce n'est pas vrai qu'une multinationale américaine va venir dicter nos lois. Nous avons entièrement confiance en notre système de justice, qui viendra confirmer que notre Code du travail est bien conforme à la charte, n'en déplaise à Amazon », de conclure la présidente de la CSN.
Au cours des prochains jours, le syndicat tiendra une première assemblée générale pour établir ses statuts et règlements et élire ses représentantes et représentants syndicaux. Un processus de consultation sera par la suite mené auprès des salarié-es afin de jeter les bases d'une première convention collective. En vertu du Code du travail du Québec, Amazon a dorénavant l'obligation légale de négocier un tel contrat collectif de travail.
L'information sur l'actuelle campagne de syndicalisation d'Amazon au Québec peut être trouvée à l'adresse suivante : https://sesyndiquer.org/mawu/
Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour en finir avec la complicité du Canada avec Israël

Alors que l'agression génocidaire d'Israël s'abat sur Gaza depuis plus de sept mois, les Palestinien·ne·s commémorent aujourd'hui, 15 mai, le 76e anniversaire de la Nakba (la Catastrophe). D'hier à aujourd'hui, complice d'Israël, le Canada a toujours été un obstacle à l'autodétermination du peuple palestinien. Le respect des droits humains universels et du droit international appellent à un changement radical de la politique canadienne vis-à-vis Israël et la Palestine.
15 mai 2024
La Nakba de 1948
Le 29 novembre 1947, suite à l'Holocauste – l'horreur ultime qu'avait infligée l'antisémitisme européen aux populations juives d'Europe – l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait un plan de partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe. Répondant ainsi à l'objectif du mouvement sioniste européen d'un foyer national juif en Palestine, remontant à la fin du 19e siècle, l'ONU naissante allait ainsi ouvrir la voie à d'autres crimes.
Au cours de l'année 1948, des milices sionistes ont chassé de force environ 750 000 Palestinien.ne.s de leurs foyers, soit plus de 80 % de ceux qui vivaient alors dans les territoires qui allaient devenir l'État d'Israël. Elles ont détruit plus de 500 villages palestiniens et ont vidé 11 quartiers urbains de leurs habitants palestiniens.
Ces crimes ont longtemps été occultés sous la mythologie fondatrice d'un petit Israël luttant courageusement pour sa naissance et sa survie face à des populations arabes hostiles et non civilisées. Un récit tout à fait semblable aux mythes fondateurs des pays coloniaux des Amériques, dont le Canada, dépossédant et massacrant leurs populations autochtones. Mais, au fil des années, les travaux d'historiens palestiniens et israéliens ont révélé que cette ‘catastrophe' n'avait pas été un dommage collatéral de la première guerre israélo-arabe de 1948, mais plutôt le résultat de la mise en œuvre d'un nettoyage ethnique méticuleusement planifié.
La Nakba : d'hier à aujourd'hui
Mais la Nakba n'est pas que cet horrible nettoyage ethnique de 1948. Elle est aussi comprise comme le projet de dépossession qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Car ni ces réfugié·e·s, ni leur descendance, n'ont jamais pu exercer leur droit au retour, tel que stipulé dans la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies (11 décembre 1948). En 1967, Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Jusqu'à aujourd'hui, son occupation et son contrôle militaires de ces territoires ont étranglé l'économie palestinienne, soumis leur population à des vexations et des humiliations constantes, brutalement réprimé la résistance légitime. Israël a aussi illégalement colonisé ces territoires de centaines de milliers de ses citoyen·ne·s juifs, continué à confisquer des terres, à déposséder le peuple palestinien.
Depuis octobre 2023, l'assaut génocidaire d'Israël contre la population de Gaza s'inscrit dans cette Nakba toujours en cours, des dirigeants israéliens faisant même référence à « finir le travail » de 1948. Une « Nakba 2.0 » !
Le Canada complice depuis 1947
Dès 1947, le Canada a été associé à l'histoire d'Israël. Membre du Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, il y a soutenu la position sioniste et l'adoption du plan de partage.
Face aux violations historiques et persistantes du droit international par Israël, le Canada se contente d'en nommer quelques-unes. Ainsi, il dit reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens, et il dit que les colonies israéliennes et l'annexion de Jérusalem-Est contreviennent au droit international. Mais face aux innombrables crimes qu'entraînent l'occupation et la colonisation des territoires palestiniens, il n'exprime aucune indignation et, surtout, n'entreprend aucune action conséquente. Au contraire. Le Canada professe constamment son « amitié indéfectible » avec Israël, ajoutant que le soutien qu'il lui accorde « est au cœur de la politique canadienne à l'égard du Moyen-Orient depuis 1948 ».
Face aux nouvelles horreurs commises par Israël à Gaza depuis plus de 7 mois, la complicité canadienne se poursuit, avec des ajustements de discours pour tenter de sauver la face. Le Canada a donc finalement voté en faveur d'un cessez-le-feu à l'ONU. Et il exprime parfois des « préoccupations » face à la situation humanitaire à Gaza. Après avoir vendu plus d'armes à Israël d'octobre à décembre 2023 que pendant toute l'année 2022, le Canada a annoncé ne plus accorder de nouvelles autorisations en ce sens… tout en indiquant qu'il allait respecter les ententes déjà signées. Et cette position n'a pas été modifiée par l'adoption, le 20 mars dernier, d'une motion parlementaire stipulant que le Canada cessera d'autoriser et de transférer des armes à Israël.
Pour un vrai « changement fondamental » !
Le 6 mai 2024, Israël a finalement lancé son offensive annoncée, tous azimuts, contre la ville de Rafah, où 1,5 millions de Gazaoui·e·s avaient trouvé un énième refuge. Israël empêche maintenant l'entrée de toute aide humanitaire au passage de Rafah. Le lendemain, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, déclarait que c'était « totalement inacceptable », ce qu'elle avait aussi déclaré plus de deux mois auparavant.
Le 10 mai, professant un « changement fondamental » dans son approche, le Canada s'est abstenu lors d'un vote massif à l'ONU reconnaissant formellement la Palestine comme État. Le Canada a indiqué qu'il pourrait apporter lui-même cette reconnaissance « au moment le plus propice à une paix durable », même sans l'accord d'Israël, à condition que le Hamas n'y joue aucun rôle.
Mais au regard de l'ampleur des crimes commis par Israël, une telle prise de position n'est qu'un petit brassage d'air inutile. Comme le soulignait récemment Agnès Callamard, secrétaire-générale d'Amnesty International (AI), à propos d'Israël, « l'échelle des violations [du droit international] commises au cours des six derniers mois est sans précédent ». En effet, il n'y a jamais eu, comme conséquence directe de bombardements, autant de morts d'enfants, de journalistes, de personnel de la santé, de travailleurs humanitaires. Et la famine ne s'est jamais répandue aussi rapidement à toute une population que par suite du blocus orchestré par Israël.
Il est plus que temps que le Canada mette un terme à son « amitié » avec Israël. Il est plus que temps qu'il remette en question l'État d'apartheid, l'État colonisateur, l'État génocidaire qu'est Israël. Il est plus que temps qu'il dénonce tous ces crimes et en rende Israël imputable. Ce n'est pas un supposé projet palestinien de « jeter les Juifs à la mer » que l'on doit redouter. C'est le projet sioniste d'un Grand Israël d'où la population palestinienne est chassée, étouffée, affamée, exterminée, et qui est en cours d'exécution depuis des décennies, qu'on doit arrêter.
Jean Baillargeon
Martine Eloy
Raymond Legault
Suzanne Loiselle
du Collectif Échec à la guerre
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Colloque du SCFP sur l’énergie : « on peut rater la transition juste »

« Avec l'approche préconisée par le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie et avec la complicité du président directeur général d'Hydro-Québec, les sections locales représentant plus de 16 000 personnes salariées de la société d'État n'ont pas d'autres choix que dénoncer des décisions politiques qui feront reculer le Québec d'un point de vue socioéconomique. »(tiré du site du SCFP : https://scfp.qc.ca/nos-energies-a-nous/)
C'est dans le cadre de cette campagne qu'a été organisé un colloque sous le thème : Colloque sur l'énergie : « on peut rater la transition juste » le 15 mars dernier qui a réuni plus de 200 personnes au Palais des Congrès à Montréal. Des spécialistes sont intervenus pour présenter de nouvelles données sur les dangers de la privatisation des services publics d'électricité.
Presse-toi à gauche a trouvé important de publier les vidéos de certaines des interventions faites à ce colloque à partir de l'enregistrement de la journée qu'a bien voulu nous fournir l'organisation syndicale.
1. Des extraits des interventions des syndicalistes du SCFP d'Hydro-Québec
2. L'intervention de Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie (IREC)
3. L'intervention de Jean-François Blain, analyste sénior en énergie
4. L'intervention de Colin Pratte, chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Numérique : les milieux de travail en transformation

Du taxi au REM, de la presse mécanique à la manutention de colis, en passant par les mines et le camionnage, depuis la maison, le bureau ou l'atelier, presque tous les postes de travail sont aujourd'hui connectés, suivent des lignes de programmation, produisent ou interagissent avec des données numériques. Plus que les révolutions technologiques précédentes, le numérique change-t-il la donne ?
tiré du journal LE MONDE OUVRIER N° 147 • printemps-été 2024
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2024/05/MO147.pdf
Le numérique change-t-il la donne ?
Depuis quelques années, le visage du monde du travail change avec la transition numérique. Que l'on pense au recours croissant au télétravail, à l'intensification de l'automatisation, à l'accélération de la robotique ou encore à l'intégration croissante des outils d'intelligence artificielle (IA), ces changements affectent l'organisation du travail, les compétences requises ou encore les modes de gestion et de surveillance.
La pandémie a entraîné une adoption rapide et massive du télétravail dans de nombreux secteurs d'activité. Bien que cette nouvelle façon de travailler offre des avantages, elle soulève aussi des défis pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que pour les syndicats, notamment sur les plans de la représentation et de la mobilisation.
L'arrivée en force de l'IA suscite aussi de nombreuses interrogations et beaucoup de zones grises. Elle recèle certes des opportunités d'amélioration des conditions de travail, par exemple en automatisant des tâches fastidieuses et répétitives ou en renforçant la sécurité des travail- leurs et travailleuses grâce à une meilleure détection des risques. Cependant, elle ouvre aussi la porte à une surveillance accrue par les employeurs, brouille les frontières entre vie privée et professionnelle, peut intensifier le rythme de travail, et risque de fragmenter, voire de déshumaniser, les relations au travail. Par ailleurs, son intégration progressive dans nos environnements de travail se fait parfois sans que les travailleurs et travailleuses en aient pleine- ment conscience, et souvent sans règlementation claire pour encadrer la gestion des données générées par leur activité.
La FTQ proactive
La numérisation du travail mérite donc notre pleine attention. En 2019, la FTQ en a d'a i l leurs fait la thématique de son 32 e Congrès. Si les technologies ont beaucoup évolué dans les dernières décennies, la position de la FTQ est demeurée claire face à ces enjeux : une transition numérique juste doit privilégier avant tout l'amélioration des conditions de travail et profiter équitable- ment à tous et toutes, sans laissés-pour-compte.
Devant ces nombreuses zones d'ombre, la collabo- ration avec le monde académique est précieuse pour démêler les implications de ces changements sur le travail. Comme en témoignent plusieurs articles de ce cahier spécial, des études menées par des chercheurs et chercheuses de l'UQAM dans des milieux de travail affiliés à la FTQ ont permis d'explorer les effets du télé- travail ainsi que les modalités de surveillance dans différents milieux. Plusieurs rapports importants ont aussi vu le jour dans les derniers mois, témoignant de l'intérêt général pour ces enjeux. En mars, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (Obvia) lançait un guide pour négocier la gestion algorithmique au travail 1 . Et à l'automne dernier, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, présentant son rapport sur l'encadrement de l'IA 2 , plaidait pour une réflexion collective. De son côté, la FTQ continue d'en faire une de ses préoccupations centrales, en défendant une transition numérique équitable et respectueuse des droits des travailleurs et travailleuses.
1. OBVIA, Négocier la gestion algorithmique : un guide pour les acteurs du monde du travail, [En ligne] [https://www. obvia.ca/ressources/ guide-gouvernance- algorithmique]
2. CONSEIL DE L'INNOVATION DU QUÉBEC, PRÊT POUR L'IA, Rapport de recommandations sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, [En ligne] [https:// conseilinnovation.quebec/ pret-pour-lia-est- maintenant-deposer
Négocier la gestion algorithmique
Dans le monde du travail, l'avènement de la gestion algorithmique s'annonce comme une révolution silencieuse aux conséquences potentiellement immenses.

À l'heure où l'intelligence artificielle (IA) commence à s'immiscer dans l'organisation du travail et que des sanctions disciplinaires peuvent être imposées à partir d'un algorithme, les changements sont majeurs dans les façons de gérer les griefs et de négocier l'organisation du travail. Comment garantir la transparence et l'équité des décisions prises automatiquement ? Et quelles seront les conséquences sur le travail et les relations entre employeurs et personnes employées ?
La question n'est plus « si », mais « quand » ces technologies impacteront le quotidien d'une majorité de travailleurs et travailleuses. La nécessité d'agir et de prévenir n'a jamais été aussi pressante. Les syndicats, souvent en première ligne dans la négociation de l'organisation du travail, se trouvent face à un défi inédit : négocier la place et le rôle de ces technologies dans les milieux de travail, alors même que leurs formes et leurs effets sont encore assez mal connus.
Un guide pratique
L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (Obvia) a récemment proposé une nouvelle ressource : le guide Négocier la gestion algorithmique.
Élaboré avec la participation de la FTQ et de ses syndicats affiliés, ce guide arrive à point nommé pour aider les syndicats à négocier autour de l'utilisation des algorithmes au travail. Il permet de mieux comprendre ce qu'est l'IA et la gestion algorithmique et fournit une liste de questions à se poser pour identifier quelles formes ces technologies peuvent prendre et quoi négocier avec les employeurs lors de leur intégration dans les milieux de travail.
Une gestion algorithmique ?
De manière générale, il s'agit de l'automatisation de tâches de gestion traditionnellement effectuées par des humains. Par exemple, l'évaluation de la productivité de télétravailleurs et télétravailleuses, la sélection de candidatures parmi un grand nombre, la surveillance des déplacements ou encore le contrôle de la qualité de diction d'un téléopérateur ou d'une téléopératrice…
Autrement dit, ces systèmes automatisés peuvent assister, voire remplacer, les gestionnaires dans leur fonction et cela devient particulièrement préoccupant lorsque c'est un algorithme qui peut décider d'imposer une sanction disciplinaire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre sur quelles bases ces décisions sont prises et qui en est responsable.
Le rôle essentiel des syndicats
Le guide met en avant le rôle essentiel des syndicats dans la négociation de l'utilisation et des impacts des technologies de gestion algorithmique. Il encourage les travailleurs et travailleuses, via leurs représentants syndicaux et représentantes syndicales, à prendre part activement à l'élaboration des politiques d'utilisation de l'IA, pour garantir une mise en œuvre éthique et respectueuse des droits des employés et employées.
Pour le moment, la question de la gestion algorithmique peine à émerger dans les discussions de négociation collective et aucune convention collective n'intègre encore explicitement ce terme. Pour cause, le sujet est encore très récent, sans compter que ses effets sont souvent difficiles à observer, la technologie étant souvent elle-même invisible. Mais l'Obvia souligne l'importance de la vague anticipée et les effets concrets à venir sur le monde du travail, d'où la nécessité pour les syndicats de s'emparer de cette question comme un enjeu de négociation. n
Comment les travailleuses et travailleurs s'adaptent-ils au télétravail ?
Par Yanick Provost Savard, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et directeur du Laboratoire de recherche sur les sphères de vie et le travail, et Dana Bonnardel, étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et membre du Laboratoire de recherche sur les sphères de vie et le travail.
Au cours des dernières années, la réalité du télétravail a évolué rapidement. Afin de mieux comprendre comment les travailleurs et travailleuses s'adaptent à cette modalité de travail, le Laboratoire de recherche sur les sphères de vie et le travail, dirigé par le professeur Yanick Provost Savard, a sondé 155 membres de la FTQ de janvier à juin 2023. Dans l'ensemble, plus de 62 % des membres sondés rapportent un très bon ajustement au télétravail. Plus précisément, ces membres perçoivent le télétravail comme une bonne option, en plus de se percevoir comme performants et de ressentir des émotions positives lorsqu'ils et elles télétravaillent. Grâce aux réponses récoltées, deux principaux facteurs facilitant l'ajustement au télétravail ont aussi été identifiés.
Meilleure conciliation
Premièrement, les personnes qui subissent moins d'interruptions par des communications électroniques (courriels, messagerie instantanée, etc.) rapportent un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. Ainsi, il est préférable, même en télétravail, de limiter les communications électroniques à certaines plages horaires pour ne pas nuire aux tâches nécessitant davantage de concentration, par exemple en désactivant certaines notifications. Les milieux de travail pourraient également mettre en place des politiques de déconnexion adaptées à leur réalité et établissant les attentes en termes d'envois des communications électroniques (par exemple, aucun envoi de courriel la fin de semaine) et de délai de réponse (par exemple, 24 heures ouvrables).
Plus d'autonomie
Deuxièmement, cette étude souligne l'importance pour maximiser l'ajustement au télétravail d'offrir aux travailleurs et travailleuses la possibilité de choisir le lieu et le moment le plus approprié pour réaliser certaines de leurs tâches, ce que la littérature scientifique appelle le remodèlement spatio-temporel. Afin de mettre à profit la flexibilité inhérente à plusieurs arrangements de télétravail, une personne pourrait décider de réaliser en télétravail une tâche qui nécessite une attention soutenue ou de réaliser les tâches les plus difficiles le matin, lorsqu'elle a plus d'énergie. Accorder une flexibilité quant à l'horaire de travail, le nombre et le moment des journées de télétravail permettrait aux travailleurs et travailleuses qui le souhaitent de remodeler leur façon de travailler de manière à retirer les plus grands bénéfices de leur situation de télétravail. Parmi les autres facteurs explorés dans le cadre de ce projet, il faut mentionner également le soutien reçu à la conciliation travail-famille de la part des collègues, des employeurs, des membres de la famille et du syndicat, qui était dans l'ensemble rapporté comme modérément élevé à élevé.
La pandémie a tout changé
Jusqu'en mars 2020, le télétravail était encore rare dans la plupart des métiers de bureau. Pratique aujourd'hui plus normalisée, Le Monde ouvrier a voulu en discuter avec trois adeptes.
Une implantation en catastrophe
Crise sanitaire oblige, du jour au lendemain, des milliers de travailleurs et travailleuses étaient renvoyés chez eux et obligés d'y aménager un espace de travail pour maintenir l'activité économique. À Rimouski, c'est dans ce contexte que Joël Lefebvre Lapointe est entré au centre de soutien d'Hydro- Québec comme analyste informatique (SCFP- 4250). « C'était très dur pour tout le monde. Il fallait se procurer et gérer l'installation d'un paquet d'équipements à distance, et en même temps installer les logiciels, développer les nouvelles méthodes d'identification auprès de tous les employés et les aider à se connecter », raconte-t-il.
Malgré une adaptation forcée, la viabilité du télétravail a été vite démontrée. « On a senti une méfiance durant environ six mois. L'employeur surveillait nos connexions informatiques, notre disponibilité à répondre aux appels téléphoniques de service à la clientèle, etc. Puis, la surveillance s'est apaisée », se rappelle Stéphane Morin, agent d'assurance chez TD assurance à Montréal (Teamsters 931).
À la Société de transport de Montréal, « la direction s'est rendu compte qu'elle peut nous faire confiance, que le travail se fait. De notre côté, on a la volonté de maintenir notre productivité pour conserver cet acquis », explique Rachel Thibault, analyste principale en soutien technique à l'ingénierie (SEPB-610).
Des bienfaits appréciés
Constat unanime : le télétravail améliore la qualité de vie. « Les gens sauvent du temps de transport, peuvent garder un enfant malade à la maison sans avoir à prendre congé. Ça donne une certaine flexibilité », observe Stéphane Morin. Le télétravail est devenu une condition d'emploi essentielle pour Rachel Thibault : « J'habite à Saint-Jérôme et ne plus faire le trajet aller-retour au bureau a enlevé un stress énorme dans mon quotidien, au bénéfice de ma vie personnelle. Je ne retournerais jamais en arrière. »
Des relations sociales différentes
L'alternance entre travail au bureau et télétravail pose des défis de socialisation. « Je n'ai pas de problème avec la solitude. Avec les collègues, on essaie de se parler le plus possible, caméras ouvertes, ou d'aller au bureau le même jour. Mais certains ont davantage besoin de socialiser et c'est moins évident quand tu ne vois personne », explique Joël Lefebvre Lapointe.
La réduction des contacts humains crée d'autres défis. « La mobilisation syndicale et l'aide auprès de nos membres sont moins faciles. Les conversations de cafeteria, les liens directs avec les délégués syndicaux, nos antennes ne sont plus les mêmes pour les préoccupations des collègues », conclut Stéphane Morin, délégué en chef de sa section locale.
Un récent guide résume les résultats d'une étude menée au printemps

2023 auprès de quelques 800 membres de la FTQ, de la CSQ et de la CSN, exposant l'éventail des technologies de surveillance utilisées dans les milieux de travail. Les grands constats 82% des personnes participantes sont soumises à une forme de surveillance électronique et 30 % se sentent constamment surveillées ! Face à ces constats, le guide souligne l'importance d'une collaboration et d'un dialogue ouvert pour une utilisation éthique et transparente des technologies de surveillance. n Le guide est disponible en ligne à sac.uqam.ca/le-service-aux- collectivites/rapports/552-guide- pratique-sur-la-surveillance- electronique-au-travail.ht
Vers une surveillance électronique au travail 2.0 ?
Par Ariane Ollier-Malaterre, professeur au Département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM, Xavier Parent-Rocheleau, professeur adjoint au Département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal, Yanick Provost Savard, professeur au département de psychologie de l'UQAM, et Sabrina Pellerin, candidate au doctorat, Département d›organisation et ressources humaines de l'UQAM. / Recherche menée en partenariat avec la CSN, la CSQ et la FTQ, avec l'accompagnement du Service aux collectivités de l'UQAM, dans le cadre du Protocole UQAM/CSN/CSQ/FTQ.
Que les employeurs surveillent les personnes employées au travail, c e n'est pas nouveau. Toutefois, de nouvelles technologies, parfois appelées « patrongiciels », permettent désormais de collecter plus de données sur les activités des personnes employées et de les analyser à l'aide d'algo- rythmes pour en dresser des « portraits » détaillés. Les heures de travail, les comportements, la performance, les attitudes et parfois les émotions sont ainsi observés, que l'on travaille dans les locaux de l'organisation, sur la route ou en télétravail.
État des lieux
Est-ce que ces technologies sont très présentes au Québec ? Dans le cadre d'un projet de recherche mené dans le cadre du Protocole intersyndical du Service aux collectivités de l'UQAM, presque 800 membres de la FTQ, de la CSQ et de la CSN ont été consultés au printemps 2023 : 82 % des personnes répondantes signalent au moins une technologie de surveillance et 30 % se sentent constamment surveillées dans leur travail. Le manque d'information sur ces technologies est un vrai problème : 50% des personnes répondantes ignorent si leurs médias sociaux ou leurs activités sur ordinateur sont surveillés et 36 % ignorent si leurs appels sont écoutés.
Les technologies les plus signalées sont : les cartes à puces et badges (60 %), la surveillance des sites web visités (38 %), des courriels (30 %), des visioconférences et statuts d'activité sur les plateformes comme TEAMS (28 %), les caméras (28 %), la surveillance du téléchargement de fichiers (24 %) et des médias sociaux (22 %) et la géolocalisation (21 %). Viennent ensuite la surveillance de la messagerie instantanée (19 %), l'écoute d'appels et les microphones (15 %), les captures d'écran (14 %), la surveillance des mouvements de la souris (12 %), de l'écran en temps réel (11 %) et des frappes au clavier (8 %). Les cols bleus, la main-d'œuvre ouvrière et les personnes employées des grandes organisations signalent davantage de surveillance.
Plusieurs inquiétudes
La légitimité, la transparence et l'intrusivité de la surveillance sont les principales pré- occupations des personnes répondantes. La plupart considèrent qu'il n'est pas normal que les employeurs utilisent ces technologies et estiment que les employeurs n'informent pas les employés et employées de façon transparente.
Plus de 70 % des personnes répondantes voient ces technologies comme une atteinte à leur vie privée et beaucoup pensent qu'elles sont aussi intrusives pour les autres personnes pré- sentes, comme les collègues et les membres de la famille dans le cas du télétravail. Les autres préoccupations sont la persistance dans le temps des données collectées, sans droit à l'oubli, et la dénaturation des outils qui peuvent être utilisés pour d'autres raisons que celles annoncées (par exemple, un badge pour assurer la sécurité, qui devient un moyen de suivre le temps travaillé).
La SST à l'ère numérique
L'avènement de nouvelles technologies, du télétravail et du travail de plateforme pose de nouveaux défis en matière de santé et de sécurité. Bien que ces avancées permettent souvent plus de flexibilité dans l'organisation du travail, elles mettent à l'épreuve les lois en santé et sécurité du travail et, conséquemment, la protection des travailleurs et travailleuses.
Statut à clarifier
Le travail de plateforme en est un bon exemple. Celui-ci implique souvent des emplois précaires et mal rémunérés dans l'économie à la tâche et soulève des défis réels en matière d'accès aux droits de santé et de sécurité. Les personnes qui travaillent à partir des plateformes sont exposées à des risques physiques et psychologiques, comme le transport de charges lourdes, les agressions verbales, la non-reconnaissance et la précarité, sans pour autant avoir le statut de personnes salariées. Obtenir ce statut légal obligerait les plateformes, à titre d'employeurs, à s'assurer que le travail effectué ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique de ces personnes. Or, malgré qu'elles distribuent des tâches rémunérées, les plateformes ne sont pas encore reconnues comme des employeurs. Cette lacune empêche les personnes qui travaillent pour les plateformes de faire reconnaître une lésion professionnelle, puisqu'elles sont plutôt reconnues comme travailleurs et travailleuses autonomes. Or, à ce titre, elles doivent elles-mêmes cotiser au régime de santé et sécurité du Québec, une obligation généralement méconnue.
Surconsommation
Pour l'ensemble des personnes qui travaillent pour des plateformes numériques ou qui expérimentent le télétravail, la pression pour rester constamment connectées, les interruptions incessantes et le sentiment de devoir être toujours disponibles peuvent brouiller la séparation entre les vies professionnelle et personnelle. D'un autre côté, le manque de contact humain et d'échanges crée un isolement tout aussi néfaste. Ces réalités peuvent entraîner un stress accru et des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. De plus, les personnes qui travaillent à distance peuvent être confrontées à des problèmes liés à leur environnement de travail inapproprié, comme des chaises non ergonomiques, alors que les employeurs se déresponsabilisent des conditions de travail lorsqu'elles sont en dehors du lieu de travail conventionnel. Pourtant, la Loi sur la santé et la sécurité du travail s'applique en contexte de télétravail, et ce, tant pour les risques psychosociaux que physiques.
Revendiquer
Pour atténuer ces risques et garantir la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses dans un environnement en évolution, il est essentiel que les syndicats soient vigilants et obtiennent des mesures proactives, comme le droit à la déconnexion, et les ajustements législatifs nécessaires pour que tous et toutes soient protégés de manière égale.
Plateformes de travail Faux jeu ou vrai travail ?
Les plateformes numériques comme Uber, DoorDash ou SkipTheDishes ont pro- fondément transformé les conditions de travail et d'emploi, posant de sérieux défis juridiques pour les droits des travailleurs et travailleuses. Au Québec, environ 32 000 chauffeurs et chauffeuses d'Uber ont été recensés en 2023. Bien qu'il n'en représente qu'une petite fraction, le nombre de travailleurs et travailleuses « à la demande » est passé de 5,5 à 8,6 % de la population active entre 2005 et 2016.
La stratégie du jeu vidéo
Ces compagnies se pré- sentent comme de simples intermédiaires, ce qui leur permet d'esquiver les responsabilités légales des employeurs. Le statut prétendument indépendant de ses travailleurs et travailleuses permet à Uber de réduire ses coûts, mais elle ne peut exiger qu'ils opèrent à des moments ou lieux précis, une condition cruciale pour un service qui vise à répondre à une demande en temps réel.
Pour contourner le problème, l'entreprise recourt à des incitatifs psychologiques similaires à un jeu, comme des badges ou des systèmes de points permettant de débloquer des niveaux associés à des privilèges. Les tarifs peuvent aussi être augmentés dans certaines zones pour encourager les travailleurs et travailleuses à se diriger vers les lieux à forte demande. Surveillant étroitement leur activité, Uber peut également les pousser à continuer de travailler par l'envoi de notifications indiquant qu'ils sont proches d'obtenir une récompense. Le fonctionnement même de l'application vise à garder les travailleurs et travailleurs connectés en leur proposant des courses avant même que la précédente ne soit achevée. Ces derniers dis- posent alors de 8 secondes pour accepter ou refuser la course, sachant qu'ils doivent maintenir un taux d'acceptation des courses suffisamment élevé pour ne pas se faire désactiver de la plateforme.
Un décalage existe donc entre l'autonomie promise et la réalité d'un conditionnement qui retient les travailleurs et travailleuses captifs. Cette ludification qui transforme le travail en jeu pose de sérieux risques pour la santé. En incitant à se connecter le plus sou- vent et le plus longtemps possible pour obtenir des récompenses, l'application peut pousser à l'épuisement physique et mental, augmentant aussi les risques d'accident. Ces travailleurs et travailleuses sont également aux prises avec le brouillage des frontières du temps de travail, une gestion déshumanisée par les algorithmes, de faibles rémunérations, une absence de pouvoir de négociation et des inégalités croissantes…
La FTQ à l'affût
La FTQ suit depuis plusieurs années les conditions de travail sur ces plateformes. Sans s'opposer aux changements technologiques, la centrale milite pour un progrès sans victime, et appelle à des réformes législatives qui garantiraient une reconnaissance et une protection sociale à ces travailleurs et travailleuses. La FTQ revendique également un droit d'association, que ce soit par l'élargissement de la définition légale de salarié ou l'instauration de la présomption de salariat. D'ailleurs, une directive adoptée par le Parlement européen en avril dernier pourrait inspirer les autorités canadiennes et québécoises en ce sens. Celle-ci reconnait le statut de salarié aux travailleurs et travailleuses de plateforme, et régule pour la première fois l'utilisation des algorithmes, permettant de contester les décisions automatisées comme les désactivations de la plateforme. La FTQ reste vigilante et poursuit son engagement pour stimuler un dialogue social constructif autour de ces questions.
Une mutation tranquille
Les changements technologiques sont courants dans les entreprises manufacturières, mais pas nécessairement aussi radicaux et profonds qu'on peut le penser. Souvent coûteuses, les nouvelles technologies accompagnent les stratégies de développement et de repositionnement des entreprises, lentement mais sûrement. Le Monde ouvrier en a discuté avec deux représentants syndicaux du secteur manufacturier.
Des évolutions lentes, mais réelles
Martin Boulanger est opérateur à l'usine de Tafisa Canada de Lac- Mégantic depuis 1996 et président syndical de Tafisa section locale 299 d'Unifor, qui compte 265 membres aux opérations et à la maintenance. « Nous produisons des panneaux destinés à la fabrication de meubles d'armoires de cuisine avec différents types de mélamine ou de finis », explique-t-il. Un processus qui exige une grande précision, car les clients ont des attentes élevées en matière de finition.
Ces dernières années, l'entreprise a développé trois nouvelles lignes de production automatisées à gros volume. Elle y a implanté des systèmes d'inspection de la qualité informatisés, intégrant caméras et technologie de reconnaissance visuelle, pour repérer les défauts (trous, papier pressé abîmé ou mal collé, etc.) sur les panneaux en cours de production, tant à l'étape du sablage qu'à la presse. Convoyé à bonne vitesse sur la ligne de production, chaque panneau doit être inspecté.
« Avant l'arrivée de la machine, c'était des gens qui étaient responsables de l'inspection. Elle classe les panneaux selon la qualité de la finition, en examine la surface en détail pour repérer les imperfections et les écarte s'ils ne répondent pas aux exigences de qualité », explique Martin Boulanger. « On n'a pas perdu d'emplois, et il reste des opérateurs sur les anciennes lignes. Il y a encore certaines choses que la machine ne voit pas, comme des plis dans le papier, qu'un opérateur peut voir. La machine n'est pas nécessairement plus efficace, mais elle nous soutient beaucoup, sans ajouter de pression sur les travailleurs et travailleuses », conclut-il.
L'humain comme soutien à la machinerie
L'automatisation est également forte chez Raufoss Technology à Boisbriand. L'entreprise compte sur une soixantaine de robots industriels (par exemple : bras articulés) pour soutenir la production de bras de suspension destinés aux fabricants d'automobiles. Mais selon Dominic Beaulieu, électromécanicien et président de la section locale 698 d'Unifor, « il n'y a actuellement pas beaucoup d'intelligence artificielle réelle. Tous ces robots n'apprennent pas et ne décident de rien d'autre que les différentes tâches pour lesquelles les humains les ont programmés ».
L'entreprise ayant triplé son volume de production au cours des 10 dernières années, l'équipe sur le plancher est passée d'une soixantaine à près de 160 personnes. Cela dit, ce système de production change le rôle des humains. « Ils interviennent à certains moments : ils approvisionnent la ligne avec des pièces brutes, ils s'assurent que la machinerie roule en cadence, puis à la sortie, ils font l'inspection visuelle des pièces fabriquées et assurent les opérations d'empaquetage et d'expédition. Mais il y a maintenant très peu d'intervention humaine dans les opérations d'assemblage », explique Dominic Beaulieu.
En conséquence, l'automatisation « modifie le travail des gens, ce qui les oblige à se spécialiser. Il faut continuer d'obliger les employeurs à former les gens pour qu'ils puissent développer leurs compétences en fonction de l'évolution de la technologie, se maintenir en emploi et continuer à évoluer dans l'entreprise », conclut le représentant d'Unifor.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La guerre génocidaire du sionisme cristallise la crise civilisationnelle

Les camps étudiants contre la guerre génocidaire du gouvernement sioniste, qui ont fini par poindre au Québec, sont la conscience humaniste d'un monde capitaliste sans rémission gagné jusqu'à son tréfonds par la course au profit et le culte de l'argent, corrompu jusqu'à la moelle par l'idéologie néolibérale du chacun pour soi et au diable la catastrophe, à l'aise avec des chefs à poigne qui tonitruent les droits humains tout en faisant taire les humanitaires qui les empêchent de tourner en rond.
Les partis politiques n'ont de cesse de s'ajuster à ce monde en chamaille où la guéguerre des grands garçons, pour régner sur les gangs qui paralysent les compatissantes, jouent à la roulette russe avec le sort du monde. Les guerres polarisantes tassent dans la marge tant la centralité politique que l'allocation des ressources pour la course éperdue de la terre-mère vers la terre-étuve.
Tout va très bien Mme la marquise mais le Consensus de Washington fout le camp Pourtant, comme le dit The Economist :
À première vue, l'économie mondiale semble rassurante par sa résistance. L'Amérique a prospéré malgré l'escalade de sa guerre commerciale avec la Chine. L'Allemagne a résisté à la perte de l'approvisionnement en gaz russe sans subir de catastrophe économique. La guerre au Moyen-Orient n'a pas provoqué de choc pétrolier. Les rebelles houthis, qui tirent des missiles, n'ont pratiquement pas affecté les flux mondiaux de marchandises. En tant que part du PIB mondial, le commerce a rebondi après la pandémie et devrait connaître une croissance saine cette année.
Mais ce magazine par excellence de l'intelligentsia de la grande bourgeoisie mondiale n'est pas dupe pour autant tout en regrettant son monde idyllique du « Consensus de Washington » dont il ne voit que des bienfaits :
Mais si l'on regarde plus en profondeur, on s'aperçoit de la fragilité de la situation. Pendant des années, l'ordre qui a régi l'économie mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale s'est érodé. Aujourd'hui, il est proche de l'effondrement. Un nombre inquiétant d'éléments déclencheurs pourrait déclencher une descente dans l'anarchie, où le pouvoir a raison et où la guerre est à nouveau le recours des grandes puissances. Même s'il n'y a jamais de conflit, l'effet sur l'économie d'un effondrement des normes pourrait être rapide et brutal.
[…] la désintégration de l'ancien ordre est visible partout. Les sanctions sont quatre fois plus utilisées que dans les années 1990 ; l'Amérique a récemment imposé des sanctions « secondaires » aux entités qui soutiennent les armées russes. Une guerre des subventions est en cours, les pays cherchant à copier les vastes aides publiques accordées par la Chine et les États-Unis à l'industrie verte. Bien que le dollar reste dominant et que les économies émergentes soient plus résistantes, les flux de capitaux mondiaux commencent à se fragmenter […]
Les institutions qui protégeaient l'ancien système sont soit déjà défuntes, soit en train de perdre rapidement leur crédibilité. L'Organisation mondiale du commerce aura 30 ans l'année prochaine, mais elle aura passé plus de cinq ans dans l'impasse, en raison de la négligence des États-Unis [qui refusent le renouvellement du personnel des panels d'arbitrage afin de les paralyser, NDLR]. Le FMI est en proie à une crise d'identité, coincé entre un agenda vert et la garantie de la stabilité financière. Le Conseil de sécurité des Nations unies est paralysé. […] les tribunaux supranationaux tels que la Cour internationale de justice sont de plus en plus instrumentalisés par les belligérants [sic]. […]
Jusqu'à présent, la fragmentation et le déclin ont imposé une taxe furtive à l'économie mondiale : perceptible, mais seulement si l'on sait où regarder. Malheureusement, l'histoire montre que des effondrements plus profonds et plus chaotiques sont possibles et peuvent frapper soudainement une fois que le déclin s'est installé. La première guerre mondiale a mis fin à un âge d'or de la mondialisation que beaucoup, à l'époque, pensaient éternel. Au début des années 1930, après le début de la dépression et les droits de douane Smoot-Hawley, les importations américaines ont chuté de 40 % en l'espace de deux ans. En août 1971, Richard Nixon a suspendu de manière inattendue la convertibilité des dollars en or ; 19 mois plus tard seulement, le système de taux de change fixes de Bretton Woods s'est effondré.
Aujourd'hui, une rupture similaire semble tout à fait imaginable. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, avec sa vision du monde à somme nulle, poursuivrait l'érosion des institutions et des normes. La crainte d'une deuxième vague d'importations chinoises bon marché pourrait l'accélérer. Une guerre ouverte entre l'Amérique et la Chine à propos de Taïwan, ou entre l'Occident et la Russie, pourrait provoquer un effondrement tout-puissant.
Dans bon nombre de ces scénarios, les pertes seront plus profondes qu'on ne le pense. Il est de bon ton de critiquer la mondialisation débridée comme étant la cause des inégalités, de la crise financière mondiale et de la négligence du climat. Mais les réalisations des années 1990 et 2000 — l'apogée du capitalisme libéral — n'ont pas d'équivalent dans l'histoire. Des centaines de millions de personnes ont échappé à la pauvreté en Chine, qui s'est intégrée à l'économie mondiale. Le taux de mortalité infantile dans le monde est inférieur à la moitié de ce qu'il était en 1990. Le pourcentage de la population mondiale tuée par des conflits étatiques a atteint en 2005 son niveau le plus bas de l'après-guerre, à savoir 0,0002 % ; en 1972, il était près de 40 fois plus élevé. Les dernières recherches montrent que l'ère du « Consensus de Washington », que les dirigeants d'aujourd'hui espèrent remplacer, a été celle où les pays pauvres ont commencé à bénéficier d'une croissance de rattrapage, comblant ainsi le fossé qui les séparait des pays riches.
La grande défaite des économies collectives a permis le rebond impérialiste
Il peut sembler étonnant que The Economist parle de recul mondial des inégalités lors de l'ère néolibérale. Selon le World Inequality Report ce constat est exact pour les revenus : le ratio revenus du 10% le plus riche versus le 50% le plus pauvre se situe autour de 40 depuis 1910 avec une pointe de plus de 50 en 1980. Ce mystère s'explique par la montée plus rapide des PIB des pays de l'Asie de l'Est, surtout la Chine, et du Sud-Est et de plus en plus du Sud, surtout l'Inde, par rapport à ceux des pays du vieil impérialisme. Ce constat est cependant inexact pour l'accumulation de richesse où la croissance de la richesse privée à l'encontre de la décroissance de celle publique durant l'ère néolibérale a arrêté la baisse séculaire des ratios entre les plus riches et les plus pauvres pour au contraire les voir légèrement croître, du moins pour les pays du vieil impérialisme pour lesquels existent suffisamment de statistiques. Quant au ratio de l'égalité des genres pour le revenu, il croît à peine demeurant autour du tiers. The Economist oublie de mentionner que le 10% mondial le plus riche est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) contre à peine plus de 10% pour le 50% le plus pauvre.
La signification de cette relative bonne performance égalitaire des revenus entre les pays s'explique par la stratégie de l'impérialisme néolibéral qui a fait jouer à plein l'utilisation de la main-d'œuvre des pays dépendants, gonflée à bloc par l'intégration de celle de la Chine et la pleine intégration de celle de l'Inde dans le marché mondial, afin de vaincre l'inflation structurelle de l'ère keynésienne. En effet, après avoir cassé l'inflation, en fait la « stagflation », par le remède de cheval d'une hausse drastique des taux d'intérêts autour de 1980, l'effondrement du Mur de Berlin a livré au capitalisme désormais mondialement mur-à-mur un immense réservoir de main-d'œuvre suffisamment formée et incrustée dans d'adéquates infrastructures pour rétablir un tant soit peu la croissance capitaliste en panne. Le coût pour l'impérialisme, cependant, en a été l'industrialisation et même la financiarisation des pays dit émergents maintenant en mesure de réclamer leur part du gâteau des surprofits, d'où la crise du « Consensus de Washington » déplorée par The Economist, et la crise existentielle des grands équilibres écologique de l'Holocène, minimisée par le magazine de la Cité. Cette crise s'explique par la tendancielle mondialisation de la consommation de masse indispensable à la réalisation de la demande solvable soutenue par l'endettement généralisé.
L'ordre organique des inégalités remplace le factice ordre international humaniste
Les relatifs acquits de la « globalisation heureuse » du Consensus de Washington volent en éclats. Il s'ensuit qu' « une grande partie de l'ordre international libéral qui a vu le jour dans les années 1990 est en train de s'effondrer. Le langage autour des droits de l'homme, de l'intervention humanitaire ou même de l'État de droit mondial a été condamné à mort par Gaza. Mais il est tout aussi clair qu'un nouvel ordre conservateur est en train d'émerger, dans lequel les préoccupations en matière de droits de l'homme sont secondaires, même sur le mode rhétorique qui était le sien dans les années 1990. »
Cet effondrement de l'ordre international nominalement humaniste au profit d'un sans gêne ordre organique hiérarchique entre les classes, les genres, les races et les ethnies se cristallise dans la guerre génocidaire de Gaza. « La crise de Gaza a mis en évidence les profondes fractures de la politique intérieure en Europe occidentale, aux États-Unis et en Australie. Il s'agit autant d'une crise politique intérieure que d'un conflit au Moyen-Orient. […] la crise de Gaza a ramené la décolonisation dans les rues de Londres, de Paris, de Berlin, de Sydney et de New York. On oublie souvent que beaucoup de ceux qui sont dans la rue ne demandent pas seulement un cessez-le-feu à Gaza, mais une voix politique qui est marginalisée. Et n'oublions pas que cela se joue dans le registre de la classe et de la race. Beaucoup - mais pas tous - de ceux qui sont dans la rue sont la nouvelle classe ouvrière migrante et Gaza est l'expression de leur mécontentement politique. »
L'auteur signale qu'il y a là « le retour de la politique coloniale » ce qui explique « un virage de plus en plus autoritaire dans la restriction de la dissidence. La tentative d'interdire les marches et les manifestations est peut-être la plus inquiétante… » Si on n'en est pas encore là au Canada et encore moins au Québec, peut-être faut-il en trouver l'explication par l'absence d'expérience coloniale hors frontières, ce à quoi s'ajoute au Québec la conscience de la Conquête à la source de la lutte indépendantiste. Mais ce serait oublier le colonialisme de peuplement vis-à-vis les peuples autochtones. La raison de la relative modération vis-à-vis les camps universitaires contre la guerre génocidaire s'explique peut-être simplement par la marginalité de l'État canadien dans les affaires mondiales en combinaison au rôle onusien apparemment pacifiste du Canada qui a pourtant souffert de nombreuses exceptions à l'ère de l'impérialisme néolibéral. La contrepartie de la relative modération autoritaire canadienne et de la nouvelle tergiversation de la politique canadienne vis-à-vis la Palestine est la faiblesse et la tardivité des mobilisations pro-Palestine. La manifestation montréalaise commémorant la Naqba, par un beau dimanche printanier, ne comptait qu'environ 3 000 personnes (mon album de photos ).
Le décrochage Solidaire de sa base à corriger par un coup de barre internationaliste
L'auteur attire l'attention sur ce que révèle la guerre génocidaire de Gaza à propos des partis de centre-gauche. « La troisième fracture [après celle de la combinaison classe et race et celle d'un plus fort autoritarisme, NDLR] est peut-être la plus frappante et c'est la façon dont les partis de centre-gauche - et cela inclut les démocrates au sein de l'Union européenne - se comportent. […] Les partis étant de plus en plus imbriqués dans l'État, ils ont perdu le lien avec leurs bases sociétales - ou ce que les politologues aiment appeler leurs fonctions représentatives. […] Ce qui est nouveau, c'est que ces partis sont de plus en plus enfermés dans une sorte de rivalité inter-impériale militarisée, économique et politique, à l'échelle mondiale, entre les États-Unis et la Chine. »
Malgré que la politique extérieure ne relève pas constitutionnellement des provinces, Québec solidaire (QS) a toujours pris position, très pacifistement sans toujours distinguer l'opprimé de l'oppresseur, à chaque fois que l'État sioniste a attaqué la Bande de Gaza tant en 2009, 2012, 2014 que maintenant. Mais comme explicité dans un article précédent, QS s'est traîné les pieds avant d'appuyer le camp étudiant de McGill sans que ce soit ses porte-parole qui ne le fassent. Sauf une exception, QS n'a pas mobilisé ni était présent comme parti aux manifestations hebdomadaires pro-Gaza de Montréal. Comme signalé par notre auteur ci-haut, cette tiédeur démontre cette imbrication du parti dans l'État, particulièrement par son financement, et la perte de lien avec sa base sociétale dont l'actuelle crise du parti est la démonstration la plus flagrante. On remarque que le pacifisme Solidaire est élastiquement lié, par la gauche, au positionnement des Libéraux fédéraux même QS se démarque des positions réactionnaires de la CAQ. D'où sa propension à s'en prendre exclusivement à la CAQ en ce qui concerne la guerre génocidaire contre la Bande de Gaza.
Il serait pourtant possible pour la députation Solidaire de faire preuve d'internationalisme conséquent vis-à-vis cet enjeu crucial redéfinissant tant idéologiquement que politiquement l'état du monde. Le député européen Miguel Urbán, militant d'Anticapitalistas dans l'État espagnol, partant du constat que « [l]es institutions sont construites contre nous et contre nos intérêts […] en tant qu'anticapitalistes, [nous devons, dit-il,] mettre un pied dans les institutions et 100 pieds dans la rue. » A découlé de ce principe de faire de la politique autrement que « la première activité que j'ai faite quand j'ai pris mes fonctions de député européen a été d'aller avec les camarades de la coordination européenne bloquer la Banque centrale européenne, de participer aux actions Occupy Frankfurt, […] et, à partir de là, c'est ce qui a marqué l'activité que nous avons eue. »
Pour marquer le coup, l'un ou l'autre membre de la députation Solidaire, et pourquoi pas un des deux porte-parole, pourrait pendant quelques jours dresser sa tente dans un des camps pro-Gaza du Québec. Ce serait là clamer non seulement par la parole mais aussi par son corps que la guerre génocidaire de l'État sioniste, en passe de devenir l'Holocauste du XXIe siècle avec la pleine complicité de tous nos gouvernements, doit être arrêté illico par des occupations et manifestations monstres jusqu'à et y compris par une grève de masse.
Marc Bonhomme, 18 mai 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.c
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
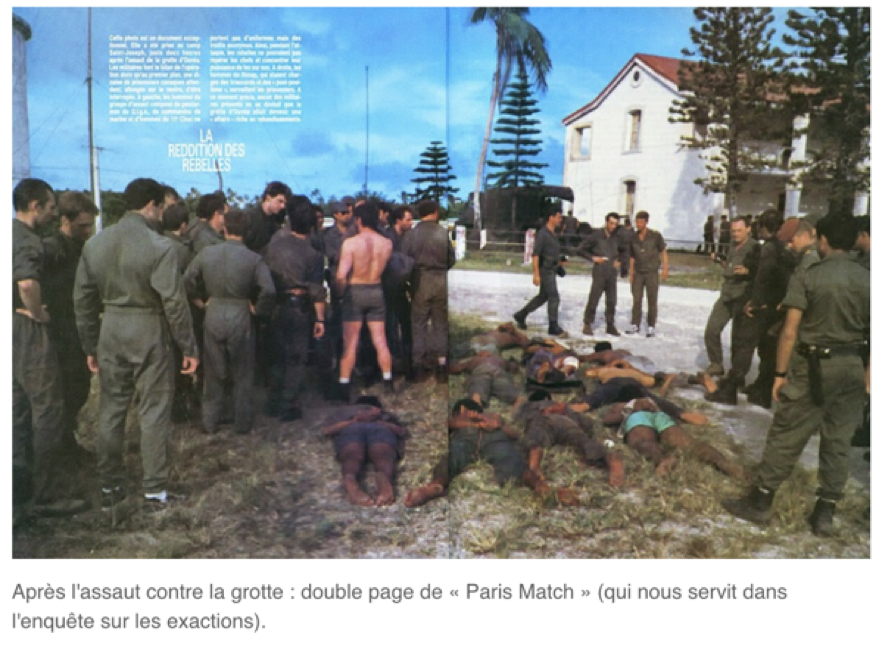
En Kanaky, la terre est le sang des morts
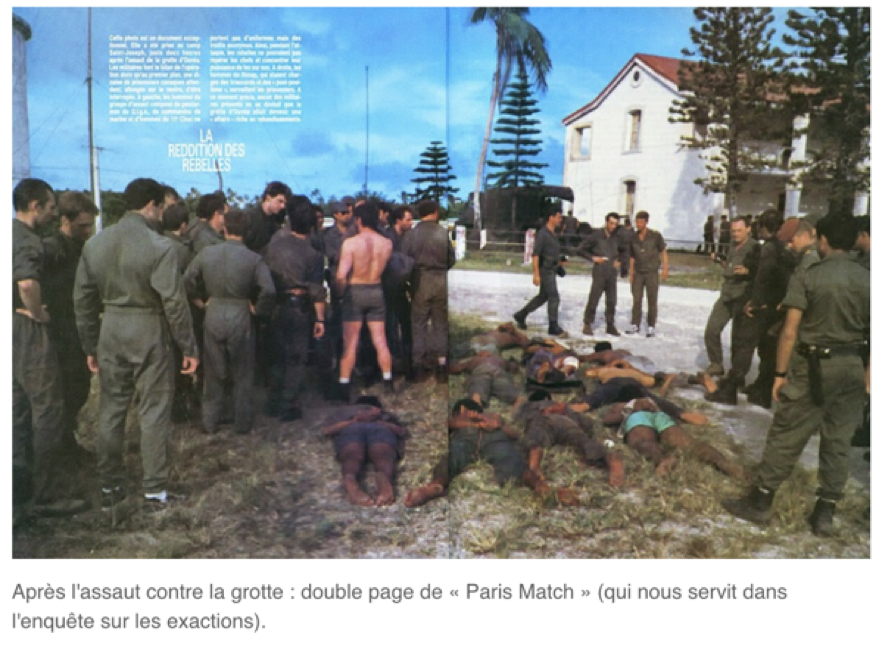
La question calédonienne est une question coloniale, et le colonialisme est une violence : né dans la violence, prolongé par la violence, enfantant la violence. Rappel, professionnellement vécu, par un retour aux sources du processus de décolonisation ouvert par Michel Rocard en 1988 et fermé par Emmanuel Macron en 2021.
Tiré du blogue de l'auteur.
L'amnésie politique et médiatique qui règne sur l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie m'a incité à écrire ce billet, en accompagnement de la couverture par Mediapart de l'actualité de ce territoire. Dans une récente vidéo de Brut, fort pertinente au demeurant, même Pascal Blanchard, pourtant spécialisé dans l'histoire critique du colonialisme français, s'en tient à des généralités sur l'origine de la crise actuelle, au point de relativiser l'aveuglement du pouvoir macroniste alors qu'il repose sur l'oubli, voire la négation, de quelques vérités historiques (lire cette analyse d'Ellen Salvi).
Reprenons, en invitant lectrices et lecteurs (abonnez-vous !) à visiter tous les articles de Mediapart qui témoignent de l'engagement collectif de notre rédaction sur cette question où se joue notre relation au monde et aux autres. Ils sont en partie réunis dans ce dossier où vous retrouverez notamment une série de reportages de Carine Fouteau, dont on peut lire aussi cette récente analyse, ainsi qu'un récit historique de Lucie Delaporte sur le projet colonial en Nouvelle-Calédonie.
Tout part de l'année 1988 (du moins pour la séquence récente car, sinon, tout commence en 1853 avec la prise de possession par la France). La cohabitation de deux années entre François Mitterrand, président de la République élu à gauche, et Jacques Chirac, premier ministre tenant de la droite, arrive à son terme dont l'élection présidentielle est l'échéance. Or leur duel électoral franco-français fera aux antipodes un martyr, le peuple kanak, renvoyé aux pires heures de la violence coloniale.
Le Chirac de cette époque n'est pas celui du musée du Quai Branly, de la passion des arts primitifs et de l'amour des peuples premiers. Encore moins du refus du colonialisme (israélien, à Jérusalem) ou de l'impérialisme (américain, en Irak). À droite toute, il défend une illusion de puissance impériale et de supériorité civilisationnelle. Sans doute par opportunisme politicien, mais cela ne l'empêchera pas d'épouser l'éternel refrain des colonialismes : la déshumanisation du peuple conquis et dominé. « La barbarie de ces hommes, si l'on peut les appeler ainsi », dira-t-il après l'assaut par des indépendantistes du FLNKS de la gendarmerie de Fayaoué, sur l'île d'Ouvéa.
Avec cet événement, le 22 avril 1988, s'ouvre une tragédie antique dont les plaies ne sont toujours pas refermées en Kanaky. Des plaies qu'au choix, l'inconscience, l'ignorance ou l'aveuglement d'Emmanuel Macron, doublés de l'incompétence de son ministre de l'intérieur et des outre-mer Gérald Darmanin, ont aggravées. Leurs premiers responsables sont Jacques Chirac, son gouvernement et sa majorité : contre l'avis des forces rassemblées au sein du FLNKS, qui porte la voix du peuple kanak colonisé, ils imposent que l'élection présidentielle française de 1988 coïncide avec des élections régionales néo-calédoniennes, dans le cadre d'un nouveau statut jugé défavorable aux indépendantistes. Lesquels appellent, en riposte, à un « boycott actif » des élections.
Dans un ordre inversé, ce sont exactement les mêmes fautes qui ont été rééditées par le pouvoir actuel : d'abord imposer un calendrier électoral contre la volonté des représentants légitimes du peuple kanak (ce fut la tenue avancée à fin 2021 du troisième référendum d'autodétermination, contre l'avis du FLNKS qui appellera à son boycott, traduit par plus de 56 % d'abstentions) ; puis imposer un changement du corps électoral afin de relancer une colonisation de peuplement française qui rende minoritaire les populations océaniennes originelles (c'est ce qui se joue aujourd'hui avec la question du « dégel » auquel s'opposent les indépendantistes). Comme l'ont dit, sans être entendus, tous les connaisseurs du dossier – savants, fonctionnaires, politiques –, les mêmes causes ne pouvaient que produire les mêmes effets : la violence (lire ces deux articles prophétiques d'Ellen Salvi en 2021, ici et là).
Mais revenons à 1988, année qui s'inscrit dans une décennie terrible pour la Nouvelle-Calédonie, marquée par une radicalisation de la violence étatique et caldoche – la communauté d'origine européenne – contre les aspirations indépendantistes kanak, lesquelles se radicalisent en retour. En témoignent en 1984 la « fusillade » (un massacre) de Hienghène (territoire de la tribu du principal dirigeant du FLNKS Jean-Marie Tjibaou) et en 1985 la « neutralisation » (une exécution) d'Eloi Machoro (leader extrêmement populaire dans la jeunesse kanak). Faisant fi de ce contexte, qui prolongeait une longue histoire d'injustice coloniale dont s'émut la communarde déportée Louise Michel, solidaire de l'insurrection kanak de 1878, Jacques Chirac fit donc le choix de foncer dans le tas.
Le « boycott actif » des élections, présidentielle et régionales, préconisé par le FLNKS se traduit alors par des actions militantes sur tout le territoire néo-calédonien. Mais l'une, sur Ouvéa, la plus petites des îles Loyauté (si l'on excepte la minuscule Tiga), tourne très mal. Quatre gendarmes sont tués dans la tentative de prise, aux fins de l'occuper, de la gendarmerie de Fayaoué, au centre de l'île. Une partie des gendarmes est ensuite emmenée de force par les indépendantistes kanak dans une grotte du nord de l'île, sur le territoire de la tribu de Gossanah. À la manière kanak, dont la culture n'est ni autoritaire ni verticale, c'est une action localisée qui, malgré sa violence, aurait sans doute pu se résoudre par une patiente négociation, sans chercher à précipiter son dénouement à tout prix avant le second tour de l'élection présidentielle.
Ce ne fut pas le choix du pouvoir français, qui se comporta comme s'il était en péril, fragile et faible. Le drame qui s'ensuivit va se jouer sur seulement quatorze journées, du 22 avril au 5 mai 1988, mais, pas loin de quatre décennies plus tard, il habite encore la mémoire kanak, jusque dans ses déchirures. Car c'est une tragédie fondatrice, qui porte à la fois le malheur et l'espoir. L'espoir, c'est que, de la catastrophe, va naître un sursaut, grâce à l'intelligence politique (et anticolonialiste) du premier ministre Michel Rocard : ce seront les accords de Matignon de la fin de l'année 1988 qui vont fonder un processus de décolonisation validé par les deux camps néo-calédoniens, représentés par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, dont la poignée de main du 26 juin 1988 prendra la dimension d'un geste historique.
Il s'est ensuivi une dynamique, aussi bien économique que politique, qui a permis aux élus indépendantistes de prendre des responsabilités, de gouverner des régions, de diriger l'exécutif. À bientôt quarante années de la tragédie, la Nouvelle-Calédonie est évidemment différente, avec de nouvelles élites kanak (dont d'ailleurs l'actuel directeur du musée du Quai Branly, Emmanuel Kasarhérou). Les nouvelles générations, de toutes communautés, construisent des échappées nouvelles qui sortent des affrontements anciens. C'est d'ailleurs ce qu'exprima, dans Le Monde en 2020, une tribune critique du livre de Mediapart, dirigé par Joseph Confavreux, sur la Nouvelle-Calédonie, à laquelle j'ai répondu en plaidant la persistance de la question coloniale.
Les événements actuels nous donnent raison. Quels que soient les progrès (économiques, culturels, éducatifs, etc.) obtenus depuis 1988 (qui ont aussi creusé les inégalités sociales), on ne saurait oublier qu'ils ont été permis par l'affirmation, dans les accords de Matignon puis de Nouméa, de l'injustice coloniale et de la légitimité d'une décolonisation. Ce qui suppose de mener à son terme ce processus d'autodétermination, sans renier la parole donnée ni tricher sur la règle du jeu. Pour en convenir avec honnêteté, il suffit de se reporter aux textes des accords de Matignon en 1988, puis de l'accord de Nouméa de 1998.
De cette prise de conscience, le massacre d'Ouvéa restera, pour toujours, le point de départ. Grâce aux révélations de la presse (Le Monde en l'espèce, où je faisais tandem avec Georges Marion) et de la Ligue des droits de l'homme (qui les prolongea par une commission d'enquête), le pouvoir français comprit qu'il était dans l'impasse. S'il s'entêtait à poursuivre les preneurs d'otages survivants d'Ouvéa, il risquait de devoir affronter des procédures judiciaires lui demandant des comptes sur une violence coloniale sans précédent depuis la guerre d'Algérie, dont la préméditation gouvernementale allait au-delà des répressions sanglantes qu'ont connues la Martinique (1959) ou la Guadeloupe (1967).
Car le malheur, cet envers de l'espoir qui, en même temps, lui servit paradoxalement de tremplin, ce fut la violence inimaginable de la riposte de l'État français à la prise d'otages d'Ouvéa : aucunement une opération de police, mais une déclaration de guerre totale avec des opérations confiées aux unités d'élite de l'armée française sous la direction d'un haut gradé militaire, le général Jacques Vidal, qui avait commencé sa carrière à la fin de la guerre d'Algérie. Chef des armées, François Mitterrand aurait pu se mettre en travers. Mais, à quelques jours du second tour de la présidentielle, il ne le fit pas, sans doute par peur de perdre des voix au nom de l'ordre et de la sécurité (sans compter que sa biographie politique n'en fait pas un anticolonialiste convaincu).
Dès lors, Jacques Chirac, secondé en Nouvelle-Calédonie par Bernard Pons, ministre des outre-mer qui considéra que « l'honneur de la France » était en jeu, put imposer la solution de force. Il dédaigna les appels à la temporisation que lançaient les dirigeants du FLNKS, eux-mêmes dépassés par la radicalité de l'action menée à Ouvéa par le militant Alphonse Dianou, non-violent poussé à bout par la domination coloniale ainsi que le campa en 2018 l'écrivain Joseph Andras (lire le compte rendu d'Antoine Perraud). Comme toujours dès que le poison colonial fait son effet funeste, la force employée fut démesurée : sortie de ses gonds, elle se déchaîna à l'écart des règles professionnelles et des conventions humanitaires. Sur place, à Gossanah, il y eut ainsi des interrogatoires musclés, des tortures physiques, y compris à la matraque électrique – gégène moderne portable (ici, mon article d'août 1988 dans Le Monde) –, à l'encontre des populations civiles dans l'espoir de localiser la grotte où étaient détenus les otages.
Puis, à la fin, ce fut un assaut sans pitié dont le bilan de vingt-et-un morts – dix-neuf militants kanak, deux militaires français – cache l'impensable violence : plus de dix mille munitions tirées en un temps record, des assauts menés au lance-flammes, au minimum cinq « corvées de bois » (exécutions de prisonniers vivants), un déchaînement totalement disproportionné si l'on met en balance la compétence militaire des deux camps : d'un côté, des militants kanak, pour la plupart très jeunes, sans aucune expérience du combat ; de l'autre, toutes, je dis bien toutes les unités d'élites de l'armée française (GIGN et EPIGN pour la gendarmerie, Commando Hubert pour la marine, 11e RPC dit 11e Choc pour l'armée de terre – bras armé de la DGSE, dissous depuis, en 1993), autrement professionnelles, entraînées et équipées.
Ces faits sont aujourd'hui largement documentés. Les révélations initiales du Monde ont été depuis complétées (j'en ai rendu compte récemment dans ce podcast), notamment par une investigation aussi discrète que patiente d'un journaliste à la retraite, Jean-Guy Gourson, à laquelle Mediapart a donné un large écho sous la plume de Joseph Confavreux. Nous avons aussi diffusé en 2017 Retour à Ouvéa, un film de Mehdi Lallaoui qui a également réalisé un portrait de Jean-Marie Tjibaou. Et l'on trouvera sur Mediapart, notamment ici par Joseph Confavreux et là par Julien Sartre, bien d'autres reportages qui rendent compte de ce passé qui, là-bas, ne passe pas. Enfin, dès 2008, un documentaire d'Élizabeth Drévillon autopsia ce massacre « côté tueurs ».
« Exterminez toutes ces brutes ! » : la phrase prêtée par Joseph Conrad au colonel Kurtz, le personnage central d'Au cœur des ténèbres, roman qui inspira Apocalypse Now, le célèbre film de Francis Ford Coppola sur la guerre américaine au Vietnam, pourrait résumer ce qui se joua, le 5 mai 1988, sur cette île de l'océan Pacifique. Ce fut un assaut d'un autre temps, digne de ces terrifiantes épopées coloniales du XIXe siècle que les légendes patriotiques glorifiaient sans retenue, ainsi que le rappela François Maspero dans L'Honneur de Saint-Arnaud. À l'époque, les armées européennes n'hésitaient pas à raser des villages, à couper des têtes, à massacrer des civils – ce dont témoignèrent, en France, quelques rares consciences, dont un médecin militaire, Paul Vigné d'Octon.
Mais nous étions en 1988… Même si la France restait – et reste toujours – la dernière puissance coloniale directe, la décolonisation faisait désormais partie du droit international avec un comité ad hoc aux Nations unies qui, d'ailleurs, inscrit toujours la Nouvelle-Calédonie parmi les territoires en attente de leur autodétermination. Le massacre d'Ouvéa a donc surgi comme un anachronisme, un retour sidérant du refoulé colonial sous son pire visage. Son souvenir est une marque indélébile dans la conscience kanak et au-delà, pour toutes les communautés du territoire néo-calédonien, voire du monde océanien. Mais, s'agissant du peuple kanak, c'est un traumatisme redoublé car, au crime colonial, s'est ajoutée une incommensurable déchirure fratricide. Et je suis stupéfait de constater que, dans les actuels rappels chronologiques des médias, cette dimension est totalement occultée, presque jamais mentionnée.
Car, en 1989, un an après le massacre d'Ouvéa, lors de la cérémonie commémorative organisée dans l'île, les deux principaux leaders du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné, furent assassinés par l'un de leurs camarades de lutte, Djubelly Wéa, figure indépendantiste de la tribu de Gossanah. Ancien pasteur, violenté comme d'autres durant les interrogatoires ayant précédé l'assaut contre la grotte, faisant partie des militants un temps emprisonnés ensuite en France, il portait le ressentiment de sa tribu d'avoir été livrée à son triste sort par des dirigeants indépendantistes, ceux de la Grande Terre, impuissants ou inconséquents. Une tragédie antique, en effet, digne des classiques grecs.
À l'époque, un livre remarquable, hélas oublié, en témoigna : journaliste ayant choisi l'immersion comme moyen d'investigation, à la manière de l'Allemand Günter Wallraff (elle le fit à propos de l'extrême droite renaissante, puis de l'immigration dite clandestine), Anne Tristan vécut une année à Gossanah, après l'assaut de 1988 et avant les meurtres de 1989, côtoyant celui qui allait tuer Tjibaou et Yeiwéné. Lire ou relire aujourd'hui L'Autre Monde, sous-titré Un passage en Kanaky, c'est prendre la mesure d'une blessure difficilement guérissable. Il fallut plusieurs décennies pour qu'une coutume de réconciliation entre les trois tribus concernées réduise le fossé qui s'était creusé entre Kanak luttant pour la même cause (Tjibaou, le pardon, film de Gilles Dagneau et Walles Kotra, en rend compte).
Mais il suffit de visionner Les Enfants de la patrie, film documentaire d'Éva Sehet et Maxime Caperan tourné à Ouvéa en 2018 lors du trentième anniversaire du massacre, pour comprendre que les blessures ne sont pas cicatrisées. Emmanuel Macron, qui a été élu président l'année précédente (après avoir dit, à Alger, que le colonialisme est « un crime contre l'humanité »), est alors en Nouvelle-Calédonie et veut absolument se rendre dans l'île au jour des commémorations. Les gens de Gossanah, que l'on sent à l'écart de ce qui s'est construit depuis trente ans, toujours hantés par le souvenir de la tragédie au point de la mettre en scène chaque année, ne veulent pas en entendre parler. Ils sont prêts à recevoir le président de la République mais à une autre date. Par respect pour leurs morts.
Emmanuel Macron va passer outre. Le film montre les gens de Gossanah, emmenés par Macky Wéa, le frère de Dubelly Wéa, tenus à l'écart par un barrage de gendarmes mobiles. Humiliés, frustrés, et néanmoins pacifiques, décidant finalement de faire demi-tour. Diffusé en 2023 sur la chaîne Caledonia, ce documentaire a eu un fort retentissement sur le territoire. Ses réalisateurs disent que la scène du barrage inaugure la suite des événements, exprimant la rupture du dialogue, de l'écoute et de la patience, de la palabre et du silence, par le plus haut représentant de la France. Et manifestant le mépris d'un pouvoir qui s'imagine supérieur, jusqu'à manquer de respect.
« La terre est le sang des morts » : figure tutélaire de l'anthropologie océanienne, Jean Guiart (son petit-fils blogue sur Mediapart) popularisa cette expression, au point d'en faire le titre d'un de ses livres, paru en 1983. « La terre est faite du sang des morts, écrit-il, et nous voulons cette terre parce que nous devons pouvoir nous retrouver face à face avec nos morts, qui constituent, avec le lien qui nous lie à la terre qu'ils composent, le soubassement de notre société et notre tradition essentielle. Telle est la conviction profonde, indéfiniment répétée sous toutes sortes de formes, d'une Nouvelle-Calédonie mélanésienne qui se veut aujourd'hui appelée kanak. »
La terre, le sang, les morts… Chaque fois que je cours au Jardin des plantes à Paris, je pense à la Kanaky en passant devant l'orme blanc qui y a été planté en 2014 quand la France a restitué à ses descendants le crâne du chef Ataï, tué lors de l'insurrection de 1878. Et, sous les regards étonnés des passants, je ne manque jamais de la saluer, en criant simplement : « Ataï ! »

Rafah et El Fasher : guerre génocidaire et devoir de solidarité

Alors que l'armée israélienne achève ses préparatifs pour attaquer la ville de Rafah, qui abritait plus de la moitié de la population de Gaza, soit plus d'un million de personnes, après leur déplacement des autres zones de l'enclave, les Forces de soutien rapide soudanaises se préparent à attaquer la ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord, dont la population a dépassé le million d'habitants depuis que de nouveaux déplacés ont rejoint les précédents.
Gilbert Achcar
Dans les deux cas, la population locale est confrontée à une guerre génocidaire : l'une est menée par une armée sioniste inspirée par un projet raciste juif qui vise à contrôler l'ensemble de la Palestine au moyen d'un génocide accompagné de nettoyage ethnique, tandis que l'autre est menée par des bandes armées animées par des desseins tribaux et racistes arabes visant à contrôler toute la région du Darfour (soit environ vingt fois la superficie de la Palestine entre le fleuve et la mer), également au moyen d'un génocide accompagné de nettoyage ethnique.
Alors que nous sommes confrontés à l'horreur de la guerre génocidaire sioniste en cours à Gaza, qui, après sept mois et une semaine, a causé près de 45 000 morts (en tenant compte des corps non identifiés encore sous les décombres, dont le nombre est de 10 000 selon l'estimation la plus basse), nous sommes confrontés à une guerre qui n'est pas moins horrible au Darfour, si l'on en juge par le nombre de morts tombés l'automne dernier dans la seule ville d'El Geneina, dans l'ouest du Darfour, où un rapport de l'ONU estime qu'entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées par les Forces de soutien rapide sur une population totale de 150 000. Ce pourcentage nous avertit que le bilan des morts à El Fasher pourrait atteindre entre 60 000 et 100 000 si les agresseurs occupaient la ville, d'autant plus que la guerre génocidaire menée au Darfour sous Omar el-Béchir, à partir de 2003, a fait 300 000 morts selon l'estimation de l'ONU. Ceci sans parler de l'ampleur de la catastrophe humanitaire, qui au Soudan dépasse celle de Gaza, puisque le nombre de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du territoire soudanais excède 8,5 millions, dont une grande partie est menacée par une famine non moins horrible que celle qui menace désormais la population de Gaza.
Si l'armée sioniste occupait Rafah après l'avoir assiégée sans qu'aucun de ses habitants ni des personnes déplacées n'ait osé en sortir de peur d'être massacré, comme c'est le cas à El Fasher, le bilan des morts ne serait pas moindre que celui qui attend la capitale du Nord Darfour. Mais la pression internationale exercée sur Israël, y compris celle de son partenaire américain dans la guerre contre Gaza – sous l'influence du formidable mouvement mondial de solidarité avec la population de Gaza, y compris le mouvement issu des universités américaines – a contraint l'État sioniste à chercher à réduire le nombre de victimes potentielles de son attaque sur Rafah en appelant les Gazaouis à quitter la ville et à s'installer dans la zone côtière « humanitaire » élargie d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Khan Younès. Toutefois, contrairement à Gaza et Rafah, il n'y a aucun mouvement mondial autour de la guerre en cours au Soudan ni aucun intérêt pour le sort qui attend El Fasher, à l'exception de quelques rares articles dans la presse mondiale.
Cette différence d'intérêt est interprétée par les partisans d'Israël comme découlant de « l'antisémitisme » au sens de juger l'État « juif » selon des normes plus strictes que celles par lesquelles d'autres pays sont jugés. La vérité est que le monde occidental se soucie d'Israël par « compassion narcissique », car il considère l'État sioniste comme un morceau d'Occident enfoncé dans le flanc de l'Orient arabe. C'est cette « compassion narcissique » qui conduit les médias occidentaux à accorder bien plus d'attention aux victimes du 11 septembre, au nombre d'environ 3000, et aux victimes du 7 octobre, au nombre de 1143 du côté israélien, qu'aux millions de victimes qui sont tombées et tombent encore dans les guerres en Afrique subsaharienne en particulier. Mais l'identification occidentale à Israël, qui est fondamentalement une « compassion narcissique », se retourne contre lui, car les gens de bonne conscience dans l'opinion publique occidentale lui demandent des comptes, tout comme ils demandent des comptes à leurs propres gouvernements.
Ainsi, le mouvement contre la guerre américaine au Vietnam dans les pays occidentaux a largement dépassé le mouvement contre la guerre russe en Ukraine. C'est parce que les antiguerres en Occident savaient que la responsabilité de la première incombait au pays occidental le plus puissant, alors qu'ils ne ressentent pas la même responsabilité pour ce que fait l'État russe. La raison pour laquelle leur intérêt pour l'attaque israélienne contre Gaza est bien plus grand que leur intérêt pour ce qui se passe au Darfour est qu'ils sont conscients que l'État sioniste est une partie organique du camp occidental et que son agression contre le peuple palestinien n'aurait pas été possible sans la participation américaine. C'est ce que Mahmoud Darwish voulait dire lorsqu'il répondit à la poétesse israélienne Helit Yeshurun, lors d'un entretien qu'elle avait mené avec lui en 1996 : « Savez-vous pourquoi nous sommes célèbres, nous autres Palestiniens ? Parce que vous êtes notre ennemi. L'intérêt pour la question palestinienne a découlé de l'intérêt porté à la question juive. Oui. C'est à vous qu'on s'intéresse, pas à moi ! […] L'intérêt international pour la question palestinienne n'est qu'un reflet de l'intérêt pour la question juive. »
C'est la vérité, mais cela ne nous absout pas, nous autres Arabes, de la culpabilité de faire preuve de « compassion narcissique » en manifestant de l'intérêt pour ce que l'État sioniste fait subir à nos frères et sœurs palestiniens, au moyen d'armes fournies par les États-Unis d'Amérique, mais de l'indifférence à l'égard de ce que des bandes arabes font subir à des Africains non arabes au Darfour, au moyen d'armes fournies par les Émirats arabes unis. Les personnes de bonne conscience et attachées aux valeurs humanistes doivent dénoncer les crimes perpétrés au Darfour et au Soudan, tout comme elles dénoncent les crimes perpétrés à Gaza et en Palestine.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 14 mai en ligne et dans le numéro imprimé du 15 mai. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Près de 1300 signataires de la Déclaration d’appui au personnel mis à pied de la revue Relations et du Centre justice et foi

Plusieurs personnalités des milieux artistique, littéraire, médiatique, universitaire, social et religieux manifestent leur appui.
Voir la liste des signataires
Le texte de la Déclaration :
Solidarité avec le personnel mis à pied du Centre justice et foi !
Nous avons appris avec stupeur la suspension des activités du Centre justice et foi (CJF), incluant celles de la revue Relations, et la mise à pied cavalière de son personnel pour une durée indéterminée, sur décision de son conseil d'administration.
Nous, qui apprécions et/ou collaborons et participons à divers titres aux activités du CJF, nous des milieux religieux, universitaire, artistique, communautaire, médiatique, littéraire, syndical et autres, signons cette déclaration en solidarité avec les employé·es mis à pied sans justification valable, qui n'ont eu que deux jours d'avis.
Cette mise à pied consternante, même si elle se révélait temporaire, heurte de front les principes de justice sociale et l'esprit de concertation et de solidarité du CJF. La confiance de nombreux partenaires en la stabilité du CJF et de Relations depuis des décennies est ébranlée. Des financements actuels et futurs, ainsi que la campagne de financement qui était en cours, sont mis en péril, cela alors même qu'on évoque des difficultés budgétaires parmi les facteurs justifiant la suspension des activités. Toute une expertise et une mémoire organisationnelle risquent d'être sacrifiées, puisque les personnes mises à pied, ne pouvant compter uniquement sur l'assurance-emploi, doivent se trouver un autre emploi « temporairement ». Qu'on ose parler d'un processus sans heurt pour les employé·es, dans le communiqué officiel émanant du CJF publié sur le site Web, est scandaleux.
En solidarité avec la revue Relations, nous signons
L'interruption abrupte, même temporaire, de la production et de la commercialisation de la revue Relations la met gravement en danger, à court terme, nous le dénonçons vivement ! Récipiendaire de nombreux prix d'excellence, Relations est un foyer intellectuel important dans le paysage médiatique et culturel du Québec, un carrefour de voix diversifiées et engagées, d'ici et d'ailleurs. Elle est unique en son genre. Nous apprécions entre autres la place qu'elle fait aux artistes et ses dossiers thématiques, souvent à l'avant-garde sur plusieurs sujets (décroissance, racisme, technosciences, entre autres). La publication de la revue n'avait jamais été interrompue depuis 83 ans et 824 numéros. Les jésuites progressistes qui l'ont fondée y verraient sans doute un sacrilège, commis de surcroît dans l'improvisation la plus totale, l'opacité et l'ignorance des exigences de sa production et de sa commercialisation – plusieurs d'entre nous, collaborateurs, collaboratrices ou partenaires d'aujourd'hui, pouvons en témoigner. Un tel affaiblissement provoqué nous consterne, et doit être freiné sans tarder. Nous n'osons penser que Relations pourrait avoir publié son dernier numéro, sans le savoir, sans dire au revoir à son lectorat et à ses nombreux abonné·es. C'est une possibilité inadmissible !
En solidarité avec le secteur Vivre Ensemble (VE) du CJF, nous signons.
L'interruption des activités du Centre, même temporaire, nuit aussi grandement à ce secteur dynamique estimé depuis plus de 40 ans par un grand nombre de citoyen·nes, d'allié·es et de partenaires. VE apporte des réflexions essentielles sur des enjeux cruciaux liés à l'immigration et au pluralisme croissant au Québec, à une société dite démocratique qui dénie pourtant souvent des droits et un vrai statut de citoyen·ne à de trop nombreuses personnes, racisées, minorisées, exploitées. Le secteur Vivre ensemble travaille avec ces personnes et porte leur voix dans plusieurs milieux – universitaire, communautaire, religieux, etc. Comme toutes les composantes du CJF, il explore les causes profondes des réalités sociales, pas uniquement les symptômes, cherchant à comprendre et à analyser les enjeux dans toute leur complexité, en créant des solidarités, plutôt qu'à polariser les débats bêtement comme on le voit trop souvent. De cela, le Québec a bien besoin.
En solidarité avec le volet sur l'avenir du christianisme social du CJF, nous signons.
L'interruption des activités du CJF, même temporaire, vient freiner tout un élan. Dans un contexte de déclin des forces qui ont façonné l'héritage social de l'Église catholique au Québec – un héritage souvent méconnu et auquel les jésuites et le CJF ont contribué –, les responsables de ce volet ont su construire patiemment des ponts, depuis 2018, entre différentes générations de chrétien·nes socialement engagé·es. Ces personnes mettent en valeur et font découvrir cet héritage social, oeuvrant à garder vivant et inspirant un pôle précieux du christianisme, essentiel lorsqu'on conçoit la foi comme étant indissociable de la justice. Elles réussissent à aller à la rencontre et à rassembler des personnes, souvent des jeunes marqué·es par une culture individualiste et consumériste dominante, qui étaient isolées dans leur quête spirituelle et d'engagement.
En solidarité avec le Centre justice et foi tel que nous le connaissions jusqu'ici, nous signons.
Des difficultés et des défis exigeants, bien d'autres organismes en connaissent. Sauraient-ils vraiment justifier une suspension des activités et des mises à pied faites de manière si abrupte et si lourde de conséquences – pour l'avenir du CJF, pour les employé·es, et pour plusieurs d'entre nous aussi ? Nous en doutons sérieusement, d'autant que des solutions ont été de facto écartées.
Le Centre justice et foi et Relations méritent mieux que d'être traités comme un banal programme qu'on interrompt et qui va revenir après « la pause ». Encore plus lorsque ladite « pause » compromet, par ses graves conséquences, la possibilité même d'une reprise. Solidarité avec le personnel mis à pied du Centre justice et foi !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les négociations entre le campement pro-palestinien de l’UQAM et le rectorat s’amorce

L'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM (UPA-UQAM) a réitéré sa demande
d'adoption d'un boycott académique au recteur de l'Université du Québec à
Montréal, Stéphane Pallage, lors d'une rencontre aujourd'hui à 15h.
L'UPA-UQAM déplore que le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, ait avant
aujourd'hui feint l'ignorance sur sa capacité d'agir en solidarité avec la
lutte du peuple palestinien contre le génocide, l'apartheid et la violence
coloniale israélienne. Or, une résolution de boycott académique rédigée par
le groupe Solidarité pour les droits Humains des Palestiniennes et
Palestiniens de l'UQAM (SDHPP-UQAM) circule au sein de l'Université depuis
décembre 2023. Déjà, plusieurs instances de programme de l'UQAM ont adopté
cette résolution
<https://aecsspd.uqam.ca/2024/02/24/...>
« L'administration semblait plus préoccupée par les besoins matériels du
campement que de vouloir répondre aux revendications politiques”, affirme
Paul Science, étudiant nommé par l'UPA-UQAM pour faire la liaison avec
l'Université. “Toutefois, il y semble y avoir une ouverture au dialogue.
L'administration a reçu notre demande de boycott académique. Maintenant, la
balle est dans leur camp. »
En ce sens, l'UPA-UQAM impose un ultimatum à l'UQAM : le maintien de
l'occupation au Cœur des sciences et une escalade des moyens de pression
tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'adoption à la Commission des
études et au Conseil d'administration d'une résolution de boycott
académique.
Lundi dernier le recteur affirmait que l'UQAM n'a « aucun accord avec des
universités israéliennes » et que le campement rate sa cible. Or, malgré
l'absence actuelle d'entente formelle entre l'UQAM et des universités
israéliennes, il n'est aucunement garanti qu'elle n'en conclut pas à
l'avenir. En outre, Pallage admettait lui-même en entrevue qu'il
maintiendrait les ententes avec ces établissements si elles existaient.
Rappelons que M. Pallage avait lui-même signé une entente en 2015 avec
l'Herzliya Interdisciplinary Center, renommée Université Reichman en 2021,
alors qu'il était doyen de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
« En l'absence d'actions concrètes devant tenir Israël responsable des
violations de droits et des crimes recensés, la communauté internationale,
dont l'UQAM fait partie, contribue à saper les normes juridiques
internationales et encourage Israël à poursuivre ses actes criminels en
toute impunité », déplore Leila Khaled, étudiante à l'UQAM et porte-parole
de l'UPA-UQAM. « Or, l'UQAM peut à faible couts montrer l'exemple et
explicitement affirmer qu'elle ne sera pas complice des crimes
internationaux que commet l'État voyou d'Israël. »
*Ultimatum pour un boycott académique*
Explicitement, un boycott académique à l'UQAM implique :
● La fermeture de toute entente bilatérale d'échange étudiant entre
l'UQAM et des universités israéliennes ;
● L'interdiction de signer des ententes d'échange étudiant avec les
universités israéliennes ;
● La dissuasion à la communauté universitaire de toute collaboration
institutionnelle, culturelle et universitaire avec le gouvernement
israélien.
● L'interdiction de promouvoir le programme de Coopération
bilatérale Québec-Israël.
● La reconnaissance du nettoyage ethnique effectué par Israël sur le
peuple palestinien.
● La dénonciation du génocide, des crimes de guerre, de l'apartheid
et des pratiques coloniales d'éradication du peuple palestinien en cours.
● Le développement d'ententes et initiatives de collaboration entre
l'UQAM et les universités palestiniennes, leurs étudiant-e-s et leurs
chercheur-e-s.
● Le rappel de l'importance politique et juridique de respecter la
lettre et l'esprit de la Politique 43 de l'UQAM encadrant la Politique
internationale, en particulier l'art. 2.1, c, et f.
*Perturbation économique et expansion du mouvement*
L'UPA-UQAM souhaite réitérer que ses demandes ne visent pas uniquement
l'Université. « Les gouvernements du Québec et du Canada sont des acteurs
clés quant à l'imposition de sanctions économiques à l'égard d'Israël »,
explique Leila Khaled.
D'ailleurs, l'UPA-UQAM défend que le bureau diplomatique que le
gouvernement québécois projette de développer en Israël doit purement et
simplement être aboli.
L'UPA-UQAM encourage ainsi la perturbation économique des activités
contribuant à l'oppression du peuple palestinien ou collaborant avec
Israël, afin de construire un rapport de force menant à l'abrogation de
toutes ententes interétatiques ou inter-institutionnelles avec Israël.
De même, l'UPA-UQAM collabore à la multiplication de campements dans les
autres universités et dans les cégeps afin de construire également ce
rapport de force pour un boycott académique généralisé.
Enfin, l'UPA-UQAM réaffirme sa solidarité avec le campement de McGill. Il
est impératif que le Comité des investissements de Concordia (Concordia
Investment Committee) et le Conseil d'administration de McGill (Board of
governors) divulguent le montant des investissements dans les entreprises
complices. McGill et Concordia doivent immédiatement retirer les dizaines
de millions de dollars qu'elles ont investis dans des entreprises complices
du colonialisme irsaélien.
Vive la lutte palestinienne, à bas le génocide de Israël !
Vive l'intifada étudiante !
Vive la liberté et la justice pour toustes !
Solidarité pour les droits Humains des Palestiniennes et Palestiniens
(SDHPP) basé à l'UQAM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
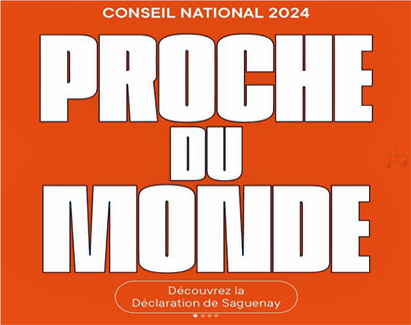
Quelques réflexions concernant la Déclaration de Saguenay
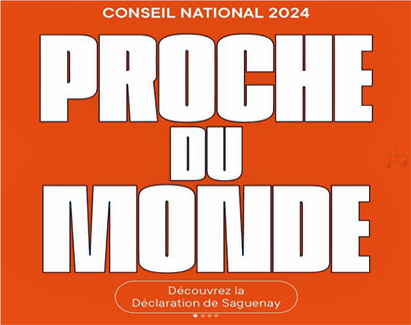
Introduction [1]
Cet article est une mise à jour d'un texte déjà publié en ligne. Il contient une critique du processus d'élaboration de la Déclaration de Saguenay, de sa forme et de son rôle dans le discours de Québec solidaire (QS). De plus, il met en évidence des problèmes de respect des statuts du parti et des mandats respectifs de certaines instances. À noter, que la version du Cahier de proposition discutée ici est celle publiée le 17 avril 2024 et que ce Cahier a été modifié le 10 mai 2024, après la date limite de présentation des ajouts et des amendements par les instances statutaires fixée au 1er mai 2024.
Rapport entre la Déclaration de Saguenay et la tournée des régions
• La Déclaration de Saguenay se veut le résultat de la Tournée de régions lancée en juin 2023 ;
• cette tournée est en fait une version dévoyée de ce que plusieurs associations ont fait pendant la rédaction du programme : tenir des cercles citoyens !
• les cercles citoyens (depuis longtemps oubliés ou soigneusement évités ?!) étaient des assemblées générales en bonne et due forme, auxquelles participaient les membres de l'association (ou de l'instance statutaire) et la population locale dans la circonscription ou la région ;
• « en bonne et due forme » veut dire que la présence active des membres de l'association concernée (ou de l'instance) implique un travail de rédaction des propositions, et non une conférence écoutée et donnée par une personne représentant le parti ;
• les résultats de ces cercles citoyens étaient rédigés sous forme de propositions intégrées dans le Cahier de propositions et suivaient la procédure courante de délibération et d'adoption ;
• s'il y a des procès-verbaux des rencontres organisées pendant la tournée, pourquoi ils n'ont pas été publiés ?
• tous les sujets de cette Déclaration sont déjà présents dans le programme du parti soit par leur généralité (par exemple, transport, logement, indépendance, etc.), soit par leur particularité (par exemple, la création des Conseils régionaux de développement et de transition qui découlerait de la section 5.3.2 Décentralisation démocratique et régions, p. 59 du programme).
Conseil national ou Congrès : qui décide de la Déclaration de Saguenay ?
• Selon les statuts du parti, le Conseil national (CN) ne peut modifier le programme ou y ajouter des amendements ; seul le Congrès du parti peut le faire (voir dans les statuts, articles 10.1 Pouvoirs du Congrès et 11.1 Pouvoirs du Conseil national) ;
• toujours selon les statuts, « Si les circonstances l'exigent, le Conseil national, pour des raisons urgentes et importantes, peut utiliser, de façon transitoire, les pouvoirs habituellement dévolus au Congrès. Dans ce cas, les décisions se prennent aux deux tiers des voix. » (extrait de l'article 11.1 des statuts, nous soulignons) ;
• donc, c'est le CN lui-même qui décide, aux deux tiers des voix, de s'octroyer les pouvoirs du Congrès ;
• ainsi, le Comité de coordination national (CCN) ne peut transférer les pouvoirs du Congrès au CN et faire adopter par ce dernier des modifications ou des ajouts au programme ;
• il faut faire la démonstration, séance tenante du CN, du caractère urgent de la situation qui exige l'utilisation des pouvoirs du Congrès par le CN.
• on ne peut simplement invoquer la tournée des régions comme « urgence » pour que le CN adopte la Déclaration de Saguenay ;
• il n'y a aucune urgence pour modifier le programme ; la question si le programme est désuet ou s'il est réalisable en un ou plusieurs mandats de gouvernement ne constitue pas une urgence ;
• le Congrès est « [l'i]nstance suprême du parti, ses décisions sont mises en œuvre par toutes les instances du parti. » (extrait de l'article 10.1 des statuts) ;
• finalement, la suprématie du Congrès veut dire qu'une fois on sort de la situation d'urgence, l'utilisation temporaire des pouvoirs du Congrès par le Conseil ne peut empêcher ce premier d'annuler les décisions du second ;
• ainsi, le Congrès peut annuler toute décision prise par toute autre instance, incluant le CN, et même par un Congrès précédent.
Rôle de la Déclaration de Saguenay dans le discours du parti
Voici comment le Comité de coordination national (CCN) voit la Déclaration et comment il agira suite à son adoption :
• « Les principaux engagements politiques que nous vous proposons d'adopter comme parti à la suite de cette tournée se retrouvent dans la proposition que nous appelons la Déclaration de Saguenay. Ce document vise à être un socle à partir duquel nous construirons notre discours politique sur différents dossiers importants pour l'avenir du Québec lors des prochaines années. Ce sont des choix politiques importants que nous aurons à faire lors de notre Conseil national et nous avons hâte d'en débattre avec nous. » (page 2 du Cahier de propositions).
• bien que les considérants ne soient pas votés avec leurs propositions respectives, ce paragraphe dit clairement que les propositions à adopter vont affecter « notre discours politique [...] pour l'avenir du Québec » ;
• sachant que trois documents officiels définissent le discours politique du parti, à savoir, la Déclaration de principes, le programme et la plateforme électorale, et puisque la Déclaration est « un socle », autrement dit, base, fondation, principe, etc., on voit ici que la Déclaration déterminera directement une modification du programme ou son remplacement en 2026 ;
• si cette Déclaration ne modifie pas le programme, à quoi servira-t-elle ? Selon la vision du CCN, elle servira à ajouter de nouveaux éléments aux « plusieurs prises de position politique du parti [qui] ne se retrouvent pas dans le programme, puisqu'elles ont été adoptées lors d'autres instances nationales et non dans le strict processus d'élaboration du programme. » (page 19 du Cahier de propositions, nous soulignons).
• cette mise en avant du « socle » fondateur par le CCN fait écho aux déclarations médiatiques non mandatées du co-porte-parole masculin sur le soi-disant pragmatisme nécessaire impliquant impérativement un nouveau programme (proposition 15 du Cahier de propositions).
Déclaration, principes fondateurs, programme et plateforme électorale
• Quelle est la place de la Déclaration par rapport à trois autres documents fondamentaux (la Déclaration de principes, le programme et la plateforme électorale) ? Est-ce un quatrième document fondateur ? Quelle est l'instance nationale qui peut adopter un tel document ? La Déclaration fait-elle partie du programme ou de la plateforme ? Quelle est l'instance qui décide de la place de ce texte dans le « discours politique » du parti ?
• ayant déjà souligné le lien étroit entre Déclaration et programme, à quoi sert une Déclaration qui ne fait que répéter les éléments du programme ? De même, la Déclaration contient des propositions tellement précises que leur place toute désignée serait la plateforme, notamment, la reconnaissance de l'Union des producteurs agricoles, la révision du rôle de la Société d'habitation du Québec (SHQ), les Conseils régionaux de développement et de transition (CRDT), la convocation un sommet national afin de lancer une nouvelle Corvée habitation, etc. Pourquoi ne pas attendre la rédaction de la plateforme électorale de 2026 pour inclure ces propositions dans le Cahier de propositions afférent ?
• et puis le CCN n'est pas le seul à voir que la Déclaration amène un nouveau programme ou de nouvelles propositions au programme existant, les consignes du Comité de synthèse encadrent cette nouveauté espérée de la Déclaration et ajoutent encore à l'ambiguïté de la place de la Déclaration dans le discours : « L'objectif est que cette déclaration se tourne majoritairement vers des éléments nouveaux pour notre parti et non pas de réitérer des engagements pris dans le passé. » (page 5 du Cahier de propositions, nous soulignons) ;
• également, ce comité reconnaît clairement les nouvelles retombées majeures de la Déclaration sur les politiques du parti, lire programme et plateforme : « Cette proposition [la Déclaration] nous amenant à débattre d'un texte de plusieurs pages, nous voulons nous assurer que les amendements reçus nous permettront de discuter d'enjeux politiques et non pas de procéder à un exercice de réécriture collective d'un texte en plénière, [...]. » (nous soulignons).
Conclusion
La mise à jour du Cahier de proposition le 10 mai 2024, qui stipule que « Le programme de Québec solidaire est l'âme de notre parti et représente le socle de notre projet politique. », a été probablement faite à cause des modifications et des critiques présentées par plusieurs instances et portant sur le rôle de la Déclaration. Le présent article en a mentionné quelques unes concernant l'élaboration de la Déclaration comme résultat de la tournée des régions ainsi que le respect des statuts et des mandats respectifs des instances nationales.
Cette mise à jour est, en réalité, un renversement total du rôle initial prévu pour la Déclaration qui cède sa place d'un élément déterminant du « discours du parti » au programme et rétablit ainsi, en espérant une fois pour toute, la primauté et la préséance de ce dernier. De plus, cette mise à jour ne fait que mettre en évidence le problème insolvable du rôle d'un élément programmatique mais qui n'est pas voulu comme tel.
Voilà pourquoi on ne peut exclure la visée transformatrice du programme ou de son remplacement, par le détour de la Déclaration, pour aboutir ensuite à la modification de la position du parti sur le spectre politique gauche-droite. Le renversement du rôle de la Déclaration, qui ne sera pas voté au Conseil national de mai 2024, est-il arrivé trop tard pour affecter les propositions qui y seront débattues ? En tout cas, le travail effectué par toutes les instances dans la production du Cahier de synthèse ne sera pas vain ; la suprématie du Congrès permet très bien de reprendre la discussion du programme et de sa mise à jour, comme prévu, dans un prochain avenir. C'est le Congrès qui décidera de la place de la Déclaration dans le discours du parti !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Merci à Isabelle pour la révision de la première version de ce texte ; je demeure le seul responsable de son contenu.

Projet de loi 56 : de conjoint·e·s de fait avec enfant au régime d’union parentale

Depuis l'annonce à la fin mars 2024 du gouvernement caquiste concernant le projet de loi 56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, la FFQ a été très active dans ce dossier fidèle aux positions que nous avons prises en 2016. Ce projet de loi est le troisième volet de la réforme globale en droit de la famille, suivant le projet de loi 2 en matière de filiation, de droit des personnes et d'état civil (sanctionné en juin 2022 mais dont la mise en vigueur est prévue en juin 2024) ainsi que le projet de loi 12 en matière de filiation, des enfants nés suite à une agression sexuelle et de gestation pour autrui (sanctionné en juin 2023). Cette réforme du droit de la famille est attendue depuis des décennies !
En effet, dans nos positions adoptées en 2016, nous souhaitions notamment militer pour une nouvelle législation du droit de la famille qui s'assure de prendre en compte la diversité de la composition des familles, qui évite que les femmes et les enfants portent le fardeau de l'appauvrissement inhérent à une séparation conjugale, qui s'assure d'un traitement égal des femmes peu importe leur statut et leurs identités et qui assure une cohérence entre le droit fiscal et civil. En plus, la FFQ demandait qu'une analyse différenciée selon les sexes soit produite avant toute législation à ce sujet.
Cette position de 2016 percole encore à ce jour dans le travail collaboratif qui a été entrepris avec le Groupe des 13 dans ce dossier. Nous avons proposé à nos membres de participer à une séance d'appropriation collective du projet de loi avec le Groupe des 13 le 5 avril dernier et nous avons partagé les éléments clés de ce projet de loi via notre infolettre d'avril 2024.
Après avoir collaboré étroitement avec divers groupes féministes et partenaires, nous avons rejoint les actions de mobilisation collective autour de ce projet de loi avec le Groupe des 13. Plus spécifiquement, le Groupe des 13 a eu des rencontres avec plusieurs partenaires et députés de différents partis politiques afin de présenter et défendre nos revendications. Nous avons participé activement au comité de rédaction du mémoire. En outre, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 56, notre responsable des dossiers politiques Sara Arsenault est intervenue pour présenter le mémoire du Groupe des 13 le 1er mai dernier à l'Assemblée nationale aux côtés d'Annie-Pierre Bélanger, coordonnatrice du Groupe des 13, et Marianne Lapointe, responsable de dossiers au CIAFT.
Nos principales recommandations en un aperçu :
– Respect des engagements en matière d'égalité : Que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'égalité énoncés dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022-2027. Que le gouvernement réalise une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) du projet de loi 56 et qu'il effectue, au besoin, les correctifs nécessaires.
– Simplification du droit de la famille (inclusion des régimes de retraite au patrimoine ; prestation compensatoire unifiée) : Que l'on modifie le Code civil afin d'accorder aux conjointes et conjoints de fait (tel que nous les définissons à la recommandation 3) les mêmes droits que les couples en union civile, c'est-à-dire que nous souhaitons leur rendre applicables les articles 521.6 à 521.19 et 585 à 596.1 du Code civil, avec les adaptations nécessaires, ainsi que les droits et obligations en matière de succession et aliments.
– Définition des conjoint·e·s de fait : Que l'on définisse les conjointes et conjoints de fait comme étant deux personnes, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre, qui : qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple et qui sont toutes les deux les parents d'un même enfant, sans égard à la durée de leur vie commune ; qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, depuis au moins trois ans ; ou qui ont signé un contrat de vie commune notarié et qui l'ont enregistré auprès du Directeur de l'état civil.
– Effet immédiat et droit de retrait : Que la loi s'applique aux conjointes et conjoints de fait répondant aux critères de notre recommandation 3, et cela, dès l'entrée en vigueur de la loi. Que les couples jouissent d'un délai d'un an après l'adoption de la loi pour se soustraire de son application par acte notarié et que le ou la notaire qui enregistre la décision ait l'obligation de s'assurer que chaque conjointe ou conjoint ait bénéficié d'un conseil juridique indépendant au préalable, comme condition à la validité de la convention.
Campagne d'information sur les droits : Que le gouvernement réalise une campagne d'envergure pour informer la population de ses droits en matière de droit de la famille à la lumière des modifications adoptées par le projet de loi 56.
En amont de ce travail, notre présidente Sylvie St-Amand avait émis des craintes concernant le choix d'exclure les REER et les fonds de pension du patrimoine commun dans un article paru dans Le Devoir. Notre passage à l'Assemblée nationale a de même été souligné dans un article de Radio-Canada le 7 mai dernier concernant la notion de violence judiciaire.
Nous suivrons de près les travaux de l'Assemblée nationale afin d'évaluer les retombées de ce projet de loi sur les femmes, lorsque sanctionné et mis en vigueur.

Plusieurs groupes invitent la population à aller à la séance du 21 mai sur le projet minier Horne 5 à Rouyn-Noranda

Le groupe Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié.e.s et le Comité ARET, appuyés par le groupe Mères au front - Val-d'Or, le Regroupement vigilance mines Abitibi-Témiscamingue (Revimat) , Eau Secours, la Coalition Québec meilleure mine et MiningWatch Canada encouragent la population de Rouyn-Noranda et des environs à assister à la séance d'information dédiée au projet Horne 5 de Ressources Falco Ltée prévue ce mardi 21 mai à 19h30, au Petit Théâtre de Rouyn-Noranda ou en ligne.
La séance consistera en une rencontre entre l'entreprise et la population de Rouyn-Noranda, sous les pieds de laquelle Falco souhaite développer son projet de mine d'or et d'autres métaux accessoires. La compagnie présentera les grandes lignes de son projet et la population sera invitée à lui poser des questions concernant ce dernier et concernant les procédures d'évaluation en cours. Des représentants du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) seront également présents.
Les liens entre les minières Falco et Osisko sont nombreux. Le président de Falco siège au conseil d'administration de Métaux Osisko qui, par l'une de ses filiales, a prêté des millions de dollars à Falco. Le 21 mai, l'information technique portant sur le projet Horne 5 et ses impacts proviendra de la compagnie elle-même, soit d'un acteur non-neutre. Il s'agit néanmoins d'une opportunité intéressante pour la population d'en apprendre davantage sur ce projet à risques élevés aux niveaux social et environnemental.
Quand : mardi, 21 mai 2024, 19h30
Où : Petit Théâtre du Vieux Noranda (112, 7e Rue), en ligne site du BAPE ou Facebook
Citations
« Une nouvelle pression industrielle cherche à s'ajouter dans notre milieu déjà trop lourdement affecté. Il est important de se renseigner pour agir », Jennifer Ricard Turcotte, Mères au front - Rouyn-Noranda
« Pour connaître les impacts du projet minier Horne 5 sur la qualité de l'air, il faut participer aux séances d'information et poser des questions jusqu'à ce que nous obtenions des réponses », Nicole Desgagnés, Comité ARET
« Les projets de mines d'or se multiplient partout dans la région. Suivre aujourd'hui le projet Horne 5, c'est aussi anticiper ce qui se passera demain ailleurs », Geneviève Béland, Mères au front – Val-d'Or
« En démocratie, la participation des gens aux débats publics est essentielle. Il est important d'offrir des tribunes indépendantes de la seule parole des promoteurs miniers », Marc Nantel, Regroupement vigilance mines Abitibi-Témiscamingue
« Comme pour tout projet minier, les impacts appréhendés du projet Horne 5 sur la qualité de l'eau sont sérieux et préoccupants. Nous entendons participer à toutes les étapes pour faire la lumière et exiger une saine gestion de notre bien commun », Rébecca Pétrin, Eau Secours
« C'est le début d'un processus important pour exiger la meilleure prise de décision concernant le projet minier Horne 5. Le rôle de la population est crucial et nous serons présents pour aider les gens à faire entendre leurs voix », Rodrigue Turgeon, avocat, Coalition Québec meilleure mine et MiningWatch Canada

Haïti : un Conseil présidentiel dans la tourmente de la terreur des gangs armés

Alors qu'une lutte serrée pour la présidence du Conseil présidentiel de transition (CPT) en Haïti laissant croire qu'une entente n'était pas à portée de main, une solution a été trouvée avec un accord sur une présidence tournante de cinq mois pour chacun des quatre candidats au sein du conseil. Cet accord, conclu le mardi 7 mai, cherche à apporter une certaine stabilité. Y réussira-t-il, alors que le pays est en proie à une profonde crise sécuritaire et sociale.
19 mai 2024 | tiré du Journal des alternatives
https://alter.quebec/haiti-un-conseil-presidentiel-dans-la-tourmente-de-la-terreur-des-gangs-armes/
Alors que les dirigeants politiques arrivent à une entente pour diriger le pays, l'insécurité continue de sévir dans les rues haïtiennes. La ville paisible de Gressier a été le théâtre de l'horreur. Le vendredi 10 mai, les gangs armés ont lancé une série d'attaques dévastatrices, semant la terreur parmi la population et les forces de l'ordre. Au cours de ces attaques brutales, plusieurs victimes ont été déplorées, dont des policiers courageux qui ont tenté de protéger la population contre la violence incontrôlée des criminels.
Depuis environ une semaine, les habitants de Gressier vivent dans la plus grande peur alors que les gangs continuent de maintenir leur emprise sur la zone, perturbant gravement la vie quotidienne et menaçant la stabilité de la commune. Les rues autrefois animées sont maintenant hantées par le silence, tandis que la population reste terrée dans leur résidence, craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches. La voie est strictement fermée aux véhicules, néanmoins, il n'y a que les piétons, sous l'autorisation des gangs qui peuvent traverser la route nationale.
Alors que l'accord entourant le CPT ouvre une nouvelle période qui sera tout autant un test pour cette nouvelle gouvernance, les enjeux sécuritaires restent immenses. Les gangs continuent de défier l'autorité et de semer le chaos, mettant en péril les progrès potentiels vers la stabilité et la reconstruction.
Dans ce climat de chaos et d'insécurité croissante, l'annonce de l'arrivée d'une force étrangère dirigée par le Kenya est vue par plusieurs Haïtien.nes avec un certain espoir. Cette force vise à restaurer la paix et la sécurité en Haïti, avec l'aval des puissances occidentales qui l'utilise pour conditionner leur aide pour surmonter la crise.
L'avenir d'Haïti dépend de la capacité pour la société civile et des mouvements sociaux d'offrir une gouvernance qui rompe avec l'ancien régime au pouvoir et de mobiliser l'ensemble des acteurs et actrices de changement à travailler conjointement pour mettre fin à la violence des gangs et restaurer la paix dans le pays.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

“La chute” : une œuvre de Wartin Pantois pour dénoncer l’inaction du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté

Le 15 mai, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a procédé à la présentation de la dernière œuvre de l'artiste Wartin Pantois : un collage photographique de 9 mètres par 5 mètres sur un des murs du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, au coin des boulevards Charest et Langelier, à Québec. Le thème de “la chute” a inspiré l'artiste ; notamment la chute collective qui nous menace quand le gouvernement refuse d'assumer son rôle en matière de solidarité sociale.
« Un Québec plus juste et plus solidaire est possible. Je souhaite que l'œuvre La chute interroge l'indifférence gouvernementale et contribue à mettre en action contre la pauvreté. » (Wartin Pantois)
L'URGENCE DE LA SOLIDARITÉ
Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, l'œuvre de Wartin Pantois évoque l'urgence de la solidarité envers les personnes en situation de pauvreté. « Quelle devrait être la réaction spontanée devant une telle image, quand on voit des gens perdre pied, tomber, s'enfoncer ? se demande le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Ne devrait-on pas avoir le réflexe d'agir, de porter secours aux gens ? L'indifférence du gouvernement du Québec à l'égard de la pauvreté et des personnes qui la vivent n'est pas seulement intolérable ; elle est tout simplement inexplicable !
« Le gouvernement doit agir de toute urgence, mais ce qu'on veut, ce n'est pas juste freiner la chute des gens. Le filet social, ça ne devrait pas être juste pour gérer les urgences ! Le filet social, c'est aussi pour améliorer le sort des gens, pour réduire sinon éliminer la pauvreté, pour réduire les inégalités, bref, pour faire du Québec une société plus juste et plus humaine. Avec le dépôt du 4e plan de lutte contre la pauvreté qui est attendu au mois de juin, le gouvernement a une belle occasion d'assumer ses responsabilités et de doter le Québec d'un plan ambitieux, qui vise l'élimination de la pauvreté. »
UN PETIT DÉTOUR PAR LE CENTRE JACQUES-CARTIER
Le lieu de l'installation de l'œuvre n'a pas été choisi au hasard. Le Centre Jacques-Cartier fait partie des nombreux groupes communautaires du quartier Saint-Roch qui essaient de faire une différence dans la vie des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Il sera possible d'y observer l'œuvre de Wartin Pantois… tant qu'elle résistera aux intempéries !
« La mission du Centre Jacques-Cartier est d'apporter un soutien aux jeunes à travers, notamment, l'éducation populaire. L'œuvre “La Chute”, par son message et son médium artistique, correspond à nos valeurs. C'est une démarche naturelle pour nous d'être un partenaire du projet. » (Laurent Metais, coordonnateur de la vie communautaire et associative)
LES TROIS « COMPLICES » DU PROJET
Wartin Pantois
Wartin Pantois est un artiste visuel socialement engagé. Son art in situ s'infiltre dans l'espace public et dans des lieux non conventionnels. Sa pratique artistique questionne le monde actuel, ses valeurs et ses possibles. Ses œuvres contextuelles sont autant de mises en perspective qui suscitent réflexions et discussions. Wartin Pantois vit et crée dans le quartier Saint-Roch à Québec. Il a effectué des interventions artistiques aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal et au Canada. Il détient une maîtrise en sociologie et une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Il travaille anonymement.
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 41 organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des régions du Québec. Des centaines de milliers de citoyen∙nes adhèrent à ces organisations qui ont dans leur mission la lutte à la pauvreté, la défense des droits et la promotion de la justice sociale. Depuis le début, le Collectif travaille en étroite association AVEC les personnes en situation de pauvreté.
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier
Le Centre Jacques-Cartier est un lieu d'appartenance entièrement consacré au bien-être des jeunes de 16 à 35 ans dont le projet de vie ne peut être soutenu par l'offre traditionnelle du milieu scolaire. Il véhicule leurs valeurs, respecte leurs aspirations, développe leurs talents, donne un sens et un but à leur vie, vise à améliorer leur qualité de vie et à développer leur pouvoir d'agir individuel et collectif.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À Québec, des rues dénaturées par l’affichage en anglais.

Bien que la situation ne soit pas aussi « dramatique » qu'à Montréal, Québec, la plus vieille ville française en Amérique du nord, voit de plus en plus son paysage visuel changé par un affichage commercial où un anglais frondeur prend parfois toute la place. Une dégradation lexicale éhontée, un tarabiscotage dû entre autres au laxisme de cette loi 101 qu'on vient juste de modifier avec la loi 96. Mais sera-ce suffisant pour contrer l'anglomanie galopante ?
Chose certaine, le touriste qui arpente les rues Côte de la Montagne, Saint-Jean, Saint-Louis ou Saint-Paul pour y trouver la patine linguistique « tipically french » tant recherchée, sera certainement déçu de voir comment les affiches quasi unilingues en anglais des franchises sans âme Mary's Popcorn, Mango Tea, Cool as a Moose, Sugar Daddy, David Tea, etc., ont pu si facilement remplacer le français des charmants bistros d'autrefois.
Et ce qui vaut pour l'affichage commercial extérieur, vaut aussi pour les instructions d'utilité publique, les événements culturels, (Fest, Week …), les menus de restaurants, les programmes …
C'est un cancer dont les métastases se sont propagées partout en basse-ville et aussi dans le faubourg St-Jean Baptiste, un quartier (le mien) réputé très militant, où des vitrines telles Stay Sharp, Gold Rice et Barber Shop donnent la réplique aux placards North Face et Vape Shop de ce monde. La « diversité linguistique » quoi !
Et le comble dans tout ça, c'est que souvent hélas les affiches fautives batifolent innocemment à côté des fanions et des gonfalons marqués ACCENT LOCAL semées à tout vent par la Ville dans un effort de promotion économique et sociale. Le franglais comme « accent local », vraiment ?


L'anglais, comme la renouée japonaise
En fait, j'ai l'impression que l'affichage en anglais est devenu aussi pire que la renouée japonaise en matière de colonisation du champ visuel de la Capitale-Nationale. Tu coupes une tige et il en repousse quatre issues du même rhizome. Ainsi, il y a peu, après avoir logé une plainte à l'Office Québécois de la Langue Française (OQLF), nous avons réussi dans mon quartier à pousser un commerçant « délinquant » à refaire son enseigne en français. Tout le monde était content, à commencer par le propriétaire lui-même, sauf qu'à peine trois semaines après, trois nouveaux commerces du même secteur s'affichaient pompeusement en anglais. Comme la renouée, je vous dis … Décourageant !
Mais comment se fait-il que l'on ne puisse compter que sur la dénonciation citoyenne et les sanctions (souvent risibles) de l'OQLF pour mettre au pas les commerçants inconscients ou peu scrupuleux ? Qu'est-ce qui fait qu'à Québec, haut lieu d'histoire et de culture, il soit si facile pour un commerçant non respectueux de la loi d'obtenir un permis d'exploitation ?
Partant, pourquoi doit-on toujours attendre de sévir en aval (avec l'OQLF) alors que ce serait si simple, en amont, si les municipalités, les sociétés de développement commerciales (SDC) et autres organismes concernés menaient conjointement de véritables campagnes de conscientisation pour un affichage commercial en français ? Qu'attend-on pour agir plutôt que de se renvoyer la balle quand ça dérape ? Et nos élus-es, tous paliers confondus, dorment-ils ? La cause n'en vaut-elle pas la peine ?
Finalement, adoptée il y a peu, la loi 96 doit devenir pleinement opérante en juin 2025, question affichage. D'ici là, en espérant que ce soit suffisant pour mettre le holà, j'espère seulement que Québec et son « ACCENT D'AMÉRIQUE » n'en pâtiront pas trop. C'est déjà bien assez de globish indigeste comme ça.
Gilles Simard, citoyen de Québec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
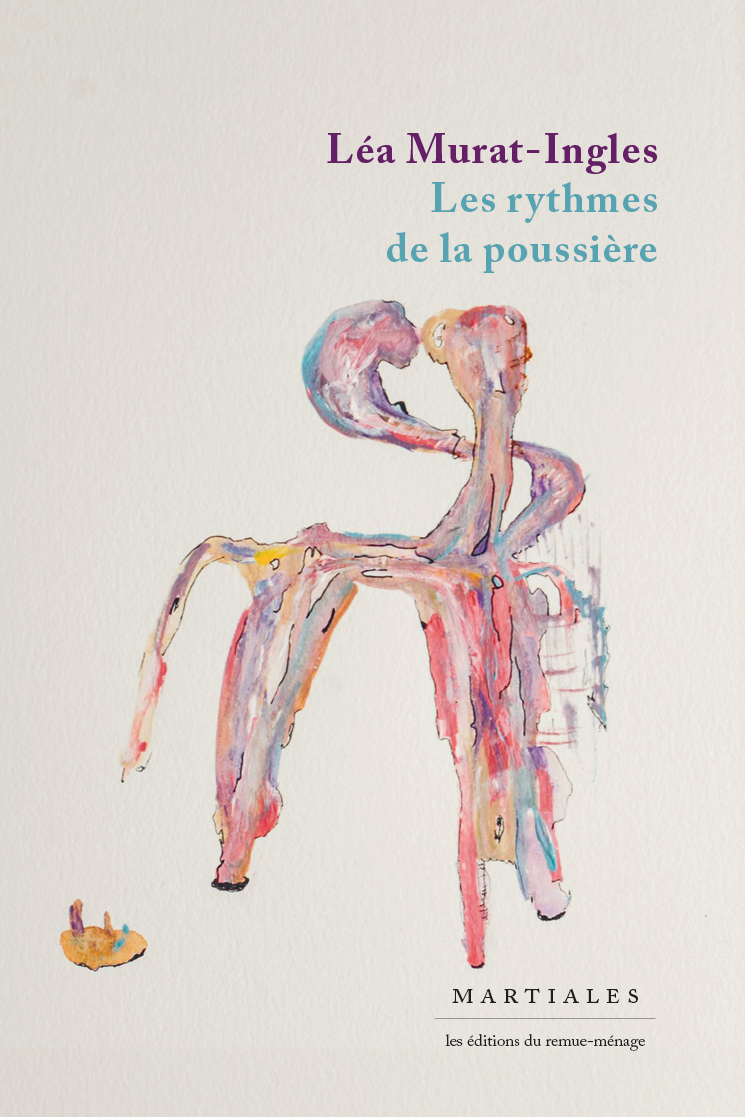
Les rythmes de la poussière
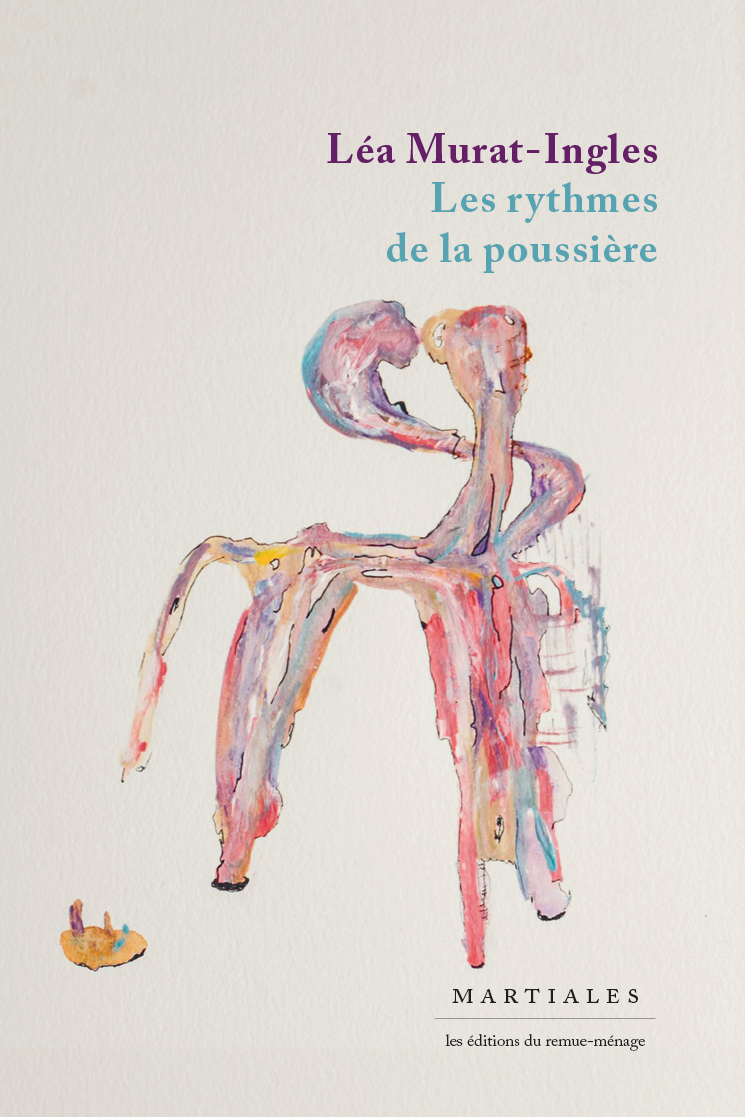
Léa Murat-Ingles
Sixième titre de la collection Martiales, dirigée par Stéphane Martelly,
Les rythmes de la poussière est le premier livre de Léa Murat-Ingles.
En 2045, une jeune femme se trouve confinée, isolée chez elle, en Amérique du Nord, pendant une énième pandémie. Elle plonge alors dans les archives léguées par sa grand-mère, qui est arrivée d'Haïti au Québec dans les années 1960. Elle mène en parallèle des recherches sur l'accès à l'histoire des communautés Noires, sur la constitution et le statut de leurs archives. Recluse dans un univers qui se virtualise et s'effrite, elle cherche à rétablir les liens avec sa famille, en tentant de retrouver quelque chose qu'elle croit avoir perdu.
« Je me demande si je serais plus saine d'esprit, plus sereine, si ma conscience était transférée dans un robot. Sans doute que cette version artificielle de moi résisterait mieux à la vie. Mes fantômes grondent. Elles sont agacées par ma bêtise. Dans les flocons de poussière qui valsent doucement vers le sol, je décide de revenir vers la seule chose qui pourrait me protéger autant qu'un corps synthétique : tous ces papiers, ces boîtes qui recèlent une partie cruciale de moi que j'ai tardé à chercher, mais que j'ai enfin commencé à trouver. »
extrait
Léa Murat-Ingles est doctorante en littérature à l'Université de Sherbrooke, auxiliaire de recherche et libraire occasionnelle. Ses travaux portent principalement sur la littérature haïtienne du Québec, l'afrofuturisme, l'intelligence artificielle et l'utilisation des archives dans la recherche-création. Ses textes ont été publiés dans les revues Mœbius, Possibles et dans le journal Montreal Review of Books. Les rythmes de la poussière est son premier livre.
photo ©Valérie Gassien
En librairie le 14 mai 2024 | 23,95$ | 224 pages
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

"Harlem : Une histoire de la gentrification"

France - Parution : "Harlem : Une histoire de la gentrification", par Charlotte Recoquillon, Éd. de la Maison des sciences de l'homme.
*Harlem : Une histoire de la gentrification*
Par Charlotte Recoquillon, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2024.
La gentrification de Harlem résulte des politiques publiques volontaristes qui y ont été déployées. Cet ouvrage présente plusieurs conflits locaux qui mettent en évidence les frictions et les tensions qui ont émergé entre les habitant⸱es, la municipalité et les acteur⸱ices privé⸱es. En faisant l'histoire de la gentrification de Harlem, ce livre contribue à documenter les modalités de mise en œuvre du racisme systémique et à enrichir la compréhension des dynamiques historiques de subjugation des espaces et des populations noires aux États-Unis.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
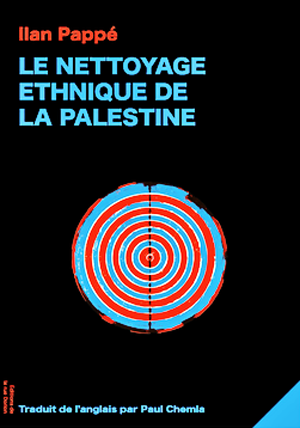
Le nettoyage ethnique de la Palestine d’Ilan Pappe
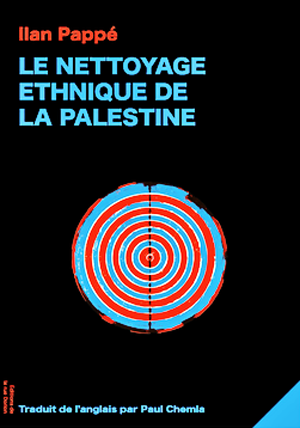
Nous publions ci-dessous l'avant-propos d'une nouvelle édition d'un livre d'Ilan Pappe, intitulée Le nettoyage ethnique de la Palestine publié cette année. Nous remercions l'éditeur "rue Dorion" qui nous a fait parvenir le pdf de ce livre.
Avant-propos
Cet avant-propos à l'édition française comporte deux parties. La première examine la pertinence du livre dans la période écoulée depuis sa parution, il y a une quinzaine d'années, et se rapporte également aux diverses réactions qu'il a suscitées. La seconde replace le livre dans le contexte des événements qui ont marqué la fin 2023 – la guerre contre Gaza et les événements du 7 octobre 2023.
Depuis la parution du livre, j'ai pu échanger avec un nombre incalculable de lecteurs et de lectrices qui ont démontré en quoi le livre restait aussi pertinent aujourd'hui en 2024 qu'au moment de sa parution il y a près de quinze ans. Cette pertinence se mesure de deux manières, qui sont corrélées.
Premièrement, il y a le fait que le terme de « nettoyage ethnique » pour qualifier les événements de 1948 soit désormais largement accepté. Dans un premier temps, ce terme a pu paraître trop extrême et exagéré pour bon nombre de chercheurs et de chercheuses ou de personnes qui avaient un lien avec la Palestine ou un intérêt pour le sujet. Toutefois, depuis la publication du livre, il semble que ce soit devenu le terme le plus commun pour désigner les événements de 1948. Ce qui veut dire qu'il s'agit de l'histoire d'un crime, que nous savons qui l'a commis et que nous pouvons réfléchir ensemble à la meilleure façon d'y remédier.
Deuxièmement, il semble que le concept de nettoyage ethnique puisse s'appliquer non seulement aux politiques israéliennes en 1948 mais aussi à la stratégie israélienne depuis lors. À bien des égards, nous ne sommes pas sortis de ce moment historique. L'opération de nettoyage ethnique de 1948 a permis à Israël de contrôler environ 80 pour cent de la Palestine mais elle a maintenu une minorité palestinienne assez importante au sein de l'État juif. La méthode du nettoyage ethnique a été remplacée entre 1948 et 1967 par un régime militaire sévère imposé à la minorité palestinienne en Israël.
Jusqu'à 1967, presque 20 % de la Palestine échappait encore au contrôle israélien. Israël s'est emparé de cette dernière portion de territoire lors de la guerre de juin 1967. Dès lors, la totalité de la Palestine était sous son contrôle mais il se trouvait confronté à d'immenses défis démographiques s'il voulait rester fidèle à l'idée d'un État juif incluant un nombre très réduit d'Arabes, voire pas d'Arabes du tout. La méthodologie développée par Israël pour conserver la totalité de la Palestine comprenait une panoplie de moyens : régime militaire, lois discriminatoires, pratiques et microprojets de nettoyage ethnique. Du nord au sud d'Israël, dans la région du grand Jérusalem, dans la région d'Hébron et dans la vallée du Jourdain, les Palestiniens ont été expulsés de façon à créer de nouvelles réalités démographiques sur le terrain. Ces opérations se poursuivent jusqu'à ce jour.
Cette réalité, ce que les Palestiniens appellent la « Nakba continuelle », nous ramène aujourd'hui à 1948, chaque fois que nous sommes confrontés à une démolition de maison, à l'assassinat d'un manifestant palestinien ou à tout autre abus des droits civiques et humains fondamentaux des Palestiniens.
Chacun de ces événements nous fait remonter dans le temps. Chaque année, ce voyage dans le temps nous ramène à un aspect différent de la Nakba. Ces derniers temps, ce qui me préoccupe plus que tout, c'est l'apathie et l'indifférence persistante des élites politiques et des médias occidentaux à l'égard de la situation des Palestiniens. Même l'horreur des camps de réfugiés palestiniens en Syrie n'a pas établi dans l'esprit des politiciens et des journalistes une possible connexion entre la nécessité de porter secours aux réfugiés et leur droit reconnu internationalement au retour dans leur pays.
Au plus fort de la guerre civile en Syrie, Israël se targuait de prodiguer des soins médicaux aux islamistes qui combattaient le régime d'Assad, les réparant avant de les renvoyer sur le champ de bataille, une action qualifiée d'humanitaire par l'État juif. Le refus de ce même État d'accueillir un seul réfugié du chaos syrien, refus tout à fait exceptionnel si l'on pense à ce qu'ont fait tous les autres voisins – bien plus pauvres – de la Syrie, est passé inaperçu.
C'est en juin 1948 que la communauté internationale a pris conscience pour la première fois du nettoyage ethnique en Palestine, lors de la première trêve dans les combats entre l'armée israélienne et les unités des armées arabes qui étaient entrées en Palestine le 15 mai.
À la fin de cette trêve, il est apparu clairement que l'initiative arabe pour reprendre la Palestine était vouée à l'échec. La trêve a permis aux observateurs de l'ONU de voir pour la première fois de visu la réalité sur le terrain à la suite du plan de paix proposé par l'organisation.
Ce à quoi ils ont assisté alors, c'est à un nettoyage ethnique à grande vitesse. La principale préoccupation du nouvel État israélien était à ce moment-là de profiter de la trêve pour accélérer la désarabisation de la Palestine. Ça a commencé dès l'instant où les armes se sont tues et ça s'est fait sous les yeux des observateurs des Nations unies.
Dès la deuxième semaine de juin, la Palestine urbaine avait déjà disparu et avec elle, des centaines de villages autour des principales villes. Les villes comme les villages ont été vidés par les forces israéliennes. La population a été chassée, souvent bien avant l'entrée des unités arabes en Palestine, mais les maisons, les boutiques, les écoles, les mosquées et les hôpitaux étaient toujours là. Maintenant que le bruit des tirs avait cessé, le vacarme des bulldozers qui rasaient ces bâtiments et les campagnes alentour ne pouvaient échapper aux observateurs de l'ONU.
Comme vous le verrez dans ce livre, les observateurs de l'ONU ont enregistré assez méthodiquement la transformation spectaculaire de ce paysage typique de la Méditerranée orientale que constituait alors la campagne palestinienne en un kaléidoscope de nouvelles colonies juives entourées de pins européens et de gigantesques systèmes de canalisations asséchant les centaines de ruisseaux qui parcouraient les villages – effaçant un panorama qu'on ne peut guère plus imaginer aujourd'hui que depuis quelques recoins relativement préservés de la Galilée et de la Cisjordanie.
Les observateurs de l'ONU ont rapporté sans relâche à leurs supérieurs qu'un nettoyage ethnique était en cours et les délégués de la Ligue arabe ont soumis des rapports similaires. La pression a fini par porter ses fruits puisqu'en décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 194. L'organisation internationale affirmait ainsi que la seule manière de pacifier le territoire était d'autoriser les réfugiés palestiniens à rentrer chez eux.
Cette logique a été acceptée par la Commission de conciliation pour la Palestine nommée par l'ONU pour assurer la mise en œuvre de la résolution 194, qui a donné lieu à la conférence internationale de Lausanne en mai 1949. L'effort de conciliation était mené par les Américains qui ont accepté également cette logique puisqu'ils ont fait pression sur Israël pour qu'il rapatrie un nombre significatif de réfugiés – pression qui comprenait une menace de sanctions.
Les mois ont passé et à la fin de l'année 1949, la pression états-unienne s'est relâchée. Le lobbying juif, l'escalade de la guerre froide dans le monde et le fait que l'attention de l'ONU se soit reportée sur le statut de Jérusalem, dont Israël contestait l'internationalisation décidée par l'organisation, sont les principales raisons de cette évolution. Seule l'Union soviétique a continué à rappeler au monde, par la voix de son ambassadeur aux Nations unies, et à Israël par le biais d'une correspondance bilatérale avec l'État juif, que la nouvelle réalité que le sionisme avait créée sur le terrain était encore réversible. À la fin de l'année, Israël est également revenu sur son engagement, pris sous la pression américaine, de rapatrier 100000 réfugiés.
Des colonies juives et des forêts européennes ont été implantées à la hâte sur des centaines de villages de la campagne palestinienne et les bulldozers israéliens ont démoli des centaines de maisons palestiniennes dans les zones urbaines pour tenter d'effacer le caractère arabe de la Palestine. Certaines de ces maisons ont été « sauvées » par des Israéliens, bohèmes ou yuppies, et des immigrés juifs fraîchement arrivés qui s'y sont installés avant de voir cette appropriation validée a posteriori par le gouvernement. La beauté de ces maisons et leur emplacement en ont fait des biens de premier choix sur le marché immobilier, prisés par les riches israéliens, les légations et les ONG internationales qui font souvent le choix d'y installer leurs nouveaux sièges.
Si le pillage au grand jour qui a commencé en juin 1948 a ému les représentants de la communauté internationale sur place, il n'a suscité aucune réaction chez ceux – rédacteurs en chef de journaux, responsables des Nations unies ou chefs d'organisations internationales – qui les y avaient envoyés. Le message de la communauté internationale à Israël était clair : le nettoyage ethnique de la Palestine – aussi illégal, immoral et inhumain soit-il – serait toléré.
Ce message a été parfaitement reçu et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le territoire du nouvel État a été déclaré exclusivement juif et les Palestiniens qui y sont restés ont été soumis à un régime militaire qui les privait de leurs droits civiques et humains fondamentaux tandis que des plans pour s'emparer des parties du territoire palestinien encore non occupées en 1948 ont été aussitôt mis en œuvre. Au moment où ils ont été pleinement exécutés en 1967, le message de la communauté internationale était déjà inscrit depuis longtemps dans l'ADN sioniste d'Israël : même si ce que vous faites est observé et enregistré, ce qui compte, c'est la manière dont les puissants de ce monde réagissent à vos crimes.
La seule manière de s'assurer que la plume de l'enregistrement sera plus puissante que l'épée de la colonisation, c'est d'espérer un changement dans le rapport de force en Occident et dans le monde en général. Les actions menées par les sociétés civiles, les responsables politiques consciencieux et les nouveaux États émergents n'ont pas encore été en mesure de changer ce rapport de force.
Mais on peut se sentir encouragés par les vieux oliviers de Palestine qui parviennent à repousser sous les pins européens, par les Palestiniens et les Palestiniennes qui peuplent à présent les villes juives huppées bâties sur les ruines des villages de Galilée, et par la ténacité des populations de Gaza, de Bil'in, d'alAraqib, de Cheikh Jarah et de Masafer Yatta, et garder l'espoir que ce rapport de force change un jour.
Une nouvelle Nakba : octobre 2023.
Deux récits concurrents ont accompagné l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël et la réaction génocidaire d'Israël à cette attaque. Les Israéliens ont insisté sur le fait que l'attaque venait de nulle part et qu'elle avait été provoquée par l'Iran et par la nature antisémite du Hamas, qui incarne selon ce récit un mélange de nazisme et de fondamentalisme islamique.
L'autre récit, porté entre autres par le secrétaire général des Nations unies, tenait à contextualiser historiquement l'attaque du Hamas – et j'ajouterais que la réaction israélienne demande aussi à être contextualisée.
Le contexte historique remonte au nettoyage ethnique de 1948 et même au-delà. Ce récit commence par observer que le sionisme est un mouvement de colonisation qui, comme d'autres mouvements de ce type, visait à éliminer les indigènes afin de construire un État pour les colons qui bien souvent, comme dans le cas du sionisme, venaient d'une Europe qui les chassait ou ne voulait pas d'eux.
En tant que mouvement politique, le sionisme a attendu 1948 pour faire passer l'élimination des indigènes palestiniens au stade supérieur – en chassant la moitié d'entre eux hors de Palestine, en démolissant la moitié de leurs villages (500 villages) et en détruisant la plupart de leurs villes.
C'est ce contexte qui explique également comment la bande de Gaza a été créée. Israël l'a conçue comme un immense camp de réfugiés pour absorber les centaines de milliers de Palestiniens qu'il chassait du centre et du sud de la Palestine, dans la mesure où l'Égypte ne voulait pas les accueillir. Les derniers réfugiés ont été chassés des villages qu'Israël a détruits, brûlés et démolis en 1948. Ces villages étaient très proches de la bande de Gaza et c'est sur leurs ruines qu'un certain nombre des colonies attaquées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont été construites.
La Nakba continuelle – l'expulsion de 1967 (qui n'a jamais réellement cessé depuis), le régime militaire sévère et l'occupation qui a pris un tour particulièrement cruel à partir de 2020 et le siège inhumain de la bande de Gaza commencé en 2007 – sont les éléments de contexte historique plus récents qui expliquent à la fois l'action du Hamas et la réaction israélienne (qui était moins une réaction qu'une nouvelle intensification, comme en 1948, du nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et, à une moindre échelle, en Cisjordanie – au prétexte de l'attaque du Hamas).
À quatre reprises, depuis 2006, la population assiégée de Gaza a été bombardée depuis les airs, la terre et la mer. Les jeunes gens qui ont envahi des bases militaires, des kibboutzim et des villes (où ils ont commis des meurtres et des enlèvements) n'ont connu qu'une réalité – celle du ghetto de Gaza et des quatre bombardements. Ça ne justifie pas tout ce qu'ils ont fait mais ça donne une très bonne explication à ce qu'ils ont fait.
Pendant un temps, au lendemain de l'attaque du Hamas, et bien naturellement, Israël a reçu des témoignages de compassion et de soutien presque universels de la part de gouvernements du monde entier. Des grands monuments un peu partout dans le monde occidental ont été illuminés aux couleurs du drapeau israélien en solidarité avec les victimes (y compris la tour Eiffel).
Les responsables israéliens ont pris ces témoignages de compassion pour une carte blanche pour punir collectivement les deux millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza – ce qui, selon l'avis récent de la Cour internationale de justice, pourrait conduire à un génocide.
Ce qui va se passer à Gaza une fois que les opérations militaires auront cessé n'est pas absolument clair, y compris peutêtre pour les Israéliens eux-mêmes. Il semble que les responsables israéliens souhaitent annexer une partie de la bande de Gaza, concentrer les Palestiniens dans un espace encore plus densément peuplé et y imposer une réalité similaire à celle qui existe dans plusieurs parties de la Cisjordanie. L'avenir nous dira si cette stratégie fonctionne. Si c'est le cas, cela peut aisément conduire à d'autres soulèvements qui peuvent tourner à la guerre régionale.
Cela suppose l'emprisonnement perpétuel de millions de Pales tiniens et de Palestiniennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais dans des conditions encore plus dures et inhumaines.
Le nettoyage ethnique de la Palestine restera hélas un titre pertinent dans la décennie à venir et on ne décèle pas le moindre signe d'un processus de réflexion interne en Israël qui permettrait au pays de s'écarter de cette stratégie. Il est possible que les méthodes varient à l'avenir et que les objectifs soient ensuite dirigés non plus vers Gaza mais vers l'intérieur de l'État d'Israël ou la Cisjordanie.
La question demeure la même qu'au moment où le livre a paru pour la première fois : comment le monde réagira-t-il ? Israël sera-t-il toujours « la seule démocratie du Moyen-Orient » ou deviendra-t-il une source d'embarras stratégique et moral nécessitant une intervention internationale pour mettre fin au nettoyage ethnique continu de la Palestine qui menace à présent de tourner au génocide ?
Ilan Pappé, février 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les rebonds de l’histoire
Karl Marx disait que l'après révèle souvent les tendances lourdes de l'avant, il en constitue le révélateur autant que l'aboutissement ; ou quelque chose d'approchant, en tout cas.
Cette affirmation se vérifie pleinement dans la façon dont les classes politiques occidentales et une bonne partie de leurs opinions publiques ont longtemps considéré la civilisation arabe. Par contraste, Israël a toujours été présenté comme une société supérieure à celles qui l'entouraient.
En effet, les populations arabes ont toujours fait l'objet d'un mépris larvé de la part de beaucoup d'Occidentaux, comme si ça allait de soi. Dans la bande dessinée ("Le crabe aux pinces d'or" d'Hergé), dans certains romans, au cinéma et même dans la chanson on note un dénigrement des Arabes. On peut mentionner la célèbre chanson du chanteur de charme Adamo, "Inch'Allah" sortie en 1967, l'année de la guerre des six jours (du 5 au 10 juin) entre Israël et certains pays arabes (Égypte, Jordanie et Syrie), une chanson à la gloire d'Israël. Inutile de revenir sur le cinéma hollywoodien, notoirement pro-israélien et anti-palestinien.
De plus, les pays arabes producteurs de pétrole réunis au Koweït ont décidé à la suite de la guerre du Yom Kippour ( 6 au 24 octobre 1973) d'augmenter unilatéralement de 70% le prix du baril de brut et de réduire mensuellement de 5% la production pétrolière jusqu'à l'évacuation complète des territoires occupés par Israël et la reconnaissances des droits des Palestiniens. Cette offensive commerciale a contribué à provoquer une sérieuse crise économique en Occident.
C'est à partir de cette époque que le dénigrement des Arabes est devenu ouvert, virulent, et même haineux, surtout du côté américain, en dépit du pacifisme relatif du président Jim Carter.
Mais c'est aussi à partir de cette période que la question palestinienne est devenue plus connue en Occident et qu'un mouvement favorable à leur cause a pris son envol. On peut mentionner certains films et romans européens ; aussi, il faut le souligner, le film québécois d'Anaïs Barbeau-Lavalette "Inch'Allah" sorti en 2012.
Avec l'actuel conflit Gaza-Israël, la sympathie à l'endroit de la cause palestinienne s'affirme chaque jour davantage, même aux États-Unis du moins au niveau de l'opinion publique, encore que la partie est encore loin d'y être gagnée pour les Palestiniens.
Que peut-on augurer pour l'avenir ? Difficile de le savoir, mais le présent conflit marque sans doute un point tournant dans l'antagonisme israélo-palestinien. Un retour en arrière paraît impossible. Les contours des futures relations entre Israël et la Palestine demeurent flous, mais ce qui semble se dessiner ressemble à une rupture avec un passé particulièrement pénible pour les deux peuples, surtout les Palestiniens. Peut-on rêver d'un apaisement durable ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

ATELIER DISCUSSION – Archives et politique. Que faire dans la conjoncture actuelle ?
Ce vendredi 24 mai, 14h00, au Bâtiment 7, on se retrouve pour un atelier-discussion explosif sur le pouvoir des archives et de l’histoire, ainsi que sur leur impact dans le monde d’aujourd’hui. Un panel de quatre intervenant(e)s explorera :
- L’importance des documents imprimés dans l’histoire de l’activisme, et le rôle des collectifs d’archivistes militants pour stimuler la réflexion politique.
- L’approche épistémologique et les pratiques du collectif Archives Révolutionnaires.
- La conjoncture politique depuis les années 1980 et notre intervention dans le contexte actuel.
L’objectif sera de réfléchir en commun aux pratiques historiennes dans le contexte politique québécois, et la manière dont notre travail peut et doit participer à un combat pour le progrès social.
Après une discussion animée avec le public, un moment informel est prévu pour prolonger les échanges entre les participant(e)s. Nourriture et boissons fournies. À ne pas manquer !
OÙ : Bâtiment 7 (1900, rue Le Ber, Pointe-Saint-Charles)
QUAND : vendredi 24 mai, de 14h00 à 19h00
Plus de détails sur l’évènement Facebook


L’antisémitisme, arme de diffamation

Tandis que l'horreur de la guerre génocidaire israélo-américaine contre Gaza se poursuit sans relâche ni solution en vue, il n'y a eu qu'un seul développement vraiment encourageant : le déferlement de l'activisme propalestinien dans de nombreuses communautés américaines, plus particulièrement le magnifique mouvement sur les campus universitaires organisés en campements exigeant un cessez-le-feu permanent immédiat et le désinvestissement des entreprises liées à la machinerie israélienne de massacre et d'épuration ethnique du peuple palestinien.
Tiré de Inprecor 720 - mai 2024
15 mai 2024
Par Against The Current
En raison de l'autorité morale et du pouvoir de ce mouvement face à un massacre monstrueux financé par l'argent des contribuables américains, il n'est pas surprenant qu'il ait été attaqué de toutes parts, y compris par des représailles de l'administration des campus et des actions violentes de la police contre des étudiants et des enseignants sympathisants.
Une arme de l'extrême droite
Nous souhaitons nous concentrer ici sur une diffamation spécifique à l'encontre du mouvement : le fait qu'il serait « antisémite » ou qu'il prônerait le « génocide du peuple juif ». Ce mensonge est sans cesse relayé par une grande partie des médias, par le théâtre des auditions du Congrès et maintenant par la législation imposant des services de « surveillance de l'antisémitisme » dans les universités, et bien sûr par les groupes de pression « pro-israéliens » dirigés par l'AIPAC (America Israel Political Affairs Committee) et l'Anti-Defamation League (ligue anti-diffamation).
Une grande partie de l'hystérie au Congrès et dans les médias est propulsée par des éléments du mouvement d'extrême droite MAGA (Make America Great Again) qui, bien sûr, se sont peu exprimés sur les marcheurs suprémacistes blancs porteurs de torches « les Juifs ne nous remplaceront pas » à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Cela fait en fait partie d'une campagne républicaine plus large visant à discréditer et finalement à écraser toute expression progressiste dans l'enseignement universitaire, en particulier les arts libres.
L'accusation d'« antisémitisme » contre la solidarité avec la Palestine est un ajout opportuniste aux cibles existantes comme les programmes d'inclusion de la diversité et de l'égalité, la théorie critique de la race, les études de genre, tout ce qui est « woke » et d'autres menaces perçues contre ce que l'aile droite considère comme la civilisation occidentale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est aussi un prétexte pour ouvrir d'énormes brèches dans les protections de la liberté d'expression et pour purger les institutions académiques.
Ce qu'est l'antisémitisme, et ce qu'il n'est pas
Il s'agit notamment d'une campagne visant à criminaliser littéralement les slogans « Free, Free, Palestine » et « From the river to the sea, Palestine will be free » (De la rivière à la mer, la Palestine sera libre). (Mais personne ne propose d'interdire la déclaration du Likoud, le parti au pouvoir en Israël, et du Premier ministre Netanyahou, « du fleuve à la mer, souveraineté totale d'Israël »…). Quelle que soit la signification de ces phrases pour des personnes différentes dans des lieux différents, il n'y a aucune excuse pour les interdire en les qualifiant d'incitation à la haine ou de « génocide du peuple juif ».
Dans ce climat, il est nécessaire de défendre le militantisme de solidarité avec la Palestine et d'affirmer clairement ce qu'est l'antisémitisme – et ce qu'il n'est pas. L'antisémitisme est une idéologie de haine et de mépris à l'égard des Juifs, en tant que peuple et en tant qu'individus. S'il plonge ses racines dans le sectarisme religieux depuis des siècles, l'antisémitisme a pris la forme d'une théorie raciale pseudo-scientifique au cours des quelque 150 dernières années, en commençant par l'Europe. Comme toutes les formes de racisme, il est irrationnel et, dans le cas spécifique de l'antisémitisme, il attribue aux juifs divers stratagèmes pour contrôler la finance, la politique, les médias, etc.
Dans ses formes les plus extrêmes, l'idéologie et le mythe antisémites ont bien sûr alimenté la machine d'extermination nazie qui a presque anéanti la vie juive dans une grande partie de l'Europe. Dans ses formes les plus extrêmes, l'idéologie et le mythe antisémites ont alimenté la machine d'extermination nazie qui a presque anéanti la vie juive dans une grande partie de l'Europe.
La liberté de critiquer Israël
L'antisémitisme en tant qu'ensemble de stéréotypes raciaux antijuifs ne doit pas être confondu avec l'analyse critique de l'État israélien. Les « crimes d'apartheid et de persécution » d'Israël (comme les appellent Amnesty International et Human Rights Watch) contre le peuple palestinien ne sont pas plus à l'abri d'un examen minutieux que ceux des États-Unis au Vietnam et en Irak, de la Russie en Ukraine ou de la Chine contre le peuple ouïghour, la campagne Hindutva du gouvernement indien contre les musulmans, etc. La prétention idéologique d'Israël à agir en tant qu'"État-nation du peuple juif" cherche faussement - et dangereusement - à rendre tous les juifs responsables de ses actes criminels.
Dans ces conditions, et alors que les atrocités génocidaires diffusées en direct à Gaza augmentent de jour en jour, il peut être surprenant et encourageant de constater que si peu d'incidents antisémites se sont réellement produits. La plupart de ces incidents se sont produits en dehors du campus, comme le rassemblement des Proud Boys près de Columbia ou le discours de haine prononcé à l'extérieur du campus. (Un organisateur de manifestations sur le campus qui avait envisagé de "tuer des sionistes" a été immédiatement répudié).
D'où vient la violence
Dans le cas notoire de l'université Northeastern de Boston, l'administration a appelé la police sur le campus après que des chants « Kill the Jews » ont été signalés – des images vidéo ont montré qu'ils provenaient d'un contre-manifestant apparent portant un drapeau israélien.
Il y a eu beaucoup plus d'agressions physiques et de menaces contre des étudiants palestiniens, arabes et musulmans que contre des étudiants juifs. Bien entendu, toutes ces agressions sont vicieuses et absolument inacceptables sur un campus ou ailleurs. Les attaques contre les étudiants juifs sont à la fois moralement répugnantes et préjudiciables au mouvement de solidarité avec la Palestine.
Il est toutefois important de souligner un point soulevé par Nadia Abu el-Haj, professeur à Columbia et à Barnard, qui a elle-même été la cible de campagnes de diffamation sionistes au cours de sa carrière universitaire. Tout le monde sur le campus, dit-elle, a le droit absolu d'être en sécurité. Cela ne donne à personne le droit de mettre fin à un discours ou à une manifestation simplement parce qu'il ou elle ne se sent pas en sécurité.
En fait, une partie de l'objectif de l'attaque de la droite - rejointe de manière déplorable par une grande partie de l'establishment centre-libéral - contre la lutte propalestinienne sur le campus est de faire en sorte que les juifs se sentent en danger. L'instrumentalisation de l'insécurité juive de cette manière, comme outil contre la lutte contre le génocide, peut être considérée comme une manipulation de l'antisémitisme.
L'antisémitisme réel est-il en augmentation aux États-Unis aujourd'hui ? Probablement (bien que malheureusement les statistiques autrefois utiles compilées par l'ADL ne soient plus du tout fiables depuis qu'elle agit comme un avant-poste de propagande et de renseignement de l'État israélien). Il doit être résolument combattu, au même titre que toutes les autres expressions du racisme. Elle ne doit pas être confondue avec la dénonciation de ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, comme le génocide conjoint israélo-américain en Palestine.
Le 9 mai 2024, publié par Against the Current.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.

















