Derniers articles

Afrique du Sud : la xénophobie et le sexisme, un héritage de la colonisation et de l’apartheid

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/09/afrique-du-sud-la-xenophobie-et-le-sexisme-un-heritage-de-la-colonisation-et-de-lapartheid/
in Salim Chena & Aïssa Kadri, Routes africaines de la migration. Dynamiques sociales et politiques de la construction de l'espace africain, Paris : Éditions du Croquant, collection Sociétés et politique en Méditerranée, 7 mai 2024.
https://editions-croquant.org/societes-et-politique-en-mediterranee/990-routes-africaines-de-la-migration-dynamiques-sociales-et-politiques-de-la-construction-de-lespace-africain.html
En Afrique du Sud, les manifestations xénophobes sont récurrentes. En mai 2008, des émeutes racistes font soixante-deux morts. En 2015, des pillages à Johannesburg et à Durban visent des commerces tenus par des « étrangers » et font sept morts. En septembre 2019, le pays connaît une nouvelle flambée d'émeutes xénophobes. Les commentaires s'orientent vers les forts taux de chômage ou les niveaux élevés de pauvreté pour en expliquer la cause. Les images que renvoient ces mouvements – foule d'hommes armés de gourdins, de pierres, de machettes ou de haches, passant à tabac ou massacrant sur leur passage des « étrangers » (le plus souvent venus d'autres pays d'Afrique), détruisant leurs commerces ou brûlant des bâtiments – réfléchissent davantage les fortes violences de genre qui caractérisent le pays et qui se sont depuis accrues avec l'épidémie de Covid-19.
Extrait de l'introduction de l'ouvrage
par Salim Chena et Aïssa Kadri
Tandis que d'innombrables travaux traitent des migrations des Africains depuis l'Afrique vers l'Europe, peu évoquent les migrations intérieures au continent. Lorsque les migrations transsahariennes sont objets de recherches ou d'enquêtes, l'hypothétique destination européenne est habituellement au centre de la problématique. L'étude des migrations internationales, plus généralement, reste encore dominée par le paradigme des migrations Sud-Nord. Dans l'édition 2020 du rapport sur L'économie africaine, par exemple, le chapitre traitant de « la migration africaine », en dépit d'une volonté affichée de discuter les discours dominants, est consacré quasi-exclusivement aux pays de l'OCDE. Y compris lorsque l'impact sur les sociétés, économies et espaces d'émigration constitue un enjeu central de la recherche, le prisme des migrations en direction de l'Europe reste prégnant. Les récits qui traversent les constructions médiatiques et politiciennes des migrations des Africains sont, depuis longtemps, concentrés sur le présupposé d'une Europe menacée d'« invasion » par les traversées de la Méditerranée. Ce mot, « invasion », prononcé par Valery Giscard d'Estaing en 1991 s'est rapidement banalisé, et a été légitimé par sa reprise et sa diffusion. Il paraît bien faible à l'heure actuelle en comparaison du vocabulaire utilisé, de l'état du débat public, de l'orientation des politiques publiques et des résultats électoraux lorsqu'il est question des « immigrés » en Europe. La construction performative de l'invasion, de la menace migratoire, s'inscrit ainsi, à travers les caractéristiques des enjeux des mobilités interétatiques actuelles qu'elle révèle, dans un processus qui ressemble à une forme de « guerre ». Elle tend en tous les cas à travers des appropriations de la question migratoire, comme arme politique et symbolique, à l'établissement de nouveaux rapports de domination à l'échelle du monde. Il est nécessaire de mettre au jour comment se fabriquent, dans leurs interrelations et affichages publics, les assignations, dans un monde où l'exclusion vise de larges pans des sociétés. Il y a sans doute à revenir sur le prisme colonial et ses catégories, sur un certain ethnocentrisme « occidental » des sciences sociales dans la prise en compte et l'analyse des nouvelles migrations. Les thèmes et problèmes qui affichent de manière désinhibée le stigmate, deviennent récurrents, reproduits à l'envi, selon des schèmes et des stéréotypes qui font fi autant de l'histoire profonde, que des contextes actuels des circulations intra-régionales africaines, méditerranéennes et internationales.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
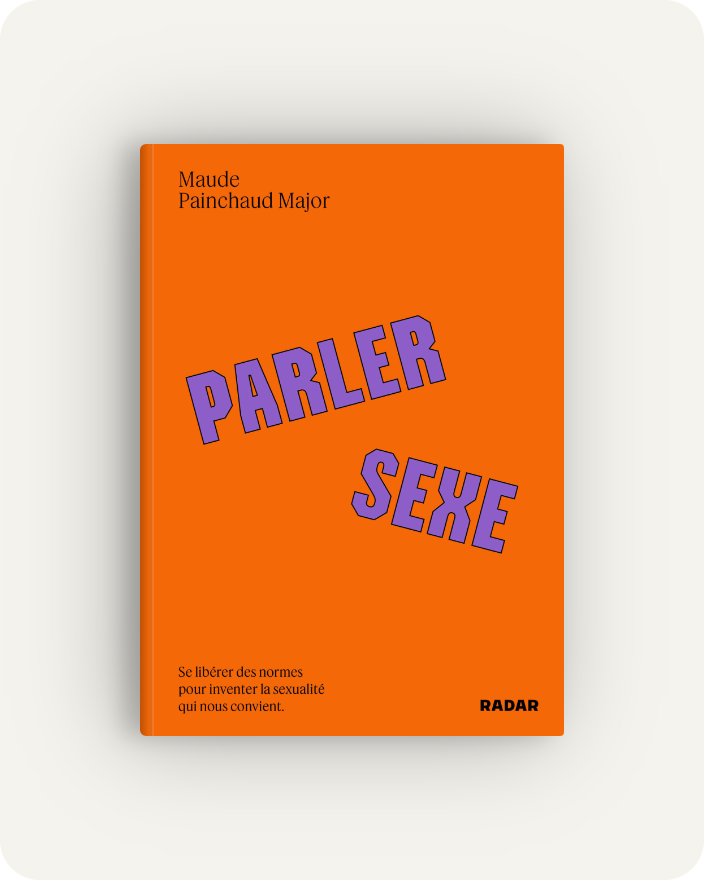
Parler sexe - Se libérer des normes pour inventer la sexualité qui nous convient
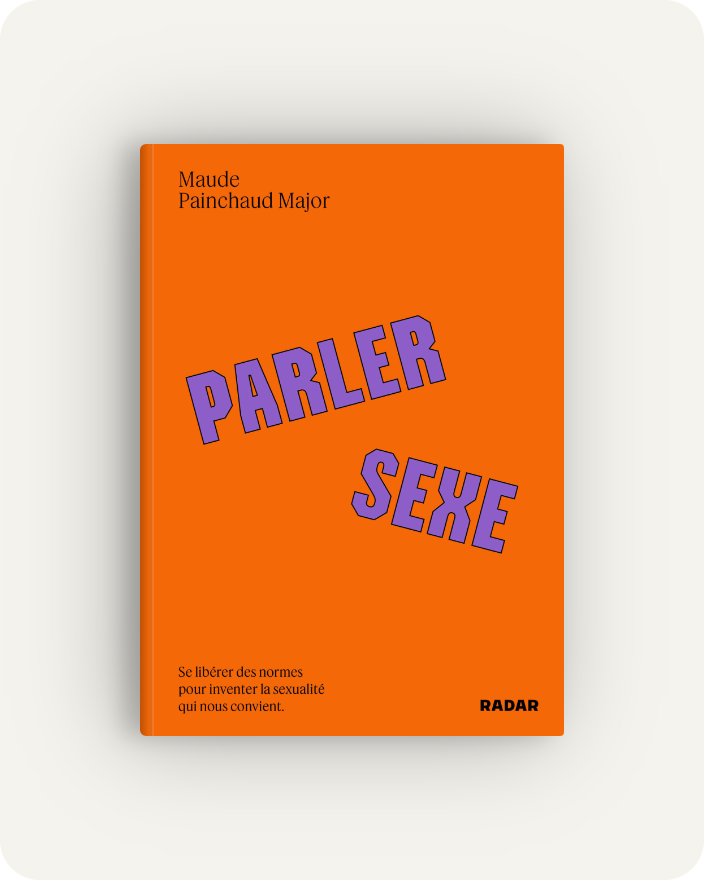
Construire sa sexualité sans se soucier des normes, avoir et donner du plaisir sans tabous, développer une intimité sexuelle loin des obligations de performance... Il est temps ! Par chance, la sexologue et tiktokeuse Maude Painchaud Major publie cette semaine un essai rafraîchissant, Parler sexe - Se libérer des normes pour inventer la sexualité qui nous convient, dans la collection Radar. Tous les détails se trouvent ci-bas dans l'infolettre.
Comment parler sexe aux jeunes en 2024 ? Forte de son expérience comme conférencière et animatrice d'ateliers en milieu scolaire, Maude Painchaud Major le fait avec le plus grand des tacts. Bien que le livre ne prétende pas remplacer un précieux cours d'éducation à la sexualité, il en incarne un complément particulièrement efficace, un rempart rassurant en ces temps où les sources d'informations ne sont pas toutes des mines d'or.
L'autrice offre une visite guidée généreuse et bienveillante des différents aspects de la sexualité auxquels est confronté·e un·e ado : pression de performance, désir, plaisir, consentement, stéréotypes de genre, orientation sexuelle, pornographie, contraception, masturbation, etc. Aux questions sans réponse, aux inquiétudes d'avant l'expérience, elle suggère la communication : parler entre partenaires, parler entre ami·es.
Ouvrage de référence à la fois concis et pratique, ce n'est toutefois pas le lieu d'une accumulation de statistiques. En effet, l'autrice prend davantage le parti de s'intéresser aux préoccupations d'ordre qualitatif que ressentent les élèves du secondaire. « La taille du pénis, est-ce que c'est important ? », « Peut-on avoir des relations sexuelles en étant menstruée ? », « Être beau, ou belle, qu'est-ce que ça veut dire ? », mais surtout : « Suis-je normal·e ? ».
« Le plaisir devrait être le pilier de la sexualité, la fondation sur laquelle tout le reste se bâtit. Le plaisir de se donner du plaisir à soi-même, de connecter intellectuellement, émotionnellement et physiquement avec d'autres êtres humains, de découvrir d'autres corps, d'avoir du plaisir à donner du plaisir, de partager son intimité, d'explorer toutes sortes de pratiques sexuelles, etc. »
– Maude Painchaud Major
Diplômée en sexologie, Maude Painchaud Major propose des ateliers et des conférences dans les écoles, centrés sur une éducation à la sexualité saine, positive et inclusive. Elle anime aussi une chaine Tiktok, pour répondre aux questions des ados sur la sexualité.
En librairie le 8 mai au Canada / 17 mai en Europe
Collection Radar (15 ans et +)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Israël interdit Al Jazeera afin de cacher la réalité de plus en plus embarrassante que cette chaîne dévoile
Ovide Bastien, professeur à la retraite, Collège Dawson
Le 5 mai, le gouvernement israélien ferme les bureaux d'Al Jazeera en Israël, confisque son matériel de diffusion, coupe cette chaîne de télévision des compagnies de câble et de satellite et bloque ses sites web.
Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou justifie ce geste en déclarant qu'Al Jazeera agit comme « porte-parole du Hamas, incite à la violence contre ses soldats, et porte atteinte à la sécurité d'Israël ».
Le 6 mai, le Hamas étonne le monde en annonçant qu'après de nombreuses semaines de négociations ardues, il accepte finalement une proposition de cessez-le-feu égypto-qatarie pour Gaza. Le lendemain, Nétanyahou annonce que la proposition ne rencontre pas ses exigences et que l'armée israélienne va envahir Rafah « afin d'éliminer complètement le Hamas ».
Le 8 mai, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin annonce que les Etats-Unis, en désaccord avec la décision d'Israël d'envahir Rafah, suspendent la livraison de milliers de grosses bombes à Israël.
Se pourrait-il que la pression énorme provenant des milliers d'étudiants qui manifestent dans de nombreuses universités aux Etats-Unis, appelant à un cessez-le-feu et au désinvestissement de leurs institutions de toute entreprise livrant des armes à Israël, commence à porter fruit ? Même si ces manifestants sont qualifiés par Nétanyahou « d'antisémites et ennemis d'Israël » et même « de nazis » ?
*************
Avant le début novembre dernier, j'obtenais mon information au sujet de l'invasion de Gaza par Israël, déclenchée à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, uniquement de médias comme le Devoir, Radio-Canada, CBC, le Guardian, El País, et BBC.
C'est grâce à Nadia Kanji, une étudiante du profil Les Études Nord-Sud du Collège Dawson que j'accompagnais lors du stage étudiant au Nicaragua en décembre 2010, que j'ai commencé à suivre aussi la chaîne de télévision Al Jazeera.
J'y suis devenu rapidement accro.
« Ovide, je réside présentement aux États-Unis et travaille pour l'émission Upfront d'Al Jazeera, » m'écrit-elle octobre dernier. « Voici le lien où tu pourras visionner notre dernier épisode. »
J'ouvre le lien. La qualité de cet épisode m'impressionne. Le reporter Marc Lamont interroge, pendant une demi-heure et sans annonce aucune, l'auteur d'un livre sur la question palestinienne.
Je décide de consulter le programme régulier d'Al Jazeera.
Je suis étonné de voir la qualité de sa couverture de la guerre à Gaza. Celle-ci dépasse, et de beaucoup, à la fois en profondeur et étendue, celle de toutes les autres sources que je consultais auparavant. En plus, je suis agréablement surpris de voir qu'il est possible de visionner toute la programmation en direct sur Internet, et ce gratuitement et avec fort peu d'annonces.
Je découvre éventuellement qu'Al Jazeera a plusieurs émissions-débats, de qualité similaire à Upfront – The Bottom Line, Inside Story, Listening Post, Witness, etc. – ainsi que plusieurs excellents documentaires. Ces émissions et documentaires portent sur les principaux sujets de l'actualité internationale, mais la question palestinienne, sans doute à cause de la guerre en cours, occupe la place d'honneur.
L'expertise des reporters qui animent ces émissions ainsi que leur maitrise de l'anglais m'étonnent. M'impressionnent aussi la diversité et grande compétence des personnes invitées à participer aux débats. Il n'est pas rare de voir parmi celles-ci des Juifs critiques du sionisme comme les historiens Norman Finkelstein et Ilan Pappé, l'autrice et activiste canadienne Naomi Klein, l'ex-négociateur israélien dans le cadre du processus de paix d'Oslo Daniel Levy, et l'écrivain israélien et membre de la direction du quotidien Haaretz Gideon Levy. Apparaissent aussi régulièrement de hauts placés, actuels ou passés, de divers gouvernements. Des États-Unis, du Royaume-Uni, et de divers pays arabes, mais aussi, assez étonnamment, du gouvernement israélien lui-même et de militaires des forces armées israéliennes.
Bien qu'Israël n'autorise aucun journaliste étranger à entrer dans la bande de Gaza à moins qu'il ne soit intégré à son armée, Al Jazeera a de nombreux reporters palestiniens là. Ces derniers, peu étonnamment, soulignent que leurs reportages proviennent d'un territoire occupé et s'acharnent à documenter méticuleusement la guerre, présentant au monde entier des images de chaque bombardement occasionnant la destruction massive de résidences, d'hôpitaux, d'universités, de mosquées, etc., de chaque carnage (présentement il y a 34 900 morts, 70% femmes et enfants, et 78 200 blessés), d'enfants affamés (31 en sont morts jusqu'à maintenant) par le blocage systématique d'aide humanitaire à Gaza, de fosses communes (celle découverte à l'hôpital Nasser, le principal établissement médical du centre de Gaza, contenait près de 400 cadavres)...
Ces images difficiles à regarder incommodent énormément le gouvernement Nétanyahou. Non seulement sapent-elles sa crédibilité lorsqu'il affirme faire tout ce qui est humainement possible afin de limiter le nombre de victimes civiles, mais elles noircissent aussi substantiellement son image dans l'opinion publique internationale.
Le simple fait que plus de 140 journalistes et employés des médias aient été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023 démontre le courage impressionnant dont ils font preuve. Mais aussi, malheureusement, la grande détermination du gouvernement israélien à faire taire leurs voix.
Doit-on vraiment s'étonner de voir le gouvernement Nétanyahou procéder à l'interdiction d'Al Jazeera en Israël ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Réaction à l’Infolettre de QS intitulée « La suite des choses pour notre parti » ─ 6 mai 2024.
Ce qui ressort le plus, à mon sens, dans les dernières déclarations de GND ainsi que dans les prises de position de la direction de QS, et qui est aussi le plus problématique, c'est le sentiment d'« urgence », voire de « panique » qui habite tout ce beau monde. Comme si les membres les plus influents du parti venaient de prendre conscience de l'ampleur de tous les problèmes soulevés (environnement, logement, services publics) et qu'il fallait, de ce fait, prendre le pouvoir à Québec « de toute urgence » pour remédier le plus tôt possible à la situation devenue alarmante. Comme si la volonté affirmée de résoudre au plus vite ces crises devenues « chroniques » allait pouvoir précipiter les événements en faveur d'un parti qui serait le seul à avoir les moyens d'en venir à bout. Comme si le fait, pour QS, de décréter l'« urgence » d'accéder au pouvoir parlementaire allait coïncider, comme par magie, avec ces autres « urgences » (climat, habitation, éducation, santé, etc.) Tout comme cette « foi » dans l'alignement favorable des planètes pour poser une action, prendre une décision, lancer un projet qu'on retrouve principalement dans l'ésotérisme ou l'astrologie, qui ne se sont pas des disciplines qui se démarquent particulièrement par leur caractère rigoureux, scientifique ou prédictif, on prend ses désirs pour la réalité et on veut une victoire électorale dans l'« immédiat ».
Pour quelqu'un qui veut faire prendre à QS un tournant « pragmatique », donc « réaliste », GND (appuyé semble-t-il par la nomenklatura du parti) fait preuve au contraire d'un très grand « idéalisme », pour ne pas dire d'un illusionnisme qui se détourne des fondements « idéologiques », « politiques » et « éthiques » de Québec Solidaire. Cet empressement subi à gravir les marches institutionnelles vers la gouvernance de la Belle Province est le symptôme, soit d'une perte de confiance dans le programme « progressiste » de QS, soit d'une montée de fièvre « politicienne », « partisane », « opportuniste » qui relègue au second rang les principes les plus élémentaires d'un mouvement social et populaire de « gauche ». Dans les deux cas, la seule réponse possible est la précipitation qui va toujours de pair avec l'improvisation. On s'interdit ainsi de mettre à profit le caractère potentiellement « rationnel » du libéralisme démocratique qui pourrait nous être favorable si on y adhère avec discernement.
Dans le contexte de cette démocratie libérale qui perd de plus en plus ses ancrages et d'un système parlementaire qui se fossilise en réaction au déclin du modèle (et du monde) occidental, ces tentatives de « recentrage », ce vocabulaire (« pragmatisme ») et cette méthode (« électoralisme »), directement inspirés du modèle stratégique « caquiste » (qui, comme on le sait, se démarque par ses « hauteurs de vue »), donnent l'impression d'une démission devant la lenteur du processus électoral qui n'est, somme toute, qu'un moyen parmi d'autres pour faire advenir la société à laquelle aspire la gauche québécoise. Avec la perspective pessimiste qui se fait jour depuis les dernières élections, le parti est confronté à faire des choix « difficiles », comme le disent notre chef, notre directrice et notre présidente, quoiqu'il faille interpréter ce constat en un sens fort différent de celui qu'ils veulent lui donner. Allons-nous nous enfoncer encore plus loin dans une optique « opportuniste » à partir de laquelle il faudra éternellement se questionner sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment le dire ou comment ne pas le dire, dans quelles circonstances il est bon d'affirmer ceci ou cela ou de ne pas l'affirmer (ou encore de l'affirmer sans vraiment l'affirmer), que maintient-t-on dans notre plate-forme électorale et que repousse-t-on aux calendes grecques ? Là est la question : comment se situer face au parlementarisme qui n'a pas que des qualités mais dont les militants progressistes ont accepté les règles en formant un parti en bonne et due forme (QS), quitte à redéfinir, en temps et lieu, au moment d'avoir en mains les rênes du pouvoir parlementaire, certains protocoles qui se sont empoussiérés depuis que l'Empire britannique nous a fait « cadeau » de son système électoral.
Étant donné la récente remontée du PQ dans les sondages qui pourrait se traduire par un retour au pouvoir du parti souverainiste et un déclassement de QS, avec comme conséquence une régression vers le troisième groupe d'opposition (ou peut-être même le quatrième), ce qui constituerait un recul encore pire qu'en 2022 où le pourcentage de votes en faveur du parti a diminué, il est compréhensible et même nécessaire de vouloir opérer un processus d'introspection (une sorte de « thérapie de groupe », si l'on veut), d'autant plus que les deux formations sollicitent à peu près le même électorat (une gauche plus ou moins modérée, souverainiste ou indépendantiste selon le cas, « progressiste » avec toutes les variantes sémantiques existantes qui peuvent qualifier cette expression).
Ceci dit, évitons de tomber dans l'auto-flagellation, la culpabilisation à outrance (mea culpa, mea maxima culpa), le remords de conscience, procédés que nous avons hérité de notre culture judéo-chrétienne (du moins, pour les plus vieux d'entre nous), car il semble bien que, déjà, nous ayons beaucoup d'éléments à portée de la main pour effectuer un questionnement « en-retour » sur les décisions (plus ou moins heureuses, plus ou moins pertinentes et avisées) prises depuis 2018 : a) Le résultat tangible de la stratégie de « recentrage » de la dernière campagne électorale, b) L'abandon du travail parlementaire par des éléments cruciaux du parti (Dorion, Lessard-Thérien), c) Les effets négatifs, perturbateurs, aliénants (et même « traumatisants ») de l'adoption, sans distance « critique », du rythme effréné imposé par l'appareil politico-médiatique qui dicte quasiment l'agenda du Parlement (ce qui constitue une entrave sérieuse à une démocratie parlementaire « libérée » des pressions extérieures indues exercées par des intérêts particuliers qui viennent en contradiction avec les intérêts de la Majorité, donc avec le Bien Commun) et, finalement, d) L'expérience, très parlante, de la surmédiatisation grandissante de GND qui a pour effet de concentrer l'attention sur le porte-parole masculin, au détriment, peut-être, des fondamentaux du programme, ce qui, de plus, nourrit faussement l'image d'un parti dirigé par un seul homme.
En résumé, même si la ferveur « citoyenne » (devrait-on dire « révolutionnaire » ?) est importante dans la militance, elle constitue une sorte de « carburant » pour se mobiliser, mener des actions, poser des gestes « concrets » et « significatifs », il faut garder la tête froide et prendre des décisions réfléchies à l'aune de nos valeurs, nos principes, notre sens de l'intégrité morale, éthique, politique. Dans ce qu'on peut lire, entendre, voir de la part des représentants « officiels » de QS (Internet, médias, réseaux sociaux), on perçoit assez bien une sorte d'irritation, de décontenance, d'impatience devant le piétinement que vit QS eu égard à la volonté populaire (toujours instable, il faut le dire) ; à l'inverse (comme on peut s'en rendre compte en consultant le site Presse-toi à gauche !), il ressort une vraie et grande sagesse venant de la base militante qui a à cœur de mener une réflexion rigoureuse en faisant la part des choses entre le réel « électoraliste » (dont il faut tenir compte) et la pureté « idéologique » (qu'on doit toujours garder à l'esprit). L'impasse dans laquelle semble se débattre actuellement le parti, autant au niveau des instances décisionnelles qu'au niveau du membership militant, va trouver sa résolution entre ces deux extrêmes…
Mario Charland
Shawinigan
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : Un salaire minimum de 250 euros en 2024, c’est toujours plus de pauvreté et de misère

D'après la résolution du Conseil suprême du travail, le salaire minimum augmenterait de 35,3% entre 2023 et 2024. Selon Sulat Mortazavi, le ministre des Coopératives, du Travail et de l'Etat social [depuis le 19 octobre 2022 – dans le gouvernement Ebrahim Raïssi], la rémunération minimum d'ensemble sera de 250 euros par mois en 2024.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les soi-disant représentants des salarié·e·s au Conseil suprême du travail affirment que cette augmentation du salaire minimum a été validée sans leur signature. Alors que ces « représentants syndicaux » avaient admis que pour faire face au « coût de la vie » 514 euros par mois étaient nécessaires, ils avaient néanmoins proposé pour 2024 un salaire minimum mensuel de 382 euros, soit 25% inférieur.
Le résultat est que, malgré l'inflation galopante et l'augmentation astronomique du coût de la vie, même 670 à 900 euros ne suffisent plus pour une famille de quatre personnes. Des millions de travailleurs doivent vivre avec des salaires trois fois inférieurs au seuil de pauvreté, ce qui n'est en aucun cas soutenable.
Le salaire minimum est déterminé chaque année par le Conseil suprême du travail, qui se compose de 9 à 10 représentants du gouvernement, des employeurs et de soi-disant représentants des travailleurs.
Au nom de ce tripartisme et sous prétexte que les travailleurs participent à la détermination du coût de leurs moyens de subsistance, les décisions anti-ouvrières du gouvernement et des employeurs sont imposées aux salarié·e·s dans le cadre de ce dispositif. Celui-ci et ces délégués fantoches, privent les travailleurs/euses de toute possibilité de s'opposer à la décision du Conseil suprême du travail. Résultat, le système capitaliste est plus fort d'année en année, et les salarié·e·s plus pauvres. En fait, ce Conseil suprême du travail tire vers la ruine des millions de travailleurs et travailleuses au début de chaque année.
Pour nous, le Conseil suprême n'est rien d'autre qu'une institution mensongère. Dans ce Conseil, les personnes représentant les travailleurs/euses n'ont aucun pouvoir de négociation, ils n'y sont présents que pour cautionner des décisions imposées.
Même s'ils avaient un pouvoir de négociation, le vote final appartiendrait de toute façon à la majorité des membres : si les représentants du gouvernement (le plus grand employeur du pays) et les représentants des organisations patronales privées ainsi que la chambre de commerce s'entendent sur un faible pourcentage d'augmentation des salaires, l'avis des faux représentants du travail n'a aucune valeur. Néanmoins ce Conseil fixe à sa convenance le montant du salaire minimum et l'impose aux salarié·e·s au nom du principe du tripartisme.
Les « représentants du travail » n'ont aucun pouvoir indépendant. Le gouvernement et les autres employeurs savent très bien qu'ils n'ont pas le soutien du peuple et des travailleurs qu'ils sont censés représenter. Ces représentants sont entrés dans ce Conseil grâce à des pots-de-vin et avec le soutien total du système. Ils ne disposent en conséquence d'aucune indépendance envers celui-ci.
Ils ne veulent pas recourir au pouvoir des travailleurs/euses, qui est celui de la rue, des manifestations et des grèves, contre les décisions anti-ouvrières du Conseil suprême des travailleurs.
Par conséquent, le Conseil suprême fait traîner en longueur ses travaux principalement pour maintenir l'apparence de ces réunions, et finalement, dans les derniers moments de l'année, il annonce sa décision anti-ouvrière à la population.
Le Conseil agit ainsi dans le but de montrer à la population que les « représentants du travail » étaient tous présents lors de ces réunions pour défendre les droits des travailleurs, et que ceux-ci ont participé à la décision du pourcentage d'augmentation du salaire minimum. Le but de cette manœuvre est de mieux pouvoir réduire au silence les travailleurs/euses en cas de mobilisations dans la rue.
Reste à comprendre pourquoi des travailleurs et des dizaines de millions de familles de travailleurs laissent leur sort entre les mains de ces représentants.
Le syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue (Vahed) condamne la fixation du salaire minimum à 247 euros par mois.
Il la considère comme inacceptable, et comme une attaque éhontée contre la vie, le corps et l'âme des travailleurs/euses et de leurs familles.
La seule façon de faire face à cette attaque contre les moyens de subsistance et la vie des travailleurs/euses de notre pays est l'unité, la mobilisation et la constitution d'organisations indépendantes.
La solution, c'est l'unité et l'organisation des travailleurs/euses ! (19 mars 2024)
Déclaration publiée en français par Echo d'Iran, Bulletin d'information sur le mouvement ouvrier en Iran, avril 2024)
http://alencontre.org/moyenorient/iran/iran-un-salaire-minimum-de-250-euros-en-2024-cest-toujours-plus-de-pauvrete-et-de-misere.html
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soldat ou soldate ?

Commençons dans l'ordre. Notre équipe défend les droits des femmes dans l'armée et après le service, et nous sommes tout à fait favorables à l'utilisation de titres féminins. Cela renvoie à la question de la visibilité des femmes et est plus profond qu'il n'y paraît à première vue.
Dans notre domaine professionnel, il est important d'utiliser des titres féminins, par exemple : vétéran et vétérane, défenseur et défenseuse. Il ne s'agit pas d'un usage artistique, mais si le cadre normatif ne précise pas la différence entre les sexes dans un groupe, il y a des risques de restriction des droits et de négligence dans les politiques destinées à ces groupes. Le langage façonne la conscience, la législation et les règlements sont tout ce qui guide une institution. Si vous n'avez pas mis le pain sur votre liste de courses, vous pouvez ou non vous en souvenir. C'est ainsi que cela fonctionne partout. Une fois que vous l'avez écrit, vous vous en souvenez.
Dans les professions militaires, il est également important d'utiliser des titres féminins. Il arrive que des enfants soient surpris de voir des femmes dans l'aviation, par exemple, parce qu'ils n'ont jamais entendu le féminin dans la bouche d'un pilote (messieurs les sexistes, nous vous avons laissé de la place pour des blagues dans les commentaires). Les mots façonnent notre vision du monde dès l'enfance, et c'est pourquoi les inégalités sont plus difficiles à éradiquer dans la société, car simplement au niveau du langage, les femmes n'existent pas dans certains domaines.
La présence de noms féminins normalise à long terme la présence des femmes dans diverses activités. Une femme de ménage, une princesse, une enseignante n'ennuient personne. Le mot directrice se banalise de plus en plus au fil des années. Pour une raison ou une autre, ce sont les professions militaires avec des titres féminins qui irritent le plus la communauté. Et est-ce une coïncidence si c'est dans l'armée qu'il existe encore des obstacles à l'évolution de la carrière des femmes ?
Les féministes ne résoudront pas les problèmes liés aux mécanismes de développement de carrière et ne créeront pas non plus un système de formation et de coordination de haute qualité. Cependant, les féminismes ont une approche différente : une approche qui prête attention aux besoins et à la diversité des personnes, et qui développe le potentiel et les capacités humaines pour renforcer le bien commun. C'est cette approche qui permet de construire des systèmes efficaces.
Dans une communication privée, il est normal que vous demandiez à être appelé d'une certaine manière et que votre interlocuteur se plie à votre demande au lieu d'argumenter. (...)
Féminiser n'est pas une raison de haïr. Gardez votre calme et respectez-vous les un.es les autres, car nous devons tous.tes gagner.
30 avril 2024
Veteranka - Жіночий Ветеранський Рух
Traduction : Patrick Le Tréhondat (9 mai 2024)
Image : Veteranka ("Vétéran(ne ?) du travail")

La privation de monde face à l’accélération technocapitaliste

La pandémie de COVID-19 a conduit à un déploiement sans précédent de l'enseignement à distance (EAD), une tendance qui s'est maintenue par la suite, et cela malgré les nombreux impacts négatifs observés. De plus, le développement rapide des intelligences artificielles (IA) dites « conversationnelles » de type ChatGPT a provoqué une onde de choc dans le monde de l'éducation. La réaction des professeur·e·s à cette technologie de « disruption[1] » a été, en général, de chercher à contrer et à limiter l'usage de ces machines. Le discours idéologique dominant fait valoir, à l'inverse, qu'elles doivent être intégrées partout en enseignement, aussi bien dans l'élaboration d'une littératie de l'IA chez l'étudiant et l'étudiante que dans la pratique des professeur·e·s, par exemple pour élaborer les plans de cours. Nous allons ici chercher à montrer qu'au contraire aller dans une telle direction signifie accentuer des pathologies sociales, des formes d'aliénation et de déshumanisation et une privation de monde[2] qui va à l'opposé du projet d'autonomie individuelle et collective porté historiquement par le socialisme.
7 mai 2024 | publié sur le site des Nouveaux Cahiers du socialisme
https://www.cahiersdusocialisme.org/la-privation-de-monde-face-a-lacceleration-technocapitaliste/
L'expérience à grande échelle de la pandémie
Les étudiantes, les étudiants et les professeur·e·s ont été les rats de laboratoire d'une expérimentation sans précédent du recours à l'EAD durant la pandémie de COVID-19. Par la suite, nombre de professeur·e·s ont exprimé des critiques traduisant un sentiment d'avoir perdu une relation fondamentale à leur métier et à leurs étudiants, lorsqu'ils étaient, par exemple, forcés de s'adresser à des écrans noirs à cause des caméras fermées lors des séances de visioconférence. Quant aux étudiantes et étudiants, 94 % d'entre eux ont rapporté ne pas vouloir retourner à l'enseignement en ligne[3]. Des études ont relevé de nombreuses répercussions négatives de l'exposition excessive aux écrans durant la pandémie sur la santé mentale[4] : problèmes d'anxiété, de dépression, d'isolement social, idées suicidaires.
Le retour en classe a permis de constater des problèmes de maitrise des contenus enseignés (sur le plan des compétences en lecture, en écriture, etc.) ainsi que des problèmes dans le développement de l'autonomie et de la capacité de s'organiser par rapport à des objets élémentaires comme ne pas arriver à l'école en pyjama, la ponctualité, l'organisation d'un calendrier, la capacité à se situer dans l'espace ou à faire la différence entre l'espace privé-domestique et l'espace public, etc.
D'autres études ont relevé, au-delà de la seule pandémie, des problèmes de développement psychologique, émotionnel et socioaffectif aussi bien que des problèmes neurologiques chez les jeunes trop exposés aux écrans. Une autrice comme Sherry Turkle par exemple note une perte de la capacité à soutenir le regard d'autrui, une réduction de l'empathie, de la socialité et de la capacité à entrer en relation ou à socialiser avec les autres.
Tout cela peut être résumé en disant qu'il y a de nombreux risques ou effets négatifs de l'extension des écrans dans l'enseignement sur le plan psychologique, pédagogique, développemental, social, relationnel. Le tout est assorti d'une perte ou d'une déshumanisation qui affecte la relation pédagogique de transmission en chair et en os et en face à face au sein d'une communauté d'apprentissage qui est aussi et d'abord un milieu de vie concret. Cette relation est au fondement de l'enseignement depuis des siècles ; voici maintenant qu'elle est remplacée par le fantasme capitaliste et patronal d'une extension généralisée de l'EAD. Or, il est fascinant de constater qu'aucun des risques ou dangers documentés et évoqués plus haut n'a ralenti le projet des dominants, puisqu'à la suite de la pandémie, les pressions en faveur de l'EAD ont continué à augmenter. À L'UQAM, par exemple, les cours en ligne étaient une affaire « nichée » autrefois ; après la pandémie, on en trouve plus de 800. L'extension de l'EAD était aussi une importante demande patronale au cœur des négociations de la convention collective dans les cégeps en 2023, par exemple. Il sera maintenant possible pour les collèges de procéder à l'expérimentation de projets d'EAD même à l'enseignement régulier !
Une société du « tele-everything »
Toute la question est de savoir pourquoi la fuite en avant vers l'EAD continue malgré les nombreux signaux d'alarme qui s'allument quant à ses répercussions négatives. Une partie de la réponse se trouve dans le fait que l'EAD s'inscrit dans un projet politique ou dans une transformation sociale plus large. Comme l'a bien montré Naomi Klein[5], la pandémie de COVID-19 a été l'occasion pour les entreprises du capitalisme de plateforme ou les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) de déployer le projet d'une société du « tele-everything » où tout se ferait désormais à distance grâce à une infrastructure numérique d'une ampleur sans précédent. Cela signifie non seulement un monde avec beaucoup moins d'enseignantes et d'enseignants, puisque les cours seront donnés en ligne ou éventuellement par des tuteurs-robots, mais cela concerne aussi un ensemble d'autres métiers dont les tâches sont d'ordre cognitif, puisqu'il s'agit précisément d'automatiser des tâches cognitives autrefois accomplies par l'humain. De nombreux métiers sont donc menacés : journaliste, avocat, médecin, etc. Désormais chacun pourra accéder, par exemple, au téléenseignement, à la télémédecine, au divertissement par la médiation d'un écran et depuis son foyer. Nous pouvons donc parler d'un projet politique visant à transformer profondément les rapports sociaux au moyen de l'extension d'un modèle de société technocapitaliste ou capitaliste cybernétique intercalant la médiation des écrans et de la technologie entre les sujets.
Vers une société cybernétique
Nous pouvons, en nous appuyant sur des philosophes comme le Québécois Michel Freitag ou le Français Bernard Stiegler, relever que la société moderne était caractérisée par la mise en place de médiations politico-institutionnelles devant, en principe, permettre une prise en charge réfléchie des sociétés par elles-mêmes. Plutôt que de subir des formes d'hétéronomie culturelles, religieuses ou politiques, les sociétés modernes, à travers leurs institutions que l'on pourrait appeler « républicaines », allaient faire un usage public de la raison et pratiquer une forme d'autonomie collective : littéralement auto-nomos, se donner à soi-même sa loi. La condition de cette autonomie collective est d'abord, bien entendu, que les citoyennes et citoyens soient capables d'exercer leur raison et leur autonomie individuelle, notamment grâce à une éducation qui les ferait passer du statut de mineur à majeur. Le processus du devenir-adulte implique aussi d'abandonner le seul principe de plaisir ou le jeu de l'enfance pour intégrer le principe de réalité qu'implique la participation à un monde commun dont la communauté politique a la charge, un monde qui est irréductible au désir de l'individu et qui le transcende ou lui résiste dans sa consistance ou son objectivité symbolique et politique.
D'après Freitag, la société moderne a, dans les faits, été remplacée par une société postmoderne ou décisionnelle-opérationnelle, laquelle peut aussi être qualifiée de société capitaliste cybernétique ou systémique. Dans ce type de société, l'autonomie et les institutions politiques sont déclassées au profit de systèmes autonomes et automatiques à qui se trouve de plus en plus confiée la marche des anciennes sociétés. De toute manière, ces dernières sont de plus en plus appelées à se dissoudre dans le capitalisme, et donc à perdre leur spécificité culturelle, symbolique, institutionnelle et politique. Ces transformations conduisent vers une société postpolitique. Elles signifient que l'orientation ou la régulation de la pratique sociale ne relève plus de décisions politiques réfléchies, mais se voit déposée entre les mains de systèmes – le capitalisme, l'informatique, l'intelligence artificielle – réputés décider de manière plus efficace que les individus ou les collectivités humaines. Bref, c'est aux machines et aux systèmes qu'on demande de penser à notre place.
Les anciennes institutions d'enseignement se transforment en organisations calquées sur le fonctionnement et les finalités de l'entreprise capitaliste et appelées à s'arrimer aux « besoins du marché ». Plus les machines apprennent ou deviennent « intelligentes » à notre place, et plus l'enseignement est appelé, suivant l'idéologie dominante, à se placer à la remorque de ces machines. Désormais, la machine serait appelée à rédiger le plan de cours des professeur·e·s, à effectuer la recherche ou à rédiger le travail de l'étudiante ou de l'étudiant ; elle pourra même, en bout de piste, corriger les copies, comme cela se pratique déjà en français au collège privé Sainte-Anne de Lachine. L'humain se trouve marginalisé ou évincé du processus, puisqu'il devient un auxiliaire de la machine, quand il n'est tout simplement pas remplacé par elle, comme dans le cas des tuteurs-robots ou des écoles sans professeurs, où l'ordinateur et le robot ont remplacé l'ancien maître. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évoque déjà dans ses rapports un monde où les classes et les écoles physiques auront tout bonnement disparu. Ce projet participe aussi d'un processus de délestage ou d'« extranéiation » cognitive qui est à rebours de la conception moderne de l'autonomie, et qu'il convient maintenant d'expliciter.
Délestage ou extranéiation cognitive
Le philosophe français Eric Sadin[6] estime qu'un seuil inquiétant est franchi à partir du moment où des facultés ou des tâches cognitives spécifiques à l'humain sont remises entre les mains de systèmes d'intelligence artificielle, par exemple l'exercice du jugement ou le fait de poser un diagnostic médical. Automatiser le chauffage d'une maison ou les lumières d'un immeuble de bureaux est beaucoup moins grave que de transférer le jugement humain dans un système extérieur. Certains intervenants et intervenantes du monde de l'éducation s'enthousiasment devant ce processus, estimant que le délestage cognitif en faveur des machines permettra de sauver du temps qui pourra être utilisé à de meilleures fins[7]. Il faut au contraire insister pour montrer que ce processus pousse la destruction de l'idéal du citoyen – ou de la citoyenne – moderne encore plus loin, puisque celui-ci est remplacé par un individu assisté ou dominé par la machine, réputée penser, juger ou décider à sa place. L'individu n'exerce plus alors la réflexivité, l'autonomie, la liberté : « il faut s'adapter », comme le dirait Barbara Stiegler.
Il est frappant de constater à quel point les technoenthousiastes prennent position sur les nouvelles technologies sans jamais se confronter à l'immense corpus de la philosophie de la technique ou la technocritique, ceci expliquant cela… La position technocritique est généralement ridiculisée en l'assimilant à quelque peur comique du changement semblable à la crainte des minijupes et du rock'n'roll dans les années 1950… Pourtant, les dangers relatifs à ce mouvement de délestage (Entlastung) ou d'extranéiation cognitive ont bien été relevés, et depuis longtemps, par les Arnold Gehlen, Günther Anders ou Michel Freitag, pour ne nommer que ceux-là.
Dès 1956, Anders développe dans L'Obsolescence de l'homme une critique du rapetissement de l'humain face à la puissance des machines. Le concept de « honte prométhéenne » désigne le sentiment d'infériorité de l'ouvrier intimidé par la puissance et la perfection de la machine qui l'a dépassé, lui, l'être organique imparfait et faillible. Le « décalage prométhéen » indique quant à lui l'écart qui existe entre la puissance et les dégâts causés par les machines d'un côté, et la capacité que nous avons de les comprendre, de nous les représenter et de les ressentir de l'autre. Les machines sont donc « en avance » sur l'humain, placé à la remorque de ses productions, diminué et du reste en retard, largué, dépassé par elles.
Anders rapporte un événement singulier qui s'est déroulé à la fin de la guerre de Corée. L'armée américaine a gavé un ordinateur de toutes les données, économiques, militaires, etc., relatives à la poursuite de la guerre avant de demander à la machine s'il valait la peine de poursuivre ou d'arrêter l'offensive. Heureusement, la machine, après quelques calculs, a tranché qu'il valait mieux cesser les hostilités. On a conséquemment mis un terme à la guerre. D'après Anders, c'est la première fois de l'histoire où l'humain s'est déchargé d'une décision aussi capitale pour s'en remettre plutôt à une machine. On peut dire qu'à partir de ce moment, l'humanité concède qu'elle est dépassée par la capacité de synthèse de la machine, avec ses supports mémoriels et sa vitesse de calcul supérieure – supraliminaire, dirait Anders, puisque débordant notre propre capacité de compréhension et nos propres sens. Selon la pensée cybernétique[8] qui se développera dans l'après-guerre, s'il s'avère que la machine exécute mieux certaines opérations, il vaut mieux se décharger, se délester, « extranéiser » ces opérations dans les systèmes. La machine est réputée plus fiable que l'humain.
Évidemment, à l'époque, nous avions affaire aux balbutiements de l'informatique et de la cybernétique. Aujourd'hui, à l'ère du développement effréné de l'intelligence artificielle et de la « quatrième révolution industrielle », nous sommes encore plus en danger de voir une part croissante des activités, orientations ou décisions être « déchargées » de l'esprit humain en direction des systèmes cybernétiques devenus les pilotes automatiques du monde. Il faut mesurer à quel point cela est doublement grave.
D'abord, du point de vue de l'éducation qui devait fabriquer le citoyen et la citoyenne dont la république avait besoin, et qui produira à la place un assisté mental dont l'action se limitera à donner l'input d'un « prompt[9] » et à recevoir l'output de la machine. Un étudiant qui fait un travail sur Napoléon en demandant à ChatGPT d'exécuter l'ensemble des opérations n'aura, finalement, rien appris ni rien compris. Mais il semble que cela n'est pas très grave et que l'enseignement doit aujourd'hui se réinventer en insistant davantage sur les aptitudes nécessaires pour écrire des prompts bien formulés ou en mettant en garde les étudiantes et étudiants contre les « hallucinations », les fabulations mensongères fréquentes des machines qui ont désormais pris le contrôle. « Que voulez-vous, elles sont là pour rester, nous n'avons pas le choix de nous adapter… », nous dit-on du côté de ceux qui choisissent de garnir les chaines de l'ignorance des fleurs de la « créativité », car c'est bien de cela qu'il s'agit : l'enseignement de l'ignorance comme l'a écrit Michéa[10], le décalage prométhéen comme programme éducatif et politique.
Deuxièmement, ce mouvement de déchargement vers la machine vient entièrement exploser l'idéal d'autonomie moderne individuelle et collective et réintroduire une forme d'hétéronomie : celle du capitalisme cybernétique autonomisé. Comme le remarque Bernard Stiegler, le passage du statut de mineur à celui de majeur, donc le devenir-adulte, est annulé : l'individu est maintenu au stade infantile et pulsionnel, puis branché directement sur la machine et le capital. Il y a donc complicité entre l'individu-tyran et le système une fois court-circuitées les anciennes médiations symboliques et politiques de l'ancienne société. Suivant une thèse déjà développée dans le néolibéralisme de Friedrich Hayek, notre monde serait, du reste, devenu trop complexe pour être compris par les individus ou orienté par la délibération politique : il faut donc confier au marché et aux machines informatiques/communicationnelles le soin de devenir le lieu de synthèse et de décision de la société à la place de la réflexivité politique. Or, ce système est caractérisé, comme le disait Freitag, par une logique d'expansion infinie du capital et de la technologie qui ne peut qu'aboutir à la destruction du monde, puisque sa logique d'illimitation est incompatible avec les limites géophysiques de la Terre, ce qui mène à la catastrophe écologique déjà présente. Cela conduit à une forme exacerbée de la banalité du mal comme absence de pensée théorisée par Hannah Arendt, cette fois parce que le renoncement à penser ce que nous faisons pour procéder plutôt à un délestage cognitif de masse mène dans les faits au suicide des sociétés à grande échelle à cause du totalitarisme systémique capitaliste-cybernétique. Nous passons notre temps devant des écrans pendant que le capitalisme mondialisé sur le « pilote automatique » nous fait foncer dans le mur de la crise climatique.
Accélérationnisme et transhumanisme
Ce mouvement de décervelage et de destruction de l'autonomie individuelle et collective au profit des systèmes ne relève pas seulement d'une dérive ou d'une mutation propre à la transition postmoderne. Il est aussi revendiqué comme projet politique chez les accélérationnistes, notamment ceux de la Silicon Valley. Une des premières figures de l'accélérationnisme est le Britannique Nick Land, ancien professeur à l'Université de Warwick, où il a fondé le Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) dans les années 1990. Land dit s'inspirer de Marx (!), de Deleuze et Guattari, de Nietzsche et de Lyotard pour conclure que l'avenir n'est pas de ralentir ou de renverser le capitalisme, mais d'accélérer son processus de déterritorialisation. Cette idéologie favorise ainsi l'accélération du capitalisme, de la technologie et se dit même favorable au transhumanisme, à savoir la fusion – partielle ou totale – de l'humain avec la machine dans la figure du cyborg[11]. Après avoir quitté l'université, Nick Land, notamment à cause de son usage de drogues, sombre dans la folie et l'occultisme. Il devient également ouvertement raciste et néofasciste. Il disparait pour refaire surface plusieurs années plus tard en Chine, une société qui, selon lui, a compris que la démocratie est une affaire du passé et qui pratique l'accélérationnisme technocapitaliste. Ses idées sont par la suite amplifiées et développées aux États-Unis par Curtis Yarvin, proche de Peter Thiel, fondateur de PayPal. Cela a engendré un mouvement de la néo-réaction ou NRx qui combine des thèses accélérationnistes et transhumanistes avec la promotion d'une privatisation des gouvernements, une sorte de technoféodalisme en faveur de cités-États gouvernées par les PDG de la techno. Il s'agit donc d'un mouvement qui considère que la démocratie est nuisible, étant une force de décélération, un mouvement qui entend réhabiliter une forme de monarchisme 2.0 mélangé à la fascination technique. On pourrait dire qu'il s'agit d'une nouvelle forme de technofascisme.
Ajoutons qu'une partie des idées de Land et de Yarvin nourrit non seulement l'« alt-right », mais aussi des mouvements ouvertement néonazis dont la forme particulière d'accélérationnisme vise à exacerber les contradictions raciales aux États-Unis pour mener à une société posteffondrement dominée par le suprémacisme blanc. Il existe également une forme d'accélérationnisme de gauche, associé à une figure comme celle de Mark Fisher, qui prétend conserver l'accélération technologique sans le capitalisme. Mais la majeure partie du mouvement est à droite, allant de positions anciennement libertariennes jusqu'à des positions néoautoritaires, néofascistes, transhumanistes ou carrément néonazies. Cette nébuleuse accélérationniste inspire les nouveaux monarques du technoféodalisme de la Silicon Valley, les Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreesen[12]. Ceux-ci pensent que l'humain doit fusionner avec l'IA pour ensuite aller coloniser Mars, la Terre étant considérée comme écologiquement irrécupérable. Il n'est donc pas suffisant de parler d'un projet de scénarisation de l'humain par la machine au moyen du délestage cognitif, puisque ce qui est en cause dans le projet accélérationniste et transhumaniste implique carrément la fin de l'humanité telle qu'on l'entendait jusqu'ici. L'anti-humanisme radical doit être entendu littéralement comme un projet de destruction de l'humanité. Il s'agit d'un projet de classe oligarchique et eugéniste qui entend bien donner tout le pouvoir à une nouvelle « race » de surhommes riches et technologiquement augmentés dont le fantasme est de tromper la mort par le biais de la technique pour pouvoir jouir de leur fortune éternellement, à tel point qu'ils modifient actuellement les lois aux États-Unis pour pouvoir déshériter leur descendance et contrôler leurs avoirs éternellement lorsque la technologie les aura rendus immortels…
L'oubli de la société
Ce délire se déroule aussi sur fond « d'oubli de la société », comme le disait Michel Freitag[13], à savoir qu'il implique la destruction des anciennes médiations culturelles et symboliques aussi bien que celle des anciennes sociétés, comprises comme totalités synthétiques ou universaux concrets. Marcel Rioux l'avait déjà remarqué dans les années 1960, l'impérialisme technocapitaliste étatsunien conduit à la liquidation de la langue, de la culture et de la société québécoise. Du reste, comme le souligne Freitag, le fait d'être enraciné dans un lieu et un temps concret est remplacé par un déracinement qui projette le néosujet dans l'espace artificiel des réseaux informatiques ou de la réalité virtuelle. Du point de vue de l'éducation, à quoi sert-il alors de transmettre la culture, la connaissance du passé, les repères propres à cette société concrète ou à son identité, du moment qu'on ne nait plus dans une société, mais dans un réseau ? La médiation technologique et les écrans, en tant que technologie de disruption, viennent contourner les anciennes médiations et le processus d'individuation qu'elles encadraient, produisant des individus socialisés ou institués par les machines. Il devient alors beaucoup plus important d'anticiper l'accélération future et d'enseigner à s'y adapter, beaucoup plus important que d'expliquer le monde commun et sa genèse historique. De ce point de vue, l'ancien instituteur, « hussard noir de la République[14] », doit être remplacé par un professeur branché qui s'empresse d'intégrer les machines à sa classe, ou carrément par ChatGPT ou par un quelconque tuteur-robot. Ainsi la boucle serait complète : des individus formés par des machines pour vivre dans une société-machine, où l'ancienne culture et l'ancienne société auraient été remplacées par la cybernétique.
Une aliénation totale
Nous l'avons dit : les jugements enthousiastes sur cette époque sont généralement posés sans égard au corpus de la théorie critique ou de la philosophie de la technique. Il nous semble au contraire qu'il faille remobiliser le concept d'aliénation pour mesurer la dépossession et la perte qui s'annoncent en éducation, pour les étudiants, les étudiantes, les professeur·e·s, aussi bien que pour la société ou l'humanité en général. L'aliénation implique un devenir étranger à soi. En allemand, Marx emploie tour à tour les termes Entaüsserung et Entfremdung, extériorisation et extranéiation. La combinaison des deux résume bien le mouvement que nous avons décrit précédemment, à savoir celui d'une extériorisation de l'humanité dans des systèmes objectivés à l'extérieur, mais qui se retournent par la suite contre le sujet. Celui-ci se trouve alors non seulement dépossédé de certaines facultés cognitives, mais en plus soumis à une logique hétéronome d'aliénation qui le rend étranger à lui-même, à sa pratique, à autrui, à la nature et à la société – comme l'avait bien vu Marx –, sous l'empire du capitalisme et du machinisme. Le sujet se trouve alors « privé de monde[15] » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Ce processus concerne aussi bien la destruction de la société et de la nature que celle de l'humanité à travers le transhumanisme. Nous pouvons ainsi parler d'une forme d'aliénation totale[16] – ou totalitaire – culminant dans la destruction éventuelle de l'humanité par le système technocapitaliste. Ajoutons que le scénario d'une IA générale (AGI, artificial general intelligence) ou de la singularité[17] est évoqué par plusieurs figures crédibles (Stephen Hawking, Geoffrey Hinton, etc.) comme pouvant aussi conduire à la destruction de l'humanité, et est comparé au risque de l'arme nucléaire. L'enthousiasme et la célébration de l'accélération technologique portés par les idéologues et l'idéologie dominante apparaissent d'autant plus absurdes qu'ils ignorent systématiquement ces mises en garde provenant pourtant des industriels eux-mêmes. Sous prétexte d'être proches des générations futures, soi-disant avides de technopédagogie, on voit ainsi des adultes enfoncer dans la gorge de ces jeunes un monde aliéné et courant à sa perte, un monde dont ils et elles ne veulent pourtant pas vraiment lorsqu'on se donne la peine de les écouter, ce dont semblent incapables nombre de larbins de la classe dominante et de l'accélérationnisme technocapitaliste, qui ont déjà pressenti que leur carrière actuelle et future dépendait de leur aplaventrisme devant le pouvoir, quitte à tirer l'échelle derrière eux dans ce qu'il convient d'appeler une trahison de la jeunesse.
Conclusion : réactiver le projet socialiste
Nous avons montré précédemment que l'extension du capitalisme cybernétique conduit à des dégâts : psychologiques, pédagogiques, développementaux, sociaux/relationnels. Nous avons montré que le problème est beaucoup plus large, et concerne, d'une part, le déchargement de la cognition et du jugement dans des systèmes extérieurs. D'autre part, il participe de la mise en place d'un projet politique technocapitaliste, celui d'une société postmoderne du « tout à distance » gérée par les systèmes, ce qui signifie la liquidation de l'idéal d'autonomie politique moderne. Cela entraine bien sûr des problèmes en éducation : formation d'individus poussés à s'adapter à l'accélération plutôt que de citoyens éclairés, fin de la transmission de la culture et de la connaissance, oubli de la société, etc. Plus gravement, cela participe d'une dynamique d'aliénation et de destruction du rapport de l'individu à lui-même, aux autres, à la nature et à la société. Ce processus culmine dans le transhumanisme et la destruction potentielle aussi bien de l'humain que de la société et de la nature si la dynamique accélérationniste continue d'aller de l'avant. Ce qui est menacé n'est donc pas seulement l'éducation, mais la transmission même du monde commun à ceux qu'Arendt appelait les « nouveaux venus », puisque ce qui sera transmis sera un monde de plus en plus aliéné et en proie à une logique autodestructive. Les Grecs enseignaient, notamment dans le serment des éphèbes, que la patrie devait être donnée à ceux qui suivent en meilleur état que lorsqu'elle avait été reçue de la génération antérieure. Les générations actuelles laissent plutôt un monde dévasté et robotisé, tout en privant celles qui viennent des ressources permettant de le remettre sur ses gonds.
Il convient évidemment de résister à ces transformations, par exemple en luttant localement pour défendre le droit à une éducation véritable contre la double logique de la marchandisation et de l'automatisation-robotisation. On peut encore réclamer de la régulation de la part des États, mais il est assez évident aujourd'hui que le développement de l'IA a le soutien actif des États – « comité de gestion des affaires de la bourgeoisie », disait Marx. Mais il faut bien comprendre que seule une forme de société postcapitaliste pourra régler les problèmes d'aliénation évoqués ci-haut. Il sera en effet impossible de démarchandiser l'école et de la sortir de l'emprise de la domination technologique sans remettre en question la puissance de ces logiques dans la société en général.
Depuis le XIXe siècle, la réaction à la destruction sociale engendrée par l'industrialisation a trouvé sa réponse dans le projet socialiste[18], qu'il s'agisse de la variante utopique, marxiste ou libertaire. On trouve aussi aujourd'hui des approches écosocialistes, décroissancistes ou communalistes[19]. Cette dernière approche, inspirée par l'écologie sociale de Murray Bookchin, préconise la construction d'une démocratie locale, écologique et anti-hiérarchique. Ce sont là différentes pistes pouvant nourrir la réflexion sur la nécessaire reprise de contrôle des sociétés sur l'économie et la technologie, dont la dynamique présente d'illimitation est en train de tout détruire. Cela laisse entière la question du type d'éducation qui pourrait favoriser la formation des citoyennes et citoyens communalistes dont le XXIe siècle a besoin. Chose certaine, il faudra, à rebours de ce que nous avons décrit ici, que cette éducation favorise l'autonomie, la sensibilité, la compassion, l'altruisme ; qu'elle donne un solide enracinement dans la culture et la société, qu'elle apporte une compréhension de la valeur et de la fragilité du vivant et de la nature. Bref, elle devra former des socialistes ou des communalistes enracinés au lieu de l'aliénation et du déracinement généralisé actuels.
Par Eric Martin, professeur de philosophie, Cégep St-Jean-sur-Richelieu
NOTES
1. Ce type de technologie cause un bouleversement profond dans les pratiques du champ où elle apparait. ↑
2. Franck Fischbach, La privation de monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin, 2011. ↑
3. Carolyne Labrie, « Les cégépiens ne veulent plus d'enseignement à distance », Le Soleil, 27 février 2023. ↑
4. Pour un développement détaillé de ces constats, voir Eric Martin et Sebastien Mussi, Bienvenue dans la machine. Enseigner à l'ère numérique, Montréal, Écosociété, 2023. ↑
5. Naomi Klein, « How big tech plans to profit from the pandemic », The Guardian, 13 mai 2020. ↑
6. Eric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Anatomie d'un anti-humanisme radical, Paris, L'Échappée, 2021. ↑
7. « L'intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l'enseignement ? », La tête dans les nuances, NousTV, Mauricie, 29 mai 2023. ↑
8. Céline Lafontaine, L'Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004. ↑
9. NDLR. Prompt : il s'agit d'une commande informatique destinée à l'utilisateur ou l'utilisatrice lui indiquant comment interagir avec un programme, ou dans le cas de ChatGPT, des instructions envoyées à la machine pour lui permettre de faire ce qu'on lui demande. ↑
10. Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Castelnau-le-Lez, Climats, 2006. ↑
11. NDLR. Cyborg (mot formé de cybernetic organism) : personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et de parties mécaniques. ↑
12. Marine Protais, « Pourquoi Elon Musk et ses amis veulent déclencher la fin du monde », L'ADN, 20 septembre 2023. ↑
13. Michel Freitag, L'oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité, Québec, Presses de l'Université Laval, 2002. ↑
14. En 1913, l'écrivain français Charles Péguy qualifie les instituteurs de « hussards noirs ». Combatifs et engagés, ils défendent l'école de la République.
15. Fischbach, La privation de monde, op. cit. ↑
16. Voir la présentation de Gilles Labelle lors du séminaire du Collectif Société sur l'ouvrage Bienvenue dans la machine, UQAM, 28 avril 2023. ↑
17. D'après Wikipedia, « La singularité technologique (ou simplement la Singularité) est l'hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligences artificielles qui s'auto-amélioreraient, de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement dans une « explosion d'intelligence », débouchant sur une puissante superintelligence qui dépasserait qualitativement de loin l'intelligence humaine ». Cette thèse est notamment défendue par le futurologue transhumaniste Ray Kurzweil. ↑
18. Jacques Dofny, Émile Boudreau, Roland Martel et Marcel Rioux, « Matériaux pour la théorie et la pratique d'un socialisme québécois », article publié dans la revue Socialisme 64, Revue du socialisme international et québécois, n° 1, printemps 1964, p. 5-23. ↑
19. Eric Martin, « Communalisme et culture. Réflexion sur l'autogouvernement et l'enracinement », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 24, automne 2020, p. 94-100. ↑
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Larissa Packer : capitalisme vert, agro-industrie et crise environnementale

L'avocate socio-environnementale explique comment l'économie verte sert les intérêts financiers, transformant les biens communs en actifs financiers
Tiré de Capiré
https://capiremov.org/fr/entrevue/larissa-packer-capitalisme-vert-agro-industrie-et-crise-environnementale/
03/05/2024 |
Par MST
Foto : Selma Farias
La crise environnementale de ce siècle est directement liée au modèle agro-industriel, basé sur les grandes propriétés et sur la monoculture de produits de base. La production intensive et prédatrice qui progresse dans les campagnes est pratiquement ancrée dans la déforestation de l'Amazonie et du Cerrado brésilien, deux des régions les plus riches en biodiversité de la planète. À l'heure où l'on s'inquiète de plus en plus du changement climatique et de la durabilité, l'économie verte, le capital vert et le marché du carbone sont apparus comme des « concepts » dans la recherche de solutions « viables » et respectueuses de l'environnement.
Le site internet du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil (MST) a interviewé Larissa Ambrosano Packer pour discuter de la dynamique entre l'agro-industrie et de l'environnement, en apportant des aspects liés aux nouvelles technologies capitalistes dans l'organisation de l'agriculture et de l'élevage et aux expressions de la financiarisation de l'économie dans les dynamiques agraire et environnementale. Packer est avocate socio-environnementale, titulaire d'un master en philosophie du droit et membre de l'équipe Grain pour l'Amérique Latine.
L'économie verte, qui semble aujourd'hui « à la mode », apporte-t-elle des solutions au problème de la crise environnementale mondiale ?
Cette relation entre les marchés de capitaux, l'agro-industrie et l'environnement s'inscrit dans cette tendance des investisseurs institutionnels qui cherchent à générer des milliards de dollars dans le monde, recherchant la rentabilité la plus élevée possible pour les « élites rentières », qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises. Je parle de BlackRock, Vanguard, State Street, Global Advisors, qui gèrent des billions de dollars, parfois beaucoup plus que le PIB des États-Unis et de la Chine. Ces investisseurs institutionnels professionnels, confrontés aux fluctuations des marchés financiers, aux mouvements inflationnistes et à la baisse des taux d'intérêt, recherchent des actifs physiques, des biens matériels tangibles tels que l'immobilier, les infrastructures de transport, les ports, les aéroports et les métaux précieux tels que l'or, les terres agricoles ou les ressources naturelles en général.
Cette alliance d'investisseurs institutionnels sur le marché financier et ces actifs physiques et matériels sont très présents en temps de crise, à la fois comme stratégie de protection de l'argent contre l'inflation et pour placer cette suraccumulation d'argent sur une base physique garantissant une rentabilité à long terme plus sûre que les actifs financiers traditionnels, tels que les actions ou les obligations d'État. Cela fait partie de ce moment de ruée vers l'or, vers le foncier, vers l'immobilier, qui s'est intensifiée au cours des 15 dernières années, depuis la crise hypothécaire de 2008 aux États-Unis, qui a également généré un énorme volume de capital financier sans ballast sur lequel reposer et qui a fini par conduire à plus ou moins trois mouvements majeurs.
Et quels sont ces mouvements ?
Grain a prouvé qu'il y avait eu une augmentation des transactions foncières internationales entre 2008 et 2009, passant de 4 à 45 millions d'hectares. La littérature parle de land grabbing, cette course aux terres agricoles à laquelle la Banque mondiale se réfère depuis 2011.
En 2012, par exemple, plusieurs investisseurs institutionnels ont cherché à acquérir des entreprises qui gèrent des terres agricoles aux États-Unis et à placer cette super accumulation de capital sur un marché foncier limité. Et cela a conduit à des prix stratosphériques de la valeur des terres, allant jusqu'à 67 000 dollars par hectare dans le Wisconsin. Pour vous donner une idée, ces actifs dits réels – qui sont en fait les marchés immobilier, commercial et résidentiel – correspondaient en 2021 à 51 % du total des actifs courants dans le monde, soit 290 billions de dollars.
Le deuxième marché le plus important est celui des instruments de dettes, qui représente moins de la moitié de ce montant (123 billions de dollars) et le troisième marché le plus important est celui de l'or. C'est également un actif très recherché en temps de crise, qui offre une plus grande sécurité et protection contre la corrosion de la monnaie en période d'inflation, et qui représente un marché de 12 billions de dollars.
Selon AGBI Real Assets, gestionnaire d'actifs immobiliers, les propriétés rurales représentent plus de 35 billions de dollars, soit environ 6 % des actifs de l'économie mondiale. Au cours des 20 dernières années, la valeur des terres agricoles a augmenté de 300 %.
Ensemble, ces fonds immobiliers qui investissent dans les propriétés commerciales, résidentielles et rurales totalisent plus de 320 billions de dollars, soit environ quatre fois le PIB mondial de 2020. Ainsi, l'alliance entre les investisseurs financiers, l'agro-industrie et les ressources naturelles s'inscrit dans ce moment d'intensification des crises financières, cherchant une protection contre la corrosion de l'argent face à l'inflation et aussi une plus grande rentabilité, une meilleure distribution de dividendes aux investisseurs et aux élites rentières.
Quel est l'impact de cette course au capital sur les terres et les biens communs des pays ?
Ce phénomène touche principalement les pays qui possèdent des terres agricoles et des ressources naturelles. Il y a un déplacement de cette suraccumulation de capital vers ces autres régions du Sud global, qui disposent de terres et de ressources naturelles en abondance. De nombreux investisseurs institutionnels cherchent à surévaluer ces actifs, augmentant ainsi le prix des terres et des produits agricoles, ce qui finit par avoir un impact sur la valeur des aliments, l'accès à la terre et les biens communs qu'elle fournit, tels que l'eau, la biodiversité, la végétation locale et la qualité et l'intégrité de l'environnement, qui sont des droits humains liés à la dignité de la vie et de la santé, à la fois des humains et des animaux et de la planète.
En période de crise financière, ces investisseurs financiers profitent de cet environnement de surconcentration et de rareté pour procéder à l'introduction de biens jusque-là courants dans le régime juridique de la propriété privée et, pire encore, dans le régime financier. Ils rapprochent ces biens communs non seulement du régime juridique des marchandises, mais des actifs financiers eux-mêmes. Ils subordonnent les biens autrefois communs, tels que la terre, l'eau et les ressources naturelles, aux intérêts des investisseurs de fonds en matière de distribution de dividendes. Cela signifie que plus l'expansion de l'agro-industrie est importante, produisant peu de produits de faible qualité nutritionnelle pour l'exportation, avec davantage de déforestation, d'appropriation des terres et de l'eau, plus la tarification de ces actifs réels qui deviennent des actifs financiers est élevée, et plus la distribution de dividendes à ces gestionnaires d'actifs et aux élites rentières mondiales est importante. Cela aboutit à subordonner les biens communs et les intérêts de la population à la stratégie de gains financiers de quelques familles, de quelques personnes super-riches dans le monde.
C'est ce que l'on appelle une économie verte ?
L'économie verte est un slogan de plus pour légitimer ou populariser un intérêt de classe, limité à une petite élite de rentiers et aux agents financiers qui travaillent pour elle. On fait donc intervenir des intérêts de classe et on les met en avant comme s'il s'agissait d'un intérêt global et plus large pour tout le monde.
Le discours hégémonique prétend vouloir une économie verte dans laquelle ces investisseurs aident la planète, aident toutes les populations à lever des fonds pour des projets environnementaux à faible impact. Mais il dit cela précisément pour dissimuler le fait qu'il s'agit d'une économie de rentiers, de capitalistes, d'investisseurs financiers, qui recherchent de plus en plus une rentabilité accrue basée sur l'augmentation de la valeur de la terre et de la valeur des marchandises et des denrées alimentaires.
Il en résulte une minorité de propriétaires et une majorité de personnes sans accès, sans toit, sans terres, de sorte que cet accès entre de plus en plus dans la composition de la valeur de ces actifs, de plus en plus par l'intérêt d'une plus grande rentabilité pour ces investisseurs.
On a beau dire que ces ressources seront utilisées pour le bien de la planète , la recherche d'une plus grande rentabilité est intrinsèque à la dynamique des investissements financiers. La rentabilité la plus élevée est liée aux transactions où les terres sont achetées à bas prix et vendues à un prix élevé.
Il n'est donc pas étonnant que de nombreux rapports fassent état de l'implication de ces gestionnaires d'actifs fonciers, y compris des fonds de pension, qui achètent des terrains très bon marché dans le Matopiba [acronyme désignant une région brésilienne comprenant les États de Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia], qui sont bon marché précisément parce que toute la chaîne de propriété est contaminée par des vices et des fraudes dus à l'accaparement de terres publiques et collectives. Après quelques années, les pâturages dégradés deviennent des monocultures de soja, dégradées pour d'autres raisons, afin de produire des marchandises destinées à l'exportation. Cela augmente la valeur de la terre et, lorsque celle-ci est vendue, les bénéfices sont distribués à quelques investisseurs financiers.
Il y a toute une dynamique d'augmentation du prix ou d'appréciation de ces terres et ceux qui n'ont pas d'argent sont poussés à vendre. On assiste à une concentration de ces terres, à l'expulsion de la population et des petits agriculteurs, des peuples et communautés traditionnels, à une déforestation accrue, etc. Quand on suit vraiment le phénomène du capital lié à ce qu'on appelle l'économie verte, ce qu'on voit c'est une économie brune, une économie qui conduit à une très grande violence contre les personnes et l'environnement.
En 2008, avec la suraccumulation de capital sans ballast sur lequel s'appuyer avec la crise hypothécaire aux États-Unis, il y a eu une fuite de capital et une recherche de nouveaux marchés, de nouveaux actifs, plus sûrs pour ces trillions de dollars. Trois phénomènes se sont plus ou moins produits : le land grabbing, avec une course mondiale à la terre, principalement dans les pays du Sud ; la spéculation financière sur les matières premières agricoles, avec une concentration par quelques fonds de futurs contrats d'achat et de vente de soja et de maïs, etc., générant un boum de l'indice des prix des denrées alimentaires ; et l'évaluation économique autonome, qui fait référence à la valeur des terres et aux valeurs environnementales.
Avant il y avait la qualité ou l'intégrité environnementale, qui relevait du régime juridique des biens communs. Ceux-ci étaient inappropriées pour une seule personne et ne pouvaient pas être échangés comme n'importe quelle autre marchandise, précisément parce qu'ils étaient destinés à tous, générations présentes et futures. Le régime de la propriété privée fait désormais l'objet d'une évaluation économique, autorisant certains acteurs à délivrer un titre de propriété sur ce qu'ils commencent à appeler les services environnementaux ou les services écosystémiques.
Vous pouvez nous expliquer plus en détail comment cela fonctionne ?
Il s'agit aujourd'hui d'un principe du droit de l'environnement, mais en réalité, tout un marché d'achat et de vente est en train de se construire à partir de la tarification et de l'autorisation des contrats et de la circulation de nouvelles marchandises autour des biens environnementaux, qui sont désormais considérés comme des actifs tangibles et peuvent faire l'objet d'échange comme n'importe quelle autre marchandise, en particulier dans l'environnement des actifs financiers.
Au Brésil, les quotas de réserve environnementale (CRA), qui représentent un hectare de végétation locale à n'importe quel stade de régénération, ne doit pas nécessairement être une forêt primaire ou secondaire, il peut s'agir d'une zone dégradée ou en cours de régénération. Ils fournissent un service environnemental de piégeage du carbone avec la croissance, permettant à cette zone de se régénérer et de se développer.
À partir de ces territoires, on peut émettre des titres financiers négociés en bourse et de gré à gré. De même, le Nasdaq et la Los Angeles Stock Exchange ont également inclus l'eau comme actif financier, qui se négocie donc également en bourse et dont le prix est fixé — d'où le terme de quotas d'eau.
Nous voyons des biens communs qui appartenaient à tout le monde passer au régime de la propriété privée et, en plus, devenir un actif financier. Cela peut entraîner la déforestation. Placer la gestion de l'environnement dans la logique de l'offre et de la demande, dans la logique des prix du marché, peut générer des mouvements spéculatifs très dangereux contre l'environnement. La logique est la suivante : plus il y a d'incendies en Californie ou dans le Pantanal, moins il y a d'eau disponible ; et plus elle est rare, plus la valeur du quota en bourse sera élevée. Et ceux qui détiennent ces actions auront une meilleure rentabilité, et pourront acheter et vendre ces actions à une valeur plus élevée sur le marché secondaire. De même, les quotas de réserve environnementale dans les régions où l'exploitation minière et l'agro-industrie se développent, avec la monoculture du soja, du coton et du maïs, auront moins de forêts ou de végétation locale et protégée, et la valeur des quotas sera plus élevée. Cela n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Nous parlons d'économie financière, qui n'a rien de vert.
Interview de Fernanda Alcântara éditée par Solange Engelmann
Révision de Helena Zelic
Traduction du portugais pas Claire Laribe
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pluies meurtrières au Brésil et en Afrique : le changement climatique a encore frappé

De nombreuses régions du monde font face à des pluies diluviennes meurtrières. Des événements extrêmes qui s'expliquent en partie par le réchauffement climatique causé par l'humain.
Tiré de Reporterre
6 mai 2024
Par Émilie Massemin
Des Kenyans regardent une voiture détruite qui a été emportée par des pluies torrentielles dans le village de Kamuchiri, au Kenya, le 29 avril 2024. - © AFP / Luis Tato
Au moins 188 décès au Kenya, 155 en Tanzanie, 28 000 foyers déplacés en République démocratique du Congo, 2 000 au Burundi... Des pluies meurtrières frappent plusieurs régions du monde, en particulier l'Afrique de l'Est. Pour toute la zone Kenya, Tanzanie, Comores, la situation pourrait s'aggraver dans les prochaines heures avec le passage du cyclone Hidaya.
Au sud du Brésil, le bilan des inondations dans l'État du Rio Grande do Sul s'établissait le 3 mai à 29 morts et 60 personnes portées disparues. En Chine, des pluies diluviennes ont frappé la province du Guangdong, la plus peuplée du pays avec ses 127 millions d'habitants. Elles ont provoqué le décès de quatre personnes et des dizaines de milliers d'évacuations. Mi-avril, des précipitations extrêmes ont frappé plusieurs pays du Golfe, tuant vingt-et-une personnes à Oman. Les Émirats arabes unis ont enregistré des niveaux de pluie jamais atteints en soizante-quinze ans de relevés météorologiques. Quatre personnes sont mortes.
Certains épisodes peuvent être liés à des phénomènes météorologiques locaux. Par exemple en Afrique de l'Est. « L'événement El Niño, dont un s'est produit récemment, a généralement un lien avec les précipitations », explique Benjamin Sultan, climatologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Cette année, il a été amplifié par le dipôle de l'océan Indien, une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer.
Mais pour les chercheurs interrogés par Reporterre, il ne fait aucun doute que ces événements climatiques extrêmes sont liés au changement climatiquecausé par l'humain. « Les précipitations associées à El Niño et au dipôle de l'océan Indien sont rendues plus fortes par le changement climatique », explique Benjamin Sultan. En cause, une élévation de la température des océans qui entraîne un surcroît d'évaporation, une augmentation du taux d'humidité dans l'atmosphère et, en bout de chaîne, des pluies plus abondantes. « 1 °C supplémentaire se traduit par une augmentation de 7 % de l'humidité atmosphérique, précise le chercheur. En conséquence, même si la probabilité de l'événement météorologique ne change pas, il peut devenir plus intense. »
Un lien que confirme Davide Faranda, directeur de recherche en climatologie au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) de l'Institut Pierre-Simon Laplace et coordinateur du consortium international ClimaMeter. « Aux tropiques, les océans sont particulièrement chauds, avec beaucoup d'évaporation. Cette chaleur humide se transfère à l'atmosphère et peut déclencher des pluies assez intenses, et donc des inondations », explique-t-il. En élargissant la focale, on observe même un lien entre les épisodes de chaleur extrême et ces inondations dévastatrices. « Au Sahel, en Chine et au Brésil, des records de température ont été battus dans plusieurs zones, contribuant à l'évaporation, rappelle le chercheur. Quand ces masses d'air chaud entrent en contact avec des zones d'air frais — ce qu'on appelle goutte froide dans la météorologie française —, elles déclenchent orages et précipitations. »
Inégalités face aux risques
Au niveau local cependant, difficile de lier tel ou tel épisode au changement climatique. Davide Faranda est spécialisé dans cette science en construction, baptisée « attribution ». « Pour Dubaï [aux Émirats arabes unis], les inondations sont tellement exceptionnelles que l'on n'a pas trouvé d'événement similaire dans nos bases de données. On ne peut donc pas vraiment dire si elles sont liées au changement climatique », précise-t-il. En revanche, son équipe a pu établir un lien entre les inondations en Chine et les émissions de gaz à effet de serre.
Les personnes mortes lors de ces récents épisodes d'inondations sont-elles donc des victimes du changement climatique ? Oui, mais d'autres éléments sont à prendre en considération. « Le risque n'est absolument pas naturel, rappelle la géographe Valérie November, directrice de recherche au CNRS. Si les pluies et les inondations font autant de dégâts, c'est parce que des populations vivent dans les endroits inondés. » D'autres facteurs, notamment économiques, peuvent jouer. « Une part du risque est fondamentalement injuste, il frappe les populations qui vivent le plus en marge, poursuit la chercheuse. Il est clair que les territoires et les populations sont inégaux face au risque. »
Le changement climatique viendra sans nul doute compliquer cette équation. « Il rend les phénomènes météorologiques plus intenses. Cette intensité produit des dommages dans des endroits qui n'étaient pas identifiés à l'avance, et prennent de court des personnes qui ne se pensaient pas exposées », explique Valérie November.
Benjamin Sultan, lui aussi, observe cette difficulté à anticiper les catastrophes climatiques et donc à limiter le nombre de décès qu'elles entraînent. « On sait que les pluies vont être un peu plus fortes, mais on ne sait pas exactement où. Souvent, les prévisions ne sont pas assez précises pour que les décideurs prennent les décisions associées, remarque le climatologue. On atteint aussi les limites de certains pays à gérer des événements extrêmes. Ces derniers sont parfois tellement extrêmes que même si l'on sait qu'ils vont arriver, cela dépasse les capacités d'adaptation du pays. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Derrière l’euphorie pour l’hydrogène, la menace des énergies fossiles

[Enquête 1/2] L'engouement mondial autour de l'hydrogène est dopé par le lobbying massif de l'industrie des énergies fossiles. Objectif : nous rendre encore plus dépendants d'elle.
3 mai 2024 | tiré de reporterre.net
https://reporterre.net/Derriere-l-euphorie-pour-l-hydrogene-la-menace-des-energies-fossiles
Les promesses mirobolantes de l'hydrogène n'étaient-elles qu'une illusion, sur le point d'être dissipées ? Un vent d'inquiétude flottait ces derniers temps sur le secteur, perceptible jusque dans la communication de l'Hydrogen Council, un groupe de lobbying représentant des industriels majeurs du domaine. « L'industrie de l'hydrogène propre est confrontée à des vents contraires », qui ont entraîné un développement « plus lent que prévu », écrivait-il en décembre 2023.
Lire aussi : Avions et bateaux : comment l'hydrogène entretient le mythe de la croissance
Présenté comme l'un des piliers de la transition énergétique, ce gaz possède des vertus qui le rendent, de fait, indispensable. L'hydrogène « vert », c'est-à-dire produit par électrolyse de l'eau à partir d'énergies renouvelables, peut à la fois servir à stocker de l'énergie (un enjeu essentiel pour compenser l'intermittence de la production électrique des éoliennes et panneaux photovoltaïques), à fabriquer des carburants décarbonés et, surtout, à remplacer les énergies fossiles dans des secteurs industriels difficiles à décarboner autrement, comme la sidérurgie et de vastes pans de l'industrie chimique.

L'hydrogène « vert » est produit par électrolyse de l'eau. L'électricité renouvelable (en jaune) vient casser les molécules d'eau (en bleu), ce qui produit du dihydrogène et relâche du dioxygène, comme schématisé ci-dessus pour les usines d'électrolyseurs de Lhyfe, entreprise européenne de production d'hydrogène vert. Capture d'écran YouTube/Lhyfe
Ces derniers mois, pourtant, plusieurs analyses majeures se sont montrées assez pessimistes, voire carrément alarmistes quant à nos capacités à déployer l'hydrogène vert dans les temps impartis pour tenir nos objectifs climatiques.
C'est le cas d'un rapport publié en janvier par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui revoit à la baisse, de quelque 35 %, ses prévisions de croissance pour la production d'hydrogène vert d'ici 2028, par rapport à l'évaluation établie l'année précédente. Pire encore : seuls 45 gigawatts (GW) de capacités de production d'hydrogène vert additionnels devraient être construits entre 2023 et 2028, soit… 7 % des projets annoncés pour cette période, estime l'AIE.
Le constat est à peine moins sévère au niveau européen. L'étude « Sisyphe », publiée en mars par le CEA, qui s'appuie notamment sur le témoignage de soixante-dix industriels européens, estime que la demande en hydrogène électrolytique bas carbone en 2030 ne devrait pas dépasser les 2,5 millions de tonnes. Soit huit fois moins que l'objectif européen, officialisé dans le plan RepowerEU.
Une ambition démesurée ?
Une multitude de facteurs est invoquée de manière récurrente par les acteurs de l'hydrogène pour expliquer ces difficultés : les incertitudes sur le coût — et la compétitivité — de l'hydrogène bas carbone par rapport aux alternatives fossiles actuelles ; le cadre réglementaire international jugé trop instable ou trop contraignant ; l'absence d'équipements suffisants (électrolyseurs de grande puissance, gazoducs et ports pour transporter l'hydrogène, etc.) ou encore le contexte économique global, plombé par l'inflation et le coût du crédit, entre autres.
La douche froide actuelle est surtout à la mesure des gigantesques ambitions affichées ces dernières années. À l'échelle mondiale, l'AIE prévoit que la demande en hydrogène bas carbone atteindra en 2050 près de 400 millions de tonnes (Mt) par an. D'autres analyses vont jusqu'à 600 Mt.

© Stéphane Jungers / Reporterre
Des volumes titanesques à déployer quasiment à partir de rien : aujourd'hui, le monde consomme environ 95 Mt d'hydrogène par an, dont seulement 0,6 % est bas carbone, selon l'AIE. « Créer ex nihilo un système de production et de distribution d'hydrogène bas carbone constitue l'un des plus grands défis de la stratégie énergétique française et européenne », soulignait en février dernier Thomas Veyrenc, directeur général économie, stratégie et finances chez Réseau de transport d'électricité (RTE), lors d'une audition au Sénat.
L'ambition de la France incarne cette démesure : un objectif de production de 600 000 tonnes d'hydrogène décarboné est attendu pour 2030, ce qui nécessite l'installation de 6,5 gigawatts (GW) d'électrolyseurs.
À titre de comparaison, en 2023, France Hydrogène recensait 0,03 GW installé dans le pays, avec une progression de 0,017 GW en un an. « On ne va pas se mentir [...] un certain nombre d'objectifs ne seront pas atteints dans les temps », concédait en janvier à La TribunePhilippe Boucly, président de France Hydrogène.
Une bulle gonflée par le lobby fossile
La vague d'euphorie et d'annonces tonitruantes sur l'hydrogène remonte à 2020, selon Ines Bouacida, chercheuse et spécialiste de la transition énergétique à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) : « Elle est la conjonction de trois facteurs. D'abord, les objectifs de neutralité carbone en 2050 ont poussé à s'intéresser à l'hydrogène pour des secteurs difficiles à décarboner et qui étaient jusque-là peu regardés. Ensuite, les plans de relance post-Covid ont fait affluer beaucoup d'argent frais qui a suscité certaines ambitions d'investissements. Et il y a, enfin, une course technologique, l'envie d'avancer vite pour devenir les leaders mondiaux sur les technologies hydrogène. »
Autant d'éléments ayant pu pousser à surestimer nos capacités réelles à produire de l'hydrogène vert. Mais un quatrième facteur, plus surprenant, a certainement joué un rôle dans cet engouement mondial : le lobbying massif de l'industrie des énergies fossiles.
L'ONG OpenSecrets, qui traque les financements et l'influence des lobbies dans la politique étasunienne, évaluait en décembre 2023 à plus de 41 millions de dollars (environ 38 millions d'euros) le lobbying réalisé à Washington par les compagnies fossiles faisant la promotion de l'hydrogène, entre janvier et septembre 2023 seulement. Le nombre d'entreprises déclarant une activité de lobbying en faveur de l'hydrogène a explosé sous la présidence de Joe Biden : elles plafonnaient à moins de 25 jusqu'en 2020 avant de dépasser les 200 en 2023.

© Stéphane Jungers / Reporterre
Le même type de lobbying opère au Royaume-Uni et dans l'Union européenne (UE). Le centre de recherche sur le lobbying européen Corporate Europe Observatory estimait, en octobre 2023, à plus de 75 millions d'euros l'argent engagé par des industriels déclarant faire la promotion de l'hydrogène, entre autres, auprès des institutions de l'UE. Soit près du double (43 millions d'euros) de ce qu'investit la « Big tech » en lobbying dans l'UE. Parmi les plus gros acteurs impliqués dans cette promotion de l'hydrogène, on retrouve une bonne part des majors de l'industrie fossile : Shell, ExxonMobil, TotalEnergies ou BP.
« Leur principal objectif est de maintenir l'Europe dans une dépendance aux énergies fossiles, pour que leur business model puisse continuer quelques décennies supplémentaires », dénonce Belén Balanya, chercheuse au Corporate Europe Observatory. La subtilité de cette stratégie supposée tient au lien persistant entre énergies fossiles et hydrogène bas carbone. À côté de l'hydrogène vert, il est en effet possible de produire de l'hydrogène dit « bleu » : celui-ci n'est pas produit à partir d'électricité, mais est issu de la transformation d'hydrocarbures. Ce procédé est néfaste pour le climat, mais l'hydrogène bleu contourne ce problème en promettant de neutraliser les émissions de carbone générées, au moyen des techniques de capture et stockage du carbone (CSC).
L'hydrogène bleu, danger climatique
Ainsi, même si les objectifs chiffrés à long terme de la plupart des États parlent spécifiquement d'hydrogène vert, « ces objectifs irréalistes permettront aux compagnies pétrolières et gazières de faire revenir l'hydrogène d'origine fossile par la porte de derrière », alerte Bélen Balanya. De fait, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) estimait, dans un rapport de 2022, que l'hydrogène vert ne pourra répondre qu'aux deux tiers de la demande mondiale en 2050, complété par 200 millions de tonnes annuelles d'hydrogène bleu. Un volume identique est envisagé par l'AIE et l'Hydrogen Council.
Officiellement, pourtant, l'hydrogène bleu est présenté par la Commission européenne comme une solution temporaire, le temps que les capacités de production d'hydrogène vert se déploient. Les industriels du gaz fossile, eux, ne comptent pas se contenter d'un rôle de « passerelle » vers l'hydrogène vert. Investissant conjointement dans l'hydrogène vert et bleu, Shell, par la voix de son vice-président, assurait par exemple en 2021 que l'hydrogène bleu n'aurait pas vocation à disparaître, quand bien même sa version verte deviendrait compétitive. Le 28 avril dernier, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, en rajoutait une couche en assénant que l'objectif officiel de déploiement de l'hydrogène vert n'avait « aucun sens ».
« L'hydrogène bleu est loin d'être aussi neutre en carbone »
Cette perspective inquiète de nombreuses ONG, avant tout parce que l'hydrogène bleu est loin d'être aussi neutre en carbone qu'il le prétend. La principale technique de production d'hydrogène bleu passe par le vaporeformage du méthane : un processus qui transforme ce gaz en hydrogène tout en libérant du CO2. Une activité pouvant générer, en amont, des fuites de méthane (gaz quatre-vingts fois plus réchauffant que le CO2 sur vingt ans), et en aval des fuites de CO2, les techniques de capture et stockage étant rarement aussi efficaces que prévu.
Les études sur le sujet sont nombreuses et trop contradictoires pour aboutir à des données certaines, mais une part conséquente de ces travaux s'avère extrêmement inquiétante. Une des plus citées, publiée dans Energy Science & Engineering, conclut que les fuites de méthane rendent la production d'hydrogène bleu potentiellement plus néfaste pour le climat que la combustion directe de gaz naturel ou de charbon !
En France, un rapport de l'Ademe de mai 2022 expliquait que le bilan carbone de l'hydrogène bleu dépendait fortement de la technique employée ainsi que de l'origine du méthane qui sert à le produire : le gaz naturel liquéfié (GNL) importé des États-Unis et lié à la production de gaz de schiste très émetteur de gaz à effet de serre étant particulièrement nocif. L'hydrogène bleu actuellement sur le marché n'est pas bas carbone, conclut l'Ademe, mais pourrait le devenir si l'on suit les bonnes pratiques, ce qui n'est pas assuré en l'état.
Verrouiller notre dépendance aux fossiles
Au-delà de son bilan carbone, le développement de l'hydrogène bleu présente le risque pernicieux de nous maintenir dans une dépendance aux énergies fossiles en investissant dans leurs infrastructures, d'entretenir une « dépendance au sentier », alerte également Pierre Sacher, ingénieur de l'Ademe et auteur du rapport.
La crainte, régulièrement relayée par des ONG écolos, serait donc de tomber dans le « piège des lobbies » : faire miroiter de l'hydrogène vert, tout en se tenant prêt à vendre de l'hydrogène bleu, voire du gaz fossile, une fois levés le mirage et l'irréalisme des objectifs initiaux. C'est ce que dénonçait le 16 avril dernier Julian Popov, juste après avoir quitté ses fonctions de ministre de l'Environnement en Bulgarie. « Construire des gazoducs prêts pour l'hydrogène signifie construire des gazoducs qui ne seront pas utilisés pour autre chose que du gaz naturel », observait-il alors, cité par le média Contexte.

L'usine d'hydrogène de l'entreprise Lhyfe à Bouin, en Vendée, lors de sa construction en 2020. Capture d'écran YouTube/Lhyfe
Les gouvernements risquent « d'aider et encourager les intérêts des énergies fossiles » et de « perpétuer le statu quo », s'inquiète également Julie McNamara, directrice adjointe climat et énergie de l'ONG Union of Concerned Scientists. Si nous établissons des règles trop généreuses avec l'hydrogène bleu, produit à partir de méthane, « cela peut signifier plus de consommation de gaz naturel pour plus longtemps », un contexte « extrêmement lucratif pour l'industrie fossile », souligne-t-elle.
Ces enjeux se cristallisent en ce moment autour de « l'acte délégué » que doit produire la Commission européenne, pour établir clairement les critères définissant l'hydrogène bas carbone en Europe. Plusieurs industriels de l'hydrogène vert et ONG environnementales européennes ont adressé une lettre ouverte à la Commission, le 2 avril, s'inquiétant des pressions mises par certains industriels pour définir une norme au plus vite et au rabais pour l'hydrogène bleu.
Le risque serait notamment celui d'une définition trop permissive avec les fuites de carbone. Les signataires veulent aussi la garantie que l'hydrogène bleu ne soit produit qu'à partir des capacités fossiles existantes, sans générer l'ouverture de nouveaux puits d'hydrocarbures.
« Dans le pire des scénarios, le système hydrogène pourrait être encore pire pour le climat que le système fossile qu'il doit remplacer », s'inquiète Ciel Jolley, de l'ONG étasunienne Environmental Defense Fund, cosignataire de la lettre. « Des règles permissives sur l'hydrogène bleu pourraient saper le travail sur l'hydrogène vert et retarder sa compétitivité de plusieurs années », alerte également Geert De Cock, de Transport & Environment, autre organisation signataire.
L'acte délégué doit être rendu par la Commission européenne d'ici le 31 décembre 2024. Qu'il soit réellement bas carbone ou non, l'hydrogène fait aussi office d'argument magique, invoqué par certaines industries pour perpétuer leur modèle de croissance et éviter de parler de sobriété, comme l'explique par ailleurs Reporterre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les combattant.tes en Amérique latine : la lutte périlleuse pour le droit à l’avortement

Au Salvador, au Honduras et au Suriname, l'avortement est strictement interdit. L'Uruguay ou la Colombie autorisent l'avortement selon certaines conditions gestationnelles. En revanche, au Chili ou au Venezuela, les conditions sont restrictives, l'avortement étant seulement permis en cas de danger pour la mère. En Bolivie et en Équateur, l'IVG est autorisée pour des raisons de santé. L'instabilité du droit à l'avortement en Amérique latine tend à empêcher certaines femmes à y recourir.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/10/les-combattant-tes-en-amerique-latine-la-lutte-perilleuse-pour-le-droit-a-lavortement/
Entre efforts d'ouverture et conservatisme rétrograde
Les conditions d'accès obligent les femmes à s'exposer publiquement, devant parfois avouer des cas de viols pour « justifier » leur demande. Certaines préfèrent rester silencieuses pour éviter l'humiliation ou y recourent secrètement, s'exposant aux dangers de l'avortement clandestin.
Alors que le Brésil n'autorise l'IVG qu'en cas de danger pour la mère, des procédures pour dépénaliser l'avortement avaient été entreprises. Or, comme les négociations traînent et sont toujours en suspens, les femmes continuent d'y avoir recours. En 2023, 19 d'entre elles sont mortes suites à avoir recouru à un avortement clandestin.
Certains pays font un bond en arrière. Le gouvernement de Milei en Argentine, cherche à effacer la victoire de 2020 en proposant de pénaliser l'IVG : trois ans pour la femme qui y recourt et quatre ans pour la personne professionnelle qui l'effectue. À Puerto Rico, alors que depuis 1973 l'avortement est légal, des députés de l'Assemblée législative se sont mobilisés en 2023 pour condamner les centres qui permettaient aux femmes d'y recourir.
L'avortement est nécessaire pour la liberté des femmes, pour décider de leur corps et de leur destinée
La maternité infantile est une réalité partagée en Amérique latine, mais cela n'encourage pas le débat vers la légalisation. Selon l'Observatoire de la santé sexuelle et reproductive, en 2023 au Guatemala, 52 878 naissances provenaient de mères qui avaient entre 10 et 19 ans.
En Uruguay, 119 filles de moins de 15 ans sont tombées enceintes entre 2021 et 2023 et 50% de ces grossesses faisaient suite à des agressions sexuelles. Au Pérou, en 2023, 1 354 naissances étaient le fait de filles de moins de 15 ans. Alors que le pays l'autorise pour des raisons de santé, Camilla, une indigène de 13 ans s'est vue refuser l'accès à l'avortement.
Le gouffre de l'acceptation sociale
Ce n'est pas parce que les droits sont accordés qu'ils sont appliqués. D'une part, certains pays lancent des campagnes de désinformations qui empêchent les femmes de se renseigner sur leurs droits. En mai 2023, à travers les réseaux sociaux, les photos de personnes qui vendaient des pilules abortives ont été partagées au Salvador, entravant leur vie privée. Au Guatemala, au sein d'une société ultrareligieuse, les femmes qui avouent avoir eu recours à l'avortement sont accusées d'être des criminelles. L'accès à l'avortement révèle aussi les inégalités intersectionnelles, la pression étant encore plus violente pour les femmes pauvres, indigènes ou afrodescentes.
Par ailleurs, certain.es professionnel.les de santé refusent d'y recourir par conviction personnelle ou par peur de représailles. Alors que l'IVG est légale en Argentine, la médecin Miranda Ruiz a été arrêtée après avoir pratiqué un avortement. On l'a accusé de l'avoir réalisé sans le consentement de la patiente. Dans le même cas au Venezuela, Vanessa Rosales est arrêtée en 2020 pour avoir aidé une jeune fille de 13 ans à avorter après avoir été violée par son professeur. Elle a été emprisonnée neuf mois pour « conspiration au sein d'une organisation criminelle ».
Une fausse couche peut aussi être considérée comme un cas de négligence. Au Salvador, alors qu'un fœtus est retrouvé dans un sac plastique, Beatriz est condamnée pour trente ans de prison, jugée pour homicide volontaire. Quelques années plus tard, on révèlera qu'elle avait en fait eu une fausse couche. Les femmes ont la responsabilité totale de leur grossesse et, restreintes à leur rôle de progénitrice, elles n'ont pas le droit à l'« erreur ». Leur bien-être est négligé, peu importe le contexte qui entoure la grossesse.
« Le droit à l'avortement n'est pas une affaire d'opinion c'est un droit fondamental » [1]
Ce n'est pas parce que l'IVG est pénalisée que les femmes n'y ont pas recours. Mais cela signifie qu'elles s'exposent à des dangers en ayant recours à l'avortement clandestin ou en poursuivant une grossesse à risques.
Les racines idéologiques traditionalistes et religieuses sont encore implantées en Amérique latine. Même lorsque l'avortement est dépénalisé (voire légalisé), les discriminations sociales empêchent l'accès aux femmes de jouir pleinement de leur droit. Malgré les mesures répressives adoptées par certains gouvernements, les mobilisations perdurent pour faire appliquer ce droit fondamental chez les femmes qui en ont besoin.
Pour en savoir plus :
* Amnesty International. « L a situation des droits humains dans le monde ». Avril 2024.
* Amnesty International. « An unstoppable movement. A global call to recognize and protect those who deffend the right to abortion ». Novembre 2023
* Statista. « L'avortement dans le monde. Statut légal de l'avortement (IVG) dans le monde en 2024 ». Janvier 2024.
[1] Citation de l'article d'Amnesty internationales
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Vas-y tiens l’écarteur comme t’écartes les cuisses ! » : il est temps d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles à l’hôpital

L'esprit carabin ne peut servir d'excuse aux agissements sexistes, au harcèlement, à l'agression sexuelle, dénonce un collectif de soignantes. Elles décrivent un système hiérarchique patriarcal verrouillé et demandent la fin de l'impunité.
Tiré de Entre les lignes et les mots
En 2020, suite à la cérémonie des césars, Virginie Despentes a publié une tribune dans ce même journal : « Désormais on se lève et on se barre ». Aujourd'hui, en 2024, à l'Hôpital, nous voulons affirmer : « Désormais on se relève, on reste, et on en finit avec l'impunité ». Plus jamais il ne devra être dit qu'on parle mais que vous n'entendez pas.
Nous tous⸱tes, médecins, infirmier⸱es, aides-soignant⸱es, personnels administratifs travaillons et avons été formé⸱es à l'Hôpital et nous y sommes attachés.
Pourquoi ? Pour prendre soin de l'autre. Travail visible ou invisible, qu'avons-nous en commun ? D'avoir découvert dès notre premier pas dans ce tout petit monde que pour pouvoir nous former, pour pouvoir exercer notre métier, nous allions devoir subir les violences sexistes et sexuelles quasi institutionnelles.
De quoi parle-t-on ? D'un système. Là aussi, comme au cinéma, on rigole, ce n'est pas grivois, c'est « l'esprit carabin ! ». Il y aura donc toujours une excuse aux comportements subis ! L'esprit carabin, cette particularité soi-disant folklorique des études médicales françaises permettrait donc d'entendre quotidiennement des phrases comme : « Vas y tiens l'écarteur comme t'écartes les cuisses ! », « Faut pas faire l'effarouchée ! », « Ben quoi, t'es belle et j'ai envie, tu devrais être flattée », « OK, je te prends comme cheffe de clinique si tu t'engages à ne pas tomber enceinte ! ».
Et plus récemment « maintenant avec #MeToo, on peut plus rien faire… ». Pourtant si, vous faites. Subir, être témoin et se taire. Cautionner et sourire. Surtout ne pas passer pour des victimes dans ce monde ou pour être respecté il faut être fort et dur.
L'ampleur de la tâche est immense
Voilà les préceptes que nous suivons tous⸱tes. Et c'est ainsi que les violences banalisées perdurent, s'aggravent et conduisent non seulement à des agissements sexistes, à du harcèlement sexuel ou moral, mais aussi à l'agression sexuelle : l'association Donner des elles à la santé a publié son baromètre pour preuve : en 2023, sur 521 médecins interrogées, 20% d'entre elles ont subi des pressions répétées pour obtenir des faveurs sexuelles et 17% d'entre elles ont même subi des situations d'agressions sexuelles.
Et il est très probable que ces chiffres soient sous-estimés devant la faible libération de la parole encore aujourd'hui. Pourquoi ces femmes ne parlent pas ?
Mais parler à qui ? C'est parole contre parole, et elles ne font pas le poids. Le peu de femmes qui parlent, on cherche à les dissuader : « Mais quand même c'est un bon médecin… », « Oh tu sais ça fait vingt ans qu'il est comme ça on va pas le changer ». A cela s'ajoute la peur. Peur de l'exclusion, de la mise au ban de ce petit monde hospitalier où tout le monde se connaît et se serre les coudes. Peur aussi de se voir empêcher dans sa progression de carrière. L'une des clés du silence réside donc aussi sur la confraternité imposée.
L'ampleur de la tâche est immense. Certaines femmes pourront dire : « Moi, il ne m'est rien arrivé… », mais elles oublient ! Elles oublient qu'elles ont réglé leur conduite sur l'évitement : ne pas aller dans tel service où le chef drague et tripote, faire attention à ce médecin qui rentre sans frapper dans le vestiaire…
Comment fonctionne ce système, en place depuis des décennies ? Les hôpitaux sont structurés avec un système hiérarchique patriarcal verrouillé. Plus de la moitié des employé⸱e⸱s sont des femmes. Pourtant elles sont totalement sous-représentées dans les postes décisionnels clés. Une femme médecin oui, une femme cheffe de service, beaucoup plus rare. Il est fréquent que l'évolution de carrière d'une jeune médecin dépende du bon vouloir d'une seule personne, « le » chef de service. Archaïque, vous trouvez ? C'est un « boys club » puissant et efficace.
Comment faire pour impulser des changements ? Il faut d'abord un état des lieux et la reconnaissance de l'ampleur du problème. Il faut identifier les verrous de parole, les faire sauter et sanctionner les personnes qui se considèrent comme intouchables.
Ce système pénalise toute personne sous la coupe de certains mandarins
Les institutions ont un devoir de protection et doivent réformer les systèmes qui permettent ces abus de pouvoir. Elles doivent favoriser la prise de parole, la consignation des plaintes, avertir, voire sanctionner, les personnes ciblées par des plaintes et non les exfiltrer, puis les déplacer dans une autre structure ou elles risquent de sévir à nouveau. Pour protéger les étudiant·es en santé d'aujourd'hui et de demain, il nous faut mettre les agresseurs face à leurs actes d'une part, et soutenir les victimes qui doivent être épaulées et entendues d'autre part.
Pour cela, nous avons besoin et demandons aux universités de s'engager à une protection pédagogique obligatoire pour les étudiant⸱es portant plainte ou témoignant afin de ne pas être pénalisé⸱es dans leur cursus de formation. Sans cela, les victimes et les témoins ne parleront pas !
Ce système ne pénalise pas que les femmes mais toute personne sous la coupe de certains mandarins : ces supérieurs qui font la pluie et le beau temps et sont quasi intouchables du fait de leur notoriété médiatique, académique, ou autres. Un mode de management horizontal et participatif aiderait certainement à régler une partie du problème.
Faire médecine, c'est plus de dix ans d'études. Pendant cette dizaine d'années, combien d'heures sont consacrées à la compréhension du système ? De l'institution ? Du comportement à adopter avec autrui ? Avec les femmes mais aussi les plus discriminé⸱e⸱s du fait de leur genre, de leur origine, de leur classe ou bien de leur handicap ? Trop peu en début de cursus et quasiment aucune lorsqu'ils et elles deviennent internes et vous soignent en première ligne au quotidien !
La misogynie de notre société ne s'arrête pas à la porte des hôpitaux. Soignant⸱es, administratif⸱ves, patient⸱es, relevons-nous pour pouvoir dire ensemble : « Adieu impunité ! ».
Premiers signataires :
Karine Lacombe Cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine de Paris
Audrey Bramly Interne, du Syndicat des internes des hôpitaux de Paris (Sihp) et du Comité de lutte contre les agressions sexuelles et le harcèlement en anesthésie réanimation (Clash-AR)
Emmanuel Hay Président Sihp
Elsa Mhanna Médecin, « Donner des elles à la santé »
Agnès Setton Médecin du travail référents égalité pro et VSS à la Pitié-Salpêtrière
Ghada Hatem Fondatrice de la Maison des femmes
Elsa Brocas Médecin, PH Clash-AR
Pauline Dureau Médecin PH Clash-AR
Lucie Guillemet Médecin PH Clash-AR
Victor Jullien Interne Clash-AR
Marie-France Olieric « Donner des elles à la santé »
Vanessa Christinet Médecin en santé sexuelle (Lausanne)
Françoise Linard Psychiatre à l'hôpital Tenon de Paris,
Emmanuelle Dolla, Médecin PH Clash-AR…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les femmes haïtiennes font face à une nouvelle ingérence impérialiste

Islanda Micherline présente les défis et stratégies des paysannes haïtiennes pour l'autodétermination et la souveraineté populaire.
Tiré de Capité
25/04/2024 |
Capire
Le peuple haïtien fait face, une fois de plus, à une ingérence impérialiste sur son destin. L'île des Caraïbes connaît une situation de violence croissante et de violations systématiques, de contrôle des territoires par des groupes armés, de répression et de subordination des intérêts du peuple à ceux du capital transnational. Les conditions de vie dans les villes et à la campagne se détériorent considérablement. L'accès à la nourriture et la circulation de la production paysanne ont été profondément affectés. C'est précisément pour cette raison qu'ils sont au centre de la résistance paysanne, féministe et populaire.
Face à cette situation, l'ONU, historiquement responsable des interventions militaires qui approfondissent les problèmes sociaux et politiques, agit à nouveau de manière alignée sur l'impérialisme états-unien. Dans la vidéo suivante,Islande Micherline, de la Via Campesina haïtienne, dénonce le rôle des pays du Nord qui, à travers le Groupe Central des Nations Unies en Haïti, ont opéré la nouvelle tentative d'intervention dans le pays.
À la campagne et en ville, les femmes haïtiennes proposent des stratégies économiques pour cette transition, comme le dit Islanda, dans le sens de la construction de l'agroécologie, de l'économie solidaire et de la souveraineté alimentaire, objectifs qui ont pour condition préalable l'autodétermination des peuples et un gouvernement populaire. De toutes les régions des Amériques, les femmes continuent en solidarité internationaliste et anti-impérialiste, pour la défense d'une Haïti digne et souverain, libre de l'occupation.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bruits de bottes sur la planète, les armées s’équipent

À mesure que les tambours de guerre résonnent plus fort, les nations ouvrent grand leurs coffres, injectant des milliards dans l'arsenal de la défense. La récente annonce par le Canada d'un plan record pour augmenter ses dépenses militaires ne fait que souligner une tendance observée à l'échelle mondiale. La montée en puissance des budgets de défense partout sur la planète, constatée par les dernières données publiées par le SIPRI1, soulève des questions cruciales sur les motivations, les implications et les alternatives possibles à cette course aux armements moderne.
6 mai 2024 | tiré du journal des alternatives | Photo : États-Unis : soldats de la 374e compagnie du génie - Domaine public
https://alter.quebec/bruits-de-bottes-sur-la-planete-les-armees-sequipent/
Mauvais élève de l'OTAN qui demande à ses membres d'accroître leur budget militaire à 2 % du Produit intérieur brut (PIB), le Canada a annoncé un rattrapage le 8 avril dernier en planifiant une augmentation de 32%, le faisant passer de 1,33% à 1,76% du PIB. Cette tendance est observable partout sur la planète, alors que les dépenses militaires ont atteint 2 443 milliards de dollars en 2023, une augmentation de 6,8% comparée à 2022, soit la plus grande augmentation en 15 ans, selon la dernière mise à jour de SIPRI sur les budgets de la défense dans le monde, publiée le 22 avril.
Des suspects habituels…
La force d'armée la plus puissante demeure celle des pays de l'OTAN soit 1 341 milliards de dollars, ce qui représentent 55% dépenses militaires mondiales si on additionne les chiffres de la figure 1 de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Océanie.
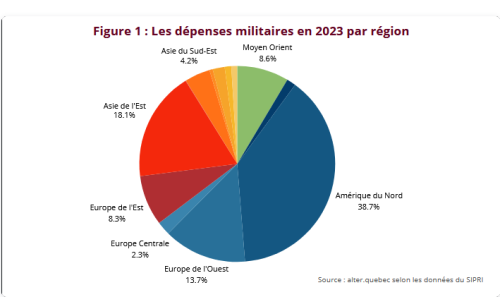
Les États-Unis expliquent près de 70 % de ces dépenses de l'alliance transatlantique, soit 37,5% des dépenses militaires mondiales. L'importance de l'économie des États-Unis lui permet de dominer sur ce plan, tout en ne consacrant que 3,7% du PIB, ce qui est toutefois plus du double de la plupart des pays de l'OTAN. Malgré cela, la guerre russo-ukrainienne met la pression sur les pays européens qui ont quasiment tous connu une augmentation de leurs dépenses en défense en 2023.
… Aux guerres multipolaires
Mais l'hégémonie militaire n'est pas uniquement une affaire occidentale. Depuis le début du siècle, la carte des dépenses militaires a été redessinée, reflétant les tensions et les dynamiques changeantes de pouvoir. Le deuxième pays le plus dépensier, la Chine, a consacré 296 milliards de dollars US en 2023, soit 6,2 fois plus qu'au début du siècle. Après la Russie qui arrive troisième, c'est l'Inde qui se positionne au quatrième rang avec une augmentation de 174% en 2023.

Cette évolution devient d'autant plus flagrante lorsque l'on compare les dépenses de l'an 2000 à celles de 2023. À l'époque, les cinq pays les plus dépensiers étaient tous occidentaux. Aujourd'hui, des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont cédé leur place à la Chine, à la Russie, à l'Inde et à l'Arabie saoudite. Cette transition illustre clairement que la course à l'hégémonie passe aussi par l'armement.
Des poids différents sur les économies
Cependant, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne en matière d'effort de guerre, et ces politiques belliqueuses exigent des sacrifices économiques. Chaque dollar investi dans les forces armées est un dollar de moins pour l'éducation, la santé ou les programmes sociaux. Ce sont plus de 150 milliards de dollars US qui ont été soutirés des autres missions des budgets des gouvernements de la planète.
Si les États-Unis maintiennent leur influence avec des dépenses de 3,7 % de leur budget de l'État, l'Arabie Saoudite consacre près d'un quart du sien aux affaires militaires. En Ukraine, ce chiffre atteint presque 60 %, tandis qu'en Russie, la part du budget gouvernemental attribué à la guerre a augmenté de près de 50% entre 2021 et 2023. Elle se situe actuellement à plus de 16% des dépenses budgétaires et qui traduit sa plus grande capacité économique face à l'Ukraine.

Il est également pertinent de souligner le cas du Qatar, considérant son historique de violations des droits de la personne, souvent ignorées pour favoriser des accords économiques et des investissements lucratifs. Bien que les données de 2023 ne soient pas encore disponibles, en 2022, ce pays a investi plus d'un quart de son budget gouvernemental dans les dépenses militaires, malgré l'absence de conflits directs, et tout indique que ce nombre a depuis augmenté.
Des indicateurs cependant limités
Le manque de données transparentes et complètes pour des pays profondément affectés par les conflits, comme le Yémen, la Syrie ou l'Érythrée, reste préoccupant et limite notre capacité d'analyse et d'action. D'autant plus que les guerres en Ukraine et en Palestine, les tensions en mer de Chine méridionale et les frictions continues entre les grandes puissances sont autant de facteurs qui alimentent cette incertitude quant à l'avenir.
Ces conflits ne sont pas seulement des tragédies humaines, mais aussi des catalyseurs pour une escalade militaire rappelant les tensions d'avant la Seconde Guerre mondiale ou de Guerre froide. Si l'on ne peut pas espérer un nouvel effondrement de l'URSS pour inverser cette tendance, on peut tout de même se demander jusqu'où ira cette escalade.
Autres faits saillants tirés du communiqué du SIPRI
- Les dépenses militaires estimées au Moyen-Orient ont augmenté de 9,0 % pour atteindre 200 milliards de dollars en 2023. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée dans la région au cours des dix dernières années. Les dépenses militaires d'Israël – les deuxièmes plus importantes de la région après celles de l'Arabie saoudite – ont augmenté de 24 % pour atteindre 27,5 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation des dépenses est principalement due à l'offensive militaire d'ampleur menée à Gaza durant les trois derniers mois de 2023, en réponse à l'attaque au Hamas en octobre 2023.
- En 2023, la plus forte augmentation en pourcentage des dépenses militaires de tous les pays a été observée en République démocratique du Congo (+105 %), où un conflit perdure entre le gouvernement et des groupes armés non étatiques. Le Soudan du Sud a enregistré la deuxième plus forte augmentation en pourcentage (+78 %) dans un contexte de violence interne et de répercussions de la guerre civile soudanaise.
- Les dépenses militaires de la République dominicaine ont augmenté de 14 % en 2023 en réponse à l'aggravation de la violence des gangs en Haïti voisin.
- Les dépenses militaires de la Pologne, 14ème plus grand dépensier au monde, s'élèvent à 31,6 milliards de dollars après une hausse de 75 % entre 2022 et 2023 – de loin la plus forte augmentation annuelle de tous les pays européens.
- En 2023, les dépenses militaires du Brésil ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars. Citant les lignes directrices de l'OTAN en matière de dépenses, en 2023 les membres du Congrès brésilien ont soumis au Sénat un amendement constitutionnel visant à augmenter la fardeau militaire du Brésil à un minimum annuel de 2 % du PIB (contre 1,1 % en 2023).
- Les dépenses militaires de l'Algérie ont augmenté de 76 % pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Il s'agit du niveau de dépenses le plus élevé jamais enregistré par l'Algérie et cela s'explique en grande partie par une forte augmentation des recettes issues des exportations de gaz vers les pays d'Europe à mesure que ces derniers se sont éloignés des approvisionnements russes.
- L'Iran est le 4ème plus grand dépensier militaire au Moyen-Orient en 2023 avec 10,3 milliards de dollars. Selon les données disponibles, la part des dépenses militaires allouée au Corps des gardiens de la révolution islamique est passée de 27 % à 37 % entre 2019 et 2023.
L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un organisme indépendant à but non lucratif dédié à la recherche sur les questions de paix et de sécurité internationales [↩]
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce-que l’approche des capabilités ?...

L'approche des capabilités est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans différents domaines, en théorie de la justice, en développement, en santé publique, en éthique ou en éducation. Elle a été introduite par l'économiste et le philosophe indien Amartya Sen en 1979. Celui-ci a reçu le prix Nobel d'économie en 1998. C'était la première fois que ce prix a été offert à un non-occidental. Son prix a été reconnu comme un plaidoyer pour un retour de l'éthique en économie [1] . Après avoir été professeur à Oxford et Cambridge, Amartya Sen est aujourd'hui professeur à Harvard.
tiré du Journal d'Attac Québec
Bulletin, avril 2024
https://quebec.attac.org/?qu-est-ce-que-l-approche-des&utm_source=Bulletin&utm_medium=Email&utm_campaign=2024-04-30&utm_content=Qu%27est-ce-que%20l%27approche%20des%20capabilit%C3%A9s%20?...
par Thierry Pauchant
La notion de capabilité provient d'une fusion entre celle d'être libre et celle d'être capable. Pour Sen, de nombreux mouvements qui invoquent la liberté ne sont que théoriques, les personnes n'étant pas réellement capables de réaliser ces libertés. Par exemple, même si des adeptes du néolibéralisme affirment que le libre marché fait en sorte que l'accès à la propriété est accessible à toute la population, dans de nombreux cas même des personnes travaillant à temps plein ne peuvent acheter un logement, leur prix étant devenu trop élevé. Pour Sen, différentes politiques - privées, publiques et associatives - doivent être développées pour permettre à toutes les personnes, nanties et modestes, d'accéder à un logement. Sa notion de liberté appelle donc aussi celle d'égalité. De façon similaire, l'anthropologue libertaire David Graeber a proposé que si la notion de liberté doit permettre à chaque personne de formuler ses propres choix, celle d'égalité doit permettre à chaque personne de pouvoir accéder à des ressources pour réaliser ces choix [2].
Dépasser le PIB
Amartya Sen a aussi proposé la notion de capabilité afin de dépasser celle d'utilité. Cette notion est centrale dans l'idéologie actuelle en science économique, qu'elle soit néoclassique ou néolibérale. Cette idéologie présuppose que l'être humain est un être qui calcule son utilité financière, c'est-à-dire son profit potentiel, avant chaque décision et action. Selon cette idéologie, la seule responsabilité demandée aux entreprises est de maximiser leurs profits, selon Milton Friedman. De même, pour les gouvernements, la chose la plus importante à réaliser est, prétendument, d'accroître la croissance économique. Par exemple, le gouvernement actuel du Québec nous exhorte à gagner les mêmes « gros salaires » qu'en Ontario. Cette obsession au rendement financier s'observe aussi dans de nombreux autres domaines. Aujourd'hui, certaines professions sont choisies non pas par choix personnel, mais parce qu'elles sont payantes. Et des livres à succès vantent l'enquête financière à réaliser sur une personne avant de tomber en amour avec elle.
Amartya Sen a conseillé de dépasser le PIB dès 1979. Avec des collègues, il a proposé l'Indice de Développement Humain (IDH) qui combine des mesures économiques avec des données sur la santé des populations et leur niveau d'éducation. Cet indice est calculé pour chaque pays et chaque année par le PNUD des Nations unis depuis 1990. Il démontre qu'une seule mesure économique mène à des conclusions biaisées. Par exemple, si les États-Unis avaient en 2021 le plus gros PIB de toutes les nations, l'IDH de ce pays n'était que 21ième au niveau mondial. Il est clair que le développement économique ne garantit pas à lui seul la santé et l'éducation des populations, sans parler de la santé de l'environnement naturel.
Même si cette mesure de l'IDH présente encore des limites, elle démontre qu'une alternative au PIB est effective depuis 1990. Aujourd'hui d'autres mesures et critères ont été proposés dans une tentative de mieux balancer les réalités économiques avec d'autres, incluant la santé, l'éducation, l'écologie, l'équité, la sécurité, etc.
Le développement comme un élargissement des libertés
Le travail de Sen et de ses collègues a aussi modifié durablement notre conception du développement, en rajoutant à l'utilité économique la notion plus large de capabilité. C'est ainsi que le développement est aujourd'hui considéré par les Nations Unies comme mettant « l'accent sur l'élargissement des libertés et des possibilités offertes à chaque être humain plutôt que sur la croissance économique » [3].
Elle est en train de révolutionner tranquillement et pacifiquement notre conception du développement. Cette approche a, par exemple, modifié les critères internationaux retenus pour évaluer le développement humain depuis 1990. Elle est, de plus, au centre des nouveaux « Objectifs de développement durable », définis par les Nations Unies en 2015, comme nous le verrons dans le prochain article. Sen et Nussbaum sont aussi tous deux fondateurs de la Human Development and Capability Association qui fait la promotion de cette approche à travers le monde.
Il est aussi important de souligner que, contrairement à la théorie de l'utilité, supposée objective et exhaustive, l'approche des capabilités n'est pas présentée comme universelle, c'est-à-dire identique à travers le temps et l'espace. Cette approche n'utilise donc pas une prétendue liste de biens premiers, supposés identiques pour toutes les personnes. De plus cette approche se refuse d'utiliser la pensée magique, prétextant qu'une seule variable est responsable du progrès, comme celle de la maximisation des profits. Ce faisant elle s'oppose de façon radicale à l'idéologie dominante en économie et en affaires.
Les contributions de Martha Nussbaum
Martha Nussbaum est l'une des philosophes les plus respectées au niveau international. Professeure de droit et d'éthique à l'université de Chicago, spécialiste de la philosophe antique, notamment Aristote, elle a beaucoup contribué à l'approche des capabilités, Elle reconnait qu'une liste définitive des capabilités est impossible à établir, vu les différences culturelles et sociales existantes entre les sociétés. Cependant, elle a proposé une liste tentative de 10 capabilités, qui se doit d'être adaptée à chaque situation [4] :
1. La vie. Être capable de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue et d'une longueur normale.
2. La santé du corps. Être capable d'être en bonne santé, incluant une nutrition et un abri convenables. ;
3. L'intégrité du corps. Être capable de se déplacer librement, d'être en sécurité et d'avoir des possibilités de satisfaction sexuelle et de choix de reproduction.
4. Les sens, l'imagination et la pensée. Être capable de les utiliser de manière vraiment humaine, ayant reçu une éducation adéquate.
5. Les émotions. Être capable de s'attacher à des choses et des gens.
6. La raison pratique. Être capable de se former une conception du bien et du mal, ayant une liberté de conscience et de culte.
7. L'affiliation. Être capable d'être empathique avec autrui et avoir des bases sociales du respect de soi.
8. Les autres espèces. Être capable de vivre en relation avec les animaux, les plantes et le monde naturel.
9. Le jeu. Être capable de rire, de jouer, de jouir des loisirs.
10. Le contrôle sur son environnement. Être capable de participer à la vie politique, de jouir des droits de la propriété, de travailler de façon humaine et de recevoir une compensation financière adéquate et équitable.
Il est notable que la liste proposée par Martha Nussbaum, à titre indicatif, est résolument plurielle. Cette liste n'est pas définitive et ne tente pas d'évaluer si une politique est capabilisante ou non, en établissant un score optimal. Différemment, Nussbaum propose cette liste comme des possibilités susceptibles d'élargir les libertés des personnes et ainsi enrichir les décisions.
Libertés négatives et positives
Un trait essentiel, dans cette approche des capabilités, est sa conception large des libertés. Sen et Nussbaum font tous deux une distinction importante entre les libertés « négatives » et les libertés « positives » [5] . Les libertés négatives tentent d'exclure l'ingérence d'autrui. Par exemple, la volonté de réduire le plus possible le rôle de l'État, dans l'idéologie néolibérale, provient en partie de cet attachement à cette conception négative des libertés. Dans certains cas, la notion de liberté est alors réduite à celle de « libarté ».
Différemment, les libertés positives s'ajoutent à celles négatives et visent à accroître les capabilités des personnes, leurs possibilités concrètes de vie. Bénéficier d'une éducation gratuite ou peu coûteuse, par exemple, ou avoir accès à des soins médicaux de base, sont des libertés positives. Elles permettent potentiellement à des personnes d'exercer des choix auxquels elles attribuent de la valeur, car elles sont, dans l'exemple pris, capables de lire et de s'instruire, ou car elles demeurent en santé, grâce, en partie, à un système de santé publique.
Cette notion de liberté positive est très importante pour évaluer le rôle d'un État. L'accroissement du secteur privé dans le système de santé, par exemple, peut faciliter les soins aux classes nanties, mais aussi réduire les capabilités disponibles aux classes plus modestes, par manque de moyens financiers. De même, l'accroissement des frais en éducation peut favoriser la qualité de l'éducation dispensée aux classes nanties, mais aussi diminuer les capabilités des classes plus modestes, de nouveau par manque de moyens financiers.
Il est à noter qu'actuellement au Québec, le secteur privé gagne en importance à la fois dans le système de santé et celui de l'éducation. Cette tendance réduit ainsi les capabilités d'une partie importante de la population. Elle va, de plus, à l'encontre de ses droits pour recevoir de façon équitable des services adéquats en santé, en services sociaux et en éducation.
Thiery Pauchant est membre du C.A. d'Attac-Québec et professeur honoraire à HEC Montréal où il a fondé la Chaire de management éthique. Auteur de plus de 200 articles et de 13 livres, il fait la promotion de l'économie sociale et durable, notamment via Attac-Québec, le CIRIEC au Canada, l'Institut Veblen à Paris et l'UNDP aux Nations Unies.
Notes
[1] Amartya Sen, L'économie est une science morale, Paris, La Découverte, 1999.
[2] David Graeber, Comme si nous étions déjà libres (Trad. A. Doucet), Montréal, Lux Éditeur, 2014, p. 270.
[3] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Indices et indicateurs de développement humain, 2018, p. iii, disponible en ligne.
[4] Martha Nussbaum, Capabilités, Paris, Climats, 2012, p. 55-57.
[5] Amartya Sen, L'Idée de justice, (Trad. P. Chemla), Paris, Champs Essais, 2012, p. 341-342.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Soudan, la ville d’El-Fasher sous le feu meurtrier de la guerre

Chef-lieu de la région du Darfour, la ville d'El-Fasher accueille quelque 800 000 personnes déplacées qui se retrouvent piégées dans la guerre entre l'armée soudanaise et la milice des Forces de soutien rapide. Le quotidien burkinabè “Le Pays” déplore la “macabre détermination” de ces frères ennemis de ne pas déposer les armes.
Tiré de Courrier international. Article originalement paru dans lepays.bf Légende de la photo : Des déplacés internes font la queue pour récupérer des vivres à Gedaref, le 12 mai 2024. Les affrontements ont repris entre l'armée soudanaise et les RSF, à El-Fasher. Photo AFP.
C'est un pas de plus dans la descente aux enfers du Soudan qui a été franchi avec le siège de la capitale de la province du Darfour du Nord [le 11 mai] par les Forces de soutien rapide (RSF) du général [Dagalo dit] “Hemeti”, faisant redouter des risques énormes d'atrocités massives et de meurtres ethniques ciblés, notamment contre les populations non arabes entassées dans cette ville surpeuplée de réfugiés [les RSF, qui ont succédé aux milices arabes des janjawids, sont accusées de nettoyage ethnique, notamment à l'encontre de l'ethnie des Masalit].
La bataille engagée, hier dimanche [12 mai], par les RSF pour reprendre la ville aux forces loyalistes du général Al-Burhan [chef de l'armée soudanaise et chef d'État de facto] pourrait provoquer, en effet, un désastre humanitaire pire que celui de juin dernier [début des attaques contre la ville d'El-Geneina] dans cette ville d'El-Fasher et dans d'autres localités de la province [de juin à novembre 2023, la ville d'El-Geneina, dans l'ouest du Darfour, a été le théâtre d'épuration ethnique de la part des RSF], qui a révélé au monde entier l'horreur de cette guerre absurde avec un bilan effroyable de 10 000 à 15 000 civils qui y ont été massacrés.
L'inquiétude est d'autant plus grande que des combats à mort, rue par rue, ont été signalés jusqu'au centre de la capitale [Khartoum] qui abrite plus d'un million d'habitants, et qui est la seule ville à être tenue jusque-là par l'armée loyaliste, [laquelle] a dû se résoudre à renforcer ses positions et ses équipements par le biais de largages aériens.
Une bataille acharnée, donc, en perspective qui va probablement durer des semaines, possiblement plus, et qui va fatalement transformer El-Fasher en une cité de mise à mort à ciel ouvert, à moins qu'une hypothétique cessation des hostilités n'intervienne dans les prochaines heures.
L'impuissance internationale et le cynisme des diplomates
Malheureusement, les protagonistes ne semblent pas en prendre le chemin, bien au contraire, puisqu'ils ont répondu à l'appel désespéré du secrétaire général des Nations unies à respecter leur obligation de protéger les civils par des tirs d'armes lourdes dans plusieurs quartiers densément peuplés de la ville et de sa zone périurbaine.
L'on se demande d'ailleurs qui pourrait encore, dans ce chaos de corps et de cris, faire entendre raison à ces frères ennemis qui ont manifestement décidé d'aller jusqu'au bout de leur folie meurtrière et de leur macabre détermination de ne pas déposer les armes.
Personne, est-on tenté de dire, surtout quand on constate que tous les cessez-le-feu laborieusement obtenus se sont littéralement effondrés, ouvrant de nouveau la voie aux cohortes de combattants écervelés, aux chars et aux hélicoptères rugissants, pour commettre des crimes abominables contre des pauvres populations qui fuient éperdument vers les États qui bordent le Soudan.
Il ne faut surtout pas compter sur les diplomates aux ventres repus qui n'ont pas pu ou su empêcher d'autres pays avant le Soudan de sombrer, et qui se contentent de parler à la cantonade là où ils devraient plutôt taper du poing sur la table pour se faire entendre par les protagonistes.
Et si la solution la plus envisageable à cette crise soudanaise était de laisser le pays se déliter sous les feux croisés des généraux Al-Burhan et “Hemeti”, jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre et décide de quitter le pouvoir après sa victoire à la Pyrrhus, au nom de la réconciliation nationale ?
C'est peut-être un scénario cynique et improbable, mais sur les cendres du Soudan et des consciences des dirigeants des grandes puissances, un nouvel ordre politique pourrait ainsi miraculeusement naître, pour le bonheur et la sécurité durable des Soudanais.
Hamadou Gadiaga
Plus de 800 000 civils menacés
Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) a averti le 12 mai : des tirs à l'“arme lourde” ont eu lieu contre la ville d'El-Fasher, menaçant les quelque 800 000 civils qui y sont réfugiés. Dans ce chef-lieu du Darfour-Nord, au Soudan, la guerre entre l'armée soudanaise et la milice des RSF se fait meurtrière. Selon le Sudan Tribune, des frappes aériennes et des armes lourdes ont pilonné la ville ce 10 mai, du matin jusqu'à 18 h 30, marquant une escalade dramatique du conflit en cours.
Le titre soudanais décrit une ville où les combats en périphérie ont fini par gagner le centre-ville, le marché principal et les quartiers alentour, déclenchant des fuites et déplacements massifs. “L'hôpital El-Fasher Sud, le principal établissement médical de la ville, est submergé de blessés. L'hôpital de 100 lits peine à faire face au manque d'ambulances, de fournitures et de médicaments. Malgré le cessez-le-feu, les habitants craignent une reprise des combats”, poursuit Sudan Tribune.
À cette violence s'ajoute le drame des déplacés qui avaient trouvé refuge dans la ville, fuyant d'autres combats. “Plus de 40 600 personnes ont été déplacées dans la localité d'El-Fasher entre le 1er et le 18 avril en raison d'affrontements tribaux et de combats entre forces gouvernementales et rebelles. L'accès humanitaire à El-Fasher est sévèrement restreint, ce qui entrave l'acheminement de l'aide”, détaille le titre soudanais.
Au Darfour, 9 millions de personnes sont confrontées à des besoins humanitaires énormes, une situation exacerbée par le conflit prolongé et l'accès limité à l'aide.
Courrier International
Le trouble jeu de la Russie
On pensait la Russie solide alliée et principale pourvoyeuse d'armes des Forces de soutien rapide (RSF). Mais Middle East Eye affirme que Moscou sécurise ses intérêts stratégiques au Soudan, en fournissant aussi des armes aux Forces armées soudanaises (FAS) du général Al-Burhan tout en continuant à soutenir les paramilitaires des RSF du général Hemeti.
La Russie a montré jusque-là son soutien aux RSF, qui lui assuraient un approvisionnement en or soudanais. Moscou, via le groupe paramilitaire Wagner, avait sécurisé des mines aurifères soudanaises tout en soutenant les RSF. Mais, assure Middle East Eye, certains signes indiquent que la Russie “se concentre désormais davantage sur ses relations avec Burhan et le gouvernement aligné sur l'armée”.
Signe fort de ce rapprochement, en déplacement à Port-Soudan, ville dans laquelle s'est repliée l'armée soudanaise, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a clairement indiqué en langue arabe que c'est le Conseil de souveraineté du Soudan, contrôlé par l'armée, qui représente véritablement le peuple soudanais. Le ministre russe, qui dirigeait une délégation composée d'officiers militaires, a également rencontré le général Al-Burhan, chef de facto de l'État soudanais, lui assurant le soutien russe.
Dans le même temps, le Sudan Tribune a rapporté que, lors de ces discussions, la Russie a offert aux Forces armées soudanaises “une aide militaire qualitative sans restriction”. Cette offre pourrait “impliquer une expertise spécialisée et, potentiellement, une présence russe au Soudan”. À Port-Soudan, la délégation russe a également discuté de la perspective d'une base navale russe sur la côte de la mer Rouge.
Courrier International
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections 2024 en Afrique du Sud : un appel au réveil pour la gauche

Les élections nationales et provinciales du 29 mai en Afrique du Sud s'annoncent les plus déterminantes depuis les « élections de la liberté » de 1994. Reste qu'encore une fois aucune force de gauche ou anticapitaliste crédible n'est en lice. Selon l'appréciation générale, l'ANC ne devrait pas remporter une majorité absolue, ce qui implique des possibilités de nouvelles configurations de pouvoir. L'incapacité de la gauche de se faire une place dans le cadre des élections qui arrivent en dit long sur son état et sur la situation des mouvements syndicaux et sociaux. Ces derniers ne sont guère que l'ombre des mouvements qui ont été si décisifs pour bouter le régime raciste du Parti national hors des « Union Buildings » (Siège du gouvernement sud-africain — NDT).
Tiré du Journal des alternatives.
Les 30 années de règne de l'ANC ont été un désastre pour notre pays et une catastrophe pour les pauvres et les travailleuses et travailleurs. Le taux de chômage a atteint des sommets inégalés. Les disparités sociales se sont aggravées au point d'être sans équivalent dans le monde. La violence à l'égard des femmes atteint des niveaux effrayants. En moyenne, une femme est violée toutes les 25 secondes et on compte un féminicide toutes les huit heures dans nos contrées. La plupart des municipalités sont incapables de fournir des services de base à la population locale en raison d'un manque de financement abyssal.
La corporisation et la marchéisation des entreprises publiques ont été un désastre. Eskom et Transnet se trouvent dans une spirale de mort. Extrêmement endettées, elles sont incapables de répondre aux besoins de la population et de l'économie en matière d'électricité et de transport. Presque toutes les autres sociétés d'État souffrent des mêmes symptômes.
Le vide à gauche
Il est donc tragique que la gauche, qui a développé une critique convaincante des politiques néolibérales, ne soit pas en mesure de promouvoir des voies véritablement nouvelles, au moment même où l'électorat réclame plus que jamais des solutions de rechange.
Tous les fragments de l'opposition à l'ANC (et chaque jour un nouveau fragment émerge) offrent des explications largement superficielles et fausses de l'état actuel de la nation. Pour l'Alliance démocratique (Democratic Alliance) et ses alliés, c'est la corruption et le placement des cadres dans les institutions de l'État qui sont en cause. Les populistes blâment soit l'immigraiton illégale, soit la protection défaillante des valeurs familiales chrétiennes. En ce qui concerne celles et ceux qui ont pris leurs distances par rapport à l'ANC, on dénonce le manque de prise de pouvoir économique de la population noire (Black Economic Empowerment — BEE) et déplorent que la transformation économique radicale prônée n'aille guère au-delà des mots.
L'incapacité de la gauche à constituer une force crédible a donné lieu à une situation grotesque : des populistes corrompus, qui ont autrefois dirigé l'ANC, se présentent de manière opportuniste comme des radicaux de gauche. Zuma et son parti MK (uMkhonto we Sizwe en zoulou/xhosa ; fer de lance de la nation) ne sont que les derniers d'une longue série à incarner cette tendance. Citons aussi Ace Magashule et son parti, le Congrès africain pour la transformation (African Congress for Transformation), le parti Mouvement du peuple pour le changement (People's Movement for Change) de Marius Fransman et, bien sûr, le parti Combattants pour la liberté économique (Economic Freedom Fighters – EFF), dernier en date auprès duquel Carl Niehaus a réussi à faire son nid. Quant aux nouveaux partis, comme l'Alliance patriotique (Patriotic Alliance) et l'Action pour l'Afrique du Sud (Action SA), ils ont pour stratégie électorale de faire appel aux pires sentiments d'un peuple désespéré par la crise socio-économique. Ils se livrent à une surenchère pour être les plus farouchement xénophobes, homophobes et durs à l'égard de la criminalité.
Les résultats désastreux du Parti socialiste révolutionnaire des travailleuses et travailleurs (Socialist Revolutionary Workers Party) aux élections de 2019 ont eu des répercussions pour l'ensemble de la gauche. Cette débâcle marque la fin de ce qu'on a appelé le « moment Numsa » (National Union of Metalworkers of South Africa, le syndicat national des métallurgistes de l'Afrique du Sud) de 2013 — une opportunité de renouveau pour une politique de gauche indépendante enracinée dans les mouvements populaires de masse. Ces déboires renforcent l'idée fausse selon laquelle il est difficile de construire des mouvements politiques démocratiques, radicaux, faisant appel aux masses et à même de percer dans les élections — l'idée selon laquelle la politique électorale n'est pas un domaine dans lequel la gauche devrait intervenir. De même, la dérive du parti EFF vers une politique nationaliste grossière et l'application d'un calque radical de l'ANC fera obstacle au renouveau d'une politique de gauche militante.
La conséquence pour une véritable gauche socialiste démocratique est que, même si elle était en mesure d'entrer dans la mêlée électorale, elle se retrouverait dans un champ des possibles encombré, à lutter pour se démarquer par rapport aux nombreux imposteurs.
Et puis il y a les électrices et électeurs en puissance de la gauche qui ont été tellement désillusionné.es par l'état des choses qu'ils et elles se sont retiré.es du jeu, ne prenant même pas la peine de s'inscrire sur les listes électorales.
Les élections nécessitent une considérable cagnotte. Trouver les fonds nécessaires pour rivaliser avec les partis bourgeois sans sombrer dans l'opportunisme, représente une énorme montagne à gravir pour une gauche qui dépend du soutien de celles et ceux qui ne possèdent rien.
Il est urgent de résoudre le problème de l'absence électorale d'une gauche crédible. Il faudra repenser en profondeur les perspectives et la stratégie de la gauche, ce qui provoquera une réorganisation substantielle de celle-ci.
La longue marche vers la construction d'un mouvement de gauche de masse susceptible de détourner l'électorat du camp politique nationaliste demandera de faire face à des décisions stratégiques et tactiques difficiles, en particulier dans le contexte d'un déclin des mouvements sociaux de la classe ouvrière, et notamment de l'affaiblissement et de la fragmentation du bloc travailliste.
Notre point de départ
Notre compréhension de l'absence d'un parti anticapitaliste aux prochaines élections doit aller au-delà de l'analyse de Steven Friedman, qui attribue cette absence à la centralité de la race et de l'inégalité raciale. Un bon point de départ serait de reconnaître la défaite de la gauche en Afrique du Sud. Le philosophe et militant socialiste français Daniel Bensaïd, en intervenant dans le cadre d'une évaluation de la stratégie révolutionnaire au tournant du 21e siècle a pointé ce qui suit : d'où venons-nous ? D'une défaite historique. Mieux vaut l'admettre et en mesurer la portée. L'offensive néolibérale du dernier quart de siècle est la cause de cette défaite, en plus d'en être la conséquence et l'aboutissement.
Quelque chose a été accompli au tournant du siècle, entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre. Mais de quoi s'agit-il ? De la fin du « court vingtième siècle » et de son cycle de guerres et de révolutions ? De la fin de la modernité ? De la fin d'un cycle, d'une période ou d'une époque ?
Il est clair que la gauche sud-africaine a souffert et qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Mais on peut relever des éléments qui lui sont spécifiques.
Tout d'abord, les déboires du pays émergent dans le sillage de l'effondrement de la distorsion socialiste de l'URSS et de ses États satellites, dont ils procèdent. Ensuite, comme l'a adéquatement expliqué Vishwas Satgar :
- « Deux décennies de néolibéralisation sous la direction de l'ANC, qui a abandonné la démocratie, de même que le développement et la formation de l'État par rapport au capital, ont consacré la défaite stratégique de la gauche et de la classe ouvrière en Afrique du Sud. Le moment et le processus de la “National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa)”, sous la houlette du plus grand syndicat d'Afrique du Sud (plus de 330 000 membres) et du plus militant aussi, ont constitué un vaste agrégat visant à faire face à cette défaite stratégique. Ce fut le ferment d'une bataille pour déterminer l'avenir de l'Afrique du Sud, une initiative stratégique pour la classe ouvrière du pays. »
Il n'en demeure pas moins que c'est l'effondrement de ce « moment Numsa » qui rend la situation de la gauche encore plus difficile et complexe. C'est comme s'il fallait reconstruire à partir de zéro. Comme le souligne le marxiste britannique Stuart Hall :
« Lorsqu'une conjoncture se déploie, il n'y a pas de “retour en arrière” possible. L'histoire change de palier. Le terrain se modifie. Vous êtes dans un nouveau moment. Vous devez approcher les choses avec “violence”, avec tout le “pessimisme de l'intellect” dont vous êtes capable, en phase avec la “discipline de la conjoncture”. »
La politique stalinienne a prévalu
Pourquoi la gauche anticapitaliste sud-africaine n'a-t-elle pas réussi à marquer ce moment de son empreinte ? Le dogme marxiste-léniniste à l'ancienne était dominant, avec son autoritarisme intrinsèque et son emprise sur d'importantes machines bureaucratiques telles que le parti communiste sud-africain (South African Communist Party ou SACP, en anglais), le Congrès des syndicats sud-africains (Congress of South African Trade Unions ou COSATU, en anglais) et le Numsa. Cette coupe réglée a exterminé les jeunes pousses d'une politique émancipatrice plus ouverte, démocratique et pluraliste.
Parmi les protagonistes à l'origine de la formation du parti EFF et de celui du SRWP, le Numsa, il y a pu y avoir rupture avec l'ANC/le SACP, mais pas avec les politiques et les pratiques du congrès/du stalinisme. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la régurgitation des notions de « révolution démocratique nationale » — la théorie étapiste du changement révolutionnaire — étayée par une alliance avec la bourgeoisie patriotique, au nom de la classe ouvrière. Les jeunes militant.es et cadres issus des luttes ouvrières, communautaires et étudiantes ont été absorbés par ces bureaucraties dans leur quête d'un revenu stable et d'une sécurité personnelle.
Reconnaître la défaite que nous avons subie, ce n'est pas se démoraliser. C'est plutôt reconnaître un échec sans capituler devant l'ennemi, en sachant qu'un nouveau départ est susceptible de prendre des formes inédites.
Vers un renouveau
Il n'y aura pas de voie rapide pour sortir de cet état de déclin. L'élection qui vient pourrait être déterminante dans la mesure où elle mettra, selon toute vraisemblance, un terme à la domination totale de la politique nationaliste. Partant, une telle évolution pourrait avoir de meilleures chances de structurer l'échiquier politique selon l'opposition entre classes. Mais dans une autre optique, de tels changements seront totalement insignifiants — ils n'auront aucun effet sur la vie matérielle de la classe ouvrière et des pauvres. Les canalisations d'eau et d'égout brisées ne se répareront pas pour autant. Les délestages, les longues coupures d'électricité quasi quotidiennes, ne cesseront pas demain la veille. Et surtout, cela n'éloignera pas le gouvernement de l'orientation néolibérale que partagent la plupart de ses opposants politiques.
Pour un véritable changement, il n'y aura pas d'autre option que de continuer à construire des organisations populaires, de lutter pour reprendre le mouvement syndical à sa direction bureaucratique et de lutter pour reconstruire l'unité du mouvement de la classe ouvrière afin d'en faire un mouvement pour le socialisme. Il ne doit plus y avoir d'élections sans représentation de la gauche sur le bulletin de vote. Et pour que la gauche fasse entendre sa voix, celle-ci doit être ancrée dans des organisations populaires actives.
Publiée sur le site d'Alternatives International et traduit par Johan Wallengren.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Rwanda supplétif de l’Union européenne en Afrique

Le Rwanda devient une pièce maîtresse pour l'Union européenne (UE) tant dans la lutte contre l'immigration que pour la sécurisation de pays africains en proie aux attaques de leur rébellion.
Tiré de Afriques en Lutte
7 mai 2024
Par Paul Martial
À la suite à leur accord, Rishi Sunak et Kagamé se disent impatients de voir au plus vite les premiers migrants de Grande-Bretagne expulsés au Rwanda, et tant pis si ce pacte déroge au droit international. Si on perçoit les intérêts électoraux pour Sunak de cette politique démagogique et raciste, qu'en est-il pour Kagamé ?
Argent contre migrant
Les intérêts sont d'abords financiers, et les autorités rwandaises ne s'en cachent pas. Les 300 premiers migrantEs transférés devraient rapporter au Rwanda 220 millions d'euros. À cela s'ajoutent 25 millions d'euros financés par l'UE dans le cadre du « mécanisme de transit d'urgence » pour des migrantEs évacués de Libye. En plus du gain financier, Kagamé bénéficie d'une tolérance pour ses violations systématiques des droits humains. Il va d'ailleurs entamer son quatrième mandat lors des prochaines élections présidentielle à l'été 2024, qu'il gagnera avec les mêmes scores soviétiques affichés lors des précédents scrutins. Les organisations de défense des droits humains ont pu dénoncer à maintes reprises les assassinats d'opposantEs à travers le monde, rien ne bouge.
Indulgence coupable
Cette mansuétude des pays occidentaux pourrait s'expliquer par la culpabilité. Celle de l'indifférence à un génocide qui se déroulait sous leurs yeux. Mais il y a surtout la diplomatie militaire du Rwanda. Il est le deuxième contributeur africain des opérations de maintien de la paix. Près de 4 600 soldats rwandais sont déployés dans les missions onusiennes au Sud Soudan et en Centrafrique. Dans ce pays, le Rwanda a envoyé ses forces spéciales en 2020 pour sauver le régime. Un soulagement pour l'Europe craignant de voir une nouvelle fois cet État tomber dans un chaos aux conséquences délétères pour la stabilité de la région.
Le nouveau gendarme
Le Rwanda s'est rendu indispensable pour la France en intervenant au Mozambique. Ses soldats ont repoussé les combattants islamistes de Cabo Delgado et assurent la sécurité de cette région stratégique pour TotalEnergies. La multinationale investit près de 15 milliards de dollars pour la production de gaz liquéfié.
Kagamé, c'est un peu le Wagner de l'occident. En effet l'armée française étant désormais indésirable à peu près partout en Afrique, le rôle de gendarme semble être dévolu au pays des milles collines. Ainsi le Bénin, qui subit des incursions des djihadistes du Burkina Faso voisin, vient de passer un accord militaire. Il ouvre la voie à une intervention de l'armée rwandaise. Si cette opération est un succès, il y a fort à parier que d'autres pays pourraient être demandeurs.
Les autorités rwandaises profitent de ce nouveau rôle pour mener leur politique d'agression et de pillage dans l'est de la République démocratique du Congo en soutenant la milice du M23, coupable des pires atrocités contre les populations sans risque de se voir sanctionner.
Paul Martial
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique - RDC : les minerais de la honte

Il y a cent cinquante ans, le Congo belge, maintenant République démocratique du Congo (RDC), accompagnait l'essor industriel de l'Europe et des USA en fournissant des milliers de tonnes de caoutchouc nécessaires à la fabrication des pneus, des courroies et tuyaux flexibles. Aujourd'hui ce sont le cuivre, le cobalt, l'étain, le cadmium, le niobium et bien d'autres minerais rares indispensables à la fabrication des batteries et au secteur industriel de haute technologie.
Tiré de Afriques en Lutte
7 mai 2024
Par Paul Martial
Conditions de travail périlleuses
Un siècle et demi plus tard, l'exploitation éhontée des populations est restée identique. Certes, les punitions corporelles comme les amputations des mains des travailleurEs ou de leurs enfants pour manque de rendement n'est plus de mise mais les conditions de travail restent terrifiantes dans les mines artisanales qui représentent pour le coltan 90 % de la production de la RDC. Les puits de mine peuvent atteindre 100 mètres de profondeur et deviennent, lors des saisons des pluies, de véritables pièges mortels par noyade ou ensevelissement si les bâches protégeant les cavités se déchirent sous le poids de l'eau. Pour les mineurs, appelés aussi creuseurs, pour les femmes qui lavent les minerais de cobalt, la présence de métaux lourds dans leur sang est avérée, entraînant des dommages oxydatifs de l'ADN, des fausses couches ou des malformations des fœtus. Le travail des enfants reste monnaie courante. La plupart des mines artisanales sont sous le contrôle de milices armées ou des militaires congolais. Dans les deux cas ils imposent aux populations un travail forcé.
Économie de guerre
L'extraction des minerais est un enjeu économique qui explique la pérennité des conflits. En 2000, le kilo de tantale se vendait 22 dollars US aujourd'hui il s'échange à plus de 400 dollars, le niobium à plus de 1 000 dollars. Les milices armées utilisent ces sources de financement pour leur guerre. Le Rwanda qui soutient un de ces groupes, le M23, profite de la situation pour accaparer une partie de la production de la RDC engendrant plus d'un milliard de dollars de recettes en 2023. Les grandes entreprises occidentales certifient à grands coups de label la non-utilisation de ces « minerais de sang ». Impossible à garantir !
Si les mines industrielles et artisanales ont chacune en théorie des circuits distincts, le nombre important d'intermédiaires, acheteurs au détail, négociants en gros, courtiers, transporteurs, opacifie la chaîne d'approvisionnement, ce qui autorise le mélange de la production des deux circuits. D'autant que les minerais issus de l'industrie artisanale sont recherchés pour leur forte teneur en métaux car, faute d'instrument de mesure, les creuseurs les trient à l'œil nu.
Larmes de crocodiles
Officiellement il y a un consensus pour dénoncer les conditions de travail des mineurs artisanaux. Chacun y va de son couplet, que ce soient les dirigeants africains ou ceux de l'industrie électronique. Pourtant rien n'est fait alors que deux mesures pourraient être prises.
La première est d'arrêter la répression contre les mineurs artisanaux qui tentent de s'organiser en coopérative et d'améliorer ainsi leurs conditions de vie et de rémunération.
La seconde est la mise en place — par les multinationales d'industries de première transformation des minerais créant une valeur ajoutée pour la RDC — de mesures de protection des travailleurEs et de l'environnement.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mayotte Place Nette. Vers un monde inhabitable

Mayotte serait-elle devenue la mauvaise conscience de la France, sa honte, sa dissimulation ? Le pire s'y passe tranquillement. Bien qu'y adviennent les événements les plus tragiques, les plus infamants et de fait les plus moralement discutables, les citoyens se réclamant Français et revendiquant la France pour leurs intérêts, expriment peu leur trouble quant aux maux infligés aux populations pauvres, qui composent tout de même la grande majorité des habitants de l'ile.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/09/mayotte-place-nette-vers-un-monde-inhabitable/
Pire encore, les citoyens les mieux traités récriminent contre le pouvoir et surenchérissent sur sa brutalité envers les plus pauvres, catégorie à laquelle appartiennent également les migrants.
Il devient particulièrement difficile de chroniquer les événements qui se chassent les uns les autres. Comment évaluer leur gravité tant le dernier épisode excède le précédent et accentue le harcèlement permanent dont sont affligés les indésirables désignés ?
Une population insulaire dont 80% vit sous le seuil de pauvreté ne peut se plier aux dictats d'une législation soucieuse de promouvoir les conditions de vie répondant aux critères du confort bourgeois. Des règles d'éligibilité aux prestations sociales qui excluent près de la moitié de la population, un marché de l'emploi qui n'occupe que le tiers des individus en âge de travailler, un cout de la vie supérieur à celui observé en métropole : voilà au moins trois conditions qui se combinent pour astreindre les laissés-pour-compte à se débrouiller avec les moyens à leur portée, opportunités qui ne font pas bon ménage avec la légalité. Puisque l'État les écarte de la solidarité nationale, ils n'ont d'autres choix que de se confiner dans l'économie informelle où ils puisent toutes les ressources nécessaires à la survie.
Depuis la mise en application de la loi Elan qui permet au préfet de Mayotte, et à celui de la Guyane, de détruire l'habitat insalubre, illégal ou indigne, adjectifs permutables en fonction de la justification souhaitée, 33 arrêtés de démolition sous couvert de la loi Elan ont été publiés et exécutés délogeant 11 585 personnes [1].
L'opération Wuambushu 2, inaugurée le 16 avril par la démolition de 220 habitations dans le quartier de Doujani 2, doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin et durer onze semaines. Comme l'an passé, rien n'a été préparé sauf les prétentions affichées : détruire 1300 cases en tôle durant cette période bien qu'un seul arrêté ait été publié à ce jour contre un quartier de Sada, village côtier sur le littoral ouest, que les services de la préfecture n'ont pas pris la peine de recenser. L'adjudant qui signe le rapport de gendarmerie annexé à l'arrêté confirme sans gêne qu'il « n'existe pas de recensement précis de la population dans ce village vu la nature des constructions, souvent illégales, et abritant des personnes en situation administrative irrégulière sur le territoire français[2] ».
Mais qu'importe puisque les gens ne sont pas le souci de l'administration. On ne les compte pas parce qu'ils ne comptent pas.
L'atteste la nouvelle appellation dont le Gouvernement affuble le Wuambushu nouveau à la périodicité printanière : « Mayotte Place nette ».
L'expression « place nette » est devenu récemment la marque de fabrique de toutes les actions de politique urbaine : ainsi l'opération « Place nette XXL » à Marseille vise à « renforcer la lutte contre la délinquance et plus particulièrement le trafic de stupéfiants [3] », même refrain à Strasbourg, à Nantes, dans leNord. Le pouvoir exécutif règle son action sur la dimension régalienne, la seule pour laquelle il semble avoir encore un peu d'imagination lexicale comme l'emploi à toutes les sauces du terme « réarmement » et les préfixes e « R » (refondation, révolution…) particulièrement affectionné par le président de la République, franchement belliqueux.
Pour Mayotte où s'applique depuis longtemps déjà une politique répressive sans alternative, la formule exprime toutes les menaces déclinées par le dictionnaire le Robert : « faire place nette, vider les lieux et fig. renvoyer d'une maison, d'une entreprise, tous ceux dont on veut se débarrasser ; rejeter ce dont on ne veut plus ».
Faire place nette, nettoyer (au “karcher” [4]), faire le vide, tel est le programme de coups de torchon périodiques promu en lieu et place d'une politique sociale solidaire et redistributive. Pareil traitement n'est pas réservé au petit confetti lointain perdu dans l'océan indien, dont la relation avec la France s'est transformée d'ancienne colonie à nouveau département sans que son sort en soit pour autant amélioré. Par population pauvre il faut de toute évidence comprendre les nationaux et les migrants dont les maltraitances administratives et gouvernementales finissent par s'équivaloir : harcèlements, accumulation d'atteintes aux droits et aux protections, travail forcé ou emplois dégradés, dénonciation d'une nationalité supposément extorquée, la liste reste à la mesure de l'imagination des dominants.
Outre la politique extrême de démolition des quartiers pauvres, dite à présent « décasages [5] », les deux autres volets complètent inlassablement le dispositif mis en place depuis des décennies dont l'inefficacité patente conduit les autorités à l'amplifier ad nauseam.
La lutte contre l'immigration clandestine imagine purger Mayotte des habitants venus des autres iles de l'archipel sans que les mesures mise en œuvre depuis des lustres n'aient la moindre incidence sur une démographie dont les données sont devenues un enjeu de lutte [6]. Contester les données de l'INSEE procure des avantages dans le rapport de force avec l'État français : les personnes non comptées figurant implicitement des hordes menaçantes de clandestins par définition cachés, les activistes des collectifs de citoyens et les élus font valoir une sous-estimation de la population pour aggraver la politique anti-comorienne et plus généralement anti-migratoire. La théorie du complot est appelée à la rescousse : obsessionnellement, les deux député·es fantasment et remâchent sur une offensive délibérée de l'État des Comores pour convaincre du grand remplacement en cours et radicaliser toutes les relations quotidiennes avec les migrants.
Et cela fonctionne au-delà de toute espérance : le gouvernement manipule la nationalité des habitants sans retenue, promet de supprimer ce qu'il reste d'un Droit du sol bien attaqué depuis la loi Asile de 2018 et concentre toute sa politique sur le rejet et le harcèlement des habitants venus des autres iles quel que soit leur statut administratif ; tout ceci au détriment de mesures favorables au développement et à l'intérêt général.
Immigration, délinquance, habitat insalubre. Guerre aux migrants, aux jeunes, et aux pauvres. La nouvelle entreprise baptisée « Mayotte, place nette », ritualisée dans une répétition annuelle de deux mois environ d'avril à juin, célèbre des politiques simplistes qui ne visent qu'à saper les fondements qui assurent la survie d'une société sinistrée.
Le programme des démolitions de quartiers pauvres reste pourtant le seul volet parmi la triade annoncée dont le gouvernement prétend faire valoir sa maîtrise et sur lequel il communique avec le plus d'assurance. Ainsi, le 16 avril, premier jour de l'opération Mayotte place nette, sur son compte X/Twitter, le préfet annonce : « Lancement de l'opération Mayotte Place Nette. Sécuriser, Décaser, Reconduire à la frontière. À Doujani, une opération de grande envergure s'est déroulée : l'objectif est de décaser + de 200 cases en tôle pour permettre l'émergence des projets de la collectivité [7]. » Ce jour-là, la lutte contre les délinquants s'est résumée là à « 6 interpellations d'individus hostiles à cette opération ».
La démolition du quartier avait été décidée par l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 « portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, périmètre haut et bas, commune de Mamoudzou [8] ».
La plus grande imprécision recouvre cette opération.
Le document annexé à l'arrêté, signé le 11 décembre 2024 par le directeur de l'Association à la Condition Féminine et à la violence faite aux femmes (ACFAV) mentionne une proposition de logement provisoire à 39 familles sur 60 repérées sur le secteur ciblé, ménages dont la composition n'est jamais précisée. Mais dans la mesure où les parents sont désormais bien informés sur le risque que le déplacement fait courir sur la scolarité des enfants et sur les capacités de survie loin du réseau de solidarité constitué, ils ne sont pas enclins à renoncer à leur autonomie contre une vague promesse de relogement par des associations qui n'ont pas les moyens de la mission qui leur est confiée.
L'annexe 2 rédigée par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dont les agents ont visité les lieux pour rendre un rapport d'insalubrité se contentent de compter « plusieurs centaines de locaux à usage d'habitation ». Impossible d'en savoir plus.
La ministre déléguée aux Outre-mer se cale toujours sur l'objectif de détruire 1 300 cases durant les cent jours dévolus au Wuambushu 2, mais dans la mesure où seuls le gouvernement et ses représentants locaux contrôlent une information invérifiable, il est impossible de connaitre le nombre de personnes effectivement relogées. La presse, reprenant les indications de la préfecture, relate qu'entre 200 et 250 cases en tôle auraient été détruites. Qu'importe finalement le nombre d'habitants délogés puisqu'il n'est jamais question de les secourir, de les inclure dans un projet d'insertion d'ailleurs difficile à réaliser compte tenu des droits négatifs qui les frappent [9] ; seul vaut le nombre de logements à détruire à partir duquel sera évalué le succès de l'opération. Puisque personne ne compte, ni les journalistes, ni les associations neutralisées par la démesure des actions et la forfaiture des institutions, ni les autorités résolues à se concentrer sur des projets déshumanisés car sans humains dignes de ses décisions, le gouvernement ne risque plus de perdre la face.
Ainsi petit à petit, face à la permanence des brutalités qu'elle subit, la majorité des habitants de Mayotte s'habitue à la violence institutionnelle qu'elle affronte silencieusement. Sans doute les poussées de colère et de fureur s'expriment quotidiennement chez les jeunes qui font l'expérience, depuis leur plus jeune âge, qu'ils ont peu à perdre dont les actes de délinquance leur semblent le seul acte délibéré à leur portée. Mayotte est devenue pour les populations pauvres un État policier qui contrôle en permanence les identités et les visas dans une ile-frontière, qui exclut et renvoie dans les iles voisines, qui spolie les biens acquis « illégalement » dans des pratiques de pêche ou d'agriculture traditionnelles, qui poursuit et punit les solidarités et les systèmes d'entraide en tant qu'emplois non déclarés.
Les quelques-uns qui tirent avantage de leur position dans l'administration quasi-coloniale, principalement les fonctionnaires territoriaux, leurs parents et alliés, ne se privent pas de récriminer sans cesse contre l'État, non pour revendiquer une qualité de vie qui pourrait profiter à tous, mais pour exiger qu'on les débarrasse des indésirables qui envahissent leur territoire.
Une semaine après le début de « Mayotte Place Nette » et la démolition du quartier de Doujani, le préfet a procédé au démantèlement du campement de Cavani-stade. Ce démantèlement a simplement consisté à détruire les abris provisoires des migrants venus de l'Afrique des Grands Lacs, de fermer l'enceinte du stade et de condamner les sinistrés à se regrouper sur les trottoirs qui la bordent. Environ 300 personnes, hommes, femmes et enfants, vivent depuis à la rue dans le plus grand dénuement [10]. Pourtant le Gouvernement semblait résolu à gérer l'affaire de ce campement sans trahir ses obligations. A deux reprises, par les voix du ministre de l'Intérieur le 17 janvier et du premier ministre lui-même sept jours plus tard, il s'était solennellement engagé à respecter l'obligation internationale de protection à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le premier professa : « Il y a des gens qui sont réfugiés, qui sont reconnus comme réfugiés, je vais donner comme instruction de pouvoir les rapatrier dans l'Hexagone […] On a reconnu qu'[ils] avaient le droit à l'asile et mon travail est de les protéger désormais [11] » ; le second mit en garde la population contre les exactions éventuelles commises contre ces populations : « Le démantèlement du camp doit permettre le retour à un fonctionnement normal de l'ensemble des activités. C'est une attente forte des Mahorais, et nous le leur devons. Mais je veux aussi le dire : les violences à l'encontre des migrants ne sont pas acceptables [12] ».
Dès lors, le démantèlement du camp se fit de manière progressive en fonction des solutions : transfert des réfugiés vers la métropole et installation des demandeurs d'asile en hébergement d'urgence. Mais à la faveur du changement de préfet, le Gouvernement a renoué avec sa politique de brutalité à l'égard des populations vulnérables : démantèlement du camp sans solution pour les personnes mises à la rue le 21 mars.
L'État confirme ainsi son mépris du droit. D'une part il a défié l'ordonnance du tribunal administratif du 26 décembre qui rejetait la demande d'autorisation de démantèlement du camp de Cavani sans relogement préalable ; d'autre part il s'assied sans scrupule sur les déclarations ou engagements antérieurs prononcés au plus haut sommet de l'État.
Dans ce climat délétère qui fait place nette de tout scrupule moral et humanitaire, l'exemple du préfet qui détruit les abris des plus vulnérables qu'il a le devoir de protéger, est imité par des membres de collectifs de citoyens haineux et leurs recrues qui saccagent le campement de réfugiés à Massimoni, aux abords du siège de l'association Solidarité Mayotte. Ces brutalités, attribuées aux délinquants des quartiers voisins, commandités et rejoints par les riverains du village de Cavani, ont consisté à vandaliser les installations des Africains, à voler leurs biens, à brûler papiers et vêtements, matelas et bâches de protection, provoquant des incendies qui ont menacé le bâtiment associatif. Ces violences se sont répétées deux soirs de suite et ont contraint les migrants à rejoindre les sinistrés du camp de Cavani. Le responsable du campement raconte : « on a été attaqués par des monstres cagoulés la nuit du 21 avril. On a fui pour trouver refuge sur le trottoir qui longe le stade, avec ceux qui ont été chassés la semaine passée. »
Une maman, qui a fui le Rwanda il y a cinq ans avec sa fille aujourd'hui âgée de 13 ans scolarisée en collège, pleure sa détresse : « Ça ne va pas, on a été attaquée, on a peur, on a peur beaucoup, il faut prier. On a peur, la nuit, la journée. Ils sont venus pour nous tuer. Les policiers ils passent, les gendarmes ils passent, mais on a peur. J'ai la peur, je crois qu'on va me tuer avec mon enfant. Elle, ça ne va pas, je vais voir le psychologue parce que ça ne va pas. Je n'ai rien pour manger, il y a des gens qui viennent comme ça, qui me donnent un peu de pain. Mon enfant va abandonner l'école parce qu'elle ne dort pas, parce qu'elle ne mange pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, je vais mourir avec mon enfant, j'ai fui mon pays, mon mari a été tué, je suis partie et on va me tuer ici. »
Ainsi il apparait que les autorités et les collectifs de citoyens dissimulés derrière des délinquants qu'ils rejoignent dans leurs forfaits contre les Africains livrés à eux-mêmes sans la moindre assistance, se sont tacitement associés pour faire place nette des migrants. Ni dans les instances judiciaires, ni dans la hiérarchie policière il ne s'est trouvé un responsable s'estimant légitime pour neutraliser, voire poursuivre et punir, les criminels qui ont ainsi pu semer la terreur deux soirs de suite sans la moindre retenue [13].
Tour à tour, les insatiables fauteurs de misère et de malheur, les élus et les autorités se sont relayés dans une connivence interminable. Le maire de Mamoudzou prend un arrêté d'interdiction d'occupation de la voie publique en vue de chasser les sinistrés des campements dévastés. Le vendredi 26 avril, au point du jour, la police et la gendarmerie sont intervenues pour disperser les gens regroupés sur les trottoirs. Il semble que l'aventure se soit terminée par une impasse.
La communication officielle parle à présent de nettoyage de la place.
Vers midi, dans un retour au calme précaire, un Congolais conclut : « finalement la préfecture et la Cadema [14] pour nettoyer et vider les poubelles ». D'autres se plaignent que leurs biens, papiers et argent, vêtements, ont été emportés en leur absence.
La politique en œuvre dans « Mayotte, Place nette », consiste simplement à rendre la terre inhabitable aux plus vulnérables, à ceux auxquels il n'est reconnu aucune place, devenus partout des indésirables. Dans les Outre-mer, et dans l'Hexagone.
[1] 35 habitants en 2019, 410 en 2020, 7800 en 2021, 598 en 2022, 1566 en 2023, et déjà 1175 en 2024. Voir à ce sujet les rapports annuels de la Ldh : « Mayotte, démolitions des quartiers pauvres sous couvert de la loi Elan ». Trois rapports ont d'ores et déjà été mis en ligne. Voir ici.
[2] « Arrêté n°2024-SG-303 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit quartier citadelle Mangajou, commune de SADA (23 pages) », Recueil des actes administratifs, Préfecture de Mayotte, voir ici.
[3] « Lancement des opérations “Place nette” XXL », Site de la police nationale, voir ici.
[4] Cette idée de régler les problèmes sociaux comme la délinquance et la pauvreté en déshumanisant semble érigée en valeur universelle.
[5] Le terme « décasage » désignait les soulèvements villageois violents contre les quartiers comoriens accompagnés de la destruction de leurs habitats. Les dernières survinrent en 2016. La loi Elan a signé le relais pris par l'État français dans ces exactions. Que le préfet et les journalistes suivis par la population reprennent le terme désignant ces exactions criminelles pour nommer les opérations de résorption de l'habitat insalubre ou illégal en dit long sur leurs intentions profondes.
[6] Jérome Talpin, « Mayotte, Marine le Pen polémique sur le nombre réel d'habitants ». Le Monde, du 5 et 6 mai 2024, p.10.
[7] Cliquer sur le lien suivant pour accéder au fil du préfet, voir ici.
[8] « Arrêté n°2023-SG-1015 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit DOUJANI périmètre haut et bas, commune de MAMOUDZOU », Recueil des actes administratifs, Préfecture de Mayotte, voir ici.
[9] Depuis le début des opérations de destruction, avant même la loi Elan, aucun des terrains libérés n'a été aménagé, ils sont retournés à la végétation. Il serait intéressant d'organiser des circuits touristiques à l'intention des journalistes pour constater ce phénomène.
[10] Lire à ce sujet mon précédent billet de blog : « Épilogue d'une revendication raciste : le démantèlement d'un camp de migrants », voir ici. L'histoire de ce campement a été relatée dans mes « Chroniques de l'inhospitalité » et dans divers billets antérieurs.
[11] « Le camp de migrants installé au stade de Cavani sera démantelé annonce ce mercredi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. » Mayotte la 1ère, le 18 janvier 2024, lien ici.
[12] « L'État « déterminé » à évacuer le camp de migrants de Cavani, à Mayotte, assure Gabriel Attal », Mayotte la 1ère, le 24 janvier 2024, lien ici.
[13] Jérome Talpin, « Migrants africains à Mayotte : l'Etat face à la pression des collectifs de citoyens ». Le Monde, 30 avril 2024, voir ici.
[14] CADEMA : Communauté d'agglomération Dembeni, Mamoudzou,
Daniel Gros
Ancien Cpe du Lycée de Mamoudzou. Référent de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte.
https://blogs.mediapart.fr/daniel-gros/blog/060524/mayotte-place-nette-vers-un-monde-inhabitable
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« VEYE YO ! PINGA ! » – Déclaration de la diaspora haïtienne

Le Conseil présidentiel de transition (CPT) a été installé le jeudi 25 avril dernier. Nous publions ci-dessous la Déclaration de la diaspora haïtienne de Miami, New York et Montréal, suivi de la Déclaration de la Coalition haïtienne du Canada contre la dictature en Haïti comme contribution collective aux échanges avec les groupes de Miami et New York.
Tiré du Journal des Alternatives
https://alter.quebec/veye-yo-pinga-declaration-de-la-diaspora-haitienne/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Des-nouvelles-de-votre-plateforme-altermondialiste-preferee-
Par Coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti (CHCCD) -6 mai 2024
« Surveillez-les, arrêtez-les, il y a une loi pour ça ». Aujourd'hui, alors que le Conseil présidentiel de transition prend le pouvoir, il est crucial de rester vigilants !
Le peuple haïtien endure d'énormes souffrances. Nous refusons de retomber dans les mêmes erreurs qui ont causé notre situation actuelle. Les gangs continuent de semer la terreur en tuant, torturant, chassant les gens de chez eux, détruisant les hôpitaux, les universités, les commissariats de police, et bloquant les routes. Ils ont pris en otage l'État. La pauvreté et la faim se répandent. Notre capitale dépérit. Notre pays est en danger d'extinction.
Quand Dessalines parlait de « couper la tête, brûler la maison », il ne visait pas les maisons malheureuses, mais plutôt les misérables qui luttaient pour leur survie.
Durant ces trois dernières années, plusieurs organisations civiles représentatives du pays se sont réunies sous la bannière du groupe Montana pour proposer un changement radical s'opposant au régime PHTK. Ce régime qui, depuis 2010, a conduit le peuple vers la ruine, la mort, la corruption et l'impunité.
Le groupe Montana a fait de nombreuses propositions concernant la sécurité publique, la justice, la participation citoyenne et la décentralisation. Ces propositions ont servi de base à un accord politique facilitant la création d'un Conseil présidentiel transitoire pour promouvoir le changement.
Ce n'est pas toutes les propositions du Montana qui se retrouvent dans cet accord politique, mais ce groupe a compris qu'un COMPROMIS est nécessaire pour freiner cette machine de la mort et rétablir d'autres règles dans le jeu politique.
C'est une étape importante. À cet égard, nous saluons tous les participants ainsi que le CARICOM (Caribbean Community) qui ont rendu cet accord possible. Cependant, le peuple haïtien a beaucoup trop souffert pour que nous acceptions de jouer à ce jeu malicieux, et nous refusons que des acteurs peu crédibles soient une fois de plus au centre des affaires.
Le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henri, qui est directement responsable de cette situation chaotique, a publié un décret formant le Conseil présidentiel de transition, en modifiant des détails importants de l'accord qu'ils avaient eux-mêmes signé.
NOUS EXIGEONS LA PUBLICATION DU TEXTE AUTHENTIQUE SANS AUCUNE MODIFICATION
Le gouvernement démissionnaire n'a aucun droit de modifier quoi que ce soit dans cet accord.
Nous estimons que le gouvernement de facto n'a aucune légitimité pour enseigner la Constitution aux citoyens. De même, nous pensons que ceux qui ont contribué à plonger le pays dans son état actuel ne peuvent pas prétendre être ceux qui le dirigent.
REGARDEZ-LES ! DÉMASQUEZ-LES ! Le peuple haïtien a trop souffert pour que nous tolérions un retour au même jeu corrompu où le pouvoir est détenu au bénéfice personnel, utilisant des gangs pour empêcher les gens de questionner l'origine de l'argent de Petro Caribbean.
L'Accord du Montana repose sur un ensemble de valeurs éthiques non négociables. C'est un document respecté nationalement et internationalement.
Ces valeurs doivent guider le conseil présidentiel de transition, tout en respectant la loi et la constitution de notre pays. En élisant les candidats du Montana au Conseil de transition, ces valeurs démontrent comment des élections transparentes peuvent se dérouler et également comment des Haïtiens de divers horizons peuvent s'asseoir ensemble, discuter et parvenir à un consensus en plaçant les intérêts nationaux au-dessus des intérêts personnels. C'est donc une source d'exaspération dans notre système actuel.
Nous, de la diaspora, soutenant l'accord du Montana, luttons contre toutes les politiques destructrices qui minent les institutions du pays depuis quatorze ans. Nous dénonçons les manœuvres dilatoires qui maintiennent le pays sur le chemin chaotique sur lequel il est.
Nous avons le droit de participer aux décisions qui nous concernent, nous, le peuple haïtien.
Nous avons besoin de deux personnes responsables pour diriger la transition avec succès : un coordinateur du conseil présidentiel et un premier ministre.
NOUS AVONS BESOIN DE PATRIOTES qui croient en notre pays, qui sont qualifiés et honnêtes, pour nous aider à sortir de la crise de mort et de destruction que nous vivons actuellement.
Le peuple haïtien souffre énormément. Il y a de l'espoir de changement. Ne le gaspillons pas.
NOUS RESTERONS VIGILANTS !
Groupes au sein de la diaspora haïtienne de Miami, New York et du Canada
Initiative citoyenne à New York pour soutenir l'accord du Montana : Daniel Henrys Daniel Huttinot Julien Jumelle, Lionel Legros Michèle Montas
Comité de Solidarité et de Résistance du Peuple Haïtien à Miami : Hudes Desrameaux, Abel Simon Zéphir.
Coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti : Jean-Claude Icart Chantal Ismé, Richard Mathelier, Dominique Mathon, Walner Osna, Alain Saint-Victor.
La position de la Coalition haïtienne du Canada contre la dictature en Haïti
Nous, de la Coalition haïtienne du Canada contre la dictature en Haïti, signataires de l'Accord de Montana du 30 août 2021, sommes très préoccupés par la manière dont la communauté internationale impose ses propres règles du jeu aux acteurs haïtiens dans la mise en place d'une transition continue.
Nous sommes d'accord sur le principe de transition que l'accord du 30 août supportait. La transition radicale a une série de principes et de caractéristiques fondamentaux qui la caractérisent. Des principes comme la reconquête de la souveraineté du pays ne peuvent être négociés. Conserver la souveraineté, c'est abandonner toute forme d'occupation.
La CARICOM (Caribbean Community), qui est censée jouer un rôle intermédiaire, semble, par ses actions, être un acteur politique intéressé qui agit selon l'agenda des puissances qui dominent le pays, en collaboration avec les politiciens et les organisations politiques à l'intérieur du pays. Dans cette logique, l'occupation transnationale s'impose comme condition d'établissement de la transition. Cela ne correspond pas du tout à nos convictions et à nos principes.
Une transition radicale doit être claire du choix des personnes qui y participent. En ce sens, nous continuons de croire que le PHTK et ses alliés n'ont pas leur place dans un gouvernement de transition visant à retrouver la souveraineté du pays et à établir les conditions permettant au peuple haïtien de vivre dans la paix et la dignité. C'est ce régime qui nous a mis dans le bourbier dans lequel nous nous trouvons, dans le but de démanteler de fond en comble toutes les initiatives et mobilisations populaires du pays qui nécessitent un changement de système.
Le dicton populaire « Renverser le chaudron » exprime clairement la volonté et la détermination du peuple haïtien d'établir un autre modèle de société. Par conséquent, les personnes et les organisations des « bandits légaux » du PHTK et de ses alliés soutenus par la « communauté internationale » sont les responsables du chaos et de la situation terroriste d'aujourd'hui depuis plus d'une décennie. Le peuple haïtien dit c'est assez. Le PHTK et ses alliés sous la dictée du Core Group (États-Unis, France, Canada…) ne peuvent être a la base du chaos, des problèmes pour ensuite chercher les solutions. Ils mettent le feu et redeviennent pompiers.
Cela fait 13 ans que le régime PHTK est au pouvoir et bénéficie des bénédictions des pays du Core Group (en particulier les États-Unis, la France et le Canada), le peuple haïtien ne manque jamais une occasion de jeter ces gens à la poubelle de l'histoire pour les crimes financiers, les massacres, la corruption et toutes les mauvaises actions commises contre le peuple. Une transition radicale nécessite des personnes et des organisations crédibles, qui ne sont impliqués dans aucune mauvaise action, drogue, délits financiers, enlèvements, meurtres ; des personnes qui n'ont jamais été condamnées par la justice nationale ou internationale.
Une transition radicale doit avoir des gens qui ne sont soumis à aucune sanction nationale ou internationale, des gens qui n'ont jamais lié leurs saucisses au régime criminel du PHTK et qui n'ont jamais servi les intérêts des pays étrangers. Cela signifie que cette transition n'a besoin que de personnes et d'organisations intégrées, crédibles, honnêtes, patriotiques, fortes, compétentes et qui feront passer les intérêts d'Haïti avant tout. En ce sens, nous sommes très préoccupés par la présence du Montana dans le collège présidentiel de la CARICOM, car l'initiative de la CARICOM ne répond à aucune démarche vraiment radicale. À notre avis, l'objectif est de mettre fin à toutes les initiatives haïtiennes pour que le pays accède à sa propre souveraineté et d'empêcher Haïti d'apporter une solution haïtienne à la crise créée dans le pays.
Nous constatons que toutes les manigances que la CARICOM exécute au nom de ses employeurs sont contraires à tous les principes fondamentaux de la transition. Tout ce qui se passe ici répond aux objectifs des pays opprimant Haïti de renouveler et renforcer le régime du PHTK et ses alliés qui répondent comme des proxénètes aux projets des pays dominants Haïti. De plus, c'est une astuce pour maintenir et renforcer la dépendance et la domination du pays. Accepter cela, c'est vendre le droit souverain du pays.
Comme Montana l'a dit dans son programme initial, Haïti a besoin d'une transition radicale venant des Haïtiens. C'est une transition qui doit au moins créer les conditions pour dé-ghoster le pays dans toutes ses coutures (notamment économiques et politiques), rapatrier la souveraineté du pays en organisant de véritables élections sans dictature étrangère ni oligarchie locale. Toutes les transitions doivent être claires pour le peuple haïtien à partir du choix des personnes et des organisations qui y participent.
Cette transition doit créer les conditions permettant aux gens de vivre en paix, dans la dignité et poser les bases pour que les gens vivent comme les gens, les bases pour que les citoyens voient et fassent la politique d'une manière différente dans le pays et créent les conditions des procès à mener sur tous les crimes financiers et le massacre contre le peuple haïtien.
Toutes les démarches de la CARICOM sont contraires à ce projet. Et en ce sens, nous pensons que l'accord du 30 Aout doit lancer un processus de communication permanent pour expliquer à toutes les organisations signataires et au peuple haïtien en général ce qui se passe.
Quand on constate que ce qui se fait est contraire au projet de transition radicale, cela nous inquiète beaucoup. Tôt ou tard, et c'est encore plus triste, nous continuons de croire qu'à la croisée des chemins où nous nous trouvons, tous les vrais patriotes et organisations progressistes ont la responsabilité historique et éthique de se rassembler et de s'unir dans un front uni pour empêcher le pays de tomber dans un piège qui renouvellera PHTK et ses alliés et démanteler toutes les initiatives démocratiques et populaires.
Nous devons unir nos forces comme des adultes pour faire aboutir le projet de transition. C'est un rendez-vous que nous avons avec l'histoire, réagissons maintenant et assumons notre responsabilité.
Haïti avant tout ! Vive Haïti souverain ! Vive la lutte du peuple haïtien ! Ceux qui combattent ne meurent pas !
Pour la Coalition
Alain Saint-Victor, Walner Osna.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine. Grève générale du 9 mai : « Non à l’austérité, non à la Ley Bases »

La grève du jeudi 9 mai doit être vigoureuse. Elle enverra un message au gouvernement et à ses associés, mais sera aussi un point d'appui pour enclencher une continuité le jour où la Loi fondamentale (Ley Bases) sera examinée au Sénat. Ce jour-là, la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) et la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) doivent appeler à une grève et à une mobilisation massives. Elle peut être gagnée. A bas la Ley Bases, la contre-réforme de la législation du travail, les privatisations, l'impôt sur les salaires, les attaques contre les retraites ainsi que l'éducation publique et les programmes sociaux.
Par le Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC | PTS-Partido de los Trabajadores Socialistas – FIT-U-Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad + indépendants)
8 mai 2024 | tiré du site alencontre .org
http://alencontre.org/ameriques/amelat/argentine/argentine-greve-generale-du-9-mai-non-a-lausterite-non-a-la-ley-bases.html
***
Les raisons ne manquent pas pour lancer une grève totale et puissante le 9 mai. Ils détruisent les salaires, les pensions et les programmes sociaux, les licenciements se multiplient ainsi que des hausses de tarifs, autrement dit le plan de Milei et du FMI est contre le peuple. En outre, les gouvernants viennent d'adopter au parlement, avec le PRO-Propuesta Republicana [de Mauricio Macri] et les blocs collaborationnistes (y compris des députés du Parti justicialiste-PJ, péroniste), la Ley Bases et le paquet budgétaire. Cela attribue des pouvoirs spéciaux au gouvernement de Milei. Ce dernier impose une réforme de la législation du travail qui nous rend plus flexibles et nous enlève plus de droits. Il élimine le moratoire sur la retraite en augmentant l'âge de la retraite pour les femmes. Il s'oppose à la souveraineté énergétique. Il permet la privatisation d'entreprises publiques comme Aerolíneas et Ferrocarriles, parmi d'autres. L'impôt sur les salaires est rétabli et le monotributo social [loi qui permet d'avoir accès à des œuvres sociales et à un système de retraites] est éliminé, tandis que les avantages sont accordés aux riches, avec le blanchiment de capitaux et les promotions économiques.
Tout cela s'est produit suite à la passivité des directions syndicales, qui n'ont pas appelé de suite à la mobilisation [une grève générale a eu lieu le 24 janvier, il a fallu attendre le 9 mai pour un deuxième appel des centrales syndicales à la grève]. Les députés d'Unión por la Patria [coalition péroniste] se sont limités à voter contre la Ley Bases, sans appeler à la mobilisation. Leur objectif politique est d'administrer le pays au service du FMI et des grandes entreprises, mais avec un peu plus de régulation étatique, comme nous l'avons vu lors du gouvernement précédent d'Alberto Fernandez [décembre 2019-décembre 2023]. Ils ne veulent pas mettre en échec, par l'action des travailleurs et travailleuses, l'ensemble du plan de Milei.
Depuis le Frente de Izquierda, nous nous battons au Congrès avec nos députés, mais aussi dans la rue avec les assemblées de quartier, les organisations sociales et les syndicats. Nous avons des propositions pour mettre en échec les mesures d'austérité et ces lois.
Tout d'abord, la grève du 9 mai doit être totale et puissante. Pour cela, la grève des transports est essentielle, y compris l'UTA [Union Tanviarios Automotor, qui représente tous les travailleurs des transports publics de l'Argentine]. Sans cela, les patrons écraseront des millions de travailleurs et travailleuses, en particulier celles et ceux précaires et informels. La direction du syndicat UTA a assuré qu'elle adhérerait à la grève [1], mais nous savons qu'elle a souvent pas tenu ses engagements. C'est pourquoi la CGT doit garantir que toutes les lignes de transport se joignent à la mesure.
Deuxièmement, si la grève a cette force vitale et cette vigueur, nous serons mieux à même de lui donner une continuité jusqu'à ce que toutes les mesures du gouvernement soient annulées. C'est pourquoi nous appelons la CGT, le CTA et tous les syndicats à une grève générale et à une mobilisation lors de l'examen de la loi organique et budgétaire (Ley Bases y Fiscal) au Sénat, pour descendre dans la rue comme nous l'avons fait pour la défense de l'enseignement public. Le 23 avril, lors de la grève des syndicats de l'université et de l'éducation publique, nous étions un million dans les rues [voir sur ce site l'article publié le 24 avril].
Dans ce but, nous avons besoin d'organiser des assemblées sur tous les lieux de travail afin de discuter ensemble de la manière de gagner ce combat. La colère est là. Mais nous devons transformer cette force en un mouvement. C'est nous qui faisons bouger le pays. Et c'est nous qui pouvons préparer la grève générale qui nous permettra de mettre en échec tout le plan de Milei, du FMI et des grandes entreprises afin de faire avancer une solution ouvrière et populaire.
Nous vous invitons à vous joindre à cette revendication et à promouvoir la pétition que nous diffusons dans les syndicats et sur les lieux de travail : « Depuis la base, nous exigeons : Grève et mobilisation face au Congrès le jour où la Ley Bases y Fiscal est examinée au Sénat ! » (Article publié par La Izquierdia Diario le 7 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine : Deuxième grève générale en cinq mois

L'Argentine vient de connaître sa deuxième grève nationale en cinq mois. Comme d'habitude, les bilans de la CGT et du gouvernement national sont différents. Pour la fédération des travailleurs, la grève a été énergique et a envoyé un message : cela ne peut pas continuer. Pour le gouvernement, la grève n'a pas atteint la dimension attendue et ne modifie en rien l'agenda et le cours général déjà esquissés.
11 mai 2024 | tiré de Viento sur
Une frappe à fort impact
Dans les médias officiels, il y a beaucoup d'arguments qui prétendent que la grève a été facilitée par le manque de transports, comme si les conducteurs de train, ceux qui conduisent des bus de moyenne et longue distance ou le personnel aéronautique ne faisaient pas partie de la classe ouvrière et que leurs syndicats n'adhéraient pas à la CGT ou aux centres alternatifs. Ils ont également appelé à la grève. Pour diminuer la dimension de la mesure de force, ils prétendent que certains magasins étaient ouverts (en fait, en particulier ceux qui vendent des produits anciens et certains supermarchés), mais ils ne disent rien que les quelques bus qui circulaient étaient presque vides et que les places et les parcs étaient remplis de familles entières comme s'il s'agissait de vacances.
L'appel de la CGT à une grève nationale s'est fait sans mobilisation, ce que l'on appelle habituellement ici une grève dominicale ; Cependant, dans de nombreuses villes de l'intérieur du pays, il y a eu des mobilisations, y compris des blocages de rues et de routes, que le gouvernement fait semblant d'ignorer.
La réalité indéniable est que les usines, les banques et les institutions financières, les écoles et les universités, de nombreux magasins, les différents moyens de transport ont été fermés ou n'ont pas fonctionné pendant 24 heures. Contradictoirement, le gouvernement a calculé que la grève a coûté 500 millions de dollars au pays, un calcul difficile à vérifier, comme beaucoup de données officielles, mais qui implique une reconnaissance implicite de ceux qui créent la richesse du pays que d'autres s'approprient.
Un nouveau lien
Le gouvernement insiste sur le fait qu'il n'y a pas de raisons à la grève, qu'il s'agit des intérêts personnels d'une direction syndicale très discréditée aux yeux de la société. Il y a un certain degré de vérité là-dedans, mais ce n'est pas une explication suffisante.
Pour l'instant, cette mesure de force est un nouveau maillon d'une chaîne de marches et de rassemblements, alors qu'en même temps il y a de multiples conflits syndicaux. Les rassemblements du 8M, Journée de la femme, et du 24M, l'anniversaire du coup d'État de 1976, ont été massifs, dépassant ceux des années précédentes, à la fois en nombre et en définitions politiques, mais ce sont des dates déjà inscrites dans l'agenda populaire. Au contraire, la manifestation 23A pour la défense des universités publiques et de l'éducation a été un événement politique majeur qui a pris le gouvernement par surprise. Deux mobilisations ouvrières complètent cette séquence. Le 24E, le syndicat a appelé à une grève nationale avec mobilisation. Une action inédite en raison de l'ampleur de l'appel (les deux CTA, les mouvements de défense des droits de l'homme, les mouvements de femmes, les écologistes, les minorités sexuelles et le retour des assemblées de quartier). Alors que le 1er mai, une foule de travailleurs a appelé, on estime que plus de 300 000 d'entre eux étaient présents, avec un document totalement critique à l'égard du gouvernement et ratifiant la deuxième grève nationale qui a eu lieu le 9 de ce mois. Tout cela en seulement quatre mois.
Les raisons de la grève
Avec les données officielles connues à ce jour, presque tous les analystes économiques n'hésitent pas à affirmer que la consommation a fortement chuté, que les dépenses publiques ont subi une réduction caractéristique sans précédent, que l'investissement est quasi nul pour l'instant et que les exportations sont dans l'attente d'une amélioration du taux de change ou d'une hausse des prix internationaux.
L'empressement du gouvernement à atteindre le déficit zéro signifie que depuis le 10 décembre, il n'a pas émis un seul peso ; Le résultat n'est autre qu'une récession, dont la profondeur et la portée sont plus grandes que ce que le gouvernement lui-même avait prévu, que de nombreux hommes d'affaires craignent de transformer en dépression.
La baisse des salaires réels, des retraites et des pensions, des programmes de protection sociale et des travaux publics est corrélée à la récession et à la perte d'emplois. Les dossiers du Secrétariat national du travail montrent une augmentation des demandes d'adhésion des entreprises aux procédures préventives de crise, un mécanisme installé à l'époque du ménémisme qui permet aux employeurs de suspendre ou de licencier des travailleurs sans coûts majeurs.
Tout cela est le produit de l'ajustement en cours, le plus grand de l'humanité selon le président Milei lui-même ; mais le projet de la LLA [La Libertad Avanza, le parti au pouvoir] va beaucoup plus loin. Elle implique une reformulation complète du pays en termes économiques, sociaux et politiques, ce qui implique un changement fort des rapports sociaux en faveur du capital.
C'est ce qui est implicite dans la Loi fondamentale et le paquet financier qui ont déjà la moitié de l'approbation des députés et qui sont maintenant discutés au Sénat. Bien que ces factures aient été réduites, elles maintiennent l'essentiel comme un régime plus que généreux d'incitations à l'investissement, une réforme de la loi sur les hydrocarbures adaptée aux compagnies pétrolières, une flexibilité du travail qui limite les compensations et légalise la fraude au travail, une réduction de l'impôt sur la fortune et un nouveau blanchiment plus permissif que les précédents. Avec la privatisation d'une douzaine d'entreprises publiques, ce ne sont là que quelques-uns des points qu'ils contiennent, qui, comme vous pouvez le constater, ne sont pas en faveur des travailleurs.
L'objectif n'est autre que de fournir un cadre juridique à ce que sont les exigences historiques des grandes entreprises. C'est l'explication de la raison pour laquelle le bloc des classes dirigeantes soutient ce gouvernement sans faille.
Il est à noter que des événements politiques de l'ampleur que nous traversons sont des signaux d'alarme pour le gouvernement, mais qu'ils ne l'amènent pas à modifier son agenda. Ils ne le font pas parce que le gouvernement n'a pas de plan B. À moins de petites concessions, il ne peut plus concéder au risque de mettre en péril son programme de grande envergure et de perdre le soutien des classes dominantes, de sorte que la confrontation avec les confédérations syndicales et le mouvement populaire se poursuivra jusqu'à ce qu'ils soient résolus en faveur de l'un ou de l'autre.
Ces faits n'ont pas pu être capitalisés par l'opposition jusqu'à présent. Cette absence d'alternatives politiques permet de maintenir des attentes pour l'avenir qui nourrissent l'adhésion au gouvernement, qui semble encore élevée.
C'est aussi l'explication de la raison pour laquelle cette grève nationale énergique est un nouveau maillon de la chaîne des mobilisations, mais pas le dernier. Le fait est que de plus en plus de secteurs de la société, à commencer par les syndicats, se rendent compte que le projet Milei implique une subordination totale au capital international, financier et extractiviste, réduisant le poids de l'industrie manufacturière et transformant le pays en une simple enclave d'exportation. Un pays soumis à la loi du profit, où la concurrence et l'individualisme seront dominants puisque le marché sera la mesure de la valeur de toutes les valeurs, un pays où les inégalités seront plus grandes qu'elles ne le sont actuellement.
Les grèves de la CGT et des autres confédérations peuvent servir de plate-forme pour forger les alliances tactiques nécessaires pour changer le rapport de forces en faveur des travailleurs. Et en cela, la gauche anticapitaliste est obligée de jouer un rôle décisif. C'est l'avenir de la nation et des classes subalternes qui est en jeu.
10/05/2024
Eduardo Lucita,
du collectif EDI – Économistes de gauche
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Brésil : Une tragédie historique et l’urgence de nouvelles perspectives

La catastrophe environnementale qui frappe le Rio Grande do Sul exige une solidarité immédiate et des mesures structurelles pour éviter qu'elle ne se reproduise.
Tiré de Inprecor 720 - mai 2024
6 mai 2024
Par Roberto Robaina
Le Rio Grande do Sul vit la pire catastrophe environnementale de son histoire. Des dizaines de morts, des centaines de milliers de personnes luttant pour leurs conditions de vie, des déplacés, les quartiers les plus pauvres et les plus vulnérables sous les eaux.
Il faut renforcer la solidarité immédiate et la combiner avec la nécessaire mobilisation de la société autour d'une « nouvelle normalité » résultant du réchauffement climatique et de la dévastation de l'environnement. Une lutte contre le négationnisme climatique et contre les réformes néolibérales, qui réduisent les investissements sociaux destinés à défendre les populations les plus vulnérables.
Le modèle de développement basé sur la production de gaz à effet de serre est protégé et stimulé par l'agro-industrie, avec l'élevage extensif, la monoculture du soja et d'autres formes d'extractivisme prédateur. La destruction des biomes, des rivières et des forêts entraîne une dégradation de l'environnement. Il s'agit d'un problème concret, dont la facture est toujours payée par les plus pauvres.
Les tragédies du mois de mai ne sont qu'un nouveau chapitre. Le Rio Grande do Sul a connu ces derniers mois une série de catastrophes faisant des centaines de morts, comme celle de la vallée de Taquari en 2023 ou celle qui a frappé Porto Alegre pendant une semaine au début de l'année.
La ligne de l'extrême droite est évidemment négationniste sur le plan idéologique, mais elle a des implications politiques très concrètes. La politique de dérégulation de la législation environnementale et le lobby de l'agro-business rural ne font qu'aggraver les catastrophes environnementales, présentes ou à venir. La droite de São Paulo, par exemple, continue de s'appuyer sur le négationnisme pour privatiser un bien aussi précieux que l'eau, avec les négociations pour la vente de la SABESP au sein du conseil municipal de São Paulo. Et cette même bourgeoisie est incapable d'affronter les catastrophes lorsqu'elles se présentent.
Il faut agir maintenant pour sauver des vies et éviter que le peuple ne paie la facture
Des mesures urgentes s'imposent, un effort déterminé de solidarité active, avec plus de dons et la collecte de fournitures de première nécessité, de nourriture et de médicaments aux sièges des syndicats, des organisations de la société civile, des associations et des mouvements sociaux.
En outre, des actions sont nécessaires, qui vont de garantir immédiatement des conditions de base pour les personnes touchées – comme la suspension des factures d'électricité et d'eau pour les sans-abris, un plan d'installation et de logement d'urgence, des fonds pour la reconstruction de la logistique et des infrastructures, à un plan efficace de prévention des catastrophes. Dans le cadre du plan d'urgence, le pouvoir public a réquisitionné des embarcations, comme les motos aquatiques, les barques et les bateaux pour participer à l'effort de mobilisation.
Lula, Lira, Pacheco et les ministres ont rencontré Eduardo Leite dans le Rio Grande do Sul pour discuter des mesures budgétaires urgentes. Ce ne sont pas les pauvres qui doivent payer la facture de la tragédie, mais les riches, en mettant fin à l'ajustement fiscal et au plafond de dépenses prévus dans le cadre budgétaire. L'imposition des grandes fortunes pourrait être d'un grand secours.
Au delà de la solidarité – et nous demandons à tous nos lecteurs de participer à la campagne ci-dessous –, nous devons réfléchir à deux tâches supplémentaires. Nous avons besoin d'un nouveau modèle qui corresponde, malheureusement, à « la nouvelle normalité », avec une synthèse des propositions dans les domaines politique, social et économique. Comme le proposent déjà nos parlementaires, nous demandons des mesures qui exigent la suspension du paiement de la dette de l'État afin que ces ressources puissent être affectées à un plan de reconstruction, basé sur la petite propriété, l'agriculture familiale, une vaste réforme urbaine et la puissance publique comme garante des conditions de vie de la majorité.
La seconde est de renforcer – contre les négationnistes et les néolibéraux – la conscience que la réponse à la crise environnementale est une urgence et ne peut être répondue qu'en unissant la classe ouvrière et la jeunesse pour gagner une majorité sociale au service d'un autre projet, radical pour changer les couches les plus profondes du capitalisme néolibéral actuel, l'indéniable responsable de la catastrophe en cours.
Soutenez la campagne de solidarité avec les victimes des inondations dans le Rio Grande do Sul
Clé Pix : emancipamulher@gmail.com (au nom de Carla Zanella)
Point de collecte : Av. Senador Salgado Filho, 353, de 9h à 17h, à la permanence de la députée Luciana Genro et du conseiller Roberto Robaina (PSOL)
Le 5 mai 2024, publié par la revue Movimento, traduit par Luc Mineto.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux Etats-Unis, la remise des diplômes ne couvre pas la voix des étudiantEs mobilisés pour la Palestine

Au milieu d'attaques violentes, les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent et perturbent les cérémonies de remise des diplômes.
Hebdo L'Anticapitaliste - 707 (09/05/2024)
Par Dan La Botz
Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université du Michigan, le 4 mai, par une belle journée de printemps, 62 000 personnes, amiEs et membres de la famille, se sont rassemblées pour assister à la remise des diplômes à 8 500 étudiantEs de premier cycle et 6 622 diplôméEs. Au début de la cérémonie, une cinquantaine de diplôméEs, portant des keffiehs et des drapeaux palestiniens, ont scandé : « Publiez, désinvestissez ! Nous ne nous arrêterons pas, nous ne nous reposerons pas. »
De nombreuses remises de diplômes ne se dérouleront pas normalement cette année. À l'université de l'Indiana, certains étudiantEs ont quitté la cérémonie. L'université de Californie du Sud a déplacé sa cérémonie de remise des diplômes hors du campus, au Los Angeles Memorial Coliseum. D'autres manifestations de diplôméEs sont attendues ce mois-ci.
Le mouvement des campus s'étend
Au cours de la semaine écoulée, le mouvement de soutien à la Palestine s'est étendu à 43 campus universitaires dans 25 États. C'est la plus important mobilisation de ce type depuis des décennies. Ces manifestations, souvent initiées par des étudiantEs palestiniens, ont été soutenues par des juifs progressistes et bien d'autres.
Sur la plupart des campus, les étudiantEs demandent à leurs universités de désinvestir les entreprises israéliennes, en particulier celles qui produisent du matériel militaire, de rompre les liens avec les institutions israéliennes et de soutenir un cessez-le-feu. Ils ont installé des campements appelant à la solidarité avec la Palestine et, dans l'ensemble, leurs manifestations ont été pacifiques, n'ont pas perturbé la routine du campus et n'ont pas menacé les autres étudiantEs. Bien qu'antisionistes, ces actions n'étaient pas antisémites, même si certaines interventions ont pu apparaître ambiguës voire relever d'un certain antisémitisme.
De nombreux administrateurs d'université, sous la pression des politiciens et de leurs donateurs, ont fait appel à la police, ce qui a conduit à quelque 2 300 arrestations dans tout le pays. À l'université de Columbia, où le mouvement a commencé, 112 personnes ont été arrêtées ; à l'université du Texas à Austin, 135 ; à l'université de l'État de New York à New Paltz, 130 ; à l'université Washington à St. Louis, Missouri, 100 ; et à Northeastern, Boston, 98.
200 personnes arrêtées à UCLA
À l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), où des contre-manifestants violents ont attaqué le camp pro-palestinien, quelque 200 personnes ont été arrêtées. La mère d'un étudiant, qui s'était rendue à l'UCLA pour être avec son fils, a décrit la scène dans un courriel que nous avons reçu.
« La “contre-manifestation” était en fait un rassemblement commun de sionistes enragés et de suprémacistes blancs, au nombre de 2 000. Ensuite, pendant trois nuits, des bandes d'hommes sionistes et leurs alliés des Proud Boys (un groupe fasciste violent) ont attaqué les manifestants toute la nuit, avec de la musique à plein tube, des lumières éblouissantes, des crachats, des épithètes racistes et homophobes, des jets de morceaux de bois et de tuyaux métalliques, des jets de gaz et de bombes lacrymogènes. Les flics étaient là. Juste là. Et ils n'ont rien fait. Quelques dizaines de jeunes ont été hospitalisés. L'administration s'est servie de ces attaques comme d'une excuse pour évacuer le campement », a écrit la mère. « Je suis très fière de mes enfants et des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté et des 200 qui ont été arrêtées. Ce n'est pas fini. Palestine libre, libre ! »
Biden ne plie pas
Tous les administrateurs d'université n'ont pas fait appel à la police. Plusieurs d'entre eux ont déclaré que leur travail consistait à protéger la liberté d'expression et à maintenir un campus où elle pouvait avoir lieu. Ils ont négocié avec les étudiantEs, acceptant généralement que leurs revendications soient présentées au conseil d'administration de l'établissement, notamment à Vassar (New York), à l'université Brown (Rhode Island), à l'université Northwestern (Illinois), à l'Evergreen State College (Olympia, Washington), à l'université Rutgers (New Brunswick) (New Jersey) et à l'université du Minnesota (Minneapolis).
Le président Biden s'est prononcé sur les manifestations. « D'abord, il y a le droit à la liberté d'expression et celui de se rassembler pacifiquement et de faire entendre sa voix. Ensuite, il y a le respect de la loi. Les deux doivent être respectés. » Mais Biden a aussi déclaré que les manifestations ne changeront pas sa position.
Les étudiantEs affirment qu'ils poursuivront leurs mobilisations. Mais après la remise des diplômes, les campus se videront. Si le mouvement doit se poursuivre, les étudiantEs, désormais hors du campus, auront besoin de nouvelles stratégies.
Traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux États-Unis, les étudiants se soulèvent pour la Palestine

Depuis plusieurs jours, les étudiants occupent les campus des grandes universités étatsuniennes pour protester contre les crimes d'Israël à Gaza et contre la complicité de leur gouvernement. Enseignant à Washington dans l'une de ces facultés, l'écrivain Abdourahman A. Waberi est un témoin privilégié de cette mobilisation historique.
7 mai 2024 | tiré d'Afrique XXI | Photo : La statue de Georges Washington a été recouverte d'un keffieh et d'un drapeau palestinien par les étudiants de la GWU. DR
https://afriquexxi.info/Aux-Etats-Unis-les-etudiants-se-soulevent-pour-la-Palestine
« Quand votre maison brûle, vous n'attendez pas quelques années pour commencer à éteindre l'incendie », Greta Thunberg.
Tout a commencé par un courriel alarmiste envoyé à toute la communauté de George Washington University (GWU), à laquelle j'appartiens depuis le 1er janvier 2012, qui compte près de 30 000 personnes dont 26 000 étudiants. Fondée en 1821, notre université privée est la plus ancienne de Washington DC, c'est un fleuron qui rivalise aujourd'hui avec la cossue Georgetown University. Si on était à New York, on pourrait comparer la première à New York University (NYU) et la seconde à Columbia University, mais nous sommes à Washington DC, capitale du pays depuis 1800.
Bâtie sur un terrain marécageux offert par George Washington, le riche planteur et chef militaire devenu premier président des États-Unis, GWU possède un atout exceptionnel : sa position stratégique et son accès aux cercles du pouvoir. Son campus est au cœur du quartier historique de Foggy Bottom, soit à quelques rues de la Maison-Blanche. Des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont mitoyennes tandis que nombre de ministères comme le Département d'État, sis au Harry Truman Building, se trouvent à moins de deux kilomètres. C'est dire combien le quartier est sous haute surveillance de jour comme de nuit. Les véhicules de la police, les caravanes de convois officiels sont tellement familiers que les étudiants n'y font plus attention.
Cette effervescence paraît tout à fait normale dans beaucoup de quartiers washingtoniens. Là où j'habite à South Capitol Metro, je tombe sur la brigade canine le matin, mais pas le soir, quand je rentre chez moi. La circulation est fluide l'après-midi, les agents fédéraux quittent les bureaux du Capitole. Les plus jeunes montent les marches quatre à quatre. Les autres se laissent porter par l'escalator. Foggy Bottom Metro est le point de passage pour me rendre à mon bureau avant de rejoindre mes étudiants. Sur le chemin, un gobelet de café à la main, chacun vaque à ses occupations.
Ça y est, ils sont là !
Quand le courriel est arrivé, le jeudi 25 avril à 10 h 30, c'est son titre alarmant et équivoque qui a attiré mon attention. J'ai mis un petit moment avant de saisir la portée de son message. Les étrangers, plus généralement les gens peu familiers du langage bureaucratique, ont de quoi se creuser le ciboulot : « Campus Advisory : First Amendment Activity on Foggy Bottom Campus » (« Avis sur les campus : Activité relative au premier amendement sur le campus de Foggy Bottom »). Le muscle de cette phrase repose sur le segment « First Amendment Activity ». Il recouvre toute activité à caractère politique ou religieux, rassemblant des gens dans la rue. Les rassemblements, les pétitions, les distributions de tract ou les prises de parole sont des activités garanties par le fameux amendement.
Trois phrases plus tard, le style de l'auteur du courriel se fait plus limpide. Ce matin, des étudiants de GWU se sont rassemblés sur la place University Yard et y ont planté des tentes. Des agents de la police de l'université et des hauts responsables discutent avec les étudiants. Suit un rappel du protocole de sécurité et de la protection des biens. Ça y est, ils sont là !
Nous sommes le 25 avril au matin. Nul ne pouvait imaginer que quelques jours plus tard, Gilad Erlan, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, déclarerait devant l'Assemblée générale de l'ONU que le Hamas se cache dans les universités américaines : « Nous avons toujours su que le Hamas se cachait dans les écoles. Mais nous n'avions pas réalisé qu'il n'y avait pas que des écoles à Gaza. Il y a aussi Harvard, Columbia et de nombreuses universités d'élite ». Pareille déclaration pourrait faire rire aux éclats en temps normal. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Nous ne sommes plus en temps normal. Et pas seulement depuis le 7 octobre 2023, après que le Hamas a lancé ses horribles attaques sur le sol israélien.
Les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie ne connaissent depuis 1947 que l'occupation, les privations, les humiliations, la prison et la mort. Depuis sept mois, c'est la mort familière qui hante tous les Palestiniens de l'intérieur et de la diaspora, unis dans la même peur et la même angoisse. La mort, de nuit et en plein jour, à toute heure. La mort tombée du ciel, par bombardements sans trêve. Un génocide en direct. En son et en images. Un génocide payé en partie avec les milliards de dollars américains collectés par le fisc, dont une part provient des sommes reçues par les universités au titre des frais de scolarité. Des frais de scolarité astronomiques [plus de 60 000 dollars par an en règle générale, soit plus de 55 000 euros, NDLR] qui forcent les étudiants à s'endetter pour des décennies. Et ces derniers veulent mettre un terme au génocide.
« Always Historicize ! »
Tout cela n'a pas commencé hier mais en 1947. Et si on ne veut pas ajouter de l'incompréhension à la déroute intellectuelle et à la dérive génocidaire du gouvernement israélien, il faut remonter le temps, revenir aux enseignements tirés du passé et expliquer encore et encore - n'en déplaise aux Manuel Valls de toutes les contrées ! Il faut pour le dire avec les mots de Fredric Jameson, le plus célèbre des marxistes américains, professeur de littérature comparée à Duke qui a marqué des générations d'étudiants et d'enseignants : « Always Historicize ! » (« Toujours historiciser ! ») Mettre en ordre et en perspective avec les outils de la science historique.
Jameson outille son lecteur d'une grille qui permet de dénicher dans une figure deux réalités incommensurables, deux codes indépendants, deux pôles asymétriques. Ainsi, il faudrait tenir d'une main un livre d'histoire et de l'autre le journal sorti la veille. Les révoltes pacifiques des étudiants américains de ces dernières semaines s'expliquent par des facteurs historiques qui sont connus de tous les jeunes activistes d'aujourd'hui.
Les révoltes sont d'abord des occupations de bâtiments, de halls, de jardins, de parcs soustraits provisoirement à l'autorité de la présidence de l'université et déclarés « zones franches », « territoires libérés ». Les thèmes de l'occupation et de la libération constituent le fil directeur des récits en circulation sur tous les camps (le terme « encampment » est plus dynamique) qui ont fleuri sur les campus américains. Cette vague de campements propalestiniens n'est pas sans parenté, loin de là. Elle s'inscrit dans une longue tradition qui, pour rester dans les six dernières décennies, va des grandes manifestations pacifistes pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam de 1968, à l'onde de choc « Black Lives Matter » de 2013, en passant par le mouvement « Occupy » qui a démarré le 17 septembre 2011 dans le parc Zucotti tout en bas de Manhattan avec une poignée de personnes qui ne se connaissaient pas.
Un mouvement est né ce jour-là. Il a son slogan : « We Are the 99 % » (« Nous sommes les 99 % »). Il va se répercuter jusqu'à Oakland en Californie, faire pousser des campements devant les townhalls de bourgades improbables, infuser les consciences, puis disparaître pour laisser la place à une nouvelle vague animée par une nouvelle génération d'organizers - le terme d'organisateur fait pale figure, fomenteur est trop louche, praticien, suggérerait le camarade Lénine s'il était de ce monde. Il y a une ligne droite entre les révoltes d'hier et celle d'aujourd'hui.
Le cap de la boussole morale
Au-delà - peut-être même à cause - de son immense fortune, Columbia University (et son affilié le Barnard College) est resté un volcan actif. Si les revendications des étudiants de la décennie 1960 ont un écho mondial, celles des années 1980 n'étaient pas moins nobles. L'enjeu était immobilier et concernait des pans entiers de Harlem qui ont été vidés de leurs habitants noirs puis revendus avec une grosse plus-value. Ce phénomène appelé « gentrification » s'exportera facilement. En 1985, de nombreux étudiants vinrent aux secours des habitants expulsés de leur logement. La même année, les mêmes ou d'autres tenaient la dragée haute à l'administration en l'invitant à boycotter l'Afrique du Sud. Les massacres de Soweto avaient provoqué une vague d'indignation sans précédent. Quelques mois plus tard, l'université se décidait à couper ses liens avec le régime d'apartheid après des années d'atermoiements.
En 2024, les étudiants tissent les liens entre justice climatique, critique de l'institution carcérale, rejet de toute forme de racisme, combat pour la dignité des migrants et lutte pour l'autodétermination de la Palestine. À chaque crise, la part la plus progressiste du corps enseignant s'est levé pour défendre les libertés académiques et protéger les jeunes gens qui ne font que tester la portée de l'enseignement reçu. Et nous sommes, à l'heure où j'écris ces lignes, en cette 11e journée d'occupation, 460 professeurs et personnels à avoir signé la pétition intitulée « DMV Faculty for Academic Freedom » pour protéger les étudiants qui s'indignent devant le martyr de Gaza.
La lettre ouverte à l'adresse des présidents des universités de l'agglomération appelée DMV [1]
rappelle combien le sursaut de nos étudiants donne le cap de la boussole morale du moment, marqué par la campagne génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens à Gaza notamment, à travers des massacres, des destructions généralisées et d'autres actes susceptibles d'être condamnés par la Cour internationale de justice.
Les messages de ces étudiants sont basés sur une compréhension de notre bien-être collectif et, souvent, sur une objection de principe à ce qui l'entrave. En tant que professeurs, nous prenons au sérieux notre obligation de préparer nos étudiants au leadership, à la pensée critique, à la citoyenneté mondiale et à l'engagement politique dans une société de plus en plus divisée et inégalitaire. Le but d'une université est d'encourager par tous les moyens l'expression ouverte et libre de la parole afin de défendre les idéaux démocratiques d'une société. L'Université George-Washington, tout comme les universités du DMV et des États-Unis dans leur ensemble, échoueront dans leurs promesses et leurs engagements les plus fondamentaux si elles continuent à réprimer, arrêter, suspendre et étouffer la liberté d'expression et l'activité politique de leurs étudiants.
Le commissariat pour les brimades et les interrogations
Nous condamnons toute décision de GWU visant à interdire les rassemblements d'étudiants et à restreindre l'accès au campus. Nous ne tolérerons pas l'utilisation de présomptions infondées de sectarisme pour intimider, punir et faire taire nos étudiants. En tant qu'enseignants, nous ne tolérerons pas la criminalisation des manifestations pacifiques sur nos campus. Les étudiants qui participent aux manifestations aujourd'hui maintiennent et renforcent la fière tradition de protestation, de dissidence et de liberté d'expression si chère à George Washington et aux révolutionnaires d'illustre mémoire. Si l'administration actuelle choisit de leur faire obstacle, elle se placera du mauvais côté de l'Histoire. Tous nos étudiants sont membres du Consortium des universités de la région métropolitaine de Washington. Leur action collective est conforme à la mission du consortium qui consiste à défendre tous nos membres.
Nous appelons donc les conseils d'administration, les présidents et les administrations des collèges et universités du DMV et du pays dans son ensemble à s'engager à nouveau en faveur de la liberté d'enquête, d'expression et de mouvement sur les campus, qui sont les piliers de l'académie américaine depuis des décennies. Alors que les massacres de Palestiniens et les destructions généralisées se poursuivent à Gaza, les signataires de la pétition exigent également que l'administration assume sa responsabilité pour défendre les manifestants pacifiques, faire respecter la liberté académique et rejeter toutes les pressions visant à bloquer l'accès et à criminaliser les campements et les manifestations pacifiques.
Je me suis contenté de traduire de longs paragraphes de la pétition pour donner à voir les grandes lignes du plaidoyer et les points saillants du contexte historique. Le contenu de cette lettre n'est pas singulier, on le trouve peu ou prou dans la bouche des nombreuses personnalités qui ont soutenu la révolte des campus. La militante iconique, professeure émérite de UC Santa Cruz (Californie), Angela Davis, a affirmé son admiration, puis délivré le même message aux étudiants de Brown (dans la ville de Providence, État de Rhode Island), le 25 avril, quelques heures avant que l'étincelle allumée à Barnard et Columbia (New York) n'embrase la plaine des universités de la Côte Ouest, puis du reste du pays.
De facto, la situation s'est tendue sur les campus, à cause de la police ou des militants pro-Israël qui cherchent à provoquer des heurts ou lancer des attaques. À grand renforts, la police new-yorkaise a bouclé tout le quartier autour de Columbia le 31 avril en fin d'après-midi. À la tombée de la nuit, elle a brisé l'occupation pacifique du Hamilton Hall à Columbia, maltraité les étudiants et en a parqué plus d'une centaine dans des véhicules sous les cris et les pleurs de leurs camarades. Puis ce fut le commissariat pour les brimades et les interrogations. Cette nuit du 31 avril fut un choc national. Du côté des étudiants et dans une grande partie de l'opinion nationale, le maire de New York, Eric Adams, et la présidente de l'université, Minouche Shafek, ont été tenus pour responsables du fiasco. Pourtant, pas loin de là, à Brown, autre institution d'excellence, la principale revendication portant sur le désinvestissement et l'arrêt de toute relation avec l'État d'Israël a été actée après un vote et les étudiants ont levé le camp dans un climat euphorique. Preuve que la répression n'est pas la solution.
La mort d'Aaron Bushnell [2] et de Rachel Corrie [3] ne sera pas vaine.
La tête et le cœur entre Paris et Washington
Pour étouffer l'indignation et la colère estudiantines dans l'œuf, c'est au tour des grands médias et de l'élite politique de passer à l'attaque à coup de mensonges, de faits tronqués ou maquillés. Une vedette de CNN ment effrontément en opérant un numéro de jonglage destiné à faire passer des sbires pro-Israël qui ont attaqué les étudiants pour les victimes. Le président Joe Biden a condamné le climat de violence sur les campus, en considérant tout propos critique à l'encontre du régime de Benyamin Netanyahu comme un geste antisémite. Pour labourer le terrain de la criminalisation, une nouvelle loi (Antisemitism Awareness Act) est votée dans la foulée. Quiconque veut donner l'assaut final sur un campus au fin fond de la Géorgie n'aura plus qu'à évoquer des motifs de sécurité.
Le lendemain, le 1er mai, l'argument avancé par le maire de New York sur le thème usé de l'infiltration d'éléments extérieurs, fauteurs de troubles, s'est écroulé en direct quand l'édile a été incapable de produire une seule preuve (à part des livres et des chaînes de vélo présentées par la police comme étant des armes) ou de citer le nom ne serait-ce que d'un fauteur de troubles venu de l'extérieur. En France, on retrouve les mêmes raccourcis, les mêmes partis pris. La même chape de plomb, le même déni. L'occupation de Science Po à Paris enrage les « belles personnes ». Sur les plateaux, rares sont les témoins connaissant les campus américains comme Thomas Dodman, historien et professeur à Columbia. Son passage à l'émission C ce soir, le 2 mai, fut un petit moment miraculeux (voir ci-dessous). https://twitter.com/i/status/1786282040473899394
J'ai la tête et le cœur entre Paris et Washington. Comme tous les gens sensés, je fuis les grands médias étatsuniens et français. Je me pince à chaque fois que je tombe sur les têtes de gondole des talk-shows. Je préfère regarder le monde avec mes yeux.
Le droit à la beauté
Tous les deux jours, je rends visite au campement installé à U Yard. À cause de sa position stratégique, à quelques blocks de la Maison-Blanche, les étudiants pacifistes de l'agglomération ont prêté main forte aux nôtres, au nez et à la barbe de l'administration. Le campement attire les journalistes et les politiciens en mal de visibilité. Il faut préciser que le site est cogéré par une dizaine de collectifs provenant des universités locales (Georgetown, American, George Mason, Howard, Catholic, Gallaudet…) avec une efficacité et une harmonie tout simplement remarquables.
La première fois, j'y suis allé juste pour prendre la température et j'ai fini par suivre un concert de musique orientale d'honnête facture. J'y suis retourné le surlendemain et je suis tombé sur une fête grecque orthodoxe liée à Pâques. J'ai échangé avec un de mes meilleurs étudiants qui, sac de couchette sous le bras, m'a montré du doigt sa tente. J'ai pris quelques photos avant de partir. La troisième fois, je suis passé en coup de vent car il pleuvait dru. Le soir, j'ai écouté une petite vidéo où une étudiante de Gallaudet [4] s'exprimait par signes en mettant en avant l'inclusion et la lutte contre les discriminations.
La dernière fois, le 3 mai, j'ai trouvé le campement plus grand, plus ordonné et plus beau. Les allées étaient balayées, dégagées et décorées. Le fameux droit à la beauté si cher aux communards m'est revenu à l'esprit. Il faut lire La forme-Commune. La lutte comme manière d'habiter des excellentes éditions La Fabrique (2023). Son autrice Kristin Ross, professeure émérite de littérature comparée à NYU, a travaillé sur le présent de la Commune de Paris (1871) et sur la poésie d'Arthur Rimbaud tout en traduisant en anglais les ouvrages du philosophe français Jacques Rancière.
J'observe d'un œil les multiples activités militantes, créatives et spirituelles. Il fait beau. Des étudiants prennent le soleil, leur portable sur les genoux. Des stands proposent de la nourriture gratuite. Le stand des medics est calme et tant mieux. Des interviews ici et là. Les voitures de la police et les effectifs tout autour font partie du décor. À zigzaguer entre les tentes, je me fais cette réflexion : « Quel paisible tableau ! » On y prend goût ! Je ne trouve pas que la statue du président George Washington qui se trouve au milieu du camp a été des-sacrée comme disent les détracteurs. Les drapeaux palestiniens autour de sa tête et de son cou ne sont pas que des gestes symboliques, carnavalesques. Rien à voir avec un coup de savate ou un lancer de missile.
Avant de partir, j'ai envoyé un SMS enjoué à un ami en lui rappelant le titre du morceau légendaire qui a fait connaître le groupe de rap Public Enemy en 1988.
« Don't Believe The Hype ! » (« Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte ! »)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] istrict de Washington en symbiose avec une bonne part du Maryland et la frange septentrionale de la Virginie
[2] Vêtu de son uniforme militaire, ce jeune homme de 25 ans s'est immolé par le feu le 25 février 2024 devant l'ambassade d'Israël à Washington. Il voulait protester contre le soutien des États-Unis à Israël.
[3] Rachel Corrie (1979-2003), étudiante et activiste pacifiste étatsuninenne, a été écrasé par un bulldozer israélien alors qu'elle tentait de venir au secours d'une famille palestinienne expulsée lors de la deuxième Intifada. Son université, Evergreen State College, s'est engagée à cesser tout investissement et toute collaboration avec l'État israélien. Quantité de chansons, portraits, films, récits lui ont été dédiés.
[4] Institution semi-publique accueillant des étudiants sourds et malentendants.

États-Unis. Les étudiants bousculent la complicité des universités avec Israël

Du jamais-vu depuis les années 1970 : malgré les accusations d'antisémitisme et la répression, les étudiants américains se mobilisent en masse, y compris au sein de la communauté juive. Ils réclament notamment l'arrêt des financements de leurs universités par les marchands d'armes servant à massacrer les Palestiniens. Les manifestations sont si importantes que Joe Biden a dû menacer Tel-Aviv de suspendre certaines de ses livraisons d'armes.
Tiré d'Orient XXI.
Shany Littman, journaliste israélienne, s'inquiète : « Où sont les étudiants protestataires israéliens contre la guerre à Gaza ? » Alors que les campus américains s'enflamment, dans les universités israéliennes, c'est le « calme plat » (1). En période de préparation des examens, on ne quitte la bibliothèque que pour se sustenter à une terrasse au soleil. Les assassinats massifs de Gazaouis n'intéressent pas les étudiants. Enfin si, note-t-elle : depuis le 7 octobre, la seule manifestation sur un campus a été menée par Im Tirtzou (« si vous le voulez » en hébreu), un mouvement colonial venu exiger l'expulsion des universités de professeurs non conformes à ses vues, en particulier Nadera Shalhoub-Kevorkian, spécialiste des violences familiales et l'une des rares enseignantes palestiniennes de l'université de Jérusalem.
Constatant que les professeurs israéliens se soucient du risque croissant de boycott à leur encontre réclamé par les étudiants américains, Littman estime qu'ils feraient mieux de s'inquiéter de ce qui se passe à Gaza et de se mobiliser « comme à Columbia et à Yale ». Sinon, pourquoi l'académie « ne resterait-elle pas identifiée au gouvernement israélien et à ses politiques destructrices ? », s'interroge-t-elle.
Les grandes industries américaines
La mobilisation contre Israël sur les campus états-uniens est inédite depuis celle contre la guerre du Vietnam des années 1970 — à cette différence près qu'à l'époque, des jeunes américains étaient mobilisés et risquaient donc de rentrer morts ou blessés. Cette contestation surgit sur un fond strictement politique : comme l'écrivait il y a plus de vingt ans l'historien anglo-américain Tony Judt, Israël apparait aux manifestants étudiants comme « un anachronisme » (2), un État d'un autre temps, à la fois ethniciste et colonial, l'un des derniers de la planète. C'est pour ce motif qu'ils s'insurgent contre ce qu'il advient à Gaza.
Ceux qui manifestent exigent une « gestion éthique » des avoirs des universités, en particularité des plus riches. Ainsi, la dotation dont disposait Columbia en 2023 atteignait 13,64 milliards de dollars (12,66 milliards d'euros). Or une partie non négligeable de cet argent est investi dans des portefeuilles d'actions incluant des sociétés de fabrication d'armes et d'autres fournitures qui participent à la colonisation israélienne. Un financement qui a souvent pour contrepartie la présence des dirigeants d'entreprise dans les conseils d'administration des universités privées. Larry Fink, PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, siège à celui de l'Université de New York (NYU). Tout comme des dirigeants de sociétés d'armements dans de nombreuses universités.
Résultat : le 17 avril 2024, le comité consultatif de la responsabilité des investisseurs de Yale (ACIR) a annoncé qu'il ne recommanderait pas à ses administrateurs de se priver des fonds des fabricants d'armes américains parce que, selon lui, cette industrie n'a pas « atteint le seuil de ‘‘préjudice social grave”, condition préalable au désinvestissement ». À Gaza, a-t-il estimé, les armes fournies à Israël soutiennent « des utilisations socialement nécessaires, telles que l'application de la loi et la sécurité nationale » (3). Un cas parmi d'autres.
Le mouvement engagé concerne donc autant les grandes industries américaines que les universités. En premier lieu parce que les groupes du « secteur militaro-industriel », comme Boeing, Raytheon, Northrop Grumann, Lockheed Martin ou General Dynamics figurent parmi les grands donateurs des universités et les fournisseurs d'emplois de leurs laboratoires. Ces institutions académiques se trouvent ainsi directement intéressées à la poursuite de la livraison gratuite d'armes au pouvoir israélien (pour 4,2 milliards de dollars annuels, soit 3,89 milliards d'euros). L'un des premiers rassemblements étudiants en appui à la cause palestinienne qui a eu lieu le 22 avril à NYU s'est focalisé sur deux exigences : la rupture du rapport financier de l'université avec les fabricants d'armes utilisées par Israël à Gaza, et la fermeture de son campus ouvert à Tel-Aviv, en raison des liens avec la colonisation des territoires palestiniens.
Être « américains juifs » sans interférence d'Israël
Les références les plus souvent utilisées par les étudiants sont la ségrégation raciale aux États-Unis, abolie en 1965, la guerre du Vietnam, perdue en 1975, et l'apartheid sud-africain, aboli en 1990. Autant de situations où l'alliance du colonialisme et du suprémacisme racial a été vaincue. L'État d'Israël leur apparait comme une manifestation tardive, incongrue et inadmissible d'un suprémacisme ethnique là aussi ancré dans un colonialisme initial.
Ces manifestations s'insèrent dans un mouvement de distanciation de la jeunesse vis-à-vis de ce pays qui a commencé dès les années 2000, et dans lequel les jeunes juifs ont joué un rôle important. Cette distanciation n'a fait que croître, le long de deux grandes lignes de force. L'une, politique et minoritaire, est radicalement hostile au caractère colonial de l'État israélien. L'autre, plus communautaire, souligne la volonté de vivre en tant qu'« Américains juifs », sans interférence d'Israël ni soumission à son égard. Les deux apparaissaient aux dirigeants de Tel-Aviv comme une menace pour le sionisme, qui a toujours ambitionné d'être l'unique représentant de la totalité des juifs du monde.
Le phénomène le plus marquant chez les jeunes juifs américains est l'accroissement exponentiel du nombre des adhérents aux organisations antisionistes ou non sionistes qu'a suscité la guerre à Gaza. Une association comme Jewish Voice for Peace, fondée en 1966 et antisioniste assumée, n'avait que très peu d'adhérents et une audience très limitée. La moyenne d'âge de ses adhérents était élevée. Depuis quelques années, elle a vu poindre de jeunes adhérents, et des milliers depuis la guerre à Gaza.
Le cas de la revue Jewish Currents est encore plus spectaculaire. La lettre hebdomadaire de son journal en ligne dirigé par Peter Beinart, un universitaire issu du sionisme qui a publiquement rompu avec cette idéologie en juillet 2020, disposait de 34 000 abonnés à l'automne dernier. En sept mois, leur nombre est passé à 300 000.
Beinart a publié le 28 avril un article en défense des étudiants américains. Son titre dit tout de son contenu : « Les manifestations sur les campus ne sont pas parfaites, mais nous en avons désespérément besoin » (4). Il y déplore l'ignorance ou l'outrance de certains manifestants qui s'aventurent sur des terrains fleurant l'antisémitisme, mais il dénonce la menace, beaucoup plus grave à ses yeux, des tentatives permanentes de réduire toute critique de la guerre menée par Israël à une résurgence de l'antisémitisme. Il note en particulier qu'elles émanent souvent de cercles juifs qui, par ailleurs, n'ont aucune réticence à s'acoquiner avec des suprémacistes blancs affichés. Ainsi Beinart écrit :
- Le cœur du mouvement en cours est l'exigence de mettre fin à la complicité de l'université et du gouvernement américain avec le système d'oppression d'Israël, qui aujourd'hui culmine dans cet effroyable carnage de la population de Gaza. Cette complicité doit cesser.
Hier hostiles, les médias évoluent
Dans la phase qui a suivi le massacre du 7 octobre 2023, la quasi-totalité des grands médias américains a basculé dans une rhétorique très favorable à la guerre. Pourtant depuis, certes à des degrés divers, leur regard a évolué au fil des crimes bien plus effroyables encore commis par l'armée israélienne. Lorsque le mouvement en défense des Palestiniens a pris son essor sur les campus, la réaction de ces mêmes médias, là encore, a été globalement très hostile. L'idée systématiquement promue par les partisans de Tel-Aviv selon laquelle les mobilisations étudiantes incarnent une poussée violente d'antisémitisme a été amplement relayée. Le simple usage du mot « intifada » en est devenu une preuve, par exemple.
Avec le temps, cet argumentaire s'est lentement désagrégé. Le vénérable magazine The New Republic (fondé en 1914) dénonçait récemment « une couverture honteuse par les médias des manifestations contre la guerre dans les universités » (5).
La répression de toute activité en solidarité avec les Palestiniens a commencé dès les lendemains des bombardements de Gaza, rappellent huit étudiants de la faculté de droit de l'université Yale (6) dans l'hebdomadaire The Nation. Ils affirment que plusieurs grands cabinets d'avocats américains ont exclu de leurs offres d'emploi les candidats ayant exprimé des vues pro-palestiniennes. À Berkeley, le recteur de la faculté de droit a voulu interdire tout débat public sur la question palestinienne tant que la totalité de son université n'aurait pas accepté la légitimité du projet politique sioniste. Dans des établissements de premier plan tels que Yale, Columbia, Brandeis, Rutgers ou Harvard, des mesures interdisant l'expression du soutien aux Palestiniens ont été imposées. À Columbia, le 9 novembre 2023, la participation de Jewish Voices for Peace et de l'association Students for Justice in Palestine a mené à l'annulation d'un débat. Ces interdits se sont multipliés. Les étudiants écrivent :
- Si la liberté d'expression doit avoir un sens sur les campus, elle doit inévitablement englober ce qui est controversé, inconfortable et dérangeant. Mais nous assistons à une micro gestion administrative de la liberté d'expression.
Le correspondant du quotidien britannique The Guardian a signalé le 10 mai que des chercheurs californiens ont constaté la présence parmi les agresseurs des étudiants manifestant en faveur du combat palestinien sur les campus de l'université de Californie, des militants notoirement connus comme des suprémacistes blancs.
Cependant, on assiste désormais à un net recul de la capacité des soutiens d'Israël à faire taire tout débat sur le sort de Gaza. L'argumentaire assimilant la défense de la cause palestinienne à une forme d'antisémitisme est de plus en plus inopérant, perçu comme une misérable feuille de vigne visant à masquer les crimes israéliens massifs en cours. D'ores et déjà, diverses universités ont passé des accords avec les manifestants afin d'autoriser leurs activités sur les campus.
Des « mesures légales en dehors de la loi »
Dans les années 2015-2019, Benyamin Nétanyahou avait créé un ministère des affaires stratégiques doté de moyens financiers conséquents, qui avait pour objectif quasi unique de combattre le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) sur les campus américains. Avec l'aide d'associations locales (souvent liées aux milieux coloniaux israéliens en Cisjordanie), ce ministère a mené la bataille. Elle s'est achevée par une débâcle. Au lieu de disparaître, BDS n'a fait que se renforcer. Aujourd'hui, son poids et celui d'une flopée d'associations estudiantines anticolonialistes — dont celles des étudiants juifs se réclamant de l'antisionisme, du post-sionisme ou de l'a-sionisme — ont crû de manière spectaculaire, tant en nombre d'adhérents que de campus touchés, passant en dix ans de quelques dizaines à plusieurs centaines actuellement.
Cette guerre contribue à accroitre fortement la critique et la prise de distance des milieux universitaires, tant à l'égard de la politique que du type d'État qu'Israël représente. Dernier exemple en date : le campement des scientifiques contre le génocide au Massachussetts Institute of Technology (MIT), le plus important institut de recherche scientifique des États-Unis, a demandé à son université de mettre un terme à l'investissement du ministère israélien de la défense (11 millions de dollars, soit 10,21 millions d'euros) dans ses « recherches liées à la guerre », arguant que l'institut « ne reçoit de financement d'aucune autre armée étrangère ». Le groupe rappelle que le MIT avait mis fin à sa collaboration universitaire avec un institut technologique russe juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
Que fait Nétanyahou pour combattre ce qu'il considère comme des « manifestations d'antisémitisme » ? Il constitue une équipe de travail (task force) dirigée par le ministre des affaires étrangères Eli Cohen, elle aussi dotée de moyens conséquents, pour mener un « plan d'action » de « lutte contre l'antisémitisme » sur les campus américains. On y retrouve les mêmes partenaires locaux qu'il y a dix ans, notamment Israel on Campus Coalition, Amcha, Canary Mission, The David Project et d'autres.
Selon ynetnews, le site d'informations du quotidien Yedioth Ahronoth, le plus diffusé en Israël, il s'agit de mener des « opérations politiques et psychologiques » pour « infliger des conséquences économiques et professionnelles aux étudiants antisémites et obliger les universités à les éloigner des campus ». Par « étudiants antisémites », il faut évidemment entendre hostiles à la politique coloniale israélienne.
Un chapitre intitulé « L'axe économique » expose les pressions financières permettant d'amener les responsables universitaires à résipiscence et à briser la carrière des étudiants ou des enseignants récalcitrants. Ce « plan d'action » est très similaire à celui qui a échoué en 2015-2019. Son avenir n'apparait pas plus prometteur. D'après ynetnews, il serait spécifié qu'il « ne doit pas porter la signature d'Israël », et évoque la nécessité de « prendre des mesures légales en dehors de la loi contre les activités et les organisations qui représentent une menace pour les étudiants juifs et israéliens sur les campus ». Le sens de l'expression « mesures légales en dehors de la loi » n'est pas explicité.
Apparaissant de plus en plus comme une tentative d'éluder le débat sur l'avenir de la Palestine, la répression du mouvement estudiantin a causé plus de dégâts que de bénéfices aux soutiens israéliens. Un sondage de la chaîne CNN du 27 avril indiquait que 81 % des Américains de moins de 35 ans désapprouvent la manière dont Joe Biden a soutenu la guerre contre Gaza. L'image de l'État d'Israël se ternit un peu plus chaque jour, aux États-Unis comme ailleurs. Le 7 mai 2024, dans le quotidien El País, l'Espagnole Diana Morant déclarait : « En tant que ministre des universités, je ne peux qu'exprimer ma fierté de voir les étudiants manifester leur pensée critique, l'exercer et la transmettre à la société . »
La journaliste israélienne Dahlia Scheindlin pose la question suivante en titre de son article dans le quotidien Haaretz, le 2 mai : « Israël devient désormais un État paria international. Les Israéliens s'en préoccupent-ils ? ».
Notes
1- Shany Littman, « Where are Israel's students protesters against the Gaza War ? », Haaretz, 2 mai 2024.
2- Tony Judt, « Israel : The Alternative », The New York Review of Books, 23 octobre 2003.
3- Columbia Law Students for Palestine, « From the Encampments : Student Reflections on protests for Palestine », LPE Project, 2 mai 2024.
4- Peter Beinart, « The campus protests aren't perfect. And we need them desperately », Jewish Prospects, 28 avril 2024.
5- Alex Shepard, « The Media's shameful coverage of the College antiwar protests », The New Republic, 30 avril 2024.
6- Alaa Hajyahia, « The Student Crackdown didn't start last week. Months of repression got us here », The Nation, 1er mai 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

JO 2024 : un rapt démocratique ? Entretien avec Jade Lindgaard

En juillet et août 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Derrière les discours célébrant cet événement, la réalité est beaucoup plus sombre. Qu'il s'agisse de l'incidence environnementale, sociale ou économique des Jeux, des voix tentent aujourd'hui de s'élever pour s'opposer ou alerter concernant leur tenue.
Tiré du site de la revue Contretemps.
L'ouvrage Paris 2024 – Une ville face à la violence olympique (Éditions Divergences), de la journaliste Jade Lindgaard, décrit les conséquences des JO sur le département de la Seine-Saint-Denis : derrière les discours promettant un rattrapage pour le département, ce sont des expulsions et destructions qui sont mises en œuvre. Cette contribution permet de tenter de susciter le débat, alors même que l'absence de délibération démocratique autour de l'accueil d'un tel événement rend complexe l'organisation de mobilisations d'ampleur.
Un entretien réalisé par Marion Beauvalet et Louis Hardy.

Contretemps – Dans La nature est un champ de bataille, Razmig Keucheyan mobilise le concept de racisme environnemental. L'organisation des Jeux a une incidence sur les villes (on peut par exemple penser à cet échangeur autoroutier à proximité d'une école à Saint-Denis) et les populations. Vous parlez quant à vous de brutalisme et d'injustice environnementale. Comment décrire ce qui se passe ?
Jade Lindgaard – L'organisation des Jeux de Paris, leurs répercussions sociales sur la région à la frontière entre Saint-Denis-Saint-Ouen et L'Île-Saint-Denis, et les conséquences probables sur la population après la fin des Jeux sont des enjeux majeurs. Ce qui se produit est assimilable à une forme de dépossession, une violence sociale, voire une violence olympique, comme dans le cas de l'école Anatole France (Saint-Denis) qui constitue un cas d'injustice environnementale. Il est encore trop tôt pour dire que c'est du racisme environnemental : il faut notamment attendre de connaître les personnes qui vont venir habiter à terme.
Depuis le début de mon enquête sur les aménagements du village des athlètes, j'avais en tête le racisme environnemental. Je remarquais les distinctions entre les habitants de ces quartiers en matière de statut socio-économique, la situation des personnes racisées, originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qu'elles soient françaises ou non. Dans ce mélange de résidents, qu'ils soient descendants de première ou deuxième génération d'immigrés ou nouveaux arrivants, je percevais une différence marquée avec les personnes représentées sur les publicités des promoteurs immobiliers pour le futur quartier, et avec le niveau économique requis pour acheter les appartements qui seront mis en vente.
En 1982, une église américaine (l'Église unie du Christ) a mené une enquête autogérée sur le racisme environnemental. C'était en quelque sorte la première grande enquête sur le racisme environnemental aux États-Unis, où une église, avec ses fidèles et un militant, a réalisé un vaste recensement des maladies dans les ghettos noirs de villes américaines. C'était un excellent exemple de la façon dont, même sans être des scientifiques ou sans disposer des ressources statistiques de l'État, on pouvait mettre en lumière un problème fondamental et systémique de racisme et de santé environnementale. Cela a permis d'établir un lien entre le fait de vivre dans un quartier noir d'une ville américaine et les occurrences de cancer, par exemple. J'avais cela en tête, et j'ai même envisagé, au début, de faire quelque chose de similaire pour le village des athlètes, en relevant entre autres les noms sur les boîtes aux lettres de certains immeubles du quartier. J'ai abandonné cette idée parce que je disposais de trop peu de temps. De plus, c'était une problématique bien trop importante pour risquer de la traiter de manière incorrecte.
C'est pourquoi je n'ai pas utilisé le concept de racisme environnemental. Je pense qu'il y a des indices qui montrent que c'est ce qui se passe. Pour pouvoir affirmer cela, il est néanmoins nécessaire d'avoir des éléments factuels et démontrés. J'ai donc préféré des termes plus généraux, comme le remplacement de population, la dépossession, la violence sociale, la violence symbolique. J'ai mentionné le remplacement de population, qui est déjà en soi un terme très fort. Je précise que sur les 1500 personnes qui ont été définitivement privées de leur lieu de vie en raison de l'organisation des JO, directement ou indirectement, la grande majorité d'entre elles est racisée. J'ai exposé ces éléments dans l'idée d'éventuellement contribuer à un travail ultérieur sur ce sujet. C'est une question suffisamment grave et sérieuse et elle doit être traitée de manière très factuelle.
Contretemps – Vous expliquez ne pas avoir commencé ce livre en étant hostile aux Jeux, vous expliquez aussi vous être mobilisé pour sauvegarder les jardins d'Aubervilliers en 2018. Quel a été votre cheminement dans votre rapport aux JO ?
Jade Lindgaard – Pour être honnête, avant de commencer à travailler sur les Jeux, je n'avais pas vraiment d'opinion tranchée. Je n'avais pas une vision particulièrement positive. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à propos des JO, bien que je les regarde en partie depuis mon enfance : sans passion, mais sans animosité non plus. Lorsque j'ai commencé à m'engager dans la défense des jardins ouvriers à Aubervilliers, lors des premières assemblées générales ou des premières réunions où certains s'exprimaient contre les JO, je n'étais pas en accord. Je me suis sentie déconnectée politiquement, avec un sentiment flou, distant par rapport aux Jeux. Ma perception de cette question s'est développée de manière progressive et empirique à mesure que j'approfondissais mes recherches et que je faisais face à leur organisation. Mon point de vue s'est construit avec ces deux casquettes, celle de journaliste enquêtrice sur la préparation des infrastructures olympiques et celle de l'habitante-militante défendant un jardin.
J'ai eu par la suite des interactions aussi différentes qu'instructives avec la sous-préfecture, la mairie, la police. J'ai été frappée par le caractère très vertical du processus qui, une fois lancé, refuse absolument de s'adapter, refuse le pas de côté, refuse la mise en suspens et ne laisse absolument aucune prise à la remise en question, même partielle, de ce qui s'organise. C'est précisément ce manque de remise en question qui m'a conduite à avoir une position beaucoup plus critique vis-à-vis du processus JO. Je dirais que la reconstitution de l'historique de la non-consultation des populations au moment de la candidature a posé les jalons de ma distanciation vis-à-vis du processus olympique, renforcée par la suite par la manière dont s'est mis en œuvre cet aménagement, avec le refus d'écouter les habitants qui proposaient des contre-projets, le refus de faire l'effort de s'adapter à ce que disaient les jardiniers et jardinières, quand ils tentaient de défendre leur jardin, un lieu de liens sociaux, de subsistance et de protection contre la canicule.
Le comité de vigilance JO 93 s'est constitué très tôt, non pas en opposition aux JO, mais en tant qu'observateur attentif. Il a plusieurs fois signalé que les aménagements envisagés pourraient avoir des conséquences négatives, ce qui a été pris en compte par le CIO, mais pas par les élus. Non seulement les habitants, comme le comité de vigilance JO 93, la FCPE ou un petit groupe de l'école Anatole France concernant la voie autoroutière A86, n'ont pas été écoutés par les élus. Mais pire encore, la situation donne l'impression qu'ils ont été traités comme des ennemis politiques, ce que je trouve très préoccupant.
Il y a eu un véritable détournement démocratique. Avant les Jeux, nous n'avons pas pu débattre, nous n'avons pas pu nous exprimer en tant qu'habitants pour décider si nous étions d'accord pour les accueillir. Je trouve frappante la différence entre les consultations citoyennes qui ont été organisées à Paris sur des questions telles que la tarification des parkings des SUV, ou sur le maintien des trottinettes électriques, des sujets concrets de transport quotidien, et l'absence de consultation sur l'organisation des JO de Paris 2024. Pour moi, il s'agit d'un détournement démocratique. Les gens ont été empêchés de se prononcer. Je ne sais pas quel aurait été le résultat. Dans d'autres grandes villes internationales où de telles consultations ont eu lieu, notamment par référendum, il est remarquable de voir que la réponse a toujours été négative.
Comme ce n'était pas le cas et pas non plus le sujet de la mobilisation des habitants, tout ceci est à garder en mémoire, si on veut tirer un bilan d'expérience politique de ce qui s'est passé avec les Jeux. Il faut qu'on garde en tête ce cheminement de la décision publique qui est imposée à des habitants, comme un critère de critique de ces grands projets d'aménagement, tous porteurs de nombreuses conséquences. Je pense que la faible mobilisation contre les JO est aussi la conséquence du fait qu'il n'y a pas eu de consultation au début. Le débat n'a jamais été construit. Les arguments tant en soutien qu'en opposition n'ont pas été posés clairement dans l'espace public. Cela s'en ressent jusqu'à aujourd'hui.
Contretemps – Dans votre introduction, vous présentez votre démarche et insistez sur le fait que votre livre n'est pas un livre contre les JO mais un récit d'élucidation et une enquête sur les injustices liées au JO. Comment expliquez-vous la nécessité de justifier sa démarche pour ne pas passer pour un militant anti-JO, la difficulté d'avoir un discours critique sur les JO, notamment à gauche, sans être perçu comme rabat-joie ?
Jade Lindgaard – C'est un des enjeux politiques majeurs de l'année 2024. Il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il semble nécessaire de préciser qu'on n'est pas opposé aux JO. C'est une question de sincérité par rapport à mon propre cheminement. De plus, je n'ai pas écrit un pamphlet, même si je reconnais que les pamphlets peuvent être très utiles parfois pour interpeller politiquement. Je voulais écrire une enquête, car je souhaitais produire quelque chose d'accessible à tous et à toutes et ouvrir la discussion à un public plus large, y compris à ceux qui soutiennent les Jeux, afin de les encourager à regarder au-delà des apparences et à examiner les coulisses de l'événement. C'était une démarche sincère et transparente, ainsi qu'une stratégie éditoriale. Cela me paraissait important de souligner cela, car l'espace public et médiatique actuel paraît encore assez homogène, avec peu de voix critiques. Même aujourd'hui, à l'approche des JO, les critiques sont rares et se concentrent sur des aspects très spécifiques.
Elles se manifestent, mais sur le principe même de ces Jeux, sur la manière dont ils ont été décidés et mis en œuvre, on entend très peu de choses. C'est une forme de verrouillage du débat public, mais pas imposé par le Comité International Olympique, ni par une dictature qui s'abattrait sur la France depuis le CIO. Je pense qu'il s'agit d'un verrouillage coconstruit. Les organisateurs des Jeux, le COJO, la SOLIDEO, la Direction Interministérielle des Sports, le ministère des Sports, Matignon, l'Elysée, tout un appareil d'État et politique, ont depuis des années investi politiquement dans l'événement pour le rayonnement de la France.
Il y a aussi l'attitude et le positionnement des élus de la Seine-Saint-Denis, que ce soit les mairies de Saint-Denis, Saint-Ouen, L'Île-Saint-Denis, ainsi que Plaine-Commune (l'établissement public territorial regroupant ces communes et le département). Ces élus, majoritairement de gauche, restent très favorables à l'organisation des Jeux, travaillant de concert avec les organisateurs. Cette alliance s'est formée autour de la promesse d'un héritage et surtout d'un rattrapage, car les investissements publics en Seine-Saint-Denis sont historiquement inférieurs à la moyenne nationale et à d'autres départements, notamment en ce qui concerne les services publics fondamentaux. Face à ce sous-investissement chronique, ces élus ont vu dans les Jeux l'occasion de compenser ces déficits en équipements vitaux pour la région. Cette perspective a été notamment portée par Patrick Braouezec, ancien maire de Saint-Denis et ancien président de Plaine Commune, qui a été un acteur majeur dans l'organisation des grands événements sportifs dans la région, et notamment dans la construction du Stade de France en 1998, considéré comme la première pierre de cet aménagement majeur de la plaine Saint-Denis et de la région environnante.
Cela a été la première pièce. À l'époque, le discours était très clair. En fait, le 93 a été abandonné. On construit ce grand stade qui sera regardé par des milliards de personnes dans le monde entier parce qu'il y a du football et une source d'admiration pour le département. Autour de ce stade, nous allons construire un quartier de bureaux pour stimuler l'activité. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur la plaine Saint-Denis. Lorsque vous sortez du RER La Plaine-Stade de France, vous voyez entre autres les sièges d'Orange, de SFR. Ce qui a été décidé ensuite pour le village olympique est la continuation de cela. D'ailleurs, cela a été explicitement assumé par Patrick Braouezec qui a parlé du deuxième étage de la fusée. Il s'agit de faire décoller le 93, avec une métaphore qui est assez brutale. Quand on pense à un décollage de fusée, la fusée va très haut, mais tout est brûlé en bas, donc c'est un décollage très intense d'une fusée, et c'est le deuxième étage. C'est un discours qui est en place depuis longtemps, qui avait fait basculer à l'époque le précédent maire de L'Île-Saint-Denis. C'est une petite commune agréable sur la Seine, une petite commune qui a longtemps été dirigée par un maire écologiste, Michel Bourgain, qui était opposé aux grands projets pour des raisons écologistes. Finalement, il s'est rallié à l'organisation des Jeux et a proposé que sa ville y participe, notamment en accueillant une partie du village des athlètes. C'est pourquoi, au début de mon enquête, j'ai choisi de le rencontrer. Selon lui, dès lors que Saint-Denis et Saint-Ouen acceptaient, il voyait bien qu'il serait écrasé s'il refusait. Autrement dit, tous les moyens auraient été dédiés aux communes encore plus importantes.
Concernant Saint-Denis et Saint-Ouen, qui ont changé de majorité politique, c'est encore différent. On retrouve par exemple cette logique qui consiste à faire monter Saint-Denis de plus en plus comme une ville importante, de la même manière qu'elle a candidaté pour être la Capitale de la Culture, chose qu'elle n'a pas obtenue. Il s'agit là de la même logique : augmenter sa notoriété et son pouvoir d'attractivité. C'est un point très important dans tous ces discours autour des métropoles. J'ai été frappée par le fait que toutes ces personnes, que ce soit les élus de la mairie de Saint-Denis, de L'Île-Saint-Denis, de Saint-Foy ou d'autres élus, parlent toujours du développement du territoire, ce qui est considéré comme bénéfique pour la Seine-Saint-Denis.
Il y a quelques semaines, dans le métro parisien, on pouvait voir d'immenses publicités proclamant que la Seine-Saint-Denis allait accueillir le monde. Le concept de territoire est en réalité très abstrait. De quel territoire parle-t-on exactement ? Où commence-t-il, où se termine-t-il ? Le département de la Seine-Saint-Denis est en fait très étendu, et il existe des différences significatives entre des quartiers comme ceux du Raincy et de Stains. Autrement dit, ce qui pose problème, c'est qu'on prétend parler au nom d'un endroit où les habitants sont fortement discriminés, mais la manière dont on construit ce discours tend à négliger ses habitants.
Concernant le développement territorial, il est crucial de distinguer deux approches fondamentalement différentes. D'une part, il y a l'approche axée sur la croissance économique, visant à augmenter le PIB et les activités économiques, quelles qu'elles soient. D'autre part, il y a l'approche de la justice environnementale, défendue par de nombreux mouvements sociaux, notamment aux États-Unis depuis les années 1970. Cette approche consiste à partir des besoins et des désirs des habitants d'un quartier pour construire ensemble des projets visant à réparer les discriminations et les inégalités existantes. Il s'agit donc d'une démarche ascendante, partant de la base pour aboutir à un mieux-être collectif. Il est évident que ces deux logiques sont diamétralement opposées, et que la logique des grands projets est en contradiction avec celle de la justice environnementale, qui prend en compte les besoins des habitants.
Ce discours sur le développement territorial semble, à bien des égards, partiel, voire unilatéral. En ne considérant qu'une partie des enjeux, il devient possible de justifier la construction d'un village olympique destiné à des personnes extérieures au territoire, au détriment des habitants actuels. Cette vision peut être acceptée au nom de l'image de la ville ou de ses recettes fiscales, sans tenir compte des conséquences sociales et environnementales. Il est donc difficile de démêler ces enjeux, d'autant plus que le discours en faveur des Jeux olympiques, présenté comme progressiste, continue d'avoir un fort impact.
Contretemps – Vous qualifiez l'économie des JO d'économie dysfonctionnelle. Pour appuyer votre propos, vous mobilisez les travaux de chercheurs d'Oxford sur les mégaprojets : pouvez-vous revenir sur ce qui fait que les Jeux engendrent systématiquement des surcoûts colossaux ?
Jade Lindgaard – Des économistes des grands projets ont établi que, depuis 1968, tous les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'hiver ou d'été, ont toujours dépassé leur budget. Pour les JO de 2012 à Londres, par exemple, dans cette ville assez comparable à Paris, le budget a été largement dépassé à la fin. Ce qui est intéressant, c'est d'en chercher les causes. Les chercheurs disent qu'il y a différentes raisons qui sont liées à la nature même du processus olympique. La première raison est celle du délai : c'est impossible de ne pas être prêt pour la date. À partir du moment où il y a une variable qui ne peut pas changer, toutes les autres variables sont flexibles, à commencer par celle du coût. Si le plus urgent, c'est de réussir à finir les travaux, on va être prêt à dépenser plus, à embaucher plus de gens, à les faire travailler plus longtemps, pour que les choses soient terminées en temps voulu. La deuxième raison, c'est le syndrome du débutant : il est très rare pour un pays et pour une ville d'organiser des Jeux Olympiques.
En France, la dernière organisation des Jeux d'été remonte à 1924. Los Angeles, qui va les organiser à nouveau en 2028, les a accueillis en 1984, une chose jamais vue dans l'histoire moderne. Le problème que cela pose, c'est l'absence d'habitude et d'expérience. En France, nous avons par exemple l'habitude de construire des autoroutes, des ponts, des métros, même si nous constatons déjà un retard sur le projet Grand Paris Express. Les centrales nucléaires sont également un bon exemple. Aucune n'a été construite pendant des années, et nous avons maintenant des années de retard sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Ces grands projets sont donc très complexes en raison des paramètres et des nombreuses choses à maîtriser simultanément… Durant la phase de conception, la phase de construction, la phase d'exploitation, il y a tellement de paramètres sociaux, économiques, humains.
À cela s'ajoutent d'autres éléments comme le cours des matières premières, l'inflation, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, qui engendrent de l'incertitude. Malgré toute l'ingénierie déployée, toute la puissance publique, tout l'argent investi, le budget de près de 9 milliards d'euros est déjà considérable. C'est peut-être là, et je dis bien peut-être, que le CIO ne remplit pas suffisamment son rôle de transmission des bonnes pratiques d'un pays à l'autre, même s'il a essayé de le faire, même s'il y a des cahiers des charges, et même si, dans ces cahiers des charges, par exemple, le CIO a demandé aux villes hôtes de construire le moins possible. Paris, par exemple, construit peu, beaucoup moins que Londres, et en construira encore moins que Los Angeles en 2028, et derrière cela, il y a l'idée que si l'on construit moins, on sera moins en retard.
Cela nous amène au troisième point qui est à mon avis le plus intéressant : la question de l'échelle. Les Jeux Olympiques correspondent à une échelle gigantesque, ce qui est contradictoire avec beaucoup de choses, notamment le respect d'un vrai budget carbone, la protection des écosystèmes, mais c'est aussi avec les enjeux d'une bonne administration, d'une bonne gestion de manière démocratique et transparente. La Cour des Comptes, qui a déjà publié deux rapports sur le budget des Jeux Olympiques, s'apprête à en publier un troisième, sur l'héritage, qui sera intéressant à lire pour comprendre le fil qu'ils arrivent à tirer.
La Cour des Comptes a écrit l'année dernière que les chiffres ne sont pas clairs, ni sur le coût final pour la puissance publique, ni sur l'augmentation des coûts au cours du projet. Elle écrit même qu'il y a une sous-estimation des coûts dans les premières moutures des projets de Paris 2024. Bien loin de la promesse initiale selon laquelle ces JO seraient positifs pour le climat et devaient, sinon ne rien coûter aux Français, comme il en était question au début du projet, du moins leur coûter peu, les organisateurs ont mis un peu d'eau dans leur vin et adouci leur slogan. L'opacité de l'organisation et cette difficulté à s'y retrouver sont aussi la conséquence de la peur d'augmenter les dépenses et donc d'être en dépassement budgétaire.
Ils donnent l'impression de ne pas vouloir trop montrer les risques de dépassement budgétaire par peur que cela alimente la critique des anti-JO mais on pourrait dire, au contraire, que c'est grâce à la transparence qu'on est peut-être conduit à faire des arbitrages budgétaires – qui ont été faits d'ailleurs. On parle beaucoup du village des athlètes mais il y a une partie du village des médias qui est construite à Dugny. Ils l'ont coupé en deux, ils n'ont construit que la moitié de ce qui avait été envisagé. Un autre exemple intéressant est le centre aquatique olympique inauguré par Emmanuel Macron le jeudi 4 avril qui est beaucoup plus petit que le projet initial.
Contretemps – Paris était la seule ville en lice pour ces Jeux, les jeux de 2030 semblent peu attirer. Comment expliquer ce désintérêt ? D'ailleurs, vous expliquez que plusieurs villes se sont désistées suite à l'organisation de référendums. Pouvez-vous revenir sur la genèse de cette candidature et de cette victoire sans compétition ? Vous qualifiez aussi le CIO de « bizarrerie démocratique » : qu'est-ce que cette institution que nous connaissons finalement peu ?
Jade Lindgaard – Lorsque Paris a été choisie pour accueillir les Jeux en 2017, c'était la seule ville candidate. Quelques mois auparavant, un accord avait été conclu avec Los Angeles pour se répartir les années : Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. Dès 2017, il ne restait que deux villes candidates pour les Jeux de 2024 et 2028. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Tout d'abord, les autres villes qui avaient envisagé de présenter leur candidature pour 2024 ont peu à peu retiré leur candidature, soit suite à des référendums comme Hambourg et Munich, soit suite à des mobilisations citoyennes comme à Boston, avec un mouvement appelé No Boston Olympics, porté par des architectes et des urbanistes. Ce mouvement met en avant des préoccupations très similaires à celles que l'on voit aujourd'hui émerger avec Paris 2024, notamment l'idée que l'aménagement urbain ne devrait pas être dicté par les visiteurs, mais par les habitants. Cela résume bien la dimension extractiviste d'un grand projet tel que les JO. La ville de Rome s'est retirée de la course car la candidate à la mairie Virginia Raggi, issue du mouvement 5 étoiles, avait inscrit son opposition aux JO dans son programme. Élue, elle a retiré la candidature de Rome. Je ne vais pas présenter cela comme un exemple de démocratie, puisqu'il y a eu par la suite des problèmes de corruption.
Cela montre néanmoins que beaucoup de villes craignaient les dépassements budgétaires, ce qui était un des arguments principaux des mouvements d'opposition aux JO dans différentes villes : « ça va coûter trop cher, nous n'avons plus les moyens ». Alors, pourquoi Paris s'est-elle quand même portée candidate ? Il faut inverser la question. D'autant qu'initialement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était opposée aux Jeux. Puis, en 2015, le président de la République François Hollande a exercé une pression pour que Paris se porte candidate. Pourquoi le pouvoir socialiste voulait-il que Paris soit candidate ?
Tout d'abord, les attentats de 2015. Avant eux, Paris était déjà candidate. Après, il y a une volonté de ne pas se laisser abattre face au terrorisme. Ensuite, il y a la volonté de faire rayonner la France à l'international, notamment à travers des événements prestigieux comme les JO ou encore la COP21. Il y a aussi une tendance croissante des villes à jouer un rôle majeur sur la scène internationale – ce qui correspond à l'agenda de développement et de croissance. Enfin, il y a probablement des enjeux politiques personnels pour Anne Hidalgo, qui envisageait de se présenter à la présidentielle. La candidature aux Jeux pouvait constituer un moyen de renforcer sa position. En 2017, Paris a été choisie pour accueillir les Jeux, ce qui soulève des questions sur les processus de décision et sur qui les prend, ainsi que sur les motivations derrière ces décisions.
C'est le CIO qui décide. C'est un autre paradoxe de cette histoire, celle de la communauté internationale olympique, une association basée à Lausanne, dans un bâtiment impressionnant, avec des escaliers en forme d'anneau olympique. Malgré sa taille modeste, le CIO est sans aucun doute l'une des institutions les plus puissantes au monde. C'est le CIO qui décide quelle ville organisera les Jeux, quels sponsors auront le privilège de figurer parmi les sponsors premium. C'est un cercle très fermé dont les modalités d'accès et les coûts sont généralement inconnus du public. C'est également le CIO qui fixe le cahier des charges de l'organisation des Jeux, comprenant des critères tels que le village olympique, la construction d'une grande piscine et d'un grand stade.
Ainsi, tous les JO se traduisent par d'importants projets d'aménagement urbain et des opérations immobilières conséquentes, car leur organisation nécessite la construction de nombreuses infrastructures. Les Jeux sont bien plus qu'un simple événement sportif ; depuis des décennies, ils sont aussi des opportunités d'aménagement urbain, d'activité économique. Le CIO n'est soumis à aucun contrôle externe, n'ayant pas à rendre de comptes à des organes élus ou à des instances de vérification des comptes. Il gère lui-même son conseil d'administration et ses présidents, sans aucune obligation de transparence démocratique. C'est cette opacité qui soulève des questions sur la nature démocratique du processus décisionnel du CIO, une petite association capable de dicter des termes aux États et d'organiser l'un des événements les plus médiatisés du monde, mais dans un relatif secret.
Contretemps – Vous expliquez que « les chantiers accélèrent et renforcent une valorisation immobilière qui a aussi d'autres causes » (p.103), vous parlez aussi des 1 500 personnes déplacées à cause des JO en Seine-Saint-Denis, des 2 millions déplacées depuis la fin des années 1960. Il s'agit là encore de données peu mises en avant, pouvez-vous nous en parler ?
Jade Lindgaard – Les aménagements liés aux JO vont de pair avec une casse sociale qui est importante et surtout qui est complètement invisibilisée. Si on reprend l'exemple du village des athlètes, il y a énormément de personnes qui ont perdu leur logement de manière définitive, en lien direct ou indirect avec les JO.
J'ai fait une estimation, minimaliste, de 1 500 personnes délogées de façon directe ou indirecte par les Jeux. Il y a par exemple les hommes qui habitaient dans un foyer de travailleurs migrants, un foyer qui se trouvait sur le périmètre du village des athlètes. Il a été démoli. Les habitants ont été déplacés, évacués de leur domicile. Même si la police n'est pas venue les déloger de leur chambre, ces personnes ont été temporairement relogées dans deux bâtiments différents en attendant un relogement définitif qui devrait avoir lieu après les JO, mais qui ne se fera pas dans le village des athlètes. Il s'agit d'environ 300 personnes.
Il y a approximativement 400 personnes qui résidaient dans le squat Unibéton, en bordure d'une autre partie du village des athlètes. Elles ont été expulsées au printemps 2023. Il s'agissait quasiment toutes de personnes sans-papiers, donc pour elles, aucun relogement. Et enfin, les habitants de la cité Marcel-Paul de L'Île-Saint-Denis. Leur situation est différente et me semble très emblématique de ce qui se passe tout en étant totalement invisibilisée. La cité Marcel Paul est une zone de logements sociaux sur L'Île-Saint-Denis, en partie abandonnée par son bailleur (aujourd'hui Seine-Saint-Denis Habitat), et qui a sombré dans les difficultés sociales et économiques, devenant depuis des années un important lieu de trafic de drogue. C'est un endroit marqué par la violence et les difficultés, mais aussi par une forte solidarité. Cette cité était concernée par un projet de rénovation urbaine de l'ANRU, entamé avant l'attribution des Jeux, avec pour objectif de reloger une partie de ses habitants, notamment ceux des trois tours qui la composent.
Dès lors que les Jeux ont été attribués à Paris, le processus de rénovation urbaine s'est accéléré. Il était sous-entendu, dans de nombreux rapports, que la cité Marcel-Paul ne devait pas rester dans son état actuel pendant les Jeux. Bien qu'elle ne soit pas directement adjacente au village des athlètes, elle en est très proche. La présence de cette cité en tant que vitrine de la misère sociale ou plaque tournante du trafic de drogue n'était pas compatible avec le niveau de sécurité prévu sur L'Île-Saint-Denis pour les JO.
Dès lors que les Jeux ont été attribués, tout le processus de rénovation urbaine a dû être considérablement accéléré. Ces habitants, qui sont déjà pour beaucoup des gens sous pression, se sont retrouvés avec des injonctions à choisir le plus vite possible un logement dans lequel déménager. Dans la précipitation, il y avait des offres faites qui ne correspondaient pas à la loi, aux règles du relogement ANRU : des appartements trop chers ou trop loin, et surtout des gens mis sous une pression terrible. Cela se poursuit, car une partie d'entre eux a été relogée, mais les situations les plus difficiles n'ont pas été résolues. Leurs droits en tant que locataires, droits de logement sociaux, n'ont pas été toujours respectés.
Cela a créé le sentiment terrible de se faire dégager pour les JO. Ce sont des choses que j'ai entendues de nombreuses fois : « ils ne veulent pas voir nos visages pendant les Jeux Olympiques, on est virés à cause des JO ». C'est dit avec tristesse, colère, amertume par ces personnes. J'ai fait un article là-dessus dans Mediapart[1]. Le maire de L'Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, a fait un communiqué en disant que c'était mensonger, une intox de notre part, il a été très agressif dans sa communication. Il s'agissait pourtant de paroles rapportées des habitants, tous les habitants ne pensent pas qu'ils sont virés à cause des Jeux, mais certains le pensent. La raison pour laquelle cela a tant crispé la mairie est celle du positionnement des maires de gauche vis-à-vis des Jeux. On veut que cela serve au développement du territoire, et là, on a un endroit où des gens se font dégager par l'événement olympique, qu'on le veuille ou non ; des gens qui ne pourront pas revenir derrière, habiter là et qui sont un peu les victimes de ce processus d'aménagement.
C'est pourquoi j'ai évoqué le sentiment de dépossession que j'ai ressenti de leur part : ils habitent un quartier dans lequel des gens vivent depuis plusieurs décennies, que ce soit au foyer des travailleurs ADEF ou encore à Marcel Paul. Cette forme de violence sociale est amplifiée par le manque de visibilité qui entoure ce processus de dépossession, comme si celui-ci passait inaperçu. Même aujourd'hui, cela demeure largement méconnu. Vous êtes-vous rendu compte de la visite d'Emmanuel Macron au village des athlètes qu'il a inauguré il y a quelques semaines ? Lors de cette visite officielle étaient présents tous les « chefs des JO » : le préfet de Saint-Denis, le directeur général de la SOLIDEO, Nicolas Ferrand, le président du COJO, Tony Estanguet, et le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Selon eux, la fierté de cette organisation réside dans le fait qu'il n'y a pas eu d'expropriation. C'est tout à fait exact : il n'y a pas eu d'expropriation au sens où des propriétaires auraient été forcés de céder leur logement, comme cela s'est produit par exemple pour le Grand Paris Express, comme le relate le livre d'Anne Clerval et de Laura Wojcik, Les naufragés du Grand Paris Express[2]. Certes, il n'y a pas eu d'expropriation, mais il y a eu des expulsions. Et cela, en revanche, n'a pas du tout été mentionné. Cette déclaration m'a interpellée, car elle montre clairement qu'ils souhaiteraient que personne n'ait été contraint de partir à cause des Jeux. Cela remet en question leur narration politique et leur discours, tout en mettant en lumière le manque d'engagement démocratique dans la candidature de Paris 2024. Rien n'empêchait Paris de s'engager, au moment de sa candidature, à ce que personne ne soit expulsé, délogé ou ne perde son logement. Cependant, cet engagement n'a pas été pris, alors que des situations similaires à ce que je décris pour Paris 2024 se sont déjà produites à Londres en 2012.
Il s'est même passé la même chose dans toutes les villes qui ont organisé des Jeux : cela a été terrible avec des destructions entières de quartiers à Rio, près d'un million de personnes déplacées à Pékin et même à Barcelone 1992, qui est toujours décrit comme l'exemple vertueux, il y a eu des camps de roms détruits. Je veux donc dire que c'est un phénomène systémique et c'est loin d'être une surprise car c'est lié à la manière dont les jeux s'aménagent. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ces jeux dès 2018, que j'ai commencé à aller sur ce territoire en me disant qu'il fallait documenter ce qu'il y avait à ce moment-là.
Contretemps – Dès l'annonce des Jeux, des collectifs se sont montés, puis pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, on a vu fleurir le slogan « pas de retrait, pas de JO », depuis des collectifs s'organisent (comme Saccage 2024). La mobilisation s'organise déjà concernant les Jeux d'Hiver, notamment l'incidence qu'ils auront sur la montagne déjà abîmée par l'activité humaine et la fonte des glaces. Est-ce que ces événements ont encore un sens à l'heure où les urgences écologiques, sociales se multiplient et sont de plus en plus vives ?
Jade Lindgaard – À tout ce qu'on vient de raconter sur le rapt démocratique et la casse sociale s'ajoute l'aspect écologique que nous avons moins abordé, même si on a parlé de la destruction d'une partie des jardins d'Aubervilliers, de la construction d'un village des athlètes, de celle du village des médias sur le parc Georges Valbon, où avait lieu la fête de l'Humanité. Enfin, l'organisation d'un événement qui doit faire venir 13 millions de personnes, dont une grande partie en avion, fait partie des nombreuses atteintes environnementales de ces jeux.
Alors qu'on a l'objectif de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le transport aérien, que Paris a par ailleurs un plan climat dans lequel la ville s'engage à considérablement réduire ses émissions de gaz à effet de serre, on a là un événement qui représente l'inverse de ces promesses. Certes, on construit peu de nouvelles infrastructures, mais on construit malgré tout des infrastructures gigantesques, comme la piscine de Saint-Denis ou encore un village des athlètes alors qu'il y a de nombreux hébergements à Paris. Nous sommes donc dans un événement qui est de toute façon un peu un attentat à la sobriété, au sens où toutes les échelles sont énormes voire démesurées pour les Jeux Olympiques.
Ce gigantisme se retrouve notamment dans la passerelle, large comme douze autoroutes, qui relie la piscine de Saint-Denis et le Stade de France. Dans sa philosophie, on a là quelque chose de vraiment antinomique avec la situation de sobriété nécessaire face au changement climatique. Je ne vois pas très bien comment ce gigantisme olympique est compatible avec la planète et la nécessité de réduire notre impact environnemental. Plutôt que de continuer à organiser de l'extérieur des événements qu'on essaye de faire rentrer de manière forcée dans les critères sociaux et environnementaux, on est plutôt dans un moment où il faudrait se dire qu'en fait on ne construit plus.
On arrête de construire, on occupe et on habite au maximum ce qui est déjà construit, et s'il y a absolument besoin de construire autre chose, on construit, mais dans un second temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de révolution copernicienne écologique. Plutôt que de partir de l'idée qu'on va construire et on va rendre ça écologique en utilisant du bois, en n'ayant pas de climatisation, on part de ce qui existe déjà et on voit ce qu'on peut en faire. L'engagement du COJO et du CIO d'émettre deux fois moins de CO2 que Londres en 2012 n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.
Si on met bout à bout les arguments démocratiques, sociaux, environnementaux, tout cela conduit à penser que les Jeux Olympiques organisés tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, ne sont absolument pas compatibles avec notre situation humaine actuelle. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut arrêter les Jeux Olympiques ? Moi, je n'en sais rien. Je me dis juste qu'il y a plein d'autres manières possibles de les faire. Par exemple, si les Jeux Olympiques arrêtaient de tourner d'une ville à l'autre, ça ferait déjà moins de construction. Il y aurait un endroit, un seul, où ça se passerait.
On peut également imaginer que tout le monde ne soit pas obligé d'être au même endroit au même moment ou encore qu'il y ait moins de sports. Il y a plein de pistes, il y a plein de gens qui travaillent beaucoup mieux que moi sur ces sujets. Mais en tout cas, pour terminer, si on croit à notre démonstration selon laquelle, pour ces raisons démocratiques, sociales et environnementales, les jeux tels qu'ils sont organisés aujourd'hui ne sont pas compatibles avec les exigences de notre époque, alors, continuer à les organiser comme si on n'était pas dans cette époque-là est hyper problématique.C'est un problème car d'un point de vue philosophique et politique, ça laisse penser qu'on peut continuer comme avant. C'est pourquoi, en dehors de tous les aspects français et parisiens de Paris 2024, je pense qu'il y a des chiffres politiques, systémiques qui valent pour tout le monde. On se rassure à peu de frais d'une certaine manière mais jusqu'à quand peut-on continuer à se rassurer à peu de frais ? Une vague caniculaire comme on en a eu lors d'autres étés serait-elle un signal suffisant sur le caractère intenable de notre système ? Pour les Jeux de 2030, je trouve que c'est le seul signal de quelque chose. On voit une vraie mobilisation autour de la candidature de la France pour les Jeux d'hiver. Il y a une critique déjà beaucoup plus importante que ce qu'il y a eu contre Paris 2024, et cette critique est portée à la fois par des associations écologistes et par des sportifs.
Stéphane Passeron a notamment pris la parole[3] pour dire qu'il ne fallait pas faire ces Jeux au nom de la protection de la montagne, un écosystème très fragile, très abîmé par le changement climatique. Organiser les Jeux là-bas reviendrait à renforcer le tourisme de masse et l'industrialisation de la montagne. Dans ce cas précis, l'argument environnemental a été saisi par un grand nombre de personnes qui aiment ces paysages et la vie qui s'y trouve. Force est de constater que cette critique pour l'instant n'a pas de prise sur la candidature puisque, de nouveau, la France est le seul pays candidat pour les Jeux d'hiver de 2030. L'enjeu est donc de faire vivre un peu cette discussion jusqu'à la désignation.
Contretemps – Votre livre s'ouvre sur un préambule, en 2025, les Jeux ont laissé des infrastructures, l'écosystème est demeuré intact, les politiques liberticides notamment la surveillance ont disparu : sans verser dans la politique fiction, à l'aune de ce que vous avez étudié, quelle sera l'incidence des Jeux ?
Jade Lindgaard – Ce que l'on peut craindre, c'est la pérennisation des problèmes induits par les JO : Paris 2024 pourrait justifier ses constructions et ses aménagements au nom de leur durabilité écologique. Cependant, le risque est que ce ne soient pas seulement des bâtiments qui soient pérennisés, mais aussi le mode de vie qui les accompagne. Cela inclut un renforcement des mesures de sécurité, avec l'installation de nombreuses caméras de vidéosurveillance à Saint-Denis. Il y a également le risque d'une gentrification agressive, avec l'arrivée de nouveaux résidents dans le village des athlètes.
De plus, il y a le risque que cela perpétue un modèle de ville largement financé par le secteur privé (le village des athlètes représentant un investissement de 2 milliards d'euros, dont 78% proviennent du secteur privé). C'est une ville coproduite par l'État et des investisseurs immobiliers, avec l'objectif de réaliser des profits à long terme. Cela représente une extension du capitalisme urbain. Le risque est que, malgré les discours vantant ce quartier comme une vitrine du savoir-faire français en matière d'urbanisme, cela perpétue également un rythme effréné de construction de quartiers. La métropole parisienne est entourée de nombreux terrains vagues, et si ce modèle se généralise, cela pourrait poser des problèmes démocratiques, sociaux et environnementaux. C'est une hypothèse à prendre en considération.
*
Propos recueillis par Marion Beauvalet et Louis Hardy.
Notes
[1] Jade Lindgaard, À l'Île-Saint-Denis : « Ils ne veulent pas voir nos visages pendant les JO », Mediapart, 26 juillet 2023.
[2] Anne CLERVAL, Laure WOJCIK, Les naufragés du Grand Paris Express, Paris, La Découverte, 2024.
[3] « Ces JO 2030 ne sont ni souhaitables ni tenables », Politis, 6 mars 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Barcelone, Berlin, Amsterdam... : le mouvement étudiant pro-Palestine s’étend en Europe

Après plusieurs semaines de mobilisation étudiante aux États-Unis, et face à l'offensive israélienne sur Rafah, le soutien à la Palestine se développe dans de nombreuses universités en Europe. En réponse, les gouvernements opèrent un saut dans la criminalisation du mouvement.
9 mai 2024 | tiré du site de Révolution permanente | Crédit photo : La Izquierda Diario
https://www.revolutionpermanente.fr/Barcelone-Berlin-Amsterdam-le-mouvement-etudiant-pro-Palestine-s-etend-en-Europe
Alors qu'Israël franchit une nouvelle étape dans son projet génocidaireavec l'offensive contre Rafah, la mobilisation étudiante de soutien à la Palestine progresse dans les universités d'Europe.
Dans l'État Espagnol, l'Université de Valence entame ce jeudi 9 mai son 11ème jour de mobilisation. Premier campus mobilisé contre le génocide en cours à Gaza sur le territoire, et l'un des premiers en Europe, le mouvement étudiant, qui revendique un cessez-le-feu immédiat et la fin des partenariats avec les universités israéliennes ainsi qu'avec toutes les entreprises espagnoles qui entretiennent des relations avec l'État d'Israël, a reçu le soutien de nombreux syndicats et collectifs pro-Palestine.
Même son de cloche du côté de Madrid, où le 7 mai, des centaines d'étudiants ont déferlé dans la rue pour dénoncer l'offensive à Rafah. L'occasion pour les manifestants de dénoncer l'utilisation de la « loi bâillon » pour criminaliser et réprimer le mouvement de solidarité avec la Palestine, qui n'est pas sans rappeler en France la multiplications des convocations pour « apologie du terrorisme » des soutiens du peuple palestinien.
https://twitter.com/i/status/1787926864310219101
A l'université de Barcelone, les étudiants ayant installé un campement sur le campus le 7 mai défendent les mêmes revendications : « Nous espérons que les directions universitaires ne vont pas agir comme elles l'ont fait ailleurs dans le monde. Et nous revendiquons la fin des partenariats avec l'État d'Israël » explique ainsi Pablo Castilla, militant à Contra Corriente (organisation sœur de Révolution Permanente). Sous la pression de la mobilisation étudiante et du rassemblement qui avait lieu pendant le conseil de l'université, la présidence a approuvé ce jeudi une motion appelant à un « positionnement urgent de l'Université de Barcelone sur le génocide et une interruption des liens académiques et économiques avec l'État sioniste »..
Au total, dans l'État Espagnol, la mobilisation étudiante contre le génocide à Gaza s'est déployé dans une douzaine de villes. Comme le rapporte la Izquierda Diario, le mouvement devrait encore s'étendre puisque les universités de Séville, Grenade, Malaga ou encore Alicante ont l'intention de rejoindre la mobilisation dans les jours à venir.
En Allemagne, les universités de Münster ou encore de Brême sont également mobilisées en soutien à la Palestine. A Berlin, une centaine d'étudiants de la Freien Universität ont tenté d'occuper leur campus ce mardi 7 mai, en défendant notamment « la reconnaissance et le renforcement de l'étude de l'histoire coloniale allemande ». En réponse, la présidence de l'université a immédiatement fat appel à la police qui a violemment expulsé les manifestants et a procédé à de nombreuses interpellations..
Quelques jours plus tôt, la ministre fédérale de l'Education avait appelé les universités à agir fermement contre le prétendu « antisémitisme » des manifestations pro-palestiniennes. Une rhétorique qui vise à criminaliser les mobilisations étudiantes, partagée par la ministre de l'Enseignement Supérieur française Sylvie Retailleau, qui a récemment sommé les présidences d'université à utiliser « l'étendue la plus complète de leurs pouvoirs » contre les étudiants et annoncé poursuivre en justice les étudiants interpellés à la fac de la Sorbonne mardi 7 mai.
La mobilisation étudiante gagne aussi les universités du Royaume-Uni. L'université de Warwick est occupée depuis le 26 avril, et a entraîné avec elle les facs de Newcastle, Manchester, Cambridge, Oxford, ou encore Edimbourg où plusieurs étudiants ont annoncé entamer une grève de la faim jusqu'à l'obtention d'un cessez-le-feu. Aux Pays-Bas, les étudiants mobilisés de l'Université d'Amsterdam ont eux aussi été violemment réprimés par la police, qui a utilisé un bulldozer pour détruire les barricades et a violenté de nombreux étudiants à coup de matraque et de gaz lacrymogènes. 125 personnes ont été interpellées, et l'université a ensuite été bouclée à l'aide de clôtures métalliques.
Le mouvement continue à se développer dans toutes les universités d'Europe, notamment à Helsinki en Finlande, à Copenhague au Danemark où une quarantaine de tentes ont été déployées dans l'université, ou encore à Vienne où la police a interpellé une dizaine de manifestants pro-Palestine. En Suisse également, depuis la semaine dernière, des bâtiments des universités de Genève, Zurich ou Lausanne sont occupés par des étudiants. En Belgique, l'occupation d'un bâtiment de l'Université Libre de Bruxelles se poursuit malgré les provocations de militants sionistes.
https://twitter.com/i/status/1787907443290222611
Le mouvement étudiant de solidarité avec la Palestine s'étend bel et bien partout en Europe. Lieux symboliques qui ravivent le souvenir du mouvement contre la guerre du Vietnam, les universités cristallisent désormais la dénonciation de la complicité des États impérialistes dans le génocide en cours à Gaza. Par la dénonciation des partenariats et relations qu'entretiennent les universités avec l'État d'Israël et les entreprises qui le soutiennent, les étudiants mobilisés montrent aux yeux du monde comment leurs universités participent à la militarisation, à la production d'armes et au financement de l'armée israélienne.
En réponse, les gouvernements européens accentuent la répression et la criminalisation des étudiants mobilisés, par crainte d'une extension du mouvement en dehors des murs de l'université. Face à la tentative de muselage de la solidarité avec Gaza, il s'agit au contraire d'élargir le mouvement à l'ensemble des lieux d'études mais également au monde du travail, pour mettre un stop à l'offensive autoritaire à l'œuvre partout en Europe et défendre le droit de soutenir la Palestine au moment où le génocide pourrait s'accélérer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

A propos des élections européennes

Présentation
Comme annoncé dans notre publication du 6 avril dernier, nous avons ouvert la discussion sur les élections européennes du 9 juin prochain au niveau de la rédaction d'Aplutsoc. Nous n'avons donc pas encore pris de position et rien n'oblige à se priver de discussion avant d'en prendre, bien au contraire. Pour amorcer ce débat, nous commençons par une contribution de Vincent Présumey. Toutes autres contributions seront les bienvenues.
3 Mai 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2024/05/03/a-propos-des-elections-europeennes-par-vp/
Contribution
La discussion sur les élections européennes, abordée lors de notre réunion du 1° mai, tarde à démarrer par des textes, ce qui est cependant nécessaire. A moins que l'on pense qu'il n'y a rien de nouveau et que les larges masses se contrefoutent de ce scrutin, qui, effectivement, ne porte aucune perspective permettant d'avancer vers la satisfaction de la moindre de leur revendication. Et pourtant, s'imaginer qu'elles s'en contrefoutent serait une erreur de militants blasés, ne saisissant pas les processus profonds.
Indifférence et non-participation à un scrutin ne sont pas la même chose. S'il reste assez probable, quoique non absolument certain, qu'une grande majorité va s'abstenir, c'est en raison de cette absence de perspective et du caractère antidémocratique aussi bien des institutions de la V° République que des institutions dites « européennes » issues du traité de Lisbonne. Mais cela n'empêche en rien que le souci pour la situation européenne, pour le message à la fois national et continental de ce scrutin, surdéterminé par les deux guerres en cours (Ukraine et Gaza), ainsi que la conscience d'une situation mondiale dans laquelle la réaction la plus violente, incarnée par les noms de Vladimir Poutine et de Donald Trump, voudrait barrer la route à tout avenir, soit tout à fait massif et prégnant. Le tout sous le surplomb de l'emballement climatique dont il va probablement se confirmer cette année qu'il a franchi un seuil qualitatif, non officiellement anticipé par les climatologues, depuis l'été 2023.
Macron a échoué à faire de son second mandat, démarré sur des bases précaires, le moment de la reconstitution d'une « présidence forte ». Mais il a été sauvé de l'affrontement social central au premier semestre 2023. D'où le fait que pour le monde du travail et la jeunesse, le principal enjeu réel de ce scrutin, premier scrutin national du second quinquennat, est que son illégitimité et son affaiblissement, malgré la fuite en avant autoritaire incarnée par le ministre Darmanin et par une politique visant à corseter et abrutir la jeunesse, soient confirmées et aggravées. Et c'est bien ce qui se profile.
Le problème, c'est que, l'ensemble des partis de la plus ou moins défunte NUPES ne représentant pas une alternative à Macron, car tous acceptent et protègent le cadre et le calendrier institutionnel de ce régime, c'est le RN qui semble devoir gagner le scrutin. Sa tête de liste Bardella annonce que s'il est en tête il exigera la dissolution de l'Assemblée nationale. Cela veut dire qu'il espère gagner des élections législatives, et demandera alors à être premier ministre. Il y a un an et demi, telle était la revendication de Jean-Luc Mélenchon, qui elle aussi impliquait de garder Macron à la présidence. Naturellement, Bardella est assuré, lui, que ce serait pour mener sa politique à lui, déjà largement anticipée par Macron dans sa loi « Immigration », contre la jeunesse, contre la fonction publique et l'école laïque, et dans la répression.
Le score potentiel du RN ne signifie pas qu'il y a « extrême-droitisation » en profondeur de la société – il y a radicalisation de la classe capitaliste, ce qui n'est pas la même chose – mais que le RN est parfaitement légitime, hé oui, pour prétendre diriger et rétablir la V° République dans la force de l'État, dirigée contre le monde du travail et la jeunesse. Ce parti, répétons-le car cela est souvent peu compris, est l'héritier du coup d'État colonial d'Alger du 13 mai 1958. Il est une composante organique de ce régime et il revendique à présent son droit à le diriger, en exigeant de cohabiter avec Macron avant 2027 et en pesant, ce qui n'est pas difficile, sur la politique de Macron. Le combat contre le RN est donc inséparable du combat pour que Macron et ce régime soient renversés par l'affrontement social avant 2027, qui est et doit demeurer notre perspective dans et à travers le scrutin du 9 juin prochain.
La confrontation apparente avec le RN convient à Macron et a été recherchée par lui. En revanche, le fait que la liste Renaissance soit talonnée par la liste PS et sa tête de liste Raphaël Glucksmann de Place publique (l'une des formations éthérées nées de l'effondrement du PS en 2017, avec Générations.s, Nouvelle donne, Diem-21 …), et puisse être éventuellement dépassée par elle, surtout si, à une échelle de masse, se développe ce qui a commencé – la volonté d'utiliser ce vote apparaissant comme vote utile à la fois contre Macron et contre le RN – n'a été ni prévu ni recherché par lui. Bien que, évidemment, la remise en cause du calendrier institutionnel et la recherche de l'affrontement social pour casser le cercle infernal Macron/RN avant 2027, ne soit absolument pas l'orientation ni la raison d'être de cette liste, sa relative poussée n'a rien du phénomène « bobo » fantasmé par la sociologie gauchisante. Il n'est pas nécessaire de se faire la moindre illusion sur leur orientation et sur l'absence totale de garantie sur ce qu'ils feraient d'un score élevé, pour comprendre que celui-ci constituerait un coup direct et supplémentaire porté à Macron et – du coup – au RN.
Un élément clef de leur percée, probablement le facteur initial qui a fait la différence avec les autres listes issues de la NUPES, c'est l'Ukraine. Raphaël Glucskmann est l'objet d'une campagne de haine, aux relents antisémites, de la part de LFI et de secteurs du PCF et surtout des JC, ainsi que d'une partie de ce qu'il est convenu d'appeler l' « extrême-gauche » et qui s'estime propriétaire, contre le mouvement réel de la majorité, de la révolution. Cette campagne est allée jusqu'à l'agression physique ce 1° mai à Saint-Étienne. Elle est inspirée et largement manipulée par les « organes » russes et chinois, formant le trait d'union avec ce que notre camarade d'Oakland Socialist (Californie) John Reimann a appelé la « gauche poutinienne » – l'irredressable gauche poutinienne. Mais de qui fait elle principalement le jeu ? De Macron, car c'est Macron qui serait frappé gravement si sa liste n'était même pas deuxième après le RN.
La percée possible de cette liste est bien sûr à relier au fait que J.L. Mélenchon est de moins en moins perçu comme porteur d'une perspective politique de rupture avec les gouvernements de droite de la V° République. Pendant que les courants potentiels issus de LFI et leurs têtes d'affiche, Ruffin le premier, attendent que passe le 9 juin pour voir comment dégainer, LFI s'étiole en une garde prétorienne autour du Chef, assurée surtout par le POI, et mise à fond sur la mise en scène du « génocide de Gaza » pour prétendre représenter le puissant et réel sentiment d'indignation qui parcourt la jeunesse étudiante contre le massacre en cours. Sa tête de liste Manon Aubry a à peu près disparu des radars, au profit du vieux Chef et de Rima Hassan, poursuivie par les journalistes et les magistrats comme soi-disant « apologue du terrorisme ». Il va sans dire, mais disons-le, que ces attaques du régime contre la liberté d'expression et contre la liberté politique doivent être combattues. Mais notons-bien que LFI ne souhaite pas être défendue par d'autres forces contre ces attaques, ne veut pas d'une victoire démocratique contre Macron, mais entend seulement les utiliser pour jouer les faux martyrs. De plus, le fait que Rima Hassan a manifestement, pour le moins, des relations parfaitement cordiales avec le régime d'extrême droite syrien (et n'a jamais dénoncé le plus grand massacre de Palestiniens avant celui qui se déroule en ce moment à Gaza, mené par Bachar el Assad ces dernières années) constitue un gros problème potentiel.
La jeunesse mobilisée pour la cause palestinienne, mobilisée à juste titre, ne doit pas être trompée. Quand Mélenchon écrit : « Honte à ceux qui regardent ailleurs face au génocide en cours à Gaza » – juste après avoir écrit : « L'Ukraine et la Russie doivent négocier des garanties de sécurité mutuelle. », Mélenchon ne défend pas les Gazaouis et ne leur sert en rien. C'est, là aussi, une campagne unitaire, démocratique, internationaliste, qui peut imposer un cessez-le-feu à l'armée israélienne et du même coup mettre en cause la colonisation en Cisjordanie. Pas une campagne identitaire autour du mot-fétiche « génocide » visant à interdire qu'on « regarde ailleurs », notamment vers les territoires occupés d'Ukraine. La libération conjointe des territoires occupés en Palestine et en Ukraine, voila l'objectif internationaliste, contre le gardien de l'ordre européen Mélenchon.
A l'échelle du monde, la menace de la guerre et de l'extrême-droite porte deux noms, qui sont alliés : Vladimir Poutine et Donald Trump. La plus grave accusation contre Joe Biden ou Emmanuel Macron est qu'ils leur pavent la voie, en cautionnant le massacre de Gaza et tout simplement par leur politique capitaliste. Toute lutte contre l'extrême droite, toute lutte contre la guerre, qui ne comprend pas cela, fait le lit du fascisme, et, indépendamment de l'orientation et de ce que représente R. Glucskmann, cela vient d'être démontré en France par la campagne potentiellement meurtrière de la fausse gauche poutinienne à son encontre.
VP, le 02/05/2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












