Derniers articles
L’Hindutva : l’idéologie nationaliste hindoue au cœur du pouvoir indien
L’eau en résistance face à l’extractivisme : le cas de l’Amérique latine
Winnipeg a vaincu un règlement municipal « extrêmement dangereux »

Solidarités noires face aux génocides

En 2023, Pauline Lomami, Marlihan Lopez et moi-même avons mis sur pied Harambec, une initiative consacrée à la défense des droits des femmes Noires et des personnes non binaires Noir·es [1]. Parmi les actions menées, en mars 2024, nous avons organisé un panel sur Les Solidarités Noires face aux génocides animé par Belen Blizzard. Nous avons eu le privilège d'accueillir Dalia Elsayed, Duha Elmardi et Kandake, qui ont démontré les liens inextricables entre les contextes soudanais, congolais, palestinien et sud-africain.
Début 2024, lors de la planification de notre calendrier d'activités hivernales, la nécessité de discuter de la Palestine s'est évidemment imposée. Il était impensable de ne pas organiser un événement de soutien, considérant que nous participions toustes à divers efforts de cette lutte, mais aussi parce qu'actualité oblige ! Or, des questions ont immédiatement surgi : pourquoi la Palestine et pas le Soudan ? Ou le Congo, par exemple ? Alors que la capacité du monde à suivre, à absorber et à comprendre les actualités ne cesse de diminuer, pourquoi certains contextes s'imposent-ils, et pas d'autres ?
Limites de l'attention dans un monde saturé d'informations
Prenons le cas du Soudan : en 2022, j'avais écrit une chronique pour À bâbord ! sur la révolution soudanaise, intitulée « La Révolution du peuple », où j'expliquais que la population avait renversé un régime en place depuis trente ans et luttait pour empêcher que sa révolution soit usurpée par l'armée. La Charte révolutionnaire pour le pouvoir du peuple (CRPP), élaborée par des comités de résistance, démontrait un vrai exercice de démocratie directe. Malgré son importance, ce mouvement populaire avait à l'époque reçu peu d'attention médiatique à l'international. Pour réaliser ma chronique, j'avais bénéficié d'informations et de contacts d'une militante et fille d'ancien·nes réfugié·es politiques soudanais·es qui faisait son possible pour donner de la visibilité à cette actualité hors du commun. En 2022, malgré un sursaut d'intérêt à l'international, le Soudan a toutefois été vite éclipsé par l'Ukraine. Aujourd'hui, la situation s'est empirée. Le pays subit une guerre civile cauchemardesque qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes, ainsi que le déplacement de plus de dix millions d'individus, que ce soit au sein des frontières soudanaises ou vers des pays adjacents comme l'Égypte, l'Éthiopie et l'Ouganda. Le Soudan est désormais le pays qui compte le plus grand nombre de personnes en exil et qui connaît la crise de déplacement d'enfants la plus importante au monde, avec plus de trois millions de concerné·es. À ce stade, on estime qu'un·e réfugié·e sur huit dans le monde est soudanais·e. Qui dit guerre civile dit aussi violences et agressions sexuelles, famine, difficultés d'accès à l'eau potable, accès limité aux soins, et risques d'épidémies [2]. « Le Soudan est une crise majeure », tentent d'alerter les agences humanitaires et la diaspora soudanaise. Pourtant, l'intérêt médiatique et politique se fait attendre.
Notre capacité à accorder de l'attention est devenue une ressource précieuse, intégrée dans un système capitaliste en roue libre. Devant l'abondance d'informations, nous sommes non seulement saturé·es, mais aussi formaté·es à ne plus prendre notre temps. Le contenu doit être digeste, réduit à quelques secondes, et presque caricatural pour retenir notre intérêt. La structure des réseaux sociaux a aussi participé à symétriser ce que nous consommons : un appel aux dons pour le Soudan côtoie l'annonce d'un tout nouveau restaurant à Montréal, une danse devenue virale, une citation de Maya Angelou sur fond musical épique, et la chute d'un émeu sauvage en pleine course. Comprendre, chercher, analyser et retenir ce qui se joue dans l'actualité deviennent des compétences en perte de vitesse. Mais ce serait trop simpliste de réduire ce déficit d'intérêt à un trop-plein d'informations médiatiques. Lorsqu'à Harambec nous nous interrogeons sur les raisons derrière ce silence autour du Soudan, ou encore sur la difficulté à garder le Congo dans nos actualités, le spectre des corps concernés n'est jamais bien loin.
Hiérarchie de l'empathie et ingérence occidentale en Afrique
Interrogé·es à ce sujet, nos panélistes, certaines originaires du Soudan, de la République démocratique du Congo (RDC) ou d'Afrique du Sud, ont longuement dénoncé des dynamiques claires dans la hiérarchisation de l'empathie. Il existe une normalisation et une apathie face à la souffrance, la violence et la mort sur le continent africain, et sur les corps Noirs en général. Dans cet imaginaire nécropolitique, le Soudan ou encore la RDC sont en crise parce que de toute manière, il y a toujours une crise dans cette partie du monde. Qu'importe que six millions de personnes aient été tuées au Congo depuis 1996, que plus de sept millions soient en exil ou qu'il y existe des enfants soldats. Ces populations incapables de se gouverner seraient vouées à rester dans la sauvagerie et l'incivilité. Cette vision justifie et légitimise les ingérences internationales tout en camouflant le pillage organisé des ressources. L'appétit impérialiste à la racine des conflits actuels demeure invisible à la face du monde, et peut aisément prétendre sauver ces populations. Flux financiers, extractivisme minier et forestier… Tous les contextes géopolitiques présentés par nos panélistes ont comme point commun l'ingérence impérialiste occidentale et le capitalisme.
Face au racisme anti-Noir·es, comment tisser des solidarités ?
Enfin, nos panélistes ont souligné l'impact du racisme anti-Noir·es au sein même de nos luttes. Si nous avons choisi de parler de Solidarités Noires face aux génocides, c'était aussi pour entamer une conversation difficile, mais nécessaire sur le fait qu'au sein des luttes contre l'impérialisme et le colonialisme, le racisme anti-Noir·es se maintient, souvent minimisé ou ignoré. Malgré nos buts communs, la difficulté à reconnaître et à intégrer pleinement les expériences et les luttes des communautés Noires persiste. Ainsi, nos panélistes ont, avec beaucoup de finesse et de justesse, abordé les rapports entre le monde arabe et ses populations Noires par exemple, et entre la diaspora et ses terres d'origine.
A aussi été évoquée la difficulté à créer des solidarités de luttes dans un contexte de dénigrement et de mépris envers les communautés afro-descendantes. Par exemple, si les milieux militants soudanais ne manquent jamais d'intégrer la Palestine à leurs revendications, l'inverse est plus rare. A été également soulevé un certain malaise de voir certains discours et slogans des luttes contre le racisme anti-Noir·es sortis de leurs contextes et devenus des slogans dans les marches pour Gaza, sans aucune mention pour la condition Noire. Autant de conversations importantes et difficiles qui ont mobilisé les participantes et le public. Ce soir-là, nous avions d'ailleurs exceptionnellement ouvert l'événement aux BIPOC [3], ce qui a rendu les échanges d'autant plus riches et précieux. Depuis, le Sudan Solidarity Collective a organisé un événement de collecte de fonds avec salle comble. Des bénévoles présent·es à l'événement sont des figures qu'on croise aux marches pour la Palestine. Et je vois des visages de notre public au camp de soutien aux étudiant·es de McGill, de Concordia et de l'UQAM. Plus que tout, la conviction demeure que nos luttes sont connectées et que nous ne survivons que grâce à nos solidarités.
[1] Harambec est un organisme par et pour des femmes Noires et personnes non binaires Noir·es. Nous travaillons en non-mixité raciale, tant parmi les personnes qui s'impliquent que dans le CA et chez nos membres futur·es. Sauf exception, nos événements se font également en non-mixité. Ce choix politique est ancré dans la revendication de notre droit à déterminer les conditions et modalités de nos luttes, afin de mieux œuvrer pour notre libération.
[2] Notamment le choléra, avec plus de 1 000 cas soupçonnés à Gedaref, Khartoum et Kordofan.
[3] En anglais : « Black, Indigenous and People of Color », soit « Noir·es, Autochtones et personnes de couleur ».
Photo : Ben Welsh (CCO 1.0)

22 jours de grève

Après une tentative de médiation et plusieurs séances à la table de négociation sans véritables avancées, les enseignantes et enseignants de la FAE – dont le contrat de travail était échu depuis avril 2023 – déclenchent une grève générale illimitée le 23 novembre 2023. L'objectif est de taille : améliorer les conditions de travail des profs, freiner la désertion en enseignement, et renverser la vapeur du recul des dernières années en éducation.
Les témoignages en rouge ont été partagés à 8 h le matin et à -14 degrés. Une nouvelle confiance et un remue-méninges collectif prennent forme.
23 novembre, 7 h du matin. Sylvie, Rana, Louise, Martine, Patricia, François, Guillaume et Salim se dirigent devant leur école et forment leur ligne de piquetage aux portes, fier·es, courageux·ses, fatigué·es, tanné·es, rempli·es d'espoir, uni·es.
Chacune et chacun croit ou espère que cette fois-ci sera la bonne. La grève illimitée est le combat qui mettra fin aux années d'austérité et qui marquera le retour des investissements et des signes d'amour pour nos écoles publiques. Chacune et chacun est prêt·e à un grand sacrifice sur son salaire pour y aller plus fort, pour « la gagner cette fois-ci ».
« Quand j'ai commencé ma carrière, ce n'était pas du tout comme ça. On avait plus d'élèves, mais moins de grands besoins, moins de paperasse à faire, moins de courriels, de rencontres. »
Ces courageux collègues resteront sur cette ligne de grève pendant 22 jours. La grève devient un rituel : on se lève à la même heure que lorsqu'on enseigne, mais au lieu de nos boîtes à lunch, nos piles de corrections et nos chemises à boutons, on enfile combines, pantalons de neige, deux couches de bas, de grosses mitaines de ski et la fameuse tuque rouge. Vingt-deux jours, de la fin novembre à la fin décembre, la partie la plus sombre de l'hiver. Vingt-deux jours qui ne seront jamais suffisants pour combattre 25 ans de reculs et de désinvestissements en éducation.
Qu'est-ce qui nous a fait tenir 22 jours ? Notre désespoir devant les élèves, que nos écoles trahissent chaque jour par manque de ressources. Notre espoir que les choses pourraient encore s'améliorer puisque les solutions sont connues. Le gouvernement n'aurait qu'à écouter nos idées.
Tous les jours de cette grève, je faisais la tournée des lignes avec des collègues. On apportait du matériel de mobilisation, du ravitaillement, des nouvelles et des encouragements aux 15 écoles sur notre circuit. Tous les jours, les profs nous le répétaient : « Pas question qu'on rentre avant d'avoir de vrais gains ». Si la possibilité d'un retour en classe avant les Fêtes diminuait, le moral, lui, ne flanchait pas : « Moi je n'accepterai pas n'importe quelle entente, et mes collègues non plus. »
« Je suis venue ici enseigner, dans ce pays dit développé, et on ne peut même pas offrir mieux que ça aux enfants ? »
« Dans le fond, c'est un choix »
Mais c'est lors de la cinquième semaine que le ton des discussions a vraiment changé sur les lignes. Jusque-là, beaucoup croyaient encore que ça se réglerait. Toutefois, face au mépris de la partie patronale, un discours nouveau émerge. On a eu cinq semaines pour mieux se connaître : collègues du sous-sol et du troisième étage, collègue de maternelle et spécialiste de musique, collègues plus expérimenté·es et à leurs débuts, collègues d'ici et d'ailleurs.
« C'est vrai que ça pourrait être mieux, que Legault pourrait bouger, nous rejoindre à n'importe quel moment. »
« Choisir », ce mot clé qui nous permet d'entrer dans une conversation nouvelle, qui nous libère, qui nous permet enfin d'explorer le contexte de la machine néolibérale derrière notre grève, notre travail, et notre quotidien dans le secteur public. Il a fallu ces cinq semaines dans le froid pour réaliser qu'on est toutes et tous dans notre droit, qu'on a raison d'en demander plus. Qu'on ne devrait plus se contenter d'écoles qui tombent en ruines. Que l'État peut faire mieux, peut choisir de faire mieux. Pour nous, les profs, et pour les enfants du Québec.
Ça nous aura pris 22 jours pour que ce genre de discours émerge sur les lignes.
Poursuivre l'éducation politique
Que pouvons-nous faire de plus, dans le mouvement syndical, pour entamer une relance, pour amorcer cette éducation politique, pour la propager dans chacune des instances et des actions afin qu'elle atteigne chaque membre de la base ? Nos syndicats ne devraient pas être juste des machines à griefs ou des pourvoyeurs de services aux membres. Où, à part dans nos syndicats, retrouve-t-on d'aussi importants espaces d'éducation politique dans notre société ?
« En fait, il montre à la jeunesse qu'il se fout de leur éducation, ça ne l'affecte même pas, les cinq semaines où il a laissé les enfants à la maison. »
La question se pose d'autant plus dans le secteur public, où les travailleur·euses subissent, dans leur travail quotidien, l'effritement du filet social et l'appauvrissement des familles. Comment poursuivre cette réflexion politique parmi les membres de la base dans chaque milieu de travail, au quotidien, et pas seulement avant une négociation de la convention collective ? Comment poursuivre cette éducation à long terme, pour faire de notre force syndicale le vecteur des changements politiques sur de multiples fronts ?
« Chez nous, on n'avait pas le choix, on faisait ce qu'on pouvait, mais je pensais que ce serait différent ici. »
Comment reproduire ce mouvement qui aura fait tenir debout les profs pendant 22 jours pour une meilleure école publique ? Par le biais d'un élargissement de notre rôle dans l'éducation politique, certes, mais aussi par un élargissement de nos liens avec la population.
L'appui des parents a été spectaculaire tout au long de cette grève, mais ce n'est pas grâce aux efforts très superficiels qui ont été faits de notre côté pour les rejoindre. Nous avons distribué tracts et rubans, mais n'avons pas fait d'appels plus larges à la mobilisation, et n'avons pas pris le temps d'écouter et d'impliquer les familles. Les parents et citoyen·nes, qui voient de leurs propres yeux les problèmes en éducation, ont fait preuve d'une extraordinaire solidarité par leurs propres moyens. Semaine après semaine, parents, grands-parents ou tuteur·rices nous apportaient du café, des beignes, des sandwichs, des chauffe-mains, des mots d'encouragement. Iels klaxonnaient pour nous aux quatre coins de la ville, nous arrêtaient à l'épicerie pour nous féliciter, nous envoyaient des courriels et des messages. Iels passaient nous voir sur les lignes avec les enfants pour nous saluer, et se déplaçaient même à nos manifestations au centre-ville.
« Dans le fond, c'est un choix. On choisit, au Québec, de ne pas s'offrir une école publique de qualité. »
Tout cela témoigne d'une énorme sympathie et d'une grande générosité de la part des familles de nos élèves. Mais il faudrait, à l'avenir, créer des espaces pour réellement impliquer les parents, pour mener cette lutte côte à côte et avec un ancrage dans les quartiers et communautés de nos écoles. Il y a un grand travail à faire pour arriver à cet élargissement de la lutte. Malheureusement, les 22 jours n'auront pas été suffisants pour obtenir les gains souhaités par les profs. Il nous faudra chaque parent et chaque citoyen·ne à nos côtés, pour demander, pour exiger un système d'éducation meilleur, à la hauteur des besoins des enfants, de nos attentes et de nos espoirs pour notre société.
Marion Miller est enseignante d'arts plastiques au secondaire et membre des comités de mobilisation de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal et de la Fédération autonome de l'enseignement.
Illustration : Ramon Vitesse

Palestine. Haro sur la censure

Depuis le début de la guerre israélienne contre la population palestinienne de Gaza, le 7 octobre, nous sommes témoins d'une recrudescence de cas de censure des opinions propalestiniennes. Cette volonté d'effacement vise spécifiquement l'expression de la solidarité et l'expertise qui démentent les discours officiels israéliens.
Cela n'a rien de nouveau. Les droits des Palestinien·nes sont violés en regard du droit international depuis 1948 et une surveillance injustifiée n'a cessé de s'exercer sur les initiatives en leur faveur. Récemment, les exemples de censure se multiplient dans les milieux littéraires, artistiques et universitaires.
Édition, arts et milieux universitaires
Paris, octobre 2023. Un libraire parisien, Patrick Bobulesco, constate qu'il n'a plus en stock un titre qui lui est régulièrement réclamé depuis la reprise des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza. Il s'agit de l'essai d'Ilan Pappé intitulé Le nettoyage ethnique de la Palestine, dont la traduction de l'anglais a été publiée en 2008 chez Fayard. Le célèbre auteur appartient à la mouvance des nouveaux historiens israéliens qui entendent repenser le sionisme et l'histoire de leur pays de manière critique.
Contacté par le libraire, le distributeur indique qu'il y a eu arrêt définitif de commercialisation depuis le 7 novembre. L'éditeur confirme : l'ouvrage a été retiré de leur catalogue. Or, des chiffres publiés par Edistat indiquent clairement que les ventes de ce livre sont en plein essor : 158 exemplaires se sont envolés entre le 9 et le 15 octobre, et 89 entre le 6 et le 12 novembre. Le retrait semble injustifié, malgré les explications de Fayard qui plaide la caducité du contrat. À noter que Fayard avait aussi publié, en 2008, le controversé père de la théorie du Grand remplacement, Renaud Camus, avec comme argument la défense de la liberté d'expression. Finalement, la maison d'édition La Fabrique (Paris) et les Éditions de la Rue Dorion (Montréal) ont négocié la reprise des droits. Le traducteur de la première édition, Paul Chemla, a pour sa part remis la main sur ses droits de traduction. Le livre d'Ilan Pappé devrait se trouver à nouveau dans les librairies en mai 2024.
Toronto, novembre 2023. Le conservateur d'art Amin Alsaden se prépare à ouvrir l'exposition de photos intitulée Lands Within sur la plateforme en ligne du Art Canadian Institute (ACI). L'exposition regroupe des artistes de culture arabe et souhaite exposer des photos de pays souvent sous-représentés en photographie.
Le 23 novembre, à quelques jours de l'ouverture, on informe Alsaden que l'exposition fera l'objet d'une lecture critique afin de s'assurer qu'elle n'offense pas les visiteurs. À la suite des protestations d'Alsaden, faisant valoir une lettre d'entente reçue en août, la direction décide de faire marche arrière. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.
On apprend, en effet, que Wanda Nanibush, conservatrice de la collection d'art canadien et autochtone du Musée des Beaux-arts de l'Ontario (AGO), elle-même anishinaabe, est subitement congédiée. Elle aurait, semble-t-il, exprimé son soutien aux Palestinien·nes et dénoncé le rôle de l'État israélien dans la colonisation et le génocide. La fondatrice et directrice du ACI, Sara Angel, a soutenu, avec d'autres, le renvoi de Wanda Nanibush. On apprend alors qu'elle siège au conseil de direction du Israel Museums and Arts, Canada (ICAAM). Il n'en faut pas plus : cette fois, c'est Alsaden et les artistes qui décident en bloc de mettre un terme à cette collaboration. Iels reprennent leurs œuvres, considérant que ces évènements représentent une menace directe à leur liberté d'expression.
Cambridge, janvier 2024. Claudine Gay, première femme noire et fille d'immigré·es haïtien·nes à présider la prestigieuse université de Harvard, est invitée à démissionner après moult tergiversations administratives (et idéologiques) et une cabale sans précédent. En fonction depuis juillet 2023, elle a appris bien malgré elle qu'on ne conteste pas le récit national israélien. Soupçonnée de n'avoir pas condamné avec suffisamment de vigueur les propos d'étudiant·es propalestinien·nes, dans l'esprit de préserver leur liberté d'expression et pour ne pas nuire à leur réadmission, elle sera tenue de rendre compte de ses actions et fera l'objet d'un interrogatoire pour le moins éprouvant. Dans cette enquête, menée par Elise Stefanik, une élue républicaine de la Chambre des représentants du Massachusetts, le verdict semble décidé à l'avance. Pour la faire tomber, on l'accuse même d'avoir plagié des passages de sa thèse, une accusation non fondée qui sera démentie par la suite. Acculée au pied du mur, elle remet sa démission le 2 janvier 2024.
Montréal, janvier 2024. Lorsqu'on parle de censure, les campus canadiens ne sont pas en reste. Dans un reportage de Radio-Canada, on apprend que cela frise la menace et son corollaire : la peur des représailles. Des étudiant·es de médecine l'ont appris à leurs dépens. En effet, plusieurs avaient signé une pétition de la Health Workers Alliance for Palestine (Alliance des travailleur·euses de la santé pour la Palestine) demandant un cessez-le-feu à Gaza. Pour la profession médicale, protéger la vie est un devoir moral. Mais des professeur·es membres de l'Association des médecins juifs ont intercepté la pétition et dressé une liste de ses 271 signataires. Iels se proposent de partager cette liste avec les directions chargées d'évaluer des demandes de jumelage pour les résident·es. Les signataires, de futurs médecins, risquent de ne pas obtenir leur premier choix de résidence ou d'entacher leur carrière professionnelle. On ne connaît pas le fin mot de l'affaire, mais la menace suffit à dissuader toute voix dissidente.
Montréal, février 2024. Une trentaine de livres de l'illustratrice Élise Gravel, bien connue pour ses dessins pour enfants et ses idées progressistes, sont mis à l'index par la Bibliothèque publique juive de Montréal et rendus accessibles uniquement sur demande. Notons que plusieurs livres d'Élise Gravel ont fait l'objet de censure dans des États conservateurs chez nos voisins du Sud. Depuis quelque temps, elle fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux parce qu'elle prend position pour la Palestine et contre la déshumanisation, à l'heure où des milliers d'enfants tombent sous les bombes à Gaza. Grâce aux pressions de citoyens, de son avocat Julius Gray, de l'organisme Voix juives indépendantes Montréal, ainsi que d'une motion votée au Parlement condamnant cette censure, ses livres seront remis sur les rayons de la bibliothèque. Élise Gravel n'a pas l'intention de se laisser réduire au silence.
Une longue expertise de la censure
On aurait tort de croire que ces récents événements sont inédits. Ils s'inscrivent en continuité avec une pratique de censure ininterrompue depuis le début de l'occupation israélienne en Palestine.
Par exemple, à Manchester, en août 2021, le directeur de la Whitworth and Manchester Art Gallery, Alistair Hudson, a dû quitter ses fonctions sous les pressions de l'Association de juristes britanniques pour Israël (UK Lawyers for Israel, UKLFI). Le motif ? Avoir organisé une exposition des travaux de Forensic Architecture, groupe de recherche multidisciplinaire qui enquête sur les violences d'État et les violations des droits de la personne dans le monde. L'exposition témoignait des opérations militaires israéliennes et du nettoyage ethnique que subissent les Palestinien·nes, et était assortie d'une déclaration en appui à la cause palestinienne. UKLFI soulevait des inexactitudes dans les contenus de l'exposition, ce qui a été formellement démenti par le groupe Forensic Architecture. À la suite du départ du conservateur Alistair Hudson, les artistes décident de retirer leurs œuvres en signe de protestation. Eyal Weizman, architecte israélo-britannique et fondateur de Forensic Architecture, commentait le départ de Hudson en déplorant l'intention de l'université qui héberge la galerie de faire taire le débat autour d'une question aussi importante.
De même, à Paris, à la suite des attaques perpétrées par l'armée israélienne contre Gaza le 6 août 2022, l'un des plus éminents spécialistes français du monde arabe, Alain Gresh, est invité par une grande chaîne d'information en continu, BFMTV, à commenter les événements. Il positionne son propos sur deux aspects précis. D'abord, l'armée israélienne a pris l'initiative de l'offensive et n'était pas en situation de légitime défense. Ensuite, ce sont les politiques israéliennes qui portent la responsabilité des violences dans la région, violences qui ne pourront cesser tant que le blocus de Gaza et l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ne seront pas levés, en conformité avec les résolutions de l'ONU. Dans la foulée de ces déclarations survient ce qu'il est convenu d'appeler une « tempête médiatique », et l'entrevue est rapidement retirée des ondes. La raison évoquée : puisqu'elle n'avait pas été diffusée en entier, on craignait qu'elle soit sujette à des manipulations… Voilà de quoi laisser dubitatif.
Allégations d'antisémitisme
Terminons par un petit tour en Allemagne, où des artistes juifs allemands font aussi l'objet de censure pour avoir soutenu la Palestine, même très longtemps avant les événements actuels. Interrogée par un journaliste du Guardian, l'artiste Candice Breitz témoigne. Le 24 novembre 2023, elle reçoit un appel du directeur de la Saarland Museum's Modern Gallery, en Allemagne de l'Ouest, qui l'informe de l'annulation de son exposition devant se tenir au printemps 2024. L'exposition n'avait aucun lien avec la Palestine. L'annulation avait été décidée unilatéralement, sans qu'aucun entretien n'ait eu lieu avec elle. Elle soupçonne des représailles concernant ses déclarations où elle évoquait « le carnage en cours en Israël-Palestine ». Lorsque plus tard des échanges ont lieu, le directeur lui apprend que cette annulation se justifiait par le fait qu'elle avait « peut-être signé une lettre de soutien à BDS » (Coalition « Boycott, Désinvestissement, Sanctions »). Toutefois, cette signature n'a jamais eu lieu. L'artiste explique qu'en fait, elle a appuyé une lettre de protestation contre une résolution du parlement allemand qui voulait désigner l'organisation BDS comme antisémite, et dont les signataires comprenaient des chercheur·euses spécialistes de l'Holocauste, plusieurs rabbins, et des personnes de confession juive, comme l'artiste elle-même.
L'antisémitisme est systématiquement évoqué pour légitimiser l'annulation d'un événement ou d'une prise de parole pour défendre la Palestine, quelle qu'elle soit. C'est là un argument de taille au regard de l'histoire tragique des communautés juives dans le monde. Et outre ce qui est relaté ici, l'on peut signaler un grand nombre d'occasions où les défenseur·euses de la Palestine sont bâillonné·es, licencié·es, annulé·es avec cet argument à l'appui.
Or, si des débordements injustes ont aussi eu lieu envers des personnes juives qui n'ont rien à voir avec la guerre menée par le Tsahal, l'enjeu est radicalement différent et ne saurait soutenir quelque comparaison que ce soit avec ce que défendent et soutiennent les artistes ou les intellectuel·les propalestinien·nes. Car ce sont les Palestinien·nes qui, par milliers, meurent ou sont menacé·es de mort, que ce soit par les bombes, la famine ou les maladies résultant de conditions sanitaires déplorables. Il est par conséquent incompréhensible que celleux qui dénoncent cette situation soient brimé·es dans leurs droits d'expression, et taxé·es de discrimination envers les personnes juives. Chaque fois où cela se produit, les censeurs se font les complices de la violence sioniste.
La censure, en fait, ne procède pas uniquement par effacement. Elle est aussi punitive, en ce sens qu'elle va jusqu'à prescrire des licenciements, ou privative, dans la mesure où elle empêche des événements d'être tenus. Et nous comprenons aussi que cette censure s'exerce parfois à la suite de simples soupçons, et de manière injustifiée. Ainsi, cette volonté manifeste d'imposer le silence se fait l'écho d'un génocide qui tarde à être reconnu comme tel par la communauté internationale.
Photo : Campement sur le campus de l'université Mc Gill, Montréal, avril 2024 (André Querry).

Une sagesse qui se perd

S'inspirant du mouvement anti-trans britannique, le gouvernement du Québec a créé un « comité de sage » censé légitimer la transphobie d'État. La résistance s'organise.
Après une escalade verbale de quelques semaines l'automne dernier impliquant le Parti conservateur du Canada, le Parti québécois et la CAQ sur les toilettes mixtes dans les écoles, le gouvernement de François Legault a annoncé la mise sur pied d'un comité pour « étudier les questions sensibles liées à l'identité de genre ».
Le gouvernement a ensuite entamé des négociations avec le directeur général du Conseil québécois LGBT dont la nature n'a pas été révélée par ce dernier, faisant l'objet d'une entente de confidentialité selon lui. En décembre pourtant, la ministre de la Famille annonçait un comité composé uniquement de personnes cisgenres, dont deux membres ayant des liens documentés avec PDF Québec, un des principaux lobbys transphobes de la province [1].
Devant le ridicule de l'exercice et l'ambiguïté volontaire de la mission du comité, une coalition de militant·es grassroot s'est formée pour demander sa dissolution pure et simple. Cet appel avait été appuyé par 143 organismes et plus de 1000 personnes au moment du lancement de la campagne intitulée Nous ne serons pas sages en avril dernier [2].
Les appuis viennent d'un large éventail de luttes, tant féministes que syndicales ou étudiantes, et des comités régionaux ont aussi été mis sur pied en Estrie, au Bas-Saint-Laurent et dans la région de Québec pour coordonner les efforts en dehors de la région métropolitaine. Après une première manifestation lors de la journée de la vengeance trans le 31 mars dernier, l'effort a également reçu le soutien du Réseau Enchanté, un rassemblement pancanadien d'organismes 2SLGBTQIA+.
Un village Potemkine
Selon François Legault, son comité aviseur aurait été créé pour apaiser les débats initiés par le mouvement 1 Million March 4 Children, qui avait affronté des militant·es queers antifascistes au centre-ville de Montréal en septembre dernier. Son rapport, prévu pour 2025, doit permettre d'adopter des orientations gouvernementales sur les questions liées au genre.
Cela n'a pas empêché Bernard Drainville [3], ministre de l'Éducation, d'annoncer un moratoire immédiat sur les toilettes mixtes dans les écoles du Québec en mai 2024, déclarant au Devoir qu'il avait « confiance que [les membres du comité des sages] n'arriveront pas à la conclusion inverse » [4].
L'honnêteté du ministre est surprenante, mais quand on compare le coût politique relatif de la transphobie dans les autres pays où le mouvement anti-trans a eu un certain succès, on remarque qu'il est plutôt favorable aux réactionnaires. En ce sens, il se pourrait que le gouvernement ne voie simplement plus l'utilité de prendre des pincettes. La panique médiatique accordée récemment aux transitions chez les mineur·es au Québec a sans doute contribué à cette perception.
L'écran de fumée n'aura duré que quelques mois, mais heureusement les militant·es de la campagne Nous ne serons pas sages et leurs allié·es auront su voir à travers dès le départ. Avec un véhicule politique et une base militante déjà mobilisée, ce mouvement est voué à prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le gouvernement abandonnera les gants blancs.
Mais la communauté trans seule est trop peu nombreuse pour remporter ce combat. Il faudra donc plus que des appuis et des paroles de la part des allié·es ; ça va prendre de l'argent et des bras.
[1] En ligne : https://pivot.quebec/2023/12/07/qui-sont-les-sages-qui-guideront-le-gouvernement-sur-la-question-de-lidentite-de-genre
[2] En ligne : https://pas-sages.info
[3] Bernard Drainville et Éric Duhaime s'exaspéraient ensemble de la « guerre des bécosses de Donald Trump » sur les ondes de FM93, le 23 février 2017. L'actuel ministre ridiculisait l'idée de toilettes genrées et souhaitait généraliser les toilettes mixtes.
[4] Marie-Michèle Sioui, Le Devoir, 1er mai 2024.
Judith Lefebvre est militante transféministe et queer.
Photo : André Querry
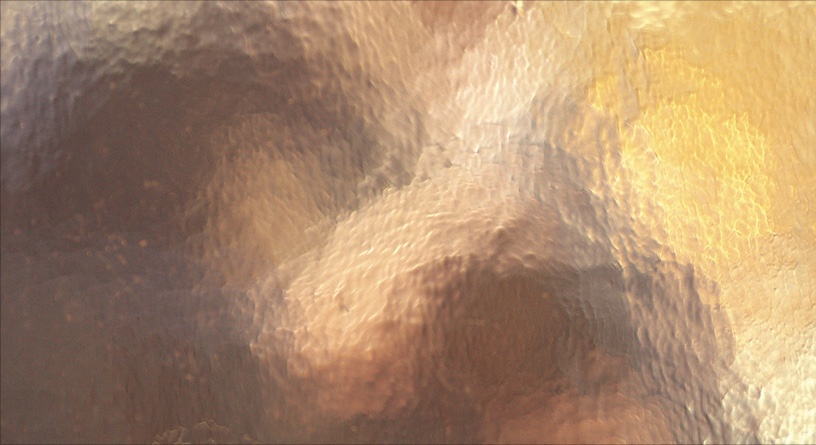
La figure québécoise dite colonisée et l’invisibilisation autochtone
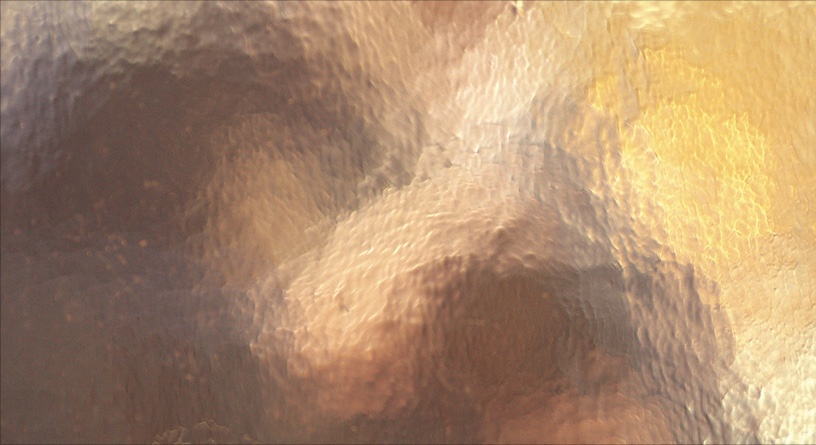
À l'occasion de la fête nationale du Québec, il semble important d'ouvrir un débat critique sur la figure du québécois comme figure colonisée, et d'évoquer les angles morts et les héritages, accidentels ou non, de cette représentation mise en avant par des revues comme Parti pris.
La revue politique et culturelle et maison d'édition des années 1960 Parti pris est essentielle pour comprendre les origines de la promotion d'une identité québécoise dite colonisée. Celle-ci présentait régulièrement les Canadien·nes français·es comme étant colonisé·es. Cette représentation a aussi été mise de l'avant par le célèbre essai de Pierre Vallières [1]. Une qualification difficile à accepter, voire à comprendre, et qui peut même sembler farfelue. Albert Memmi préférait dire des Québécois·e qu'ils étaient dominé·es et non colonisé·es [2]. Aimé Césaire s'amusait de l'exagération de Vallières lorsqu'il aperçut son livre dans une vitrine de librairie [3]. C'est que la qualification est étonnante, et le vocabulaire qu'elle mobilise l'est encore plus. Elle se révèle être un jeu, le jeu d'un devenir révolutionnaire. Le jeu, poussé à l'extrême, n'est pas sans rappeler les mots de Césaire dans Cahier d'un retour au pays natal : « de-peur-que-ça-ne-suffise-pas, de-peur-que-ça-ne-manque [4] ». Voilà l'effort partipriste de pousser l'identification victimaire au-delà de la raison, de peur que le combat nationaliste québécois ne soit pas pris au sérieux.
En identifiant le·a Québécois·e à la figure du colonisé, les membres de Parti pris ensevelissent les vécus autochtones. Trois hypothèses se présentent d'emblée. La naïveté peut-être – Emilie Nicolas a déjà répondu à cette hypothèse dans la revue Liberté [5]. L'ignorance alors ? Les écrits partipristes démentent cette hypothèse. Ils y reconnaissent « la lecture de Fanon et le vol de bâtons de dynamite [6] », que la vérité de la question nationale est une vérité première qui n'a pas à être soumise aux faits [7], et que « la parole, pour nous, a une fonction démystificatrice ; elle nous servira à créer une vérité qui atteigne et transforme à la fois la réalité de notre société […] nous ne visons à dire notre société que pour la transformer [8] ». Ainsi, les partipristes ont écarté d'eux-mêmes l'hypothèse de l'ignorance.
Spoliation identitaire
La seule hypothèse viable semble celle de la stratégie politique. La professeure Ching Selao a déjà présenté les pratiques discursives de Parti pris comme les outils d'une stratégie d'appropriation identitaire sans toutefois aborder l'absence de considération que de telles pratiques impliquaient à propos des présences autochtones sur le sol québécois [9]. Les Québécois·es qui pensaient la transformation de la société dans cette revue se sont approprié l'identité autochtone en se présentant comme indissociables du territoire, comme s'il n'y avait jamais eu de spoliation territoriale, effaçant totalement l'histoire des terres arrachées pour y ajouter une nouvelle spoliation discursive, celle de l'identité. Selon ce discours, les Québécois·es sont des Autochtones, ce qui ne laisse plus aucun espace aux Premiers Peuples. Dans le numéro de l'été 1964, Pierre Maheu écrivait qu'il faut « risquer l'irraison, pour retrouver nos racines [10] ». En posant les Québécois·es comme des figures indissociables du sol, portées par un destin révolutionnaire inévitable, Parti pris met en marche sa dialectique : les victimes québécoises vont renverser la société par l'entremise d'un socialisme décolonisateur. La revue efface la présence première des populations autochtones. Toutefois, il n'est pas uniquement question d'effacer l'Autre, il s'agit également d'usurper son identité. Ainsi, selon la revue, le Québécois est « autochtone, indigène, indien dans sa réserve victime d'un génocide culturel [11] ».
Les écrivain·es de Parti pris ont voulu rendre leur figure de colonisé crédible, réelle, convaincante, et ont utilisé des mots galvaudés pour en tracer les traits. Toutefois, en instrumentalisant le langage, ils ont évacué les souffrances et les vécus des communautés autochtones et des communautés noires. Paradoxalement, en travaillant les reliefs de cette figure, les partipristes ont également trahi leurs propres souffrances. Presque tous·tes les auteur·trices ayant par la suite dénoncé cette stratégie d'appropriation langagière reconnaissent dans leur analyse historique la domination économique exercée sur les populations francophones du Québec, les pressions exercées sur leur langue et leur culture. Iels soulignent également toutes les vicissitudes de l'impérialisme américain. Personne ne dément les souffrances canadiennes-françaises. Les réactions coléreuses de celles et ceux qui s'agrippent à une identité canadienne-française dite autochtone et colonisée sont ainsi injustifiées. En évacuant le réel pour rendre le mythe opérant, pour reprendre les termes de Roland Barthes [12], Parti pris a effacé ses véritables souffrances, et en s'appropriant celles des autres, a bâclé son propre combat.
Fêter l'évacuation des mythes
Pierre Bourdieu écrivait que c'est en nommant que l'on confère une existence sociale [13]. Parti pris n'a cessé de nommer le portrait du colonisé québécois, d'en travailler la figure. Les membres de la revue ont, du coup, donné naissance à cette figure fantasmée du Québécois autochtone, une figure sans aucune vraisemblance. Et puisque l'existence donnée à cette figure a été sculptée dans la colère, il apparaît aujourd'hui que ses mutations carburent encore à cette émotion. Le discours nationaliste est gavé d'un ressentiment que l'on s'acharne à défendre pour ne pas reconnaître qu'un dominé peut participer au projet colonial, que quelqu'un ayant souffert peut aussi faire souffrir d'autres. On protège cette colère pour ne pas avoir à écouter, pour continuer de s'offusquer de la douleur de celles et ceux qui occupaient déjà le sol avant nous. Ce discours nationaliste s'essouffle face aux émotions et aux souffrances qu'il refuse de reconnaître. Son vocabulaire a donné vie à une figure, mais refuse l'existence de personnes bien réelles.
Aujourd'hui, alors que les Québécois·es célèbrent leur fête nationale, il faut se souvenir que la figure du colonisé québécois construite par les partipristes était fallacieuse. Plutôt que de s'accrocher à la défense de cette figure colonisée, convenons que la situation est gênante. Plutôt que de se protéger de toute dissonance cognitive, le discours nationaliste québécois doit évacuer ses mythes. L'instrumentalisation des mots au service d'un devenir révolutionnaire en a terminé de consommer sa décrépitude. An Antane Kapesh a écrit : « Tu as préféré me voler, rien que pour pouvoir t'appeler QUÉBÉCOIS [14] ». La figure du colonisé québécois relevait du déguisement. Et les jeux du répertoire langagier ne sont toujours pas parvenus à rendre cette figure crédible.
[1] Pierre Vallières, Nègres blancs d'Amérique (Montréal : Parti pris, 1968).
[2] Albert Memmi, L'homme dominé : le Noir, le Colonisé, le Prolétaire, le Juif, la Femme, le Domestique (Paris : Gallimard, 1968), p. 87.
[3] Aimé Césaire, Le discours sur la négritude [1987] dans Discours sur le colonialisme (Paris : Présence Africaine, 2004 [1955]), pp. 81-82.
[4] Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal (Paris : Présence Africaine, 1983), p. 15.
[5] Emilie Nicolas, « Maîtres chez l'Autre », Liberté 326 (2020).
[6] Jean-Marc Piotte, « autocritique de parti pris », Parti pris 10 (septembre 1964), p. 43
[7] Paul Chamberland, « de la damnation à la liberté », Parti pris 9 (été 1964), p. 82.
[8] « Présentation », Parti pris 1 (Octobre 1963), p.2.
[9] Ching Selao, « Portrait du colonisé québécois : Peau blanche, masques noirs ? » dans Avec ou sans Parti pris : le legs d'une revue, Gilles Dupuis et al., dir. (Montréal : Nota Bene, 2018), 329-359.
[10] Pierre Maheu, « l'œdipe colonial », Parti pris 9 (été 1964), p. 29.
[11] Voir, entre autres, mais particulièrement, les numéros d'octobre 1963 et de l'été 1964 pour observer la répétition de ces formules.
[12] Roland Barthes, Mythologies (Paris : du Seuil, 1957), pp. 252-253.
[13] Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique (France : Fayard, 2014 [1991]), p. 328.
[14] An Antane Kapesh, Qu'as-tu fait de mon pays ? (Montréal : Mémoire d'encrier, 2020), p. 77.
Mathieu Paradis est candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal.
Photo : Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

Un Conseil national sans boussole

Le dernier Conseil national du 21 février de Québec solidaire devait clarifier la stratégie du parti à l'aube d'un cycle électoral crucial. Au lieu de décisions concrètes, les délégué·e·s ont été invités à consulter et discuter, tandis qu'une exemption controversée dans la circonscription de Gouin illustrait l'urgence électorale prenant le pas sur les principes. Retour sur un week-end qui en dit long sur les tensions internes et la fragilité de la démocratie interne du parti.
Quand discuter remplace décider à Québec solidaire
Le dernier Conseil national de Québec solidaire devait être un moment de clarification politique. À l'approche d'un cycle électoral incertain, alors que le gouvernement multiplie les projets de loi liberticides et que plusieurs associations locales vivent un essoufflement militant bien réel, nous avions besoin d'une chose simple : une discussion franche sur la conjoncture, une orientation stratégique assumée et des décisions claires.
Ce ne fut pas le cas.
Au terme d'une journée compressée, ce qui est déjà inhabituel pour une instance nationale, le sentiment dominant n'est pas celui d'un parti qui se dote d'une boussole, mais celui d'une organisation qui consulte beaucoup, échange longuement, puis reporte les choix politiques à plus tard. Un parti qui parle de stratégie, mais hésite à en décider une.
Trois éléments ont particulièrement cristallisé ce malaise : l'absence de véritable plan de rapport de force face aux offensives de la Coalition avenir Québec, la transformation progressive des instances décisionnelles en espaces de discussion sans mandat réel, et, surtout, la suspension d'une résolution démocratiquement adoptée concernant la circonscription de Gouin au nom d'une logique électoraliste.
Pris ensemble, ces épisodes ne relèvent pas de simples désaccords tactiques. Ils révèlent une tendance plus profonde : la dépolitisation de nos propres lieux de décision et un glissement vers une culture de gestion plutôt que de confrontation politique.
Une opposition parlementaire sans stratégie de rapport de force
Face à la multiplication des lois autoritaires, plusieurs délégué·e·s espéraient entendre une orientation claire de l'aile parlementaire. Quelle est notre stratégie pour bloquer ou ralentir ces projets de loi ? Y aura-t-il des tactiques d'obstruction ? Une coordination avec les syndicats et les mouvements sociaux ? Une articulation entre travail parlementaire et mobilisation populaire ?
Bref : comment construisons-nous un rapport de force réel ?
Les réponses sont demeurées étonnamment modestes autant de la part du caucus, mais aussi de l'exécutif (CCN). Pas de filibuster. Pas de plan pour ralentir systématiquement les travaux. Pas d'effort structuré de convergence avec les luttes sociales. La posture avancée relevait plutôt d'une logique d'« amélioration » : déposer des amendements, bonifier les textes, limiter les dégâts.
Il serait toutefois injuste de ne voir dans ce Conseil national qu'un enchaînement de reculs. L'adoption, à majorité, de la proposition d'urgence visant à lancer une campagne nationale contre le virage autoritaire du gouvernement de la CAQ et contre ses lois liberticides constitue l'un des rares moments politiques clairs de la fin de semaine. En appelant à dénoncer ces attaques, à construire un front social de résistance et à faire de QS un pôle d'appui aux luttes populaires, les délégué·e·s ont montré qu'une combativité subsiste un peu toujours dans le parti. Malgré la fatigue et les frustrations, la base militante ne demande pas moins d'ambition : elle demande un parti qui assume pleinement son rôle d'alternative et de rapport de force. Dès qu'on lui offre un mandat concret, elle répond présente. En espérant que l'exécutif du parti écoute et agisse dans cette direction…
Cette approche est compréhensible sur le plan technique. Mais politiquement, elle est insuffisante.
Quand un gouvernement gouverne à coups de bâillon et impose un « package deal » de réformes régressives, se contenter d'amender revient à accepter le terrain de l'adversaire. Sans stratégie assumée de confrontation, l'opposition parlementaire se transforme en gestionnaire critique. Elle accompagne le processus plus qu'elle ne le conteste.
Pour un parti qui s'est toujours présenté comme un relais des luttes sociales à l'Assemblée nationale, cette déconnexion est lourde de sens. Elle donne l'impression d'un repli institutionnel, d'une prudence défensive, comme si l'objectif premier n'était plus de changer le rapport de force, mais de paraître responsable.
Or, l'histoire des avancées sociales nous enseigne exactement l'inverse : sans pression extérieure, sans mobilisation, sans conflit assumé, les institutions ne cèdent rien.
Discuter sans décider : des instances vidées de leur sens
Le malaise ne se limitait pas à la stratégie parlementaire. Il traversait aussi la manière même dont le Conseil national était organisé.
Traditionnellement, ces instances servent à délibérer collectivement et à trancher des orientations politiques. Or, le seul véritable moment de « participation » proposé aux délégué·e·s aura été un atelier de 55 minutes pour parler de l'environnement politique au Canada, au Québec, du parti et des co-porte-parole : une consultation éclatée en une dizaine de salles, où les délégués ont été dispersés pour répondre à des questions larges, souvent vagues, sans mécanisme clair pour transformer ces échanges en décisions concrètes, contraignantes ou mandatées.
On nous parlait d'« espaces de dialogue », de « consultations », de « retours ». Mais sans mandat. Sans vote. Sans échéancier. Sans reddition de comptes. Un exercice d'expression, pas un exercice de pouvoir.
Le contraste était frappant : alors que cette brève parenthèse consultative se voulait participative, la matinée, elle, s'est surtout résumée à une succession de rapports — du Comité de coordination national, de l'aile parlementaire, des différentes instances — souvent descriptifs, rarement politiques, presque jamais suivis de prises de position ou de décisions. Beaucoup d'information, très peu de délibération. Certes nécessaire pour l'administration du parti, mais dérisoire face à l'ampleur de la tâche qui devait être devant nous.
À une question posée par certains militant.e.s sur un espace ou une instance décisionnelle et mandataire sur la stratégie électorale et sur la conjoncture politique devant nous.
La réponse, franchement décevante et balayant du revers de la main une question hautement pertinente : « On prend en note ».
À force, le décalage devient évident. Discuter n'est pas décider. Consulter n'est pas mandater. Informer, ce n'est pas écouter. Un parti politique ne peut pas fonctionner durablement sur la seule impression d'avoir été entendu.
Ce glissement transforme progressivement la démocratie interne en exercice symbolique. Les membres parlent, l'exécutif décide. Les instances deviennent des lieux d'expression, plus que des lieux de pouvoir.
Or, la fatigue militante ne vient pas d'un excès de démocratie. Elle vient du sentiment que notre implication ne change rien. Quand débattre ne mène pas à décider, l'engagement s'étiole.
Gouin : le moment où nos principes ont été testés
C'est toutefois sur la question de Gouin que ce malaise a pris une forme politique beaucoup plus nette.
En juin dernier, le parti adoptait une résolution visant à favoriser la représentation des femmes et des personnes non binaires dans certains contextes électoraux. Une mesure concrète, imparfaite sans doute, mais qui cherchait à traduire en actes notre engagement féministe.
Cette résolution devait maintenant être appliquée pour la première fois.
C'était un test.
Allions-nous respecter une règle adoptée démocratiquement, même si cela compliquait nos calculs électoraux ? Ou allions-nous la suspendre dès la première difficulté ?
L'exécutif a demandé une exemption, invoquant une « situation critique » et la possibilité d'une candidature d'envergure qui n'est toujours pas confirmée, mais pressentie — celle d'Alexandre Boulerice.
La question, pourtant, n'était pas la valeur d'une personne. Elle n'était pas de savoir si ce candidat serait compétent ou populaire. Elle était beaucoup plus fondamentale : une candidature, aussi forte soit-elle, justifie-t-elle de suspendre une règle adoptée collectivement pour promouvoir l'égalité ?
Car c'est précisément dans les moments difficiles que l'on teste ses principes.
S'ils tiennent seulement quand ils ne coûtent rien, ce ne sont plus des principes. Ce sont des slogans.
En ouvrant la porte à cette exception, nous avons créé un précédent. Chaque circonscription pourra désormais invoquer sa « situation particulière ». Chaque campagne pourra plaider l'urgence stratégique. À force de multiplier les dérogations, la règle perd toute crédibilité.
Le message envoyé est lourd. Lourd pour les militantes et les personnes non binaires qui envisageaient une candidature. Lourd pour les associations locales qui se voient déposséder de leur processus. Lourd pour l'image du parti, qui prétend vouloir faire « de la politique autrement », qui se dit féministe et qui affirme vouloir transformer la politique, mais plie ses engagements dès que la pression électorale augmente.
Plus encore, cette décision nourrit une culture de personnalisation. Elle laisse entendre que certaines candidatures valent plus que les règles communes, que la notoriété peut justifier des exceptions, que les « vedettes » priment sur le travail militant.
C'est exactement l'inverse de ce qui a toujours fait la force de QS.
Ironiquement, même sur le terrain électoral, le calcul est douteux. La logique des « candidatures vedettes » a déjà été testée par le passé, avec des résultats mitigés et peu d'enracinement durable. On ne remplace pas une organisation militante vivante par un nom connu.
Gouin est souvent présentée comme une circonscription vitrine, un château fort symbolique du parti. Mais un château fort ne se défend pas en suspendant ses principes. Il se défend en renforçant la confiance de celles et ceux qui y militent.
Au fond, cette décision révèle quelque chose de plus large : quand la base réclame des espaces décisionnels, on lui offre des consultations. Quand l'exécutif veut modifier une règle, on trouve rapidement les mécanismes pour leur vote.
Ce deux poids, deux mesures mine la confiance.
Et sans confiance, aucune stratégie électorale ne tient longtemps.
Quand la démocratie devient un « problème logistique »
Dans la foulée, la proposition de créer une instance nationale spécifiquement consacrée à la conjoncture et à la stratégie électorale a été rejetée.
Les arguments avancés : la lourdeur, les coûts, la fatigue des militant·e·s.
Soyons sérieux. La démocratie n'est pas un irritant administratif. C'est la raison d'être d'un parti militant.
On nous répond que ces discussions pourront avoir lieu au prochain congrès. Mais ce congrès sera, légitimement, consacré à l'adoption de la plateforme électorale. Un travail déjà immense : débats, amendements, arbitrages programmatiques. C'est normal et nécessaire.
Dire que nous y « discuterons aussi de stratégie » sans que cet espace soit décisionnel revient à déplacer le problème. On promet un débat qui ne pourra pas trancher. On reporte les choix vers un moment qui n'est pas conçu pour cela.
Autrement dit : encore de la discussion, peu de décisions.
Ce n'est pas la démocratie qui épuise. C'est l'absence de pouvoir réel.
Les membres ne se déplacent pas pour échanger des impressions. Ils se déplacent pour décider ensemble.
Un signal politique préoccupant
Pris isolément, chacun de ces épisodes pourrait sembler anecdotique. Ensemble, ils dessinent un portrait beaucoup plus clair.
Ce Conseil national révèle : une centralisation accrut des décisions, une multiplication d'espaces consultatifs au détriment d'instances décisionnelles, une priorité donnée à l'électoralisme défensif, et un affaiblissement du lien organique avec les luttes sociales.
Le parti qui se voulait un outil de mobilisation populaire risque de devenir une machine électorale prudente, cherchant avant tout à limiter les pertes plutôt qu'à transformer le rapport de force.
Cette tension existe depuis la fondation de QS. Mouvement ou parti institutionnel ? Outil de lutte ou formation gestionnaire ? Mais ce week-end, la balance a clairement penché d'un côté.
Et ce côté n'est pas le plus mobilisateur.
Retrouver le sens politique de nos instances
Ces débats ne relèvent pas de querelles internes. Ils touchent à notre crédibilité collective.
Un parti qui ne respecte pas ses propres résolutions aura du mal à convaincre qu'il respectera ses engagements une fois élu. Un parti qui hésite à débattre franchement de stratégie aura du mal à mobiliser. Un parti qui relègue ses principes féministes au second plan au nom de l'urgence électorale perd ce qui le distingue fondamentalement des autres.
Si nous voulons être autre chose qu'une version plus sympathique de la politique traditionnelle, nous devons faire l'inverse : redonner du pouvoir réel à nos instances, assumer des choix stratégiques clairs, tenir nos principes même lorsque cela complique la route.
La gauche ne gagnera pas en se montrant plus prudente que ses adversaires. Elle gagnera en étant plus démocratique, plus cohérente et plus fidèle à celles et ceux qui la font vivre.
Parce qu'au bout du compte, un parti qui ne décide plus collectivement finit toujours par subir les décisions prises ailleurs.
Et ce n'est certainement pas pour cela que nous avons choisi de militer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Négociations de 2023 : bilan et avenir du Front commun

L'automne 2023 restera dans les annales de l'histoire syndicale québécoise. Les négociations du secteur public y ont pris une ampleur inégalée dans les dernières décennies. Au cœur de ces dynamiques, un cartel syndical représentant la vaste majorité des travailleur·euses de l'État : le Front commun. Revenons sur cette bibitte bien québécoise et réfléchissons à son avenir.
Rappelons tout d'abord ce qu'est le Front commun : un cartel intersyndical composé, pour ces dernières négociations, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Le Front commun est une conséquence logique du système de négociation centralisé du secteur public québécois mis en place à partir des années 1960. L'État imposant que les discussions sur les enjeux salariaux et de régime de retraite, notamment, aient lieu au niveau national plutôt que par établissement ou secteur, les organisations syndicales se sont ajustées en créant des coalitions leur permettant d'établir un meilleur rapport de force.
Le premier Front commun date ainsi de la deuxième grande ronde de négociations du secteur public, en 1971-1972, et s'est répété depuis à plusieurs reprises. À quelques occasions toutefois, en particulier dans les années 1980, les différentes centrales ont décidé de négocier chacune de leur côté. La composition du Front commun est aussi à géométrie variable. S'il a toujours compté la FTQ, la CSN et la CSQ, le Front commun s'est élargi, en particulier dans les années 2010, aux membres du défunt Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) qui comptait, outre la CSQ, l'APTS, le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), et même pendant un temps le Syndicat des professionnel·les du gouvernement du Québec (SPGQ) et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). La configuration du Front commun de 2023 est donc unique, puisqu'elle comprend pour la première fois les trois centrales et l'APTS, mais pas les autres anciens membres du SISP. Par ailleurs, chaque organisation négocie séparément les enjeux non monétaires à des tables sectorielles, à de rares exceptions près (par exemple, les professeur·es de cégep de la CSN et de la CSQ, qui négocient à une table commune).
Contexte des négociations
Les négociations de 2023 se sont tenues dans un contexte particulier. Qualifié·es d'essentiel·les pendant la pandémie, les travailleur·euses du secteur public voulaient voir les remerciements se concrétiser en amélioration de leurs conditions de travail. L'inflation n'a fait que renforcer le besoin d'un rattrapage salarial avec le secteur privé, rattrapage dont l'urgence est mise en évidence depuis des années par les études de l'Institut de la statistique du Québec. Partout en Amérique du Nord et ailleurs, on constate une recrudescence des conflits de travail, donnant régulièrement lieu à des gains salariaux significatifs, comme dans les industries automobiles états-unienne et canadienne. Par ailleurs, les difficultés de recrutement et de rétention des employeurs du secteur public renforçaient d'autant plus l'argumentaire syndical en faveur d'une amélioration des conditions de travail.
Dans les faits, le Front commun était la locomotive des négociations de 2023. Ses syndicats représentaient près des trois quarts des effectifs de la santé et des services sociaux, presque 80 % de ceux du réseau de l'éducation, et la quasi-totalité des travailleur·euses du réseau collégial. Le rapport de force numérique ne compte toutefois pas pour grand-chose s'il n'est pas exercé. À ce titre, le Front commun a une histoire mouvementée. L'imposition des conditions de travail par décret en 2005 a marqué les esprits, ce qui a sans doute contribué à refroidir les ardeurs des dirigeant·es lors des négociations suivantes, lors desquelles pas ou très peu de journées de grève ont été utilisées. Cette frilosité n'a pas été sans entraîner de contestations à l'interne, menant par exemple à l'établissement de réseaux d'affinités cherchant à pousser les directions syndicales dans une direction plus combative, comme Lutte commune.
Cette fois-ci, le contexte politique et économique a permis aux syndicats du Front commun d'aller chercher des mandats de grève très forts dès le début de l'automne. L'impopularité croissante du gouvernement Legault, pris entre les fiascos de l'invitation des Kings de Los Angeles, du troisième lien de Québec et des cadeaux à Northvolt, a sans doute contribué à renforcer les convictions des syndiqué·es, mais aussi à les voir soutenu·es par une part significative de l'opinion publique, chose plutôt rare lors des rondes précédentes. Forts de ces mandats et de l'appui du public, les syndicats du Front commun font une première journée de grève le 6 novembre, qui donne lieu à la désignation d'un conciliateur, puis enchaînent avec trois journées supplémentaires, du 21 au 23 novembre. C'est à cette dernière date qu'ils sont rejoints par la FIQ et la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), ce qui en fait l'une des plus grosses journées de grève de l'histoire du Québec, avec 570 000 employé·es de menant ainsi à l'une des plus longues grèves du secteur public que le Québec ait connues.
Les chiffres compilés par Statistique Canada sont éloquents : 2023 est l'année comptant le plus d'heures de travail perdues pour conflit de travail au Québec depuis au moins le début du siècle. Le Québec compte par ailleurs pour plus de 60 % des heures de travail perdues pour conflit de travail au Canada, et près de 80 % de celles des absences de moins d'une semaine. Le Front commun n'est certes pas le seul acteur de ces conflits, mais sa taille en fait un facteur déterminant. Faisant planer la possibilité d'une grève générale illimitée, le Front commun obtient une entente à la table centrale avant les Fêtes, qui sera suivie par des ententes aux tables sectorielles dans les semaines suivantes. Soumise aux membres en vertu des règles propres à chaque organisation (il n'y a pas de procédure d'adoption uniforme au sein du Front commun), l'entente centrale est adoptée avec des taux généralement plus élevés que les ententes sectorielles, illustrant ainsi que la question des conditions de travail est loin d'être réglée dans le secteur public.
Résultats des votes et perspectives syndicales
Les conditions et les résultats des votes au Front commun ont été moins controversés qu'au sein de la FAE, mais aucun syndicat ne devrait faire l'économie d'un bilan et d'un débat sur la démocratie et la vie syndicales dans le contexte des négociations du secteur public. La centralisation et l'unité ont incontestablement leurs avantages : elles permettent une uniformisation des conditions de travail et l'établissement d'un rapport de force rarement vu ailleurs en Amérique du Nord. Le simple fait que l'unité permette, dans une certaine mesure, de contourner les limites imposées par les lois sur les services essentiels (les enseignant·es faisant, par exemple, grève pour les travailleur·euses de la santé puisque leurs conditions salariales sont négociées à la même table) fait l'envie de bien des syndicats dans le reste du Canada.
Le défi en matière de démocratie syndicale est toutefois de taille. En éloignant ainsi le lieu de prise de décision des milieux de travail, on crée une distance en tension avec un modèle nord-américain favorisant l'échelon local. Les refus d'ententes de principe ont certes été plus nombreux ces derniers temps qu'auparavant (à l'image de celui de membres de la FIQ), mais ils présentent tout un défi dans le cadre de négociations centralisées. Chose certaine, ça n'est pas la réforme Dubé en santé et services sociaux qui risque d'arranger les choses. En forçant le regroupement de la représentation syndicale en six unités nationales, elle va conduire à la création de mégasyndicats et nuire à la pluralité syndicale typique du Québec. Le Front commun est certes un exercice de centralisation, mais il est volontaire et négocié. Figer la situation dans la loi comme l'impose le gouvernement Legault risque de créer des rivalités inutiles à court terme et de compliquer la vie syndicale à long terme. Souhaitons donc que les organisations puissent tabler sur la mobilisation exceptionnelle de l'automne 2023 afin de contourner ces nouvelles contraintes, raviver leurs instances et faire (re)vivre ce mouvement collectif et démocratique au-delà des périodes de « crunch » des négociations. Sans cela, l'avenir et l'unité du Front commun et de ses composantes resteront bien incertains.
Photo : André Querry

Secteur culturel : formes, limites et possibilités de l’action collective
Le secteur culturel subit actuellement une importante crise qui affecte autant les artistes que les travailleur·euses culturel·les, les organismes et les collectifs qui le composent. Reprise post-pandémique inégale, coupes budgétaires importantes chez les principaux bailleurs de fonds publics, exacerbation de la compétition entre individus et entre organisations pour accéder aux ressources, pénurie de main-d'œuvre, pressions inflationnistes…
L'étude des conditions de travail des artistes et de la main-d'œuvre culturelle révèle d'importantes formes de précarité au niveau de leurs revenus, qui demeurent largement inférieurs à ceux de la moyenne de la population active. La précarité se matérialise aussi par des barrières d'accès à un réel filet social ou le manque de reconnaissance professionnelle. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant d'observer une mobilisation accrue des artistes et des travailleur·euses culturel·les pour dénoncer les réponses gouvernementales à la crise, jugées insuffisantes ou inadéquates, et revendiquer des changements.
Dans les derniers mois, de nombreuses prises de parole ont circulé dans les médias, des manifestations ont eu lieu, ainsi que des initiatives de solidarité vis-à-vis d'autres mouvements sociaux. Parmi ces stratégies, la syndicalisation brille pourtant par son absence. Comment expliquer ce phénomène ?
La précarité n'est pas une fatalité
La précarité n'est pas subie passivement par les artistes et les travailleur·euses culturel·les qui la subissent. Iels déploient plutôt, sur une base continue, de nombreuses actions visant à leur permettre de persévérer dans des carrières qui partagent plusieurs similitudes : haut degré d'incertitude, particulièrement pour les personnes dont l'organisation du travail se fonde sur les projets, faibles salaires par rapport aux niveaux élevés de scolarité, accès inégal et limité à des régimes d'assurances et de retraite, etc. Contrairement aux représentations stéréotypées des artistes, qui les dépeignent comme des êtres hautement individualistes et solitaires, la plupart des stratégies mises en place revêtent au contraire une dimension collective.

Dans son étude sur les artistes montréalais·es en arts visuels en contexte de précarité du travail [1], Laurence Dubuc souligne la diversité de ces stratégies. Certains groupes cherchent à collaborer avec les pouvoirs publics dans le but de trouver des solutions durables à des enjeux particuliers, comme la gentrification et le manque d'espaces de travail abordables pour les artistes (comme le fait le Regroupement Pied Carré), alors que d'autres visent à unifier des professions culturelles hétérogènes dans le but de se donner une voix collective, un plan d'avenir et des outils pour mieux affronter la précarité (comme le Regroupement TRACE). Au niveau de la syndicalisation, Dubuc documente aussi le cas du défunt syndicat S'ATTAQ, affilié à Industrial Workers of the World (IWW), qui visait à syndiquer des travailleur·euses autonomes œuvrant dans différents secteurs. Le modèle de syndicalisation de S'ATTAQ différait du régime de rapports collectifs institué par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène. Ce dernier se caractérise par un régime de représentation et de négociation collective qui se déploie à l'échelle sectorielle et qui permet à un nombre significatif d'artistes qui travaillent à titre indépendant d'être couvert·es par des ententes collectives qui fixent des conditions minimales d'embauche.
La précarité du travail ne constitue pas une fatalité, mais bien le résultat d'un système de distribution arbitraire des ressources et des inégalités dans un temps et un espace donnés [2]. En critiquant les discours dominants sur la précarité, il demeure possible de rejeter une posture fataliste en explorant ou en (re)découvrant des actions qui la combattent et qui y résistent activement. La tenue de la Grande Manifestation pour les Arts #1 devant les bureaux du ministère de la Culture et des Communications du Québec le 18 avril 2024 constitue un autre témoignage de l'engagement des artistes et des travailleur·euses culturel·les sur le plan politique.
Qu'en est-il dans le secteur culturel ?
Dans le secteur culturel québécois, où une majorité de travailleur·euses sont salarié·es, on observe aussi un faible taux de syndicalisation malgré d'importants niveaux de précarité. Bien sûr, le travail culturel recouvre une variété de professions et de domaines : création et production artistique, technique et opérationnel, collecte et préservation du patrimoine, gestion de la culture, etc. Les conditions de travail varient aussi en fonction d'autres facteurs tels que la taille de l'organisation, son budget, ses sources de financement, le poste en question, etc.

Même si les revenus tirés d'un emploi culturel demeurent en moyenne plus élevés que ceux qui découlent de l'exercice d'une pratique artistique, l'étude des salaires dans les organismes culturels québécois réalisée par Compétence Culture en 2019 montre qu'une part significative des postes classiques (4 sur 11) sont associés à un salaire horaire qui oscille entre 20 et 25 $ [3]. Ceci est préoccupant considérant que l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a établi le revenu horaire viable pour le Québec à 20 $ de l'heure en 2023 [4]. Autrement dit, une part significative de postes dans les organismes culturels du Québec permettent à peine aux personnes qui les occupent de vivre une vie exempte de stress financier. La même étude de Compétence Culture révèle également des lacunes importantes relatives aux protections conférées par le travail culturel, et notamment au niveau de l'accès des travailleur·euses à un régime d'assurances collectives et à un régime de retraite. Encore une fois, le faible taux de syndicalisation intrigue et interpelle.
Limites et possibilités de la syndicalisation
Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi la communauté culturelle priorise souvent des stratégies de luttes plus éphémères, spontanées ou horizontales plutôt que des tactiques institutionnalisées comme la syndicalisation. Outre le manque d'éducation en matière de droits au travail, l'organisation du secteur fait souvent paraître la syndicalisation comme un outil contre-productif. Les structures artistiques et culturelles, elles-mêmes souvent largement financées par l'État et donc également victimes de la précarisation ambiante, sont régulièrement perçues comme des partenaires plutôt que des employeurs. Au sein des nombreux OBNL qui composent l'écosystème culturel, l'usage de tactiques syndicales classiques comme la grève n'est pas toujours susceptible d'avoir le même impact qu'au sein de structures tournées vers l'accumulation de profits.
Si la syndicalisation peut paraître, aux yeux des artistes et des travailleur·euses culturel·les, comme une stratégie peu attrayante, voire hors de leur portée, il demeure que des gains significatifs en matière de droits au travail pourraient être acquis dans de plus grosses organisations ou entreprises culturelles par la syndicalisation. Cependant, des obstacles au niveau de la capacité et de la volonté des syndicats d'organiser efficacement le travail culturel persistent. Au-delà de l'absence potentielle de volonté politique et financière des syndicats à s'engager dans une telle démarche, le fait que ceux-ci déploient généralement leurs actions de manière décentralisée et non coordonnée à travers les établissements constitue une limite importante à l'amélioration des conditions de travail d'un point de vue structurel. La compétition entre syndicats nuit également à leur collaboration. Cette approche devra changer pour que de véritables gains collectifs soient envisageables dans le futur.
[1] Laurence D. Dubuc, L'action stratégique des artistes en arts visuels et de leurs collectifs en contexte de précarité du travail : Quel(s) rôle(s) pour les centres d'artistes autogérés situés à Montréal ?, thèse de doctorat, École de relations industrielles, Université de Montréal, 2022.
[2] Isabell Lorey, State of Insecurity : Government of the Precarious, Londres, Verso, 2015.
[3] Compétence Culture, « Étude sur la rémunération des travailleurs culturels au sein des organismes artistiques et culturels québécois », 2019. En ligne : competenceculture.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/fc3e2bb03cf7aeb_file.pdf
[4] Louis Gagné, « Au Québec, gagner moins de 20 $ de l'heure condamne à rester pauvre ». En ligne : ici.radio-canada.ca/nouvelle/1976149/etude-revenu-viable-quebec-2023-iris-inflation-hausse-prix-salaire-minimum-pauvrete
Laurence D. Dubuc est chercheure associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT-Université de Montréal) ; Maxim Baru est syndicaliste.
Photos : Arts Manif du 18 avril 2024 (Selena Phillips-Boyle)
France : le meurtre d’un militant fasciste achève la diabolisation de la gauche radicale

La victoire du PQ dans Chicoutimi, un indice de la volatilité de la scène électorale

Si le PQ connaît une septième victoire dans des élections partielles, il serait erroné de croire que l'électorat a clairement défini ses choix et que les prochaines élections québécoises ne seront qu'une formalité. En fait, les élections dans Chicoutimi ont montré des glissements importants dans les allégeances du corps électoral. Face aux crises qui multiplient les difficultés vécues par la majorité populaire et qui ancrent des angoisses profondes, la volonté d'en finir avec cette situation ouvrira une période d'importants débats et de redéfinition des loyautés. Les élections qui viennent poseront donc d'importants défis aux partis, et particulièrement à la gauche politique.
Des résultats qui illustrent des changements politiques profonds
La victoire du Parti québécois dans Chicoutimi marque indéniablement un moment politique fort, à la fois symbolique et révélateur. Avec 45,35 % des voix (6 999 votes), Marie-Karlynn Laflamme permet au PQ de reconquérir un ancien bastion perdu en 2018 et confirme une quatrième victoire consécutive en élection partielle depuis 2022. Elle a dû remonter une pente importante, car le PQ avait alors dû se contenter de 14,2 % des votes. Ce retour s'inscrit dans un rejet clair du statu quo caquiste.
Le scrutin a d'abord valeur de sanction. La Coalition avenir Québec, qui avait récolté plus de 62 % des voix en 2022 dans Chicoutimi, s'effondre à 11,97 % (1 848 votes). Il s'agit d'un véritable effondrement. Comme l'écrit Philippe J. Fournier de QC125 : Lors de l'élection partielle d'Arthabaska, l'été dernier, la CAQ s'est complètement effondrée, perdant 44 points par rapport à son résultat de 2022. À Chicoutimi, la CAQ termine avec 12 % des voix, soit 50 points de moins qu'en 2022. Cette chute vertigineuse traduit l'usure d'un gouvernement perçu comme déconnecté, brouillon et miné par les scandales, et dont les politiques ont aggravé les crises concrètes vécues par la population : logement, itinérance, accès aux soins, surcharge du réseau de la santé, crise de l'école publique et irresponsabilité face aux changements climatiques. L'absence de figures nationales caquistes sur le terrain et l'ambiance de fin de régime autour du candidat illustrent un parti en perte de légitimité, bien au-delà d'un simple accident électoral.
La véritable percée de la soirée est celle du Parti conservateur du Québec, qui termine deuxième avec 26,07 % (4 023 votes), triplant ses appuis par rapport à 2022, où il avait recueilli 8,43 % des voix. Cette montée de la droite populiste doit inquiéter. Elle capte une colère réelle — contre l'inflation, l'insécurité économique, l'abandon régional — mais la détourne vers des solutions idéologiques régressives, individualistes et souvent hostiles aux solidarités collectives et aux mouvements sociaux. Le fait que ce vote conservateur dépasse largement celui de la CAQ indique que le rejet du gouvernement sortant ne se traduit pas mécaniquement par un déplacement vers la gauche du champ politique. C'est plutôt le constat inverse qui tend à s'imposer.
Dans ce contexte, la situation de Québec solidaire est particulièrement préoccupante. Avec 5,59 % (862 votes), QS poursuit un recul entamé depuis 2018, malgré un terrain objectivement favorable à un discours de gauche : circonscription urbaine, présence d'un cégep, d'une université, d'un milieu communautaire actif et d'un bassin important de travailleuses et travailleurs du secteur public. En 2022, Québec solidaire avait obtenu plus de 12 % du vote. Le fait que QS ne capte aucun des votes libérés par l'effondrement caquiste souligne l'absence d'un rapport de force social suffisamment structuré pour porter ses propositions contre la vie chère, pour des services publics accessibles, pour des logements abordables et pour un avenir vert, mais aussi une difficulté stratégique et organisationnelle profonde, qui reste à surmonter face aux élections générales à venir.
Le Parti libéral du Québec, avec 9,13 % (1 409 votes), améliore son score famélique de 2022, soit 3,04 %, sans pour autant redevenir un acteur crédible. Sa progression est davantage mathématique que politique et ne constitue en rien une alternative pour les classes populaires ou les régions. Même s'il est vrai que la crise qu'a connue récemment ce parti et le manque de notoriété de son nouveau chef ont pu jouer un rôle certain dans la nature de ses résultats.
Les leçons politiques tirées par Paul St-Pierre Plamondon
Du côté du PQ, le discours de victoire de Paul St-Pierre Plamondon révèle une tension centrale. Tout en réaffirmant l'engagement de tenir un référendum dans un premier mandat, il reconnaît explicitement que le contexte géopolitique — notamment l'imprévisibilité de l'administration américaine et la figure de Donald Trump — alimente une peur réelle dans l'électorat. Le porte-à-porte qu'il a effectué dans le comté a été pour lui révélateur de la peur de nombre de ses concitoyen·nes face à la situation géopolitique. Le chef péquiste a tenté de rassurer en parlant d'une « fenêtre de quatre ans » avant la tenue d'un éventuel référendum, du départ de Trump d'ici là et de la protection des PME face aux risques de représailles économiques qu'un gouvernement péquiste devrait assurer. Ces propos rassurants posent toutefois une question fondamentale : peut-on relancer un projet d'indépendance sans affronter frontalement les rapports de force économiques, commerciaux et sociaux qui structurent déjà la dépendance du Québec, en se contentant d'éviter les provocations envers notre puissant voisin ?
Des élections qui expriment le désir d'un changement réel
D'un point de vue de gauche, la victoire péquiste exprime un désir de changement réel, une lassitude envers un gouvernement technocratique et autoritaire, et une volonté de redonner un rôle politique aux régions. Mais les politiques mises de l'avant par la direction de PSPP ne garantissent pas que le Québec pourra dépasser les multiples crises auxquelles il doit actuellement faire face. Le faible taux de participation (34,22 %) rappelle que cette victoire repose sur une mobilisation limitée et que de larges segments de la population demeurent à distance du jeu électoral.
En somme, Chicoutimi « revient à la maison » péquiste, mais la maison elle-même reste à définir, et ce ne sont pas les maigres réflexions offertes jusqu'ici par le Livre bleu qui permettent d'être rassurés. Sans un projet clairement arrimé à la justice sociale, à la redistribution de la richesse, à la transition écologique, à l'élargissement réel de la démocratie et à une conception pluraliste de l'indépendance, le risque demeure que le désir de changement profite autant — sinon davantage — à une droite conservatrice en quête de légitimité qu'à une transformation émancipatrice du Québec.
Illustration : Qc-125
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Communauté Milton Parc

L’histoire de Milton Parc est avant tout celle d’un quartier ancien et délabré situé à la périphérie du centre-ville de Montréal et composé de belles maisons victoriennes en pierre grise. Menacés d’expulsion par un grand promoteur immobilier, les voisines et voisins s’organisent pour la survie du quartier et réussissent à partir des années 1970, et dans les années qui suivent, à en faire une communauté coopérative démocratique unique au Québec et au Canada. Les résidentes et résidents ont créé 22 organismes sans but lucratif pour gérer leurs logements. Ils ont consacré au moins un million d’heures aux finances, à l’entretien, à la sélection des nouveaux et nouvelles locataires et aux comités de gouvernance de ces organismes. Ils y ont élevé leur famille. Ils ont siégé aux conseils d’administration pour aider les personnes âgées vulnérables ainsi que les femmes et les hommes menacés d’itinérance qui ont eu la chance de vivre dans ce quartier Milton Parc, dans des maisons de chambres et des foyers sûrs et abordables pour personnes âgées. Ils ont pris de nombreuses initiatives sociales, économiques et écologiques axées sur la justice, l’égalité des genres et la protection des personnes vulnérables. Ce texte en est la présentation.
L’histoire de Milton Parc
| Années 1960 | Années 1970 | Années 1980 | Années après 1980 |
| – Des promoteurs ont acheté la plupart des immeubles dans six îlots de maisons du centre-ville de Montréal, près du campus de l’Université McGill.
– 250 maisons sont démolies. – Il y a le développement d’un hôtel, d’un immeuble de bureaux, de 3 tours résidentielles et d’un centre commercial souterrain. |
– La communauté se bat, menée par des résidentes et résidents intéressés par le logement abordable, les coopératives et la préservation.
– La communauté se rattache au mouvement patrimonial montréalais et au mouvement politique communautaire progressiste. |
-La communauté prend le contrôle de son quartier en formant l’un des plus grands projets coopératifs du pays.
– Elle apprend à gérer des coopératives et d’autres entreprises à but non lucratif. – Elle supervise la rénovation de leurs maisons. |
– La copropriété à vocation sociale est mise en place et la Communauté Milton Parc en devient la gardienne, sous contrôle local, des buts et objectifs de la communauté.
-Les résidentes et résidents se battent pour plus d’habitation coopérative, des solutions écologiques et la justice sociale. – Ils veulent créer des endroits pour les sports, la récréation et l’éducation, ainsi qu’une taverne communautaire. Ils veulent aider les personnes vulnérables. |
Contexte du réaménagement de la communauté Milton Parc
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans une communauté forte qui s’est mobilisée contre les stratégies de réaménagement de la Ville de Montréal. Il fallait arrêter la démolition des maisons de Milton Parc par le projet immobilier de La Cité.
Dès le départ, deux amies montréalaises ont partagé leurs forces et leurs convictions pour transformer Milton Parc. Il s’agit de l’architecte Phyllis Lambert[3] et de la travailleuse sociale Lucia Kowaluk[4]. Quant à lui, le Groupe de ressources techniques Milton Parc (GRT) – l’équipe professionnelle chargée de réaménager les immeubles, d’assurer la liaison avec le gouvernement et les institutions financières et de renforcer les capacités locales – a travaillé sans relâche et n’a ménagé aucun effort pour atteindre ses objectifs.
Le projet Milton Parc a constitué un tournant dans les stratégies de rénovation urbaine de la Ville de Montréal : on ne démolit pas des quartiers anciens bien situés même s’ils sont délabrés pour les remplacer par des tours commerciales et résidentielles et ainsi déloger les anciens habitants et habitantes qui n’avaient plus les moyens d’y vivre.
Par le projet Milton Parc, on a sauvegardé le tissu physique, social et économique de la communauté où les résidentes et résidents sont très engagés avant, pendant et après le réaménagement, où ils forment des coopératives et des organismes sans but lucratif, gèrent les rénovations, où ils sont propriétaires – à but non lucratif – de leur logement et où les droits d’occupation après les travaux restent abordables.
Buts et objectifs de Milton Parc
Les buts et objectifs de Milton Parc élaborés en 1979 ont été consacrés dans le Plan d’action de Milton Parc, préparé par James McGregor du Conseil de développement de logement communautaire, en étroite collaboration avec la Communauté Milton Parc et le Groupe de ressources techniques communautaires Milton Parc. Les différents éléments de ces buts et objectifs témoignent du caractère communautaire et démocratique du projet.
1. Aucun résidant ne sera expulsé pour des raisons économiques.
2. Les immeubles seront détenus et administrés sans but lucratif.
3. Le contrôle ultime de la communauté sera entre les mains des résidents.
4. De petits groupes seront formés pour posséder et administrer les immeubles.
5. Aucun membre du projet ne sera expulsé parce qu’il n’est pas impliqué dans l’administration de l’immeuble dans lequel il réside.
6. Les bâtiments seront rénovés.
7. Des fonds gouvernementaux de tous les niveaux seront utilisés.
8. Les ressources et les compétences nécessaires à l’accomplissement des objectifs du projet seront fournies.
9. Les ressources existantes dans le projet et dans la communauté seront utilisées.
10. Afin d’atteindre les objectifs financiers ainsi que l’objectif de contrôle par les résidents, la propriété des immeubles sera transférée d’ici mai 1982.
Stratégies gagnantes d’une communauté forte
La communauté Milton Parc porte des convictions progressistes et est audacieuse. Elle se réunit pour établir un consensus sur des stratégies gagnantes à l’origine d’une liste impressionnante de réalisations inhabituelles et innovantes :
1. Une avance de fonds pour l’achat des immeubles est permise.
2. Le programme de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), adapté pour Milton Parc, reconnait les droits acquis des locataires, de sorte que les loyers après les rénovations restent abordables, non seulement dans Miton Parc, mais à travers toute la ville.
3. Les maisons de chambres sont reconnues comme éligibles aux subventions.
4. Le supermarché Steinberg décide de ne pas construire un dépanneur sur un terrain vacant adjacent aux maisons.
5. La Cour accorde une injonction pour arrêter la démolition de l’annexe de l’école secondaire D’Arcy McGee pour en faire un stationnement.
6. La Ville accepte de ne pas démolir de logements afin de faciliter la circulation à l’angle de la rue Jeanne Mance et de l’avenue des Pins.
1979-1988 : mise en place des structures organisationnelles qui ont permis le réaménagement de Milton Parc
La mise en œuvre de ce projet d’envergure a nécessité la création de plusieurs organismes « hors marché », une démarche unique à ce processus.
Il y a d’abord la Société d’amélioration Milton Parc (SAMP), un organisme cadre sans but lucratif qui était propriétaire des immeubles de Milton Parc pendant le réaménagement. La présidente Phyllis Lambert a réuni au sein du conseil d’administration un groupe diversifié d’administrateurs et d’administratrices possédant des compétences et une expérience solides dans les domaines du droit, de l’urbanisme et du développement communautaire, de la finance, de l’immobilier et du renforcement des capacités.
J’ai occupé le poste de directeur général de la SAMP ainsi que du GRT. Mon expérience d’avocat du premier bureau de l’aide juridique à Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, a été précieuse[5].
Pour sa part, l’aide du Groupe de ressources techniques Milton Parc a permis de renforcer les capacités des 21 coopératives et organismes sans but lucratif qui ont été créés : 15 coopératives d’habitation et 6 organismes sans but lucratif contrôlés par des résidentes et résidents et des représentantes et représentants sociaux, communautaires et religieux. En outre, un organisme sans but lucratif a été mis sur pied pour gérer 12 bureaux et espaces commerciaux répartis dans la communauté.
Le groupe a offert des services d’architecture dirigés par l’architecte Pierre Beaupré[6] et, conjointement avec des chargés de projet[7], des services pour négocier et obtenir les autorisations techniques de la SCHL, de la Ville de Montréal et de la Société d’habitation du Québec, pour obtenir des prêts assurés par la SCHL et des prêts à long terme des institutions financières.
Quelques faits saillants du réaménagement
Le nombre de bâtiments, leur typologie, les revenus des résidentes et résidents ainsi que les coûts et les sources de financement sont les éléments clé de cette démarche.
Il y avait 133 bâtiments répartis sur six îlots comprenant des immeubles qui ont été construits au début du siècle avec des façades en pierre grise. Ces bâtiments ont été convertis en maisons familiales et en 24 maisons de chambres ; certains ont constitué un bloc d’appartements – un des premiers blocs d’appartements de Montréal –, d’autres une tour de six étages et 12 bureaux et espaces commerciaux.
Les logements, autour de 600, sont de plusieurs types : 118 chambres ; 69 studios ; 175 unités ayant 1 chambre à coucher ; 109 ayant 2 chambres à coucher ; 98 ayant 3 chambres à coucher ; 21 ayant 4 chambres à coucher ; 7 ayant 5 chambres à coucher ou plus.
Le revenu moyen des ménages vivant dans les coopératives et autres OSBL contrôlés par des résidents était de 14 860 dollars ($) en 1982, alors que 66 % des ménages vivant dans des immeubles pour personnes âgées et des maisons de chambres gagnaient en 1981 moins de 7 000 $ et 30 % gagnaient entre 7 000 et 15 000 $.
Les coûts totaux des investissements sur la période de développement 1979-1988 se sont élevés à 30,7 millions de dollars. Les subventions d’investissement ont été accordées par le fédéral (2,2 M$), Québec (1,6 M$), Montréal (2,2 M$) et la SCHL. Le prêt accordé par cette société fédérale l’a été en vertu d’un programme annuel de réduction des taux d’intérêt, d’une durée de 35 ans : la première année, la SCHL a donné une subvention de 4 M$[8].
Le financement de la SCHL pour l’achat des immeubles de Milton Parc comportait l’obligation de préparer un plan d’action viable en dedans de six mois. Le défi a été relevé et cela a permis la création d’un quartier « hors marché » durable comportant 133 bâtiments appartenant à 21 coopératives et OSBL.
Mise en place d’une copropriété à vocation sociale
La Communauté Milton Parc et la Société d’amélioration Milton Parc, propriétaire des immeubles, souhaitaient trouver un mécanisme juridique pour protéger les caractéristiques physiques, sociales, économiques et architecturales à long terme du quartier de Milton Parc.
Elles devaient aussi disposer d’une structure où la communauté pourrait se réunir pour discuter des problèmes rencontrés. De plus, les coopératives et les autres organismes sans but lucratif impliqués devaient être propriétaires de leurs immeubles. Certains membres auraient préféré une propriété privée plutôt que collective, mais les programmes de subvention ne pouvaient pas servir pour l’accession à la propriété.
La Société d’amélioration Milton Parc et des conseillers juridiques ont mené un processus participatif exigeant avec les résidentes et résidents, les coopératives et les organismes sans but lucratif. Les représentantes et représentants des 22 organismes coopératifs et sans but lucratif récemment constitués se sont rencontrés chaque semaine pendant six mois.
La communauté s’est regroupée autour de trois objectifs principaux :
- empêcher la spéculation sur les immeubles ;
- sélectionner les futurs résidents et résidentes en fonction de leur revenu faible ou modéré ;
- protéger les caractéristiques architecturales.
Les craintes de voir l’association communautaire devenir un forum de débats politiques ont été levées : l’association devait se limiter à son rôle de gardienne des trois objectifs centraux.
La communauté a discuté de plusieurs mécanismes juridiques, y compris des formes de bail, de vente avec restrictions et de charges hypothécaires ; ces mécanismes ne satisfaisaient pas aux besoins, mais, ce faisant, ces discussions ont permis de clarifier la structure voulue, et la copropriété à des fins sociales s’est avérée la structure juridique la plus appropriée. Bien que similaire à l’idée américaine de « land trust », elle va au-delà en ce qu’elle empêche la spéculation pour toujours.
On peut dire que le processus qui a mené à cet accord de copropriété et à sa mise en œuvre a été le fruit d’un effort multilatéral de la part des principales parties prenantes internes et externes.
Arguments pour l’utilisation des règles sur la copropriété
Plusieurs juristes spécialisés en droit immobilier ont été consultés. C’est le notaire François Frenette, professeur de la Faculté de droit de l’Université Laval qui a proposé l’utilisation très novatrice du droit de la copropriété divise.
Le concept juridique utilisé pour la copropriété tient compte de la qualité des caractéristiques physiques des différents types de logements, du degré de confort, de l’emplacement et du quartier où sont situés les immeubles, de la situation sociale des occupantes et occupants, des raisons pour lesquelles les copropriétaires ont acheté leur immeuble et de la nécessité de protéger les intérêts généraux des copropriétaires. La beauté du concept de copropriété réside dans le fait qu’il crée une communauté autonome qui peut formuler et respecter ses propres règles, dont celle d’un processus de décision collective.
Dans le modèle choisi, les règles qui avaient été le plus souvent utilisées par les propriétaires à revenu élevé pouvaient également être utilisées pour atteindre les objectifs collectifs et individuels des ménages à revenu faible et modéré.
Le fonctionnement de la copropriété de Milton Parc
Propriété, charges et vote
Dans Milton Parc, chaque copropriétaire – ici il ne s’agit pas d’un individu, mais d’une coopérative ou d’un organisme sans but lucratif – est propriétaire de son bâtiment et du terrain sur lequel il est bâti. Chaque copropriétaire est également propriétaire d’une partie des cours, allées et chemins environnants, en copropriété indivise avec tous les autres copropriétaires.
Cependant, les charges communes, qui sont réparties entre tous les copropriétaires, sont établies en fonction de la valeur des actifs de chaque copropriétaire en tant que pourcentage de la valeur de l’ensemble des immeubles de Milton Parc.
Lors des assemblées de l’ensemble des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d’une voix.
La clause de destination
Les règles sont inscrites dans une clause appelée « clause de destination » et ne peuvent être modifiées sans le consentement unanime des copropriétaires. Ces règles résument les trois objectifs principaux déjà énoncés et les rendent contraignants à perpétuité[9]. Soulignons la règle qui empêche la spéculation : les copropriétaires ne peuvent jamais vendre leurs immeubles pour réaliser une plus-value.
Les règles de copropriété n’avaient jamais été utilisées auparavant pour empêcher la spéculation et dédier l’utilisation des immeubles à des occupants et occupantes à faible revenu. Le recours à la copropriété était très novateur et allait permettre de protéger le sol et les bâtiments contre la spéculation et l’embourgeoisement.
La Communauté Milton Parc : un syndicat de copropriété unique en son genre
La Communauté Milton Parc (CMP) est un syndicat de copropriété unique en son genre, créé en 1987 par l’Assemblée nationale du Québec. La CMP est régie par sa Déclaration de copropriété[10] qui se distingue parce qu’elle contient des restrictions liées à la responsabilité sociale et à la non-spéculation. Il y a une similitude avec les restrictions sur la collectivité qui se trouvent dans une fiducie foncière (land trust), mais celles-là sont moins contraignantes. La raison d’être de la CMP est de rassembler les intérêts des copropriétaires par l’entremise de leurs délégué·e·s et de gérer les espaces collectifs. Cela comprend la mutualisation des besoins (ex. les primes d’assurance des immeubles), les espaces communs (ex. les trois ruelles) et toutes autres orientations qui sont pour le bien-être collectif des copropriétaires et qui sont en lien avec la Déclaration de copropriété.
Les créanciers hypothécaires
Les créanciers hypothécaires devaient être rassurés, sinon aucune institution financière n’allait prêter aux copropriétaires.
Un accord a finalement été conclu avec la SCHL, l’assureur de tous les prêts hypothécaires. Les créanciers hypothécaires qui saisiraient les biens devaient être liés par les mêmes conditions que les autres copropriétaires – ce qui les inquiétait –, mais comme la SCHL s’est engagée à assurer entièrement les prêts, toutes les inquiétudes concernant la protection de leur investissement ont été dissipées. Soulignons que même la SCHL est liée par lesdites conditions.
Un projet de loi d’intérêt privé adopté unanimement par l’Assemblée nationale
À l’époque, il n’était pas possible de créer des copropriétés à partir d’immeubles locatifs existants sans l’approbation de la Régie du logement du Québec, devenue le Tribunal administratif du logement. Or, la Régie du logement ne pouvait donner son accord car il n’existait pas encore de règlement lui donnant des critères d’approbation. Pour sortir de l’impasse, la Communauté Milton Parc a soumis un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée nationale, qui a été présenté par le député local, Jacques Chagnon. Le consentement de tous les partis était requis pour les projets de loi de cette nature.
Le projet de loi, adopté le 23 juin 1987[11], prévoit que le ministre autorisera la Déclaration de Milton Parc s’il est convaincu qu’elle favorise l’accès à des logements de qualité pour les ménages à revenu faible ou moyen, qu’elle préserve le tissu urbain et l’unité architecturale et socioéconomique du quartier et qu’elle prévoit des mécanismes de prévention de la spéculation.
Le développement communautaire de Milton Parc depuis les années 1980
Que s’est-il passé depuis ? Forts de leur victoire qui leur assurait un logement adéquat, abordable et sûr, les citoyennes et citoyens de Milton Parc ont réalisé toutes sortes de projets socioéconomiques, écologiques et coopératifs novateurs et rassembleurs, dont voici quelques exemples.
La Société de développement communautaire Milton-Parc
Créée en 1982, la Société de développement communautaire Milton-Parc (SDC), un organisme sans but lucratif dont les administratrices et administrateurs sont des représentants des organismes de Milton Parc, a pris en charge la gestion des locaux commerciaux en 1987. « Son objectif est de créer un quartier où les besoins de toutes et tous sont pris en compte et où les liens sociaux et l’économie solidaire sont privilégiés. En tant que copropriétaire du Syndicat de copropriété Communauté Milton-Parc, la SDC travaille de concert avec des coopératives et des organismes sans but lucratif pour promouvoir l’économie solidaire dans ses actions, une mission qui répond aux besoins sociaux du quartier[12] ».
La mise sur pied de la SDC a permis d’intégrer 12 bureaux et locaux commerciaux adjacents aux coopératives. Ces entreprises locales participent à l’économie du quartier, répondent aux besoins de la communauté et renforcent le tissu social. À titre d’exemple, citons le Centre d’écologie urbaine de Montréal, cofondé par Lucia Kowaluk et Dimitri Roussopoulos, qui a occupé les locaux de la SDC pendant plusieurs années. La SDC a aussi financé d’importants travaux pour soutenir la coopérative de solidarité du Bar Milton-Parc. Le financement de la SDC provient de façon importante de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
L’Association récréative Milton-Parc
L’Association récréative Milton-Parc (ARMP) a été créée à partir d’initiatives de personnes résidentes et d’intéressé·e·s qui désiraient offrir, à des prix abordables, des activités et des services aux résidentes et résidents ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs du quartier Milton-Parc. L’organisme a été inscrit au Registre des entreprises en mars 1984 par Cindy Cook qui demeure dans la Communauté Milton Parc.
Forte de ce mandat et à l’écoute des besoins de la population, l’ARMP a mis en place des activités récréatives et des programmes éducatifs. Elle offre aujourd’hui ses activités au Centre de loisirs multiethnique Saint-Louis sur la rue Saint-Urbain, aux Galeries du Parc, à l’école Au-Pied-de-la-Montagne (pavillons Jean-Jacques-Olier et Saint-Jean-Baptiste) en plus de gérer les sept terrains de volleyball de plage au parc Jeanne-Mance, des programmes de camp de jour, de plein air interculturel et de soccer récréatif[13].
La Banque alimentaire Milton-Parc
La Banque alimentaire Milton-Parc est « un groupe communautaire offrant des repas chauds et des paniers alimentaires d’urgence. […] Coordonnée et administrée par des bénévoles, la banque alimentaire est en mesure de distribuer plus de 100 repas une fois par semaine, en se servant des ressources de l’église luthérienne St. John’s[14] ».
La coopérative de solidarité du Bar Milton Parc
La coopérative est détenue et gérée par des membres travailleurs et travailleuses qui ont choisi de s’organiser pour mieux servir leur communauté. Elle fournit des boissons brassées localement, un lieu pour les événements et la culture, et des repas abordables grâce à un programme de repas solidaires[15]. La coopérative a mis en place un programme de sécurité alimentaire pour venir en aide aux personnes vulnérables.
Le Comité des citoyen·ne·s de Milton Parc
Le Comité des citoyen·ne·s de Milton Parc (CCMP) existe depuis plus de 50 ans. Il a été fondé par Lucia Kowaluk et Dimitri Roussopoulos en 1968 dans le cadre de la lutte contre la démolition du quartier Milton Parc. Organisme sans but lucratif non partisan, il vise à développer une démocratie populaire et une autonomie collective. Ses projets sont axés sur l’entraide, l’écologie urbaine, l’éducation populaire, la justice du logement et la démocratie directe. Le CCMP gère deux jardins collectifs, une banque alimentaire, une bibliothèque communautaire et un immeuble de trois étages. Parmi ses activités récentes, on retrouve la lutte pour la transformation de l’hôpital Hôtel-Dieu et de l’ancien Hôpital Royal Victoria en espaces communautaires répondant notamment aux besoins en matière de logement[16].
Malgré son orientation vers le développement communautaire, la communauté Milton Parc doit parfois faire face à des problèmes complexes qui peuvent la diviser. C’est le cas de la présence de sans-abri sur l’avenue du Parc, les ruelles et le centre Open-Door au sous-sol de l’Église Notre-Dame-de-la-Salette qui offre de la nourriture et des espaces pour dormir. Cela a des répercussions significatives sur les personnes qui circulent et habitent le quartier.
La communauté est partagée : les uns nourrissent les sans-abri, les autres veulent qu’on les chasse en poursuivant la Ville et plusieurs autres instances impliquées pour qu’elles s’en chargent.
Conclusion
Il ne faut jamais dire que les défis sont insurmontables. Le projet Milton Parc est l’histoire remarquable de citoyennes et citoyens qui ont sauvé des immeubles et la communauté qui y habitait des démolisseurs et trouvé un nouveau mécanisme pour en assurer la pérennité. Ils se sont battus contre la mairie et ont affronté les promoteurs. Un juriste chevronné a eu l’idée d’adapter la loi sur la copropriété pour préserver le caractère physique, architectural et socioéconomique du quartier. Un projet de loi d’initiative privée a été adopté par l’Assemblée nationale. La spéculation est interdite pour toujours. Tout cela a donné naissance à un écosystème communautaire unique, dynamique, autosuffisant et démocratique qui vit collectivement dans des logements hors marché.
Par Robert Cohen, avocat impliqué étroitement dans le projet Milton Parc
- Un grand merci à ma conjointe, Me Susan Altschul, pour sa contribution à ce document ainsi que pour le développement de Milton Parc. ↑
- Robert Cohen a été entre autres directeur du Groupe de ressources techniques Milton Parc (1980-1988). Il a créé les structures juridiques et sociales qui continuent de gouverner le quartier. Il a également été directeur et vice-président de la Société d’amélioration Milton Parc. ↑
- Phyllis Lambert, architecte québécoise, est la fondatrice du Centre canadien d’architecture. De nombreux prix soulignent la qualité de ses travaux. ↑
- Lucia Kowaluk, travailleuse sociale, militante, intervenante et leader, a cherché à préserver le patrimoine bâti. Elle a aussi reçu plusieurs reconnaissances. ↑
- Les autres membres du conseil d’administration étaient : Lucia Kowaluk, Me Adele Mardoche, James McGregor, Me Daniel Mettarlin, Richard Phaneuf, James Raymond, Dimitrios Roussopoulos, Jeanne Wolfe. ↑
- L’équipe d’architecture comprenait : Douglas Alford, Guy Giguère. André Laverdière, John Mumme, Colin Munro, Robert Paradis. Elizabeth Shapiro. ↑
- Mentionnons surtout : Marie-France Bélanger, John Bradley, Joanne Du Temple, John Gardiner, Gisèle Gingras, Sue Moorhead, Luba Serge, Linda Tremblay. ↑
- Lucia Kowaluk et Carolle Piché-Burton, Communauté Milton-Parc. L’histoire d’hier et le fonctionnement d’aujourd’hui, 2012. ↑
- La clause de destination indique que l’immeuble servira « d’une part à favoriser à perpétuité à la fois un contrôle de l’ensemble des titres aux fractions de l’immeuble et un accès à des unités d’habitation de qualité pour des gens à revenu modéré et à faible revenu pour ainsi promouvoir les intérêts des résidents actuels et futurs dudit immeuble, et, d’autre part, pour le même temps et la promotion des mêmes intérêts, à préserver le caractère et l’unité à la fois physique architecturale et socio-économique du quartier Milton Parc, auxquelles fins du reste l’immeuble dans son ensemble et tel que défini dans ses parties composantes, est affecté en exclusivité. La destination ainsi imprimée à l’immeuble vise à assurer le maintien en état, de façon aussi intégrale que possible, des différents traits du microcosme dans lequel cet immeuble se situe. Diverses restrictions imposées par la présente déclaration aux droits et à l’exercice des droits des copropriétaires tendent à garantir le respect de cette déclaration dans le quotidien des actes que ces derniers sont appelés à poser. Au détail comme dans leur ensemble, ces restrictions se justifient à ce titre et à nul autre ». ↑
- Voir Kowaluk et Piché-Burton, 2012, op. cit. ↑
- Voir : Projet de loi 224, Loi concernant la conversion en copropriété par déclaration de l’immeuble appartenant à la Société d’Amélioration Milton Parc Inc., 1987, annexe du document de Kowaluk et Piché-Burton, op. cit. ↑
- <https://sdcmiltonparc.org/>. ↑
- <https://www.miltonpark.org/>. ↑
- <https://www.miltonparc-foodhub.org/fr>. ↑
- <https://bmp.coop/>. ↑
- <https://ccmp-mpcc.com/>. ↑

Dispersés aux quatre vents : la gauche anti-guerre russe entre exil et résistance

Dispersés aux quatre vents : la gauche anti-guerre russe entre exil et résistance
La plupart des Russes commencent par dire ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, mais il ne faut pas longtemps pour découvrir des critiques
12 février 2026 | tiré du site Solidarité Ukraine Belgique | Photo : "Paix pour l'Ukraine, liberté pour la Russie" - une manifestation à Moscou le 24 février 2022
Feb 12, 2026 - Source : article publié en anglais par Morten Hammeken dans "Jacobin" | Traduit en français par Adam Novak, Europe, Solidarités Sans Frontières, 7 février 2026
https://solidarity-ukraine-belgium.com/post/disperses-aux-quatre-vents-la-gauche-anti-guerre-russe-entre-exil-et-resistance?fbclid=IwdGRleAP8BlxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xNzM4NDc2NDI2NzAzNzAAAR6tqYlgKqytbu1qOE4QJyR1eSFgfH969hlbHSKmDctwk0G1C7sK056wEE_V2w_aem_AlU5IaO4DM8uWpWkZEg0lw
Danemark : quand les dissidents russes de gauche se retrouvent Dispersés aux quatre vents : la gauche antiguerre russe entre exil et résistance
L'État russe a contraint de nombreux militants de gauche antiguerre à l'exil, les coupant des Russes ordinaires. Mais les activistes savent bien que le changement en Russie doit venir de l'intérieur, en mobilisant les gens autour de leurs propres intérêts.
« Veuillez vérifier auprès de chaque participant s'il est d'accord pour être photographié. »
Après avoir pris une photo d'une diapositive pendant l'une des présentations, un homme s'approche de moi. C'est Mikhaïl Lobanov [1], un socialiste russe, qui me rappelle gentiment qu'il s'agit d'un panel où les intervenants ne doivent pas être rendus publics. Je le rassure en lui disant que je ne publierais jamais rien sans consentement. Mikhaïl accepte avec un sourire et retourne à sa place.
J'ai été invité à « La lutte contre la guerre de la Russie et le régime autoritaire », une conférence organisée par le Réseau Démocratie Radicale (Radical Democracy Network) [2], une large coalition de dissidents et de militants antiguerre russes. Les organisateurs précisent qu'il ne s'agit pas d'une réunion ordinaire. Des prospectus informent les participants que nous ne sommes pas autorisés à rendre public quoi que ce soit sur l'événement du jour pour des raisons de sécurité. Un embargo de cinq jours est imposé sur tous les articles de presse. Il s'agit d'empêcher les services de renseignement russes de suivre et de cartographier les activités des invités --- mais aussi de passer sous les radars de la police danoise. Les invités sont souvent traités avec suspicion par les services de sécurité occidentaux.
Cette préoccupation compréhensible rappelle également aux autres participants les contraintes sous lesquelles vivent les militants russes. Deux des intervenants du jour sont présentés avec un rappel de ne pas filmer ni mentionner de noms, car cela pourrait compromettre leurs réseaux en Russie. De nombreux Russes présents figurent déjà sur la liste gouvernementale des « extrémistes représentant une menace pour la sécurité nationale ».
« Cet événement n'est pas un séminaire public, mais une tentative de rassembler les bonnes personnes dans la même salle. Je pense que nous y sommes parvenus », déclare Bjarke Friborg du Dansk Magisterforening (Association danoise des diplômés) [3]. Son syndicat a contribué à organiser l'événement par l'intermédiaire du tout récent Réseau Europe de l'Est (Eastern Europe Network), tandis que leurs collègues du syndicat des professionnels de l'informatique PROSA [4] ont accepté d'accueillir l'événement. Le plus grand syndicat du Danemark, 3F [5], ainsi que l'Association des journalistes danois ont cofinancé les frais de déplacement.
Les Russes sont arrivés à Copenhague de toute l'Europe, où ils vivent depuis 2022. Marina Simakova réside dans une ancienne république soviétique, Mikhaïl Lobanov en France, tandis que Denis Leven est venu de Berlin. La plupart n'ont pas revu leur pays depuis au moins quatre ans et vivent dans l'incertitude et l'exil.
Felix, organisateur de Démocratie Radicale, lance les travaux en présentant une vision destinée à séduire autant ses compatriotes que le public occidental.
« L'opposition russe à la guerre est souvent rendue invisible ou considérée avec suspicion. Pour renforcer notre travail, nous devons unir les militants russes, les féministes et les militants syndicaux et combler nos divisions. »
Pour ce jeune universitaire, tout est question de créer un récit nouveau, ou peut-être plus nuancé, du mouvement antiguerre russe.
« Les gens en Occident soutiennent généralement la lutte ukrainienne contre l'oppression. Mon espoir est que nous puissions canaliser une partie de ce soutien vers notre propre lutte contre Vladimir Poutine. »
Lutter pour quelque chose de différent
Après une conférence introductive sur Démocratie Radicale et la gauche russe [6], les questions sur la guerre en Ukraine commencent à filtrer. Lors de la séance de questions-réponses sur le féminisme contemporain en Russie, un Danois dans le public change de sujet. Il veut savoir si Démocratie Radicale a publié un communiqué condamnant la guerre en Ukraine, vers lequel il pourrait orienter les gens. La question est bien intentionnée, mais elle doit sembler légèrement offensante pour les critiques de Poutine réunis à Copenhague, qui ont sacrifié une grande partie de leur existence pour combattre son administration. Le militant syndical Denis Leven répond :
« Nous condamnons sans équivoque l'invasion impérialiste de l'Ukraine par notre pays et faisons tout notre possible pour que cela soit clair. À Berlin, où je réside, nous travaillons avec la communauté ukrainienne pour organiser des manifestations antiguerre. Mais nous nous concentrons sur le travail pratique pour assurer la défaite de notre régime, pas simplement sur des mots creux au sujet de la guerre », dit-il.
L'opposition libérale se bat pour la même Russie avec un nouveau chef d'État. Nous, nous luttons pour quelque chose de différent.
Cette dernière remarque est aussi un coup de griffe à la partie plus libérale-conservatrice de l'opposition russe, qui reçoit le plus d'attention des médias occidentaux. Cela inclut des figures comme Garry Kasparov [7], Vladimir Kara-Murza [8], l'assassiné Alexeï Navalny et sa veuve, Ioulia Navalnaya. Bien qu'ils puissent tous s'accorder sur l'opposition à la guerre de Poutine, beaucoup de militants estiment que l'objectif ultime de l'opposition libérale manque de profondeur.
« Ils se battent pour la même Russie avec un nouveau chef d'État. Nous, nous luttons pour quelque chose de différent », dit Leven.
Comme souvent, la lutte s'accompagne de contraintes financières. Par rapport à l'opposition bourgeoise, partiellement financée par des oligarques d'opposition comme Mikhaïl Khodorkovski [9], l'argent est rare pour le réseau militant, et les caisses se vident chaque mois, surtout pour ceux qui continuent d'opérer à l'intérieur de la Russie. Mais comment collecter des fonds efficacement tout en évitant de se faire repérer par le gouvernement ? La réunion d'aujourd'hui vise aussi à résoudre ce casse-tête.
« Notre travail à l'intérieur de la Russie est plus efficace si nous restons discrets », dit Anna.
Soutenir l'équipe locale
Plus tard dans l'après-midi, nous abordons une autre question que tout le monde a en tête : que pensent réellement les Russes ordinaires de la guerre et de la direction que prend le pays ? C'est compliqué, explique le sociologue Oleg Jouravlev [10].
« Les sondages officiels montrent des niveaux élevés de soutien à la guerre ; cependant, des enquêtes indépendantes et des études plus approfondies --- comme les recherches menées par le Laboratoire de sociologie publique --- suggèrent un tableau différent. La guerre n'est pas populaire ni véritablement soutenue par le public. De plus, le gouvernement fait tout son possible pour permettre à la plupart des Russes de vivre sans remarquer la guerre. En même temps, l'économie de guerre contribue à maintenir la stabilité, voire crée de nouvelles opportunités pour beaucoup de gens. En conséquence, de nombreuses personnes éprouvent un sentiment d'implication dans la Russie en guerre, même si elles s'opposent au conflit et sont indifférentes à Poutine. Cela dit, il ne faut pas oublier ceux qui souffrent de la guerre économiquement, psychologiquement et physiquement --- et leur nombre ne cesse de croître. »
Les sondages officiels montrent des niveaux élevés de soutien à la guerre ; cependant, des enquêtes indépendantes et des études plus approfondies suggèrent un tableau différent.
Jouravlev compare le sentiment de certains Russes à celui des Américains qui critiquaient les guerres en Irak et en Afghanistan tout en « soutenant les troupes ». Beaucoup de gens se sentent obligés de soutenir l'équipe locale, même s'ils ne sont pas d'accord avec les décisions du capitaine. La présentation de Jouravlev met également en vedette le seul intervenant non russe de la journée, l'ethnographe et anthropologue politique britannique Jeremy Morris, en visioconférence. Morris examine la Russie à travers un prisme post-soviétique et publie nombre de ses conclusions sur le blog au nom évocateur Postsocialism [11]. Ses recherches lui offrent un aperçu unique des véritables sentiments des Russes ordinaires.
Un membre du public veut savoir qui sont les partisans les plus fervents de la guerre. Les plus pauvres sont souvent présentés comme les plus vulnérables aux justifications revanchistes et fortement nostalgiques de l'époque soviétique du pouvoir. Le professeur Morris n'est pas d'accord.
« Si Poutine s'appuie effectivement sur une base nationaliste de droite, on en trouve partout dans le monde --- y compris ici au Danemark. Ce qui préoccupe les Russes ordinaires est la même chose que tout le monde : l'éducation de leurs enfants, le prix du logement et le coût des voitures. Sur ces paramètres, le régime échoue actuellement », dit Morris.
Bien que les sondages montrent toujours des niveaux élevés de soutien à Poutine au sein de la société russe, cela peut aussi être trompeur, explique Morris.
« La plupart des Russes commencent par dire ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, mais il ne faut pas longtemps pour découvrir des critiques sévères de l'État. »
« Les sondages d'opinion en provenance de Russie ne sont pas inutiles, mais il faut les prendre avec prudence », ajoute Oleg Jouravlev [12].
Pureté idéologique
Les militants de Démocratie Radicale espèrent exploiter le mécontentement qui couve sous la surface. Mais construire une opposition forte capable de contester l'emprise du parti Russie unie [13] sur la politique exige l'unité. Les groupes tentent donc d'éviter les « tests de pureté idéologique », comme Denis Leven les appelle, en se concentrant sur l'union d'un large éventail d'opinions et de divers mouvements sociaux sous la même bannière. La construction de coalitions larges est essentielle si le mouvement veut développer un véritable pouvoir dans la politique russe, explique Lobanov --- renvoyant à de précédentes interviews dans Jacobin et Meduza [14].
Pour beaucoup de militants, cela signifie mettre leur idéologie politique au second plan au profit d'une approche plus pragmatique. Denis Leven mentionne un numéro d'assistance téléphonique pour les travailleurs, qu'il a contribué à créer, comme exemple de la façon dont ils tentent d'atteindre les Russes ordinaires et de les conseiller sur le droit du travail ou de leur apporter un soutien professionnel.
Néanmoins, certains principes fondamentaux restent nécessaires.
« Bien que nous représentions une variété d'opinions, nous sommes d'accord sur certaines choses fondamentales. Nous n'allons pas réintroduire les goulags le premier jour, et probablement pas le deuxième non plus », dit Denis.
« Démocratie Radicale a le potentiel d'unir et de diffuser des idées qui sont déjà massivement populaires en Russie », dit Lobanov.
Ancien professeur de mathématiques à l'Université d'État de Moscou, Lobanov est parmi les vétérans de l'opposition de gauche russe, et ses paroles pèsent auprès des participants. Il a contribué à organiser les enseignants et les scientifiques lors des immenses manifestations contre le gouvernement de 2011—2013, familièrement appelées la « révolution des neiges » [15].
Lobanov, qui se décrit comme un socialiste démocratique dans la lignée de Bernie Sanders et Jeremy Corbyn, illustre l'ampleur du mouvement. Lorsqu'il s'est présenté aux élections législatives de 2021, il a été soutenu à la fois par des syndicats indépendants et par le Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR) [16], bien qu'il fût candidat indépendant. Sa victoire électorale convaincante dans le quartier de Kountsevo à Moscou a été annulée par la commission électorale contrôlée par Russie unie, qui a déclaré vainqueur son adversaire, le propagandiste gouvernemental de premier plan Ievgueni Popov. Après de multiples arrestations, des menaces et une étiquette d'agent de l'étranger, Lobanov a quitté la Russie en 2023.
La conférence accueille également l'ancien conseiller municipal de Moscou Ievgueni Stoupine, dont la critique de la guerre lui a rapidement valu l'étiquette d'agent de l'étranger. Comme la plupart des dissidents, il a aussi été exclu du PCFR en raison de sa position antiguerre et a quitté la Russie en 2023. Il réside actuellement en Allemagne, où il anime une chaîne YouTube comptant plus de neuf cent mille abonnés.
L'effondrement
Une présentation sur l'économie russe donne à Denis Leven et « Anna » l'occasion d'approfondir les sombres perspectives économiques évoquées par Morris et Jouravlev.
« L'invasion de l'Ukraine a accéléré un démantèlement néolibéral du marché du travail qui dure depuis des décennies », dit Anna. En tant qu'avocate spécialisée dans les droits humains représentant plusieurs Russes actuellement poursuivis en justice, son vrai nom ne peut être révélé.
Le chômage est bas, même si le chiffre officiel de 1 pour cent est probablement un mensonge, dit Denis Leven. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire.
« Depuis la guerre, les conditions de travail se sont fortement dégradées en Russie. Conjuguées au taux d'inflation élevé, la plupart des gens ont moins d'argent en poche, malgré les augmentations de salaires », explique Anna.
L'invasion de l'Ukraine a accéléré un démantèlement néolibéral du marché du travail qui dure depuis des décennies.
Les militants dressent un tableau sombre. De moins en moins d'emplois russes répondent aux critères de travail décent de l'Organisation internationale du travail [17]. Les heures supplémentaires ne sont plus payées pour de nombreux travailleurs, tandis que de nouveaux logiciels sont utilisés pour surveiller les salariés. Le seuil du travail des enfants a été abaissé à quatorze ans, et le travail forcé, en particulier au sein du système pénitentiaire russe, gagne du terrain comme moyen de trouver une main-d'œuvre bon marché pour les plus grandes entreprises [18].
Si beaucoup de ces problèmes peuvent avoir un écho familier pour un public occidental, la situation en Russie semble exacerbée. Parallèlement au démantèlement des droits des travailleurs, un nombre croissant de personnes sont également employées dans des emplois précaires sans heures garanties. Face à de fortes baisses des ventes, des entreprises comme AvtoVAZ et Kamaz [19], les plus grands constructeurs automobiles de Russie, ont également commencé à réduire les heures de leurs employés dans un exercice de réduction des coûts déguisé, explique Denis Leven. Le contexte est une forte baisse des ventes automobiles, mettant certains des plus grands fabricants russes au bord de la faillite.
« En Occident, la semaine de quatre jours fait l'objet d'un vaste débat. Eh bien, en Russie, c'est déjà devenu la réalité pour beaucoup --- même si le contexte est un peu différent », ajoute-t-il en plaisantant.
Je demande au panel son avis sur une récente information révélant des projets d'importation d'un million de travailleurs en provenance d'Inde. Comment ce besoin apparemment désespéré de main-d'œuvre supplémentaire s'inscrit-il dans l'équation ?
« L'État russe a toujours compté sur l'importation de main-d'œuvre bon marché. Depuis la guerre en Ukraine, moins de personnes des pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont enclines à migrer pour travailler, préférant d'autres pays comme le Kazakhstan. Ils essaient donc de combler ce vide avec des travailleurs d'Inde. Cela met encore plus de pression sur les droits du travail », dit Denis Leven.
« Cela s'applique aussi aux territoires occupés et à la périphérie russe. L'État russe exploite cyniquement les peuples colonisés et opprimés pour une main-d'œuvre bon marché », ajoute la chercheuse féministe Alexandra Talaver. « Nous voyons aussi la citoyenneté russe utilisée comme levier contre les travailleurs, avec la menace d'expulsion planant au-dessus des têtes, même pour des personnes nées citoyennes. »
Talaver mentionne l'homme politique d'opposition Ilia Iachine comme exemple récent. L'ancien protégé du leader d'opposition assassiné Boris Nemtsov [20] a été déclaré apatride en septembre 2025, après avoir été condamné à huit ans et demi de prison en décembre 2022 pour avoir dénoncé la guerre. Iachine a été libéré en août 2024 dans le cadre de l'échange de prisonniers qui incluait également les journalistes américains Alsu Kurmasheva et Evan Gershkovich [21].
Dispersés aux quatre vents
Le programme officiel est terminé. Pour les dissidents russes, avoir pu se rencontrer en personne est déjà une petite victoire.
« Nous sommes dispersés aux quatre vents. Le mieux que nous puissions faire dans cette situation est de poursuivre le travail depuis nos nouveaux foyers », me dit Katya Chouvalova autour d'une pizza dans la cuisine. Elle vit en Allemagne depuis 2019 et n'est pas retournée en Russie depuis 2021. Dans son nouveau pays, elle travaille à l'éducation civique et à la culture médiatique --- ce qui passe aussi par la lutte contre la désinformation russe.
« C'est grave en Allemagne. Beaucoup de gens gobent les faux récits du Kremlin là-bas », dit-elle.
Comme beaucoup dans la salle, l'historienne Marina Simakova n'a pas mis les pieds dans son pays depuis bientôt quatre ans. Elle s'appuie sur ses travaux pour expliquer comment l'agression russe a pris forme. Elle partage ces analyses avec les militants antiguerre pour clarifier ce qui se passe au pays et ce qui peut être fait.
Pour la journaliste Maria Menchikova (ou « Macha »), le choix de rester éloignée de la Russie est tout aussi évident. Elle a mis les pieds en Russie pour la dernière fois en novembre 2021, et a été condamnée par contumace à sept ans de prison en septembre 2024 pour apologie du « terrorisme ».
« Je n'avais en fait rien fait. Le magazine dont je faisais partie, Doxa [22], avait publié deux messages sur VKontakte [23] en soutien aux prisonniers politiques. Mais ils avaient besoin d'un bouc émissaire, et comme j'étais inscrite en tant qu'administratrice, j'étais une cible facile », dit Macha avec un sourire résigné.
Vitaly Bovar raconte la même histoire. Ancien conseiller municipal de Saint-Pétersbourg pour le parti libéral Iabloko [24], il a été suspendu en mai 2021 après avoir assisté à une conférence déclarée illégale pour violation du confinement lié au COVID-19. Bovar risque trois ans de prison s'il retourne en Russie.
« Je me suis échappé de Russie le jour du verdict. J'ai simplement hélé un taxi et je suis parti. Les autorités étaient probablement contentes de me voir partir, ce qui fait que c'était étonnamment facile de sortir », dit-il.
L'effondrement ne viendra pas de la pression extérieure ni du résultat de développements stratégiques en Ukraine. Pour que la Russie change, sa classe ouvrière doit se relever.
Les histoires de Marina, Macha et Vitaly illustrent les contraintes sous lesquelles opèrent les opposants. La pression est encore aggravée par les difficultés auxquelles ils font face dans leur nouvelle vie en Europe, où de nombreux militants antiguerre sont traités avec suspicion et peinent à se construire une existence stable.
Felix dit qu'il est actuellement menacé d'expulsion du Danemark, où il réside avec sa femme depuis deux ans et demi. Il cherche actuellement à faire prolonger son permis de séjour mais craint que sa demande ne soit rejetée, étant donné la position restrictive des autorités migratoires danoises envers les ressortissants russes. Elles exigent aussi qu'il trouve un emploi suffisamment rémunéré pour justifier un séjour prolongé, ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
« Si mon permis de séjour européen n'est pas prolongé, la prochaine étape pour moi sera probablement l'Arménie. Ce qui créerait une grande incertitude pour moi et ma famille. Les services de sécurité russes ratissent large dans les anciennes républiques soviétiques », dit-il.
La fissure dans l'armure
Aujourd'hui, la question sur toutes les lèvres est de savoir si le règne de Poutine pourrait s'effondrer sous le poids de ses ambitions impérialistes. Pour les dissidents réunis à Copenhague, cette question a des implications pour tout leur avenir. Denis Leven et Alexandra Talaver voient tous deux des signes que 2026 pourrait être un tournant.
S'agit-il d'une évaluation lucide ou d'un rêve de lendemains meilleurs ?
Leven revient une fois de plus sur les sombres perspectives économiques de la Russie. Bien que le gouvernement ait fait preuve de résilience face aux sanctions [25], les opposants estiment que des fissures commencent à apparaître dans son armure apparemment solide. Le fonds souverain, le trésor de guerre de Poutine, s'épuise, les actifs liquides comme l'or étant vendus à un rythme record. La surproduction a fait chuter les prix du pétrole de près de 20 pour cent en 2025, entamant sérieusement l'une des principales sources de revenus de l'État. Même les propres projections de croissance du Kremlin, d'environ 1 pour cent, annoncent des difficultés, tandis que les hausses d'impôts telles que celles récemment appliquées aux appareils électroniques, aux smartphones et aux luminaires seraient malvenues pour n'importe quelle population.
Bien que ces problèmes s'accumulent clairement, les militants s'accordent à dire que l'effondrement ne viendra pas de la pression extérieure ni du résultat de développements stratégiques en Ukraine. Pour que la Russie change, sa classe ouvrière doit se relever et se débarrasser du despote.
« Nous sommes du bon côté de l'histoire. Tous les bons élèves du marxisme savent qu'un régime comme celui de la Russie est voué à s'effondrer --- une fois de plus », dit Leven, concluant sa présentation sur une note combative.
« Quand cela arrivera, nous devrons être prêts. »
Morten Hammeken est un historien et auteur danois. Il est spécialisé dans la désinformation en ligne et la politique européenne contemporaine, et rédige le bulletin d'information hebdomadaire EuropaNyt.
P.-S.
https://jacobin.com/2026/02/russia-ukraine-putin-antiwar-opposition
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] Mikhaïl Lobanov est un socialiste démocratique russe, ancien professeur de mathématiques à l'Université d'État de Moscou et figure de proue de l'opposition de gauche en Russie. Il a été renvoyé de son poste universitaire, déclaré « agent de l'étranger » par les autorités russes, et a quitté la Russie en 2023 après de multiples arrestations. Voir Federico Fuentes et Mikhail Lobanov, « Russian socialist Mikhail Lobanov : 'We are sure that at this election, millions will cast a protest vote' », Europe Solidaire Sans Frontières, mars 2024. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article70183
[2] Le Réseau Démocratie Radicale (Radikalnaya Demokratiya) est une large coalition de dissidents de gauche et de militants antiguerre russes, dont beaucoup sont aujourd'hui en exil, cherchant à unir les divers mouvements progressistes contre le régime de Poutine.
[3] Le Dansk Magisterforening (DM) est un syndicat danois représentant les travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier dans les secteurs académique, culturel et de la communication.
[4] PROSA est un syndicat danois des professionnels de l'informatique, fondé en 1968.
[5] 3F (Fagligt Fælles Forbund) est le plus grand syndicat du Danemark, représentant environ 260 000 membres dans de nombreux secteurs dont le transport, la construction et l'industrie.
[6] Sur le développement de l'opposition de gauche russe, voir la collection d'articles sur le site d'Europe Solidaire Sans Frontières, « A gauche (Russie) ». Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?rubrique1792
[7] Garry Kasparov est un grand maître d'échecs russe et figure de l'opposition, critique de longue date de Poutine depuis des positions libérales-conservatrices. Il vit en exil depuis 2013.
[8] Vladimir Kara-Murza est un militant d'opposition russo-britannique et journaliste qui a survécu à deux empoisonnements présumés. Il a été condamné à 25 ans de prison en avril 2023 pour trahison et diffusion de « fausses informations » sur l'armée russe, avant d'être libéré en août 2024 dans le cadre d'un échange de prisonniers.
[9] Mikhaïl Khodorkovski est un homme d'affaires russe et ancien dirigeant de la compagnie pétrolière Ioukos. Autrefois l'homme le plus riche de Russie, il a été emprisonné de 2003 à 2013 pour des accusations de fraude largement considérées comme politiquement motivées. Il vit depuis lors en exil, finançant diverses activités de l'opposition russe.
[10] Oleg Jouravlev est un sociologue russe travaillant au sein du Laboratoire de sociologie publique (PS Lab), un groupe de recherche qui mène des enquêtes qualitatives indépendantes sur la vie sociale et politique en Russie, notamment les mouvements de protestation et les attitudes du public envers la guerre. Voir « Today's Russian Protest Movements are Younger, Poorer, and More Left Wing », Europe Solidaire Sans Frontières. Disponible à : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article48598
[11] Postsocialism est un blog universitaire tenu par Jeremy Morris, explorant la vie quotidienne, le travail et les attitudes politiques dans la Russie post-soviétique.
[12] Sur l'opinion publique russe et les limites des sondages, voir Oleg Shein, « Russia : Reaction, cynicism and division three years after the invasion of Ukraine », Europe Solidaire Sans Frontières, mai 2025. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article74720
[13] Russie unie (Iedïnaïa Rossiïa) est le parti politique dominant en Russie, étroitement aligné sur le président Poutine. Il détient une supermajorité à la Douma d'État (parlement) et contrôle la plupart des gouvernements régionaux.
[14] Meduza est un média indépendant en langue russe basé à Riga, en Lettonie, fondé en 2014. Il a été déclaré « organisation indésirable » par les autorités russes et bloqué en Russie, mais continue d'atteindre des millions de lecteurs grâce à des solutions techniques de contournement.
[15] La « révolution des neiges » (également connue sous le nom de manifestations de Bolotnaïa) fut une vague de grandes manifestations à Moscou et dans d'autres villes russes, déclenchée par la fraude électorale généralisée lors des élections législatives de décembre 2011. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour ce qui est devenu les plus grandes manifestations en Russie depuis les années 1990. Voir « Appel à des actions de solidarité avec les militants anti-guerre en Russie », Europe Solidaire Sans Frontières, janvier 2023. Disponible à : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article65142
[16] Le Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR, Kommounistitcheskaïa partiïa Rossiïskoï Federatsii) est le deuxième parti à la Douma d'État. Bien que nominalement dans l'opposition, il est largement considéré comme un parti d'opposition « systémique » soutenant globalement les politiques clés du Kremlin, y compris la guerre en Ukraine. Voir Mikhaïl Lobanov et al., « Russie : Résolution de la table ronde anti-guerre des forces de gauche », Europe Solidaire Sans Frontières, février 2022. Disponible à : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article61341
[17] L'Organisation internationale du travail (OIT) est une agence des Nations unies qui fixe les normes internationales du travail, promeut les droits des travailleurs et les conditions de travail décentes. Le « travail décent » est défini par l'OIT comme un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine.
[18] Sur l'impact de la guerre sur l'économie et les dépenses sociales en Russie, voir Nikolay Sukhanov, « Russia : Guns Instead of Butter », Europe Solidaire Sans Frontières, novembre 2023. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article68705
[19] AvtoVAZ est le plus grand constructeur automobile russe, produisant la marque Lada. Kamaz est un important fabricant de camions et de véhicules lourds, basé à Naberejnyé Tchelny, au Tatarstan.
[20] Boris Nemtsov était un homme politique libéral d'opposition russe et ancien vice-premier ministre. Critique éminent de Poutine, il a été abattu à proximité du Kremlin en février 2015. Son assassinat reste controversé, les critiques alléguant une implication de l'État.
[21] Alsu Kurmasheva est une journaliste russo-américaine de Radio Free Europe/Radio Liberty. Evan Gershkovich est un reporter du Wall Street Journal. Tous deux ont été détenus en Russie pour des accusations largement condamnées comme politiquement motivées, avant d'être libérés lors d'un important échange de prisonniers en août 2024.
[22] Doxa est un média étudiant indépendant russe fondé en 2017, spécialisé dans la justice éducative, la lutte contre la propagande et la répression politique. Plusieurs de ses rédacteurs ont été poursuivis par les autorités russes. Voir « The resistance movement is being built on a scorched field. Conversation with DOXA, oppositional Russian media », Europe Solidaire Sans Frontières. Disponible à : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?rubrique1794
[23] VKontakte (VK) est le plus grand réseau social russe, souvent décrit comme l'équivalent russe de Facebook. Il est détenu par une entreprise étroitement liée au Kremlin.
[24] Iabloko est un parti libéral démocrate russe fondé en 1993. Il s'oppose à la guerre en Ukraine et a été de plus en plus marginalisé sous le régime de Poutine.
[25] Sur l'impact des sanctions occidentales sur l'économie russe, voir Lutz Brangsch, « Russia : Are Sanctions Working ? », Europe Solidaire Sans Frontières, octobre 2022. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article64314
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les groupes femmes employabilité en péril : le CIAFT lance une pétition nationale

Montréal, le 17 février 2026 — Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) lance une pétition nationale afin de réclamer un financement à la mission pour les groupes femmes employabilité. En l'absence de ce soutien structurel, le seul secteur qui travaille au quotidien à l'autonomie économique
Un réseau en voie d'extinction
De 40 à 15 aujourd'hui, les groupes femmes employabilité continuent de disparaître. Un autre, le Jalon, a dû fermer ses portes en juin dernier. Désormais, ils ne sont plus que 15, et ceux qui tiennent encore debout sont à bout de souffle.
L'employabilité, c'est bien plus que de refaire un CV
Chaque année, ces groupes accompagnent des milliers de femmes, dans un contexte où les inégalités de genre continuent de marquer l'ensemble des parcours professionnels. Leur expertise couvre aussi les discriminations qui s'y ajoutent — pauvreté, violences, discrimination, responsabilités de conciliation — et qui accentuent l'éloignement de certaines femmes du marché du travail.
« Avant même de parler d'emploi, plusieurs femmes que nous accompagnons doivent se reconstruire. Retrouver leur confiance, reconnaître leurs compétences, reprendre du pouvoir sur leur parcours. D'autres doivent apprivoiser un marché du travail qui a changé pendant leurs années consacrées à la famille ou après des périodes marquées par la précarité ou la violence. Ce travail invisible peut durer quelques semaines, plusieurs mois, parfois plus d'un an. C'est une étape essentielle, mais trop souvent méconnue », explique Nathalie Cloutier, porte-parole du Comité Femmes Employabilité du CIAFT.
L'autonomie économique des femmes est reconnue comme un pilier de l'égalité réelle par l'État québécois. Pourtant, ces groupes demeurent exclus du financement à la mission, malgré l'augmentation globale des budgets en emploi et en action communautaire. Ce décalage entre les engagements publics et les choix budgétaires fragilise un maillon essentiel du filet social et compromet durablement la lutte contre la pauvreté des femmes.
Lien vers la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-12003/index.html
À propos du CIAFT : Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et l'accès équitable des femmes au marché du travail, tout en défendant leurs droits et en favorisant une société inclusive et égalitaire.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journée internationale des droits des femmes 2026

Il y a plus de 50 ans, le journal Québécoises deboutte ! faisait vibrer les rues et les consciences. Par ces deux mots, il portait la voix d'un féminisme émergeant déterminé à se faire entendre malgré les interdits de l'époque. Être deboutte, ce n'est pas une posture physique : c'est une position politique. Plus qu'un slogan, c'est un appel à l'action, un cri de ralliement pour une société plus juste, plus égalitaire et plus libre.I
Le thème de la campagne 2026 : GÉNÉRATIONS DEBOUTTE !
Aujourd'hui encore, les forces économiques, politiques et sociales divisent, oppressent, et cherchent à restreindre nos droits, à freiner nos avancées, à semer la peur et la haine. D'une génération à l'autre, nos appels se répondent, nos luttes s'entrelacent et nos victoires se tissent ensemble vers l'égalité. Le féminisme se renouvelle, s'enracine et se nourrit de la diversité. Pour contrer ces courants réactionnaires, allons puiser dans nos forces féministes vivantes, solidaires et multiples. Reprenons cet élan, ne tolérons aucun recul : Générations deboutte !
AFFICHEZ VOTRE FÉMINISME !
Il est possible de commander des affiches, épinglettes et collants à l'effigie du thème du 8 mars. Faites vite, les stocks sont limités !
PROFITEZ-EN POUR VOUS PROCURER UN COTON OUATÉ DE LA FFQ À SEULEMENT 50$ !
On profite du 8 mars pour lancer notre nouveau coton ouaté FFQ ! Affichez fièrement votre engagement avec ce coton ouaté FFQ en édition limitée. Pensé pour être aussi confortable que symbolique, il vous permet de soutenir directement la Fédération des femmes du Québec et ses actions féministes.
Quantités très limitées. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus !
Téléchargez nos visuels en français (FR) ou en anglais (ANG) :
ViGNETTE DE L'AFFICHE FR / ANG
FOND D'ÉCRAN ZOOM ET TEAMS FR /ANG
Le matériel produit est la propriété du Collectif 8 mars.
Toute reproduction est réservée aux organisations membres du Collectif et ses affiliées. Si vous n'êtes pas membre du Collectif ou d'une organisation affiliée, vous devez demander la permission pour reproduire intégralement le matériel.
Toute utilisation ou reproduction par des partis politiques est strictement interdite.
Pour toute reproduction, les droits d'autrices doivent être cités de la façon suivante :
Collectif 8 mars. Club Sexu. Illustratrice : Alex Bilodeau
Toute correction, transformation ou adaptation de l'illustration est interdite en l'absence du consentement préalable et écrit du Collectif 8 mars.

La nécessité de construire un vaste mouvement antimilitariste contre la Stratégie industrielle de défense du gouvernement Carney

La Stratégie industrielle de défense du Canada, annoncée en février 2026 par le gouvernement de Mark Carney, ne constitue pas une simple mise à jour des politiques de sécurité nationale. Elle marque un tournant historique vers une véritable économie de guerre. Elle intervient à un moment où le gouvernement se détourne de ses objectifs environnementaux (le « capitalisme vert ») et promeut le développement de l'exploitation des énergies fossiles. Plus que jamais, le développement d'un mouvement anti-guerre est essentiel pour s'opposer à une politique qui présente une dimension clairement écocidaire.
1. Les grands objectifs de la Stratégie industrielle de défense
Comme l'explique le document du gouvernement fédéral, cette stratégie vise à rebâtir et à moderniser l'armée canadienne en investissant dans de nouveaux équipements (navires, avions, sous-marins, radars, drones, technologies de surveillance, etc.) et à augmenter les dépenses militaires. L'explosion des dépenses militaires constitue le pilier central de cette réorientation. Le Canada atteindra dès 2025-2026 le seuil de 2 % du PIB exigé par l'OTAN, avant de viser 5 % du PIB d'ici 2035, soit environ 150 milliards de dollars par an. Sur une décennie, plus de 500 milliards de dollars seront aspirés vers la machine militaire.
Cette stratégie vise également à réduire la dépendance aux achats militaires américains en privilégiant l'acquisition d'équipements fabriqués au Canada ou en partenariat avec des alliés, et à renforcer la présence militaire dans le Nord du pays (Arctique) afin de protéger la souveraineté canadienne sur cette portion de son territoire.
Comme l'écrit Marie Vastel dans son éditorial Sur la ligne de défense : « Plutôt que de continuer à verser 71 % du montant des achats militaires au sud de la frontière, le gouvernement canadien projette d'accorder d'ici dix ans 70 % de ses contrats à des entreprises du pays. La priorité de cette philosophie de dépenses militaires historiques sera donc l'acquisition auprès de compagnies canadiennes ; à défaut, le Canada privilégiera des partenariats de production en Europe ou dans la région indo-pacifique, sinon acquiescera, en tout dernier lieu, à des achats à l'étranger. »
Pour parvenir à ces objectifs, l'État canadien mettra consciemment sa puissance financière, réglementaire et politique au service du capital militaro-industriel. Les industries aérospatiale et de la cybersécurité, ainsi que d'autres secteurs, seront ainsi en mesure d'accroître leurs activités afin d'augmenter leurs ventes au pays et auprès de partenaires étrangers, créant des emplois dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de la défense. L'État garantira la demande, financera la recherche, sécurisera l'accès aux ressources et allégera les contraintes environnementales, tandis que les bénéfices seront captés par une minorité d'entreprises intégrées aux chaînes impérialistes occidentales. Il cherchera également à augmenter les effectifs de l'armée.
2. Ce tournant s'inscrit dans le cadre de l'augmentation généralisée des budgets militaires aux États-Unis et en Europe
Ce renforcement passera par l'augmentation de la production d'armes, de technologies de surveillance et d'infrastructures militaires, tout en subordonnant les besoins sociaux, écologiques et démocratiques de la population aux exigences de l'impérialisme américain. Le renforcement du complexe militaro-industriel canadien ne répond pas à une menace réelle pesant sur le Canada, mais découle des pressions exercées par les États-Unis et leurs alliés afin que le Canada assume une part croissante du fardeau industriel, logistique et financier de la militarisation occidentale.
En mettant de l'avant cette politique de « sécurité nationale », le gouvernement Carney subordonne les besoins sociaux, écologiques et démocratiques de la population canadienne aux exigences de l'impérialisme américain et de l'OTAN.
3. Derrière le prétexte de la nouvelle réalité géopolitique : une militarisation garante de l'accumulation capitaliste
Le prétexte invoqué est désormais bien rodé : chaos géopolitique, montée des tensions entre blocs, guerre en Ukraine, rivalités sino-américaines, instabilité au Proche-Orient, incertitudes quant à la fiabilité future de l'allié américain. La perspective d'une éventuelle offensive de la Russie contre le Canada, à l'heure où ce pays est embourbé dans son offensive impérialiste contre l'Ukraine, manque totalement de fondements.
Derrière cette rhétorique sécuritaire se cache une réalité plus brutale : la militarisation devient un instrument central de gestion du capitalisme en crise. Loin de chercher à prévenir les conflits, l'État canadien choisit de s'y préparer activement et d'en tirer profit sur les plans économique, industriel et géopolitique.
Cette stratégie vise essentiellement à sécuriser l'accès aux matériaux stratégiques indispensables à l'économie de guerre contemporaine — minéraux critiques, aluminium, terres rares, énergie — et à protéger, par des moyens militaires, diplomatiques et sécuritaires, les intérêts des entreprises minières canadiennes opérant à l'étranger, souvent au cœur de territoires marqués par la dépossession, la destruction environnementale et les conflits sociaux.
Dans ses multiples déclarations, le premier ministre Carney a souligné sa volonté de renforcer l'exportation des armes produites par les entreprises canadiennes à l'échelle internationale. Ces exportations ne pourront qu'alimenter les conflits et accroître les risques de guerres généralisées. Chaque arme exportée participe potentiellement à la destruction de sociétés entières et à la perpétuation d'un ordre mondial fondé sur la violence et la domination.
4. Les impacts de cette politique sur le renforcement de l'unité canadienne
Sur le plan idéologique, la peur de la guerre sera mobilisée pour restreindre les droits démocratiques : surveillance accrue, criminalisation des mouvements sociaux, répression des luttes écologistes, autochtones, antiracistes et ouvrières. La militarisation de l'économie s'accompagne d'une militarisation intérieure des politiques sécuritaires.
Alors que Carney se plie aux demandes de l'administration Trump en matière d'augmentation des dépenses militaires, de développement des énergies fossiles et de politiques migratoires de plus en plus restrictives, le premier ministre parvient néanmoins à apparaître comme le défenseur de la souveraineté canadienne face aux menaces des États-Unis, tant en ce qui concerne les tarifs douaniers que les velléités d'annexion fréquemment évoquées. Ce battage idéologique vise à renforcer l'unité canadienne et à permettre une centralisation accrue de l'État fédéral.
Cet objectif est renforcé par le fait que le gouvernement Legault salue cette militarisation de l'économie canadienne. Le premier ministre Legault présente cette politique comme une nouvelle stratégie de développement économique, liant l'avenir du Québec à l'aéronautique militaire, à l'extraction minière de matériaux stratégiques et aux technologies de défense. Le Québec, grâce à des entreprises comme Bombardier, CAE, ou les Chantiers maritimes Davie, pourrait, selon lui, construire des avions de combat, des appareils de surveillance, des drones, des brise-glaces et des sous-marins.
Le Conseil du patronat et la Fédération des chambres de commerce accueillent également avec enthousiasme cette économie de guerre. Leurs seules préoccupations portent sur le fait que les grandes entreprises recevant l'essentiel des fonds fédéraux permettent aux PME québécoises de bénéficier de certaines retombées de cette manne.
Le tournant militariste de la bourgeoisie canadienne est un tournant nationaliste et impérialiste. Il s'est accompagné d'un abandon de toutes velléités de lutte contre les changements climatiques, d'un rejet de plus en plus assumé de toute autodétermination collective des peuples et des nations opprimés dans l'État canadien, que ce soit les Premières Nations, les Inuit ou les Québécois·es. La lutte pour l'indépendance et l'autodétermination du peuple québécois doit s'inscrire dans le combat contre les changements climatiques et dans la lutte pour la remise en cause des politiques de l'État canadien, de plus en plus liées à des stratégies écocidaires. L'indépendance du Québec peut et doit devenir un levier pour mettre en place des politiques climatiques ambitieuses, adaptées au territoire et orientées vers le bien commun plutôt que vers les intérêts du complexe militaro-industriel.
Réagissant au dévoilement de la Stratégie industrielle de défense d'Ottawa, les député·es du Bloc québécois ont exigé du gouvernement libéral qu'il réclame la part qui revient au Québec des contrats de cette nouvelle stratégie fédérale, longtemps réclamée par le Bloc québécois, participant ainsi à apporter leur contribution au renforcement de l'unité canadienne.
5. Le choix du renforcement de l'économie de guerre : un choix écocidaire
Les promesses de création d'emplois évitent de questionner la pertinence de créer ce type d'emplois plutôt que des emplois répondant réellement aux besoins de la majorité populaire. Produire des marchandises orientées vers la destruction, la surveillance et la mort, qui ne répondent à aucun besoin réel, ne peut conduire à une amélioration des conditions de vie de la majorité.
De plus, ces investissements en soutien au complexe militaro-industriel représentent autant de fonds qui ne seront plus disponibles pour faire face aux conséquences déjà visibles des changements climatiques — feux de forêt dévastateurs, inondations, destruction de terres agricoles, pénuries d'eau et insécurité alimentaire. L'économie de guerre détourne ainsi des ressources matérielles, politiques et financières qui devraient être consacrées à la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité.
Pourquoi investir dans des avions de combat plutôt que dans des bombardiers d'eau pour lutter contre les feux de forêt, ou dans des travaux d'aménagement des rives face à la montée prévue des eaux ?
À l'heure où les manifestations de la crise climatique multiplient les désastres, le gouvernement Carney réduit les sommes consacrées à la lutte contre cette crise, affaiblit les protections environnementales avec sa loi C-5 concernant les projets d'intérêt nationalet soutient le développement de l'exploitation des énergies fossiles.
Cette politique écocidaire, qui augmentera les émissions de gaz à effet de serre, reléguera aux calendes grecques les investissements essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et fera de la production et de l'exportation d'armements l'un des piliers de l'économie canadienne, créera une situation particulièrement catastrophique pour les populations du Sud global. Les migrations internationales sont donc appelées à se développer.
Face à ces dynamiques, les grandes puissances d'Amérique du Nord et d'Europe accompagnent la militarisation de leur économie d'une logique de forteresse assiégée. Devant les migrations climatiques à venir, provoquées par la crise climatique et l'exploitation impérialiste des pays du Sud, les États capitalistes avancés optent pour la militarisation de leurs frontières, la construction de murs, la surveillance, la répression et, dans certains cas, les expulsions de masse, comme on peut l'observer aux États-Unis et dans plusieurs pays européens.
L'économie de guerre devient ainsi un instrument de gestion autoritaire des crises sociales et écologiques, transformant les victimes du système en menaces sécuritaires.
6. Une stratégie anti-impérialiste et écosocialiste face au tournant militariste des grandes puissances
Nous reprenons ici essentiellement les thèses développées par Alexis Cukier dans son texte « Guerre impérialiste, militarisme environnemental et stratégie écosocialiste à l'heure du capitalisme des catastrophes », publié sur le site Contretemps.eu.
Face à la trajectoire destructrice imposée par le capitalisme militarisé, une stratégie écosocialiste de défense n'est pas une option parmi d'autres : elle est une nécessité politique et sociale. Elle commence par une rupture nette avec la logique de réarmement permanent portée par les États impérialistes, qu'elle prenne la forme de l'OTAN ou d'alliances similaires. Cette rupture implique la sortie des cadres militaires impériaux, le refus des objectifs de hausse des dépenses militaires, le rejet sans concession des armes nucléaires et la lutte active pour leur abolition. Elle suppose aussi de dénoncer la guerre pour ce qu'elle est dans le capitalisme contemporain : un marché lucratif et un instrument de domination au service du profit.
Un tel projet ne peut aboutir qu'à travers la construction d'un vaste mouvement antimilitariste transnational, capable de s'opposer à la remilitarisation austéritaire en cours au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ce mouvement doit s'attaquer au cœur idéologique du militarisme : une conception de la sécurité réduite à l'accumulation d'armes, de budgets militaires et d'infrastructures de guerre. À l'inverse, il s'agit de promouvoir une sécurité véritablement émancipatrice, fondée sur la satisfaction des besoins sociaux fondamentaux : un système de santé public fonctionnel, une éducation accessible, des emplois dignes, un logement garanti, un accès démocratique à l'énergie, des services sociaux renforcés et une réponse radicale à la crise climatique dans une perspective écosocialiste.
Cette transformation ne peut se faire sans celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans les secteurs concernés. L'antimilitarisme que nous défendons repose sur l'implication active des travailleuses et des travailleurs de l'industrie de l'armement, sur le soutien à leurs luttes syndicales et sur la reconversion des emplois et des savoir-faire vers des productions socialement utiles. Transports collectifs, infrastructures écologiques, énergies renouvelables, santé publique : la reconversion écosocialiste de l'appareil productif passe par le démantèlement des armes les plus destructrices, la réduction drastique de certaines productions et la socialisation d'autres, y compris dans le secteur militaire.
Mais cet antimilitarisme ne peut être ni abstrait ni strictement pacifiste. Il ne s'agit pas d'ignorer la violence impérialiste ni de laisser seuls les peuples contraints de se défendre pour survivre. Une stratégie écosocialiste de défense s'inscrit dans un antimilitarisme anti-impérialiste clair, qui distingue la guerre menée par les puissances dominantes des luttes d'autodéfense des peuples opprimés. Soutenir les résistances face à l'agression impérialiste — en Ukraine, en Palestine et ailleurs — y compris par la fourniture de moyens matériels pour leur autodéfense, n'est pas une contradiction, mais une exigence politique et morale. Si certaines armes doivent être abolies sans compromis, notamment les armes nucléaires et les systèmes offensifs, d'autres peuvent être mises au service des luttes anti-impérialistes et antifascistes afin de défendre concrètement les populations agressées.
Enfin, seule la convergence des luttes écologistes, anti-impérialistes, antiracistes, féministes, antifascistes et ouvrières peut faire échec à la stratégie de guerre permanente du capital. Cela implique de ne pas abandonner la question de la défense aux forces réactionnaires, de reconnaître les liens entre les peuples en résistance armée et les mouvements sociaux confrontés à une répression toujours plus militarisée, et de construire une sécurité fondée non sur la domination, mais sur la justice sociale, l'autodétermination des peuples et la préservation des conditions matérielles de la vie.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada doit agir pour empêcher Israël d’annexer la Cisjordanie

*Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, le 17 février 2026* – La Coalition du Québec URGENCE Palestine dénonce les mesures prises récemment par le gouvernement israélien, qui préparent le terrain à l'annexion illégale des Territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, et demande aux gouvernements canadien et québécois de poser immédiatement des actions
fortes pour dénoncer de telles politiques et exiger qu'elles soient renversées.
Le Cabinet de sécurité israélien a pris, le 8 février 2026, une série de décisions qui soustraient des portions importantes du Territoire de la Cisjordanie à l'Autorité palestinienne. Rappelons que les Accords d'Oslo de 1993 divisaient la Cisjordanie en trois zones (A, sous contrôle
palestinien ; B, sous contrôle sécuritaire israélien et administratif palestinien et C, sous contrôle exclusif israélien ; la zone C représentant 60 % du territoire). Au nombre des mesures adoptées : l'autorisation pour les Israélien·nes d'acheter des terres en Cisjordanie sans avoir à demander un permis de transaction à l'Autorité palestinienne, l'extension du pouvoir décisionnel israélien dans les zones A et B, ce qui pourrait accélérer la destruction de maisons palestiniennes, et la prise de contrôle israélienne du Caveau des patriarches à Hébron et du Tombeau de Rachel à Bethléem.
Le 15 février 2026, le gouvernement israélien a aussi approuvé une proposition visant à enregistrer de vastes zones de la Cisjordanie occupée comme « propriété de l'État », une première depuis le début de l'occupation du territoire en 1967.
De plus, le parlement israélien étudie actuellement un projet de loi visant à transférer la gestion des sites archéologiques de Cisjordanie au ministère israélien du Patrimoine.
Tout ceci s'ajoute à l'expulsion de 694 Palestinien·nes de leur domicile pour le seul mois de janvier 2026 et aux attaques incessantes des colons qui empêchent les Palestinien·nes de cultiver leurs terres et tuent plusieurs d'entre eux.
Ces mesures rendent possible l'annexion pure et simple de la Cisjordanie, comme s'en sont vantés le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Défense, Israël Katz. Une telle politique est contraire à la Charte de l'ONU (qui interdit l'acquisition de territoires par la force), aux conventions de Genève (qui interdisent le transfert de population d'une
puissance occupante dans le territoire occupé), aux résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, de même qu'à l'avis de la Cour internationale de justice de juillet 2024 qui déclarait illégales l'occupation et la colonisation israéliennes des Territoires palestiniens conquis en 1967.
La Coalition du Québec URGENCE Palestine demande au gouvernement canadien, qui a reconnu l'État palestinien, d'adopter immédiatement des sanctions à l'encontre d'Israël, dont la révocation de l'Accord de libre-échange Canada-Israël. Elle demande aussi au gouvernement québécois de fermer son bureau à Tel Aviv. Le Canada et le Québec doivent marquer fermement leur désaccord avec la volonté clairement exprimée de l'État d'Israël de s'emparer de l'ensemble du territoire de Palestine et ainsi s'associer aux divers pays qui accentuent leurs pressions politiques et économiques sur Israël afin d'exiger le respect du droit international et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien.
*Citations :*
« Il est important que le Canada concrétise son engagement en faveur d'un État palestinien et agisse immédiatement pour empêcher Israël de procéder à l'annexion de la Cisjordanie, après avoir rasé Gaza ».
– Diane Lamoureux, Coalition du Québec URGENCE Palestine
« Par son inaction, le Canada est complice non seulement du génocide à
Gaza, qui est toujours en cours, mais aussi de la dépossession violente du
peuple palestinien en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui s'est grandement
accélérée depuis octobre 2023 ».– Raymond Legault, Coalition du Québec URGENCE Palestine
*La Coalition du Québec URGENCE Palestine*, constituée en février 2024, compte 54 organismes membres (groupes de défense des droits, syndicaux, citoyens et communautaires), représentant des centaines de milliers de Québécois·es. La Coalition vise à rendre visible l'indignation de la société civile québécoise devant le génocide à Gaza et à rassembler les organisations qui réclament la fin de l'occupation en Palestine, de la
dépossession et de l'extermination des Palestinien·nes.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mi-figue, mi-raisin

À qui appartient un parti politique ? À ses fondatrices ? À ses employées ? À ses membres ? À ses donatrices ? À ses députées ? À ses porte-paroles ? Dans ce texte, une fois n'est pas coutume, le féminin l'emportera sur le masculin, une petite douceur féministe en ces temps difficiles pour la cause des femmes. Juridiquement, je ne sais pas, ce doit être une réponse compliquée.
Bien sûr, en régime capitaliste, la réponse la plus habituelle à cette question est que la personne qui paie est la propriétaire. Donc, le parti appartiendrait à ses membres et à ses donatrices. Depuis 2024, je ne fais plus de contributions annuelles, sans doute cela m'enlève-t-il de la légitimité pour me plaindre. Ou, au contraire, le fait de ne pas contribuer porte le message que je suis mécontente des orientations du parti. Je ne suis pas la seule. Je me suis retirée en périphérie et j'attends.
Je parle de la propriété du parti, mais véritablement, j'aimerais savoir à qui appartient la légitimité de la parole dans QS ? Pour bien des journalistes, une des personnes qui compte, c'est Renaud Poirier-St-Pierre. Comme dans un article de L'actualité paru la semaine dernière : « Renaud Poirier-St-Pierre, directeur de cabinet de Gabriel Nadeau-Dubois durant près de quatre ans, estime, lui aussi, que le modèle de QS a des limites. « Au sein du Comité de coordination national [sorte de conseil d'administration de QS], les porte-paroles n'ont qu'un vote chacun », souligne celui qui est maintenant directeur pour l'agence de communication TACT. » [1] Ainsi, même après avoir quitté son emploi et, apparemment, résisté à la culture du parti pendant tout ce temps, c'est à lui qu'on demande d'analyser ce qui ne fonctionne pas chez nous. L'existence du Comité de coordination national, de même que l'absence de chef n'est pas exactement une nouveauté, quiconque décidant de venir travailler ou militer dans QS devrait respecter la structure que les militantes se sont collectivement donnée. Poirier-St-Pierre était un des tenants de la « gauche pragmatique », il a participé à la tentative de changer les structures vers une formation politique plus traditionnelle. Cela a partiellement échoué. Inévitablement, son récit est celui qu'on privilégie dans les médias qui, semble-t-il, peinent toujours à comprendre que l'on veuille faire de la politique autrement après vingt ans d'existence de Québec solidaire.
De même, dans les pages du Devoir, Guillaume Boivin, celui-là, ancien président du syndicat des employées de QS, somme certaines militantes de la base de quitter ou de se rallier. Dans une publication de Meta en complément de sa lettre parue la semaine dernière, il affirme : « Pour le dire crûment : Christine Labrie ne peut faire du Christine Labrie en même temps que Haroun Bouazzi fait du Haroun Bouazzi et penser que le parti aura de la cohérence d'action nécessaire pour progresser. » Étrangement, le Conseil national (CN) du 21 février lui donne tort. D'un côté, on aura adopté l'exception dans Gouin, faisant montre d'un sens de la realpolitik qui devrait rendre les partisanes des urnes contentes ; de l'autre côté, on soutiendra la lutte contre les lois liberticides de la CAQ, comme le veulent plusieurs mouvements sociaux qui s'acheminent tranquillement, mais résolument vers une grève sociale. Cerise sur le sundae, une motion d'urgence pour soutenir Haroun Bouazzi, à nouveau dans la tourmente, a été votée par le Conseil national. Les militantes l'ayant soutenu lors de la dernière crise contre des parlementaires, qui voulaient le jeter sous l'autobus, sont surprises de ce changement de ton.
Revenons sur ce que dit, maladroitement, Boivin. Il faudrait, selon lui, se décider entre une approche pragmatique (et parlementaire) de collaboration avec les instances officielles, comme celle de l'Assemblée nationale, le temps d'arriver à se faire élire pour ne pas contredire l'opinion publique de manière frontale. L'ennui, c'est que je pense qu'il se trompe là aussi : personne ne sait ce qu'elle pense l'opinion publique, ou le peuple, ou la majorité silencieuse. Tout ce qu'on peut en connaitre est filtré par les agences de sondage, comme Léger, puis les empires médiatiques concentrés qui les publient, entre autres Quebecor. La version non filtrée, ce sont les mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent en ce moment ? Ils sont fortement irrités des lois liberticides de la CAQ, les groupes communautaires ne veulent pas voir leur parole étouffée et les syndicats non plus.
Depuis deux ans, les militantes de la base ont subi une traversée du désert en marche forcée : démission d'Émilise, réforme des statuts, réécriture du programme et pseudo-consultation pour la plateforme, le tout pour normaliser le parti, le rendre professionnel, comme les autres, aux yeux des journalistes et de la population. Nous sommes pris dans cette vision même si plusieurs de ses artisanes ont quitté le navire ou sont sur le point de le faire. Nous avons donc un programme javellisé et récuré de ses éléments plus radicaux qui sera porté par le sauveur. Ce dernier ne pourra que redonner de l'envergure et la notoriété au parti : il connait la job, c'est un professionnel ! Enfin, c'est ce que laisse penser la prise de décision de cette exception dans Gouin. On se gardera d'être cynique et de penser que c'est un autre politicien opportuniste, qui, soit traverse la chambre des communes soit change de palier de gouvernement pour conserver sa job.
Les membres du Parti de la rue croient que l'on doit continuer à accepter le tiraillement et la contradiction au sein de QS. C'est le coût démocratique. Ainsi, on devrait plutôt se dire qu'il faut : défendre ses principes, délibérer, être dissident quand c'est nécessaire, critiquer, être transparent et, finalement, se rallier aux décisions prises en assemblée, même si elles nous mécontentent. Car, quelle est l'alternative ? Quitter le parti après y avoir investi toute cette énergie ? La gauche est mal en point, elle va avoir besoin de militantes.
En définitive, je pense que nous allons apprendre bientôt à qui appartient le parti : à ses électrices. Et quand je dis électrices, ce n'est pas un effet de style : notre électorat est porté davantage par des femmes que des hommes. Ce sont elles qui auront, en octobre, le pouvoir final d'approuver ou non cette nouvelle version de QS.

Quatrième anniversaire de la guerre en Ukraine : déclaration du collectif éditorial Posle

Alors que la gauche et les syndicats québécois continuent d'ignorer magistralement les appels à l'aide de nos camarades Ukrainien·nes, voire pour certain·es reprennent sans honte, mot à mot, la propagande et les revendications des autorités russes, nous publions ici le communiqué de Posle, un collectif d'opposants Russes.
Une telle déclaration de solidarité provenant de militant·es Russes, qui met clairement en avant la complicité de Trump et de Poutine, contre le peuple d'Ukraine, tranche avec l'absence totale de solidarité du Collectif échec à la guerre (dont font partie Québec solidaire et de nombreux syndicats Québécois), incapable d'adopter une seule déclaration de solidarité avec nos camarades ukrainiennes qui ne cessent d'appeler à l'aide (contre les drones, les missiles ou simplement pour se chauffer). À croire que pour le Collectif, seul l'impérialisme états-unien existe et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est à géométrie variable.
Martin Gallié
Présentation de Posle :
POSLE : Après l'invasion russe en Ukraine, la vie dans les deux pays ne sera plus jamais la même. Mais pour pouvoir continuer à vivre et à agir, nous devons trouver des réponses à certaines questions cruciales. Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé ? Pourquoi est-il si difficile d'y mettre fin ? À quoi ressemblera l'avenir après la guerre ?
Posle (« après » en russe) tente de répondre à ces questions. En tant que communauté d'auteurs partageant les mêmes idées, nous condamnons la guerre qui a déclenché une catastrophe humanitaire, causé des destructions colossales et entraîné le massacre de civils en Ukraine. Cette même guerre a provoqué une vague de répression et de censure en Russie. En tant que membres de la gauche, nous ne pouvons pas considérer cette guerre indépendamment des immenses inégalités sociales et de l'impuissance de la majorité des travailleurs. Bien sûr, nous ne pouvons pas non plus ignorer l'idéologie impérialiste qui s'efforce de maintenir le statu quo et se nourrit du discours militariste, de la xénophobie et du sectarisme.
Déclaration :
Le quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie est marqué par les bombardements les plus intenses et les plus destructeurs des villes ukrainiennes depuis le début de la guerre. Plus de 1,2 million de foyers se retrouvent sans chauffage ni électricité en plein hiver rigoureux, et des centaines de milliers de personnes sont contraintes de vivre dans des conditions inhumaines. Les frappes de représailles ukrainiennes ont, à leur tour, entraîné des coupures d'électricité et des perturbations du chauffage à Belgorod. Pendant ce temps, les pertes russes ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le début de la guerre, bien que l'armée russe n'avance que d'environ 15 mètres par jour. Selon les estimations de Mediazona, au moins 200,186 soldats Russes ont été tués depuis le 24 février 2022. Ce décompte ne comprend que les noms qui ont été confirmés ; le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Néanmoins, il y a peu de raisons de croire que ces pertes, voire des pertes plus importantes, affaibliront la détermination du régime de Poutine à poursuivre la guerre.
Dans le même temps, le Kremlin considère le fossé grandissant entre l'UE et les États-Unis, ainsi que la volonté de l'administration Trump de conclure un accord bilatéral, comme une opportunité d'atteindre les « objectifs de l'opération militaire spéciale ». Lorsque les troupes russes ont envahi l'Ukraine en février 2022, la réaction mondiale a été sans équivoque : il s'agissait d'une guerre d'agression injustifiable, et la résistance de l'Ukraine était fondée non seulement sur le droit international, mais aussi sur les principes fondamentaux de moralité et de justice, des idées que l'humanité semblait avoir intériorisées après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, quatre années de carnage ont non seulement causé la mort de centaines de milliers de personnes, mais ont également entraîné un changement moral plus large. Les pourparlers initiés par l'administration Trump traitent la guerre comme « absurde » pour les deux parties — quelque chose à qui il faut mettre fin non pas en réaffirmant le droit international, mais en établissant un nouvel équilibre des pouvoirs. Dans cette vision du monde, il n'y a ni victimes ni agresseurs, ni bien ni mal — seulement les forts et les faibles, l'« équilibre » étant assuré par les concessions des seconds.
Ce changement moral dans l'opinion publique mondiale est peut-être la plus grande réussite de Poutine à ce jour. S'il devient le nouveau consensus, il ouvrira très certainement la voie à de nouvelles guerres plus destructrices, alimentées par le redécoupage des frontières des petits États et la réaffirmation du contrôle des grandes puissances sur leurs anciennes colonies. C'est pourquoi tout véritable mouvement anti-guerre doit aujourd'hui se tenir fermement et sans réserve aux côtés des victimes de l'agression. Il ne s'agit plus seulement de défendre le droit de l'Ukraine à l'indépendance, c'est le seul moyen crédible d'empêcher le monde d'être entraîné dans une spirale de conflits croissants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. « Bannon appelle l’ICE à intimider les électeurs lors des élections de mi-mandat »

Le 3 février, alors que Donald Trump redoublait d'efforts pour « nationaliser » les élections, Steve Bannon, le Raspoutine de MAGA, a promis à l'auditoire de son podcast War Room que des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) seraient déployés pour envahir les bureaux de vote lors des prochaines élections de mi-mandat le 3 novembre [1].
Tité de A l'Encontre
6 février 2026
Par Sasha Abramsky
(Capture d'écran)
« Vous pouvez être sûrs que l'ICE encerclera les bureaux de vote en novembre », a averti Bannon de manière inquiétante. « Nous n'allons pas rester les bras croisés et vous laisser voler à nouveau le pays. »
Pour être tout à fait clair, ni les propositions de Donald Trump ni celles de Bannon ne sont légalement recevables (ni fondées sur des faits). La loi interdit d'intimider les électeurs et électrices lorsqu'ils votent, et il est difficile de voir comment la présence d'agents armés et masqués appartenant à une organisation paramilitaire – qui n'a montré aucun scrupule à kidnapper et à tuer des personnes – pourrait avoir un quelconque autre objectif. De plus, la Constitution donne aux États le contrôle de leurs propres processus électoraux, ce qui contredit directement le souhait de Trump, exprimé dans une interview avec Dan Bongino, personnalité médiatique conservatrice, de voir le Parti républicain « prendre le contrôle » [« nationaliser les élections »] des systèmes électoraux d'au moins 15 États (The Hill, 2 février 2026).
Pourtant, Bannon et Trump sont très sérieux. Pour eux, toute élection qui ne se déroule pas comme ils le souhaitent est illégitime, et tous deux sont prêts à utiliser leurs vastes plateformes médiatiques pour inciter à des interventions armées dans les bureaux de vote. Tous deux sont apparemment indifférents aux normes démocratiques et prêts à pousser le système constitutionnel à ses limites pour arriver à leurs fins lors des élections de mi-mandat.
Le département de la Sécurité intérieure (DHS) a répondu à la rhétorique enflammée de Bannon en niant que l'ICE envahirait les bureaux de vote en novembre, mais il a déclaré que si l'ICE visait des individus particuliers, il pourrait les arrêter à proximité des bureaux de vote. Les détracteurs de l'ICE n'ont guère été apaisés par cette déclaration et, en milieu de semaine, beaucoup ont demandé que tout accord de financement du Congrès pour le DHS [dirigé par Kristi Noem] et l'ICE inclue des interdictions spécifiques concernant les opérations de l'agence dans les bureaux de vote ou à proximité.
Si Bannon avait simplement parlé à brûle-pourpoint, il aurait été possible de rejeter sa menace pesant les bureaux de vote comme étant simplement une hyperbole de la « War Room » (cellule de crise). Mais le moment choisi pour ses propos, après des semaines pendant lesquelles Trump a intensifié ses déclarations autour des « élections volées » et de la « fraude » dans les bureaux de vote, suggère que les stratèges de Trump mènent une action coordonnée pour saper la confiance dans les élections de novembre.
Trump a récemment déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir ordonné à la Garde nationale de saisir les urnes après les élections de 2020. Après avoir ruminé cette idée pendant plus de cinq ans, le président a ordonné la semaine dernière au FBI de se rendre dans le comté de Fulton, en Géorgie, pour perquisitionner les bureaux électoraux à la recherche de « preuves » attestant que les élections de 2020 avaient été entachées de fraude. Étonnamment, les agents du FBI étaient accompagnés de la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, qui a par la suite reconnu que Trump lui avait ordonné d'être présente pendant la perquisition. Plus étonnant encore, Tulsi Gabbard a ensuite appelé Trump sur son téléphone portable, lui a laissé un message et, lorsqu'il l'a rappelée, lui a fait parler directement avec les agents sur le terrain. Il s'agissait, a-t-elle déclaré plus tard aux journalistes, d'un bref appel, semblable à un discours d'encouragement de la part d'un entraîneur.
Vous vous souvenez de l'indignation suscitée lorsque les Clinton ont rencontré la procureure générale de l'époque, Loretta Lynch, sur le tarmac d'un aéroport pendant la campagne présidentielle de 2016, alors qu'Hillary Clinton faisait l'objet d'une enquête pour son utilisation d'un serveur de messagerie privé ? Vous vous souvenez des voix du Parti républicain qui réclamaient une enquête et exigeaient de savoir si les Clinton avaient fait pression sur Loretta Lynch pour qu'elle abandonne l'enquête ? Ce que Trump a fait en s'adressant aux agents du FBI dans le comté de Fulton (Géorgie) était bien plus inapproprié : il a essentiellement utilisé tout le poids de sa fonction pour pousser les agents à trouver des preuves d'un crime que de nombreuses enquêtes et procédures judiciaires antérieures n'avaient pas réussi à identifier. Et pourtant, les dirigeants républicains au Congrès sont restés totalement silencieux à ce sujet.
Le passé est bien sûr souvent le présage de l'avenir. La volonté de Trump de lancer le département de la Justice (DoJ) et le FBI à la poursuite des responsables électoraux de Géorgie et de saisir les bulletins de vote de cette élection (ainsi que la volonté de Pam Bondi du DoJ et Kash Patel du FBI de se prêter à cette sordide entreprise) suggère qu'il n'hésiterait pas à ordonner la saisie des urnes en novembre s'il pensait que le Parti républicain se dirigeait vers la défaite. Après tout, Trump sait que sans la majorité républicaine au Congrès, la protection dont il a bénéficié au cours de l'année écoulée disparaîtra et qu'il devra très probablement faire face à une troisième procédure de destitution.
Un nombre croissant de démocrates ont commencé à tirer la sonnette d'alarme à propos de ce scénario, suggérant une sérieuse inquiétude quant au fait que Trump n'acceptera tout simplement pas les résultats électoraux qui lui seront défavorables. Les récentes tentatives du département de la Justice d'accéder aux listes électorales des États à majorité démocrate n'ont fait qu'alimenter cette inquiétude. À ce jour, l'administration a poursuivi 24 États en justice afin de les contraindre à lui remettre des données électorales sensibles (State Democracy Research Initiative, 2 février).
Dans ce contexte, le soutien de Bannon à l'intimidation des électeurs revient à jeter de l'huile sur le feu. Le stratège en chef du MAGA, l'homme qui se vantait de « noyer la presse sous la merde » pour déstabiliser les médias et ses adversaires politiques, proclame que les républicains sont prêts à s'ingérer dans les élections de mi-mandat en intimidant les électeurs si nécessaire. Alors que de plus en plus de personnes réclament le « retrait de l'ICE de nos villes », elles pourraient bientôt devoir exiger le « retrait de l'ICE de nos bureaux de vote ». Pour préserver ce qui reste des élections libres et équitables, il est impératif que les électeurs et électrices ne se laissent pas intimider par ces manoeuvres autoritaires. (Article publié sur le site Truthout le 5 février 2026 ; traduction rédaction A l'Encontre)
[1] The Guardian du 6 février indique que : « Le sénateur démocrate de l'Arizona Ruben Gallego a appelé les Américains à organiser une grève générale qui “paralyserait le pays” au cas où Donald Trump tenterait de saboter les élections de mi-mandat. En effet, au début de la semaine, le président a appelé les républicains à « prendre le contrôle » et à « nationaliser » le vote dans au moins 15 régions non précisées, répétant ses fausses allégations selon lesquelles les élections seraient entachées de fraudes généralisées. Ruben Gallego a déclaré que les citoyens devaient se préparer au “pire scénario” lors des élections de novembre, comme l'arrêt du dépouillement des votes ou la saisie des urnes. Que signifie « nationaliser » le vote ? La Constitution américaine confère à chaque État la responsabilité de gérer ses élections. Trump semble demander au gouvernement fédéral d'organiser les élections, présentant cela comme un moyen d'empêcher les immigrants sans papiers de voter. L'affirmation selon laquelle les non-citoyens ont voté en nombre suffisant pour influencer une élection est un mensonge. » (Réd. A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Défendre LFI, faire front face à la fascisation

Le ministère de l'Intérieur a classé LFI à l'extrême gauche. Quand on milite dans une organisation révolutionnaire, il peut être tentant d'en plaisanter, de « fact-checker », de caractériser ce qu'est l'extrême gauche : la conscience que renverser le capitalisme et mettre fin aux systèmes d'oppression implique un affrontement ; la primauté accordée aux rapports de force par les mobilisations de masse plutôt qu'aux échéances électorales ; l'indépendance de classe plutôt que l'alliance avec des secteurs du patronat ; un internationalisme conséquent, qui ne cède rien au campisme ou à son propre impérialisme…
Hebdo L'Anticapitaliste - 788 (19/02/2026)
Par Olivier Lek Lafferrière
Crédit Photo
Wikimedia Commons
Copied to clipboard
Mais ce qui se joue ici n'est pas un débat interne à la gauche. La séquence politico-médiatique après les événements du 14 février à Lyon le confirme : l'objectif est de construire des chaînes d'équivalence infamantes : LFI = Extrême gauche = Antifa = Violence ; LFI = Extrême gauche = PropalestinienEs = Antisémitisme ; LFI = Extrême gauche = Islamogauchistes = AntirépublicainEs…
Le danger n'est plus seulement celui de la délégitimation morale. L'État peut dissoudre pour motifs politiques, comme avec le CCIF pour avoir dénoncé l'islamophobie d'État ou la Jeune Garde pour avoir organisé l'autodéfense face aux violences fascistes.
Toute une série de dispositifs permet d'étendre ces interdictions. La procédure contre la Jeune Garde vise LFI par association. La proposition de loi Yadan entend pénaliser des critiques d'Israël pour antisémitisme et, parallèlement, un projet de loi gouvernemental prévoit de rendre inéligible toute personne condamnée pour racisme — et donc avec la loi Yadan potentiellement tous les opposantEs au colonialisme israélien. L'empêchement électoral et légal de LFI devient un risque chaque jour moins invraisemblable.
LFI est au centre de l'offensive en raison de son poids politique et électoral. Mais les mouvements situés à sa gauche — antiracistes, féministes, LGBT, anticapitalistes — le sont plus encore.
Quelles que soient nos divergences, défendre LFI face aux attaques est un impératif. C'est tout le mouvement ouvrier, toute la gauche combative, tout le mouvement pour l'égalité et l'émancipation dont l'existence même est mise en cause par la fascisation en cours.
Renforcer les solidarités à tous les niveaux et constituer un véritable front unique antifasciste, c'est urgent et vital.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Débat. « Retour sur 2025 »

Il y a un peu plus d'un mois, nous sommes sortis de l'année 2025 et, en même temps, du premier quart du XXIe siècle. Le monde est criblé de conflits meurtriers, dont les deux plus emblématiques sont l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine et la destruction systématique du peuple palestinien et de son territoire par l'État d'Israël, sans oublier les guerres civiles au Soudan, en Éthiopie, au Yémen, en R.D. du Congo, la régression des droits des femmes en Afghanistan et l'atroce répression en Iran. Les rapports de force internationaux sont chamboulés par l'affrontement entre les plus grandes puissances économiques et militaires, les États-Unis et la Chine, et celle qui voudrait bien être à leur hauteur, la Russie.
Tiré de A l'Encontre
19 février 2026
Par Jean-Marie Harribey
John Wilson Carmichael, The Irwin Lighthouse, Storm Raging, 1851
Le basculement géopolitique se produit au moment où l'édifice démocratique est lui-même ébranlé par la montée des mouvements d'extrême droite arrivant au pouvoir ou s'approchant de celui-ci. Il s'ensuit un affaiblissement général des régulations internationales fonctionnant jusqu'alors tant bien que mal, notamment celles concernant le changement du climat et le système monétaire. Les plaques tectoniques bougent sous l'effet conjugué de forces qui sont à la fois techno-économiques et socio-culturelles. Ces forces prennent des formes variables selon les pays et les régions du monde, mais, au-delà de leur diversité, il faut repérer ce qui leur donne une dimension systémique et structurelle.
Le petit bout de la lorgnette
Commençons par examiner le lieu commun de la plupart des discours économiques et politiques. Le cas de la France est particulièrement éclairant. Elle a connu en 2025 un taux de croissance économique de 0,9 %. Le gouvernement français se réjouit de cet exploit qui, naguère, serait passé pour un désastre. La productivité du travail, lit-on, « se redresse » depuis 2024 et 2025 et le redressement « devrait se prolonger en 2026 » [1]. Or elle n'a fait que retrouver le niveau de 2019 avant la pandémie. Le plein emploi que Macron devait atteindre à la fin de son second mandat ne sera jamais atteint. Le taux de chômage avoisine de nouveau 8 %. Et sa lente décrue de 2012 à 2022 n'était due qu'à la création d'emplois précaires et mal payés et à l'aide à l'apprentissage qui permettait aux jeunes d'avoir un emploi déguisé.
La plupart des commentateurs, et le gouvernement lui-même, répètent inlassablement que la faiblesse, pourtant chronique, de la progression de la productivité du travail, serait due à l'instabilité politique née de la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 et du résultat des élections législatives suivantes. C'est vraiment regarder la situation par le petit bout de la lorgnette. C'est ne pas comprendre quelles sont les évolutions fondamentales du capitalisme en France, en Europe et dans le monde. Il suffirait de regarder ce qui se déroule en Allemagne pour ouvrir les yeux. Ce pays, présenté jusqu'ici comme le modèle envié, est dans l'impasse. Son modèle exportateur s'effondre dans les secteurs clés qui avaient fait sa force. En 2023 et 2024, son taux de croissance était négatif ; en 2025, il n'était que de 0,2 % [2].
Penser que nous sommes en face d'une crise conjoncturelle, c'est ignorer les transformations profondes du capitalisme qui ont structuré le dernier quart du XXe siècle et le premier quart de celui-ci. On lira avec intérêt l'analyse de Michael Roberts sur l'économie américaine qui confirme l'écart entre « dépenses colossales [d'investissements] et gains de productivité très incertains » ; les premières connaissant une évolution exponentielle depuis 20 ans, pendant que, « sans la technologie, l'économie américaine serait proche de la récession » et que le déficit commercial en biens et services s'est dégradé de 31 % pendant les sept premiers mois de 2025, comparativement à la période analogue de 2024. Hormis les très grandes entreprises, « dans l'ensemble, le secteur des entreprises non financières étatsuniennes commence à voir la croissance de ses bénéfices s'estomper. », ce qui conduit l'auteur à conclure à un « épuisement du modèle » [3].
La trame de la crise capitaliste
La trame des convulsions que traverse le capitalisme actuel est la crise d'un mode de production qui voit se rapprocher à grands pas les limites de son expansion qu'il voulait infinie [4]. Quand le travail prolétaire est malmené et quand s'étend la difficulté à utiliser les ressources naturelles menacées d'épuisement ou de dégradation irréversible, le résultat est un effondrement en cinquante ans de la progression de la productivité du travail, qui reste l'ultime source de la rentabilité du capital [5]. Pendant cette longue période, les idéologues du capital ont répété à l'envi que les nouvelles techniques d'information et de communication, la généralisation de l'usage de l'informatique et des ordinateurs, puis l'automatisation et la robotisation, allaient, d'ici peu, inverser la tendance et refaire partir la machine au galop. Peine perdue ! C'est au tour de l'intelligence artificielle de renouveler la même promesse. Qui y croit encore ? Sans doute pas vraiment les protagonistes de la Silicon Valley. En effet, les géants de la tech comme Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft, annoncent qu'ils investiront 600 milliards de dollars en 2026 pour se doter, entre autres, de gigantesques data centers, en fermant les yeux sur leur rentabilité à venir.
Trois difficultés majeures se dressent qui risquent de perturber gravement la venue du miracle attendu. Premièrement, la rentabilité de ces énormes investissements n'est pour l'instant pas au rendez-vous. L'immense cash détenu par ses géants ne provient pas d'une profitabilité matérielle préalablement accumulée mais plutôt d'une centralisation des rentes récupérées, surtout par le biais de la captation de la publicité [6]. Deuxièmement, les capitaux investis dans l'organisation capitaliste numérique s'entrecroisent et leurs propriétaires s'achètent entre eux les services produits : « lorsque Netflix lui [à Amazon] règle sa facture annuelle – estimée à un milliard de dollars – elle ne verse pas un tribut féodal mais elle achète la machinerie numérique indispensable à son fonctionnement » [7]. On a donc affaire à un « capitalisme incestueux » [8] qui donne l'apparence d'une capacité de relance alors qu'il ne s'agit peut-être que d'une illusion. Troisièmement, le risque d'un éclatement de la bulle IA est devenu la hantise des financiers et des banquiers centraux. Par exemple, en dix jours, l'action Microsoft a perdu 18 %, partiellement regagnés ensuite, mais révélant ainsi la nervosité des spéculateurs sur l'IA. Autre signe : sur les 600 milliards d'investissements projetés en 2026, la moitié serait financée par emprunts. Quelle peut être la garantie de cette dette si la rentabilité réelle n'est pas au rendez-vous ? D'autant que le prix des microprocesseurs et surtout celui des puces à mémoire vive croissent rapidement. À ces contraintes de coûts vont s'ajouter celles au sujet des besoins en eau et en électivité pour faire tourner les centres de données.
Du côté des grands banquiers centraux, c'est le grand écart. La Réserve fédérale états-unienne interrompt la baisse de ses taux directeurs pour contrecarrer la chute du dollar, au grand dam du président Trump. La Banque centrale européenne vient de décider de ne rien faire puisqu'elle estime avoir (trop bien ?) rempli sa mission de réduire à presque zéro l'inflation. Mais cette valse-hésitation des banquiers centraux doit être reliée à leur volonté tardive de créer des monnaies numériques de banque centrale, qui soient à même de parer la tendance à ce que les crypto-actifs supplantent les monnaies souveraines, tendance soutenue par Trump qui y voit l'occasion pour les stablecoins assis sur le dollar de pérenniser encore la suprématie de ce dernier, principale arme économique de l'impérialisme américain [9].
L'impérialisme, vraiment stade ultime ? [10]
En 1902, l'économiste John A. Hobson crée le terme d'impérialisme pour critiquer la domination britannique dans le monde [11]. Le socialiste autrichien Rudolf Hilferding l'utilise en 1910 pour montrer la fusion du capital industriel et du capital bancaire et financier [12]. Lénine s'inspire des deux pour écrire en 1916 L'impérialisme, stade suprême du capitalisme [13] qui tente par l'exportation de capitaux de contrer la baisse tendancielle du taux de profit au fur et à mesure que la création de plus-value par la force de travail évolue moins vite que les investissements matériels. Mais, trois ans auparavant, en 1913, Rosa Luxemburg avait innové par rapport à l'analyse marxiste traditionnelle de Lénine en montrant que l'accumulation du capital [14] exige deux choses : l'anticipation par le crédit bancaire de la plus-value pour que le capital puisse vendre son équivalent de marchandises et le transformer en profit monétaire [15] ; et l'élargissement constant de la sphère du capital en intégrant de gré ou de force des secteurs et des territoires extérieurs à elle-même. De là résultent l'expansion coloniale, qui connaît un bond au XIXe siècle, et les formes modernes de l'impérialisme. Maints historiens ont vu dans cette lutte pour la conquête de nouveaux espaces, notamment entre la France et l'Allemagne, les ferments de la Première Guerre mondiale.
Les fondements de cette analyse sont restés pertinents pendant tout le XXe siècle mais ont intégré le fait que, en plus d'une domination économique des pays capitalistes développés sur les autres, s'exerçait une domination politique et culturelle. Pillage du tiers monde, échange inégal et développement inégal furent ainsi analysés notamment par André Gunther Franck, Arghiri Emmanuel et Samir Amin [16], mais, malgré les luttes anticoloniales, l'impérialisme économique se doublait de l'installation de pouvoirs locaux à la solde de la bourgeoisie impériale.
Aujourd'hui, les contradictions socio-économiques, écologiques et politiques se conjuguent. Poutine est obsédé par la reconquête de territoires de la défunte URSS, Netanyahou élimine Gaza et colonise toute la Cisjordanie, Xi Jinping lorgne sur Taïwan et Trump bombarde Caracas, kidnappe Maduro, incite les pétroliers à reprendre leurs activités profitables au Venezuela, avant peut-être de s'emparer du Groenland et de menacer le Canada, la Colombie et Cuba. Suivant la doctrine Monroe, l'Amérique est une chasse gardée des États-Unis. Le temps des empires est revenu où intérêts économiques et stratégiques se mêlent et aiguisent les tensions géopolitiques.
Partout, les métaux rares, les réserves de ressources dans l'Arctique ou ailleurs et la terre africaine sont convoités par les firmes et États impérialistes. Mais, comme il y a des limites objectives à l'exploitation de la force de travail et à celle de la nature, il s'ensuit que la production de valeur et donc de plus-value s'essouffle au point que les gains de productivité du travail s'érodent. Les palliatifs à cet enchaînement délétère sont l'élargissement de la sphère marchande pour compenser la baisse de la valeur unitaire de chaque marchandise, et la financiarisation pour concentrer la richesse : c'est la fuite en avant productiviste et financière. Et, afin de vaincre les résistances à l'exploitation et la domination générales, il faut jeter par terre l'État de droit et les règles du droit international. Ce n'est pas l'anthropocène, c'est plus que le capitalocène, c'est le capitalobscène.
Au chaos socio-économico-écologique s'ajoute un chaos géopolitique
Quatre années pleines que dure maintenant la guerre impérialiste de la Russie en Ukraine. Aussi longue que la Première Guerre mondiale. Presque autant que la Seconde, et ce n'est hélas pas fini, tant que perdureront la comédie des négociations entre Trump et Poutine et les atermoiements et les velléités des pays européens, surtout d'accord pour ne pas faire grand-chose.
En parallèle, et depuis bien plus longtemps encore, trois quarts de siècle de colonialisme d'une violence extrême de l'État d'Israël en Palestine visent à chasser les Palestiniens qui ne sont pas tués, à détruire leur territoire, et à empêcher définitivement tout projet d'État pour eux. Certaines voix prétendaient que le 7 octobre du Hamas était « une opération militaire d'envergure nécessaire qui a produit une modification brusque et radicale du rapport de force régional en faveur des Palestiniens » [17]. Je pense que, au vu des massacres du 7 octobre et de ceux à tendance génocidaire de la part de l'État d'Israël, le soi-disant « rapport de force en faveur des Palestiniens » était une vue funeste de l'esprit. La gauche et les gauches françaises se sont fracassées sur cette discussion. Ce n'est qu'une illustration de plus de leurs pannes théoriques et stratégiques.
Des pannes d'autant plus désarmantes que l'hypothèse d'une fin de la phase néolibérale du capitalisme devient crédible sans qu'une réponse à la hauteur ne s'esquisse. Les prémisses d'un tournant libertarien sont maintenant visibles. Le symbole est le massacre à la tronçonneuse des protections sociales, des services publics et du maximum de régulations en Argentine et aux États-Unis. Sur le continent européen, le massacre des espaces collectifs se fait avec une scie à main, mais, si c'est moins brutal, cela n'en pas moins d'effets à long terme. Au vu des restrictions apportées aux allocations chômage, du recul de l'âge de la retraite, du délabrement de l'hôpital, de l'école et de l'enseignement supérieur, la France en sait quelque chose. Et, par-dessus tout, la démocratie est remise en cause par les coups de boutoir de l'extrême droite, au pouvoir dans plusieurs pays européens ou sur le point d'y parvenir.
Le monde semble pris au dépourvu par ce chambardement, sinon par ce basculement. Pourtant, nous étions prévenus. Depuis les années 1930-1940, les Schmitt, Von Mises, Lippmann, Hayek et la Société du Mont-Pèlerin avaient défini la finalité ultime : imposer le marché absolu en tous domaines et en tous lieux, au nom d'une prétendue liberté totale des individus, débarrassés de tout enracinement collectif. L'utopie irréaliste parfaite car impossible, déniant aux humains leur caractère d'êtres sociaux [18]. L'anthropologue austro-hongrois Karl Polanyi avait averti que ce délire risquerait de conduire à la mort de la société [19]. Si celle-ci n'est pas advenue, on voit tout de même l'arrivée des « lumières de l'ombre » émises par un courant « néoréactionnaire » [20] qui a désormais pignon sur rue aux États-Unis jusque dans les allées du pourvoir trumpiste.
Répétons-le, on ne peut être certain de la fin d'une période et du début de la suivante qu'après coup. Raison de plus d'être en garde. Le capitalisme change, ce serait étonnant que l'altermondialisme lié à sa phase néolibérale en sorte intact et perdure comme si de rien n'était [21]. (Publié par Jean-Marie Harribey sur son blog sur le site d'Alternatives économiques le 11 février 2026)
Notes
1. Nathalie Silbert, « Portée par le numérique, la productivité de l'économie française se redresse », Les Échos, 10 février 2026.
2. Peter Wahl, « L'économie allemande dans une crise structurelle inouïe », Note pour les Économistes atterrés, février 2026.
3. Michael Roberts, « La bulle de l'IA et l'économie étatsunienne », Contretemps, 27 janvier 2026.
4. Jean-Marie Harribey, « Derrière la crise politique, une convulsion capitaliste », 7 décembre 2024 ; « Le monde penche du mauvais côté », 18 mars 2025.
5. Jean-Marie Harribey, En quête de valeur(s), Vulaines-sur-Seine, Éd. du Croquant, 2024.
6. Jean-Marie Harribey, « Capitalisme productif et/ou capitalisme rentier ? », 2 décembre 2025.
7. Evgeny Morozov, « Controverses sur le techno-féodalisme, Le numérique nous ramène-t-il au Moyen Âge ? », Le Monde diplomatique, août 2025.
8. Le mot se trouve dans Arnaud Leparmentier, « IA : la folle course des géants de la tech », Le Monde, 8 et 9 février 2026.
9. Voir le dossier « Basculement économique, monétaire et financier » dans Les Possibles, n° 43, automne 2025.
10. Ce paragraphe est issu de ma chronique « L'ère du capitalobscène », Politis, n° 1897, 15 janvier 2026.
11. John A. Hobson, Imperialism, A Study, 1902.
12. Rudolf Hilferding, Le capital financier, 1910.
13. Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1917.
14. Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Paris, François Maspero, 1972.
15. Jean-Marie Harribey, « Karl Marx, Charles Dumont et Édith Piaf : « rien de rien » ou la réalisation monétaire de la production capitaliste », 16 mai 2018 dans le blog et Été 2018 dans Les Possibles, n° 17.
16. André Gunder Franck, Le développement du sous-développement, L'Amérique latine, Paris, Maspero, 1972 ; Arghiri Emmanuel, L'échange inégal, Paris, Maspero, 1969 ; Samir Amin, Le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique, Paris, Ed. de Minuit, 1973.
17. Saïd Bouamama, « Palestine et Moyen-Orient : Buts officiels de guerre et buts réels », 12 mai 2025. La citation rapportée par l'auteur sur son blog dans la présentation de ce texte expliquant le refus de la revue Les Possibles que j'ai signé est exacte, sauf que ce texte n'avait pas été sollicité par les responsables de la revue. Il s'en est suivi une levée de boucliers de la part d'une petite poignée de personnes s'insurgeant contre une « censure », alors que toute direction de revue est en droit d'accepter ou de refuser une proposition. Surtout quand elle contient une bévue aussi tragique. [Voir dans le quotidien Le Monde du 5 février 2026 l'article de bilan critique sur le 7 octobre et ses conséquences fait par un ancien cadre du Hamas vivant à Gaza. – Réd.]
18. Jean-Marie Harribey, « Les racines intellectuelles du libertarisme et de la démocratie dite illibérale », Note pour les Économistes atterrés, octobre 2025.
19. Karl Polanyi, La grande transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1944, Paris, Gallimard, 1983.
20. Arnaud Miranda, Les Lumières sombres, Comprendre la pensée néoréactionnaire, Paris, Gallimard, 2026. Voir aussi Ugo Palheta, Comment le fascisme gagne la France, Paris, La Découverte, 2025.
21. Voir le dossier « Où en est l'altermondialisme dans un contexte de crise globale du capitalisme et de montée de l'extrême droite ? », Les Possibles, n° 40, Été 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’agression croissante des États-Unis est un symptôme du déclin impérial

Des Amériques au Moyen-Orient, les États-Unis déploient les formes les plus brutales d'agression impériale pour maintenir leur pouvoir. Il s'agit en fin de compte d'un signe de faiblesse plutôt que de force, car les fondations sur lesquelles reposait l'empire américain sont en train de s'effondrer.
22 février 2026 | tiré de la lettre de Jacobin | Photo : Privés de toute grande vision structurante, les impérialistes américains jettent tout ce qu'ils ont sous la main pour voir s'ils peuvent inverser leur dénouement impérial. (Leonard Ortiz / MediaNews Group / Orange County Register via Getty Images)
https://jacobin.com/2026/02/us-imperialism-decline-military-aggression
L'impérialisme américain est en roue libre. Sous Joe Biden, la Maison-Blanche a violé de manière flagrante le droit international en permettant le génocide du peuple palestinien par Israël. Aujourd'hui, Donald Trump est allé encore plus loin dans la même direction.
Jusqu'à présent, son administration a fait chanter les partenaires européens de Washington, lancé des frappes aériennes contre l'Iran, déclaré son intention d'occuper le Groenland et kidnappé le chef de l'État vénézuélien, tout en continuant à soutenir le génocide israélien.
Les États-Unis ont directement attaqué « l'ordre international fondé sur des règles » qu'ils avaient eux-mêmes contribué à établir, en affaiblissant les Nations unies, en se retirant de l'Organisation mondiale de la santé et en imposant des sanctions à la Cour pénale internationale.
Aussi terrifiantes que puissent paraître ces offensives impérialistes, elles sont le signe non pas de la force, mais de la faiblesse. Il ne s'agit pas simplement de la faiblesse des individus actuellement aux commandes, mais de celle des États-Unis dans leur ensemble. Si la sénilité de Biden et l'imprévisibilité de Trump ont certes joué un rôle, la trajectoire effrayante de l'impérialisme américain découle de dynamiques bien plus profondes.
L'imperium américain traverse aujourd'hui une crise grave. Ce que nous observons n'est pas sa résurgence, mais plutôt les symptômes de son déclin frénétique.
L'empire le plus puissant de l'histoire
Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs facteurs ont permis aux États-Unis de devenir l'empire le plus puissant de l'histoire. Il y avait bien sûr la domination militaire. Sa marine était plus importante que celles de tous les autres États réunis, il contrôlait un chapelet de bases à travers le monde et, pendant plusieurs années, il fut le seul pays à posséder l'arme nucléaire.
Cependant, la puissance militaire à elle seule ne suffit pas à faire un impérialisme solide. L'empire américain a largement bénéficié de l'avance technologique du pays et de sa puissance économique sans équivalent. À un moment donné, la moitié de tous les biens manufacturés de la planète étaient produits aux États-Unis.
Les États-Unis reposaient également sur de solides fondations de légitimité intérieure. Les deux principaux partis politiques s'accordaient sur la plupart des questions fondamentales et, pendant des années, la majorité des Américains faisait confiance à son gouvernement.
L'imperium américain traverse aujourd'hui une crise grave. Ce que nous observons n'est pas sa résurgence, mais les symptômes de son déclin frénétique.
Un autre facteur vital était le soutien international. Les États-Unis pouvaient agir avec une telle ampleur parce qu'ils commandaient l'allégeance d'un bloc impérial transcontinental relativement uni.
Au cœur de cette alliance se trouvaient les États-Unis. Autour d'eux, un noyau étroit composé du Japon, de l'Allemagne de l'Ouest et de la Grande-Bretagne. Puis venait une autre couche d'États capitalistes européens, rejoints par la suite par d'autres alliés comme l'Iran, Israël, la Corée du Sud et les Philippines. Washington s'engageait à protéger le capitalisme à l'échelle mondiale, et cette alliance impériale lui apportait le soutien nécessaire pour intervenir partout dans le monde afin de réprimer tout mouvement perçu comme une menace pour cet ordre capitaliste global.
Mais ce qui maintenait l'ensemble, c'était la grande vision « civilisationnelle » de l'État américain. Les fractions composant le bloc dirigeant américain ne cherchaient pas simplement à s'enrichir. Beaucoup croyaient que leur pays avait atteint le sommet de la civilisation humaine. La vie américaine était « la belle vie » : un emploi stable, une famille nucléaire, une montagne de biens de consommation abordables, des libertés civiles et des élections tous les quatre ans. Certes, il restait des problèmes, mais ils seraient résolus avec le temps.
De plus, les États-Unis affirmaient que leur modèle était universellement reproductible. Partout, les gens pouvaient eux aussi devenir « américains », pour ainsi dire, s'ils acceptaient de suivre le modèle que l'État américain avait découvert. Ils promettaient également d'aider à atteindre cette belle vie par l'aide, les prêts, les transferts de technologies et la formation dans leurs meilleures universités. Autrement dit, l'objectif de l'État américain n'était pas seulement de maintenir son pouvoir, mais de remodeler le monde à son image.
La réalité, bien sûr, a toujours été différente de ce qui était promis, et de nombreuses personnes à travers le monde détestaient l'impérialisme américain. Bien qu'il prétendît apporter la paix, la liberté et la prospérité, les États-Unis sont devenus le plus grand adversaire des mouvements émancipateurs partout dans le monde. Ils ont renversé des démocraties, soutenu des dictatures, massacré des millions de personnes et détruit toute alternative dès qu'elle apparaissait.
Pourtant, des millions de personnes ont néanmoins accepté volontairement le leadership américain durant les années d'après-guerre, car elles croyaient sincèrement que les États-Unis représentaient le sommet du développement humain. Elles voulaient vivre le « rêve américain ». C'est précisément pour cette raison que l'impérialisme américain était si puissant. Il ne gouvernait pas seulement par la terreur, mais par le consentement international.
Un impérialisme en déclin
Aujourd'hui, l'empire américain n'est plus ce qu'il était. Un à un, les facteurs majeurs qui faisaient autrefois sa puissance ont commencé à s'effriter. Les États-Unis ont perdu leur avance technologique dans de nombreux domaines, et la récente guerre de Trump contre les universités ne fera qu'élargir cet écart, retardant la recherche et le développement américains de plusieurs décennies.
L'économie américaine est également dans un état préoccupant. Le gouvernement accumule un déficit sans précédent, et une grande partie de l'économie est liée à des actifs spéculatifs comme l'immobilier, les actions, les métaux précieux, les cryptomonnaies et une bulle de l'intelligence artificielle. Des rivaux comme la Chine ne se contentent pas de rattraper les États-Unis : ils les dépassent sur des points essentiels. Les principales exportations chinoises vers les États-Unis sont des produits électroniques, tandis que la principale exportation américaine vers la Chine ces dernières années a été le soja.
Parallèlement, la légitimité intérieure de l'État américain s'est effondrée, et la confiance dans les grandes institutions — les médias, les universités, l'État lui-même — est à un niveau historiquement bas. Seuls 17 % des Américains font confiance à leur gouvernement pour « faire ce qui est juste ».
Un à un, les facteurs majeurs qui faisaient autrefois la puissance des États-Unis ont commencé à s'effondrer.
Le tissu de la vie américaine se déchire, avec une explosion du coût de la vie, un système de santé dysfonctionnel, des fusillades de masse incessantes et des descentes de l'ICE (la police de l'immigration). Pour beaucoup, ce pays n'est ni sûr, ni stable, ni agréable à vivre. Selon un sondage, seuls 13 % des jeunes Américains pensent que leur pays va dans la bonne direction.
Si des millions rêvaient autrefois d'émigrer vers la « terre des opportunités », beaucoup hésitent désormais. De nombreux Américains cherchent même à obtenir une double nationalité afin de pouvoir quitter ce navire en train de couler.
Ces problèmes intérieurs expliquent en grande partie pourquoi de nombreux Américains, tous bords politiques confondus, ne soutiennent plus les interventions américaines à l'étranger. Ayant vécu l'échec des guerres récentes, ils en sont venus à la conclusion qu'il est absurde que l'État américain gaspille leurs impôts dans des guerres inutiles à l'étranger alors que la vie intérieure se détériore.
Près de la moitié des Américains souhaitent que le gouvernement réduise son rôle dans le monde. L'époque où la majorité suivait docilement son gouvernement, de la Corée et du Vietnam à l'Afghanistan et à l'Irak, semble révolue.
Un bloc dirigeant fracturé
Malgré la détérioration évidente de la situation intérieure, aucune des principales fractions du bloc dirigeant n'a été disposée à engager de véritables réformes structurelles. Alors qu'autrefois l'État américain cherchait à obtenir le consentement par des programmes sociaux et des politiques économiques améliorant la vie de nombreux Américains, les dirigeants actuels se contentent de changements largement symboliques. Les démocrates ont nommé la première femme à la tête de la CIA et peint des drapeaux arc-en-ciel sur des fourgons de police ; les républicains nous ont offert le golfe d'Amérique et le Département de la guerre.
Dans le même temps, le bloc dirigeant américain est profondément divisé. Les dirigeants d'un camp poursuivent en justice ceux de l'autre, et les camps eux-mêmes sont devenus dangereusement incohérents. La coalition autour de Trump comprend des néoconservateurs qui veulent qu'Israël colonise le Moyen-Orient et des isolationnistes qui souhaitent s'en retirer complètement ; des milliardaires désireux de sabrer l'État social et des populistes voulant l'étendre ; des suprémacistes blancs qui veulent « purifier » le territoire et des immigrés voyant dans le Parti républicain un moyen d'ascension sociale ; des fondamentalistes religieux attendant l'Armageddon et des techno-oligarques athées rêvant de devenir des cyborgs.
Malgré la détérioration évidente de la situation intérieure, aucune des principales fractions du bloc dirigeant n'a été disposée à engager de véritables réformes structurelles.
Les États-Unis ont également gravement compromis leur alliance impériale. Ils ont aliéné leurs alliés européens, de toute façon bien plus faibles qu'ils ne l'étaient dans les années 1950 et 1960. Ils ont tendu leurs relations avec d'autres États alliés comme l'Inde et infligé des dégâts durables à l'ordre international qu'ils avaient construit après la Seconde Guerre mondiale. « Nous sommes au milieu d'une rupture, pas d'une transition », a récemment déclaré le premier ministre canadien Mark Carney à Davos. « Nous savons que l'ancien ordre ne reviendra pas. »
Le principal indicateur du déclin impérial américain est la désintégration de sa vision « civilisationnelle ». Le projet d'après-guerre qui soutenait l'ordre libéral international a disparu, et rien n'est venu combler le vide. Certains membres du bloc dirigeant ont proposé des substituts, mais au lieu de se rallier à une vision unique, ils se disputent autour de projets incompatibles : un État ethno-nationaliste suprémaciste blanc ou un multiculturalisme identitaire ; un capitalisme social rénové ou encore plus de néolibéralisme ; la renaissance des États-Unis comme centre manufacturier mondial ou leur dissolution dans un nouvel ordre post-national dirigé par les entreprises technologiques.
Le problème principal est que la plupart des éléments du bloc dirigeant, démocrates comme républicains, semblent ne même pas disposer d'une vision globale cohérente. Il semble parfois que certains des acteurs les plus importants de ce bloc — de l'initiée de la Bourse Nancy Pelosi au marchand de taudis Trump — veuillent simplement s'enrichir. Ils cherchent à gonfler le marché boursier, à remplir leurs poches avec autant de richesse sociale que possible et à extorquer des tributs à leurs États clients. On dirait que le pays est dirigé par une bande de vandales égoïstes.
Étant donné que l'un des piliers essentiels de l'impérialisme américain était une vision « civilisationnelle » relativement cohérente de l'avenir, partagée par la plupart des fractions du bloc dirigeant, soutenue par ses alliés à l'étranger et acceptée par des millions de personnes à travers le monde, l'absence totale d'une telle vision aujourd'hui ne peut qu'annoncer des difficultés pour l'impérialisme. Convaincus que les États-Unis n'ont plus rien à leur offrir, des millions de personnes se tournent ailleurs.
À terre, mais pas hors-jeu
Les États-Unis conservent encore certains atouts. Ils disposent de l'armée la plus avancée du monde, suffisamment puissante pour raser des pays entiers et massacrer des millions de personnes.
Washington possède également le dollar, qui demeure la monnaie la plus puissante. Il est devenu une arme redoutable contre des adversaires comme l'Iran. Même des rivaux de poids comme la Chine sont tellement imbriqués dans le régime du dollar qu'ils doivent réfléchir à deux fois avant de défier directement la suprématie financière américaine — du moins pour l'instant.
L'État américain est également relativement à l'abri de défis révolutionnaires internes. Historiquement, les troubles intérieurs ont contribué à la chute des empires. Bien qu'il existe un mécontentement généralisé et de nombreuses luttes importantes aux États-Unis, rien ne constitue encore une menace sérieuse pour l'empire américain.
Les États-Unis ne font pas non plus face à de véritables concurrents internationaux. Le Venezuela est en crise et a opposé peu de résistance à la capture illégale de son président. La Russie est empêtrée dans une guerre coûteuse, et ses propres aventures impériales ont sapé sa crédibilité. La République islamique d'Iran a une économie affaiblie et un front intérieur miné par la contestation. Bien que la Chine ait le plus grand potentiel pour déjouer les États-Unis, elle a jusqu'à présent évité toute confrontation directe, espérant que Washington s'épuisera de lui-même dans des engagements stériles, lui ouvrant ainsi la voie pour hériter du monde.
Bien que la Chine ait le plus grand potentiel pour surpasser les États-Unis, elle a jusqu'à présent délibérément évité toute confrontation directe.
Le plus grand avantage de l'impérialisme américain est qu'aucun de ses rivaux ne propose une vision crédible d'un nouvel ordre mondial capable de mobiliser des millions de personnes. Aucun n'a articulé un projet hégémonique véritablement fondateur. Malgré leurs différences réelles, ils représentent tous des variantes d'un même capitalisme autoritaire. Il n'existe pas encore d'alternative organisée.
Comment les empires prennent fin
Le bloc dirigeant sait que l'empire américain est en déclin et qu'il lui reste peu de cartes à jouer. Nombre de ses dirigeants ont conclu qu'il fallait tenter un coup audacieux avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi l'impérialisme américain est devenu si imprudent ces dernières années.
Privés de toute grande vision structurante, ou des moyens de la réaliser même s'ils en avaient une, les impérialistes américains lancent tout ce dont ils disposent pour tenter d'inverser leur dénouement impérial : soutien à un génocide, imposition de droits de douane, enlèvement d'un dirigeant étranger, pressions sur les vassaux européens, nouvelle guerre contre la drogue, attaques contre les immigrés, accélération des changements de régime à l'étranger, promotion de la suprématie blanche et destruction de l'ordre international. Aucune de ces manœuvres spectaculaires n'a résolu la crise de l'empire, alors ils continuent de surenchérir.
L'impérialisme américain est en déclin, mais il est loin d'être hors de combat, et ses efforts frénétiques pour se sauver risquent de le rendre encore plus dangereux dans les années à venir. Comme des bêtes acculées, les empires en déclin sont souvent audacieux et vindicatifs, frappant dans toutes les directions, prenant des risques inconsidérés, agissant sans plan cohérent et semant le chaos partout.
Les États-Unis sont l'empire le plus puissant qui ait jamais existé. Leur déclin continuera d'être inégal et prolongé, et il sera probablement destructeur. Pour celles et ceux qui se soucient de l'émancipation, ce processus de déclin fiévreux apporte à la fois des opportunités inédites et des dangers considérables. Le défi consiste à élaborer une stratégie qui reconnaisse simultanément les faiblesses de l'impérialisme américain tout en prenant très au sérieux sa puissance résiduelle

Fonderie Horne : quand les citoyens prennent le relais

Quand les autorités assouplissent les normes pour l'industrie, le fardeau retombe sur les citoyens. À Rouyn-Noranda, protéger sa santé est devenu un acte quotidien de vigilance.
17 février 2026 | tiré de The conversation | Photo : Manifestation contre le projet de relocalisation de citoyens qui résident à proximité de la fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, en mars 2023. La Presse canadienne/Stephane Blais
https://theconversation.com/fonderie-horne-quand-les-citoyens-prennent-le-relais-275780
Le 3 février dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelait que des millions de cancers sont évitables, notamment en réduisant l'exposition à des contaminants environnementaux comme l'arsenic. Deux jours plus tard, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a accepté de maintenir l'autorisation de la concentration d'arsenic de la Fonderie Horne à 45 ng/m3 pour 18 mois supplémentaires. Cela malgré les avertissements d'octobre dernier de la Direction régionale de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue sur les risques sanitaires liés à ce niveau d'émissions. En modifiant sa position initiale, le gouvernement revient sur les normes imposées en 2023.
Pendant que le débat se cristallise autour d'un chiffre, l'expérience quotidienne des personnes vivant avec ce risque sanitaire s'efface. À Rouyn-Noranda, la gestion du risque ne se joue pas seulement dans les rapports d'experts : elle se déplace dans les cours arrière, les écoles, les corps. Et elle repose de plus en plus sur les citoyens eux-mêmes.
En tant que doctorante à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, je m'intéresse aux violences environnementales et aux formes de care citoyen – c'est-à-dire aux pratiques de vigilance, d'entraide et de protection mises en place par les communautés elles-mêmes – qui émergent face aux défaillances institutionnelles.
Choc citoyen et imprégnation à l'arsenic
En 2019, la population de Rouyn-Noranda apprenait que les enfants du quartier Notre-Dame étaient en moyenne 3,7 fois plus imprégnés à l'arsenic que ceux d'Amos. La toxicité de cette substance est connue depuis des siècles. Pourtant, malgré ces connaissances, la Fonderie a maintenu un seuil d'émission largement supérieur à la norme provinciale.
Les historiens des sciences Erik N. Conway et Naomi Oreskes ont montré comment certaines industries fabriquent le doute pour retarder l'action politique : multiplication d'études, brouillage des certitudes dans les médias, contestation des expertises scientifiques.
C'est ce qui s'est produit dans le cas maintenant célèbre de l'étude écrite par Monsanto sur le glyphosate. Il s'agit également du type de tactiques auxquelles nous semblons avoir assisté lorsque la Fonderie Horne a lancé son programme de biosurveillance sur l'arsenic. L'enjeu avec cette étude, hormis son manque d'indépendance, est qu'elle pourrait servir à contester les données indépendantes de la santé publique.
Lire plus :Fonderie Horne : quel rôle occupent les preuves scientifiques dans la décision politique au Québec ?
Contrôle du dicible
La pression ne se limite pas au terrain scientifique. Le 10 février, une citoyenne dénonçait au conseil municipal les pressions exercées de la part de certaines entreprises pour décourager la prise de parole critique contre la Fonderie Horne.
Quand la communauté d'affaires affirme ne pas croire la santé publique et que des citoyens se sentent surveillés ou rappelés à l'ordre, le signal est clair : certaines critiques dérangent. Dans ce climat, défendre la science et la santé publique devient difficile.
Dans les entretiens que j'ai réalisés avec des citoyens de Rouyn-Noranda, plusieurs dénoncent une forme d'omerta et l'imposition d'une alternative insoutenable. L'un dit :
La violence environnementale, c'est aussi l'omerta, la désinformation et la division de la communauté sur cet enjeu. Quand on proteste, qu'on parle publiquement contre le pollueur, on perd des amis de longue date et des membres de notre famille nous excluent.
L'enjeu est alors réduit à une question d'opinion ou de croyance – être pour ou contre la santé, croire ou non la santé publique. Pendant ce temps, les impacts concrets sur la population, y compris sur les travailleurs, passent au second plan.
Care entravé ou communautaire
Ces impacts s'inscrivent dans des histoires intimes, familiales, intergénérationnelles de problèmes de santé que plusieurs soupçonnent liés aux rejets historiques de contaminants de la Fonderie. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que ce soient principalement des personnes touchées ou en rôles de soin (mères, parents, médecins) qui dénoncent l'injustice environnementale et sanitaire vécue.
Découvrir que l'on a été exposé, ou que ses proches ou ses patients l'ont été, est un bris dans leur relation de soin. Plusieurs parents de Rouyn-Noranda ont d'ailleurs exprimé un sentiment de culpabilité en réalisant avoir exposé leurs enfants sans le savoir. Ce sentiment de trahison fragilise la confiance envers l'État.
Pour les Mères au front, comme Jennifer Ricard Turcotte le développe dans Il en va de notre dignité(2025), se mobiliser pour protéger la santé de sa communauté est un geste d'amour et une nécessité face à un État perçu comme défaillant. Les pratiques de vigilance citoyenne et de sensibilisation du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) et des Mères au front visent alors à pallier aux lacunes des dispositifs institutionnels.
Lire plus : Le rôle stratégique et essentiel des métaux rares pour la santé
Quotidien altéré
Derrière le débat autour des chiffres, de la norme et des emplois se cache un quotidien altéré pour les personnes vivant près de la Fonderie. Prendre conscience du risque sanitaire transforme le quotidien et crée un stress important.
Cette situation impose des choix que la majorité des Québécois ne connaissent pas et ne connaîtront pas. Laisser ou pas son enfant jouer dans sa cour bien que son terrain est contaminé ? Prendre ou non une marche dans son quartier alors que le goût de la mine est présent ? Cette conscience du risque modifie les pratiques quotidiennes et instille une vigilance individuelle et collective.
Ajuster ses habitudes pour limiter l'exposition lorsque le risque est perçu comme plus important, s'avertir entre voisins lorsque les signes de rejets sont présents et alerter les autorités lors d'épisodes extrêmes de contamination, deviennent des mécanismes de protection.
Ce soin contraint, façonné par le risque, s'ajoute à une vigilance face aux stratégies de relations publiques de l'entreprise. Les documents promotionnels envoyés par la Fonderie aux résidents, vantant ses efforts environnementaux, réactivent l'incertitude sur le respect réel de ses engagements. Récemment, l'entreprise a conditionné ses investissements environnementaux à une permission gouvernementale de continuer à dépasser la norme d'arsenic pendant plusieurs années.
Joute politique et risque évitable
Dans les médias, le care communautaire quotidien, assumé par les personnes qui œuvrent à se défendre de l'injustice environnementale, demeure largement invisible. La couverture médiatique se concentre principalement sur la menace de fermeture brandie par la Fonderie, qui lie son avenir à une « prévisibilité » du seuil sur l'arsenic.
Le gouvernement de la CAQ a d'abord semblé tenir tête aux menaces de fermeture de la Fonderie. Mais les concessions récentes laissent planer le doute : cette posture de courage n'était-elle qu'un mirage ?
D'autant plus que cette décision s'inscrit dans une série d'accommodements face aux demandes de la multinationale suisse, dont l'assouplissement en 2022 de la norme sur le nickel. Elle illustre une fois de plus un compromis politique où les intérêts et considérations économiques du secteur industriel et extractif des minéraux critiques semblent avoir primé sur la santé publique, laissant à la communauté le fardeau de se protéger d'un risque connu.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mémoire du MQRP sur le projet de loi N° 19 : Le statu quo, à quel coût ?

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec a multiplié les réformes pour améliorer l'accès aux soins, notamment avec les projets de loi 83, 106, 2 et 19. Bien que le projet de loi 19 adopte un ton plus conciliant et atténue certaines mesures coercitives, suite à l'entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec=AZbMYALuhsr7Y4e88ocs5fB_7zxJfoar-ZHNtKQ61yH6ex8NOQhG59ptqCoKamKL-IBQ9RigwO1gqm-aFxZ23JlaJoGP6Q7_CJBWCO3XkgOhkt5dCuGoBF15PznnIq3YvIxqk6NjS78wsaqw3rleIF1B&__tn__=-]K-R] (FMOQ), il maintient essentiellement la même approche : tenter de résoudre un problème structurel d'accès à la première ligne par des ajustements liés à la rémunération médicale. Or, l'inscription administrative de patients et les primes de performance ne garantissent ni un accès réel aux rendez-vous ni une continuité des soins.
Médecins québécois pour un régime public (MQRP) estime qu'une amélioration durable passe par une réforme organisationnelle en profondeur : revoir le modèle des GMF, mettre fin aux structures à but lucratif en première ligne, renforcer les équipes interdisciplinaires inspirées du modèle public des CLSC et redonner une place aux réalités locales dans la gouvernance. L'accès aux soins exige une vision systémique centrée sur les besoins de la population, et non uniquement sur des incitatifs financiers.
Le mémoire
COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE LOI N° 19
Un bref survol de la situation
Pour mieux comprendre le projet de loi, nous souhaitons exposer au lecteur la suite des événements des derniers mois :
● En février 2025, le gouvernement semble commencer à reconnaître l'ampleur des conséquences désastreuses de l'exode des médecins vers le secteur privé. Rappelons que le Québec est la province affichant le plus haut taux de médecins exerçant au privé au Canada : 98,5 % des médecins travaillant au privé au pays se trouvent au Québec, dans un contexte de croissance exponentielle des cliniques privées au cours des 25 dernières années. Christian Dubé présente alors le projet de loi 83, Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux, visant à freiner cet exode et à retenir les médecins au Québec.
Tel que nous l'avons présenté dans notre mémoire en commission parlementaire, de façon étonnante, plutôt que d'utiliser les leviers législatifs déjà existants (dont l'article 30.1 de la Loi sur l'assurance maladie), le gouvernement choisit d'introduire des mesures contraignantes visant principalement à maintenir les nouveaux médecins en pratique au Québec pendant cinq ans. Un mécanisme est également instauré afin de limiter les affiliations et désaffiliations répétées qui fragilisent le réseau public. Toutefois, Santé Québec, responsable de cette gestion, accepte la majorité des demandes au cours de l'année suivante.
● En mai 2025, en pleine période de négociation avec la FMOQ et la FMSQ, le gouvernement dépose le projet de loi 106, Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Ce projet de loi vise à corriger les enjeux d'accès aux services médicaux.
De façon surprenante, le gouvernement écarte les conclusions un rapport d'experts sur la première ligne qu'il a lui-même commandé, pour imposer diverses mesures de bonifications et de pénalités financières aux médecins — une méthode qui ne s'est pas révélée particulièrement fructueuse par le passé pour améliorer l'accès aux soins pour les patients.
MQRP témoigne alors en commission parlementaire et dépose un mémoire intitulé Construire plutôt que déstabiliser : propositions alternatives pour une réforme de la première ligne, dans lequel nous nous positionnons en faveur « d'une réforme de la première ligne et d'une refonte du mode et du montant de rémunération, à condition qu'elles favorisent réellement une meilleure prise en charge, par le bon professionnel, au bon moment, pour le bon patient ».
● En octobre 2025, devant l'échec du processus de négociation avec la FMOQ et la FMSQ, le gouvernement dépose le projet de loi 2, Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Cette loi spéciale, adoptée sous bâillon, reprend les éléments clés (bonifications et pénalités liées à la performance, emphase sur la capitation) et ajoute des mesures coercitives, suscitant une vive réaction au sein du corps médical.
MQRP réagit en deux temps : nous publions Les angles morts du système public révélés par la loi 2, dans lequel nous mettons en lumière quatre axes de solutions ne reposant pas sur la rémunération médicale, puis nous réagissons à l'entente de principe intervenue entre la FMOQ et Santé Québec dans le texte Tout ça pour ça ? Une entente sans vision, ou quand le statu quo l'emporte sur les soins, mettant en lumière les limites du modèle actuel des groupes de médecine familiale (GMF), notamment le fonctionnement fondé sur la distinction entre patients inscrits et non inscrits.
● En février 2026, à la suite des démissions successives des ministres Lionel Carmant et Christian Dubé dans la foulée de la controverse soulevée par le projet de loi 2, ainsi que du départ annoncé du premier ministre François Legault, un nouveau projet de loi est présenté : le projet de loi 19, Loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population, déposé par la nouvelle ministre de la Santé, Mme Sonia Bélanger.
Nous l'aborderons plus en détail, mais celui-ci vient essentiellement entériner l'entente intervenue avec la FMOQ en décembre 2025. À noter qu'au moment d'écrire ces lignes, la FMSQ a annoncé être dans une impasse dans ses négociations avec le gouvernement provincial.
Notre analyse du PL19
En tenant compte des événements des derniers mois, le projet de loi 19 semble surtout tenter d'apaiser les tensions créées par la loi 2. En reculant sur les mesures coercitives et sur d'autres aspects contestés de cette dernière (mécanismes de surveillance, pouvoir discrétionnaire du ministre quant à la fixation de la rémunération) et en troquant les pénalités financières pour des primes à la performance, le gouvernement semble vouloir privilégier la carotte plutôt que le bâton.
L'approche change de ton, mais non de logique : on mise toujours sur des incitatifs financiers pour orienter l'organisation des soins. Le gouvernement se réjouit de l'inscription possible de 500 000 patients additionnels, sur une base volontaire, avec des primes à la clé. « ‘'Les cibles restent là, elles sont établies différemment ', a indiqué la ministre, évoquant la mise en place prochaine de tableaux de bord ». Le ministère se félicite également de la modification de la proportion que représentera la capitation dans le futur, laquelle pourrait atteindre jusqu'à 50 % de la rémunération des médecins.
Rappelons que l'inscription administrative d'un patient ne garantit ni l'accès réel à un rendez-vous, ni la continuité de soins, ni leur qualité. Être « inscrit » auprès d'un médecin ou d'un groupe de médecine familiale, ou avoir été « affilié » à un GMF via le GAP, ne signifie pas nécessairement être pris en charge. Le modèle GAP, qui consiste à offrir des primes substantielles aux médecins afin qu'ils libèrent ponctuellement quelques plages horaires pour des patients orphelins, comporte son lot de problèmes : absence fréquente de disponibilité en clinique pour le patient (une seule plage annuelle par patient étant généralement prévue), limitation à un seul enjeu par rencontre, absence de suivi longitudinal et perte d'efficacité systémique, notamment lorsque les patients doivent consulter plusieurs médecins différents pour un même problème.
Nous ne pouvons que demeurer circonspects devant une approche consistant à accorder une rémunération accrue aux médecins en échange de l'inscription de patients sur une liste, sans pour autant leur donner les moyens concrets de voir ces patients. En effet, tout comme le projet de loi 106 et la loi 2, le projet de loi 19 ne prévoit aucune ressource supplémentaire susceptible de favoriser l'accès aux soins, telle que l'ajout de personnel administratif ou le déploiement accru d'autres professionnels de la santé. On ajuste la rémunération sans transformer les conditions réelles de pratique.
Le gouvernement persiste ainsi à traiter un enjeu systémique, l'accès à la première ligne, par un levier essentiellement financier. Or, les expériences récentes démontrent les limites de cette approche. Nous constatons l'absence d'une vision cohérente et structurante pour la première ligne. Nous constatons également que le rapport d'experts commandé par le gouvernement ne semble toujours pas avoir guidé les choix proposés.
Enfin, nous tenons à souligner que cette succession de projets de loi a davantage fragilisé le système public, ce qui accroît les occasions pour le secteur privé de recruter des professionnels de la santé. Cette gestion centralisée, déconnectée des multiples réalités du terrain, reposant sur une approche uniforme et assortie de contraintes souvent impraticables, combinée à une gestion fondée sur les primes et les pénalités et à l'un des cadres législatifs les plus permissifs au Canada en matière de médecine privée, crée un environnement particulièrement propice à la croissance du secteur privé.
CONCLUSION
Médecins québécois pour le régime public (MQRP) déplore la tendance lourde du gouvernement de légiférer à coup de réformes, souvent imposées sous bâillon. Il est préoccupant de constater que deux principes ayant déjà montré leurs limites dans les dernières décennies, au Québec comme ailleurs, continuent d'être privilégiés : la centralisation accrue du système de santé et la modulation de l'accès aux soins par la rémunération médicale.
Certes, le PL19 préserve le statu quo, mais à quel prix ? Peut-on réellement améliorer l'accès aux soins sans revoir en profondeur le modèle de première ligne ? L'organisation actuelle de la première ligne sur le modèle des groupes de médecine familial (GMF), dans sa configuration présente, semble atteindre un plafond structurel.
RECOMMANDATIONS
MQRP ne recommande pas d'amendement spécifique au projet de loi 19, qui rétablit essentiellement le statu quo dans les relations entre la FMOQ et le gouvernement.
Cependant, l'amélioration réelle de l'accessibilité aux soins, particulièrement en première ligne, nécessite des réformes structurelles dépassant la seule question de la rémunération médicale. À cet égard, MQRP formule les recommandations suivantes :
1. Réformer structurellement la première ligne Revoir le modèle des GMF et le système de patients « inscrits/non inscrits », et rétablir une responsabilité populationnelle inspirée du modèle public des CLSC.
2. Sortir d'une logique centrée sur la rémunération médicale Revoir les modes de rémunération pour corriger les incitatifs pervers, découpler le financement des cliniques des actes médicaux et mettre fin aux structures à but lucratif en première ligne.
3. Renforcer le caractère public et la gouvernance locale Accroître l'accès public aux professionnels de la santé et redonner aux équipes locales, incluant soignants et patients, un rôle réel dans l'organisation des soins. Utiliser l'article 30.1 de la LAM pour freiner l'exode des médecins au privé.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

S’engager collectivement pour la justice sociale au Québec

Saint-Lin-Laurentides, 20 février 2026 - La Coalition des Tables Régionales d'Organismes Communautaires (CTROC) tient à souligner la Journée mondiale de la justice sociale, qui a lieu aujourd'hui le 20 février, dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, l'aggravation des inégalités et une fragilisation préoccupante de notre démocratie.
Proclamée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée repose sur des principes clairs : accès équitable aux ressources, respect des droits humains, travail décent, égalité des chances et pleine participation de toutes et tous à la vie économique, sociale et politique.
Or, dans un contexte prébudgétaire où le discours du gouvernement tend vers les coupures
budgétaires et le retour à l'austérité, la CTROC tient à rappeler que la justice sociale passe nécessairement par une véritable justice fiscale et qu'investir dans le communautaire, c'est investir dans la cohésion sociale.
En ce 20 février, la Coalition Main Rouge, dont la CTROC est membre, appelle à des actions dérangeantes partout au Québec. Ces mobilisations, portées dans toutes les régions, rappellent qu'une société équitable ne peut se construire sur l'exclusion, ni sur le désengagement de l'État. Les choix budgétaires ont des conséquences directes sur la vie des personnes et sur la solidité de notre filet social. Son renforcement passe par un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux afin d'agir en amont des inégalités plutôt que d'en assumer les conséquences une fois qu'elles se sont aggravées. À l'inverse, le recours accru à la privatisation et aux compressions, trop souvent présentées comme des solutions, fragilise le tissu social et accentue les écarts.
Un tel réinvestissement doit s'appuyer sur une fiscalité plus juste et plus progressive, d'autant
que des alternatives fiscales existent : augmenter le nombre de paliers d'imposition, accroître la contribution des grandes entreprises, mieux taxer la richesse et certaines activités financières et lutter activement contre l'évitement fiscal.
La Journée mondiale de la justice sociale est l'occasion de reconnaître que la solidarité est un
choix politique et social et que les inégalités ne sont pas des fatalités individuelles, mais des réalités structurelles, qui exigent des réponses collectives.
Le Québec a les moyens de faire plus pour lutter contre les inégalités sociales.
La Coalition des Tables Régionales d'Organismes Communautaires (CTROC) réunit 14 Regroupements régionaux d'organismes communautaires autonomes et représente plus de 3000 organismes enracinés dans toutes les régions du Québec. Elle a comme mission de soutenir les regroupements régionaux et leurs membres, de promouvoir l'action communautaire autonome et d'analyser l'organisation du réseau public de la santé et des services sociaux et ses impacts sur les organismes communautaires autonomes et
la population. La CTROC est interlocutrice privilégiée des organismes communautaires autonomes intervenants en santé et services sociaux auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mémoire prébudgétaire 2026-2027 du Collectif pour un Québec sans pauvreté

En 2002, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'objet de cette loi, adoptée à l'unanimité, est de « guider le gouvernement et l'ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté ».
Presque vingt-cinq ans plus tard, et après quatre plans de lutte contre la pauvreté, un constat ressort : aucun des gouvernements successifs n'a pris au sérieux l'objet de cette loi, qui est d'aspirer à éliminer la pauvreté au Québec.
Pour espérer « tendre vers un Québec sans pauvreté », le gouvernement devra inévitablement changer de discours et reconnaître que la pauvreté est inacceptable, car elle constitue un déni des droits et libertés ainsi qu'une atteinte au respect et à la protection de la dignité des personnes qui la subissent.
Ce mémoire porte neuf recommandations regroupées en trois catégories :
Recommandations visant à améliorer le revenu des personnes en situation de pauvreté :
– Hausser les protections publiques de façon à assurer à tous les ménages un revenu au moins égal à la Mesure du panier de consommation (MPC).
– Augmenter le salaire minimum pour qu'une personne seule qui travaille 35 heures par semaine vive hors de la pauvreté.
– Recommandations visant à alléger le fardeau financier des personnes en situation de pauvreté :
Adopter une politique globale en habitation, basée sur la reconnaissance du droit au logement.
– Adopter une loi-cadre sur le droit à l'alimentation.
– Interdire le privé en santé et élargir la couverture du régime public d'assurance maladie à un plus grand nombre de soins de santé.
– Assurer la gratuité et l'accès universel à l'éducation, des centres de la petite enfance aux études supérieures.
Recommandations visant à réformer la fiscalité afin de la rendre plus progressive et ainsi accroître la marge de manœuvre du gouvernement :
– Faire passer de 4 à 8 le nombre de paliers d'imposition pour les particuliers.
– Instaurer un impôt sur le patrimoine.
– Imposer la totalité des gains en capital des particuliers.
Document PDF : mémoire prébudgétaire 2026-2027
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Danielle Smith annonce un référendum anti-immigration pour le 19 octobre

Les référendums de la première ministre de l'Alberta pourraient fonctionner à Ponoka, mais pas à Powell River ou à Peterborough – c'est probablement l'idée.
20 février 2026 | tiré de Rabble.ca | Photo : La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, lors de sa discussion au coin du feu sur l'économie de l'Alberta et ses projets de référendum. Crédit : Gouvernement de l'Alberta
https://rabble.ca/politics/canadian-politics/danielle-smith-announces-anti-immigration-referendum-for-oct-19/
La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a annoncé hier une série de questions référendaires pour le 19 octobre, exigeant l'ingérence de la province dans les compétences fédérales, la réduction des services aux nouveaux Canadiens et d'autres mesures anti-immigrés, et demandant des changements importants à la Constitution canadienne.
Il y aura cinq référendums politiques verbeux axés sur l'immigration et clairement conçus pour plaire à la base du Parti conservateur uni (UCP), mais formulés de manière à paraître raisonnables à première vue. Quatre questions supplémentaires demanderont aux électeurs d'approuver un effort de négociation de changements constitutionnels majeurs.
Il va sans dire qu'une fois éloigné d'une ou deux frontières des électeurs bien formés du Wild Rose Country, tout cela risque de faire long feu.
Mais si rien ne change dans la structure de la fédération, cela conviendra parfaitement à Mme Smith et à son groupe d'experts politiques. En effet, le plan décrit dans son message télévisé de 13 minutes hier soir à l'heure du dîner est clairement conçu pour réussir dans un premier temps, à savoir être adopté à la majorité par les Albertains qui prendront la peine de voter, puis pour s'enliser dans l'opposition des autres provinces et les complexités de la formule d'amendement de la Constitution canadienne. Cela fera avancer le programme séparatiste du Parti conservateur uni.
En attendant, en pointant du doigt la chute des prix du pétrole et les politiciens libéraux comme responsables de la hausse des coûts et de la réduction des dépenses en Alberta, son intervention télévisée d'hier soir a également été l'occasion de réduire les attentes concernant le budget provincial de jeudi prochain.
Comme l'a fait remarquer hier Keith Brownsey, professeur de sciences politiques à la retraite de l'université Mount Royal, après la diffusion de la vidéo, « nous avons ici une première ministre qui reproche aux immigrants l'incapacité de son gouvernement à maintenir les services de santé, d'éducation et autres services sociaux. Elle a oublié de mentionner que la plupart des « immigrants » en Alberta viennent d'autres régions du Canada. »
« Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de changements constitutionnels », a ajouté M. Brownsey. « Elle semble préparer la province à un vote sur l'indépendance. »
Mme Smith a reconnu que toutes les idées de référendum provenaient des tournées de promotion de la politique « Alberta Next » de son gouvernement, dirigées et remplies de partisans, mais elle a présenté cela comme une bonne chose.
Tout au long de cette discussion au coin du feu, elle a attribué la plupart des problèmes de la province aux prix du pétrole inférieurs aux prévisions, aux immigrants et à Justin Trudeau, sans nécessairement respecter cet ordre. L'accent mis sur l'immigration était largement attendu, en partie grâce à quelques publications intempestives sur les réseaux sociaux de certains de ses conseillers au cours des heures précédentes.
Mme Smith a désigné les politiques d'immigration de l'ère Trudeau comme la cause du manque de places dans les salles de classe pour les enfants des nouveaux Albertains. Peu importe que son gouvernement UCP n'ait pas su planifier la croissance que tout le monde savait depuis des années qu'elle allait arriver, ni la financer.
Et si elle a à peine mentionné le manque de capacité des hôpitaux de l'Alberta, qui les a plongés dans le chaos ces derniers mois, elle a passé sous silence le fait que cela fait plus de 40 ans qu'aucun nouvel hôpital n'a été construit à Edmonton, alors que la population de la capitale de l'Alberta a plus que doublé. Il aurait été difficile de nier que Trudeau a été premier ministre pendant moins d'un quart de cette période.
Naturellement, Mme Smith n'a pas non plus mentionné les millions de dollars que son gouvernement a gaspillés dans des projets idéologiques et des manœuvres politiques visant à s'approprier les libéraux à Ottawa, comme les 70 millions de dollars dépensés pour acheter du « Tylenot » pour enfants, pratiquement inutilisable, lors d'une brève pénurie nationale d'acétaminophène en 2022.Le Globe and Mail a rapporté hierque l'Alberta venait de dépenser 718 000 dollars supplémentaires pour détruire ce qui restait.
Smith n'a pas non plus mentionné son appel, il y a moins de deux ans, à doubler la population de l'Alberta pour atteindre 10 millions d'habitants, afin de mieux faire valoir notre poids au sein de la Confédération. Ni les campagnes publicitaires réussies de l'UCP appelant les résidents de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à s'installer ici. Cela a attiré l'attention de la base MAGA très influente de son propre parti et, à l'été 2024, elle avait rejoint le mouvement anti-immigration.
Son rêve de voir Red Deer, une ville de 100 000 habitants surtout connue comme une halte pour prendre un café et faire le plein d'essence à mi-chemin entre les centres urbains de Calgary et d'Edmonton, atteindre bientôt le million d'habitants devra donc être mis en veilleuse pour longtemps.
« On ne peut plus demander aux contribuables de l'Alberta de continuer à subventionner l'ensemble du pays par le biais de la péréquation et des transferts fédéraux, de permettre au gouvernement fédéral d'inonder nos frontières de nouveaux arrivants et d'accorder ensuite un accès gratuit à nos programmes sociaux, les plus généreux du pays, à toute personne qui s'installe ici », s'est plainte Mme Smith, exploitant la méconnaissance populaire soigneusement entretenue par son gouvernement sur le fonctionnement des transferts fédéraux.
Il s'avère que la croissance démographique qu'elle réclamait il y a peu est « financièrement ruineuse et nuit à la qualité de nos soins de santé, de notre éducation et d'autres services sociaux ». Vous savez, comme les soins de santé publics, que son gouvernement s'efforce de démanteler.
De manière hilarante, la première ministre a assuré à ses auditeurs que malgré la baisse des prix du pétrole et le coût de tous ces immigrants, « les augmentations salariales approuvées pour nos médecins, infirmières et enseignants resteront en vigueur afin que nous puissions continuer à attirer les professionnels qualifiés nécessaires pour rattraper notre retard en matière de croissance ».
C'est bon à savoir. Je me demande qui lui a dit que, contrairement aux États-Unis qu'elle admire tant, même les gouvernements de ce pays doivent respecter les contrats légaux et l'état de droit ? Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si l'UCP avait tenté de revenir sur les salaires qui venaient d'être négociés avec les professionnels de santé qualifiés ? Cela n'aurait pas été joli.
Voici donc les questions du référendum prévu par Mme Smith, dans ses propres mots :
- Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement de l'Alberta renforce son contrôle sur l'immigration afin de la ramener à des niveaux plus durables, en donnant la priorité à l'immigration économique et en garantissant aux Albertains la priorité pour les nouvelles opportunités d'emploi ?
- Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement de l'Alberta adopte une loi stipulant que seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes ayant un statut d'immigration approuvé par l'Alberta pourront bénéficier des programmes financés par la province, tels que la santé, l'éducation et d'autres services sociaux ?
- En supposant que tous les citoyens et résidents permanents continuent à bénéficier des programmes d'aide sociale, comme c'est le cas actuellement, êtes-vous favorable à ce que le gouvernement de l'Alberta adopte une loi exigeant que toutes les personnes ayant un statut d'immigration légal non permanent résident en Alberta depuis au moins 12 mois avant de pouvoir bénéficier des programmes d'aide sociale financés par la province ?
- En supposant que tous les citoyens et résidents permanents continuent d'avoir droit aux soins de santé et à l'éducation publics comme c'est le cas actuellement, êtes-vous favorable à ce que le gouvernement de l'Alberta impose des frais ou des primes raisonnables aux personnes ayant un statut d'immigration non permanent qui vivent en Alberta pour leur utilisation et celle de leur famille des systèmes de santé et d'éducation ?
- Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement de l'Alberta adopte une loi exigeant que les personnes fournissent une preuve de citoyenneté, telle qu'un passeport, un certificat de naissance ou une carte de citoyenneté, pour pouvoir voter aux élections provinciales afin de renforcer la position constitutionnelle et fiscale de l'Alberta au sein d'un Canada uni ?
Il va sans dire que, pour la plupart, ces mesures n'ont guère de sens lorsqu'on les examine de près. Il s'agit pour la plupart de mauvaises politiques qui ne permettraient pas de réaliser des économies et qui, dans certains cas, violeraient la Constitution actuelle. En outre, elles seraient mesquines et souvent cruelles. Le dernier point est une solution à la recherche d'un problème, même si les fantasmes des partisans de MAGA y croient fermement.
En outre, le gouvernement demandera l'autorisation de travailler avec « d'autres provinces volontaires » pour modifier la Constitution canadienne de quatre manières, a déclaré M. Smith. On ne sait pas très bien s'il s'agit d'une seule question référendaire avec quatre points ou de quatre référendums.
- Les gouvernements provinciaux, et non le gouvernement fédéral, devraient-ils sélectionner les juges nommés à la Cour du Banc du Roi et aux cours d'appel provinciales ?
- Abolir le Sénat fédéral non élu.
- Permettre aux provinces de se retirer des programmes fédéraux qui empiètent sur leurs compétences, telles que la santé, l'éducation et les services sociaux, sans perdre le financement fédéral associé à ces programmes pour leurs propres programmes sociaux provinciaux.
- Mieux protéger les droits des provinces contre l'ingérence fédérale en donnant la priorité aux lois provinciales traitant de domaines de compétence constitutionnels provinciaux ou partagés sur les lois fédérales en cas de conflit entre elles.
Toutes ces idées risquent d'être immédiatement rejetées par les autres provinces. Ce qui, comme indiqué précédemment, est probablement le but recherché.
L'opposition néo-démocrate a bêtement décidé d'attendre ce matin, après que l'actualité ait évolué, pour réagir. Cela correspond au souhait du chef Naheed Nenshi de faire de la politique en phrases complètes. Cela ne montre toutefois pas une grande compréhension de la manière dont le discours politique se déroule à notre époque. Je suis sûr que l'UCP s'en est réjoui.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











