Derniers articles
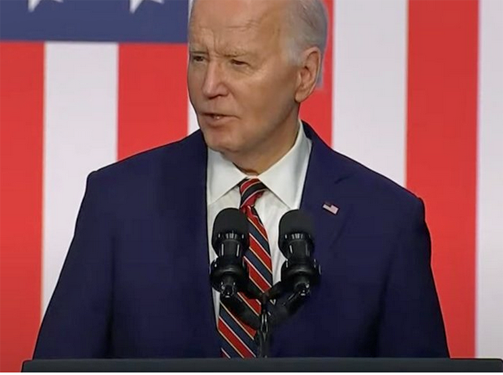
Génocide à Gaza : Biden prêt à sanctionner la Cour pénale internationale pour protéger Netanyahou
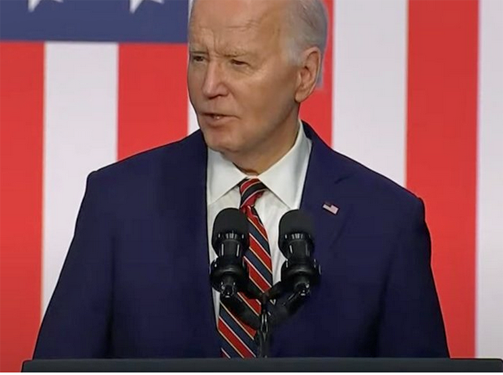
Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken veut un accord bipartisan avec les Républicains pour prendre des sanctions contre la Cour pénale internationale, après que le procureur ait requis des mandats contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense.
22 mai 2024 | tiré de Révolution permanente
Ce lundi, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), M. Khan a demandé plusieurs mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la défense, Yoav Gallant, ainsi que contre des membres du bureau politique du Hamas. Si cette demande doit encore être examinée par les juges de la CPI, le président américain n'a pas tardé à réagir. Le jour même de l'annonce, Joe Bidena condamné en conférence de presse la décision du procureur de poursuivre des responsables israéliens : « Permettez-moi d'être clair : nous rejetons la demande de la Cour pénale internationale de délivrer des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Contrairement aux allégations de la Cour internationale de justice à l'encontre d'Israël, ce qui se passe n'est pas un génocide. Nous rejetons ces allégations ».
Ce mardi, c'était au tour du secrétaire d'Etat Anthony Blinken de menacer la CPI d'éventuelles sanctions de l'Etat américain. L'administration de Joe Biden va ainsi travailler avec le Congrès américain pour sanctionner la Cour pénale internationale pour être intervenu dans les affaires des États-Unis. Si la nature des sanctions n'a pas encore été annoncée, elles pourraient être similaires à celles imposées par l'administration Trump à Fatou Bensouda, alors procureur en chef de la CPI, et à Phakiso Mochochoko, chef de juridiction de la Cour, pour leur enquête sur les crimes de guerre présumés des États-Unis en Afghanistan : un gel de leurs avoirs et une interdiction de déplacement aux États-Unis.
Des mesures qui vont nécessiter une étroite collaboration entre l'administration démocrate et les Républicains, majoritaires au Congrès, comme l'a assumé Anthony Blinken dans des propos rapportés par le Financial Times : « Nous voulons travailler avec vous sur une base bipartisane pour trouver une réponse appropriée ». Une nouvelle démonstration de l'unité de l'establishment étatsunien derrière la politique du gouvernement israélien, le soutien inconditionnel à l'Etat d'Israël étant un axiome commun aux Républicains comme aux Démocrates, et de la continuité de la politique étrangère de Trump et de Biden.
Pourtant, les attaques contre la Cour pénale internationale pourraient aiguiser encore davantage les contradictions qui fissurent le camp démocrate, déjà affecté par la mobilisation étudiante contre les massacres à Gaza et la complicité de Genocide Joe. Sous la pression du mouvement propalestinien, la position de l'aile gauche du parti démocrate a grandement évolué ces derniers mois. Si les démocrates ne parviennent pas à instrumentaliser les mobilisations, l'aile gauche tente de se distinguer pour capitaliser sur le mouvement : Bernie Sanders a ainsi annoncé « soutenir la CPI et ses actions ».
Si l'administration étatsunienne tente toujours de pousser le gouvernement israélien à abandonner son projet d'invasion à Rafah, la décision de la Cour décrédibilise la diplomatie étatsunienne qui espérait pouvoir convaincre Netanyahou de renoncer à prendre Rafah en contrepartie de la fin de l'enquête de la CPI. Si le gouvernement étatsunien joue de la menace pour empêcher la suite de la procédure, l'émission de mandats d'arrêt à l'encontre des gouvernants israéliens affaiblirait encore davantage Joe Biden, déjà dans une situation particulièrement délicate.
Pour autant, ces mandats d'arrêt ne forceraient pas le gouvernement étatsunien à arrêter Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant, les Etats-Unis n'étant pas signataires des statuts de Rome. Même dans l'hypothèse où la CPI parviendrait à ne pas céder à la pression, il est très improbable que les mandats soient exécutés. La CPI dépend en effet de la bonne volonté des Etats membres pour arrêter les personnes ciblées par un mandat, puisqu'elle ne dispose d'aucune force indépendante. La CPI ne peut pas non plus juger les accusés par coutumace, c'est-à-dire en leur absence, et il y a donc fort à parier que les dirigeants israéliens ne répondront jamais aux accusations qui les visent devant la CPI. Si la position de la CPI est pour le moment la plus « dure » exprimée à l'encontre du gouvernement israélien, elle ne devrait pas avoir d'impact sur la situation à Gaza et la politique menée par Benjamin Netanyahou.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël armé par les Etats-Unis : comment et avec quelle ampleur Biden contourne les procédures établies ?

Les Etats-Unis sont depuis longtemps le plus grand fournisseur d'armes d'Israël. Au cours des quatre dernières années, les Etats-Unis ont fourni à Israël 69% de ses importations d'armes : des F-35 aux munitions chimiques (phosphore blanc), en passant par les obus de chars et les bombes de précision. Malgré cela, l'administration Biden prétend ne pas savoir comment ces armes sont utilisées, même lorsqu'elles mutilent et tuent des citoyens américains [référence à la frappe ayant causé la mort de sept employés de World Central Kitchen, le 1er avril].
Tiré d'À l'encontre.
Depuis le début de la dernière guerre contre Gaza, des fonctionnaires du ministère de la Défense et de la CIA se trouvent en Israël pour aider les Israéliens dans les domaines du renseignement, de la logistique, du ciblage et de l'évaluation des dommages causés par les bombes. Pourtant, l'administration Biden affirme n'avoir aucune preuve tangible que les armes qu'elle a transférées à Israël ont été utilisées pour massacrer des civils, torturer des détenus ou restreindre l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils palestiniens affamés, déshydratés et malades.
***
Sous la pression de Bernie Sanders [sénateur indépendant du Vermont], Chris Van Hollen [sénateur démocrate du Maryland], Jeff Merkley [sénateur démocrate de l'Oregon]et d'autres démocrates du Congrès, le président a publié en février le mémorandum de sécurité nationale 20 (NSM-20, ou « mémorandum de sécurité nationale sur les garanties et la responsabilité concernant les articles de défense et les services de défense transférés »). Ce dernier demande au département d'Etat d'« obtenir certaines assurances écrites crédibles et fiables de la part des gouvernements étrangers recevant des équipements de défense [américains] et, le cas échéant, des services de défense » qu'ils respecteront le droit américain et le droit international. La NSM-20 exige également que les départements d'Etat et de la Défense fassent rapport au Congrès dans les 90 jours sur la mesure dans laquelle ces partenaires respectent leurs assurances. Il souligne « l'évaluation de tout rapport ou allégation crédible selon lequel des équipements de défense et, le cas échéant, des services de défense, ont été utilisés d'une manière non conforme au droit international, y compris le droit international humanitaire ». Le rapport NSM-20 demandait également à l'administration Biden d'évaluer si Israël avait pleinement coopéré avec les efforts internationaux et soutenus par le gouvernement des Etats-Unis pour fournir une assistance humanitaire dans la zone de conflit. Le délai de 90 jours a été dépassé de deux jours [le 17 mai], ce qui a probablement repoussé la publication du rapport à la fin de l'après-midi d'un vendredi, moment traditionnellement creux pour les nouvelles que l'on voudrait enterrer.
***
Depuis le 7 octobre, l'administration Biden a approuvé plus de 100 transferts d'armes à Israël dans le cadre des ventes de matériel militaire à l'étranger. Deux de ces transferts ont fait l'objet d'une autorisation d'urgence afin de contourner l'examen du Congrès. La vague de transferts d'armes vers Israël a commencé au début du mois d'octobre et la quantité de matériel expédié était telle que le Pentagone a eu du mal à trouver suffisamment d'avions-cargos pour les acheminer. Alors que le Pentagone fournit régulièrement des informations détaillées sur les armes envoyées en Ukraine, il n'a publié que deux mises à jour sur le type et la quantité d'armes envoyées en Israël. Mais ces deux rapports, publiés en décembre 2023, suggèrent que les armes comprenaient des obus d'artillerie, des obus de chars, des systèmes de défense aérienne, des munitions guidées de précision, des armes légères, des missiles Hellfire utilisés par des drones, des obus de canon de 30 mm, des dispositifs de vision nocturne PVS-14 et des roquettes à épaulement jetables (mais probablement pas biodégradables). Fin octobre, une vente à Israël comprenait des kits JDAM (Joint Direct Attack Munition) d'une valeur de 320 millions de dollars, destinés à convertir des bombes « muettes » non guidées en munitions guidées par GPS. Cette vente s'ajoutait à une autre, d'une valeur de 403 millions de dollars, portant sur les mêmes systèmes de guidage. Entre le 7 octobre et le 29 décembre, les livraisons d'armes américaines à Israël comprenaient 52 229 obus d'artillerie M795 de 155 millimètres, 30 000 charges propulsives M4 pour obusiers, 4792 obus d'artillerie M107 de 155 millimètres et 13 981 obus de chars M830A1 de 120 millimètres.
Depuis des années, les Etats-Unis conservent en Israël un stock d'armes secrètes destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations américaines au Moyen-Orient. Dans un geste extraordinaire, l'administration Biden a donné aux FDI (Forces de défense israéliennes) l'accès à ces munitions, y compris les bombes de 2000 livres qui ont été utilisées pour détruire les villes de Gaza. Les Etats-Unis auraient transféré au moins 5000 « bombes muettes » de 2000 livres à Israël depuis le 7 octobre.
Ces transferts et ventes d'armes s'inscrivent en grande partie dans le cadre d'un accord conclu en 2016 par l'administration Obama, qui engageait les Etats-Unis à fournir à Israël au moins 38 milliards de dollars d'armes sur dix ans. En mars, alors que le nombre officiel de morts à Gaza avait déjà dépassé les 30 000, le département d'Etat a autorisé le transfert de 25 avions de combat F-35A et de leurs moteurs, d'une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars. Cet accord a été rapidement suivi, en avril, par l'approbation par Biden de la vente de 50 chasseurs F-15 à Israël, pour un prix de vente total de 18 milliards de dollars. Plus tard, en avril, Biden a signé un programme d'aide qui permettra à Israël de bénéficier d'une aide militaire supplémentaire de 15 milliards de dollars.
***
Aucun de ces transferts n'a été assorti de conditions quant à l'utilisation des armes. En effet, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de Joe Biden, John Kirby, a déclaré à plusieurs reprises que la Maison-Blanche n'avait imposé « aucune ligne rouge » pour les offensives d'Israël à Gaza et au Sud-Liban. Selon une analyse du Washington Post, les FDI ont largué plus de 22 000 munitions sur Gaza au cours des 45 premiers jours de la guerre, munitions qui ont été fabriquées aux Etats-Unis.
L'administration Biden s'était enfermée dans un carcan, car les « lignes rouges » étaient déjà fixées. Et ce n'est pas seulement le droit international, pour lequel l'administration Biden fait régulièrement preuve de mépris lorsqu'il s'applique aux Etats-Unis et à leurs alliés, qui interdit les ventes d'armes aux pays qui violent le droit humanitaire, mais aussi plusieurs lois américaines, ainsi que les procédures internes de l'exécutif de Biden.
***
La loi, les règlements et la politique de transfert d'armes conventionnelles des Etats-Unis exigent la suspension de l'assistance militaire lorsque nos transferts d'armes sont utilisés en violation du droit humanitaire international :
– La « loi Leahy » (22 U.S. Code § 2378d) exige l'interruption automatique de l'aide américaine à la sécurité des unités militaires étrangères impliquées de manière crédible dans des violations flagrantes des droits de l'homme.
– La section 502B de la loi sur l'assistance aux pays étrangers interdit aux Etats-Unis de fournir une assistance en matière de sécurité à tout gouvernement qui se livre à des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme [ce que tendent à confirmer les dernières conclusions de la CIJ et de la CPI].
– La section 620I de la loi sur l'aide à l'étranger « …interdit aux Etats-Unis de fournir une assistance en matière de sécurité ou de vendre des armes à tout pays lorsque le président est informé que le gouvernement interdit ou restreint, directement ou indirectement, le transport ou l'acheminement de l'aide humanitaire des États-Unis ».
– La politique de transfert d'armes conventionnelles de l'administration Biden, publiée en 2023, stipule que les Etats-Unis ne transféreront pas d'armes lorsqu'il est « plus probable qu'improbable » que ces armes seront utilisées pour commettre, faciliter la réalisation ou aggraver le risque de violations graves des droits de l'homme ou du droit humanitaire international, parmi d'autres violations spécifiées.
– En 2022, l'administration Biden a signé, avec plus de 80 autres pays, une déclaration commune sur les armes explosives dans les zones peuplées (EWIPA-Explosive Weapons in Populated Areas), dans laquelle les signataires « condamnent fermement toute attaque dirigée contre des civils, d'autres personnes protégées et des biens civils, y compris les convois d'évacuation de civils, ainsi que les bombardements aveugles et l'utilisation aveugle d'armes explosives », qui sont incompatibles avec le droit humanitaire international.
***
Comment Biden pourrait-il se sortir de ce dilemme ?
Bien que le département d'Etat américain ait prudemment admis qu'il était « raisonnable d'estimer » qu'Israël utilisait des armes fournies par les Etats-Unis dans des cas qui, selon lui, pourraient être « incompatibles » avec les obligations du droit humanitaire international et avec le mémorandum américain sur la sécurité nationale de février 2024 qui exige des gouvernements étrangers qu'ils garantissent qu'ils ne violeront pas les droits de l'homme avec des armes achetées aux Etats-Unis, il a conclu qu'il ne disposait d'aucune preuve tangible que c'était le cas. Plus risible encore, le rapport du département d'Etat a déclaré qu'il acceptait comme « crédibles et fiables » les assurances d'Israël selon lesquelles il utiliserait les armes américaines conformément à la loi, étant donné l'absence d'informations complètes permettant de vérifier que les armes américaines ont bien été utilisées dans des cas spécifiques. L'administration n'a pas non plus constaté qu'Israël avait intentionnellement entravé l'aide humanitaire à Gaza, du moins pas pendant la semaine où le rapport a été publié, ce qui semble être à peu près tout ce qu'elle a pris en compte.
Alors que le NSM-20 demandait au département d'Etat d'enquêter sur « tout rapport ou allégation crédible » concernant une éventuelle utilisation abusive d'armes américaines par le gouvernement israélien, l'équipe d'Antony Blinken n'a examiné que dix incidents, et encore, de manière superficielle. Lorsqu'il s'est agi de déterminer si Israël avait mis en œuvre les « meilleures pratiques » pour limiter les dommages causés aux civils lors de ses opérations militaires dans des zones urbaines densément peuplées, le rapport de Blinken n'a pas identifié ni examiné de cas spécifiques, se contentant de citer la conclusion anodine de la Communauté du renseignement des Etats-Unis selon laquelle Israël « pourrait faire plus » pour éviter les pertes civiles.
Selon Akbar Shahid Ahmed, du Huffington Post (le 9 mai), deux des principaux collaborateurs de Joe Biden, Jack Loew (ambassadeur en Israël) et David Satterfield (envoyé humanitaire à Gaza), ont joué un rôle décisif dans l'édulcoration des critiques formulées par le rapport conter Israël, en particulier en ce qui concerne la restriction des flux d'aide à Gaza. Un fonctionnaire du département d'Etat a déclaré à Amar : « C'était la tâche de Satterfield de défendre Israël. »
Les preuves du massacre massif de civils par Israël, du bombardement de cibles non militaires et d'infrastructures civiles, de l'assassinat de travailleurs humanitaires et de personnel médical, ainsi que du retard, de l'obstruction et de la restriction de l'aide humanitaire sont accablantes et ont été méticuleusement documentées depuis octobre par l'ONU, ainsi que par des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, Oxfam et Human Rights Watch. Si le département d'Etat ne pouvait pas obtenir les évaluations de la CIA et du Pentagone, il aurait pu consulter et évaluer les rapports préparés par ces organisations. Mais, comme l'a noté Chris Van Hollen, « ces rapports indépendants soulignent une tendance inquiétante : l'administration cite l'important travail de ces organisations lorsque cela lui convient, mais l'ignore lorsque cela ne lui convient pas ».
***
Pour mémoire, examinons le dossier depuis le 7 octobre en suivant simplement le cheminement des missiles.
Le 7 octobre, jour des attaques du Hamas, Israël a coupé l'électricité qu'il fournit à Gaza, la principale source d'énergie de la bande. L'électricité est restée coupée au moins jusqu'au mois de mars.
Le 7 octobre 2023, Nidal al-Waheidi et Haitham Abdelwahed, journalistes palestiniens de Gaza, ont été arrêtés par les FDI alors qu'ils couvraient l'attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël. Plus de sept mois plus tard, les autorités israéliennes refusent toujours de révéler le lieu où ils se trouvent, ainsi que les motifs légaux et les raisons de leur arrestation.
En octobre, Israël a utilisé des munitions d'attaque directe conjointes (JDAM-Joint Direct Attack Munitions) fabriquées aux Etats-Unis lors de deux frappes meurtrières sur des maisons palestiniennes dans la bande de Gaza occupée, tuant 43 civils – 19 enfants, 14 femmes et 10 hommes.
Le 9 octobre, une frappe aérienne des Forces de défense israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia a détruit plusieurs bâtiments à plusieurs étages, tuant au moins 39 personnes. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a constaté qu'il n'y avait pas d'objectif militaire spécifique et qu'aucun avertissement n'avait été donné avant l'attaque.
Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé un « siège complet » de Gaza : « Nous imposons un siège complet à [Gaza]. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant – tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » La politique de blocus a été réaffirmée le 18 octobre 2023 par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a déclaré que « nous n'autoriserons pas l'aide humanitaire sous forme de nourriture et de médicaments à partir de notre territoire vers la bande de Gaza ». Pendant les douze jours qui ont suivi, Israël a fermé tous les points d'accès à Gaza et a bombardé à plusieurs reprises le poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. Le blocus complet impose une punition collective à tous les habitants de Gaza et viole la section 620I du Foreign Assistance Act.
Le 10 octobre, une frappe aérienne des FDI a démoli un bâtiment dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza, tuant au moins 40 civils. Selon Amnesty International, un membre du Hamas vivait à l'un des étages de l'immeuble, mais il n'était pas présent au moment du bombardement. Le même jour, une frappe aérienne des FDI sur une maison à Deir al Balah a tué 21 membres de la famille al Najjar ainsi que trois voisins. L'enquête d'Amnesty International a permis d'établir qu'une bombe de 2000 livres équipée d'une munition d'attaque directe conjointe (JDAM) et d'un kit de guidage avait été utilisée lors de cette frappe meurtrière. Rien n'indique qu'il y ait eu des cibles militaires légitimes dans la zone.
Le 11 octobre, la seule centrale électrique de Gaza s'est retrouvée à court de réserves de carburant, après qu'Israël a bloqué l'entrée du carburant dans la bande.
Le 13 octobre, une attaque de chars israéliens dans le sud du Liban a tué le journaliste de Reuters Issam Abdallah, grièvement blessé la photographe de l'AFP Christina Assi, et blessé cinq autres reporters, dont un citoyen américain. Selon une enquête de Human Rights Watch, les tirs des Israéliens étaient « apparemment une attaque délibérée contre des civils, ce qui constitue un crime de guerre ».
Le 16 octobre, les forces israéliennes ont utilisé du phosphore blanc de fabrication américaine lors d'une attaque à Dhayra, dans le sud du Liban, d'une manière incompatible avec le droit humanitaire international, qui a blessé au moins neuf civils et endommagé des bâtiments civils. Le ministère libanais de l'Environnement a déclaré qu'au moins 6,82 kilomètres carrés de terres ont été brûlés lors des attaques des forces israéliennes, en grande partie à cause du phosphore blanc. Une enquête menée par le Washington Post a révélé que l'armée israélienne avait utilisé des munitions au phosphore blanc fournies par les Etats-Unis lors de ces attaques.
Le 19 octobre, une frappe aérienne israélienne a détruit un bâtiment dans l'enceinte de l'église orthodoxe grecque Saint Porphyre, au cœur de la vieille ville de Gaza, où s'abritaient environ 450 personnes déplacées de la petite communauté chrétienne de Gaza. La frappe a tué 18 civils et en a blessé au moins 12 autres.
Le 19 octobre, les FDI ont mené deux frappes aériennes sur la maison de la famille Saqallah à Sheikh Ajleen près de Tal-Hawa, à l'ouest de la bande de Gaza, où la famille élargie s'était réunie pour s'abriter de l'attaque. Tous les occupants de la maison ont été tués, dont 4 enfants et 4 médecins.
Le 20 octobre, 28 civils, dont 12 enfants, ont été tués par une frappe israélienne qui a détruit la maison de la famille al-Aydi et gravement endommagé deux maisons voisines dans le camp de réfugiés d'al-Nuseirat. Les maisons se trouvaient dans une zone du centre de la bande de Gaza où l'armée israélienne avait ordonné aux habitants du nord de la bande de Gaza de se déplacer.
Le 21 octobre, Israël n'a autorisé que 20 camions d'aide humanitaire, contenant des denrées alimentaires, de l'eau, du fourrage pour les animaux, des fournitures médicales et du carburant, à passer par le point de passage de Rafah pour entrer dans la bande de Gaza. En revanche, avant le 7 octobre, la population de Gaza dépendait en moyenne de 500 camions chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres produits essentiels chaque jour. Des mois plus tard, lorsqu'Israël a finalement ouvert les points de passage de Rafah et de Kerem Shalom, les FDI ont imposé un système d'inspection arbitraire et restrictif qui a entraîné des embouteillages massifs et de longues files d'attente pouvant aller jusqu'à 2000 camions. Aujourd'hui encore, il faut en moyenne 20 jours aux camions humanitaires pour se rendre du point d'inspection israélien d'Al Arish à Gaza.
Le 22 octobre 2023, une frappe aérienne des FDI sur une maison à Deir al-Balah a tué 18 membres de la famille Mu'ei-leq – 12 enfants et 6 femmes – ainsi qu'un voisin. Amnesty International a établi que la maison avait été touchée par une bombe de 1000 livres équipée d'une munition d'attaque directe conjointe (JDAM) dotée d'un système de guidage.
Entre le 7 octobre et le 7 novembre, les forces israéliennes ont bombardé plusieurs hôpitaux et cliniques, notamment l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, l'hôpital indonésien et le centre international de soins ophtalmologiques. Les hôpitaux bénéficient d'un statut protégé en vertu du droit humanitaire international et ne perdent leur protection contre les attaques que s'ils sont utilisés pour commettre des « actes préjudiciables à l'ennemi », bien que les avertissements, la proportionnalité et la distinction soient toujours requis.
Le 25 octobre, des frappes aériennes israéliennes ont décimé le quartier d'Al Yarmouk, détruisant sept tours résidentielles. Dans la seule tour résidentielle Al Taj, le bombardement a tué 91 Palestiniens, dont 28 femmes et 39 enfants.
Le 31 octobre, une frappe aérienne des FDI a visé un immeuble d'habitation de six étages près du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza. Au moins 106 civils, dont 54 enfants, ont été tués dans ce bombardement. Les autorités israéliennes n'ont fourni aucune justification pour cette attaque. Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'une cible militaire à proximité de l'immeuble au moment de l'attaque.
Le 5 novembre, les forces israéliennes ont frappé une famille dans une voiture dans le sud du Liban, tuant trois filles âgées de 10, 12 et 14 ans et leur grand-mère. Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'une cible militaire à proximité de la voiture qui a été frappée et qui ne contenait que des civils en fuite. Selon Human Rights Watch, l'attaque de la voiture montre « un mépris inconsidéré de l'armée israélienne pour son obligation de faire la distinction entre les objets civils et militaires et un manquement significatif à l'obligation de prendre des mesures de protection adéquates pour éviter la mort de civils ».
Le 3 novembre, une frappe aérienne israélienne sur une ambulance balisée à l'extérieur de l'hôpital al-Shifa a tué 21 personnes, dont 5 enfants, et en a blessé 60. Les ambulances sont des biens civils protégés en vertu du droit international humanitaire et ne peuvent être prises pour cible lorsqu'elles sont utilisées pour soigner des blessés et des malades, qu'il s'agisse de civils ou de combattants. Un porte-parole des FDI a justifié l'attaque lors d'une interview télévisée en déclarant : « Nos forces ont vu des terroristes utiliser des ambulances pour se déplacer. Elles ont perçu une menace et, en conséquence, nous avons frappé cette ambulance. » Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve que l'ambulance attaquée était utilisée à des fins militaires, mais a au contraire vérifié une vidéo montrant une femme sur un brancard dans l'ambulance.
En décembre 2023, des frappes aériennes des FDI ont détruit plusieurs bâtiments dans le camp de réfugiés d'Al Maghazi, tuant au moins 68 personnes. Un responsable militaire israélien a admis à la chaîne publique israélienne Kanque « [l]e type de munition ne correspondait pas à la nature d'un tel objectif, causant d'importants dommages collatéraux qui auraient pu être évités ».
Du 1er janvier au 12 février, plus de la moitié des missions d'aide humanitaire prévues dans le nord de Gaza ont été entravées par les autorités israéliennes. Les restrictions comprenaient : l'absence de garantie d'un passage sûr ; l'absence d'ouverture de routes supplémentaires vers le nord de Gaza ; des retards excessifs ; et le refus pur et simple de l'accès par l'armée israélienne.
Le 9 janvier 2024, une frappe aérienne israélienne a touché un immeuble d'habitation de cinq étages appartenant à la famille Nofal dans le quartier de Tal Al-Sultan à Rafah. L'attaque a tué 18 civils, dont 10 enfants, quatre hommes et quatre femmes. Au moins huit autres personnes ont été blessées. Une analyse des fragments de la bombe effectuée par Amnesty International a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une bombe de petit diamètre GBU-39 à guidage de précision, fabriquée aux Etats-Unis par Boeing.
Le 29 janvier 2024, les FDI ont attaqué une voiture transportant la famille de Hind Rajab, une fillette palestinienne de 6 ans, dans la zone identifiée plus tard comme Tel Al-Hawa, dans la ville de Gaza. La plupart des membres de sa famille ont été tués lors de l'attaque initiale, laissant Hind en vie parmi les corps de ses six parents. Deux médecins du Croissant-Rouge palestinien ont été dépêchés pour secourir Hind, qui a peut-être été tuée par les tirs israéliens avant leur arrivée. Ils ont également été attaqués et tués. Leur ambulance a été écrasée par des chars israéliens. Le Washington Post a identifié sur les lieux un fragment d'obus de 120 mm de fabrication américaine.
Le 2 février, un navire israélien a tiré sur un convoi de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui attendait d'entrer dans le nord de Gaza par la route Al Rashid.
Le 13 février, il a été révélé que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, bloquait la livraison d'une cargaison de farine financée par les Etats-Unis au port d'Ashdod depuis au moins le 19 janvier 2024, alors que Netanyahou avait assuré à Biden que la cargaison serait autorisée à entrer à Gaza.
Le 16 février, la production d'eau à Gaza n'était plus que de 5,7% de ce qu'elle était avant le début de la guerre, ce qui a entraîné des cas de déshydratation grave, ainsi que l'apparition de maladies, notamment l'hépatite A et la diarrhée. Depuis novembre, les habitants du nord de Gaza n'ont pas accès à l'eau potable, tandis que depuis mars, les habitants du sud de Gaza ne disposent en moyenne que de deux litres d'eau par jour.
Le 24 mars 2024, alors que le nord de Gaza est au bord de la famine, les autorités israéliennes déclarent aux Nations unies qu'elles n'autoriseront plus le passage de convois alimentaires de l'UNRWA dans le nord de Gaza. Le même jour, les forces israéliennes ont tiré sur des personnes qui attendaient la distribution de nourriture sur un site situé au rond-point de Koweït.
Le 1er avril, une frappe aérienne israélienne a tué sept travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen suite à trois frappes distinctes sur des véhicules portant le logo de la WCK dans une rue « désignée pour le passage de l'aide humanitaire ». Les trois voitures ont été frappées l'une après l'autre et ont été retrouvées détruites à près d'un kilomètre et demi de distance. Les frappes ont été autorisées par un colonel et supervisées par un major.
***
Voici un extrait du rapport (publié le 18 avril) de l'Independent Task Force on NSM-20, rédigé par Noura Erakat et Josh Paul, ancien fonctionnaire du département d'Etat : « Bien qu'Israël ait attribué les 34 000 victimes palestiniennes, dont 70% sont des femmes et des enfants, à la prétendue utilisation de civils comme boucliers humains par le Hamas, nous avons constaté que dans 11 des 16 incidents que nous avons analysés, Israël n'a même pas défini publiquement une cible militaire ou tenté de justifier l'attaque. Sur les cinq incidents restants, Israël a publiquement désigné des cibles, avec vérification dans deux cas, mais aucun avertissement de précaution n'a été donné et nous estimons que les dommages civils anticipés étaient connus et excessifs. »
Depuis qu'Antony Blinken a publié son rapport réaffirmant sa confiance en Israël pour utiliser son arsenal américain de manière responsable, Israël a fermé le point de passage de Rafah, forcé plus de 500 000 personnes à quitter la ville [1], recommencé à bombarder le camp de réfugiés de Jabalia déjà dévasté, frappé un camion d'aide de l'ONU par un drone, laissé 20 médecins américains bloqués à l'hôpital sans eau. Et les forces de sécurité israéliennes se sont retirées alors que des centaines de colons et de paramilitaires israéliens détruisaient les fournitures d'un convoi humanitaire et incendiaient deux des camions.
En réponse à ces nouvelles atrocités, Joe Biden a approuvé un nouveau transfert de 1,2 milliard de dollars d'armes (700 millions de dollars de munitions pour chars, 500 millions de dollars de véhicules tactiques et 60 millions de dollars d'obus de mortier) vers Israël, ce qui constituera certainement une récompense bienvenue lorsque les FDI franchiront une nouvelle ligne rouge de facto fictive dans leur assaut terrestre sur Rafah.
*
Article publié dans Counterpunch le 17 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre.
Jeffrey St. Clair est rédacteur en chef de CounterPunch. Son livre le plus récent est An Orgy of Thieves : Neoliberalism and Its Discontents (Counterpunch, novembre 2022, avec Alexander Cockburn).
Notes
[1] Déclaration de Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, sur Rafah, le 24 mai
« La souffrance et la misère que l'opération militaire israélienne à Rafah a infligées à la population de Gaza n'ont rien de limité.
Comme on le craignait, il s'agit d'une tragédie sans nom.
L'incursion terrestre à Rafah a déplacé plus de 800 000 personnes, qui ont fui une fois de plus en craignant pour leur vie et sont arrivées dans des zones dépourvues d'abris adéquats, de latrines et d'eau potable.
Elle a interrompu l'acheminement de l'aide dans le sud de la bande de Gaza et paralysé une opération humanitaire déjà à bout de souffle.
Elle a interrompu les distributions de nourriture dans le sud et ralenti l'approvisionnement en carburant des éléments vitaux de Gaza – boulangeries, hôpitaux et puits d'eau – jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un mince filet d'eau.
Bien qu'Israël ait rejeté les appels de la communauté internationale à épargner Rafah, la clameur mondiale en faveur d'un arrêt immédiat de cette offensive est devenue trop forte pour être ignorée.
Avec l'adoption aujourd'hui de la résolution 2730 du Conseil de sécurité appelant à la protection des travailleurs humanitaires et l'ordre de la Cour internationale de justice d'ouvrir le point de passage de Rafah pour fournir une aide à grande échelle et mettre fin à l'offensive militaire, nous vivons un moment de clarification.
C'est le moment d'exiger le respect des règles de la guerre auxquelles tous sont tenus. Les civils doivent pouvoir se mettre à l'abri. L'aide humanitaire doit être acheminée sans obstruction. Les travailleurs humanitaires et le personnel des Nations unies doivent pouvoir accomplir leur travail en toute sécurité.
Alors que la population de Gaza est confrontée à la famine, que les hôpitaux sont attaqués et envahis, que les organisations humanitaires sont empêchées d'atteindre les personnes dans le besoin, que les civils sont bombardés du nord au sud, il est plus important que jamais de tenir compte des appels lancés au cours des sept derniers mois :
Libérer les otages. Accepter un cessez-le-feu. Mettez fin à ce cauchemar. » (Traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : À la Cour suprême, réaction et corruption

La Cour suprême des États-Unis (SCOTUS), la plus conservatrice depuis 80 ans, s'est totalement discréditée aux yeux de beaucoup d'AméricainEs par ses décisions antidémocratiques. Mais aussi la corruption de certains juges et l'identification de certains d'entre eux avec l'insurrection d'extrême droite et la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021.
27 mai 2024 | Hebdo L'Anticapitaliste - 710
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/etats-unis-la-cour-supreme-reaction-et-corruption
La Cour suprême a toujours été composée en majeure partie de personnes issues de la classe dirigeante ou de son élite politique, mais cela faisait des décennies qu'elle n'était pas apparue aussi clairement partiale. Aujourd'hui, 60 % des AméricainEs disent désapprouver la Cour et beaucoup la méprisent totalement.
Les juges de la SCOTUS, qui siègent à vie, sont nommés par le président avec l'approbation du Sénat, une institution très peu démocratique qui tend à refléter d'abord les intérêts de la classe dirigeante. De la fin des années 1930 aux années 1960, des présidents démocrates – Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson – ont pu nommer la plupart des juges, conférant à la Cour un caractère libéral. Au cours de ces années, certains droits des travailleurEs, des NoirEs et des femmes ont été renforcés et étendus. Avec la fin de l'expansion économique de l'après-guerre, la Cour est devenue plus conservatrice à partir des années 1980 et une cour de droite dans les années 2000.
L'orientation de la Cour suprême de plus en plus à droite
Les neuf juges de la SCOTUS reflètent le pays en termes de race, de religion et de sexe : six sont blancs, deux sont noirs, une est latina et deux sont juifs, ce qui en fait peut-être la cour la plus diversifiée de l'histoire des États-Unis. Mais c'est aujourd'hui la cour la plus conservatrice depuis quatre décennies, dominée par des membres nommés par les Républicains et qui ont adopté des décisions de plus en plus réactionnaires. Le président républicain George H. W. Bush a nommé le juge Clarence Thomas et George W. Bush a choisi le juge en chef John Roberts ainsi que Samuel A. Alito, tandis que Donald Trump en a nommé trois, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. La droite dispose désormais d'une majorité de six contre trois, ce qui a complètement modifié l'orientation de la Cour.
La décision la plus importante de la Cour a été l'affaire Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization of 2022, qui a renversé Roe vs. Wade, l'arrêt de 1973 de la SCOTUS qui avait établi le droit constitutionnel des femmes à l'avortement. Mais dans d'autres décisions, la Cour a également défait des lois sur la discrimination raciale, sapé la protection du droit de vote, compromis la séparation de l'Église et de l'État, affaibli des agences fédérales de régulation et miné des lois sur le contrôle des armes à feu.
Corruption
Dans le même temps, a été révélée une grave corruption au sein de la Cour. Le juge Clarence Thomas a accepté des cadeaux financiers du milliardaire et donateur républicain Harlan Crow. Celui-ci a payé l'éducation en école privée du petit-neveu et du fils adoptif de Thomas, la maison où vivait la mère de Thomas, de nombreux voyages de vacances pour Thomas dans les jets et yachts privés de Crow ; il a donné un demi-million de dollars à l'épouse de Thomas, Ginni, pour sa fondation politique de droite et lui a versé un salaire annuel de 120 000 dollars. Ginni Thomas soutient le mouvement « Stop the steal » (« Arrêtez le vol ») de Trump qui prétend, faussement, que celui-ci a gagné la dernière élection présidentielle. Le juge Alito, lui, a accepté un voyage pour pêcher en Alaska d'une valeur de 100 000 dollars de la part du gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Singer. Crow et Singer sont tous deux des hommes dont les affaires ont été portées devant la Cour, et ni Thomas ni Alito n'ont signalé leurs cadeaux ou se sont excusés.
On vient d'apprendre qu'Alito a fait flotter des drapeaux associés à l'expression « Arrêtez le vol » de Donald Trump et à l'insurrection du 6 janvier, l'un étant un drapeau américain renversé à son domicile et l'autre un drapeau nationaliste chrétien « Appel au ciel » dans sa maison de vacances. Au sein de la plus haute juridiction du pays, nous avons donc deux juges corrompus, tous deux liés à l'extrême droite, six conservateurs au total qui annulent des réglementations et des lois décidées démocratiquement au niveau des États et au niveau fédéral. Il n'est pas étonnant que la Cour soit désormais méprisée par tant de gens.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
Dan La Botz, enseignant, chauffeur routier, historien et journaliste, est l'auteur, entre autres, de What Went Wrong ? The Nicaraguan Revolution : A Marxist Analysis (Ce qui a mal tourné – la révolution nicaraguayenne, une analyse marxiste), Brill, Leiden 2016 et Haymarket Books, Chicago 2018. Il a été cofondateur de Teamsters for a Democratic Union (TDU). Militant de l'organisation socialiste Solidarity (section sympathisante de la IVe Internationale aux États-Unis) il est également membre de la branche de Brooklyn des Socialistes démocratiques d'Amérique (DSA).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Florence Montreynaud : « La prostitution est pour moi la pire des violences contre les femmes »

Florence Montreynaud est féministe depuis toujours. Elle a créé de nombreuses associations dont Zéromacho qui regroupe des hommes abolitionnistes de la prostitution. Aujourd'hui 4000 hommes de plusieurs pays ont signé le manifeste. Sa dernière idée est le Front féministe international qui rassemble 413 associations de 7 pays.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Avec l'aimable autorisation de l'autrice
Quand et pourquoi êtes-vous devenue féministe ?
C'était évident, étant donné l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Elle me racontait que sa mère à elle était indignée : avant la guerre, ma grand-mère était professeure dans un lycée de filles, et le concierge, qui était idiot et invalide de guerre, plastronnait parce qu'il avait le droit de vote, lui, alors qu'aucune des professeures ni la directrice ne l'avaient. Ma grand-mère trouvait cela scandaleux, et ma mère nous le racontait pour nous montrer qu'on venait de loin : jusqu'en 1944, tous les hommes avaient le droit de vote mais aucune femme, y compris une femme de génie comme Marie Curie ! Je me souviens aussi qu'elle avait dû demander l'autorisation de mon père pour pouvoir ouvrir un compte en banque à son nom, avec son argent (c'était avant 1965). J'ai été élevée dans la conscience de l'injustice qui frappe les femmes. Je n'ai pas de frère, j'ai quatre sœurs et nous n'avons pas été motivées par ce que beaucoup de féministes ont ressenti dans leur jeunesse : la différence de traitement entre les garçons et les filles. Le féminisme m'est venu d'une façon intellectuelle. J'ai lu Le Deuxième Sexe pendant l'été 1970 ; ce livre m'a confortée dans mes idées : toutes ses analyses me semblaient évidentes.
Le moment de mon engagement, c'est le 28 août 1970. J'ai lu dans Le Monde que le 26 août un groupe de féministes avaient tenté de déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe « à la femme du soldat inconnu ». J'ai trouvé cette idée fabuleuse. J'ai voulu les rejoindre parce que c'était ce que j'attendais depuis des années. Comme je me tenais au courant de ce qui se passait à l'étranger, j'avais entendu parler d'actions féministes en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Italie, aux États-Unis. En France, il ne se passait rien à ma connaissance. Je me suis dit que c'était exactement ce type d'action auquel je voulais participer, c'est-à-dire à base d'humour féministe : quand on n'a pas de moyens, qu'on est peu nombreuses, on a toujours l'outil de l'humour, pour ridiculiser les machos. Je peux donc dater mon désir d'engagement du mois d'août 1970. Mais à cette époque, comment trouver ces femmes ? J'ai pu le faire en avril 1971 quand est sorti Le Nouvel Observateur avec la fameuse couverture noire sur les 343 Françaises qui déclarent « J'ai avorté ». Il y avait une adresse postale, je leur ai écrit, je les ai rejointes. Je me suis engagée à la fois au MLF (Mouvement de libération des femmes) et au Planning familial pour suivre une formation. C'est ainsi que tout a commencé pour moi, et cela n'a jamais fini : je suis une féministe engagée sans interruption depuis 1971.
Quel est votre parcours de féministe ?
J'ai commencé par une formation sur la contraception et l'avortement, j'ai eu un fort engagement sur l'avortement dès avant le vote de la loi Veil (en décembre 1974). Après le vote de la loi, j'ai reçu au Planning familial des centaines de femmes qui voulaient avorter afin de les aider, les conseiller, les rassurer. Avec le Planning Familial, je me suis aussi engagée dans l'éducation sexuelle à l'école. La sexualité et l'avortement qui ont été mes sujets de formation me paraissent essentiels encore aujourd'hui, et pour mon prochain livre je travaille sur la sexualité, parce que c'est le lieu de l'oppression des femmes : le chantage à l'amour leur fait accepter des violences ; quant à l'avortement, on voit bien l'actualité brûlante de ce sujet. Sans le droit d'avorter, les femmes sont contraintes par les limites de la contraception à porter une grossesse. J'ai quatre enfants, et je sais ce qu'est une grossesse non désirée – avec l'impression d'être colonisée contre sa volonté. Ce qui me semble le plus monstrueux, quand on veut contraindre les femmes à porter une grossesse à terme, c'est de les forcer à aimer. L'avortement, c'est la liberté des femmes, c'est la possibilité de se projeter dans l'avenir, de construire sa vie au lieu de la subir. Je me battrai pour ce droit jusqu'à ma mort.
Quelles associations avez-vous créées ?
À partir de 1981, je me suis occupée pendant près de vingt ans de l'Association des femmes journalistes.
En 1999, j'ai lancé les Chiennes de garde, contre les insultes sexistes publiques adressées aux femmes, et je suis très fière d'avoir inventé ce nom ; en 2000, j'ai lancé la Meute contre la publicité sexiste et en 2001 le réseau Encore féministes ! Parallèlement, j'écrivais des livres sur l'histoire des femmes, et j'ai commencé à m'intéresser à la question de la prostitution – mon premier livre est sorti en 1993. La prostitution est pour moi la pire des violences contre les femmes. Très vite, j'ai pensé que c'était une affaire d'hommes, que c'était aux hommes de s'emparer de cette question. Dans un premier temps, j'ai cherché à motiver les hommes de mon entourage, cela m'a pris beaucoup de temps, jusqu'à la création en 2011 de Zéromacho, dont je m'occupe toujours. Il y a deux ans, nous avons créé le Front féministe international qui prend position sur un certain nombre de sujets clivants parmi les féministes : la prostitution, la location d'utérus, le voile islamique, la transidentité. Le Front féministe international regroupe 413 associations de 7 pays.
J'ai aussi publié 19 livres, le dernier traite de la double morale sexuelle : Les femmes sont des salopes, les hommes sont des Don Juan (Hachette).
La prostitution est donc pour vous une question très importante
Quand un éditeur m'a proposé d'écrire un livre sur ce sujet, comme je n'y connaissais rien, j'avais un regard neuf. Il m'a semblé évident que ce n'était pas un problème de femmes, mais d'hommes, et que le sujet n'était pas la pauvreté des femmes et les violences qui les amènent à la prostitution. Pour moi, c'est une question politique : certains hommes estiment qu'ils ont le droit de payer pour avoir accès au sexe de femmes pauvres, qui n'ont que cela à vendre. Pour moi, la sexualité, c'est la rencontre des désirs de deux adultes, à la recherche du plaisir. Une femme qui ne ressent pas de désir subit un viol, même si elle est payée, même si elle est consentante.
La prostitution est considérée comme un « droit de l'homme ». Après avoir écrit ce premier livre, je me suis engagée au Mouvement du Nid parce que j'avais rencontré des hommes qui payaient des femmes prostituées. Je les avais écoutés et j'en avais conclu que pour beaucoup la prostitution était une recherche de contact, d'écoute, parfois de tendresse, et même d'amour : or c'est le pire moyen pour les trouver. J'ai fait de la formation de travailleurs sociaux ; j'ai organisé un colloque sur la prostitution avec l'Association des femmes journalistes.
J'ai voulu que les hommes s'organisent car j'avais constaté, pour ceux de mon entourage, que cette question ne les touchait pas du tout, ne les concernait pas ; ce n'est pas leur monde. J'ai eu du mal à les convaincre de s'engager ! Le manifeste de Zéromacho est sorti en 2011. À ce jour, il a été signé par 4 000 hommes, c'est peu ; ce sont des hommes courageux qui s'affichent publiquement contre le système prostitueur et pour une sexualité libre, dans un désir réciproque d'adultes. Les responsables sont Gérard Biard et Fred Robert.
J'avais étudié l'histoire de la prostitution et les luttes contre le système prostitueur. Il n'avait jamais existé d'association d'hommes sur cette question. Certains hommes disent non à la prostitution mais jamais un réseau d'hommes abolitionnistes n'avait été créé. Zéromacho existe maintenant en Espagne et en Allemagne. Il faut que dans tous les pays les hommes qui ne payent pas les femmes pour un acte de prostitution se revendiquent publiquement comme tels. Ils sont la majorité, car c'est seulement une petite minorité d'hommes qui font prospérer le système prostitueur. Je les appelle « prostitueurs » et non « clients », mot qui valide un point de vue commercial. Il y a aussi 10 à 20% d'hommes prostitués mais 99% des prostitueurs sont des hommes.
Je n'arrive pas à comprendre que l'opinion publique soit aussi complaisante pour ces violences. À Paris, par exemple, Zéromacho agit contre les 403 prétendus « salons de massage » asiatiques qui ont pignon sur rue, avec des Chinoises victimes de la traite des femmes. Ce sont uniquement des hommes qui vont dans ces « salons ». Tout le monde le sait, mais la loi Olivier-Coutelle de 2016 n'est pas appliquée, alors que cette loi fait honneur à la France en s'alignant sur la position suédoise : considérer la prostitution comme un système dont les responsables à poursuivre sont les proxénètes et les prostitueurs. Que fait la police ? Pourquoi continuer à protéger des hommes qui traitent des femmes pauvres comme des marchandises ? Cette impunité est un scandale.
Propos recueillis par Caroline Flepp 50-50 Magazine
https://www.50-50magazine.fr/2024/05/06/florence-montreynaud/
Texte repris dans :
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté – N° 431 – 12 mai 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L’avenir de l’Inde si Modi est réélu – une entrevue avec Christophe Jaffrelot
Le ‘’ cheuf ‘’ a pris le contrôle de mon parti
J'ai suivi le conseil national de Québec Solidaire via les nouvelles télé en fin de semaine. J'en ressors avec l'impression que Gabriel-Nadeau, notre ‘' porte-parole masculin ‘' devenu en peu de temps son seul ‘' cheuf ‘' a pris en fin de semaine le contrôle de Québec Solidaire avec l'aval de la direction du parti, de la députation, et de la majorité des délégué,es présents,es votants,es malgré les réserves émises par plusieurs d'entre eux,elles. Entendre également Rhuba Gazal exprimer dès lors son intérêt pour le poste de porte-parole féminine tout en étant députée fait craindre l'accroissement du contrôle du parti parlementaire sur le parti de la rue et des rangs. Il n'y avait aucune urgence selon moi pour adopter en fin de semaine la Déclaration de Saguenay, le fruit d'une consultation des gens en région, et en faire le nouveau programme du parti alors qu'il s'agit tout au plus pour moi d'une plateforme électorale toute en douceur pour rallier le plus d'électeurs,trices possible et pour y perdre une fois pour toute son âme dès les prochaines élections. La Déclaration de Saguenay mise sur la glace et un véritable débat sur le programme précédant une prochaine plateforme électorale et sur les structures du parti auraient pu avoir lieu au congrès de l'automne en présence d'un beaucoup plus grand nombre de délégués,es élus,es suite à des débats engagés dès maintenant dans nos associations locales. J'ai l'impression que la parti nous a glissé d'entre les mains en fin de semaine. Suite au conseil national, le TGV de Québec Solidaire semble rouler à toute vitesse sur les rails avec l'aval des médias présents à L'Assemblée Nationale et il sera très difficile de l'arrêter à moins d'avoir dès maintenant des débats ouverts et démocratiques au sein de nos associations locales en vue de la préparation du congrès de l'automne et la désignation de délégués,es reflétant nos échanges et nos prises de position au bout du processus.
J'ajouterai comme ancien membre de L'Union Paysanne que d'avoir entendu notre
‘' co-porte parole masculin ‘' appuyer à fond de train en fin de semaine le monopole syndical dans le secteur agricole avec son approche industrielle de l'agriculture m'inquiète au plus haut point et, quel bel exemple de recentrage de notre parti pour ne plus faire peur à personne et peut-être gagner des votes. J'espère me tromper et seul un sursaut démocratique à partir de la base pourrait nous permettre de faire dérailler le train et prendre un pas de recul avant qu'il n'entre définitivement en gare, et d'envisager personnellement de quitter le navire Solidaire.
Solidairement
Yves Chartrand
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Vers un grand mouvement écosocialiste international
Québec adopte une réforme controversée de la construction

DIRECT ACTION – Une expérience radicale au Canada (1980-1983)
Les années 1980 marquent un ressac de la gauche, notamment révolutionnaire, partout en Occident. Dans ce contexte, des groupes travaillent au renouvellement de leur stratégie comme de leurs pratiques. C’est le cas de Direct Action, un collectif canadien anarchiste, écologiste, féministe et anti-impérialiste qui mène une série d’attaques contre l’État et l’industrie de 1980 à 1983. Retour sur une expérience radicale[1].
À la suite des grands cycles de luttes des années 1960 et 1970, marqués par les grèves ouvrières, la puissance des partis communistes, la « New Left », l’Autonomie[2] ainsi que l’anti-impérialisme et la décolonisation, la gauche faiblit durant la décennie suivante. Les modèles soviétique et chinois sont de moins en moins attrayants : l’URSS connaît une stagnation politique et économique sous la direction de Léonid Brejnev (1964-1982) alors que la Chine se libéralise sous l’impulsion de Deng Xiaoping (1978-1989). Les organisations de gauche ont aussi de la difficulté à résister à la restructuration du travail et aux politiques néolibérales qui transforment les lieux de production. Le roulement et la précarisation des employé·e·s, ainsi que la délocalisation, nuisent aux groupes qui s’organisent historiquement dans les milieux de travail. Enfin, la violente répression étatique des années 1970 a détruit partout en Occident les mouvements révolutionnaires, du Black Panther Party aux États-Unis en passant par l’Autonomie italienne, sans compter la multiplication des interventions impérialistes contre les régimes de gauche, comme au Chili en septembre 1973. Dans ce contexte, plusieurs groupes militants cherchent à redéfinir leur stratégie, comme c’est le cas de Direct Action au Canada.
Dans l’ambiance morose des années 1980, les révolutionnaires sont forcé·e·s de reconsidérer les raisons de leur échec et leurs manières de lutter. On voit par exemple émerger la revue Révoltes (1984-1988) au Québec qui ouvre le dialogue entre libertaires et marxistes. Dans le même sens, des militant·e·s relancent le débat sur les causes de l’oppression tout en cherchant les meilleures méthodes pour renverser l’injustice. Acculés à la marginalité, les mouvements d’extrême-gauche arrivent toutefois à se maintenir au sein des milieux contre-culturels en Occident, en particulier au sein de la scène punk.
À la fin des années 1970, la scène anarcho-punk de Vancouver joue donc un rôle important dans le renouveau d’une pensée révolutionnaire au Canada. Une réflexion critique du colonialisme, du capitalisme et de l’impérialisme, tournée vers un horizon égalitaire, féministe et écologiste, se développe au sein du journal Open Road (1975-1990). De ce milieu émerge, en 1980, le collectif Direct Action qui veut mener des attaques contre des symboles et des infrastructures capitalistes, afin de sensibiliser la population à certains enjeux et pour nuire au système lui-même. Contrairement aux groupes armés des années 1970, souvent des factions militarisées d’un mouvement de masse, Direct Action est un petit groupe qui souhaite, par son action, être un agent de la relance de la gauche au Canada.


Dessin par Julie Belmas. Source.
Repenser le rapport de force
Direct Action s’inscrit dans la pensée anarchiste et critique le développement technique ainsi que l’État. En raison de son analyse, le groupe préconise de mener des luttes de solidarité avec les peuples autochtones, de s’attaquer aux infrastructures de l’État bourgeois, de participer aux campagnes antiguerres, etc. Direct Action tente de s’intégrer à l’ensemble de ces combats en se donnant la tâche spécifique de mener des actions d’éclat lorsque la situation est totalement bloquée. Le groupe espère relancer des luttes qui stagnent en faisant la démonstration qu’un nouveau rapport de force peut émerger grâce à l’action armée, comme moyen de dernier recours et en évitant de blesser ou de tuer des individus. Par une activité soutenue, il souhaite plus largement redynamiser et radicaliser la gauche canadienne. Le groupe propose une réflexion théorique tout en jouant un rôle « d’avant-garde tactique ». Par son analyse politique et par les méthodes de lutte qu’il propose, Direct Action peut être associé au courant de l’anarchisme vert, qui se développe au cours des années 1980 en réponse à l’institutionnalisation des mouvements écologistes en Occident.
Direct Action procède d’abord à des actes de vandalisme contre l’entreprise minière Amax puis les bureaux du ministère de l’Environnement. Une première attaque d’envergure cible, le 30 mai 1982, les transformateurs de Cheekye-Dunsmuir sur l’île de Vancouver. Cette station fait partie d’un immense projet hydro-électrique particulièrement nuisible à l’environnement que les luttes populaires n’avaient pas été en mesure de bloquer. L’attentat relance le débat concernant le projet, mais celui-ci est tout de même achevé et mis en service.
Quelques mois plus tard, le 14 octobre, une seconde bombe explose, cette fois à Toronto. L’attentat vise Litton Industries, une société qui concentre tous les problèmes que dénoncent Direct Action. Cette entreprise, honnie par les citoyen·ne·s, produit des systèmes de guidage pour les missiles de croisière américains. Elle est financée par le gouvernement canadien et procède à des tests dangereux et polluants en Alberta et dans les Territoires-du-Nord-Ouest, notamment en terres autochtones. Litton est une pièce maîtresse de l’appareil étatique, capitaliste et militaire occidental. L’attaque est annoncée par Direct Action afin d’éviter de faire des victimes, mais Litton n’écoute pas et plusieurs personnes sont blessées. Malgré tout, cette action est relativement bien perçue par les milieux militants opposés depuis des années au complexe militaro-industriel. De grandes manifestations anti-Litton suivent l’attaque, dont une rassemblant 15 000 personnes à Ottawa en octobre. De plus l’usine finit par perdre son financement gouvernemental.
Peu après, Direct Action se recompose sous le nom de la Wimmin’s Fire Brigade et incendie, le 22 novembre 1982, trois succursales de Red Hot Video. Cette entreprise américaine se spécialise alors dans la distribution de films pornographiques hardcore pirates. Au nom de la « liberté de choix » elle rend disponible une sélection de vidéos violentes et dégradantes qui mettent en scène viols et torture. En un an, la chaîne était passé d’une succursale à treize. L’attaque féministe est particulièrement bien reçue par la gauche canadienne qui lutte depuis longtemps contre la chaîne.
Six mois de luttes légales contre l’entreprise (pétions, soirées d’information, appels à la justice, manifestations) se butaient à la soude-oreille du gouvernement. Le coup d’éclat, accompagné d’un communiqué, s’attire donc la sympathie marquée du mouvement féministe qui refuse, malgré les pressions politiques et médiatiques, de « condamner la violence » de l’action. Le succès de l’initiative, selon plusieurs journaux militants de l’époque, s’explique par la complémentarité de celle-ci avec la campagne publique légale. Pendant plusieurs mois, des militantes avaient pris le temps de faire un travail d’information et porté leurs revendications dans l’espace public, créant ainsi un bassin de personnes conscientisées et déterminées à combattre cet affront capitaliste, sexiste et violent contre l’intégrité, la dignité et la sécurité des femmes. La dynamique entre action citoyenne et action directe fait le succès de l’opération ; les autorités, d’abord complaisantes, lancent des enquêtes contre Red Hot Video et six de ses boutiques finissent par fermer.
En janvier 1983, les cinq membres de Direct Action sont pourtant arrêté·e·s, interpellé·e·s sur la route par des agents de la GRC déguisés en travailleurs routiers dans le cadre d’une opération policière élaborée. Le procès de ceux qu’on surnomme les « Vancouver Five » mène à de lourdes peines. Ann Hansen, Brent Taylor, Juliet Belmas, Doug Stewart et Gerry Hannah écopent tous de plusieurs années de prison.



De la lutte armée à la lutte populaire
L’arrestation des membres de Direct Action témoigne d’une limite de leur action : leur aventurisme et leur isolement les exposaient à la répression. L’usage de l’action armée, même en évitant de cibler des personnes, était aussi à double tranchant : elle permettait d’attirer l’attention sur un enjeu précis, voire d’instaurer un rapport de force direct avec l’État ou une industrie, mais pouvait effrayer les militant·e·s moins radicaux·ales et diviser les luttes. Sans moraliser le débat, la tactique de Direct Action était-elle suffisamment arrimée aux mouvements populaires, et participait-elle d’un horizon stratégique à même d’ébranler l’État canadien et le régime capitaliste ? Le réseau d’appui du groupe, ancré surtout dans la scène punk, constituait-il un bassin suffisant pour donner de la légitimité et de la visibilité aux actions qu’il posait ?
À propos de l’expérience de Direct Action et des enjeux tactiques et stratégiques autour des actions de propagande armée, le journal torontois Prison News Service (1980-1996), écrivait :
« Les actions de guérilla ne sont pas une fin en soi ; un acte unique, ou même une série d’actions coordonnées, a peu probabilité d’atteindre autre chose qu’un objectif immédiat. De telles actions sont problématiques si l’on suppose qu’elles peuvent être substituées au travail légal, mais si elles peuvent être comprises dans une politique plus large, comme une tactique parmi tant d’autres, alors elles peuvent donner aux mouvements légaux plus de marge de manœuvre, les rendre plus visibles et plus crédibles. […]
Pour la plupart des activistes nord-américains, la lutte armée est réduite à une question morale : « Devrions-nous ou ne devrions-nous pas utiliser des moyens violents pour faire avancer la lutte ? » Bien que cette question soit pertinente sur le plan personnel, elle ne fait que brouiller une question qui, dans les faits, est politique. La plupart des radicaux, de toute façon, à ce stade, ne participeront pas directement à des attaques armées. Mais, à mesure que les mouvements de résistance se développeront en Amérique du Nord – et ils doivent se développer, ou nous sommes tous perdus – il est inévitable que des actions armées seront entreprises par certains. La question demeure si ces actions armées seront acceptées dans le spectre des tactiques nécessaires. […]
Loin d’être « terroriste », l’histoire de la lutte armée en Amérique du Nord montre que les groupes de guérilla ont été très prudents dans la sélection de leurs cibles. Il y a une différence majeure entre attaquer une cible militaire, corporative, […] et poser une bombe dans les rues encombrées de la ville. La gauche en Amérique du Nord n’a jamais posé d’actes de terreur aléatoires contre la population en général. Dénoncer ceux qui voudraient choisir d’agir en dehors des limites étroitement définies des « actions pacifiques » pour paraître moralement supérieur, ou pour soi-disant éviter de s’aliéner la population, c’est donner à l’État le droit de déterminer quelles sont les limites admissibles de la protestation.»
Ce qui est certain, c’est que le groupe a su renouveler avec originalité l’analyse de la conjoncture canadienne, tout en ayant l’audace de rouvrir la question de la stratégie et de la tactique révolutionnaire dans un moment de ressac. En liant les questions du colonialisme, du capitalisme, de l’écologie, du sexisme et de l’impérialisme, Direct Action a aidé les mouvements canadiens à mieux comprendre ses adversaires : l’anarcho-indigénisme de la Colombie-Britannique en témoigne encore de nos jours. La matrice théorique développée dans les années 1980 a contribué à la critique des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 et informe toujours la gauche, comme on le voit dans les luttes de solidarité avec les Wet’suwet’en depuis 2019. L’activité de Direct Action pousse à réfléchir à ce qui peut être fait lorsqu’une situation politique est bloquée. Comment la gauche doit-elle agir lorsque les cadres légaux l’empêchent objectivement d’avancer, lorsque le monopole étatique de la violence lui est imposé ?
Lors de son procès, Ann Hansen, membre de Direct Action, demandait : « Comment pouvons-nous faire, nous qui n’avons pas d’armées, d’armement, de pouvoir ou d’argent, pour arrêter ces criminels [les capitalistes] avant qu’ils ne détruisent la terre ? » Une partie de la réponse se trouve dans la construction de mouvements populaires eux-mêmes en mesure de dépasser la légalité bourgeoise lorsque la situation l’exige. Cette stratégie évite l’isolement d’un groupe comme Direct Action sans confiner la gauche à la défaite lorsque l’État le décide. Un horizon commun est aussi nécessaire afin de déconstruire le capitalisme et de produire une société émancipée.


L’affiche en couverture, présentée aussi à droite ici, est l’œuvre de Matt Gauck (2013). Ses œuvres sont disponibles sur le site de la coopérative d’artistes engagé.es Justseeds.
Pour en savoir plus sur l’expérience de Direct Action, on consultera l’autobiographie d’Ann Hensen Direct Action. Memoirs of an Urban Guerrilla (2001). En 2018, cette militante publiait Taking the Rap: Women Doing Time for Society’s Crimes, un ouvrage portant à la fois sur son expérience en prison ainsi que sur celle des nombreuses femmes qu’elles y a rencontrées. Pour une discussion extensive sur le contexte politique, culturel et idéologique dans lequel évoluait le groupe Direct Action, on consultera la thèse d’Eryk Martin Burn it Down! Anarchism, Activism, and the Vancouver Five, 1967–1985. On lira aussi avec profit les textes et écrits des Vancouver Five ainsi que le pamphlet War on Patriarchy, War on The Death Technology. Toutes ces ressources sont en anglais (quelques traductions en français sont aussi disponibles, mais éparses).
Le journal libertaire Open Road nous fournit plus d’informations sur l’actualité, les débats et les procès entourant Direct Action, notamment dans le #15, Printemps 1983 et le #16, Printemps 1984.
Enfin, le site d’archives bilingue sur les Vancouver Five recense (presque) tout ce qui existe et se publie sur le groupe.
Notes
[1] Cet article est une version bonifiée de l’article « Direct Action : une expérience radicale », paru dans le numéro 94 de la revue À Bâbord !
[2] La « New Left » et les mouvements autonomes (italien et français) des années 1960-1970 s’inspirent du marxisme, tout en élargissant leur champ d’action à d’autres thèmes que le travail.
La pollution atmosphérique

Les têtes brûlées

Catherine Dorion, Les têtes brûlées. Carnets d'espoir punk, Montréal. Lux éditeur, 2023.
« Nous sommes un parti décentralisé dans notre façon de fonctionner ; nous n'avons pas une façon unique de parler, de prendre la parole. Personne ne nous dit : voici comment nous allons livrer le message. (…) si je dois m'exprimer, par exemple, sur la crise des médias, personne ne me dira comment procéder. » Ce sont ici les paroles de Catherine Dorion publiées dans le numéro 82 d'À bâbord ! en janvier 2020, c'est-à-dire les mots d'une nouvelle députée de Québec Solidaire (QS) pour qui tout semblait possible, y compris mener une stratégie populiste de gauche. Quatre ans plus tard, le moins que l'on puisse affirmer, une fois terminée la lecture des Têtes brûlées, c'est que, d'une part, le fonctionnement de QS semble avoir changé au fil des dernières années et que, depuis, Dorion a déchanté non seulement sur la vie parlementaire, mais à l'égard de QS lui-même, notamment dans sa manière d'envisager ses relations avec les mouvements sociaux.
En fait, outre le livre de Lise Payette écrit il y a quelques décennies (Le pouvoir ? Connais pas !), rarissimes sont les témoignages de la qualité de ces « carnets d'espoir punk » relatant les coulisses du pouvoir (avec un petit « p »). Carnets qui font réfléchir et que je vous invite à lire sans aucune hésitation, et ce, pour deux grandes raisons.
Primo, l'autrice décrit très bien le malaise ressenti par nombre de sympathisant·es de QS qui, à force de vouloir se montrer respectable, devient aussi beige que n'importe quel autre parti. On dira que c'est ici moins l'affaire de personnalités que de contraintes structurelles-organisationnelles auxquelles doit s'astreindre un parti politique dont les récents succès électoraux ont aiguisé l'appétit du pouvoir. Pourtant, ces carnets nous rappellent que cela n'est pas une fatalité, mais relève bel et bien d'un choix politique, fort discutable au demeurant. Aussi, l'ex-députée de Taschereau ne manque pas d'identifier de nombreuses occasions ratées de la gauche (que ce soit en Grèce ou au Québec) et suggère de réfléchir à la pertinence d'un populisme de gauche qui tenterait de déjouer les attentes de la sphère politico-médiatique obsédée par le ronron des actualités évanescentes ou par le conformisme (vestimentaires, entre autres) des femmes en politique.
Deuxio, Dorion a l'intelligence de lier le singulier au collectif d'une admirable façon. Dans une mise en abyme quasi parfaite, elle démontre le caractère anxiogène, épuisant et dépressif de notre culture en alliant raison et émotion, et ce, dans une langue accessible qui rejette les codes classistes de la politique institutionnelle. On y trouve donc une belle critique du capitalisme dans ses effets atomisants et pathologiques. De là découle sa conception (romantique diront certain·es) de la politique comme médiation créatrice de liens sociaux.
Au cours de l'entretien cité ci-dessus, Dorion avançait que son parti ne devait pas devenir un parti de politicien·nes et parlait déjà de son « passage » en politique comme une opportunité de « briser quelques murs ». Force est de constater que ces derniers étaient plus solides qu'elle le croyait.
L’enjeu à QS n’est ni la prise du « pouvoir » ni l’unité du parti
Aujourd'hui s'ouvre à Saguenay le Conseil national (CN) de Québec solidaire dont l'enjeu n'est ni la volonté de conquérir la majorité parlementaire — le « pouvoir » est à Washington, New-York, Toronto, Ottawa, quelque peu à Montréal mais si peu à Québec — ni la remise en cause de l'unité du parti. Ce discours est une marotte de l'aile parlementaire pour faire peur au monde et pour faire rentrer dans le rang la dissidence toutes tendances confondues. L'enjeu est à la fois l'intensité gauche de la politique du parti et le degré de démocratisation de son organisation étant entendu la corrélation positive entre les deux.
L'aile parlementaire, par la prise de position tonitruante de Gabriel Nadeau-Dubois (GND) pour un « parti de gouvernement » avec à l'avenant « une refonte complète de son programme » et « la structure du parti "plus efficace, moins lourde et plus simple" », avait marginalisé le malaise féministe révélé au grand jour par la démission de la porte-parole à une affaire de « damage control ». Par le même moyen, elle a réitéré cette semaine le même discours sur un mode à la fois plus compatissant et plus concret. Il faut savoir gré à la nouvelle porte-parole, à deux jours du CN, d'avoir explicité très au ras du sol ce que signifie gouverner selon un programme plus efficace soit se réjouir que la CAQ propose une loi allant au-delà de ce que l'aile parlementaire avait demandé depuis belle lurette.
Il ne s'agit pas ici de s'opposer aux réformes absolument nécessaires pour immédiatement soulager les souffrances populaires mais, dixit l'ancien porteparole Amir Khadir, à la politique des « mesurettes ». Cette petite politique au gré de la conjoncture réduit la politique de gauche à une affaire de pression sur le parti au pouvoir ce qui a pour effet de confondre l'électorat sur son caractère carrément capitaliste et fier de l'être. On attendrait de l'aile parlementaire, toujours au gré de la conjoncture, un discours de politique alternative pour une augmentation du salaire minimum au niveau du revenu viable de l'IRIS, une indexation des salaires au coût de la vie, un blocage des prix de biens de première nécessité dont l'électricité de base, un gel des prix des loyers et en contrepartie la construction de logements sociaux répondant à la demande tout comme pour les places en CPE, l'imposition des surprofits et la hausse des taux marginaux sur le revenu à ce qu'ils étaient à l'ère des « trente glorieuses », un tournant vers le transport en commun gratuit se substituant à l'auto solo et non s'y ajoutant, une rénovation écoénergétique de tous les bâtiments et un tournant vers l'agrobiologie et l'alimentation végétarienne.
Pour l'aile parlementaire, la politique des « mesurettes » terre à terre… et acceptable à la droite est « fai[re] de la politique de la manière que je crois la meilleure. » L'aile parlementaire se targue de « collaborer efficacement avec les mouvements sociaux » ce dont je ne doute pas. Quoique le parti est resté bien discret à propos de la dénonciation de la loi 51, un recul drastique pour les syndicats de la construction. Cependant, s'ajuste-elle à des mouvements sociaux battus en brèche depuis plus d'une génération, qui osent à peine revendiquer des réformettes ou s'élève-t-elle au niveau des réformes historiques du sommet combatif des années 60-70 ? Que la plate-forme électorale de 2022 ait lâché la revendication historique du FRAPRU réclamant la construction de 50 000 logements sociaux (écoénergétiques ?) sur 5 ans en dit long. Affirmer que « notre approche des urnes et de la rue nous permet de développer des propositions qui répondent aux besoins des personnes qu'on représente » est plutôt une démonstration d'une coupure par rapport à la réalité populaire. Parler de « gains véritables » est encore plus décroché.
Mais est-ce vraiment les besoins et revendications des mouvements sociaux qui guident la politique de l'aile parlementaire ? Une phrase-clef de la dernière lettre aux membres de la porte-parole révèle le pot aux roses : « Nous avons conclu il y a quelques semaines un exercice de tournée des régions où des centaines d'acteurs institutionnels, industriels et des mouvements sociaux nous ont partagé leurs craintes et leurs souhaits pour leurs régions ». Notez l'ordre de préséance. Amen.
Marc Bonhomme, 24 mai 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Des investissements miniers canadiens liés à des violations des droits de l’homme aux Philippines
La démocratie sous attaque ? Le projet de loi 57 sous la loupe
La démocratie sous attaque ? Le projet de loi 57 sous la loupe Ligue des droits et libertés
Documentaire Colère citoyenne : Détournement de l'acceptabilité sociale :
Vous avez entendu parler du projet de « Loi édictant la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal »… appelé aussi projet de loi 57 ?
Suite à une série d'évènements où des élus ont été confrontés à des situations d'intimidation, de harcèlement et de menaces, le gouvernement de la CAQ a décidé de promulguer une nouvelle loi.
Nous sommes tous conscients que les phénomènes de violences, d'intimidation et de harcèlement ont explosé particulièrement depuis l'avènement des réseaux sociaux. Vouloir endiguer ce fléau est louable, mais le projet de loi 57 soulève de sérieuses questions.
Dans le contexte actuel où le gouvernement de la CAQ met les conseils municipaux et les élus sous tension en lien avec un déferlement de projets qui sont loin de faire l'unanimité, face aux changements de règles qui privent les citoyens de BAPE, du recul démocratique qui s'accentue dans toutes les sphères sociales depuis plus de 2 décennies et dont le système public de santé a été particulièrement l'une des victimes, face à la privatisation des institutions publiques, dont Hydro-Québec qui participe à la dépossession de la population, face à la transition écologique et aux choix économiques que fait le gouvernement caquiste sans consulter la population mais qui, au contraire, privilégie des entreprises, une partie de la population réalise que ce n'est rien de moins que sa propre démocratie qui est sous attaque.
Est-ce que le projet de loi 57 ne devient pas une arme qui porte atteinte de manière injustifiée à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique dans une société libre et démocratique ? Nous allons discuter avec Jacques Benoit de ces enjeux qui sont à la base de notre démocratie.
Visionnez le PressMob du 23 mai 2024
BON VISIONNEMENT !
Pour accéder au site de GMob, cliquez ICI.
Pour accéder à la page Facebook de GMob, cliquez ICI.
Pour accéder à la page Facebook de la DUC, cliquez ICI.
Pour accéder à la chaîne Youtube du Bulletin PressMob, cliquez ICI.
Si vous désirez ne plus recevoir notre BULLETIN PressMob, écrivez-nous ICI.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Livre Défendre le logement - Nos foyers, leurs profits | À paraître le 4 juin

La crise du logement n'est pas une anomalie temporaire. C'est l'état normal du marché immobilier dans notre système économique.
L'essai Défendre le logement - Nos foyers, leurs profits, du sociologue David Madden et de l'urbaniste Peter Marcuse, va paraître en librairie le 4 juin.
En bref : Selon l'urbaniste Peter Marcuse et le sociologue David Madden, cela fait cent ans qu'il y a une « crise » du logement, notamment pour les plus vulnérables. Il s'agit d'une conséquence logique et prévisible de notre système économique. Voici un ouvrage majeur sur le processus de marchandisation du logement et la nécessité d'une réappropriation radicale des espaces, au-delà des solutions technocratiques et de la reconnaissance symbolique d'un droit...
À propos du livre
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la crise du logement n'est pas causée par le manque d'unités locatives, des taux d'intérêt élevés ou une conjoncture économique défavorable. Selon l'urbaniste Peter Marcuse et le sociologue David Madden, c'est l'état normal – voire optimal – du marché immobilier en régime capitaliste. Cela fait cent ans qu'il y a une « crise », notamment pour les plus vulnérables. Il s'agit d'une conséquence logique et prévisible de notre système économique : « [...] l'habitation n'est pas produite et répartie afin de fournir un toit à chacun, mais comme une marchandise destinée à enrichir une minorité. »
Défendre le logement nous plonge dans un conflit opposant deux conceptions du logement. D'un côté, on le considère – à juste titre – comme un droit fondamental, un foyer défini par sa valeur d'usage ; de l'autre, il devient sans problème un privilège, un bien immobilier qui possède d'abord et avant tout une valeur d'échange. Cet ouvrage essentiel met ainsi le doigt sur les processus de marchandisation du logement qui, au cours des dernières années, ont atteint des sommets inégalés, notamment avec l'essor des plateformes comme Airbnb et l'utilisation de l'immobilier comme instrument d'accumulation financière. Une situation qui ne fait que creuser les inégalités dans la ville : quand le profit prend le pas sur le droit de se loger, les loyers augmentent, leur qualité diminue et les communautés sont confrontées à la violence des expulsions, de la gentrification, de la stigmatisation et de la honte. Voilà ce que Madden et Marcuse nomment l'aliénation résidentielle.
Essai incontournable pour comprendre les causes et conséquences du problème du logement, il fait aussi le point sur les solutions progressistes et montre combien cet enjeu ne peut être résolu par des solutions technocratiques : meilleures technologies de construction, aménagement plus intelligent du territoire, nouvelles techniques de gestion, accès facilité à la propriété... Parfois utiles, ces changements ne suffiront jamais. La crise du logement a des racines politiques et économiques profondes et nécessite une réponse radicale de réappropriation des espaces, une réponse qui dépasse la reconnaissance symbolique d'un droit. Le logement est d'abord politique.
À propos des auteurs
David Madden est professeur assistant au département de sociologie et au programme des villes de la London School of Economics. Auteur de nombreux ouvrages, Peter Marcuse (1928-2022) était professeur émérite en urbanisme à la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de l'Université Columbia. Tous deux ont été publiés dans de nombreux journaux et magazines.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soirée 20e anniversaire / 100 numéros

Venez célébrer avec nous les 20 ans et le 100e numéro de la revue À bâbord !
Entrée gratuite.
L'événement se déroule à La Cabane, fabrique familiale. Il s'agit d'un espace ludique et sympathique situé à 5 minutes du métro Fabre.
Au menu : Prises de paroles de membres du collectif ainsi que de contributeurs-rices, présentation du numéro 100, kiosques de vente de numéros provenant de différents médias, prestation humoristique avec Charlie Morin et ... party !
Grignotines ainsi que breuvages alcoolisés et non-alcoolisés en vente sur place.
L'espace est accessible (entrée et toilette).
L'événement Mobilizon est ici. L'événement Facebook est ici.

Quelques leçons féministes marxistes pour penser l’intelligence artificielle autrement

Dès le début, les féministes marxistes qui voulaient une émancipation féministe et antiraciste se sont heurtées aux limites que représentaient les contre-propositions socialistes au régime capitaliste. Plus tard, elles ont aussi dû considérer des courants anti-technologiques qui tendaient à essentialiser le lien des femmes à la nature. Ces réflexions se sont consolidées dans le courant théorique de la reproduction sociale. Dans le présent texte, je reviens sur certains des travaux qui en sont issus afin d’envisager d’autres voies aux technologies d’intelligence artificielle (IA) qui dévalorisent le travail reproductif. Ils permettent de critiquer simultanément le rôle des technologies dans la précarisation des activités de soin tout en ne masquant pas les insuccès de leur contrôle par l’État. J’illustrerai ces avenues à partir des propositions que j’ai formulées dans le cadre d’une étude publiée par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) qui explorait les conditions de production de l’IA dans le secteur de la santé[1]. J’envisagerai de quelle manière, en se référant aux théories de la reproduction sociale, on pourrait penser et produire des innovations respectant les objectifs de réduction des inégalités en santé dans le réseau public.
Le numérique comme vecteur de marchandisation
Dès les années 1970, les théories de la reproduction sociale ont traité de l’organisation du travail en usine, de la bombe atomique et même des ordinateurs. Plus récemment, les travaux sur les biotechnologies ont ramené cet horizon théorique à l’avant-plan. Dans son plus récent ouvrage, Silvia Federici, figure de proue de ce courant, offre une courte réflexion sur les nouvelles technologies numériques et les robots de soins. Elle affirme : « Les techniques – et plus particulièrement les techniques de communication – jouent incontestablement un rôle dans l’organisation des tâches domestiques et constituent aujourd’hui un élément essentiel de notre vie quotidienne[2] ». À l’image d’autres marxistes avant elle, Federici voit les technologies de communication comme des moyens de production, à la différence qu’elles s’intègrent directement dans l’organisation du travail reproductif. Celui-ci est considéré comme l’envers du travail productif. Sa dévalorisation systématique est l’une des clés de voûte de l’organisation de l’exploitation capitaliste. Il comprend des activités comme préparer les repas, s’occuper des personnes vulnérables ou assurer le maintien des relations affectives. Pour Federici, les technologies de communication sont des outils de travail parce qu’elles sont mobilisées dans le cadre de ces activités économiques essentielles de reproduction matérielle et sociale de la vie humaine même si elles sont souvent peu ou pas rémunérées.
Sarah Sharma, une autrice qui s’intéresse aux enjeux de genre et de race liés à la valorisation du temps, accorde elle aussi un rôle économique au numérique dans le cadre du travail reproductif. Dans un essai sur l’économie de plateforme[3], elle s’attarde à TaskRabbit, une application mobile qui organise très précisément la vie quotidienne. Celle-ci permet de déléguer l’exécution de certaines tâches ordinaires à des inconnu·e·s, moyennant rémunération. Les utilisateurs/employeurs affichent en ligne de menus travaux à faire comme aller chercher un objet acheté sur la plateforme d’échange MarketPlace, promener le chien ou aller nettoyer les planchers avant une réception. Historiquement, ce type de travail a été inégalement réparti au sein des ménages. Il tend désormais à être externalisé vers des personnes socioéconomiquement précaires qui sont, de manière croissante, des personnes racisées. Grâce à des technologies de communication comme TaskRabbit, certains groupes favorisés se délestent de l’ennui et du stress qui accompagnent la réalisation de tâches socialement dévalorisées. Ils en profitent pour vivre, selon les mots utilisés par la compagnie, « la vie qu’ils devraient vivre » :
TaskRabbit accomplit le travail, mais vous sauve aussi d’une dépendance envers autrui en dehors d’un échange économique. L’application vous met en relation avec des groupes de personnes pour qui le travail domestique n’est pas si ennuyant[4].
Ils laissent à d’autres cette vie à ne pas vivre. Dans des cas de ce type, les technologies participent à la marchandisation des tâches reproductives. Elles remplacent la figure de la ménagère par celle du tâcheron enthousiaste et flexible. La pensée de la reproduction sociale sur les technologies ne s’arrête cependant pas à leur capacité d’externalisation du travail reproductif.
Données, logique productive et économie spéculative
Les années 1990 ont été marquées par l’implantation de techniques visant à quantifier et à mesurer le travail d’exécution des soins de santé. Ce faisant, ce type de tâche reliée à la sphère reproductive devait respecter une logique productive qui implique de pouvoir calculer le plus précisément possible le rapport entre les intrants et les extrants du processus de production. Dans le cas des services publics, l’objectif consiste à augmenter l’efficience de la production. La manifestation la plus concrète de cette vision a probablement été le déploiement des méthodes de la nouvelle gestion publique, désormais appuyées par des technologies capables de capter et d’analyser des quantités monstrueuses de données. Cette quantification extrême des données est portée par le fantasme de surmonter l’improductivité d’activités comme le soin des personnes en rationalisant leur caractère intuitif et affectif. Encore aujourd’hui, la volonté de quantifier le produit des soins persiste, mais demeure un défi inachevé.
Pourtant, cette ambition n’est pas nouvelle. Dès les années 1970, les théoriciennes féministes ont examiné cette volonté de rationalisation du reproductif. Elles ont élaboré leur critique à partir du concept d’« usinification » de la reproduction. Alors que l’usine est associée à la domination d’intérêts marchands, la critique de l’usinification de la reproduction formulée par Nicole Cox et Silvia Federici[5] ne porte pas sur la privatisation de la reproduction, au contraire. Elle vise directement l’étatisation de certains services jusqu’alors offerts par les femmes. En effet, l’État est l’acteur central de la « mise en usine » de la reproduction. Dans la pensée socialiste de l’époque, la production industrielle, une fois retirée du contrôle bourgeois, représente un progrès. Après tout, elle résulte d’une collectivisation des moyens de production. La coopération dans le processus de travail augmente l’efficacité et réduit la quantité de travail socialement nécessaire pour assurer la survie des humains. La machine matérialise l’espoir de la fin du labeur physique dur et répétitif. Qui ou quoi exécute la tâche n’a réellement d’importance. Qu’il soit atteint par une machine ou par un humain, le résultat est le même. Dans la pensée socialiste, la même logique peut s’appliquer à toutes les tâches, dont les tâches reproductives.
La robotisation de certaines tâches ménagères n’est pas complètement loufoque. Le lave-vaisselle en est bien la preuve. Cependant, la robotisation de certaines tâches domestiques parait absurde pour celles qui les exécutent. Comment mécaniser « l’action de donner le bain à un enfant, de le câliner, de le consoler, de l’habiller et de lui donner à manger, de fournir des services sexuels ou d’aider les malades et les personnes âgées dépendantes[6]? » demande Federici. Pour elle, non seulement la mécanisation de ce travail de nature relationnelle est peu probable, mais elle ne représente pas un horizon post-capitaliste désirable. En effet, la collectivisation et la rationalisation de la reproduction signifient de soumettre davantage ce travail aux pressions de la performance mesurable. L’usinification du travail reproductif signifie qu’il se plie à une vision machinique du travail qui évacue la spécificité des tâches reproductives pour faire dominer la mesure et l’efficacité.
Pour les féministes de la reproduction, la collectivisation du travail reproductif par l’État n’a jamais constitué une voie d’émancipation. Dans la pensée socialiste, le travail reproductif est rétrograde et obsolète, ce qui constitue un problème majeur. Son étatisation a pour objectif de contrer son inefficacité, sans tenir compte de ses qualités non productives. En cela, ces théoriciennes se sont distinguées très tôt des autres marxistes : la répartition de la richesse ne constitue pas le problème fondamental du capitalisme. Pour éliminer les formes de domination imposées par le capitalisme, il faut selon elles abolir son mode de fonctionnement qui dévalue fondamentalement tout ce qui ne se plie pas à la rationalité productive. Cette vision industrielle des soins a aussi été appliquée dans des pays non socialistes. C’est le cas par exemple des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) qui représentent désormais l’antithèse d’un lieu de vie épanouissant pour les personnes âgées et dont le modèle s’est révélé absurde durant la pandémie de COVID-19.
Les expériences japonaises d’intégration de robots pour les soins aux ainés démontrent que pour assumer les coûts élevés d’acquisition, les établissements de soins doivent être de grande taille et très standardisés[7]. Le travail humain, lui, ne diminue pas, mais il devient plus routinier. Si l’avenir politique des soins est celui des robots et d’une intelligence artificielle pensée comme pour une usine, cet avenir sera celui de mégastructures industrielles de soins. L’intégration actuelle des machines respecte la logique productive appliquée à l’organisation des soins. Si cette logique continue de dominer la façon de penser et d’intégrer l’IA, cette technologie dévalorisera les activités reproductives, qu’elles soient soumises à l’échange marchand ou qu’elles soient produites par l’État.
Valorisation des savoirs reproductifs
Avec le développement de l’intelligence artificielle, on peut constater une modification du rapport entre sphère productive et sphère reproductive. La tendance historique vise à dépasser l’improductivité du champ reproductif, soit en intégrant ses activités dans le circuit marchand, soit en les rationalisant de façon à les plier à la logique de production. Désormais, ces tentatives sont exacerbées par l’émergence d’une industrie des données ancrée dans une économie spéculative. Des entreprises comme TaskRabbit ne font pas qu’offrir des services. Leur modèle d’affaires repose en majeure partie sur la promesse de revenus futurs décuplés. Elles doivent croitre rapidement afin d’attirer l’attention d’une masse critique d’investisseurs. Elles seront ensuite acquises par une plus grande corporation ou, plus rarement, elles feront leur entrée sur le marché boursier. Par exemple, après avoir récolté près de 50 millions de dollars d’investissements privés en six ans, TaskRabbit a été rachetée par IKEA. L’entreprise offre désormais des services d’assemblage de ses meubles vendus en pièces détachées sans avoir à s’encombrer de la responsabilité d’être un employeur. Alors que le travail industriel de montage a été délocalisé à l’intérieur des foyers individuels pour être accompli gratuitement, celui-ci redevient rémunéré, mais très précaire.
Dans le secteur de la santé, un champ d’activités plus près de la sphère de la reproduction que le montage de mobilier, j’ai pu observer un foisonnement de nouvelles entreprises qui profitent d’un accès privilégié aux institutions publiques de santé pour commercialiser des technologies d’IA destinées au marché international. Le système public de santé sert de terrain de mise au point et d’expérimentation de produits. Cette exploitation des activités de soins outrepasse leurs limites productives en ne cherchant pas à agir directement sur elles. Or, bien qu’elles ne participent pas de prime abord à marchandiser ou à « usinifier » les soins, ces technologies pourraient avoir une incidence sur leur orientation. Déjà, on voit un accroissement des approches médicales axées sur les traitements complexes et invasifs. On observe une adéquation entre le développement de l’IA et les priorités des géants pharmaceutiques. Les ressources sont orientées vers la production de technologies hyperspécialisées en oncologie ou en génétique. Pourtant, la recherche montre que des politiques orientées vers des investissements massifs dans des traitements curatifs sont inefficaces du point de vue de la santé publique. Des actions préventives axées sur l’environnement ou le logement le sont significativement plus. C’est une vision de l’efficacité que ceux qui sont à l’origine des initiatives en IA en santé ne partagent pas.
Mesurer sobrement
Serait-il possible d’intégrer des technologies comme l’IA dans l’organisation des soins de santé sans procéder à une hyperrationalisation congruente à la logique de la sphère productive ? Une posture prudente reste de mise face à ces technologies qui quantifient, mesurent, analysent et dirigent la prise de décision de façon schématique. Cela est d’autant plus vrai qu’actuellement les structures organisationnelles complexes et hiérarchiques des régimes publics se révèlent avides de données. Elles exercent aussi une surveillance accrue des travailleuses et des travailleurs. Sachant que l’accumulation des dispositifs alourdit le travail et entraine toujours des résistances qui peuvent se solder par du désistement face à la perte du sens au quotidien, les technologies doivent éviter d’attiser une soif insatiable de données quantitatives.
Par ailleurs, une collecte extensive de données pourrait aussi nuire à la relation de soins, en particulier celle avec des personnes qui vivent des situations de marginalité ou qui sont criminalisées. Pour ces dernières, la relation interpersonnelle de confiance est fondée sur la confidentialité. Au printemps 2023, une nouvelle loi a été adoptée pour favoriser la circulation des données des patientes et patients du Québec. Plusieurs ordres professionnels ont publiquement dénoncé de nombreuses dispositions qui mettent à mal le secret professionnel. Ceux-ci craignent que certains patients puissent refuser des soins ou évitent de livrer les informations essentielles à une intervention professionnelle réussie par peur de s’exposer à d’autres regards.
Des principes de sobriété technologique et de sobriété quant à la quantité de données constituent des priorités pour éviter une approche surrationalisante, prête à tout pour réduire les actes reproductifs à des entités comparables. Cette sobriété permettrait de freiner les ambitions économiques qui accompagnent la montée de la production de données depuis déjà plus de 10 ans.
Pour un autre contrôle des outils
Rejeter en bloc l’adoption de technologies ou de savoirs contemporains soulève néanmoins deux problèmes majeurs. D’abord, cette posture est façonnée par le déterminisme technologique. Elle ne prend pas en compte le fait que l’usage d’une même technologie peut varier selon les intérêts qui contrôlent sa production ou ses infrastructures. Ensuite, une opposition catégorique participe à la naturalisation du travail reproductif. L’anthropologue féministe marxiste Paola Tabet soutient que la dévalorisation du travail des femmes, et la dévalorisation des femmes elles-mêmes, se sont construites par le contrôle masculin des outils techniques spécialisés[8]. En ne pouvant pas créer les outils performants par et pour elles-mêmes, elles ont été astreintes à des tâches inutilement harassantes. Ce faisant, certains travaux considérés comme typiquement féminins ont aussi été connotés comme plus naturels. Exclure des technologies sous prétexte qu’elles ne respecteraient pas l’essence de la sphère reproductive perpétuerait la division sexuelle du travail par les outils.
Ainsi, il faut faire le pari que l’IA n’est pas foncièrement en opposition aux soins de santé, mais qu’elle ne doit pas être contrôlée par des intérêts étrangers aux soins. En sortant son développement du circuit marchand de la spéculation pour remettre la prise de décision de ses orientations dans les mains de celles et ceux qui sont au plus près des activités de soins, la production de l’IA pourrait correspondre à une conception radicalement différente.
Bientôt, les besoins en soins à domicile et la privatisation des services en cours depuis vingt ans s’accéléreront probablement. Les plateformes de type Uber centrées sur les soins à domicile risquent alors de devenir d’usage commun. Le discours promotionnel se fera autour des capacités algorithmiques de la prédiction des besoins, de l’optimisation des trajets et de l’établissement de prix concurrentiels. Malgré la demande, ce type de plateforme n’améliorera pas les conditions d’exercice du travail de soin. Pourtant, il sera quand même possible de trouver des personnes pour qui sortir un grand-père malade du lit ne sera « pas ennuyant » parce que cela lui permet de gagner sa vie. De quoi pourrait avoir l’air une telle plateforme si le contrôle de l’organisation du travail était laissé aux mains des bénéficiaires et des travailleuses et travailleurs au sein d’un système public ? Pourrait-elle, dans de bonnes conditions structurelles, soutenir une démarche de valorisation du reproductif ? Ces questions exigent des expérimentations pour y répondre. Pour que les technologies ne soient pas seulement au service de ceux et celles qui ont le luxe de « vivre la vie qu’ils devraient vivre », une réflexion profonde sur le temps de travail et le rapport aux tâches relationnelles s’imposera inévitablement.
Par Myriam Lavoie-Moore, chercheuse à l’IRIS et professeure adjointe à l’École de communications sociales de l’Université Saint-Paul
- Myriam Lavoie-Moore, Portrait de l’intelligence artificielle en santé au Québec. Propositions pour un modèle d’innovation au profit des services et des soins de santé publics, Montréal, IRIS, 2023. ↑
- Silvia Federici, Réenchanter le monde. Le féminisme et la politique des communs, Genève/Paris, Entremonde, 2022, p. 258. ↑
- Sarah Sharma, « TaskRabbit : the gig economy and finding time to care less », dans Jeremy Wade Morris et Sarah Murray (dir.), Appified. Culture in the Age of Apps, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2018. ↑
- Ibid.p. 64. Ma traduction. ↑
- Nicole Fox et Silvia Federici, Counter-Planning from the Kitchen : Wages for Housework, a Perspective on Capital and the Left, New York, New York Wages for Housework Committee et Bristol, Falling Wall Press, 1975. ↑
- Silvia Federici, Le capitalisme patriarcal, Paris, La Fabrique, 2019, p. 94. ↑
- James Wright, « Inside Japan’s long experiment in automating elder care », MIT Technology Review, 9 janvier 2023. ↑
- Paola Tabet, Les doigts coupés. Une anthropologie féministe, Paris, La Dispute, 2018. ↑
L’ascension d’un nouveau paradigme économique : le cybersocialisme
FS Maghreb-Machrek sur la Palestine : Sumud (tenir bon en arabe)
Des dirigeants américains et philippins coupables de crimes de guerre, selon Tribunal des Peuples

UQAM - Solidarité avec la Palestine : le droit de réunion pacifique en question

Le 22 mai 2024, le recteur de l'UQAM a déposé une requête en émission d'une ordonnance d'injonction pour demander le démantèlement, au moins partiellement, des quelques quarante tentes installées dans une cour intérieure de l'UQAM, presque invisible de la rue, par des organisations étudiantes et militantes en solidarité avec le peuple Palestinien.
Pour justifier ce recours juridique engagé avec des fonds publics, qui porte atteinte à la liberté d'expression et au droit de réunion en solidarité avec un peuple qui fait face à un « risque plausible » de violation du droit à être protégé d'un génocide, selon la Cour internationale de justice, le recteur invoque les atteintes au droit de propriété de l'UQAM, la sécurité des membres de la communauté universitaire et des dommages. Outre l'occupation du terrain de l'UQAM, des issues de secours seraient bloquées, des rallonges électriques constitueraient des risques « de surcharge du réseau électrique », des bidons d'essence et des barres de fer auraient été aperçus et menaceraient la sécurité des « occupants » et de la communauté universitaire.
Tels sont, avec des graffitis, les principaux éléments factuels avancés en vertu desquels,
après la très violente charge menée par la police de la ville de Montréal lundi 20 mai 2024, il y aurait urgence à agir du point de vue de l'administration universitaire.
Constatant que l'administration uqamienne n'a pas été en mesure de mentionner un seul acte de violence, un seul propos antisémite, raciste ou haineux dans sa requête, il nous semble urgent et important de rappeler quelques normes minimales fixées par le droit international et qui s'imposent à tous et toutes avant de vouloir imposer des restrictions au droit de réunion pacifique, « le parent pauvre du domaine des libertés fondamentales garanties », pour reprendre une formule mobilisée par la Juge Marie-France Bich de la Cour d'appel du Québec.
Concernant les atteintes au droit de propriété de l'UQAM, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a récemment rappelé que les rassemblements dans les espaces privés, en Chine, au Mali, comme au Québec, sont protégés par le droit de réunion pacifique et qu'avant d'imposer des restrictions, il convient de prendre « dûment en compte » les intérêts des autres personnes ayant des droits sur la propriété, comme ceux des membres de la communauté universitaire. Or, sur ce point, la « communauté uqamienne », via des dizaines de résolutions souvent adoptées à l'unanimité, a fait part de son intérêt à afficher ouvertement sa solidarité avec le peuple Palestinien et son engagement en faveur d'un cessez-le-feu. Des restrictions au droit de réunion sont toujours possibles mais celles-ci dépendent notamment de « considérations telles que le fait que l'espace soit ou non habituellement accessible au public, la nature et l'ampleur des perturbations ». Ici on évoque principalement des rallonges électriques, des graffitis et quelques portes barrées dans un espace « habituellement accessible au public ».
"L'interdiction d'une réunion ne peut être envisagée qu'en dernier ressort". Comité des droits de l'homme des Nations unies, 2020, para.37.
Concernant la protection de la santé des « occupants » et des membres de la communauté universitaire, une préoccupation urgente fort louable du patronat et que n'oublieront pas les employé·es victimes de maladies professionnelles ou les étudiant·es en dépression, des restrictions sont également possibles mais au nom de la santé publique et « exceptionnellement » ou « dans des cas extrêmes ». Si quelques rallonges électriques ou portes bloquées constituent un « cas extrême » qui justifierait une interdiction de rassemblement, on peut dire adieu au droit de manifester.
Enfin, concernant les actes de « vandalisme » (comme les graffitis mentionnés dans la requête), cela ne constitue pas en soi un motif légitime pour interdire le droit de réunion pacifique. Si des méfaits voire même des voies de fait sont commis, il appartient au service de sécurité et à la police d'intervenir et d'identifier les responsables, individuellement. Les restrictions au droit de réunion pacifique doivent quant à elles être « nécessaires », « proportionnées », « les moins intrusives » possible et elles ne doivent pas « porter atteinte à l'essence du droit visé » ou avoir « pour but de décourager la participation à des réunions ni avoir un effet dissuasif ».
Que s'agit-il donc de faire en judiciarisant le conflit, en sanctionnant de manière indiscriminée tout un collectif et en demandant l'interdiction ou le strict encadrement d'une réunion pacifique pour des motifs aussi légers que ceux portés dans cette requête, si ce n'est de décourager ou de dissuader d'afficher sa solidarité avec le peuple palestinien sur le campus universitaire ?
Martin Gallié
Le 23 mai 2024.
Les BRICS+ ne seront pas l’alternative à l’hégémonie américaine
Le génocide oublié de la République démocratique du Congo
Je slame, tu slames, nous slamons

Regards critiques sur l’incarcération

[caption id="attachment_19730" align="alignleft" width="336"] Artiste : Eve[/caption]
Artiste : Eve[/caption]
La Ligue des droits et libertés consacre son nouveau numéro de Droits et libertés aux enjeux liés à l'incarcération au Québec.
Disponible dès juin 2024, ce numéro rassemble des perspectives critiques sur plusieurs facettes de l'incarcération à travers unevingtaine d'articles.
Page après page, le fil des logiques carcérales se déroule. Ces logiques ont beau constituer la norme, elles révèlent leurs noeuds et leurs failles en matière de réparation envers les victimes, de réinsertion sociale, de dissuasion et de la diminution de la violence. L'incarcération produit et reproduit des violations de droits, de la détresse et des discriminations que les réformes du système carcéral ne peuvent pas enrayer.
Dans bien des cas, le recours à l'enfermement est une réponse punitive et restrictive de liberté à des enjeux sociaux, résultat d'un désengagement de l'État quant à ses obligations en matière de droits économiques et sociaux. Le dossier se termine en dégageant de nouvelles avenues, plaçant les victimes d'actes criminels au coeur de la justice transformatrice.
Bonne lecture!
Consulter la table des matières
Procurez-vous la revue Droits et libertés!
- Devenez membre de la LDL pour recevoir deux numéros de Droits et libertés par année!
- Numérique (PDF) : 8 $
- Imprimée incluant livraison* : 11 $ incluant les frais de poste
- Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.
* Les articles sont mis en ligne de façon régulière. *
Dans ce numéro
Éditorial
Les services publics et les droits humains : deux faces d'une même médailleAlexandre Petitclerc
Chroniques
Ailleurs dans le monde
La Palestine, un test pour l'humanitéZahia El-Masri
Un monde sous surveillance
Un trio législatif… accommodant pour l'industrieAnne Pineau
Le monde de l'environnement
Fonderie Horne : une allégorie de l'opacitéLaurence Guénette
Un monde de lecture
Un autre soi-mêmeCatherine Guindon
Dossier principal
** Des articles du dossier seront ajoutés au site Web à chaque semaine jusqu'au 30 septembre 2024. **REGARDS CRITIQUES SUR L'INCARCÉRATION
Présentation
Dérouler le fil des logiques carcéralesDelphine Gauthier-Boiteau
Aurélie Lanctôt Un portrait de la population carcérale
Aurélie Lanctôt
Violations de droits
Rien ne change pour les femmes incarcéréesJoane Martel Prison et déficience intellectuelle, ça ne va pas!
Samuel Ragot
Guillaume Ouellet
Jean-François Rancourt Portes tournantes : une spirale sans fin
Philippe Miquel Quand la prison fait mourir
Catherine Chesnay
Mathilde Chabot-Martin Être en prison dans une prison
Lynda Khelil
Me Nadia Golmier Contre vents et marées : liens avec un proche incarcéré
Sophie Maury Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité
Daniel Poulin-Gallant Le politique, le Code criminel et la prison
Jean Claude Bernheim
D'autres formes d'enfermement
La prison, l'antichambre de la déportationPropos recueillis par Laurence Lallier-Roussin L'enfermement en centre jeunesse
Ursy Ledrich Pinel : Les cas complexes crient au secours !
Jean-François Plouffe
Remise en question de l'incarcération
La prison comme institution colonialeEntretien avec Cyndy Wylde
Propos recueillis par Alexia Leclerc Qu'en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes?
Entretien avec Marlihan Lopez
Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau Nouvelles prisons, mêmes enjeux?
Mathilde Chabot-Martin
Karl Beaulieu Courtes peines ou recours excessif à l'incarcération
Jean Claude Bernheim Comparutions virtuelles, droits virtuels ?
Me Khalid M'Seffar
Me Nicolas Lemelin
Me Ludovick Whear-Charrette Coup d'oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke
Entrevue avec Dale Dione
Propos recueillis par Nelly Marcoux Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral
Entretien avec Marlihan Lopez
Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau La justice transformatrice, s'organiser pour guérir
Propos recueillis par Laurence Lallier-Roussin
Reproduction de la revue
L'objectif premier de la revue Droits et libertés est d'alimenter la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Ainsi, la reproduction totale ou partielle de la revue est non seulement permise, mais encouragée, à condition de mentionner la source.
Procurez-vous la revue Droits et libertés!
- Devenez membre de la LDL pour recevoir deux numéros de Droits et libertés par année!
- Numérique (PDF) : 8 $
- Imprimée incluant livraison* : 11 $ incluant les frais de poste
- Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.
L’article Regards critiques sur l’incarcération est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Pour gouverner autrement ... agir autrement et construire dans l’unité !

Amir Khadir, Carol-Ann Kack, Marie-Ève Mathieu, François Saillant, Amira Bouacida, Karine Clliche, Pierre Mouterde, Solène Tanguay, Pierre Dostie et Roger Rashi
Nous sommes des militantes et militants de QS et avons suivi avec inquiétude le déroulement de la crise que traverse actuellement le parti, plus particulièrement depuis le départ d'Émilise Lessard- Therrien.
Dans les semaines et mois à venir bien des défis se dressent devant nous et les décisions du Conseil national de QS qui se déroulera cette fin de semaine au Saguenay auront une incidence décisive sur notre capacité à surmonter les difficultés.
La plupart d'entre nous sommes impliqué-es depuis longtemps dans des tâches organisationnelles ou de direction du parti. D'autres ont été membres fondateurs-trices d'Option citoyenne, de l'UFP puis de QS, ou encore sont de jeunes militant·e·s, féministes, écologistes, étudiant·e·s, mobilisés par les volontés affirmées de changement social portées par QS. Nous avons décidé de réfléchir ensemble et agir au nom de l'unité du parti. Quelques député·e·s et membres du CCN ont accueilli notre démarche avec intérêt et ouverture.
Tous et toutes, nous nous retrouvons dans la déclaration S'unir pour gouverner autrement signée par près de 200 membres du parti et qui insiste sur la nécessité de tout à la fois préserver notre unité et renouveler notre ancrage dans les mouvements sociaux depuis une perspective féministe et démocratique. Comme la Commission nationale des femmes de QS, nous croyons qu'une « meilleure écoute des voix des militant·e·s, et en particulier des femmes, est indispensable pour sortir de cette crise et retrouver le cap des valeurs fondatrices … du parti ».
Les critiques sur le déficit dans les pratiques paritaires et de la trop grande centralisation des décisions semblent avoir été entendues ainsi les délégués au CN comptent s'y pencher avec sérieux. Mais la recherche d'une voie de passage lors de ce CN est nécessaire pour surmonter d'autres dimensions de la crise et c'est ce qui motive cet appel.
QS aspire depuis sa fondation à gouverner autrement. Pour exercer le pouvoir autrement... il faut agir autrement. Le CN est un lieu d'exercice du pouvoir à l'intérieur même de notre parti. Agir autrement comme QS aspire à le faire consiste pour nous à en faire un lieu de partage de pouvoir le plus inclusif et rassembleur possible.
C'est dans cet esprit et afin de créer une voie de passage entre des courants en apparence opposés que nous appelons les délégués à considérer les propositions d'action suivantes pour construire QS dans l'unité :
1) Lors du prochain Conseil national : replacer le débat sur la Déclaration du Saguenay dans son juste contexte
Tout en reconnaissant l'importance de la tournée régionale initiée par le parti ainsi que le travail mené en ce sens par QS pour prendre en compte les régions, nous pensons qu'il faut resituer la Déclaration du Saguenay dans son contexte et rappeler clairement la place relative qu'elle doit occuper dans notre démarche. Ce texte n'est que « la synthèse politique de la tournée des régions ». Il ne peut donc être ni « le socle », ni l'amorce d'un nouveau programme de QS. Dans une lettre aux membres des associations, la présidente de QS, Roxane Milot, a rappelé à juste titre que « ce texte ne vient nullement remettre en question les autres positions du parti ».
Nous proposons aux délégué·e·s qui se réuniront lors du prochain Conseil national :
de s'assurer que le parti réitère et souligne publiquement le fait que la déclaration du Saguenay n'a pas pour fonction de servir de point de départ à un nouveau programme pour QS ;
de prendre en compte, dans le plus large esprit démocratique possible, les nombreux amendements qui ont été proposés par les associations pour bonifier cette déclaration.
2) Au cours des prochains mois : favoriser une large discussion démocratique sur le programme
La proposition du Comité de coordination national, reprise par Gabriel Nadeau-Dubois, de ré-écrire le programme, et de le faire dans un temps extrêmement court, nous paraît dans le contexte actuel de crise que connaît QS, contre-productive. C'était là une des forces et originalités de QS et le gage d'une démarche vraiment démocratique : avoir bâti son programme politique pas à pas, en prenant le temps de réfléchir et de débattre de chacune de ses dimensions. Il est normal qu'à l'aune des transformations que connaît la société québécoise, notre programme ait besoin d'être actualisé ou ajusté de manière à mieux faire face à de nouveaux défis conjoncturels. Mais il manque encore un bilan compréhensif de ce qui pourrait être dépassé, inaccessible ou contradictoire dans le programme. Sans un tel bilan, il est hâtif de vouloir « tabletter » le programme alors qu'une mise à jour de certains passages et aspects pourrait être plus judicieux et porteur de sens.
Par ailleurs, vouloir effacer le précieux et patient travail collectif s'échelonnant sur 15 ans pour réécrire le programme à partir de zéro et le faire adopter en quatre mois alors que le parti est secoué par une crise interne d'importance, risque de bousculer notre démocratie interne et raviver quelques-uns des ingrédients se trouvant à la source des difficultés que nous connaissons. Cette approche est opposée à ce qui donne à QS sa solidité et sa force : favoriser le pluralisme de gauche en faisant place à la convergence des courants qui existe en son sein.
C'est la raison pour laquelle nous proposons dans l'immédiat au Conseil national de mai :
d'adopter une approche qui permette l'actualisation ciblée du programme de Québec solidaire sur des thèmes déterminés au préalable ;
d'adopter un échéancier revu dans le temps et des mécanismes démocratiques permettant une implication large et ouverte des instances de base du parti afin que cette actualisation puisse se faire dans un débat démocratique mené en profondeur.
3) Ouvrir le débat sur la stratégie qui devrait guider QS
Comme souhaité, la question du départ d'Émilise Lessard-Therrien a été mise à l'ordre du jour remanié du prochain conseil national pour une bonne partie de la matinée et de l'après-midi du samedi. Toutefois, le débat sur la stratégie, demandé par tant d'intervenants, brille par son absence. La déclaration du co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois sous-entend pourtant une stratégie déjà arrêtée pour la prise du pouvoir. À la vue des réactions qu'elle a suscitées, un large débat devient nécessaire pour que Québec solidaire se rassemble autour d'une stratégie claire, partagée, et pour qu'il prenne un second souffle vers le pouvoir. C'est de cette stratégie collectivement décidée que doit découler la mise à jour de notre programme, de notre plateforme électorale et de nos statuts, lesquels préciseront notamment les rapports entre l'aile parlementaire, la permanence du parti et les instances militantes, tout comme le statut et la contribution des co-porte-paroles.
Certes, il ne s'agit pas de régler cette question au prochain Conseil national, mais d'amorcer le débat, et sur la base d'une approche pleinement démocratique et orientée par des principes féministes, d'en baliser les contours, de favoriser la participation la plus large de toutes et tous les membres, et non uniquement des délégués présents aux instances nationales.
Pour ce faire, nous proposons que QS mette en place « des espaces de délibérations démocratiques ad-hoc » qui permettraient que ce débat soit mené en profondeur au sein du parti, puis débouche sur une série d'orientations stratégiques qui pourraient être discutées et votées à son congrès d'automne 2024. Dans la mesure où une révision des statuts a déjà été programmée à ce congrès, nous pensons nécessaire de faire précéder ce congrès d'événements et d'espaces délibératifs où il serait possible de discuter plus facilement et plus librement de la question stratégique. On pourrait penser à la mise sur pied « d'une école ou université d'été », permettant de lancer le débat et de bénéficier ainsi d'une série de contributions de fond. On pourrait aussi organiser « une conférence nationale ouverte » (comme on l'a fait dans le passé à propos de la question nationale) permettant d'élaborer et de mettre en débat les principales thèses en présence concernant notre stratégie future. Dans tous les cas, il s'agira en même temps de chercher l'apport des sympathisant·e·s ainsi que des divers mouvements sociaux qui partagent nos aspirations afin d'enrichir et de clarifier notre posture stratégique de fond. Le secret est là : pour trouver une voie de passage dans la crise actuelle, nous devons passer par le renforcement de nos pratiques démocratiques et féministes, par l'ouverture d'un débat large et franc auquel tous les membres du parti sont invités.
C'est seulement à ce prix que nous pourrons rester un parti de gauche pluraliste, et doté d'une stratégie clarifiée, réaliser notre objectif commun : être ce parti de gouvernement ET de transformation sociale dont le Québec a tant besoin pour faire face aux défis de notre temps.
Pour signer la pétition :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemSUz9ZDJDwXjkR63frB2JzrRqcQR1IVQSVPVXSsuvY7Tgw/viewform
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La crise à QS, la résilience et l’internationalisme

Beaucoup d'encre a coulé depuis la démission d'Émilise Lessard-Therrien comme co-porte-parole à Québec solidaire et la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois du 1er mai. QS doit viser à prendre le pouvoir et à gouverner, ça ne fait aucun doute. Toutefois, il ne peut y arriver par une stratégie d'accumulation clientéliste de votes individuels.
La prise du pouvoir, même électorale, sera d'autant plus possible qu'elle saura s'appuyer sur un mouvement social. Ce sont aussi des évidences répétées de plusieurs façons depuis un mois par différents courants. Alors que lesbruits de bottes se font entendre comme jamais sur la planète, QS ne peut faire l'économie d'une posture internationale sans équivoque dans une stratégie résiliente de prise du pouvoir, notamment en regard de l'OTAN !
Depuis, la tempête a commencé à s'apaiser, du moins devant les caméras, alors que des voix s'élèvent pour calmer le jeu et éviter les déchirements qui desserviraient la position du parti. Le consensus va probablement reconnaître qu'il y a toujours une double réalité à un parti comme Québec solidaire. Ça fait partie de la voix de passage vers l'unité souhaitée notamment par Françoise David et Amir Khadir.
Alliances occidentales et le parti de gouvernement
Dès sa fondation, Québec solidaire a affirmé qu'il était altermondialiste (voir Déclaration de principe de Québec solidaire, 2006). L'opposition des députés solidaires à l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv est exemplaire. Toutefois, l'enjeu du débat sur le programme du parti en ce qui concerne les questions internationales ne concerne ni les grands principes, ni les positions circonstancielles. Elle concerne la posture à suivre devant une géopolitique guerrière, le déclin de l'empire américain, la montée des blocs dont celui entre la Russie et la Chine et l'accroissement des dépenses militaires partout sur la planète !
Parmi ces questions, sur le plan international, il y a celle des alliances. Un Québec indépendant doit-il se retirer de l'OTAN ? Devons-nous désavouer cette alliance occidentale et devenir un pays susceptible de ne pas voter avec les État-Unis et le Canada, et pas seulement sur la question d'Israël ? Devant les sirènes de la démocratie occidentale, la posture anti-impérialiste des solidaires peut être mise à rude épreuve.
La démocratie libérale et la politique internationaliste des solidaires
Le soutien au peuple ukrainien n'est pas un appui à l'OTAN, Il relève de la reconnaissance du droit à l'autodétermination. La démocratie occidentale n'est pas le terminus de l'histoire sur la liberté d'expression et la démocratie. Notre posture internationaliste exige de s'y opposer, non pas parce qu'elle est pire qu'en Russie, il est vrai que ce n'est pas le cas, mais parce qu'elle est incapable de résoudre les problèmes de notre temps : les guerres, les inégalités, le colonialisme, le racisme, la soumission des femmes ou l'environnement. Que pouvons-nous proposer comme démocratie supérieure à la démocratie libérale ?
La singularité de la question nationale québécoise dans l'État canadien est de proposer un parcours qui rompt avec l'impérialisme. Ce projet ne saurait se suffire d'une élection de solidaires qui gèrent les affaires quotidiennes du Québec, sans entreprendre une réelle épreuve de force avec l'État fédéral et du même coup avec le modèle occidental de démocratie libérale. Le projet à long terme des solidaires est donc de proposer plus de démocratie que celle que nous avons.
Nous savons que bon nombre de problèmes ne se régleront pas dans le cadre de la mondialisation capitaliste qui favorise une minorité de possédants au détriment des droits humains fondamentaux. Être altermondialistes, c'est aussi prêter main-forte aux mouvements de solidarité avec les peuples en lutte contre des situations d'oppression. Nos solidarités vont aux milliards de personnes vivant dans un état de pauvreté abject, aux femmes exploitées et opprimées à travers le monde, aux enfants esclaves ou soldats. (Déclaration de principe de Québec solidaire, 2006)
La participation électorale ne fait pas l'économie de la résilience
Depuis plus de cinquante ans, la gauche au Québec, y compris son aile radicale, n'a pas cessé de chercher à s'insérer dans le paysage politique institutionnel et à s'engager dans l'action politique électorale. Elle reconnaît que le champ politique de la vaste majorité de la population est celui des partis politiques de l'Assemblée nationale. On doit reconnaître que la création de Québec solidaire constitue une avancée dans cette perspective.
Dès la naissance de QS, l'ambition était de proposer un projet audacieux qui ne peut trouver son énergie que dans la mobilisation sociale. Les avancées parlementaires ont mis dans l'ombre l'autre réalité du parti, celle de l'action sociale et politique des membres au sein de la société. Un tel projet exige une forte résilience et une vision sur le long terme. Toutefois, c'est une vision de courte vue affecte le parti.
La démission d'Émilise après 6 mois a eu l'intérêt de déclencher une prise de conscience, mais un parti ne pourra pas se renforcer par cette méthode. Par contre, la courte vue est d'abord le problème de la direction. Croire à l'imminence de la victoire du parti aux élections et le répéter depuis la campagne de 2018 n'est pas la manière de développer la résilience.
La vision à court terme est ancrée profondément dans le parti. Il s'agit d'une vision volontariste qui ne tient compte ni de la réalité de la conjoncture politique ni de celle du projet social ni de celle des mouvements sociaux. Quelle que soit la mise en place d'un passage vers l'unité, la périodisation de l'action politique des solidaires doit reprendre une foulée longue, pour durer, en s'associant aux mouvements pour s'ancrer comme option électorale.
Construire le parti, s'engager dans les mouvements
Lors du bilan du scrutin de 2022, le bilan présenté au conseil national affirmait que 10 000 personnes ont « levé la main » pour appuyer le parti dans sa campagne ! Peu de mouvements sociaux peuvent bénéficier d'un tel appui. Pour s'assurer qu'aux prochaines échéances électorales ça se reproduise, les membres du parti doivent aller sur le terrain, non pas seulement à la rencontre de l'électorat, mais surtout en s'engageant dans l'action politique des mouvements, en faisant bloc avec eux
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La crise à QS, la résilience et l’internationalisme
Monnaie locale, un projet entériné ?

Les Banques canadiennes parmi les plus importants investisseurs dans les énergies fossiles

Un collectif d'organisations a publié le 13 mai dernier le rapport intitulé Banking on climate chaos. Ce document nous apprends que les banques, à l'échelle internationale, ont investit la somme de 6 896 milliards de dollars depuis l'accord de Paris, fin 2015. Les banques canadiennes figurent avantageusement dans ce classement. Quatre d'entre elles arrivent parmi les 20 plus importants investisseurs dans les énergies fossiles.
Comme le souligne le site Reporterre, « rien qu'en 2023, année la plus chaude jamais enregistrée, les plus grandes institutions bancaires de la planète ont injecté 705 milliards de dollars dans les énergies fossiles ». Parmi les 60 institutions bancaires qui figurent au classement présenté par le rapport, la Banque royale du Canada arrive au 7e rang avec 256 milliards investis entre 2016 et 2023. La Scotia Bank se pointe au 11e rang avec des sommes investies totalisant plus de 192 milliards de dollars. Puis, la Banque Toronto Dominion arrive au 16e rang mondial avec des investissements totaux de plus de 178 milliards durant la même période. La CIBC n'est pas en reste alors qu'elle se pointe au 21e rang avec des investissements de plus de 134 milliards. La RBC (7e rang), la Scotia Bank (10e rang) et la Banque TD (11e rang) apparaissent ainsi au classement intitulé les 12 salauds. Le deux premières figurent parmi les 12 plus importantes investisseurs dans les énergies fossiles depuis 2016.
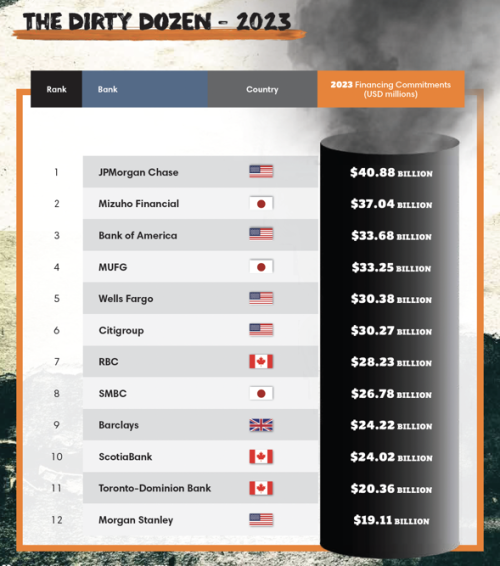
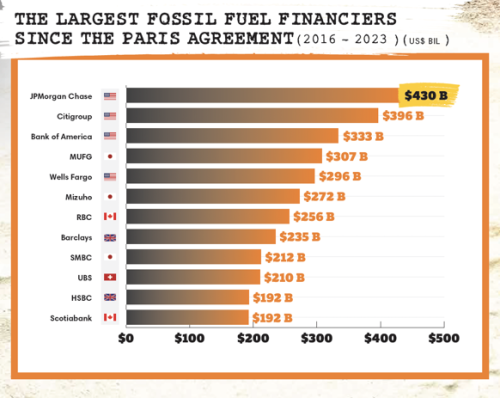
Le rapport souligne également le grands projets d'exploitation des énergies fossiles. Parmi ces projet apparaît au 3e rang parmi les plus importants an niveau mondial le pipeline Coastal gazlink qui comprend des investissements de la RBC, de la TD et de la Banque de Montréal. Le pipeline Trans Mountain arrive au 4e rang de ce classement appuyé par des investissements du même trio de banques. En bas de classement de ces investissements se pointent trois projets d'exploitation de mines de charbon de la compagnie Glencore appuyé par la RBC et d'autres banques étrangères celles-là : la Elk Valley resources Cokin Coal Mines (Sparwood, Colombie-Britannique) appuyé notamment de la RBC, la Greenhill coal mine (Elkford, Colombie-Britannique) de la même Glencore appuyé à nouveau par la RBC au 45e rang et la Line Creek coal (Kootenay, Colombie-Britannique) mine au 46e rang.
En ce qui a trait aux investissements dans l'exploitation des sables bitumineux, 5 des 6 plus importants investisseurs du secteur bancaire sont canadienne. Celles-ci ont investit plus de 2 milliards de dollars en 2023 dans ce secteur. Depuis 2016, ce sera plus de 44 milliards de dollars qui auront été investit dans l'exploitation des énergies fossiles les plus polluantes.
Quant aux projets visant l'Artique, les banques canadiennes se montrent prudentes. La Banque royale du Canada arrive au 30e rang mondial des investisseurs du secteur bancaire dans ce type de projets avec des investissements totalisant 209 millions de dollars. La CIBC a placé 172 millions de dollars et arrive au 32e rang de ce groupe, la Scotia Bank (36e rang, 127 millions de dollars) et la Toronto Dominion (37e rang, 116 millions de dollars).
À l'étranger, les Banques canadiennes sont passablement actives dans des projets situés en Amazonie, un territoire sensible. La Scotia Bank a investit 472 millions de dollars (8e rang mondial) dans des projets ayant cours dans cette zone géographique depuis 2016, la Banque Royale 208 millions de dollars (11e rang mondial), la CIBC 93 millions de dollars (17e rang mondial) et la TD 13 millions de dollars (29e rang mondial).
Enfin, les banques canadiennes sont bien présentes dans les projets d'exploitation en eaux profondes. La Banque royale a investit 998 millions de dollars (22e rang mondial) depuis 2016 dans ce secteur. Suit la Toronto Dominion avec des investissements de 370 millions de dollars (29e rang mondial), la CIBC avec 195 millions de dollars (36e rang mondial) et la Banque de Montréal 96 millions de dollars (41e rang mondial).
Devant un tel amas de chiffres, on ne peut que conclure que les banques, canadiennes ou autres, n'ont aucun intérêt à se retirer de l'exploitation des énergies fossiles. C'est leur survie qui est en jeu. On ne peut que conclure que rien ne pourra les convaincre d'agir en faveur d'une société faible en carbone. Elles ont au contraire tout intérêt à poursuivre leur travail et pousser plus avant les projets destructeurs de l'environnement. Elles devront être contraintes à s'en retirer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













