Derniers articles
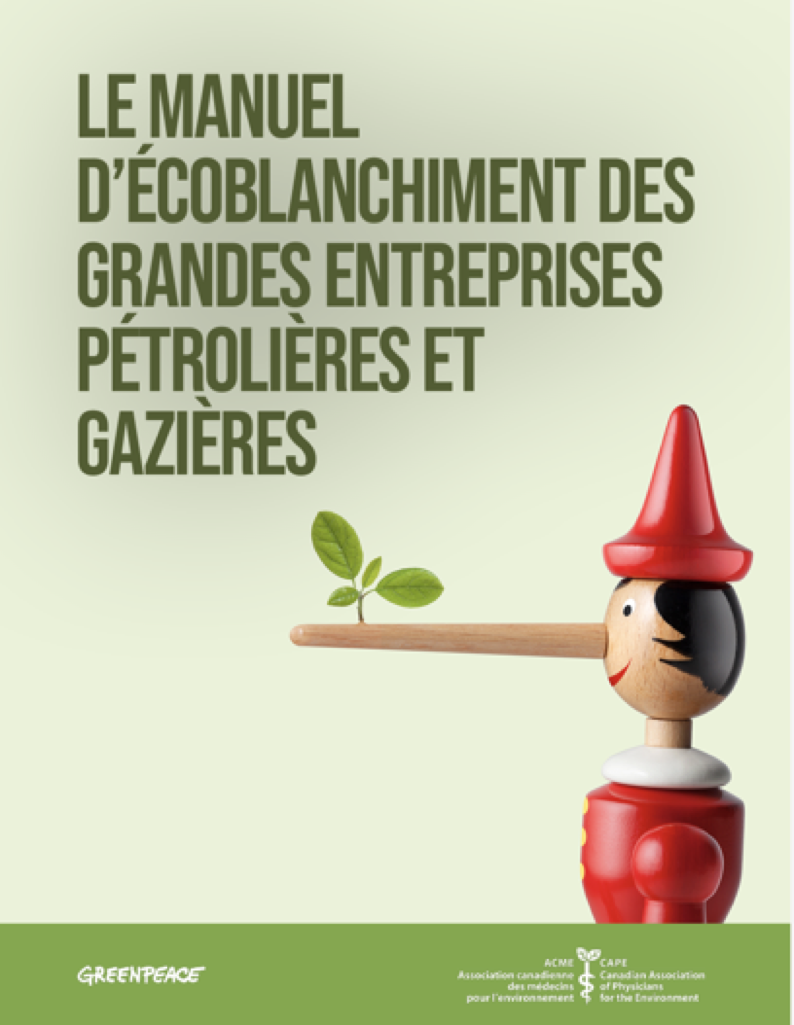
Les normes canadiennes de la publicité déclarent des publicités pro-GNL coupables d’écoblanchiment
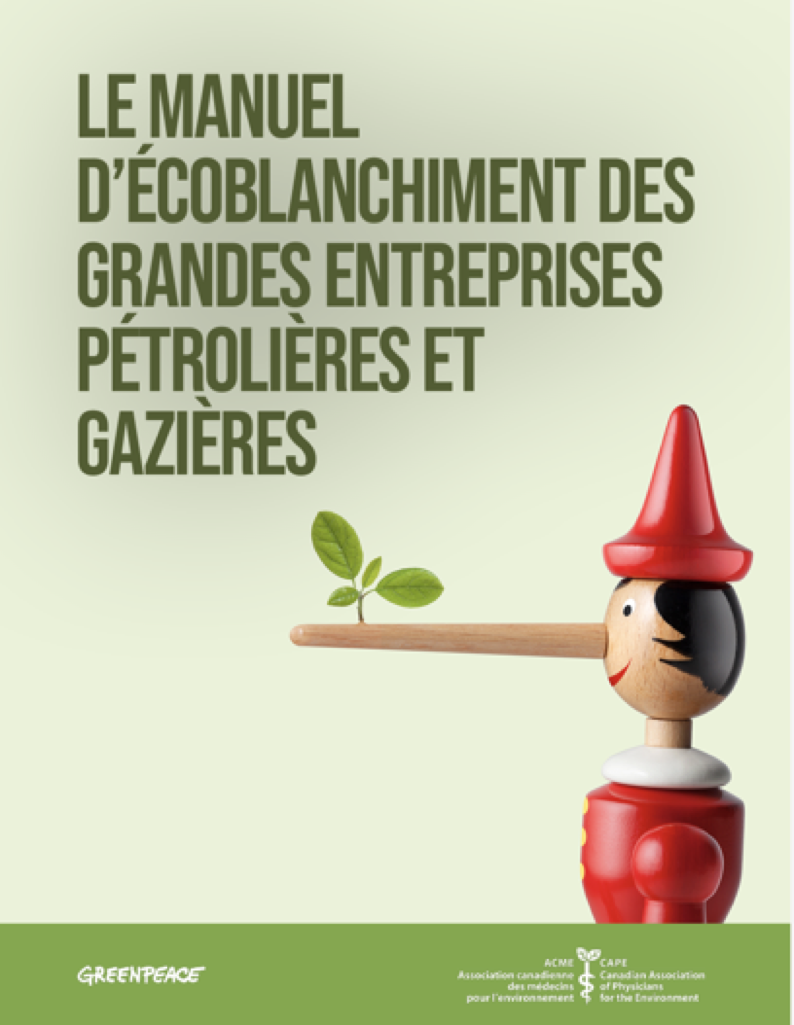
Les publicités financées par Canada Action vantant les avantages environnementaux du gaz naturel liquéfié (GNL) d'origine fossile sont inexactes et trompeuses, en plus de déformer le véritable propos des scientifiques, selon une décision unanime des Normes de la publicité. La décision a été communiquée anonymement à l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (CAPE) compte tenu de la campagne visant à interdire la publicité pour les combustibles fossiles.
Les publicités de Canada Action affirment que « le GNL de la Colombie-Britannique réduira les émissions mondiales ». Ce faisant, d'après l'organisme de réglementation chargé d'administrer le Code canadien des normes de la publicité pour garantir la véracité et l'exactitude de la publicité, elles « déforment le véritable propos des spécialistes et des autorités scientifiques », « promettent un résultat sans éléments probants valides et fiables » et donnent « une fausse impression générale que le GNL de la Colombie-Britannique est bon pour l'environnement, ce qui constitue de l'écoblanchiment ».
Pour sa campagne multicanal promouvant le pétrole et le gaz naturel, Canada Action a choisi un fond vert distinctif, ce que les Normes de la publicité dénoncent comme « un moyen de faire valoir un avantage environnemental que le gaz naturel ne possède pas réellement ». L'organisme à but non lucratif enregistré au fédéral affirme être une initiative populaire non partisane visant à encourager le soutien à l'industrie pétrolière et gazière canadienne. Canada Action a dépensé plus de 5 millions de dollars en publicité entre 2017 et 2022, selon des documents publics. Il ne divulgue pas publiquement ses sources de financement, qui comprennent plus de 7 millions de dollars en commandites par le secteur privé, mais un reportage d'investigation a révélé le versement de paiements par l'industrie pétrolière et gazière, dont 100 000 dollars provenant d'ARC Resources.
Même si le Conseil des Normes de la publicité est parvenu à une décision le 30 janvier 2024, les publicités n'ont pas été retirées. À ce jour, elles continuent d'être diffusées dans des emplacements bien en vue dans les grands centres urbains de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, sur les tableaux d'affichage, à la radio, dans les transports en commun et dans les grands quotidiens. L'une de ces publicités occupe d'ailleurs entièrement la première page du Times Colonist du 4 mai. (En Ontario, les publicités affichent le message « Le GNL canadien réduira les émissions mondiales ».) Contrairement à d'autres organismes d'autorégulation de la publicité, tels que l'Advertising Standards Authority au Royaume-Uni et la National Advertising Division aux États-Unis, les décisions des Normes canadiennes de la publicité sont confidentielles et ne sont pas rendues publiques.
Selon la Dre Melissa Lem, médecin de famille à Vancouver et présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement : « Ces publicités sont des exemples classiques d'écoblanchiment, sans parler de leur couleur verte. Nous nous sommes sentis obligés de rendre cette décision publique parce que la population canadienne a le droit de ne pas être trompée à propos de l'impact du GNL sur le climat, l'environnement et notre santé ».
L'ACME sonne l'alarme depuis plusieurs années au sujet des effets nocifs causés par l'extraction et la combustion du gaz naturel sur la santé humaine, la santé des écosystèmes et les changements climatiques, en particulier en Colombie-Britannique. Ceci inclut de nouvelles études qui établissent un lien entre les activités de fracturation et les issues défavorables des grossesses (naissances prématurées, anomalies congénitales, poids insuffisant à la naissance), la leucémie infantile, les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que la mortalité prématurée.
Dans une initiative dirigée par l'ACME, les organisations pour la santé au Canada militent depuis 2022 pour l'interdiction de la publicité sur les combustibles fossiles, à l'instar de la promotion du tabac, afin de protéger la santé publique. Ces organisations craignent que les campagnes de désinformation de l'industrie pétrolière et gazière nuisent à l'action climatique et perpétuent les méfaits pour la santé et l'environnement, tout comme l'industrie du tabac a trompé le public pendant des années au sujet de la dangerosité de ses produits.
L'ACME a donc envoyé une lettre aux entreprises où les annonces ont été diffusées, dans laquelle elle demande le retrait des publicités de Canada Action prétendant que le GNL de la Colombie-Britannique ou du Canada réduira les émissions mondiales, de même que toute publicité similaire. La lettre réclame également l'affichage d'annonces pour corriger ces publicités et la mise en place d'un système complet permettant de détecter les pratiques d'écoblanchiment à l'avenir. Parmi les destinataires, on trouve TransLink, BC Transit et le Times Colonist, mais aussi les annonceurs extérieurs Branded Cities, Pattison et Lamar. Les publicités ont suscité la controverse et une pétition demandant à Translink et à BC Transit de se prononcer sur la campagne a recueilli des milliers de signatures.
Citations
Dre Melissa Lem, médecin de famille de Vancouver et présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement
« Ces publicités fallacieuses sont profondément offensantes pour les travailleurs et les travailleuses de la santé qui doivent traiter des patient(e)s souffrant des conséquences des changements climatiques : maladies liées à la chaleur, exacerbations de l'asthme causées par la fumée des feux de forêt, ou anxiété et dépression après une évacuation. Il faut y mettre un terme. Tout comme ce fut le cas pour la promotion du tabac au Canada, nous devons interdire la publicité sur les combustibles fossiles pour cesser d'alimenter la demande de produits qui nuisent à la santé et protéger la santé publique. »
Naxginkw (Tara Marsden), directrice de la durabilité Wilp pour les chefs héréditaires Gitanyow
« Les chefs héréditaires Gitanyow se réjouissent du nombre croissant de voix qui réclament la vérité et la reddition de comptes en matière de publicités fossiles au Canada. Déjà, cette année, des milliers de personnes ont été chassées de leur foyer par des feux de forêt extrêmes, ce qui montre bien l'urgence de combattre la désinformation de l'industrie pétrolière et gazière. Non seulement les campagnes trompeuses menacent l'action climatique, mais elles posent aussi de sérieux risques pour la santé publique et l'environnement. Nous félicitons l'ACME de faire preuve de leadership en tenant l'industrie responsable de ses actes et la remercions de travailler à la protection du bien-être de toutes les personnes. »
Leah Temper, directrice du Programme de politiques sanitaires et économiques, Association canadienne des médecins pour l'environnement
« L'industrie des combustibles fossiles exploite les lacunes de la réglementation canadienne pour semer la confusion et tromper le public sur la façon dont ses produits nuisent à l'environnement, à la santé publique et à l'économie. Il est inadmissible que des entreprises puissent dépenser des millions pour mentir à la population canadienne et que le public n'ait pas le droit d'apprendre la vérité, même lorsque ces entreprises sont prises en défaut. Le système est défaillant et nous avons besoin de l'intervention du gouvernement pour mettre fin à l'écoblanchiment et arrêter la machine à désinformer. »
Dre Margaret McGregor, médecin de famille, chercheuse en politiques publiques et coautrice de l'article « The human health effects of unconventional oil and gas development (UOGD) : A scoping review of epidemiologic studies » (Canadian Journal of Public Health, mars 2024)
« Espérons qu'il y aura une prise de conscience du côté du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le GNL n'est pas une solution aux changements climatiques. De plus en plus de données probantes font état d'un taux élevé de retard de croissance fœtale, de naissances prématurées, de crises d'asthme, de leucémie infantile, d'insuffisance cardiaque et de mortalité dans les communautés exposées à l'industrie de la fracturation hydraulique. Il est temps que le gouvernement de la Colombie-Britannique tienne compte des nouvelles connaissances scientifiques sur la fracturation et la santé humaine lorsqu'il élabore ses politiques énergiques. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mise en demeure citoyenne au ministre de l’Environnement du Québec

afin qu'il agisse et prenne ses responsabilités pour que cesse la contamination de l'usine-dépotoir STABLEX à Blainville et en aval.
ENVOYÉE AU MINISTRE LE 22 MAI 2024
Monsieur le Ministre,
Compte tenu que depuis le 8 septembre 2023, vous avez reçu la recommandation du BAPE à l'effet de rejeter le projet de réaménagement de la cellule 6 de Stablex et qu'en regard de la contamination, tout continue comme avant.
Compte tenu qu'un échantillonnage récent et certifié a révélé la présence de contaminantstels qu'arsenic, cadmium et cuivre et ce très largement au-dessus de normes pour un cours d'eau comme le ruisseau Lockhead.
Compte tenu, entre autres, du témoignage d'un lanceur d'alerte lors du BAPE Stablex 2023(Document # DM29- https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000442298) révélant l'incapacité du « procédé Stablex » à stabiliser les déchets industriels toxiques contrairement aux prétentions de la multinationale. De plus, l'absence d'une évaluation, indépendante du promoteur, de la capacité de l'argile sous les cellules à contenir / supporter le poids de millions de tonnes de déchets accumulés depuis 1983 auxquels s'ajoute de plus que probable pressions climatiques et / ou sismiques.
Compte tenu de la confirmation par le fournisseur que les géomembranes ne sont garanties que pour 5 ans(Document DA10 - https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000437448). Ce qui est en contradiction avec les prétentions de Stablex de la sécurisation à perpétuité de ses cellules.
À cela s'ajoute le rapport accablant de la Police verte de 1990 (Document DB14 - https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000438699) sur la contamination STABLEX, celui de la commission Charbonneau sur les déchets toxiques du début des années 90 et l'abandon par la Grande Bretagne et d'autres pays du « procédé Stablex »
Compte tenu que la négligence du suivi ministériel mentionnée par le BAPE de 1981 a de nouveau été constatée par le BAPE Stablex 2023.
Compte tenu de l'absence d'une évaluation hydrogéologique, indépendante du promoteur, sur l'état actuel des nappes phréatiques sous le dépotoir et celle des eaux de surface en aval du ruisseau Lockhead et de la rivière au Chien jusqu'à la rivière des Mille Îles.
Compte tenu de l'ignorance inacceptable par les gouvernements de recommandations du premier BAPE (1981) à l'effet notamment d'irrégularités dans l'octroi d'autorisations ministérielles sans évaluation préalable des autorités responsables.
Compte tenu que Blainville s'est beaucoup développée depuis le début des années 80 et que le site d'enfouissement se retrouve maintenant entouré de résidences familiales sans compter la Grande Tourbière de Blainville qu'on se doit de préserver.
Aussi, nous sommes préoccupés du peu de considération que l'absence d'acceptabilité sociale de ce projet suscite chez les élu.e.s régionaux, notamment ceux et celles de la mairie de Blainville. Vous comme eux, monsieur le Ministre, n'avez pas été élus pour prioriser l'importation américano-canadienne de déchets industriels toxiques à Blainville afin de satisfaire l'avidité sans fin d'actionnaires de multinationales et ce au détriment de la santé publique, celle des citoyen.ne.s et de leurs enfants.
Compte tenu des circonstances actuelles, il serait sage de vous assurer du respect du droit du public à participer effectivement aux processus décisionnels, droit qui exige de la transparence et un accès équitable à l'information de la part des autorités. (https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm)+ (Convention d'Aarhus : https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf ).
Monsieur le ministre de l'Environnement,
la contamination STABLEX doit cesser !
En vertu de vos responsabilité à l'égard du droit citoyen à un environnement sain, à l'égard du contrôle des activités polluantes, à l'égard de la protection de l'eau et des milieux humides, nous sommes d'avis qu'il serait déraisonnable, excessif, irresponsable et contraire au principe de précaution (Principe # 10 de la Loi québécoise sur le Développement Durable : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1 )+ (Principe # 15 de la Déclaration de Rio :https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm)de continuer à permettre ou de renouveler quelques formes d'autorisations en lien avec les activités d'enfouissement et d'importation de déchets industriels toxiques à l'usine-dépotoir Stablex de Blainville.
Cosignataires :
Anick Plouffe, citoyenne qui dénonce le projet de remblai massif dans la Grande Tourbière de Blainville
Florent Gravel, Chef du Parti d'opposition municipal de Blainville "Mouvement Blainville"
Marie-Claude Archambault, pour la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule #6 de STABLEX
Martine Ouellet, Climat Québec
Normand Léo Beaudet, Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER)
Serge Paquette, citoyen ayant participé au BAPE Stablex 2023
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
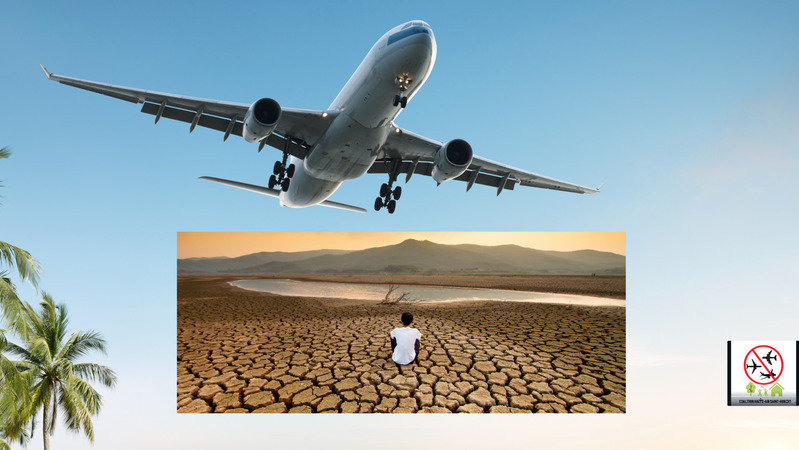
L’Aéro-salon : pour un avenir à reculons !
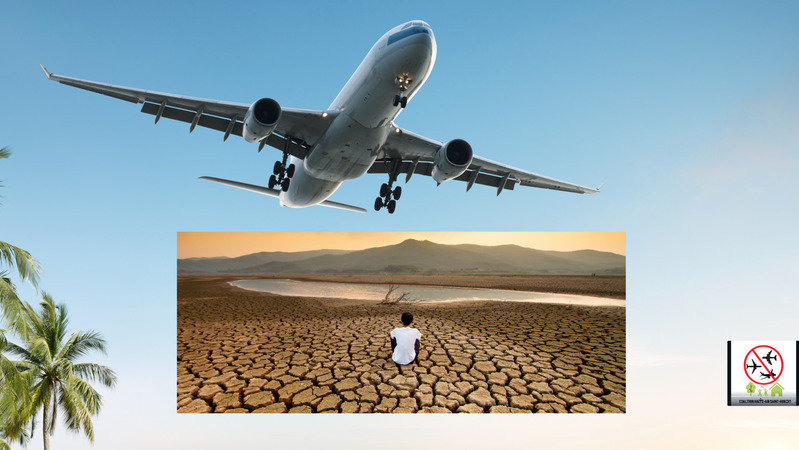
Longueuil, 31 mai 2024. – Ce week-end, les 1er et 2 juin, aura lieu « l'Aéro-salon » à l'aéroport de Saint-Hubert, un événement qui célébrera et glorifiera un moyen de transport délétère pour notre santé et pour notre environnement.
Pour la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, il est effarant de lire les articles de presse sur cet événement : aucune réflexion sur les impacts de l'aviation et les nombreuses pollutions (sonores, atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre) qu'elle engendre à la fois au niveau local pour les riverain.e.s et au niveau planétaire. Pire, à l'heure où nous vivons des crises climatiques, environnementales et de la biodiversité toujours plus nombreuses, certain.e.s préférent accélérer la catastrophe climatique en développant toujours plus le secteur aéronautique, invoquant une chimérique décarbonation de cette industrie qui repose à 99% sur le pétrole.
À Longueuil, cela se traduit concrètement par la construction de l'aérogare Porter Airlines, prévue pour 4 millions de passagers par année, plus de cent vols par jour, 6 à 8 par heure, 3000 places de stationnement. Des centaines de milliers de tonnes de kérosène seront acheminées à St-Hubert pour ensuite brûler dans l'atmosphère, amplifiant le réchauffement climatique, et pour une bonne partie, au-dessus de la tête des riverain.e,s avec de graves conséquences sur leur santé, ainsi qu'une dépréciation immobilière ruineuse.
Au moment où la Ville de Longueuil et son agglomération s'apprêtent à publier leur plan climat, dont l'un des objectifs est de “meilleures pratiques respectueuses de 'environnement”, la Coalition Halte-Air se questionne. Est-ce que ce type d'événements ultra-polluants sera intégré au plan climat puisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-Avec ce “projet des années 80”, comme l'a résumé la mairesse de Saint-Lambert, l'inconscience des décideur.e.s est criante.
Après une année 2023 la plus chaude des 100 000 dernières, où les mégafeux de forêt au Canada ont enfumé des zones urbaines à des centaines de kilomètres des brasiers, entraînant de graves problèmes de qualité de l'air, on annonce déjà un été 2024
similaire, mais aussi des sécheresses qui peuvent affecter négativement les récoltes et avoir un impact à la baisse sur le niveau des réservoirs et des cours d'eau. Nous nous dirigeons vers un réchauffement d'au moins 4,3°C à Montréal.
Quant à l'Aéro-salon, rappelons que les spectacles aériens ont été arrêtés pendant de longues années, en raison des risques élevés d'accidents à proximité des quartiers résidentiels densément peuplés, l'aéroport de St-Hubert étant enclavé dans la ville. Ce fut le cas lors d'une démonstration aérienne des Snowbirds en 2020 dans un quartier résidentiel de Kamloops, en Colombie-Britannique, coûtant la vie de la capitaine Casey,.
La Coalition se demande si la Ville de Longueuil, qui est partie prenante à l'événement, a avisé la population des risques auxquels elle sera exposée et si des mesures d'urgence ont été envisagées. On se souvient que la communication de la Ville de Longueuil avait été loin d'être optimale lors de la contamination à la bactérie E. coli début septembre 2023.
Au moment où la Ville de Longueuil et son agglomération s'apprêtent à publier leur plan climat, dont l'un des objectifs est de “meilleures pratiques respectueuses de l'environnement”, la Coalition Halte-Air se questionne. Est-ce que ce type d'événements ultra-polluants sera intégré au https:/www.longueuil.quebec/fr/services/transition-ecologique'>plan climatpuisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-] puisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-elle son appui au développement de l'aérogare Porter qui viendra augmenter les émissions de GES sur son territoire et annihiler une bonne partie, sinon l'entièreté des efforts demandés à ses citoyen.ne.s ? Des citoyen.ne.s à qui l'on imposera probablement de nouvelles mesures coercitives (à l'instar de la taxe mobilité durable introduite cette année à Longueuil, ou de l'augmentation de la taxe d'immatriculation votée par Longueuil) alors que l'entreprise Porter Airlines pourra émettre autant de gaz à effet de serre qu'elle le souhaite.
Pour la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, qui continue avec des milliers de citoyen.e.s à réclamer un moratoire sur la construction du terminal Porter Airlines, les dirigeant.e.s de DASH-L, tout comme les élu.e.s de tous paliers, doivent arrêter d'ignorer les faits scientifiques, et cesser d'agir de manière irresponsable comme si rien n'était.
Pour information : coalition.halteair@gmail.com
Suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/coalitionhalteairSH
instagram.com/coalitionhalteairsh/
https://twitter.com/Coalition_YM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Écoblanchiment : les banquiers doivent répondre de leurs actes

Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes a officiellement convoqué les PDG des banques à témoigner devant ses membres le 13 juin prochain !
Tiré du site de Greenpeace Canada.
Les PDG des banques canadiennes ont initialement refusé la convocation à répondre aux questions relatives à l'enquête du Comité portant sur les impacts environnementaux et climatiques du système financier, mais ceux-ci ont décliné l'invitation, préférant envoyer un·e représentant·e de leur association corporative à leur place. Comme l'a admis un lobbyiste d'ExxonMobil dans une vidéo captée lors d'une opération d'infiltration de Greenpeace, les compagnies envoient des représentants d'associations industrielles aux auditions parlementaires pour qu'ils servent de « souffre-douleur » et que leurs PDGs n'aient pas à répondre à des questions difficiles.
C'est une très bonne nouvelle que la commission ait entendu notre appel et ait convoqué les PDG pour qu'ils témoignent. Nous avons maintenant besoin de votre aide pour convaincre les membres de la commission de poser des questions difficiles en notre nom.
Contactez le président du Comité, Francis Scarpaleggia, par téléphone au 613-995-8281 ou par courriel à et demandez-lui de convoquer les PDG des banques pour qu'ils rendent compte de leurs engagements en matière de climat.
Cette audition du Comité intervient à un moment critique :
– Toutes les grandes banques canadiennes se sont engagées à atteindre l'objectif « zéro émission nette » en 2021 ; or, elles figurent toujours parmi les plus importants bailleurs de fonds des combustibles fossiles dans le monde et n'investissent pas suffisamment dans les énergies renouvelables.
– Le Bureau de la concurrence du Canada enquête actuellement sur les pratiques d'écoblanchiment de RBC.
– Les gros titres comme « RBC faces questions on climate, Indigenous rights at annual general meeting » (RBC fait face à des questions sur le climat et les droits des peuples autochtones lors de son assemblée générale annuelle) et « BMO dropped anti-coal policy, avoiding energy ‘boycotter' label in West Virginia » (BMO abandonne sa politique anti-charbon afin d'éviter d'être qualifiée de « boycotteur » de l'énergie en Virginie-Occidentale) illustre la façon dont les banques sont mises au défi de montrer que leurs engagements climatiques ne sont pas que des paroles en l'air.
Nous ne pourrons atteindre nos cibles en matière de climat que si les banques cessent de financer le chaos climatique.
Les PDG des banques sont parmi les personnes les mieux payées au pays et ils devraient se préparer à rendre compte de leurs décisions. Il est crucial que les PDG soient présents pour répondre aux questions de nos représentant·es élu·es ─ sous serment si nécessaire. Aussi, merci de contacter le Comité et d'enjoindre ses membres à utiliser leur pouvoir, en notre nom, pour convoquer les banquiers et les forcer à répondre de leurs actes.
Contactez le président du Comité, Francis Scarpaleggia, par téléphone au 613-995-8281 ou par courriel à et demandez-lui de convoquer les PDG des banques pour qu'ils rendent compte de leurs engagements en matière de climat.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 56 : de conjoint·e·s de fait avec enfant au régime d’union parentale

Depuis l'annonce à la fin mars 2024 du gouvernement caquiste concernant le projet de loi 56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, la FFQ a été très active dans ce dossier fidèle aux positions que nous avons prises en 2016.
Tiré de Site web FFQ
https://ffq.qc.ca/portfolio-items/projet-de-loi-56-de-conjoint%c2%b7e%c2%b7s-de-fait-avec-enfant-au-regime-dunion-parentale/?portfolioCats=26
18 MAI 2024
Ce projet de loi est le troisième volet de la réforme globale en droit de la famille, suivant le projet de loi 2 en matière de filiation, de droit des personnes et d'état civil (sanctionné en juin 2022 mais dont la mise en vigueur est prévue en juin 2024) ainsi que le projet de loi 12 en matière de filiation, des enfants nés suite à une agression sexuelle et de gestation pour autrui (sanctionné en juin 2023). Cette réforme du droit de la famille est attendue depuis des décennies !
En effet, dans nospositions adoptées en 2016, nous souhaitions notamment militer pour une nouvelle législation du droit de la famille qui s'assure de prendre en compte la diversité de la composition des familles, qui évite que les femmes et les enfants portent le fardeau de l'appauvrissement inhérent à une séparation conjugale, qui s'assure d'un traitement égal des femmes peu importe leur statut et leurs identités et qui assure une cohérence entre le droit fiscal et civil. En plus, la FFQ demandait qu'une analyse différenciée selon les sexes soit produite avant toute législation à ce sujet.
Cette position de 2016 percole encore à ce jour dans le travail collaboratif qui a été entrepris avec le Groupe des 13 dans ce dossier. Nous avons proposé à nos membres de participer à une séance d'appropriation collective du projet de loi avec le Groupe des 13 le 5 avril dernier et nous avons partagé les éléments clés de ce projet de loi via notre infolettre d'avril 2024.
Après avoir collaboré étroitement avec divers groupes féministes et partenaires, nous avons rejoint les actions de mobilisation collective autour de ce projet de loi avec le Groupe des 13. Plus spécifiquement, le Groupe des 13 a eu des rencontres avec plusieurs partenaires et députés de différents partis politiques afin de présenter et défendre nos revendications. Nous avons participé activement au comité de rédaction du mémoire. En outre, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 56, notre responsable des dossiers politiques Sara Arsenault estintervenue pour présenter lemémoire du Groupe des 13 le 1er mai dernier à l'Assemblée nationale aux côtés d'Annie-Pierre Bélanger, coordonnatrice du Groupe des 13, et Marianne Lapointe, responsable de dossiers au CIAFT.
Nos principales recommandations en un aperçu :
Respect des engagements en matière d'égalité : Que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'égalité énoncés dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022-2027. Que le gouvernement réalise une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) du projet de loi 56 et qu'il effectue, au besoin, les correctifs nécessaires.
Simplification du droit de la famille (inclusion des régimes de retraite au patrimoine ; prestation compensatoire unifiée) : Que l'on modifie le Code civil afin d'accorder aux conjointes et conjoints de fait (tel que nous les définissons à la recommandation 3) les mêmes droits que les couples en union civile, c'est-à-dire que nous souhaitons leur rendre applicables les articles 521.6 à 521.19 et 585 à 596.1 du Code civil, avec les adaptations nécessaires, ainsi que les droits et obligations en matière de succession et aliments.
Définition des conjoint·e·s de fait : Que l'on définisse les conjointes et conjoints de fait comme étant deux personnes, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre, qui : qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple et qui sont toutes les deux les parents d'un même enfant, sans égard à la durée de leur vie commune ; qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, depuis au moins trois ans ; ou qui ont signé un contrat de vie commune notarié et qui l'ont enregistré auprès du Directeur de l'état civil.
Effet immédiat et droit de retrait : Que la loi s'applique aux conjointes et conjoints de fait répondant aux critères de notre recommandation 3, et cela, dès l'entrée en vigueur de la loi. Que les couples jouissent d'un délai d'un an après l'adoption de la loi pour se soustraire de son application par acte notarié et que le ou la notaire qui enregistre la décision ait l'obligation de s'assurer que chaque conjointe ou conjoint ait bénéficié d'un conseil juridique indépendant au préalable, comme condition à la validité de la convention.
Campagne d'information sur les droits : Que le gouvernement réalise une campagne d'envergure pour informer la population de ses droits en matière de droit de la famille à la lumière des modifications adoptées par le projet de loi 56.
En amont de ce travail, notre présidente Sylvie St-Amand avait émis des craintes concernant le choix d'exclure les REER et les fonds de pension du patrimoine commun dans un article paru dans Le Devoir. Notre passage à l'Assemblée nationale a de même été souligné dans un article de Radio-Canada le 7 mai dernier concernant la notion de violence judiciaire.
Nous suivrons de près les travaux de l'Assemblée nationale afin d'évaluer les retombées de ce projet de loi sur les femmes, lorsque sanctionné et mis en vigueur.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour se retrouver dans la négociation en petite enfance

C'est bien connu, une négociation, ça peut être complexe. Particulièrement lorsque le Conseil du trésor est de la partie. Pour établir les demandes salariales, il faut faire des calculs complexes, et il est parfois difficile pour les membres de s'y retrouver, et donc de s'approprier ces demandes.
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
Pour aider les intervenantes en petite enfance des CPE et les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) qui sont présentement en négociation, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a développé un calculateur en ligne permettant de comprendre les impacts des demandes syndicales sur les différents échelons salariaux en CPE et sur le montant de la subvention des RSE.
Des demandes raisonnables et nécessaires
Les intervenantes en petite enfance, malgré de grandes responsabilités et un travail essentiel, ne comptent pas parmi les travailleuses les mieux rémunérées au Québec. En tenant compte de l'inflation des dernières années, leur pouvoir d'achat a d'autant plus diminué.
Pour les RSE, la FIPEQ-CSQ revendique une hausse les protégeant de l'inflation. Les RSE doivent fournir deux collations par jour en plus d'un repas à six ou neuf enfants à même le montant de leur subvention. Leur revenu est directement affecté par la hausse du coût de l'alimentation. Depuis 2020, le coût du panier d'épicerie a augmenté de 13,9 %, et rien n'indique que la situation se résorbera puisque les projections parlent d'une hausse de 9,9 % à 11,3 % en 2023. La demande syndicale consiste en une augmentation de 6,12 $ de la subvention totale par enfant au terme de l'entente collective, en 2026.
Quant aux travailleuses des CPE, elles demandent un ajustement salarial à l'indice des prix à la consommation afin de protéger leur pouvoir d'achat et empêcher leur appauvrissement. Elles demandent, en outre, une bonification salariale afin de poursuivre le rattrapage salarial avec les autres secteurs et les autres provinces. Pour 2023, la demande est de 2,86 $ l'heure (environ 100 $ par semaine). Pour les deux autres années de la convention, elles demandent 3 % et 4 %, respectivement.
Pas qu'une question d'argent
Les RSE veulent également pouvoir être remplacées lorsqu'elles s'absentent pour des raisons personnelles afin d'éviter des bris de service aux familles et aux tout-petits. Elles souhaitent aussi que tous les enfants ayant des besoins particuliers puissent bénéficier de la subvention nécessaire afin de pouvoir répondre à leurs besoins tout en respectant le rythme de leur développement. Par ailleurs, les RSE revendiquent un soutien lors des moments difficiles, comme un deuil, soutien qui consisterait en des congés sociaux payés pour s'occuper des nombreuses obligations entourant le décès d'un proche.
Ces demandes trouvent écho dans les demandes des intervenantes en petite enfance des CPE, qui voudraient avoir accès à plus de personnel spécialisé pour accompagner les enfants ayant des besoins particuliers. Elles veulent également que les CPE embauchent davantage de personnel afin de diminuer la surcharge et augmentent le nombre de journées pédagogiques permettant des moments dédiés à la planification en lien avec le programme éducatif.
On remarquera au passage que, dans les deux cas, les demandes portent sur la capacité des intervenantes en petite enfance à offrir des services de qualité et à accompagner au mieux les enfants dans leur développement.
Des solutions à la pénurie de main-d'œuvre
Les services de garde éducatifs à la petite enfance publics sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui compromet l'ouverture de nouvelles places très attendues par les parents, qui, dans certains cas, se voient contraints de reporter leur retour au travail.
Pour attirer et retenir le personnel des CPE et les RSE, il faut réussir à démontrer qu'elles auront les moyens de réaliser leur travail dans de bonnes conditions, tant sur le plan salarial que par la réponse aux besoins exprimés, tant en termes de ressources matérielles que sur le plan de la surcharge de travail.
C'est dans cet esprit que, pour la première fois dans l'histoire de la FIPEQ-CSQ, les intervenantes en CPE et en milieu familial régi et subventionné vont unir leurs forces afin de mener une négociation commune. Il s'agit d'une opportunité unique d'allier l'ensemble des intervenantes afin de bonifier leurs conditions de travail et de poursuivre la valorisation de la profession.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réaction de la FTQ et du SCFP-Québec à l’annonce d’Hydro-Québec sur l’avenir de l’industrie éolienne

La FTQ et le SCFP-Québec saluent l'annonce d'Hydro-Québec de revoir sa stratégie de développement éolien, en se lançant dans la production d'énergie éolienne, confiée au privé depuis 2006.
« 10 000 MW de production d'électricité publique, avec Hydro-Québec comme maître d'œuvre, c'est un pas dans la bonne direction ! Les personnes citoyennes québécoises méritent de capter la valeur de nos gisements éoliens. Une redistribution équitable de nos richesses québécoises est essentielle », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.
La privatisation du secteur éolien a toujours été combattue par les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP et la FTQ. Par ailleurs, rappelons que dès 2005, une campagne a été mise en œuvre pour la nationalisation et le développement de l'expertise d'Hydro-Québec. Le gouvernement de l'époque avait déployé un système qui a enrichi de milliards de dollars des entreprises privées. Aujourd'hui, le changement de cap d'Hydro-Québec, avec sa nouvelle stratégie, permet aux membres de la FTQ de voir de la lumière au bout du tunnel.
Par ailleurs, la FTQ et le SCFP-Québec restent sur leurs gardes, car un projet de loi du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui est attendu depuis l'automne 2023, fait toujours craindre le pire aux syndicats d'Hydro-Québec.
« Notre campagne pour la nationalisation de la production éolienne ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas la garantie que les signaux envoyés aujourd'hui par Hydro-Québec ne se seront pas concrétisés par des actions. Mais disons que nous entrevoyons la suite positivement et que nous travaillerons sur toute proposition intelligente », précise le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.
« La FTQ souhaite toujours qu'Hydro-Québec soit maître d'œuvre et actionnaire de ses projets, dans le respect des communautés autochtones et locales. L'héritage de René Lévesque doit être préservé : la nationalisation de la production et de la distribution d'électricité a été un levier de développement socioéconomique extraordinaire et il doit le rester », concluent les leaders syndicaux.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fierté 2024 : Personne ne doit être laissé pour compte : égalité, liberté et justice pour tous

Pour la Fierté 2024, les syndicats du Canada réitèrent le thème « Personne ne doit être laissé pour compte : égalité, liberté et justice pour tous ». En solidarité avec nos camarades 2SLGBTQI+, nous réaffirmons notre engagement à protéger les droits des personnes 2SLGBTQI+ et à réfuter toute tentative de faire reculer les progrès pour lesquels nous nous sommes tant battus et obtenus.
Les travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ sont des membres à part entière du mouvement syndical du Canada et sont fiers d'être des militantes et militants, des déléguées et délégués syndicaux et des membres de la haute direction.
« La Fierté est l'occasion de célébrer les progrès que nous avons réalisés, mais c'est aussi l'occasion de dire avec certitude que nous défendrons ces droits s'ils sont menacés. Nous avons assisté à une forte montée des actes de harcèlement et de violence motivés par la haine contre la communauté 2SLGBTQI+, alimentés par les conservateurs de droite », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous reconnaissons depuis longtemps la responsabilité collective de combattre la discrimination et la haine envers les travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ par la promotion de l'égalité au travail et dans nos communautés. Alors, bien que nous ayons beaucoup à célébrer en cette saison de la Fierté, il nous reste aussi beaucoup à faire. »
Au cours de la dernière année, les dirigeants conservateurs ont fomenté un climat de haine, de peur et de mépris en perpétuant des stéréotypes nuisibles sur les personnes queer et trans en attaquant les lois portant sur les enfants, les jeunes et les adultes trans et d'identités de genre diverses. Alors que les travailleuses et travailleurs et les familles font face à une crise de l'abordabilité, aux changements climatiques et aux compressions dans les services publics, les politiciens conservateurs utilisent les enfants trans et d'identités de genre diverses comme pions politiques pour détourner l'attention de la population canadienne, car ils n'ont aucune solution concrète à présenter.
Leurs efforts sont également soutenus par des individus et des groupes du mouvement anti-genre (en anglais), qui utilisent l'intimidation et le harcèlement pour miner les efforts des entreprises et des institutions visant à favoriser l'inclusion, l'équité et la sécurité des personnes 2SLGBTQI+.
« Soyons clairs : la haine anti-2SLGBTQI+ concerne les travailleurs et travailleuses. Les préjugés et la violence dont sont victimes nos camarades 2SLGBTQI+ mettent en péril leurs droits humains fondamentaux », déclare Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC. « Et la haine anti-2SLGBTQI+ se manifeste souvent sous forme de harcèlement et de violence sur les lieux de travail, présentant de graves risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs. Nous devons être unis dans notre réponse, en solidarité avec tous les travailleurs et travailleuses, quelles que soient leur identité de genre, leur expression de genre et leur orientation sexuelle. » Les syndicats du Canada restent fidèles à leur principe fondamental : ce qui fait du tort à une personne en fait à toutes. Nous prenons résolument position contre toute tentative des conservateurs de restreindre nos droits durement acquis. Nous continuerons d'amplifier les voix des travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ et de défendre sans relâche un Canada sécuritaire, juste et inclusif pour tous.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Claudia Sheinbaum Pardo, PRÉSIDENTE !

"Pour la première fois en 200 ans, je deviendrai la première femme présidente du Mexique, et je m'engage à gouverner honnêtement, dans la paix et l'harmonie, sans distinction", a déclaré Claudia Sheinbaum Pardo, dans son message initial en tant que gagnante virtuelle de la course à la présidence. "Merci Mexique, c'est votre triomphe, nous avons encore écrit l'histoire", a-t-elle déclaré plus tard dans le Zócalo de la capitale, où après minuit elle a célébré avec des milliers de partisan-e-s.
3 juin 2024 | tiré de La Jornada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/03/politica/presidenta-5769
Après des heures d'incertitude, on a rapporté que Xóchitl Gálvez et Jorge Álvarez Máynez, ses opposants dans la course, l'ont appelée pour reconnaître sa victoire. Le président Andrés Manuel López Obrador a également pris la parole pour la féliciter.
« Un homme exceptionnel et unique qui a transformé l'histoire de notre pays pour le mieux. Nous continuerons à faire du Mexique une nation plus juste, démocratique, libre et souveraine et ce, chaque jour, afin de continuer à construire la grandeur de notre pays. Soyez assuré, Monsieur le Président, que nous serons à la hauteur de notre histoire et du généreux peuple mexicain. »
Elle s'est engagée à conserver son héritage. « Il est clair pour moi que la responsabilité est énorme, mais quand on a de la conviction et de l'amour pour les gens, tout est possible. Elle a insisté sur le fait que López Obrador n'a jamais abandonné, ne s'est jamais fatigué et a consacré sa vie à la justice« . Et, reprenant le titre du dernier livre du président, elle a dit : « D'ici, nous disons merci ! »
La présidente virtuellement élue a remercié les millions de Mexicaines et de Mexicains qui ont voté pour elle ce jour-là afin d'aller de l'avant avec la Quatrième Transformation [1]
Dans une ambiance festive, d'abord à l'hôtel Hilton Alameda, où se trouvait son centre d'opérations, elle a déclaré que « bien que de nombreux Mexicain-e-s ne soient pas d'accord avec le projet, nous devrons marcher dans la paix et l'harmonie, pour continuer à construire un Mexique juste et plus prospère. »
Après que le décompte rapide de l'Institut national électoral lui ait donné plus de 30 points d'avantage, elle a souligné qu'en ce jour d'élection, la fourchette la plus basse des résultats préliminaires donne aux partis de la coalition, Morena, PT et PVEM, une majorité qualifiée à la Chambre des député-e-s et très probablement au Sénat.

Dans son premier message en tant que présidente virtuellement élue, Claudia Sheinbaum a assuré qu'elle serait à la hauteur de « notre histoire et du généreux peuple mexicain ». Crédit photo : Marco Pelaéz
Des cris de « Présidente, présidente ! » ont inondé la salle où elle a délivré son message, devant des dizaines de représentant-e-s de la presse, sa famille, des collaborateurs et collaboratrices, des membres de son équipe de campagne, des dirigeant-e-s des partis qui la défendent, Morena, PT et PVEM, ainsi que divers candidat-e-s.
Elle a réitéré qu'elle n'était pas venue seule à la présidence. « Nous sommes tous arrivés, avec nos héroïnes qui nous ont donné notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites-filles. Je félicite tous les Mexicain-e-s qui, par leur participation, ont démontré que le Mexique est un pays démocratique, avec des élections pacifiques et très participatives. »
L'ancienne cheffe du gouvernement a insisté sur le fait qu'elle conçoit un Mexique pluriel, diversifié et démocratique.« Nous savons que la dissidence fait partie de la démocratie, et bien que la majorité du peuple ait soutenu notre projet, notre devoir est et sera toujours de veiller sur chacun des Mexicain-e-s, sans distinction. »
Enthousiaste, Sheinbaum a promis un gouvernement « honnête, pas sous influence, sans corruption, sans impunité. Ce sera un gouvernement de l'austérité républicaine, de la discipline financière et fiscale et de l'autonomie de la Banque du Mexique. Il n'y aura pas de réelles augmentations des prix du carburant ou de l'électricité. »
« Nous maintiendrons, a-t-elle ajouté, la division entre le pouvoir économique et le pouvoir politique et nous défendrons et travaillerons toujours pour l'intérêt suprême du peuple mexicain et de la nation. Nous agirons conformément aux lois et à la loi. Nous garantirons les libertés d'expression, de presse, de réunion et de mobilisation. »
« Nous sommes démocrates, a-t-elle souligné, et par conviction, nous ne formerons jamais un gouvernement autoritaire ou répressif. Nous respecterons également la liberté politique, sociale, culturelle et religieuse, la diversité sexuelle et de genre. »
« Nous continuerons toujours à lutter contre toute forme de discrimination, à respecter la liberté d'affaires et à promouvoir et faciliter honnêtement les investissements privés nationaux et étrangers, qui favorisent le bien-être social et le développement, en garantissant toujours le respect de l'environnement. »
Claudia Sheinbaum a déclaré qu'elle consacrerait le budget public par conviction « à garantir tous les programmes d'aide sociale initiés par le président López Obrador, ainsi que tous les programmes dans lesquels nous nous sommes engagés, ainsi qu'à poursuivre la construction d'un véritable État-providence. »
Elle a également déclaré qu'elle consoliderait, entre autres, les projets stratégiques du gouvernement actuel, développerait l'infrastructure des trains, des routes, des ports et des aéroports, et qu'elle ferait la promotion de la souveraineté énergétique, des énergies renouvelables et du développement scientifique et technologique.
Sheinbaum a indiqué qu'elle poursuivrait la politique étrangère basée sur les principes de non-intervention, de coopération internationale pour le développement, d'autodétermination des peuples et de consolidation de la paix.
Et avec les États-Unis, il y aura « une relation d'amitié, de respect mutuel et d'égalité comme ce fut le cas jusqu'à présent, et nous défendrons toujours les Mexicain-e-s qui sont de l'autre côté de la frontière. Avec le Sud et les Caraïbes, nous continuerons à développer nos relations amicales, ainsi qu'avec le monde entier. »
Attention aux causes
« Nous conduirons le Mexique, a-t-elle souligné, sur la voie de la paix et de la sécurité. Nous irons de l'avant en prêtant attention aux causes, à la consolidation de la Garde nationale, au renseignement et aux enquêtes pour la sécurité publique, et à la coordination des institutions des différentes branches et niveaux du gouvernement, c'est-à-dire que notre politique de sécurité et de justice portera attention aux causes et à l'impunité zéro. »
Sheinbaum a rapporté qu'hier encore, elle a reçu les félicitations de divers chefs d'État et s'est ensuite rendu au Zócalo pour célébrer son triomphe. « Oui, nous avons pu, oui nous avons pu !« a-t-elle scandé. Nous avons atteint près de 35 millions de voix et nous avons également remporté la mairie de Mexico avec Clara (Brugada) », à qui elle a donné une accolade chaleureuse.
Je suis enthousiaste et j'éprouve de la gratitude pour la reconnaissance de la Quatrième Transformation. Je ne vais pas vous laisser tomber. Nous allons gouverner pour tous et pour toutes.
Nous devons ce triomphe à tant d'hommes et de femmes qui se sont battus pour notre patrie, pour nos libertés et notre justice, à des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour notre pays, aux mouvements sociaux, aux travailleurs et travailleuses, aux étudiant-e-s, aux médecins, aux enseignant-e-s, aux paysan-ne-s, aux femmes.
Dès le matin, lorsqu'elle est allée voter, la moréniste a déclaré qu'elle se sentait très heureuse et qu'elle s'attendait à une journée très participative et démocratique. Elle a voté dans un bureau de vote voisin de Duraznos 5C à San Andrés Totoltepec, Tlalpan.
Elle a affirmé avoir voté pour Ifigenia Martinez, qu'elle admire. À la maison, elle a attendu avec sa famille jusqu'en après-midi, avant de se rendre au centre des opérations où elle a appris son triomphe. Après la fermeture des bureaux de vote, elle a rencontré, entre autres, les anciens présidents de la Bolivie, Evo Morales, et de l'Argentine, Alberto Fernández.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Andres Manuel Lopez Obrador, le président sortant avait promis un ambitieux programme réformateur qu'il avait nommé la « quatrième transformation du Mexique », après l'indépendance de 1810, la réforme (instaurant la laïcité) de 1857 à 1861 et la révolution de 1910. Cette quatrième transformation viserait à combattre les inégalités criantes provoquées par les politiques néolibérales, à lutter contre la corruption, à allouer des sommes importantes au développement du marché intérieur, à hausser le salaire minimum, à développer des programmes sociaux et à assurer la gratuité de la santé et de l'éducation.
L’invasion des terriens
L'expression "Terra nullius", vous connaissez ? Il s'agit d'une locution latine qui signifie : "territoire de personne" ou encore : "terre inhabitée". Elle apparaît pour la première fois dans une bulle papale de 1095. Elle a par la suite légitimé l'injustifiable : la prise de possession de territoires par les puissances coloniales européennes.
En effet, cette définition, même inconstante dans le temps, a servi à justifier l'appropriation de territoires dont les habitants, jugés primitifs et négligeables parce qu'ils ne disposaient pas d'une organisation étatique, étaient vus comme quantité négligeable ; des inférieurs en quelque sorte. Ce fut le cas dans dans les Amériques, en Afrique et une partie de l'Asie et même en Europe (les territoires balkaniques, dont une partie était peuplée de chrétiens non catholiques). À cette époque, il revenait au pape de trancher sur la définition de ces "territoires sans maître".
De nos jours, on interprète cette notion de façon plus modérée. L'actuel droit internationale considère comme Terra nullius une région sur laquelle aucun État n'a exercé sa souveraineté ou qui a renoncé à celle-ci formellement. Inutile de préciser que ces zones sont rarissimes. L'acquisition d'un territoire ne peut désormais se réaliser ni sur simple déclaration de souveraineté ni par un acte symbolique.
On peut citer sommairement le continent Antarctique qui constitue par voie de traité une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, plus quelques minuscules territoires (comme le rocher de Rockall, à l'ouest de l'Écosse).
Si on transpose la notion de Terra nullius à l'espace interplanétaire, elle convient parfaitement à première vue puisque les astres voisins du nôtre ne semblent pas abriter des formes de vie, du moins évoluées. Dans un traité de l'espace signé le 27 janvier 1967, l'article 2 interdisait toute appropriation nationale d'une planète ou d'une partie d'un astre par proclamation de souveraineté. Lors de la conquête de la lune deux ans plus tard, les États-Unis déclaraient solennellement que notre satellite appartenait à toute l'humanité et qu'ils n'avaient pas l'intention de l'annexer.
Mais on peut maintenant se demander combien de temps encore se maintiendra cette bonne volonté. Au printemps 2020, le président en poste Donald Trump annonçait que les États-Unis devraient disposer du "droit de s'engager dans l'exploration commerciale, la récupération et l'utilisation des ressources dans l'espace extra-atmosphérique conformément au droit applicable. L'espace extra-atmosphérique est un domaine de l'activité humaine sur le plan juridique et physique, et les États-Unis ne le considèrent pas comme un bien commun mondial".
Voilà le grand danger qui guette l'espace et aussi, par ricochet, l'humanité, dans la mesure où nos sociétés productivistes risquent d'y transporter leurs conflits commerciaux, économiques et même militaires.
À mesure que les ressources naturelles terrestres se raréfient vu leur exploitation effrénée, que la pollution continuera d'augmenter, la tentation sera forte (et sans doute irrésistible) d'aller piller les ressources manières éventuellement présentes sur certaines planètes voisines. D'où l'urgence d'un autre traité dans la foulée de celui de 1967 visant à renforcer la protection des autres planètes des convoitises nationales terrestres, à la fois publiques et privées.
On s'interroge beaucoup sur les OVNIS que plusieurs témoins pensent avoir observés ; mais s'il y avait des habitants intelligents sur Mars, Ganymède, Encelade ou Europe, ils verraient nos vaisseaux spatiaux foncer chez eux. Contrairement aux élusifs OVNIS chez nous, les nouveaux venus, eux, ne se cacheraient pas et ils iraient droit au but : l'établissement sans vergogne d'un régime colonial.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Jean-François Delisle

Lancement de la 4e Édition d’En juin, je lis autochtone : « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone »

Wendake, le 30 mai 2024 - Afin de souligner le Mois national de l'histoire autochtone, la campagne En juin, je lis autochtone revient pour une 4e édition. Sous le thème « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone », plus de 75 librairies et 165 bibliothèques du Québec participeront à l'initiative.
Pour l'occasion, l'organisme Je lis autochtone invite les lecteurs et les lectrices à se rendre dans l'une des succursales participantes afin de se procurer un livre écrit par un auteur ou une autrice autochtone et découvrir toute la diversité que la littérature autochtone a à offrir.
À ce sujet, la porte-parole de l'édition 2024, Natasha Kanapé Fontaine, décrit la littérature autochtone comme suit : « Elle est héritière des traditions orales, des cultures ancestrales, mais elle est aussi pleine des réalités d'aujourd'hui et aborde une foule de sujets. Il y a de la science-fiction, des bandes dessinées, de la littérature jeunesse. Il y a tout plein de livres pour ouvrir notre esprit. »
Pour rendre l'expérience plus immersive, un mélange de bannique, un pain traditionnel autochtone, ainsi que le nouveau cahier thématique annuel de Je lis autochtone seront remis gratuitement à l'achat d'un livre des Premiers Peuples. Le cahier thématique permet de découvrir toutes les nouveautés livresques autochtones, des entrevues exclusives, une nouvelle inédite et des recommandations littéraires et musicales.
La programmation de l'événement est disponible sur le site Web de l'organisme
(jelisautochtone.ca). Plusieurs activités avec des auteurs et des autrices auront lieu tout au long du mois dans plusieurs librairies et bibliothèques de la province.
Je lis autochtone met aussi en vente des sacs réutilisables au coût de 20 $. Pour chaque sac vendu, l'organisme remettra un livre à un.e jeune d'une communauté autochtone du Québec.
Rappelons que l'initiative a d'abord été lancée, en 2021, par la Librairie Hannenorak située à Wendake. Vu l'intérêt grandissant, le projet s'est développé pour devenir un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire découvrir la littérature autochtone, mais aussi de rendre les livres plus accessibles dans les communautés des Premières Nations et y augmenter la littératie.
Pour tout connaître sur la campagne, visiter le jelisautochtone.ca ainsi que les pages Facebook et Instagram de l'organisme.
À propos de Natasha Kanapé Fontaine :
Natasha Kanapé Fontaine est une autrice, poète et artiste interdisciplinaire innu, de la communauté de Pessamit, sur le Nitassinan (Côte-Nord, Québec). Ses œuvres poétiques, son roman, son recueil de nouvelles et ses essais sont reconnus et salués par la critique, voyagent dans le monde, traduits en plusieurs langues et sont à l'étude à plusieurs niveaux dans les écoles du Québec et d'ailleurs.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
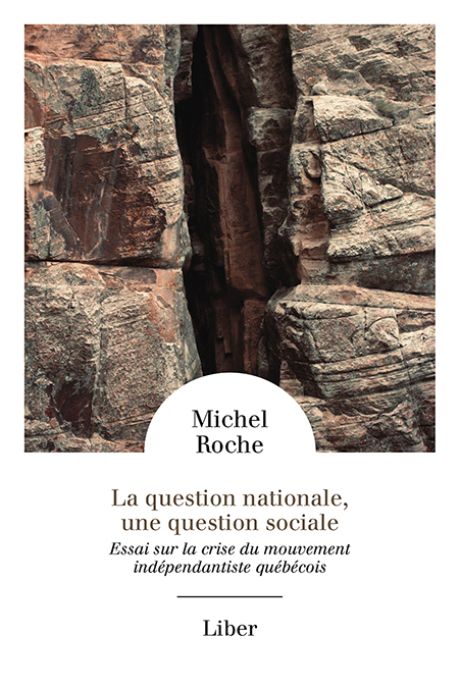
« La question nationale, une question sociale » de Michel Roche Un livre majeur
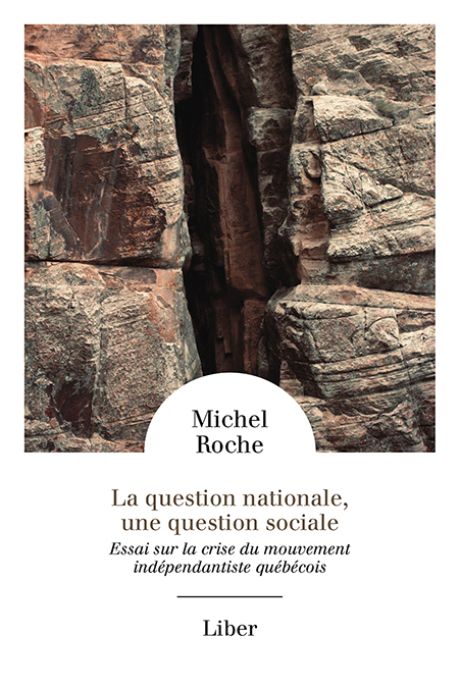
« L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, elle est en avant ». Cette phrase de Bernard Landry, on l'entend fréquemment de la bouche de péquistes souvent bien intentionnés mais un brin allergiques à toute critique de leur parti.
Germain Dallaire
Pourtant, l'histoire même du PQ démontre que cette phrase est fausse. Les deux référendums de 1980 et 1995 ont été menés par des gouvernements péquistes clairement de centre gauche. Dans les deux cas mais plus particulièrement en 1995, le ralliement des groupes populaires et syndicaux au camp du Oui ont joué un rôle majeur.
Gouvernements de centre gauche ? Démystifions un peu les choses. La révolution tranquille a été le point de départ de deux décennies de décisions gouvernementales volontaristes allant dans le sens d'une intervention accrue de l'État dans l'économie et le développement de programmes sociaux. Toutes ces réalisations s'inscrivaient dans une logique de développement du bien commun profitable à tou(te)s. C'était à proprement parler du « nation building" et c'est loin d'être un hasard si, parallèlement à ce processus, s'est développé un nationalisme toujours plus affirmé nourrissant une aspiration croissante à l'indépendance. En fait, ce à quoi les gens sont attachés c'est à un État qui a pour objectif le bien commun et favorise l'unité et la solidarité entre les membres de la société. C'est ce qu'on caractérise comme étant de centre gauche et qui est pour l'essentiel la réalisation au Québec d'un État providence plus affirmé qu'ailleurs compte tenu de notre fragilité. On peut dire qu'une des manifestations récentes de cet attachement des Québécois(es) à une telle orientation gouvernementale est son appui aux employé(e)s du secteur public lors des dernières négociations.
Dans un ouvrage au titre évocateur (la question nationale, une question sociale), le professeur Michel Roche établit un lien direct entre politiques sociales et nationalisme. Les politiques sociales créent de la solidarité entre les membres d'une nation, ce faisant elles favorisent le sentiment national. Dans un pays en devenir comme le Québec, cela signifie une montée de l'indépendantisme.
Pour étayer sa démonstration, Michel Roche a fait un patient travail d'archive puisqu'il fait l'analyse de l'action des gouvernements fédéraux et provinciaux depuis l'instauration de l'État providence dans la foulée du New deal de Roosevelt à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Dans l'histoire des relations entre les gouvernements fédéraux et québécois de cette longue période, il est possible de distinguer trois épisodes :
1- De 1945 à 1960, les gouvernements fédéraux successifs sont les maîtres d'œuvre de l'État Providence. Le Québec sous Duplessis se caractérise par un conservatisme social important ce qui l'amène à dénoncer les ingérences du fédéral même pour des initiatives favorables à la population.
2- La révolution tranquille se caractérise par une inversion des rôles. C'est le Québec qui prend l'initiative de façon spectaculaire avec la nationalisation de la majorité des barrages hydroélectriques décidée à la suite de la seule élection référendaire de notre histoire. Cette nationalisation est un geste par excellence de solidarité sociale puisqu'elle a été explicitement réalisée pour favoriser les coûts d'électricité les plus bas possibles pour l'ensemble des Québécois(e)s. Elle a inaugurée une longue suite de réformes (création des ministères de l'éducation et de la santé, assurance-maladie, créations de sociétés d'État, etc, etc.. la liste est longue) allant toutes dans le même sens d'une prise en main collective au bénéfice de l'ensemble des Québécois(e)s. Résultat : un sentiment fort de destin commun, une solidarité croissante, un nationalisme atteignant des zéniths et la nécessité de l'indépendance qui s'impose.
3- Arrive les années 80 avec l'échec référendaire et, l'année suivante, un gouvernement Lévesque qui se retourne contre ses alliés du secteur public. La chape de plomb du néolibéralisme s'installe progressivement avec les premiers traités de libre-échange qui ouvrent à la marchandisation de toute chose. C'est le début des baisses d'impôt et du démantèlement de l'État. Le PQ se convertit au libre-échange et le gouvernement libéral de Robert Bourassa parle d'État Provigo. Même une partie de la gauche se rallie en parlant d'alter-mondialisation. Le gouvernement fédéral est à l'offensive avec le rapatriement unilatéral de la constitution et les premières privatisations sous Mulroney.
Son néolibéralisme affirmé ne lui permet cependant pas d'envahir le champ des politiques sociales. Les leaders indépendantistes se déchirent avant de reprendre la main. Les échecs de Meech et Charlottetown les galvanise et conduit au référendum volé de 1995.
La suite de l'histoire s'apparente à un effondrement. Lucien Bouchard devient premier ministre et, prenant exemple sur René Levesque, se retourne contre ses alliés en imposant des coupures drastiques. Ces coupures sont une conséquence directe des actions d'un gouvernement fédéral paniqué par les résultats référendaires. En plus d'inonder le Québec de publicité (programme des commandites), Ottawa coupe de 33% ses transferts en santé obligeant le Québec à diminuer les services. Plus catholique que le pape, le gouvernement Bouchard réduit de 6% le budget de l'État en 1996 et 1997. Au gouvernement québécois le rôle ingrat ; au fédéral, le rôle de Père Noël. Le déficit zéro, présenté aux indépendantistes par Lucien Bouchard comme la condition gagnante d'un référendum à venir, est la démonstration parfaite qu'indépendance et néolibéralisme sont tout simplement antagonistes. Appliqués avec d'autant plus de vigueur que Bouchard y avait rallié les alliés du camp du Oui, ces politiques ont conduit à une grogne populaire et à l'effondrement du leadership indépendantiste. La condition gagnante s'est avérée être une condition perdante.
En symbiose avec la politique fédérale d'envahissement des compétences provinciales, le gouvernement Charest (2003-2012) poursuit le travail de démantèlement de l'État québécois bien entamé sous Lucien Bouchard. Profitant d'un ministre des finances qui s'est époumoné à dénoncer le déséquilibre fiscal (Yves Séguin), Jean Charest se permet même de convertir en baisses d'impôt le 700 millions accordé en 2007 par Stephan Harper. Néolibéralisme, quand tu nous tiens ! En 2013, une étude de l'Institut de Recherches en Économie Contemporaine (IREC) révélait qu'en appliquant le régime fiscal de 1997, le gouvernement québécois aurait obtenu 8,4 milliards de plus en financement…
L'arrivée du gouvernement de Justin Trudeau au pouvoir en 2015 allait marquer une accélération dans l'intrusion du fédéral. On se souvient qu'à l'époque Trudeau, sur l'obsession du déficit, défendait une position plus progressiste que le NDP. C'est ce qu'il a mis en application en envahissant les champs de compétence du Québec. Récemment, il l'a fait sur la question du logement mais surtout en instituant une assurance-dentaire pour les personnes âgées, une assurance bien populaire au Québec…
Pendant ce temps au Québec, c'est « back to the future » avec un gouvernement caquiste qui fait de l'aide aux entreprises le pivot de son action. Élu sur un discours nationaliste qui a vite montré ses limites, ce gouvernement en est réduit à protester contre les empiètements du fédéral et cela, même concernant des initiatives profitables à la population. Son attitude ressemble à s'y méprendre à celle du gouvernement Duplessis. La boucle serait-elle bouclée ? Serions-nous en fin de cycle… mûrs pour une nouvelle révolution peut-être pas si tranquille qui donne toute sa place à un État québécois indépendant soucieux en priorité du bien commun. C'est tout le bien qu'on se souhaite.
Le livre de Michel Roche ne se contente pas d'analyser l'évolution du Québec des 80 dernières années ce qui serait déjà beaucoup. Il embrasse beaucoup plus large dès le début en retournant aux écrits de Karl Marx sur le nationalisme. Il montre que ce dernier était loin d'y être hostile et le voyait comme une étape non suffisante mais parfois essentielle dans la prise en mains par les peuples de leur destin. On est loin de la vision réductrice de la répétition un peu mécanique du fameux « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Comme dirait l'autre : encore faut-il avoir un pays. Marx l'avait bien compris.
Je termine en signalant une autre contribution importante du livre de Michel Roche qui consiste à analyser les cas écossais et catalans en démontrant le lien entre nationalisme et politiques sociales. Dans ces deux derniers cas, la relation joue à l'inverse tout simplement parce que ce sont les instances « fédérales » qui exercent le pouvoir exclusif en matière de protection sociale. C'est ainsi que Michel Roche montre sur un temps long que les épisodes de montées d'aspiration à l'indépendance dans ces deux pays en devenir sont directement liées à des coupures dans la protection sociale par le gouvernement central.
En ces temps où le néolibéralisme montre de sérieux signes l'essoufflement, le livre de Michel Roche est une contribution majeure dans les débats sociaux et politiques québécois. Que tous les indépendantistes en prennent bonne note : la réalisation de l'indépendance implique le retour en force du « commun". C'est ce que les pionniers indépendantistes avaient compris.
« La question nationale, une question sociale » Essai sur la crise du mouvement indépendantiste québécois, Michel Roche, Éditions Liber
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous avons besoin des Éditions sociales, les Éditions sociales ont besoin de nous ! »

TRIBUNE. Des universitaires et auteurs appellent à soutenir financièrement cette maison d'édition historique, associée à La Dispute, qui a su préserver son indépendance au milieu de grands groupes capitalistes.
Tiré du site du CADTM. Photo : Malediction_Wolf, Pixabay, CC
Comme d'autres espaces indépendants où se construit une pensée critique, les Éditions sociales (ES) traversent actuellement une période difficile. Longtemps liées au Parti communiste français, les ES ont été l'un des éditeurs politiques majeurs du XXe siècle. Elles ont aussi bien diffusé des outils de formation militante que l'œuvre de Marx et d'Engels, la première anthologie de textes de Gramsci en français, le travail de grands historiens marxistes, ou encore, avec une collection sans équivalent comme « les classiques du peuple », à faire connaître à un public large des œuvres marquantes du patrimoine littéraire et intellectuel.
Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité.
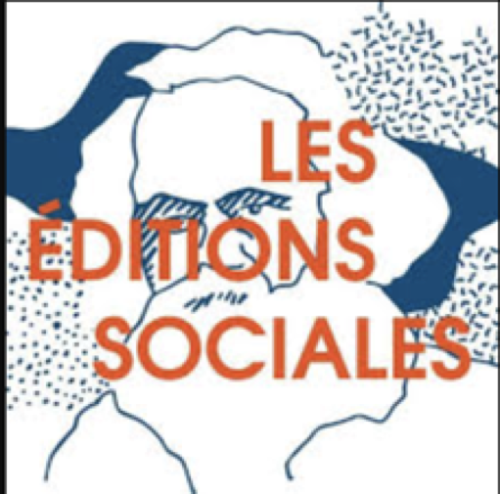
Une nouvelle vie a commencé pour les ES à la fin des années 1990, après de rudes batailles pour leur indépendance politique et leur autonomie économique. La pensée de Marx et d'Engels sert toujours de boussole mais elle est désormais travaillée sans exclusive théorique ou politique, et en réunissant différentes sensibilités intellectuelles. Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité. En lançant de nouvelles collections, comme la collection de petits livres de pédagogie « Découvrir » et en redynamisant d'ambitieux projets, tels que la GEME (Grande Édition Marx-Engels) qui vise à publier l'ensemble des textes de Marx et d'Engels dans de nouvelles traductions à partir de l'édition de référence allemande, les Éditions sociales visent à transmettre une histoire et des expériences issues du mouvement ouvrier et à ouvrir à la diversité des débats des marxismes contemporains.
Pour nous qui sommes intéressé⋅es ou impliqué⋅es dans ces débats, les ES sont un espace irremplaçable, un bien commun pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre la marche du monde. Car il ne s'agit nullement de conserver un héritage comme des antiquités précieuses dans un musée, mais, au contraire, de forger des outils pour penser au présent le travail, les rapports de domination, l'écologie et les oppressions racistes ou sexistes, dans la perspective de leur dépassement, donc de l'émancipation.

C'est pourquoi nous appelons à soutenir les Éditions sociales, en participant à la campagne de dons et en faisant connaître le plus largement possible leur travail éditorial et leurs publications.
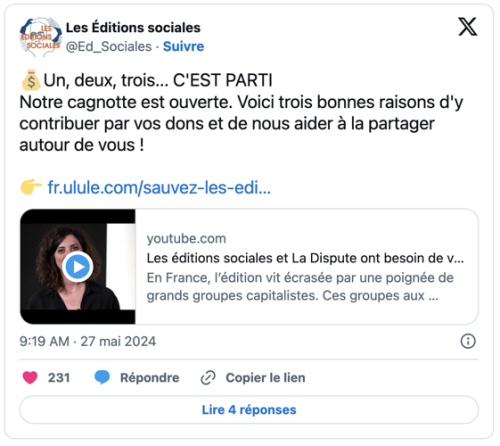
Signataires
Bruno Amable, Économiste
Éric Aunoble, historien
Étienne Balibar, Philosophe, Université de Paris-Nanterre
Laurent Baronian, Économiste, enseignant-chercheur au CEPN
Jean Batou, Historien, auteur
Philippe Bazin, Artiste
Marc Belissa, Maître de conférences émérite Paris Nanterre
Judith Bernard, Enseignante et metteuse en scène
Vincent Berthelier, Maître de conférence en littérature
Alain Bertho, Professeur émérite d'Anthropologie
Michel Biard, Historien
Jacques Bidet, Philosophe
Alexia Blin, Directrice de coll
Patrick Bobulesco, Libraire du Point du Jour
Stéphane Bonnéry, Professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-VIII
Saliha Boussedra, Docteure en philosophie
Sebastian Budgen, Directeur éditorial Verso Books
Antony Burlaud, Directeur de collection
Juan Sebastian Carbonell Gerpisa, École Normale Supérieure Paris-Saclay, IDHES
Yves Clot, Professeur émérite en psychologie du travail au CNAM,
Annick Coupé, Syndicaliste et altermondialiste
Pierre Cours-Salies, Sociologue
Thomas Coutrot, Économiste
Alexis Cukier Philosophe, auteur
Laurence De Cock, Historienne
Pauline Delage, Sociologue
Thierry Discepolo, Éditeur Agone
Étienne Douat, Sociologue
Yohann Douet, Directeur de coll, auteur, docteur en philosophie
Laurent Douzou, Historien
Jean-Numa Ducange, Professeur des Universités, historien, membre de la GEME
Cédric Durand, Économiste
Anaïs Enjalbert Riot, Éditions
Marouane Essadek, Enseignant
Jules Falquet, Département de philosophie, Université Paris 8 St Denis
Juliette Farjat, autrice, philosophe
Caroline Fayolles, Maîtresse de conférences en histoire
Franck Fischbach, Philosophe
Quentin Fondu, Directeur de collection
Guillaume Fondu, Directeur de collection
Clément Fradin, Traducteur, germaniste
Camille François, Sociologue
Tony Fraquelli, Syndicaliste CGT cheminot
Bernard Friot, Sociologue, auteur
Lise Gaignard, Psychanalyste
Davide Gallo Lassere, Philosophe
Isabelle Garo, Autrice et directrice de collection, enseignante en philosophie
Franck Gaudichaud, Auteur, historien
Olivier Gaudin, Enseignant et chercheur à l'École de la nature et du paysage, responsable éditorial des Cahiers de l'École de Blois
Vincent Gay, Sociologue
Romaric Godin, Économiste, journaliste Mediapart
Paul Guillibert, Philosophe
Florian Gulli, Professeur agrégé de philosophie
Stéphane Haber, Philosophe
Jean-Marie Harribey, ancien maître de conférences à l'Université de Bordeaux, HDR en sciences économiques.
Samuel Hayat, Chargé de recherche CNRS, Sciences Po
Laurent Hebenstreit, Fondateur des éditions Démopolis
Vincent Heimendinger, Directeur de collection
Liem Hoang Ngoc, Économiste
Chantal Jaquet, Philosophe
Anne Jollet, Maîtresse de conférences Université de Poitiers, Coordonnatrice de la rédaction des Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique
Razmig Keucheyan, Sociologue
Pierre Khalfa, Économiste, Fondation Copernic
Aurore Koechlin, Sociologue
Stathis Kouvélakis, Philosophe, auteur
Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire
Jean Jacques Lecercle, Professeur honoraire des universités
Marion Leclair, Directrice de collection, Maîtresse de conférence en civilisation britannique
Vincent Legeay, Maître de conférences en philosophie
Simon Lemoine, Philosophe, chercheur indépendant
Frédéric Lordon, Philosophe
Michael Lowy, Sociologue, philosophe, auteur
Sandra Lucbert, Écrivaine
Christophe Magis, Sociologue des médias
Elsa Marcel, Avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Roger Martelli, Historien, auteur
Christiane Marty, Fondation Copernic, chercheuse
Frédéric Monferrand, Philosophe
Olivier Neveux, Professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre
Ugo Palheta, Sociologue, auteur
Stefano Palombarini, Maître de conférence en économie à l'Université Paris 8
Evelyne Payen-Variéras, Enseignante-chercheuse
Clément Petitjean, Sociologue
Dominique Plihon, Économiste, professeur émérite, Université Sorbonne Paris Nord
Allan Popelard, Enseignant et directeur de collection aux Éditions Amsterdam
Raphaël Porcherot, Docteur en sciences économiques et traducteur
Stefanie Prezioso, Professeure d'histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne
Stéfanie Prezioso, Historienne
Jean Quétier, Auteur des éditions sociales
Makan Rafatdjou, Architecte-urbaniste
Matthieu Renault, Professeur de philosophie, Université Toulouse – Jean Jaurès
Emmanuel Renault, Philosophe
Haude Rivoal, Sociologue
Gwendal Roblin, Doctorant en sociologie, GRESCO, Université de Poitiers
Daniel Rome, Enseignant retraité, militant altermondialiste
Lucie Rondeau du Noyer, Historienne
Grégory Salle, Chercheur en sciences sociales
Catherine Samary, Économiste altermondialiste
Raphaël Schneider, Fondateur de Hors-série
Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe
Maud Simonet, Sociologue au CNRS (IDHES)
Alexandra Sippel, Enseignante-chercheuse et traductrice
Omar Slaouti, Militant antiraciste
Daniel Tanuro Auteur écosocialiste
Jean Pierre Terrail, Sociologue, auteur
Eric Toussaint, Porte-parole CADTM international
Enzo Traverso, Historien
Mathieu Van Criekingen, Enseignant-chercheur en géographie et études urbaines, Université libre de Bruxelles
Bernard Vasseur, Philosophe
Françoise Verges, Politologue, militante décoloniale
Nicolas Vieillecazes, Éditeur aux éditions Amsterdam
Christiane Vollaire, Philosophe
Xavier Wrona, Riot Éditions
Karel Yon, Sociologue
La Fabrique éditions
Fondation Gabriel Péri
Les éditions Syllepse
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Occuper le monde : vers le plus grand mouvement international jamais connu ?

Des occupations partout. En quelque deux semaines, le mouvement étudiant lancé aux États-Unis s'est répandu dans le monde, prenant une ampleur encore inédite. Au point que la liste des universités mobilisées semble impossible à tenir : il y a eu, à l'heure où nous écrivons ces lignes, des occupations ou tentatives d'occupations dans des dizaines de pays, sur tous les continents (1). Et en Belgique, bien sûr, dorénavant dans toutes les grandes universités du pays : ULB et VUB, Gand, Anvers, Leuven, Liège, Louvain-la-Neuve.
Tiré de Gauche anticapitaliste
20 mai 204
Par David Lhotellier
Dans certains pays, les autorités tentent la méthode douce ; dans d'autres, elles répriment frontalement. Mais quelle que soit le degré de violence, les recettes sont les mêmes : faire passer les étudiant∙es pour une minorité radicalisée, et les accuser d'antisémitisme, voire de soutien au terrorisme.
La Palestine est-elle le nouveau Viêtnam ?
Le propre des mouvements de solidarité internationale, c'est qu'ils sont durs à lancer, étant donné la difficulté de s'intéresser à ce qui se passe à l'autre bout du globe (on aurait bien sûr aimé voir des mobilisations semblables pour soutenir les peuples ukrainien, iranien, syrien, yéménite, soudanais, congolais ou encore mapuches) ; mais qu'une fois démarrés, rien ne les arrête, et certainement pas les frontières. Jamais encore un mouvement ne s'était propagé aussi vite dans autant de pays : si l'on veut chercher une comparaison sensée, la seule qui vienne en tête concerne sans doute mai 1968, dont on oublie souvent qu'il a en réalité commencé le 22 mars, par une occupation en soutien à des étudiants arrêtés lors d'une manifestation contre la guerre au Viêtnam. Rares mais puissantes, ces déflagrations rappellent aux militant∙es révolutionnaires une vérité dont on pourrait, le reste du temps, douter : frapper et s'organiser ensemble, à l'échelle internationale, est tout à fait possible, et c'est certainement le seul moyen de faire vaciller une classe capitaliste qui, elle, n'a aucun mal à se jouer des frontières quand ça l'arrange.
Frapper et s'organiser ensemble, à l'échelle internationale, est tout à fait possible, et c'est certainement le seul moyen de faire vaciller une classe capitaliste qui, elle, n'a aucun mal à se jouer des frontières quand ça l'arrange.
Les étudiant∙es, généralement bien connecté∙es et souvent mobiles, ont toujours eu une longueur d'avance dans ce domaine. Mais pour créer des rapports de force plus puissants, il faut bien sûr des mobilisations plus larges : en 1968, ce sont effectivement les étudiant∙es qui ont lancé les premières étincelles, mais les victoires n'ont été arrachées que quand dix millions de travailleur∙ses se sont mis∙es en grève. Toutes proportions gardées, le mouvement aujourd'hui en cours présente des signes d'un tel effet d'entraînement : depuis octobre, les manifestations ont atteint des proportions gigantesques dans de nombreux pays, et les quartiers populaires sont fortement mobilisés contre un impérialisme qu'ils perçoivent (à raison) comme l'autre visage du racisme d'État auquel ils font face à domicile. Et dans le reste de la société, la colère qui couve comme des braises depuis sept mois se matérialise de plus en plus par des actions spontanées et inattendues, comme la grève de la VRT durant la prestation de la candidate israélienne à l'Eurovision. À quand une grève générale contre l'impérialisme ?
On en parle à l'AG
En attendant, les étudiant∙es occupent leurs universités. Et c'est déjà pas mal.
Certes, par rapport à une grève, la capacité d'une telle mobilisation à bloquer des flux financiers, et à faire pression sur telle ou telle entité en l'attaquant par le portefeuille, est assez limitée. Mais ce sont des mobilisations visibles, symboliquement fortes, et ce n'est pas rien, vu la dépendance d'Israël à son softpower et à ses soutiens diplomatiques. Et surtout, elles donnent aux occupant∙es un espace pour s'organiser – et du temps, là où le rapport de forces permet le blocage des cours et l'annulation des examens.
La question clef est alors de savoir si elles seront utilisées comme telles, si elles pourront être le point de chute d'un mouvement tourné vers l'extérieur, ou bien si elles se refermeront sur elles-mêmes, pensées comme une fin en soi et plus comme un outil de lutte. C'est ce qui a tué, entre autres, la mobilisation étudiante de 2018 en France, qui avait pris une forme comparable : alors que la moitié des universités du pays étaient bloquées, les manifestations se sont vidées et, progressivement, plus personne n'a vu d'intérêt à se joindre aux occupations en-dehors des personnes qui les habitaient de manière permanente. Et le gouvernement a finalement pu cueillir les dernier∙es d'entre elleux après avoir joué l'usure. Rester tourné∙es vers l'extérieur, ne pas voir l'occupation comme une fin en soi : voilà le mot d'ordre à garder en tête. Car il faut dire que la tentation est forte.
Il faut se figurer l'ambiance : ces lignes sont écrites dans la salle où ont lieu d'ordinaire les conseils d'administration de l'ULB, sur une immense table ovale. Le design, sobre et chic, est à des années-lumière de nos auditoires délabrés. Mais le lieu, désormais tapissé de drapeaux palestiniens et d'affiches reprenant des slogans décoloniaux, féministes ou révolutionnaires, a été converti en une salle d'étude silencieuse, où les étudiant∙es mobilisé∙es qui en ont besoin révisent leurs examens. Et, la nuit, elle sert de grand dortoir – les JAC ont installé leurs matelas au milieu, dans la découpe centrale de la table. Ailleurs dans le bâtiment, on trouve une chambre non-mixte, un garde-manger, une salle de prière pour les pratiquant∙es de diverses religions… et bien sûr l'auditoire dans lequel, tous les jours, se tiennent les assemblées générales, où se discutent aussi bien l'orientation stratégique du mouvement que l'organisation de la vie en communauté sur place.
Le double sens du mot « occupation » amène régulièrement à des situations étranges. Alors qu'il était jusque-là utilisé, dans de nombreux slogans, en référence à l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël, il est devenu en même un mot porteur d'émancipation, lorsqu'il fait référence à la forme prise par la lutte. À travers « l'occup' », les étudiant∙es se réapproprient un lieu qui a bien souvent été, pour elleux, un lieu de violence et de domination. La notion de propriété privée s'efface sans même qu'on le remarque : chacun∙e garde évidemment son téléphone, son sac de couchage et sa brosse à dents (autant de biens pour lesquels il y a une évidente notion de propriété d'usage), mais il ne viendrait à personne l'idée que le stock de pommes apporté par le voisin devrait appartenir à quelqu'un, ou que telle personne pourrait priver telle autre du droit de s'y servir, autre que la communauté des occupant∙es toute entière, réunie en assemblée générale, ou l'une de ses émanations. En nous obligeant à nous organiser nous-mêmes, l'occupation ouvre une parenthèse dans le capitalisme, et une fenêtre sur un possible après.
Il ne s'agit pas de faire croire que c'est un petit paradis. La pratique de la démocratie directe nécessite un long apprentissage, qui nous manque à tou∙tes cruellement : cela peut rendre les assemblées générales longues, les processus décisionnels peu efficaces, même si nous progressons un peu chaque jour. L'occupation constitue aussi un formidable lieu de libération de la parole, ce qui est salvateur, mais jette en même temps une lumière crue sur la souffrance et les oppressions qui traversent notre société – et qui ne s'arrêtent pas à nos murs, même si elles y sont activement combattues.
Ce mouvement a le potentiel d'obtenir une réelle victoire face à l'État d'Israël, en l'isolant grâce au boycott académique, culturel, diplomatique et économique
Pas facile tous les jours, mais indubitablement émancipatrice : l'occupation est une petite révolution. Et comme toutes les révolutions, elle se propage ou elle meurt. Ce mouvement a le potentiel d'obtenir une réelle victoire face à l'État d'Israël, en l'isolant grâce au boycott académique, culturel, diplomatique et économique ; et en même temps, de redessiner considérablement les rapports de forces et le savoir-faire militant dans tous les pays où il se déploie, en donnant un nouveau souffle aux organisations et aux perspectives révolutionnaires. De là à aboutir à une révolution mondiale, nous n'y sommes peut-être pas encore. Mais nous aurons au moins fait un petit pas de plus sur ce chemin vers un monde nouveau, où les frontières, l'impérialisme, le colonialisme, l'extrême droite et le génocide auront été renvoyés à leur place : dans les poubelles de l'Histoire.
Crédit photo : Université populaire de Bruxelles (Gauche anticapitaliste (CC BY-NC-SA 4.0)
Print Friendly, PDF & Email
Notes
1. Une carte interactive des mobilisations est donnée dans cet article (en castillan) : https://www.elsaltodiario.com/palestina/universidades-salamanca-rioja-se-suman-300-acampadas-genocidio
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La fin de la croissance économique approche

Le réveil risque d'être brutal car le rêve de la croissance économique infinie s'évanouit. La chose est entendue maintenant aussi bien dans certains cercles hétérodoxes (pas tous hélas !) que dans ceux plus orthodoxes (pas beaucoup encore !). On fait le point ici sur deux séries de travaux qui rompent avec la doxa dominante qui tend à faire accroire à un capitalisme vert sous la dénomination d'une croissance verte.
Tiré d'À l'encontre.
1. Vers la postcroissance[1]
Un demi-siècle de capitalisme néolibéral a poussé à l'extrême les deux contradictions qui lui sont inhérentes : la dévalorisation de la condition du travail, pourtant seule source de la valeur, et la dégradation de la nature, les deux ensemble conditions de la richesse, selon les mots de William Petty et de Karl Marx[2]. Ces deux contradictions jumelées mènent à l'épuisement des gains de productivité du travail d'un côté et au réchauffement climatique et à l'épuisement de la biodiversité de l'autre. Les choses sont claires : poursuivre le rêve de l'accumulation infinie est une impasse. Au moins trois livres qui viennent d'être publiés remettent en question de nouvelle manière le dogme de la croissance économique éternelle.
Il faut donc prendre acte que le débat sur la post-croissance est posé. Sans tomber dans une chimère comme celle de la croissance verte ou dans une décroissance uniforme sans transition. Post-croissance a un sens s'il s'agit de sortir de la logique du capitalisme que la croissance sert : bannir le critère du taux de profit devient la priorité et non pas en finir avec l'indicateur PIB. C'est la croissance de ce dernier qui est une illusion, ce n'est pas le PIB lui-même qui donne la somme des revenus bruts annuels produits dans l'économie. Aussi, c'est le sous-titre du livre de l'économiste britannique du développement Tim Jackson, Post-croissance (Actes Sud, 2024) qui est important : Vivre après le capitalisme.
Une institution-clé doit être mise en œuvre pour amorcer ce passage : la planification écologique. Mais plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, l'instauration d'un débat démocratique pour décider des besoins à satisfaire prioritairement. Ensuite, dresser des comptabilités matières sur les ressources disponibles et à sauvegarder. Mais là se loge la principale difficulté : la comptabilité « en nature » ne se substitue pas à la comptabilité monétaire, comme le croient l'économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan dans Comment bifurquer, Les principes de la planification écologique (La Découverte, 2024). Dans une économie post-capitaliste, où subsistera une division du travail importante, il faudra comptabiliser l'amortissement des équipements, les consommations intermédiaires de matières premières et d'énergie et les salaires. Les prix seront donc nécessaires, même si leur mode de fixation ne découlera pas exclusivement du marché parce qu'ils seront, au moins partiellement, administrés.
Et cela n'a rien à voir avec l'illusion de ce que les économistes libéraux appellent « capital naturel » auquel il faudrait donner un prix, comme si la nature avait une valeur économique intrinsèque. Cette idée trop fréquemment colportée par les mouvements écologistes, croyant bien faire, est le leitmotiv des institutions internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, cette dernière cherchant à se disculper d'avoir diligenté les politiques productivistes. Cette notion de capital naturel est parfois reprise par des experts tout à fait conscients de la nécessité de la planification, tels les économistes Michel Aglietta et Étienne Espagne dans Pour une écologie politique, Au-delà du Capitalocène (Odile Jacob, 2024), mais en oubliant le caractère incommensurable des écosystèmes à quoi que ce soit de produit par l'Homme, c'est-à-dire qui est inestimable[3].
2. Le changement climatique fera baisser la production
Une étude du National Bureau of Economic Research (NBER), menée par Adrien Bilal et Diego R. Känzig, respectivement de l'Université de Harvard et de l'Université Northwestern, évalue l'impact macroéconomique mondial du changement climatique[4]. Prenant à rebours les évaluations traditionnelles aboutissant à chiffrer à hauteur de seulement à 1 à 3 % la réduction de la production mondiale à cause d'une hausse de 1 °C de la température mondiale, ils aboutissent à des impacts « six fois plus importants », c'est-à-dire 12 % de produit brut mondial en moins au bout de six ans.
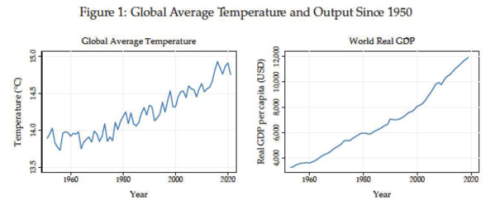
Notes : La figure montre l'évolution de la température moyenne mondiale, calculée à partir des données d'anomalie de la température mondiale et de la climatologie correspondante de la NOAA, dans le graphique de gauche, et l'évolution du PIB réel mondial par habitant (en 2017 USD) calculée à partir des données PWT dans le graphique de droite.
Bilal et D.R. Känzig, p. 9
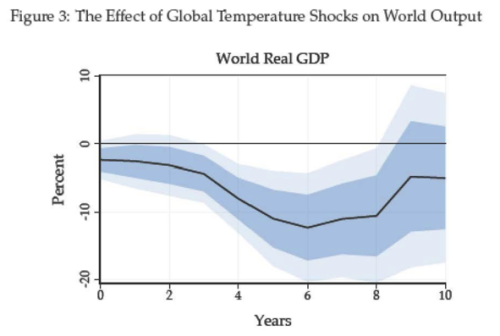
Notes : La figure montre les réponses impulsionnelles du PIB réel mondial par habitant à un choc de température mondial, estimées sur la base des dates de récession retenues par la Banque mondiale (note 2 p. 12)). La ligne continue est l'estimation ponctuelle et les zones ombrées foncées et claires sont les intervalles de confiance de 68 et 90 %, respectivement.
Bilal et D.R. Känzig, p. 13.
Comment ces auteurs parviennent-ils à une évaluation bien plus pessimiste que les études antérieures, notamment celle fameuse de Nordhaus[5] ? Parce qu'ils étudient l'impact d'une hausse de la température moyenne mondiale au lieu de celui des hausses de températures locales, c'est-à-dire dans un pays ou une région donnés. Ils expliquent :
« Nous étudions l'impact de ces chocs sur la probabilité d'événements météorologiques extrêmes, tels que des températures extrêmes, des vitesses de vent extrêmes et des précipitations extrêmes. […] Les chocs thermiques locaux entraînent une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême. Cependant, les chocs thermiques mondiaux entraînent une augmentation nettement plus importante du nombre de jours de chaleur extrême. Le contraste est encore plus marqué pour les précipitations extrêmes et la vitesse extrême du vent : les chocs de température globale prévoient une forte augmentation de leur fréquence, ce qui n'est pas le cas des chocs de température locale. Ces résultats sont cohérents avec la littérature géoscientifique : la vitesse du vent et les précipitations sont des résultats du climat mondial – par le biais du réchauffement océanique et de l'humidité atmosphérique – plutôt que des résultats de la distribution locale des températures. Étant donné que les événements climatiques extrêmes sont connus pour causer des dommages économiques, l'effet différentiel des chocs de température mondiaux par rapport aux chocs de température locaux sur les événements climatiques extrêmes peut expliquer les effets économiques beaucoup plus importants des chocs de température mondiaux. »[6]
L'étude de Bilal et Känzig a le mérite d'anticiper ce qu'il se passerait si l'élévation de la température atteignait 2 °C, voire 3 °C en 2100. Dans ce dernier cas, à cause des effets cumulatifs, le produit brut mondial baisserait de 50 % par rapport à ce qu'il aurait été sans changement du climat.
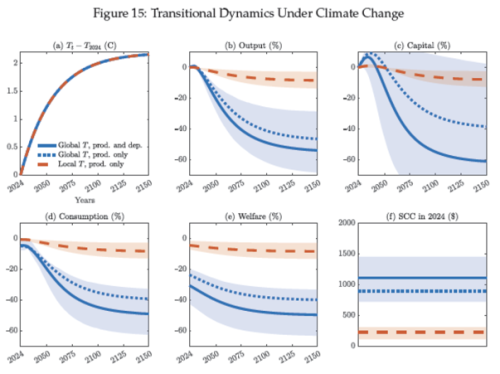
Notes : La figure montre la dynamique de transition de notre modèle estimé dans le cadre de notre scénario où le monde se réchauffe de 3°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100. Les lignes continues bleues représentent la dynamique de transition lorsque nous estimons le modèle sur la base des chocs de température mondiaux, ainsi que les intervalles de confiance à 68 % (bleu ombré). Les lignes bleues en pointillé représentent la dynamique de transition lorsque nous n'utilisons que les dommages causés à la production par les chocs de température mondiaux. Les lignes rouges en pointillé représentent la dynamique de transition lorsque nous utilisons uniquement les chocs de productivité estimés en fonction des chocs de température locaux, ainsi que les intervalles de confiance à 68 % (en rouge ombré). Intervalles de confiance basés sur 1000 tirages bootstrap de production, de capital et de température.
Bilal et D.R. Känzig, p. 40.
Mesuré en termes de bien-être, l'impact du changement climatique est considérable, même en ne prenant en compte que la consommation qui baisserait autant que la production :
« Cette baisse substantielle de la consommation se traduit par une importante perte de bien-être. Le graphique (e) montre que l'impact du changement climatique sur le bien-être équivaut à une perte de bien-être de 31 %, en pourcentage équivalent de consommation. Cette perte de bien- être dépasse l'impact sur la consommation, car les ménages ne tiennent pas compte des baisses futures de la consommation, mais les valorisent également. Comme la température continue d'augmenter, le bien-être continue de diminuer et atteint une perte de 52 %. Nos résultats indiquent que l'impact du changement climatique est considérable. En termes de bien-être, le coût du changement climatique est 640 fois supérieur au coût des cycles économiques, ou dix fois supérieur au coût du passage des relations commerciales actuelles à une autarcie complète. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est qu'en termes de production, de capital, de consommation et donc de bien-être, le changement climatique est comparable, en termes d'ampleur, à l'effet d'une guerre majeure sur le plan national. Cependant, le changement climatique est permanent. Ainsi, les pertes liées à la vie dans un monde avec changement climatique par rapport à un monde sans changement climatique sont comparables au fait de mener une guerre majeure au niveau national, et ce pour toujours. »[7]
Parmi les facteurs qui expliquent la perte de production et de bien-être, il y a l'augmentation considérable du coût social du carbone qui est de l'ordre de « 1056 dollars par tonne de dioxyde de carbone (tCO2) […] six fois supérieure à la limite supérieure des estimations existantes »[8]. Si la température augmentait de 5 °C en 2100, la perte de bien-être atteindrait plus de 60 %[9].
Certes, le modèle d'impact du changement climatique à travers le monde de Bilal et Känzig est bâti sur une fonction de production Cobb-Douglas avec une productivité totale des facteurs (c'est-à-dire ici le progrès technique) dépendant du temps, fonction dont on connaît les graves limites. Ce qui, peut-être, permet au chef économiste de TotalEnergies, Thomas-Olivier Léautier, de déclarer : « Cette étude permet de réconcilier la littérature économique néoclassique avec la vision des scientifiques »[10].
Le chef économiste de TotalEnergies aurait dû lire attentivement les auteurs :
« Enfin, notre article alimente le débat de longue date sur la question de savoir si les modèles d'évaluation intégrée sont bien adaptés pour représenter le coût du changement climatique (Nordhaus, 2013 ; Stern et al., 2022). Notre article démontre que ces modèles ont historiquement produit des coûts faibles du changement climatique non pas tant parce qu'ils reposaient sur des bases incomplètes, mais plutôt parce qu'ils étaient calibrés sur des dommages économiques qui ne représentaient pas l'impact total du changement climatique. »[11]
L'étude de Bilal et Känzig vient à point nommé au moment où l'Union européenne défait le modeste Pacte vert qu'elle venait d'adopter, au moment aussi où le gouvernement français se réjouit de la diminution des émissions de gaz à effet de serre en France de 5,8 % en 2023, en oubliant de comptabiliser les émissions importées, et au moment enfin où le gouvernement fait voter à l'Assemblée nationale une loi sur l'agriculture qui envoie à la poubelle toute considération environnementale à la grande satisfaction de la FNSEA. La croyance en la possibilité d'une fuite en avant perpétuelle relève de l'aveuglement sinon du cynisme de classe. (Article publié sur le blog de Jean-Marie Harribey « L'économie par terre ou sur terre ? » le 29 mai 2024, blog d'Alternatives économiques. Nous profitons d'indiquer ici l'ouvrage de Jean-Marie Harribey qui doit paraître en août, En quête de valeur(s), Editions du Croquant)
Notes
[1] Cette première partie a été en largement publiée dans Politis, n° 1808, 2 mai 2024.
[2] K. Marx, Le Capital, Livre I, 1867, Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, tome I, 1965, p. 998-999.
[3] Recension de ces livres sur ce blog. Sur le caractère inestimable de la nature et des services écosystémiques, voir J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Fondements d'une critique socio-écologique de l'économie capitaliste, Les Liens qui libèrent, 2013, en libre accès ; et dans En quête de valeur(s), Paris, Éd. du Croquant, 2024.
[4] A. Bilal et D.R. Känzig, « The macroeconomic impact of climate change : Global vs local temperature », WP 32450.
[5] William D. Nordhaus, « An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases », Science, vol. 258, 20 november 1992, p. 1316-1319.
[6] A. Bilal et D.R. Känzig., p. 44-45.
[7] Ibid, p. 40-41.
8] Ibid, p. 5.
[8] Ibid, p. 5.
[10] Propos rapportés par Anne Feitz, « Le réchauffement climatique freinera la croissance nettement plus que prévu », Les Échos, 28 mai 2024.
[11] A. Bilal et D.R. Känzig, p. 7.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’alimentation et la crise climatique

Il est impossible de lutter contre la crise climatique sans repenser la manière dont nous produisons et consommons les aliments. Le système alimentaire, responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est un facteur clé du changement climatique, mais en subit également les conséquences : les populations sont confrontées à des difficultés croissantes dans la pratique de l'agriculture, de l'élevage et dans l'accès à l'alimentation.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il faut de toute urgence transformer nos systèmes alimentaires pour nous adapter. Mais pour ce faire, il faut bien comprendre quel est le problème et quelle est la solution.
Dans cette nouvel article, GRAIN désigne les coupables et les solutions en matière d'alimentation et de crise climatique.
Alimentation et crise climatique : quel est le problème ? Quelle est la solution ?
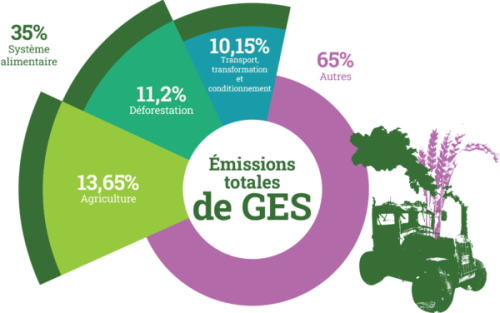
Le système alimentaire industriel est l'un des facteurs clés du changement climatique : Le système alimentaire industriel est responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La majeure partie de cette pollution provient de l'élevage intensif de bétail pour la viande et les produits laitiers, de l'énorme gaspillage de nourriture, de notre dépendance au commerce mondial plutôt qu'aux aliments d'origine locale, de l'accaparement des terres et de la déforestation pour l'expansion de grandes plantations, et de l'utilisation massive de pesticides et d'engrais chimiques [2].

L'alimentation est un pouvoir : Ce n'est pas la faute des agricultrices et des agriculteurs. C'est celles des entreprises. Ce sont elles qui gèrent le système alimentaire industriel en fonction de leurs propres intérêts financiers. Non seulement les lois, réglementations et subventions renforcent le système alimentaire industriel, mais en outre l'influence des entreprises sur les gouvernements et les agences internationales conduit à l'inaction en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises agroalimentaires ont recours au greenwashing et à de fausses solutions telles que les « compensations » pour se créer de nouvelles sources de revenus tout en sapant les vraies solutions que sont l'agroécologie et la souveraineté alimentaire.
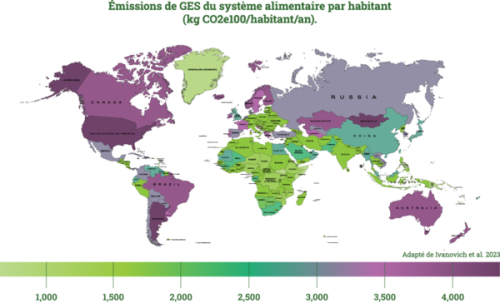
La géographie de l'injustice : La plupart des émissions de GES liées à l'alimentation proviennent de pays où l'agriculture est dominée par des exploitations productrices de viande et de produits laitiers et par des grandes plantations de cultures d'exportation, comme le soja, le maïs hybride et le palmier à huile. Le Brésil, les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande en fournissent des exemples. Ces territoires produisent des excédents qui alimentent la surconsommation de viande et d'aliments transformés, souvent par le biais du commerce international, tout en détruisant les systèmes alimentaires locaux et sains par l'accaparement des terres ou le dumping. Ce système est enraciné dans le colonialisme et perpétué par les accords dits de libre-échange, à tel point que le commerce représente aujourd'hui 20% des émissions liées à notre alimentation. Les exploitations agricoles industrielles représentent plus de 70% des terres agricoles et de l'eau utilisées dans le monde, alors qu'elles ne nourrissent que 30% de la population mondiale [2].
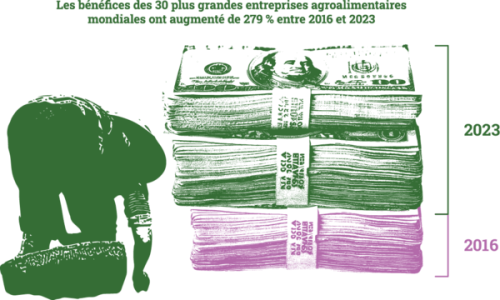
Des répercussions plus vastes : Le système alimentaire industriel est également l'une des principales causes de l'effondrement de la biodiversité, de la diminution et de la pollution des nappes phréatiques, de la dégradation des sols, de la déforestation et de l'exploitation de la main-d'œuvre. Il est une source majeure de problèmes de santé causés par les pesticides et la consommation d'aliments ultra-transformés. Et comme ce système est structuré de manière à générer des bénéfices pour les entreprises, on peut constater que des centaines de millions de personnes souffrent de la faim, alors même qu'on enregistre d'importants excédents alimentaires par ailleurs. Jour après jour, les entreprises étendent leurs activités et leurs marchés en détruisant et en criminalisant les systèmes alimentaires locaux, en empêchant les communautés d'utiliser leurs propres terres, leur eau, leurs semences et leurs pratiques traditionnelles et en les évinçant de leurs territoires. Elles laissent les populations à la merci d'investisseurs qui, depuis leurs lointaines salles de conférence, décident de ce qui est cultivé et de qui reçoit la nourriture. Les conséquences de cette situation s'aggravent à mesure que la crise climatique exerce une pression croissante sur la production alimentaire mondiale [3] [4].
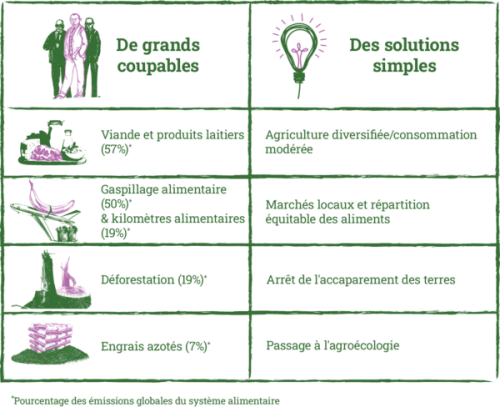
La solution réside dans la souveraineté alimentaire : Nous pouvons lutter contre le changement climatique en nous attaquant à la principale source d'émissions liées à l'alimentation, tout en veillant à ce que les populations aient un accès suffisant à des aliments nutritifs et à ce que les communautés puissent conserver leurs moyens de subsistance. En ce qui concerne la viande et les produits laitiers, nous devons mettre fin à l'élevage industriel à grande échelle et passer à des systèmes de production locaux et diversifiés qui fournissent à la population une quantité modérée de viande et de produits laitiers, en utilisant des sources d'alimentation locales. Nous pouvons réduire le gaspillage alimentaire et les kilomètres alimentaires en créant des liens plus directs entre les personnes qui produisent et celles qui consomment, en démantelant les accords de libre-échange et en veillant à ce que les réglementations et les politiques soutiennent les systèmes de production et de commercialisation agroécologiques gérés par les paysans et paysannes et qui les protègent contre le dumping des importations. Ces mesures, ainsi qu'un contrôle accru des territoires par les communautés, permettront également de freiner la déforestation. Enfin, nous pouvons éliminer progressivement les engrais chimiques grâce à une transition massive vers des pratiques agroécologiques qui renforcent la santé des sols et y maintiennent le carbone [5].
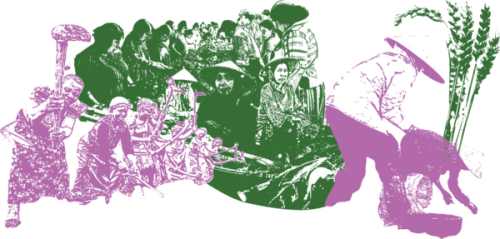
L'agroécologie paysanne dès maintenant : Des preuves scientifiques montrent que l'agroécologie est mieux à même d'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés dans la plupart des régions du monde que les stratégies de type « révolution verte »[6]. Ceci se traduit par un ensemble d'initiatives : rotations et mélanges de cultures, production végétale et animale intégrée, agroforesterie, intrants organiques, semences adaptées aux conditions locales, connaissances traditionnelles et bonnes stratégies de gestion des sols et de l'eau. Mais l'agroécologie est bien plus qu'un ensemble de techniques. Il s'agit d'une approche du travail agricole et de l'approvisionnement alimentaire ancrée dans le territoire, les connaissances et la culture. Elle doit être dirigée par les paysans et paysannes afin que le pouvoir et la vision restent entre les mains des petites exploitations, en particulier des femmes.

Confier le contrôle aux communautés : La lutte contre le changement climatique dans et à partir de nos systèmes alimentaires doit garantir que les communautés ont le contrôle de leurs territoires et que ce sont les producteurs et productrices alimentaires, et non les entreprises, qui définissent les politiques. De nombreuses initiatives sont actuellement prises par des mouvements sociaux, parfois soutenus par les autorités publiques, pour nous faire avancer dans la bonne direction. Les actions visant à briser la domination des entreprises dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, à renforcer les marchés locaux, à redistribuer les terres, à créer des réserves alimentaires et des systèmes de sécurité sociale alimentaire, à démanteler le régime commercial actuel, à promouvoir les systèmes de semences paysannes et à donner des moyens d'action aux personnes travaillant dans le secteur agroalimentaire sont autant d'étapes cruciales. En fin de compte, seul le contrôle communautaire des ressources, des systèmes et des connaissances nous permettra de disposer de systèmes alimentaires résilients face au changement climatique et fondés sur la justice.
Téléchargez et imprimez le nouveau poster sur l'alimentation et la crise climatique ici
[1] C. Costa et al. « Roadmap for achieving net-zero emissions in global food systems by 2050 », Scientific Reports, 12, 15064, 2022 :
https://doi.org/10.1038/s41598-022-18601-1 ;
UNEP, « Driving finance for sustainable food systems : A roadmap to implementation for financial institutions and policy makers, » avril 2023 :
https://www.unepfi.org/publications/driving-finance-for-sustainable-food-systems/
[2] ETC Group, « Small scale farmers and peasants still feed the world », janvier 2022 :
https://www.etcgroup.org/files/files/31-01-2022_small-scale_farmers_and_peasants_still_feed_the_world.pdf
[3] Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, « De l'uniformité à la diversité : Changer de paradigme pour passer de l'agriculture industrielle à des systèmes agroécologiques diversifiés », 2016 :
https://ipes-food.org/_img/upload/files/Uniformiteala%20Diversite_IPES_FR_Full_web.pdf
[4] Forbes' Global 2000.
[5] Xiaoming Xu et al., « Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods », Nature Food (2), 2021 :
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x ;
Jingyu Zhu, « Cradle-to-grave emissions from food loss and waste represent half of total greenhouse gas emissions from food systems », Nature Food (4), 2023 :
https://www.nature.com/articles/s43016-023-00710-3 ;
Mengyu Li et al., « Global food-miles account for nearly 20% of total food-systems emissions » Nature Food (3), 2022 :
https://www.nature.com/articles/s43016-022-00531-w ;
Stefano Menegat et al., « Greenhouse gas emissions from global production and use of nitrogen synthetic fertilisers in agriculture », Scientific Reports, 2022 :
https://www.nature.com/articles/s41598-022-18773-w
[6] Guy Faure et al, « What agroecology brings to food security and ecosystem services : a review of scientific evidence », Desira-Lift, février 2024,
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2024/02/DeSIRA-LIFT-Knowledge-brief4-Scientific-Evidence-for-Agroecology.pdf
https://grain.org/fr/article/7131-nouvelle-affiche-sur-l-alimentation-et-la-crise-climatique
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment aider les petits États insulaires ?

Victimes de l'utilisation mondiale des énergies carbonées, les petits États insulaires en développement cherchent désespérément la manière de faire comprendre au reste de la planète que leurs économies et même leurs survies sont en jeux dans la lutte au changement climatique.
Le 20 mai, un gigantesque iceberg de 380 kilomètres carrés appelé A-83 s'est détaché de la banquise en Antarctique. C'est le troisième événement de ce type au cours des quatre dernières années dans cette région. La perte continue de glace en Antarctique est une preuve tangible que le réchauffement climatique entraîne l'élévation du niveau de la mer. Les petits États insulaires sont en première ligne de ces impacts dévastateurs. Ce vêlage mettait donc la table pour la 4e Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (SIDS4), qui s'est tenue à Antigua-et-Barbuda du 27 au 30 mai. Son thème était, « Tracer la voie vers une prospérité résiliente ». Plus de 4000 participants et une vingtaine de dirigeants et ministres de plus de 100 pays s'y sont ainsi réunis. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a dénoncé lors de cette rencontre une situation obscène ou ces petits États insulaires en développement payaient pour la compétition entre les grandes économies et la soif de profits des industries fossiles.
En première ligne des crises mondiales
Il y a une quarantaine de petits États insulaires en développement (PEID) membres des Nations Unies. Une vingtaine d'autres sont associés à des commissions régionales [EN]. Principalement situées dans le Pacifique, l'Atlantique, les Caraïbes, la mer de Chine et l'océan Indien, ils totalisent environ 65 millions d'habitants, sur moins de 0,5 % de la surface du globe. Bien qu'ils contribuent à moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ils n'en sont pas moins en première ligne des crises mondiales créées par le changement climatique qui menacerait les trois quarts de leurs récifs coralliens. Non seulement les ouragans, les inondations et les sécheresses les touchent de manière disproportionnée, mais la montée du niveau de la mer pourrait même en faire disparaître plusieurs tels les archipels Tuvalu, de Nauru, des Kiribati, les îles Marshall et les Maldives.
Réduire les émissions de carbone
Le programme d'action adopté à Antigua-et-Barbuda met en lumière que les efforts de ces États insulaires seront vains sans une action urgente pour augmenter le financement climatique et mettre en œuvre l'Accord de Paris. La présidente des Îles Marshall, Hilda Heine, a déclaré lors de la rencontre qu'il fallait un changement radical dans la volonté politique, en particulier de la part des pays les plus développés du G20, de réduire les émissions de carbone. « C'est le début d'un sprint de 10 ans et nous espérons qu'il n'y aura pas de frein sur cette voie de la résilience partagée », a mentionné la Vice-secrétaire générale, Amina J. Mohammed, qui a affirmé que les perspectives de développement se sont détériorées ces quatre dernières années pour ces États insulaires. « Sans le soutien total de la communauté internationale, les conséquences pourraient être de très vaste portée pour eux ».
Une situation catastrophique
Non seulement ces pays disparaissent lentement sous les eaux, mais le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé lors de cette rencontre que l'architecture financière mondiale actuelle, qui n'est pas à la hauteur des attentes des pays en développement en général, l'est encore moins pour eux. Croulant sous les dettes, l'économie de plusieurs de ces petits États insulaires tournerait à vide en raison des conséquences du changement climatique. Une partie d'entre eux sont de plus exclus de l'aide internationale et des prêts préférentiels des banques de développement, car classés comme pays à revenu intermédiaire ou supérieur. La conséquence en est donc qu'ils doivent payer davantage pour le service de leur propre dette qu'ils n'investissent dans leurs soins de santé et l'éducation, nuisant ainsi à leur développement.
Mobiliser la justice internationale ?
Le Tribunal international du droit de la mer a émis le 21 mai dernier un avis consultatif sur le changement climatique et le droit international. Dans cet avis unanime, les membres de ce Tribunal ont confirmé la relation entre la mer et le climat. C'est la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS 2), qui a soumis cette demande en décembre 2022. Elle voulait clarifier les obligations des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) au sujet du changement climatique. Ce tribunal a conclu que les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère constituaient une pollution du milieu marin. Les États parties à la CNUDM auraient donc des obligations de diligence élevée pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire, maîtriser et prévenir la pollution marine due aux émissions de GES. Ceux-ci devraient aussi s'efforcer d'harmoniser leurs politiques à ce sujet.
La Cour européenne des droits de l'homme, avait rendu en avril un jugement contraignant contre la Suisse qui aurait manqué à son obligation de mettre en œuvre des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique. Ces cours internationales, et d'autres qui sont actuellement saisies à ce sujet, pourront-elles apporter plus de justice et de protection pour ces petits pays insulaires qu'ils n'en ont eu jusqu'à maintenant ?
Michel Gourd
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Corée du Sud : quand 28 000 travailleurs de Samsung enclenchent une grève...

En Corée du Sud, 20 % de la main-d'œuvre de Samsung s'est mis en grève pour la première fois de son histoire.
Tiré de l'Humanité
Publié le 29 mai 2024
Mis à jour le 29 mai 2024 à 18:21
Lina Sankari
Photo :Un drapeau national sud-coréen et un drapeau du groupe Samsung flottent devant le bâtiment Seocho de l'entreprise à Séoul.
© Kim Jae-Hwan/ZUMA-REA
C'est un nouveau vestige de la dictature qui est ébranlé en Corée du Sud, en l'espèce la répression antisyndicale. Pour la première fois dans l'histoire du géant de l'électronique Samsung, connu pour son autoritarisme, 28 000 travailleurs, soit 20 % de la main-d'œuvre, se sont mis en grève, ce 29 mai.
Faute de dialogue, le syndicat national de l'entreprise explique : « Nous ne pouvons plus supporter les persécutions contre les syndicats. Nous déclarons une grève face à la négligence de l'entrepriseà l'égard des travailleurs. » L'instance représentative, qui a accepté l'augmentation de salaires proposée par la direction, demande en outre un jour férié supplémentaire ainsi qu'un « système transparent de mesure de la prime de performance basée sur le bénéfice des ventes ».
La grève menée sur les jours de congé pourrait toutefois déboucher sur une grève générale. En 2019, le président et le vice-président du chaebol avaient écopé de dix-huit mois de prison pour répression antisyndicale.
Aux côtés de celles et ceux qui luttent !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Droit voisin : les représentants des journalistes et auteurs non journalistes en appellent au respect de la loi

Il y a 5 ans, la directive européenne DAMUN du 17 avril 2019 instituait un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse devant leur permettre d'obtenir une rémunération pour la réutilisation de leurs publications par les services de communication au public en ligne. Dans ce cadre, le législateur européen a explicitement prévu qu'une part de cette rémunération versée par les plateformes de l'internet aux éditeurs de presse, revienne aux journalistes et autres auteurs contribuant au contenu des publications de presse.
Depuis, une dizaine de contrats ont été conclus entre une partie de la presse française et des géants du numérique comme Google et Facebook. Ces accords, obtenus après de longues négociations au cours desquelles les éditeurs ont souvent critiqué le comportement et le manque de transparence des plateformes, ont permis à la presse de percevoir une nouvelle catégorie de revenus. Toutefois, les journalistes et autres auteurs qui créent le contenu des publications de presse, ne reçoivent toujours pas la part qui leur est due.
L'heure est donc plus que jamais aux négociations, loyales et de bonne foi, entre les éditeurs et les auteurs (journalistes et non journalistes) afin de déterminer la part de cette nouvelle redevance qui revient à chacun, que le législateur a voulu « appropriée et équitable » pour les auteurs.
Nombre d'éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs, alors même qu'ils avaient dénoncé le refus des plateformes d'accepter le partage de valeur que procure la mise en ligne d'articles de presse.
Ces négociations sont très difficiles et ont du mal à aboutir. Nombre d'éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs, alors même qu'ils avaient dénoncé le refus des plateformes d'accepter le partage de valeur que procure la mise en ligne d'articles de presse.
Nous avons participé à la lutte qui a permis d'obtenir ce nouveau droit au Parlement européen et salué la création de la loi qui l'instaurait. Mais six ans plus tard il est évident qu'elle ne permet pas en l'état d'atteindre son but. Les éditeurs s'étaient engagés à partager les sommes dès qu'ils les auraient touchés, ils sont trop nombreux à n'avoir pas tenu parole.
Nous saluons la proposition de loi du député Laurent Esquenet-Goxes visant à garantir l'effectivité des droits voisins de la presse. Nous encourageons aussi à ce qu'elle soit complétée par des obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l'égard des auteurs.
Ces raisons nous incitent à saluer la proposition de loi du député Laurent Esquenet-Goxes visant à garantir l'effectivité des droits voisins de la presse. Nous encourageons aussi à ce qu'elle soit complétée par des obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l'égard des auteurs. Cette transparence doit être due dès la négociation et pas seulement a posteriori, en reddition de comptes, et doit être assortie de sanctions en cas de non-respect.
A défaut d'obtenir des accords satisfaisants dans le cadre légal actuel, la loi devrait aussi être améliorée :
– en déterminant un taux de partage auteurs/éditeurs comme ceci existe par exemple en matière de licence légale radiophonique entre artistes de la musique et producteurs phonographiques, en l'occurrence 50/50
– et en prévoyant des garde-fous afin d'empêcher la diminution artificielle de l'assiette de rétrocession du droit voisin dans les accords conclus entre les éditeurs et les plateformes de l'internet.
– Pour une bonne poursuite des négociations, un encadrement législatif strict est nécessaire. Les incertitudes économiques, les dangers qui pèsent sur l'information et les nouveaux enjeux liés à l'intelligence artificielle imposent de réagir vite.
Il n'est pas concevable que les auteurs ne bénéficient pas d'une partie juste et équitable de la richesse qu'ils ont créée, c'est de la justice élémentaire !
Paris, le 27 mai 2024.
* SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes, SGJ-FO, Scam, ADAGP, UPP, Saif
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Que veut Nina ?

Le syndicat Sois comme Nina vient de publier une nouvelle déclaration qui précise, entre autres, sa stratégie syndicale et ses objectifs ainsi que ses plus récentes victoires.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La mission de Sois comme Nina est de protéger les droits des infirmières, du personnel soignant, des médecins et de tous les professionnels de la santé qui sont confrontés à l'humiliation, au harcèlement moral et au non-paiement des salaires.
Notre objectif est de créer un syndicat médical panukrainien qui sera en mesure de le faire encore plus efficacement, en utilisant tous les pouvoirs étendus qui lui sont accordés par la loi.
La nécessité d'un nouveau syndicat est apparue parce que les structures existantes ne remplissent souvent pas leur rôle principal ou ont partie liée de l'administration de l'hôpital.
Dans le contexte de la réforme des soins de santé, où les médecins-chefs se sont vus attribuer des pouvoirs énormes, un syndicat indépendant est pratiquement la seule garantie que les soignant.es recevront leur salaire et leurs primes bien méritées en temps voulu.
Nos valeurs
Outre l'assistance professionnelle, Sois comme Nina mène également des actions humanitaires. Cette action est dictée par nos valeurs centrées sur l'être humain. Notre mouvement a aidé des personnes socialement vulnérables, soutenu des familles avec enfants, organisé des activités de loisirs pour les familles et fourni des traitements médicaux abordables.
Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien notre action.
Vous pouvez le faire en adhérant officiellement à notre organisation, qui a déjà été rejointe par plus de 600 personnels soignants, ou en faisant un don.
Est-ce que les membres de Sois comme Nina sont assurés de recevoir ?
Un soutien juridique, médiatique et psychologique, la solidarité de personnes partageant les mêmes idées. Un soutien financier en cas d'urgence grave.
Qu'est-ce qui a déjà été fait ?
Sois comme Nina fédère des syndicats indépendants actifs et travaille à la création d'un syndicat indépendant pour l'ensemble de l'Ukraine. Parmi les membres du mouvement figurent Oleksiy Chupryna, responsable d'un syndicat indépendant de Myrhorod, qui est également cofondateur du mouvement, et Olha Turochka, responsable d'un syndicat indépendant de Shostka, qui a réussi à diriger la branche locale syndicale malgré les pressions exercées par les autorités locales. Le mouvement a également soutenu des travailleur.euses du secteur de la santé qui luttent contre les licenciements et les salaires impayés à Nizhyn, Pryluky, Zaporizhzhia et dans de nombreuses autres villes.
Sois comme Nina coopère également avec des syndicats polonais et internationaux.
L'année dernière, grâce au soutien de la Fondation Medico International, nous avons réussi à fournir un logement à 45 familles à Lviv, Kyiv et Balta pendant un an. 444 familles déplacées ont reçu des bons alimentaires et des médicaments.
Grâce aux 50 000 euros alloués par Medico, il a pu être payé des traitements coûteux à 48 médecins, dont 12 pour des remplacements d'articulations, des chirurgies cardiaques et oculaires. Par exemple, Sois comme Nina a payé l'opération d'une infirmière qui vivait avec des douleurs constantes depuis des années. Nous avons également acheté des médicaments coûteux pour des patients atteints de cancer et de maladies graves.
Victoires juridiques
Grâce à la coopération de Sois comme Nina avec l'avocate Roksolana Lemyk et Vitaliy Dudin, avocat et militant du Mouvement social, le mouvement est en mesure de fournir une assistance juridique qualifiée à ses militant.es et de les représenter devant les tribunaux.
Roksolana Lemyk a donné cinq exemples :
Une réunion avec le directeur d'un hôpital à Sambir, dans la région de Lviv. Suite à la conversation, la décision de réduire le nombre d'infirmières a été modifiée.
Dans une maternité de Lviv (IMO 3), malgré tous les obstacles posés par l'administration de l'établissement de santé, une organisation syndicale indépendante a été créée et une convention collective a été conclue dans l'intérêt des employé.es.
Dans ce même, une lettre de réclamation a modifié la décision qui approuvait l'horaire de travail d'une infirmière ne répondant pas aux intérêts de l'employée et, sur la base de demandes dûment exécutées, a payé des prestations de santé pour un congé régulier.
Au Centre régional de diagnostic clinique de Lviv, la procédure de règlement des différends a permis de résoudre la question du paiement des arriérés de salaire aux employé.es qui avaient été transféré.es du Centre régional d'État de diagnostic clinique et de traitement endocrinologique.
Une requête a été préparée et déposée dans l'intérêt d'un employé de l'hôpital municipal multidisciplinaire de Derazhnyanska dans l'Oblast de Khmelnytskyi (la décision n'a pas encore été prise).
Ainsi, de nombreux litiges sont résolus avant d'être portés devant les tribunaux grâce à des négociations collectives, des appels auprès de l'administration de l'hôpital et des autorités locales, et une publicité sur les médias sociaux et dans les médias. Cependant, il y a aussi des victoires judiciaires.
Par exemple, la réintégration de Natalia Yurenkova, une infirmière de la région de Lviv. Elle a été licenciée au début de l'année 2020, mais elle n'avait pas le droit d'être licenciée parce qu'elle élevait seule sa fille.
Une autre victoire a été la réintégration de Lyudmyla Pukha, une infirmière de Myrhorod. Devant le tribunal, elle a réussi à prouver qu'on ne lui avait pas proposé tous les postes vacants lorsqu'elle a été licenciée et qu'elle n'avait pas été réintégrée.
Sois comme Nina a accumulé suffisamment d'expérience et de force pour pallier de fait efficacement le secteur syndicat médical existant et parfois même le service public du travail. Le mouvement est ouvert à tous les professionnels de la santé. La principale condition attendue d'eux est leur volonté de se battre pour leurs droits.
Patrick Le Tréhondat
ENSU-RESU
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70869
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

#Metoo syndical : Un procès historique contre la parole de femmes syndicalistes Appel à la solidarité syndicaliste et féministe

Nous, militantes syndicalistes et féministes, en appelons à votre solidarité et à votre soutien pour notre camarade Christine, qui passe en procès pour diffamation les 30 septembre et 1er octobre 2024 à Paris.
Tiré de Entre les lignes et les mots
En 2016 et 2017, plusieurs militantes de l'Union Syndicale CGT ville de Paris sont harcelées et/ou agressées par des membres de leur organisation. Contre ces agressions physiques et sexuelles, le collectif Femmes Mixité du syndicat se réunit et mène plusieurs actions. Elles font face à une immense hostilité de certains militants. Christine est membre de ce collectif et co-secrétaire générale du syndicat CGT Petite Enfance de la Ville de Paris.
C'est elle qui fait, au congrès de l'UD CGT de Paris en 2020, le rapport des actions menées par le collectif, et c'est pour cette raison que Régis Vieceli, alors secrétaire général du syndicat CGT déchets et assainissement (FTDNEEA), porte plainte contre elle pour diffamation. (Pour en savoir plus : https://www.mediapart.fr/journal/france/270618/violences-et-agissements-sexistes-l-affaire-que-la-cgt-etouffee).
La Confédération CGT est elle aussi poursuivie en la personne de Philippe Martinez, alors secrétaire général, pour le travail d'enquête mené par la cellule de veille confédérale contre les violences sexuelles.
Ce procès en diffamation est une première dans l'histoire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein d'un syndicat.
Ce procès en diffamation est une démarche patriarcale de musellement de la parole des femmes et de leurs soutiens dans nos structures syndicales. Cette procédure-bâillon vise à punir celles qui ont parlé et exercer une pression telle, que le découragement l'emporte.
Christine ne doit pas être condamnée pour diffamation. Si elle l'était, la possibilité même de dénoncer et de combattre les violences sexuelles, dans les organisations syndicales et partout ailleurs, serait remise en cause.
Si la CGT (au travers de P. Martinez) était condamnée pour le travail de la cellule de veille, ce serait un très mauvais message pour toutes les OS qui tentent de faire sanctionner les militants machistes. L'ensemble des organisations syndicales est en effet confronté aujourd'hui à leur responsabilité pour prévenir, protéger les victimes et sanctionner les violences sexuelles perpétrées en interne (Voir les articles sur CFDT, FO, Solidaires, CFTC :https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/violences-sexuelles-les-syndicats-aussi)
Quel soutien des OS à Christine ?
Christine a été forcée de quitter la CGT, où elle militait depuis vingt ans, suite à cette affaire. Elle est aujourd'hui contrainte de se lancer dans des démarches juridiques coûteuses pour se défendre, alors qu'elle a été avec le collectif Femmes Mixité de l'US CGT Ville de Paris, une lanceuse d'alerte, pour obtenir de son organisation syndicale qu'elle assure la sécurité des syndiquées.
Les faits de violences sexistes commises contre les victimes directes remontent à 2016, soit plus de 8 ans. Chaque nouvelle attaque est une résurgence violente du traumatisme vécu, pour Christine comme pour toutes les victimes. S'attaquer à notre camarade, c'est s'attaquer à toutes les femmes de la CGT, comme de tous les syndicats, qui ont été, sont victimes ou soutiens de victimes de violences sexistes et sexuelles.
Comme nous l'exigeons auprès de nos employeurs, notre camarade devrait bénéficier d'une prise en charge globale et solidaire de tous les frais afférents à cette attaque en justice. La camarade ne doit pas, comme cela s'est déjà passé à FO récemment, payer les préjudices financiers et humains de violences qui n'auraient jamais dû exister. (cf article AVFT :https://www.avft.org/2024/04/30/lettre-ouverte-a-la-confederation-force-ouvriere/).
Le procès se tiendra au Tribunal correctionnel de Paris – Parvis du tribunal, 75017 Paris – le lundi 30 septembre à 13h30 et le mardi 1er octobre à 13h30.
Pour assurer une présence solidaire, nous appelons les OS à consacrer des moyens syndicaux pour participer à ce procès historique et formateur pour nos luttes. Toutes les organisations syndicales, avec en tête la CGT dont elle était membre, doivent la soutenir.
Exprimons notre soutien syndicalo féministe à notre camarade et notre détermination à combattre les violences sexistes et sexuelles dans nos organisations, en nous retrouvant sur place. Rejoignez- nous pour en savoir plus : resyfem@riseup.net
Résyfem, un réseau de militantes de la Cgt, de la Fsu, de Solidaires, de Fo, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France.
Paris, le 24 mai 2024
https://blogs.mediapart.fr/resyfem/blog/240524/metoo-syndical-un-proces-historique-contre-la-parole-de-femmes-syndicalistes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Étudiant·es, soignant·es, patient·es : ensemble contre les violences sexistes et sexuelles en santé !

Le monde de la santé, loin d'être épargné par les violences sexistes et sexuelles, en est au contraire un terreau particulièrement fertile. La culture du viol et l'omerta sont nourries par les fortes hiérarchies professionnelles, le management pathogène, l'esprit de corps et la « culture carabine ».
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/28/etudiant%c2%b7es-soignant%c2%b7es-patient%c2%b7es-ensemble-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-en-sante/
Les femmes, qu'elles soient étudiantes, professionnelles des établissements de santé ou patientes, sont les premières victimes de ces violences patriarcales, qui touchent toutefois également des hommes et des enfants.
Aujourd'hui, les langues se délient et les témoignages se font de plus en plus nombreux. Nous, organisations féministes et représentatives d'étudiant·es, de professionnel·les des établissements de santé et de patient·es, nous mobilisons ensemble pour dénoncer ces pratiques.
La peur doit changer de camp.
Etudiant·es en santé, nous sommes quatre sur dix à subir du harcèlement sexuel à l'hôpital, majoritairement de la part de nos supérieurs hiérarchiques. Nous sommes une étudiante sur cinq à être agressée sexuellement à l'université, par nos propres camarades. Dans 90% des cas, nous ne signalons pas ces agressions par peur des représailles.
Dans nos études de médecine, des agresseurs sont protégés, dont certains peuvent continuer leurs études sans être inquiétés malgré des condamnations en justice.
Souvent, les violences sexuelles ont lieu lors de weekends d'intégration et soirées étudiantes, qui sont aussi le théâtre de bizutages et d'humiliations sexistes. Dans les salles de garde des internes, des fresques pornographiques ramènent les femmes à l'état d'objets sexuels soumis à la domination des hommes. Sous couvert de « culture carabine », il s'agit de normaliser la culture du viol dans nos études.
Nous l'affirmons, aucune « tradition » ne justifie de reproduire des violences.
Professionnel·les des établissements de santé, nous exerçons dans un milieu où règnent l'omerta et l'impunité, à tous les échelons de la hiérarchie. Quand une infirmière est violée par un médecin, c'est elle qui change de service. Quand une aide-soignante fait remonter des faits d'agressions sexuelles, c'est son emploi qui est menacé. Quand un médecin dénonce à l'Ordre le comportement d'un collègue, c'est lui qui écope d'un blâme.
Le principe de confraternité ne doit pas protéger des agresseurs au détriment du personnel et des patientes. « D'abord ne pas nuire », c'est le serment d'Hippocrate sur lequel les médecins et sages-femmes ont juré. Cet engagement doit être respecté et l'intégrité des soignant·s ne doit pas être mise en doute.
Patient·es, nous subissons des abus de pouvoir et des violences sexistes et sexuelles de la part de certains professionnels de santé. Nous sommes nombreuses à avoir été confrontées à des violences obstétricales et gynécologiques (VOG) quand des examens ou des actes médicaux nous sont imposés. Notre consentement est trop souvent bafoué, nos corps et nos choix jugés, notre parole, notre douleur, nos symptômes niés.
Nos plaintes auprès de l'Ordre sont trop peu relayées, voire étouffées. Des médecins visés par des dizaines de plaintes pénales et mis en examen peuvent continuer à exercer sans être suspendus. L'impunité empêche la reconnaissance des préjudices et la réparation, elle augmente notre défiance envers le médical.
Le respect de notre consentement, la considération de notre intégrité physique et morale, la déontologie et l'éthique devraient être au cœur de la relation soignant·es-soigné·es. Il est temps de mettre fin à une médecine patriarcale, paternaliste et archaïque au profit d'un partenariat entre les patient·es et les soignant·es, une réelle démocratie sanitaire.
Ensemble, pour combattre les violences sexistes et sexuelles en santé, nous exigeons des mesures concrètes et immédiates :
– La mise en place en urgence d'un plan ambitieux de prévention et de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, dont les VOG, dans les universités et les établissements de santé publics comme privés, avec notamment des formations obligatoires pour l'ensemble des étudiant·es en santé, des médecins et de tous les autres professionnel·les
– Le retrait effectif de toutes les fresques pornographiques encore présentes dans certains hôpitaux malgré leur interdiction
– La création d'une plateforme de signalement anonyme pour patient·es et la mise en place effective dans tous les établissements de santé du dispositif de signalement obligatoire dans la fonction publique contre les violences, les discriminations et le harcèlement
– La protection effective, notamment par la mise en place de la protection fonctionnelle dans la fonction publique, pour les étudiant·es et professionnel·les signalant des violences sexistes et sexuelles
– L'obligation d'informer les instances du personnel des établissements de santé et les conseils des universités sur les actes de violences sexistes et sexuelles
– Un véritable accompagnement psychologique, médical et juridique des étudiant·es, professionnel·les et patient·es victimes
– L'interdiction de déplacer un·e professionnel·le de santé victime en l'absence de volonté explicite et écrite de la part de cette dernière
– Par principe de précaution, la mise à l'écart immédiate et systématique (notamment par l'application de la mesure conservatoire) de tout médecin ou autre professionnel concerné par un signalement ou une plainte le temps de l'enquête disciplinaire et l'interdiction d'exercer pour les étudiant·es en médecine et médecins condamnés par la justice
– Une formation obligatoire du personnel de l'administration, des directions d'établissement de santé et des universités pour mettre en place des plans de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, accompagner les victimes et si nécessaire dispenser des sanctions à la hauteur des faits
– Dans l'enseignement supérieur, le déclenchement systématique d'une procédure disciplinaire avec mise à l'écart conservatoire en cas de signalement contre un étudiant pour violence sexuelle
Pour faire entendre ces revendications, nous appelons à l'initiative du collectif Emma Auclert à un rassemblement devant le ministère de la Santé à Paris, qui se tiendra mercredi 29 mai à 18h, et demandons à être reçu·es par Madame Vautrin et Monsieur Valletoux.
LE SILENCE NE PROFITE QU'AUX AGRESSEURS.
Organisations signataires : Collectif Emma Auclert, Stop VOG, CNDF, Nous Toutes, Union étudiante, Sud Santé Sociaux, Union syndicale Solidaires, Osez le Féminisme, SNJMG, Anef, Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, Les Affolées de la Frange, Action Féministe Tours, CADAC, CLASCHES, Les Fallopes, Héroïnes 95, MIOP, Association Mémoire Traumatique et Victimologie, Pour une santé engagée et solidaire, Ruptures, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Stop Harcèlement de rue, Les Effronté-es, CLIT, CQFD.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Danger : Les autorités religieuses se rapprochent des droits des femmes minoritaires

Pendant de nombreuses années, certaines d'entre nous ont fait campagne contre le développement des conseils de la charia et la création du tribunal d'arbitrage musulman, car nous reconnaissons que tous ces systèmes religieux de résolution des litiges sont, par leur nature même, liés à une politique croissante de fondamentalisme religieux qui cible les droits et les libertés des femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les conseils de la charia et le tribunal d'arbitrage suivaient, bien entendu, le modèle des tribunaux juifs Beth Din, et notre principale préoccupation était la possibilité très réelle que d'autres religions minoritaires insistent pour que leurs propres ordres juridiques personnels soient également pris en compte par l'État.
Il n'a pas fallu longtemps pour que notre crainte devienne réalité. À la liste des conseils et tribunaux de la charia musulmans et des Beth Dins juifs qui existent déjà, nous pouvons désormais ajouter le « tribunal » sikh, et nous pouvons être sûres que les hindous ne seront pas loin derrière.
En tant que femmes issues de diverses minorités – ayant fait de grands progrès dans la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans le cadre de notre lutte pour l'autodétermination – nous sommes alarmées par la croissance incontrôlée de ces systèmes juridiques parallèles au Royaume-Uni. L'utilisation de lois personnelles religieuses pour réglementer la vie des femmes appartenant à des minorités n'est pas seulement discriminatoire ; elle est également extrêmement préjudiciable dans un contexte où les violences domestiques et les fémicides qui en découlent pour les femmes d'Asie du Sud et d'autres minorités restent nombreuses et prennent un caractère de plus en plus audacieux.
En témoignent, par exemple, l'agression brutale d'Ambreen Fatima Sheikh à Huddersfield, laissée dans un état végétatif permanent après avoir été forcée à prendre des médicaments contre le diabète et aspergée d'une substance corrosive en 2015 ; le meurtre de Fawziyah Javed, poussée du haut d'une falaise à Édimbourg alors qu'elle était enceinte de 17 semaines en 2021 ; ou le cas de Kulsuma Aktar, poignardée à mort alors qu'elle poussait son fils dans un landau dans un centre commercial de Bradford en 2024. Toutes ces attaques se sont produites dans le contexte d'une dynamique ultra-patriarcale de coercition et de contrôle facilitée par des chefs religieux et communautaires qui, de manière flagrante, ne condamnent pas publiquement de telles atrocités.
La « Cour » sikhe a été créée en vertu de la loi de 1996 sur l'arbitrage, soi-disant pour pallier le « manque d'expertise » des tribunaux laïques qui ne sont pas en mesure de « comprendre » les sensibilités culturelles et religieuses des Sikhs lorsqu'il s'agit de résoudre des litiges familiaux et civils. Composée d'une trentaine de magistrat·es et de 15 juges – dont beaucoup sont des femmes – la « Cour » utilisera une combinaison de médiation et d'arbitrage pour présider les litiges familiaux et civils au sein de la communauté sikhe. Tout en reconnaissant que le sikhisme (comme l'hindouisme, mais contrairement à l'islam et au judaïsme) ne dispose pas d'un cadre juridico-religieux de règles codifiées pour juger les affaires, l'intention des fondateurs est claire : créer un ordre à partir de rien pour statuer sur des questions telles que le mariage et le divorce, la résidence/le contact/la garde des enfants et le règlement des biens matrimoniaux « conformément aux principes religieux sikhs » tels qu'ils les définissent.
Il est affirmé que la « Cour » a été créée à la suite de discussions avec des organisations caritatives et des avocats sikhs du monde entier, jusqu'à présent anonymes. Mais il n'y a pas eu de débat transparent et démocratique ni de consultation publique, en particulier avec les femmes sikhes, sur la nécessité d'une telle « Cour » ou sur ce qui constitue les principes sikhs. La « Cour » a simplement été proclamée par des avocats sikhs qui se sont clairement désignés comme les représentants de la communauté sikh et les gardiens de ses valeurs.
Le « tribunal » se présente comme un organe formel et professionnel, quasi légal, qui est prêt à adhérer à des règles d'engagement légales formelles. Cependant, il est clair que son véritable objectif est de monopoliser le pouvoir non étatique au sein de la communauté afin de contrôler les femmes.
Pour justifier son existence, un porte-parole de la « Cour » a souligné la prétendue incapacité des tribunaux laïques à tenir compte des valeurs « sikhes » dans une affaire concernant une femme sikhe divorcée qui, en tant que principale personne en charge de son jeune fils, avait soutenu sa décision de lui couper les cheveux, au mépris des souhaits de son père (son ex-mari). Le tribunal des affaires familiales a statué en faveur de la mère, mais il a été vivement critiqué par le porte-parole du « tribunal » sikh pour n'avoir pas tenu compte du principe sikh interdisant de couper les cheveux.
Cette interprétation de l'affaire ne fait aucune référence au contexte plus large de l'affaire : le contexte familial et l'histoire des relations, et en particulier les raisons du divorce des parents, sachant que la plupart des femmes d'Asie du Sud – y compris les femmes sikhes – n'envisagent même pas l'idée d'un divorce à moins qu'il n'y ait des allégations d'abus domestique et de contrôle coercitif. Il est significatif qu'elle ne tienne aucun compte du raisonnement qui sous-tend la décision du tribunal de la famille, ni d'ailleurs d'aucune évaluation professionnelle des souhaits, des sentiments et des besoins de l'enfant dans le cadre de l'application du principe juridique fondamental selon lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit toujours être primordial.
Cet exemple montre clairement que la priorité absolue du « tribunal » sikh est d'assurer la conformité religieuse dans l'intérêt du père plutôt que dans l'intérêt de l'enfant ou de la mère dans tout conflit familial. Dans cette mesure, sa position représente une lutte pour la préservation des droits du père qui fait écho à une bataille idéologique plus large menée par les hommes violents sur le fait que les tribunaux de la famille sont partiaux à leur égard. La demande trop familière de respect des valeurs religieuses, quelles que soient les circonstances, est un élément clé du modus operandi de tous les systèmes d'arbitrage religieux.
Nos inquiétudes ont été renforcées par l'affirmation selon laquelle le « tribunal » sikh traitera les cas de « violence domestique mineure » ainsi que les questions de « gestion de la colère, de jeu et de toxicomanie » par le biais de la médiation avant tout, et ensuite – si la médiation n'aboutit pas et que les parties sont d'accord – une affaire peut être portée devant un juge du « tribunal » sikh qui peut rendre un jugement juridiquement contraignant en vertu de la loi sur l'arbitrage de 1996. C'est l'un des aspects les plus troublants du fonctionnement de la Cour : il soulève des questions sur la manière dont le consentement est obtenu et qui définit ce qu'est une violence domestique « de bas niveau » ?
Nos années d'expérience en première ligne nous montrent que, lorsque des chefs religieux sont impliqués, les cas d'abus domestiques et sexuels et de contrôle coercitif sont presque toujours niés ou interprétés comme des problèmes « mineurs » de « gestion de la colère » qui peuvent être résolus par la médiation en vue de réconcilier les parties. Loin de procéder à une évaluation correcte des risques ou d'informer les femmes de leurs droits à la protection en vertu du droit civil ou pénal, ils ont tendance à balayer les problèmes sous le tapis, au mieux, et au pire, ils reprochent aux femmes de défier l'autorité patriarcale. Des préoccupations similaires ont été exprimées par l'Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (enquête indépendante sur les abus sexuels commis sur des enfants) dans son rapport 2021 axé spécifiquement sur les milieux religieux, dans lequel elle critiquait les autorités religieuses – dans les religions majoritaires et minoritaires – pour leurs « manquements flagrants » en matière de protection des enfants et pour avoir couvert des cas d'abus sexuels commis sur des enfants par leurs adeptes.
L'expérience montre également que la grande majorité des femmes appartenant à des minorités qui utilisent les systèmes de médiation et d'arbitrage communautaires le font non pas par choix, mais par contrainte sociale, par crainte de la stigmatisation, de l'isolement et même de répercussions violentes. Les patriarches religieux exploitent à leur détriment leur méconnaissance des droits légaux et des systèmes de soutien alternatifs, ainsi que les retards et les obstacles à l'accès aux conseils juridiques et à la représentation. Beaucoup racontent qu'elles sont rendues impuissantes par un processus qui ignore et invalide leurs besoins et leurs souhaits. La plupart d'entre elles sont très critiques et méfiantes à l'égard du pouvoir religieux et de son utilisation pour leur accorder un statut social et juridique inférieur à celui des hommes. Loin d'inspirer la confiance, ce système oblige les femmes à exercer une forme d'action très limitée : faire des choix contre leurs intérêts et dans des contextes où l'emprise de la religion leur a déjà laissé peu de marge de manœuvre.
Les ordres juridiques non étatiques – dont le « tribunal » sikh est le dernier né – n'ont qu'un seul objectif en tête : « préserver les valeurs religieuses » et, en particulier, le « caractère sacré du mariage » dans lequel les femmes sont censées jouer un rôle central. Nous savons par expérience que si les femmes sikhes de ce pays avaient été consultées sur la nécessité de tribunaux religieux, la majorité d'entre elles auraient établi une séparation claire entre la religion en tant que croyance personnelle et source de réconfort, et la religion en tant que base d'attribution des ressources et des droits au sein de la famille.
Le « tribunal » sikh a affirmé que son rôle n'était pas de supplanter, mais de compléter et de soutenir un système judiciaire de plus en plus surchargé, manquant de ressources et confronté à de longs délais. C'est évidemment vrai. Dans le cadre de sa politique d'austérité, l'État n'a que trop voulu détourner les ressources de ce qui est considéré comme des litiges coûteux et chronophages. À cette fin, les gouvernements successifs ont expressément encouragé l'utilisation de services de médiation informels et essentiellement privés dans les affaires familiales, à la fois pour réduire les coûts et pour s'attaquer idéologiquement à ce qui est perçu à tort comme une culture litigieuse des droits au Royaume-Uni. En décimant les services d'aide juridique et de protection sociale et en promouvant des politiques multiconfessionnelles, l'État a réussi à renforcer le pouvoir religieux élitiste et patriarcal tout en limitant l'accès des femmes minoritaires au système juridique formel et laïque, un système qui, malgré ses nombreux défauts, peut au moins être remis en question sur les questions de responsabilité, de droits et de justice.
Dans ce contexte, les forces religieuses de droite ne font que profiter de l'espace laissé vacant par l'État. L'ensemble du projet de « tribunal » sikh – comme les modèles qui l'ont précédé dans l'islam et le judaïsme – montre comment la religion s'installe dans le vide laissé par l'État et déploie ses muscles politiques, simplement parce qu'elle peut le faire.
Les droits des femmes minoritaires sont en péril au Royaume-Uni. Loin d'inverser l'assaut contre nos droits, l'État a facilité la création d'ordres juridiques non étatiques antidémocratiques impliquant des systèmes d'arbitrage religieux qui bafouent la législation nationale et internationale en matière de droits de l'homme. Ce faisant, toute la philosophie de protection et de prévention qui sous-tend la loi de 2021 sur les violences domestiques, tout comme les principes de non-discrimination et d'égalité des chances inscrits dans la loi de 2010 sur l'égalité, sont sérieusement mis à mal. De même, les principaux principes de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes – qui obligent les États à éradiquer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne le mariage et les relations familiales, afin qu'elles puissent exercer un choix éclairé – sont également violés. La Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes, qui engage le Royaume-Uni à s'abstenir de tolérer ou d'encourager les attitudes néfastes, les préjugés, les stéréotypes sexistes et les coutumes ou traditions sexistes qui rabaissent les femmes et les traitent comme des êtres inférieurs, est ainsi compromise.
En effet, le fossé de la justice pour les femmes issues de minorités s'est creusé et est devenu encore plus dangereux. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre pour empêcher que la loi de 1996 sur l'arbitrage ne soit utilisée par les autorités religieuses pour saper les principes des droits de l'homme, de l'égalité devant la loi, du devoir de diligence, de la diligence raisonnable et de l'État de droit. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de ces principes dans la sphère privée de la famille et à toutes les femmes dans toutes les communautés. Agir autrement reviendrait à permettre aux autorités religieuses de construire un nouvel échelon pour appuyer leurs tentatives de jeter les bases d'un régime d'apartheid sexuel dans les communautés minoritaires.
Nous remercions One Law for All et Project Resist de nous avoir autorisés à reproduire cet article.
https://feministdissent.org/blog-posts/in-peril-religious-authorities-are-closing-in-on-minority-womens-rights/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Une sécurité sociale de la menstruation » pour combattre les effets délétères du patriarcat et du capitalisme

Face à la précarité menstruelle entretenue par une industrie capitalisant sur les règles, la chercheuse indépendante Jeanne Guien expose différentes alternatives à ce consumérisme nocif, de l'autoproduction de produits durables à leur prise en charge par le service public.
Tiré de l'Humanité
Publié le 27 mai 2024
Que les produits menstruels ne soient pas reconnus comme essentiels « montre bien que la loi est centrée autour de la masculinité », estime la chercheuse.
Dans son livre une Histoire des produits menstruels (Divergences, 2023), la docteure en philosophie Jeanne Guien étudie ce que le consumérisme fait au corps féminin. Dénonçant une stratégie patriarcale et capitaliste dangereuse pour les personnes menstruées, la chercheuse indépendante questionne les pratiques alternatives « de militants et militantes fabriquant eux-mêmes depuis des décennies des produits menstruels durables, que ce soit des serviettes, des culottes ou des cups », et souligne que « ces produits pourraient aussi être pris en charge par le service public ».
Quels tabous persistent encore autour des produits menstruels ?
En parler, évoquer les douleurs, lesincapacités dues aux menstruations, est relativement toléré. Mais il est toujours compliqué de rendre les règles visibles. On peut éventuellement les mentionner, mais le phénomène physiologique lui-même doit demeurer soigneusement caché. Les produits menstruels continuent à servir à ça. Les marques de culottes menstruelles ont beau se présenter comme des révolutions par rapport au tampon ou à la serviette jetable, elles participent de la même « culture de la dissimulation », pour reprendre l'expression de la journaliste Karen Houppert, qui est entretenue par les différentes industries de produits menstruels.
Mode d'achat, mise au rebut, conditionnement : tout a été fait pour construire un monde dans lequel les saignements n'existent pas, ne font pas partie de l'expérience « normale », du quotidien socialement partagé. Un monde masculin, en somme. Au-delà des règles, les difficultés des femmes liées à la santé reproductive émergent rarement, comme la ménopause, les contraceptions d'urgence…
La précarité menstruelle est présentée comme nouvelle, or vous expliquez qu'elle a toujours existé, voire qu'elle a été entretenue. Comment ?
La précarité menstruelle est entretenue par le consumérisme, par le fait qu'on associe tout besoin matériel à un produit marchand. À partir du moment où vous avez une industrie menstruelle qui se construit autour du dénigrement des solutions artisanales autoproduites par les femmes pour les femmes, à partir du moment où on présente le fait d'acheter un produit et de le racheter régulièrement comme la seule solution digne pour vivre ces menstruations, on crée forcément un fossé entre les personnes qui ont accès au marché et les autres.
Il y a aussi l'argent réclamé par l'État, la partie impôt. Dans de nombreux pays, la TVA sur les produits menstruels est égale aux autres produits du quotidien et même supérieure à ceux classés comme essentiels. Des produits non nécessaires à une hygiène de base sont pourtant parfois détaxés comme certains shampoings, le Viagra aux États-Unis… En France, nous avons obtenu en 2016 la baisse de la taxation de 19,6 % à 5,5 %, mais la taxe n'a pas été annulée comme dans d'autres pays. Beaucoup de mouvements sociaux à travers le monde veulent obtenir la reconnaissance de ces produits comme essentiels. Le fait qu'ils ne le soient pas montre bien que la loi est centrée autour de la masculinité.
En quoi ce que vous nommez « l'imaginaire impérialiste » des pays du Nord a-t-il des conséquences nocives sur les pays du Sud dans ce secteur ?
L'histoire des produits menstruels industriels commence au Nord. Ces produits ont d'abord été vendus en Europe, ensuite aux États-Unis, puis progressivement exportés. Ces produits sont présentés comme des symboles de la modernité, avec l'idée que celle-ci vient forcément du Nord. Et puis, des produits menstruels qui ont été interdits au Nord vont rester distribués au Sud. Dans les années 1990, par exemple, on a démontré qu'une certaine serviette Always contenait un composant dangereux pour la santé. Ces serviettes ont été interdites à la vente en Amérique du Nord et en Europe, mais ont continué à être vendues au Kenya.
On va exporter des serviettes hygiéniques, faire des dons en Inde, en Afrique de l'Est. Des produits sont déstockés, distribués un peu à l'aveuglette sans qu'on s'inquiète de savoir si c'est viable, soutenable. Il ne suffit pas de donner des produits jetables pour créer de l'hygiène menstruelle. Cela crée des problèmes de déchets et rend une population dépendante d'un produit qui ne sera pas toujours gratuit. Par ailleurs, on continue à décrédibiliser les techniques jusqu'ici utilisées localement.
Comment construire une culture menstruelle anticonsumériste ?
Il faut trouver des manières de se passer du marché. Donc, cesser de recourir à des produits industriels jetables, en essayant de revenir ou d'inventer une nouvelle forme d'autoproduction. C'est ce que font déjà beaucoup de militants et militantes depuis des décennies en fabriquant eux-mêmes des produits menstruels durables, que ce soit des serviettes, des culottes, des cups. Cela crée aussi de la sociabilité, en apprenant à faire l'objet, en partageant des informations.
Ces produits pourraient aussi être intégralement pris en charge par le service public, et les informations autour de ces besoins menstruels rendues accessibles dans les structures de proximité. Je suis pour une « sécurité sociale de la menstruation », dans l'esprit de ce que l'on appelle la « sécurité sociale de l'alimentation ». La santé reproductive fait partie de la santé, pourquoi les produits menstruels n'ont-ils jamais été pris en compte et remboursés ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Kanaky. Du méfait colonial à la mondialité

La Kanaky (maintenant convulsive sous le mépris, la violence et la mort) offre à la vieille République française une occasion de se moderniser. Sa juste revendication exige une autre vision du monde. Elle demande aussi un réexamen de ce qui se « crie » tristement « Outre-mer ». Cette estampille ténébreuse camoufle ensemble un système et un syndrome.
28 mai 2024 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
Système, parce que, depuis des décennies (déjouant les mannes européennes et les paternalistes plans de développement), tous les indicateurs mortifères attestent d'une évidence : ces situations humaines demeurent largement en dessous du niveau de bien-être humain que l'on pourrait attendre de terres dites « françaises ». Syndrome, parce que dans ces pays-là, les signes pathologiques d'assistanat, de dépendance ou de déresponsabilisation sont les mêmes et sévissent de concert. [1 – Voir « Faire-Pays ». P. Chamoiseau. Editions Le Teneur. 2023]
La mondialité
Les individus les plus accomplis (ceux qui, de par leurs divers engagements, habitent sinon des communautés mais des multitudes de « Nous ») forment aujourd'hui une matière noire du monde bien plus décisive que celle des communautés archaïques ou des vieux États-nations.
Via la Kanaky, ces pays méprisés par la France offrent à la compréhension du monde une réalité encore inaperçue. Celle-ci ne peut se percevoir par l'unique prisme du « colonial », comme le pensent encore les activistes décoloniaux. Le fait (ou mé-fait) colonial n'est qu'une donnée parmi d'autres. Il nous faut sortir de la prégnance occidentale (seule aujourd'hui à raconter le monde), et entreprendre d'inventorier, une à une, toutes les forces visibles et invisibles qui ont œuvré à l'accouchement de notre époque. En attendant, commençons par ouvrir notre focale à la mondialité.
Le poète Édouard Glissant appelait ainsi la résultante d'un tourbillon complexe. On y trouve enchevêtrées, les évolutions impénétrables du Vivant, les emmêlées des peuples, cultures et civilisations, résultant des chocs coloniaux, du broiement des empires, puis du capitalisme protéiforme. Une des résultantes cruciales de ce chaosmos : l'individuation.
Cette force a éjecté des millions d'individus des vieux corsets communautaires pour précipiter leurs combats, leurs rêves, leurs idéaux, vers des accomplissements imprévisibles dans la matière du monde. Les individus les plus accomplis (ceux qui, de par leurs divers engagements, habitent sinon des communautés mais des multitudes de « Nous ») forment aujourd'hui une matière noire du monde bien plus décisive que celle des communautés archaïques ou des vieux États-nations. Dès lors, si la mondialisation économique est un standard barbare, la mondialité est une matrice vivante ; un en-commun infra-planétaire où les « Nous » s'entremêlent et relient par des agentivités créatives tout ce qui se trouvait séparé. C'est de cette matrice encore invisible à nos yeux que va surgir, tôt ou tard, un autre monde, encore imprédictible.
La relation
Cette mondialité peut nous aider à comprendre la Kanaky, et à mesurer combien la Constitution française est maintenant obsolète. Surtout inacceptable. Elle verrouille (sous une fiction absurde de « départements », « régions », « collectivités » ou « territoires » d'Outre-mer) des complexités territoriales, historiques et humaines qui lui sont étrangères.
Ce ne sont pas des choses « ultramarines ». Ce sont des peuples-nations, encore dépourvus de structures étatiques ! Ils ont surgi d'une alchimie que les anthropologues reconnaissent maintenant comme étant une « créolisation ». Ce terme souligne ce qui se produit quand, de manière immédiate, massive et brutale, des peuples, des civilisations, des individus (mais aussi des interactions amplifiées entre les écosystèmes, biotopes et biocénoses) imposent aux existences une entité globale de référence : celle de Gaïa qu'aimait Bruno Latour, de cette Mère-patrie dont parle Edgar Morin, ou de ce chaosmos poétique que Glissant nomme Tout-monde.
Cette notion du tout-relié-à-tout dans des fluidités inter-rétro-actives constitue le principe actif de la créolisation. C'est d'elle qu'ont surgi ces peuples-nations que la Constitution française ne comprend pas.
Cet entremêlement inextricable du Vivant et des Hommes se serait inévitablement produit car notre planète est ronde et parce que le vivant est avant tout une mobilité. Prenons, la traite des Africains, l'esclavage de type américain, le système des plantations et des extractions massives. Ajoutons-y, la colonisation, le capitalisme, la prolifération urbaine et les systémies technoscientifiques, on aura alors à peine esquissé le plus visible d'un processus insondable : celui de la Relation. Cette notion du tout relié à tout dans des fluidités inter-rétro-actives constitue le principe actif de la créolisation. C'est d'elle qu'ont surgi ces peuples-nations que la Constitution française ne comprend pas. Elle les verrouille sous un effarouchement « indivisible » et fonde sa cinquième République sur un aussi fictif que monolithique « peuple français ». Elle réduit ainsi à de simples « populations » les entités humaines formidables que son bond colonial et son histoire relationnelle ont rendu solidaires de sa présence au monde.
Peuples ataviques et peuples composites
Mais le plus important, c'est ceci : dans la Relation, dessous le couvercle « Outre-mer », il y a aujourd'hui deux types de peuples : les peuples ataviques et les peuples composites.
Les peuples ataviques (mélanésiens de Kanaky ; polynésiens ; mahorais ; peuples originels de Guyane…) disposent d'une antériorité multimillénaire sur l'emprise du mé-fait colonial.
Les peuples composites (Martinique, Guadeloupe, Réunion…) sont des surgissements (des créolités) de la créolisation. Complètement nouveaux, ils sont les derniers peuples de l'aventure humaine à être apparus sur cette terre. Ils n'ont pas d'antériorité qui se perd dans la nuit des temps. Ils sont nés dans le vortex relationnel où se retrouvent les communautés fracassées et les individuations. Ils mélangent presque toutes les présences anthropiques planétaires. La conscience qu'ils ont désormais d'eux-mêmes en fait de véritables nations qui attendent d'être reconnues comme telles — ce que ne nul ne sait faire, à commencer par les politiciens français qui distinguent encore à peine les peuples ataviques et rechignent à comprendre leur revendication d'une existence au monde.
C'est surtout la beauté de Jean-Marie Tjibaou d'avoir accepté l'hybridation caldoche alors que cette dernière avait (conserve encore) de son sang sur les mains…
La Martinique, la Guadeloupe ont vécu la « désapparition » [2 – Les peuples Kalinago. Malgré leur effondrement, ils demeurent présents de mille façons dans les imaginaires. de leurs peuples ataviques.] En Kanaky, le peuple atavique des Kanaks a traversé héroïquement les exterminations. Il constitue une part déterminante du peuplement actuel qui, avec les diverses migrations et le choc colonial, est dorénavant une entité post-atavique. Car le mé-fait colonial et ses fluidités migrantes collatérales ont installé des complexités anthropologiques désormais inextricables. Elles obligent les peuples ataviques à composer avec des implantations nées de la colonisation et des mouvements relationnels du vivant. C'est la beauté de Nelson Mandela d'avoir su admettre la présence blanche dans le devenir de l'Afrique du Sud alors qu'il avait le pouvoir de la frapper. C'est la beauté de Mahmoud Darwich et des grands politiques palestiniens confrontés à l'irréversible implantation des Juifs. C'est surtout la beauté de Jean-Marie Tjibaou d'avoir accepté l'hybridation caldoche alors que cette dernière avait (conserve encore) de son sang sur les mains… L'agentivité de ces hommes ne s'est pas laissée enfermer dans un imaginaire communautaire ancien ou dans les frappes et contres-frappes coloniales : elles les ont dépassés pour deviner la mondialité et pour donner une âme fraternelle à la Relation. Ces hommes ont maintenu ainsi — pour tous, au nom de tous — une espérance.
L'éthique d'un nouveau vivre-ensemble
Dès lors, une éthique de la Relation s'impose.
Quand le peuple atavique subsiste dans une sédimentation composite, la bienséance du nouveau vivre-ensemble exige de lui remettre la prééminence sur le devenir de son pays : nul ne saurait démanteler ce qui l'unit à sa terre, laquelle est toujours faite (comme le disait Jean Guiart) du sang noble de ses morts.
Quand le composite est entièrement fondateur d'un nouveau peuple, il faut — non pas ignorer son existence (comme cela se fait actuellement en France pour la Guadeloupe ou pour la Martinique), mais considérer qu'il y a là une entité nouvelle, qui n'est réductible à aucune de ses composantes, qu'elle soit dominée, qu'elle soit dominante, et qui détient une autorité légitime sur le devenir de sa terre.
Le devenir des peuples ataviques est d'être post-atavique, et progressivement composite, dans l'énergie relationnelle du vivant. Celui des peuples d'emblée composites, est d'aller de la manière la plus haute, la plus humaine, la plus poétiquement ouverte et fraternelle, aux fastes de la Relation.
C'est cet imaginaire de la Relation qui nous donnera le goût de la diversité qui est au principe du vivant, d'en percevoir la profonde unité qui n'a rien à voir avec l'Universel occidental, et d'en goûter l'inépuisable diversité dont le trésor est cette insaisissable unité qui ne vit, ne s'accomplit, que dans son évolutive diversité.
Une Kanaky kanak
Cette éthique oblige donc que le corps électoral de Kanaky n'autorise aux votes déterminants que les Kanaks. Que s'y adjoignent ceux qui, venus d'ailleurs, ont été identifiés par les accords de Nouméa (1988,1998). C'est l'autorité à venir, à prépondérance kanake, qui seule pourra décider des évolutions de son système électoral.
Kanaka signifiait : être humain.
Kanak signifie pour nous, pour tous,
l'espérance possible
d'un nouvel humanisme.
Kanaka signifiait : être humain.
Kanak signifie pour nous, pour tous, l'espérance possible d'un nouvel humanisme.
Restituée à son imaginaire kanak, la Kanaky disposera de toutes les chances pour trouver un nouvel espace-temps, échapper à la gravité morbide du trou noir capitaliste, réenchanter notre rapport au vivant, et habiter enfin poétiquement la terre selon le vœu de ce cher Hölderlin.
Quant à la modernisation relationnelle de la Constitution française, elle est très simple : il suffit de proclamer une sixième République ; de la rendre capable d'accueillir en pleine autorité tous les peuples-nations (peuples nouveaux de la Relation) qui le voudraient ; d'inaugurer ainsi le pacte républicain ouvert qu'exige la nouvelle réalité (post-coloniale, post- capitaliste, post-occidentale) qu'annonce notre mondialité.
L'exploitation du nickel, le domaine maritime, la biodiversité, l'activité spatiale ou le souci géostratégique doivent désormais s'inscrire dans le respect des peuples concernés. Nous avons rendez-vous là où les océans se rencontrent, disait mystérieusement Glissant.
Que disparaisse dans cette rencontre l'Outre-mer de la France !
Patrick Chamoiseau, poète, romancier, essayiste, a construit une œuvre protéiforme couronnée de nombreuses distinctions (Prix Carbet de la Caraïbe, Prix Goncourt, Gallimard,1992, Prix marguerite Yourcenar en 2023…) et traduite dans le monde entier.
Son esthétique explore la créolisation et les poétiques relationnelles du monde contemporain.
Il est aujourd'hui une des présences littéraires les plus importantes de la Caraïbe.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique du Sud : L’ANC travaille à former une coalition

'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud depuis 30 ans, qui a perdu sa majorité au Parlement cette semaine, a confirmé, hier, son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition.
Tiré d'El Watan.
« L'ANC s'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, qui est stable et capable de gouverner efficacement », a déclaré Fikile Mbalula, son secrétaire général, selon des propos recueillis par l'AFP précisant que le parti mènerait des discussions en interne et avec d'autres partis « ces prochains jours ». « Les électeurs ont montré qu'ils attendaient des dirigeants de ce pays qu'ils travaillent ensemble dans l'intérêt de tous », a-t-il ajouté devant la presse, alors que la proclamation officielle des résultats est attendue en fin de journée. Après dépouillement de 99,89% des bulletins de vote déposés dans les urnes, mercredi, le Congrès national africain (ANC) du président Cyril Ramaphosa n'a obtenu que 40,2% des voix, une claque sévère par rapport aux 57,5% qu'il détient dans le Parlement sortant.
Ce résultat marque un tournant historique pour l'Afrique du Sud où l'ANC jouit d'une majorité absolue depuis 1994, lorsque le parti de Nelson Mandela a sorti le pays des griffes de l'apartheid et l'a fait entrer en démocratie. « Les résultats envoient un message clair à l'ANC », a reconnu F. Mbalula. « Nous voulons assurer au peuple sud-africain que nous avons entendu leurs préoccupations, frustrations et mécontentement », dans un pays plombé par un chômage tenace, de fortes inégalités et une criminalité record. L'ANC reste le parti le plus important au Parlement. Et c'est la nouvelle Assemblée qui sera chargée d'élire le prochain président courant juin.
L'ANC doit ainsi forger des alliances, soit pour former un gouvernement de coalition avec un ou plusieurs partis, soit pour persuader d'autres partis de soutenir la réélection de C. Ramaphosa qui constituerait un gouvernement minoritaire de l'ANC, qui devra chercher au coup par coup des alliés pour faire passer son budget et ses projets de loi. Bénéficiant d'une forte popularité, ce dernier a fait savoir qu'il prononcerait un discours lors de la cérémonie de proclamation des résultats, alors que certains partis ont fait état d'irrégularités dans le décompte des voix. L'uMkhonto weSizwe (MK) de l'ex-président Jacob Zuma, 82 ans, qui a demandé samedi soir un report de cette proclamation, dans un bref discours aux sous-entendus menaçants. « Si cela arrive, vous allez nous provoquer », a-t-il déclaré. « Les résultats ne sont pas corrects (...). Ne créez pas de problèmes là où il n'y en a pas », a-t-il prévenu, se plaignant de problèmes « graves » sans autre précision. Son incarcération en juillet 2021 pour outrage a provoqué des émeutes qui ont fait plus de 350 morts. Le MK devient le troisième groupe à l'Assemblée, avec 14,59% des suffrages, un score sidérant pour un parti fondé il y a seulement quelques mois pour servir de véhicule à J. Zuma. Pendant la campagne, ce parti très implanté dans la région zouloue a martelé qu'il allait remporter les deux tiers des voix.
Le président de la commission électorale, Mosotho Moepya, a affirmé que « tout ce qui se présente à nous » serait examiné, faisant état de 24 cas de recomptage. L'ANC peut composer une coalition sur sa droite, avec le premier parti d'opposition l'Alliance démocratique (DA, centre libéral), ou sur sa gauche radicale, avec le MK de Zuma ou l'EFF de Julius Malema, deux ex-figures de l'ANC ayant fait sécession. « Un gouvernement minoritaire serait totalement inédit en Afrique du Sud mais c'est une option parmi d'autres », a confirmé Helen Zille de la DA. Le MK a fait savoir qu'il ne discuterait pas avec l'ANC tant que Cyril Ramaphosa resterait à sa tête. Mais F. Mbalula a balayé cette exigence : « C'est une zone où nous n'irons pas. Aucun parti ne nous dictera de tels termes », a-t-il indiqué.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan : une année de guerre insensée et de violence extrême contre la population

La guerre au Soudan a éclaté le 15 avril de l'année dernière et continue jusqu'à aujourd'hui de ravager le pays. A l'occasion de ce triste « anniversaire », nous revenons sur l'année écoulée. Malgré les chocs et les horreurs auxquels la population est confrontée au quotidien, les Soudanais·es continuent de se mobiliser pour réclamer la fin des combats et le retour à une transition démocratique.
Tiré de la revue Contretemps
22 mai 2024
Par Sudfa
Retour en avril 2023 : une situation fragile
Suite au coup d'État du général Al-Burhan mené en octobre 2021 contre la composante civile du régime de transition, qui devait permettre l'instauration d'une démocratie réclamée par les Soudanais-e-s durant la révolution, la population soudanaise n'a pas cessé de manifester son refus du coup d'État, à travers des manifestations, grèves et occupations. En avril 2023, sous pression et de plus en plus isolé, le général Al-Burhan (chef de l'armée soudanaise) avait réouvert les discussions autour d'une transition civile.
L'objectif était de trouver un accord pour sortir de l'impasse. Mais ces discussions – qui portaient notamment sur la réforme de l'institution militaire et le calendrier de cette réforme – ont ravivé les tensions entre Al-Burhan et son allié Mohamed Hamadan Dagalo (appelé « Hemedti), à la tête de la milice des « Forces de Soutien Rapide » (RSF). Les révolutionnaires civils demandent la dissolution de toutes les milices et la constitution d'une seule armée unifiée, qui se tienne à l'écart du pouvoir politique. Mais les RSF, devenues aussi puissantes que l'armée elle-même – n'avaient pas d'intérêt à être dissoutes et regroupées dans l'armée.
La tension s'est brutalement accentuée entre Al-Burhan et Hemedti. En parallèle d'une visite stratégique aux Émirats Arabes Unis, qui le soutiennent, Hemedti commençait à déployer ses soldats à divers endroits stratégiques, notamment à Marawi, où se trouve l'aéroport militaire de l'armée soudanaise.
Le 15 avril, le jour où tout a basculé
Ce jour aurait dû être une célébration de l'Aïd. Mais ce matin-là, les habitant-e-s de Khartoum ont été réveillé-e-s par des tirs et des explosions. La guerre venait d'éclater entre l'armée soudanaise et les RSF. Qui a tiré la première balle ? On ne le sait toujours pas. Pour la première fois dans l'histoire du Soudan, la guerre a éclaté dans la capitale, à proximité du palais présidentiel. La sidération était totale. Pensant que les affrontements dureraient à peine quelques heures, nombreux sont ceux à avoir quitté leurs maisons en imaginant y revenir le soir même. Mais ils ne sont jamais revenus.
La sidération s'est poursuivie dans les jours suivants. L'attention de la communauté internationale (États-Unis, pays européens et pays du Golfe) a principalement porté sur l'évacuation de leurs ressortissants. Le départ des étranger-e-s issu·e·s de ces pays a été vécu par la population soudanaise comme un abandon de la communauté internationale. Les Soudanais-e-s et les étranger-e-s d'autres nationalités qui n'avaient pas été évacué-e-s (notamment africaines) sont resté-e-s livré-e-s à eux-mêmes, au milieu des combats.
Entre massacres à répétitions et tentatives de négociations : synthèse d'une année de guerre
Pendant plus de trois semaines, la capitale et plusieurs villes du Darfour (Nyala, Al Fasher) et du Kordofan (Al Obeid) ont été soumises à des combats ininterrompus entre les bombardements de l'armée et les tirs des RSF. Les habitant-e-s ont rapidement témoigné sur les réseaux sociaux de cambriolages, de vols, et de viols de la part des soldats des RSF, mais aussi des militaires. Les Soudanais·e·s ont continué à quitter massivement leurs maisons, pour aller depuis la capitale vers la province (Wad Madani, Gezira, Port Soudan) mais aussi vers l'Égypte et l'Éthiopie, le Tchad et le Sud du Soudan.
En mai 2023, des négociations ont eu lieu à Djeddah avec la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'objectif était de rassembler les deux généraux autour de la table. Mais l'initiative était vouée à l'échec : les RSF débutaient – au même moment – un massacre (qualifié de génocide) à Al-Geneina, ville frontière avec le Tchad, située au Ouest Darfour [1].
Le massacre d'Al-Geneina prolonge ainsi l'histoire des génocides au Darfour qui ont eu lieu au début des années 2000, avec le soutien de l'armée et du gouvernement d'Omar El-Béshir. Musab, militant soudanais en exil, pointe ainsi du doigt la double responsabilité des RSF et de l'armée dans ces massacres :
« Les militaires sont complices de tout ça, même durant le génocide au Darfour en 2003, ils étaient témoins du massacre. Les milices permettent à l'armée soudanaise de rejeter sur elles sa responsabilité. Les militaires sont censés être le premier groupe qui évite d'entrer dans une guerre, mais au Soudan c'est le contraire. »
En décembre 2023, la ville de Wad Madani est tombée aux mains des RSF, après que l'armée ait une nouvelle fois abandonné la population locale. Les destructions, bombardements, vols, pillages, se sont poursuivis dans tout le pays, s'étendant progressivement du Darfour et de la capitale vers le centre et l'Est.
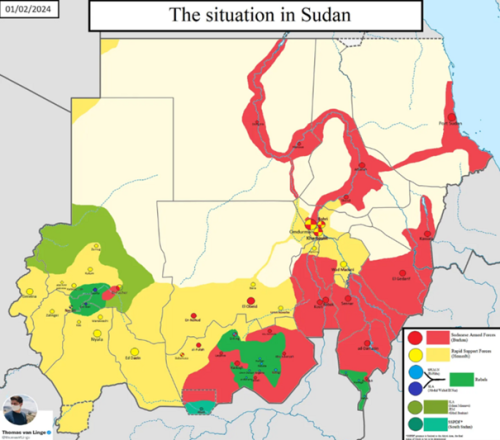
Avancée des différentes forces armée en février 2024. Source : Sudan War Monitor
En janvier 2024, le collectif « Taqqadum » – composé de plusieurs partis politiques – a signé un accord avec les RSF à Addis-Abeba, dans lequel les RSF s'engagent à garantir une transition civile et démocratique s'ils gagnent la guerre. Cet accord – qui a notamment été signé par Abdallah Hamdock (l'ancien premier ministre de la période de transition) – a été largement contesté et décrié par les Soudanais-e-s, qui considèrent qu'aucune compromission n'est possible avec les RSF.
Si cet accord survenu à un moment où les RSF prenaient l'avantage sur l'armée, il s'inscrit également dans une « normalisation diplomatique » des relations avec les RSF. De janvier à mars 2024, Hemedti a ainsi effectué une série de visites officielles dans les pays voisins, où il a été reçu comme un allié diplomatique. Mais plus récemment, l'armée soudanaise a remporté – grâce à des drones iraniens – plusieurs combats majeurs sur les RSF. A ce jour, l'issue de la guerre reste donc toujours très incertaine.
Une guerre difficile à comprendre
Les raisons profondes de cette guerre sont obscures et font l'objet de débats au sein des Soudanais·e·s, comme le constate Khansa, militante soudanaise en exil :
« Il n'y a pas une seule analyse profonde sur la situation actuelle au Soudan, et c'est ça qui nous rend confus. Il y a des gens qui soutiennent la guerre, qui veulent que les militaires écrasent les RSF quoi qu'il arrive, mais il y a aussi des gens qui considèrent les RSF comme un allié politique, ou encore d'autres qui ont des intérêts directs dans la guerre. Et il y a des gens qui disent : « Non à la guerre ! », qui pensent que c'est la pire chose qui peut arriver. Avec tous ces discours, on n'arrive pas à trouver une bonne orientation, ni de bons outils de travail pour être plus efficaces. Parce qu'il y a un manque d'analyse et on n'a pas de boussole. »
Certains estiment que c'est une guerre de pouvoir entre deux hommes, pour leurs simples intérêts personnels. Pour Khaled – militant soudanais en exil – la guerre peut être analysée d'un point de vue féministe, comme une « compétition de virilité entre deux généraux qui prennent en otage la population soudanaise ». D'autres estiment qu'il s'agit d'une « guerre entre différents groupes sociaux et culturels de la société », avec une dimension raciale qui conduit à des génocides. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une guerre « impérialiste », car chacun des deux groupes qui s'affrontent est soutenu par différentes puissances étrangères qui convoient le Soudan pour ses ressources naturelles et pour sa localisation stratégique. Khansa considère ainsi que : « la guerre est une étape très violente qui se traduit par le fait qu'il y a des organisations armées qui essayent de monopoliser les richesses et le pouvoir du pays par les armes, par n'importe quel moyen. »
Mais pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une guerre « contre-révolutionnaire ». En mettant le pays à feu et à sang, elle a fait s'effondrer les espoirs de la révolution civile et démocratique. Et a poussé sur les routes de l'exil de nombreux·ses militant·e·s engagé·e·s dans la révolution. En déstabilisant complètement le pays, cette guerre permet aux cadres de l'ancien régime de rester en place sans être jugés pour les crimes qu'ils ont commis durant des décennies (durant la dictature militaire puis du coup d'État).
Se mobiliser et résister
Malgré l'immense douleur et la colère, les Soudanais-e-s n'ont pas dit leur dernier mot et la flamme de la résistance est toujours présente. La mobilisation demeure active dans le pays (voir notre précédent article). Du côté de la société civile, les initiatives se sont multipliées pour réclamer la fin de la guerre. En novembre 2023, les comités de résistance (organisations autogérées par quartier de la société civile, et fer de lance du mouvement de contestation depuis 2018) ont publié une déclaration avec des pistes concrètes de propositions pour mettre fin à la guerre [2], réformer les forces armées soudanaises, mettre en place un gouvernement civil et obtenir justice pour toutes les victimes de guerre. De nombreuses initiatives locales mettent en œuvre une solidarité dans les différents quartiers, malgré une situation humanitaire catastrophique.
La résistance se poursuite également dans la diaspora soudanaise à travers le monde, même si la guerre affecte aussi fortement les Soudanais-e-s à l'étranger (voir notre précédent article). Rashida – militante soudanaise en exil – note une différence entre la période post-révolutionnaire et la situation aujourd'hui :
« Les gens sortaient en masse après le coup d'État, parce qu'il y avait de l'espoir. Mais maintenant, nous ne sommes pas nombreux aux manifestations. C'est la guerre, et il n'y a plus d'espoir, nous sommes perdus. Les manifestations sont tristes, car il n'y a personne qui n'a pas été touché directement par cette guerre. »
Pour autant elle continue à se mobiliser, en considérant que « c'est le minimum que je peux faire » pour soutenir son pays depuis la France, et « qu'il ne faut rien lâcher ».
A Paris, des militants ont manifesté place de la République contre la guerre, et d'autres ont fait entendre leur voix en perturbant la « Conférence sur la crise humanitaire au Soudan » organisée par les puissances internationales, accusée par de nombreux militants soudanais de poursuivre la normalisation des relations internationales avec les RSF et d'aller à l'encontre de la volonté de la population soudanaise. Des manifestations ont eu lieu hier dans différentes villes du monde, à Paris, Londres, Boston, New York, Oslo, Washington, Phoenix, Cardiff, dans le cadre de la « Global March for Sudan » qui vise à demander la fin immédiate de la guerre.
*
Illustration : Combats à Nyala au Darfour. Source : réseaux sociaux
Sudfa est un blog participatif franco-soudanais, créé par un groupe d'ami-e-s et militant-e-s français-e- et soudanais-e-. Il se donne pour objectif de partager ou traduire des articles écrits par des personnes soudanaises, ou co-écrits par des personnes soudanaises et françaises, sur l'actualité et l'histoire politiques, sociales et culturelles du Soudan et la communauté soudanaise en France. Il publie le bloghttps://blogs.mediapart.fr/sudfa, d'où est tiré cet article.
Notes
[1] Aujourd'hui, des journalistes soudanais·e·s et organismes d'investigation tentent de comprendre ce qui s'est passé à Al-Geneina au cours de ces derniers mois, et d'estimer le nombre de morts : certaines études évoquent entre 10 et 15 000 mort·e·s rien que dans cette ville, ce qui est autant que le nombre total de mort·e·s dans tout le pays évoqué par l'ONU.
[2] La déclaration des comités de résistance sera traduite prochainement sur Sudfa.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tunisie. Kaïs Saïed instrumentalise la crise migratoire pour mettre au pas la société civile

Le président tunisien accuse les organismes d'aide aux migrants de faciliter leur implantation dans le pays et de “porter atteinte à l'État”. Un nouveau prétexte pour tenter de faire taire les voix critiques, s'alarme “Nawaat”, un média tunisien lui-même menacé, après l'arrestation de plusieurs responsables associatifs.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Dessin de Z paru dans Débats Tunisie, Tunisie. Article paru à l'origine dans nawaat.org
Des militants et des employés d'organisations de la société civile arrêtés, des organismes onusiens vilipendés, des médias, dont Nawaat, ciblés. Encore une fois, la crise migratoire sert de prétexte pour encourager la chasse aux voix critiques envers [le président tunisien,] Kaïs Saïed.
Dans le sillage de cette guerre contre la migration irrégulière, des figures de la société civile ont été arrêtées. Parmi elles, la fondatrice de l'association Mnemty et militante antiraciste Saadia Mosbah [ainsi que d'autres responsables d'associations travaillant auprès des migrants subsahariens]. Les chefs d'accusation contre eux sont graves : blanchiment d'argent ou encore “association de malfaiteurs dans le but d'aider des personnes à accéder au territoire tunisien”, selon le parquet
Le chef de l'État avait convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale, le 6 mai, consacrée notamment à la question de la migration irrégulière et au financement étranger des associations.
Le chef de l'État parle de “mercenaires”, de “traîtres” qui “portent atteinte à l'État au nom de la liberté d'expression”. Le président de la République évoque un complot visant l'implantation des migrants subsahariens en Tunisie. Il s'agit, selon lui, d'“individus qui ont reçu de l'argent en 2018 pour installer les migrants irréguliers en Tunisie”.
Des ONG accusées d'inertie
Dans ce cadre, Saïed a entamé sa diatribe contre la société civile, notamment contre ceux qui viennent en aide aux migrants. Il les accuse ainsi de manigancer pour fragiliser l'État. Son argumentaire se base sur la publication d'un appel d'offres dans un quotidien venant d'une association d'accueil de migrants. Et sur ce qu'il appelle “les fonds venant de l'étranger en millions de dinars”.
Son discours intervient dans un contexte de crise migratoire. Depuis plusieurs jours, les habitants d'El-Amra et de Jbeniana, deux petites villes très proches, au nord de Sfax, ont exprimé leur ras-le-bol face à la présence de migrants subsahariens. Plusieurs de ces derniers ont été installés dans les oliveraies de la région.
Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État se sert de la question migratoire pour s'attaquer à ses opposants et à la société civile en particulier. Au mois d'août 2023, la crise migratoire à Sfax a été une occasion de mener son offensive contre eux. À l'époque, il a critiqué violemment le positionnement des ONG internationales et locales dans cette crise, et ce, sans jamais les nommer. Il s'est contenté de les accuser d'inertie dans la prise en charge des migrants. “Elles prétendent protéger les migrants mais leur prétendue protection se limite [à] la publication de communiqués mensongers”, avait-il déclaré.
La nouveauté avec cette crise, c'est qu'il a désigné clairement deux de ces ONG, en l'occurrence l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ces derniers ne font que publier des communiqués, lance Saïed. Et d'insister sur la nécessité pour les associations de traiter avec un seul interlocuteur, à savoir l'État tunisien. Paradoxalement, tout en leur reprochant “leur inertie”, il pointe du doigt leur aide aux migrants.
Deux organisations liées à l'ONU
Pointés du doigt par le chef de l'État, l'OIM et le HCR ne travaillent pas dans l'opacité. Contacté par Nawaat dans le cadre d'un reportage sur le campement des réfugiés soudanais dans le quartier du Lac 1 (gouvernorat de Tunis), le HCR nous a fourni les détails concernant son action auprès des réfugiés.
Débordé par l'afflux massif de migrants, notamment des Soudanais fuyant la guerre, l'organisme onusien avance qu'il s'“efforce” de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient d'une protection conforme au droit international, englobant l'accès aux procédures d'asile et aux services de base. En l'occurrence l'aide juridique, un soutien psychosocial, des abris, l'accompagnement vers l'autonomisation, etc.
Ces aides élémentaires ne permettent pas, comme le disent les migrants eux-mêmes et d'autres associations tunisiennes, de vivre confortablement en Tunisie mais [seulement] de survivre. D'ailleurs, le HCR est couramment la cible de critiques de la part des réfugiés et des demandeurs d'asile.
Accusée de faciliter l'implantation des migrants, l'OIM dispose d'un programme d'aide au retour volontaire en faveur des migrants se trouvant en Tunisie.
Rattachés à l'ONU, l'OIM comme le HCR bénéficient de sources de financement connues et reconnues. Les autorités tunisiennes ont une visibilité sur les entrées d'argent de ces organisations comme de toute association bénéficiant d'un financement étranger. Ces ONG affirment, par ailleurs, collaborer étroitement avec les autorités tunisiennes dans la gestion de la crise migratoire.
Rétrécir le champ civique et politique
La société civile est dans le collimateur de Kaïs Saïed depuis des années. Ses appréhensions quant [au] rôle [de ces organismes] et son obsession en rapport avec leur financement étranger se sont manifestées depuis [l'époque où] il était candidat à la présidentielle en 2019. Pourtant, le financement étranger ne concerne pas uniquement la société civile mais tous les domaines, y compris les institutions de l'État.
[Après avoir été] associée au financement du terrorisme, la société civile est désormais accusée d'activités criminelles visant la composition démographique du pays. Les prétextes changent, mais le but reste le même : rétrécir l'espace civique en instaurant un climat hostile vis-à-vis d'une frange de la société civile critique envers le pouvoir en place.
En effet, depuis des mois, la menace d'un amendement du décret-loi 88 [la Tunisie dispose de l'un des cadres juridiques les plus progressistes du monde arabe en matière de liberté d'association, mais une proposition de loi risque de remettre en question les acquis de l'actuel décret-loi 88-2011 relatif aux associations] plane sur la société civile. Des projets de loi dans ce sens sont en gestation. Leur caractère liberticide limitera considérablement l'espace civique.
Mais les restrictions de l'espace civique ont d'ores et déjà commencé. Selon nos sources, certaines ONG ont vu leurs partenariats avec des acteurs publics suspendus ou gelés. De nombreux abus ont été enregistrés également contre des individus travaillant dans des organisations de la société civile, notamment au niveau du renouvellement de leur carte d'identité.
En mars dernier, la Banque centrale de Tunisie a émis une circulaire contenant de nouvelles règles relatives aux transferts financiers provenant de l'étranger au profit des associations. Ces règles apportent de nouvelles restrictions ciblant les associations.
“Une offensive méthodique et systématique”
“Avec l'arrestation de personnalités de la société civile, le danger est monté d'un cran. On est passé de simples menaces à des intimidations financières, et aujourd'hui à des arrestations policières”, s'inquiète Amine Ghali, directeur des programmes au centre Al-Kawakibi pour la transition démocratique (Kadem), dans un entretien avec Nawaat.
Même son de cloche du côté de Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH). “Il s'agit d'une offensive méthodique et systématique contre la société civile, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle a juste pris une autre tournure, bien plus dangereuse, avec cette vague d'arrestations”, dénonce Trifi dans un entretien avec Nawaat.
D'après lui, la société civile “sert de bouc émissaire” lors de cette crise. Au lieu de clarifier la politique de la Tunisie dans la gestion frontalière des flux migratoires, du contenu de ses accords avec l'Union européenne ou avec les pays subsahariens, Saïed ne rate pas une occasion de s'attaquer à la société civile. Il entretient ainsi des “amalgames” entre le problème de la migration et le rôle de la société civile, dénonce le représentant de la LTDH.
Ces amalgames alimentent également la haine et le racisme d'une frange de la population envers les migrants, sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État les livre encore une fois à la vindicte populaire et à la répression policière. Plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été expulsés vers les frontières du pays.
La vague de racisme s'abat aussi sur les Tunisiens à la peau noire. La présidente de Mnemty, Saadia Mosbah, est ainsi touchée. Des compatriotes à la peau noire sont accusés de comploter contre l'État en soutenant le projet colonisateur des migrants subsahariens.
Les médias dans le viseur
Outre les associations et les militants, les sbires du régime à l'image de Riadh Jrad, chroniqueur à l'émission télé Rendez-vous 9, sur la chaîne de télévision privée Attessia, s'en prennent aux médias en les traitant de “traîtres” et de “mercenaires”. Selon lui, ces derniers essaient d'abattre le président de la République, et par ricochet l'État tunisien. Et Nawaat figure en bonne place parmi les médias cités par Jrad, supporteur inconditionnel du régime de Saïed.
Le chroniqueur accuse Nawaat d'avoir “des financements suspects”. Or les sources de financement de notre média sont clairement indiquées sur notre site en toute transparence et sont connues des autorités tunisiennes. Les contenus publiés sur notre site témoignent de notre attachement aux droits et libertés, à la dignité des personnes, notamment les plus vulnérables dont les migrants, et à la souveraineté de la Tunisie.
“Cette offensive visant Nawaat et d'autres médias s'inscrit dans le cadre de la répression de la liberté d'expression”, explique Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), interviewé par Nawaat. En effet, des dizaines de journalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires depuis le coup de force de Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021.
“Le rôle des journalistes n'est pas de relayer la version officielle de l'État, qu'elle soit politique, judiciaire ou sécuritaire, mais de chercher l'information de façon objective et déontologique”, insiste-t-il. Et de rejeter “les propos diffamatoires” visant Nawaat et les autres médias. “Nous encourageons les journalistes à continuer leur travail dans la recherche de la vérité”, plaide-t-il.
Un appel qui risque de ne pas être entendu par une partie des journalistes et des militants de la société civile. “Les gens sont fatigués. Un climat de peur et d'autocensure s'est instauré”, se désole Bassem Trifi.
Rihab Boukhayatia
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel à la vérité et la justice en Kanaky/Nouvelle-Calédonie

« Nous appelons les journalistes et critiques politiques qui œuvrent pour une information impartiale et véridique, à apporter une couverture médiatique plus globale et plus juste sur ce qui se passe actuellement dans l'archipel. » Une cinquantaine d'universitaires, artistes et citoyen·es de Kanaky/Nouvelle-Calédonie et de France interpellent les responsables politiques et les médias. Et alertent sur les nombreuses contrevérités en circulation dans les débats en cours.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Nous, citoyen·nes de Kanaky/Nouvelle-Calédonie et de France, engagé·es pour la justice envers le peuple kanak et les peuples colonisés, appelons le plus grand nombre à prendre conscience de la crise politique, sociale et économique qui se déroule actuellement en Kanaky/Nouvelle-Calédonie.
Malgré les dix jours de mobilisations pacifiques (les « Dix jours pour Kanaky » ) organisés par le mouvement indépendantiste sous le leadership de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) et l'adoption, le 13 mai, par la majorité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de la résolution demandant le retrait du projet de loi sur la modification du corps électoral provincial, le passage en force du Parlement français le 14 et 15 mai dernier a attisé les tensions dans la capitale de l'archipel.
Le corps électoral gelé est un acquis fondamental pour le peuple kanak minorisé dans son propre pays. Obtenu au prix de vies kanak et françaises, il est formalisé dans l'Accord de Nouméa signé en 1998.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, le passage en force de l'État français a causé 7 morts officiellement, des centaines de blessés, l'instauration de l'état d'urgence, l'interdiction de TikTok et le déploiement des forces de l'ordre (gendarmes, GIGN, CRS et forces armées de Nouvelle-Calédonie) de façon démesurée.
Certains représentant·es et commentateur·ices politiques profitent de l'ignorance générale quant à la nature de ces mobilisations et s'empressent de ressortir le discours qualifiant les Kanak de « voyous » et « terroristes », souvent utilisés dans les années 80 pour décrédibiliser le mouvement indépendantiste et justifier le recours à la force de l'État français.
Nous appelons les journalistes et critiques politiques qui œuvrent pour une information impartiale et véridique, à apporter une couverture médiatique plus globale et plus juste sur ce qui se passe actuellement dans l'archipel.
Cela implique de faire remonter d'égale manière les violences envers le peuple autochtone kanak et/ou militant·es indépendantistes plus largement qui sont initiées et perpétrées par des milices européennes armées et par les forces de l'ordre, dans un contexte où la population kanak semble être perçue comme « ennemi intérieur ».
Nous appelons les représentant·es politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale et au Sénat de montrer une plus grande vigilance quant à la désinformation et aux propos biaisés qui circulent au cours de leurs débats sur les aspirations et les actions du peuple kanak colonisé et des populations qui veulent construire le pays avec lui, ainsi que sur le projet politique indépendantiste.
Nous appelons enfin tous les représentant·es politiques de Kanaky/Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas su accepter la main tendue par le peuple autochtone kanak mais qui ont, au contraire, au cours de ces dernières années, et jours, refusé de négocier autrement que selon leurs propres termes, durci leurs positions politiques et, plus récemment, appelé à la mobilisation de milices armées et mortifères, à prendre leur pleine et entière responsabilité.
Bien que le processus d'autodétermination du territoire exigeait la neutralité de l'État français, le président Emmanuel Macron avait clairement annoncé son parti pris en déclarant en mai 2018, lors d'une visite dans l'archipel à la veille du 1er référendum, que « la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie ».
Emmanuel Macron avait présenté lors de cette même visite sa stratégie d'axe Indo-Pacifique qui nécessite la pérennisation de l'occupation et de la colonisation française dans la région. La non-neutralité de l'État dans ce processus s'est à nouveau manifestée lors de la nomination de Mme Sonia Backès, cheffe de file des Loyalistes, comme secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté sous le Gouvernement d'Elisabeth Borne de juillet 2022 à octobre 2023, puis plus récemment celle de M. Nicolas Metzdorf, député anti-indépendantiste, comme rapporteur du projet de réforme constitutionnelle du corps électoral provincial.
Le gouvernement français a failli dans sa responsabilité face à la Kanaky/Nouvelle-Calédonie et, au lieu de continuer le processus de décolonisation sur lequel il s'était engagé depuis deux décennies, s'est borné à son agenda politique jusqu'au-boutiste en faisant passer le troisième référendum d'autodétermination par la force en 2021 et en faisant voter le dégel du corps électoral à Paris en 2024, en l'absence totale de représentant·es politiques kanak et/ou indépendantistes, par des politiques qui, pour la plupart, ignorent l'histoire et le contexte historique et politique du pays, ainsi que l'impact de leurs décisions pour la population de Kanaky/Nouvelle-Calédonie.
Plutôt que le chemin du dialogue et de l'humilité, ce gouvernement a choisi celui de la force en y mobilisant 2700 effectifs de la gendarmerie, des CRS, et du GIGN, en plus des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. La mémoire est encore fraîche dans l'opinion publique française des violences des forces de l'ordre envers les gilets jaunes, envers le personnel soignant lors de la grève des hôpitaux, envers les pompiers lors des manifestations ou encore envers les habitants de banlieues françaises.
Nous invitons les lecteur·ices à prendre la mesure de l'ampleur que cette violence peut prendre dans un contexte colonial, à la couverture médiatique restreinte, et situé à 17 000 km de la France.
Nous appelons la population ainsi que les représentant·es politiques, médias et journalistes français·es à se conscientiser et à se mobiliser pour une plus grande justice envers le peuple kanak et les populations engagées à ses côtés en Kanaky/Nouvelle-Calédonie.
Si le contexte de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie a souvent été brandi comme « exception » dans l'histoire de la France, en ce qu'il représente une opportunité de première décolonisation « réussie », les actes de l'État français piétinent cette opportunité aux dépens du peuple kanak et des autres communautés du pays désirant vivre ensemble paisiblement et de manière égale.
L'histoire contemporaine nous enseigne que la légalité des actions d'un gouvernement n'est pas forcément juste ni humaine. Trop d'horreurs ont été perpétrées par le passé par le colonialisme européen qui bafoue les droits humains fondamentaux des peuples du Pacifique et des Suds pour ses intérêts économiques et politiques.
En ces heures sombres, il s'agit donc de s'éduquer et de se mettre du bon côté de l'histoire en portant des valeurs de justice et d'humanité, car ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui rend la France plus belle, mais la capacité du peuple français à s'engager sur la voie de la décolonisation et à véritablement incarner les valeurs promues par la France.
Les signataires
Anaïs DUONG-PEDICA, chercheuse et enseignante d'université
Angélique STASTNY, docteure en science politique et maître de conférence en études anglophones
Teva AVAE, artiste musicien
Aurélie BOULA, hydrogéologue
Louise CHAUCHAT, avocate
Mathias CHAUCHAT, professeur des universités, agrégé de droit publique, Université de Nouvelle-Calédonie
Stéphanie COULON, auto-entrepreneuse Marcus GAD, artiste musicien
Jean-Michel GUIART, essayiste
Karyl KONDREDI, enseignant
Iabe Patrick LAPACAS, inspecteur des finances publiques, acteur, membre du Mouvement des Jeunes Kanak en France (M.J.K.F)
Matthieu LE BARBIER, journaliste reporter d'images
Pierre Chanel Uduane LEPEU, militant associatif des associations JUPIRA, Cap 2026, Ceméa Pwârâ Wâro, centre Céméa Hubéé
Luen LOPUE, militant anticolonial
Diana MACHORO, gérante de société
Roselyne MAKALU, auto-entrepreneuse
Chrystèle MARIE, doctorante en anthropologie sociale, Lesc-CNRS, Université de Paris- Nanterre, calédonienne
Hamid MOKADDEM, écrivain, citoyen de Nouvelle-Calédonie Mouvement des Jeunes Kanak en France (M.J.K.F)
Doriane NONMOIRA, demandeuse d'emploi
Noëlla POEMATE, professeur de français
Cécile TAUHIRO, Adjoint technique de recherche et de formation dans l'enseignement et gérante de société
Pascal TJIBAOU, militant indépendantiste FLNKS et CCAT
Ariel TUTUGORO, président de la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique
Claudia WABEALO, éducatrice
Coralie WAKAJAWA, fonctionnaire communale
Hmana WAWALAHA, juriste en droit public
Billy WETEWEA, pasteur de l'église évangélique de Kanaky/Nouvelle-Calédonie
Walter WHAAP, chauffeur engins miniers
Tristan XALITE, jeune kanak de Lifou
Jean-Pierre XOWIE, militant du FLNKS
Sadia AGSOUS BIENSTEIN, Université Libre de Bruxelles
Etienne BALIBAR, professeur honoraire, Université Paris Nanterre
Yazid BEN HOUNET, anthropologue, chargé de recherche (HDR) au CNRS, Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Collège de France – CNRS – EHESS)
Saïd BOUAMAMA, sociologue indépendant
Vincent BRENGARTH, avocat
Lucia DIRENBERGER, sociologue, CNRS
Annie ERNAUX, écrivaine
Giulia FABBIANO, maîtresse de conférence en anthropologie, Aix-Marseille Université
Nacira GUÉNIF, sociologue et anthropologue, professeure des universités, Paris 8, LEGS (CNRS), citoyenne algéro-française
Abdellali HAJJAT, professeure de sociologie, Université Libre de Bruxelles
Sari HANAFI, professeur, Department of Sociology, Anthropology & Media Studies, Directeur du Islamic Studies program et du Center for Arab and Middle Eastern Studies, American University of Beirut, ancien président de la International Sociological Association (2018- 2023)
Léopold LAMBERT, rédacteur en chef du magazine The Funambulist
Claire MARYNOWER, maîtresse de conférences en histoire, Sciences Po Grenoble-UGA
Sylvie MONCHATRE, Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2
Paul B. PRECIADO, philosophe
Ulysse RABATÉ, Université Paris 8
Guillaume SIBERTIN-BLANC, professeur de philosophie, Université Paris 8
Sylvie TISSOT, sociologue, Université Paris 8, CRESPPA (CNRS)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nouvelle-Calédonie : après avoir tout cassé, Macron demande aux autres de réparer

Au terme d'une visite éclair dans l'archipel, le président de la République n'a rien annoncé de concret, si ce n'est qu'il donnait « quelques semaines » aux indépendantistes pour ramener le calme et reprendre le dialogue. Fuyant ses propres responsabilités, il a surtout démontré son entêtement à nier la racine coloniale du problème.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Emmanuel Macron aura donc passé 18 heures en Nouvelle-Calédonie pour finir par annoncer qu'il pourrait éventuellement défaire ce qu'il a fait et que beaucoup lui conseillaient de ne pas faire. Le tout sans jamais reconnaître sa part de responsabilité dans la crise politique que traverse l'archipel depuis bientôt deux semaines. Elle est pourtant immense, comme s'accordent à le dire la plupart des personnes qui ont eu à traiter ce dossier au cours des trois dernières décennies. Et qui en ont mesuré la complexité, tout autant que la fragilité.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, juste avant de redécoller pour la métropole, le président de la République a donné une conférence de presse dans laquelle il a dressé ses « objectifs » à court terme : le retour au calme et la reprise du dialogue entre les loyalistes et les indépendantistes. « Nous allons reprendre pas à pas chaque quartier, chaque rond-point, chaque barrage », a-t-il indiqué, évoquant les 3 000 forces de sécurité intérieure et les 130 membres du GIGN et du Raid déployés dans l'archipel pour faire face à « des émeutiers [aux] techniques quasi insurrectionnelles ».
Il s'agit là de sa « priorité », a-t-il ensuite insisté dans un entretien accordé à plusieurs médias locaux. « C'est pas le Far West, la République doit reprendre l'autorité sur tous les points. [...] En France, c'est pas chacun qui se défend, il y a un ordre républicain, ce sont les forces de sécurité qui l'assurent », a martelé le chef de l'État, en désignant explicitement les militants des quartiers populaires de Nouméa, mais sans jamais évoquer clairement les milices qui se sont constituées du côté des loyalistes. Et dont le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc, avait soutenu l'existence.
Face à la presse, et après avoir abordé la question de la reconstruction, Emmanuel Macron s'est attardé sur celle du « chemin politique », reconnaissant que ce sujet était « derrière une grande partie des violences ». « Nous ne partons pas d'une page blanche », a-t-il affirmé, en se référant au préambule de l'accord de Nouméa signé en 1998. « La reconnaissance du peuple kanak, cette histoire commune, les ombres et les lumières... », a égrené le président de la République, sans jamais employer le mot « colonisation », pourtant au cœur de ce texte fondateur et des révoltes actuelles.
Le chef de l'État est resté volontairement flou sur la suite des évènements, se contentant d'expliquer qu'il ferait « un point d'étape d'ici un mois au maximum ». Mais en omettant sciemment de nommer les choses et de poser ainsi les véritables bases du problème, il a finalement donné un aperçu assez clair de ses intentions. Et exprimé entre les lignes sa volonté de poursuivre la méthode initiée fin 2021, au moment où il avait imposé le troisième référendum dans l'espoir de conclure le processus de décolonisation en l'absence du peuple colonisé.
Une méthode grossière
Interrogé sur ses échanges avec la délégation d'indépendantistes, Emmanuel Macron a d'ailleurs indiqué qu'il « ne reviendrai[t] pas sur le troisième référendum ». « C'est un point de désaccord, mais il est assumé », a-t-il dit, balayant une nouvelle fois les raisons pour lesquelles le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) avait à l'époque appelé à la non-participation. Les Kanak, premières victimes de la pandémie, étaient alors dans le temps des coutumes du deuil, qui sont intrinsèquement liées à leur identité, elle-même au cœur du contrat social calédonien.
Non content de nier le fondement même de l'accord de Nouméa, le président de la République s'est aussi employé à parler à la place des indépendantistes, avant même que ces derniers ne se soient exprimés. « Je crois qu'ils sont conscients de leurs responsabilités », a-t-il affirmé, à la façon d'un maître d'école faisant état de ses remontrances auprès de garnements. Une façon de procéder pour le moins grossière lorsqu'on connaît l'importance de la parole pour le peuple kanak. « Maintenant, je veux leur faire confiance », a ajouté le chef de l'État sur le ton de la magnanimité, comme s'il n'avait pas lui-même rompu ce contrat.
Un contrat qui reposait depuis près de quarante ans sur une exigence : l'impartialité de l'État. Plus qu'une exigence même, un principe cardinal qu'Emmanuel Macron n'a cessé de bafouer depuis 2018 et sa première visite officielle dans l'archipel. D'abord en répétant que « la France serait moins grande et moins belle sans la Nouvelle-Calédonie ». Puis en prenant fait et cause pour le camp loyaliste, jusqu'à nommer l'une de ses figures de proue au gouvernement – Sonia Backès, présidente de l'assemblée de la province Sud depuis 2019, devenue secrétaire d'État chargée de la citoyenneté entre 2022 et 2023. Enfin en tentant de mettre la pression sur les indépendantistes en imposant le dégel du corps électoral.
Emmanuel Macron considère avoir fait « le maximum d'efforts possibles » pour un retour au calme.
Les signaux d'alarme clignotaient pourtant dans tous les sens. Il y a quelques jours encore, même Édouard Philippe, dernier premier ministre à s'être occupé de ce dossier à Matignon, a publiquement affirmé que « nous [étions] sortis du cadre politique » dans lequel vivait la Nouvelle-Calédonie depuis les accords de Matignon en 1988. Ce cadre reposait « sur une forme d'impartialité de l'État, sur l'idée que toutes les évolutions devr[aient] être le produit d'un compromis, c'[était] ça la promesse », a précisé le maire du Havre (Seine-Maritime).
Ces différents coups de boutoir ont fini par faire exploser l'archipel. À présent qu'il a tout bien cassé, le chef de l'État exige des indépendantistes qu'ils réparent, selon une variante de la formule désormais consacrée de Gabriel Attal. Lui « considère avoir fait le maximum d'efforts possibles pour un retour au calme ». C'est du moins ce qu'il a expliqué lors de sa conférence de presse, lorsqu'une journaliste l'a interrogé sur la présence d'un représentant de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) dans la délégation des indépendantistes qu'il a rencontrée.
Une présence d'autant plus remarquée que le militant en question, Christian Tein, fait partie des nombreux membres de la CCAT actuellement assignés à résidence. « Les responsables politiques indépendantistes m'ont demandé de l'associer, a justifié Emmanuel Macron face aux médias locaux. J'ai accédé à cette demande par souci d'efficacité. C'est un geste de ma part de confiance et même de responsabilité. J'espère qu'ils seront à la hauteur de cette confiance et qu'ils tiendront leur parole [...]. S'ils ne sont pas au rendez-vous aux résultats, j'aurai eu tort. »
Une mission et toujours autant de questions
Également questionné sur la façon dont son gouvernement, et en particulier son ministre de l'intérieur et des outre-mer, avait tenté de rendre cette organisation politique infréquentable, le président de la République a balayé le sujet. « Les ministres font attention à ce qu'ils disent », a-t-il affirmé, oubliant un peu vite que Gérald Darmanin, posté juste derrière, avait parlé de « groupe mafieux » et qualifié Christian Tein de « voyou », tandis que l'ex-secrétaire d'État Sonia Backès employait le mot « terroristes ».
En signe d'« apaisement » – les guillemets sont de rigueur –, Emmanuel Macron s'est « engagé » à ce que la révision constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral « ne passe pas en force dans le contexte actuel » et que « nous nous donnions quelques semaines afin de permettre la reprise du dialogue en vue d'un accord global ». Une solution qui a sa « préférence » depuis toujours, a-t-il assuré, comme s'il n'était en rien responsable de la façon dont l'exécutif a conduit toute cette affaire, au mépris de la prudence et des alertes.
Comme toujours en pareilles circonstances, le président de la République s'est exprimé de telle façon que chacun·e puisse interpréter les sous-textes à sa manière. Ce qui n'a pas manqué, notamment dans le camp loyaliste, où le député Renaissance Nicolas Metzdorf, rapporteur du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, s'est réjoui du maintien du « calendrier initial », tandis que l'élu Calédonie ensemble (parti non indépendantiste), Philippe Gomès, a jugé que le chef de l'État avait dit « diplomatiquement que cette réforme “unilatérale et partielle” [était] abandonnée ».
Pour réengager le travail, le chef de l'État a choisi une mission de discussion administrative et confié à trois hauts fonctionnaires, spécialistes de la Nouvelle-Calédonie ou des sujets constitutionnels, le soin de poursuivre les échanges avec les forces politiques. Cet accord global, a-t-il précisé en conférence de presse, devra comporter la question du dégel du corps électoral, mais aussi l'organisation du pouvoir, la citoyenneté, le « nouveau contrat social » censé régler les inégalités qui se sont accrues dans l'archipel, et son avenir économique.
Il concernera également « la question du vote d'autodétermination », a conclu le président de la République, sans trop s'attarder sur ce point. Il est pourtant crucial, car il dément toutes celles et ceux qui, au sein du gouvernement et de la majorité, font mine de penser que le processus de décolonisation s'est achevé avec le troisième référendum et que la Nouvelle-Calédonie restera éternellement française. C'est renier, là encore, l'engagement que la France avait pris en signant l'accord de Nouméa : conduire l'archipel « sur la voie de la pleine souveraineté ».
Ellen Salvi
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











