Derniers articles

« Comment Israël dévoie les allégations d’antisémitisme pour projeter ses propres crimes sur les Palestiniens »

Dans la foulée de la multiplication des campements d'étudiant·e·s pro-palestiniens sur les campus universitaires des Etats-Unis, les accusations d'antisémitisme sont de nouveau au centre du discours politique états-unien et mondial. Il ne fait aucun doute, comme Peter Beinart (Notebook, 28 avril 2024) et d'autres l'ont indiqué, que des expressions d'antisémitisme sont apparues dans certaines de ces actions, mais leur fréquence a été fortement exagérée. En effet, des personnalités juives et non juives influentes dans les médias et la politique ont délibérément cherché à créer une inquiétude morale publique en associant les critiques sévères d'Israël et du sionisme à de l'antisémitisme.
Tiré d'À l'encontre.
Cet amalgame est le résultat d'une campagne menée depuis des décennies par Israël et ses partisans dans le monde entier afin d'étouffer toute opposition aux politiques violentes d'occupation [Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza…], d'apartheid et de domination de l'Etat sur les Palestiniens – qui, au cours des sept derniers mois, ont pris des proportions immenses, voire génocidaires.
Cette stratégie n'est pas seulement cynique, hypocrite et nuisible à la lutte essentielle contre le véritable antisémitisme. Elle permet également à Israël et à ses partisans, comme nous le soutiendrons ici, de nier les propres crimes et le discours violent d'Israël en les inversant et en les projetant sur les Palestiniens et leurs partisans, et en appelant cela de l'antisémitisme [1].
Ce mécanisme psycho-discursif d'inversion et de projection sous-tend le document fondateur de la prétendue « lutte contre l'antisémitisme » : la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA-International Holocaust Remembrance Alliance), qu'Israël et ses alliés diffusent agressivement dans le monde entier [2].
En réponse aux protestations des étudiant·e·s, la Chambre des représentants des Etats-Unis a récemment adopté un projet de loi qui, s'il était approuvé par le Sénat, intégrerait cette définition dans la législation, et ce malgré le fait que l'IHRA elle-même la décrive comme une « définition de travail juridiquement non contraignante ».
Une définition par inversion et projection
L'IHRA est une organisation internationale influente composée de 35 Etats membres provenant principalement du Nord (y compris Israël et l'Europe de l'Est). L'organisation a adopté une définition de travail de l'antisémitisme en 2016 qui comprend une vague articulation de l'antisémitisme comme « haine envers les Juifs » ainsi que 11 exemples qui prétendent l'illustrer ; sept d'entre eux se concentrent sur Israël, assimilant essentiellement la critique d'Israël et l'opposition au sionisme à l'antisémitisme. Cette définition a donc suscité une énorme controverse dans le monde juif et au-delà, bien qu'elle ait été adoptée par des dizaines de pays et des centaines d'organisations, des universités aux clubs de football [3].
D'innombrables exemples ont été enregistrés au fil des ans pour montrer comment cette définition sert à restreindre la liberté d'expression, à faire taire les critiques à l'égard d'Israël et à harceler ceux qui les expriment. A tel point que Kenneth Stern, principal rédacteur de la définition, en est devenu le principal opposant. D'autres définitions, comme la Déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme (dont les auteurs de cet article ont été parmi les initiateurs et les rédacteurs), ont été proposées comme des outils plus précis et moins politiquement biaisés à utiliser à des fins éducatives dans la lutte contre l'antisémitisme.
La définition de l'IHRA met en évidence le mécanisme d'inversion et de projection par lequel Israël et ses partisans nient les crimes d'Israël et les attribuent aux Palestiniens. L'un des exemples de la définition stipule, par exemple, que « nier au peuple juif son droit à l'autodétermination » est antisémite. Pourtant, la politique officielle d'Israël en matière de colonisation, d'occupation et d'annexion au cours des dernières décennies a nié au peuple palestinien son propre droit à l'autodétermination.
Cette politique s'est intensifiée sous la direction de Benyamin Netanyahou qui, en janvier 2024, s'est publiquement engagé à résister à toute tentative de création d'un Etat palestinien. Les principes directeurs fondamentaux de la coalition gouvernementale déclarent en outre, en écho à la loi sur l'Etat-nation juif de 2018, que « le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les régions de la Terre d'Israël ». Alors qu'Israël s'oppose activement à l'autodétermination des Palestiniens, la définition de l'IHRA inverse et projette cet état de fait sur les Palestiniens eux-mêmes, en la qualifiant d'antisémitisme.
Selon la définition de l'IHRA, « établir des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis » est un autre exemple d'antisémitisme. Ici aussi, le schéma d'inversion et de projection est évident, puisqu'Israël et ses partisans ne cessent d'associer les Arabes et surtout les Palestiniens aux nazis.
Il s'agit d'un discours profondément enraciné et très populaire en Israël. Il va de David Ben-Gourion, premier Premier ministre israélien, qui considérait les Arabes qui combattaient Israël comme les successeurs des nazis, à Benyamin Netanyahou, qui affirme que le Hamas représente de nouveaux nazis, en passant par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui a récemment affirmé qu'il y avait deux millions de nazis en Cisjordanie occupée (Times of Israel,28 novembre 2023).
A la lumière de ce narratif inversé, l'affirmation de la définition de l'IHRA selon laquelle « appliquer deux poids deux mesures » dans les jugements moraux sur Israël est antisémite traduit un autre exemple de ce mécanisme d'inversion et de projection. La définition de l'IHRA elle-même utilise deux poids deux mesures : alors qu'Israël est autorisé à refuser aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination et à les comparer aux nazis, la définition affirme que refuser aux Juifs le droit à l'autodétermination et établir des liens entre la politique israélienne et la politique nazie est antisémite.
Pour la défense du génocide
Ce mécanisme psycho-discursif va au-delà de la définition de l'IHRA, comme l'a révélé la récente audition au Congrès de trois présidents d'universités d'élite des Etats-Unis. Un moment clé s'est produit lorsque la députée républicaine Elise Stefanik a demandé aux présidents si leurs institutions toléreraient des appels au génocide des Juifs.
Je suppose que vous connaissez le terme « intifada », n'est-ce pas ? a demandé Elise Stefanik à Claudine Gay, présidente de l'Université de Harvard. « Et vous comprenez, a-t-elle poursuivi, que l'utilisation du terme intifada dans le contexte du conflit israélo-arabe est en fait un appel à la résistance armée violente contre l'Etat d'Israël, y compris la violence contre les civils et le génocide des Juifs. Le savez-vous ? »
Cette assimilation de l'intifada au génocide est sans fondement : l'intifada est le mot arabe qui désigne un soulèvement populaire contre l'oppression et pour la libération et la liberté (le verbe intafad signifie littéralement « se débarrasser »). Il s'agit d'un appel à l'émancipation qui a été répété à de nombreuses reprises dans le monde arabe contre des régimes oppressifs, et pas seulement en Israël. Une intifada peut être violente, comme l'a été la seconde intifada en Israël-Palestine entre 2000 et 2015, ou non violente, comme l'a été la majeure partie de la première intifada entre 1987 et 1991, ou l'« intifada WhatsApp » au Liban en 2019. Dans ces conditions, la seule allusion au génocide réside dans l'imagination d'Elise Stefanik et de ses semblables. Ce fut un moment douloureux : Stefanik a tendu un piège à Claudine Gay, et elle est tombée dedans.
Un autre exemple de fausse allégation pernicieuse est l'affirmation d'Israël et de ses partisans selon laquelle le slogan de libération palestinien « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » est génocidaire et antisémite [voir l'article de Stephen Zunes publié sur ce site le 7 mai 2024]. Comme l'ont affirmé les historiens Maha Nasser, Rashid Khalidi et d'autres, la grande majorité des Palestiniens et de leurs partisans qui scandent ce slogan veulent simplement dire que la terre de la Palestine historique sera libérée politiquement – en rejet absolu de la réalité actuelle de l'absence de liberté pour les Palestiniens, sous diverses formes, entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Cela pourrait prendre la forme d'un seul Etat avec des droits égaux pour tous, de deux Etats-nations pleinement indépendants ou d'une sorte d'arrangement binational ou confédéral.
Dans les deux cas, Israël et ses partisans trouvent un appel au génocide contre les Juifs là où il n'existe pas. Pourtant, en Israël, après les massacres et les atrocités du 7 octobre, de nombreux dirigeants israéliens, ministres du cabinet de guerre, hommes politiques, journalistes et rabbins ont appelé explicitement et ouvertement à un génocide à Gaza dans plus de 500 cas documentés rien qu'au cours des trois premiers mois (Law for Palestine, 4 janvier 2024), certains d'entre eux lors d'émissions de télévision à des heures de grande écoute. Cela a été exposé de manière bouleversante au monde entier dans la plainte que l'Afrique du Sud a déposée contre Israël en décembre 2023 devant la Cour internationale de justice (CIJ).
Il s'agit, par exemple, du président Isaac Herzog, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu. Plus récemment, l'influent rabbin Eliyahu Mali a exhorté l'armée israélienne à tuer tous les enfants et toutes les femmes de Gaza, tandis que Bezalel Smotrich a appelé à l'anéantissement total des villes de Rafah, Deir al-Balah et Nuseirat. Ces voix représentent une large part de l'opinion publique israélienne et correspondent à ce qui se passe réellement sur le terrain.
Le 26 janvier, la CIJ a rendu un arrêt provisoire déclarant qu'il existe un « risque plausible » de violation du droit des Palestiniens à être protégés d'un génocide. La situation s'est encore détériorée depuis, Israël étendant son invasion à Rafah et affamant délibérément les 2,3 millions d'habitants de Gaza [4].
De nombreux spécialistes du génocide – parmi lesquels Raz Segal, Omer Bartov, Ronald Grigor Suny, Marion Kaplan, Amos Goldberg et Victoria Sanford – sont parvenus plus ou moins à la même conclusion que la CIJ. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a également affirmé, dans son récent rapport intitulé « Anatomie du génocide », qu'« il y a des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant qu'Israël a commis un génocide est atteint ».
Ainsi, ce qu'Israël et ses partisans accusent les Palestiniens d'inciter à commettre, les fonctionnaires et les personnalités israéliennes le déclarent explicitement et ouvertement, et l'armée israélienne le perpètre. Et tandis que les Palestiniens et leurs partisans chantent la libération « du fleuve à la mer », Israël impose la suprématie juive « du fleuve à la mer » sous la forme de l'occupation, de l'annexion et de l'apartheid.
Nous suggérons donc d'interpréter cette inversion et cette projection non seulement comme un cas classique de double standard hypocrite contre des Palestiniens, mais aussi – comme c'est souvent le cas avec les processus de projection – comme un mécanisme de défense et de déni. Comme Israël et ses partisans ne peuvent pas faire face à la structure d'apartheid oppressive de l'Etat, à sa délégitimation des Palestiniens ou à sa rhétorique et à ses crimes génocidaires, alors ils déforment ces allégations et les projettent sur les Palestiniens.
La prétendue « lutte contre l'antisémitisme » menée par Israël et ses partisans, fondée sur la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, doit donc être considérée comme un moyen supplémentaire utilisé par un Etat puissant pour nier ses actes criminels et ses atrocités massives. Le gouvernement des Etats-Unis doit le refuser catégoriquement. (Article publié sur le site israélien +972 le 21 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Amos Goldberg est professeur d'histoire de l'Holocauste. Ses ouvrages les plus récents sont Trauma in First Person : Diary Writing during the Holocaust (Indiana University Press, 2017) et un ouvrage coédité avec Bashir Bashir, The Holocaust and the Nakba : A New Grammar of Trauma and History (Columbia University Press, 2018).
Alon Confino est titulaire de la chaire Pen Tishkach d'études sur l'Holocauste à l'Université du Massachusetts, à Amherst. Son dernier ouvrage est A World Without Jews : The Nazi Imagination from Persecution to Genocide (Yale University Press, 2014).
Notes
[1] Henry Laurens, professeur au Collège de France, dans un entretien avec le quotidien Libération, à la question « L'usage du slogan « Du Jourdain à la mer » ou le symbole des mains ensanglantées sont-ils le signe d'une radicalisation des manifestants pro-palestiniens ? » répond : « Ce symbole est utilisé depuis des siècles et renvoie simplement à l'expression « avoir du sang sur les mains ». C'est le célèbre monologue de Lady Macbeth ! Quant au slogan « Du Jourdain à la mer », on a oublié que c'est aussi un vieux discours sioniste d'extrême droite. Il renvoie au droit à l'autodétermination des Palestiniens. Juridiquement, Israël n'a pas de frontières officielles. En 2004, un avis de la Cour internationale de justice déclare que ses frontières sont celles d'avant juin 1967 mais Israël ne le reconnaît pas et se revendique dans de nombreuses occasions comme le seul héritier territorial de la Palestine mandataire. Côté palestinien, le discours officiel depuis Oslo a toujours distingué un Etat à construire dans les territoires occupés libérés, et une Palestine historico-géographique, qui existe indépendamment de l'Etat palestinien à construire, comme une origine, un passé qui ne peut être effacé. La solution des deux Etats, une fois appliquée, implique des deux côtés l'abandon de toute revendication territoriale. » (Réd.)
[2] Voir l'ouvrage Whatever Happened to Antisemitism ? : Redefinition and the Myth of the ‘Collective Jew, d'Antony Lerman, Pluto Press, June 2022.
[3] A ce sujet, voir sur ce site la tribune « Antisémitisme : combattre le feu avec le pyromane ? », signée par Mateo Alaluf, Vincent Engel, Fenya Fischler, Henri Goldman, Heinz Hurwitz, Simone Süsskind. (Réd.)
[4] La Cour internationale de justice a ordonné, ce vendredi 24 mai 2024, à Israël d'arrêter « immédiatement » son offensive militaire à Rafah dans le sud de Gaza. Voir ONU Info. « La Cour considère également que, d'après les informations dont elle dispose, “les risques immenses associés à une offensive militaire à Rafah ont commencé à devenir réalité, et augmenteront encore si l'opération se poursuit”. Face à cette situation, dans son ordonnance du vendredi 24 mai, la Cour réaffirme, par 13 voix contre deux, les mesures conservatoires indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, qui doivent être immédiatement et effectivement mises en œuvre. »
Dans ONU Info, il est aussi indiqué : « L'ordonnance de vendredi survient quelques jours après que le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et trois dirigeants du Hamas, pour des crimes présumés commis à Gaza et en Israël. » (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« The Apprentice » de Ali Abbasi – Don’t feed the Trump

La force du portrait d'Ali Abbasi est d'opposer l'empathie à la cruauté, la force de l'enquête à l'impunité. Il déconstruit ainsi intelligemment le mythe du patriote américain. En compétition en sélection officielle au Festival de Cannes. « The Apprentice » d'Ali Abbasi, avec Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova…
Tiré du blogue de l'autrice.
Dans The Apprentice, le réalisateur dano-iranien Ali Abbasi s'intéresse à la fabrique du monstre Donald Trump. C'est une nouvelle pierre à la déconstruction du mythe méritocratique, déjà entamée par le précédent documentaire "Trump, un rêve américain" qui se concentrait davantage sur les talents de Donald héritier pour accumuler les dettes et les procès. Ali Abbasi se concentre ici sur la genèse du magnat de l'immobilier, son apprentissage de l'agressivité et de la masculinité toxique, le développement de son phrasé caractéristique rempli d'hyperboles, de la candeur naïve de sa jeunesse jusqu'à son addiction au pouvoir et à l'argent.
La sortie du film est prévue à la mi-septembre, avant les élections américaines de novembre. Alors que Donald Trump, 77 ans, ancien président, est donné gagnant par la majorité des sondages, malgré les affaires qui le visent, son sexisme notoire, ses liens avec des groupuscules suprémacistes, et les mensonges qu'il a proférés, rien ne semble interférer avec son inexorable retour au pouvoir. Le biopic a donc l'ambition au moins d'expliquer et idéalement de contrer la nouvelle ascension jusqu'au pouvoir de celui que la moitié des Américains abhorre alors que l'autre moitié l'adore.
Pas étonnant de voir que cet homme, héritier de l'empire de son père, grandit dans le culte du self-made man, mais surtout avec des millions dans les poches. Ce que l'on ignore davantage c'est qu'il tient son éthique de requin à un illustre avocat, connu pour son agressivité redoutable. Pour Roy Cohn (les Français les plus malintentionnés y verront une déclinaison américaine d'un Nicolas Sarkozy, petit homme à la gouaille hargneuse criblé d'enquêtes pour corruption, aux mouvements de menton saccadés et au franc-parler provocateur), l'essentiel est de gagner. La vie se sépare en deux catégories, les killers et les losers. Pour cela, tous les moyens sont bons : l'attaque, l'argent, le mensonge. Toujours surenchérir. Tout s'achète. Toujours prétendre qu'on a gagné même quand on a perdu.
Le jeune Trump, qui paraît si inoffensif, suivra à la lettre la leçon fondatrice d'un délire narcissique botoxé au capitalisme décomplexé. Il y a les exemples que détaille le film : le chantage exercé sur un fonctionnaire pour gagner une affaire, la corruption et les menaces sur le maire de New York. Dans la catégorie masculinité toxique on retrouve : la Trump Tower que Donnie veut plus grande que les autres, l'achat du consentement d'Ivanka au mariage, le viol. Mais il y a aussi le hors champ, ces exemples que le film invoque immanquablement : les réalités alternatives, le gros bouton du nucléaire que Trump se dispute avec Kim Jong Un, et bien sûr la prise du Capitole par un groupuscule encouragé par un Trump contestant sa défaite.
pprentice » reprend le nom de la série de télé-réalité animée et produite par Donald Trump. C'est un trompe-l'œil ; face aux réalités alternatives propagées et revendiquées par Trump, le réalisateur convoque justement la seule arme qui vaille : l'analyse sociologique et la vérité. La prestation de l'acteur est époustouflante, autant dans les moues proéminentes qu'arbore le personnage que dans sa transformation d'un être méché, jamais éméché, d'abord complètement gauche puis si imposant. La force du parti pris est aussi celle d'un regard empreint de compréhension, presque de compassion face à la rudesse d'un père et aux moqueries d'un milieu impitoyable. Ali Abbasi nous rappelle qu'avant d'être un être abject, Donnie aussi a été innocent. La société, ou plus exactement le capitalisme et son agitation d'ego et d'ambitions débridés prête à tout écraser, est profondément responsable de phénomènes médiocratiques comme le trumpisme.
La force du portrait d'Ali Abbasi est d'opposer l'empathie à la cruauté, la force de l'enquête à l'impunité. Il déconstruit ainsi intelligemment le mythe du patriote américain s'élevant au-dessus d'une loi du Talion. Don't feed the troll qui s'engraisse des attaques et des coups bas. Dans un ultime pied de nez qui clot son film, le réalisateur convoque un journaliste chargé de tirer le portrait de Trump dans un livre. L'intéressé se moque un peu du résultat, pourvu que le livre fasse parler de lui. En conférence de presse, Abbasi persiste et signe : il n'est pas contre une rencontre avec le héros de son film. Il n'est d'ailleurs pas sûr que le film lui déplairait, « il serait probablement surpris ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Taylor Swift, l’icône pop qui influence la technologie

Tournée record, album record, personnalité de l'année… le phénomène Taylor Swift semble inarrêtable. Son influence est significative, en particulier dans le secteur de la technologie.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
2 mai 2024
Par Oihab Allal-Cherif
Taylor Swift en août 2023, à Los Angeles, lors de sa tournée « Eras ». Flickr/Paolo Villanueva, CC BY
Le 19 avril, Taylor Swift a sorti son onzième album Tortured Poets Department, qui bat tous les records. Elle avait déjà à son actif celui de l'album le plus streamé sur Spotifyen 24 heures, ses albums Midnights et 1989 étant maintenant respectivement en deuxième et troisième place. Elle est actuellement la première artiste à occuper les 14 premières places duBillboard Hot 100, après être devenue la première à occuper les dix premières places en 2022 avec son précédent album. Le 2 avril, Taylor Swift est également entrée dans le classement Forbesdes milliardaires uniquement grâce à sa musique, ce qui est exceptionnel pour une artiste. Sa tournée « Eras » se poursuit et elle sera en France du 9 au 12 mai pour quatre concerts à Paris La Défense Arena.
Youtube : Décryptage du « Eras Tour » de Taylor Swift.
Recordwoman absolue des albums classés N°1, Taylor Swift n'est pas seulement une chanteuse populaire et créative : c'est une artiste engagée et militante qui lutte pour changer certaines mauvaises pratiques des entreprises de la tech. Elle est aussi une inventeuse qui révolutionne l'industrie musicale et crée une nouvelle relation avec son public. Sa capacité à être en phase avec la société et la technologie a contribué à son succès exceptionnel. C'est sans doute ce qui a conduit à sa désignation comme[ personnalité de l'année 2023par le magazine Times.
L'amour-haine pour les plates-formes de streaming
Taylor Swift n'hésite pas à utiliser sa notoriété et son influence pour mettre en place un rapport de force avec les géants du numérique, les studios de cinéma, et les professionnels de la musique.
Si son dernier album est le premier au monde à atteindre 300 millions de streams en une seule journée, Taylor Swift n'a pas toujours eu de bonnes relations avec les plates-formes musicales, surtout gratuites. Fin 2014,Taylor Swift a retiré tout son catalogue de Spotify, Deezer, Google Play, Amazon Music et Tidal, pour manifester son mécontentement concernant le niveau de rémunération des artistes. Elle ne reviendra qu'au début de l'année 2018.
Pourtant, la consommation de la musique se faisait, et se fait toujours, essentiellement gratuitement via YouTubeou SoundCloud, sans parler du piratage. Bien que sa décision de boycott la prive de millions de dollars de revenus annuels,elle l'assume et explique défendre les jeunes artistes pour lesquels gagner 0,00029 dollar par écoute est inacceptable. Dans une tribune pour le Wall Street Journal, elle dénonce la valeur trop faible accordée à la musique par les services de streaming.
Une plus grande transparence sur les droits d'auteurs et certaines nouvelles règles comme le délai de deux semaines avant que les nouveaux titres soient accessibles, de même que les contraintes d'écoute pour les abonnés non payants ont contribué au retour de Taylor Swift sur ces plates-formes. La lutte de la chanteuse aura donc favorisé l'émergence d'un modèle de streaming plus juste. En 2023, Taylor Swift est devenue l'artiste mondiale de l'année de Spotify avec plus de 26 milliards d'écoutes sur la plate-forme.
Toutube : Taylor Swift est l'artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023.
Lors du lancement d'Apple Music en 2015, Taylor Swift a annoncé qu'elle allait refuser que son album 1989 soit accessible sur la plate-forme de streaming qui avait prévu un essai gratuit de trois mois au cours desquels les droits de propriété intellectuelle ne seraient pas payés aux interprètes, auteurs, compositeurs et producteurs. À la suite de sa lettre ouverte sur Tumblroù elle dit très clairement « Nous ne vous demandons pas d'iPhones gratuits. Ne nous demandez pas de vous fournir notre musique sans compensation », Apple est revenu sur sa décision et a décidé de verser les droits d'auteurs pendant la période d'essai. Taylor Swift deviendra ensuite l'ambassadrice de la plate-forme.
L'innovation technologique au cœur des concerts
La tournée « The Eras Tour » de Taylor Swift est la plus lucrative de tous les temps, ayant déjà rapporté plus d'un milliard de dollars. Le spectacle de trois heures trente, qui rassemble une quarantaine de titres et nécessite 50 camions, a même causé un tremblement de terre de magnitude 2,3 à Seattle.Sa scénographie très élaborée se compose d'un écran géant et de trois scènes avec des plates-formes mobiles connectées par une rampe, le tout recouvert d'écrans pour générer des effets visuels. Viennent s'ajouter des projecteurs, des lasers, des lance-flammes, des canons à fumée, des feux d'artifice… dans une surenchère technologique.
Taylor Swift crée des images associées à ses musiques dans la foule grâce à des bracelets distribués aux spectateurs.La technologie LED de PixMoba aussi été utilisée par plusieurs artistes en 2022 comme Coldplay (« Music of the Spheres World Tour »), Lady Gaga (« Chromatica Ball »), Imagine Dragons (« Mercury World Tour »), The Weeknd (« After Hours til Dawn Tour ») et Bad Bunny (« The World's Hottest Tour »). Dès 2015, pour son « 1989 World Tour », Taylor Swift est une des premières à utiliser ces effets visuels, déjà très populaires dans la K-pop. Depuis, elle les intègre systématiquement à ses concerts, avec des fonctionnalités nouvelles à chaque tournée.
Youtube : Comment fonctionnent les bracelets LED utilisés aux concerts de Taylor Swift ?
Le dispositif s'appuie sur des fréquences radio, des signaux infrarouges ou le Bluetooth pour transmettre aux bracelets les couleurs qui forment des images dynamiques dans le public sans passer par la géolocalisation. Le public devient donc une extension du show dont il est cocréateur pour une expérience encore plus interactive. En tant que pionnière dans cet usage des bracelets LED, Taylor Swift a largement influencé les autres artistes qui l'ont adopté ensuite, tout comme la NBA pour les matchs de basket et la NHL pour ceux de hockey.
Taylor Swift a utilisé la reconnaissance faciale– autorisée dans tous les états sauf l'Illinois – lors de ses concerts américains pour la protéger des harceleurs. Les spectateurs passent par des kiosques qui sont capables de vérifier leur identité en moins d'une seconde. En plus de la dimension sécuritaire, la vidéosurveillance algorithmique permet d'établir des statistiques sur le profil des spectateurs des concerts.Les données démographiques sont collectées et exploitées à des fins marketing. Bien entendu, cet usage pose de nombreuses questions éthiques, même s'il s'agit d'événements privés. Malgré certaines menaces,la reconnaissance faciale reste interdite en France, y compris pendant les prochains Jeux olympiques.
Pour le film de sa tournée, Taylor Swift a eu recours à L.A. Drones, une entreprise spécialisée dansles prises de vues aériennes d'événements. La dynamique et l'esthétique des plans sont époustouflantes et ont favorisé le succès du film, proposé dans les cinémas d'une centaine de pays pour offrir aux fans qui n'auraient pas pu y assister en live un show hyperimmersif.
Youtube : The Eras Tour (Taylor's Version) – Bande-annonce officielle | Disney+
Taylor Swift a aussi innové en distribuant elle-même le film en partenariat avec la chaîne de salles de cinéma AMC, sans passer par un studio comme c'est l'usage. Taylor Swift : The Eras Tour est le concert filmé le plus rentable jamais diffusé au cinéma. Ce film bat le record de vente de billets en 24 heures d'AMC en 103 ans d'existence. Le film a également étéprojeté au Tech Interactive, renommé « Swift Interactive » pour l'occasion, un cinéma en forme de dôme avec un écran enveloppant de 840 mètres carrés et 13 000 watts de son surround numérique pour être au plus près des conditions réelles du concert.
Réalité augmentée et réalité virtuelle
Les « swifties » (comme se nomment les fans de la chanteuse) contribuent à l'accélération de l'adoption de nouvelles technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Depuis plus d'une décennie, Taylor Swift s'appuie sur les innovations technologiques pour faire évoluer la façon dont on consomme de la musique et en particulier pour stimuler la vente d'objets physiques face à la domination du digital.
Dès 2012, l'application officielle de Taylor Swift utilisait la réalité augmentéepour permettre à ceux qui faisaient l'acquisition de son album Red d'obtenir du contenu exclusif en 3D. Ce type d'expérience interactive ravit les fans qui se sentent privilégiés, modernes et complices de la star. Leur niveau d'engagement et de loyauté est donc significativement plus élevé.
En 2014, pour l'album 1989, Taylor Swift s'est associée à American Express pour lancer l'application Taylor Swift Blank Space Experience. Grâce à leur smartphone, les « swifties » sont emmenés dans un monde virtuel réplique du décor du clip de la chanson « Blank Space », où ils peuvent interagir avec des personnages et des objets qui représentent des souvenirs et révèlent des photos et des histoires.
Youtube : Taylor Swift Blank Space Experience, une exploration à 360° d'un monde virtuel.
Pour sa tournée « Reputation » en 2018, Taylor Swift a proposé à ses fans uneautre application en partenariat avec Glu, The Swift Life, elle aussi basée sur la réalité augmentée, pour leur donner accès à des filtres personnalisés, à des jeux associés à chaque chanson, et à des visites virtuelles des coulisses.
En 2022, pour l'album Midnights, Taylor Swift noue unpartenariat avec Snapchatet l'entreprise BLNK pour développer des lentilles de réalité augmentée qui projettent les « swifties » à Londres ou à New York afin d'y vivre une expérience basée sur l'imagerie de l'artiste. Toutes ces innovations permettent à Taylor Swift de donner plus d'originalité et de valeur aux albums physiques, CDs ou vinyles, et donc d'en augmenter significativement les ventes. En 2023, Taylor Swift areçu le Prix de l'Innovation aux iHeartRadio Awards pour sa contribution continue à l'industrie musicale.
Un modèle de marketing d'influence
Taylor Swift est uncas d'école de communication multicanalcohérente qui s'appuie sur un grand nombre de plates-formes et de technologies combinées pour donner une image faite pour paraître la plus authentique possible. La carrière de Taylor Swift a connu un essor très rapide en s'appuyant sur une maîtrise parfaite des réseaux sociaux et sur la consolidation progressive d'une relation intime avec sa communauté de fans.
Elle développe un puissant storytelling pour captiver son audience, transmettre des messages engagés, cultiver son originalité et construire sa légende. Star iconique, elle s'adapte continuellement aux nouvelles tendances de la technologie et anticipe même certaines évolutions pour rester à la pointe de l'innovation. Elle joue sans cesse avec les codes de la pop culture et avec son image pour créer le mystère et la frénésie autour de ses projets.
Taylor Swift utilise aussi les réseaux sociaux pourdiffuser un discours militant concernant la diversité, l'inclusion, l'égalité, et la protection de l'environnement, sans craindre de faire face aux controverses. Elle fédère sa communauté autour de ces valeurs partagées, ce qui se traduit en une mobilisation sans faille. Cependant, son engagement lui vaut d'être la cible de très nombreuses fake news et théories complotistes.Les « swifties » et leur icône pop pourraient bien [jouer un rôle décisif dans les prochaines élections présidentielles]https://theconversation.com/2024-taylors-version-taylor-swift-et-les-elections-americaines-224015) américaines.
Oihab Allal-Chérif, Business Professor, Neoma Business School
< !—> The Conversationhttp://theconversation.com/republishing-guidelines —>
P.-S.
• The Conversation. Publié : 2 mai 2024, 19:55 CEST.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.
•Oihab Allal-Chérif, Neoma Business School
Oihab Allal-Chérif est professeur de Management à Neoma Business School. Ses recherches portent principalement sur le numérique avec des thématiques telles que : la transformation digitale des organisations, les nouvelles technologies, le côté obscure (menaces) des technologies, l'intelligence artificielle, le big data, le management des systèmes d'information, l'innovation, l'open innovation, l'open access/content, et la prospective des métiers. Il a également publié de nombreux articles sur le management des achats, la collaboration fournisseurs, les équipes multifonctionnelles, ou l'e-business. Il étudie principalement les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la culture, avec un intérêt particulier pour le gaming (e-sport, serious games, casual games, gamification,...), le digital dans les musées et les monuments, les plateformes de streaming, et les nouveaux modes de création et de diffusion d'objets culturels. Il travaille également sur des projets liés au leadership et à l'éthique dans le management.
• The Conversation est un média indépendant, sous un statut associatif. Avec exigence, nos journalistes vont à la rencontre d'expert•es et d'universitaires pour replacer l'intelligence au cœur du débat. Si vous le pouvez, pour nous soutenirfaites un don.
Pas de licence spécifique (droits par défaut)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Université populaire Al-Aqsa de l’UQAM dénonce la judiciarisation*

Pour une politique de boycott académique, maintenant !
*Montréal le 28 mai 2024* - L'Université Populaire Al-Aqsa de l'UQAM (UPA-UQAM) dénonce la voie que l'UQAM a choisie en déposant une demande d'injonction provisoire le 22 mai dernier afin de judiciariser la lutte palestinienne, portée notamment par les étudiant-es uqamien-nes au campement situé au Coeur des sciences. Ce choix constitue une attaque visant à taire les revendications pro-palestinniennes et à maintenir la
complicité de l'UQAM avec le gouvernement criminel israélien.
Plutôt que de répondre à notre revendication principale, à savoir l'adoption d'une politique de boycott académique, l'UQAM a choisi de détourner l'attention du fond de la question, vers des technicalités spatiales dites « sécuritaires », qui ne font que faciliter le profilage
politique des étudiant-e-s et empêcher tout réel dialogue.
Nous nous désolons aussi que l'attention soit portée presque exclusivement sur la répression de notre mouvement et non sur la violence extrême qui a cours en ce moment même en Palestine.
Hier, l'armée d'occupation israélienne a bombardé sans relâche le camp de réfugié-e-s de Rafah, causant un massacre indescriptible. La violence génocidaire de l'occupation par l'État sioniste doit cesser immédiatement.
Nous trouvons insupportable que les dirigeant-e-s et les médias préfèrent s'attarder sur des formalités judiciaires plutôt que d'informer réellement sur le génocide du peuple palestinien et ses conditions d'existence. Le gouvernement canadien tient actuellement une position de complicité dans la perpétuation de ce génocide, et refuse de sanctionner Israël pour ses crimes contre l'humanité.
Lorsque l'État sioniste avait évoqué au début du génocide des rumeurs de bébés décapités, sans fournir de preuves, ces allégations ont tout de même bénéficié d'une large couverture médiatique et du soutien des puissances impériales. Or, depuis hier à Rafah, nous sommes témoins de scènes d'horreur sans précédent à notre époque : des corps complètement brûlés, des bébés décapités en direct, le tout dans un silence total et avec la complicité de l'Occident. Ce traitement à double standard est révoltant et
nous refusons d'être complices de ce silence.
Nous déplorons également le harcèlement juridique et policier des campements étudiants et de toutes les personnes qui militent pour la Palestine.
Le campement s'est pourtant engagé depuis le 13 mai dernier, au lendemain de son installation, dans des pourparlers de bonne foi avec la direction de l'UQAM visant à adresser les enjeux de sécurité réels et pratiques liés aux sorties de secours et aux accès affectés par sa présence. Les solutions proposées, notamment la création d'un corridor de sécurité menant à la voie publique, avec l'appui logistique et moral du Festival TransAmériques (FTA) qui occupe le bâtiment jusqu'au 5 juin prochain, ont toutes été rejetées par l'UQAM. En effet, malgré ses interventions médiatiques à l'effet qu'elle recherche le dialogue et une résolution pacifique à la situation, la direction de l'UQAM n'a à aucun moment accepté les solutions concrètes sur les enjeux les plus urgents quant aux accès aux bâtiments.
Les syndicats de professeur-e-s et chargé-e-s de cours représentant la communauté universitaire de l'UQAM ont quant à eux multiplié les représentations afin de plaider pour une solution pacifique et offrir une médiation facilitant le dialogue entre le campement et la direction de l'UQAM.
Plutôt que de saisir les occasions de résolution proposées par le FTA et la communauté universitaire, l'UQAM a préféré avoir recours aux tribunaux. Cette judiciarisation nuit de façon effective au dialogue que l'UQAM prétend privilégier.
Nous considérons que la demande d'injonction provisoire de l'UQAM, bien qu'elle n'exige pas un démantèlement du campement, impose des mesures restrictives qui équivalent à un démantèlement "déguisé".
Nous ferons toutefois de notre mieux pour nous conformer aux ordonnances, en tenant compte de nos capacités et des ressources matérielles disponibles, tout en garantissant la sécurité de toutes et tous. Mais, il est important de noter que certains facteurs échappent à notre contrôle.
Nous exigeons aussi de recentrer l'attention sur le génocide en cours en Palestine et sur les véritables revendications du campement, dont l'adoption d'une politique de boycott académique contre toutes collaborations présentes ou futures avec les universités israéliennes.
Vive l'intifada étudiante, longue vie au mouvement des camps partout !
La Palestine sera libérée, de notre vivant !
Solidarité pour les droits Humains des Palestiniennes et Palestiniens
(SDHPP) basé à l'UQAM
sdhpp.uqam@gmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel urgent à l’action pour les Rohingyas de l’État de Rakhine, au Myanmar

Le Réseau des femmes pour la paix appelle à une action immédiate pour protéger la minorité ethnique et religieuse des Rohingyas dans l'État de Rakhine, ou Arakan, et empêcher que d'autres crimes atroces soient commis au Myanmar.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le 17 mai 2024, à partir d'environ 22 heures (heure de Myanmar), l'armée de l'Arakan a mis le feu au centre-ville de Buthidaung et aux villages environnants, notamment Tat Min Chaung et Kyauk Phyu Taung, selon des informations provenant de ces localités. Des témoins ont raconté que des membres de l'AA avaient brûlé la grande majorité des quartiers de la ville, y compris les maisons, les écoles et d'autres édifices à caractère civil. Des centaines de Rohingyas auraient été tués ou mutilés, et près de 150 000 d'entre eux auraient été déplacés de force. C'est dans la commune de Buthidaung que l'on trouve la plus forte concentration de Rohingya – plus de 200 000 civils – dans l'État.
Selon ces rapports, l'attaque de l'Armée contre le centre-ville de Buthidaung, qui compte sept quartiers, n'a pas de lien direct avec le conflit armé en cours, qui s'intensifie, avec les militaires birmans dans l'État de Rakhine. Trois jours avant l'attaque de l'AA, les militaires birmans se seraient retirés du centre-ville de Buthidaung. L'Armée du Salut des Rohingyas de l'Arakan, dont il est connu qu'elle coopère avec l'armée, s'est retirée du centre-ville de Buthidaung quelques jours avant l'attaque. Les Rohingyas recrutés de force par l'armée, qui avaient brûlé plusieurs maisons que les habitants de l'ethnie rakhine avaient fuies il y a quelques semaines, n'étaient pas non plus présents dans la zone touchée.
Il est alarmant de constater que l'attaque de l'AA contre Buthidaung s'inscrit dans un contexte d'escalade des atrocités contre les civils rohingyas. Au cours des deux dernières semaines, le WPN a été informé de cas où l'AA a incendié des dizaines de villages rohingyas et a bombardé l'école secondaire d'éducation de base n°1 et le seul hôpital de la commune, où les Rohingyas déplacés à l'intérieur du pays cherchaient refuge. Des cas de massacres de familles rohingyas dans plusieurs villages de la commune ont également été signalés ; il s'agit notamment d'un groupe d'anciens rohingyas qui ont tenté d'engager des pourparlers avec les membres des AA présents dans le secteur dans le but de modérer les agressions des AA contre eux et leurs communautés. Ces attaques ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les civils, et dans l'État de Rakhine, près de 100 000 Rohingyas ont été déplacés de force. Le WPN continue de vérifier les informations et de rechercher activement des preuves dans un contexte où les lignes téléphoniques et l'Internet sont constamment coupées arbitrairement dans l'État de Rakhine, assorti de la diffusion en ligne et hors ligne de fausses informations et de désinformation, de la promotion de discours de haine et de rhétorique génocidaire de la part d'acteurs tels que l'armée birmane et les dirigeants de l'AA, ainsi que d'actes visant à exacerber les tensions ethniques et à instrumentaliser (weaponize) les Rohingyas à l'encontre des objectifs et des efforts du mouvement pro-démocratique birman.
Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler que les centaines de milliers de Rohingyas déplacés, qui risquent de plus en plus de subir de nouvelles atrocités sont des victimes et des survivants des attaques génocidaires de 2017. Ils font également partie des 600 000 Rohingyas restés au Myanmar, dont environ 130 000 déplacés internes, dans des conditions de précarité extrêmes sur ple plan humain. Systématiquement privés de citoyenneté, de liberté de mouvement et d'autres droits fondamentaux, les Rohingyas n'ont aucun moyen de fuir ou de se protéger d'un régime d'apartheid, de la conscription forcée, d'actes généralisés d'enlèvement, de torture, de meurtre, ainsi que d'autres attaques ciblées de la part de l'armée birmane et d'autres acteurs. Dans le même temps, l'évacuation récente du personnel des Nations unies et de diverses organisations non gouvernementales internationales a privé les civils rohingyas de l'État de Rakhine de tout accès à l'aide humanitaire, notamment à la nourriture et aux produits de première nécessité. Les coupures généralisées des communications et des transports sont toujours d'actualité. La famine, en particulier pour les femmes et les enfants, est désormais imminente dans la région.
Le droit international doit être respecté pour que la situation dans l'État de Rakhine soit traitée de manière globale. Il est essentiel que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger la minorité ethnique et religieuse rohingya, qui a été reconnu par la Cour internationalede justice comme un « groupe protégé » en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Une action immédiate est nécessaire pour mettre fin aux atrocités en cours dans l'État de Rakhine et pour empêcher que d'autres crimes atroces ne soient commis contre les Rohingyas. La communauté internationale ne doit plus laisser tomber les Rohingyas comme elle l'a fait dans les jours, les mois, les années et les décennies qui ont précédé les attaques génocidaires de 2017.
En conséquense, WPN appelle immédiatement :
– la communauté internationale à déployer des observateurs indépendants dans l'État de Rakhine afin que des experts puissent vérifier les faits et établir un rapport sur la crise actuelle ;
– les États membres de l'ONU et les gouvernements donateurs à fournir une assistance humanitaire aux Rohingyas déplacés de force par la crise actuelle dans l'État de Rakhine ;
– le Secrétaire général des Nations unies à invoquer l'article 99 de la Charte des Nations unies concernant la situation dans l'État de Rakhine et à faire en sorte que l'aide transfrontalière puisse être apportée aux communautés touchées ;
– le Conseil de sécurité des Nations unies à tenir une réunion publique sur la situation dans l'État de Rakhine, en mettant l'accent sur le non-respect des mesures conservatoires demandées par la CIJ ;
– les dirigeants du mouvement démocratique birman, y compris le gouvernement d'unité nationale, le Conseil consultatif d'unité nationale et les organisations révolutionnaires des communautés ethniques à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'escalade des atrocités contre la minorité ethnique et religieuse rohingya dans l'État de Rakhine, et à lutter activement contre l'utilisation manipulatrice des divisions ethniques par l'armée birmane contre le mouvement démocratique et ses efforts pôur aller vers une démocratie fédérale véritablement inclusive ; et
– l'AA et ses dirigeants à s'engager immédiatement et de manière significative auprès de la communauté rohingya dans le but bien circonscrit d'empêcher que d'autres atrocités soient commises à leur encontre, d'assurer leur protection, leur accès à la justice et aux responsabilités, de façon à établir une base solide pour la coexistence pacifique de toutes les communautés dans l'Arakan.
19 mai 2024
Réseau des femmes pour la paix
Déclaration au format PdF
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70805
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeeplPro.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël, fait colonial. Maxime Rodinson met KO Bernard-Henri Lévy

Dans son dernier ouvrage Solitude d'Israël comme dans les interventions médiatiques qui s'en sont suivies, BHL conteste la qualification d'Israël de « fait colonial », opérée en juin 1967 par l'orientaliste Maxime Rodinson dans un texte au titre éponyme. Les arguments farfelus et fallacieux que le philosophe mobilise à cet effet ne sont jamais contestés par ses interviewers. Mise au point.
Tiré d'OrientXXI
17 mai 2024
Par Alain Gresh
Le dernier opus de Bernard-Henri Lévy mérite-t-il ces quelques lignes et le temps gaspillé à sa lecture ? Les interviews complaisantes que l'auteur multiplie lui permettent de dérouler, la plupart du temps sans contradicteur – l'ignorance de ses interviewers est souvent abyssale -, sa routinière défense d'Israël, de ses crimes de guerre, de son armée ô combien morale. Tout en déplorant la solitude d'un État qui dispose — excusez du peu — d'un soutien robuste des États-Unis et de la plupart des pays occidentaux, dont la conscience est à peine ébréchée par les quelque 35 000 morts, en majorité civils, dénombrés à Gaza. Rien de bien nouveau dans le monde selon BHL.
Nous aurions donc pu dédaigner ce pamphlet, triste ramassis des éléments de langage du discours politique et médiatique dominant, qui se drape dans les habits de la dissidence. Pourtant, l'ouvrage vaut pour un seul point : il fait remonter à la surface un texte oublié de l'orientaliste Maxime Rodinson, paru dans la revue de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Les Temps modernes à la veille de la guerre de juin 1967, et intitulé « Israël, fait colonial ? ». BHL en cite la conclusion :
Je crois avoir démontré, dans les lignes qui précèdent, que la formation de l'État d'Israël sur la terre palestinienne est l'aboutissement d'un processus qui s'insère parfaitement dans le grand mouvement d'expansion européo-américain des XIXe et XXe siècles pour peupler ou dominer les autres terres.
Une phrase qui ne peut que susciter l'indignation de ce « Jean-Paul Sartre dévalué » que moquait Renaud dans sa chanson « L'Entarté ».
« De vieilles passions communistes au cœur d'Israël »
Les migrants sionistes n'étaient-ils pas animés par des idéaux de la révolution d'Octobre ? Ne brandissaient-ils pas le drapeau rouge ? N'entonnaient-ils pas des chants spartakistes ? Ne se réclamaient-ils pas pour certains du marxisme-léninisme ? Dans une lettre à son ministre des affaires étrangères datée du 29 novembre 1924, le consul de France à Jérusalem notait :
Dans les colonies coopératives tout est indivis, le sol, les instruments de travail, les bénéfices, le plus souvent les repas se prennent en commun, tous les enfants sont rassemblés dans une nursery où l'une des femmes s'occupe d'eux. Ce système a, sous le rapport de la culture, des inconvénients graves qu'il est superflu de signaler, mais les chefs sionistes s'y résignent parce qu'il satisfait cette espèce de curiosité, d'inquiétude des formules sociales nouvelles qui tourmente l'âme de la plupart de leurs recrues. (…) Le sionisme, ne vivant que d'un appel aux forces morales, aux traditions nationales, doit utiliser tout ce qu'il fermente de vieilles passions communistes au cœur d'Israël.
Les dirigeants sionistes surent, comme l'a démontré l'historien israélien Zeev Sternhell (1), manipuler ces « vieilles passions communistes » pour créer des kibboutz très militarisés – « une main sur la charrue, l'autre sur le glaive » – dont l'objectif réel était le maillage du territoire palestinien, premier pas vers sa conquête.
Marx écrivait qu'on ne juge pas un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même. On ne peut évaluer non plus un mouvement sur l'idée qu'il se fait de lui-même. Il ne s'agit pas de nier la sincérité de cette « passion communiste » qui animait (certains) émigrants juifs, mais d'analyser leur pratique politique réelle, nombre de massacres et de crimes se sont fait au nom du Bien et de « la civilisation ». Rodinson a bien mis en lumière le point aveugle de ces colons :
La suprématie européenne avait implanté, jusque dans la conscience des plus défavorisés de ceux qui y participaient [à l'émigration en Palestine], l'idée que, en dehors de l'Europe, tout territoire était susceptible d'être occupé par un élément européen. Le cas de l'utopie sioniste n'était pas, de ce point de vue, différent de celui des utopies socialistes du type de l'Icarie de Cabet (2). Il s'agit de trouver un territoire vide, vide non pas forcément par l'absence réelle d'habitants, mais une sorte de vide culturel. En dehors des frontières de la civilisation (…), on pouvait librement insérer, au milieu de populations plus ou moins arriérées et non contre elles, des « colonies » européennes qui ne pouvaient être, pour employer anachroniquement un terme récent, que des pôles de développement.
Ce sentiment de supériorité n'était pas propre au seul mouvement sioniste, on le retrouve dans le mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. Ainsi, les communards en Algérie qui se réclamaient de la Commune de Paris de 1871, saluaient la répression de l'insurrection en Kabylie, qui embrasait alors le pays (3). Les fédérations algériennes de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) votèrent massivement l'adhésion à l'Internationale communiste au congrès de Tours en 1920, tout en dénonçant le nationalisme indigène « rétrograde » et en prônant l'assimilation. Tous ces socialistes chantaient pourtant « L'Internationale », se réclamaient de « la dictature du prolétariat », appelaient au soulèvement des « damnés de la Terre » réduits aux seuls ouvriers européens. Il fallut la création de l'Internationale communiste pour que s'impose, non sans obstacles, le mot d'ordre « prolétaires de tous les pays et peuples opprimés unissez-vous », et pour rompre en paroles et parfois en actes avec les vieilles tendances coloniales de la social-démocratie.
L'Ancien Testament comme titre de propriété
Pour contester le caractère colonial de l'entreprise sioniste, BHL rabâche plusieurs thèses auxquelles le long texte de Rodinson dans Les Temps Modernes avait répondu par avance, mais qu'il ne s'est pas donné la peine de relire, ne serait-ce que pour les contester.
« Il y a toujours eu des Juifs sur la terre de ce qu'est aujourd'hui l'État d'Israël », écrit-il, depuis des milliers d'années, avant et après la destruction du Temple en l'an 70. Certes, ils n'étaient pas constitués en nation, concède BHL, mais « les autochtones arabes ne l'étaient pas davantage ». Ils n'acquirent ce statut, selon lui, que dans les années 1940, en même temps que les Juifs, ce qui permet, par un tour de passe-passe, d'apposer un signe d'égalité entre les aspirations des Palestiniens et celles des Juifs en Palestine. Cette logique amènerait à prétendre que les peuples autochtones amérindiens ou africains, qui n'étaient pas des communautés nationales, n'ont donc pas subi le colonialisme.
Et quelle est la légitimité d'une revendication juive sur la Palestine ? Rappelons que Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique, avait envisagé une installation des juifs en Argentine ou au Congo. BHL invoque la Bible désignée comme le « Malet et Isaac des sionistes », pour justifier cette prétention. Rappelons que Malet et Isaac est la collection de manuels d'histoire conçue par la République au début du XXe siècle, et qui a inventé plusieurs thèmes de la mythologie nationale, dont « nos ancêtres les Gaulois ». S'il relève plus de l'idéologie que de l'Histoire, il a quand même quelques rapports avec cette dernière, ce qui n'est pas le cas de la Bible, même s'il reste un texte majeur pour l'humanité. Et qui peut considérer, sauf quelques illuminés, l'Ancien Testament comme un titre de propriété ?
Évoquant les droits historiques des juifs sur la Palestine, Maxime Rodinson ironise : « Je ne ferai pas à mes lecteurs l'affront de les croire séduits par cet argument », ou alors — c'est nous qui complétons — on ouvrirait les portes à une guerre de mille ans, notamment en Europe, avec les revendications « historiques » de la Russie sur l'Ukraine, de la Serbie sur le Kosovo, voire de la France sur la partie francophone de la Belgique.
Dans sa préface à un livre que j'avais écrit sur l'histoire de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Rodinson avait illustré l'absurdité d'une revendication reposant sur les mythes développés par les mouvements nationalistes :
Qu'on cherche à s'imaginer les Tsiganes – peuple persécuté depuis des siècles et exterminé en masse par les hitlériens – réclamer un État dans le département des Bouches-du-Rhône où se situe un sanctuaire qu'ils révèrent, celui des Saintes-Maries-de-la-Mer, réaliser leur projet grâce à l'appui des États-Unis et de l'Union soviétique, après s'être constitué une base territoriale en achetant systématiquement des terres, après avoir vaincu militairement les forces françaises s'efforçant de résister. Qu'on pense à la réaction des habitants placés dans une position subordonnée, forcés d'apprendre le tsigane pour avoir une place dans l'État tsigane, poussés autrement à aller s'établir ailleurs (la France est grande, il y a 95 autres départements diraient les apologistes de l'État tsigane) (4).
Le rôle central de Londres
« Il y a un point, un au moins, sur lequel tous s'accordent, argumente ensuite BHL, la colonisation, c'est le vol. Or il n'y eut ni vol ni dol. Les terres acquises par les migrants non moins que par les autochtones juifs ne furent, sauf exception, pas ravies mais achetées. (…) Il n'est pas vrai que les terres constitutives du futur Israël aient été prises par la force ou au mépris de la loi. » Là encore, BHL n'a pas lu Rodinson qui explique comment en Afrique noire comme en Tunisie, l'acquisition des terres par les colons s'opéra le plus souvent légalement. À la veille du plan de partage de la Palestine voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, le pourcentage des terres cultivables de Palestine possédées par des Juifs ne représentait que 9 % à 12 % des terres cultivables ; il fallut la création de l'État d'Israël, « le vol et dol » des terres des réfugiés palestiniens, la « judaïsation » des propriétés des Palestiniens citoyens d'Israël pour bouleverser le cadastre. Résultat : à la veille de la guerre de 1967, 72 % des terres aux mains de Juifs israéliens avaient appartenu à des Palestiniens avant 1947 (5).
Ultime pierre du raisonnement de notre philosophe, « qui dit colonialisme dit métropole coloniale. Or la réalité c'est que la métropole, c'est-à-dire, en la circonstance, la Grande-Bretagne, s'opposa de toutes ses forces, ici comme ailleurs, à la dislocation de son empire. … [La naissance d'Israël] est un moment de l'histoire, non des empires, mais de leur dissolution ; et le sionisme n'est pas un impérialisme, mais un anti-impérialisme. » Ce raccourci qui trouverait sa place dans un Mallet et Isaac israélien occulte le rôle central de Londres. À partir de 1922, date du début de leur mandat sur la Palestine, les Britanniques ont encouragé non seulement une émigration massive juive, mais ont aidé le Yichouv — la communauté juive en Palestine — à se constituer en corps séparé, avec ses institutions politiques, sa vie économique reposant sur « le travail juif » et la séparation d'avec les Arabes, et bientôt ses milices armées par les Britanniques. Le Royaume-Uni ne le fit pas par « amour des juifs », nombre de défenseurs du projet sioniste, Lord Balfour en tête, étaient antisémites, mais parce que Londres voyait ces colons européens comme « un poste avancé de la civilisation » et un point d'appui pour la défense de ses intérêts dans la région.
Cette approche se modifia durant la Seconde guerre mondiale, quand le Royaume-Uni dut prendre en compte les demandes de ses commensaux arabes sur lesquels il régnait (Égypte, Transjordanie, Irak). L'utilisation du terrorisme par les groupes sionistes contre des intérêts et des soldats britanniques – qui soulevèrent une véritable indignation dans l'opinion publique du royaume - et la volonté du sionisme de s'appuyer sur les États-Unis élargirent le fossé entre les alliés d'hier. Peut-on parler pour autant d'une guerre de libération sioniste contre l'empire ? Il faudrait alors considérer comme un soulèvement anticolonial la révolte des pieds-noirs d'Algérie contre Paris en 1960-1962, et l'Organisation armée secrète (OAS) comme un mouvement anti-impérialiste. Ou saluer la sécession des Blancs de Rhodésie en 1965 de la tutelle britannique comme un coup porté à l'empire de Sa Majesté. L'engagement d'Israël contre tous les mouvements d'émancipation des peuples du tiers-monde, du Vietnam aux colonies portugaises en passant par l'Amérique latine, a confirmé l'inscription durable de ce pays dans « le camp impérialiste ». Comme l'illustre l'alliance stratégique tissée avec l'Afrique du Sud de l'apartheidà partir de 1948, que poursuivirent tous les gouvernements israéliens de « gauche » comme de droite, allant jusqu'à aider Pretoria dans son programme nucléaire militaire.
On ne conseillera pas à BHL de relire Maxime Rodinson dont le texte dense — même s'il est parfois un peu daté - fait voler en éclat ses piètres démonstrations. En revanche, les lecteurs y trouveront de quoi nourrir leur réflexion à un moment où le caractère colonial du projet sioniste apparaît dans toute son horreur à Gaza.
Notes
1. Zeev Sternhell, Aux origines d'Israël. Entre nationalisme et socialisme, Fayard, 1998.
2. Étienne Cabet, théoricien politique français (1788-1856), voulait construire une cité idéale ; il tenta une expérience au Texas.
3. Alain Ruscio, « Commune(s), communards, question coloniale », Cahiers d'histoire, n° 153, 2022.
4. Préface à Alain Gresh, OLP, histoire et stratégies. Vers l'État palestinien, Spag-Papyrus, 1983.
5. Lire John Ruedy, « Land Aliénation » dans The Transformation of Palestine, sous la direction d'Ibrahim Abu-Lughod, Northwestern University Press, Evanston, 1971.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Comment l’islamophobie travaille la société française

Dans un livre paru récemment au Seuil, Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin présentent les résultats d'une enquête sociologique vaste et inédite sur l'exil de Français·es de culture ou de confession musulmane, en réponse aux multiples discriminations et à la stigmatisation quasi-permanente, dans l'espace public, de l'islam et des musulman·es. S'inscrivant dans un champ de recherche en développement, les auteurs·rices nous invitent ainsi, à travers cet ouvrage, à prendre enfin toute la mesure des effets concrets de l'islamophobie sur la vie de millions de personnes vivant en France. Nous vous proposons d'en lire l'introduction.
23 mai 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/islamophobie-discriminations-exil-musulmans-france/
Introduction
Quand vous entrez dans l'amphi, il y a un silence de mort. Alors que quand c'est les autres, on les applaudit, parce que c'est un peu le bazar en médecine en fait, il y a comme un système de bizutage, mais nous, on n'entre pas dans ce délire‑là. On en est même exclues d'office. Voilà… alors qu'on s'en fiche, qu'on soit intégrées ou pas, on s'en fiche. Mais, je sais pas, c'est comme un non‑dit, c'est : “bon elle, elle est voilée, elle ne fait pas partie de notre monde”.
Appelons cette femme Ilham[1]. Installée à Salford près de Manchester au moment où elle nous accorde un entretien en 2021, elle se souvient avec émotion de son passage en faculté de médecine, où elle était la seule à porter un hijab[2]. L'exclusion dont elle témoigne est à la fois liée à ses origines, à sa religion visible dans l'espace public, mais aussi à sa classe sociale. Elle confie en effet qu'en bifurquant ensuite vers des études de sage‑femme, elle a côtoyé un milieu plus hétéro‑ gène, moins marqué par un entre‑soi blanc et bourgeois, et que sa religion est « mieux passée » auprès des étudiantes de sa nouvelle promo.
Elle se souvient tout de même d'un événement traumatique dans son cursus de sage‑femme, lorsqu'un professeur d'anatomie avait exigé qu'elle retire son foulard avant un examen. Elle avait beau avoir soulevé son voile un instant pour montrer qu'elle ne portait pas d'écouteurs dans le but de tricher, le professeur n'avait rien voulu savoir. Ilham a essayé de se défendre, car la demande de l'enseignant n'était pas légale. Mais rien n'y a fait.
Ilham est née et a grandi dans un quartier populaire d'Orléans. Ses parents sont marocains, son père a été ouvrier agricole, puis a travaillé dans le BTP et sa mère s'est occupée de ses sept enfants. Ses études supérieures ont validé sa trajectoire sociale ascendante, mais le port du foulard a donné lieu pour elle à de multiples discriminations, et a fait de son parcours en médecine un épisode douloureux. Elle a décidé de le porter peu après la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école.
Les controverses précédant la loi et la législation elle‑même ont cristallisé la volonté d'Ilham d'affirmer son islam publiquement, tout en respectant les règles du dévoile‑ ment à l'entrée du lycée : « Le fait d'avoir mis la lumière sur le voile, ça m'a fait réfléchir, oui. J'étais adolescente, j'avais deux amies qui le portaient déjà, et j'ai décidé de le porter. » Avant d'ajouter :
« Le symbole de devoir retirer ce voile avant l'école reste gravé dans ma mémoire parce que, j'utilise des termes un peu forts mais, au début, de devoir retirer son voile devant l'école, c'était un crève‑cœur, on avait l'impression de se trahir. Et de voir les autres nous regarder, ce n'était pas de la curiosité malsaine, les autres se demandaient juste, « mais qu'est‑ce qu'elles font ? C'est trop bizarre ! » »
Son diplôme de sage‑femme en poche, elle postule dans des hôpitaux à Orléans, à Montargis, travaille quelques mois mais les entretiens, souvent, se passent mal. La suspicion qui entoure le port du voile est forte. Un chef de service lui demande d'emblée : « j'espère que vous ne portez pas le voile ! », alors qu'elle garde les cheveux découverts sur le lieu de travail. Dans ce climat délétère, elle essaie de s'ins‑ taller en statut libéral, mais malgré ses efforts n'y parvient pas. Elle « tombe au RSA », est proche de la dépression. Elle rencontre alors son futur mari, un biologiste marocain, qui part faire une thèse de doctorat en Espagne, et qu'elle suit. Installée à Saragosse, elle a l'impression de revivre, son hijab ne posant plus de problème. Elle se dit abasourdie par le contraste entre les deux pays :
« Moi, en Espagne, je me sentais revivre, je l'ai dit à mon mari, “c'est fou ici, on est à la porte de la France. Il n'y a qu'une chaîne de montagnes qui nous sépare, mais c'est une autre mentalité”. »
Comme d'autres, elle sait qu'un autre pays européen, l'Angleterre, est connu pour être, pour « des gens comme nous », un « autre monde ». Elle finit par partir avec son mari à Salford, près de Manchester.
Deux années après son installation, elle raconte :
« Dès qu'on est arrivés, on s'est sentis à l'aise ici, moi je n'étais jamais allée en Angleterre, jamais. Tout ce qu'on m'avait dit sur le pays s'est confirmé ; en tant que musulmans on se sent comme des poissons dans l'eau, clairement. Le fait musulman n'est juste pas un problème ici » (E129)[3].
Elle est en cours de validation de son équivalence de diplôme de sage‑femme, et donne des cours de français, comme son mari donne des cours de biologie. Elle se dit heureuse que ses deux enfants grandissent dans une atmosphère trilingue, avec le français, grâce à elle, l'arabe, grâce à son mari, et l'anglais. Elle sait aussi que ses enfants ne connaîtront pas toutes les vexations qu'elle a subies.
Redouane habite pour sa part à Dubaï depuis 2016. Il se qualifie assez naturellement d'« expatrié ». De fait, il ne partage pas le vécu traumatique d'Ilham. Français d'origine marocaine, il est arrivé en France à l'âge de deux ans. Son père, mécanicien, est décédé quand il était enfant. Sa mère, préparatrice en pharmacie, a alors dû assurer l'éducation des quatre enfants :
« Elle a toujours suivi nos études dès le plus jeune âge ; elle nous a appris qu'il fallait bosser, travailler dur. »
Comme lui, ses frères et sœurs partagent une trajectoire sociale ascendante, grâce à de longues études. Redouane en est pleinement conscient, d'où son profond sentiment de gratitude :
« En France, on a pu grandir, on a pu vivre en sécurité, on a pu manger à notre faim, on a pu étudier, tous étudier sans jamais avoir eu besoin de payer quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu avoir dans notre pays d'origine. »
Redouane a pu intégrer une classe préparatoire scientifique, puis une école d'ingénieur, où il est parvenu à s'imposer dans ce milieu dont il souligne lui aussi le caractère « blanc » et « bourgeois ». Étant musulman, il s'est toujours tenu à dis‑ tance des fêtes alcoolisées. En 2011, il a passé un semestre aux États‑Unis, qui lui a ouvert les yeux sur certaines réalités françaises, notamment sur les manières d'accommoder la religion musulmane :
« Là‑bas, j'ai vu des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont déplu ; et quand je suis rentré en France, j'ai découvert pas mal de choses, que je n'avais pas vues avant, des choses qui tournent pas forcément très rond ; des choses qu'on comprend quand on prend du recul et ça a été, disons, la première phase où j'ai commencé à réfléchir à quitter la France. »
Lors d'un road-trip dans le Golfe, il se pose la question de partir travailler à Dubaï. On est alors en 2016. Il s'informe sur les possibilités de faire un Volontariat inter‑ national en entreprise (VIE), qu'il obtient finalement. Il y rencontre une Marocaine, elle aussi en VIE. Ensemble ils ont un enfant, et semblent épanouis à Dubaï, dont ils louent le respect multiconfessionnel, entre membres d'une élite économique multiculturelle, où il est tout à fait banal de ne pas être autochtone :
« On est 80 % de la population et de fait, quelle que soit sa culture, sa religion, etc., tout est fait pour qu'on se sente à l'aise. Il faut travailler dur, c'est vrai. Il faut s'adapter. Mais comme je l'ai dit, tout est fait pour que ça marche bien. »
Même s'il a conscience de faire partie d'une élite économique, aux conditions de travail et de rémunération radicalement différentes de celles des ouvriers pakistanais ou philippins, Redouane s'épanouit dans un environnement musulman où sa religion n'est pas stigmatisée. Cela passe par des pratiques banales de la vie de tous les jours :
« J'ai ressenti énormément de respect vis‑à‑vis de ça, le genre de choses que je n'aurais jamais imaginées en France. Par exemple, lorsque je travaillais en France, j'allais manger à la cantine. Et il y avait cinq ou six choix différents de viande pour un à deux choix de légumes, dont des frites. Malgré cette diversité, je n'ai jamais demandé à avoir de la viande halal. J'étais à des millénaires, presque, de pouvoir revendiquer ce genre de choses, juste avoir un peu plus de légumes, pour avoir un menu végan ou avoir du poisson, plus de viande et ça m'était refusé, dans les années 2010‑2015. Ici, par contre, c'est le genre de question qu'on ne se pose pas » (E42).
Un récit collectif jamais sollicité
Les vécus, ressentis, comparaisons dont font état Ilham et Redouane sont au cœur de notre enquête, qui s'est déroulée entre 2021 et 2023. Quantitative et qualitative, elle repose sur un matériau original qui permet de comprendre pourquoi des milliers de Françaises et Français décident, sans doute de façon croissante, de quitter leur pays pour, notamment, fuir le racisme. On verra qu'il ne s'agit peut‑être pas de musulmans comme les autres, la grande majorité appartenant à une élite, hautement qualifiée, ayant connu des trajectoires d'ascension sociale. Reste qu'une fuite des cerveaux à la française se produit silencieusement sous nos yeux. Ce livre ambitionne d'en rendre compte.
Jusqu'ici, que des Français et Françaises de culture ou de confession musulmane quittent le pays pour aller vivre et travailler ailleurs n'a guère suscité l'intérêt des politiques, des médias et des universitaires. Quelques articles ont été publiés sur les départs en Angleterre, en Turquie, ou bien à Dubaï[4]. L'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture s'est penchée sur la question. Enfin, deux thèses de doctorat ont été consacrées à cette thématique, en élargissant la focale à d'autres origines géographiques. Celle de Jérémy Mandin s'intéresse aux Français et aux Belges d'origine maghrébine installés à Montréal[5]. Celle de Jaafar Alloul observe les mobilités euro‑maghrébines aux Émirats arabes unis et suit la trajectoire de jeunes Hollandais, Français et Belges[6]. On notera au passage que ces thèses ont été sou‑ tenues hors de France.
Alors que la France est le pays européen comptant le plus de personnes de confession musulmane, on recense encore peu de travaux investiguant leur expérience minoritaire ordinaire, permettant aussi de comprendre les trajectoires d'exil et d'expatriation que nous avons cherché à documenter. Que notre objet soit jusqu'alors passé sous les radars médiatiques et politiques a été illustré par la publication, le 13 février 2022, d'un article du New York Times intitulé « Le départ en sourdine des musulmans de France », qui mentionne explicitement notre enquête. Par l'effet de ce que Pierre Bourdieu aurait appelé « la circulation circulaire de l'information », dès la publication de cet article, une quinzaine de médias nationaux – journaux, magazines, radios, chaînes d'info – ont contacté des membres de notre équipe pour en savoir davantage, avec un mélange de curiosité et parfois de suspicion.
La séquence des attentats de 2015‑2016 et plus tard, en 2020, celle qui a vu se succéder le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron (2 octobre 2020) sur le « séparatisme », l'assassinat de Samuel Paty deux semaines plus tard (le 16 octobre), puis les restrictions des libertés associatives avec l'adoption de la « loi contre le séparatisme » en août 2021 ont constitué une véritable escalade dans un pays pourtant habitué aux controverses sur l'islam. Si le « problème musulman » a été construit de longue date[7], l'islamophobie (nous reviendrons sur l'usage que nous faisons de ce terme) a connu une forme d'accélération – attestée tant par les chiffres officiels des actes anti‑musulmans que par le ressenti des personnes interrogées – au cours de la dernière décennie. Ce n'est donc pas un hasard si, comme on le verra à l'aide de notre étude quantitative, la fuite des musulman·es français·es s'est accélérée depuis 2015.
Cette exacerbation des stigmatisations a été ressentie à l'université elle‑même. Pour preuve : la séquence polémique autour d'un « islamo‑gauchisme » imaginaire pourtant brandi comme une menace réelle sur « le vivre‑ensemble » par les ministres Jean‑Michel Blanquer et Frédérique Vidal[8]. La vie et le financement des associations n'ont pas été épargnés non plus.
Au‑delà des dissolutions du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), du Collectif contre le racisme et l'islamophobie (CRI) et de Baraka City, les associations musulmanes et leurs alliés ont fait l'objet d'une chasse aux sorcières, marquée par des coupes de subvention, des fermetures de mosquées jugées « séparatistes », des fermetures de comptes en banque et surtout par la disqualification de leurs membres perçus de manière indifférenciée comme « islamistes », « communautaristes » ou « séparatistes », toutes ces mesures contribuant à fragiliser les acteurs les mieux à même de prendre en charge les colères que suscitent les discriminations[9].
La stigmatisation d'un nombre croissant de personnes ou d'associations comme « ennemies de la République » illustre un rétrécissement inquiétant du pluralisme démocratique, où l'invocation mécanique de la « République » et de ses « valeurs » vaut rappel à l'ordre autoritaire et musellement des contestations[10]. Ce livre se penche sur ses conséquences, sur les trajectoires individuelles, les destins familiaux, les corps et les âmes des personnes touchées par cette violence ordinaire.
Dans ce contexte, beaucoup de personnes interrogées ont accueilli avec enthousiasme l'existence même de l'enquête, et la possibilité d'offrir des témoignages illustrant l'ampleur de ce racisme spécifique qu'est l'islamophobie. On peut jauger leur démarche à l'aide de la triade, classique dans les sciences sociales, proposée par l'économiste Albert Hirschman : exit, voice, loyalty. Selon Hirschman, quand un produit ou un service se détériore, le consommateur ou le citoyen peut choisir entre : la loyalty, où il renonce à l'action ; la prise de parole (voice) dans le but de faire connaître son mécontentement et de changer la situation ; ou enfin l'exit, c'est‑à‑dire la défection pure et simple.
On peut arguer dans notre cas qu'après l'exit, matérialisée par le départ de France, beaucoup de personnes interrogées ont eu recours à la prise de parole, voice, en répondant à nos questions, surtout quand ces individus partagent des vécus discriminatoires douloureux[11]. En voici quelques exemples :
Je veux commencer par dire que c'est assez extraordinaire qu'on nous donne la parole (Lamia, Ottawa, qui a quitté la France en 2007, E75).
Merci de faire ce travail parce que ça va aider. J'espère que ça va aider les politiques et, un petit peu, la société française à ouvrir les yeux (Mokhtar, New York, qui a quitté la France en 2012, E122).
Je trouve ça beaucoup plus impactant qu'un bulletin dans une urne. C'est beaucoup plus constructif que de mettre « Macron » pour faire barrage à « Le Pen » au deuxième tour (Sofiane, région de Birmingham, 2021, qui a quitté la France en 2016, E50)
Je trouve que c'est une super initiative de faire ce type d'étude. Les médias et les politiques sont obsédés par les musulmans, mais […] ils sont dans un monde imaginaire, avec leurs idées bien particulières sur ce que c'est les musulmans. Et ils ne comprennent pas la diversité de ce qui nous compose (Assia, Londres, qui a quitté la France en 2013, E137).
Qui sommes-nous ?
Cette attente crée une pression et pose la question de la relation entre enquêteurs et enquêtés, dont on mesure la complexité dans les pages qui suivent. Cette relation a été façonnée par les profils hautement qualifiés de la plupart des personnes interrogées : pour simplifier, des individus aux longs parcours universitaires répondaient aux questions d'autres individus aux parcours universitaires assez analogues, fût‑ce dans des disciplines différentes. Sans oublier que plusieurs membres de l'équipe ont accumulé, depuis des années, des séjours plus ou moins longs et répétés dans des pays anglophones qui sont des lieux de résidence des personnes enquêtées : Grande‑Bretagne, Canada, États‑Unis, Irlande, principalement.
Ainsi, régulièrement, selon les différences d'âge, de parcours personnel ou d'identité ethno‑raciale, les personnes interrogées basculaient spontanément d'un « vous » à un « tu »[12]. Sans que cela crée de connivences, ces similitudes facilitent la compréhension de situations vécues, des situations qui, de France, sont réifiées par des politiques et médias toujours avides de dichotomies faciles entre « les Anglo‑Saxons et nous »[13].
Encore plus centrale est la question de notre identité en tant que non‑musulmans pour coordonner cette enquête. Sans que nous ayons abordé le sujet d'emblée, il paraissait souvent préférable aux yeux des personnes rencontrées que ce travail soit mené par des non‑musulmans, condition à leurs yeux d'une plus grande légitimité des résultats produits. Car le fait est que la plupart des membres de notre équipe ne sont pas issus du groupe minoritaire faisant l'objet de cet ouvrage. Se pose donc pleinement la question de la « positionnalité », que Silyane Larcher envisage ainsi, en s'inspirant notamment d'un article important de Donna Haraway[14] sur la connaissance située (situated knowledge) :
« La positionnalité ne désigne pas le point de vue d'une identité essentialisée, sorte de posture figée, mais plutôt la perspective socialement et historiquement déterminée, donc changeante, à partir de laquelle le sujet de connaissance regarde le monde social et est en même temps façonné par lui. »[15]
L'écriture de cet ouvrage par des personnes subissant racisme et islamophobie au sein de la société française aurait peut‑être permis aux lecteurs de se faire une meilleure idée des expériences dont il sera question dans les pages qui suivent, ou de s'y retrouver plus fidèlement s'ils les partagent. Diverses raisons expliquent cette quasi‑absence de musulmans dans l'équipe à l'origine de ce livre. Tout d'abord, une présomption de partialité voire de militantisme pèse sou‑ vent sur les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur un groupe auquel on estime qu'ils et elles appartiennent[16].
Cette question avait déjà été explorée par la chercheuse Philomena Essed au début des années 1990, à travers la figure de la Black angry woman aux États‑Unis[17], une critique qui n'épargne pas le travail des universitaires issus de minorités, sur lesquels pèsent, pour citer Audrey Célestine, des « soupçons d'être “trop près de leur objet” ou “trop concernés” »[18]. De fait, la nécessaire « neutralité axiologique » à laquelle invite le sociologue Max Weber[19] est souvent mal comprise. Elle est souvent caricaturée en une injonction à une neutralité de façade qui reviendrait à prétendre, lorsqu'on est universitaire, qu'on est capable de s'extraire du social, des rapports de force qui le traversent et le structurent.
Travailler sur ce qui n'est pas soi n'abolit pas la position sociale que l'on occupe et à partir de laquelle on porte un regard sur le monde social. Il n'existe pas de regard neutre, ce qui n'empêche pas d'objectiver les phénomènes sociaux. En second lieu, et plus concrètement, l'université française demeure un espace très majoritairement blanc où les personnes racisées sont largement sous‑représentées[20]. Enfin, les coûts sont réels dans une carrière universitaire lorsqu'on s'investit dans un projet jugé politiquement inflammable et entouré de soupçons.
Des collègues au statut précaire – qui sont de plus en plus nombreux, surtout en sciences sociales – prennent un risque en s'associant à ce type de projet. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si un chercheur comme Abdellali Hajjat est désormais professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles, expatriation universitaire qu'il a justifiée par les « grandes difficultés » qu'il a connues en France pour « mener un travail serein sur la question de l'islamophobie »[21].
Collectivement, nous pensons en outre que la charge raciale qui pèse sur la composante musulmane de la société française ne doit pas reposer sur ce seul groupe. Maboula Soumahoro définit cette « charge raciale », notion inspirée du pionnier de la sociologie américaine W. E. B. Du Bois (1868‑1963), comme la « tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes »[22] auprès du groupe majoritaire dans la société. Nous proposons modestement de partager cette charge raciale. Il nous semble également que notre ouvrage en dit au moins autant sur la France que sur les personnes interrogées, leurs trajectoires, leur identité ou leur foi. Or nous faisons partie de cette société et c'est donc aussi sur nous‑mêmes que nous avons travaillé.
Qu'on nous permette de faire un pas de côté pour mieux saisir ce qui se joue ici, en nous inspirant de l'expérience de l'historien canadien John Milloy. Auteur d'un ouvrage de référence sur les pensionnats (residential schools) imposés aux enfants des peuples autochtones jusque dans les années 1990 au Canada, et dont l'histoire tragique a suscité un traumatisme national, il insiste à la fin de son introduction sur le fait que son livre est « une histoire écrite par un non‑Aborigène, quelqu'un qui n'a jamais été envoyé de force dans un pensionnat », quelqu'un qui « n'a jamais ressenti le racisme ou dû subir le dénigrement de sa propre identité », mais que, en réalité, son ouvrage en dit davantage sur son propre pays que sur les peuples premiers du Canada.
Pour étayer son propos, Milloy précise qu'en 1965, lors d'auditions par le Bureau des affaires indiennes, un ancien élève d'un pensionnat appartenant à la nation Mohawk exprima « une vraie réticence » à témoigner, parce que, selon lui, « pour être honnête, cette histoire, ce n'est pas celle de mon peuple, mais c'est plutôt la vôtre »[23].
Islamophobie, une notion militante ?
Dans son ouvrage Why Race Still Matters (« Pourquoi la race est toujours d'actualité »), la théoricienne australienne Alana Lentin met en question la manière dont le racisme est défini, et surtout par qui. Elle note que ce sont toujours les élites politiques et médiatiques, qui dans leur majorité n'en souffrent pas, qui jouissent du pouvoir de définition officielle du racisme, tandis que ses victimes ont peu voix au chapitre dans l'espace public sur la nature des discriminations qu'elles subissent[24].
Notre enquête illustre la validité de cette thèse : alors qu'en France une bonne partie des élites politiques, au nom d'un universalisme abstrait, nie l'existence de cette forme majeure et spécifique de racisme, les premiers concernés utilisent le terme « islamophobie » de manière banale, à la mesure de la banalisation de ce racisme dans notre pays. Comme le dit Lila, qui travaille aujourd'hui dans la finance à Singapour après avoir quitté un emploi rémunérateur en France du fait d'une atmosphère devenue trop pesante :
« c'est clairement de l'islamophobie. Quand on a une discrimination envers une religion, c'est sûr, c'est du racisme. Et celui‑ci, plus particulièrement, s'appelle de l'islamophobie. Comment vous voulez appeler ça, vous ? » (E23).
On notera aussi que les rares personnes n'ayant pas fait d'études supérieures parmi notre échantillon l'utilisent tout autant que celles qui sont passées par les bancs de Sciences Po Paris ou l'École Centrale.
Nous entendons par islamophobie la stigmatisation de l'islam et des musulmans et ses conséquences concrètes : discriminations, micro‑agressions[25], violences verbales et physiques. À ce titre, et alors que le débat public s'est beaucoup concentré sur cette question ces dernières années, l'islamophobie ne relève pas de la « peur » de l'islam, et encore moins de la possibilité ou non de critiquer cette religion, pas plus que l'homophobie ne renvoie à la seule peur des homosexuels, mais à l'ensemble des actes discriminatoires ou violents qui les ciblent.
Le concept d'islamophobie est aujourd'hui reconnu par les sciences sociales à l'échelle internationale et mobilisé par de très nombreuses institutions nationales et internationales[26]. Les querelles sémantiques qu'il déchaîne en France paraissent donc exceptionnelles, et contribuent peut‑être à détourner l'attention des conséquences réelles de ce problème. Sans fétichiser le terme – au fond, « racisme anti‑musulman » est équivalent – il mérite peut‑être d'autant plus d'être conservé qu'il est attaqué et que son abandon ou son évitement reviendraient à délégitimer l'usage ordinaire dont nos entretiens témoignent.
Des mobilités internationales à part ?
D'autres concepts qu'« islamophobie » nous ont causé bien davantage de problèmes, à commencer par la manière de nommer ces musulmans français partis vivre à l'étranger. Est‑ce que ce sont des personnes émigrées, exilées, expatriées, et quel est le degré de porosité des situations auxquelles renvoient ces termes ?
La mobilisation de ces notions par les personnes interrogées est elle‑même assez hésitante. Ainsi, Monia, ingénieure installée à Düsseldorf depuis cinq ans au moment de l'entretien, est dubitative sur la pertinence du terme « expatriée » dans son propre cas. Assez politisée, elle souligne la dimension post‑coloniale du terme d'« expat » :
« Les “expats”, c'est un peu les cadres sup blancs après école d'ingé qui partent à l'étranger. […] Pour moi le mot “expat” je l'utilise de manière presque ironique. Fondamentalement, c'est de l'immigration, mais on aime bien faire une différence entre les expatriés et les immigrés » (E12).
Même hésitation sur le qualificatif d'expatrié pour Mourad, inscrit en thèse à Montréal depuis 2020 :
« Donc, quand je suis venu à Montréal, je me considérais comme… non pas un expatrié parce que j'ai l'impression qu'expatrié ça fait très référence à une migration liée à l'emploi, alors que dans notre cas, c'était plus lié aux études [réfléchit] Pour moi ce serait plus “Français de l'étranger”, mais honnêtement je n'ai pas de terme exact » (E16).
Le constat qu'aucun terme ne correspond parfaitement à sa situation est partagé par Charles, résident à Dubaï depuis 2015, converti depuis 2012 et diplômé d'une école de commerce toulousaine :
Je me dis : est‑ce que je me considère comme un expat ? Pour moi, un expat, c'est quelqu'un qui vient ici pour ramasser de l'argent et puis repartir en France. C'est pas moi, ce n'est pas mon délire. En fait, je suis plus… Est‑ce que je peux me considérer comme un immigré ici, parce que je ne pourrai jamais devenir un Émirati et je ne pourrai jamais vraiment m'intégrer à cette société ? Donc, en fait, je ne sais pas si je suis un expat. Je suis un immigré, et je n'ai pas l'intention de rentrer en France (E62).
Lamia, ingénieure d'origine syrienne installée depuis 2007 à Ottawa, récuse sans ambages le terme : « Expatriée, c'est vraiment quelqu'un qui a choisi de le faire, moi je pense que j'ai été un peu poussée à la porte » (E75). Certaines personnes, les plus attachées à leur religion, notamment des femmes coiffées d'un hijab partageant un vécu traumatique en France, se vivent d'une certaine manière comme des « réfugiées de la laïcité », en tant que celle‑ci prend la forme d'une « laïcité d'interdiction ».
La complexité des parcours personnels donc, dépendant surtout de l'importance du vécu discriminatoire en France, peut faire opter pour « exilé » plutôt qu'« expatrié ». Pour donner un exemple mentionné plus haut, Ilham nous semble correspondre à un profil d'exilée en Angleterre (Salford), alors qu'on classerait plus aisément Redouane parmi les « expatriés » à Dubaï. La frontière entre les deux, tout comme les motivations au départ, est souvent ambiguë, plusieurs raisons, professionnelles et économiques, mais aussi politiques, étant imbriquées.
Malgré les réticences exprimées dans ces extraits d'entretiens, les termes d'« expatrié » et d'« expatriation » restent les plus communément utilisés par les personnes interrogées, notamment celles qui exercent les métiers les plus rémunérateurs et paraissent les moins politisées. Ce n'est pas un hasard si le groupe Facebook des francophones musulmans au Royaume‑Uni produit un guide « du musulman expatrié » dans le pays, où l'on trouve, en 129 pages, neuf occurrences du terme « expatriation », et trois de celui « expatriés ».
D'une certaine manière, la mobilisation de ce vocabulaire est une façon de banaliser l'ascension sociale à l'étranger, d'inclure les Français et les Françaises de confession musulmane dans le groupe plus vaste des expatriés. Cela n'empêche pas que ces termes eux‑mêmes sont inappropriés, principalement d'ailleurs parce que l'expatriation présuppose un retour au pays. Or, nous le verrons, les personnes interrogées, dans leur grande majorité, ne souhaitent pas revenir en France.
Le terme de « diaspora », adopté en sous‑titre de notre livre, peut finalement s'avérer utile pour appréhender notre objet d'étude pris dans sa globalité, au‑delà des trajectoires individuelles. La littérature en sciences sociales a repris et étendu la notion de diaspora, historiquement dédiée à la dissémination du peuple juif dans le monde, pour décrire les mouvements transnationaux dans un contexte de mondialisation où se complexifient des réseaux de solidarités par‑delà les frontières nationales. « Diaspora » est également précieux puisqu'il permet à la fois de désigner un type de phénomène, une condition sociale et un processus d'affinités transnationales[27]. Ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons au chapitre 5.
Notre titre
Le titre de cet ouvrage et du projet de recherche dont il est l'aboutissement a fait l'objet d'âpres discussions, sur lesquelles nous souhaitons revenir brièvement. D'emblée, il peut sembler provocateur. Il reprend, pour le détourner, un slogan de la droite radicale française utilisé notamment en 2006‑2007[28], slogan lui‑même inspiré de la révolution conservatrice sous Nixon (America, you love it or leave it !)[29], mais en transformant « La France, tu l'aimes ou tu la quittes » en un « La France tu l'aimes mais tu la quittes ».
Le simple passage d'une conjonction de coordination (« ou ») à une autre (« mais ») permet au groupe stigmatisé de se réapproprier politique‑ ment une alternative perverse, dans laquelle une partie de la population française est publiquement soupçonnée de ne pas aimer assez, ou de ne pas aimer « comme il faut », son propre pays. Ce titre exprime bien le tiraillement de nombreuses personnes interrogées et leur identification paradoxale à la France, dans laquelle les sentiments de reconnaissance, de gratitude, de nostalgie vis‑à‑vis des amis et de la famille laissés derrière elles se mêlent à l'amertume, le ressentiment et l'hostilité vis‑à‑vis des élites politiques et médiatiques de leur pays.
Le sentiment paradoxal qui consiste « à aimer mais à quitter » a déjà été évoqué par Marwan Muhammad, fondateur du CCIF en conclusion de son ouvrage Nous (aussi) sommes la Nation[30], ainsi que par le journaliste Claude Askolovitch[31]. Il a aussi été souligné par un de nos enquêtés, Ali, qui habite à Alger et y travaille pour la même grande entreprise française qui l'employait en France. Dans un post intitulé « La France, elle m'aime ou je la quitte », publié sur le site LinkedIn en août 2018, il donne des détails sur sa décision de partir.
Les éléments qu'il fournit entrent en résonance avec de nombreux entretiens que nous avons menés. En outre, il rappelle le déferlement de haine dont il a été victime après sa publication, l'extrême agressivité de Génération identitaire, Riposte laïque, le Printemps républicain qui l'ont harcelé en ligne (E56). Il évoque également les nombreux soutiens qu'il a reçus de la part de personnes qui se sont reconnues dans son expérience, qu'elles envisagent ou non de quitter la France, comme lui.
Dans son texte, Ali se présente comme un jeune diplômé d'une école d'ingénieur en hautes technologies qui, « après des semaines de doutes, des mois de réflexion, des années de mal‑être, de tensions intérieures et de frustration », a pris une décision forte : « quitter mon pays, la France, pour d'autres horizons ». Puis il décrit de manière assez clinique et dépassionnée pourquoi l'atmosphère lui est devenue irrespirable :
« Ce sentiment s'est aggravé année après année jusqu'à en devenir insupportable aujourd'hui. Le sentiment de ne pas me sentir considéré comme un citoyen lambda. D'avoir droit à des traitements, des réactions, des regards, qui me mettent mal à l'aise et créent une atmosphère pesante dans laquelle j'étouffe. »
Il en veut « énormément aux médias et aux politiques de ce pays, qui jour après jour, entretiennent les divisions entre citoyens », avant de s'en prendre nommément à des figures médiatiques et politiques de l'islamophobie hexagonale. Il pose également la question :
Dois‑je avoir honte de dire que le Canada, pour y avoir vécu six mois, est le pays où je me suis le plus senti chez moi, le mieux accepté tel que j'étais ? Devant la France, pays où j'ai grandi, devant l'Algérie et l'Italie, pays de mes grands‑parents ? Que cette expérience m'a permis de prendre conscience que le mal-être que je ressentais jusque‑là en France n'était pas une fatalité, et que je pouvais probablement être plus épanoui au‑delà de ses frontières ?
Ces interrogations constituent l'essence même de notre ouvrage, dans lequel des gens comme Ali expriment leur sentiment d'injustice, leur mal‑être en France, leur sérénité (re)trouvée dans un pays dont beaucoup ne connaissaient presque rien au départ, leurs craintes également pour leurs proches restés au pays. Nous avons choisi de les suivre dans leur cheminement de façon chronologique, depuis leurs socialisations initiales en France, jusqu'à leur décision de partir, dans ses motivations immédiates et profondes, ses conditions pratiques et sa réalisation (choix du pays, premiers pas à l'arrivée, nouvel enracinement réel ou envisagé).
Nous finissons par le regard et le rapport pratique et symbolique que les personnes que nous avons rencontrées entretiennent désormais avec la France. On verra qu'elles évoquent souvent leur relation complexe d'attraction/répulsion vis‑à‑vis d'un pays où la grande majorité est née, selon qu'elles convoquent le souvenir de grandes figures nationales d'émancipation, de la littérature, de la culture populaire hexagonale dans laquelle elles ont baigné, ou, au contraire, qu'elles se souviennent du défilé d'éditorialistes sur CNews et de l'accumulation de polémiques depuis la première affaire du voile de Creil en 1989 jusqu'aux dernières sur le port de l'abaya dans les écoles en 2023, soit presque trente‑cinq ans plus tard.
*
Notes
[1] Tous les prénoms utilisés dans cette enquête ont été modifiés, en respectant leur consonance originelle. C'est pourquoi on a conservé, pour la version « pseudonymisée », soit une consonance manifestant l'appar‑ tenance confessionnelle et/ou ethnique (Mohammed, Karima), soit une consonance qui l'efface (Adam, Sofia), selon le prénom d'usage des per‑ sonnes interrogées. Ces choix de prénoms par les parents ne sont pas anodins, on le verra, ils reflètent l'intériorisation, par ces derniers, du fait que choisir certains prénoms qui sonnent « trop arabes » ou « trop musulmans » aurait des incidences négatives pour leur enfant, par exemple sur le marché du travail.
[2] Nous utilisons indifféremment « hijab », « foulard » ou « voile » dans cet ouvrage, et l'utilisons avec la voix active (« femme qui porte un foulard »), jamais à la voix passive (« femme voilée »). Ceci véhiculerait l'idée d'une absence de choix, d'une forme de soumission, qui ne corres‑ pond pas du tout à l'expérience des femmes interrogées.
[3] (E129) correspond à notre entretien n° 129. Pour une présentation succincte de chaque entretien (principales données socio‑démographiques de chaque enquêté·e), nous renvoyons à notre site Internet : https://love‑ leave.hypotheses.org/
[4] Entre autres : « “En France, j'avais le cul entre deux chaises” : Dubaï, terre promise pour les enfants d'immigrés », Le Parisien, 28 mars 2021 ; « Ces musulmanes portant le voile qui quittent la France pour trouver du travail en Angleterre », Slate, 30 novembre 2020 ; « Comment la Turquie courtise les Français musulmans », La Croix, 21 octobre 2020.
[5] Jérémy Mandin, « Leaving Europe : Emigration, aspirations and pathways of incorporation of Maghrebi French and Belgians in Montréal », CEDEM / Université de Liège, soutenue le 19 mars 2021, sous la direc‑ tion de Marco Martiniello.
[6] Jaafar Alloul, « Leaving Europe, Navigating Access : Status Migra‑ tion, Traveling Habitus, and Racial Capital in Euro‑Maghrebi Mobilities to the United Arab Emirates », soutenue le 02 juillet 2021 à l'Université de Louvain.
[7] Thomas Deltombe, L'Islam imaginaire. La construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2007.
[8] Olivier Esteves, « Cartographier la vague réactionnaire dans les universités françaises », Médiapart, 14 février 2022 ; Michèle Zancarini‑ Fournel et Claude Gautier, De la défense des savoirs critiques. Quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, Paris, La Découverte, 2022.
[9] Sur le sujet : Observatoire des libertés associatives, « Une nouvelle chasse aux sorcières », Enquête sur la répression des associations dans le cadre de la lutte contre l'islamisme, 2022 ; Julien Talpin, Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Ronchin, Les Étaques, 2020.
[10] Voir Haouès Seniguer, La République autoritaire. Islam de France et illusion républicaine (2015-2022), Bordeaux, Le Bord de l'eau, 2023.
[11] Albert Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge (Mass.), Havard University Press, 1970.
[12] Sans oublier que pour les personnes installées à Montréal, Bruxelles ou Genève, le sens du vouvoiement et du tutoiement n'est pas le même qu'en France.
[13] Sur les problèmes inhérents à l'expression « pays anglo‑saxons » : Émile Chabal, A Divided Republic. Nation, State and Citizenship in Contemporary France, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
[14] Donna Haraway, « Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, vol. 14, n° 3, 1988, p. 575‑599.
[15] Dossier coordonné par Silyane Larcher, « Positionnalités des cher‑ cheur.e.s minoritaires », Raisons politiques, vol. 1, n° 89, 2023, p. 5‑24 (ici, p. 13).
[16] Delphine Naudier et Maud Simonet (dir.), Des sociologues sans qualités ?, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2011.
[17] Philomena Essed, Understanding Everyday Racism : An Interdisciplinary Theory, Londres, Sage, 1991, p. 7.
[18] Cité dans Audrey Célestine, Une famille française. Des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie, Paris, Textuel, 2018, p. 138‑139.
[19] Max Weber, Le savant et le Politique, 1919.
[20] Abdellali Hajjat, « Islamophobia and French Academia », Current Sociology, vol. 69, n° 5, 2021, p. 621‑640.
[21] Abdellali Hajjat revient sur son départ de France à l'occasion d'une controverse avec Nathalie Heinich dans l'émission Le Temps du débat (France Culture), https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le‑temps‑du‑debat/ le‑militantisme‑a‑l‑universite‑pose‑t‑il‑probleme‑9722930.
[22] Maboula Soumahoro, Le Triangle et l'Hexagone, Paris, La Découverte, 2020, p. 135.
[23] John S. Milloy, A National Crime : The Canadian Government and the residential School System, 1879 to 1986, Winnipeg, University of Manotiba Press, 2017 [1999], p. XLI, [notre traduction].
[24] Alana Lentin, Why Race Still Matters, Cambridge, Polity Press, 2020, p. 14 et p. 58‑59.
[25] Une micro‑agression peut se définir comme une parole, un geste, un comportement vécu comme hostile par un ou des membres d'un groupe minoritaire, souvent stigmatisé. D'apparence banale, la micro‑agression est perçue comme hostile même si elle ne provient pas nécessairement d'une volonté de blesser. Souvent, les micro‑agressions procèdent par accumulation : c'est leur multiplication qui est considérée comme intolérable.
[26] Sur le sujet : Houda Asal, « Islamophobie : la fabrique d'un nouveau concept. État des lieux de la recherche », Sociologie, vol. 5, n° 1, 2014, p. 13‑29.
[27] Voir Floya Anthias, « Evaluating “Diaspora” : Beyond Ethnicity ? », Sociology, vol. 32, n° 3, 1998, p. 557‑580 ; et plus généralement, Arjun Appa‑ durai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.
[28] « M. Sarkozy veut ravir ses électeurs au FN et au MPF », Le Monde, 23 avril 2006.
[29] Voir Romain Huret, De l'Amérique ordinaire à l'État secret. Le cas Nixon, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
[30] Marwan Muhammad, Nous (aussi) sommes la Nation. Pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie, Paris, La Découverte, 2017, p. 232.
[31] Claude Askolovitch, Nos mal-aimés. Ces musulmans dont la France ne veut pas, Paris, Grasset, 2013, p. 120‑121.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le tribunal sikh – Les systèmes judiciaires parallèles sont un danger pour les femmes

Les porte-paroles de la Cour sikhe la décrivent comme un mécanisme alternatif de résolution des conflits (ADR) fonctionnant dans le cadre des dispositions de la loi sur l'arbitrage de 1996. Ils s'attendent à ce qu'il traite principalement des questions familiales et des conflits liés aux gurdwara. Ils ont fait allusion à trois objectifs principaux préserver l'intégrité des mariages et des familles sikhs et réduire les taux de divorce réduire les frais de justice en facturant un montant minimal et en garantissant une résolution rapide des conflits aider les sikhs à éviter les retards dans le système judiciaire civil.
Ces actions sont présentées comme une forme de seva (service désintéressé) qui améliorera l'accès à la justice pour les Sikhs au Royaume-Uni.
Depuis plusieurs décennies, Southall Black Sisters (SBS), One Law for All et d'autres organisations au Royaume-Uni ont mis en évidence la manière dont les organismes religieux sapent et entravent activement l'accès à la justice et violent les droits des femmes minorisées, des enfants et des minorités religieuses au sein de ces communautés. C'est notamment le cas des victimes de violences domestiques et d'abus sexuels qui subissent des pressions constantes pour servir de médiateurs avec des partenaires violents et abusifs et des familles élargies, ainsi que pour céder aux demandes de droit de visite des enfants, même lorsque cela met en péril leur sécurité et le bien-être de leurs enfants. À ce jour, rien ne prouve que les institutions religieuses ont agi dans l'intérêt des plus vulnérables de nos communautés, quelque soit le nombre de femmes impliquées dans le fonctionnement de ces institutions. En revanche, il existe de nombreuses preuves qu'elles ont renforcé le pouvoir et le contrôle des maris, des membres masculins de la famille et des belles-mères, et qu'elles ont violé les droits des êtres humains.
En outre, les EIM religieux au Royaume-Uni ont été fondés par des hommes ayant une vision étroite, conservatrice et/ou fondamentaliste des femmes, du mariage et de la cellule familiale. Il s'agit de projets politico-religieux profondément investis dans l'institution du mariage et les structures familiales patriarcales et liés à des projets politiques plus vastes sur l'autonomie de la communauté. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'agences apolitiques et bienveillantes motivées par la justice sociale et l'égalité. En effet, les exemples donnés par les porte-parole de The Sikh Court équivalent à un soutien au contrôle coercitif, à une atteinte significative à l'autonomie des femmes et au droit à la liberté de religion. Dans un exemple, la raison du divorce d'une femme sikhe est présentée comme une réaction mesquine au fait que son mari ne lavait pas ses propres sous-vêtements, alors qu'il s'avère que la femme luttait contre la présence autoritaire de sa belle-mère. Dans un autre exemple, une femme est critiquée pour avoir coupé ses cheveux et ceux de son fils, alors que les « droits religieux » de son ex-mari sont défendus.
Le SBS a présenté au gouvernement et à la Law Society des observations fondées sur des preuves. Ces soumissions citent une série d'exemples de cas (musulmans, hindous, sikhs et juifs) sur les pratiques discriminatoires des organismes d'arbitrage religieux qui instituent effectivement des systèmes juridiques parallèles sur les familles au sein des communautés minoritaires. Bien qu'il ait tenté de prendre ses distances avec le tribunal d'arbitrage musulman et les conseils de la charia en raison des critiques largement répandues à l'encontre de ces organismes, le tribunal sikh n'est pas différent dans ses objectifs.
Bien que les représentants du tribunal sikh affirment qu'ils ne sont pas un tribunal religieux parce qu'ils s'en remettent à l'Akal Takht d'Amritsar pour les jugements religieux, ils fonctionneront sur la base de « principes sikhs » instables qui sont eux-mêmes ouverts à l'interprétation et au débat. Ils revendiquent « l'égalité » et « l'intégrité » comme principes clés, mais si c'est le cas, pourquoi ne pas concentrer l'énergie sur la garantie que le système juridique britannique respecte ces principes ? Plus inquiétant encore, s'il ne s'agit pas d'un tribunal religieux, pourquoi ses membres ont-ils prêté serment d'allégeance au Panj Pyare et à l'Akal Takht, un édifice politico-religieux du Pendjab qui exerce une influence considérable sur les Pendjabis du monde entier.
Les conservateurs religieux cherchent à imposer leurs projets politiques et leur version particulière de la religion par le biais d'une série de voies juridiques, de projets éducatifs et de services d'aide sociale. Les SBS ont documenté la manière dont ils ont capitalisé sur les failles de la politique gouvernementale et sur le rétrécissement de l'État-providence, y compris les dispositions d'aide juridique sévèrement restreintes et une pression croissante sur le système judiciaire séculier, pour accroître leur propre capacité et légitimité à gouverner et à contrôler la vie des communautés minoritaires. En fait, le rapport du sommet sikh qui accompagne cette évolution présente précisément un plan d'autonomie élargie des communautés sikhes au Royaume-Uni. Les sikhs de Grande-Bretagne ne sont pas homogènes, mais une seule version du sikhisme est au cœur de ces initiatives. Cela conduira invariablement à l'institutionnalisation et au privilège de cette seule interprétation du sikhisme et donnera lieu à de nouvelles accusations de blasphème et d'apostasie contre ceux qui remettent en cause leur interprétation et leur autorité sur les sikhs du Royaume-Uni.
Nous, soussigné·es, appelons nos communautés et nos organismes publics à
* Renoncer à la nécessité d'un tribunal sikh et de tout autre tribunal religieux.
* Reconnaître que les organismes religieux pratiquent la discrimination à l'égard des femmes et des enfants.
* Exiger une loi unique pour toutes et tous.
* unir nos forces avec d'autres pour faire pression sur le gouvernement et sur les tribunaux civils et pénaux laïques existants afin de garantir que chacun ait accès à une bonne représentation et à une aide juridique et qu'il puisse faire valoir ses droits dans le cadre d'un système juridique laïque.
* Demander au gouvernement de ne pas autoriser l'utilisation de la loi sur l'arbitrage dans les affaires familiales, car cela constitue une discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles.
Les chefs religieux ne parlent pas en notre nom ! Une seule loi pour tous !
Signataires :
Southall Black Sisters (SBS)
One Law for All
Council of Ex-Muslims of Britain
Dr Sukhwant Dhaliwal
Professor Ravi K. Thiara
Professor Aisha K. Gill
Gurpreet Kaur Bhatti, Playwright
Professor Avtar Brah
Professor Virinder S. Kalra
Kiranjit Ahluwalia
Professor Kiran Kaur Sunar
Dr Permala Sehmar
Dr Sunny Dhillon
Baljit Banga
Yasmin Rehman
Rights of Women
Mandip Ghai, Solicitor
Juno Women's Aid
Women's Aid Federation of England
Anah Project
Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA)
Respect
Kurdish and Middle Eastern Women's Organisation
IDAS (Independent Domestic Abuse Services)
Middle Eastern Women and Society Organisation (MEWSO)
Laïques Sans Frontières (LSF)
Professor Sundari Anitha
Professor Geetanjali Gangoli
Dr Fiona Vera-Gray
Jo Lovett, Researcher
Dr Maria Garner, Researcher
Dr Nikki Rutter
Professor Catherine Donovan
Pratibha Parmar, Filmmaker
Rana Ahmad, Atheist Refugee Relief Founder
Jayne Egerton, Broadcast Journalist
Mandana Hendessi, Author
Alice Bondi
Ibtissame Betty Lachgar, Alternative Movement for Individual Liberties (M.A.L.I.) Morocco
Annie Laurie Gaylor, Freedom From Religion Foundation Co-President
Dr Rose Rickford
Mariam Oyiza Aliyu, LETSAI NGO
Nadia El Fani, Filmmaker
Ahlam Akram, BASIRA British Arabs Supporting Universal Women's Rights
Dr Savin Bapir-Tardy
Paminder Parbha
Cinzia Sciuto, MicroMega
Maryam Namazie, Campaigner
Atieh Niknafs, Anti Theist Activist
Secularism Is A Women's Issue (SIAWI)
Marieme Helie Lucas, Campaigner
Professor Purna Sen
Dr Christophe Clesse
Professor Anna Seymour
Dr Windy Grendele
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : Gouvernance masculine, démocratie bafouée

Le remplacement du ministère de la Femme par celui de la Famille est une régression. Aucun secteur n'échappe à la compétence, l'expérience et le dévouement des femmes
Tiré de Entre les lignes et les mots
Collectif des citoyen.ne.s pour le respect et la préservation des droits des femmes
Alors que le Sénégal s'est positionné comme pionnier de l'égalité de genre en Afrique, la nomination des membres du gouvernement laisse les organisations féminines circonspectes. Seulement 4 emmes sur 34 postes, une disproportion qui appelle des mesures correctrices selon un collectif des citoyen.ne.s pour le respect et la préservation des droits des femmes dont nous publions la déclaration ci-dessous :
« De la nécessité d'inclure les femmes dans les instances de prise de décision pour une gouvernance véritablement démocratique !
Nous avons accueilli avec une grande satisfaction l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'espoir fondé en ce président est à la hauteur de la rupture prônée.
Nous tenons aussi à rappeler le combat des femmes pour la tenue d'une élection présidentielle apaisée dans le respect du calendrier républicain. C'est au nom de ce même combat, en tant qu'organisations, personnalités indépendantes, et collectif de citoyen.ne.s soucieux du respect et de la préservation des droits des femmes, que nous alertons sur la nécessité d'une gouvernance démocratique inclusive avec une représentativité substantielle des femmes aux sphères de décisions publiques. La liste des membres du premier gouvernement, parue ce 5 avril 2024, laisse très peu de place aux femmes. Sur 25 ministres, 5 secrétaires d'État, et 4 membres du cabinet du chef d'État, soit 34 postes, seules quatre femmes sont présentes. Cette inqualifiable sous-représentation induit une perte intolérable d'intelligences et de visions que seuls le pluralisme et l'inclusion permettent de garantir. Il n'y a aucun secteur dans lequel on ne trouve des femmes qui allient compétence, expérience et dévouement de premier ordre.
Cette disproportion est d'autant plus regrettable que c'est le Sénégal qui, dès 2004, a proposé à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine, l'adoption d'une Déclaration solennelle pour l'égalité de genre en Afrique, posant ainsi les jalons vers une Commission de l'Union africaine (CUA) paritaire pour ne citer que cet exemple. De plus, l'article 7 de notre Constitution dispose : « les hommes et les femmes sont égaux en droit. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions ».
Doit-on encore rappeler qu'à chaque étape de la construction de notre Nation, nous avons été présentes et avons été actrices incontournables dans toutes les luttes pour l'indépendance, l'émancipation, la justice sociale, le bien-être de tous ? Il est important de rappeler qu'aucun pays ne s'est développé en laissant en marge les femmes.
C'est pourquoi, outre la faible représentativité des femmes, nous sommes circonspectes sur le remplacement du ministère de la Femme, de la famille et de la protection des enfants par le ministère de la Famille et des solidarités. Cette appellation est une véritable régression. L'emphase portée sur les femmes et les enfants soulignait précisément l'urgence d'élaborer des politiques publiques destinées à mettre fin aux inégalités de genre (économiques, éducatives, sanitaires, politiques, foncières, etc.) et à améliorer les conditions de vie de celles qui demeurent encore les plus vulnérables à la pauvreté et à la violence, et sur qui, reposent toujours la charge du soin des plus petits et des plus âgés. Soulignons aussi de manière définitive ceci : bien que les femmes jouent un rôle central dans la cellule familiale, elles sont des êtres à part entière qui existent en dehors de la sphère familiale. Les assimiler à cette dernière, c'est nier leur droit à exister dans leur multidimensionnalité.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que cette erreur de départ soit rectifiée par la nomination de femmes dans les directions nationales et les instances administratives. De surcroît, nous demandons le renforcement des cellules genre déjà présentes au niveau des différents ministères pour une mise en œuvre transversale de la Stratégie Nationale d'Équité et d'Égalité de Genre (SNEEG) en collaboration avec la Direction de l'équité et l'égalité de genre (Deeg) et le Programme d'appui à la stratégie d'équité et d'égalité de genre (pasneeg).
« Poursuivre, intensifier et accélérer les efforts pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux », c'est ce à quoi l'État du Sénégal s'était engagé dans le cadre de la Déclaration Solennelle pour l'Egalité de Genre en Afrique (DSEGA) et c'est à quoi nous invitons le nouveau gouvernement qui définit son projet de société comme panafricain.
Dans notre volonté de veiller à ce que ce nouveau gouvernement, celui de tous les Sénégalais et Sénégalaises, remplisse ses missions de rupture pour plus de gouvernance démocratique, de justice sociale, d'équité, nous continuerons d'alerter et de faire des propositions constructives sur le besoin d'inclusion des femmes et de représentation égalitaire. »
Voir la liste des signataires
https://www.afriquesenlutte.org/afrique-de-l-ouest/senegal/article/senegal-gouvernance-masculine-democratie-bafouee
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Monsieur le Président de la République, votre inaction tue

Le 14 mai, des militant·es du collectif NousToutes ont déposé 940 bateaux en papier rouge sur la Seine, pour symboliser les 940 victimes de féminicides des sept dernières années. Dans cette lettre ouverte, nous rappelons au Président de la République leurs prénoms, mais aussi et surtout, que des solutions concrètes existent.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/24/monsieur-le-president-de-la-republique-votre-inaction-tue/
Le vendredi 3 mai, à Saint-Jean-de-Luz, une femme de 34 ans a été tuée à coups de marteau. Elle avait été hospitalisée 15 jours avant, après avoir « chuté » de la fenêtre d'une chambre d'hôtel. À l'époque, son compagnon avait été placé en garde à vue puis libéré alors même que cet homme était déjà connu des services de police pour violences conjugales.
Cette histoire vous choque ?
Pourtant, ce n'est qu'une parmi les 940 femmes assassinées depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Depuis début 2024, c'est près d'un féminicide ou tentative de féminicide par jour.
Mardi 14 mai 2024, 940 bateaux en papier rouge portant le prénom des femmes assassinées ont été mis à l'eau sur la Seine (papier et encre biodégradables).
Face au silence complice et meurtrier du gouvernement d'Emmanuel Macron, #NousToutes a décidé de leur rendre femmage pour ne jamais les oublier. Les militant.es ont choisi de réaliser une action symbolique forte pour dénoncer l'absence de volonté politique et de moyens financiers pour lutter efficacement contre les violences de genre.
Pour l'anniversaire de son arrivée au pouvoir, les militant.es ont également rédigé une lettre ouverte au Président de la République pour conjurer le gouvernement de, enfin, se saisir de ses responsabilités. Cette lettre énonce le prénom et l'âge des 940 femmes, jeunes filles et petites filles ainsi que les revendications du collectif.
Nous espérons que la réponse sera à la hauteur des enjeux, immenses.
Nous avons également adressé cette lettre à des député.es et sénateur.rices pour qu'iels la relaient dans leur assemblée respective.
Pour soutenir et relayer notre action, vous pouvez télécharger cette lettre
À l'attention d'Emmanuel Macron, président de la République et l'adresser sans l'affranchir à Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, Palais de l'Elysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris
***
Monsieur le Président de la République,
Depuis le début de votre mandat le 14 mai 2017, au moins 940 femmes ont été tuées par des hommes parce qu'elles étaient des femmes. Votre inaction tue.
Vous et vos gouvernements n'avez rien fait pour toutes ces femmes. Alors que des solutions existent, largement partagées :
* La mise en place d'un budget minimum de 2,6 milliards d'euros par an pour la lutte contre les violences de genre et l'adoption de politiques publiques adaptées.
* L'inscription du féminicide dans le code pénal avec une définition qui s'étend au-delà de la sphère conjugale et incluant le suicide forcé.
* La mise en place d'un décompte institutionnel par l'État qui inclut tous les féminicides, y compris par suicide forcé et hors sphère conjugale.
* La formation obligatoire, initiale et continue des professionnel·les susceptibles d'être en lien avec des personnes victimes de violence et l'application de la loi du 4 août 2014
* Concernant la formation des professionnel·les de l'éducation, de la santé, du social, de la justice, de la police, des personnels des entreprises (notamment personnel encadrant, institutions représentatives du personnel et services RH) à la détection des violences, à la prise en charge des victimes et à la prévention de toutes les violences sexistes et sexuelles dont les violences obstétricales et gynécologiques, les violences psychologiques et les violences économiques.
* Le déploiement massif du personnel accompagnant et des dispositifs de protection existants via l'augmentation du nombre de personnels en charge de l'accompagnement et de la protection des victimes dans les domaines de la justice, santé, travail social et éducation, la généralisation de l'accès aux ordonnances de protection et la création de 15 000 nouvelles places d'hébergement dédiées chaque année.
* La mise en place d'une aide financière pour assurer la sécurité et l'accompagnement des victimes de violences de genre ainsi que leur famille. Garantir la prise en charge automatique des frais médicaux (incluant l'accompagnement psychologique) et juridiques dans le cadre du parcours de sortie des violences.
* Le maintien et l'augmentation des financements pour les associations qui remplissent des missions de service public d'accueil, d'hébergement et de solidarité envers les victimes de violences.
* La mise en place d'un plan d'urgence pour la protection de l'enfance.
* L'éducation des enfants à l'égalité des genres et au consentement. Notamment par l'application de la loi de 2001 prévoyant 3 séances par an à l'éducation à la vie sexuelle et affective dès le premier cycle de scolarité et jusqu'à la terminale.
* Une modification du code pénal afin de redéfinir l'agression sexuelle et le viol pour y intégrer la notion de consentement et prendre en compte le caractère sériel des agressions sexuelles et des viols.
Cessez vos effets d'annonce ! Agissez !
Voici le prénom et l'âge des femmes qui ont été tuées. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas :
Mariame 32 ans ; Guenaelle 56 ans ; Dorothée 41 ans ; Leila 89 ans ; Aurélie 34 ans ; Odette 75 ans ; Mana 25 ans ; Nafia 59 ans ; Lou 18 ans ; Shpresa 36 ans ; Danielle 62 ans ; Fatim 25 ans ; Jocelyne 62 ans ; Zenash 27 ans ; Mauricette 70 ans ; Jacqueline 69 ans ; Muriel 40 ans ; Marie-Christine 60 ans ; Noémie 30 ans ; Chantal 55 ans ; Christine 44 ans ; Céline 47 ans ; Stéphanie 36 ans ; Annie 67 ans ; Alexia 29 ans ; Jeanine 66 ans ; Corine 42 ans ; Catherine 50 ans ; Nicole 56 ans ; Yamina 42 ans ; Linda 51 ans ; Marielle 50 ans ; Myriam 50 ans ; Marine-Sophie 24 ans ; Emmanuelle 26 ans ; Joséphine 99 ans ; Aude 34 ans ; une femme 34 ans ; Marie-Anne 24 ans ; Lauren 24 ans ; Letitia 42 ans ; Leïla 34 ans ; Carole 50 ans ; Gisèle 52 ans ; Karine ; Fatema 29 ans ; Sindy 34 ans ; Noëlle 65 ans ; Natacha 54 ans ; Laura 18 ans ; Anne-Marie 68 ans ; Geneviève 76 ans ; Thalie 36 ans ; Hülya 35 ans ; Brigitte 64 ans ; Aurélie 29 ans ; Delphine 42 ans ; Aïcha 38 ans ; Alba 35 ans ; Mounia 30 ans ; Frédérique 51 ans ; Marie 58 ans ; Dominique 52 ans ; Nadine 50 ans ; Yasmina 37 ans ; Natacha 38 ans ; Michelle 44 ans ; Florence 31 ans ;
Estelle 36 ans ; Brigitte 62 ans ; Evelyne 69 ans ; Sandra 32 ans ; Marybelle 34 ans ; Marie-Claire 67 ans ; Charlène 28 ans ; Stella 41 ans ; Maryline 45 ans ; Rhadia 46 ans ; Virginie 48 ans ; Sophie 90 ans ; Emilie 37 ans ; Colette 79 ans ; Liliya 49 ans ; Margaux 29 ans ; Karma Tsering 29 ans ; Johane 48 ans ; Sadia 47 ans ; Aurélie 32 ans ; Nora 46 ans ; Lucie-Anne 47 ans ; Vanessa 36 ans ; Céline 35 ans ; Lesline 38 ans ; Manon 24 ans ; Natacha 39 ans ; Nicoleta 26 ans ; Bernadette 67 ans ; Magali 40 ans ; Laura 32 ans ; Marianne 41 ans ; Denise 72 ans ; Patricia 62 ans ; Sylviane 60 ans ; Claire 49 ans ; Johanna 30 ans ; Lisa 22 ans ; Sylvia 42 ans ; Sandrine 41 ans ; Sophie 51 ans ; Laetitia 45 ans ; Marie 28 ans ; Une femme 51 ans ; Marie 65 ans ; Agnès 49 ans ; Audrey 35 ans ; Julie 25 ans ; Seloua quinquagénaire ; Razia 34 ans ; Lydia 53 ans ; Adelissa 21 ans ; Sylvie 55 ans ; Amélia 38 ans ; Raouiyah 39 ans ; Magali 21 ans ; Noelle 76 ans ; Louisette 85 ans ; Jasmine 64 ans ; Hélène 58 ans ; Marie-Amélie 38 ans ; Monique 68 ans ; Valérie 53 ans ; Marie-Bergerette 43 ans ; Martine 56 ans ; Michelle 84 ans ; Alvina 36 ans ; Estelle 36 ans ; Danièle 72 ans ; Fatma 58 ans ; Isabelle 50 ans ; Jessica 26 ans ; Hélène 36 ans ; Ateraita 29ans ; Antonia 56 ans ; Audrey 36 ans ; Akila 73 ans ; Charlotte 27 ans ;
Stéphanie 35 ans ; Ana, trentenaire ; Najat 78 ans ; Jacqueline 56 ans ; Marie-Thérèse, octogénaire ; Alexandrine 42 ans ; Corinne 51 ans ; Christine 53 ans ; Manuela 36 ans ; Rose quadragénaire ; Viviane 68 ans ; Agnès 54 ans ; Linda 43 ans ; Laëtitia trentenaire ; Marnia 40 ans ; Marie Thérèse 76 ans ; Marion 35 ans ; Nathalie 51 ans ; Aline 35 ans ; Marie-Géraldine 44 ans ; Marie-Claire 58 ans ; Magali 24 ans ; Lucienne 31 ans ; Graziella trentenaire ; Sonia 45 ans ; Valérie 46 ans ; Magdalena 31 ans ; Lucette octogénaire ; Marion 28 ans ; Eliane 83 ans ; Vanina 19 ans ; Réjane 70 ans ; Marie-Jo 72 ans ; Elodie 28 ans ; Maria 63 ans ; Roxanne 32 ans ; Céline 39 ans ; Alicia 14 ans ; Isabelle 38 ans ; Sevilay 40 ans ; Maria 64ans ; Vivienne 59 ans ; Linda 50 ans ; Paméla 36 ans ; Laura 39 ans ; Jacqueline 81 ans ; Christiane 80 ans ; Catherine quinquagénaire ; Delphine 34 ans ; Aline 34 ans ; Annie septuagénaire ; Nabilla 23 ans ; Danielle 70 ans ; Virginie 42 ans ; Claudine 66 ans ; Nelly 52 ans ; Estelle 34 ans ; Francine 58 ans ; Lucienne 88 ans ; Nathalie 47 ans ; Sylvie 48 ans ; Catherine 46 ans ; Candice quadragénaire ; Sylvie 43 ans ; Marie-Christine 60 ans ; Jessica 41 ans ; Georgette 75 ans ; Laurie 29 ans ; Hajer 15 ans ; Nadia 43 ans ; Séverine 32 ans ; Maxence 17 ans ; Romy ; Jocelyne sexagénaire ; Marie-Pascale 55 ans ; Lucia 58 ans ; Sylvie 45 ans ; Marie-Claude 65 ans ; Floriane 16 ans ; Jessica 29 ans ; Audrey 28 ans ; Rebecca 44 ans ; Mariette 65 ans ; Régine 92 ans ; Hélèna 54 ans ; Marie-Eliza 26 ans ; Sandrine 46 ans ; Marcelle 80 ans ; Sabrina 38 ans ;
Nicole 55 ans ; Laëtitia 34 ans ; Pascale 55 ans ; Florence 55 ans ; Priya 30 ans ; Marinette 85 ans ; Aurelia 22 ans ; Elea 24 ans ; Aminata 31 ans ; Karine 48 ans ; Sylvia 40 ans ; Aurore 34 ans ; Nathalie 53 ans ; Jacqueline 87 ans ; Monique 83 ans ; Anne-Marie 54 ans ; Shaïna 15 ans ; Safia 35 ans ; Marie-Claude 70 ans ; Naima 31 ans ; Bernadette 73 ans ; Annick 75 ans ; Valérie 51 ans ; Marie 88 ans ; Hang Rol 40 ans ; Marie-Claire 72 ans ; Delphine 33 ans ; Nathalie 53 ans ; Fadela 21 ans ; Berthe dite Natacha 38 ans ; Suzanne 69 ans ; Geonovessa 86 ans ; Janice 30 ans ; Gracieuse 39 ans ; Audrey 27 ans ; Chafia 53 ans ; Johanna 27 ans ; Monique 72 ans ; Mauricette 76 ans ; Aurélie 50 ans ; Fatima 92 ans ; Salomé 21 ans ; Céline 41 ans ; Sarah 39 ans ; Maguy 52 ans ; Clothilde 35 ans ; Eliane 26 ans ; Euphémie 49 ans ; Marianne 37 ans ; Denise 58 ans ; Irina 22 ans ; Martine 62 ans ; Antoinette 76 ans ; Jackie 71 ans ; Ophélie 28 ans ; Corinne 18 ans ; Chloé 29 ans ; Lucette 80 ans ; Mélissa 26 ans ; Stéphanie 35 ans ; Bernadette 43 ans ; Yvonne 86 ans ; Daisy 54 ans ; Yvonne 76 ans ; Samantha 43 ans ; Catherine 47 ans ; Laura 30 ans ; Christelle 32 ans ; Ermira 29 ans ; Isabelle 37 ans ; Leïla 20 ans ; Coralie 33 ans ; Michèle 62 ans ;
Chantal 72 ans ; Justine 20 ans ; Audrey 37 ans ; Mayie 81 ans ; Maïté 36 ans ; Dounia 46 ans ; Priscilla 29 ans ; Alina 31 ans ; Mariette 65 ans ; Nathalie 47 ans ; Mambu 64 ans ; Maryline 49 ans ; Pierrette 57 ans ; Gwénaelle 37 ans ; Moumna 56 ans ; Laura 22 ans ; Martine 60 ans ; Marie-Alice 53 ans ; Martine 64 ans ; Sandra 31 ans ; Chloé 33 ans ; Yaroslava 44 ans ; Danielle 74 ans ; Sandra 25 ans ; Nathalie 53 ans ; Marinette 85 ans ; Dalila 50 ans ; Chantal ; Céline 32 ans ; Stéphanie 39 ans ; Caroline 55 ans ; Marie-Josée 56 ans ; Fabienne 51 ans ; Sophie 35 ans ; Babeth 43 ans ; Dolorès 40 ans ; Georgette 84 ans ; Chantal 60 ans ; Julie 35 ans ; Maria ; Maureen 29 ans ; Hilal 30 ans ; Nicole 85 ans ; Nelly 46 ans ; Ginette 89 ans ; Gaëlle 22 ans ; Josette 66 ans ; Marie 66 ans ; Samira 29 ans ; Céline 38 ans ; Caroline 30 ans ; Simone 81 ans ; Sylvie 56 ans ; Gulçin 34ans ; Patricia 51 ans ; Cherline 40 ans ; Isabelle 48 ans ; Béatrice 51 ans ; Michèle 72 ans ; Guo 49 ans ; Christine 54 ans ; Nadine 49 ans ; Séverine 46 ans ; Félicie 90 ans ; Céline 48 ans ; Taïna 20 ans ; Pascale 56 ans ; Monica 29 ans ; Nora 44 ans ; une femme septuagénaire ; Chantal 55 ans ; Doona 19 ans ; Avril Luna 17 ans ; Jessyca 38 ans ; Sylvie 61ans ; Delphine 33 ans ; Karine 65 ans ; Nathalie 55 ans ; Kim 31 ans ; Karine 45ans ; Yvonne 81 ans ; Une femme 85 ans ; Yasemin 25 ans ; Assia 32 ans ; Cécile 44 ans ; Valérie 51 ans ; Sylvie 59 ans ; Monique 77 ans ; Gisèle 81 ans ; Eliane 59 ans ; Nathalie 51 ans ; Lucette 78 ans ; France 56 ans ; Sandy 33 ans ; Une femme 48 ans ; Nicole 79 ans ; Camille 32 ans ; Sonia 47 ans ; Une femme 76 ans ; Laetitia 38 ans ; Maelys 26 ans ; Catherine 47 ans ; Mélissa 42 ans ; Valérie quadragénaire ; Aurélie 38 ans ; Rejane 88 ans ; Nirojini ; Carine 24 ans ; Karine 51 ans ; Christine 58 ans ; Franciele 29 ans ; Aurélie 43 ans ; Séphanie 43 ans ; Alexandra 30 ans ; Khaddija 48 ans ; Aurore 40 ans ; Brigitte 59 ans ; Silvina ; Natacha 43 ans ; Korotoume 30 ans ; Lorelei 27 ans ; Manon 19 ans ; Hanane 37 ans ; Laure 52 ans ; Céline 38 ans ; Virginie 46 ans ; Déborah 29 ans ; Simone 76 ans ; Joëlle 50 ans ; Geneviève 42 ans ; Monica Andreea 51 ans ; Tiffany 22 ans ; Linda 37 ans ; Madalena 40 ans ; Emmanuelle 46 ans ; Myriam 37 ans ; Barbara 47 ans ; Bettina 53 ans ; Dialine alias Fétia 29 ans ; Karina 25 ans ; Fatiha 52 ans ; Brigitte 68 ans ; Marcelle 84 ans ; Celene 55 ans ; Anne 83 ans ; Sabrina 21 ans ; Olivia 33 ans ; Lisiane 70 ans ; Séverine 31 ans ; Grâce 22 ans ; Salma 21 ans ; Marguerite 90 ans ; Sylvie 45 ans ; Jennifer 35 ans ; Magdalena 33 ans ; Florence 49 ans ; Sylvie 50 ans ; Virginie 41 ans ; Claudette 80 ans ; Andrée 86ans ; Marie-Amélie 53ans ; Gwenaëlle 34ans ; Aissatou Billguissa (Aïcha) 25 ans ; Véronique 50 ans ; Thérèse 80 ans ; Brigitte 67 ans ; Georgette 88 ans ; Jaqueline 23 ans ; Mélanie 35 ans ; Pascaline 60 ans ; Dina 55 ans ; Valérie 47 ans ; Jeannine 88 ans ; Valérie 49 ans ; Laetitia 31 ans ; Anne-Sophie 48 ans ; Raymonde 84 ans ; Sté ; Jay 16 ans ; Sasha 22ans ; Tal 29 ans ; Paula 51 ans ; Ambre 49ans ; Ivanna 31 ans ; Erminah 28 ans ; Corinne 56 ans ; Mary quinquagénaire ; Nadine 54 ans ; Myrjana 22 ans ;
Katy 43 ans ; Elisabeth 51 ans ; Irène 59 ans ; Laurence 53 ans ; Magalie 35 ans ; Bouchra 44 ans ; Une femme 83 ans ; Marie Josiane 60 ans ; Une femme 85 ans ; Valérie 49 ans ; Lise May 55ans ; Christine 50ans ; Cindy 20ans ; Sofya 34ans ; Marie69ans ; Une femme 59ans ; Bernadette 74 ans ; Une femme septuagénaire ; Elga 47 ans ; Karine 50 ans ; Nadège 37 ans ; Jennifer 24 ans ; Adeline 30 ans ; Willinelle 23 ans ; Léa 23 ans ; Yoselis 51 ans ; Une femme 88 ans ; Une femme 66 ans ; Hamana 38 ans ; Une femme 62 ans ; Ivana 39 ans ; Carole 38 ans ; Clara 18 ans ; Lili 20 ans ; Une femme 86 ans ; Une femme 61 ans ; Une femme 83 ans ; Lauréna 33 ans ; Une femme 26 ans ; Une femme 48 ans ; Une femme 38 ans ; Sylvie 58 ans ; Bouchra 43 ans ; Lætitia 54 ans ; Delphine 36 ans ; Doriane 32 ans ; Une femme 85 ans ; Françoise sexagénaire ; Daniela 48 ans ; Augustine 26 ans ; Gabrielle 24 ans ; Sandra 31 ans ; Rachel quadragénaire ; Sarah 27 ans ; Cécilia 33 ans ; Une femme, 39 ans ; Jocelyne 55 ans ; Angélique 32 ans ; Karine 46 ans ; Une femme 46 ans ; Doris 48ans ; Jennifer 40ans ; Christiane 77 ans ; Aurélie 33 ans ; Odile 62ans ; Mezgebe 30 ans ; Stéphanie 22 ans ; Claire 34 ans ; Coralie 32 ans ; Dominique 69 ans ; Chahinez 31 ans ;
Haby 27ans ; Une femme 73 ans ; Une femme 72ans ; Meriyam 40ans ; Rose May 71 ans ; Germaine 74 ans ; Gloria 46 ans ; Céline 46 ans ; Aurélie 39 ans ; Louiza 41 ans ; Nadia 81 ans ; Jani 36 ans ; Marie-Jeanne 75 ans ; Une femme septuagénaire ; Pascale 55 ans ; Magali 42 ans ; Peggy 45 ans ; Annick 51 ans ; Amélie 34 ans ; Sandrine 23 ans ; Geneviève 78 ans ; Alisha 14 ans ; Jeannette 87 ans ; Fatima 30 ans ; Stella 46 ans ; Muriel 47 ans ; Stéphanie 31 ans ; Martine 61 ans ; Iraida 43 ans ; Laura 34 ans ; Caroline 29 ans ; Rabia 73 ans ; Saliha 24 ans ; Isabelle 27 ans ; Rosa 41 ans ; Annie septuagénaire ; Laura 21 ans ; Ashley 16 ans ; Leslie 22 ans ; Une femme 50 ans ; Une femme 23 ans ; Molka 31 ans ; Jacqueline 67 ans ; Une femme 30 ans ; Florence 48 ans ; Une femme 70 ans ; Lucienne 68 ans ; Sophie 22 ans ; Diana 40 ans ; Dominique 68 ans ; Une femme 65 ans ; Émilie 89ans ; Laetitia 12 ans ; Dominique 64 ans ; Une femme 60 ans ; Une femme 76 ans ; Laurence 56 ans ; Une femme 53 ans ; Une femme 40ans ; Sara 40 ans ; Une femme 90 ans ; Une femme 51 ans ; Bérénice 25 ans ; Brigitte 62 ans ; Une femme 60 ans ; Vanesa 14 ans ; Sabah 49 ans ; Chantal 65 ans ; Edwige 35 ans ; Véronique 59 ans ; Une femme 34 ans ; Hélana 19 ans ; Une femme 69 ans ; Charlotte 49 ans ;
Johanna 27 ans ; Une femme 60 ans ; Florence 38 ans ; Une femme 35 ans ; Une femme 40 ans ; Justine 20 ans ; Nadia 47 ans ; Kimberly 23 ans ; Une femme 78 ans ; Une femme 36 ans ; Amélie 30 ans ; Une femme 71 ans ; Une femme 60 ans ; Une femme 40 ans ; Sabine 43 ans ; Edith 60 ans ; Sasia 30 ans ; Une femme 32 ans ; Élodie 34 ans ; Charlène 36 ans ; Marie-Antoinette 70 ans ; Marion 43 ans ; Ghania 50 ans ; Une femme 74 ans ; Linda 52 ans ; Une femme 52 ans ; Sylveline 49 ans ; Clara 18 ans ; Une femme 86 ans ; Marie-Josèphe 54 ans ; Clothilde 31 ans ; Magali 42 ans ; Rianne 22 ans ; Sonia 51 ans ; Anne-Françoise 58 ans ; Tricia 29 ans ; Marie-Lise 64 ans ; Nabou 14 ans ; Une femme 80 ans ; Marie-Agnès 33 ans ; Kadia 50 ans ; Aurélie 32 ans ; Malgorzata 51 ans ; Une femme 47 ans ; Edina 31 ans ; Nina 35 ans ; Laetitia 51 ans ; Rita 44 ans ; Selen 18 ans ; Une femme 73 ans ; Une femme 62 ans ; Cristal 26 ans ; Martine 68 ans ; Monique 78 ans ; Sandrine 35 ans ; Patricia 51 ans ; Emma 13 ans ; Valéria 34 ans ; Sylvie 60 ans ; Claire 38 ans ; Sarah 32 ans ; Audrey 33 ans ; Nathalie 33 ans ; Julie 26 ans ; Liza 31 ans ; Lili 32 ans ; Sandra 40 ans ; Marie-Reine 36 ans ; Kumrije 44 ans ; Jennifer 25 ans ; Amelia 26 ans ; Kathryn 65 ans ; Véronique 45 ans ; Annick 75 ans ; Émilie 25 ans ; Anna 36 ans ; Marie 45 ans ; Mélanie 39 ans ; Une femme 77 ans ; Nathalie 47 ans ; Nadège 44 ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 66 ans ; Farida 50 ans ; Une femme 29 ans ; Kethia 30 ans ; Dehbia 28 ans ;
Monique 75 ans ; Beatriz 38 ans ; Angélique 27 ans ; Elise 50 ans ; Nadia 62 ans ; Alessandra 46 ans ; Jocelyne 65 ans ; Lucia 49 ans ; Laura 31 ans ; Une femme 69 ans ; Une femme 95 ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 60 ans ; Amanda 28 ans ; Une femme 45 ans ; Simone 80 ans ; Nana 22 ans ; Céline 20 ans ; Une femme 57 ans ; Amélie 21 ans ; Caroline 24 ans ; Elsa-Marie 29 ans ; Lisa 45 ans ; Muriel 56 ans ; Éléonore 27 ans ; Béatrice 35 ans ; Alison 49 ans ; Une femme 55 ans ; Doina 31 ans ; Une femme 70 ans ; Danielle 74 ans ; Zohra 38 ans ; Mélodie 34 ans ; Une femme 81 ans ; Betty 4 5ans ; Mélanie 36 ans ; Catherine 58 ans ; Danielle 26 ans ; Patricia 52 ans ; Claire 42 ans ; Une femme 38 ans ; Sophie 50 ans ; Irène 82 ans ; Jeanine 92 ans ; Madison 24 ans ; Une femme 80 ans ; Chantal 74 ans ; Jessyca 46 ans ; Giuliana 37 ans ; Jemima 29ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 24 ans ; Maeva 28 ans ; Fabienne 68 ans ; Loana 10 ans ; Une femme 93 ans ; Une femme 61 ans ; Assunta 85 ans ; Une femme 50 ans ;
Yasmina 41 ans ; Séverine 47 ans ; Hélène 55 ans ; Édith 88 ans ; Mouna 51 ans ; Mauricette 90 ans ; Céline 42 ans ; Caroline 38 ans ; Monique 61 ans ; Agnès 78 ans ; Emmanuelle 57 ans ; Karen 42 ans ; Taghreed 57 ans ; Marie-Christine 39 ans ; Une femme 30 ans ; Nacera 53 ans ; Dana 26 ans ; Samar 63 ans ; Élodie 34 ans ; Marie-Astrid 39 ans ; Agnès 80 ans ; Jacqueline 27 ans ; Cindy 38 ans ; Hélène 57 ans ; Sylvie 58 ans ; Kugamany 85 ans ; Djeneba 38 ans ; Madouda 38 ans ; Armelle alias Deo 44 ans ; Hadjira 45 ans ; Maïté 32 ans ; Martine 60 ans ; Nouara 62 ans ; Nadine 33 ans ; Adélaïde 40 ans ; Aicha 40 ans ; Brigitte 58 ans ; Karima 47 ans ; Céline 51 ans ; Alicia 18 ans ; Julie 29 ans ; Sophie 60 ans ; Karine 54 ans ; Nelly 40 ans ; Sélina 13 ans ; Sonia 29 ans ; Nathalie 48 ans ; Aline 39 ans ; Valérie 56 ans ; Iris 24 ans ; Marie 72 ans ; Cagla 36 ans ; Eliane 95 ans ; Annick 86 ans ; Audrey 41 ans ; Laura 27 ans ; Chloé 5 ans ; Giovanna 41 ans ; Nadine 63 ans ; Manon 22 ans ; Fatima 40 ans ; Halima 26 ans ; Corinne 64 ans ; Héléna 20 ans ; Rose 5 ans ; Nisrine 25 ans ; Madalina Gabriela 26 ans ; Luna 22 ans ; Sandra 36ans ; Yamina 47 ans ; Francisca 47 ans ; Cécile 48 ans ; Mathilda 34 ans ; Isabelle 36 ans ; Nadège 48 ans ; Hadas 39 ans ; Nelly 50 ans ; Fathia/Fatiha 27 ans ; Cathy/Catherine 54 ans ; Nacera 53 ans ; Élisa 24 ans ; Marie-Antoinette 75 ans ; Assia 46 ans ;
Heide 44 ans ; Sophie 47 ans ; Laure 28 ans ; Neda/Valéria/Valéryia 51 ans ; Séverine 43 ans ; Flora 34 ans ; Marina 45 ans ; Laurence 47 ans ; Marie-Camille 37 ans ; Sihem 18 ans ; Magdalena 29 ans ; Catherine 46 ans ; Mongia 73 ans ; Eva 20 ans ; Angélique 22 ans ; Catherine 47 ans ; Valérie 52 ans ; Virginie 46 ans ; Claude 60 ans ; Shanon 13 ans ; Alexandra 36 ans ; Une femme 43 ans ; Jeannette 88 ans ; Une femme 31 ans ; Une femme 85 ans ; Une femme 55 ans ; Une femme 45 ans ; Alicia 28 ans ; Une femme 35 ans ; Gigi 44 ans ; Mailyss 18 ans ; Pauline 32 ans ; Marie-Pierre 66 ans ; Hayatte 38 ans ; Emma 24 ans ; Marie-Antoinette 86 ans ; Une femme 15 ans ; Lauren 29 ans ; Loréna 22 ans ; Cynthia 45 ans ; Une femme 95 ans ; Une femme 76 ans ; Une femme 56 ans ; Une femme 77 ans ; Édith 54 ans ; Une femme 64 ans ; Une femme 72 ans ; Christelle 29 ans ; Magali 52 ans ; Brigitte 63 ans ; Une femme 28 ans ; Michelle 60 ans ; Une femme 29 ans ; Une femme 56 ans ; Leïla 50ans ; Asmina 29 ans ; Louane 16 ans ; Ghislaine 75 ans ; Martine 62 ans ; Lucie 29 ans ; Nathalie ; Yasmin 24 ans ; Corinne 60 ans ; Auriane 22 ans ; Emeline 26 ans ; Zaouina 60 ans ; Une femme 16 ans ; une femme 75 ans…
Les militant·es #NousToutes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
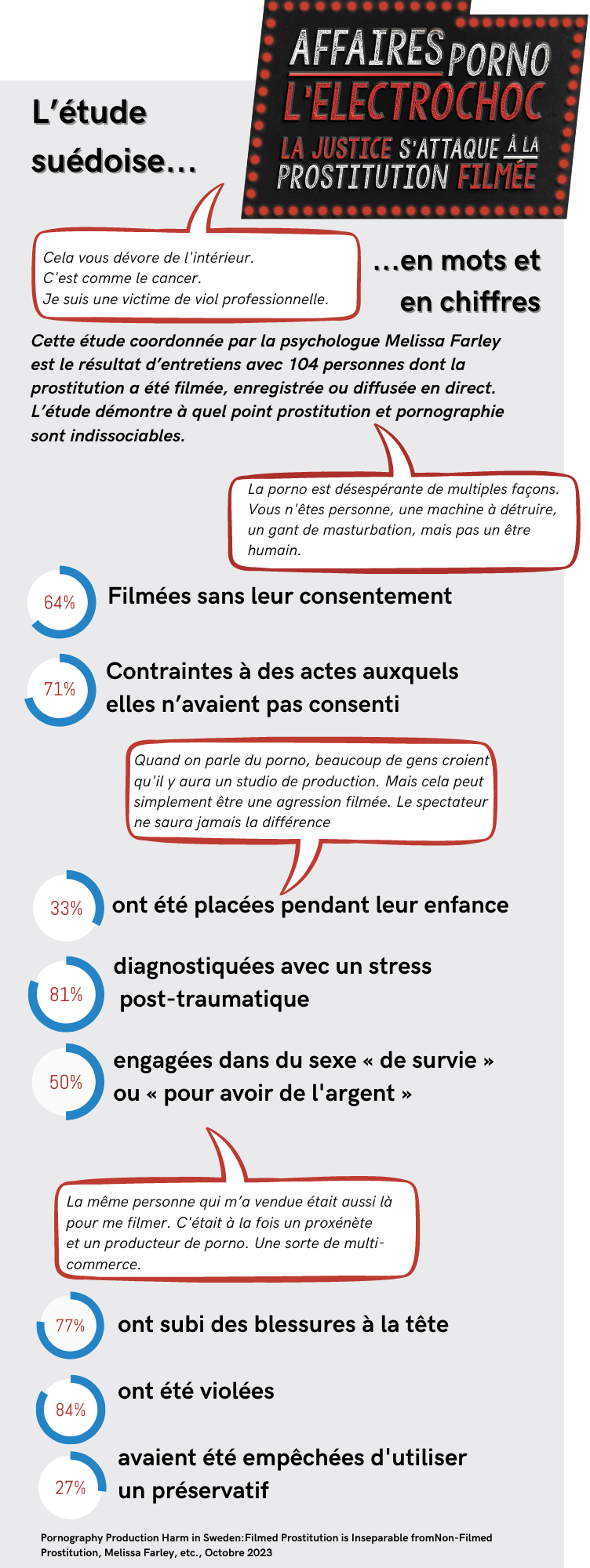
Affaires porno : L’électrochoc
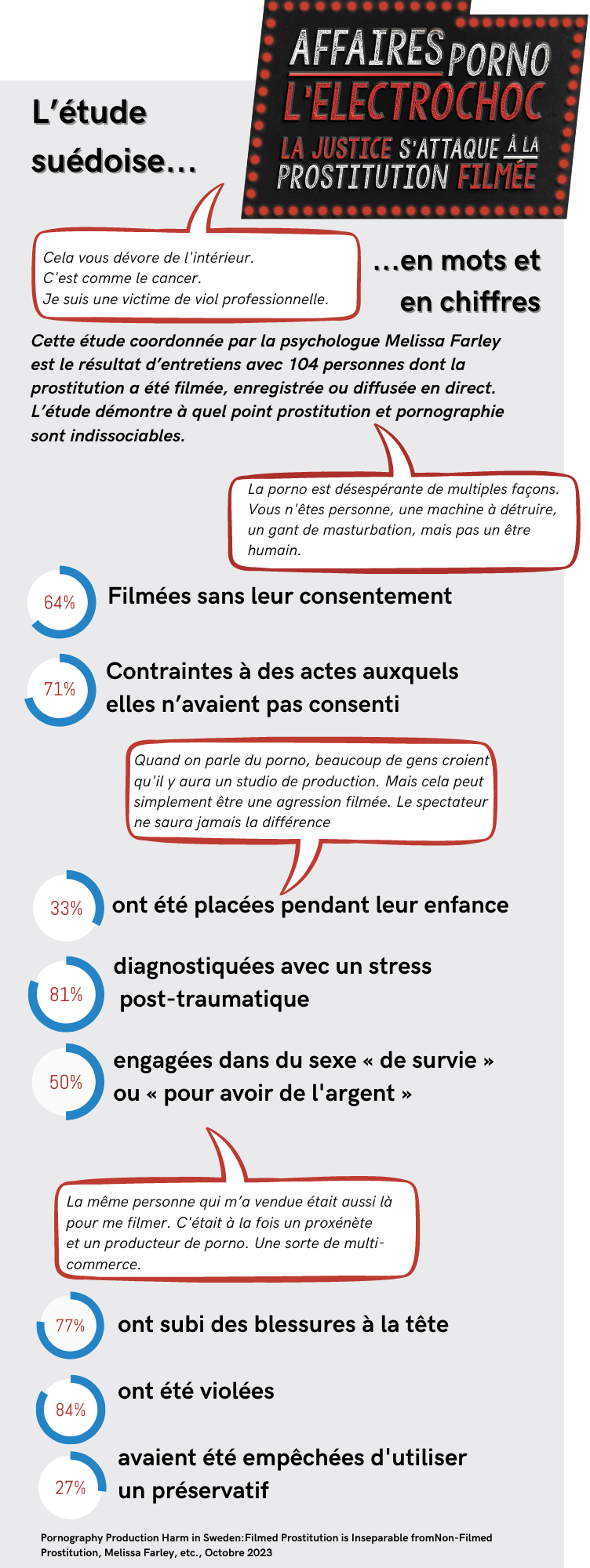
Un procès historique en termes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la pornographie devrait avoir lieu en France au début de l'année 2025. Pour la première fois, sont dénoncées à grande échelle les violences subies par les actrices sur les tournages pornographiques. Deux affaires en cours – dites French Bukkake et Jacquie et Michel – pourraient (on l'espère !) être un électrochoc dans une société incroyablement complaisante vis-à-vis d'actes sexuels tarifés, jusqu'ici blanchis par la magie de la caméra.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La justice s'attaque à la prostitution filmée
La porosité entre les univers pornographique et prostitutionnel apparaît aujourd'hui clairement, confirmant ce que se tue à répéter le Mouvement du Nid, qui préfère au terme « pornographie » celui de « prostitution filmée » et qui soutient les nombreuses victimes qui ont eu le courage de témoigner et de se porter parties civiles dans les procès en cours. Jeunes, souvent polytraumatisées, leur parole est aujourd'hui d'une importance capitale et s'inscrit dans un contexte général plus favorable à l'écoute.
Tout indique que l'industrie du porno est intrinsèquement prostitutionnelle. C'est un système régi par un mode opératoire proxénète, dont le moteur est la violence, sexiste et sexuelle. Misogynie, racisme, incitation aux fantasmes pédocriminels, incestes, tortures, séquestrations, de pareils contenus seraient inacceptables sur tout autre support. La violence, érotisée, normalisée, constitue l'essence même de cette industrie, mais jusqu'ici en toute impunité.
LE PORNO, ENFIN À LA UNE DE L'ACTUALITÉ !
17hommes bientôt jugés au premier grand procès du porno. Le chiffre est sans précédent comme le nombre de victimes, une soixantaine, qui ont déjà eu le courage de prendre la parole pour dénoncer les atrocités dont elles ont été victimes.
* Des victimes polytraumatisées
*Reléguées en cour départementale
PROSTITUTION, PORNOGRAPHIE, DEUX FACES DE LA MÊME PIÈCE
Les procès pourraient, on l'espère, faire la lumière sur le caractère proxénète de ces sociétés pornographiques, c'est-à-dire leur enrichissement fondé sur l'exploitation de rapports sexuels tarifés, donc obtenus sous la contrainte de l'argent.
* Duproxénétisme ?
* Des faits pourtant avérés
* Des acteurs, ou des clients ?
* Les mêmes parcours fracassés
* Les mêmes dommages sur la santé
POUR EN FINIR AVEC LA PROSTITUTION FILMÉE
Dans leur rapport, les sénatrices insistent sur l'urgence d'en faire une priorité de politique pénale qui s'inscrirait dans les priorités plus larges telles que la lutte contre les violences conjugales, pour l'égalité femmes-hommes et la protection des mineur·es.
A lire également :
* Le rapport du Sénat,L'enfer du décor
* Le rapport du HCE
Télécharger le dossier Porno, l'électrochoc complet ici PS219-DOSSIER
A lire également :« le porno, ce n'est pas du cinéma »
Claudine Legardinier
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/affaires-porno-lelectrochoc/bona
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tentative de licencier un syndicaliste malgré le refus de l’inspection du travail : défendons les droits syndicaux

Le 23 avril, Christian Porta, délégué syndical, a été notifié de son licenciement par son entreprise malgré une décision de refus très motivée de l'Inspection du travail. Un ensemble de juristes, d'avocat·es, de syndicalistes et d'inspecteurs du travail dénonce un passage en force inquiétant, tant pour les représentants du personnel que pour les Inspecteurs du travail qui voient ainsi leur prérogative anéantie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les atteintes à l'État de droit dont s'inquiète Amnesty International dans son dernier rapport annuel ne sont pas l'apanage des gouvernements, elles concernent aussi les entreprises, où se cumulent recul légal des droits protecteurs pour les salariés et refus de respecter la législation en vigueur pour les droits toujours existants.
Les 22 et 23 avril dernier, Christian Porta, délégué syndical central de la boulangerie industrielle Neuhauser, filiale du groupe InVivo, a été notifié coup sur coup du refus par l'inspection du travail d'autoriser son licenciement puis de son licenciement. Au lendemain de la publication d'une décision longuement motivée, invalidant l'argumentaire de l'entreprise qui accuse le syndicaliste CGT de « harcèlement » envers sa direction, InVivo a tout simplement décidé de passer outre le code du travail.
Ce choix de se placer consciemment dans l'illégalité est l'aboutissement d'un bras de fer d'une intensité rare entre la direction du groupe ayant racheté Neuhauser en 2021 et Christian Porta, représentant du personnel depuis près de 10 ans. Dans le secteur de l'agro-alimentaire, le site de Folschviller où il exerce se distingue par une importante implantation de la CGT, qui a recueilli 74% des suffrages aux dernières élections professionnelles, et par les conquêtes accumulées : 32 heures payées 35, embauches en CDI, lutte victorieuse contre la fermeture de sites et la mise en œuvre d'un PSE, réintégration de salariés injustement licenciés, etc.
Une contre-tendance au recul des droits des salariés face à laquelle la direction du groupe InVivo assume explicitement vouloir en finir avec la CGT. Pour cela, dès février dernier, à la veille d'une grève de revendication sur les salaires, elle a mis à pied son délégué syndical en l'accusant de « harcèlement » sur la base d'une pseudo-enquête interne disqualifiée par l'inspection du travail. À l'époque déjà, la décision d'interdire à Christian Porta d'entrer dans son usine y compris pour exercer son mandat avait été invalidée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour « atteinte à l'exercice des droits syndicaux » et en l'absence « d'éléments probants » concernant les accusations de la direction.
Ces premières défaites judiciaires n'ont pas empêché InVivo de poursuivre son offensive. Bien que les collègues du syndicaliste lui aient exprimé une large solidarité, non seulement par la grève mais également en signant majoritairement une pétition de soutien, et alors que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement, InVivo poursuite sa politique de répression syndicale, jusqu'à violer l'article L.2411-5 du code du travail qui consacre la protection des représentants du personnel. Ce licenciement contra legem, par un géant européen de l'agroalimentaire, porte à l'extrême le mépris des droits syndicaux et du service public de l'inspection du travail et rappelle que le syndicaliste, en période de régression des droits, est à ce point vital pour l'organisation collective de la revendication qu'il reste l'homme à abattre.
Comme le rappelle la Cour de cassation depuis des décennies, la protection des élus du personnels « a été instituée non dans le seul intérêt de ces derniers mais dans celui de l'ensemble des salariés ». Par cet acte de défi, un patronat décomplexé s'affranchit de la loi et méprise ouvertement une décision administrative de l'inspection du travail pour passer outre la protection des représentants du personnel. C'est le projet assumé de la direction d'InVivo, dont le DRH n'hésite pas à affirmer publiquement vouloir « attaquer l'État » si son licenciement illégal était rendu impossible.
Alors que les inspecteurs du travail et syndicalistes font l'objet de contre-réformes constantes qui réduisent toujours plus leurs moyens et leurs prérogatives, nous, juristes, avocats et Inspecteurs du travail souhaitons rappeler l'évidence : licencier un salarié protégé sans autorisation de l'Inspection du travail est interdit. L'exercice des mandats syndicaux est protégé par le Préambule de la Constitution du 1946 qui affirme d'une part, la liberté syndicale (alinéa ) et d'autre part, le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail (alinéa 8). Le représentant du personnel est protégé car il est exposé, au service de la défense des intérêts des travailleurs.
La protection des représentants du personnel est la condition de l'exercice des droits des salariés, et sa remise en cause opère un retour vers le XIXème siècle pour déstabiliser l'ensemble de l'édifice des droits des salariés dans l'entreprise, arrachés au travers longues luttes. Plus que jamais, le droit du travail est une conquête collective que les avocats, inspecteurs du travail, syndicalistes et forces politiques doivent défendre dans le cadre du combat plus large pour s'opposer au recul des droits démocratiques dans le pays.
Signataires
Savine Bernard, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, présidente de la commission droit social du Syndicat des Avocats de France
Sophie Binet, Secrétaire générale de la Confédération générale du Travail (CGT)
Ralph Blindaueur, avocat au barreau de Metz
CGT SNTEFP, Syndicat National Travail Emploi Formation Professionnelle CGT
Karim Chagroune, vice-président section industrie du Conseil des Prud'hommes du Havre
Marie-Laure Dufresnes-Castet, avocate au barreau de Paris
Michel Estevez, président du Conseil des Prud'hommes de Metz
Gérard Filoche, inspecteur du travail
Manuela Grévy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Julien Huck, secrétaire Général FNAF CGT
Judith Krivine, avocate au barreau de Paris, présidente du Syndicat des Avocats de France
Reynald Kubecki, délégué syndical CGT Sidel et Vice-président section industrie du Conseil des Prud'hommes du Havre
Mornia Labssi, inspectrice du travail
Gérald Le Corre, syndicaliste CGT et inspecteur du travail
Elsa Marcel, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Sébastien Menesplier, Secrétaire général FNME CGT
Pascal Moussy, directeur de publication de la revue Chroniques ouvrières
Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris
Antony Smith, inspecteur du travail
Isabelle Taraud, avocate au barreau de Paris
Cyril Wolmark, professeur de droit à l'Université Paris Nanterre
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rassemblement de solidarité à Genève avec les syndicalistes et enseignant·e·s d’Iran, vendredi 7 juin

A l'occasion de la Conférence internationale du travail de l'OIT (Organisation internationale du travail), les organisations syndicales signataires appellent à un rassemblement devant le siège des Nations Unies à Genève, le vendredi 7 juin 2024.
Photo et article tirés de NPA 29
Elles entendent ainsi dénoncer la nouvelle campagne de répression entreprise par les autorités de la République islamique d'Iran, et notamment :
-le nombre effrayant d'exécutions capitales, dont plus de soixante rien que pendant les deux dernières semaines du mois d'avril ;
-la poursuite de la répression de femmes refusant de porter le voile.
Nous protestons également contre la venue annoncée à la Conférence internationale du travail de personnes désignées par le régime pour représenter les salarié·e·s.

La République islamique d'Iran a refusé de ratifier de nombreux textes fondamentaux de l'OIT, dont ceux concernant la liberté de constituer des syndicats, la protection du droit syndical et la négociation collective (Conventions 87 et 98 de l'OIT).
Rien ne justifie néanmoins que l'Iran agisse en contradiction avec ces normes. En effet, la Déclaration de 1998 « oblige les Etats Membres à respecter et à promouvoir » ces dispositions, « qu'ils aient ou non ratifié les conventions correspondantes ».
Et cela d'autant plus que l'Iran siège officiellement dans certaines instances de l'OIT.
L'Iran est par ailleurs signataire de deux traités internationaux protégeant notamment le droit de constituer des syndicats, de s'y affilier et de rencontrer des syndicalistes d'autres pays :
-Pacte international (ONU) relatif aux droits civils et politiques (PIDCP/ICCPR), article 22 ;
-Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC/ICESCR), article 8.
Le régime réprime néanmoins des dizaines de personnes agissant dans le cadre de ces deux textes signés par l'Etat iranien.
Nous organisons un rassemblement :
Vendredi 7 juin 2024, à partir de 12h à Genève devant le Palais des Nations – « La Chaise »
– contre la répression généralisée du régime iranien,
– pour soutenir les personnes arrêtées, dont notamment les syndicalistes et les enseignant·e·s,
– pour exiger leur libération immédiate.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)-France,
Confédération générale du travail (CGT)-France,
Fédération syndicale unitaire (FSU)-France,
Union syndicale Solidaires-France,
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)-France,
Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)–Suisse,
Syndicat SSP enseignement Genève –Suisse.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce qu’Atlas, ce réseau climatosceptique d’extrême droite ?

Atlas, ce n'est pas seulement le nom d'un titan portant la planète sur ses épaules, ou d'un livre regroupant les cartes du monde. C'est un puissant réseau d'une centaine de groupes de réflexion ou organisations ayant un seul but : promouvoir des politiques ultralibérales et climatosceptiques dans le monde entier. « Une machine de guerre idéologique d'une nouvelle extrême droite, libertarienne et ultraconservatrice », explique Anne-Sophie Simpere, autrice d'un rapport sur Atlas publié le 22 mai par l'Observatoire des multinationales.
Tiré de Reporterre.
En France, les membres d'Atlas sont peu nombreux, mais ont des accointances avec les milieux médiatique, financier et politique, en particulier avec l'extrême droite. On compterait aujourd'hui une dizaine d'organisations, dont la plus active est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap), dirigée par la lobbyiste Agnès Verdier-Molinié. Son travail consiste à publier des études pour défendre les intérêts des plus fortunés. L'Ifrap critique également les réglementations environnementales, ciblant pêle-mêle la loi Climat, les éoliennes, l'interdiction de la voiture thermique et la fiscalité écologique. Elle recommande aussi de repousser la transition écologique aux calendes grecques.
Autre organisation tout aussi anti-écolo : l'Institut de recherches économiques et fiscales (Iref), qui publie des articles niant la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. L'association Contribuables associés, fondée en 1990, est vent debout contre les politiques environnementales, en particulier le développement des éoliennes, et a rejoint l'Association des climatoréalistes.
Enfin, l'institut économique Molinari, financé par les industriels du pétrole et du tabac, est dans le déni climatique. « Une chose est sûre : il n'y a pas de consensus sur le changement climatique parmi les scientifiques », déclarait sa directrice Cécile Philippe en 2005. Cette position étant aujourd'hui trop difficile à assumer, l'institut porte désormais des critiques plus subtiles, notamment sur les réglementations, les taxes environnementales et les énergies renouvelables. Elle s'active également à promouvoir l'énergie nucléaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine : le peuple sur la défensive dans un scénario incertain

L'Argentine vit le premier semestre du gouvernement d'ultra-droite de Javier Milei, qui vise à porter un coup définitif à la classe ouvrière et à restructurer le capitalisme argentin pour relancer l'accumulation, dans un contexte de crise généralisée. S'il réussit, cela pourrait se traduire par une défaite à long terme du mouvement populaire.
Tiré de Inprecor 720 - mai 2024
22 mai 2024
Par Poder popular (Argentine)
Manifestation du 23 avril 2024.
Depuis le début de son mandat, le gouvernement n'a pas été en mesure de se stabiliser pour mener à bien les aspects structurels de son programme. Il a produit un ajustement féroce des prestations de l'État et un effondrement de 20 % des salaires réels des travailleurs enregistrés entre décembre et mars, laissant le salaire formel moyen en dessous du panier de biens de base d'une famille typique. La situation de la moitié de la classe ouvrière argentine, qui occupe des emplois non déclarés, est encore pire. La pauvreté a atteint 41,7 % en décembre, selon les données officielles, et serait passée à 51,8 % au premier trimestre 2024. Cependant, le radicalisme de son programme et l'incapacité à harmoniser les volontés des secteurs politiques qui soutiendraient certaines des réformes structurelles ont jusqu'à présent empêché qu'elles soient adoptées par le parlement. Le 1er mars, dans son discours inaugural lors de l'ouverture des sessions du Congrès, le président a exprimé son intention de changer de tactique en faveur d'une plus grande flexibilité afin de générer des accords permettant le vote des réformes, ce qui n'implique pas, en principe, l'abandon effectif de leur radicalisme.
Depuis lors, le gouvernement a tenté de parvenir à un consensus sur au moins certaines des mesures et a réussi à faire voter par la chambre des députés une version partielle du projet de loi fondateur de son mandat (un projet de loi qui n'avait pas pu être promulgué en février). Toutefois, le vote nécessaire du Sénat et sa promulgation ne sont pas encore assurés, même si l'on peut s'attendre à ce qu'ils soient atteints, moyennant quelques modifications supplémentaires.
Les résistances populaires sont réelles
D'autre part, bien que le peuple argentin ait été démobilisé ces dernières années, depuis les premières mesures gouvernementales, une série de protestations de différentes natures ont eu lieu, culminant avec l'énorme mobilisation nationale du 23 avril en défense de l'université publique (qui, en Argentine, est accessible sans restriction ni frais). Plus d'un million et demi de personnes se sont mobilisées dans tout le pays, issues de secteurs hétérogènes, tant sur le plan économique que politique, avec toutefois une forte présence des classes moyennes. Il s'agit probablement de la plus grande manifestation de la dernière décennie, et la protestation a également été légitimée par les grands médias et les secteurs politiques qui observent passivement ou même soutiennent le gouvernement.
Alors que le projet de loi comprenant une réforme régressive du travail et un régime favorisant les grands investissements sans aucun avantage pour la population était en cours d'examen au parlement, les confédérations syndicales ont appelé à une manifestation le 1er mai et à une grève nationale le 9 mai. La manifestation du 1er a été unitaire et a connu une participation massive, essentiellement syndicale. La grève du 9 a été bien suivie, bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'ampleur et d'en tirer des conclusions. Cependant, le discrédit des directions syndicales et l'absence de manifestation dans la rue ont atténué l'impact que la grève du 9 mai aurait pu avoir sur les politiciens qui doivent voter pour ou rejeter la loi du gouvernement.
Le scénario est encore ouvert. Le gouvernement peut ou non se stabiliser et même s'il se stabilise, il n'est pas certain qu'il puisse surmonter les énormes difficultés macroéconomiques du pays, y compris en s'attaquant brutalement aux conditions de vie de la classe ouvrière. Mais aucune issue ne sera favorable pour le peuple si elle n'est pas le produit d'une vague de protestations de rue qui inverse le climat de démobilisation imposé ces dernières années.
Le 15 mai, traduction de Fabrice Thomas.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mexique : les élections du 2 juin

Les enjeux : président de la République, 9 des 32 postes de gouverneurs, 128 sénateurs et 500 députés fédéraux et locaux (dont certains à représentation proportionnelle) doivent être élus, entre deux alliances, celle dirigée par Xóchitl Gálvez qui comprend le PRI, le PAN et le PRD et celle dirigée par Claudia Sheinbaum, qui réunit MORENA, PVEM et PT. [1]
23 mai 2024 | tiré de Rebelion
https://rebelion.org/elecciones-2-de-junio/
Avec la candidature présidentielle de Jorge Máynez, du Movimiento Ciudadano, ce qui est en jeu, c'est son enregistrement en tant que parti, même s'il compte sur un important avantage dans l'État de Jalisco. Le classement le plus sérieux du pays place la plupart des États dans une égalité technique et même l'élection présidentielle. Certains pronostics sont réservés, bien qu'il puisse également y avoir perte de l'enregistrement en tant que partis nationaux du PT et du PVEM et l'affaire autour du PRD ne le sauvera que dans certains États.
Toutefois, ces campagnes électorales et leurs principaux acteurs ont été laissés à eux-mêmes. (...). Dans la plupart des débats au niveau des États et au niveau présidentiel, on a privilégié la dénonciation de la prétendue corruption des prétendants, qui auraient amassé d'immenses fortunes sous le couvert de leurs postes élus et travaux passés, avec comme dénominateur commun un mandat de six ans. Récemment, ces actes de corruption et d'impunité n'ont pas été dénoncés par les chefs de ces gouvernements d'État ou du pays.
Par conséquent, il semble que le Mexique se dirige vers une démocratie ne servant qu'à porter quelqu'un au pouvoir, mais pas à assurer son objectif suprême, la mise en place d'un gouvernement de bienfaiteurs et bien sûr incorruptibles.
D'autre part, au Mexique, le sentiment général est que les acteurs politiques actuels utilisent les partis politiques, les pouvoirs qu'ils obtiennent, les prérogatives des partis et les institutions, pour judiciariser la politique et politiser les justices.
Le sentiment est que quelles que soient les positions politiques, ce qui est en jeu c'est la rupture de l'ordre constitutionnel établi et l'intrusion croissante du crime organisé dans la vie publique du pays, dans les élections. Des études sérieuses révèlent que ces manœuvres ont été « institutionnalisées » dans un tiers du pays. Face à la politique actuelle, l'État mexicain a été défendu par AMLO (l'actuel président mexicain), avec des câlins et non des balles et sans programmes sociaux-constitutionnels et permanents. Quel que soit le vainqueur, l'insécurité publique dans le pays ne sera pas inversée, et il ne sera pas mis fin à l'impunité rampante ni aux disparitions, comme si par un décret criminel l'insécurité publique et la délinquance organisée devenaient un pouvoir parallèle aux trois pouvoirs de l'Union : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Le Mexique est un pays d'environ 120 millions d'habitants dont environ la moitié est embourbée dans une pauvreté gérée par des programmes d'assistance qui ne sont pas une solution et qui ont été utilisés, depuis le gouvernement de Salinas de Gortari jusqu'au gouvernement actuel, pour recueillir des votes et prendre le pouvoir. Le présent bilan blâme le passé sans le décrire et sans rendre justice aux personnes touchées. Tout se maintient au niveau d'un discours qui est usé car le présent dure déjà depuis presque 6 ans.
La pauvreté, l'insécurité, la faim, les hôpitaux sans médicaments, les services coûteux, le chômage, les migrations, les déplacements forcés, la pandémie, la tristesse, la résignation, c'est aujourd'hui « notre pain quotidien ». Gagner l'élection ne permettra pas de résoudre ces problèmes mais lavera les vainqueurs de leur culpabilité et de leur irresponsabilité publique et constitutionnelle, sans parler de leur manque d'éthique et de morale.
Il me semble qu'après les élections du 2 juin, les citoyens devront reconstruire par le bas et se donner les moyens d'agir, car les partis politiques et leurs éternels dirigeants ne sont plus la solution au cancer qui ronge lentement le Mexique. Leur renouvellement se fera à une autre étape.
Il me semble que la validité de la Constitution politique du Mexique et de l'État de droit est encore absente aujourd'hui à cause de la classe politique actuelle. C'est très malheureux, mais c'est vrai que tout l'actuel personnel politique devrait quitter la politique et assumer son rôle devant l'histoire et devant la justice.
Rafael Marín Marín est secrétaire général du Front juridique national pour la défense de la Constitution et de l'État de droit.
Rebelión a publié cet article avec l'autorisation de l'auteur sous une licence Creative Commons, dans le respect de sa liberté de le publier dans d'autres sources.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Dix partis sont reconnus par l'Institut National Electoral (INE) :
- Parti Action Nationale ("Partido Acción Nacional", abrégé PAN) est démocrate chrétien. C'est le parti des anciens présidents Vicente Fox et Felipe Calderón.
- Parti Révolutionnaire Institutionnel ("Partido Revolucionario Institucional", abrégé PRI) a été au pouvoir sous différents noms, à l'échelle locale, fédérale et nationale durant la majeure partie du xxe siècle. C'est le parti de l'ancien président Enrique Peña Nieto, au pouvoir entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2018.
- Parti de la Révolution Démocratique ("Partido de la Revolución Democrática", abrégé PRD), né d'une scission du PRI sous le nom de Front démocratique national durant les élections présidentielles de 1988, son candidat d'alors, Cuauhtémoc Cárdenas, a perdu et depuis lors le parti s'est consolidé.
- Parti Vert Écologiste du Mexique ("Partido Verde Ecologista de México", abrégé PVE-PVEM) est un parti de centre.
- Parti du travail ("Partido del Trabajo", abrégé PT) est un parti mineur de gauche.
- Mouvement Citoyen ("Movimiento Ciudadano", abrégé MC), parti de centre gauche fondé en 2011 à partir de Convergence ("Partido Convergencia", abrégé CON), fondé en 1997.
- Mouvement de régénération nationale ("Movimiento Regeneración Nacional", acronyme MORENA), parti de centre gauche créée en 2014. Il devient le premier parti du pays en 2018, son chef Andrés Manuel López Obrador étant élu président du Mexique.
- Parti réunion solidaire (es) ("Partido Encuentro Solidario", abrégé PES), parti de centre droit, fondé en 2020 à partir de Parti de la Réunion sociale. Wikipédia -https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_politiques_au_Mexique

L’expansion impérialiste interplanétaire : pour bientôt

On parle beaucoup ces temps-ci de politique internationale, de l'impérialisme qui lui est consubstantielle et des rivalités qu'il entraîne. Mais il faut penser aussi au moment où cet impérialisme va déborder des limites terrestres et s'étendre sur les astres voisins et même, beaucoup plus tard, sur tout le système solaire.
C'est dans la logique même de l'impérialisme de s'étendre et de contrôler le plus possible de territoires. C'est ainsi que certaines puissances européennes ont, à partir du seizième siècle, envahi le reste du monde. À moins que de strictes mesures ne soient adoptées là-dessus, on risque l'anarchie dans l'espace motivée par l'appât du gain et l'orgueil national.
L'exploration spatiale a débuté en avril 1961 lorsque le cosmonaute soviétique Youri Gagarine a été le premier homme à faire le tour de la Terre à bord d'un vaisseau spatial. Il n'était que dans la "banlieue" de notre planète mais c'était un pas de géant dans de l'exploration de l'espace. Pour la première fois, un homme y allait en personne.
Durant toute la décennie 1960, on a assisté à une compétition acharnée entre l'URSS et les États-Unis pour la course à la Lune : quelle puissance y parviendrai en premier ? Les Américains ont gagné en mettant le pied sur notre satellite avec Apollo 11 le 21 juillet 1969. Depuis, les missions spatiales habitées sur la Lune, et inhabitées (pour l'instant) ailleurs dans l'espace se sont multipliées. Les sondes ont atteint la planète Mars, certaines y ont atterri pour prélever des échantillons de sol et tenter de trouver des traces de vie. Sans succès jusqu'à maintenant. Tout ceci sans compter les satellites mis en orbite autour de la Terre par plusieurs pays (dont le Canada) pour des prévisions atmosphériques et des études scientifiques. Certains de ces engins sont aujourd'hui en "fin de vie" et il faudra les remplacer. Que faire de toute cette ferraille devenue inutile ? L'éliminera-t-on et si oui, de quelle manière ? Des interrogations sans réponse, en tout cas pour le grand public. Conclusion : le danger de pollution gagne à présent l'espace...
Aux dernières nouvelles (mais s'agit-il d'une ferme décision ?), les États-Unis projettent d'établir une base permanente sur notre satellite la Lune vers 2035. Beijing vient de lancer un engin pour explorer la face cachée de notre satellite. Dans ce contexte, pas besoin d'être grand devin pour prévoir une "course à la Lune" et à Mars entre diverses puissances, non seulement par intérêt scientifique mais aussi économique. États-Unis, Chine, Russie, Union européenne, peut-être aussi Japon. Ces entités étatiques vont essayer de s'installer d'ici quelques décennies sur ces astres, et à plus long terme, sur d'autres.
On ignore si notre satellite contient des ressources minérales exploitables, mais c'est sans doute le cas pour Mars et peut-être aussi pour Vénus, l'autre planète "voisine" de la Terre. Toutefois, il y règne une température infernale qui en rend l'exploitation minière impossible dans l'état actuel de la technologie.
Certains satellites de planètes gazeuses géantes, Jupiter et Saturne présentent un intérêt certain pour l'étude scientifique.
Europe par exemple, une des lunes galiléennes de Jupiter laisse présager la présence d'eau, ce qui peut s'avérer d'un intérêt primordial pour "l'exobiologie". Pareil pour Ganymède et Callisto, autres satellites de Jupiter qui pourraient receler chacune un océan sous-glaciaire. Encelade est une lune de Saturne où on a détecté des geysers de vapeur d'eau provenant du pôle sud de l'astre. Ils sont constitués de sel et de matières organiques, ingrédients jugés indispensables à l'apparition de la vie. La NASA a même annoncé en 2014 la présence d'un océan sous la surface gelée du pôle sud. On croit donc que ce satellite de Saturne constitue, avec Mars un des astres les plus susceptibles d'abriter de la vie. Un autre satellite de Saturne, Titan, possède une atmosphère très développée.
Cérès, une planète naine (un peu moins de mille kilomètres de diamètre) contient des minéraux hydratés, de la glace d'eau, des carbonates et de la matière organique ; on considère probable que cette petite planète contient un océan sous sa glace de surface.
Ces astres sont donc susceptibles d'abriter des formes de vie, mais comme ils sont loins de la Terre, des expéditions ne sont pas à la veille de s'y rendre.
Pour Mars, c'est différent. Plusieurs missions spatiales s'y sont rendues depuis 1964 et dont certaines, les plus récentes, y ont atterri. On sait que le véritable but de l'établissement d'une base permanente sur la Lune est de servir de tremplin pour en implanter une autre sur Mars. Les responsables de ce programme n'ont sans doute pas encore mis au point un calendrier pour réaliser cet objectif, mais on peut aisément prévoir que la "colonisation" de la planète rouge se fera dans quelques décennies.
On ne sait pas quelle sera la nature exacte de la base permanente projetée sur la Lune : scientifique ou économique ? Les deux peut-être, et si oui, dans quelles proportions ?
En tout cas, cette expansion dans les astres voisins du nôtre par certains gros joueurs internationaux (étatiques et privés) pose toute une série de questions qu'il faut examiner dès maintenant si on veut éviter l'apparition éventuelle de conflits interétatiques et le pillage des ressources manières de Mars, par exemple. C'est encore plus vrai pour protéger les planètes abritant peut-être des formes de vie.
Le statut juridique et politique des planètes est pour le moment incertain, non défini, du moins à ma connaissance. Si un droit existe à ce sujet, il ne peut être qu'embryonnaire.
Avant même que les premières bases permanentes soient établies sur la Lune et sur Mars, il importera de définir un cadre juridico-politique concernant leur occupation et régulant la circulation dans l'espace. Sinon, on se dirige vers une anarchie destructrice en raison des rivalités à l'origine de cette expansion entre les puissances hégémoniques.
À moins d'une entente internationale interdisant toute exploitation économique peu importe sa nature de nos planètes voisines, on doit s'attendre à une course au profit. Les rivalités commerciales, économiques, politiques et militaires terrestres risquent fort de s'étendre au-delà de notre planète (déjà assez maganée par la pollution). On peut redouter en particulier la militarisation de l'espace.
On fera peut-être valoir qu'il est légitime d'exploiter d'éventuelles ressources minières sur Mars et Vénus, vu que ces planètes ne contiennent aucune trace de vie. C'est le cas pour Vénus (une vraie fournaise), mais moins pour Mars. Il y a peut-être existé voici très longtemps de l'eau et des formes microscopiques de vie pourraient y subsister sous la surface. On sait qu'il y a du pergélisol et du mollisol. Seule une expédition habitée pourra trancher la question.
L'entente internationale que j'évoquais plus haut devrait faire la distinction entre des planètes abritant éventuellement une forme de vie et les autres, stériles. Les premières devraient être protégées de toute exploitation économique et ne contenir que des bases d'études scientifiques. Quant aux secondes, devrait-on en permettre l'exploitation minière ? Ce n'est pas parce qu'un astre n'héberge aucune forme de vie qu'on dispose du droit d'en abîmer à jamais la surface et le paysage en général. Il s'ensuivrait de plus une pollution de ces planètes par des micro-organismes terrestres qui accompagneraient l'homme dont ils sont les commensaux, modifiant à jamais l'aspect du sol de ces corps célestes, en dépit de toutes les précautions prises pour les éliminer à bord des engins décollant de la Terre. La matière minérale présente autant d'intérêt scientifique que les diverses formes de vie, de laquelle d'ailleurs ces dernières dérivent. Demandez-le aux géologues...
Mais si dépassera le stade des bases scientifiques et que des colonies humaines sont implantées sur d'autres planètes, elles ne pourront à la longue subsister uniquement d'approvisionnements terrestres. Elles devront subvenir à leurs besoins par elles-mêmes. Seuls des échanges commerciaux entre elles et des États terrestres leur procureront les moyens de se maintenir. Que pourront offrir ces établissements aux gouvernements de la Terre sinon des "produits locaux", forcément d'origine minérale ? L'expansion démographique sur ces astres apportera aussi son lot de problèmes, dont celui du statut politique de ces établissements. Mais c'est pour l'instant encore de la science-fiction.
Sans tomber dans l'angélisme, on peut souhaiter dans l'immédiat un traité international régulant l'exploration de l'espace et l'occupation par l'homme d'autres planètes. On doit éviter de laisser le champ libre à l'exploitation débridée de celles-ci. Un équilibre devra être mis au point entre l'exploitation raisonnable de certaines ressources extraterrestres et l'exploration scientifique de l'Univers. Tout est affaire de mesure.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections partout, démocratie nulle part ?

Selon les différents indices de santé mesurés de par le monde, ça ne va pas trop bien pour la démocratie. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que, malgré le fait que jamais dans notre histoire il n'y a eu autant d'humains vivant dans des pays en élection, la démocratie soit en si mauvais état ?
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
L'année 2024 nous révèle l'un des plus grands paradoxes politiques de notre époque. D'un côté, le monde connaît une année électorale historique. De l'autre, la démocratie connaît des reculs marqués, sans précédent depuis que nous la mesurons à l'échelle mondiale.
Au milieu de cela, on découvre un fascinant jet de lumière : de tous les indicateurs de la démocratie, celui qui ne cesse de croître est la participation démocratique des populations dans les organisations et mobilisations de la société civile, dont les syndicats.
Coup d'œil sur trois phénomènes qui se situent en plein cœur de la crise de confiance envers les institutions.
L'année des élections
Des élections sont prévues dans 76 pays, notamment dans 8 des 10 pays les plus populeux : l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh, le Mexique et la Russie. Également, les 27 pays de l'Union européenne (EU) seront en élections pour le Parlement européen.
Théoriquement, deux milliards d'électrices et d'électeurs seront appelés aux urnes, du jamais vu !
Nombre de personnes vivant dans un pays en élection (en milliards) de 2020 à 2024
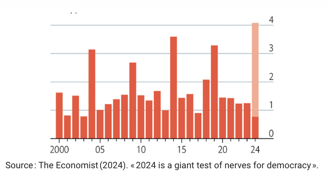
En théorie, cette année devrait être un triomphe pour la démocratie. En pratique, une hirondelle ne fait pas le printemps : la démocratie ne se résume pas à la tenue d'élections.
Sur les 76 pays en élections, 28 ne remplissent pas les conditions essentielles au vote démocratique. Il s'agit de régimes à saveur autoritaire, où les élections peuvent être tronquées ou reportées sans cesse, comme au Sénégal. Ou encore, il s'agit d'un simulacre destiné à fournir un vernis démocratique à un gouvernement pleinement autoritaire, comme c'est le cas en Russie.
La démocratie en plein recul
Il faut de nombreuses conditions pour pouvoir qualifier un pays de démocratie complète. L'indice de démocratie est une mesure publiée chaque année par The Economist afin de mesurer l'état de la démocratie dans la grande majorité des pays et des territoires du monde (167 pays et territoires), selon 60 indicateurs répartis dans 5 catégories :
– pluralisme et processus électoraux ;
– fonctionnement du gouvernement ;
– droits civils et politiques ;
– participation politique ;
– culture démocratique.
Le tout récent rapport À l'ère des conflits dresse un constat fort inquiétant : à 5,23 sur 10, la moyenne mondiale atteint son niveau le plus bas depuis la première publication de l'étude, en 2006.
Moyenne mondiale de l'indice de démocratie de 2006 à 2023
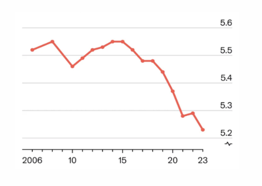
Le déclin a commencé en 2016 et il est particulièrement aigu depuis 2019, aggravé par la réduction des droits et libertés pendant la pandémie et l'incidence croissante des violences armées.
Ci-dessous, la carte des pays du monde selon leur indice de démocratie.

Ainsi :
Moins de 8 % de la population mondiale vit dans une démocratie complète (24 pays) ; et 37 % de la population vit dans une démocratie défaillante (50 pays). Cela signifie que moins de la moitié de la population du monde (45 %) vit dans une démocratie ;
15 % de la population mondiale vit dans un régime hybride (34 pays) ; et 40 % dans un pays autoritaire (39 pays), soit une hausse de 3 % depuis 2022. C'est donc 55 % de la population mondiale qui est soumise à une forme ou à une autre d'autoritarisme.
Aussi, le rapport indique que 32 pays ont connu une hausse de leur indice, contre 68 pays qui ont vu leur indice régresser.
Les cinq États les mieux classés au monde
Dans l'ensemble, 10 des 12 premières places sont occupées par des pays d'Europe de l'Ouest.
L'Amérique du Nord (Canada et États-Unis) a connu un recul de sa moyenne globale et, pour la première fois depuis 2006, est passée du premier au deuxième rang au classement par continent. Les reculs démocratiques ont d'abord été très marqués aux États-Unis : le pays est tombé au stade de démocratie défaillante en 2016, pour se situer présentement à la vingt-neuvième position mondiale. Le Canada est en treizième position, et l'indice de 8,7 représente son plus faible résultat depuis 2006.
De la démocratie au Canada et au Québec
L'indice du Canada a chuté drastiquement en 2021, passant de 9,24 à 8,87, ce qui a fait dégringoler le pays de la cinquième à la douzième position au classement mondial, puis à la treizième position en 2023. Pourtant, le Canada avait l'habitude de figurer parmi les cinq premiers rangs du classement mondial depuis 2006.
Trois tendances similaires aux courants de fond que l'on observe aux États-Unis sont les principaux facteurs de ce recul :
– la hausse de la polarisation, qui consiste à chercher la division autour des politiques plutôt que la collaboration et le consensus ;
– la diminution de la confiance envers le gouvernement actuel et la démocratie en général ;
– les reculs de droits pour certaines minorités.
Au Canada, ces tendances se renforcent actuellement sur des enjeux comme l'immigration, les politiques environnementales, les droits des personnes LGBTQI+, les droits sexuels et reproductifs des femmes et la crise des opioïdes.
Les baisses s'observent plus précisément dans trois catégories : fonctionnement du gouvernement, droits civils et politiques et culture démocratique, là où la baisse est la plus marquée (en bleu ci-dessus). Cette dernière courbe est l'illustration statistique la plus claire du déploiement de la crise de confiance envers les institutions au Canada et au Québec.
Les indicateurs de cette catégorie mesurent la proportion de la population qui déclare soutenir la démocratie, l'état de droit et la séparation des pouvoirs vs celle qui est en accord avec une personnalité ou un mouvement antidémocratique ou qui préférerait un gouvernement militaire ou d'experts et de technocrates.
La participation et la mobilisation de la population tirent la démocratie vers le haut
Somme toute, les systèmes électoraux et le pluralisme politique demeurent hautement démocratiques au Québec et au Canada. Nous faisons partie des dix États les mieux classés au monde à cet égard.
La participation politique demeure stable. Cette catégorie comprend les indicateurs mesurant les taux de participation électorale, la représentation des minorités et des femmes dans les institutions politiques, la proportion de la population membre d'un parti ou d'une association de la société civile, celle ayant pris part à une manifestation ainsi que pour laquelle les niveaux d'éducation et d'alphabétisme sont élevés.
Bien que les taux de participation électorale aient connu une tendance à la baisse au Québec et au Canada, les mobilisations et l'engagement au sein de groupes de la société civile, incluant les syndicats, tiennent la démocratie à flot. L'indice démontre que nous sommes parmi les populations les plus participatives et mobilisées au monde, occupant la cinquième position mondiale.
À surveiller !
La priorité est de prévenir les reculs des droits et la hausse des violences à l'encontre de certains groupes ciblés par les discours de l'extrême droite, notamment pour les femmes, surtout sur le plan des droits sexuels et reproductifs, les personnes LGBTQI+ et les personnes migrantes.
Il importe aussi de dénoncer la forte tendance de plusieurs partis et personnalités politiques à jouer de la polarisation à l'américaine, à des fins électoralistes.
Au Québec, il faut également surveiller une très forte tendance à la concentration des pouvoirs, accompagnée d'une diminution de la transparence et de la participation de la population dans la conduite des affaires publiques. Le parti actuellement majoritaire est le moins démocratique de l'Assemblée nationale, il n'est pas enraciné dans une tradition démocratique. C'est un parti géré comme une grande entreprise : les candidates et candidats, ainsi que la plateforme politique, sont nommés par le chef et son entourage.
La culture du milieu des affaires, qui ne carbure pas à la transparence et à la reddition de comptes, s'implante rapidement au sein de l'État québécois : on doit surveiller de près la multiplication des agences, créées à l'extérieur des ministères.
Répression de la parole citoyenne
On observe aussi une forte tendance à utiliser les mécanismes criminels pour réprimer la participation citoyenne aux instances démocratiques, la liberté d'expression et le droit de manifestation. Les cas de représentantes et représentants élus qui menacent de poursuivre des citoyennes et citoyens à la suite de leur mobilisation sur des enjeux d'affaires publiques se multiplient de façon inusitée.
Pourtant, les vrais cas de harcèlement et d'intimidation se multiplient, notamment au niveau municipal, et la documentation du problème montre que la polarisation est en cause. Aussi, les femmes élues, ainsi que les personnes issues des minorités culturelles, sont beaucoup plus exposées au problème. Malheureusement, les mesures proposées ne prennent pas en compte ces dimensions. Elles tendent plutôt vers la répression de la population, comme l'a souligné la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) aux côtés des autres centrales syndicales.
Cette vision risque davantage de jeter de l'huile sur le feu, car la démocratie repose sur l'acceptabilité et le consensus autour des politiques. Moins la population a de prise sur la politique, moins elle est consultée et écoutée, plus les dynamiques de polarisation et de clivages vont aller en s'accentuant.
Crise de confiance envers les institutions : pas une affaire de désintérêt politique
On ne saurait interpréter les données de l'indice mondial de démocratie avec cynisme. En effet, à l'échelle mondiale, toutes les catégories d'indicateurs ont connu des baisses de leur moyenne, à l'exception de la participation politique.
Moyenne mondiale par catégorie d'indicateurs 2008-2023

La recrudescence de l'implication citoyenne et des mobilisations – notamment des mobilisations ouvrières, dont la hausse s'observe dans de nombreux pays – viennent donc contrebalancer le récit dominant du déclin démocratique mondial.
Globalement, les catégories ayant enregistré les plus fortes détériorations à l'échelle mondiale sont les droits et libertés, les processus électoraux et le pluralisme. En clair : le déclin démocratique mondial et la crise de confiance envers les institutions ne sont pas causés par un désengagement de la population, mais par les abus de pouvoir :
« La corruption, le manque de transparence et l'absence de responsabilités ont sapé la confiance envers les gouvernements et les partis politiques. Dans de nombreux pays, de puissants groupes d'intérêt exercent une influence considérable. En retour, les citoyennes et citoyens ont de plus en plus l'impression de ne pas avoir de contrôle sur leur gouvernement ou sur leur vie. Cette tendance est perceptible tant dans les économies développées que dans les économies en développement, car les dysfonctionnements institutionnels, la corruption et la non-représentativité des partis politiques ont entraîné partout une crise de confiance qui sape la foi en la démocratie. »
The Economist, Democracy Index 2023 : Age of conflict, 2024.
Là où le bât blesse : une part de cette mobilisation citoyenne se concrétise dans une hausse de l'adhésion populaire à des discours de nature antidémocratique. Le retour en force de groupes et de partis d'extrême droite en est la manifestation la plus éclatante et celle-ci prend des couleurs variées, selon les régions du monde.
La tactique d'accuser les minorités / l'Autre d'être responsables des problèmes est vieille comme le monde. Or, la première moitié du 20e siècle a prouvé hors de tout doute que diviser pour régner et porter aux nues des hommes forts aux discours antidémocratiques ne fait qu'aggraver les crises, jusqu'au basculement dans la répression et les violences armées sans précédent.
En conclusion : une opportunité inédite
La chute de confiance de la population envers les institutions appelle à revoir en profondeur notre fonctionnement, à commencer par le mode de scrutin. Il y a lieu également de mieux encadrer la politique partisane et le recours à la polarisation par des personnalités et des partis politiques, dans un contexte où la population doit faire face aux répercussions d'un monde non seulement en crise, mais en multicrises (logement, pauvreté et itinérance, climat, agriculture, médias, services publics, etc.).
L'histoire a également démontré que les politiques mûrement réfléchies en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la société reçoivent une bien plus grande adhésion de la société, atteignent davantage leurs objectifs et ont des effets beaucoup plus durables. Au Québec, les politiques les plus respectées et considérées comme les plus gros succès de l'Assemblée nationale ont été élaborées sur les bases de la collaboration entre les partis, de l'état des connaissances à jour et une sérieuse prise en compte des préoccupations et des réalités des différents groupes de la population, dont les travailleuses et travailleurs.
Enfin, le rôle des organisations de la société civile, surtout dans leur pluralité et leur diversité, doit être pleinement reconnu. De plus, soutenir financièrement l'éducation à la démocratie est, plus que jamais, crucial pour permettre à la population de réfléchir, de dialoguer et de s'engager dans l'occasion qui nous est offerte d'améliorer notre santé démocratique.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Kyiv : nouvelle agression des fascistes contre les étudiants du syndicat Priama Diia

Le lundi 20 mai, deux militants, un étudiant et une étudiante de Priama Diia (Action Directe ) à Kyiv ont collé des affiches d'un événement syndical, la présentation du zine du syndicat Agir qui doit avoir lieu le dimanche 26 mai. Lors de l'affichage dans le centre-ville, ils ont été abordés par trois personnes, dont un soldat. Ce dernier leur a demandé s'ils étaient de Priama Diia et leur a dit : « Oh, vous êtes donc des antifascistes ! Et moi, je suis un nazi. »
21 Mai 2024 | tiré du site Argument pour la lutte sociale | Photo illustrant cet article : un soldat ukrainien anarchiste, blessé au combat, attaqué par des petits fachos, Odessa.
Après cela, les trois agresseurs ont sorti une bombe lacrymogène et ont aspergé les militants syndicaux de gaz poivré. Arseniy, responsable de la section d'Action directe de l'académie de Kyiv-Mohyla, a également été battu. Les agresseurs ont fini par s'enfuir. Les victimes ont fait une déclaration à la police et le syndicat a pris contact avec un avocat.
21 mai 2024.
Notre commentaire
Aplutsoc appelle tous les internationalistes véritables et les composantes du Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine à prendre avec le plus grand sérieux les dernières informations concernant les attaques d'extrême-droite et/ou policières contre les camarades du syndicat étudiant ukrainien Prima Dia, et notamment contre les camarades militaires.
Pour gagner contre l'impérialisme russe, le peuple ukrainien a besoin de telles organisations, comme il a besoin d'un vrai droit du travail, de syndicats et d'organisations féministes. Ceux qui en veulent aux droits des travailleurs font le jeu de l'invasion. Les enjeux se concentrent dans l'armée, actuellement celle au monde où le plus de droits démocratiques existent de fait pour les soldats et où se pose, significativement pour les soldates et les LGBT, et à présent de plus en plus pour tous les militaires, la question de la liberté d'organisation syndicale et politique, condition de la victoire !
Nous appelons aussi à la solidarité financière avec des camarades jeunes, en situation précaire ou militaires, qui vont en avoir de plus en plus besoin. Nous écrire par mail à sujet.
Voir ci dessous le « zine » de Priama Dia, en ukrainien (dès que des traductions circuleront en anglais ou en français, nous les diffuserons). A noter que Priama Dia était le nom de la première organisation syndicaliste de jeunesse à l'esprit libertaire, qu'avait impulsé dans les années 1990 le camarade Maksym Butkevych, aujourd'hui détenu aux mains des forces russes d'occupation.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La déliquescence des services publics sud-africains, reflet d’un pays en crise

L'Afrique du Sud est-elle un “État en faillite” ? Devant les coupures d'eau et d'électricité en série, la question est régulièrement posée par la presse du pays.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Infrastructures publics. Sur le robinet : Manque d'entretien. Dessin de Brandan Reynolds paru dans Business day, Johannesburg.
“Cela a été dit à l'infini, mais cela vaut le coup d'être répété parce que c'est vrai : les élections de cette année sont les plus importantes depuis 1994. Pourquoi ? L'ANC a mal gouverné l'Afrique du Sud pendant trente ans, au point de provoquer l'effondrement de la société.” Si le constat du rédacteur en chef du média sud-africain News24 peut sembler excessif, il est globalement partagé par le reste de la presse du pays, qui, ces derniers mois, se pose régulièrement la question suivante : l'Afrique du Sud est-elle un “État en faillite” ?
Sans en être rendu à ce stade, le pays s'enfonce dans une multitude de crises qui se nourrissent les unes des autres. Corruption, gestion incompétente, criminalité record, chômage massif, services publics en déshérence… Pas une journée sans que les médias locaux se fassent l'écho de ces maux, qui figurent parmi les préoccupations majeures des électeurs à l'approche du scrutin qui doit se tenir le 29 mai prochain.
Symbole le plus évident de ce déclin, les coupures d'électricité récurrentes devenues nécessaires pour éviter l'effondrement du réseau alors que la compagnie publique d'électricité est incapable de faire face à la demande. “Un manque d'entretien et de bonne gouvernance et la corruption ont laissé la compagnie d'électricité Eskom dans un état critique”, résumait récemment le quotidien The Citizen.
Ces coupures de courant ont atteint un niveau record en 2023, avec trois cent trente-cinq jours de délestages, parfois jusqu'à douze heures par jour, avant de cesser à la surprise générale deux mois avant les élections – “le résultat de plus d'une année de travail acharné”, selon le gouvernement. Reste à savoir si ce progrès s'inscrira dans le temps.
Quoi qu'il en soit, les chantiers ne manquent pas, car, après la crise énergétique, le pays est désormais confronté à des coupures d'eau de plus en plus fréquentes jusque dans la capitale économique, Johannesburg. “Après des dizaines d'années de négligence des infrastructures et une décennie de pillage pur et simple sous l'administration Zuma, […] la crise de l'eau est là”, écrivait à la mi-mars le quotidien économique Business Day dans un éditorial.
Pillage et corruption
Au début de mai, le média d'investigation sud-africain Daily Maverick examinait également le cas de l'effondrement du réseau ferré, lié, là encore, au “pillage” de la compagnie publique de transport, Prasa. “Cette corruption a détruit le service de transports de passagers d'Afrique du Sud”, commente le Daily Maverick, qui note que le nombre de trajets annuels assurés par l'entreprise publique est passé de plus de 500 millions en 2010 à 19 millions en 2022.
Le transport de marchandises, supervisé par la compagnie publique Transnet, qui gère également les ports du pays, est dans le même état. “L'incompétence du gouvernement, la corruption et la paralysie politique ont laissé en lambeaux les infrastructures critiques du pays le plus industrialisé d'Afrique”, résumait Bloomberg en juillet 2023.
Les coupures d'électricité et les dysfonctionnements, en particulier, du circuit logistique (transport de marchandises et ports) plombent la croissance, et par ricochet l'emploi : plus de 30 % de la population est au chômage. Le taux monte à plus de 60 % au sein des 15-24 ans. Des chiffres parmi les plus élevés au monde qui expliquent en partie le taux de criminalité élevé – en moyenne, 84 personnes ont été tuées chaque jour au troisième trimestre 2023, d'après les statistiques officielles.
Un constat sombre qui agace le président sud-africain, rapporte la chaîne eNCA. Le 27 avril, alors que le pays célébrait les 30 ans de la démocratie, Cyril Ramaphosa a vanté le bilan de l'ANC en rappelant que son parti a “construit des maisons, des cliniques, des hôpitaux, des routes, des ponts, des barrages et beaucoup d'autres infrastructures”. N'en déplaise aux critiques, l'Afrique du Sud est “un endroit infiniment meilleur qu'il y a trente ans”, a-t-il souligné.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique - Bonnes feuilles, le bilan critique des juntes au pouvoir au Sahel

Comment Emmanuel Macron, le plus jeune président de la Vème République, a-t-il pu collectionner autant de casseroles depuis sa première élection en 2017 ? Dans Emmanuel au Sahel. Itinéraire d'une défaite, la journaliste Leslie Varenne livre un portrait accablant de ce « président qui ne sait pas qu'il ne sait pas »
Tiré de Mondafrique
23 mai 2024
Par La rédaction de Mondafriqu
Dans ce livre au ton incisif mais toujours nuancé où les juntes sont traitées dans leur singularité et où l'expertise de l'armée française est saluée, cette passionnée de l'Afrique cherche à comprendre comment le Sahel va apprendre désormais à vivre sans la tutelle de la France.
Puisé aux meilleures sources, ce livre décrit sans concession les bilans des juntes militaires au Niger, Mali, Burkina, Tchad et Guinée depuis qu'elles sont parvenues au pouvoir. Une première.
Nous livrons les bonnes feuilles de ce livre utile, voire indispensable, pour tout lecteur aussi curieux de l'Afrique que de l'Ukraine et de Gaza. Les photos, les légendes et les titres sont de la rédaction de Mondafrique. Extraits.
***
La défaite politique de la France au Niger illustre la méthode Macron. Décider seul, tenir, quoi qu'il en coûte, contre tous, contre l'histoire, contre vents et marées, contre les évidences. Puis, finir par jeter l'éponge et faire comme si rien ne s'était passé ; comme si les soldats cloîtrés et l'ambassadeur claquemuré n'avaient jamais existé ; comme si les militaires français n'avaient pas été contraints de partir. Le président français se retourne rarement sur ses échecs, le franc CFA, Takuba, le new deal, le Mali, etc. Néanmoins, pour les événements d'août 2023, il a fait une exception pour louer sa perspicacité : « En Afrique, les reconfigurations que j'avais décidées en février 2023 ont vu leur nécessité confirmée par le putsch de cet été au Niger », a-t-il déclaré lors de ses derniers vœux aux armées.
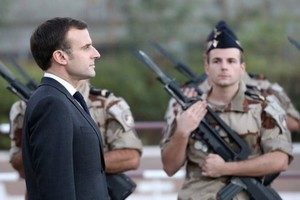
La défaite politique de la France au Niger illustre la méthode Macron
En réalité, les réflexions autour des remodelages, redimensionnements dans les pays où la France est encore présente militairement – au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad et à Djibouti – ce dernier pays est épargné par cette reconfiguration – ont commencé en novembre 2022. Un an et demi plus tard, sœur Anne ne voit toujours rien venir. Ce sont les mêmes questions, le même manque de cap, de vision. Le 6 février 2024, le président français a créé un nouveau poste, celui d'envoyé personnel en Afrique. En agissant ainsi Emmanuel Macron s'inscrit une nouvelle fois dans une démarche solitaire et en première ligne.
Était-ce nécessaire ? Est-ce pertinent ? L'heureux élu se nomme Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la Coopération de Nicolas Sarkozy, qui fut remercié à l'époque pour avoir dénoncé la « Françafrique ». Quelles que soient les qualités de cet ancien sénateur, qui a perdu un fils lors de l'opération Barkhane au Mali, que pourra-t-il faire sans boussole ? En outre, cette nomination ignore une fois encore le Quai d'Orsay, et quid du rôle du nouveau conseiller Afrique de l'Élysée, Jérémie Robert, entré en fonction en janvier 2024 ? Ce poste sera resté vacant six mois, il est vrai qu'il n'y avait pas urgence ! Selon la feuille de route élyséenne157, Jean-Marie Bockel dispose de dix-huit mois pour revoir « les formats », « les modalités d'action » en partenariat avec les pays africains concernés, et pour rendre sa copie. Au Sahel, les événements se précipitent en mode turbo comme jamais dans l'histoire de cette région. Au rythme de ces changements, un an et demi, c'est une éternité…
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tous les ponts avec Paris ont été coupés. De mesures de rétorsion suivies de mesures de réciprocité, il n'y a plus d'ambassadeur dans aucun de ces trois pays, plus de coopération, et même plus de vol Air France. Dans ces trois États, pour la première fois depuis la colonisation, l'Élysée doit se contenter de regarder la caravane de l'histoire passer.

Capture d'écran du compte X (ex-Twitter) de la présidence du Niger montrant le colonel Goïta, du Mali, signant le charte de « l'Alliance des États du Sahel »
Le coup d'État au Niger a également modifié les rapports de force dans le Sahel. En septembre 2023, les trois juntes de Niamey, Bamako et Ouagadougou ont créé un front politicomilitaire : l'Alliance des États du Sahel (AES), censé symboliser leur solidarité et leur unité dans la lutte contre les djihadistes. Puis, elles ont créé une force conjointe, une sorte de G5 Sahel à trois, sans les financements européens, mais également sans les contraintes et les pesanteurs administratives.
Le Mali a été le premier à sortir du G5, en mai 2022, suivi ensuite par le Burkina Faso et le Niger. Après le départ de Barkhane, les autorités de Bamako ont méthodiquement détricoté tous les outils concoctés par la France depuis 2013. Un an après leur sortie du G5 Sahel, ils ont demandé et obtenu le départ de la Minusma, qui a plié bagage à la fin de l'année 2023. Dans la foulée, la mission de formation de l'Union européenne, EUTM, s'est, elle aussi, retirée. Pour mener leur guerre contre les djihadistes, les Maliens ne comptent plus que sur les 1500 à 2000 mercenaires de Wagner. Bamako a acquis du matériel russe, chinois, turc, des avions et des drones. Ces vecteurs aériens ont été un véritable « game changer », pour employer, une fois n'est pas coutume, un anglicisme à la mode. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ils maîtrisent leur ciel.

La junte malienne n'a pas privilégié le dialogue avec le chef djihadiste Iyad Ag Ghali ou les groupes rebelles touareg
Fortes de ces moyens conjugués, les autorités n'ont pas privilégié le dialogue, ni avec les djihadistes ni avec les groupes rebelles touareg et alliés. Elles ont opté pour la seule option militaire. L'armée a réussi à reprendre toutes les bases laissées vacantes par la mission des Nations unies, y compris celles du Nord, disputées à la fois par le JNIM, le groupe de Iyad Ag Ghali, et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA). En novembre 2023, grâce à Wagner et à sa supériorité aérienne qui ont dissuadé l'ennemi, avec une aide modeste mais réelle des Nigériens et des Burkinabè, elle a repris, sans combattre, le bastion de Kidal, contrôlé par les rebelles touareg depuis 2014. Une victoire en forme de revanche éminemment symbolique.
Le Burkina, maillon faible
Le Burkina Faso n'engrange, lui, aucun succès. Il apparaît comme le maillon faible de cette nouvelle alliance. Nonobstant l'aide que l'AES lui apporte dans la région des « trois frontières », ce pays vit une tragédie. Les attaques du JNIM et de l'État islamique s'enchaînent. Malgré les dénégations des autorités qui minimisent les pertes et les échecs sur le front, le nombre de morts civils et militaires atteint des sommets jamais égalés en sept années de guerre. Ibrahim Traoré a échoué à unir une armée exsangue, démotivée et malmenée. Et la descente aux enfers se poursuit. Le possible effondrement de ce pays impacterait tous les pays côtiers, notamment le Bénin, avec la création d'un corridor non contrôlé de l'Atlantique à la Méditerranée.

Les juntes au pouvoir au Sahel n'ont ni les mêmes origines, ni les mêmes objectifs
Autre pays, autre constat.
Malgré leur front commun, essentialiser ces juntes serait une erreur. Leur histoire, leur armée, leur culture présentent de nombreuses différences. Depuis le coup d'État au Niger, la plupart des médias ont décrit une situation sécuritaire dégradée dans ce pays. Comme toujours, la réalité est plus complexe. Les attaques de l'État islamique dans la zone des « trois frontières » ont effectivement repris après le putsch, pour autant cela n'est pas lié à l'arrêt des opérations militaires françaises. Dès son arrivée au pouvoir en 2021, Mohamed Bazoum a entrepris des négociations avec l'État islamique. Sans qu'aucune précision n'ait été fournie sur les conditions du compromis, le président du Niger s'était néanmoins exprimé sur le sujet, reconnaissant « une main tendue » aux jeunes enrôlés dans ce groupe. Officiellement, il avait admis la libération de sept djihadistes emprisonnés à Niamey ; officieusement, ils seraient beaucoup plus nombreux.
Par conséquent, à partir de l'été 2022, ces djihadistes n'ont plus livré de batailles sur le sol nigérien. En revanche, ils ont redoublé leurs coups contre le Mali. Le putsch a sonné la fin de l'accord et les assauts contre le Niger ont repris de plus belle. Emmanuel Macron n'avait, cette fois, pas imposé de veto à ces négociations, le président nigérien, considéré comme le dernier atout français dans la région, a bénéficié d'une certaine marge de manœuvre. Et ce, d'autant que Washington était favorable à ce dialogue. Ce programme dit des « repentis » était financé par l' Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 160. Il existait déjà un programme pour les repentis du groupe Boko Haram, il a été étendu aux éléments de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS)
Malgré la reprise de ces attaques, l'analyse des données 2023 montre une diminution des décès161, la même tendance est constatée au Mali. L'accroissement exponentiel des courbes au Sahel est porté par le seul Burkina Faso, 7 622morts, soit une augmentation de plus de 77 % au cours de cette même année162. En conclusion, pour le Mali et le Niger, les catastrophes prédites sans la participation des forces étrangères ne se sont pas produites. Au Burkina Faso, les forces étrangères n'étaient pas actives sur le terrain des combats. Cependant, la prudence est de mise, car la situation reste très volatile et l'accès aux informations difficile. D'autant qu'au cours du premier trimestre 2024, il y a eu une importante recrudescence d'attaques au Mali, qui se rapprochent dangereusement de Bamako.
De la capacité des juntes à ramener la sécurité dépend leur survie politique
La sécurité, enjeu essentiel
Pour ces trois juntes, le sujet sécuritaire est central. Bien entendu, la vie de leur population, l'économie, le développement, la réalisation de routes, d'infrastructures en dépendent. De leur capacité à ramener la paix et la sécurité dépend également leur survie politique. Ces succès leur permettraient de poursuivre à l'intention de leurs opinions publiques respectives le discours souverainiste qui leur a, il est vrai, fort bien réussi jusqu'alors. Faire mieux sans l'armée française ; faire mentir Emmanuel Macron qui déclarait lors de son discours devant les ambassadeurs en août 2023 : « Si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidées, nous ne parlerions aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. »
Outre, qu'il ne sert à rien de disserter sur ce qui aurait pu avoir lieu, ce genre de saillies humiliantes participent à alimenter le discours anticolonialiste. L'Afrique, et le Sahel en particulier, n'a pas l'apanage de cette rhétorique anticoloniale, elle prospère partout dans le monde. Cependant, certaines juntes l'utilisent à l'excès, par opportunisme plus que par idéologie.
Le 30 janvier 2024, la sortie en chœur de la CEDEAO des trois pays qui forment l'AES164 s'inscrit également dans ce registre-là. En accusant l'organisation d'être soumise aux ingérences étrangères, de ne pas les avoir aidés dans la lutte contre le terrorisme, d'avoir soumis leurs peuples à des sanctions dévastatrices, ils ont obtenu l'approbation d'une grande partie des opinions publiques d'Afrique de l'Ouest. Avec le départ de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, l'organisation paye comptant son passé, ses arrangements avec ses propres textes, ses doubles standards perpétuels et sa menace d'intervention militaire.

La CEDEAO n'a pas obtenu la libération de l'ex Président Bazoum
Trois semaines seulement après l'échappée belle du trio, sans avoir obtenu la libération de Mohamed Bazoum retenu depuis sept mois en son palais, la CEDEAO levait ses sanctions sur le Niger. À la fin de son long communiqué justifiant cette mesure de grâce, l'organisation appelait « tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale. »À qui peut bien être destiné le message ? Les lignes bougent, cette supplique en forme d'aveu est sans précédent dans l'histoire de cette institution.
Les juntes se nourrissent de ces victoires-là, car pour le reste le compte n'y est pas. Au Niger, il est encore trop tôt pour évaluer une situation encore volatile. La manne du pétrole, 90000 barils/jour, ouverte avec le nouveau pipeline inauguré le 1er mars 2024, ruissellera-t-elle sur la population ? Les autorités remettront-elles le pouvoir aux civils à la fin d'une durée de transition raisonnable ? Par le passé, lors des quatre précédents putschs, cela a toujours été le cas. En revanche, toutes les autres s'accrochent au pouvoir. Les coups d'État de Bamako et Niamey ont été les seuls qui pouvaient être qualifiés de « populaires » puisqu'ils venaient lever un blocage démocratique et donner un espoir de changement aux citoyens.

Le colonel malien Assimi Goitaa fermé la porte à toute transition démocratique
Le Mali sous une chape de plomb
Au Mali, les sauveurs sont-ils devenus les bourreaux ? Une chape de plomb s'est abattue sur le pays. Les élections promises en février 2024 n'ont pas eu lieu et aucune nouvelle date n'est annoncée. La vie politique autrefois si intense et bruyante semble encalminée. Le 10 avril 2024, la junte a ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et des associations à caractère politique, coupables de « discussions stériles et de subversion. »167 De nombreux opposants vivent en exil. Après neuf années d'atermoiements, de hauts, de bas, le 26 janvier 2024, les autorités maliennes avaient unilatéralement dénoncé l'accord d'Alger. Leur porte-parole a martelé trois fois cette annonce, comme chaque fois qu'une décision importante est prise, signifiant ainsi que celle-ci est irrévocable. Cet accord était de toute façon moribond depuis août 2023, date de la relance des hostilités entre l'armée malienne et la CMA.
Mais les victoires obtenues par les forces militaires contre ces groupes armés, la reprise des bases de la Minusma et de Kidal se sont accompagnées d'exactions terribles commises par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner toujours à l'œuvre au Mali. Ces derniers ont mené une campagne de terreur contre les civils, principalement contre les communautés touareg, arabes et peules. Ils sont arrivés parfois seuls à moto, tuant sans discrimination, volant le bétail, pillant absolument tout ce qu'ils trouvaient, jusqu'au charbon de bois.
La liste est longue : « exécutions sommaires, massacres de masse, disparitions forcées, détentions arbitraires, actes de torture, destructions de sources d'eau, spoliation des biens, etc. » Cette description corrobore les témoignages de nombreux contacts de la région. En mars 2022 avait également eu lieu le massacre de Moura où, selon la Minusma, 500 personnes ont été tuées par l'armée malienne et les supplétifs de Wagner169. Traumatisées, apeurées, des milliers de personnes ont fui vers l'Algérie et la Mauritanie, un pays qui a, de manière exemplaire, accueilli 100 000 nouveaux réfugiés qui s'ajoutent à ceux présents dans ce pays depuis 2012. L'Azawad déjà sous-peuplé s'est vidé d'une grande partie de ses habitants.
Pour les faire revenir, retrouver la confiance et recoudre les déchirures, il faudra du temps. Les autorités de Bamako ont décidé de remplacer l'accord d'Alger par un dialogue intermalien qui, pour une fois, n'est pas inclusif puisque la CMA n'y est pas conviée. Pourtant, relancer des négociations politiques avec les groupes armés de la CMA permettrait d'envisager un retour de la paix dans le nord du Mali. Ce sera long, difficile, la suite est imprévisible, mais la société malienne est ainsi faite que même les pires ennemis peuvent se réconcilier. Rien n'est impossible.
À ces graves conséquences humanitaires, à ces difficultés sécuritaires et politiques s'ajoutent d'importants problèmes économiques. Avec la fin de Barkhane, de la Minusma, des missions de l'Union européenne, toute l'économie de guerre s'est effondrée. Certes, ce type d'économie est connu pour être un déstabilisateur des sociétés. La présence massive d'agents des Nations unies, de consultants, d'experts grassement rémunérés participe à une inflation du coût de la vie. Ils enrichissent d'abord l'élite, les grands commerçants et les riches propriétaires à qui appartiennent les villas luxueuses dans lesquelles sont logés les fonctionnaires internationaux. Cependant, les autorités n'ont pas anticipé sa fin et des milliers de travailleurs et de sous-traitants se sont retrouvés sans emploi (…)

Ibrahim Traoré, le dernier de la classe
Le Burkina, un bilan désastreux
Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles en juillet 2024. Puis, il s'est ravisé. En septembre 2023, il a déclaré170 : « Ce n'est pas une priorité, je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui est la priorité ». Les Burkinabè doivent donc attendre une amélioration sécuritaire… Pendant ce temps, les déplacés internes représentent plus de 10 % des 22 millions d'habitants. À cela, il faut ajouter les réfugiés dans les pays voisins, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Ils seraient 100000 selon les Nations unies171, chiffres fortement, sous-évalués, car de nombreuses familles ne s'inscrivent pas auprès des organisations humanitaires. Un tableau dramatique qui compte en plus trois millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire.
Pendant ce temps, le budget de la présidence a augmenté de 60 %. Le Capitaine s'est offert une compagnie aérienne, Kangala Air Express172, détenue par un prête-nom.
Le népotisme atteint des sommets, oncle, frère, cousin sont installés sous les lambris du pouvoir. La révolution de 2014 n'est plus qu'un lointain souvenir, la peur a envahi le débat public. Des experts des Nations unies173 se sont inquiétés de l'existence de fosses communes et des disparitions forcées commises par les forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie. Les critiques du régime, les courageux, les téméraires, les militaires récalcitrants sont enlevés par des hommes encagoulés. Ils s'évanouissent subitement dans la nature puis, quelques jours plus tard, les plus chanceux réapparaissent sur des photographies, en treillis, kalachnikov en main. Ils ont été envoyés au front.
Ablassé Ouédraogo, homme politique de 70 ans, pas le plus vindicatif, a vécu la mésaventure, comme Arouna Louré, anesthésiste de son état, ou encore Daouda Diallo, pharmacien. Cet homme frêle, également professeur à l'université, a été projeté dans la guerre sans y être préparé. Devant les horreurs vécues par son pays, il a créé une association documentant les atrocités, les disparitions, les massacres et le voilà dans la savane une arme à la main… Tous punis par le Sankariste 4.0, au nom des « masses » et de la patrie ! En s'adressant à Ibrahim Traoré et pour moquer sa fatuité, un internaute a un jour écrit : « Ce n'est pas en buvant du Kérosène que tu vas voler comme un avion ! » En attendant des jours meilleurs, Ouagadougou bruisse de rumeurs sur des tentatives de coups d'État. Le Capitaine ne dort que d'un œil et surveille ses arrières. Ce n'est vraisemblablement qu'une question de temps…
L'ancien caporal de la Légion, Mamadi Doumbouya, porte désormais très haut le titre de général
À Conakry, en revanche, la France est toujours présente. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui porte désormais très haut le titre de général, n'a pas envie de laisser le pouvoir. C'était prévisible. Il a envoyé des émissaires à Paris et dans les capitales anglo-saxonnes pour négocier une prolongation de la transition d'un an, jusqu'à décembre 2025. Les lignes bougent, il fut un temps pas si lointain où la parole de l'Élysée aurait suffi. Son ministre de la Défense a été reçu au Château, en décembre 2023. Selon la lettre « Africa Intelligence », sa demande « n'a pas suscité de levée de bouclier ». Il aurait néanmoins vivement conseillé au représentant de la Guinée d'entamer des pourparlers avec la CEDEAO ; de donner des gages visibles de retour à l'ordre constitutionnel ; de lever les restrictions pesant sur la presse et sur l'opposition.
Un message pas vraiment bien compris puisque trois semaines plus tard, Sékou Jamal Pendessa était mis aux arrêts. Ce journaliste, syndicaliste, avait appelé à manifester contre les restrictions qui ciblent la presse guinéenne. Il a fini par être libéré fin février, après deux jours d'une grève massive qui a totalement bloqué le pays. Dans le même élan, Internet et les réseaux sociaux, coupés depuis trois mois, ont été rétablis.
Si la France continue d'afficher une grande bienveillance envers l'ancien caporal de la Légion devenu général, en revanche, les États-Unis s'impatientent. Ils dénoncent le non-respect des libertés fondamentales. Le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest175, Michael Heath, s'inquiète également du non-respect du calendrier électoral. Leur agacement se comprend aisément, l'Amérique défend les valeurs occidentales et « l'ordre international fondé sur des règles ». Il se pourrait aussi que leur exaspération soit due à la lenteur de la redistribution des cartes des concessions minières : Russes et Chinois sont toujours là, confortablement installés. Ainsi va la malédiction des ressources naturelles. Combien de temps se poursuivra cette tragi-comédie ? Les Guinéens sont à bout ; l'économie tourne au ralenti ; un mouvement a été créé, le FRAC, Front pour le retour d'Alpha Condé… Les jeux sont ouverts.
Sale temps pour le Tchad
Au Tchad, en revanche, dernier pays du Sahel où la France déploie encore un millier de soldats, les portes se sont hermétiquement refermées. Les temps qui viennent s'annoncent sombres et difficiles, tant pour la présence militaire française que pour le pays. En janvier 2024, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, avait nommé l'opposant Succès Masra, Premier ministre. Certains voulaient y voir un signe d'ouverture, d'autres ont perçu ce rapprochement, entre deux adversaires, comme une simple compromission. Puis dans la perspective de consolider son pouvoir et suivre les traces de son père, le chef de l'État a annoncé qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle du 6 mai 2024. Quelques jours plus tard, Succès Masra postulait lui aussi à la fonction suprême. Le Tchad se retrouve donc dans une situation inédite avec un Président de la Transition et son Premier ministre s'affrontant lors d'un scrutin dont l'issue ne laisse aucune place au doute : une confiscation annoncée du pouvoir. C'est peu de dire que cette succession dynastique passe mal dans la population tchadienne, mais également au sein de la famille Déby. Le fils n'a pas su conserver le fragile équilibre entre tous les clans que son paternel avait trouvé. La guerre intestine a repris.
Le 28 février, Yaya Dillo, cousin de Mahamat Déby et président du Parti socialiste sans frontière, a été tué par l'armée lors d'un assaut contre le siège de son mouvement. Le gouvernement assure avoir agi en riposte. Ses soutiens démentent et dénoncent une exécution. La photo de son cadavre qui circule sur les messageries privées tend à leur donner raison : il a reçu une balle dans la tête. Saleh Idriss Déby, frère de Déby père, appartenant également au Parti socialiste sans frontière a, lui, été mis aux arrêts. Dans la foulée, le siège de ce parti a été démoli au bulldozer.

Mahamat Déby reste le meilleur allié de la France au Sahel
« L'admiration de la France » pour Déby !
Deux jours plus tard, en visite à Washington, Succès Masra, exprimait « son soutien total et inconditionnel au chef de l'État. »176, tout en qualifiant « les événements de moments malheureux et douloureux ». À ses côtés, tout sourire, Victoria Nuland apportait son soutien « à une transition démocratique inclusive au Tchad. »177. Inclusive, sans les morts bien entendu ! La sous-secrétaire d'État n'a pas dit un mot de l'assassinat de Yaya Dillo. Succès Masra a poursuivi son voyage en France où il a été reçu discrètement à l'Élysée et officiellement à Matignon. Si rien n'a filtré de ses discussions avec Emmanuel Macron, le menu de sa conversation avec Gabriel Attal a été publié : projets économiques, soutien à la jeunesse, travaux sur le changement climatique178. Publiquement, le Premier ministre n'a pas trouvé judicieux d'évoquer les « moments malheureux et douloureux ». Aucune condamnation, un silence d'autant plus assourdissant qu'au même moment s'enchaînaient les déclarations sur la mort de l'opposant russe, Alexeï Navalny. Mais l'histoire ne s'arrête pas là…
Deux jours plus tard, Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, atterrit à Ndjamena. Un voyage prévu de longue date. N'était-il pas au courant de la mort de Yaya Dillo, de l'arrestation de Saleh Idriss Déby, de la destruction du siège de leur parti ? Toujours est-il que lors de sa rencontre avec Mahamat Déby, il a tenu à lui faire part de « l'admiration de la France »179 pour le processus de transition. En de telles circonstances, le mot « admiration » n'était-il pas un peu fort ? Sûrement, au vu du tollé provoqué. Il a également profité de cette visite pour annoncer que l'armée française resterait. Comme une impression de déjà- vu… « L'histoire se répète toujours deux fois, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce », écrivait Karl Marx. La quatrième fois se passe comment ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des milliers de morts au nom de la sécurité

Les frappes menées depuis les avions ou les drones des États africains ont un coût humain dramatique pour les populations. Au nom de la sécurité et de la lutte contre les groupes armés dans une Afrique perçue comme « anormale » depuis la colonisation, des milliers de civils ont péri sous leurs bombes.
Tiré d'Afrique XXI.
Suite de l'article Un mimétisme lourd de conséquences.
Les actions aériennes de plusieurs États africains ont un coût humain dramatique pour les populations. Cela est notamment attesté par l'action des forces aériennes kényanes qui agissent à la fois de manière indépendante et au sein de Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), dans des opérations contre le groupe Al-Chabab depuis 2011. Selon un rapport de l'ONU de 2017, les opérations des forces aériennes kényanes menées dans ce contexte auraient causé la mort de 36 civils et en auraient blessé 6 entre le 1er janvier 2016 et le 14 octobre 2017. En plus, du bétail aurait été tué lors de ces opérations. Elles auraient aussi provoqué la destruction d'habitations et le déplacement d'une partie de la population (1). Le 3 juin 2021, une attaque aérienne menée par un avion kényan aurait aussi provoqué la mort d'une femme et de son enfant et blessé quatre personnes en Somalie. En juin 2023, une autre attaque d'un appareil kényan en Somalie aurait causé la mort de deux civils et en aurait blessé trois autres.
En 2017, ce sont les forces camerounaises qui ont été accusées de larguer des gaz lacrymogènes et de faire feu à partir d'hélicoptères sur des protestataires dans les zones anglophones (2). Cette attaque aurait provoqué la mort de plusieurs personnes.
En Éthiopie également, des civils ont été blessés et tués lors d'attaques aériennes visant des groupes rebelles. Ainsi, en 2022, des attaques de drones des forces éthiopiennes dans la région Oromia auraient causé la mort de quelque 100 personnes. Des attaques des drones des forces éthiopiennes en août, octobre, novembre et décembre 2023, dans les régions Oromia et Amhara, ont également provoqué la mort de dizaines de civils – nombre de ces attaques sont apparemment réalisées avec des drones TB-2 achetés à la Turquie (3).
Des corps noircis, carbonisés
En 2022, les forces togolaises ont aussi reconnu avoir tué sept civils et en avoir blessé deux de plus par erreur au mois de juillet de la même année lors d'une attaque aérienne. Les victimes, prises pour des djihadistes, avaient toutes entre 14 et 18 ans. Au cours de l'année 2023, lors de trois attaques de drones, les forces du Burkina Faso ont touché deux marchés et un enterrement (deux des attaques ont eu lieu au Burkina Faso et une au Mali). Les militaires burkinabè, qui visaient des membres de groupes armés islamistes, ont tué au moins 60 civils et en ont blessé des dizaines lors de ces attaques. Selon un des témoins de l'une de ces attaques : « Les corps étaient noircis et carbonisés. […] Nous avons eu du mal à les identifier car les corps étaient déchiquetés. » (4) En novembre 2023, des attaques de drones de l'armée malienne ont quant à elles tué au moins 12 civils. Le 17 mars 2024, deux autres attaques ont provoqué la mort de 13 civils, dont 7 enfants.
En juillet 2017, un avion des forces aériennes du Niger a tué par erreur 14 civils dans le village d'Abadam alors qu'il visait des djihadistes. Il est à noter qu'une frappe par un avion non identifié (possiblement nigérian) avait largué trois bombes sur ce village en janvier 2015 lors d'une opération visant des éléments du groupe Boko Haram. Cette attaque avait causé la mort de 37 personnes et en avait blessé une vingtaine. Les victimes participaient à une cérémonie funéraire. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2024, les forces aériennes du Niger ont aussi mené une attaque dans la région de Tilabéri. Lors de cette action, qui visait des « terroristes » et aurait été menée avec des drones, des dizaines de civils ont été tués.
Des frappes aériennes font aussi des ravages parmi les civils dans le conflit qui oppose les forces armées nationales aux Forces de soutien rapide au Soudan. Entre avril et septembre 2023, 244 civils ont été tués, et 123 blessés lors de 26 incidents concernant des actions aériennes menées par les deux camps. Rien qu'en septembre 2023, des attaques d'artillerie et de drones à Khartoum ont aussi provoqué la mort d'au moins 40 civils.
Une Afrique vue comme « anormale »
Les armées africaines, en adhérant à l'idéologie de la puissance aérienne, participent à la construction d'une représentation du monde au sein de laquelle l'Afrique est « anormale » et mérite, pour cette raison, un traitement coercitif de ses problèmes sociaux et politiques – un processus également à l'œuvre au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Une telle représentation est par ailleurs utilisée par des sécurocrates afin de justifier le fait que ce continent aurait besoin de forces armées plus puissantes et de davantage d'aéronefs. Les notions d'ordre et de désordre sont intimement connectées ici ; le désordre appelle l'usage de moyens aériens qui provoque du désordre.
Les populations de plusieurs États africains vivent dans les fantasmes de la « puissance aérienne » développés en Europe et aux États-Unis (5). Ces fantasmes, qui ont pris forme dans le contexte colonial, promeuvent la pacification par la violence et transforment en fétiches les moyens aériens. Ces derniers se voient conférer une efficacité qu'ils n'ont pas, leur utilité pour régler les problèmes sociaux et politiques des sociétés africaines étant des plus limitées, comme en atteste la situation nigériane.
L'État nigérian est confronté à des problèmes d'insécurité depuis de nombreuses années. Le recours aux forces armées pour y mettre un terme n'a pas eu l'effet escompté. Ces forces, qui sont régulièrement accusées de commettre des exactions, se sont finalement retrouvées dans une situation délicate dans plusieurs régions. Au cours de l'année 2019, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (Islamic State West Africa Province, Iswap) prend d'assaut plusieurs postes militaires. En réaction, les militaires décident de se regrouper dans une vingtaine de « supercamps » installés dans les régions de Borno et Yoba. Peu d'informations circulent à propos de ces camps. On sait néanmoins qu'ils seraient installés autour des villes de l'État de Borno et seraient gardés par 300 à 1 200 soldats. Le regroupement est de fait une retraite pour les militaires. Les forces armées décident alors de mener davantage de raids afin de soutenir les camps.
La normalisation du recours aux moyens aériens a cependant des effets dramatiques pour les populations locales. Cela découle tout d'abord du fait que l'emploi des aéronefs pour chasser des « bandits » participe aussi à la militarisation des tensions. Loin de solutionner les problèmes d'insécurité, cet emploi renforce en fait le cycle de la violence. Les forces aériennes nigérianes sont aussi responsables de nombreux « accidents ». Ceux-ci auraient causé la mort de 426 civils entre 2017 et 2023. 9 % des tués par l'action des forces aériennes sont des civils.
Un coût catastrophique pour les populations
Régulièrement, les autorités promettent de mettre sur pied des commissions d'enquête après les attaques lors desquelles des civils ont perdu la vie. Ces promesses ne débouchent cependant sur rien de concret. Les familles des victimes sont dissuadées de s'adresser à la justice. Assez rarement, elles perçoivent une (faible) compensation financière. Depuis 2023, les appareils des forces aériennes nigérianes sont par ailleurs employés pour lutter contre les voleurs de pétrole. Dans ce cadre, ces aéronefs utilisent leurs puissantes armes contre ces bandits et contre leurs installations. Ces actions, comme le note Human Rights Watch, posent la question d'un usage excessif de la force à l'encontre non pas de combattants mais de criminels.
La situation nigériane met en exergue le coût catastrophique pour les populations des rêves sécuritaires issus du présent colonial. Pour reprendre les propos de Norman Ajari, ces rêves font émerger « une condition noire et une histoire noire essentiellement modernes, définies par une surexposition structurelle à la violence sociale et politique, et par une constante invention contrainte de stratégies de survie » (6). Les victimes civiles des attaques doivent être appréhendées comme le prix que les décideurs politiques et militaires ont accepté de faire payer aux populations pour le maintien de leur image d'acteurs capables d'assurer la sécurité selon des modalités coloniales.
L'Afrique n'est cependant pas qu'un réceptacle de techniques développées dans le passé ou éprouvées en Afghanistan, en Irak et au Pakistan dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Elle est aussi devenue un laboratoire pour les guerres du futur. Cela se vérifie en particulier en Libye. Dans cet État, les belligérants ont réalisé plus de 1 000 attaques de drones depuis le début de la guerre civile. Pour cette raison, Ghassan Salamé, le représentant spécial de l'ONU, a dit de ce conflit qu'il était « la plus grande guerre de drones au monde » (7). Cette situation a bien entendu eu un coût pour les populations civiles. Selon un rapport publié en mai 2020, les attaques aériennes menées par l'ensemble des belligérants entre 2012 et 2020 auraient causé, selon les sources, entre 871 à 1 384 morts au sein de la population. Nonobstant, le conflit en Libye est transformé par les sécurocrates en un argument stratégique servant à justifier l'acquisition de davantage de drones par les forces armées modernes. Les événements libyens sont mis en récit par ces experts d'une manière qui ne nuit pas à la mythologie de la puissance aérienne, et qui lui permet de survivre malgré les dégâts humains découlant de son usage. Dans ce contexte, on peut dire que les populations libyennes ont participé, à leur détriment, à une vaste expérimentation.
La longue liste des « accidents » des forces aériennes nigériannes
Mai 2009. Une action conjointe de l'armée, de la marine et des forces aériennes dans le Delta aurait fait des centaines de morts, dont de nombreux civils.
17 janvier 2017. Les forces aériennes nigérianes bombardent un camp de personnes déplacées dans l'État de Borno. Selon Médecins sans frontières, 50 civils décèdent et 120 sont tués pendant cette attaque. D'après le journaliste Nick Turse, les forces états-uniennes auraient assisté les militaires nigérians, peut-être en leur fournissant des renseignements (8).
4 décembre 2017. 35 personnes auraient été tuées lors d'une attaque aérienne sur cinq villages dans l'État d'Adamawa. Lors de cette attaque, les forces aériennes nigérianes ont utilisé un hélicoptère Airbus EC-135, et un Alpha Jet d'origine française qui a tiré des roquettes SNEB de 68 mm, également fabriquées en France. Les tirs auraient notamment atteint des personnes qui s'enfuyaient. 3 000 habitations auraient aussi été détruites lors de cette opération.
9 avril 2019. 11 civils décèdent et 20 autres sont blessés lors de six attaques aériennes menées dans l'État de Zamfara.
8 juillet 2019. Un raid aérien mené dans l'État de Borno cause, d'après la presse, 13 morts parmi les populations.
13 avril 2020. 17 personnes, dont des enfants, meurent après un bombardement dans l'État de Borno.
8 avril 2021. Un hélicoptère Leonardo AW109 des forces aériennes nigérianes aurait tiré de manière indiscriminée sur des habitations, des fermes et une école. Un rapport officiel indique que 6 civils ont été tués lors de cette attaque. D'autres sources évoquent 70 morts. L'hélicoptère impliqué dans le carnage a probablement tiré des roquettes de 70 mm fabriquées par les Forges de Zeebrugge, une filiale belge de Thales. Ses pilotes ont probablement été formés au Royaume-Uni.
16 septembre 2021. 9 personnes, dont 3 enfants, sont tuées par une attaque des forces aériennes nigérianes sur un village au Niger.
18 février 2022. Un appareil des forces aériennes nigérianes cause la mort de 7 enfants au Niger alors qu'il pourchassait des « bandits ».
20 avril 2022. Une attaque aérienne nigériane aurait provoqué la mort de 6 filles âgées de 6 à 9 ans, et détruit des maisons dans le village de Kurebe, dans le Niger State.
7 juillet 2022. Une attaque aérienne cause 1 mort dans un village de l'État de Katsina.
29 décembre 2022. 71 personnes meurent des suites d'une attaque aérienne dans l'État de Zamfara.
Janvier 2023. 37 personnes décèdent lors d'un bombardement qui a eu lieu dans l'État de Nasarawa.
24 janvier 2024. Les forces aériennes nigérianes bombardent par erreur la communauté de Galadima Kogo, au Niger. Cette action cause de nombreux morts parmi la population. L'attaque aurait par ailleurs provoqué le déplacement d'environ 8 000 personnes.
Cet article est le 4e d'une série de 5.
L'Afrique, un nouveau champ de bataille dans le ciel
JOHN RINGQUIST · 20 MAI
Les drones, une histoire coloniale
CHRISTOPHE WASINSKI · 21 MAI
Les effets de la « dronisation » de la guerre au Sahel
RÉMI CARAYOL · 24 MAI
Un mimétisme lourd de conséquences
CHRISTOPHE WASINSKI · 22 MAI
Notes
1- « UNSOM/OHCHR, Protection of Civilians. Building the Foundation for Peace, Security, and Human Right in Somalia », décembre 2017. Les forces kényanes ont contesté ces affirmations. Certaines de leurs opérations aériennes sont menées conjointement avec les États-Unis en Somalie.
2- Edward McAllister, « Cameroon army helicopters shot separatist protesters : witnesses », Reuters, 6 octobre 2017.
3- Addis Standard, « Drone strikes inflicting immeasurable civilian casualties in Oromia, Amhara regions. Army must employ maximum restraint », 12 janvier 2024 ; Fred Harter, « “Horrific” civilian toll as Ethiopia turns to combat drones to quell local insurgencies », The New Humanitarian, 5 mars 2024.
4- « Burkina Faso : les frappes de drones contre des civils constituent des crimes contre de guerre apparents », Human Rights Watch, 25 janvier 2024.
5- Joseph Tonda, Afrodystopie. La vie dans le rêve d'Autrui, Karthala, 2021.
6- Norman Ajari, La Dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, La Découverte, 2019.
7- Africa Defense Forum, « The Dizzying Possibilities of Drones in Africa », Defence Web, 20 octobre 2023.
8- [Nick Turse, « U.S. Played Secret Role in Nigeria Attack That Killed More Than 160 Civilians », The Intercept, 28 juillet 2022
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Norvège, l’Espagne et l’Irlande reconnaissent conjointement l’état de palestine : Un grand pas pour la cause palestinienne

La Norvège, l'Irlande et l'Espagne ont annoncé hier, dans une démarche coordonnée, leur reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine. Cette reconnaissance entrera en vigueur le 28 mai. L'Autorité Palestinienne, l'OLP et le mouvement Hamas ont salué avec ferveur cette décision en faveur du peuple palestinien et son droit à l'autodétermination, tandis qu'Israël a rappelé ses ambassadeurs à Oslo, Dublin et Madrid.
Tiré de El Watan-dz
23 mai 2024
Par Mustapha Benfodil
Photo : D. R.
Au milieu de l'épouvantable apocalypse qui s'acharne sur Ghaza, depuis près de huit mois maintenant, sous l'abominable déluge de feu israélien, une espérance dans la nuit sanglante palestinienne : trois pays européens ont déclaré hier leur reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine. Il s'agit de la Norvège, de l'Espagne et de l'Irlande. Les trois pays qui sont parmi les plus engagés en faveur du peuple palestinien et son droit à l'autodétermination, et qui depuis longtemps militent pour une solution à deux Etats, ont annoncé que cette reconnaissance entrera en vigueur le 28 mai.
Chacun des pays concernés a fait cette annonce de son côté,mais il s'agit à l'évidence d'une démarche concertée. Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, a organisé hier une conférence de presse à Oslo spécialement pour cette annonce. Il était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Espen Barth Eide. « Le gouvernement norvégien a décidé que la Norvège reconnaîtra la Palestine en tant qu'Etat.
Au milieu d'une guerre qui fait des dizaines de milliers de morts et de blessés, nous devons maintenir en vie la seule alternative qui offre une solution politique aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens : deux Etats, vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité, a déclaré le Premier ministre norvégien, selon un document rendu public par son service de presse.
Et de préciser : « La reconnaissance officielle de la Palestine par la Norvège en tant qu'Etat entrera en vigueur le mardi 28 mai 2024. Un certain nombre d'autres pays européens partageant les mêmes idées reconnaîtront également officiellement la Palestine à la même date. Ces pays feront leurs propres annonces. Au total, 143 pays ont déjà reconnu l'Etat palestinien. »
« Pas de paix sans une solution à deux États »
« Le peuple palestinien a un droit fondamental à l'autodétermination. Israéliens et Palestiniens ont le droit de vivre en paix dans leurs Etats respectifs. Il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans une solution à deux Etats. Il ne peut y avoir de solution à deux Etats sans un Etat palestinien. En d'autres termes, un Etat palestinien est une condition préalable à la réalisation de la paix au Moyen-Orient », a insisté le Premier ministre norvégien.
Jonas Gahr Store n'a pas manqué de rappeler les fameux Accords d'Oslo de 1993 qui, bien qu'inachevés et fortement critiqués, avaient tout de même permis de donner corps à un embryon d'Etat palestinien après la proclamation de celui-ci à Alger en 1988. « La reconnaissance par la Norvège d'un Etat palestinien a lieu un peu plus de 30 ans après la signature du premier accord d'Oslo en 1993 », observe le PM norvégien.
Il relève dans la foulée que « depuis lors, les Palestiniens ont franchi des étapes importantes vers une solution à deux Etats. En 2011, la Banque mondiale a conclu que la Palestine satisfaisait aux critères clés requis pour fonctionner en tant qu'Etat. Des institutions nationales ont été créées pour fournir à la population des services essentiels. Néanmoins, la guerre à Ghaza et l'expansion continue des colonies illégales en Cisjordanie ont rendu la situation en Palestine plus difficile qu'elle ne l'a été depuis des décennies ».
M. Store fait remarquer, par ailleurs, que « depuis les Accords d'Oslo (...), la Norvège et de nombreux autres pays ont suivi une stratégie selon laquelle la reconnaissance suivrait un accord de paix. Cela n'a pas abouti ». « En l'absence d'un processus de paix et d'une solution politique au conflit, les évolutions sont allées dans la mauvaise direction. Ni les Palestiniens ni les Israéliens ne peuvent vivre en sécurité.
C'est pourquoi nous devons penser différemment et agir en conséquence. Nous ne pouvons plus attendre que le conflit soit résolu avant de reconnaître l'Etat de Palestine », plaide Jonas Gahr Store.
« Un moment historique »
Simultanément, ce même mercredi, à Dublin, le Premier ministre irlandais, Simon Harris, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Micheal Martin, et du ministre de l'Environnement, Eamon Ryan, a annoncé la reconnaissance par l'Irlande de l'Etat de Palestine en précisant lui aussi que ce processus rentrera en vigueur le 28 mai comme à Oslo et Madrid. « L'Irlande reconnaît aujourd'hui la Palestine comme une nation parmi les nations avec tous les droits et les responsabilités que cela implique », a déclaré le Premier ministre irlandais, selon un communiqué officiel de son cabinet.
Et de souligner : « Nous avions espéré reconnaître la Palestine dans le cadre d'un accord de paix à deux Etats, mais nous reconnaissons plus tôt la Palestine pour maintenir vivant l'espoir d'une solution à deux Etats. Le rêve de l'Irlande est que les enfants israéliens et palestiniens du 28 mai 2024 grandissent pour devenir des voisins en paix. » Pour Simon Harris, « la seule façon d'arrêter la guerre et la mort est d'exploiter les qualités des deux nations ».
Et de conclure : « Nous sommes honorés de reconnaître la Palestine en même temps que nos amis espagnols et norvégiens. Nous espérons que d'autres feront de même. » Micheal Martin dira que cette décision « est un moment historique pour l'Irlande ». « Nous sommes profondément convaincus, poursuit le chef de la diplomatie irlandaise, qu'il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient tant que les peuples israélien et palestinien ne jouiront pas des mêmes droits à l'autodétermination, à la création d'un Etat, à la paix, à la sécurité et à la dignité. La reconnaissance de la Palestine n'est pas la fin d'un processus ; c'est le début. Nous sommes convaincus que la solution à deux Etats reste la seule option viable pour garantir une paix juste et durable et un avenir meilleur. »
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé à son tour hier la reconnaissance de l'Etat de Palestine par son pays devant les députés espagnols. « Mardi prochain, le 28 mai, l'Espagne adoptera en Conseil des ministres la reconnaissance de l'Etat palestinien », a-t-il déclaré avant une séance plénière du Congrès espagnol. « Cette reconnaissance n'est contre personne.
Ce n'est pas contre le peuple d'Israël (…) et encore moins contre les Juifs », a-t-il précisé. Selon l'agence de presse espagnole EFE, Pedro Sanchez a « communiqué la décision du gouvernement au roi Felipe VI, au secrétaire général de l'ONU António Guterres et aux présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen ».
Le 22 mars dernier, en marge d'un sommet européen, l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Slovénie, avaient fait savoir, rappelle-t-on, que ces pays reconnaîtraient prochainement l'Etat de Palestine.
Le gouvernement slovène a adopté un décret le 9 mai actant la reconnaissance de l'Etat palestinien. Ce texte sera soumis d'ici au 13 juin à l'approbation du Parlement. Huit Etats membres de l'UE reconnaissaient jusqu'à présent l'Etat palestinien, à savoir la Suède, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque et Chypre. Ils seront bientôt 12, voire davantage à accueillir une représentation diplomatique palestinienne sur leur territoire.
« C'est le résultat de la courageuse résistance palestinienne »
Réagissant à cette annonce, la présidence de l'Autorité palestinienne a salué avec ferveur le soutien affiché par Oslo, Dublin et Madrid et en a profité pour appeler les autres pays à rallier ce formidable élan de solidarité. Hussein Al Sheikh, secrétaire général de l'OLP, s'en est félicité en postant ce message plein d'enthousiasme sur la plateforme X : « Des moments historiques au cours desquels le monde libre triomphe pour la vérité et la justice après de longues décennies de lutte nationale palestinienne, de souffrance, de douleur, d'occupation, de racisme, de meurtre, d'oppression, d'abus et de destruction auxquels le peuple palestinien a été soumis.
Nous remercions les pays du monde qui ont reconnu et reconnaîtront l'Etat indépendant de Palestine. Nous affirmons que c'est la voie vers la stabilité, la sécurité et la paix dans la région. » Le mouvement Hamas a également accueilli la nouvelle avec allégresse : « Nous considérons cela comme une étape importante vers l'affirmation de notre droit à la terre et à l'établissement d'un Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale », a déclaré le parti d'Ismaïl Haniyeh dans un communiqué. Bassem Naïm, un cadre du mouvement, estime dans une déclaration à l'AFP que cette vague de reconnaissances « est le résultat de la courageuse résistance palestinienne ».
« Nous pensons qu'il s'agit d'un tournant dans la position internationale sur la question palestinienne » a-t-il ajouté. Plusieurs pays et institutions internationales ont salué cet élan de solidarité dont plusieurs capitales arabes. L'Egypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore la Jordanie y voient « une étape essentielle vers la solution à deux Etats ». Le Conseil de Coopération du Golfe, l'Organisation de la coopération islamique ont, elles aussi, salué cette décision avec ardeur.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a appelé les autres pays qui hésitent encore à reconnaître l'Etat palestinien à « suivre l'exemple de ces trois pays dans leur démarche courageuse ».
Pour sa part, la France, qui a toujours plaidé pour une solution à deux Etats, a considéré que le moment n'était pas le bon pour franchir le pas. « Ce n'est pas un tabou pour la France », a précisé Stéphane Séjourné dans une déclaration à l'AFP. Le chef de la diplomatie française estime toutefois que les conditions ne sont pas réunies « à ce jour pour que cette décision ait un impact réel » sur le processus visant la solution à deux Etats.
« Cette décision doit être utile, c'est-à-dire permettre une avancée décisive sur le plan politique », a-t-il argumenté, avant de souligner : « Dans cette perspective, elle doit intervenir au bon moment pour qu'il y ait un avant et un après. » « Il ne s'agit pas seulement d'une question symbolique ou d'un enjeu de positionnement politique, mais d'un outil diplomatique au service de la solution à deux Etats vivant côte à côte, en paix et en sécurité. » Israël a évidemment très mal vécu ce geste fort envers les Palestiniens et a rappelé « pour consultations » ses ambassadeurs en Irlande, en Norvège et en Espagne. Par ailleurs, Tel-Aviv a convoqué les ambassadeurs de ces trois pays en Israël pour une « conversation de réprobation » de leur position.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mort du président iranien Raïssi : les images de deuil ne disent rien de la détestation des Iraniens pour un pouvoir bourreau

La mère de l'anthropologue Chowra Makaremi est morte dans les purges de 1988 auxquelles le président mort le 18 mai avait participé. Elle souligne la violence du traitement médiatique qui a privilégié la foule en pleurs aux messages de joie sur les réseaux sociaux qui étaient une façon de dire : « On est encore là, on n'oublie pas et on ne pardonne pas ».
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Il y a trente-six ans, un hélicoptère promenait quatre membres des ministères de la Justice et des Renseignements iraniens, de prison en prison, à travers le pays : leur mission était d'interroger les opposants détenus qui défilaient devant eux en longues queues, puis de les ordonner en deux rangs.
Celles et ceux de gauche partaient vers la mort, celles et ceux de droite retournaient dans leurs cellules où ils seraient fouettés à l'heure de chaque prière, jusqu'à ce qu'ils acceptent de prier ou meurent à leur tour sous les coups.
Les files de gauche étaient les plus grosses, témoignent les survivants. Mais nul d'entre elles et eux ne savaient à l'époque ce que signifiaient ces tris et ce qui les attendait. Les questions étaient insolites : « Priez-vous ? », « Vos parents priaient-ils ? », « Que pensez-vous de la république islamique ? ».
Les prisonniers, détenus pour la plupart depuis le début des années 80, purgeaient la fin de leur peine : on leur avait parlé du passage devant une « commission d'amnistie ».
Le groupe était, en réalité, chargé d'appliquer le décret du Guide suprême, Khomeiny, qui ordonnait la mort de tous les prisonniers restés « fidèles à leurs positions ».
On ne sait pas combien moururent, quand et comment en ces mois d'été 1988, au moins plusieurs milliers. Ma mère en faisait partie.
Dans cette « commission de la mort », comme on l'appelle depuis, siégeait Ebrahim Raissi, président de la république islamique mort le 18 mai dernier à bord d'un hélicoptère.
Leur disparition ne modifie rien, ne menace rien, n'ouvre rien
Dans les dernières décennies, les récits de ces événements se sont progressivement fait entendre, redessinant une autre généalogie de l'Iran postrévolutionnaire.
Le meurtre et les tortures de masse dont Raïssi, comme beaucoup d'autres aujourd'hui au pouvoir, fut un exécutant zélé, ne sont pas seulement « restés impunis » : ils ont été une rampe de lancement de la carrière des médiocres, leur vaisseau de colonisation de l'Etat.
La violence, la cruauté et le féminicide ne sont pas des déviances déplorables – fougues de jeunesse de la république islamique – mais un processus de construction de l'appareil d'Etat.
Ce fait historique, simple et pourtant si long à émerger sous les discours réformateurs, et si prompt à disparaître à nouveau sous les discours experts, est mis à nu depuis le soulèvement « Femme, vie, liberté » de 2022 : comme une créature qui porte ses tripes au-dehors, comme le monument de Beaubourg à Paris porte ses tuyaux sur son flanc.
Les figures criminelles de haute volée, catapultées au sommet de l'Etat sur la volonté du Guide suprême, comme feu Raïssi mais aussi Mohseni Ejei, actuel chef du système judiciaire et membre du comité en charge de l'intérim présidentiel, ont occupé l'espace politique (peut-on encore l'appeler ainsi ?) en réprimant par le meurtre les résistances têtues de la société iranienne, comme on enfile les perles d'un collier : assassinat à la chaîne des intellectuels dans les années 2000, tortures et suppression des manifestants du « mouvement vert » de 2009, meurtres des manifestants de novembre 2019, meurtres et viols des manifestants du soulèvement « Femme, vie, liberté ».
Ces politiciens sont ceux qui demeurent quand tous les autres ont évacué la scène purges après purges : de plus en plus vieux, de plus en plus exclusifs, de plus en plus paranoïaques.
Mais il ne faudrait pas croire que ces éléments puissent constituer des facteurs de fragilité du pouvoir iranien.
C'est l'analyse principale qui entoure aujourd'hui la mort soudaine du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères. Leur disparition ne modifie rien, ne menace rien, n'ouvre rien. Cela ne saurait déstabiliser le pouvoir iranien. « Oui chef, tout est normal » pour reprendre une chanson du rappeur opposant Toomaj Salehi, condamné à mort en avril dernier.
Le crash de leur hélicoptère n'est qu'un accident dû au mauvais temps, et, au pire, au régime des sanctions américain qui empêche l'Iran de renouveler sa flotte.
Des feux d'artifice ont été tirés à Saqqez
Pourtant, cette mort fut une expérience différente pour les Iraniens.
Samedi 18 mai au soir, les médias annonçaient que l'hélicoptère du Président s'était écrasé dans les montages, dans une forêt dense, peu accessible aux humains, peuplée de bêtes sauvages, précisaient-ils. L'image a quelque chose d'halluciné, et de fort ironique.
S'ensuit une nuit d'hilarité et d'ahurissement sur les réseaux sociaux, qui mobilise les muscles du sourcil, levé, et ceux du ventre, secoué de rire.
C'est dans cette réalité que nous vivons pourtant : un monde où les bureaucrates de la mort s'écrasent dans des forêts brumeuses. Un monde où l'on ne sait pas s'ils sont morts d'accident ou de manigance, entre loups qui se mangent les uns les autres. Un monde où leur rôle comme président de la république était si prévisible et inconséquent que leur mort soudaine n'est même pas vraiment grave : c'est ce que répètent tous les experts du monde entier.
On peut simplement s'en esclaffer. Les Iraniens, dans leur vaste majorité, sont allés plus loin que le gloussement cependant : ils ont manifesté de la joie. Des feux d'artifice ont été tirés à Saqqez, la ville de Jina Mahsa Amini dont la mort avait mis le feu aux poudres du soulèvement « Femme, vie, liberté ».
Dans le contexte de répression féroce qui prévaut depuis, cela demande un certain cran. La vague de vidéos et de messages de joie qui a saturé les réseaux sociaux était aussi une façon de dire : « On est encore là, on n'oublie pas et on ne pardonne pas ».
Une petite fenêtre de tir à investir pour profaner et rendre visible sa détestation du pouvoir. Une autre façon de donner corps à la résistance à travers nos émotions : l'empathie pour les victimes d'exécutions, là où le pouvoir se nourrit de l'indifférence et de l'atomisation ; la jubilation pour une mort officielle qui commande le deuil.
Ces images cependant n'ont pas fait le tour du monde. Là où les images du soulèvement « Femme, vie, liberté » nous parvenaient par les réseaux sociaux, cette fois, ce sont celles produites par les médias iraniens qui ont été relayées en boucle par les chaînes d'informations occidentales : un spectacle de deuil public et de chancelleries.
Les Iraniens ont cessé de consentir aux fictions d'ordre et de puissance
D'un côté, les événements dans leur imprévisibilité et leur opacité – dans les jeux d'ombres du cortège de symboles, de coïncidences, de signes et de rumeurs qu'ils charrient.
D'un autre côté, les analyses, les commentaires, les pronostics et les explications médiatiques qui ordonnent cette réalité en une information consommable mondialement.
Entre les deux, un décalage brutal qui participe à la violence du monde – laquelle est indicible dans les mots et les raisonnements des experts.
Or, cette opacité, cette brutalité existent : elles ne cessent de faire irruption et de déchirer nos vies ; elles tissent aussi nos choix et la trame de nos actions. Les badigeonner de pronostics informés comporte peu d'intérêt.
Pourquoi rassembler des experts pour débattre à propos de qui sera le prochain président, élu le 28 juin 2024, tout en rappelant que cette élection n'en sera pas une (tout comme celle du défunt président n'en fut pas une) ?
Pourquoi tant d'efforts pour mettre en ordre ce qui, de toute évidence, n'en finit pas de dérailler ? Nous voulons rendre le monde lisible et objectivable dans tout son sérieux, et nous normalisons sa violence, nous amplifions le silence.
Les Iraniennes et les Iraniens, dans une majorité inouïe, ont cessé de consentir aux fictions d'ordre et de puissance que se donne ce pouvoir. Quel intérêt avons-nous, ici, à retricoter dans nos analyses et nos commentaires, cette légitimité longtemps perdue ?
Ne doutez pas que les images de foules en pleurs sont produites à destination de l'étranger qui y croit encore.
Celle qui émeut les Iraniennes et les Iraniens est indélébile et puissante. Elle n'existe pas ailleurs que dans nos têtes, mais elle est tout aussi réelle, sinon plus, que celle des foules en pleurs : c'est celle du corps des bourreaux devenus gouvernants, écrasé dans leurs hélicoptères (les mêmes qu'en 1988), perdus dans le brouillard, à la merci des fauves qui rôdent quand la nuit tombe.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le malaise de la gauche face à la République populaire de Chine

À gauche, la République populaire de Chine (RPC) déroute toujours autant. Dans les pays émergents elle est parfois érigée en modèle, ou perçue comme une alliée, en raison de son rôle central dans la dynamique de désoccidentalisation qui s'amorce. En Europe, elle est souvent considérée avec une défiance qui rejoint parfois celle des dirigeants américains. Pour échapper à ces deux impasses, il faut appréhender la géopolitique chinoise à l'aune de transformations économiques en cours depuis la mort de Mao Zedong. Par Martine Bulard [1].
21 mai 2024 | tiré de la lettre Le Vent Se Lève (LVSL) | Illustration : LHB pour LVSL
https://lvsl.fr/le-malaise-de-la-gauche-face-a-la-republique-populaire-de-chine/
Aux yeux d'une fraction – très minoritaire – du camp progressiste, la RPC apparaît, sinon comme un phare, du moins un pôle de contestation de l'hégémonie américaine. Pour la grande majorité, c'est une toute autre vision qui prédomine, alimentée par des clichés médiatiques : nouvel empire du mal, « péril jaune », omniprésence de la main de Pékin, etc. Mais que veut exactement la Chine ? Comprendre les ressorts de sa politique étrangère implique de considérer ses ambitions à la lueur de son histoire.
L'irrésistible ascension de la Chine
Du XVIè siècle au début du XIXè, on comptait la Chine et l'Inde au nombre des puissances dominantes. Les expéditions militaires occidentales devaient changer la donne, au prix d'un dépeçage de ces pays – lequel a pris la forme d'une occupation en Inde, et d'enclaves territoriales étrangères en Chine. Si des causes internes ont également conduit au déclin subséquent de celle-ci, ce sont les facteurs exogènes que la population chinoise garde aujourd'hui à l'esprit. Ainsi, l'idée qu'aujourd'hui leur pays ne fait que reprendre sa place dans le monde demeure prégnante. Tout comme celle d'associer intimement prospérité économique et intégrité territoriale. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi le gouvernement de la RPC est aujourd'hui soutenu par la majorité des Chinois, malgré la répression et les difficultés quotidiennes.
Peut-on s'appuyer sur la Chine, sinon pour construire un bloc alternatif aux États-Unis, du moins s'en servir comme point d'appui face à la puissance américaine ? Pour répondre, il faut revenir sur la manière dont la Chine s'est insérée dans l'ordre international actuel. Et rappeler quelques faits élémentaires : à la mort de Mao Zedong, la Chine ne possède pratiquement pas d'industrie, de capitaux et de technologie. Tout juste une main d'oeuvre qui sait lire et écrire, avec un taux d'alphabétisation qui avoisine les 60 à 75 %. Il s'agit d'un acquis remarquable si l'on garde à l'esprit qu'en Inde, à l'époque, seuls 40 à 42 % de la population maîtrise la lecture et l'écriture.
On dit parfois que Pékin menace de vendre ses dollars, mais il ne peut le faire du jour au lendemain : la valeur du billet vert diminuerait alors considérablement et paupériserait… ses détenteurs
Au sortir de la période maoïste, la Chine cherche un mode de développement, et lorgne du côté de Singapour ou du Japon – deux modèles capitalistes avec un degré variable d'autoritarisme. Elle se tourne vers l'Occident pour obtenir des investissements, mais avec une condition essentielle : elle exige des capitaux productifs, et non de simples capitaux financiers. Les Chinois deviennent ainsi rapidement en mesure d'exiger des transferts de technologie, comme ce fut par exemple le cas pour les investissements nucléaires français.
Heureuse coïncidence : cette ouverture de la Chine rencontre la vague de dérèglementation et de délocalisations qui frappe alors le « premier monde ». Pour le patronat occidental, il s'agit d'accroître ses profits par l'exploitation d'une main-d'oeuvre à bas coût et de pressurer les salaires européens et américains, contre une importation de biens chinois à prix modiques. Au fil du temps, la Chine se développe. Elle devient l'« atelier du monde », inondant la planète de produits finis. Mais elle n'en reste pas là et fabrique des biens de plus en plus sophistiqués, à « haute valeur ajoutée », comme les nomment les économistes. Au point de mettre en danger les multinationales occidentales, qui lui avaient fait la courte-échelle.
Avec cette stratégie, les dirigeants chinois ont gagné leur pari de développer leur pays, fût-ce à marche forcée, au prix d'une exploitation de la main d'oeuvre et d'un sabotage de l'environnement. Toutefois 800 millions de personnes sont sorties de la grande pauvreté, et plus personne n'y meurt aujourd'hui de faim.
Nouvelle lueur à l'Est ou « péril jaune » ?
La Chine a choisi le capitalisme – un capitalisme d'État, certes, mais un capitalisme tout de même, avec ses inégalités et ses crises cycliques. Elle n'a accouché d'aucun « modèle » alternatif. Et si elle peut faire figure d'exemple pour de nombreux pays en voie de développement pour la vitesse à laquelle elle s'est industrialisée, elle demeure fortement dépendante du reste du monde. Les États-Unis et l'Europe ne peuvent vivre sans marchandises chinoises, de même que les Chinois ont besoin des technologies occidentales.
Le degré d'interdépendance financière sino-américaine est tout aussi parlant. La Chine demeure le deuxième acheteur de la dette américaine, derrière le Japon. En janvier 2024, on comptait dans les caisses chinoises près de 800 milliards de dollars. On dit parfois que Pékin menace de les vendre mais il ne peut le faire du jour au lendemain : la valeur du billet vert baisserait alors considérablement et paupériserait… ses détenteurs. Ainsi, les Chinois financent les Américains, lesquels achètent des produits chinois, qui permettent en retour aux Chinois d'acheter de la dette américaine. Cette chaîne perverse, la RPC n'a pas réussi à la rompre, même si l'affrontement sino-américain actuel risque d'accélérer le découplage.
La Chine s'est ainsi insérée dans le système international sans barguigner, et ne souhaite nullement le remettre en cause : elle veut y avoir toute sa place, ce qui n'est pas la même chose. Retournement de situation : ce sont les États-Unis qui ne veulent plus de cet ordre international. Les Américains multiplient les mesures protectionnistes, ainsi que les subventions pour encourager les capitaux délocalisés à revenir sur leur territoire. De manière tout à fait extraordinaire, alors que pendant des années les États-Unis ont dénoncé le montant des subventions chinoises – supposément en contradiction avec les règles de la libre concurrence -, aujourd'hui ce sont eux qui, avec l'Inflation Reduction Act (IRA) financent la relocalisation de leur économie !Ils veulent y consacrer 369 milliards de dollars !
La Chine ne souhaite pas être le chef de file d'un camp. Elle n'est à la tête d'aucune alliance militaire. Elle demeure traumatisée par l'expérience soviétique, estimant que l'URSS a payé le prix de son positionnement « campiste »
Sur le plan des mesures protectionnistes, on a vu les Big Tech américaines s'allier à Donald Trump pour interdire ou taxer les produits de haute technologique venus de Chine. En plus, Washington brandit la dimension extraterritoriale du droit américain qui est une arme létale : il suffit, par exemple, qu'un produit français ait utilisé un seul composant chinois, dans une série de secteurs de haute technologie, pour que l'entreprise coupable tombe sous le coup des sanctions. Ou à l'inverse que cette société utilise un élément américain ou même un morceau de logiciel pour qu'elle ne puisse plus exporter son produit en Chine sous peine d'amende. Et l'on sait à quel point elles peuvent être sévères : BNP-Paribas a été condamnée à payer 9 milliards d'euros au Trésor américain en 2013 pour avoir commercé en dollars avec des pays sous embargo américain (et non de l'ONU), sans protestation notable des élites françaises…
Les États-Unis veulent garder leur avance technologique et bloquer les produits novateurs sur lesquels la Chine possède un avantage comparatif. Ils ont donc organisé un blocus total des semi-conducteurs de la dernière génération auquel participent Taïwan, le Japon et les Pays-Bas. Du jour au lendemain, les entreprises chinoises doivent se rabattre sur des semi-conducteurs moins performants. Dès 2019, le numéro un chinois des smartphones et de la 5G, Huawei, a vu son marché occidental s'effondrer, faute de puces performantes. Il s'est depuis requinqué au moins en Chine et dans le reste du monde, mais le coup fut rude. Si d'une façon plus générale, l'industrie chinoise est touchée par cet embargo, l'État a lancé un vaste plan de recherche-développement dans le domaine des semi-conducteurs et dans celui de l'intelligence artificielle, pour tenter de combler son retard et acquérir son indépendance. Gagnera-t-il son pari ? Trop tôt pour le dire.
Porte-avions à Formose et explosion des budgets militaires
Autre noeud des affrontements américano-chinois : Taïwan. Les États-Unis, sur cette question, agitent le chiffon rouge – ce qui ne veut pas dire que, dans ses rapports avec l'île, Pékin est blanc comme neige. Dans le Détroit de Formose, assez étroit, les médias parlent souvent des incursions d'avions et de navires chinois — réelles — mais rarement des avions militaires et porte-avions américains, et même un porte-avion français, qui y circulent régulièrement. Imagine-t-on la réaction américaine si un porte-avion chinois bordait les côtes américaines, entre la Floride et Cuba ? Ou si les Chinois installaient un système de surveillance à proximité à cet endroit, comme les Américains l'ont fait à Formose ? Ils ont même établi un contingent de forces spéciales sur la petite île taïwanaise de Kinmen (ou Quemoy) qui se situe à 4,5 kilomètres de la Chine continentale.
On ne peut que regretter l'alignement européen sur ces manoeuvres américaines. Reconnaissons au président Emmanuel Macron la justesse de sa position diplomatique lorsqu'il a rappelé la doctrine officielle de la France (qui est aussi celle de l'ONU) : il n'existe qu'une seule Chine – il est même allé plus loin, rappelant que Taiwan n'était pas une affaire française ni américaine.
À lire aussi...
Taïwan, à l'ombre des empires
Des provocations américaines de cette nature constituent un jeu dangereux, dans une région qui compte trois puissances nucléaires : Inde, Pakistan, Chine – et presque une quatrième, la Corée du Nord. Cet accroissement des tensions conduit à une escalade sans fin des budgets militaires. Rappelons que le Japon – à la Constitution « pacifiste » depuis 1945 – est en passe de multiplier son budget de défense par deux, essentiellement pour alimenter l'industrie américaine de défense. Il est de bon ton de s'extasier devant la croissance outre-Atlantique… en oubliant de rappeler le rôle qu'y tient l'armement, lui-même alimenté par les commandes des alliés des États-Unis.
Cette dynamique d'accroissement des tensions conduit à un rapprochement entre Russie et Chine. Ces deux pays ne sont pourtant pas des alliés naturels : gardons simplement à l'esprit les conflits sino-soviétiques qui ont failli dégénérer en guerre en 1969. C'est l'agressivité américaine actuelle qui les conduit au rapprochement.
La Chine et les BRICS, au-delà des fantasmes
La Chine souhaite-t-elle construire un bloc anti-occidental ? Les BRICS sont l'objet de tous les fantasmes. La dernière réunion de ce groupe a généré des commentaires médiatiques particulièrement fournis – et hostiles. On peut le comprendre : que ce groupe informel parvienne à se structurer, et à intégrer cinq nouveaux membres – Arabie Saoudite, Iran, Émirats arabes unis, Éthiopie et Égypte – mérite que l'on s'y arrête [NDLR : l'Argentine devait rallier les BRICS, mais cet agenda est devenu lettre morte depuis l'élection de Javier Milei].
Ce nouveau bloc possède de 45 à 55% des réserves pétrolières du monde, et près de la moitié des réserves de métaux rares. Ces matières premières s'échangent en dollars mais les BRICS souhaitent dé-dollariser le monde ou en tout cas commencer à s'en émanciper.
Il faut dire que la politique de sanctions tous azimuts des États-Unis conduit plutôt à fragiliser l'empire du billet vert. Que les États-Unis aient gelé les fonds souverains de Russie et expulsé ce pays du système SWIFT – une première mondiale – ont fait paniquer de nombreuses grandes fortunes. Personne ne se sent à l'abri – et certainement pas les pays qui carburent aux pétro-dollars, comme l'Arabie Saoudite. On comprend donc l'intérêt, pour les BRICS, de la Nouvelle banque de développement impulsés par Pékin, qui permet de commercer en monnaies nationales. Pour la Russie, la possibilité d'échanger sans dollar est fondamentale.
Certes, on est encore loin d'une dédollarisation, telle que la réclamait le Brésil lors du sommet des BRICS d'août 2023. Mais ces dynamiques ne devraient pas être balayées d'un revers de la main. Rappelons simplement que les BRICS, s'ils se coalisent, ont un droit de veto au FMI. Pour l'heure, cette condition n'a bien sûr rien d'évident : elle nécessiterait qu'Inde, Chine et Arabie Saoudite s'entendent pour défier les États-Unis… Les BRICS ont-ils le pouvoir d'édifier un nouvel ordre ? Non. Les BRICS ont-ils un vrai pouvoir de bousculer certaines règles ? Oui. Ce qui les unit, c'est simplement la volonté de se faire une place au soleil dans un système international conçu au temps où ils n'étaient que des nains économiques et politiques.
La Chine ne souhaite pas être le chef de file d'un camp. Elle n'est à la tête d'aucune alliance militaire – et c'est assez rare pour être souligné. Elle ne possède qu'une seule base à l'étranger, à Djibouti. Elle demeure traumatisée par l'expérience soviétique, estimant que l'URSS a payé le prix de son positionnement « campiste » et de sa militarisation. Elle cite souvent l'Organisation de Shanghai, qui réunit la Russie, la Chine, les pays d'Asie centrale, l'Inde et le Pakistan, etc, comme le modèle de sa conception du monde. Ces pays qui ne sont pas des alliés et sont parfois en conflits plus ou moins larvés, se parlent pourtant régulièrement dans ce forum et peuvent même faire avancer des dossiers communs. De plus, Pékin s'inscrit dans un temps long. C'est ainsi qu'il faut entendre la vision « multi-civilisationnelle » évoquée par Xi Jinping – ce qui ne manque pas de sel, lorsqu'on considère ce qu'il fait de la diversité culturelle au sein de son propre pays…
La Chine ne cherche pas à remplacer les États-Unis, comme puissance dominante. Elle veut offrir un modèle alternatif suivant de nouvelles normes de relations internationales, et retrouver la place qui était la sienne avant l'ère coloniale – si possible au centre du monde…
Note :
[1] Martine Bulard est journaliste, spécialiste de la région asiatique. Cet article est issu de son intervention à la conférence « Occident : fin de l'hégémonie » co-organisée par LVSL et l'Institut la Boétie. Martine Bulard y est intervenue aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Christophe Ventura et Didier Billion – ces deux derniers étant auteurs du livre Désoccidentalisation paru chez Agone (2023).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Même s’il évite la guerre civile, la crise finale d’Israël s’annonce cataclysmique !

En juillet 2021, commentant les avertissements prophétiques formulés par Albert Einstein dès 1948 sur l'avenir désastreux d'Israël, nous terminions notre texte par le constat et, en même temps, la prédiction suivants : « Malheureusement, tout montre qu'Einstein a eu de nouveau raison. Avec les Britanniques étant depuis longtemps un lointain souvenir, ce sont effectivement les épigones des « organisations terroristes » de 1948 qui inéluctablement conduisent Israël -qu'ils gouvernent- vers la « catastrophe finale » ! Un Israël qui peut se montrer maintenant plus puissant et arrogant que jamais, mais qui, en même temps, est en train de traverser sa plus grande crise existentielle de son histoire, pourrissant et se désintégrant à son intérieur. Le compte à rebours a déjà commencé et l'heure de la vérité approche... » [1]
Tiré du site du CADTM.
Peut-être plus vite que nous ne l'avions prévu, tout indique en ce printemps 2024, que l'heure de la grande vérité de l'État juif n'est pas seulement proche, mais qu'elle est déjà arrivée, qu'elle est là et qu'elle se déroule sous nos yeux ! Et les pronostics ne sont pas du tout optimistes. En Israël même, les premières voix commencent à se faire entendre, exprimant des doutes sur la viabilité de l'État d'Israël. Comme, par exemple, celles des auteurs du texte au titre éloquent « A ce rythme, Israël n'atteindra pas son centième anniversaire », qui a été reproduit et discuté ces derniers jours comme aucun autre en Israël et hors d'Israël. L'une des raisons de ce choc est que ses deux auteurs, Eugene Kandel et Ron Tzu, sont tous deux des membres éminents de l'establishment gouvernemental israélien, le premier ayant dirigé pendant des années le Conseil économique national de Netanyahou ! La deuxième raison, la plus importante, est que le document estime que, à moins d'un changement de cap radical de la part d'un personnel politique radicalement différent, la crise existentielle que les Israéliens commencent à vivre conduira à la fin d'Israël, ce qui signifiera nécessairement la fin aussi du « rêve sioniste »...
Ce n'est pas un hasard si, au moment même où l'on parle tant de la « solution à deux États » et où l'État palestinien commence à être reconnu même par des pays membres de l'Union européenne, des voix s'élèvent en Israël même pour parler d'une... « solution à trois États » ! En effet, à côté de l'État palestinien de demain, elles considèrent qu'il existe déjà - de facto - non pas un, mais deux États juifs ! C'est exactement ce que dit l'ancien diplomate Alon Pinkas lorsqu'il fait les constats suivants dans un article très récent dans Haaretz : « Il y a désormais, ici, deux États – Israël et la Judée –, avec des visions opposées de ce que doit être une nation. Il y a un « éléphant dans la pièce » et ce n'est pas l'occupation, bien que celle-ci en soit la cause principale. Cet “éléphant dans la pièce” est constitué par le fait qu'Israël est progressivement mais inéluctablement divisé entre l'État d'Israël – high-tech, laïc, ouvert vers l'extérieur, imparfait mais libéral – et le royaume de Judée, une théocratie suprémaciste juive ultranationaliste antidémocratique et isolationniste. »I.
Bien sûr, Pinkas, qui appartient au premier, à cet Israël moderne et « ouvert sur l'extérieur », a tendance à l'idéaliser et évite de tirer ses conclusions jusqu'au bout. Mais d'autres le font, notamment le vétéran de la gauche israélienne antisioniste Michel Warschawski, qui répond comme suit à la question de savoir s'il entrevoit la possibilité d'une guerre civile en Israël : « J'ai souvent été interrogé sur les risques d'une guerre civile : j'ai toujours dit que ce n'était pas possible.Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûr. Et ce n'est pas lié à Gaza. Il n'y a pas simplement deux Israël sociologiques. Nous sommes en présence de deux projets de société irréconciliables. Avec à la tête du pays le gouvernement le plus faible que nous ayons jamais eu, et Netanyahou incapable de contrôler des ministres qui pour certains sont des fous furieux ».
Nous pensons que Warshawski a raison à la fois lorsqu'il n'exclut plus la possibilité d'une guerre civile en Israël et lorsqu'il affirme que cela n'a rien à voir avec Gaza et le génocide en cours des Palestiniens. Certes, le fait est que le spectre du génocide et de la guerre plane sur Israël et sa société. Mais c'est aussi un fait que la grande, voire l'écrasante majorité des citoyens israéliens, des hommes politiques et de leurs partis se montrent, aujourd'hui encore, indifférents à l'incroyable souffrance que leur propre État inflige aux Palestiniens, alors même qu'ils manifestent contre Netanyahou et se heurtent parfois violemment à sa police. À l'exception de quelques petits groupes de citoyens qui perpétuent les vieilles traditions juives humanistes et internationalistes, en déclarant leur solidarité et leur soutien au peuple palestinien, la société israélienne ne veut ni entendre ni voir l'horrible tragédie qui se déroule à quelques kilomètres de ses villes et de ses kibboutz, faisant preuve de la plus monstrueuse insensibilité face au génocide en cours commis par sa propre armée et son propre État ! Et c'est pour cela qu'il se rallie - de facto - même à ce Netanyahou par ailleurs si détesté, lorsque, par exemple, la Cour Pénale Internationale ose lancer un mandat d'arrêt contre lui, tout comme il se rallie à l'État israélien lorsque certains pays européens osent reconnaître l'État palestinien...
Shlomo Sand, dans son dernier et magnifique livre « Deux peuples, pour un État ? », attribue cette monstrueuse insensibilité et ce tout aussi monstrueux « patriotisme », entre autres, au « lavage de cerveau » auquel les citoyens d'Israël sont systématiquement et méthodiquement soumis tout au long de leur vie afin de croire fermement que c'est... la volonté de Dieu que tous les territoires occupés, de Hébron, Jéricho et Bethléem à Jérusalem, soient israéliens ! C'est donc cette relation étroite entre messianisme nationaliste et messianisme religieux -qui non seulement a existé dès l'origine dans le projet sioniste, mais constitue le pilier idéologique central de l'État israélien, surtout depuis que la référence initiale à un certain « socialisme des kibboutz » mythique a été « jetée dans les poubelles de l'histoire »-, qui nous a fait constater il y a trois mois, que « cette actuelle ferveur exterminatrice de la société israélienne ne serait pas possible si elle n'était pas le produit et l'aboutissement de la logique interne du projet constitutif de l'État hébreu, du projet sioniste ! ». [2]
C'est donc pour toutes ces raisons que nous assistons aujourd'hui à des développements qui auraient été totalement inimaginables à la naissance d'Israël. Comme, par exemple, l'alliance du gouvernement israélien avec des antisémites notoires d'extrême droite ou même avec des leaders néo-fascistes de cette Internationale Brune en gestation, tels que l'Italienne Meloni, la Française Le Pen, l'Argentin Milei, le Hongrois Orban, le Portugais Ventura et plusieurs autres d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, qui se sont réunis il y a quelques jours à Madrid sous l'égide du Vox des nostalgiques du franquisme. C'est à ce rassemblement madrilène de ce ramassis fasciste, qui s'est transformé en une manifestation de soutien à Netanyahou, que le ministre israélien de la diaspora, Amichai Chikli a envoyé un message de remerciement et d'encouragement confirmant ce que nous savions depuis longtemps : que Netanyahou et l'extrême droite israélienne sont devenus le symbole et le drapeau des racistes, de l'extrême droite et des néo-fascistes du monde entier, dont la plupart continuent d'ailleurs à être des ...antisémites décomplexés !
La boucle du projet sioniste et en même temps de l'État juif d'Israël est donc en train d'être bouclé, dans une atmosphère non seulement de crise généralisée, mais aussi de décadence morale généralisée. Et ce n'est pas un hasard si son élément fondateur fondamentale, le racisme à l'égard des Palestiniens, coule aujourd'hui dans ses veines comme un poison au point de permettre aux ministres Gvir et Smotrich et à leurs amis colons et autres de parler de la nécessité d'expulser (violemment) de la terre de leur mythique Grand Israël (Eretz Israël) non seulement les Palestiniens mais même les citoyens israéliens juifs qui ne partagent pas leurs opinions et leurs choix barbares et inhumains !
Nous concluons donc comme nous avons commencé : il est désormais manifeste que le prix que paie l'Israël sioniste pour l'exhibition de son arrogance et de sa toute-puissance mesurée par les hécatombes de morts civils palestiniens à Gaza, est sa propre décadence morale et sa propre décomposition sociale et politique. Avec ou sans guerre civile, la crise finale d'Israël s'annonce cataclysmique.
Notes
[1] Voir notre article « Quand Einstein appelait « fascistes » ceux qui gouvernent aujourd'hui Israël » : https://www.pressegauche.org/Quand-Einstein-appelait-fascistes-ceux-qui-gouvernent-Israel-depuis-44-ans
[2] Voir notre article « Essayant de comprendre la dérive génocidaire de la société israélienne » : 22320
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La résistance palestinienne brouille les cartes du gouvernement israélien : Netanyahu face aux doutes de l’appareil militaire

Plus de sept mois après le déclenchement de la guerre et le début de l'offensive terrestre à Ghaza, la résistance palestinienne arrive à asséner des coups surprenants à l'armée israélienne. Mercredi dernier, une embuscade conjointe entre les éléments des brigades Al Qassam, affiliées au Hamas, et les brigades Al Qods de la faction du Djihad islamique, a fait entre 10 et 20 morts, selon des sources, parmi les troupes engagées dans des opérations dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de Rafah.
Tiré de Algeria-Watch
18 mai 2024
Par Mourad Slimani
Les porte-paroles de l'armée israélienne ont, dans un premier temps, avancé la thèse des « tirs amis » ayant résulté d'un manque de coordination à une phase de l'offensive, avant de reconnaître que les pertes ont été subies lors d'opérations conduites par les éléments du Hamas.
D'autres opérations, sur les bilans desquels les informations sont restées contradictoires, ont eu lieu depuis deux jours dans le périmètre, démontrant une fois de plus que malgré la puissance de feu criminelle et sans précédent lâchée sans discontinuation contre l'enclave palestinienne depuis plus de 220 jours, des foyers de résistance restent actifs, enlisant l'armée israélienne dans un conflit qui n'est pas prêt de connaître une issue.
La témérité de la résistance palestinienne se manifeste par des coups d'éclats non seulement dans ce nouveau front que constitue la région de Rafah, mais aussi dans certains points du nord de l'enclave de Ghaza théoriquement passés au peigne fin, les mois derniers et les semaines dernières, après avoir été complètement dévastés.
On ne sait pas si ce sont ces événements qui ont vaincu les dernières réticences du ministre israélien de la Défense à faire part publiquement des difficultés auxquelles fait face son armée sur le terrain, après sept mois de mobilisation extrême et, surtout, de l'incapacité du gouvernement à tracer un plan politique et un objectif clair à un déploiement militaire de plus en plus coûteux et de plus en plus incertain.
Ce faisant, Yoav Gallant, un des trois hommes qui composent le Cabinet de guerre, entre en confrontation directe avec Benyamin Netanyahu et sa garde rapprochée d'extrême droite, et donne un aperçu des failles qui se sont creusées au fil des déconvenues diplomatique et stratégique dans l'Exécutif aux commandes à Tel-Aviv.
« Efforts sisyphiens » à Ghaza
Le ministre de la Guerre a ainsi exprimé, dans une déclaration télévisée, son opposition au plan de contrôle militaire de Ghaza après la fin de la guerre, tel que préconisé par le Premier ministre, renouvelant sa préférence pour une autorité combinée associant des représentants de tribus arabes locales « non hostiles » et une coalition internationale dont il reste à définir les contributeurs.
Très peu élaborée, la proposition de Gallant semble plus viser une porte de sortie à l'armée du bourbier ghazaoui, d'autant que, argue-t-il, une présence sur la durée des forces israéliennes sur le territoire est synonyme de pertes supplémentaires dans les rangs et un coût social et économique que l'Etat hébreu aura du mal à assumer.
Sans le reconnaître ouvertement, il laisse entendre donc que l'objectif d'anéantir le Hamas et ses capacités militaires va rester hors de portée et qu'il faudra donc éviter de surexposer l'armée sur le terme par une occupation prolongée, ou définitive, de Ghaza. Quelques jours auparavant, un son de cloche aussi sceptique et polémique a été développé par le chef d'état major, lui-même gagné par le doute quant à l'efficacité de l'effort de guerre engagé à Ghaza sans perspectives politiques clairement déclarées sur le fameux « jour d'après » par le gouvernement.
Il aurait ainsi lâché, lors d'une entrevue avec le Premier ministre, que le gouvernement avait compromis l'armée dans des « efforts sisyphiens » et qu'il était temps de changer de fusil d'épaule. Les faits font suite à d'autres marques de défiance de l'appareil sécuritaire et militaire contestant ces dernières semaines la navigation à vue du gouvernement s'agissant de la durée prévisionnelle de la guerre, ainsi que sur ses objectifs tactique et stratégique.
Le roc de la résistance palestinienne
La réponse à cette montée au créneau est venue rapide et sans précautions de forme. Près d'une heure après les déclarations de Gallant, Benyamin Netanyahu rétorque qu'elles sont simplement « dénuées de substance » et qu'elles ne méritent donc pas d'être considérées au-delà de ce commentaire.
Le Premier ministre ajoute cependant qu'il n'est pas question d'envisager une alternative de gouvernance à Ghaza tant que le Hamas garde la moindre possibilité d'entreprendre des actions et que ladite alternative ne portera surtout pas le cachet du Fatah ni de l'Autorité palestinienne qui siège à Ramallah.
C'est la première fois depuis le début du conflit qu'une passe d'armes pareille oppose le sommet du gouvernement au département de la guerre ; le désaccord, en débordant l'obligation de confidentialité institutionnelle, atteste d'une tension qui accentue l'isolement de Netanyahu, certes, sans effets réels sur ses choix politiques pour le moment.
Encore une fois, il n'a dû compter que sur le soutien des forcenés de la coalition d'extrême droite. Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité intérieure et dirigeant du parti suprémaciste Force juive, dénonce les « visions défaitistes » du ministre de la Défense et appelle Netanyahu à le limoger sans tarder. Bezalel Smotrich, dirigeant du Parti sioniste religieux, ramassis de colons racistes et boulimiques, enjoint, lui, Yoav Gallant à démissionner immédiatement s'il ne partage pas les options du gouvernement.
Le ministre de la Défense, détenteur pourtant d'un palmarès fourni en actes et déclarations criminels contre les Palestiniens, dont l'appel à traiter les Ghazaouis « comme des animaux », au tout début de l'offensive, passe dans le contexte pour un tiède qui ne fait pas l'affaire, juste parce qu'il émet l'idée de ne pas occuper Ghaza. C'est dire la qualité du climat actuellement dans les rouages de décisions au sein de l'Etat hébreu et l'impasse dans laquelle le pousse l'héroïque résilience palestinienne.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Que se cache-t-il derrière l’accusation d’antisémitisme lancée contre Karim Khan ?

Si toute cette colère sioniste et pro-israélienne contre la position du procureur de la CPI, Karim Khan, indique quelque chose, c'est bien son importance, qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'historique. (Traduit de l'arabe.)
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
L'affaire était si évidente qu'il ne valait pas la peine de parier dessus. Il était tout à fait évident et absolument certain que la demande du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Ahmed Khan, d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre et le ministre de la « défense » israéliens conduirait l'establishment sioniste à lancer l'accusation d'antisémitisme à son encontre et à celle de la cour. Comme les chiens du savant russe Ivan Pavlov, qui ont confirmé sa célèbre étude du réflexe conditionné, Netanyahu et Gallant, ainsi que l'ensemble de l'élite du pouvoir sioniste, y compris Gantz, le chef du bloc d'opposition qui coopère actuellement avec le Likoud, le parti des deux inculpés et Lapid, le leader du principal bloc d'opposition qui refuse de les rejoindre, ont tous immédiatement et violemment condamné la position du procureur tout en la qualifiant d'« antisémite ».
C'est en effet à la quasi-unanimité que la classe politique sioniste – 106 des 120 membres de la Knesset, le parlement israélien (outre les dix membres des listes « arabes », les quatre députés du parti travailliste sont restés à l'écart du consensus sioniste en raison de leur forte hostilité à l'égard de Netanyahu) – a approuvé une déclaration condamnant le procureur et qualifiant son inculpation du gouvernement sioniste et des dirigeants du Hamas pour crimes contre l'humanité de « comparaison scandaleuse » qui constitue « un crime historique indélébile et une expression claire d'antisémitisme ». Netanyahu a vu dans sa condamnation par Karim Ahmad Khan une occasion de renforcer sa popularité en déclin en se présentant comme un symbole de l'État sioniste. Il a déclaré que « le mandat absurde et fallacieux du procureur de La Haye est dirigé non seulement contre le premier ministre et le ministre de la défense israéliens, mais contre l'État d'Israël tout entier ». Il a ensuite ajouté, s'adressant directement au procureur : « Avec quel culot osez-vous comparer les monstres du Hamas aux soldats de Tsahal, l'armée la plus morale du monde ? » La position de Netanyahu a été rejointe par Gantz, son partenaire au sein du cabinet de guerre israélien, qui a affirmé que l'armée israélienne « se bat avec l'un des codes moraux les plus stricts de l'histoire ».
Il est, bien sûr, d'un aplomb sans précédent de la part de quiconque de décrire les forces génocidaires sionistes comme « l'armée la plus morale du monde », mais cette impudence est devenue monnaie courante. Répéter cela en qualifiant d'impudente une critique des actions de l'armée sioniste, que la Cour internationale de justice a considérées comme relevant de la catégorie du génocide, porte le toupet à un paroxysme propre à Netanyahu et très difficile à égaler. Comme à son habitude, le premier ministre israélien a eu recours à ce que l'on appelle en anglais des insinuations par « sifflet à chien » en pointant indirectement la descendance de Karim Ahmed Khan d'une famille d'origine pakistanaise appartenant à la communauté musulmane Ahmadiyya. L'insinuation est apparue dans la déclaration de Netanyahu selon laquelle le « nouvel antisémitisme » – une expression souvent utilisée pour décrire l'hostilité envers l'État d'Israël lorsqu'elle est exprimée par des musulmans – « s'est déplacé des campus occidentaux vers la cour de La Haye » !
Si le Hamas avait ajouté à sa condamnation parallèle du procureur pour l'avoir mis sur le banc des accusés aux côtés du gouvernement sioniste, l'affirmation que la position de ce dernier reflétait la haine de l'islam (ou islamophobie), le monde entier se serait moqué du mouvement. Mais le Hamas ne revendique pas et ne peut pas revendiquer le monopole de la représentation des musulmans comme l'État sioniste revendique le monopole de la représentation des Juifs, avec l'approbation de la plupart des dirigeants occidentaux. Ainsi, bien que l'administration américaine se soit abstenue de qualifier la position de Karim Khan d'« antisémite », Biden n'a pas tardé à la qualifier de scandaleuse et à renouveler son engagement à « toujours se tenir aux côtés d'Israël contre les menaces à sa sécurité ». De son côté, son secrétaire d'État, Blinken, a réitéré la description de l'opération Déluge d'al-Aqsa menée par le Hamas comme « le pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste » – une description devenue un mantra dont le but est de dépeindre l'hostilité des Palestiniens envers les Israéliens comme une hostilité envers les Juifs inspirée par « l'antisémitisme » plutôt qu'une hostilité envers une persécution sioniste féroce qui insiste pour se décrire comme juive (pour plus sur ce sujet, voir mon article « Gaza : le 7 octobre en perspective historique »).
Si toute cette colère sioniste et pro-israélienne contre la position de Karim Khan indique quelque chose, c'est bien son importance, qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'historique. En effet, la CPI, depuis sa création jusqu'à présent, n'a traité que de plaintes contre des personnes originaires des pays du Sud mondial, du continent africain en particulier, en plus des dirigeants russes récemment inculpés en raison de l'invasion de l'Ukraine par leur armée. Il était devenu habituel de considérer cette cour, créée en 2002 au plus fort de l'hégémonie occidentale, comme l'un des outils politiques de l'Occident, au point que les familles de 34 Israéliens morts ou enlevés lors de l'opération Déluge d'al-Aqsa ont déposé une plainte contre le Hamas auprès d'elle, quelques jours après l'événement. Il est en effet très significatif que les seuls actes d'accusation émis par la CPI au sujet de l'Irak concernent l'organisation de l'État islamique et non l'armée et le gouvernement américains.
C'est donc la première fois que le tribunal inculpe deux dirigeants d'un pays considéré comme faisant partie du camp occidental, ce qui explique le ressentiment exprimé à l'égard de la position du procureur par le gouvernement américain et le gouvernement britannique, son fidèle partenaire (notamment dans l'occupation de l'Irak), ainsi que quelques autres gouvernements occidentaux. C'est pourquoi la position du procureur est très inquiétante aux yeux du gouvernement sioniste et de ses alliés les plus fidèles. Elle s'ajoute au procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour tourner la page de l'hégémonie occidentale sur les instances judiciaires internationales, en général, et confirmer la condamnation mondiale croissante du comportement criminel de l'État sioniste à la lumière de la guerre génocidaire qu'il mène à Gaza, en particulier.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe,Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 21 mai en ligne et dans le numéro imprimé du 22 mai. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël : côté obscur de l’armée la plus morale du monde entier

À Gaza, le nombre de morts atteint 36 000 et de blessés 80 000... Depuis deux semaines, environ 900 000 Gazaouis, soumis à d'incessants bombardements et attaques israéliens, quittent Rafah et se dirigent ailleurs à Gaza, cette fois où presque tout a été démoli et où trouver eau, nourriture, et abris s'avère quasi impossible...
Ovide Bastien
Alors que la famine devient chaque jour plus évidente, Israël non seulement restreint l'aide humanitaire qui entre à Gaza, mais ferme carrément celle qui entre de l'Égypte par Rafah et permet à des colons juifs, pour une deuxième fois en quelques jours, d'attaquer et saccager impunément des camions qui transportent de l'aide humanitaire en provenance de la Jordanie...
Le 20 mai le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, annonce qu'il fait la demande de mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou et de son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre – faim utilisée comme arme de guerre, notamment en privant les Gazaouis d'aide humanitaire, et ciblage intentionnel de civils, extermination – ainsi que de trois dirigeants du Hamas pour les atrocités commises le 7 octobre dernier – extermination, viols, prise d'otages.
Le même jour, le président Joe Biden, principal fournisseur d'armes à Israël, affirme aux étudiants qui, lors d'une cérémonie de graduation, l'accusent de complicité dans un génocide :
« Je sais que la situation vous brise le cœur, mais elle brise le mien aussi. » Et, commentant la décision de Karim Khan, il affirme, « Il n'y a pas un iota d'équivalence entre Israël et le Hamas. La décision de la CPI est choquante. Nous appuierons toujours Israël d'une main de fer. Il n'y a pas de génocide à Gaza ! »
Le 23 mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège annoncent que leur pays va se joindre aux 145 autres pays qui ont déjà reconnu la Palestine comme État. Le lendemain, la Cour internationale de justice, à la suite d'une nouvelle demande provenant de l'Afrique du Sud, ordonne à Israël de mettre immédiatement fin à son offensive militaire à Rafah, à son blocage de l'aide humanitaire à Rafah, et de permettre aux agences de l'ONU d'entrer à Gaza afin de pouvoir y réaliser des enquêtes.
Peu étonnamment, Benjamin Nétanyahou réagit avec colère. Des exemples éhontés d'antisémitisme, affirme-t-il. Des pays et des juges antisémites, qui se comportent comme ceux qui ont facilité l'Holocauste ! Nous avons l'armée la plus morale dans le monde entier ! Rien ni personne ne nous empêchera de nous défendre !
*************
De toute évidence, Israël se trouve de plus en plus isolée sur la scène internationale. Plus ces gestes concrets la noircissent, plus elle s'affirme pure et innocente et se présente comme LA victime du monde entier, que seul le géant étatsunien protège.
Dans ce qui suit, j'aimerais illustrer à lectrices et lecteurs un côté obscur d'Israël que m'a permis de découvrir la lecture d'un livre qui apparaissait à peine quelques semaines avant l'attaque violente d'Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, The Palestine Laboratory : How Israel Exports the Technology of Occupation around the World.
Rédigé par le journaliste juif australien Antony Loewenstein, ce livre montre comment Israël, dont la population dépasse à peine celle du Québec, est devenue, grâce à son appareil de sécurité et de technologies et tactiques sophistiquées développés pour maintenir le contrôle sur la population palestinienne, le dixième plus grand exportateur d'armes au monde ainsi qu'un leader dans l'exportation d'outils de surveillance, de répression et de contrôle. Drones, caméras de surveillance, logiciels comme Pegasus qui espionnent les cellulaires, reconnaissance faciale, systèmes de sécurité aux frontières, armes de contrôle des foules, etc., tous ces outils, affirme Loewenstein, ont été perfectionnés dans le creuset du conflit palestinien et sont désormais commercialisés et vendus aux gouvernements et aux forces de sécurité du monde entier. Que ces gouvernements bafouent systématiquement les droits de la personne, cela importe peu à Israël.
« Il existe aujourd'hui en Israël plus de trois cents multinationales et six mille start-ups qui emploient des centaines de milliers de personnes, » rappelle Loewenstein. « Les ventes sont en plein essor, les exportations de matériel de défense atteignant en 2021 un niveau record de 11,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 % en deux ans. Les entreprises israéliennes de cybersécurité sont également en plein essor, avec 8,8 milliards de dollars US obtenus dans le cadre de cent transactions en 2021. La même année, les entreprises israéliennes de cybersécurité ont reçu 40 % du financement mondial dans ce secteur. »
Les exemples que donne Loewenstein sont nombreux et fort troublants. En voici quelques-uns.
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud représente sans doute le cas le plus spectaculaire. Si Israël a été le plus grand et fidèle allié du régime d'apartheid dans ce pays, ce n'est pas seulement, rappelle Loewenstein, parce que ce dernier achetait beaucoup de ses armes. C'est aussi et surtout, insiste-t-il, en raison de la très forte communauté de pensée qui existait entre les deux. Ici, les Afrikaners se percevaient comme les civilisés, et ne voyaient chez les Noirs que barbarie, méchanceté, et terrorisme. Là, les Israéliens se perçoivent comme les civilisés, et ne voient chez les Palestiniens que barbarie, méchanceté, et terrorisme.
Il est assez révélateur que Nelson Mandela, dans son discours du 4 décembre 1997, affirmait : « Notre liberté ne saura être complète sans celle du peuple palestinien ».
Il est assez révélateur, aussi, que ce soit l'Afrique du Sud qui prenait l'initiative, décembre dernier, d'accuser Israël, auprès de la Cour internationale de justice, de génocide à Gaza.
Chili
J'étais au Chili au moment où la junte militaire renversait le gouvernement de Salvador Allende en septembre 1973. J'ai pu voir de mes yeux, au jour le jour pendant un an, la répression impitoyable – censure, torture, exécution sommaire, camps de concentration - qui s'abattait sur le peuple chilien. La dictature a duré 17 ans, a fait plus de 3 000 victimes, et a torturé plus de 40 000 Chiliens et Chiliennes. De centaines de milliers, afin de fuir la terreur, se sont réfugiés à l'étranger.
Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à Loewenstein, que j'apprends qu'Israël vendait des armes à la dictature. En 1976, le Congrès étatsunien décrétait un embargo sur les armes à destination du Chili. Loewenstein cite un télégramme, provenant de l'ambassade étatsunienne à Santiago le 24 avril 1980, où on reconnait qu'Israël, malgré l'embargo de son grand allié, non seulement continue à vendre des armes à la dictature, mais est même un de ses principaux fournisseurs !
L'Inde
Une communauté de pensée existe, selon Loewenstein, entre l'ethno nationalisme d'Israël et celui du régime de Narendra Modi en Inde, où les Musulmans sont perçus comme des citoyens inférieurs. À la suite d'un accord conclu en 2014 entre Israël et l'Inde, ces deux pays se sont engagés à collaborer en matière de sécurité publique et intérieure. Par la suite, plusieurs officiers, forces spéciales, pilotes et commandos indiens se sont rendus en Israël pour y suivre une formation. Entre 2015 et 2020, le principal marché d'exportation d'armes d'Israël est l'Inde, avec 43 % des ventes totales. Les drones israéliens Heron survolent le Cachemire, tout comme ils survolent les territoires occupés de la Palestine, affirme Loewenstein. Plusieurs militants israéliens des droits de l'homme, notamment Eitay Mack, ont adressé une pétition à la Cour suprême d'Israël en 2020, exigeant qu'Israël cesse de former des policiers indiens qui « aveuglent, assassinent, violent, torturent et font disparaitre des civils dans le Cachemire ».
Guatemala
Dans les années 1970s et 1980s, Israël a collaboré avec les États-Unis pour fournir un appui militaire, diplomatique et idéologique au régime génocidaire du Guatemala, affirme Loewenstein. Dans un pays où la majorité de la population est indigène, le gouvernement, poursuivant l'objectif intitulé ‘pacification des campagnes', a construit des ‘villages modèles' où les populations indigènes furent forcées de vivre. Celles-ci ont lutté contre cette répression, et environ 200 000 personnes, presque tous indigènes, ont été tuées entre 1960 et 1996.
L'un des moyens les plus efficaces utilisés par Israël pour aider le régime guatémaltèque a été l'installation d'un centre d'écoute informatique par la société privée israélienne Tadiran Israel Electronics Industries, poursuit Loewenstein. Devenu opérationnel à la fin de 1979, ce centre contenait les noms d'au moins 80 % de la population et pouvait détecter les changements dans l'utilisation de l'électricité ou de l'eau dans les maisons privées, ce qui permettait de repérer les activités antigouvernementales – par exemple, si une presse d'imprimerie était utilisée. Les médias israéliens rapportaient, précise Loewenstein, que l'objectif de ce centre était de « suivre les mouvements de la guérilla indigène dans la capitale ».
On sait que Ríos Montt, qui a géré le Guatemala de 1982 à 1983, a été condamné en 2013 à 80 ans de prison pour génocide et crimes contre l'humanité. Or, lorsqu'il a pris le pouvoir par un coup d'État le 23 mars 1982, les médias israéliens ont rapporté que des conseillers militaires israéliens avaient participé à ce coup. Et Montt a lui-même déclaré à un journaliste d'ABC, souligne Loewenstein, que si le coup d'État avait été un succès éclatant, c'est « parce que beaucoup de nos soldats avaient été formés par les Israéliens ».
La collaboration d'Israël avec Montt ne se limitait pas, cependant, à n'offrir que conseils et formation à ses militaires, poursuit Loewenstein. Le 6 décembre 1982, Montt commettait, dans le petit village indigène de Dos Erres, un des massacres les plus horribles et notoires de son règne. Environ trois cents personnes furent massacrées avec une brutalité choquante – crânes fracassés à coups de masse et corps jetés dans un puits.
« Toutes les preuves balistiques retrouvées correspondaient à des fragments de balles provenant d'armes à feu et de cosses de fusils Galil, fabriqués en Israël, » déclarait en 1999, la Commission vérité des Nations unies, après s'être rendue sur place pour exhumer les cadavres.
Colombie
Israël et les États-Unis ont formé et armé des escadrons de la mort en Colombie jusque dans les années 2000, affirme Loewenstein. « Les tristement célèbres fusils Galil de fabrication israélienne, autrefois utilisés dans le génocide guatémaltèque, se sont retrouvés chez des barons de la drogue colombiens à la fin des années 1980. Fabriquées par Israel Military Industries, rachetées par Elbit Systems en 2018, ces armes faisaient partie d'une présence israélienne beaucoup plus importante en Colombie, » poursuit-il. L'ancien trafiquant de drogue Carlos Castaño, qui dirigeait une force paramilitaire d'extrême droite, explique dans son autobiographie rédigée par un écrivain fantôme : « J'ai appris une quantité infinie de choses en Israël [dans les années 1980], et c'est à ce pays que je dois une partie de mon identité, de mes réalisations humaines et militaires. J'ai copié le concept des forces paramilitaires sur les Israéliens ».
L'ex-président colombien, Juan Manuel Santos a fait l'éloge de la société israélienne qui avait formé ses militaires, poursuit Loewenstein. Dans une émission de télévision israélienne, il déclarait : « On nous a même accusé d'être les Israélites de l'Amérique latine, ce qui me rend personnellement très fier. » L'émission mentionnait le raid colombien de 2008 en Équateur et l'assassinat du commandant en second des FARC, Paul Reyes.
Il est peu étonnant que le président progressiste de la Colombie, Gustavo Petro, soit un des critiques les plus virulents des actions génocidaires d'Israël à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le 1 mai 2024, il annonçait que son pays coupait tout lien diplomatique avec Israël.
La frontière entre les États-Unis et le Mexique
Les entreprises israéliennes de sécurité et de surveillance jouent un rôle important dans la protection de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Leur activité en Palestine s'avère, à cet égard, un outil précieux de promotion et commercialisation, affirme Loewenstein. La sécurisation de la frontière de 3 000 kilomètres bénéficie d'un grand soutien de la Maison Blanche, peu importe que celle-ci soit contrôlée par un Démocrate ou un Républicain. Et pour militariser cette frontière, on se sert fondamentalement de la technologie israélienne. L'objectif est de combiner la technologie de surveillance, l'infrastructure frontalière, les unités tactiques et le système de tours intégrées pour empêcher et dissuader les migrants d'entrer dans le pays et de traverser le désert mortel.
C'est l'objectif déclaré. Cependant, une telle militarisation de la frontière ne peut qu'aboutir à des morts, et en grand nombre, affirme Loewenstein. En constitue une preuve éloquente le fait que, depuis les années 1990, on ait retrouvé sept mille cadavres à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Palestiniens dénoncent un “massacre” à Rafah

L'Autorité palestinienne a accusé Israël d'avoir perpétré “un massacre” dimanche, en frappant un centre pour personnes déplacées à Rafah. L'attaque, qui a fait au moins 35 morts selon les autorités de Gaza, a été confirmée par l'armée israélienne, qui assure avoir visé “un quartier général du Hamas”.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Un incendie fait rage dans un centre pour personnes déplacées à Rafah, dans la Bande de Gaza, après une frappe israélienne, le 26 mai 2024. Photo Reuters TV / Reuters.
La présidence palestinienne a accusé Israël d'avoir ciblé “délibérément” un centre pour personnes déplacées, géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) au nord-ouest de Rafah, rapporte Middle East Eye.
“Cet atroce massacre perpétré par les forces d'occupation israéliennes est un défi à toutes les résolutions internationales”, a tonné l'Autorité palestinienne, trois jours après une décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires à Rafah.
Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a lui aussi “qualifié l'attaque de Rafah de massacre, tenant les États-Unis pour responsables, compte tenu de leur aide militaire et financière à Israël”, ajoute Middle East Eye. Selon les autorités de Gaza, aux mains du Hamas, l'attaque aurait fait au moins 35 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants.
“Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un énorme incendie sur le site, alors que les ambulanciers et les pompiers semblent avoir du mal à gérer la situation”, écrit CNN. “La zone ciblée comprenait un grand conteneur utilisé comme abri par des dizaines de familles, entouré de centaines de tentes”, ajoute la chaîne américaine.
Deux hauts responsables du Hamas tués
Selon Al-Jazeera, des dizaines de milliers de Palestiniens ont décidé d'installer leurs tentes dans cette zonne de Rafah, car le fait d'être “à côté d'un espace logistique de l'UNRWA” leur paraissait “plus sûr”. La chaîne qatarie précise que le feu s'est propagé à tout le secteur car “de nombreuses tentes sont en plastique et en tissu”.
“L'armée israélienne a confirmé l'attaque” mais a indiqué “avoir visé un quartier général du Hamas, où se tenait une réunion de haut niveau” du groupe armé, rapporte La Stampa. La décision de la CIJ publiée vendredi “semble donc avoir été inutile”, déplore le titre italien.
Le porte-parole de Tsahal a précisé que “deux hauts responsables du Hamas” avaient été tués lors de l'opération : “Yassin Rabia, responsable des opérations du Hamas en Cisjordanie, et Khaled Nagar, autre responsable du Hamas en Cisjordanie”, relève Ha'Aretz.
L'armée israélienne a également soutenu que les frappes avaient été menées “contre des cibles légitimes au regard du droit international, grâce à l'utilisation de munitions précises et sur la base de renseignements précis indiquant l'utilisation de la zone par le Hamas”. Elle a aussi concédé “avoir connaissance d'informations” selon lesquelles “un certain nombre d'individus non impliqués [avaient] été touchés” dans l'attaque et que “l'incident [était] en cours d'examen”.
“Isolement grandissant d'Israël”
Le New York Times souligne que les frappes israéliennes ont eu lieu “quelques heures après que le Hamas eut tiré plusieurs roquettes vers le centre d'Israël, déclenchant les sirènes d'alerte à Tel-Aviv pour la première fois depuis des mois”.
“Le Hamas se sent renforcé par l'isolement grandissant d'Israël et la pression internationale croissante pour que cesse l'offensive” sur Gaza, “malgré l'absence d'accord sur les otages”, analyse El Mundo. Un avis partagé par la BBC, pour qui “ce barrage de roquettes met en évidence la menace que le Hamas représente toujours pour la population d'Israël, même si aucun blessé n'a été signalé”.
La radiotélévision britannique remarque en outre que les événements de dimanche ont lieu “avant de nouvelles négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui devraient reprendre la semaine prochaine”, sous l'égide des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar.
Mais peu avant une réunion du cabinet de guerre dimanche soir à Tel-Aviv, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a assuré qu'il “[s'opposait] fermement” à la fin de la guerre dans les conditions actuelles.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.















