Derniers articles

Alerte à l’action : La guerre des mots du NYT : évitez la « Palestine », le « génocide », le « nettoyage ethnique »

Les rédacteurs en chef du New York Times ont publié une note de service à l'intention de leurs employés qui mettait en garde contre l'utilisation d'un « langage incendiaire et d'accusations incendiaires de toutes parts » – mais les instructions offertes par la note, qui a été divulguée à The Intercept (15/04/24), semblaient destinées à atténuer les critiques des actions d'Israël à Gaza et à renforcer le récit israélien du conflit.
18 AVRIL 2024
Tiré de Fair
JIM NAURECKAS
Photo :Bâtiment du New York Times à New York (Photo Creative Commons : Wally Gobetz)
Parmi les termes que le mémo demande aux journalistes du Times d'éviter : « Palestine » (« sauf dans de très rares cas »), « territoires occupés » (par exemple, « Gaza, Cisjordanie, etc. ») et « camps de réfugiés » (« désignez-les comme des quartiers ou des zones »).
Ce sont tous des termes classiques : « Palestine » est le nom d'un État reconnu parles Nations Unies et de 140 de ses 193 membres. Les « territoires occupés » sont la façon dont Gaza et la Cisjordanie sont désignées par l'ONU ainsi que par les États-Unis. « Camps de réfugiés » sont le nom qu'ils donnent à l'agence de l'ONU qui administre les huit camps de Gaza.
La note de service décourage l'utilisation des termes « génocide » (« Nous devrions... placer la barre très haut pour permettre à d'autres de l'utiliser comme une accusation ») et « nettoyage ethnique » (« un autre terme chargé d'histoire »).
Le génocide est défini par la Convention sur le génocide comme certains « actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel ». Ces actes comprennent le fait de « tuer des membres du groupe » et « d'infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique en tout ou en partie ». La Cour internationale de justice a statué en janvier qu'il était « plausible » qu'Israël viole la Convention sur le génocide (NPR, 26/01/24). Un juge fédéral américain a également statué que « le traitement actuel des Palestiniens dans la bande de Gaza par l'armée israélienne peut constituer de manière plausible un génocide en violation du droit international » (Guardian, 2/1/24).
Mondoweiss : Israël annonce sa fin de partie à Gaza : le nettoyage ethnique est considéré comme de l'« humanitarisme »
« Notre problème n'est pas de permettre la sortie, mais le manque de pays prêts à accueillir des Palestiniens », a déclaré Netanyahu à un allié du Likoud (Mondoweiss, 28/12/23) « Et nous y travaillons. » Au New York Times, vous n'êtes pas censé appeler cela un « nettoyage ethnique ».
Le « nettoyage ethnique » n'a pas de définition légale, mais il est certain que la campagne militaire israélienne qui a déplacé 85 % de la population de Gaza, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet qu'il « travaille » sur « l'émigration volontaire » de cette population (Mondoweiss, 28/12/23), est admissible selon n'importe quelle norme raisonnable.
Contrairement à son point de vue sur le « génocide » et le « nettoyage ethnique », le mémo soutient qu'« il est exact d'utiliser les termes « terrorisme » et « terroriste » pour décrire les attentats du 7 octobre » ; Cependant, les mots « combattants » ou « militants » sont déconseillés aux participants à ces attaques. C'est l'opposé de l'approche adoptée par des médias comme AP (X, anciennement Twitter, 1/7/21) etla BBC (10/11/23) ; John Simpson, rédacteur en chef des affaires mondiales de ce dernier, qualifie le « terrorisme » de « mot lourd de sens, que les gens utilisent à propos d'une organisation qu'ils désapprouvent moralement ».
Également sur la liste des termes approuvés par le Times : « l'attaque la plus meurtrière contre Israël depuis des décennies ». Apparemment, les journalistes n'ont pas de superlatifs à utiliser pour décrire l'agression israélienne contre Gaza, comme « l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire » (AP, 21/12/23), ou la « détérioration la plus rapide vers une famine généralisée » (Oxfam, 18/03/24), ou « la plus grande cohorte d'amputés pédiatriques de l'histoire » (New Yorker, 21/03/24).
« Notre objectif est de fournir des informations claires et précises, et le langage enflammé peut souvent obscurcir plutôt que clarifier le fait », indique le mémo, rédigé par la rédactrice en chef des normes du Times, Susan Wessling, et le rédacteur en chef international, Philip Pan, ainsi que leurs adjoints. « Des mots comme 'massacre', 'massacre' et 'carnage' véhiculent souvent plus d'émotion que d'information. Réfléchissez bien avant de les utiliser dans notre propre voix. La note de service pose la question suivante : « Pouvons-nous expliquer pourquoi nous appliquons ces mots à une situation particulière et pas à une autre ? »
Comme FAIR l'a noté dans une nouvelle étude(17/04/24), le Times applique un « langage enflammé » d'une manière résolument déséquilibrée. Lorsque les articles du Times utilisaient le mot « brutal » pour décrire une partie au conflit de Gaza, 73 % du temps, il était utilisé pour caractériser les Palestiniens. Une analyse par The Intercept (1/9/24) de la couverture de la crise de Gaza dans le Times (ainsi que dans le Washington Post et le Wall Street Journal) a révélé que
Des termes hautement émotionnels pour désigner le meurtre de civils, tels que « massacre », « massacre » et « horrible », ont été réservés presque exclusivement aux Israéliens qui ont été tués par des Palestiniens, plutôt que l'inverse.
Le terme « horrible » a été utilisé neuf fois plus souvent par les journalistes et les rédacteurs en chef pour décrire le meurtre d'Israéliens que de Palestiniens ; Le terme « massacre » décrit le nombre de morts israéliens 60 fois plus élevé que le nombre de morts palestiniens, et le terme « massacre » plus de 60 fois.
ACTION :
S'il vous plaît, demandez au New York Times de réviser ses directives sur la couverture de la crise de Gaza afin qu'il n'interdise plus les descriptions standard et ne mette plus hors de portée les caractérisations les plus précises des actions israéliennes.
CONTACT :
Lettres : Centre des lecteurs letters@nytimes.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le candidat Biden, entre progressisme sur l’avortement et impérialisme réactionnaire

L'élection présidentielle américaine pourrait dépendre de deux questions et des mouvements sociaux. Les attaques incessantes des Républicains contre le droit des femmes à l'avortement, dont la dernière en date a eu lieu en Arizona, devraient inciter davantage d'électeurEs à soutenir le candidat sortant lors de la prochaine élection présidentielle, mais cela suffira-t-il compte tenu de sa position sur Israël ?
Hebdo L'Anticapitaliste - 704 (18/04/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia commons / Fibonacci Blue from Minnesota, USA
La Cour suprême de l'Arizona, composée de sept membres nommés par les républicains, a statué le 9 avril que la loi de 1864 interdisant tous les avortements, à l'exception de ceux pratiqués pour sauver la vie de la mère, était à nouveau une loi de l'État. Cette loi a été adoptée avant que l'Arizona ne devienne un État et que les femmes n'y obtiennent le droit de vote, ce qui s'est produit en 1912. La loi de 1864, qui ne contient aucune disposition relative à l'avortement en cas de viol ou d'inceste, était restée en suspens jusqu'à ce que la décision Roe vs. Wade de la Cour suprême des États-Unis, qui prévoyait une protection fédérale de l'avortement, soit annulée en juin 2022.
L'Arizona est un État charnière crucial. Biden n'y a gagné qu'avec environ 10 000 voix d'avance sur Trump, soit une marge de 0,3 %. C'était la première fois qu'un candidat démocrate à l'élection présidentielle remportait l'Arizona depuis Bill Clinton en 1996, et la deuxième fois seulement depuis la victoire de Harry Truman en 1948. C'est pourquoi la décision de la Cour suprême de l'Arizona a horrifié les politiciens républicains et, malgré ses implications réactionnaires, enthousiasmé les démocrates, car les deux partis reconnaissent qu'elle aidera Biden et les démocrates lors de la prochaine élection présidentielle. Comme le disent Biden et sa colistière Kamala Harris dans leurs publicités télévisées, « c'est Trump qui a fait ça ».
Régressions et attaques répétées sur l'avortement
La décision de l'Arizona fait suite à un arrêt rendu au début du mois par la Cour suprême de Floride, qui a confirmé l'interdiction des avortements après six semaines de grossesse, une loi qui avait été adoptée par l'assemblée législative à majorité républicaine et signée par le gouverneur républicain Ron DeSantis. Étant donné que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes à six semaines, il s'agit en fait d'une interdiction totale des avortements. En Géorgie, la Cour suprême de cet État a pratiquement interdit la fécondation in vitro, ce qui a rendu plus difficile la tâche des femmes qui souhaitent recourir à la FIV. Tout cela montre clairement que les républicains représentent un danger pour les droits des femmes.
L'attaque des politiciens républicains contre les droits reproductifs des femmes, menée par la base chrétienne évangélique blanche du parti, a entraîné une forte réaction politique de la part des démocrates, des électeurEs indépendants et même de certains républicains. Au cours des trois dernières années, dans sept États politiquement différents — le Kansas, le Vermont, le Montana, le Michigan, le Kentucky, la Californie et l'Ohio —, les électeurEs ont, soit voté en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la législation de l'État, soit rejeté les tentatives visant à le pénaliser. Lors des élections de 2023, les démocrates ont remporté des élections législatives ou des élections au poste de gouverneur où ils apparaissaient comme des défenseurs du droit des femmes à l'avortement. La plupart des analystes estiment que l'attaque contre l'avortement incitera davantage de femmes, de jeunes et d'électeurs des banlieues à se rendre aux urnes pour voter en faveur de Biden et des démocrates en novembre.
Les électeurEs de Biden lui retirent leur soutien à propos de la Palestine
Dans le même temps, cependant, le soutien continu de Biden à Israël dans sa guerre génocidaire contre les PalestinienEs — au moins 33 000 morts, dont 13 800 enfants — pourrait lui coûter l'État du Michigan, un autre État crucial pour l'élection présidentielle. Trump a été victorieux dans le Michigan en 2016. En 2020, Biden a remporté le Michigan avec 154 000 voix d'avance. Mais l'État compte quelque 300 000 électeurEs musulmans ou arabes. Il semble désormais probable que Biden a perdu le soutien de dizaines de milliers d'électeurEs arabes et musulmans du Michigan, ainsi que d'autres électeurEs arabes, jeunes et noirs qui pourraient soit ne pas participer à l'élection, soit voter pour un parti tiers. La contradiction entre la posture progressiste des démocrates en matière d'avortement et leur politique étrangère réactionnaire et impérialiste pourrait conduire à la défaite de Biden.
Traduction d'Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. Face au duopole Biden-Trump, pourquoi n’y a-t-il pas d’alternative en 2024 ?

Ce n'est pas un secret que la plupart des électeurs et électrices des Etats-Unis sont insatisfaits du choix du grand bloc bipartite Biden-Trump pour l'élection présidentielle de novembre 2024. Et ce n'est pas un secret que les Américains souhaitent que le système politique leur offre plus de choix que le seul duopole démocrate-républicain. A l'automne dernier, un sondage Gallup a révélé que 63% des adultes états-uniens estimaient qu'un troisième parti était nécessaire parce que les grands partis ne parvenaient pas à représenter le peuple des Etats-Unis. Bien qu'il s'agisse du plus haut niveau de soutien à un troisième parti que Gallup ait perçu en 20 ans, le soutien à un troisième parti est resté à peu près à ce niveau depuis 2013.
Tiré de A l'Encontre
15 avril 2024
Par Lance Selfa
Jill Stein et Cornel West lors d'un entretien avec « New Politics ».
Avant 2013, les données de Gallup montraient une baisse du soutien à un troisième parti et une augmentation de l'opinion selon laquelle les principaux partis « font un travail adéquat » pour représenter le peuple des Etats-Unis lors des années d'élection présidentielle. Mais les choses ont changé depuis 2012, même si le comportement de l'électorat états-unien –qui se range derrière les deux grands partis lors de chaque année électorale – continue de refléter l'ancienne tendance.
Ce n'est qu'en 2016, lorsque l'électorat a dû choisir entre Hillary Clinton et Donald Trump, que les votes pour des partis autres que les Démocrates et les Républicains ont augmenté. Environ 5% des électeurs qui ont participé à l'élection présidentielle cette année-là ont choisi un troisième parti, comme les libertariens [Gary Johnson, Libertarian Party] ou les Verts [Jill Stein du Green Party], plutôt que Clinton ou Trump.
Les libéraux [gauche des démocrates] continuent de reprocher à Jill Stein, du Parti vert, d'avoir enlevé à Hillary Clinton des victoires dans des Etats clés en 2016, même si Clinton était une candidate déplorable qui a mené une campagne minable. Il est un peu fort de la part des responsables démocrates d'accuser Jill Stein [qui a obtenu 1,256 million de voix, soit 0,98% des suffrages] d'avoir permis à Trump de gagner dans l'Etat « charnière » du Wisconsin, alors que Hillary Clinton n'a pas fait campagne dans cet Etat pendant l'élection. On pourrait également affirmer que le libertarien Gary Johnson a retiré suffisamment de voix à Trump [4,489 millions de voix, soit 3,27% des suffrages] pour permettre à Hillary Clinton de remporter de justesse des Etats comme le Colorado, le New Hampshire, le Maine et le Nouveau-Mexique.
Tous ces calculs découlent de l'absurdité du choix d'un président basé sur les votes Etat par Etat d'un « collège électoral » [constitué au total par 538 grands électeurs ; l'élection présidentielle se fait donc au suffrage indirect] qui surreprésente les Etats conservateurs peu peuplés. Hillary Clinton a remporté près de 3 millions de voix de plus que Trump au niveau national en 2016. Pourtant, elle a perdu l'élection parce qu'environ 78 000 votes dans trois Etats ont donné la victoire à Donald Trump.
Les démocrates sont déterminés à ne pas répéter l'expérience de 2016 en 2024. Mais au lieu de s'efforcer de donner à l'électorat une raison de voter, ils font régner la peur au sujet de Trump et organisent une campagne de plusieurs millions de dollars pour disqualifier les candidatures de partis alernatifs (third party). Les démocrates ont rassemblé une « armée d'avocats » qui chercheront à dresser des obstacles juridiques sur la route des candidats alternatifs qui défient Biden.
« L'offensive juridique, menée par Dana Remus, qui a été jusqu'en 2022 la conseillère juridique du président Biden à la Maison Blanche, et Robert Lenhard, avocat indépendant du parti, sera assistée par une équipe de communication chargée de contrer les candidats dont les démocrates craignent qu'ils ne jouent les trouble-fêtes face à Joe Biden. Il s'agit d'une sorte de « Whac-a-Mole » [Jeu de la taupe : taper à l'aide d'un marteau sur les taupes en plastique qui sortent de manière aléatoire des trous de la console de jeu] juridique, d'un plan de contre-insurrection Etat par Etat avant une élection qui pourrait dépendre de quelques milliers de voix dans des Etats clés », a rapporté le New York Times le 20 mars.
Cette campagne a remporté sa première grande victoire au début du mois d'avril, lorsque le comité d'action politique No Labels [créé en décembre 2010 avec comme slogan « Not Left. Not Right. Forward »] a annoncé qu'il ne mènerait pas de campagne présidentielle en 2024. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais No Labels – l'émanation de lobbyistes de Washington qui s'imaginent que les électeurs américains aspirent à une alternative « modérée » aux partis du business « extrêmes » – n'a pas pu trouver un politicien traditionnel entrant dans le moule du défunt [en mars 2024] – et non regretté – sénateur Joseph Lieberman qui aurait accepté de figurer sur un ticket présidentiel.
Les démocrates s'intéressent désormais à la candidature indépendante de l'avocat écologiste et anti-vax Robert Kennedy Jr (RFK Jr.). Malgré l'appartenance de Robert Kennedy au célèbre clan Kennedy du Parti démocrate et ses antécédents en matière de protection de l'environnement, il est surtout connu aujourd'hui comme l'un des principaux pourvoyeurs de fausses informations sur les vaccins, dont le profil a été renforcé au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les démocrates craignent qu'il puisse jouer sur son nom et collecter suffisamment d'argent [avec l'appui de son épouse milliardaire] pour poser un défi à Biden au niveau de l'Etat fédéral.
Certains sondages effectués l'année dernière suggèrent que Robert Kennedy pourrait obtenir un résultat à deux chiffres, voire même atteindre les niveaux que le milliardaire cinglé Ross Perot a atteints en 1992. [Perot a obtenu environ 19% des voix au niveau national lors de l'élection contre le président sortant George H.W. Bush et le challenger Bill Clinton]. Néanmoins, il est peu probable que RFK Jr. obtienne un soutien supérieur à 2 ou 3% au total. En outre, sa campagne ne figure que sur les bulletins de vote de six Etats à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il s'est déjà présenté aux primaires démocrates, mais a abandonné après avoir échoué.
Néanmoins, les démocrates ne prennent aucun risque. Ils ont fait appel à presque tous les membres de la famille de Kennedy pour qu'ils le désavouent et mènent actuellement une campagne médiatique de dénigrement le visant. Le lobby libéral MoveOn.org, aligné sur les démocrates, a même embauché un membre de son personnel dont la description du poste comprend « l'aide à l'inoculation [vous voyez le jeu de mots ? – LS] des groupes progressistes et autres groupes non-MAGA » contre l'appel de RFK Jr. Candidat néophyte, RFK Jr. a fourni aux analystes des opposants au Parti démocrate un trésor de déclarations et d'apparitions dans les médias qui vont des étranges théories de la conspiration aux diatribes antisémites et racistes. Et quiconque pense que RFK Jr. est une alternative à Biden sur Israël et la Palestine se trompe.
Pour les socialistes engagés dans une alternative de gauche aux deux partis du monde des affaires, No Labels, RFK Jr. et les Libertariens n'offrent rien.
Mais deux autres campagnes vraisembables – la campagne du Parti vert de la Dresse Jill Stein et la campagne indépendante du professeur activiste Dr Cornel West [connu du monde des African-American studies] – offrent des moyens de protester contre le statu quo bipartisan. La question est de savoir dans quelle mesure ces campagnes nationales seront viables. Pour saisir le contenu des campagnes des Verts et de Cornel West, ainsi que leur relation, la contribution de l'écosocialiste et candidat au Parti vert en 2020 Howie Hawkins vaut la peine d'être lue (New Politics, hiver 2024, n° 76).
Comme le souligne Howie Hawkins, les Verts ont obtenu un peu moins d'un demi-million de voix lors des élections présidentielles de 2012 et de 2020. Mais leur total a grimpé à environ 1,4 million lors de la compétition Clinton-Trump de 2016 et, comme indiqué ci-dessus, ils ont obtenu des totaux significatifs dans des Etats clés comme le Wisconsin et le Michigan. Les Verts sont actuellement inscrits sur les listes électorales dans 20 Etats, tandis que Cornel West n'a pas encore réussi à se qualifier [chaque Etat détermine un certain nombre d'exigences et de délais pour le dépôt d'une liste qui permette que ce candidat figure sur le bulletin de vote de l'Etat, ce qui doit être acquis avant les primaires ou les caucus – réd.].
Un ticket commun Stein-West est une possibilité, note Howie Hawkins. Un ticket Stein-West soutenant la fin de la guerre à Gaza et la solidarité avec les Palestiniens, les soins de santé pour tous, les droits reproductifs et une « transition socialement juste » pour sortir d'une économie militarisée et basée sur les combustibles fossiles offrirait une alternative de gauche à des millions de personnes qui en ont assez du statu quo Biden/Trump.
Mais si un tel ticket représente une menace pour Biden, la puissance de feu des Démocrates actuellement dirigée contre RFK Jr. sera redirigée contre les verts et West. Une campagne soutenue par les verts devra également faire face à d'énormes pressions de la part de la « gauche large » pour qu'elle se retire face à la menace Trump – ou pour qu'elle se concentre uniquement sur des Etats comme la Californie ou l'Utah, où la victoire ou la défaite des Démocrates ne se jouera pas sur un nombre limité de votes.
Au fur et à mesure que le mois de novembre se rapproche, le soutien aux « third party » diminuera. Mais pour que les démocrates parviennent à étouffer toute alternative à un statu quo dirigé par Biden, il faut une indépendance politique vis-à-vis des partis capitalistes et la construction de mouvements sur les lieux de travail et dans les collectivités pour remettre en cause ce statu quo dans la pratique. (Article publié le 13 avril 2024 par International Socialism ; traduction rédaction A l'Encontre)
Lance Selfa est l'auteur de The Democrats : A Critical History (Haymarket, 2012) et éditeur de U.S. Politics in an Age of Uncertainty : Essays on a New Reality (Haymarket, 2017).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Joe Biden condamne les manifestations pro-palestiniennes dans les universités

De l'université Columbia (New York) à Yale (New Haven), en passant par l'université de Californie du Sud (Los Angeles), les campus américains connaissent un regain de tensions autour de la guerre entre Israël et le Hamas. De quoi pousser la Maison-Blanche à sortir de sa réserve, à la veille de la pâque juive.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Manifestation pro-palestinienne à proximité du campus de l'université de Columbia, à New York le 21 avril. Photo Bing Guan/NYT.
"Ces derniers jours, nous avons été témoins de harcèlement et d'appels à la violence contre des Juifs. Cet antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux, et il n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires, ni nulle part dans notre pays."
– Joe Biden
Alors que les manifestations propalestiniennes se multiplient sur les campus américains et que les tensions se cristallisent autour de la guerre à Gaza, le président américain, Joe Biden, a publié un communiqué, le 21 avril, à la veille de la pâque juive pour rappeler que l'antisémitisme n'avait “pas sa place” sur les campus, rapporte The Washington Post. Depuis le début du conflit, de nombreuses voix – en particulier chez les républicains – dénoncent une montée de l'antisémitisme dans les universités.
“Le président et la Maison-Blanche partagent souvent leurs vœux lors des fêtes religieuses, mais le dernier communiqué en date est notable en raison de sa portée politique, affirme le quotidien. Il remarquait que la fête de Pessah [la pâque juive] survenait à un moment difficile pour les Juifs, qui se remettent à peine de l'attaque du 7 octobre, quand les militants du Hamas ont tué environ 1 200 personnes dans le sud d'Israël et fait plus de 250 otages.”
Si le communiqué du président Biden ne cite pas nommément l'université Columbia, à New York, il intervient néanmoins “trois jours après qu'une centaine d'étudiants propalestiniens de l'université ont été arrêtés sur le campus par la police new-yorkaise”, rappelle le journal. Les étudiants protestataires dénonçaient la guerre menée par Israël à Gaza et réclamaient que l'université Columbia, qui a notamment un programme d'échanges avec Tel Aviv, boycotte toute activité en lien avec Israël.
La semaine dernière, “la présidente de Columbia, Minouche Shafik, avait également été appelée pour témoigner devant le Congrès sur l'antisémitisme au sein de son campus”, souligne le quotidien. Ce week-end, les étudiants de la prestigieuse université new-yorkaise “ont continué de se mobiliser et repris l'occupation du campus via un campement de fortune”, tandis qu'une opération similaire a eu lieu à l'université Yale.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pas de technologie pour l’apartheid : des employés de Google arrêtés pour avoir protesté contre le contrat de 1,2 milliard de dollars de l’entreprise avec Israël

Democracy now ! s'entretient avec deux des employé-e-s de Google qui ont été arrêtés alors qu'ils organisaient des sit-in mardi dans les bureaux de l'entreprise à New York et à Sunnyvale, en Californie, pour protester contre le travail du géant de la technologie avec le gouvernement israélien. Organisés par le groupe No Tech for Apartheid, les manifestant-e-s exigent que Google se retire du projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars pour fournir des services de cloud computing à l'armée israélienne. « Les dirigeants de Google ont essentiellement choisi d'arrêter les travailleurs pour s'être prononcés contre l'utilisation de notre technologie pour alimenter le premier génocide alimenté par l'IA », a déclaré Mohammad Khatami, ingénieur logiciel chez Google, qui a été arrêté à New York. Le travailleur-organisateur de Google, Ray Westrick, qui a été arrêté alors qu'il occupait le bureau du PDG Thomas Kurian, a déclaré que « de plus en plus de gens sont prêts à s'organiser et à risquer leur emploi afin de prendre position contre la complicité de génocide ». Nous nous sommes également entretenus avec Gabriel Schubiner, organisateur de No Tech for Apartheid et ancien employé de Google, qui appelle l'industrie de la technologie à se désinvestir des services de Google et d'Amazon. « Les travailleurs de la technologie ont en fait beaucoup de pouvoir pour changer ce paradigme et pour retirer la technologie de cette profonde complicité avec l'occupation israélienne », a déclaré Schubiner.
17 avril 2024 | tiré de democracy now !
https://www.democracynow.org/2024/4/17/no_tech_for_apartheid_google_israel
AMY GOODMAN : C'est Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je m'appelle Amy Goodman à New York et je suis Juan González à Chicago.
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à Democracy Now ! Mohammad, commençons par toi. Vous étiez, il y a quelques heures à peine, en prison...
MOHAMMAD KHATAMI : C'est juste.
AMY GOODMAN : ... dans le commissariat de police local. Expliquez pourquoi vous étiez prêt à vous faire arrêter.
MOHAMMAD KHATAMI : oui. Eh bien, plutôt que, vous savez, de considérer les demandes que nous soulevons depuis des années maintenant et d'écouter les travailleurs et de considérer les choses que nous avons soulevées, Thomas Kurian et les dirigeants de Google ont essentiellement choisi d'arrêter les travailleurs pour s'être prononcés contre l'utilisation de notre technologie pour alimenter le premier génocide alimenté par l'IA. Donc, nous étions prêts à nous faire arrêter pour cela, parce qu'à ce stade, nous ne voulons plus nous laisser mentir par nos supérieurs. Nous ne voulons plus être méprisés par nos supérieurs. Et nous voulions apporter cela aux bureaux et nous assurer qu'ils le comprenaient, oui.
JUAN GONZÁLEZ : Comment ressentez-vous le soutien que vous avez parmi les autres employés de Google, le degré d'insatisfaction à l'égard des politiques de Google ?
MOHAMMAD KHATAMI : oui. Je veux dire, Google a fait un très bon travail pour créer une culture de la peur et des représailles contre les travailleurs en général. Mais ce que nous avons remarqué était beau. Tant de gens sont venus à notre sit-in et ont manifesté leur soutien et ont senti qu'ils étaient inspirés par le travail que nous faisions, et qu'ils se sentaient inspirés à s'exprimer, ce qui est exactement ce que nous recherchions. Nous voulons que les travailleurs sentent qu'ils ont le pouvoir de choisir l'orientation de notre technologie et les personnes auxquelles nous contribuons. Donc je me suis senti vraiment heureux de voir ça, oui.
AMY GOODMAN : Ray Westrick, vous êtes sur la côte ouest. Vous avez été arrêté en Californie. Parlez-nous de ce projet Nimbus et des raisons pour lesquelles vous étiez prêt à vous faire arrêter, et quelle a été la réponse – étiez-vous dans les bureaux du PDG de Google Cloud ?
RAY WESTRICK : Oui, nous nous sommes assis dans le bureau de Thomas Kurian, le PDG de Google Cloud, pour protester contre le projet Nimbus, qui est un contrat de 1,2 milliard de dollars avec le gouvernement israélien et l'armée entre Google et Amazon. Nous avons également exigé la protection de nos collègues, en particulier de nos collègues palestiniens, arabes et musulmans, qui ont constamment fait l'objet de représailles, de harcèlement et de doxxing pour avoir parlé du projet Nimbus et, vous savez, de l'humanité des Palestiniens. Nous étions donc là en solidarité avec eux. Nous étions là pour protester contre le contrat, qui est en train d'être vendu directement – fournissant de la technologie directement à l'armée israélienne alors qu'elle inflige un génocide aux Palestiniens de Gaza. Et oui, c'est pour cela que nous avons choisi de nous asseoir dans le bureau de Thomas Kurian.
JUAN GONZÁLEZ : Et, Ray, pourriez-vous — y a-t-il eu une réponse de la part du PDG ou de son bureau ? Et craignez-vous de perdre votre emploi ? Pourquoi et quand avez-vous décidé de prendre cette mesure ?
RAY WESTRICK : oui. Nous n'avons reçu aucune réponse de la part du PDG. Et je pense qu'il est vraiment révélateur qu'ils préfèrent nous laisser rester assis là pendant plus de 10 heures et nous arrêter pour nous être assis pacifiquement dans son bureau plutôt que de voir les dirigeants s'engager dans nos revendications de quelque manière que ce soit. Nous n'avons donc reçu aucune réponse de la part du PDG et nous avons été expulsés de force par la police.
Et moi, travailler chez Google a été, vous savez, un honneur. J'aime vraiment mon équipe. J'adore le travail que je fais. Mais je ne peux pas, en toute conscience, ne rien faire tant que Google fait partie de ce contrat, alors que Google vend de la technologie à l'armée israélienne, ou à n'importe quelle armée. Et donc, c'était un risque que j'étais prêt à prendre, et je pense que c'est un risque que beaucoup de mes collègues sont prêts à prendre, parce que beaucoup de gens sont vraiment agités à ce sujet et ont toujours exprimé clairement leurs demandes et ont fait face à des représailles pour cela. J'ai donc choisi de m'asseoir, en connaissant les risques, par souci de l'utilisation de notre technologie, par souci de l'impact de notre technologie et par souci de mes collègues.
AMY GOODMAN : Pour notre auditoire radio, je voulais faire savoir aux gens que Ray porte un T-shirt sur lequel on peut lire « Googler contre le génocide », avec le mot « génocide » dans le célèbre multicolore de « Google », pour lequel il est si connu. Je voulais inviter Gabriel Schubiner dans cette conversation, un ancien ingénieur logiciel chez Google Research, un organisateur de la campagne No Tech for Apartheid, et vous demander – vous savez, nous vous avons eu il y a plus d'un an – c'était avant la dernière attaque d'Israël contre Gaza – de parler exactement de cela. Et vous étiez avec une organisation juive de travailleurs de Google à ce moment-là en train de vous exprimer. Parlez de toute l'histoire du projet Nimbus.
GABRIEL SCHUBINER : oui.
AMY GOODMAN : Et la résistance contre cela.
GABRIEL SCHUBINER : oui. Merci beaucoup.
Ainsi, le projet Nimbus a été signé en mai 2021 alors que des bombes étaient larguées sur Gaza, tandis que des Palestiniens étaient expulsés de Sheikh Jarrah et battus à la mosquée Al-Aqsa. C'était vraiment un moment – quand nous avons découvert le projet Nimbus, personnellement, pour moi, ce fut un tournant, où je ne me sentais plus capable de continuer à faire mon travail sans m'engager et m'organiser. Il y avait un groupe de personnes qui ressentaient la même chose, alors nous avons lancé une pétition. Nous avons été connectés, nous nous sommes mis en contact avec des travailleurs d'Amazon, avec des organisations communautaires, Jewish Voice for Peace et MPower Change, et nous avons lancé une campagne à partir de cela.
Je veux être clair : par exemple, la campagne est vraiment motivée par les préoccupations et les besoins des travailleurs concernant l'utilisation éthique de notre main-d'œuvre, ainsi que par les préoccupations directes sur le lieu de travail, comme les préoccupations en matière de santé et de sécurité liées au travail dans une entreprise qui facilite le génocide. Nous savions depuis longtemps que ce projet visait directement les militaires. Il a été rapporté dans la presse que Google donnait des formations directement à l'IOF. Nous savons que Google a donné des formations directement au Mossad. Nous savons que l'OIF —
AMY GOODMAN : Lorsque vous dites « OID », expliquez-le.
GABRIEL SCHUBINER : Je suis désolé, le... oui.
AMY GOODMAN : Parce que les gens ont l'habitude d'entendre « Tsahal », les Forces de défense israéliennes.
GABRIEL SCHUBINER : Oui, c'est vrai. Oui, ce sont les forces d'occupation israéliennes, juste pour indiquer, donc nous ne répétons pas leur message selon lequel leur répression vraiment agressive des Palestiniens est un acte de défense. Nous savons qu'il s'agit d'un acte d'occupation, alors nous disons « OID ».
Et donc, nous savions depuis longtemps que ce projet visait directement l'armée israélienne. Mais ce n'est que récemment, à travers ce dernier contrat que Google a signé directement avec l'IOF, que nous avons reconnu que Google doublait vraiment la mise, que ce contrat est directement destiné à faciliter l'utilisation militaire. Et nous savons que Google a été choisi par rapport à d'autres entreprises en raison de la technologie d'IA avancée qu'ils sont en mesure d'offrir. Donc, étant donné que nous avons appris comment les FOI utilisent l'IA dans cette guerre, nous voyons vraiment cela comme une campagne vraiment critique pour la libération de la Palestine.
Pour revenir à ce que vous avez dit au sujet de la résistance contre le projet, nous travaillons contre ce projet en tant que travailleurs depuis qu'il a été signé il y a trois ans. Nous nous sommes occupés de l'organisation. Nous avons fait, vous savez, de la construction de bases et de l'organisation du travail. Nous avons eu des protestations à l'extérieur et à l'intérieur. Nous avons signé des pétitions. Nous avons sensibilisé nos dirigeants par le biais de forums internes, de forums de discussion, par tous les moyens disponibles, parce que, je pense – vous savez, comprendre, comme, ce contrat est vraiment – comme, c'est vraiment un problème incroyable pour notre travail, comme, tout le travail des travailleurs chez Google. Tant de travailleurs contribuent directement à ce projet, parce que toute la technologie de Google est profondément liée les unes aux autres. Donc, oui, nous considérons que c'est vraiment important, oui.
JUAN GONZÁLEZ : Eh bien, Gabe, je voulais vous demander – à la personne moyenne, qui n'est pas un employé de Google, qui pourrait soutenir votre position et qui utilise Google plusieurs fois par jour dans le monde entier, que leur demandez-vous de faire ?
GABRIEL SCHUBINER : Droite. Donc, je veux dire, nous appelons tout le monde dans le monde à nous aider vraiment, comme, avec la sensibilisation, comme, nous aider à faire savoir que Google est un profiteur de guerre. Je pense que Google est profondément ancré dans la vie des gens, n'est-ce pas ? — qu'il est difficile de demander un boycott. Mais je pense que nous appelons spécifiquement les gens de l'industrie de la technologie à se désinvestir de Google et d'Amazon. Les services Google Cloud et Amazon Web Services sont à la base d'une grande majorité d'Internet, mais il existe d'autres options. Ainsi, les travailleurs de la technologie ont en fait beaucoup de pouvoir pour changer ce paradigme et, par exemple, pour retirer la technologie de cette profonde complicité avec l'occupation israélienne.
AMY GOODMAN : Mohammad Khatami, pouvez-vous nous parler de vos propres antécédents familiaux et des raisons pour lesquelles vous vous souciez particulièrement de ce qui se passe à Gaza en ce moment ?
MOHAMMAD KHATAMI : Oui, oui. Donc, je viens d'une famille musulmane. J'ai été élevé dans la religion musulmane. Et c'est vraiment difficile de se réveiller en voyant les images d'enfants massacrés et de savoir que votre — vous savez, le travail que vous faites contribue à cela. J'ai perdu le sommeil. Il a été extrêmement difficile de se concentrer sur le travail et de penser que vous travaillez pour quelque chose qui contribue au massacre de masse qui a lieu. Et pour m'être prononcé contre cela, on m'a littéralement traité de partisan du terrorisme, ce qui est quelque chose qui...
AMY GOODMAN : Appelé par ?
MOHAMMAD KHATAMI : Vous savez, par des collègues, des RH et des gens de l'entreprise, un partisan du terrorisme, ce qui est, vous savez, quelque chose – c'est comme une insulte de cour d'école. C'est quelque chose que je n'ai pas entendu depuis le collège. Et ce n'est qu'un exemple des représailles, du harcèlement et de la haine auxquels nous sommes confrontés simplement parce que nous dénonçons l'utilisation de notre travail de cette manière.
AMY GOODMAN : Craignez-vous de perdre votre emploi ?
MOHAMMAD KHATAMI : Absolument. Mais ce n'est pas le cas – ce n'est même pas important pour moi du tout par rapport à travailler pour quelque chose qui a du sens et qui a un bon impact sur la planète. Je ne veux pas être associé à ce génocide. Et j'espère que Google changera d'avis à ce sujet également.
AMY GOODMAN : Et enfin, Ray Westrick, où voyez-vous ce mouvement aller à partir d'ici ? Et pouvez-vous nous en dire plus sur l'alliance judéo-musulmane autour de cela parmi les travailleurs de Google et les anciens travailleurs de Google ?
RAY WESTRICK : oui. Je ne vois que ce mouvement grandir et continuer à faire pression. Nous avons reçu tellement de soutien pendant le sit-in. J'ai reçu tellement de messages personnels de gens, vous savez, me remerciant de m'être exprimé, et me demandant comment ils peuvent être plus vocaux et s'impliquer davantage. Je pense donc que c'est en pleine croissance. Je pense que Google sait que cela va continuer, que, vous savez, les travailleurs sont très agités à ce sujet et continueront à s'exprimer et à faire pression. Et je pense que c'est pour ça qu'il était important pour eux de nous faire taire. Mais ce mouvement prend de l'ampleur, et de plus en plus de gens le découvrent, et de plus en plus de gens sont prêts à s'organiser et à risquer leur emploi pour prendre position contre la complicité de génocide.
AMY GOODMAN : Eh bien, je tiens à remercier...
RAY WESTRICK : Et oui, je pense que cela a été une campagne vraiment unificatrice pour les gens de tous les horizons. Et je sais, en particulier, que beaucoup d'entre nous se sont rassemblés parce que nous étions particulièrement préoccupés par la façon dont Google a traité et exercé des représailles contre nos collègues palestiniens, arabes et musulmans, en particulier, comme Mohammad l'a mentionné, beaucoup d'entre eux ont été victimes de harcèlement et de doxxing pour s'être exprimés sur les canaux appropriés chez Google et ont été constamment ignorés, harcelés et victimes de représailles. Et donc, nous avons dû nous rassembler pour dire que nous ne pouvions plus laisser cela se produire. Nous devons nous unir pour protéger nos collègues et les uns les autres et pour protéger l'utilisation éthique de notre technologie, afin de nous assurer que nous ne construisons pas une technologie qui est utilisée pour nuire. Donc, je pense que c'est une campagne vraiment unificatrice qui est vraiment fondée sur le fait de prendre soin les uns des autres et sur le fait d'avoir un impact positif et de ne pas faciliter plus de dommages avec la technologie.
AMY GOODMAN : Je tiens à vous remercier tous d'être avec nous. Ray Westrick et Mohammad Khatami sont tous deux des employés de Google qui ont été arrêtés hier, Ray dans les bureaux du PDG de Google Cloud à Sunnyvale, en Californie, et Mohammad ici à New York. Il y a aussi Gabriel Schubiner, un ancien ingénieur logiciel chez Google Research et un organisateur de la campagne No Tech for Apartheid, avant cela, avec Jewish Diaspora in Tech.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand les crues engendrent la soif : la lutte pour l’eau au Pakistan

Le Pakistan est le cinquième pays le plus touché par le réchauffement climatique. À l'été 2022, le pays a subi de fortes inondations aux effets encore vifs aujourd'hui. En conséquence, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a repris son activité dans le nord du Sind en 2023 afin d'accompagner les communautés pakistanaises dans le renforcement de leur résilience face aux catastrophes climatiques.
Tiré du blogue de l'auteur.
1- Le Pakistan est la victime régulière d'une multitude de catastrophes naturelles telles que les inondations, sécheresses et tremblements de terre. En juillet 2022, le gouvernement pakistanais a déclaré subir « l'évènement climatique du siècle » : les provinces du Sind, du Balouchistan et de Khyber Pakhtunkhwa ont subi des précipitations record, causant d'importantes inondations responsables de la mort de plus de 1 700 personnes et affectant directement 33 millions de personnes, selon les Nations Unies.
Aujourd'hui, les effets de ces inondations se font encore sentir. Les crues ont en effet causé des dégâts importants et durables à travers le pays, particulièrement éprouvants pour les populations vivant en zones rurales. Les inondations s'ajoutent à une série de crises qui perdurent : augmentation de la pauvreté, insécurité alimentaire à long terme, propagation de maladies comme le paludisme et la typhoïde, et perturbation de la scolarité de millions d'enfants.
Ghous Baksh, 6/12/2023
2- La période de la mousson est vitale pour le Pakistan. Elle fournit chaque année une grande partie de l'eau nécessaire aux cultures pendant la saison de croissance. Mais le réchauffement climatique rend cette période de plus en plus intense et imprévisible.
À l'été 2022, des pluies de moussons sept fois supérieures à la moyenne, conjuguées à la fonte rapide des glaciers himalayens desquels découlent les rivières, ont été dévastatrices. En s'abattant sur des sols asséchés par une canicule inhabituellement forte et prolongée au printemps, les intempéries ont transformé les ruisseaux et rivières dévalant les montagnes en fleuves de boue, de bois et de débris des infrastructures détruites par les eaux.
Plusieurs mois après ces pluies, les provinces du Sind et du Baloutchistan, les plus touchées du pays, n'étaient toujours pas entièrement libérées de l'eau qui les avait submergées. Six mois après les crues, près d'1,8 million de Pakistanais vivaient encore à proximité d'eaux de crue stagnantes, les exposant, à long terme, à un risque accru de maladies liées à l'eau. Les ménages les plus pauvres, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées sont les plus exposés. Dans les zones les plus touchées, on recense des cas de malnutrition, maladies diarrhéiques, paludisme, maladies de la peau ou encore infections des voies respiratoires.
Ramzanpur, 4/12/2023
3- Dans le 5e pays plus gros producteur de coton au monde, les inondations ont aussi affecté matériellement la population, qui a vu ses opportunités économiques s'envoler et ses revenus disparaitre. Les pluies ont dévasté plus de 600 000 hectares de culture de coton selon les autorités pakistanaises, notamment sur la rive gauche du fleuve de l'Indus. Il en va de même pour les cultures de riz et de blé sur la rive droite où près de la moitié des champs ont été engorgés. Les éleveurs non plus n'ont pas été épargnés. Plus de 700 000 têtes de bétails ont péri à travers le pays d'après les autorités nationales qui estiment à 10 milliards d'euros les pertes subies par le pays.
En conséquence directe des inondations, la Banque mondiale estime que près de 9 millions de personnes risquent de tomber sous le seuil de pauvreté, s'ajoutant ainsi aux 44 millions de Pakistanais vivant déjà sous ce seuil. Il en va ainsi d'Allah Rakhio qui, faute d'argent, a dû quitter sa maison à la suite des inondations dans l'espoir de rejoindre des terres épargnées par les eaux. En vain. À son retour chez lui, 40 jours plus tard, et sans avoir pu s'installer ailleurs, tout avait disparu. « Nos cultures, prêtes à être récoltées, ont été détruites et nos maisons ont toutes été volées. » déclare-t-il, amer, devant une situation qui se répète sans cesse. « Nous sommes rentrés chez nous sans rien. Nous avons travaillé dur, puis il a plu à nouveau. Les toits et les murs [de nos maisons] ont été détruits. ». À l'image d'Allah Rakhio, près de 20,6 millions de Pakistanais ont aujourd'hui un besoin urgent d'aide humanitaire, d'après l'UNICEF.
Ramzanpur, 4/12/2023
4- La montée des eaux a rendu très critiques les conditions d'hygiène dans certains villages, du fait du manque de système d'assainissement. En emportant des débris, de la boue, et d'autres substances, les inondations contaminent les sources d'eau potable, les rendant impropres à la consommation humaine. « Les inondations ont détruit notre environnement ; notre eau a été contaminée. Des maladies comme la malaria et la diarrhée se sont répandues. » relate Aijaaz aux équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL présentes dans le village de Ghous Baksh pour conduire une évaluation des besoins sur place. Dans les zones où l'ONG mène cette évaluation, la moitié des villages déclarent ne plus avoir accès à l'eau potable.
En se propageant, les inondations submergent les systèmes d'égouts et de drainage, ce qui entraîne des débordements et la contamination des points d'eau à proximité. D'ailleurs, la plupart des points d'eau (puits, réservoirs, stations) ont été inondés et sont soit détruits soit grandement endommagés (fissures, ruptures) ce qui compromet leur capacité à fournir de l'eau potable aux populations. « Nous avons besoin de nouvelles pompes manuelles, d'eau douce et d'un environnement propre. » explique Aijaaz.
Ghous Baksh, 6/12/2023
5- Devant des besoins en eau, hygiène et assainissement clairement identifiés, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont lancé des activités dans les zones les plus affectées du Nord de la province du Sind.
L'ONG travaille ainsi à la construction et la réhabilitation de points d'eau, en veillant à leur élévation afin de prévenir des contaminations des eaux souillées au sol et protéger les infrastructures. « SOLIDARITÉS INTERNATIONAL nous a fourni des pompes manuelles. Nous avons maintenant de l'eau propre et la pompe à eau est placée à l'intérieur de notre maison » explique Waziran, habitante du village de Ghaus Bux, dont les enfants étaient tombés malades du fait de l'eau impure. Au total 40 pompes manuelles ont été installées.
Ghous Baksh, 6/12/2023
6- Une première action d'urgence à mettre en place pour assurer la salubrité d'une zone habitée est la réhabilitation de latrines. « Un moyen pour nous de prendre soin de notre santé et de notre hygiène » assure Imam Zaadi après la reconstruction de ces latrines détruites par les inondations.
Au premier trimestre 2023, 12 villages ont pu bénéficier de l'aide de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. On dénombre 468 latrines construites. Un résultat qui permet de garantir la sécurité et la salubrité de l'environnement mais aussi et surtout la dignité des hommes, femmes et enfants qui y vivent.
Les prochaines interventions permettront de viser environ 15 000 personnes afin d'améliorer leur accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. À l'image du point d'eau et des latrines construits dans le village de Ghous Baksh où vit Imam Zaadi : « nous sommes mieux protégés de toutes ces maladies et nous menons aujourd'hui une vie beaucoup plus saine. »
Ghous Baksh, 6/12/2023
7- Dans les premiers mois suivants les inondations, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées selon les Nations Unies. Si certaines sont retournées dans les villages dévastés par les inondations, toutes ont dû faire face à un état de dénuement presque total. C'est pour pallier le manque de ressources de première nécessité que SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a fourni des kits de santé, d'abris et de nourriture. Plusieurs centaines de kits d'hygiène ont été distribués. Ici, Mohammad Shoaib en liste le contenu aux cotés de Noor Jahan, bénéficiaire de cette distribution. Dentifrices, brosses à dents, savons ou encore serviettes hygiéniques constituent une première aide d'urgence pour les ménages les plus en difficulté. « L'ONG nous a guidés sur la santé et l'hygiène, nous a parlé de la prévention des maladies et nous a fourni des kits d'hygiène. » explique Abdul Ghaffar.
Point de distribution, 7/12/2023
8- Les inondations destructrices de l'été 2022 ont eu lieu dans un contexte de grave crise économique, compliquant la capacité des Pakistanais à répondre à leurs besoins vitaux. En outre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que presque la moitié de la population rurale se trouverait en phase d'insécurité alimentaire. Si plus d'un millier de kits alimentaires ont été distribués aux populations les plus vulnérables dans les premiers temps de l'urgence, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL cherche aussi à accompagner les populations dans la durée.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL concentre son action sur le renforcement de la production agricole locale, en fournissant un soutien à l'élevage. Elle cherche également à soutenir les mécanismes d'adaptation au changement climatique dans les zones rurales, ce qui renforce la résilience des populations et réduit la pauvreté à long terme. Cela implique d'améliorer l'accès à des moyens de subsistance durables, de développer les compétences et les opportunités d'emploi, tout en élargissant le soutien aux secteurs tels que l'élevage, la volaille, la pêche, les entreprises artisanales et l'artisanat.
Point de distribution, 7/12/2023
9- Renforcer la résilience des communautés vulnérables aux effets du changement climatique est un objectif clef de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Pour cela, l'ONG collabore avec des partenaires locaux qu'elle forme, afin de développer des compétences locales déjà présentes. Sur la vingtaine de salariés de l'ONG sur place, seuls deux sont des staffs internationaux, le reste étant constitué de Pakistanais et Pakistanaises.
L'ONG conduit des ateliers de sensibilisation aux connaissances et bonnes pratiques en matière de nutrition, de santé et d'hygiène. Ces ateliers contribuent à réduire le taux de maladies évitables et à améliorer la qualité de vie globale des populations locales.
Sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, village Basham Jakhrani, 7/12/2023
10- « [SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a] créé un comité, dont je suis membre, et nous résolvons nos problèmes quotidiens grâce à une contribution collective » raconte Abdul Ghaffar. Un tel comité permet d'intégrer pleinement les habitants à la prise de décision et de travailler à la résilience des populations sur le long terme. Au Pakistan, les inondations seront nécessairement amenées à se reproduire. Violentes, désastreuses, meurtrières, elles ne doivent toutefois pas occulter que le pays s'apprête à souffrir de nombreuses sècheresses et d'un manque cruel d'eau potable dans les années futures. Réunir les communautés vulnérables au changement climatique et travailler à leurs côtés permet de renforcer leur résilience en garantissant la continuité de l'approvisionnement en eau. Surtout, cette méthode permet de souligner l'ultra nécessité de la préservation de l'eau et d'accompagner ces communautés dans les initiatives intelligentes face au climat qu'elles sont les premières à porter.
Village Sher Ali, 8/12/2023
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Inde : ce sont les mouvements populaires, et non les élections, qui apporteront un changement transformateur

À l'exception d'une brève période, l'Inde a eu la chance, plus que bien d'autres nations, de garder un régime parlementaire au cours des 77 dernières années. Avec 900 millions d'électeurs, soit plus que les populations de l'Europe et de l'Australie réunies, les élections indiennes sont considérées comme la plus grande vitrine et célébration de la démocratie. La croissance économique du pays au cours des 30 dernières années - l'une des plus rapides au monde - rend également les élections dignes d'intérêt à l'échelle mondiale.
Tiré d'Inprecor 719 - avril 2024
19 avril 2024
Par Sushovan Dhar
L'Inde est incontestablement à la pointe de l'expansion capitaliste mondiale, même si ce processus a entraîné une augmentation massive des inégalités. Les proportions de cette inégalité rappellent les jours les plus sombres de l'ère coloniale.
La « magie Modi »
À l'instar de ses prédécesseurs d'extrême droite et fascistes, le Premier ministre indien Narendra Modi peut rassembler des foules considérables, en adoration, tant dans son pays qu'à l'étranger. Auparavant, élément clé des coalitions au pouvoir, son parti, le BJP, a remporté des victoires électorales remarquables depuis 2014, sous sa direction très personnalisée. En mettant l'accent à la fois sur le nationalisme hindou et sur le néo-développement, il a également réussi à établir une domination idéologique. L'analyse détaillée des positions nationalistes du BJP dépasse le cadre de cet article. Mais nous pouvons affirmer que le parti a créé un nouveau récit nationaliste largement accepté par une grande partie de l'électorat. En outre, le BJP a également été en mesure de définir et d'affiner le discours sur l'économie et la croissance économique.
La stratégie du BJP s'articule autour de quelques éléments clés. Tout d'abord, l'administration Modi est résolument favorable aux entreprises, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises appartenant à des Indiens. Il a également habilement lié le prestige de l'Inde à l'étranger à cette libération des entreprises indiennes. Par exemple, après son élection en 2014, Modi s'est audacieusement engagé à propulser la position de l'Inde dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires dans les 50 premiers rangs mondiaux. L'Inde est classée 63e sur 190 économies dans le dernier classement annuel de la Banque.
Deuxièmement, Modi a réussi à s'afficher comme meilleur réformateur anti-corruption. Il a su transformer des initiatives, pourtant essentiellement inefficaces, en succès médiatiques grâce à sa maîtrise de la harangue publique et de la gestion des messages. Troisièmement, l'auto-projection du Premier ministre en tant que créateur de l'État-providence contemporain en Inde trouve un écho auprès des électeurs. Toutefois, ces développements ont suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie dans le pays.
Défauts systémiques
Le système électoral indien présente de nombreuses failles systémiques. Le système électoral uninominal à un tour (ou winner-take-all), établi par la Constitution indienne sur le modèle de Westminster [le Parlement à Londres], a été l'une des principales lacunes. Auparavant, il avait continué à donner au Parti du Congrès d'énormes majorités parlementaires, alors même que sa part du vote populaire commençait à diminuer. Le BJP en a profité et, depuis 2014, Modi et son entourage ont une présence disproportionnée au Parlement par rapport à leur pourcentage de voix.
Deuxièmement, il est devenu de plus en plus évident que l'argent domine les élections indiennes. Les énormes dépenses sont désormais reconnues et déplorées comme un aspect fondamental de l'économie politique du pays. En outre, les contributions politiques sont très peu transparentes. Il est pratiquement impossible de savoir qui a donné de l'argent à un homme politique ou à un parti, ou d'où l'homme politique tire le financement de sa campagne. Les donateurs ne sont guère disposés à rendre publiques leurs contributions politiques, car ils craignent de subir un retour de bâton si le parti qu'ils ont choisi perd le pouvoir. C'est dans ce contexte que l'administration de Narendra Modi a fait une grande annonce sur le financement des campagnes électorales en 2017, présentant cette proposition de réforme comme une tentative d'accroître la transparence des financements politiques.
Selon une analyse récente, entre 2016 et 2022, le BJP a reçu trois fois plus d'argent en dons directs d'entreprises et en obligations électorales (5 300 crore 639,36 millions de dollars) que tous les autres partis nationaux réunis (1 800 crore 217,17 millions de dollars). Les électeurs indiens ont certainement le droit de connaître la source de financement d'un parti qui visent à capter l'électorat. Ces sociétés donatrices d'obligations sont-elles légitimes ou ont-elles été créées uniquement pour transférer de l'argent noir vers des dons politiques ? Les « Public Sector Undertakings » (l'équivalent indien des entreprises publiques) sont-elles forcées de faire des dons ?
Récemment, la Cour suprême a déclaré illégal le système d'obligations électorales du gouvernement indien. Elle a souligné que ce système, en autorisant les dons politiques anonymes, contrevenait au droit à l'information prévu par la Constitution. On ne peut qu'espérer que ce verdict permettra à l'électorat de prendre des décisions plus éclairées et facilitera la mise en place de règles du jeu plus équitables pour les partis politiques à l'approche des élections générales de cette année.
Le verdict a également montré clairement que ce type de droit va au-delà de l'exercice de la liberté de parole et d'expression. Il est essentiel pour faire progresser la démocratie participative en obligeant le gouvernement à rendre des comptes. Il a souligné la forte corrélation entre l'argent et la politique, et la façon dont l'inégalité économique se traduit par des degrés variables de participation politique. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le fait de donner de l'argent à un parti politique entraînerait des accords de contrepartie. La Cour a jugé que l'amendement apporté aux sociétés, qui permettait aux entreprises d'effectuer des paiements politiques illimités, était manifestement arbitraire.
Enfin, la Commission électorale indienne dispose de facto d'une indépendance limitée et peut être contrôlée et manipulée par le pouvoir en place.
Des institutions démocratiques fragilisées
L'Inde est l'un des principaux exemples de récession démocratique mondiale. La polarisation croissante, la persécution des médias, la censure, l'intégrité électorale compromise et la diminution de l'espace de dissidence sont autant de menaces pour la démocratie indienne. L'administration dirigée par le BJP, qui a pris le pouvoir en 2014 et l'a conservé en 2019, a été critiquée pour ses résultats médiocres en matière d'indices démocratiques.
Freedom House maintient le statut « partiellement libre » de l'Inde, mais les commentateurs affirment que le pays est devenu de plus en plus illibéral sur le plan idéologique. Le BJP au pouvoir a encouragé les nationalistes hindous radicaux, ce qui a entraîné une augmentation des attaques contre les minorités religieuses et des discriminations à l'encontre des musulmans et des chrétiens.
L'Inde a été classée comme une « autocratie électorale » par le projetVarieties of Democracy (V-Dem) et comme une « démocratie imparfaite » par l'Economist Intelligence Unit, ce qui souligne le déclin démocratique du pays. Les tendances antidémocratiques du gouvernement indien se sont de plus en plus intensifiées, laissant très peu d'espace à la dissidence et à la protestation. Même le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a été expulsé du parlement à la suite d'une condamnation pour diffamation pour une blague sur le Premier ministre. Le gouvernement a également pris le contrôle de l'une des rares chaînes de télévision encore indépendantes, ce qui a entraîné un recul significatif de l'Inde dans le classement mondial de la liberté de la presse 2023. L'Inde occupe la 161e place sur 180 pays.
Les prochaines élections générales indiennes se dérouleront dans un contexte où le choix libre et informé de l'électorat est de plus en plus compromis par des facteurs à la fois structurels et techniques. À l'heure actuelle, l'opinion commune est que le BJP a toutes les chances de s'en sortir, même si l'opposition tente de créer un semblant de front uni contre lui. Cependant, l'opposition est tout autant ancrée dans les mêmes doctrines économiques néolibérales, et il n'y a pas grand-chose à choisir entre les deux camps belligérants en ce qui concerne les politiques qu'elles promeuvent en ce domaine.
Mouvements populaires
La seule force capable d'apporter un changement progressif et transformateur dans le corps politique indien est la mobilisation populaire d'en bas. Il y a quelques années, le mouvement des agriculteurs indiens a démontré que des mouvements populaires forts pouvaient avoir le potentiel d'affronter le rouleau compresseur de l'Hinduvta (l'extrémisme hindou), bien plus que des alliances électorales improvisées.
Les mouvements sociaux n'ont toutefois que très peu d'effet sur la politique électorale. Malgré les protestations des agriculteurs en 2020-2021, le BJP a largement remporté les élections législatives de 2022 en Uttar Pradesh, en particulier dans la région agricole de l'ouest de l'Uttar Pradesh, qui abrite une importante population de Jat qui a largement soutenu le mouvement. Il ne fait aucun doute que le mouvement a motivé des millions de personnes dans le monde entier à lutter pour l'équité, la démocratie et la solidarité, mais il lui reste encore beaucoup à faire pour créer une hégémonie politique au-delà des protestations militantes. De nombreux autres groupes sociaux se sont mobilisés de manière significative ; le défi consiste à déterminer comment les rassembler pour élaborer un programme de transformation.
Comment expliquer l'incapacité des mouvements sociaux à créer une hégémonie politique malgré les nombreuses luttes menées à travers le pays ? L'absence de la gauche et des forces progressistes a créé un vide idéologique qui conduit de nombreux mouvements dans une impasse, même après avoir obtenu des gains au terme de luttes laborieuses. Au lieu de forger des solidarités et de favoriser des alternatives, le ressentiment et la rage populaires alimentent l'ascension de la droite en Inde en l'absence d'un programme anticapitaliste idéologiquement motivé. C'est dans ce contexte que la renaissance d'une nouvelle gauche radicale est plus que jamais nécessaire.
Post-scriptum
Une éventuelle défaite du BJP peut certainement offrir un répit vital pour la construction d'un programme alternatif. Cependant, ce n'est qu'un moyen et non une fin en soi.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La confrontation sino-américaine en Asie de l’Est s’envenime

Loin de s'apaiser, la confrontation entre la Chine et les États-Unis s'envenime toujours un peu plus. Principale zone de fracture entre les deux superpuissances de la planète : l'Asie de l'Est où les grandes manœuvres ont franchi un pas inédit avec un partenariat renforcé entre Washington, Tokyo, Canberra et Manille qui a déclenché la fureur de Pékin.
Tiré de Asialyst
13 avril 2024
Par Pierre-Antoine Donnet
Le président américain Joe Biden entouré du président philippin Ferdinand Marcos Jr (à gauche) et du Premier ministre japonais Fumio Kishida, le 11 avril 2024 à la Maison Blanche. (Source : SCMP)
Les petits plats dans les grands à la Maison Blanche. Mercredi 10 avril, Joe Biden a invité Fumio Kishida à un dîner d'État, un privilège jusque-là jamais accordé à un Premier ministre japonais japonais. Parmi les convives, l'ancien président Bill Clinton, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, l'acteur Robert De Niro, le patron d'Amazon Jeff Bezos, le PDG d'Apple Tim Cook et celui de JP Morgan Chase, Jamie Dimon.
Et pour cause, ce n'était pas une visite de courtoisie. Le président américain et le chef du gouvernement japonais ont annoncé un vaste programme de défense conjointe visant à renforcer la coopération militaire entre leur deux pays. Lors d'une conférence de presse, Joe Biden a précisé : les États-Unis et le Japon ont décidé « la mise en œuvre d'étapes significatives pour moderniser les structures de commandement et de contrôle. Nous augmentons l'interopérabilité et la planification de nos armées afin qu'elles puissent travailler ensemble d'une façon efficace et sans accroc. » Autrement dit, avec un nouveau commandement militaire conjoint.
Plus tard, accueillant le chef du gouvernement japonais dans le Bureau Ovale, le président américain a souligné la nécessité « de garantir que l'Indo-Pacifique demeure libre, prospère et ouvert sur le monde en restant ensemble ». Fumio Kishida, de son côté, a mis l'accent sur « l'amitié et la confiance mutuelle » avec Joe Biden. Les deux pays, selon lui, se trouvent « à l'avant-garde pour maintenir et renforcer un ordre international libre et ouvert fondé sur l'exercice du droit ».
Selon des responsables américains, Américains et Japonais vont en outre étudier les possibilités de produire ensemble des armes. La coopération permettra de renforcer la puissance industrielle du Japon et de créer des synergies entre les deux armées en cas de conflit régional. Le scénario le plus probable, ont-ils expliqué, est une invasion de Taïwan par l'Armée populaire de libération (APL) chinoise. Mais ce pourrait être aussi une initiative militaire agressive de la Corée du Nord. Cette année, Pyongyang a déclaré la Corée du Sud comme son principal ennemi tout en resserrant ses liens militaires avec la Russie. « Toute tentative de changer le statu quo [dans le détroit de Taïwan] par la force ou tout coercition serait absolument inacceptable, a lancé Fumio Kishida. Washington et Tokyo continueront de répondre d'une façon appropriée à de tels actes. L'Ukraine d'aujourd'hui pour être l'Asie de l'Est demain. »
La Constitution japonaise adoptée après la reddition du Japon en 1945 lui interdit de livrer toute guerre en dehors de son territoire, tandis que l'opinion publique japonaise demeure attachée à la paix et hostile à toute participation de l'archipel nippon à une guerre à l'extérieur de ses frontières. Quelque 54 000 soldats américains sont stationnés sur le sol japonais. Les États-Unis y possèdent bases navales et aéroports militaires, dont celui de Kadena à Okinawa, dans le sud du Japon, d'où décollent des avions-espions ainsi que des bombardiers stratégiques à long rayon d'action. À l'initiative de Fumio Kishida, le Japon a entrepris en 2022 un programme de dépenses militaires inédites depuis 1945 dans le but de moderniser son armée et se doter de nouvelles armes, principalement américaines, afin d'être en mesure de se défendre en cas d'agression militaire ou de conflit en Asie de l'Est.
Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre japonais de la Défense Minoru Kihara vont finaliser les détails de cette coopération pour la production conjointe d'armes dans les prochains mois. Le budget militaire prévisionnel du Japon pour 2024 devrait atteindre 52 milliards de dollars, une hausse de 47 % comparée à celui de 2022. Ces dépenses ne prennent pas en compte des rallonges budgétaires généralement votées en cours d'année. L'objectif est de porter la part des dépenses militaires à 2 % du PIB japonais d'ici quatre ans, contre 1 % actuellement.
« Pour le président Biden, [la visite de Fumio Kishida] représente à l'évidence l'occasion de souligner et cimenter les progrès dans cette relation qui est la plus importante alliance bilatérale en Indo-Pacifique, estime Christopher Johnstone, expert du Japon au Center for Strategic and International Studies, cité par Foreign Affairs. Pour Kishida, il y a là une chance de montrer l'excellence des liens avec les États-Unis dans le but de renforcer son soutien au Japon. »
Fumio Kishida : « Les États-Unis ne doivent pas être seuls à tout faire »
Ce sommet américano-japonais a pris place dans un contexte de tensions croissantes en Indo-Pacifique. En cause, les ambitions chinoises toujours plus grandes en mer de Chine Méridionale et les inquiétudes, elles aussi croissantes, suscitées par la posture belliciste de la Corée du Nord. Le partenariat entre les États-Unis et le Japon est « incassable », a célébré Joe Biden. « Le monde fait aujourd'hui face à davantage de défis et de problèmes que jamais auparavant, a de son coté déclaré le Premier ministre japonais. Le Japon va resserrer les liens avec nos amis américains et, ensemble, nous ouvrirons la voie pour surmonter les défis dans la région Indo-Pacifique et le monde. » Pour le sénateur républicain Bill Hagerty, un ancien ambassadeur américain au Japon, la décision de Fumio Kishida de renforcer le rôle sécuritaire du Japon illustre « à quel point les pressions de la Chine se sont multipliées et, de la sorte, ont réorienté l'opinion publique [japonaise] d'une façon significative et profonde ».
Réaction quasi-immédiate de la Chine en réaction à ce sommet : Mao Ning, l'un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « le Japon doit réfléchir avec sérieux sur son passé d'agression, mettre fin à toute participation à des groupes militaires et choisir la voie du développement pacifique. » Xi Jinping, lui, avait choisi le moment de ce sommet à la Maison Blanche pour rencontrer à Pékin Ma Ying-jeou. Avec l'ancien président taïwanais, qu'il avait rencontré à Singapour en 2015, le numéro un chinois a évoqué la nécessité d'une réunification de l'ancienne Formose avec le continent chinois. Ce geste n'est pas le fait du hasard : il rappelle à Joe Biden et Fumio Kishida que la priorité des priorités pour la Chine demeure la prise de contrôle de Taïwan, quels que soient les engagements des États-Unis à défendre l'île et celui du Japon à lui apporter une aide en cas d'invasion par la Chine, estiment les analystes.
Jeudi 11 avril, Fumio Kishida a en outre prononcé un discours en anglais devant les deux chambres du Congrès américain, le deuxième dirigeant japonais à le faire. Les États-Unis, a-t-il déclaré, ne doivent pas être les seuls à endosser la responsabilité de défendre l'ordre international, le Japon étant prêt à s'engager lui aussi dans ce combat. « Je sens bien un courant sous-jacent chez des Américains qui doutent du rôle qui devrait être le vôtre dans le monde. Ce doute croît au moment où l'Histoire se trouve à un tournant. L'ère de la Guerre froide est déjà derrière nous et nous nous trouvons maintenant à un point de bascule qui va définir la prochaine étape de l'histoire de l'humanité, a-t-il ajouté dans une allusion transparente à la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Je veux m'adresser à ces Américains qui ressentent la solitude et la fatigue d'un pays qui a défendu l'ordre international presque tout seul. Je comprends qu'il s'agit là d'une lourde charge que celle de soutenir de tels espoirs sur vos épaules. Les États-Unis ne doivent pas être seuls à tout faire. Vous êtes notre plus proche ami, le peuple japonais est avec vous, côte à côte, pour garantir la survie de la liberté. […] Nous sommes sur le pont, nous ferons notre part. Nous sommes prêts pour faire ce qui est nécessaire. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous », a encore lancé le chef du gouvernement japonais, déclenchant un tonnerre d'applaudissements.
Le même jour, Fumio Kishida a pris part à un sommet tripartite avec Joe Biden et le président des Philippines Ferdinand Marcos Junior pour discuter de la posture agressive de l'armée chinoise ainsi que le harcèlement dont sont victimes des navires de pêche ou militaires philippins. Il a rencontré en tête-à-tête son homologue philippin qui, selon un responsable américain cité par Reuters, entend « retourner la situation et isoler la Chine ».
Le Japon proche d'Aukus
Loin de s'apaiser, les manœuvres d'intimidation commandées depuis Pékin se sont multipliées contre les Philippines depuis plus d'un mois. L'objectif non-dit mais évident de Pékin : contraindre Manille à accepter la suzeraineté que la Chine proclame jusque dans ses eaux territoriales, phénomène qui a conduit l'archipel philippin à se rapprocher des États-Unis. Or c'est précisément ce rapprochement qui a déclenché la fureur de la Chine, qui entend non seulement affirmer sa puissance en Asie de l'Est mais chasser les États-Unis de la région.
Le 7 avril, pour la première fois, le Japon, les États-Unis, les Philippines et l'Australie ont procédé à des exercices aéronavals conjoints en mer de Chine méridionale. Ces manœuvres se sont déroulées dans la Zone économique exclusive (ZEE) des Philippines, selon un communiqué de l'armée à Manille : « Ces activités avaient pour but de renforcer les capacités de ces différentes forces à travailler ensemble dans le cadre de scénarios maritimes. » Dans un autre communiqué, les chefs des forces armées de ces quatre pays ont souligné que ces exercices conjoints visaient à démontrer leur « engagement collectif pour renforcer la coopération régionale et internationale afin de soutenir un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Ce communiqué ne fait pas mention de la Chine mais l'allusion était transparente. Pékin revendique une « souveraineté indiscutable » sur quelque 90% des 4 millions de km² de la mer de Chine méridionale réputée riche en réserves halieutiques et en hydrocarbures et où transitent chaque année des milliers de milliards de dollars de marchandises. Outre les Philippines, Taïwan, l'Indonésie, Brunei, la Malaisie et le Vietnam revendiquent une partie de ces vastes étendues maritimes et contestent les revendications chinoises.
En réaction à ces manœuvres, la Chine a annoncé le 7 avril la tenue de ses propres manœuvres aéronavales dans la région dans une zone non précisée. « Toutes les activités militaires qui gênent la stabilité en mer de Chine méridionale sont sous contrôle », a indiqué un communiqué du ministère chinois de la Défense. Les incursions incessantes de l'Armée populaire de libération dans les eaux des Philippines sont « une démonstration de violence qui doit cesser. Ce sommet doit montrer que l'alliance entre le Japon, les Philippines et les Etats-Unis représentent une dissuasion crédible face à l'agression de la Chine », a estimé le sénateur philippin Risa Hontiveros, membre du parti d'opposition Citizens' Action Party, dans une interview accordée à China Watcher.
Le sommet trilatéral à la Maison Blanche le 11 avril « est une réponse directe à la coercition menée par la Chine en mer de Chine méridionale et vise à envoyer un message parfaitement clair d'unité », a indiqué un responsable américain cité par le Nikkei Asia. Notre alliance [qui date de 1951] avec les Philippines est la plus ancienne en Indo-Pacifique et n'a jamais été aussi forte. » Entouré de Fumio Kishida et de Ferdinand Marcos Jr, Joe Biden a lancé un avertissement fort à Pékin : « Toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclenchera la mise en œuvre du traité de défense mutuelle » qui lie Washington et Manille.
Plus inquiétant encore pour la Chine, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis avait indiqué le 9 avril qu'ils « envisagent de coopérer » avec le Japon dans le cadre de l'alliance tripartie de défense Aukus (Australie, Royaume-Uni, États-Unis). L'entrée du Japon dans le traité Aukus fait actuellement l'objet de négociations, selon des sources diplomatiques citées dans les médias américains et japonais. Depuis la création d'Aukus en 2021, « nos pays ont clairement exprimé leur intention de faire participer d'autres pays aux projets de deuxième pilier au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, ajoute un communiqué américain. Nous avons construit une base trilatérale solide destinée à fournir des capacités militaires avancées rapidement et à grande échelle. »
L'alliance Aukus vise à renforcer les liens de défense entre Washington, Londres et Canberra, sur fond de montée en puissance militaire de la Chine en Asie-Pacifique. Le premier pilier de ce pacte consiste à équiper l'Australie d'une flotte de puissants sous-marins à propulsion nucléaire. Le second grand volet porte sur la cyberguerre, l'intelligence artificielle (IA) ainsi que le développement de drones sous-marins et de missiles hypersoniques de longue portée. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a précisé devant la presse que la participation du Japon ne concernerait que le deuxième pilier de l'accord. « Le Japon est un candidat naturel pour cela », a-t-il insisté.
Soutien de Pékin au complexe militaro-industriel russe
Les États-Unis ont d'autre part adressé une sérieuse mise en garde à la Chine contre toute aide à la Russie qui mène une guerre brutale en Ukraine depuis le 24 février 2022. Toute aide par les entreprises chinoises à Moscou aurait « de graves conséquences », a expliqué vendredi Janet Yellen, secrétaire au Trésor, au terme d'une courte visite officielle en Chine. Le 12 avril, un haut responsable américain a accusé la Chine d'aide la Russie à mener « sa plus importante expansion militaire depuis l'ère soviétique, et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible » au début de la guerre en Ukraine. Les États-Unis encouragent Pékin à jouer au contraire « un rôle constructif » dans le conflit, a-t-il dit, en ajoutant : « Nous espérons que nos alliés se joindront à nous ».
Cet appel intervient alors que le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays entretient des liens économiques particulièrement étroits avec la Chine, est en Chine du 13 au 15 avril. En guise d'exemples du soutien de Pékin au complexe militaro-industriel russe, une autre haute responsable américaine a cité des achats massifs par Moscou de composants électroniques, de machines-outils et d'explosifs chinois : des « entités chinoises et russes travaillent à produire ensemble des drones » sur le sol russe. Les deux responsables américains cités ont requis l'anonymat.
Dans le détail, les renseignements à la disposition de l'administration Biden montrent que sur les trois derniers mois de 2023, « plus de 70% des importations de machines-outils de la Russie provenaient de Chine », ce qui a selon eux permis aux Russes d'augmenter leur production de missiles balistiques. Les Américains ont cité l'entreprise chinoise Dalian Machine Tool Group parmi les fournisseurs de la Russie. Les hauts responsables cités ont précisé que les groupes Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology et Hikvision fournissaient des systèmes optiques utilisés dans les chars russes. La Chine livre également à la Russie, selon la même source, des moteurs de drones et des systèmes de propulsion pour missiles de croisière, ainsi que de la nitrocellulose, matériau utilisé par la Russie pour fabriquer des munitions d'artillerie.
« Nous savons aussi que la Chine fournit des images de reconnaissance à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré la haute responsable déjà citée. « L'une des manières les plus décisives d'aider l'Ukraine aujourd'hui est de convaincre la Chine d'arrêter d'aider la Russie à reconstituer sa base militaro-industrielle », a commenté l'autre haut responsable américain.
De son côté, le 3 avril, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken expliquait devant les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) que Pékin apportait un soutien à Moscou « à une échelle inquiétante ». La Chine fournit, selon le ministre cité par le Financial Times, à la Russie « des outils, des produits et une expertise substantielle ». Cette aide concerne essentiellement la production par la Russie d'équipements optiques et des carburants pour des missiles et fusées qui « non seulement contribue à l'agression de la Russie en Ukraine mais menace d'autres pays ».
Joe Biden avait soulevé cette question avec son homologue chinois Xi Jinping le 4 avril lors d'un entretien téléphonique. Selon la Maison Blanche, Le président américain lui a fait part de son inquiétude à propos du « soutien [de la Chine] à l'industrie de défense de la Russie et son impact sur la sécurité de l'Europe et [des pays] outre-Atlantique ». Le narratif chinois est constant sur ce sujet : la Chine ne fournit pas d'armes létales à la Russie et accuse l'Occident de « mettre de l'huile sur le feu » dans cette guerre qualifiée « d'opération spéciale » par la Russie, terme repris par les organes de propagande chinois.
Autre développement qui souligne le rapprochement rapide entre la Chine et la Russie, le 9 avril, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin entend « renforcer la coopération stratégique » avec Moscou, lors d'un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov, en visite officielle les 8 et 9 avril dans la capitale chinoise. « Pékin et Moscou continueront à renforcer la coopération stratégique sur la scène mondiale et à s'apporter mutuellement un soutien de poids », a précisé Wang Yi, cité par l'agence russe RIA Novosti.
Sergueï Lavrov a, lui, remercié Pékin pour le « soutien » apporté à Vladimir Poutine après sa récente réélection.Le président russe a été « réélu » pour un cinquième mandat le 17 mars, obtenant 87,28 % des suffrages, score abondamment condamné et comparé en Occident à un plébiscite grâce à un scrutin truqué. Depuis le déclenchement de l'assaut russe en Ukraine il y a un peu plus de deux ans, les relations entre Moscou et Pékin se sont profondément renforcées. En mars 2023, Xi Jinping s'était rendu à Moscou, réaffirmant avec Vladimir Poutine « une amitié sans limites » entre leurs pays qui, tous deux, dénoncent l'hégémonie occidentale sur la scène internationale.
Ces déclarations, manœuvres et gesticulations militaires témoignent d'une montée constante des périls en Asie-Pacifique. S'ils ne sont pas maîtrisés, ils risquent de conduire à un embrasement général aux conséquences potentiellement catastrophiques pour cette zone et, au-delà, pour la planète entière.
Par Pierre-Antoine Donnet
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Deux leçons de ce qui s’est passé cette nuit dans le ciel au-dessus de la Palestine et d’Israël

Premièrement, les mollahs iraniens n'en ont absolument rien à foutre des Palestiniens. Les motifs de leur attaque étaient en partie internes (donner une impression de force après le bombardement de leur consulat à Damas, qui n'est qu'un prétexte purement symbolique) et en partie externes, et là, c'est important : la distanciation croissante de Washington envers le gouvernement Netanyahou, avec une condamnation par avance de toute “seconde Nakba” achevant de se réaliser à Gaza, portait en elle le blocage de la destruction de Gaza.
14 avril 2024 | tiré d'aplusoc
https://aplutsoc.org/2024/04/14/deux-lecons-de-ce-qui-sest-passe-cette-nuit-dans-le-ciel-au-dessus-de-la-palestine-et-disrael-billet-dhumeur-par-vp/
Par son opération, Téhéran permet à Tsahal de poursuivre. Il est essentiel que les “campistes” et les « BRICS+ » puissent compter en permanence sur ce qu'ils appellent « le génocide », c'est-à-dire la destruction de Gaza, pour mener leurs opérations ailleurs, manipuler des foules et des idiots utiles partout, il serait catastrophique pour eux que les Palestiniens arrêtent de se faire tuer.
Symbole de cette réalité : à ce que l'on sait à cette heure, la seule victime humaine au pronostic vital engagé est une petite fille bédouine.
Quand au Hezbollah et aux Houtis, ils ont poursuivi leur cirque habituel, sans plus. Ils n'en ont rien à foutre des Palestiniens, les cris du chœur des groupies hurlant « Stop au génocide » n'ont d'autre fonction réelle que de perpétuer le massacre des Palestiniens.
Deuxièmement, l'attaque iranienne massive a été presque totalement déjouée par la défense antiaérienne israélienne adossée à l'aide américaine, avec la collaboration jordanienne. Au plan militaire et technique, c'est, pour l'Iran, un fiasco (mais le vrai but politique : garantir que la destruction de Gaza puisse continuer pour pouvoir continuer à s'en servir, est sans doute atteint, hélas).
Cette défense efficace devrait conduire tout esprit libre à crier une question, adressée au Pentagone : POURQUOI L'UKRAINE EST-ELLE PRIVÉE DE SON “DÔME DE FER” ?

Orientalisme, impérialisme et couverture des médias dominants de la Palestine

Cet article examine la façon dont les préjugés des grands médias dominants occidentaux et la défense du discours israélien sont liés à l'orientalisme, au racisme et à l'impérialisme, et servent les intérêts des élites politiques et économiques occidentales au pouvoir. Cependant, ces discours dominants en occident sont remis en question par des mouvements mondiaux visant à faire la lumière sur les réalités de la guerre génocidaire menée à Gaza et à exprimer la solidarité avec la population palestinienne.
Tiré de la revue Contretemps
19 avril 2024
Par Joseph Daher
***
Couverture occidentale de la Palestine et de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza
A l'heure de l'écriture de cet article, l'armée d'occupation israélienne poursuit sa campagne génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis maintenant plus de 6 mois. Le bilan humain est catastrophique. Les chiffres officiels font état de plus de 33 000 Palestiniens tués, dont plus de 12 300 enfants, soit un nombre supérieur à celui des enfants tués dans toutes les guerres mondiales des quatre dernières années réunies. Il y a également plus de 1,7 million de personnes déplacées, soit plus de 75 % de la population de Gaza, selon l'Unrwa, et 95% de la population est face à un risque d'insécurité alimentaire. Dans l'ensemble, 1,1 million de personnes sont déjà touchées par une « famine catastrophique », le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé, selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) publié le 18 mars Les destructions sont également sans précédent dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, avec plus de 60 % d'immeubles endommagés ou détruits, parmi lesquels environ 45 % sont des bâtiments résidentiels, laissant un million de personnes sans abri sur les 2,4 millions d'habitants.
De même, l'État israélien continue à non seulement ignorer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant le 25 mars à un cessez-le-feu immédiat pour le ramadan – pour laquelle les États-Unis se sont abstenus –, mais il a aussi fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de la Cour internationale de justice le 28 mars relative au risque que « la famine s'installe » à Gaza, alors que l'Afrique du Sud l'accuse de non-respect de la Convention sur le génocide.
Cet guerre constitue à bien des égards une nouvelle Nakba ou catastrophe, qui rappelle la Nakba de 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés par la force de leurs maisons et sont devenus des réfugiés.
Les médias grand public occidentaux continuent de mettre l'accent sur la « souffrance » et la « légitime défense » israéliennes à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont fait 1 139 morts selon les autorités israéliennes. Ces chiffres incluent 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers. Il convient toutefois de noter que de nombreux décès de civils israéliens ont également été causés par les forces d'occupation israéliennes, y compris le bombardement par des chars d'assaut de maisons où des Israéliens étaient détenus – un détail crucial qui n'a été que très peu couvert par les principaux médias occidentaux. Certains articles récents ont commencé à démentir de nombreuses affirmations erronées propagées sans vérification par les médias israéliens et reprises dans les pays occidentaux. Par exemple, les premières informations faisant état de 40 enfants israéliens décapités se sont avérées par la suite fabriquées de toutes pièces. Ces accusations ont néanmoins été approuvées et diffusées par les principaux médias et hommes politiques occidentaux, dont le président américain Joe Biden. En outre, plusieurs études ont démontré l'existence de préjugés systémiques des médias à l'encontre des Palestiniens dans différents pays occidentaux.
De même, le journalisme alternatif sur le terrain est devenu quasiment impossible, les forces d'occupation israéliennes prenant quasi-systématiquement pour cible les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Plus de 133 journalistes palestiniens ont été tués par Israël depuis le 7 octobre.
Dans le même temps, la réalité de la guerre génocidaire israélienne en cours contre la bande de Gaza est souvent ignorée par les médias grand public. Les Palestiniens ont souvent été déshumanisés dans les représentations médiatiques. Leurs aspirations politiques et leur rôle ont également été mis sous silence ou minimisés. Dans une grande partie de la couverture médiatique occidentale, le récit ne prend en compte que les événements survenus à partir du 7 octobre, sans fournir de contexte suffisant ni tenter d'expliquer comment la situation a évolué sur le long terme.
Les points de vue des Palestiniens eux-mêmes sur le contexte historique ne sont souvent pas mis en avant ou autorisés, en particulier lorsqu'il s'agit de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les événements en sont arrivés là. Comme l'a expliqué le journaliste palestinien Motaz Azaiza dans un tweet concernant les questions relatives au 7 octobre dans les grands médias occidentaux, « j'ai répondu à cette question plusieurs fois mais ils ne l'ont jamais gardée ou partagée parce qu'ils ont enregistré mon interview avant et ont ensuite pris ce qui convenait à leur agenda ».
La nature inhérente de l'État israélien en tant qu'entité coloniale, et ses politiques au fil du temps, ont mené à créer les circonstances qui ont conduit aux événements du 7 octobre et au-delà – comme c'est si souvent le cas pour les puissances coloniales et occupantes au cours de l'histoire. Cependant, à ce jour, le 7 octobre a tendance à être présenté de manière simpliste comme une « attaque terroriste » sans que le contexte historique approprié ne soit généralement fourni. Dans le même temps, les réponses israéliennes contre Gaza sont souvent décrites comme de simples actes d' »autodéfense »…
Mais pourquoi la majorité des grands médias occidentaux continue-t-elle à adopter et à défendre le discours israélien ? Pourquoi y a-t-il une tendance à déshumaniser les Palestiniens et à les rendre responsables aux événements actuels ? Quels sont les intérêts des grands médias occidentaux à maintenir ce type de couverture ?
Les réponses à ces questions trouvent leur origine dans l'orientalisme, le racisme et l'impérialisme, qui sont tous liés. Les images et les récits propagés par une grande partie des médias grand public occidentaux ne peuvent pas vraiment être dissociés des intérêts géopolitiques et économiques des élites dirigeantes occidentales.
La forme évolutive de l'orientalisme
L'orientalisme est une idéologie essentialiste enracinée dans l'idéalisme philosophique et les notions hégéliennes selon lesquelles le destin des personnes est déterminé par leurs cultures et religions éternelles. Le terme « orientaliste » est apparu en anglais vers 1779 et en français en 1799, d'abord axé sur l'étude linguistique, puis lié aux expansions coloniales impériales occidentales en Orient et ailleurs. Alors que les puissances européennes intervenaient, envahissaient et dominaient de plus en plus le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie au XIXe siècle, des discours sont apparus, décrivant des régions comme l'Empire ottoman comme « l'homme malade de l'Europe », qui souffrait de plus en plus des interventions et de l'influence des puissances impériales européennes, tandis que le terme d'« Homo Islamicus » apparaissait également à cette époque. L'idée d'une essence arabe/islamique spécifique est toujours d'actualité dans les analyses traditionnelles et néo-orientalistes.
La supériorité économique, technique, militaire, politique et culturelle croissante de l'Europe sur l'Empire ottoman, et plus généralement sur l' »Orient », a été associée pendant cette période à la religion chrétienne (dans sa compréhension et sa pratique occidentales) et les revers du monde musulman à l'islam. Le christianisme est présenté comme favorable au progrès, tandis que l'islam est au contraire décrit comme repoussant le progrès. Toute résistance à l'Europe et à son influence était présentée comme un fanatisme religieux et un rejet de la civilisation.
Ce type de discours n'a jamais vraiment disparu de la scène politique et des grands médias occidentaux, avec une intensité variable selon les périodes. Le discours prononcé il y a plus d'un an, en octobre 2022, par Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, à la nouvelle Académie diplomatique européenne de Bruges illustre cette perspective orientaliste. Il explique que « l'Europe est un jardin » où « tout fonctionne », combinant « la liberté politique, la prospérité économique et la cohésion sociale que l'humanité a pu construire », tout en s'inquiétant que « la majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait prendre le dessus sur le jardin… Les jardiniers doivent aller dans la jungle. Les Européens doivent s'engager davantage dans le reste du monde. Sinon, le reste du monde nous envahira, par différents moyens ». Ce discours ignore bien sûr la montée constante de l'extrême droite dans toute l'Europe, la montée du racisme et des attaques contre les droits démocratiques et les migrants, etc.
Il n'est donc pas surprenant que les responsables israéliens et occidentaux ainsi que les médias grand public aient utilisé cette rhétorique pour qualifier de barbares les actions du Hamas le 7 octobre et justifier la guerre génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza. Un éditorialiste israélien du Jerusalem Post a par exemple déclaré que « le 7 octobre, la civilisation occidentale a perdu et les barbares l'ont emporté… L'Occident moderne contre le djihad meurtrier », tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :
« C'est un mal ancien, qui nous rappelle le passé le plus sombre et nous choque tous au plus profond de nous-mêmes… Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses ».
Dans le cadre de cette stratégie, les comparaisons entre Daesh (« État islamique ») et le Hamas se sont multipliées chez les responsables israéliens et occidentaux et dans les grands médias occidentaux, à l'image du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin décrivant le Hamas comme « pire que l'Etat Islamique ». Les tentatives d'Israël et des gouvernements occidentaux de présenter le Hamas, et plus généralement les Palestiniens, comme des terroristes semblables aux organisations djihadistes ne sont pas nouvelles.
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la classe dirigeante israélienne a décrit sa guerre contre les Palestiniens pendant la deuxième Intifada comme sa propre « guerre contre le terrorisme ». Et ce, bien que l'Autorité Palestinienne et le Hamas aient condamné les actions d'Al-Qaïda. Les actions suicides du Hamas à Jérusalem et ailleurs dans la Palestine historique ont été présentées comme « un symptôme du terrorisme islamique mondial ». Avant cela, l'OLP et ses factions avaient également été comparées par les dirigeants israéliens à des nazis.
Plus généralement, les tentatives des dirigeants israéliens et occidentaux de faire l'amalgame entre le Hamas et les groupes djihadistes tels que Daesh ou Al-Qaïda s'inscrivent dans une stratégie plus large qui consiste à s'appuyer de plus en plus sur l'islamophobie pour justifier leur soi-disant guerre contre la terrorisme. Au début des années 2000, l'administration Bush a défendu le droit d'Israël à l'autodéfense contre le « terrorisme islamique », tout comme le font aujourd'hui l'administration américaine et les États occidentaux.
Dans cette perspective, l'objectif d'éliminer le Hamas justifie la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, comme l'explique un chroniqueur du New York Times :
« La cause principale de la misère de Gaza est le Hamas. Il porte seul la responsabilité des souffrances qu'il a infligées à Israël et qu'il a sciemment invitées contre les Palestiniens. La meilleure façon de mettre fin à la misère est d'éliminer la cause, et non pas d'arrêter la main de celui qui l'élimine ».
Ainsi, les responsables israéliens et les commentateurs pro-israéliens peuvent prétendre agir en légitime défense, et même dans certains cas pour aider les Palestiniens, en commettant un génocide contre les Palestiniens…
Cette perspective raciste des grands médias occidentaux est ancrée dans une vision orientaliste du monde, et plus particulièrement de la région. Cet orientalisme est ancré dans la dynamique politique moderne, notamment l'impérialisme, la colonisation, la lutte des classes, la dynamique du genre et du racisme, etc.
Cette conception est donc différente de celle du célèbre auteur palestinien Edward Said, auteur du livre L'Orientalisme. Said n'a pas critiqué l'idéalisme historique en tant que matrice principale de l'essentialisme culturel, et il existe une forme de continuité historique homogène dans ses critiques de l'orientalisme, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Comme l'affirme l'auteur marxiste Aijaz Ahmad, il n'y a aucune considération pour les dynamiques de classe, les dynamiques de genre, aucune mention de l'histoire, de la résistance, des projets de libération humaine, etc. [1]
En d'autres termes, l'orientalisme n'est pas un phénomène profondément moderne, comme nous l'avons expliqué, mais le produit naturel d'un esprit européen ancien et presque irrésistible visant à déformer les réalités des autres cultures, peuples et langues, en faveur de l'affirmation de soi et de la domination de l'Occident. En rejoignant les critiques constructives d'autres auteurs orientaux également critiques de l'orientalisme, tels que Sadiq Jalal al-Azm, Mehdi Amel, [2] Samir Amin [3] et Aijaz Ahmad, la compréhension de l'orientalisme par Said risque de tomber dans ses dénonciations de l'essentialisme occidental, dans une forme d' »orientalisme en retour ou inversé », comme l'explique l'auteur marxiste syrien Sadiq al-Azm. [4]
En effet, comment expliquer la défense des politiques meurtrières d'Israël par les grands médias occidentaux, si ce n'est par la protection de leurs intérêts politiques ? Cela se fait au travers d'une lentille orientaliste.
Israël, un instrument essentiel pour les élites dirigeantes occidentales
Dans un cadre typiquement orientaliste, Israël a été présenté par ses alliés occidentaux et ses grands médias pendant des décennies comme un phare de la démocratie et du progrès dans une région hostile peuplée de barbares.
Cette propagande a également été promue par les dirigeants du mouvement sioniste avant la création d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui par les responsables israéliens actuels. Avant la Nakba et la fondation d'Israël en 1948, Theodor Herzl, principal idéologue du mouvement sioniste, écrivait que le futur État juif serait « l'avant-garde de la civilisation contre la barbarie ». Il prônait en effet un projet colonial visant à installer une population majoritairement européenne, d'origine juive, sur une terre majoritairement peuplée de populations arabes, en l'occurrence la Palestine.
Aujourd'hui, ce discours est tenu par les responsables israéliens. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré dans de nombreux discours après le 7 octobre qu' »Israël ne mène pas seulement sa guerre, mais la guerre de l'humanité contre les barbares… » : « Nos alliés dans le monde occidental et nos partenaires dans le monde arabe savent que si nous ne gagnons pas, ils seront les prochains dans la campagne de conquête et de meurtre de l'axe du mal »… De même, le président israélien Isaac Herzog a affirmé que la guerre d'Israël contre Gaza « a pour but… de sauver la civilisation occidentale », Israël étant « attaqué par un réseau djihadiste » et « si nous n'étions pas là, l'Europe serait la prochaine, et les États-Unis suivraient ».
Les responsables occidentaux et les grands médias ont soutenu cette propagande. Le mot génocide ou guerre génocidaire n'est presque jamais mentionné par ces acteurs, mais il est en outre rejeté lorsqu'il est utilisé par les détracteurs d'Israël. Cette impunité de l'État israélien n'a pas commencé après le 7 octobre, mais dure depuis des décennies. Même les groupes traditionnels reconnaissent désormais la nature violente et réactionnaire de l'État israélien. Par exemple, Human Rights Watch et l'organisation israélienne B'Tselem ont tous deux dénoncé la saisie permanente de terres palestiniennes par Israël. Ils ont documenté la manière dont Israël a violé les lois internationales pour soutenir plus de 700 000 colons construisant des colonies dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ils ont également conclu qu'Israël est un État d'apartheid qui accorde des privilèges spéciaux aux Juifs et réduit les Palestiniens à une citoyenneté de seconde zone.
Cela démontre une fois de plus que les soi-disant principes des États européens et des États-Unis concernant la démocratie et le respect des droits de l'homme ne sont utilisés que pour leur propagande rhétorique, cherchant à couvrir des politiques ancrées dans la protection de leurs propres intérêts politiques et économiques. Dans ce cadre, la déclaration du pasteur palestinien Munther Isaac, de Bethléem, est tout à fait correct :
« À nos amis européens, je ne veux plus jamais vous entendre nous faire la leçon sur les droits de l'homme ou le droit international. »
Comme indiqué plus haut, le mouvement sioniste, depuis ses origines en Europe jusqu'à la création d'Israël en 1948 et au déplacement des Palestiniens qu'il opère aujourd'hui, est un projet de colonisation. Pour établir, maintenir et étendre son territoire, l'État israélien a dû nettoyer ethniquement les territoires palestiniens de leurs habitants, chassés de leurs maisons et de leurs emplois. Pour ce faire, il a dû rechercher le soutien de l'étranger. En effet, tout au long de ce processus, il s'est allié à des puissances impérialistes, d'abord l'Empire britannique, puis les États-Unis, qui ont utilisé Israël comme leur agent dans la lutte contre leurs ennemis, ou perçus comme tels, dans la région, et lui ont apporté leur soutien. [5]
Les Britanniques ont d'abord soutenu le projet sioniste de créer une nation alliée dans une région d'une grande importance politique et stratégique – une « petite Ulster loyale », selon les termes de Ronald Storrs, haut fonctionnaire du ministère britannique des affaires étrangères et des colonies. Ensuite, Washington, en particulier après la guerre des Six Jours de 1967, a été le principal soutien d'Israël, qui a également joué le rôle de force de police locale contre les menaces américaines perçues dans la région et contre tout événement susceptible de remettre en cause son contrôle sur ses réserves d'énergie stratégiques.
Depuis lors, les États-Unis ont soutenu Israël. Washington a versé en moyenne 4 milliards de dollars par an dans les coffres de Tel-Aviv, soutenant sa colonisation de la Palestine et ses guerres d'agression contre différents gouvernements et mouvements de la région. Selon un rapport du Congressional Research Service de mars 2023, les États-Unis ont fourni à Israël 158 milliards de dollars d'aide bilatérale et de financement de la défense antimissile depuis 1948, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire cumulé de l'aide étrangère des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.
Depuis les années 1960, les gouvernements successifs américains ont mis en place une politique d'aide militaire envers l'Etat d'Israël permettant un « avantage militaire qualitatif » (Qualitative Military Edge) sur les états voisins et les acteurs non étatiques de cette zone. Entre 2013 et 2022, 69 % des armes importées en Israël provenaient des États-Unis.
Alors que les responsables américains ont utilisé à plusieurs reprises leur droit de veto contre des résolutions appelant à un éventuel cessez-le-feu, la guerre israélienne actuelle contre la bande de Gaza aurait été impossible sur le plan militaire sans le soutien continu des États-Unis. Washington a notamment accepté depuis le 7 octobre 2023 la fourniture de 25 avions de combat dernière génération F-35, et de l'autre 500 bombes MK82 et plus de 1 800 bombes MK84 – qui ne sont plus utilisées par les armées des États occidentaux dans des zones densément peuplées en raison des dégâts collatéraux inévitables. Ces livraisons d'armes ont contourné l'obligation de consultation du Congrès en invoquant des « pouvoirs d'urgence ».
Cette administration américaine a effectué également plus de 100 livraisons d'armes à Israël sans aucun débat public, en utilisant une faille dans laquelle le montant spécifique en dollars de chaque vente était inférieur au seuil requis à partir duquel le Congrès doit être averti. De son côté, le journal israélien Haaretz a déclaré que les données de suivi des vols accessibles au public montrent qu'au moins 140 avions de transport lourd à destination d'Israël ont décollé de bases militaires américaines dans le monde entier depuis le 7 octobre, transportant des équipements principalement vers la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël.
Et si le président américain Joe Biden a fait signe d'un mécontentement à la suite de l'attaque sur le convoi humanitaire du World Central Kitchen, tuant sept employés de l'organisation américaine, il a encore récemment affirmé que « la défense d'Israël reste essentielle, qu'il n'y a donc pas de ligne rouge qui pourrait couper toutes les (livraisons d')armes pour que le pays n'ait plus de Dôme de fer pour le protéger »
De même, depuis novembre 2023, le gouvernement allemand, deuxième principal exportateur d'armes à Israël après les États-Unis, a approuvé l'exportation d'équipements de défense d'une valeur d'environ 303 millions d'euros (323 millions de dollars) vers Israël. À titre de comparaison, des exportations de matériel de défense d'une valeur de 32 millions d'euros avaient été approuvées en 2022.
La raison en est qu'Israël est toujours perçu comme un acteur clé pour préserver les intérêts occidentaux dans la région. Le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes initié par le président Donald Trump et poursuivi par le président Joe Biden avait pour objectif de consolider les intérêts américains dans la région, y compris dans sa rivalité avec la Chine. L'un des principaux objectifs de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était de saper ce processus et a été temporairement couronné de succès.
Peu après le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, l'Arabie saoudite a en effet réagi en interrompant tout progrès dans les accords bilatéraux entre elle-même et Israël et a annoncé qu'aucun processus de normalisation n'interviendrait entre les deux pays avant l'établissement clair d'un plan de route pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël.
En outre, de nombreux États européens et les États-Unis ont tenté d'amalgamer l'antisémitisme et l'antisionisme pour criminaliser la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS). Ces actions doivent être comprises comme un objectif plus large des élites occidentales visant les politiques progressistes et de gauche, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, et comme des tentatives de restreindre les droits démocratiques dans ces sociétés.
Dans ce cadre, les théories du complot affirmant que les Juifs contrôlent le monde ne remettent pas en cause les perspectives orientalistes, mais au contraire les renforcent. En effet, les différentes formes de racisme se nourrissent généralement l'une l'autre, comme l'a dit le penseur anticolonialiste Frantz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». De plus, ce type d'explications minore en partie la responsabilité des élites occidentales dans la tragédie palestinienne.
Sans oublier que le soutien occidental à Israël n'a jamais empêché l'antisémitisme permanent de ses élites. De Lord Balfour au président américain Trump, tous ont soutenu des politiques ou des dynamiques antisémites. Lord Balfour était bien l'auteur de la lettre disant que « le gouvernement de Sa Majesté voit d'un bon œil l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif », mais aussi l'un des promoteurs de l'Aliens Act de 1905 qui fermait les frontières britanniques aux émigrants juifs fuyant les pogroms russes, tandis que les partisans de Trump défilaient à Charlottesville en 2017 en criant « Les juifs ne nous remplaceront pas ». De même, en France, Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir réhabilité le maréchal Pétain ou remis sur le devant de la scène le théoricien antisémite Charles Maurras.
Remettre en cause l'orientalisme et l'impérialisme : une lutte commune menée par en bas
La remise en cause des perspectives orientalistes et racistes sur la Palestine et les Palestiniens, ainsi que sur d'autres populations non blanches, est liée à la lutte d'en bas dans le monde entier et en particulier dans les sociétés occidentales, dans lesquelles les institutions dirigeantes sont les principales productrices de ces idées. Comme nous l'avons déjà mentionné, la cause palestinienne influence la dynamique politique bien au-delà du Moyen-Orient.
Les premières critiques de l'orientalisme et des études orientalistes en Occident sont apparues pendant la période de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'auteurs originaires de régions colonisées et vivant souvent dans des pays occidentaux, comme Anouar Abdel al-Malek [6] et Edward Said. Les études et orientations orientalistes dominantes dans les universités ont commencé à être remises en question après la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et par la révolution russe, mais surtout par la résistance croissante et grandissante des mouvements anticoloniaux à l'impérialisme occidental en « Orient », de l'Asie à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Plus tard, les mouvements antiracistes et féministes ont également joué un rôle dans la remise en question de ces idées dans les États occidentaux. [7]
De même, aujourd'hui, la multitude de luttes qui se déroulent dans diverses sociétés, dans les universités, sur les lieux de travail, dans les médias alternatifs, etc. en faisant pression sur les autorités dirigeantes et les gouvernements pour qu'ils agissent afin d'empêcher la guerre génocidaire israélienne continue contre la population palestinienne de la bande de Gaza, pour qu'ils fassent la lumière sur le contexte historique de la Palestine, sur la nature coloniale d'Israël et sur son système d'apartheid, et surtout pour qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens, remettent en question la perspective orientale des grands médias occidentaux, qui servent de bouclier (parmi de multiples autres) pour protéger les intérêts de l'élite dirigeante.
*
Cet article a aussi été publié sur le site de Al-Jazeera – Middle East Institute
Notes
[1] Aijaz Ahmad, Orientalism and After : Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of Edward Said, Economic and Political Weekly, Vol. 27, No. 30 (Jul. 25, 1992), pp. PE98-PE116
[2] Voir Gilbert Achcar, « Mahdi Amel (1936-1987). Préface à un recueil de textes choisis », https://www.contretemps.eu/mahdi-amel-marxisme-arabe-liberation-nationale-preface-achcar/
[3] Voir Samir Amin, Eurocentrism, New York : Monthly Review Press, 1989
[4] Sadik Jalal al-'Azm, Orientalism and orientalism in reverse, https://libcom.org/article/orientalism-and-orientalism-reverse-sadik-jalal-al-azm
[5] Voir Joseph Daher, « La Palestine et les révolutions au Moyen Orient et en Afrique du Nord », Contretemps.
[6] La première critique est venue en effet du philosophe égyptien marxisant de l'université de la Sorbonne, Anouar Abdel al-Malek (né en 1923 au Caire), avec son article « l'Orientalisme en crise » écrit en 1962 et publié en 1963. Après avoir étudié à l'université d'Aim Chams, au Caire, et la Sorbonne, et avoir enseigné la philosophie au Lycée al-Hourriyya, au Caire, il fut nommé en 1960 Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris. Voir Anouar Abdel Malek, « Orientalisme en crise », L'orientalisme en crise », Diogène, n° 44, hiver 1963, p. 109-142
[7] Il faut également souligner les écrits de Maxime Rodinson dans la critique de l'orientalisme, notamment son livre de « La fascination de l'Islam » publié en 1980 qui est une critique remarquable de l'eurocentrisme et de l'orientalisme.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il est impossible de quantifier la souffrance à Gaza

En raison des limites de l'imagination humaine (par opposition à l'imagination des fauteurs de guerre et des fabricants d'armes), et en l'absence d'un tout autre dictionnaire, il n'y a pas de véritable moyen de décrire la destruction et les pertes subies à Gaza après six mois de guerre.
Tiré de la revue Contretemps
12 avril 2024
Par Amira Hass
En théorie, il suffirait de visionner les centaines, voire les milliers de vidéos qui montrent les enfants tremblants– incapables de contrôler leurs tremblements – après les bombardements israéliens : dans les hôpitaux, dans la rue, certains d'entre eux sanglotant, d'autres incapables de prononcer un mot. Ils sont couverts de poussière et de sang. C'est un détail qui suffit à représenter le désastre. Que ceux qui aiment se venger regardent les vidéos, une par une.
En pratique, dans un journal, les mots doivent suffire. Cela signifie qu'en raison des limites des termes, nous nous réfugions dans les chiffres. Selon l'UNICEF, à la fin du mois de janvier,17 000 enfants « errent » dans la bande de Gazasans être accompagnés d'un adulte. Leurs parents ont été tués, ils n'ont pas pu être extirpés des ruines. Ou bien les enfants se sont perdus lors des déplacements massifs vers le sud.
Et c'est sans compter les 14 000 enfants (sur environ 33 000 morts recensés) qui ont été tués jusqu'à présent par les bombardements israéliens. A cela s'ajoutent des milliers d'enfants qui ont perdu des membres, souffrent de brûlures, se promènent avec des blessures qui se sont infectées en l'absence de bandages et de médicaments, et souffriront de troubles post-traumatiques pour le reste de leur vie. Quel est leur avenir ? Il est impossible de quantifier la souffrance. Est-il possible de quantifier le coût de leur traitement et de leurs besoins spécifiques, ainsi que les répercussions sur l'économie ?
***
Pour chaque décompte de morts, de blessés et d'orphelins qui ne sont pas les nôtres, il y a un piège. C'est général, c'est abstrait pour nous. Même lorsqu'il s'agit de 44 membres d'une même famille, tués dans un seul attentat, comme la famille du Dr. Abdel Latif al Haj, à laquelle j'ai déjà consacré un article (Haaretz, 1er janvier 2024). Plus le nombre est élevé, moins nous pouvons comprendre ce que cela signifie. Psychologiquement, nous pouvons éviter de comprendre le trou béant causé par les bombardements israéliens dans une société à l'égard de laquelle nos sentiments vont de l'ignorance de notre domination à notre haine.
Mais si nous oublions la quantité et racontons une seule histoire, ce sera une unique histoire. Et elle devrait atteindre le seuil de l'histoire la plus horrible de toutes pour être comprise. Lorsque je parlerai de l'histoire unique à la fin, je dirai : c'est un détail représentatif, qui contient le tout. Et ce n'est pas le plus horrible.
***
Voici un autre chiffre : « Les Palestiniens de Gaza représentent désormais 80% de toutes les personnes confrontées à la famine ou à la faim sévère dans le monde », selon le rapport intérimaire conjoint – publié la semaine dernière – de la Banque mondiale (BM), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU).
Comparez cette affirmation avec la déclaration devant la Haute Cour de justice du lieutenant-colonel Nir Azuz, de l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), selon laquelle « en ce qui nous concerne, la quantité de nourriture qui entre [à Gaza] permet une solution raisonnable pour la population ».
L'officier a été appelé à défendre la position du gouvernement [israélien] contre une pétition d'organisations israéliennes de défense des droits humains demandant d'autoriser des livraisons d'aide illimitées, afin d'enrayer la propagation de la faim et de la mort par inanition à Gaza. L'écart entre les deux affirmations – ou entre la réalité et le déni – nécessite une définition qui fait défaut dans le lexique disponible.
L'objectif du rapport conjoint (Banque Mondiale, Union Européenne, ONU) est de présenter une estimation des dommages matériels subis jusqu'à présent, qui servira de base aux premiers efforts de réhabilitation. Les données relatives aux dégâts matériels sont plus faciles à quantifier, et peut-être aussi plus faciles à comprendre.
A la fin du mois de janvier 2024, les destructions matérielles dans la bande de Gaza étaient estimées à environ 18,5 milliards de dollars. C'est le coût de 50 avions de combat que l'administration Biden souhaite vendre à Israël, sous réserve de l'approbation du Congrès, comme le rapporte CNN. C'est le montant des indemnités que le Canada a accepté de verser à 300 000 personnes en raison de la discrimination et de la négligence dont ont été victimes les enfants des peuples indigènes dans le système scolaire, entre 1991 et 2022. C'est 92,5 millions de salaires mensuels moyens à Gaza (environ 200 dollars avant la guerre).
Si cette somme semble atteignable, il faut rappeler que les besoins de reconstruction sont plus coûteux que le coût des dommages, comme le note le rapport. Par exemple, lors de la guerre de 2014 à Gaza, les dégâts se sont élevés à 1,4 milliard de dollars. Les coûts de reconstruction se sont élevés à 3,9 milliards de dollars. Lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en février 2023, les dégâts ont été estimés à 3,7 milliards de dollars. Les coûts de reconstruction, à 7,9 milliards de dollars.
Le volume des décombres dans la bande de Gaza, qu'il faudra déblayer pour commencer la reconstruction, est de 26 millions de tonnes. Il faudra des années pour les déblayer, selon le rapport. Combien d'années ? Le rapport ne fait aucune promesse, puisqu'il ne s'agit pas d'une estimation précise.
Tout d'abord, l'étendue des dégâts depuis début février n'a pas encore été mesurée (elle comprend, par exemple, les ruines du complexe hospitalier Al-Shifa et les maisons environnantes). Deuxièmement, pour des raisons évidentes de sécurité, les équipes ne peuvent pas se rendre sur place et l'évaluation se fait à distance. Troisièmement, nous ne savons pas combien de temps la guerre va durer.
Parmi les décombres, il y a des munitions qui n'ont pas explosé, ce qui rend le processus de déblaiement et de recyclage plus dangereux, plus long et plus coûteux. Si Israël imposeles mêmes restrictions et difficultés que par le passé pour l'acheminement des matières premières et des équipements, le processus sera encore plus long.
Le coût des dommages environnementaux, l'un des secteurs examinés par le rapport conjoint, est estimé à environ 411 millions de dollars. En réalité, on ne sait pas très bien comment on est arrivé à ce calcul, mais les conséquences immédiates et à long terme sont faciles à comprendre : la contamination supplémentaire des eaux souterraines, la pollution de l'air et du sol par des rebuts dangereux, y compris des munitions, les produits chimiques toxiques émis par toutes les bombes, les déchets médicaux dispersés partout, la pollution causée par les eaux usées non traitées qui inondent les rues et finissent dans la mer.
***
De tous les secteurs détruits (infrastructures d'eau et d'électricité, système de santé, écoles, usines et commerces, fermes, bref, tout), le coût des dégâts infligés aux habitations est le plus élevé : 13,3 milliards de dollars. A la fin du mois de janvier, 62% des maisons de la bande de Gaza étaient totalement ou partiellement détruites, soit 290 820 unités d'habitation.
Je suppose que le terme « partiellement détruit » correspond aux dégâts subis par les appartements et les maisons de certains de mes amis à Gaza : ils n'ont plus de murs intérieurs, plus de toit, plus de fenêtres et de portes, plus de tuyaux, plus de planchers, plus d'escaliers, avec des murs extérieurs tordus et pleins de fissures. « Totalement détruit », c'est comme l'appartement d'un ami, au septième ou huitième étage, dans un complexe résidentiel qui, en un seul bombardement, s'est transformé en une bouillie de béton froissé.
***
La quantification n'inclut pas l'intérieur des appartements. Simples ou élégants. Bijoux en or ou bibliothèques privées, si chères au cœur de leurs propriétaires. Leurs livres ont servi à un moment donné de bois d'allumage, faute de combustible ou de bois.
La quantification suggérée par le rapport n'inclut évidemment pas la nostalgie de la mer vue de la fenêtre, les histoires et les poèmes enregistrés sur un ordinateur de bureau sans sauvegarde. Les peintures. L'importance de la maison pour les personnes qui ont grandi dans le désastre fondateur de la guerre de 1948 : quitter la maison et en être expulsé. Les souvenirs des premiers pas de la fille. La fierté et la joie lorsque les économies lentement accumulées ont permis d'obtenir un appartement séparé des parents ou des frères et sœurs.
Les chanceux – comme les habitants de Gaza ne cessent de le répéter aujourd'hui – ont effectivement été déracinés au début de cette guerre, mais ils vivent avec le reste de la famille élargie dans un appartement loué à un prix exorbitant à Rafah, ou chez des parents, avec une densité d'une douzaine de personnes ou plus par pièce. On entend de plus en plus parler de querelles et de tensions à l'intérieur de cette cocotte-minute. « J'en ai assez. J'envisage d'aller vivre sous une tente avec mes enfants », dit une amie. Ses tentatives pour se rendre en Egypte ont été vaines jusqu'à présent.
Même ceux qui sont partis à l'étranger n'y sont pas vraiment. Ils vivent le cauchemar jour et nuit. C'est le cas de Mona (nom fictif), la petite-fille de Naifa Al-Nawati. Mona, sa mère, son mari et ses enfants sont arrivés en Egypte il y a plus d'un mois. Ils ont essayé de parler tous les jours à leur famille restée sur place, dans l'immeuble Al Islam 3, dans la rue Ahmad Bin Abdel Aziz, à l'ouest de la maternité de l'hôpital Al-Shifa de Gaza.
Ils ont parlé à leurs oncles et tantes, ainsi qu'à leurs enfants. Ils n'ont pas pu parler à leur grand-mère de 94 ans : elle souffre de la maladie d'Alzheimer et a besoin de soins infirmiers et d'une surveillance 24 heures sur 24. « Elle ne peut même pas prendre un verre d'eau toute seule. » En raison de ses maladies et de sa dépendance, la famille est restée dans la ville de Gaza, malgré les ordres israéliens de se déplacer vers le sud au début de la guerre. « J'ai des amis dont les mères sont mortes dans une tente à Rafah », m'a dit Mona au téléphone, dans une sorte de justification inutile pour expliquer pourquoi ils ont refusé de traîner leur grand-mère vers le sud.
***
Au début de l'incursion terrestre et pendant les batailles dans la zone de l'hôpital Al-Shifa en novembre, la famille Al-Nawati a trouvé refuge dans les quartiers est de la ville. Plus tard, ils sont retournés dans leur immeuble, qui a été partiellement endommagé lors des échanges de tirs. Le 18 mars, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont de nouveau assiégé Al-Shifa, affrontant des hommes armés des organisations militantes palestiniennes.
Comme tout a commencé par une attaque surprise après minuit, les Al-Nawati et les autres habitants du bâtiment n'ont pas pu sortir et sont restés retranchés dans leurs maisons, sans nourriture ni eau, pendant quatre jours. Autour d'eux, les échanges de tirs et les rugissements des chars. « Le 21 mars, vers 11 heures du matin, une force des FDI a fait irruption dans l'appartement après avoir fait sauter la porte d'entrée », m'a raconté Mona.
Elle m'a raconté ce qu'elle avait entendu lors d'une conversation fragmentée avec sa tante à Rafah, lors d'une liaison téléphonique avec elle coupée à plusieurs reprises. Les militaires qui ont fait irruption dans la maison ont rassemblé les hommes qui se trouvaient dans le bâtiment dans une pièce séparée, où on leur a demandé de se déshabiller, on leur a bandé les yeux, puis on les a menottés et interrogés.
Mona ne sait pas combien ils étaient, mais elle affirme qu'ils n'étaient pas nombreux, car la plupart des habitants des appartements adjacents avaient déjà quitté l'immeuble. Au même moment, les soldats ont ordonné aux femmes de laisser leurs maris et leurs enfants adultes derrière elles et de partir vers le sud. Les femmes de la famille ont demandé aux soldats de laisser l'une d'entre elles rester dans la maison avec la grand-mère âgée, qui est dépendante d'elles.
Sur la base du rapport qu'elle a reçu de ses parentes, Mona m'a dit que « les soldats qui ont fait irruption dans la maison de ma grand-mère se sont comportés relativement bien, par rapport à leur comportement dans d'autres endroits, et au moins il a été possible de leur parler ».
Tout le monde à Gaza connaît les images et les témoignages sur les corps de civils retrouvés, abattus, dans les maisons où l'armée est entrée. Tout le monde connaît les histoires d'humiliation, y compris les photos des soldats. Pourtant, malgré leur relative gentillesse, les soldats ont refusé que l'une des femmes de la famille reste avec la grand-mère dans l'appartement. Ils ont promis aux femmes d'emmener Al-Nawati à l'hôpital Al-Shifa !
***
Les femmes qui se trouvaient dans l'immeuble sont arrivées dans le sud de la bande de Gaza vers le soir, et à peu près au même moment, les hommes ont été libérés, et elles ne savaient même pas que la vieille femme avait été laissée derrière. Depuis lors, la famille n'a pas été en mesure de savoir ce qui est arrivé à la femme de 94 ans. Elle s'est adressée à Hamoked [organisation de défense des droits humains basée en Israël dans le but déclaré d'aider « les Palestiniens soumis à l'occupation israélienne qui cause des violations graves et continues de leurs droits »], qui a déposé jeudi dernier une requête en habeas corpus devant la Haute Cour, en exigeant que les FDI déterminent ce qui est arrivé à la femme qui était sous leur garde.
Le porte-parole des FDI a déclaré à Haaretz à la fin de la semaine dernière qu'il n'était pas au courant de cet événement. La semaine dernière également, Mona m'a écrit qu'après que l'armée eut nettoyé la zone, ses cousins ont cherché sa grand-mère dans la maison elle-même et dans ce qui restait de l'hôpital, et n'ont trouvé aucune trace d'elle. « Personne ne les a informés qu'elle était entrée à Al-Shifa, la maison a complètement brûlé, et ils n'y ont pas trouvé son corps. Où l'ont-ils emmenée ? Nous sommes arrivés à une situation où nous pensons qu'il est préférable qu'elle soit morte. »
Lorsque je lui ai posé la question, Mona a expliqué : « Mercredi [la semaine dernière], ils ont vu tous les corps qu'ils soient en décomposition, intacts ou enterrés à Shifa. Elle n'en fait pas partie. Dans le bâtiment, ils n'ont rien trouvé, à l'exception des corps de ma cousine de 28 ans et de son mari au septième étage. Le toit est entouré de fenêtres en verre. Ma cousine est venue d'Allemagne – où vivent ses parents – pour se marier à Gaza, deux mois avant la guerre. Elle était enceinte de jumeaux. Nous pensons qu'un drone les a tués, puis que les corps ont brûlés avec le bâtiment. Ce sont les seuls cadavres qui ont été retrouvés dans le bâtiment. Nous ne savions pas jusqu'à présent ce qu'ils étaient devenus. »
« Il n'y a aucune trace de ma grand-mère », poursuit Mona. « Nous avions peur qu'ils trouvent son corps dans la maison et qu'elle soit morte seule, et nous avions peur que les chars l'écrasent dans la rue, s'ils l'avaient laissée seule pour qu'elle arrive à l'hôpital Al-Shifa. Nous avions peur de tout. Nous avions peur de l'étendue de sa souffrance si elle était vraiment morte seule, et nous avions peur de sa souffrance si elle était encore en vie. »
Après la publication de cet article en hébreu, Mona m'a écrit pour m'informer que ses cousins ont fouillé à nouveau la maison et ont trouvé les restes brûlés de sa grand-mère, dans son lit.
*
Article publié dans Haaretz le 10 avril 2024– traduction A l'Encontre revue par Contretemps.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les JO à Tahiti : défis logistiques et enjeux environnementaux
Jour de la terre : la nouvelle extinction de masse s’accélère !
La gauche qui tombe
Les travailleurs d’Amazon à Laval prêts à former un syndicat historique
Le membres de la FIQ rejettent une entente de principe « irrespectueuse »
Le mouvement étudiant déclenche une grève à durée indéterminée à l’Université nationale de Colombie
Plus d’abattoir au BSL pour le corps objet

L’intelligence artificielle et les algorithmes : au cœur d’une reconfiguration des relations internationales capitalistes

Dans cet article, nous explorons certaines reconfigurations de l’économie politique des relations internationales dans la foulée de l’avènement de nouveaux modes d’exploitation et d’expropriation et de nouvelles relations de dépendance à l’ère des technologies algorithmiques et de l’intelligence artificielle (IA).
Nous identifions d’abord certaines limites de l’hypothèse influente du « techno-féodalisme » pour expliquer les changements politicoéconomiques contemporains, et nous adoptons plutôt le cadre du « capitalisme algorithmique » qui nous apparait plus apte à rendre compte des développements actuels. Deuxièmement, nous examinons les nouveaux rapports capital-travail engendrés par la montée des plateformes et par la prolifération du « travail digital », en nous concentrant surtout sur des espaces du Sud global. Nous nous penchons ensuite sur une nouvelle modalité de transfert de valeur du Sud global vers le Nord sous la forme de l’extraction de données rendue possible par le déploiement d’infrastructures de technologies numériques dans des pays du Sud. Finalement, nous discutons brièvement de la rivalité sino-américaine et nous faisons appel au concept de « périphérisation » afin d’explorer quelques tensions, déplacements et continuités dans l’économie politique internationale, de la période du capitalisme néolibéral à celle du capitalisme algorithmique.
L’économie politique de l’IA et des algorithmes : une logique féodale ou capitaliste ?
Comment conceptualiser le contexte historique du déploiement accéléré des technologies d’IA ? L’économiste Cédric Durand a formulé une théorisation des transformations contemporaines de l’économie politique du numérique qui a réveillé l’économie politique hétérodoxe de son sommeil dogmatique et qui exerce une grande influence au sein de la gauche[2]. Sa conceptualisation « technoféodale » de l’économie politique contemporaine constitue une contribution d’une grande valeur, mais elle souffre également de limites importantes. Le concept de technoféodalisme met l’accent sur les intangibles[3] et sur les déplacements qu’ils occasionnent dans l’organisation de la production, de la distribution et de la consommation. Selon cette hypothèse, le durcissement des droits de propriété intellectuelle, la centralisation des données et le contrôle oligopolistique de l’infrastructure sociotechnique au cœur du déploiement des technologies algorithmiques et du pouvoir économique des grandes plateformes participent tous à la formation d’une vaste économie de rentes structurée autour de relations de dépendance de type « féodal ».
Les configurations économiques technoféodales sont largement répandues, selon Durand. D’une part, elles s’expriment dans les relations de travail : « Alors que la question de la subordination se trouve au cœur de la relation salariale classique, c’est le rapport de dépendance économique qui est prééminent dans le contexte de l’économie des plateformes[4] ». Durand détecte une dynamique de dépendance non capitaliste dans un contexte où la gestion par les plateformes d’une myriade de travailleuses et travailleurs dispersés subvertit les formes contractuelles d’exploitation du travail salarié. D’autre part, des dynamiques « féodales » se déploient également dans les relations entre différents capitaux : « L’essor du numérique bouleverse les rapports concurrentiels au profit de relations de dépendance, ce qui dérègle la mécanique d’ensemble et tend à faire prévaloir la prédation sur la production[5] ». Malgré la diversité des innovations, notamment autour de l’IA, lesquelles se multiplient à un rythme accéléré, il peut sembler tentant d’aller plutôt vers la notion de féodalisme étant donné la tendance lourde à la stagnation de la productivité et de la croissance économique.
La terminologie féodale identifie certes des changements importants dans les relations fondamentales du capitalisme, mais elle crée à notre avis un cadre conceptuel anachronique qui souffre de limites importantes, surtout lorsqu’il s’agit d’analyser le moment contemporain du déploiement de technologies algorithmiques et de l’IA dans une perspective globale. Premièrement, le terme génère une conception du changement sociohistorique eurocentriste en situant les développements contemporains dans un cadre conceptuel qui reproduit l’expérience historique européenne. Deuxièmement, et de façon reliée, le cadre conceptuel « néoféodal » ignore ainsi comment le capitalisme s’est développé à l’échelle mondiale à partir d’une articulation interne de formes hétérogènes de travail et de marché, d’exploitation et d’extraction, en particulier en rendant l’existence de formes marginales et subordonnées en périphérie indispensable pour le maintien de formes capitalistes plus typiques au centre. Troisièmement, le modèle mène à une conception réductionniste de la transition en niant son contenu concret. Dans l’analyse d’un processus en cours, il est problématique de recourir à des débats sur la transition du féodalisme au capitalisme alors que ceux-ci portent sur des modes de production pleinement constitués sur le plan historique. Cela risque de mener à un raisonnement tautologique, où des caractéristiques soi-disant « non capitalistes » de la nouvelle économie sont étiquetées a priori comme « féodales », pour ensuite en faire dériver un modèle « technoféodal ». Pour ces raisons, la référence au féodalisme européen est davantage une allusion, une métaphore, certes très évocatrice, mais sans véritable pouvoir explicatif[6] : il s’agit davantage par cette notion de signaler des changements économiques contemporains sous le sceau d’un sentiment général de « régression ».
Il faut à notre avis inscrire la récente vague de changements sociotechniques dans un cadre qui permet de saisir les reconfigurations globales et les combinaisons émergentes entre anciennes et nouvelles formes d’accumulation. Plutôt qu’un « retour vers le futur » féodal, nous soutenons que les transformations contemporaines représentent un nouveau stade du développement capitaliste, le capitalisme algorithmique[7], au sein duquel une logique d’exploitation/extraction capitaliste déploie des mécanismes rentiers et de nouvelles formes de dépendance[8]. Comme nous l’ont rappelé entre autres Nancy Fraser, David Harvey et David McNally, l’extraction et « l’accumulation par dépossession » sont des processus continus de l’accumulation du capital, et non pas un moment « d’accumulation initiale » révolu, ou encore des restes historiques de modes de production précapitalistes.
Le capital algorithmique se caractérise par le développement et l’adoption rapide des technologies algorithmiques portés par un impératif d’extraction de données qui (re)produit des relations d’exploitation/extraction dans les espaces-temps du travail, du loisir et de la reproduction sociale, brouillant ces distinctions du point de vue de l’économie politique du capitalisme[9]. En effet, l’exploitation du temps de travail dans la production de valeur d’échange, la forme « classique » de l’accumulation capitaliste, s’accompagne désormais d’une nouvelle forme d’extraction, celle des données, qui se produit pendant et au-delà du temps de travail. On observe ainsi de nouvelles formes de production de valeur qui s’étendent au-delà du temps de travail au fil de différentes opérations d’extraction, de traitement et de transformation de données qui génèrent diverses formes d’actifs et de marchandises pour les capitalistes algorithmiques.
Depuis le milieu des années 2000, les algorithmes se sont encastrés dans divers aspects de l’accumulation du capital, que ce soit sur le plan de la production, de la distribution ou de la consommation. Ils médiatisent les relations sociales, orientent les flux de la (re) production socioéconomique et du travail, et disséminent leur logique prédictive dans la société. Il est désormais ardu de trouver des secteurs économiques, des marchés, voire des sphères de la société, qui ne soient pas transformés ou influencés par les données massives et les algorithmes. Depuis la crise du néolibéralisme financiarisé de 2007-2008, le capital algorithmique reconfigure, réoriente et transcende divers processus et dynamiques du capitalisme néolibéral, alors que les compagnies technologiques des GAFAM[10] entre autres sont devenues les plus grandes compagnies au monde et des fers de lance de l’accumulation capitaliste. Bien entendu, les transitions historiques s’opèrent sur le long terme, et la crise de 2007-2008 est selon nous le symbole d’un processus prolongé de chevauchements et de changements plutôt qu’une rupture nette ou subite. Néanmoins, une transition s’opère effectivement depuis les 15 à 20 dernières années et reconfigure le système capitaliste et son économie politique internationale. De ce point de vue, les nouvelles articulations des rapports entre le Nord et le Sud global se déploient non pas dans le contexte d’un moment « néoféodal » mondialisé, mais dans celui de l’avènement du capital algorithmique. Les nouvelles relations dans la division internationale du travail et les nouveaux mécanismes de transfert de valeur du Sud vers le Nord (et maintenant aussi vers la Chine) se saisissent plus aisément de ce point de vue.
Rapports capital-travail et division internationale du travail
La montée historique du capital algorithmique s’accompagne de reconfigurations importantes du travail aux ramifications internationales. Au premier chef, de nouvelles formes de travail digital combinent, au sein d’assemblages divers, des processus d’exploitation du travail et d’extraction de données sous quatre formes principales. Le « travail à la demande » est le résultat d’une médiation algorithmique, souvent par des plateformes, de l’économie des petits boulots (gig work) ; le « microtravail » fragmente et externalise des tâches numériques auprès de bassins de travailleuses et travailleurs du clic ; le « travail social en réseau » est le lot d’utilisatrices et d’utilisateurs de plateformes, notamment les médias sociaux, lesquels produisent du contenu et traitent des données ; finalement, le « travail venture » forme une nouvelle élite du travail autour de femmes et d’hommes programmeurs, ingénieurs et autres scientifiques de données et experts en IA employés par les firmes technologiques[11]. Chacune de ces formes de travail digital déploie une logique d’exploitation/extraction, alors que la valeur et les données migrent du travail vers le capital algorithmique.
Ces reconfigurations de la relation capital-travail ont en retour réajusté des pratiques de sous-traitance et de délocalisation du travail par les compagnies technologiques du Nord vers les travailleuses et travailleurs du Sud. L’exemple bien connu de la plateforme américaine Uber, qui a conquis tant d’espaces urbains et semi-urbains dans le Sud global, est évocateur de cette tendance large. De plus, la sous-traitance du microtravail par les firmes technologiques auprès de travailleuses et travailleurs du digital du Sud global crée de nouvelles relations d’exploitation/extraction directes et indirectes. Des cas bien documentés comme celui de la sous-traitance par la firme OpenAI de travail d’étiquetage et de « nettoyage » des données utilisées pour entrainer son large modèle de langage ChatGPT auprès de microtravailleuses et microtravailleurs kenyans est évocateur. Ces derniers devaient « nettoyer » les données d’entrainement de ChatGPT afin d’en retirer les contenus violents ou inacceptables pour le modèle tels que des agressions sexuelles, l’abus d’enfants, le racisme ou encore la violence qui pullulent sur Internet[12]. Plusieurs de ces travailleuses et travailleurs ont souffert par la suite du syndrome de choc post-traumatique. Cela n’est que la pointe de l’iceberg d’un vaste réseau de nouveaux marchés de travail digital qui reconfigurent la division internationale du travail à l’ère numérique.
Hormis le microtravail effectué sur la gigaplateforme Amazon Mechanical Turk, surtout concentré aux États-Unis, la plupart du microtravail est effectué dans le Sud global. Le travail digital configure ainsi ses propres chaines de valeur selon une dynamique qui reproduit les pratiques de délocalisation suivant l’axe Nord-Sud de la division internationale du travail. En 2024, la majorité des requérants de microtravail se trouve dans les pays du G7, et la majorité des exécutants de ces tâches dans le Sud global. Souvent, ces travailleuses et travailleurs ne sont pas reconnus comme employés des plateformes, ne jouissent d’aucune sécurité d’emploi, d’affiliation syndicale ou de salaire fixe. Ces personnes héritent également de tâches aliénantes et sous-payées d’entrainement d’algorithmes, de traitement de données et de supervision d’intelligences artificielles qui passent pour pleinement automatisées.
La constitution d’un marché international du travail digital mobilise différents mécanismes institutionnels de l’industrie du développement international. Par exemple, la montée d’organisations d’« impact-sourcing[13] » participe d’une redéfinition du développement international autour de la notion de « fournir des emplois au lieu de l’aide[14] ». La logique de l’impact-sourcing n’est pas nouvelle, elle reproduit des processus de délocalisation et la quête de travail bon marché typique de la mondialisation néolibérale, comme la délocalisation des emplois de services à la clientèle en Asie, notamment en Inde. L’impact-sourcing se concentre toutefois sur la délocalisation du travail digital. Au départ, ces organisations d’externalisation étaient sans but lucratif pour la plupart et, appuyées par la Banque mondiale, elles distribuaient des téléphones portables et des tâches de microtravail dans des camps de réfugié·es, des bidonvilles et dans des pays du Sud global frappés durement par des crises économiques, au Venezuela par exemple. Plusieurs de ces organisations sont devenues par la suite des compagnies à but lucratif qui jouent désormais un rôle majeur dans la constitution et l’organisation d’un marché du travail digital dans des communautés où les occasions d’emploi formel sont rares. La firme Sama par exemple, celle-là même engagée par OpenAI pour sous-traiter l’entrainement des données de ChatGPT, est active en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où elle constitue des bassins d’emploi de travail digital à bon marché, notamment en Haïti et au Pakistan.
Nous voyons ainsi que le capital algorithmique introduit des modes d’articulation d’activités formelles et informelles, de boulots d’appoint et de tâches diverses sur plusieurs territoires. Le contrôle centralisé algorithmique de toutes ces activités garantit qu’elles produisent des données qui (re)produisent des formes de surveillance, de pouvoir social et de subordination du travail. Le travail qui supporte le développement de l’IA et des technologies algorithmiques ne provient donc pas uniquement de la Silicon Valley. C’est plutôt un travail collectif mondial qui produit l’IA à l’heure actuelle, mais la concentration de richesse et de pouvoir qui en découle se retrouve aux États-Unis et en Chine.
Extraction des données et transfert de valeur
La montée du travail digital dans le Sud global est également symptomatique de l’impératif d’extraction du capital algorithmique. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la plupart des accords mondiaux de libre-échange qui structurent le commerce international régulent le mouvement des biens et services, mais aussi des données. Les géants du numérique comme Meta, Google, Amazon et Microsoft dominent à l’échelle mondiale et sont actifs dans le déploiement d’une infrastructure numérique dans les pays du Sud global en échange d’un accès exclusif aux données ainsi générées. Les ramifications internationales de cette « datafication » du Sud global[15] nous invitent à réviser le contenu de concepts tels que le colonialisme ou encore l’impérialisme. L’hégémonie américaine de la deuxième moitié du XXe siècle s’est bâtie sur des rapports économiques inégalitaires et des transferts de valeur du Sud global vers le Nord global, surtout vers les États-Unis et leurs alliés, sous diverses formes : la division internationale du travail, l’échange inégal, la coercition et l’appropriation par le marché, ou encore le mécanisme de la dette. L’ère du capitalisme algorithmique reproduit ces relations d’exploitation/extraction, mais déploie également un nouvel aspect : les transferts de valeur qui s’opèrent du Sud vers le Nord prennent désormais également la forme d’un transfert de données vers les centres que sont les États-Unis et la Chine[16], un transfert de données qui s’accompagne d’un pouvoir algorithmique de surveillance[17], de dépendance et potentiellement de gouvernementalité algorithmique[18] qui posent de nouveaux défis à la souveraineté nationale des pays du Sud. C’est ce que nous appelons le néocolonialisme algorithmique.
La « datafication » du Sud global a également des conséquences importantes dans la sphère du développement international, où l’on assiste à un transfert de pouvoir vers des acteurs du secteur privé. Les compagnies algorithmiques ont maintenant supplanté les autres joueurs traditionnels du complexe institutionnel du développement international (ONG, organisations internationales, gouvernements, banques de développement, organisations humanitaires, etc.) en ce qui concerne les informations sur les populations du Sud global. Les donateurs et autres bailleurs de fonds du développement international se tournent désormais vers des compagnies technologiques pour un accès aux données collectées par leurs applications, lesquelles sont plus nombreuses et détaillées que celles colligées par les méthodes « traditionnelles » (recensements, enquêtes, recherches scientifiques, etc.). Il en résulte que ces compagnies privées héritent d’un plus grand pouvoir de définir les enjeux de développement, de fixer des priorités et d’influencer la gouvernance des projets de développement.
De nouvelles dynamiques de pouvoir émergent ainsi entre acteurs publics et acteurs privés, ce qui soulève également des enjeux épistémologiques et éthiques. D’une part, les données extraites par les compagnies algorithmiques reflètent davantage la situation des populations « connectées » que celle des populations moins intégrées à l’économie de marché, au monde numérique et à la consommation de masse. D’autre part, la propriété des données donne aux capitalistes algorithmiques le pouvoir de voir tout en niant aux utilisatrices et utilisateurs le pouvoir de ne pas être vus. Mark Zuckerberg, par exemple, fait appel à une rhétorique philanthropique afin de promouvoir son projet de développement international « internet.org », visant à connecter gratuitement à l’Internet à l’échelle mondiale les populations défavorisées. L’intérêt de Meta dans un tel projet consiste bien sûr à s’approprier ainsi toutes les données générées par ces nouvelles connexions à grande échelle, surtout dans un contexte où la plupart des pays du Sud global visés par une telle initiative n’ont pas de législation solide concernant la propriété des données ou encore la protection de la vie privée. C’est cette logique extractive, combinée à un « solutionnisme technologique[19] » sans complexe, qui pousse IBM à vouloir utiliser l’IA afin de solutionner les problèmes en agriculture, en santé, en éducation et des systèmes sanitaires au Kenya, ou encore le géant chinois Huawei à développer environ 70 % du réseau 4G en Afrique, en plus de conclure des contrats notamment avec les gouvernements camerounais et kenyan afin d’équiper les centres de serveurs et de fournir des technologies de surveillance[20]. Les compagnies algorithmiques du Nord et de la Chine accumulent ainsi du pouvoir, de la richesse et de l’influence dans les pays du Sud global par ces formes de néocolonialisme algorithmique.
L’économie politique internationale du capitalisme algorithmique et la périphérisation
Le néocolonialisme algorithmique et les relations sino-américaines
L’avènement du capitalisme algorithmique se produit dans une conjoncture internationale de possible transition hégémonique. La croissance soutenue et parfois spectaculaire de la Chine dans les 40 dernières années se traduit désormais par une mise au défi du pouvoir unipolaire américain en place depuis la fin de la Guerre froide. La Chine est encore bien loin de l’hégémonie mondiale, mais sa montée en puissance ébranle déjà les dynamiques de pouvoir en Asie. Alors que le champ gravitationnel de l’accumulation mondiale s’est déplacé de la zone nord-atlantique vers l’Asie du Sud et du Sud-Est dans les dernières décennies[21], la Chine a développé son propre modèle de capitalisme algorithmique autoritaire et se pose désormais en rival mondial des États-Unis sur le plan de l’accumulation algorithmique et des technologies d’IA[22]. Les tensions manifestes dans cet espace de compétition internationale s’accompagnent d’un déclin soutenu du pouvoir économique des pays de l’Union européenne, pour qui le développement du capitalisme algorithmique se fait dans une relation de dépendance envers les États-Unis.
Tout comme le capital algorithmique américain déploie ses rapports capital-travail et ses modes d’exploitation/extraction dans de nouvelles configurations internationales, le capital algorithmique chinois déploie également une infrastructure technologique au fil de ses investissements internationaux, construisant des réseaux de transfert de valeur et de données en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, des réseaux orientés vers la Chine. Les flux mondiaux de données prennent ainsi deux directions majeures, les États-Unis et la Chine, avec l’exception notable de la Russie, le seul pays du monde autre que les États-Unis et la Chine à conserver une certaine forme de souveraineté numérique. Alors que le capital algorithmique déploie son unique configuration de mécanismes d’exploitation/extraction, des espaces du capitalisme mondial qui étaient jadis centraux dans l’accumulation du capital sont maintenant en voie de devenir périphériques.
La périphérisation
L’infrastructure sociotechnique algorithmique contemporaine imprègne de plus en plus chaque pore des chaines de valeur mondiales et approfondit les segmentations entre nations et régions au sein des espaces d’accumulation du capital. Le processus actuel de périphérisation de certains espaces du capitalisme mondial doit toutefois être remis dans un contexte historique plus long : la dépendance mondiale envers les GAFAM (et leurs contreparties chinoises) s’enracine dans des formes du droit international et des processus politiques hérités de la période néolibérale. La thèse technoféodale peut également être critiquée de ce point de vue : en décrivant un monde où les pouvoirs privés surpassent ceux des États, elle reproduit la même confusion qui caractérisait les arguments du « retrait de l’État » lors des rondes de privatisations intensives au plus fort de la période néolibérale. En fait, cette asymétrie de pouvoir est elle-même promulguée par les États sous la forme du droit, et elle résulte des positions inégales qu’occupent les différents pays en relation avec les compagnies technologiques transnationales. En ce sens, des formes de gouvernance néolibérale perdurent dans des types d’administration qui favorisent les compagnies privées et maintiennent en place l’orthodoxie budgétaire. Les politiques d’innovation demeurent ainsi largement orientées vers le secteur privé, et le système de droit de propriété intellectuelle international hérité de la période néolibérale sous-tend l’hégémonie des GAFAM aujourd’hui. En adoptant une perspective historique à plus long terme, nous voyons que la subordination d’États et de leur territoire à des compagnies transnationales n’est pas nouvelle dans le capitalisme ; en fait, il s’agit d’une condition structurelle qui distingue les pays périphériques des pays du centre.
Les « nouvelles relations de dépendance » à l’ère contemporaine se comprennent plus aisément lorsqu’on tient compte de l’histoire des monopoles intellectuels au-delà de la Californie. La vaste offensive de privatisation des actifs intangibles a débuté dans les années 1990 et s’est appuyée sur les tribunaux et les sanctions commerciales afin d’obliger les pays du Sud à se conformer au régime strict de droit de propriété intellectuelle. L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC; TRIPS en anglais) est né d’une collaboration avec des entreprises du savoir du Nord de façon à établir des unités de production partout dans le monde tout en limitant l’accès aux intangibles par l’entremise des brevets. La disponibilité de cette infrastructure pour les pays du Sud était conditionnelle à l’adoption d’une forme renouvelée de domination. De plus, bien que les États-Unis et la Communauté européenne occupaient à l’époque une position dominante dans les secteurs informatique, pharmaceutique, chimique et du divertissement, et détenaient les marques déposées les plus importantes au monde, les États-Unis, en tant que premier exportateur mondial de propriété intellectuelle, jouissaient de davantage de marge de manœuvre pour consolider leur position et celle des compagnies qui possédaient d’importants portfolios de propriété intellectuelle.
Quelques décennies plus tard, le sol a certes bougé. Le développement du néocolonialisme algorithmique modifie l’ancienne division entre les gagnants du Nord et les perdants du Sud. Le durcissement du droit de propriété intellectuelle affecte même le Nord global, surtout les pays européens ou encore le Canada, et ce, en raison d’effets à long terme de politiques de flexibilisation et d’austérité qui ont jeté les bases de la montée du capital algorithmique. Cela illustre bien la complexité des transitions historiques, qui sont autant des moments de rupture que de chevauchement d’un vieux monde qui prépare le terrain pour le nouveau. L’Europe est désormais durablement larguée dans la course aux technologies algorithmiques et à l’IA, notamment en raison de systèmes d’innovation nationaux qui demeurent largement articulés autour du leadership du secteur privé, ce qui empêche les gouvernements d’intervenir dans les jeux de la concurrence capitaliste internationale. Alors que la Chine et la Russie ont été en mesure de développer de robustes écosystèmes numériques nationaux, on constate l’absence de capital européen au sommet du secteur technologique algorithmique, et les pays européens doivent pour la plupart se fier à l’infrastructure numérique de compagnies américaines.
Alors que l’avantage industriel historique européen s’est effrité sans être remplacé par de nouvelles capacités, cela nous rappelle que la compétition dans l’ordre international est bidirectionnelle : certains pays gagnent du terrain, d’autres en perdent. Comme le rappelle Enrique Dussel[23], les relations de dépendance entre des capitaux nationaux avec des degrés d’intrants technologiques différents sont un produit de la concurrence internationale. La « dépendance » européenne découle ainsi d’une logique de compétition internationale qui a altéré la relation des pays de l’Union européenne avec les intangibles. L’expérience européenne n’est pas celle d’une transition vers un autre mode de production « technoféodal », mais celle d’un passage de l’autre côté de l’ordre capitaliste mondial, celui de la périphérie. Loin d’un « retour vers le futur » néoféodal, ce processus de périphérisation qui affecte l’Europe, mais également d’autres espaces du capitalisme mondial, est symptomatique d’une reconfiguration des relations d’exploitation/extraction dans le nouveau stade du capitalisme algorithmique.
Par Giuliana Facciolli, Étudiante à la maîtrise à l’Université York et Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l’Université Concordia.
NOTES
L’autrice et l’auteur remercient Écosociété de sa permission de reproduire certains passages du livre de Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco, Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle, Montréal, Écosociété, 2023. ↑
- Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, Zones, 2020. D’autres contributions importantes à la conceptualisation des changements contemporains en lien avec le concept de féodalisme viennent entre autres de : Jodi Dean, « Communism or neo-feudalism? », New Political Science, vol. 42, no 1, 2020 ; Yanis Varoufakis, « Techno-feudalism is taking over », Project Syndicate, 28 juin 2021 ; David Graeber parle de son côté de « féodalisme managérial » dans les relations de travail contemporaines. Voir David Graeber, Bullshit Jobs, New York, Simon & Schuster, 2018; en français: Bullshit Jobs, Paris, Les liens qui libèrent, 2018. ↑
- Les actifs intangibles sont des moyens de production qu’on ne peut « toucher », par exemple un code informatique, un design, une base de données. Durand, Techno-féodalisme, op. cit., p. 119. ↑
- Durand, p. 97. ↑
- Durand, p. 171. ↑
- Pour une critique différente mais convergente, voir Martineau et Durand Folco, 2023, op. cit., p. 174-179. ↑
- Martineau et Durand Folco, 2023, op. cit. ↑
- L’idée des relations capitalistes comme assemblages de modes d’exploitation et d’extraction (ou expropriation) et de l’accumulation du capital comme à la fois un processus d’exploitation et de « dépossession » est inspirée de contributions de Nancy Fraser, David Harvey et David McNally : Nancy Fraser, « Expropriation and exploitation in racialized capitalism : a reply to Michael Dawson », Critical Historical Studies, vol. 3, no 1, 2016 ; David McNally, Another World is Possible. Globalization and Anti-capitalism, Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing, 2006 ; David Harvey, Le nouvel impérialisme, Paris, Les Prairies ordinaires, 2010. ↑
- Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco, « Paradoxe de l’accélération des rythmes de vie et capitalisme contemporain : les catégories sociales de temps à l’ère des technologies algorithmiques », Politique et Sociétés, vol. 42, no 3, 2023. ↑
- NDLR. Acronyme désignant les géants du Web que sont Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft. ↑
- Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019 ; Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco, « Les quatre moments du travail algorithmique : vers une synthèse théorique », Anthropologie et Sociétés, vol. 47, no 1, 2023 ; Gina Neff, Labor Venture. Work and the Burden of Risk in Innovative Industries, Cambridge, MIT Press, 2012. ↑
- Billy Perrigo, « Exclusive : OpenAI used kenyan workers on less than $2 per hour to make ChatGPT less toxic », Time, 18 janvier 2023. ↑
- Parfois traduit en français par « externalisation socialement responsable ». ↑
- Phil Jones, Work Without the Worker. Labour in the Age of Platform Capitalism, Londres,Verso, 2021. ↑
- Linnet Taylor et Dennis Broeders, « In the name of development : power, profit and the datafication of the global South », Geoforum, vol. 64, 2015, p. 229‑237. ↑
- Ce phénomène a certains précédents, notamment la compagnie IBM qui s’appropriait dès les années 1970 les données transitant par ses systèmes informatiques installés dans certains pays du Sud global. Il se déploie toutefois aujourd’hui à une échelle beaucoup plus grande. ↑
- Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Paris, Zulma, 2022. ↑
- Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, vol. 1, n° 177, 2013, p. 163‑96. ↑
- Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here. The Folly of Technological Solutionism, New York, PublicAffairs, 2014. ↑
- Mohammed Yusuf, « China’s reach into Africa’s digital sector worries experts », Voice of America, 22 octobre 2021. ↑
- David McNally, Panne globale. Crise, austérité et résistance, Montréal, Écosociété, 2013. ↑
- Kai-Fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2018. ↑
- Enrique Dussel, Towards an Unknown Marx. A Commentary on the Manuscripts of 1861-63, Abingdon, Taylor & Francis, 2001. ↑

Le sage centenaire

Guy Rocher a vu le jour le 20 avril 1924. Il a donc maintenant 100 ans révolus. Il est un des 9 500 centenaires que compte le Canada. Nul doute que l'implication de cet homme dans nos grands débats de société, tout au long de son parcours de vie en général et surtout de la fin des années quarante à aujourd'hui, a été bénéfique et profitable pour nous tous et toutes.
Son anniversaire de naissance me permet de revenir sur certains aspects de sa vie et de profiter de l'occasion pour lui dire un immense merci pour tout ce qu'il a fait et continue toujours de faire pour notre collectivité encore aujourd'hui. Dans les prochaines lignes, je veux vous parler de l'homme que je connais, de l'auteur que je lis, du professeur de sociologie qui m'a enseigné, de l'acteur social qui m'interpelle et bien entendu de l'ami indéfectible que j'apprécie.
Un parcours diversifié
Guy Rocher a un parcours atypique. Après des études classiques ininterrompues qui le mènent à l'obtention d'une licence en droit, il délaisse les bancs d'école pour se joindre à la Jeunesse étudiante catholique (JEC). C'est au sein de cette organisation, dans laquelle il milite bénévolement à temps plein, qu'il va décider, quelques années plus tard, d'effectuer un retour aux études universitaires en sociologie. Entre-temps, il fera la rencontre d'une personne qui va l'inviter ultérieurement à participer aux travaux d'une commission d'enquête, dont on parle encore aujourd'hui de plusieurs de ses recommandations.
De cette époque (des années quarante et cinquante), deux hommes méritent d'être nommés : le père Georges-Henri Lévesque et bien entendu Paul Gérin-Lajoie. Pourquoi ces deux personnes ? D'une part, c'est le père Lévesque qui a parrainé Guy Rocher dans ses démarches d'inscription à la prestigieuse Université Harvard et, pour sa part, Paul Gérin-Lajoie fera de notre jeune nouveau centenaire un commissaire chargé de formuler des recommandations porteuses d'avenir en matière d'éducation pour la province de Québec (et j'ai nommé la célèbre Commission Parent).
Il m'arrive souvent de me demander ce qui aurait pu arriver aux enfants de la classe ouvrière qui ont vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale n'eût été les travaux de cette commission d'enquête. Une chose est certaine, peu parmi les bébés boomers, issus des milieux populaires, auraient été en mesure d'accéder aux niveaux d'enseignement supérieur. C'est grâce aux travaux des membres de la Commission Parent et aux audacieuses propositions de réformes contenues dans leur rapport qu'il y a eu, durant les années soixante, la création d'une kyrielle de nouvelles institutions scolaires au Québec (les polyvalentes, les cégeps et aussi le réseau de l'Université du Québec). En bref, la création de plusieurs dizaines d'établissements d'enseignement susceptibles de permettre autant aux filles en plus grand nombre qu'aux garçons de développer leurs aspirations scolaires et de pouvoir poursuivre leurs études en s'endettant le moins possible. Montrons-nous reconnaissant à l'endroit des hommes et des femmes qui ont fait partie de cette commission d'enquête et qui n'ont pas hésité à oser proposer la reconfiguration de notre système scolaire pour en faire un système intégré (de la prématernelle à l'université) et adapté aux nouvelles exigences de la société du savoir et surtout moins porteur de discrimination fondée sur le sexe. Mais Guy Rocher c'est plus qu'un ex-membre de la Commission Parent, c'est aussi un grand intellectuel inspirant.
L'intellectuel inspirant
En écoutant ou en lisant Guy Rocher, nous nous retrouvons avec un scientifique qui tient des discours ou qui rédige des textes invitant à douter des théories doctrinales. Sa démarche nous incite fortement à analyser et à nuancer ce qui mérite de l'être. Pour être bref, Guy Rocher nous encourage à éviter dans nos réflexions et notre production de connaissances les chapelles dogmatiques ou les catégories illusoires que reprennent à leur compte les personnes au pouvoir ou qui ambitionnent de le conquérir. Il est certes un brillant scientifique ; un des rares à pouvoir communiquer avec clarté dans une langue accessible au plus grand nombre. Son style d'écriture s'oppose au langage hermétique de trop nombreux universitaires nébuleux qui s'expriment dans une exposition de leur savoir tarabiscotée à outrance. La pensée de Guy Rocher s'éloigne évidemment d'un manichéisme simpliste ou des oppositions élémentaires et souvent binaires.
Un regard analytique qui va au-delà des théories toutes faites
Il m'a toujours été agréable de lire un texte écrit par Guy Rocher ou de prendre connaissance de ses résultats de recherche. Son étude portant sur les aspirations scolaires (l'étude du groupe ASOPE) nous en a appris beaucoup sur les raisons expliquant pourquoi certains jeunes abandonnaient l'école. À l'époque où les théories sur la surdétermination en dernière instance ou non des structures sociales étaient à la mode et faisaient des adhérentes et des adhérents rapidement, lui et son équipe de recherche ont plutôt découvert, à travers une longue étude empirique, que dans certains cas la raison principale résidait dans le fait que le personnel de l'école et certains parents demandaient à leurs enfants « que vas-tu faire à la fin de tes études ? ». La fin des études correspondait ici au secondaire 5. Pour le jeune professeur de cégep et d'université que j'étais, les résultats de cette recherche m'ont fait comprendre que la réponse à certains faits sociaux ne résidait pas, hélas, dans la richesse d'un cadre théorique élaboré au XIXe siècle ou dans les écrits d'universitaires localisés dans une tour d'ivoire de certaines institutions prestigieuses. Guy Rocher n'adhère pas au déterminisme à la manière d'Émile Durkheim. Il est d'avis que la découverte sociologique est à la fois le résultat d'une intervention de la société sur elle-même et implique également de reconstruire le tout dans les gestes et les paroles des individus concernés par le phénomène à l'étude. Inspiré en cela par Max Weber, Guy Rocher a pratiqué le constructivisme sociologique bien avant que celui-ci soit de mise dans la recherche actuelle.
Guy Rocher et la curiosité
Lors d'une intervention au Collège Montmorency, Guy Rocher a déclaré qu'il existait deux sources d'accès au bonheur : la curiosité et l'adhésion à une cause susceptible de modifier l'organisation de la vie dans la Cité. C'est en effet l'étonnement ou la curiosité, si vous préférez, qui le conduit depuis fort longtemps dans la voie de la résolution de l'énigme du changement social. Sans la curiosité, il n'y a pas, selon lui, de connaissances susceptibles de nous permettre de comprendre le monde ou ses phénomènes concrets et de trouver des voies qui mènent à la résolution du changement raisonné. Pourquoi les filles et les garçons n'ont-ils pas accès aux mêmes programmes de formation scolaire et universitaire ? Pourquoi les francophones, les autochtones, les allophones subissent-elles et -ils des discriminations face aux anglophones ? La quête du savoir ou de la connaissance chez Guy Rocher puise incontestablement dans une forme de stupeur devant le monde tel qu'il se présentait ou se dresse devant lui. C'est la persistance de son étonnement, tout au long de sa longue vie d'adulte, qui lui a permis de continuer à interroger d'une manière franche et authentique le monde dans lequel nous sommes et où nous retrouvons des personnes qui veulent le garder intact, tandis que d'autres veulent contribuer à le refaçonner. Chez Guy Rocher, le premier moteur du changement reste incontestablement la surprise, l'étonnement ou la curiosité devant ce qui est et ce qui ne fonctionne pas. Voilà aussi pourquoi face à ce monde divisé et présentant des injustices, pour être heureux, il faut adhérer à des causes en s'impliquant et en s'engageant.
Le professeur Guy Rocher
Je côtoie l'ex-professeur Guy Rocher depuis maintenant 35 ans. J'ai assisté à son séminaire portant sur la sociologie du droit ; séminaire donné à des étudiantes et des étudiants de deuxième et troisième cycles à l'Université de Montréal. Nous étions environ une vingtaine de personnes à suivre ce cours. Au menu des séances hebdomadaires de chaque cours : l'étude d'un ou de plusieurs documents puisés à même un volumineux recueil de textes, des exposés du professeur, mais surtout un échange intense entre le professeur et les étudiantes et étudiants portant sur les textes lus. Moi, j'ai toujours été étonné par la richesse de cette approche pédagogique. Le professeur Rocher avait autant de plaisir que nous à commenter les textes, mais aussi à écouter les commentaires des participantes et participants. Durant ces échanges, j'ai vu monsieur Rocher prendre des notes ; je l'ai entendu reconnaître humblement ne pas avoir perçu la question sous l'angle exprimé par l'étudiante ou l'étudiant et il reconnaissait la pertinence de ce point de vue. Monsieur Rocher sait écouter les autres avec beaucoup d'ouverture d'esprit, tout en étant très tolérant face aux points de vue qui s'opposent aux siens.
L'acteur social
Monsieur Rocher est aussi un acteur social qui a beaucoup donné à la collectivité. Il a largement contribué à façonner certaines institutions qui ont fait du Québec une société dynamique, porteuse de changements bénéfiques et nécessaires. Pensons ici à nouveau à sa contribution à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la Province de Québec (la Commission Parent) qui a permis la mise en place d'un système d'éducation démocratique, accessible, public et laïque. C'est principalement grâce à l'acteur social Guy Rocher (et aux autres commissaires de la Commission Parent) que plus de deux millions de personnes ont pu se diplômer aux niveaux collégial et universitaire ; ce qui n'est pas peu dire. En tant qu'acteur social, Guy Rocher a joué un rôle important lors de la rédaction de la Charte de la langue française au Québec (la Loi 101). De plus, durant la grève de ses collègues universitaires, il n'a pas hésité à prendre parti en leur faveur. Tout en étant attaché à l'Université de Montréal, il a demandé à la ministre de l'Éducation de l'époque de financer adéquatement l'UQAM. Que dire de ses interventions lors des grèves des professeurs de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Montréal en 1976-1977 ? À cette époque, il a été un sous-ministre du développement culturel qui n'a pas eu peur d'ouvrir la porte de son bureau à des présidents de syndicats, alors que le ministre de l'Éducation préférait entendre le seul point de vue des recteurs de ces universités désertées pendant plus de 15 semaines.
Une vie qui a contribué à changer le monde
Quand je regarde la vie de Guy Rocher, je constate qu'il est possible d'analyser, dans le cadre d'une démarche rigoureuse et originale, notre monde en vue de le changer en fonction des intérêts du plus grand nombre. Guy Rocher est pour moi un sociologue et un citoyen qui s'est mis au service des membres de la société en nous suggérant fortement d'envisager la nécessité de s'enrôler socialement et politiquement, d'abord en observant notre monde, ensuite en identifiant les injustices et finalement en s'engageant dans la voie du changement afin de combattre les discriminations intolérables entre les sexes, les oppressions inqualifiables entre les groupes ethniques et culturels ainsi que les exclusions inacceptables des groupes minoritaires.
Pour conclure : Sur un ton un peu plus personnel…
De ce qui précède, deux mots me viennent en tête : générosité et inspiration. Monsieur Rocher vous êtes un être profondément généreux. Vous avez donné beaucoup aux autres et vous êtes toujours disponible pour continuer à donner. Encore aujourd'hui, vous intervenez quand on sollicite votre avis sur certains enjeux de société. Vous nous montrez qu'une personne, même centenaire, peut toujours entreprendre avec passion ce qu'elle a le goût de faire. Contrairement à ce que suggère Sénèque, vous êtes la preuve que même à un âge avancé il n'est pas nécessaire de se retirer de la scène publique. Il y a incontestablement beaucoup de vous dans ce que nous sommes.
Sur un ton un peu plus personnel qu'il me soit permis de dire que vous êtes un de ceux qui m'ont inspiré dans la voie des études avancées, mais surtout à trouver du plaisir dans les sentiers non balisés à emprunter qui mènent à la découverte sociologique. Vos écrits n'ont jamais cessé d'alimenter ma réflexion critique.
Monsieur Rocher, continuez à afficher ce sourire serein d'une personne qui ne renonce pas à jeter un regard critique sur la vie en société. Pour cette raison et encore plusieurs autres, moi, je vous encourage à continuer à nous livrer le résultat de vos analyses… Sachez en terminant que votre nom figure bien haut sur la courte liste de personnes exceptionnelles qui marquent leur époque. Bonne continuation, monsieur Rocher, et surtout longue vie… notre monde a toujours besoin de personnes qui ont une soif de justice sociale et qui indiquent la voie à définir et à emprunter pour réaliser le nécessaire changement social.
Vous incarnez, depuis fort longtemps, aux yeux de plusieurs un sage. À partir d'aujourd'hui, le 20 avril 2024, nous pouvons dire, salutations amicales à l'ami Rocher, le sage centenaire.
Yvan Perrier
20 avril 2024
yvan_perrier@hotmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La Suisse condamnée pour inaction climatique : une éclaircie dans l’orage
Les « droits numériques » sont des droits humains
Rire du Pire

Vers une théorie globale du capitalisme algorithmique

La littérature sur l’intelligence artificielle (IA) et les algorithmes est aujourd’hui foisonnante, c’est le moins qu’on puisse dire. Toutefois, la plupart des analyses des impacts de l’IA abordent différents domaines de façon isolée : vie privée, travail, monde politique, environnement, éducation, etc. Peu de contributions traitent de façon systématique des rapports complexes qui se tissent entre le mode de production capitaliste et les algorithmes. Notre hypothèse de départ est qu’on ne peut comprendre le développement fulgurant des algorithmes sans comprendre les reconfigurations du capitalisme, et vice versa.
Pour saisir adéquatement les implications sociales, politiques et économiques des machines algorithmiques, il faut situer ces innovations dans le contexte de mutation du capitalisme des deux premières décennies du XXIe siècle. Nous suggérons que la valorisation des données massives et le déploiement rapide de l’IA grâce aux avancées de l’apprentissage automatique (machine learning) et de l’apprentisage profond (deep learning) s’accompagnent d’une mutation importante du capitalisme, et ce, au même titre que la révolution industrielle qui a jadis propulsé l’empire du capital au XIXe siècle. Nous sommes entrés dans un nouveau stade du capitalisme basé sur une nouvelle logique d’accumulation et une forme de pouvoir spécifique, que nous avons baptisé capital algorithmique. Ce terme désigne un phénomène multidimensionnel : il s’agit à la fois d’une logique formelle, d’une dynamique d’accumulation, d’un rapport social et d’une forme originale de pouvoir fondé sur les algorithmes. Il s’agit de conceptualiser la convergence entre la logique d’accumulation du capital et l’usage accru de nouveaux outils algorithmiques. Par contraste, l’expression « capitalisme algorithmique » renvoie plutôt à la formation sociale dans sa globalité, c’est-à-dire l’articulation historique d’un mode de production et d’un contexte institutionnel, ce que Nancy Fraser appelle un « ordre social institutionnalisé[2] ». Il faut donc distinguer la société capitaliste dans laquelle nous sommes, et le rapport social spécifique qui se déploie d’une multitude de manières.
Si la littérature a produit une panoplie d’appellations qui mettent l’accent sur différents aspects du capitalisme contemporain (capitalisme de surveillance, de plateforme, etc.), le concept de « capital algorithmique » comporte plusieurs avantages heuristiques afin de saisir la logique du nouveau régime d’accumulation capitaliste. Il permet d’abord de replacer le travail et la production au centre de l’analyse, mais également d’identifier ce qui, à notre avis, constitue le réel cœur de la logique d’accumulation du capitalisme aujourd’hui et de la relation sociale qui s’y déploie : l’algorithme. En effet, l’algorithme est le principe structurant du nouveau régime d’accumulation capitaliste qui prend appui sur, réarticule, et dépasse le néolibéralisme financiarisé. Premièrement, l’algorithme devient le mécanisme dominant d’allocation du « travail digital » (digital labor). Deuxièmement, l’algorithme ou l’accumulation algorithmique devient le mécanisme dominant de détermination du processus de production. Troisièmement, les algorithmes et les données qui leur sont associées deviennent un objet central de la concurrence entre les entreprises capitalistes. Quatrièmement, les algorithmes médiatisent les relations sociales, notamment par l’entremise des réseaux sociaux et des plateformes numériques. Cinquièmement, les algorithmes médiatisent l’accès à l’information et à la mémoire collective. Sixièmement, l’algorithme génère des revenus en participant à la production de marchandises, ou en tant que mécanisme participant de l’extraction de rentes différentielles. Septièmement, au-delà des entreprises privées, nombre d’organisations et de sphères sociales, allant des pouvoirs publics, services de police, complexes militaires, aux ONG de développement, en passant par les soins de santé, l’éducation, le transport, les infrastructures publiques, etc., ont recours à des technologies algorithmiques afin d’exercer leur pouvoir ou leurs activités. C’est la raison pour laquelle l’algorithme, bien davantage que le « numérique », le « digital », la « surveillance » ou autre constitue le cœur du nouveau régime d’accumulation : il médiatise les relations sociales, préside à la (re)production socioéconomique et diffuse sa logique prédictive dans la société contemporaine.
Si l’expression « capitalisme numérique » peut servir à désigner de manière large les multiples façons dont les technologies numériques influencent le capitalisme et inversement, cette catégorisation demeure trop générale et abstraite pour bien saisir les mécanismes et métamorphoses à l’œuvre au sein des sociétés du XXIe siècle. Plus précisément, l’hypothèse du capitalisme algorithmique suggère qu’il existe une rupture entre deux phases ou moments du capitalisme numérique. Alors que la période qui part de la fin des années 1970 correspond à l’émergence du capitalisme néolibéral, financiarisé et mondialisé, dans la première décennie du XXIe siècle, avec l’arrivée de nouvelles technologies comme l’ordinateur personnel et l’Internet de masse, une série de transformations a produit un effet de bascule ; les médias sociaux, les téléphones intelligents, l’économie de plateformes, les données massives et la révolution de l’apprentissage automatique ont convergé avec la crise financière mondiale de 2007-2008 pour accélérer le passage vers une reconfiguration du capitalisme où la logique algorithmique joue un rôle déterminant.
Pour éviter une conception trop mécanique et réductrice du capitalisme algorithmique, il importe de positionner notre perspective parmi la littérature foisonnante des théories critiques du capitalisme contemporain. Comme il existe une variété de positions entourant les relations complexes entre les technologies et le système capitaliste, nous pouvons distinguer trois principaux axes de débats : l’IA comme outil du capital, la nature du capitalisme et les possibilités d’émancipation.
L’IA, outil du capital ?
Premièrement, dans quelle mesure les algorithmes sont-ils des outils soumis à la logique capitaliste ? Selon une première position acritique, les algorithmes possèdent leur propre réalité, fonctions et usages potentiels, de sorte qu’il est possible de les analyser et de les développer sans faire référence au mode de production capitaliste, à ses impératifs d’accumulation, à ses modes d’exploitation et à ses contraintes spécifiques. Cette vision dominante des algorithmes, largement partagée au sein des milieux scientifiques, industriels et médiatiques, inclut les théories courantes de l’IA, l’éthique des algorithmes ou encore les positions techno-optimistes qui considèrent que les données massives, les plateformes et l’apprentissage automatique pourront créer un monde plus efficace, libre et prospère. Si les auteurs n’hésitent pas à reconnaitre les risques propres à ces technologies, l’objectif ultime est de « harnacher » la révolution algorithmique afin qu’elle soit au service du bien commun, ou encore qu’elle permette de réinventer le capitalisme à l’âge des données massives[3].
Face à ces positions acritiques, des théories critiques n’hésitent pas à dénoncer cette fausse indépendance de la technique et à voir dans les algorithmes un nouvel outil au service du capital. La question de savoir s’il existe plusieurs usages possibles des données massives et de l’IA est matière à débat, mais toutes les approches critiques du capitalisme partagent un constat commun : ce sont les grandes entreprises du numérique qui contrôlent en bonne partie le développement de ces technologies. En effet, ce sont elles qui possèdent les droits de propriété intellectuelle, les budgets de recherche, les centres de données qui stockent nos données personnelles, de même que le temps de travail des scientifiques et celui des lobbyistes qui font pression auprès des gouvernements pour empêcher des législations contraires à leurs intérêts[4]. Nous soutenons la thèse voulant que les technologies algorithmiques soient principalement ou surtout développées en tant qu’outils d’accumulation du capital, tout en étant aussi utilisées dans une variété de sphères de la vie sociale avec des conséquences qui débordent largement cette finalité économique. Sans être réductibles à leur fonction lucrative, les données massives et les algorithmes sont appropriés, façonnés et déployés selon une logique qui répond aux impératifs du mode de production capitaliste et contribuent à modifier ce système en retour.
Nous croyons d’ailleurs, comme d’autres, que les craintes associées aux dangers de l’IA, des robots et des algorithmes constituent souvent au fond des anticipations de menaces liées au fonctionnement du capitalisme. Comme le note l’écrivain de science-fiction Ted Chiang, « la plupart de nos craintes ou de nos angoisses à l’égard de la technologie sont mieux comprises comme des craintes ou des angoisses sur la façon dont le capitalisme va utiliser la technologie contre nous. Et la technologie et le capitalisme ont été si étroitement imbriqués qu’il est difficile de distinguer les deux[5] ». Certaines personnes craignent par exemple que l’IA finisse un jour par nous dominer, nous surpasser ou nous remplacer. Or, derrière le scénario catastrophe d’une IA toute-puissante version Terminator[6] ou de la « superintelligence » présentant un risque existentiel pour l’humanité du philosophe Nick Bostrom se cache la domination actuelle des entreprises capitalistes. Le problème n’est pas l’IA en soi, mais le rapport social capitaliste qui l’enveloppe et qui détermine en bonne partie sa trajectoire. Un autre problème se surajoute : le capital algorithmique est lui-même imbriqué dans d’autres rapports sociaux comme le patriarcat, le colonialisme, le racisme, la domination de l’État.
Certains diront qu’il faut abolir l’IA – ou certaines de ses applications –, saboter les machines algorithmiques, refuser en bloc la technologie, mais ce sont là des réactions qui s’attaquent seulement à la pointe de l’iceberg. Nous sommes confrontés aujourd’hui à une dynamique similaire à celle que Marx observait à son époque, celle de la révolution industrielle où la machine commençait déjà à remplacer une partie du travail humain. Aujourd’hui, la « quatrième révolution industrielle », célébrée par Klaus Schwaub, représente au fond une révolution technologique qui relance la dynamique d’industrialisation, mais à l’aide de machines algorithmiques et de systèmes décisionnels automatisés. La réaction néoluddite qui vise à détruire ces machines est tout à fait normale et prévisible, mais il faut voir ici qu’il est vain d’avoir peur de ChatGPT, des robots ou des algorithmes. Ce qu’il faut, au fond, c’est remettre en question l’ensemble des rapports sociaux qui reproduisent la domination qui se manifeste aujourd’hui en partie par le pouvoir des algorithmes.
Qu’est-ce que le capitalisme ?
Qu’entend-on exactement lorsqu’on parle de « capitalisme » ? S’agit-il d’une économie de marché où les individus se rencontrent pour échanger des biens et services, un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et l’exploitation du travail par les capitalistes, ou encore une dynamique d’accumulation fondée sur la logique abstraite de l’autovalorisation de la valeur qui tend à transformer le capital en « sujet automate » ? Selon la perspective que l’on adopte sur la nature du capitalisme, l’analyse du rôle exact des algorithmes sera bien différente.
Lorsque les institutions du capitalisme comme l’entreprise privée et le marché sont tenus pour acquis, l’usage des données et des algorithmes sera généralement analysé à travers la lunette des applications potentielles pour améliorer la performance des entreprises. Les algorithmes seront conçus comme des « machines prédictives » permettant d’accomplir une multitude de tâches : réduire les coûts de production, améliorer le processus de travail, optimiser les chaines de valeur, bonifier l’expérience client, guider les décisions stratégiques, etc.[7]
Si on adopte plutôt une perspective critique du capitalisme dans le sillage du marxisme classique, on aura plutôt tendance à mettre en lumière les dynamiques d’appropriation privée des nouvelles technologies, les rapports d’exploitation et les résistances des classes opprimées. Cette conception du capitalisme aura tendance à voir le monde numérique comme un « champ de bataille[8] ». En effet, le capitalisme algorithmique repose en bonne partie sur le pouvoir prédominant des géants du Web, l’exploitation du travail et de l’expérience humaine; il renforce différentes tensions, inégalités et contradictions du monde social, et de nombreux fronts de résistance luttent contre ses effets pernicieux : mouvements pour la protection de la vie privée, mobilisations contre Uber, Amazon et Airbnb, sabotage de dispositifs de surveillance, Data 4 Black Lives[9], etc. Cela dit, les analyses uniquement axées sur la « lutte des classes » et les approches inspirées du marxisme classique ont tendance à réduire le capitalisme numérique à un affrontement entre les géants du Web – les capitalistes – et les femmes et hommes « utilisateurs » ou « travailleurs du clic » qui se font exploiter ou voler leurs données. On omet ainsi l’analyse conceptuelle minutieuse des rouages de l’accumulation capitaliste et des rapports sociaux qui structurent la société capitaliste dans son ensemble et sur laquelle il faut se pencher.
C’est ce qu’une troisième approche critique, distincte du marxisme classique, cherche à faire : adopter une vision holistique qui considère le capital comme « une totalité qui prend la forme d’une structure quasi objective de domination […] une situation d’hétéronomie sociale qui prend la forme d’un mode de développement aveugle, incontrôlé et irréfléchi sur lequel les sociétés n’ont aucune prise politiquement[10] ». Dans la lignée des critiques marxiennes de la valeur, l’analyse du capitalisme se concentre sur les catégories centrales de la société capitaliste comme le travail abstrait, la marchandise et la valeur. La critique du capitalisme comme « totalité sociale aliénée » implique donc la critique radicale de la valeur et des « médiations sociales fétichisées », de « l’imaginaire communicationnel du capitalisme cybernétique » et de la « révolution culturelle de l’idéologie californienne » qui nous mènerait vers un « monde numériquement administré[11] ». Or, ces approches totalisantes, malgré leurs prouesses théoriques, ont tendance à éluder les conflits, résistances et possibilités d’émancipation présentes dans le développement économique.
Ces deux approches critiques marxiennes, prenant appui l’une sur les conflits de classes et l’autre sur la logique totalisante du capital, ont donc chacune leurs forces et leurs faiblesses. Selon nous, le capital algorithmique tend à coloniser l’ensemble des sphères de l’existence humaine par une dynamique d’accumulation basée sur l’extraction des données et le développement accéléré de l’IA. Le capitalisme ne se réduit pas à un rapport de force entre classes antagonistes : il représente bel et bien une totalité sociale. Or, il faut également éviter le piège fataliste des approches surplombantes et réifiantes, et analyser en détail les rapports de pouvoir et les conflits qui se déploient dans le sillon de la montée du capital algorithmique. Il est donc nécessaire, pour une théorie critique des algorithmes, d’articuler les deux logiques distinctes, mais complémentaires du capital : « la logique du capital comme système achevé » et « la logique stratégique de l’affrontement[12] ».
Quelles possibilités d’émancipation?
L’accent plus ou moins grand porté sur la logique du capital (comme dynamique totalisante) ou la stratégie d’affrontement (faisant intervenir l’agentivité des acteurs) implique une évaluation différenciée des possibilités d’émancipation sous le capitalisme algorithmique. Des approches centrées sur la lutte des classes soutiennent parfois que l’impact de l’IA est grandement exagéré par les capitalistes, lesquels visent à effrayer le mouvement ouvrier des dangers imminents de l’automation. Astra Taylor soutient par exemple que les récits catastrophistes liés à l’arrivée des robots et du chômage technologique de masse sont des tentatives délibérées d’intimider et de discipliner les travailleurs et travailleuses en brandissant le discours idéologique de ce qu’elle nomme la fauxtomation[13]. Sans doute, des capitalistes utilisent-ils cette rhétorique de la sorte. Nous aurions tort cependant de minimiser l’impact de l’IA sur le processus de travail, les emplois et des secteurs entiers de l’économie. Même si les estimations sur le chômage engendré par l’automation varient grandement (de 9 % à 50 % en fonction des méthodologies utilisées), il faut bien reconnaitre la tendance du capital algorithmique à remplacer les humains par les robots, ou du moins à les compléter, surveiller et contrôler par de nouveaux moyens algorithmiques sophistiqués. S’il pouvait achever sa logique en totalité, le capital algorithmique viserait à développer un capitalisme pleinement automatisé.
À l’opposé du spectre, les auteurs du courant « accélérationniste » évaluent positivement l’horizon d’une automation généralisée, pour autant qu’elle soit combinée à une socialisation des moyens de production[14]. Les technologies algorithmiques jetteraient ainsi les bases d’une économie postcapitaliste au-delà du travail[15]. D’autres courants comme le xénoféminisme et les théoriciens du « capitalisme cognitif » soulignent également le potentiel émancipateur du travail immatériel, des pratiques de collaboration, de l’hybridation humain-machine et des nouvelles technologies[16]. À l’instar de Lénine, selon qui « le communisme, c’est le gouvernement des soviets plus l’électrification du pays », on pourrait dire que les courants anticapitalistes techno-optimistes considèrent aujourd’hui que le cybercommunisme signifie « le revenu de base plus l’intelligence artificielle[17] ». Cela n’est pas sans rappeler la position de Trotsky sur le taylorisme, « mauvais dans son usage capitaliste et bon dans son usage socialiste ». On trouve la vision la plus aboutie de ce marxisme accélérationniste chez Aaron Bastani et sa vision d’un « communisme de luxe entièrement automatisé » (fully automated luxury communism), qui propose l’utopie d’une économie postrareté par le plein déploiement des forces productives algorithmiques au-delà des contraintes de la logique capitaliste. Dans cette perspective, le capital algorithmique creuserait sa propre tombe, en laissant miroiter la possibilité d’un monde pleinement automatisé, basé sur l’extraction de minerai sur les astéroïdes, la production d’aliments synthétiques et la réduction drastique du travail humain[18]. Cette vision parait digne d’un Jeff Bezos ou d’un Elon Musk qui porterait soudainement une casquette socialiste.
Cela dit, il semble bien naïf de croire que l’automation algorithmique soit mauvaise sous les GAFAM, mais bonne sous le socialisme. Loin de poser les bases d’une société au-delà de la misère et des inégalités, le capital algorithmique automatise les différentes formes de domination, contribue à la surexploitation des ressources naturelles et siphonne notre temps d’attention grâce à ses multiples technologies addictives. En d’autres termes, l’extraction toujours plus intense des données et le développement actuel des algorithmes contribuent à créer les bases d’un capitalisme pleinement automatisé, accélérant la pénurie de temps et de ressources naturelles.
Enfin, il serait trompeur de se limiter à la logique du capital, en omettant les stratégies d’affrontement qui peuvent dégager des possibilités d’émancipation pour dépasser l’horizon du capitalisme automatisé. À la différence des courants technosceptiques et néoluddites qui refusent en bloc les technologies algorithmiques, il existe différentes perspectives de résistance et des stratégies anticapitalistes visant une potentielle réappropriation collective des données et des algorithmes[19]. Il est possible d’envisager les potentialités et limites liées à la planification algorithmique dans une optique d’autolimitation écologique, de justice sociale et de démocratie radicale[20].
Le capitalisme algorithmique comme ordre social institutionnalisé
Nancy Fraser a développé durant les dernières années une théorie globale du capitalisme qui comprend non seulement un mode de production économique spécifique, mais aussi une articulation avec la nature, les pouvoirs publics et le travail de reproduction sociale[21]. Cette reconceptualisation permet de saisir l’imbrication du capitalisme avec les inégalités de genre et la crise du care (les soins), les dynamiques d’expropriation et d’exploitation au sein du capitalisme racialisé, ainsi que les dynamiques complexes qui alimentent la crise écologique, laquelle exacerbe les inégalités raciales, économiques et environnementales. Ce cadre conceptuel large inspiré du féminisme marxiste permet de saisir l’enchevêtrement des multiples systèmes de domination (capitalisme, patriarcat, racisme, etc.) et d’éclairer les « luttes frontières » présentes dans différents recoins du monde social. La perspective critique de Fraser nous semble ainsi la meilleure porte d’entrée pour brosser un portrait systématique de la société capitaliste qui nous permettra ensuite de mieux comprendre comment les technologies algorithmiques reconfigurent celle-ci.
Nancy Fraser propose de voir le capitalisme comme un ordre social institutionnalisé. Que cela signifie-t-il ? Fraser définit d’abord la production capitaliste en la définissant par quatre caractéristiques fondamentales : 1) la propriété privée des moyens de production ; 2) le marché du travail ; 3) la dynamique d’accumulation ; 4) l’allocation des facteurs de production et du surplus social par le marché. Le capital algorithmique reconfigure les modèles d’entreprise (hégémonie des plateformes numériques), les formes du travail (travail digital et travail algorithmique), la dynamique d’accumulation (par l’extraction de données et les algorithmes), ainsi que l’apparition de nouveaux marchés (marchés des produits prédictifs, etc.). Mais cette caractérisation sommaire du système économique capitaliste reste largement insuffisante.
Selon Fraser, la « production économique » repose en fin de compte sur l’exploitation de trois sphères « non économiques » : la nature, le travail de reproduction sociale et le pouvoir politique, qui représentent ses conditions de possibilité. Loin de nous concentrer sur la seule économie capitaliste, il faut s’attarder sur les différentes sphères de la société capitaliste à l’ère des algorithmes. L’avantage de la perspective de Fraser est de décentrer l’analyse de la contradiction économique capital/travail pour mettre en lumière les multiples tendances à la crise du capitalisme sur le plan social, démocratique et écologique : « La production capitaliste ne se soutient pas par elle-même, mais parasite la reproduction sociale, la nature et le pouvoir politique. Sa dynamique d’accumulation sans fin menace de déstabiliser ses propres conditions de possibilité[22]. » Aujourd’hui, le capital algorithmique cherche à résoudre ses multiples crises et contradictions par l’usage intensif des données et de l’intelligence artificielle : innovations technologiques pour accélérer la transition écologique (efficacité énergétique, agriculture 4.0, voitures autonomes, robots pour nettoyer les océans), soutien des tâches domestiques et de reproduction sociale (maisons intelligentes, plateformes de services domestiques, robots de soins pour s’occuper des personnes ainées et des enfants), solutions des crises de gouvernance (ville intelligente, optimisation de l’administration publique, police prédictive, dispositifs de surveillance), etc.
Cela dit, la théorie de Fraser souffre d’un oubli majeur : elle n’aborde pas du tout la question technologique. Elle analyse l’évolution historique du capitalisme à travers ses différents stades ou régimes d’accumulation, mais elle s’arrête au stade du capitalisme néolibéral, financiarisé et mondialisé. Or, il semble bien que l’infrastructure technologique représente une autre condition de possibilité du capital, que Fraser omet de mettre dans son cadre théorique : sans système de transport et de communication, sans machines et sans outils techniques, il semble difficilement possible de faire fonctionner le capitalisme, y compris dans ses variantes mercantiles et préindustrielles. Autrement dit, Fraser semble avoir oublié les conditions générales de production dans sa théorie globale du capitalisme, y compris les technologies algorithmiques qui contribuent aujourd’hui à sa métamorphose. Pour combler cette lacune, il nous semble donc essentiel de compléter le portrait avec les contributions névralgiques de Shoshana Zuboff et de Kate Crawford, qui jettent un regard perçant sur les dimensions technologiques de l’économie contemporaine, laquelle repose de plus en plus sur la surveillance et sur l’industrie extractive de l’intelligence artificielle.
Le capitalisme de surveillance comme industrie extractive planétaire
Le livre L’âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff offre un portrait saisissant des mutations de l’économie numérique qui a vu naitre l’émergence de nouveaux modèles d’affaires basés sur l’extraction de données personnelles et le déploiement d’algorithmes centrés sur la prédiction de comportements futurs[23]. Alors que le développement technologique des ordinateurs et de l’Internet aurait pu mener à diverses configurations socioéconomiques, une forme particulière de capitalisme a pris le dessus au début des années 2000 avant de dominer complètement le champ économique et nos vies. Voici comment Zuboff définit ce nouveau visage du capitalisme contemporain :
Le capitalisme de surveillance revendique unilatéralement l’expérience humaine comme matière première gratuite destinée à être traduite en données comportementales. Bien que certaines données soient utilisées pour améliorer des produits ou des services, le reste est déclaré comme un surplus comportemental propriétaire qui vient alimenter des chaines de production avancées, connues sous le nom d’« intelligence artificielle », pour être transformé en produits de prédiction qui anticipent ce que vous allez faire, maintenant, bientôt ou plus tard. Enfin, ces produits de prédiction sont négociés sur un nouveau marché, celui des prédictions comportementales, que j’appelle les marchés de comportements futurs. Les capitalistes de surveillance se sont énormément enrichis grâce à ces opérations commerciales, car de nombreuses entreprises sont enclines à miser sur notre comportement futur[24].
Zuboff fournit une excellente porte d’entrée pour comprendre la mutation fondatrice du capital à l’aube du XXIe siècle : l’extraction et la valorisation des données par le biais d’algorithmes se retrouvent maintenant au cœur du processus d’accumulation du capital. Elle offre aussi une deuxième contribution majeure. Selon elle, le capital de surveillance n’est pas réductible à un simple processus économique ; il donne lieu à l’émergence d’une nouvelle forme de pouvoir inquiétante : le pouvoir instrumentarien, soit « l’instrumentation et l’instrumentalisation du comportement à des fins de modification, de prédiction, de monétisation et de contrôle[25] ». Cette « gouvernementalité algorithmique » ne sert pas seulement à extraire de la valeur par le biais de publicités ciblées qui anticipent nos comportements futurs ; ces machines prédictives visent aussi à influencer, à contrôler, à nudger (donner un coup de pouce) et à manipuler nos conduites quotidiennes. Cette nouvelle logique de pouvoir dans différentes sphères de la vie sociale, économique et politique confère à cette configuration du capitalisme sa plus grande emprise sur les rapports sociaux et notre relation au monde.
Une limite de l’approche zuboffienne est qu’elle insiste beaucoup, voire peut-être trop, sur la question de la surveillance et de l’appropriation des données personnelles. Sa théorie a le mérite de décortiquer la nouvelle logique d’accumulation du capital et les mécanismes inédits de contrôle algorithmique des individus, mais elle finit par déboucher sur le « droit au temps futur », le « droit au sanctuaire », et autres revendications qui se limitent à la protection de la vie privée. La théorie de Zuboff ne permet pas vraiment de thématiser les injustices en termes de classe, de sexe et de « race » qui sont amplifiées par la domination algorithmique. Elle suggère un recadrage du capitalisme, soulignant la contradiction fondamentale entre l’extraction des données et le respect de la vie privée. La critique de l’exploitation du travail par le capital chez Marx est ainsi remplacée par la critique de l’extraction/manipulation de la vie intime des individus dans leur quotidien. Ce n’est donc pas un hasard si Zuboff passe sous silence le rôle du travail, l’extraction des ressources naturelles et les enjeux géopolitiques dans son cadre d’analyse. Pour nous, la surveillance ne représente que l’un des nombreux visages du capital algorithmique, qui a des conséquences beaucoup plus étendues.
C’est la raison pour laquelle il nous semble essentiel de compléter ce premier aperçu de Zuboff par un portrait élargi des nombreuses ramifications de l’IA dans le monde contemporain à travers l’approche riche et originale de Kate Crawford. Celle-ci propose de dépasser l’analyse étroite de l’IA qui est devenue monnaie courante de nos jours et qui la voit comme une simple forme de calcul, un outil comme le moteur de recherche de Google ou encore ChatGPT. Bien que ces multiples descriptions ne soient pas fausses, elles dissimulent néanmoins toute une infrastructure complexe en concentrant notre attention sur des technologies isolées, abstraites, rationnelles et désincarnées :
Au contraire, l’intelligence artificielle est à la fois incarnée et matérielle, faite de ressources naturelles, d’énergies fossiles, de travail humain, d’infrastructures, de logistiques, d’histoires et de classifications. Les systèmes d’IA ne sont pas autonomes, rationnels, ou capables de discerner sans un entraînement computationnel extensif et intensif basé sur de larges ensembles de données, de règles et de récompenses prédéfinies. Et compte tenu du capital requis pour bâtir l’IA à large échelle et des manières de voir qui optimisent celle-ci, les systèmes d’IA sont ultimement conçus pour servir les intérêts établis dominants. En ce sens, l’intelligence artificielle entre dans le registre du pouvoir[26].
Pour Crawford, on ne peut comprendre les algorithmes adéquatement, d’un point de vue strictement technique, sans les insérer au sein de structures et systèmes sociaux plus larges. Crawford élargit notre champ de vision en montrant que l’IA repose sur l’extraction généralisée de minerais, d’énergie, de travail humain, de données, d’affects et d’éléments de nos institutions publiques. C’est pourquoi elle propose de concevoir l’IA d’un point de vue matérialiste et holistique, en évitant les pièges d’une vision trop formelle et idéaliste telle que véhiculée par l’éthique des algorithmes.
Néanmoins, cette vision donne un aperçu encore trop parcellaire et fragmenté de ce système en voie de consolidation. La riche cartographie de Crawford donne à voir les multiples visages, territoires et manifestations de ce phénomène complexe, mais sans fournir une grille d’analyse, un cadre conceptuel ou une théorie globale permettant d’expliquer et de comprendre ces différents enjeux dans un tout cohérent. C’est pourquoi il nous semble essentiel de comprendre l’enchevêtrement complexe entre la technologie, le pouvoir et le capital au sein d’une théorie globale du capitalisme algorithmique qu’il reste à déployer[27].
Par Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l’Université Concordia et Jonathan Durand Folco, professeur à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université Saint-Paul.
NOTES
Cet article est une version remaniée de la thèse 2 du livre de Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco, Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle, Montréal, Écosociété, 2023. ↑
- Nancy Fraser et Rahel Jaeggi, Capitalism. A Conversation in Critical Theory, Cambridge, Polity Press, 2018. ↑
- Viktor Mayer-Schönberger et Thomas Ramge, Reinventing Capitalism in the Age of Big Data, New York, Basic Books, 2018. ↑
- Voir par exemple Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen et James Steinhoff, Inhuman Power. Artificial Intelligence and the Future of Capitalism, Londres, Pluto, 2019. ↑
- Cité par Ezra Klein, « The imminent danger of A.I. is one we’re not talking about », The New York Times, 26 février 2023. ↑
- NDLR. Terminator est un film américain de science-fiction sorti en 1984 où le Terminator est une créature robotisée programmée pour tuer. ↑
- Ajay Agrawal, Joshua Gans et Avi Goldfarb, Prediction Machines. The Simple Economics of Artificial Intelligence, Boston, Harvard Business Review Press, 2018. ↑
- Philippe de Grosbois, Les batailles d’Internet. Assauts et résistances à l’ère du capitalisme numérique, Montréal, Écosociété, 2018, p. 30. ↑
- NDLR. Mouvement de militants et militantes et de scientifiques dont la mission est d’utiliser la science des données pour améliorer la vie des Noirs·es. ↑
- Maxime Ouellet, La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la société globale de l’information, Montréal, Écosociété, 2016, p. 38. ↑
- Ibid., p. 60. ↑
- Pierre Dardot et Christian Laval, Marx, prénom : Karl, Paris, Gallimard, 2012. ↑
- Astra Taylor, « The automation charade », Logic, no 5, 2018.NDLR. Fauxtomation est un mot inventé par Taylor et formé de « faux » et d’« automatisation » pour exprimer comment le travail accompli grâce à l’effort humain est faussement perçu comme automatisé. ↑
- Nick Srnicek et Alex Williams, Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work, Brooklyn, Verso, 2015. ↑
- Paul Mason, Postcapitalism. A Guide to Our Future, Londres, Allen Lane, 2015. ↑
- Helen Hester, Xenofeminism, Cambridge (UK) /Medford (MA), Polity Press, 2018 ; Laboria Cuboniks (Collectif), The Xenofeminist Manifesto. A Politics for Alienation, Brooklyn, Verso, 2018 ; Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, 2000 ; Yann Moulier Boutang, Le capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation, Paris, Amsterdam, 2007. ↑
- Dyer-Witheford, Kjøsen et Steinhoff, Inhuman Power, 2019, op. cit., p. 6. ↑
- Aaron Bastani, Fully Automated Luxury Communism, Londres, Verso, 2020. ↑
- Voir à ce sujet, Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau, « Cartographier les résistances à l’ère du capital algorithmique », Revue Possibles, vol. 45, n° 1, 2021, p. 20-30. ↑
- Cédric Durand et Razmig Keucheyan, « Planifier à l’âge des algorithmes », Actuel Marx, n° 1, 2019, p. 81-102. ↑
- Nancy Fraser, « Behind Marx’s hidden abode », New Left Review, no 86, 2014 ; Nancy Fraser, « Expropriation and exploitation in racialized capitalism : a reply to Michael Dawson », Critical Historical Studies, vol. 3, no 1, 2016 ; Nancy Fraser, « Contradictions of capital and care », Dissent, vol. 63, no 4, 2016, p. 30‑37 ; Fraser et Jaeggi, Capitalism, 2018, op. cit ; Nancy Fraser, « Climates of capital », New Left Review, no 127, 2021. ↑
- Fraser et Jaeggi, Capitalism, 2018, op. cit., p. 22. ↑
- Soshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Paris, Zulma, 2020. ↑
- Ibid., p. 25. ↑
- Ibid., p. 472. ↑
- Kate Crawford, Contre-atlas de l’intelligence artificielle. Les coûts politiques, sociaux et environnementaux de l’IA, Paris, Zulma, 2022, p. 8. ↑
- C’est là l’objet des 20 thèses de notre livre, Le capital algorithmique, 2023, op. cit. ↑
Deux pas en avant, un pas en arrière pour Unifor à Amazon

Heures et promesses d’un débat : les analyses de classes au Québec (1960-1980)
Archives Révolutionnaires republie ici un article d’Anne Legaré (née en 1941), militante et théoricienne marxiste. Suivant les travaux de Nicos Poulantzas, elle a mené les plus ambitieuses études sur les classes sociales au Québec dans la seconde partie du XXe siècle, notamment à travers son ouvrage Les classes sociales au Québec (1977). Dans cet article publié en 1980 dans Les Cahiers du socialisme, Legaré propose un bilan des principales contributions théoriques sur le sujet des classes au Québec depuis 1960, en critiquant le double écueil du nationalisme et de l’économisme. L’article est joint d’une bibliographie chronologique qui recense les contributions les plus importantes sur le sujet (les notes sont mises entre parenthèses).


Aujourd’hui, la revalorisation des travaux de Legaré semble nécessaire à un moment où les études sur les classes se font rares, alors que leur importance pour comprendre la réalité sociale, elle, n’a pas diminué. Qui fait partie du prolétariat ? De(s) classe(s) moyenne(s) ? De la bourgeoisie ? Quels sont leurs intérêts, leurs secteurs d’activité ? Quelles fractions de classes sont pertinentes à considérer ? Quelles alliances de classes sont (im)possibles ? Voilà autant de questions préliminaires sur lesquelles nous laisse Legaré pour comprendre notre cycle de lutte actuelle.
Archives Révolutionnaires tient à souligner l’important travail d’archivage numérique des Classiques des sciences sociales de l’UQAC, d’où est tirée la version de cet article.
***
Introduction
L’heure est aux bilans. En effet, la conjoncture nous presse de réfléchir et les quelques mois qui viendront, quelle qu’en sera leur issue, pèseront lourd d’expérience dans la lente démarche du mouvement socialiste au Québec. J’aimerais joindre à ce cheminement une réflexion rétrospective sur l’évolution de la contribution des intellectuels de gauche sur les classes sociales québécoises depuis quinze ans.
Le bilan que je me propose de faire comprendra deux grandes parties. La première tentera de situer dans leur contexte les textes partant de la Révolution tranquille à la victoire péquiste de 76 et rappellera à travers leur chronologie, le cheminement parcouru par ces analyses. La deuxième partie fera la synthèse du débat sur la bourgeoisie qui a dominé la période du règne péquiste jusqu’à maintenant en s’efforçant de dégager sommairement les propositions idéologico-politiques qui lui sont reliées.
Le questionnement sur les classes depuis le début de la Révolution tranquille a été, à mon avis, scandé par quatre grandes questions, chacune d’elle révélant les préoccupations majeures des intellectuels à partir de leur lien aux diverses phases organisationnelles du mouvement ouvrier.
La première question fut celle posée par Dofny et Rioux en 1962 : qu’est-ce qui sépare et qu’est-ce qui unit les classes sociales au Québec ? À cela, ils répondaient qu’il y avait au Québec une seule classe unie par l’ethnicité. Ensuite, Bourque et Frenette ouvrirent en 1970 deux questions : la première fut celle de la composition sociale de la petite bourgeoisie québécoise et la seconde, en creux, fut celle de l’existence d’une bourgeoisie québécoise, question qui sera en fait, dans l’histoire récente, reprise à partir de 1976-1977. Enfin, Céline St-Pierre en 1974 avait posé celle du lieu de division sociale entre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie.
Trois éléments conjugués ont à mon avis, présidé à ce découpage :
1) le rapport de ces questions à la conjoncture du moment (soit : a) d’abord la scission du NPD et la formation du PSQ ; b) la création du M.S.A. puis celle du PQ ; c) la période précédant l’élection du PQ, caractérisée par l’électoralisme et par le développement de l’extrême gauche ; d) le règne du Parti Québécois ;
2) la spécificité des thèmes évoqués touchant chacun des aspects théorico-politiques de l’analyse des rapports sociaux ;
3) enfin, la pertinence de ces textes et leur répercussion dans la mémoire politique des dernières années.
1. Le contexte historique général
Tant les thèmes que les approches ont grandement évolué depuis 15 ans. La question nationale fut cependant au cœur de toutes ces analyses. Parfois considérée comme étant le seul aspect important de la division sociale, parfois au contraire greffée aux classes comme aspect second, plus récemment, enfin, l’oppression nationale fut étudiée en tant qu’élément constitutif de la structure de classes elle-même ou de la division sociale du travail. Ces trois temps dans l’évolution du rapport entre classes et nation indique un remarquable progrès dans la pensée socialiste et marxiste au Québec, progrès commandé par l’évolution des rapports de classes eux-mêmes.
Cette évolution dans les rapports de classes fut consolidée par la démonstration de plus en plus irréfutable effectuée par le PQ lui-même de son conservatisme socio-politique fondamental. Autour de cette lente et progressive mise à jour, poursuivie à travers l’exercice du pouvoir jusqu’à maintenant, les intérêts des classes et fractions se sont progressivement précisés et continuent de le faire.
Cependant, la démarche intellectuelle fut tributaire des transformations dans les rapports de classes d’un double point de vue. En effet, les chercheurs qui s’appliquèrent à faire progresser les analyses de classes eurent d’abord comme souci majeur, et avec raison, de lier leur démarche à ce qu’ils percevaient comme questions stratégiques pour l’organisation du mouvement ouvrier québécois. Parfois, leurs résultats furent pertinents, parfois leurs observations s’avérèrent mal orientées. Et de plus, ces textes furent souvent débordés par les aléas du mouvement lui-même. Car on ne peut encore parler jusqu’à ce jour de prise à son compte par le mouvement de ces travaux. Ceci ne peut être imputé ni aux chercheurs ni aux organisations. Les intellectuels sont ni à côté ni au-dessus de l’histoire, ils sont dedans et en tant que tels, ils en subissent les conditions. Les quinze dernières années ont été éprouvantes pour les travailleurs québécois. La question nationale, sacralisée par le PQ, a brouillé les cartes. Le mouvement ouvrier a été freiné dans son organisation et les travaux des intellectuels de gauche ont été mêlés à cette difficile naissance.
La démarche intellectuelle fut donc tributaire des rapports de classes dans la mesure où, comme on le verra plus loin, les études sur les classes sociales se sont nouées à la conjoncture organisationnelle du moment ouvrier en tentant à travers leur diversité, de répondre finalement à une seule question : comment, et par quel parti, seront satisfaits, à tel ou tel mouvement, les intérêts des classes dominées, question à laquelle le mouvement ouvrier lui-même n’apportait pas de réponse claire.
Ensuite on peut dire que cette démarche de recherche et de réflexion fut tributaire des étapes suivies par le mouvement ouvrier dans la mesure où ces travaux demeurèrent isolés et ne furent pas inscrits d’une manière directe dans sa démarche. Ce n’est que depuis peu de temps que les conditions se précisent pour une collaboration organique entre les intellectuels et les organisations ouvrières au Québec.
Les rapports de classes ont donc été dominés pendant cette période par un gigantesque effort de clarification des intérêts de chaque parti, clarification effectuée d’abord en rapport avec la scène politique par l’expérience négative du pouvoir sous le gouvernement péquiste. Mêlés à ce cheminement historique, les travaux des intellectuels québécois ont tenté de fournir une connaissance étayée des différentes étapes que traversait le mouvement nationaliste.
C’est ainsi que témoignait de ces préoccupations idéologiques l’article de Rioux et Dofny. Cet article, repris à son propre compte par J. Marc Piotte en 1966 [1] (3) pour être ensuite critiqué surtout par Michel Van Schendel en 1969 et par Gilles Bourque et Nicole Frenette en 1970, témoignait des interrogations qui dominaient à ce moment-là en avançant des propositions d’analyse fortement teintées de nationalisme.
Qu’il suffise de se rappeler les nombreux événements qui accompagnèrent cette phase. On connut du côté des mouvements sociaux la fondation du R.I.N. en 1960 et sa transformation en parti en 1963, la formation de la CSN (1960), la fondation du NPD (1961), le Rapport Parent, l’émergence du FLQ, la scission au NPD–Québec et la formation du PSQ, puis le lancement de la revue Parti Pris en 1963 ; ensuite ce fut la création du ministère de l’Éducation, l’acquisition du droit de grève dans les services publics et para-publics, et la création de l’UGEQ en 1964 ; enfin les nombreuses grèves de 1965-66 et enfin, la fondation du MSA en 1967.
L’année de lancement de la revue Parti Pris, marqua en effet un effort particulier pour reconnaître les différences sociales et politiques qui s’affrontaient à travers la question nationale et pour dégager des intérêts correspondants, que ce soit dans le RN, le RIN, le MS A puis dans le PQ.
En 1968, suite à la fondation du MSA, les positions de ces intellectuels se divisèrent autour de l’analyse du rapport MSA/classes sociales. D’un côté, Jean-Marc Piotte encouragea un appui au MSA, pour qui « une large fraction des masses les plus politisées et les plus conscientes suivent Lévesque… Se situer hors du MSA, c’est se condamner à demeurer extérieur à la fraction la plus progressiste des masses populaires » disait-il [2] (7) (p. 132). Piotte reviendra sur cette position en 1975 lorsqu’il fera la critique de l’allégeance du PQ avec l’impérialisme en disant « actuellement, face au PQ et compte tenu de la faiblesse et de la division des organisations socialistes, il faut se démarquer clairement du projet indépendantiste et défendre la véritable solution aux problèmes fondamentaux des travailleurs : le socialisme » [3] (7) (p. 170)
D’un autre côté, à l’instar de Piotte et au même moment, soit à l’été 68, Gilles Bourque, Luc Racine et Gilles Dostaler fondent le Comité Indépendance-Socialisme (C.I.S.) et formulent une critique sévère des intérêts de Lévesque qu’ils disent représentant d’une « classe antagoniste à celle des travailleurs » [4] (6) (p. 30). Déjà, l’interrogation la plus angoissante et la plus décisive était au cœur des débats : en appuyant le MSA, ou plus tard le PQ, les travailleurs allaient-ils marcher à leur défaite comme classe ? Cette question n’a cessé de hanter les recherches qui furent faites par la suite.

A. Des analyses historiques
Avant de présenter les textes dont l’objet principal était de relier ponctuellement la scène politique aux classes en lutte, je fournirai une vue d’ensemble d’une série de travaux de portée historique plus large. Ces travaux doivent être mentionnés car ils fournissent un cadre général indispensable à la compréhension de l’étude des articles suivants. Ils permettent de voir également que cet aspect plus général de la recherche a subi des transformations et s’est acheminé aussi sur des terrains éminemment politiques. J’ai tenté, à travers toute cette étude, de respecter scrupuleusement la progression chronologique et de présenter tous les principaux travaux. S’il en est qui ont échappé à ma vigilance, je prie les auteurs de m’en excuser.
En 1967, un article d’Alfred Dubuc [5] (4) présentait le processus de formation de l’État canadien comme un moyen permettant la centralisation financière nécessaire au développement de la bourgeoisie. Selon cette thèse, l’État canadien n’a pas été le produit de rapports entre les classes mais plutôt l’instrument de la bourgeoisie commerciale et bancaire. En 1970 parut ensuite le premier ouvrage de Gilles Bourque intitulé Classes sociales et question nationale au Québec [6] (10). Cet ouvrage contient la thèse de la double structure de classes, se superposant et renvoyant à chacune des deux nations. Bourque fera la critique de cette thèse dans le numéro 1 des Cahiers du Socialisme disant, pour l’essentiel : « On ne peut produire une définition « classiste » de la nation sans tomber dans le réductionnisme et, curieusement, dans le nationalisme lui-même. On risque, en effet, dans ce dernier cas, de produire des analyses affirmant l’existence de structures de classes nationalement hétérogènes » [7] (25) (p. 195). Dans le même champ de préoccupations, une version refondue, corrigée et augmentée de Unequal Union de Stanley Ryerson, parue en anglais en 1968, sera traduite en 1972 [8] (13). Une des thèses centrales de cet ouvrage est que le mouvement national des Patriotes de 37 avait un « caractère démocratique et anti-impérialiste ». Ryerson y fait ressortir l’émergence « des manufactures domestiques, d’une industrie locale et autochtone » et la formation d’une « classe coloniale ».
En 1975, un article d’Hélène David [9] (15) met en rapport la scène politique et le mouvement ouvrier, et rompt avec la périodisation conventionnellement liée à la Révolution Tranquille en dégageant les conditions de « cinq moments conjoncturels » différents qui caractérisent cette période.
En 1978, Dorval Brunelle fournit, dans La désillusion tranquille [10] (22) des éléments nouveaux et originaux pour aborder l’analyse des relations des provinces entre elles ainsi que par rapport au gouvernement fédéral : la thèse qui s’en dégage tend à faire ressortir que « le Canada est surtout une somme de gouvernements » (provinciaux) caractérisée par « l’absence totale d’intégration au niveau des rapports économiques ». De plus, l’étude expose à travers l’histoire politique récente et en particulier celle du Conseil d’orientation économique, comment évoluèrent les conditions politiques de développement de la bourgeoisie québécoise au cours des années 60.
Nicole Laurin-Frenette en 1978 [11] (11) élabore un nouveau cadre conceptuel pour l’analyse de la nation et défend comme thèse que c’est le procès de production de l’État qui assigne sa place à la nation ainsi qu’aux appareils qui la reproduisent et à leurs agents. Le rôle du nationalisme est de « garantir la reproduction de la place de l’État (national) ». L’auteur applique son postulat théorique à l’analyse de six conjonctures depuis le Régime français, et s’inscrit en même temps en rupture avec la thèse qu’elle soutenait avec Gilles Bourque en 1970 sur le rapport de la petite bourgeoisie technocratique avec le projet de souveraineté-association.
Mai 79 vit d’abord la parution d’un ouvrage de Roch Denis [12] (37) qui met l’emphase sur les rapports entre le mouvement ouvrier et la question nationale et conclut sur les difficultés de formation d’un parti sans son intégration transitoire aux organisations syndicales. L’ouvrage aboutit à cette conclusion après une longue analyse des différentes phases traversées par le mouvement ouvrier, ses organisations et par le rôle des intellectuels depuis 1948.
Enfin, Gilles Bourque et moi-même [13] (38) avons tenté dans Le Québec–la question nationale, de lier les événements politiques survenus depuis la Conquête aux rapports de classes et aux transformations des modes et formes de production. Les principales thèses développées portent sur la résistance paysanne au développement du M.P.C., sur la formation de l’État canadien caractérisé par une tendance structurelle à l’éclatement sur le rapport privilégié de l’U.N. et de Duplessis avec la bourgeoisie locale, du P.L.Q. et de la Révolution tranquille avec la bourgeoisie canadienne, du projet de souveraineté-association et du gouvernement péquiste avec la bourgeoisie non monopoliste québécoise et enfin, sur l’issue de l’actuel enjeu référendaire.
B. De la Révolution tranquille jusqu’à la formation du P.Q. En 1968 : l’éveil du nationalisme de gauche
Pour aborder les textes portant plus spécifiquement sur le rapport classes/scène politique, cette première tranche de la périodisation s’imposait car les écrits de cette première période portaient en germe les questions qu’allait soulever plus tard la formation du Parti québécois.
C’est pourquoi, sans doute, l’article de Dofny et Rioux [14] (1) eut-il tant d’échos comme s’il réveillait, en quelque sorte, le subconscient de la pensée en gestation. La thèse principale qu’il contenait, consistait à poser que les Québécois forment ensemble une classe dite « ethnique », unifiée par l’originalité de sa stratification sociale face au groupe anglais dominant.
Un an après, Mario Dumais, comme Jacques Dofny et Marcel Rioux, veut « ouvrir la voie à une action politique cohérente » dans un article [15] (2) qui comporte d’abord une assez longue élaboration théorique sur le fait qu’existent des classes, puis sur une méthode qui se veut rigoureusement marxiste pour les analyser. Ce texte ne fait pas de différence entre la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie traditionnelle ; la classe des travailleurs y est composée de « ruraux, de manuels et de non-manuels », comprenant aussi des « employés de bureau, des techniciens et des intellectuels » ; les couches marquent une distinction entre hommes et femmes. Le texte représente alors la première recherche concrète de la période sur la division sociale du travail au Québec. Cependant, la faiblesse de son cadre conceptuel ne permit pas d’en faire une utilisation très large.
Piotte, lui, reprend ensuite à son compte [16] (1) les principales affirmations de Dofny, Rioux (1962) et de Dumais (1963) en tentant de les recouper. Il retient les « valeurs, les institutions, les comportements des Québécois » (comme le font Dofny et Rioux) pour démontrer d’abord comment ils sont souvent « nord-américains avant d’être canadiens ou canadiens-français »; ensuite, il fait sienne la thèse du Québec, classe ethnique à l’intérieur d’une société globale, le Canada. Ceci amènera Piotte à affirmer que « RIN a un rôle historique essentiel quoique transitoire en tant qu’avant-garde du processus de libération dirigé par « les collets blancs ». On voit dans ce texte que pour Piotte comme pour beaucoup d’autres, le concept de petite-bourgeoisie ne recouvrait à ce moment-là que les P.M.E., les professionnels et les artisans. Les collets blancs représentent une couche de la très large « classe des travailleurs ».
Réfléchissant sur l’esprit qu’avait animé l’équipe de Parti Pris durant les années 60, Jean-Marc Piotte écrivait récemment à propos de cette période : « Vivant la rupture comme une libération intellectuelle, nous n’étions guère pressés de nous trouver des racines historiques. Nous nous prenions pour l’avant-garde intellectuelle de la révolution… Me relisant, je fus littéralement étonné : je me croyais marxiste alors que ma catégorie fondamentale d’analyse demeurait – si on excepte Notes sur le milieu rural, d’ailleurs seule enquête menée sur le terrain – bel et bien la nation » [17] (3) (p. 14-15). Et commentant son texte de 1966, résumé plus haut, Piotte dira : « mon étude du Québec n’est pas centrée sur la lutte de classes à laquelle j’articulerais les mouvements de libération nationale, mais sur la nation que je cherche à éclairer à la lumière des classes sociales » [18] (3) (p. 16). Les six textes de la période de 68-76 qui suivent, marqueront un progrès notoire par rapport à cette dernière tendance.
Le premier texte de cette période, signé de Bourque, Racine et Dostaler [19] (6) contient d’abord une critique radicale du MSA, inspirée d’un texte de Bourque publié dans Parti Pris quelques mois plus tôt [20] (5). Bourque, à cette époque-là préparait déjà son ouvrage Classes sociales et question nationale au Québec – 1760-1840. Par cet article, les trois auteurs posent comme élément central la persistance et la dominance des intérêts bourgeois dans la formation du MSA à travers la présence de Lévesque et de ses associés. Les auteurs y reconnaissent la présence dans le mouvement d’éléments de gauche « non organisés » mais ils posent que ceux-ci seront utilisés pour masquer l’aspect conservateur véritable du mouvement.
Paraît ensuite, signée de Michel Van Schendel [21] (8), la première critique de la thèse publiée par Dofny et Rioux en 1962. Michel Van Schendel tente de cerner ce qui définit « structurellement » la classe ouvrière québécoise. Ce texte contient en outre une critique serrée des notions de classe et de conscience ethnique utilisées par Dofny et Rioux et fondamentalement opposées au matérialisme historique. Michel Van Schendel joue alors un rôle important dans l’équipe de la revue Socialisme.
Un an plus tard, en 1970, paraît l’article de Luc Racine et de Roch Denis [22] (9) qui (avec l’éditorial de ce numéro qui avait été préparé par M. Van Schendel et Emilio de Ipola) est le premier de cette période à reconnaître l’existence d’une « moyenne bourgeoisie canadienne française. » Plus que par une simple allusion métaphorique, ce texte, quoique prudemment, précise que cette bourgeoisie est sous-traitante, et que le PQ est le représentant de sa fraction nationaliste. Ce texte fait aussi des distinctions très pertinentes entre bourgeoisie et petite-bourgeoisie. Cependant, si cette dernière indique une « prolétarisation graduelle », la classe ouvrière, elle, y recouvre indistinctement tous les travailleurs manuels et intellectuels, les ouvriers et les employés. Le PQ y est clairement vu comme un recul par rapport au MSA en autant qu’il est plus clairement pro-impérialiste que le RIN.
Après le texte de Jacques Dofny et de Marcel Rioux publié en 1962, celui de Bourque-Frenette [23] (10), quoique se voulant marxiste, représente la deuxième forte percée du nationalisme de gauche dans l’analyse sociologique québécoise. Même si ce texte se fixe comme objectif « de dégager au moins les éléments de base d’une théorie marxiste de la nation, du nationalisme et des rapports entre classes sociales, nations et idéologies nationalistes » et « s’inspire de la pratique du mouvement révolutionnaire au Québec au cours des dix dernières années », il contient quelques extrapolations dont l’utilisation sert aujourd’hui encore d’arguments aux thèses nationalistes. Gilles Bourque de son côté, a largement fait la critique des positions contenues dans ce texte en ce qui concerne le PQ comme parti de la petite-bourgeoisie en disant pour l’essentiel : « je ne peux suivre Niosi quand il déduit…le caractère exclusivement petit-bourgeois du Parti Québécois. Au-delà de désaccords théoriques spécifiques…, il me semble de plus en plus urgent de repenser la problématique implicite de la plupart des analyses proposées jusqu’ici » [24] (14) (p. 122).
Nicole Frenette a, elle, également pris ses distances (1978) en disant « nous recherchions les dites bases objectives de la nation et, comme bien d’autres, nous trouvions de tous côtés des mirages parmi lesquels nous tentions de distinguer l’objet, la nation, de son reflet dans le miroir du nationalisme » [25] (31) (p. 55). Pourtant, encore aujourd’hui, avertis de l’autocritique des auteurs, des auteurs comme Sales, Niosi et Monière continuent d’appuyer leurs propositions sur ce texte.
En même temps que Roch Denis et Luc Racine et un an à peine après la première parution du texte de Bourque-Frenette, Michel Van Schendel relève la confusion contenue dans le texte de Bourque-Frenette au sujet de la bourgeoisie [26] (12). Il affirme en effet qu’il existe une bourgeoisie québécoise qui accumule et tend, à travers ses porte-parole péquistes qui eux, sont d’origine petite-bourgeoise, à « prendre l’aspect d’une bourgeoisie d’État-Patron ». Michel Van Schendel souligne que cette « conséquence désarmante » de l’analyse de Bourque-Frenette était « décidément, dit-il, opposée à leurs prémisses théoriques ». Enfin, Van Schendel y définit la classe ouvrière québécoise comme « typique du capitalisme du centre dominant ». À partir de ce texte, un débat est lancé et deux problèmes majeurs s’imposent donc pour les recherches futures : l’existence de la bourgeoisie québécoise et la composition de la classe ouvrière.
À l’automne 1971 avait été formé au CFP un groupe de recherches sur les classes, groupe dans lequel on trouvait trois militants d’organisations populaires, Jean Roy du C.R.I.Q., Charles Gagnon du Conseil central de la C.S.N. à Montréal et Bernard Normand du CFP ainsi que trois intellectuels, Céline St-Pierre, Gilles Bourque et moi-même. C’est au cours de réunions qui s’échelonnèrent pendant huit mois que les critères de la division sociale du travail furent approfondis. Ainsi, le groupe avait dégagé la distinction entre travaux directement et indirectement productifs qui devint la clé de voûte de l’élaboration théorique que formula par la suite Céline St-Pierre [27] (14). Quelques-uns des aspects de la position à laquelle arrivait Céline St-Pierre ne faisant pas consensus, elle finalisa seule la démarche qui avait été jusque là collective. Ce texte fut important à plusieurs titres.
D’abord il répondait à des besoins très aigus des milieux militants et étudiants face à la théorie des classes. Ensuite, il contenait un certain nombre de notions nouvelles qui permettaient à ceux qui étaient engagés dans l’action d’établir une hiérarchie « théorico-stratégique » entre les couches de travailleurs auprès desquels ils oeuvraient. Il permet aussi de constater, à partir de sa large diffusion, que ces questions étaient à l’ordre du jour. La formation de ce groupe de recherche au CFP en témoigne d’ailleurs.
Dans ce texte, Céline St-Pierre posait que la classe ouvrière comprend les travailleurs directement productifs et la classe laborieuse, ceux qui le sont indirectement ainsi que tous les travailleurs manuels improductifs. Le prolétariat est donc l’ensemble de toutes ces places, soit la classe ouvrière et la classe laborieuse. La nouvelle petite-bourgeoisie, elle, comprend les travailleurs intellectuels affectés à la reproduction de la force de travail. La fonction politique de cette approche est donc d’étendre la classe ouvrière au plus grand nombre de salariés possibles. Cette élaboration eut et a encore une grande influence auprès des intellectuels québécois. Jean-Marc Piotte y ajoutait en 1978 quelques précisions. « Je me sépare donc de Céline St-Pierre sur les points suivants. L’utilisation gramscienne de la distinction travailleurs intellectuels/travailleurs manuels me permet de démarquer plus nettement la nouvelle petite-bourgeoisie des travailleurs improductifs, membres de la classe laborieuse qui oeuvrent eux aussi, à la reproduction des rapports sociaux nécessaires à la production de la plus-value… Je nomme classe laborieuse ce que Céline St-Pierre appelle « les classes laborieuses autres que la classe ouvrière »… [28] (17) (p. 212).
Le texte de Céline St-Pierre, avait, malgré les points de vue divers qu’il a pu entraîner, une qualité sans contredit : sa méthode claire permit aux chercheurs de trier avec adresse et cohérence parmi les couches de la division du travail celles qui correspondaient à leurs préoccupations idéologiques, ce qui permit à plusieurs de se démêler dans l’écheveau complexe des classes sociales en les sensibilisant à l’hétérogénéité du corps social.
À l’automne 1977 paraissait mon ouvrage Les classes sociales au Québec [29] (16). J’aimerais ici dégager ce qui constituait, à mes yeux, son apport principal, en faire une brève critique et dégager ce qui m’apparaît une priorité pour les analyses futures.
Ce travail se caractérise principalement par le fait que les classes et fractions qui y sont constituées condensent à la fois des distinctions économiques ainsi que des critères de domination/subordination, de sexes, de salaires, d’autorité/d’exécution, etc. La petite-bourgeoisie y est une classe déchirée. La contribution idéologique de ce texte consiste, selon moi, dans le fait d’avoir établi, tout au long de l’étude de la division sociale au Québec, un recoupement avec la place des femmes. Distinguer entre femmes et hommes de la classe ouvrière, entre ménagères et travailleurs productifs, entre la couche féminine du travail manuel improductif et la couche masculine est aussi important et litigieux que la démarcation entre petite-bourgeoisie et classe ouvrière. Non pas que les femmes forment une classe mais leur présence dans les classes reproduit doublement et d’une manière spécifique à chaque fois pour elles et pour les classes les rapports de pouvoir puisqu’elles sont les supports de la domination/subordination. Mon étude mettait l’accent sur cette question. Dans la représentation concrète que je donnais de la structure de classes, la répartition de l’ensemble tenait compte des ménagères, ce qui bouleversait les distributions statistiques conventionnelles. De plus, je conservais dans la couche prolétarisée de la petite-bourgeoisie les salariés manuels improductifs, ce qui correspondait à 7 % de la population et a semblé troubler la conscience prolétarienne de nombreux intellectuels.
Je ne crois pas, par ailleurs, avoir atteint l’objectif qui aurait consisté à fournir des représentations suffisamment empiriques de la structure sociale. Par « empiriques », je veux dire repérables spatialement et décrites localement. L’étude, en fait, n’a accompli que les deux premières étapes de son parcours, i.e. la démarche abstraite et théorique d’abord conduisant à la seconde, structurelle. La dernière étape non franchie aurait été de remonter au plus concret et d’opérer l’analyse de la fusion entre la structure et la conjoncture. Il est bien évident qu’on ne dispose pas des données historiques complètes permettant de finaliser cette phase de la recherche pour chaque classe sociale.
Enfin, une dernière réflexion s’impose à moi à propos des futures analyses de classes. Il me semble de plus en plus essentiel de tenir compte des modes concrets dans lesquels les ensembles sociaux vivent leur rapport à la société comme la question de l’identification à chaque sexe (dans la théorie, la classe ouvrière n’a pas de sexe). D’autre part, gommer l’existence des classes comme sujets m’apparaît aussi être une erreur politique et théorique : la dimension historiciste doit être présente aussi dans les analyses.
Car l’alliance large que les défenseurs du concept large de prolétariat ou de classe ouvrière étendu à tous les opprimés salariés recherchent devra témoigner de multiples différences sociales. Il n’y a pas dans le concret de classe ouvrière monolithique, classe sans sexe, sans âge, sans ethnie, sans espace physique propre. Seule existe la conjugaison de multiples déterminations et formes sociales singulières.
C’est confrontés à l’action politique et au changement que les partis de gauche traditionnels se heurtent à ces différences. C’est pourquoi, au sortir de la phase actuelle, nos recherches devront devenir de plus en plus spécifiques et reconnaître la pluralité du corps social.
C. Pendant le règne du Parti québécois jusqu’au référendum : des différences théorico-politiques
Contrastant avec les périodes précédentes, les quatre dernières années viennent de nous valoir une abondance exceptionnelle de textes. La période sera marquée par un questionnement qui porte sans contredit sur la composition de classes et sur l’hégémonie de l’alliance consacrée par le gouvernement péquiste. La réflexion sur la nature de classe de cette alliance présuppose évidemment une connaissance appropriée des ensembles socio-politiques composant la structure sociale et qui entrent en interaction dans les luttes politiques concrètes. Sur ce dernier point, les diverses étapes traversées par ce débat ont révélé des différences théoriques assez fondamentales.
La partie suivante du présent texte se développera donc à partir d’événements internes du cheminement de la gauche intellectuelle. En effet, contrairement aux deux périodes précédentes pour lesquelles les textes faisaient suite à l’actualité et étaient l’aboutissement surtout de collectifs fermés (Parti Pris, Socialisme, groupe de recherche du CFP), les travaux diffusés depuis novembre 1976 témoignent de préoccupations de plus en plus complexes, d’une écoute plus large et partant d’ailleurs de rencontres publiques. Deux colloques ont été à l’origine de la formulation des deux tendances qui allaient principalement s’opposer quant à l’analyse du PQ. Ces tendances, depuis les deux colloques qui eurent lieu en novembre 1977, ont donné suite à de nombreux textes sur la bourgeoisie québécoise et sur la question nationale. Pour illustrer ce phénomène, voici, à titre d’exemples, quelques-uns des titres des articles étudiés plus loin : « La nouvelle bourgeoisie canadienne-française »(Niosi), « Les nouveaux paramètres de la bourgeoisie québécoise » (Fournier), « Petite bourgeoisie envahissante et bourgeoisie ténébreuse » (Bourque).
Je ferai donc une étude plus systématique des principaux articles directement liés à ces colloques, considérant que leur aspect polémique et l’évolution qui les a en même temps marqués leur confèrent, de par ce caractère dynamique, une importance idéologique majeure.
Les 10 et 11 novembre 1977, la Société canadienne de science politique et l’Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue française organisèrent (par l’entremise de Jean-François Léonard) un colloque proposant comme thème un « bilan du gouvernement du Parti québécois » intitulé « Un an après ». Au cours de ce colloque, dans l’ensemble des interventions qui portèrent sur le PQ, les communications de Pierre Fournier, d’Arnaud Sales et de Gilles Bourque traitèrent plus exclusivement du PQ dans son rapport aux classes sociales. Ces trois communications furent publiées dans La chance au coureur [30] (19-20-21) et marquèrent le point de départ d’une longue course à la recherche d’un consensus. Une semaine plus tard avait lieu à Toronto, les 18 et 19 novembre 1977, le colloque « The American Empire and dependent States : Canada and the Third World ». Une session particulière y était consacrée au Québec et avait pour thème : « The Parti Québécois government, social classes and the state ». Jorge Niosi et moi-même y présentions des communications dont les commentateurs furent Pierre Fournier et Jean-Guy Vaillancourt. Plusieurs chercheurs québécois assistèrent à ce colloque et participèrent ensuite aux discussions dont Arnaud Sales, Carol Levasseur, Paul Bélanger et Gilles Bourque. La contribution de Jorge Niosi correspondait dans ses grandes lignes à l’article qu’il publia six mois plus tard dans le premier numéro des Cahiers du Socialisme [31] (24). En ce qui me concerne, le texte de ma communication fut repris par la Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie dans son numéro de mai 1978 [32] (23).
Par la suite, ces prolégomènes à l’étude du Parti québécois furent analysés, critiqués, nuancés dans les trois premiers numéros des Cahiers du Socialisme (1978-1979), dans un numéro spécial de la revue française Politique aujourd’hui paru au printemps 1978, ainsi que dans un ouvrage collectif publié sous la direction de Pierre Fournier en décembre suivant. Les incidences idéologico-politiques exprimées dans ces colloques et contenues dans ces articles ayant des implications politiques pour l’étape dans laquelle nous entrons, elles méritent notre plus grande attention.
Avant, cependant, d’en amorcer l’analyse, je ne voudrais pas négliger de faire mention de quelques autres travaux non moins utiles à notre démarche. Je pense en particulier à des ouvrages comme celui de Dorval Brunelle La désillusion tranquille [33] (22) qui a été le premier à démontrer avec précision la capacité de la bourgeoisie québécoise de mettre en place des mesures concrètes assurant le développement de ses ressources économiques propres. Je pense aussi aux ouvrages de Jorge Niosi sur le capitalisme canadien et d’Arnaud Sales sur la bourgeoisie industrielle canadienne-anglaise et canadienne-française au Québec [34] (35) ainsi qu’à l’essai de Jacques Mascotto et de Pierre-Yves Soucy intitulé Sociologie politique de la question nationale [35] (36). Enfin, je voudrais souligner, parmi d’autres, l’excellent article de Carol Levasseur et de Jean-Guy Lacroix, « Rapports de classes et obstacles économiques à l’association » paru à l’automne 1978 dans le deuxième numéro des Cahiers du Socialisme [36] (30). Quoique je ne partage pas tous les points de vue exprimés dans l’ensemble de ces travaux, j’aurais souhaité pouvoir leur consacrer une étude approfondie à la lumière des récents débats sur la bourgeoisie québécoise. On comprendra que dans les limites du présent texte il me soit impossible de le faire.
2. Une problématique
Il est clair, je ne saurais m’en cacher, que l’analyse concrète des classes sociales au Québec ainsi que le développement et l’affermissement des prémisses conceptuelles qui la servent représentent pour moi un centre d’intérêt de toute première importance. Avec d’autres, j’ai consacré la majeure partie de ces dernières années à travailler ces questions et en ce qui concerne ma recherche personnelle sur la structure de classes au Québec, c’est en 1970 que je l’ai commencée.
C’est pourquoi je me permettrai de rappeler pour commencer les principaux éléments d’analyse de la bourgeoisie et du Parti québécois que j’avais élaborés dans mon ouvrage Les classes sociales au Québec [37] (16) paru au moment même où se tenaient les deux colloques mentionnés plus haut, soit en novembre 1977, dans la mesure aussi où il furent largement repris au cours de la réflexion qui allait s’ensuivre.
Cinq éléments définissaient alors pour l’essentiel mon analyse : 1) « Le PQ est le représentant des intérêts de la bourgeoisie non monopoliste au Québec » (p. 191) ; 2) « les aspects super-structuraux de détermination de la place de la bourgeoisie non monopoliste québécoise ont un effet de domination sur sa constitution. Sous sa seule détermination économique (malgré sa faiblesse structurelle, elle, surdéterminée), détermination s’accrochant inlassablement à des velléités autonomistes de couleurs multiples, la bourgeoisie québécoise n’aurait pas fait long feu » (p. 191) ; 3) « de son existence structurelle en intérêts et pratiques économiques, juridico-politiques et idéologiques distinctifs, ce capital devient une force sociale organisée, produisant ses effets sur toutes les classes et sur tous les partis au Québec et même au Canada tout entier… c’est la constitution de la bourgeoisie non monopoliste québécoise en fraction autonome de classe par cette formation en parti » (p. 192); 4) « les éléments canadiens-français qui participent aux rapports monopolistes s’amalgament à ceux-ci de telle sorte que leur caractère « ethnique » ne supporte encore aucun fractionnement » (p. 189); 5) « On voit bien que les politiques d’un parti ne s’analysent pas seulement quant aux caractères des agents qui le composent mais surtout par son rapport aux places de classes de la structure qu’il comble ou vise à combler. Ainsi, les analyses expliquant le PQ par sa composition dite « technocratique » conduisent à toutes sortes de méprises simplificatrices et évacuent le problème des luttes au sein de l’État, et, indirectement, du fédéralisme canadien… (le PQ est une) organisation de la bourgeoisie non monopoliste à clientèle ouvrière et petite-bourgeoise » (pp. 193-194).
Isoler ces éléments permet de saisir la trajectoire que suivit par la suite le débat sur les classes. On le verra plus loin, c’est successivement que s’inscrivirent les oppositions et les consensus face à ces éléments.
Pour commencer chronologiquement par la fin, je citerai, à titre d’illustration, la dernière pièce d’œuvre à date de cette réflexion, parue quand Denis Monière écrivit, il y a aussi peu longtemps qu’en octobre dernier « Est-il possible alors de parler d’une bourgeoisie « QUÉBÉCOISE » au sens plein du terme, quand celle-ci est à ce point liée qu’elle est absolument incapable d’influencer de façon autonome le développement économique du Québec ? Cette bourgeoisie liée et dépendante ne peut être qualifiée de québécoise par le simple fait qu’elle réside sur un territoire géographiquement situé, le Québec. Cette bourgeoisie résidant au Québec peut-elle réellement s’identifier à un projet national qui risquerait de compromettre sa position actuelle auprès et vis-à-vis du capital et de la bourgeoisie canadienne, dont elle ne représente qu’une fraction ethnique dépendante ? Il faut répondre par la négative » [38] (39) (p. 157). Et, conséquence de cette première position, « la souveraineté-association… implique qu’une plus grande part de pouvoir politique sera contrôlée par la nouvelle petite bourgeoisie qui pourra ainsi accéder à l’élite du pouvoir économique » [39] (39) (p. 157).
Les voies politiques opposant les positions citées sont claires, leurs prémisses théoriques, elles sont plus complexes et malheureusement je ne pourrai ici qu’en faire rapidement mention. Les fondements des différences méthodologiques et théoriques sont, bien entendu, idéologiques. Cependant, ces différences peuvent parfois témoigner de l’influence prévalente d’une approche sur une autre dans un contexte culturel scientifique à un moment donné et ne signifient pas nécessairement que ces positions n’évolueront pas ni que leurs auteurs en assument pleinement et définitivement à chaque fois toutes les conséquences. C’est pourquoi je m’efforcerai de traiter avec précaution de ces divergences, sans présumer de leur avenir. Cependant, avant d’en dégager l’évolution, il serait utile, me semble-t-il, de dégager à grands traits ce qui sous-tend ces interprétations de la conjoncture récente.
3. Des différences théoriques
Certes l’unanimité sur la structure des rapports sociaux au Québec aurait entraîné une plus grande unité au niveau de l’analyse du Parti québécois et, en conséquence, de la stratégie et des tactiques à mettre en œuvre dans la gauche québécoise.
Or il n’en fut pas ainsi. Ceux que j’appelle ici « les chercheurs universitaires de gauche » (sans connotation d’exclusivité, bien entendu, par rapport aux auteurs chercheurs marxistes dont les travaux ne sont pas étudiés ici) pour la commodité sociologique de l’expression, ces intellectuels d’appartenance large au matérialisme sont partagés quant à la définition de la division sociale du travail caractérisant le Québec, i.e. quant à l’existence, à la composition interne et à l’importance des unes et des autres classes sociales.
Les désaccords quant à la bourgeoisie, fondent sans doute les principaux débats. Pour les uns, il n’y a pas de bourgeoisie proprement québécoise, pour d’autres, la distinction entre la bourgeoisie canadienne-française d’un côté et québécoise de l’autre fait l’objet d’un litige ; pour d’autres encore la reconnaissance d’une bourgeoisie nationale et/ou d’une bourgeoisie compradore est acquise, pour d’autres elle, ne l’est pas ; enfin, quelques-uns trouvent essentielles les distinctions entre capital monopoliste et capital non monopoliste, entre petite bourgeoisie et PME : et d’autres les considèrent superflues. L’inclusion ou l’exclusion de l’un ou de l’autre de ces critères affecte la vision du PQ et les positions politiques conséquentes.
Un corollaire des divergences précédentes à propos de la bourgeoisie surgira d’ailleurs à propos de la petite-bourgeoisie. En effet, à cause de sa position intermédiaire entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, les critères qui délimitent cette classe, autant vers le haut que vers le bas, feront l’objet de désaccords. Du côté des frontières entre avec la bourgeoisie, et la petite-bourgeoisie les définitions seront diverses *. Certains y incluront par exemple, tous les professionnels, y compris ceux qui capitalisent et concentrent leurs ressources en complexifiant l’organisation du travail entre plusieurs niveaux et services ; dans ces cas, les chercheurs qui les rangent (malgré la concentration de leurs revenus) dans la petite bourgeoisie privilégient le critère de la « nature » abstraite de leur travail de professionnels, indépendamment de la transformation du rapport social. Les mêmes travaux seront portés à nier l’existence d’une bourgeoisie québécoise puisque la petite bourgeoisie nationaliste y tient lieu de classe dominante québécoise opposée à la bourgeoisie canadienne. Tomberont donc dans la petite bourgeoisie les gestionnaires du capital-action, des sommets de l’État et souvent les PME. Pour ce courant, la petite-bourgeoisie est une classe comportant une forte polarisation vers le haut. Pour ce courant également plusieurs couches de travailleurs intellectuels salariés (cols blancs), et tous les employés forment avec les travailleurs de la production la classe ouvrière. Ce schéma aboutit le plus souvent à deux classes proprement québécoises, une petite bourgeoisie d’artisan, de gestionnaires, de professionnels, de hauts fonctionnaires d’État et d’intellectuels de la reproduction et une classe ouvrière recouvrant le reste des salariés. Au niveau de l’analyse conjoncturelle, ce cadre conceptuel supportera l’analyse du PQ comme parti de la petite bourgeoisie avec alliance populiste de la classe ouvrière, c’est-à-dire le reste de la population québécoise. Les mêmes recherches nieront donc d’un côté l’existence d’une bourgeoisie québécoise et présenteront de l’autre le PQ comme parti à tendance sociale-démocrate sous la gouverne d’intérêts petits-bourgeois.
Dans un sens tout à fait différent, d’autres travaux reconnaissent l’existence d’une bourgeoisie québécoise ayant une place politique propre et une petite-bourgeoisie qui est moins la condensation des intérêts économiques d’une élite qu’une classe profondément contradictoire, comprenant un vaste ensemble de salariés socialement démarqués de la classe ouvrière et polarisés à la fois vers elle et vers la bourgeoisie. En conséquence, le Parti québécois présente pour ce 2e courant une configuration plus complexe dans laquelle son rapport propre à la bourgeoisie québécoise sera un facteur central dominant, une alliance plus contradictoire avec les couches sociales dominées, à la fois celles de la petite-bourgeoisie et celles de la classe ouvrière. Ce dernier courant ne voit pas le PQ comme parti social-démocrate puisque le rapport politico-idéologique de ce parti aux classes dominées est la légitimation des intérêts sous-jacents de la bou
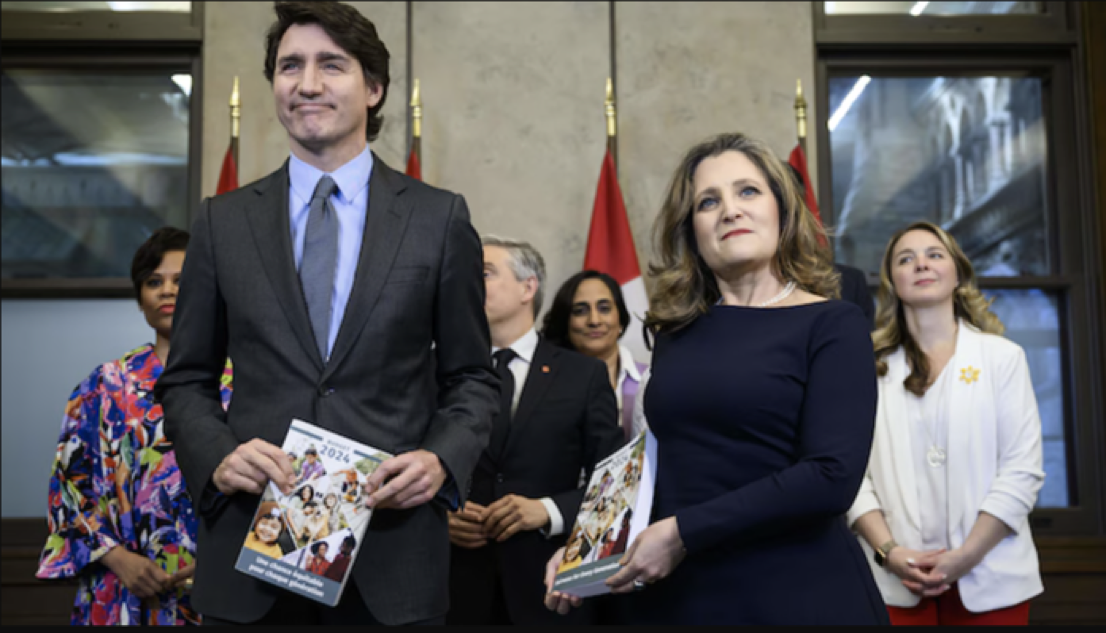
Le budget Freeland, une revue de presse
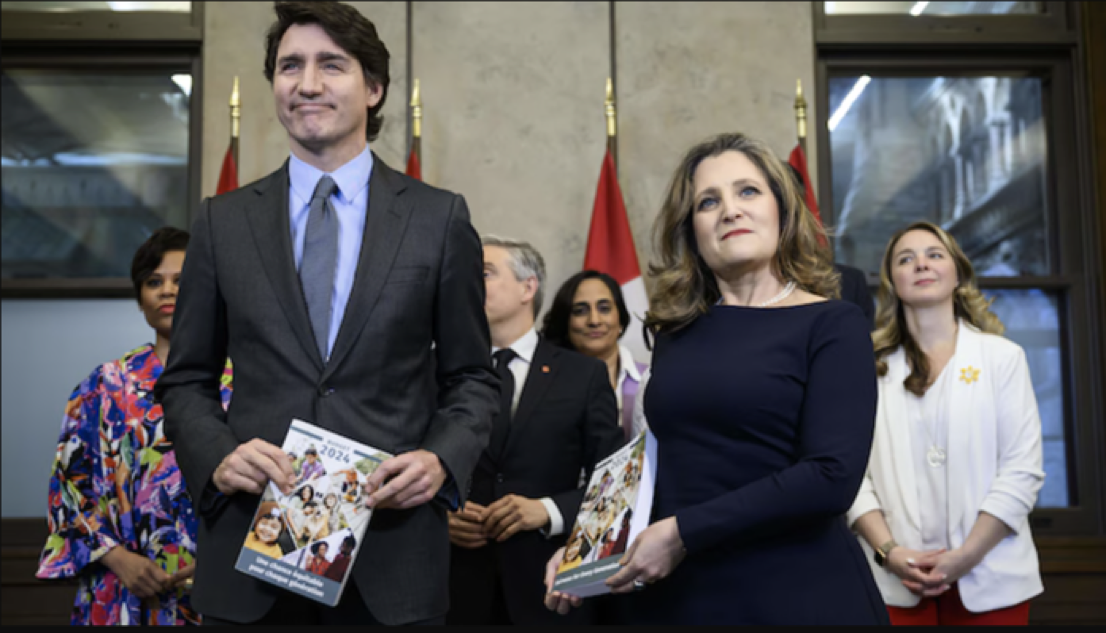
Voici les réactions des organisations syndicales et populaires au budget fédéral 2024-2025. Nous les publions au fur et à mesure de leur publication.
Un budget qui ne va pas assez loin (CSQ)
Après la pluie d'annonces des dernières semaines : 500 M$ pour la santé mentale, 9 G$ pour l'armée, un « Plan du Canada pour le logement » à 5 G$, 1 G$ pour l'aide alimentaire et 2,1 G$ pour amorcer la mise en place d'une assurance médicaments universelle et publique…, il nous semblait difficile d'être surpris par le budget fédéral déposé ce mardi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.
Par Pierre-Antoine Harvey, conseiller CSQ
À la surprise générale, le déficit est inférieur aux prédictions des analystes. Un déficit de 40 G$ équivalant à seulement 1,3 % du PIB, soit trois fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE1. Le gouvernement pourra remercier la vigueur imprévue de l'économie au Canada et aux États-Unis pour ces bons résultats.
Ce budget, qui se veut progressiste et axé vers les jeunes générations, fait plusieurs pas dans la bonne direction. Cependant, il aurait pu aller beaucoup plus loin, étant donné les différentes crises réelles auxquelles la population fait face.
Une plus grande justice fiscale
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se préoccupe de la justice fiscale et salue l'initiative du gouvernement fédéral d'augmenter les impôts sur les gains en capital des plus riches, ce qui devrait générer des recettes fiscales supplémentaires de 17,7 milliards de dollars.
Actuellement, les Canadiens paient des impôts sur 50 % de leurs gains en capital. Le gouvernement a annoncé que ce taux passera à 66 % pour les gains supérieurs à 250 000 $ annuellement à partir du 25 juin 2024. Pour les gains inférieurs à ce seuil, la partie imposable demeure à 50 %. De plus, le taux d'inclusion des gains en capital des entreprises et des fiducies sera également majoré de 50 % à 66 %.
Investissements dans le logement abordable (et non social !)
Le gouvernement fédéral s'engage à encourager la construction de 250 000 logements supplémentaires d'ici 2031, comme indiqué dans son « Plan du Canada pour le logement » de 8 G$ qui introduit plusieurs mesures d'aide aux constructeurs, aux futurs propriétaires ainsi qu'aux locataires.
Cependant, cette initiative, bien qu'essentielle, demeure encore trop timide en termes de développement du logement social ou coopératif, qui est essentiel pour aider les ménages les plus pauvres, soit les premières victimes de la crise du logement.
En parallèle, Ottawa prévoit transformer des terrains et des édifices fédéraux afin de construire 30 000 nouveaux logements à travers le Canada. Le budget nous apprend que Postes Canada, qui compte plus de 1 700 bureaux de poste à travers le pays, et les Forces armées pourraient devoir se départir d'immeubles sous-occupés.
Malheureusement, la cible de logements dits « abordables » est fixée à seulement 20 %, sans garantie qu'il s'agisse de véritables logements sociaux en dehors du marché privé.
Enjeux autochtones
En ce qui concerne les dépenses pour les peuples autochtones, le budget fédéral prévoit cette année des investissements avoisinant les 3 milliards de dollars à travers le pays. Malheureusement, ce montant est insuffisant, surtout en prenant en compte les besoins criants en matière de services essentiels qui ne sont pas pourvus dans les communautés des Premières Nations.
La santé et le soutien de la jeunesse recevront la part du lion des fonds destinés aux peuples autochtones dans le budget fédéral 2024-2025. Ottawa prévoit investir 1,06 milliard de dollars dans le premier de ces domaines et 499 millions de dollars dans le second. En santé, l'accent est mis sur l'amélioration de l'accès aux soins et aux services de santé mentale, avec des investissements respectifs de 1,06 milliard de dollars (dont 646 millions cette année) et de 630 millions de dollars (dont 315 millions cette année).
On s'éloigne de la transition juste
Si le dernier budget avait une forte saveur environnementale, la transition juste est la grande absente du budget 2024-2025. La mesure à connotation environnementale qui se démarque semble être avant tout une protection contre les attaques préélectorales du Parti conservateur.
Près de 600 000 entreprises de moins de 500 employés recevront une compensation pour la taxe carbone. La taxe de 15 $ par tonne de carbone émis génère beaucoup de mécontentement dans toutes les provinces…, à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique, qui ont leur propre Bourse du carbone ou une taxe déjà plus élevée.
Marcher sur les platebandes de Québec
Plusieurs des mesures progressistes mises de l'avant par Ottawa laissent présager un empiètement sur les compétences provinciales. La défense des juridictions du gouvernement du Québec est importante, mais elle ne doit pas être une excuse pour l'immobilisme. Québec doit s'entendre avec Ottawa pour recevoir les sommes équivalentes, tout en s'assurant que ces dernières serviront à la mise sur pied de programmes, totalement québécois, qui s'attaqueront aux problèmes concrets de la population.
Par exemple, l'argent fédéral prévu pour l'assurance médicaments doit permettre la mise en place d'un réel régime public universel d'assurance médicaments québécois. Elles ne doivent pas être détournées afin de servir de « plaster » sur le régime hybride québécois, qui a démontré ses lacunes2.
La stratégie du saupoudrage
La stratégie du gouvernement consistant à disperser les fonds dans une multitude de mesures, bien que progressive, présente des lacunes. Le saupoudrage financier sur divers postes de dépenses entraine une mise en œuvre partielle de nombreuses initiatives, notamment en ce qui concerne l'assurance médicaments universelle et à payeur unique …, qui ne couvre qu'une sélection restreinte de médicaments3.
Pour répondre aux besoins actuels, des mesures structurantes sont nécessaires pour stabiliser réellement l'économie et soutenir les travailleurs. Malheureusement, la stratégie du saupoudrage ne suffira pas à accomplir cette tâche.
Des finances publiques qui vont bien
Quoi qu'en disent les prophètes de l'austérité : surprise ! Les finances publiques du Canada vont bien ! Le déficit n'a pas explosé, et le pays se retrouve avec la dette la plus soutenable des pays membres du G74. La crise du logement, la crise écologique, la crise de l'abordabilité, la crise des conditions de vie dans les communautés autochtones, etc., exigeaient que le gouvernement intervienne. Il faudrait même qu'il accélère ses interventions et les coordonne mieux avec les provinces si nous voulons offrir un répit à la population, qui subit les conséquences de ces multiples crises.
Déception des artistes en arts visuels canadiens : le droit de suite tant attendu n'est pas inclus dans le budget fédéral 2024
OTTAWA, le 18 avril 2024 – Les artistes en arts visuels de tout le pays attendent depuis longtemps que le Canada reconnaisse le droit de suite pour les artistes canadiens. Les organisations qui les représentent, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et le Front des artistes canadiens (CARFAC) représentent ensemble plus de 5 000 artistes dans tout le pays. Les artistes ont exprimé leur frustration à l'égard du gouvernement canadien, car cet important droit économique pour les artistes visuels a encore une fois été exclu du budget 2024 – qui ne prévoit pas non plus d'autre soutien spécifiquement pour les artistes en arts visuels.
Le droit de suite est une redevance qui permet aux artistes d'obtenir une part de la richesse produite par la revente de leurs œuvres. Il permet au Canada de s'aligner sur la législation de plus de 90 pays dans le monde qui disposent déjà de lois sur le droit de suite. Bon nombre de ces lois prévoient que les artistes en arts visuels reçoivent 5% lorsque leurs œuvres sont revendues sur le marché secondaire par un intermédiaire tel qu'une maison de vente aux enchères ou une galerie d'art. Le droit de suite permet aux artistes de bénéficier du succès continu de leurs œuvres. Si le droit de suite s'applique à tous les artistes en arts visuels, celui-ci aurait été particulièrement favorable aux artistes seniors qui ont travaillé pendant des années à développer leur carrière artistique et qui se retrouvent souvent en situation de précarité durant leurs vieux jours. Cela aurait été également une grande victoire pour les artistes autochtones, qui ont trop souvent été exploités sur le marché secondaire de l'art.
Le droit de suite apporterait un soutien financier bien mérité et reconnaîtrait la contribution continue d'un artiste à la culture canadienne.
“L'adoption du droit de suite pour les artistes en arts visuels au Canada est essentielle », déclare Camille Cazin, directrice générale du RAAV. “Le droit de suite rétablit un équilibre en garantissant que les artistes sont équitablement rémunérés pour leur travail lorsque leurs œuvres sont revendues à des prix supérieurs à la valeur initialement reçue par l'artiste et nous mettrait en conformité avec nos partenaires internationaux. Nous demandons instamment au gouvernement de respecter son engagement de mettre en œuvre ce droit dans un avenir immédiat afin de garantir l'équité et la reconnaissance de la contribution des artistes à la richesse culturelle et économique du Canada. »
« L'absence d'inclusion du droit de suite des artistes dans ce budget est une incroyable déception pour la communauté artistique canadienne. Tout le monde sait à quel point ce droit aiderait les artistes en arts visuels canadiens à se remettre de la pandémie et leur permettrait de bénéficier d'une nouvelle source de revenus pour les années à venir », a déclaré April Britski, directrice générale nationale de CARFAC, qui se bat depuis près de vingt ans pour que ce droit soit inscrit dans la législation canadienne. « Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour qu'il respecte son engagement de présenter un projet de loi sur le droit de suite et pour que les artistes en arts visuels soient mieux rémunérés pour leur travail. »
Budget fédéral 2024 - La FNCC déplore le peu d'intérêt d'Ottawa pour la survie des médias
MONTRÉAL, le 18 avril 2024 - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) salue la reconduction de certains financements en culture, aux festivals, aux arts vivants et au Fonds du livre, par le gouvernement fédéral, tout en déplorant le fait que ces financements soient ponctuels. La FNCC est également déçue qu'Ottawa n'ait pas annoncé de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région.
« Ottawa a certes bonifié de 42 millions de dollars le financement public de Radio-Canada, réduisant la nécessité d'abolitions de postes annoncée en décembre 2023. Nous saluons aussi la reconduction de l'Initiative de journalisme local annoncée en février. Mais qu'en est-il des autres médias ? La crise des médias, on ne l'invente pas. Elle se vit tous les jours. Ottawa doit en faire plus pour la résorber, c'est sa responsabilité de préserver l'information de qualité, qui est essentielle pour la démocratie », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC.
La FNCC est présentement en campagne afin de mettre de l'avant des solutions structurantes à cette crise qui perdure. « Plusieurs solutions relativement simples sont à la portée d'Ottawa. Ne manque que la volonté politique du gouvernement fédéral ! », enchaîne Mme Charette.
La FNCC propose notamment que le crédit d'impôt à la masse salariale des médias d'information soit renforcé, en l'étendant aux salles de rédaction radio et télé. Pour la presse écrite, ce crédit pourrait être élargi afin de couvrir l'ensemble des emplois.
La FNCC propose aussi de doubler la déduction d'impôt pour les achats publicitaires auprès d'un média d'information. « Enfin, dans le contexte où des géants du numérique comme Meta rient de nos règles fiscales, il est aberrant que des organismes publics et des ministères fédéraux leur achètent encore de l'espace publicitaire. Le gouvernement fédéral devrait être cohérent en cessant immédiatement de transiger avec ce type d'entreprise et en adoptant une politique d'achat publicitaire responsable, visant à appuyer les médias d'information », continue Mme Charette.
Pour le secteur culturel, la FNCC et ses membres s'inquiètent du pourcentage de réponses positives aux projets soumis au Conseil des arts du Canada, qui semble se réduire actuellement. « Y a-t-il moins d'argent ? Là aussi, les besoins sont grands et l'action est urgente ! », termine la présidente.
Budget libéral - La CAQ doit injecter les fonds fédéraux dans les réseaux publics en crise, pas les dilapider en baisses d'impôt (FSSS-CSN)
MONTRÉAL, le 17 avril 2024 - La FSSS-CSN demande au gouvernement de la CAQ de réaffecter intégralement les fonds fédéraux destinés à des enjeux sociétaux, de santé, pour renforcer le filet social, non pas de dilapider les fonds en octroyant de nouvelles baisses d'impôt.
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, regrette que la Coalition avenir Québec ait laissé le champ libre au gouvernement du Canada qui piétine allègrement les plates-bandes du Québec.
« La CAQ a négligé les investissements requis pour répondre aux diverses crises qui ont actuellement cours et qui affaiblissent le filet social qu'il s'agisse de la crise du logement, de l'insécurité alimentaire, de la montée des problèmes de santé mentale, du manque de places dans les services de garde éducatifs à l'enfance », fait remarquer le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. « Elle a aussi préféré octroyer des baisses d'impôt qui profitent disproportionnellement aux mieux nantis plutôt que de s'attaquer aux maux du secteur public. »
Pas le choix
Dans ce contexte malheureux, les transferts budgétaires du fédéral, quoiqu'insuffisants, sont nécessaires et bienvenus… pourvu que le gouvernement de la CAQ se serve de l'argent pour réinvestir dans les réseaux publics de santé et services sociaux ainsi que dans les services de garde. Pas pour faire des chèques de 500 $ ou offrir des baisses d'impôt aux plus riches.
« Le gouvernement de la CAQ doit impérativement protéger les services publics du Québec en utilisant les transferts fédéraux pour s'attaquer aux nombreux enjeux qui secouent notre nation : santé, logement, services de garde, financement du communautaire, soins à domicile, etc. », réclame Réjean Leclerc.
Nouveaux revenus
La FSSS-CSN salue, par ailleurs, la décision d'Ottawa de chercher de nouveaux revenus dans les classes les plus aisées de notre société.
« Au lieu de pencher vers l'austérité, Québec devrait prendre des notes et s'octroyer de nouvelles sources budgétaires », avance Réjean Leclerc. « Des exemples : revoir la fiscalité trop avantageuse des grandes entreprises, diminuer les subventions aux riches corporations, éliminer l'évitement fiscal, taxer le patrimoine des 1% les plus fortunés, mettre en place un impôt sur les gains en capital, etc. »
Il y a de nombreuses mesures qui permettraient d'accroître les revenus de l'État et d'offrir les services auxquels les citoyennes et les citoyens sont en droit de s'attendre. Tout en favorisant le rétablissement du filet social, qui fait la fierté de la population québécoise.
Budget fédéral 2024 - Un pas vers plus de justice fiscale (CSN)
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - La CSN salue les augmentations d'impôt sur les gains en capital de plus de 250 000 $.
« C'est un pas vers plus de justice fiscale entre les mieux nantis et ceux qui gagnent leur argent en travaillant », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.
Le gouvernement a ajouté plusieurs nouveaux programmes intéressants ces dernières années, mais il faudra qu'il pense à les consolider pour que la population en profite vraiment. C'est sans compter des programmes déjà en place depuis plusieurs années, comme l'assurance-emploi ou les transferts pour la santé, qui méritent d'être bonifiés.
« Ce sera tout un défi de mener tout ça à terme dans un délai raisonnable. Il y a beaucoup de pain sur la planche », ajoute la présidente.
La CSN est par ailleurs déçue qu'il n'y a pas de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région. L'information de qualité est essentielle pour la démocratie.
L'annonce d'un projet de loi sur le droit à la déconnexion pour les entreprises de compétence fédérale est une bonne nouvelle. La CSN tient à collaborer au projet de loi.
Toujours pas assez pour le logement
Les nouvelles dépenses d'Ottawa pour le logement, annoncées avant le budget, représentent un effort louable d'augmentation du nombre de logements, mais cela demeure insuffisant, surtout à court terme. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoit qu'il faudrait construire 3,4 millions de logements d'ici 2030 pour atteindre une offre suffisante afin d'assurer un retour à l'abordabilité. Or, si ce n'est pas abordable, c'est impossible de se loger.
Réaction de la FTQ au budget fédéral : « La nature ayant horreur du vide, on comprend pourquoi le fédéral agit dans les "champs d'incompétence" de la CAQ » ‒ Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue plusieurs des mesures annoncées dans le budget fédéral, comme les investissements dans le logement, l'assurance médicaments ou l'aide alimentaire, et estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de la population. La centrale considère qu'il est important pour le Québec de protéger ses champs de compétence, mais comprend les actions du palier fédéral face au gouvernement de la CAQ. Pour la FTQ, il faut s'attaquer à la vie chère, à la crise du logement, à l'aide alimentaire, aux soins dentaires ou à l'assurance médicaments. C'est pourquoi Québec et Ottawa doivent collaborer et s'entendre rapidement pour que les milliards de dollars sur la table aident ceux et celles qui peinent chaque jour à joindre les deux bouts.
« La population québécoise souffre encore beaucoup de l'inflation. Se loger est rendu inabordable, la fréquentation des banques alimentaires ne cesse d'augmenter et le phénomène de l'itinérance atteint des proportions alarmantes. Il ne faut donc pas se surprendre que le fédéral réagisse. La nature ayant horreur du vide, on comprend pourquoi le fédéral agit dans les "champs d'incompétence" de la CAQ », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.
« Devant l'urgence actuelle, il faut mettre de côté les chicanes de clôtures. Les deux paliers de gouvernement doivent collaborer pour que l'argent soit utilisé aux programmes auxquels il est destiné et non pour baisser les impôts, donner des chèques cadeaux pour se faire élire ou payer des millionnaires pour venir jouer au hockey », ajoute le secrétaire général.
Aussi, il faut saluer les mesures sur les gains en capital qui visent les mieux nantis. Il s'agit d'une mesure positive, mais beaucoup d'efforts restent à faire, notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Soulignons également le 1,5 milliard de dollars qui seront investis en culture et communautés.
Par ailleurs, la FTQ invite les oppositions à faire preuve de bon sens et à travailler avec le gouvernement Trudeau pour une adoption rapide du projet de loi anti-briseurs de grève et une mise en œuvre dès sa sanction royale. Les travailleurs et les travailleuses ne devraient pas attendre 18 mois comme ce qui est proposé à l'heure actuelle. Ottawa doit également bonifier l'assurance-emploi et poursuivre ses efforts pour l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments. « Au Québec, le régime hybride (public-privé) est complètement inadéquat. Trop de personnes à faible revenu se privent de médicaments faute d'argent. Il est déjà démontré qu'un régime public et universel permettrait d'économiser plusieurs milliards de dollars grâce à un plus grand pouvoir de négociation. La raison doit l'emporter sur les intérêts des lobbys pharmaceutiques et des compagnies d'assurances », conclut le secrétaire général.
Budget fédéral : des promesses reléguées aux oubliettes, déplore le Réseau FADOQ
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 – Près de trois ans après la dernière élection fédérale, le Réseau FADOQ constate que le gouvernement du Canada semble abandonner définitivement les promesses faites aux électrices et électeurs aînés.
En 2021, le Parti libéral du Canada s'était engagé à bonifier le Supplément de revenu garanti (SRG), à créer un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière et à améliorer le crédit d'impôt pour aidant naturel.
Aucune de ces mesures ne figure au budget fédéral dévoilé mardi.
« Nous sommes profondément déçus qu'aucun de ces engagements ne fasse partie du budget. Il s'agit de mesures qui feraient une différence dans la vie de centaines de milliers de personnes. Le gouvernement libéral avait entre autres l'occasion de s'attaquer à la détresse financière des personnes de 65 ans et plus en bonifiant le Supplément de revenu garanti. Ces personnes n'ont pas été entendues », déplore la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral continue d'exclure les personnes de 65 à 74 ans de la bonification de 10 % du montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse alors que cette augmentation est versée aux personnes de 75 ans et plus.
« Au Réseau FADOQ, nos membres de 65 à 74 ans nous parlent quotidiennement de cette exclusion à laquelle ils et elles font face. On ne devrait pas avoir deux classes de personnes aînées dans notre société, mais c'est ce qui se passe actuellement », souligne Mme Tassé-Goodman.
Rappelons qu'une personne de moins de 75 ans qui reçoit uniquement la Sécurité de la vieillesse et le SRG bénéficie d'un revenu annuel de seulement 21 45,72 $, ce qui se situe sous le seuil de pauvreté officiel du gouvernement fédéral. Avec un tel revenu, il est impossible de composer avec l'augmentation des prix à la consommation sans avoir à faire des choix déchirants dans la vie de tous les jours.
Des gestes à venir, mais un déploiement complexe
Le gouvernement du Canada a profité du dépôt du budget pour annoncer le financement de 1,5 milliard $ sur cinq ans à Santé Canada afin de soutenir l'établissement du Régime national d'assurance médicaments. Le nouveau financement fédéral ne remplacerait pas le programme public d'assurance médicaments existant du Québec, mais viserait plutôt à le bonifier et à l'élargir.
Le Réseau FADOQ tient à souligner que le déploiement du Régime national d'assurance médicaments du fédéral est timide, puisqu'il ne cible que la couverture universelle de nombreux contraceptifs et de certains médicaments contre le diabète.
Le gouvernement du Canada a également réitéré sa volonté de déposer un projet de loi sur les soins de longue durée sécuritaires afin notamment d'appuyer de nouvelles normes nationales et d'améliorer les soins de santé dans les établissements de soins de longue durée comme les CHLSD.
Bien que ces deux gestes démontrent une volonté politique, le gouvernement du Canada souligne néanmoins que leur concrétisation devra se faire avec le concours des provinces et territoires, présageant un déploiement long et complexe.
Des efforts en logement
Le gouvernement fédéral a également annoncé plusieurs mesures afin de juguler la crise actuelle du logement. Il prévoit notamment favoriser la construction de logements sur des terrains publics ou encore des terrains appartenant à Postes Canada et à la Défense nationale. Le gouvernement fédéral souhaite également convertir des immeubles de bureaux fédéraux sous-utilisés en logements et taxer les terrains vacants pour encourager la construction de logements.
Budget fédéral : déception sur toute la ligne (Conseil national des chômeurs et chômeuses)
Montréal, le 16 avril 2024 – Le budget fédéral s'avère une grande déception pour le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).
« Il n'y a rien. Pas de réforme, même pas de mesures ciblées pour que le programme soit plus juste, plus équilibré et plus protecteur pour les travailleurs et les travailleuses », a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC. « Comme à a chaque année, le gouvernement prolonge la mesure des cinq semaines de prestations supplémentaires aux travailleurs et travailleuses saisonniers de 13 régions du Canada. Encore une fois, du temporaire et c'est trop peu. Cette mesure est un copier-coller du dernier budget 2023, c'est rire du monde ! ».
Le CNC critique également le refus du gouvernement de suivre ses propres projections pour résorber le déficit pandémique de la caisse de l'assurance-emploi, préférant plutôt réduire le taux de cotisation à un plancher historique, et s'empêchant de facto de faire des améliorations. « En refusant d'augmenter même minimalement le taux de cotisation, le gouvernement se prive d'argent, prolongeant le déficit de la caisse de l'assurance-emploi pour mieux justifier son inaction. Il se condamne lui-même à l'inaction », a déclaré le porte-parole.
Le CNC s'interroge finalement sur les raisons du revirement total du gouvernement, qui promettait encore l'année dernière une réforme complète de l'assurance-emploi, afin d'en faire un programme « digne du 21e siècle ».
« Pourquoi le gouvernement s'est engagé à réformer l'assurance-emploi s'il n'avait pas l'intention de le faire ? Il a engagé des dépenses, à hauteur de 5 millions de dollars, pour effectuer des consultations et des recherches. Il sait très bien ce qu'il faut faire. Il a donné très clairement sa parole, et a entretenu l'espoir. Qu'est-ce que les ministres attendent ? », a poursuivi Pierre Céré.
« Le gouvernement prévoit lui-même dans ce budget une augmentation des taux de chômage pour les deux années à venir, mais préfère ne rien faire. Le gouvernement devrait savoir que nous ne sommes pas à l'abri de crises et de catastrophes naturelles. Il semble préférer l'inaction et l'irresponsabilité », a conclu le porte-parole.
Budget fédéral 2024 : le gouvernement a les moyens d'en faire plus (IRIS)
OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 - La ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland a déposé aujourd'hui son 4e budget fédéral qui, en continuité des budgets précédents, ne cède pas à un conservatisme fiscal qui aurait été particulièrement inadapté aux crises actuelles.
Selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), la situation des finances publiques du Canada est loin d'être alarmante. Elle continue d'être enviable quand on la compare à celle des autres pays du G7. Ce faisant, le gouvernement devrait aller plus loin pour aider la population canadienne à faire face aux différentes crises que traverse le Canada.
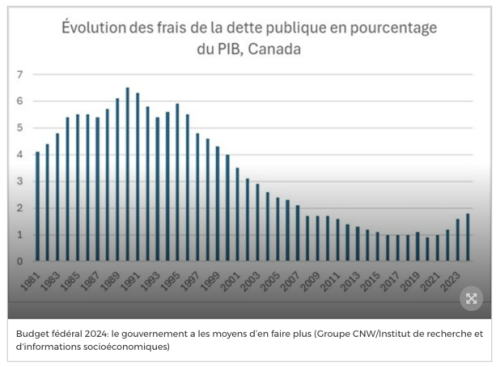
Service de la dette historiquement bas en proportion du PIB
L'exercice budgétaire 2024-2025 prévoit des revenus de 497,8 G$ et des dépenses de 537,6 G$, pour un déficit annuel de 39,8 G$. Le service de la dette, qui atteindra 54,1 milliards cette année, demeure parmi les plus faibles des trente dernières années lorsque rapporté au PIB et à l'ensemble des revenus du gouvernement.
« L'idée reçue selon laquelle le Canada est surendetté ne résiste pas à l'épreuve des faits. Même avec le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé, le déficit et les frais d'intérêt encourus en pourcentage du PIB demeurent marginaux en 2024-2025 », remarque Colin Pratte, chercheur à l'IRIS.
Imposition des entreprises et des mieux nantis : un rattrapage nécessaire
Le gouvernement prévoit générer de nouvelles sources de revenus totalisant 6,5 milliards de dollars, principalement grâce à un rehaussement à 66% du taux d'inclusion des gains en capital, qui rapportera environ 4 G$ par année.
Le gouvernement aurait pu dégager encore plus de marge de manœuvre fiscale. Le Directeur parlementaire du budget a en effet calculé qu'un retour à un taux d'inclusion de 75% des gains en capital, c'est-à-dire le taux qui prévalait dans les années 1990, engendrerait des revenus additionnels de 13 G$.
Notons que le taux d'imposition des entreprises au fédéral a diminué de 60 % depuis les années 1980, passant de 37,8 % à 15 %.
« Il y a un énorme rattrapage à faire en matière d'imposition des entreprises au Canada ; le gouvernement est sur la bonne voie, mais devra aller plus loin s'il veut ''soutenir la classe moyenne'' pour faire face aux différentes crises », remarque Colin Pratte.
Budget fédéral 2024 - Toujours pas assez de logements d'ici 2030 (CSN)
MONTRÉAL, le 15 avril 2024 - Les nouvelles dépenses d'Ottawa pour le logement, annoncées avant le budget, représentent un effort louable d'augmentation du nombre de logements, mais cela demeure insuffisant.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoit qu'il faudrait construire 3,4 millions de logements d'ici 2030 pour avoir une offre suffisante afin d'assurer un retour à l'abordabilité. Or, si ce n'est pas abordable, c'est impossible de se loger.
« L'intention du gouvernement est bonne, mais ça ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité dans le secteur du logement d'ici 2030. La demande est telle, qu'une stratégie canadienne en consultation avec tous les partenaires impliqués, dont les provinces, serait essentielle pour faire en sorte que toute la population puisse avoir accès à un logement décent, et ce, à coût accessible », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN, précisant que le financement et la main-d'œuvre devront être au rendez-vous si l'on veut que ce méga chantier aboutisse enfin.
La CSN estime que le déficit ne devrait pas empêcher de voir plus grand sur cet enjeu crucial. Le directeur parlementaire du budget estimait l'an dernier que le gouvernement fédéral pouvait accroître ses dépenses de 1,7 % du PIB, ou 49,5 G$, sans nuire à sa viabilité financière à long terme. Il serait par ailleurs possible d'augmenter les revenus d'Ottawa tout en assurant une meilleure redistribution de la richesse. La CSN propose, par exemple, une taxe sur les services numériques pour les géants du web, laquelle avait déjà été envisagée par le gouvernement fédéral. Comme il n'y a toujours pas d'entente multilatérale pour imposer ces entreprises, le Canada devrait mettre en place une telle taxe, dès 2024, comme annoncé dans le précédent budget.
Des promesses toujours en plan
Alors que le gouvernement Trudeau est en place depuis 2015, la réforme de l'assurance-emploi n'a toujours pas été réalisée et quelque 60 % des Canadiennes et des Canadiens qui perdent leur emploi n'ont pas le droit à des prestations. Les syndicats et plusieurs groupes communautaires exigent depuis plusieurs années des changements fondamentaux. Rien n'est fait.
Le régime d'assurance médicaments universel n'est pas encore en place, mais la CSN salue le premier pas dans cet important dossier. Il faudra toutefois aller plus loin que la couverture de deux médicaments et pour cela, il faudra une entente avec les provinces.
La décarbonisation de l'économie canadienne piétine. Ottawa doit être au rendez-vous pour appuyer des moyens concrets de réduction des émissions de carbone, comme l'augmentation de l'offre en transport en commun. « Les intentions sont là, mais l'atteinte des objectifs prend énormément de temps », conclut la présidente de la CSN, qui estime qu'il serait pourtant possible de se donner les moyens de faire ce qui doit être fait pour l'avenir de nos enfants.
Le FRAPRU commente les mesures du budget Freeland sur le logement : Un changement de cap souhaitable, mais beaucoup trop timide
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement québécois pour le droit au logement, accueille favorablement certaines des mesures proposées dans le Plan du Canada sur le logement dévoilé vendredi et dont les détails seront annoncés dans le budget de la ministre Chrystia Freeland. Il estime cependant que le gouvernement Trudeau mise encore trop sur le marché privé pour s'attaquer à la crise du logement.
Sa porte-parole, Véronique Laflamme, explique cette réaction en demi-teinte « Depuis des années, le FRAPRU revendique un vigoureux changement de cap d'Ottawa dans ses investissements en logement pour qu'ils soient clairement dirigés vers le secteur sans but lucratif et l'aide aux personnes et aux familles qui vivent le plus durement les effets de la crise. La Défenseure fédérale du logement et le Conseil national du logement, deux entités mises sur pied par le gouvernement fédéral pour surveiller le droit à un logement adéquat au Canada, ont fait des recommandations allant dans le même sens. Certaines des mesures du Plan du Canada sur le logement qui seront confirmées aujourd'hui opèrent un tel virage, mais les incitatifs visant à encourager les promoteurs privés à construire, eux, ne peuvent résulter qu'en des logements totalement inabordables dans le contexte actuel ».
Des changements salués
Le FRAPRU salue l'ajout attendu dans le budget de 1 milliard $ pour le Fonds pour le logement abordable permettant « de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement ». Il considère cet investissement additionnel d'autant plus bienvenu qu'il permettra entre autres de pérenniser l'Initiative de création rapide de logements qui finance la réalisation de logements abordables permanents pour des personnes et des familles vulnérables.
Le regroupement se réjouit aussi de la création d'un Fonds canadien de protection des loyers de 1,5 milliard $ qui permettra l'acquisition de logements locatifs existants pour les sortir de la spéculation. « Le FRAPRU revendiquait une mesure similaire depuis des années », rappelle Véronique Laflamme, en ajoutant que les fonds prévus ne seront pas suffisants, puisque ce sont des contributions plutôt que des prêts qui devraient être accordées pour assurer la pérennité et l'accessibilité financière des logements sans but lucratif ainsi réalisés.
Le FRAPRU attend enfin avec impatience les détails du Programme de coopératives d'habitation doté d'un budget de 1,5 milliard $ et annoncé lors du budget 2022. Véronique Laflamme lance un appel à ce sujet : « Le modèle de coop d'habitation qui s'est historiquement développé au Québec est basé sur une mixité de revenus permettant entre autres à des ménages à faible revenu d'y avoir accès, grâce à une aide financière additionnelle. C'est aussi ce que devrait faire le nouveau programme dont les détails seront dévoilés à l'été 2024 ».
Trop pour les promoteurs privés
« C'est bien beau de vouloir construire plus de logements, plus rapidement, comme l'affirme le Plan du Canada sur le logement, mais il ne faudrait pas pour autant construire à n'importe quel loyer et augmenter ainsi le problème d'inabordabilité ». C'est en ces termes que Véronique Laflamme a fait part du désaccord du FRAPRU face à certaines mesures du Plan favorisant en grande partie les promoteurs privés et des logements qui sont majoritairement inabordables, dont l'ajout de 15 milliards $ dans le Programme de prêts à faible coût L'introduction d'une nouvelle mesure de déduction fiscale permettant aux constructeurs de « lancer davantage de projets en augmentant leur retour sur investissement après impôt » qui s'ajoute à l'élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les nouveaux projets d'appartements locatifs, peu importe leur loyer. « C'est dilapider indirectement des sommes qui seraient beaucoup plus utiles en logement social », insiste Véronique Laflamme.
Le FRAPRU s'inquiète finalement de l'utilisation que le gouvernement fédéral pourrait faire de ce qu'il appelle « un plan historique de terres publiques disponibles pour le logement ». Il craint que ce plan répète les erreurs de l'Initiative des terrains fédéraux, inaugurée en février 2019 et qui, en décembre 2023 avait permis la réalisation de 4000 logements mais dont 57 % n'étaient même pas abordables, selon les critères fédéraux déjà élastiques. Il ajoute qu'au Québec, cette initiative n'a jusqu'ici servi qu'à la réalisation de 12 logements. Le FRAPRU réclame que les terrains publics soient réservés au secteur sans but lucratif.
« Le gouvernement Trudeau semble avoir compris qu'il devait favoriser davantage le logement sans but lucratif qu'il ne le faisait jusqu'à maintenant avec sa Stratégie nationale du logement. Il doit cependant aller beaucoup plus loin et y concentrer ses investissements. Le logement social demeure le seul véritable moyen de s'attaquer en profondeur à la crise du logement dans toutes ses dimensions, dont la pénurie d'appartements, mais aussi leur inaccessibilité financière et il faut prendre tous les moyens pour augmenter rapidement la maigre part qu'ils occupent sur le parc locatif du Québec et du Canada », conclut la porte-parole du FRAPRU.
Le FRAPRU analysera le budget qui sera déposé aujourd'hui et y réagira. Il se réjouit de possibles mesures fiscales visant à faire contribuer davantage les très riches aux fonds publics en espérant que ces fonds permettront de lutter davantage contre les inégalités sociales en finançant massivement le logement social. Le regroupement espère que d'autres mesures fiscales favorisant de façon disproportionnée les propriétaires seront également revues.
De l’état du monde et du déni des gens qui nous gouvernent
« L’art palestinien est une manière de se questionner politiquement »
Un boulevard pour l’industrie ou une ville durable
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












