Derniers articles

Permis de travail fermés : invitation d’Amnistie internationale pour une action nationale le 22 septembre

La FTQ se prononce en faveur de l'abolition du permis de travail fermé qui a pour effet de provoquer une importante vulnérabilité pour les travailleurs et travailleuses migrantes. Tous les travailleurs et travailleuses doivent être égaux dans leurs droits ; il est inacceptable que les règles relatives au statut migratoire aient pour effet de créer deux classes de travailleurs.
Amnistie internationale a pris l'initiative de l'organisation, du 22 au 26 septembre prochain, d'une semaine d'action nationale portant sur l'élimination des permis fermés. La FTQ invite tous les travailleurs et travailleuses à se mobiliser et à participer aux actions prévues dans le cadre de cette semaine d'action.
Invitation d'Amnistie internationale
Chaque année, des milliers de personnes migrant-es viennent travailler au Canada, dans les champs, les foyers ou les services essentiels. Chaque année, trop de ces travailleuses et travailleurs sont abusé-es, précarisé-es et invisibilisé-es.
C'est inacceptable et c'est injuste.
C'est un système d'exploitation qui relève des permis de travail fermés qui les piègent dans des situations abusives.
Le 22 septembre : agissons à Ottawa
Nous serons à Ottawa pour une action nationale devant le Parlement – joignez-vous à nous pour exiger la fin des permis de travail fermés.
Lorsque des leaders politiques blâment ces travailleur-euses à tort pour des choses qui ne sont pas de leur ressort, nous devons agir pour les droits de ces personnes, essentielles dans nos collectivités
C'est le moment de faire pression sur le gouvernement, de rendre visible l'injustice et de montrer que nous ne resterons pas silencieux.
Vous ne pouvez pas être à Ottawa ? Vous pouvez quand même faire une différence :
Interpellez votre député dès aujourd'hui.
Partagez votre solidarité sur les réseaux sociaux.
Découvrez le documentaire Mon ami Omar, afin de mieux comprendre la réalité des travailleuses et travailleurs migrant·e·s au Canada.
Retrouvez toutes les idées et un guide pratique ici : Comment Agir.
Notre message est clair :
Les travailleuses et travailleurs migrant·e·s ont des droits. Le 22 septembre à Ottawa, et partout au Canada, mobilisons-nous pour la justice et la dignité !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclenchement de la grève des 2400 employé-es d’entretien de la STM

Les 2400 employé-es d'entretien ont déclenché la grève pour que la STM abandonne sa position inflexible à la table de négociation. Après plus d'un an de négociation et plus de 100 séances de pourparlers, le Syndicat du transport de Montréal–CSN souhaite obtenir une entente le plus rapidement possible.
L'annonce de la grève le 5 septembre dernier et l'ouverture que le syndicat a montrée à la table de négociation n'ont pas suffi à convaincre la STM de faire le nécessaire pour éviter le conflit et convenir d'une entente. La STM se borne à attaquer les conditions de travail de ses salarié-es au moment où leurs efforts sont plus nécessaires que jamais pour entretenir les métros et les autobus. Alors que des ententes interviennent dans les sociétés de transport un peu partout au Québec, la STM ne fait aucun effort pour faire avancer la négociation. Elle continue de réclamer le recours à la sous-traitance pour tout et rien et revendique plus de contrôle sur le travail des salarié-es par les gestionnaires. Et pour couronner le tout, la STM continue d'offrir des augmentations salariales sous l'inflation, ce qui aurait pour effet d'abaisser le pouvoir d'achat des employé-es d'entretien.
La grève d'une durée de quatorze jours engendrera des arrêts de services en dehors des heures de pointe les lundis, mercredis et vendredis. À cela s'ajoute une grève des heures supplémentaires sur l'ensemble de la séquence, laquelle affectera de manière importante l'administration de la STM, sans toucher directement les services à la population. Rappelons que le syndicat a convenu d'une entente avec la STM sur les services essentiels à maintenir durant la grève et que cette entente a été validée par le Tribunal administratif du travail. Les travailleurs et les travailleuses manifesteront ce soir dès 19 h 30 devant l'hôtel de ville pour faire entendre leurs revendications en marge de la séance du conseil municipal.
« Si on déclenche la grève aujourd'hui, c'est parce que c'est le seul moyen de faire entendre raison à la STM. Après plus de 100 rencontres de négociation, la société de transport veut mettre la hache dans nos conditions sans rien offrir pour attirer et retenir le personnel. Doit-on rappeler à la STM que près de la moitié des stations de métro sont vétustes ? Pour avoir des métros et des autobus sécuritaires et bien entretenus, on doit miser sur les employé-es d'entretien, pas ouvrir la porte à une sous-traitance qui va nous coûter une fortune pour un travail de moindre qualité », lance le président du Syndicat du transport de Montréal–CSN, Bruno Jeannotte.
« Dans les derniers jours, la STM semblait pas mal plus occupée à communiquer les horaires de la grève qu'à tout faire pour l'éviter. Le syndicat a donné tout le temps nécessaire à la société de transport pour trouver une entente. Comment ça se fait qu'il y a des ententes dans les autres sociétés de transport et rien à Montréal ? Tôt ou tard, il va falloir que la STM se mette en mode règlement et qu'elle montre enfin de l'ouverture à la table de négociation », explique la première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), Stéphanie Gratton.
« Les 2400 employé-es d'entretien de la STM débutent aujourd'hui une deuxième séquence de grève. Ils seront visibles pendant les deux semaines de la grève pour défendre le transport collectif public. Si on veut améliorer les services à la population, on doit nécessairement offrir de bonnes conditions aux travailleurs et aux travailleuses », poursuit le président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN), Bertrand Guibord.
« Plutôt que de dénoncer le gouvernement qui la sous-finance, la STM veut refiler la facture à ses salarié-es. Ce que les usagères et les usagers veulent, c'est un transport collectif public efficace et abordable. Ce n'est pas en attaquant les conditions de travail des employé-es d'entretien qu'on va y arriver. Et que fait le gouvernement pour aider les parties à trouver une entente satisfaisante ? On croirait qu'il laisse perdurer les choses. Le ministre Boulet et le ministre Julien peuvent dès maintenant s'impliquer pour que cette négociation mène à une bonne entente », de conclure la présidente de la CSN, Caroline Senneville.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vous avez dit humilité et écoute ?

Cette lettre signée par Julie Bouchard présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est adressée au premier ministre François Legault. Le 11 août dernier, après la défaite de votre parti dans Arthabaska, vous avez déclaré : « Je pense que c'est le temps pour moi d'abord de faire preuve d'humilité et d'écouter les citoyens. »
À l'aube de la rentrée parlementaire, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ vous rappelle vos propres paroles. Il est temps de les mettre en pratique, dès maintenant, en écoutant celles qui empêchent le réseau public de la santé de s'effondrer.
Depuis des mois, nos membres subissent les contrecoups de décisions et d'inactions gouvernementales qui mettent leur patience à rude épreuve.
Neuf mois après la signature de la convention collective, elles attendent encore des sommes qui leur sont dues. Le fameux processus unique de reconnaissance de l'ancienneté (PURA), censé reconnaître leur parcours et leur fidélité au réseau, a été retardé pour cause de mauvaise préparation. Derrière ces délais administratifs, il y a des femmes privées de reconnaissance et de revenus légitimes.
À cela s'ajoute le fiasco du système informatique SIFARH qui a englouti des centaines de millions pour… ne même pas verser correctement les primes prévues au nouveau contrat de travail. Pendant que vos budgets explosent, nos membres, elles, attendent leur dû.
Soins et services déficients
Les exemples où les soins et les services à la population sont déficients s'accumulent également. Le plus éloquent en liste ? Celui de Rouyn-Noranda.
Depuis l'incendie, il n'y a plus de salle d'opération fonctionnelle. Des dizaines de femmes ont dû accoucher à plus de 100 km de chez elles, plongées dans l'angoisse et l'incertitude. Chaque mois de retard ajoute un risque inacceptable. Rouyn-Noranda ne peut plus attendre — et vous non plus.
Le réseau de la santé est à un point de rupture et ce sont les patient-e-s qui écopent.
Alors que les médecins spécialistes et omnipraticiens ont commencé leurs moyens de pression, le réseau de la santé fait du surplace.
Votre gouvernement a une obligation de résultat et ce n'est pas en maintenant la ligne dure avec les médecins que ces négociations vont se conclure.
Plus que jamais, le réseau de la santé a besoin de tout le monde, y compris des médecins ! Et eux aussi ont le droit d'être écoutés. Pour le reste, c'est à la table de négociation que cela doit se passer.
Par ailleurs, l'absence d'ententes avec les fédérations de médecins entraîne des conséquences sur le déploiement de la convention collective des professionnelles en soins. En guise de rappel, une enveloppe de 60 millions de dollars destinée au rattrapage des chirurgies dort actuellement faute de vous entendre avec les médecins.
Enfin, écoutez celles que vous avez exclues des consultations sur le projet de loi 101. Écarter la FIQ, qui représente près de 90 000 professionnelles en soins, c'est museler celles qui vivent chaque jour les conséquences de vos décisions. C'est un mépris pour les femmes et pour la démocratie syndicale.
Et maintenant, voilà que votre gouvernement veut ouvrir un nouveau front contre les syndicats. Ce n'est pas de transparence dont il est question, mais bien de réduire la capacité des organisations à défendre leurs membres. Vous parlez d'écoute, mais vous cherchez en réalité à faire taire les voix syndicales, celles qui portent la voix des travailleuses et des travailleurs.
La rentrée parlementaire est l'occasion de démontrer que vos paroles ne sont pas vides. Écouter, c'est respecter les conventions signées. Écouter, c'est investir dans la relève. Écouter, c'est protéger les travailleuses de la santé. Écouter, c'est prioriser le public, pas le privé.
Alors, monsieur le premier ministre, allez-vous continuer à détourner le regard, ou aurez-vous enfin le courage d'agir ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réunion entre le STTP et le ministre responsable de Postes Canada

Aujourd'hui, 19 septembre 2025, l'équipe de négociation et des membres du Conseil exécutif national du STTP ont tenu une réunion d'une demi-heure avec Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Le ministre a finalement convoqué une réunion hier afin d'entendre le point de vue du Syndicat sur l'actuelle ronde de négociation et l'avenir du service postal public.
Nous avons expliqué au ministre la nécessité de conclure des conventions collectives que les membres voudront ratifier avant la période de pointe de fin d'année. Nous lui avons fait remarquer que, depuis qu'elle a perdu le vote imposé, Postes Canada ne ressent plus aucune urgence d'agir, choisissant plutôt de laisser tomber les négociations, les travailleurs et travailleuses des postes et la population. Nous ignorons pourquoi il faut une semaine de plus à Postes Canada pour préparer ses nouvelles offres globales.
Nous avons souligné quelques-unes des revendications majeures qui doivent absolument figurer dans les prochaines conventions collectives : salaires adéquats, meilleures conditions de travail, emplois à plein temps, effectifs en nombre suffisant, équilibre entre travail et vie personnelle et égalité pour les FFRS.
Nous avons présenté au ministre quelques-unes de nos idées pour redessiner l'avenir du service postal public grâce à l'ajout de services lucratifs susceptibles de procurer de réels avantages aux collectivités du pays, petites et grandes. Le ministre s'est abstenu de formuler tout commentaire sur nos propositions.
Nous avons insisté sur le fait que nous sommes fiers du travail que nous accomplissons, mais que nous sommes préoccupés par l'avenue que la direction de Postes Canada veut faire emprunter à cette importante institution publique.
Nous avons quitté cette première réunion avec le ministre Lightbound sur une note d'incertitude quant à la direction qu'il donnera à Postes Canada, et ce, malgré le fait que les deux parties comprennent bien l'importance du service postal public. Nous avons aussi convenu qu'il importe de maintenir les canaux de communication ouverts entre nous.
Le Syndicat attend le retour de Postes Canada à la table de négociation dans les plus brefs délais.
Pour recevoir par courriel les dernières nouvelles du Syndicat, abonnez-vous à Somm@ire : www.sttp.ca/fr/sommaire-sttp.
Solidarité,
Jan Simpson
Présidente nationale
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le silence comme faillite morale !

Le silence des artistes et des intellectuels québécois face au génocide à Gaza n'est pas un détail, ni un fait conjoncturel : il est le symptôme d'une faillite morale profonde.
Photo Serge D'Ignazio
Jadis, ces voix dénonçaient l'injustice, rompaient avec la complaisance des puissants et se tenaient aux côtés des opprimés. Des figures comme Pierre Falardeau ou Michel Chartrand manifestaient régulièrement, haut et fort, leurs indignations et leurs colères. "Vive la Palestine Libre" criaint-ils sans honte ni peur !
Pendant trente-cinq ans, j'ai reçu des artistes en prison, dans le cadre de mon programme radiophonique Souverains anonymes, pour soutenir les personnes incarcérées dans leurs efforts de réhabilitation. Mais depuis une vingtaine d'années, les vedettes se faisaient de plus en plus rares, ou hésitaient à adhérer à cette cause pourtant noble. Seuls quelques rares courageux (et une courageuse Michaëlle Jean) acceptaient de franchir les murs de la prison.
Aujourd'hui, le mutisme des artistes face à Gaza sidère. Non pas qu'ils ignorent ce qui s'y passe, mais parce qu'ils préfèrent ne pas le dire. « Ce n'est pas clair, ce qui se passe là-bas », m'a confié un artiste dont je tairai le nom. Ce refus d'assumer la parole publique, sous de faux prétextes, s'inscrit dans ce que la philosophe Cynthia Fleury a nommé La fin du courage : un monde où l'on se protège davantage qu'on ne protège les autres.
Le courage politique ne naît pas de calculs stratégiques ni de compromis prudents : il plonge ses racines dans le courage moral, celui qui pousse à dire « non » quand tout incite au silence. Or, lorsque les intellectuels renoncent à cette exigence éthique, ils abandonnent la possibilité d'une action politique véritable. Leurs prises de parole, quand elles existent, se réduisent à des gestes cosmétiques, calibrés pour ne froisser personne, et donc incapables de transformer le réel.
Certes, il faut reconnaître la force de la peur : peur d'être ostracisé, réduit au silence médiatique, de perdre financements, postes ou reconnaissance. Mais n'est-ce pas précisément dans la confrontation à ces risques que se mesure le courage ? Celui qui se tait pour protéger sa carrière choisit son confort au détriment de la dignité d'autrui. Son silence devient alors une complicité tacite avec la violence.
En se taisant, les intellectuels ne se contentent pas de faillir à leur mission critique : ils appauvrissent le débat public et fragilisent la démocratie elle-même. Car une démocratie sans voix dissidentes est une démocratie morte. Les minorités persécutées, les peuples massacrés, ne trouvent plus de relais dans l'espace symbolique. L'histoire nous apprend que les régimes autoritaires commencent toujours par réduire la parole libre, mais que parfois, c'est la société elle-même qui s'impose une autocensure, par confort ou par peur.
Il est relativement aisé pour un artiste de se faire le porte-parole d'une cause consensuelle : la prévention du suicide, la défense des sans-abris, les femmes victimes de violence, la protection des rivières menacées, etc. Ces engagements, tout à fait louables, rejaillissent positivement sur l'image publique de l'artiste et renforcent son prestige. En retour, la cause bénéficie d'une visibilité accrue auprès du grand public. Mais il ne faut pas se méprendre : dans bien des cas, il n'y a pas là de véritable courage, mais un simple échange, presque une transaction symbolique. C'est du donnant-donnant, une forme de « business » moral.
En revanche, lorsqu'un artiste choisit d'appuyer une cause controversée, comme celle du peuple palestinien, il sort du confort des consensus et s'expose à des représailles concrètes. Des figures comme Roger Waters, cofondateur de Pink Floyd, ont accepté de prendre ces risques, sacrifiant parfois leur réputation dans certains milieux, leur carrière, voire leurs sources de revenus, au nom d'une fidélité à la justice. Lorsque Julien Poulin brandit le drapeau du Hezbollah pour manifester son appui aux Libanais victimes des attaques d'Israël en 2006, il fut sermonné publiquement à l'émission Tout le monde en parle. L'impression retenue de son passage devant deux millions de téléspectateurs fut celle d'un artiste engagé contraint de faire son mea culpa pour avoir soutenu un peuple agressé ! Disons que ce n'est pas le genre d'événement qui incite au courage…
À cette lumière, la situation d'organismes comme Artistes pour la Paix, fondé au Québec il y a quarante-trois ans, est révélatrice. Apprendre que cette association est aujourd'hui menacée de disparaître, faute d'attention médiatique, en dit long sur le climat ambiant. Car si le courage moral se fait rare chez les artistes eux-mêmes, il se fait tout aussi rare dans les sphères médiatiques qui façonnent leur visibilité. Les médias, en privilégiant les causes neutres et « rentables » en termes d'audience, condamnent des voix réellement critiques à la marginalité, voire à l'invisibilité. Ainsi, ce n'est pas seulement le monde artistique qui faillit, mais tout un système de communication qui hiérarchise les luttes selon leur degré de commodité et qui décide silencieusement de ce qui mérite d'exister dans l'espace public. Quel artiste-vedette québécois oserait embarquer avec sa guitare sur l'un de ces 44 bateaux, aux côtés des 500 volontaires qui tentent d'apporter une aide à un peuple affamé, alors qu'aucun grand média n'en parle ?
Le silence n'est pas une simple absence de mots : il est une abdication, une désertion. Le courage moral, loin d'être un héroïsme surhumain, est au contraire la fidélité à une exigence minimale : témoigner de l'injustice, refuser de détourner les yeux. Sans ce socle, le courage politique devient impossible. En renonçant à parler, les artistes et intellectuels ne perdent pas seulement leur honneur : ils laissent s'installer l'idée qu'il est possible de tuer sans que personne ne dise « non ».
Quel mot pour qualifier cette abdication muette face à l'injustice ?
Je vous laisse deviner.
Mohamed Lotfi
15 septembre 2025
PS : "Je n'ai jamais voyagé vers d'autres pays que toi mon pays" le grand Gaston Miron n'avait pas peur d'afficher toute sa solidarité avec la cause palestinienne. Devant mon micro, j'ai capté sa voix et un de ses plus beaux poèmes sur les images de solidarité avec Gaza en 2014 : https://youtu.be/U1hJneoPTK8?si=lWOL5gUeusZ3VBLF
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Héritage du dodo

L'Héritage du dodo, c'est une bande dessinée en ligne. L'Héritage du dodo, c'est une bande dessinée en ligne sur la crise du climat et de la biodiversité. En 10 épisodes, on explore la santé des écosystèmes, on parle du réchauffement climatique, de déforestation, de pollution, de surexploitation…
Tiré de L'Info lettre de l'R des Centres de femmes
On découvre à quel point nous sommes dépendant·es de la biodiversité. On décortique les raisons qui nous empêchent d'agir en faveur de l'environnement. On décrypte les stratégies de désinformation et de manipulation mises au point par les industriels et les climatosceptiques. Le tout avec humour et légèreté, mais sans culpabilisation, ni naïveté.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le livre d’anniversaire offert à Epstein vous choque-t-il ? Cette culture était omniprésente avant le féminisme contemporain.

Le féminisme a mis en lumière l'omniprésence de la molestation sexuelle d'enfants, des viols, celle du harcèlement sexuel et de la violence conjugale, et a contribué à la lutte contre cette culture.
Rebecca Solnit, le 13 septembre, dans The Guardian
*-*
J'y étais. J'en ai conservé les preuves. Je me souviens d'à quel point l'exploitation sexuelle des adolescentes et même des préadolescentes par des hommes adultes était traitée comme la norme au cours des années 70, comment elle figurait dans les films, dans les récits sur les rock stars et les « baby groupies », dans la contre-culture et la culture dominante, bref à quel point le viol, l'exploitation, le grooming, l'objectivation et la marchandisation étaient normalisés.
Le dernier film de Woody Allen que j'ai vu était Manhattan, dans lequel il jouait plus ou moins son propre rôle, celui d'un quadragénaire ringard qui sortait avec une lycéenne incarnée par Mariel Hemingway. Elle avait mon âge, 17 ans, et je ne connaissais que trop bien ce genre de types répugnants. Le film m'a donné la chair de poule, même si ce n'est que bien plus tard que j'ai lu qu'elle avait déclaré qu'il avait fait pressionsur elle pour qu'elle ait des relations sexuelles avec lui dans la vie réelle.
Manhattan est sorti en 1979 ; deux ans plus tôt, Roman Polanski, sous prétexte de prendre des photos pour l'édition française du magazine Vogue, avait convaincu une jeune fille de 13 ans de venir seule dans une maison, où il l'avait droguée et violée vaginalement et analement. L'agent de probation qui lui a été assigné a écrit : « Certains éléments indiquaient que les circonstances étaient provocantes, que la mère faisait preuve d'une certaine permissivité » et « que la victime était non seulement physiquement mature, mais consentante ». Selon son propre compte-rendu, cette jeune fille avait dit non à plusieurs reprises et avait même feint une crise d'asthme pour essayer de dissuader Polanski, mais l'agent de probation était de son époque et trop disposé à blâmer une enfant droguée. C'était normal à l'époque.
Les films des années 1970 ont normalisé tout cela. Jodie Foster avait 12 ans lorsqu'elle a joué le rôle d'une prostituée dans Taxi Driver. Dans Pretty Baby, Brooke Shields, âgée de 11 ans, jouait une autre prostituée dans la pittoresque Nouvelle-Orléans, dont la virginité était vendue aux enchères et qui apparaissait nue dans certaines scènes, comme elle l'avait fait dans un numéro spécial « sugar and spice » du magazine Playboy à l'âge de 10 ans. Dans Taking Off, le film de Milos Forman sorti en 1971, la fille de 15 ans du protagoniste, qui s'était enfuie, réapparaît avec un petit ami rock star. La culture des groupies comprenait plus d'une poignée d'enfants couchant avec des rock stars ; le magazine Interview raconte qu'une groupie célèbre « a perdu sa virginité à l'âge de 12 ans avec le guitariste de Spirit, Randy California. Pendant un certain temps, elle a eu une relation avec Iggy Pop, qui a glorifié leur relation dans sa chanson Look Away de 1996, écrivant : « J'ai couché avec Sable quand elle avait 13 ans / Ses parents étaient trop riches pour faire quoi que ce soit. »
C'est dans les années 70 que les photographies en couleurs et floues de David Hamilton représentant des adolescentes nues ou à moitié nues ont été normalisées sous forme de livres de salon et d'affiches. Dans les années 90, les photographies en noir et blanc de Jock Sturges représentant des adolescentes blanches minces photographiées dans une colonie nudiste ont suscité la controverse. Alors qu'il les défendait avec des notions fades d'art haut de gamme et de vie édénique sans honte, une de ses anciennes élèves a réalisé un film semi-documentaire sur la relation sexuelle qu'elle avait eue avec lui lorsqu'elle avait 14 ans et qu'il était son professeur d'art, dans les années 70.
Plus tard, lorsque Brooke Shields a tenté d'empêcher la diffusion des photos d'elle nue à l'âge de 10 ans prises par Gary Gross,comme l'a rapporté le Guardian en 2009, « les avocats de Gross ont fait valoir que ses photographies ne pouvaient pas nuire davantage à la réputation de Shields car, depuis qu'elles avaient été prises, elle avait mené une carrière lucrative « en tant que jeune vamp et prostituée, vétérane sexuelle chevronnée, enfant-femme provocante, sex-symbol érotique et sensuel, la Lolita de sa génération ». Le juge a donné raison à Gross et, tout en louant le « charme sensuel et sulfureux » des photos, a jugé que Gross n'était pas un pornographe : « Elles n'ont aucun attrait érotique, sauf peut-être pour des esprits pervers. »
C'était aussi comme ça dans les années 1980. À l'âge adulte, Molly Ringwald a écrit à propos des films pour adolescents de John Hughes dans lesquels elle jouait à l'époque : « Je suis un peu gênée de dire qu'il m'a fallu encore plus de temps pour comprendre pleinement la scène à la fin de Sixteen Candles, lorsque Jake, le garçon de rêve, prête en quelque sorte sa petite amie ivre, Caroline, au Geek, afin de satisfaire les pulsions sexuelles de ce dernier, en échange des sous-vêtements de Samantha. Le Geek prend des photos Polaroid avec Caroline pour avoir une preuve de sa conquête ; quand elle se réveille le matin avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, il lui demande si elle « a apprécié ». Le fait qu'il s'agissait d'un viol n'était pas clair pour Ringwald, comme elle le dit, ni pour le public. En 1984, Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones alors âgé de 47 ans, a commencé une relation avec une enfant qu'il avait rencontrée, affirmant qu'« elle était une femme à treize ans ». Bien plus tard dans sa vie, cette femme a milité pour que l'âge du consentement sexuel soit relevé de 16 à 18 ans en Grande-Bretagne, déclarant : « À 16 ans, on est encore un enfant. »
Avant ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, la pudibonderie et les convenances considéraient les filles et les jeunes femmes comme la propriété de leurs pères et de leurs futurs maris, et ne pas souiller la pureté qui faisait partie de leur valeur était au moins une raison de dire non. La révolution sexuelle a supprimé cette barrière et, lorsque j'étais adolescente dans les années 1970, l'idée générale était que le sexe était une bonne chose et que tout le monde devait en profiter. J'ai donc commencé à être draguée par des garçons issus de la contre-culture lorsque j'avais 12 ou 13 ans, tout comme mes camarades féminines. Tout signifiait oui, rien ne signifiait non, presque personne n'aidait les filles qui voulaient éviter ces garçons ; nous étions livrées à nous-mêmes et devions devenir des artistes de l'évasion. Dans l'école alternative où je suis allée au milieu des années 1970, dans une banlieue agréable, des filles de 13 ans sortaient avec des dealers de drogue adultes, une fille de 14 ans exhibait la bague de son fiancé d'âge mûr, et une fille de 15 ans est tombée enceinte d'un marin d'une base voisine et a décidé de garder le bébé. Aucun adulte ne semblait s'en préoccuper.
C'était encore une culture misogyne ; le sexe était encore largement considéré en fonction des besoins des hommes. Un autre aspect frappant de la culture des années 1970 était l'éthique sexuelle des terroristes de la contre-culture qui ont kidnappé Patti Hearst en 1974 : c'était être une bonne « camarade » de répondre aux besoins des autres, et les femmes de la Symbionese Liberation Army devaient donc toujours dire oui aux hommes, pour répondre aux besoins de ces derniers, sans se soucier des leurs. Voilà pour la libération.
Fondée en 1978, la NAMBLA (North American Man-Boy Love Association) était une organisation d'hommes adultes qui militaient activement pour la légalisation des relations sexuelles avec des enfants de sexe masculin, et qui n'a été que très progressivement poussée dans la clandestinité. Les hommes hétérosexuels n'avaient pas besoin d'une organisation spéciale pour défendre leurs intérêts ; c'était toute la culture qui le faisait. C'était la philosophie Playboy, c'était Hollywood et le rock'n'roll, c'était l'art kitsch comme celui de David Hamilton, c'était les ricanements et les excuses.
J'écris tout cela parce que l'album anniversaire de Jeffrey Epstein, qui vient d'être révélé en 2003, est un vestige tardif de cette culture, tout comme l'attitude de Donald Trump envers les femmes. Trump était souvent vu aux événements organisés par Epstein, où se pressaient de très jeunes mannequins, à une époque où les mannequins étaient envoyées pour se mêler à des hommes fortunés.
Deux pages de cet album sont particulièrement frappantes. L'une d'elles montre une photo de trois personnes tenant un chèque géant à l'ordre d'Epstein, avec la signature de Trump (probablement fausse), décrivant la vente par Epstein d'une femme « entièrement dépréciée », dont le nom a été caviardé, à Trump pour 22 500 dollars. « Dépréciée » est un terme immobilier ; la blague semble être qu'une femme a en quelque sorte perdu une partie de sa valeur, mais qu'elle reste vendable comme un bien immobilier, du bétail, un bien mobilier ou tout autre terme utilisé pour désigner des êtres humains considérés comme des biens.
Dans l'autre, un dessin d'Epstein en 1983 approchant des fillettes avec des ballons et des bonbons le reconnaît clairement comme un pédophile ; l'autre moitié des photos le montre en 2003 dans un fauteuil inclinable, entouré de quatre jeunes femmes ou filles, dont deux en string, l'une avec les initiales d'Epstein tatouées sur la fesse. Il est clair que celui qui a ajouté ces pages suggestives à l'album d'Epstein connaissait son appétit sexuel pour les jeunes filles, tout comme beaucoup d'autres personnes.
Ce qui s'est passé entre les années 1970 que j'ai décrites et le présent, c'est le féminisme : un féminisme qui a insisté sur le fait que les femmes étaient des personnes dotées de droits, que le sexe, à la différence du viol, devait être quelque chose que les deux parties désiraient, que le consentement devait être actif et conscient, que toutes les interactions humaines impliquaient un rapport de force et que l'énorme différence de pouvoir entre les hommes adultes et les enfants rendait un tel consentement impossible.
C'est le féminisme qui a révélé l'omniprésence de la molestation sexuelle d'enfants, des viols, du harcèlement sexuel et de la violence conjugale, qui a dénormalisé ces agressions qui faisaient partie intégrante de la société patriarcale. Et qui le sont encore, bien trop, mais l'attitude dédaigneuse et permissive du passé appartient désormais au passé, du moins dans la culture dominante.
Rebecca Solnit dans The Guardian, le 13 septembre
Rebecca Solnit est chroniqueuse pour l'édition étasunienne du Guardian. Elle est l'autrice de Orwell's Roses et coéditrice, avec Thelma Young Lutunatabua, d'une anthologie sur le climat.
Plusieurs de ses livres onbt été traduits en français :
Unparadis en enfer, Éditions de l'Olivier, 2023.
Souvenirs de mon inexistence, Éditions de l'Olivier, 2022.
Cendrillon libératrice,Les Arènes, 2020.
La mère de toutes les questions, Éditions de l'Olivier, 2019.
Ces hommes qui m'expliquent la vie, Éditions de l'Olivier, 2018.
Garder l'espoir. Autres histoires, autres possibles, Actes Sud, 2006.
L'art de marcher, Actes Sud, 2002.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/13/epstein-birthday-book-feminism-culture
Traduction : TRADFEM
https://tradfem.wordpress.com/2025/09/15/le-livre-danniversaire-offert-a-epstein-vous-choque-t-il-cette-culture-etait-omnipresente-avant-le-feminisme-contemporain/
Note de lecture : La mère de toutes les questions, sous le titre : Un océan d'histoires brise le silence et conteste l'impunité
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2020/09/08/un-ocean-dhistoires-brise-le-silence-et-conteste-limpunite/
Note de lecture : Ces hommes qui m'expliquent la vie, sous le titre : Ce qu'on ne dit pas quand on ne parle pas de genre
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2019/11/20/ce-quon-ne-dit-pas-quand-on-ne-parle-pas-de-genre/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce que le féminisme marxiste ? D’un point de vue marxiste-féministe : essais sur la liberté, la rationalité et la nature humaine

Nancy Holmstrom est professeure émérite de philosophie à l'université Rutgers. Elle incarne un mélange unique de rigueur philosophique et d'activisme ancré dans une préoccupation sincère pour les femmes et les personnes LGBTQ qui souffrent des maux du capitalisme, du racisme, du patriarcat et de l'homophobie dans les pays du Nord et du Sud.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Nancy Holmstrom
Brill, 2024 ; Haymarket, 2025
Dans ce recueil d'essais, elle présente ses principales contributions à la théorie féministe au cours de sa vie. Alors que The Socialist Feminist Project (2002), un recueil d'essais qu'elle a édité, avait une portée plus large, cet ouvrage identifie ce qui, selon elle, distingue le féminisme marxiste du féminisme socialiste. Elle définit le féminisme marxiste, la perspective à laquelle elle s'identifie, comme la centralité du mode de production : « L'idée que le mode de production capitaliste fixe les conditions, si vous voulez, des degrés de liberté et de non-liberté, là encore d'une manière historiquement particulière qui diffère des autres modes de production. » Le mode de production capitaliste est considéré comme « fondamental mais non déterminant » (3).
Cette opinion peut être mieux comprise en explorant l'articulation par Holmstrom du concept marxiste de la nature humaine. Elle est également particulièrement pertinente dans le cadre des débats actuels sur la théorie et l'identité queer, qui remettent en question une conception essentialiste et immuable de la nature humaine.
Dans son essai « A Marxist Theory of Women's Nature » (Une théorie marxiste de la nature des femmes), Holmstrom soutient que, selon la philosophie de Karl Marx, les besoins et les capacités humains s'expriment, se façonnent et se créent à travers le travail (une activité visant à satisfaire des besoins). C'est donc le travail, et non le déterminisme biologique, qui est la clé pour expliquer la vie sociale et le changement social. Elle démontre que pour Marx, les différences biologiques entre les hommes et les femmes ne peuvent expliquer ou justifier aucune discussion sur des natures distinctes, car son effort vise à examiner la nature des personnes en tant que groupes sociaux et non en tant que groupes biologiques. Ainsi, « Marx nie l'existence d'une nature humaine au sens traditionnel et transhistorique. Selon lui, il existe cependant des formes historiquement spécifiques de nature humaine… propres au féodalisme, au capitalisme, au socialisme, etc. » (232).
De plus, Holmstrom ajoute que la nature humaine, et même la nature biologique, peuvent changer sous l'influence de facteurs socio-historiques et de l'évolution. Elle affirme ainsi que « selon Marx, l'opposition entre le social et le naturel et immuable est particulièrement inappropriée pour les êtres humains, car ceux-ci sont par nature des êtres sociaux dotés d'une histoire » (233). Si les différences biologiques ne peuvent être ignorées, ce sont les facteurs sociaux, et non les facteurs biologiques, qui sont les principaux déterminants. Par conséquent, d'un point de vue marxiste, les différences psychologiques entre les femmes et les hommes seraient liées au type de travail qu'ils effectuent et aux relations sociales qui en découlent. « Le point de vue marxiste n'est pas qu'il existe un lien de causalité direct entre le type de travail effectué par les individus et leur structure de personnalité. Au contraire, le type de travail effectué par les individus les place dans certaines relations sociales et ces relations sont institutionnalisées dans des ensembles de pratiques, d'institutions, d'agences culturelles, etc. » (237).
Ce n'est pas principalement la biologie, mais surtout les conditions sociales, économiques et historiques oppressives qui déterminent la division sexuelle/sociale du travail. Ainsi, même les femmes qui ont des emplois non traditionnels et qui n'ont pas de famille à charge sont toujours influencées par les institutions patriarcales, sociales et culturelles dominantes.
Holmstrom souligne que si Marx n'avait pas une vision essentialiste de la nature humaine, il croyait néanmoins que les êtres humains ont un potentiel unique d'activité libre et consciente qui ne peut être pleinement développé que dans une société socialiste exempte de travail aliénant. Sur cette base, elle soutient que même s'il y aura toujours certaines différences dans la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent en tant qu'êtres physiques, la signification de ces expériences variera en fonction de l'évolution de la société. En outre, dans une société qui ne repose pas sur le travail aliéné, « les choix sexuels et reproductifs des femmes n'auraient pas les conséquences sociales profondes qu'ils ont actuellement pour les femmes par rapport aux hommes » (246).
La formulation par Holmstrom d'un concept non essentialiste de la nature humaine, expliqué plus en détail dans un essai intitulé « Humankind(s) », peut également éclairer ceux qui participent aux débats sur l'identité transgenre. Si elle n'est pas d'accord avec « les formulations de la distinction entre sexe et genre qui présentent le biologique comme un substrat sous-jacent intact par la société, et le genre comme une pure culture, superposée à une biologie inerte », elle n'est pas non plus d'accord avec le point de vue qui efface la distinction entre sexe et genre et affirme que le genre n'est qu'une performance (257). Elle nous aide à comprendre que, s'il existe certaines différences liées au sexe qui ne pourront jamais être éliminées, il n'existe pas de nature humaine essentielle ancrée dans la biologie. Les opinions actuelles bien ancrées sur la masculinité et la féminité sont plutôt profondément enracinées dans un ensemble de relations économiques, historiques et sociales propres à notre époque capitaliste.
Bien que les femmes et les personnes LGBTQ aient réalisé d'importants progrès dans diverses régions du monde, une grande partie de la population aux États-Unis et dans le monde continue de s'accrocher aux normes traditionnelles en matière de genre. Le fait que les dirigeants autoritaires et fascistes utilisent actuellement la transphobie comme l'un des éléments de leur stratégie pour obtenir le soutien des masses signifie que les opinions misogynes, patriarcales et homophobes sont encore très ancrées dans toutes les sociétés. Les travaux de Holmstrom montrent que le dépassement de ces opinions ne peut se faire par le simple biais d'un travail culturel et performatif, mais nécessite de profondes transformations économiques, sociales et politiques. À cet égard, elle partage certaines des opinions de Rosemary Hennessy (2000), une importante théoricienne queer.
Dans un essai intitulé « Sex, Work and Capitalism » (Sexe, travail et capitalisme), Holmstrom offre une perspective unique sur les débats féministes actuels concernant le travail du sexe. Parmi les féministes socialistes, il existe des divergences quant à la signification d'un mouvement queer et sex-positif qui s'oppose à toutes les formes d'exploitation sexuelle, à toutes les normes de genre oppressives et à toutes les formes d'instrumentalisation de nous-mêmes ou des autres (Goldberg, 2021 ; Srinivasan, 2021). Certaines prônent la légalisation et la normalisation totales du travail du sexe et affirment qu'il peut être « créatif » ou « satisfaisant » (Smith et Mac, 2020). D'autres, qui défendent également les droits des travailleuses du sexe et leurs efforts pour s'auto-organiser afin d'assurer leur sécurité, considèrent le travail du sexe comme une pratique de marchandisation et d'instrumentalisation du corps et des sentiments. Bien qu'eils soutiennent la dépénalisation des travailleurs du sexe, iels soulignent que le travail du sexe, en plus d'être exploiteur et abusif, cause de terribles dommages physiques et psychologiques à long terme à ceux qui l'exercent, qu'iles y soient contraint·es ou qu'iles le fassent « volontairement . Partisane de ce dernier point de vue, Holmstrom écrit : « La vente de services sexuels n'est donc pas comparable à la vente d'autres services. La vente d'expériences corporelles intimes est une forme d'aliénation ultime » (37).
Le défi pour les féministes socialistes consiste donc à trouver comment soutenir les femmes qui se prostituent sans renoncer à notre critique du travail et de l'institution de la prostitution. Mais le soutien aux femmes qui exercent cette activité doit toujours être associé à la lutte pour changer les conditions politico-économiques qui poussent tant de personnes à s'y adonner. Nous devons nous battre pour des emplois avec des salaires décents, des logements et des services de garde d'enfants abordables, des programmes de lutte contre la toxicomanie, une aide pour les problèmes d'immigration et tout ce dont les travailleuses du sexe disent avoir besoin (39).
Je partage ce point de vue et je dirais que plutôt que de concentrer nos efforts d'organisation sur la légalisation du travail du sexe, il serait préférable de contribuer à diffuser le message du mouvement #MeToo afin de remettre en question la normalisation des abus et des agressions sexuels dans tous les domaines de la vie (Boussedra, 2017 ; Mock, 2014). Les faits montrent que l'extension de la légalisation du travail du sexe aux proxénètes et aux clients facilite l'exploitation des femmes et des enfants et augmente le trafic sexuel (Harvard Law School, 2014). Ajouter le travail du sexe à la liste des emplois normaux du secteur des services signifie également que les femmes sans emploi qui reçoivent une aide de l'État ne pourraient pas refuser le travail du sexe comme emploi. La normalisation du travail du sexe signifie que de plus en plus de jeunes femmes, d'hommes et de personnes transgenres envisageraient le travail du sexe comme un emploi à temps plein ou à temps partiel pour gagner de l'argent.
Holmstrom a également contribué aux débats féministes sur la théorie de la reproduction sociale. Elle estime que si l'oppression des femmes n'a pas commencé avec le capitalisme, elle ne peut s'expliquer simplement par le travail domestique et reproductif. Elle soutient que le travail domestique peut être progressivement supprimé sous le capitalisme afin de faciliter davantage l'exploitation capitaliste du travail. Cependant, le travail aliéné capitaliste et sa séparation entre l'esprit et le corps affectent notre psychisme et réduisent notre liberté dans tous les domaines de la vie (281).
C'est son approche humaniste socialiste qui permet à Holmstrom d'apporter un éclairage profond sur les débats féministes socialistes actuels et d'exprimer une véritable solidarité avec les personnes opprimées. Contrairement aux penseurs post-structuralistes qui définissent la liberté comme la lutte pour le pouvoir et la domination, elle considère la liberté comme l'épanouissement humain ou la réalisation de soi, enracinés dans la solidarité et la rationalité. Son concept de rationalité ne concerne pas le calcul capitaliste et la maximisation de l'utilité. Il s'agit de coopération et de lutte collective enracinées dans le contrôle humain sur les moyens et le processus de notre travail. Ce travail est ce que Marx appelait le potentiel humain pour une activité libre et consciente, et non un travail mécanique et aveugle. Une activité libre et consciente concerne également la protection de la nature/de l'environnement et la création d'un avenir durable.
Frieda Afary
Publié à l'origine sur New Politics
https://socialistfeminism.org/book-review-what-is-marxist-feminism/
traduit par DE
Che cos'è il marxismo-femminismo ?
https://andream94.wordpress.com/2025/09/21/che-cose-il-marxismo-femminismo/
References
Butler, Judith. (2006 [1990]) Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity. New York : Routledge.
— (2011 [1993]) Bodies That Matter : On the Discursive Limits of Sex. New York : Routledge.
Boussedra, Saliha. (2017) “Marx and Prostitution.” Resources Prostitution. Feb. 13.
Goldberg, Michelle. (2021) “Sex-Positive Feminism Is Falling out of Fashion.” New York Times. Sept. 25.
Harvard Law School. (2014) “Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking ?” Harvard Law and International Development Society. June 12.
Hennessy, Rosemary. (2000) Profit and Pleasure : Sexual Identities in Late Capitalism. New York : Routledge
Mock, Janet. (2014) Redefining Realness : My Path to Womanhood, Identity, Love and So Much More. New York : Atria.
Smith, Molly, and Juno Mac. (2020) Revolting Prostitutes : The Fight for Sex Workers' Rights. London : Verso.
Srinivasa, Amia. (2021) The Right to Sex : Feminism in the Twenty-First Century. New York : Farrar, Strauss and Giroux.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 23 septembre 2025


Le cas Trump
Alain Roy
J'avais déjà lu « Les déclinistes » du même auteur. Qui est Donald Trump ? Que nous révèle sa jeunesse, son passé ? Incarne-t-il la réussite, comme il veut le laisser croire ? La franchise ? L'honnêteté ? Est-il cultivé, renseigné, à l'écoute des autres, de ses conseillers ? Est-il même sain d'esprit ? Ou dangereux ? En proie au chantage d'intérêts étrangers ? C'est à toutes ces questions qu'Alain Roy répond dans cet essai fouillé, dont les chapitres alternent entre les réponses à ces questions et la participation de l'auteur et de son ami photographe à un invraisemblable rallye pour Trump à Manchester. Un bouquin plus éclairant que je ne l'aurais cru et qui m'a donné le goût de lire l'ouvrage « Trop et jamais assez » de Mary Trump, la nièce de Donald Trump, auquel l'auteur fait souvent référence.
Extrait :
Puis une vidéo a défilé sur l'écran géant au-dessus de la grande scène. On y voyait la Terre depuis l'espace, puis l'image de Trump petit garçon, puis Trump adulte vaquant à ses tâches présidentielles. Le narrateur parlait d'une voix grave et solennelle, mais ce ton tranchait curieusement - ou comiquement plutôt - avec ce qu'il disait car il s'agissait de choses extravagantes. Les rédacteurs de cette narration avaient dû s'amuser beaucoup en produisant ce tissu d'absurdités : « Le 14 juin 1946, Dieu a regardé le paradis qu'il avait créé et il a dit : J'ai besoin de quelqu'un qui se lèvera avant l'aube, réparera ce pays, travaillera toute la journée, combattra les marxistes, prendra son repas, puis retournera au Bureau ovale jusqu'à minuit pour discuter avec des chefs d'État. Dieu nous a ainsi donné Trump ».

Gaza
Mazen Kerbaj
Traduit de l'anglais
L'artiste Mazen Kerbaj nous offre, dans ce superbe album, un dessin par jour sur la situation en Palestine depuis le début des bombardements du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahu sur la bande de Gaza. Il y témoigne en images et en mots de l'horreur de l'épuration ethnique en cours et y dénonce haut et fort l'indifférence et la terrible complicité des pays occidentaux. Un album extraordinaire, facile d'accès, qui nous sort de notre éventuelle indifférence et nous pousse à agir. À mettre entre toutes les mains !
Extrait :
Une mère avance dans les ruines de son quartier qui vient d'être bombardé, elle hurle inlassablement le nom de ses quatre enfants dans l'espoir d'en entendre un lui répondre sous les décombres.

« L'Enfant » est un roman engagé, en partie autobiographique, dans le plus pur style du roman réaliste de la fin du XIXe siècle. L'auteur y dresse un tableau saisissant de la société et de la triste condition des enfants de l'époque. C'est un roman révélateur que j'ai adoré.
Extrait :
La maison que nous habitons est dans une rue sale, pénible à gravir, du haut de laquelle on embrasse tout le pays, mais où les voitures ne passent pas. Il n'y a que les charrettes de bois qui y arrivent, traînées par des bœufs qu'on pique avec un aiguillon. Ils vont, le cou tendu, le pied glissant ; leur langue pend et leur peau fume. Je m'arrête toujours à les voir, quand ils portent des fagots et de la farine chez le boulanger qui est à mi-côte ; je regarde en même temps les mitrons tout blancs et le grand four tout rouge, — on enfourne avec de grandes pelles, et ça sent la croûte et la braise !

L'odyssée des illusions
Jean Lemire
C'est à la suite d'une chronique de Josée Blanchette dans Le Devoir que j'ai entrepris la lecture de ce livre superbement illustré sur l'état de la planète et de la vie animale. Le biologiste, cinéaste et photographe Jean Lemire s'était lancé il y 25 ans le défi de sensibiliser les gens à la beauté et à la fragilité de la planète. À bord du voilier SEDNA IV, il aura sillonné les mers du monde et ainsi constaté les défis environnementaux presque insurmontables qu'entraînent d'une part le réchauffement climatique et d'autre part, de façon plus générale, le capitalisme de marché. Un très beau livre, triste parfois, mais plein de compassion pour les animaux et pour les humains les plus pauvres. Je ne saurais trop vous en recommander la lecture.
Extrait :
Non, si tout cela était à refaire, je ne serais pas le porteur d'espoir créé par des médias en recherche de modèles qui doivent impérativement être plus grands que nature. À force de départs et d'escales, devant le constat implacable d'un environnement sacrifié au nom de la croissance économique, j'ai réussi à transformer le rêve en illusion, triste bilan pour celui qui ambitionnait de sensibiliser le monde jusqu'à engendrer le changement. Au fil des jours, des mois, des années, l'indifférence de l'humanité s'est faufilée dans les entrailles intérieures pour rejoindre mon âme en peine, et le grand pèlerinage des espoirs s'est transformé en odyssée des illusions. Si la perte de racines fragilise l'être devant la tempête, la capitulation de ses propres rêves souffle la lueur qui enflammait pourtant toutes les passions.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
De la montée de l’extrême droite et sa menace
Les partisans de Charlie Kirk ne cessent d'en appeler à la liberté d'expression alors qu'ils tentent de faire taire les opposants à ses discours haineux du style que Trump a malheureusement rendu familiers. Ce double discours favorise la montée de l'extrême droite alors que l'on connait depuis le XX ième siècle les torts que celle-ci a causé à l'humanité par la manifestation de l'intolérance.
Je ne suis pas moi-même très tolérant face aux transnationales et à la facilité avec laquelle elles influent sur les gouvernements. C'est ma liberté d'expression qui est en jeu et j'ai, dans ce cas le droit inaliénable de m'exprimer, compte tenu de l'expérience historique du lien qu'ont entretenu les grands patrons allemands avec l'extrême droite lors de l'ascension de Hitler au pouvoir. On peut s'insurger justement contre le lobbyisme comme un dévoiement des institutions démocratiques.
C'est dans ce contexte que j'exhorte les partisans de Charlie Kirk a plus de modestie face à l'histoire de leur mouvement et à considérer l'opposition à ses discours comme une sinécure pour la société démocratique qui leur permet d'exprimer leurs paroles nauséabondes en toute impunité. Car les discours haineux comme ceux d'un Trump envers les immigrants sont censés être punis par les lois qui défendent les libertés démocratiques. Les symboles de leur haine raciale sont interdits dans le pays qui ont connu le nazisme et il est grandement dommage que l'on voit ressurgir de tels discours au plus haut sommet de l'État pour en faire des politiques discriminatoires aux États-Unis sans que cela ne soit dénoncé par les dirigeants actuels des démocraties comme une menace aux institutions de ces sociétés.
Ce serait en fait un minimum que soient stigmatisés pour ce qu'ils sont, i.e. de la propagation de la haine, ces discours odieux contre des boucs-émissaires de la détérioration des conditions de vie de la population dans nos pays et dans le monde Si l'on n'y prend garde ce sera toute forme d'opposition qui sera enterrée sous les injonctions de Trump contre la gauche radicale qui ne constitue en réalité une menace que contre ses abus de pourvoir comme on a vu au XX ième siècle et qui ont mené à la catastrophe de la Deuxième Guerre Mondiale.
Si le climat est toxique pour l'extrême droite, sa pertinence devrait être conçue comme un mécanisme de défense des société démocratiques qui n'ont que faire de ce pouvoir en gestation qui les a menacées et contre lequel elles n'ont réagi que trop trad alors que les droits ont été engloutis derrière des sociétés sclérosées qui n'avaient plus pour évoluer que la violence des institutions figés par le pouvoir dictatoriale.
Avant que l'extrême droite ne conquiert un pouvoir définitif qui est antagonique avec la démocratie, il faudrait un sursaut des peuples de ces systèmes de manière que soient préservé les droits fondamentaux élémentaires qui font des démocraties ce qu'elles sont : des endroits où la tolérance fait foi de valeur importante pour préserver la qualité des débats.
L'intolérance d'un meurtrier comme Tyler Robinson, aussi déplorable soit-elle, devrait être perçue comme le réflexe d'un individu qui sent menacée l'intégrité de sa société par des propos tendant à en dissoudre l'essence même. Dans ce sens les appels à la tolérance des propos d'un Charlie Kirk sont hypocrites et contribuent à la montée de l'extrême.
Guy Roy, syndicaliste à la retraite
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Québec Solidaire : l’écart marqué entre rêve et réalité

Comment le parti peut-il remontrer la pente ? Est-ce même encore envisageable pour la seule formation de gauche au Québec ? Le dernier sondage en date sur les intentions de vote s'avère dévastateur pour Québec solidaire : il ferme la marche à 7% d'appuis, derrière le Parti conservateur qui lui, en ramasse 12%. Il arrive un moment où l'espoir de regagner de la crédibilité pour une formation politique s'effondre. Québec solidaire en est-il rendu là ? Qu'est-ce qui cloche ?
Tout d'abord, la tête. Il faut pointer la ou plutôt les actuelles têtes dirigeantes du parti pour ce déclin, ainsi que plusieurs militants. Les deux premiers piliers du parti, Françoise David et Amir Khadir l'ont quitté depuis un bon bout de temps. Un autre joueur majeur, Gabriel Nadeau-Dubois vient de faire pareil parce qu'il ne s'y sentait pas à l'aise C'est malheureux, car il était particulièrement crédible, vu son sens politique, son réalisme et son pragmatisme. S'il avait joint le Parti québécois, il aurait pu y remplir un rôle important, et même devenir « ministrable ». Il représentait l'aile pragmatique de Québec solidaire, suspecte d'opportunisme aux yeux de l'aile gauche.
Tout ceci peut être dit sans dénigrer les autres têtes dirigeantes de la formation, comme Ruba Ghazal, co porte-parole et près de l'aile la plus à gauche. Par ailleurs, il faudra attendre le résultat de la course au porte-parolat pour savoir qui remplacera GND comme l'autre co porte-parole. Qui sera le nouveau collègue de Ruba Ghazal ?
En examinant la situation de Québec solidaire, on observe le conflit classique dans tous les partis de gauche : l'affrontement entre sociaux-démocrates d'une part et les marxistes et leurs sympathisants de l'autre. Ces derniers oublient, ou refusent de voir une vérité fondamentale en politique : éviter de prendre ses rêves pour la réalité. Ils ont tendance à s'enfermer dans une certaine pureté idéologique qui les aveugle. Quand un parti conquiert le pouvoir, même s'il est doté d'un audacieux programme social et économique de gauche, et qu'il est dirigé par des gens prestigieux en qui une bonne part de l'électorat se reconnaît, doit faire des choix parfois déchirants en ce qui concerne l'application dudit programme. Il y a et il y aura toujours une certaine distance entre les bonnes intentions et la réalisation de ce programme. Bref, l'éventuel gouvernement de gauche devra mettre de l'eau dans son vin pour gérer au mieux la société.
Sa direction n'aura d'autre choix que de garder un oeil sur l'état des finances publiques, surveiller les polémiques qui se produisent au sein même de la formation (ce qui est sain, dans la mesure où elles ne dégénèrent pas en schisme) et faire des choix équilibrés dans la constitution du conseil des ministres entre l'aile gauche, le centre et l'aile droite. Les têtes dirigeantes du nouveau gouvernement devront aussi (et surtout) surveiller les forces sociales et économiques dont le programme heurte les intérêts et qui sont susceptibles d'essayer de le déstabiliser. C'est une question de réalisme élémentaire. Ces nécessités, si elles sont respectées, déçoivent forcément les membres les plus à gauche du parti, qui en retirent souvent une impression de trahison des idéaux initiaux de leur formation politique.
Dans le cas du Parti québécois, ces querelles et dissensions portaient avant tout sur le processus d'accession du Québec à la souveraineté, sur le référendum et la question à poser aux électeurs et électrices à cette occasion. Mais le parti était dirigé par un chef prestigieux et ancien ministre dans le cabinet libéral de Jean Lesage, René Lévesque et des technocrates de haut vol comme Jacques Parizeau, Claude Morin et Jacques-Yvan Morin, entre autres. Cela lui conférait une crédibilité certaine, mais qui ne fut toutefois pas suffisante pour arracher en mai 1980 (pour Lévesque) et en avril 1995 (pour Parizeau) une majorité de OUI en faveur de la souveraineté.
Ce n'est pas du tout pareil pour Québec solidaire. en dépit de la sympathie que certains de ses leaders ont pu inspirer à la population, comme Françoise David, Amir Khadir et Manon Massé. Il n'a jamais exercé le pouvoir ni même formé l'Opposition officielle. La plus grande partie de l'électorat ne le prend pas (ou plus) au sérieux.
On peut donc en conclure que Québec solidaire ne peut se permettre de se couper de celui-ci en s'enfermant dans un cadre idéologique trop strict, ni se déchirer dans des querelles internes virulentes. Il a au contraire un urgent besoin d'une direction solide, crédible et peut-être aussi d'une certaine révision de son programme. Jusqu'à quel point ? Ça demeure à discuter. Mais tirer le parti toujours plus à gauche constituerait une erreur diminuant encore davantage le peu de crédibilité qui lui reste. Il faut éviter les fuites en avant, une erreur fatale en politique électorale.
C'est de ce hiatus entre rêves et projets qui en découlent d'un côté, et l'incontournable de réalité de l'autre qui produit la tragédie de l'action politique, et de manière plus générale, de l'existence humaine elle-même.
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les BRICS sont les nouveaux défenseurs du libre-échange, de l’OMC, du FMI et de la Banque mondiale

Les BRICS+ sont une coalition hétéroclite rassemblant 10 pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud auxquels se sont ajoutés en 2024 l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Indonésie et l'Iran) dont certains sont directement alliés aux États-Unis.
Tiré du site du CADTM.
Face à l'offensive de Donal Trump à propos des tarifs douaniers, les pays membres des BRICS+ négocient en ordre dispersé. Il n'y a aucune tentative de leur part de faire bloc. Face aux attaques de Trump, la Chine et l'Inde se rapprochent et entretiennent d'importantes relations commerciales avec la Russie mais ces pays ne fonctionnent pas en bloc ni avec les deux autres membres fondateurs des BRICS, à savoir le Brésil et l'Afrique du Sud, ni en tant que BRICS+.
Alors que les 10 pays membres des BRICS+ représentent la moitié de la population mondiale, 40% des ressources fossiles d'énergie, 30% du produit intérieur mondial et 50% de la croissance, ils ne proposent pas de mettre en œuvre un modèle de développement différent.
Les dirigeants des BRICS soutiennent le mode de production capitaliste qui nous a mené·es au désastre écologique actuel. Les BRICS sont favorables au maintien de l'architecture financière internationale (avec le FMI et la Banque mondiale en son centre) et commerciale internationale (OMC, traités de libre-échange…) telle qu'elle existe.
Que proposent les BRICS au niveau du système financier international ?
Les BRICS+ considèrent que le FMI doit rester au centre du système financier international.
Dans la déclaration finale du sommet que les BRICS+ ont tenu à Rio de Janeiro (Brésil) début juillet 2025, ils écrivent au point 11 :
- « Le FMI doit rester doté de ressources suffisantes et mobilisables rapidement, au cœur du Réseau de sécurité financière mondiale (RSFM), afin de soutenir efficacement ses membres, en particulier les pays les plus vulnérables. » [1]
Ils apportent aussi leur soutien à la Banque mondiale. Ils affirment au point 12 de leur déclaration qu'ils veulent augmenter la légitimité de cette institution. Or, depuis leur fondation, la Banque mondiale et le FMI mènent, depuis leur fondation, une politique contraire aux intérêts des peuples et des équilibres écologiques.
Les BRICS se contentent de demander une meilleure représentation des pays dits en développement au sein du FMI et de la Banque mondiale. C'est tout. Comme l'ont démontré de nombreux auteurs et le CADTM, la Banque mondiale, tout comme le FMI imposent une sous-représentation anti démocratique des pays dits en développement et un mode de gouvernement favorables aux intérêts des grandes puissances économiques et des grandes entreprises privées.
Dans la déclaration finale, les BRICS n'expriment aucune critique à l'égard des politiques néolibérales que les deux institutions de Brettons Woods s'activent à faire appliquer. A aucun moment ils ne remettent en cause les dettes que ces institutions réclament aux pays endettés.
Cette position des BRICS en faveur du FMI et de la BM va à l'encontre des intérêts des peuples et des positions des mouvements sociaux ou/et altermondialistes (voir plus loin dans la série Q/R sur les BRICS, la partie sur le soutien des BRICS au sauvetage par le FMI du gouvernement d'extrême droite de Milei en Argentine).
Quelle est la position des BRICS+ à l'égard de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ?
Les BRICS sont devenus les principaux avocats de l'OMC qui est paralysée suite à l'action du président Trump au cours de son premier mandat. Dès 2017, l'administration Trump a refusé de nommer de nouveaux juges pour faire partie de l'organe d'appel (Appellate Body) de l'OMC. Cette sorte de “cour suprême” du commerce international tranche les litiges entre États une fois qu'un premier panel a statué. Comme cet organe est bloqué depuis 2017, l'OMC est mise hors d'état de fonctionner.
Au point 13 de la déclaration de Rio de juillet 2025, les BRICS+ affirment leur soutien aux règles de l'OMC et déclare que l'OMC doit être en cœur du système commercial mondial. Les BRICS+ affirment :
- « Nous soulignons que l'OMC, qui célèbre son 30e anniversaire, reste la seule institution multilatérale dotée du mandat, de l'expertise, de la portée universelle et de la capacité nécessaires pour mener des discussions sur les multiples dimensions du commerce international, y compris la négociation de nouvelles règles commerciales. » [2]
Rappelons que les mouvements sociaux, la Via Campesina et le mouvement altermondialiste (le mouvement contre la globalisation capitaliste néolibérale) ont systématiquement critiqué et dénoncé l'OMC pour son rôle néfaste car son action va à l'encontre des intérêts des travailleur·euses, des paysan·nes, des économies locales et de la Nature (voir encadré sur l'OMC).
Encadré : Pourquoi l'action de l'OMC est-elle négative ? Pourquoi faut-il s'y opposer ?
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui compte 166 pays membres est entrée en activité en 1995 et cherche à mettre fin à toutes les barrières que les États pourraient mettre en place pour protéger leurs producteur·ices locaux·ales.
Or, contrairement à ce que veut l'OMC, les barrières douanières devraient servir par exemple à protéger les petites exploitations paysannes, les petites et moyennes entreprises ou/et les entreprises publiques, qui pour différentes raisons ne sont pas en mesure de répondre à la compétition que représente les produits exportés par les économies plus avancées technologiquement. Les protections douanières peuvent aussi servir à protéger les entreprises locales de la concurrence que constitue l'importation de produits exportés par les économies où les salaires sont plus bas à cause d'une surexploitation du Travail. Il peut s'agir aussi de protéger les économies dites en développement de l'invasion de marchandises provenant des pays qui subventionnent leurs productions nationales, notamment celles destinées à l'exportation. On sait que les grandes puissances économiques comme celle d'Amérique du Nord ou d'Europe occidentale n'hésitent pas à subventionner largement leurs grandes entreprises en contournant les régles de l'OMC alors qu'elles ont contribué à les établir.
A travers l'accord général sur le commerce des services, l'OMC favorise fortement la privatisation des services publics (eau, santé, éducation, transports, etc.), ce qui augmente la domination des multinationales et la marginalisation des petites structures locales. L'OMC joue aussi un rôle clé dans la défense des droits de propriété intellectuelle à travers l'Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce / TRIPS en anglais) y compris dans des domaines sensibles comme les médicaments, les semences, ou les technologies. On a vu dans le cas des vaccins anti-Covid, que l'OMC, sous la pression des grandes puissances et des multinationales pharmaceutiques, a refusé de suspendre ces règles, ce qui a freiné l'accès des pays pauvres aux vaccins. Concernant les variétés végétales, l'OMC a été l'instrument catalyseur qui a permis d'imposer un standard strict de droits de propriété intellectuelle et privatisation du vivant dans le domaine agricole à l'échelle mondiale, au détriment des droits des petits paysan-nes et de la souveraineté semencière des pays. L'OMC collabore avec le FMI et la BM et les trois institutions agissent comme un trio qui promeut des politiques favorables aux multinationales et impose une orientation des économies du Sud vers plus d'intégration dans le marché mondial et par conséquent l'accentuation de leur dépendance économique, financière et alimentaire.
Si on se place du point de vue de l'intérêt des peuples, il faut que les pays (ou les groupes de pays) mènent des politiques contre les règles de l'OMC afin de renforcer leur production locale pour satisfaire les besoins du marché intérieur. Il s'agit ainsi de répondre aux besoins de leur population, notamment en subventionnant les producteur·ices locaux·ales. Contre les règles de l'OMC, il faut que les pays puissent protéger leurs services publics, leurs entreprises publiques contre la concurrence étrangère. Dans le passé toutes les économies qui ont réussi une diversification industrielle et une souveraineté alimentaire l'ont fait en protégeant leur marché intérieur de la concurrence.
Rappelons que la Grande Bretagne n'est devenue libre échangiste que dans la seconde moitié du 19e siècle que lorsqu'elle a atteint un niveau suffisant d'avancée technologique pour résister à la concurrence. Avant cela, la Grande Bretagne a été très protectionniste et a protégé systématiquement son industrie locale (voir les travaux de Paul Bairoch et de nombreux autres auteurs). Il en a été de même pour les Etats-Unis qui ne sont devenus timidement libre échangiste que dans l'après seconde guerre mondiale lorsque leurs industries ont atteint une importante avancée technologique. De même pour la Corée du Sud dans les années 1960- 1970 (lire : Éric Toussaint, « La Corée du Sud et le miracle démasqué » [3], https://www.cadtm.org/La-Coree-du-Sud-et-le-miracle-demasque ). Même chose pour le Japon du 19e siècle à la seconde moitié du 20e siècle. De même que la Chine qui a fortement protégé son marché et soutenu ses industries jusqu'à conquérir un avantage de compétitivité qui l'amène aujourd'hui à devenir une grande avocate du libre-échange.
Si Trump est aussi protectionniste et aussi agressif en matière de droits de douane, c'est que l'économie des Etats-Unis a perdu énormément en compétitivité et que sur le marché mondial et sur le marché intérieur les industries locales ne sont plus en mesure de répondre à la concurrence des produits chinois et d'autres pays. Cette évolution provoque la paralysie de l'OMC notamment parce que Trump lors de son premier mandat (suivi par Biden) n'a pas désigné de juges des Etats-Unis pour compléter le tribunal de l'OMC, ce qui bloque son fonctionnement.
Croire à gauche qu'au nom du multilatéralisme, il serait bon de relancer l'OMC est une erreur. Il ne faut pas accepter l'orientation pro-OMC des BRICS+. Cette orientation des BRICS+, en particulier soutenue par la Chine, le Brésil, les Émirats Arabes Unis, coïncide également à la volonté de multiplier des traités de libre commerce qui vont à l'encontre des producteur·ices locaux·les et favorisent les intérêts des grandes entreprises transnationales (principalement du Nord mais aussi certaines du Sud). La Chine multiplie les signatures de Traités de libre commerce, le Brésil veut aboutir à la ratification du traité de libre commerce MERCOSUR-Union européenne alors que les mouvements sociaux en Europe et dans le MERCOSUR s'y opposent.
A l'opposé des traités de libre commerce, il faut promouvoir des accords entre groupes de pays qui cherchent ensemble comment mettre en pratique des politiques économiques, sociales et culturelles qui favorisent la satisfaction de de droits humains dans le respect de la Nature avec comme priorité la justice sociale et environnementale. Ces accords doivent inclure le commerce dans un ensemble plus large basé sur les principes de solidarité et de complémentarité. Augmenter le commerce n'est pas un but en soi, loin de là. Promouvoir des échanges non commerciaux doit devenir une priorité : échange de savoirs, transfert gratuit de technologie et de savoir-faire, réparations, restitution de bien mal acquis…
Il faut que les pays puissent protéger l'environnement, la biodiversité en imposant des règles strictes pour stopper la surexploitation des ressources naturelles le saccage du milieu naturel.
Soulignons que l'OMC a refusé en 2022 de soutenir la proposition soutenue par plus d'une centaine de pays du Sud de lever l'application des brevets sur les vaccins. Il s'agissait de permettre leur fabrication à grande échelle pour protéger les populations victimes de la pandémie.
Dans la déclaration finale de Rio des BRICS+ qui est longue d'une quarantaine de pages et contient 126 points, nulle part, il n'est demandé de suspendre l'application des brevets pour la production de vaccins. Or ces brevets favorisent les intérêts particuliers des grandes entreprises privées pharmaceutiques dont la principale motivation est la recherche des profits maximums.
Pour comprendre cette position des BRICS+, il faut avoir en tête que la Chine a pris l'avantage sur les États-Unis et sur l'Europe en termes de production et de commerce tant au niveau des coûts que de la productivité et des avantages technologiques dans un nombre importants de secteurs. La Chine est devenue une fervente avocate du libre-échange, des traités de libre commerce, des règles de l'OMC, de la libre concurrence tandis que les États-Unis, l'UE, la GB, le Canada, sont devenus de plus en plus protectionnistes [4]. Les autres BRICS suivent la Chine.
Au nom du respect des règles de l'OMC, les BRICS+ dénoncent les mesures protectionnistes, les sanctions commerciales prises par les Etats-Unis et par les puissances européennes. Bien sûr, la Russie et l'Iran qui sont directement visés par des sanctions sont très favorables au discours libre échangiste, anti protectionniste et anti-sanctions (voir notamment le point 14 de la déclaration finale).
En plus, les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, qui sont entrés en guerre commerciale avec la Chine, ont abandonné le discours et les actions en faveur de la globalisation qu'ils avaient présentée comme une voie royale vers la prospérité pendant la période qui va des années 1990 au milieu des années 2010. A cette période, de 1997 à 2013, la Russie avait été invitée par le G7 (Etats-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie) à ses réunions. Du coup, le G7 a été rebaptisé G8 pendant toute cette période. La Chine, de son côté, était considérée par les Etats-Unis comme un partenaire économique et commercial intéressant (voir Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, Paris, 2024, 302 pages).
Maintenant, les BRICS sont devenus les principaux avocats de la globalisation/mondialisation capitaliste, elle-même en pleine crise. Au point 8 de la déclaration finale du sommet de Rio 2025, ils affirment :
- « Nous reconnaissons que la multipolarité peut élargir les possibilités pour les pays en développement et les marchés émergents (PDME) de développer leur potentiel constructif et de bénéficier d'une mondialisation et d'une coopération économiques universellement avantageuses, inclusives et équitables. » [5]
Au point 43 de la déclaration, on peut lire :
- « Nous réaffirmons l'importance de veiller à ce que les politiques commerciales et de développement durable soient mutuellement bénéfiques et conformes aux règles de l'OMC. » [6]
Conclusions
L'élargissement des BRICS en 2024 (BRICS+) a fait naître des attentes quant à leur capacité à proposer une alternative au système économique mondial dominé par les puissances impérialistes traditionnelles sous le leadership des Etats-Unis. Pourtant, malgré leur poids démographique et économique — près de la moitié de la population mondiale, 40 % des ressources fossiles, 30 % du PIB mondial et 50 % de la croissance —, les BRICS+ ne cherchent pas à rompre avec l'architecture néolibérale internationale.
Sur le plan financier, la déclaration finale du sommet de Rio (juillet 2025) réaffirme le rôle central du FMI et de la Banque mondiale, les BRICS+ se limitant à revendiquer une meilleure représentation des pays en développement sans remettre en cause les politiques d'ajustement structurel, les dettes imposées ou l'orientation néolibérale de ces institutions. Concernant le commerce, les BRICS+ défendent l'Organisation mondiale du commerce (OMC), paralysée depuis le blocage américain initié par Donald Trump en 2017. Ils en soulignent la légitimité et souhaitent la placer au cœur du système commercial mondial, sans critiquer ses effets néfastes sur les économies locales, les droits sociaux ou l'environnement.
Dans la pratique, la Chine, appuyée par d'autres membres, multiplie les traités de libre-échange et promeut une mondialisation capitaliste fondée sur le libre-échange, alors même que les anciennes puissances du Nord virent désormais vers le protectionnisme. Ainsi, loin de représenter un contre-modèle, les BRICS+ se présentent comme les nouveaux défenseurs d'un système capitaliste mondialisé en crise, au détriment des mouvements sociaux et des alternatives fondées sur la justice sociale, la souveraineté économique et la protection écologique.
En soutenant le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, ils s'inscrivent dans la continuité du néolibéralisme globalisé plutôt que d'en proposer une alternative. Cette posture traduit une volonté d'accroître leur influence à l'intérieur des institutions dominantes, sans rompre avec leurs logiques destructrices pour les peuples et la planète.
Loin de représenter une chance d'émancipation pour les pays du Sud, les BRICS+ apparaissent comme des partenaires de la gestion d'un capitalisme en crise qui a entraîné la planète vers la catastrophe écologique, vers une accentuation des conflits armés et une aggravation massives des crimes contre l'Humanité. Face à cela, il revient aux mouvements sociaux et altermondialistes de continuer à porter des propositions alternatives : protection des biens communs, solidarité entre peuples, souveraineté économique, bifurcation écologique et justice sociale.
L'auteur remercie pour leur relecture et pour leurs conseils Omar Aziki, Sushovan Dhar, Jawad Moustakbal et Maxime Perriot. L'auteur est entièrement responsable des opinions qu'il exprime dans ce texte et des erreurs éventuelles qu'il contient.
Notes
[1] Engl. : 11. “the International Monetary Fund (IMF) must remain adequately resourced and agile, at the center of the global financial safety net (GFSN), to effectively support its members, particularly the most vulnerable countries.” https://dirco.gov.za/rio-de-janeiro-declaration-strengthening-global-south-cooperation-for-a-more-inclusive-and-sustainable-governance-rio-de-janeiro-brazil-6-july-2025/
Esp. : 11. “FMI debe permanecer con recursos adecuados y ágil, en el centro de la Red de Seguridad Financiera Global (RSFG), para apoyar efectivamente a sus miembros, particularmente los países más vulnerables » https://noticiaspia.com/declaracion-final-de-la-cumbre-del-brics-en-brasil/
Pt. : 11. « o FMI deve permanecer com recursos adequados e ágil, no centro da Rede de Segurança Financeira Global (RSFG), para apoiar efetivamente seus membros, particularmente os países mais vulneráveis. » https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-de-lideres-do-brics-2014-rio-de-janeiro-06-de-julho-de-2025
[2] Esp. « Enfatizamos que la OMC, en su 30º aniversario, continúa siendo la única institución multilateral con el mandato, la expertise, alcance universal y capacidad para liderar discusiones sobre las múltiples dimensiones del comercio internacional, incluyendo la negociación de nuevas reglas comerciales. »
English : « We emphasize that the WTO, at its 30th anniversary, remains the only multilateral institution with the
necessary mandate, expertise, universal reach and capacity to lead on the multiple
dimensions of international trade discussions, including the negotiation of new trade
rules »
Pt : « Enfatizamos que a OMC, em seu 30º aniversário, continua sendo a única instituição multilateral com o mandato, a expertise, alcance universal e capacidade para liderar discussões sobre as múltiplas dimensões do comércio internacional, incluindo a negociação de novas regras comerciais. »
[3] Éric Toussaint, « La Corée du Sud et le miracle démasqué », CADTM, publié le 10 avril 2024, https://www.cadtm.org/La-Coree-du-Sud-et-le-miracle-demasque
[4] Il y a bien sûr des exceptions notamment quand l'UE maintient son avantage dans ses rapports avec des partenaires commerciaux moins avancés par exemple avec des pays d'Afrique elle reste favorable aux accords de libre commerce.
[5] Esp. : « 8. Reconocemos que la multipolaridad puede ampliar las oportunidades para que los Países en Desarrollo y Mercados Emergentes (PDME) desarrollen su potencial constructivo y se beneficien de una globalización y cooperación económicas universalmente ventajosas, inclusivas y equitativas. »
Pt. : « 8. Reconhecemos que a multipolaridade pode ampliar as oportunidades para que os Países em Desenvolvimento e Mercados Emergentes (PDME) desenvolvam seu potencial construtivo e se beneficiem de uma globalização e cooperação econômicas universalmente vantajosas, inclusivas e equitativas. »
En. : “8. We acknowledge that multipolarity can expand opportunities for EMDCs to develop their constructive potential and enjoy universally beneficial, inclusive and equitable economic globalization and cooperation.”
[6] Esp. : “43. Reiteramos la importancia de asegurar que políticas de comercio y desarrollo sostenible sean mutuamente beneficiosas y alineadas con las reglas de la OMC.”
EN. “43. We reiterate the importance of ensuring that trade and sustainable development policies are mutually supportive, and aligned with WTO rules.”
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. La zone de pondération

Toute critique de la guerre menée par Israël contre Gaza est canalisée, édulcorée et rendue inoffensive, enfermée dans un cadre médiatique et politique, qui banalise la catastrophe en cours et empêche d'appeler les choses par leur nom.
Tiré de orientxxi
18 septembre 2025
Par Marie Arnaud
Visages aux expressions saisies dans des couleurs vives, évoquant une émotion forte.
Amal Abdenour, Maman ne pleure pas ! je suis bien ! (1974–1979)
© Courtesy Enseigne des Oudin
Depuis peu, une brèche est venue lézarder le « dôme de fer » (1) symbolique sur lequel venait ricocher toute prise de position ferme en faveur de Gaza et contre ses tortionnaires. Aucun des verrous qui font tenir l'édifice n'a sauté, mais force est de constater que, l'un après l'autre, ils se desserrent et que les lignes bougent. Reconnaissons au journal Le Monde un courage louable, bien que tardif. Il a fallu attendre ces tout derniers mois pour observer ce virage éditorial. La famine de masse a ceci d'effroyable qu'elle s'imprime partout sur les visages et les corps, produisant un effet de vérité qu'il n'est plus possible d'ignorer : on réalise soudain qu'une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux…
Ne reste plus qu'à nommer clairement les coupables pour mieux les combattre. Ce qui, dans le paysage médiatique de 2025, n'est assurément pas une mince affaire. Comme le rappellent Serge Halimi et Pierre Rimbert dans un article du Monde Diplomatique, mener à bien un authentique travail de journaliste est devenu une gageure lorsqu'on se heurte continuellement au « lobby pro-israélien » (2). Celui-ci forme un bloc compact, belliqueux et très efficace dès qu'il s'agit de museler toute voix dissidente ou d'invisibiliser les inconscients qui auraient l'audace de ranger le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou bien en vue dans la liste des exterminateurs.
Certains ont pu se réjouir qu'Emmanuel Macron soit le seul président occidental à se rendre aux portes de Gaza, en avril 2025, pour dénoncer le blocage des points de passage humanitaires et appeler au cessez-le-feu immédiat. Ce sont les mêmes qui, quelques mois plus tard, l'applaudiront pour avoir annoncé en grande pompe la reconnaissance de l'État de Palestine. Après les pires compromissions avec le régime de Nétanyahou, Macron consent finalement à ce geste symbolique pour reprendre pied sur une scène internationale où depuis bien longtemps il a perdu toute influence et toute crédibilité. Certes, d'autres pays devraient emboîter le pas à la France, sous la pression d'opinions publiques ulcérées et devant l'évidence d'un désastre que plus rien ne peut dissimuler. Cet appel d'air ne doit pas être méprisé. De là à parler d'une victoire ? Y a-t-il encore un sens à reconnaître l'existence d'un État sur un territoire éventré où survit une population parquée et promise à l'hécatombe ? La décision tardive et hasardeuse du président français n'offre-t-elle pas un prétexte idéal aux autorités israéliennes, Bezalel Smotrich et Yariv Levin en tête, pour accélérer la destruction de Gaza et procéder au plus vite à l'annexion pure et simple de la Cisjordanie ?
Pendant ce temps, la députée Caroline Yadan et la ministre macroniste en sursis Aurore Bergé s'efforcent de promulguer une énième loi scélérate qui, sous couvert de lutter contre « les formes renouvelées de l'antisémitisme », vise à criminaliser toute critique sérieuse de la politique génocidaire du gouvernement israélien. Un levier supplémentaire parmi tant d'autres pour renforcer le régime de terreur méthodiquement mis en place pour lier les langues et obturer l'espace politique.
Un régime de terreur
Ce que j'appelle ici « terreur », c'est l'installation progressive, mais autoritaire et brutale, d'un régime d'exception qui exclut a priori toute possibilité de dénoncer le « Gazacide » dont parle le journaliste palestinien Rami Abou Jamous et de combattre pied à pied les thuriféraires de Nétanyahou. Il ne s'agit pas ici d'une terreur qui, comme c'est le cas à Gaza, détruit et soumet les corps à la famine et à la mort, mais d'une terreur qui empêche de formuler toute inquiétude distinctement, qui proscrit dans tout l'espace public l'existence d'un véritable débat contradictoire, avec ce que cela implique d'ouverture aux nuances de l'argumentation, à la nécessaire contextualisation des faits, sans parler de l'historicisation salutaire des événements en cours.
La terreur, c'est la disparition d'un socle commun dans le prolongement duquel il serait possible d'entrevoir un horizon de justice. Tous ceux qui n'ont pas vu ou voulu voir ce sol s'émietter et se dérober sous leurs pas en ont fait l'amère expérience : se croyant libres de débattre et de hausser le ton, ils ont vite découvert qu'un certain nombre de référents étaient par avance exclus des jeux de langage autorisés, qu'il n'y avait pas de « génocide », de « famine » planifiée par l'armée israélienne, encore moins de « camps de concentration » programmés. Si l'on voulait parler malgré tout, il fallait se résoudre à slalomer en terrain miné.
Les prescriptions autoritaires destinées à vous clouer le bec sont désormais bien connues et repérables par tout un chacun. Leur puissance, certes, s'émousse peu à peu, mais elles font toujours recette sur les plateaux télé comme dans la vie publique. Vous engagez votre parole sur une ligne critique de la politique d'Israël, vous devrez inévitablement traverser un certain nombre de sas de neutralisation. Préalable à toute tentative pour rendre justice à l'insondable souffrance des Gazaouis, il vous faudra d'abord reconnaître, en prenant le ton solennel de circonstance, que le tort subi par Israël le jour du 7 octobre 2023 est incommensurable. Il ne s'agit évidemment pas de partager un écœurement légitime devant les exactions du Hamas, ou d'exprimer une compassion sincère pour les victimes israéliennes et les otages. Il s'agit de s'assurer qu'avant toute chose, vous resterez pétrifiés devant la date sacralisée du 7 octobre, et que vous reconnaîtrez par-là, implicitement, le droit d'Israël à châtier les coupables, dans les proportions qu'elle estime justes et appropriées.
Puisqu'Israël a subi, le 7 octobre 2023, le coup le plus terrible de son histoire récente, vous voilà maintenant sommé de reconnaître qu'il est, et a toujours été, menacé dans son existence même. Ce qui lui donne évidemment le droit de protéger ses frontières, extensibles à volonté, pour tenir en respect les États hostiles et barbares qui l'entourent, États qui, par leur simple présence, mettent en péril son intégrité. Et tant pis, si cette politique ultra-agressive déstabilise toute la région qu'elle transforme en poudrière. Et tant pis si elle s'intègre explicitement dans le projet millénariste du « Grand Israël », terre promise qui inclurait la Jordanie, le Liban, et la Syrie, comme l'appelle de ses vœux Smotrich, l'une des figures les plus radicales de l'État génocidaire.
Raphaël Enthoven, le Meyer Habib de la philosophie
Au besoin, une troisième opération de filtrage vous attend : un tour de passe-passe plus pernicieux encore que les précédents qui vous contraindra à reconnaître que le Hamas occupe toujours la bande de Gaza. Et c'est un fait, le Hamas est toujours là… Mais dans le débat truqué que bien imprudemment vous avez accepté, ce simple fait justifie qu'un voile de suspicion recouvre immédiatement toute information et toute image en provenance de l'enclave. Par conséquent, vous serez obligé de l'admettre : la famine n'est absolument pas utilisée par Nétanyahou comme une arme de guerre. C'est un spectacle propagandiste mis en scène par les hommes du Hamas, reconvertis pour l'occasion en maîtres du montage hollywoodien et de la superproduction misérabiliste. Devenu avec le temps, le Meyer Habib de la philosophie, le propagandiste Raphaël Enthoven assène même le 15 août sur X qu'« Il n'y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse ». Il lui faudra un mois pour s'excuser. Évidemment, Enthoven ne peut ignorer qu'Israël seul décide qui a le droit de raconter ce qu'il voit ou qui est condamné à disparaître. Mais ce tweet tout en nuances avait sans doute vocation à assassiner une seconde fois Anas Al-Sharif, journaliste d'Al-Jazira, ciblé et tué cinq jours plus tôt par un bombardement israélien.
Parvenu en ce point ultime, il n'y a tout simplement plus de débat. Ne vous faites plus prier, avouez-le : en frappant ses voisins et en nettoyant Gaza, Israël ne fait que combattre à notre place la barbarie islamiste ! C'est le chancelier allemand Friederich Merz qui l'assure, Israël fait « le sale boulot », le grand ménage qui alimente les fantasmes inavoués de l'Occident (3) Israël ne prend pas de gants, il n'a que faire des timides scrupules de la vieille Europe. Et sa brutalité, bien loin d'entrer en contradiction avec les valeurs de l'Occident, est devenue le moyen le plus légitime de les faire respecter. « La seule démocratie du Proche-Orient » porte la lumière au cœur de l'obscurantisme moyenâgeux.
Comme chacun sait, quiconque a pu refuser de franchir l'un ou l'autre de ces sas et, partant, de se soumettre intégralement à ce régime de terreur savamment déployé est devenu, sans autre forme de procès, un « antisémite ».
Une nouvelle « zone d'intérêt »
Cédez à la terreur et vous voilà adoubés, accueillis à bras ouverts dans un tout autre espace de discussion : la zone de pondération. Tout différend s'efface alors comme par magie. Plus d'injonction et d'aboiement au moindre signe suspect de gazaphilie. Vous avez désormais voix au chapitre avec en toile de fond un idéal de consensus qui guide tous les intervenants. On vous écoute, on vous comprend, on consent même à verser quelques larmes sur le sort des enfants gazaouis amaigris dont on diffuse les images entre deux étapes du tour de France. On accepte même, soyons fous, d'élever la voix contre l'incorrigible « Bibi » qui parfois, c'est vrai, pousse le bouchon un peu loin…
La zone de pondération, c'est un peu la Zone d'intérêt du film de Jonathan Glazer, ce petit univers coquet dans lequel se retranchent Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz et sa petite famille. Les enfants jouent, on cuisine, la vie domestique s'y installe avec une liberté et une placidité improbable, alors que l'extermination industrielle bat son plein à quelques encablures. Entouré de larges haies et de murs épais, notre adorable jardinet se porte bien et l'on peut deviser à tête reposée. En ce sens, ce que j'appelle « zone de pondération », est la survivance incongrue d'un espace feutré et apaisé, celui de l'égalité de parole, des critiques qui atteignent leurs cibles, des idées régulatrices qui réunissent malgré les désaccords énonciateurs et destinataires. Un espace donc où l'on simule le débat et la vie démocratiques aux portes d'un univers de brutalité intégrale que nous avons choisi de ne pas voir et de ne pas montrer.
Cet univers possède sa logique propre, celle de guerre bien sûr, mais surtout celle de l'extermination. Si la guerre a pu un temps apparaître comme la continuation de la politique par d'autres moyens, selon la formule bien connue du général prussien Carl von Clausewitz (1780-1831), l'extermination implique une rupture brutale avec tout état de raison. C'est un saut sans retour dans une logique folle d'agression pure et généralisée. Parvenu en ce point, on peut tout dire, tout se permettre. Comme « Bibi » le farceur qui promet de la glace Ben & Jerry's (4) aux futurs pensionnaires palestiniens du camp de concentration bientôt installé sur les ruines de Rafah (5). Ou comme le facétieux ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, qui propose au moment du dessert de larguer une bombe atomique à Gaza pour en finir une bonne fois pour toutes avec la question palestinienne (6). Sans oublier Itamar Ben-Gvir, Israël Katz et les autres qui rêvent éveillés de déporter massivement les derniers Gazaouis pour faire de l'enclave une station balnéaire, une marina où le président étatsunien Donald Trump lui-même se voit déjà trôner, triomphant, cocktail à la main, sous une pluie de dollars.
Pendant ce temps-là, laissons donc aux Européens tout le loisir de papoter vainement en « zone de pondération ». Rien d'essentiel ne peut s'y formuler, on s'en est assuré. Des experts disserteront des heures durant sur les nuances juridiques du mot « génocide », jusqu'à se noyer dans l'abstraction et oublier le génocide bien réel qui se déroule sous nos yeux. On multipliera les analogies, Arménie, Rwanda. On veillera bien sûr à distribuer la parole de manière équitable. On vantera les vertus de la patience. Mais s'agit-il bien de prendre son temps pour mieux comprendre ce qui se passe ou de gagner du temps pour que rien ne change ? Même les intervenants les plus coriaces, comme le député Aymeric Caron face au grand inquisiteur Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio le 25 mai, finissent, de guerre lasse, par brandir les valeurs morales bafouées, le droit international piétiné. Or, ces valeurs et ce droit sont invoqués pour plaider en faveur d'un peuple qui par avance échappe à leur champ d'application. Notre universalisme s'arrête aux portes de Gaza. La disparition des Palestiniens n'est pas, comme le dirait Judith Butler, soumise au deuil (7). Le Palestinien qui meurt n'est pas digne d'être pleuré. Aux otages israéliens, les noms propres scandés solennellement, les portraits et les larmes des familles ; aux « animaux humains » de la bande de Gaza, les chiffres rapidement égrénés, la froide récapitulation des faits, comme pour soulager sa conscience et s'acquitter d'une vilaine besogne.
L'heure de la guérilla
Tant que nous accepterons de nous cantonner à la « zone de pondération », le Palestinien restera ce mort-vivant sans droit — l'homo sacer dont parle le philosophe Giorgio Agamben — celui qui n'a pas de nom et dont le meurtre ne sera jamais un crime
(8). Il restera l'irreprésentable au sein du champ de la représentation, l'autre radical, forclos même lorsqu'il est visible. Nous devrons nous résoudre à l'abandonner dans son face-à-face interminable avec l'ennemi israélien.
L'heure a déjà sonné de s'engager dans une guérilla contre toute loi scélérate qui viserait à prolonger le statu quo, octroyant à Israël le temps nécessaire pour achever ses basses œuvres. Peu à peu, les conditions se réunissent pour faire bouger les lignes et arracher l'UE à son goût immodéré pour la torpeur diplomatique et l'attentisme coupable. Un dispositif permanent de harcèlement juridique se met en place. De plus en plus d'ONG portent plainte et assignent au tribunal des soldats israéliens soupçonnés de crimes de guerre. Amnesty International s'attaque à l'entité Gaza Humanitarian Foundation (GHF), pilier du dispositif israélien déployé pour rassembler et affamer les réfugiés gazaouis, sous prétexte de sécuriser la distribution d'aide alimentaire. C'est également au tour de certaines entreprises (Carrefour) et même de banques (BNP Paribas) d'être attaquées pour complicité de génocide.
Face à un horizon figé et alors même qu'une profonde mélancolie nous étreint, il faut imaginer l'improbable, l'événement anodin ou fracassant qui portera l'accroc décisif dans le tissu des faits imposés, et restaurera le possible lors même qu'on le croit évaporé. Et nous ne cesserons pas, pour paraphraser le poète Mahmoud Darwich, d'écrire notre silence, de « faire exploser ce silence plein de toutes ces voix », celles de tous ceux qui, dans les décombres, trompent la mort et la tiennent obstinément en respect.
Notes
1. Référence au système de défense antiaérien israélien réputé très efficace.
2. Serge Halimi et Pierre Rimbert, « Le lobby pro-Israël en France », Le Monde Diplomatique, août 2025.
3. NDLR. Interrogé le 17 juin 2025 par la chaîne publique allemande ZDF, le chancelier a assuré que l'État israélien faisait « le sale boulot » de l'Occident en bombardant les sites nucléaires iraniens.
4. NDLR. Ben Cohen, 74 ans, cofondateur de la marque Ben & Jerry's et partisan de Bernie Sanders, a interrompu une audition au Congrès le 14 mai 2025 pour dénoncer le soutien des États-Unis à Israël.
5. Mera Aladam, « Netanyahu 'backs Gaza concentration camp' plan, reportedly says 'feed them Ben & Jerry's' », Middle East Eyes, 9 juillet 2025.
6. Michael Bachner, « Amichaï Eliyahu : “Atomiser Gaza est une option” ; Netanyahu le suspend des réunions », Times of Israel, 5 novembre 2023.
7. udith Butler, « The Compass of mourning », London review of books, volume 45, n° 20, 19 octobre 2023.
8. Le concept d'Homo sacer (Homme sacré/maudit) renvoie au droit romain et désigne une personne qui peut être tuée sans que ce meurtre ne soit considéré comme un homicide. Dans Le Pouvoir souverain et la vie nue (1997, Seuil), Agamben transpose l'idée à l'époque contemporaine. Pour le philosophe italien, l'Homo sacer moderne est l'interné en camp de concentration, objet de l'arbitraire et de l'état d'exception, sans droits.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Métapolitiques : un site à fréquenter

Nous reprenons ici la descrition la description du site Métapolitiques lancé par Jonathan Durand Folco. (PTAG)
tiré du site Métapoliiques : https://metapolitiques.ghost.io/
Mission
Métapolitiques est une publication indépendante lancée par Jonathan Durand Folco à l'automne 2025. Il s'agit d'un espace de réflexion qui se situe au carrefour de la philosophie, des théories critiques et des débats chauds de l'actualité. C'est à la fois un blogue, une infolettre, et un terrain de jeu pour expérimenter diverses formes d'écriture. À mi-chemin entre l'essai argumentatif, la chronique, l'analyse politique et des méditations plus libres sur les enjeux sociaux de l'époque, Métapolitiques vise à nourrir la réflexion pour reconstruire des récits émancipateurs, des propositions radicales et des pistes d'action pour lutter contre l'hégémonie des forces réactionnaires et accélérer la transformation sociale.
Thématiques
Ce site explore divers sujets comme la montée des autoritarismes, la critique du capitalisme, et l'imbrication des systèmes de domination, tout en explorant des pratiques sociales, des projets collectifs et des « utopies réelles » qui préfigurent une société libre, démocratique, inclusive et écologique. C'est un espace pour réfléchir aux déboires actuels de la gauche, la guerre culturelle, les communs, la décroissance, la politique municipale, les stratégies pour lutter contre l'oligarchie et le techno-fascisme. Le fil conducteur est : résister, créer, transformer.
Biographie
Jonathan Durand Folco est un « chercheur engagé », qui intervention au carrefour de la recherche universitaire, la création d'alternatives postcapitalistes et l'engagement actif au sein des débats de l'espace public. Il est actuellement professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l'Université Saint-Paul, et impliqué dans diverses luttes et projets collectifs. Pour un aperçu de ses travaux de recherche et engagements militants, voir les sections publications et projets collectifs.
Abonnement
En vous abonnant à Métapolitiques, vous avez un accès complet au site web et aux infolettres, tout en pouvant commenter les publications. Votre abonnement permet à Métapolitiques de continuer à exister.
Contenu récent
Restez à l'affût des nouveaux contenus envoyés directement dans votre boîte courriel. Ne vous inquiétez plus de savoir si vous avez manqué quelque chose à cause d'un algorithme ou d'un fil d'actualité !
Rencontrer des gens comme vous
Rejoignez une communauté d'abonné·e·s qui partagent les mêmes intérêts.
Démarrer sa propre activité
L'expérience vous plaît ? Commencez gratuitement et créez votre propre page en utilisant Ghost, la plateforme open source qui alimente ce site web.
Métapolitiques © 2025
Devenez membre
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La solidarité ouvrière ne connaît pas de frontières !

Grève générale de 24 heures Jeudi 18 septembre 2025
Aux adhérents, sympathisants de l'USTKE,
Le Bureau confédéral appelle l'ensemble de ses adhérents du secteur privé et public à une grève générale de 24 heures ce jeudi 18 septembre 2025.
La mobilisation se déroulera devant le haussariat NC de 09H00 à 13H00.
A cet effet, l'appel des organisations syndicales dans l'hexagone a pour titre :
« Les sacrifices pour le monde du TRAVAIL, ça suffit ! »
Ce mouvement syndical ouvrier national ce 18 septembre 2025 se lève une fois de plus pour défendre les droits des travailleurs, le pouvoir d'achat et une meilleure justice sociale qui nous concernent aussi dans le Pacifique Sud et dans l'Outre-mer.
Ici, au PAYS nos réalités rejoignent celles des travailleurs de métropole et de par le Monde :
* Le pouvoir d'achat des travailleurs calédoniens et de leurs familles est aussi étranglé par un système qui écrase la création d'emplois stables et qui maintient les salaires au plus bas,
* Les protections sociales mises à mal, Les politiques successives des GOUVERNEMENTS, diminuant nos droits celles des travailleurs et menaçant même jusqu'a nous considérer, comme de simples participants.
* Les inégalités sociales toujours aussi criantes entre une minorité de privilégiés et une majorité de salariés qui peinent à vivre dignement.
Ces attaques contre le monde du travail se généralisent.
Notre riposte doit donc être unie et solidaire malgré le contexte de crise sociale et économique qui ont laissé près de 11 000 travailleurs au bord de la route, qui plombe notre moral et affecte nos nombreuses familles.
Malgré tout cela, nous devons nous lever et ne pas se laisser abattre.
Défendre notre dignité en tant que travailleur n'a pas de barrières !
L'USTKE rappelle que la défense de l'emploi durable, d'un système de protection sociale juste et d'une meilleure répartition des richesses demeure l'âme de nos luttes ouvrières.
Depuis toujours, l'USTKE dénonce et combat le système capitaliste, ce même système qui nous exploite, qui nous appauvrit et qui nous colonise.
Oui, l'USTKE revendique une véritable politique publique fondée sur des mesures concrètes pour mettre fin à la précarité et renforcer la solidarité.
Le 18 septembre prochain, nous saluerons la détermination des travailleuses et travailleurs en lutte en France et affirmerons que leur combat est aussi le nôtre.
« La solidarité ouvrière ne connaît pas de frontières ! »
MOBILISONS ensemble TOUS & TOUTES, et de façon massive !
Comptant sur nous tous, camarades !
Salutations fraternelles et solidaires !
Pour le Bureau confédéral
La Présidente
Mélanie ATAPO
Une assemblée générale est programée au mardi 16 septembre 2025 à 17 H 30 au Charley's, à la Vallée-du-Tir Nouméa afin d'informer les adhérents sur les modalités de la grève générale du jeudi 18 septembre 2025.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - Après l’assassinat de Kirk, la gauche en danger

L'assassinat de Charlie Kirk, dirigeant de 31 ans de l'organisation de jeunesse d'extrême droite Turning Point USA, a intensifié la polarisation politique aux États-Unis et entraîné des appels du mouvement « Make America Great Again » (MAGA) de Trump à éliminer la gauche de la vie politique américaine.
Hebdo L'Anticapitaliste - 767 (18/09/2025)
Par Dan La Botz
Kirk a été assassiné d'une balle de fusil alors qu'il s'exprimait à l'université de la vallée de l'Utah, à Orem. Deux jours plus tard, Tyler Robinson, étudiant de 22 ans, s'est rendu à la police et a été inculpé de meurtre. Ses motivations restent à ce jour incertaines.
Charlie Kirk, fer de lance de la jeunesse MAGA
Kirk était un fidèle partisan et ami de Donald Trump, qui voyait dans son organisation Turning Point USA le mouvement de jeunesse du camp MAGA. En 2024, le groupe avait mobilisé la jeunesse en faveur de Trump, contribuant à sa victoire à la présidentielle.
Kirk était un nationaliste chrétien blanc qui affirmait régulièrement que les NoirEs, en particulier les femmes noires, sont intellectuellement inférieurEs. Il soutenait que les Juifs sont responsables du « grand remplacement » des Américains blancs par des personnes racisées. Il affirmait que les femmes doivent rejeter le féminisme et se soumettre à leurs maris. Il considérait que les personnes LGBT violent la loi biblique de Dieu. Tout en prétendant défendre la liberté d'expression, son organisation Turning Point USA entretenait une « liste noire des professeurEs » destinée à expulser les enseignantEs progressistes des universités. Il déclarait que les musulmans tueraient chaque juif sur terre. Il disait que la Palestine n'existe pas et affirmait que les témoignages de famine d'enfants à Gaza sont des fakes news. Il niait le changement climatique, mentait sciemment en affirmant qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur ses causes.
La gauche, les progressistes et les libéraux sont en danger
À la suite du meurtre de Kirk, le président Donald Trump a déclaré dans une allocution nationale : « Depuis des années, ceux qui appartiennent la gauche radicale comparent de merveilleux Américains comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous observons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement. » Laura Loomer, proche de Trump, a écrit : « Nous devons réduire ces gauchistes fous au silence. Une bonne fois pour toutes. La gauche est une menace pour la sécurité nationale. »
Agitateurs de droite, politicienNEs et gouvernement profitent du meurtre pour appeler à une purge de la gauche aux États-Unis. La gauche, les progressistes et les libéraux sont en danger. Avant même le meurtre de Kirk, Trump envoyait des troupes dans plusieurs villes américaines. Plusieurs figures de droite appellent désormais à une guerre civile. Les dirigeants de groupes armés violents comme les Oath Keepers et les Proud Boys ont appelé leurs membres à se mobiliser. Nous devrons rester vigilantEs et nous organiser pour défendre nos organisations et nos droits, tout en continuant à combattre Trump, les Républicains et l'extrême droite.
Dan La Botz
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ebullitions, provocations … et mouvement d’en bas : notes sur les évènements mondiaux, 14/09/25, par VP.

Ébullitions, provocations : ainsi pourrait-on, non pas résumer, mais caractériser la tonalité générale, des derniers jours en matière internationale. Du sommet Xi-Poutine-Modi (et Kim) à Beijing, à l'assassinat de Charlie Kirk, le chaos apparent traduit des contradictions de fond.
Tiré de Arguments pour la lutte sociale
14 septembre 2025
Par aplutsoc2
Le sommet de Tianjin le 1° septembre, fantasmé par certains comme « acte de naissance du Sud global », et où l'on sait que Poutine et Xi se sont entretenus de leur désir d'immortalité dominatrice, a surtout été marqué par la venue de Modi, signifiant ainsi non un véritable rapprochement avec la Chine, mais un profond mécontentement envers les Etats-Unis, qui subissent là un nouveau revers. De plus, Xi et Modi cherchent maintenant tous deux à conforter la junte du Myanmar en grande difficulté. Mais les despotes ont tous les pieds d'argile …
En Chine, les grèves économiques et parfois les explosions de colère ont encore augmenté en nombre ces dernières semaines, dans les industries pharmaceutiques comme dans le textile, l'aérospatiale et les semi-conducteurs. En Indonésie, c'est une explosion de la jeunesse suite au meurtre policier d'Affan Kurniawan à Djakarta, énorme vague de manifestations – et de grèves – dont l'emblème, apparu auparavant chez les chauffeurs routiers, officiellement interdit, est le drapeau pirate du manga japonais One piece (photo illustrant cet article). Intégrant rapidement les images du mouvement indonésien, ainsi que celles, proches, des insurrections populaires au Sri Lanka et au Bangladesh, la jeunesse du Népal, suite à l'interdiction des réseaux sociaux (envers lesquels il ne s'agit pas seulement d'addictions mais d'intérêt vital pour communiquer avec la masse de travailleurs népalais à l'étranger qui envoient de l'argent), et au massacre de 19 manifestants, a en fait submergé, renversé et détruit la présidence, le gouvernement et le parlement, dans une sorte de fête populaire parfois sanglante qui évoquerait 1789 aux Français si leurs médias daignaient leur parler de ce qui se passe …
On notera les appellations généralement « marxistes-léninistes » ou « maoïstes », non pas des structures insurrectionnelles … mais du pouvoir renversé, des têtes coupées, en même temps totalement élitaire, capitaliste et oligarchique : le discrédit final d'une longue histoire politique s'accomplit ici, avec ces chefs maoïstes devenus des corrompus au pouvoir, qui préconisaient la « démocratie nouvelle », c'est-à-dire le capitalisme. D'une façon générale, ces insurrections témoignent à la fois de la résilience et de la puissance des jeunes prolétariats du monde, et de l'absence de perspectives politiques organisées leur permettant de pérenniser leurs victoires : au Népal aussi, un gouvernement provisoire a rapidement été constitué, promettant de nouvelles élections, mais derrière lequel Modi est (en urgence) à la manœuvre.
En Corée du Sud, une commotion nationale a été provoquée par le raid de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) au moyen de véhicules fournis par l'armée, kidnappant, agenouillant et enchainant 475 travailleurs hautement qualifiés envoyés à l'usine Hyundai Motor/LG Energy Solution, près de Savannah en Géorgie, Etats-Unis, produisant la plus grave crise diplomatique anti-américaine de l'histoire sud-coréenne. C'est précisément au même moment que l'étoile montante de l'extrême droite mondiale dans la foulée de Trump, Vance et Poutine, le jeune Charlie Kirk, est venu faire une tournée en Corée du Sud et au Japon, escorté de la fille de Steeve Banon et de chefs néofascistes locaux, pour appeler à l'organisation de la protestation mondiale des « jeunes hommes » qui en ont marre du féminisme.
A son retour aux Etats-Unis, Charlie Kirk a été assassiné lors d'un meeting dans l'Utah. Dans une grande confusion causée par la venue immédiate de J.D. Vance, les silences et les déclarations contradictoires et délirantes du nouveau chef comploto-trumpiste du FBI, Kash Patel, sur fond de tentative immédiate de dénoncer la « gauche radicale » et de faire de cet évènement un « incendie du Reichstag » – une idée qui ne circule pas, par crainte, à gauche, mais chez les MAGA offensifs -, il s'avère en fait que le principal suspect, Tyler Robinson, est issu d'un milieu ultra-MAGA, et probablement membre d'un groupe « catholique » tradi-nazi, les Groyspers, groupe qui voyait en Kirk, protestant évangélique et Christian nationalist, un ennemi, quoi que leurs idéologies soient à peu près les mêmes.
Cela n'empêche pas les trumpistes de vouloir développer une campagne de masse visant à l'appel à la violence contre la « gauche radicale » et les « wokistes », appels qui se sont d'ores et déjà internationalisés. De façon immédiate, l'affaire sert à tenter de faire le silence sur l'affaire Epstein/Trump – on notera d'ailleurs que Kirk s'était opposé en juin, avec d'autres « MAGA historiques » comme Bannon, à Trump à propos de l'intervention en Iran, et avait réclamé la publication des Epstein files avant de se raviser tout en attaquant la procureure de Trump, Pam Bondi : sa liquidation pourrait donc aussi avoir eu l'intérêt de supprimer une « étoile » montante mais pas forcément contrôlable …
L'internationalisation des appels à pleurer Charlie Kirk et à prévenir la prétendue violence des milices d'extrême gauche est en marche, et peut trouver un écho en France dans les provocations du ministre « démissionnaire » d'union des droites Bruno Retailleau. Douguine, à Moscou, et Netanyahou, en Israël, ont dit pleurer la perte d'un ami – un grand allié anti-ukrainien pour Douguine, un grand ami antisémite et « sioniste chrétien » pour Netanyahou. La présentation médiatique de ce fasciste comme un simple « influenceur conservateur » fait le lit de cette opération. Le site fasciste spécialisé dans la désignation de cibles « Riposte Laïque », bien mal nommé, a déjà expliqué que les « milices » gauchistes qui veulent interdire la « libre expression » en France vont tuer, préparant ainsi les attaques de l'extrême droite ; Kirk y a été comparé – ce qui n'est pas faux …- à Jordan Bardella, en tant que « vrai jeune homme » …
Les 110 000 manifestants à Londres dans le rassemblement raciste appelé par l'agent du Kremlin Tomy Robinson (son vrai nom : Stephen Yaxley-Lennon) sont bien sûr la pointe avancée des provocations politiques en marche.
Mais il y a, en même temps, les provocations militaires. L'envoi de 19 drones sur la Pologne par la Russie, dont nous avons parlé en relation avec la libération/expulsion des camarades bélarusses, ne s'est pas arrêté le 11 septembre : de nouvelles agressions se sont produites depuis, visant la Pologne et la Roumanie. Et c'est simultanément que le pouvoir israélien a bombardé le Qatar, non pour « punir » les chefs du Hamas, des assassins en effet, mais, sous ce prétexte, pour interdire toute négociation, laisser les otages crever et préparer l'achèvement génocidaire de la population de Gaza et l'expulsion de masse des Palestiniens de Cisjordanie, voire leur élimination génocidaire eux aussi.
Ce climat de menaces et de provocations ne doit pas conduire à la pusillanimité, car il indique qu'en haut, ils ont peur. La crise de régime en France participe de cette situation globale. Les impérialismes européens sont pris à la gorge. La France reconnait un Etat palestinien, envoie trois Rafales en Pologne, et, plus discrètement, a positionné un navire de guerre en rade de … Nuuk, capitale du Groenland. C'est tout : la loi de programmation militaire de Macron et Lecornu, quant à elle, ne vise pas à aider l'Ukraine mais à prolonger et renforcer le nucléaire militaire et civil, à assurer les profits des industriels du secteur et à conforter la place acquise de second marchand d'armes du monde par la France. Alors que campistes « de gauche » et souverainistes « de droite » prétendent que l'aide à l'Ukraine affaiblit les droits sociaux, ils se gardent bien de mettre en cause les ventes d'armes aux Emirats, à l'Egypte, à l'Inde, à Israël !
Toute la situation internationale appelle en Europe des gouvernements démocratiques représentant la majorité et répondant aux besoins sociaux, écologiques et de défense. Ceux-ci ne passent pas par les centaines de milliards des lois de programmation militaire et les armes nucléaires et de destruction massive, mais par une aide immédiate et massive à l'Ukraine, par le forçage immédiat du blocus de Gaza – et par la protection du Groenland !
Mais pour cela, comme pour les besoins sociaux et écologiques, il faut combattre et renverser les gouvernements en place !
VP, le 14/09/2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De Valmy à l’Ukraine : la force d’une nation en armes

C'était il y a bien longtemps, un 20 septembre 1792, et pourtant, comme l'écrira Goethe 30 ans plus tard, « de ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle ». Jaurès, à son tour, ne dira pas autre chose : « C'est un monde nouveau qui se lève. » Clausewitz, qui n'avait guère de sympathie pour les révolutions mais s'y connaissait en guerres, ne s'y trompa pas : « La guerre était soudain devenue l'affaire du peuple, d'un peuple de 30 millions d'habitants qui se considéraient comme des citoyens de l'État » et réussirent à stopper l'invasion.
Durant les 19e et 20e siècles, le cri de Valmy continuera de retentir dans l'Europe entière et même au-delà. Le général Giap, admirable stratège de la longue guerre d'indépendance du Vietnam et excellent connaisseur de l'histoire de France, dira combien l'inspira cette première guerre populaire couronnée par la victoire de Valmy. En 1962, l'Algérien Ferhat Abbas parlera, pour évoquer la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu, de « Valmy des peuples colonisés ».
La bataille de Valmy [1], gagnée par un peuple en armes et dont procédera, dès le lendemain, la proclamation de la République, fut en effet l'acte fondateur d'une nouvelle forme de guerre.
Y revenir aujourd'hui, à l'approche d'un anniversaire qui, vraisemblablement, ne suscitera pas en France une immense attention, est une occasion de souligner combien, de nos jours, les héritiers légitimes de Valmy sont les combattants et les combattantes d'Ukraine qui résistent aux envahisseurs poutiniens. N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon qui prononça, en 2020, un assez beau discours célébrant la victoire de Valmy contre l'invasion et l'actualité de son message sans dire un mot d'une autre nation combattant aujourd'hui l'invasion de son territoire : l'Ukraine. Il est vrai que l'on comprend mieux cette occultation nullement fortuite quand on entend le leader de la France insoumise reprendre avec servilité les éléments de langage du Kremlin, assaisonnés d'un zeste de real politik, pour disqualifier la résistance ukrainienne, coupable, forcément coupable, de ne pas céder.
Bien sûr, le monde a changé. Bien sûr, entre le canon de Gribeauval, très moderne pour son époque, et le missile à longue portée Flamingo, utilisé pour la première fois par l'armée ukrainienne en août dernier, entre les baïonnettes des soldats de l'An I et les drones qui saturent aujourd'hui le ciel ukrainien, nombre de révolutions technologiques et industrielles ont radicalement changé la donne, sans même parler des armes nucléaires. Bien sûr, au regard de la canonnade d'une journée en Argonne et de la brièveté de l'invasion austro-prussienne (deux mois : du 19 août au 22 octobre), le pilonnage quotidien que subissent depuis trois ans et demi les civils et les militaires ukrainiens représente plus qu'un changement d'échelle : l'horreur d'une guerre génocidaire sans merci, telle qu'on n'en avait plus vu sur le sol européen depuis 1945.
Et pourtant, malgré les siècles qui séparent la France d'avant-hier de l'Ukraine d'aujourd'hui, certaines correspondances sont frappantes. Sans tomber dans le piège de l'anachronisme, on peut en relever plusieurs (au nombre desquelles il n'est pas besoin de comparer les trombes d'eau qui s'abattirent sur le champ de bataille de Valmy et la boue qui y noyait les boulets avec les pluies d'automne ou la fonte printanière des neiges et la raspoutista d'Ukraine qui rend si difficiles les mouvements de troupes).
Une même arrogance des envahisseurs et l'illusion d'une victoire facile
Poutine, on s'en souvient, pensait en février 2022 que ses troupes seraient à Kyiv en quelques jours. La Crimée, huit ans plus tôt, n'avait pu être suffisamment défendue et l'« opération militaire spéciale » s'annonçait comme une promenade de campagne.
En 1792, les chefs de l'invasion austro-prussienne et les émigrés revanchards enrôlés dans ses rangs, font preuve du même aveuglement et de la même suffisance. Les premiers affrontements ont tourné à la débandade des Français, la prise de Verdun et Longwy semble ouvrir la route de Paris. Le duc de Brunswick, qui conduit les troupes prussiennes, pense pouvoir se passer de ses alliés autrichiens tant la tâche s'annonce facile. Assuré de la supériorité militaire d'une armée orgueilleuse de ses succès passés et réputée la meilleure d'Europe, Brunswick avait publié deux mois plus tôt un Manifeste comminatoire sommant les révolutionnaires de rétablir Louis XVI dans ses pouvoirs et menaçant Paris d'une vengeance exemplaire.
Le résultat ne fut pas celui escompté : loin de céder à l'intimidation, le peuple s'était soulevé, avait envahi les Tuileries, renversé la monarchie le 10 août et mis le roi sous les verrous. Les injonctions et les menaces de représailles avaient attisé la colère des Parisiens et des Français qui, dès lors, se mobilisent en masse, répondant de plus en plus nombreux à l'appel lancé par l'Assemblée législative :
Citoyens, la patrie est en danger, que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher se souviennent qu'ils sont Français et libres.
Français libres, déjà…
Dès le lendemain, une loi est votée pour une nouvelle levée en masse (la première avait eu lieu en 1791) : 50 000 hommes pour les troupes de ligne et 33 600 pour les bataillons de volontaires. Danton, comme souvent, avait su trouver les mots : dans la France entière, « tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre ». Les fédérés de Marseille le chantent : « Tout est soldat pour vous combattre », faisant connaître au fil de leur périple ce Chant de guerre de l'Armée du Rhin (également appelé Chant de marche des volontaires de l'Armée du Rhin) que les Parisiens baptiseront promptement La Marseillaise.
Rien de tout cela n'entame l'arrogance des coalisés. « N'achetez pas trop de chevaux, recommande l'aide de camp du roi de Prusse, la farce ne durera pas longtemps. Les fumées de l'ivresse de la liberté se dissipent à Paris. » Quant au colonel von Massenbach, il compare l'invasion de la France en révolution à « une simple chasse à courre ». Gibier ? Le peuple français.
Une même surprise en découvrant l'hostilité populaire
Comme ces soldats russes, gavés de propagande, qui se prétendaient libérateurs, pensaient être accueillis avec des fleurs et ne comprennent pas que tant de russophones leur crient de rentrer chez eux, les troupes austro-prussiennes sont surprises de n'être pas reçues à bras ouverts et s'irritent de l'hostilité de la population française. Certains officiers s'étonnent que des gens de peu qui devraient rester à leur place et même des domestiques s'enhardissent jusqu'à leur faire la leçon et les invitent à repasser au plus vite la frontière en sens inverse. D'autres se scandalisent que, jusque dans les églises, des prêtres patriotes fassent des sermons appelant à résister (comme, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, de nombreux popes ayant rompu avec le patriarcat de Moscou).
Les paysans se murent dans un silence hostile, cachent les denrées et refusent de nourrir les envahisseurs. Dans les bois et sur les chemins, des partisans et des francs-tireurs harcèlent les soldats ennemis. Le prince de Ligne, qui sera tué une semaine avant la bataille de Valmy, constate cette animosité omniprésente : « Nous commençons à être las de cette guerre où Messieurs les émigrés nous promettaient plus de beurre que de pain », ajoutant que les troupes françaises ne désertent pas et que « les paysans sont armés et nous assassinent » à la première occasion. Deux jours après Valmy, l'archiduc Charles, frère de l'empereur d'Autriche, fera le même constat : « Nous avons trouvé les paysans de plus en plus épris de la nouvelle Constitution et de plus en plus hostiles à nous autres » ; il en tire, après la défaite, cette conclusion navrée mais lucide : « Il faut regarder comme absurde et impossible le projet des émigrés français de tout rétablir sur le pied d'autrefois. »
Les hauts gradés russes et leur chef suprême, le dictateur du Kremlin, n'ont hélas pas été touchés par la grâce d'une semblable lucidité, fût-elle tardive. Face au rejet et à la résistance du peuple ukrainien, leur réponse est à l'inverse : intensification des destructions meurtrières avec pour seul objectif l'éradication de la nation ukrainienne.
En 1792, l'armée d'invasion venue rétablir la monarchie et les privilèges de la noblesse n'avait pas pris la mesure de la haine accumulée dans les campagnes contre les droits seigneuriaux : les paysans ne veulent plus être « esclaves d'un superbe seigneur, objets de mépris aux yeux d'un riche insolent ». Elle n'avait pas pris la mesure, non plus, de l'attachement du peuple à ses conquêtes de liberté et d'égalité politique (il vient d'être décidé que l'Assemblée serait désormais élue au suffrage universel… masculin).
En Ukraine, l'armée d'invasion venue vassaliser son voisin n'a pas non plus pris la mesure de la longue mémoire de l'oppression russe, constitutive de l'identité ukrainienne, ni de l'intensité du désir de liberté et d'indépendance d'une nation qui refuse de plier.
« Europe esclave ou Europe libre » : l'enjeu ainsi résumé par les révolutionnaires d'antan vaut plus que jamais pour aujourd'hui et c'est désormais le peuple ukrainien qui combat en première ligne.
Un même mépris pour le peuple qu'on vient remettre au pas
Edmund Burke, homme politique et philosophe d'outre-Manche dont les Réflexions sur la révolution de France sont un pilier de la pensée réactionnaire, décrivait les volontaires de Valmy comme « une troupe de comédiens ambulants, un pitre à leur tête ». Le régime du Kremlin et ses affidés traitent régulièrement le président Zelensky de comédien raté et de « clown pitoyable », voire « cocaïné ». La disqualification est sommaire et la veine similaire…
Taine, autre penseur réactionnaire hostile à la Révolution française, aura pour les volontaires nationaux ces mots de mépris : « On a puisé à la pelle et au rabais dans le fumier social. »
Un paternalisme sans fard prétend faire le bonheur du peuple sans qu'il ait voix au chapitre : « Nous vous rendrons un monarque bon père » (les émigrés vus par Chateaubriand).
Quinze jours après sa défaite à Valmy, Brunswick n'en démord pas : « Quand je suis venu en France, je n'avais d'autre but que de concourir à rétablir l'ordre. »
Poutine aussi veut « rétablir l'ordre » en installant à Kyiv un régime fantoche qui restaure une sujétion pluriséculaire ! Un représentant des armées de la République rétorque lors de ce piquant échange qui a tout du dialogue de sourds : « Permettez-moi de vous demander quelle est la puissance qui vous a placé intermédiaire entre le peuple français et son intérêt. » À quoi Brunswick, qui ne semble pas comprendre la question, répond : « J'insiste pour que la nation française, connaissant mieux ses intérêts, revienne à des principes modérés. » Comprendre : les Français ne savent pas ce qu'ils font en mettant à bas l'ordre ancien. De même que les Ukrainiens ne savaient pas ce qu'ils faisaient en mettant dehors Ianoukovitch… La répartie du Français est savoureuse :
Si c'est l'auteur du Manifeste qui parle, alors je ne puis lui répondre qu'à coups de canons. Si c'est au contraire l'ami de l'humanité, je lui dirai que la meilleure preuve qu'il puisse nous donner à notre égard est d'évacuer le territoire français.
Deux visions du monde, deux visions du peuple : acteur souverain pour le révolutionnaire, privé de tout pouvoir d'agir par lui-même pour le bras armé des cours d'Europe.
Lors des pourparlers entre ceux de l'armée vaincue et ceux de l'armée victorieuse, les Prussiens demandèrent à négocier avec un envoyé du roi, alors que la République vient d'être proclamée et que les seuls interlocuteurs légitimes sont ses représentants ! On pense, une fois encore, à Poutine affirmant que le président Zelensky, démocratiquement élu, n'est pas légitime et qu'il ne saurait être un interlocuteur crédible faute de nouvelles élections (inorganisables en pleine guerre et interdites, dans ce contexte par la Constitution ukrainienne). Hier comme aujourd'hui, le même déni impavide de la volonté populaire.
Une même mobilisation populaire pour défendre le droit de son peuple à disposer de lui-même
Sauver la patrie en danger devient, en 1792, l'affaire de tous les citoyens. Les volontaires affluent aux tables d'enrôlement dressées par les municipalités. Ils viennent de toutes les régions et parlent souvent des langues différentes. Le prussien Laukhard, ensuite rallié à la Révolution, décrira en ces termes les artisans de la première victoire militaire d'une guerre populaire :
Sans doute, ils n'étaient pas tirés au cordeau, aussi astiqués, aussi dressés, aussi habiles à manier le fusil et à marcher au pas que les Prussiens. Ils ne savaient pas non plus se sangler dans leurs tuniques mais ils étaient dévoués, corps et âme, à la cause qu'ils servaient […]. Presque tous ceux que j'ai rencontrés savaient pour qui et pour quoi ils se battaient et se déclaraient prêts à sacrifier leur vie pour le bien de leur patrie. Ils ne connaissaient d'autre alternative que la liberté ou la mort.
Ils viennent de la campagne et de la ville, représentent tous les métiers : compagnon d'atelier, carreleur, fouleur de drap, sabotier, forestier, laboureur, journalier, berger mais aussi étudiants, membres des professions juridiques et médicales, artisans du monde de l'échoppe et de la boutique. Des travailleurs du bâtiment et de l'habillement, des ingénieurs et des géomètres, des perruquiers, des nobles acquis aux idées nouvelles, des bourgeois et des prolétaires, des sans-culotte épris d'égalité.
Cette levée en masse de 1792 évoque celle de février 2022 en Ukraine, qui vit affluer dans les rangs de la Défense territoriale des volontaires de toutes origines et de tous milieux, eux aussi souvent sans expérience militaire préalable, dont l'engagement fut décisif notamment pour la protection de Kyiv.
En 1792, on consigne dans les mairies les dons en argent et en nature pour armer, habiller et nourrir les Volontaires qui s'enrôlent. Français et Ukrainiens durent, les uns comme les autres, généralement s'équiper eux-mêmes, pour pallier les carences de l'État et parer aux urgences, avec l'aide de leurs proches, de collègues de travail et de collectes solidaires qui, en Ukraine, continuent plus que jamais.
Aujourd'hui comme hier, « la force des faibles », titre de l'excellent livre d'Anna Colin Lebedev qui rend hommage aux capacités d'initiative et d'auto-organisation de la société civile ukrainienne ainsi qu'à ses mille manières de soutenir ses forces armées, pousse à co-construire la défense du pays. Si l'Ukraine a pu tenir, explique Olena Tregub, spécialiste de la réforme du secteur de la Défense et de la lutte contre la corruption, dans une tribune publiée dans Le Monde le 21 mai dernier, « c'est aussi grâce à la volonté et à l'ingéniosité de sa population ». « Tout le pays s'est mobilisé, nos agriculteurs, nos ingénieurs, nos enseignants, nos informaticiens, nos artistes, nos fonctionnaires », ajoutait-elle en soulignant l'efficacité, la réactivité et la capacité d'innovation des réseaux locaux décentralisés qui ont renforcé les liens entre le peuple et son armée.
En 1792, malgré le canon de Gribeauval qui donnait aux troupes françaises la supériorité d'une artillerie moderne et mobile, on manquait cruellement d'armes. Les directoires des districts invitaient les gardes nationaux à se munir d'armes et de munitions mais aussi de vieux fusils, de pioches, de haches, de bêches. Les maréchaux-ferrants et les serruriers se mirent à fabriquer au plus vite des piques en fer à fixer sur un manche pour en faire des lances.
En Ukraine, pour faire face à l'invasion, on s'est mis à fabriquer toutes sortes de drones, dans les cuisines et dans des ateliers parfois montés en urgence ; des milliers de petites mains se sont mises à tresser des filets de camouflage.
A l'une comme à l'autre époque, la mobilisation créative de la société civile s'est avérée décisive car, dans une guerre populaire où l'asymétrie est la règle, c'est ce qu'on appelait jadis la « fraternité civique » qui permet aussi de tenir et de remporter des victoires. Le général Giap a expliqué combien, à Dien Bien Phu, les milliers de Vietnamiens et de Vietnamiennes qui assurèrent le transport des vivres et des pièces d'artillerie à l'insu de l'ennemi, ont été des artisans déterminants de la victoire car, dans la guerre révolutionnaire, la logistique assurée par la population est aussi importante que la tactique militaire.
« Toute la France était en mouvement pour pourvoir aux besoins de son armée », dira un officier anglais qui avait rallié la Révolution. Derrière chaque arme, écrit Anna Colin Lebedev, il y a un Ukrainien prêt à combattre et de nombreux autres qui soutiennent son combat, des centaines de milliers de citoyens qui répondent aux besoins des unités engagées sur le front et constituent « le tissu social de la défense ».
Une même acculturation réciproque entre soldats de métier et volontaires en armes
Sur le plateau d'Argonne, convergèrent les troupes de ligne de la « ci-devant armée royale », soldats de métier plus expérimentés, les volontaires nationaux enthousiastes mais peu familiers de la guerre, des fédérés de la Garde nationale, des membres des corps francs et de légions étrangères. Nombre de « patriotes étrangers » s'étaient engagés dans les rangs révolutionnaires : belges, anglais, polonais, irlandais, allemands… et même latino-américains comme Francisco de Miranda, combattant de l'indépendance vénézuélienne qui se battit à Valmy avec le grade de maréchal de camp. Des déserteurs du camp d'en face les rejoignirent parfois car ils avaient « abandonné le service du despotisme » et choisi de « vivre au sein d'une nation libre » en lui apportant leur courage.
De cette armée hétérogène, il fallut faire un corps soudé. Il y eut, au début, des frictions, des rivalités, parfois des rixes entre les « faux-culs blancs » (l'armée de ligne) et « la porcelaine bleue qui ne sait pas aller au feu » (les volontaires), ceux dont les cadres étaient nommés et ceux qui élisaient les leurs, ceux rompus à la discipline militaire et ceux, plus rétifs, qui ne l'acceptaient que très librement consentie. Peu à peu, on fraternisa. « Bluets » et « habits blancs » étaient majoritairement des jeunes âgés de moins de 25 ans. Ces troupes disparates réussirent à s'hybrider en s'apportant mutuellement : l'ardeur révolutionnaire des uns se communiqua aux autres, qui découvraient qu'ils avaient des droits, cependant que ceux-ci apportèrent en retour, à ceux qui n'avaient pas reçu d'instruction militaire, leur expérience des combats et de la fermeté sous le feu, le tout dans une armée démocratisée.
Le général Kellermann sut galvaniser l'ardeur patriotique de ses troupes au cri de « Vive la Nation ! » dont la clameur ne cessa de s'élever dans les rangs français et surprit l'ennemi. A chaque boulet français qui fait mouche et à chaque boulet ennemi qui rate sa cible, on crie « Vive la Nation ! ». Chaque régiment avait jusqu'à ce jour son propre cri de ralliement, « Vive la Nation ! » devint celui de tous. La bonne tenue au feu et la combativité des Français désarçonnèrent les Prussiens qui pensaient facilement casser « de la faïence bleue ». Quand un soldat tombe, les rangs se reforment aussitôt. Aucune attaque prussienne n'ébranle la détermination des forces révolutionnaires. Toute la journée, 36 canons crachent 20 000 boulets jusqu'à ce que Brunswick donne le signal de la retraite. Une nouvelle armée est née à Valmy dont ce qu'on appellera l'« amalgame » sera achevé par Carnot.
L'Ukraine aussi procédera à une intégration plus poussée des volontaires de la Défense territoriale et de son armée de métier mais dans les conditions infiniment plus difficiles d'une guerre qui dure et d'une pénurie de militaires face à l'inépuisable chair à canon que Poutine utilise et sacrifie sans compter pour détruire l'Ukraine. À Valmy, la supériorité numérique était à l'avantage des Français, en Ukraine, elle est à l'avantage des envahisseurs. Mais on y observe aussi des processus d'acculturation mutuelle entre volontaires et militaires de carrière, entre armée et pratiques de la vie civile : « La société civile s'est militarisée et l'armée s'est civilianisée », note Anna Colin Lebedev qui observe combien les Ukrainiens et les Ukrainiennes assument désormais d'être une nation en armes, fière de tenir tête et de tenir bon. Ceux de Valmy disaient la même chose.
Un même idéal de soldat-citoyen qui conserve ses droits sous l'uniforme
Valmy mêla dans un même élan des soldats devenus citoyens, ceux des anciens régiments de ligne qui découvraient leurs droits nouveaux, et des citoyens devenus soldats pour un temps, volontaires qui avaient pris les armes et appris à se battre sur le tas. Conjuguer la liberté du citoyen et la discipline du soldat, tel était l'objectif dans une armée qui se voulait à l'image de la nation tout entière (quoiqu'excluant les femmes du droit de porter les armes comme du suffrage universel).
De nos jours, c'est l'armée ukrainienne, de loin la plus aguerrie d'Europe, qui incarne le mieux cet idéal. On n'y prend pas la discipline à la légère et nul n'en conteste la nécessité pour combattre efficacement, mais la liberté de parole, d'expression publique et au besoin de critique est sans commune mesure avec les pratiques des autres armées et cela malgré la guerre. L'armée ukrainienne est le contraire exact de ce que fut la « Grande Muette ». Sous l'uniforme, ses soldats restent pleinement des citoyens. Nulle autre armée au monde ne permet à ses militaires d'arborer sur leur uniforme un écusson LGBT et de participer en uniforme à la Gay Pride de Kyiv. Peu d'autres armées ont su se réformer à l'écoute du « bataillon invisible » (femmes soldates) en matière d'égalité des droits entre les hommes et les femmes sous les drapeaux.
Il ne s'agit pas ici de brosser un tableau idyllique : il reste dans ses rangs des machos invétérés et des homophobes (ce sont souvent les mêmes), des plafonds de verre et des décisions arbitraires, des discriminations à l'égard des couples de même sexe (le mariage pour tous n'existe pas en Ukraine). Mais pour les combattre, les militaires y sont moins démunis qu'ailleurs, peuvent en appeler à des syndicats de soldats LGBT, à des ONG de défense des droits, à l'opinion publique.
Jadis, un député du tiers état avait résumé l'enjeu : « Tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen. » Il plaidait pour une conscription obligatoire : dans l'Europe contrainte de repenser sa défense face à la menace russe et au désengagement américain, la question de la conscription revient en force dans les pays qui l'ont abolie et, plus largement, celle du lien entre la nation et ses forces armées (sujet du livre de Jaurès L'armée nouvelle, qui avait en tête le modèle des armées révolutionnaires et l'idée d'une défense nationale reposant sur des citoyens en armes, à l'opposé à bien des égards des conceptions du général de Gaulle dans Vers l'armée de métier).
Olena Tregub, dans sa tribune déjà citée, insiste sur la nécessité pour l'Europe de « réorganiser sa défense comme une mission incombant à chaque citoyen », car « elle doit s'appuyer non seulement sur ses chars mais sur ses citoyens », civils et militaires.
Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : pour que chaque citoyen se fasse soldat, il faut aussi que le soldat soit pleinement reconnu comme un citoyen doté de la plénitude de ses droits démocratiques. Là est, outre les armes évidemment nécessaires, la dialectique vertueuse la plus dissuasive contre toute agression. Des expériences fondatrices de Valmy à celles, actuelles, de l'Ukraine, il y a matière à poursuivre le débat.
Une même peur de la contagion des idées de liberté
L'Ukraine est pour l'autocrate du Kremlin l'exemple intolérable d'un affranchissement qui la soustrait à l'impériale domination de la Russie. Un ferment dangereux dans les ex-Républiques soviétiques que Moscou veut de nouveau arrimer à son char. Un risque qui pourrait fissurer la chape de plomb que le régime poutinien fait peser sur le peuple russe. C'est pourquoi il lui faut à tout prix administrer la preuve que la lutte de l'Ukraine pour son indépendance et sa souveraineté est sans espoir. La peur de la contagion est un puissant moteur de la guerre effrénée qu'il lui livre.
Au temps de Valmy aussi, la croisade des Austro-Prussiens pour rétablir la monarchie en France devait beaucoup à la crainte que le virus de la liberté, de l'égalité et de la fraternité se diffuse dans tout le continent. Des commissaires à la levée en masse l'expliquaient en ces termes aux volontaires d'une commune de l'Aube : l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse « ne se sont unis contre nous qu'à cause de l'inquiétude que leur donne la marche rapide de notre révolution ; le système de liberté que nous avons adopté les effraye ; ils craignent que les peuples ne partagent notre bonheur ; ils tremblent de voir troublé le sommeil de l'esclavage ; c'est à cause de la tyrannie qu'ils redoutent le voisinage et l'exemple de la liberté. C'est pour river de plus en plus les chaînes de leurs peuples qu'ils entreprennent de nous rendre nos fers ». Mais, ajoutaient-ils, nous continuerons d'avancer « sur les ruines des donjons des antiques oppresseurs ».
Tel est aussi le message que nous délivre l'opiniâtre et courageuse résistance ukrainienne. Dans un monde où s'affirment des autocraties belliqueuses et la loi du plus fort, dans un monde où, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, les collabos poutinophiles ou poutino-compatibles sont légion, vouloir la victoire de l'Ukraine et l'aider à vaincre, c'est défendre ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui vaut de Kyiv à Gaza. N'en déplaise aux campistes hémiplégiques qui refusent de prendre la mesure de l'impérialisme russe. C'est aussi nous défendre car l'Ukraine est aujourd'hui le premier rempart de la sécurité et de la souveraineté française et européenne.
Alors oui, de même que tant de peuples en lutte pour leur émancipation se sont emparés de la Marseillaise, des révolutionnaires russes de 1917 aux jeunes de la place Tien An Men en passant par les républicains espagnols et bien d'autres encore qui se sont reconnus dans son message appelant à combattre les tyrans et les despotes, de même la résistance ukrainienne doit être une source d'inspiration pour tous ceux et toutes celles qui, en Russie et hors de Russie, luttent pour leur liberté.
Avec la Révolution française et la victoire inaugurale de Valmy se leva une espérance pour les peuples alentour, qui gagna ensuite les autres continents et fut retournée contre la « Grande France » et ses aventures coloniales quand la République se fit oublieuse de ses principes fondateurs. En ce temps-là, l'Américain Thomas Paine et l'Allemand Anacharsis Cloots furent tous deux élus à l'Assemblée nationale française car « patriotes étrangers » exemplaires.
En Ukraine aussi, des combattants internationalistes ont rejoint les rangs de l'armée ou de légions étrangères. Certains ont payé leur engagement de leur vie. Parmi la forêt de drapeaux et de photos qui donne, sur la place Maïdan, un aperçu partiel mais spectaculaire du nombre de soldats et soldates morts au combat, des combattants étrangers sont également honorés et un carré français mentionne ceux venus de France.
Les mêmes négationnismes et complotismes pour salir la lutte
La victoire de Valmy à l'issue d'une bataille d'une journée ne fut pas un événement militaire majeur mais l'acte de naissance d'une nouvelle forme de guerre, celle – populaire et révolutionnaire – d'une nation en armes ne s'autorisant que d'elle-même. Son impact fut immense, suscitant l'enthousiasme des épris de progrès et l'horreur des réactionnaires de tout acabit.
Quelques commentaires de l'époque montrent comment leur défaite fut vécue par ceux qui avaient tenté en vain de faire tourner la roue de l'histoire en arrière. Le général suédois Wolfradt confia au colonel prussien von Messenbach :
Vous allez voir comme la crête va pousser à ces jeunes coqs […]. L'opinion qu'ils avaient de notre esprit militaire avait baissé ; l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes avait grandi. Nous avions perdu plus qu'une bataille, nous avions perdu notre renommée.
Pour contrer l'écho de Valmy, se mirent en place des contre-récits visant à en minimiser l'importance et surtout à minorer le rôle de la mobilisation populaire. On commença par dire que cette bataille n'en était pas vraiment une, seulement une très modeste canonnade. On assura qu'une armée de sans-culottes n'aurait jamais pu l'emporter sur la meilleure armée d'Europe s'il n'y avait pas eu complot et traîtrise.
On souligna que si Brunswick avait sonné la retraite c'est qu'il était pressé de participer au partage de la Pologne. On évoqua de sombres manigances de la franc-maçonnerie, présente dans les deux camps. On mit la défaite sur le compte de la dysenterie. On supposa que Danton avait organisé le vol des diamants de la couronne pour acheter l'armée prussienne. On fit et on diffusa toutes sortes de supputations dont le point commun était que jamais, au grand jamais, les peuples ne sont eux-mêmes auteurs et acteurs de leur histoire.
Contre l'Ukraine aussi, les mêmes ressorts furent activés par le régime poutinien, combinant déni de réalité et mensonges éhontés. Maïdan ne fut pas une insurrection populaire et démocratique mais un putsch ourdi par l'OTAN, les Américains, l'Europe, Georges Soros et tous les russophobes décidés à nuire à la Russie. Le peuple ukrainien, son auto-organisation des semaines durant lors de la révolution de la dignité, sa volonté massivement exprimée, sa solidarité et sa détermination collectives ? Un leurre pour masquer le complot des ennemis de la Russie.
Le vol de la Crimée ? Un juste retour de la péninsule dans son giron historique. La déstabilisation du Donbass avec l'aide des petits hommes verts ? Le sursaut spontané de russophones menacés de génocide. La guerre d'agression ? Un acte de légitime défense et une fraternelle main tendue de la Grande à la Petite Russie, nations sœurs que rien ne saurait séparer.
D'un siècle à l'autre, les ficelles de la disqualification se ressemblent…
Une même fierté de nation prenant son destin en main
La naissance d'une nation est à la fois une lente gestation, enracinée dans une histoire au long cours, et le fruit de soudaines accélérations où, souvent sous l'effet de la résistance à une guerre injuste, tout se cristallise rapidement. Ce fut vrai pour la France de Valmy. Ça l'est plus que jamais pour l'Ukraine d'aujourd'hui.
Deux nations en armes se sont retrouvées, à deux époques bien différentes, soudées contre une invasion et fières de n'avoir pas plié. Il en coûte mille fois plus cher à l'Ukraine meurtrie, endeuillée, ravagée, pillée et amputée de tant de ses forces vives. Et pourtant, malgré la fatigue, l'usure, le stress permanent, malgré une aide internationale qui n'a jamais été et n'est toujours pas à la hauteur de ses besoins, le pays refuse de capituler et ses habitants tiennent tête au tyran.
Il faudra dire un jour non pas ce que l'Europe doit à la résistance ukrainienne mais ce que l'humanité entière lui doit. Valmy fut un signal.
L'Ukraine est aujourd'hui un exemple. Nul besoin que tout y soit parfait pour qu'il nous inspire et nous donne du courage.
300 morts côté français à Valmy, des centaines de milliers de tués et de blessés en Ukraine. Les guerres modernes sont devenues infiniment meurtrières mais la seule chance de gagner une guerre juste en dépit d'un rapport de force défavorable, numériquement et matériellement, reste, comme la longue guerre remportée par les Vietnamiens nous l'a montré, qu'une nation en armes finit pas être plus forte que les B52 et les missiles balistiques, que la solidarité internationale, des gouvernements et des peuples, est vitale.
A Valmy, nos soldats furent plus forts de l'adhésion d'une nation dressée à leurs côtés.
En Ukraine, ceux qui combattent sur le front et ceux qui résistent dans les territoires actuellement occupés sont plus forts des mille canaux de solidarité que toute la société ukrainienne a construits et fait vivre pour eux.
[1] Nombre des informations relatives à Valmy dans cet article doivent beaucoup au livre de Jean-Paul Bertaud, Valmy : la démocratie en armes, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2013.
Sophie Bouchet-Petersen
Sophie Bouchet-Petersen est secrétaire générale de l'association Comb'Art et membre du Comité français du RESU.
Publié dans : Soutien à l'Ukraine résistante N°42 – 12 septembre 2025
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/15/bernard-dreano-comment-aborder-des-sujets-difficiles/
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-42.pdf

Une réponse aux appels au boycott de Standing Together (Israël)

Le Comité académique palestinien pour le boycott d'Israël (PACBI) [1], un organisme de premier plan au sein du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), et la Palestine Solidarity Campaign (PSC) [2] au Royaume-Uni, ont publié de nouveaux appels au boycott de Standing Together, ciblant cette fois également le réseau des Amis de Standing Together, y compris les Amis britanniques de Standing Together. Leurs textes reprennent et développent les thèmes d'une précédente déclaration, publiée en janvier 2024.
En réponse à la déclaration de janvier 2024, les membres palestiniens de la direction de Standing Together ont écrit : « La lutte pour la libération palestinienne est multiforme. En tant que mouvement opérant en Israël, nous avons assumé un rôle spécifique : faire évoluer l'opinion publique israélienne pour qu'elle cesse de soutenir une politique qui maintient et approfondit l'assujettissement des Palestiniens. »
Aucune tentative n'a été faite pour répondre à la déclaration des dirigeants palestiniens de Standing Together. Les nouvelles déclarations du PACBI et de la PSC se caractérisent également par une absence quasi-totale de référence aux activités réelles de Standing Together.
Nous encourageons tous les lecteurs à se faire leur propre opinion sur cette question, et à lire les appels au boycott dans le contexte du bilan de Standing Together.
Ces dernières semaines et ces derniers mois, Standing Together a :
Organisé plusieurs manifestations à la frontière de Gaza, y compris en s'engageant dans la désobéissance civile qui tentait de bloquer les véhicules de transport de troupes
Mené des actions directes perturbatrices à l'aéroport Ben Gourion et perturbé des émissions télévisées en direct
Mené campagne de manière constante pour encourager les soldats israéliens à refuser les ordres illégaux
Confronté physiquement les colons d'extrême droite et mis en échec leurs tentatives d'entraver les camions d'aide
Conduit sa propre campagne « Aide à Gaza », collectant des dons à travers Israël, notamment dans les communautés palestiniennes du nord
Soutenu les communautés arabo-bédouines du Néguev/Naqab [3] pour résister aux déplacements
Collecté des fonds participatifs pour construire des abris anti-bombes dans les communautés arabo-bédouines non protégées pendant la guerre d'Israël avec l'Iran
Mobilisé pour défendre les Palestiniens et les entreprises dirigées par des Palestiniens dans Jérusalem-Est occupée contre les attaques de foules racistes
Soutenu et organisé des manifestations, grèves et autres actions directes nationales pour exiger un cessez-le-feu
Répandu de la peinture rouge devant la résidence du chef d'état-major de Tsahal [4]
Organisé un die-in [5] devant le quartier général de l'armée à Tel-Aviv
Ces actions sont-elles utiles ? La cause palestinienne serait-elle mieux servie si le mouvement qui organise ces actions n'existait pas ?
Les récentes déclarations du PACBI et de la PSC se caractérisent également par une fixation sur les formes de langage plutôt que sur la politique pratique. Les termes que nous utilisons pour décrire les choses importent. Mais attaquer Standing Together pour ne pas utiliser certains mots, tout en ne faisant aucune référence à ce que Standing Together fait réellement, privilégie le linguistique sur le matériel. En tout cas, les attaques sont inexactes selon leurs propres termes : Standing Together fait référence à la politique d'Israël en Cisjordanie comme de l'apartheid, et décrit la guerre à Gaza comme génocidaire.
Contrairement aux affirmations du PACBI et de la PSC, Standing Together n'assimile pas oppresseurs et opprimés. Ils reconnaissent et se mobilisent pour résister aux structures violentes qui maintiennent l'inégalité entre Palestiniens et Juifs israéliens.
La Théorie du changement du mouvement déclare : « Nous prendrons un rôle actif dans la lutte pour mettre fin au contrôle d'Israël sur le peuple palestinien. » Elle affirme que « le régime actuel sert les intérêts d'un petit groupe — l'élite financière capitaliste et l'élite politique de construction de colonies — aux dépens des intérêts de la majorité », tout en reconnaissant que le régime « reste dépendant du consentement de la majorité ».
Standing Together se mobilise parmi la minorité palestinienne en Israël, une communauté de deux millions de personnes représentant près d'un tiers de la population palestinienne entre le Jourdain et la Méditerranée. La moitié de l'organe dirigeant de Standing Together est composée de Palestiniens. Le fait de leur citoyenneté israélienne ne rend pas ces personnes moins palestiniennes.
Ils ont écrit : « Nous croyons qu'il est politiquement efficace d'argumenter que l'oppression, le racisme et le sectarisme nuisent aux gens de l'oppresseur aussi bien qu'aux opprimés. Le mal n'est nullement égal, bien que le rôle de l'intérêt personnel dans l'organisation politique ne doive pas être sous-estimé. Nous travaillons sous l'hypothèse de base que des millions de Palestiniens et des millions de Juifs vivent sur cette terre aujourd'hui, et personne ne va nulle part. Mettre fin au contrôle israélien sur les Palestiniens et forger une société dans laquelle chacun est libre et égal entre le fleuve et la mer est dans l'intérêt à la fois des Palestiniens et des Juifs israéliens. »
Les lecteurs devraient considérer les perspectives des Palestiniens de Standing Together concernant leur propre mouvement : « Standing Together est la seule organisation qui nous a fourni, à nous et à des dizaines de milliers de citoyens palestiniens d'Israël, un refuge politique sûr pendant ces temps difficiles, un endroit pour exiger un cessez-le-feu, pleurer en sécurité, et nous organiser pour un avenir où nous sommes libres et égaux dans notre patrie. »
Standing Together est un mouvement en croissance, et les efforts pour le boycotter n'ont pas affecté cela. Mais s'ils devaient le faire, les bénéficiaires ne seraient pas le peuple palestinien, mais le gouvernement israélien. Comme l'ont dit les dirigeants palestiniens de Standing Together : « Les efforts pour faire taire et isoler Standing Together ne servent pas la cause palestinienne, ils servent les intérêts de l'establishment politique d'Israël, qui tente aussi de nous faire taire. »
Des militants de Standing Together ont été arrêtés pour leurs actions, notamment lors d'une manifestation d'août devant la résidence du chef d'état-major de Tsahal, et d'une manifestation à la frontière de Gaza en mai. En août, une collecte de fonds de Standing Together à Jérusalem a été interdite, la police alléguant qu'elle pourrait « servir le Hamas [6] ». Les autorités de l'Université de Haïfa [7], où près de 50 % des étudiants sont palestiniens, ont interdit la section Standing Together en avril, après qu'elle ait organisé une manifestation où des images d'enfants tués à Gaza étaient affichées. L'interdiction a été par la suite annulée après une campagne locale. En avril, la police a tenté d'interdire aux manifestants lors d'un rassemblement anti-guerre organisé par Standing Together d'afficher des photos d'enfants morts, ou des pancartes utilisant le mot « génocide ». Les militants ont défié la tentative d'interdiction. En janvier 2024, une manifestation de Standing Together à Tel-Aviv a été entièrement interdite, forçant les organisateurs à réorganiser l'événement.
Si les affirmations faites par les partisans de la position PACBI/PSC, selon lesquelles Standing Together « apaise », « normalise », ou « blanchit » les actions d'Israël étaient vraies, pourquoi l'État israélien ferait-il de tels efforts pour les supprimer ?
Quiconque veut voir un mouvement anti-guerre, anti-occupation plus fort en Israël devrait soutenir celui qui existe actuellement, et l'aider à grandir.
Les Amis britanniques de Standing Together restent ouverts à travailler avec la Palestine Solidarity Campaign et ses soutiens partout où nous sommes d'accord, par exemple en faisant campagne pour exiger la fin des licences d'exportation d'armes vers Israël et dans les manifestations pour exiger une fin immédiate au génocide en cours à Gaza. Les militants de la PSC qui veulent l'unité dans l'action chaque fois que possible, tout en respectant les différences politiques, seront toujours les bienvenus à nos événements.
UK Friends of Standing Together
Contact : ukfriendsofstandingtogether@gmail.com
Social media : @uk_fost on Twitter | @omdimbeyachad on Instagram | Facebook
More information : standing-together.org
P.-S.
https://ukfost.co.uk/solidarity-with-standing-together-a-response-to-calls-for-a-boycott
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76304
Une correction a été apportée le 20 septembre, concernant le Comité académique palestinien pour le boycott d'Israël (PACBI) : « un organisme de premier plan » [et non dirigeant] au sein du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS)

De la « guerre des 12 jours » aux sommets de l’OTAN et de l’UE : un bond en avant dans la militarisation, sous les ordres du trumpisme

« Comme le souligne l'historien anglais Edward P. Thompson, la guerre nucléaire n'est pas seulement imaginable, elle a déjà été imaginée et menée à deux reprises, contre les populations d'Hiroshima et de Nagasaki. L'inimaginable, dit Thompson, semble être que cela nous arrive, mais pas que nous l'infligions à d'autres. » Manuel Sacristán, « Le danger d'une guerre avec des armes nucléaires », El País, 16 janvier 1983
Quatrième internationale
16 septembre 2025
Par Jaime Pastor
La déclaration commune de l'OTAN, signée le 25 juin lors de sa réunion à La Haye, peu après la guerre de 12 jours contre l'Iran, a confirmé la subordination des puissances européennes – menées par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, à la stratégie trumpiste de remilitarisation de l'Europe dans un cadre mondial de concurrence interimpérialiste et de responsabilité partagée du bloc transatlantique dans le génocide que l'État d'Israël continue de perpétrer contre le peuple palestinien.
En outre, le sommet a eu lieu après l'agression lancée d'abord par Israël, puis par les États-Unis, contre l'Iran, en recourant à l'argument bien connu selon lequel le régime iranien produisait des armes nucléaires, comme ce fut le cas en 2003 avec l'Irak. Une fois de plus, ces deux pays ont mené une guerre illégitime et illégale au regard du droit international, soutenus par leurs alliés européens, invoquant une fois de plus, dans leur langage orwellien classique, le « droit légitime à la défense »... des États agresseurs, qui possèdent tous deux des armes nucléaires. L'actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est distingué par ses félicitations pour cette attaque, dont le niveau de servilité et de flatterie envers Trump, promettant que « l'Europe paiera CHER, comme il se doit, et ce sera sa victoire », semble sans limites (1).
Au-delà du triomphalisme discutable du dirigeant américain sur les résultats de son attaque contre l'Iran, alors que même des rapports officiels s'interrogent sur la destruction effective des installations iraniennes d'enrichissement et de stockage d'uranium, ce qui semble clair, c'est que la possibilité d'une reprise de ces attaques dans une zone géostratégique clé – comme elle l'est également pour la Chine – continuera d'être une menace permanente, en particulier de la part de Netanyahou, déterminé à s'imposer par la force comme la puissance dominante dans la région.
La différence avec ce qui s'est passé en 2003 est que, alors que la France et l'Allemagne s'étaient opposées au trio des Açores (Bush, Blair et Aznar) dans la guerre contre l'Irak, leurs dirigeants actuels ont désormais affiché une acceptation honteuse et scandaleuse de leur rôle de vassaux vis-à-vis de ceux qui continuent de les considérer comme des concurrents commerciaux. Macron a dû le reconnaître cyniquement lorsqu'il a déclaré que « on ne peut pas, entre alliés, dire qu'il faut dépenser plus et, au sein de l'Otan se faire la guerre commerciale, c'est une aberration ».
Le point le plus important de la déclaration de La Haye était sans aucun doute l'accord visant à augmenter les dépenses totales de 5 % du PIB, réparties entre les dépenses de défense au sens strict (3,5 %) et les infrastructures critiques, la cybersécurité et d'autres dépenses (1,5 %) d'ici 2035, avec une révision en 2029. Cela signifierait 510 milliards d'euros supplémentaires par an pour les pays européens, ce qui conduirait évidemment à une nouvelle réduction des dépenses sociales dans des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation, les retraites et les soins de longue durée et, comme nous le constatons dans presque tous les pays, à négliger la réalisation d'un droit aussi fondamental que le droit à un logement décent.
Seul Pedro Sánchez a tenté de se distancier de l'accord, en s'appuyant sur la flexibilité ambiguë supposée du secrétaire général de l'OTAN, qui, dans ce cas, pourrait limitée les dépenses à 2,1 % du PIB annuel (2). Il tente ainsi de les convaincre que ce pourcentage sera suffisant pour atteindre les objectifs de capacités militaires que l'OTAN exige de l'État espagnol. Il n'en reste pas moins un engagement à augmenter les dépenses militaires qui, malgré l'irritation qu'il a suscitée chez Trump, est tout aussi critiquable et, de surcroît, n'est rien d'autre qu'un recours cosmétique à usage interne pour neutraliser le mécontentement de ses partenaires au sein du gouvernement espagnol (3), puisque la signature de la déclaration et son insistance à se présenter comme un « partenaire fiable » de l'OTAN confirment qu'il partage le même projet militariste que ses alliés (4).
À tout cela s'ajoute l'absence de toute critique de la part du gouvernement espagnol concernant l'utilisation par les États-Unis des bases de Rota et Morón pour leur attaque contre l'Iran. Cela rend l'État espagnol complice de la guerre illégitime et illégale menée contre ce pays et rappelle la fraude que représente la promesse de respecter l'une des clauses que le gouvernement de Felipe González avait incluse dans le référendum de 1986 pour obtenir le « oui », qui prévoyait la « réduction progressive de la présence militaire des États-Unis en Espagne ». Non seulement celle-ci a été maintenue, mais son expansion dans le cas de Rota s'est poursuivie sous les gouvernements de Rodríguez Zapatero et Pedro Sánchez.
Vers une plus grande militarisation et nucléarisation du capitalisme à l'échelle mondiale
Il ne fait aucun doute que le grand bénéficiaire du bond en avant de la militarisation de l'Europe sera le complexe militaro-industriel américain (auquel les armées européennes achètent 64 % de leurs armes). Bien que la Grande-Bretagne et la France soient des puissances militaires et nucléaires majeures, elles ne suffiront pas à répondre aux besoins auxquels les pays européens seront confrontés dans les années à venir pour atteindre les objectifs fixés dans cette déclaration.
Cependant, d'autres aspects importants de cette déclaration sont passés inaperçus. Le plus pertinent est peut-être le point 1, où, comme l'ont observé certains médias, et malgré la rhétorique habituelle sur les valeurs que le bloc occidental prétend défendre, toute mention de la défense des droits humains et de l'État de droit est absente. Une absence qui ne semble pas fortuite, car il est difficile de cacher que pratiquement tous les États signataires, avec les États-Unis, la Turquie et la Hongrie en tête, ne sont pas à l'abri de violer ces principes. Il n'est donc pas surprenant que l'UE, lors de sa réunion qui a suivi le sommet de l'OTAN, ait reporté sa décision de suspendre ou non l'accord d'association avec l'État d'Israël (5).
Un autre aspect controversé est la référence à l'article 5 de l'OTAN dans la déclaration. Avant même la réunion, cet article avait été remis en question par Trump lui-même, qui n'a pas hésité à préciser que l'engagement de solidarité avec tout pays attaqué qui y est exprimé peut être sujet à différentes interprétations. Cela pourrait servir de prétexte à l'avenir pour se désengager de conflits qui ne correspondent pas à ses propres intérêts géostratégiques en Europe (où elle continue d'entretenir une présence militaire importante) ou, comme elle l'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises, à ses propres intentions concernant le Groenland...
Comme on pouvait s'y attendre, la déclaration dénonce « la menace à long terme que représente la Russie pour la sécurité euro-atlantique », sans toutefois mentionner l'invasion russe de l'Ukraine. Elle réaffirme toutefois « son engagement souverain et durable à soutenir l'Ukraine ». Ce relatif changement de ton confirme que ce ne sont pas la démocratie et les droits humains qui motivent l'OTAN dans la région, mais bien ses intérêts géostratégiques.
En bref, le leader MAGA sort victorieux de ce sommet : il a transféré la responsabilité des futurs conflits en Europe à ses alliés afin que les États-Unis puissent concentrer leur attention sur la région indo-pacifique contre la Chine ; il a garanti des profits importants à l'industrie militaire de son pays et a contribué à endiguer les divisions au sein de ses rangs causées par son implication directe au Moyen-Orient avec l'attaque contre l'Iran... jusqu'à la prochaine crise.
Cependant, le succès de Trump dans l'imposition de ses objectifs lors de ce sommet ne garantit pas pour autant une avancée significative dans son projet de transformation de l'ancien ordre mondial et d'enrayage de son déclin en tant que grande puissance hégémonique. Un déclin qui continue de se manifester sur différents fronts et auquel Trump cherche à opposer un court-termisme qui continue de ne pas produire les résultats escomptés par le bloc social interclassiste qui l'a porté au pouvoir. La preuve en est que les conflits qu'il avait promis de résoudre en quelques semaines, qu'il s'agisse de l'invasion russe de l'Ukraine ou de celle d'Israël contre le peuple palestinien et maintenant contre l'Iran – où il a même cherché à obtenir un changement de régime – menacent de s'éterniser.
Ce bond en avant s'inscrit également dans un contexte mondial de « ralentissement économique important, voire de stagnation, associé à une inflation encore relativement élevée, à un endettement écrasant pour la majorité de la population active mondiale et à une accélération de la crise climatique » (6). Une série de défis face auxquels le militarisme prôné par Trump et les principaux dirigeants du bloc occidental ne représente qu'une fuite en avant qui stimulera à son tour le réarmement des autres grandes et moyennes puissances dans leurs zones régionales respectives, avec le risque permanent d'une escalade nucléaire dans tout conflit impliquant l'un des États possédant ces armes de destruction massive. La justification cynique par Trump des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki devrait suffire à nous faire prendre au sérieux le carrefour historique auquel nous sommes arrivés.
Un militarisme qui, grâce aux progrès technologiques représentés par l'intelligence artificielle, transforme les systèmes militaro-industriels en un instrument fondamental d'une nouvelle phase d'accumulation capitaliste, ainsi qu'une culture de la sécurité et de la surveillance qui se répand dans le monde entier et qui, comme le dénonce à juste titre Claude Serfati (7), pourrait finir par être aussi dangereuse que les guerres pour les classes populaires.
Ainsi, tout en étant conscients que nous sommes dans des conditions difficiles pour lancer une contre-offensive par le bas contre cet ensemble de menaces, il est urgent de construire et d'élargir les plateformes unifiées qui se forment pour empêcher ce nouveau bond en avant. Il s'agit désormais d'aborder cette tâche au-delà du court-termisme, à travers une mobilisation internationale soutenue, solidaire de la Palestine et de tous les peuples attaqués, que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs dans le monde, en les inscrivant dans une perspective de rupture avec le militarisme et en plaidant pour la dissolution de l'OTAN et la dénucléarisation de la planète.
Ces campagnes doivent être coordonnées avec celles qui doivent être développées dans tous les domaines où nous devons remettre en cause le cadre dominant des discours sécuritaires en leur opposant un concept multidimensionnel visant à garantir la durabilité d'une vie digne sur une planète habitable (8).
Publié le 28 juin 2025 par viento sur .
1. À quoi il a ajouté des phrases comme celle-ci : « Vous allez réaliser ce qu'aucun autre président américain n'a réalisé depuis des décennies. »
2. Même si nous savons, comme l'a critiqué le Centre Delàs pour les études sur la paix, que certains postes liés à ces dépenses ne sont généralement pas inclus dans cette section.
3. Je me réfère ici à l'article de Mario Espinosa dans Viento Sur, 25/06/2025
4. D'autre part, rien ne garantit que cette flexibilité sera respectée dans les années à venir, compte tenu de la position précaire dans laquelle se trouve Sánchez au palais de la Moncloa depuis l'éclatement du scandale de corruption connu sous le nom d'affaire Santos Cerdán, dont l'ampleur reste à déterminer en fonction des nouveaux rebondissements qui pourraient survenir dans les semaines à venir.
5. Il est vrai que Pedro Sánchez a exigé la suspension de cet accord lors de la récente réunion de l'UE, mais cela contraste avec la poursuite du commerce d'armes avec Israël, contrairement à la demande d'un « embargo total » formulée par plus de 500 organisations, comme c'est actuellement le cas dans une affaire récente.
6. Michael Roberts, « Des montagnes Rocheuses à Stockholm : le G-7 ignore la crise mondiale », 16/06/2025, à paraître dans Inprecor n°734.
7. « Les systèmes militaro-industriels pourraient représenter des noyaux totalitaires de notre société », interview de Claude Serfati par Hélène Marra et Nicolas Menna, Inprecor, 733, juin 2025, p. 16. Voir également, du même auteur, « Plus destructeur et plus profitable : l'injonction de Trump au système militaro-industriel des États-Unis », lundi 19 mai 2025
8. Pour préciser les objectifs à atteindre dans cet engagement, l'article de Tom Kucharz, « Diez alternativas a una seguridad militarizada », El Salto, 20/06/25, est intéressant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : Retour sur les trois années écoulées depuis le début du soulèvement « Femme, Vie, Liberté »

Le 16 septembre 2022, la jeune kurde Jina-Mahsa AMINI a été tuée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés ». Sur la pierre tombale de Jina est écrit : « Bien aimée Jina, tu ne mourras pas ; ton nom sera un symbole ». Et effectivement, ce féminicide d'Etat a suscité une colère qui s'est étendue au-delà de l'Iran.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/16/iran-retour-sur-les-trois-annees-ecoulees-depuis-le-debut-du-soulevement-femme-vie-liberte/
Une lame de fond a vu le jour dont « Femme, Vie, Liberté » est devenu le slogan. Les revendications intersectionnelles du mouvement « Femme, Vie, Liberté », ne se sont pas limitées à la question du port obligatoire du voile. Elles se sont élargies au refus de la dictature des mollahs, à la défense des libertés, aux droits des femmes et de genre, des minorités ethniques, des salarié-es, etc.
Initiées dans un premier temps par des femmes notamment dans les régions dont la majorité de la population appartient à des minorités nationales comme le Kurdistan et le Balouchistan, les mobilisations ont gagné ensuite tout le pays et une grande partie de la population. Plus de 155 villes peuvent témoigner du courage sans limite des femmes et hommes ayant affronté sans relâche les forces répressives tirant à balles réelles. Pour le seul premier mois du mouvement, plus de 434 mort-es ont été dénombrés dont au moins 50 enfants. Au 12 janvier 2023, plus de 19 000 personnes ont été arrêté.es dont beaucoup de jeunes ayant été éduqués dans les écoles de la République islamique, et notamment des étudiant.es, des journalistes, des artistes, des sportifs/ves. Le régime islamique a mobilisé tout son appareil sécuritaire pour réprimer les manifestations, qui ont fini par s'essouffler. Depuis, la répression n'a pas cessé : en 2025, plus de 889 personnes ont été exécutées au 5 septembre, dont au moins 50 pour leur engagement militant [1].
De multiples formes de résistance
Sous les cendres, les braises sont restées chaudes.
– Nombre de femmes, surtout dans les grandes villes ont défié le pouvoir en circulant dans la rue sans porter le voile. Suite à cela, le 15 décembre 2024, la loi sur le hidjab obligatoire a été abolie.
– Des grèves éclatent périodiquement, malgré la répression, l'ampleur du chômage, et la généralisation de la précarité [2].
– Des organisations syndicales ou associatives ont réussi à se maintenir ou se sont crées [3].
L'action de ces structures ne se limite pas à soutenir les luttes sur les revendications immédiates et le refus de la répression. Le 15 février 2023, par exemple, certaines d'entre elles ont lancé un appel à la mise en place, par en bas, d'une alternative au régime des Mollahs [4].
La guerre des 12 jours
Le 13 juin 2025, et ce durant 12 jours, la population d'Iran a subi une guerre dite préventive, déclenchée par Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien [5]. Suite aux interventions militaires d'Israël puis des Etats-Unis, 657 Iranien-nes ont été tué-es, et 2 037 ont été blessé-es [6].
Comme le déclarait une tribune à laquelle Solidaires a participé « À l'unisson avec toutes celles et ceux qui luttent en Iran depuis des décennies pour la liberté, l'égalité et la justice sociale, nous refusons tout changement de régime « par en haut » et par des interventions étrangères. Le renversement de la République Islamique ne doit résulter que de la lutte des peuples d'Iran. » [7]
Prétendre que ces attaques ont pour but la libération de la population est une ignominie. Bien au contraire, le régime a profité de la guerre pour aggraver considérablement la répression contre les opposant-es ou supposé-es tel-les en les accusant d'être des agents d'Israël ou des USA : plus de 250 exécutions ont eu lieu après les bombardements de juin, et d'autres lourdes condamnations sont prononcées ; L'intervention militaire extérieur a permis au pouvoir de réduire les espaces de contestation, et de tenter d'étouffer l'expression des mécontentements.
Néanmoins le 16 juin, plusieurs organisations syndicales ou associatives ont courageusement condamné simultanément les bombardements israéliens et affiché leur opposition radicale au régime des mollahs [8].
A l'inverse, pendant qu'Israël et les USA déversaient un déluge de bombes sur le pays, certains iranien-nes de la diaspora se léchaient déjà les babines à la perspective de revenir au pays dans les fourgons l'armée américaine pour y établir leur pouvoir. Trump ayant rapidement décrété un cessez-le feu, ils/elles ont été contraint-es de renvoyer leurs espoirs à plus tard [9].
Un pays dans une situation catastrophique
La pénurie d'eau actuelle n'est pas une simple conséquence de la crise climatique mondiale. L'épuisement des nappes phréatiques résulte en grande partie de l'existence d'innombrables barrages construits par les Gardiens de la révolution, la pièce centrale de l'appareil militaire et sécuritaire où règne une corruption endémique.
Le détournements de rivières au profit de notables du régime est une autre cause de cette sécheresse. Par manque d'eau, une partie de la faune et de flore est menacée d'extinction et les agriculteurs voient leur production diminuer.
Alors que l'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et les troisièmes plus grandes réserves de pétrole, la pénurie d'hydrocarbures porte un coup terrible à une économie déjà exsangue.
Les fréquentes coupures d'électricité entraînent de fréquents arrêts des systèmes de climatisation/chauffage et des processus de travail. Des établissements scolaires et des administrations sont périodiquement fermés.
Sur un an, la devise iranienne a perdu plus de la moitié de sa valeur.
La déliquescence de l'économie iranienne a été aggravée par :
– D'une part le coût faramineux du financement de milices armées dans nombre de pays voisins, des années de soutien à l'ex-dictature syrienne, la poursuite du programme nucléaire iranien ;
– D'autre part le poids des sanctions économiques internationales, dont les principaux bénéficiaires sont des réseaux de contrebande liés à des responsables de l'appareil sécuritaire [10].
L'inflation est faramineuse, en particulier sur les produits alimentaires. Les couches populaires en sont les premières victimes. La pomme de terre, aliment de base des plus pauvres, a vu son prix multiplié par cinq en un an. De nombreux/euses iranien.nes suspendent leurs traitements médicaux devenus trop onéreux et certain-es renoncent même à se faire soigner.
Face à cela il est plus nécessaire que jamais de :
– Soutenir les syndicats et organisations iranien.nes combattant la répression et défendant les droits des opprimé-es et exploité-es ;
– Apporter une solidarité concrète aux luttes en cours et aux victimes de la répression ;
– Aider à marginaliser les forces de la diaspora cherchant à s'emparer du pouvoir en Iran dans la foulée d'une intervention occidentale.
L'Union syndicale Solidaires soutient en particulier :
– Le droit inconditionnel des femmes sur leur corps, dont celui de porter ou pas le voile ;
– L'abolition de toute discrimination envers les femmes, les LGBTIQ+, les minorités nationales et religieuses ;
– La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers·ères d'opinion, dont Sharifeh MOHAMMADI, ainsi que de tous/toutes les syndicalistes dont Davood RAZAVI du syndicat VAHED ;
– L'abolition immédiate de la peine de mort et de l'usage de la torture ;
– La liberté d'expression, d'organisation, de manifestation et de grève, le démantèlement des organes de répression existants ;
– Les luttes contre la destruction de l'environnement.
Paris, le 10 septembre 2025
[1] Première page du blog Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran
[2] Comme dans les hydrocarbures, la sidérurgie, l'enseignement, les soins infirmiers, les transports routiers, etc.
[3] Notamment dans les transports en commun de Téhéran et sa banlieue (VAHED) dont un des responsable (Davood RAZAVI) est emprisonné depuis 2022, à la sucrerie Haft-Tapeh, parmi les enseignant.es, les retraité.es, etc.
[4] https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/310523/pour-une-societe-degalite-et-de-liberte-nous-soutenons-les-iranien-nes
[5] La politique guerrière d'Israël bénéficie du soutien actif de Trump et de la complaisance de nombreux pays.
[6] Human Rights Activists News Agency
https://www.en-hrana.org/
[7] https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110725/solidarite-avec-les-peuples-en-lutte-contre-la-guerre-le-colonialisme-et-la-dictature
[8] https://laboursolidarity.org/fr/n/3500/declaration-commune-des-organisations-independantes-en-iran
[9] C'est notamment le cas du fils de l'ex-monarque qui détient une fortune colossale accumulée par son père sur le dos du peuple iranien, et qui a ses entrées auprès de politicien-nes de divers pays dont notamment Israël. C'est aussi le cas de l'Organisation des Moudjahiddines du peuple qui dispose d'une armée privée, et dont la façade est un autoproclamé Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) pratiquant également le lobbying au niveau international. Ces deux courants ont pour emblème le drapeau traditionnel de la monarchie iranienne (avec le lion et l'épée).
[10] En ayant inclus les biens de consommation courante dans l'éventail des sanctions, les puissances occidentales pénalisent avant tout une population qui n'est en rien responsable de la politique de ses dirigeants.
Télécharger le document :2025-09-10 Solidaires – Iran Retour sur 3 ans écoulés
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
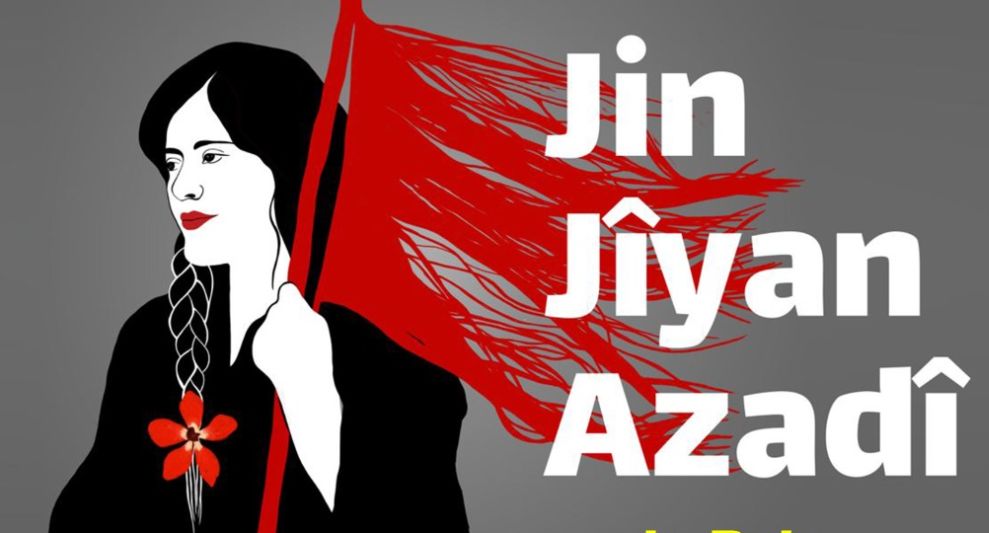
« Le mouvement Jin, Jiyan, Azadi vise à reconquérir le corps, l’esprit et la volonté des femmes »
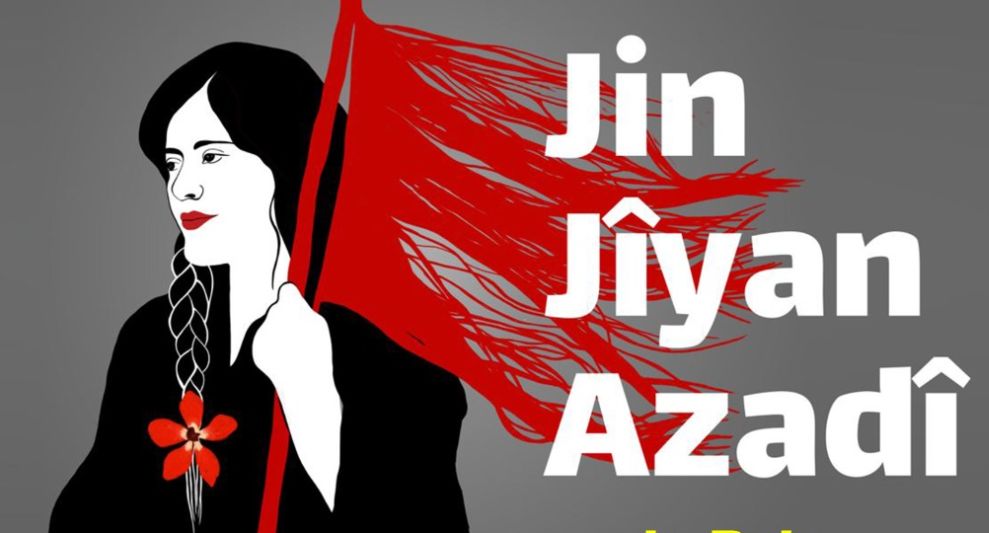
IRAN / ROJHILAT – À l'occasion du troisième anniversaire du mouvement « Jin, Jiyan, Azadî » déclenché par le meurtre barbare de Jina Mahsa Amini, Warisha Moradi, activiste kurde condamnée à mort par les mollahs, a publié un manifeste appelant à la refondation de la société, de la démocratie et de la collectivité sous un leadership féminin.
Tiré de Entre les lignes et les mots
À l'occasion du troisième anniversaire du mouvement « Jin, Jiyan, Azadî », la militante kurde Varisheh Moradi, condamnée à mort en Iran, a écrit une lettre détaillée qui va bien au-delà d'un simple message commémoratif. Dans sa lettre, publiée par la campagne « Libérez Varisheh », la femme kurde emprisonnée à la prison de Qarchak décrit le 16 septembre non seulement comme l'anniversaire d'un soulèvement, mais aussi comme le point de départ d'un nouveau paradigme social – porté par les femmes, porté par la résistance contre la violence patriarcale, la répression d'État et l'effacement culturel. Elle décrit cette journée non seulement comme une commémoration, mais aussi comme une occasion d'exposer sa vision d'une vie en liberté.
Voici la lettre de Varisheh Moradi :
« À tous ceux dont le cœur bat aux mots « Jin, Jiyan, Azadi »
Ce troisième anniversaire marque l'éclat suscité dans les cœurs par le mouvement « Jin, Jiyan, Azadi ». Ce mouvement n'est ni une simple explosion de colère ni la revendication partielle d'un groupe ; il est complexe et multidimensionnel. Le spectre de ses revendications s'étend des libertés individuelles et collectives au droit à l'autodétermination collective ; des droits économiques fondamentaux à la justice culturelle et linguistique ; et de la résistance à l'oppression de genre à l'exigence d'une société véritablement démocratique. Chacune de ces revendications est un maillon d'une chaîne visant à recréer des structures et des rapports de pouvoir – des rapports actuellement fondés sur la domination, la violence et la reproduction des inégalités.
« Jin, Jiyan, Azadi » est une lutte pour des modes de pensée et de vie différents. Ce mouvement vise à reconquérir le corps, l'esprit et la volonté des femmes asservies et dont les libertés ont été spoliées par l'État iranien au fil des années de lois et de restrictions. L'État a bâti son pouvoir sur l'asservissement, l'humiliation et l'effacement des femmes. « Jin, Jiyan, Azadi » place les femmes au cœur de la révolution, révélant que sans leur participation, aucune révolution ne peut apporter un changement démocratique à la société. Aucune exécution, répression ou autre mesure ne peut faire obstacle à cette vérité.
L'idée sur laquelle nous nous appuyons est celle d'une société démocratique, écologique et éprise de liberté – une société qui ne soit ni simpliste ni purement émotionnelle. Les transformations engendrées par ce mouvement sont profondes et fondamentales, et non superficielles ou accidentelles. Nous n'assistons pas seulement à une évolution des espaces publics ou des slogans, mais à une transformation fondamentale de notre conception de l'ordre social : qui a le droit de décider et comment nous interprétons la « vie démocratique collective ». Dans ce contexte, le concept de « vivre librement ensemble » redéfinit les relations humaines et sociales, des structures familiales à la sphère publique. Ce mouvement a démontré qu'aucune réforme ne sera durable sans une reconstruction des structures. Notre lutte vise donc à reconstruire les institutions, les cultures et les mentalités, et non pas simplement à occuper la scène politique.
Chaque slogan possède un esprit, une époque et un lieu, et se nourrit d'une idéologie sur laquelle repose un paradigme. Chacun possède un contexte historique et social. Exprimer la mémoire collective, traduire la pensée en mots et s'approprier ces mots exige un effort et une lutte considérables. Les slogans qui expriment les réalités et les expériences de groupes sociaux, tels que les classes sociales, les races, les femmes, les peuples et les cultures opprimées, sont des symboles de résistance, d'espoir et de quête de liberté. Ces slogans sont des produits de l'histoire, où les mots trouvent leur sens et s'entremêlent à la vie. Par le son et la parole, ils transmettent la force vitale de ceux dont les voix sont réduites au silence ou ignorées. Ce faisant, ils créent un espace convaincant et transformateur de résistance et de libre création.
Au cœur de ce renouveau se trouve le rôle pionnier des femmes. Il est important de comprendre qu'être femme n'est pas seulement un fait biologique, mais que le « féminin » est un état d'esprit, une domination éthique et politique, et une avant-garde idéologique qui guide la société vers la libération, la solidarité et la démocratie. Par « avant-garde féminine », j'entends une femme qui remet en question les rôles imposés et propose une mentalité qui rejette la domination. Cette mentalité envisage la redistribution du pouvoir, la démocratisation des relations et l'acceptation des différences. En ce sens, la liberté des femmes a toujours été synonyme de liberté sociétale.
Je sais qu'ils veulent présenter ce soulèvement comme une émeute passagère et lui prescrire des solutions sécuritaires et pénales. Cependant, l'enjeu dépasse largement le simple contrôle de l'espace ; nous sommes confrontés à une profonde remise en question. C'est pourquoi ils ont recours à des outils allant au-delà de la simple coercition. Les ordres d'exécution et la répression des voix dissidentes doivent être appréhendés plus précisément ; ils visent non seulement les individus, mais aussi l'état d'esprit représenté par ces symboles. Ces ordres constituent une forme de vengeance systématique contre un mouvement qui appelle à une refonte fondamentale du pouvoir.
Cette forme de vengeance est une tentative de faire taire le message en séparant la voix du corps. Cependant, on oublie qu'une mentalité libératrice ne peut être détruite par la corde, la prison ou les décrets. De tels ordres ne sont pas des signes de force, mais plutôt l'aveu d'une légitimité affaiblie et d'une peur de la propagation des idées. Lorsque l'attention se déplace de la politique vers la suppression des symboles, cela indique que le dialogue et le changement sont perçus comme de sérieuses menaces. Le traitement des femmes emprisonnées s'inscrit dans ce projet de vengeance – vengeance contre « Jin, Jiyan, Azadi » – et témoigne de l'impact profond du mouvement.
Ils peuvent chercher à freiner le mouvement social par des décisions judiciaires, mais ils ne pourront jamais effacer la mentalité d'avant-garde qui l'inspire. Tant que les gens resteront fidèles à leurs pensées et à leurs actions, et tant qu'ils continueront à rechercher de nouvelles définitions de la liberté et de la démocratie, chaque condamnation ne fera que renforcer leur détermination.
La poursuite des idéaux « Jin, Jiyan, Azadi » est une nécessité historique. Cet idéal comble le fossé entre la théorie et la pratique quotidienne. C'est un moyen d'organiser, d'éduquer politiquement, de construire des institutions démocratiques parallèles, d'intégrer le rôle des femmes dans le leadership collectif et de reconstruire l'économie, la culture et les systèmes judiciaires sur la base de la dignité humaine.
Plutôt que de faire de cet anniversaire un simple moment de deuil, transformons-le en un manifeste pour une vie libre. Lettres, notes, petits et grands rassemblements, travaux théoriques et éducation des nouvelles générations sont autant d'outils qui doivent être utilisés conjointement. Nous devons démontrer que le rôle d'avant-garde des femmes n'est pas seulement un plaidoyer, mais un plan d'action qui transforme la sphère publique et permet une vie plus égalitaire. » (ANF)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cancers féminins, à bas le sexisme !

Une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein. Il est le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pourtant, le cancer du sein n'est inscrit sur aucun tableau des maladies professionnelles.
Pourquoi cette absence ? Les femmes ne sont-elles pas exposées aux cancérogènes au travail ?
Pourtant, alors que le travail de nuit se généralise à tous les secteurs, il est établi qu'il représente un facteur indéniable de risque de cancer du sein pour les femmes.
De même, il est établi que les radiations sont des facteurs de cancers pour les personnels de bord dans les avions ou travaillant dans le milieu médical. Milieux dans lesquels les femmes sont largement sur-représentées.
Alors que les données scientifiques sont bien présentes et plaident pour une meilleure reconnaissance des cancers professionnels pour les femmes, il n'y a guère d'avancées sur le sujet.
Alors pourquoi un tel retard ? Une seule réponse : le sexisme !
En effet, le processus pour l'inscription d'une nouvelle maladie, ou la modification des tableaux existants des maladies professionnelles est en général hyper restrictif et lent. Et pour les femmes, c'est encore pire !
Tout d'abord les recherches sur les origines professionnelles des cancers spécifiques des femmes sont moins nombreuses. Il manque encore beaucoup de données.
En trente ans, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France. Cette hausse concerne particulièrement les femmes. Comment expliquer l'explosion des cancers en France, si ce n'est par les multiples expositions aux substances chimiques cancérogènes.
Des expert·es rappellent que les facteurs de risque dits classiques, comme le tabac, l'alcool ou la sédentarité, ne suffisent pas à expliquer cette explosion. Les facteurs environnementaux sont nombreux : résidus de pesticides, perturbateurs endocriniens, microplastiques, nanoparticules, métaux lourds… et leurs effets toxiques sont multipliés par un « effet cocktail ».
Faute de recherche sérieuse, des milliers de femmes touchées par le cancer seront exposées à des discours culpabilisants d'ordre médical : c'est la faute de vos hormones, vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez pas allaité, vous avez eu vos règles trop tôt, etc., et, bien sûr, vous ne faites pas assez de sport, vous mangez trop ou pas assez bien.
Si les causes hormonales et le mode de vie sont des facteurs de risques indéniables de ce cancer, le corps médical ne s'interroge que très peu sur ses causes environnementales et professionnelles. Les femmes ne seront pas incitées à examiner les éventuelles causes professionnelles de leur cancer. Ce qui explique que seule 1 femme pour 11 hommes obtient une reconnaissance en maladie professionnelle.
Puis, de manière générale, les expositions professionnelles des femmes sont invisibilisées, minimisées, pour ne pas dire carrément niées. Le fait que les femmes soient plus fréquemment confrontées à des carrières hachées, à de la précarité et du travail non déclaré participe à ce phénomène. Elles sont aussi concentrées dans certaines catégories professionnelles, où les risques professionnels sont invisibilisés : par exemple, les 3 ou 5 tonnes cumulées (le poids d'un éléphant) portées par jour par les caissières et soignantes dans les hôpitaux et EHPAD, ou les efforts cardiaques des femmes de chambre soumises à des cadences infernales de nettoyage, ou encore les cocktails de produits chimiques dangereux auxquels sont exposées les coiffeuses, esthéticiennes et fleuristes.
Plus de 100 ans après les premiers tableaux de maladies professionnelles en 1919, les cancers du sein, de l'utérus, du col de l'utérus ne sont nulle part ! Bref on pourrait presque croire en lisant ces tableaux que, pour le ministère du Travail, les travailleuses ne tombent pas malade !
Il a fallu attendre octobre 2023 pour que le cancer de l'ovaire soit reconnu comme maladie professionnelle pour exposition aux fibres d'amiante !
Cette absence de tableau est très préjudiciable pour les femmes. Aujourd'hui, alors qu'elles sont exposées à de multiples cancérogènes au travail, elles devront mener une longue lutte pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur cancer et obtenir réparation auprès de leur employeur.
La situation des salarié·es (majoritairement des femmes) de TETRA MEDICAL en est une bonne illustration. Elles ont été exposées au travail à l'oxyde d'éthylène, un cancérogène, mutagène et reprotoxique avéré utilisé pour stériliser le matériel médical, alors qu'elles ne disposaient d'aucune protection. Elles viennent de gagner en juin et juillet après un long combat le droit d'être partiellement indemnisées au titre du préjudice d'anxiété par deux jugements des conseils des Prud'hommes.
Les experts scientifiques indiquent qu'il n'y a pas de seuil de toxicité pour ce gaz, le SCOEL (comité scientifique des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle pour l'UE) n'a en conséquence pas recommandé de valeur limite professionnelle. Pourtant c'est bien une Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) qui a été établie et transposée par le décret du 9 décembre 2020.
Il était plus important que les employeurs puissent continuer d'utiliser ce produit, plutôt que de préserver la santé des travailleuses concernées.
Conclusion, non seulement les femmes risquent de continuer à être exposées à ce cancérogène sans effet de seuil au travail, mais, en plus, elles auront toutes les peines à faire reconnaître l'origine professionnelle de leur cancer.
La santé au travail passe après la recherche du profit, et la lutte des classes s'exprime aussi dans l'appropriation par les employeurs de nos vies.
Rappelons-le si nécessaire, le cancer, même s'il est mieux soigné reste toujours une maladie mortelle, il laisse de nombreuses séquelles et cicatrices pour les femmes, la prévention des cancers des femmes doit devenir enfin une priorité !
Leurs économies nous coûtent cher !
Faire des économies sur la santé, c'est prendre le risque que l'état de santé des salarié·es se détériore, ce qui coûte finalement plus cher à la collectivité.
En refusant de mener de véritables politiques de prévention des cancers professionnels pour préserver les intérêts des employeurs, les pouvoirs publics contribuent à l'épidémie de cancers et négligent le suivi médical, donc le traitement précoce, des personnes les plus exposées.
La lutte contre le cancer ne peut se limiter à la recherche médicamenteuse. Pas d'économies sur nos vies ! Une véritable politique de prévention doit être mise en place. La censure partielle de la loi dite Duplomb doit nous encourager à poursuivre cette lutte !
Le ministère du travail et de la santé doit inscrire sur le tableau des maladies professionnelles l'ensemble des cancers féminins !
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/argumentaires/cancers-feminins-a-bas-le-sexisme/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Connaître et reconnaître l’endométriose, une urgence pour les femmes

Pour la première fois en France, une vaste enquête en ligne sur le coût réel de l'endométriose supporté par les patientes a été lancée le 5 juin sur la plateforme collaborative de recherche sur les maladies chroniques ComPaRe, à la demande du ministère de la Santé.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/09/connaitre-et-reconnaitre-lendometriose-une-urgence-pour-les-femmes/
Les diverses associations de patientes atteintes de cette maladie, comme Endomind, Info Endométriose, EndoFrance ou EndoAction, souhaitaient depuis longtemps que l'on mesure le coût réel de cette maladie qui touche de 1,5 à 2,5 millions de femmes.
Rappelons qu'elle représente un coût important pour la société et pour les femmes concernées. On estime ainsi que l'endométriose coûte 9,5 milliards d'euros par an en France, entre coûts directs en frais médicaux et coûts indirects en perte de productivité ou de pouvoir d'achat.
Mais pour les femmes elles-mêmes, le coût est plus difficile à évaluer. Il est pourtant bien réel, d'autant que la majorité d'entre elles n'ont pas obtenu la reconnaissance de leur maladie comme affection de longue durée (ALD). Qui plus est, il existe des effets négatifs indirects en termes d'emploi et de carrière.
Toujours pas reconnue comme affection de longue durée
Cette maladie gynécologique chronique est liée à la présence anormale de tissus semblables à la muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus. Elle se traduit pour les 10% de femmes concernées par une multitude de symptômes parfois très invalidants, comme des douleurs pelviennes, des maux de dos ou encore une fatigue chronique et un risque d'infertilité.
L'inscription sur la liste des ALD donne droit à une prise en charge automatique à 100% de toutes dépenses liées à ces soins et traitements. De plus, les patient·es bénéficient d'une réduction du délai de carence, qui n'est plus retenu que pour le premier arrêt de travail pendant trois ans.
– Seules 4 500 femmes sur un à deux millions ont obtenu la reconnaissance de leur endométriose comme affection « hors liste »
Malgré une proposition de loi portée par Clémentine Autainau nom de La France insoumise, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en janvier 2022, le gouvernement n'a toujours pas accordé cette reconnaissance. Or, selon la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), en 2018, seules 4 500 femmes sur un à deux millions ont obtenu la reconnaissance de leur endométriose comme affection « hors liste ». Même si depuis, ce nombre a augmenté, il est loin de couvrir l'ensemble des patientes.
En outre, l'association Endomind dénonce une discrimination géographique subie par les femmes. Le gouvernement a pourtant mis en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en janvier 2022.
Ce plan consiste à développer la recherche sur cette maladie, avec environ 11 millions d'euros affectés. Il s'agit également de faciliter l'accès aux soins et d'améliorer les connaissances de la maladie, avec un volet de formation pour les professionnel·les de santé. Mais il n'est pas question ici de reconnaître systématiquement l'endométriose en ALD…
Les effets sur l'emploi et la carrière
Une enquête de la chercheuse Alice Romerioauprès d'environ 2 000 femmes atteintes, en 2020, avait montré les effets de cette maladie sur l'emploi et la carrière des femmes.
La moitié des répondantes estiment que l'endométriose les a gênées dans leur carrière professionnelle (licenciement, contrat non renouvelé, moindre avancement de carrière, perte de clients, etc.). Un tiers d'entre elles quitte précipitamment au moins une fois par mois leur travail pour rentrer à leur domicile ou consulter un médecin à cause de symptômes liés à leur endométriose.
Enfin, elles sont 36% à déclarer se rendre au travail malgré des symptômes qu'elles estiment incapacitants au moins deux fois par mois. Le travail au quotidien des personnes atteintes d'endométriose se trouve ainsi affecté par la maladie, et pas seulement pendant la période des règles. L'endométriose entraîne des pertes de concentration, des impossibilités à tenir une posture de travail à cause de douleurs, ou encore des troubles digestifs et urinaires handicapants et perçus comme honteux.
– 82% des personnes atteintes d'endométriose ont des réticences à demander des arrêts maladie
Alors que les personnes atteintes d'endométriose souffrent de troubles rendant difficile leur activité professionnelle, 82% d'entre elles ont des réticences à demander des arrêts maladie à leur médecin pendant des crises. Ceci est lié à la perte de salaire éventuelle, mais aussi à l'anticipation de reproches de la part de leurs directions ou même de leurs collègues.
C'est pourquoi plus d'un quart des répondantes déclarent avoir demandé au moins cinq jours de congé ou de RTT au cours des douze derniers mois en anticipant les symptômes incapacitants de leur endométriose, pendant leurs règles par exemple. Elles ont aussi recours plus souvent au télétravail.
Mais au lieu de s'appuyer sur des dispositifs institutionnels comme les arrêts maladie ou la médecine du travail pour un aménagement de poste, la plupart font donc appel à des arrangements individuels, les stigmatisant davantage.
Evaluer les coûts réels pour les femmes
La nouvelle enquête lancée à partir du 5 juin durant tout l'été complétera cette analyse en s'interrogeant sur les frais médicaux restant à charge de ces patientes. Il faut pour cela s'inscrire sur le site compare.aphp.fr. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) hébergera ces données qui seront analysées par l'Inserm.
Les différents symptômes se traduisent par de nombreuses consultations et examens qui ne sont pas toujours pris en charge par la Sécurité sociale, comme le recours aux imageries médicales, à des traitements spécifiques, la consultation de spécialistes, la kinésithérapie ou les médecines douces permettant de soulager les douleurs… Il s'agit d'évaluer précisément les types de professionnel·les consulté·es et le montant resté à charge pour les patientes après l'intervention de l'Assurance maladie et de la mutuelle.
– On est encore loin d'une réelle (re)connaissance de cette maladie, pour laquelle les patientes paient le prix fort
Seront également évalués les frais de procréation médicalement assistée (PMA) – car l'endométriose peut avoir une influence sur la fertilité –, les frais de biologie, les passages aux urgences, les hospitalisations, les médicaments et autres dispositifs pour lutter contre la douleur. On est donc encore loin d'une réelle (re)connaissance de cette maladie, pour laquelle les patientes paient le prix fort, au sens propre et figuré.
Pour finir sur une note d'espoir, un progrès important a eu lieu début 2025, puisqu'un simple test, rapide et non invasif, pourra très bientôt diagnostiquer l'endométriose. L'endotest, test salivaire, déjà commercialisé dans des pays européens, sera délivré et remboursé auprès de 25 000 femmes. Un premier pas vers un diagnostic rapide, alors que bien souvent ces femmes mettent des années à obtenir cette reconnaissance : « On a si longtemps dit que ces douleurs étaient dans nos têtes. »
Rachel Silvera
Maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre
https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/connaitre-reconnaitre-lendometriose-une-urgence-femmes/00115321
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ethiopie : Un syndicat digne de ce nom

Un exemple d'une centrale syndicale qui se renforce dans les batailles sociales et maintient son indépendance vis-à-vis des autorités en dépit des pressions politiques.
Une note d'optimisme ! En Ethiopie le syndicalisme progresse. De 2015 à 2019 les syndicats d'entreprise sont passés de 918 à 1901 et le nombre de syndiqués de 415 000 à 615 000. Actuellement on compte 2200 syndicats d'entreprise et un million de salariés sont affiliés à la Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) dotée de neuf fédérations professionnelles.
La légitimité syndicale
La CETU a gagné deux grandes batailles. La première est l'abrogation de la loi sur le travail élaborée en dehors de toute négociation et promulguée en 2017. Elle permettait notamment une grande liberté de licenciement, la suppression d'une partie des congés payés, l'allongement de la période d'essai. Des grèves spontanées ont éclaté et la base syndicale a enjoint la confédération de mener la lutte. La CETU a brandi la menace d'une grève générale, obligeant les autorités à revenir sur les dispositions litigieuses et également à accorder l'extension du congé maternité et la création d'une instance pour fixer un salaire minimum.
La seconde bataille est la syndicalisation dans les parcs industriels, sortes de zones franches censées inciter les capitalistes étrangers à investir dans le pays. Le pouvoir éthiopien considère ces parcs comme le principal moyen pour industrialiser le pays et met en avant la faiblesse des coûts salariaux. C'est donc au nom de l'intérêt national que la syndicalisation était proscrite dans les faits. La pression de la CETU conjuguée aux grèves sauvages a eu raison de cette politique anti syndicale.
Environnement hostile
La CETU évolue dans un pays où le régime est particulièrement répressif contre les organisations de la société civile, les journalistes et les opposants. Si la répression syndicale est utilisée par le patronat elle l'est aussi par le gouvernement. Lors de la grève du personnel soignant dont on s'est fait l'échoi, le gouvernement n'a pas hésité à menacer et emprisonner des grévistes.
La question financière est aussi un domaine délicat. La CETU tire ses ressources des locations immobilières qu'elle a héritées du syndicat inféodé au régime dictatorial de la fin des années 1980. Ce mode de financement prête le flanc à des éventuelles mesures de confiscation que pourrait prendre le gouvernement.
Mais la difficulté majeure pour la CETU c'est son isolement. Aucun parti ne prend en compte les revendications des salariés. A tel point qu'un débat est apparu, initié par la base, pour que le syndicat lance un parti travailliste capable de faire entendre sur la scène politique les exigences des travailleurs. Déjà lors de la guerre contre la province du Tigré, en dépit des énormes pressions gouvernementales, la CETU non seulement s'était abstenue de tout discours belliciste mais avait au contraire prôné l'union et la solidarité entre les travailleurs et soutenu les syndicats tigréens.
Paul Martial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De Tunis à Gaza. Hisse et oh !

Zukiswa Wanner, écrivaine et activiste sud-africaine, publie dans Afrique XXI son journal de bord de la flottille Global Sumud, en route pour Gaza. Son bateau, rebaptisé par elle Mendi Réincarné, a rallié vendredi 19 septembre le reste de la flotte parti avant lui.
Tiré d'Afrique XXI. Cet article est le deuxième d'une série de type "Journal de bord" de la flottille Global Sumud. Le premier est disponible ici.
Vendredi 19 septembre
Nous sommes partis mercredi au crépuscule. Sauf que non. Après environ trois heures à bord, tout le monde, sauf l'équipage, était pris de fou rire. Certains plus que d'autres. Il existe peut-être de meilleurs moyens, mais je continue de penser que rien ne rapproche plus vite des inconnus que de partager le mal de mer. Vous ne le croiriez jamais si l'Acteur homonyme du Prophète – celui qui, selon ce que nous avons convenu, jouera le rôle du Capitaine, un jour, lorsque nous en ferons un film – ne l'avait filmé et posté sur Instagram. Soit dit en passant, je pensais jusque-là que l'Acteur faisait partie de l'équipage du bateau, car, avant notre départ, « Mandem »1 était toujours là pour aider en cas de besoin. C'est lui qui nettoyait les barils de gasoil, soulevait des choses, attachait ce qui devait l'être. Quand ils nous ont dévoilé les noms des participants, imaginez ma surprise en apprenant qu'il n'était qu'un participant parmi d'autres et non un membre de l'équipage ! Mais revenons au mal de mer.
Le Capitaine, du premier vomissement au dernier, s'est montré attentionné et a veillé à ce qu'on se sente tous bien pris en charge. Et remarquant une embellie générale pendant une minute, il a sorti son téléphone, commencé à filmer et dit : « Tout le monde dit “free free”... [“libérez, libérez”]... »
Notre faible « ... Palestine. Libérez la Palestine » aurait été hilarant s'il n'avait pas été dit avec conviction. Par un groupe d'hommes et de quelques femmes malades, ne perdant pas de vue que leurs maux d'estomac étaient insignifiants par rapport à la plus grande mission. Le Capitaine a fait demi-tour et nous nous sommes retrouvés au port de Gammarth, où nous avons dormi jusqu'à ce qu'il lève l'ancre à nouveau, à 4 heures du matin. Je le sais parce que j'étais réveillée à ce moment-là.
Plus tard dans la matinée, Eurozone, mon camarade franco-allemand, a commencé à préparer le petit déjeuner avec mon aide. Bizarrement, on avait tous bon appétit. Preuve, peut-être, qu'aucune vague adverse ne prospérerait ? À regarder notre groupe, à l'exception de deux personnes, on aurait pu croire que la nuit dernière n'avait jamais existé. Mais il était trop tard. Aucun acteur, imam, journaliste, chercheur, philosophe ou avocat ne pouvait plus revenir au formalisme des relations entre étrangers : nous étions tous liés par le mal de mer.
« Un anglais approximatif et un français encore pire »
Et puis, une illumination. Le Chercheur. Je l'ai vu lire Ghassan Kanafani, et je me suis aussitôt mise à discuter avec lui de Kanafani. Un écrivain que je tiens pour l'un de mes aînés en littérature, au même titre qu'Ama Ata Aidoo, Ahdaf Soueif, Ahmadou Kourouma, Maryse Condé, Paulina Chiziane, Conceição Evaristo, Shimmer Chinodya et Zakes Mda. C'est en les lisant que j'ai compris que je n'avais pas le privilège de « l'art pour l'art », et, inspirée par eux, j'ai toujours voulu poser des questions morales difficiles, à moi-même et à mes lecteurs, tout en respectant la capacité des lecteurs à tirer leurs propres conclusions, et, j'espère, sans paraître trop sérieuse.
Nous avons échangé, le Chercheur et moi, lui, dans un anglais approximatif et moi dans un français encore pire, mais nous nous sommes compris. Le Journaliste, me voyant préparer du thé pour ceux qui ne se sentaient pas bien, m'a demandé de lui faire du café. Euh, pardon ? Il a répété sa demande. Je lui ai montré la cuisine.
Finalement, ni lui ni moi n'avons fait de café. Il n'a eu sa tasse de café que lorsqu'un membre de l'équipage en a préparé pour lui-même. Maintenant, vous vous demandez si j'étais obligée d'adopter cette attitude passive-agressive. Est-ce que je n'aurais pas pu tout simplement lui faire un café ? C'est simple : nous allons passer ensemble les dix prochains jours au moins. Si je commence à faire la stagiaire préposée au café maintenant, je serai la stagiaire préposée au café jusqu'à ce qu'on brise le siège.
« Une foi plus grande qu'une graine de moutarde »
Et oui. Je suis consciente de la possibilité d'une interception par les FIO (Forces israéliennes d'occupation), mais même si on nous a entraînés à nous y préparer autant que possible, je fais le choix d'ignorer cette éventualité. À la fin de la formation, le 5, j'étais sûre à 25 % que nous atteindrions Gaza. Puis les deux attaques de drones ont eu lieu, et mon estimation est tombée à 10 %. Si les FIO agissaient ainsi alors que les bateaux étaient à quai dans les eaux d'un autre pays, quelles étaient nos chances de réussite ? Mais quelque chose s'est produit entre le moment où j'attendais que les bateaux soient réparés et celui où j'ai finalement pu embarquer. C'est peut-être grâce à mes discussions avec mon frère gazaoui, l'auteur et universitaire Haïdar, qui vit maintenant à Johannesburg, et qui m'a dit : « Avec ces évacuations, je ne sais pas où se trouve ma famille. Mais je sais que tous mes quarante parents encore en vie auraient été honorés de vous accueillir à votre arrivée à Gaza. »
À votre arrivée. Pas si vous arrivez. Une foi plus grande que la graine de moutarde de la Bible2. J'aurais déshonoré Haïdar, sa compagne – ma sœur Rifka – et leurs deux enfants si j'avais embarqué sans être convaincue de la victoire. Alors maintenant, je crois que nous avons 75 % de chances d'y parvenir, même si je me prépare aussi à l'éventualité des 25 % restants. Je ne le souhaite pas, mais j'y suis préparée.
Aujourd'hui, tout le monde a enfin le pied marin. La personne qui avait le plus souffert du mal de mer était debout et nous a même préparé du thé vert.
Aujourd'hui aussi, j'ai pris une douche « accidentelle ».
Nous ne pouvons pas nous doucher tous les jours, car le bateau transporte une quantité d'eau limitée. Pour une raison que j'ignore, l'un des membres d'équipage a dit au Chercheur qu'il pouvait prendre une douche, et j'étais à côté. Après le Chercheur, le membre de l'équipage m'a demandé si je voulais y aller. J'ai acquiescé avec enthousiasme. J'étais prête depuis ma dernière douche, mercredi. Les lingettes humides et un peu d'eau de ma propre bouteille ne permettent pas de se sentir fraîche bien longtemps. Il m'a montré comment faire fonctionner la douche en s'assurant que l'eau s'écoule bien. Consciente du peu d'eau dont nous disposons (nous sommes limités à 1,5 litre par personne ; tous ceux qui me connaissent vous diront que j'en bois 5 litres par jour en temps normal), j'ai pris une douche courte mais ô combien merveilleuse. Maintenant, toute fraîche et propre, je suis montée et j'ai demandé : « Qui est le prochain pour la douche ? » Le capitaine m'a regardée comme si j'étais folle. « Tu as pris une douche ? Tu n'étais pas censée prendre de douche. Personne n'est censé se doucher avant le quatrième jour, quand nous aurons rechargé de l'eau. » Le membre d'équipage qui m'avait incitée à prendre une douche a pris ma défense et a expliqué qu'il avait supposé... qu'il pensait... Cher lecteur, vous êtes-vous déjà senti coupable d'être propre ? Cela peut paraître étrange, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti.
« L'extermination de lignées entières »
Une conversation avec le Philosophe m'a réconfortée. Je connaissais le Philosophe en tant qu'universitaire spécialiste d'économie. Mais aujourd'hui, il m'a révélé qu'il avait d'abord étudié la philosophie. Comme toujours quand je bavarde, j'ai appris quelque chose de nouveau. Le Philosophe m'a parlé d'Ibn Khaldoun3. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai enfin compris qui représentait la statue du centre-ville de Tunis, ce que personne n'avait pu me dire jusqu'alors. De plus, le Philosophe m'a fait parvenir quelques articles universitaires sur Ibn Khaldoun, ce penseur tunisien qui philosophait à une époque où l'Europe était encore au Moyen Âge... Je parle de ça parce que je me demande comment nous avons fini par être colonisés alors que nous avions, sur notre continent, tant de personnalités sages qui semblent avoir des intellectuels et des aventuriers équivalents à ceux d'Europe.
Toujours aujourd'hui, nous avons enfin rattrapé les autres bateaux de la flottille. Les cris, les célébrations, la joie étaient absolument palpables. C'était comme si nous retrouvions des gens que nous n'avions pas vus depuis des années, alors que nous n'étions ensemble que depuis dimanche. Cela m'a fait réfléchir lorsque j'ai dégrisé de l'allégresse. Je ne connais toutes ces personnes que depuis deux semaines, et pourtant je suis ravie de voir chacune d'entre elles, même de loin sur d'autres bateaux. Et je serais peinée si quelque chose leur arrivait. Alors que ressentent les Gazaouis en voyant mourir ceux avec lesquels ils ont grandi ? En enterrant des jeunes qu'ils connaissent depuis leur naissance et des aînés qui les réprimandaient quand ils étaient encore des enfants ? Que ressentent les Gazaouis lorsque les FDI détruisent les lieux qui abritent leurs souvenirs ? Et que ressentent les membres des FIO, ceux des gouvernements du nord en sachant que les bombes qu'ils envoient à « la seule démocratie du Moyen-Orient » sont responsables de l'extermination de lignées entières ? De l'écocide ? Du scholasticide4 ? Comment les dirigeants mondiaux, qui se réunissent ce jour en grande pompe à l'Assemblée générale des Nations unies, justifient-ils que le profit prime sur les vies humaines ?
Aujourd'hui encore, mon cœur souffre pour l'humanité.

République démocratique du Congo : la paix introuvable

La guerre continue malgré l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, signé à Washington sous les auspices de Trump. Dès le début, les observateurs étaient circonspects sur l'arrêt du conflit, du fait de la mise en place de deux processus de paix parallèles et intimement liés.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Deux accords de paix
Le premier, parrainé par les USA, est un accord entre États, la RDC et le Rwanda. Il a été signé le 27 juin dernier. De l'avis même des acteurs, il prend du retard, notamment sur la question du retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Il est conditionné à la mise hors jeu, par les forces armées de la RDC (FARDC), des FDLR, une milice composée d'anciens génocidaires dont le Rwanda surestime le danger, considérant qu'elle représente une menace existentielle.
Le second accord, toujours en discussion, est celui de Doha, cette fois-ci entre la RDC et la milice M23/AFC, massivement soutenue par le Rwanda. Elle a conquis une large part du territoire de l'est du pays en occupant les principales villes de Goma et Bukavu. Les pourparlers piétinent. Les autorités congolaises exigent de recouvrer leur autorité sur l'ensemble du territoire, quand le M23/AFC parle de cogestion de la région. Si le M23, au début, était une rébellion strictement militaire, elle s'est transformée en force politique avec l'adjonction de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), dirigée par Corneille Nangaa.
Régime parallèle et essor des milices
Cette milice a rapidement installé une nouvelle administration pour gérer les territoires conquis. Des gouverneurs ont été nommés, des tribunaux institués et, depuis peu, une police a été créée avec l'embauche de nouveaux fonctionnaires. Les chefs coutumiers opposés à ce nouveau pouvoir ont été écartés et parfois éliminés physiquement. L'autre problème épineux est celui de la démobilisation des forces du M23. Ces combattants exigent d'être intégrés à l'armée. Tshisekedi, le président de la RDC, refuse catégoriquement, considérant qu'une telle intégration serait une épée de Damoclès pour son régime.
Pour mener la guerre contre le M23/AFC, le gouvernement congolais a largement fait appel à de nombreuses milices qui sévissent dans la région. Elles agissent sous le nom générique de Wazalendo (les patriotes, en kiswahili). Officiellement, leurs membres ont le statut de « réserve armée de la défense ». Dans les faits, les Wazalendo bénéficient d'une grande indépendance et considèrent qu'ils ne sont pas tenus par les engagements pris à Doha, car absents des discussions. En effet, ces derniers avaient demandé à participer aux réunions, mais le refus tant du gouvernement congolais que du M23/AFC a abouti à ignorer les revendications de ces groupes armés. Déjà apparaissent les premières escarmouches entre milices Wazalendo et FARDC. La dernière en date s'est déroulée à Uvira, provoquant la mort d'une dizaine de personnes
Contrairement à ce que Trump déclare, lorsqu'il affirme avoir mis fin à une guerre de trente ans, le conflit perdure, poussant les populations civiles, victimes des exactions perpétrées de toutes parts, à prendre le chemin de l'exil.
Paul Martial

Décoloniser l’esprit pour alimenter l’avenir vert de l’Afrique

Alors que la course mondiale aux minéraux critiques s'intensifie, du lithium au Zimbabwe au cobalt en République démocratique du Congo, l'Afrique se retrouve, une fois de plus, riche en ressources, mais pauvre en énergie. L'industrialisation verte est présentée comme l'opportunité pour le continent de dépasser l'extraction pour fabriquer des biens verts.
Tiré d'Afrique en lutte.
Mais cette opportunité nous échappera si les dirigeants africains continuent d'être prisonniers des séquelles psychosociales du colonialisme. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une question de conscience. Le philosophe et penseur anticolonialiste Frantz Fanon nous a avertis que le colonialisme ne prend pas fin avec le départ des colonisateurs. Il persiste dans les psychés.
Dans Peau noire, masques blancs , il décrit comment les peuples colonisés intériorisent la logique de leurs oppresseurs, aspirant à détenir le pouvoir de ces derniers et gouvernant au service du capital mondial plutôt que de leur propre peuple. Il soutient que cela constitue un obstacle majeur à une véritable libération.
Partout en Afrique, les élites post-indépendance reproduisent souvent les structures de pouvoir coloniales, préservant les économies extractives, obéissant aux règles de l'ordre capitaliste mondial et donnant la priorité aux besoins des investisseurs étrangers plutôt qu'à ceux de leurs propres citoyens.
Comme l'a souligné l'analyste sud-africain William Gumede, l'Afrique du Sud demeure une « postcolonie », politiquement indépendante, mais toujours manipulée économiquement. Les structures d'accumulation racialisée de l'époque de l'apartheid demeurent intactes, simplement rebaptisées pour l'ordre néolibéral mondial.
L'Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres États africains, aspirait autrefois à devenir un État développementaliste, un modèle qui canalise les ressources de l'État, les incitations du marché et la mobilisation de la société civile pour améliorer l'avenir de la population. Mais ces ambitions ont été progressivement érodées par la crainte de la fuite des capitaux, la discipline de la dette et une élite trop satisfaite du statu quo. Résultat ? Un État qui protège les monopoles et le capital financier, sans pour autant garantir la justice, la dignité et l'inclusion économique de la majorité.
Cet état d'esprit est évident dans la crise budgétaire, où l'ANC a insisté sur le fait que l'augmentation de la TVA était le seul moyen viable d'augmenter les recettes, tout en rejetant l'option d'augmenter les impôts sur la fortune ou les sociétés, invoquant la crainte que les riches exploitent les failles ou retirent leurs investissements.
Cette peur n'est pas seulement politique. Elle est psychologique. C'est la « blessure coloniale » décrite par Fanon, l'incapacité à nous considérer comme les acteurs de notre propre avenir. C'est important car l'industrialisation verte de l'Afrique ne se résume pas au climat. Pour l'Afrique, elle offre l'occasion de rompre avec les schémas d'extraction qui ont servi des intérêts extérieurs, et de suivre une voie centrée sur la souveraineté, la justice et la transformation économique.
Un plan pour l'avenir vert de l'Afrique
L'industrialisation verte implique d'utiliser les richesses minérales de l'Afrique non seulement pour l'exportation, mais aussi comme levier stratégique pour développer des chaînes de valeur nationales et régionales. Cela exige de repenser la logique qui sous-tend le développement industriel, en dépassant les modèles linéaires axés sur les gains en capital pour privilégier des approches régénératrices, redistributives, circulaires et socialement intégrées.
L'industrialisation verte de l'Afrique peut suivre différentes voies, allant des stratégies traditionnelles aux stratégies transformatrices, notamment la décarbonisation des industries telles que la construction, les infrastructures et la production d'énergie renouvelable, le développement des capacités nationales de transformation et de fabrication de minéraux essentiels, comme dans la technologie des batteries, les systèmes de transport public et les appareils économes en énergie adaptés aux contextes africains.
Les stratégies transformatrices remettent en question l'extractivisme et adoptent des modèles écologiques, solidaires et circulaires. Celles-ci peuvent inclure le recyclage à grande échelle, la réutilisation et l'exploitation minière urbaine des métaux et minéraux déjà en circulation afin de réduire la demande de nouvelles extractions ; la transition de l'agriculture et de l'agroalimentaire, passant des intrants industriels et de la dépendance aux combustibles fossiles à des systèmes agroécologiques qui restaurent les sols, améliorent la biodiversité et renforcent la souveraineté alimentaire ; la production d'énergie renouvelable communautaire et solidaire, garantissant que les transitions énergétiques répondent aux besoins publics et ne soient pas accaparées par les intérêts des entreprises ou des élites, et la démocratisation de la propriété et de la prise de décision dans les industries vertes.
À grande échelle, ces efforts peuvent non seulement stimuler les économies nationales, mais aussi transformer des vies. Une production et une transformation ancrées localement créeront des emplois, soutiendront les petites entreprises et développeront les compétences des communautés. Des systèmes énergétiques plus propres réduiront les coûts énergétiques des ménages et atténueront les impacts environnementaux.
Plus important encore, ce changement peut créer un avenir où le développement est centré sur les personnes, moins dépendant des marchés mondiaux volatils et guidé par les besoins et les capacités de l'Afrique.
Comme le souligne le rapport du Centre d'information et de développement alternatif, La controverse sur l'énergie verte : démasquer les zones critiques de sacrifice des minéraux en Afrique australe , l'expansion de l'énergie verte et de l'industrialisation verte ne doit pas reproduire les injustices des régimes miniers passés et présents.
Mais rien de tout cela n'est garanti. Sans un projet politique conscient et des dirigeants prêts à résister aux pressions néocoloniales, nous risquons de simplement verdir le même modèle extractif, inégalitaire et dépendant de l'extérieur dans lequel nous sommes prisonniers depuis des décennies.
La politique du nationalisme des ressources
Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a proposé de nouvelles taxes douanières draconiennes. Présentées comme une stratégie visant à protéger les travailleurs américains et à réduire la dépendance à la Chine, ces mesures protectionnistes visent à promouvoir l'industrie nationale, à affirmer la souveraineté économique des États-Unis et à reconfigurer le commerce mondial en faveur des intérêts américains.
Ces propositions n'ont pas été accueillies favorablement par tous. Alliés comme rivaux ont exprimé leurs inquiétudes, et de nombreux économistes mettent en garde contre la montée des tensions commerciales mondiales. Pourtant, peu de pays disposent des moyens de résister ou de riposter efficacement. Seuls les grands blocs économiques, comme l'Union européenne ou la Chine, ont la capacité de riposter. Les autres, notamment dans les pays du Sud, doivent souvent gérer les répercussions de ces changements, avec une marge de manœuvre limitée pour protéger leurs économies des chocs extérieurs.
Cette asymétrie géopolitique est illustrée par les récentes évolutions politiques au sein de l'Union européenne. Le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), par exemple, impose des droits de douane liés au carbone sur les importations de biens tels que l'acier, l'aluminium et le ciment. Bien que présenté comme une politique climatique, le MACF risque de pénaliser les pays en développement qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se décarboner au même rythme que l'Europe, ce qui affectera notre capacité à une industrialisation verte. Au lieu de soutenir les transitions bas carbone dans les pays du Sud, il risque plutôt de consolider les hiérarchies commerciales mondiales sous couvert de justice climatique.
De même, la loi européenne sur les matières premières critiques identifie les minéraux stratégiques essentiels à la transition verte de l'Europe et fixe des objectifs pour les sécuriser par l'extraction nationale et des « partenariats stratégiques » à l'étranger. Les pays africains sont censés fournir ces matières premières dans des conditions dictées par les besoins industriels européens, et non par les priorités de développement africaines, comme dans le cas des projets d'hydrogène vert en Namibie. Cela renforce l'externalisation des coûts écologiques et sociaux, l'Afrique fournissant les intrants d'une transition verte dont elle est largement exclue.
Pourtant, lorsque les gouvernements africains adoptent des outils similaires pour défendre leurs intérêts, par le biais d'interdictions d'exportation, d'exigences de contenu local, de mandats de valorisation ou de tarifs industriels, ils se heurtent à une forte résistance. Des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale mettent en garde contre les « distorsions du marché ». Les investisseurs menacent de désinvestir. Les commentateurs qualifient ces mesures de « protectionnistes » ou de « populistes », même lorsqu'elles s'inscrivent dans des programmes de développement démocratique.
Ce qui apparaît n'est pas une simple contradiction, mais une réalité structurelle : les règles du commerce et de l'investissement mondiaux sont façonnées par le pouvoir, et c'est ce pouvoir qui détermine qui peut les contourner ou les réécrire. Lorsque les grandes économies interviennent pour protéger ou réindustrialiser, cela est perçu comme stratégique. Lorsque les États africains cherchent à faire de même, ils sont censés rester « ouverts » et « favorables au marché ».
C'est pourquoi les pays africains doivent se doter du pouvoir politique et institutionnel nécessaire pour définir leurs trajectoires de développement, non pas en imitant l'Occident, mais en proposant des alternatives décoloniales et redistributives.
La solidarité régionale et le contrôle démocratique des ressources et des politiques fondées sur les réalités des économies africaines doivent être au cœur de ce projet.
Déconnexion et souveraineté panafricaine
Pour réussir, l'Afrique doit se déconnecter des systèmes mondiaux d'exploitation – qu'ils soient contrôlés par Washington, Bruxelles ou Pékin – et bâtir des institutions et des marchés panafricains solides. Cela implique d'approfondir les échanges commerciaux continentaux grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine, d'harmoniser les politiques industrielles et d'investir dans des infrastructures et des systèmes de recherche partagés.
Mais cela implique également de reconquérir un terrain idéologique. Le développement ne se résume pas à la croissance du PIB ou à la confiance des investisseurs. Il doit être synonyme de dignité, d'égalité, de durabilité écologique et du droit des peuples à décider de leur propre avenir.
Fanon croyait que la liberté ne se résumait pas à la fin du colonialisme, mais à la libération des esprits. Gumede, reprenant cette idée, affirmait que la voie vers l'émancipation africaine exigeait « une prise de conscience de la position subalterne du continent dans la matrice mondiale du pouvoir » et une rupture consciente avec les « structures socio-économiques et politiques qui rendent possibles l'exploitation et la domination ».
La transition verte de l'Afrique ne réussira pas si les dirigeants ont peur d'agir, de perturber ou d'imaginer différemment. Elle ne réussira pas si les élites extractives sont soumises au capital étranger. Elle ne réussira que si nous décolonisons non seulement nos économies, mais aussi nos consciences.
Et c'est la révolution la plus difficile de toutes.
Charlize Tomaselli est chercheuse principale au Centre d'information et de développement alternatifs.
*Cet article est co-publié avec le Mail & Guardian .
Traduction automatique de l'anglais
Source : https://www.amandla.org.za
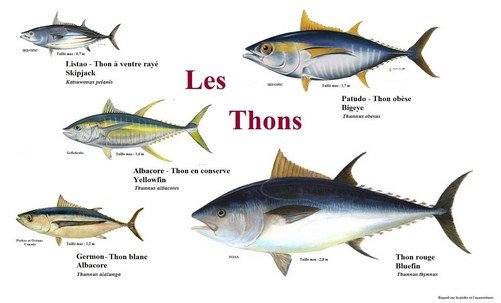
BBNJ : la haute mer sera-t-elle enfin bien protégée ?
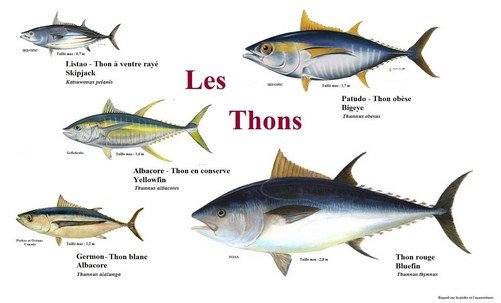
L'entrée en vigueur en début de 2026 du traité international régissant la haute mer, où l'anarchie règne actuellement, est vue comme une grande avancée pour la protection des océans bien que plusieurs pays importants ne l'aient pas signé.
L'acceptation formelle requise de 60 pays permettant à la prise d'effet du traité sur la haute mer (BBNJ) a été atteinte le 19 septembre avec les ratifications de la Sierra Leone et du Maroc. Si tout va comme prévu, il devrait entrer en vigueur le 17 janvier 2026. Le texte qui a été finalisé le 4 mars 2023 lors d'une conférence intergouvernementale à l'ONU et adopté le 19 juin 2023 est un instrument juridique contraignant.
Une avancée extraordinaire
La mise en vigueur du traité peut être considérée comme une victoire du multilatéralisme environnemental. Il devrait imposer l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Lisa Speer du programme international sur les océans du Natural Ressources Defense Council affirme à ce sujet : « aujourd'hui nous célébrons une avance extraordinaire et importante pour nos océans. »
Ce texte permet désormais aux États de créer pour la première fois en haute mer des aires marines protégées. Il demande le partage juste et équitable des avantages tirés des ressources, la traçabilité, le partage d'informations et l'obligation de réaliser des évaluations d'impact environnemental avant toute nouvelle activité en haute mer.
Il vise aussi à mettre en place une coordination et une coopération étroite avec tous les organismes concernés pour s'assurer que les objectifs de conservation et d'utilisation durable de la haute mer soient bien pris en compte dans leurs plans de gestion.
Le traité impose à tous les navires souhaitant réaliser des activités de recherche en haute mer de faire parvenir une déclaration détaillée à un Centre d'échange et de lui transmettre un rapport sur leurs activités au maximum un an après la fin de ces dernières.
S'il atteint ses objectifs, ce traité pourrait contribuer à améliorer la santé et la résilience des océans au-delà des juridictions nationales. Puisque la haute mer représente près des deux tiers de la superficie des océans et couvre près de la moitié de la surface de la planète, les progrès en matière de conservation qui en résulteraient pourraient être véritablement historiques.
La directrice de la coalition d'ONG High Seas Alliance, qui fédère une cinquantaine d'organisations, Rebecca Hubbard, considère de bon augure que des pays de tous les continents aient signé. Cela montre, selon elle, un engagement de ces pays qui pourraient aider à l'application sur le terrain du traité.
Des écueils à l'horizon : l'anarchie en haute mer
L'engagement des pays signataires du traité à aider à son application sur le terrain serait une chose importante puisque certains des plus puissants États de la planète comme l'Inde, la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis et tous les pays du G7, à l'exception de la France, n'ont pas ratifié ce traité.
C'est en effet la mise en application de toutes ces nouvelles réglementations qui est la clé du succès. Or, actuellement, l'exploitation des ressources de la haute mer s'y fait sans contrôle. Le secteur privé, les acteurs illégaux et même plusieurs pays profitent de biens communs mondiaux de manière anarchique. La pêche illégale et la surpêche y constituent des problèmes majeurs dans un environnement où il n'y a pas de règles et où il y a peu d'incitation à dissuader ces activités.
Le vice-président sénior chargé des océans au Fon
ds mondial pour la nature, Johan Bergenas, commente à ce sujet : « les océans au-delà des frontières nationales constituent la plus grande scène de crime au monde. »
De plus, ce traité ne porte pas sur des aspects déjà réglementés par des institutions existantes. La gestion de la pêche restera donc régie en priorité par les organisations régionales de pêche. Les ressources minérales des fonds marins resteront aussi gérées par l'Autorité internationale des fonds marins.
Un autre problème que devront résoudre les personnes qui vont appliquer ce traité est que le financement de nombreux processus opérationnels relèveront en partie des pays qui l'ont signé et devront être négociés entre eux, ce qui est un long processus. Ils pourraient donc avoir à en payer certaines parties les concernant comme la surveillance des aires marines protégées qui seront en haute mer, donc très loin de leurs côtes.
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »

Amnesty International publie un nouveau rapport intitulé Breaking up with Big Tech (« Rompre avec les géants de la technologie ») qui appelle les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains.
17 septembre 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/13/amnesty-lance-un-rapport-intitule-rompre-avec-les-geants-de-la-technologie/
Les cinq grandes entreprises de la tech que sont Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple exercent une influence extraordinaire sur les infrastructures, les services et les normes qui façonnent notre vie en ligne. Ces entreprises dominent des secteurs clés de l'Internet, des moteurs de recherche et des médias sociaux aux boutiques d'applications et à l'informatique en nuage. Leur pouvoir largement incontrôlé dans divers secteurs du numérique fait peser de graves risques sur le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, la liberté d'opinion et l'accès à l'information.
Le rapport explique comment ces grandes entreprises technologiques ont bâti leur pouvoir, comment elles le maintiennent et comment elles s'efforcent à présent de le consolider davantage encore dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle.
« Ces quelques entreprises agissent dans le domaine du numérique comme des propriétaires qui déterminent la forme de nos interactions en ligne. » – Hannah Storey, conseillère en matière de plaidoyer et de politique relative à la technologie et aux droits humains à Amnesty International.
« Il est essentiel de s'attaquer à cette domination, non seulement pour des questions d'équité du marché, mais aussi parce qu'il s'agit d'une urgence en matière de droits humains. Le démantèlement de ces oligarchies technologiques contribuera à créer un environnement en ligne équitable et juste. Ne pas s'attaquer à la domination des géants technologiques peut avoir de graves conséquences hors ligne, comme l'ont montré nos enquêtes sur le rôle de Facebook dans la guerre du Tigré en Éthiopie et le nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar. »
Dans de nombreux pays, ces plateformes sont désormais tellement ancrées dans la vie quotidienne que la participation significative à la société dépend désormais de l'utilisation de leurs services. Cela leur confère un pouvoir énorme pour influencer le discours public et contrôler les flux d'informations.
Les cas recensés de suppression de contenu, de pratiques de modération incohérentes et de biais algorithmiques soulignent les dangers liés au fait de laisser quelques entreprises dominer la sphère publique numérique.
Aux termes du droit international relatif aux droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger et réaliser les droits humains, notamment avec la réglementation et en recourant à d'autres mesures pour contrôler le pouvoir des entreprises.
C'est la première fois qu'Amnesty International publie un rapport de cette nature afin de souligner que les États doivent de toute urgence s'attaquer au problème du pouvoir incontrôlé de ces entreprises technologiques.
Le 12 août 2025, Amnesty International a transmis à Meta, Google, Amazon, Microsoft et Apple un résumé des conclusions présentées dans son rapport. Meta et Microsoft ont répondu par écrit ; leurs réponses ont été intégrées au rapport. Google, Amazon et Apple n'avaient pas encore répondu au moment de la publication.
Des instances de régulation et des organisations de la société civile à travers le monde ont pris diverses mesures pour tenter de régler ce problème.
Amnesty apporte son soutien à ces initiatives en publiant cette approche fondée sur les droits humains en ce qui concerne le droit de la concurrence et le pouvoir des marchés.
Les États et les autorités de la concurrence devraient utiliser la législation relative à la concurrence en tant qu'outil au service des droits humains. Les États devraient aussi enquêter et sanctionner les comportements anticoncurrentiels qui portent atteinte aux droits humains, empêcher la capture réglementaire et empêcher la formation de monopoles nuisibles.
Le rapport recommande aux États, entre autres mesures :
- d'enquêter sur les grandes entreprises technologiques au sujet des pratiques anticoncurrentielles qui portent atteinte aux droits humains ;
- de démanteler les entreprises dont le pouvoir monopolistique porte atteinte aux droits humains ;
- d'enquêter sur le secteur émergent de l'IA générative afin de déterminer quels sont les risques et les répercussions sur les droits humains liés aux pratiques anticoncurrentielles ;
- de bloquer les fusions et acquisitions qui risquent de porter atteinte aux droits humains ; et
- d'intégrer les considérations relatives aux droits humains dans les enquêtes et les décisions portant sur les pratiques anticoncurrentielles.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











