Derniers articles

Marine Le Pen célèbre l’Internationale facho

10 juin 2025 |Tiré de la lettre de Regards.fr
06:10 (il y a 3 heures)
Finito la dédiabolisation, la cheffe de l'extrême droite française se « trumpise » avec ses semblables européens autour d'un adversaire commun : l'UE.
Un an après les élections européennes de juin 2024, Marine Le Pen s'est offert, en plein Loiret, un jubilé de victoire (relative) des extrêmes droites du continent. Dans une mise en scène soigneusement orchestrée, entre drapeaux nationaux et accents martiaux, elle a célébré le premier anniversaire de la création de son groupe au Parlement européen en compagnie de ses alliés : le premier ministre hongrois Viktor Orbán, le néo-franquiste espagnol Santiago Abascal (Vox), le nazillon autrichien Herbert Kickl (FPÖ), le fasciste italien Mateo Salvini (Ligue du Nord) et Jordan Bardella, désormais président de groupe et dauphin désigné. Une Europe des nations, contre Bruxelles. Une Internationale des nationalistes, contre la gauche, les juges, les immigrés et les minorités. Une scène. Et derrière, un virage stratégique majeur.
Marine Le Pen, depuis 2017, s'était appliquée à lisser sa rhétorique sur l'Europe. Finie la sortie de l'euro, oubliée la tentation du Frexit, elle s'était faite gestionnaire de la souveraineté. Mais à Mormant-sur-Vernisson, elle est redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être : une adversaire frontale de l'Union européenne. Elle l'a qualifiée de « tombeau de promesses politiques non tenues », de machine « woke et ultra-libérale », jugeant que l'heure n'était plus à la réforme de l'intérieur mais à la reconquête : « Nous ne voulons pas quitter la table. Nous voulons terminer la partie et gagner. »
La formule résume une stratégie : renverser Bruxelles de l'intérieur. Affaiblir la Commission. Asphyxier le Parlement. Coaliser les forces identitaires, climatosceptiques, autoritaires. Et redonner à chaque capitale le droit de s'opposer à la solidarité européenne. L'Union n'est plus un cadre de négociation : c'est un ennemi. Et elle entend le diriger depuis Strasbourg.
Cette offensive est menée avec Viktor Orbán, dont Marine Le Pen se rapproche plus que jamais. Le chef du gouvernement hongrois, mis au ban par Bruxelles pour atteinte à l'État de droit, trônait à ses côtés. Plus qu'un allié, un frère d'armes. Avec lui, Le Pen ne partage pas seulement une alliance stratégique : elle épouse une vision du pouvoir. Répression des ONG, contrôle des médias, priorité nationale à l'économie, rejet de l'immigration et mise au pas des contre-pouvoirs. Ce n'est plus l'extrême droite marginale : c'est un projet d'alternative civilisationnelle.
Ce tournant s'était déjà amorcé le 1er mai 2025 : pour la première fois, Marine Le Pen avait publiquement adopté le lexique anti-« wokisme », jusqu'ici manié avec prudence. Loin de sa rhétorique souverainiste classique, elle a accusé la gauche, les féministes, les antiracistes d'« imposer leur vision du monde », reprenant les codes sémantiques forgés par la droite américaine. L'héritière du FN, longtemps méfiante à l'égard des guerres culturelles, est désormais pleinement engagée dans la bataille culturelle — et idéologique.
Et puis il y a Trump. Longtemps, Marine Le Pen avait tenu à distance le président américain. Trop instable, trop provocateur, trop dangereux. Elle s'en distinguait pour mieux rassurer les électeurs français. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle en mime sa posture et adopte son récit de persécution. Après sa récente condamnation judiciaire pour détournement de fonds, elle enfile le costume de la martyre politique, persécutée par l'establishment. Une stratégie directement calquée sur celle du milliardaire américain, devenu modèle plus qu'inspiration. Et si elle y fait référence, ce n'est pas un hasard. C'est qu'elle pense que cela peut marcher. Trump n'est plus, pour son électorat, un épouvantail à moineaux. Il est une force. Il est la revanche des humiliés, des « vrais gens » contre les élites mondialisées. En s'alignant sur lui, Le Pen entend galvaniser sa base : elle veut faire croire que l'Histoire est de son côté. Qu'elle aussi, bientôt, passera de l'opposition au pouvoir. Comme Trump en 2016. Comme Orbán depuis 2010.
Ce repositionnement dur n'est pas qu'européen. Il vise aussi à affirmer son hégémonie sur la droite française. En ligne de mire : Bruno Retailleau. Le président des LR tente, du haut de son magistère de Beauvau, de se positionner comme tête de proue d'une droite ultraconservatrice et autoritaire. Mais il demeure symbole d'un vieux monde politique, asséché, solitaire. En s'affichant avec des chefs d'État et de parti d'envergure continentale, Marine Le Pen se pose en figure d'autorité : elle organise des sommets avec des puissants et prépare l'OPA mondiale des extrêmes droites.
Ce tournant idéologique, stratégique et symbolique n'est pas un simple glissement. C'est une offensive. Marine Le Pen a digéré sa dédiabolisation. Elle veut incarner le pouvoir, la victoire, la force. La gauche ne peut plus se contenter de la renvoyer à son passé familial ou à son programme économique vide. Elle doit comprendre ce que ce discours produit : un sentiment d'ordre, de virilité politique, d'unité culturelle. Si Le Pen se met à parler comme Trump, ce n'est pas une erreur de communication. C'est un calcul : pour le RN, la France aussi est mûre pour l'extrême droite populiste. Pour gouverner avec Orbán. Avec Trump. Et sûrement aussi avec Poutine.
Pablo Pillaud-Vivien
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Notre capitaine Achab

Notre perspective ne peut être qu’un changement radical de société

Le Conseil national des 7 et 8 juin a porté de façon centrale sur les perspectives avancées par Ruba Ghazal. Le Manifeste était au cœur des discussions et la table ronde qu'elle animait portait sur le thème d'un gouvernement des travailleuses et des travailleurs. Dans cette mesure Ruba a gagné son pari.
Le panel, animé par Ruba Ghazal, a été l'occasion d'aborder entre autres les attaques du gouvernement Legault contre les droits des travailleuses et travailleurs et faisait des comparaisons avec le PL 5 en Ontario. L'annexe 9 de ce projet de loi omnibus, actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario, accorderait au gouvernement le pouvoir élargi de désigner, n'importe où dans la province, des « zones économiques spéciales ». Dans ces zones, le gouvernement provincial peut suspendre ou annuler toutes les lois et réglementations existantes concernant les conditions de travail, la santé et la sécurité, et les protections environnementales, ainsi que les règlements municipaux.
Les orientations politiques
La partie cruciale, la crise environnementale, ne faisant pas partie du Manifeste ni de la discussion de ce Conseil national. Plusieurs associations et Comités d'Action Politique (CAP) ont apporté des propositions pour y remédier. L'asso de Maurice-Richard proposait l'amendement suivant concernant le logement :
Il le fera en promouvant un modèle de développement écoresponsable à l'opposé des politiques d'étalement urbain et de gentrification qui exclut les classes populaires et participe à leur appauvrissement. Il n'hésitera pas à légiférer dans ce sens afin de bloquer les projets d'un marché débridé.
Cette proposition a été battue au profit d'une résolution appuyée par un membre du CCN, qui proposait à la place : « en priorisant les projets de développement durable », un concept plutôt sans saveur.
L'ajout d'un texte indiquant que les investissements requis pour rebâtir les services publics devraient être financés par l'augmentation des taxes sur les milliardaires, les surprofits des grandes pétrolières, les surprofits des grandes chaînes d'épicerie, les surprofits des multinationales de la haute technologie telles qu'Amazon, Apple, Meta, et Google a été référé.
En ce qui concerne la Proposition 5 Droits des travailleurs et travailleuses, la résolution du CAP indépendance a été adoptée presque dans sa totalité : Un gouvernement solidaire mettra en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la démocratie dans les institutions publiques et les milieux de travail, en favorisant la participation directe des travailleuses et des travailleurs aux décisions, et la transparence dans la gestion.
Un débat très intéressant concernant la transition juste a conduit à l'adoption du texte suivant : un gouvernement de Québec solidaire s'engagera dans une transition sociale et écologique juste, équitable et transformatrice. Il investira massivement dans le transport collectif électrifié et urbain, régional et interrégional, travaillera à la sortie des hydrocarbures et des industries ultrapolluantes et au développement massif des énergies renouvelables, le tout sous contrôle public et démocratique.
Il travaillera de concert avec les mouvements sociaux et syndicaux, les populations vulnérables et les Peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement dans la construction d'un mouvement unitaire pour cette transition. Celle-ci doit se faire en planifiant l'avenir avec les travailleurs et travailleuses, pas contre elles et eux. La division entre travailleuses et travailleurs fait le jeu du système capitaliste et des véritables responsables de la crise climatique, dont les grandes entreprises polluantes. En pleine crise du coût de la vie, la culpabilisation des individus est une impasse.
Une position sans équivoque concernant la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques,
Pour que les travailleuses et les travailleurs puissent se défendre et conquérir de nouveaux droits, un gouvernement solidaire interdira les lockout, inscrira le droit de grève dans la Charte des droits et libertés de la personne et s'assurera de faire respecter la Charte des droits et libertés et la Loi sur les normes du travail pour toutes les travailleuses et travailleurs, y compris évidemment celles et ceux provenant de minorités ou au statut temporaire.
Il abrogera également toute loi établissant une forme de discrimination ou de racisme systémique contrevenant à l'esprit de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, notamment les articles de loi visant les personnes portant des signes d'appartenance religieuse.
Quatre résolutions d'urgence adoptées
Concernant le 30e anniversaire de la marche Du pain et des roses, le soutien à la Palestine et la dénonciation de la complicité de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'opposition de QS à la réforme énergétique de la loi 69 et à la réforme du régime forestier de la loi 97.
Quelles seront les suites ?
Le congrès de l'automne prochain doit réviser le programme, ce qui est en soi une nécessité afin de mieux répondre à la situation politique actuelle et à la montée du conservatisme et de la droite. Cependant, lors du Conseil national de Saguenay tenu en mai 2024, nous avons adopté la position suivante : [1]
Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus d'actualisation de son programme, qui sera suivi par l'adoption de la plateforme électorale.
Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'actualisation du programme, pour adoption lors d'un Congrès spécial en 2025. Que le processus soit guidé par les balises suivantes :
a. Que le programme prenne la forme d'un document présentant la vision politique de Québec solidaire ainsi que sa philosophie gouvernementale générale et sa vision de la transformation sociale et notre projet visant à renverser le statu quo politique au Québec, afin d'encadrer notamment l'élaboration des plateformes électorales du parti ;
b. Le programme de Québec solidaire ne se limite pas à définir les orientations d'un éventuel gouvernement solidaire, mais aussi les axes de transformations sociales et politiques nécessaires à l'atteinte d'un Québec écologiste, égalitaire, démocratique, féministe, altermondialiste et souverain.
c. Que le programme soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques ;
d. Que le programme respecte l'esprit de la « Déclaration de principes » adoptée à la fondation de Québec solidaire ainsi que l'entente de fusion entre Québec solidaire et Option nationale ;
e. Que le programme soit le résultat d'une réflexion impliquant l'ensemble du parti et portant notamment sur les grandes orientations politiques du parti, en dehors des réflexions conjoncturelles ;
f. Que le processus se fasse de façon démocratique, mobilisatrice et en impliquant l'ensemble des membres et des instances statutaires de Québec solidaire ;
g. Qu'au cours du processus de consultation des membres et des instances statutaires de Québec solidaire, ces personnes et ces instances soient invitées à échanger en ateliers autour des grandes orientations du programme.
Avec des paramètres semblables, il sera difficile de faire une campagne politique qui permettra de contrer le discours dominant de droite concernant la culpabilisation des personnes immigrantes qui seraient responsables de la crise du logement, le nationalisme identitaire, l'augmentation du budget militaire. Comment pourrons-nous dans un cadre de débat aussi court et restreint, répondre à une problématique politique de plus en plus intense et complexe ?
De plus, en limitant les changements possibles aux programems et les paramètres de la plateforme à quelques engagements électoraux, nous confinons nos perspectives à une voie parlementariste et non de combat de changement do société.
Voilà nos défis, notre perspective ne peut être qu'un changement radical de société, pour y arriver nous devons élargir le processus de débat, la crise environnementale à elle seule le réclame !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Abolir le patriarcat. L’utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus

« Abolir le patriarcat. L'utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus, Presses universitaires de Saint-Étienne, collection "Le Genre en toutes lettres", Saint-Étienne, 2025. https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
Se souvient-on encore de James Henry Lawrence et de son roman « L'Empire des Nairs », un rêve d'un monde où les femmes sont libérées de la dépendance des hommes ? À contre-courant des mœurs et des lois de son époque, Lawrence invente un équilibre inédit entre les rôles de genre : il imagine un monde où les femmes transmettent la propriété et le nom de famille, et assument seules l'éducation des enfants.
Comment est né ce livre ? Quelle a été sa destinée ? Quels échos a-t-il suscités à l'époque, et dans quelles traditions intellectuelles peut-on le situer ? Cet essai répond à ces questions et présente une étude inédite de l'auteur.
*Par sa critique du patriarcat et des violences de genre, et par les moyens qu'il met en œuvre pour répondre aux enjeux de la liberté pour les deux sexes, Lawrence se révèle d'une étonnante modernité.*
*Anne Verjus, *directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française, explore les logiques du patriarcat à travers ses deux piliers : le mariage et la paternité. Depuis ses premiers travaux, elle considère la recherche comme un levier de transformation sociale.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 10 juin 2025

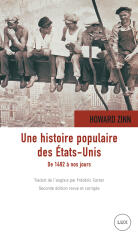
Une histoire populaire des États-Unis
Howard Zinn
Traduit de l'anglais
Ce fut un cadeau de ma femme et c'est un livre que tout le monde devrait lire. Cette histoire des États-Unis nous présente le point de vue des sans voix, de ceux dont les manuels d'histoire parlent peu et au sort desquels on s'intéresse encore moins dans l'actualité. Howard Zinn y confronte la version officielle et héroïque de l'histoire à la réalité et aux témoignages des acteurs les plus modestes : les Indiens, les esclaves en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les activistes et les victimes contemporaines de la politique intérieure et étrangère américaine. « Une histoire populaire des États-Unis » est un livre de référence incontournable.
Extrait :
Deux mois plus tard à Charleston, dans le sud de l'État, il [Abraham Lincoln] déclarait : « Je dirai, donc, que je ne suis pas - et n'ai jamais été - pour l'instauration sur quelque mode que ce soit d'une égalité sociale et politique des races blanche et noire (applaudissements). Je ne suis pas non plus - et n'ai jamais été - pour que l'on accorde aux Noirs le droit de vote ou celui d'être juré ; pas plus que pour autoriser leur accession aux postes administratifs ou les mariages interraciaux. [...] Aussi, comme tout cela leur est interdit et qu'ils doivent rester entre eux, il en découle qu'il doit nécessairement y avoir des supérieurs et des inférieurs. En ce qui me concerne, comme tout le monde, je suis favorable à ce que les Blancs jouissent de ce statut de supériorité. »

La Chine contemporaine
Alain Roux
Alain Roux est l'un de nos plus éminents sinologues. Il a publié sur le sujet de très nombreux ouvrages et de nombreux articles dans Le Monde diplomatique et Manière de voir. Cette sixième édition de son ouvrage « La Chine contemporaine » nous permet de mieux comprendre l'histoire de ce pays depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nous jours, depuis la chute de l'empire Qing, en passant par l'instauration de la République de Chine en 1912 sous Sun Yat-sen, par la création de la République populaire de Chine en 1949 sous Mao Zedong, par le grand bond en avant et par la révolution culturelle. Il nous explique les luttes et les avancées, les tiraillements, les erreurs coûteuses en vies humaines, les importants jalons aussi, qui ont permis à ce pays longtemps le plus populeux de la planète de lentement émerger d'un siècle de dominations et de misères, d'importants retards technologiques, pour devenir l'une des principales puissances économiques et industrielles de la planète. Une analyse honnête et sans compromis de la Chine, du chemin qu'elle a parcouru et de celui qu'il lui reste à faire.
Extrait :
À la fin du XIXe siècle, à partir des guerres de l'Opium (1840-1860),la Chine des Mandchous paraît vouée à l'éclatement. Les grandes puissances y découpent des zones d'influence, imposent l'humiliation des Traités inégaux à un État incapable de défendre sa souveraineté, tandis que le retard entre l'immense pays et le niveau de développement atteint par les nations les plus dynamiques s'accroît sans cesse. Jadis centre civilisateur rayonnant sur toute l'Asie orientale, l'Empire du Milieu a raté le rendez-vous de la révolution industrielle et n'est plus qu'une province déshéritée du monde moderne.

Sur ma mère
Tahar Ben Jelloun
Tahar Ben Jelloun est reconnu comme l'un des écrivains les plus traduits au monde. Son livre "Sur ma mère" se situe à la frontière entre le roman et le récit. Il porte sur sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant des journées entières, alors qu'il vient passer du temps à ses côtés et la veiller, l'auteur l'écoute dans ses moments de lucidité comme dans ceux où elle perd pied et où la réalité n'a plus de prise sur elle. Malgré sa souffrance face à sa propre impuissance, il découvre celle qui lui a donné la vie. Les souvenirs qu'elle lui offre au fur et à mesure de ces longues heures douloureuses permettent à l'écrivain de reconstituer sa vie dans la ville de Fès des années trente et quarante et de plonger dans les ressentis de la fille, de l'épouse et de la mère qu'elle a été. Tahar Ben Jelloun nous dit que ce récit est celui d'une vie dont il ne connaissait rien, ou presque rien. Une œuvre vraiment touchante.
Extrait :
Depuis qu'elle est malade, ma mère est devenue une petite chose à la mémoire vacillante. Elle convoque les membres de la famille morts il y a longtemps. Elle leur parle, s'étonne que sa mère ne lui rende pas visite, fait l'éloge de son petit frère qui, dit-elle, lui apporte toujours des cadeaux. Ils défilent à son chevet et passent de longs moments ensemble. Je ne la contrarie pas. Je ne les dérange pas. Sa femme de compagnie, Keltoum, se lamente : « Elle croit que nous sommes à Fès l'année de ta naissance. »
La condition humaine
André Malraux
Ce fut le premier et seul roman que ma mère m'empêcha momentanément de lire. J'étais assez jeune et c'est l'enthousiasme créé par l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque municipale avec ses livres neufs qui sentaient si bon qui m'avait fait choisir ce roman parmi une foule d'autres. Je me suis repris plus tard et plus tard encore. Ce grand roman, le plus connu de Malraux, relate le parcours d'un groupe de révolutionnaires communistes chinois préparant le soulèvement de la ville de Shanghai. Au moment où commence le récit, le 21 mars 1927, communistes et nationalistes préparent une insurrection contre le gouvernement...
Extrait :
Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bangladesh : Journée internationale de commémoration des luttes des travailleurs

Aujourd'hui, le 1er mai 2025, la Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF) a organisé une réunion-débat pour commémorer le grand 1er mai, Journée internationale de la solidarité des travailleurs, dans ses locaux de Dhaka. Présidée par le président par intérim de la BSBWWF, le camarade Badrul Alam, la réunion a été animée par le secrétaire général de la BSBWWF, AKM Shadul Alam Faruq, et le coordinateur du Progotisheel Krishok Sangram Parishad, Sultan Ahmed Biswas, entre autres.
1er mai 2025 - BSBWWF (Bangladesh)
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75253
Au début de la réunion, les dirigeants se sont levés pour rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs au Bangladesh et partout dans le monde qui sont mort.e.s au travail et ont observé une minute de silence à leur mémoire. Ils ont également exprimé leur respect et leurs vœux de rétablissement aux personnes blessées. Leurs familles doivent recevoir une indemnisation. Les orateurs ont également demandé avec force la ratification de la Convention 102 de l'OIT et la mise en œuvre des Conventions 87 et 98 de l'OIT. Ils ont ajouté qu'ils exigeaient la mise en œuvre de tous les droits des travailleurs mentionnés dans la loi sur les syndicats, y compris la protection de la santé au travail et la sécurité sociale dans le secteur de la construction.
Les intervenants ont insisté sur la question de l'augmentation du salaire minimum des travailleurs, de la réouverture des usines qui ont licencié leurs employé.e.s, du paiement des arriérés de salaire, de la mise en œuvre des recommandations des organisations syndicales à la Commission de réforme du travail, de la mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives au travail, à la sécurité au travail, de la déclaration d'un salaire minimum de 30 000 Tk, etc.
Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF)

Gaza : la CSI appelle à une action urgente pour mettre fin à la catastrophe humanitaire

En réponse à l'escalade de la violence à Gaza et à la catastrophe humanitaire qui s'y déroule, la Confédération syndicale internationale (CSI) appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages, à une aide humanitaire urgente et à un regain des efforts mondiaux en faveur d'une paix juste et durable fondée sur une solution prévoyant deux États.
Tiré du site de la Confédération syndicale internationale.
« Les horreurs qui se déroulent à Gaza et dans toute la région doivent cesser immédiatement. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire et de la libération de tous les otages conformément au droit international. La vie et la liberté des civils, en particulier des enfants, ne doivent pas être sacrifiées dans les conflits politiques. Les syndicats défendent la paix, la démocratie et la protection de tous les droits humains », a déclaré Luc Triangle, secrétaire général de la CSI.
La CSI exprime sa profonde préoccupation concernant les pertes en vies humaines sans précédent parmi les civils, et en particulier les effets dévastateurs sur les enfants, notamment la malnutrition et la famine généralisées. Elle réaffirme sa condamnation de toutes les attaques contre les populations civiles et des violations du droit humanitaire international, y compris le ciblage de zones résidentielles, le refus d'apporter une aide essentielle à la population civile et la prise d'otages.
Le mouvement syndical international exige :
– un cessez-le-feu immédiat et permanent, et la fin de toutes les attaques contre les civils ;
– la libération immédiate de tous les otages ;
– l'accès humanitaire sans entrave aux populations touchées ;
– le soutien à la reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution juste prévoyant deux États, fondée sur le droit international ;
– la réouverture urgente du marché du travail israélien aux travailleurs palestiniens et le paiement des arriérés de salaires dus à plus de 200 000 travailleurs, conformément à la plainte déposée par la CSI et les Fédérations syndicales internationales auprès du BIT ;
– le soutien au travail humanitaire essentiel de l'UNRWA et au programme de l'OIT en faveur du territoire palestinien occupé.
La CSI est solidaire de ses organisations affiliées et des autres forces démocratiques, tant en Palestine qu'en Israël, qui continuent de promouvoir la paix et la réconciliation dans un contexte de grande adversité. Il n'y a pas de place pour les extrémistes dans un processus de consolidation de la paix.
La CSI appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts sur le plan diplomatique pour remédier aux causes profondes du conflit, notamment l'occupation illégale, l'expansion des colonies et le déni systémique des droits des Palestiniens. La récente annonce par le gouvernement israélien de l'implantation de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie doit dès lors être fermement condamnée. En outre, il convient d'exiger des garanties solides qu'aucune nouvelle attaque de missiles ne sera lancée sur Israël.
« Nous soutenons tous ceux qui, dans les deux camps, s'opposent à la haine et à la division et œuvrent pour un avenir fondé sur la coexistence et la sécurité commune. La communauté internationale doit agir de toute urgence et par principe. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale », a indiqué Luc Triangle.
La CSI exhorte tous les gouvernements, institutions multilatérales et syndicalistes du monde entier à renforcer l'appel en faveur de la paix, à soutenir les efforts humanitaires et à rester solidaires des peuples de Palestine et d'Israël dans leur lutte pour la paix et la prospérité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le SNJ-CGT soutient les dockers CGT du Golfe de Fos

Le SNJ-CGT exprime sa solidarité totale avec les dockers CGT du Golfe de Fos, qui ont refusé de charger des conteneurs d'armement qui devaient embarquer depuis le port de Marseille-Fos à destination d'Israël.
Les dockers CGT du Golfe de Fos ont rappelé qu'ils ne sont pas des exécutants aveugles, mais des acteurs conscients et responsables. Nos camarades ont agi dans l'esprit des valeurs fondamentales de la CGT : solidarité internationale, refus de la guerre et défense des droits humains.
Le SNJ-CGT salue cet acte car il est de notre devoir de soutenir celles et ceux qui, au nom de la paix et de la justice, refusent la complicité avec des opérations militaires contraires au droit international et à la dignité humaine.
Alors que les journalistes continuent - malgré les assassinats, les violences et les menaces - de documenter les ravages à Gaza et les violations des droits des Palestiniens en Cisjordanie, l'action des dockers CGT est un geste de fraternité et de résistance qu'il faut saluer.
Le SNJ-CGT appelle l'ensemble des syndicats, des travailleurs et des citoyens à soutenir les dockers CGT du Golfe de Fos et à interpeller les pouvoirs publics pour que la France ne soit plus complice de la guerre.
Pas d'armes pour les criminels de guerre !
Soutien aux dockers CGT du Golfe de Fos !
Montreuil, le 6 juin 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De la Biélorussie aux risques biologiques : les syndicats revendiquent des initiatives de la part de la Conférence internationale du travail (CIT)

Les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail se réunissent chaque année en juin à l'occasion de la Conférence internationale du travail (CIT), à Genève, en Suisse. Cette année, la CIT débute le 2 juin et se penchera sur d'éventuelles nouvelles normes internationales relatives à la protection des travailleurs et travailleuses contre les risques biologiques dans l'environnement de travail ainsi qu'au travail décent dans l'économie de plateforme.
27 mai 2025 - tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/03/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de-la-conference-internationale-du-travail-cit/
Pourquoi la CIT est-elle importante pour les syndicats ?
La Conférence internationale du travail réunit les travailleurs et travailleuses, les gouvernements et les représentants des employeurs sur un pied d'égalité. Par l'intermédiaire du groupe des travailleurs, les organisations syndicales nationales et internationales peuvent influencer les politiques des gouvernements et des employeurs, par exemple lors de l'élaboration des conventions et du suivi de leur mise en œuvre au sein des États membres.
La conférence est également importante pour les syndicats, car :
- C'est l'occasion de demander aux gouvernements de rendre des comptes sur les violations du droit du travail dans leur pays.
- Elle offre une exposition internationale aux cas de violation des droits des travailleurs.
- Elle peut contribuer à résoudre les violations en formulant des recommandations d'action aux gouvernements et en sanctionnant l'assistance technique aux États membres.
IndustriALL participe cette année à la discussion sur d'éventuelles normes internationales sur la protection des travailleurs contre les risques biologiques, ainsi qu'aux discussions sur la promotion de la transition vers des statuts formels dans le cadre du travail décent. IndustriALL fera également partie du groupe des travailleurs dirigé par la CSI au sein du Comité de normalisation sur le travail décent dans l'économie de plateforme.
L'OIT est invitée à appliquer l'article 33 au Myanmar
Au début de cette année, le Conseil d'administration de l'OIT a rédigé une décision sur le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar, recommandant à la CIT d'envisager des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT pour garantir le respect par le Myanmar du rapport de la commission. Les motifs invoqués sont l'incapacité de la junte militaire à mettre en œuvre les recommandations formulées après qu'une commission d'enquête de l'OIT a constaté de graves violations des protocoles relatifs au travail forcé et à la liberté syndicale.
L'invocation de l'article 33 ne s'est produite que deux fois dans l'histoire de l'OIT, la dernière fois étant à propos de la Biélorussie en 2023, ce qui souligne la gravité des violations des droits des travailleurs commises dans ce pays. La Biélorussie est devenue l'un des pires pays au monde pour les travailleurs, où les syndicats indépendants ont été démantelés, les droits du travail criminalisés et la liberté syndicale complètement supprimée, ce qui a suscité des appels urgents à l'action internationale et à l'intervention de l'OIT.
Qu'est-ce que la Commission de l'application des normes (CAN) ?
La CAN est un élément essentiel du système de contrôle de l'OIT, car elle vérifie la manière dont les normes de l'OIT sont appliquées par les États membres. Il existe une liste préliminaire de 40 cas, dont 24 seront sélectionnés pour être discutés par la CAN. En outre, une séance spéciale de la CAN sur la Biélorussie aura lieu le 7 juin.
Avec les syndicats affiliés présents à Genève pendant la CIT, ainsi que d'autres militants, les Fédérations syndicales internationales prévoient un certain nombre de manifestations auprès de la sculpture dite Broken Chair (Chaise brisée), devant le Palais des Nations. Cette sculpture symbolise la résistance à la violence et sert de point de rencontre pour les manifestations en faveur des droits de l'homme et des droits du travail.
3 juin : rassemblement pour le Myanmar
4 juin : rassemblement pour les travailleurs et travailleuses des plateformes
5 juin : rassemblement pour la Biélorussie
9 juin : rassemblement pour l'Ukraine
https://www.industriall-union.org/fr/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nickel, ce “métal du diable” qui ravage la Nouvelle-Calédonie

Indispensable à la fabrication des batteries, le nickel, abondant sur le territoire, est exploité sans limites, créant des dégâts environnementaux et économiques. La colère gronde chez les Kanaks explique le journal néerlandais “De Volkskrant”.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Isabelle Goa cherche des crabes au milieu des mangroves d'Oundjo. Depuis l'arrivée de l'usine de traitement de la mine de nickel de Koniambo, ils se font rares. Photo Sven Torfinn. Article paru à l'origine dans Volkskrant.nl
Les bottes d'Isabelle Goa (57 ans) s'enfoncent dans la boue spongieuse des mangroves d'Oundjo. Penchée en avant, elle progresse lentement vers les vagues du Pacifique, qui viennent s'écraser au loin contre la côte rocheuse. Tous les quelques mètres, elle plonge un bâton dans la vase. Le ressac et le bruit de la terre humide la ramènent à son enfance, à l'époque où sa mère lui apprenait à attraper des crabes, des poissons et des coquillages pour le dîner.
“Les mangroves, c'est notre garde-manger, notre inépuisable potager”, se félicite-t-elle tout en marchant. “Mais regarde un peu ce désastre”, ajoute-t-elle d'emblée en désignant la boue rouge qui colle à ses bottes. Les broussailles se retirent pour faire place à une étendue brune, vaste comme dix terrains de football. “On appelle ça la zone morte. La terre est rougie par les minerais. Tous les arbres sont morts. Et tout ça, c'est à cause de cette machine meurtrière, là-bas un peu plus loin. C'est un monstre.”
Ce “monstre”, c'est l'usine métallurgique de la mine de nickel de Koniambo [dite mine KNS], dans le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. De loin, elle évoque une cathédrale industrielle faite de tuyaux et de cheminées qui s'élève au-dessus des mangroves. Sortie de terre il y a onze ans au bord d'un lagon d'un bleu azur classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa richesse corallienne, l'usine permet de traiter et d'exporter en un temps record des quantités gigantesques de nickel vers un marché mondial dont la faim est impossible à assouvir.

Après l'Indonésie, les Philippines et la Russie, la Nouvelle-Calédonie est le quatrième producteur mondial de nickel – une filière stratégique à l'heure de la transition verte. Selon l'Institut de relations internationales et stratégiques, la demande mondiale de nickel devrait augmenter de 75 % d'ici à 2040. Un boom dû à la transition énergétique, censée tourner la page des énergies fossiles et, par la même occasion, de la pollution massive qu'elles représentent et des violations des droits humains qu'elles favorisent.
Le leurre d'un modèle de croissance plus propre
Résistant à la corrosion et recyclable, le nickel est utilisé depuis longtemps dans la fabrication de l'acier inoxydable, mais c'est aussi un matériau clé pour l'industrie “verte”. Il constitue le “N” des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) des voitures électriques. Les constructeurs automobiles européens et américains préfèrent pour l'instant les batteries NMC à la variante LFP sans nickel, car elles sont plus denses en énergie et donc plus compactes et plus rapides à charger.
Ce que le charbon fut au XIXe siècle, et le pétrole au XXe, le nickel, le cobalt, le lithium et les terres rares le sont au XXIe : les piliers de la révolution industrielle, la troisième. “Au cours des trente prochaines années, nous aurons besoin de plus de minerais que l'humanité n'a pu en extraire en soixante-dix mille ans”, écrivait en 2018 le journaliste Guillaume Pitron dans La Guerre des métaux rares. Le journaliste y démontre que la quête d'un modèle de croissance plus “propre” pourrait paradoxalement entraîner un impact écologique plus lourd encore que l'exploitation pétrolière.
De nombreux militants écologistes et acteurs de l'industrie voient dans la Nouvelle-Calédonie, véritable île au trésor, une préfiguration des conséquences dévastatrices pour la nature et pour l'homme de la ruée vers les métaux dits “moins rares”, comme le nickel, également indispensables à la transition énergétique.
“Rouler à l'électrique ? Non merci, je ne suis pas convaincu. Si vous voulez vraiment protéger l'environnement, déplacez-vous à pied”, lance Jean-Christophe Ponga, ingénieur sur le site minier, en observant le paysage lunaire qui s'étend sous ses yeux, dévasté par les pelleteuses et bulldozers de son entreprise, dans le nord-ouest de l'île.
“N'achetez pas de voiture électrique”, renchérit Glenn Bernanos, barbe grisonnante et short de rigueur pour un militant écologiste. Il travaille pour l'association Environord, qui suit de près l'impact de l'activité minière sur l'archipel. D'où nous sommes, il pointe une autre montagne, décapitée par l'exploitation du nickel. De profonds sillons parcourent le mont Poindas, comme un corps tailladé couvert de cicatrices.
Une industrie qui “pulvérise la biodiversité”
Le père de Glenn était lui-même chauffeur de camion dans cette mine. Aujourd'hui, son fils tient l'industrie pour responsable, non seulement de la destruction des reliefs, mais aussi de la pollution des rivières et du lagon par les métaux lourds, et de la contamination de l'air par les particules fines. L'énergie qui alimente les trois usines de l'île, nécessaires à l'extraction du nickel, provient encore du charbon. Résultat : la Nouvelle-Calédonie (270 000 habitants) figurait parmi les cinq plus gros émetteurs de CO₂ par habitant au monde en 2023 (source : Emissions Database for Global Atmospheric Research). “Si on veut vraiment une économie verte, il va falloir réapprendre à monter à cheval”, ironise Bernanos.
- “La révolution verte a peut-être du sens si l'on regarde uniquement la réduction des émissions par rapport aux énergies fossiles. Mais cette industrie rase des montagnes entières, pulvérise la biodiversité. Nos îles se meurent, il ne nous restera bientôt plus qu'un gros caillou percé de trous béants.”
Situé à plus de 1 300 kilomètres à l'est de l'Australie, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est pourtant considéré comme l'un des hauts lieux de biodiversité de la planète. Près de 76 % des espèces végétales qui y poussent sont endémiques, introuvables ailleurs. Cette richesse exceptionnelle s'explique par l'histoire géologique de l'île, née du morcellement du supercontinent Gondwana, celui-là même dont sont issues l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La roche y est gorgée de chrome et de nickel, qui recouvre à lui seul près d'un tiers de la surface terrestre de la Grande Terre. Le minerai affleure, on pourrait presque le ramasser à la main.
Cette ressource est longtemps restée intacte, jusqu'à l'arrivée des Français, qui annexent l'île en 1853. Dans les décennies qui suivent la découverte des premiers gisements de nickel, les populations autochtones kanaks sont déplacées de force vers des réserves du Nord et de l'Est. Un siècle plus tard, plus de 300 mines sont en activité sur l'île, et l'industrie attire des foules d'expatriés venues de métropole ou d'Asie.
De la richesse à la malédiction
“On appelle le nickel le métal du diable”, déplore Roch Wamytan, chef coutumier kanak indépendantiste et ancien président du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Depuis son bureau, il observe l'usine métallurgique de la Société Le Nickel à Nouméa, première des trois usines de l'archipel. Ses ancêtres, raconte-t-il, ont été chassés de leurs terres à la fin du XIXe siècle pour faire place à l'industrie.
- “Nous n'avions pas d'armes pour nous défendre. Si elle tombe entre de mauvaises mains, cette richesse se transforme en malédiction.”
Révoltés par les injustices découlant de l'industrialisation, les Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, s'engagent dans un conflit armé avec les descendants des colons français dans les années 1980. Des accords politiques sont finalement conclus au cours de la décennie qui suit, promettant aux Kanaks une plus grande part des revenus du nickel. De cette volonté naîtront, en 2010, l'usine du Sud à Goro, et en 2013, la mine KNS, détenue à 51 % par la province Nord kanak.
Les problèmes ne se font toutefois pas attendre. Des eaux usées chargées de métaux lourds s'infiltrent dans les ruisseaux et rivières autour des sites miniers. Le plus grave incident survient en 2014, lorsque plus de 100 000 litres d'eau contaminée et hautement toxique s'échappent de la mine de Goro. Des milliers de poissons meurent. La colère gronde chez les Kanaks, pêcheurs ou agriculteurs. Des jeunes incendient des camions, des bâtiments, du matériel. L'exploitation est interrompue pendant un mois. Le propriétaire de l'époque, le géant brésilien Vale, chiffre les pertes à 30 millions de dollars.
Les protestations violentes se reproduisent par vagues régulières, comme en 2020, après une rumeur sur la possible revente de la mine de Goro au sulfureux investisseur Trafigura. Et en mai dernier encore, lors de manifestations contre un projet de réforme de la Constitution visant à accorder le droit de vote aux Français vivant depuis plus de dix ans sur l'île. Bilan : plus de 1 milliard d'euros de dégâts, treize morts. Après des affrontements avec de jeunes Kanaks armés, la police française coupe l'accès au sud de l'île, devenu zone de tensions.
Une concurrence féroce avec l'Indonésie
“Sans le nickel, les Français ne seraient pas ici. Ils ne nous persécuteraient pas, ne tueraient pas nos enfants”, lance Anne-Marianne Ipere. Venue déposer des fleurs au cimetière de Nouméa, elle se recueille en silence à l'ombre de la colline, tête basse. Son neveu a été abattu par la police française, avec un ami, lors d'émeutes dans le quartier très sensible de Saint-Louis, au sud de la ville. Pour elle, la responsabilité est claire :
- “C'est l'industrie du nickel qui est en cause. On n'en veut plus. Elle pollue nos rivières, tandis que l'argent, lui, part ailleurs. Vous avez déjà vu un Kanak riche ? Moi, j'en connais pas.”
Le constructeur américain Tesla, dirigé par Elon Musk, avait investi en 2021 dans la mine de Goro, espérant s'assurer un approvisionnement direct en nickel. Le groupe s'est finalement retiré après les troubles. Idem pour le géant suisse Glencore, actionnaire minoritaire de la mine KNS dans le Nord, qui a quitté le navire en 2024. Depuis août, la mine est à l'arrêt, et ses 1 200 salariés cherchent du travail ailleurs.
- Alexandre Rousseau, vice-président et porte-parole de la mine KNS, rejette la faute sur la concurrence déloyale des exploitations de nickel en Indonésie. Celles-ci ne seraient pas soumises aux normes environnementales et sociales en vigueur dans ce territoire français d'outre-mer.
“La concurrence avec l'Indonésie est féroce. Leurs coûts en énergie, en main-d'œuvre et en taxes environnementales sont bien plus bas que les nôtres. Ils cassent littéralement le marché partout dans le monde.”
L'Indonésie produit tant de nickel que le marché mondial en est aujourd'hui saturé. Le cours actuel [en mai 2025], autour de 15 000 dollars la tonne, ne représente même pas le tiers du prix record atteint en 2007 (52 000 dollars la tonne). À ce tarif-là, la faillite menace la dernière usine métallurgique encore en activité en Nouvelle-Calédonie. Ce serait un coup fatal pour l'économie de l'île, dont les exportations sont composées à 90 % de nickel.
Glenn Bernanos, notre militant écologiste, escalade un éperon rocheux. Depuis la crête, il surplombe l'arrière d'une mine de la côte ouest, qui alimente encore la seule usine active de l'île. En contrebas, les camions filent vers le port, moteurs diesel rugissant, soulevant d'énormes nuages de poussière sur leur passage.
Bernanos désigne une nappe de fange rougeâtre qui s'écoule lentement vers les eaux turquoise du lagon. “On aurait dû réfléchir à tout ça avant de lancer les voitures électriques sur le marché. On est allés trop vite, sans mesurer les conséquences.” Pollution, érosion, tensions sociales… Les griefs ici rappellent à s'y méprendre ceux des régions productrices de pétrole. “Les grands investisseurs ne pensent qu'à leur profit. Le reste, ils s'en moquent. C'est la même logique prédatrice qui règne, partout dans le monde.”
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le capitalisme contre la mondialisation

La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale.
Le capitalisme contre la mondialisation
Posted by Juan Tortosa et Benjamin Bürbaumer | 26/05/2025 | International
Le capitalisme contre la mondialisation
Le développement économique et politique de la Chine initiée par les successeurs de Mao Tsé-toung n'a cessé de surprendre. Le nouvel horizon fixé par la direction de Xi Jinping de devenir la première puissance mondiale économique, technologique et militaire va-t-elle se réaliser ? Quelles sont les contradictions que le régime chinois va affronter dans cette perspective ? Entretien avec l'économiste Benjamin Bürbaumer, invité à l'université de printemps de nos camarades suisses de solidaritéS.
Quelles conséquences pourrait avoir le retour au pouvoir de Donald Trump sur les relations entre les États-Unis et la Chine ?
Beaucoup d'analystes de la politique mondiale mettent en avant des raisonnements individualisants de type « Trump est plus nationaliste et agressif que son prédécesseur, et c'est pour cela que la situation mondiale se dégrade ». Pourtant, Trump n'est pas simplement un fâcheux accident de l'histoire, un homme d'un autre temps tombé du ciel. En réalité, plus qu'une cause, il est avant tout un symptôme – le symptôme d'une rivalité inter-impérialiste croissante entre les États-Unis et la Chine.
Fondamentalement, Trump fait ce que les locataires de la Maison blanche font depuis 10 ans : chacun radicalise un peu plus l'hostilité envers une Chine, qui tente effectivement de remplacer la supervision étasunienne de la mondialisation par un marché mondial sous contrôle chinois. Voilà ce qu'indique une analyse de la situation du point de vue de l'économie politique internationale.
Si Trump n'est donc pas aussi exceptionnel qu'on pourrait le croire, il ne conserve pas moins des particularités. Son recours massif aux droits de douane le distingue d'une politique commerciale plus ciblée sous Joe Biden, tout comme ses tentatives d'extorsion envers les alliés des États-Unis le différencient des autres présidents étasuniens qui voyaient dans l'alliance un multiplicateur de puissance. Ainsi, Trump montre au monde entier à quel point la participation à la mondialisation dépend du bon vouloir des États-Unis. Le mythe du marché autorégulateur n'a plus la moindre crédibilité. Au contraire, le marché mondial est de plus en plus reconnu comme une source de vulnérabilité politique.
En conséquence, la Chine va chercher à accélérer ses tentatives de contourner les infrastructures physiques, numérique, monétaire, technique et militaire sous contrôle étasunien, sur lesquels reposent la mondialisation. Car c'est ce contrôle qui permet, à l'heure actuelle, aux États-Unis d'enregistrer des profits extraordinaires et d'exercer un pouvoir politique extraterritorial. En d'autres termes, Trump incite la Chine à renforcer la mise en cause de la supériorité politique et économique étasunienne, ce qui produira des réactions encore plus hostiles à Washington. Trump est donc l'amplificateur d'une conflictualité, dont les racines profondes dépassent chaque dirigeant politique individuel car elles se trouvent dans le fonctionnement même du capitalisme.
Comment définiriez-vous aujourd'hui la Chine sur les plans politique, économique et militaire ?
La Chine est un pays capitaliste en situation de suraccumulation flagrante. Depuis son retour plein et entier au monde capitaliste à partir des années 1980, le parti-État a mené des politiques hautement favorables aux entreprises. La planification a fortement reculé au profit de logiques marchandes : libéralisation des prix, privatisations, autorisation des licenciements, démantèlement du service public, … En somme, l'économie a été radicalement réorganisée autour du principe du profit, y compris dans les entreprises qui restent formellement sous contrôle étatique.
Au passage, une série de mesures ont été prises afin d'attirer des capitaux étrangers, et ce avec l'objectif d'adapter l'économie chinoise à la concurrence : suppression du monopole public du commerce extérieur, mise en place de zones franches avec un droit du travail et une fiscalité dérogatoire, rapatriement des profits, ouverture des marchés financiers aux étrangers. La Chine, avec ses millions de travailleur·ses bon marché, et comparativement en bonne santé et bien formé·es, est donc une source de profit particulièrement attractive pour le capital des pays les plus riches, les pays européens et les États-Unis en tête.
Dans l'optique de favoriser le développement capitaliste, les autorités chinoises ont maintenu le niveau de rémunération des travailleur·ses à un niveau faible. L'une des conséquences macroéconomiques de cette configuration est une forte suraccumulation depuis plusieurs décennies, et qui s'est particulièrement accentuée depuis la crise de 2008–09. En conséquence, la Chine est contrainte d'exporter des marchandises et des capitaux. La Chine contemporaine est une illustration frappante du caractère inégal et combiné du développement capitaliste.
Régulièrement, on entend des commentateurs recourir à un argument d'inspiration keynésienne selon lequel il suffirait de basculer le régime d'accumulation chinois vers la consommation intérieure pour mettre fin aux déséquilibres économiques et aux problèmes sociaux qui en découlent. Or, cet argument ignore les ramifications politiques de l'accumulation du capital. La hausse de la rémunération des travailleurs indispensable à un tel basculement est susceptible d'exercer une pression sur une rentabilité du capital. On pourrait objecter qu'une telle hausse pourrait stimuler les profits par le biais d'une consommation accrue. Mais encore aurait-il fallu que les dirigeant·es d'entreprise en soient convaincu·es.
Or, face à cette éventualité, ils et elles ont la certitude que leurs coûts de production augmenteraient, tout en nageant en pleine incertitude quant à la répartition des profits potentiels. Mieux vaut éviter de se faire siphonner ces profits par les concurrents en s'opposant à une réorientation fondamentale de l'économie. Un basculement se heurterait aussi à la fraction du capital chinois (et étranger) qui tire ses bénéfices de sa fonction de fournisseur à bas coût dans les chaînes globales de valeur. Son opposition à l'amélioration du pouvoir de négociation des travailleurs est farouche.
Par ailleurs, la réorientation vers la consommation intérieure n'est pas sans risque pour le Parti communiste chinois (PCC). Afin d'en prendre la mesure, il convient de rappeler que la libéralisation fut synonyme de chômage massif en Chine. Dans son fameux texte sur les aspects politiques du plein-emploi, l'économiste Michał Kalecki indique que la disparition du chômage implique la disparition de son effet disciplinaire : « la position sociale du patron serait ébranlée et l'aplomb et la conscience de classe de la classe ouvrière augmenteraient. Les grèves pour les augmentations de salaires et l'amélioration des conditions de travail créeraient des tensions politiques. » Or le seul tabou absolu de quarante ans de réformes en Chine était celui du pouvoir du PCC. Hors de question d'alimenter des troubles politiques.
Par conséquent, plutôt que de renforcer la consommation populaire domestique, les autorités chinoises privilégient la conquête du marché mondial – au risque d'entrer de plus en plus frontalement en collision avec l'État dont la grande stratégie visait à promouvoir son capital transnational : les États-Unis.
La Chine bénéficie d'une image relativement positive dans les pays du Sud global, contrairement aux États-Unis et à l'Europe. Peut-on considérer que ce pays est un pays impérialiste ?
Selon Rosa Luxemburg, l'impérialisme désigne les tensions entre grandes puissances résultant du processus d'accumulation du capital. La Chine contemporaine cherche précisément à soulager sa suraccumulation domestique par la conquête du marché mondial.
Cette démarche se heurte directement aux États-Unis, qui supervisent le marché mondial depuis des décennies. La Chine voudrait se débarrasser de cette source de vulnérabilité en tentant de remplacer la mondialisation – ce processus sous supervision américaine – par un marché mondial sino-centré. Cela signifie concrètement le remplacement des infrastructures physiques, numériques, monétaires, techniques et militaires américaines, sur lesquels reposent les transactions économiques mondiales à l'heure actuelle.
Tout comme les États-Unis, la Chine vise à masquer la nature impérialiste de sa démarche par le déploiement d'un projet hégémonique. En effet, la supervision de la mondialisation tout comme sa contestation ne peuvent être le fruit de l'action d'un unique pays. Le concept gramscien d'hégémonie permet de comprendre qu'une grande puissance ne l'est durablement qu'à la condition de créer une adhésion volontaire des pays soumis à son autorité. Pour les mêmes raisons, la contestation de l'hēgemon exige un projet de réorganisation suffisamment captivant pour produire un effet d'entraînement sur des pays tiers. La puissance contestataire doit être un pôle d'attraction.
Le projet hégémonique chinois a fait des progrès notables au cours des 15 dernières années. La Chine a fourni énormément de vaccins contre le covid à de nombreux pays périphériques à l'heure où les États-Unis étaient trop préoccupés à protéger les rentes de leurs compagnies pharmaceutiques. Elle pratique une diplomatie de l'éducation très performante alors que les universités étasuniennes exigent des frais d'inscription monumentaux et se ferment de plus en plus aux étudiant·es étranger·es. À travers les Nouvelles routes de la soie, la Chine n'allège pas seulement ses problèmes de suraccumulation, elle finance aussi la construction d'infrastructures physiques dans de nombreux pays pauvres où les routes, les réseaux électriques et les chemins de fer ont été délaissés justement en raison du Consensus de Washington.
La Chine bénéficie également du fait que la politique étrangère de Washington est largement perçue comme hypocrite. Ce reproche est devenu plus saillant face aux réactions contrastées concernant la situation à Gaza et en Ukraine. De multiples pays périphériques ont relevé avec amertume le traitement particulier réservé aux seules victimes ukrainiennes par rapport aux dizaines de milliers de victimes en Palestine. Ils ont également remarqué que les sommes toujours si difficiles à débloquer pour le développement ont été facilement mobilisées pour armer l'Ukraine ou Israël. Dans cette situation, la Chine se positionne comme nouvel intermédiaire pour la gestion des conflits internationaux – tout comme, face à Trump, elle se place en défenseure d'un ordre mondial multilatéral et ouvert. Cette démarche a fortement contribué à améliorer l'image de la Chine en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Bien que ce positionnement, tout comme sa diplomatie sanitaire, éducative et culturelle et ses financements puissent temporairement répondre à de véritables besoins des pays de la périphérie, la Chine ne le fait pas par charité. Elle le fait pour trouver une solution spatiale à sa suraccumulation.
Et même si elle reste loin de l'interventionnisme militaire étasunien, qui, ces 20 dernières années, a causé plus de 4,5 millions de mort·es en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Yémen, elle augmente fortement ses dépenses militaires et adopte une démarche de plus en plus musclée en Mer de Chine méridionale, notamment contre les alliés les plus proches des États-Unis. Cela la place directement sur les rails de la confrontation avec Washington qui, en particulier depuis le pivot asiatique et grâce à ses innombrables bases militaires dans la région et à ses dépenses militaires exorbitantes, a de facto transformé les océans indien et pacifique en eaux étasuniennes.
La Chine est officiellement un pays communiste dirigé par un Parti communiste. Quel rôle cette idéologie joue-t-elle dans sa politique intérieure et extérieure ?
Déjà en 1978, face aux débuts de la politique menée par Deng Xiaoping et ses alliés au sein du Parti communiste chinois, Charles Bettelheim a observé que lorsque le rôle dirigeant de la classe ouvrière disparaît, la doctrine selon laquelle « faire plus de profit c'est créer plus de richesse pour le socialisme » devient une formule creuse. Dans les faits, la compréhension du socialisme par le PCC se superpose largement à l'idée de modernisation capitaliste. Il y a un certain temps, Chen Yuan, dirigeant du PCC et fils d'un des leaders de la première génération du Parti, a résumé la situation ainsi : « Nous sommes le Parti communiste et nous déciderons de ce que le communisme signifie. » Dans cette optique, la marchandisation est pleinement compatible avec le communisme.
Avec la valorisation du marché vient aussi une révision de l'appréciation des différents groupes dans la société. À cet égard, la gymnastique idéologique du PCC apparaît tout à fait remarquable. Sous son secrétaire général Jiang Zemin (entre 1989 et 2002), l'analyse suivante fut proposée : « À l'époque de l'industrie manufacturière traditionnelle, lorsque Marx a écrit ses textes révolutionnaires, les travailleurs étaient en effet à la pointe de la productivité. Toutefois, à l'ère des technologies de l'information, les hommes d'affaires et les professionnels ont supplanté les travailleurs relativement moins éduqués, sans parler des agriculteurs, en tant qu'avant-garde de la société. » Certes, la référence au socialisme est maintenue, mais elle est vidée de sens.
Un affrontement militaire direct entre les États-Unis et la Chine est-il envisageable ? Les États-Unis semblent vouloir rapprocher la Russie de leur camp dans une logique d'opposition à la Chine. Que signifierait un tel rapprochement pour la Chine, et comment pourrait-elle y réagir ? Quels sont aujourd'hui les principaux alliés de la Chine ?
Depuis plus d'une dizaine d'années la Chine est la priorité numéro 1 de la politique étrangère étasunienne. Cette préoccupation s'intensifie de président en président. Aujourd'hui, le monde connaît une course à l'armement sans précédent, qui est principalement tirée par les États-Unis et la Chine. Cette manne permet la multiplication des exercices militaires autour de la Chine, où cette dernière adopte une démarche de plus en plus musclée et où les États-Unis et leurs alliés régionaux, notamment les Philippines et l'Indonésie, procèdent régulièrement à des démonstrations de force. La boucle s'annonce sans fin. Ces exercices se déroulent sur fond de frictions et attaques régulières entre des bateaux chinois d'un côté et vietnamiens ou philippins de l'autre, qui peuvent déboucher un accident de type collision maritime, susceptible de dégénérer en une guerre désastreuse. À cela s'ajoute que les frictions se multiplient aussi au-delà de Taïwan, dans cette vaste zone nommée indopacifique. Toutefois, le risque de guerre ne vient pas seulement de la probabilité grandissante d'un incident non-intentionnel, Washington et Pékin préparent activement la guerre. Pour ne prendre qu'un exemple très récent : En mars Pete Hegseth, Secrétaire à la Défense des États-Unis, a indiqué à ses services de faire de la préparation d'une guerre avec la Chine une priorité opérationnelle.
Les tensions militaires sont donc dans le prolongement direct du processus d'accumulation du capital. Dans ce cadre, il est utile de garder à l'esprit les ordres de grandeur : les États-Unis disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde, la Chine ne dépasse pas la trentaine, tout au plus ; les dépenses militaires étasuniennes représentent près de trois fois celles de la Chine, et les dépenses militaires de l'OTAN – qui, depuis son sommet de Madrid en 2022, a acté l'élargissement de sa sphère d'intérêt de l'Atlantique nord à l'Asie pacifique – sont quatre fois supérieures à celles de la Chine. Les capacités destructrices étasuniennes et la logistique sous-jacente dépassent donc très largement la Chine. Par contraste, cette dernière ne dispose d'aucune alliance militaire comparable à l'OTAN.
La volte-face envers la Russie est certainement le domaine dans lequel Donald Trump est vraiment différent par rapport aux autres présidents étasuniens. Et il est cohérent : depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'économie russe s'est beaucoup plus fortement tournée vers la Chine et a notamment donné un coup d'accélérateur important à l'internationalisation de la monnaie chinoise renminbi. Voilà une des conséquences inattendues des sanctions financières de Washington contre la Russie, qui affaiblit directement le contrôle étasunien de l'infrastructure monétaire mondiale. Dans la même veine, Trump pousse les pays européens à augmenter leur budget militaire de 50%, voire de 150%. C'est une gigantesque amplification de la militarisation du Vieux Continent, qui ne vise pas tant à contenir la Russie qu'à soutenir l'effort militaire de Washington contre Pékin. Car cette hausse des budgets européens permettra aux États-Unis de réorienter des ressources supplémentaires substantielles vers la Chine. Réarmer l'Europe c'est in fine alimenter l'escalade militaire en Extrême-Orient et perpétuer la supervision étasunienne de l'économie mondiale dont les peuples européens ne tirent aucun bénéfice.
Existe-t-il aujourd'hui une opposition démocratique au sein de la société chinoise ou la répression du mouvement de Tiananmen a-t-elle définitivement étouffé toute contestation démocratique ?
Il est difficile d'identifier une opposition organisée, notamment en raison des politiques répressives de Pékin. Néanmoins, depuis sa transformation capitaliste, la Chine est régulièrement secouée par des mobilisations importantes. Malgré un rapport de forces peu favorable aux travailleur·ses, le nombre de conflits du travail a considérablement augmenté. En 1994, 78000 salarié·es étaient en conflit ouvert avancé avec leur employeur, en 2007 ce nombre atteignait 650000. Ces conflits concernent principalement les provinces exportatrices où l'exploitation est particulièrement féroce. De plus, les conflits du travail ne restent pas nécessairement inscrits dans le cadre étroit prévu par la loi. On observe au contraire ce que l'historien Eric Hobsbawm a appelé la « négociation collective par l'émeute ». En effet, les chercheurs Eli Friedman et Ching Kwan Lee montrent que « l'accélération de la privatisation, de la restructuration et des licenciements dans le secteur d'État a déclenché des niveaux d'insurrection inconnus dans l'histoire de la République populaire ». La panoplie des actions était large : sit-in, blocage, occupation, grève, émeute, jusqu'au suicide des travailleur·ses et au meurtre des employeur·ses. À titre d'exemple, en 2005, les chiffres officiels faisaient état de 87000 « incidents de masse » de ce type. Jusqu'aujourd'hui la contestation est très active mais éparpillée.
Enfin, il convient d'ajouter que la contestation est souvent à la fois démocratique et sociale. Loin de l'image d'un mouvement libéral porté exclusivement par des étudiant·es et intellectuel·les, les mobilisations de Tiananmen étaient déjà largement des contestations sociales et démocratiques, portées par les travailleur·ses, qui répondaient directement au processus violent de transformation capitaliste entrepris par la fraction libérale du PCC.
Est-il possible pour les peuples de sortir de cette logique de blocs opposés ?
La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale. La racine de ce monde de plus en plus conflictuel se trouve dans l'accumulation du capital. L'apaisement définitif passe donc par le remplacement de l'impératif du profit vers la satisfaction des besoins. Dans l'immédiat, une série de pays pourraient décider d'un découplage sélectif par rapport au marché mondial – rétrécissement planifié des chaînes de valeur, conditionnalités environnementales, politiques redistributives. La mise en cause ouverte de certains principes du libre-échange par Trump peut donc constituer une fenêtre d'ouverture.
Propos recueillis par Juan Tortosa
Article initialement publié le 9 mai 2025, sur le site de solidaritéS
Photo : le président de la république populaire de Chine Xi Jinping visite un centre d'innovation à Shanghai, 29 avril 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour syndiquer Amazon, perturber les flux

Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement syndical revoie en profondeur sa stratégie. Il ne suffira plus de syndiquer des lieux de travail isolés : il faudra apprendre à perturber la circulation des marchandises à travers toute la chaîne d'approvisionnement.
4 juin 2025 | tiré de Jacobin.com
https://jacobin.com/2025/06/unionize-amazon-disrupt-supply-chain
(Traduction en français de l'article « To Unionize Amazon, Disrupt the Flow », publié dans New Labor Forum)
Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement
Héritages industriels et leçons du passé
Dans l'imaginaire collectif, le complexe River Rouge de Ford incarne une époque industrielle révolue. Achevé en 1928 à Dearborn, au Michigan, il comptait 93 bâtiments sur 4 km² et employait jusqu'à 80 000 travailleurs à son apogée. Véritable ville-usine, il comprenait des quais, des chemins de fer, une centrale électrique, une aciérie, et était surveillé par 8 000 hommes de main employés par Ford.
River Rouge représentait tout ce que la désindustrialisation nous a fait perdre : centralisation, intégration verticale, puissance manufacturière et communautés ouvrières denses. Ce n'était pas un cas isolé. Les années 1930 comptaient de nombreux sites similaires – Goodyear à Akron, General Motors à Flint, les abattoirs de Chicago, les aciéries de Pittsburgh, les usines de General Electric à Schenectady et Lynn, etc. Ces lieux étaient les points névralgiques du capitalisme industriel, et le CIO (Congress of Industrial Organizations) les a conquis entre 1937 et 1941.
Là où de tels centres n'existaient pas – dans l'Ouest ou le Sud –, l'organisation syndicale a échoué.
Les deux clés du succès du CIO
Le succès du CIO s'explique par deux facteurs principaux :
1. Un contexte politique relativement favorable, où Roosevelt et le New Deal ne réprimaient pas systématiquement les grèves.
2. Une capacité à surmonter les divisions pour organiser des actions réellement perturbatrices, capables d'arrêter la production.
Par exemple, la célèbre grève du sit-down à Flint fut décisive lorsque les ouvriers prirent le contrôle de l'usine Chevrolet n° 4, la seule qui fabriquait des moteurs. De même, en avril 1941, les travailleurs de Rouge mirent en place des piquets et des barricades automobiles pour bloquer tous les accès à l'usine. Rien ne bougeait sans leur accord.
Ce que cette période nous enseigne n'est pas tant la nostalgie d'un âge d'or industriel, mais une leçon stratégique claire : pour gagner, il faut cibler les grands acteurs et perturber leurs opérations jusqu'à obtenir la reconnaissance syndicale.
De l'usine au flux : un déplacement stratégique
Mais comment appliquer cette leçon aujourd'hui ? Nous ne vivons plus dans l'ère des grands complexes industriels.
Aujourd'hui, les grandes entreprises à cibler – Amazon, Walmart, FedEx, Target, Home Depot, etc. – tirent leur force non de la production, mais de la logistique. La centralité n'est plus dans l'usine, mais dans le flux.
C'est ici que s'ouvre un débat entre deux penseurs du syndicalisme :
• Kim Moody soutient que la concentration logistique dans certaines zones (comme Memphis) peut être comparée à celle des années 1930.
• Eric Blanc, au contraire, estime que la dispersion du travail rend impossible de répliquer les stratégies du CIO.
La vérité se situe entre les deux : oui, certains nœuds logistiques sont stratégiques, mais ils sont moins concentrés, souvent répartis entre plusieurs sous-traitants, avec des chaînes complexes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de travailleurs en un même lieu que le potentiel de blocage économique est moindre.
Les ports, par exemple, ont moins de dockers qu'avant, mais restent des points névralgiques.
Perturber les flux plutôt qu'organiser les lieux
La logique d'aujourd'hui doit donc changer : plutôt que d'organiser des lieux de travail, il faut viser à perturber les flux d'opérations.
Qu'impliquerait une telle stratégie ?
Quelques pistes pour une stratégie de perturbation des flux
• Cibler les bons nœuds logistiques
Exemple : les sortation centers d'Amazon, cruciaux dans le système hub and spoke, sont moins nombreux que les entrepôts (fulfillment centers), donc plus stratégiques. Les centres de livraison (delivery stations) sont plus faciles à perturber, mais leur impact reste local.
• Gagner les techniciens à la cause syndicale
Ils réparent les robots, contrôlent les flux et connaissent les vulnérabilités. Leur soutien peut être décisif.
• Dépasser la fiction de la sous-traitance
L'intégration fonctionnelle des sous-traitants rend caduque la séparation juridique. La récente décision du NLRB reconnaissant Amazon comme « employeur conjoint » de ses livreurs est un pas important.
• S'appuyer sur les travailleurs déjà organisés
Exemple : en 2021, les dockers de Tacoma ont soutenu des mécaniciens en grève – le syndicat a été reconnu en six heures. Il faut que les syndicats du rail, du transport routier ou portuaire relancent ce type d'action coordonnée.
Vers une approche syndicale en réseau
Le mouvement syndical ne manque pas d'expérience, mais il doit réorienter son action. Quelques éléments pour cela :
• Organiser les travailleuses et travailleurs de points de vente (comme Starbucks ou Home Depot) pour soutenir des grèves dans les centres de distribution dont ils dépendent.
• Développer des accords régionaux avec vérification rapide de l'adhésion (card-checks).
• Agir en fonction de l'effet de levier, et non seulement du nombre de travailleurs à syndiquer.
Ce type d'approche, fondée sur la perturbation stratégique des flux, exige des outils et des institutions capables de penser en termes de réseau, et non plus seulement de lieux de travail.
C'est un défi immense, mais la syndicalisation des géants d'aujourd'hui passe par là.
Traduction réalisée à partir de l'article original publié dans New Labor Forum.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous nous battons, nous souffrons de traumatismes de guerre, nous existons » : défendre les droits des vétérans LGBT+ en Ukraine

Alors que l'Ukraine poursuit son combat pour la liberté, une autre lutte se déroule en parallèle : celle pour l'égalité des droits des militaires LGBT+. Bien qu'ils risquent leur vie au front, beaucoup continuent d'être confrontés à des préjugés et à de l'hostilité, y compris à leur retour chez eux.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le Sunny Bunny Queer Film Festival 2025, qui s'est tenu à Kiev en avril, en est un exemple récent, où des groupes d'extrême droite ont tenté de perturber l'événement. Pourtant, parmi ceux qui se tenaient fièrement debout au festival, il y avait des soldats LGBT+ eux-mêmes, affirmant ouvertement leur droit à la dignité et au respect. L'ONG « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights » utilise des fonds européens pour fournir une aide juridique, un soutien et une sensibilisation du public à ces personnes courageuses, promouvant ainsi une vision de l'Ukraine où le courage de tous les défenseurs est honoré de la même manière.
« Le sujet des personnes LGBT est encore tabou dans l'armée ukrainienne. La discrimination est profondément ancrée, tant pendant qu'après le service, et trouve ses racines dans les attitudes post-totalitaires qui persistent dans notre société », explique Viktor Pylypenko, directeur de l'ONG « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights ». Créée en 2018 sous la forme d'une petite communauté de militaires LGBT, elle est devenue en 2021 une organisation officielle qui défend leurs droits dans les forces armées.
La guerre a mis en évidence la vulnérabilité des personnes LGBT. Beaucoup de personnes homosexuelles et transgenres sont émotionnellement fragiles et souffrent de traumatismes liés à la guerre. Malgré cela, elles sont souvent envoyées au combat sans que l'on se soucie de leur bien-être ou de l'efficacité de leur déploiement. « Les gens doivent comprendre que beaucoup seront simplement tués au front, jetés comme de la paille dans un poêle », souligne Viktor, qui connaît la dure réalité du front depuis 2014.
Pendant leur service militaire, les membres du personnel LGBT sont souvent victimes de discrimination et de mauvais traitements systémiques : leurs supérieurs les prennent pour cible avec des ragots, sabotent leur carrière et les affectent délibérément aux missions les plus risquées. Ces abus sont aggravés s'ils dénoncent la corruption ou l'incompétence, ce qui conduit à l'isolement, au désespoir et, dans certains cas, à la désertion. En outre, les partenaires de même sexe ne sont pas reconnus, ce qui les exclut des programmes d'aide de l'État destinés aux familles des militaires. Bien qu'un projet de loi n°9103 sur les partenariats civils ait été préparé il y a longtemps, il n'a toujours pas été adopté, ce qui renforce encore cette inégalité.
Pour lutter contre cette injustice, l'ONG a créé une communauté active de plus de 600 anciens combattants LGBT, y compris des personnes handicapées et démobilisées. Avec le soutien de l'UE via l'International Renaissance Foundation (IRF), ils ont créé un centre pour anciens combattants à Kiev, un espace sûr et inclusif offrant un soutien psychologique, juridique et par les pairs. Ce centre est rapidement devenu un refuge vital pour beaucoup. « Cela nous aide à nous sentir protégés, parmi des personnes qui partagent les mêmes idées, et à nous sentir normaux », explique Dmytro Pavlov (32 ans), un ancien combattant gay.
Dmytro s'est engagé dans l'armée en mars 2022, mais a été blessé trois mois plus tard près de Bakhmut. Pendant sa convalescence, il a découvert la communauté de l'ONG sur Instagram et a contacté Viktor Pylypenko. « C'était une période difficile pour moi : je ne communiquais pas avec mes parents, mes camarades étaient au combat et je n'avais pas beaucoup de soutien », se souvient Dmytro. Au centre, il a vu les exemples inspirants d'autres soldats blessés et a trouvé le courage de faire son coming out, réalisant qu'il voulait « vivre librement et respirer pleinement ». Depuis lors, Dmytro est un membre actif de la communauté, ambassadeur du festival du film Sunny Bunny, participant actif à la Kyiv Pride et aux réunions avec les membres du Parlement.
Une défense juridique en première ligne pour l'égalité
L'aide juridique fournie par l'ONG s'est avérée cruciale pour beaucoup. Une infirmière de combat lesbienne de 37 ans, qui a souhaité rester anonyme, a expliqué que les consultations juridiques de l'organisation l'avaient aidée à naviguer dans le processus complexe de démobilisation et l'avaient guidée dans la préparation des documents nécessaires. « L'avocat m'a beaucoup aidée à préparer les documents requis », se souvient la vétérane.
Grâce au financement de l'UE, l'organisation « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights » traite chaque mois entre 15 et 30 demandes juridiques individuelles, allant des procédures de licenciement et des documents médicaux aux demandes de congé et à la certification du statut de combattant. « 80% de nos clients sont des militaires en service actif », explique Oleksandr Danylov, avocat de l'ONG. « Le besoin d'aide découle souvent d'un manque de réglementation juridique claire, en particulier dans les cas impliquant des personnes LGBT, comme un soldat qui a changé de sexe après avoir obtenu le statut de combattant, ou des partenaires qui ont du mal à accéder à des informations sur leurs proches disparus en raison de l'absence de reconnaissance légale de leur famille. »
Une affaire historique concernait un ancien combattant qui était passé du sexe féminin au sexe masculin après avoir obtenu son certificat de statut de combattant. Les autorités ne savaient pas comment procéder, mais l'ONG a réussi à obtenir la modification du certificat. « C'est très gratifiant de voir que le système fonctionne pour les gens », se réjouit l'avocat.
Malheureusement, toutes les affaires ne se terminent pas par une victoire, souvent en raison de l'absence de cadre juridique. Beaucoup impliquent des cas de harcèlement, de blessures corporelles causées par la haine envers les personnes LGBT, ainsi que des abus commis par des commandants. « L'absence de réglementation souligne le besoin urgent d'une assistance juridique », explique Olexandr. « Malgré des ressources limitées, nous continuons à fournir une aide gratuite pour répondre aux demandes nombreuses non seulement des anciens combattants, mais aussi des militaires en service. »
Du champ de bataille à la librairie
En avril 2025, l'ONG a lancé l'une de ses initiatives les plus marquantes : la publication d'un livre révolutionnaire intitulé LGBTIQ+ Veterans of the Russian-Ukrainian War (Les anciens combattants LGBTIQ+ de la guerre russo-ukrainienne). Écrit par Alina Sarnatska, ancienne combattante et défenseuse des droits humains, il rassemble des témoignages de soldats LGBT et de leurs alliés. « Ces histoires sont importantes, non seulement pour la communauté LGBT, mais pour tout le pays. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissance, mais de réécrire l'histoire de l'Ukraine pour y inclure tous ses défenseurs. »
Alina est une ancienne combattante et défenseuse des droits humains L'idée derrière ce livre fait écho au passé, rappelant comment, après la Seconde Guerre mondiale, les archives sur la lutte contre les personnes LGBT ont dû être minutieusement rassemblées à partir de sources fragmentées dans différents pays, avec peu de documents disponibles malgré le nombre important de personnes concernées. Ce livre contribue à préserver la culture et la mémoire ukrainiennes, en veillant à ce que les vétérans LGBT ne soient pas effacés de l'histoire.
Un changement visible
Grâce à la reconnaissance croissante de son travail, l'ONG est devenue un acteur important dans la promotion de réformes juridiques, notamment en matière de partenariats civils et de lois anti-discrimination. « Chaque succès est un pas vers l'égalité totale », déclare le directeur de l'ONG. « Nous travaillons avec le ministère de la Défense, le ministère des Anciens combattants, l'Institut des conseillers en matière d'égalité des sexes et les ambassades. Les changements sont lents, mais ils sont réels. » Leur plaidoyer porte ses fruits. Des enquêtes récentes montrent une forte augmentation du soutien de la population ukrainienne aux droits des LGBT, les gens étant témoins du sacrifice de soldats LGBT aux côtés de leurs camarades.
Pour l'Ukraine, la lutte pour les droits des LGBT est étroitement liée à son combat pour la démocratie et l'indépendance. Et pour les militants et les anciens combattants au cœur de cette histoire, la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, commémorée chaque année le 17 mai, est plus qu'une date : c'est un rappel du courage et du dévouement dont ils font preuve pour défendre les droits des personnes LGBT en temps de guerre. « Nous ne sommes pas des troupes de l'arrière. Nous menons les mêmes missions de combat, nous perdons des êtres chers, nous sommes blessés, nous mourons. Cette ONG nous donne des droits et rend visibles les soldats LGBT », conclut Dmytro.
Volha Prokharava et Olena Kifenko
Publié en anglais par EU NeighboursEast
14 mai 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une économie d’armement permanente

Alors que les débats sur l'industrie d'armement prennent une nouvelle tournure depuis l'élection de Donald Trump et les décisions de l'Union européenne quant au plan Rearm Europe, Contretemps propose de (re)découvrir Michael Kidron, marxiste britannique spécialiste des liens entre économie et guerre. L'article de M. Kidron est précédé d'une présentation de l'auteur par Stathis Kouvelakis, et un prochain article d'Alex Callinicos permettra de mieux saisir la portée de sa théorisation de l'économie d'armement permanente.
Présentation
La relance de la course aux armements et de la remilitarisation de l'Europe, dans un contexte de nouvelle montée des tensions internationales déclenchée par la guerre en Ukraine et l'offensive génocidaire de l'Etat sioniste à Gaza, rendent nécessaire une analyse approfondie de l'économie de guerre et de son rôle dans le capitalisme contemporain. Forts de leur compréhension du lien constitutif entre les guerres, le système étatique mondial et le mode de production régi par le capital, les marxistes ont joué un rôle majeur dans les débats sur cette question, en particulier dans la période qui suit la 2e guerre mondiale.
Parmi eux, l'économiste Michael Kidron (1930-2003) occupe une position de pionnier. Militant et théoricien du courant qui a donné naissance au Socialist Workers Party britannique (qu'il quitte dans les années 1970), il cherche à percer dès les années 1950 ce qui apparaît alors comme une énigme, à savoir les ressorts de la croissance économique sans précédent du capitalisme occidental au cours de ce qu'on a appelé les « 30 glorieuses ». Le défi est en effet de taille pour les marxistes, traditionnellement davantage enclins à prédire, ou constater, les crises du système, pour y lire les signes de son obsolescence, qu'à analyser les mécanismes de son dynamisme. Cette propension a été accentuée depuis la fondation de la 3e Internationale, dont la thèse fondatrice est le capitalisme serait entré, avec l'éclatement du premier conflit mondial, dans une « crise générale » irréversible et quasi-permanente, annonciatrice de son effondrement, de nouvelles guerres et d'inéluctables poussées révolutionnaires, inaugurées par celle d'octobre 1917. Dans ce cadre, les périodes de « stabilisation » ne pouvaient être vues que comme de brefs intermèdes d'un mode de production supposément entré dans sa phase « ultime » de « déclin » accéléré.
Eugène Varga (1879-1964), l'économiste-expert de l'Internationale Communiste, et, pendant un temps, de Staline, avait largement diffusé ces thèses – souvent désignées comme celles du « catastrophisme économiste » – pendant l'entre-deux guerres, thèses auxquelles la Grande Dépression de 1929 et la perspective d'une nouvelle guerre avaient donné une certaine crédibilité. A l'exception de Gramsci, cette vision était quasi-unanimement partagée au sein du mouvement communiste. Ainsi, dans le Programme de transition (1938), Trotsky parle de « capitalisme pourrissant », à « l'agonie », et affirme que « les forces productives de l'humanité ont cessé de croître ». Il ajoute : « Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. Les crises conjoncturelles, dans les conditions de la crise sociale de tout le système capitaliste, accablent les masses de privations et de souffrances toujours plus grandes ». Certains courants se réclamant de lui, notamment, en France, le courant « lambertiste », ont maintenu la validité de ces analyses plusieurs décennies après la fin de la guerre.
Du côté de l'« orthodoxie » des partis communistes, la situation n'est pas moins affligeante : Maurice Thorez (1900-1964), secrétaire général du PCF de 1930 à sa mort, défend tout au long des années 1950 et jusqu'au début des années 1960 la thèse d'une « paupérisation absolue de la classe ouvrière », malgré l'embarras croissant que ses positions suscitaient au sein même des spécialistes en économie du parti. Face à cette caricature de marxisme, le mainstream social-démocrate ou libéral n'avait aucun mal à diagnostiquer la réalité du boom économique de l'après-guerre et d'en tirer les conclusions politiques : une ère de croissance illimitée, assurant à tous prospérité et accès à la consommation de masse. La perspective d'une rupture révolutionnaire est déclarée caduque au profit d'un gradualisme réformiste, voire même d'une société d'abondance pacifiée, ayant surmonté à la fois les crises économiques et les antagonismes de classe.
C'est dire donc le mérite d'un Michael Kidron qui, dès ses articles du milieu des années 1950, prend au sérieux les réalités nouvelles du capitalisme de l'après-guerre, façonné par le compromis social mis en place par le gouvernement travailliste qui accède au pouvoir en 1945 – l'équivalent britannique des conquêtes sociales de la Libération : nationalisations, intégration du mouvement syndical dans les instances de négociations, hausse des salaires et de la production etc. A partir du début des années 1960, il met l'accent sur le rôle de l'industrie de l'armement dans cette dynamique d'expansion économique. La guerre dite « froide », en réalité bien « chaude » en-dehors du théâtre européen et occidental, devenait en effet de plus en clairement synonyme de course aux armements entre les deux blocs opposés. En janvier 1961, dans un discours de fin de mandat qui fit date, le président étatsunien Dwight Eisenhower avait déclaré que « nous avons été contraints de créer une industrie permanente de l'armement [c'est quasiment la formulation de Kidron] dans des proportions considérables. En outre, trois millions et demi d'hommes et de femmes sont directement engagés dans l'établissement de la défense. Nous dépensons chaque année pour la sécurité militaire plus que le revenu net de toutes les entreprises américaines ». Dans ce même discours, Eisenhower, pourtant férocement anticommuniste et impérialiste, lançait un avertissement prémonitoire : « nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le risque d'une montée en puissance désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques ».
En fait, dès les années 1940, des marxistes hétérodoxes comme Edward L. Sard (qui forge le terme « économie d'armement permanente »), Michael Kalecki ou Paul M. Sweezy avaient analysé le rôle de l'industrie de l'armement et de l'économie de guerre dans une optique keynésienne – au sens large – centrée sur le rôle de l'intervention étatique et de la dépense publique. Si la thématique n'est donc pas nouvelle, bien que confinée aux marges du débat intellectuel et politique de la gauche, les thèses de Kidron se caractérisent par une volonté d'intégration du débat dans le cadre rigoureusement marxien de la théorie des crises capitalistes, dont l'expression concentrée est, selon lui, à chercher dans la tendance à la baisse du taux de profit.
Cette théorisation trouvera sa présentation la plus complète dans l'article qui suit, publié pour la première fois dans la revue International Socialism au printemps 1967 et resté jusqu'à présent inédit en français. Il s'accompagne d'un article d'Alex Callinicos, écrit spécialement pour Contretemps, qui resitue le parcours de Kidron et le débat auquel son intervention a donné lieu.
Stathis Kouvélakis
*
Une économie d'armement permanente
La plupart des explications avancées pour rendre compte de la stabilité et de la croissance du capitalisme occidental après la Seconde Guerre mondiale reposent sur l'idée que, sans un facteur compensateur particulier, le système sombrerait dans la surproduction et le chômage. Certains ont vu ce facteur dans la planification étatique, d'autres dans le progrès technologique rapide, ou encore dans l'essor du commerce mondial. Cet article partage cette hypothèse de départ. Mais il s'en distingue par un point essentiel : il localise le mécanisme garantissant l'enchaînement de l'emploi élevé, de la croissance et de la stabilité en dehors de cette boucle elle-même.
L'argument selon lequel une menace permanente de surproduction (et non une menace de surproduction permanente) est inséparable du capitalisme repose sur trois propositions empiriques : premièrement, la force concurrentielle d'un capital individuel est, dans une certaine mesure, liée à la taille et à l'étendue de ses opérations ; deuxièmement, les relations entre les différents capitaux sont en grande partie de nature concurrentielle ; troisièmement, les décisions concernant la taille et l'affectation des capitaux individuels sont prises de manière privée par des individus ou des groupes qui ne représentent qu'un petit segment de la société — laquelle doit pourtant vivre avec les conséquences de ces décisions.
Sans les deux premières conditions, il n'y aurait aucune contrainte poussant chaque capital à croître aussi vite que possible par l'« accumulation » (c'est-à-dire l'épargne et l'investissement) et la « concentration » (fusions et acquisitions). Sans la troisième, la croissance ne dépasserait jamais de beaucoup la capacité d'absorption de la société.
Ensemble, ces trois éléments constituent également un mécanisme permettant d'atteindre — et de maintenir — une certaine stabilité : ils accroissent la capacité d'absorption tout en modérant le rythme d'expansion que cette dynamique pourrait entraîner. Idéalement, ce mécanisme devrait fonctionner sans bouleverser de manière excessive les relations entre les capitaux individuels.
Un tel mécanisme se trouve dans un budget d'armement permanent. Dans la mesure où le capital est taxé pour financer les dépenses militaires, il est privé de ressources qui auraient autrement pu être investies ; dans la mesure où ces dépenses concernent un produit final à obsolescence rapide, elles constituent un ajout net au marché des biens de consommation ou « biens finaux ». L'un des résultats évidents de ce type de dépense est le plein emploi, et l'un des effets du plein emploi, ce sont des taux de croissance parmi les plus élevés jamais enregistrés ; ainsi, l'effet modérateur de cette taxation n'est pas immédiatement perceptible. Mais il n'est pas pour autant inexistant. Si le capital pouvait investir l'ensemble de ses profits avant impôt, l'État intervenant pour créer la demande si nécessaire, les taux de croissance seraient bien plus élevés. Enfin, dans la mesure où les armements sont un « luxe » — au sens où ils ne servent ni d'instruments de production ni de moyens de subsistance dans la fabrication d'autres marchandises — leur production n'a aucun effet sur les taux de profit globaux, comme cela sera démontré ci-dessous.
L'augmentation des dépenses mondiales due aux budgets militaires est stupéfiante. En 1962, bien avant que la guerre du Vietnam ne fasse exploser les dépenses militaires américaines (et russes), une étude des Nations Unies concluait qu'environ 120 milliards de dollars (43 000 millions de livres sterling) étaient consacrés chaque année aux dépenses militaires. Cela représentait entre 8 et 9 % de la production mondiale de biens et de services, et au moins les deux tiers — voire jusqu'à l'équivalent — du revenu national de l'ensemble des pays sous-développés. Ce montant était très proche de la valeur des exportations mondiales annuelles de toutes les marchandises. Encore plus saisissante est la comparaison avec les investissements : les dépenses militaires représentaient environ la moitié de la formation brute de capital à l'échelle mondiale.[1]
Leur importance variait considérablement d'un pays à l'autre : 85 % de la dépense totale était concentrée dans sept pays — le Royaume-Uni, le Canada, la Chine, l'Allemagne de l'Ouest, la France, la Russie et les États-Unis.[2] Dans les pays capitalistes occidentaux, les dépenses militaires représentaient, en proportion du produit intérieur brut, entre 9,8 % aux États-Unis (moyenne 1957-1959) et 2,8 % au Danemark (6,5 % pour la Grande-Bretagne). En proportion de la formation brute de capital fixe, elles allaient de près de 60 % aux États-Unis à 12 % en Norvège (42 % au Royaume-Uni).[3] Dans aucun de ces pays, ces dépenses n'étaient négligeables, ni comme débouché pour le marché, ni — et c'est encore plus important — en comparaison des ressources consacrées à l'investissement.
Certaines industries dépendent fortement des dépenses militaires. Aux États-Unis (en 1958), plus de neuf dixièmes de la demande finale pour les avions et leurs pièces provenaient de l'État, la majeure partie à des fins militaires ; il en allait de même pour près de trois cinquièmes de la demande en métaux non ferreux, plus de la moitié pour les produits chimiques et les équipements électroniques, plus d'un tiers pour les équipements de communication et les instruments scientifiques — et ainsi de suite, dans une liste de dix-huit grandes industries dont au moins un dixième de la demande finale provenait de la commande publique. En France (en 1959), cette part allait de 72,4 % pour les avions et pièces détachées à 11 % pour les équipements optiques et photographiques.[4] Au Royaume-Uni, une liste similaire inclurait l'industrie aéronautique, dont 70 % de la production (en 1961) dépendait de commandes publiques, l'électronique industrielle et la radiocommunication (35 % chacune), la construction navale (23 %), ainsi que plusieurs autres secteurs.[5]
L'impact des dépenses militaires sur la croissance et l'innovation est tout aussi direct. Le plein emploi favorise l'innovation technique et l'investissement intensif, ce qui stimule à son tour la recherche. Or, dans ce domaine, les dépenses militaires pèsent d'un poids considérable : elles représentaient 52 % de l'ensemble des dépenses de recherche et développement (R&D) aux États-Unis (1962-63), 39 % au Royaume-Uni (1961-62), 30 % en France (1962) et 15 % en Allemagne (1964, estimation partielle).[6] Pas moins de 300 000 scientifiques qualifiés travaillaient dans la R&D à des fins militaires et spatiales dans la zone OCDE, principalement dans six pays (ceux déjà mentionnés, plus le Canada et la Belgique).[7] Au Royaume-Uni, 10 000 scientifiques y étaient affectés en 1959, soit un cinquième du total national, assistés par environ 30 000 autres chercheurs non qualifiés.
La recherche militaire a joué un rôle crucial dans le développement de produits civils tels que les systèmes de navigation aérienne, les avions de transport, les ordinateurs, les médicaments, les locomotives diesel (issues des moteurs de sous-marins) ou encore le verre renforcé. La production en grandes séries à des fins militaires ont permis de réduire le coût d'autres produits comme les cellules solaires ou les détecteurs infrarouges, jusqu'à les rendre accessibles au marché de masse. Par ailleurs, l'usage militaire a perfectionné de nombreuses techniques à usage général, telles que les turbines à gaz, la transmission hydraulique ou le soudage par ultrasons. Plus important encore, comme le souligne le rapport de l'OCDE sur le gouvernement et l'innovation technique, est le fait que :
« Les résultats de la recherche militaire et spatiale ont eu — et continueront d'avoir — une influence majeure sur l'innovation civile, en stimulant le rythme général du progrès technologique. Par exemple, les exigences de ces recherches, notamment en matière de guidage et de contrôle, ont conduit à des avancées fondamentales et appliquées dans des domaines comme les semi-conducteurs, les microcircuits, les micromodules, la conversion d'énergie ou la métallurgie physique — autant de domaines appelés à avoir un impact sur la technologie civile. De plus, des techniques de planification comme la recherche opérationnelle, la méthode PERT (Program Evaluation and Review Technique), l'ingénierie des systèmes ou l'analyse de la valeur — développées à l'origine pour répondre aux besoins militaires et spatiaux — facilitent désormais l'identification rapide des opportunités d'innovation. Enfin, l'exigence extrême en matière de perfection et de fiabilité dans ces secteurs a permis le développement de méthodes de mesure, de test et de contrôle qui améliorent la qualité et la fiabilité des produits. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'électronique. »[8]
En ce qui concerne les armements et le commerce international, l'étude des Nations Unies déjà citée estimait que, pour les années 1958 et 1959, la demande militaire annuelle moyenne des pays industrialisés représentait une part importante de la production mondiale de plusieurs matières premières.[9]
Il est difficile de tirer des conclusions définitives sur l'impact des dépenses militaires sur la taille des entreprises. Toutefois, une étude de l'EIU (Economist Intelligence Unit) concernant la Grande-Bretagne révèle que, parmi les entreprises interrogées, les dix-huit plus grandes (celles comptant chacune plus de 10 000 salariés) représentaient 71 % de l'ensemble des emplois, et concentraient 75,2 % des emplois liés à la production d'armement.[10] Aux États-Unis, on observe un phénomène similaire : la majeure partie des contrats de défense profite aux très grandes entreprises. Malgré les efforts officiels pour en répartir les bénéfices, les cent premières entreprises ont reçu, en valeur, les deux tiers de tous les contrats de défense durant la première moitié des années 1950 ; à elles seules, les dix premières en ont capté un tiers.[11]
Cela n'a rien de surprenant : seules les plus grandes entreprises disposent des ressources techniques et technologiques nécessaires pour faire face à la complexité et à l'ampleur de la production d'armement. Une fois intégrées au « club » des bénéficiaires, leur croissance est pratiquement garantie. Les principaux contrats d'armement sont si colossaux que, selon les mots d'un observateur, « même la prétention à un appel d'offres ouvert ne pouvait sérieusement être maintenue pour certains des contrats publics les plus lucratifs ».[12]
En 1963, un secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis déclarait devant le Joint Economic Committee du Congrès qu'« établir une nouvelle source de production pour le missile Polaris, par exemple, exigerait jusqu'à trois ans et un investissement de 100 millions de dollars en installations et équipements spécialisés ».[13] Bien que les techniques de contrôle gouvernemental aient été régulièrement renforcées pour gérer cette dépendance à des fournisseurs uniques, les grands contrats, rémunérés sur la base coûts réels en matériaux et temps investis, éliminent tout risque de perte… et donc toute entrave à la croissance. Dans certains cas, les garanties sont si larges et le suivi si faible que les sous-traitants perdent eux-mêmes le contrôle. Ce fut le cas de Ferranti avec son contrat pour le missile Bloodhound, qui l'obligea à restituer 4,5 millions de livres de bénéfices excédentaires sur un contrat de 13 millions en 1964. Mais en règle générale, le capital reste prudent, et les risques pour la croissance sont étroitement neutralisés.
Enfin, les dépenses militaires ont joué un rôle crucial dans le développement de la planification gouvernementale et dans le perfectionnement des techniques de planification. Il existe des preuves officielles indiquant que la planification aux États-Unis fut une réponse directe à l'avance soviétique dans le domaine des missiles balistiques. La surveillance étroite du secteur industriel privée fait désormais partie intégrante de tout grand contrat d'armement. Les méthodes modernes d'audit et de contrôle proviennent directement des besoins militaires. Il en va de même pour un outil devenu de plus en plus essentiel dans la plupart des grands exercices de planification : l'ordinateur. Né de la Seconde Guerre mondiale, il est toujours principalement utilisé dans les domaines militaires, que ce soit pour résoudre des problèmes de conception, simuler des « jeux de guerre » ou gérer les stocks et la production. Les grands ordinateurs restent d'ailleurs soumis à des restrictions d'exportation par les États-Unis pour des raisons militaires.Ces effets directs des dépenses militaires sont interconnectés et forment ensemble une boucle causale qui semble se perpétuer sans nécessiter de stimulus extérieur. Pourtant, bien que cela semble suffisamment probant, tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus. Il est possible que d'autres éléments contribuent également à expliquer la stabilité économique. N'importe quel économiste universitaire devrait être capable de construire un modèle dans lequel l'épargne et l'investissement s'équilibrent parfaitement, et où la demande se situe exactement au niveau du plein emploi. Les techniques pour y parvenir ne posent aucune difficulté.
Des non-universitaires, comme John Strachey se sont, non sans mal, efforcés de démontrer, de manière plus pragmatique, que « les dépenses militaires pourraient être remplacées par d'autres formes de dépenses publiques… [pour financer] logements, routes, écoles, etc. » , ou encore que le gouvernement pourrait obtenir un effet similaire en réduisant les impôts sur les petits revenus.[14] Et il n'y a, logiquement, aucune raison de les contredire. Mais la réalité capitaliste est plus résistante que les stylos et le papier des planificateurs. D'une part, des dépenses productives trop importantes de la part de l'État sont exclues. Du point de vue d'un capitaliste individuel, ce type de dépenses représenterait une intrusion directe dans son domaine réservé, par un concurrent infiniment plus puissant et disposant de ressources matérielles bien supérieures : une telle menace doit être combattue sans réserve. Du point de vue du système dans son ensemble, cela entraînerait une augmentation rapide du ratio capital/travail — ce que Marx appelait la composition organique du capital — abaissant fortement le taux moyen de profit, à tel point que la moindre hausse des salaires réels pourrait suffire à provoquer faillites et récession.
Seul le dernier point mérite une explication plus détaillée. Marx a montré — pour le dire simplement — que, sur le long terme et malgré de nombreux mécanismes compensateurs, la hausse de la composition organique du capital du capital entraîne une baisse tendancielle du taux de profit dans une économie capitaliste fermée.[15] Le raisonnement est simple : puisque seul la part non-payée du travail génère du profit, et que la part de l'investissement consacrée à la force de travail diminue constamment, le rendement global du capital est voué à décroître. Marx avait conditionné cette « loi » à plusieurs facteurs et peinait à expliquer pourquoi elle ne se manifeste pas de manière absolue mais comme une tendance à la baisse graduelle. Il la considérait toutefois comme la tendance dominante du capitalisme. Sa démonstration reposait sur deux hypothèses, toutes deux réalistes : d'abord, que toute la production réintègre le système sous forme d'intrants productifs, via la consommation des travailleurs ou des capitalistes. Idéalement, il n'existe ni fuites hors du système ni d'autres usages que ce que l'on appelle aujourd'hui l'investissement et la consommation ouvrière. Ensuite, que, dans un tel système fermé, cette répartition évolue progressivement en faveur de l'investissement.
La première hypothèse est cruciale. Si l'on admet qu'une part de la production est soustraite au cycle productif — par exemple sous forme de dépenses non productives — alors le rapport entre capital et travail devient indéterminé, la seconde hypothèse s'effondre… et la loi avec elle. Marx lui-même avait identifié certaines « fuites » hors du cycle productif — notamment la consommation personnelle des capitalistes (les « produits de luxe ») et la production d'or, mais il avait choisi, à juste titre, de les négliger dans son analyse. Il construisait alors une théorie à partir d'une base abstraite, et ces éléments étaient, à l'époque, relativement marginaux.
Des théoriciens postérieurs, contraints de raffiner le modèle et écrivant aussi à une époque plus prospère, se sont penchés plus en profondeur sur ce Département III non productif. Ladislaus Von Bortkiewicz (1868-1931) a démontré, dans un article publié en 1907[16], que la composition organique du capital dans la production de biens de luxe (la consommation personnelle des capitalistes) n'avait aucun impact sur la détermination du taux de profit global. Piero Sraffa (1898-1983), dans ce qui reste à ce jour[17] [17], la version la plus raffinée d'un système économique « classique », a généralisé cette idée. Il a démontré que :
« Les produits de luxe qui ne sont utilisés ni comme moyens de production, ni comme biens de subsistance dans la fabrication d'autres produits […] ne participent pas à la détermination du système. Leur rôle est purement passif. Si une invention permettait de diviser par deux la quantité de moyens de production nécessaires à la fabrication d'un bien de luxe, son prix serait divisé par deux. Mais cela n'aurait aucun autre effet : ni les prix des autres marchandises, ni le taux de profit n'en seraient modifiés. À l'inverse, une invention affectant la production d'un bien utilisé comme intrant modifierait l'ensemble des prix relatifs ainsi que le taux de profit. »[18]
Bien que Sraffa s'abstienne, comme à son habitude, de donner des exemples concrets, aucun cas n'illustre mieux la catégorie des « produits de luxe » que les armements. Ils ne peuvent en effet servir à la production d'aucune autre marchandise et aucune autre ne peut soutenir la comparaison avec ce qu'ils représentent en termes de poids spécifique et de signification. Du point de vue du système — c'est-à-dire dans une optique strictement théorique — la production d'armement constitue donc le principal, et apparemment durable, contrepoids à la tendance à la baisse du taux de profit.
Mais ce n'est là qu'une des contraintes à la possibilité pour l'État d'utiliser d'autres types de production — non militaires — comme leviers de stabilisation économique. Cette contrainte est d'ailleurs d'autant moins convaincante qu'elle repose uniquement sur une construction théorique. Une autre limite, plus concrète, tient à l'« effet domino » propre aux armements : dès lors qu'un pays s'y engage, les autres grandes puissances sont contraintes de suivre, enclenchant ainsi une course aux armements à l'échelle du système mondial, et se retrouvant prises dans l'engrenage de ce mécanisme stabilisateur.
Il n'existe pas d'autre issue. Si l'absence de planification, la mise en concurrence, ou, pour reprendre le terme de Marx, « l'anarchie de la production » a pu être partiellement atténuée à l'intérieur des États-nations grâce à l'intervention publique, permettant d'anticiper dans une certaine mesure les décisions spontanées des capitaux individuels par des choix politiques globaux, à l'échelle internationale, cette anarchie persiste presque totalement. À quelques exceptions près — celles de petites économies — il n'existe aucune autorité coercitive au-delà de l'État-nation. Le système mondial fonctionne toujours selon le schéma classique : un ajustement permanent entre capitaux nationaux, sans instance de coordination supérieure. C'est pourquoi même un bloc relativement homogène comme celui des puissances capitalistes occidentales continue de régler ses échanges sur la base de l'or — ce symbole par excellence du mysticisme capitaliste autour des rapports sociaux. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans un ensemble pourtant encore plus homogène comme l'Europe de l'Est, le commerce bilatéral reste le mode dominant des échanges. Le fossé entre la réalité concurrentielle et l'illusion de la coopération est immense, même à l'intérieur de blocs étroitement intégrés — et devient incommensurable entre blocs rivaux.
Dans ces conditions, tout pays qui choisirait d'assurer le plein emploi et la stabilité au moyen d'investissements productifs — ou même à travers des activités publiques de substitution non productives — se retrouverait inévitablement en position de faiblesse dans la compétition mondiale. Un tel pays pourrait certes parvenir au plein emploi, mais isolément ; or, cela entraînerait presque immanquablement un certain niveau d'inflation, le rendant moins compétitif et, à terme, le pousserait hors du marché mondial. Pour que cette situation soit tenable, il faudrait empêcher les autres économies de l'affaiblir. Autrement dit, le plein emploi doit être exporté — et quoi de plus incitatif, pour pousser les autres à le « racheter », qu'une menace militaire extérieure ?
Cela ne signifie pas pour autant que les budgets militaires aient été consciemment conçus dans le but de garantir un environnement international propice à la stabilité. On peut admettre que les gouvernements ont souvent accru leurs dépenses de défense à contrecœur ; que les principales hausses n'ont pas toujours coïncidé avec des périodes de ralentissement économique ; que, bien souvent, ces décisions ont été perçues comme contraignantes, imposées ou simplement regrettables. On peut même accepter que le passage initial à une économie d'armement permanente ait résulté d'un concours de circonstances. Mais cela ne modifie pas le fond du problème. L'essentiel est que l'existence même d'appareils militaires nationaux de cette envergure, quelle que soit leur origine, augmente à la fois les chances de stabilité économique et contraint les autres États-nations à adopter une posture similaire sans que cela nécessite un pilotage par une autorité supérieure. Ensemble, ces réponses forment un système dont les éléments sont à la fois interdépendants et autonomes, liés entre eux par des contraintes réciproques — bref, un système capitaliste dans sa forme classique.
Une fois ancrée dans la réalité, l'économie d'armement tend presque inévitablement à devenir permanente. Ce n'est pas seulement parce qu'un système de contraintes réciproques fondé sur la menace militaire s'avère particulièrement impérieux, mais aussi parce qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer entre concurrence militaire et concurrence économique. Comme on le voit maintenant [1967], avec les États-Unis et la Russie qui s'engagent à s'équiper en missiles antibalistiques au coût effrayant, la course aux armements pouvait s'intensifier non pour des raisons d'efficacité militaire réelle, mais dans le but d'alourdir les coûts de la préparation militaire pour le concurrent. Le responsable de la rubrique défense du magazine Times le résumait ainsi :
« Une telle décision n'a de sens que si les deux parties entendent se livrer à une guerre économique totale, persuadées que les atouts fondamentaux de leur système économique finiront par l'emporter ; toutes deux convaincues que le poids paralysant de cette nouvelle charge militaire précipitera l'effondrement économique de l'autre. »[19]
Telle est la dynamique entre « ennemis ». Mais entre « alliés », la défense commune peut aussi servir de paravent à des intérêts industriels particuliers, propres à chaque pays. Un exemple parlant : dans le cadre d'un accord de deux ans s'achevant le 30 juin 1967, l'Allemagne [de l'Ouest] s'était engagée à acheter pour 5,4 milliards de marks d'armements aux États-Unis, en compensation des dépenses militaires américaines sur son sol. Dix mois avant l'échéance, 2,4 milliards de marks restaient à commander, « aucune nouvelle commande ne semble se profiler à l'horizon ». Comme le souligne The Economist, « l'obligation pour l'Allemagne d'acheter autant de matériel militaire aux États-Unis… constitue un sérieux désavantage pour l'industrie allemande, en particulier l'industrie aéronautique ».[20] Elle portait également préjudice aux ambitions britanniques, qui tentaient péniblement d'entrer sur le marché allemand de l'armement.
Il n'est pas nécessaire d'en rajouter pour constater que les armements sont devenus une composante permanente de nos économies. L'intense concurrence dans les exportations d'armes — entre blocs rivaux comme au sein même de chaque bloc — en apporte une démonstration éclatante. Les États-Unis disposent de leur propre représentant commercial pour les ventes d'armes. En Grande-Bretagne, le gouvernement travailliste est allé jusqu'à nommer à la fois un ministre du Désarmement et un directeur des ventes de matériel de défense – ce dernier détaché de Racal Electronics, une entreprise d'armement en pleine expansion. Il dispose du pouvoir d'ouvrir des canaux d'exportation privilégiés, d'influencer la conception des équipements dès leur développement[21], de contrôler les délais de livraison, d'utiliser le service diplomatique, etc. Comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères :
« Tant que nous n'aurons pas obtenu un désarmement généralisé par un accord international, il est raisonnable que ce pays bénéficie d'une part équitable du marché de l'armement. »[22]
L'intégration de l'industrie d'armement dans l'économie générale, en tant que levier de compétitivité, produit des effets considérables. La fonction du budget militaire comme instrument de stabilisation au sein de chaque économie nationale se trouve affaiblie par son rôle dans la concurrence entre économies. Un pays peut développer son arsenal pour des raisons purement internes ; mais cette dynamique entraîne presque immanquablement une réaction de ses concurrents, fondée sur des justifications d'ordre international tout aussi légitimes. Or, rien ne garantit que cette spirale s'interrompe au niveau nécessaire pour assurer la stabilité. Même si un pays réussissait, contre toute attente, à stabiliser ses dépenses militaires à un seuil optimal, cela ne signifierait nullement que les autres en feraient autant — en raison de leurs différences de taille, de structure économique, de niveau de développement, d'alliances, ou d'autres caractéristiques propres aux économies nationales liées par une même base technologique militaire. Certains pays chercheront donc à réduire leurs dépenses pour préserver leur compétitivité civile, d'autres poursuivront leur trajectoire actuelle, et d'autres encore accentueront leur effort militaire. Le désarroi au sein de l'OTAN en fournit une illustration éloquente : la France se retire [du commandement militaire de l'Alliance, en 1965], tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne s'opposent sur le financement commun et le partage des responsabilités nucléaires. Washington tente de faire pression pour une augmentation des budgets militaires européens, face à une Europe réticente. Le Pacte de Varsovie n'est pas en reste : la Roumanie parvient à « gaulliser » Moscou [c'est-à-dire à adopter, à l'égard de Moscou, une posture d'indépendance comparable à celle de De Gaulle vis-à-vis des États-Unis. NdT].
L'existence d'un plafond économique aux dépenses militaires est un élément clé de l'économie d'armement permanente. Dans une économie de guerre, les limites sont dictées par les ressources physiques disponibles et la capacité de la population à supporter pertes humaines et privations. Dans une économie d'armement, s'ajoute une contrainte propre : la nécessité de rester compétitif à l'échelle globale, sur le plan militaire comme civil.
Ce paradoxe conduit à un affaiblissement de la fonction même de défense. En l'état, celle-ci est minée par la logique suicidaire d'une grande partie de l'arsenal dit « défensif ». Par ailleurs, une préparation militaire limitée – caractéristique des économies d'armement permanentes – ne provoque pas automatiquement d'hostilités, ce qui fait de la fixation des niveaux de dépenses un sujet de débat constant, notamment pour les membres les plus fragiles de la coalition occidentale, souvent incapables de suivre le rythme imposé.
Le contexte est propice à une lente érosion des dépenses d'armement en périphérie, compensée par leur concentration croissante au centre — en l'occurrence, aux États-Unis. Les faits sont parlants : ni Cuba, ni le Vietnam, ni même les tensions aiguës de la période dite de la « confrontation » – entre 1961 et 1963, marquée notamment par la construction du mur de Berlin et la crise des missiles de Cuba – n'ont inversé la tendance à la baisse, en termes réels, des dépenses militaires britanniques depuis le début des années 1950. Malgré la force de frappe de De Gaulle et le réarmement de l'Allemagne, la part des États-Unis dans les dépenses militaires totales des pays de l'OTAN n'a cessé d'augmenter, même avant les importantes hausses liées à la guerre du Vietnam. Cette situation est loin d'être stable.
L'existence d'un plafond de dépenses est importante pour une autre raison. Il constitue une incitation massive à l'augmentation de la productivité (mesurée en millions de morts potentielles par dollar dépensé) et conduit ainsi les industries de l'armement à devenir de plus en plus spécialisées et à s'éloigner de la pratique générale de l'ingénierie. Comme l'indique l'un des rapports de l'OCDE déjà cités :
« le transfert direct vers le secteur civil de produits et de techniques développés à des fins militaires et spatiales est très limité, comparé à l'ampleur globale de la recherche et du développement militaires et spatiaux. En outre, les exigences technologiques de la défense et de l'espace divergent de plus en plus de celles de l'industrie civile, ce qui signifie que les possibilités de transfert direct tendent à diminuer. »[23]
Cette spécialisation va de pair — et découle en partie — d'une intensité croissante en capital et en technologie dans les industries de l'armement. Sur ces deux plans, elles deviennent de moins en moins aptes à soutenir le plein emploi, sauf à franchir les limites jugées acceptables dans une économie d'armement.
La forme insoluble que prend le chômage dans une économie d'armement permanente est étroitement liée à ce phénomène. Les mutations technologiques rapides, non planifiées – et impossibles à planifier – dans les industries d'armement soumises à un niveau plafonné de dépenses créent des aires régionales et industrielles de chômage, qui restent largement insensibles aux remèdes fiscaux et monétaires généraux. Elles créent également des couches de main d'œuvre non qualifiée rendues inemployables par les technologies de pointe, en perpétuelle évolution, mises en œuvre. Une fois encore, le haut niveau de croissance à l'Ouest masque ce phénomène, mais la situation des régions de construction navale ici [au Royaume-Uni] et aux États-Unis, les difficultés rencontrées dans les zones de fabrication aéronautique aux États-Unis, voire les problèmes que rencontrent les Noirs américains, doivent au moins en partie leur intensité aux fluctuations des dépenses militaires et à la complexité croissante de la production militaire.
L'instabilité, en elle-même, ne condamne pas un système. Mais elle peut contribuer à le remettre en question dans son ensemble et ouvrir ainsi la voie à une alternative. Elle peut aussi permettre d'articuler entre elles différentes formes de contestation. En d'autres termes, l'instabilité peut transformer un sentiment diffus d'aliénation ou d'échec — que cette société ne cesse d'alimenter — en conscience de classe et en projet politique. Que ce processus advienne ou non dépend de la réceptivité des travailleurs aux idées de changement radical. Et c'est précisément dans cette réceptivité accrue que l'économie d'armement permanente trouve ses véritables limites.
L'argument a été exposé ailleurs[24] et ne nécessite ici qu'un bref résumé. L'économie d'armement permanente tend à raréfier la main-d'œuvre et à rendre les qualifications coûteuses pour chaque capital individuel, tout en augmentant la taille moyenne du capital et en concentrant le pouvoir dans quelques grands complexes, majoritairement industriels. Ces entreprises sont contraintes de prendre en compte les réformes probables — c'est-à-dire des concessions matérielles aux travailleurs — bien avant de les mettre en œuvre, au moment même de formuler leurs plans à long terme. Parallèlement, l'État est poussé à intervenir activement dans la gestion de l'économie et à créer de l'emploi productif à grande échelle. Son apparente neutralité politique s'effrite, ses politiques apparaissent de plus en plus clairement comme des politiques capitalistes, que ce soit en tant qu'employeur direct, en tant que composante – via les entreprises publiques – des organisations patronales, ou en tant que gestionnaire économique de l'ensemble de l'économie. Son caractère unique en tant qu'agent de réforme, dans le sens évoqué précédemment, est de plus en plus entamé par l'activité du secteur privé dans ce domaine. Après tout, les avantages sociaux dans l'industrie (c'est-à-dire les réformes privées), représentant 13 à 14 % des salaires en moyenne en 1960[25], se comparent très favorablement aux « dépenses sociales » publiques (c'est-à-dire les réformes publiques), qui représentaient 12,6 % des dépenses de consommation cette même année.[26]
La réaction des travailleurs s'en est trouvée profondément transformée. Le réalisme impose que la lutte pour les réformes se mène localement, sur le lieu de travail, de manière directe, plutôt qu'au niveau national, sur le terrain politique, et par l'intermédiaire de représentants parlementaires issus de la classe moyenne. Il est vrai que ce réalisme tend souvent à substituer la solidarité d'équipe à la solidarité de classe, la conscience du poste à la conscience de classe, une éthique entrepreneuriale aux prémices d'une éthique socialiste. Il est également vrai qu'un tel réalisme menace de démolir les étages supérieurs — les organisations de classe traditionnelles — sans attendre que les fondations aient été élargies et consolidées. Pourtant, ce réalisme déplace le centre de gravité de l'activité de « là-bas » vers « ici », de « eux » vers « nous » ; il érode les barrières artificielles entre la classe et ses organes, ainsi que les loyautés souvent contradictoires.
Le révolutionnaire potentiel de demain et le réformiste actif d'aujourd'hui deviennent de plus en plus indiscernables, tandis que les instabilités de l'économie d'armement permanente font de la révolution tout simplement une étape dans les activités de tous les réformistes sincères.
*
Publié pour la première fois dans « International Socialism » (première série), n° 28, printemps 1967, p. 8-12, puis sous forme de brochure par le SWP (GB).
Traduit de l'anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Notes
[1] Nations Unies, Conséquences économiques et sociales du désarmement (New York 1962).
[2] Ibid., p. 4.
[3] Ibid., tableau 2-1, pp. 55-7. Dans l'étude de l'ONU, les chiffres donnés pour la Grande-Bretagne sont généralement inférieurs à ceux du rapport plus détaillé réalisé par l'Economist Intelligence Unit un an plus tard : The Economic Effect of Disarmament (Londres : EIU, 1963). Cette divergence n'ayant pas d'incidence sur l'argumentation, nous ne tenterons pas d'ajuster les chiffres ici.
[4] OCDE, Les pouvoirs publics et l'innovation technique, p. 27.
[5] EIU, p. 49, 69, 82, et passim.
[6] OCDE, tableau, p. 30. L'EIU donne un chiffre de 49 pour cent pour la Grande-Bretagne en 1958-9 (59,2% en 1955-6, EIU, p. 27).
[7] OCDE, p.30.
[8] Ibid., p. 31-2.
[9] Soit 8,6 % pour le pétrole brut ; 3 % pour le caoutchouc ; 15,2 % pour le cuivre ; 10,3 % pour le nickel ; 9,6 % pour l'étain ; 9,4 % pour le plomb et le zinc ; 7,5 % pour le molybdène ; 6,8 % pour la bauxite ; 5,1 % pour le minerai de fer ; 2,7 % pour le manganèse, et 2,3 % pour la chromite, ibid., tableau 3-3, p. 65.
[10] EIU, p. 22-3.
[11] Cité par John-Kenneth Galbraith, The Modern Corporation, conférences Reith de la BBC, n° 2, The Listener, 24 novembre 1966, p. 756.
[12] Andrew Shonfield, The Modern Capitalism : the Changing Balance of Public and Private Power, Oxford, Oxford University Press, 1966, p. 344.
[13] Cité par Shonfield, ibid.
[14] John Stratchey, Contemporary Capitalism, Londres, Gollancz, 1956, p. 239-246.
[15] Karl Marx, Le Capital, Livre III, t. 1, Paris, Editions sociales, 1974, chap. 13 et 14, p. 225-253. [La composition organique du capital désigne le rapport entre le capital constat (dépensé en moyens de production : machines, bâtiment, matières premières…), dont la valeur est simplement transmise et conservée dans le produit final, et le capital variable (dépensé en salaires), qui produit une valeur supérieure à celle nécessaire à sa reproduction, dont la partie non-payée correspond à la plus-value, que s'approprie le capitaliste. L'hypothèse de Marx est que l'innovation technique conduit à une diminution tendancielle de la part consacrée au capital variable, ce qui conduit à une baisse tendancielle du taux de profit, soit du rapport de la plus-value au total du capital engagé (capital constant + capital variable) NdT].
[16] Cf. Ladislaus von Bortkiewicz, « On the Correction of Marx's Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of Capital », Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, juillet 1907 ; Rudolph Hilferding, Böhm-Bawerk's Criticism of Marx , New York, Kelly, 1949, résumé dans Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development, Londres, Dennis Dobson, 1949, p. 115-125.
[17] Piero Sraffa, The Production of Commodities by Means of Commodities , Cambridge, Cambridge University Press, 1960 [trad. française : Production de marchandises par des marchandises, Paris, Dunod, 1977].
[18] Ibid., p. 7-8.
[19] The Times, 10 mai 1966.
[20] The Economist, 21 mai 1966, p. 809-10.
[21] The Times, 12 mai 1966.
[22] Rapport de la Chambre des communes, The Times, 24 mai 1966.
[23] OCDE, p. 31.
[24] Tony Cliff, « The Economic Roots of Reformism », Socialist Review, juillet 1957, repris in Tony Cliff, Neither Washington Nor Moscow , Londres, Bookmarks, 1982 ; Michael Kidron, « Reform and Revolution », International Socialism, n° 7, 1961 ; Tony Cliff et Colin Barker, Incomes Policy, Legislation and Shop Stewards, Londres, 1966, chap. 7 et 9 ; Colin Barker, « The British Labour Movement », International Socialism, n° 28, 1967.
[25] G. L. Reid et D. J. Robinson, « The Cost of Fringe Benefits in British Industry », in G. L. Reid et D. J. Robinson (dir.), Fringe Benefits, Labour Costs and Social Security, Londres, 1965.
[26] BIT, Le coût de la sécurité sociale 1958-1960, Genève, 1964, partie 2, tableau 4, p. 249.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Arabie saoudite : Des travailleurs migrants électrocutés, décapités et victimes de chutes mortelles au travail

Les autorités devraient agir pour empêcher les décès, rendre l'assurance-vie obligatoire, enquêter sur tout décès et indemniser les familles dans de tels cas
En Arabie saoudite, de nombreux travailleurs migrants sont morts à la suite d'accidents du travail effroyables qui auraient pu être évités, notamment des chutes d'immeubles, des électrocutions et même des décapitations.
Tiré de entre les lignes et les mots
https://www.hrw.org/fr/news/2025/05/14/arabie-saoudite-des-travailleurs-migrants-electrocutes-decapites-et-victimes-de
Photo :Des travailleurs migrants se reposaient sur le site d'un chantier près de Riyad, en Arabie saoudite, le 2 mars 2024. © 2024 Jaap Arriens/Sipa via AP Photo
Parmi les causes de décès, beaucoup sont classées à tort comme « naturelles » ; ces décès ne font pas l'objet d'une enquête et ne donnent lieu à aucune indemnisation. En cas d'accident du travail, le processus d'indemnisation est long et fastidieux.
Les autorités saoudiennes, la FIFA et les autres employeurs devraient faire en sorte que tous les décès de travailleurs migrants, quels qu'en soient la cause perçue, l'heure et le lieu, fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme, et que les familles de ces travailleurs soient traitées avec dignité et reçoivent rapidement une indemnisation équitable.
(Beyrouth) — En Arabie saoudite, de nombreux travailleurs migrants sont morts à la suite d'accidents du travail effroyables qui auraient pu être évités, notamment des chutes du haut d'immeubles, des électrocutions et même des décapitations, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités saoudiennes n'ont pas protégé adéquatement les travailleurs contre des décès évitables ; elles n'ont pas enquêté sur les accidents liés à la sécurité du lieu de travail ; et elles ont négligé d'indemniser les familles rapidement et de façon adéquate, ce qui aurait pu être fait grâce à des politiques imposant la souscription d'une assurance-vie et en prévoyant des compensations pour les proches survivants. Une autre enquête indépendante, réalisée par Fairsquare et également publiée aujourd'hui, met au jour d'importantes lacunes dans les politiques et procédures du gouvernement saoudien, celui-ci ne disposant pas de suffisamment d'outils efficaces pour déterminer les causes de décès de travailleurs migrants.
Les risques de décèset de blessures professionnels augmentent encore à mesure que le gouvernement saoudien intensifie ses travaux de construction en vue de la Coupe du monde de football de 2034 et d'autres « gigaprojets ». Les familles de travailleurs migrants décédés ont déclaré que les employeurs saoudiens et les autorités leur avaient fourni très peu d'informations sur les circonstances du décès de leurs proches ; certains employeurs ont refusé de prendre en charge les frais de rapatriement des victimes, et d'autres ont même insisté pour que les familles enterrent leurs proches en Arabie saoudite, moyennant des incitations financières. De plus, les entreprises ont souvent tenté d'éviter l'envoi aux familles des effets personnels des victimes, ainsi que le paiement des sommes qui leur étaient encore dues.
« Les effroyables accidents du travail qui tuent des travailleurs migrants en Arabie saoudite devraient être perçus comme un important signal d'alerte par les entreprises et les associations sportives qui souhaitent établir des partenariats avec la FIFA pour la Coupe du monde masculine de football de 2034 et pour d'autres gigaprojets prévus dans le pays, ainsi que par les fans de football », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Étant donné que les autorités saoudiennes n'assurent pas adéquatement la sécurité de base et la protection sociale des travailleurs migrants, les entreprises locales et internationales endossent une responsabilité plus importante pour garantir l'absence de violations graves des droits au sein de leurs opérations dans ce pays. »
Human Rights Watch a mené des entretiens avec les familles de 31 travailleurs migrants décédés en Arabie saoudite. Ceux-ci étaient originaires du Bengladesh, d'Inde et du Népal, et avaient entre 23 et 52 ans. Nous avons également interrogé deux travailleurs sociaux basés dans les pays d'origine et qui ont fourni une aide au rapatriement aux familles, ainsi que trois travailleurs migrants actuellement basés en Arabie saoudite, qui ont été témoins du décès de leurs collègues. Les chercheurs ont également examiné, lorsque cela était possible, les « certificats de non objection » des travailleurs décédés, un document obligatoire émis par l'ambassade du pays d'origine préalablement à l'autorisation de rapatriement des corps et à l'émission de certificats de décès et de tout autre document officiel utile.
D'autres études ont précédemment constaté que de nombreux décès de travailleurs migrants survenus en Arabie saoudite sont classés, à tort, comme « naturels », ne faisant l'objet d'aucune enquête et ne donnant lieu à aucune indemnisation. De même, Human Rights Watch a constaté que même lorsque le certificat de décès d'un travailleur migrant indique correctement que le décès est survenu sur le lieu de travail, cette mention ne donne pas toujours lieu à l'indemnisation de la famille pourtant prévue par la loi saoudienne et les normes internationales en matière de travail. En outre, en cas d'indemnisation, la procédure est longue et fastidieuse.
Selon les documents officiels de l'Organisation générale de l'Arabie saoudite pour la Sécurité sociale (General Organization for Social Insurance,GOSI), le secteur de la construction est celui qui est le plus exposé aux risques d'accidents du travail. Les chiffres montrent que les trois principaux types de blessures professionnelles proviennent de « forces mécaniques inanimées », de chutes et d'accidents de la route, les travailleurs migrants étant touchés de façon disproportionnée.
Les lois saoudiennes imposent aux organisations employant 50 travailleurs ou plus d'instaurer une politique de santé et de sécurité, de dispenser des formations, d'évaluer les risques sur le lieu de travail et de fournir les équipements de protection requis, ainsi que des premiers secours. Le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail a déclaré que le ministère des Ressources humaines et du Développement social effectuait des inspections régulières, des vérifications de la conformité et des enquêtes sur les accidents au travail, en coordination avec les personnes concernées. Il a également affirmé que les violations devaient faire l'objet d'actions en justice ou de sanctions, comme précisé dans les réglementations relatives au travail.
Mais Human Rights Watch a constaté qu'en Arabie saoudite, quels que soient le secteur d'activité ou la région géographique, les travailleurs continuaient de subir des abus généralisés et d'être exposés à des risques professionnels sur leur lieu de travail. Si les « maladies causées par l'exposition à des températures extrêmes » sont répertoriéesdans la liste approuvée des maladies professionnelles, lesprotections contre la chaleuret les enquêtes sur ses effets, y compris les décès dus à la chaleur extrême, restent largement insuffisantes.
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a attribuéla Coupe du monde de 2034 à l'Arabie saoudite. Toutefois, la FIFA l'a faitsans avoir procédé à une vérification préalable adéquate en matière de droits humains, et sans obtenir de garanties quant à laprotection effective des travailleurs, notamment contre les températures extrêmes et en matière de sécurité sociale, y compris l'obligation de souscrire uncontrat d'assurance-vie, ainsi que l'octroi d'indemnités aux proches survivants en cas de décès accidentel lié au travail. C'est en connaissance de cause que la FIFA prend une fois encore le risque que l'organisation d'un tournoi entraîne un lourd tribut humain, a déclaré Human Rights Watch.
Human Rights Watch estime en outre que les autorités saoudiennes, la FIFA et les autres employeurs devraient faire en sorte que tous les décès de travailleurs migrants, quels qu'en soient la cause perçue, l'heure et le lieu, fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que les familles soient traitées avec dignité et reçoivent rapidement une indemnisation juste.
Danssa réponse à Human Rights Watch, la FIFA a écrit qu'elle prévoyait de mettre en place un système de protection sociale pour les travailleurs définissant des normes et des mécanismes d'application obligatoires pour les travaux de construction et la fourniture de services en lien avec la Coupe du monde en Arabie saoudite. Elle n'a cependant pas fourni de précisions sur les mesures concrètes qui permettraient de prévenir les décès de travailleurs migrants (notamment des mesures de protection contre la chaleur fondées sur le risque), et d'enquêter et d'indemniser les familles en cas de décès (par ex. : une assurance vie). Les autorités saoudiennes n'ont pas répondu à une lettre de Human Rights Watch datée du 25 mars leur demandant des précisions sur les protections dont bénéficiaient les travailleurs migrants. Human Rights Watch avait déjà montré que le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022 de la FIFA, avait encouragé les sous-traitants à souscrire une assurance vie privée pour leurs employés dès 2019. Mais en 2022, Human Rights Watch avait découvert que seulement 23 sous-traitants l'avaient fait. L'un d'entre eux avait indiqué que cela avait coûté moins de 14 dollars par travailleur et par an, pour une indemnisation de 20 599 dollars en faveur des membres de la famille si les décès n'étaient pas classés comme professionnels et ne remplissaient pas les conditions d'une indemnisation.
« La FIFA, qui prétend donner un élan à des réformes positives du travail dans les pays hôtes de la Coupe du monde, devrait tirer les leçons des catastrophes qu'ont été les compétitions passées sur le plan des droits humains, et exiger d'urgence la prévention effective des accidents, des enquêtes et des mécanismes d'indemnisation en cas de blessure ou de décès de travailleurs migrants », a conclu Michael Page.
Informations complémentaires Décès de travailleurs migrants en Arabie saoudite
Les chercheurs ont recueilli des informations sur les décès de travailleurs migrants auprès de sources gouvernementales indiennes, bangladaises et népalaises. Toutes nationalités confondues, la grande majorité des décès de travailleurs ont été attribués à des « causes naturelles ». C'est en effet le cas pour 74% des 1 420 décès de travailleurs migrants indiens enregistrés uniquement à l'ambassade indienne de Riyad en 2023 ; 80% des 887 décès detravailleurs bangladaisau cours des 6 premiers mois de 2024 ; et 68% des 870 décès de travailleurs migrantsnépalais de 2019 à 2022.
Cinq des neuf cas de décès documentés par Human Rights Watch officiellement classés comme non liés au travail, y compris des décès par « causes naturelles », concernent des travailleurs qui se sont effondrés sur leur lieu de travail et sont décédés par la suite, selon leurs familles. Des témoins de deux décès de travailleurs ont déclaré aux familles que leurs collègues étaient décédés à la suite d'accidents du travail ; dans le premier cas, il s'agissait d'une électrocution et dans le second, d'un accident d'ascenseur. Des témoins ont également indiqué aux familles de deux travailleurs migrants décédés que ceux-ci étaient morts dans leur sommeil. Ces résultats font craindre qu'en Arabie saoudite, les accidents du travail soient insuffisamment enregistrés et mal catégorisés et/ou qu'ils ne fassent pas l'objet d'enquêtes adéquates.
En outre, dans le cas du décès d'un travailleur bangladais par « électrocution », le « certificat de non-objection » indiquait qu'il n'y avait « pas de possibilité »d'indemnisation et que le motif de ce refus était « non disponible », tandis que pour deux autres cas d'accidents du travail officiellement certifiés, la possibilité de recevoir une indemnisation était indiquée comme « dépendant du rapport de police ».
Les employeurs se sont également soustraits ou ont tenté de se soustraire aux obligations leur incombant en vertu de la loi saoudienne, qui les oblige à prendre en charge les frais de rapatriement des dépouilles mortelles, à moins que ceux-ci ne soient couverts par la GOSI. Les membres des familles de neuf travailleurs bangladais décédés ont déclaré que les employeurs avaient proposé de les enterrer en Arabie saoudite, en offrant des paiements forfaitaires ou la prise en charge de dépenses mensuelles telles que les frais de scolarité des enfants. Malgré leurs conditions économiques désastreuses, huit familles ont déclaré avoir refusé ces offres, tandis que six ont payé elles-mêmes les frais de rapatriement. Dans un cas, l'épouse d'un travailleur népalais a déclaré que son conjoint avait été enterré en Arabie saoudite sans le consentement de la famille. Aucune de ces familles n'a encore été indemnisée.
Le fils d'un Bangladais décédé à la suite d'une décharge électrique a déclaré que l'employeur de son père avait conditionné l'indemnisation à un enterrement sur place. La famille a refusé cette condition et a dû payer plus de 500 000 takas bangladais (environ 4 134 dollars) pour rapatrier le corps, somme qu'elle a financée par des prêts. La famille a reçu une indemnisation de 335 000 takas (2 770 dollars) de la part du gouvernement bangladais. « Nos dettes étaient plus importantes que les indemnités », a conclu le fils.
Les familles de travailleurs migrants éligibles ont du mal à accéder aux prestations de sécurité sociale du gouvernement saoudien, même avec l'aide de leur ambassade ou de leur consulat. Les sites Webdes ambassades des pays d'origine indiquent que l'obtention d'une indemnisation est extrêmement longue et fastidieuse, et qu'elle peut prendre des années. La veuve d'un travailleur décédé a déclaré qu'il lui avait fallu dix ans pour obtenir ce qui lui était dû : « Mes fils ont 11 et 13 ans. Lorsque mon mari est décédé, ils avaient 11 mois et 2 ans. Si nous avions été indemnisés juste après sa mort, nous aurions été tellement soulagés ».
Dans un autre cas, il a fallu près de 15 ans à la famille d'un migrant décédé pour accéder à ses prestations GOSI. Son frère a déclaré à Human Rights Watch : « L'indemnisation aurait dû arriver plus tôt. Elle aurait apporté une certaine consolation à mes parents en deuil et allégé la pression des prêts. Ils sont décédés six ans après la mort de mon frère ».
Le fait de ne pas reconnaître les décès survenus sur le lieu de travail et de ne pas garantir en temps voulu la sécurité sociale aux membres survivants de la famille peut aggraver leur pauvreté ou engendrer des préjudices sur plusieurs générations, notamment parce que cela contraint les familles à déscolariser leurs enfants pour les envoyer travailler. La veuve d'un travailleur migrant bangladais a déclaré : « Pour joindre les deux bouts, j'ai fait travailler mon fils de 14 ans, et le peu d'argent qu'il gagne est utilisé pour nos dépenses quotidiennes ».
Certains témoins ayant assisté à la mort de collègues dans des accidents du travail ont déclaré que leur employeur avait exigé qu'ils reprennent rapidement le travail. L'un d'entre eux a décrit les vertiges ressentis au moment d'écarter le cadavre de son ami tué dans un accident de machine. Il a repris le travail le lendemain sans pouvoir bénéficier d'un congé de deuil ni d'un soutien social ou de santé mentale.
Un autre a déclaré que ses supérieurs remettaient en cause les raisons pour lesquelles lui et ses collègues avaient interrompu leur travail après avoir assisté à la mort de leur ami. Ils ont été contraints de reprendre le travail le jour même. « C'est difficile dans un pays étranger », a-t-il expliqué. « Nous n'avons pas osé parler de ce problème et nous n'avons rien dit, car nous avions peur ».
Décès sur le lieu de travail et manquements flagrants à la sécurité sur le lieu de travail
Morts dues à des chutes de travailleurs, ou à des chutes de matériaux de construction
La veuve d'un Bangladais de 48 ans qui a travaillé dans le secteur de la construction en Arabie saoudite pendant plus de vingt ans a raconté :
Il est décédé après être tombé du cinquième étage d'un immeuble en construction. Ses collègues présents sur place m'ont expliqué que l'endroit où il était tombé était la zone d'atterrissage de l'ascenseur, où des ordures et des morceaux de fer avaient été jetés. À ce moment-là, il effectuait des travaux de coffrage et sa ceinture de sécurité s'est détachée, ce qui l'a fait tomber… Comme il y avait beaucoup d'objets lourds et durs, il a été blessé à plusieurs endroits de la tête et du corps. Il a perdu connaissance mais est resté en vie. La police saoudienne est arrivée très rapidement sur les lieux de l'accident, l'a secouru et l'a emmené à l'hôpital le plus proche. Après avoir reçu les premiers secours, il a été admis à l'unité de soins intensifs, mais il est décédé deux heures plus tard. Je lui parlais plusieurs fois par jour. Comme tous les jours, le jour de sa mort, il m'a appelé après le déjeuner et ça a été notre dernière conversation.
La veuve d'un travailleur migrant bangladais de 36 ans qui a travaillé dans le secteur de la construction en Arabie saoudite pendant plus de huit ans a raconté :
Mon beau-frère travaillait dans la même entreprise et vivait avec lui. Le jour de l'accident, il était présent sur le chantier et c'est lui qui nous a informés du décès de mon mari. Il m'a dit : « Nous transportons des blocs lourds au travail, et il y a une grande quantité de blocs accumulée sur le chantier. Mon frère [mon mari] passait à cet endroit quand une masse de blocs lui est soudainement tombée dessus. Comme il y en avait beaucoup, nous n'avons pas pu l'extraire à mains nues. Une grue a été amenée pour le dégager de là, mais il était trop tard. Mon frère [mon mari] avait déjà cessé de respirer. Son corps a été écrasé par le poids des lourds blocs. »
La veuve d'un travailleur migrant bangladais de 33 ans qui travaillait dans le secteur de la construction en Arabie saoudite depuis à peine sept mois a témoigné :
Quelques membres de ma famille vivent en Arabie saoudite pour leur travail. Ils ont appris que mon mari était tombé du troisième étage de la fenêtre d'un bâtiment de construction qui était sur le point d'être démoli pour la reconstruction… Mon mari était au troisième étage en train de marteler le mur pour le casser lorsqu'il est tombé. Il n'est pas mort sur le coup. Mais personne n'est venu l'aider de peur d'avoir des ennuis judiciaires, car il s'agissait d'un cas d'accident.
Morts par électrocution
La veuve d'un Népalais de 25 ans qui a travaillé en Arabie saoudite pendant deux ans a déclaré :
Après avoir été électrocuté au travail, mon mari s'est effondré et a été transporté à l'hôpital. Quelques mois plus tard, nous avons été soulagés d'apprendre qu'il avait repris connaissance, puis nous avons soudainement été informés de son décès. La cause du décès est professionnelle, mais officiellement, elle est considérée comme naturelle. En plus, nous n'avons pas reçu le corps de mon mari, mais nous avons été informés que les derniers sacrements avaient déjà été administrés en Arabie saoudite, sans notre autorisation. Cela nous a encore plus attristés. Nous pensons que tout cela fait partie d'un plan conçu pour nous priver d'indemnisation. Tant de questions restent sans réponse… Qui les a autorisés à enterrer [mon mari] au lieu de rapatrier [son] corps ? Des témoins affirment que la mort a été causée par une électrocution…
La veuve d'un travailleur migrant bangladais de 27 ans qui a travaillé en Arabie saoudite pendant quatre ans et demi a raconté :
Plusieurs collègues étaient présents lorsqu'il [mon mari] a été électrocuté. Ils ont raconté qu'il travaillait à proximité de fils électriques lorsqu'il s'est effondré sous l'effet d'un choc électrique soudain. Malgré les tentatives de réanimation, il a été déclaré mort sur place.
Décapitations accidentelles
La veuve d'un Bangladais de 46 ans qui a travaillé dans le secteur de la construction en Arabie saoudite pendant deux ans a décrit les circonstances de son décès :
Selon ses collègues et le contremaître, il a remarqué un problème mécanique sur la machine qu'il utilisait. Il a éteint la machine pour la réparer et essayait de retirer une pierre coincée à l'intérieur lorsque quelqu'un a accidentellement remis la machine en marche. Sa tête est restée coincée à l'intérieur et il est mort sur le coup. Lorsque son corps est arrivé au Bangladesh, nous avons constaté que sa tête était séparée de son corps. La description fournie par ses collègues correspondait à l'état de son corps, et je n'ai donc eu d'autre choix que de croire à l'accident. Cependant, je ne peux pas dire si l'enquête sur l'accident a été approfondie ou non. Lorsque nous avons reçu son corps, j'ai voulu le serrer une dernière fois dans mes bras, mais cela n'a pas été possible. En le voyant dans cet état, j'ai perdu connaissance.
La veuve d'un autre Bangladais, âgé de 43 ans qui a taillé des blocs de béton en Arabie saoudite pendant deux ans a raconté :
Il n'avait aucune expérience de l'utilisation de ce type de machine géante. La lame s'est peut-être bloquée, mais il n'a pas remarqué qu'elle tournait dans la partie supérieure. Il a placé sa tête à l'intérieur de la machine lorsque la lame s'est soudainement mise à tourner. À ce moment-là, sa tête a été coupée par la lame et s'est détachée du corps. Il est mort sur le coup. La police est arrivée et a pris le corps. Je ne sais ce qui s'est passé qu'à travers ce qu'on m'en a dit. Je n'ai pas pu vérifier la cause du décès depuis le Bangladesh.
Pression des employeurs pour que les travailleurs migrants décédés soient enterrés en Arabie saoudite
De nombreuses familles de travailleurs migrants ont indiqué à Human Rights Watch que l'employeur de leur proche décédé avait activement fait obstacle au rapatriement de leur corps.
La veuve d'un Bangladais de 48 ans qui a travaillé pendant plus de vingt ans dans le secteur de la construction en Arabie saoudite a confié :
Au départ, les représentants de l'entreprise nous ont proposé d'enterrer le corps de mon mari en Arabie saoudite et nous ont assuré que l'entreprise nous offrirait divers avantages en échange. Mais nous avons voulu ramener le corps de mon mari au Bangladesh et l'enterrer ici. Alors, l'entreprise nous a dit que nous devrions prendre en charge tous les frais de transport du corps… C'est donc notre famille qui a payé toutes ces dépenses.
La veuve d'un Bangladais de 46 ans qui a travaillé dans le secteur de la construction en Arabie saoudite pendant deux ans a raconté :
Le Kafil [parrain] saoudien voulait enterrer mon mari en Arabie saoudite, mais je n'ai pas donné mon accord. Je voulais le ramener pour le voir une dernière fois. Le Kafil n'a fourni aucune aide financière. La présence de ma famille en Arabie saoudite a été utile, car elle s'est investie corps et âme pour que le corps de mon mari soit rapatrié. Pour ce faire, mes proches ont versé 1 000 rials saoudiens (265 dollars), plus 4 000 rials supplémentaires (1 065 dollars) de la part des collègues de mon mari… Le Kafil [sponsor] n'a fourni aucune compensation ou assurance.
La veuve d'un Bangladais de 44 ans qui a travaillé comme plombier en Arabie saoudite pendant plus de vingt ans a raconté :
Au moment du décès, l'entreprise n'a cessé de m'appeler et m'a proposé diverses aides financières en échange de l'enterrement de mon mari en Arabie saoudite même. Ils ont insisté pour que je ne reprenne pas le corps. Ils m'ont promis de m'envoyer 800 000 takas bangladais (6 584 dollars), le salaire restant de mon mari, et une allocation mensuelle pour l'éducation de mes enfants, mais j'ai insisté pour ramener son corps au Bangladesh.
La veuve d'un ouvrier bangladais de 32 ans décédé à la suite de décharges électriques a déclaré :
Le corps de mon mari est arrivé au Bangladesh environ trois mois après sa mort. Le contremaître de l'entreprise n'a cessé d'essayer de me convaincre de diverses manières que si je ne faisais pas rapatrier le corps, j'obtiendrais de nombreux avantages de la part de l'entreprise. Il m'a dit que l'entreprise nous aiderait même à payer nos dépenses mensuelles, les frais de scolarité de nos enfants, etc. Mais nous avons refusé que le corps soit enterré en Arabie saoudite, et le contremaître a lui-même contacté l'entreprise et a ramené le corps au Bangladesh.
Refus d'indemniser les familles de travailleurs migrants décédés, y compris pour des décès survenus dans le cadre du travail
La GOSIde l'Arabie saoudite couvre en principe les blessures ou les décès attribués à des accidents du travail. Cette assurance obligatoire est basée sur une cotisation de 2% du salaire, et les membres survivants de la famille du défunt perçoivent 84 mois de salaire, la somme maximum étant de 330 000 rials saoudiens (88 000 dollars).
Toutefois, la plupart des décès qui se produisent en Arabie saoudite sont attribués, en l'absence d'enquête appropriée, à des raisons non liées au travail, notamment à des « causes naturelles », ce qui prive les membres de la famille d'une indemnisation. Cependant, les recherches de Human Rights Watch montrent que même lorsque les travailleurs migrants meurent dans des accidents de travail qualifiés comme tels sur les certificats de décès, les familles rencontrent souvent des difficultés et des retards importants d'indemnisation.
Pour de nombreux travailleurs migrants qui rentrent au pays et pour leurs familles, les programmes publics de protection sociale sont un dernier recours, en particulier en cas d'abus entraînant la mort ou des blessures. De nombreux pays d'origine utilisent communément les Fonds de protection sociale aux migrants, qui sont largement financés par les contributions des migrants, pour financer ces programmes. Cependant, pour obtenir ce soutien, il faut être en possession d'un permis de travail valide, ce qui n'est pas le cas de tous les travailleurs migrants. En outre, le niveau et l'étendue de l'aide apportée par les pays d'origine varient considérablement.
Indemnisation tardive par l'Arabie saoudite ou par le pays d'origine
La veuve d'un ouvrier népalais de la construction routière âgé de 28 ans, décédé après avoir été percuté par un poids lourd, a livré ce témoignage :
J'ai reçu 700 000 roupies indiennes (8 065 dollars) du gouvernement népalais à titre d'indemnisation et 1 400 000 (16 130 dollars) de la compagnie d'assurance [népalaise]. J'ai rencontré de nombreux obstacles pour recevoir l'indemnisation de l'Arabie saoudite. Mon beau-frère a pris les devants. Les démarches ont duré deux ans et j'ai dû me rendre dans de nombreux bureaux. Les formalités administratives étaient lourdes… Il était clair que je ne pouvais pas gérer seule le processus d'indemnisation. Mon beau-frère a alors fait appel à des travailleurs sociaux qui ont fait pression sur l'ambassade du Népal en Arabie saoudite. Ce n'est qu'après de nombreuses relances que nous avons finalement reçu l'indemnisation sur les comptes bancaires de mon fils et de moi-même séparément… Sans [l'indemnisation], nous n'aurions pas été en mesure de gérer nos dépenses…
Le frère d'un travailleur népalais décédé, qui s'est battu pour obtenir une indemnisation au nom de sa belle-sœur, a déclaré :
Pour le décès de mon frère, nous avons reçu une indemnisation de la GOSI au bout de 15 ans. J'étais déterminé à obtenir une indemnisation et j'ai donc continué à suivre le dossier. Tout le monde n'aurait pas pu en faire autant. Les membres de ma famille m'ont dit d'abandonner, mais j'étais déterminé à obtenir l'indemnisation à tout prix. Si nécessaire, j'étais prêt à me rendre en Arabie saoudite pour défendre ma cause. Mais au moins, nous avons reçu l'argent : c'est mieux que de ne rien recevoir…. Cela nous a soulagés.
L'épouse d'un travailleur népalais de 34 ans décédé dans un accident de la route a déclaré :
J'ai épargné le montant de l'indemnité sur mon compte bancaire et j'essaie de ne pas y toucher. Je dois l'épargner pour l'avenir de mes enfants. J'essaie de gérer les dépenses de mon ménage grâce à l'agriculture de subsistance, aux indemnités que le gouvernement népalais verse aux veuves et aux bourses d'étude destinées aux enfants de migrants décédés par l'intermédiaire du Foreign Employment Board [programme de bourses d'études financé par le fonds contributif de protection sociale des migrants].
Autres exemples d'indemnisation tardive ou inadéquate
La veuve d'un Bangladais de 44 ans qui a travaillé comme plombier en Arabie saoudite pendant plus de vingt ans a raconté :
Je n'ai pas reçu beaucoup d'aide financière à l'arrivée du corps, mais trois mois plus tard, le gouvernement bangladais m'a versé 350 000 takas (2 879 dollars). Ni le gouvernement saoudien ni l'entreprise n'ont fourni d'aide financière. L'entreprise avait précédemment promis de m'aider, mais je n'ai jamais reçu de soutien.
La veuve d'un Bangladais de 26 ans qui a travaillé en Arabie saoudite comme ouvrier du bâtiment pendant plus de cinq ans avant de décéder sous le poids d'une chargeuse a raconté :
Il a fallu plus de trois mois pour ramener son corps au Bangladesh en raison de retards bureaucratiques et du refus de l'employeur de prendre ses responsabilités… Malgré des demandes répétées, l'entreprise n'a pas payé les salaires qui restaient, les indemnités de fin de service ou les compensations supplémentaires. Nous avons reçu 300 000 takas (2 466 dollars) du gouvernement dans le cadre du Fonds de bien-être des expatriés…
La veuve d'un ouvrier bangladais de 32 ans décédé à la suite de décharges électriques a déclaré :
Au moment de sa mort, il restait un mois de salaire impayé que l'entreprise nous a envoyé par la suite. Mais nous n'avons pas récupéré l'argent qu'il avait à la banque ni ses autres biens… Nous avons reçu 35 000 takas (287 dollars) du gouvernement bangladais lorsque nous avons reçu le corps, puis 300 000 takas (2 466 dollars), et ses amis du travail nous ont également envoyé 150 000 takas (1 233 dollars) en soutien. L'entreprise n'a versé ni le salaire dû, ni aucun avantage, ni aucune somme pour l'assurance…
La veuve d'un plombier indien de 44 ans décédé de « cause naturelle », ce que la famille ne croit pas, a précisé :
L'entreprise a versé 300 000 roupies indiennes (3 511 dollars). Nous ne savons pas si cet argent correspond à un salaire dû, à des indemnités de fin de service ou à une compensation… Nous avons parlé à Rajeev [un autre travailleur migrant de l'entreprise], qui est le seul interlocuteur de notre famille auprès de l'entreprise. Il nous a dit que l'entreprise n'était pas disposée à nous verser de l'argent supplémentaire. Pourtant, elle nous en doit encore au titre de l'indemnité de décès puisque le décès est survenu sur le lieu de travail.
Exemple d'absence d'indemnisation
La veuve d'un Népalais de 45 ans qui a travaillé en Arabie saoudite en tant qu'ouvrier sur un chantier de construction routière pendant plus de 11 ans a déclaré :
J'ai supplié la compagnie plusieurs fois de me verser de l'argent au titre de l'assurance. Mais ils disent que ce n'est pas dans leurs règles, car ils n'ont pas de police d'assurance vie, seulement une assurance accident. Notre cas n'est pas considéré comme un accident du travail. Faut-il tomber, être frappé par une pierre ou être coupé par une machine pendant le travail ? Il s'est évanoui à cause d'une forte pression au travail. Je pense que l'enquête est incomplète. Nous sommes obligés de les croire sur parole, car nous ne pouvons pas nous rendre sur place [en Arabie saoudite] pour mieux comprendre la situation. L'argent de l'indemnisation aurait été comme de l'oxygène pour nous. Nous n'avons pas non plus été indemnisés par le gouvernement népalais, car son permis de travail avait expiré et il ne pouvait prétendre à une indemnisation du fonds d'aide sociale ou de l'assurance.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entrevue sur les États généraux du syndicalisme : défis et espoirs

Nous présentons ci-dessous une entrevue avec Bertrand Guibord (président du Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM- CSN ) et de Marc-Édouard Joubert (président du Conseil régional de la FTQ) sur les États généraux du syndicalisme. Malgré la multiplication des luttes syndicales, ces dernières s'inscrivent dans un contexte global de régression sociale et de montée de la droite. Face à cela, les États généraux du syndicalisme vont permettre de préciser les défis devant le syndicalisme au Québec : mobilisation des membres et démocratie des organisations, unité intersyndicale, renforcement de l'unité syndicale et rôle de l'action politique des syndicats entre autres questions. Cette entrevue cherche à préciser les pistes soulevées de ces thèmes et le rôle des États généraux sont appelés à jouer pour les définir.
André Frappier : Merci d'être là, et bravo pour l'initiative des États généraux du syndicalisme. C'est une première qui répond à un besoin réel. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Bertrand Guibord : Militant à la CSN, j'ai œuvré à l'exécutif de mon syndicat local, le syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie Victorin. Aujourd'hui je suis président du CCMM-CSN que je représente au Comité intersyndical du Montréal métropolitain qui organise les États généraux du syndicalisme dans la région.
Marc-Édouard Joubert : Militant syndical au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), je participe aussi au Comité intersyndical du Montréal métropolitain. Je milite pour un syndicalisme plus combatif, capable de mieux répondre aux défis actuels.
États généraux du syndicalisme : Origine et attentes
André Frappier : Pourquoi avoir lancé cette démarche des États généraux et qu'est-ce qui explique l'adhésion large aujourd'hui, incluant centrales et syndicats indépendants ?
Bertrand Guibord . En ce moment, le contexte actuel fait qu'il y a de plus en plus de conflits, mais les syndicats en sortent victorieux. On doit maintenant répondre à des crises multiples : sociales, écologiques, démocratiques. Dans ce contexte, le syndicalisme a besoin de se réinventer. Les États généraux du syndicalisme visent à créer un espace démocratique, inclusif et pluraliste où les syndiqué·e·s peuvent débattre de leur avenir et proposer des perspectives de transformation.
Marc-Édouard Joubert : On a vu une série d'attaques néolibérales contre le mouvement syndical. Le rapport de force s'est érodé, et plusieurs membres sentent que leurs structures syndicales sont devenues distantes, bureaucratisées. Il est temps de reprendre la parole à la base et de réfléchir collectivement à un renouveau du syndicalisme.
André Frappier : Quels objectifs poursuivez-vous concrètement avec cette initiative ?
Bertrand Guibord : Nous voulons créer un processus de large consultation. On a préparé un document de discussion qui propose 7 grands thèmes. L'objectif est de permettre aux militantes et militants de s'exprimer, d'identifier les blocages actuels et de proposer des pistes d'actions concrètes. Il s'agit de renforcer la démocratie syndicale, de poser la question du rapport au politique et d'affirmer la solidarité avec les luttes sociales et environnementales.
Marc-Édouard Joubert : On cherche à remettre les syndiqué·e·s au centre des décisions. Ce processus doit aller au-delà des appareils syndicaux. Il est porté par la base. Les États généraux veulent non seulement faire un état des lieux, mais aussi dégager des perspectives, une vision commune, des moyens d'action pour relancer un syndicalisme de transformation.
André Frappier : À qui s'adresse ce processus ?
Bertrand Guibord : À toutes les personnes syndiquées, peu importe leur centrale ou leur secteur. On veut rassembler des militantes et militants de la FTQ, de la CSN, de la CSQ, de la FIQ, de l'APTS, de la FAE mais aussi des syndicats indépendants, comme ceux de la fonction publique fédérale.
Marc-Édouard Joubert : Il faut une participation large, transversale. Le processus est ouvert à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le besoin de repenser notre syndicalisme. On espère que les jeunes générations, souvent moins représentées, y prendront part aussi, car ils contestent les procédures et les façons de faire. Cela pousse à une remise en question salutaire.
André Frappier : Comment se déroule concrètement le processus des États généraux ?
Bertrand Guibord : On a tenu une première assemblée de lancement à Montréal. Plusieurs autres sont prévues dans différentes régions : Québec, Outaouais, Saguenay, etc. Des comités locaux se mettent en place. On a aussi une plateforme numérique pour permettre la participation à distance.
Marc-Édouard Joubert : Chaque assemblée se basera sur le document de discussion (donner la référence : L'union fait l'avenir - syndicalisme.com). On veut favoriser des échanges horizontaux, sans hiérarchie, pour faire émerger des propositions. Le comité intersyndical joue un rôle d'animation, mais ce sont les discussions de terrain qui doivent nourrir les conclusions.
Objectifs des États généraux du syndicalisme face à l'offensive patronale et gouvernementale et aux difficultés de mobilisation
André Frappier : Quel lien établissez-vous entre syndicalisme et luttes sociales (écologie, féminisme, antiracisme, etc.) ?
Bertrand Guibord : Le syndicalisme ne peut plus se limiter aux enjeux salariaux. Il doit s'ouvrir aux luttes sociales, environnementales, féministes, antiracistes. L'avenir du travail est lié à celui de la planète. Il y a des ponts à construire avec les mouvements sociaux. Les États généraux doivent être un lieu pour faire émerger cette convergence.
Marc-Édouard Joubert : Les attaques contre le droit du travail, la destruction des services publics, l'urgence climatique, la montée du racisme : tout cela est lié. Le syndicalisme doit être un acteur politique dans le sens large, enraciné dans la société. Pour ça, il faut une refondation profonde de ses pratiques et de ses priorités.
Bernard Rioux : Malgré la montée des mobilisations et des grèves depuis 2024, on observe un effritement général : augmentation des inégalités, recul des droits syndicaux, montée du racisme. Quelles formes de luttes pourraient véritablement inverser cette tendance ?
Bertrand Guibord : Il faut nuancer. Si la situation est difficile dans le secteur public et parapublic, le privé connaît des victoires importantes. Par exemple, dans le transport scolaire, certains ont obtenu jusqu'à 75 % d'augmentation salariale sur 4-5 ans. Ce qui est frappant, c'est la similarité des demandes patronales (flexibilisation, attaques sur les retraites, les congés, etc.) malgré les secteurs, ce qui appelle des luttes unitaires. La mauvaise gestion de la main-d'œuvre renforce les contradictions : au lieu d'améliorer les conditions, on impose des horaires absurdes et des contraintes qui nuisent au recrutement et à la rétention.
Marc-Édouard Joubert : Effectivement, il y a une dégradation sociale généralisée. Les propos racistes, sexistes ou homophobes se banalisent. Face à cette dérive, le syndicalisme doit rester un lieu de dignité. Le secteur privé résiste parfois mieux, mais globalement, nous devons renforcer notre présence idéologique dans l'espace public, malgré l'hostilité ambiante. Il faut former une "gang", un collectif fort, pour affronter les vagues conservatrices.
États généraux du syndicalisme et l'unité intersyndicale
André Frappier : Dans le dernier Front commun, les divisions syndicales ont été visibles. Quelles pistes concrètes pourraient favoriser une unité intersectorielle ou intersyndicale plus forte ?
Marc-Édouard Joubert : À l'échelle régionale, nous avons développé une culture du travail intersyndical. Le Conseil central a notamment réussi à syndiquer un entrepôt Amazon, ce qui est exemplaire. Il faut se concentrer sur les objectifs communs, même si les cultures syndicales diffèrent. Les États généraux devront aborder les enjeux de maraudage, de l'« ubérisation » du travail et de la solidarité syndicale.
Bertrand Guibord : Dans notre région, le travail du Conseil Intersyndical de Montréal montre qu'on peut dépasser nos divisions. Nous nous appelons « camarades » pour souligner notre solidarité. Paradoxalement, les patrons sont les meilleurs mobilisateurs. Le projet de loi 89 a uni les syndicats dans l'action. Nos divergences concernent plus les moyens d'action que les objectifs. Il faut accepter la diversité des tactiques tout en se recentrant sur nos buts communs. Et la jeune génération tend à concevoir le syndicalisme comme un mouvement social plutôt qu'un simple appareil.
La question du rôle politique des syndicats
André Frappier : Comment envisager un véritable changement politique ? Le débat politique est-il faisable dans les syndicats ?
Marc-Édouard Joubert : C'est un débat délicat, souvent douloureux. Notre expérience montre l'importance de discuter des valeurs et des enjeux avant les étiquettes partisanes. Le soutien ne devrait pas être automatique, mais basé sur les plateformes. Des militants appuient divers partis, y compris la CAQ. Le mouvement syndical devrait privilégier l'analyse critique des programmes et défendre ses positions, comme il l'a fait récemment contre Poilievre.
Bertrand Guibord : Le système politique lui-même est verrouillé. Toute expression, même neutre, peut être considérée comme partisane par la loi. Le cadre électoral est conçu pour limiter la voix syndicale. Il faut s'interroger : ce n'est pas seulement une question de soutenir tel ou tel parti, mais de remettre en question un système qui empêche toute réelle alternative. Même les partis progressistes finissent par s'adapter au jeu électoral et à ses logiques de marketing. Ce que nous vivons, c'est un système fondamentalement extractiviste — qui exploite les ressources comme les êtres humains.
Bernard Rioux : La neutralité politique de la CSN est-elle encore tenable aujourd'hui ?« On a connu dans le passé un soutien syndical à un parti comme le Parti des travailleurs. Aujourd'hui, se limiter à analyser les plateformes électorales des autres partis, sans se doter de nos propres outils politiques, n'est-ce pas se condamner à rester spectateurs ?
Bertrand Guibord : Être non-partisan ne signifie pas être apolitique. On est engagés sur des enjeux politiques tous les jours. Le problème, c'est que la loi électorale au Québec assimile toute prise de position à une prise de position partisane. Or, ce n'est pas parce qu'on soutient une mesure, comme une transition juste, qu'on soutient un parti. Il faut faire une distinction claire entre la politique parlementaire, la vie partisane et la vie politique.
André Frappier : Peut-on aller au-delà de la neutralité dans certaines situations concrètes ? Je me rappelle que plusieurs membres, candidats de Québec solidaire, ont obtenu l'appui de leur assemblée syndicale avant d'être soutenus par le Conseil général de la FTQ. Cela illustre que des formes d'engagement syndical avec des candidatures politiques progressistes ont déjà été explorées, avec un travail de base important.
Marc-Édouard Joubert : Nos statuts prévoient l'encouragement de la participation politique de militants progressistes. On a déjà appuyé des candidatures dans ce cadre. Le piège, c'est de se sentir paralysé par l'idée de neutralité. Parfois, il faut prendre position. Sur des projets comme PL89, les positions de QS rejoignent directement nos luttes syndicales. Cela dit, on observe un certain retrait des appuis formels ces dernières années, mais je crois que les États généraux pourraient rouvrir ce débat.
Espoirs et priorités
André Frappier : Quelle est, selon vous, la priorité ou l'idée principale qui devrait émerger des États généraux ?
Marc-Edouard Joubert : On doit sortir du rythme imposé par le calendrier parlementaire et les consultations gouvernementales. Ça nous éloigne de l'essentiel : nos membres. Je souhaite qu'on se redonne du temps pour deux choses : 1) réfléchir avec nos membres 2) et agir. Il faut alléger nos structures et redonner du souffle militant. Trop de militant·es sont épuisé·es. Il faut se concerter, se mobiliser et planifier.
Bertrand Guibord : Ce que j'espère des États généraux, c'est qu'ils permettent aux syndicats de redevenir un lieu pertinent et mobilisateur. Les luttes aujourd'hui sont fragmentées. On doit redonner envie aux militant·es de s'engager syndicalement pour des causes politiques. Cela commence par le lien avec nos membres. Les syndicats locaux sont submergés par la gestion quotidienne des relations de travail. Il faut plus de gens impliqués, plus de militants qui portent ces enjeux collectifs.
***
André : Bien, Bertrand, Marc-Édouard, merci beaucoup de votre excellent travail militant et d'avoir accepté de participer à notre entrevue.
Bertrand Guibord : Merci André, merci Bernard.
Marc-Édouard Joubert : Merci Bernard, merci André.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À Strasbourg, les métallurgistes CGT refusent la retraite à 64 ans et la désindustrialisation

Des centaines de militants venus de toute la France, à l'occasion de leur congrès, ont renforcé les rangs de la manifestation pour la défense des retraites, tout en travaillant à de nouvelles stratégies contre la désindustrialisation.
Tiré de l'Humanité
« Il n'y aura pas de gouvernement qui tiendra dans la durée sans abroger cette retraite », fustige Sophie Binet.
Strasbourg (Bas-Rhin)
« Aujourd'hui, nous fêtons ensemble une magnifique victoire ! »s'est exclamée la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, en prenant la parole devant les centaines de gilets jaunes et rouges qui l'entouraient, drapeaux au vent, juste avant leur départ pour rejoindre les syndicalistes locaux et démarrer la manifestation contre la réforme des retraites.
Les applaudissements nourris et les slogans qui ont fusé montraient que tout le monde savait déjà de quelle victoire il s'agissait. Le matin même, par 198 voix pour et 35 contre, les députés ont voté une résolutiondemandant l'abrogation des 64 ans et le passage à 43 annuités de cotisation en 2027, plus de deux ans après que le gouvernement a fait passer sa loi en force à coups de 49.3 à l'Assemblée.
Il y a deux ans, le gouvernement avait également réussi à bloquer une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Le référendum d'initiative populaire, demandé par les syndicats et des groupes politiques, n'a jamais vu le jour. D'où les questions qui revenaient en boucle dans les rangs des manifestants de Strasbourg, se demandant quelle suite pourrait entraîner la victoire du jour. Le gouvernement va-t-il tenir compte de ce vote ? Y est-il obligé ?N'est-ce pas un vote symbolique qui n'aura aucune conséquence ?
« Les députés ne sont pas des plantes vertes, ils font la loi. Et nous sommes donc rassemblés ici à Strasbourg, et nous manifestons partout en France, pour demander une chose très simple : que le gouvernement respecte ce vote et la démocratie, sinon nous appelons les députés à en tirer toutes les conséquences », a répondu Sophie Binet, ajoutant qu'il « n'y aura pas de gouvernement qui tiendra dans la durée sans abroger cette retraite ».
« C'est Mittal qui détourne ses bénéfices au Luxembourg »
L'autre sujet qui a occupé toutes les conversations, c'est la série noire desfermetures de sites industriels et les plans de licenciement qui balayent la France depuis plusieurs années et semblent aller crescendo. La CGT a comptabilisé entre 150 000 et 240 000 emplois supprimésdepuis un an et demi, constatant que c'était le cœur même de l'industrie française qui était touché de plein fouet, notamment sa métallurgie qui est à la base de toutes les industries de transformation, alors que le secteur n'est pas en difficulté économique.
Les ArcelorMittal, en force à Strasbourg, le confirment, au moment où un plan social concernant 630 postes est en cours. « Pour nous, le PSE n'a pas lieu d'être. Tout va bien pour la santé économique du groupe. C'est Mittal qui détourne ses bénéfices au Luxembourg, mais nous, en France, nous gagnons de l'argent et nous avons les moyens de le prouver. Nous allons donc travailler sur ce point et nous allons le porter devant le tribunal », assure le délégué central CGT d'ArcelorMittal France, Reynald Quaegebeur.
En cause selon la CGT, la financiarisation de l'industrie, qui n'a pour objectif que de satisfaire les actionnaires. « Ces choix ne sont pas faits dans l'intérêt des salariés, ni dans l'intérêt de l'outil industriel », constate Stéphane Flégeau, le secrétaire général adjoint de la fédération CGT de la métallurgie, qui confirme cette continuité, depuis des années, d'une stratégie qui ne cesse de produire des ravages. « C'est un désastre pour le territoire français mais aussi pour l'Europe. Si nous n'avons plus la capacité de produire de l'acier en France et en Europe, on ne pourra pas alimenter les filières qui en ont un besoin fondamental. C'est pourquoi la bataille pour Arcelor est essentielle », ajoute-t-il.
Quelle stratégie, dans ces conditions, mettre en place pour tenter de renverser cette hémorragie d'emplois et les fermetures de sites industriels ? La question de fond a été débattue au cours du congrès de la fédération CGT de la métallurgie, organisé dans la capitale alsacienne, notamment celle de la nationalisation des entreprises industrielles stratégiques. « Il va falloir que nous mobilisions un maximum de groupes parlementaires qui vont porter les projets de loi au Parlement, en espérant que nos analyses et nos propositions fassent un bout de chemin dans les têtes et qu'elles aboutissent concrètement », propose le délégué central d'ArcelorMittal.
« Il faut que nous réussissions à élargir au niveau de toute l'Europe le rapport de force sur la question de l'acier que nous essayons de construire ici en France avec les camarades d'Arcelor », estime Stéphane Flégeau, qui insiste également sur le rôle que doivent jouer les régions, notamment celles victimes de la désindustrialisation. Il en veut pour preuve la mobilisation de l'ensemble des députés de Bretagne, mais aussi de la population, et même du Medef, qui a permis de sauverla Fonderie de Bretagne, à Caudan (Morbihan).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un sommet pour les océans

Le président de la République avait annoncé ce projet lors du congrès de l'UICN à Marseille en fin d'année 2021.
tiré du site Humanité et diversité
https://www.humanite-biodiversite.fr/articles/91109-un-sommet-pour-les-oceans
On connaissait le One Planet Summit, initiative de la France lancée en décembre 2017 en lien avec l'Organisation des Nations-Unies (ONU) et la Banque mondiale pour apporter des réponses aux multiples enjeux posés par la protection de l'environnement et requérant l'action à la fois énergique et concertée des États, des entreprises et des organisations non gouvernementales (ONG). Celui-ci a déjà connu quatre éditions dont la dernière en janvier de l'année dernière. Désormais, sur le même modèle, il faudra aussi compter sur le One Ocean Summit, nouvelle initiative de la France, tout aussi francophone dans sa dénomination, annoncée par Emmanuel Macron lors du Congrès mondial de la nature organisé en septembre dernier à Marseille et qui se tiendra du 9 au 11 février prochains à Brest.
De même que son homologue généraliste visait à faire de la France le chef de file de la défense de l'environnement au moment où les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris sur le climat, cette nouvelle initiative a pour objet de positionner la France en tête de la protection des océans alors que celle-ci préside le Conseil des ministres de l'Union européenne. Comme l'explique Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, envoyé spécial du Président de la République pour la préparation de cet événement, celui-ci se présente comme « un sommet d'engagement qui permet, en réunissant des experts et décideurs politiques mais aussi économiques et financiers, d'identifier et d'accélérer des initiatives en faveur des océans ».
En organisant cette manifestation en février, ses concepteurs espèrent en faire la rampe de lancement des six grands rendez-vous internationaux sur l'environnement programmés en 2022 dont, en particulier, le sommet de l'ONU sur les océans prévu à Lisbonne en juin prochain.
La réunion de Brest commencera par deux jours d'ateliers et de forums réunissant, sur place ou en visioconférence, des experts du monde entier autour d'une dizaine de grands thèmes : la connaissance des océans, encore bien imparfaite, la place de la pêche, qui suscite toujours autant de débats, la décarbonation du transport maritime, alors que de nombreux projets fleurissent en la matière comme le retour de la voile, l'éducation à la mer, afin de sensibiliser les nouvelles générations, l'économie bleue, pourvoyeuse d'emplois, le verdissement des ports, qui doivent totalement repenser leur mode de fonctionnement, la prévention des risques de submersion, dont le récent tsunami qui a frappé les Îles Tonga vient de rappeler l'actualité, la mobilisation de la finance internationale, sans laquelle rien ne pourra être fait et, bien sûr, la gouvernance des océans, en particulier en haute mer.
À ce sujet, l'un des principaux sujets portera sur la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale plus connue sous son acronyme anglo-saxon BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) qui tiendra sa quatrième et dernière session en mars prochain. A cette occasion, l'Union européenne va tenir une position sur la protection de la haute mer dont le contenu sera préalablement présenté dans une résolution débattue à Brest. Son but est de rappeler que les océans constituent, à la fois, le premier réservoir de biodiversité et le premier puits de carbone pour contrer les effets du changement climatique. Contrairement à d'autres domaines, l'Europe a une forte légitimité pour imposer ses vues sur la question car elle dispose du premier espace maritime mondial grâce à l'apport majeur des 11 millions de km2 de la zone économique exclusive de la France.
D'où l'importance de la troisième et dernière journée du sommet où se tiendra un segment de haut niveau, à caractère politique, avec la présence, autour du Président de la République, d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement représentatifs des différents océans ainsi que de plusieurs dirigeants de grandes entreprises, de représentants d'ONG et de hautes personnalités du monde maritime.
Cela suffira-t-il pour imposer les vues européennes et françaises et celles-ci sont-elles aussi vertueuses qu'elles prétendent l'être ? Certains en doutent qui, sous le nom de Soulèvements de la mer, organisent quelques jours plus tôt, à Brest également, un anti-sommet visant à dénoncer l'accaparement et la privatisation de la mer, ce que la journaliste Catherine Le Gall appelle « l'imposture océanique » des grands États comme des entreprises multinationales.
Il ne faut pas oublier que si la mer est un espace de liberté, auquel Victor Hugo rattachait l'indispensable rigueur, elle est aussi et peut-être d'abord un bien...
Pour Humanité et Biodiversité ce sujet est à la fois lointain et aussi indispensable que la défense des espèces menacées. On attend du concret, pas idéologique, mais à effet sur la biodiversité marine, sur le rôle des mers dans la lutte contre le réchauffement climatique et une ferme volonté de ne pas utiliser les mers comme dépotoir… Ce n'est pas gagné.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Où va Québec solidaire ? Quelles perspectives pour la gauche québécoise ?

L'atelier a cherché à faire le bilan de Québec solidaire et des changements survenus dans le parti durant les dernières années. Ce bilan est nécessaires pour les militant.e.s progressistes qui se sont investis à bâtir cette formation qui devait incarner l'espoir d'un changement social profond et d'une indépendance inclusive. L'adhésion par le leadership de QS à une politique ‘pragmatique' afin de faciliter l'accès au pouvoir aboutit à une érosion de la tradition de démocratie participative qui animait ce parti depuis ses origines, en plus de faire fi de la nécessité d'une tentative de transformation économique et sociale fondamentale, particulièrement à la lumière de la catastrophe écologique en cours.
Nous proposons les textes des interventions d'Andrea Levy, de Roger Rashi, de Dalie Giroux et d'André Frappier.
Intervention d'Andrea Levy
Dans son livre de 1911 intitulé Les Partis politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, le sociologue allemand Robert Michels entreprend une étude poussée de l'évolution des rapports de forces à l'intérieur des partis sociaux démocrates. Il en a tiré la conclusion qu'il existe dans toutes les organisations ce qu'il décrit comme une loi d'airain de l'oligarchie, une tendance lourde vers la monopolisation du pouvoir par les dirigeants. Il maintient que toute organisation complexe requiert une forme de hiérarchie, ce qui donne lieu à un processus de professionnalisation, la formation de cliques de dirigeants et une bureaucratie permanente qui devient de plus en plus éloignée des membres et des principes de base. Selon Michels, il existe une logique organisationnelle qui assure que, pour les fonctionnaires, le parti devient une fin en soi et non pas un instrument.
Malgré les nombreux défauts de son analyse, Michels, qui était lui-même membre du Parti social démocrate allemand et syndicaliste, demeure intéressant parce qu'il a identifié certaines tendances qui se manifestent de manière répétée chez les partis progressistes depuis plus d'un siècle et qui pourraient aider à comprendre la crise qu'on vit actuellement à Québec solidaire et que nous nous donnons la tâche dans cet atelier d'analyser, de comprendre et de voir comment on peut s'en sortir.
Évidemment chaque parti possède son histoire unique, ses spécificités structurelles et ses dynamiques particulières, mais on peut néanmoins observer dans l'histoire des partis sociaux démocrates occidentaux, ainsi que dans l'évolution de nombreux partis qui se sont positionnés à gauche de ces derniers, certaines tendances à l'œuvre – institutionnalisation, bureaucratisation, professionnalisation, concentration du pouvoir, la primauté du groupe parlementaire sur le parti – qui, ensemble, aboutissent à un rétrécissement de la démocratie et à une propension à sacrifier les principes pour des gains électoral, ce qui a l'effet, au fil du temps, à ramener leur vision politique vers le centre.
Les chercheurs proposent quelques raisons principales pour cette dernière tendance. Le politologue Matthew Polacko en fait le résumé : on veut promouvoir une image de gestionnaire solide de l'économie afin d'augmenter les chances d'accéder au pouvoir ou d'être plus acceptables en tant que partenaires de coalition ; on cherche à mobiliser de nouveaux électorats dans le but de devenir des partis « fourre-tout » qui compenseraient le déclin des bases traditionnelles des partis de gauche. Mais cette stratégie n'a finalement pas bien servi les intérêts des partis sociaux démocrates qui sont en déclin un peu partout depuis plus de deux décennies.
On voit que parmi les partis politiques de la nouvelle gauche du début du 21e siècle, il y en a plusieurs qui ont fini par suivre le même chemin, c'est-à-dire s'éloigner de leurs aspirations radicales et anticapitalistes en se rendant plus respectable et acceptable à la classe politique dominante.
Dans un article de 2022 portant sur le déclin de la gauche pour la revue Frontiers in Political Science, un universitaire belge a tenté de comprendre les menaces auxquelles font face les petits partis politiques de gauche, autrement dit ceux qui ne sont pas des partis de masse. Il souligne que ces partis risquent constamment de perdre leurs bases d'appui, particulièrement lorsque les partis plus conventionnels s'approprient leurs positions. Selon ce politologue, cependant, les menaces les plus importantes résident dans la tendance de ces partis à modérer leurs positions et à remplacer leurs objectifs à long-terme visant des changements sociaux fondamentaux par des objectifs de performance électorale, tels que la maximisation de leur part des votes ou la poursuite des ambitions politiques personnelles.
En quelque part, ce sont les mêmes menaces qui pèsent sur notre parti. Québec solidaire semble se trouver à un croisé des chemins et il reste à voir quelle voie nous allons suivre. Est-ce que le virage pragmatique annoncé par Gabriel Nadeau-Dubois sera mis au rebut avec son départ ? Que nous annonce le nouveau « Manifeste pour un Québec solidaire de ses travailleuses et travailleurs » ? Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de revitaliser le « parti de la rue » qui devait toujours sous-tendre le « parti des urnes » ? Quels sont les débats à faire dans nos rangs ? Est-ce que les structures et procédures actuelles du parti sont assez souples et démocratiques pour permettre et encourager ces débats de fond ? Dans un contexte politique de la montée de la droite et de l'extrême droite, quel rôle peut et doit jouer Québec solidaire comme unique parti progressiste au Québec ?
Si l'on s'entend que la crise de QS provient en partie de ces tendances vers la bureaucratisation et l'érosion de la démocratie interne qui planent sur toutes les formations de gauche dont la raison d'être étaient bien de contribuer à l'avènement d'un monde radicalement meilleur, le défi est de s'efforcer à contrer ses tendances et à réancrer le parti dans les mouvements populaires pour la justice sociale et une planète vivable.
Comme l'affirme Mario Candeias, économiste associé à la fondation allemande Rosa Luxemburg, la force d'un parti de gauche radical dépend fondamentalement du lien organique aux mouvements populaires actifs. Sans cela, prévient-il, un parti de gauche va s'isoler et se perdre dans les machinations de la politique parlementaire, privé du pouvoir transformateur des mouvements comme son épine dorsale mobile et de l'espace vital pour l'imagination.
Avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais conclure sur une note optimiste en soulignant une belle victoire de la gauche qui devrait nous inspirer dans nos efforts pour construire l'avenir de notre parti. Il s'agit du retour dernièrement de Die Linke, le Parti de gauche en Allemagne. Une longue période de luttes internes avait laissé cette formation avec peu d'espoir d'atteindre le 5 % du vote nécessaire pour siéger au Bundestag. Mais avec une stratégie axée sur des questions économiques, comme les loyers, qui touchent la vie quotidienne de la population et en refusant de se plier aux sentiments et aux discours anti-migrant adopté par tous les autres partis, ils ont eu un succès relatif inattendu de 8,8 % du vote et 64 des 630 sièges. Et ils ont fait campagne munis d'un slogan original qui fait penser : « Tout le monde veut gouverner. Nous voulons le changement. »
Intervention de Dalie Giroux
Comment on sort de l'imaginaire du parasitisme ?
Merci pour l'invitation, d'abord. Contente d'être avec vous, contente d'être là, de vous entendre, surtout.
Je dirais d'abord : moi, je ne suis pas active dans les instances de Québec solidaire. Donc je fais peut-être un petit pas de côté par rapport à une conversation qui est bien ancrée sur les chemins pour organiser la gauche au Québec, au sein de Québec solidaire.
Je ne ferai pas de commentaires ni sur les enjeux de réalisme électoral ni du point de vue des médias sociaux. Je comprends les impératifs de la politique institutionnelle, mais ce n'est pas toujours raccordable avec une pensée politique intègre ou cohérente.
Je vais donc présenter deux lignes de réflexion, autour de la question qui est posée aujourd'hui. Ce sont des questions, pas des réponses. Mais je pense que se poser les bonnes questions, c'est crucial. Si on n'a pas les bonnes questions, on ne peut pas prendre les bonnes directions.
Alors, deux enjeux que je veux mettre sur la table pour la discussion. Le premier porte sur la question de l'imaginaire. Le deuxième concerne ce que pourrait être la critique d'un capitalisme qui se présente comme porteur d'avenir.
Donc, d'abord, l'imaginaire politique dans lequel nous baignons. Le recentrage, l'accusation des partis de gauche qu'on connaît, qu'on a mentionnée, touche aussi à ça. Et ça s'inscrit dans un contexte, et pour moi c'est important de le nommer, ce contexte, parce que c'est ce contre quoi il faut s'organiser.
Appelons ça populisme de droite, si on veut. Il y a une espèce de consensus autour de ce populisme de droite. On l'a vu, je trouve, au Québec depuis trois-quatre ans, se former ce consensus-là, autour de la CAQ et du Parti québécois. Moi, j'inscris le virage pragmatique de Québec solidaire — de Gabriel — là-dedans.
Et ce populisme de droite, je trouve qu'on manque de précision dans la manière de le qualifier. Je voudrais simplement faire référence ici à un ouvrage récent de Michel Feher, Producteurs et parasites, L'imaginaire si désirable du Rassemblement national, où il réfléchit à ce qui s'est passé en France, comment le Rassemblement national est devenu un parti d'adhésion, en particulier pour les classes populaires.
Je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, et qui, pour moi, parle beaucoup à la situation actuelle de Québec solidaire.
Qu'est-ce que c'est que cet imaginaire politique-là, du "producteur et parasites" ? C'est un imaginaire qui s'organise autour de ce que Feher appelle le productionnisme. C'est une réflexion sur la production — sur le travail, sur l'économie — mais pas au sens des rapports de production qu'on critique, qu'on remet en question. Plutôt, on place au centre de la réflexion une figure : le "bon producteur", le "bon travailleur", les "bonnes jobs payantes", les "bons citoyens", les "familles ordinaires", les "gens qui contribuent à la nation".
Et on oppose à ce personnage central une figure-miroir : le parasite. Celui ou celle qui menace ce bon producteur.
C'est un imaginaire politique populaire très fort. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je viens d'une famille vaguement social-démocrate, et c'était déjà très présent.
Dans la droite classique, le parasite, c'était "ceux d'en bas" : les paresseux, les dépendants, les immigrants. Toute une série de figures politiques du parasitisme.
Du côté de la gauche, le parasite, lui, était "en haut" : le spéculateur, le banquier, le bourgeois, le propriétaire des moyens de production.
Ce qui se passe en ce moment — et c'est la thèse de Michel Feher —, c'est que la droite publique a trouvé un moyen de capitaliser des deux côtés. Elle arrive à créer une relation producteur-parasite où il y a des parasites en bas et des parasites en haut : les immigrés, les assistés sociaux… mais aussi "l'État profond", les mondialistes, etc. Toute une rhétorique conspirationniste qu'on connaît bien.
Et on ne peut pas faire comme si on était à l'abri de cette culture politique-là. Cette formule du populisme de droite structure le psychique collectif. Et, dit Michel Feher, la gauche est coincée dans cette formule-là. Elle ne peut pas l'assumer, mais elle n'arrive pas non plus à la remettre en question.
On le voit actuellement, par exemple, dans la difficulté du comité des droits, dans l'affaire avec Guillaume Cliche-Rivard. On est prêt à sacrifier des enjeux fondamentaux pour préserver une image acceptable du bon producteur.
Ce productionnisme, en plus, s'adresse avant tout aux "jobs des messieurs". Les bonnes jobs payantes, en région : les jobs d'hommes, pas les jobs du care. Et on voit Québec solidaire se coller à ça. Le bon producteur, le bon citoyen.
Didier Eribon disait que ce parasitisme était déjà présent dans les classes populaires communistes. Il essaie de comprendre comment les communistes ont pu se déplacer vers le Rassemblement national, en France, dans les années 1980. C'est qu'il y a un continuum de l'imaginaire. On fonctionne là-dedans.
Alors il faut faire face à cette chose-là. Il faut se demander : comment on va se positionner dans cet imaginaire ? Comment on en sort ? Comment on produit des discours politiques qui nous permettent de poser des problèmes autrement que dans cette logique binaire ? Et c'est très difficile. Parce que l'imaginaire, c'est quelque chose de partagé, de structurant.
Je vois deux choses : d'un côté, le consensus médiatique — que j'ai analysé dans un article récemment — qui entérine le virage pragmatique de Québec solidaire. Mon analyse, c'est que ce virage, c'est une capitulation devant ce consensus. Et on l'a vu dans la réception médiatique : tout le monde a applaudi Gabriel Nadeau-Dubois. Les médias ont salué sa "maturité". On a dit : voilà, enfin, QS devient raisonnable, on enlève tout ce qui ressemble à du socialisme. Donc on met de côté les discussions sur la socialisation des ressources, des forêts, de l'agriculture. Et on propose quoi ? Une voie centrée sur les travailleurs, sans préciser lesquels.
C'est très problématique. Parce que QS reste, dans la province, la seule offre politique où il y avait encore un programme socialiste. Et si on enterre ça, alors il n'y a plus de gauche institutionnelle au Québec. Et si on veut exercer le pouvoir, mais qu'on ne peut plus critiquer le capitalisme… qu'est-ce qu'on fait ? Tant qu'on va rester dans l'imaginaire du parasite, on ne pourra pas porter une radicalité politique.
Alors je repose la question : Comment on reconstruit une culture politique ? Comment on donne un cadre à la défense des droits dans un grand contexte ?
Parce que ce que fait le populisme de droite, c'est de fabriquer de fausses guerres de classes : cols bleus contre cols blancs, régions contre villes, gens "ordinaires" contre gens "différents", "fantastiques", "woke", etc. Et là-dedans, on piège les travailleurs. Ce n'est pas nouveau. On l'a vu dans d'autres époques, d'autres contextes. Et les médias jouent un rôle énorme dans cette fabrication.
Et donc, il faut militer pour redéfinir la liberté, la démocratie. Parce que la liberté, aujourd'hui, elle est à droite. C'est la liberté du "choix", la liberté de consommer, la liberté à travers la marchandise. Alors qu'est-ce qu'une liberté réelle ? Une liberté qui ne passe pas par la marchandise ? C'est une question centrale.
Deuxième enjeu : l'absence d'une critique assumée du capitalisme. Ça fait très mal. Ce qu'on voit, c'est une gauche de la dépense, une gauche qui défend des programmes sociaux — mais dans un cadre provincial, où on n'a pas les leviers sur les ressources naturelles. On se retrouve donc avec une gauche très faible, qui passe par la taxation, la réglementation… mais ce n'est pas une gauche de rupture.
Et on dirait qu'on a abandonné l'économie politique. On n'a pas de critique des grands accumulateurs de capital, de leur rapport avec l'intelligence artificielle, avec la transition énergétique, avec les transformations industrielles.
Toute la place est laissée à la droite. La littérature économique au Québec est à droite. C'est effarant. Et ça permet aux journalistes de dire n'importe quoi, d'acclamer n'importe quoi. Et Gabriel Nadeau-Dubois, face à eux, a l'air de quelqu'un qui ne sait pas quoi répondre, qui a du mal à tenir une ligne.
Alors je repose la question une dernière fois : comment on sort du productionnisme ? Comment on pense la vie de tout le monde autrement qu'à travers la figure centrale du travailleur masculin en région, dans l'extraction des ressources ?
Et les femmes, dans tout ça ? Les jobs de service, les soins ? Toute cette structure-là existe, dans une économie réelle, avec des capitaux, des machines. Il faut qu'on soit capables de penser là-dedans. Je pense que les gens en région veulent être entendus. Il faut pouvoir leur parler. Mais il faut aussi pouvoir parler de l'ensemble de la société.
Alors comment on fait ? Je vous laisse là-dessus. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter. Merci.
Intervention de Roger Rashi à La Grande Transition 2025 Comment comprendre la crise que vit Québec solidaire ?
Deux remarques rapides. Québec solidaire n'est pas un parti social-démocrate classique. C'est un parti qui est le produit typique de la gauche radicale des années 2000 : les mouvements sociaux, la remise en question du néolibéralisme, une vision autre de la politique, une intégration complète d'une vision écologiste, féministe, dans son activité politique quotidienne, etc.
De plus, ce parti a connu deux phases de radicalisation. La première, selon moi, de 2008 à 2014, a essentiellement suivi la fameuse crise économique et financière de 2008, et surtout le coup de fouet qu'a été le printemps érable, la grève étudiante de 2012. Pendant cette période de six ans, on a vu une radicalisation du programme de Québec solidaire. C'est là où tout ce qui touche à la sortie du système, à l'anticapitalisme, etc., a été accepté, intégré. Par deux fois, dans des congrès, des propositions d'alliance électorale avec le Parti québécois – mises de l'avant par des figures du parti, comme Amir Khadir ou Françoise David – ont été battues à près de 70%. Donc c'est quand même une phase de radicalisation que Québec solidaire a connue de 2008 à 2014.
De 2014 à 2018, selon moi, c'était une sorte de phase d'assagissement. Québec solidaire a relativement mal performé dans l'élection de 2014 : trois députés, 6 %. Ça a comme assagi un peu ce radical-réalisme momentané. Mais 2018 : très bon résultat électoral, l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en 2017, l'arrivée de beaucoup de jeunes issus du mouvement étudiant. Et l'aile parlementaire s'est radicalisée pendant une période d'à peu près deux ans. Ce n'était pas devenu un parti populiste de gauche, mais ça avait adopté une rhétorique populiste.
En 2018, la plateforme électorale faisait une critique très forte du système néolibéral, appelait à des taxes sur les riches et les grandes corporations, et présentait aussi une vision de la transition écologique – qu'on a beaucoup critiquée à gauche du parti – mais qui était quand même une transition transformatrice de la société. Cette deuxième phase de radicalisation a duré environ deux ans de 2018 au début de 2020.
Sortie de la COVID-19 : début de la crise interne
Le grand coup, selon moi, le début de la crise actuelle de QS, arrive avec la COVID-19. Rappelez-vous : à partir de mars 2020, tout a été fermé. Et la direction du parti a pris une décision qui, pour moi, a été très coûteuse – qu'on a mal évaluée à l'époque. Ils ont complètement fermé le parti pendant six mois. Plus d'assemblées, plus de réunions locales, plus de discussions. La seule fraction du parti qui fonctionnait, c'était l'aile parlementaire. Rien d'autre pendant 6 mois.
Et à cette époque-là, pour la première fois dans l'histoire de Québec solidaire, l'aile parlementaire a adopté une politique d'union nationale où ils ont appuyé la CAQ et les premières fameuses mesures sanitaires. Il a été impossible de voir le début d'une critique de ces mesures-là entre mars 2020 et, je vous dirais, le mois de juin de cette année. Et encore, ce n'est que parce qu'une partie de la gauche du parti s'est insurgée, a organisé des rencontres, des ateliers, des discussions, a tenté de faire fonctionner, tant bien que mal, les structures du parti – ou plutôt des structures à l'extérieur, puisque tout avait été gelé – qu'il y a eu un minimum d'activités et de critiques de l'orientation du parti.
À la sortie de la COVID, quant à moi, c'est là que l'équipe autour de Gabriel Nadeau-Dubois a complètement pris le contrôle, tant de l'aile parlementaire que des structures du parti. Elle a commencé son travail d'exclusion des éléments de gauche présents dans la direction du parti.
À la sortie de la COVID, deux conseils nationaux se sont tenus : un premier en septembre 2020, puis un deuxième, si je me rappelle bien, en novembre ou décembre de la même année. Dans le premier, la critique de l'attitude du parti pendant le début de la pandémie a été faite. La direction était complètement sur la défensive, mais n'arrivait pas à répondre de façon cohérente à cette critique-là. Il a alors été décidé de lancer une campagne politique de mobilisation du parti à l'intérieur et à l'extérieur du parlement, pour remettre de l'avant les grandes revendications des mouvements sociaux.
Cette campagne n'a jamais été appliquée. Elle n'a même jamais été publicisée par les organes du parti. Silence total.
Le conseil national de décembre arrive : l'orientation de cette campagne est reconfirmée. Même résultat : zéro. Pas un mot de l'aile parlementaire, pas un mot des organes du parti. Tout est tombé entre les craques, entre les maillons du filet.
Début 2021, on a vu une autre escalade : l'exclusion du collectif décolonial et antiraciste. Oui, il y avait quelques questions, mais de là à exclure un petit groupe militant – on n'avait jamais vu ça dans Québec solidaire. Ce fut perçu comme le début d'une répression interne de la gauche du parti.
Au même moment, au sein de Québec solidaire, il y avait un mouvement très actif depuis 2019, pour la démocratisation interne. Ce mouvement regroupait des centaines de membres qui demandaient des discussions stratégiques continues sur l'évolution du parti et remettaient en question certaines prises de position de l'aile parlementaire. Notamment le fait que Québec solidaire, dès 2019, avait appuyé la fameuse loi 21. Et ils avaient battu en congrès l'aile parlementaire – l'ensemble de l'aile parlementaire. Alors que, précédemment, le parti avait déjà battu les porte-paroles sur la question de l'alliance avec le Parti québécois, cette fois-ci en 2019, l'aile parlementaire au complet a été battue sur la question de l'appui à la loi 21.
Donc, il y avait encore à ce moment-là une gauche active dans Québec solidaire, capable d'avoir un impact sur l'orientation du parti.
Après 2021, tout s'écroule. Deux choses ont été utilisées de façon incroyable par le parti. Un : Gabriel Nadeau-Dubois et son entourage avaient pris le contrôle de l'aile parlementaire. C'est à ce moment-là que le conflit avec Catherine Dorion a éclaté. On l'a su plus tard. Elle ne pouvait plus dire ce qu'elle voulait. Elle n'avait plus accès aux médias de communication du parti. Essentiellement, on lui disait : « Sois belle et tais-toi. »
Et de deux : ce qu'ils ont fait à l'intérieur, de façon très habile, c'est de changer complètement la discussion : « Oublions la loi 21, préparons les élections de 2022 ». Ces élections devaient être cruciales. On se donnait comme objectif de devenir l'opposition officielle.
Élections de 2022 : électoralisme débridé
On a vu les mêmes problèmes avec Podemos en Espagne. À un moment donné, Podemos se donne comme objectif de dépasser le Parti socialiste et de devenir la force politique principale. L'échec électoral enclenche une crise interne dont le parti ne s'est jamais vraiment remis. C'est un peu la même chose à Québec solidaire : on se donne un objectif irréaliste et on organise la campagne électorale sur cette base. Le parti devient obnubilé par un électoralisme débridé qui mène à un échec mal encaissé et de multiples crises internes suivies de la démobilisation des membres.
Je me rappelle, parce que j'étais impliqué dans la commission politique qui devait discuter et préparer la plate-forme électorale : le mot d'ordre de la direction, c'était : « La CAQ est très forte, et on va se faire écraser si on ne fait pas attention dans nos prises de position. Il faut aller chercher la majorité la plus large possible. C'est une élection historique, car on peut se faufiler devant les libéraux et les péquistes qui sont tous deux en crise et en déclin. C'est l'occasion historique de s'imposer comme opposition officielle. »
Et c'est ce mot d'ordre qui a prédominé jusqu'à l'élection.
L'élection n'a pas été mauvaise – un peu moins de 16 %, 11 ou 12 députés – mais au vu des objectifs irréalistes que le parti s'étaient donnés, ce fut un échec. Gabriel l'avait affirmé : on vise l'opposition officielle. Rappelez-vous le deuxième débat des chefs, où il a voulu se présenter comme l'interlocuteur principal de François Legault. Cela a dégénéré en un face-à-face entre Legault et lui, où Gabriel avait complètement abandonné toute tentative de mettre de l'avant un programme électoral. Il cherchait seulement à s'affirmer comme chef. Au vu de cet objectif, 2022 a été un échec.
Il y a eu quelques rumeurs comme quoi Gabriel allait démissionner, parce que, objectivement, c'était un échec personnel, politique et organisationnel.
Le congrès ou le conseil national pour faire le bilan de cette élection a été retardé. D'habitude, ça se fait dans les deux mois suivant l'élection – ici, ça a été repoussé à janvier. L'objectif : ramener Gabriel et établir un discours justificatif. Mais ce discours a surtout consisté à dire : « Parlons encore moins de transition, d'écologie, de sortie de l'auto, etc., parce qu'on veut gagner dans les régions. »
Les crises s'enchainent
Et c'est là que les crises se sont enchaînées : la sortie de Catherine Dorion, avec son livre publié en novembre 2023 qui dénonce ce que Gabriel lui a fait subir alors qu'elle était dans l'aile parlementaire. Puis, moins que six mois plus tard, la démission fracassante d'Émilise Lessard-Therrien, qui reprend exactement les mêmes motifs que Catherine. On l'a empêchée de parler, d'agir réellement comme co-porte-parole. Tout était verrouillé par le chef parlementaire et co-porte-parole masculin : Gabriel et son entourage. Émilise ne pouvait que suivre la parade et se taire.
Gabriel entame alors un petit début d'autocritique, puis change rapidement de sujet : il parle de faire de Québec solidaire un « parti de gouvernement », en lançant le débat sur le « pragmatisme politique » qui devait prédominer, selon lui, dans le parti.
La crise la plus grave, quant à moi, c'est celle qui éclate autour d'Haroun Bouazzi en novembre 2024. On l'a vu partout ailleurs : en Espagne avec Iglesia, en France avec Mélenchon, au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, ou aux États-Unis avec Bernie Sanders. Les leaders de la gauche sont attaqués en continu dans les médias. Et ici, pour tenter d'éviter l'attaque médiatique, l'ensemble de l'aile parlementaire condamne Haroun pour avoir osé dire que le racisme systémique est aussi présent à l'Assemblée nationale du Québec !
Au congrès du parti de novembre, je vous jure, l'aile parlementaire était prête à l'expulser. La seule chose qui l'a empêché, c'est l'organisation d'une riposte interne : 20 associations et structures de Québec solidaire se sont publiquement opposées à l'attitude de la direction. Cette lettre a été « coulée » aux médias pendant le congrès. La direction a reculé, mais Haroun a dû faire une autocritique.
Et dans la semaine suivante, à l'Assemblée nationale, aucun membre de l'aile parlementaire ne s'est levé pour le défendre. Deux de nos député-e-s se sont même levés pour applaudir les attaques du PLQ contre leur collègue !
À partir de là, les choses se sont accélérées. On a perdu énormément de membres. Les structures internes sont devenues fantomatiques.
Je termine. Les campagnes financières vont très mal. Le parti est à 50 000 à 70 000 dollars en dessous de ses objectifs. Il y a énormément de difficultés à faire fonctionner les comités de coordination locaux. Là où, en 2019, dans Laurier-Dorion par exemple, une assemblée publique pouvait rassembler 150 personnes, aujourd'hui, ils ne peuvent pas en réunir une dizaine
C'est pareil dans de multiples associations à travers l'organisation.
Je vais m'arrêter là. D'autres, notamment André Frappier vont parler après moi des remèdes à cette crise. Car depuis six mois, la gauche s'est réorganisée dans Québec solidaire. Elle a recommencé à batailler, tant sur la place publique que dans les structures internes – entre autres, ce que nous faisons ici aujourd'hui.
Mais je vous laisse sur cette idée : c'est une crise sérieuse. C'est une crise existentielle. Je ne vous dis pas que le parti va nécessairement tomber, mais c'est extrêmement sérieux. C'est la période la plus noire que j'ai connue depuis les débuts de Québec solidaire.
Mais il y a des gens, des militantes et des militants qui travaillent très sérieusement à changer l'orientation de Québec solidaire. Et nous parlerons des perspectives futures un peu plus tard.
Merci.
Intervention d'André Frappier Perspectives ; débattons, battons-nous ensemble
Alors, je vais vous avouer que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Mais je pense que c'est la même chose pour mes camarades aussi, parce qu'on est, pour la plupart, membres fondateurs de Québec solidaire. Et j'ai été dans la direction de Québec solidaire pendant des années. Ce sont mes camarades. J'ai travaillé avec plusieurs personnes, j'ai participé avec vous, avec beaucoup de gens, à construire ce parti-là. C'est mon parti. Et je suis absolument halluciné, fâché, de voir ce qu'ils en ont fait aujourd'hui.
Mais je ne veux pas lâcher prise. Je pense qu'il faut se battre tant qu'on est capable, jusqu'à une certaine limite, mais c'est un combat qu'il faut mener. La tâche est quand même immense en ce moment.
J'adhère à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On a parlé tout à l'heure du manifeste, et je vais en parler un peu. Parce que c'est quand même hallucinant, pour un parti politique de gauche, de lancer un débat avec un manifeste qui ne parle pas d'environnement, qui ne parle pas de la lutte des femmes, qui ne parle pas de la conjoncture politique actuelle — alors qu'on a des fascistes au sud de notre frontière, un peu partout dans le monde. Un manifeste qui ne traite pas un seul mot de ces questions-là, mais qui nous dit : « Oui, on va faire le point pour avoir de meilleurs logements. » On va proposer un débat complètement en dehors du champ politique qu'on vit présentement, et du danger qui est à nos portes.
Je pense que c'est à ça qu'il faut s'adresser maintenant, il faut resituer la situation politique dans son contexte. Un véritable débat politique doit commencer par indiquer qu'on a maintenant une extrême droite fasciste à nos frontières, au sud, qui a un impact immense sur la situation politique au Canada. Déjà, des budgets s'en vont dans l'armement. On sait que ça va aller dans tous ces secteurs-là, et qu'on aura de moins en moins d'argent pour les services publics, pour les écoles. Et ça a un effet direct chez nous. C'est ça qu'il faut regarder comment on peut contrer cette situation. Et on ne pourra pas la contrer si on ne fait pas de conscientisation politique, et si on ne fait pas de débat politique. C'est là que ça se joue.
Avant de parler des perspectives, je veux revenir sur quelques moments forts qui, selon moi, ont marqué Québec solidaire et nous ont amenés jusqu'ici.
Il y a eu deux moments importants où la direction — Gabriel, mais pas seulement lui, parce qu'il ne faut pas le fétichiser. Il est entré à QS pour raffermir un courant qui existait déjà. Il ne l'a pas inventé, il l'a renforcé, il l'a structuré, avec d'autres.
Les deux moments, ce sont : d'abord le débat qu'on a eu en 2017 sur les alliances avec le Parti québécois. C'était une tension qu'on avait depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à résoudre. On a décidé de le faire de manière publique, dans un débat qui a duré presque un an. Et c'est comme ça qu'il faut faire des débats profonds, pas en trois semaines comme on le fait aujourd'hui dans nos structures. Un an de débat ! On a fait le tour des régions.
Moi, j'étais le représentant de la direction opposé aux alliances, et Andres Fontecilla défendait l'autre position. Et j'ai beaucoup de respect pour lui, il a participé politiquement au débat avec rigueur.
On a tenu des débats à Québec, à Montréal, dans des assemblées de cuisine… Un an de débat, et au final, lors du congrès, la gauche a gagné à plus de 70 % contre les alliances. Deux ans plus tard, en 2019, même chose avec le débat sur la laïcité. Encore une fois, la position des directions a été battue avec le même pourcentage.
Quelle conclusion en ont-ils tirée ? Que quand on fait des débats démocratiques, c'est la gauche qui gagne. Et c'est là que les choses ont commencé à se refermer.
Je voudrais illustrer ça avec quelque chose que j'ai gardé dans mes archives — parce que c'est aussi mon passe-temps de conserver les archives. En 2006 210, on faisait des cahiers de propositions avec un échéancier qui durait six mois. J'ai ici la preuve. On lançait un cahier en février, et le congrès avait lieu en novembre. Cela permettait de faire des assemblées citoyennes, des rencontres publiques. On avait un cahier de proposition qu'on appelait "Bâtir ensemble Québec" et on faisait des réunions publiques pour discuter, et cela permettait de recruter, de faire des débats avec des gens en dehors de notre cercle de membres militants.
Mais ça, il faut prendre le temps de le faire.
Un parti de gauche, s'il veut avoir un impact dans la société, il l faut aller à la population, travailler avec elle. À l'époque, on prenait six mois entre la sortie des propositions et le congrès, pour faire ce travail de fond. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Et pourtant, les enjeux sont encore plus complexes : racisme systémique, crise écologique, montée de l'extrême droite…
J'en ai parlé récemment : on a une côte à monter. Pour les gens politisés, pour les personnes racisées, c'est sûr qu'ils sont avec nous. Mais pour les autres ? Ceux qui ont entendu les discours de la CAQ, du PQ, et qui n'ont vu personne se lever pour soutenir Haroun Bouazzi ? Je ne suis pas sûr qu'ils vont voter pour nous aux prochaines élections. Il y a un gros travail de politisation à faire, et ce n'est pas le parti qui va le faire dans son état actuel.
Sur les perspectives maintenant.
Il y a des choses positives. Par exemple, la solidarité internationale, qui a été abandonnée depuis des années. Grâce à nos efforts, une résolution a été adoptée pour créer un poste responsable de la solidarité internationale, presque à l'unanimité. C'est un début, mais il faut aller plus loin.
On avait des liens avec la DSA aux États-Unis, on était allés à leur congrès, ils étaient venus au nôtre. Même chose avec Die Linke en Allemagne, la CUP en Catalogne… Tout ça s'est perdu. Et ces liens ne se construisent pas avec un coup de téléphone. Il faut échanger, bâtir ensemble.
Autre enjeu majeur : la montée du fascisme au sud. Si on veut parler de changement social au Québec, il faut comprendre que ça implique aussi un changement dans tout le Canada. On ne peut pas faire ça tout seuls. Il faut des liens avec la gauche du Reste-du-Canada, avec les nations autochtones qui n'ont pas la même vision du territoire que nous. Il faut composer, bâtir ensemble.
Et ça veut dire contrer le néolibéralisme canadien, qui va s'accentuer dans les prochaines années avec la course aux armements. On ne pourra pas le faire seuls.
Et enfin, il y a les enjeux centraux : immigration, racisme systémique. On ne réussira pas à bâtir une société égalitaire si on ne s'adresse pas à ça, la terre appartient à tout le monde, nous sommes toutes et tous égaux, que l'on soit au Québec ou ailleurs. C'est un discours qu'on n'entend pas assez. Même à QS, on n'est pas forts pour contrer les discours de la droite sur l'immigration. C'est notre rôle. Et on ne le joue pas. C'est ça, le défi.
La reconstruction de la gauche passe par là. Mais les conditions sont difficiles. Par exemple, pour le prochain conseil national, on a trois semaines pour recevoir les documents, les étudier, préparer une assemblée, convoquer 10 jours à l'avance, proposer des choses, envoyer des amendements. On n'a pas le temps de faire de vrais débats.
Il y a un déficit démocratique.
Et les changements apportés aux statuts rendent les choses pires. Par exemple, la course au porte-parolat : maintenant, ce sont des élections générales par voie électronique. Imaginons que Gabriel Nadeau-Dubois se présente contre quelqu'un d'inconnu. Les gens votent par courriel, de chez eux. Pour qui vont-ils voter ? Ce n'est pas pour rien que les syndicats et la majorité des organismes font leurs élections en congrès. Parce que les membres entendent les débats, rencontrent les gens. Là, on coupe ça. On virtualise. Et on coupe le lien humain.
Je conclus.
Je pense qu'il faut une personne extra-parlementaire au poste de porte-parole. Il y a une personne qui s'est annoncée. Il y en aura une autre bientôt. Je veux vous dire aussi qu'on constate une certaine démobilisation de nos membres, on leur lance l'appel : ne partez pas. Un regroupement s'est formé : le "Parti de la rue", auquel j'appartiens, créé au dernier congrès, pour dire : « Si QS devient le parti des urnes, nous, on va faire le parti de la rue. »
Ce regroupement n'est pas un organe de QS, c'est une manière de dire : venez, débattons, battons-nous ensemble mais ne partez pas il faut continuer à lutter. Et on tirera les conclusions plus tard, ce n'est pas le moment de décrocher. C'est le temps de se battre. La rue est à nous.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vers un Moyen-Orient plus juste et plus inclusif grâce aux femmes ?

KURDISTAN – Les 15 et 16 mai 2025, la ville kurde de Souleimaniye accueillait le premier Congrès de la Coalition des femmes NADA permettant le partage les expériences féminines pour une lutte commune et de solutions régionales.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/07/vers-un-moyen-orient-plus-juste-et-plus-inclusif-grace-aux-femmes/?jetpack_skip_subscription_popup
Environ 200 femmes de 19 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, ont participé au premier congrès de la Coalition régionale des femmes démocratiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (en kurde : Kongreya Koordînasyona Jinên Herêmî ya Demokratîk a Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîkayê, NADA).
Les initiatives féminines au Moyen-Orient et en Afrique du Nord peuvent-elles apporter un changement réel et durable à la situation des femmes ? Ce défi préoccupe l'Alliance Nada car il reflète le combat décisif mené par les femmes de la région contre une histoire de marginalisation, sous le poids d'une réalité politique et sécuritaire turbulente.
Dans la ville de Souleimaniye, témoin de transformations majeures et centre dynamique de culture et de résistance civile, l'Alliance Nada s'est réunie pour sa première conférence, réunissant des voix de femmes de 19 pays. Ni festive ni traditionnelle, cette rencontre a plutôt été un espace de redéfinition des priorités et de définition de nouvelles frontières pour l'action féministe, transcendant les slogans et s'attaquant directement au cœur des dilemmes : guerres, violences systématiques, déplacements, marginalisation et domination masculine sous toutes ses formes.
Il est remarquable que les participantes n'aient pas apporté de griefs ; elles ont plutôt apporté des projets, des propositions et des idées concrètes. Les discussions, ancrées dans des situations concrètes, laissaient peu de place à la théorie et reposaient sur un principe simple mais essentiel : la dignité ne s'acquiert pas, mais se gagne par l'organisation, l'action et la solidarité féministes.
Au cours de sessions intensives, la conférence s'est transformée en un laboratoire d'idées, où les femmes ont discuté des moyens de surmonter la fragmentation, de nouer des alliances transfrontalières et de construire des réseaux de soutien fondés sur l'expérience plutôt que sur la théorie. Le concept de « révolution féministe » n'a pas été présenté comme un slogan radical, mais plutôt comme une transformation profonde visant la structure sociale et politique qui relègue les femmes à des rôles secondaires dans la prise de décision.
Ce qui distingue cette rencontre des autres, c'est l'audace de son approche et la clarté avec laquelle elle définit les outils de confrontation. Les ateliers n'étaient pas de simples ornements organisationnels, mais plutôt des plateformes de formation, de déconstruction et d'analyse. Ils abordaient les questions de violence sexuelle, d'autonomisation économique, de présence politique et de lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Chaque discussion était accompagnée d'expériences, de chiffres et de récits réels, utilisés non pas pour susciter la pitié, mais pour mobiliser.
À un moment charnière, les participantes ont annoncé la création de la « Confédération mondiale des femmes démocratiques », entité fédératrice qui fédère les énergies des femmes et leur offre un cadre commun de travail et d'influence. Cette initiative n'est pas une nouvelle structure bureaucratique, mais un cadre militant issu d'une longue accumulation et de diverses expériences féministes, visant à protéger les femmes et à élargir leur espace public.
Ce qui est ressorti de Souleimaniyeh n'est pas une simple déclaration finale. C'est l'affirmation d'une nouvelle conscience collective et la décision claire que le temps de l'attente de justice est révolu. Les femmes du Moyen-Orient ne sont plus sur la défensive ; elles sont au cœur de la bataille pour l'avenir. Du ventre de la douleur naissent des visions, et du chaos de la réalité naît la volonté. D'une ville qui a résisté aux vents, une feuille de route pour un Moyen-Orient plus juste et plus inclusif est née. (Par Huthami Mahjoob pour ANHA)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Obsession : Élections !Comment l’électoralisme affaiblit nos démocraties d’Alexandre Duval

Un essai captivant sur l'électoralisme et la perte de confiance envers les institutions politiques.
L'essai Obsession : élections pose un diagnostic lucide sur les façons dont l'électoralisme mine les fondements de nos démocraties, à l'heure où le niveau cynisme de la population n'a jamais été aussi inquiétant. L'auteur aborde son profond malaise face à cette manière de faire la politique, qui enferme toujours un peu plus les élus dans une logique de gains électoraux – parfois malgré eux – au détriment des débats de fond. Il plaide de manière convaincante que la dynamique actuelle constitue une menace qu'il est grand temps de prendre au sérieux. Sa réflexion est documentée et s'inspire de nombreuses années d'observation en tant que journaliste, dont deux comme correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale.
Alliant anecdotes personnelles, analyse critique et données de recherche, son travail pose un regard sans complaisance sur la situation. Il réussit à entrelacer ses expériences de journaliste et des événements ayant été au cœur de l'actualité québécoise, canadienne et internationale. Il nous permet de revisiter des enjeux im
portants en y découvrant les nombreuses ramifications de l'électoralisme et ses conséquences.
Date de parution : 8 avril 2025
Éditions : Somme toute

Santé menstruelle : un tabou qui freine l’avenir des filles

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/01/sante-menstruelle-un-tabou-qui-freine-lavenir-des-filles/?jetpack_skip_subscription_popup
Des millions de filles et de femmes dans le monde vivent leurs règles dans la précarité, le silence ou l'humiliation. Parce que les menstruations restent taboues, elles entraînent de fortes inégalités sociales et de genre et génèrent des risques pour la santé. Pour le Planning familial et Plan international, « faire du droit à la santé menstruelle une réalité pour tous·tes, c'est faire un pas décisif vers l'égalité. Il est temps de le franchir. »
Des millions de filles et de femmes dans le monde vivent leurs règles dans la précarité, le silence ou l'humiliation. Parce que les menstruations restent taboues, elles entraînent de fortes inégalités sociales et de genre et génèrent des risques pour la santé. À l'occasion de la Journée mondiale consacrée à la santé menstruelle, Plan International France et le Planning familial rappellent que la santé menstruelle est un droit fondamental qu'il faut respecter, partout dans le monde.
En 2025, avoir ses règles reste un facteur d'exclusion pour des millions de filles dans le monde. En France, environ 4 millions de femmes menstruées vivent dans la précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les ressources financières pour s'acheter des protections périodiques. Parmi elles, 1,7 millions sont des mères célibataires ou des étudiantes.
En France, plus d'un tiers des adolescent·es ressentent un sentiment de honte du simple fait d'avoir leurs règles, selon un sondage Opinion Way de 2022 commandé par Plan International France. 35% avouent qu'elles ou une de leurs proches ont déjà subi des moqueries et des humiliations en milieu scolaire. Une fille sur deux a déjà raté l'école pendant ses règles. Ces données montrent à quel point les tabous entourant les règles restent vivaces.
Un enjeu mondial de dignité, de santé et d'éducation
Dans le monde, au moins 500 millions de filles et de femmes n'ont pas accès à des protections périodiques en quantité suffisante. Des millions de filles manquent l'école chaque mois, faute d'infrastructures adaptées ou simplement d'un endroit sécurisé pour pouvoir se changer.
D'après l'Unicef, en 2022, 15% des filles au Burkina Faso, 20% en Côte d'Ivoire et 23% au Nigeria ont été contraintes de manquer l'école tout au long de l'année en raison de leurs règles.
Au Népal, la pratique traditionnelle du chhaupadi contraint les femmes à vivre isolées dans des huttes pendant toute la durée de leurs règles.
En situation de crise – conflits, catastrophes climatiques -, l'accès à la santé menstruelle est encore plus restreint.
Ce manque entraîne des conséquences directes sur la santé des femmes, comme des infections, des douleurs chroniques, un mal-être psychologique. La désinformation liée aux règles, les mythes, les préjugés sexistes empêchent les jeunes de comprendre leur propre corps, de poser des questions et prendre de soin de leur santé.
Un droit humain trop ignoré
La santé menstruelle ne peut plus être un sujet oublié ou relégué au second plan, surtout au moment où les droits sexuels et reproductifs sont remis en cause. Elle est une composante essentielle de la santé sexuelle et reproductive. Elle doit être pensée comme un droit humain à part entière, condition de la dignité, de l'autonomie et de la pleine participation des filles et des femmes à la société.
Accéder à une information fiable, des protections, à de l'eau, disposer d'un lieu sûr, comprendre son cycle, tout cela fait partie du droit fondamental à la santé. Et pourtant, ce droit reste trop souvent ignoré, nié.
Un levier en faveur de l'égalité de genre
Une personne qui peut gérer ses règles dans de bonnes conditions a plus de chances de poursuivre sa scolarité. Une personne qui vit ses règles sans honte ni obstacle peut participer pleinement à la vie sociale, économique et citoyenne.
À l'inverse, tant que les règles seront entourées de silence et de stigmatisation, elles resteront un facteur d'exclusion. C'est un enjeu d'égalité de genre et de justice sociale.
Nous agissons pour faire de la santé menstruelle un droit effectif
Au Planning familial comme à Plan International France, nous agissons pour faire du droit à la santé menstruelle une réalité. Chacun·e à notre échelle, nous distribuons des protections périodiques, sensibilisons les jeunes à la question des règles, aux préjugés qui les entourent. Nous luttons contre les mythes et la désinformation.
Mais ces actions doivent s'inscrire dans une dynamique plus large. Nous appelons les pouvoirs publics à garantir à chaque jeune un accès à une éducation complète à la sexualité, qui doit mieux inclure la question des règles. Il faut également assurer à tous·tes les adolescent·e un accès universel, continu à l'information, aux soins, aux protections, y compris en situation d'urgence. Nous exigeons également des produits menstruels sans risques pour la santé ainsi que la formation des professionnel·les de la santé ! Il est essentiel d'éviter l'errance médicale par une meilleure prise en compte de la douleur, une meilleure orientation des personnes et une sensibilisation aux diagnostics possibles.
En parler, c'est déjà agir
Chacun et chacune peut agir à son niveau. En parlant ouvertement des menstruations, en s'informant, en sensibilisant les plus jeunes. Ensemble, déconstruisons les stéréotypes, levons les tabous et exigeons des politiques publiques ambitieuses en faveur de la santé menstruelle. Faire du droit à la santé menstruelle une réalité pour tous·tes, c'est faire un pas décisif vers l'égalité. Il est temps de le franchir.
Le Planning familial et Plan International France
https://blogs.mediapart.fr/le-planning-familial-et-plan-international-france/blog/280525/sante-menstruelle-un-tabou-qui-freine-l-avenir-des-filles
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Président Trump rétablit l’interdiction d’entrée aux États-Unis aux citoyens.nes de 12 pays traités de « dévasteurs »

Nermeen Shaikh : Le Président Trump a signé un nouveau décret interdisant aux citoyens.nes de 12 pays d'entrer aux États-Unis. Il avait fait de même durant son premier mandat et avait soulevé une vague de protestations dans tous les aéroports du pays accompagnée de nombreuses poursuites judiciaires.
Democracy Now. 5 juin 2025
Traduction, Alexandra Cyr
Des pays comme l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Lybie, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la République du Congo dit Congo-Brazzaville, seront directement impactés. Ces restrictions s'appliquent aussi aux visiteurs.euses du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkmènistan et du Venezuela.
Le Président a mis cette nouvelle interdiction d'entrée sur le territoire en lien avec l'attaque par un homme d'origine égyptienne à Boulder au Colorado. Il s'est servi d'une torche enflammée et d'autres objets incendiaires pour attaquer une foule qui prenait part à une marche hommage hebdomadaire aux otages israéliens.es à Gaza. Mais l'Égypte n'a quand même pas été ajoutée à la liste des pays sous interdiction. Mercredi soir, la Maison blanche a publié une vidéo où le Président Trump parlait de cette interdiction.
Président D. Trump : Très simplement, nous ne pouvons accepter d'immigration venant de pays où nous ne pouvons compter sur un examen approfondi, sûr et fiable de ceux et celles qui veulent entrer aux États-Unis. C'est pour cela que je signe un nouveau décret introduisant des restrictions d'entrée au pays, pour des pays dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Lybie et nombre d'autres.
Amy Goodman : Pour l'examiner un peu plus, nous sommes avec Baher Azmy le directeur légal du Center for Constitutional Rights qui s'est attaqué à un décret semblable par le Président Trump lors de son premier mandat.
Soyez le bienvenu sur Democracy Now, Baher. Expliquez-nous le sens de ce que le Président a fait hier soir.
Baher Azmy : C'est très significatif en soi mais aussi parce que cela se situe dans un continuum, dans une série de démonstration jour après jour ou semaine après semaine, de nouvelles politiques migratoires qui comblent les sortes de fantasmes des évangéliques et des suprémacistes blancs à propos de notre pays. Nous avons eu, vous le savez, l'expulsion de gens vers la prison de Guantanamo ancien lieu de sécurité, puis le Centre de confinement du terrorisme, ensuite la chasse aux étudiants.es palestiniens.nes, les descentes de la police des frontières (ICE) dans les écoles et dans les prétoires et maintenant, ceci : une répétition de l'interdiction faite aux musulmans.es d'entrer sur le territoire qui va être épouvantable pour les familles originaires de ces pays qui cherchent des visas d'immigration et dans certains cas de tourisme.
Malheureusement, la Cour suprême semble ouverte à ces demandes. Presque la totalité de cette Cour semble disposée à entendre ces demandes de l'exécutif basées sur l'idée qu'il a une très grande autorité en immigration pour : « sécuriser les frontières et déterminer ce qui est nuisible aux États-Unis » en interdisant l'entrée aux gens de couleur.
N.S. : Baher, pouvez-vous nous expliquer ? Vous mentionnez qu'en 2018, la Cour suprême, a conclu de telle manière que, selon des expets.es judiciaires, cela va rendre la lutte contre ce nouveau décret plus difficile que celle contre le décret de 2017.
B.A. : Oui, malheureusement, je pense que c'est exact. On se rappellera le chaos suscité dans les aéroports par la première interdiction. Elle était très particulière, elle visait directement une majorité de pays musulmans. Tous les tribunaux de première instance ont déterminé ce qui était une évidence crue : cette mesure était discriminatoire. Elle l'était sur la base de la religion et de l'origine nationale parce qu'elle excluait les seuls.es musulmans.es donc elle violait la Constitution.
Le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, prétends que contrairement à ce qui est évident à tout être humain qui a le cœur à la bonne place, cette fois ce n'est plus le cas. Ce décret ne serait plus vraiment basé sur la race ou les croyances religieuses. Pour cela, il invoque l'arrêt de son tribunal à propos de l'Immigration and Nationality Act. qui donne une autorité amplifiée au gouvernement fédéral pour exclure les « étrangers.ères » ceux et celles qui n'ont pas la citoyenneté même lorsque cela parait basé sur la race ou la religion.
N.S. : Ce décret comporte des exemptions pour les détenteurs.trices de visas et pour les résidents.es permanents.es. Pouvez-vous, Baher nous expliquer pourquoi ? Le savez-vous ?
B.A. : Oui. C'est un tout petit peu moins illégal, un tout petit peu moins inconstitutionnel à sa face même que le premier. Il touche plus de pays qui ne sont pas musulmans en majorité. Il permet la demande de l'asile et les résidents.es permanents.es n'y sont pas hors la loi. Je pense qu'ils ont fait un effort pour qu'il soit plus conforme légalement. Probablement qu'ils ont appris de leur expérience : ils ne peuvent pas effacer le choc des valeurs et le traumatisme des parents et des familles (touchées par la mesure). Donc, ils ont travaillé à une version plus raffinée, plus acceptable à la Cour suprême.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un capitalisme en crise, prédateur et autoritaire. Entretien avec Romaric Godin

Le capitalisme est en crise profonde, avec des taux de croissance faibles (en particulier en Europe), et marqué par la remise en cause par la Chine de la domination des États-Unis. C'est le support de politiques résolument antisociales, de plus en plus autoritaires et prédatrices, un aspect particulièrement visible lors des premiers mois de la présidence Trump. Dans cet entretien publié par la revue Inprecor, le journaliste économique Romaric Godin revient sur la stagnation du capitalisme et ses effets politiques.
Tiré du site de la revue Contretemps.
Lorsque nous t'avions contacté, le point de départ de notre questionnement était la situation économique en Europe. Depuis, l'arrivée de Trump contraint à observer la situation plus globalement.
La situation européenne se comprend dans un contexte beaucoup plus global. C'est une particularité de l'époque : il y a encore des forces de dissociation assez fortes au sein du capitalisme même si on sort d'une période de mondialisation et d'interdépendance de tous les capitalismes. Il est assez difficile de comprendre de façon autonome les dynamiques dans chaque région.
Que peut-on dire sur la situation économique de l'Europe, la croissance, ou plutôt la quasi-récession qui la touche ?
Regardons les dynamiques à long terme de la croissance pour ensuite revenir sur ce qui se passe actuellement. Il y a un ralentissement de la croissance mondiale sur les cinq dernières décennies. Dans les années 1960, la croissance mondiale calculée par la Banque mondiale était de 6,2 % par an en moyenne. Aujourd'hui, elle est autour de 3 %. En un demi-siècle, la croissance mondiale a été divisée par deux, selon la Banque mondiale. Ça veut dire très concrètement que le rythme d'accumulation capitaliste a été divisé par deux. Il faut souligner cet élément peu discuté, parce qu'à gauche on se focalise souvent sur l'accroissement des richesses de la classe capitaliste, et à droite on se rassure en considérant que la croissance se poursuit.
Mais la dynamique de fond est celle d'un ralentissement de la croissance, dans les pays avancés et particulièrement en Europe occidentale. Dans cette dernière, elle se situe autour de 1 % (l'Espagne étant un cas particulier). Le rythme de la croissance a été divisé par 6, c'est un ralentissement extrêmement fort et continu : lors de la première crise des années 1970, on passe de 6 % à 3-4 %, il y a une petite réaccélération à la fin des années 90, et on descend autour de 2 % avant la crise de 2008. Depuis la crise de 2008 – avec des différences selon les pays – on est entre 0 et 1 %. En France, la dernière fois qu'on a dépassé les 2 % de croissance, c'était 2017 et c'était la seule année entre 2008 et 2024.
Il s'agit donc de niveaux de croissance historiquement faibles. 1 % de croissance pour une économie comme la France, c'est proche de la stagnation et c'est d'autant plus vrai qu'on ne voit pas de dynamique de reprise, même si on a pu y croire après la crise sanitaire. Mais dans la plupart des pays occidentaux et en Europe occidentale en particulier, le PIB réel est maintenant en dessous de la tendance d'avant la crise sanitaire et encore plus par rapport à la crise de 2008. Pour la France, on se retrouve à 14 % en dessous de la tendance d'avant 2008. Pour les pays de l'OCDE, le décalage est de 9,5 %.
C'est un tableau extrêmement important, parce que ça signifie que toutes les promesses qui reposent sur un redémarrage de la croissance, et toutes les politiques qui ont été menées pour faire redémarrer la croissance – les politiques de répression sociale et les politiques de soutien à l'activité, les subventions directes au secteur privé, les politiques monétaires – n'ont permis en réalité que de freiner la décélération, mais ne l'ont pas arrêtée.
La situation européenne est donc celle d'une croissance extrêmement faible, y compris en termes de PIB par habitant – et là c'est valable y compris pour l'Espagne, qui a actuellement une croissance de 3 %, mais une stagnation de son PIB par habitant depuis dix ans. Il n'y a pas de création intrinsèque de valeur.
Nous sommes donc dans une situation de quasi-stagnation et certains pays sont carrément en stagnation. C'est le cas de l'Allemagne – la première économie de la zone euro et la troisième économie mondiale – quasiment en stagnation depuis 2018, soit 7 ans. Son PIB réel a augmenté de 0,7 % sur cette période. C'est le fruit d'un mouvement de fond général propre au capitalisme mondial et le capitalisme européen se situe à l'avant-poste de ce ralentissement mondial.
Certaines économies s'en sortent un peu mieux parce qu'elles profitent de quelques avantages. Les technologies permettent aux États-Unis de capter un peu plus de valeur et leur puissance impérialiste leur donne accès à des marchés. La Chine utilise la puissance de son État pour investir sur des technologies nouvelles et des infrastructures, et le coût du travail y est encore très faible. Certains pays, comme l'Indonésie, combinent un faible coût du travail et la présence de matières premières. Il y a donc encore des zones en croissance, mais cette croissance est souvent insuffisante pour les pays en question, et d'autres zones en pâtissent : c'est comme si le gâteau ne grossissait plus suffisamment vite… cela conduit à des problèmes dans la répartition des parts.
On se retrouve dans cette situation de quasi-stagnation, avec des perspectives de croissance quasi inexistantes. Quels seraient les moteurs aujourd'hui de la croissance européenne et française ? En France, l'impact de l'industrie, contrairement à ce que raconte le gouvernement, reste extrêmement faible. C'est une niche, centrée sur quelques secteurs qui peuvent doper les chiffres comme les plomber. Il y a le transport ferroviaire – quelques TGV sont vendus mais le secteur devient extrêmement concurrentiel, avec la présence de la Chine, de l'Espagne et de l'Italie – ou la construction de paquebots, mais c'est très limité, la moindre livraison produit une embellie conjoncturelle qui donne la possibilité au gouvernement de prétendre que sa politique fonctionne. Dans l'aéronautique, il y a une vraie dynamique, mais avec les conséquences environnementales que l'on sait.
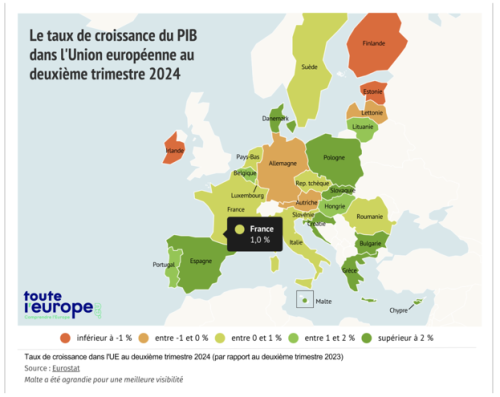
L'essentiel de l'économie française aujourd'hui, c'est 55 % de consommation et 80 % de services marchands qui dépendent la plupart du temps de la consommation des ménages. La très faible croissance est achetée par l'État via des subventions, des baisses d'impôts massives – entre 160 et 200 milliards par an – pour subventionner des embauches – donc un peu de redistribution de pouvoir d'achat – et de l'investissement qui souvent, parce qu'on est dans une économie tertiarisée, ne débouche pas sur des gains de productivité. C'est le point essentiel, qui est général au capitalisme contemporain mais très problématique pour l'Europe : ce ralentissement de la croissance a comme sous-jacent le ralentissement de la productivité.
Il y a deux façons de faire de la plus-value : la plus-value relative et la plus-value absolue. Si la plus-value relative est faible, c'est-à-dire si la productivité ne s'accroit pas – et en l'occurrence en France, en Allemagne, en Italie, il n'y a quasiment plus de gains de productivité –, la seule façon d'avoir, de produire de la plus-value est d'augmenter la plus-value absolue, c'est-à-dire augmenter le temps de travail, dégrader les conditions de travail, faire baisser le salaire horaire, etc. Le mantra de nos dirigeants, qui est de « travailler plus », vise ainsi à augmenter le temps de travail.
Mais même ça ne suffira pas, parce que les gains de productivité ainsi créés sont extrêmement faibles. Pour faire du profit, les solutions sont alors l'aide directe de l'État, la prédation des services publics, la prédation via des systèmes de rente (c'est ce qu'on voit par exemple avec les technologies où on vous fait payer l'utilisation de vos propres données) mais aussi tout ce qu'on appelle en anglais les utilities (les services aux collectivités, l'eau, l'électricité, l'énergie…). La rente, ce sont ces pratiques qui consistent à vendre des abonnements pour n'importe quoi. On vous fait payer pour des choses que vous ne voulez pas acheter parce qu'on essaye de contourner le recours au marché pour avoir un accès direct à l'argent. Le but est de contourner en quelque sorte le schéma de production de valeur traditionnel car il n'est plus capable de produire suffisamment de plus-value.
Ce développement du capitalisme de rente, cette prédation sur l'État dans des économies comme les économies européennes, qui dépendent beaucoup à la fois des transferts sociaux, des salaires, contribue à affaiblir la demande des ménages et à les insécuriser. Ceux-ci voient leurs dépenses contraintes augmenter, se tournent vers une épargne de précaution et réduisent leur consommation « arbitrable », ce qui a pour conséquence, en retour, de réduire encore plus la croissance, en un cercle vicieux.
Dans le même temps, les investissements sont faibles et surtout de très mauvaise qualité. Le supposé boom de l'investissement qu'on observe dans les statistiques françaises entre 2018 et 2022 concerne quasiment exclusivement des investissements de maintenance, sans effets durables. C'est un des cœurs du problème du capitalisme contemporain : la révolution technologique des années 1980 à 2000 n'a pas produit de gains de productivité. Lorsque les investissements ne produisent pas de productivité, vous vous retrouvez avec des dépenses qui ne produisent pas de valeur, vous vous êtes endetté et vous n'avez même pas les moyens de rembourser les dettes. C'est un peu la situation là dans laquelle on est maintenant, avec le développement de ce qu'on appelle les « entreprises zombies ».
Le deuxième élément très important, en particulier pour ce qui concerne l'Europe, c'est le cas de la dette, la dette publique comme la dette privée dont on vient de parler. Comme la dette privée finance des investissements non productifs au sens propre du terme – c'est-à-dire qu'ils n'améliorent pas ou pas assez les gains de productivité –, elle ne peut pas être remboursée et c'est donc la dette publique qui sert à soutenir une activité quasi factice. Cela existait depuis 2008 mais c'est devenu énorme avec la crise sanitaire : un soutien aux entreprises inconditionnel et général a été développé – un véritable soutien direct à leur taux de profit – et une partie du capital est devenue dépendante de ce soutien. Ce soutien se substitue à la production de valeur, il ne vient pas favoriser la production de valeur.
Par conséquent, il ne permet pas de nouvelles entrées fiscales. Les revenus fiscaux sont donc insuffisants pour faire face aux dépenses. C'est ainsi que la dette publique augmente et que la pression des marchés financiers se renforce sur les pays occidentaux, et singulièrement sur la France. On entre là aussi dans un cercle vicieux, avec une austérité qui freine encore la croissance.
Ce qu'on voit est un échec absolu des politiques néolibérales, de la promesse néolibérale selon laquelle en libéralisant le marché du travail on allait produire à la fois de l'emploi et de la croissance. En réalité on a produit de l'emploi mal payé, subventionné et très peu productif. Avec des emplois à faible productivité, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Et lorsque vous avez une pression sur les transferts de fonds de l'État vers le secteur privé, une pression de la conjoncture ou n'importe quelle autre pression des marchés financiers sur la dette privée ou publique, c'est l'effondrement.
Vous vous retrouvez avec des emplois qui sont précaires non seulement dans le sens où on l'entend généralement, mais plus fondamentalement parce qu'ils dépendent d'un contexte où ces emplois ont un problème d'existence propre, lié à leur manque de rentabilité. À l'inverse de la période précédente, pendant laquelle la création d'emplois industriels créait des emplois extrêmement productifs, qui démultipliaient la plus-value. Aujourd'hui la plus-value extraite sur chaque emploi est extrêmement faible, c'est pour cela que tous les emplois sont subventionnés, et c'est pour cela que ceux qui nous dirigent disent qu'il faut baisser ce qu'ils appellent les charges – les salaires socialisés, les impôts – et qu'ils exigent que l'État paie même une partie du salaire ! On a connu ça durant la crise sanitaire, où les États les payaient directement.
L'Europe est une version caricaturale de cette situation, mais c'est un problème qu'on peut retrouver aux États-Unis, au Japon – déjà avant la crise –, d'une certaine façon en Chine… C'est un élément commun au capitalisme mondial, un capitalisme de stagnation qui se met en place. Des économistes indiquent que les rythmes de croissance actuels sont supérieurs à ceux de la fin du 19e siècle. Mais depuis, l'accumulation s'est accélérée et revenir en arrière fragilise l'intégralité du système, qui est fait pour accélérer en permanence et non pour ralentir. Le rêve des économistes néo-classiques de « se poser en douceur » est impossible : dans le système capitaliste il n'y a pas d'équilibre possible, c'est un système de fuite en avant.
À la fin du 19e siècle il y avait la possibilité de la prédation coloniale, qui s'est développée à une grande vitesse, et cela n'existe plus de la même manière aujourd'hui.
Exactement. À la fin du 19e siècle, il y a eu une grande crise entre 1873 et 1896. La réponse qui a été apportée par le capitalisme d'alors a été la prédation impérialiste. Mais il y a eu, en parallèle, une vraie révolution technologique, à la fin des années 1890, le moteur à explosion et l'électrification. Cela a mis 60 à 70 ans à se développer, jusqu'au développement des marchés de masse.
Le capitalisme survit parce qu'il y a, à un moment, un coup de dynamisme donné à la productivité par un changement technique ou plusieurs qui se combinent. C'était le grand rêve des néolibéraux avec l'ordinateur et internet.
Mais là, ça ne fonctionne pas…
Si ça avait fonctionné, on aurait des gains de productivité qui seraient au moins équivalents à ceux du moment où on a eu l'électrification et le moteur à explosion. Peut-être pas les 6 ou 7 % des années 1970, mais au moins des gains de productivité de 4 ou 5 %. Actuellement, des gains de productivité existent, mais ils sont limités à l'industrie et sont plutôt faibles. Mais le problème est qu'en parallèle, ce sont les secteurs les moins productifs qui se développent le plus rapidement et, dès lors, les gains de productivité globaux sont en baisse.
De nombreuses explications sont possibles. Aaron Benanav (L'Automatisation et le futur du travail, éditions Divergences, Quimperlé 2022) estime que c'est précisément la tertiarisation qui entraîne ces baisses de gain de productivité. Jason E. Smith (Les capitalistes rêvent-ils de moutons électriques ? Éditions Grevis, Caen 2021) distingue les services productifs et les services non productifs et place cette baisse de productivité dans une logique de réduction globale du taux de profit.
Ce développement des services non productifs est une réponse directe à l'affaiblissement de la croissance globale. Quand vous avez de moins en moins de croissance, vous avez deux formes de réponse possibles : la surveillance des clients et des travailleurs d'une part, et ce qu'il appelle la sphère de la circulation (le marketing, la publicité…), d'autre part. Ce sont des services complètement non productifs qui se payent sur la productivité que vous allez dégager « grâce à eux ». Mais c'est un poids pour le capital et ils conduisent, dans les faits, à une baisse de la productivité, qui pousse à développer ces services encore davantage.
Sans entrer dans les détails et dans les débats théoriques, la question est de savoir si cette baisse est une tendance lourde et irréversible ou – je sais que vous aimez bien Mandel – si on est dans une onde longue descendante et qu'une innovation technologique (par exemple l'IA) ou un autre facteur non directement économique est susceptible de faire repartir les gains de productivité au niveau économique général.
C'est là où j'ai des doutes. Parce que même si vous remplacez des juristes d'entreprise ou des conseillers commerciaux et financiers par de l'IA, vous rompez avec une promesse du capitalisme selon laquelle les salarié·es monteraient en gamme, que l'ouvrier dont le travail est mécanisé allait entrer dans un bureau. Aujourd'hui, la seule chose que les capitalistes ont à proposer comme débouché, ce sont précisément des emplois tertiaires bas de gamme. Par ailleurs, au niveau purement économique, comme tous ces emplois ne sont pas intrinsèquement très productifs, il est peu probable qu'on gagne beaucoup en productivité. C'est un élément important parce que les libertariens, les trumpistes et ce qui reste de néolibéraux vont essayer de nous faire croire qu'il y a encore un avenir dans le capitalisme.
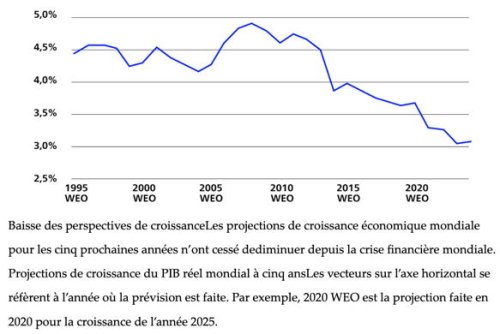
Comment analyses-tu la vague de licenciements de novembre-décembre dernier ?
C'est extrêmement simple : après le Covid, il y a eu une augmentation de l'emploi assez importante, mais sans croissance, dans le cadre d'une dégradation de la productivité. Ces emplois ne sont tenables que si, à un moment, vous avez une accélération de la croissance. Ils ont été créés grâce aux aides publiques, et la vague d'inflation qui, dans beaucoup de secteurs – notamment les secteurs de la distribution –, a permis de compenser la baisse des volumes par une augmentation des prix et donc une augmentation de leur marge.
Il y a eu donc eu une possibilité d'embaucher plus de gens que nécessaire, des salarié·es qui ne correspondaient pas du tout à la production. Certains employeurs ont dû vouloir profiter de l'aubaine des aides publiques pour améliorer l'outil au cas où il y aurait une accélération de la demande suite à la crise sanitaire. En 2021, une grande partie des gens y croyait : on avait 6 % de croissance, on s'imaginait un retour aux années folles d'il y a un siècle, Bruno Le Maire nous disait que ça allait être formidable. Il ne faut pas exclure la possibilité que les capitalistes croient dans leurs propres discours et donc qu'ils aient anticipé une croissance forte. Mais cette croissance forte n'est jamais arrivée, les aides publiques doivent être redéployées pour des raisons budgétaires, la demande est quasi atone et tous ces emplois constituent un poids sur la rentabilité.
C'était des centaines de milliers de licenciements en France…
C'est énorme mais c'est logique : cette surembauche était une anomalie. Le taux de chômage anormalement bas au regard de l'activité globale du pays s'est traduit par une baisse de la productivité du pays et cette baisse de la productivité n'est tenable que si vous avez en contrepartie dans les années qui suivent une hausse équivalente ou supérieure. Cette hausse n'arrivant pas, vous avez des licenciements et une forme de retour à la normale.
Avec une réorganisation de la main-d'œuvre au passage, parce qu'ils ont recruté des plus jeunes et là ils vont virer les vieux…
Oui, on lisse : on retire les gros salaires et on garde les plus bas. Leur obsession est la plus-value absolue. Donc il faut prendre des gens avec des salaires horaires plus faibles et avec des contrats plus précaires ou en tout cas plus souples. Quand vous embauchez aujourd'hui compte tenu des réformes du droit du travail qui ont eu lieu, c'est plus facile à gérer que des gens qui ont passé des contrats il y a 20 ans ou 30 ans.
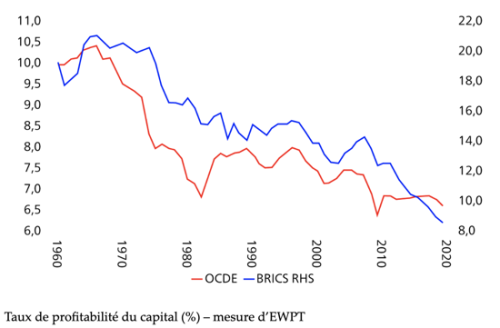
Ces suppressions d'emplois ont lieu dans l'industrie, l'automobile, le commerce…
L'industrie est la plus touchée car elle a été beaucoup aidée. Le commerce est frappé de plein fouet aussi parce que la situation est désastreuse : les ventes dans le commerce de détail ont été catastrophiques en 2022-2023 et se sont très peu améliorées en 2024, il y a eu une série de faillites et ce n'est pas fini. Dans la grande distribution, ils avaient embauché grâce à l'augmentation des prix… mais cette « inflation par les profits » a des limites et ils ont été obligés d'arrêter de jouer là-dessus, leurs profits sont donc maintenant sous pression. Et puis les entreprises ont commencé à réduire les commandes à leurs fournisseurs, donc tous les services aux entreprises vont être touchés. Les ménages frappés par le chômage, ne vont plus avoir recours à des services aux personnes – les gardes d'enfants, etc. – et cela représente beaucoup de postes d'emploi en France…
La France, l'Allemagne, l'Italie sont les trois régions les plus touchées, non ?
L'Allemagne est très touchée alors qu'elle est encore au milieu de sa crise d'origine industrielle. La structure économique de l'Allemagne est complètement différente de la structure française : l'industrie c'est encore en Allemagne 20 à 25 % du PIB, et cela représente tout un tissu économique. Une vague de licenciements a commencé, même si finalement Volkswagen n'a pas fermé d'usine. Le pays a perdu 100 000 emplois industriels en un an. En Allemagne, les gens sont extrêmement inquiets parce que le modèle du pays repose sur l'industrie très haut de gamme qui fournit à la fois beaucoup de plus-value et des salaires élevés qui arrosent ensuite tout le reste du pays, notamment les services.
Le cas de l'Allemagne est particulier parce que c'est une crise liée à la montée en gamme de l'économie chinoise. L'Allemagne a évité la crise européenne pendant très longtemps parce qu'elle fournissait à la Chine les moyens de sa croissance, notamment les machines-outils (et évidemment les voitures de luxe). Quand la Chine organise son plan de relance après la crise de 2008 pour sauver le capitalisme mondial, les commandes à l'industrie allemande repartent très vite dès la mi-2009 parce qu'ils envoient des machines-outils en Chine.
Le problème est que la Chine est en train de changer de modèle économique en montant en gamme. Elle fabrique moins cher des marchandises que l'Allemagne produisait. Leur qualité commence à se rapprocher de plus en plus de la qualité allemande et donc un marché de la production allemande est en train de disparaître. De plus, des concurrents chinois prennent des parts dans le marché mondial, par exemple dans le solaire. L'Allemagne avait une industrie florissante dans ce domaine et puis la Chine a commencé à vendre moins cher la même chose et a raflé tout le marché. Elle pratique un peu de dumping : elle surproduit, baisse les prix très fortement, et les industriels allemands ne peuvent pas suivre, puisque, à qualité égale ou légèrement inférieure, les prix chinois sont 30 % en dessous. L'Allemagne a vraiment complètement raté le train et s'est contentée d'innovations à la marge pour justifier ses prix élevés.
De plus, entre 1997 et 2013, il y a eu un dumping salarial allemand – une stagnation des salaires – qui a complètement ravagé tous leurs concurrents européens et ils se sont retrouvés face à des industriels chinois qui n'avaient que l'industrie allemande comme fournisseurs possibles. C'est terminé. Le cas le plus évident est la voiture électrique : pendant que les constructeurs allemands essayaient de truquer les tests sur les moteurs diesel, l'État chinois a subventionné les voitures électriques – et quand la voiture électrique est devenue un produit de masse, les Allemands n'étaient pas du tout prêts.
Pour reparler de Mandel, il est vrai que nous considérons en général que le retour à une onde longue de croissance est lié à des facteurs exogènes, soit des grandes découvertes technologiques soit des facteurs exogènes politiques… Ça change la focale, mais comment analyses-tu les initiatives de Trump, les droits de douane, la volonté d'annexions et ses attaques contre l'appareil d'État ?
C'est vraiment la question. Pour être un peu sur cet espace théorique et faire le lien avec Trump : si vous avez effectivement un système d'onde longue, et si nous sommes dans le creux de la vague, pour aller vite, on va avoir une guerre et puis ça va remonter parce qu'il va falloir reconstruire. Mais le problème est que la tendance actuelle est celle d'un affaiblissement à très long terme, ce qui fait que même si on repart par des facteurs exogènes – ou endogènes –, la dynamique interne du capitalisme est tellement affaiblie que je ne suis pas sûr qu'on puisse repartir très haut. C'est finalement ce qu'on a pu constater avec la crise sanitaire, même si l'outil productif avait été préservé. Le rattrapage a été rapide et les tendances à l'affaiblissement sont redevenues importantes.
Ça pose encore plus le problème en termes politiques : même ceux qui ont des idées pour maintenir leur rythme d'accumulation vont se retrouver quoi qu'il arrive face à une tendance forte sous-jacente qui tire l'accumulation vers le bas. Par exemple en Ukraine, après la guerre, vous allez avoir une reconstruction et le PIB ukrainien va bondir, c'est logique. Mais en réalité si l'Ukraine devient un lieu de production bon marché en Europe occidentale, elle va prendre la place d'un autre pays. C'est la logique du gâteau qui ne grandit plus.
La Seconde Guerre mondiale a fait repartir le capitalisme, parce qu'il y avait aussiun changement technologique, un changement d'échelle de la production, la deuxième révolution industrielle qu'il s'agissait de diffuser. Et la guerre a accéléré cette diffusion. Et parce qu'il y avait, en parallèle, la possibilité d'un développement de la consommation de masse, qui a commencé à la fin du 19esiècle mais ne s'est développé réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs en grande partie pour des raisons politiques.
Il y a là des dynamiques internes au capital et la dynamique externe a permis de faire repartir le tout. Aujourd'hui il n'y a même pas ça : il y a quelque chose qui est de l'ordre de la baisse tendancielle du taux de profit et qui est lié à la question de la productivité. À un moment vous avez une force qui tire cette productivité vers le bas, qui est ce qu'on appelle la composition organique du capital : vous avez atteint un certain niveau de productivité alors que votre capital coûte très cher et que les gains que vous réalisez ne vous permettent plus de gagner suffisamment de plus-value. L'intérêt de l'investissement productif décline et la seule façon d'avoir une croissance est d'augmenter la plus-value absolue.
Aux États-Unis, on entend dire que leur 2,5 % de croissance est formidable, mais ce n'est pas du tout les taux de croissance qu'ils faisaient dans les années 1950-1960 ou même 1980. De même l'Espagne fait 3 % mais elle faisait 4 % ou 5 % dans les années 2000. Et notre gouvernement nous dit qu'on est les champions quand on fait 0,8 %…
Je pense qu'une grande partie, voire la totalité du capital, est consciente de cette situation et c'est pour ça qu'à mon avis on est en train de sortir du néolibéralisme. Ils ont compris qu'un développement des marchés et leur libéralisation, ça ne fonctionne pas. Ça peut servir à développer certaines politiques publiques, justifiées avec les vieux arguments – la réforme des retraites, les libéralisations à venir du marché du travail, etc. – mais ce n'est plus le cœur du problème.
Le cœur du problème est en fait double. D'un côté, une partie du capital – notamment le capital productif, les services marchands et beaucoup d'industries – dépend aujourd'hui de l'aide directe des États – subventions, baisses d'impôts, etc. Si vous supprimez cette aide, ils n'ont plus rien, il n'y a plus de profits, il n'y a plus d'activité. Et ça c'est vrai aussi en Chine, parce qu'on est dans une quasi-crise de surproduction industrielle.
De l'autre côté, il y a une autre stratégie qui consiste à dire que, puisqu'on a beaucoup de mal à produire de la valeur de façon classique à partir du travail, on va contourner ce système et produire de la valeur au travers de la rente. Tout un secteur vise précisément ce système de rente, ce système de prédation à la fois des ressources et des marchés. À titre de capitaliste individuel c'est parfait : vous pouvez encaisser toutes les baisses du taux de profit global si, de votre côté, votre profit personnel dépend juste de l'obligation qu'ont les gens de vous payer pour pouvoir vivre normalement. C'est en fait un leurre car cet argent lui-même dépend du taux de profit global. Mais c'est une illusion forte dans ces secteurs.
Ce n'est pas une division stricte, des secteurs – comme par exemple la finance – ont un pied dedans et un pied dehors, parce que le crédit dépend évidemment de l'activité, mais une partie de la finance est complètement déconnectée du système productif. On a donc, grosso modo, ces deux stratégies.
Quelle est la théorisation politique de ces deux stratégies ? Pour les secteurs productifs, la traduction politique est un État qui détruit tant l'État social que les conditions de travail pour disposer d'un maximum de ressources afin de subventionner le secteur privé. Ça implique une politique d'austérité sociale et une politique de transfert – ce qu'on a connu avec le covid : une « politique de sécurité sociale des profits des entreprises ».
Pour les secteurs rentiers, ce qui les intéresse, ce n'est pas d'être aidé par l'État parce qu'aujourd'hui ils sont quasiment à des niveaux étatiques, donc en concurrence avec les États. Les Big Tech et les grandes entreprises extractivistes sont concurrentes de l'État, qui entrave leur développement : il faut obtenir des droits de forage quand vous êtes un pétrolier, il y a des problèmes de réglementation quand vous êtes dans la technologie… L'idée est donc de vider l'État de sa substance, de ne garder que ce dont on a besoin au minimum et de remplacer l'État par des entreprises. C'est le régime « minarchique » [« État minimal »] ou anarcho-capitaliste, qui remplace l'État par des entreprises qui font du profit et se substituent à ses grandes fonctions. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis : Elon Musk arrive avec ces jeunes blancs-becs de la Silicon Valley qui n'ont comme expérience que celle des entreprises de rente et qui prennent l'État américain, le désossent pour garder seulement ce qui intéresse le capital rentier.
Il y a cependant des points de jonction entre les deux grandes stratégies : les réductions des impôts, la destruction des protections pour les travailleurs et de l'État social… Autrement dit, la répression sociale.
Il y a donc une forme d'accélération du phénomène néolibéral, mais aussi une fuite en avant : pour compenser cet affaiblissement continuel de la croissance, il va y avoir une mise à sac de l'État. Pour les entreprises industrielles, c'est problématique parce que si vous n'avez plus les transferts de l'État vous avez un problème de survie. Et aussi un problème de dépendance vis-à-vis des secteurs rentiers parce que les entreprises industrielles dépendent des entreprises technologiques, des entreprises de fourniture d'électricité, d'eau etc. donc elles deviennent une forme de sous-secteur.
Cette concurrence à l'intérieur du capital peut être réglée dans certains cas par la répression sociale qui arrange un peu tout le monde – c'est un peu aujourd'hui la politique de Macron : on maintient les aides aux entreprises en faisant de la répression sociale, et grosso modo comme on n'augmente pas les impôts les entreprises rentières sont elles aussi satisfaites. C'est possible en France parce que ce sont principalement des services marchands qui font l'économie, qu'il n'y a pas de géant de la Tech. C'est un peu différent aux États-Unis : du fait de la place des géants de la Tech dans le modèle économique américain, il va y avoir un conflit beaucoup plus fort entre les deux parties. La politique protectionniste peut tenter de trouver un compromis interne au capital, mais certaines Big Tech ont des plumes à y perdre…
D'une main Trump les impose et de l'autre il les annule…
La première lecture est que ces droits de douane sont du protectionnisme classique visant à défendre l'intégralité du capital national contre les capitaux étrangers en vue de relocaliser la production aux États-Unis. Et grâce au revenu des droits de douane l'État baisse les impôts et tout le monde est content en interne. C'est ce qu'ont fait les États-Unis dans la première phase de leur développement après la guerre de Sécession : ils se sont développés à l'abri des droits de douane massifs et c'est la référence de Trump.
Le problème de cette hypothèse est qu'il y a une contradiction dans les termes. Les droits de douane doivent dissuader l'importation des produits aux États-Unis. Or Trump va baisser les impôts grâce au produit des droits de douane. Donc, si la relocalisation se réalise, le revenu des droits de douane diminue et la baisse des impôts ne peut être financée. Par ailleurs, pour relocaliser, il faut des droits de douane suffisamment élevés pour compenser les différentiels de coût du travail. Entre un travailleur mexicain et un travailleur étatsunien, la différence aujourd'hui est de l'ordre de 1 à 6 %, pas 25 %. Si vous relocalisez, vous allez donc avoir des augmentations de prix. Et comme le marché du travail étatsunien est déjà tendu, vous allez avoir des augmentations de salaires, donc une pression sur le taux de profit des entreprises industrielles qui n'est pas forcément tenable en l'état et va se traduire par une augmentation des prix qui sera beaucoup plus importante que les 25 % d'augmentation des droits de douane…
Cette première hypothèse ne doit pas être complètement évacuée. Il est possible que ce soit le projet de Trump. On serait alors sur un plan à la Macron : essayer de faire la paix au sein du capital en donnant en même temps aux industriels une protection et au capital rentier les baisses d'impôts qu'il veut. Mais c'est voué à l'échec.
La deuxième hypothèse est que ces choix sont en réalité politiques. Les États-Unis ont un problème : leur modèle économique est fondé sur une économie de services marchands à 80 %, avec un secteur technologique haut de gamme extrêmement rentable, extrêmement puissant et en avance sur tous les autres. C'est une toute petite partie de l'économie étatsunienne mais c'est une partie extrêmement importante parce qu'elle produit énormément de valeur. Le problème est qu'aujourd'hui la Chine est en train de les rattraper – on l'a vu avec l'IA.
Je fais une petite parenthèse que je trouve intéressante : depuis des années on nous vend l'idée (notamment les macronistes) que pour innover il faut des baisses d'impôts des entrepreneurs, il faut les caresser, leur apporter le café, il ne faut pas que les gens soient trop payés, il faut des aides publiques, il faut des commandes, etc. Mais en réalité, c'est complètement faux : c'est quand vous avez des contraintes que vous innovez, c'est quand il y a quelque chose qui vous bloque que vous devez trouver une solution. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine : les chercheurs se sont dit « on n'a pas les microprocesseurs, on ne peut pas avoir cette stratégie (une stratégie par ailleurs délirante sur le plan écologique qui est d'augmenter les capacités de calcul) donc on va trouver une solution pour faire avec ce qu'on a ». Le cauchemar américain c'est que les Chinois soient capables aujourd'hui d'innover moins cher avec une qualité quasi équivalente et vont donc leur prendre des marchés partout, même sur l'IA.
Jusqu'ici la stratégie des États-Unis pour maintenir leur hégémonie était de se déporter un peu partout, avec la guerre en Irak, en Afghanistan, des troupes en Europe, etc. Maintenant c'est de construire un vrai empire, c'est-à-dire avec des réseaux de vassaux qui vont venir consommer leurs produits, notamment leurs produits tech, leur pétrole ou leur gaz liquéfié. Et qui n'auront pas le choix.
On retrouve ce que je disais sur la rente : l'enjeu aujourd'hui d'une partie du capitalisme étatsunien est d'éviter la concurrence, donc de construire non pas un grand marché transatlantique et transpacifique comme au temps du néolibéralisme, mais un empire : un centre et des périphéries où chacune a un rôle à jouer vis-à-vis du centre. Aujourd'hui évidemment ce n'est pas le cas : l'Europe passe des accords de libre-échange avec des d'autres pays. Mais si le but des États-Unis est que chaque pays soit au service de la métropole, du cœur de l'empire, les droits de douane sont un moyen de pression. C'est une explication du jeu actuel de Trump : il les met, il les retire.
Quand il les retire on dit que c'est un clown. C'est peut-être un clown mais il envoie le message aux Mexicains et aux Canadiens : je peux les retirer mais évidemment il va falloir accepter des conditions, sinon je vais les remettre. Ces conditions, cela va être l'accès au marché, par exemple en Europe. On sait bien ce qu'il vise : la suppression de toutes les réglementations sur la technologie, le monopole du gaz liquéfié, l'accès au marché des industries de la défense (et donc quand il dit qu'il faut consacrer 5 % du PIB à la défense, c'est pour acheter aux États-Unis)… On peut même imaginer qu'ils mettent d'accord tout le capital étatsunien en disant à sa périphérie : on a des produits industriels qu'on veut vendre et vous allez vous inscrire dans notre chaîne logistique, à nos conditions.
Les droits de douane auraient alors vocation à faire pression sur les pays périphériques de l'empire pour les vassaliser encore plus. C'est quelque chose qui peut paraître complètement contre-intuitif, mais en fait il vise ses alliés avant de viser ses ennemis parce qu'il est en train de constituer un bloc impérial et quand ce bloc impérial sera constitué, il pourra aller à l'affrontement avec la Chine (la Chine qui est en train de faire exactement la même chose, sous des formes moins violentes et moins clownesques, avec les « nouvelles routes de la soie » qui sont des formes d'influence et de dépendance à la dette). Mais là aussi, c'est très risqué : l'influence que vont avoir ces droits de douane sur la croissance mexicaine ou colombienne peut conduire le Mexique et la Colombie à aller chercher des appuis chinois par exemple… mais si la Chine met les deux pieds au Mexique ou en Colombie, cela devient extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas évacuer non plus le caractère dangereux du personnage…
Comment expliques-tu que le Wall Street Journal ait publié un éditorial extrêmement agressif contre ce choix de Trump sur les taxes – c'est quand même le journal du capital financier – et la chute de l'indice Dow Jones face à ces annonces ?
On retrouve la discussion qu'on avait précédemment : on a affaire à des gens qui tentent par tous les moyens de sauvegarder leur taux de profit mais qui se confrontent à des contradictions permanentes. Musk est confronté au fait qu'il a délocalisé une partie de sa production en Chine, que le marché chinois est important pour lui et c'est ce qui provoque un recul de l'action Tesla. Sous l'impulsion de Trump à la fin des années 2010, le capitalisme américain s'est structuré précisément autour du Mexique et de la fourniture de produits mexicains – mais aujourd'hui, avec les droits de douane, la chaîne logistique du capitalisme industriel américain risque d'être complètement rompue. Ce n'est pas logique et d'ailleurs la réaction du Wall Street Journal montre que ces milieux sont confrontés à une contradiction de ce point de vue. Mais c'est aussi ce qui explique que c'est très politique. Si c'était un choix purement économique, la promesse de Trump que les pertes de Wall Street seront compensées par la garantie d'une accélération, la croissance serait crédible. En réalité, la véritable promesse est celle de la constitution d'un empire centralisé dont les gains économiques restent incertains.
L'État est la représentation des intérêts collectifs de la bourgeoisie parce que, n'étant qu'une somme de capitaux, elle n'arrive pas à exprimer ses intérêts collectifs…
Exactement. Et alors quand – comme c'est le cas aujourd'hui – il s'agit d'intérêts qui sont divergents entre les secteurs (et je n'ai mentionné que deux grands aspects contradictoires, mais en fait on peut trouver des dizaines d'intérêts divergents à l'intérieur des secteurs), ce qui est intéressant c'est que ces intérêts divergents traduisent aussi ces contradictions, c'est-à-dire les limites de la capacité qu'ils ont aujourd'hui à venir contrer la tendance de fond à l'affaiblissement de la rentabilité.
La présence d'un fou à la direction de l'État permet aussi de prendre des décisions radicales, même si une partie de la bourgeoisie ne les estime pas pertinentes à l'instant T. Il faut un peu d'audace…
Une grande partie du discours capitaliste dominant essaye de nous cacher la gravité de la situation et de nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Mais la situation est tellement critique qu'ils ne peuvent tenter de s'en sortir qu'en prenant des décisions radicales qui vont avoir des conséquences pour certains membres de leur classe. Il y a un aspect de désespoir, c'est aussi le symptôme de la crise du régime capitaliste…
Sans parler de la crise écologique…
Je pense qu'on est en crise de régime capitaliste parce que le néolibéralisme, qui était le mode de gestion du capitalisme jusqu'ici, est épuisé et il faut donc trouver un nouveau mode de gestion et un nouveau mode d'hégémonie. C'est là où l'empire remplace le marché, et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Dans les périodes de crise, il y a toujours des tâtonnements : au cours de la crise de 1929, il y a une période de protectionnisme qui ne fonctionne pas vraiment, puis le New Deal est en réalité constitué de trois phases : après des avancées et des arrêts, une nouvelle crise conduit à l'idée que la seule solution c'est de produire des chars…
Dans les périodes de crise, il y a naturellement beaucoup de confusion parce qu'on tente des solutions et que ces solutions ne se révèlent pas toujours efficaces et parfois échouent carrément. Aujourd'hui, comme il n'y a que le capitalisme, seuls les capitalistes tentent des choses. Mais si par exemple, dans un monde idéal, les travailleurs se mettaient à tenter des choses, tout ne se ferait pas du jour au lendemain, il y aurait des échecs,1 on reviendrait en arrière, on avancerait…
La vraie singularité de la crise actuelle est à mon avis son caractère multiforme : il y a cette crise économique dont on a beaucoup parlé mais qui – comme tu l'as dit – vient en fait se rajouter à une crise écologique qui est le produit du mode de production. On voit clairement que Trump va mettre à la poubelle toutes les maigres concessions faites à l'écologie et à l'environnement. Pour tenter de sauver le capital.
Dans l'article « Stratégie écosocialiste en période de turbulences », Martin Lallana Santos dit que les sorties de crise du capitalisme nécessitent en général un décuplement de la production énergétique…2
Évidemment. Et encore une fois n'oublions pas que la référence de Trump, c'est la fin du 19e siècle : des puits de pétrole partout. Ce qui est certain, c'est qu'il va mettre à bas les normes écologiques, et pas seulement aux États-Unis. Il va faire pression pour qu'il y ait la même chose en Europe, en Amérique latine et dans tous les pays qui dépendent des États-Unis. D'ailleurs les dirigeants européens commencent déjà à dire qu'ils sont allés trop loin, qu'il y a trop de normes. En réalité, derrière, c'est la destruction écologique parce qu'il ne faut pas oublier que la crise écologique ce n'est pas seulement le réchauffement. C'est la destruction de la biodiversité et la viabilité de notre espèce qui est en cause. La crise écologique est niée parce que la priorité est donnée à l'accumulation.
Il y a aussi la crise sociale, sociétale et anthropologique. La vague réactionnaire ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que la société capitaliste est malade de ce qu'elle a produit, c'est-à-dire de la surconsommation, qui n'a pas que des effets délétères sur l'environnement, elle en a aussi sur les êtres humains qui sont en permanence appauvris par cette surconsommation : plus vous consommez, et plus vous manquez de quelque chose. Ce qu'on a connu avec la crise inflationniste est extrêmement intéressant de ce point de vue. Cette frustration de ne pas pouvoir être dans cette folie consommatrice permanente rend les gens malheureux et en panique. Aux États-Unis, la croissance se fait par l'augmentation des rentes, donc des dépenses contraintes, notamment dans la santé. La marchandisation de la santé est la preuve que croissance et bien-être deviennent des états divergents. C'est un élément qui a en partie déterminé le résultat de l'élection américaine : les démocrates ont fait campagne en s'appuyant sur une croissance à 3 %, dans le New York Times Paul Krugman nous expliquait toutes les semaines que les États-Unis étaient très prospères et qu'il n'y avait aucune raison de se plaindre… mais les gens devaient faire face à ces dépenses contraintes qui augmentent.
Plus globalement, l'injonction à la consommation est fondamentalement insatisfaisante. Trump est cette tentative de sauvegarder un mode de vie intenable avec la fausse promesse qu'elle est un gage de bonheur.
Pendant longtemps le capitalisme occidental a pu dire que le niveau de vie augmentait et que la qualité de vie s'améliorait parce que la production pouvait se concentrer sur la satisfaction de besoins évidents. Et puis à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 où on avait à peu près rempli tous les besoins basiques des gens, et même un peu plus, il a fallu quand même continuer à vendre des marchandises. C'est le moment où les besoins des individus sont construits par le capital pour sa propre reproduction. Les besoins des individus sont donc en permanence identifiés aux besoins du capital. C'est ce qui provoque à la fois un désir permanent, de la frustration, et une profonde solitude. Les sociétés vont mal, y compris quand la croissance résiste, et peut-être même surtout quand la croissance résiste ! C'est quelque chose qui fait partie pour moi de la crise globale, un troisième pôle de la crise.
Il y a quelque chose qui est un peu désespérant : quand vous essayez de régler un des pôles de la crise, vous augmentez les deux autres. Si vous essayez de régler la crise économique, comme Trump et les autres dirigeants européens, vous décuplez la crise écologique et les besoins technologiques pour rendre les gens encore plus dépendants et encore plus neurasthéniques… Vous essayez de régler la crise écologique ? Alors là vous pouvez oublier votre croissance et votre accumulation du capital. Vous essayez de régler la crise sociale ? Vous mettez fin à la consommation de masse… En fait vous vous retrouvez dans une espèce d'impasse continuelle et tout ça est lié à un fait central : la société est dominée par le besoin d'accumulation du capital et donc est dépendante des clowns que nous fournit le capital : les Trump, les Macron…
Ça me conforte en tout cas dans le fait que nous sommes entrés – c'est Tom Thomas qui utilise ce terme – dans une phase de sénilité du capitalisme : on est dans un système qui fonctionne de plus en plus mal mais qui survit parce qu'il nous enferme dans des choix impossibles. Les gens envisagent plus la fin du monde que la fin du capitalisme…
On a connu dans le dans le passé de l'humanité la décadence de systèmes sociaux – Rome bien évidemment, mais aussi la République nobiliaire polonaise aux 16e-18e siècle – mais à chaque fois c'était centré sur une région. Mais là on a un système qui a été réellement mondialisé, c'est le capitalisme partout même si ses régimes politiques sont un peu différents. Il y a aussi une tendance du libéralisme à être de plus en plus oppresseur, de moins en moins démocratique, et le système chinois, qui n'est pas un système démocratique et ne l'a jamais été. Dans cette situation il y a des capitaux qui sont au-delà de l'État, il y a des guerres qui sont loin d'être uniquement locales – Ukraine, Palestine/Israël, Congo – mais pour l'instant ce n'est pas un affrontement généralisé. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers un affrontement généralisé pour sortir des contradictions ?
Il y a deux choses dans ce que tu dis sur lesquelles j'aimerais bien revenir. La première, qui est importante, c'est la fin du capitalisme démocratique. Pendant longtemps, on nous a dit que la démocratie a besoin du capitalisme et on n'envisageait pas l'un sans l'autre. Mais l'histoire nous a appris que capitalisme et démocratie, ce n'est pas du tout la même chose, et c'est même parfois contradictoire. Dans un système en crise généralisée, dans une impasse globale, la démocratie est un frein à l'accumulation et on voit partout aujourd'hui qu'on essaie de contourner la démocratie, on essaie d'en faire une coquille vide.
Pour des raisons historiques ça ne prend pas – pas encore – les formes traditionnelles de la dictature classique, mais on vide la démocratie de son sens. Ce que fait Musk est assez intéressant de ce point de vue : ils ne vont pas supprimer les élections, ils vont détruire l'État de droit, prendre le contrôle des médias, faire une démocratie formelle vidée de son sens. Le modèle le plus avancé, c'est la Russie avec un régime qui devient de plus en plus oppressif. On ne peut donc pas exclure que cela débouche sur une dictature classique. Il y a deux choses qui vont dans ce sens. La première est la logique de rente, qui est une logique quasi féodale : ce n'est pas une logique où les gens choisissent, où les individus sont des citoyens, c'est une logique où on doit payer pour des services rendus indispensables… La seconde, c'est la République populaire de Chine. C'est un capitalisme non démocratique et le seul succès capitaliste de notre époque. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose d'équivalent à la Chine dans l'histoire du capitalisme. Les gens disent donc : si notre problème c'est l'accumulation, on a un exemple sous nos yeux d'un pays qui a réalisé l'accumulation dans des conditions extraordinaires, c'est la Chine, un pays à parti unique.
Concernant la question des guerres : si, effectivement, dans ce régime de basse croissance, le gâteau grossit moins vite, que les parts sont plus difficiles à distribuer et que l'on entend avoir une logique prédatrice sur le peu de valeur créée, alors il faut pouvoir contrôler politiquement un plus grand nombre de parts. Quand en Chine il y avait une croissance de 10 %, la question du contrôle territorial n'était pas importante. Mais quand la croissance est tombée à 5 % officiellement, et peut-être en réalité à 2 ou 3 %, et que la promesse du Parti communiste chinois, c'est le plein-emploi et un niveau de vie équivalent à l'Occident à l'horizon 2050, vous ne pouvez plus vous contenter de votre croissance interne. Il faut donc assurer des ressources et des marchés qui ne soient pas soumis aux aléas de la concurrence. Il faut alors en prendre possession. Cette logique impérialiste c'est le chemin de la Chine, et c'est exactement la même chose pour les États-Unis.
C'est le retour d'un impérialisme brutal, celui de la fin du 19e siècle : le contrôle exclusif du territoire est la clé et l'obsession de Trump pour le Groenland et le canal du Panama, c'est la recherche du contrôle exclusif de ces richesses. On ne peut pas dire que le Danemark soit un danger pour les États-Unis ni un sérieux concurrent, mais Trump ne veut pas prendre de risque et veut un contrôle exclusif. Quand vous êtes dans cette logique de contrôle exclusif, l'affrontement est inévitable… Est-ce que ça débouchera sur un conflit généralisé ? Si on suit la logique globale selon laquelle la guerre est la seule chose qui fonctionne pour relancer l'accumulation, pourquoi pas. En tout cas, les conflits régionaux sont déjà là. Et l'Europe est au centre du problème. Si le vieux continent devient un simple gâteau à se partager entre Washington et Moscou, alors les conflits risquent d'être très violents. L'abandon de l'OTAN par les États-Unis et la soumission d'une garantie de sécurité étatsunienne à une vassalisation peut ouvrir la voie à une expansion russe et à de nouveaux conflits en Europe orientale. Aujourd'hui il n'y a plus de sécurité internationale.
Je ne dis pas que l'OTAN c'était formidable. C'était une autre forme d'impérialisme. Mais là, on est dans autre chose, la seule sécurité que vous avez, c'est d'être un vassal de la métropole et de remplir votre rôle pour la prospérité de cette métropole. C'est ce que Trump dit au Danemark et au Canada : il dit à deux pays alliés : « vous me donnez un morceau de votre territoire sinon j'envoie mes troupes », ou « si vous voulez être tranquilles, vous rentrez et vous ferez partie du centre ».
Et l'Europe dans tout ça ?
On ne voit pas comment l'Europe serait capable de construire quelque chose qui soit capable de contrebalancer la puissance américaine et le chantage américain, parce que l'Europe est en train de payer la facture de son néolibéralisme débridé : elle s'est mise à découvert, elle s'est désindustrialisée, elle s'est affaiblie. Elle a tout misé sur son alliance avec les États-Unis et se retrouve aujourd'hui face à Trump qui lui met le pistolet sur la tempe. Avec une autre puissance impérialiste à ses portes, la Russie, qui va profiter du moindre faux pas pour se jeter sur elle. Et la Chine impérialiste qui n'attend que de récupérer le marché européen.
On est dans une situation complexe, sans dynamique économique, des sociétés complètement fracturées, des partis d'extrême droite qui jouent pour les Américains ou pour les Russes, ou pour les deux. On est clairement dans une phase de déclin.
Le 4 février 2025. Propos recueillis par Antoine Larache et Jan Malewski.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Guerrières de la Paix

Les Guerrières de la Paix est un mouvement de femmes pour la Paix, la Justice et l'Egalité (association loi de 1901).
Créé en France en 2022, ce mouvement réunit des femmes de toutes sensibilités, cultures, croyances et origines. La reconnaissance de l'autre à la fois dans son identité et dans son altérité constitue la condition du dialogue véritable et de la sororité, ciments de nos combats.
Nous luttons contre toutes les formes de haine qui traversent la société française, et notamment le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la haine anti-LGBTQI+ …
Au-delà de nos frontières, nous sommes mobilisées partout où les droits des femmes sont menacés, et les droits humains bafoués. Ukrainiennes, Ouighours, Iraniennes, Palestiniennes, Israéliennes, Russes, Rwandaises, leurs combats sont aussi les nôtres.
À l'initiative du premier Forum Mondial des Femmes pour la Paix, nous, les Guerrières de la Paix, nous sommes données pour mission de promouvoir le rôle des femmes dans le processus de Paix pour faire émerger ces autres voix et d'autres futurs, basés sur la Paix, la Justice et l'Égalité.
*-*
Notre manifeste
Notre pays est traversé depuis des décennies par de graves crises à la fois sociales et sociétales qui ont bouleversé notre capacité à vivre ensemble mais aussi à débattre et donc à appréhender sereinement les défis qui se posent à nous. Différents « camps » s'affrontent de plus en plus violemment et il n'y a presque plus de place pour l'écoute, le doute et la contradiction. Pourtant, nous devons ensemble faire face à la montée des tensions identitaires et des extrémismes, autant qu'aux enjeux écologiques et aux inégalités sociales qui s'aggravent.
Face à ces dérives et à ces crispations, face à la montée des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, de la haine des musulmans, du sexisme et de l'homophobie, la réponse que nous souhaitons porter est celle de la voix des femmes. Nous sommes un groupe de femmes d'origines, de croyances, de milieux sociaux, d'âges et de sensibilités diverses. Grâce à ces différences mais aussi malgré elles nous avons décidé de nous unir.
Toutes engagées sur différents terrains, confrontées dans notre quotidien à ces réalités. Nous mesurons chaque jour l'ampleur des dégâts et nous avons décidé d'unir nos voix et nos forces pour offrir une nouvelle alternative. Chaque jour, nous nous battons, nous sommes sur le front, nous apportons des solutions, nous ouvrons des espaces de débats là où plus personne n'essaye d'ouvrir les champs du possible.
Nous voulons rendre visibles toutes ces guerrières du quotidien, ces héroïnes invisibles qui déplacent des montagnes chaque jour, anonymement, silencieusement. Elles sont celles qui partout retissent l'espoir et nos derniers remparts face aux haines qui nous menacent.
Nous sommes les Guerrières de la Paix, animées d'une volonté farouche d'essaimer notre désir de dialogues, de débats, d'écoute sur l'ensemble du territoire. Toutes engagées dans un combat d'égalité et de justice sociale, nous savons que nos engagements en tant que femmes ne peuvent faire l'impasse sur les questions fondamentales que sont le racisme et l'antisémitisme, mais aussi le sexisme, l'homophobie et toutes les formes d'exclusion.
Nous sommes les Guerrières de la Paix. Femmes engagées dans nos métiers, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos familles, nous voulons avec nos différences faire la démonstration qu'il est possible et urgent de créer partout en France, des espaces de dialogues sincères et apaisés.
Notre mouvement des Guerrières de la Paix veut rétablir et garantir à chaque persécuté.e sa légitimité. Il sera le lieu de la reconnaissance de toutes les souffrances, de toutes nos mémoires et le refus de leur opposition ou mise en concurrence.
Chaque fois qu'une personne sera agressée, stigmatisée, rejetée, humiliée, privée de son droit à la dignité, nous nous lèverons d'une seule voix, telle une armée au service de l'humanisme, de la fraternité, de la sororité, de la solidarité.
Chaque fois que nous sentirons l'instrumentalisation de nos peurs et de nos différences, nous parlerons au nom de l'avenir, celui de notre pays et de tous ses enfants.
Chaque fois que nous constaterons l'absence de résistance, de contestation, d'indignation quand quelqu'un.e sera ciblé.e en raison de ce qu'il est ou de ce en quoi il croit, nous réagirons, liguées contre ceux qui pensent que les limites peuvent toujours être repoussées.
Nous lançons cet appel, ce cri d'urgence, à toutes celles capables de prendre le risque de participer au changement, de remettre en jeu ses certitudes, de venir partager, dialoguer et se battre à nos côtés.
Il y a urgence à réunir nos forces face aux dangers qui nous guettent.
Ensemble nous sommes plus fortes !
https://www.lesguerrieresdelapaix.com
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marche pour GAZA : GRANDE MANIFESTATION, 14 juin, 13 h 30, à Montréal

EN MARCHE, LE SAMEDI 14 JUIN
ENSEMBLE, EN ROUGE, EN SOLIDARITÉ
DÉPART À 13 h 30, Place Norman-Bethune (métro Guy-Concordia)
Un regroupement large d'organisations de la société civile, syndicales et humanitaires, dont la Coalition du Québec URGENCE Palestine, lance un appel conjoint à une grande manifestation, samedi à Montréal, en solidarité avec le peuple palestinien. Le texte de la bannière de tête de la manifestation sera : « Gaza : Un peuple assassiné, nous refusons d'être complices ». Les participantes et participants sont invités à se vêtir de rouge pour symboliser les nombreuses lignes rouges franchies par Israël à Gaza, et appeler le Canada à passer de la parole aux actes maintenant.
Nous invitons les organisations membres et sympathisantes de la Coalition de la grande région de Montréal à se regrouper derrière la bannière de la Coalition et à se munir de pancartes dénonçant le génocide à Gaza et exigeant que le Canada impose des sanctions sévères contre Israël maintenant : embargo bilatéral sur tout matériel militaire, actions devant les cours internationales, résiliation des ententes économiques et militaires, imposition de sanctions, ruptures des relations diplomatiques, etc.
Pour ajouter le nom de votre organisation à la liste des organisations appuyant la manifestation, remplissez ce formulaire.
Solidairement !
—
Coalition du Québec URGENCE Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sisters in Islam (SIS)

Sisters in Islam (SIS) est une organisation non gouvernementale qui œuvre à la promotion des droits des femmes musulmanes en Malaisie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/03/sisters-in-islam-sis/?jetpack_skip_subscription_popup
Notre histoire
SIS a été fondée en 1988 par un groupe de femmes musulmanes qui se sont réunies pour lutter contre l'injustice à laquelle les femmes sont confrontées dans le cadre du système de la charia (loi islamique). Notre lecture critique du Coran à travers une approche herméneutique a ouvert un monde islamique que nous pouvions reconnaître : un monde pour les femmes rempli d'amour et de miséricorde, d'égalité et de justice.
À la fin des années 1990, l'activisme du SIS s'est étendu au-delà des questions spécifiques des droits de la femme, à la question plus large de la défense des principes démocratiques et des libertés fondamentales garantis par la Constitution fédérale et les traités et conventions sur les droits de l'homme. C'est ainsi que le SIS a commencé à prendre des positions publiques sur la liberté de religion et la liberté d'expression.
Aujourd'hui, le SIS joue un rôle clé dans le mouvement local et international des femmes en apportant une contribution à la compréhension de l'islam dans une perspective fondée sur les droits, des stratégies de défense et de mise en réseau, et il est à la pointe d'un mouvement émergent de femmes musulmanes visant à pousser à la réforme à la fois dans la compréhension de l'islam et à influencer les lois et les politiques promulguées par les gouvernements musulmans ou les groupes au sein des communautés musulmanes minoritaires.
Notre mission est de promouvoir les principes d'égalité des sexes, de justice, de liberté et de dignité dans l'Islam et de donner aux femmes les moyens d'être les avocates du changement.
Nous envisageons une société progressiste et démocratique qui défend la liberté d'expression, l'égalité des sexes et la justice sociale pour tous et toutes. Nous voulons être reconnues comme le leader national et mondial de l'égalité des sexes et de la justice dans l'Islam.
Nos activités
Défense
La principale activité de SIS est la réforme des lois et des politiques. Nous nous sommes engagées auprès des décideurs politiques, des médias, des ONG et des groupes de femmes de la base. Nous avons formé des coalitions et mené des campagnes pour améliorer les lois et les politiques et sensibiliser le public à toute une série de questions telles que les questions relevant de la loi islamique sur la famille, c'est-à-dire la polygamie, l'égalité des droits à la tutelle des enfants et d'autres questions telles que la police morale, la loi hudud, la liberté de religion et la liberté d'expression.
Recherche
La recherche a constitué la base des arguments du SIS pour la réforme juridique, l'introduction de nouvelles politiques et la contestation des déclarations faites au nom de l'Islam qui discriminent les femmes et violent les enseignements éthiques de la religion. La recherche a également servi directement les activités de défense de SIS. En 2006, le SIS s'est engagé dans deux grands projets de recherche en cours dans les domaines de la réforme du droit musulman de la famille et de l'impact de la polygamie sur la vie familiale.
En outre, le SIS s'est lancé dans un projet mondial de recherche et de défense de la réforme du droit de la famille islamique. Baptisé MUSAWAH, ce mouvement mondial pour l'égalité et la justice dans la famille musulmane a été lancé en février 2009. En 2014, le SIS, en partenariat avec ARROW, s'est lancé dans un projet de recherche intitulé « Fondamentalismes religieux et santé et droits sexuels et reproductifs dans le Sud ». Le titre du document de recherche est « Rapport national sur la Malaisie. Le mariage des enfants : sa relation avec la religion, la culture et le patriarcat ». Le projet a été achevé en avril 2018.
Sensibilisation et autonomisation
La principale activité de SIS porte sur la réforme des lois et des politiques. Nous nous sommes engagées auprès des décideurs politiques, des médias, des ONG et des groupes de femmes de la base. Nous avons formé des coalitions et mené des campagnes pour améliorer les lois et les politiques et sensibiliser le public à toute une série de questions telles que les questions relevant de la loi islamique sur la famille, c'est-à-dire la polygamie, l'égalité des droits à la tutelle des enfants et d'autres questions telles que la police morale, la loi hudud, la liberté de religion et la liberté d'expression.
Conseil juridique
SIS fournit des services de conseil juridique gratuits aux femmes et aux hommes sur leurs droits légaux en vertu de la loi islamique sur la famille et de la loi sur les infractions pénales de la Syari'ah. Notre permanence juridique, appelée Telenisa, fonctionne tous les mardis, mercredis et jeudis de 10h00 à 17h00 (sauf les jours fériés).
En savoir plus sur nos travaux
Violence contre les femmes
Impact de l'extrémisme sur les femmes
Cadre universel des droits des êtres humains
https://sistersinislam.org/who-we-are/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[Malaysia, Sisters in Islam (SIS)->https://sistersinislam.org/who-we-are/]
https://andream94.wordpress.com/2025/06/03/malaysia-sisters-in-islam-sis/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les comités logement solidaires des grévistes de la construction résidentielle

Cette après-midi, une coalition de comités logement ont tenu une conférence de presse le à Sherbrooke pour but d'exprimer sa solidarité avec les grévistes de la construction résidentielle et de dénoncer la campagne de dénigrement de la grève menée par le gouvernement.
« Nous sommes ici aujourd'hui en tant que coalition d'organisations qui sont en première ligne de la crise du logement, pour dire que la lutte des travailleurs de la construction résidentielle pour de meilleurs salaires et conditions de travail est intimement liée à notre lutte pour le droit au logement. En tant que comités pour le droit au logement, nous avons vu le gouvernement de la CAQ fournir toutes les excuses possibles pour masquer sa responsabilité dans la crise actuelle du logement. Il a d'abord blâmé les migrants, puis les communautés de la classe ouvrière en disant qu'elles n'étaient pas assez avisées dans leurs investissements, et maintenant, il blâme les travailleurs.” Nicholas Harvest, membre du Comité d'action des
Citoyennes et Citoyens de Verdun (CACV).
Les travailleurs de la construction résidentielle, en grève depuis deux semaines, réclament des augmentations de salaire de 22 % et de meilleures conditions de travail. L'Alliance syndicale, qui regroupe tous les syndicats de la construction au Québec et représente les travailleurs de la construction résidentielle en grève, a envoyé une délégation à Sherbrooke pour soutenir la
conférence de presse.
« L'événement d'aujourd'hui démontre une fois de plus que lorsque des liens transversaux se créent entre divers secteurs de lutte, la solidarité pousse nos causes plus loin. C'est pourquoi l'Alliance syndicale de la construction tient à remercier chaleureusement le Comité d'action des Citoyennes et Citoyens de Verdun (CACV), le Comité BAILS, le Comité d'action de
Parc-Extension (CAPE) et la Ligue 33 pour leur soutien envers les grévistes de la construction résidentielle. » affirme Alexandre Ricard, porte-parole de l'Alliance syndicale de la construction, qui malheureusement ne pouvait pas être présent pour la conférence. Il continue : « Sans des conditions salariales à la hauteur, il sera impossible pour les travailleurs
et travailleuses du secteur résidentiel de construire le Québec de demain et de répondre aux besoins criants en matière de logement de la population »
La coalition appuie pleinement les revendications de l'Alliance et des grévistes du secteur résidentiel, et dénonce les tactiques de négociation de mauvaise foi de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ). Ils retardent les progrès à la table de négociation, ils diffusent des informations erronées sur la grève qui ont Samedi 7 Juin 2025
conduit à des agressions et à des tensions accrues sur les lignes de piquetage, et prétendent que l'Alliance prend en otage la population et le marché de logement.
« L'APCHQ attend que le gouvernement intervienne avec une loi spéciale. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déjà menacé de l'enforcer sur la grève. Au lieu de dénoncer la négociation de mauvaise foi de l'APCHQ, la CAQ se range de leur côté et blâme les travailleurs pour l'explosion du prix des logements, qui est en réalité causée par les grands promoteurs et
les spéculateurs », déclaré Lewis-King, qui est un charpentier-menuisier et porte-parole de la Ligue 33, une organization de cartier en Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il poursuit : « Les patrons prétendent que l'augmentation de salaire demandée par les travailleurs de la construction résidentielle fera augmenter le prix d'une maison de 55 000 dollars. Cela ne tient pas la route. Depuis 2020, le prix d'une maison individuelle a augmenté de 73 %, mais les salaires dans la construction résidentielle n'ont augmenté que de 8,2 % depuis la dernière convention collective en 2021. La différence est allée dans les poches des patrons sous forme de profit. »
La CAQ a promis plus de logements et plus d'investissements dans le marché pour résoudre la crise du logement, mais nous considérons qu'il s'agit de promesses vides qui ne profiteront qu'aux investisseurs, aux spéculateurs et aux promoteurs immobiliers. Pour s'attaquer correctement à la crise du logement et à ses racines, la coalition revendique pour :
➢ Un gel total des loyers.
➢ La construction de 10 000 unités de logement social par an afin que 20 % du marché locatif devienne socialisé.
➢ L'élaboration d'un programme pérenne et autoportant dédié à la création du logement social qui perdure dans le temps et qui inclura un capital de démarrage au début des projets communautaires.
« Les locataires de notre communauté font face aux plus fortes augmentations de loyer depuis 30 ans, et la ministre du Logement, France-Élaine Duranceau, propose de nouveaux règlements qui entraîneront des augmentations de loyer encore plus abusives dans les années à venir. Ces nouveaux règlements sont un cadeau pour les propriétaires et un cauchemar
absolu pour les locataires, et ils entraîneront encore plus d'expulsions et de sans-abri » déclare Amy Darwish, du Comité d'Action de Parc Extension. Elle poursuit : « La crise du logement affecte de manière disproportionnée les travailleurs -
Québécois, immigrés, migrants - nous le voyons tous les jours à Parc Extension. Pour répondre aux besoins des gens en matière de logement, il est essentiel de s'assurer qu'ils ont des salaires suffisants pour pouvoir traverser cette tempête. C'est pour ces raisons que nous soutenons les travailleurs de la construction qui vivent dans nos communautés et qui sont
essentiels pour continuer de les construire. »
Organizations
Le Comité d'action des Citoyennes et Citoyens de Verdun (CACV) : Le Comité d'action des
Citoyennes et Citoyens de Verdun (CACV) est un comité logement qui intervient dans la
communauté verdunoise depuis 1975. Ils offrent des services d'informations aux locataires sur
leurs droits en matière de logement, et mobilisent pour accroître l'offre en logement social dans
notre quartier.
Comité BAILS : Créé en 1993, le Comité de base pour l'action et l'information sur le logement
social d'Hochelaga-Maisonneuve (Comité BAILS HM) contribue à la promotion du logement
social et la défense collective des droits des mal-logés. Leur mission est de promouvoir avec
leur membres le logement social et la défense collective des droits des mal-logés.
Comité d'action de Parc-Extension (CAPE) : Le Comité d'action de Parc-Extension (CAPE) est
le comité logement du quartier Parc Extension. Il informe les citoyen-ne-s sur les droits et
recours en matière de logement. Le CAPE mène également des campagnes de sensibilisation
sur la nécessité et l'importance du logement social.
Ligue 33 : La Ligue 33 est un regroupement dédié à l'amélioration de la qualité de vie dans l'est
de Montréal
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La SPCA de Montréal dénonce l’inaction du gouvernement face aux fermes à fourrure

Montréal, le 3 juin 2025 – Selon des documents obtenus [1] par la SPCA de Montréal [2] via une demande d'accès à l'information, des membres du personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) signalent, depuis 2022, que les conditions dans lesquelles sont élevés les renards et les visons pour la fourrure au Québec « ne répondent pas aux impératifs biologiques des animaux ».
Dans un courriel datant d'octobre 2023, une conseillère en règlementation du ministère affirme que « l'industrie est en déclin, présente une acceptabilité sociale très faible et n'assure pas le bien-être de ces animaux ». S'adressant à la directrice de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux, elle lui demande sa collaboration en vue de « trouver une solution la plus rapide et efficace possible » pour interdire cette industrie au Québec. En réponse à ces révélations, la SPCA somme le gouvernement d'agir rapidement pour mettre fin à la souffrance des animaux élevés pour leur fourrure.
Un rapport faisant état de la situation produit en 2022 par le MAPAQ se conclut avec la recommandation suivante : « Le moment serait tout à fait indiqué pour interdire cette pratique avec des conséquences économiques nulles pour l'industrie. » Les documents précisent qu'« [a]ucune mesure [d'atténuation] n'est possible en fonction des impératifs biologiques des animaux » et que « [c]es animaux ne peuvent pas être gardés dans un contexte d'élevage intensif en respectant leur bien-être. »
« Pourtant, rien n'a bougé dans ce dossier », déplore Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. « Considérant que le MAPAQ lui-même estime que l'élevage d'animaux pour leur fourrure est incompatible avec le bien-être animal et devrait être interdit, il est inadmissible que le gouvernement n'ait pas encore agi. »
Le Québec serait la deuxième province à interdire cette pratique
Plus d'une quinzaine de pays à travers le monde ont déjà interdit les fermes à fourrure. Au Canada, la Colombie-Britannique est devenue la première province à interdire l'élevage de visons pour leur fourrure en 2021. La majorité des Québécois.es souhaitent la fermeture de ces installations au Québec*. À l'occasion d'un débat électoral provincial [3] sur la protection des animaux organisé par la SPCA en 2022, les trois partis d'opposition, soit le Parti libéral du Québec, le Parti Québécois et Québec solidaire, s'étaient engagés à interdire l'élevage de renards et de visons pour leur fourrure.
*Sondage en ligne effectué par Léger pour le compte de TACT auprès de 1015 Québécois et Québécoises du 6 au 9 mai 2022.
Une industrie en déclin
L'industrie de la fourrure, et particulièrement de l'élevage des animaux pour leur fourrure, est en déclin, et ce, à l'échelle mondiale. Le Québec ne fait pas exception : alors qu'en 1982 on enregistrait 226 fermes d'élevage en sol québécois, en 2022, on n'en comptait plus que trois**. Mais à elles seules, ces trois fermes font encore souffrir des milliers d'animaux.
La SPCA de Montréal invite la population à signer une lettre [4]adressée au gouvernement provincial pour réclamer l'interdiction rapide des fermes à fourrure au Québec.
**Statistique Canada, Bilan des visons et renards dans les fermes d'élevage et nombre de fermes (Tableau 32-10-0116-01) (2021), en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210011601 [5] ;
Statistique Canada, Certains types de bétail et volailles, données chronologiques du Recensement de l'agriculture [6] (Tableau
32-10-0155-01) (2022), en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3210015501&request_locale=fr
[7].
[4]
Extraits d'un rapport*** faisant état de la situation produit en 2022 par le MAPAQ
* « Les conditions de gardes ne répondent pas aux impératifs biologiques des animaux. »
* « Garde sur plancher entièrement grillagés dans des conditions d'hygiène pauvres. »
* « L'environnement est très appauvri et ne peut répondre aux besoins de stimulation de prédateurs intelligents. »
* « L'accumulation de fèces et autres odeurs présente un irritant olfactif constant. »
* « Impossibilité pour les animaux d'exprimer des comportements normaux. »
* « Les bâtiments ne sont pas chauffés ce qui peut rendre l'accès à l'eau difficile en hiver. »
* « L'abattage se fait par inhalation pour les visons et par électrocution rectale pour les renards. […] le stress et la douleur
subis par l'animal dans les minutes précédant cette perte de conscience apparaissent comme très élevés. »
Source : SPCA de Montréal, www.spca.com [2]
Fondée à Montréal en 1869, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (mieux connue sous le nom de « SPCA de Montréal ») fut la première organisation vouée au bien-être animal au Canada. La SPCA de Montréal a parcouru un long chemin depuis sa fondation : elle est maintenant le plus grand organisme de protection des animaux au Québec, s'exprimant au nom des animaux partout où règnent l'ignorance, la cruauté, l'exploitation ou la négligence à leur
endroit.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le continuel chantage à l’antisémitisme

Dans l'édition de la fin de la fin de semaine des 31 mai et 1er juin dernier, le billettiste Joseph Facal reprend la rengaine de l'antisémitisme. Il utilise tous les clichés de circonstance, en particulier le plus commode qui consiste à confondre l'antisionisme et l'antisémitisme.
Il utilise la caution intellectuelle de l'essayiste français Alain Finkielkraut pour établir une continuité douteuse entre l'antisionisme et l'antisémitisme, celui-ci défini comme "l'hostilité envers les Juifs, tous les Juifs, où qu'ils soient, moins pour ce qu'ils font que pour ce qu'ils sont, parce qu'ils existent tout simplement."
Ìl n'y a pas moyen de discuter du conflit israélo-palestinien pour ce qu'il est, c'est-à-dire la lutte d'un peuple dépossédé (les Palestiniens) par un autre, certains Juifs, au nom d'une prétendue antériorité qui remonterait à l'Antiquité. Les partisans de l'État hébreu ressortent toujours l'argument éculé de "l'antisémitisme" pour discréditer les partisans de la cause palestinienne.
Il faut le répéter encore et encore : les Juifs ne sont pas une ethnie (des "Sémites"), mais les adhérents à une religion et une philosophie spécifiques, l'un et l'autre ni plus ni moins respectables que les autres croyances. Une mauvaise foi (c'est le cas de le dire) ressort de cette accusation de racisme contre les Juifs et les Juives. Ces derniers forment pas davantage une ethnie que les chrétiens et les musulmans. Il vaudrait mieux parler d'antijudaïsme.
Evidemment, cela n'excuse nullement les persécutions dont Juifs et Juives ont longtemps été l'objet, mais cette situation ne légitime en rien l'établissement forcé de l'État hébreu au détriment de la population palestinienne vivant depuis toujours dans le pays qui allait devenir Israël.
Donc, n'en déplaise à Facal et Finkielkraut, il faut maintenir la distinction entre antijudaïsme et antisémitisme. Les antijudaïstes sont tous opposés par principe à l'État hébreu, mais les antisionistes ne sont pas hostiles aux Juifs, loin de là. Défendre le droit à l'autodétermination des Palestiniens et Palestiniennes, y compris s'il exerce par le recours aux armes, n'a aucun rapport avec la haine des Juifs. Certains de ceux-ci sont même antisionistes au nom de considérations religieuses, philosophiques (ils croient que le sionisme trahit l'authentique judaïsme) ou simplement démocratiques. Y aurait-il donc des Juifs antisémites ? Monsieur Facal a-t-il déjà entendu parler de PAJU (Palestiniens et Juifs unis) ?
Le sionisme est une idéologie nationaliste soutenant que les Juifs ont le droit de revenir s'établir sur la terre où auraient vécu leurs lointains ancêtres et dont ils auraient tous été chassés par les Romains. Les "Arabes", selon cette thèse, auraient alors comblé le "vide" ainsi créé. Outre qu'elle ne résiste pas à une analyse historique rigoureuse, elle néglige le fait que les "Arabes" avaient des droits acquis de longue date lorsque des Juifs d'origine européenne surtout, tenants du sionisme, ont débarqué en Palestine et commencé à la coloniser au début du vingtième siècle. Une entreprise qui a provoqué, comme on pouvait le prévoir, l'opposition et la résistance de la population locale, un phénomène bien compréhensible et qui dure encore. Comme on l'a déjà fait remarquer, il s'agit d'une nouvelle guerre de Cent ans, et qui ne paraît pas près de finir, vu l'expansionnisme israélien.
Facal et ses semblables reprennent toujours l'idée reçue du droit à l'autodéfense d'Israël devant la résistance palestinienne. Ils nient donc le droit à la lutte armée de la population palestinienne en Cisjordanie occupée et de celle en exil. Ils reprennent la vieille tactique qui consiste à délégitimer sa lutte de libération en la criminalisant. Ils passent sous silence que la notion de terrorisme est hautement partisane ; en effet, on est toujours le résistant ou le terroriste de quelqu'un, tout dépendant du point de vue. Au cours de l'Occupation en France, les nazis qualifiaient les maquisards de "terroristes".
Facal ne prend même pas la peine de se pencher sur tout le contexte qui a poussé le Hamas à lancer son offensive du 7 octobre 2023. Elle avait pourtant des motivations valables et considérées comme urgentes par les responsables du mouvement (élu en 2007). De toute manière, Nétanhayou (une "honte nationale" selon Facal) n'innove pas en ce qui concerne les tueries de Palestiniens, résistants comme civils. Il ne fait que reprendre une vieille tradition israélienne, qui remonte en réalité à l'époque où des organisations clandestines juives terrorisaient la population palestinienne pour la pousser à quitter sa terre natale, ce qui fut hélas, largement réussi. Cette violence israélienne antipalestinienne s'est poursuivie par la suite. L'actuel premier ministre israélien ne doit donc pas être vu comme le premier ni le seul responsable des massacres de Palestiniens.
Au cours de toutes ces décennies de guerres épisodiques, infiniment plus de Palestiniens ont perdu la vie ou ont été estropiés par les initiatives militaires israéliennes que l'inverse, ce qui n'a jamais empêché la plupart des classes politiques occidentales (et en particulier l'américaine) de continuer à appuyer cet État oppresseur.
On peut donc parler d'un racisme très réel celui-là, le racisme antipalestinien. Il se cachait (et se dissimule encore) derrière l'argument de la défense du "seul État démocratique du Proche-Orient". Il y en aurait long à dire sur ce jugement de politiciens et d'idéologues vis-à-vis de sociétés dont l'échelle de valeurs diffère de la nôtre. Ils présentent toujours Israël comme un bijou démocratique fiché dans une mer de boue arabe. Les dirigeants occidentaux soutiennent en fait le nationalisme sionisme et non la supposée démocratie israélienne.
On peut conclure de cet examen, plutôt sommaire j'en conviens, que ce qui alarme Finkielkraut, Facal et les autres sionistes occidentaux, est le retournement qu'on observe en Occident du côté des opinions publiques en faveur de la cause palestinienne ; même des classes politiques (comme au Canada, en France et en Grande-Bretagne) ne peuvent plus dissimuler leur embarras devant les excès commis par le cabinet Nétanyahou à Gaza. En Israël, une partie de l'opinion publique s'inquiète de la brutalité de la répression dont fait preuve son gouvernement, laquelle entraîne une baisse évidente de la sympathie des Occidentaux à l'endroit de leur pays. Cette montée de l'esprit critique à l'égard d'Israël pousse les sionistes comme Facal et Finkielkraut à dépoussiérer l'argument usé à la corde de "la haine des Juifs". En fait de malhonnêteté intellectuelle, on peut difficilement trouver pire.
Le retournement des opinions publiques occidentales en faveur des Palestiniens et Palestiniennes annonce peut-être un changement politique décisif.
Il faut plutôt attaquer la haine larvée qui a longtemps sévi chez beaucoup de gouvernements occidentaux à l'encontre de la nation palestinienne.
À quand un commentaire de Joseph Facal à ce sujet ?
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












