Derniers articles

Pour la BBC

De part et d'autre de l'Atlantique, la BBC est dans le collimateur de forces autocratiques décidées à liquider ce joyau public d'une information de qualité, ouverte au grand large et, partant, rempart démocratique essentiel. Que vive la BBC !
Tiré du blogue de l'auteur.
La BBC connaît une menace sans précédent. La cause occasionnelle en est une liberté litigieuse prise au montage, dans un sujet de « Panorama », magazine phare de la télévision britannique.
Diffusé peu avant les élections américaines de novembre 2024, le reportage revenait sur la prise du Capitole du 6 janvier 2021, encouragée, de toute évidence, par un Donald Trump qui refusait de reconnaître sa défaite électorale face à Joe Biden.
Trump s'était adressé aux manifestants factieux. Et la BBC a résumé son propos en accolant, sans le signaler, deux moments du discours de l'autocrate mauvais perdant.
D'où, accusent les détracteurs de la British Broadcasting Corporation, l'impression que M. Trump incitait à l'insurrection, au-delà de ce qu'il fit – le Donald, en mafieux d'extrême droite accompli, sait, pour échapper aux rigueurs de la loi, jouer sur l'implicite et les sous-entendus.
Il y eut certes une bévue professionnelle – il aurait sans doute fallu mentionner la coupe, par le truchement d'un fondu enchaîné, équivalent des points de suspension entre crochets ([…]) du code typographique.
Cette erreur, dénoncée au bout de cinq ans, voilà une dizaine de jours, par le Daily Telegraph (quotidien britannique flirtant avec la droite la plus dure), est montée en épingle par Donald Trump ainsi que par ses alliés au Royaume Uni, bien décidés à en faire la mère de toutes les fautes impardonnables.
Avec une première conséquence : le directeur général de la BBC, Tim Davies, a démissionné, ainsi que la responsable des informations, Deborah Turness.
Bluff yankee
Renversant la réalité – Donald Trump a bien encouragé, à sa façon, les émeutiers du 6 janvier 2021 –, l'actuel pouvoir à Washington saisit l'occasion de mettre en accusation un média influent qu'il ne cesse de trouver en travers de sa route. La BBC dit la vérité en commettant une maladresse ? Il faut l'accuser d'être un propagateur de fausses nouvelles, corrompu, manipulé et manipulateur !
Face au bluff yankee lourd de périls – les avocats de Trump menacent d'un procès avec 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à la clef –, les dirigeants de la BBC ont fait le gros dos, sachant que la droite et l'extrême droite britanniques n'attendaient que ces circonstances pour noyer l'organisme d'information en l'accusant de la rage.
D'autant que l'organe de gouvernance (« board ») de la BBC compte des agents dormants, nommés par Boris Johnson ou autres premiers ministres conservateurs, qui veulent la peau, en définitive, de « Tante Beeb » sur laquelle ils sont censés veiller.
Les conservateurs du royaume s'avèrent aimantés par Reform UK de Nigel Farage, formation trumpienne en plein ascension outre-Manche – et qui présage une grève de la redevance menée par le peuple pour couler le média des élites. Tout ce monde démagogue, converti à des politiques antidémocratiques, s'est engouffré dans la brèche anti BBC.
Les travaillistes au pouvoir n'ont guère moufté, tétanisés par leurs échecs et ayant intériorisé la cadence politique aujourd'hui imprimée par l'extrême droite. Seuls quelques môles de résistance – le Guardian de Londres ou Ed Davey, chef de file des libéraux – sont montés au créneau pour défendre la BBC.
« Bébécé »
Cette situation inquiète bien au-delà du Royaume-Uni, tant la BBC joue un rôle, planétaire, dans l'apport d'une information essentielle, crédible et vitale. En ce qui me concerne, j'écoute d'abord et avant tout Radio 4 pour savoir ce qui se passe dans le monde – toute station française m'apparaît, en comparaison, provinciale.
J'ai pu constater, dans les anciennes démocraties populaires des années 1980, à quel point le service extérieur de la BBC, pour tant d'intellectuels et de citoyens au-delà du rideau de fer, incarnait la seule torchère parmi tant de ténèbres.
Ces dernières années à Mediapart, j'étais parfois moqué par mes camarades d'une rédaction volontiers franglaisante, pour m'obstiner à prononcer non pas « bibici » mais « bébécé ».
Et ce, ne serait-ce qu'en hommage à Julien Carette, comédien titi parisien par excellence, qui pendant l'occupation nazie, au théâtre, avait l'habitude de fouler les planches avec un jeu de mot à propos d'un abbé dont il était question : « l'abbé Gonia », « l'abbé Tise », « l'abbé Rézina », « l'abbé Cane », ou encore « l'abbé Gum ». Un jour, Carette osa « l'abbé Bécé », ce qui froissa l'occupant vert de gris…
Il se trouve qu'au début de ma vie journalistique, existaient encore, dans le Lot par exemple, des paysans qui continuaient à écouter les services français de la BBC, trente-sept ans après la fin de la guerre.
Il se trouve aussi que je n'avais qu'un rêve : travailler, à Londres, au sein de ce service en langue française – aujourd'hui disparu – de la BBC. J'avais passé tous les tests, je m'étais rendu pour un ultime entretien à Bush House, avant que ne me douchât un courrier... discriminatoire : « Your voice is not suitable for short waves. »
Qu'importe, je suis resté fidèle à ce poste, à défaut d'y causer. Jamais je n'oublierai la voix de Nick Robinson, héraut du programme matinal « Today » de Radio 4, lorsqu'il annonça, de Kiev, le 24 février 2022, l'invasion lancée par Poutine : notre avant-guerre avait commencé.
J'ai encore dans l'oreille les sons que parvenait, après vérifications, à diffuser la BBC aux pires moments, génocidaires, exercés par le pouvoir de Benjamin Netanyahou à l'encontre de l'entière population palestiniennes de Gaza. Nous y étions, malgré l'interdiction de travailler sur place imposée aux journalistes par Israël.
C'est cela que ne pardonnent pas à la BBC ses contempteurs et ses ennemis acharnés. Leur sont restées en travers de la gorge les interventions à l'antenne de Jeremy Bowen, qui décrit si parfaitement la situation déplorable, à partir le plus souvent de Jérusalem. Il transmet l'impalpable, soudain palpable, sur un ton navré, implacable ; objectif tout en exposant l'horreur, le cynisme des uns et la déréliction des autres.
Dans un monde qui se délite et fonce vers tant de catastrophes démocratiques ou géopolitiques, nous n'avons et n'aurons jamais autant besoin de la BBC.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France - Instabilité politique : agir pour qu’il ne soit pas trop tard

La crise mondiale du capitalisme et sa dimension écologique provoquent une crise politique forte. Dans les pays du Nord global et en France en particulier, la bourgeoisie cherche à finir de solder violemment et à grande vitesse les comptes du compromis social de l'après Seconde Guerre mondiale.
Tiré de Inprecor 738 - novembre 2025
12 novembre 2025
Par Elsa Collonges
Le premier ministre Sébastien Lecornu avec d'autres membres du gouvernement le 16 octobre 2025. © Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
La lutte des classes ressemble aujourd'hui davantage à un mélange de la fin du 19e siècle et des années trente qu'à ce que nous avons connu dans les cinq dernières décennies. Il nous faut construire le front unique à la fois pour reconstituer la classe pour soi et pour lutter contre la montée de l'extrême droite, c'est-à-dire combiner des éléments de clarification avec une politique unitaire. Les acquis historiques et théoriques de notre courant politique constituent des outils qu'il s'agit aujourd'hui de s'approprier collectivement, d'actualiser et de mettre en œuvre.
Si la croissance économique mondiale est divisée par deux par rapport aux années 60, elle est divisée par six en Europe et la France devrait péniblement atteindre 0,8 % cette année, selon la dernière prévision de l'INSEE (1).
Crise économique, dette et transfert massif d'argent public vers le privé
Les ressorts utilisés précédemment par le capitalisme européen pour maintenir son taux de profit sont inopérants aujourd'hui, que l'on pense à l'augmentation de la productivité du travail ou à l'extension de sa sphère impérialiste. D'autres mécanismes sont donc mis en œuvre avec une efficacité moindre et un coût social élevé pour les classes populaires.
Pour maintenir la rentabilité du capital, l'État français a opéré ces dernières années un transfert massif d'argent public. D'après une note d'ATTAC France (2) sur la période 2018-2023, les baisses des prélèvements (cotisations sociales, impôts, etc.) représentent plus de 300 milliards d'euros cumulés, qui contribuent pour près de 35 % à la hausse de la dette de la France.
Du côté des aides publiques versées aux entreprises, une commission d'enquête du Sénat les estime à plus de 211 milliards d'euros pour la seule année 2023 (3). Le syndicat Solidaires Finances publiques évalue à plus de 80 milliards d'euros l'évitement illégal de l'impôt (4).
Ces estimations vont complètement à contresens des discours gouvernementaux qui attribuent systématiquement cette dette à l'envolée des dépenses, au « modèle social français » prétendument trop généreux. Ce « désaccord » d'interprétation recouvre un enjeu idéologique majeur et est au cœur des affrontements sociaux des dernières années autour de la Sécurité sociale.
En attendant, cette hausse de la dette et les difficultés du pouvoir à boucler un budget ont conduit à la dégradation de la note de la France par diverses agences de notation, dégradation qui elle-même alimente l'instabilité économique et l'augmentation du coût de la dette.
Crise de l'impérialisme français, crise industrielle et course à la guerre
Dans le contexte de crise globale, l'accès à l'énergie et aux ressources minières est un enjeu majeur. Que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, les volontés de contrôle et la réorganisation des impérialismes exacerbent les tensions, avec des conséquences terribles pour les peuples, que ce soit à Gaza, en Ukraine, au Soudan ou en RDC pour ne citer que ceux-là. La place que cherche à prendre la Chine sur le plan industriel et technologique pousse dans leurs retranchements tant la puissance étasunienne que les pays de la vieille Europe.
En France, malgré la perfusion sous laquelle sont placées les entreprises, celles-ci peinent à tirer leur épingle du jeu. Ce sont aujourd'hui probablement plus d'un demi-million d'emplois qui sont en cours de disparition alors que le pays compte déjà plus de cinq millions de chômeur·ses. Les quelques « sauvetages » d'emplois réalisés par une réorientation dans le militaire comme aux Fonderies de Bretagne ou à Renault ne pourront endiguer la vague, à moins d'une réorientation bien plus nette vers une réelle économie de guerre.
Face à la crise de la production industrielle de masse et à la concurrence internationale acharnée, l'industrie militaire et de défense est une des solutions envisagées aujourd'hui par les puissances impérialistes (5). La tendance au réarmement était déjà engagée en France puisque le budget de la défense était passé de 32 milliards à 50 milliards (hors pensions) entre 2017 et 2025. L'objectif de 3,5 % du PIB consacré aux dépenses militaires fixé par Macron représenterait une augmentation très importante de l'ordre de 40 milliards (6).
Transfert de la crise globale dans le champ politique
Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, ce n'est pas la crise politique qui déstabilise l'économie française. Bien au contraire, cette crise politique est la conséquence directe de la crise du capitalisme, de la volonté féroce des possédants d'accaparer toujours davantage les richesses produites et des contradictions à l'œuvre dans la bourgeoisie sur les moyens d'y parvenir (7).
La France est un des pays européens où les classes populaires restent encore structurées de manière significative. Les défaites accumulées au cours des trois dernières décennies pèsent lourdement, mais le fait qu'elles n'aient été concédées qu'après de dures batailles a permis de maintenir un niveau de conscience et de combativité qui a considérablement affaibli le pouvoir politique.
Alors que Macron est sur la fin de son deuxième mandat, il a usé jusqu'à la corde le filon du gestionnaire se plaçant au centre. Tout d'abord parce que les politiques menées depuis près de dix ans ont clairement montré le camp qui est le sien et ensuite parce que chacune des formations politiques espère tirer son épingle du jeu en se désolidarisant de son bilan.
Un réel risque d'accession au pouvoir de l'extrême droite
Le développement des discours racistes et notamment islamophobes mais aussi sécuritaires depuis les attentats de 2001 a pavé la voie au Front national devenu Rassemblement national. La droite est évidemment à l'offensive sur ces thèmes mais une partie de la gauche contribue aussi au développement des idées nauséabondes avec des discours sécuritaires et/ou protectionnistes/nationalistes. Le recul des combats antiracistes et internationalistes en lien avec les désillusions d'une part importante de la population racisée vis-à-vis de la gauche institutionnelle pèse gravement.
S'appuyant sur le désespoir généré par la situation sociale, le Rassemblement national réalise des scores importants dans les classes populaires. Mais lors des dernières échéances électorales, c'est surtout un élargissement de sa base sociale que l'on a pu constater dans les couches intermédiaires (8). En parallèle, un certain nombre de grands patrons ne cachent plus leur sympathie pour les idées d'extrême droite, patrons qui progressivement étendent leur influence dans les médias par des rachats divers.
Du point de vue de l'influence croissante de l'extrême droite, on est dans un contexte qui ne va pas sans rappeler les années 30.
Une gauche éclatée
De l'autre côté de l'échiquier politique, l'extrême gauche révolutionnaire est extrêmement morcelée et pour une part repliée sur elle-même. Être partie prenante du Nouveau Front populaire (NFP) lors des élections législatives de juin 2024 a permis au NPA-L'Anticapitaliste de porter un discours radical à une échelle large, les autres organisations d'extrême gauche étant complètement invisibilisées du fait de leur orientation incompréhensible face au danger de l'accession au pouvoir de l'extrême droite.
Pour ce qui est des forces plus importantes, l'unité du NFP n'a pas perduré et la gauche institutionnelle se retrouve à nouveau éclatée entre un pôle social libéral affaibli – incarné essentiellement par le PS et prêt à des compromis importants pour maintenir ses positions institutionnelles – et La France insoumise (LFI), qui apparaît comme une force très radicale dans un contexte de recul de la conscience. C'est elle qui canalise aujourd'hui très majoritairement les aspirations des catégories les plus conscientes des classes populaires. Mais son ancrage militant réel reste faible proportionnellement à ses scores électoraux et les illusions institutionnelles sont très fortes parmi ses militant·es et ses sympathisant·es. De plus, l'absence de structuration démocratique est un obstacle important à l'élargissement de cette force. LFI est aujourd'hui la seule force politique qui a la possibilité d'impulser des mobilisations de masse mais la façon dont elle l'envisage, en maintenant son hégémonie sans partage, empêche leur développement et freine la construction unitaire à la base et les possibilités d'auto-organisation.
Des affrontements sociaux massifs et réguliers mais défaits
Après le compromis des dites Trente glorieuses – période finalement bien courte dans l'Histoire – le choc pétrolier et la crise structurelle ont conduit rapidement la bourgeoisie à élaborer une stratégie pour reprendre l'offensive. Les années 80 et 90 ont vu le démantèlement des grandes concentrations de travailleur·ses et l'élaboration de nouvelles modalités de management individualisant les salarié·es. Les attaques se sont multipliées pour diminuer le « coût du travail » : baisses de salaires, attaques contre le salaire socialisé, licenciements, augmentation des cadences, etc.
De 1995 à 2023, les différents gouvernements n'ont cessé de vouloir détruire notre système de protection sociale pour reprendre la main sur des masses d'argent socialisé qui leur échappent, mais aussi pour jeter dans l'arène du monde du travail des millions de personnes qui auraient dû bénéficier de l'assurance chômage, maladie ou être à la retraite.
Les travailleur·ses ont été des millions dans la rue pour défendre notre système de retraites mais, à part la victoire partielle de 1995, toutes les autres batailles se sont soldées par des défaites. La faiblesse de la grève, en particulier dans le secteur privé, la difficulté à enclencher la grève reconductible dans des secteurs significatifs, ont pesé lourdement. Les stratégies des organisations syndicales n'ont pas aidé mais elles sont aussi le reflet du recul de la conscience et de l'organisation de notre classe, de l'absence de confiance dans ses propres forces faute d'expériences de victoires.
La combativité et la radicalité existent, comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaune (GJ) en 2019 et aussi dans de nombreux secteurs syndicaux comme dans les mobilisations de la jeunesse, des quartiers populaires, féministes ou écologistes qui tissent de plus en plus de liens avec le mouvement ouvrier traditionnel. Mais dans tous les cas, l'auto-organisation des mobilisations n'a pas été suffisante pour rattraper des décennies de reculs. Notons positivement que la défiance vis-à-vis des organisations syndicales est plutôt en recul à la fois grâce aux expériences de mobilisations mais aussi à l'unité qu'elles ont réalisée dans la dernière période.
Cette aspiration à l'unité reste extrêmement forte tant sur le plan syndical que politique. Elle repose sur la compréhension de la nécessité de l'unité de notre camp social pour gagner et est d'autant plus forte que le niveau de conscience et de combativité ne pousse pas au dépassement des stratégies de compromis des organisations les moins combatives.
Une stratégie pour reconstruire la conscience de classe
Face à l'attentisme des travailleur·ses et aux stratégies timides des intersyndicales, la tentation est grande de s'appuyer sur les secteurs les plus radicalisés pour faire des démonstrations. Pourtant, l'histoire a montré à de nombreuses reprises au cours du 19e siècle que les raccourcis n'existent pas et que seule la construction de luttes de masse en capacité de bloquer l'économie permet d'obtenir des avancées significatives. Tant en 1995 (mobilisation pour la Sécurité sociale et les retraites) qu'en 2003 (alignement des retraites du public sur le privé) ou en 2010 (défense des retraites à nouveau) ou encore durant la mobilisation de la jeunesse contre le CPE en 2006, de réels cadres d'auto-organisation ont existé à différentes échelles, des cadres qui ont été malheureusement beaucoup plus faibles dans les mobilisations qui ont suivi. L'apparition des réseaux sociaux et des modes de communication dématérialisés sont des éléments qui participent de cette désaffection des cadres de discussion et de prise de décision sur les lieux de travail. S'ils permettent une circulation beaucoup plus rapide et plus large des informations, ils renvoient à un rapport individualisé, sans débat, à ces informations et rendent la présence en réunion facultative pour y accéder.
Le recul des cadres d'auto-organisation rend difficile le partage d'expérience et donc l'émergence de préoccupations et de revendications qui solidifient les mobilisations et homogénéisent les secteurs. La solidarité, la détermination et la colère collective se renforcent dans l'enthousiasme des moments partagés en assemblée générale, autour de piquets de grève encore plus que dans les défilés. Reconduire la grève se fait avant tout dans la chaleur d'une assemblée générale et, sans elle, il est très difficile de prolonger une grève de 24 heures.
Les cadres d'auto-organisation permettent également de faire progresser, d'homogénéiser et d'être au plus près du niveau de conscience, y compris dans les phases d'accélération. Celles-ci se cristallisent ces dernières années sur des éléments politiques ou démocratiques comme la question des retraites des femmes en 2019, l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites par décret en 2023, ou encore la répression violente de l'État lors du mouvement des Gilets jaunes. Les cadres d'auto-organisation permettent de partager une compréhension de l'affrontement capital/travail à une échelle large, de le retranscrire dans des revendications concrètes et également d'expliciter l'affrontement avec l'appareil d'État défendant les classes dominantes.
Faire émerger des revendications sectorielles et construire l'auto-organisation sont donc des taches essentielles des militant·es révolutionnaires.
Pour que notre classe prenne confiance en sa force, il est essentiel qu'elle fasse à nouveau des expériences de luttes victorieuses, même partielles ou locales, mais significatives à une échelle de masse. De ce point de vue, le recul du gouvernement Lecornu, obligé de décaler la mise en application de la réforme des retraites, doit être un encouragement à pousser notre avantage face à un pouvoir illégitime et très affaibli.
Construire le front social et politique
La mobilisation de cette rentrée est partie immédiatement sur des mots d'ordre très globaux et politiques : refus du budget présenté par le Premier ministre François Bayrou et omniprésence du mot d'ordre « Macron dégage ! ». La démission du gouvernement et la crise institutionnelle durant plusieurs semaines ont partiellement désarmé le mouvement, faute de revendications concrètes en l'absence de budget concret et d'ennemi auquel s'opposer. Il s'agit aujourd'hui de prendre le mouvement là où il en est, c'est-à-dire pas seulement focalisé sur une revendication précise du type « retrait de la réforme » mais sur une compréhension plus globale des enjeux et sur un affrontement direct avec le pouvoir en place. En effet, derrière la revendication de retrait du budget de Bayrou, il y avait non seulement le refus de travailler deux jours supplémentaires, mais aussi la défense des services publics et de la Sécurité sociale, et également l'opposition à l'augmentation du budget de la défense.
Cette maturité du mouvement ne doit cependant pas nous faire oublier les difficultés, dans un contexte de rapport de force très dégradé. En premier lieu, nous ne devons absolument pas sous-estimer la menace de l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il faut comprendre comment cela pèse dans les dynamiques des différentes organisations : les recompositions en cours à droite, la peur d'une partie de la gauche d'un basculement vers l'extrême droite en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les réticences de l'intersyndicale à pousser la crise…
Cela nous impose d'être extrêmement clairs sur notre positionnement politique. L'unité de notre camp social face à l'extrême droite est un enjeu crucial pour la grande majorité de la population et en particulier pour les personnes racisées, les femmes, les LGBTI, les militant·es… Nous devons mener la bataille pour cette unité en tant qu'aile la plus radicale, ce que nous avons fait en nous inscrivant dans la campagne des législatives de juin 2024. Les divisions actuelles au sein de la gauche et les calculs électoralistes des un·es et des autres font craindre qu'en cas de dissolution de l'Assemblée, l'extrême droite ne trouve cette fois-ci pas d'obstacle à son accession au pouvoir. Le rejet de la motion de censure du gouvernement a reporté cette échéance mais il est urgent de mettre nos forces dans cette bataille.
Garder une perspective révolutionnaire dans un contexte difficile
Au-delà de ces enjeux immédiats, en tant qu'organisation révolutionnaire, nous réfléchissons aux formes que pourrait prendre la contestation du pouvoir en place par les travailleurs·ses, quelles cristallisations politiques et organisationnelles pourraient permettre à notre classe de franchir des étapes significatives. En effet, celles-ci sont ballottées, très rapidement, entre d'un côté un rejet de toutes les organisations, une contestation du pouvoir dans la cadre du système, et de l'autre un fort suivisme vis-à-vis des directions syndicales ou des appareils politiques réformistes. C'est pour cela que nous portons la perspective d'un gouvernement des travailleur·ses, un gouvernement de rupture qui mette en œuvre les revendications du mouvement social, en formulant les bases de son programme à partir de la réalité du mouvement actuel. L'objectif est de faire le pont entre les mobilisations et la colère contre le système et la nécessité de formuler une perspective politique, que les masses concrétisent essentiellement d'un point de vue institutionnel. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est capital de lier le mot d'ordre de gouvernement de rupture avec des revendications radicales, voire anticapitalistes, sur les salaires, la réquisition des banques, l'échelle mobile des heures de travail, l'ouverture des frontières, etc.
Dans le cadre d'une mobilisation de masse qui viendrait à contester réellement le pouvoir, le présidentialisme et le fonctionnement des assemblées parlementaires, il nous faut en même temps populariser le mot d'ordre d'assemblée constituante, rejetant la 5e République et remettant en question tous les fondements de la société, en ayant la préoccupation que ce mot d'ordre ne serve pas à faire rentrer dans le champ institutionnel le débordement des masses et qu'il trouve écho dans les milieux mobilisés, qu'il renforce la dimension politique de l'auto-organisation.
Dans tous les cas, la reconstruction d'un projet politique global, écosocialiste, est à l'ordre du jour, quelque chose qui vaille le coup de se battre, qui rompe avec le défaitisme et permette à notre classe de rêver à nouveau à des jours meilleurs pour y puiser la force de se battre !
Le 24 octobre 2025
Notes
8. « Sociologie des électorats - Législatives 2024 », 30 juin 2024, IPSOS.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Serbie : Le soulèvement après l’effondrement à Novi Sad

Un an après l'effondrement de la verrière de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts, le paysage politique serbe a été radicalement bouleversé par un mouvement social étudiant d'une intensité sans précédent depuis des décennies. Une délégation de la Quatrième Internationale, composée de camarades de la GA (Gauche anticapitaliste, Belgique) et du NPA-A (Nouveau Parti Anticapitaliste, France), est allée à la rencontre de militants politiques, syndicaux, associatifs et étudiants, afin de tisser des liens de solidarité avec eux et de rapporter leurs paroles dans nos pays.
https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9254
9 novembre 2025
Violence, corruption, népotisme, nationalisme : ces mots ne suffiraient probablement pas à caractériser le régime policier du président serbe Aleksandar Vučić, à la tête du pays depuis 2012. Son emprise sur les institutions et le patrimoine foncier du pays est tentaculaire. Pour obtenir un emploi de base dans de nombreux secteurs, ou même un simple logement, il est fortement recommandé de prendre sa carte du parti au pouvoir, le SNS (Parti progressiste serbe), et de participer à ses réunions de propagande. De nombreux Serbes se considèrent comme « sous occupation ». Et ils parlent d'ingérence impérialiste venant de l'Est comme de l'Ouest, qui ferme les yeux sur la réalité du régime.
Les étudiants, moteur de la résistance
La catastrophe de Novi Sad, symptôme de la corruption qui a dévasté les infrastructures économiques du pays, a fait office de détonateur. Le personnel enseignant, dépassant son corporatisme traditionnel, a lancé un mouvement de grève. Il a rapidement été rejoint, et massivement, par des étudiants de tout le pays. Organisés en assemblées appliquant des pratiques démocratiques strictes, ils ont mis en place de longues marches à travers tout le pays. De village en village, ils sont accueillis comme des héros par les habitants. La majorité de la population a soutenu avec enthousiasme le mouvement de ceux qu'ils appellent « nos enfants ».
L'un des symboles les plus frappants et émouvants a été la rencontre entre les étudiants de Novi Pazar, une ville à majorité musulmane et bosniaque, et les étudiants du reste du pays : une scène d'une force symbolique incroyable dans cette région d'Europe hantée par une guerre civile génocidaire. « C'était la première fois que je me sentais citoyen serbe », a déclaré un étudiant de Novi Pazar à son arrivée à Belgrade.
Le mouvement envisage de se lancer dans la bataille électorale
Depuis septembre, le mouvement peine à trouver un second souffle ; les blocages des universités ont cessé presque partout. Manque de coordination politique ? Le mouvement s'essouffle-t-il sur le long terme ? Convergence ratée avec le mouvement syndical ? Relation conflictuelle avec une opposition politique discréditée ? Intensification de la répression par le régime ? Blocage structurel lié à la position de la Serbie dans l'économie mondiale ? Les explications de l'impasse actuelle sont nombreuses et témoignent de la richesse des débats stratégiques qui traversent la gauche serbe.
Pour trouver un exutoire politique, le mouvement étudiant, qui réclame le départ de Vučić et la tenue d'élections libres et démocratiques, a choisi de présenter une liste électorale indépendante. Une liste étudiante qui s'est engagée dans un travail programmatique et organisationnel de grande envergure, en collaboration avec le reste de la population et la société civile. Certains sondages lui attribuent plus de 45 % des intentions de vote. Le régime l'a bien compris, rejetant toute élection anticipée et jouant à fond la carte de la pourriture et de la répression. Nous les soutiendrons dans ce combat périlleux et leur exprimons toute notre solidarité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Travailleurs/travailleuses, vous êtes important·es pour l’avenir de l’Ukraine (appel)

L'Ukraine se trouve actuellement dans une impasse due à un néolibéralisme corrompu qui retarde la fin de la guerre et maintient la population dans la pauvreté.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/17/travailleurs-travailleuses-vous-etes-important%c2%b7es-pour-lavenir-de-lukraine-appel/
Le fonctionnement de toutes les institutions publiques est imprégné par la recherche du profit personnel, l'absence de planification et le manque de transparence vis-à-vis du grand public. Un tel système ne peut pas être efficace. Les travailleurs/travailleuses ukrainien·nes résistent massivement et avec abnégation à l'ennemi, ce qui contraste avec le modèle d'État qui dépend d'un cercle restreint de personnes et qui est incapable de veiller au bien commun.
Les ressources du pays sont épuisées non seulement par les occupants, mais aussi par des hommes d'affaires avides qui tirent profit des besoins essentiels de la société, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'industrie de la défense. La réaction de la société à ces abus a donné lieu à des manifestations en juillet 2025 avec leurs slogans anti-corruption.
Le soi-disant « remaniement » du gouvernement n'a fait qu'accélérer le risque d'adoption de lois favorables aux oligarques. L'arrivée à des postes clés de Yulia Svyrydenko, Oleksiy Sobolev, Taras Kachka et d'autres adeptes du capitalisme effréné de la Kyiv School of Economics (KSE) en est une démonstration évidente. La plus grande menace provient du ministère dirigé par M. Sobolev, qui cherche à priver les travailleurs/travailleuses de leurs droits en élaborant un projet de Code du travail et qui, dans le même temps, s'est arrogé des pouvoirs dans le domaine de l'écologie, facilitant ainsi l'exploitation des ressources naturelles par les entreprises. Notre pays devient peu propice à la vie, et les espoirs d'une reconstruction équitable s'amenuisent de jour en jour.
Cette situation reflète les tendances mondiales. La montée en puissance des forces réactionnaires dans le monde et le comportement inapproprié de l'administration américaine ont conduit toutes et tous les Ukrainiens à ressentir un manque de sécurité. Les interruptions dans la livraison d'armes destinées à repousser l'agresseur russe modifient l'équilibre mondial des forces en faveur des oppresseurs. Cependant, la sécurité ne se résume pas à la question de l'armement. Elle concerne également la sécurité sociale, le fonctionnement stable des infrastructures essentielles, une rémunération équitable pour un travail consciencieux, ainsi que la protection à long terme de celles et ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Tout cela constitue le fondement sur lequel peut reposer une défense efficace.
La défense et le bien-être sont les principales fonctions de l'État. Le capital privé n'y trouve aucun intérêt en raison de son orientation vers le profit et de sa volonté de verser le moins possible au budget. Malgré les espoirs du peuple ukrainien de voir l'État se soucier davantage de la résolution des problèmes des citoyens, c'est le contraire qui s'est produit. Les scandales se succèdent, impliquant des hommes d'affaires qui tirent profit de tout, y compris de la production d'armes. Tout cela est le résultat de la centralisation du pouvoir, de la dissimulation d'informations sous le « brouillard de la guerre » et de l'érosion des principes démocratiques. Malheureusement, l'État n'agit pas comme un bouclier social pour le peuple, mais comme une superstructure corrompue. Le manque de soutien est ressenti de manière aiguë par tous et toutes, en particulier les militaires, les personnes contraintes de quitter leur foyer, ainsi que celles qui élèvent les nouvelles générations d'Ukrainien·nes·en cette période d'incertitude.
La classe ouvrière, dont le potentiel politique n'est pas exploité, a été et reste une force massive capable de changer le cours de l'histoire à un moment critique. Les masses laborieuses ont été écartées de la politique, devenant les jouets des classes dominantes. Si les travailleurs/travailleuses s'unissent, elles et ils peuvent changer les règles de la politique et, à terme, retirer le pouvoir aux élites actuelles. En effet, l'influence sociale des cheminot·es, du personnel soignant, des énergéticien·nes et des enseignant·es s'est considérablement accrue grâce à leur importante contribution au bien-être. La vie quotidienne dépend de l'accomplissement rigoureux de leurs devoirs, c'est pourquoi il sera difficile pour les autorités de contester leur opinion.
À l'inverse, le capital ne joue aucun rôle dans le maintien à flot de la société. Le budget de l'État n'est pas alimenté par les impôts sur les bénéfices : ceux-ci ont toujours été dissimulés dans des paradis fiscaux et, depuis le début de l'invasion, ils ont chuté en raison de l'effondrement des exportations.
Le budget repose en grande partie sur les impôts sur les salaires (13,11% des recettes), qui financent la défense, ainsi que sur l'aide internationale, qui financent le secteur social. Le rôle des secteurs d'infrastructure critiques, qui fonctionnent en dehors de la logique du marché mais sont essentiels à la stabilité sur le champ de bataille et à l'arrière, s'est accru.
Les travailleurs et les travailleuses employé·es dans ces secteurs sont souvent victimes des attaques russes, mais le Fonds de pension ukrainien ne leur verse pas les indemnités promises en raison de problèmes bureaucratiques liés à l'obtention du statut d'infrastructure critique. L'existence de ce problème annule toute prétention à une politique axée sur l'humain.
Le faible niveau de soutien aux retraité·es et aux personnes handicapées, compte tenu des énormes volumes d'aide financière internationale, est inacceptable. Pour justifier les normes sociales médiocres, des clichés idéologiques erronés sur la menace d'une montée des « sentiments paternalistes » (tant au sein du pouvoir que dans le camp de l' « opposition ») sont largement répandus.
L'absence d'évolutions positives dans le domaine de l'aide sociale, combinée à de faibles salaires, entraîne un exode massif vers l'étranger, en particulier chez les jeunes de moins de 22 ans.
Pendant des décennies, l'État s'est adapté aux investisseurs et aux hommes d'affaires, car ils génèrent des profits. Cependant, il devient évident qu'il est actuellement impossible de réaliser des profits dans une économie dévastée par la guerre. Il est temps pour de larges couches de la population de faire valoir leurs besoins, car tout repose sur elles. Le niveau de bien-être ne sera pas déterminé par l'efficacité économique, mais par la mesure dans laquelle la population exigera d'être traitée avec humanité. L'influence disproportionnée que l'oligarchie continue d'exercer sur le pouvoir doit disparaître afin de ne pas entraver le développement de l'Ukraine.
Considérant que seule la suppression du capitalisme permettra de garantir pleinement les intérêts des travailleurs et des travailleuses, le Sotsialnyi Rukh souligne la priorité des revendications suivantes :
1. Une économie commune pour une victoire commune. Nationalisation sous contrôle ouvrier des secteurs de l'infrastructure, de l'industrie de défense et des entreprises exploitant les ressources minérales. Un quota de 50% pour les représentant·es des collectifs de travailleurs/travailleuses au sein des conseils de surveillance de ces entreprises constituera un garde-fou contre les abus de corruption et l'usurpation du pouvoir par les serviteurs du capital. Cela permettra de contrôler les ressources pouvant être utilisées pour la défense. La socialisation des entreprises du secteur énergétique permettra, entre autres, de prévenir la crise écologique qui se traduit par la détérioration de la qualité de l'eau, des sols et de l'air. Il est particulièrement nécessaire de nationaliser à 100% le complexe militaro-industriel afin d'empêcher les particuliers de tirer profit des commandes et d'assurer des conditions de travail stables au personnel. Pendant la période de l'état d'urgence, il ne peut y avoir de marché de location de logements, du médicament ou de technologies militaires : tous les processus doivent être réglementés par des organismes publics indépendants, qui ne sont pas guidés par la recherche du profit. Il convient de refuser le financement des établissements médicaux sur la base de critères d'efficacité, car cela conduit à transformer l'aide médicale d'un droit garanti en une marchandise. L'expansion du secteur public dans l'économie constituera un pont vers le plein-emploi, à condition que les services de l'emploi et les syndicats coopèrent. Le système fiscal doit remplir une fonction sociale en luttant contre la différenciation excessive des richesses par le biais de l'imposition des fortunes.
2. Relancer l'État social. Une guerre prolongée doit être considérée comme un facteur de risque social pour l'ensemble de la population, et la protection sociale doit être reconnue comme une obligation de l'État. Les organismes de protection sociale doivent être proactifs et proposer eux-mêmes leur aide aux familles des militaires, aux travailleurs/travailleuses sinistré·es et aux couches vulnérables de la population, avant même que ces personnes ne s'adressent à eux. Les logements neufs inoccupés doivent être mis à la disposition des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des militaires tant que la crise du logement persiste. En temps de guerre, l'État ne peut pas imposer à la population le paiement des dettes liées aux services publics et l'augmentation des tarifs. La période de résidence dans les zones frontalières, ainsi que le statut de personne déplacée à l'intérieur du pays après le 24 février 2022, doivent être pris en compte comme période d'assurance, indépendamment de l'emploi officiel. Afin d'éviter le risque d'un manque éducatif de la population, il convient d'encourager le travail dans l'éducation, en garantissant à tous les enseignant·es un salaire au moins égal à la moyenne nationale et l'accès à des abris sûrs et confortables. Il convient de mettre en place un suivi indépendant des pertes éducatives, en particulier dans les régions proches du front.
3. Renaissance de la démocratie de masse. Les autorités doivent écouter les citoyen·nes lors de la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux, en créant de nouvelles institutions de représentation publique et en élisant des représentants du personnel pour gérer les entreprises. Il est nécessaire de garantir aux travailleurs/travailleuses le droit à un congé payé annuel de 14 jours pour des activités bénévoles, afin qu'elles et ils puissent soutenir l'armée et résoudre les problèmes sociaux. Le Parlement, dont le mandat a expiré, n'a pas le droit d'examiner les projets de loi pour lesquels les représentant·es de la société civile ont exprimé des craintes quant à la restriction de leurs droits et libertés. Il convient de garantir la force juridique des pétitions adressées aux autorités publiques. Des élections doivent être organisées dès que possible après la levée de l'état d'urgence. Afin d'empêcher l'arrivée au pouvoir de politiciens qui se sont discrédités par leurs liens avec les oligarques, il convient de supprimer les cens de propriété, d'abaisser le seuil d'éligibilité des partis politiques à 1% et de garantir la liberté de se présenter aux élections. La résolution des problèmes sociaux quotidiens doit devenir à la fois un objectif politique et une incitation à une plus large participation des masses à la vie politique. Les contradictions accumulées dans la société doivent être résolues par le renforcement de la concurrence politique réelle, à condition que les droits humains et le pluralisme idéologique soient respectés.
Ce sont précisément les travailleurs/travailleuses – ouvrier·es, enseignant·es, médecin·es, cheminot·es, énergéticien·nes – qui doivent devenir le moteur du renouveau de l'Ukraine. Vous créez toute la richesse du pays, vous le défendez, vous avez le droit de décider comment le diriger.
Le Sotsialnyi Rukh appelle toutes et tous les travailleurs à s'unir. Créez des syndicats dans vos entreprises. Exigez de participer aux décisions qui vous concernent. Organisez des conseils dans vos communautés. N'attendez pas l'autorisation d'en haut – prenez ce droit vous-mêmes.
Seules une organisation massive et la solidarité permettront de remporter la guerre et d'assurer une reconstruction équitable après celle-ci. L'histoire montre que toutes les transformations sociales importantes ont été obtenues par la lutte venue d'en bas, et non accordées par le haut.
Approuvé le 28 septembre 2025 lors de la conférence annuelle du Mouvement social.
Sotsialnyi Rukh
Traduction PLT
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Après la manifestation du 13 septembre 2025, état des lieux de la montée du fascisme en Angleterre

Le 13 septembre 2025, une manifestation appelée par une figure notoire de l'extrême droite fasciste anglaise, Tommy Robinson (Stephen Yaxley-Lennon, de son vrai nom) a réuni entre 110 000 et 150 000 personnes à Londres. Par son ampleur, sans précédent en Grande-Bretagne, cet évènement marque un saut qualitatif dans la capacité de l'extrême droite à mobiliser dans la rue, et constitue un nouveau symptôme de la résurgence fasciste d'échelle internationale.
Thierry Labica, membre de la rédaction de Contretemps, revient ici sur les origines et les significations de cette manifestation et de la montée du fascisme qu'elle signale, dans un pays où l'extrême-droite – bien que présente depuis longtemps – est longtemps demeurée groupusculaire.
12 novembre 2025 tiré d'Europe solidaire sans frontières
La manifestation du 13 septembre est d'autant plus significative qu'elle s'inscrit dans une dynamique forte de mobilisations d'extrême droite dans le monde anglophone. À Londres même, à l'appel du même « influenceur », 30 000 personnes avaient déjà défilé en juillet 2024. Des manifestations de même nature ont eu lieu en Irlande à plusieurs reprises depuis 2023 (récemment encore, en juin et octobre 2025 à Cork et à Dublin), ainsi qu'en Irlande du Nord (Belfast, mars 2025), ou encore, en Nouvelle Zélande [1], au cri de « foi, drapeau, famille » et « pas assimilation, pas d'immigration ») et en Australie (le 1er septembre 2025).
À ces manifestations, il faut ajouter les journées d'émeutes, d'attaques racistes contre des centres d'hébergement de demandeurs d'asile, des commerces : ce fut le cas à Dublin en novembre 2023, dans une douzaine de villes à travers le Royaume Uni fin juillet-début août 2024, ou plus récemment en Irlande du Nord (Ballymena) en juin 2025. [2]
Parmi les divers facteurs et temporalités à prendre en compte, on pense à la trajectoire historique d'une vingtaine d'années dans laquelle l'épisode s'inscrit et vient faire date : la focalisation raciste sur l'immigration doit peu aux représentants de l'extrême droite elle-même et beaucoup à la violence des discours politiques et médiatiques et à l'inflation législative toujours plus agressivement « hostile » [3] qui s'en est autorisée depuis environ quinze années. Autant préciser d'emblée qu'en la matière, les responsabilités travaillistes à partir de la fin des années 2000 sont immenses.
On pense ensuite à la conjoncture politique, nationale et internationale, dont la manifestation du 13 septembre est une cristallisation : crise profonde des forces du bipartisme historique (travaillistes et conservateurs), audience de la formation d'extrême droite Reform UK dirigée par Nigel Farage et Richard Tice, et aux deux années de métabolisation post-libérale du fascisme génocidaire qui sévit en Palestine au nom de « nos valeurs occidentales », sur fond de dégradation sociale ininterrompue.
Qui était présent à la manifestation fasciste du 13 septembre ?
Mais pour commencer, un aperçu du personnel réuni et de ses principaux thèmes – aussi prévisibles soient-ils – paraît nécessaire. On voudra ensuite attirer l'attention sur certaines, au moins, des conditions matérielles de l'évènement ; les forces et les ressources qui en déterminent la possibilité, les figures, et qui en définissent le contenu et l'expression.
Placée sous la bannière de la « liberté d'expression », autrement dit, du bon sens pluraliste et démocratique, l'évènement a réuni nombre de fractions de l'extrême droite britannique, mais également européenne, australienne, et américaine. Les participants ont pu entendre des interventions d'Elon Musk ou d'Eric Zemmour (accompagné de Jean Messiha), mais également Petr Bystron pour l'AfD [4], ou encore la figure de l'extrême droite chrétienne néérlandaise Eva Vlaardingerbroek (un million de followers sur X, plus de 390 000 sur instagram [5] et présente sur Foxnews, GBnews, et les supports en ligne du parti d'extrême droite des « Démocrates suédois », entre autres).
Étaient encore invités, le fondamentaliste chrétien pentecôstiste néo-zélandais Brian Tamaki, convaincu que la pandémie de 2020-22 ou que le cyclone Gabrielle étaient autant de punitions divines pour nos égarements loin de Dieu, entre pornographie, droits des homosexuels et avortement ; l'israélo-australien Avi Yemini, ancien membre de l'armée israélienne, provocateur notoire qui lors d'une manifestation contre l'emprisonnement de Robinson en 2018, s'était déclaré « le plus fier juif nazi au monde », Ezra Levant, fondateur du site Rebel News et connu comme le « Steve Bannon Canadien », ou la britannique Katie Hopkins, régulièrement aperçue aux côtés de Robinson, un temps personnalité médiatique grand public familière pour qui les demandeurs d'asile, sont des « cafards » se répandant dans « nos villes […], plaies purulentes infestées d'un grouillement de migrants et de demandeurs d'asile auxquels on jette des allocations comme des billets de monopoly ». [6]. D'autres personnages d'un genre comparable, venus d'Espagne, de Belgique, d'Irlande, ou du Danemark, ont été invités à proposer leur contribution.
Tommy Robinson, à l'initiative de la manifestation du 13 septembre, est devenu le point de convergence de cette vaste mouvance ultra-conservatrice et fasciste nourrie d'un puissant imaginaire victimaire dont la martyrologie lui réserve désormais une place centrale. Loin d'avoir été disqualifié et marginalisé par son passé de hooligan, de membre d'une organisation néo-nazie notoire (le British National Party de 2004 à 2005) puis de fondateur d'une organisation ultra-nationaliste et islamophobe (l'English Defence League, EDL, de 2009 à 2013), Robinson est parvenu au statut d'incarnation exemplaire de victime du système. Personnage gouailleur d'extraction modeste, abandonné par son père à l'âge de deux ans, celui-ci a vu sa riche carrière de délinquant récidiviste (entre exclusions des réseaux sociaux pour incitations à la haine et séjours carcéraux – cinq – pour fraude au passeport, entrave à la justice, agressions, détention de stupéfiants, fraude hypothécaire) se muer en titre de bravoure et de gloire face à la malfaisance à la fois oppressive et occulte d'un « système » dont il dévoilerait aujourd'hui les crimes.
Selon cette version des choses, le pouvoir réprimerait la liberté d'expression (« free speech ») afin d'empêcher que l'on dénonce son rôle dans le « grand remplacement », « l'immigration incontrôlée » et l'extinction de la « civilisation occidentale », « l'islamisation de nos sociétés » et la menace du « jihad » généralisé. Une vision cauchemardesque concentre l'horreur de cette logique exterminatrice secrète dont « nous » serions les victimes méprisées et ignorées : « le viol de nos filles » par des migrants accusés non seulement d'agressions sexuelles sur mineures, mais pire encore, d'organisation de réseaux (grooming gangs) d'exploitation sexuelle des mineures.
L'imaginaire raciste du « viol de nos filles »
Il vaut la peine de s'arrêter, même trop brièvement, sur ce motif du « viol » (« de nos filles »). S'y retrouve, pour commencer, une ancienne panique face au mélange racial propagé par l'étranger non-blanc, sauvage et insatiable – plusieurs femmes, beaucoup d'enfants -, incomplètement civilisé et, de fait, demeuré à un état de nature plus ou moins anomique et destructeur de nos normes.
Ce personnage fantasmatique de l'imaginaire raciste le plus classique, proto-animal et présumé chroniquement en surnombre, migrerait pour venir jouir sans limite ni scrupule des largesses d'un État national-social auquel il n'aurait jamais contribué. Tandis que le brave et loyal contribuable accepte diverses privations (et doit se contenter de la promesse lointaine de jouissance que lui fait miroiter une immense industrie pornographique, ce dès les premières pages de la presse quotidienne à grand tirage), le migrant profiteur, lui, se rend alors coupable de « l'effondrement civilisationnel » général.
Mais il faut également remarquer, même trop brièvement, comment cet ensemble thématique a été activé et entretenu depuis bientôt quinze ans. Comme le rappellent les chercheuses Ella Cockbain et Waqas Tufail [7], c'est au début des années 2010 qu'apparaît la construction médiatique d'une nouvelle menace pédocriminelle liée à la figure du « grooming gang » secrètement organisé par des hommes originaires du Sud-Est asiatique. Le 5 janvier 2011, le journal du groupe Murdoch, The Times, publiait un premier article prétendant révéler, à la fois, une « déferlante » de crimes d'exploitation sexuelle de jeunes filles britanniques blanches aux mains d'adultes pakistanais, et l'attitude coupable d'autorités que la crainte d'accusations de racisme potentiellement dirigées contre elles aurait entraîné dans une « conspiration silence ».
Si The Times, et son journaliste à l'origine de ce premier article, inaugurèrent et poursuivirent ce travail d'ethnicisation de la criminalité sexuelle envers les mineurs britanniques blancs, ils ne tardèrent pas à être largement suivis, tant sur le terrain médiatique que politique. L'élue parlementaire travailliste et membre du cabinet d'opposition en 2017, Sarah Champion, offrit un exemple notoire de ce type d'attelage en rédigeant pour le journal sensationnaliste à grand tirage, The Sun (lui aussi propriété du groupe Murdoch), un article intitulé : « British Pakistani men ARE raping and exploiting white girls . . . and it's time we faced up to it » [Oui, des britanniques d'origine pakistanaise violent et exploitent des filles blanches… et il est temps d'y faire face » (The Sun, 10 Août 2017).
La même année (2017), un rapport de la fondation Quilliam, think tank liée au très islamophobe Gatestone Institute (on va y revenir) et, prétendant lutter contre « l'extrémisme », parut apporter une caution autorisée aux pires spéculations et fantasmes. Selon ce document, « 84 % » de la pédocriminalité organisée était le fait d'hommes asiatiques /pakistanais / musulmans. En dépit de son absence amplement démontrée de rigueur méthodologique (et en dépit des liens, eux, démontrés, de cette fondation avec des milieux d'extrême droite), cette statistique ne tarda pas à se propager à une presse et à un champ audiovisuel peu soucieux de vérification [8].
De cette manière, le rapport Quilliam représenta une étape-clé dans la construction d'une panique morale raciste et islamophobe (non exempte, soit dit en passant, d'un voyeurisme sadique présumant une certaine fatalité du viol). De la même manière, ce rapport a été une étape décisive du processus d'occultation et recodage d'une terrible réalité ; la négligence et la maltraitance systémiques de millions d'enfants au Royaume-Uni, subissant le plus souvent dans le silence de mots qu'ils n'ont pas, l'appauvrissement de toutes les structures de protection, de soins et de suivi [9], et exposés à tout un répertoire d'abus et de violences sexuelles, continent sombre dont les organismes dédiés disent ne percevoir que la faible zone émergée.
Les connaissances disponibles permettent, en effet, de mettre un peu plus en lumière la dimension désinformationnelle militante à l'œuvre dans ces fabrications narratives. Premièrement, les études menées en Grande-Bretagne sur les violences sexuelles commises sur mineurs soulignent le caractère épidémique et massif du problème, ce en dépit d'estimations nécessairement basses compte tenu des difficultés de recensement précis des faits concernés. Pour les autrices du rapport du Centre d'expertise sur les abus sexuels d'enfants,
« Le nombre des enfants victimes d'abus sexuels est bien supérieur à ce qui est porté à l'attention des organismes publics. A partir des données d'enquêtes disponibles, nous estimons qu'au moins un enfant sur 10 en Angleterre et au Pays de Galles est victime d'abus sexuels avant l'âge de 16 ans (Karsna et Kelly, 2021). Selon une estimation basse, le nombre d'enfants victimes d'abus sexuels sur une année est de l'ordre de 500 000. » [10]/p>
Deuxièmement, comme l'a récemment souligné le Pr. Tahir Abbas, selon les données fournies par le Ministère de la Justice et par l'Office national de statistiques britanniques, 88 % des personnes poursuivies pour abus sexuels sur mineurs en Angleterre et au Pays de Galles en 2022 étaient blanches, soit un pourcentage supérieur à la part de la population blanche (85%) dans la population totale. Les accusées originaires d'Asie du Sud représentaient 7 % des personnes poursuivies, soit un pourcentage inférieur à leur représentation (9%) dans la population totale. Quant aux personnes noires, elles représentaient 3 % des personnes poursuivies, soit un chiffre inférieur à la représentation (4%) dans la population totale [11].
Il paraît donc entendu, assez prévisiblement, et sans aucunement chercher à disculper qui que ce soit par ailleurs, que la très grande majorité des personnes poursuivies pour faits de pédocriminalité sont des hommes blancs, sensiblement surreprésentés, de surcroît, au regard de la part de la population générale qu'ils représentent.
Ce fantasme a nourri le succès de la marche du 13 septembre
Le 13 septembre fut un moment de plein aboutissement de la panique morale promise par ces « 84 % » du rapport Quilliam, dans le prolongement des « révélations » initiales du Times. Celles-ci avaient d'emblée formulé ce qui allait être le socle d'affects de la manifestation « unite de the kingdom » : le « viol de nos filles » (blanches), le danger (pédo-)criminel « musulman » dû à « l'immigration incontrôlée » et la censure et l'autocensure « antiraciste » d'une gauche « complice » de la mise en danger de l'ordre identitaire national-racial. D'où la revendication de « liberté d'expression » contre la censure-autocensure maintenant couramment rapportée au « wokisme » et à sa « culture de l'annulation » [cancel culture].
Dans cette perspective, la gauche « multiculturaliste », les féministes et les antiracistes, dès lors qu'ils et elles remettent en cause l'autorité protectrice des pères, des frères et des époux (sur « nos filles »), et dès lors qui défendent les droits des migrants, se voient attribuer une responsabilité directe dans le désastre social, moral et civilisationnel ». Ou, pour citer Robinson dans sa vidéo intitulée « The Rape of Britain : Part One » [le viol de la Grande-Bretagne – première partie] :
« Plus aucun pays dans le monde n'est pas sans savoir que notre gouvernement, nos services sociaux, et nos forces de police sacrifient une génération de nos filles aux mains [sic] de l'autel du multiculturalisme […] ; il y a encore des jeunes filles, dans chaque ville et chaque grande ville, qui nous sont enlevées, enlevées à leur mère, comme esclaves sexuelles aux moins de gangs islamiques ». [12]
Ce même motif se retrouve presque mot pour pour dans l'intervention de Petr Bystron, de l'AfD, et sa défense de « notre combat » européen « depuis 2000 ans » :
« Nous ne voulons pas que nos filles, nos sœurs, se fassent violer. Nous ne voulons pas que nos frères, nos amis, se fassent poignarder quand ils les défendent ». [13]
Elon Musk, en version écran géant, « clarifie » le problème de fond à sa manière :
« Ce que je vois, c'est la destruction de la Grande-Bretagne. D'abord une lente érosion, mais une érosion de la Grande-Bretagne qui s'aggrave rapidement avec une migration massive incontrôlée. Un échec du gouvernement à protéger les gens innocents, dont les enfants qui sont violés en réunion. C'est incroyable ».
Pour Musk, c'est « la gauche qui veut simplement empêcher le débat et mettre les gens en prison pour avoir pris la parole, comme tu [Robinson] l'as fait et avoir dit ce qu'ils pensaient. » Et outre le « gouvernement qui ne fait rien et tente de cacher ces crimes affreux », il y la violence de la gauche, désignée comme responsable de l'assassinat de Charlie Kirk trois jours plus tôt aux États-Unis : « La gauche est le parti du meurtre et qui célèbre le meurtre. Pensez-y une minute. Voilà à qui nous avons à faire, ici. Voilà à qui nous avons à faire. »
On comprend alors, si ça n'était pas assez clair, que c'est contre le « virus de l'esprit woke » [the woke mind virus] [14] et sa logique de terreur « annulatrice » (pour « empêcher le débat et mettre les gens en prison ») qu'a été déployée l'étendard du « free speech », comme une parfaite évidence après plusieurs années de panique morale politico-médiatique anti-wokiste généralisée, et trois jours après l'assassinat de Charlie Kirk, attribué à ce même « parti du meurtre ».
En conclusion de cet échange, Musk confirme l'idée de Robinson selon laquelle la gauche serait la force occulte en capacité de contrôler les gouvernements, et d'organiser les migrations de masse dont elle tirerait ensuite des électorats qu'elle serait par ailleurs incapable de réunir parmi les populations « authentiquement » nationales :
« La gauche [parti du meurtre, donc] importe des électeurs […] des gens d'autres nations qui voteront pour eux […] privant ainsi les citoyens de leur pouvoir démocratique. C'est vraiment un problème d'importation d'électeurs ».
On retrouve ici à peu près terme pour terme, les imputations conspirationnistes classiquement antisémites – mais pour un adepte du salut nazi, la chose ne peut vraiment surprendre – dirigées par l'extrême droite hongroise contre George Soros en 2017 : Soros, le « financier juif » libéral qui œuvrerait à la dissolution des identités nationales en mettant sa fortune au service d'une vaste manipulation des migrants vers l'Europe.
Ce même motif, toujours assorti de la référence rapide mais explicite à Georges Soros, est au cœur d'un long entretien proposé sur la chaîne d'extrême droite ardemment pro-israélienne GB News. [15] On retrouve ici la rencontre qu'évoquait Enzo Traverso entre l'islamophobie et « l'archive antijuive » [16], et dont Reza Zià-Ebrahimi a proposé une analyse indispensable. [17]
Rappelons que ce même imaginaire victimaire de « l'invasion » est celui qui avait animé l'auteur néo-nazi de la tuerie de la synagogue de Pittsburgh en octobre 2018 (onze morts). Pour le tueur, Robert Bowers, la Société hébraïque d'aide aux migrants (HIAS) était responsable de l'arrivée de migrants d'Amérique centrale et de « musulmans maléfiques » [evil] ; cette société « aime faire venir des envahisseurs qui tuent les gens de chez nous. Je ne vais pas rester là à regarder les miens [my people] se faire massacrer ». [18]
Plusieurs décennies de surenchère nationaliste et raciste
En Angleterre même, ce sont toujours ces mêmes fantasmes « d'invasion » et de criminalité pédophile racialisée qui ont inspiré l'idée à Darren Osborne de lancer sa camionnette sur des fidèles sortant de la mosquée londonienne du quartier de Finsbury Park, le 19 juin 2017, faisant un mort et onze blessés. Osborne, dont l'intention première était de tuer le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, s'était déjà laissé convaincre, lui aussi, que « tous les musulmans sont des violeurs », « des animaux retournés à l'état sauvage », qui « s'en prennent aux enfants ».
Les justifications délirantes des tueries de masse perpétrées par Anders Brevik en Norvège en 2011 sur de jeunes militants de gauche (71 morts) et par Brenton Tarrant dans une mosquée en Nouvelle Zélande en 2019 (51 morts), n'étaient pas différentes.
On peut rester bref sur l'origine de ces figures et motifs rhétoriques. Ils ont une longue tradition dans l'histoire des paranoïas ethno-nationalistes. Mais ils ont surtout une histoire d'activation récente et incessante par les forces politiques du bipartisme britannique au cours des vingt dernières années. Sur ce registre, et comme on l'a déjà indiqué, la social-démocratie travailliste a laissé derrière elle un héritage uniformément toxique à partir des années 2000, entre validation des « justes préoccupations » du British National Party néo-nazi en matière d'attribution de logements sociaux et lexique de l'« envahissement » et de la « submersion » des écoles par les enfants de migrants et de demandeurs d'asile.
Ce langage a été promu par des ministres (de l'Intérieur, du Travail) en exercice. En 2010, le programme électoral du labour consacrait une rubrique à « crime et immigration : renforcer nos territoires, protéger nos frontières » pour préparer « la prochaine étape du renouveau national » [19]. En 2015, le merchandizing du congrès du parti proposait des tasses portant l'inscription : « Control on immigration : I'm voting labour ».
Ce catalogue interminable de surenchères nationalistes et racistes a atteint un nouveau seuil critique lorsque le premier ministre travailliste depuis juin 2024, Sir Keir Starmer, sioniste inconditionnel et soutien assumé du génocide palestinien, s'empresse d'exprimer le premier hommage à l'idéologue raciste américain, Charlie Kirk.
On note, en outre, que les condoléances de Starmer et de Kemi Badenoch (dirigeante de l'opposition conservatrice) se sont elles aussi focalisées sur la question de la « liberté d'expression » au nom de laquelle les propos ouvertement racistes, sexistes et les obscurantismes qui les inspirent, doivent avoir toute leur place dans le débat public (ce qui ne saurait valoir pour les dénonciations du génocide et la solidarité palestinienne, comme on a eu amplement l'occasion de le comprendre).
Au lendemain de la mort de Kirk, et à la veille de la manifestation pour la « liberté d'expression » appelée par Tommy Robinson, Badenoch déclarait :
« Le meurtre de Charlie Kirk est un coup porté contre tout ce que représente la civilisation occidentale : débat ouvert, vigoureux et contestation pacifique ». Pour Boris Johnson, Kirk n'était rien moins qu'« un martyr lumineux de la liberté d'expression ».
Trois semaines plus tard, Badenoch annonçait le plan de fermeture des frontières « le plus dur que la Grande-Bretagne n'ait jamais vu », plan prévoyant la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et l'abrogation de la loi sur les droits humains (Human Rights Act de 1998).
De cette manière, outre-Manche, les diverses nuances d'extrême droite peuvent continuer de se contenter de poursuivre et de faire prospérer l'œuvre de formations politiques longtemps hégémoniques et à présent en proie l'une et l'autre à une crise de légitimité d'une gravité inédite. La dette est donc grande à l'égard du tandem Labour-Tory, son multi-récidivisme législatif anti-étrangers, ses attaques contre les libertés publiques, sa panique morale « anti-woke », sa complicité et sa normalisation génocidaires.
Cette absence de « mérite » des héritiers est d'ailleurs parfaitement, entre autres, dans la médiocrité extrême de ce personnel propagandiste. L'échange entre Robinson et Musk, ou les interventions de Zemmour ou Bystron ne présentent pas même le moindre danger ne serait-ce que d'un quelconque charme rhétorique. En cela, le 13 octobre comporte la possibilité d'une jouissance dans une nullité dont l'imaginaire du « viol de nos filles et de nos sœurs » pourraient être une tentative de correction aussi sordide que désespérée.
A ce stade, faut-il peut-être admettre, la brutalité rhétorique dépourvue de la moindre sophistication, de la moindre adresse, suffit en tant que manifestation du pur désir de recours à la force, tandis que les milices ICE trumpistes, l'exaltation fasciste de la puissance génocidaire israélienne, ou les émeutes et ratonnades géantes en Grande-Bretagne et maintenant en Irlande, montrent l'avenir.
Tech, armement et israélisme
La poussée de l'extrême droite britannique se manifeste de deux manières évidentes. La manifestation du 13 octobre en est une ; l'avance considérable acquise dans les sondages d'opinion par Reform UK, le parti anti-immigration de Nigel Farage, en est une autre. Entre Robinson et Farage se joue la fausse contradiction et la vraie complémentarité qui peuvent exister entre un délinquant-martyr longtemps sans parti autre que sa propre marque en ligne, et un notable déterminé à s'inscrire dans un cadre institutionnel au sein duquel il peut prétendre incarner une relève majoritaire.
Le premier, Robinson, a obtenu le soutien de Musk, lui-même en rupture avec Trump, au détriment du second, le milliardaire ayant jugé Farage trop « faible » sur la question de l'immigration.
L'extrême droite officielle se distribue donc à présent entre Reform UK (Farage) et Advance UK, scission de Reform UK conduite par Ben Habib, rejoint par Robinson depuis août 2025. Mais à ce stade, leurs nuances peuvent être considérées mineures au regard de l'ampleur et de la continuité des forces désormais engagées dans le soutien à cette nouvelle configuration politique.
Robinson, dont l'audience et la fortune sont liées aux réseaux sociaux et à ses ventes de livres « manifestes », doit à Musk d'avoir retrouvé sa « liberté d'expression » sur un nouveau compte X, propriété de Musk qu'il a en outre remercié pour la prise en charge de frais de justice (non confirmée par Musk lui-même).
Mais c'est à l'israélisme parmi des plus fanatiques que l'ancien néo-nazi britannique, reconverti en « free speech martyr », islamophobe frénétique et admirateur inconditionnel d'Israël (pour lequel il s'est déclaré prêt à se battre en cas de guerre [20]), doit une grande part de sa prospérité.
Sa condamnation à treize mois de prison pour avoir filmé illégalement et posté sur Facebook le procès de personnes musulmanes accusées d'agression sexuelle (d'où la bannière du « free speech » contre une justice woke acquise à « l'invasion migratoire »), a valu Robinson une campagne de l'extrême droite internationale « Free Tommy » (relayée par de nombreux comptes russes ainsi que par Trump lui-même), avec l'appui de la droite pro-israélienne américaine. L'ultra-sioniste Middle East Forum (MEF) de Daniel Pipes a pris en charge les frais de justice et l'organisation de trois manifestations de soutien à Robinson pour un coût de 60 000 dollars.
L'Institut Gatestone, un think-tank pro-Israël, et le David Horowitz Freedom Center, organisme d'extrême droite qui se décrit comme une « école de guerre politique » contre « la cinquième colonne » [21], ont publié des articles en défense de Robinson. En outre, le Gatestone Institute et le MEF bénéficient l'un et l'autre des largesses de Nina Rosenwald, co-présidente d'une firme de placements financiers (American Securities Management), se revendiquant « sioniste ardente » et connu comme la « maman-gâteau de la haine anti-musulmane ».
Un peu plus tôt, le milliardaire de la tech (entreprise Cognex), Robert Shillman, donateur régulier d'institutions pro-israéliennes, avait fait embaucher Robinson par l'organisation d'extrême droite canadienne Rebel Media en 2017-2018, lui attribuant une bourse au montant annuel estimé aux environs de 85 000 dollars. Cette position était en outre assortie de trois postes d'assistant.es, chacun.es rémunéré.es à hauteur de 2500 dollars par mois. Le patrimoine personnel de Robinson est estimé quelque part entre un et trois millions de livres sterling.
En octobre 2025, le verdict d'un nouveau procès a été repoussé suite à l'invitation officielle adressée à Robinson par le ministre israélien chargé de la diaspora et président de la Knesset, Amichai Chikli. Les précédents de ce genre sont nombreux et l'on peut remonter ainsi jusqu'à 2003 et à l'accueil réservé par Ariel Sharon, alors premier ministre, au néo-fasciste Gianfranco Fini, admirateur de Mussolini et du mur de l'apartheid alors en construction autour de la Cisjordanie. Toutefois, la venue d'un influenceur sans autre titre que celui d'ex-hooligan islamophobe déroge manifestement au décorum diplomatique autrefois de rigueur. L'initiative a toutefois suscité la colère et l'incompréhension en Israël même, et jusque dans les organisations communautaires juives britanniques, d'habitude si loyalistes à l'égard d'Israël.
Reform UK : un parti-entreprise en embuscade
Qu'en est-il de Reform UK et de ses figures de proue ? Farage, président honoraire, et Richard Tice, dirigeant de Reform UK (qui, contrairement aux autres partis, a un statut d'entreprise privée), ont marqué leur distance vis à vis du « voyou » Robinson. Mais comme Robinson, Farage et Tice sont les relais dévoués et tout à fait serviles de forces plus que jamais déterminées à se passer de normes et contraintes bien trop encombrantes (fiscales, juridiques, environnementales…), aussi faibles ou cosmétiques puissent-elles être.
Farage (patrimoine estimé entre 3 et 5 millions de livres) et Tice (40 millions et patriote adepte de l'évitement fiscal), deux authentiques hommes du peuple, ont la particularité de disposer l'un et l'autre de leur propre émission sur la Chaîne conservatrice et islamophobe, GB News, lancée en 2021. Dans ce cadre, l'un et l'autre ont eu tout le loisir de contester la réalité du changement climatique ; « un ramassis d'absurdités », selon Tice.
Forts de cette conviction profonde, et pour le bien de tous, les dirigeants de Reform UK défendent l'exploitation du potentiel gazier de la Grande-Bretagne, sachant que « nous avons potentiellement des centaines de milliards de trésors énergétiques sous la forme de gaz de schiste », selon Tice. Il serait alors « manifestement négligent financièrement, et dans une certaine mesure, criminel, de laisser toute cette richesse sous terre sans l'extraire ». [22]
Alliant les actes aux paroles, les élu.es Reform UK, dans des assemblées où ils et elles ont acquis nombre de positions majoritaires depuis les dernières élections locales, ont décidé d'abroger les objectifs de neutralité carbone et d'éliminer les références à « l'urgence climatique » intégrées aux orientations des assemblées régionales ces dernières années. Les budgets ont alors été réaffectés à d'autres priorités, tout en continuant de percevoir les subventions fléchées sur les politiques de transition énergétique. [23] Ont ainsi été annulées des orientations et des politiques récemment mises en route dans les comtés de Durham, du Staffordshire, du Kent, du Derbyshire, ou du Northamptonshire Ouest.
Mais cette détermination dans le déni du dérèglement climatique et le déraillement des quelques efforts existants en matière de transition énergétique, correspond strictement à ce que l'on pouvait attendre d'un « parti » quasi-intégralement aux mains de l'industrie fossile. Une enquête parue dans le New York Times en mars 2025 a montré que sur le 4,75 millions de livres obtenus en 2024 par Reform UK, 40 % provenaient d'individus connus pour avoir « ouvertement contesté la réalité du dérèglement climatique, ou de détenteurs d'investissements dans les énergies fossiles et autres industries polluantes ». [24]
D'autres chercheurs ont montré, pour le site DeSmog, qu'entre décembre 2019 et juin 2024, Reform UK a récolté pour plus de 2,3 millions de livres provenant d'intérêts pétroliers et gaziers et de personnalités climatosceptiques, dont, par exemple, Terence Mordaunt, directeur du Global Warming Policy Foundation, organisme à la pointe de la contestation des travaux sur la science climatique. Ce montant correspondait à 92 % du total des dons au parti-entreprise Reform UK. La plupart de ses contributions sont issues, en outre, de comptes enregistrés dans des paradis fiscaux.
Mais le conflit d'intérêt peut être plus caricatural encore ; Tice et Farage sont les employés d'une chaîne, GB News, dont le propriétaire, Paul Marshall, détient pour 1,8 milliard de livres sterling en actions dans le secteur des énergies fossiles, dont les entreprises Shell, Chevron, Equinor (Norvège) et plus d'une centaine d'autres encore. L'enquête de DeSmog montrait encore qu'en 2022, un tiers des présentateurs de GB News avaient ouvertement remis en cause les travaux sur le climat et la moitié avaient dénoncé les initiatives pour le climat.
Reform UK est également destinataire des dons d'une entreprise d'armement, QinetiQ, très largement bénéficiaire de l'accroissement des dépenses d'État dans le secteur de la défense. « QinetiQ tire 80 % de ses revenus liés à l'armement des seuls contribuables britannique », selon le Byline Times, manne d'argent public dont l'actionnaire principal de l'entreprise, Christopher Harborne, redirige une partie au profit de Reform UK dont Harborne est le principal financier. Harborne a fait don à Reform UK de près de 14 millions de livres entre 2019 et 2024, et a pris en charge les deux récentes visites que Farage à rendues à Trump, en 2024 et 2025 pour un coût total de près de 60 000 livres.
Conclusion
Entre Robinson et Farage-Tice, on comprend tout l'enjeu et toute la signification de la « liberté d'expression » : entretenir des paniques morales anti-migrants, en perturbant les procédures de justice si nécessaire, et pour répandre le mythe de l'islamisation et du « viol » de l'occident ; pouvoir contester la recherche climatique au profit du lobby fossile dans le cadre de conflits d'intérêts manifestes, et défendre toutes les logiques d'oppression, jusqu'à l'horreur génocidaire, en continuant de se présenter en victime de la censure féministe, anti-raciste, ou pro-palestinienne, le tout au service de la « liberté » d'extraction, d'évasion, d'exploitation, de pollution et de manipulation, conditions de l' « expression » d'un capital absolu.
Diverses composantes de l'extrême droite britannique pourraient donc être en capacité d'assumer une relève des partis discrédités qui ont fait leur lit et qui comptent encore assurer leur survie à coups de nouvelles surenchères anti-réfugiés, islamophobes, et de sadisme réformateur en guise de preuve de crédibilité gestionnaire : l'enfer de cruauté et d'indifférence infligé aux enfants de Gaza vient de loin.
Sans doute sont-ce là les symptômes de la transition d'un néolibéralisme parlementaire décrépit vers l'ordre oligarchique qu'il n'a cessé de sécréter et maintenant en passe d'atteindre son plein accomplissement politique. Auquel cas, il faut bien l'admettre, défendre cet indéfendable exige une très grande « liberté d'expression », de pure fabrication, non encombrée par une justice encore capable d'indépendance, des médias et une presse encore libres, une recherche scientifique assumant encore sa vocation critique, et par une quelconque revendication politique d'égalité.
Une bonne nouvelle pourrait cependant sortir du naufrage en cours des partis qui ont dominé la vie politique britannique jusqu'ici : le travaillisme profondément droitisé et sectaire, inspirant un dégoût quasi-universel, pourrait enfin laisser une chance réelle à l'émergence d'une force de gauche, socialiste, cette fois non plus condamnée au genre d'agitation périphérique et éphémère dans laquelle tant d'enthousiasmes et d'élans ont immanquablement fini par s'essouffler et dépérir jusqu'ici. Reste donc à savoir, et à suivre, le renouveau social-démocrate porté par les Verts britanniques, et plus encore, ce qu'il pourrait advenir de Your Party, lancé par les députés Jeremy Corbyn et Zarah Sultana, dont la seule annonce pendant l'été a reçu près d'un million de messages de soutien et de demandes d'adhésion. De quoi faire. Enfin peut-être.
Thierry Labica
P.-S.
• Contretemps. 12 novembre 2025 :
https://www.contretemps.eu/poussee-historique-extreme-droite-grande-bretagne/
Notes
[1] Nb, dans un contexte d'attaques inédites du pouvoir conservateur contre les droits de populations Maoris, en vigueur depuis près de deux siècles : https://www.commondreams.org/news/new-zealand-treaty-of-waitangi
[2] Il faudrait traiter à la fois de la désinformation qui constitue l'élément déclencheur de plusieurs de ces épisodes émeutiers (on y revient), et des expressions de solidarité antiraciste à l'égard des minorités visées. Ces deux points mériteraient d'être étudiés à part entière.
[3] En référence aux politiques officiellement dites d'« environnement hostile » à partir de 2012.
[4] Bystron a perdu son immunité parlementaire de député européen suite à des affaires de corruption (au service de Poutine), de fraude et de blanchiment,
[6] Article paru dans The Sun (fleuron britannique de l'empire médiatique de Rupert Murdoch) le 17 avril 2015 (archivé ici : https://www.gc.soton.ac.uk/files/2015/01/hopkins-17april-2015.pdf). L'article débutait avec les propos suivants : « Non, je m'en fous. Montrez-moi les images des cercueils, montrez-moi les corps flottants sur la mer, sortez les violons et montrez-moi des gens amaigris à l'air triste. Je continue de m'en foutre. Parce que l'instant d'après, vous me montrerez des images de jeunes hommes agressifs à Calais, se répandant comme une épidémie de norovirus sur un navire de croisière ». La commission des droits de l'homme de l'ONU avait reconnu là des expressions très similaires à celles du journal rwandais Kangura, à la propagande génocidaire de Radio Mille collines, et au-delà, à des motifs typiques du nazisme.
[7] Ella Cockbain, Waqas Tufail, « Failing victims, fuelling hate : challenging the harms of the ‘Muslim grooming gangs' narrative » [[« Trahir les victimes, alimenter la haine : combattre la construction des « grooming gangs musulmans » et ses ravages »], Institute of Race Relations, vol.61, #3, janvier 2020, [en ligne] ; on écoutera également avec profit l'entretien (« The truth on ‘grooming gangs' ») accordé en juin 2023 par la Pr. Ella Cockbain à Mintpress News, avec le (très remarquable) commentateur politique et artiste, Lowkey
[8] Voir Cockbain et Tufail, « Failing Victims »…
Dès son introduction, le rapport du National Audit Office, « Pressure on Children Social Care », 2019 [en ligne], notait ceci : « En 2016, le Comité des comptes publics a conclu que le Ministère paraissait d'une complaisance inquiétante à l'idée que rien ne pouvait être fait pour améliorer les services de l'enfance plus rapidement, et que le Ministère ne disposait pas d'un plan crédible pour déterminer quand et comment opérer des améliorations significatives, et pour garantir une intervention des autorités locales à même d'apporter un changement concret dans la vie des enfants. Jusqu'à récemment, le Ministère n'a pas jugé que la compréhension des facteurs déterminants pour la protection sociale de l'enfance, dans toutes les collectivités locales, était au centre de ses missions. Sans organisation de services de l'enfance efficaces et à la hauteur des besoins, les enfants qui ont besoin d'aide ou de protection seront exposés à la négligence, à des abus ou à des préjudices », p. 6.
[9] S. Kewley et K. Karsna, « Child Sexual Abuse in 2023/24 : Trends in Official Data », Center of Expertise on Child Sexual Abuse, juin 2025, [
en ligne], p.12.
[10] S. Kewley et K. Karsna, « Child Sexual Abuse in 2023/24 : Trends in Official Data », Center of Expertise on Child Sexual Abuse, juin 2025, [en ligne
[11] Tahir Abbas, « The grooming gang debate : Navigating race, politics, and justice in the UK », [en ligne], 6 janvier 2025.
[12] https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1874590921850798502
[13] https://www.youtube.com/watch?v=NEGkHa_55c4
[14] https://www.youtube.com/watch?v=0DM6dxETDfI cf. 6'30''
; le dialogue entre Oliver et Cummins est
[16] E. Traverso, La fin de la modernité juive, La Découverte [2013], 2016, p.123.
[17] R. Zià-Ebrahimi, Antisémitisme & islamophobie. Une histoire croisée, Amsterdam, 2021.
[19] Cf chapitre 5 du programme de 2010.
[20] Cf.2'48 de la video de Middle East Eye.
[21] Tommy Robinson Winds up Bigots and the cash floods in
», The Times, 5 août 2018.
[22] https://www.bbc.com/news/articles/c74172wlezwo
[23] Reform Council Bans All Mentions of Climate Change While Quietly Taking Green Funds From Government », Byline Times, 23 juillet, 2025.
[24] Reform Council Bans All Mentions of Climate Change While Quietly Taking Green Funds From Government », Byline Times, 23 juillet, 2025.
Copyright

Inscrire le consentement dans la loi sur le viol : une bonne idée ?

Depuis deux ans, un nouveau débat secoue le féminisme. Faut-il redéfinir le viol dans le code pénal en y introduisant la notion de non-consentement ? Une proposition de loi (PPL) a été déposée par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin allant dans ce sens, mais l'adoption n'est pas encore définitive.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/10/27/inscrire-le-consentement-dans-la-loi-sur-le-viol-une-bonne-idee/?jetpack_skip_subscription_popup
La définition du viol telle qu'elle est inscrite dans le code pénal depuis 1980 est la suivante : « Article 222 : « constitue un viol » tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Malgré cette définition améliorée au fil du temps, la prise en compte judiciaire du viol reste largement insuffisante. Des magistrat·es, des avocat·es qui défendent les victimes, constatent régulièrement que l'infraction de violence, contrainte, menace ou surprise (VCMS) reste trop difficile à caractériser dans une interprétation restrictive. Notamment, elle ne permet pas au juge d'investiguer le comportement de l'agresseur, ce qui revient à maintenir une sorte de « présomption de consentement ».
A lire également sur le sujet,
notre interview de Frédérique Pollet-Rouyer, avocate
Forte de cette constatation, la juriste Catherine Le Magueresse, autrice de Les pièges du consentement (PS n°207), a étudié le droit international et constaté que les pays les plus avancés avaient introduit la notion de consentement dans la définition du viol. Le viol devient alors un acte de pénétration non consenti. Avec raison, des féministes et théoriciennes se sont interrogées sur le risque que cette notion ne prenne pas en compte la situation intrinsèque de domination qui préside à l'acte sexuel hétérosexuel dans une société patriarcale. Pour elles, définir le consentement favoriserait l'agresseur, qui pourrait se contenter de dire : elle était consentante.
« Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». PPL Garin
Une définition féministe du consentement ?
Éviter cet écueil est ce à quoi se sont employées de nombreuses expertes juridiques, en vue de proposer une définition qui ne laisse pas la part belle à la subjectivité de l'agresseur. Ce que propose l'article de la proposition de loi Garin et la définition du groupe de travail, réunissant une vingtaine de juristes et avocates, vise précisément à éviter cet écueil en objectivant la définition du consentement.
Dans la PPL Garin, l'agression sexuelle et le viol sont définis comme tout acte sexuel non consenti et le consentement est défini : « Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Les « VCMS », sont par ailleurs maintenues dans le code pénal. « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Avis du Conseil d'État et de la CEDH
Le Conseil d'État, dans une décision du 6 mars propose de définir le consentement en précisant que celui-ci « doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et constate que chacun de ces termes est en soi porteur d'une richesse de signification donnant autant de points d'appui à des poursuites mieux adaptées.
En outre, la PPL prévoit que le consentement soit aussi examiné en fonction des circonstances environnantes (le Sénat a préféré remplacer ce terme par « contexte »).À ce propos, la décision du 4 septembre de la CEDH qui condamne la France dans l'affaireE.A. et AVFT contre France], apporte un éclairage important. Elle affirme, dans un arrêt que l'association Osez le féminisme ! juge historique, « que la justice française a manqué à ses obligations d'examiner les circonstances environnantes, de manière précise et sincère, pour apprécier le consentement de la victime ».
Mieux, elle détaille dans le paragraphe 143 quelles sont ces circonstances environnantes (voir notre interview p.10 à 12). La PPL devait être adoptée définitivement en commission mixte paritaire fin septembre 2025, mais la chute du gouvernement Bayrou a remis en cause cette échéance.
Pour en savoir plus : consentementfeministe.fr
Sandrine Goldschmidt
Sandrine Goldschmidt est chargée de communication au Mouvement du Nid et militante féministe. Journaliste pendant 25 ans, elle a tenu un blog consacré aux questions féministes (A dire d'elles – sandrine70.wordpress.com) et organise depuis quinze ans le festival féministe de documentaires « Femmes en résistance ». Aujourd'hui elle écrit régulièrement dans Prostitution et Société.
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/consentement-loi-viol/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Palestine, les femmes sont les icônes de la révolution

Lisez le discours prononcé par Samah Abunina de La Via Campesina lors de l'Assemblée des femmes du 3e Forum Mondial de Nyéléni
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/16/viols-et-de-tortures-sexuelles-dans-les-centres-de-detention-israeliens-et-autres-textes/?jetpack_skip_subscription_popup
Je suis une femme de Palestine, où les voix des femmes sont censées être enterrées sous les décombres. Mais malgré les différentes formes de blocus, je suis ici aujourd'hui pour faire entendre la voix des femmes palestiniennes – paysannes, révolutionnaires, martyres et prisonnières.
Je suis témoin du crime qui se passe, des femmes qui perdent leurs enfants sous les bombardements, des femmes chassées de chez elles, de toute une génération privée du droit de vivre dans la dignité. Nous avons connu le génocide, la famine et les déplacements forcés. Cependant, nous nous accrochons à notre terre, en prenons soin, la protégeons et la défendons.
En Palestine, les femmes sont les icônes de la révolution, de la résurrection et de la renaissance. Ce sont elles qui protègent leurs maisons assiégées et leurs terres, sous la menace d'expropriation et d'implantation [de colons promus par l'entité sioniste]. Les femmes sont les gardiennes de la mémoire collective. Ce ne sont pas de simples victimes, mais des cibles qui, lorsqu'elles sont touchées, ont un impact sur les générations futures.
Je me tiens devant vous aujourd'hui au nom des femmes paysannes qui constituent l'épine dorsale de la souveraineté alimentaire dans le monde entier. En même temps, elles sont parmi les plus vulnérables à la marginalisation et à l'exploitation. Les femmes rurales cultivent leurs terres, préservent les semences, s'occupent des animaux et assument la responsabilité de nourrir les nations. Cependant, elles se voient refuser les droits fondamentaux à la terre, à l'eau et aux semences, et ce sont elles qui subissent la violence patriarcale, sociale et économique. Elles paient le prix le plus élevé de la pauvreté, des déplacements forcés et des conflits armés.
Dans la région arabe, la souffrance des femmes à la campagne est aggravée par des régimes politiques et économiques satellites, subordonnés à des puissances étrangères, limités par des accords qui placent les intérêts des grandes entreprises au-dessus des intérêts du peuple. Les femmes rurales des pays arabes sont privées de ressources et menacées par le changement climatique et la sécheresse. Elles sont confrontées à des politiques agraires néolibérales qui les privent de leurs droits à la terre, au travail et à une vie digne. Cela dit, elles restent inébranlables, luttant pour que la vie continue, pour protéger la terre et défendre le droit des peuples à l'alimentation et à la souveraineté.
La situation dans mon pays, la Palestine occupée, est encore plus difficile. Les femmes paysannes palestiniennes sont confrontées à l'occupation, aux colonies et à la confiscation des terres, en plus de la violence quotidienne perpétrée par la machine de guerre coloniale sioniste.
Le génocide auquel les Palestiniens sont confrontés aujourd'hui révèle l'impérialisme cruel et la complicité des puissances coloniales et capitalistes mondiales. À ce jour, on compte plus de 73 000 martyrs et disparus, dont 19 000 enfants, et plus de 13 000 femmes ont été tuées par les bombardements, la famine et le siège. Les femmes palestiniennes perdent non seulement leurs maisons et leurs terres, mais aussi leurs fils et leurs filles. On leur refuse le droit à la vie. Pourtant, elles continuent de se battre pour la terre, pour la vie, pour un avenir libre et digne.
À La Via Campesina, nous réaffirmons que notre lutte est mondiale. Nous reconnaissons que notre lutte contre l'occupation sioniste en Palestine est la même lutte contre le capitalisme sauvage et les multinationales qui volent les semences des paysans, détruisent l'environnement et asservissent les gens.
Notre lutte contre le génocide en Palestine est une lutte contre les régimes patriarcaux, rétrogrades et impérialistes qui oppriment les femmes partout dans le monde.
Mon message à vous et à toutes les femmes, les jeunes et les hommes du monde qui embrassent des causes justes est : ne laissez pas la Palestine seule. Notre lutte n'est pas locale. C'est la lutte de tout être humain qui rejette l'injustice. Nous sommes inébranlables et nous nous battons. Nous rêvons d'une liberté incassable.
Ensemble, nous devons défendre et protéger les femmes paysannes contre toutes les formes de violence et d'exploitation, en garantissant leur droit à la terre, aux semences et à l'eau. Nous continuerons d'exprimer notre solidarité mondiale avec le peuple palestinien, considérant sa lutte comme indivisible de la lutte du peuple contre l'impérialisme. Nous lutterons contre le régime patriarcal et capitaliste qui marginalise les femmes, opprime les paysans et détruit l'environnement. Nous affronterons les entreprises monopolistiques qui volent les semences des personnes paysannes, imposant une agriculture industrielle dévastatrice au détriment de l'agriculture populaire et de la souveraineté alimentaire. À travers ces actions, nous construirons un mouvement mondial de lutte ancré dans la solidarité et le partage d'expériences et de connaissances, qui place la souveraineté alimentaire au centre de la lutte pour la justice sociale et la libération nationale et féministe.
Camarades, notre lutte est pour la vie face à la politique de la mort. D'ici, nous élevons la voix : il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans une Palestine libre, il n'y a pas de justice sociale sans des femmes rurales libres, il n'y a pas d'avenir pour notre peuple sous le contrôle de l'impérialisme, du capitalisme et du retard. Mondialiser la lutte, mondialiser l'espoir !
Samah Abunina est membre de la Via Campesina en Palestine. Le texte est une édition de son discours lors de la Assemblée des Femmes du 3ème Forum mondial Nyéléni.
https://capiremov.org/fr/analyse/en-palestine-les-femmes-sont-les-icones-de-la-revolution/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le désespoir s’installe » : augmentation du nombre de suicides chez les femmes dans l’Afghanistan des talibans

Tout d'abord, on lui a retiré son droit à l'éducation. Ensuite, on lui a imposé un mariage contre son gré avec son cousin, un héroïnomane. Latifa s'est retrouvée confrontée à un choix inimaginable.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« J'avais deux options : épouser un héroïnomane et mener une vie misérable, ou mettre fin à mes jours », a déclaré la jeune fille de 18 ans lors d'un entretien téléphonique depuis son domicile dans la province de Ghor, dans le centre de l'Afghanistan.
Les rêves de Latifa d'étudier la médecine ayant été anéantis par l'interdiction par les talibans de l'enseignement secondaire et universitaire pour les filles et sa famille insistant sur le mariage arrangé qui était en préparation depuis six ans, l'adolescente afghane n'a vu qu'une seule option.
« J'ai choisi la seconde », a-t-elle déclaré. Elle a tenté de se suicider l'automne dernier en prenant une overdose de médicaments sur ordonnance.
La tentative de suicide de Latifa n'est pas un cas isolé. Alors que les femmes afghanes voient leurs libertés durement acquises – étudier, travailler et même quitter leur domicile – leur être retirées par les talibans, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir de mettre fin à leurs jours par désespoir et désespoir, selon une enquête menée par Zan Times et The Fuller Project.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d'hommes qui se suicident est plus de deux fois supérieur à celui des femmes dans le monde. Jusqu'en 2019, dernière année pour laquelle des données officielles sont disponibles, les hommes étaient plus nombreux que les femmes à se suicider en Afghanistan. Mais les chiffres obtenus auprès des médecins des hôpitaux publics et des cliniques du pays pour cette enquête suggèrent que les femmes sont désormais beaucoup plus nombreuses que les hommes à mettre fin à leurs jours, une anomalie mondiale qui souligne l'impact des politiques draconiennes des talibans.
Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à se suicider ou à tenter de se suicider dans neuf des onze provinces afghanes pour lesquelles Zan Times et The Fuller Project ont obtenu des données pour l'année allant jusqu'en août 2022. Ces chiffres ne sont en aucun cas exhaustifs : ils ne couvrent qu'un tiers des 34 provinces afghanes et ne représentent probablement que la partie visible de l'iceberg dans une société où le suicide est considéré comme une source de honte et souvent dissimulé. Mais ils montrent une tendance claire. Au cours des 12 mois qui ont suivi la prise de pouvoir par les talibans, les femmes et les filles ont représenté la grande majorité des personnes ayant tenté de mettre fin à leurs jours et des décès par suicide.
« Lorsque je rencontre des Afghanes à travers le pays, elles me font toutes part de l'impact des restrictions croissantes sur leur bien-être psychologique. L'Afghanistan est en proie à une crise de santé mentale précipitée par une crise des droits des femmes », a déclaré Alison Davidian, représentante nationale de l'ONU Femmes, dans des commentaires envoyés par courrier électronique.
« Nous assistons à un moment où un nombre croissant de femmes et de filles préfèrent la mort à la vie dans les circonstances actuelles, où elles sont privées de la possibilité de mener leur propre vie. »
Perte d'espoir
Les militant·es afghan·es, les agences d'aide internationales et les expert·es des Nations Unies affirment que le taux élevé de suicides chez les femmes en Afghanistan reflète non seulement une perte de liberté pour les femmes, mais aussi une augmentation des mariages forcés et des violences domestiques, ainsi qu'une perte d'espoir.
En juillet dernier, Fawzia Koofi, ancienne vice-présidente du Parlement afghan, a déclaré devant le Conseil des droits humains des Nations unies que la situation était devenue si désespérée qu'« au moins une ou deux femmes se suicident chaque jour ».
Latifa a tenté de mettre fin à ses jours avec des médicaments contre la toux, des comprimés de caféine et des somnifères achetés dans une pharmacie qui ne demandait pas d'ordonnance. Après sa tentative de suicide, elle a déclaré s'être réveillée dans un lit d'hôpital, entourée de sa famille et de médecins, souffrant d'une sensation de brûlure à l'estomac et incapable d'ouvrir les yeux.
Elle a été informée que son cousin, un homme de sept ans son aîné, avait disparu après avoir appris sa tentative de suicide. Il n'y a pas eu d'autres discussions au sujet du mariage, mais Latifa craint toujours qu'il ne revienne à un moment donné.
« S'il revient et que ma famille essaie à nouveau de me forcer [à me marier], je me pendrai pour être sûre de ne pas survivre », a-t-elle déclaré.
L'histoire de l'Afghanistan, marquée par les conflits, les troubles civils et la pauvreté, avait donné lieu à une crise de santé mentale bien avant août 2021.
Une enquête nationale sur les troubles dépressifs et anxieux publiée dans la revue BMC Psychiatry en juin 2021, deux mois avant la prise de pouvoir par les talibans, a révélé que près de la moitié des 40 millions d'habitant·es souffraient de détresse psychologique.
Un rapport publié en 2019 par Human Rights Watch indiquait que plus de la moitié des Afghan·es souffraient de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique, mais que « moins de 10% d'entre elles et eux bénéficiaient d'un soutien psychosocial adéquat de la part de l'État ».
Il est difficile de savoir dans quelle mesure la situation a évolué depuis lors. Une enquête réalisée en 2022 par Gallup a révélé que si « la souffrance est désormais universelle chez les hommes et les femmes » en Afghanistan, les femmes interrogées se montraient plus pessimistes quant à l'avenir.
Les talibans ne publient pas de données sanitaires et toutes les données recueillies par Zan Times et The Fuller Project ont été fournies par téléphone par des professionnel·les de santé s'exprimant sous couvert d'anonymat. Un professionnel de santé mentale de la province occidentale de Herat, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, a déclaré que les talibans avaient interdit aux professionnel·les de santé de publier ou de partager des statistiques sur le suicide, qui étaient auparavant publiées régulièrement.
Les porte-parole des talibans n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
Herat est la province qui a enregistré le plus grand nombre de tentatives de suicide parmi celles pour lesquelles des données ont été obtenues : 123, dont 106 par des femmes. Dix-huit décès ont été signalés, dont 15 femmes. Selon la Commission indépendante afghane des droits humains (AIHRC), aujourd'hui en exil, cette région conservatrice, qui compte une proportion importante de femmes instruites, a toujours enregistré des niveaux élevés de violence sexiste et de tentatives de suicide chez les femmes.
Un travailleur en santé mentale de Herat a déclaré que la province avait toujours connu un taux de suicide élevé, mais que le personnel était désormais débordé. Environ 90% des patient·es en santé mentale de l'hôpital provincial étaient des femmes qui « s'effondraient sous le poids des nouvelles restrictions », a-t-il déclaré.
« Les patient·es ne bénéficient pas du temps d'hospitalisation et des conseils dont elles ou ils ont besoin », a déclaré ce soignant. « Souvent, nous mettons deux patient·es dans un même lit. »
Le soignant a cité la violence domestique et les mariages forcés ou précoces parmi les facteurs de suicide, affirmant que l'arrêt de la scolarité secondaire avait conduit les filles à se marier plus tôt. Les femmes « payaient souvent le prix » lorsque les familles connaissaient des difficultés financières et que les hommes devenaient violents, a ajouté le travailleur.
Stigmatisation sociale
Roya, 31 ans, a été retrouvée pendue dans sa maison de la ville d'Herat en mai 2022.
Son jeune frère, Mohammad, qui a demandé à ce que son vrai nom ne soit pas divulgué, a déclaré que Roya avait parlé à plusieurs reprises à leurs parents du comportement violent de son mari, qui la battait fréquemment.
« Mais à chaque fois, mes parents la persuadaient de préserver l'unité familiale », a déclaré Mohammad. « Un matin, nous avons appris que Roya s'était pendue. Nous n'aurions jamais pensé que les choses iraient aussi loin. »
La famille a déclaré qu'elle était décédée des suites d'une maladie, craignant que son suicide ne soit une source de honte s'il était rendu public, a expliqué Mohammad.
Shaharzad Akbar, ancienne présidente de l'AIHRC, a déclaré que ce type de comportement était courant en raison de la stigmatisation sociale qui entoure le suicide.
« Les rares cas où les parents admettent volontiers le suicide sont ceux où elles et ils ne veulent pas qu'un membre de la famille soit accusé de meurtre », a déclaré Mme Akbar, qui est aujourd'hui directrice exécutive de Rawadari, une nouvelle organisation afghane de défense des droits humains.
Selon les militant·es et les organismes d'aide humanitaire, la santé mentale des femmes et des filles en particulier se détériore, car les talibans ont systématiquement fermé presque toutes les voies d'accès à l'éducation pour les femmes – les filles ne pouvant plus aller à l'école après l'âge de 12 ans – et les possibilités pour les femmes de travailler, de gagner un revenu ou d'exercer une quelconque autonomie.
Selon les chiffres obtenus, la plupart des tentatives de suicide et des décès concernaient des femmes et des filles ayant reçu une éducation, soit parce qu'elles avaient été scolarisées avant la prise de pouvoir par les talibans, soit parce qu'elles avaient des diplômes scolaires. La mort aux rats, facilement accessible en Afghanistan, et la pendaison étaient les méthodes de suicide les plus courantes.
Une étude publiée en août 2022 par Save the Children a révélé que 26% des filles présentaient des signes de dépression, contre 16% des garçons.
Behishta Qaimy, coordinatrice de projet pour Save the Children Afghanistan, a déclaré que les filles étaient de plus en plus découragées depuis qu'elles avaient été interdites d'école, rappelant qu'une d'entre elles avait déclaré aux travailleur·es humanitaires : « Je suis désespérée, je m'énerve rapidement, je pleure pour moi-même et quand je vais me coucher, je fais des cauchemars. »
Si certaines organisations peuvent encore opérer en Afghanistan, beaucoup ont suspendu leurs activités après que les talibans ont interdit aux femmes de travailler pour des ONG nationales et internationales. En conséquence, 11,6 millions de femmes et de filles ne reçoivent plus d'aide vitale, a averti ONU Femmes, et les services destinés aux victimes de violences ou à la prévention de l'exploitation sexuelle ont été fermés.
Selon les Nations Unies, neuf femmes sur dix en Afghanistan sont victimes d'une forme ou d'une autre de violence domestique. Les expert·es affirment que les modestes progrès réalisés dans la lutte contre ce fléau avant la prise de pouvoir par les talibans ont été réduits à néant.
« Le mécanisme de lutte contre la violence domestique a été totalement éradiqué ; les femmes n'ont d'autre choix que de subir la violence ou de se suicider », a déclaré Akbar.
Les avertissements concernant les suicides de femmes ne font que s'intensifier à mesure que les talibans renforcent leur emprise sur les droits des femmes et des filles.
En mai, des expert·es de l'ONU, dont le rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan, Richard Bennett, ont déclaré après une visite dans le pays qu'elles et ils étaient « alarmé·es par les problèmes de santé mentale généralisés et les témoignages faisant état d'une augmentation des suicides chez les femmes et les filles ».
Certaines personnes considèrent ces actes comme la seule forme de rébellion possible pour les femmes dans un pays où la dissidence et les manifestations sont punies.
« Nous ne pouvons pas réduire le message des femmes qui commettent ces formes très ostentatoires de suicide à un simple acte de désespoir », a déclaré Julie Billaud, professeure d'anthropologie à l'Institut universitaire de Genève et autrice de Kabul Carnival, un livre sur la politique de genre dans l'Afghanistan d'après-guerre.
« Le désespoir s'installe. Peut-être que [le suicide] est la dernière tentative de celles qui n'ont plus aucun pouvoir pour s'exprimer et se faire entendre. »
Cet article est publié en partenariat avec le Fuller Projectet The Guardian.
Zahra Nader, Matin Mehrab et Mahsa Elham, 28/8/2023
* Les noms ont été modifiés afin de protéger l'identité des personnes interrogées. Matin Mehran et Mahsa Elham sont les pseudonymes de journalistes du Zan Times en Afghanistan.
https://zantimes.com/2023/08/28/despair-is-settling-in-female-suicides-on-rise-in-talibans-afghanistan/
Traduit par DE
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une épidémie de violence sexiste en Afghanistan :« Je ne veux pas vivre. Je veux mourir »

Lorsque le père de Tahmina a compris que les talibans étaient sur le point de revenir au pouvoir, il l'a rapidement mariée à un homme dont la famille avait des liens avec les militant·es. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a emménagé dans la maison familiale de son mari, dans le district de Dand-e-Ghori, dans la province de Baghlan, au nord de l'Afghanistan.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Là-bas, elle a été maltraitée dès qu'elle a franchi le seuil de la porte. Son mari la giflait, la frappait et la battait, souvent à la demande de son beau-père. Sa nouvelle famille se moquait d'elle, l'humiliait et la maltraitait.
La vie est devenue encore plus insupportable après que le mari de Tahmina a été pris en embuscade et tué par des bandits. Son père a insisté pour que la jeune veuve, alors mère d'un garçon de deux mois, épouse le frère de son mari, âgé de huit ans. Lorsque Tahmina a refusé, il a tué son bébé en lui tranchant la gorge.
« L'horreur et la colère que j'ai ressenties sont si fortes que je ne veux plus vivre. Je veux mourir », confie Tahmina au Zan Times. Elle explique qu'elle n'a pas pu demander justice car son beau-père avait des liens étroits avec les talibans.
L'Afghanistan connaissait déjà un taux élevé de violence envers des femmes avant la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Sous le régime rétabli, la situation s'est encore détériorée. Toutes les avancées législatives réalisées au cours des deux dernières décennies pour protéger les femmes ont été rapidement anéanties.
La grande majorité des 60 femmes interrogées par Zan Times pour ce rapport dans 17 provinces d'Afghanistan ont déclaré avoir été victimes de violences, notamment de tortures physiques, de violences verbales et de travail forcé. Seules huit d'entre elles ont déposé une plainte officielle auprès des autorités.
« Il est à la fois horrible et sans surprise que la violence à l'égard des femmes ait augmenté après la prise de pouvoir par les talibans », déclare Heather Barr, directrice adjointe de la division des droits des femmes à Human Rights Watch. « L'une des premières mesures prises par les talibans — l'une de leurs priorités les plus urgentes — a été de démanteler systématiquement l'ensemble du système qui avait été mis en place pour protéger les femmes et les filles contre la violence. Ce système promettait aux femmes et aux filles une certaine autonomie, la possibilité de faire leurs propres choix et de revendiquer leurs droits – les talibans ne peuvent pas le supporter. Leur vision de la société est celle où les femmes et les filles sont la propriété exclusive de leurs proches masculins, entièrement à leur merci, et sont exclues de la vie publique – et ils y sont largement parvenus. »
En effet, compte tenu des restrictions officielles imposées à la liberté de mouvement des femmes, la plupart d'entre elles se retrouvent effectivement prisonnières de leur foyer, souvent avec des conjoints ou des beaux-parents violents. Parmi les femmes interrogées, une sur cinq a déclaré avoir envisagé de se suicider, tandis que deux ont tenté de mettre fin à leurs jours.
« Les femmes et les filles sont exclues de la vie publique, la dissidence pacifique n'est pas tolérée, la violence et la menace de violence sont utilisées en toute impunité pour contrôler et instiller la peur dans la population », a déclaré Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, le 29 février 2024. « Cette situation est aggravée par une crise économique et humanitaire qui se traduit par le déni des droits économiques, sociaux et culturels. »
Shafiqa, une jeune fille de 18 ans originaire de la ville de Firozkoh, dans la province de Ghor, raconte au Zan Times comment elle a été contrainte d'épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui avait déjà une femme et quatre enfants adultes.
« Parfois, ses enfants me frappaient, et quand je m'en plaignais à mon mari, il me répondait que ce n'était pas grave s'ils me frappaient, que j'avais sûrement fait quelque chose de mal », explique Shafiqa. « Une fois, alors que je me disputais avec son autre femme, il a coupé des branches dans les arbres de la cour et m'a rouée de coups. J'avais des bleus sur tout le corps et j'ai souffert pendant une semaine. »
« J'en avais vraiment marre de la vie », poursuit-elle. En désespoir de cause, elle a rassemblé tous les comprimés qu'elle a pu trouver dans la maison et les a avalés. Au lieu de mourir, elle est tombée malade et a vomi les pilules. Une fois son état amélioré, son mari l'a battue pour avoir terni sa réputation.
Selon l'indice « Femmes, paix et sécurité » (WPS), l'Afghanistan est le pays le plus hostile aux femmes au monde. Cet indice, qui évalue la situation des femmes dans 177 pays, prend en compte des indicateurs tels que l'inclusion économique, sociale et politique, ainsi que la justice et la sécurité.
« L'Afghanistan obtient le score le plus bas pour cet indicateur, avec une note de 0,37 due au régime oppressif des talibans qui a sévèrement restreint la capacité des femmes à obtenir justice de manière sûre et équitable », indique le rapport de l'indice.
Un rapport des Nations unies sur les droits humains publié en janvier 2024 a souligné « un manque de clarté concernant le cadre juridique applicable aux plaintes pour violence sexiste à l'égard des femmes et des filles en Afghanistan, notamment en ce qui concerne la question de savoir quel acteur judiciaire est responsable de chaque étape de la chaîne judiciaire pour ce type de plaintes ». Le rapport souligne que « de nombreuses victimes préféreraient apparemment recourir à des mécanismes traditionnels de résolution des conflits par crainte des autorités de facto ».
« Un enfer pour les femmes »
Fanoos*, issue d'une famille de dix personnes vivant dans la province de Jawzjan, était une étudiante brillante qui a obtenu une licence dans une université privée. Après avoir obtenu son diplôme, elle a rapidement décroché son premier emploi dans le cadre d'un projet de développement.
Elle était fière de ses réalisations et de sa carrière. Mais son indépendance a pris fin brutalement lorsque les talibans ont interdit aux femmes afghanes de travailler pour des ONG, l'ONU et de nombreuses autres organisations. Craignant pour sa sécurité en tant qu'ancienne employée du gouvernement précédent, les parents de Fanoos l'ont contrainte à se fiancer à un Afghan qu'elle n'avait jamais rencontré et qui vit en Turquie. Chaque fois qu'elle suggérait de rompre ses fiançailles, son père et ses frères maltraitaient physiquement la jeune femme de 23 ans. Sa mère refusait également de l'aider.
Le désespoir de Fanoos était tel qu'elle s'est tailladé les poignets avec un couteau, perdant connaissance avant que sa sœur ne la découvre.
« Les femmes n'ont pas le droit de travailler, de choisir leur partenaire de vie ou d'accéder à l'éducation. L'Afghanistan est devenu un enfer pour les femmes », dit-elle. « Dans ces circonstances difficiles et sombres, nous ne pouvons nous plaindre à personne de nos problèmes familiaux car, pour eux, battre les femmes est normal. »
« Selon les talibans, il n'est pas nécessaire que les femmes engagent des poursuites judiciaires et aillent devant les tribunaux. Même si elles sont victimes de violences au sein de leur famille, celles-ci sont soit justifiées, soit elles doivent les gérer en privé, au sein de leur famille », explique Shaharzad Akbar, ancienne présidente de la Commission indépendante des droits humains en Afghanistan, ajoutant que les talibans ne voyaient « aucun rôle pour le système judiciaire dans la protection des femmes contre la violence ».
« Il n'y a pas de porte officielle à laquelle frapper, sauf celle de la famille, si elle est solidaire », explique Akbar, aujourd'hui directrice exécutive de Rawadari, une nouvelle organisation afghane de défense des droits humains.
Les expert·es de l'ONU établissent également un lien entre la résurgence des talibans et l'augmentation du nombre de mariages précoces, qui exposent les filles à un risque particulier de violence sexiste perpétrée en toute impunité.
Nazanin* n'a que 15 ans et est prisonnière d'une vie qu'elle n'a ni choisie ni souhaitée. Elle a été contrainte de se fiancer à 13 ans et mariée à 14 ans. Elle vit dans la ville de Sheberghan, dans la province de Jawzjan, et envie les filles qu'elle voit jouer dans les ruelles près de la maison qu'elle partage avec son mari de 16 ans, qui gagne sa vie en achetant et en vendant de la ferraille, et sa famille.
« Il utilise la moitié de ses revenus pour acheter des cigarettes et donne le reste à son père. Il ne me donne pas d'argent, même si j'en ai besoin », dit-elle. Par conséquent, bien que Nazanin soit enceinte de son premier enfant, elle n'a pas le droit de se reposer. Chaque jour, elle doit transporter deux bidons de 10 litres d'eau depuis la pompe du village. Chaque nuit, elle s'inquiète pour son avenir et celui de son bébé à naître.
« Parfois, quand je pense à quitter la maison, je me demande où je pourrais aller et qui me tendrait la main et m'offrirait une vie meilleure. Je n'ai personne », dit-elle.
Mahtab Safi, Freshta Ghani et Mehsa Elham, 4 mars 2024
Cet article du Zan Times a été publié en partenariat éditorial avec l'IWPR.
* Les noms ont été modifiés afin de protéger l'identité des personnes interrogées et des journalistes.
https://zantimes.com/2024/03/04/an-epidemic-of-gender-based-violence-in-afghanistan-i-dont-want-to-live-i-want-to-die/
Traduction DE
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lutte contre les violences patriarcales faites aux femmes :nous ne voulons plus attendre !

Partout dans le monde, au travail, à la maison, dans la rue : les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux minorités de genre restent une réalité insupportable. Elles ne viennent pas de nulle part : elles découlent d'un système de domination : le patriarcat ! Violences conjugales, violences sexuelles, violences sexistes au travail, violences intra-familiales touchent en immense majorité les femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/17/25-novembre-2025-contre-le-patriarcat-ni-oubli-ni-silence-marchons-contre-les-violences/?jetpack_skip_subscription_popup
Ce système patriarcal qui les génère et les perpétue est la première cible de la lutte à mener. Depuis plusieurs années, Macron se contente de modifications juridiques à la marge sur ce sujet, sans donner les véritables moyens d'éradiquer ces violences. Nous pouvons, nous devons agir !
3 milliards pour que les femmes ne subissent plus les violences sexistes et sexuelles, c'est donc trop demander ?*
La rigueur budgétaire que la Macronie et ses alliés tentent de nous imposer ne pourra qu'accentuer ces violences. Au delà du fait que les femmes sont toujours plus impactées par les coupes budgétaires, ce sont aussi les associations qui en payent le prix. En particulier celles qui luttent contre les violences et accompagnent les victimes au quotidien. Alors que le nombre de femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales n'a jamais été aussi haut (en hausse de 11% en un an selon les chiffres du ministère de l'Intérieur), les subventions des associations diminuent drastiquement, le système d'aide est saturé. 40% des victimes qui demandent un hébergement sont renvoyées chez elles, donc confrontées à un conjoint violent.
Quant à la prise en charge des plaintes, là encore les améliorations se font attendre. Les moyens manquent, notamment en matière de formation des forces de l'ordre, l'Etat ne les prenant plus en charge financièrement depuis janvier !
Pour Solidaires, il est aussi nécessaire d'agir contre les violences conjugales et leurs conséquences sur nos lieux de travail. En sensibilisant l'ensemble du personnel, on permet une meilleure détection et orientation des salariées concernées. Les entreprises comme les administrations doivent prendre des mesures d'actions sociales et administratives pour aider matériellement les victimes (logement, prise en charge des frais juridiques, aménagement d'horaires, facilités de mutation, congés rémunérés pour faire des démarches …).
* Où trouver 3 milliards ? Boîte à idées :
• l'augmentation du budget de l'armée dans le projet de loi de finances 2026 est de 6,7 milliards…
• un nouveau porte-avion nucléaire est en cours de construction en 2025, coût estimé 10 milliards…
• la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises pourrait rapporter de 4 à 6 milliards en 2026 si elle était maintenue.
Sexisme et culture du viol, toujours ancrés dans la société…
La question spécifique des violences sexuelles n'avance pas ou si peu. Avec l'un des plus petits budgets de l'État, aujourd'hui, les moyens manquent toujours cruellement. Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées a doublé sur la période depuis 2016, et ça n'est que la partie émergée !
… Et dans les entreprises !
60% des femmes sont ou seront victimes de violence sexistes et sexuelles au travail. Les remarques indécentes répétées, blagues sexistes, attitudes et gestes non sollicités sont encore le quotidien de nombreuses travailleuses. Dans les cas d'agressions sexuelles et de harcèlement, les victimes se confrontent trop souvent à des directions qui tentent de leur mettre des bâtons dans les roues. Ici aussi, elles doivent se battre pour que les rôles ne soient pas inversés, leurs agresseurs considérés comme des victimes et elles, comme des coupables…
La ratification de la Convention 190 de l'Organisation Internationale du Travail de 2019 (première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles au travail) s'est faite à moyens constants, sans adopter de lois qui auraient permis clairement de valider des droits supplémentaires pour les femmes, ce n'est pas admissible ! Alors que d'autres pays ont pris des mesures comme l'Irlande qui a instauré un congés payés aux victimes de violences domestiques
Malgré tout, les choses bougent, même si c'est encore trop lent, trop rare. Les femmes, seules ou dans des collectifs, des associations féministes, avec les syndicats, parlent et dénoncent les faits dont elles sont victimes et ce dans de nombreux domaines : le sport, la culture, les universités, mais également les associations, les partis politiques, les structures syndicales. Aucun milieu n'est épargné par les violences sexistes et sexuelles.
Désormais il faut agir, concrètement !
L'extrême droite, ennemi mortel… Des femmes !
La montée en puissance des mouvements réactionnaires et masculinistes, en France comme ailleurs dans le monde, représente une menace majeure pour les droits des femmes et des personnes minorisées de genre.
Bien que les tentatives de le dissimuler soient nombreuses, le sexisme demeure l'un des fondements idéologiques de l'extrême droite. Certaines femmes s'y engagent ouvertement et défendent ses thèses, tout en promouvant une vision rétrograde du rôle des femmes : celui d'une mère blanche, gardienne des « valeurs traditionnelles » de la France, dévouée à son foyer et soumise à son mari.
L'une des stratégies les plus efficaces de ces partis d'extrême droite consiste à détourner certaines revendications féministes. Ça n'est qu'un moyen de plus pour diffuser, sous une apparence plus lisse, les idées nauséabondes et réactionnaires des fascistes.
Leur propagande mensongère s'appuie sur des thèmes comme les violences de rue ou le harcèlement, qu'ils attribuent exclusivement aux « étrangers violeurs ».
Derrière cette instrumentalisation des peurs se cache une volonté de contrôler à nouveau les femmes, de les cantonner à un rôle docile et subordonné, loin de toute émancipation politique et sociale.
Solidaires revendique :
* 3 milliards dans le budget consacré à la lutte et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles
* Des moyens conséquents pour les associations qui luttent et accompagnent les femmes victimes de violences,
* l'augmentation du nombre de places d'accueil en hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.
* Au travail, un droit à 20 jours de congés rémunérés, sans préavis et sans justificatif, destiné à faciliter les démarches nécessaires aux victimes de violences intra-familiales
* Des aménagements de travail tels que des droits à la mobilité géographique, fonctionnelle, ou des changements d'horaires en cas de violences conjugales notamment.
* L'interdiction de sanctions et du licenciement des femmes, et des minorités de genre, victimes de violence.
* Le renforcement des services de soins, de justice et d'accompagnement socio-éducatif compétent en matière de violences intra-familiales.
* Une reconnaissance des violences intrafamiliales pendant le télétravail en accident du travail.
* De faciliter les démarches de déclaration (plaintes, signalements, information à l'employeur) afin d'éviter la répétition des entretiens où les femmes et l'ensemble des victimes doivent exposer les faits de violences intrafamiliales.
* La formation des salarié·es et des différents acteurs de la prévention et de l'encadrement à la lutte et la prise en charge des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles
* La reconnaissance de toutes les violences au travail
* Une véritable prévention avec la mise en place effective et non détournée de l'EVARS (Éducation à la Vie Affective Relationnelle et à la Sexualité).
Solidaires appelle à participer massivement aux manifestations et rassemblements autour de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes !
violences !
Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l'avons déjà fait le 11 octobre, avec et pour les femmes du monde entier : celles qui sont victimes des violences machistes, des conflits armés, des famines, des spoliations de terres et de leurs biens naturels, des gouvernements réactionnaires et des états théocratiques. Avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, dont les voix sont étouffées, qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations.
Le 25 novembre nous marcherons pour rendre hommage à toutes les victimes de la violence machiste, les femmes, les filles, les personnes LGBTQIA+, à toutes celles qui souffrent et qui luttent, en dépit des risques encourus. A toutes celles que nous avons perdues.
Les violences et l'impunité des agresseurs persistent 8 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, en plein #MeToo. La plupart du temps, encore, les victimes ne sont pas crues, les plaintes classées sans suite. Le parcours judiciaire revictimise bien souvent les femmes et constitue un obstacle à la sortie de la violence comme la baisse du financement public des associations d'accompagnement des victimes.
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps : dans nos espaces familiaux, sur nos lieux de travail et d'études, dans l'espace public, dans les transports, dans les établissements de soin, les cabinets gynécologiques, dans les maternités, dans les ateliers des chaînes d'approvisionnement des multinationales, les commissariats, les centres de rétention, dans les milieux du théâtre, du cinéma, du sport, en politique… Dans tous les milieux sociaux.
Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent au croisement de plusieurs systèmes d'oppressions.
Ainsi les femmes les plus touchées par ces violences sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : les femmes victimes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, les femmes migrantes, sans papiers, les travailleuses précaires, les femmes sans domicile et autres femmes précarisées, femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes et bi, les femmes trans, les femmes en situation de prostitution, et celles victimes de l'industrie pédo et pornocriminelle.
Sans autorisation de travailler, les femmes étrangères dont les demandeuses d'asile sont très vulnérables aux réseaux de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
En France, en 2024, c'est encore plus d'un féminicide tous les trois jours commis par un conjoint ou un ex-conjoint Des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes. Le nombre de femmes victimes de violences dans le couple et les enfants co-victimes ne diminue pas, tout comme les viols ou tentatives.
La quasi-totalité des agresseurs sont des hommes (97,3%).
Une femme en situation de handicap sur cinq a été victime de viol. 50% des lesbiennes et 75% des bi ont été confrontées à des violences dans l'espace public et 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe. Les femmes âgées de plus de 70 ans ne sont pas prises en compte dans les enquêtes sur les violences, elles représentent pourtant 21% des féminicides.
160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, en majorité au sein de la famille. Sur les lieux de travail plus de 8000 viols ou tentatives ont lieu chaque année et un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel. Les employeurs publics et privés doivent faire cesser les violences et protéger les victimes, y compris de violences conjugales.
La montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde constitue une menace majeure pour les droits des femmes et en France, le danger de son accession au pouvoir n'est pas écarté. Ces droits sont attaqués dès que l'extrême droite est au pouvoir.
Depuis quelque temps, elle prétend lutter contre les violences faites aux femmes. Sous couvert de défendre certaines d'entre elles, ces mouvements exploitent la question des violences sexistes à des fins racistes et fémonationalistes, ne s'indignant que selon l'origine, la nationalité ou la religion réelle ou supposée des agresseurs. Dans ce climat délétère, les femmes portant le voile sont de plus en plus souvent la cible d'agressions dans la rue, dans les médias, comme dans les discours politiques.
Les groupuscules fascistes attaquent régulièrement des militantes et militants sans réaction des pouvoirs publics.
Derrière les slogans et les postures prétendument féministes, l'extrême droite ne défend ni la liberté des femmes, ni leur émancipation, ni l'égalité, et se désintéresse profondément de la réalité et des droits des femmes qui luttent dans le monde.
Sans politique publique à grands moyens, sans prévention et sans éducation, les garçons et les hommes continueront de perpétrer des violences
Les organisations féministes et syndicales exigent :
* Une loi-cadre intégrale contre les violences, comme en Espagne.
* 3 milliards d'euros nécessaires pour la mettre en œuvre
* Une Éducation à la Vie Affective Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) effective partout
* L'arrêt immédiat de la baisse des financements
et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent les victimes et assurent l'éducation populaire sur les questions de violences et d'égalité femmes-hommes.
Tant que l'une d'entre nous n'est pas libre, tant que les violences machistes s'exerceront sur une seule d'entre nous, nous lutterons !
Nous appelons à participer aux mobilisations à l'occasion de la journée internationale des droits des enfants et pour le jour du souvenir trans (TDoR).
Contre les violences faites aux femmes et aux filles, les violences sexistes et sexuelles, manifestons partout le samedi 22 novembre 2025 et le mardi 25 novembre 2025 !
Le 20 octobre 2025
Manifestons partout le samedi 22 novembre 2025
et le mardi 25 novembre 2025 !
Premières signataires au 25 Octobre 2025
ACDI Cameroun , ActionAid France, Assemblée des Femmes, Attac France, CGT confédération Générale du Travail, CNT-SO Éducation/Recherche, Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, Collectif National pour les Droits des femmes, Collectif des Féministes Narbonnais.es, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), CRID, Égalités, Excision parlons-en !, FAGE, FEMEN France, Femmes Égalité, Femmes Solidaires, Femmes Solidaires 80, Fondation Copernic, Force Féministe (57), France Amérique latine FAL , FSU, Genre et altermondialisme, Iran Justice, Las Rojas Paris, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des femmes Thérèse Clerc de Montreuil, Marche Mondiale des Femmes France, Mouvement de la Paix, Mouvement des femmes kurdes, Organisation de Solidarité Trans (OST), UNEF le syndicat étudiant, Union des femmes socialistes SKB, Union Étudiante , Union syndicale Solidaires, Visa – Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes.
En soutien
Génération-s, L'APRÈS La France insoumise, Les Jeunes de L'APRÈS, NPA-l'Anticapitaliste, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, Socialisme ou Barbarie France, Réseau coopératif Gauche Alternative, Union communiste libertaire
Télécharger l'appel :
Appel GREVEFEMINISTE 25 novembre 2025 au 25102025
******
#25Nov25
Appel à l'action : Ni guerre, ni galère — justice, paix et souveraineté pour les femmes paysannes, maintenant !
Bagnolet, 3 novembre – Depuis 26 ans, le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, rappelle au monde : NON à la violence contre les femmes ! Cependant, cette journée intervient dans un contexte marqué par de multiples crises — climatique, alimentaire, économique, politique, migratoire et des soins — qui menacent les avancées en matière d'égalité, au point que, selon ONU Femmes, il faudra près de 300 ans pour atteindre l'égalité de genre.
La situation reste plus alarmante que jamais : les quelques droits acquis par les femmes — en particulier par les femmes paysannes, bergères, pêcheuses, sans-terre, salariées agricoles et saisonnières — reculent aujourd'hui, tandis que les taux de violence continuent d'augmenter en milieu rural.
Selon le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation des femmes et des filles rurales, 43% de la population mondiale vit en zones rurales, et parmi les 80% des personnes vivant en situation d'extrême pauvreté dans ces zones, la moitié sont des femmes. Le rapport souligne que l'inégalité persiste : les femmes rurales ne gagnent que 82 centimes pour chaque dollar perçu par les hommes dans l'agriculture, et dans de nombreux pays, seules 29% des lois garantissent effectivement l'égalité des droits fonciers.
Nous observons également avec grande inquiétude la montée de la droite et de l'extrême droite à l'échelle mondiale, ainsi que les conservatismes qui portent atteinte aux droits historiques et fondamentaux des femmes. Cette dynamique s'accompagne de guerres, conflits, génocides, crises climatiques, discriminations, colonisations directes et indirectes des territoires, et militarisme, exposant les femmes paysannes, les enfants et les personnes LGBTQIA+ à de graves menaces pour leur sécurité et à diverses formes de violence systémique et structurelle.
En tant que mouvement paysan international, nous sommes horrifié·e·s de voir que, dans certaines régions du monde — Gaza, le Soudan, le Congo, Haïti et l'Équateur — les populations subissent quotidiennement massacres, exécutions brutales et attaques extrêmes, où la violence atteint son paroxysme.
En 2024, l'ONU a estimé que 676 millions de femmes, filles, soit 17% de la population mondiale, vivaient à moins de 50 km de zones de conflit, le chiffre le plus élevé depuis les années 1990. Cette réalité constitue une catastrophe humanitaire de dimension planétaire. Malgré l'ampleur de ces atrocités, les droits internationaux et les mécanismes de protection restent largement dépassés, incapables de protéger les survivant·e·s. Les femmes, et les filles paient le prix le plus lourd et sont exposées à des tactiques de guerre brutales, telles que l'utilisation de la famine ou de la violence sexuelle comme armes de guerre.
Les femmes rurales comme urbaines, qu'elles vivent dans le monde arabe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Europe, subissent toutes violences, injustices et crimes contre l'humanité. Ces réalités sont indéniables et ne peuvent plus être minimisées. La violence affecte tous les aspects de la vie d'une femme : physique, psychologique, sexuelle, économique, politique, patrimoniale, culturelle, institutionnelle et environnementale.
À cela s'ajoutent des taux alarmants de féminicides, preuve que le droit fondamental à la vie des femmes — gardiennes de la vie — reste en danger permanent. Selon un rapport de l'ONU publié en 2024, chaque jour, 140 femmes, et filles meurent sous les coups ou agissements de leur partenaire ou d'un proche, soit une personne toutes les dix minutes.
Cette réalité reflète les défaillances d'un système mondial à la fois capitaliste, patriarcal, colonial et raciste, qui oriente les politiques locales et internationales et condamne la moitié de la planète à vivre dans un danger permanent et une injustice structurelle, loin de toute égalité de genre. L'universalité de ces faits n'est pas anodine : elle est renforcée par les hiérarchies patriarcales et la faible représentation féministe dans les espaces de pouvoir, perpétuant la violence structurelle et l'inégalité de genre.
Les femmes paysannes, autochtones, travailleuses migrantes, sans terre, bergères, pêcheuses, nomades et cueilleuses sont en première ligne des luttes et résistances contre toutes les formes de violence et contre le système capitaliste mondial qui confisque la souveraineté des peuples et la paix. Gardiennes des systèmes de vie et de la résilience des communautés, elles sont au cœur des combats pour la justice climatique, la terre et une alimentation saine. Protectrices de la terre, elles préservent leurs territoires et les semences, et nourrissent leurs familles, leurs communautés et le monde entier. Leur travail de soin défie les modèles économiques et politiques de mort : elles préservent les pratiques agricoles ancestrales, assurent la production et la transformation des aliments, garantissent une alimentation saine pour toutes et tous et jouent un rôle crucial dans la lutte pour la souveraineté alimentaire, tout en proposant des changements structurels basés sur les droits et en étant actrices politiques de transformations qui soutiennent la vie et la planète.
Elles réalisent un travail productif — qui soutient les économies locales et les territoires — et un travail reproductif — qui préserve la vie, la solidarité et la cohésion des communautés. Pourtant, au cœur même de cette mission vitale, elles se trouvent privées de leur droit à la terre et aux ressources qui garantissent leur autonomie, leur dignité et la justice. Elles sont les plus touchées par la famine, les crises climatiques, la pauvreté et le manque de soins.
C'est pourquoi notre mouvement considère que la véritable révolution vers un monde plus juste, en paix et capable de garantir la souveraineté alimentaire ne pourra advenir sans les femmes et leur justice. Nous poursuivons notre lutte paysanne, femmes et hommes uni.e.s, pour défendre la vie et la justice dans le monde contre ce système global basé sur la logique de destruction et le profit capitaliste, qui menace la Terre-Mère, les systèmes écologiques, les communautés rurales, la souveraineté alimentaire, notre santé et les générations de demain.
Notre vision du monde, basée sur les principes de souveraineté alimentaire, réforme agraire et pratiques agroécologiques, est une réponse à toutes ces crises contre la pauvreté et la famine.
En ce jour, nous appelons toutes nos organisations régionales et locales, nos allié·e·s, nos mouvements et collectifs sociaux, ainsi que toutes les personnes de conscience, à se réunir et à se mobiliser pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les diversités, tant à la campagne qu'en ville, et face aux guerres et aux génocides.
Notre lutte pour la paix est collective et solidaire.
Ensemble, nous pouvons changer cette réalité et affronter un système capitaliste mondial qui nous affecte toutes et tous.
Rejoignez l'action mondiale !
Tout au long du mois de novembre, nous vous invitons à vous auto-organiser et à partager vos actions locales avec nous. Nous vous encourageons également à tisser des alliances avec nos organisations nationales et régionales afin d'amplifier nos luttes collectives. Nous le ferons en construisant l'unité d'action ! Il est temps d'enraciner les féminismes dans les luttes paysannes et d'unir nos forces dans la lutte pour la souveraineté alimentaire !
Le 25 novembre, nous lancerons notre nouvelle publication : « Justice climatique, la perspective du féminisme paysan et populaire », disponible en espagnol, français, anglais et portugais. Consultez notre site officiel pour la télécharger et l'utiliser dans les formations aux niveaux régional, national et local.
Kit de communication : lien ICI– Affiche officielle + Formats pour les réseaux sociaux — adaptez l'affiche à votre langue locale ; une version vierge est également disponible.
Mur des actions mondiales : téléversez via ce LIEN les actions locales et régionales que vous réaliserez durant cette journée. Utilisez également ce mur comme outil de consultation pour découvrir toutes les actions menées à l'échelle mondiale.
Utilisez ces hashtags : #25N25 #StopAuxViolencesFaitesAuxFemmes #FemmesEnLutte #FéminismePaysanEtPopulaire
Telegram pour les dernières mises à jour : t.me/lvcstruggles
Facebook : @ViaCampesinaOfficial
Instagram : @la_via_campesina_official
X : @viacampesinaFR
Mastodon : @vicampesina_fr@movimientos.social
Envoyez vos actions (communiqués, invitations, photos ou vidéos) à : communications@viacampesina.org
Demandes de presse : press@viacampesina.org
Cette publication est également disponible en English : liste des langues séparées par une virgule, Español : dernière langue.
https://viacampesina.org/fr/25nov25-appel-a-laction-ni-guerre-ni-galere-justice-paix-et-souverainete-pour-les-femmes-paysannes-maintenant/
******
Lutte contre les violences patriarcales faites aux femmes :
nous ne voulons plus attendre !
Partout dans le monde, au travail, à la maison, dans la rue : les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux minorités de genre restent une réalité insupportable. Elles ne viennent pas de nulle part : elles découlent d'un système de domination : le patriarcat ! Violences conjugales, violences sexuelles, violences sexistes au travail, violences intra-familiales touchent en immense majorité les femmes.
Ce système patriarcal qui les génère et les perpétue est la première cible de la lutte à mener. Depuis plusieurs années, Macron se contente de modifications juridiques à la marge sur ce sujet, sans donner les véritables moyens d'éradiquer ces violences. Nous pouvons, nous devons agir !
3 milliards pour que les femmes ne subissent plus les violences sexistes et sexuelles, c'est donc trop demander ?*
La rigueur budgétaire que la Macronie et ses alliés tentent de nous imposer ne pourra qu'accentuer ces violences. Au delà du fait que les femmes sont toujours plus impactées par les coupes budgétaires, ce sont aussi les associations qui en payent le prix. En particulier celles qui luttent contre les violences et accompagnent les victimes au quotidien. Alors que le nombre de femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales n'a jamais été aussi haut (en hausse de 11% en un an selon les chiffres du ministère de l'Intérieur), les subventions des associations diminuent drastiquement, le système d'aide est saturé. 40% des victimes qui demandent un hébergement sont renvoyées chez elles, donc confrontées à un conjoint violent.
Quant à la prise en charge des plaintes, là encore les améliorations se font attendre. Les moyens manquent, notamment en matière de formation des forces de l'ordre, l'Etat ne les prenant plus en charge financièrement depuis janvier !
Pour Solidaires, il est aussi nécessaire d'agir contre les violences conjugales et leurs conséquences sur nos lieux de travail. En sensibilisant l'ensemble du personnel, on permet une meilleure détection et orientation des salariées concernées. Les entreprises comme les administrations doivent prendre des mesures d'actions sociales et administratives pour aider matériellement les victimes (logement, prise en charge des frais juridiques, aménagement d'horaires, facilités de mutation, congés rémunérés pour faire des démarches …).
* Où trouver 3 milliards ? Boîte à idées :
• l'augmentation du budget de l'armée dans le projet de loi de finances 2026 est de 6,7 milliards…
• un nouveau porte-avion nucléaire est en cours de construction en 2025, coût estimé 10 milliards…
• la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises pourrait rapporter de 4 à 6 milliards en 2026 si elle était maintenue.
Sexisme et culture du viol, toujours ancrés dans la société…
La question spécifique des violences sexuelles n'avance pas ou si peu. Avec l'un des plus petits budgets de l'État, aujourd'hui, les moyens manquent toujours cruellement. Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées a doublé sur la période depuis 2016, et ça n'est que la partie émergée !
… Et dans les entreprises !
60% des femmes sont ou seront victimes de violence sexistes et sexuelles au travail. Les remarques indécentes répétées, blagues sexistes, attitudes et gestes non sollicités sont encore le quotidien de nombreuses travailleuses. Dans les cas d'agressions sexuelles et de harcèlement, les victimes se confrontent trop souvent à des directions qui tentent de leur mettre des bâtons dans les roues. Ici aussi, elles doivent se battre pour que les rôles ne soient pas inversés, leurs agresseurs considérés comme des victimes et elles, comme des coupables…
La ratification de la Convention 190 de l'Organisation Internationale du Travail de 2019 (première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles au travail) s'est faite à moyens constants, sans adopter de lois qui auraient permis clairement de valider des droits supplémentaires pour les femmes, ce n'est pas admissible ! Alors que d'autres pays ont pris des mesures comme l'Irlande qui a instauré un congés payés aux victimes de violences domestiques
Malgré tout, les choses bougent, même si c'est encore trop lent, trop rare. Les femmes, seules ou dans des collectifs, des associations féministes, avec les syndicats, parlent et dénoncent les faits dont elles sont victimes et ce dans de nombreux domaines : le sport, la culture, les universités, mais également les associations, les partis politiques, les structures syndicales. Aucun milieu n'est épargné par les violences sexistes et sexuelles.
Désormais il faut agir, concrètement !
L'extrême droite, ennemi mortel… Des femmes !
La montée en puissance des mouvements réactionnaires et masculinistes, en France comme ailleurs dans le monde, représente une menace majeure pour les droits des femmes et des personnes minorisées de genre.
Bien que les tentatives de le dissimuler soient nombreuses, le sexisme demeure l'un des fondements idéologiques de l'extrême droite. Certaines femmes s'y engagent ouvertement et défendent ses thèses, tout en promouvant une vision rétrograde du rôle des femmes : celui d'une mère blanche, gardienne des « valeurs traditionnelles » de la France, dévouée à son foyer et soumise à son mari.
L'une des stratégies les plus efficaces de ces partis d'extrême droite consiste à détourner certaines revendications féministes. Ça n'est qu'un moyen de plus pour diffuser, sous une apparence plus lisse, les idées nauséabondes et réactionnaires des fascistes.
Leur propagande mensongère s'appuie sur des thèmes comme les violences de rue ou le harcèlement, qu'ils attribuent exclusivement aux « étrangers violeurs ».
Derrière cette instrumentalisation des peurs se cache une volonté de contrôler à nouveau les femmes, de les cantonner à un rôle docile et subordonné, loin de toute émancipation politique et sociale.
Solidaires revendique :
* 3 milliards dans le budget consacré à la lutte et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles
* Des moyens conséquents pour les associations qui luttent et accompagnent les femmes victimes de violences,
* l'augmentation du nombre de places d'accueil en hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.
* Au travail, un droit à 20 jours de congés rémunérés, sans préavis et sans justificatif, destiné à faciliter les démarches nécessaires aux victimes de violences intra-familiales
* Des aménagements de travail tels que des droits à la mobilité géographique, fonctionnelle, ou des changements d'horaires en cas de violences conjugales notamment.
* L'interdiction de sanctions et du licenciement des femmes, et des minorités de genre, victimes de violence.
* Le renforcement des services de soins, de justice et d'accompagnement socio-éducatif compétent en matière de violences intra-familiales.
* Une reconnaissance des violences intrafamiliales pendant le télétravail en accident du travail.
* De faciliter les démarches de déclaration (plaintes, signalements, information à l'employeur) afin d'éviter la répétition des entretiens où les femmes et l'ensemble des victimes doivent exposer les faits de violences intrafamiliales.
* La formation des salarié·es et des différents acteurs de la prévention et de l'encadrement à la lutte et la prise en charge des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles
* La reconnaissance de toutes les violences au travail
* Une véritable prévention avec la mise en place effective et non détournée de l'EVARS (Éducation à la Vie Affective Relationnelle et à la Sexualité).
Solidaires appelle à participer massivement aux manifestations
et rassemblements autour de la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

25 novembre 2025 : contre le patriarcat : ni oubli, ni silence, marchons contre les violences !

Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l'avons déjà fait le 11 octobre, avec et pour les femmes du monde entier : celles qui sont victimes des violences machistes, des conflits armés, des famines, des spoliations de terres et de leurs biens naturels, des gouvernements réactionnaires et des états théocratiques. Avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, dont les voix sont étouffées, qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/17/25-novembre-2025-contre-le-patriarcat-ni-oubli-ni-silence-marchons-contre-les-violences/?jetpack_skip_subscription_popup
Le 25 novembre nous marcherons pour rendre hommage à toutes les victimes de la violence machiste, les femmes, les filles, les personnes LGBTQIA+, à toutes celles qui souffrent et qui luttent, en dépit des risques encourus. A toutes celles que nous avons perdues.
Les violences et l'impunité des agresseurs persistent 8 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, en plein #MeToo. La plupart du temps, encore, les victimes ne sont pas crues, les plaintes classées sans suite. Le parcours judiciaire revictimise bien souvent les femmes et constitue un obstacle à la sortie de la violence comme la baisse du financement public des associations d'accompagnement des victimes.
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps : dans nos espaces familiaux, sur nos lieux de travail et d'études, dans l'espace public, dans les transports, dans les établissements de soin, les cabinets gynécologiques, dans les maternités, dans les ateliers des chaînes d'approvisionnement des multinationales, les commissariats, les centres de rétention, dans les milieux du théâtre, du cinéma, du sport, en politique… Dans tous les milieux sociaux.
Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent au croisement de plusieurs systèmes d'oppressions.
Ainsi les femmes les plus touchées par ces violences sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : les femmes victimes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, les femmes migrantes, sans papiers, les travailleuses précaires, les femmes sans domicile et autres femmes précarisées, femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes et bi, les femmes trans, les femmes en situation de prostitution, et celles victimes de l'industrie pédo et pornocriminelle.
Sans autorisation de travailler, les femmes étrangères dont les demandeuses d'asile sont très vulnérables aux réseaux de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
En France, en 2024, c'est encore plus d'un féminicide tous les trois jours commis par un conjoint ou un ex-conjoint Des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes. Le nombre de femmes victimes de violences dans le couple et les enfants co-victimes ne diminue pas, tout comme les viols ou tentatives.
La quasi-totalité des agresseurs sont des hommes (97,3%).
Une femme en situation de handicap sur cinq a été victime de viol. 50% des lesbiennes et 75% des bi ont été confrontées à des violences dans l'espace public et 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe. Les femmes âgées de plus de 70 ans ne sont pas prises en compte dans les enquêtes sur les violences, elles représentent pourtant 21% des féminicides.
160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, en majorité au sein de la famille. Sur les lieux de travail plus de 8000 viols ou tentatives ont lieu chaque année et un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel. Les employeurs publics et privés doivent faire cesser les violences et protéger les victimes, y compris de violences conjugales.
La montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde constitue une menace majeure pour les droits des femmes et en France, le danger de son accession au pouvoir n'est pas écarté. Ces droits sont attaqués dès que l'extrême droite est au pouvoir.
Depuis quelque temps, elle prétend lutter contre les violences faites aux femmes. Sous couvert de défendre certaines d'entre elles, ces mouvements exploitent la question des violences sexistes à des fins racistes et fémonationalistes, ne s'indignant que selon l'origine, la nationalité ou la religion réelle ou supposée des agresseurs. Dans ce climat délétère, les femmes portant le voile sont de plus en plus souvent la cible d'agressions dans la rue, dans les médias, comme dans les discours politiques.
Les groupuscules fascistes attaquent régulièrement des militantes et militants sans réaction des pouvoirs publics.
Derrière les slogans et les postures prétendument féministes, l'extrême droite ne défend ni la liberté des femmes, ni leur émancipation, ni l'égalité, et se désintéresse profondément de la réalité et des droits des femmes qui luttent dans le monde.
Sans politique publique à grands moyens, sans prévention et sans éducation, les garçons et les hommes continueront de perpétrer des violences
Les organisations féministes et syndicales exigent :
* Une loi-cadre intégrale contre les violences, comme en Espagne.
* 3 milliards d'euros nécessaires pour la mettre en œuvre
* Une Éducation à la Vie Affective Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) effective partout
* L'arrêt immédiat de la baisse des financements
et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent les victimes et assurent l'éducation populaire sur les questions de violences et d'égalité femmes-hommes.
Tant que l'une d'entre nous n'est pas libre, tant que les violences machistes s'exerceront sur une seule d'entre nous, nous lutterons !
Nous appelons à participer aux mobilisations à l'occasion de la journée internationale des droits des enfants et pour le jour du souvenir trans (TDoR).
Contre les violences faites aux femmes et aux filles, les violences sexistes et sexuelles, manifestons partout le samedi 22 novembre 2025 et le mardi 25 novembre 2025 !
Le 20 octobre 2025
Manifestons partout le samedi 22 novembre 2025
et le mardi 25 novembre 2025 !
Premières signataires au 25 Octobre 2025
ACDI Cameroun , ActionAid France, Assemblée des Femmes, Attac France, CGT confédération Générale du Travail, CNT-SO Éducation/Recherche, Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, Collectif National pour les Droits des femmes, Collectif des Féministes Narbonnais.es, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), CRID, Égalités, Excision parlons-en !, FAGE, FEMEN France, Femmes Égalité, Femmes Solidaires, Femmes Solidaires 80, Fondation Copernic, Force Féministe (57), France Amérique latine FAL , FSU, Genre et altermondialisme, Iran Justice, Las Rojas Paris, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des femmes Thérèse Clerc de Montreuil, Marche Mondiale des Femmes France, Mouvement de la Paix, Mouvement des femmes kurdes, Organisation de Solidarité Trans (OST), UNEF le syndicat étudiant, Union des femmes socialistes SKB, Union Étudiante , Union syndicale Solidaires, Visa – Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes.
En soutien
Génération-s, L'APRÈS La France insoumise, Les Jeunes de L'APRÈS, NPA-l'Anticapitaliste, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, Socialisme ou Barbarie France, Réseau coopératif Gauche Alternative, Union communiste libertaire
Télécharger l'appel :
Appel GREVEFEMINISTE 25 novembre 2025 au 25102025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel à l’action : Ni guerre, ni galère — justice, paix et souveraineté pour les femmes paysannes, maintenant !

Bagnolet, 3 novembre – Depuis 26 ans, le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, rappelle au monde : NON à la violence contre les femmes ! Cependant, cette journée intervient dans un contexte marqué par de multiples crises — climatique, alimentaire, économique, politique, migratoire et des soins — qui menacent les avancées en matière d'égalité, au point que, selon ONU Femmes, il faudra près de300 ans pour atteindre l'égalité de genre.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/17/25-novembre-2025-contre-le-patriarcat-ni-oubli-ni-silence-marchons-contre-les-violences/?jetpack_skip_subscription_popup
La situation reste plus alarmante que jamais : les quelques droits acquis par les femmes — en particulier par les femmes paysannes, bergères, pêcheuses, sans-terre, salariées agricoles et saisonnières — reculent aujourd'hui, tandis que les taux de violence continuent d'augmenter en milieu rural.
Selon le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation des femmes et des filles rurales, 43% de la population mondiale vit en zones rurales, et parmi les 80% des personnes vivant en situation d'extrême pauvreté dans ces zones, la moitié sont des femmes. Le rapport souligne que l'inégalité persiste : les femmes rurales ne gagnent que 82 centimes pour chaque dollar perçu par les hommes dans l'agriculture, et dans de nombreux pays, seules 29% des lois garantissent effectivement l'égalité des droits fonciers.
Nous observons également avec grande inquiétude la montée de la droite et de l'extrême droite à l'échelle mondiale, ainsi que les conservatismes qui portent atteinte aux droits historiques et fondamentaux des femmes. Cette dynamique s'accompagne de guerres, conflits, génocides, crises climatiques, discriminations, colonisations directes et indirectes des territoires, et militarisme, exposant les femmes paysannes, les enfants et les personnes LGBTQIA+ à de graves menaces pour leur sécurité et à diverses formes de violence systémique et structurelle.
En tant que mouvement paysan international, nous sommes horrifié·e·s de voir que, dans certaines régions du monde — Gaza, le Soudan, le Congo, Haïti et l'Équateur — les populations subissent quotidiennement massacres, exécutions brutales et attaques extrêmes, où la violence atteint son paroxysme.
En 2024, l'ONU a estimé que 676 millions de femmes, filles, soit 17% de la population mondiale, vivaient à moins de 50 km de zones de conflit, le chiffre le plus élevé depuis les années 1990. Cette réalité constitue une catastrophe humanitaire de dimension planétaire. Malgré l'ampleur de ces atrocités, les droits internationaux et les mécanismes de protection restent largement dépassés, incapables de protéger les survivant·e·s. Les femmes, et les filles paient le prix le plus lourd et sont exposées à des tactiques de guerre brutales, telles que l'utilisation de la famine ou de la violence sexuelle comme armes de guerre.
Les femmes rurales comme urbaines, qu'elles vivent dans le monde arabe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Europe, subissent toutes violences, injustices et crimes contre l'humanité. Ces réalités sont indéniables et ne peuvent plus être minimisées. La violence affecte tous les aspects de la vie d'une femme : physique, psychologique, sexuelle, économique, politique, patrimoniale, culturelle, institutionnelle et environnementale.
À cela s'ajoutent des taux alarmants de féminicides, preuve que le droit fondamental à la vie des femmes — gardiennes de la vie — reste en danger permanent. Selon un rapport de l'ONU publié en 2024, chaque jour, 140 femmes, et filles meurent sous les coups ou agissements de leur partenaire ou d'un proche, soit une personne toutes les dix minutes.
Cette réalité reflète les défaillances d'un système mondial à la fois capitaliste, patriarcal, colonial et raciste, qui oriente les politiques locales et internationales et condamne la moitié de la planète à vivre dans un danger permanent et une injustice structurelle, loin de toute égalité de genre. L'universalité de ces faits n'est pas anodine : elle est renforcée par les hiérarchies patriarcales et la faible représentation féministe dans les espaces de pouvoir, perpétuant la violence structurelle et l'inégalité de genre.
Les femmes paysannes, autochtones, travailleuses migrantes, sans terre, bergères, pêcheuses, nomades et cueilleuses sont en première ligne des luttes et résistances contre toutes les formes de violence et contre le système capitaliste mondial qui confisque la souveraineté des peuples et la paix. Gardiennes des systèmes de vie et de la résilience des communautés, elles sont au cœur des combats pour la justice climatique, la terre et une alimentation saine. Protectrices de la terre, elles préservent leurs territoires et les semences, et nourrissent leurs familles, leurs communautés et le monde entier. Leur travail de soin défie les modèles économiques et politiques de mort : elles préservent les pratiques agricoles ancestrales, assurent la production et la transformation des aliments, garantissent une alimentation saine pour toutes et tous et jouent un rôle crucial dans la lutte pour la souveraineté alimentaire, tout en proposant des changements structurels basés sur les droits et en étant actrices politiques de transformations qui soutiennent la vie et la planète.
Elles réalisent un travail productif — qui soutient les économies locales et les territoires — et un travail reproductif — qui préserve la vie, la solidarité et la cohésion des communautés. Pourtant, au cœur même de cette mission vitale, elles se trouvent privées de leur droit à la terre et aux ressources qui garantissent leur autonomie, leur dignité et la justice. Elles sont les plus touchées par la famine, les crises climatiques, la pauvreté et le manque de soins.
C'est pourquoi notre mouvement considère que la véritable révolution vers un monde plus juste, en paix et capable de garantir la souveraineté alimentaire ne pourra advenir sans les femmes et leur justice. Nous poursuivons notre lutte paysanne, femmes et hommes uni.e.s, pour défendre la vie et la justice dans le monde contre ce système global basé sur la logique de destruction et le profit capitaliste, qui menace la Terre-Mère, les systèmes écologiques, les communautés rurales, la souveraineté alimentaire, notre santé et les générations de demain.
Notre vision du monde, basée sur les principes de souveraineté alimentaire, réforme agraire et pratiques agroécologiques, est une réponse à toutes ces crises contre la pauvreté et la famine.
En ce jour, nous appelons toutes nos organisations régionales et locales, nos allié·e·s, nos mouvements et collectifs sociaux, ainsi que toutes les personnes de conscience, à se réunir et à se mobiliser pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les diversités, tant à la campagne qu'en ville, et face aux guerres et aux génocides.
Notre lutte pour la paix est collective et solidaire.
Ensemble, nous pouvons changer cette réalité et affronter un système capitaliste mondial qui nous affecte toutes et tous.
Rejoignez l'action mondiale !
Tout au long du mois de novembre, nous vous invitons à vous auto-organiser et à partager vos actions locales avec nous. Nous vous encourageons également à tisser des alliances avec nos organisations nationales et régionales afin d'amplifier nos luttes collectives. Nous le ferons en construisant l'unité d'action ! Il est temps d'enraciner les féminismes dans les luttes paysannes et d'unir nos forces dans la lutte pour la souveraineté alimentaire !
Le 25 novembre, nous lancerons notre nouvelle publication : « Justice climatique, la perspective du féminisme paysan et populaire », disponible en espagnol, français, anglais et portugais. Consultez notre site officiel pour la télécharger et l'utiliser dans les formations aux niveaux régional, national et local.
Kit de communication : lienICI– Affiche officielle + Formats pour les réseaux sociaux — adaptez l'affiche à votre langue locale ; une version vierge est également disponible.
Mur des actions mondiales : téléversez via ce LIEN les actions locales et régionales que vous réaliserez durant cette journée. Utilisez également ce mur comme outil de consultation pour découvrir toutes les actions menées à l'échelle mondiale.
Utilisez ces hashtags : #25N25 #StopAuxViolencesFaitesAuxFemmes #FemmesEnLutte #FéminismePaysanEtPopulaire
Telegram pour les dernières mises à jour : t.me/lvcstruggles
Facebook :@ViaCampesinaOfficial
Instagram : @la_via_campesina_official
X :@viacampesinaFR
Mastodon :@vicampesina_fr@movimientos.social
Envoyez vos actions (communiqués, invitations, photos ou vidéos) à : communications@viacampesina.org
Demandes de presse : press@viacampesina.org
Cette publication est également disponible en English : liste des langues séparées par une virgule, Español : dernière langue.
https://viacampesina.org/fr/25nov25-appel-a-laction-ni-guerre-ni-galere-justice-paix-et-souverainete-pour-les-femmes-paysannes-maintenant/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Sans précédent » ! De la Cour suprême, des droits de douane, du droit de vote et l’héritage de J. Roberts avec Lisa Graves

Je veux faire ici une distinction très importante : nous ne contestons pas que ce qui est en cause ici c'est le pouvoir de taxation
Democracy Now ! 07 novembre 2025
Traduction et organisation du texte, Alexandra Cyr
Amy Goodman : (…) Nous restons sur le sujet de la Cour suprême mais à propos d'une cause majeure qui est devant elle, soit le pouvoir ou non du Président Trump d'imposer unilatéralement des vagues de droits de douane sans précédent sur les marchandises importées. Mercredi elle entendu les plaidoyers des deux parties. Le solliciteur général, John Sauer a défendu l'idée que le Président avait ce pouvoir en raison de la loi dite « International Emergency Powers Act » ou IEEPA, adoptée en 1977. Elle garantit au Président le pouvoir de réguler le commerce en période de guerre ou autres urgences nationales. (…) :
John Sauer : Je veux faire ici une distinction très importante : nous ne contestons pas que ce qui est en cause ici c'est le pouvoir de taxation. C'est le pouvoir de réguler le commerce extérieur. Ce sont des droits de douanes qui régularisent. Ce ne sont pas des droits pour augmenter les revenus. S'ils contribuent à faire augmenter les revenus, ce n'est qu'accidentel. Les droits de douane seraient encore plus valables, pour ainsi dire, si personne ne les payait jamais.
A.G. : Ce sont de petites entreprises qui mettent au défi cette politique. Voici l'avocat des plaignantes, l'ancien procureur général Neal Katyal, s'exprimant en dehors de la Cour :
Neal Katyal : Notre message est simple en ce jour : la Constitution, nos fondateurs et 238 années d'histoire américaine disent tous que le pouvoir d'imposer des droits de douane au peuple américain appartient au seul Congrès. Les droits de douane ne sont que des taxes imposées au peuple américain qui devra les payer. Nous ne poursuivons pas le Président mais la Présidence. Rien à voir avec la partisannerie mais tout à voir avec un principe. Et pardessus tout, cela concerne la division des pouvoirs tel que stipulée dans la Constitution qui est le fondement de notre gouvernement. Nous remercions les juges d'avoir questionné aussi à fond les plaidoyers et nous attendons les conclusions.
A.G. : Cette cause avait vite fait son chemin devant les cours fédérales. Jusqu'ici, la Cour suprême a entendu environ 24 appels d'urgence de l'administration Trump. Avec sa majorité conservatrice elle a sans trop de restrictions, approuvé le plan agressif du Président qui a pu aller de l'avant. Mais c'est la première fois qu'elle prendra une décision définitive sur une de ces politiques. Mercredi, les juges, dont les juges conservateurs.trices semblaient sceptiques devant les arguments du gouvernement. Voici le juge en chef, John Roberts :
Juge en chef Roberts : Ici, l'IEEPA est invoquée. Jamais au paravent cette loi n'a servi à justifier l'établissement de droits de douane. Personne ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour dans cette cause particulière. Le Congrès établit des droits de douane et d'autres dispositions ; ce n'est pas le cas ici. Et, corrigez-moi si je me trompe, on s'en sert pour pouvoir imposer des droits de douane sur n'importe quel produit de n'importe quel pays, pour n'importe quel montant, et pour des durées illimitées. Cela semble, et je n'insinue pas que ça ne soit pas là, que cette super autorité, et que les arguments de base pour la défense de la cause, soient inappropriés.
A.G. : Afin de creuser cette question des droits de douane et de la cause devant la Cour suprême, nous recevons Mme Lisa Graves. Elle est la directrice et la fondatrice du groupe de recherche sur les politiques, True North Research. Son dernier ouvrage s'intitule : Whitout Precedent : How Chief Justice Roberts and His Accomplices Rewrote the Constitution and Dismantled Our Rights. Elle est aussi ancienne adjointe du procureur général. Nous la rejoignons à Superior au Wisconsin.
Soyez la bienvenue sur Democracy Now ! Donc, le juge en chef est la principale cible dans votre livre portant sur la Cour suprême. Parlez-nous de l'importance de la cause actuelle. Est-ce que vous avez été surprise par les questionnements de la majorité conservatrice du tribunal dont les trois nommés.es par le Président Trump ?
Lisa Graves : C'est une très importante cause. Je crois que les questions que pose le Juge en chef sont sincères. Mais nous nous souvenons que l'an dernier tout juste, il a inventé une immunité au Président dans la cause des poursuites criminelles contre un président, sans aucune base réelle et malgré le fait que la Constitution ne donne pas ce pouvoir. Et nous voilà, l'année suivante devant ce tribunal qui devra décider si oui ou non le Président a le pouvoir d'imposer des droits de douane alors que la Constitution stipule clairement que ce pouvoir appartient au Congrès. L'invocation de cette loi, IEEPA, ne donne pas au Président le pouvoir d'imposer des droits de douane.
Comme vous le savez et de même pour votre auditoire, les droits de douane et les taxes finissent par être payées par le peuple américain qui achète les biens au prix contenant les droits. D. Trump s'est vanté que ces droits de douane produiraient tant et tant de revenus, des milliards et des milliards de dollars. Pourtant, devant le tribunal, le gouvernement plaide que s'il y a des revenus se sera accidentel, qu'il ne s'agit que d'un pouvoir normal de régulation. Ça ne l'est pas. Rien n'est normal dans tout ça.
Je pense que ce tribunal, la Cour du juge en chef Roberts, va rejeter cette cause, mais simplement parce qu'elle doit occasionnellement décider à l'encontre de ce Président. Et comme vous l'avez noté en introduction, cette année, elle est intervenu 24 fois pour permettre les actions irresponsables et dommageables du Président et de son administration envers le peuple américain, de lui faire un mal irréparable. Cette fois, puisque la communauté d'affaire s'implique, peut-être que la décision ira contre le Président. Et elle tentera de se cacher en disant : « Vous voyez, c'est juste », alors que cette cour, sous la direction de J. Roberts, a agit de si nombreuses fois de manière injuste, anti constitutionnellement, de manière à diminuer nos droits dont celui de voter.
A.G. : Donc, parlons de ce qui qui amène cette cause dans l'actualité. Les entreprises (qui sont parties à la cause), ne sont pas les géantes mais des petites et moyennes. Expliquez-nous ce qui fait que ce sont des taxes, contrairement à ce que dit le Président, par exemple : « Nous allons faire payer ces pays », (seront payées par le peuple), comme vous le dites. Qui va payer ?
L.G. : Il ne s'agit de « qui va payer ? ». Les droits de douane s'appliquent aux biens vendus aux États-Unis importés par les États-Unis. Donc, ultimement, ou les entreprises vont acheter des marchandises et/ou composantes de ce qu'elles assemblent ou construisent ou encore, ce seront les consommateurs.trices qui vont les payer en achetant à l'épicerie ou dans d'autres commerces. C'est le peuple américain qui va payer. Dès maintenant, certaines entreprises qui importent ne refilent pas le coût des droits de douane aux consommateurs.trices d'ici. Elles attendent de voir ce qui va arriver en fin de course ; elles les absorbent. Donc, l'idée que se n'en sont pas, ou encore que ce soit quelques revenus accidentels, qu'ils seraient payés par les exportateurs.trices, que ça ne nous affecterait pas, est fausse. C'est nous, les Américains.es qui allons payer en bout de ligne.
Et c'est le Congrès qui a le pouvoir de lever les taxes et impôts. C'est explicite dans la Constitution ; ce n'est pas donné au Président. Donc, par voie de conséquence, le Congrès à le pouvoir d'imposer des droits de douane. Ce que prétend l'administration Trump à ce sujet est inexact : le Président n'a pas le pouvoir de créer des taxes et impôts ni d'imposer des droits de douane. Et il y a de bonnes raisons pour cela et ce n'est pas seulement à cause de la Constitution. Le comportement du Président Trump est une de ces raisons. Si ce pouvoir n'a pas été accordé aux Présidents, c'est que sa concentration dans les mains d'une seule personne permet l'arbitraire, des décisions capricieuses, saugrenues, vindicatives, comme nous l'a démontré D. Trump. La première ronde de ces droits de douane visait même des iles où il n'y a que des pingnouins mais épargnait la Corée du nord et la Russie. Des droits de douane arbitraires. Nous assistons à une sorte de chantage pour arriver à ce que certains pays apaisent l'égo du Président en échange d'élimination des droits de douane ou encore de baisse. Ce n'est pas ainsi qu'une politique de ces droits devrait fonctionner. Le Congrès devrait en avoir été le maitre d'œuvre et en avoir délibéré démocratiquement. Plus encore, comme ce sont des taxes et impôts imposés.es au peuple américain, seul le Congrès peut le faire parce qu'il détient le pouvoir sur les finances nationales ce qui n'est pas le cas du Président. Le Président ne peut à la fois exercer les pouvoirs législatifs et exécutifs.
A.G. : Voici un échange entre la juge Elena Kagan et le procureur général John Sauer durant les plaidoyers et à propos des pouvoir d'urgence :
J. Sauer : Le Président doit déclarer formellement l'état d'urgence ce qui le soumet à un examen intensif de la part du Congrès : revue des actes périmés naturellement, des révisions à répétition, des rapports etc. qui disent tous que vous devez consulter le Congrès le plus possible.
Juge Kagan : (Si je comprends bien), pour vous la déclaration d'urgence nationale ne peut être examinée. Et même si elle ne l'est pas, c'est bien sûr le genre de décision présidentielle à laquelle la Cour devrait porter une déférence considérable. Ça ne semble pas une contrainte très importante.
J.S. : Mais s'en est une.
Juge Kagan : De fait, ces derniers temps, nous avons eu à traiter des urgences issues du pouvoir du Président. Finalement, nous sommes toujours dans les urgences comme la moitié de la planète.
A.G : S'il vous plait, Lisa clarifiez.
L.G. : Sous la loi IEEPA, il s'agit de savoir s'il y a urgence ou non ; c'est la base pour établir les règles conséquentes, en quelque sorte un embargo. Mais ici il n'y en a pas. L'administration a déclaré que la crise du Fentanyl lui permettait d'imposer cette vague énorme et arbitraire de droits de douane. Elle a aussi invoqué le déficit commercial qui fait partie de notre économie depuis des décennies comme une sorte d'urgence. Ça ne l'est pas. D. Trump a aussi déclaré l'état d'urgence à Portland et Los Angeles. En fait il utilise le terme « urgence « pour tenter de se tirer de quoi que ce soit.
Il est vrai que la Cour suprême a traditionnellement accepté les déclarations d'urgence des Présidents. Mais je ne crois pas qu'elle ait quelque obligation que ce soit de le faire pour la requête de ce Président. Elle n'est fondée sur aucun faits, elle n'a pas de base (crédible) si ce ne sont le genre d'arguments que J.Sauer avance pour justifier que son client doit pouvoir faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'urgence réelle. Nous ne sommes pas en guerre, seule raison pour se prévaloir du IEEPA. Et même si c'était le cas, ça ne permettrait pas d'imposer des droits de douane.
A.G. : Lisa, vous venez de publier cet ouvrage intitulé : Without Precedent : How Chief Justice Roberts and His Accomplices Rewrote the Constitution and Dismentled Our Rights. Pouvez-vous nous parler des éléments les plus importants de ce livre, spécialement ceux qui concernent le Juge en Chef Roberts ? Commencez par tout ce qui traite de la loi sur le droit de vote. Parlez-nous des origines de l'histoire d'origine du Juge en Chef Roberts.
L.G. : D'accord. Le Juge Roberts a choisi d'être le greffier du Juge Bill Rehnquist, un adversaire notoire du droit de vote qui a travaillé personnellement à rendre plus difficile le droit de vote des électeurs.trices de l'Arizona en visant directement ceux et celles de couleur en les leur supprimant. Il l'a fait personnellement à Bethune et ses environs. Quand il est entré à la Cour suprême, avant que le juge Roberts ne devienne son greffier, il a émis un premier jugement qui tentait d'éliminer la section 2 de la loi sur le droit de vote pour stipuler qu'elle serait sans effets.
Donc, Bill Renquist s'est adressé à Ken Strar qui était alors le chef de cabinet du nouveau procureur général de l'administration R. Reagan et l'a poussé à engager John Roberts qui n'avait aucune expérience en droits de vote tout comme en matière de procès. Sa seule expérience était celle de greffier (…) pour le juge le plus réactionnaire en matière de droits de vote. En passant, le juge Rehnquist l'a aussi poussé à devenir le greffier du côté des dissidents.es dans la cause Brown c. Board of Education, (jugement célèbre de la Cour suprême qui a déclaré la ségrégation inconstitutionnelle dans les écoles publiques). Le juge Rehnquist a donné un coup de main au Sénateur Bary Goldwater qui s'opposait à la loi sur les droits civiques.
Ce sont donc des éléments des débuts de l'histoire du Juge Roberts. Il a passé des centaines d'heures à travailler pour défaire cette loi. Quand la loi sur les droits de vote a été prolongée de 20 ans en 2007, quand il est devenu juge en chef en 2005, aussitôt qu'il y avait une cause devant le tribunal à ce sujet, comme par exemple, celle du Comté de Shelby, (concernant la gestion de la loi sur le droit de vote dans les États) il a voté contre. Il a voté contre d'autres articles qui renforcent la loi dont les sections quatre et cinq qui exigeaient qu'on procède à des changements (en faveur) des juridictions qui avaient une histoire de suppression du vote ou de restriction du vote des gens de couleur. Le jugement de la cause du Comté Shelby a provoqué une avalanche de suppression et de restriction du vote comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Maintenant, exactement en ce moment, ce tribunal, celui du Juge Roberts examine la possibilité de rejeter la section deux de la loi sur le droit de vote. Cela donnerait aux législatures dominée par les blancs.ches de diluer considérablement le droit de vote des gens de couleur, par exemple en Louisiane et d'en d'autres État.
A.G. : (…) Quand vous observez l'actuelle Cour, en ce moment, quels sont vos plus importantes préoccupations ? Et quelles sont les autres Juges face au Juge en chef ?
L.G. : Je pense que ce tribunal agit illégitimement. Les jugements prononcés en urgence qui défont des jugements antérieurs argumentés à raison, fondés sur des faits et sur la légalité, pour imposer des restrictions temporaires à des gestes unilatéraux et extrêmes de ce Président ont des conséquences irréparables démontrées par les porteurs de causes. C'est illégitime de la part de ce tribunal qui ne le fait que pour aider le Président. Ce n'est que la deuxième partie de ce qu'il a fait l'an dernier soit dans les faits, de pardonner le Président en repoussant le procès (qu'il devait subir) pour son implication dans l'émeute du six janvier (2021). Pratiquement cela lui permettait de reprendre le pouvoir. Et maintenant qu'il y est, le Juge Roberts a permis que son pouvoir se renforce, qu'il puisse avancer avec l'aide des juges qu'il a nommé et qui sont associés.es aux Républicains.
Je pense que les démocrates qui siègent à cette Cour, qui sont en minorité, sont frustrés.es. Cela se voit dans leurs dépôts de jugements dissidents quand la majorité du tribunal ne démontre pas pourquoi il défait les causes des tribunaux inférieurs et permet au Président Trump d'avancer encore plus vite alors que le peuple souffre jour après jour.
Je pense que le Juge Roberts et son tribunal sont hors de contrôle. Leurs agissements sont arrogants. Leur intervention dans ces causes a été agressive tout comme dans celle sur l'immunité (du Président). Les jugements des cours inférieures auraient pu être maintenus. Ils étaient bien établis sur les précédents solides légalement, ils se tenaient. Mais c'est le coup de mains à D. Trump qui était recherché à chaque détours. Ce faisant, le tribunal s'est affiché comme un hyper partisan, il n'a pas agi comme il devrait agir mais comme un appui à la Présidence MAGA de D. Trump.
A.G. : Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en faisant la recherche pour écrire votre bouquin ?
L.G. : Alors !! Ce fut une petite chose. Vous savez comment le Juge Roberts se présente comme un arbitre, qu'il sera juste et ne fera que gérer la partie de baseball. Quand j'étudie son passé je découvre qu'il n'a jamais joué au baseball que ce soit au secondaire ou au collège. Il jouait au football. Et son coach a déclaré à un groupe monétaire obscur qui a soutenu sa confirmation (à la Cour suprême) qu'il était un plaqueur particulièrement doué, quelqu'un qui étudie ses adversaires et qui cherche un moyen de les plaquer. C'est vraiment ce que nous avons à la tête de la Cour suprême : un joueur sur le terrain qui fait avancer le plan régressif de droite de la révolution Reagan(?), pas l'arbitre juste qu'il prétend être et qu'il a tenté d'introduire dans la tête du peuple américain. Il n'est pas cet arbitre. J'ai pensé l'appeler l'arbitre trumpiste parce qu'il a été si complaisant avec Trump, de toutes sortes de façons qu'il en a étendu le pouvoir bien plus largement que celui de n'importe quel autre Président. De fait, ce jugement a retiré un des piliers fondamentaux des pouvoirs et contrepouvoirs (checks and balances) de notre démocratie. Ce qui rend le serment que Donald Trump a prononcé devant J. Roberts à l'effet qu'il serait fidèle à la loi, presque sans signification.
A.G. : Merci Lisa d'avoir été avec nous. (…)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les démocrates ont cédé dans la lutte contre la paralysie budgétaire. Les syndicats les ont laissés faire

La fermeture du gouvernement est le test qui a montré où les forces progressistes sont fortes et où elles sont faibles. Les résultats sont connus après la capitulation des démocrates face au Parti républicain hier soir : la plupart des dirigeants syndicaux ne sont pas à la hauteur de la situation.
Tiré de Jacobin.
10 novembre 2025
Dans un acte spectaculaire de lâcheté et d'idiotie hier soir, sept sénateurs démocrates et un indépendant ont voté pour mettre fin à la paralysie budgétaire selon les conditions des républicains, gaspillant ainsi leur élan et leur influence. Bernie Sanders a exposé les conséquences probables de cette capitulation :
« Cela augmente les primes d'assurance maladie de plus de vingt millions d'Américain·es en les doublant, voire en les triplant ou quadruplant dans certains cas, et cela ouvre la voie à l'exclusion de quinze millions de personnes du programme Medicaid et de l'Affordable Care Act. Des études montrent qu'environ 50 000 Américain·es mourront chaque année inutilement, et tout cela pour accorder un trillion de dollars d'allégements fiscaux aux 1 % les plus riches. »
Aujourd'hui, d'innombrables Américain·es sont à juste titre indigné·es non seulement par les sénatrices et sénateurs qui ont cédé, mais aussi par le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, qui a laissé cette capitulation se produire.
Mais il y a un autre groupe qui mérite notre colère aujourd'hui : les dirigeantes et dirigeants syndicaux.
Le principal élément déclencheur de la capitulation d'hier soir a été la décision prise le 27 octobre par la direction nationale de l'American Federation of Government Employees (AFGE) d'appeler les démocrates à mettre fin à la paralysie budgétaire selon les conditions de Donald Trump, sans aucune garantie pour la couverture santé de dizaines de millions d'Américain·es.
La principale justification avancée par le président de l'AFGE, Everett Kelley, était que ses membres souffraient économiquement de la paralysie budgétaire. Il ne fait aucun doute que ce préjudice est bien réel, et je ne doute pas de la sincérité de l'engagement de Kelley envers ses membres. Mais les dirigeant·s de l'AFGE auraient pu décider de faire pression sur les républicain·es plutôt que sur les démocrates pour mettre fin à la paralysie budgétaire. C'était un choix politique.
Les membres de base de l'AFGE ont publié ce matin une lettre ouverte appelant leurs dirigeants nationaux à s'opposer à l'accord. Comme me l'a écrit hier soir un membre de base de l'AFGE : « Beaucoup d'entre nous sont furieux et furieuses contre les dirigeant·es de l'AFGE. [...] Même si les dirigeant·es de l'AFGE estimaient que la paralysie budgétaire était devenue trop coûteuse, ils et elles auraient pu rejeter la responsabilité sur les républicain·es, qui peuvent rouvrir le gouvernement à tout moment en modifiant les règles du Sénat. » Loin de capituler après avoir mené un combat acharné, l'AFGE a refusé, dès le premier jour de cette fermeture, de fixer des limites claires aux républicain·es et de lancer de véritables campagnes de pression à leur encontre.
Les dirigeant·es de l'AFGE ne sont pas les seuls membres du mouvement syndical à avoir ouvert la voie à cette débâcle. Les deux sénateurs démocrates ont cédé au Nevada, un État où le syndicat Culinary Union, affilié à UNITE HERE, principalement composé d'immigrant·es et parfois militant, est l'acteur le plus puissant de la politique démocrate. Il est difficile d'imaginer que les sénateurs du Nevada auraient pris une décision aussi importante sans le feu vert tacite ou explicite des dirigeant·es du syndicat Culinary. En effet, aucune mention n'est faite de la lutte contre la fermeture dans les récents communiqués de presse du syndicat.
Les dirigeant·es du syndicat Culinary craignaient probablement que la poursuite des retards dans le trafic aérien ne nuise à leurs membres en freinant le tourisme à Las Vegas, mais cela ne justifie pas le refus de mener une lutte intersyndicale pour forcer les républicain·es à céder. Les travailleuses et travailleurs du secteur culinaire bénéficient d'une couverture santé réputée excellente ; il est regrettable que les dirigeant·es de leur syndicat semblent encore réticent·es à se battre pour que toustes les Américain·es bénéficient des mêmes droits. (Lors de l'élection présidentielle de 2020, les dirigeant·es du syndicat Culinary s'étaient également opposés à Sanders ainsi qu'à sa revendication d'une couverture médicale universelle.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le projet de « Golden Dome » de Trump. Encore plus d’or pour les oligarques de la Défense et de ses sous-traitants

Au cours des derniers mois, la rédaction du Washington Post s'est progressivement déplacée vers la droite, soutenant l'augmentation des budgets de défense, le recours à la force militaire et même le retour de l'armée états-unienne dans sa plus grande base aérienne en Afghanistan [en septembre 2025, Trump annonçait que « la surveillance de la Chine » impliquait la récupération de la base de Bagram, à 50 km de Kaboul ; début novembre, Trump a réactivé une base militaire abandonnée depuis vingt ans à Porto Rico, celle baptisée Roosevelt Roads, dans le cadre de son opération anti-« Venezuela-Maduro » dans la mer des Caraïbes – réd.]. Dans un récent éditorial intitulé « Comment vivre dans notre “maison de dynamite” nucléaire », le Washington Post a renversé sa position de longue date pour soutenir la construction du bouclier antimissile national du nom de « Golden Dome » [le Dome d'or, ce qui renvoie à une obsession des nazis pour l'or, une obsession que l'on retrouve dans le « trumpisme » – réd.]. La construction de ce système pourrait prendre plus d'une décennie et nécessiter un financement de plus de 1000 milliards de dollars.
10 novembre 2025 | Alencontre.org
https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/le-projet-de-golden-dome-de-trump-encore-plus-dor-pour-les-oligarques-de-la-defense-et-de-ses-sous-traitants.html
Les États-Unis ont déjà dépensé près de 400 milliards de dollars pour des systèmes de défense au cours des 50 dernières années, sans aucune raison de croire qu'un système de type « Guerre des étoiles » [projet lancé par Reagan en 1983 – réd.] puisse être efficace. Les tests eux-mêmes ont été menés dans des conditions soigneusement contrôlées afin d'en garantir le succès et d'éviter des scénarios réalistes dont l'issue ne serait pas assurée.
Le budget actuel de la défense prévoit déjà une modeste avance de 25 milliards de dollars pour un système qui n'est pas viable. La seule certitude est que des milliards de dollars seront injectés dans les caisses de l'industrie de la défense. Encore plus d'or pour les oligarques ! [1]
Plusieurs décennies d'essais sur des systèmes de défense antimissile nationaux et sur le théâtre des opérations montrent qu'il n'est pas facile de frapper un missile avec un autre, et qu'il n'existe à ce jour aucun système capable de distinguer un missile balistique réel d'un leurre. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis et l'Union soviétique ont conclu un traité sur les missiles antibalistiques (ABM) le 26 mai 1972 était leur reconnaissance du fait que tout système de défense nationale serait inefficace et provoquerait une nouvelle escalade dans les systèmes de vecteurs stratégiques offensifs. Le traité ABM-Anti-Ballistic Missil était considéré comme une avancée majeure en matière de contrôle des armements et de désarmement, qui devait permettre une réduction plus importante des systèmes offensifs. L'abrogation du traité a ouvert la voie à la justification de nouveaux systèmes offensifs.
Dans un monde dépourvu de systèmes nationaux de défense antimissile, les États-Unis et l'Union soviétique/la Russie ont réduit leurs stocks nucléaires de plus de 80% et les essais nucléaires (à l'exception de la Corée du Nord) ont cessé. Cependant, Donald Trump menace aujourd'hui de reprendre les essais pour la première fois depuis 1992. Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE-Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty-CTBT] interdit les essais nucléaires, mais les États-Unis, la Russie et la Chine, signataires du TICE, n'ont jamais ratifié le document. Le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968 (entré en vigueur en mars 1960) a également réussi à limiter le nombre d'États dotés d'armes nucléaires, mais la reprise des essais et la mise en place d'un système national de défense antimissile aux États-Unis conduiraient à des scénarios plus menaçants. [Les lectrices et lecteurs peuvent disposer d'une information remarquable en écoutant le professeur Benoit Pelopidas dans une vidéo d'Elucid disponible sur la home page du site alencontre.org, grâce à l'aimable autorisation d'Elucid – réd.]
L'une des meilleures raisons de négocier la fin de la guerre en Ukraine serait la possibilité pour les États-Unis de revenir à la table des négociations avec la Russie sur le contrôle des armements et le désarmement. Le dernier traité de contrôle des armements entre la Russie et les États-Unis, le nouveau traité SALT [Strategic Arms Limitation Talks, négocié depuis 1969, le traité SALT I est signé en 1972 et le traité SALT II en 1979 – réd.], expirera en février 2026, et le président russe Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont indiqué que Moscou était prêt à prolonger la durée du traité et à discuter d'autres questions relatives au contrôle des armements. Une telle mesure contribuerait à réduire le niveau de tension et de suspicion qui existe entre les deux plus grandes puissances nucléaires, et pourrait même inciter la Chine, troisième puissance nucléaire, à entamer un dialogue sur le contrôle des armements. Dans le même temps, la Chine est en passe de disposer d'un stock de 1000 ogives nucléaires d'ici 2020.
L'éditorial du Washington Post affirme avec une certaine désinvolture que la destruction mutuelle assurée et la menace d'une riposte écrasante ont empêché une attaque nucléaire [voir à ce sujet la démythification de Pelopidas]. Il conclut néanmoins que, « tout comme les défenses antimissiles peuvent échouer, la dissuasion peut également échouer ». Il en conclut donc qu'un Golden Dome est nécessaire. Nous n'avons certainement pas besoin d'un système qui ne fonctionne pas et qui risquerait d'entraîner une accumulation accrue d'armes offensives et une course aux armements coûteuse.
Les États-Unis et la communauté internationale auraient tout intérêt à mener des négociations visant à réduire les armes offensives, à empêcher toute idée de défense antimissile nationale, à empêcher la militarisation de l'espace [voir la nomination à la tête de la NASA de Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk qui pourra placer le matériel de SpaceX – réd.] et à relever le défi de l'IA (Intelligence artificelle) qui pourrait potentiellement conduire à l'utilisation accidentelle d'armes nucléaires. Pendant ce temps, les États-Unis sont prêts à dépenser des centaines de milliards de dollars pour un système qui n'a jamais été testé avec succès et qui combine des intercepteurs, des radars et des réseaux informatiques de contrôle. Tout système de défense nationale ne fera qu'entraver la coopération nécessaire pour réduire les risques de lancements accidentels et compromettre la coopération nécessaire pour les systèmes d'alerte précoce. (Publié sur le site Counterpunch le 6 novembre 2025 ; traduction et édition rédaction A l'Encontre)
Melvin A. Goodman est chercheur senior au Center for International Policy et professeur de sciences politiques à l'université Johns Hopkins. Auteur récemment, parmi d'autres ouvrages, de Containing the National Security State (Opus Publishing, 2021).
[1] Au National War College à Washington, le 7 novembre, devant des responsables de l'armée et des représentants de l'industrie de défense, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, ancien chroniqueur à Fox News, a dévoilé sa stratégie pour doper l'armée états-unienne : « Nous orientons le Pentagone et notre base industrielle vers un temps de guerre. Nous posons les bases d'une domination continue pour les décennies à venir. » (Le Grand Continent, 10 novembre 2025)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« La machine de guerre à mille milliards de dollars » :

Democracy Now ! s'entretient avec William Hartung au sujet de son nouveau livre « The Trillion Dollar War Machine » et de ceux qui profitent de la dérive incontrôlée des dépenses militaires américaines qui alimentent les guerres à l'étranger. Hartung affirme que la politique américaine est « fondée sur le profit » et appelle à repenser nos engagements extérieurs : « Nous n'avons gagné aucune guerre au XXIᵉ siècle. Nous avons causé d'immenses dégâts. Nous avons dépensé 8 000 milliards de dollars », dit-il.
14 novembre 2025 | tiré de Democracy now !
https://www.dem
AMY GOODMAN : C'est Democracy Now !, democracynow.org. Je suis Amy Goodman avec Juan González. Alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire en Amérique latine, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré plus tôt cette semaine que le Pentagone est désormais sur le pied de guerre. Dans un discours majeur, Hegseth a appelé les dirigeants des entreprises d'armement à accélérer la production d'armes pour l'armée.
SECRÉTAIRE PETE HEGSETH : Chaque dollar gaspillé dans la redondance, la bureaucratie et le gaspillage est un dollar qui pourrait être utilisé pour équiper et soutenir le combattant. Nous devons mener une campagne totale pour rationaliser les processus du Pentagone afin de libérer nos équipes d'un travail improductif et de déplacer nos ressources de la bureaucratie vers le champ de bataille.
Notre objectif est simple : transformer tout le système d'acquisition pour fonctionner en temps de guerre, accélérer rapidement la mise en service de nouvelles capacités et se concentrer sur les résultats. Notre objectif est de construire — de reconstruire — l'arsenal de la liberté.
AMY GOODMAN : Nous sommes maintenant rejoints par William Hartung, coauteur du nouveau livre The Trillion Dollar War Machine : How Runaway Military Spending Drives America into Foreign Wars and Bankrupts Us at Home. Bill Hartung est chercheur principal à l'Institut Quincy pour une gestion responsable des affaires étrangères. Bill, bienvenue à nouveau sur Democracy Now !.
Dans quelle mesure le budget du Pentagone est-il aujourd'hui sans précédent, et que fait l'armée ? Par exemple, même le président Trump, dans son décret exécutif, a renommé le Département de la Défense en « Département de la Guerre », bien que seul le Congrès puisse officiellement le faire.
WILLIAM HARTUNG : Le budget du Pentagone n'avait jamais atteint mille milliards de dollars auparavant. Même ses plus fervents partisans ne croyaient pas que nous atteindrions un jour ce seuil. Mais maintenant que nous y sommes, toutes les limites sautent.
Et des discours comme celui de Pete Hegseth reviennent à dire : « Non seulement nous allons dépenser mille milliards, mais il n'y aura plus de règles. Nous n'allons pas tester indépendamment ces armes, nous n'allons pas examiner leur conformité aux droits humains lorsqu'on les exporte. » C'était essentiellement un cadeau à l'industrie de l'armement. Et lorsqu'ils parlent d'accélérer la production… en matière d'armement, la vitesse tue.
AMY GOODMAN : Juan, vas-y.
JUAN GONZÁLEZ : Oui, Bill, je voulais vous interroger sur le déplacement croissant de la machine militaire américaine : moins de troupes, plus de machines. Ce nouveau complexe militaro-industriel issu de la Silicon Valley rêve de mener des guerres sans perdre un seul être humain, grâce aux capacités de mise à mort à distance, aux robots, à l'IA. Jusqu'où cette évolution est-elle allée ?
WILLIAM HARTUNG : Eh bien, elle avance clairement. À Washington, il y a deux mots magiques pour faire de l'argent : si vous mentionnez la Chine, si vous mentionnez l'IA — ou les deux ensemble, c'est encore mieux. Cela repose sur un vieux mythe : la technologie gagnerait les guerres. Ce n'était pas le cas au Vietnam, ni en Irak, ni avec la défense antimissile prétendument « étanche » de Reagan.
Ils vendent une marchandise éventée : une vieille idéologie avec un nouveau logiciel. Et ils sont beaucoup plus agressifs que les PDG traditionnels comme celui de Lockheed Martin. Par exemple, Palmer Luckey dit : « Nous allons être en guerre avec la Chine dans deux ans. Nous allons les écraser. Nous aurons plus de munitions. » Ils agissent comme s'ils dirigeaient notre politique étrangère et se voient comme de nouveaux messies technologiques. Leur idéologie et leur influence politique sont presque aussi dangereuses que les armes qu'ils veulent nous faire utiliser.
JUAN GONZÁLEZ : Et dans votre livre, vous discutez longuement de la guerre à Gaza et de la façon dont elle est devenue une grande source de profits pour les entreprises américaines. Pouvez-vous en parler ?
WILLIAM HARTUNG : Oui. Il existe ce mythe au Pentagone affirmant qu'envoyer des armes, c'est mieux qu'envoyer des troupes : nos soldats ne sont pas en danger et les pays « se défendent eux-mêmes ». Mais bien sûr, Israël a commis un génocide à Gaza. Ce n'était en aucun cas de la défense. Et lorsqu'on envoie des armes, tout l'argent revient aux entreprises. Pas de troupes, pas de logistique : presque du revenu pur.
Et lorsque l'on parle « d'aide militaire à Israël », il s'agit en réalité d'aide militaire à Lockheed Martin et à Palantir. L'argent va en Israël pour revenir immédiatement vers ces entreprises. Palantir a même tenu une réunion de son conseil d'administration durant la guerre à Gaza et a tenté d'inciter d'autres entreprises profitant de la guerre à soutenir plus ouvertement Israël. Ils ont également fourni les logiciels permettant d'accélérer les bombardements.
C'est l'un des épisodes les plus honteux de l'histoire d'une industrie qui, bien sûr, n'est pas basée sur la morale mais sur le profit. Beaucoup de gens fascinés par la technologie disent : « Oh, ces gens sont brillants, ils envoient des fusées dans l'espace, ce sera moins cher. » Mais nous paierons cher cette confiance accordée à ces entreprises.
Et elles sont très proches de l'administration Trump, y compris J. D. Vance, qui a été façonné par la Silicon Valley et doit sa carrière à Peter Thiel. Lorsqu'il a été nommé vice-président, les bouchons de champagne ont sauté dans la Silicon Valley et des sommes énormes sont arrivées derrière Trump.
Ils essaient de remplacer les géants comme Lockheed Martin, mais le gouvernement va payer les deux. Le système Golden Dome aura du matériel de Lockheed Martin et des logiciels d'Anduril et d'autres entreprises. Cela signifie que le seuil du mille milliards sera bientôt dépassé si l'on ne se bat pas — et il faudra se battre durement, ce qui implique de rejeter le mythe de la supériorité technologique.
AMY GOODMAN : Votre livre contient deux chapitres fascinants : « La militarisation de la science américaine : acheter la tour d'ivoire » et « Capturer les médias : comment la propagande alimente la machine de guerre ». Parlez-nous-en.
WILLIAM HARTUNG : Le tournant vers l'IA et les technologies avancées signifie que l'armée a désormais besoin des universités : Lockheed Martin n'a pas ces profils. Ces compétences sont très recherchées. Ils intensifient donc leurs recrutements et leurs financements. Johns Hopkins reçoit un milliard de dollars par an pour travailler sur des missiles balistiques, mais l'étudiant moyen n'en sait rien : le laboratoire est à 60 km.
Berkeley coadministre un laboratoire d'armes nucléaires, mais si vous interrogiez un étudiant sur le campus, il ne le saurait probablement pas. Ils accélèrent tout cela. Il y a aussi les pipelines directs des programmes d'ingénierie vers l'industrie de l'armement.
Quant aux médias, entre la révision des scénarios hollywoodiens, les interventions de think tanks financés par l'industrie de l'armement, et les cadrages favorables… très peu de médias proposent aujourd'hui de vraies critiques du militaire. Certains journaux n'ont même plus de correspondant au Pentagone : ils impriment simplement les communiqués du Pentagone. Dans le paragraphe 32, on cite un type comme Bill Hartung pour dire qu'ils sont « équilibrés ». Mais le cadrage reste entièrement pro-militaire.
Et cette idée persiste : si un événement se produit dans le monde et que nous ne répondons pas par le militaire, nous « ne faisons rien ». Alors que chaque intervention est catastrophique. Certains élus parlent de « paix par la force ». Or, nous n'avons gagné aucune guerre ce siècle. Nous avons causé des ravages, dépensé 8 000 milliards, et des centaines de milliers de soldats souffrent de PTSD sans prise en charge adéquate. Pourtant, le mythe se maintient.
Il y a donc un travail culturel et éducatif à mener, en plus de réduire les sommes colossales versées à ces entreprises.
JUAN GONZÁLEZ : Vous commencez votre livre en citant un discours de campagne de Trump en 2024 dans le Wisconsin, où il promettait de mettre fin aux guerres sans fin. Mais vous affirmez qu'en réalité, Trump ne se distingue pas beaucoup de Biden : les deux sont des partisans farouches de la machine de guerre américaine. Pouvez-vous développer ?
WILLIAM HARTUNG : Trump utilise ce discours quand cela l'arrange. Quand il a attaqué Jeb Bush et Hillary Clinton sur l'Irak, bien qu'il ne s'y soit pas opposé à l'époque. Et ce discours sur les profits de guerre vise une partie de sa base, lassée du capitalisme de connivence, des guerres et de l'aide aux grandes entreprises. Certains ont même voté pour lui en croyant qu'il serait moins interventionniste.
Mais nous en sommes là : faire exploser des bateaux de civils au large du Venezuela, continuer à armer un génocide à Gaza, et dérouler le tapis rouge aux entreprises d'armement : « On vous donne de l'argent, pas de réglementation, carte blanche. » Durant son premier mandat, il a fait pareil, puis s'est rapproché de l'Arabie saoudite pour lui vendre des armes record, affirmant que cela créait des emplois.
Trump voit l'industrie de l'armement comme un allié politique et ne l'affrontera jamais vraiment. Il dit parfois que nous avons trop d'armes nucléaires, mais aucune action ne suit. Les dépenses nucléaires augmentent. Il est erratique, mais cela répond à un objectif : garder le soutien de la partie de sa base sceptique des guerres.
AMY GOODMAN : Avant de terminer, je voulais vous interroger sur une information d'Axios hier : Israël chercherait un nouvel accord de sécurité sur vingt ans avec les États-Unis. Le précédent accord prévoyait environ 4 milliards de dollars par an d'aide militaire, et Israël devrait demander au moins autant.
WILLIAM HARTUNG : Israël veut être un client permanent des États-Unis et que nous financions son agressivité. L'accord actuel comportait quelques limites qui ne plaisaient pas à Israël : par exemple, ils pouvaient autrefois utiliser l'aide américaine pour développer leur propre industrie d'armement — cela devait prendre fin. Sous Trump, cela sera certainement annulé.
Un tel accord nous lierait en permanence aux actions d'Israël dans la région. Par exemple, quand Israël a bombardé l'Iran alors que les États-Unis négociaient, Trump a enchaîné avec des bombardements et des fausses affirmations sur la destruction du programme nucléaire iranien. Il a même réprimandé ses propres conseillers pour avoir admis que c'était faux.
Ce serait l'une des pires orientations possibles : s'attacher à une politique archaïque, dangereuse et déstabilisatrice, tout en encourageant les forces les plus extrémistes en Israël. J'espère qu'il y aura une résistance, mais ces accords se négocient souvent à huis clos.
JUAN GONZÁLEZ : Encore une question : dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la question des terres rares revient comme une faiblesse majeure pour l'armée américaine et pour d'autres industries. À quel point est-ce un problème ?
WILLIAM HARTUNG : Cela contredit leur idée de créer un État-caserne autosuffisant. L'économie est mondiale. Les États-Unis n'ont pas toutes les ressources ni toutes les expertises. L'idée que tout serait produit localement, sous contrôle américain, relève du fantasme.
Même aux moments les plus hégémoniques de leur histoire, les États-Unis n'ont jamais été autosuffisants. Trump vend une illusion intenable — dangereuse lorsqu'il s'agit de paix et de sécurité.
AMY GOODMAN : Bill Hartung, merci d'avoir été avec nous. Il est chercheur principal à l'Institut Quincy pour une gestion responsable des affaires étrangères. Son nouveau livre, coécrit avec Ben Freeman, vient de paraître : The Trillion Dollar War Machine : How Runaway Military Spending Drives America into Foreign Wars and Bankrupts Us at Home.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand un gardien de la liberté vacille : l’annulation d’un colloque sur la Palestine au Collège de France

La liberté académique des scientifiques menant des recherches sur la Palestine est régulièrement remise en cause. Ce texte en dépeint un cas survenu la semaine dernière au prestigieux Collège de France.
Kaveh Boveiri et Michaël Séguin
« La non-liberté est le vrai danger mortel des humains ». Cette phrase très connue, d'un penseurde 19e siècle, maintenant l'adage de toutes formes de la liberté, garde sa vigueur dans tous les domaines de la vie sociale.
A fortiori, on peut argumenter que le respect de la liberté en général, et de la liberté d'expression en particulier, constitue un impératif dans les domaines où une grande partie de l'activité se réalise dans la production, reproduction, distribution, échange et réception des mots et des idées, notamment le milieu académique. Ceci devrait être obligatoirement le cas dans les institutions des pays soi-disant démocratiques, comme la France. À ce propos, une des institutions les plus connues dans l'Hexagone est sans doute le Collège de France. Institué en 1530 à Paris, et avec ses 52 chaires à l'heure actuelle, ce collège est une des écoles les plus prestigieuses du monde universitaire, et jusqu'à tout récemment, un des gardiens importants de la liberté.
Un colloque international, « La Palestine et l'Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines », coorganisé par le Professeur Henry Laurens, titulaire de la chaire Histoire du monde arabe du Collège de France, et par le Centre arabe de recherches et d'études politiques de Paris (CAREP), aurait dû avoir lieu les 13 et 14 novembre 2025 à ce collège. Parmi les conférenciers des quatre coins du monde, deux viennent du Canada, le professeur Michaël Séguin de l'Université Saint-Paul (Ottawa) et la doctorante Clara Denis Woelffel de l'Université du Québec à Montréal. Dans un communiqué en date du 9 novembre,l'Administrateur du Collège, Thomas Röner, annonce que celui-ci est annulé en réponse à la politique qu'il suscite et afin de « garantir la sécurité du personnel du Collège de France, ainsi que de ses auditeurs, et d'éviter tout risque quant à l'ordre public ».
Selon deux journalistes du journal Le Monde,Christophe Ayad et Soazig Le Nevé : « Les motivations ayant conduit à cette décision radicale – du jamais-vu depuis le Second Empire, quand le cours d'Ernest Renan fut « suspendu jusqu'à nouvel ordre » par l'empereur Napoléon III, le 26 février 1862 [!] – interpellent dans leur enchaînement. » Et cet enchaînement, impliquant notamment une campagne de pression politiquemenée par un réseau d'intellectuels et d'avocats pro-israéliens ayant fait pression sur le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, avant qu'il ne fasse à son tour pression sur le Collège, soulève de nombreuses questions.
L'attaque ne se limite toutefois pas à l'annulation de ce colloque à ce Collège, mais à la peur qu'elle inflige dans le milieu académique français. Bien que 1500 universitairesaient signé une lettre collective dénonçant cette situation et demandant la démission du ministre, aucune institution universitaire de la région parisienne n'a accepté d'accueillir le colloque dans ses locaux. Les organisateurs se sont donc repliés sur les modestes locaux du CAREP, lesquels accueillent d'ordinaire une quarantaine de personnes, tout en assurant une diffusion en lignequi, elle, a rejoint des milliers d'intéressés.
Selon Salam Kawakibi, chercheur en science politique et directeur du CAREP, toute cette histoire est plutôt étonnante : « Je n'aurais jamais cru arriver à un jour pareil en France », dit-il en entrevue avec Le Monde. Pour sa part, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, également invitée au colloque, n'est pas surprise parce que « les groupes de pression “pro-israéliens” sont très forts, très épanouis un peu partout ».
Le déni de la liberté d'expression du Collège est, certes, un signe d'une absence de liberté académique qui témoigne d'une dérive importante de notre monde contemporain. Si ce type de culture de l'annulation est devenue courante aux États-Unis, cette fois l'attaque se passe à Paris, « la ville des Lumières, la Capitale de liberté, le symbole de droits de l'homme et de la raison critique », pour répéter les mots d'ouverture de Salam Kawakibi. Selon lui, avec ce genre d'action, « nous sommes dans uneère de McCarthyisme à la française ».
Si le manque de liberté est un danger mortel pour tous les humains, il est d'autant plus frappant de constater que la parole de chercheurs reconnus est ici réprimée sous prétexte d'être pro-palestinienne et anti-sioniste. Et donc, parce que des universitaires tentent de faire connaître un génocide commis par l'État d'Israël à Gaza, l'establishment pro-israélien en France a tout mis en œuvre pour les discréditer. Le débat médiatique qui s'en est suivi dans les grands médias français a fait d'autant plus de bruit parce qu'il soulevait un enjeu fondamental : celui non seulement du droit à l'information, mais tout simplement du droit à la vie des Palestiniens et de la complicité européenne face à ce déni.
Ce n'était évidemment pas la première attaque contre la liberté. Il y en a eu beaucoup ces derniers mois, en particulier dans le contexte des camps pro-palestiniens sur les campus universitaires de partout dans le monde. Mais chaque attaque demeure une attaque de trop. Dans ce cas-ci, les syndicats locaux, les associations, les fédérations de l'enseignement, mais particulièrement les autorités universitaires et politiques québécoises et canadiennes ne peuvent pas garder le silence.
Crédit de la photo : Michaël Séguin
La photo représente le débat de clôture avec Josep Borrell, ancien Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, et Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Trois pays africains se retirent de la Cour pénale internationale

Reconsidérer l’impérialisme
Dans ce texte initialement paru dans la revue Traces (vol.62, no.3), l’historien Samir Saul cherche à produire une synthèse des grands débats entourant le concept d’impérialisme. Basé sur les résultats de son récent livre L’impérialisme, passé et présent (Éditions les Indes Savantes, 2023), l’article de Saul a pour objectif d’offrir une définition de l’impérialisme, sans pour autant s’enfermer dans un débat purement théorique. La question impériale est ainsi suspendue à un certain aléas des événements historiques. Ceci implique que, loin d’être une réalité figée, l’impérialisme se modifie selon les configurations historiques et les phases du capitalisme.
Samir Saul est professeur d’histoire à l’Université de Montréal. Il a co-rédigé avec Michel Seymour le livre Le conflit mondial du XXIe siècle (Éditions L’Harmattan, 2025).

Introduction
Comme concept, schéma explicatif et sujet de discussion, l’impérialisme était, il n’y a pas si longtemps, très répandu, voire surutilisé. Sans discontinuité, il a connu une belle fortune à la faveur de l’expansion coloniale du 19e siècle, des guerres mondiales du 20e siècle, de la diffusion du marxisme, de la décolonisation, puis de la lutte contre le sous-développement. De passionnants débats sur l’impérialisme et sur les lectures faites de ce phénomène étaient courants, des salles de classe aux conférences, et même sur la place publique. Sur le plan politique, l’impérialisme était le pain quotidien des marxistes et même de la gauche non marxiste.
Puis vint la crise économique systémique des années 1970 qui mit fin à la croissance continue des Trente Glorieuses. Le keynésianisme, l’interventionnisme de l’État dans l’économie et l’économie mixte ou concertée sont à bout de souffle. Alors même que se réalisent les prédictions des marxistes sur les tendances au fléchissement du taux de profit et à la stagnation économique sous le capitalisme, ils s’avèrent incapables de remplir le vide, se trouvant dépourvus de projet politique en prise avec la situation et accaparés par des luttes intestines, et parfois dans des disputes quasi théologiques sur des points de doctrine. L’ensemble de la gauche perd de son influence, recule et se marginalise. Paradoxalement, c’est le libéralisme, discrédité depuis la Dépression des années 1930, qui profite de la crise du capitalisme. Les années 1980 sont celles de l’offensive néolibérale qui reprend les positions perdues et vise à remettre à flot le capitalisme en misant sur le marché, l’endettement et la délocalisation de la production pour retrouver la rentabilité. La mondialisation devient la voie de salut et la libéralisation est mise de l’avant comme gage de la prospérité pour les pays développés et sous-développés.
Du coup, l’impérialisme est évacué du discours, y compris — fait à noter — de la gauche, ou de ce qu’il en reste. L’hégémonie idéologique du libéralisme et le discours idéaliste sur la mondialisation bénéfique à tous écartent le concept d’impérialisme, lequel tient compte de la domination, de l’exploitation et des conflits. Ainsi le vocable passe à la trappe, à telle enseigne que même des éléments se considérant de gauche ne le comprennent plus. Il se réduit aux Empires coloniaux du passé, lesquels sont démantelés par les décolonisations post-1945, ou à une « nouvelle histoire impériale », faite d’influences réciproques entre métropoles et colonies, entre centre et périphérie. Or, ces perspectives sur l’impérialisme s’apparentent à celle du libéralisme, ainsi qu’on le verra ci-dessous.
Passé de mode comme concept d’usage courant, l’impérialisme n’est pas moins une réalité tangible et observable à l’œil nu, tellement la domination, l’extraction de richesses, les rapports de force sur la scène internationale et la mise en place de systèmes internationaux de contrôle s’imposent à quiconque regarde même distraitement. Comment les expliquer ? Aseptisée, l’idée de la mondialisation écarte ces réalités. Les notions d’Empires et de colonies ne suffisent pas, d’autant plus que leur démantèlement n’a pas mis fin à ces phénomènes. Aux décolonisations a succédé une phase postcoloniale. De fait, l’impérialisme perdure, les Empires n’ayant été qu’un moment délimité de son histoire.
1. Historiciser l’impérialisme
D’où le recours au concept d’impérialisme, lequel englobe le colonialisme, tout en le dépassant. Mais la difficulté sur laquelle on bute est qu’aucune des interprétations existantes de l’impérialisme ne correspond pleinement à la situation. Aucune ne traite le présent, postcolonial, unipolaire, mondialisé. Toutes s’occupent d’une époque du passé. À l’aune de ces interprétations, il n’y aurait plus d’impérialisme, ce qui serait un non-sens vu la persistance de ses caractéristiques et de ses symptômes. L’obstacle est sérieux, car, sans une définition de l’impérialisme, il devient impossible de qualifier une situation, une relation ou une action d’impérialistes.
Par conséquent, il convient d’opérer un retour au concept pour vérifier ce qui peut en être récupéré. Cependant, le domaine est un univers foisonnant d’écrits, un terrain encombré d’interprétations contradictoires, issues du passé, surtout partielles, applicables à un cas, pas à d’autres, et encore moins au présent. Il faut revaloriser et actualiser le concept. De fait, c’est une nouvelle interprétation qui tienne compte du présent, tout en étant valable pour diverses époques, qu’il faut élaborer. On ne saurait se laisser égarer par l’équivalence établie entre l’impérialisme et le colonialisme ; ils sont à distinguer. Le colonialisme, autrement dit, les Empires coloniaux, n’est qu’une phase historique de l’impérialisme, une forme non dissimulée d’impérialisme. Reste la phase actuelle, postcoloniale et universelle, à prendre en compte.
Comment mettre à jour le concept ? Il est possible de se limiter à la théorie et d’essayer d’en tirer une autre théorie. Mais la démarche est circulaire et peut tourner à vide ou en vase clos. Mieux vaut remonter aux sources, aux faits historiques, passés et présents. L’entreprise – et c’est là où réside sa spécificité, voire son originalité – consiste à historiciser le concept impérialisme. L’intention est de produire une interprétation enracinée dans l’histoire. C’est le propos du livre récent dont le présent article est un abrégé[1].
2. Les théories existantes et leurs limites
Tout effort de reconstitution doit débuter par un bilan du savoir disponible, un tour d’horizon des contributions qui ont marqué la réflexion sur le thème de l’impérialisme. Favorables ou défavorables, une demi-douzaine de courants traite l’impérialisme, y apportant leur explication de ses causes, de ses forces motrices et de ses conséquences.
Au préalable, il importe de rappeler que le premier courant qui prône l’impérialisme apparaît avant l’utilisation du mot. Il s’agit du mercantilisme, un ensemble de prescriptions qui ont cours des 16e au 18e siècle, au moment où de nouveaux États dynastiques et territoriaux se mettent en place et se consolident en Europe occidentale. Les guerres sont récurrentes et les besoins pécuniaires pour payer les troupes sont un gouffre financier (lancinants). Le mercantilisme est bullioniste : il prône l’accumulation de métaux précieux, acquis par tous les moyens, dont un commerce extérieur toujours excédentaire (la différence entre exportations et les importations étant réglée par des rentrées d’or et d’argent). Porté vers l’autosuffisance dans une perspective de guerre, le pays doit viser à tout produire chez lui. Le mercantilisme est productiviste et protectionniste. Pour écouler sa production, il recommande l’acquisition de colonies comme formule pour se réserver des marchés à l’abri de la concurrence et comme lieu d’approvisionnement exclusif de produits primaires à transformer (ex. le sucre). La traite et l’esclavage sont des corollaires de cet impérialisme avant la lettre. Les Empires européens des 16e au 18e siècle sont régis par des principes mercantilistes.
Six grands courants abordent l’impérialisme explicitement. Le premier, le libéralisme, relève du mouvement historique d’affirmation des droits individuels contre l’autorité et la tradition. Son volet économique est l’économie politique classique qui se développe dès la fin du 18e siècle en Angleterre en particulier, mais en France aussi. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say en sont les chefs de file et les devanciers d’une longue lignée de successeurs. L’industrialisation de l’Angleterre consacre le magistère de l’économie politique classique, qui prend valeur de dogme. Le mot d’ordre est la liberté, y compris dans l’économie. Le libéralisme s’en remet au marché, à la liberté d’entreprise, au « laissez-faire », plutôt qu’à l’intervention de l’État. Il s’ensuit qu’il prend le contrepied du mercantilisme et le dénonce avec vigueur. La possession de colonies est critiquée, étant donné que l’ouverture des frontières tarifaires procure des marchés plus larges que les débouchés coloniaux. La pensée libérale est anti-impérialiste en principe. Pour elle, les Empires n’ont de motivations que politiques (nationalisme, soif de puissance, etc.). Ils sont une erreur économique, une méprise et un gouffre financier. Elle ne connaît pas l’exploitation économique. Toutefois, dans les faits, les pays libéraux ne s’interdisent pas de posséder et d’acquérir des colonies, en dépit de l’idéologie libérale dominante. Ainsi, les plus grands Empires appartiennent aux deux principaux pays libéraux, la Grande-Bretagne et la France. Une conception ayant peu de rapports avec le réel cesse d’être adéquate.
Le deuxième courant émerge en opposition à l’économie politique classique et son analyse voulant que les crises économiques se règlent d’elles-mêmes, que la demande et l’offre finissent par s’équivaloir, que l’appauvrissement se résorbe par l’extension de la production. Les critiques, dont Sismondi, rappellent que les acheteurs potentiels n’arrivent pas à consommer faute de pouvoir d’achat. La critique de ce courant sous-consommationniste est considérée comme « hétérodoxe », une hérésie par rapport à la sacrosainte économie politique classique. Pour ces contestataires, les maux dont souffre le capitalisme lui sont intrinsèques, pas passagers. Aux yeux de certains, par exemple les « réformateurs coloniaux », Paul Leroy-Beaulieu, Jules Ferry et Joseph Chamberlain, des mesures externes contre les crises sont à rechercher, notamment la réhabilitation des colonies. Soupapes pour les marchés métropolitains engorgés en l’absence de clients solvables, elles constitueraient des marchés réservés qui absorberaient les invendus, sans oublier que les pauvres pourraient y émigrer, réduisant le nombre de chômeurs et de bouches à nourrir, tout en éloignant le danger de révolution en métropole. Ce courant sous-consommationniste énonce en termes clairs l’intérêt économique des colonies. Pour la révolutionnaire Rosa Luxemburg, l’existence du capitalisme dépend de la disponibilité de régions sous-développées. Leur perte annoncerait sa fin. Le réformiste John Hobson pensait plutôt qu’il n’y aurait plus besoin de colonies si les marchés métropolitains étaient élargis par l’élévation du pouvoir d’achat. Hobson est le précurseur de John Maynard Keynes. Dans les faits, la possession d’Empires n’a pas prévenu les crises économiques et la hausse des revenus disponibles n’a pas rendu obsolète l’impérialisme. Le sous-consommationnisme est en décalage avec le réel.

À ses débuts, le marxisme, troisième courant, et le plus critique du capitalisme, ne se prononce pas sur l’impérialisme. Marx ne l’évoque pas, même si les Empires et « l’accumulation primitive » jouent un grand rôle dans la naissance du capitalisme. C’est à la fin du 19e siècle que les marxistes s’intéressent à l’impérialisme. Le social-démocrate Rudolf Hilferding observe la concentration du capital en Allemagne dans d’énormes sociétés mêlant l’industrie et la banque dans ce qu’il nomme « capital financier ». Le bolchevik Nikolaï Boukharine se focalise sur les affrontements internationaux de ces sociétés géantes, soutenues par leurs États respectifs. Comme Boukharine, Vladimir Lénine écrit durant la Première Guerre mondiale, que les deux comprennent comme une guerre interimpérialiste pour l’hégémonie mondiale. Lénine produit l’analyse la plus influente de toutes concernant l’impérialisme parce qu’elle traite tous les problèmes relatifs au sujet. Pour lui, l’impérialisme est le dernier stade du capitalisme avant l’avènement du socialisme. Ce stade suprême est celui de la prédominance du capital financier, selon la définition de Hilferding, et du repartage du monde par la guerre. L’analyse de Lénine devient celle du communisme international pendant des décennies en raison de sa construction cohérente et sa force explicative. Elle est si identifiable et répandue qu’elle tend à faire de l’impérialisme un sujet appartenant aux communistes. Opératoire pour la Première Guerre mondiale, elle l’est cependant moins sur d’autres points : le capital financier de Hilferding ne se retrouve vraiment qu’en Allemagne, les « monopoles » ne le sont pas complètement, l’idée qu’ils donnent lieu à un stade nouveau du capitalisme est problématique, le début de l’impérialisme au 20e siècle fait l’impasse sur le colonialisme des siècles précédents, etc. Enfin, l’évolution du capitalisme depuis 1917 appelle l’intégration de nombreuses transformations postérieures à Lénine.

Un quatrième courant, celui de l’« école de la dépendance », se focalise sur une des questions prioritaires de la période post -1945, à savoir le sort du « tiers-monde ». L’impérialisme était jusque-là étudié du côté des métropoles et des conflits entre elles. À la faveur des décolonisations, le regard s’étend sur le sous-développement du Sud, sa quête de développement Karl Marx en 1875, par John Jabez Edwin Mayall et les rapports Nord-Sud. L’idée commune voulant que l’impérialisme apporte le développement à des pays retardataires est rejetée. En réduisant les colonies à de simples compléments des métropoles, spécialisées dans quelques produits exportables, il aurait plutôt apporté le sous-développement et la dépendance. L’intégration au marché mondial serait antithétique au développement et à l’industrialisation. Il fallait s’en déconnecter pour avoir quelque espoir de s’extirper du sous-développement, ce qui va directement à l’encontre des prescriptions libérales. Partant de l’Amérique du Sud, les idées des dependentistas font le tour du monde, exerçant une forte influence dans les milieux universitaires et politiques, portées par le nationalisme anti-impérialiste des pays « en voie de développement ». Paul Baran, Harry Magdoff, André Gunder Frank, Arghiri Emmanuel et Samir Amin acquièrent une réelle notoriété. Si la part de vérité historique dans les analyses historiques de ce courant est incontestable, ses recommandations n’apportent pas les succès escomptés. La sortie du marché mondial n’est souvent pas possible pour les exportateurs de matières premières. Malgré la planification, le développement « autocentré » n’aboutit pas au développement, encore moins à l’industrialisation. Coup fatal : durant les années 1970, des pays de l’Asie de l’Est réalisent l’industrialisation par la voie de l’exportation et en pleine intégration dans le marché mondial. La clé est la présence d’un État fort qui veille à la cohésion de l’économie nationale et empêche sa désarticulation par les forces du marché, national et international. Dernière faiblesse de ce courant : son mutisme sur les pays du Nord et les rapports Nord-Nord. Une compréhension globale de l’impérialisme reste à atteindre.

Un cinquième courant, mettant l’accent sur l’action internationale du capital, renoue avec les analyses classiques, tout en les adaptant à la fin du 20e siècle. Il pallie ainsi aux manques du « dépendantisme » et éclaire des zones d’ombre. S’en prenant frontalement aux « dépendantistes », le marxiste britannique Bill Warren les accuse de nationalisme petit-bourgeois aveugle au rôle transformateur du capital que Marx avait souligné. À ses yeux, le capital international apporte le développement à des régions arriérées et ne doit pas être refusé par amour-propre. La charge est à fond de train et l’éloge du capital est tel que, sous couleur de marxisme, le propos se mue en reprise des idées libérales de modernisation par l’apport extérieur et l’imitation de l’Occident. Ce livre contribue au recul de l’« école », sans en être la raison principale. Pierre-Philippe Rey s’intéresse aux modes de production au sein des formations sociales des pays du Sud. Des modes de production différents — capitalistes et précapitalistes — peuvent coexister et s’articuler dans une même société. Enfin Christian Palloix explique comment s’internationalisent successivement les différents circuits du capital : capital-marchandises, capital-argent, capital productif. Cette conception de l’internationalisation du capital tend à ressembler à la mondialisation, à accorder au capital des métropoles le rôle moteur de la transformation du monde dans un mouvement unilatéral et unidirectionnel, et à laisser de côté l’impérialisme.
Le sixième et dernier groupe est hétéroclite, à l’image de la complexification de l’économie mondiale et de la moins grande lisibilité de l’impérialisme à l’ère de la mondialisation et de l’unipolarité étatsunienne. Marqués par le mondialisme et le postmodernisme triomphants, Michael Hardt et Antonio Negri, deux auteurs issus de la gauche, publient un pavé déconcertant qui reproduit les poncifs répandus par les chantres de la mondialisation : fin des États, monde homogénéisé et réseauté, Empire déterritorialisé et décentralisé, économie immatérielle, etc. La disparition des États, de la politique et de l’impérialisme sont des idées en vogue depuis l’offensive libérale des années 1980 et le pari fait sur la mondialisation néolibérale. Les affirmations des deux auteurs sont en phase avec le courant mondialisant, transnational, post- étatique qui règne sans partage au début des années 2000. Trois ans plus tard, il est rudement rappelé à la réalité par l’invasion étatsunienne de l’Irak. L’impérialisme « classique » et militarisé, l’hégémonisme traditionnel, l’État et la géopolitique se rappellent au bon souvenir du monde, balayant les rêveries et les spéculations idylliques sur un monde sans structures ou rapports de force. Aux commandes, les néoconservateurs parlent le langage désinhibé de la puissance militaire, rendu encore plus agressif par la démagogie sur la prétendue diffusion de la démocratie. La pensée sur l’impérialisme cherche désormais à (ré)intégrer le politique dans la mondialisation économique. C’est ce que font David Harvey, Helen Meiksins Wood et Alex Callinicos. D’autres, comme John Smith et Zak Cope, se refocalisent sur l’exploitation du Sud par le Nord à travers les délocalisations d’entreprises. Enfin, le thème fécond de la financiarisation de l’économie est développé par Pierre Chesnais, Michael Hudson et Costas Lapavitsas. Avancées appréciables, ces contributions laissent toujours pendante la question d’une interprétation d’ensemble de l’impérialisme dans ses composantes Nord-Sud et Nord-Nord, économique et politique, historique et actuelle.

3. Retour à l’histoire et reconceptualisation
L’impossibilité de se limiter à la théorisation disponible et la volonté de remonter à l’observation sans intermédiation du phénomène impérialiste commande d’esquisser un retour à l’histoire. L’histoire est appelée au secours de la théorie. La conception proposée de l’impérialisme par le livre est ancrée dans l’histoire. Il s’agit de l’élaboration d’une nouvelle interprétation de l’impérialisme, fondée sur une démarche historique. Avec l’histoire comme laboratoire de l’exercice, il est fait recours à l’empirisme comme approche et comme méthode de travail.
L’objectif est d’éviter une interprétation de plus qui soit valable pour un moment historique et pas pour un autre. L’intention est de repérer ce qu’il y a constant, récurrent à travers le temps, pour le phénomène impérialiste, sans ignorer les spécificités des époques. De l’Antiquité au Moyen-Âge à l’ère moderne à la période contemporaine, il y a un certain comportement qui représente ce qu’on pourrait comprendre comme l’impérialisme.
Il y a un besoin d’une définition qui concilie le phénomène général et ses manifestations particulières, et qui se prête à une périodisation selon les mécanismes propres à chaque époque, sans perdre son unicité. Par conséquent, il faut prendre un peu de recul et d’altitude pour recadrer (ou redessiner la grille de compréhension). Il importe d’articuler l’impérialisme, le colonialisme, et les Empires coloniaux.
L’exercice arrive à la définition suivante : l’impérialisme est un système de transferts économiques internationaux basé sur des moyens extra-économiques (principalement la force, la coercition politique et/ou militaire). C’est de l’appropriation (ou accaparement) économique sous pression non économique. Autrement dit, l’Impérialisme, c’est l’usage de moyens extra-économiques à des fins économiques. Ce n’est pas seulement des échanges et des relations économiques, même avantageux, mais un abus économique résultant de l’inégalité dans les rapports de force. Il a un caractère primaire, primitif, avec des modalités d’application qui se modernisent. C’est un comportement ancien, avec une mise en œuvre qui s’adapte au temps et au lieu.
Certains fils conducteurs se retrouvent à travers les époques :
- une ponction économique par des leviers non économiques,
- un passage de la rapine et du pillage primaires, bruts, non déguisés, à des systèmes plus complexes et voilés de siphonnage des richesses,
- certains modes d’accaparement privilégiés par chaque période historique, sans nécessairement rendre caducs les précédents.
Les deux points de repère dans cette l’analyse sont l’historicité de l’impérialisme (il est contextualisé) et la persistance de comportements primaires. Il y a autant continuité que de complexité croissante.
4. Les périodes
Les modèles impérialistes se succèdent chronologiquement, se complexifient et se déploient sur une échelle de plus en plus grande. L’analyse menée dans l’ouvrage identifie des périodes durant lesquelles l’impérialisme s’incarne dans des traits spécifiques et communs pour chacune des périodes. Quatre phases historiques émergent et sont présentées dans les quatre parties du livre. En bref, la phase ancienne s’apparente à un pillage non déguisé. Les deux suivantes, les plus connues, sont celles des empires coloniaux formellement constitués, sont tout aussi transparentes. Ces phases sont territorialement définies. L’actuelle, postcoloniale, est la plus voilée et pourtant la plus prégnante et la plus étendue sur le plan territorial, car universelle par vocation.
La première phase est celle de l’Antiquité et de ses prolongements dans l’ère médiévale. Elle recouvre les premiers États agricoles du Proche-Orient, de l’Inde et de la Chine. Les États de la Grèce ancienne et, surtout, l’Empire romain en sont des exemples aboutis. Des formes d’organisation étatique diverses, souvent éphémères, apparaissent suite à la disparition de l’Empire romain. L’impérialisme est dans sa préhistoire, primitif, élémentaire, rudimentaire, sommaire. Le transfert de la richesse s’effectue de manière primaire, par la force brute, sans l’intermédiation de mécanismes économiques. Il relève de la prédation et de la spoliation, du versement d’un tribut et comporte la quête d’une main-d’œuvre à réduire à l’esclavage. D’où le descriptif de cette phase comme étant celle de l’extraction coercitive.
Les deux prochaines phases couvrent l’ère moderne et l’ère contemporaine, soit un demi-millénaire du 15e au 20e siècle durant lesquels le capitalisme émerge et devient graduellement le mode dominant de production et d’organisation sociopolitique. Elles sont coloniales, c’est-à-dire que l’impérialisme s’y incarne dans des Empires coloniaux appartenant à des États, européens pour la plupart. Dans le cadre capitaliste, le pompage/siphonnage des richesses devient structurel et théorisé, notamment par les conceptions mercantilistes. Le centre de gravité se déplace vers l’Atlantique à partir de la « découverte » de l’Amérique et de l’essor des Empires ibériques. Suivront les Empires formés par les autres États de l’Europe occidentale qui étendront leur emprise petit à petit sur le monde entier et s’affronteront régulièrement pour s’imposer aux dépens des autres. L’impérialisme commercial est la première étape de l’impérialisme capitaliste. La recherche des métaux précieux, des épices, des produits tropicaux est effrénée. Les échanges sont forcés ; l’objectif est l’accaparement, le monopole et l’élimination de la concurrence ; le protectionnisme est la règle ; la traite et l’esclavage sont largement pratiqués comme méthodes pour générer revenus et profits. Le caractère structuré et contraint des transferts internationaux de richesses sous l’impérialisme colonial motive sa description comme étant celui de la captation par la force.
Propre à la période moderne (15e–18e siècles), cette description vaut aussi pour l’impérialisme de la période contemporaine (19e–20e siècles) qui est aussi la deuxième phase de l’impérialisme capitaliste. Au capital commercial s’ajoute désormais le capital industriel et son besoin de marchés plus larges pour les produits de la fabrication en masse. Le mercantilisme est abandonné et le protectionnisme desserré au profit de la liberté du commerce afin d’étendre les marchés étrangers, ouverts par tous les moyens, y compris les canonnières. Cette ère du libre-échange est censée élaguer les colonies et les Empires, car, selon les enseignements de l’économie politique classique, ils seraient trop étroits et coûteux à administrer. Or, il n’en est rien ; les Empires sont maintenus, voire agrandis. À la fin du 19e siècle, il y a même une ruée vers l’acquisition de possessions coloniales et l’apparition d’un néomercantilisme prônant le protectionnisme et les zones économiques réservées. Cette troisième phase, néomercantiliste, de l’impérialisme capitaliste ajoute, par l’exportation des capitaux, un volet financier aux objectifs commerciaux et industriels déjà établis. Durant cette phase, le monde entier se trouve partagé entre les Empires territoriaux d’une demi-douzaine de grandes puissances qui s’affrontent dans deux guerres qui entraînent l’implosion de l’impérialisme néomercantiliste.
La quatrième phase de l’impérialisme capitaliste débute après la Seconde Guerre mondiale. Elle est marquée par deux faits nouveaux. D’abord cet impérialisme est postcolonial parce que la décolonisation met fin à six siècles d’Empires coloniaux territorialement définis. Ensuite, une grande puissance, les États-Unis, surclasse toutes les autres et aspire à un impérialisme planétaire s’étendant au monde entier, englobant pays développés et moins développés, le Nord et le Sud. Cet impérialisme extrait les richesses de l’extérieur vers les États-Unis par l’exploitation d’une rente de situation, à savoir les privilèges associés au dollar. Les États-Unis ont la possibilité d’émettre de la monnaie en quantité quasi illimitée, sans tenir compte des règles élémentaires de l’économie, et de s’en servir pour importer des biens et services. Plus abstrait que le pillage d’autrefois, le transfert des richesses (de la valeur) emprunte la voie monétaire. L’absence de tutelle formellement reconnue, comme à l’ère coloniale, ne signifie pas la disparition de la coercition. Ce système est expansionniste par sa nature et tend vers l’absorption du monde entier. Le refus d’y être intégré équivaut à une contestation de la puissance hégémonique et entraîne un usage de la force se traduisant par des bombardements, des invasions ou des déstabilisations/changements de régimes. C’est pourquoi l’impérialisme postcolonial et planétaire actuel est caractérisé par l’incorporation contrainte.
Conclusion
Revisiter l’impérialisme répond à un besoin d’une notion qui permette de donner un sens à des phénomènes tangibles et persistants. La carence en la matière avait pratiquement évacué le terme impérialisme de la pensée ces dernières années. Y revenir exigeait un passage en revue des interprétations existantes, leur réévaluation et leur déconstruction. Était aussi nécessaire une extension à la période actuelle d’une analyse qui en était restée à des temps révolus.
Prendre en charge l’impérialisme dans sa globalité est un défi redoutable. Il ne peut être relevé par davantage de théorisation, sous peine de tourner en rond dans l’abstraction. Le parti est pris ici de fonder la reconstruction du concept sur l’histoire et de dégager une définition qui soit applicable sur toute la trame historique, sans pour autant négliger les conditions spécifiques à chaque époque. On dispose désormais d’un outil d’analyse utilisable pour le passé comme pour le présent.
Samir Saul
[1] Samir Saul, L’impérialisme, passé et présent. Un essai, Paris, Les Indes savantes, 2023.
La 3e édition du Fusionarium, un laboratoire créatif d’intersections, aura lieu le 27 novembre
Tout ce que vous voulez savoir sur le Programme de stages internationaux d’Alternatives pour les jeunes !
Un ouvrier de la STM remet les pendules à l’heure après la grève
Le NPD, pas un « parti des travailleurs », dit un gréviste du public de C-B
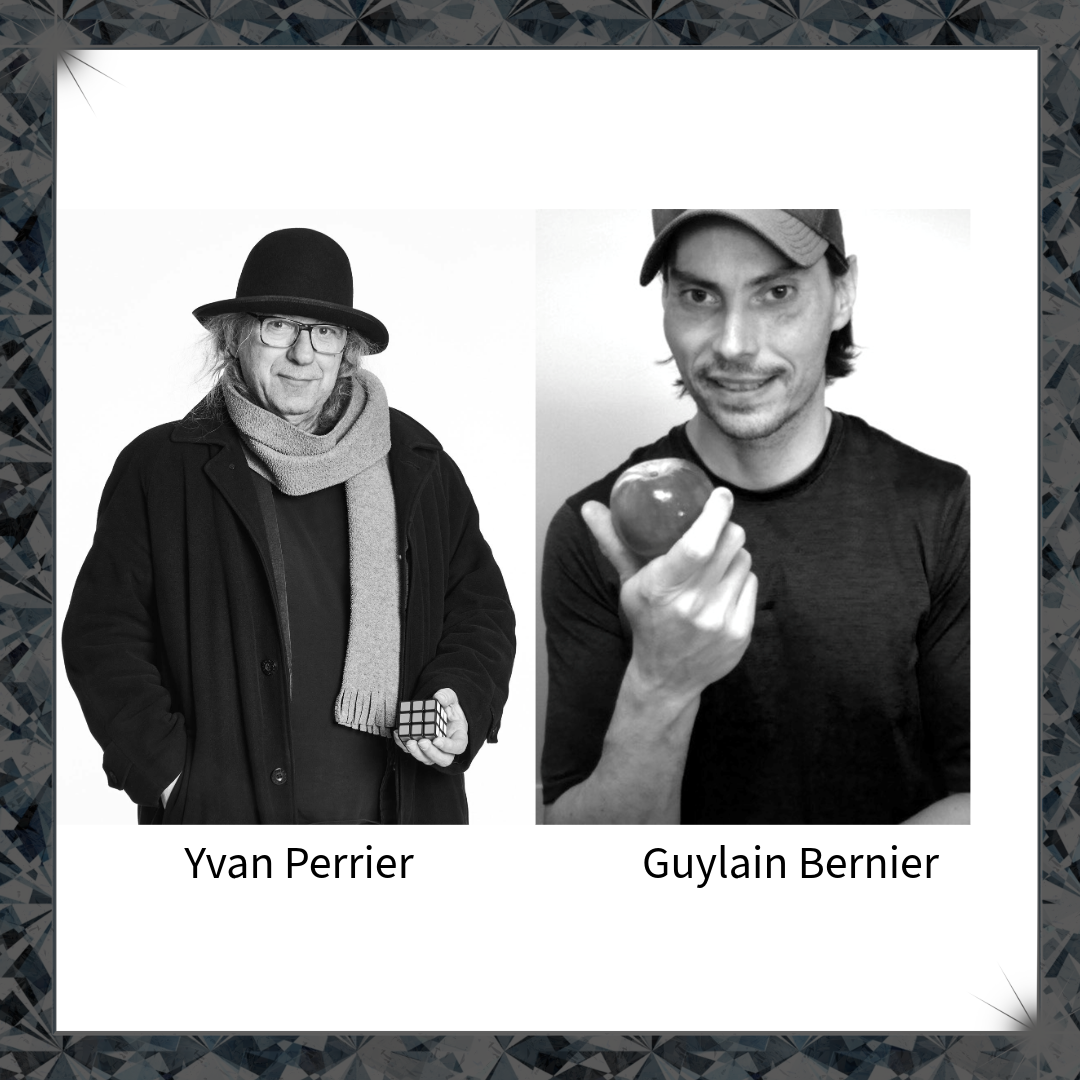
Impressions politiques automnales
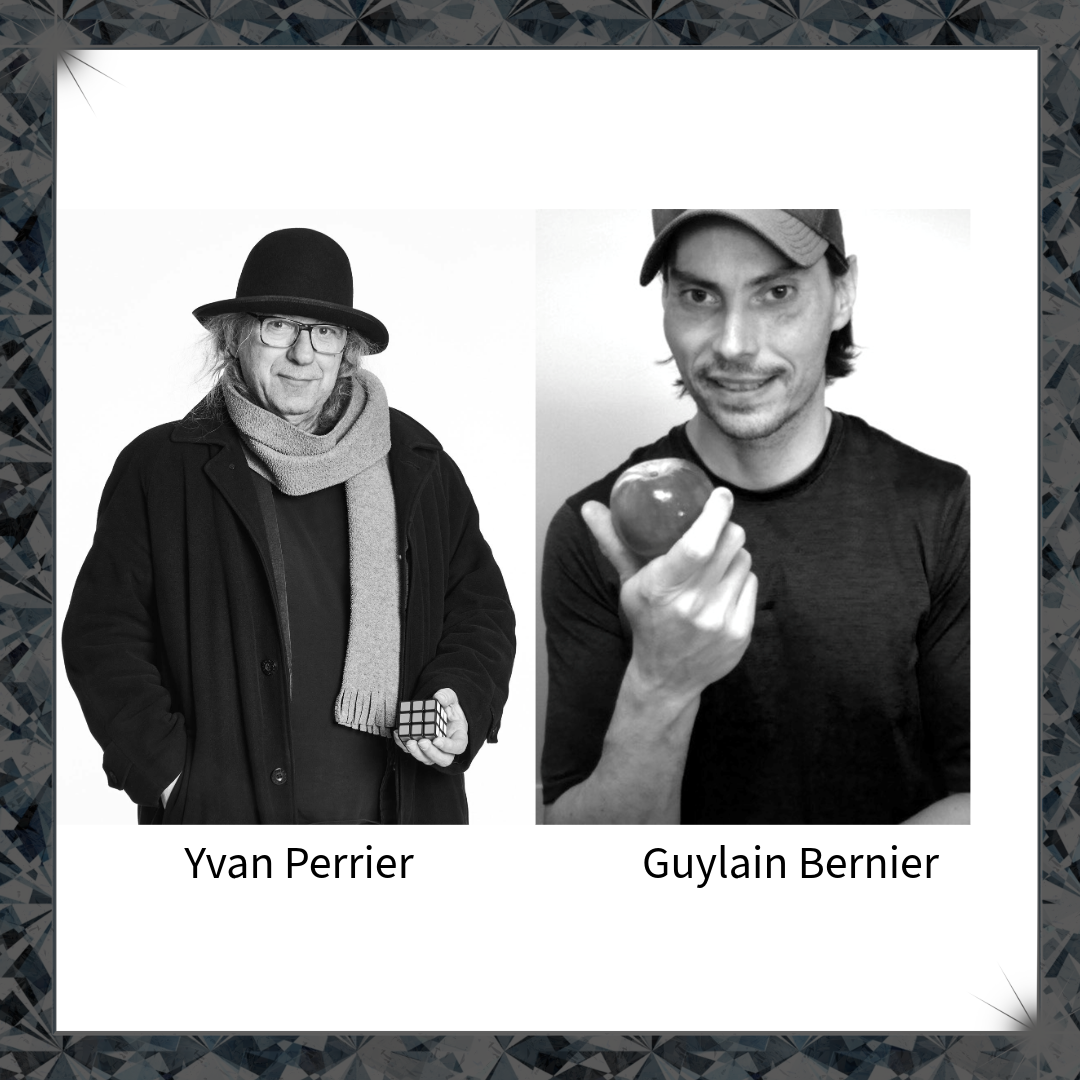
La mémoire est une faculté qui oublie
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas d'avoir entendu le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, traiter les mairesses et les maires du Québec de « quêteux ».
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas d'avoir entendu ce même premier ministre affirmer que les employéEs des municipalités étaient trop bien rémunéréEs.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas que l'actuel premier ministre du Québec déteste viscéralement les syndicats et souhaite même leur disparition.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas d'avoir entendu l'ex-ministre des Transports, madame Guilbault, se réjouir d'avoir sabré dans le financement du transport public.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas que le premier ministre du Québec a autorisé une augmentation salariale des députéEs de l'Assemblée nationale de plus de 35 % depuis 2023.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne savent même pas que le droit de grève est un droit dont l'exercice est protégé par la Constitution.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne savent même pas comment les « services essentiels » ont vu le jour au Québec et comment ils sont déterminés lors d'un conflit ouvert de travail, c'est-à-dire lors d'une grève.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne savent même pas à qui incombe l'obligation de démontrer, devant le Tribunal administratif du Québec, que la santé (et la sécurité) de la population est menacée par un arrêt de travail.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui ne se rappellent pas qu'une stratégie de négociation patronale, comme syndicale, s'élabore avant même les premières rencontres entre les parties.
Il se peut qu'il y en ait parmi nous, qui s'imaginent que le ministre Boulet agit de manière isolée, sans être en appui avec les Guilbault et Legault. Mais il se peut que cela corresponde exactement à ce que se disent les Guilbault, Legault et Boulet, à savoir : dans le brouhaha de l'actualité déstabilisante, une majorité de la population semble complètement s'y désintéresser et restera indifférente ou incapable de voir clair ou de décoder la stratégie gouvernementale. En termes de stratégie, il est possible d'y lire, tout dépendant de la lunette utilisée, le scénario du sauveur de la population supposément prise en otage par les « syndicats ».
Après le rappel passionnel, la critique
Chez l'humain, il y a souvent cette tendance à pointer du doigt des personnes, surtout en politique, lorsque les choses vont moins bien ou n'avancent pas comme souhaité. Ainsi, nous entrerions dans cette même tendance l'assertion voulant que les Gilbault, Legault et Boulet poursuivent actuellement leur entreprise de privatisation-externalisation (sous-traitance) des services publics, de détournement de la caisse commune vers des subventions aux entreprises privées millionnaires, voire même milliardaires, ce qui contribue, selon ce point de vue, à l'intensification de la cassure sociale et à l'accentuation des écarts entre les riches et les pauvres… Or, ce qui est en cause dépasse les individus ou les ministres pour tenir compte d'une réalité fort simple : nous évoluons dans un régime économique qui vante l'accumulation de richesses et qui considère comme étant anti-productifs les enjeux sociaux, syndicaux et environnementaux, parce qu'ils deviennent des freins à l'idéal d'une économie politique capitaliste et néolibérale. Voilà alors pourquoi il devient aisé de résumer le gouvernement actuel d'« affairiste », de « comptable », d'« antisyndical » et d' « antisocial », du moins, pour les gens qui perçoivent davantage les inconvénients du régime dans lequel nous évoluons que ses avantages. En revanche, il faut rappeler cette propriété du Québec d'être un digne représentant de la sociale démocratie. Le hic repose sur son effritement depuis quelques décennies, notamment en voulant calquer notre politique et la supériorité de la donne économique à ce qui se fait ailleurs et surtout aux États-Unis. Pourtant, il y a moment de tirer notre épingle du jeu, malgré les circonstances mondiales actuelles, sans renier notre identité sociale démocrate, ce qui signifie justement de savoir ramener à l'ordre du jour les raisons pour lesquelles nous aspirons à un système d'éducation et de santé universel et idéalement gratuit, y compris les raisons pour lesquelles nous nous sommes donné le droit de mettre sur pied des syndicats.
Rappelez-vous encore. Durant la pandémie, François Legault parlait des anges gardiennes et des anges gardiens. Il voyait même d'un bon œil, durant une très courte période faut-il le préciser, les syndicats. Il voulait régler vite avec ces derniers le renouvellement des conventions collectives. Le retournement de situation survenu ensuite, pour ne pas dire le retour à la normale, peut certes se justifier sur la base de la fin de la pandémie, mais aussi la guerre tarifaire qui lui a succédé. Peu importe, le régime n'a pas changé ; il demeure celui qui était déjà là. En tout bon gouvernement réactionnaire plutôt que visionnaire, les sommes investies pour augmenter les salaires et le nombre de préposéEs aux soins, de même que l'ouverture aux syndicats, qui alertaient d'ailleurs de la situation de pénurie depuis belle lurette, ne visaient qu'à faire face à la crise, sans plus. Car l'objectif n'a jamais été d'améliorer le système de santé ou de préparer une nouvelle forme de dialogue avec les syndicats. Il a toujours été question de rendre l'État telle une entreprise, capable de productivité et de rendement sur investissement. Ce faisant, l'inflation est entrée par la porte d'en avant, parce que seul le pouvoir d'achat comptait — et compte toujours —, seul l'enrichissement comptait comme toujours. Mais la richesse ne se compte pas seulement en argent… Celle véritable pour un pays représente sa population, sa culture, son territoire et ses ressources.
C'est vrai qu'il n'y a aucun mal à vouloir s'enrichir et garantir un meilleur fonctionnement de l'État. Le problème repose sur le fait de ne pas veiller convenablement à une redistribution équitable de cette richesse et de constamment vouloir favoriser les grandes entreprises qui agissent d'ailleurs en quasi-monopoles et qui ont négligé d'investir dans l'innovation à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, afin de combattre le changement climatique, d'un côté, et d'assurer la requalification des travailleurEUSEs, de l'autre, ce qui aurait permis un gain de productivité et l'amélioration de leurs conditions, comme le souhaitent d'ailleurs les syndicats. Et cette nouvelle richesse aurait pu servir ensuite au gouvernement à refinancer les services publics et parapublics. Mais que s'est-il passé dans la réalité ? La pandémie a amené le gouvernement à donner des sommes à des entreprises qui n'en avaient pas besoin, d'autant plus qu'elles conservaient des fonds en réserve. Les dépenses de soutien ont contribué à créer une inflation, qui a affecté l'ensemble de l'économie et qui se fait encore sentir. Voici le paradoxe : le support à l'économie a été fixé de façon à assurer ou à pallier le manque de consommation, ce qui a créé, à l'inverse, une perte de pouvoir d'achat. On le répète, le meilleur investissement de l'État doit viser le bien-être et la sécurité de sa population et son territoire, non à vouloir devenir maître de l'économie. Voilà une leçon à tirer.
Il est très tristounet le paysage politico-social automnal actuel au Québec. Les solutions présentées jusqu'ici sont entièrement orientées sur l'économie, sans se soucier de la façon dont il serait possible de les conjuguer avec les défis en éducation, en logement abordable, en santé et en environnement. Toujours cette solution magique de l'investissement dans l'économie, dans la grande industrie et dans l'efficacité étatique pour régler tous les problèmes. Quoi penser alors de ce qui est survenu dans Northvolt ? à la SAAQ ? Voyons-y un discours qui manque d'originalité pour l'avenir. En plus, n'oublions pas que ce qu'il y a de minimalement excitant à voir en démocratie électorale représentative est un gouvernement usé, et ce durant les derniers mois qui précèdent son éventuelle cuisante défaite électorale annoncée. Il se révèle très décevant en effet de voir un parti politique bénéficier d'une si grande majorité à l'Assemblée nationale, lui donnant ainsi le pouvoir de réaliser de bonnes choses, mais au final d'avoir si peu de réalisations concrètes positives. Mais rappelons que si la CAQ est au pouvoir, ce n'est pourtant pas en raison de ses performances électorales ou d'un large appui majoritaire de l'électorat. Cette formation politique dirige en raison de la division du vote entre quatre principaux partis politiques (le pluripartisme) et du mode de scrutin uninominal à un tour. Ses faibles appuis électoraux procentuels constituent son principal talon d'Achille.
Être à ce point critique envers un parti politique insinue peut-être deux choses : il est de plus en plus difficile de contenter la population, ce qui devrait augurer des changements dans la manière de faire de la politique, ou encore, le parti au pouvoir ne répond pas adéquatement aux attentes.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
13 novembre 2025
20h
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Québec : des organismes dénoncent la militarisation de l’économie aux dépens de la transition écologique et de la justice sociale
Les élections municipales ont un impact sur la scène politique centrale

Le sens et la portée du choix de Sol Zanetti comme porte-parole masculin de Québec solidaire

L'élection de Sol Zanetti avec plus de 50,4 % des voix reflète une recomposition des équilibres internes au sein de Québec solidaire. La majorité de la députation s'était rangée derrière Étienne Grandmont, qui a obtenu 37,9 %. Il n'était pas identifié comme le porteur du projet indépendantiste, mais plutôt comme un député centré sur le travail parlementaire et le soutien aux luttes sociales. Le soutien à Yv Bonnier Viger était d'abord motivé par le désir d'avoir un porte-parole qui ne soit pas membre de l'équipe parlementaire et qui fasse de la reconstruction des associations électorales l'essentiel de son travail. Cette approche n'a toutefois attiré que 9,2 % des membres de Québec solidaire.
Sol Zanetti a bénéficié du ralliement des indépendantistes du parti — notamment des ancien·nes militant·es d'Option nationale — ainsi que de figures comme Ruba Ghazal, qui partage avec lui une vision d'une indépendance ouverte et inclusive. La majorité des membres qui ont voté pour Sol Zanetti y ont sans doute vu un moyen de réaffirmer le projet indépendantiste comme préoccupation essentielle du parti.
Cette élection se traduira donc par un renforcement de la place de l'indépendance dans le profil et la communication de Québec solidaire. Dans le contexte des élections à venir et de la perspective d'un éventuel référendum, le choix des membres visait à replacer Québec solidaire au centre d'un champ politique redéfini par la question nationale.
Son discours d'inauguration
Le discours inaugural de Zanetti a insisté sur l'indépendance comme projet démocratique, social et inclusif, ouvert aux personnes immigrantes et aux nations autochtones, rompant ainsi avec la tradition souverainiste du PQ, fondée sur une conception plus fermée de l'identité québécoise. Ruba Ghazal a repris cette ligne et a formulé une critique bien sentie des propos de PSPP sur la prétendue responsabilité des personnes migrantes dans les maux vécus par la société québécoise.
Ces interventions ont déjà provoqué un conflit ouvert avec le Parti québécois, sur le terrain même de l'indépendance. PSPP a accusé Québec solidaire de chercher à diviser la société québécoise et de nuire à la cause indépendantiste. De nombreux péquistes ont relayé ces attaques sur les médias sociaux.
En même temps, cette première escarmouche réintroduit la centralité de la question de l'indépendance du Québec dans le discours de Québec solidaire, après plusieurs années où elle avait été marginalisée au profit d'enjeux sociaux souvent définis de manière étroite. La campagne électorale de 2022 avait pratiquement écarté la question de l'indépendance.
Ce porte-parolat Ghazal–Zanetti peut-il redéfinir la politique et le profil de Québec solidaire ?
L'enjeu pour le nouveau porte-parolat sera de transformer le discours sur l'indépendance en un projet politique concret, articulé à la transition écologique, à la justice sociale, à la refondation démocratique et à la rupture avec l'impérialisme. Cela nécessitera une vision stratégique claire, une démarcation sans concession face au projet péquiste et une capacité à se lier aux différents mouvements sociaux antisystémiques.
« Un Québec indépendant devra aligner ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis, malgré la guerre tarifaire menée par Donald Trump », croit Paul St-Pierre Plamondon. Contrairement au premier ministre canadien, Mark Carney, le chef péquiste ne compte pas tourner le dos au voisin américain en cas de victoire du Oui. D'une part pour « favoriser la stabilité » du nouvel État indépendant, d'autre part en raison de sa situation géographique. « Il y a un contexte géopolitique et nos intérêts, au Québec, sont alignés sur ceux des États-Unis », a-t-il déclaré jeudi en dévoilant les premiers éléments de son Livre bleu sur un Québec souverain. [1]
L'indépendance proposée par PSPP n'est pas une indépendance véritable : le Québec demeurerait assujetti aux politiques de l'empire américain et à celles de l'État canadien. Ce serait une indépendance croupion.
À l'inverse, une indépendance pleine et entière devrait s'enraciner dans la souveraineté du peuple, non seulement sur le plan constitutionnel, mais aussi sur les plans économique, écologique, démocratique et culturel. Elle devrait affirmer le droit à l'autodétermination des nations autochtones, rompre avec les logiques néolibérales et impériales, et ouvrir la voie à l'institution d'une république démocratique, solidaire, écologiste et décoloniale — une république du peuple pour le peuple, libre des tutelles du capital et des empires.
Conclusion : un tournant à saisir
Le choix de Sol Zanetti par les membres de Québec solidaire traduit une volonté de réorientation stratégique afin de remettre le projet d'indépendance au centre de la stratégie politique du parti et de replacer celui-ci au cœur d'un champ politique où la question nationale redevient un enjeu essentiel. Mais ce tournant ne prendra sens que s'il s'accompagne d'une repolitisation du parti lui-même : formations sur les enjeux de l'indépendance, explication de la nécessité que la lutte pour une majorité indépendantiste soit portée par un projet de société égalitaire, féministe, écologiste et décolonial.
Le nouveau porte-parolat de Québec solidaire devra relever un défi crucial : rendre le projet solidaire clair, intelligible et convaincant, en démontrant sa nécessité face au projet péquiste d'une indépendance croupion — une indépendance qui ne remettrait pas en cause le Québec néolibéral ni son intégration au cadre géopolitique nord-américain actuel. Il s'agira donc d'affirmer une alternative nette : s'opposer à cette indépendance sans rupture réelle et défendre un projet de société porteur d'une véritable libération nationale, fondée sur la souveraineté populaire et la justice sociale. Il faudra également redéfinir clairement la stratégie de lutte pour une majorité indépendantiste et le caractère essentiel de la perspective de constituante, qui a été remise en cause par l'abandon d'une option claire de sa mise en place lors d'une élection au suffrage universel au dernier congrès. Le pire abandon serait de faire croire qu'une victoire du PQ pourrait constituer une voie royale vers le référendum et vers l'indépendance. Il est des illusions qu'il faudra éviter de nourrir. Reconstruire la pertinence du projet de Québec solidaire pour l'indépendance impliquera de surmonter une série d'obstacles. Comme l'a rappelé Sol Zanetti dans son allocution au congrès : « Il n'y en aura pas de facile. »
[1] Patrick Bellerose, Journal de Québec, 6 novembre 2025.

Définir les orientations politiques pragmatiques d’un futur gouvernement solidaire

Le 18ᵉ congrès de Québec solidaire, consacré à l'« actualisation » du programme, aurait pu être un moment fort de délibération démocratique et de clarification des orientations stratégiques du parti. Il s'est plutôt transformé en un exercice d'encadrement politique et organisationnel révélant la normalisation électoraliste en cours. Derrière le discours rassurant de la « lisibilité » et de la « pédagogie » du programme, la direction a imposé une conception restrictive du mandat confié par le parti : réduire le programme à un document de gouvernement, formulé à un haut niveau de généralité, dénué de propositions concrètes et de toute perspective de rupture radicale avec l'ordre existant, exprimée de façon claire et précise. Sous prétexte de simplification du langage et d'accessibilité pour le grand public, ont été écartés les éléments les plus structurants du projet solidaire : la mention explicite du capitalisme comme responsable de la dégradation de la biodiversité, des crises économiques, politiques et environnementales a été rejetée.
Les débats autour du programme réactualisé se sont faits très rapidement. Il y avait 288 amendements à discuter, sans parler des parties du texte qui n'avaient pas fait l'objet d'amendements et qui ont également été votées. Nous faisons ci-dessous un survol rapide des débats.
La majorité des amendements portaient sur le Bloc I « Économie et transition socioécologique » et sur le Bloc II « Habitation, énergie, ressources naturelles et travail ». Dans les domaines économiques et écologiques, les mesures adoptées restent symboliques ou limitées : la décroissance est réduite aux industries fossiles, et le rôle des PME et du secteur privé est légitimé comme pouvant être l'instrument de la transition socioécologique. Si la discussion a permis de clarifier que le secteur privé ne se limite pas aux PME, mais qu'il comprend également de grandes entreprises engagées dans le capital fossile et dans les industries d'extraction des ressources naturelles, souvent multinationales, aucune politique concrète en direction de ces secteurs n'a été définie. La définition de la décroissance a été limitée aux industries fossiles, évitant toute prise de position explicite sur la décroissance globale. Ainsi, la reconversion des industries militaires en industries productrices de biens utiles (comme des moyens de transport électrifiés), par exemple, n'a pas été discutée. Pourtant, à l'heure où Legault veut relancer cette industrie, une position claire sur sa nécessaire décroissance aurait été indispensable.
Les propositions de nationalisation/socialisation des grands monopoles du secteur de l'énergie, de l'exploitation des ressources forestières ou minières ont toutes été rejetées. Ces propositions ont été présentées comme trop spécifiques, et il a été avancé que ce serait un éventuel gouvernement de Québec solidaire qui pourrait définir les entreprises à nationaliser. Le texte du programme révisé s'est donc contenté de définir des critères. C'est un choix qui empêche de prendre en compte que, tant que les grandes entreprises contrôleront les choix en matière d'énergie et d'exploitation des ressources, la planification démocratique et décentralisée nécessaire à la transition écologique sera entravée. C'est un choix qui reporte dans un avenir indéterminé, après l'accession hypothétique de Québec solidaire au pouvoir, la lutte effective pour la reprise en main de nos ressources naturelles. Les propositions adoptées se contentent de parler de surveillance attentive des entreprises, sans s'interroger sur le pouvoir réel que garderont les grandes entreprises sur l'économie du Québec.
Dans les secteurs sociaux — Bloc III « Santé et services sociaux » — tels que le logement, le travail et l'éducation, des mesures progressistes ont été adoptées. Mais la proposition de réduction du temps de travail à 35 heures, puis à 32 heures, sans baisse de salaire et sans augmentation de l'intensité du travail, qui était reprise de l'ancien programme de Québec solidaire, a été rejetée (jugée trop spécifique). A également disparu, faute d'amendement en ce sens, le soutien à la syndicalisation multipatronale. En ce qui concerne la santé publique et les services sociaux, aucune discussion n'a eu lieu sur la privatisation rampante du système de santé, ni sur la rémunération des médecins. Les débats sur le système de santé sont restés limités à la reconnaissance ou non des médecines traditionnelles.
Dans le Bloc IV, portant sur la fiscalité, les familles, l'éducation et la justice, Québec solidaire a confirmé son refus des politiques d'austérité et adopté une fiscalité orientée vers la réduction de la pauvreté. Les services de la petite enfance ont été élargis et le caractère mixte du réseau scolaire a été maintenu. Des mesures redistributives et progressistes ont été adoptées, mais sans que des propositions concrètes en ce sens ne soient discutées, car elles avaient été d'emblée écartées des débats.
Dans le Bloc V, sur le plan démocratique et culturel, certaines avancées symboliques ont été adoptées : élargissement du droit de vote à 16 ans, protection contre l'usage discriminatoire de la laïcité, régularisation des sans-papiers et promotion de l'inclusion.
Le Bloc VI « Indépendance et altermondialisme » illustre des reculs dont l'importance reste à évaluer. L'abandon de l'élection au suffrage universel de l'Assemblée constituante affaiblit considérablement la stratégie indépendantiste de Québec solidaire. Le débat portait sur le tirage au sort, l'élection au suffrage universel ou le fait de ne pas se prononcer sur le mode de constitution de l'Assemblée constituante. C'est cette dernière proposition qui a été retenue, avec le soutien du porte-parole masculin, Sol Zanetti. Cette position a été, comme les autres, adoptée à la va-vite. Il s'agissait pourtant d'un abandon de la position traditionnelle de Québec solidaire.
L'élection d'une assemblée est essentielle à une réelle expression de la souveraineté populaire.
Cette élection permet de définir le peuple québécois comme le seul détenteur du pouvoir constituant, capable de définir ses institutions, ses droits fondamentaux et son mode de gouvernement. Elle permet à chaque Québécoise et Québécois de participer directement à la fondation de son pays. L'élection d'une assemblée constituante ouvre toute une période où les mouvements sociaux, syndicaux, féministes, écologistes et communautaires sont invités à formuler leurs propres propositions constitutionnelles. Cette élection ouvre un vaste débat public sur la société québécoise à construire. Les peuples autochtones, s'ils le souhaitent, peuvent s'impliquer dans ce processus. L'ensemble des citoyennes et citoyens sont invité·es à se prononcer sur les droits sociaux, sur la protection de l'environnement, sur la laïcité, sur la démocratie économique… Cette élection de la constituante et le travail qui s'en suivrait permettraient d'articuler le projet d'indépendance au projet de société défini collectivement, dans une réelle démarche de souveraineté populaire. L'élection n'est pas qu'un simple mécanisme de désignation : c'est un moment d'expression de la souveraineté populaire. Il faut reconnaître qu'une assemblée élue au suffrage universel, ouverte à toutes les forces politiques et validée par un référendum final, comme le proposait le programme de Québec solidaire, aurait une légitimité indiscutable pour parler au nom du peuple québécois lui-même. Le tirage au sort, lui, court-circuite cette politisation, en réduisant la participation citoyenne. Affirmer que la question reste ouverte, et qu'il sera toujours possible de réactualiser cette position, c'est affaiblir la position de Québec solidaire dans le débat actuel.
Le refus du congrès d'indiquer explicitement qu'un Québec indépendant refuserait de participer à l'OTAN et au NORAD constitue un recul par rapport au programme original de Québec solidaire. L'OTAN est une organisation qui « oblige ses membres à dépenser 5 % de leur PIB au détriment des investissements en santé, en éducation, en logement social et dans la lutte contre les changements climatiques ». À l'heure d'une reprise de la course aux armements, sous l'impulsion de l'OTAN, cette position nous désolidarise de celles et ceux qui mènent chaque jour un combat contre le militarisme.
Le Bloc VII, portant sur le féminisme, les identités sexuelles et de genre, et les peuples autochtones, n'a pas donné lieu à des débats, car, contrairement aux autres, le seul amendement significatif concernait la reconnaissance de l'écoféminisme. Le texte réactualisé a donc été adopté avec un minimum de débats.
Le Bloc VIII, sur l'immigration, l'inclusion et la langue française, a permis l'adoption de mesures favorisant l'inclusion et l'égalité des droits. L'obligation stricte « pour toute personne vivant au Québec de maîtriser suffisamment le français pour en faire sa langue d'usage dans la vie courante comme au travail » a été biffée du texte du programme actualisé. La régularisation des sans-papiers et l'égalité de traitement pour toustes les résident·es ont été adoptées. La tendance qui se dégage est clairement progressiste et inclusive, évitant toute forme de discrimination ou de traitement différencié.
En résumé, le programme se distingue par son caractère idéologique, son absence d'objectifs politiques concrets et sa faiblesse critique à l'égard du pouvoir économique de la classe dominante. Les luttes syndicales, populaires, écologiques, féministes et décoloniales ne sont pas présentées comme le principal moteur du changement. En fait, le programme est réduit, dans l'ensemble, à de futures orientations politiques et sociales d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire. Les transformations sociales y sont ainsi présentées comme s'effectuant à partir des sommets de la société. Cela découle du choix d'avoir écarté l'idée de faire du programme une boussole pour les luttes de rupture sociale et écologique, pourtant si nécessaires dans le moment actuel.
L'organisation de la discussion a su imposer l'idée que la « lisibilité » du programme devait primer sur la cohérence politique, et que les débats de fond sur la stratégie de rupture pouvaient être ajournés au nom de la définition d'un projet de société sans propositions spécifiques claires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les grands propriétaires bien servis par le PL60 du gouvernement Ford
La CAQ menace la grève de la STM, les travailleurs battent en retraite
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











