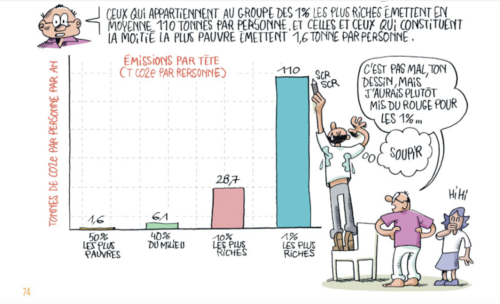Derniers articles

L’internationalisme, la question juive et la question palestinienne

Il existe une différence fondamentale entre l'internationalisme juif et le nationalisme sioniste. Comme l'a dit Daniel Bensaïd, la critique internationaliste du nationalisme juif est une très vieille histoire, illustrée, entre autres, par les noms d'Otto Bauer, d'Abraham Léon, d'Isaac Deutscher, de Roman Rosdolsky, de Maxime Rodinson, d'Ernest Mandel, de Nathan Weinstock, ou de Michel Warschawsky.
En tant que personne d'ascendance juive (séfarade), je pense que cette tradition intellectuelle s'efforce de répondre à la question de savoir par quel miracle un « peuple juif » a pu survivre, au fil des siècles, à l'épreuve de la diaspora, de l'antisémitisme religieux ou racial, de la différence des langues et des cultures. Rejetant l'hypothèse d'une mission religieuse ou d'une essence éternelle, elle a cherché dans l'histoire une réponse à cette énigme.
Abraham Léon ou Bruno Bauer ont ainsi élaboré la thèse matérialiste d'un « peuple-classe », esquissée par Marx à propos de ces « peuples de l'Antiquité » qui « vivaient comme les dieux d'Épicure dans les entre-mondes, ou plutôt comme les Juifs dans les pores de la société polonaise ». D'après Marx, les Juifs se sont perpétués, non malgré l'histoire, mais par l'histoire. Abraham Léon ajoutait qu'ils se sont maintenus, non malgré, mais « à cause de leur dispersion ».
Au seuil du XXe , les socialistes juifs étaient aussi confiants dans la vocation universellement libératrice du prolétariat, que la bourgeoisie révolutionnaire des Lumières avait cru à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce bel optimisme s'est brisé sous épreuve du nazisme et de la création d'un « État juif » en Palestine.
Le judéocide a joué le rôle déterminant. Isaac Deutscher souligne à ce propos la cruelle ironie de la déraison historique : « Auschwitz fut le terrible berceau de la nouvelle conscience juive et de la nouvelle nation juive. Nous qui avons rejeté la tradition religieuse, nous appartenons maintenant à la communauté négative de ceux qui ont été exposés tant de fois dans l'histoire et dans des circonstances si tragiques à la persécution et l'extermination des nations » (voir Isaac Deutsher, « Qu'est-ce qu'être juif », in Essai sur le Problème juif, Paris, Payot, 1969.). Pour ceux qui ont toujours mis l'accent sur l'identité juive et sur sa continuité, il est étrange et amer de penser qu'elle doit son nouveau bail sur la vie à l'extermination de six millions de Juifs.
Mais une autre raison de la persistance de la complexité de la question juive tient à sa reterritorialisation par l'établissement d'une « communauté nationale hébraïque en Palestine », puis par la création de l'État d'Israël. Selon Nathan Weinstock, dans l'ouvrage Le Sionisme contre Israël, ainsi se développe graduellement en Palestine une société juive autonome, dotée d'une classe ouvrière propre et d'une bourgeoisie embryonnaire, brassant en un ensemble national homogène les colons sionistes venus d'horizons divers et la population juive autochtone. L'adoption d'une langue commune, l'hébreu, cimente la cohésion de cette nouvelle entité.
On assiste dès lors à la constitution d'une nationalité nouvelle au Proche-Orient, issue d'un processus spécifique de la colonisation sioniste séparatiste du melting-pot juif palestinien : la nation israélienne en gestation. » Les Juifs palestiniens « se convertissent ainsi graduellement en une nation hébraïque nouvelle structurée selon des rapports de classe. Le titre du livre de Nathan Weinstock impliquait la reconnaissance de ce fait national nouveau, qui agit en retour comme un catalyseur sur l'ensemble d'une diaspora, dont les perspectives d'assimilation ont été obscurcies par le génocide. Alors que les persécutions nazies avaient contribué à rapprocher dans un malheur commun les branches ashkénaze et séfarade, les communautés d'Afrique du Nord furent bouleversées par les circonstances de la décolonisation et par les développements du conflit judéo-arabe.
La partition de la Palestine, portée sur les fonts baptismaux des Nations unies par les États-Unis et par l'Union soviétique, s'inscrit dans le grand partage de Yalta. Il en est sorti un État chevillé à la domination impérialiste de la région et fondé sur l'expulsion du peuple palestinien. Les bifurcations historiques ont déterminé un rebond morbide de « la question juive », inimaginable pour les Juifs internationalistes au seuil du XXe siècle. L'État d'Israël a cristallisé les peurs, rationnelles ou non, de la diaspora, et suscité ce « sionisme étrange », que Vladimir Rabi qualifia de « sionisme par procuration ».
Comme Trotski le reconnut à la fin de sa vie, la solution socialiste de la question juive dépend de l'émancipation générale de l'humanité, mais on ne saurait préjuger des rythmes et des formes de dépérissement des questions nationales et des autonomies culturelles.
En ce sens, concernant la question juive et la question palestinienne, selon les mots de Daniel Bensaïd, la voie d'une paix juste et durable passe par le primat du droit du sol sur le droit du sang, par la destruction des structures discriminatoires de l'État d'Israël, par sa laïcisation effective, par l'instauration d'une réelle égalité de droits civiques et sociaux entre Juifs et Arabes. Elle exige la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la souveraineté. Que la coexistence des deux peuples prenne la forme de deux États laïques et démocratiques séparés, d'une fédération régionale d'États, ou d'un État binational, la question reste historiquement grande ouverte. De nombreuses formules institutionnelles sont concevables. Mais, pour qu'elles deviennent concrètement possibles, il faut d'abord réparer les torts faits aux Palestiniens.
C'est la perspective d'une réponse internationaliste à la question juive et à la question palestinienne.
Ivonaldo Leite est un sociologue brésilien d'origine juive séfarade ; il est professeur à
l'Université Fédérale de Paraíba, au Brésil.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie a fini par imploser »

L'essayiste Pablo Stefanoni revient sur l'effondrement électoral du pouvoir sortant. Il décrit la désagrégation du capital politique qu'Evo Morales avait accumulé et les conséquences régionales de la bascule à droite du pays andin.
19 août 2025 | tiré de Viento sur
https://vientosur.info/el-partido-mas-poderoso-del-ultimo-medio-siglo-en-bolivia-ha-acabado-implosionando/
https://www.mediapart.fr/journal/international/190825/le-parti-le-plus-puissant-du-dernier-demi-siecle-en-bolivie-fini-par-imploser
Si les secteurs conservateurs jubilaient dimanche soir à l'annonce des résultats des élections générales en Bolivie, il était frappant de constater la marginalité à laquelle a été renvoyé le Mouvement vers le socialisme (MAS). Après avoir obtenu la majorité absolue des suffrages pendant plusieurs scrutins d'affilée, y compris en 2020, il n'a même pas atteint la barre des 5 %.
L'essayiste Pablo Stefanoni a travaillé sur la dynamique du MAS, en publiant notamment, avec Hervé Do Alto, Nous serons des millions. Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie (Raisons d'agir, 2008). Cet ancien directeur de l'édition bolivienne du Monde diplomatique, que nous avions reçu pour son dernier livre sur les « contre-cultures néoréactionnaires », décrit à Mediapart les étapes et les conséquences du déclin du « parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie ».
Mediapart : La situation critique du pays rendait prévisible une sanction du pouvoir sortant et de la gauche en général, mais l'ampleur de la chute est spectaculaire. Comment l'expliquer ?
Pablo Stefanoni : Trois facteurs se sont conjugués : une guerre intestine au sein du MAS, la fin du leadership incontesté d'Evo Morales à la tête de la gauche bolivienne, et une crise économique.
La guerre intestine entre les « évistes » (partisans d'Evo Morales), les « arcistes » (partisans du président Luis Arce Catacora) et les « androniquistes » (partisans du candidat à la présidence Andrónico Rodríguez) a été brutale et a contribué à l'autodestruction du mouvement. Le gouvernement a disqualifié Morales et lui a retiré le sigle du MAS par le biais d'une manœuvre judiciaire, tandis que Morales a tenté de bloquer le pays contre le gouvernement d'Arce.
Le jeune candidat Andrónico Rodríguez, relativement bien placé dans les sondages au début, est passé du statut de dauphin d'Evo Morales à celui de traître pour s'être présenté à la présidence sans son autorisation. C'est pourquoi Morales a appelé à l'annulation du vote. Attaquée par le gouvernement et par Morales, la candidature d'Andrónico Rodríguez s'est effondrée.
Le leadership d'Evo Morales ne s'en est pas moins effondré. Les 18 % de votes nuls – qui ont largement répondu à son appel – montrent qu'il conserve une influence dans certains secteurs. Cependant, ce vote nul reflète également l'impuissance de Morales face à son inéligibilité. Il correspond aux 15 % de l'électorat qui lui vouent un soutien inconditionnel. Morales s'est retranché dans la région du Chapare, son bastion politique, pour éviter d'être arrêté dans une affaire de détournement de mineure réactivée par le gouvernement Arce.
Enfin, il y a la crise économique. Elle a fait oublier aux Bolivien-nes la période de prospérité connue sous le nom de « miracle économique bolivien ». Les discours de type libéral ont commencé à séduire face aux problèmes du nationalisme économique du MAS.
Parmi les nombreuses expériences gouvernementales de gauche dans la région, dans les années 2000, quelle était l'originalité de celle du MAS et d'Evo Morales ? Si le nom du parti évoque le socialisme, comment caractériser ses réalisations effectives ?
L'originalité du MAS a été de mettre au premier plan la question indigène et la « plurinationalité » d'une part, et le nationalisme économique d'autre part, notamment à travers la nationalisation du gaz. Le nom du parti peut prêter à confusion : le Mouvement vers le socialisme (MAS) était un sigle qu'Evo Morales avait adopté parce que la justice n'avait pas légalisé son choix initial : l'Instrument politique pour la souveraineté des peuples (IPSP).
Son modèle nationaliste de gauche semblait fonctionner grâce aux prix élevés des matières premières et à une politique budgétaire prudente, mais l'industrialisation promise s'est limitée à de petites usines inefficaces, et les réserves de gaz se sont épuisées. La Bolivie a bien connu une forte croissance pendant près d'une décennie et demie sous Morales, avec Luis Arce comme ministre de l'économie, mais cette période semble appartenir au passé.
Dans le même temps, l'idée que les indigènes allaient régénérer la Bolivie s'est affaiblie. Les Bolivien-nes se sont lassé-es de Morales et de ses efforts permanents pour se faire réélire. Le symbole « indigène » a perdu de son prestige et de son pouvoir narratif. Et la plurinationalité, très difficile à mettre en œuvre, s'est plutôt réduite à des questions symboliques. Il y a toutefois eu un véritable empowerment populaire, dont nous verrons les effets dans le nouveau cycle qui s'ouvre.
Avec le déclin du MAS, la Bolivie semble revenir à la décennie des années 1990 : crise économique, fragmentation politique, pactes entre les élites pour obtenir des majorités parlementaires sur fond de divisions de la gauche.
Evo Morales apparaissait comme la clé de voûte de ce mouvement. Que s'est-il produit, en interne, depuis son renversement après l'élection contestée de 2019 ?
Evo Morales a commencé à s'user après le référendum de 2016, lorsqu'il a perdu le vote sur la possibilité de faire un mandat supplémentaire, mais il a poursuivi son projet malgré tout. En 2019, il a été renversé par un soulèvement original, à la fois civique et policier. À la surprise générale, le MAS est revenu au pouvoir un an plus tard, lors du nouveau scrutin organisé, avec plus de 50 % des voix.
Ce n'est pas Morales qui est alors revenu, mais Luis Arce. C'est là qu'a commencé une guerre pour le contrôle du gouvernement et du MAS. Morales a toujours considéré Arce comme un candidat de transition qui devait faciliter son retour au pouvoir, mais celui-ci s'est entouré de sa propre clique et a finalement décidé de briguer un second mandat – avant de se retirer faute de soutien.
De nombreuses personnalités ont tenté de servir de médiateurs dans la crise du MAS – le président vénézuélien Nicolás Maduro, l'ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Castro et d'autres –, mais aucun n'y est parvenu.
La guerre interne s'est intensifiée, alimentée par une culture politique bolivienne marquée par le caudillisme. Par ailleurs, le MAS n'est pas un parti au sens strict du terme, mais une fédération complexe de syndicats et de mouvements sociaux. Au milieu de ces affrontements, le parti a subi un processus de décomposition politique accélérée. Morales a commencé à voir des traîtres partout, y compris parmi ses plus fidèles soutiens, comme son ancien vice-président Álvaro García Linera.
Il est frappant de constater que le parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie a fini par imploser. Evo tente aujourd'hui de résister avec son nouveau mouvement EVO Pueblo, retranché dans des positions idéologiques bolivariennes, comme son soutien à Poutine et Maduro, qui ne trouvent écho que parmi ses partisans les plus radicaux.
Quoi qu'il arrive en octobre, ce pays sera gouverné par la droite. À quelles répercussions peut-on s'attendre du point de vue régional ?
Les deux candidats ont annoncé leur intention de prendre leurs distances avec le Vénézuéla et l'Iran, pays avec lesquels la Bolivie a signé des accords de coopération, tout en se rapprochant des États-Unis. Tous deux sont cependant favorables au maintien de la Bolivie dans les Brics [club regroupant, depuis les années 2010, les puissances non occidentales les plus importantes – ndlr].
Jorge « Tuto » Quiroga, un anticommuniste affirmé, est beaucoup plus proche que l'autre candidat des réseaux de la droite radicale et plus hostile au Mercosur [le marché commun du Sud des Amériques – ndlr], qu'il considère comme une « prison commerciale ». Il faut tenir compte du fait que Milei en Argentine pourrait être rejoint par José Antonio Kast au Chili si les sondages sont exacts, ce qui créerait un axe régional marqué à droite.
Le discours de Rodrigo Paz est moins idéologique que celui de Quiroga, mais son pragmatisme devrait aujourd'hui le conduire vers des positions de droite, comme cela a été le cas pour son père Jaime Paz Zamora (1989-1993), un ancien gauchiste élu président l'année de la chute du mur de Berlin, qui avait fini par s'allier avec l'ancien dictateur Hugo Banzer.
La première place de Rodrigo Paz, justement, a été une surprise. Tous les sondages donnaient en tête l'homme d'affaires Samuel Doria Medina, suivi de l'ancien président Jorge « Tuto » Quiroga. Comment expliquer ce résultat ?
Bien qu'étant dans le champ politique depuis des décennies, Paz n'est pas identifié au retour au pouvoir des anciennes élites. Il avait pour colistier un ancien policier très populaire, Edman Lara, renvoyé des forces de police après avoir dénoncé la corruption interne – un sujet particulièrement sensible en Bolivie.
Bien qu'il s'inspire du président salvadorien Nayib Bukele, Lara insiste sur le respect de la Constitution et des lois. Son « bukélisme soft » met l'accent sur la lutte contre la police corrompue, en affichant un « bon sens » qui a séduit une Bolivie désabusée et fatiguée.
Grâce à une campagne efficace sur TikTok, le « Capitaine Lara », âgé de 39 ans, s'est ainsi présenté comme le « candidat viral du peuple » et a su séduire l'ouest andin de la Bolivie. Mais les réseaux sociaux n'expliquent pas tout : Paz et Lara ont sillonné le pays, concluant des accords avec diverses organisations en quête de soutien électoral.
La Bolivie andine, la plus populaire, a voté en faveur du tandem Paz-Lara pour éviter de donner le pouvoir aux anciennes élites (Doria Medina et Tuto Quiroga). Ce résultat contraste fortement avec celui de la région agro-industrielle de Santa Cruz, où Quiroga était largement en tête. Le vote qui s'exprimait autrefois en faveur du MAS semble ainsi s'être divisé entre les votes nuls et l'alliance Paz-Lara, celle d'un « politique politicien » et d'un outsider.
La victoire de l'un ou de l'autre finaliste fera-t-elle une différence pour les gauches boliviennes ? Quel est leur chantier prioritaire pour se reconstruire ?
Une victoire de Paz-Lara pourrait permettre un meilleur dialogue avec le monde populaire que celle de Tuto Quiroga, comme le montre déjà la géographie électorale. Dans ce scénario, la renaissance de la gauche serait rendue plus difficile.
Le MAS est né de processus profonds tels que les « guerres » de l'eau et du gaz en Bolivie, mais il a également bénéficié d'un contexte régional de remise en question du néolibéralisme. Et il y a eu un leader, Evo Morales, le seul capable d'unifier la gauche et le bloc « populaire ». Aujourd'hui, ce contexte a disparu. Les gauches régionales au pouvoir manquent de dynamisme transformateur et plusieurs d'entre elles risquent de perdre les prochaines élections – au Chili, en Colombie et peut-être au Brésil.
Il est probable que le prochain gouvernement bolivien soit confronté à la nécessité d'imposer des programmes d'austérité sans disposer d'une majorité au Congrès ni de dirigeants capables de susciter une véritable adhésion populaire, ce qui pourrait alimenter de nouvelles vagues de contestation sociale.
Fabien Escalona
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections nationales. Ce n’est pas n’importe quel choix

Une fois les alliances politiques et les listes de candidats arrêtées (dans un spectacle malheureux qui nourrit l'abstentionnisme et met à nu l'implosion du système des partis sorti de la crise de 2001), la dernière ligne droite de la course électorale est engagée. Il ne s'agit pas d'un autre choix à mi-chemin.
21 août 2025| tiré de Viento.sur
Jamais depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, les élections législatives nationales n'ont eu l'importance de celles qui auront lieu cette année. Elles n'ont jamais été aussi décisives, encore plus après les défaites subies par le parti au pouvoir à la Chambre des députés, au point qu'elles sont suivies au jour le jour, soit en termes quantitatifs, par le biais de sondages d'opinion, soit qualitativement, par le biais de groupes de discussion. Peut-être parce qu'elles n'ont jamais eu lieu sous un gouvernement de la nature de celui d'aujourd'hui, qui les a proposées comme plébiscite de sa gestion et de son orientation générale.
Ceux qui, au début du gouvernement Milei, ont énoncé la théorie du « fruit mûr », qui a maintenant muté en « que cela tombe tout seul » ou « que cela ne tient pas jusqu'en octobre », ceux qui ont mis l'accent sur la politique d'ajustement (il est vrai que dans cette année et demie de gouvernement, l'ajustement a été prépondérant) ou que « les chiffres ne se ferment pas » (cause de la volatilité du taux de change, les difficultés à renouveler la dette en pesos, de plus en plus avec des durées plus courtes et des taux plus élevés) laissent de côté le fait que l'ajustement (stabilisation de l'économie en termes néoclassiques) n'est qu'un premier pas de quelque chose de beaucoup plus profond.
L'élimination et la réduction des politiques publiques, la fermeture et la fusion d'agences de l'État, l'attaque systématique des journalistes, des personnalités de la culture, des arts et des scientifiques, l'agenda progressiste, la déréglementation totale, sont autant d'indices que ce qui est en cours est une restructuration de l'économie, la politique et la culture accompagnées de la tentative de changer le régime politique dans le pays. En d'autres termes, Milei et compagnie ne sont pas seulement là pour gérer la crise, comme les gouvernements précédents, et faire des affaires, mais ils viennent pour la résoudre en termes de capital international et de groupes de pouvoir locaux. Le tout dans une dérive autoritaire du régime de la démocratie libérale et une insertion internationale totalement subordonnée à l'empire et aux grandes entreprises mondiales.
C'est en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une élection à mi-chemin, mais qu'il s'agit de la reconversion totale du pays. Si vous comprenez ce qui est en jeu, si vous comprenez que ces élections ne sont pas seulement importantes pour le gouvernement, mais aussi pour le camp populaire, alors vous comprendrez que les résultats des sondages d'octobre vont définir les mouvements des principales variables financières à court terme et peuvent ou non consolider la politique du gouvernement à long terme. Dans ce contexte, l'abstentionnisme est l'expression d'un non-conformisme passif, ou d'une dépolitisation qui ne favorise que le parti au pouvoir. La première chose à faire est de le combattre et de promouvoir le vote contre Milei, au-delà de celles et ceux d'entre nous qui voteront pour la gauche.
Ces derniers temps, plusieurs groupes de la banlieue de Buenos Aires qui discutaient de l'abstention ont changé de position et le « Votez contre Milei » ou « Ne votez pas pour Milei » se développe. De toutes ces définitions, je retiens celle du Colectivo Comuna Docente, un groupe de La Matanza (province de Buenos Aires). il montre clairement qu'ils voteront pour la gauche réellement existante, mais ils ajoutent : « Nous nous sentons jumelés dans cette lutte avec tous ceux qui choisissent d'autres listes pour vaincre Milei. »
Bien sûr, les élections dans la province de Buenos Aires du 7 septembre sont en route et, à mesure que la date approche, prennent une plus grande importance, car les résultats peuvent avoir un impact sur les élections nationales d'octobre. Elles seront totalement atypiques. Pour la première fois, elles sont séparées des lois nationales, elles sont votées en vertu d'une loi provinciale jamais utilisée jusqu'à présent.
Le vote aura lieu dans huit juridictions, dans certaines pour les sénateurs, dans d'autres pour les députés. Si la pondération de chaque juridiction venait à faire défaut, le rapport entre le nombre d'habitant-es et l'élection des sièges ne correspondrait pas à la réalité démographique actuelle. Cela soulève des questions : quelle coalition sera considérée comme gagnante ? Celle qui a obtenu le plus de votes, celle qui a remporté le plus de juridictions ou celle qui a obtenu le plus de sièges ? Tout cela dans un contexte où différents sondages montrent une égalité technique, bien que d'autres donnent le péronisme vainqueur. En revanche, qu'est-ce qui pèsera le plus sur le macro ou le micro ? En d'autres termes, la nationalisation voulue par le gouvernement ou le poids des locaux (maires) et la gestion du gouverneur Kicillof ? Selon les dernières contraintes, la possibilité d'une victoire pour le FP (Frente Patria, Péronisme) augmente, pour LLA (La Libertad Avanza, mileistas) jusqu'à trois points de différence seraient une victoire.
Au niveau national, tous les sondages donnent LLA gagnant (il faudra le vérifier). Pour le gouvernement comme pour les marchés, ce qui importe le plus, c'est le rapport de forces politiques qui ressortira des urnes. Ce ne sera pas la même chose s'il remporte une victoire confortable (40 % ou plus des suffrages exprimés) ou s'il obtient un résultat que l'on peut qualifier de neutre (entre 35 et 39 %).
Dans le premier cas, le projet Milei serait consolidé, le Cercle rouge (hommes d'affaires, médias...) renouvellerait son soutien, la droite institutionnelle se tournerait à nouveau vers un soutien sans grandes nuances. Il améliorerait sa représentation dans les chambres des députés et des sénateurs, bien qu'il ne soit en mesure d'obtenir une majorité parlementaire dans aucune d'entre elles et que les réformes structurelles en cours aient les mains libres. Les possibilités de former un bloc de pouvoir (au sens gramscien du terme) augmenteraient alors. Cela renforcerait la réélection pour 2027. Dans le cas d'une issue neutre, les difficultés à gouverner la crise et la volatilité des marchés persisteraient. Le Cercle rouge prendrait une distance relative, tandis que la droite institutionnaliste continuerait son comportement erratique envers le gouvernement et approfondirait ses projets actuels pour 2027. Au Parlement, sa représentation s'améliorerait, mais pas beaucoup plus.
Cependant, le gouvernement, déjà sur la défensive depuis les défaites subies au parlement (une nouvelle session extraordinaire des députés est désormais convoquée pour faire face aux vetos de Milei et aux exigences des gouverneurs, qui pourraient lui donner de nouveaux bouleversements) est désormais acculé par la situation financière. Ce que les marchés attendaient dans les jours qui ont précédé les élections d'octobre a été mis en avant et a ouvert un front de discussion avec les banques, jusqu'à présent privilégiées par le modèle de valorisation financière.
Suite à une mauvaise pratique de la Banque centrale (selon les commentaires, sur ordre du président Milei, contrairement à ce que pensait le ministre Caputo), le démantèlement des Lefis (lettres financières d'environ 15 billions de pesos) a obligé à augmenter fortement les taux d'intérêt et à augmenter les réserves bancaires pour retirer de l'argent du marché. Malgré cela, lors du nouvel appel d'offres pour les lettres, la Banque centrale n'a réussi à renouveler que 61 % (environ 6 milliards de pesos sont restés en circulation), ce qui l'a contrainte à relever à nouveau les taux (un peu plus de 70 %) et à accepter des réserves rémunérées (paiement d'intérêts plus élevés), tout cela pour éviter une ruée sur le dollar. Certaines estimations montrent que les intérêts versés seraient déjà supérieurs aux retraites et pensions.
Ces mesures permettront non seulement d'aggraver la baisse de la consommation et de l'activité économique, mais aussi d'augmenter le coût du fonds de roulement des entreprises, d'augmenter le coût du crédit bancaire pour les entreprises et les particuliers, et de frapper de plein fouet ceux qui refinancent leurs soldes de cartes de crédit. Tout rend prévisible une augmentation des défauts de paiement et des difficultés dans la chaîne de paiement. Tout cela aura-t-il un impact sur les décisions des électeurs ?
Le ministre Caputo a reconnu ces jours-ci que contenir le dollar pour contrôler l'inflation est transitoire pour atteindre les élections. La situation soulève des questions : vont-ils durer jusqu'en octobre ? Et s'ils arrivent, que se passera-t-il après les élections ? Enfin, quelle est la limite de la patience sociale ?
Ces élections ne sont pas des élections comme les autres.
Eduardo Lucita est membre de l'EDI, Economistas de Izquierda.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Equateur : la synergie des crises

L'Équateur traverse une période historique chaotique, marquée par une crise économique, des problèmes de sécurité et une résistance sociale organisée. Les élections de 2025 [1] ont mis en évidence toutes ces conditions, créant un panorama politiquement très polarisé entre deux camps : le correísme [référence à Rafael Correa, président de la République de l'Equateur de janvier 2007 à mai 2017] et l'anti-correísme, qui avaient déjà jeté les bases de la lutte électorale depuis huit ans, mais qui atteignaient désormais leur paroxysme.
21 juillet 2025 par ROJAS Juan Carlos Rojas
En gros, le correísme est un populisme de gauche qui, après dix ans au pouvoir, dispose d'une importante base sociale dans les provinces les plus peuplées du pays. Depuis 2017, suite au revirement de Lenín Moreno [président de mai 2017 à mai 2021, vice-président de 2007 à 2013 du gouvernement Correa] qui rompt avec le mouvement après avoir remporté la présidence, le correísme devient la force d'opposition aux partis de droite qui lui succéderont. Il a ainsi réussi à rassembler et à défendre les positions de la gauche pendant la campagne.
En juillet 2024, une cinquantaine de mouvements sociaux, dont beaucoup proches de Rafael Correa, ont organisé une rencontre pour rechercher l'unité de la gauche et du centre-gauche. Ils ont invité RC (Revolución Ciudadana, correiste), RETO (Renovación Total), Pachakutik [dont l leader Leonidas Iza fut le candidat au 1re tour de la présidentielle en 2025, avec 5,5% des suffrages], Centro Democrático, Partido Socialista (PSE), Unidad Popular (UP), Izquierda Democrática (ID) et la CONAIE (Confederacion de Naciones Indigenas de Ecuador). L'ID n'a pas participé à la réunion, tandis que l'UP (un ancien parti maoïste) et le PSE (qui présente son propre candidat de droite) y ont assisté, mais ont souligné la nécessité pour le correísme de procéder à un examen critique de ses dix années au pouvoir. La réunion s'est terminée par un appel à l'unité et la décision de former une commission chargée d'élaborer un programme commun.
Mais le leader du RC, Rafael Correa [en exil en Belgique], s'était déjà déclaré opposé à cette initiative dès le début : « Participer avec n'importe qui, simplement parce qu'il est de gauche, est une grave erreur. Il y a là des gens honnêtes, mais aussi d'autres qui sont très compromis, complices de la destruction de la patrie et qui considèrent la politique comme un business, et non comme une mission. » Et il a affiché des préférences politiques différentes : « Pourquoi ne pas lancer un appel à tous les secteurs honnêtes et patriotes, qu'ils soient de gauche ou de droite ? »
Cela provoqua une rupture entre le leadership de facto de la Révolution citoyenne, l'ancien président, et les candidats et dirigeants nationaux de ce même mouvement, qui cherchent à consolider une coalition leur permettant de remporter les élections. Si une bonne partie de la gauche refuse de soutenir le correísme, tant en raison des erreurs actuelles d'orientation que de la persécution dont elle a été victime pendant la décennie de son gouvernement, l'un des secteurs les plus importants, la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (CONAIE), conclut une alliance explicite.
Le 20 février 2025, quelques jours après le premier tour, Leonidas Iza (président de la CONAIE) et Andrés Tapia (l'un de ses plus proches conseillers) ont publié dans Jacobin un article intitulé « La gauche entre social-démocratie et néofascisme » [2]. Le titre annonce déjà la teneur de l'argumentation. L'Equateur traverse « un moment de dégradation historique » et risque de voir le néofascisme s'emparer du pouvoir. Pour la gauche et les secteurs populaires, il s'agit de « définir le cadre du débat pour les quatre prochaines années » et de parvenir à « un climat le moins conflictuel possible ». Si d'un côté se trouve le néofascisme et de l'autre la social-démocratie, la conclusion est de soutenir Luisa González au second tour.
Dans sa simplicité, cet article reprend presque tous les arguments de ceux qui ont choisi de soutenir Luisa González (candidate de la RC en 2025). Mais cette simplicité relève d'un raisonnement circulaire, dont les fondements théoriques ne sont pas clairs. En effet, Daniel Noboa (ADN) et son gouvernement sont qualifiés successivement de « néofascisme créole », de « d'affirmation d'une république bananière néocoloniale », de « droite radicalisée », de « projet oligarchique », de « populisme oligarchique »…
***
Le projet politique de la droite, représenté par Daniel Noboa, avait déjà remporté les élections extraordinaires de novembre 2023, après que Guillermo Lasso [président de la République de mai 2021 à novembre 2023] eut dissous l'Assemblée nationale par le biais de la figure juridique de la « muerte cruzada » [3] et convoqué de nouvelles élections. Après un court mandat de près de deux ans, Noboa cherchait à se faire réélire dans un contexte d'insécurité croissante et de pire crise énergétique que le pays ait connue.
Depuis fin 2023, l'étiage [niveau le plus bas de l'eau] laissait présager une crise énergétique que le gouvernement a niée avec obstination et catégoriquement pendant plusieurs mois. Au début, il ne s'est pas prononcé sur une série de coupures surprises d'eau, qu'il a ensuite tenté de dissimuler sous la forme de « coupures programmées » pour des raisons techniques. Ce silence traduisait l'espoir que le climat change, que les pluies reviennent et que le problème soit résolu.
Une grande partie de l'image favorable de Noboa est associée à son discours « dur » pour lutter contre la violence du trafic de drogue à travers une « guerre interne ». Beaucoup de gens non seulement réclament et applaudissent la présence de l'armée et de la police dans les rues, mais ont également tendance à passer sous silence, voire à justifier, les violations des droits humains commises en cours d'opération : c'est ce qui s'est passé lors du meurtre de quatre mineurs à Guayaquil (trois adolescents et un enfant afro-descendants) après avoir été appréhendés par une patrouille de la marine, conduits à la base de Taura et, selon les militaires, abandonnés aux petites heures du matin à l'extérieur de la base. Ils ont été retrouvés plus tard assassinés et leurs corps incinérés.
Mais la « violence » n'a pu être contrôlée par la militarisation, ni par le « Plan Fénix » [2024, dans un style à la Bukele du Salvador, a arrêté quelque 2000 personnes en une semaine], un plan qui reste un mystère pour les citoyens, ni par les récents « accords de sécurité » conclus avec Erik Prince, fondateur du groupe mercenaire Blackwater, connu pour sa participation à la guerre en Irak, où il a été dénoncé pour un massacre de civils en 2007.
Prince est arrivé en Équateur le 5 avril et a participé, aux côtés des ministres du Gouvernement et de l'Intérieur, à des opérations, des perquisitions et des arrestations. Il a même eu le temps de faire du prosélytisme politique à quelques jours des élections : « Le peuple équatorien », a-t-il déclaré, « peut choisir la loi et l'ordre (…) ou il peut choisir de faire de l'Équateur un pays semblable au Venezuela, un narco-État avec un trafic de drogue massif, avec toute la criminalité, le socialisme et le désespoir que cela implique », avant de quitter le pays. Ses déclarations ont été largement relayées par la presse. [Voir par exemple l'article du Courrier international du 6 avril 2025.]
Malgré les multiples crises dont son gouvernement est indéniablement responsable, Daniel Noboa (ADN, Acción Democrática Nacional) a été réélu président de la République le 13 avril après avoir largement battu Luisa González au second tour. Selon les données du CNE (Consejo Nacional Electoral), Noboa a obtenu 55,63% (5 870 618 voix), tandis que González a obtenu 44,37% (4 683 260 voix). Ce qui a peut-être le plus surpris, ce n'est pas la victoire de Noboa, qui semblait prévisible en raison des énormes erreurs commises par la RC, mais l'écart entre les deux candidats.
Le discours de Noboa a été axé sur le fait qu'avec ce gouvernement l'Équateur entre dans une nouvelle ère. Une fois de plus, nous sommes face à un gouvernement autoritaire qui prétend refonder le pays, le transformer en quelque chose d'inédit, faire les choses comme elles n'ont jamais été faites. Noboa se présente comme un héros et un sauveur ; ainsi, sa seule présence suffirait à prouver qu'une nouvelle ère a commencé.
Comme nous l'avons déjà vu lors de son précédent mandat, s'attribuer ce rôle messianique conduit à ne jamais reconnaître les erreurs commises. Toutes les erreurs sont dues au fait qu'il y a un boycott ou que l'opposition l'empêche de travailler. De plus, derrière ce type de discours se cache l'esprit conspirationniste qui l'anime et auquel il recourt constamment.
Mais le discours se heurte à la réalité. Quelques jours avant son investiture, il a envoyé à l'Assemblée nationale le projet de loi économique d'urgence, la loi organique visant à démanteler l'économie criminelle liée au conflit armé interne.
Contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son investiture, ce projet bafoue les droits les plus élémentaires de la population et, s'il est adopté, nous serons exposés à l'arbitraire total du gouvernement. Des discours apparemment démocratiques, mais une pratique répressive qui ne recule devant rien, allant jusqu'à bafouer la Constitution quand bon lui semble.
Les attaques contre la démocratie et la liberté se poursuivent avec la loi organique sur les services de renseignement, qui porte atteinte aux libertés fondamentales des Équatoriens et vise en réalité à contrôler les mouvements sociaux et à empêcher toute révolte populaire contre le gouvernement de Noboa, qui aura ainsi les mains libres pour poursuivre en toute impunité les leaders populaires.
Tous les droits à la liberté d'expression, à l'information et à la vie privée sont entre les mains du gouvernement, qui n'a de comptes à rendre à personne et n'a pas besoin d'autorisation judiciaire. De plus, le relevé des activités couvertes par cette loi disparaîtra sans mention ni trace.
Pour l'instant, le gouvernement n'a pas annoncé la tenue d'une nouvelle assemblée constituante qui réformerait la Constitution [de 2008, révisée en 2021] et l'adapterait aux besoins du néolibéralisme et du contrôle autoritaire de l'État et de la société, rompant ainsi avec l'orientation protectrice de la Constitution actuelle. Mais la voie des réformes constitutionnelles est ouverte à l'Assemblée, où nous constatons qu'il n'y a pratiquement pas d'opposition et que même le correisme finira par s'entendre avec l'ADN.
Dans la lutte contre le crime organisé, rien n'a été appris des expériences d'autres pays, comme le Mexique et la Colombie, où les mesures purement militaires ou répressives, associées à l'augmentation des peines de prison, n'ont pas résolu le problème, mais l'ont aggravé. Sans s'attaquer aux problèmes de fond, il n'y a pas de solution. Au contraire, les trois premiers mois de 2025 ont été le trimestre le plus violent depuis que des statistiques sont tenues, selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur. Entre janvier et mars de cette année, 2361 homicides violents ont été commis, soit 65% de plus qu'au premier trimestre 2024 et 39% de plus qu'au cours des trois premiers mois de 2023.
À la base de tout cela se trouvent la consommation effrénée de drogues aux États-Unis et en Europe [avec la demande qui en découle], la pauvreté qui augmente chaque jour dans notre pays, le chômage, le sous-emploi et l'informalité galopante.
***
L'économie équatorienne ne semble pas se redresser après la forte contraction enregistrée pendant la pandémie de Covid : en 2020, la variation du PIB a été de -9,2% ; le rebond de l'année suivante s'est situé à 9,4%, pour redescendre à 5,9% en 2022 et à 2,0% en 2023. En 2024, il est tombé à -2,0%. Des baisses de cette ampleur n'avaient été observées qu'avec le tremblement de terre qui a dévasté Manta et d'autres zones de la province de Manabí et de la côte équatorienne en 2016, et, comme nous venons de le voir, en 2020 avec la pandémie.
En 2024, seuls 5 des 20 secteurs de l'économie ont affiché une évolution positive, notamment l'agriculture, l'élevage et la sylviculture avec 3,1%. Les quatre autres (activités immobilières, activités financières et d'assurance, fabrication de produits alimentaires, santé et services sociaux) ont enregistré une croissance comprise entre 1,3% et 0,2%.
En revanche, en examinant les secteurs les moins performants, on peut se faire une idée de la gravité de la crise : construction (-7,8%), activités professionnelles techniques (-6,8%), industrie manufacturière non alimentaire (-5,7%), l'information et la communication (-5,1%), le raffinage du pétrole (-4,3%), l'électricité et l'eau (-4,3%), les arts et les loisirs (-3,9%), les mines et les carrières (-3,2%), les transports et le stockage (-2,5%) et l'administration publique (-2,5%).
En décembre 2024, le taux de pauvreté national s'élevait à 28% et le taux d'extrême pauvreté à 12,7%. Dans les zones urbaines, le taux de pauvreté atteignait 20,9% et le taux d'extrême pauvreté 6%. Enfin, dans les zones rurales, le taux de pauvreté atteignait 43,4% et le taux d'extrême pauvreté 27%.
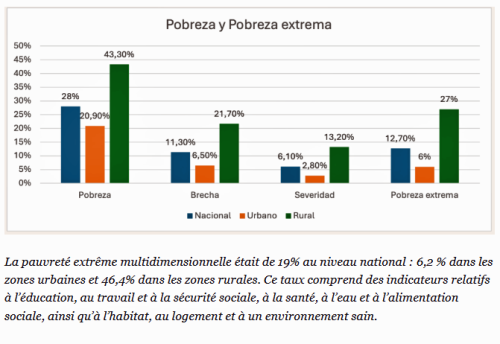
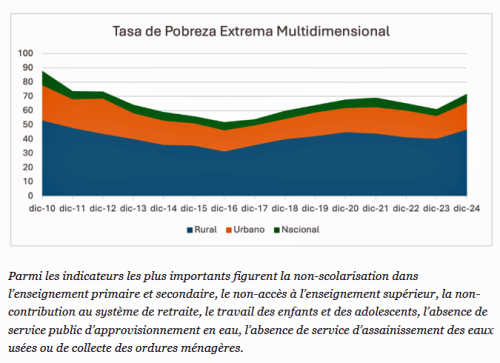
Parmi les indicateurs les plus importants figurent la non-scolarisation dans l'enseignement primaire et secondaire, le non-accès à l'enseignement supérieur, la non-contribution au système de retraite, le travail des enfants et des adolescents, l'absence de service public d'approvisionnement en eau, l'absence de service d'assainissement des eaux usées ou de collecte des ordures ménagères.
Dans ce contexte, la situation des populations rurales est confrontée à de sérieuses difficultés pour organiser la résistance. D'une part, nous avons le mouvement indigène organisé principalement au sein de la CONAIE – qui est une confédération de confédérations, avec la participation de la CONFENIAE, Confédération des nationalités indigènes de l'Amazonie, ECUARUNARI, Ecuador Runakunapak Rikcharimu, qui représente les organisations indigènes de la sierra, et un ensemble de communautés paysannes et indigènes de la côte. Il s'agit du mouvement social le mieux organisé et le plus capable de mobiliser à l'échelle nationale. Il faut tenir compte du fait que les indigènes représentent environ 8% de la population équatorienne.
D'autre part, il y a le Front unitaire des travailleurs, qui regroupe les principales organisations syndicales ; en raison des attaques systématiques dont il est victime, des conditions de travail précaires en Équateur et du faible taux de syndicalisation, il a eu des difficultés à regrouper les travailleurs et travailleuses. Malgré cela, il conserve sa capacité de mobilisation même dans les moments les plus difficiles.
Cependant, la formation d'un front unique réunissant ces mouvements et d'autres organisations, telles que les écologistes ou les défenseurs des droits humains, est depuis de nombreuses années une tâche impossible à réaliser. Ces dernières années, la direction de la CONAIE a systématiquement refusé toute unité avec le mouvement ouvrier. Lors de la dernière période électorale, elle a préféré promouvoir un front large avec des secteurs de la bourgeoisie et du correísme, laissant de côté les travailleurs et travailleuses. Cette situation a conduit les travailleurs des campagnes et des villes à ne pas avoir de représentation politique, car Pachakutik n'est majoritairement représenté que par des secteurs indigènes et paysans.
La formation d'un front unique est la tâche centrale du camp populaire, y compris dans la perspective de former des alliances et des mobilisations plus larges contre le gouvernement autoritaire. Seule cette unité garantira que les luttes populaires aient une orientation anticapitaliste claire.
Juan Carlos Rojas
P.-S.
• Article reçu le 21 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre le 22 juillet 2025
https://alencontre.org/ameriques/amelat/equateur/equateur-la-synergie-des-crises.html
• Juan Carlos Rojas est un des animateurs du Mouvement révolutionnaire des travailleurs (MRT).
Notes
[1] Elections présidentielles : 1er tour 9 février 2025, 2e tour 13 avril. Les inscrits au 1er tour étaient 13 732 194, soit une participation de 82%. Au 2e tour, la participation s'est élevée à 82,97%. En 2023, la population était estimée à 18 millions d'habitants. (Réd.)
[3] En Equateur, la « muerte cruzada » est le nom communément donné au mécanisme de destitution du président de l'Équateur et de dissolution de l'Assemblée nationale prévu par les articles 130 et 148 de la Constitution de 2008. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Où vont la société et la gauche grecques ?

En 2015, le peuple grec élisait Alexis Tsipras et son parti, SYRIZA. Cette nette élection puis le non massif exprimé lors du référendum en juillet 2015 sur les mesures de gestion de la dette du pays avaient envoyé un message populaire fort à l'Union européenne contre le néolibéralisme et l'austérité. Tassos Anastassiadis, sociologue et journaliste, membre d'Anametrisi et de la section grecque de la IVe Internationale, nous expose son point de vue sur la situation actuelle en Grèce. Entretien.
Il y a 10 ans, Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé la population grecque à rejeter par référendum le programme de gestion de la dette imposé par l'UE et le FMI. Pourtant, SYRIZA a ignoré le non exprimé par la population à plus de 61% et appliqué un oui. Pourquoi penses-tu que le gouvernement Tsipras a accepté les conditions de l'UE contre la volonté populaire ?
12 août 2025 | tiré du la gauche anticapitalise
https://www.gaucheanticapitaliste.org/ou-vont-la-societe-et-la-gauche-grecques/
Cette impressionnante volte-face a été expliquée politiquement de multiples façons, de « l'adaptation à la réalité d'un supposé TINA (There Is No Alternative) » à « l'inadéquation réformiste » de SYRIZA ou même à sa « bureaucratisation ». Toutefois, quelle que soit leur valeur interprétative, ces explications doivent s'intégrer à la question plus fondamentale de la réponse ouvrière à la crise capitaliste. En effet, les enjeux conjoncturels, « l'accord sur la dette », n'étaient que l'expression d'une crise de l'Eurozone qui aspirait à transférer violemment de la valeur créée du travail vers le capital, par le biais de la gestion de la dette dite « publique » – et, bien sûr, à un affaiblissement des relations de travail.
Ce conflit a atteint son paroxysme dans les « pays du Sud », en particulier en Grèce. Malgré les intentions relatives, il n'y a pas eu d'unification des classes ouvrières au niveau européen, à l'inverse de ce qui s'est passé avec ses classes dirigeantes, même sur le plan institutionnel. L'observation de Trotsky et de Gramsci selon laquelle l'émancipation sera plus compliquée à l'Ouest qu'à l'Est, en raison des méandres et des tentacules de l'État, est renforcée par cette dimension d'une classe dirigeante s'organisant au-delà de ses parcelles nationales. Dans ce contexte, où le chantage au grexit acquiert une matérialité immédiate, seules une clarté programmatique et une unité de classe, au-delà des frontières bourgeoises, peuvent répondre, même de manière transitoire. À ces deux niveaux, les insuffisances étaient évidentes !
Quel rôle a joué la gauche radicale à l'époque ?
Les insuffisances mentionnées sont vraies même pour la gauche radicale, d'autant plus qu'en termes de volume et de poids, elle était relativement forte. Sa principale faiblesse était sa fragmentation, bien qu'une partie, ANTARSYA, ait aspiré au début de la crise à se constituer en acteur politique anticapitaliste, et qu'une autre partie se soit jointe à l'aile gauche de SYRIZA.
Le rôle joué par ces différentes composantes diffère, même si la recherche de ruptures radicales avec la société bourgeoise semble être un bjectif commun. Pour la gauche grecque, de tradition largement stalinienne, avec un KKE (Parti communiste grec) fort et sans considération pour l'unité de classe, ses propositions politiques n'ont pas soulevé la question de l'unité des travailleur·ses dans le cadre d'un « gouvernement de gauche » existant.
Les réflexes corrects de la gauche radicale, comme lors du référendum pour le non, n'ont pas suffi à construire un discours politique et, surtout, une action dans une perspective anticapitaliste unitaire. Même sur des questions tactiques, comme l'établissement d'une commission d'audit de la dette, ses réponses ont été multiples et divergentes. Dans une certaine mesure, ses différentes composantes se sont retrouvées piégées dans la concurrence théâtrale de la politique bourgeoise et de son échec prévisible sans construction d'un rapport de forces suffisant pour répondre aux chantages des bourgeoisies européennes unifiées. Or, la défaite n'est pas celle de Tsipras, c'est celle de nous tous·tes.
Comment la situation économique et sociale grecque a été impactée par les mesures d'austérité imposées par l'UE ?
Le troisième mémorandum, signé par Tsipras avec la Troïka (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI) en 2015, n'a fait qu'approfondir la ligne néolibérale des deux précédents gouvernements. Il a même été ratifié par le gouvernement qui l'avait contesté initialement. Au-delà de la pérennisation de la dette, le démantèlement des relations de travail, les privatisations, la suppression d'une partie de la protection sociale, la réduction permanente et étendue des salaires et surtout des retraites se sont poursuivis et intensifiés. Plus important encore, la promesse de Tsipras selon laquelle il parviendrait à « adoucir » l'austérité s'est révélée être une illusion, voire un mensonge – et c'est peut-être la raison objective de son recul et de sa disparition politique après 2019.
Comment se porte la société grecque 10 ans après ?
La reprise économique semble réelle, mais c'est surtout aux niveaux des affaires et des profits, centrée sur quelques secteurs comme le tourisme ou le bâtiment. Par rapport à l'énorme contraction économique imposée par les mémorandums et la crise, ça peut sembler euphorique, même si on ne voit pas de décollage de fond ! Le prix a été payé par une société qui a subi une baisse radicale de son niveau de vie, mais aussi une décomposition des liens sociaux.
La généralisation du travail flexible et de l'individualisation a bien profité aux affaires, mais a aussi réduit considérablement le potentiel défensif et revendicatif, surtout au niveau syndical. D'ailleurs, cela a affecté plus largement l'action collective, d'autant plus qu'un arsenal institutionnel et étatique spécial contre toute forme d'action collective s'est progressivement instauré, en particulier par le gouvernement de droite de la Nouvelle Démocratie (et son aile d'extrême droite).
Quel impact ont eu les décisions de SYRIZA sur la gauche en Grèce de manière générale ? Où en est ce parti aujourd'hui et la gauche plus largement ?
Que dire de SYRIZA ? Peut-être qu'il n'existe plus ? Si l'on fait abstraction de ceux qui l'ont quitté après 2015 (ses tendances de gauche, sa jeunesse, ou même des personnalités comme Zoe Konstantopoulou ou Yanis Varoufakis), SYRIZA s'est formellement scindé en trois petits partis, ce que l'on appelle SYRIZA, la « Nouvelle gauche » – composée des figures politiques qui ont encadré le gouvernement SYRIZA – et une partie autour de Kasselakis (qui était le successeur de Tsipras à la présidence) – et il y a même des bruits de couloir d'une éventuelle nouvelle « initiative » de Tsipras lui-même.
Si nous voulons parler de « la gauche », il est plus pertinent de parler de ce qui existe. Le KKE existe à la fois de manière organisée sur les lieux de travail et au niveau local, et il a aussi une vraie base électorale. On doit aussi parler des différentes parties de l'ancienne « gauche radicale », voire des milieux anarchistes. Plus généralement, les effets de la défaite de 2015 continuent à peser et à pousser une dynamique de fragmentation, voire de scissions, tant du point de vue de la compréhension et des bilans de la défaite que du point de vue des masses, pour lesquelles l'individualisation et la désorganisation accélérées créent des frustrations compréhensibles.
Dans une telle atmosphère générale, le repli sur des schémas de pensée hérités rend plus difficile toute reconfiguration nécessaire de la gauche, d'autant plus que l'héritage stalinien et le repli national ajoutent des obstacles à l'orientation dans un monde de plus en plus chaotique. Ce n'est donc pas un hasard si la prédominance campiste empêche cette gauche de se solidariser réellement avec l'Ukraine, la Syrie, l'Iran, etc. Mais en fin de compte c'est la lutte de classes réelle qui peut nourrir une renaissance politique.
Comment tu expliques la montée du parti de Zoe Konstantopoulou, Cap sur la liberté ? S'agit-il vraiment d'une alternative à gauche ?
La montée de Cap sur la liberté dans les sondages est réelle et exprime aussi le type de relation qui lie Konstantopoulou avec son public. Bien qu'elle ait quitté SYRIZA juste après sa capitulation face à l'UE, et malgré sa radicalité contre les mémorandums, elle n'a pas formé un pôle organisé, mais est restée une personnalité « intransigeante ». Cependant, il est difficile de la situer à gauche, car elle a parfois adopté des positions nationalistes extrêmes. Il est vrai que, ces derniers temps, dans ses interventions parlementaire sur les questions de Tempi (un accident ferroviaire tragique causé par les privatisations et le néolibéralisme en 2023), et sur d'autres thèmes (comme les droits des immigré·es), elle a pris une orientation plus à gauche. C'est le problème des « caudillos » (personnalités publiques), surtout s'ils n'ont pas de liens systématiques avec des forces populaires organisées.
Il serait intéressant de comparer Konstantopoulou à Varoufakis et son parti, MERA25, qui, avec à peine moins de voix, n'a pas pu entrer au parlement lors des législatives de 2023. Bien qu'il s'agisse également d'une « personnalité » et qu'il soit moins « radical » qu'elle dans sa rupture avec SYRIZA (après tout, il est l'un des principaux coresponsables de la prétendue négociation avec la Troïka), MERA25 et sa coopération avec la LAE (Unité populaire) ont donné à son espace une orientation de gauche, voire « radicale ».
Quelle perspective pour reconstruire un front de gauche porteur d'une alternative crédible et radicale face au gouvernement de Kyriakos Mitsotakis et de la Nouvelle Démocratie ?
Dans l'arène électorale, aucune perspective de ce type n'est actuellement à l'horizon, alors que les forces politiques qui dominent la scène officielle et médiatique aujourd'hui sont la Nouvelle Démocratie et le PASOK. Le KKE et les débris de SYRIZA ne veulent pas ou ne peuvent pas former quelque chose de ce genre. Mais en dehors de l'arène électorale, plus fondamentalement, les difficultés à former un front, en particulier radical et réaliste, découlent des effets de la défaite, mais aussi des enjeux sentis par les masses.
Cependant, il y a aussi des signes positifs, en particulier dans certaines luttes, syndicales ou autres (écologiques, pour les immigré·es, etc.), où l'on constate une tendance à l'unité de classe contre un capitalisme sans limitations et très répressif. Même au sein de la gauche radicale, des tentatives sont faites pour surmonter la fragmentation. Ce fut, par exemple, le cas de la fondation d'Anametrisi (l'Épreuve) qui a été rejoint par TPT-4, la section grecque de la 4e Internationale. Bien que les mêmes impasses risquent de se reproduire, et souvent sur les mêmes questions tactiques, il y a aussi de nouvelles tentatives, au moins pour la discussion et l'action commune. À la recherche d'une boussole politique socialiste face aux méandres de la société actuelle.
Propos recueillis par Ph. K.
Article initialement publié le 18 juillet sur le site de solidaritéS
Photo : Zoe Konstantopoulou, l'une des principales figures de la gauche grecque, lors du rassemblement de protestation à Athènes à l'occasion du 2e anniversaire de l'accident ferroviaire de Tempi. Ces rassemblements qui ont eu lieu dans toutes les villes de Grèce et la grève concomittante appelée par les syndicats ont fait du 28 février 2025 le plus grand mouvemement social depuis la fin de la dictature.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Révolte en Serbie et passivité de l’Europe : la situation serbe vue par les médias internationaux

De l'admiration pour le mouvement étudiant à la critique des symboles nationalistes lors de la manifestation de Vidovdan, la couverture médiatique étrangère des événements en Serbie depuis le 1er novembre dernier a connu différentes phases. À en juger par les derniers titres, cependant, l'autocrate Aleksandar Vučić est à court de marge de manœuvre. L'Europe est exhortée à accroître la pression sur son régime à Belgrade.
Mašina est une Revue serbe - Droit du travail, luttes ouvrières, mouvements sociaux
Parfois critique, parfois indulgente selon les circonstances, telle a été globalement la tonalité de la presse internationale à l'égard du président serbe. Mais à mesure que la répression est devenue plus flagrante et que le recours à la force contre les citoyens s'est généralisé, l'image de Vučić à l'étranger s'est progressivement détériorée.
Le Financial Times note qu'après plus d'une décennie au pouvoir, les dirigeants autoritaires expérimentés se trouvent presque toujours à la croisée des chemins : soit ils renforcent la répression, consolident davantage leur cercle d'alliés oligarques et étouffent les vestiges des médias indépendants, soit ils cèdent aux demandes de réforme de l'opposition.
Le journal ajoute qu'après huit ans à la présidence – et avant cela au poste de Premier ministre – Vučić continue de gouverner selon ce qu'il appelle une forme de « démocratie contrôlée » plutôt que d'autocratie pure et simple.
Il conclut que l'Europe doit intensifier ses pressions sur Vučić afin qu'il agisse de manière responsable et organise des élections véritablement équitables, afin d'éviter un recul démocratique encore plus profond.
« S'ils ne le font pas et que la Serbie continue sur la voie de l'autoritarisme, la responsabilité n'incombera pas seulement à Vučić, mais aussi à ses soutiens occidentaux qui détournent le regard », met en garde le quotidien londonien.
La passivité de l'Europe
Le quotidien français Le Monde a écrit hier qu'après neuf mois de manifestations quasi ininterrompues, le gouvernement serbe n'est toujours pas parvenu à réprimer le mouvement étudiant anti-corruption qui secoue le pays depuis l'effondrement de la verrière de la gare rénovée de Novi Sad, deuxième ville de Serbie, en novembre 2024.
« Au pouvoir depuis 2014, d'abord comme Premier ministre puis comme président, Aleksandar Vučić n'a jamais pris au sérieux les revendications des étudiants en faveur d'un système judiciaire fonctionnel et de l'État de droit. Il a également rejeté leur demande d'élections législatives anticipées. Après avoir minimisé pendant des mois des manifestations entièrement pacifiques, M. Vučić s'est lancé mardi 12 août dans une stratégie d'intimidation inquiétante, déployant des voyous et des hooligans connus pour leurs liens avec de puissants groupes criminels organisés en Serbie afin de provoquer les manifestants », rapporte Le Monde.
Le journal français souligne également la passivité de l'Europe, notant que M. Vučić espère clairement que la violence discréditera les étudiants serbes, en particulier aux yeux de l'UE et de ses dirigeants.
Selon Deutsche Welle, le gouvernement serbe réprime les manifestations avec une extrême sévérité. La journaliste Silke Hane, du portail d'information Tagesschau, affirme que le président Vučić révèle désormais son vrai visage.
« Ces derniers jours, le président serbe Aleksandar Vučić montre son vrai visage. La semaine dernière, il a lâché des voyous masqués sur ce qui était jusqu'alors un mouvement de protestation pacifique. Alors que les partisans du parti attaquaient les manifestants à coups de matraques et de feux d'artifice, la police restait les bras croisés. Des passages à tabac sous la protection de la police », a rapporté le média allemand.
Point d'ébullition
Un autre journal anglais réputé, The Guardian, a rapporté après les manifestations de vendredi que les protestations antigouvernementales en Serbie s'étaient intensifiées, avec des témoignages faisant état de brutalités policières et d'un usage excessif de la force.
« C'était le quatrième jour de troubles dans plusieurs villes du pays, dont Belgrade, où la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants et tenté de séparer les groupes opposés. Des dizaines de personnes ont été blessées lors d'affrontements violents, tandis que des centaines d'autres ont été arrêtées au cours de la semaine dernière, alors que neuf mois de manifestations largement pacifiques contre la corruption et pour la démocratie atteignaient leur point d'ébullition », note l'article.
Décrivant l'atmosphère après les manifestations de mercredi et jeudi dans plusieurs villes serbes, l'Associated Press a écrit que pour la deuxième journée consécutive, des affrontements avaient éclaté entre les manifestants anti-gouvernementaux serbes et les partisans du gouvernement, dans ce qu'elle a qualifié d'« escalade majeure » après plus de neuf mois de manifestations persistantes contre le président « autocratique » Aleksandar Vučić.
Au cours de la même semaine, Reuters a également rapporté que des partisans du SNS à Novi Sad avaient lancé des fusées éclairantes et des pétards sur les manifestants, tandis qu'Al Jazeera a couvert l'utilisation de gaz lacrymogènes par la police à Belgrade. Bloomberg a souligné qu'après des mois de manifestations, les protestations en Serbie ont de nouveau tourné à la violence lorsque les partisans de Vučić se sont affrontés avec les manifestants à Belgrade, Novi Sad et Niš.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France - Où allons-nous ? Éditorial du 28 août 2025

Toute la presse le dit : Bayrou est en train de se faire hara-kiri, avec ou sans panache (ce qui n'a guère d'importance). Insistons, quant à nous, sur ce que cela traduit : la faiblesse insigne de l'exécutif et la grande force du mécontentement social et de son potentiel.
Tiré de Arguments pour la lutte sociale
28 août 2025
Défaire le budget antisocial qui veut baisser les salaires, supprimer les jours fériés, etc.., c'est une victoire sociale. Nous allons vers cette victoire. Encore faut-il l'assurer : l'intersyndicale devrait appeler à agir le 8 septembre, vers l'Assemblée nationale, aussi pour qu'il soit bien clair que ce soit notre victoire.
La perspective de la chute du gouvernement remet au premier plan ce qui, en fait, n'en est jamais sorti : la question du pouvoir en France. Comme le dit la lettre ouverte de l'APRÈS : « Une seule chose décisive manque et il faut la retrouver, sans préalable et sans tarder : l'union de tout le NFP, du NPA au PS, avec LFI, EELV et le PCF. » L'union défensive, contre le RN qui veut le pouvoir seul ou en coalition dans une « union des droites », contre les mauvais coups et les petits coups d'État de Macron. L'union offensive, pour la démocratie, pour un gouvernement du NFP car c'est le seul gouvernement que les plus larges masses pourront interpeller pour qu'il réponde aux besoins urgents et aux revendications.
La peur de l'affrontement social et le spectre du « 10 septembre » vont faire tomber Bayrou. L'unité du NFP dans cet affrontement qui vient aurait donc la force d'imposer son gouvernement, donc de prendre le pouvoir et, ainsi, de commencer réellement à en finir avec la V° République. Les autres scénarios envisagés – dissolution, présidentielles anticipées – visent à sauver celle-ci en faisant le jeu du RN. La division doit être battue.
Le Comité Confédéral National de la CGT a déclaré souhaiter que le 10 septembre « soit une première étape réussie, ce qui passe en particulier par la grève sur les lieux de travail. » Solidaires appelle « à se mettre en grève et à soutenir le mouvement « Bloquons tout » qui exprime la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou ». Les sections départementales et les syndicats de la FSU vont être impliqués ou vont lancer l'action dès la semaine prochaine avec la rentrée scolaire. Les sommets de FO se démarquent à présent du 10 septembre mais bien des syndicats FO s'y sont lancés. Marylise Léon, dirigeante de la CFDT, après avoir reçu Bayrou dans l'Essonne, s'est déclarée déçue et dit ne pas vouloir discuter sur les jours fériés et l'assurance chômage. C'est bien une poussée vers la grève générale qui a ébranlé Bayrou.
Le 10 et ce mois de septembre, les grèves, qui sont toujours à la fois revendicatives et réellement politiques au vrai sens du mot, le seront plus que jamais. Pour Aplutsoc, l'heure est aux comités d'actions, aux assemblées générales et aux cahiers de doléances définissant le contenu de ce que serait la politique d'un gouvernement démocratique au service de la majorité. En avant !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
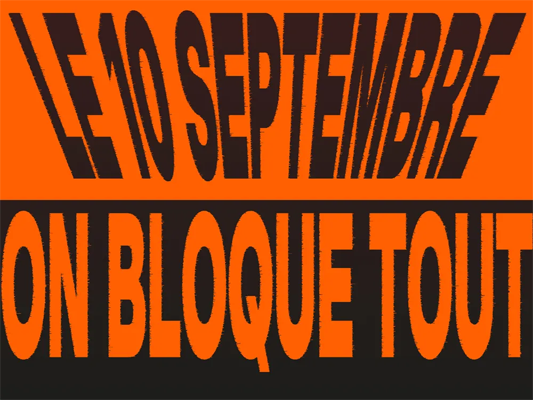
Le 10 septembre, on fait quoi ?
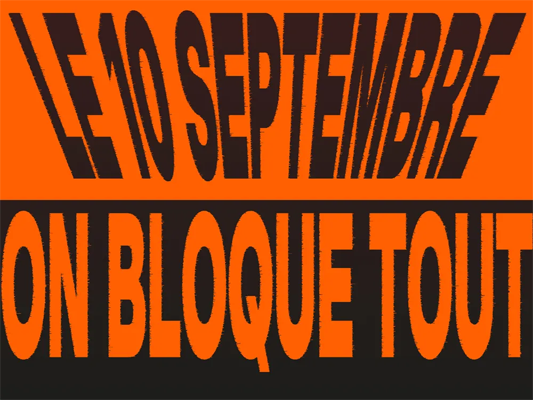
A la mi-juillet, nous appelions à réagir aux annonces brutales et ultra violentes de Bayrou pour le budget et nous recevions des centaines de mails et de messages de gens prêts à en découdre. Fin juillet, un groupe anonyme lançait une plateforme web contenant une date : le 10 septembre et nous leur emboitions le pas. Depuis, et une fois les réticences initiales dépassées (“qui sont ces gens ?” “Pourquoi cette date ?” “et avec qui ?” “est-ce que c'est pas d'extrême-droite ?”) de très nombreuses personnes ont annoncé, sur leurs réseaux sociaux, rejoindre le mouvement, tandis que le premier sondage mené sur le sujet évalue à ⅔ la proportion de Français sympathisants du 10 septembre. Et ce, alors que l'extrême droite, RN en tête, s'en est complètement désolidarisée, et que la gauche politique (EELV, PCF, FI et même, et ce n'est pas une bonne nouvelle, le PS) a affirmé son soutien au mouvement. Côté syndicats, les avis sont bien plus mitigés : c'est au niveau des fédérations, c'est-à-dire à l'échelle des branches professionnelles, que des appels ont été lancés : Sud rail ou la CGT Chimie, par exemple. Mais à la tête de la CGT, Sophie Binet n'est pas du tout emballée : “Les modes d'action sont flous et puis, du côté des initiateurs, il y a une pluralité de points de vue.” Et c'est ennuyeux ? La secrétaire générale de la CGT reprend le préjugé selon lequel le mouvement serait noyauté par l'extrême droite, alors même que toutes les figures médiatiques de ce courant l'ont critiqué mais soit : la force du 10 septembre, c'est précisément qu'il semble, pour l'instant, échapper aux formes traditionnelles de mouvement social, ces formes-réflexes que sont la grève d'une seule journée et la manifestation sage qui va d'un point A à un point B, de telle sorte que l'absence d'enthousiasme des directions syndicales, qui nous ont entraînés dans ce manège, en 2023, sans jamais admettre son inefficacité, est plutôt une bonne nouvelle. Mais si les choses ne sont pas dirigées vers les formes classiques (intersyndicale, manif, grève, merci et bonsoir) que peut-on attendre ? Est-ce que ça ne sera pas le chaos, la confusion ? Et au-delà de l'attente, que devrait-on imaginer et, localement, initier ? Plusieurs propositions stratégiques ont émergé ces dernières semaines.
24 août 2025 | tiré de Frustrations
https://frustrationmagazine.fr/10-septembre
1 – “Arrêt de la consommation” et paiement en liquide : l'impasse
Des boucles Telegram (appli de discussion instantanée au fonctionnement similaire à Whatsapp) ont été créées au niveau national, régional et départemental. Elles comptent désormais des milliers de personnes à travers tout le pays, qui débattent des modalités d'action à adopter. Sur ces boucles comme sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, l'idée d'un “arrêt de la consommation” a été lancée depuis plusieurs semaines, mais peine à rencontrer une forte adhésion : en effet, on a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place ce type d'action peut susciter. Autant les boycott peuvent avoir une utilité car ils ciblent une ou plusieurs enseignes ou marques et abîment la réputation et les résultats de quelques entreprises. Les résultats sont variables : le groupe McDonald's admet subir fortement les effets du boycott lié à son soutien à l'armée israélienne, et ce boycott est particulièrement marqué en France. Mais cela n'a pas eu, pour l'instant, d'effet sur la poursuite du génocide. En Turquie, un boycott des entreprises proches du parti au pouvoir a été lancé, un jour par semaine, depuis l'arrestation du principal opposant d'Erdogan, en mars dernier. Mais les résultats ne sont pas non plus tangibles.
On a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place un « arrêt de la consommation » et du paiement en cash peut susciter.
Un “arrêt de la consommation” ne cible aucune entreprise en particulier. Et ce n'est pas un mode d'action réaliste, vu l'ampleur de ce qui est demandé : ne plus se déplacer, ne plus s'acheter à manger… Cela ne peut fonctionner que quelques jours, pour une petite partie de la population, et ne peut donc faire peser une menace crédible sur le gouvernement et ses alliés.
Le paiement en cash et le boycott de l'usage de la carte bancaire est un mode d'action prôné par une mouvance plus à droite, plus proche des comptes “Nicolas qui paie” sur les réseaux sociaux. Il s'agit de payer en espèces soit-disant pour réduire les frais bancaires des commerçants et destabiliser le système bancaire en provoquant un afflux aux distributeurs… Or, les banques peuvent tout à fait gérer une telle situation. Mais c'est aussi une façon – assumée par certains comptes sur les réseaux sociaux – de permettre la fraude fiscale et la sous-déclaration de chiffre d'affaires, pratique bien connue des commerces qui pratiquent des “montants minimum de paiement en CB” complètement arbitraires et abusifs. L'objectif d'un mouvement comme le 10 septembre est de faire front le plus possible, dans notre diversité et le respect de nos différences : le monde des “petits commerçants”, qui ne sont pas exempts, comme les restaurateurs, de comportement abusif et maltraitant envers leurs salariés, devrait s'y conformer. Ils veulent éviter de payer des impôts et des cotisations mais ils devraient aussi faire un pas vers le reste de la population et ne pas profiter de la période pour se mettre des liasses de billets sous le matelas.
2 – La grève, ça marche, mais comment et pour qui ?
La grève, contrairement au boycott, à l'arrêt de la consommation ou au paiement en espèce, produit un rapport de force immédiat et avec des effets rapides : une grève fait perdre des millions d'euros à l'économie capitaliste et donc à ses dirigeants, qui, dans notre histoire, ont toujours lâché du lest quand ça leur arrivait. Quasi tout ce que nous avons obtenu comme richesse collective l'a été lors de grands mouvements de grève : les congés payés en 1936, des augmentations de salaires et pléthores de droits sociaux en 1968, toute la construction de la sécurité sociale en 1945-46 a été possible parce que la classe ouvrière avait la main sur la production et sur son arrêt potentiel.
Localement, la grève fonctionne et c'est loin d'être un mode d'action ringard ou obsolète, comme on l'entend parfois. Les chiffres sont là : une étude du ministère du Travail basée sur l'année 2020 nous informe que 62,8 % des entreprises ayant connu une grève dans l'année ont connu des négociations fructueuses pour les salariés, contre seulement 12,7 % des entreprises qui n'ont pas connu de conflit social. L'année suivante, en 2021, c'est encore davantage : 79,0 % des entreprises déclarant au moins une grève ont mis en place des accords favorables aux salariés, contre seulement 16,6 % des entreprises n'ayant connu ni grève ni une quelconque forme de conflit.
La stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c'est devenue une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement.
Mais qu'en est-il au niveau national ? Les exemples de succès récents manquent. Et pour cause : la stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c'est devenu une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement. Pour les directions syndicales, ces journées isolées deviennent l'équivalent des manifestations : elles permettent de générer des chiffres qui donnent une certaine légitimité à venir le soir à Matignon quémander des concessions… et ça ne marche pas, comme on l'a vu en 2023.

Alors que faire ? Il nous faut des grèves reconduites plusieurs jours dans le plus de secteurs possible, et ce, de façon coordonnée : ces dernières années, nous avons eu ce type de grève forte et longue mais non simultanée. Les ouvriers des raffineries se sont mis en grève, puis les éboueurs, localement les enseignants… Et chaque grève a pu être traitée selon un timing et des modalités différentes. D'où cet objectif, devenu un vrai slogan, de “grève générale” ou, pour être plus correct, “quasi-générale” : des secteurs se mettent en grève en même temps et deviennent, tous ensemble, un problème insurmontable pour les pouvoirs en place.
La grève quasi-générale permet de désorganiser la production de l'intérieur. Mais il se pourrait bien que, d'ici le 10 septembre, nous n'ayons pas les forces pour y parvenir : le monde syndical est éclaté entre secteurs, il s'est considérablement dépolitisé, au sens où la majorité des syndicalistes n'appartiennent plus à des confédérations qui font de l'action syndicale une arme pour changer les rapports de pouvoir au travail et, à terme, sortir du capitalisme. Seuls la CGT et Solidaires affirment être dans cette perspective mais ce ne sont pas les syndicats majoritaires. Il faut donc bien admettre que dans certains entreprises et secteurs, les syndicalistes peuvent être davantage un obstacle qu'un atout pour construire cette grève générale. Puisque nous n'arriverons pas à changer cette donne en quelques semaines, il faut que toutes celles et ceux qui travaillent dans des secteurs potentiellement bloquants pour l'économie (grande distribution, transport, agroalimentaire, énergie, services publics, mais aussi tout ce qui génère du cash pour les actionnaires) mobilisent leur énergie pour sensibiliser leur collègue à la nécessité d'une grève dure et reconduite plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à partir du 10 septembre. S'ils ont de bons syndicats sur lesquels s'appuyer, tant mieux. Sinon, ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes en attendant de mettre en place une organisation plus durable. Nous proposons un certain nombre de conseils ici.
3 – Tout bloquer : où, pourquoi et comment ?
Pour celles et ceux qui ne travaillent pas (étudiants, lycéens, retraités, chômeurs etc.), qui travaillent dans des entreprises, associations et administrations où ils estiment qu'une grève n'aurait aucun impact ou qui sont indépendants, il existe une autre façon de contribuer à la mise en place d'un rapport de force : désorganiser la production de l'extérieur.
Le 7 mars 2023, alors que le pays comptait plus d'un million de manifestants, un peu moins des records battus lors des semaines précédentes, Gabriel Attal, alors Premier ministre, déclarait, cynique : “Il y a une mobilisation, réelle, du même ordre que dans les précédentes journées de mobilisation”. Mais “la France n'a pas été complètement à l'arrêt”. C'est pourquoi le gouvernement a continué à faire voter sa réforme, avec un passage en force via l'article 49-3. Pourquoi se serait-il privé ? Ce gouvernement ne craint pas l'impopularité. Au contraire : plus un ministre commet des “réformes impopulaires”, plus son “courage” et sa “ténacité” seront loués par ceux chez qui il ira ensuite travailler : les banques, les assurances, les entreprises du CAC 40.
Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, qui travaillent dans des entreprises, associations et administrations où ils estiment qu'une grève n'aurait aucun impact ou qui sont indépendants, il existe une autre façon de contribuer à la mise en place d'un rapport de force : désorganiser la production de l'extérieur, par le blocage des flux de circulation du capitalisme.
Aussi, les manifestations ne créent aucun rapport de force avec ces gens-là. Il faut se le dire et le répéter. Ce n'est pas qu'elles ne servent absolument à rien – on s'y retrouve, on y discute, on y éprouve son nombre et sa force – mais elles ne peuvent se suffire à elle-même. Il faut accepter cette réalité sinon on se condamne à reproduire encore et toujours les mêmes échecs. Et nous n'avons plus le luxe d'en subir de nouveaux.
D'où le mot d'ordre “tout bloquer”, qui rompt avec la logique du rassemblement et de la manifestation. Concrètement, il s'agit d'entraver le fonctionnement du pays et de l'économie capitaliste pour que la production et le cours normal des choses ne fonctionne plus ou très mal, ce qui aura pour effet de forcer le gouvernement à se plier aux demandes de la population. C'est un mot d'ordre populaire. Selon un sondage Harris, qui vaut ce qu'il vaut (c'est-à-dire pas grand chose de précis mais qui permet de distinguer une tendance), 60% des sondés seraient favorables aux blocages. Mais concrètement, que faire ?
Le média Contre-attaque propose de mener des occupations durables de boulevards périphériques, en se basant sur des expériences récentes, particulièrement concluantes : “Le 12 avril à Nantes, il a suffit de trois points de blocage pour créer des dizaines de kilomètres de bouchons et mettre la ville entièrement à l'arrêt. La plupart des personnes travaillant à l'intérieur de la ville n'ont pas pu arriver à bon port. Cette action a eu plus d'impact que les manifestations réunissant des dizaines de milliers de personnes la même semaine à Nantes. Mais ces blocages sont restés temporaires, ils n'ont duré que quelques heures avant d'être levés. Insuffisant.”
La recette, ce serait des blocages de longue durée, où la population se relaie pour tenir des jours et des semaines : “En Argentine, dans les années 1990, le mouvement des piqueteros, qui étaient des précaires en lutte contre le néolibéralisme équipés de bâtons, a bloqué les autoroutes à de nombreuses reprises. En paralysant les flux, les piqueteros ont gagné en visibilité et en rapport de force en bloquant l'économie. Mais contrairement à la France, il ne s'agissait pas de blocages ponctuels : ils occupaient réellement les routes du pays, notamment près de Buenos Aires, pendant plusieurs jours voire semaines d'affilée.”
En bloquant les flux de circulation, on permet la mise en grève, de fait, de milliers de personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité. “Désolé patron, la ville était bloquée, j'ai dû rentrer chez moi.” On empêche aussi la livraison de marchandises.
En bloquant les flux de circulation, on permet la mise en grève, de fait, de milliers de personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité. “Désolé patron, la ville était bloquée, j'ai dû rentrer chez moi.” On empêche aussi la livraison de marchandises. Sur ce sujet, le blocage des autoroutes serait aussi particulièrement efficace. Car en France, le transport de marchandises se fait très majoritairement par la route (8 fois plus que par voie ferroviaire). En quelques jours, l'économie capitaliste peut se retrouver en carafe et le patronat demanderait à Macron de lâcher du lest : ce serait un très bon début.
Les blocages sont des actions qui nécessitent de la préparation et beaucoup de prudence : en 2018, une femme était décédée lors d'un blocage de rond-point. Une conductrice avait paniqué et provoqué l'accident fatal. Il est essentiel que ces blocages soient progressifs, sans provoquer des réactions de peur et en canalisant les réactions de colère des automobilistes. Le début est forcément le plus dur : interrompre un flux et imposer son barrage, sa barricade, nécessite d'être très nombreux et d'agir avec calme et méthode. Une fois le barrage installé, et pour qu'il dure dans le temps, il faut qu'il devienne un lieu de vie, où il est possible de venir une heure, deux, une journée ou une nuit, sans se sentir menacé ou jugé, en particulier pour les femmes et les minorités. Il faut que ces blocages soient filtrants et organisent le passage des véhicules de secours. Mais il s'agit ni plus ni moins de reprendre le contrôle sur ce qui circule, pourquoi et comment.
Le pouvoir tremble déjà
Pour résumer, en vue du 10, il faut définitivement changer de paradigme. En finir avec le paradigme de la “démonstration de force” ou de “l'action symbolique” : c'est-à-dire montrer qu'on n'est pas content, montrer qu'on est nombreux pendant une journée, montrer qu'on sait danser sur “HK et les Saltimbanques” ou “Freed from desire”, montrer qu'on peut être 20% de grévistes pendant 8h (et en rester là), montrer qu'on peut bloquer un péage pendant 2 heures (et partir)…Le gouvernement et ses alliés s'en foutent. Ils s'en foutaient en 2016, ils s'en foutaient en 2017, ils s'en foutaient en 2023, ils s'en foutront à nouveau… Aussi, partout où l'on se trouve, il faut adopter la tactique du rapport de force. Cela consiste à se demander, pour chaque action, si elle fait peur au pouvoir et ce qu'elle lui fait perdre. Faut-il occuper ce bâtiment-ci plutôt que celui-là ? Bloquer ce périphérique plutôt que cette autoroute ? Faire grève dans cette entreprise ou aider à faire grève dans celle-ci ? Perturber les déplacements de tel homme politique ou se concentrer sur le blocage de telle zone portuaire ou logistique ?
En attendant, on peut déjà noter que les mouvements qui sortent des canaux officiels et qui battent en brèche les modes d'action traditionnels font peur, même au stade de leur annonce. Les médias et le gouvernement, via les services de renseignement, sont incapables de définir cette mobilisation : « On travaille dessus, mais on est très loin de l'événement, on est très prudents » déclarait un policier du renseignement territorial à France Info fin juillet, tandis que les médias ne savent plus sur quel pied danser pour qualifier le mouvement. C'était rassurant de le dire d'extrême droite, mais depuis que le RN et toute la droite, sur les réseaux sociaux notamment, ont pris leurs distances, ce narratif confortable ne tient plus.
Partout où l'on se trouve, il faut adopter la tactique du rapport de force. Cela consiste à se demander, pour chaque action, si elle fait peur au pouvoir et ce qu'elle lui fait perdre. Faut-il occuper ce bâtiment-ci plutôt que celui-là ? Bloquer ce périphérique plutôt que cette autoroute ? Faire grève dans cette entreprise ou aider à faire grève dans celle-ci ? Perturber les déplacements de tel homme politique ou se concentrer sur le blocage de telle zone portuaire ou logistique ?
La gauche des partis soutient le mouvement du 10. D'un côté c'est une bonne chose, parce que cela veut dire que ces formations, leurs responsables et leurs militants ont su sortir de la défiance quasi épidermique que ce camp avait ressenti en 2018 à l'égard du mouvement des gilets jaunes. Et de l'autre c'est un risque, celui de voir ce mouvement catégorisé comme un banal, clivant et inoffensif rassemblement de gauche, avec ses drapeaux, ses chansons et son folklore. Et celui de faire fuir les gens qui, dans leur grande majorité, et qu'on le veuille ou non, sont hostiles aux partis politiques car ils voient dans leurs actions de soutien des tentatives hypocrites de briller, récupérer et se faire valoir. Comment leur donner entièrement tort ?
Il n'empêche qu'à ce jour, l'absence de méthodes traditionnelles rassurantes comme la manifestation déclarée met le pouvoir mal à l'aise. Depuis une semaine, le ton du Premier ministre putschiste François Bayrou a un petit peu changé : il parle désormais de réduire certains privilèges des politiques et a annoncé une conférence de presse le 25 août pour parler de son fameux budget et du mouvement du 10 septembre. Le pauvre homme s'inquiète d'un »climat de rapport de force ».
Dès maintenant, le mouvement du 10 septembre nous montre une chose : il est possible d'organiser une contestation sur d'autres bases que celles proposées par les professionnels de l'action revendicative et nous n'avons besoin de personne pour le faire.
Ces premiers indices de succès – évidemment très insuffisants – doivent nous pousser à conserver la même dynamique et la tournure prise par le 10 septembre. Un mouvement qui échappe à toute organisation, qui est insaisissable, dont aucun leader n'existe et qui ne peut faire l'objet d'aucune négociation au chaud à Matignon. Un mouvement sans drapeau, sans ballon, sans camion ni slogan préétabli. Mais un mouvement qui met déjà en avant des revendications fortes, de justice fiscale, de justice sociale et de démocratie directe.
Le 10 septembre peut être un semi-flop. Il ne sera sans doute pas une révolution. Mais dès maintenant, il nous montre une chose : il est possible d'organiser une contestation sur d'autres bases que celles proposées par les professionnels de l'action revendicative et nous n'avons besoin de personne pour le faire. Et cela inquiète bien plus que lorsque nous respectons la routine. Mais le 10, et surtout les jours qui suivront, nous allons peut-être pouvoir enfin tourner la page d'une décennie de défaites.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dégageons par la rue Bayrou, Macron et la 5e République !

26 août 2025 | tiré de l'Anticapitaliste | Photo : Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
https://lanticapitaliste.org/communique/degageons-par-la-rue-bayrou-macron-et-la-5e-republique
En choisissant de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale dès le 8 septembre à propos de la dette publique, Bayrou accélère la crise de régime ouverte depuis la mobilisation contre la casse des retraites.
Il montre ainsi à quel point ce pouvoir est isolé et minoritaire dans le pays, effrayé par les mobilisations qui se préparent. Car, c'est bien sous la pression du 10 septembre et du mouvement « Bloquons tout », rejoint par des franges significatives du mouvement syndical, que Bayrou a décidé de prendre le risque de la censure dès la rentrée. Cette décision montre que la peur change de camp et doit nous donner confiance pour la suite !
Bayrou dégage le 8 ! Le 10, dégageons Macron et imposons une autre politique !
Pour que la crise politique ne profite pas au RN ou à un gouvernement d'alliance avec celui-ci, le mouvement qui va démarrer le 10 septembre devra se poursuivre. Notre perspective est celle d'un grand mouvement d'ensemble, appuyé par les organisations sociales et politiques et notamment les organisations syndicales, qui ont un rôle majeur pour préparer et construire les grèves nécessaires et centrales afin de gagner. Au-delà, ce mouvement peut et doit devenir celui qui mettra un coup d'arrêt à la crise sociale, politique, démocratique et environnementale. Pour cela, reprenons la rue le 10 pour retrouver l'initiative et imposer notre gouvernement, un gouvernement au service de toutes et tous, avec un programme de rupture démocratique, écologique et sociale à même de répondre à nos besoins.
La violence du programme austéritaire voulu par Macron est sans précédent. Elle va pousser à la misère des milliers de personnes sur tout le territoire, elle va finir de détruire ce qui reste de nos services publics essentiels, l'éducation, l'hôpital. La réponse de notre camp social doit être à la hauteur de la colère qui gronde dans les villes, les villages et les quartiers du pays. Par leur manœuvre politicienne, Bayrou et Macron cherchent à désamorcer la mobilisation sociale qui s'annonce. Partout dans le pays la mobilisation s'organise. Amplifions la préparation de la journée du 10 septembre et construisons les suivantes. La gauche sociale et politique doit se retrouver dans la rue le 10 septembre et prolonger la mobilisation. Partout dans le pays, des assemblées générales des secteurs en luttes et des réunions publiques doivent s'organiser pour étendre et inscrire la mobilisation dans la durée. Ces initiatives permettraient d'alimenter la mobilisation et de reprendre nos affaires en main. Il est temps d'en finir avec la 5e République moribonde et le présidentialisme. Il est temps de construire le chemin pour un gouvernement de rupture qui émane des mobilisations des classes populaires.
Montreuil, le 26 août 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face à la tempête politique : unité et mobilisation populaire !

La décision de François Bayrou de demander à l'Assemblée nationale un vote de confiance, le 8 septembre prochain, est un coup de tonnerre dans un climat de tempête politique déjà intense.
27 août 2025
https://www.l-apres.fr/face_la_tempete_politique_unite_et_mobilisation_populaire
Bien entendu, les députés de l'APRES, comme toutes les composantes issues du NFP voteront contre la confiance.
La politique menée par François Bayrou, minoritaire à l'assemblée, minoritaire dans le pays, n'avait aucune légitimité. Ce qui est le fruit de la ruse et du déni de démocratie ne peut durer. Le projet de budget d'une brutalité antisociale sans précédent n'avait aucune possibilité d'être adopté. Les mobilisations sociales du mois de septembre, qu'elles soient d'initiative syndicale ou plus spontanées, s'annoncent importantes.
Coincé, François Bayrou cherche vainement à reprendre la main du calendrier politique pour soigner sa sortie. Acte d'orgueil ou coup tactique désespéré, son ultime liberté est de choisir la date de son départ. Il se rêve alors en héros sacrifié, prenant la pose du grand homme incompris mais courageux, vaincu par la médiocrité de ses opposants.
Croyant entrer pour longtemps dans l'Histoire, il ne tombera que dans sa poubelle et sera vite oublié.
De cette situation, il faut en saisir toutes les opportunités. D'abord, bonne nouvelle, puisque Bayrou va tomber le 8 septembre, son budget tombera aussi. Réjouissons-nous.
Ensuite, le soir de sa chute, il y aura donc vacance de pouvoir. Dès lors, que faire ?
Pour l'APRES, le choses sont claires.
Les forces du NFP doivent se déclarer prêtes à prendre leurs responsabilités pour mettre en œuvre une politique conforme aux intérêts de nos concitoyens. C'est le rôle institutionnel du Président de la République de désigner un Premier Ministre issu de nos rangs, qui sera chargé de trouver des majorités pour des mesures d'urgence sociale (abrogation de la réforme Borne, taxe Zucman, etc). Ne laissons pas le RN apparaître comme la seule alternative au macronisme. Oui, nous sommes toujours prêts à gouverner !
Cela exige que le NFP, dans sa totalité, se réunisse au plus vite et que cessent les divisions en son sein. Unité !
Autre cas de figure. Macron annonce une dissolution. Il est alors nécessaire que l'ensemble des forces qui composent le NFP se réunissent et décident, comme elles l'ont fait en 2022 et 2024, de présenter un candidat commun et unique dans toutes les circonscriptions sur la base d'un programme social, écologique et démocratique fidèle au NFP.
Cela exige aussi, que le NFP, toujours dans sa totalité, se retrouve. Unité encore !
Dernier cas de figure, le départ de Macron. Là encore, le NFP doit se réunir au plus vite pour trouver les conditions d'un candidat commun, s'assurant par l'unité qu'il sera au second tour, et en capacité ensuite de réunir une majorité pour l'emporter. Nous ne cessons de le répéter depuis des mois. Face à la menace de l'extrême droite, la division fait courir un danger qui n'est pas acceptable.
Soyons audacieux. La décision de Bayrou nous redonne la main à une condition : notre unité maintenue. Macron et les siens nous veulent divisés, opposés, irréconciliables, c'est leur seule chance de survie. Ne leur faisons pas ce cadeau.
Aussi, comme nous l'avons déjà dit, tous les chemins de victoire possible passent par l'unité maintenu du NFP, sans exclusive.
C'est le travail que l'APRES a engagé le 2 juillet avec Lucie Castets, les écologistes, le PS, Génération's et Debout dans le cadre de « Front Populaire 2027 ».
Nous répétons que cet arc de force doit continuer de s'élargir.
C'est ce que nous dirons samedi 30 août à Chateaudun.
Alexis Corbière
Publié par L'APRÈS le 27 août 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les militant.es de gauche américain es et la solidarité avec l’Ukraine

Comment l'exceptionnalisme américain s'oppose-t-il à la solidarité avec l'Ukraine parmi la gauche américaine ? Est-il possible de combiner une position antimilitariste avec un soutien à l'Ukraine ?
Ilya Budraitskis a discuté de ces questions avec Tanya Vyhovsky, sénatrice de l'État du Vermont et membre des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA).
23 août 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/08/23/les-militant-es-de-gauche-americain-es-et-la-solidarite-avec-lukraine/
— Vous êtes probablement la seule personnalité politique américaine d'origine ukrainienne à avoir des opinions progressistes, une combinaison qui semble plutôt inhabituelle dans le contexte américain. Parlez-nous un peu de votre parcours, de votre engagement militant et de votre travail au Sénat de l'État du Vermont.
— Oui, tout à fait. Beaucoup ont remarqué que c'est une combinaison de caractéristiques quelque peu inhabituelle. Je suis issue d'une famille ouvrière. Mon père est ukrainien — son père était originaire d'Ukraine et sa mère de Hongrie. Elle a quitté la Hongrie à l'âge de 15 ans, pendant la révolution de 1956. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère pendant mon enfance, car mes parents étaient très jeunes. Je pense donc que les conversations que nous avions à table étaient très différentes de celles de mes camarades américains, notamment en ce qui concerne la compréhension du fascisme et de ce que signifie vivre sous occupation. Ma grand-mère et mon père m'ont tous deux inculqué des valeurs fortes, selon lesquelles tout le monde a droit à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Je pense que ces valeurs de gauche m'ont été transmises dès mon plus jeune âge. Je ne savais pas vraiment ce qu'elles signifiaient, ni ce qu'elles représentaient. Elles faisaient simplement partie intégrante de mon éducation, de nos conversations, de la façon dont nous discutions et parlions de ce qui se passait dans le monde. Je pense également que l'un des aspects unique de mon éducation, qui diffère de celle de la plupart des Américains, est que j'ai beaucoup voyagé. J'ai pu découvrir d'autres endroits et voir qu'il existe d'autres façons de faire les choses dans le monde.
À la fin de mes études universitaires, avant l'adoption de l'Affordable Care Act, j'ai été jugée in-assurable par l'assurance maladie de mon employeur en raison de problèmes de santé dont je souffrais depuis l'enfance. C'est ce qui m'a vraiment poussée à devenir organisatrice communautaire. Je me suis impliquée ici, dans le Vermont, avec le Vermont Workers' Center et la campagne « Healthcare is a Human Right » (Les soins de santé sont un droit humain). J'ai beaucoup travaillé dans l'organisation communautaire, ce qui m'a permis d'entrer en contact avec d'autres organisateurs communautaires et m'a aidée à trouver les mots pour exprimer mes convictions et mes valeurs. J'ai également passé toute ma carrière professionnelle dans les services à la personne et j'ai vraiment commencé à prendre conscience à quel point nos systèmes faisaient défaut aux gens. Et je pense que cela m'a finalement conduit à me présenter aux élections, en tant qu'organisatrice communautaire. Je fais partie de celles qui regardent les structures et les cadres gouvernementaux ici et dans le monde entier et qui veulent qu'ils fonctionnent pour tout le monde.
Et ce ne sont généralement pas des personnes comme moi qui sont élues. Ce ne sont généralement pas des locataires issu·es de la classe ouvrière, des personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés quotidiennes que la majorité de la population. Elles et ils n'ont généralement pas leur place à la table des négociations. C'est donc un parcours assez long et sinueux qui m'a mené jusqu'ici. Mais je pense, encore une fois, que cela est dû aux valeurs fondamentales des personnes qui m'ont élevé et qui ont passé beaucoup de temps avec moi quand j'étais jeune, m'aidant à développer ma vision du monde et à déterminer ce qui est important. Cela m'a permis depuis de nouer des liens internationaux avec des militant·es de gauche, des militant·es de gauche ukrainien·nes et des personnes qui partagent vraiment ma conviction qu'un monde meilleur est possible, mais seulement si nous nous unissons et nous battons pour cela.
— Selon de récents sondages, plus de la moitié des Américain·es estiment que le soutien à l'Ukraine, y compris l'aide militaire, est nécessaire. Dans le même temps, la majorité pense que la guerre doit prendre fin par des négociations entre la Russie et l'Ukraine, avec la participation des États-Unis. Cependant, il est clair que l'attention portée à la guerre a considérablement diminué dans le contexte du génocide en cours à Gaza. Comment évalueriez-vous l'évolution de l'attitude de la société américaine à l'égard de l'Ukraine et de son droit de résister à l'agression au cours des trois dernières années ? Et quel rôle ont joué les mois de tentatives infructueuses de Trump pour négocier un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie dans ce contexte ?
— Je pense que vous avez raison de dire que ce type d'attention a diminué. Une chose que j'ai remarquée, dans pratiquement tous les domaines, c'est que les Américain·es ont une capacité d'attention très limitée. Je me souviens, c'était sans doute en mars 2022, nous avions organisé avec un petit réseau d'Ukrainiens vivant ici dans le Vermont, ainsi qu'avec notre délégation fédérale, un rassemblement et un événement à la State House. Les personnes disaient : « Oh, on devrait repousser ça jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud. » Et moi, de manière très cynique, mais malheureusement à juste titre, j'ai répondu : « Vous savez, les personnes ne s'intéresseront plus à cela quand il fera plus chaud. » En ce moment, tout le monde se concentre sur cette question parce qu'elle vient de se produire, mais il y aura une autre catastrophe qui détournera l'attention des personnes. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'attention s'est portée sur la crise suivante.
Je pense aussi que oui, nous devrions parler du génocide à Gaza. Nous devons parler de toutes ces choses. Je dirais même que, d'une certaine manière, il y a un comportement génocidaire en Ukraine dont nous ne parlons pas. Les Russes kidnappent des enfants ukrainien·nes et tentent de leur enlever leur identité ukrainienne. Les histoires de prisonnier·es politiques battu·es pour avoir parlé ukrainien sont des actes génocidaires et une tentative d'effacer une culture et une identité. Et je ne veux pas entrer dans le débat pour savoir quelles souffrances sont les pires. Je pense que nous devons être capables de parler de toutes ces choses. Si nous voulons vraiment faire preuve de solidarité mondiale pour un monde meilleur, nous devons être capables de marcher et de mâcher du chewing-gum en même temps.
Nous devons être capables de reconnaître qu'il y a un génocide à Gaza et que le peuple ukrainien mérite de défendre sa souveraineté. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps.
Ce qui s'est passé, selon moi, au cours des mois qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est que beaucoup d'Américain·es ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Ils ont vu cette réunion désastreuse où Donald Trump a attaqué le président Zelensky. Cela a surtout rappelé aux gens qu'il y a une guerre en cours et qu'il existe un partenariat horrible entre Poutine et Trump, alors que le monde s'enfonce dans le fascisme et l'autoritarisme. Je pense donc qu'à certains égards, cela a remis la question au premier plan, plus qu'elle ne l'avait été au cours des trois dernières années. Et la situation reste très complexe. Je pense qu'il y a eu un mouvement important et organisé pour maintenir la lutte palestinienne au premier plan dans l'esprit des gens, ce qui n'a pas été le cas pour la lutte ukrainienne qui n'a pas bénéficié d'une mobilisation aussi forte ni aussi unifiée.
— Depuis le début de la guerre totale en Ukraine, une partie importante de la gauche américaine a repris à son compte le discours de Poutine, selon lequel l'agression du Kremlin serait en réalité une forme d'autodéfense de la Russie contre l'impérialisme menaçant des États-Unis et de l'OTAN, tandis que l'Ukraine serait en fait une colonie occidentale dont le pouvoir serait de surcroît entre les mains de néonazis. Ce schéma explicatif primitif, fondé sur une compréhension extrêmement superficielle des situations politiques ukrainienne et russe, s'est révélé très tenace et largement insensible aux arguments factuels. À quoi pensez-vous que ces attitudes soient liées ? Et est-il possible de les changer d'une manière ou d'une autre ?
— Je pense qu'il y a probablement un mélange de facteurs qui font que cette attitude s'est installée dans les milieux de gauche. Il est extrêmement difficile de la faire évoluer. Ce que nous savons grâce à des études sociologiques, c'est que lorsque les personnes croient à quelque chose qui leur a été inculqué par la propagande, leur présenter des faits contraires tend en fait à les renforcer dans leurs convictions plutôt qu'à les faire changer d'avis. Il est beaucoup plus efficace d'établir un rapport sur le plan personnel ou moral, puis d'aider à faire le lien avec la question. C'est possible, mais probablement pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des individu·es qui vont se battre jusqu'au bout, mais je ne pense pas que tous ceux et toutes celles qui ont été endoctriné·es de cette manière soient une cause perdue. Je pense que tout dépend de la manière dont nous établissons le contact avec les personnes, dont nous les aidons à changer leur discours, à comprendre l'histoire et à comprendre ce qui se passe en les mettant en relation avec des personnes réelles qui sont sur le terrain, qui sont là, qui vivent cette situation.
Ces trois dernières années et demie ont été une expérience incroyablement douloureuse en tant que militante de gauche ukrainienne-américaine dans des milieux progressistes. Je pense que certain·es ont changé d'avis, et il y a eu des moments où, parce que cela me touche personnellement, j'ai pu entrer en contact avec des personnes et les aider à me voir comme un être humain à part entière et, grâce à cette relation, commencer à approfondir leur compréhension. Il y a eu d'autres personnes à qui j'ai simplement dû dire : « Non, je ne peux pas faire ça. » Je n'ai pas l'énergie émotionnelle ni la capacité de m'engager dans cela. Et cela varie d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, selon mes capacités.
Je pense que plus nous parlons, plus nous nous connectons, plus nous pouvons être ouverts, plus nous avons la capacité de changer cela.
Je pense également que certaines de ces croyances sont ancrées dans l'exceptionnalisme américain.
Mais d'un autre côté, il y a des gens qui pensent que tout ce que font les États-Unis est mauvais. Si les États-Unis soutiennent cela, c'est forcément mauvais, c'est forcément de l'impérialisme. Ce point de vue est trop simpliste et ne reconnaît pas que ce à quoi nous assistons réellement, c'est l'impérialisme russe.
Je ne me fais aucune illusion sur le fait que les États-Unis soutenaient l'Ukraine pour des raisons altruistes, mais je reconnais que ce que faisait la Russie était de l'impérialisme et l'occupation d'une nation souveraine. C'est toujours inacceptable. Je pense donc qu'il y a un manque de nuance et de compréhension. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est intentionnel. Je veux dire par là que, depuis des décennies, les États-Unis ont désinvesti dans l'éducation civique et dans le développement de l'esprit critique qui aide les gens à percevoir ces nuances. C'est presque une sorte de position réactionnaire. Il existe une vision exceptionnaliste américaine selon laquelle tout ce que font les États-Unis est formidable. Et puis il y a cette vision réactionnaire de gauche qui dit que non, c'est tout le contraire qui est vrai. Ces positions coexistent sans reconnaître qu'en réalité, la plupart des expériences humaines se situent dans une zone grise et non dans les extrêmes.
Les messages sur les néonazis sont particulièrement troublants. Tout est troublant, mais cela est particulièrement inquiétant car cela repose sur une incompréhension profonde de la signification même de ces mots. Oui, il y a des nazis en Ukraine, mais il y en a aussi aux États-Unis. En fait, certains sont même à la Maison Blanche. Quand je regarde le nombre de nazis d'extrême droite qui se sont présentés aux élections en Ukraine et qui ont été élus – zéro, soit dit en passant – par rapport au nombre de celles et ceux qui occupent des fonctions officielles aux États-Unis, je pense que nous, la gauche, devons faire notre introspection. Il y a des nazis partout.
— En fait, il y a beaucoup de nazis américains qui soutiennent la Russie et admirent Poutine.
— Oui, certainement. Et en fait, j'ai lu certains discours de Russes qui ont été arrêté·es et sont emprisonné·es pour avoir dénoncé Poutine. Beaucoup d'entre elles et eux citent les nazis au pouvoir en Russie. C'est donc un récit complètement faux, qui ne repose sur aucune compréhension réelle de ce qu'est l'impérialisme ou le fascisme.
Bien sûr, il y a des nazis en Ukraine, mais le peuple ukrainien ne mérite pas l'occupation et le fascisme impérialiste simplement parce que certaines personnes s'identifient à des opinions d'extrême droite. Et comme vous le soulignez, il y a beaucoup plus de personnes en position de pouvoir ici, aux États-Unis, qui soutiennent réellement la Russie. Donc, le fondement factuel de ces arguments me frustre parfois, car il faut faire des acrobaties mentales pour leur donner un sens logique.
— L'une des questions les plus difficiles liées à la guerre en Ukraine est celle de l'aide militaire. D'un côté, les villes ukrainiennes sont bombardées chaque jour de manière barbare et l'armée russe poursuit son offensive sans se soucier des victimes, rendant indispensable l'envoi de nouvelles fournitures militaires à l'Ukraine. De l'autre, les forces de gauche et progressistes se sont traditionnellement opposées à l'intervention militaire américaine dans d'autres pays et au renforcement de son complexe militaro-industriel. Est-il possible aujourd'hui de combiner une position antimilitariste avec un soutien à l'Ukraine, en particulier avec la demande adressée au gouvernement américain de poursuivre son aide militaire ?
— Je pense que c'est l'un de ces domaines où les gens refusent de vivre dans la zone grise qu'est la réalité. Je me considère comme une antimilitariste, une défenseure de la paix et une opposante à la guerre. Mais je crois aussi que laisser un agresseur impérialiste prendre le contrôle d'un pays ne mène pas à la paix. En fait, cela va entraîner une recrudescence des actions militaristes. Si la Russie impérialiste parvient à conquérir l'Ukraine et à lui retirer sa souveraineté, elle ne s'arrêtera pas là. Nous le savons déjà. Nous le savons depuis 2014, lorsque la Crimée a été annexée. À l'époque, nous nous sommes dit : « D'accord, tant que vous vous arrêtez là ». Mais bien sûr, ils ne l'ont pas fait, et ils ne le feront pas.
Je pense donc que la situation se situe dans une zone nuancée. Dire « Non, je ne veux pas la guerre » plutôt que « Bien sûr, vous pouvez entrer, attaquer et prendre la souveraineté de cette nation » ne mène pas à une paix durable. Si la Russie cessait de se battre dans cette guerre, la guerre serait terminée. Si l'Ukraine s'arrête, il n'y a plus d'Ukraine. Et ce sont deux situations différentes. Bien sûr, j'aimerais vivre dans un monde sans guerre, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Et demander à une nation souveraine de renoncer à son territoire, d'être occupée, de vivre à nouveau sous le joug oppressif d'une autre puissance occupante, ce n'est pas la paix.
Nous le voyons encore une fois, et c'est ce que nous demandons aux Palestinien·nes depuis plus de 70 ans : vivre sous occupation, être occupé·es par une autre puissance militaire. Cela n'apporte pas la paix. Cela n'a pas apporté la paix à Gaza. Cela n'apportera pas la paix en Ukraine. Cela n'apportera pas la paix mondiale dont nous avons besoin. Et donc, quand je réfléchis à la manière de plaider en faveur d'un soutien à l'Ukraine pour mettre fin à cette situation par une défaite militaire de la Russie, cela me semble être une meilleure voie vers une paix mondiale réelle. Et ensuite, bien sûr, nous devrons nous atteler à la reconstruction des relations, au travail de solidarité et à tout ce qui est nécessaire pour que le peuple russe puisse également renverser son gouvernement fasciste.
Mais je ne considère pas que laisser tomber l'Ukraine soit un mouvement vers l'antimilitarisme. Je vois cela comme un mouvement vers l'antidémocratie.
— Nous en avons déjà brièvement discuté, mais l'Ukraine et Gaza sont actuellement le théâtre de deux des conflits les plus sanglants et les plus génocidaires de notre époque, mais il est extrêmement difficile d'imaginer un mouvement unique de solidarité avec les peuples palestinien et ukrainien en Amérique aujourd'hui. Quels parallèles voyez-vous entre ces guerres ? Et comment cela peut-il être porté à l'attention de la société américaine ?
— Je vois beaucoup de parallèles, et bien sûr, les situations ne sont pas exactement les mêmes. Je pense qu'il est vraiment difficile de trouver le juste équilibre, car lorsque vous êtes attaqué·e, il est difficile de voir la douleur et l'horreur de tout ce qui se passe ailleurs. Je réfléchis à cela et je suis convaincue que cela existe. J'ai eu le plaisir de passer du temps avec des personnes de Gaza qui reconnaissent les similitudes entre ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr, aucun endroit n'est monolithique. Je ne vais pas dire que tout le monde ressent la même chose, mais j'ai eu le privilège d'avoir ces conversations avec des personnes de Gaza. Cependant, je pense qu'il est difficile de faire des comparaisons, car il existe des différences.
Bien sûr, je pense que chaque fois que nous entrons dans une sorte de « concours du traumatisme » – qui est la ou le plus mal loti –, nous sommes voués à l'échec. Je pense donc qu'il s'agit vraiment de s'asseoir avec les personnes, de vraiment entrer en contact avec elles et de les comprendre. Où se trouvent nos similitudes ? Comment pouvons-nous nous unir ? Où devons-nous mettre l'accent sur tel ou tel aspect ? Je pense que c'est la même chose qui se passe au sein de la gauche et des grands mouvements, du moins aux États-Unis, et peut-être même à l'échelle mondiale. En général, lorsque nous nous enfermons dans notre problème, nous avons tendance à dire : « Oh non, rien d'autre n'importe », au lieu de reconnaître qu'en réalité, lorsque nous nous unissons au-delà de ces problèmes et que nous luttons pour des causes qui ne nous touchent peut-être pas directement, nous sommes plus fort·es et nous avons le pouvoir de remporter de grandes victoires à l'échelon mondial.
Et donc, les parallèles que je vois – je pense que nous en avons déjà mentionné certains. Le peuple palestinien est occupé depuis 75 ans par une nation impérialiste étrangère financée par l'Occident. Et je pense que c'est l'un des domaines où cela devient difficile pour la gauche, car les États-Unis ont beaucoup fait pour financer Israël. Mais nous avons très peu fait pour financer la Russie. Cela nous ramène à la même idée : si les États-Unis le financent, c'est que c'est mauvais, et si les États-Unis ne le financent pas, c'est que c'est bon. C'est une vision trop simpliste. L'Ukraine se bat depuis des siècles pour sa liberté. L'occupation actuelle n'a pas duré aussi longtemps. La Crimée a été annexée en 2014. Cela ne fait pas 75 ans, et ce n'est pas tout le pays. Il y a des différences, mais il y a aussi des similitudes très réelles. Dans les deux cas, le peuple palestinien mérite la souveraineté. Il mérite de ne pas être occupé. Il mérite de ne pas être affamé ou bombardé. Et quand je regarde l'histoire de l'Ukraine, je vois que la Russie a fait des choses très similaires avec l'Holomodor, avec ce qui se passe actuellement, avec l'annexion de la Crimée. Donc, des parallèles ? Oui. Exactement la même chose ? Non.
Vous savez, je pense qu'une autre grande différence est qu'Israël a été en quelque sorte créé artificiellement par l'Occident — selon mon point de vue le plus cynique — afin d'ouvrir une porte sur le Moyen-Orient aux forces occidentales. Et dans ma vision la moins cynique, il a été créé comme un État ethnique. Je ne sais pas si les États ethniques peuvent être sains. Ce n'est pas le cas de la Russie. La Russie n'est pas un État ethnique et n'a pas été créée de cette manière. Donc oui, il y a clairement des différences.
Quant à la manière d'attirer l'attention de la société américaine sur ce sujet, je pense qu'il faut simplement en parler. Nous devons discuter avec les gens. Nous devons être prêt·es, lorsque nous le pouvons, à adopter une position audacieuse, voire impopulaire. C'est ce que j'ai fait, grâce à la tribune dont je dispose, en m'exprimant publiquement, en établissant ces parallèles, et j'ai été insultée pour cela. Mais cela ne me dérange pas.
Si des personnes veulent être méchantes avec moi parce que je vois ces parallèles et que je veux les nommer, j'ai le privilège de pouvoir le faire. J'ai le privilège de pouvoir dire : « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement » ou « Je ne suis pas d'accord avec ce que fait ce parti politique ». Tout le monde n'a pas ce privilège.
Donc, je pense que nous devons simplement — le message a été si fort —… nous ne pouvons pas cesser de parler de la Palestine. Nous ne pouvons pas cesser de parler de l'Ukraine.
— Ces dernières années, certain·es militant·es de gauche et syndicalistes américains ont manifesté leur solidarité avec l'Ukraine non seulement par des déclarations, mais aussi par des actions concrètes : aide humanitaire, organisation de délégations en Ukraine, aide aux réfugié·es, etc. Selon vous, comment ces campagnes de solidarité devraient-elles évoluer, non seulement avec l'Ukraine dans son ensemble, mais surtout avec la classe ouvrière ukrainienne, les syndicats et le mouvement de gauche ? Pourquoi ces campagnes sont-elles importantes pour l'Ukraine, et pourquoi sont-elles significatives pour la société américaine et les mouvements progressistes de gauche américains eux-mêmes ?
— Je pense qu'elles sont significatives pour la société mondiale, car elles nous permettent de nous connecter à la base et d'envisager un monde où les besoins de chacun·e sont satisfaits. Je ne vois aucun pays où cela se produit actuellement. Bien sûr, certains le font mieux que d'autres. Mais je pense que la gauche américaine, et probablement la gauche mondiale, est terriblement en retard dans la reconnaissance et l'acceptation du fait que, que cela nous plaise ou non, le monde est globalisé. Les forces fascistes, impérialistes et capitalistes sont globalisées. Elles considèrent l'exploitation des travailleurs et des travailleuses et de la planète comme un simple moyen de gagner plus d'argent. La seule façon de les vaincre est la solidarité et la connexion. Je ne dis pas que les gens ne devraient pas continuer à le faire, mais il ne suffira plus d'organiser notre lieu de travail en un petit syndicat.
C'est très important, et vous devriez organiser votre lieu de travail en syndicat si vous en avez la possibilité. Mais cela ne suffira pas si nous ne nous organisons pas également à l'échelle mondiale, car les oligarques et les fascistes sont connectés partout dans le monde. C'est pourquoi je pense que c'est important. Pas seulement pour la société américaine, mais pour le monde entier et pour l'avenir dans lequel nous vivrons. Quant à savoir pourquoi c'est particulièrement important en Ukraine, nous l'avons vu maintes et maintes fois, et c'est déjà le cas en Ukraine : les capitalistes vautours utilisent la guerre pour acheter des terres et des ressources et, au final, occuper un pays qui ne pourra jamais se relever. L'austérité s'aggrave de plus en plus avec le temps. Je pense donc qu'il est particulièrement important d'être en contact avec la gauche ukrainienne, la classe ouvrière, les syndicats, afin de réfléchir à un avenir de gauche pour l'Ukraine après cette guerre. Il ne s'agit pas de revenir à ce qui existait auparavant, car c'est impossible, ni d'aller vers ce que tant de pays connaissent après une guerre, qui est en réalité pire. Il s'agit plutôt de profiter de cette horrible situation pour reconstruire l'Ukraine et la rendre meilleure, une Ukraine fondée sur les besoins de la majorité des Ukrainien·nes, sur les droits des travailleurs et des travailleuses, la lutte contre la corruption et sur un avenir auquel tous et toutes les Ukrainiennes peuvent croire. Je pense qu'il y a de l'espoir dans cela, et j'ai trouvé beaucoup d'espoir en entrant en contact avec les gens qui sont sur le terrain, qui essaient de faire leur travail, qui reconnaissent que c'est maintenant qu'il faut agir, et non pas après la guerre. La solidarité, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher ce qui se passe, et c'est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment crucial pour la gauche américaine, et c'est en partie pour cela que je trouve la situation si frustrante, car nous avons une alternative ici.
Nous avons une alternative à ce que nous avons vu maintes et maintes fois : les États-Unis interviennent, prennent les ressources qu'ils veulent et repartent. Nous avons une alternative : intervenir, en tant que progressistes américain·es, pour construire une solidarité et quelque chose de différent entre l'Ukraine et les États-Unis, et dire : « Non, ça suffit. »
— Merci. J'aimerais ajouter une question sur la situation politique américaine. Nous traversons actuellement une période très dangereuse, avec les attaques de l'administration Trump contre les droits sociaux et politiques fondamentaux. Nous assistons également à un déclin continu du soutien au Parti démocrate, qui n'a pas de stratégie claire pour résister à l'administration actuelle. Vous avez bien sûr votre propre vision et votre propre perspective, d'autant plus que vous avez reçu le soutien des Socialistes démocrates d'Amérique. Vous êtes également en lien avec le mouvement de gauche au sens large. Quelle est votre vision de la situation actuelle et, plus précisément, quelle devrait être selon vous la stratégie de résistance ?
— Tout à fait, la situation actuelle, comme vous l'avez parfaitement décrit, est dangereuse. Elle penche totalement vers l'autoritarisme et le fascisme. Elle crée le chaos et la peur, ce qui est son but. De plus, elle crée le désespoir, ce qui est également son but. Ce sont là des symptômes, pas le véritable problème, qui réside dans les conditions matérielles de la population. L'histoire nous l'a appris. Nous savons que lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, c'était parce que les Allemand·es de base étaient en difficulté, ne pouvaient pas se nourrir, ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les gens désespérés sont plus faciles à endoctriner et à instrumentaliser. Ce que je vois aux États-Unis, c'est que Donald Trump et celles et ceux qui le suivent disent : « Oui, nous voyons votre désespoir. Nous entendons parler de vos difficultés. » Ce qui s'est passé est la faute des Démocrates. Je ne peux pas vraiment les qualifier de parti de gauche, car dans la plupart des pays du monde, ils seraient au mieux un parti de centre-droit. Ils n'ont pas réussi à proposer une alternative porteuse d'espoir. En fait, ils n'ont même pas reconnu le problème. Mais je dois montrer toute la situation. La droite dit : « Oui, je sais que les choses vont mal, et c'est la faute des immigrant·es », tandis que les Démocrates répondent : « Non, ce n'est pas vraiment comme ça. Écoutez ce que disent les économistes. L'économie va très bien ! Regardez la bourse ! » Ils ne reconnaissent même pas qu'il y a un vrai problème pour les personnes.
Et quand je pense à la voie à suivre, je crois que la gauche est la seule voie possible. C'est le mouvement de gauche qui répond aux besoins des gens, qui crée des réseaux d'entraide et qui garantit que tout le monde puisse mettre du pain sur la table — c'est la seule façon de vaincre le fascisme. Et cela va nécessiter toute une organisation pour combler le vide, car il n'existe pas de mécanisme politique de gauche unifié dans ce pays. C'est bien sûr une conséquence du système bipartite. Il existe de nombreuses lois et règles qui rendent extrêmement difficile la construction d'un tel mouvement dans le temps limité dont nous disposons. La politique électorale seule ne nous sauvera pas. Le système est structuré de manière à maintenir le pouvoir entre les mains de ceux qui le détiennent actuellement. Et je pense qu'il faut également beaucoup de travail d'organisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Je suis la seule socialiste au Sénat, et j'ai fait adopter des mesures socialistes, non pas parce que j'ai convaincu 29 autres personnes d'être socialistes, mais parce que nous avons su les présenter de manière pragmatique et mobiliser suffisamment de pression extérieure pour rendre l'inaction impossible.
Nous savons que cela a toujours été vrai à travers l'histoire. Je veux dire, le président qui a signé la loi sur les droits civiques était un ségrégationniste. Il n'a pas soudainement cessé d'être ségrégationniste. Il y a eu un tel tollé public qu'il lui est devenu politiquement impossible de ne pas la signer. Je pense que nous devons travailler avec un pied dans ces structures, mais avec beaucoup de pieds à l'extérieur pour faire revenir le discours politique vers la gauche. Nous savons que c'est ce que veulent les gens. Les résultats des élections nous ont montré que c'est ce que veulent les gens. Les victoires des initiatives populaires nous montrent ce que veulent les gens. Et nous devons commencer à travailler de manière plus unifiée pour rendre politiquement impossible de ne pas aller dans cette direction. Parce que, franchement, ce que Donald Trump vend, c'est du faux populisme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une véritable politique populaire de gauche qui fonctionne pour les gens ordinaires, sans les fondements nationalistes et fascistes vers lesquels nous nous dirigeons actuellement.
Je veux dire, si j'ai une image de mon monde idéal, c'est un monde socialiste dans lequel tout le monde a ses besoins fondamentaux satisfaits, dans lequel le gouvernement fait ce que je crois être son travail, c'est-à-dire veiller à ce que les personnes ne se nuisent pas les uns aux autres.
Parce que nous vivons dans un monde où les entreprises nuisent aux persones et où aucun gouvernement dans ce monde n'assume pleinement ses responsabilités, je pense donc qu'il est temps que nous nous unissions pour les faire respecter.
https://www.posle.media/article/the-american-leftists-and-solidarity-with-ukraine
Entretien publié dans POSLE. Traduction Deepl revue ML, révisée pour le blog
https://www.reseau-bastille.org/2025/08/14/les-militant-e-s-de-gauche-americain-e-s-et-la-solidarite-avec-lukraine-entretien-avec-tanya-vyhovsky-senatrice-du-vermont-et-membre-des-socialistes-democrates-damerique/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face à l’impérialisme de Poutine, l’aveuglement du « campisme »

Ce 24 août, alors que son peuple résiste depuis 2014 à la guerre imposée par l'impérialisme grand-russe de Poutine, l'Ukraine célèbre sa déclaration d'indépendance de 1991. Toutes les gauches devraient soutenir sa cause car elle est celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
24 août 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières | Photo : Poupées russes représentant le président russe Poutine et le président américain Trump à Moscou, en Russie, en août 2025. © Photo Mila Stepanyan / Zuma-Rea
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76013
Il n'est pires aveugles que celles et ceux qui ne veulent pas voir – par idéologie, suivisme ou conformisme. L'hydre impérialiste à deux têtes que forme désormais le duo oligarchique Trump-Poutine parle clair, ne cachant rien de ses intentions. Il suffit de les écouter, ou d'écouter leurs porte-parole.
Une guerre sans fin : samedi 16 août, au lendemain de leur sommet en Alaska, le premier cercle du président russe mettait les points sur les i. Premier adjoint d'Anton Vaïno, le chef de l'administration présidentielle russe, Sergueï Kirienko, de retour d'Anchorage, est intervenu à un « Festival des nouveaux médias » réunissant les relais de communication du régime. Évoquant une éventuelle suspension de « la guerre chaude » sur le front ukrainien, il y a martelé que « la guerre informationnelle ne se terminera jamais ».
Une « guerre » sur le front intérieur autant qu'extérieur : pas plus qu'il n'y en a pour le droit de manifestation, de réunion ou de protestation, d'opposition ou de dissidence, il n'y aucun espace pour un journalisme libre dans la Russie de Poutine. Une guerre, donc, contre la liberté des peuples de choisir leur destin, de rompre leurs chaînes, d'échapper à leurs oppresseurs. Une guerre contre la liberté du peuple russe en même temps que contre celle du peuple ukrainien.
Car c'est celle d'une « dictature fasciste », comme Mediapart l'a tôt documenté (lire cet article de François Bonnet) et comme nous l'a récemment rappelé le dissident historique Oleg Orlov, cofondateur de Memorial – organisation aujourd'hui interditequi s'efforçait de documenter l'immensité des crimes staliniens. Emprisonné pour l'avoir affirmé dès 2022 dans un texte que nous avons publié en français, miraculeusement libéré deux ans après lors d'un échange de prisonniers, il s'est immédiatement rendu en Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre commis par l'armée russe : « Sur place, tous les jours – tous les jours ! –, nous avons découvert des crimes abominables et massifs que personne jusqu'alors n'avait répertoriés. On ne sera jamais assez pour documenter l'immensité des crimes commis par la Russie. »
Commencée il y a onze ans, en 2014, la guerre de Poutine contre l'Ukraine, son droit à l'autodétermination et le libre arbitre de son peuple, n'est pas circonstancielle mais existentielle. Elle est théorisée par l'ancien agent du KGB et son clan oligarchique, qui s'est constitué dans la violente prédation mafieuse des décombres de l'URSS, comme un projet messianique de reconstitution d'une Grande Russie qui serait le nouvel empire de la tradition, rendu à ses racines identitaires chrétiennes et débarrassé de ses supposées décadences démocratiques. Mais cet habillage idéologique sert à masquer combien la guerre est le dernier moyen dont dispose le système criminel construit avec et autour de Poutine pour sécuriser son avenir (lire cet autre article de François Bonnet). Et c'est pourquoi Poutine et les siens n'ont aucunement l'intention d'y renoncer.
Théoricien géopolitique du poutinisme, Sergueï Karaganov l'a laissé entrevoir dans un récent entretien au Grand Continent : « La Russie est un pays de guerriers, elle n'a jamais su vivre hors de l'état de guerre. Faire la guerre est dans les gènes des Russes. C'est pourquoi, dès que la menace est devenue palpable, nous nous sommes unis, nous avons surmonté nos divisions et rassemblé nos forces. » Un entretien où, tout en adoubant Donald Trump, il désigne leur adversaire commun : « Trump est un nationaliste américain qui présente certaines caractéristiques du messianisme traditionnel aux États-Unis. S'il peut parfois surprendre c'est qu'il a été vacciné contre la vermine mondialiste-libérale des trois ou quatre dernières décennies. »
L'internationalisme a pour seule boussole le sort des peuples quand le campisme les prend en otage dans le jeu des puissances.
Impérialiste et fasciste, cette Russie poutinienne est le laboratoire des renaissances d'extrême droite qui, aujourd'hui, entendent prendre leur revanche contre le camp de l'égalité des droits et de l'émancipation des peuples. Prolongeant la très longue durée du tsarisme – cette « prison des peuples » que dénonçait Lénine – et du stalinisme – cette « révolution trahie » que combattit Trotsky –, elle est l'adversaire résolu des idéaux démocratiques et sociaux. Mue par l'avidité capitaliste et le suprémacisme identitaire, elle parle le même langage que Trump, Nétanyahou, Orbán et tous leurs semblables, unis dans leur rejet de l'universalité des droits fondamentaux et leur défense d'un (dés)ordre mondial fondé sur la loi du plus fort.
Dès lors, le soutien des gauches au peuple ukrainien contre l'impérialisme russe devrait être une évidence, au même titre que le soutien au peuple palestinien contre le colonialisme israélien. Les principes ne se divisent pas : être résolument du côté des peuples, c'est refuser tout double standard. De même que les puissances européennes ont ruiné, par leur soutien aveugle à Nétanyahou, le droit international qu'elles invoquent contre Poutine (lire notre mise en garde), toute solidarité avec Gaza qui fait l'impasse sur l'agression russe en Ukraine, la ménage ou s'en accommode, ruine l'universalité qu'elle revendique. C'est toute la différence entre l'internationalisme, qui a pour seule boussole le sort des peuples, quels qu'ils soient, et le campisme, qui accepte qu'ils soient pris en otage dans le jeu des puissances étatiques.
La cause de l'émancipation n'a pas de frontières, et c'est pourquoi L'Internationale fut son premier chant de ralliement. Le stalinisme, ses héritiers et ses succédanés, l'ont dévoyée en alignement sur des États, leurs intérêts et leurs dirigeants, alors même qu'ils opprimaient leurs propres peuples. Cet enrégimentement dans un supposé « camp du socialisme » – d'où est né le mot de « campisme » – a permis nombre de tragédies où ce prétendu socialisme s'est durablement discrédité. Construit en miroir de l'atlantisme, alignement sur l'impérialisme états-unien, ce campisme a survécu à la lente agonie des États dits socialistes, ébranlés par leurs peuples dès la Révolution hongroise de 1956, et persisté au-delà de la fin de l'Union soviétique et de son éclatement, en 1991.
« Seuls les peuples sauvent les peuples »
Ce fut le cas, entre autres, de l'approbation par le régime castriste cubain de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968 ou du soutien du leader communiste français Georges Marchais à l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979. Le même campisme a accompagné l'indifférence de forces se disant progressistes au sort du peuple bosniaque lors des guerres de Yougoslavie, dans les années 1990, ou à celui des peuples arabes, en Syrie notamment, lors des soulèvements populaires déclenchés depuis la Tunisie en 2011.
Du massacre génocidaire de Srebrenica aux crimes incommensurables de la dictature des Assad, nul ne saurait ignorer, aujourd'hui, les désastres qui ont accompagné ces alignements aveugles, dont les principes politiques se révélaient à géométrie variable. Si elles ne veulent pas affronter le même discrédit, les gauches qui se mobilisent pour la Palestine mais qui oublient l'Ukraine feraient bien de se ressaisir. De fait, on ne peut que rester pantois, entre étonnement et sidération, devant l'entêtement du chef de la principale force de gauche française à s'inscrire dans ce campisme désastreux, alors même qu'il a été formé idéologiquement dans un héritage trotskyste qui devrait l'en prémunir. De la Syrie à l'Ukraine, en passant par la Russie et la Chine, sur les questions internationales, Jean-Luc Mélenchon en effet n'a cessé, ces dernières années, de déserter une solidarité internationaliste sans frontières pour ne raisonner qu'en termes de puissances étatiques dont une seule, les USA, serait dangereuse, et ainsi oublier les peuples, leurs aspirations et leurs révoltes.
Au point d'affirmer des énormités, de multiplier les erreurs factuelles et de manifester de grandes ignorances (lire par exemple ici, là et làsur Mediapart). Jusqu'à paradoxalement mépriser des surgissements populaires, tel celui du peuple ukrainien depuis les aspirations démocratiques de la Révolution orange en 2004, alors même qu'il les appelle de ses vœux en France (lire notre entretien avec Anna Colin Lebedev). Tout récemment encore, un de ses anciens camarades de jeunesse, l'historien Vincent Présumey, figure du syndicalisme engagé aussi bien pour Gaza que pour Kyiv, a dû vertement corriger sa copie à propos du sommet Trump-Poutine, où le leader insoumis se montrait soumis au récit poutinien et à ses mensonges. En pure perte hélas, puisque Jean-Luc Mélenchon a réitéré cet alignement incompréhensible aux « Amfis » de son mouvement, La France Insoumise (lire le reportage de Mathieu Dejean).
Contre le campisme, prisonnier du jeu des États et indifférent au sort des peuples, l'internationalisme choisit résolument la cause de ces derniers (lire ce texte de Pierre Dardot et Christian Laval sur la faillite d'un « anti-impérialisme à sens unique »). Dans ce nouveau monde désorienté où un capitalisme du désastre enfante une nouvelle Sainte-Alliance oligarchique, c'est la seule boussole qui permet de se repérer pour maintenir le cap des idéaux émancipateurs, aussi bien contre Donald Trump que contre Vladimir Poutine. Car, tel Janus, l'Empire a désormais un double visage et tout anti-impérialisme conséquent suppose d'en affronter indistinctement les deux incarnations.
Depuis peu, cette boussole a son « manifeste internationaliste », fruit de discussions entre exilés des cinq continents, réunis autour d'un lieu né des défaites surmontées, La Cantine syrienne, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Sa lecture est vivement recommandée à toutes celles et tous ceux qui refusent toute indifférence coupable, notamment face au crime de génocide en cours à Gaza. Paru en mars dernier chez Zones/La Découverte, il enterre avec énergie ce campisme nourri par « ces approches géopolitiques et surplombantes, tout droit sorties d'un mauvais remake de la guerre froide, le socialisme en moins ».
« Dans cette perspective, écrit ce collectif, le monde se résume à un affrontement de blocs où les États et leurs coalitions sont les seuls agents capables de faire bouger les lignes. […] Ce type de logique binaire a amené une partie de la “gauche anti-impérialiste” à soutenir implicitement ou explicitement les régimes iranien, russe et syrien considérés comme des “remparts” contre l'impérialisme sioniste-colonialiste-occidental-capitaliste. […] À leurs yeux, la résistance populaire en Ukraine tout comme les féministes en Iran ou les révolutionnaires en Syrie sont soit des “agents de l'impérialisme”, soit des personnes incapables de comprendre leur propre situation. […] Considérer les pays occidentaux comme les seules puissances impérialistes, et les États-Unis comme LA source de tous les maux, biais caractéristique de ces positions “campistes”, les amène à relativiser les crimes des régimes syrien, russe, chinois ou iranien. »
« Seuls les peuples sauvent les peuples », conclut ce manifeste internationaliste (en accès libre dans quatre langues surle site de Les Peuples Veulent), en espérant la construction, partout sur la planète, d'une force « capable de s'opposer aux monstres froids qui dévorent nos présents et nos avenirs ». Une nouvelle Internationale en somme, par le bas, depuis les peuples eux-mêmes, leurs résistances et leurs espérances.
Edwy Plenel
P.-S.
• MEDIAPART. 24 août 2025 à 11h44 :
https://www.mediapart.fr/journal/international/240825/face-l-imperialisme-de-poutine-l-aveuglement-du-campisme
Les articles d'Edwy Plenel sur Mediapart :
https://www.mediapart.fr/biographie/edwy-plenel
ESSF invite lectrices et lecteurs à s'abonner à Mediapart.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Russie : la gauche et l’opposition anti-Poutine

La gauche anticapitaliste russe n'est pas parvenue à s'organiser en tant que force politique indépendante avant le début de l'« opération militaire spéciale » [1]. Pendant des années, elle a été déchirée entre deux géants : le Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR) d'un côté et l'opposition libérale de l'autre. Le PCFR détenait une « autorisation » pour participer à la vie politique électorale, il pouvait fournir les ressources organisationnelles nécessaires et offrait au moins une certaine protection contre la répression arbitraire. Mais cette coopération avait un prix : la direction du parti était profondément imbriquée dans le régime au pouvoir. Elle voyait la garantie de préserver sa position non pas dans la mobilisation de larges masses sociales, mais dans des accords secrets avec le Kremlin ou les autorités régionales. En conséquence, les dirigeants du parti ont bloqué les campagnes de protestation trop efficaces de leurs alliés de gauche et se sont montrés réticents à les laisser participer aux élections.
19 août 2025 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/europe/russie/russie-la-gauche-et-lopposition-anti-poutine.html
La coopération avec l'opposition libérale avait d'autres implications. Les libéraux pouvaient parfois se montrer intransigeants dans leur opposition à Poutine, mais leur programme était étroitement lié aux privilèges d'une élite restreinte et aliénaient la majorité pauvre de la population. Ni leurs ressources financières ni leur puissant réseau de médias d'opposition ne permettaient à l'opposition libérale de gagner un soutien au-delà de la classe moyenne. La seule tentative pour sortir de ce moule a été le « virage à gauche » d'Alexei Navalny [2] en 2018-2021, lorsqu'il a commencé à aborder les questions de justice sociale et d'inégalité. Cela a eu un effet : la popularité de Navalny a augmenté. Mais la lutte pour obtenir un large soutien s'est heurtée à des contradictions. En 2018, les autorités ont mené une réforme des retraites extrêmement impopulaire, relevant l'âge de la retraite. Le mouvement de Navalny a tenté de mener les protestations massives contre cette mesure, même si son propre programme stipulait explicitement la nécessité de relever l'âge de la retraite.
Au début de la guerre, l'opposition extraparlementaire bénéficiait du soutien de 15 à 20% des citoyens et citoyennes. La grande majorité dépolitisée du pays restait méfiante, principalement par crainte d'un « nouveau 1990 », c'est-à-dire d'une nouvelle vague de réformes néolibérales qui avaient entraîné des inégalités catastrophiques. C'est précisément cette crainte qui a permis au régime de conserver la confiance des Russes et même un certain soutien populaire.
La gauche qui soutenait Navalny est également devenue otage de cette crainte. Certains ont réussi : avec le soutien des libéraux et grâce à la mobilisation de l'électorat de la classe moyenne, certains militants de gauche ont remporté des sièges dans les parlements locaux. Mais ce faisant, ils ont souvent perdu à la fois leur identité politique et la possibilité de mobiliser le soutien des classes populaires.
Au début de la guerre
Au début de la guerre, de nombreux responsable de gauche dépendants du PCFR l'ont soutenue ou sont restés silencieux et passifs. Les députés qui ont ouvertement condamné le début des opérations militaires en Ukraine ont été expulsés du parti et soumis à la répression. L'opposition extraparlementaire a réussi à organiser des rassemblements de protestation de masse dans les grandes villes. Les militants de gauche opposants à la guerre, notamment la coalition Socialistes contre la guerre (voir le site Green Left, « Socialist Against the War Coalition », 3 mars 2022), ont activement participé à ces manifestations, mais la mobilisation s'est appuyée presque exclusivement sur la base sociale traditionnelle de l'opposition : la jeunesse urbaine et la classe moyenne des grandes villes.
Les manifestations ont été brutalement réprimées. La vague de répression a déclenché une émigration massive des militants de l'opposition : jusqu'à un million de personnes ont quitté le pays en 2022. Le noyau dur du mouvement de protestation anti-Poutine a été écrasé. Au-delà de la classe moyenne, l'opposition avait peu de partisans, et ceux qu'elle avait étaient totalement désorganisés. Cette base sociale étroite a joué un tour cruel aux opposants à Poutine.
Nouveau mécontentement
En détruisant l'ancien rapport de forces, la guerre a créé de nouvelles contradictions et de nouveaux conflits sociaux. La conscription forcée a provoqué une explosion de colère et a conduit le régime au bord de la crise. Même les sondeurs officiels ont enregistré une baisse de la cote de popularité de Poutine. Au cours du seul premier mois de la mobilisation militaire, plus de 20 incidents armés ont eu lieu dans tout le pays. Les soldats ont frappé des officiers, arrêté des trains qui les transportaient vers le front et déserté leurs unités de manière organisée. Cela a contraint les autorités à abandonner la conscription obligatoire au profit d'un système de recrutement de mercenaires, qui ne permet pas d'augmenter rapidement les effectifs de l'armée ni la production militaire. Le régime a été contraint d'accepter ce « compromis », car une nouvelle vague de mobilisation massive pourrait déclencher une crise sociopolitique profonde.
Même aujourd'hui, les difficultés de la vie militaire se font cruellement sentir dans les tranchées. Légalement, il est impossible de résilier un contrat militaire avant la fin de la guerre, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de déserteurs. Selon des chercheurs de l'OSINT (Open-source intelligence), à la fin de 2024, pas moins de 50 000 soldats avaient déserté leurs unités. Plus de 20 000 individus ont fait l'objet de poursuites pénales pour ces infractions militaires.
La politique de keynésianisme militaire, associée à une pénurie de main-d'œuvre, a apporté des avantages tangibles à la classe ouvrière russe. Les salaires dans l'industrie ont considérablement augmenté, devenant un facteur important de maintien de la stabilité sociale. Mais aujourd'hui, la croissance des salaires a pris fin et l'inflation élevée érode progressivement les gains des travailleurs et travailleuses, une évolution qui menace également de déclencher une nouvelle vague de conflits sociaux.
Dans tout le pays, le désir de paix et de retour à la vie civile grandit. Des sondages indiquent qu'en mai 2025, 61% des citoyens étaient favorables à un début rapide de négociations de paix, tandis que seulement 30% soutenaient la poursuite des hostilités (et ce, malgré le fait que de nombreux citoyens opposés à la guerre ne participent pas à ces sondages en raison de la censure et de la répression, tandis que beaucoup d'autres donnent des réponses « socialement acceptables »). Le fait que le régime soit inapte à conclure la paix, même dans des conditions internationales favorables, renforce le mécontentement face à la prolongation des hostilités. Cependant, l'ancienne opposition est totalement incapable de mobiliser ce mécontentement croissant.
Emigration anti-guerre en faveur de la « victoire jusqu'au bout »
Dans le contexte de la guerre, presque tous les dirigeants de l'opposition ont pris le parti des autorités ukrainiennes et de leurs alliés occidentaux, soutenant le programme qu'ils ont formulé : retour aux frontières de 1991, démantèlement du régime politique actuel en Russie par les vainqueurs et leurs alliés, et paiement de réparations par tous les citoyens russes. « Si vous êtes actionnaire d'une société par actions, c'est-à-dire citoyen d'un pays, même si vous n'êtes pas d'accord avec la direction, vous portez toujours votre part de responsabilité », a déclaré, par exemple, Vladimir Milov [3], un proche collaborateur de Navalny et auteur de son programme économique « Nouvelle Russie ».
Plus important encore, la mise en œuvre de ce programme nécessite une escalade de la guerre par un soutien militaire inconditionnel à l'armée ukrainienne, pouvant aller jusqu'à la défaite militaire de la Russie. « Si vous voulez aider la Russie démocratique, sauvez l'Ukraine de Poutine. C'est exactement en votre pouvoir », a déclaré l'ancien prisonnier politique Ilya Yashin [4] devant le Parlement européen le 5 juin 2025.
Pour les intellectuels libéraux proches de la Fondation anti-corruption-FBK [5] et de Yulia Navalnaya [6], les soldats russes ne sont qu'une menace pour la Russie « démocratique et européenne » de demain. Ils ne sont pas considérés comme les agents d'un changement nécessaire, mais comme des « personnes aigries et moralement déformées » qui ont besoin d'être surveillées et rééduquées. « Nous devrons faire tout notre possible pour que les personnes démobilisées de l'armée ou renvoyées des « services de sécurité » ne forment pas des gangs et ne commencent pas à créer des groupes criminels », a déclaré l'historienne Tamara Eidelman [7] lors d'un forum Navalnaya [8].
Yulia Navalnaya souligne que, par le passé, l'opposition comptait sur le soutien de l'administration américaine et qu'elle se tourne désormais vers l'Union européenne pour obtenir de l'aide. Cela correspond parfaitement au discours des autorités russes, qui présentent les personnalités de l'opposition comme faisant partie de l'appareil politico-militaire d'un ennemi extérieur. La position actuelle de l'opposition libérale renforce cette image et pousse les Russes à se rallier au gouvernement actuel.
Yulia Navalnaya affirme représenter « l'opposition unie ». C'est une exagération, mais elle repose sur certains éléments. Deux forums de l'« opposition unie » ont eu lieu à Vilnius [capitale de la Lituanie], auxquels ont également participé certains politiciens de gauche. « Pour la gauche, il est tout à fait logique d'avoir une conversation amicale avec ceux qui se trouvent à notre droite », a expliqué Mikhail Lobanov [9] à propos de sa participation à un tel forum. « La communauté militante se déplace vers la gauche. En ne nous opposant pas à l'opposition libérale, nous créons des canaux par lesquels les militants peuvent migrer vers la gauche » !
Pour la gauche, la lutte pour l'influence au sein du milieu restreint de l'opposition en exil peut permettre d'accéder à certaines ressources et aux médias, mais elle isole aussi considérablement l'opposition émigrée de ceux qui sont restés en Russie. Le soutien intérieur à l'opposition est tombé à un niveau minimal. Les sondages enregistrent une désillusion croissante à l'égard des structures du FBK, même parmi les émigrés. L'un des derniers politiciens de l'opposition encore en Russie, Lev Shlosberg [10], dresse un sombre bilan : « Le « parti du sang des autres » [11] a atteint un nouveau niveau de bassesse… Il est évident qu'ils espèrent revenir en Russie sous la protection des chars d'un autre pays. Un politicien cesse d'être un politicien de son propre pays lorsqu'il commence à souhaiter la mort de ses concitoyens. »
La coopération entre les émigrés de gauche et les dirigeants libéraux démoralise leurs propres partisans en Russie. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas pourquoi leurs camarades continuent de placer leurs espoirs dans une alliance avec une opposition libérale en faillite, misant sans cesse sur une hypothétique scission au sein des élites et sur un pacte avec celles-ci, au lieu de présenter au pays leur propre visage et leur propre stratégie.
Stratégie
Une alliance avec l'opposition libérale, désormais isolée de la Russie et transformée en une petite faction du « parti de la guerre » occidental, est un choix catastrophique pour la gauche. Aucun succès dans la recherche de nouveaux effectifs, de nouvelles ressources ou de l'attention des médias ne peut compenser une mort politique. Pour remplir sa véritable mission – devenir la voix de millions de Russes lassés par la guerre, la répression et les inégalités –, la gauche a besoin d'une stratégie claire et convaincante. Les grandes lignes de cette stratégie peuvent déjà être esquissées.
1. Au premier plan doit figurer la revendication d'une paix immédiate, et non d'une victoire militaire (pour ceux qui sont condamnés à mourir dans les tranchées, peu importe désormais que ce soit la victoire de l'Occident ou celle de la Russie). Si la classe dirigeante continue de se montrer incapable d'apporter la paix au peuple, la revendication de la fin des actions militaires fratricides deviendra le catalyseur le plus puissant de la mobilisation sociale.
2. Pour défendre la paix entre les peuples frères, les militant·e·s de gauche russes ont besoin d'alliés parmi les Ukrainiens. A partir de la base, nous pouvons faire ce que les politiciens ne peuvent pas faire : parvenir à un accord. C'est précisément l'objectif de la campagne « Peace from Below » (La paix par le bas) [12], lancée en novembre 2024 par des émigrés de gauche russes et ukrainiens lors du Forum de Cologne (novembre 2024).
3. La première étape consiste à mobiliser et à organiser les partisans, en commençant par ceux qui sont en exil. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de réfugiés russes et ukrainiens rien qu'en Europe, mais seuls quelques centaines d'entre eux sont membres d'organisations ou de groupes politiques. Cela s'explique notamment par le caractère antidémocratique de la plupart des programmes de ces organisations et leur contradiction de plus en plus flagrante avec le désir de paix de la majorité. Notre tâche n'est pas de nous battre dans le monde étroit des militants politiques professionnels, mais de trouver des moyens d'organiser des milliers de personnes démobilisées.
4. Cela permettra de remplir la mission centrale de l'émigration politique : devenir la voix de millions de compatriotes qui, sous la répression et la censure, ne peuvent pas dire haut et fort ce qu'ils pensent vraiment.
5. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine n'est pas isolé du contexte mondial. La violence militaire se propage rapidement à travers le monde : Gaza, Liban, Iran, Syrie. L'Europe est submergée par une vague de militarisation. Aux Etats-Unis, l'administration Trump cherche ouvertement à instaurer un régime autoritaire et menace même d'intervenir militairement contre des alliés traditionnels tels que le Canada, le Mexique, le Panama et le Danemark. La place des militants de gauche russes n'est pas dans les derniers rangs des salles où se réunit le parti occidental de la guerre, mais parmi les participants au mouvement anti-guerre. Nous devons rejoindre nos camarades dans la lutte commune contre l'extrême droite, les bellicistes et le capital oligarchique qui entraînent tous les pays vers une dictature ouverte et une guerre sans fin. C'est seulement ainsi que nous pourrons être vraiment utiles à notre pays.
(Publié dans Rabkor le 27 juillet 2025. Traduit pour Links du russe en anglais par Dmitry Pozhideav et publié le 15 août 2025 sur le site links.org ; traduction rédaction A l'Encontre)
Alexey Sakhnin est un journaliste, militant et homme politique russe de gauche, anciennement associé au mouvement Front de gauche. Il a été l'un des leaders du mouvement de protestation anti-Poutine de 2011 à 2013 et est membre du Progressive International Council (Conseil progressiste international). Il a beaucoup écrit sur la politique russe, les mouvements sociaux et les affaires internationales, souvent dans une perspective marxiste. Depuis qu'il s'est exilé en raison de persécutions politiques, il a contribué à divers médias indépendants, tels que Jacobin.
Liza Smirnova est une journaliste et militante russe de gauche, connue pour ses reportages et ses commentaires sur les questions de justice sociale, les droits du travail et les mouvements anti-guerre. Elle est également active en exil, participant à des réseaux de solidarité internationale et contribuant à des publications indépendantes.
____________
1. « Opération militaire spéciale » est le terme officiel utilisé par les autorités russes pour décrire l'invasion de l'Ukraine. En vertu de la loi russe, le fait de la qualifier de guerre peut faire l'objet de poursuites pénales.
2. Alexei Navalny (1976-2024) était un leader de l'opposition russe, avocat et militant anti-corruption. Il s'est fait connaître pour ses enquêtes sur la corruption des fonctionnaires russes et son opposition au régime de Vladimir Poutine. Navalny a été emprisonné en 2021 et est décédé en détention en février 2024 dans des circonstances largement considérées par ses partisans et les observateurs internationaux comme étant motivées par des raisons politiques.
3. Vladimir Milov est un homme politique russe de l'opposition, économiste et ancien vice-ministre de l'Energie de la Fédération de Russie. Proche collaborateur d'Alexei Navalny, il a participé à l'élaboration du programme économique « Nouvelle Russie » (NB) de Navalny, qui proposait des réformes libérales visant à restructurer l'économie russe. Milov vit en exil depuis 2010 et critique ouvertement le gouvernement de Vladimir Poutine. En 2021, le ministère russe de la Justice l'a désigné « agent étranger ».
4. Ilya Yashin (né en 1983) est un homme politique russe de l'opposition, ancien conseiller municipal à Moscou et critique de longue date du régime de Vladimir Poutine. Connu pour son activisme et ses discours publics contre la corruption et l'autoritarisme, Yashin a été désigné « agent étranger » et condamné en décembre 2022 à huit ans et demi de prison pour « diffusion de fausses informations » sur l'armée russe, après avoir condamné la guerre en Ukraine. Le 1er août 2024, il a été libéré dans le cadre du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide (réalisé à Ankara, en Turquie), où il a été échangé contre des agents et des collaborateurs russes détenus en Occident.
5. FBK – La Fondation anti-corruption (Fond Borby s Korruptsiei) a été fondée par Alexei Navalny en 2011 en tant qu'organisation à but non lucratif chargée d'enquêter et de dénoncer la corruption parmi les hauts fonctionnaires russes. Les autorités russes ont désigné la FBK comme « agent étranger » en 2019 et comme « organisation extrémiste » en 2021, interdisant de fait ses activités en Russie. Bon nombre de ses dirigeants opèrent désormais depuis l'exil.
6. Yulia Navalnaya est la veuve d'Alexei Navalny et une figure publique de l'opposition russe. Après l'emprisonnement puis la mort de son mari en 2024, elle est devenue l'une des leaders les plus en vue du mouvement anti-Poutine en exil, plaidant en faveur de sanctions internationales contre les dirigeants russes et cherchant à obtenir le soutien politique de l'Occident pour l'opposition. En 2025, les autorités russes l'ont qualifiée à la fois de « terroriste » et d'« extrémiste ».
7. Tamara Eidelman est une historienne, éducatrice et intellectuelle publique russe, connue pour ses conférences d'histoire très populaires et sa chaîne YouTube. Critique virulente du gouvernement de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine, elle a quitté la Russie en 2022 et est depuis active en exil, participant à des forums d'opposition et à des débats publics. En 2022, le ministère russe de la Justice l'a désignée « agent étranger ».
8. Le Forum Yulia Navalnaya, également appelé « Plateforme pour une Russie future », réunit des experts russes et des figures de l'opposition en exil afin de discuter de plans de réforme et de transition démocratique. Le forum inaugural s'est tenu du 8 au 10 novembre 2024, et le deuxième a eu lieu du 9 au 11 mai 2025.
9. Mikhail Lobanov (né en 1984) est un mathématicien, syndicaliste et homme politique russe de gauche. Ancien maître de conférences à l'université d'Etat de Moscou, il s'est fait connaître pour son opposition aux réformes de l'éducation et sa défense des droits du travail. En 2021, il s'est présenté comme candidat indépendant de gauche avec le soutien du PCFR à la Douma d'Etat, mais a été empêché de remporter les élections par le recours à la manipulation du « vote intelligent » et à des fraudes électorales présumées. Lobanov a quitté la Russie en 2022 après avoir été victime de persécutions politiques. En 2023, le ministère russe de la Justice l'a désigné « agent étranger ».
10. Lev Shlosberg est un homme politique libéral, journaliste et militant des droits humains russe originaire de la région de Pskov. Membre du parti Iabloko, il est connu pour ses enquêtes sur la corruption locale, son plaidoyer en faveur de réformes démocratiques et son opposition aux interventions militaires russes, notamment en Ukraine. Shlosberg a été victime de persécutions politiques répétées, notamment d'agressions physiques, d'inéligibilité et de poursuites pénales. En 2023, le ministère russe de la Justice l'a désigné « agent étranger ».
11. « Parti du sang des autres » – Il s'agit d'une expression péjorative utilisée dans la rhétorique politique russe pour accuser les opposants de soutenir la guerre ou l'intervention militaire étrangère au prix de vies russes.
12. Peace from Below (Mir snizu) est une initiative populaire lancée en novembre 2024 par des militants de gauche russes et ukrainiens en exil. Elle vise à favoriser le dialogue et la coopération entre les citoyens ordinaires des deux côtés du conflit, en plaidant pour la fin immédiate des hostilités et une paix négociée, contrairement aux programmes politiques officiels axés sur la victoire militaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche danoise et l’Ukraine

La gauche nordique avance à grand pas dans la réflexion sur les questions de défense populaire et de sécurité en Europe. Cette réflexion est nourrie par son engagement appuyé et permanent en faveur de l'Ukraine. Elle soutient activement les syndicats et mouvements sociaux ukrainiens mais aussi les combattants antifascistes progressistes qui combattent l'impérialisme russe.
Bjarke Friborg, membre de l'Alliance rouge et verte danoise revient d'Ukraine[1] où il a rendu visite avec Helene Vadsten à Solidarity Collectives. Il a bien voulu répondre à nos questions.
Propos recueillis par Michel Lanson et Patrick Le Tréhondat pour le Réseau Bastille.
27 août 2025 | Réseau Bastille
https://www.reseau-bastille.org/2025/08/27/retour-dukraine-interview-de-bjarke-friborg-de-lalliance-rouge-verte-danoise/
Pouvez-vous nous présenter Enhedslisten (Alliance rouge et verte), son histoire et ses orientations politiques ?
L'Alliance rouge-verte (Enhedslisten) a été fondée en 1989 en tant que front uni de plusieurs traditions radicales de gauche au Danemark, notamment les socialistes de gauche, le Parti communiste, le SAP trotskiste (Quatrième Internationale) et un groupe maoïste. Après avoir initialement lutté pour franchir le seuil électoral de 2 %, l'Alliance rouge-verte est entrée au parlement en 1994 et est depuis devenue une force parlementaire et extraparlementaire importante de la gauche danoise.
Aujourd'hui, le parti combine un profil écosocialiste et internationaliste fort avec un accent porté sur les inégalités sociales croissantes et les questions générales relatives à la classe ouvrière. Nous critiquons systématiquement l'austérité capitaliste et une transition écologique trop lente et incohérente face à la catastrophe climatique. Le parti travaille en étroite collaboration avec les mouvements populaires, les militants syndicaux et reste une organisation pluraliste avec une forte démocratie interne. Depuis 2011, nous obtenons généralement 5 à 7 % des voix au niveau national, et lors des dernières élections locales en 2021, nous avons obtenu 24,6 % des voix à Copenhague, ce qui fait de nous le parti politique le plus populaire de la ville.
Ces dernières années, des débats ont eu lieu autour de questions telles que l'UE, l'OTAN, l'Ukraine et la Palestine. Certains nous accusent d'avoir « trahi nos principes » parce que nous présentons désormais des candidats socialistes au Parlement européen au lieu de préconiser la sortie de l'UE, parce que nous soutenons les livraisons d'armes à l'Ukraine, même si elles transitent par l'OTAN, et parce que nous défendons une Palestine libre tout en condamnant le Hamas comme un groupe terroriste d'extrême droite. Cependant, pour la majorité des membres du parti, nous ne faisons que défendre une solidarité internationale cohérente et pratique en faveur des droits des travailleurs, des femmes et des minorités.
L'Alliance rouge et verte est fortement engagée en faveur de l'Ukraine et plus particulièrement en faveur de la gauche ukrainienne. Quel est le sens politique de cet engagement et comment concrètement cela se traduit-il ?
Dès le début de l'invasion à grande échelle, nous avons soutenu qu'il s'agissait d'une question de solidarité fondamentale avec les personnes qui résistent à l'oppression et à l'agression impérialiste. L'invasion russe est clairement une guerre impérialiste de conquête, et le droit de l'Ukraine à l'autodétermination doit être défendu, ce qui, dans la pratique, inclut un soutien militaire. Cela ne signifie toutefois pas que nous soutenons le gouvernement ukrainien, les oligarques ou la corruption.
Au contraire, nous collaborons avec la gauche ukrainienne, les syndicats et les organisations de la société civile qui luttent non seulement pour l'indépendance nationale, mais aussi pour la démocratie, les droits sociaux et le contrôle des travailleurs. En collaboration avec le parti vert Alternative, et depuis 2023 via l'Institut danois pour les partis et la démocratie (DIPD), nous avons obtenu une aide financière directe pour l'organisation progressiste Sotsialnyi Rukh (Mouvement social). Grâce à ce soutien, celle-ci a pu ouvrir des centres sociaux à Kyiv, Lviv et dans la ville industrielle de Kryvyï Rih, à l'est du pays. Nous sommes toujours impressionnés par le travail de ces militants, qui confirme sans équivoque que les Ukrainiens ne sont pas de simples pions sur l'échiquier géopolitique, mais bien les acteurs de leur propre lutte pour la libération.
Pensez-vous qu'il existe une menace russe sur l'Europe ? Comment la caractérisez-vous en tant qu'organisation de gauche ?
Il est évident que la Russie est un grand pays européen. Cependant, si vous faites référence à l'Union européenne et aux pays alliés tels que la Norvège, ainsi qu'aux autres pays voisins de la Russie, la menace que représente le régime de Poutine est indéniablement très réelle. Pas nécessairement en termes de « chars d'assaut entrant dans Paris », mais certainement en tant que menace pour la démocratie, la souveraineté et le principe selon lequel les frontières ne peuvent être modifiées par la force brute. En tant qu'organisation de gauche, nous nous opposons à l'impérialisme russe tout comme nous nous sommes opposés à l'impérialisme américain et à celui de l'OTAN : non pas en soutenant un bloc contre l'autre, mais en défendant le droit des peuples à l'autodétermination et en soutenant les forces démocratiques et progressistes en Russie et dans son État client, la Biélorussie.
Comment articulez-vous une politique de défense populaire et votre politique sociale d'émancipation ? Et comment cela est -t-il perçu dans la « gauche »en général ?
Pour nous, le concept clé est celui de défense populaire – une défense démocratique fondée sur les citoyens et ancrée dans la société civile, et non un appareil d'État militarisé au service des intérêts des entreprises, de l'industrie de l'armement et des interventions impérialistes en Afrique, en Asie centrale ou ailleurs. La défense ne se résume pas aux armes et aux armées, mais concerne la capacité collective des personnes à s'organiser et à protéger leurs communautés.
Certains à gauche y voient une contradiction, mais nous affirmons que c'est cohérent : s'opposer au militarisme ne signifie pas ignorer la nécessité pour les peuples de résister à l'agression. L'alternative à la défense populaire consiste à laisser le champ libre aux pouvoirs autoritaires.
Face à la menace russe, la gauche occidentale s'est retrouvée démunie. Ses traditions anti-militaristes le plus souvent obsolètes la place dans des contradictions insolubles. D'une part elle dénonce le complexe militaro-industriel et le réarmement mais de l'autre elle demande des livraisons d'armes pour l'Ukraine. Elle dénonce l'OTAN mais reste silencieuse sur les alliances militaires entre la Russie et la Chine. Et ne dit rien sur l'extraordinaire effort d'armement de cette dernière. Comment abordez-vous ces questions de défense et donc aussi militaires tant au niveau de votre pays qu'au niveau européen ?
La gauche a toujours été divisée sur les questions de sécurité, mais l'invasion à grande échelle de l'Ukraine a clairement entraîné un nouveau rééquilibrage et un rejet de certaines dichotomies. Pour nous, membres de l'Alliance rouge et verte et de la gauche nordique en général, il n'y a aucune contradiction entre le soutien militaire à l'Ukraine, la critique de l'OTAN et de l'industrie de l'armement. Nous condamnons fermement l'agression russe, mais nous nous opposons également aux renforcements militaires massifs basés sur des objectifs arbitraires fixés par Donald Trump.
Dans le même temps, nous appelons à la socialisation de l'industrie de l'armement, à l'interdiction des exportations d'armes de l'UE vers des pays tels qu'Israël et la Chine, et à une architecture de sécurité globale fondée sur le désarmement mutuel, la coopération et la souveraineté populaire – et non sur une nouvelle course aux armements.
Lors de votre dernière conférence qui a porté notamment sur les questions de défense, le SAP (section danoise de la IVe Internationale) vous a critiqué en expliquant que « Enhedslisten n'a pas une politique de défense radicalement différente de celle du courant dominant du Parlement »et donc que vous vous seriez alignés sur des partis bourgeois. Qu'avez-vous à répondre à cette accusation ?
La conférence a approuvé une nouvelle politique de défense et de sécurité qui soutient la fourniture d'armes à l'Ukraine et le renforcement de la défense territoriale du Danemark, du Groenland et des îles Féroé, tout en rejetant un renforcement général des capacités militaires, une course internationale aux armements et l'octroi de pouvoirs militaires à l'UE. Cela nous distingue clairement de tous les autres partis représentés au parlement. En ce qui concerne le SAP, le groupe a principalement mis en garde l'Alliance rouge et verte contre toute illusion quant à une réforme de l'OTAN ou de l'UE. Ces deux organisations sont composées d'États impérialistes poursuivant leurs propres intérêts, et tout renforcement militaire servira en fin de compte ces intérêts plutôt que la solidarité internationale ou la protection de la démocratie dans des pays tels que la Moldavie et la Géorgie. Je comprends et respecte cette critique, tout en soulignant que le SAP a toujours soutenu l'armement de l'Ukraine et ne s'oppose pas explicitement aux investissements dans la préparation civile ou à une meilleure protection contre la guerre hybride et les cyberattaques.
https://socinf.dk/el-aarsmoedet-hvilket-forsvar-snakker-vi-om
En revanche, certains membres de l'Alliance rouge et verte ont proposé une déclaration alternative qui rejetait sans distinction tout type d'investissement lié à l'idée d'une défense territoriale, tout en abandonnant de fait l'Ukraine et en mettant en garde contre le fait de « choisir son camp » dans une guerre qui est « également » une guerre par procuration. Je me réjouis que cette déclaration ait été rejetée.
Le Danemark présente une particularité. Il existe un syndicat de sous-officiers qui est membre de la centrale ouvrière LO. Que pensez-vous du fonctionnement et de l'organisation de l'armée danoise ?
Dans tous les pays nordiques et aux Pays-Bas, les soldats et les officiers disposent de syndicats dotés de droits de négociation collective et de représentants élus. Les syndicats sont intégrés au système du marché du travail, mais leur rôle consiste à représenter les subordonnés en tant que salariés, ce qui diffère du contrôle démocratique populaire sur les forces armées envisagé par l'Alliance rouge et verte.
Historiquement, les relations entre la gauche danoise et le principal syndicat militaire HKKF (Union des soldats et caporaux) ont alterné entre coopération et tensions. Dans les années 1970, le mouvement dit des « soldats rouges » parmi les conscrits a remis en question les hiérarchies militaires, l'OTAN et la politique de défense danoise, exigeant de meilleures conditions et une influence plus démocratique. Le HKKF, qui représente les soldats professionnels, a adopté une position plus modérée et loyale, que certains membres de la gauche ont jugée trop proche du système, même si une collaboration s'est mise en place sur des questions pratiques telles que le logement et les horaires de travail. Aujourd'hui, le HKKF fonctionne comme un syndicat traditionnel axé sur les salaires et les conditions de travail. Il convient de noter qu'en 2018, son président a été le négociateur en chef de 180 000 fonctionnaires au bord d'une grève générale. Les soldats danois se joignent aux manifestations en uniforme et soutiennent la campagne sur les réseaux sociaux, notamment par des publications du personnel déployé en Afghanistan brandissant des slogans de solidarité.
De ce point de vue, suite à vos récents voyages en Ukraine, que pouvez-vous nous dire de l'armée ukrainienne ? Tant sur sa composition sociale (essentiellement ouvrière) que sur son fonctionnement l'armée ukrainienne est surprenante. Nous savons qu'il existe en son sein, par exemple, un syndicat de militaires LGBTQ ou que les travailleurs syndiqués en uniforme sont en relation permanente avec les syndicats dont ils sont membres.
Dans le cadre d'une délégation de l'Alliance rouge et verte, j'ai rencontré plusieurs organisations progressistes de la société civile et syndicats en Ukraine qui ont tous démontré un engagement fort en faveur de l'effort de défense et des performances de l'armée. Cela comprenait un soutien général et ciblé aux soldats, aux groupes et aux unités spécifiques, ainsi qu'aux anciens combattants. D'un point de vue de gauche, je trouve que les collectifs de solidarité (Solidarity Collectives) sont particulièrement remarquables car ils acheminent une aide directe aux antifascistes, aux syndicalistes et aux éco-activistes sur le front, avec le soutien d'un vaste réseau international de base.
Outre leurs efforts humanitaires, ils participent également à la production artisanale de drones qui est clairement devenue un élément important des efforts de solidarité internationale (https://www.goethe.de/prj/jad/de/ges/26335813.html). Ces formes d'interactions civile et militaire sont très différentes de la situation dans des pays comme le Danemark, mais elles sont bien sûr tout à fait compréhensibles alors que les missiles continuent de s'abattre sur les maisons, les fermes et les villes ukrainiennes.
Fondamentalement, cela reflète le fait que la défense de l'Ukraine ne repose clairement pas uniquement sur une armée permanente composée de professionnels et de conscrits, mais sur un effort de guerre populaire, l'armée étant composée de travailleurs ordinaires, de syndicalistes, d'étudiants, de personnes LGBTQ et de volontaires qui se battent pour leurs communautés. En conséquence, il existe un degré extraordinaire d'interactions entre les civils et les militaires, les réseaux d'activistes et les organisations à but non lucratif fournissant tout, des fournitures médicales aux drones construits par leurs soins.
Les médias grand public ont tendance à mettre en avant les armes occidentales sophistiquées et les aides financières de plusieurs milliards de dollars. Cependant, ce qui passe souvent inaperçu, ce sont les campagnes de financement populaires et les réseaux de productions auto-organisées qui soutiennent quotidiennement la résistance ukrainienne. Dans le même temps, les soldats ne bénéficient toujours pas de droits essentiels, même en temps de guerre. Il n'existe pas de règles transparentes en matière de repos, de démobilisation ou de réadaptation, et les organisations syndicales officielles sont interdites. Cependant, de nouvelles initiatives ont vu le jour pour combler cette lacune. Des initiatives telles que l'Union militaire LGBTQ d'Ukraine ou le « Bataillon invisible » (qui se concentre sur les femmes dans la guerre) ont pris de l'importance, tandis que l'organisation progressiste Sotsialnyi Ruk a mis en place sa propre ligne d'assistance téléphonique et fournit une aide juridique gratuite aux soldats, aux anciens combattants et à leurs familles
D'autres partis de gauche en Scandinavie et en Europe du Nord partagent peu ou prou vos positions. Comment collaborez-vous ou envisagez- vous de collaborer ?
L'Alliance rouge et verte collabore étroitement avec les partis de gauche de la région – le Vänsterpartiet suédois, le Rødt norvégien et l'Alliance de gauche finlandaise, ainsi qu'avec des mouvements en Islande et dans les pays baltes. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur toutes les questions tactiques, mais nous reconnaissons tous que la solidarité avec l'Ukraine est indispensable et que nous devons redéfinir la politique de sécurité de gauche pour une nouvelle ère. Notre objectif est de construire un réseau nordique et européen qui relie le soutien à l'Ukraine à une vision plus large, socialiste, féministe et écologique de la sécurité, au-delà du militarisme.
27 août 2025
Le site l'Alliance rouge et verte danoise
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un siècle d’humiliation pour l’Europe

Yannis Varoufakis montre a quel point le « deal Trump – von der Leyen » nous éclaire sur l'Europe, incapable de même s'imaginer comme une puissance souveraine, déterminée qu'elle est à rester le vassal de l'empire. Ce texte, reproduit avec l'accord de l'auteur, a été initialement publié le 9 août 2025, en anglais, sur le site UnHerd sous le titre Europe's century of humiliation – Trump has outwitted von der Leyen.
21 août 2025 | tiré du site regards.fr
https://regards.fr/un-siecle-dhumiliation-pour-leurope/
En 1842, brisée et vaincue, la Chine envoya son plus haut bureaucrate, Qiying, à Nankin pour rencontrer Sir Henry Pottinger, l'impitoyable administrateur colonial britannique, qui dicta les termes de la capitulation. Le traité de Nankin qui en résulta fit perdre à la Chine tout ce qu'elle avait, sans rien obtenir en retour, si ce n'est l'humiliation. On parla alors d'un « accord commercial », tandis que les marchands trinquaient à Londres et que les poètes chinois immortalisèrent en vers la honte qui hante encore leur grande nation.
Le mois dernier, brisée et vaincue, la Commission européenne envoya sa plus haute diplomate, Ursula von der Leyen, sur un terrain de golf écossais appartenant à Trump, pour signer un traité tout aussi honteux. Là encore, on parla d'un « accord commercial » pour masquer comment l'Europe a tout donné au président américain sans rien recevoir en retour, si ce n'est l'humiliation. Contrairement à la Chine en 1842, l'Europe n'a pas succombé à une défaite militaire, mais seulement après quelques mois de « waterboarding tarifaire » – une technique de torture ( par suffocation par l'eau) que les dirigeants européens stupides, inspirés par les démocrates américains impuissants, avaient autrefois moquée sous l'acronyme TACOS (« Trump Always Chickens Out », Trump se dégonfle toujours).
Si les poètes européens n'auront rien de lyrique à dire sur cette humiliation qui planera pendant des décennies sur le continent, ses politiciens, eux, l'ont déjà reconnue. Un « jour sombre », selon les mots de François Bayrou, le premier ministre français. Un « aveu de faiblesse », s'est écrié Michel Barnier, le négociateur européen du Brexit, qui pourtant sait ce que c'est que de négocier avec une arrogance sans limites.
Les détails de l'accord commercial UE/États-Unis sont véritablement embarrassants pour l'Europe. Alors que les produits américains entreront en Europe sans droits de douane, une taxe généralisée de 15% frappera les exportations européennes vers les États-Unis, avec un taux monstrueux de 50% sur l'acier et l'aluminium. Et ce n'est que le début.
L'Europe s'est engagée à supprimer toutes les taxes actuelles ou prévues sur les activités en ligne des géants technologiques, puis a offert un énorme tribut pour apaiser Donald Trump : 600 milliards de dollars d'investissements nouveaux dans l'économie américaine et 750 milliards de dollars d'achats de pétrole et gaz de schiste d'ici fin 2028. Soit un chèque gargantuesque de 1 350 milliards de dollars – sans compter les innombrables milliards pour des armements américains que les gouvernements européens devront acheter (s'ils veulent respecter leurs engagements de dépenses militaires dans le cadre de l'Otan).
En faisant ces promesses, von der Leyen a oublié la leçon essentielle que l'Europe aurait dû tirer du premier mandat de Trump : ne pas lui offrir d'argent peut être dangereux, mais faire des promesses impossibles à tenir est bien pire. Outre le fait que la Commission ne peut forcer les entreprises à investir aux États-Unis, un autre problème se pose : ni l'argent promis, ni les capacités nécessaires n'existent. Les constructeurs automobiles et les entreprises chimiques allemands investissent bien sûr déjà aux États-Unis pour contourner les droits de douane de Trump, mais ils sont loin des 600 milliards de dollars promis pour les deux ans et demi à venir. Pire encore, la promesse d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine (250 milliards de dollars par an sur trois ans) relève de la pure fantaisie : les besoins énergétiques annuels de l'UE sont loin de pouvoir absorber ce montant, sans compter que les fracturiers américains n'ont pas la capacité de vendre à l'Europe autant de pétrole et de gaz, même si les Européens avaient la volonté et la capacité de les acheter.
Trump ne le sait-il pas ? Il le sait, bien sûr. A-t-il oublié les promesses non tenues de Jean-Claude Juncker ? Personne ne se souvient de ces choses-là aussi bien que le président américain. On le voit dans ses yeux. Il adore ça. C'est l'occasion rêvée de matraquer une Union européenne qu'il déteste avec une passion intacte depuis si longtemps. En plus de réduire le déficit commercial des États-Unis et d'empocher des recettes tarifaires substantielles dans le processus, M. Trump ne peut attendre que l'UE viole les engagements de Mme von der Leyen en matière d'investissement et d'énergie. Une fois qu'elle l'aura fait, après 2028, au cours de sa dernière année à la Maison Blanche, il sera en mesure d'obtenir des concessions plus humiliantes, en citant les promesses européennes non tenues.
Si l'on compare l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis avec celui signé entre le Royaume-Uni et les États-Unis en mai dernier, il est indéniable que Trump a traité Keir Starmer avec des gants. Cela n'avait pas grand-chose à voir avec l'économie. Il n'était pas non plus motivé par l'anglophilie ou par son aversion pour Mme von der Leyen. Quelque chose de plus grand, de son point de vue, l'a poussé à être plus gentil avec la Grande-Bretagne, même au point de déplaire aux constructeurs automobiles américains qui ne peuvent pas croire qu'il est désormais moins cher d'importer aux États-Unis une voiture britannique (sans pièces fabriquées aux États-Unis) qu'un véhicule Ford ou General Motors fabriqué au Mexique ou au Canada (mais dont la plupart des pièces ont été fabriquées aux États-Unis).
Pour quelle raison a-t-il choisi de s'attirer les foudres de son propre électorat MAGA au nom des constructeurs automobiles britanniques, dont beaucoup n'ont pas des britanniques comme propriétaires ? C'est simple : en fixant des droits de douane globaux de seulement 10% (y compris pour les voitures), soit 5% de moins que l'équivalent européen, tout en supprimant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, il a creusé un fossé si profond entre Londres et Bruxelles que même le plus fervent partisan du Brexit a certainement perdu la volonté de se battre à ce jour. Trump se réjouit donc à l'idée qu'il a rendu le Brexit, signe avant-coureur de son premier triomphe électoral, bel et bien irréversible.
Avant de se résigner à sa propre version du traité de Nanjing, les dirigeants de l'UE sont passés par les mêmes quatre étapes du deuil que les négociateurs britanniques du Brexit : de « Nous riposterons s'ils osent nous presser » à « Nous pourrions riposter si nous y sommes poussés » à « Pas d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord » à « N'importe quel accord, s'il vous plaît, nous sommes désespérés ». Maintenant que les récriminations sur le traité de Nanjing du 21ème siècle battent leur plein à Bruxelles et dans toutes les capitales européennes, deux questions appellent des réponses. En quoi les dirigeants européens se sont-ils trompés ? Et qu'auraient-ils pu faire différemment pour éviter cet accord humiliant, tout en évitant des souffrances économiques encore plus grandes ?
Tout d'abord, les négociateurs européens ont commis trois erreurs de jugement involontaires. Premièrement, ils ont supposé que la taille du marché unique de l'UE comptait plus que tout. Ce n'est pas le cas. S'il est une grandeur qui compte plus que toutes les autres, c'est bien celle de l'excédent commercial de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Avec plus de 240 milliards de dollars par an, il garantit qu'une véritable guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne nuirait bien plus à l'Europe qu'à l'Amérique.
Deuxièmement, comme l'a expliqué mon collègue Wolfgang Munchau, les Européens ont surestimé l'effet de levier que le déficit de l'UE en matière de services vis-à-vis des États-Unis conférait à Bruxelles. Alors que les Américains peuvent vivre confortablement sans foulards Hermès, champagne français, olives Kalamata et Porsche, les Européens ne peuvent pas tenir une heure sans Google, YouTube, Instagram et WhatsApp.
Troisièmement, et surtout, ils se sont bercés de l'illusoire conviction que les marchés des biens et les marchés monétaires américains seraient pris de spasmes, ce qui obligerait Trump à se dégonfler. Pendant trop longtemps, ils se sont accrochés à l'idée que les droits de douane stimuleraient l'inflation des prix à la consommation et la déflation des marchés boursiers américains à des niveaux politiquement inacceptables. Cela ne s'est pas produit pour des raisons que Bruxelles aurait dû prévoir.
La demande des consommateurs américains est relativement plus réactive (« élastique », dans le langage économique) aux hausses de prix que la demande des consommateurs européens et l'offre des exportateurs européens. C'est pourquoi une Mercedes-Benz fabriquée en Allemagne a toujours été moins chère à New York qu'à Stuttgart et pourquoi, aujourd'hui, une partie substantielle des droits de douane est absorbée par les exportateurs européens qui ne répercutent sur les consommateurs américains qu'une fraction des droits de douane, ce qui a pour effet de réduire l'impact sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis. Quant aux marchés boursiers américains, ils semblent captivés par leur propre engouement pour l'investissement dans l'IA, par les réductions d'impôts déraisonnablement importantes dont Trump les a gratifiés et par les recettes tarifaires annuelles de 300 milliards de dollars que le Trésor américain engrange. Trop enivrés par cette « exubérance irrationnelle », ils refusent de s'inquiéter des effets macroéconomiques néfastes du jeu tarifaire de Trump.
Mais supposons un instant que les dirigeants de l'UE aient prévu tout cela. Un principe fondamental des négociations veut que si vous ne pouvez pas imaginer quitter la pièce sans un accord, il est inutile de négocier – vous ne seriez alors qu'un quémandeur suppliant comme von der Leyen.
Alors, qu'est-ce que l'UE aurait pu faire différemment, étant donné qu'elle ne dispose pas de l'arme de négociation soigneusement élaborée par la Chine, à savoir des minéraux rares et un large éventail de produits de base dont les Américains ne peuvent pas se passer ? Voici une suggestion.
La première tâche de l'Europe consisterait à planifier le remplacement des 240 milliards de dollars de demande globale intérieure dus à la perte potentielle de son excédent commercial avec les États-Unis. Par exemple, le Conseil européen pourrait annoncer un programme d'investissement productif global de 600 milliards d'euros par an, financé par l'émission nette d'obligations de la Banque européenne d'investissement. Le simple fait que la Banque centrale européenne laisse entendre que, le cas échéant, elle soutiendra ces obligations de la BEI, suffirait à maintenir les coûts de financement à un niveau extrêmement bas. Tout à coup, l'Europe ne dépendrait plus de l'Amérique pour maintenir la demande globale.
En outre, l'UE devrait renoncer à tous les droits de douane et sanctions imposés par les États-Unis sur les technologies vertes et numériques chinoises essentielles, en vue de conclure un accord avec Pékin comprenant des mesures d'expansion fiscale coordonnées et des garanties de sécurité mutuelles. Elle devrait introduire une taxe sur le cloud de 5% sur toutes les transactions numériques pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions d'euros par an (quel que soit leur lieu de domiciliation). En outre, l'UE devrait abroger les lois draconiennes et anticoncurrentielles sur la propriété intellectuelle imposées par les États-Unis, qui rendent illégale l'utilisation de cartouches d'encre génériques moins chères dans votre imprimante, qui interdisent aux agriculteurs de réparer leurs tracteurs John Deere et qui empêchent les personnes handicapées de procéder à des ajustements, même mineurs, de la direction de leurs fauteuils roulants électriques. Enfin, l'UE serait bien avisée de cesser progressivement d'acheter du gaz naturel liquéfié fracturé d'origine américaine dans son bouquet énergétique et des armes fabriquées aux États-Unis dans ses armées.
Le fait qu'un tel ensemble de réponses ne soit même pas discuté à Bruxelles nous éclaire sur l'Europe. Avec toute la subtilité d'une boule de démolition, Donald Trump a révélé que l'UE n'est même pas capable de s'imaginer comme une puissance souveraine, déterminée qu'elle est à rester le vassal d'un empire atlantiste. Contrairement à la Chine de 1842, l'Union européenne a choisi librement l'humiliation permanente.
Yannis Varoufakis
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Débat. « Le désordre programmé qui submerge Trump »

Fidèle à son style de parieur téméraire, Trump a semé le chaos sur les marchés mondiaux. Il a introduit, retiré puis reformulé une liste de droits de douane qui a déclenché un désordre majeur. Sa provocation a fait revivre les pires cauchemars financiers de ces dernières décennies.
23 août 2025 | tiré du site la gauche anticapitaliste
https://www.gaucheanticapitaliste.org/debat-le-desordre-programme-qui-submerge-trump/
Le magnat a mis en place un scénario inédit de crise mondiale provoquée délibérément. Certains analystes estiment qu'il a tendance à reculer face aux résultats défavorables de ses mesures, mais d'autres considèrent qu'il continue d'effrayer ses interlocuteurs pour les forcer à capituler.
Il règne également une impression superficielle que Trump est devenu fou et que, dans leur déclin, les Etats-Unis sont tombés sous le règne d'un personnage extravagant. Le magnat ment, insulte, agresse et semble diriger la première puissance mondiale comme s'il s'agissait d'un fonds d'investissement. Mais en réalité, il suit une stratégie approuvée par d'importants groupes de pouvoir et il ne faut pas le sous-estimer (Torres López, 2025).
Il a trois objectifs sur le plan économique : restaurer l'hégémonie du dollar, réduire le déficit commercial et, finalement, encourager le rapatriement des grandes entreprises. La hiérarchie et l'articulation de ces objectifs constituent la grande interrogation du moment.
Centralité monétaire
Certaines approches soulignent, à juste titre, la primauté des objectifs financiers et monétaires sur les objectifs commerciaux ou productifs. Elles soulignent que Trump entend instaurer un dollar bon marché pour l'exportation et un dollar fort comme monnaie de réserve. Il entend favoriser les exportations états-uniennes tout en assurant le statut privilégié de la devise américaine en tant que monnaie mondiale (Varoufakis, 2025).
Les deux principaux conseillers du président, Stephen Miran et Scott Bessent, ont confirmé cette intention, avouant que les pressions commerciales sont un instrument au service des exigences monétaires [voir l'essai de Stephen Miran, novembre 2024, dans Hudson Bay Capital : « A User's Guide to restructuring the Global Trading system, november 2024 » – réd.].
Pour parvenir à la dévaluation du dollar et à son maintien comme monnaie de réserve, Trump doit renforcer la soumission des banques centrales d'Europe et du Japon. Cette subordination est indispensable pour préserver le rôle des titres de la dette états-unienne (bons du Trésor) comme principal refuge du capital.
Cette garantie détermine l'afflux vers Wall Street de l'argent liquide excédentaire dans le monde. Tokyo et Bruxelles doivent continuer à acheter ces bons du Trésor afin de valider le cours du dollar fixé par Washington, évitant ainsi les tensions monétaires qui feraient s'effondrer tout le projet.
Trump exige le maintien du règne continu du dollar et la capacité des Etats-Unis à se financer aux dépens du monde entier. L'impérialisme du dollar permet à la première puissance mondiale de s'endetter sans limite et de mettre toutes les économies du globe sous sa coupe.
Pour faire face aux sérieuses remises en question dont cet atout fait actuellement l'objet, Trump entend recréer les accords de Plaza que les Etats-Unis ont imposés à l'Allemagne et au Japon en septembre 1985. A l'époque, les deux pays subordonnés avaient accepté de soutenir la dépréciation du dollar et de maintenir une parité qui garantissait la primauté mondiale du dollar.
Trump adapte cette exigence aux temps actuels et encourage la création de nouvelles monnaies numériques liées au pouvoir politique du dollar. Le potentat a créé un fonds de cryptomonnaies adossé à sa propre personne et promeut ce marché (les stablecoins) comme un pilier supplémentaire du dollar. Il a déjà positionné ces instruments parmi les 10 plus grands détenteurs de bons du Trésor (Litvinoff, 2025).
Le président des Etats-Unis rêve de replacer le dollar sur son trône initial de Bretton Woods [1944]. Son plan B consiste à réutiliser cette influence pour atteindre le niveau de prépondérance obtenu par Nixon et Reagan. Dans le premier cas, le dollar a été libéré de la convertibilité en or [15 août 1971] et a entamé un long cycle de prédominance sans contrepartie métallique objective. Dans le second cas [1985], le dollar a été renforcé par la hausse des taux d'intérêt, l'émergence du néolibéralisme et la financiarisation sous la houlette de la Réserve fédérale. Ces deux présidents partageaient avec Trump le même profil de personnalités médiocres, mais ils ont introduit des changements significatifs dans le statut mondial du dollar.
Pour réitérer cet exploit, Trump doit freiner la tendance à la dédollarisation qui menace la suprématie du billet vert. Cette érosion est alimentée par les BRICS, qui ont commencé à concevoir des instruments de substitution à la devise américaine, par le biais d'opérations de paiement, de transactions commerciales et de mécanismes de compensation financière (Sapir, 2024).
Il existe même déjà un projet de création d'une monnaie des BRICS qui, suivant une trajectoire différente de celle de l'euro, aboutirait à un effet similaire. Ce plan prévoit la mise en place progressive d'une banque d'émission, dotée de fonds de réserve et d'agendas détaillés concernant les rythmes, les taux et les législations (Gang 2025).
Trump est conscient de ces menaces et a précipité le chaos pour déclencher la bataille contre les contestataires de la devise américaine. Il encourage cette panique afin de discipliner tous ses alliés sous son contrôle. A partir de cette centralisation, il espère redresser le dollar et réinitialiser le système économique mondial en faveur des Etats-Unis.
Mais Trupm doit limiter la portée de la crise qu'il génère, car si cette convulsion recrée le scénario de la pandémie ou le contexte de l'effondrement bancaire de 2008, le séisme finira par affecter son propre architecte (Marco del Pont, 2025a).
Le thermomètre immédiat de cette épreuve de force est le comportement des bons du Trésor. Le Japon est le principal détenteur de ces titres depuis que la Chine a commencé à les délaisser [en 2013, elle détenait pour 1277,7 milliards de dollars de bons de Trésor, en 2024, 772,5 milliards – réd.]. Les banques européennes et d'autres pays asiatiques détiennent également un stock important de ces titres. Le plan de Trump échouera rapidement si, comme l'ont laissé entrevoir les récentes turbulences, les détenteurs de la dette américaine vendent cet actif.
Mais au-delà de ce calcul immédiat, la grande question est la capacité générale des Etats-Unis à redresser leur monnaie. Il existe plusieurs différences substantielles avec l'ère Nixon et Reagan. Le déclin de la première puissance est bien plus important, le réseau de domination impériale s'est érodé, l'effondrement de l'URSS et les débuts de la mondialisation sont derrière nous et l'essor économique de la Chine est fulgurant.
La stratégie monétaire de Trump est également soumise à une forte tension avec les banques, tandis que Wall Street observe avec méfiance une orientation qui menace de réduire les énormes profits réalisés ces derniers temps.
Le boomerang des droits de douane
Le deuxième objectif de Trump est commercial et vise à réduire l'énorme déficit extérieur des Etats-Unis. Il s'agit d'un objectif à moyen terme, qui n'a pas l'acuité du tournant monétaire et dépend dans une large mesure de la recomposition du dollar. Trump introduit et modifie quotidiennement les droits de douane en fonction du rôle complémentaire de ces instruments dans les négociations avec chaque pays.
Le locataire de la Maison Blanche radicalise, dans les faits, la tendance protectionniste qui a commencé lors de la crise financière de 2008 et le déclin de la mondialisation commerciale. Depuis cette date, 59 000 mesures restrictives ont été introduites dans les échanges internationaux et les droits de douane ont atteint leur plus haut niveau depuis 130 ans (Roberts, 2025a). La guerre commerciale déclenchée par Trump avec son paquet de droits de douane spectaculaire s'inscrit dans cette lignée.
Trump a recouru à une formule absurde pour pénaliser les différents pays. Il a inventé un critère arbitraire de réciprocité pour définir le pourcentage de chaque sanction, avec des estimations farfelues du déficit commercial états-unien qui omettaient de comptabiliser l'excédent des Etats-Unis dans les services. Il a également omis que les déséquilibres commerciaux n'ont pas été causés par les pays sanctionnés, mais par les firmes américaines elles-mêmes, qui ont implanté leurs investissements à l'étranger afin d'améliorer leurs profits.
Les chances de succès du plan trumpiste sont très faibles, car les importations et les exportations états-uniennes ne constituent plus une force prépondérante dans le commerce mondial. Elles sont passées de 14% en 1990 à 10,35% aujourd'hui, tandis que dans la même période, les BRICS sont passés de 1,8% à 17,5%. La guerre tarifaire n'a pas de pouvoir dissuasif en soi et les ventes affichées par la première puissance mondiale dans le secteur des services sont insuffisantes pour faire basculer la balance (Roberts, 2025b).
Certaines estimations soulignent même que si les Etats-Unis suspendaient toutes leurs importations, 100 de leurs partenaires parviendraient à replacer leurs ventes sur d'autres marchés en seulement cinq ans (Nuñez, 2025).
Le plus grand problème de la guerre commerciale est la possibilité d'une escalade incontrôlable. En 1929-1934, la spirale descendante du commerce international qui a suivi le paquet protectionniste [loi Smoot-Hawley du 17 juin 1930) a provoqué une chute de 66% des échanges, et cet effondrement a touché tous les concurrents concernés. Trump pense qu'il évitera cette séquence grâce à des négociations bilatérales imposées depuis son bureau.
Mais l'histoire suggère une autre issue lorsque les conflits s'intensifient sans être maîtrisés. L'effet récessif du protectionnisme sur l'économie mondiale est aussi bien connu que le lien entre la Grande Dépression et le recul du commerce. Bien que les interprétations les plus courantes relient superficiellement ces deux processus – en omettant les racines capitalistes de ce qui s'est passé dans les années 1930 –, il ne fait aucun doute que le protectionnisme a déclenché, renforcé ou précipité l'effondrement au cours de cette période.
Le plus important dans une éventuelle répétition de ce précédent serait son effet sur l'économie états-unienne, qui est aujourd'hui beaucoup plus vulnérable aux turbulences mondiales. Cette incidence est d'autant plus grande que le poids du commerce extérieur est passé de 6% (1929) à 15% (2024) du PIB des Etats-Unis.
Trump réintroduit le protectionnisme à un moment historiquement inopportun. Les droits de douane ont été un instrument efficace pour les Etats-Unis dans le passé, mais ils ne remplissent plus la même fonction aujourd'hui. Ils ont facilité l'essor des puissances montantes face à des concurrents favorables au libre-échange, afin de maintenir leur domination sur le marché mondial. Le protectionnisme a été utilisé avec beaucoup d'avantages par l'Allemagne au XIXe siècle et par le Japon ou la Corée du Sud au siècle dernier. Mais ce même outil n'a pas permis à la Grande-Bretagne de contenir son déclin et cette inefficacité affecte aujourd'hui les Etats-Unis. Trump prône un protectionnisme inadapté, car au lieu d'encourager l'industrie naissante, il cherche à sauver une structure obsolète. Il ignore tout simplement que les Etats-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient.
Le rêve du retour de l'industrie
Le troisième objectif de Trump est d'ordre productif. Il encourage le retour des entreprises sur leur territoire d'origine et considère cette relocalisation comme le seul moyen de rendre effective la reprise de l'hégémonie états-unienne. C'est pourquoi il a associé le début de son offensive (le « Jour de la libération » le 2 avril) à la réindustrialisation du pays.
Trump est le premier dirigeant à reconnaître ouvertement les difficultés engendrées par la délocalisation des usines. Il recourt à des mesures drastiques pour inverser cette tendance, car il comprend que la mondialisation a fini par affecter la puissance qui a promu cette internationalisation. Il constate que la primauté des Etats-Unis dans les services, la finance ou l'univers numérique ne compense pas le recul de l'industrie et l'érosion consécutive du pilier de toute économie.
Mais son plan de rapatriement industriel est plus irréalisable que son projet monétaire ou tarifaire. Aucune alchimie monétaire ou tarifaire n'offre un attrait suffisant pour inciter les entreprises, qui ont réalisé des profits élevés à l'étranger, à revenir. Aussi persuasives que soient les incitations de Trump, produire aux Etats-Unis a un coût plus élevé. La restauration industrielle nécessiterait un investissement massif que les entreprises ne sont pas disposées à réaliser compte tenu de la faible rentabilité actuelle sur le marché intérieur.
Le virage protectionniste vise à réduire cet écart, mais il se heurte à la difficulté de fermer l'économie dans un contexte de chaînes logistiques mondialisées. Le produit final de nombreuses marchandises intègre des intrants provenant d'usines implantées dans de nombreux pays.
Il est difficile d'imaginer comment les Etats-Unis pourraient retrouver leur compétitivité en recréant les anciens modèles de fabrication nationale. De combien faudrait-il augmenter les droits de douane pour qu'il soit moins coûteux de recommencer à fabriquer dans le pays d'origine ?
Il suffit de regarder le cas de Nike, qui possède 155 usines au Vietnam et emploie un nombre considérable de personnes dans ce pays pour approvisionner un tiers des importations de chaussures des Etats-Unis. La différence de coûts de production est tellement énorme qu'un retour aux Etats-Unis semble impensable (Tooze, 2025). Le découplage du processus de fabrication en Chine aurait un impact similaire pour des entreprises comme Apple.
Les économistes de Trump affirment également que son projet sera réalisable si la primauté du dollar est rétablie et si le déficit commercial est réduit. Ils estiment que ce processus corrigera les déséquilibres mondiaux en matière de consommation, d'épargne et d'investissement qui affectent la première puissance mondiale. A l'opposé, les critiques néoclassiques et keynésiens rappellent que Trump n'a pas réussi à amorcer cette transformation au cours de son premier mandat.
Le débat entre les deux positions porte sur l'impact positif ou négatif du protectionnisme sur les dépenses, les revenus, l'épargne et la consommation. Mais il oublie que le recul des Etats-Unis ne se situe pas dans ces domaines. Il découle de la faible productivité de la principale économie occidentale face à son concurrent oriental (la Chine) en pleine ascension. Les indicateurs de ce fossé sont aussi nombreux que les preuves de son élargissement continu.
Il suffit d'observer la tendance généralisée des entreprises américaines à privilégier les investissements financiers ou à fonctionner comme un distributeur automatique de billets pour Wall Street pour que l'on constate leur compétitivité décroissante. Elles ont tendance à dépenser plus en rachats d'actions et en versements de dividendes qu'en investissements à long terme.
Une grande partie de ces entreprises ont mondialisé leurs processus de fabrication afin de contrebalancer les coûts de production élevés au niveau intérieur. Mais ce revirement les a rendues très dépendantes des importations de biens de consommation bon marché en provenance du continent asiatique afin de maintenir les salaires locaux à un niveau bas.
Le degré de dépendance à l'égard de l'approvisionnement chinois a été confirmé par la décision même de Trump d'exempter tous les puces et composants électroniques des droits de douane imposés à son rival asiatique. Le même problème s'étend aux biens d'équipement et aux biens intermédiaires, qui représentent environ 43% des importations totales de la Chine (Mercatante, 2025).
Le recul américain n'est pas dû à des erreurs commerciales et son inversion ne passe pas par un ultimatum protectionniste. Il y a certes un changement de modèle en cours qui érode la division mondiale du travail forgée au cours de décennies d'internationalisation de la production. Mais ce déclin n'inaugure pas le processus inverse de nationalisation industrielle imaginé par Trump, car la capacité des Etats-Unis à mener ce changement s'est considérablement réduite.
Le recul face à la Chine
Il est évident que la Chine est l'épicentre de la guerre économique déclenchée par Trump. Elle a été la principale cible des droits de douane qui ont déclenché l'escalade vertigineuse entre les deux pays. Les 34% initiaux imposés par Washington ont été suivis par Pékin avec le même pourcentage et la confrontation est rapidement passée à 84%-104 %, puis à 145%-125%. A ces niveaux, le commerce entre les deux pays tend à être anéanti.
La place centrale de la Chine dans l'offensive de Trump a été confirmée par sa décision de maintenir les sanctions contre ce pays, après les avoir suspendues pour le reste du monde [pour 90 jours]. Les droits de douane très élevés imposés au Vietnam, au Cambodge et au Laos s'inscrivent dans le même contexte, car la Chine contrôle les chaînes d'approvisionnement de ces pays voisins et réexporte ses marchandises à partir de là [cette situation explique le récent voyage de Xi Jinping dans ces pays, y compris la Malaisie – réd.].
Pékin a réagi fermement en imposant immédiatement des droits de douane réciproques et en indiquant clairement qu'il n'accepterait pas le chantage des Etats-Unis. Il a préparé cette riposte depuis longtemps cette réaction et entend mener la bataille sur le terrain de la productivité, en cherchant à ne dévaluer que marginalement le yuan. Il s'efforce déjà de trouver des clients compensateurs et conçoit des arguments spécifiques pour l'Europe et l'Asie.
L'establishment occidental craint largement l'issue finale de cette épreuve de force. De nombreuses estimations prévoient le succès final de la Chine si Trump continue à se tirer une balle dans le pied.
Chaque jour, de nouvelles données confirment la supériorité asiatique dans d'innombrables domaines. Le géant oriental forme, à l'échelle mondiale, déjà 65% des diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Il maintient un taux de croissance deux fois supérieur à celui de son homologue. Il représente 35% de l'industrie manufacturière mondiale et devrait atteindre 45% en 2030. Jusqu'en 2001, 80% des pays commerçaient davantage avec les Etats-Unis qu'avec la Chine, et aujourd'hui, les deux tiers de ce total ont inversé cette relation (Ríos, 2025).
Au cours du premier mois de la présidence de Trump, la Chine a lancé 30 nouveaux projets d'énergie « propre » en Afrique, a commencé la construction du plus grand barrage du monde au Tibet et a présenté une nouvelle génération de trains à grande vitesse. Son réacteur nucléaire a atteint un record de production de plasma à une vitesse qui le place près de la production d'énergie « propre » illimitée. Ses chantiers navals ont mis à l'eau le plus grand navire d'assaut amphibie au monde et les tests de la 6G sur les réseaux de téléphonie mobile laissent présager sa victoire dans cette course (MIU, 2025).
Toute la politique de Trump est une tentative désespérée de freiner l'avancée chinoise. Cette expansion ne faisait que commencer au début du millénaire, lorsque la première puissance a cessé de recevoir des transferts de revenus en sa faveur de la part de son partenaire asiatique. C'est là qu'a commencé un échange défavorable qui a aujourd'hui atteint un pic difficile à inverser.
Trump entend modifier ce scénario défavorable par des mesures drastiques. Mais l'écart entre les deux puissances ne tient pas seulement à des différences de politique monétaire, commerciale ou productive. Il réside dans la structure sociale et la gestion de l'Etat. En Chine, d'importantes classes capitalistes spéculent sur leurs fortunes et exploitent les travailleurs. Mais ces groupes ne contrôlent pas le pouvoir étatique, ce qui explique la capacité et l'autonomie de la direction politique à orienter l'économie selon des modèles efficaces.
Trump n'a pas de formule pour faire face à ce désavantage, qui dépasse toutes ses intentions et tous ses projets. Pour comble, il met en œuvre des mesures qui aggravent les deux grands maux du capitalisme contemporain : les inégalités sociales et le changement climatique. Il s'est lancé dans une bataille différée pour maintenir le leadership américain d'un système en crise, mais il accentue le déclin américain par les mesures qu'il adopte, modifie et réinstaure.
Le lexique impérial nostalgique
Trump tente de rétablir la centralité impériale des Etats-Unis. C'est le seul moyen de glorifier les capitalistes de son pays aux dépens du reste du monde. Le train de sanctions, de droits de douane et de chantages qu'il a mis en place exige de revitaliser l'empire.
Trump tente de rétablir cette primauté par des attitudes belliqueuses. Il se vante d'avoir réussi à faire négocier les droits de douane par 75 pays, après la frayeur provoquée par son tableau tarifaire. Mais il maquille la réalité avec des fanfaronnades qui occultent le déroulement réel des négociations.
Avec l'Union européenne, il aggrave un conflit qui a débuté avec l'introduction puis la suspension de droits de douane de 25%. Trump aspire à imposer un vassalisme européen qui lui permettrait de réindustrialiser son pays en désindustrialisant son partenaire transatlantique.
La première étape de cette opération consiste à réarmer le Vieux Continent, avec des dépenses en énergie, en technologie numérique et en équipements fournis par les Etats-Unis. Le potentat a semé la panique parmi les élites européennes qui, dans un élan de russophobie, se sont lancées dans un bellicisme aveugle. Elles réduisent les dépenses sociales et remplacent déjà la transition verte tant vantée par une transition grise, purement militaire.
Mais ce revirement n'est pas sans conflits et l'accord rapide que Trump espérait conclure avec Poutine (pour s'approprier les richesses de l'Ukraine) n'est pas seulement enlisé avec la Russie. Il a également déclenché un conflit sans précédent entre Washington et Londres pour déterminer qui empochera le butin des terres rares (Marco del Pont, 2025b).
Plus déterminantes encore sont es négociations avec les partenaires subordonnés en Asie. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines ont toujours répondu avec une discipline sans faille à leur parrain américain. Mais la grande nouveauté de ces dernières années est le renforcement des relations économiques de ces pays avec Pékin. L'ampleur de ces échanges commerciaux a suscité de sérieux doutes au sein du bloc anti-chinois promu par la Maison Blanche.
Trump déploie des messages impériaux explicites pour faire valoir ses exigences. Il utilise un lexique si direct que le début de son second mandat a suscité de nombreuses remarques journalistiques à ce sujet. La réticence traditionnelle des grands médias à utiliser le terme irritant d'impérialisme a été dissipée par la franchise du magnat (voir The New York Times du 21 janvier 2025, The Washington Post du 24 janvier 2025).
La même démonstration de puissance impériale a entouré l'annonce de la liste des droits de douane. Trump a pompeusement inclus dans cette liste tous les pays du monde pour souligner qu'aucun n'échappera au joug de Washington. Il n'a pas hésité à y inscrire des nations qui ne commercent pas avec les Etats-Unis ou à y ajouter des îles uniquement habitées par des pingouins. Mais les proclamations impériales du riche New-Yorkais contiennent plus d'ingrédients nostalgiques qu'efficaces. Trump regrette les actes de dirigeants lointains, qui ont combiné protectionnisme et expansion impériale pendant la gloire du capitalisme américain.
Il exalte avec une emphase particulière le président McKinley (1897-1901), qui s'est profilé comme un « Napoléon du protectionnisme ». Il a introduit une augmentation drastique de 38 à 50% des droits de douane (1890), tout en commandant l'expansion vers le Pacifique (Hawaï, Philippines, Guam) et la conquête des Caraïbes (Porto Rico et aspiration à Cuba). Trump idolâtre autant sa défense virulente de l'industrie que son extension du rayon territorial américain par les armes (Borón, 2025).
Mais cette évocation se heurte à la réalité du XXIe siècle. Trump ne peut pas mettre en œuvre le protectionnisme agressif de son idole et a choisi de combiner la pression tarifaire et la prudence militaire. Loin de reprendre les interventions du Pentagone partout dans le monde, il modère l'élan expansionniste afin de contenir la détérioration de la compétitivité économique états-unienne.
Dans un élan de réalisme, Trump a pris note de l'échec militaire de Bush et du revers économique de Biden. C'est pourquoi il tente une troisième voie, celle de la modération militaire et d'une refonte monétaire et commerciale. Il sait que la capacité offensive des Etats-Unis a été considérablement limitée par une économie qui représente 25% du PIB mondial (et non plus 50% en 1945), face à la Chine qui en représente 18%.
Trump accentue le discours interventionniste face à ses adversaires extérieurs. Comme ses prédécesseurs contemporains, il doit contrer le déclin économique en faisant largement étalage de la puissance géopolitique et militaire qui préserve son pays. Mais il sait que la compensation militaire des faiblesses économiques aggrave les tensions entre les secteurs militaristes et productivistes de l'establishment. Les bellicistes ont tendance à favoriser des campagnes destructrices à tout prix qui affectent le budget de l'Etat et détériorent la compétitivité des entreprises.
Trump navigue entre ces deux secteurs, soutenant la reprise économique par des mesures protectionnistes. Il encourage les dépenses militaires, mais limite les guerres et cherche à limiter l'effet négatif du gigantisme militaire sur la productivité. L'hypertrophie militaire imposée par le Pentagone est une maladie incurable dont souffre l'économie américaine depuis longtemps et que Trump ne peut tempérer.
Tensions locales
Les contradictions internes qui affectent le projet protectionniste ont la même portée que les tensions externes. Elles comportent un effet inflationniste comme menace la plus immédiate. Les droits de douane rendront les marchandises plus chères par la simple introduction d'un coût supplémentaire sur les produits importés.
Cet effet sera important, tant pour les denrées alimentaires de base que pour les produits manufacturés. Le Mexique fournit par exemple plus de 60% des biens alimentaires frais et on estime qu'un droit de douane de 25% sur les voitures fabriquées dans ce pays (ou au Canada) augmenterait le prix final de chaque unité de 3000 dollars. Récemment, Trump s'est félicité de la délocalisation décidée par Honda, qui va fabriquer sa nouvelle voiture Civic dans l'Indiana plutôt qu'à Guanajuato (Mexique). Mais ce transfert augmenterait le coût moyen de chaque voiture de 3000 à 10 000 dollars (Cason ; Brooks, 2025).
Il est vrai que l'inflation pourrait également contribuer à réduire la valeur réelle de la dette, mais son impact négatif sur l'ensemble de l'économie serait bien supérieur à cette réduction du passif.
Tous les analystes s'accordent à souligner l'effet récessif du virage protectionniste, qui pourrait entraîner une contraction de 1,5 à 2 points de pourcentage du PIB. Le ralentissement de l'activité, qui n'était pas prévu dans les prévisions économiques, est désormais une forte probabilité dans un avenir proche.
Cette perspective tend les relations de Trump avec la Réserve fédérale (FED), qui s'oppose à la baisse des taux d'intérêt. Trump encourage cette baisse afin de contrer la chute probable de la production, de la consommation et de l'emploi. L'effondrement des marchés déclenché par l'annonce de son programme protectionniste a aggravé ce sombre scénario et les disputes qui ont suivi entre le président et la direction de la FED (Jerome Powell).
Trump poursuit également sa bataille contre les secteurs mondialistes, qui défendent les intérêts des entreprises et des banques les plus internationalisées. L'élite de Davos est discréditée par ses échecs, mais elle attend l'occasion de reprendre l'offensive. Si les résultats du virage protectionniste sont négatifs, ce revers frappera fort et placera les démocrates en pole position dans la course aux élections de mi-mandat de 2026.
Le chef de la Maison Blanche s'est entouré d'hommes d'affaires en pleine ascension, qui se disputent avec leurs homologues du spectre traditionnel. L'establishment a donné son feu vert à son projet, mais s'attendait à des droits de douane modérés et à un comportement plus proche de la prudence du premier mandat de Trump [janvier 2017-janvier 2021]. Les bouleversements actuels les incitent à exiger un frein à la déferlante présidentielle. Les multimilliardaires sont exaspérés par la forte réduction de leur patrimoine causée par l'effondrement des marchés.
Les tensions s'étendent à l'entourage même du président, qui doit arbitrer entre les protectionnistes extrêmes (Peter Navarro, conseiller du président, entre autres sur le commerce) et les fonctionnaires ayant des investissements à l'étranger (Elon Musk). Le plan de contrôle des droits de douane conduit en outre à l'introduction d'un enchevêtrement de réglementations, qui s'oppose à la réduction de la bureaucratie promise par la nouvelle administration (Malacalza, 2025). Les innombrables conflits auxquels Trump est confronté dépassent largement le nombre de ceux qu'il peut résoudre.
Bonapartisme impérial
Les conflits extérieurs, l'absence de résultats immédiats, la forte opposition des mondialistes et la fragile cohésion interne poussent Trump à renforcer l'autoritarisme de son administration. C'est pourquoi il tentera à nouveau la voie bonapartiste qu'il a explorée sans succès lors de son premier mandat. Il doit également renforcer le pouvoir de la Maison Blanche pour faire face au repli des investissements des capitalistes états-uniens.
Trump vient du monde impitoyable des affaires et a l'habitude de négocier en tapant du poing sur la table pour obtenir des concessions de ses adversaires. Ce comportement le distingue de ses homologues du système politique, forgés par les négociations, les conciliabules et l'hypocrisie verbale.
Pour consolider son rôle central, il s'est lancé dans une hyperactivité et se distingue par la signature quotidienne d'innombrables décrets. Il cherche à centraliser le pouvoir pour déstabiliser ses opposants et privilégie la loyauté à toute autre qualité chez ses collaborateurs.
Il expérimente son côté bonapartiste dans la tradition américaine du leader charismatique. Il tente d'assumer un rôle messianique d'interprète de la nation, en stigmatisant les migrants et en dénigrant le progressisme. Avec ce personnalisme extrême, il cherche à renforcer l'image d'un homme prédestiné à réaliser le rêve américain. Mais cette orientation renforce les tensions avec l'establishment mondialiste, qui contrôle les médias les plus influents (Wisniewski, 2025).
Trump comble le vide laissé par le discrédit des politiciens traditionnels. Il profite du climat créé par le rejet des magouilles parlementaires douteuses et utilise les attributions du présidentialisme pour renforcer son image (Riley, 2018).
Il tient un discours proche de la tendance conservatrice, qui exacerbe l'opposition culturelle entre les Etats-Unis et le reste du monde. En opposition à la tradition assimilationniste, il rejette l'immigration latino-américaine et exalte la langue anglaise. Il glorifie les idéaux anglo-protestants de l'individualisme et de l'éthique du travail, méprisant la tradition hispanique, qu'il associe à la paresse et à l'absence d'ambition.
Le discours trumpiste reprend l'héritage protectionniste (Alexander Hamilton, « père du dollar ») et patriotique (Thomas Jefferson, président de 1801 à 1809) qui privilégie la prospérité intérieure (Andres Jackson, président de 1829 à 1837). Il conteste le libéralisme cosmopolite (Thomas Wilson, président de 1913 à 1921) qui associe ce bien-être à l'ouverture vers l'extérieur (Anzelini, 2025).
Avec cette vision, Trump régénère les postulats des souverainistes, qui ont traditionnellement privilégié le racisme et l'anticommunisme dans la détermination des alliances extérieures. La sympathie de cette tendance américaniste pour le nazisme a inclus dans le passé une affinité avec le Ku Klux Klan et l'apartheid sud-africain. Cet héritage est actuellement repris par Elon Musk et, dans cette veine, le trumpisme redouble ses campagnes contre le profil multiethnique, multiracial et multiculturel du Parti démocrate.
Le courant dirigé par le magnat exprime une variante ethnocentrique de l'impérialisme yankee, aussi éloignée du néoconservatisme républicain que du cosmopolitisme démocrate. Il met en avant les aspects identitaires de l'idéologie américaine et exalte le patriotisme réactionnaire comme élément essentiel de son credo. Mais avec cette adhésion idéologique, il participe au même conglomérat impérialiste que les deux autres courants.
Bush, Biden et Trump constituent trois modalités du même impérialisme qui maintient le capitalisme américain. Les différentes modalités de cette domination constituent des modalités internes d'un même bloc. L'impérialisme est une nécessité systémique du capitalisme qui fonctionne en confisquant les ressources de la périphérie, en évinçant les concurrents et en étouffant les rébellions populaires. Trump gouverne selon ces paramètres et sa brutalité révèle clairement cette affiliation.
Trajectoires, ambitions et résistances
Il est juste de qualifier Trump de capitaliste-lumpen, au sens où Marx désignait les spéculateurs financiers de la classe supérieure, impliqués dans de multiples fraudes. Le parcours du magnat réunit tous les ingrédients de ce modèle par le nombre d'escroqueries, d'évasions fiscales, de faillites frauduleuses, de transactions avec la mafia et de blanchiment d'argent qui ont marqué son passage dans les affaires. Il s'est entouré de personnages du même acabit, avec de lourds casiers judiciaires dans l'univers des cavernes financières (Farber, 2018).
Mais ce parcours personnel n'a pas caractérisé son premier mandat, ni ne définit son mandat actuel. Trump agit en tant que représentant de secteurs capitalistes très importants et dirige une administration fondée sur une coalition de groupes d'entreprises états-uniennes, comprenant des entreprises numériques qui ont pris leurs distances ave le mondialisme. Il s'appuie sur le secteur sidérurgique, le complexe militaro-industriel, la fraction conservatrice du pouvoir financier et les entreprises centrées sur le marché intérieur, qui ont été pénalisées par la concurrence chinoise (Merino ; Morgenfeld ; Aparicio, 2023 : 21-78).
Trump a obtenu son mandat actuel grâce au soutien d'une ploutocratie numérique, qui a mis de côté ses préférences pour les démocrates. Les cinq géants de l'informatique constituent actuellement le secteur dominant du capitalisme américain, qui a besoin de la belligérance trumpiste pour lutter contre ses rivaux asiatiques.
Plus controversée est la signification du nouveau pouvoir politique que les milliardaires du numérique obtiennent grâce à Trump. Ils ont déjà enchaîné le public à leurs réseaux et préservent leurs clients liés à un enchevêtrement d'algorithmes. Cette dépendance leur permet d'étendre leur lucrative intermédiation dans la publicité et les ventes. Ils tentent désormais de projeter ce pouvoir à une autre échelle, en prenant directement le contrôle de plusieurs domaines du gouvernement.
Ces groupes forment de puissants oligopoles que certains assimilent à de la prédation et à la captation de rente. C'est pourquoi ils utilisent le terme de « technoféodaux » pour conceptualiser leur activité (Cédric Durand, 2025).
D'autres approches contestent cette appellation, qui dilue le sens capitaliste d'entreprises clairement intégrées dans les circuits de l'accumulation. Leur leadership technologique leur permet de profiter de la plus-value extraordinaire qu'ils absorbent du reste du système. Ils n'évoluent pas dans le domaine des rentes naturelles et ne tirent pas de profits de la coercition extra-économique (Morozov, 2023).
Mais les deux visions s'accordent pour souligner la gestion inédite de la vie sociale qui a permis à un secteur de se lancer à la conquête de parts importantes du pouvoir politique. Sous la protection de Trump, elles cherchent avant tout à neutraliser toute tentative de régulation étatique des réseaux.
La ploutocratie numérique s'est lancée dans la gestion directe des leviers de l'Etat afin de modeler l'activité politique à son service. Certains auteurs utilisent la notion de « capitalisme politique » pour singulariser cette appropriation. Ils observent l'émergence d'un régime d'accumulation fondé sur la dépendance nouvelle des entreprises à l'égard d'un pouvoir politique qui définit les bénéficiaires avec une plus grande marge de manœuvre fiscale que par le passé. Le trumpisme pourrait être l'artisan de ces transformations intervenant au sommet du capitalisme (Riley ; Brenner, 2023).
Mais sa dérive autoritaire a déjà suscité la résistance dans les rues. Sous un slogan unificateur et mobilisateur [« Hands Off ! », le 5 avril, avec une suite le 20 avril], 150 organisations ont organisé une manifestation massive et réussie dans un millier de villes. Elles ont commencé à reprendre la réponse venue de la base à laquelle Trump s'est affronté lors de son premier mandat et qu'il a réussi à tempérer lors de son retour. Les grandes manifestations qui ont suivi ont montré le rejet du potentat et des oligarques qui l'entourent [voir le succès des meetings de Bernis Sanders placés sous le mot d'ordre « Fight Oligarchy » – réd.].
Les marches canalisent le mécontentement face à la réduction des droits démocratiques menée par l'occupant de la Maison Blanche. Si l'érosion de la légitimité interne de Trump se conjugue à la résistance qu'il suscite dans le monde, la voie sera ouverte à une grande bataille contre son gouvernement. De cette convergence pourrait émerger une alternative qui commencerait à remplacer l'oppression impériale par la fraternité des peuples. (Buenos Aires, 15 avril 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Claudio Katz, membre des Economistes de gauche (EDI), chercheur du CONICET, professeur à l'Université de Buenos Aires.
Références
– Torres López, Juan (2025). ¿Y si lo de Trump no es una simple locura personal ?, 4-4, https://juantorreslopez.com/y-si-lo-de-trump-no-es-una-simple-locura-personal/
– Varoufakis, Yanis (2025). El plan maestro económico de Donald Trump, 19-2 https://www.sinpermiso.info/textos/el-plan-maestro-de-donald-trump-para-la-economia
– Litvinoff, Nicolás (2025). Tump, stablecoins y poder : el plan para sostener la hegemonía financiera de EE.UU. 1-4 https://www.lanacion.com.ar/economia/trump-stablecoins-y-poder-el-plan-para-sostener-la-hegemonia-financiera-de-eeuu-nid01042025/
– Sapir, Jacques (2024) Los BRICS desafían el orden occidental, 4-11 https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2024/11/04/los-brics-desafian-el-orden-occidental-el-fin-de-la-hegemonia-del-dolar-esta-a-la-vista-jaques-sapir/
– Gang Gong (2025). https://www.brasildefato.com.br/2025/04/14/can-the-global-south-get-out-of-the-us-dominated-financial-system/
– Marcó del Pont, Alejandro (2025a). La nueva estrategia económica de EE.UU (II) : la explosión controlada 07/04 https://rebelion.org/la-nueva-estrategia-economica-de-ee-uu-ii-la-explosion-controlada/
– Roberts, Michael (2025a). Aranceles de Trump : algunos datos y consecuencias (de varias fuentes) 4-4 https://www.laizquierdadiario.com/Aranceles-de-Trump-algunos-datos-y-consecuencias-de-varias-fuentes
– Roberts, Michael (2025b). Guerra arancelaria : ¿El Día de la Liberación ? 02/04 https://sinpermiso.info/textos/guerra-arancelaria-el-dia-de-la-liberacion
– Nuñez, Rodrigo (2025). La suba de aranceles causará déficit de la balanza comercial y provincias en rojo, 3-4 destapeweb.com/economia/comercio/deficit-de-la-balanza-comercial-y-provincias-con-perdidas-millonarias-los-escenarios-que-se-manejan-ante-la-suba-de-aranceles-impuesta-por-trump-2025431221
– Tooze, Adam (2025) « Sólo he cometido el error de creer en vosotros, los americanos ». 06/04 https://www.sinpermiso.info/textos/solo-he-cometido-el-error-de-creer-en-vosotros-los-americanos-el-dia-despues-del-dia-de-la
– Mercatante Esteban (2025) Trump, ingeniero del caos, 6-4, https://www.laizquierdadiario.com/Trump-ingeniero-del-caos
– Ríos, Xulio (2025). Ocho ideas sobre el trumpismo y la relación con China, 14-03 https://politica-china.org/areas/politica-exterior/ocho-ideas-sobre-el-trumpismo-y-la-relacion-con-china
– MIU (2025). Cosas que ha hecho China en los 30 días que Trump ha sido presidente https://miu.do/cosas-que-ha-hecho-china-en-los-30-dias-que-trump-ha-sido-presidente/
– Marcó del Pont, Alejandro (2025b). La guerra silenciosa : Reino Unido vs. EE.UU 10/04 https://www.elextremosur.com/nota/53595-la-guerra-silenciosa-reino-unido-vs-ee-uu-por-el-control-de-ucrania/
– Boron, Atilio (2025). Trump y su lejano precursor, 9-2https://atilioboron.com.ar/trump-y-su-lejano-precursor/
– Cason, Jim ; Brooks, David (2025). Trump confirma aranceles ; ya no hay espacio, 4-3 https://www.jornada.com.mx/2025/03/04/economia/003n1eco
– Malacalza, Bernabé (2025). El “poder oscuro” de Trump en América Latina 9-2 https://www.eldiplo.org/notas-web/trump-contra-america-latina-entre-sus-deseos-y-sus-limites/
– Wisniewski, Maciek (2025). Estados Unidos. Trump y el neobonapartismo https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/02/28/estados-unidos-trump-y-el-neobonapartismo/
– Riley, Dylan (2018). Theses on Fascism and Trumpism https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sase.org/wp-content/uploads/2018/05/2-Riley-final.pdf
– Anzelini, Luciano (2025). Etnocentrista, jacksoniano y soberanista, 9-3 https://www.elcohetealaluna.com/etnocentrista-jacksoniano-y-soberanista/
– Farber, Samuel (2018). Donald Trump, un lumpencapitalista, Sin permiso, 4/11 https://www.sinpermiso.info/textos/donald-trump-un-lumpencapitalista
– Merino, Gabriel ; Morgenfeld, Leandro ; Aparicio, Mariana (2023). Las estrategias de inserción internacional de América Latina frente a la crisis de la hegemonía estadounidense y del multilateralismo globalista. Nuevos mapas. Crisis y desafíos en un mundo multipolar, Buenos Aires
– Durand, Cédric (2025) Desborde reaccionario del capitalismo : la hipó tesis tecnofeudal Entrevista https://nuso.org/articulo/315-desborde-reaccionario-del-capitalismo-la-hipotesis-tecnofeudal/
– Morozov, Evgeny (2023). No, no es tecnofeudalismo, sigue siendo capitalismo https://jacobinlat.com/2023/04/esto-sigue-siendo-capitalismo2/
– Riley, Dylan ; Brenner, Robert (2023). Siete tesis sobre la política estadounidense”, NewLeftReview : https://newleftreview.es/issues/138/articles/seven-theses-on-american-politics-translation.pdf
Article initialement publié le 21 avril sur le site d'A l'encontre
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Leur laïcité et la nôtre

À notre époque marquée par la montée des sentiments anti-immigration et la radicalisation de la droite, la lutte pour une laïcité égalitaire et contre l'islamophobie devrait être une priorité pour toute la gauche. C'est ce que nous enseignent les derniers développements à ce sujet au Québec, avec le projet de loi 94 et le rapport Pelchat-Rousseau. C'est aussi ce qui ressort d'une analyse des usages de l'islamophobie et des visions répressives et discriminatoires de la laïcité dans d'autres sociétés. Le mouvement syndical devrait placer cet enjeu haut dans sa liste de priorités. Québec solidaire, de son côté, devrait écarter des conceptions stratégiques autour de ces enjeux qui étaient fondées sur une mauvaise lecture du contexte et n'étaient pas à la hauteur des valeurs du parti. Toute la gauche doit maintenant passer à l'offensive sur ce terrain, aussi miné soit-il.
Benoit Renaud, 1er septembre 2025 | Caricature : Kaël Mercader
La pente glissante de la panique identitaire
Depuis l'adoption de la Loi 21 en juin 2019, le gouvernement de la CAQ et l'opposition péquiste se sont relayés constamment dans une surenchère de panique identitaire sur des sujets comme la langue, l'immigration et la laïcité. Les personnes migrantes, en particulier celles qui sont visiblement de religion musulmane (principalement les femmes qui portent un hijab), sont présentées comme des menaces pour la survie de la nation. La seule véritable division entre la CAQ et le PQ sur cette question est que la CAQ affirme pouvoir faire face à la “menace” en utilisant les pouvoirs accordés aux provinces, tandis que le PQ avance que seule l'indépendance permettra d'y remédier.
L'idée que l'indépendance serait nécessaire pour instaurer un régime de laïcité discriminatoire et réduire considérablement l'immigration est la conclusion logique de l'évolution du PQ depuis son virage identitaire de 2007. Ce virage n'a convaincu personne de devenir indépendantiste et constitue en fait un repoussoir pour bien des gens dégoûtés de la xénophobie ordinaire qui alimente cette vision déprimante du projet national. On se retrouve donc avec un PQ qui pourrait prendre le pouvoir à la faveur de l'usure de la CAQ, avec à peine le tiers des votes, incluant un bon nombre de personnes ayant l'intention de voter Non advenant un référendum. L'échec de cette dernière phase dans l'évolution du PQ est donc assuré et pourrait remettre en cause l'idée même d'indépendance pour longtemps. (Nous y reviendrons dans un texte à venir.)
De son côté, le gouvernement Legault - qui présentait la Loi 21 il y a à peine six ans comme un grand compromis qui mettrait fin au débat - est désormais engagé dans un effort d'élargissement de sa politique de laïcité discriminatoire et répressive dans toutes les directions. Les justifications pour cette dégringolade sur la pente glissante sont nourries par les efforts insistants des chroniqueurs de droite et des organisations engagées depuis des années dans un effort pour amener le Québec vers le modèle français de laïcité, lui-même engagé dans sa propre pente glissante perpétuelle. La motivation pour cette radicalisation identitaire se trouve aussi bien entendu dans la chute dramatique de la CAQ dans les sondages depuis l'élection triomphale de 2022. Les projections de qc125.com indiquent que ce parti pourrait être rayé de la carte l'an prochain.
Rappelons que le projet de loi 94, présenté par le ministre de l'éducation Bernard Drainville (le même qui parrainait la Charte des valeurs en 2013), propose d'étendre l'interdiction des signes d'appartenance religieuse à toutes les personnes adultes fréquentant les écoles publiques, incluant certaines catégories de bénévoles. Les écoles, qui sont constamment en crise de manque de personnel qualifié, n'ont rien demandé de tel. À ce sujet, nous vous invitons à signer la déclaration de la Ligue des droits et libertés.
De son côté, le comité Pelchat-Rousseau, mis sur pied lors de la dernière vague de panique identitaire suite à un scandale impliquant une école publique montréalaise, recommande d'appliquer la Loi 21 aux CPE et aux garderies subventionnées, en plus de miner encore davantage la Charte des droits et libertés de la personne en mettant leur version de la laïcité au même niveau que les droits fondamentaux. La gauche peut appuyer certaines des 50 recommandations du comité, notamment la fin des subventions publiques aux écoles privées confessionnelles. Mais pour l'essentiel, ce rapport sert à cautionner des attaques contre les droits et libertés que le gouvernement avait déjà en tête et qui seront sans doute approuvées par le PQ.
Du côté du PQ, qui ne va pas se laisser dépasser par la CAQ sur ce terrain, on parle même maintenant d'interdire les prières “de rue”, donc en public, ce qui correspond à une longue tradition catholique notamment au Québec, et d'interdire les signes religieux aux élèves, comme en France. La pente continue à glisser inexorablement.
On voit très bien dans ces nouvelles offensives que l'enjeu central est la peur irrationnelle (une phobie pure et simple) que “nos enfants” pourraient être affectés négativement par la fréquentation quotidienne de femmes portant des foulards. Comme si l'Islam était une maladie contagieuse. Comme si la discrimination et le racisme ordinaire vécu par ces femmes était une perspective attirante. Tout ce qu'on enseigne à “nos jeunes” avec ce genre de politique, c'est l'intolérance et les préjugés.
Les usages de l'islamophobie et de la laïcité discriminatoire
Le débat théorique sur la définition de la “vraie laïcité” est futile et ne permet pas de s'orienter politiquement. Ce concept à géométrie variable et en constante évolution peut être redéfini pour servir différents intérêts dans une société capitaliste marquée par l'exploitation et l'aliénation. En tant que militantes et militants de gauche, on doit choisir le modèle de laïcité qui permet de construire la solidarité parmi les classes subalternes dans cette société, contre ceux et celles qui veulent nous diviser pour mieux régner.
Ce qui est clair, par contre, est que la nouvelle version de la laïcité développée en France au tournant du présent siècle ne sert pas les mêmes finalités que la laïcité développée dans le même pays un siècle plus tôt. En 1905, le but de la laïcité était de réaliser le principe de l'égalité dans la citoyenneté en mettant fin aux privilèges de la majorité catholique. Elle permettait donc d'intégrer à la nation les minorités religieuses et les personnes sans croyances religieuses. Maintenant, on utilise la laïcité dans le but contraire de marginaliser et d'ostraciser les minorités religieuses et de créer deux catégories de citoyennes et de citoyens. En France, il s'agit essentiellement d'un instrument dans une lutte contre la minorité musulmane. Ce n'est pas un hasard si l'extrême-droite, qui faisait campagne contre les Arabes dans les années 1980, mène maintenant un combat contre les Musulmans, au nom de la laïcité.
L'autre usage de l'islamophobie, qui ne va pas forcément de pair avec une vision particulière de la laïcité, est de justifier des opérations impérialistes et coloniales, le militarisme et l'État sécuritaire. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, toute une série d'invasions, de bombardements et d'occupations ont été menées avec en arrière plan idéologique la caricature des populations des pays à majorité musulmane, associées par amalgame aux terroristes. Les motivations profondes pour ces guerres se trouvant dans la compétition pour le contrôle des régions riches en pétrole, on peut affirmer sans exagérer que la lutte contre l'islamophobie est aussi une question de justice climatique.
C'est aussi notamment avec cette rhétorique que l'État israélien justifie présentement son génocide en Palestine occupée. On blâme les 2 millions d'habitants de Gaza pour les attaques du 7 octobre 2024. On présente le Hamas non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un aspect indissociable d'une société qu'on doit faire complètement disparaître au nom de la “sécurité”.
Au Québec, l'influence de ces courants d'idées a déjà mené à des divisions importantes dans le mouvement des femmes (création de PDF en rupture avec la FFQ) et cause encore des tensions dans le mouvement syndical (opposition de membres de la FAE à la contestation de la Loi 21 par ce syndicat). La stigmatisation des personnes visiblement religieuse contribue aussi à un climat d'hostilité générale envers l'immigration et nourrit les discours et les organisations d'extrême-droite.
Deux mauvaises stratégies pour Québec Solidaire
La direction politique de Québec solidaire a adopté deux grandes orientations stratégiques autour des enjeux de laïcité. La première, qui correspond en gros à la période de 2009 à 2019, a consisté à chercher un grand compromis historique sur ces questions, en espérant mettre fin au débat pénible qui avait été lancé avec la fausse crise des accommodements raisonnables en 2007. La logique de cette position était à son plus fort durant le gouvernement Marois, face à la proposition de Charte des valeurs québécoises. Il s'agissait alors d'une position défensive qui cherchait à démontrer l'intransigeance du PQ sur le sujet et à mettre fin à la torture mentale des attaques incessantes des médias contre les minorités religieuses. Elle s'est incarnée dans un projet de loi présenté par Françoise David, lequel reprenait essentiellement les recommandations du rapport Bouchard-Taylor, incluant l'interdiction des “signes religieux” pour les personnes détenant une “autorité coercitive” (policiers, gardiens de prison, procureurs, juges).
Au-delà du débat sur l'interprétation du programme du parti autour de ces questions, qui pourrait faire l'objet d'un assez long texte, on se doit de critiquer cette position à deux niveaux. D'abord, elle n'était pas fondée sur une solidarité sans réserve avec les personnes ciblées par l'islamophobie et la xénophobie contenues implicitement dans ces propositions d'interdiction. On croyait agir pour leur bien en “mettant fin au débat”. Mais en fait, on ouvrait la porte à ce qui se passe depuis l'élection de 2018 en acceptant l'idée que les “signes religieux” constitueraient un réel problème et une entorse au principe de la laïcité.
Ensuite, la position était fondée sur une mauvaise analyse de la situation idéologique et sociale. L'idée qu'on pourrait mettre fin aux débats sur la visibilité des minorités culturelles et religieuse en adoptant une loi quelconque (que ce soit la Charte du PQ, le projet de QS ou la Loi 21 de la CAQ), représentait un déni face à la réalité de la montée des intolérances et du conservatisme identitaire à l'échelle mondiale. Les épisodes récents mentionnés plus haut le démontrent clairement. Toute l'histoire des débats sur le même sujet en France depuis 2005 auraient dû nous en convaincre il y a longtemps. La polarisation idéologique et la radicalisation de la droite constituent les réponses rétrogrades inévitables à la crise profonde du capitalisme et de l'ordre géopolitique mondial. On n'y échappe pas. Tout ce qu'on peut faire est de pousser de toutes nos forces dans la direction opposée.
La seconde mauvaise conception, qui a prédominé à partir du rejet de l'option Bouchard-Taylor en conseil national (mars 2019) et semble toujours être en vogue maintenant, a consisté à éviter le sujet, parce que, semble-t-il, ce ne serait pas à l'avantage du parti de le mettre de l'avant. Ici encore, on fait face à la fois à un manquement éthique et à une erreur stratégique. Un parti de gauche conséquent et ferme sur ses principes devrait accorder une grande importance à la lutte pour les droits des personnes marginalisées et discriminées, même si celles-ci sont peu nombreuses et même si leurs enjeux ne sont pas vus comme importants par la majorité de la population. C'est le cas pour les communautés autochtones, pour les personnes trans ou non-binaires, pour les personnes en situation de handicap, etc. Ça devrait aussi être le cas pour les personnes qui portent des signes religieux et veulent travailler dans l'enseignement, la police, etc.
Sur le plan stratégique, cette position place Québec solidaire dans une posture défensive et hésitante, laissant l'initiative à la droite et au gouvernement. Elle nous empêche aussi de miser sur une opposition claire et conséquente à toute forme de discrimination pour rallier autour du parti les personnes et les communautés visées directement ou indirectement par les mauvaises lois en place et celles qui se préparent. Notre vision de l'indépendance du Québec devrait se démarquer clairement de celle du PQ, notamment par notre vision d'une société unie autour d'un projet commun respectant les droits de tout le monde. Comme le disait si bien Catherine Dorion, “un pays ce n'est pas du monde tous pareil, c'est du monde tous ensemble”.
La gauche sociale et politique doit prendre le contre-pied de toutes ces mauvaises idées et ramer de toutes ses forces contre le courant xénophobe intensifié par la victoire électorale de Trump. La polarisation est inévitable et l'idée même d'un compromis est clairement intenable. Pour Québec solidaire, qui fait présentement face à un paysage politique hostile et un rétrécissement de ses appuis, la clarté des principes et l'audace stratégique sont devenus des instruments essentiels à la survie de son projet politique. On doit affirmer sans hésiter que l'indépendance sera antiraciste, décoloniale et inclusive ou ne se réalisera pas.
Benoit Renaud, 1er septembre 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Parti de la rue : par et pour la base

Le Parti de la rue est un collectif dans lequel nous nous regroupons entre militant·es, activistes, féministes, syndicalistes, travailleur·euses, écologistes, pour affirmer sans détour nos valeurs de gauche, anticapitalistes et antiracistes. Nous partageons une volonté de construire une base militante solide et réseautée, formée principalement de membres de Québec solidaire, notre unique véhicule politique de gauche, mais aussi de différentes mouvances sociales de la gauche québécoise.
Nos fondements
Nous sommes un lieu de rassemblement et de réflexion pour celles et ceux qui se sentent déçus des orientations moins assurées de Québec solidaire depuis les dernières années. Un virage pragmatique imposé, un recentrage de nos valeurs et une démocratie interne plus éteinte ont contribué à une démobilisation et à des résultats décevants. Nous voulons voir ce parti redevenir un fier représentant de la gauche et maintenir vivantes les valeurs qui nous définissent et nous distinguent des autres partis.
Nous sommes l'aile la plus à gauche de Québec solidaire et nous aspirons à redonner la motivation et l'espoir nécessaire pour continuer à faire avancer et rayonner les valeurs et les idées progressistes que nous défendons. Pour arriver à une nécessaire transformation sociale, nous devons unir les forces progressistes et créer des ponts entre le politique et la société. QS étant la voie politique pour instaurer ce changement, il est impensable qu'il puisse opérer en silo. Le véhicule politique de gauche a besoin des mouvements sociaux, syndicaux et communautaires pour se faire porter, autant que la société civile a besoin de cette voix qui portera le message à l'Assemblée nationale.
Nous sommes le pont entre la gauche politique et la gauche sociale, le lien entre Québec solidaire et le Québec solidaire de ses valeurs de gauche, le souffle entre le discours et l'action.
Nous sommes de celles et ceux qui œuvrent à mettre sur pied un front uni de la gauche pour faire face à la droite conservatrices et néofasciste et préparer une offensive commune efficace et coordonnée. Nous travaillons à réunir les forces progressistes, les luttes anticapitalistes et les mouvements de gauche pour mettre en commun nos réseaux et nos forces et organiser la résistance.
Nos orientations
Le capitalisme ne sera jamais vert, inclusif, postcolonial ou équitable. Ce système est indissociable de l'exploitation outrancière des ressources naturelles et humaines, de l'oppression et du pillage. Pour pouvoir agir concrètement sur les crises économiques, sociales, écologiques et les différentes formes d'oppression patriarcale ou raciste, il faut en finir avec le système capitaliste et instaurer une société écosocialiste et écoféministe. Pour y arriver il faut avancer des perspectives concrètes qui permettent de présenter des pistes de solution, comme le proposent les revendications suivantes :
- La remise en question de l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre énergie par des multinationales étrangères, la socialisation de ces ressources et l'instauration de leur contrôle démocratique.
- Se donner les moyens de financer la transition écologique, une décroissance dans l'utilisation des énergies et des ressources et une production centrée sur les besoins et le bien-vivre.
- L'élection d'une constituante visant l'établissement d'une république sociale et indépendante, ce qui demande, en pratique, la remise en question de l'État colonial et capitaliste canadien, en solidarité avec les peuples autochtones et les forces progressistes du reste du Canada.
- La lutte pour une société écoféministe.
- Le développement de nos services publics contrôlés par les usagers et les usagères et les personnes qui y travaillent.
- La liberté de circulation et d'installation de toutes les personnes migrantes et l'éradication du racisme systémique qui touche tant les peuples autochtones que les autres secteurs racisés de la population.
- La construction d'un réseau de solidarité altermondialiste visant l'émancipation des peuples.
Notre stratégie
Une telle transformation sociale ne peut pas se réaliser par la simple formation d'un gouvernement, aussi bien intentionné soit-il. Face à l'ampleur de la crise capitaliste et ses conséquences, la stratégie que nous défendons ne peut se réduire à une stratégie électoraliste alternative pour la construction d'un parti de gouvernement. Nous défendons une stratégie visant à construire le pouvoir dans la société par le renforcement de l'expression démocratique, de la combativité et de l'unité des différents mouvements sociaux. En plus de gagner les élections, pour réaliser notre projet de société, il va falloir trouver le chemin vers une économie autogérée, démocratique, décentralisée, mise au service des humains et respectueuse des limites écologiques. C'est par l'entremise des mouvements sociaux que nous allons construire ce chemin. La rupture avec le capitalisme ne pourra pas être le résultat seul de politiques gouvernementales, fussent-elles celles d'un parti de gauche.
De plus, la formation d'un gouvernement solidaire n'est concevable que sur la base de mobilisations sans précédent de l'ensemble des mouvements sociaux, en conjonction avec la croissance du parti. Avant de « prendre le pouvoir », il faut commencer à construire la volonté et la capacité politique de changer la société. Le Parti de la rue doit être le fondement pour que Québec solidaire ait un enracinement solide pour opérer ces changements et rendre possible le succès du parti des urnes.
Nos objectifs
Afin de rendre concrètes ces perspectives, Le Parti de la rue s'articulera autour d'actions concrètes et se déploiera de différentes manières pour agir sur les transformations de société qui doivent être faites.
Pour y parvenir, nous allons :
- Donner la priorité à l'intervention dans les mouvements sociaux comme forces essentielles de transformation sociale et d'émancipation. Construire une gauche écosocialiste dans les mouvements sociaux, mouvement syndical, mouvement écologiste, mouvement féministe et mouvement des jeunes ;
- Proposer des orientations précises dans les débats au sein de Québec solidaire, ce qui implique l'élaboration de tout un éventail de propositions : au niveau du programme, de la plate-forme, de campagnes et d'initiatives militantes, ainsi que l'amélioration de la démocratie interne. Nous veillerons à ce que Québec solidaire s'enracine dans les mouvements sociaux et participe activement aux luttes sociales ;
- Appuyer résolument les mobilisations sociales en cours et favoriser leur convergence dans un front uni des luttes contre l'antisyndicalisme du patronat et des gouvernements, l'austérité et la montée de l'extrême droite ;
- Faire connaître publiquement les débats qui traversent la gauche politique en tenant des assemblées publiques tenues sur une base régulière en collaboration avec des militant-es, des organismes et des regroupements de la gauche sociale ;
- Regrouper la gauche radicale des mouvements sociaux et de Québec solidaire autour de notre orientation politique et stratégique.
***
Le Parti de la rue, par sa capacité à rassembler les militant.e.s les plus à gauche de Québec solidaire et des différentes sphères de la société, construit les ponts nécessaires entre la gauche politique et de la gauche sociale. Nous aspirons à permettre des espaces de réflexions sains et constructifs, alimentés par les différents mouvements sociaux et notre désir de voir notre seul véhicule politique progressiste se déployer et prendre la place qui lui revient.
Les prochaines élections de 2026 ne seront pas faciles pour la gauche. Si Québec solidaire souhaite devenir le parti des urnes, il doit avant tout être celui de la rue. La conjoncture actuelle nous offre une brèche : avec la montée de la droite conservatrice, elle nous place dans un moment de crise propice pour que la gauche réagisse, s'organise et prenne sa place. Le Parti de la rue peut devenir un acteur important du débat démocratique, pour se reconstruire, se relever et rester mobilisé. À nous d'agir.
Le Parti de la rue
3 juin 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La course liberticide CAQ-PQ vers le fond du baril des Conservateurs

L'odeur des élections — dans un an le Québec sera en campagne électorale — donne un goût acide à la sauce identitaire. La CAQ, enlisée dans le scandale SAAQ-Clic et le rejet par l'électorat va au-delà des recommandations de son comité Pelchat-Rousseau pourtant mis sur pied pour justifier sa nouvelle offensive identitariste pour ne pas dire islamophobe.
L'affaire des prières dans la rue est pourtant simple à comprendre au niveau des droits démocratiques comme l'expliquait à la Presse la Ligue des droits et libertés :
Ces images de prière collective peuvent rendre mal à l'aise, mais on ne doit pas les interdire pour autant. Elles sont protégées par la liberté d'expression, la liberté de manifester et la liberté de religion, garanties par nos chartes. Défendre ces libertés, c'est parfois défendre des idées ou des gestes qui peuvent déranger.
Bien sûr, ces libertés ne sont pas absolues. Elles peuvent être restreintes de façon raisonnable. Elles le sont d'ailleurs déjà : on ne peut pas manifester en entravant la circulation, en dénaturant l'utilisation d'un lieu public ou en empêchant d'autres citoyens de profiter d'un parc, en vertu des règlements municipaux.
« Le droit de ne pas être offensé, ça n'existe pas. Tant qu'elles ne nuisent pas à la circulation, à la sécurité, à l'utilisation du parc, il faut vivre avec ce genre de manifestations dans une société qui se dit libérale et plurielle », dit Pierre Bosset, professeur en droits et libertés à l'UQAM.
Cet énoncé devrait suffire pour toute personne le moindrement démocratique. Après tout, quand le pape est en visite, on bloque bien les rues pour le recevoir ! Que la CAQ se laisse aller à son désespoir électoraliste pourrait ne provoquer qu'un sourire en coin… si elle n'avait pas le pouvoir de faire voter des lois réactionnaires appuyées par le Mouvement laïque devenu superlaïque pour sa plus grande honte. Même là on pourrait se dire que le prochain gouvernement, que les sondages annoncent comme celui du PQ, aura tôt fait de siffler la fin de la réaction. Eh bien non ! Le PQ en rajoute non par désespoir mais par espoir de conquérir le restant du vote caquiste et du vote Conservateur. On ne sait trop s'il y aura un référendum sur l'indépendance comme promis à l'encontre des conseils de prudence du mentor Lucien Bouchard. Mais il y en aura un immédiat sur la super-laïcité niant l'historique laïcité étatique, et non celle des lieux publics et de l'expression vestimentaire, un des piliers des droits démocratiques.
Il y a mieux à faire pour commencer à régler les problèmes qui accablent le peuple-travailleur en ces temps de virage vers l'extrême-droite durcissant et cristallisant le néolibéralisme. Comme le dit pertinemment le Forum musulman canadien : « À l'heure où les Québécois sont confrontés à un système de santé défaillant, au fiasco de la SAAQclic, à la flambée des coûts du logement et à l'augmentation du coût de la vie, le gouvernement de la CAQ devrait se concentrer sur la résolution des problèmes réels, et non sur le contrôle des droits fondamentaux de ses citoyens. » Il aurait pu ajouter les problèmes climatiques qui commencent à devenir des problèmes immédiats tels que la pénurie (ou la surabondance momentanée) de cette ressource vitale qu'est l'eau sans compter les canicules qui s'enchaînent à l'encontre de la santé quand ce n'est pas de la vie des pauvres et des travailleurs et travailleuses sans air climatisé.
Il ne suffit cependant pas de détourner les yeux de cette offensive raciste afin de s'occuper des « vrais affaires » du peuple-travailleur, et non pas de celles des affairistes assoiffés de grands projets climaticides ou pseudo pro-climat rentabilisant un grand capital à coups de généreuses subventions et garanties étatiques imposant une austérité permanente. Pendant que les Libéraux regardent le train passer sans rien dire, Québec solidaire se targue de poser les vraies questions (FB de Ruba Ghazal du 28 août) mais en évitant tout énoncé de politique spécifique. En y regardant de plus près, on constate que le parti se contente de ne pas cocher les cases incriminantes tout en ignorant de lister toute politique pro-active anti-raciste. À quand cette reconnaissance du racisme systémique qui pénètre société et institutions québécoises jusque dans la moelle de ses os ? À quand l'engagement à mettre sur pied cette commission de vérité pour révéler les mille et unes manifestations de ce racisme et qui de ce fait puisse purger la société québécoise de ce cancer permettant à l'ennemi capitaliste de désigner le racisé et l'étranger comme le grand responsable des misères populaires ?
Marc Bonhomme, 29 août 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Palestine, le Soudan et l’indifférence du Nord mondial

Les famines de Gaza et du Soudan : comment se comparent-elles et quelles leçons tirer de l'inaction des puissances mondiales à leur égard ?
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
26 août 2025
Par Gilbert Achcar
Le Financial Times a publié lundi dernier un article s'appuyant sur les rapports de la Classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) pour mettre en garde contre l'incidence croissante de la famine dans le monde en se concentrant sur les deux crises actuelles les plus graves : les famines à Gaza et au Soudan.
L'IPC a été développée par l'Unité d'analyse de la sécurité alimentaire (FSAU) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Elle a été élaborée il y a environ 20 ans, en réponse à l'aggravation de la famine en Somalie. L'IPC utilise une échelle standardisée qui prend en compte les données de sécurité alimentaire, les scores nutritionnels et les moyens de subsistance disponibles dans chaque crise, ce qui permet d'en évaluer la gravité et de comparer les crises afin d'identifier les plus graves.
Le pire des niveaux de la classification de la FSAU est la phase 5 de Catastrophe / Famine. Dans cette dernière condition, « au moins un ménage sur cinq (soit 20 %) souffre d'un manque extrême de nourriture et est confronté à la famine, ce qui entraîne la mort, la misère et des niveaux extrêmement critiques de malnutrition aiguë ».
La description de la famine se poursuit ainsi : « Dans cette phase, la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans dépasse 30 %, et les ménages ont atteint un point de dénuement et de mort ».
Avant la phase de catastrophe / famine, il y a la phase d'urgence, au cours de laquelle les familles souffrent de « grands écarts de consommation alimentaire qui se traduisent par une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité », ou bien elles sont contraintes de recourir à des mesures extrêmes pour éviter la famine, comme la liquidation de leurs quelques biens restants.
Étant donné que la population du Soudan (environ 50 millions) est vingt-cinq fois supérieure à celle de Gaza (environ 2,2 millions), le premier fait qui saute aux yeux dans les données de l'IPC est le nombre de personnes confrontées à un état de catastrophe / famine dans chaque cas. Ce nombre dans la bande de Gaza (641 000) est supérieur à celui du Soudan (637 000).
Quant au nombre de personnes confrontées à l'état d'urgence au Soudan (8 100 000), il n'est qu'un peu plus de sept fois supérieur à celui de Gaza (1 140 000). Dans l'ensemble, les données de l'IPC indiquent que l'ensemble de la population de la bande de Gaza et près de la moitié de la population soudanaise souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui nécessite une action urgente pour empêcher leur état de s'aggraver.
Étant donné que l'attention du monde est braquée sur Gaza bien plus que sur ce qui se passe au Soudan, et vu que tout le monde sait que la famine dans la bande de Gaza n'est pas un phénomène naturel ni le résultat d'un manque d'aide humanitaire, mais que cette aide est disponible aux portes de Gaza en quantités suffisantes pour y empêcher la propagation de la faim si ces portes étaient ouvertes, la première conclusion qui découle des chiffres ci-dessus est que la famine à Gaza est le résultat d'une tentative délibérée d'étouffer sa population. Cela fait partie de la guerre génocidaire que l'État israélien mène contre eux, dans le but d'en tuer un grand nombre et de forcer la plupart des autres à émigrer.
La deuxième leçon des données susmentionnées est que la conscience aiguë qu'a le monde de ce qui se passe dans la bande de Gaza augmente considérablement la responsabilité des pays qui sont capables d'exercer une pression efficace sur l'État sioniste. Outre le rôle primordial joué par les États-Unis à cet égard, ces pays comprennent l'Union européenne et la plupart des États occidentaux, mais aussi la Russie et la Chine.
Soit ces États sont complices du génocide, soit ils ne sont pas suffisamment concernés pour prendre des mesures effectives pour l'arrêter (ou alors ils sont occupés à mener leur propre guerre d'agression, comme la Russie l'est en Ukraine). Le fait est que tous les pays en question ont des liens économiques, militaires et politiques multiformes avec Israël, qui ont jusqu'à présent prévalu sur la nécessité d'arrêter le génocide.
La troisième leçon est l'indifférence répugnante du monde à ce qui se passe au Soudan. Il s'agit de la crise humanitaire la plus grave de notre monde contemporain, les chiffres terrifiants de l'insécurité alimentaire étant aggravés par le déplacement d'environ quinze millions de personnes à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières du pays.
Alors que l'horreur de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza est visible sur les écrans du monde entier tous les jours, voire toutes les heures, l'horreur de ce qui se passe au Soudan – qu'il s'agisse de la guerre criminelle dans laquelle les deux factions militaires soudanaises se battent aux dépens de la population, ou du génocide que les Forces de soutien rapide ont recommencé à perpétrer au Darfour – est presque complètement ignorée par les médias occidentaux, hormis des rapport isolés et occasionnels.
Cette disparité d'attention nous rappelle, une fois de plus, ce que Mahmoud Darwish avait dit à la poétesse israélienne Helit Yeshurun lors d'un entretien qu'elle réalisa avec lui en 1996 : « Savez-vous pourquoi nous sommes célèbres, nous autres Palestiniens ? Parce que vous êtes notre ennemi. L'intérêt pour la question palestinienne a découlé de l'intérêt porté à la question juive. Oui. C'est à vous qu'on s'intéresse, pas à moi ! […] L'intérêt international pour la question palestinienne n'est qu'un reflet de l'intérêt pour la question juive » (voir « Rafah et El Fasher : guerre génocidaire et devoir de solidarité », Al-Quds al-Arabi, 14 mai 2024).
La raison de ce dernier intérêt se trouve être la même que celle invoquée par les dirigeants occidentaux pour justifier leur inaction face au génocide de l'État sioniste à Gaza (il suffit de comparer cette inaction avec les efforts intensifs qu'ils déploient face à la guerre de la Russie contre l'Ukraine).
En somme, les peuples des pays pauvres du Sud mondial ne sont rien de plus que des humains de deuxième ou de troisième classe dans le système d'apartheid généralisé qui prévaut à l'échelle du monde.
Gilbert Achcar
P.-S.
• Gilbert Achcar. Billet de blog [Mediapart] 27 août 2025 :
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/270825/la-palestine-le-soudan-et-l-indifference-du-nord-mondial
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 26 août. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous devons vaincre le fascisme » : un conseiller municipal de Chicago face à la menace de Trump de déployer des troupes dans la ville

Le président Donald Trump a signé lundi un décret exécutif établissant des unités « spécialisées » de la Garde nationale, prêtes à être rapidement déployées à Washington D.C. et dans les 50 États, et a de nouveau menacé d'envoyer des troupes dans des villes dirigées par des démocrates, comme Chicago. Responsables et organisateurs de terrain ont promis de riposter.
« Nous sommes une ville ouvrière forte », déclare Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal socialiste démocrate du 25ᵉ district de Chicago. « Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de face. » Sigcho-Lopez affirme que la ville prépare une mobilisation de masse qui aura lieu le jour de la Fête du travail.
26 août 2025 | tiré de democray now !
https://www.democracynow.org/2025/8/26/byron_sigcho_lopez_chicago_trump_takeover
AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now ! Je suis Amy Goodman à New York. Juan González est à Chicago. Le président Trump a signé lundi un décret exécutif créant des unités « spécialisées » de la Garde nationale pouvant être rapidement déployées à Washington et dans tous les États. Selon ce décret, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth supervisera la Garde nationale pour aider les forces de l'ordre locales à, je cite, « réprimer les troubles civils ». Cette décision survient quelques semaines après que Trump a déjà déployé la Garde nationale à Washington, où le taux de criminalité était pourtant à son plus bas niveau depuis des décennies. Trump a également menacé d'envoyer des troupes à New York, Baltimore, Chicago et dans d'autres villes. Voici ses propos :
DONALD TRUMP : J'ai dit que la prochaine devrait être Chicago, parce que, comme vous le savez, Chicago est actuellement un champ de bataille meurtrier. Ils refusent de l'admettre. Ils disent : « Nous n'avons pas besoin de lui. Liberté, liberté. C'est un dictateur, c'est un dictateur. » Beaucoup de gens disent : « Peut-être qu'un dictateur, ça nous plairait. » Moi, je n'aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur.
AMY GOODMAN : De son côté, le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, a répondu lundi à Trump lors d'une conférence de presse, entouré d'élu-es, de responsables économiques et de leaders communautaires.
GOUVERNEUR JB PRITZKER : Plus tôt aujourd'hui, dans le Bureau ovale, Donald Trump a regardé les caméras et a demandé que je dise personnellement : « Monsieur le Président, pouvez-vous avoir l'honneur de protéger notre ville ? » À la place, je lui dis : Monsieur le Président, ne venez pas à Chicago. Vous n'y êtes ni désiré, ni nécessaire. Vos propos de ces dernières semaines révèlent une dégradation inquiétante de vos facultés mentales et sont indignes de la haute fonction que vous occupez. Plus inquiétant encore, vous semblez dépourvu de toute préoccupation pour les membres de l'armée que vous déployez sans scrupule comme de simples pions dans votre quête toujours plus alarmante de pouvoir.
AMY GOODMAN : C'était le gouverneur JB Pritzker. Pour en parler, nous rejoignons Chicago avec le conseiller municipal Byron Sigcho-Lopez, élu pour représenter le 25ᵉ district. Immigré d'Équateur, il a été élu en 2019 comme socialiste démocrate, avec l'appui des Democratic Socialists of America (DSA).
AMY GOODMAN : Nous vous souhaitons la bienvenue, conseiller municipal, à Democracy Now ! Vous avez tenu une réunion ce week-end, rassemblant des gens de partout. Vous êtes président du comité du logement et de l'immobilier. Pouvez-vous nous parler de votre réaction à la menace du président Trump ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Merci, c'est un honneur d'être avec vous en ce moment critique.
Quand Trump parle comme un dictateur, beaucoup de gens réagissent : personne n'aime un dictateur. Et personne ne veut voir la normalisation de la présence de troupes militaires dans les villes américaines. Nous avons rejoint les nombreux appels de nos communautés pour défendre notre ville. Nous ne pouvons pas normaliser la militarisation, la disparition de nos voisin-es, l'enlèvement de nos voisin-es, comme nous l'avons vu le 4 juin ici dans notre ville, lorsque des hommes masqués ont tendu un véritable piège humain et kidnappé principalement des femmes de notre communauté.
Nous ne normalisons pas ; nous organisons. Nous ne désespérons pas. Nous n'avons pas peur. Nous ne nous soumettons pas aux dictateurs. Et ici, à Chicago, nous avons fait ce que nous avons toujours fait, dès que furent annoncées les déportations massives : nous nous organisons, à la grande frustration de l'administration Trump, qui a vu une communauté informée, bien organisée, et c'est ce qu'elle continuera de voir. Nous avons appris — en tant qu'ancien organisateur syndical — que le patron est souvent notre meilleur organisateur. Il est en train d'unifier notre ville. Il a uni notre communauté immigrante. Il est en train d'organiser et d'unifier notre ville plus que jamais. Désormais, nous avons des dirigeants syndicaux et religieux prêts à s'assurer que nos écoles, nos églises, nos hôpitaux soient des refuges sûrs, comme ils devraient l'être.
Et nous voulons qu'il sache que, pour la fête du Travail, alors que Trump se prépare à faire de cette fête du Travail la dernière dans notre ville, nous voulons qu'il sache que ce sera une fête du Travail historique, avec des leaders religieux et des habitant-es de toute la ville qui se rassembleront pour défendre chaque voisin-e. Non seulement des parlementaires texans fuient actuellement la violence politique de l'administration Trump, mais nous avons aussi de nombreux voisin-es qui ont été kidnappé-es, des familles entières. Nous avons encore des milliers d'enfants séparés de leurs familles depuis la première administration Trump, qui ne sont toujours pas retrouvés. Alors, ici à Chicago, nous nous organisons. Nous mobilisons des syndicalistes, des leaders religieux et communautaires pour défendre notre ville. Nous n'allons pas normaliser un dictateur. Nous n'allons pas normaliser des zones militarisées. En un temps comme celui-ci, nous nous levons et nous organisons.
JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais vous demander : vous représentez le 25e district, où se trouve le quartier de Pilsen, avec sa communauté mexicaine et latino historique. Quelle est la situation sur le terrain en ce moment en ce qui concerne les descentes à Chicago ? En juin, au moins une douzaine de personnes ont été arrêtées par les services fédéraux d'immigration après s'être présentées à un rendez-vous administratif de routine dans un bureau du South Loop. Quelle est la situation actuelle concernant ces descentes ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Eh bien, nous avons été l'une des premières communautés ciblées par l'administration Trump. Nous avons eu, très tôt, un père arrêté après avoir déposé ses enfants à l'école. À la fin de la dernière année scolaire, l'ICE s'était installée juste à côté de l'une de nos écoles primaires, dans une laverie automatique, attendant les parents à la sortie des classes. Tout cela vise à créer la terreur, à effrayer les gens, à semer la peur, à pousser les gens à se déporter eux-mêmes. Nous voyons bien que maintenant, non seulement ils ne respectent pas les droits, mais ils utilisent la violence comme outil du fascisme. Ils n'ont pas respecté les droits constitutionnels lorsqu'ils sont entrés dans une de nos entreprises il y a quelques mois et ont arrêté deux travailleurs.
Dans notre communauté, il y a actuellement une profonde inquiétude et une peur réelle que l'administration Trump vienne arracher des familles. Ils rôdent autour des écoles, des hôpitaux, des églises. Alors, dans notre communauté, nous nous organisons. Nous dénonçons l'administration Trump qui s'attaque aux églises, aux hôpitaux, aux écoles. Nous nous préparons. Nous travaillons main dans la main avec tous les leaders communautaires, comme nous l'avons fait quand l'administration avait menacé de déportations massives. Nous nous sommes organisés.
Et maintenant, nous nous organisons avec les syndicats pour que nos leaders syndicaux, nos élus, nos leaders religieux et notre communauté en première ligne, protègent les quartiers populaires et les transforment en espaces sûrs. Et nous préparons une mobilisation massive pour le 1er septembre, jour de la fête du Travail, dirigée par le Chicago Teachers Union et bien d'autres organisations, afin que l'administration Trump voie notre dignité, notre solidarité avec Los Angeles, notre solidarité avec Washington. Nous voyons ce qui se passe. Nous devons nous assurer que cela reçoive plus de couverture médiatique. Nous invitons tous les médias à venir à Chicago.
Nous nous organisons pour protéger nos communautés. Nous sommes prêts à nous mobiliser, pas seulement à informer les gens de leurs droits. Il est clair que l'administration Trump ne respecte pas nos droits constitutionnels. Alors nous allons nous organiser pour protéger notre peuple et passer à l'offensive. Nous devons les tenir responsables des morts dans les centres de détention de l'ICE, des camps de concentration construits illégalement, et aussi des enfants séparés, des multiples atrocités. Nous sommes prêts ici à Chicago. Nous sommes une ville ouvrière forte. Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de front. Et nous savons que nous pouvons vaincre le Project 2025 et le dictateur qui veut consolider son pouvoir.
JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais aussi vous demander : vous êtes un proche allié du maire Brandon Johnson. Quelles discussions avez-vous eues avec lui sur la manière dont il compte réagir si Trump envoie la Garde nationale, notamment concernant la réaction de la police de Chicago ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Oui, nous avons été en communication étroite avec le maire Johnson, comme nous l'avions fait quand nous avons lancé une grande campagne « Connaissez vos droits », pour nous assurer que le maire sache qu'il est crucial que la ville de Chicago reste ferme. Et aujourd'hui, il se joindra à nous pour annoncer une mobilisation majeure pour la fête du Travail.
Nous avons aussi parlé de l'importance de garantir qu'il n'y ait aucune collaboration entre le département de police de Chicago et l'administration Trump. Nous avons vu ce qui s'est passé le 4 juin. Une enquête a été ouverte, de nombreux dirigeants et élus ont condamné les actions de l'ICE et toute forme de collaboration ce jour-là. Et le maire a montré son soutien à notre communauté. Il reste ferme. Il est allé à Washington défendre notre Constitution, nos lois de l'État et de la ville. Et nous sommes prêt-es à nous mobiliser pour la fête du Travail, avec le maire Johnson à nos côtés. Il n'y aura pas de collaboration entre la police de Chicago et les agents de l'ICE. Et c'est bien pour cela, selon nous, que l'administration Trump veut déployer l'armée : parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus mener de telles opérations sans la collaboration de la police de Chicago. Cette fois-ci, il veut envoyer l'armée. Nous allons continuer à résister. Nous allons continuer à faire en sorte qu'il n'y ait aucune collaboration avec la police de Chicago.
Mais plus que tout, nous voulons assurer une mobilisation massive dans notre ville pour nous protéger mutuellement, protéger nos voisin-es. Je me réjouis que le maire Johnson se joigne aujourd'hui au lancement du mouvement de la fête du Travail pour défendre notre ville. Chicago est une ville ouvrière, une ville syndicale. Et nous allons rejoindre Los Angeles et Washington dans la lutte contre le fascisme. Et nous savons que nous allons vaincre le Project 2025 ici à Chicago. Nous sommes prêt-es, comme l'a dit ma sœur, Stacy Davis Gates, à un véritable effort pour reconstruire notre pays. Les Américain-es sont courageux. Les Américain-es ne se laisseront pas gouverner par des rois ou des dictateurs. Et ici, à Chicago, nous montrons et nous allons montrer la force du mouvement ouvrier, aux côtés des leaders religieux et de nos communautés immigrantes. Le dictateur a uni notre ville, et nous sommes prêt-es à relever le défi, car nous devons vaincre le fascisme. Le président Fred Hampton l'a dit clairement : si nous ne vainquons pas le fascisme, le fascisme finira par nous écraser tous et toutes. Alors, ici à Chicago, la terre de Fred Hampton, la terre du mouvement ouvrier, nous disons à Trump : nous n'avons pas peur. Nous ne serons pas intimidé-es. Et nous ne nous soumettrons pas à un dictateur.
AMY GOODMAN : Nous parlons avec Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal de Chicago.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Cisjordanie, le processus de colonisation s’intensifie dans l’ombre du génocide

3000 oliviers ont été déracinés par des militaires israéliens la semaine dernière dans un village près de Ramallah. Une mesure symbolique qui accompagne une augmentation des violences coloniales sur les territoires occupés depuis le 7 octobre 2023. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a publié vendredi son rapport mensuel d'information sur l'état de la colonisation en Cisjordanie.
Par l'Agence Média Palestine
Le 25 août 2025
La plantation d'oliviers détruite se trouvait à proximité d'Al-Mughayyir, un village de 4000 habitants situé au nord-est de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie. L'ordre de déracinement des oliviers a été donné par l'armée. Le fondement ? Les oliviers poseraient “une menace pour la sécurité” d'une route menant à une colonie israélienne qui traverse les terres du village.
Déraciner des oliviers, une destruction symbolique
Peu après leur déracinement, les habitants du village ont commencé à replanter des oliviers sur la terre encore empreinte des stigmates des bulldozers israéliens. Pendant la destruction de ces champs d'oliviers, une des militaires à bord d'un bulldozer s'est filmée en train de ravager le champ. Elle a posté la vidéo sur les réseaux, accompagnée d'une légende menaçant de détruire les habitations la fois suivante.
Une illustration de plus de la volonté des militaires israéliens de détruire et d'occuper les terres palestiniennes situées en Cisjordanie. Le chef du village Marzouq Abu Naim a d'ailleurs annoncé à l'agence de presse palestinienne Wafa que les soldats israéliens avaient “pris d'assaut plus de 30 maisons, détruisant les biens et les véhicules des habitants”.
Les oliviers sont un marqueur symbolique car ils ont une importance dans la culture palestinienne, à la fois par leur caractère ancien et leur longévité, et aussi pour leur importance dans l'économie locale. En 2011, la production d'huile d'olive représentait 57% des territoires cultivés dans les territoires palestiniens. Qui dit symbole pour le peuple palestinien, dit aussi cible privilégiée des colons israéliens. Les oliviers sont donc régulièrement déracinés, devenant un symbole du vol et de l'accaparement des terres palestiniennes par les Israéliens.
Les violences coloniales en Cisjordanie s'intensifient
Ces dégradations des biens produits sur les terres agricoles palestiniennes s'accompagnent régulièrement de violences contre les Palestiniens de Cisjordanie, allant du harcèlement jusqu'au meurtre. D'après le rapport mensuel d'OCHA publié vendredi dernier, 25 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie au mois de juillet 2025.
Entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, près de 40.000 Palestiniens de Cisjordanie ont été victimes de déplacement forcé, dû à la destruction de leurs terres, habitations ou cultures. Cette destruction de 3000 oliviers s'inscrit dans la même logique d'après le chercheur palestinien Hamza Zubeidat, interrogé par Al-Jazeera : “Il faut être clair : depuis 1967, Israël continue de mettre en œuvre le même plan visant à expulser la population palestinienne des campagnes et des villes de Cisjordanie. Ce qui se passe actuellement n'est que la poursuite de ce processus d'expulsion des Palestiniens. Il ne s'agit pas d'un nouveau processus israélien.”
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les terres agricoles détruites par l'armée israélienne près du village d'Al-Mughayyir sont la principale source de revenus des habitants de cette zone. C'est plutôt la raison même qui a poussé au déracinement des oliviers, pour rendre invivable le quotidien des habitants palestiniens : “« L'arrachage des arbres, la confiscation des sources d'eau, le blocage et l'interdiction d'accès des Palestiniens à leurs fermes et à leurs sources d'eau entraînent une insécurité alimentaire et hydrique accrue”, conclut Zubeidat.
Les violences de l'armée israélienne et des colons sur les territoires palestiniens occupés peuvent aller jusqu'au meurtre, comme celui de l'activiste palestinien Awdah Hathaleen, que nous avions documenté plus tôt au mois d'août. D'après le dernier rapport d'OCHA, 671 Palestiniens ont été tués par des Israéliens entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, dont 113 enfants.
Il y a une dizaine de jours, la validation finale a été apportée au plan de colonisation E1, un projet massif de création de plus de 3400 logements en Cisjordanie, qui pourrait couper en deux les territoires palestiniens occupés. Ce projet est vivement critiqué par l'ONU et illégal au regard du droit international. Mais qu'importe, le régime colonisateur israélien ne s'en est jamais soucié.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Sociologie politique du sport" Une vision totalitaire du monde

Sociologie politique du sport est une analyse freudo-marxiste du système sportif, de sa bureaucratie institutionnelle et de son idéologie élitiste. L'idolâtrie du champion, la logique aliénante du dépassement, la démultiplication permanente des spectacles sportifs relayés par les médias, les agences de publicité et les sponsors ont totalement envahi l'espace public et les loisirs.
Colonisé par les multinationales capitalistes et l'affairisme des groupes financiers, le système sportif, devenu de plus en plus opaque (dopage, corruption, violences sexuelles, racisme), fonctionne comme un appareil idéologique d'État au service des pouvoirs en place, aussi bien dans les oligarchies libérales que dans les régimes totalitaires, les dictatures militaires ou les théocraties islamiques.
Avec ses effets de diversion massive, de conformisme culturel, de mimétisme de foule et d'identification nationaliste, le sport est l'exemple type d'un opium du peuple.
– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages fondateurs de la Théorie critique du sport et de l'olympisme.
– Date de parution : mars 2025
– Format : 14 x 20,5 cm, 422 pages
– ISBN : 9782490070305
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Interprétation des oeuvres musicales"

La grande diversité des interprétations d'une même oeuvre renvoie à l'énigme des compétences ou expériences des chefs d'orchestres, chanteurs et solistes dans la restitution musicale des partitions. Il existe donc un horizon imaginaire de l'oeuvre, associé aux circonstances de sa composition et aux conceptions esthétiques du compositeur, qui rend complexe l'évaluation de toute interprétation.
Sommaire :
Paradoxes de l'écoute musicale et difficultés de la critique
Hector Berlioz : La tempête romantique
Albert Roussel : L'ivresse rythmique
Charles Munch : Molto appassionato
Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern : La rupture du dodécaphonisme
Jean Sibelius : Grand Nord et épopée de la nature
Dimitri Chostakovitch : Entre déchirements, peurs et solitude
Evgeny Svetlanov : Un chef de légende
Paul Hindemith : Motorisme et harmonie du monde
Edgard Varèse : Le son organisé
Charles Ives : Le transcendantalisme américain
Leonard Bernstein : La passion de la liberté
Arthur Honegger : Cris du monde et espérance liturgique
Bohuslav Martinů : Fantaisies et paraboles
– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il a été membre du comité de rédaction de la revue Répertoire des disques compacts.
– Date de parution : septembre 2025
– Format : 14 x 20,5 cm, 336 pages illustrées en noir et blanc
– ISBN : 9782490070312
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment les riches ravagent la planète (et comment les en empêcher)

En adaptant et en mettant à jour son ouvrage de 2007, le journaliste Hervé Kempf acte l'échec de la stratégie du rapport et la sécession des ultra-riches. Décrivant la polycrise du capitalisme, il annonce le besoin d'une résistance insurrectionnelle et d'un avenir désirable.
Tiré du blogue de l'auteur.
Hervé Kempf est une figure majeure du journalisme critique en France. Suivant les pas d'un Edwy Plenel, faisant ses classes au Monde où il a assumé un engagement syndical vis à vis d'une orientation d'accompagnement du système, il co-fonde le journal écologiste Reporterre avant de s'y consacrer pleinement lorsqu'il quitte Le Monde. Auteur d'une quinzaine de livres, il adapte et mets à jour dans cet album BD son ouvrage de 2007 "Comment les riches détruisent la planète".
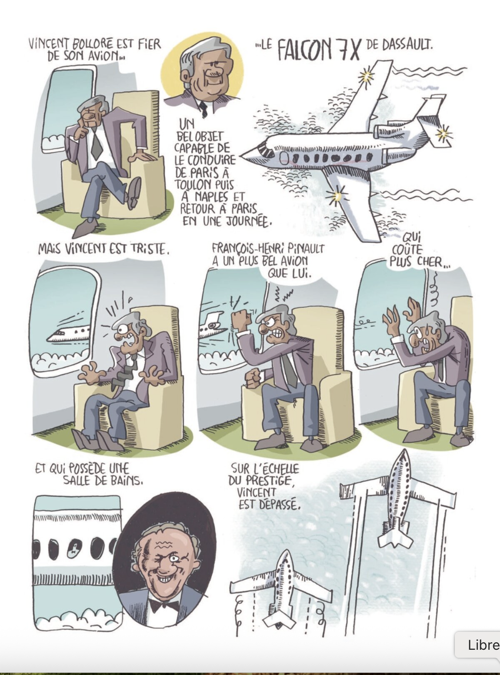
Le dispositif BD est connu et très proche du best-seller de Jean-Marc Jancovici Le monde sans fin : en mettant en scène les auteurs au milieu de figures historiques, de graphiques et de scènes humoristiques, il s'agit d'illustrer visuellement un propos parfois technique et très chiffré. Contrairement à Jancovici (auquel il s'oppose jusqu'à l'intégrer dans l'album) en revanche, Kempf assume une position radicale qui dépasse allègrement l'exposition des faits en montrant une évolution croissante de nombre d'écologistes qui clament la fin de l'information pour la lutte citoyenne face à un système capitaliste suicidaire qui se radicalise dans son refus de tout aménagement. Or l'auteur est très clair : il ne s'agit pas d'un aménagement mais d'une bascule historique qui serait nécessaire (où il rejoint Le monde sans fin sur ce point).
L'originalité du propos est de rappeler le poids pas du tout statistique mais tout à fait quantifiable du mode de vie des ultra-riches sur la crise climatique et la crise sociale et politique qui l'accompagne. Hervé Kempf dépasse alors le seul champ de l'écologie et de la justice sociale pour nous montrer l'alliance de fait du Capital (et de ses dirigeants) avec le populisme d'extrême-droite pour la préservation d'un ordre mis en danger par le choc climatique. Les évolutions sécuritaires et politiques constatées depuis plusieurs années sont une conséquence directe du risque encouru par l'ordre capitaliste. Actant comme nombre d'écologistes raisonnables l'échec de la stratégie des rapports scientifiques, il cite Nelson Mandela qui proclamait (dans les pas des Constituants de 1793 et des Pères fondateurs américains) la nécessité de la résistance violente lorsque les autres méthodes ne fonctionnent pas et que le pouvoir nous y force.
L'attaque sur les 0.01% peut paraître facile et défouloir, il demeure que la mise en cohérence de l'ensemble des éléments de la crise que nous visons (crise politique, autoritarisme et répression des contestations populaires, crise climatique, crise budgétaire, montée du fascisme, sécessionnisme,...) est très bien faite et convaincante.
Intriquant les enjeux écologiques, démocratiques et économiques, Kempf propose une vision d'ensemble et nomme les choses, comme ce "capitalisme despotique" que nombre de penseurs ont annoncé depuis le XIX° siècle. En sourcant largement ses chiffres et en concluant son propos par la nécessité d'une perspective positive pour sortir d'une résistance mortifère, l'auteur fait une démonstration courageuse et impliquante. Aux rêves citoyens !
Comment les riches ravagent la planète, et comment les en empêcher.
de Hervé Kempf et Juan Mendez
Nombre de pages : 128p.
Date de sortie (en France) : 27 septembre 2024.
Éditeur : Seuil
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le projet de loi sur le régime forestier est un important recul pour les droits des Autochtones

Déposé en avril par Québec, le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier fait l'objet d'une forte opposition des environnementalistes, d'experts en foresterie et des peuples autochtones.
Tiré de The conversation. Photo : Des travailleurs empilent et trient le bois d'œuvre résineux fraîchement coupé dans une usine de sciage à Mont-Blanc, au Québec. Le projet de loi 97 a été vivement critiqué par des communautés autochtones et des groupes environnementaux. La Presse Canadienne/Christinne Muschi
Les Premières Nations soulignent que le régime forestier ouvre la porte à une exploitation du territoire rappelant les débuts de la colonisation et qu'il viole leurs droits. Elles demandent à Québec que la politique soit repensée en co-construction avec les peuples autochtones concernés.
Ces nations ont-elles de tels droits ? Tout à fait. Voici pourquoi.
Professeure adjointe à l'Université de Montréal en droit constitutionnel, droits et libertés et droit autochtone, je suis une fière Wendat.
Vers un retour à l'exploitation intensive de la forêt ?
N'ayant de « moderne » que le nom, la Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, portée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, propose plutôt un retour en arrière. Elle rappelle les images du tristement célèbre film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins. Ses conclusions de surexploitation de la forêt avaient été essentiellement confirmées en 2004 par la Commission Coulombe sur les forêts publiques.
Le régime proposé diviserait le territoire forestier public en trois zones dédiées à l'aménagement forestier prioritaire, à la conservation et au multi-usage. L'aménagement « prioritaire » représenterait le tiers du territoire et permettrait son exploitation intensive. Dans cette zone comme dans la zone multi-usage, c'est l'industrie elle-même qui gouvernerait les activités d'aménagement, incluant la sélection des secteurs de coupe.
Pire, l'article 17.5 prévoit que « toute activité ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d'aménagement forestier aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois dans une zone d'aménagement forestier prioritaire est interdite ». Autrement dit, même si les communautés locales ont des droits légitimes sur ces territoires, toute activité de conservation ou visant l'exploitation à des fins économiques des ressources par les peuples autochtones eux-mêmes seraient interdites.
L'interdiction est si générale qu'elle permet aussi de se demander si Québec entend respecter son obligation constitutionnelle de consulter les nations visées avant que ne soit émise chaque autorisation d'exploitation du territoire.
Une violation claire des droits des peuples autochtones
Même si cela n'a pas toujours été le cas, le droit constitutionnel canadien reconnaît aujourd'hui de façon claire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones. Selon la Cour suprême du Canada, ces droits incluent notamment le pouvoir de participer à la gouvernance de leurs territoires. Les gouvernements ont donc l'obligation, avant toute décision pouvant nuire à ces droits, qu'ils soient déjà établis ou simplement revendiqués de manière crédible, de consulter les peuples autochtones, de chercher à les accommoder et, dans certains cas, de les indemniser.
Cette obligation découle du principe juridique de l'honneur de la Couronne, un principe selon lequel l'État doit agir de manière honorable envers les peuples autochtones, dans un esprit de réconciliation.
L'idée d'interdire « toute activité » restreignant l'exploitation intensive de la forêt dans la zone d'aménagement prioritaire apparaît donc à sa face même ignorer les droits autochtones bien reconnus.
Le projet de loi 97 viole également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, que le Canada s'est engagé à mettre en œuvre. Dans ses articles 10 et 28, la Déclaration interdit de retirer ces peuples de leurs territoires sans consentement et réparation. Ailleurs, elle protège notamment le droit d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les territoires et ressources occupés traditionnellement selon leurs propres modes de gouvernance. La Déclaration garantit aussi le droit des peuples autochtones à la préservation de leur environnement.
En particulier, les articles 18 et 19 de la Déclaration obligent les États à inclure les peuples autochtones dans tout processus décisionnel pouvant affecter leurs droits. De telles politiques ne peuvent être adoptées sans leur consentement préalable, libre et éclairé.
La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a une portée juridique réelle : elle constitue un instrument international permettant d'interpréter le droit canadien, notamment depuis son intégration à la loi fédérale adoptée en 2021. Cette loi « impose au gouvernement du Canada l'obligation de prendre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration ».
D'autres tribunaux commencent aussi à s'y référer pour préciser les obligations des gouvernements en matière de droits ancestraux et de consentement.
Le Québec fait bande à part en refusant toujours de reconnaître la Déclaration. Or, de la même manière qu'il aurait été intenable, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, de refuser la Déclaration universelle des droits de la personne adoptée en 1948, il est aujourd'hui impensable de nier les droits fondamentaux des peuples autochtones. Ces droits, ancrés dans leur histoire, leur territoire et leur souveraineté, ne peuvent plus être ignorés en 2025 comme ils l'ont été au début de la colonisation.
D'autres modèles existent pourtant, comme celui de la forêt communautaire pour lequel la Colombie-Britannique fait figure d'exemple. Les ententes qui en découlent permettent notamment une distribution plus équitables des profits et des investissements en éducation, en infrastructures et en loisirs. Elles peuvent également inclure des avantages sociaux, culturels et écologiques pour les communautés, en plus d'assurer une adaptation aux changements climatiques et de réduire les risques de feux de forêt.
Coconstruire un régime forestier avec les peuples autochtones
La tendance juridique est claire. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est amorcée. Les tribunaux interprètent désormais le droit canadien à sa lumière. Cette évolution va au-delà du simple droit d'être consultés : c'est le principe du consentement qui s'impose progressivement pour respecter les droits inhérents des peuples autochtones, fondés sur leur « souveraineté préexistante », c'est-à-dire leur statut de nations autonomes qui exerçaient déjà leurs propres formes de gouvernance bien avant la colonisation.
Moderniser le régime forestier québécois exige d'aller en sens inverse de l'approche de Québec. Revenir vers une exploitation intensive des forêts nie les droits des peuples autochtones déjà bien reconnus et mènera inévitablement à des contestations judiciaires.
Une approche moderne reconnaîtrait les droits fondamentaux des nations touchées et les considérerait d'égal à égal pour développer une politique équitable. Pour reprendre les mots de la Cour suprême, une telle démarche participerait d'une véritable « justice réconciliatrice ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Privatisation de la production d’électricité : investissements publics opaques et coûteux

L'Alliance de l'énergie de l'Est, sa société en commandite privée et sa société par actions, de connivence avec la CAQ, viennent de flouer une fois de plus les Québécoises et les Québécois. Le secteur Énergie du SCFP rappelle que les 6 000 MW d'éoliennes signifient qu'on ajoutera des milliers de poteaux et de pales dans les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour une énergie intermittente qui aurait plutôt dû être située là où c'est le plus efficace, c'est-à dire dans la région de la Baie-James. De plus, l'ajout de cette capacité pourrait impacter la stabilité du réseau d'Hydro-Québec.
On a appris hier que 18 milliards de dollars sont investis alors que le modèle privé de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui s'appuie sur des municipalités et des régies intermunicipales de l'électricité, ne tient pas la route.
« Fait inusité, la Commission municipale du Québec n'a jamais voulu enquêter sur des faits troublants : la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent est lourdement déficitaire depuis deux ans, avec plus de 25 millions de dollars de pertes. En effet, dans le Rapport financier consolidé 2024, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation[1], on rapporte un déficit accumulé, lié aux activités, à la fin de l'exercice, de 25,2 millions de dollars en 2024 et de 24,9 millions de dollars en 2023 », d'expliquer le président du secteur énergie du SCFP-Québec, Frédéric Savard.
« Nous avons toujours su que le premier ministre voulait donner au privé la production d'électricité. Il y a déjà 4 000 MW d'éoliennes privées au Québec, on en aura 10 000 MW. C'est plus que 25 % du total en privé ce qui constitue un retour en arrière considérable. Il faut se demander où ira l'argent public et comment il sera dépensé », s'interroge, à juste titre, le président du secteur Énergie.
Oui à plus d'énergie propre, mais au public !
Produire plus d'électricité pour favoriser l'électrification des transports ou pour diminuer les émissions de carbone de l'industrie est une nécessité, à l'heure de l'urgence climatique. Toutefois, il n'y a aucun plan viable en ce sens au gouvernement actuel ! La véritable intention de François Legault est de faire croire aux régions dévitalisées du Québec, qui ont cruellement besoin de projets structurants pour leur économie régionale, que la structure bancale et opaque de l'Alliance de l'énergie de l'Est et consorts sera une bonne chose pour leur développement, en échange de votes stratégiques en vue de la prochaine élection !
« Nous allons continuer à nous battre contre ce gouvernement qui, malgré les preuves récurrentes d'incompétence et d'irresponsabilité, continue de forcer des investissements publics pour générer des profits privés ! », de conclure Frédéric Savard.
Notes
[1] https://www.mamh.gouv.qc.ca/documentsfinanciersweb/Rapport-financier-2024-et-autres-R7010.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les cent pires citations sionistes

Jean-Pierre Bouché
Michel Collon
En donnant la parole uniquement aux dirigeants d'Israël, Jean-Pierre Bouché et Michel Collon révèlent la différence entre le discours officiel et la pensée réelle de ses fondateurs, présidents, ministres et militaires.
De 1895 à aujourd'hui, ils y exposent sans filtre leur stratégie. Et cela pourrait vous surprendre... Indispensable pour comprendre et convaincre !
Extrait de l'introduction :
De quoi avez-vous besoin ? Quels problèmes rencontrez-vous lorsque vous discutez d'Israël ? Voici les réponses que l'on reçoit en général quand on pose cette question :
1. « L'émotion. La discussion est vite tendue, cela empêche le dialogue. »
2. « Le manque de connaissances. Les gens ignorent l'Histoire. »
Ces deux problèmes, notre livre va vous aider à les résoudre. Certes les émotions face aux guerres sont légitimes. Mais l'émotion, ça se manipule. À chaque guerre, une propagande organisée par des professionnels avec de gros moyens, s'efforce de nous faire basculer dans « le bon camp ». Les armes de destruction massive en Irak ne furent qu'un exemple parmi d'autres fake news souvent passées inaperçues du public. L'émotion court-circuitant la raison, on ne cherche plus les faits manquants, ni les causes profondes du conflit.
En ce qui concerne le manque de connaissances, ce livre vous propose une solution toute simple : écouter les sionistes. Écoutez les précurseurs du projet d'État juif depuis 1895 ! Écoutez les fondateurs de l'État d'Israël en 1948 ! Écoutez les présidents, ministres et militaires qui ont géré les nombreuses guerres et l'expansion constante du territoire : 1967, 1973, 2000, 2006, 2009, 2014… À chaque fois, quand ils parlent entre Israéliens, ils tiennent un discours complètement opposé à leur com officielle destinée à l'opinion publique internationale.
Vous serez étonnés de constater qu'en fait, ils ont tout écrit noir sur blanc. Nos 100 pires citations exposent leurs plans, la violence jugée « nécessaire » et la façon aussi de tromper l'opinion internationale. « On peut mentir, dans l'intérêt de la Terre d'Israël », déclarait le Premier ministre Shamir en 1992.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mouvement syndical doit être repensé pour la nouvelle ère politique canadienne

Le mouvement syndical canadien a évité de justesse la catastrophe lors des élections fédérales d'avril. La balle tirée par la droite a été légèrement déviée grâce à la décision collective des électeurs de regrouper le vote du centre-gauche derrière les libéraux de Marc Carney. Mais l'affaire a été très serrée, après une succession de vagues politiques qui ont vu, à la toute fin, un retour de l'électorat ouvrier vers les conservateurs – les présumés vainqueurs – jusqu'à ce que le nouvel impérialisme américain menace la souveraineté canadienne et change fondamentalement la dynamique et la direction de la politique fédérale.
12 août 2025 | tiré de Canadian dimension | Photo : Des membres d'Unifor défilent lors de la parade de la Fête du travail à Toronto. Photo : Mary Crandall.
https://canadiandimension.com/articles/view/labour-needs-an-overhaul-for-the-new-era-of-canadian-politics
Les syndicats ont accueilli ce résultat avec soulagement et cherchent désormais des points d'influence et de collaboration avec le gouvernement Carney afin de protéger les acquis passés et défendre les intérêts des travailleurs dans la guerre commerciale en cours et dans le programme de « construction nationale » à venir. Le mouvement syndical dispose de quelques sièges aux tables de concertation du nouveau gouvernement, mais il n'est qu'un groupe d'intérêt parmi d'autres dans le vaste camp « Équipe Canada ». De plus, le mouvement ouvrier aborde cette nouvelle ère politique avec une liste considérable de problèmes. Le plus important est que sa campagne de 2025 n'a eu qu'un impact limité sur les travailleurs, et l'absence de stratégie politique cohérente et unificatrice a laissé le mouvement syndical vulnérable.
Ni le mouvement syndical ni le NPD n'ont réussi à freiner ou inverser la tendance mondiale au « désalignement » (dont j'ai récemment parlé dans Canadian Dimension), qui voit les électeurs ouvriers abandonner les partis traditionnels de la classe laborieuse pour se tourner vers le populisme de droite. Le dépouillement a montré que le désalignement de la classe ouvrière était encore plus marqué au Canada. Si seuls les votes ouvriers avaient compté, le populisme de droite de Poilievre et son faux « conservatisme ouvrier » auraient probablement triomphé. Selon une analyse post-électorale d'EKOS, la poussée conservatrice a été « largement alimentée par des populistes de droite… plus jeunes, massivement masculins, diplômés du collégial, plus présents dans la classe ouvrière que dans la classe moyenne ».
Alors que le gouvernement Carney approche de ses 100 jours au pouvoir, il bénéficie encore d'un taux d'approbation majoritaire, et la vague conservatrice de la fin de campagne a reculé. Mais les profondes divisions au sein de la classe ouvrière, accumulées au fil de la dernière décennie, demeurent. Les résultats de 2025 envoient un puissant message : un dialogue non partisan avec des millions de travailleurs ne peut plus attendre.
Or, alors que certains syndicats s'apprêtent à se lancer dans le processus de révision électorale et de renouvellement du leadership du NPD qui commencera en septembre, rien n'indique pour l'instant que le mouvement syndical lui-même entreprendra un examen critique de ses propres performances et stratégies politiques.
Il ne sert à rien de minimiser la montée du conservatisme dans une large partie de la classe ouvrière, y compris dans les rangs syndicaux. En 2025, plusieurs circonscriptions à forte densité syndicale ont basculé vers le Parti conservateur, renversant des sièges cruciaux comme Windsor-Ouest, où le vote conservateur a bondi de 23 %.
D'autres basculements en Ontario (Brampton-Ouest, London–Fanshawe, Kitchener-Sud) et en Colombie-Britannique (Skeena–Bulkley Valley, Nanaimo–Ladysmith, Cowichan–Malahat–Langford), souvent d'anciens bastions néo-démocrates, ont attiré l'attention médiatique. Mais comparé à 2015, quand le vote syndical avait joué un rôle décisif pour battre Harper en réduisant le soutien conservateur chez les syndiqués à 24 %, la progression conservatrice a été continue dans la plupart des circonscriptions ouvrières. Dans 50 circonscriptions fortement ouvrières en anglais canadien, définies par le revenu salarial, le travail manuel, l'emploi manufacturier et de services, ainsi que le niveau d'éducation, le soutien aux conservateurs a augmenté à chaque scrutin : une hausse de 6 % entre 2015 et 2025.
Depuis 2015, cette poussée conservatrice avait été en partie masquée par dix années de gouvernements libéraux qui ont abrogé des lois antisyndicales, élargi les programmes sociaux et soutenu les droits syndicaux. L'opinion publique envers les syndicats s'était améliorée, et les conditions post-COVID du marché du travail avaient permis de fortes avancées à la table de négociation, dont une hausse historique des grèves. Mais sous la surface, des tensions politiques et culturelles se développaient, accompagnées d'un déclin continu de la syndicalisation dans le secteur privé. En 2025, ce désalignement a brisé les barrières et s'est imposé comme une force visible et puissante dans le mouvement syndical.
- Seule une poignée de syndicats a rompu avec la tradition en appuyant officiellement des candidats conservateurs, mais ces gestes ont marqué une élection où les appuis officiels au NPD et aux libéraux ont aussi été rares. Outre les syndicats policiers, les conservateurs ont reçu le soutien officiel de la Fraternité internationale des chaudronniers, de la Fraternité des charpentiers du Nouveau-Brunswick, des Plombiers et tuyauteurs, section locale 67 de Hamilton, de sections locales de la FIOE à Windsor, Regina et Québec, ainsi que des Métallos, section locale 2251 à Sault Ste. Marie. Le syndicat des travailleurs du bâtiment (Labourers International Union) n'a pas officiellement endossé les conservateurs, mais a soutenu leur campagne « Boots Not Suits » visant les travailleurs de la construction, et a accueilli un des grands rassemblements de Poilievre en fin de campagne.
« Ces appuis ont suivi l'élection provinciale en Ontario, où huit organisations des métiers de la construction ont appuyé le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, tout comme une section locale des téléphonis d'Unifor et une section locale des travailleurs de l'automobile d'Unifor. »
À l'inverse, trois syndicats nationaux – le SCFP, les Métallos (USW) et l'ATU – ont officiellement soutenu le NPD, tandis que les Ingénieurs d'Ontario et les Charpentiers de l'Ontario appuyaient les libéraux. La grande majorité des syndicats ont toutefois évité tout endossement formel, préférant se concentrer sur les enjeux et les campagnes de mobilisation électorale.
Les campagnes syndicales de 2025 ont opposé au populisme conservateur un populisme centré sur les travailleurs, mettant en garde contre le bilan antisyndical de Poilievre et des conservateurs. Le Congrès du travail du Canada a rapporté le 1er mai que plus de 40 000 personnes avaient signé sa campagne « Workers Together ». Lancée en début d'année avec une conférence d'action politique, elle produisit un programme détaillé, une offensive sur les réseaux sociaux et des porte-à-porte en avril.
Les plus grands syndicats ont mené leurs propres campagnes d'information et de mobilisation. La plus importante, Unifor Votes, comptait 78 organisateurs et a mené des opérations dans 25 circonscriptions clés. USW Votes a mobilisé ses membres dans quatre circonscriptions, CUPE Votes a produit du matériel électoral et fait du porte-à-porte, tandis que UFCW Votes a organisé des groupes de discussion. Malgré tout, moins de syndicats se sont inscrits comme tiers participants qu'aux élections précédentes.
« Malgré ces campagnes, moins d'organisations syndicales canadiennes se sont inscrites pour participer directement à l'élection de 2025 que lors des scrutins précédents. Cela inclut 13 syndicats nationaux (Canada's Building Trades, CAPE, CFNU, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, STTP, SCFP, FTQ, NUPGE, AFPC, TUAC, IPFPC, Métallos et Unifor), quatre syndicats provinciaux (BCGEU, HEU, EFTO et ONA), deux sections locales (SCFP 4400 et Vancouver IFF) ainsi que le Toronto and York Labour Council (les données complètes sur les dépenses syndicales de tiers ne seront disponibles qu'en septembre). »
Globalement, les campagnes syndicales ont eu un impact modeste, sans égaler l'urgence ressentie par la population qui a propulsé la coalition anti-conservatrice et le plus haut taux de participation électorale depuis 1993.
La stratégie politique du mouvement syndical a subi un test de résistance en 2025, et n'a pas bien résisté. Pour la majorité des syndicats dont l'objectif principal était d'empêcher un gouvernement hostile, l'élection a été beaucoup trop serrée. Pour ceux qui voient le NPD comme le bras politique du mouvement ouvrier, 2025 fut dévastateur. Aucun camp ne peut se dire satisfait.
Les lourdes pertes du NPD l'ont repoussé aux marges de la politique fédérale, déclenchant une année de remise en question et de renouvellement de la direction. Le mouvement syndical s'est retrouvé avec beaucoup moins d'alliés au Parlement. Attribuer cette défaite uniquement au « vote stratégique » occulte des mutations plus profondes de l'opinion ouvrière, qui ont fracturé les loyautés partisanes et partagé le vote entre libéraux et conservateurs. Selon Abacus, 21 % des électeurs NPD de 2021 ont voté conservateur en 2025, et sur 17 sièges perdus, 10 sont allés aux conservateurs.
Une partie importante du mouvement syndical demeure fidèle au NPD et misera sur son renouvellement. Un NPD revitalisé, renouant avec ses racines ouvrières, pourrait redynamiser la politique de classe. Mais sans un engagement plus large du mouvement syndical et une volonté claire de transformer le parti, ce virage reste peu probable.
D'autres syndicats, eux, chercheront à forger des relations institutionnelles à divers niveaux de gouvernement. Mais cette approche manque aussi de souffle pour placer la politique ouvrière au cœur de l'agenda national.
Les revendications syndicales envers le gouvernement Carney portent surtout sur la sécurité de l'emploi et des revenus. « Nous avons besoin de plus que de simples solutions temporaires, écrivait la présidente du CTC, Bea Bruske, deux semaines après l'élection. Il faut une stratégie globale qui ne laisse aucun travailleur derrière. »
Unifor a été plus loin en réclamant un programme économique national immédiat, incluant des pénalités contre les entreprises délocalisant aux États-Unis, une expansion du réseau ferroviaire national, un pacte de défense avec l'Europe, un resserrement des règles sur les minéraux critiques, ainsi qu'un programme national de logement visant à protéger et développer l'emploi forestier.
« Pourtant, à de rares exceptions près, le mouvement syndical est resté largement spectateur lorsque le gouvernement Carney a fait adopter sa loi phare, le projet de loi C-5, la Loi sur la construction du Canada. Cette loi déréglemente de façon spectaculaire les processus d'approbation des grands projets, qui devraient provenir en grande partie de promoteurs du secteur privé. Le gouvernement n'adoptera pas une “approche descendante… disant nous voulons ceci, nous voulons cela”, a déclaré Carney au début de juillet. »
Le lobby patronal, comprenant le Business Council, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Chambre de commerce et les think tanks de droite allant du Fraser Institute au C.D. Howe Institute, a pour sa part inondé le gouvernement de demandes. Celles-ci réclament d'amples réductions et crédits d'impôt pour les entreprises, des mesures d'austérité gouvernementale dans l'ensemble des ministères et un soutien inconditionnel aux oléoducs et gazoducs, entre autres. Le Fraser Institute et le Macdonald-Laurier Institute ont également été à l'avant-garde des appels à démanteler la gestion de l'offre dans l'agriculture canadienne.
Comme lors de la campagne électorale, la présence et l'action politiques du mouvement syndical devront être considérablement renforcées s'il veut avoir la moindre chance d'influencer les choix et l'orientation du gouvernement Carney. Il faut plus qu'une politique industrielle nationale : des protestations politiques, des actions directes et même des grèves seront nécessaires pour montrer aux décideurs que les travailleurs ne resteront pas passifs dans l'attente d'investissements du secteur privé censés garantir la sécurité d'emploi et protéger leurs droits face aux guerres commerciales et à l'agression des États-Unis contre les travailleurs canadiens.
Cela a déjà été fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les syndicats canadiens ont relié les revendications des travailleurs à l'intérêt national. Entre 1941 et 1943, les grèves dans les industries clés de guerre — bien qu'illégales au regard des règlements d'exception — ont obtenu l'appui de la population et ont mené à l'Arrêté en conseil 1003 en 1944, qui établissait la reconnaissance et l'accréditation syndicales. La grève de Ford à Windsor en 1945 a ensuite assuré l'adoption de la formule Rand sur la sécurité syndicale — une percée majeure qui a nourri la croissance du syndicalisme. Deux ans plus tard, dans l'immédiat après-guerre, des grèves coordonnées de travailleurs forestiers de la côte Ouest, de marins des Grands Lacs et de travailleurs du textile au Québec ont consolidé la formule Rand et gagné la semaine de travail de 40 heures à l'échelle nationale.
Comme l'a écrit Charles Lipton dans son ouvrage de référence The Trade Union Movement of Canada :
« Il a été nécessaire que le mouvement syndical mène ce type de lutte pour les conditions de travail et l'organisation, afin de consolider les travailleurs et de combiner leurs besoins économiques élémentaires avec la cause générale de la victoire sur le fascisme. Le renforcement du mouvement est devenu décisif. C'est ce qui s'est produit : pour les syndicats, ces années furent celles de progrès sans précédent, avec des bonds gigantesques en matière de membership, d'unité et de conscience. »
Rien ne résonnera davantage auprès de la classe ouvrière élargie — syndiquée ou non syndiquée — qu'une action politique et économique de masse. Tout aussi urgent, toutefois, est le besoin de confronter le conservatisme ouvrier, à la fois dans la société en général et à l'intérieur des syndicats, par le dialogue et l'éducation. Un engagement significatif nécessitera une mobilisation sectorielle et communautaire d'envergure, ainsi que des liens plus solides avec les mouvements sociaux enracinés dans les communautés ouvrières. À l'heure actuelle, ces objectifs ne constituent ni des priorités centrales de l'organisation et de l'action politiques syndicales, ni des thèmes communs de discussion parmi les dirigeants et stratèges syndicaux.
Il existe des points de départ clairs pour un nouveau dialogue de classe. Les programmes d'éducation syndicale doivent disposer de plus de ressources, avec des contenus et des méthodes mis à jour, conçus pour relever le défi générationnel du conservatisme ouvrier. Les organisateurs et formateurs devront aussi dépasser leur focalisation traditionnelle sur les salaires et les enjeux liés au lieu de travail.
L'accessibilité n'était pas le seul, ni même le principal facteur qui a poussé des électeurs ouvriers vers les conservateurs en 2025. L'analyse d'EKOS sur la polarisation a révélé de fortes divisions à l'intérieur de segments spécifiques de la classe ouvrière : les jeunes hommes manifestaient des niveaux élevés de méfiance envers les institutions et étaient fortement exposés à la désinformation, tandis que des enjeux sociaux et de santé, comme la vaccination, se sont avérés de puissants prédicteurs du comportement électoral.Un écart entre les sexes sans précédent — les femmes ayant montré une forte résistance aux appels conservateurs — souligne la nécessité d'une approche intégrée qui prenne en compte à la fois les préoccupations économiques et culturelles.
Le cœur du conservatisme ouvrier est également tout proche pour les syndicats canadiens. Les métiers spécialisés constituent une circonscription clé de la classe ouvrière, et ils ont été à l'avant-garde du basculement vers le conservatisme et le populisme. Dans 25 circonscriptions fédérales de la classe ouvrière en anglais canadien, où la concentration des métiers spécialisés est la plus forte, les conservateurs en ont remporté 23 lors de chacune des quatre élections depuis 2015. D'autres facteurs régionaux expliquent aussi ces résultats, mais la corrélation entre les métiers et les stratégies politiques conservatrices fait des travailleurs spécialisés la première ligne dans la lutte pour la conscience de classe ouvrière.
Il existe cependant des tendances encourageantes dans la classe ouvrière canadienne, qui peuvent et doivent être mises à profit. De façon générale, les travailleurs à faible revenu n'ont pas adhéré au populisme conservateur. Dans les 50 circonscriptions fédérales de l'anglais canadien ayant les revenus médians les plus bas, seulement 16 ont élu des conservateurs et moins de 10 ont montré une croissance substantielle du soutien conservateur entre 2015 et 2025. Dans 12 cas, le soutien conservateur a même reculé.
Le désalignement peut être global, mais il n'est pas universel. Il existe des majorités démographiques et des communautés résilientes et combatives sur lesquelles on peut compter pour répondre positivement à un appel large et de classe de la part des syndicats canadiens. Mais si la politique syndicale reste de faible intensité, avec des stratégies fragmentaires, et que le glissement supplémentaire de la classe ouvrière vers le populisme de droite n'est pas freiné, il pourrait ne pas être possible d'éviter la prochaine balle. Pour élever la sécurité d'emploi et les droits des travailleurs au rang d'enjeux centraux et déterminants de la vie politique canadienne, il faudra une refonte du programme et des stratégies politiques du mouvement syndical.
Fred Wilson écrit sur les enjeux syndicaux et sociaux. Il est retraité d'Unifor et auteur de A New Kind of Union (Lorimer, 2019). Il est également bénévole comme conseiller pour le projet Mexico Worker Rights Action (CALIS). Suivez ses publications sur Bluesky et Medium.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration de Bea Bruske sur le plan de Carney de supprimer les contre-droits de douane américains

Les syndicats du Canada refusent d'accepter que les sanctions douanières imposées à nos industries d'exportation critiques soient devenues la « nouvelle norme ». Ces droits de douane s'en prennent aux travailleuses et travailleurs canadiens et à notre économie, et notre gouvernement doit tenir bon. Nous ne pouvons pas nous soumettre aux exigences de Donald Trump.
Soyons clairs : la capitulation n'a rien permis d'obtenir de plus pour le Canada de la part de Trump. Qu'il s'agisse de supprimer la taxe sur les services numériques ou de faire des concessions sur la sécurité des frontières, céder n'a fait qu'affaiblir nos industries et nuire aux travailleuses et travailleurs. Supprimer les contre-droits maintenant ne ferait que donner une fois de plus à Trump une victoire facile tout en faisant subir les conséquences aux travailleurs et aux collectivités du Canada.
Les contre-droits de douane n'ont rien de symbolique. Ils constituent la ligne de défense du Canada dans cette guerre commerciale qui s'intensifie. Abolir les contre-droits de manière unilatérale maintenant serait trahir le mandat clair confié au premier ministre par la population canadienne : lutter contre la guerre commerciale de Trump et défendre les bons emplois canadiens.
Se plier aux pressions de Trump n'est pas une option. Il est temps de répliquer avec force, de défendre les travailleuses et travailleurs et de déployer tous les outils disponibles pour protéger nos industries et nos collectivités. Le premier ministre Carney doit se servir du grand pouvoir de négociation du Canada pour empêcher la décimation d'industries indispensables et la perte de milliers de bons emplois.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.