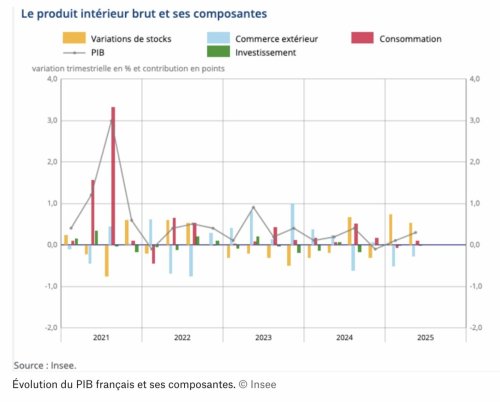Derniers articles

Pop fascisme VS Pop gauchisme : qui va l’emporter ?

La pop culture est devenue le terrain d'une lutte intense, qui se joue à coups de memes, de vidéos Youtube, de stories d'influenceurs et de shorts de Tik-tokeuses. « bataille de civilisation » VS « lutte des classes » : à chaque camp, son écosystème, ses mots et ses codes. Retour sur ce combat pour l'hégémonie culturelle autour des travaux de Bolchegeek, Maxime Macé et Pierre Plottu.
Tiré du blogue de l'auteur.
Vous l'aurez sans doute noté, à moins de vivre dans une grotte ou la boîte crânienne de Pascal Praud : l'extrême-droite la plus virulente a le vent en poupe, et inonde le champ culturel et médiatique. Et ce, notamment, nous disent les éditions Divergences, qui ont publié en septembre dernier « Pop-Fascisme. Comment l'extrême-droite a gagné la bataille culturelle sur internet » des journalistes Maxime Macé et Pierre Plottu, « grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet ». Et « cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l'appui de Bolloré et de ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? ».
Viande rouge, cigares et « grand-remplacement »
Au menu (littéralement) : de la viande rouge, des cigares et du sport, car homme-blanc-alpha-manger-viande, pas comme ces hommes-soja (nom donné par l'extrême-droite aux gauchistes supposés maigres et mal nourris) à cheveux bleus et de moins de 100 kilos. Plottu et Macé, sur le plateau de l'émission Au Poste, de David Dufresnes (1), donnent ainsi l'exemple du très suivi Baptiste Marchais, « influenceur culturiste qui connaît le succès avec ses ‘'repas de seigneur'' », dîners lors desquels il peut ressortir la rhétorique d'extrême-droite la plus éculée : « l'homme blanc solide a disparu avec la bataille de Verdun, parce que ce sont eux les courageux morts au front, tandis que ne subsistent aujourd'hui que les lâches ».
Lui-même mène donc un business de coach en musculation, ce qui lui permet, en plus de son programme idéologique, de mettre un juteux beurre dans ses épinards. Car cette fachosphère est financièrement profitable, d'autant que soutenue par les milliardaires Pierre-Edouard Stérin et Bolloré, qui rachètent tout ce qu'il leur est possible de racheter, donnant ainsi une image médiatique favorable, et des canaux de diffusion massifs, à des collectifs fascistes comme les Némésis, dont Retailleau a récemment dit « partager les combats ». Avec, toujours, comme modus operandi, la construction de la « menace » gauchiste et « immigrationiste », avec une phraséologie de « l'ennemi intérieur » identique à celle de la presse antisémite des années 30 : « C'est très important de caricaturer l'ennemi. D'abord parce qu'il est beaucoup plus simple de lutter contre un adversaire caricaturé plutôt qu'un adversaire pluriel, et puis parce que ça renforce ses propres positions », dit Macé dans cette même émission, où il rapporte aussi ce bandeau observé sur la chaîne LCI, à propos de la déportation de migrants en Albanie par la mussolinienne Georgia Meloni : « La re-migration : une solution ? ».
Quand The Boys massacre le trumpisme
Je retrouve Benjamin Patinaud, dit le Bolchegeek, à la terrasse d'un petit bar de Lyon. Spécialisé dans ces questions, entre autres pour Blast, le journal l'Humanité et sur sa propre chaîne Youtube, il a réalisé il y a peu une vidéo sur la série Canal « Paris Police », série historique fort gauchiste, dont la saison 2, se déroulant en 1905, a vu le très catholique Bolloré censurer, suppose-t-il, toute mention… de la loi 1905 de séparation de l'église et de l'État, un comble. De même pour un affrontement entre les ligues d'extrême-droite et la police et les anarchistes, se déroulant hors-champ. Reste, malgré le coup de pression, cette réalité d'une série grand public, populaire, de qualité, assumant fièrement son ancrage féministe, antifasciste, antiraciste… Mais le constat d'ensemble de la pop, malgré son caractère apparemment progressiste, est-il si optimiste, si positif ? C'est l'objet de notre rencontre.
Nous en venons rapidement à parler de la série The Boys, sur Amazon Prime, à laquelle il a également consacré une vidéo. Une série « très pas subtilement de gauche (rires) », où l'on suit une troupe de massacreurs badass de super-héros machistes et fascistes, dirigés par Homelander, caricature de Superman à la sauce Trump, bébé-cadum grotesque pathologiquement accro à la violence et au pouvoir. Mais il s'est tout de même trouvé des groupes masculinistes pour déclamer leur amour de ce personnages, obligeant l'acteur interprète, Anthony Starr, à prendre la parole à de nombreuses reprises, déclarant : « Ce personnage n'est absolument pas un héros… Pourtant, beaucoup le glorifient et l'adorent. C'est vraiment surréaliste. » Et poussant, donc, Bolchegeek à faire sa vidéo sur la mécompréhension de la série (2) : « Il y a plein de gens qui me demandaient Andor, tu vois, un des meilleurs trucs sur la révolution dans la pop culture. Mais j'ai voulu plutôt réagir là-dessus, car à un moment il faut arrêter les conneries : présenter The Boys comme « anti-woke » alors que ça dit tout le contraire, c'est juste n'importe quoi, il faut redescendre ».
Car c'est l'une des particularités de cette série. Présenter, à traits épais, une sorte de « fascisme 2.0 », un dystopique néo-nazisme « inclusif » drivé par une armée de marketeux ayant pour but d'instrumentaliser les thématiques antiracistes, LGBTQIA+ et féministes pour servir leur plan idéologique ultra-conservateur. « Et ça, c'est totalement un move de gauche, en fait ! Il y a des gens d'extrême-droite, ils se disent, ah, ça critique l'hypocrisie homo, etc. Ils se rendent pas compte qu'en fait, dans les milieux LGBT, le pink-washing, c'est l'ennemi, quoi ». Même s'il se veut optimiste sur le fait que « la majorité du public de The Boys, c'est des gens qui sont quand même sensibles aux idées progressistes », et « qu'on surestime aussi le nombre de gens qui comprennent pas », il montre cependant la puissance de déni et de toxicité culturelle de la fachosphère, capable d'essayer de tirer vers soi la couverture d'une série qui lui crache très ouvertement à la gueule.
La pop a-t-elle une réelle influence ?
Je demande à Benjamin si, à ses yeux, ce genre de productions culturelles a un réel pouvoir d'influence sur les imaginaires. Il réfléchit. De mon côté, lui dis-je, « je pense qu'il y a une incidence positive. Je ne peux pas m'imaginer qu'un gamin qui mate The Boys et qui trouve les personnages super cool, et où les nazis sont présentés comme étant des grosses merdes, ne va pas être influencé ». Il est, lui, plus nuancé : « C'est une question qu'on me pose souvent, et je trouve que ça serait cool d'avoir une discussion collective un peu là-dessus, parce que j'ai pas trop d'idées arrêtées. En fait, mon intérêt, ça serait de dire que la bataille culturelle, c'est important, que c'est là que tout se joue, et de la surestimer. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Et vu l'état du monde, il faut bien croire que ça n'a pas non plus une incidence si forte que ça. Pour l'instant, je me dis que c'est forcément mieux d'avoir des séries, des films » allant dans notre sens, comme le carton du film Sinners, de Ryan Coogler, hommage à la Blaxploitation se concluant par un massacre de blancs du KKK, ou la série Watchmen, « qui imagine une uchronie où en fait, il y aurait eu un tournant progressiste. Comme il y a eu un tournant Reagan, tu vois. Sauf que là, c'est pas Reagan, c'est Robert Redford, le président (rires). Mais évidemment la morale, même si ça critique certains aspects de la gauche, c'est que c'est toujours mieux d'être de notre côté que de celui des fascistes ».

Il donne aussi l'exemple de Beyond the spider-verse, film d'animation de Sonny Marvel où l'on retrouve le personnage de Spider-Punk, un anarchiste « qui est juste génial. Le gamin d'un pote, qui doit avoir six ans, quand, dans le film, il enlève son masque, et qu'en plus, c'est un Noir, avec des dreads, et qu'on voit que c'est le personnage le plus stylé de l'univers, il fallait voir sa gueule... il va s'en souvenir toute sa vie ». Il conclut : « Et il y a plein de petits trucs comme ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact sur les nouvelles générations » ; « Une génération qui aura vécu avec des Spider-Punks, c'est pas la même génération qui aura vécu avec des héros reaganiens ». Car les productions culturelles estampillées de droite, il en a regardé, notamment pour le podcast Dis-Cor-Dia : « c'est tout le temps des merdes. La dernière fois, ils m'ont fait faire la trilogie adaptée de La Grève de Ayn Rand. L'idée du bouquin est trop conne : tous les entrepreneurs se disent qu'ils en ont marre des collectivistes et donc ils se cassent. C'est fait par une espèce de boîte de prod' de droite, mais nulle, avec de moins en moins de budget à chaque film. Personne ne regarde ça. C'est des trucs nazes de Bac DVD… »
Une offensive réactionnaire réelle - et efficace ?
Si quelqu'un comme Louis Sarkozy, fils de, nouvelle coqueluche des réac' du pays, n'a vendu que 2000 exemplaires de son bouquin malgré son passage sur tous les plateaux télé, le livre de Jordan Bardella, ou la revue fasciste Furia, de Papacito et Obertone, diffusés dans tous les points de vente Bolloré, sont de véritables succès - même si, tempère Benjamin, « Salomé Saqué a vendu autant si ce n'est plus, avec une exposition médiatique moindre ». Et, selon lui, citant les travaux de Vincent Tiberj critiquant la prétendue « droitisation de la société », « la pop culture est quand même massivement progressiste. Les artistes ont tendance à être au moins un peu plus progressistes que la moyenne, quoi. Et sans artistes, tu ne produis rien ». « Faire des bons films, des bons livres, ils galèrent. La culture meme, internet, tiktok, ils y arrivent très bien. Mais c'est vrai que faire une culture, ils n'y arrivent pas ».

Ces contenus immédiats, qui touchent principalement les jeunes ados, adeptes de trucs courts basés sur « la déconne », arriveront-ils à asseoir en eux une véritable idéologie ? Difficile de le savoir. Mais « ce qui est observé par contre c'est qu'il y a un retour, notamment chez les jeunes mecs, du masculinisme, notamment via les influenceurs. C'est terrifiant. J'espère qu'ils en reviendront. Et s'ils n'en reviennent pas tout de suite, ça fait quand même des dégâts. S'ils grandissent avec ça, il y a du chemin à faire pour eux…. »
A la fin de leur essai, Maxime Macé et Pierre Plottu rappellent que lorsque le Rassemblement National, après la dissolution, a manqué d'arriver en tête du second tour des législatives, Squeezie, suivi par 19 millions de personnes, a pris clairement position contre l'extrême-droite, de même que Lena Mahfouf, dite Lena Situation - 11 millions d'abonnés. Cependant, précisent les auteurs, « passée la joie, les influenceurs ayant pris la parole contre le RN se sont inquiétés pour la suite. « Je considère que ce n'est qu'un sursis et non une victoire », a ainsi estimé le vidéaste MisterMV, près de 500 000 abonnés sur Youtube, pour qui la gauche doit désormais « reconstruire et trouver une solution pour parler aux circonscriptions tombées sous le joug du RN » […] Reste à savoir si cet élan perdurera au-delà de l'urgence d'un scrutin. Car, en parallèle, la fachosphère continue à fourbir ses armes ». A la gauche de faire de même, sur le vaste terrain de lutte de la pop.
Par Macko Dràgàn
Abonnez-vous ! https://mouais.org/abonnements2025/
(1) https://www.auposte.fr/pop-fascisme-trump-aux-usa-influenceurs-en-france-auposte-x-mediapart/
(2) Bolchegeek, Pourquoi personne ne comprend THE BOYS, vidéo Youtube

Des acteurs et réalisateurs s’engagent à ne pas collaborer avec des institutions cinématographiques israéliennes “impliquées dans un génocide”

Des centaines d'acteurs, réalisateurs et autres professionnels de l'industrie cinématographique ont signé un nouvel engagement dans lequel ils promettent de ne pas collaborer avec des institutions cinématographiques israéliennes qu'ils estiment “impliquées dans un génocide et un apartheid contre le peuple palestinien”. “En tant que cinéastes, acteurs, travailleurs et institutions du cinéma, nous reconnaissons le pouvoir du cinéma à façonner les perceptions”, indique le texte de l'engagement. “Dans ce moment de crise urgente, où nombre de nos gouvernements permettent le carnage à Gaza, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la complicité dans cette horreur incessante.”
Parmi les signataires figurent les réalisateurs Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley et Joshua Oppenheimer ; ainsi que les acteurs Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O'Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood et Debra Winger. L'engagement comptait 1 200 signataires dimanche soir.
Le texte, partagé en exclusivité avec le Guardian, affirme s'inspirer du boycott culturel qui a contribué à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.
Les signataires s'engagent à ne pas projeter de films, à ne pas apparaître dans ou à ne pas collaborer d'aucune manière avec les institutions considérées comme complices, incluant festivals, cinémas, diffuseurs et sociétés de production. Les exemples de complicité incluent “le blanchiment ou la justification d'un génocide et d'un apartheid, et/ou un partenariat avec le gouvernement qui les commet”.
“Nous répondons à l'appel des cinéastes palestiniens, qui ont exhorté l'industrie cinématographique internationale à refuser le silence, le racisme et la déshumanisation, ainsi qu'à faire tout ce qui est humainement possible pour mettre fin à la complicité dans leur oppression”, peut-on lire dans le communiqué.
L'engagement a été publié par le collectif Film Workers for Palestine (Travailleurs du cinéma pour la Palestine). Le scénariste David Farr, l'un des signataires, a déclaré :
“En tant que descendant de survivants de la Shoah, je suis bouleversé et révolté par les actions de l'État israélien, qui impose depuis des décennies un système d'apartheid au peuple palestinien dont il a pris les terres, et qui perpétue aujourd'hui un génocide et un nettoyage ethnique à Gaza.Dans ce contexte, je ne peux pas soutenir que mon travail soit publié ou joué en Israël. Le boycott culturel a eu un impact significatif en Afrique du Sud. Il en aura un cette fois-ci aussi, et selon moi, il doit être soutenu par tous les artistes de conscience.”.
Une foire aux questions (FAQ) jointe à l'engagement explique comment identifier les institutions impliquées, en précisant que :
“Les principaux festivals de cinéma israéliens (notamment, mais sans s'y limiter : le festival du film de Jérusalem, le festival international du film de Haïfa, Docaviv et TLVFest) continuent de collaborer avec le gouvernement israélien pendant qu'il mène ce que des experts de premier plan qualifient de génocide contre les Palestiniens à Gaza”.
Et d'ajouter : “La grande majorité des sociétés de production et de distribution israéliennes, des agents de vente, des cinémas et autres institutions cinématographiques n'ont jamais soutenu les droits des Palestiniens tels que reconnus internationalement.”
L'engagement note cependant que « certaines institutions israéliennes ne sont pas complices » et recommande de suivre les lignes directrices fixées par la société civile palestinienne.
Les signataires précisent également que l'engagement ne les empêche pas de travailler avec des individus israéliens : “L'appel vise à inciter les professionnels du cinéma à refuser de collaborer avec les institutions israéliennes complices des violations des droits humains du peuple palestinien.
Ce refus vise la complicité institutionnelle, et non l'identité. Il y a aussi 2 millions de Palestiniens citoyens d'Israël, et la société civile palestinienne a élaboré des directives adaptées à ce contexte.”
L'engagement ne mentionne pas explicitement le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), le principal effort de la société civile visant à identifier les complicités avec Israël. Cependant, il s'agit de l'une des initiatives de boycott culturel les plus notables annoncées contre Israël depuis le début de l'offensive sur Gaza, près d'un an après qu'un millier d'écrivains ont signé une déclaration similaire.
Cette initiative évoque le collectif Filmmakers United Against Apartheid, fondé en 1987 par Jonathan Demme, Martin Scorsese et d'autres grands noms du cinéma, qui refusaient de projeter leurs films dans l'Afrique du Sud de l'apartheid.
Cette campagne s'inscrit dans un contexte de multiplication des protestations dans l'industrie du divertissement contre la guerre menée par Israël à Gaza. Plus tôt cet été, des centaines d'acteurs et de réalisateurs, dont Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Ralph Fiennes et le réalisateur Guillermo del Toro, ont signé une lettre ouverte dénonçant le silence de l'industrie cinématographique face à la campagne militaire israélienne à Gaza.
Beaucoup des signataires de ce nouvel engagement figuraient également parmi les membres du Screen Actors Guild qui, l'année dernière, ont demandé à leur syndicat de protéger les membres contre d'éventuelles représailles en raison de leurs prises de position sur la Palestine. Plus récemment, le syndicat des acteurs norvégiens a recommandé à ses membres de ne pas travailler avec certaines institutions culturelles israéliennes.
L'été dernier, Variety rapportait qu'une soixantaine de cinéastes palestiniens avaient signé une lettre accusant Hollywood de “déshumaniser” les Palestiniens à l'écran depuis des décennies.
Dans cette lettre, les cinéastes appelaient leurs collègues internationaux à “refuser de collaborer avec des sociétés de production profondément complices de la déshumanisation des Palestiniens, ou du blanchiment et de la justification des crimes d'Israël contre nous.”
La semaine dernière, The Voice of Hind Rajab, un nouveau film sur une fillette de cinq ans tuée par les forces israéliennes à Gaza en 2024, a reçu une standing ovation de 23 minutes après sa première au festival du film de Venise. Brad Pitt, Jonathan Glazer, Joaquin Phoenix, Rooney Mara et Alfonso Cuarón comptent parmi les producteurs exécutifs du film.
Traduction par RM pour l'Agence Média Palestine.
Source : The Guardian.

Make Hollywood Great Again : le cinéma américain au cœur d’une bataille idéologique

Hollywood, jadis vitrine du rêve américain, traverse une crise idéologique. Polarisation politique, pressions symboliques et recomposition des marchés font du cinéma un champ de bataille. S'y rejoue la redéfinition des normes culturelles, des récits dominants et de la projection internationale des valeurs nationales, entre fragmentation des publics et impératifs économiques. (Nashidil Rouiaï)
Tiré du blogue de l'auteur.
Depuis plus d'un siècle, Hollywood n'est pas seulement une fabrique de récits : c'est aussi un vecteur de projection des valeurs américaines à l'échelle mondiale, un instrument central du soft power des États-Unis[1]. À travers ses productions cinématographiques et sérielles, l'industrie hollywoodienne a contribué à façonner des imaginaires collectifs bien au-delà de ses frontières[2]. Cette puissance symbolique, que Joseph Nye a définie comme la capacité d'influencer sans contrainte, repose sur l'attractivité d'un modèle culturel. Mais ce rôle n'est ni neutre ni immuable : l'histoire du cinéma américain est traversée par des tensions idéologiques, des conflits de représentation, des débats sur la morale, l'identité et la norme sociale.
L'époque actuelle ne fait pas exception. La réélection de Donald Trump en 2025 a ravivé les luttes culturelles, inscrivant l'industrie cinématographique dans une logique de polarisation accrue − vis-à-vis de l'exécutif, mais aussi au sein de ses propres publics.
Vitrine viriliste et effluves de naphtaline
Dès le début de son mandat, Donald Trump a multiplié les gestes symboliques vers le monde du cinéma. La nomination, en janvier 2025, de Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight comme « ambassadeurs » de l'industrie hollywoodienne − sans mission définie − relève moins d'une politique culturelle structurée que d'un affichage idéologique. Ces figures masculines, blanches, sexagénaires, issues d'un cinéma d'action patriotique, incarnent une vision nostalgique de l'Amérique : virile, triomphante, unidimensionnelle. Cette mise en scène vise à opposer les productions contemporaines, jugées trop woke, à un âge d'or fictionnalisé, débarrassé de toute diversité revendiquée.
Ce geste politique est performatif mais fragile. Il mobilise des symboles saturés, détachés de toute stratégie industrielle cohérente et expose l'administration à un double paradoxe : d'une part ces figures apparaissent aujourd'hui datées, voire caricaturales ; d'autre part, elles sont peu compatibles avec les logiques économiques dominantes du secteur, qui visent à capter des publics jeunes, urbains et connectés − les salles de cinéma, par exemple, attirent majoritairement des spectateurs de 14 à 34 ans, qui représentent environ la moitié des entrées. Mais ces publics ne se résument pas à une seule catégorie : à la fois dans les salles et sur les plateformes, les spectateurs se caractérisent aujourd'hui par une grande hétérogénéité, en termes d'âge, de capital culturel, d'origines ou de sensibilités. Les plateformes comme Netflix[3] construisent leur stratégie autour de ce pluralisme, en s'appuyant sur des modèles algorithmiques capables d'agréger des niches globales et de répondre à des attentes narratives multiples, parfois contradictoires[4].
Au-delà de l'instrumentalisation de figures emblématiques du cinéma d'action, une offensive plus structurelle s'esquisse. Les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), promues depuis plusieurs années par des groupes comme Disney, Netflix ou Amazon Studios, sont devenues des cibles récurrentes du pouvoir exécutif : dès sa réélection, Donald Trump a interdit leur mise en œuvre dans les agences fédérales et conditionné des aides publiques à leur abandon dans les entreprises privées. En parallèle, certains films accusés de véhiculer un discours trop progressiste ont fait l'objet de pressions, voire de campagnes de boycott. La Petite Sirène (Marshall, 2023), porté par l'actrice afro-américaine Halle Bailey, ou Blanche-Neige (Webb, 2024), avec Rachel Zegler, actrice latino-américaine, ont été accusés d'effacer l'« identité blanche ». Dans un registre différent, The Apprentice (Abbasi, 2024), consacré aux débuts de Donald Trump, a suscité une hostilité intense. Le film, pourtant présenté au Festival de Cannes en 2024, a eu de grandes difficultés à trouver un distributeur aux États-Unis. Il a ensuite été visé par des menaces de poursuites judiciaires, tandis que son acteur principal, Sebastian Stan, a rapporté un isolement marqué au sein de la profession.
Le retour d'un maccarthysme culturel ?
Le parallèle avec le maccarthysme est tentant : dans les années 1950, les studios hollywoodiens avaient collaboré activement avec les autorités fédérales pour censurer ou exclure les artistes jugés subversifs, sous l'impulsion de la commission HUAC (House Un-American Activities Committee). La situation actuelle semble pourtant différente : dans ce climat de tensions, les grands studios adoptent une posture de retenue. Loin d'un ralliement explicite à la ligne idéologique de l'administration, il s'agit plutôt d'un ajustement prudent des prises de position publiques et, parfois, des contenus. Ce repositionnement se lit notamment dans la faible politisation des grands événements médiatiques du secteur.
La cérémonie des Oscars en mars 2025 en a fourni une illustration. Aucun discours de soutien ou de critique n'a directement évoqué l'administration en place, contrairement à certaines années où plusieurs acteurs et actrices n'hésitaient pas à exprimer des positions tranchées. Ce silence a d'ailleurs été remarqué et critiqué, non comme un signe d'adhésion, mais comme une forme d'évitement tactique, révélatrice de l'atmosphère tendue. Certaines prises de parole ponctuelles, comme celle de Jane Fonda lors des SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), ont tenté d'introduire une parole critique, bien que de manière mesurée. Cette autocensure ne concerne pas uniquement les prises de position publiques : elle tend aussi à infléchir les choix éditoriaux. La production de certains films devient plus risquée − soit parce qu'elle est susceptible de heurter l'exécutif, soit parce qu'elle expose ses acteurs ou réalisateurs à des campagnes hostiles, notamment sur les réseaux sociaux.
Il ne s'agit cependant pas d'une transformation radicale du paysage cinématographique : les lignes de force qui structurent les contenus depuis plus d'une décennie − diversification des récits, ouverture à de nouveaux visages, inclusion de thématiques sociétales − restent largement présentes, notamment sur les plateformes de streaming. Mais l'atmosphère actuelle pousse certains studios à adopter une stratégie d'attente. Dans ce contexte, le climat de précaution agit moins comme une censure que comme une logique de mise en veille : laisser passer la tempête, différer certaines productions, limiter les prises de risque en attendant un moment plus propice pour porter à l'écran des récits jugés potentiellement polarisants.
Les moyens d'influence de l'État fédéral
Pour comprendre cette logique de mise en veille, il faut cerner les risques économiques et pratiques auxquels l'industrie culturelle hollywoodienne est exposée. Si elle repose sur un modèle largement privatisé, elle n'échappe pas totalement à l'emprise des institutions publiques. Loin d'un pilotage direct à la française par un organe comme le CNC, le rapport entre les pouvoirs publics et les studios hollywoodiens s'inscrit dans une logique d'influence plus diffuse, mais non moins structurante.
Au niveau fédéral, plusieurs instruments permettent d'exercer une pression stratégique. La Federal Communications Commission (FCC), organe de régulation des télécommunications, en constitue aujourd'hui le relais le plus visible. Officiellement indépendante, mais présidée depuis 2024 par un proche du président, la FCC a ouvert en 2025 une enquête sur les politiques de diversité menées par le groupe Disney, sous prétexte d'examiner les pratiques internes de recrutement et de gouvernance. Si cette enquête ne vise pas explicitement les contenus audiovisuels − ce qui serait inconstitutionnel − elle fonctionne comme un signal : les studios sont désormais observés. En creux, l'objectif politique transparaît : il s'agit infléchir les représentations par un encadrement des conditions de leur élaboration.
D'autres leviers viennent compléter ce dispositif d'influence. L'administration fédérale peut conditionner son soutien à l'industrie par des aides économiques, des incitations fiscales, ou encore des autorisations logistiques. La mise à disposition de ressources militaires par le Pentagone pour certains tournages − chars, avions, personnels techniques − constitue un soutien précieux pour certains blockbusters, en particulier dans le genre du film de guerre ou d'espionnage. Ce partenariat, ancien et bien documenté, peut être suspendu ou réévalué selon les priorités politiques du moment, introduisant une forme de dépendance implicite entre studios et autorités fédérales.
À cela s'ajoute l'échelon des États : aujourd'hui, 37 États américains proposent des dispositifs d'incitation à la production cinématographique − crédits d'impôt, aides à l'installation, mise à disposition de studios ou de décors. Ces politiques territoriales, souvent concurrentielles, participent d'une économie politique du cinéma qui repose notamment sur la territorialisation des tournages. Elles créent un environnement dans lequel les studios doivent composer avec les attentes politiques locales, parfois dans la ligne présidentielle, parfois plus progressistes.
Enfin, les grandes opérations de fusion-acquisition − fréquentes dans le secteur des médias et des plateformes − sont soumises à validation par les agences fédérales. Ce pouvoir d'agrément, technique en apparence, peut devenir un levier de négociation. Dans un contexte de concentration croissante du secteur, les studios savent qu'un alignement avec l'administration en place peut faciliter certaines opérations stratégiques. La prudence éditoriale devient alors un investissement symbolique, destiné à garantir des marges de manœuvre commerciales.
En somme, l'État fédéral américain ne contrôle pas l'industrie culturelle hollywoodienne, mais il contribue à structurer les conditions dans lesquelles elle évolue. Par un jeu d'actions indirectes, de pressions diffuses et de partenariats conditionnels, il agit comme un filtre, un catalyseur ou un frein, selon les configurations. Cette influence s'est accrue sous l'administration Trump, qui a su mobiliser les outils de l'État pour réorienter, sans l'avouer, les représentations produites par Hollywood. Une stratégie d'autant plus efficace qu'elle ne repose pas sur l'imposition d'une ligne unique, mais sur l'activation sélective de dépendances structurelles.
Fragmentation des récits et polarisation idéologique
Les tensions actuelles entre industrie cinématographique, pouvoirs publics et attentes sociales ne donnent pas lieu à un basculement univoque du paysage audiovisuel américain. Au contraire, c'est par la fragmentation que se redessinent les équilibres : diversification des récits, polarisation des publics, émergence de contre-industries conservatrices. Cette recomposition interne témoigne moins d'un alignement généralisé sur une ligne idéologique que d'une adaptation tactique à des rapports de force mouvants, dans un champ devenu instable.
D'un côté, les productions progressistes − intégrant des thématiques liées à la diversité, au genre, aux inégalités − demeurent présentes et parfois très performantes sur le plan économique. C'est le cas du film Wicked (Chu, 2024), porté par deux actrices issues des minorités (Cynthia Erivo et Ariana Grande), qui figure parmi les plus gros succès mondiaux récents, malgré des campagnes de critique sur les réseaux sociaux. De même, des séries comme The Last of Us (HBO – 2023-2025), Arcane (Netflix – 2021-2024) ou Sex Education (Netflix − 2019-2023) participent à incarner une ligne éditoriale inclusive, plébiscitée par une part importante du public.
D'un autre côté, on assiste à l'essor de nouvelles plateformes et structures de production revendiquant une orientation conservatrice, religieuse, ou nationaliste. Des studios comme Angel Studios ou Pinnacle Peak Pictures (anciennement Pure Flix) se positionnent comme porteurs de productions conservatrices. Le premier a rencontré un succès inattendu avec Sound of Freedom (Monteverde, 2023) centré sur le démantèlement d'un réseau de pédocriminalité en Colombie, tandis que le second a produit la série de films God's Not Dead (2014-2024), qui dénoncent les discriminations et les menaces subies par les chrétiens évangéliques de la part des élites intellectuelles et culturelles aux États-Unis.
Cette polarisation idéologique s'observe aussi dans les stratégies de distribution. Ces studios ont su contourner les circuits classiques en mobilisant les plateformes de streaming, les réseaux religieux et communautaires, ou encore les salles indépendantes. Ils développent une économie de niche engagée, fondée sur la fidélité d'un public-cible, et sur des dispositifs de financement participatif ou de marketing communautaire.
Dans ce contexte, Hollywood ne s'uniformise pas, il se fragmente : la polarisation politique qui traverse la société américaine se traduit par une polarisation culturelle croissante, non seulement dans les récits, mais dans les structures mêmes de l'industrie.
Notes
[1] Benezet, E., Courmont, B., (2007), Hollywood -Washington : Comment l'Amérique fait son cinéma, Paris,
Armand Colin, 240 p. ; Valantin, J-M., (2003), Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois acteurs d'une stratégie globale, Paris, Editions Autrement, 206 p. ; Totman, S., (2009), How Hollywood Projects Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave, 226 p.
[2] Bosséno, C-M., Gerstenkorn, J., (1992), Hollywood : l'usine à rêves, Paris, Galimard, 176 p.
[3] On considère ici Hollywood au sens large, en y incluant les plateformes de streaming, dans la mesure où elles jouent désormais un rôle central dans la production, la distribution et la structuration des récits audiovisuels contemporains.
[4] Wayne, M. L. (2021). “Netflix audience data, streaming industry discourse, and the emerging realities of ‘popular' television”. Media, Culture & Society, 44(2), 193-209.
À écouter
« Cinéma : Make Hollywood Great Again », France Culture, 23/4/2025.
Sur le blogue
« Le cinéma, puissant outil du soft-power chinois » (Nashidil Rouiaï)
« Fredric Jameson, penseur de notre détresse politique » (Manouk Borzakian)
« Trump, maître de la géographie » (Gilles Fumey)
« Géographie de la violence : les États-Unis en pôle-position » (Gilles Fumey)

Haïti : la Drill, entre phénomène musical et vecteur de violence urbaine

Importée des États-Unis et adaptée à la réalité haïtienne, la drill, un sous-genre du rap au style percutant, s'est imposée depuis quelques années comme l'un des courants musicaux les plus populaires chez la jeunesse urbaine. Si elle séduit par son énergie brute et sa dimension expressive, elle soulève également de vives préoccupations quant à son rôle dans la normalisation de la violence, dans un pays déjà ravagé par l'instabilité sécuritaire et la crise sociale.
Par Jeanty Marvens
Linguiste
Une bande-son de la rue
Initialement née dans les quartiers défavorisés de Chicago, la drill s'est ensuite propagée à Londres, Paris, puis Port-au-Prince. En Haïti, ce courant musical a trouvé un terrain fertile dans les bidonvilles et zones sensibles, où de jeunes artistes comme Bourik the Latalay, Jiji 445 , ou King Peliko, s'imposent sur les plateformes numériques. Ces musiques sont consommées majoritairement par une jeunesse très vulnérables et qui a souvent tendance à prendre au sérieux les paroles utilisées et le comportement adopté par ces chanteurs de drill. Les conséquences s'avèrent démesurées dans un pays où déjà rien ne va.
Les paroles de leurs morceaux sont explicites : elles abordent la rue, les guerres de territoires, propagande des produits illicites, la vengeance, les armes à feu et la défiance envers les autorités. Dans les clips, les armes – parfois bien réelles – et les gestes menaçants occupent une place centrale, traduisant une volonté assumée de représenter sans filtre une
réalité brutale.
Un exutoire artistique ou une incitation à la violence ?
Pour de nombreux artistes, la drill est un canal d'expression légitime, permettant de traduire les frustrations, la colère et le sentiment d'abandon d'une jeunesse livrée à elle-même. À travers la musique, certains trouvent une échappatoire, une forme de reconnaissance sociale, voire une opportunité économique dans un contexte où les voies traditionnelles sont verrouillées.
Mais pour d'autres observateurs, ce mouvement musical agit également comme amplificateur de tensions. Dans un pays où les affrontements entre gangs rivaux sont quotidiens et où les armes circulent librement, la diffusion massive de textes glorifiant la violence peut avoir des effets pervers. Certaines chansons, loin de simplement raconter la violence, la banalisent voire la légitiment. Dans certains cas, elles servent de tribunes aux revendications de groupes armés ou de messages codés entre factions criminelles.
Un vide institutionnel préoccupant
Le développement de la drill en Haïti s'inscrit dans un contexte de désintégration de l'autorité étatique, d'absence de politique culturelle, et d'effondrement du système éducatif. Pour les jeunes issus des quartiers défavorisés, cette musique devient parfois le seul espace de visibilité dans une société où ils sont largement marginalisés.
« La drill est une manifestation artistique d'un malaise social plus profond. Ce n'est pas la musique qui crée la violence, mais elle peut contribuer à en entretenir la dynamique », analyse un sociologue spécialiste des cultures urbaines. Le problème n'est donc pas uniquement musical, il est sociopolitique.
Entre liberté artistique et responsabilité collective
La question de la régulation reste délicate. Tenter de censurer ce mouvement serait perçu comme une atteinte à la liberté d'expression et risquerait d'amplifier le phénomène. Toutefois, des pistes existent : éducation aux médias, accompagnement artistique, mise en place de programmes d'encadrement dans les quartiers sensibles, sensibilisation sur l'impact social des paroles.
Les plateformes de diffusion comme YouTube ou TikTok, souvent pointées du doigt pour leur manque de modération, pourraient également jouer un rôle plus actif en instaurant des mécanismes de signalement et de contextualisation des contenus violents.
Conclusion : une musique miroir d'un pays en crise
La drill en Haïti ne peut être réduite à un simple divertissement musical. Elle est à la fois le symptôme et le révélateur d'un profond déséquilibre social. Elle traduit un mal-être, mais elle peut aussi, si elle est canalisée, devenir un moteur de transformation culturelle.
La balle est désormais dans le camp des acteurs politiques, culturels et éducatifs. Car derrière le bruit des basses et les rimes percutantes, c'est toute une génération qui tente de faire entendre sa voix.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Livre à paraître : Passer à l’action !

À quelques jours de la rentrée, dans un contexte de coupes en éducation qui poussent peut-être à annuler le club d'échec, fermer le journal étudiant ou à réduire les heures d'ouverture de la bibliothèque, etc. ; explorons l'importance de ces espaces d'engagement dans le parcours des jeunes.
Passer à l'action ! le premier essai de Catherine Ouellet-Cummings, créatrice multidisciplinaire et coéditrice de la revue pour enfants Grilled-Cheese, paraîtra le 17 septembre prochain !
Il s'agit du 10e essai dans la collection Radar (15 ans +) chez Écosociété.
En bref : Dans Passer à l'action ! Catherine Ouellet-Cummings nous présente des jeunes de tous les horizons qui ont choisi de s'impliquer dans leur milieu scolaire ou ailleurs. Leurs récits démontrent que ces expériences d'engagement ont été formatrices et motivantes dans leur parcours, ont même souvent contribué à leur réussite.
À propos du livre
L'engagement vient d'une envie de changer quelque chose, de prendre part à un mouvement, de partager une passion ou de sentir qu'on appartient à une communauté. Appuyer une cause, participer à un projet dans son école, apprendre ce qui ne s'enseigne pas, défendre ses idées, aider un organisme, influencer des décisions, se sentir moins seul·e, revendiquer des changements : il existe autant de raisons de s'engager que de gens qui s'engagent. Cette démarche, à tout âge de la vie, permet de développer son estime de soi, de créer des liens sociaux et de trouver sa place dans la communauté.
Devant une injustice, plus facile de se taire, mais ça ne fait pas changer les choses. Les jeunes sont sensibles aux inégalités ; et si on valorisait davantage leur idéalisme, leurs motivations ? Et si on répondait à leur désir de savoir et d'avoir un impact ? Cet essai, en donnant la parole aux jeunes, invite toute une société à tendre l'oreille pour grandir avec sa jeunesse et rester ouverte à de nouvelles manières d'envisager l'avenir. Et si on leur donnait les outils pour se mobiliser plutôt que de leur apprendre à se taire ?
À propos de l'autrice
Catherine Ouellet-Cummings a publié des textes dans plusieurs magazines québécois et est créatrice de fanzines. En 2006, elle a cocréé le studio multidisciplinaire L'abricot. Elle est également cofondatrice et éditrice de Grilled cheese, un magazine jeunesse bilingue.

Les crises du capitalisme : logique, moment, perspectives

Cet article est issu d'une soirée du Centre d'études marxistes, le 16 décembre 2024. Ces formations visent à la fois un objectif d'autoformation et de réflexion critiques. Elles empruntent donc beaucoup à des travaux préexistants de camarades issu·es ou non de notre courant. L'auteur expose ici les dynamiques en œuvre dans les crises du capitalisme.
11 mai 2025 | tiré de la Revue L'Anticapitaliste n° 165 | Crédit Photo : Photothèque Rouge / Copyright : Photothèque Rouge/DR
Je vais être un peu technique, mais pas trop. Et compte tenu du cadre limité de cette présentation, je ne pourrai évidemment pas aborder l'ensemble des mécanismes des crises du capitalisme. Le capitalisme, c'est la crise, mais il y en a de différentes sortes.
Il y a les crises emblématiques : celle qui commence avec le krach d'octobre 1929 aux États-Unis, suivie de la grande dépression internationale ; celle des subprimes de 2008, qui a entraîné la faillite de Lehman Brothers et une grande récession sur une bonne dizaine d'années. Il y a aussi les crises trainantes, comme la stagflation des années 1970 (hausse des prix, hausse du chômage) qui débouche sur la vague néolibérale des années 1980 ou la déflation japonaise de 1991-2021, marquée par une atonie générale. Il y a aussi les crises dans la périphérie, comme le défaut de paiement du Mexique en 1982, qui déclenche une crise dans les autres pays du Sud, ou la crise asiatique de 1997-1998, qui touche la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud, etc.
L'histoire du capitalisme, c'est donc l'histoire de ses crises, mais aussi l'histoire de ses réponses temporaires à ses crises, par une réorganisation qui relance l'accumulation. Pour Ernest Mandel il y a un lien entre les grandes crises et les vagues d'accumulation du capital (les ondes longues). Pour lui, les solutions aux grandes crises sont toujours externes à l'économie capitaliste, ce sont les guerres, les conquêtes de régions non encore dominées par le capital, etc. Tandis que pour les théoriciens de la régulation, il existe des ajustements institutionnels qui permettent de sortir de ces grandes crises. Dans tous les cas, même si l'on admet une grande plasticité du capitalisme, jusqu'où peut-elle aller ?
Je souhaiterais ici évoquer les trois logiques fondamentales des crises, telles qu'analysées par Marx et les auteurs qui en sont proches. Puis, aborder la crise actuelle comme moment charnière, comme moment de bascule dans la régulation du capitalisme. Enfin, je prendrai quelques risques en tentant d'esquisser ce que nous indique le présent comme préfiguration de l'avenir.
Les trois logiques des crises capitalistes
Je distinguerai la suraccumulation de capitaux, la spatialisation (spatial fix) et la socialisation des crises.
1. La suraccumulation
Le capitalisme, c'est une accumulation de valeurs. David Harvey propose une analogie avec le cycle de l'eau (les océans, la condensation dans les nuages, l'eau qui retombe en précipitations), c'est toujours de l'eau sous différentes formes. La valeur c'est la même chose. Or, le capital, c'est de la valeur en mouvement. Pour bien comprendre ce qu'est le capitalisme et d'où viennent ses crises, je citerai Marx (Le Capital, Livre I, section VII) :
« Le premier mouvement qu'effectue le quantum de valeur censé fonctionner comme capital est la transformation d'une somme d'argent en moyens de production et en force de travail. Celle-ci se déroule sur le marché, dans la sphère de circulation. » C'est le mouvement A-M (transformation de l'argent en marchandise) : quelqu'un a de l'argent, il achète des bâtiments, des machines et de la force de travail.
« La seconde phase de mouvement, le procès de production, est achevée quand les moyens de production sont transformés en une marchandise dont la valeur dépasse la valeur de ses composantes, autrement dit, en une marchandise qui contient le capital avancé à l'origine plus une survaleur. » C'est le procès de production (PP), au cours duquel ces marchandises sont transformées en quelque chose qui vaut davantage que ses composantes, une valeur supplémentaire.
« Ces marchandises doivent ensuite être relancées dans la sphère de la circulation. Il faut les vendre, réaliser leur valeur en argent, retransformer cet argent en capital et ainsi de suite. Ce circuit, qui parcourt constamment les mêmes phases successives, constitue la circulation du capital. » Il faut que le capitaliste réalise sur le marché la valeur nouvelle qui a été créée dans le procès de production (c'est le mouvement M'-A').
Pour comprendre les crises du capitalisme, il faut avoir en tête ces trois moments. Ce schéma de David Harvey (voir figure 1) permet de représenter la même chose. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle suggère tous les points où la crise peut avoir lieu.
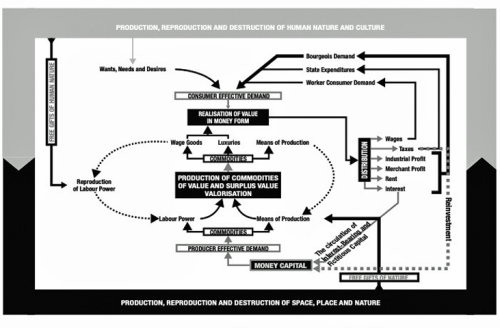
Figure 1
Elle peut se déclarer sur les marchés financiers : vous lancez une production de brocolis surgelés, votre business plan est parfait, mais les banques ne peuvent pas vous prêter d'argent, parce qu'on est en pleine crise des subprimes, en 2008. Mais la crise peut aussi se déclarer dans le procès de production, par exemple, parce qu'en 2021-2022, la pandémie prive votre entreprise des puces électroniques nécessaires. La production peut aussi être stoppée par une grève ou une catastrophe écologique. Enfin, la réalisation des profits peut être empêchée par l'absence de débouchés solvables au prix attendu, un aspect sur lequel insistent beaucoup les keynésiens. Ce schéma permet de comprendre que les crises du capitalisme peuvent avoir de multiples causes internes ou externes tout au long de la circulation du capital.
Les causes internes sont toujours liées à la suraccumulation du capital. Il y a trop de capital par rapport aux possibilités de l'utiliser de manière rentable. En d'autres termes, plus les profits sont importants, plus il est difficile de maintenir un taux de profit élevé. Cela nous ramène au thème très discuté par les marxistes de la baisse tendancielle du taux de profit (l'augmentation de la part du capital constant – les infrastructures, les machines, les matières premières –, qui ne produit pas de survaleur, augmente par rapport à celle du capital variable, la force de travail, qui produit seule la valeur nouvelle). Mais il peut aussi y avoir des stocks excédentaires et des capacités de production sous-utilisées ; un excédent de cash, parce qu'il est difficile d'investir de manière rentable (Apple dispose aujourd'hui de 160 milliards de dollars en cash) ; le chômage est aussi une manifestation de cette incapacité de mobiliser les ressources productives.
La suraccumulation conduit à la dévalorisation du capital : par ex., avec les crises immobilières, le capital congelé dans l'immobilier perd de sa valeur. C'est vrai aussi des stocks d'automobiles invendues, des machines sous-utilisées, etc. Cette dévalorisation est une manifestation de la crise, mais aussi un moyen pour le capital, qui a réussi à surmonter la crise, de se relancer en éliminant de la circulation le capital suraccumulé. Il y a ainsi de petites crises, avec des faillites, et des capitalistes qui parviennent à racheter des actifs à moindre coût, et des grandes crises, où le capitalisme peine à se relancer, comme en 1929-1932 ou en 20081…
2. La spatialisation (spatial fix)
C'est l'idée qu'on peut résoudre les crises en les déplaçant ailleurs. Par exemple, la réponse à la crise des années 1970 a été la mondialisation, la délocalisation d'une partie des activités ou l'achat d'intrants à moindre coût à des fournisseurs étrangers. Ce mécanisme a été perçu par David Ricardo et par Marx2. D'autre part, puisque la crise résulte de la suraccumulation de capitaux, l'investissement à l'étranger représente aussi une réponse possible. Marx explique que l'exportation des capitaux vise à relever le taux de profit. Il s'agit donc d'aller chercher des profits à l'étranger. La théorie marxiste de l'impérialisme explique que les capitalistes qui investissent à l'étranger vont devoir protéger leurs actifs, d'où la course aux armements, le militarisme et la guerre qui en découlent. Le cas de la Première Guerre mondiale est le plus classique.
La montée de la conflictualité avec l'étranger est aussi une réponse aux crises de réalisation (de débouchés), comme l'a montré notamment Rosa Luxemburg.
Il y a souvent un antagonisme entre marxistes et keynésiens sur ce point-là, que Michal Kalecky, un marxo-keynésien des années 1930-1940, a tenté de dépasser en expliquant qu'il y a certes des moyens de résoudre bien des crises du capitalisme, mais que cela n'est pas possible pour des raisons politiques. Parce que si la résorption du chômage dépendait d'une intervention de l'État, la société n'aurait pas besoin du capitalisme pour se gouverner elle-même ; mais aussi, parce que la disparition de l'armée de réserve industrielle minerait la discipline dans les usines. En revanche, la relance par le militarisme (keynésianisme militaire) ne pose pas les mêmes problèmes. L'aversion pour les dépenses publiques est surmontée par les dépenses d'armement, comme le montre en particulier le fascisme3.
Il peut aussi s'agir de transférer ailleurs, en particulier sur les pays du Sud, les coûts d'ajustement des crises. Le classique en la matière, c'est la crise de la dette. Dans les années 1980, lorsque le Plan Brady « résout » la crise de la dette latino-américaine, l'État américain « vient au secours » des pays les plus touchés en échange de concessions extraordinaires, les plans d'ajustement structurels, au profit des multinationales du Nord. Mais de l'argent est bien injecté dans ces économies, qui permet de sauver les banques américaines très exposées. De même, en 2011-2012, la « résolution » de la crise grecque vise à éviter un défaut de paiement et une contagion pour les banques européennes, en particulier françaises et allemandes, au prix d'un terrible ajustement pour la population grecque. Au lieu de dévaloriser les actifs des banques européennes, on a dévalorisé les Grecs eux-mêmes en coupant dans leurs salaires et leurs dépenses publiques. La perte de valeur a été ainsi transférée spatialement.
3. La socialisation
S'il y a une crise finale du capitalisme, il ne faut pas la penser en termes d'effondrement ou d'émergence spontanée du socialisme. En revanche, il y a une limite au capitalisme. Dans l'avant-dernier chapitre du Livre I du Capital, Marx explique que la tendance à long terme du capitalisme, c'est l'expropriation des expropriateurs, c'est-à-dire des capitalistes qui ont, à l'origine, exproprié les paysans, les petits artisans, les indigènes des colonies, etc. Or, cette logique d'expropriation s'est poursuivie durant toute l'histoire du capitalisme.
Les grosses entreprises absorbant les plus petites, le capitalisme conduit à une concentration et à une centralisation croissante de la production. Le monopole du capital devient ainsi un obstacle au fonctionnement du capitalisme, la loi de la valeur supposant la concurrence des capitaux entre eux. De même, la socialisation du travail tend à devenir incompatible avec son enveloppe capitaliste. « Les forces productives matérielles de la société entrent ainsi de plus en plus en contradiction avec les rapports de production existants ».
On notera que dans l'ensemble de ses raisonnements sur la logique des crises, Marx déploie une méthode qui consiste à découvrir le monde nouveau dans la critique du monde ancien. Il faut ainsi chercher dans l'ancien les potentialités de l'avenir. « Nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau en commençant par la critique du monde ancien » (Lettre à Arnold Ruge, septembre 1943).
Le moment charnière dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui
Nous sommes dans un moment de « périphérisation » de l'Europe, qui a été au centre du capitalisme pendant une grande partie de son histoire. Elle reste centrale à certains égards, mais de moins en moins. On peut dire qu'elle devient semi-périphérique dans une série de secteurs de pointe. Les deux graphiques en figure 2 montrent clairement cela.


Figure 2
Et si on considère les choses en détail, on s'aperçoit que la part des États-Unis dans le PIB mondial (à parité de pouvoir d'achat) a diminué, mais pas tant que ça, tandis que la réduction des parts du Japon, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni sont spectaculaires. Pour ne prendre que l'Allemagne et la France, soit le cœur de l'Union européenne, elles représentaient 10,6 % du PIB mondial en 1980. Aujourd'hui, elles ne pèsent plus que la moitié, soit 5,3 % du PIB mondial. En revanche, la Chine et l'Inde sont passées de 5 % du PIB mondial à plus de 20 % aujourd'hui. Il s'agit d'un basculement historique.
Ce basculement s'est produit dans une période marquée par la perte de dynamisme du capitalisme dans les principaux pays riches : dans les pays du G7, la croissance annuelle est passée de 3 %, au début des années 1980, à 1 % aujourd'hui, avec une grande instabilité croissante (la crise de 2008 et celle du Covid y sont particulièrement spectaculaires (voir figure 3).

Figure 3
Ce n'est pas pareil dans le reste du monde : la Chine et l'Inde ont connu une croissance accélérée avec un ralentissement dans les années 2000 (très marqué pour la Chine), qui se traduit par une décélération à l'échelle mondiale. Depuis les années 2010, la Chine ne compense plus le ralentissement observé dans le reste du monde. Nous sommes donc dans un moment marqué par la marginalisation de l'Europe et par un ralentissement généralisé du capitalisme mondial, à l'œuvre depuis plusieurs décennies dans les économies riches, auquel participe aujourd'hui la Chine (voir figure 4).
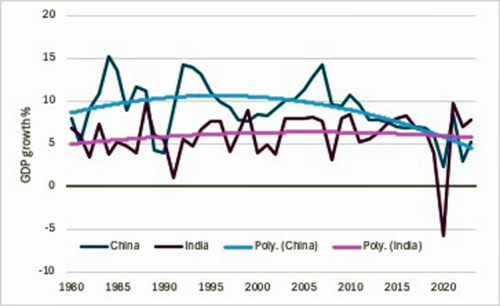
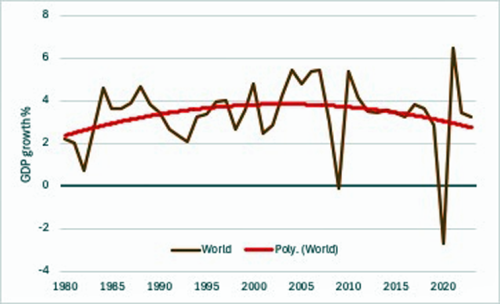
Figure 4
Nous assistons à un épuisement des forces motrices du régime néolibéral, qui a été tiré par la mondialisation financière (commerce et investissements internationaux). Il avait permis de compenser la perte de dynamisme des « pays riches ». Or, la part du commerce dans le PIB mondial a cessé de croître dans la foulée de la crise de 2008 et il a même commencé à reculer (voir figure 5).

Figure 5
De même, les entreprises tendent à moins investir dans les pays éloignés. Enfin, la part du commerce mondial sous sanction n'a cessé d'augmenter depuis 2010 (aujourd'hui 12 %), d'où une tendance à la fragmentation économique.
Depuis la crise de 2008, on observe aussi un ralentissement très net des investissements internationaux, en particulier dans les pays riches. La mondialisation financière n'a pas disparu, mais elle a cessé de croître et elle a marqué une tendance au repli.
Quelle est la dynamique des profits financiers ? Pour les États-Unis, c'est assez net. On assiste à un déclin de la part des profits financiers sur l'ensemble des profits. Pour la zone euro, on a observé une même tendance moins nette jusqu'en 2022-2023, mais, avec la hausse des taux d'intérêt, les banques ont réalisé de gros profits depuis lors. Il semble pourtant bien que le poids du secteur financier ait commencé à reculer dans l'économie mondiale.
Ce qui est le grand mystère, c'est la suraccumulation du capital fictif (actions, titres de la dette publique, prêts bancaires, etc.) (voir figure 6), qui est échangé et comptabilisé comme d'autres éléments du capital, mais qui ne génère pas de valeur, contrairement au capital investi dans les entreprises. Dans le langage commun, il s'agit de la « sphère financière ». Quel est donc le poids de ce que Marx appelait « les formes basiques du capital fictif », c'est-à-dire la capitalisation boursière, le crédit au secteur non financier et la dette publique, par rapport au PIB, à l'économie globale ? Dans ces dernières décennies, il n'a cessé de croître (à part en Allemagne, où il s'est stabilisé autour de 2008).

Figure 6
Si on veut comprendre comment le capitalisme a tenu durant ces dernières années, il faut tenter de comprendre ce qui se joue avec ce poids extraordinaire de la sphère financière et jusqu'où cela peut aller. Hyman Minsky, un économiste étatsunien postkeynésien progressiste a évoqué un « moment » où la croissance de la sphère financière arrive à un niveau insupportable, prélude à un retournement brutal. Pour éviter la répétition de la crise de 2008, James Crotty, un économiste postkeynésien américain influencé par le marxisme, avait affirmé alors qu'il fallait contraindre politiquement les marchés financiers à se contracter par rapport aux secteurs non financiers et marginaliser ou interdire les titres non transparents, complexes ou illiquides4. Il ajoutait que si ce n'était pas le cas, la croissance trop faible de l'économie réelle ne permettrait pas à terme de soutenir les expectatives de profit d'une sphère financière en expansion continue.
Pourtant, la sphère financière a continué à croître depuis 2008. Pourquoi ? Parce que l'État a volé à son secours. Les banques centrales ont validé des dettes privées en augmentation constante. Ainsi, leurs actifs, qui ne représentaient que 5 % du PIB des États-Unis en 2005 et 10 % de celui de la zone euro, se montaient respectivement à près de 40 % et 70 % du PIB en 2022 (voir figure 7). Pourtant, comme l'a expliqué l'économiste marxiste Suzanne de Brunhoff, aucune politique publique de pourra jamais abolir les contradictions fondamentales qui sont à l'origine des tensions financières. La question est de savoir où se situe l'ultime frontière de cette intervention publique et si l'on s'en rapproche aujourd'hui. Sans entrer dans des considérations techniques, je pense que nous sommes arrivés au terme de l'hégémonie de la sphère financière et qu'il va donc falloir réduire le poids du capital fictif par rapport à l'économie réelle.
Figure 7
Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir une crise financière catastrophique. Celle-ci aurait en effet déjà dû avoir lieu. En mars 2020, avec le Covid, les bourses se sont effondrées. Pourtant, elles se sont assez vite rétablies. Pourquoi ? Parce que les banques centrales sont intervenues pour empêcher une crise financière. À l'automne 2023, la Fed est encore intervenue massivement pour éviter une contagion de la faillite de la Silicon Valley Bank. En Europe, un mécanisme de la BCE est prévu pour contenir toute nouvelle crise de la dette. Donc, je crois plutôt à une crise financière au ralenti, qui verrait le capital fictif rongé par l'inflation. Cependant, avec l'essor des crypto monnaies et leur dérégulation par Trump, un grave choc financier ne peut pas être exclu.
Il n'en reste pas moins que la sphère financière ne tient que par le soutien public, et donc par une volonté politique. Lorsque la droite dénonce l'assistanat et l'explosion des dépenses publiques, etc., il faut lui rappeler ce fait essentiel.
En quoi le moment présent est-il porteur des traces de l'avenir ?
Qu'est-ce qu'on peut observer dans le présent et quelles en sont les potentialités futures ? Je vais discerner trois logiques : l'exaltation néofasciste (l'affreux) ; le vraiment moche, une stagnation techno-féodale ; une planification écosocialiste, ce qu'on souhaiterait, qui semble peu probable. Mais à l'ère des catastrophes, les choses bougent très vite. On peut aussi imaginer des hybridations de ces trois solutions.
1. L'exaltation néofasciste (l'affreux)
Nous observons aujourd'hui le mariage, à la tête de l'économie la plus puissante économie du monde, d'une extrême droite décomplexée avec une dimension néofasciste et de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, incarnation des secteurs les plus dynamiques du capitalisme en termes de valorisation. Les mêmes tendances sont à l'œuvre dans d'autres régions du monde.
Quelle est la signification économique de cela ? Rappelons que pour Kalecki, le fascisme permet de dépasser l'aversion pour les dépenses publiques, parce que la résorption du chômage ne débouche pas sur un meilleur rapport de force pour les travailleurs, dans la mesure où la liquidation des syndicats et la répression politique y pourvoient (la pression politique remplace la pression économique du chômage). Cela rend possible une relance keynésienne par les dépenses publiques avec une explosion de la dette. C'est ce qui semble se dessiner aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, où la règle d'or de la réduction du déficit budgétaire est remise en cause à l'approche des élections, même si la droite l'emporte. Les capitalistes semblent croire à cette solution, si l'on considère la hausse des marchés boursiers aux États-Unis après l'élection de Trump. Ils se disent que les impôts vont baisser, que les réglementations vont être allégées, et que de nouveaux profits seront possibles.
Les marchés anticipent aussi un retour de l'inflation. L'idée que la dernière vague d'inflation a été réglée durablement n'est pas convaincante en raison des tensions que connaît la finance internationale dans un contexte de fragmentation géopolitique et de guerre. Aux États-Unis, la facilitation de la formation d'ententes et de cartels, mais aussi la hausse des droits de douane, va aussi dans ce sens. Toutefois, en dépit de la baisse de la syndicalisation, cette dernière période a vu une montée des mobilisations ouvrières et certaines victoires (en particulier dans l'automobile). Or, il faut souligner que l'inflation n'est pas neutre sur le plan social. Bien sûr, si le pouvoir d'achat des classes populaires pouvait être maintenu, elle éroderait le pouvoir du capital. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Mais si la défense des bas revenus n'est pas assurée, elle pèse proportionnellement plus sur eux, parce que ce sont les produits les moins chers qui voient leurs prix augmenter le plus vite. Avec Trump, l'autoritarisme politique tendrait donc plus que jamais à faire payer l'inflation par les classes populaires.
Avec la hausse des dépenses publiques dans le secteur de l'armement, la guerre devient aussi une option moins improbable. Ceci peut aller de pair avec un retour de formes de planification et d'organisation de l'économie. Or, ce que montre Benjamin Bürnbaumer, c'est que la dynamique des capitalismes étatsunien et chinois les pousse de plus en plus à la confrontation. Les complémentarités entre eux, qui avaient nourri la mondialisation financière, tendent aujourd'hui à s'épuiser avec le rattrapage de la Chine5.
2. Le techno-féodalisme (le mauvais)
Le technoféodalisme est une tendance à l'œuvre au cœur du capitalisme actuel6. Le féodalisme, c'était une petite production sur laquelle pesait le prélèvement seigneurial en raison d'une contrainte politique. Certes, le capitalisme actuel ne tend pas à revenir à la petite production individuelle, tout au contraire, la socialisation croissante de la production se poursuit (il suffit de penser à Amazon et à ses liens avec une multiplicité sans précédent de secteurs économiques). Mais une logique de prélèvement, de prédation, se développe, et ceci sous trois angles :
A) Comme le serf du Moyen Âge était attaché à la terre, nous sommes attachés à la « glèbe numérique ». Les individus, la gig économie, les entreprises, les États, etc. dépendent toutes de ces plateformes. Il en découle que des entreprises très particulières dominent la structuration actuelle du capitalisme.
B) On observe une fusion de l'économique et du politique. En Chine, les plateformes numériques sont très développées et l'État les a reprises en main au cours de ces 3 à 4 dernières années. Il a acquis des actions des participations qui ne lui rapportent aucun dividende mais lui donnent un pouvoir de veto. L'État chinois comprend en effet que le contrôle de ces plateformes est indispensable au contrôle de l'organisation sociale, c'est pourquoi il n'entend pas les laisser se développer de façon autonome.
C) La concurrence entre les entreprises existe toujours, mais elle se fait de plus en plus au niveau de ces énormes capitaux numériques dans un jeu à somme nulle. Leur logique vise à multiplier les capteurs qui permettent de contrôler l'activité sociale, de la centraliser vers leurs plateformes et de prélever ainsi un revenu. Ce n'est pas une logique de production, mais une logique de prédation par le contrôle du territoire de l'organisation sociale. Des entreprises sont désormais capables de centraliser et de conserver les connaissances sociales générales, formant une nouvelle classe d'organisations propres, de plus en plus détachées des autres capitaux au sommet de la structure industrielle. Elles se battent entre elles pour monopoliser les formes de coordination sociale.
Ernest Mandel insistait sur la capacité des multinationales à organiser l'activité économique. Mais que dire du petit nombre de plateformes qui rivalisent pour le contrôle ultra-centralisé de l'activité sociale ? Ces entreprises sont des méta-agents de la connaissance. Elles représentent le top du capitalisme mondial. Ce sont les plus grosses sociétés en termes de capitalisation boursière (voir figure 8). Parmi les 8 première, il y en a 7 qui sont américaines et liées au numérique (la seule qui ne l'est pas est saoudienne, dans le secteur pétrolier).

Figure 8
Des figures incarnent cette évolution. Musk est l'homme le plus riche du monde, il est à la manœuvre au cœur du gouvernement US, il possède les capacités de calcul les plus développées (en 2024, il a lancé le centre de calcul Colossus pour entraîner son modèle d'IA), mais aussi l'ensemble de données propriétaires le plus important (grâce à son réseau de satellites Starlink qui lui fournit des images satellite et des flux de communication de l'ensemble de la planète en temps réel ; grâce aussi aux caméras vidéos de tous les véhicules Tesla qui circulent dans le monde ; grâce aux données de son réseau social X).
L'essor du techno-féodalisme laisse entrevoir une société post-capitaliste sous une forme terrifiante qui pourrait conduire à un nouveau mode de production régressif.
3. La planification écosocialiste (le bon)
Bien sûr, cette option paraît aujourd'hui improbable en raison des rapports de force sociaux en présence. Mais il ne faut pas oublier que la crise écologique qui ne cesse de s'accélérer va avoir des répercussions politiques exceptionnelles. Sur les 9 frontières écologiques évaluées, 6 ont déjà été dépassées (voir figure 9). L'idée qu'il va falloir modifier de façon radicale les formes d'organisation de notre rapport à la biosphère va devenir de plus prégnante dans les années et décennies à venir. Or, les deux options précédentes ne présentent aucune réponse à ce problème.
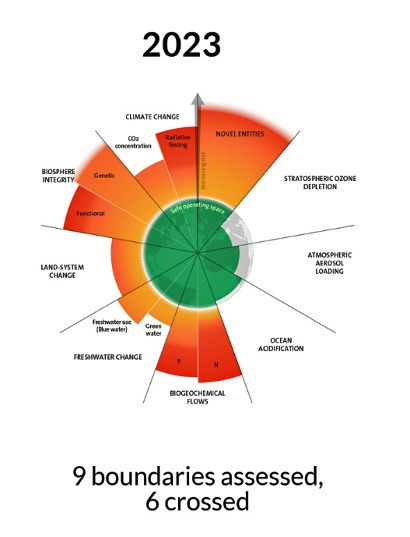
Figure 9
Comme l'économiste écologiste William Kapp l'écrivait déjà en 1970 : « La transformation actuelle de l'environnement n'est plus l'expression d'une maîtrise croissante du monde dans lequel nous vivons, mais au contraire le signe d'une perte de cette maîtrise ». Ce qui se joue à propos de la planification écosocialiste, c'est le métabolisme de la société humaine avec la nature qui est complètement dans le rouge. Aujourd'hui, le principal agent de ce métabolisme, c'est la loi du profit. Si on prend au sérieux le défi écologique, il en découle donc des conclusions radicales.
La crise écologique est aussi économique. C'est ce que les marxistes écologistes appellent « la seconde crise du capitalisme », associée aux perturbations dans le processus de valorisation liées aux dégradations de l'environnement. Un graphique de la Banque des règlements internationaux, la banque des banques centrales, montre que les catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes et que leur coût est de plus en plus lourd. Ceci pèse bien sûr sur le secteur des assurances, mais pas sur lui seul.
Cette crise peut-elle être maîtrisée au sein du capitalisme ? Que dire de la « finance verte » ? Le responsable des investissements chez Black Rock a jeté l'éponge après un an et demi en raison d'une crise morale. Il explique que les investissements verts sont du greenwashing (une escroquerie consciente), mais aussi une escroquerie théorique (si l'on pouvait faire autant ou plus de profits avec des « investissements verts », la loi du profit les garantirait spontanément).
En Allemagne, une filiale de la Deustche Bank proposait des « investissements verts ». À la suite d'une dénonciation de la part d'un responsable, une enquête de police l'a forcée à réduire de 75 % les actifs qu'elle prétendait « verts », c'est-à-dire qu'elle mentait à 75 %. Enfin, une étude publiée en septembre 2024, qui prend en compte toutes les obligations « vertes » publiques et privées émises aux États-Unis de 2014 à 2023, a montré que 2 % seulement d'entre elles apportaient quelque chose par rapport aux investissements classiques (dans 98 % des cas, ces investissements n'ont rien de « vert »).
Si les décideurs publics et privés parlent beaucoup des enjeux écologiques, ils ne font pas grand-chose de tangible en la matière. C'est une source de crise interne et de fragilité au sein des élites responsables de ces politiques. C'est pourquoi, avec Razmig Keucheyan, nous avons développé un programme de planification écologiste réformiste-révolutionnaire, qui met l'accent sur la socialisation de l'investissement7. Cette perspective a été défendue par Michel Husson, sous le nom de plume de Maxime Durand, dans un papier remarquable8.
Planifier écologiquement aujourd'hui, c'est se donner les moyens d'établir un inventaire permanent de la nature, alors que la comptabilité écologique n'existe pas. C'est se donner le moyen de faire des scénarios en fonction des contraintes écologiques dont on prend conscience et de quel genre de vie on veut. L'outil pour le faire, c'est le contrôle des investissements qui priverait les capitalistes de leurs principales prérogatives. Ainsi pourrions-nous éviter les défaites et les cauchemars que j'ai évoqués précédemment.
Notes
1. David Harvey, Les limites du capital. Suaccumulation et dévalorisation. Éd. Amsterdam, 2020.
2. « Le capital est envoyé à l'étranger, non pas parce qu'il ne pourrait absolument pas être utilisé dans le pays, mais parce qu'il peut être employé à un taux de profit plus élevé dans un pays étranger » (Marx, Le Capital, Livre III, chap. XV.
3. Sous le fascisme, « l'aversion pour les dépenses publiques [...] est surmontée en concentrant les dépenses publiques sur l'armement » in Michal Kalecki, Selected Essays on the Dynamic of Capitalist Economy, Cambridge U. P., 1971, p. 141.
4. « L'ampleur et la gravité de la crise actuelle montrent clairement que la trajectoire de croissance des marchés financiers au cours des dernières décennies n'est pas viable et doit être inversée » in James Crotty, Cambridge Journal of Economics, 33(4), 2009.
5. Benjamin Bürnbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Éd. Maspero, 2024.
6. Cédric Durand, Tecno-féodalisme, critique de l'économie numérique. Éd. La Découverte, 2023.
7. Cédric Durand et Razmig Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Paris, La Découverte, 2024.
8. « Planification. 21 thèses pour ouvrir le débat », 1991 (http ://hussonet.free.fr/plani21.pdf).

Où la main très visible de Donald Trump conduit-elle les États-Unis ?

Alors que les dirigeants du Sud global s'unissent pour tourner le dos à la politique tarifaire de Washington, Donald Trump poursuit l'administration de la politique économique des États-Unis suivant ses intérêts personnels. Si le président américain donne la priorité à la souveraineté, les effets du « national capitalisme autoritaire » qu'il déploie vont à l'encontre des objectifs du Make America Great Again.
9 septembre 2025 | tiré d'AOC media
https://aoc.media/opinion/2025/09/08/ou-la-main-tres-visible-de-donald-trump-conduit-elle-les-etats-unis/?loggedin=true
La fin du projet néolibéral a déjà été annoncée à de multiples reprises, alors même que, pendant plusieurs décennies, il a continué à inspirer les politiques, même de ses opposants. On pense au programme politique de Tony Blair ou encore à celui des partis de gauche, tel le Parti Socialiste français ou encore des Démocrates nord-américains. Au-delà de tout doute, Donald Trump ouvre une autre période qu'il convient de caractériser.
Un interventionnisme tous azimuts
Clairement le mythe de la main invisible du marché organisant l'allocation des ressources a vécu tant du fait de la domination de monopoles dans les secteurs émergents que de la recherche de la souveraineté nationale par nombre de gouvernements. Or le meilleur élève de la classe est sans nulle doute Donald Trump. Voici un échantillon de ses récentes décisions.
Le gouvernement américain octroie de nouvelles licences d'exportation aux entreprises NVIDIA et AMD moyennant le paiement de 15 % de taxes. La même mesure est envisagée pour l'exportation au reste du monde des avions F35s. Les décisions du gouvernement sont souvent négociées unilatéralement avec les entreprises qui parviennent parfois à être exemptées des droits de douane brandis comme des menaces. On se souvient du cadeau de Tim Cook à Trump qui lui a permis d'exempter Apple de droits sur l'importation de chips.
Contrairement à l'administration Biden, les mesures ne sont pas horizontales et universelles mais spécifiques car bilatérales et façonnées par la vision très personnelle du monde de Donald Trump. En témoigne la distribution chaotique de l'augmentation des droits de douane, déterminée plus par la vision géopolitique de Donald Trump que par la recherche de l'efficacité économique.
Au début de son second mandat, le lobby des capitalistes high tech de la Silicon Valley semblait faire jeu égal avec le Parti Républicain quant à l'orientation de la politique économique. Depuis le spectaculaire divorce entre Elon Musk et Donald Trump, il est clair que le pouvoir en dernière instance appartient au politique. La chute des cours boursiers de Tesla entérine cette hiérarchie. Lorsque le Président des États-Unis menace le PDG d'Intel à propos de ses exportations en direction de la Chine ce dernier résiste un temps avant d'accepter de céder 10 % de son capital à l'État Américain. Observerait-on une certaine convergence entre l'administration de l'économie par le gouvernement Chinois et celui des États-Unis, les objectifs politiques l'emportant sur le jeu des forces du marché en ce qui concerne les décisions stratégiques ?
Un national capitalisme autoritaire….
La rupture avec l'idée que l'économie est la discipline régissant l'allocation efficace des ressources rares est complète. La stratégie ouvertement protectionniste entend se passer des bénéfices de la division internationale du travail au nom de la souveraineté nationale. C'est un changement majeur par rapport au rôle qu'avaient joué les États-Unis quant à l'ouverture progressive du monde, mais finalement réussie, à l'échange international.
La seconde rupture concerne l'état de droit et le primat de la démocratie : le gouvernement a le droit de s'affranchir des règles juridiques et même de la constitution afin de mieux servir l'intérêt national. L'exécutif tend à concentrer une partie croissante du pouvoir de l'État, au détriment des instances délibératives et du respect du droit.
Voilà qui justifie le recours à la notion de « national capitalisme autoritaire » forgée à la lumière de la stratégie déployée par Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, ce depuis plusieurs décennies. Ou encore de Viktor Orbán, qui fut, semble-t-il, un temps une source d'inspiration pour Trump. Le trumpisme est alors resitué dans un mouvement plus général de basculement du primat de l'économie à celui de la sécurité et de la souveraineté. Une enquête récente montre que près de 70 % de la population mondiale n'est plus régie par des gouvernements se réclamant de la démocratie mais de formes variées d'autoritarisme (Narendra Modī) ou même de dictature au titre du Parti Communiste (Xi Jinping).
De longue date, telle était aussi la stratégie de Vladimir Poutine, sans que pour autant ce dernier parvienne à relancer la modernisation de l'économie russe. Ainsi, ce national capitalisme autoritaire est loin d'être la panacée permettant de construire des systèmes économiques alternatifs à ceux fondés sur le libéralisme. En effet, au surprenant succès économique du Parti Communiste Chinois, s'oppose le long déclassement de l'économie russe alors qu'Inde et Turquie suivent des trajectoires économiques encore différentes.
…. Contre l'amélioration du niveau de vie
Pour autant, le trumpisme introduit des caractéristiques spécifiques. D'abord, il vise un réexamen radical du capitalisme Nord-Américain en tant que pilier des relations internationales. En conséquence, la nouvelle politique impacte directement la plupart des autres pays. Leurs gouvernements se demandent si le trumpisme ne va pas s'imposer comme le nouveau régime politique. La manipulation de la menace des droits de douane est devenue l'instrument privilégié, ce qui déstabilise la plupart des autres régimes socioéconomiques, dont par exemple celui de l'Inde et plus encore celui de l'Union Européenne.
Ensuite la personnalisation et concentration du pouvoir atteignent des niveaux sans précédent pour un pays qui se voulait exemplaire en matière de démocratie. Traditionnellement, était établie une claire distinction entre les deux corps du roi : l'un personnel et mortel, l'autre incarnant un pouvoir intertemporel. De fait, dans nombre de pays, le Président est le mandataire du peuple. A contrario, Donald Trump considère que le pouvoir lui a été personnellement délégué et qu'il n'a pas à être contrôlé par une quelconque instance. Qu'il prenne des décisions qui favorisent l'accroissement de sa propre fortune n'a plus rien de choquant aux yeux de tous ceux qui ont peur de perdre leur statut et leur charge dès lors qu'ils déplaisent ou entrent en conflit avec le Président.
Ainsi s'introduit une extraordinaire personnalisation et subjectivité des décisions économiques du Président des États-Unis. Régler ses comptes avec ses partenaires ou ses ennemis conduit souvent à des décisions qui pénalisent l'économie américaine. Or Donald Trump avait promis de faire baisser l'inflation, dont l'envolée sous Biden avait pénalisé le niveau de vie des Américains et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont voté pour lui à l'élection de 2024. Cette contradiction va se développer tout au long de la seconde présidence au point d'en déterminer l'issue.
Le refus des procédures de contrôle et de régulation
Par rapport au premier mandat, le second se caractérise par la levée du contrôle que pouvaient exercer les conseillers et les administrations fédérales sur les décisions irraisonnées de Donald Trump. Tel n'est plus le cas du second puisque le critère dans le choix des hauts fonctionnaires n'est plus la compétence mais la loyauté à l'égard du président. Ont été ainsi mis à pied nombre de hauts responsables qui capitalisaient l'expertise de l'administration fédérale dans les domaines du renseignement, de l'appareil statistique, de la diplomatie, de la justice, de l'éducation ou encore de la santé.
Voilà qui augure fort mal de l'efficacité d'une politique dont la philosophie est simple et brutale : l'exécutif a le droit de reconfigurer ses relations avec le législatif et le juridique et donc d'ignorer les procédures héritées de ses prédécesseurs. En quelque sorte, le président est le décideur en toute matière et en première instance. Un tel basculement est-il viable ?
Si chaque jour le droit est mis à mal, vont se cumuler des décisions qui n'ont aucun fondement juridique ou légitimité constitutionnelle. Cela peut s'avérer dramatique puisque, par exemple, sauf situation d'urgence dûment constatée, la fixation des droits de douane appartient au Congrès et non au président. Adieu donc à une force de rappel qui viendrait de la délibération dans l'espace politique et de sa capacité à éviter des erreurs majeures du point de vue de l'intérêt bien compris des États-Unis.
Le fait que le parti Républicain se soit rangé sous la bannière de Donald Trump est aussi préoccupant car une stratégie erronée peut ainsi se prolonger tout au long du second mandat. Seul deux ou trois Républicains ont eu le courage de s'exprimer contre Donald Trump alors que d'autres opposants potentiels ont décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections. La prise de contrôle du parti par le président se construit donc sur la peur de ne pas pouvoir être candidat dès lors que l'on se serait opposé, en quoi que ce soit, à sa volonté. L'autoritarisme a remplacé la délibération démocratique. S'inscrit dans la même stratégie la volonté de redécoupage des circonscriptions électorales afin d'éviter la défaite des Républicains aux élections de mi-mandat.
La presse américaine est bien connue pour exercer un contrôle exigeant sur les décisions du gouvernement. On se souvient d'affaires célèbres à l'issue desquelles, par exemple, le président Nixon dût démissionner pour avoir indûment espionné le siège du parti démocrate. A contrario, en 2025 le Washington Post ne s'autorise plus à critiquer le président et la presse en général est loin de sonner l'alarme concernant la montée de l'autoritarisme. A nouveau le président a les moyens de limiter leur liberté de parole, tout comme la liberté de recherche dans le système académique, si importante dans la construction du soft power américain. De plus, comme il a déjà été mentionné, la Silicon Valley s'est rangée dans le clan de Trump et la volonté d'obstruction d'Elon Musk a été annihilée.
Le salut pourrait-il venir des anciens alliés des États-Unis qui lui rappelleraient les vertus du multilatéralisme et la raison économique qui montre que le protectionnisme tous azimuts est un jeu perdant-perdant ? Bien sûr, il n'en est pas question lorsque l'on observe la violence du traitement réservé à l'Union Européenne. Pendant ce temps, la Chine défend avec succès ses intérêts, alors que c'était la principale cible de Donald Trump. De plus, en complément de la route de la soie, elle est en train d'aiguiser la volonté des BRICS de faire émerger à terme un régime international qui marginaliserait les États-Unis. Dans ce contexte, ce sont les financiers internationaux qui détiennent le pouvoir de « réguler » en dernière instance l'aventure trumpiste. Ce n'est guère encourageant.
La crise ouverte de l'idéal démocratique
Rétrospectivement, Kamala Harris n'avait pas totalement tort de penser que l'un des enjeux de l'élection de novembre de 2024 n'était autre que l'avenir de la démocratie. L'argument était loin d'être percutant pour les laissés pour compte de l'internationalisation et la financiarisation de l'économie américaine, mais pour l'analyste le danger qu'elle pointait s'avère réel. Pourquoi donc les institutions de l'état de droit et l'idéal démocratique n'ont-ils pas résisté ?
Au fil des multiples interventions militaires de l'Irak à l'Afghanistan, l'opinion publique s'est lassée de voir les États-Unis jouer le rôle de gendarme du monde, au détriment de la recherche de solutions aux problèmes domestiques. Tant les Républicains que les Démocrates ont été parties prenantes de ces dépenses militaires considérables qui ont plutôt aggravé les problèmes qu'elles étaient censées résoudre. Tant le Président Obama que Trump ont perçu ce danger et ce dernier en a fait un argument de campagne électorale : obtenir par exemple la paix en Ukraine dès son arrivée au pouvoir.
La brèche sociale créée par l'ouverture à la concurrence européenne, japonaise, asiatique puis mondiale, s'est approfondie au cours des trois dernières décennies. Comme l'impôt a été rendu moins progressif, le rendement du capital a décollé par rapport à la progression de la productivité qui auparavant assurait une certaine stabilisation des inégalités de revenus et de patrimoine. A la place d'un électeur médian supposé arbitrer entre les programmes politiques Démocrate et Républicain, est apparue une polarisation des intérêts et des attentes opposant deux Amériques : celle des perdants contre celle des gagnants. Comme le parti Démocrate avait délaissé sa base ouvrière livrée à elle-même, ce fut une cible tentante et relativement facile pour le repositionnement du parti Républicain. Le mouvement, initié par Sarah Palin culmine avec la première puis la seconde campagne électorale de Trump. Peu lui importait la démocratie car l'essentiel était la peur et parfois la réalité du déclassement des Américains sans ou peu diplômés. On trouve là la ligne de partage entre l'électorat de Kamala Harris et celui de Donald Trump.
Il est une troisième rupture qui tient à la formation et l'origine de l'élite politique. Traditionnellement elle était formée dans les grandes universités et dominaient les formations juridiques. Ainsi, les présidences, tout particulièrement démocrates, ont développé une approche procédurale de la politique. La dérèglementation générale et la prise de pouvoir par Wall Street génèrent une tout autre élite, d'abord industrielle puis financière. La concentration du capital qui en résulte donne l'initiative aux entrepreneurs. Il en ressort une alliance entre la haute technologie et les inventeurs d'instruments financiers favorisant l'innovation. Le pouvoir de contrôle de l'administration américaine s'en trouve réduit.
Le personnage haut en couleur de Trump est représentatif de ce basculement. Ses talents de communication fondés sur le mensonge systématique viennent habiller une prise de pouvoir longtemps silencieuse mais qui peut s'affirmer en plein jour dans le second mandat.
Ce dépérissement de la démocratie s'explique aussi par l'affirmation de l'intérêt individuel comme premier par rapport à celui de la collectivité. La liberté de s'enrichir rapidement tend à saper la légitimité de la solidarité sociale. Ce sentiment libertarien est une composante du trumpisme. Pour l'opinion publique, la considération à l'égard des entrepreneurs qui ont su fonder une nouvelle activité l'emporte sur l'impératif de redistribution. Cette sérialisation des individus s'accompagne de la crise de la plupart des organisations et institutions qui traditionnellement assuraient l'intermédiation politique, comme en témoigne l'évolution, par exemple des partis ou des syndicats. Ainsi, dans la sphère politique, le trumpisme inaugure une nouvelle époque. Est-ce pour autant le cas dans la sphère économique ?
Une hétérodoxie économique radicale mais incohérente
Récemment est apparue une tout autre interprétation du trumpisme. L'analyse du Big and Beautiful Budget fait ressortir une certaine continuité par rapport au programme conservateur traditionnel des Républicains. La poursuite des réductions d'impôts creuse certes le déficit public mais il soutient le revenu d'autant plus que les individus sont riches.
Par contraste, les Américains les plus modestes devraient enregistrer une baisse de leur revenu après impôt et surtout souffrir d'une réduction de la couverture santé, soit un objectif permanent des Républicains depuis l'Obama Care. Favoriser les entreprises pétrolières, moderniser l'armée et accélérer la dérèglementation sont aussi, de longue date, au cœur du projet Républicain. Selon cette interprétation, Trump ne serait qu'un faire-valoir pour poursuivre l'expérience de Reagan au XXIe siècle.
C'est oublier l'extraordinaire capacité de nuisance dont l'autocrate Trump est porteur. Au fil des mois, force est de constater qu'il détruit progressivement tous les atouts sur lesquels était basée l'hégémonie, pour ne pas dire l'impérialisme américain. Les barrières tarifaires érigées avec le reste du monde vont affecter négativement le niveau de vie sans pour autant faire renaître Détroit comme emblème et défenseur de l'American World Life. Une drastique réduction du travail illégal va pénaliser la capacité productive dans l'agriculture, la construction, les services, soit un autre facteur de renchérissement du niveau de vie.
Attaquer l'actif essentiel que constituent les grandes universités et instituts de recherche revient à pénaliser la croissance à long terme et fournir autant d'atouts à la Chine quant à la maîtrise du ou des paradigmes émergents (intelligence artificielle et surtout préservation de l'environnement). Un autre danger menace la société américaine : déréglementer la finance, créer des stable coins, autoriser les actifs cryptos, remettre en cause l'indépendance de la FED sont autant de facteurs de déstabilisation d'une économie travaillée par l'exubérance irrationnelle suscitée par l'IA. Plus dure et inextricable sera la prochaine crise financière ! Bref, l'hétérodoxie économique de Trump est radicale mais sans avenir car incohérente.
Dans le long terme, mobiliser en permanence la menace des droits de douane sans parvenir à un accord en bonne et due forme et durable détruit la confiance qu'avaient les partenaires des États-Unis en la parole de ses gouvernements. Fonder un autre ordre international sur de pures relations de pouvoir bilatérales est sans doute la meilleure façon de marginaliser à long terme l'économie américaine et de rendre plus problématique la prospérité de sa population.
On mesure la contradiction ouverte entre transformation politique et dynamique économique. Nul ne sait sur quoi elle finira par déboucher !
Robert Boyer
Économiste, Directeur d'études à l'EHESS

Les syndicats britanniques soutiennent l’Ukraine

L'expérience britannique montre qu'une prise de conscience internationaliste est possible et peut déboucher sur des résultats concrets
219 août 2025 | tiré du site du RESU-Belgique | Photo : Le 22 février 2025, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Londres contre l'alliance anti-ukrainienne de Trump et Poutine. L'essentiel de la mobilisation a été réalisé par des syndicats. | Source : article de Sacha Ismael paru en anglais dans The Chartist | Traduction : en français par le RESU-Belgique
https://www.solidarity-ukraine-belgium.com/post/les-syndicats-britanniques-soutiennent-lukraine
Dès le début de l'invasion massive russe en Ukraine, les mobilisations de solidarité ont été marquées par une très forte présence syndicale. L'Ukraine Solidarity Campaign regroupe à la fois des membres individuels et des organisations affiliées qui peuvent être des fédérations syndicales ou des syndicats locaux. Cette solidarité syndicale s'est traduite par une aide importante aux syndicats ukrainiens dans leur double combat contre l'agression russe et pour la défense des droits sociaux et syndicats en Ukraine. Entre 2022 et 2025, de nombreux débats ont permis d'étendre le soutien à un certain nombre de syndicats qui s'étaient alignés sur une ligne campiste ou pacifiste. Nous reproduisons cette article de Sacha Ismael qui décrit ce processus. Alors qu'en Belgique, la solidarité syndicale avec l'Ukraine reste à un niveau assez faible, l'expérience britannique montre qu'une prise de conscience internationaliste est possible et peut déboucher sur des résultats concrets.
Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, de plus en plus de syndicats britanniques ont adopté des politiques de solidarité avec l'Ukraine. Cette année aussi, on a vu un changement dans ce sens.
En 2023, après qu'une série de syndicats aient pris position en faveur de l'Ukraine, le congrès du TUC a voté à une écrasante majorité en faveur d'une motion de solidarité. En 2024, les grands changements ont eu lieu au sein du syndicat de l'enseignement post-16 UCU et du géant des services publics UNISON (1). À la suite d'une campagne menée par ses membres, le congrès de l'UCU a effectivement renversé la position de type « Stop the War Coalition (2) » qu'il avait adoptée en 2023, a soutenu la résistance ukrainienne et s'est affilié à la Ukraine Solidarity Campaign (USC) ; et la conférence nationale des délégués d'UNISON, qui a enfin discuté de l'Ukraine pour la première fois, a facilement adopté unemotion de solidarité et s'est affiliée.
Congrès syndicaux de 2025
Cette année, les tentatives visant à détourner les syndicats d'une position pro-ukrainienne ont heureusement échoué, tandis qu'un grand progrès a été réalisé en matière de solidarité :
• Le gain a été réalisé au sein du syndicat des travailleurs de l'éducation NEU, qui compte un demi-million de membres. Après avoir été empêchés pendant trois ans de voter sur des motions de solidarité par des moyens antidémocratiques et avoir été limités à rejeter les motions de Stop the War, les délégués à la conférence ont enfin eu la possibilité de voter en faveur d'une position pro-ukrainienne, grâce aux efforts de campagne du NEU Ukraine Solidarity Network. Au final, le résultat n'a pas été serré : le vote enregistré contre l'un des deux amendements destructeurs de type STW a été de 63 % contre 37 %, tandis que le vote final en faveur de la motion non amendée a été plus important.
• Le syndicat de la fonction publique PCS (3) a été le premier syndicat à s'affilier à l'USC après l'invasion à grande échelle, votant massivement en faveur du soutien à l'Ukraine en 2022 et 2023, et le syndicat a organisé une vaste solidarité concrète. Cette année, une motion visant à renverser cette position, rejetant la lutte de l'Ukraine comme une guerre par procuration de l'Occident et engageant le PCS à faire campagne pour la fin de l'aide militaire, a été soumise à sa conférence annuelle des délégués.
Au final, avec des débats sur l'industrie, de vives polémiques autour des droits des trans et de la Palestine dominant l'ordre du jour, l'Ukraine n'a pas été abordée. À l'approche de la conférence et pendant celle-ci, la dynamique semblait vraiment de notre côté. Quoi qu'il en soit, la position pro-ukrainienne du PCS reste inchangée, même si certains éléments de la direction du syndicat y sont hostiles et qu'il faudra peut-être se battre pour la maintenir.
• Rien à l'ordre du jour du congrès de l'UCU (4) pour renverser la position adoptée l'année dernière. Il y avait cependant deux motions intitulées « Welfare not warfare » (Le bien-être plutôt que la guerre) : la première concernait en fait la militarisation au Royaume-Uni et ne mentionnait pas l'Ukraine, mais la seconde utilisait la position de Keir Starmer sur les troupes britanniques de maintien de la paix pour rejeter une position pro-ukrainienne. L'USC et les membres de l'UCU pour l'Ukraine ont plaidé pour s'opposer à la seconde motion. Les délégués ont voté en faveur de la première et ont renvoyé la seconde à leur direction nationale.
Le NEU et l'UCU ont affiché une tendance similaire, les délégués votant massivement contre le militarisme occidental, mais rejetant les tentatives de Stop the War de lier cela à l'opposition à la lutte ukrainienne.
• Juste après l'invasion à grande échelle, l'exécutif national du syndicat des pompiers (FBU) a adopté une positionsimilaire à celle de STW, et le FBU a été l'un des deux seuls syndicats à s'opposer à la motion du congrès du TUC de 2023. Cependant, sa conférence n'a jamais discuté de l'Ukraine. Cette année, une résolution a été présentée pour la première fois, incluant l'opposition à la guerre de la Russie et le soutien à l'autodétermination de l'Ukraine, la solidarité concrète avec les pompiers ukrainiens et l'affiliation à l'USC. Malheureusement, elle a été retirée, mais sa présentation a constitué un pas en avant.
• Une motion de solidarité avec l'Ukraine a également été présentée à la réunion des délégués du Syndicat national des journalistes, mais elle n'a pas été adoptée.
S'organiser pour la solidarité
Au moment où Chartist était mis sous presse, d'autres conférences syndicales étaient prévues, notamment celles des trois grands syndicats UNISON, Unite (4) et GMB (5). La conférence politique biennale du syndicat général Unite (7-11 juillet) prévoit une motion visant à activer les liens et la solidarité concrète avec les travailleurs et les syndicats ukrainiens, qui avait été approuvée lors de la dernière conférence en 2023, mais qui n'avait pas été mise en œuvre.
Juste avant le début de la saison des conférences syndicales au Royaume-Uni, le Conseil exécutif central du syndicat général GMB a également accepté d'affilier l'USC, devenant ainsi le sixième syndicat national britannique à le faire, après UNISON, PCS, ASLEF, UCU et NUM.
Ce qui s'est passé au sein du FBU est instructif : si le retrait de la résolution est décevant, il est significatif qu'elle ait été présentée à la suite d'un travail de solidarité croissant au sein du syndicat, construit autour des appels financiers de l'USC en faveur des pompiers et des secouristes ukrainiens, et qu'une région du FBU, les West Midlands, ait récemment adhéré à la campagne. Dans d'autres syndicats également, la période récente a renforcé les liens et la solidarité concrète avec le mouvement syndical ukrainien. On est bien placés pour continuer à construire dans les mois à venir.
Dans plusieurs cas, notamment au sein du NEU (7), les partisans de Stop the War ont tout fait pour éviter, voire empêcher, que les conférences syndicales discutent de l'Ukraine. En plus, STW et ses partisans ont généralement omis de rendre compte des décisions syndicales qui leur étaient défavorables. Lors du congrès de l'UCU, il est apparu que ses partisans affirmaient avoir gagné lors du congrès de 2024, alors qu'ils avaient en fait perdu !
En revanche, la campagne Ukraine Solidarity a encouragé un débat aussi large que possible et une prise de décision démocratique, par principe et parce qu'elle sait que cela profite généralement à notre camp. Nous nous sommes efforcés de rendre publiques avec précision les discussions et les décisions des syndicats dans l'ensemble du mouvement syndical et au-delà.
Notes rédigées par le RESU-Belgique :
(1) Avec 1,3 million de membres, UNISON est la plus grande fédération syndicale britannique, elle organise principalement des travailleurs des services publics.
(2) La "Stop de war coalition" (STW) a été formée en 2001 pour combattre une éventuelle participation britannique à la guerre en Afganistan. Elle a ensuite organisé de nombreuses campagnes concernant l'Irak, la Libye et d'autres conflits. Cette coalition défend une idéologie campiste. Elle est opposée aux guerres menées par les Etats-Unis et les pays occidentaux et refuse de prendre le parti de peuples qui combattent d'autres puissances impérialistes. En Syrie, elle considérait la dictature de la famille Assad comme un régime s'opposant à l'impérialisme. Elle refuse tout soutien à l'Ukraine en affirmant que la guerre massive a été provoquée par l'agressivité de l'OTAN à l'égard de la Russie.
(3) PCS est une fédération syndicale de fonctionnaires qui organise près de 190.000 membres.
(4) L'UCU regroupe des travailleurs de l'enseignement supérieur. Il compte environ 120.000 membres.
(5) Avec 1,2 million de membres, UNITE regroupe principalement des travailleurs du secteur privé.
(6) GMB est une fédération syndicale qui regroupe principalement des travailleurs de l'industrie. Avec 580.000 membres, c'est la troisième fédération syndicale la plus importante.
(7) La NEU regroupe des travailleurs de l'enseignement primaire et secondaire. Il regroupe environ 450.000 membres.

États-Unis : Trump est en train d’anéantir les syndicats. Pourquoi sont-ils si silencieux ?

Ce Labor Day est particulièrement malheureux pour le monde du travail. Le mouvement syndical a été constamment mis à l'épreuve ces dernières décennies, mais le président Trump est le président le plus résolument antisyndical depuis avant la Grande Dépression. Si le mouvement ouvrier ne se bat pas plus fort qu'il ne l'a fait depuis que M. Trump a retrouvé la présidence, son avenir sera sombre.
M. Loomis est historien du mouvement ouvrier et écrit régulièrement sur les syndicats, la politique et les travailleurs
3 septembre 2025 | tiré de l'Aut'Journal | Article paru dans le New York Times, du 1er septembre 2025.
https://www.lautjournal.info/20250903/etats-unis-trump-est-en-train-daneantir-les-syndicats-pourquoi-sont-ils-si-silencieux
M. Trump et son administration ont unilatéralement retiré les droits de négociation collective à des centaines de milliers de travailleurs fédéraux. Au sein du Department of Veterans Affairs seul, 400 000 employés, soit 2,8% des travailleurs syndiqués américains, ont perdu leurs droits à la négociation collective à cause d'un décret qui finira par toucher plus d'un million de travailleurs fédéraux.
M. Trump a marqué le début du week-end de Labor Day jeudi en poursuivant son assaut contre les syndicats fédéraux, ajoutant l'Office des brevets, la NASA et le National Weather Service à sa liste d'agences ciblées.
Malgré cette attaque contre leur existence même, on n'a presque rien entendu des syndicats. Où est le mouvement syndical dans la bataille publique pour préserver les emplois syndiqués, empêcher le démantèlement du filet de sécurité et mener le combat pour la démocratie ? À part quelques déclarations et discours enflammés, le mouvement reste muet.
Si le mouvement ouvrier veut survivre, il doit revenir à des tactiques de mobilisation massive, rappelant aux Américains que leurs droits sont le fruit d'un travail collectif — et non du soutien à un président qui prétend aider les travailleurs américains tout en réduisant les normes de sécurité, en soutenant des tarifs qui augmentent le coût des biens de consommation et en privant les travailleurs de leurs droits légaux à des contrats.
Tout cela se produit alors que le soutien des Américains aux syndicats est au plus haut depuis le milieu des années 1960.
On ne saurait trop insister sur l'importance des attaques de M. Trump contre les travailleurs du secteur public. Ce secteur est devenu le bastion du mouvement syndical, permettant au taux de syndicalisation de l'ensemble de la main-d'œuvre de rester autour de 10%, alors que dans le secteur privé, ce taux est inférieur à 6%.
Compte tenu des mesures prises par M. Trump cette année — et en l'absence de réelle opposition publique de la part de Républicains soi-disant favorables aux syndicats comme Josh Hawley et Marco Rubio — il est probable qu'il ne restera plus de travailleurs fédéraux syndiqués en dehors des agences de réglementation d'ici à la fin de son mandat en 2029.
M. Trump a attaqué les travailleurs autrement. Il a affaibli le Department of Labor par des coupes du Department of Government Efficiency. Il revient aussi sur des règles mises en place sous les administrations Obama et Biden qui permettaient aux aides à domicile de toucher des heures supplémentaires et aux ouvriers agricoles de revendiquer de meilleures conditions de travail.
M. Trump a également sérieusement fragilisé le National Labor Relations Board, qui traite des milliers de dossiers syndicaux chaque année, en limogeant son président et en nommant des personnalités proches du patronat pour orienter son action à l'encontre des intérêts des travailleurs.
Le mouvement syndical, malgré ses discours sur la solidarité, reste profondément divisé sur la meilleure façon d'organiser, de s'engager en politique et d'aborder la question Trump. Certains dirigeants, notamment Sean O'Brien, président des Teamsters, ont soutenu Trump et ses Républicains, notamment sur les restrictions à l'immigration. D'autres syndicats dont les membres sont majoritairement blancs et masculins penchent aussi vers les Républicains, mais cela reste une minorité parmi les membres.
En 2024, les travailleurs syndiqués ont constitué l'un des rares groupes démographiques où les Démocrates ont amélioré leur position par rapport à 2020. Cela reflète peut-être les efforts de Joe Biden pour être, comme il le disait, « le président le plus favorable aux syndicats de l'histoire américaine ».
Les syndicats disposent du soutien interne, de la structure et de la capacité d'organisation nécessaires pour lutter contre Donald Trump. Pourtant, personne dans le mouvement syndical n'a pris n'a pris la parole publiquement pour contrer Mr. O'Brien et expliquer clairement à l'opinion publique que la plupart des syndicats sont fortement opposés à Trump.
Cela ne signifie pas que le mouvement ouvrier, qui reste trop lié aux rouages internes du Parti démocrate, doit suivre celui-ci aveuglément. La direction démocrate elle-même est divisée sur la manière de lutter contre Trump, et les syndicats ont besoin d'indépendance tant dans leur politique que dans leurs tactiques pour susciter la confiance publique, afin qu'ils — et non Trump — puissent reconstruire le pouvoir de la classe ouvrière aux États-Unis.
Si certains des plus grands syndicats, dont les enseignants et les travailleurs des services, ont grandi en recrutant de nouveaux membres et en devenant politiquement puissants, beaucoup d'autres résistent depuis longtemps aux grands efforts d'organisation, préférant se concentrer sur la défense de leurs membres actuels. Cela explique en grande partie pourquoi le mouvement syndical peine à intégrer de nouveaux secteurs pour remplacer les usines automobiles, sidérurgiques et autres industries ayant bâti de solides syndicats dans les années 1930.
L'absence de réponse du mouvement syndical face à Trump contraste fortement avec la réponse lors de la crise ayant suivi le licenciement des contrôleurs aériens par Ronald Reagan en 1981. La journée de la solidarité (« Solidarity Day ») avait réuni pas moins de 260 000 membres et alliés syndicaux à Washington en septembre 1981 pour appeler les travailleurs à lutter contre la domination de Reagan sur la classe ouvrière. Cela n'a pas arrêté le déclin du mouvement syndical, mais a permis aux Démocrates d'agrandir nettement leur majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat de 1982.
Pour survivre à l'assaut de Trump, le mouvement syndical doit se montrer à la hauteur du moment. D'abord, il doit transgresser les protocoles syndicaux en dénonçant publiquement les dirigeants comme M. O'Brien. Tant que les syndicalistes ne reprendront pas le contrôle du discours de la résistance, beaucoup dans la grande coalition libérale penseront que les syndicats soutiennent bien plus Trump qu'ils ne le font réellement.
Ensuite, les syndicats doivent impliquer leurs propres membres sur des sujets n'a pris la parole publiquement. Cela suppose une éducation politique beaucoup plus poussée, non seulement sur les candidats lors des élections, mais aussi sur les enjeux du moment. Cela fait des décennies que de nombreux syndicats évitent d'aborder les sujets qui divisent (comme l'immigration) avec leurs membres. Chez certains, cela répond au fait que l'identité syndicale pèse moins lourd que d'autres convictions politiques chez beaucoup de membres. Mais discuter de politique uniquement durant les élections crée un fossé entre le discours et l'action qui fait que beaucoup de membres finissent par décrocher.
Enfin, les syndicats doivent remplir le vide ressenti par des millions d'Américains face à leur vie économique. Le désespoir ressenti sur des questions comme la fermeture d'usines et l'inflation a mené les travailleurs à soutenir Trump. Mais cela a aussi provoqué un brusque regain de popularité des syndicats dans le pays. La plupart des gens pensent que le système est en panne et cherchent un acteur capable de le réparer. Les syndicats peuvent assurer ce rôle de leadership.
Les syndicats aiment rappeler que la véritable force des travailleurs est de pouvoir interrompre leur travail, via la grève. Ils devraient s'en servir pour s'opposer à la guerre menée par le président Trump contre la classe ouvrière.

L’Iran doit renoncer à la bombe et Israël démanteler la sienne

C'est bien connu, les medias chassent en meute et bien souvent avec la complaisance de la classe politique qui
participe ainsi à la fabrication de l'opinion publique.
Tiré de la revue Rechreches Internationales
https://webmail.koumbit.net/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=161053&_part=3&_action=get&_extwin=1
Michel Rogalski *
Le spectre de la bombe iranienne fait ainsi la une de tous les plateaux médiatiques sans que soit abordée la question de l'autre bombe, l'israélienne. Comme si celle-ci était naturelle, allait de soi et ne pouvait faire l'objet d'aucune interrogation. Ainsi l'une serait admissible et l'autre désignée comme le mal absolu. La seconde ferait l'objet de toutes les critiques, la première serait un tabou qu'il serait indécent d'évoquer, au risque pour le journaliste qui en serait tenté de sentir son oreillette grésiller, le rappeler à l'ordre et lui faire sentir que sa carrière n'est plus assurée. Ainsi, il y aurait une bombe de la guerre et une bombe de la paix.
C'est ainsi que medias et classe politique organisent de concert le débat en évoquant de façon récurrente la menace iranienne d'accéder à l'arme nucléaire. On remarquera la fausse symétrie, l'une n'étant que virtuelle, l'autre bien réelle, mais tous deux se réfugiant, pour l'un dans l'absence d'assumer en entretenant un flou total et pour l'autre
en jurant que telle n'est pas son intention et qu'on lui fait un mauvais procès. Dissimulation chez l'un et déni chez l'autre.
L'affaire remonte à loin et reste régie par l'ombre tutélaire du Traité de non-prolifération nucléaire signé en 1968, peu à peu rejoint par une majorité de pays – aujourd'hui 192. D'emblée, refuser d'adhérer à l'Accord signifiait une intention non dissimulée d'accéder au statut de puissance dotée de l'arme nucléaire. Peu de pays en prirent le risque. On en connaît la liste : Afrique du Sud, Inde, Pakistan, Israël. Tous ces pays, avec des complicités diverses, accédèrent à
l'arme nucléaire. Deux y renoncèrent, l'Afrique du Sud et l'Ukraine, pour des raisons différentes. On peut donc affirmer que le traité, même si tous ses termes ne sont pas intégralement appliqués, a rempli l'essentiel de son rôle, celui d'éviter la prolifération nucléaire.
Ainsi l'Afrique est devenu un continent dénucléarisé et l'Amérique latine a évité de l'être malgré les ambitions symétriques de l'Argentine et du Brésil. La situation du continent asiatique étendu au Moyen-Orient est fort différente et beaucoup plus complexe car des situations spécifiques y coexistent permettant à chacun de s'affirmer comme un cas particulier. Après l'avoir signé, la Corée du Nord s'en est retirée et possède aujourd'hui l'arme et les missiles
pouvant la porter. La Chine était déjà dotée au moment de l'Accord.
L'Inde, le Pakistan et Israël, non signataires du Traité, se sont chacun dotés de l'arme et l'Iran signataire de l'Accord est suspecté par la communauté internationale de ne pas le respecter et de refuser de se soumettre aux inspections de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) censée en contrôler l'application et à procéder à une aide technique pour accéder à l'usage pacifique du nucléaire.
Il lui est reproché d'enrichir l'uranium à des taux qui se rapprochent de la capacité d'accéder à la bombe. L'Iran réfute ces accusations et affirme qu'il n'a pas une telle intention. C'est dans ce contexte que, sous la mandature de Barack Obama, un Accord fut signé à Vienne en 2015, le Joint Comprehensive Plan of Action (JPCoA) associant les 5 membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Iran. Cet Accord fut dénoncé unilatéralement par D. Trump en 2018. Depuis lors, malgré les sanctions, Téhéran augmente le nombre et le rythme de ses centrifugeuses enrichissant l'uranium à des teneurs qui approchent un possible usage militaire.
Aujourd'hui, Donald Trump, devant l'inefficacité de son retrait de l'Accord, semble désireux de renouer le contact avec l'Iran, sans se concerter avec l'Europe, et entame une série de négociations bilatérales auxquelles les Iraniens, lassés de l'entrave des embargos, L'Iran doIt renoncer à La bombe et IsraëL démanteLer La sIenne acceptent de participer. Trump tente aujourd'hui de revenir sur sa posture, mais en écartant les Européens. Ces négociations se déroulent sous l'égide du Sultanat d'Oman alors qu'États-Unis et Iran n'ont plus de relations diplomatiques. Le contexte a bien changé.
Israël s'est imposée comme puissance militaire régionale incontestée et accumule les victoires par les armes contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban, bénéficie de la chute du régime syrien et a détruit une large partie des défenses antimissiles iraniennes. Téhéran a perdu beaucoup d'alliés au Moyen-Orient, peine sous les sanctions
et redoute une attaque israélienne sur son potentiel nucléaire. Bref, Israël a fait le « sale boulot » pour le compte de l'Occident sous la protection des bâtiments de guerre américains patrouillant en Méditerranée orientale.
En réalité il est fort probable que l'Iran souhaite accéder au statut d'un État du « seuil nucléaire », c'est-à-dire d'être en capacité rapidement (entre un et deux ans) de devenir, si nécessaire, une puissance nucléaire. D'autres pays comme la Corée du Sud ou le Japon, pourraient partager une telle ambition. Cela ferait tâche d'huile au Moyen-Orient et demain l'Arabie saoudite ou la Turquie participeraient à une telle prolifération. Rien ne serait plus dangereux.
Tout doit être fait, par des moyens diplomatiques et coopératifs pour rechercher une issue non militaire.
Le paradoxe c'est qu'au Moyen-Orient le seul État doté – Israël – est le plus véhément dans l'opposition farouche à une éventuelle bombe iranienne, adoptant ainsi comme seule logique celle de vouloir être la seule puissance nucléaire de la région, au point de menacer de frappes préemptives le dispositif iranien, comme il le fit à l'égard de l'Irak en détruisant en 1981 son réacteur nucléaire en cours de construction. Cette posture n'a aucune légitimité dès lors que sa sécurité est garantie par l'allié américain qui n'hésite pas à déplacer ses bâtiments de guerre en Méditerranée pour signifier sa
totale solidarité avec Tel-Aviv et par le soutien acquis d'avance des pays occidentaux. Car en cas de danger existentiel tout le monde sait qu'Israël sera défendu de façon inconditionnelle par tous ses alliés qui ne manquent jamais de le répéter.
Cette bombe israélienne qui fut construite avec la complicité dissimulée d'États dotés et signataires du Traité de non-prolifération – notamment de la France et des États-Unis – est une incitation à pousser d'autres pays de la région à s'engager dans la même voie.
Longtemps cachée, niée et dissimulée son existence est maintenant admise mais, au contraire d'arsenaux d'autres pays pour lesquels la communication est d'usage dès lors que les expérimentations sont réussies, elle reste entourée d'un flou discret. Envisagé très tôt par Ben Gourion le programme israélien démarre dès la fin des années 1950
et sera effectivement considéré comme opérationnel dès le début des années 1970. Depuis lors, il est entouré d'une opacité entretenue et fait figure d'« exception » acceptée y compris par l'AIEA qui n'a jamais pris le sujet à bras-le-corps et a ainsi contribué à en « normaliser » l'existence. Ainsi le pays peut prétendre bénéficier du prestige de la
possession de l'arme nucléaire sans avoir à en payer le moindre coût diplomatique ou moral et peut continuer à jouir du monopole de l'arme nucléaire dans la région. Partant de ce principe d'exception, Tel-Aviv peut s'exonérer de toute recherche politico-diplomatique en vue d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient.
Cette discrétion fut accompagnée et partagée par la quasi-totalité du monde occidental. Dans le pays, les critiques et les discussions fusent de toutes parts sur les options sécuritaires choisies par les dirigeants et visent tout à la fois l'armée, le Mossad et le Shin Bet, mais la question nucléaire reste taboue et n'est jamais débattue.
Aujourd'hui, poser, à raison, la question de l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire est légitime, et il faut se réjouir de la reprise des négociations avec les États-Unis à Oman, mais peut-on aborder ce sujet en entretenant délibérément le silence sur l'autre bombe du Moyen-Orient ? Autre forme de deux poids et deux mesures ?
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment l’IA générative asphyxie le journalisme

L'IA générative détourne l'audience des médias. La chute du trafic et des recettes publicitaires érode le modèle économique du journalisme. Cette captation par les plateformes menace la production d'information originale et la survie d'un web ouvert, essentiel à notre compréhension du monde.
Tiré du blogue de l'auteur.
Dans les coulisses d'un internet en mutation, l'intelligence artificielle générative redéfinit les règles du jeu, imposant aux médias traditionnels, qu'ils soient de modestes publications ou de grands conglomérats, une remise en question existentielle. L'avènement de services comme AI Overviews de Google, et plus généralement l'essor des chatbots intelligents, ne se contente pas de modifier nos habitudes de consommation de l'information.
Là où il s'applique, comme aux États-Unis, il bouleverse les fondements économiques sur lesquels reposait jusqu'alors le journalisme et, par extension, la vitalité même du web ouvert. Cette transition rapide, orchestrée par des plateformes dont le modèle économique privilégie la rétention de l'utilisateur et la monétisation publicitaire directe, plutôt que le renvoi de trafic vers les producteurs de contenu, est lourde de conséquences pour un secteur déjà fragilisé.
L'érosion rapide du trafic des éditeurs
Les études récentes dressent un tableau préoccupant de la diminution du trafic vers les sites d'information. Ahrefs, par exemple, a révélé qu'une page de premier rang bénéficiant d'un aperçu IA subissait une baisse moyenne de 34,5% du taux de clics (CTR). Ce phénomène, loin d'être anecdotique, est renforcé par les observations de Similarweb, qui indique que près de 69% des recherches d'actualités n'aboutissent désormais à aucun clic vers un site d'information, contre 56% auparavant. Le trafic organique a chuté de plus de 2,3 milliards de visites à la mi-2024 à moins de 1,7 milliard aujourd'hui.
Les expériences des médias illustrent cette tendance alarmante : le Digital Content Next (DCN), un groupement de 40 éditeurs incluant des poids lourds comme le New York Times et Condé Nast, rapporte une perte médiane de 10% du trafic de recherche Google pour ses membres entre mai et juin 2025, atteignant -7% pour les médias d'information et -14% pour les autres. Certaines publications sont frappées de plein fouet, comme le Mirror, qui a vu sa visibilité sur Google chuter de 80% depuis 2019, ou le Financial Times, confronté à une baisse de 21% de son trafic ce printemps.
La Professional Publishers Association (PPA) au Royaume-Uni a également documenté des baisses drastiques de CTR, avec un titre de magazine lifestyle passant de 5,1% à 0,6% pour une requête populaire, et un magazine automobile perdant 25% de son trafic malgré une augmentation de 7% de sa visibilité dans les pages de Google, résultat du moindre nombre de clics. Ces chiffres contredisent les affirmations de Google, qui tente de minimiser l'impact de ses fonctionnalités IA sur le trafic référent, des allégations jugées « incomplètes » et basées sur des « méthodologies défectueuses » par les éditeurs.
Des répercussions économiques graves
Les répercussions économiques de cette érosion du trafic sont d'ores et déjà tangibles et souvent dramatiques. Les revenus publicitaires, part essentielle du modèle économique de nombreux médias, s'effondrent, entraînant des licenciements massifs et des fermetures de services. Business Insider, par exemple, a annoncé le licenciement de 21% de ses effectifs à cause de la diminution du trafic de ses sites. Moins de trafic signifie moins de revenus, ce qui se traduit directement par moins de journalistes, moins d'enquêtes approfondies, moins de correspondants étrangers et une réduction drastique du journalisme original.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que les entreprises d'IA adoptent souvent une stratégie de « blitzscaling », privilégiant une croissance rapide et l'acquisition d'utilisateurs à la rentabilité immédiate. Elles dépensent des sommes considérables pour développer des outils qui n'ont pas encore trouvé de modèle économique viable, mais qui, dans leur expansion, détruisent les structures économiques qui soutiennent le journalisme et la production de savoir public.
Le risque du cercle vicieux de l'IA
Cet affaiblissement du journalisme, qui peinait déjà à se financer, pose un risque systémique pour l'écosystème de l'information. Si le contenu original ne peut plus être monétisé, la motivation à le produire disparaît. L'IA, conçue pour synthétiser et générer des réponses, est fondamentalement dépendante de la qualité et de la fraîcheur des données sur lesquelles elle est entraînée. Or, si le journalisme s'étiole, les systèmes d'IA finiront par créer un cercle vicieux où ils se nourriront de leur propre substance dégradée. Le web risque alors de se transformer en une « galerie de miroirs », reflétant des résumés de résumés, des hallucinations d'IA et des communiqués de presse sans source originale fiable ou critique en vue.
Les outils d'IA ne sont pas neutres ; ils reflètent les biais de leurs données d'entraînement, de leurs codeurs et des motivations de leurs entreprises. Des exemples comme le chatbot Grok, qui, après une mise à jour, s'est auto-proclamé MechaHitler illustrent les dangers des réponses générées par une IA mal entraînée ou défaillante. En l'absence de journalisme professionnel et de qualité, les utilisateurs risquent de se fier davantage à des machines qui semblent faire autorité qu'à des experts qualifiés, même dans des domaines critiques comme la santé, où l'expertise est primordiale. Le journalisme citoyen, bien que potentiellement puissant, ne peut remplacer des institutions comme les médias professionnels avec leurs les ressources nécessaires pour révéler des vérités complexes tout en protégeant les sources.
La réaction des éditeurs
Face à cette menace existentielle, les éditeurs étatsuniens ne restent pas inactifs et ripostent sur plusieurs fronts. Des poursuites judiciaires retentissantes ont été engagées, le New York Times ayant par exemple intenté une action contre OpenAI et Microsoft pour l'utilisation non autorisée de son contenu protégé par le droit d'auteur pour entraîner leurs modèles. Au-delà des tribunaux, les associations professionnelles comme le DCN et la PPA réclament une régulation plus stricte et une transparence accrue de la part de Google. Elles demandent notamment la séparation des crawlers IA de Google de ses crawlers de recherche, car les éditeurs ne peuvent actuellement pas refuser que leur contenu soit utilisé par les aperçus IA sans risquer de disparaître complètement de l'index de recherche. Une injonction pourrait être émise dans le cadre de l'affaire antitrust du ministère de la Justice américain contre Google, forçant potentiellement cette séparation cruciale.
En parallèle, les éditeurs déploient des stratégies préventives et d'adaptation. Beaucoup reconnaissent la nécessité de se concentrer sur le renforcement de leur marque et de celle de leurs journalistes, car dans un environnement saturé par l'IA, la crédibilité et la confiance ne sont plus automatiquement conférées par le simple fait de figurer en haut des résultats de recherche. Le Wall Street Journal, par exemple, a cherché à embaucher un "coach de talents" pour aider ses journalistes à développer leur marque personnelle, misant sur l'idée que les lecteurs suivront les individus plutôt que les plateformes.
Les éditeurs diversifient également leurs canaux de distribution via des newsletters, des applications et les plateformes sociales pour réduire leur dépendance au trafic de recherche organique. Google, sous pression, a même lancé des initiatives comme "Offerwall", permettant aux éditeurs d'expérimenter des modèles de monétisation alternatifs tels que les micropaiements ou l'inscription à des newsletters. Enfin, des contre-mesures technologiques émergent, comme Poisonify, un outil développé par le musicien Benn Jordan pour « empoisonner » les données musicales et empêcher les IA d'utiliser le contenu sans autorisation, ou les outils de Cloudflare pour bloquer les robots d'exploration IA. Des startups proposent également de nouveaux modèles, comme Tollbit, un « paywall pour bots » permettant aux sites de facturer l'accès à leur contenu aux crawlers IA, ou ProRata, qui redistribue les revenus publicitaires générés par les réponses IA aux sites sources.
Un avenir incertain pour le journalisme
En conclusion, l'impact de l'IA générative sur les médias et le web ouvert est bien plus qu'une simple perturbation technologique ; il s'agit d'une refonte fondamentale des dynamiques de l'information et de sa monétisation. Les géants du web, dans leur quête de suprématie et de profits publicitaires, semblent prêts à sacrifier l'économie de l'information qui a permis l'émergence du web tel que nous le connaissons.
L'AI Overviews de Google est le symptôme d'une stratégie plus vaste visant à transformer les moteurs de recherche en « moteurs de réponses », capturant l'attention des utilisateurs et les revenus associés. Cette évolution, si elle n'est pas endiguée par une régulation ferme et une prise de conscience collective, menace de vider le journalisme de sa substance et de transformer le web en un écosystème d'informations obsolètes, biaisées ou générées artificiellement. L'exigence de vérité, de contexte et de responsabilité, si essentielle à une société démocratique, ne disparaîtra pas, mais sa pérennité dépendra de la capacité des éditeurs, des régulateurs et du public à défendre un journalisme de qualité et un web ouvert et diversifié face aux appétits insatiables des grandes plateformes.

Gaza ou la férocité médiatique

À Gaza, les bombes ont fait leur œuvre de destruction quand les mots, souvent distordus, sanctifiés, réécrits, ont préparé le terrain. Les médias occidentaux, en relayant sans recul le récit israélien, ont érigé un décor de guerre qui a sacrifié la voix des Palestiniens, là où l'information aurait dû dire la vérité et non la fabriquer.
Tiré du blogue de l'auteur. L'auteur est journaliste.
« Nous avons créé une légende à partir d'un massacre », Baldwin
« La perception n'est pas fantaisiste, elle est destructrice », Emerson
« Les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l'action », affirmait la philosophe Hannah Arendt, pour qui le « dire du monde » est autant le « faire du monde ». La fonction performative du langage est aussi vieille que le « Fiat Lux ». Ce qui est construit par les mots peut être perçu réel dans son existence et ses conséquences.
Ramenée aux médias, la remarque d'Arendt revient à poser que le journalisme est aussi action. Il ne se contente pas de dire le réel. Il tisse la perception du monde. Les médias opèrent une mise au monde et une institutionnalisation de leur interprétation des faits. Cet ordonnancement médiatique puissant doit être compris pour une vraie citoyenneté. Car le drame est que ce qui est vrai pour les « mots justes » l'est tout autant pour les mots injustes. Voici pour la théorie.
Le massacre du 7 octobre 2023, et la guerre contre Gaza qui a suivi, ont ouvert une parenthèse médiatique singulière en raison de l'anomalie paroxystique de cette couverture médiatique. C'est à dessein que je précise « contre Gaza » et non « à Gaza », la population civile étant la première victime de ce conflit. Un « anathème » disent certains politiques israéliens, reprenant ainsi les termes bibliques de la conquête de Canaan. « Futuricide » posent des juristes tant l'armée israélienne s'est acharnée à empêcher tout avenir pour les Palestiniens dans la Bande de Gaza.
Dans quelle mesure le narratif médiatique a permis et accompagné cette guerre contre Gaza est la question qui devrait nous hanter. Quels mots injustes, pour reprendre la catégorisation d'Arendt, ont fourni le sous-bassement rhétorique aux crimes que de nombreux juristes qualifient déjà de crime de génocide ?
Si les médias n'ont pas construit la route qui mène aux crimes de guerre, ils l'ont pour certains pavée, la rendant praticable et facile.
Au commencement donc, il y a une stupéfaction. Les exemples abondent de ce qu'il faut bien appeler une distorsion médiatique des faits. Au lieu d'interroger et de douter de chaque affirmation de l'armée israélienne, les médias ont endossé leur récit univoque. Un grand renversement des principes mêmes du journalisme, qui enseigne pourtant que la première règle est celle des 5W ou « who, what, where, when, why ». Pourtant, le « pourquoi » n'existe pas quand il s'agit des Palestiniens. Des victimes sans cause, comme flottant dans les limbes de l'évènement autogénéré.
Dans cet océan d'étonnements, un exemple. Ce « Merci, mon Colonel » qui venait conclure chaque prise de parole d'Olivier Rafowitz sur des plateaux français. Le mot semblait rouler avec gourmandise dans la bouche des journalistes qui concluaient ainsi le déroulé du parole du porte-parole francophone de l'armée israélienne. Sans doute, le frisson à peu de frais de toucher la chose militaire, d' « en être » depuis un plateau tv confortable. C'était là l'acquiescement à un tapis de mots qui venait justifier les tapis de bombes qui avaient troué le ciel, la terre et la chair de Gaza. Ce « Mon Colonel » faisait des journalistes les supplétifs empressés de la communication israélienne. Des soldats en somme, pour l'autre guerre, l'informationnelle, sans laquelle la guerre sur le terrain aurait été moins aisée.
Ce colonel remerciera à son tour BFMTV de faire “du travail excellent par rapport à la présentation du conflit ». La présentation seule, celle qui fige dans un présent décontextualisé. Car jamais ces journalistes ne poseront la seule question qui vaille devant le représentant d'une armée qui empêche tout journaliste d'accéder au terrain. Pourquoi ce blocus informationnel ? Rompez !
Devant le traitement médiatique de Gaza, il m'est souvent arrivé de repenser à un apologue de la tradition juive. On raconte qu'au 19e siècle, passant par hasard dans un shtetl polonais, un célèbre archer remarqua un nombre important de cible avec la flèche figée à chaque fois dans le mille. Il voulut rencontrer cet archer de talent et devant son insistance, les villageois finissent par lui présenter un homme tout tremblant de vieillesse. Le visiteur, étonné, veut voir de ses yeux les prouesses de l'archer cacochyme. Ce dernier se saisit de l'arc, ferme les yeux, tire sa flèche au hasard et va tranquillement dessiner la cible à la craie…la flèche au milieu. Voilà comment opèrent certains médias. Le réel importe peu, une fois la flèche du récit figée. Il s'agit simplement, par la représentation médiatique, de maintenir ce récit au centre.
La déraison médiatique
Le récit médiatique de Gaza a été tissé de ces scènes répétées, lesquelles venaient créer comme une alter-réalité, une distorsion des faits et du réel. Et on ne cessera de s'étonner que le dispositif médiatique ait produit tant d'irrationalité. Comment ce même dispositif réglé a produit de la fiction au lieu de rendre compte du réel ? Il m'est souvent arrivé, à titre personnel, d'avoir l'étrange impression de me trouver devant un conte de fées naturalisé plutôt que face à un travail journalistique. Le dispositif médiatique sur Gaza rationalise (de plus en plus laborieusement) l'irrationnel et l'inacceptable. La lingua franca médiatique normalise le génocide.
Certes, la couverture de Gaza a d'abord renouvelé les travers inhérents aux médias. Banalité de la mésinformation et de la désinformation. La communication d'Israël a misé sur ces effets structurels. Les médias mainstream ou Corporate media, comme disent les anglo-saxons, fonctionnent d'abord en vase clos et s'abreuvent aux mêmes sources. Une structuration du récit par les grandes agences de presse internationales qui fournissent le matériau premier. Les médias sont également conservateurs au sens où ils tendent à valider l'ordre existant, quel que soit cet ordre. La parole institutionnelle rassure les journalistes, et de glissement en glissement, ils s'en font désormais les rapporteurs et relais disciplinés plutôt que les questionneurs distants. La sociologie des journalistes participe aussi de ce conservatisme. Chaque journaliste apporte avec lui un univers mental et social. Que certains n'en aient pas conscience, comme le poisson rouge ignore qu'il évolue dans l'eau et qu'il est constamment mouillé, n'empêche pas ce fait.
Le récit médiatique fonctionne par la répétition, l'amplification et la saturation. “L'esprit de gramophone”, selon l'intuition géniale de George Orwell pour qui la propagande des démocraties se faisait moins par la répétition de la force que par la force de la répétition. Ce mécanisme a joué sa part pour Gaza, notamment avec la répétition de formules, dont la plus péremptoire et paralysante : “Israël a le droit de se défendre”. Pourtant, Israël se défend contre une population civile occupée qui, elle, a juridiquement le droit de se défendre contre cette même occupation. Dans les limites du droit international.
L'imposition du récit premier a également joué, à travers le recours à des codes journalistiques rassurants. D'où ces scènes d'”explication” (en hébreu, Hasbara) sous les hôpitaux palestiniens bombardés car accusés d'être des QG du Hamas, images et visites fournies gracieusement par l'IDF. Constat déplorable pour notre profession, cette communication a fleuri sur la paresse des médias qui se sont fait chambre d'échos et de validation plutôt qu'instance de vérification.
Autre mécanisme de communication sur lequel s'est appuyé l'armée israélienne, celui de l'habituation. Un paradigme s'est installé devant les exactions israéliennes à Gaza : d'abord le scandale, puis l'habituation et enfin le trop-plein qui pousse à l'apathie morale. Ainsi les bombardements d'hôpitaux ont d'abord choqué, puis leur répétition est devenue un déjà-vu et un déjà-dit médiatiques pour lesquels l'indignation n'avait plus de souffle. Si bien qu'en mai 2025, à la télévision israélienne, le député Zvi Sukkot a pu déclarer : « Vous pouvez tuer 100 Gazaouis en une nuit, et personne ne s'en soucie ». C'est cela l'habituation médiatique, un dynamique constante de l'acceptable et donc de l'inacceptable. Les médias ont fini par normaliser les situations anormales car « When everything is outrageous, nothing is outrageous »…
Cette guerre contre Gaza n'a pas échappé à un aplanissement des faits. Le dispositif médiatique objectivise toute parole et opinion, la plaçant sur le même plan que les faits. Ce métier est aussi en lambeaux par la multiplication des doxosophes ou prédicateurs de plateau, plus communément appelés “éditorialistes”. La grande ruse de l'éditorialiste est qu'il n'est pas tenu à la vérification des faits mais à leur seule interprétation. Il ne s'agit plus de savoir mais de croire.
À défaut de réalité, le récit médiatique de Gaza a produit un effet de réalité par la répétition, l'équivalence entre faits et opinion, le recours à des experts inexpérimentés, aux slogans. Autrement dit, par le recours, via un discours aux apparences rationnelles, à une mythologie. Car c'est là la force du dispositif médiatique, il rationalise, confère à un récit le vernis de la démonstration et du réel. La structuration entre logos et mythos ne veut dès lors plus rien « dire », dans tous les sens du terme. La différence entre le discours logique et l'art de la fable, voire de l'affabulation, disparaît sur certains médias.
Nous avons aussi assisté, avec Gaza, à une pétrification du langage et à sa descente dans le non-sens. Un bréviaire de mots, psalmodiés comme un credo. Ainsi « Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient », sans que jamais on n'interroge la santé d'une démocratie effective seulement pour une partie de la population qui vit entre la mer et le Jourdain. Quand bien même la presse israélienne alerte sur le glissement illibéral du pays avec un Netanyahou si occupé à survivre politiquement qu'il met au pas les contre-pouvoirs du pays.
Avec la couverture médiatique de Gaza (et il faut peser l'ambivalence du mot “couverture”, qui tient autant du dévoilement que de l'occultation), nous avons assisté à la disparition du réel. Le grand paradoxe, ou la grande perversité, est que cette disparition s'est faite sous couvert d'information et de réalité.
C'est l'avenir du réel qui se joue là aussi. L'hyperréalisme induit par le dispositif médiatique a accouché d'un nihilisme médiatique comme destruction de la réalité. En bout de chaîne médiatique, le peuple palestinien en paie le prix du sang.
D'effacement en occultation
Je ne cesse d'être frappée par la mythologie qui accompagne le récit médiatique sur Israël. Tout se passe comme si s'opérait sur ce pays un transfert d'une sacralité étrange par un Occident aux cieux pourtant vidés de sens.
Par sacralité, il faut entendre ce mot au sens premier, religieux : séparé. Israël est un pays “mis à part”. Une absence de normalité qui se perçoit dans un paradoxe épais : Israël est tellement moral qu'il échappe aux règles morales communes.
Cette sacralisation d'Israël en vient à attribuer à ce pays des caractéristiques quasi divines. Le nom de ce pays ne doit pas être “pris en vain”, comme le nom de Dieu dans le décalogue, notamment avec cette incapacité à le nommer et désigner sa responsabilité dans les crimes commis à Gaza. D'où ces titres flottants, où la conséquence était nommée sans que jamais la cause ne le soit. Les Palestiniens meurent, la famine s'installe, les hôpitaux sont détruits comme par la magie d'une volonté désincarnée et anonyme.
Israël ne bombarde pas mais “frappe”, comme le ferait un Dieu punisseur et omniscient. Ce pays apparaît alors comme ontologiquement “innocent” et donc irresponsable. Une théodicée en somme que le récit médiatique vient construire. La guerre contre Gaza doit être saisie dans un tel prérequis narratif, d'autant plus puissant qu'il est non-dit.
Cette incapacité médiatique à nommer la responsabilité d'Israël tout en décrivant les conséquences de ses actes a constitué un véritable obstacle épistémologique pour les médias, surtout occidentaux. Un écueil non nommé qui a donné lieu à toutes ces circonvolutions absurdes observées dès qu'il s'agissait de nommer les actes israéliens. D'où le recours au vocabulaire de la catastrophe naturelle ou encore à la tragédie, avec sa cohorte de déresponsablisation. Ainsi, il a été plus facile à certains médias de parler de “crise humanitaire” pour la famine à Gaza que de documenter les entraves des autorités israéliennes à l'entrée de vivres, pourtant parfaitement documentées par les ONG, l'ONU ou surtout des journalistes palestiniens et israéliens.
Autre observation, le récit médiatique s'inscrit dans une chronologie comme débutée seulement le 7 octobre. L'interprétation du massacre du 7 octobre a été comme figée dans un éternel présent, sans cesse réactualisé. Un événement sans cause, comme apparu soudainement dans un vide serein et paisible. Si rien n'excuse ce massacre de civils israéliens, comme tout massacre de civils, il s'inscrit dans un continuum historique. Ne pas appréhender les événements ainsi est se condamner à les reproduire.
Cette vision médiatique de l'histoire israélo-palestinienne rappelle ce que le philosophe Charles Mills appelle une « épistémologie de l'ignorance ». Les évènements semblent se produire dans un vide où le rôle du colonialisme, de l'impérialisme, du racisme, dans la formation des dynamiques contemporaines est tout simplement ignoré. Ce vide épistémologique a rendu là encore le récit médiatique incomplet, voire absurde. Rien n'explique le 7 octobre quand tout se justifie par ce même évènement.
La société israélienne comme certains médias occidentaux ont été traversés par des « États de déni », selon l'expression et le livre éponyme de Stanley Cohen, lequel s'est inspiré de son expérience de militant des droits humains en Israël pendant la première Intifada à la fin des années 1980. S'appuyant sur cette expérience, le sociologue israélien décrit un répertoire de dénis employés en Israël : « Cela ne s'est pas produit » (nous n'avons torturé personne) ; « Ce qui s'est produit est autre chose » (il ne s'agissait pas de torture, mais de « pressions physiques modérées ») ; « Il n'y avait pas d'alternative » (la torture un mal nécessaire).
Dès lors, "Il n'y a pas de génocide à Gaza" ; "il n'y a pas de journalistes à Gaza" ; "il n'y a pas de famine à Gaza" ; “il n'y a pas de civils à Gaza”. Autant de négations qui me rappellent la blague juive de ce chaudron neuf qui n'avait jamais été prêté mais a été rendu troué. Gaza est comme ce chaudron tout à la fois neuf et troué, perdu et jamais prêté : une impossibilité épistémologique.
Autre conséquence de cette sacralisation d'Israël, se note dans le récit médiatique une sur-présence d'Israël qui a pour pendant exact l'effacement des Palestiniens. Les Palestiniens sont généralement décrits comme étant « morts » ou « tués » dans des frappes aériennes, sans mention de l'auteur de ces frappes. Les victimes israéliennes, en revanche, sont « massacrées » et « égorgées ». S'ils apparaissent, les corps des Palestiniens sont une masse indistincte-, foule, groupe, tas, dans la vie comme dans la mort. À l'opposé, chaque Israélien est individualisé, doté d'affects trop souvent refusés aux Palestiniens. L'hyperbole pour décrire les souffrances israéliennes a eu pour pendant l'euphémisation, voire la silenciation des souffrances palestiniennes. La couverture de la guerre contre Gaza est aussi, paradoxalement, l'itinéraire de la disparition d'un peuple en sursis, comme tout peuple colonisé.
Dans le récit médiatique fait de Gaza, si les Palestiniens apparaissent, ils ne le sont qu'à travers leurs corps meurtris. Peu de place est faite à leur psyché, désir et volonté. Ils sont éternels sujets et objets d'un récit qui les dépouille de leur agentivité et souveraineté individuelle. En revanche, les affects israéliens sont mis en avant, en psyché individuelle dont seuls les Israéliens semblent dotés. Avec cet effacement médiatique, les Palestiniens ont subi tout autant une violence physique qu'une violence symbolique. Le drame est que ce traitement médiatique différencié a donné lieu à une “économie” macabre et raciste, où se trouvent figées les catégories de victime, la violence légitime, et in fine la justification de la destruction. Gaza révèle ainsi un ensauvagement policé et une radicalisation des médias occidentaux.
Outre la dévastation physique, les Palestiniens se sont vus opposer le refus implicite de raconter eux-mêmes cette guerre et ce qu'elle leur fait. Je me suis souvent demandé dans quelle mesure cela tenait aussi à des réflexes racistes inconscients, la parole “arabe” étant systématiquement dépréciée et suspecte quand celle d'Israël, présentée et perçue comme conforme aux normes occidentales de rationalité, était reçue sans recul et doute.
Edward Saïd avait déjà décrit ce mécanisme de dépossession de la parole sur soi. Ce que l'intellectuel palestinien appelait “Permission to narrate” ou l'autorisation de raconter. “Dès les débuts des spéculations occidentales sur l'Orient, la seule chose que l'Orient ne pouvait pas faire était de se représenter lui-même”, analysait-il.
Le traitement médiatique de Gaza n'a rien de nouveau sous les cieux sépia de l'orientalisme.
Le récit palestinien, ou plutôt le témoignage, a été d'emblée soupçonné, là où le récit israélien était médiatiquement objectivité. Alors même que les médias se contentaient trop souvent des dénégations officielles israéliennes. Ainsi les Palestiniens, qu'ils soient journalistes, associatifs et civils, ont très vite affirmé que l'aide du GHF servait surtout à organiser des massacres. Il aura fallu que Ha'Aretz rassemble des témoignages de soldats israéliens confirmant ce fait pour que cela soit diffusé. Mais même là, certains médias occidentaux ont préféré titré sur les réponses israéliennes plutôt que sur l'enquête elle-même.
Là encore, comment ne pas y déceler un effet de cet orientalisme qui attache aux peuples sémites les travers de fourberie, d'exagération et de mensonge. Ce que la société israélienne a ramassé dans le mot-valise “Pallywood” qui emporte l'idée que les Palestiniens mettent en scène leur propre souffrance. En cela, et je ne cesse de m'en étonner, la société israélienne projette sur les Palestiniens ce regard orientaliste qui, au cœur de l'antisémitisme européen, était projeté sur les Juifs. L'histoire de cet antisémitisme est traversée de ces mêmes accusations d'exagération et de lamento, même au plus fort des massacres et persécutions. Même au sortir des camps de concentration et d'extermination.
Tout se passe comme si c'était opéré un transfert tragique, celui de l'orientalisme européen vis-à-vis des Juifs vers la société israélienne vis-à-vis des Palestiniens. C'est peut-être en cela que la société israélienne est profondément une société orientaliste et donc une société occidentale, selon l'intuition d'Edward Saïd pour qui Orientalisme et Occidentalisme fonctionnent en symétrie inversée. C'est par cet orientalisme, et donc par le traitement des Palestiniens, qu'Israël entend aussi s'affirmer comme partie prenante de l'Occident.
Les petits soldats de l'occidentalisme
Tout récit est traversé d'un méta-récit, sous-texte ou pré-texte, d'autant plus puissant qu'il est implicite. Le récit médiatique n'échappe pas à cette règle. Depuis le 7 octobre 2023, des méta-récits ont singularisé la couverture de la guerre contre Gaza. Ce sont ceux-ci qui font aussi que le génocide à Gaza a été permis par ce récit médiatique.
D'abord, il me semble que la colonisation des Palestiniens et le génocide des Gazaouis a été implicitement vus par les médias occidentaux, comme la réparation du génocide juif. Et c'est sans doute là que gît le nœud tragique de ce qui se joue à Gaza et plus largement en Palestine. Le sang versé reste innocent.
Cette grille de lecture est tout droit issue de la Seconde Guerre Mondiale, quand l'Occident a dû se rejustifier après un génocide industriel d'ampleur inédite. Sur les cendres et le scandale d'Auschwitz, l'Occident a reconstruit sa fausse innocence. En soutenant coûte que coûte le gouvernement israélien, l'Occident est persuadé d'avoir tourné le dos à ce qui a mené aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, à Gaza, l'Occident répète ses fautes.
Dans la couverture médiatique de Gaza et la Palestine, il s'est agi beaucoup moins de défendre Israël que de défendre l'Occident auquel Israël a été identifié (et s'est identifié). À la retraumatisation constante d'Israël à travers un vocabulaire emprunté au plus fort des persécutions européennes (pogrom, extermination, génocide) a fait écho la rejustification ou la rédemption, au sens quasi religieux, de l'Occident. Plus Israël est sans équivoque la seule victime, plus l'Occident se justifie.
Mais ce récit lié à cette guerre fondatrice s'échoue et se brise désormais à Gaza. Un autre récit a émergé, celui des pays du sud. Il est ainsi significatif que ce soit l'Afrique du sud, pays qui sait dans sa chair ce qu'est le racisme, qui a la première saisi les instances internationales, CIJ comme CPI, pour alerter sur la situation à Gaza. À cette initiative sud-africaine se sont très vite ajoutés d'autres pays, le groupe de La Haye, dont la majorité sont d'anciennes colonies européennes. Rompus au colonialisme européen, ces pays considèrent Gaza comme l'un des derniers scandales coloniaux.
Gaza fait sens et signe comme la persistance d'un ordre mondial occidental qui s'accroche à ses derniers privilèges. C'est pourquoi il faut imaginer Israël comme un double ou une projection de l'Occident. Un pays auquel est autorisé des comportements que l'Occident se refuse ouvertement et s'accorde plus discrètement. Alors que la politique ethnique est mal vue en Occident, Israël est autorisé à la pousser jusqu'à ses extrêmes meurtriers, comme l'apartheid, la colonisation, les guerres dites préventives et réellement prédatrices. Quand un Louis Sarkozy affirme qu' « ils crèvent tous. Israël fait le travail de l'humanité », que le chancelier Merz affirme en marge du G7 (groupe occidental s'il en est) qu' « Israël fait le sale boulot pour nous » ou que, en religiosité hallucinée, le sénateur américain Ted Cruz affirme qu' "dans la Bible, ceux qui bénissent Israël seront bénis", tous font d'Israël le gladiateur ou le proxy de l'Occident, pour parler le langage moderne de la géopolitique. Autrement dit, Israël mène les guerres symboliques et réelles d'un Occident alarmé par sa propre chute. Telle est l'incohérence au cœur de l'ordre libéral occidental que Gaza a aussi révélée.
À Gaza s'affrontent donc deux méta-récits : celui issu de la Seconde Guerre Mondiale, lequel a fondé l'ordre international occidental dans lequel nous vivons depuis. Et celui issu des décolonisations. Qui l'emportera se joue aussi dans la petite enclave gazaouie. Quand Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël est aux avants postes de la lutte pour la “civilisation occidentale”, il s'agit tout à la fois de créer une solidarité automatique comme d'indiquer, comme l'affirment aussi Manuel Valls, Bernard Henri Lévy ou encore en 2014 José-Maria Aznar que “si Israël tombe, l'Occident tombe aussi”.
La pensée racialiste et civilisationnelle a détraqué nos médias. Le suprémacisme international a fait écho au suprémacisme national et inversement. La couverture de Gaza en a été imprégnée, avec la projection sur Israël du nihilisme européen cristallisé en montée des extrêmes et figuration de l'Islam comme ennemi intérieur et extérieur.
Car il existe un lien entre l'islamophobie en Occident et le soutien à Israël. La communication israélienne présente ainsi la question palestinienne non pas comme une lutte nationale mais comme une guerre de religion entre Juifs et Musulmans.
Cette lecture convient aussi bien aux messianistes évangéliques qu'aux milliardaires catholiques, tous engagés dans une stratégie de reconquête culturelle de la sphère occidentale.
Gaza restera une plaie ouverte pour les médias occidentaux. Ils se sont fait les soldats zélés d'un occidentalisme plutôt que les défenseurs de principes universels. Un génocide plus tard, la couverture de Gaza a ravivé les clichés et tropes les plus dangereux de l'antisémitisme. Là est aussi la gravité du traitement médiatique de la guerre à Gaza. Là est aussi notre grande responsabilité.

Les partenariats entre les acteurs du développement et de l’aide humanitaire sont essentiels pour l’intégration des réfugiés dans les systèmes de protection sociale

Une nouvelle note de l'Organisation internationale du Travail (OIT) souligne comment une décennie de travail de l'OIT démontre qu'une collaboration plus étroite entre les agences humanitaires et les acteurs du développement est essentielle pour intégrer les réfugiés dans les systèmes nationaux de protection sociale.
Tiré de Entre les lignes et les mots
GENÈVE (OIT News) – À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, l'OIT a publié Protection sociale et déplacements forcés – Enseignements tirés d'une décennie d'activités de l'OIT, une nouvelle note présentant des recommandations pratiques pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de déplacement forcé dans les systèmes nationaux de protection sociale.
Le moment choisi pour la publication de ce document est particulièrement crucial car le système mondial d'aide humanitaire est poussé à ses limites. À ce titre, le document vise à aider les pays et les acteurs humanitaires et du développement qui les soutiennent à améliorer l'accès à la sécurité des revenus, aux soins de santé et à d'autres services essentiels pour les personnes en situation de déplacement forcé, tout en réduisant la fragmentation et en favorisant la cohésion sociale.
Il tire les enseignements des dernières décennies de coopération de l'OIT avec les acteurs humanitaires visant à faciliter la transition entre les interventions humanitaires d'urgence ad hoc et les systèmes de protection sociale fondés sur les droits. La note met également en évidence la manière dont laprotection sociale universelleet l'égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les non-ressortissants peuvent contribuer à relier les efforts humanitaires, de paix et de développement.
Les déplacements forcés sont en augmentation dans le monde entier, sous l'effet des conflits, de la violence, des catastrophes environnementales et de la crise climatique. Ce défi croissant exige des réponses fondées sur les droits de l'homme et garantissant aux personnes en situation de déplacement forcé l'accès aux services et protections essentiels.
La protection sociale est un droit humain fondamental, ancré dans les droits à la sécurité sociale et à la santé, et elle doit être garantie pour tous, y compris les réfugiés et les autres populations déplacées. La protection sociale en matière de santé, en particulier, offre un point d'entrée solide pour l'inclusion, car elle est alignée sur les priorités nationales en matière de santé publique, tout en contribuant à une intégration plus large dans les systèmes de protection sociale. – Shahra Razavi, Directrice du Département de la protection sociale universelle de l'OIT
Le document souligne qu'une approche à deux volets, combinant le renforcement des systèmes nationaux et l'inclusion opérationnelle des personnes déplacées, est la voie la plus efficace à suivre et celle qui permettrait de garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Les partenariats entre les acteurs du développement et de l'aide humanitaire sont essentiels pour que ces stratégies d'inclusion fonctionnent. L'OIT apporte son expertise technique et ses normes internationales, tandis que les organisations humanitaires fournissent un accès direct aux communautés déplacées et une connaissance approfondie de leur situation. L'élaboration récente de principes communs par plusieurs organismes des Nations Unies est alignée avec les enseignements tirés par l'OIT et contribue à encadrer ces partenariats dans le cadre du nexus humanitaire-développement-paix.
Il est également essentiel de relier la protection sociale aux programmes pour l'amélioration des moyens de subsistance, car cela permet aux personnes déplacées d'avoir un accès durable aux prestations tout en améliorant leurs possibilités d'emploi, leurs revenus et leur bien-être. Pour garantir un impact à long terme, un financement durable et un plaidoyer plus fort sont nécessaires, afin de garantir une assistance sociale fondée sur les droits pour les groupes vulnérables et d'aligner les ressources nationales et internationales.
L'OIT réaffirme son engagement à soutenir les pays qui étendent la couverture de la protection sociale aux populations déplacées et à leurs communautés d'accueil, tout en progressant vers des systèmes universels.
Partnerships between humanitarian and development actors are key to including refugees in social protection systems
https://www.ilo.org/resource/news/partnerships-between-humanitarian-and-development-actors-are-key-including
Las alianzas entre los agentes humanitarios y de desarrollo son esenciales para la inclusión de los refugiados en los sistemas de protección social
https://www.ilo.org/es/resource/news/las-alianzas-entre-los-agentes-humanitarios-y-de-desarrollo-son-esenciales
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Harcèlement sexuel dans une entreprise de métallurgie

Mme Z. est soudeuse, elle est engagée en CDD à partir du mois de septembre 2018 dans une entreprise de métallurgie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/07/harcelement-sexuel-dans-une-entreprise-de-metallurgie-la-victime-condamnee-a-payer-les-frais-de-justice-de-son-employeur-par-le-conseil-de-prudhommes-dannecy/?jetpack_skip_subscription_popup
Elle travaille souvent en binôme avec son collègue M. A. Les deux logeant loin du lieu de travail, ils s'échangent leurs numéros de téléphone dans le but d'organiser des covoiturages pour se rendre au travail.
Des propos à caractère sexuel et des images pornographiques
Très vite, les moindres faits et gestes de Mme Z. deviennent des prétextes pour son collègue à tenir des propos à caractère sexuel : Lorsqu'elle se penche pour souder une pièce, il lui dit que « ça lui donne des idées ». Alors qu'elle est enrhumée, il lui propose de boire son sperme en guise de sirop.
Mme Z. ne cesse de manifester ses refus ; lorsqu'il se plaint de sa vie sexuelle, elle lui suggère de consulter des sites spécialisés souhaitant ainsi contourner ses propos, lorsqu'il lui fait des propositions sexuelles en prétendant qu'elle a besoin de se « détendre » et qu'il faut « profiter de la vie », elle lui répond que son travail et ses enfants la comblent déjà de bonheur. Et quand M. A lui envoie des GIFs issus de vidéos pornographiques par sms, montrant des actes de pénétration en gros plan, seulement un mois après son embauche, Mme Z. lui répond par un « émoji en colère » suivi du prénom de son collègue et d'un point d'exclamation, exprimant ainsi sa colère de recevoir de telles images.
Face à ces violences incessantes, le travail de Mme Z. est constamment perturbé. Alors qu'elle est concentrée, enlevant le serre-joint d'une pièce, M. A n'arrête pas de l'asséner de propos à caractère sexuel. Déconcentrée, elle ne remet pas le serre-joint en place et fait tomber sa pièce, se blessant au niveau de la côte.
Le stress engendré par le harcèlement sexuel qu'elle subi déclenche une crispation de sa mâchoire, appelée bruxisme, ce qui abîme ses dents. Mme Z. doit alors porter une gouttière. Quand on est victime de violences sexuelles au travail, on serre les dents, au sens figuré comme au sens propre.
Mme Z. signale les faits au chef de l'atelier. La secrétaire, à qui elle se confie le même jour, l'informe que M. A avait déjà commis des violences à son encontre également et que le chef d'atelier avait dû intervenir afin qu'il cesse. C'était donc, a minima, le deuxième signalement que ce chef d'atelier recevait concernant les agissements de M. A.
Malgré cela, rien ne sera mis en place pour protéger Mme Z.
Face à l'inertie de son employeur, un ami de Mme Z, M. F, rencontre M. A sur le parking de l'entreprise afin de lui demander de cesser ses agissements. Ce dernier propose alors de l'argent pour faire taire Mme Z.
Inquiète du comportement de M. A envers d'autres femmes, Mme Z. se rend au domicile de M. A accompagnée par un proche, M. L, dans le but d'avertir sa conjointe des violences qu'elle subissait. Après quoi M. A déposera une plainte pour violation de domicile et chantage ! L'inversion de culpabilité à son paroxysme !
Elle dépose alors une main courante en décembre 2018, puis en 2022, elle saisit les prud'hommes.
Une défense abjecte
Dans ce dossier, la défense use encore et toujours des mêmes stéréotypes : Mme Z. ne pourrait pas être victime car elle est plus âgée que M. A. C'est bien connu, dès lors que la différence d'âge est en faveur des femmes, elles sont soudainement protégées du patriarcat et il devient tout bonnement impossible de subir des violences sexuelles… De quoi nous donner envie de dérégler nos horloges.
Plus sérieusement, si la différence d'âge entre un agresseur et sa victime nous apporte des éléments de compréhension des rapports de pouvoir qui se jouent lorsque l'agresseur jouit d'une plus grande ancienneté dans l'entreprise et que le plus jeune âge d'une victime la vulnérabilise, l'absence de ce type de rapport de pouvoir lié à l'âge ne permet évidemment pas de faire disparaître tous les autres. En l'occurrence, Mme Z. a un contrat précaire et n'a pas eu la possibilité de développer des relations au travail lui permettant d'avoir du soutien puisqu'elle vient juste d'arriver dans l'entreprise, elle est donc seule, et la façon dont son poste et l'atelier sont organisés accentue cet isolement, propice à la commission de violences à son encontre. De plus, il règne un climat permissif dans l'entreprise, celle-ci ayant déjà eu connaissance de violences similaires commises par M. A sans que cela ne semble la pousser à mettre de quelconques mesures en place, bafouant ainsi ses obligations. Le fait que Mme Z. soit ou non plus âgée que M .A est sans incidence sur la caractérisation du harcèlement sexuel et ces autres facteurs ont bien permis à M. A de tenir ces propos à connotation sexuelle en toute impunité. La défense lui reproche également l'attitude de ses proches, notamment, le fait que M. F, ami de Mme Z., ait cherché à rencontrer M. A sur le parking de l'entreprise. Comme d'habitude, les victimes ont toujours tort ; lorsqu'elles refusent l'aide de leurs proches, on soupçonne que la situation n'est pas « si grave » sinon quoi, elles auraient accepté n'importe quelle aide afin de faire cesser les violences. Lorsqu'elles acceptent l'aide de leurs proches, il pèse sur elles le stéréotype d'une femme vengeresse.
Enfin, la défense va jusqu'à rendre Mme Z. responsable du comportement de son entourage ! Un de ses amis, qui témoigne dans la procédure, avait partagé sur son compte facebook personnel des images à connotation sexuel. La défense a alors estimé que ce témoin n'avait pas de leçon à faire sur le sexisme et que son comportement en ligne était de nature à décrédibiliser son témoignage. En clair, Mme Z. devrait jouer les modératrices de contenu auprès de ses proches pour avoir le droit de produire leurs témoignages.
Il est intéressant aussi de constater que la défense considère bien que des images à caractère sexuel soient offensantes pour les femmes lorsque celles-ci sont publiées sur un réseau social par un ami, mais pas lorsqu'elles sont imposés par un collègue, dans le cadre du travail…
Un jugement à charge contre la victime
Dans son jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a non seulement débouté Mme Z. de toutes ses demandes, mais il l'a également condamné à l'article 700 du code de procédure civile, c'est-à-dire, au paiement des frais engagés par la partie adverse. C'est donc une décision que Mme Z peut légitimement ressentir comme une « punition » pour avoir voulu être rétablie dans ses droits.
Le conseil de prud'hommes d'Annecy justifie sa décision par « une attitude de chantage et de menace » envers M. A, faisant référence à la visite de M. F au domicile de M. A.
Mme Z. a simplement fait appel à ses proches pour se défendre et espérer pouvoir reprendre son poste en sécurité. Elle souhaitait faire cesser le harcèlement sexuel commis à son encontre, elle a alors essayé toutes les stratégies possibles, et demander l'aide d'un ami en faisait simplement partie. Cela ne fait d'ailleurs que démontrer l'état de détresse dans lequel elle se trouvait…
Ainsi, le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est contenté de croire les allégations de la partie adverse qui prétendait que Mme Z. avait tenté d'extorquer de l'argent à M. A (c'était pourtant lui qui tentait d'acheter son silence !), sans que la défense n'ait à produire aucune preuve de cette « attitude de menace », tout en décidant d'ignorer les preuves du harcèlement sexuel commis par M. A. En effet, en plus d'un grand nombre d'éléments – tels que l'enquête de l'inspection du travail qui caractérise précisément l'existence du harcèlement sexuel à l'encontre de Mme Z. et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, des éléments médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, des témoignages indirects et des captures d'écran des gifs pornographiques envoyés par M. A – ce dernier avait beau contesté une partie des faits, il avait bien reconnu, lors d'un entretien dans les bureaux de la société, l'envoi de photographies à caractère pornographique et avait également reçu un rappel à loi, impliquant donc qu'il avait reconnu les faits, là encore.
La partie adverse prétendait que ces messages avaient été envoyés en dehors du temps et du lieu de travail, sans pour autant, encore une fois, le démontrer, alors que les horaires d'envoi pouvaient correspondre au temps de travail. En outre, elle a sanctionné le harceleur d'un seul avertissement montrant bien que les faits commis relevaient de sa responsabilité. De plus, l'AVFT et Me Mylène HADJI, avocate de Mme Z., avaient présenté avec précision dans leurs écritures plusieurs décisions étendant la responsabilité de l'employeur en dehors du temps et du lieu de travail, dès lors que les protagonistes étaient en lien en raison du travail.
Les justifications du conseil de prud'hommes d'Annecy pour débouter Mme Z. et la condamner au paiement des frais engagés par la partie adverse s'arrêtent là, en seulement quelques paragraphes visant tantôt à rendre Mme Z. responsable des violences subies, tantôt à nier la responsabilité de son employeur.
Quant à l'AVFT, nous avons été déclarée irrecevable pour ne pas avoir soutenu oralement nos conclusions en première instance, en raison d'une impossibilité matérielle exceptionnelle dont nous avions informé le Conseil.
Mme Z. et l'AVFT ont fait appel de cette décision. L'audience s'est déroulée le 22 mai 2025. Mme Z. était représentée par Me Mylène HADJI. L'AVFT n'était plus représentée, la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque.
Le délibéré sera rendu le 11 septembre 2025.
Tiffany Coisnard pour l'AVFT
https://www.avft.org/2025/09/03/harcelement-sexuel-dans-une-entreprise-de-metallurgie-la-victime-condamnee-a-payer-les-frais-de-justice-de-son-employeur-par-le-conseil-de-prudhommes-dannecy/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Solidarity : la gauche étasunienne et la question du travail

L'organisation étasunienne, socialiste, féministe et anti-raciste, Solidarity tient prochainement son congrès. Nous avons traduit le projet de résolution sur la question du travail. Celui-ci permet de se faire une bonne idée de l'ampleur des attaques du gouvernement Trump contre les syndicats et plus largement la classe ouvrière dans son ensemble. Le texte fait également le point sur les différents syndicats et associations qui se mobilisent actuellement aux États-Unis, sur leurs priorités et elle ouvre la discussion sur des pistes d'actions de solidarité. Beaucoup de choses donc utiles pour le mouvement ouvrier Québécois.
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE TRAVAIL
Projet du Comité national de solidarité sur le travail en 2025 et au-delà
La signature des contrats automobiles 2023 de l'UAW, qui éliminent les salaires à deux vitesses, a été rapidement suivie par le vote des travailleurs de Volkswagen dans le Tennessee en faveur de l'adhésion à l'UAW. Avec l'accord selon lequel les Teamsters travailleraient avec des formations syndicales indépendantes pour syndiquer les travailleurs d'Amazon, ces événements ont marqué un nouveau départ pour le mouvement syndical. Mais le pourcentage élevé de syndiqués et de personnes de couleur ayant voté pour Trump comme alternative au néolibéralisme et aux erreurs des syndicats a mis des bâtons dans les roues d'une avancée attendue du mouvement syndical. Le mouvement syndical, tout comme les mouvements sociaux, est passé d'une position offensive à une position défensive.
Au cours de son second mandat, Trump a adopté une position hostile à l'égard des syndicats en publiant des décrets révoquant les droits de négociation collective de 80 % des employés fédéraux, en licenciant des milliers d'autres et en réduisant de 25 % le salaire minimum dans tous les contrats fédéraux.
Les fonctionnaires fédéraux ont organisé des piquets de grève devant les bâtiments dont ils avaient été exclus et ont rejoint le tout nouveau Federal Unionists Network (FUN), une coalition capable de réagir immédiatement. Cette action, menée principalement par la base, a attiré toute une série de dirigeants syndicaux dans l'organisation et, grâce à des actions en justice, a contraint l'administration à faire (partiellement) marche arrière.
C'est en invoquant la « sécurité nationale » que Trump a pu supprimer les protections (conditions de travail, promotion, formation, rémunération des heures supplémentaires et des déplacements, licenciements et renvois, etc.) et contraindre les fonctionnaires fédéraux à devenir des employés « à volonté ». Bien sûr, une contestation judiciaire était nécessaire, mais elle s'est avérée terriblement insuffisante. Alors que le procès suit son cours devant les tribunaux, l'administration Trump va de l'avant et les fonctionnaires fédéraux travaillent sans droits. Les syndicats fédéraux et l'AFL-CIO ne semblent pas avoir l'intention de remettre en cause cette « réalité sur le terrain ».
De plus, le ministère du Travail a annoncé son intention d'abroger plus de 60 réglementations relatives au lieu de travail. Il s'agit notamment de réduire les exigences en matière de salaire minimum pour les aides-soignants à domicile et les personnes handicapées, d'abaisser le niveau d'exposition aux substances nocives et de limiter les sanctions infligées aux employeurs dans certaines circonstances lorsque des travailleurs sont blessés ou tués.
Ces nouvelles réglementations ont été annoncées par la secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer, la personne recommandée pour ce poste par le président du syndicat Teamsters, Sean O'Brien. Elle a déclaré qu'il s'agissait de « la proposition la plus ambitieuse visant à réduire les formalités administratives de tous les départements du gouvernement fédéral ».
Si nous assistons à des attaques sauvages sous l'équipe Trump, les administrations précédentes refusaient déjà de soutenir les travailleurs. Par exemple, le salaire minimum fédéral est de 7,25 dollars de l'heure, sans augmentation depuis 2009, et il existe des exceptions à ce salaire de misère pour les travailleurs recevant des pourboires, les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 18 ans et certaines professions. Même avant l'investiture de Trump, des tentatives avaient été faites pour affaiblir les lois sur le travail des enfants. Au début de l'année, le New York Times a publié une série d'articles révélant de nombreux cas d'enfants immigrés travaillant dans des professions dangereuses. Plusieurs d'entre eux ont été gravement blessés ou sont décédés. (https://www.nytimes.com/series/alone-and-exploited)
Une réponse importante à ce climat politique négatif est May Day Strong (NEA), un réseau de résistance lancé par le Chicago Teachers Union (CTU), le United Teachers of Los Angeles (UTLA) et d'autres syndicats du secteur public. Mais si l'on consulte leur site web (https://maydaystrong.org/), on constate que parmi leurs partisans figurent un certain nombre de syndicats locaux et internationaux (dont la NEA et le National Nurses United), ainsi que diverses organisations de mouvements sociaux et à but non lucratif. Ils ont commencé par lancer un appel à des actions de masse le 1er mai. Bien que moins massives que les rassemblements « Hands Off », les marches et les rassemblements ont réuni entre 60 000 et 80 000 militants syndicaux et communautaires dans plus de 1 000 lieux. Basé sur le mouvement syndical, le réseau a tendu la main aux organisations communautaires et d'immigrants autour d'un programme en cinq points :
– Mettre fin à la mainmise politique des milliardaires,
– Protéger et défendre Medicaid, SSI et d'autres programmes sociaux essentiels pour les travailleurs,
– Financer pleinement l'éducation, les soins de santé et le logement pour tous,
– Mettre fin aux attaques contre les immigrants, les Noirs, les peuples autochtones et les populations transgenres,
– Investir dans les besoins des gens, pas dans la guerre.
Le MDS a organisé plusieurs réunions de planification en personne et via Zoom, auxquelles ont participé plusieurs centaines de personnes. Il distribue des kits d'outils MDS (que la NEA a aidé à développer) pour l'organisation locale ; la prochaine action nationale se mobilise autour de la fête du Travail. Il prévoit 20 à 30 conférences régionales au cours de l'automne dans le but de coordonner les actions et les grèves régionales menant au 1er mai 2026.
Ce projet ambitieux vise à tester le terrain pour voir ce qui est possible et permettre à certaines régions du pays ou à certains segments de la population active de montrer la voie, dans l'espoir d'inspirer d'autres acteurs. Nous voulons participer à ce projet, contribuer à son développement et analyser les possibilités qu'il offre.
Nous voulons construire ce vaste réseau syndical de gauche, composé à la fois de responsables syndicaux élus et de simples membres. C'est le genre d'initiative dont nous avons besoin pour lutter contre le programme de Trump.
Un exemple : la grève chez Air Canada
Un exemple concret et actuel est la grève des agents de bord d'Air Canada en août 2025. Avant même l'expiration de leur contrat, de longues files de membres brandissant des pancartes faisaient du piquetage devant les aéroports, défilant dans les aéroports avec leurs pancartes et envahissant les conférences de presse de la direction avec leurs revendications. Alors que la direction comptait sur le gouvernement canadien pour imposer une injonction afin de forcer les travailleurs à reprendre le travail pendant la poursuite des négociations, 10 000 agents de bord et leur syndicat, le SCFP, ont clairement indiqué qu'ils étaient prêts à poursuivre la grève si la direction ne répondait pas à leurs revendications.
Les principales revendications du syndicat étaient les suivantes : 1) que la société paie les heures de travail avant et après l'embarquement qui n'étaient pas rémunérées (seul le temps de vol l'était !) et 2) qu'elle augmente les salaires. Le public était favorable à ces revendications, même si 100 000 passagers par jour ne pouvaient pas prendre l'avion.
Lorsque la direction d'Air Canada a constaté que le gouvernement intervenait mais que le syndicat défiait l'ordre, elle a été contrainte de présenter une proposition provisoire. C'est le message clair du syndicat concernant ses revendications et sa volonté de rester uni, même au mépris de la « loi », qui a contraint la compagnie à agir. De retour au travail, les agents de bord voteront pour accepter ou non le contrat.
Immigration
Une série d'actions supplémentaires est menée dans plusieurs syndicats américains. Ce qui est important à ce sujet, c'est que les syndicats soutiennent activement leurs membres qui sont arrêtés et menacés d'expulsion.
• Lors des raids massifs menés par l'ICE à Los Angeles, David Huerta, président de SEIU Californie, a été arrêté et accusé d'avoir entravé le travail d'un agent fédéral à l'extérieur d'un entrepôt de vêtements où des manifestants s'étaient rassemblés pour s'opposer au raid de l'immigration. SEIU a appelé les syndicats à organiser des manifestations pour réclamer sa libération, et plusieurs manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays.
• Le SEIU a également soutenu activement les membres qui ont été arrêtés et détenus, notamment Rumeysa Ozturk, étudiante diplômée de l'université Tufts et membre du SEIU Local 509, qui a été kidnappée par des agents d'immigration masqués, et Lewelyn Dixon (64 ans), technicienne de laboratoire à l'université de Washington, membre du SEIU Local 925 et résidente permanente. Dans ces affaires, le SEIU a collaboré avec des groupes d'étudiants et des associations locales pour faire connaître leur cas et organiser des piquets de grève devant les centres de détention.
• L'UAW a également soutenu des étudiants diplômés menacés d'expulsion pour avoir exprimé ou écrit leur soutien au cessez-le-feu à Gaza et au désinvestissement des entreprises vendant des armes à Israël.
• La section locale 100 du SMART a soutenu son membre, Kilmar Armando Abrego Garcia, en prenant publiquement sa défense et en collaborant avec CASA, une organisation dirigée par des travailleurs et des immigrants. Ils ont contacté d'autres syndicats du bâtiment pour soutenir les droits des immigrants.
• Toutes les formes d'activité syndicale doivent collaborer avec les centres de travailleurs, en particulier avec le National Day Laborer Organizing Network (NDLON) et les organisations communautaires.
Il est essentiel de discuter et d'analyser sur le lieu de travail, dans les locaux syndicaux et dans nos communautés comment ces attaques sont menées sous de faux prétextes. La sécurité des travailleurs est qualifiée d'« obsolète », les immigrants sont étiquetés comme des « criminels », les travailleurs d'autres pays nous « volent » en quelque sorte nos emplois et la « sécurité nationale » exige l'annulation des négociations collectives pour les fonctionnaires fédéraux. De nombreux membres syndicaux ont succombé à la rhétorique qui monte les travailleurs les uns contre les autres. Trop de nos collègues pensent que ce n'est qu'en érigeant des barrières que nous pouvons protéger nos communautés. La première tâche du syndicat est de montrer comment le fait de nous serrer les coudes nous donne le pouvoir de convaincre la direction de nous respecter. Nous nous protégeons lorsque nous protégeons tout le monde. Si nous échouons, nous ne pourrons pas nous protéger.
Nous avons aujourd'hui l'occasion de nous défendre et de défendre nos collègues contre les enlèvements par des agents masqués. Beaucoup ont gobé la promesse de Trump d'expulser les « terroristes » et les « criminels », oubliant que chaque travailleur est une personne avec une histoire. Nous devons saisir cette occasion pour « connaître nos droits » en tant que groupe et réapprendre que « l'atteinte à l'un est l'atteinte à tous ».
Concrètement, cela signifie organiser des formations sur la manière de minimiser les interactions de la direction avec les autorités et de s'unir contre les raids sur le lieu de travail.
Bien que limitée, la présence syndicale est présente dans le mouvement visant à mettre fin au génocide à Gaza. Le Réseau national du travail pour le cessez-le-feu demande ce qui suit :
• Il doit y avoir un cessez-le-feu à Gaza,
• Les otages détenus par le Hamas doivent être immédiatement libérés, tout comme les prisonniers de guerre palestiniens.
• Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement américain doit immédiatement suspendre son aide militaire à Israël.
Les syndicats qui ont initialement signé la déclaration sont les suivants : Association of Flight Attendants–Communications Workers of America (AFA-CWA) ; American Postal Workers Union (APWU) ; International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT) ; National Education Association (NEA) ; Service Employees International Union (SEIU) ; United Auto Workers (UAW) et United Electrical, Radio and Machine Workers (UE).
À ce jour, plus de 200 syndicats et organisations ont signé leur déclaration. Au total, ces signataires représentent plusieurs millions de travailleurs. Leur site web est https://www.laborforceasefire.org/.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un groupe militant, ce réseau syndical démontre que les responsables peuvent adopter des positions progressistes. Le problème est que la plupart des membres connaissent mal la question ou ne savent pas comment s'impliquer.
Divers syndicats
Nous ne pouvons pas fournir d'évaluations détaillées des différents syndicats et de leurs engagements. La campagne de l'UAW pour syndiquer le Sud semblait prometteuse, mais l'échec à obtenir une convention collective après la victoire électorale chez Volkswagen et l'échec à obtenir la reconnaissance syndicale chez Mercedes ont coupé l'élan.
Pour compliquer encore la tâche de l'UAW, les problèmes au sein du Comité exécutif international semblent épuiser l'énergie du syndicat. Le soutien de l'UAW aux droits de douane, bien qu'il semble populaire auprès d'une partie des membres, sape la capacité du syndicat à demander l'aide dont il a besoin pour syndiquer les usines implantées à l'étranger qui produisent désormais la majorité des véhicules américains. Dans de nombreux cas, les seules usines non syndiquées de ces entreprises sont situées dans le sud des États-Unis.
Si les syndicats des fonctionnaires fédéraux sont les premiers sur la sellette de Trump, les syndicats des assistants diplômés et des professeurs sont les suivants. L'administration Trump, comme l'administration Biden, prétend lutter contre l'antisémitisme sur les campus, mais elle utilise une définition erronée du terme afin d'attaquer le droit des étudiants diplômés et des professeurs de s'exprimer et de s'organiser contre les politiques gouvernementales.
Les enseignants des écoles publiques, les travailleurs de la santé et les employés des épiceries ont des campagnes contractuelles prévues à l'automne. Selon un article de Labor Notes publié en février 2025, intitulé « The Big Union Contract Fights Coming in 2025 » (Les grandes luttes syndicales à venir en 2025), plusieurs syndicats ont discuté de la stratégie de grève et envisagent d'aligner la date de leur prochain contrat sur celle de mai 2025, date choisie par le président de l'UAW, Shawn Fein.
La question clé est de savoir si ces discussions aboutiront à des résultats concrets. C'est l'une des raisons pour lesquelles May Day Strong a encouragé l'organisation d'actions à l'occasion de la fête du Travail en septembre, qui seront suivies d'une série de conférences régionales.
Comment s'organiser ?
Pour changer les conditions de travail, il faut expliquer ce qui doit être fait. Il faut présenter les choses de manière à ce que chaque travailleur se sente concerné par la nécessité de travailler ensemble. Cela ne signifie pas nécessairement un gain matériel immédiat, même si c'est souvent le cas. Dans d'autres cas, cela peut impliquer de se serrer les coudes pour renforcer le syndicat et le rendre plus efficace à long terme. Il est également important de formuler des revendications de manière à ce que la direction « comprenne », mais aussi à ce que le grand public comprenne et sympathise. Cela est d'autant plus nécessaire si cela doit causer des désagréments, comme cela a été le cas pour beaucoup lors de la grève d'Air Canada.
Les syndicalistes de base qui souhaitent changer leur syndicat doivent envisager de rejoindre les comités syndicaux locaux et de suivre des cours sur le syndicalisme dans leur localité et dans les universités voisines. C'est un moyen sûr de rencontrer d'autres travailleurs et de nouer des liens avec des responsables locaux militants qui souhaitent avoir un impact sur le syndicat. Souvent, ces comités sont également organisés au niveau régional et national. Même s'ils sont quelque peu bureaucratisés, ils constituent souvent une première étape dans l'organisation locale. Un comité de solidarité qui s'engage à défendre les grèves d'autres syndicats est certainement un moyen de nouer des liens avec d'autres syndicats.
Il existe également diverses organisations qui jouent un rôle important dans la fourniture de ressources et de formations aux travailleurs et à leurs syndicats. Parmi celles-ci, on peut citer Labor Notes, Emergency Workers Organizing Committee, Labor Network for Sustainability et Higher Ed Labor United (HELU).
De nouveaux caucus pourraient voir le jour grâce à ce travail, ou d'anciens caucus pourraient être relancés. Étant donné que la raison d'être d'un caucus est d'avoir un effet positif en remettant en question une méthode bureaucratique qui empêche d'élaborer des stratégies pour obtenir les revendications nécessaires, ceux qui s'adressent à l'ensemble des membres sur des questions clés peuvent avoir un impact plus important que les caucus qui se qualifient eux-mêmes de « révolutionnaires ». Ces derniers ont généralement un programme détaillé et imposent souvent des exigences idéologiques et organisationnelles à leurs membres.
Un caucus est généralement formé autour des conditions de travail ou des contrats, mais il peut également aborder des questions sociales. Il est essentiel d'envisager de mener des campagnes autour de ces questions de manière à faire comprendre comment cette oppression collective affecte les membres du syndicat.
Par exemple, s'opposer aux salaires à deux vitesses n'est pas seulement une question de justice pour les nouveaux employés, mais cela protège également les travailleurs plus âgés contre le harcèlement et renforce le syndicat contre d'autres attaques. Dans d'autres cas, si les autorités parviennent à monter une attaque autour de questions sociales ou internationales, cela les encouragera à nous attaquer également.
Lorsque la question se pose pour la première fois dans le cadre de la lutte contre le racisme, du soutien aux droits des femmes, des LGBTQ+ ou des immigrants, elle découle généralement d'une discrimination exercée par la direction au travail, mais parfois aussi par un collègue. Que l'attaque résulte d'une discrimination au travail ou soit le résultat de ce qui se passe dans la communauté ou dans le pays, l'important pour un caucus qui se saisit de la question est d'insister sur la nécessité de se protéger mutuellement en s'opposant à la discrimination. C'est ce même principe fondamental qui nous pousse à prôner la solidarité avec les travailleurs mexicains et chinois plutôt que de les considérer comme des « voleurs » d'emplois.
Nous nous protégeons de la déshumanisation en comprenant que si cela peut arriver à d'autres, cela nous arrivera certainement aussi. C'est le sens de la solidarité. C'est pourquoi nous devons élaborer des stratégies sur notre lieu de travail, qu'il soit actuellement syndiqué ou non. En élaborant des plans collectifs, nous nous défendons non seulement les uns les autres au mieux de nos capacités, mais nous développons également les compétences stratégiques qui maximisent le pouvoir des travailleurs.
Ces initiatives sont des débuts importants dans le développement d'un mouvement syndical militant. Les réunions syndicales, les comités syndicaux et les formations intersectorielles doivent considérer leur travail comme un moyen de renforcer cette solidarité. Nous avons besoin à la fois d'initiatives ascendantes et du soutien des dirigeants élus. Nous avons également besoin d'un espace où les travailleurs de tous les secteurs peuvent se rencontrer pour discuter et planifier. Des conférences à l'échelle de la ville ou de la région constituent la prochaine étape logique.
Les discussions entre travailleurs doivent se poursuivre et porter sur la manière d'intensifier notre action. Cela implique diverses tactiques, tant sur le lieu de travail que dans la communauté. Cela inclut l'entraide, les piquets de grève, la surveillance des tribunaux, les manifestations. Cela signifie des plaintes collectives, des pétitions, des marches vers les superviseurs pendant les pauses, le travail au ralenti et des grèves coordonnées, voire échelonnées.
https://solidarity-us.org/category/newsletter/
Traduit par Martin Gallié, avec Deepl.com

Comment le militantisme féminin en Russie a-t-il évolué depuis le 24 février 2022 ?

Pourquoi les initiatives populaires menées par des femmes sont-elles devenues l'une des rares formes de résistance résilientes ?
La militante féministe et LGBT+ Liliya Vezhevatova explore comment les femmes à travers le pays continuent de se soutenir mutuellement et d'établir des pratiques horizontales malgré la répression, l'isolement et la militarisation.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/08/le-tissu-de-la-resistance-feministe/?jetpack_skip_subscription_popup
Les règles de vie en Russie ont radicalement changé depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. L'appareil répressif s'est renforcé. Il est également devenu plus sévère. Il ne reste pratiquement plus d'espace pour critiquer le gouvernement, s'engager dans la défense des droits humains ou exprimer des opinions féministes. La Russie connaît désormais presque quotidiennement des détentions, des interrogatoires, des perquisitions et des arrestations pour des motifs politiques. Les militant·es comme les citoyen·nes ordinaires sont touché·es. Des personnes sont licenciées, détenues ou emprisonnées pour avoir tenu des propos anti-guerre, participé à des manifestations pacifiques ou publié des opinions impopulaires en ligne. Au moment où nous écrivons ces lignes, 3 861 personnes sont impliquées dans des affaires pénales à motivation politique en Russie. Dans le même temps, la société s'est de plus en plus militarisée. Cela est dû aux discours promus par le gouvernement, les médias pro-gouvernementaux, la politique familiale et le système éducatif. Cela inclut des cours obligatoires appelés « Conversations sur des sujets importants », qui justifient la guerre et sont souvent dispensés par des anciens combattants. Parallèlement, la sphère reproductive fait l'objet d'un contrôle accru.
Dans ce contexte, les initiatives féminines locales revêtent une importance particulière. Il est difficile d'évaluer si elles représentent un mouvement de masse ou si elles disposent de ressources suffisantes pour apporter des changements systémiques dans le pays. Cependant, elles continuent de fonctionner malgré la censure, les pressions, la menace de poursuites pénales et le manque de financement.
Nous appelons initiatives féminines locales des collectifs non gouvernementaux, non hiérarchiques et souvent informels qui travaillent de manière autonome, en ligne ou hors ligne, au niveau local ou en réseau. Elles sont unies par leur volonté d'aider les femmes, leur attention aux expériences de violences et leur rejet du programme officiel de l'État, ainsi que par leur perspective féministe ou anti-guerre, bien qu'elle ne soit pas toujours explicitement énoncée. En raison des conditions actuelles, ces groupes doivent souvent utiliser des formulations prudentes et des modes d'existence relativement sûrs pour rester sous le radar des forces de l'ordre. Pourtant, ils sont conçus pour être compris par celles qui ont besoin de les comprendre. Ces groupes ne sont pas officiellement enregistrés et ne reçoivent aucun financement public. Souvent, ils ne reçoivent aucun financement du tout. Ils travaillent de manière anonyme ou semi-légale.
Certaines de ces initiatives ont vu le jour bien avant la guerre, dans le cadre d'un mouvement féministe lent, vulnérable, mais vivant en Russie. D'autres ont émergé après le début de l'invasion de l'Ukraine, en réponse à la violence, à l'anarchie et aux destructions croissantes. Contrairement au militantisme féminin pro-gouvernemental, qui se concentre sur la démographie, la militarisation et le soutien aux « valeurs traditionnelles », les initiatives citoyennes s'attaquent aux problèmes réels auxquels les femmes sont confrontées dans un pays en guerre.
Comment ces initiatives ont-elles évolué depuis 2022 ? Quels types d'actions sont menées ? Quels sont les risques auxquels les féministes sont confrontées et pourquoi leurs expériences sont-elles importantes pour l'avenir de la société civile en Russie ?
Notre objectif n'est pas de fournir un aperçu exhaustif, mais plutôt de montrer comment, malgré les difficultés, des communautés dans différentes régions de Russie continuent d'exister et d'évoluer, protégeant les femmes et d'autres groupes vulnérables.
Réponse à l'invasion
Un mouvement féministe existait déjà en Russie avant 2022. Des groupes féministes étaient actifs dans tout le pays. Selon l'organisation féministe russe Ona (Elle), en 2021, des événements féministes ont été organisés dans 45 grandes villes en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg.
Les campagnes en faveur des sœurs Khachaturyan, la promotion d'uneloi contre la violence domestiqueetl'affaire Yulia Tsvetkova ont été largement médiatisées. Les féministes se sont également opposées aux tentatives de restriction del'accès à l'avortement. À Saint-Pétersbourg, Novossibirsk, Tcheliabinsk et dans d'autres villes, des femmes ont organisé des piquets de grève et des campagnes publiques avec des slogans tels que « Mon corps, mon choix » et « Si tu ne donnes pas naissance, tu n'as pas ton mot à dire ». Il existe des projets à grande échelle et des ONG qui se consacrent à l'aide aux femmes concernées, tels que Nasiliu.net(Non à la violence), le Consortium of Women's Non-Governmental Organizations (Regroupement des organisations non gouvernementales de femmes) etSyostry (Sœurs). Il y a également eu des initiatives locales plus modestes, telles que Rebra Yevy (Les côtes d'Ève) à Saint-Pétersbourg et un groupe féministe dans la ville d'Astrakhan. Presque toutes les universités régionales ont vu émerger des groupes féministes ou des publications (par exemple, FemKubanka à l'université d'État du Kouban et FemIrGU à l'université d'État d'Irkoutsk). Ces groupes ont organisé des événements de sensibilisation, des clubs de lecture, des expositions et des festivals, tels queNe Vinovata (Non coupable) et le Moscow FemFest.
Bien que la guerre ait radicalement changé les conditions de travail, elle n'a pas marqué le début du mouvement ; mais plutôt constitué un moment de transformation d'un domaine déjà établi
Si la guerre a radicalement changé les conditions de travail, elle n'a pas marqué le début du mouvement, mais plutôt constitué un moment de transformation dans un champ déjà bien établi.
Dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, les manifestations contre la guerre étaient encore publiques en Russie. Malgré une répression croissante, des piquets de grève, des manifestations de rue et des distributions d'autocollants et de tracts contre la guerre ont eu lieu dans tout le pays. Les initiatives féminines locales ont été parmi les rares formes de résistance résilientes, qu'il s'agisse d'initiatives pré-existantes ou de celles qui ont vu le jour en réponse aux événements actuels. Ces initiatives ont pris en charge la coordination des actions, l'entraide et l'élaboration d'un langage de résistance. Leur travail a largement défini le visage de la protestation anti-guerre en Russie, en particulier sur l'horizontalité, la décentralisation et la vulnérabilité avec une résilience frappante.
Féministes contre la guerre
La Résistance féministe contre la guerre (FAWR) a vu le jour fin février 2022 en réponse à la guerre et à la militarisation croissante. Le réseau s'appuyait sur des liens sociaux préexistants entre des militantes féministes à travers le pays. Le deuxième jour de l'invasion, des militantes ont publié le Manifeste de la Résistance féministe contre la guerre. Le manifeste appelait les femmes à s'unir dans la lutte pour la paix. Des militantes du monde entier ont immédiatement traduit le manifeste en 30 langues. La FAWR a lancé une campagne ouverte intitulée « Women in Black » (Femmes en noir), au cours de laquelle des femmes ont organisé seules des piquets de grève à travers le pays pour demander la fin de la guerre. Les membres du mouvement ont participé à des manifestations de masse, organisé leurs propres manifestations et distribué des tracts.
En avril 2022, des informations ont fait état de la mort d'au moins 5 000 civil·es à Marioupol et de l'enterrements de corps devant des immeubles résidentiels. En réponse, les militantes du FAWR ont organisé la campagne commémorative Marioupol-5000, installant des pierres tombales symboliques dans les jardins résidentiels de plusieurs villes russes. L'objectif de cette action était de détourner l'attention du public du militarisme émotionnel perpétué par la propagande pour la porter sur le sort tragique des civil·es. Dans le même but, le FAWR a publié pendant deux ans un journal intitulé Zhenskaya Pravda.
Parallèlement, des militantes ont mis en place une infrastructure horizontale en organisant des canaux d'entraide, en compilant des bases de données pour le soutien juridique et psychologique, en créant des guides de sécurité numérique et des modèles de lettres et de pétitions, ainsi qu'en mettant en place des « tchat » privés et sécurisés pour la coordination. Les membres ont formé de petites cellules autonomes en Russie et à l'étranger. Elles ont adapté le matériel à leur contexte local et ont agi de manière indépendante.
À l'été 2022, la répression s'est intensifiée, avec des arrestations massives, des interrogatoires et des perquisitions qui devenaient monnaie courante. Certaines militantes de la FAWR ont été contraintes de quitter le pays, tandis que d'autres ont poursuivi leur travail dans la clandestinité. En décembre 2022, le gouvernement russe a commencé à percevoir les initiatives féministes comme une force politique organisée, puis a qualifié la FAWR d'agent étranger, un statut discriminatoire appliqué aux organisations ou aux individu·es qui, selon le gouvernement, reçoivent des fonds de l' étranger ou sont sous influence étrangère.
En avril 2024, un an et demi plus tard, la FAWR a été ajoutée à la liste des [1]https://ovd.info/express-news/2024/.... Le gouvernement a déclaré que leurs activités menaçaient l'ordre constitutionnel, la capacité de défense ou la sécurité du pays, et a interdit toute activité et tout soutien à la FAWR en Russie.
Aujourd'hui, la FAWR est un vaste réseau décentralisé de 22 cellules actives s'étendant de la Corée du Sud aux États-Unis, ainsi qu'une communauté de femmes participantes individuelles à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. Cette structure en réseau permet au mouvement de rester résilient et de poursuivre son travail malgré la censure et la répression. Les militantes se réunissent pour organiser des manifestations locales, s'entraider, défendre les droits humains et mener des campagnes de sensibilisation. La campagne #передано_из_россии (envoyé_depuis_la_Russie), lancée en mars 024, est un exemple frappant de ce type de coordination. Cette campagne, qui s'est déroulée pendant les élections présidentielles, a rassemblé des participantes de différents pays devant les bureaux de vote installés dans les consulats et les ambassades. Elles brandissaient des pancartes sur lesquelles figuraient des messages de personnes vivant en Russie, des mots que ces dernières ne pouvaient pas prononcer librement dans leur pays. Ce mode de protestation a également été utilisé lors des commémorations des 8 et 9 mai et du 17 novembre (après l'assassinat d'Alexeï Navalny), ainsi que lors des marches LGBT+. La campagne est devenue une forme d'expression collective et un espace de solidarité.
Mouvement des proches des soldats mobilisés
Lorsqu'on évoque la résistance des femmes au début de la guerre, il est important de mentionner les manifestations organisées par les épouses et les mères des soldats incorporés après la « mobilisation partielle des réservistes militaires » déclarée par la Russie en septembre 2022. Ces manifestations ne sont pas le fruit d'un mouvement féministe organisé. Il s'agit plutôt d'initiatives spontanées et populaires menées par des femmes confrontées à la violence de l'État de la manière la plus personnelle qui soit : la conscription de leurs proches. Malgré le manque de ressources, d'institutions ou d'infrastructures « oppositionnelles », elles ont réussi à créer des groupes d'entraide, à développer un langage pour l'expression publique et à défendre leur droit à la solidarité. Il s'agit là d'un des exemples les plus remarquables d'activisme féminin populaire apparu pendant la guerre. Depuis l'automne 2022, des femmes de tout le pays organisent des piquets de grève, enregistrent des vidéos d'appel et descendent dans la rue pour réclamer le retour de leurs proches.
Les manifestations au Daghestan et en Yakoutie ont été massives, rassemblant jusqu'à 1 500 personnes et ont été réprimées avec violence par les forces de sécurité. Le 25 septembre 2022, par exemple, la police et les agents de la Garde nationale ont dispersé un rassemblement majoritairement féminin à Makhachkala. La police a utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestantes et a traîné de force nombre d'entre elles dans des fourgons de police. Néanmoins, les femmes sont revenues dans les rues le lendemain et la manifestation a été réprimée une fois de plus. Les organisations de défense des droits humains ont rapporté qu'au moins 250 personnes, dont des journalistes couvrant les événements, ont été arrêtées à Makhachkala au cours des deux jours. En Yakoutie, environ 6 000 hommes sur une population masculine totale de 400 000 ont été mobilisés. Les manifestant·es ont évoqué un génocide des peuples autochtones et ont souligné les failles du projet de loi et la répartition inégale des avis de mobilisation dans le pays. Des forces de sécurité venues de Moscou ont été déployées dans la région pour réprimer les manifestations.
Au cours de cette période, les femmes qui manifestaient ont attiré l'attention sur des problèmes tels que le manque de formation des soldats mobilisés, la pénurie d'uniformes et de fournitures médicales, l'absence de rotation dans les zones de combat, la signature forcée de contrats et la mobilisation illégale. Elles ont également exprimé leur inquiétude quant à l'envoi de conscrits au front et ont appelé à des négociations de paix avec l'Ukraine. Les manifestations ont été alimentées par l'inquiétude pour les proches mobilisés, ainsi que par la plus grande dépendance économique des femmes à l'égard des hommes dans des régions telles que le Daghestan, la Kabardino-Balkarie et la Yakoutie. La conscription inégale et intense dans ces régions a souvent laissé des familles sans soutien financier et sans moyens de subsistance.
À l'occasion de la fête des mères en novembre 2022, la FAWR, en collaboration avec les mères des personnes mobilisées, a lancé une campagne exigeant le retrait des troupes d'Ukraine et le retour des hommes. Elle a recueilli plus de 100 000 signatures en quelques jours seulement.
Au fil du temps, les manifestations spontanées de femmes ont commencé à prendre des formes plus organisées. Des initiatives indépendantes coordonnant les actions des militantes ont vu le jour, telles que le Conseil des mères et des épouses et Put' Domoy (Le chemin du retour). Elles ont publié des manifestes et des pétitions, et organisé des événements et des « flash mobs ». En novembre 2023, des militantes de Put' Domoy ont lancé une pétition contre « l'esclavage légalisé » et la « mobilisation indéfinie des réservistes militaires ». Elles ont également organisé un « flash mob » au cours duquel elles ont collé des autocollants sur des voitures avec le slogan « Vерните мужа, я Zа#балась » (Rends-moi mon mari, je suis foutue).
Les autorités ont réagi durement à ces manifestations. Elles ont refusé l'autorisation de rassemblement, arrêté des participantes, bloqué des groupes et des publications sur les réseaux sociaux et fait pression sur les hommes dont les femmes participaient aux manifestations. Les femmes ont néanmoins persévéré. Elles ont organisé des événements hebdomadaires, tels que des dépôts de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu près du Kremlin et des sit-in devant le ministère de la Défense.
Au début de l'année 2024, les manifestations des proches des mobilisés ont perdu de leur ampleur. Le Conseil des mères et des épouses et The Way Home ont été qualifiés d'« agents étrangers » et contraints de cesser leurs activités publiques. Début 2025, Olga Tsukanova, fondatrice du Conseil des mères et des épouses, a été arrêtée pour avoir prétendument manqué à ses obligations légales en tant qu'« agent étranger ». À l'heure actuelle, elle est toujours en détention provisoire et risque jusqu'à deux ans de prison.
Cependant, l'expertise en matière d'auto-organisation n'a pas disparu. De nombreuses participantes au mouvement pour la démobilisation poursuivent leurs efforts à travers des activités moins visibles. Il s'agit notamment de soutenir les familles des hommes mobilisés, de s'engager dans la défense des droits humains, de faire du bénévolat et d'aider d'autres initiatives. Grâce à leur expérience personnelle, à leur solidarité spontanée et à leur soutien mutuel, les bases d'un mouvement féminin résilient et populaire, capable de fonctionner même dans un régime fermé, militarisé et répressif, sont en train d'être jetées.
Armée des belles [Army of Beauties]
L'Armée des belles est une initiative populaire menée par des femmes qui a vu le jour en 2022, fondée par Nadine Geisler, de son vrai nom Nadezhda Rossinskaya, photographe et fleuriste à Belgorod. Lorsque la guerre a éclaté, elle a transformé son appartement en refuge pour les réfugié.es ukrainien.nes, qu'elle a ensuite transformé en centre d'aide humanitaire.
À cette époque, il existait de nombreux groupes de volontaires à Belgorod, mais la plupart d'entre eux se concentraient sur l'aide aux militaires. L'Armée des belles, en revanche, s'est concentrée sur l'aide aux réfugié.es et aux personnes restées dans les zones touchées par la guerre. Malgré l'absence de soutien institutionnel et la menace constante de persécutions, Nadine Geisler et ses camarades ont évacué des personnes des régions frontalières, distribué de l'aide humanitaire et trouvé des logements temporaires.
Les activités du groupe n'ont pas échappé aux autorités. En février 2024, Geisler a été arrêtée et accusée de haute trahison. En juin 2025, elle a été condamnée à 22 ans de prison dans une colonie pénitentiaire.
Initiatives locales
Depuis 2022, de petits groupes féministes ont poursuivi leur travail ou ont vu le jour dans différentes régions de Russie. Bien que ces initiatives soient rarement relayées par les médias, elles font partie intégrante du tissu de la résistance. Elles ne sont pas unies par une idéologie commune, mais par une pratique commune : protéger les personnes vulnérables, aider les victimes de traumatismes et s'opposer systématiquement à la militarisation et à la violence.
Le groupe féministe Feminitiv.Kaliningradopère de manière isolée dans la région enclavée de Kaliningrad. Ses membres organisent des événements éducatifs, des projections de films et des conférences. Elles créent également des espaces sûrs pour discuter des questions féministes, de la violence, des droits reproductifs et de la santé mentale. Le groupe propose des séances gratuites de conseil avec des psychologues bénévoles sur une base individuelle. Malgré leurs ressources limitées et les risques permanents, elles soutiennent les manifestations de solidarité locales et s'engagent activement auprès des jeunes.
Women's Solidarity est né dans la communauté anarchiste de la ville d'Irkoutsk. Les militantes organisent des concerts de musique punk et enquêtent sur les cas de maltraitance dans les colonies pénitentiaires pour femmes. Elles collaborent également avec des organisations de défense des droits humains et des centres d'aide d'urgence. Elles participent à des initiatives menées par les mères de prisonniers, fournissent une assistance juridique, distribuent de l'aide humanitaire et mènent des activités antimilitaristes. Grâce à sa structure horizontale et à ses liens étroits avec d'autres organisations de gauche et de défense des droits humains, le groupe reste actif malgré une répression croissante.
Les militantes féministes de Tcheliabinsk organisent des cercles de discussion et des rencontres thématiques. Elles forment un réseau de connexions horizontales sous le nom collectif Jenschina Mojet ! (Une femme peut !). Ces groupes sont généralement informels et fonctionnent sur la base de relations personnelles, d'une coordination ponctuelle et d'une confiance mutuelle. Ils se concentrent sur le soutien mutuel, le traitement des expériences de violence et de traumatisme, l'organisation de discussions, de pique-niques féministes, de projections de films et d'actions de solidarité.
Le média féministe Ogon'(Feu) est actif à Krasnodar. Une petite équipe de militantes produit des arumentaires et organise des événements afin de contribuer à la création d'une communauté sûre et solidaire pour les femmes.
Ces groupes peuvent s'adapter à des conditions changeantes grâce à leur format décentralisé, leurs liens horizontaux et l'absence de structure formelle. Malgré des possibilités d'action publique limitées, elles poursuivent leur travail à travers des pratiques de soutien et de résistance significatives, bien que souvent invisibles, dans la vie quotidienne.
Il est important de noter que les initiatives féminines locales dans les républiques nationales russes opèrent dans des conditions difficiles. L'autoritarisme croissant est aggravé par la pression patriarcale traditionnelle. Parallèlement, la militarisation se conjugue à une vulnérabilité systémique et à un manque d'infrastructures de soutien. Malgré la répression, les militantes poursuivent leurs efforts, travaillant souvent dans l'ombre, sans statut officiel ni déclaration publique. Elles s'attachent à aider les femmes, à défendre leurs droits et à mener une réflexion critique sur leur place dans la société.
Des groupes féministes tels queBashFem et FemKyzlar sont actifs dans les républiques du Bachkortostan et du Tatarstan. Elles organisent des réunions, des tables rondes et des groupes de soutien afin d'explorer les intersections entre le féminisme et l'islam. Elles génèrent des connaissances locales malgré la censure et la stigmatisation.
L'initiative Ya–SVOBODA (I–Liberté) en République de Bouriatie poursuit son travail, né dans un contexte de défense des droits humains. Le groupe a lancé une campagne contre le harcèlement de rue en 2022 et se concentre actuellement sur la création d'un refuge pour femmes dans la ville d'Oulan-Oude. Le projet aide les femmes et d'autres groupes alliés à faire face aux conséquences de la violence. Il fournit des conseils juridiques, explique comment obtenir de l'aide et offre des ressources pour le rétablissement psychologique. Il sensibilise également de manière constante à des questions négligées, allant de la violence domestique aux lacunes de la législation. Dans une région où l'État néglige ses responsabilités sociales, de telles actions deviennent une forme de résistance politique.
L'activisme féministe est rarement présent dans la sphère publique dans le Caucase du Nord, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que les risques sont exceptionnellement élevés. Bien que cela ne soit pas impossible, ces efforts sont extrêmement dangereux en raison de la pression exercée par l'État et les milieux traditionalistes. Dans ce contexte, la confiance, la flexibilité et les réseaux horizontaux sont essentiels pour mener des actions efficaces et ciblées.
Parallèlement à des efforts anonymes et clandestins, certaines initiatives plus structurées existent. Le groupe de défense des droits humainsMarem soutient les femmes victimes de violences domestiques dans les républiques nationales de Tchétchénie, du Daghestan, d'Ingouchie et d'Ossétie. Le groupe fournit des conseils juridiques et psychologiques et, si nécessaire, aide à évacuer les femmes vers des lieux sûrs.
Selon les coutumes locales, les enfants de la région sont considérés comme faisant partie de la lignée paternelle. En cas de séparation familiale, cela conduit souvent les mères non seulement à perdre la garde de leurs enfants, mais aussi à se voir refuser tout contact avec eux. Le projet de recherche et d'éducation Kavkaz bez Materi (Caucase sans mères) s'efforce de remédier à cette situation.
Malgré de nombreux obstacles, le groupe de crise SK SOS poursuit son travail considérable pour défendre les droits des personnes LGBT+ dans le Caucase du Nord. Des défenseur·es des droits humains et des militant.es ont fondé ce projet en 2017, lorsque des informations ont fait état de persécutions et de meurtres massifs de personnes LGBT+ en Tchétchénie. Le programme SK SOS aide les personnes LGBT+ à fuir les régions où elles sont victimes de discrimination, de violences et en proie à des dangers mortels.
Dans les républiques nationales russes, l'agenda féministe est étroitement lié à la pensée décoloniale. Les militantes rejettent les rôles qui leur sont imposés, remettent en question les normes culturelles et développent un langage de résistance fondé sur leur expérience personnelle et sur le contexte local. Cela a donné naissance à une forme unique de mouvement féministe : intersectionnel, résilient et profondément ancré dans les communautés qu'il sert.
Résistances
Depuis 2022, la pression sur les droits reproductifs s'est intensifiée en Russie. Parmi les changements significatifs, on peut citer les tentatives de restriction de l'accès à l'avortement, l'introductiond'amendements sur la « protection de la vie avant la naissance » à la Douma d'État, l'adoption d'une loi contrela « propagande pour le non-bébé » etl'implication accrue de l'Église orthodoxe russe dans les questions de santé. La propagande d'État ne considère plus les femmes comme des individues mais comme des instruments de la politique démographique. Dans un contexte de militarisation et de patriarcat, les initiatives numériques féminines à la base sont devenues l'une des rares formes de résistance : horizontales, réparties localement, souvent invisibles mais très efficaces.
En réponse à la montée de la violence et à l'atteinte à leur autonomie corporelle, les femmes ont commencé à créer des systèmes de soutien en dehors des canaux officiels. C'est ainsi qu'est né le Fonds de stockage de contraception d'urgence. Sa fondatrice a déjà été interviewée par Posle. Le projet rassemble plus de 220 femmes bénévoles de 80 villes à travers la Russie, qui opèrent via un « bot » Telegram. Grâce à ce système, des dizaines de femmes et de filles, y compris des survivantes de violences sexuelles , ont pu accéder gratuitement, anonymement et rapidement à la contraception d'urgence. Il s'agit là d'une forme de résistance à l'état pur qui s'exerce au niveau de l'autonomie corporelle dans une situation d'isolement juridique et social.
Une autre forme de soutien essentielle a été mise en place par les militantes à l'origine de l'initiative Poputchitsa (Compagne de voyage). Ce qui a commencé comme de petits groupes Telegram s'est transformé en un réseau de solidarité complet, permettant aux femmes de tout le pays de s'entraider pour rentrer chez elles en toute sécurité. Elles trouvent des compagnes de voyage, accompagnent des inconnues, partagent leurs itinéraires et offrent leur soutien via un « bot » et des « chats » locaux. Cette initiative aborde les questions de sécurité physique et du droit des femmes à se déplacer librement dans la ville. Elle permet aux femmes de choisir leurs itinéraires et leurs horaires sans crainte, de gérer leur temps et de vivre sans se limiter en raison de la menace croissante de violences exacerbées par la guerre.
L'Alliance des initiatives féminines opère à la croisée du politique et du social. C'est l'une des rares structures publiques à avoir lancé une campagne en faveur des droits reproductifs. Les militantes ont lançé une pétition demandant des réformes du système de soins maternels, notamment l'augmentation des allocations de maternité, la suppression de toutes les restrictions à l'avortement dans les cliniques privées, l'interdiction à l'Église orthodoxe russe d'interférer dans la médecine et la résolution des pénuries d'anesthésiques et de vaccins dans les maternités. Parallèlement, les membres de l'Alliance ont lancé une campagne d'envoi de lettres massives à la Douma d'État et aux dirigeant·es des partis politiques. Ces lettres demandaient aux dirigeant·es de rejeter un projet d'amendement à la loi « sur les principes fondamentaux de la protection de la santé publique », qui proclame la nécessité de « protéger la vie avant la naissance ». En substance, cette formulation ouvre la voie à une interdiction totale de l'avortement et met en danger l'accès des femmes enceintes aux soins médicaux. Leurs actions montrent que la résistance politique fondée sur l'expérience et la réalité quotidienne des femmes est possible, même sous une censure sévère.
Le projet « Droit à l'avortement » a vu le jour dans le contexte de l'offensive politique contre les droits reproductifs en Russie. L'initiative apporte un soutien juridique et informatif aux femmes qui rencontrent des obstacles dans leurs démarches pour obtenir une interruption médicale de grossesse. Les militantes ont rassemblé des informations actualisées sur la manière de procéder à un avortement légal et ont lancé un « bot » Telegram grâce auquel les utilisatrices peuvent bénéficier de consultations juridiques personnalisées. Cette initiative est une réponse directe à la pression croissante exercée par l'État, l'Église et certaines institutions médicales. Elle a un objectif à la fois pratique et politique : défendre les droits fondamentaux des femmes sur leur corps et leurs droits juridiques.
Enfin,Gribni:tsa est un projet féministe libertaire qui opère à la croisée des domaines des soins, de l'entraide et de l'action politique. Il réunit des militantes de différentes régions au sein d'un réseau qui assure un soutien et une coordination. Les participantes échangent leurs expériences, partagent leurs ressources et organisent des manifestations collectives. Les militantes de Gribni:tsa mettent fortement l'accent sur la mise en œuvre des principes d'interaction horizontale et de prise de décision par consensus afin de nourrir la dynamique interne d'initiatives durables. L'un des outils pratiques du projet est un manuel sur l'organisation d'événements militants en Russie. Ces événements vont des soirées de rédaction de lettres pour les prisonnier·es politiques à des actions de nettoyage local en passant par des discussions sur des films et des livres. Gribni:tsa démontre que même dans des conditions d'isolement et de pression, des formes résilientes d'action collective peuvent être créées sans structures formelles ni visibilité publique.
Une autre campagne majeure exigeant l'adoption d'une loi tant attendue pour lutter contre la violence domestique est actuellement en cours dans toute la Russie. Une pétition a été lancéesur le portail Russian Public Initiative pour exhorter les autorités fédérales à reprendre les discussions sur cette loi, qui a été reportée et rejetée à plusieurs reprises au fil des ans. La pétition a rapidement recueilli plus de 100 000 signatures vérifiées, ce qui signifie que la commission fédérale compétente doit désormais examiner cette initiative.
Pour attirer l'attention sur cette campagne, les pages publiques de groupes féministes à travers le pays ont partagé des photos de femmes brandissant des pancartes faites à la main avec des messages tels que « Nous avons besoin de cette loi », « C'est de la violence, pas de la famille » et « Je refuse de me taire ». Ces images proviennent aussi bien de grandes villes que de petites localités. Les visages de nombreuses participantes sont masqués, non pas pour créer un effet dramatique, mais pour des raisons de sécurité. Face à la répression croissante en Russie, même un geste symbolique est devenu risqué.
Une telle loi est particulièrement urgente compte tenu du retour massif des soldats du front. Des milliers de femmes sont confrontées à une violence accrue tout en perdant les moyens de protection les plus élémentaires. Dans un contexte de militarisation et d'effondrement des institutions sociales, une loi comme celle-ci pourrait constituer une barrière essentielle, même imparfaite, entre les femmes et de nouvelles violences. Il ne s'agit plus seulement d'une initiative législative, mais d'une question de survie. Des initiatives citoyennes comme celles-ci ont constitué le fondement de la résistance des femmes au cours des trois dernières années. Elles n'ont ni hiérarchie, ni statut juridique, ni possibilité d'être interdites, mais elles fonctionnent parce qu'elles reposent sur la confiance, la solidarité et l'expérience vécue.
La résilience des personnes vulnérables
Les initiatives féminines locales survivent non pas malgré leur vulnérabilité, mais grâce à elle. L'absence de hiérarchie, d'enregistrement officiel, de figures publiques et d'adhésion fixe les rend moins vulnérables à la violence étatique. Alors que les institutions traditionnelles qui renforcent la résilience « selon les règles » s'effondrent, les réseaux de solidarité perdurent. Ces réseaux reposent sur des liens horizontaux, une coordination ponctuelle et la confiance personnelle.
Il ne s'agit pas d'un choix stratégique, mais plutôt d'un mécanisme de survie adaptatif. Les initiatives émergent, disparaissent, changent de format, se dissolvent, se regroupent et forment de nouvelles configurations. Elles ne construisent pas de structures verticales, elles s'enracinent dans la réalité. La flexibilité, l'invisibilité et la petite échelle ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des sources de résilience.
Cependant, ces structures ont leurs inconvénients à longs termes. Moins une initiative est visible, plus il est difficile de la faire entendre. Si l'anonymat offre une protection contre la répression, il conduit également à l'isolement et à l'absence de soutien. L'épuisement émotionnel, la peur et l'incapacité à planifier plus de trois mois à l'avance font partie intégrante de ce travail. Bien que la décentralisation n'élimine pas la pression, elle contribue à empêcher la disparition totale. Ces initiatives ne se développent pas selon la logique du marché ou de la bureaucratie. Elles se propagent comme un mycélium [champignon – NdT : de manière invisible, en réseau et de façon non linéaire. C'est ce qui les rend résilientes dans des conditions où la simple survie est une forme de résistance.
Alternatives féministes
Les initiatives féminines locales en Russie répondent aux conséquences de la guerre, telles que l'augmentation de la violence, la pression sur la société civile et la perte de la sécurité fondamentale. Mais elles créent également des espaces dans lesquels différentes règles d'interaction peuvent être établies. Leur travail est basé sur la bienveillance, les relations horizontales et un soutien mutuel quotidien et constant, plutôt que sur la coercition et la subordination.
Dans ce cadre, les femmes ne sont pas des objets de politique étrangère ou de statistiques démographiques. Elles sont plutôt des figures autonomes qui prennent des décisions, organisent l'aide, établissent des liens et créent des modes de vie durables.
Ces initiatives s'inscrivent dans une perspective féministe qui s'exprime à travers des actions concrètes et non par de simples déclarations idéologiques. Il s'agit d'un travail quotidien qui consiste à faire face à la vulnérabilité, tant la sienne que celle des autres. Ce travail rejette la peur et l'utilisation de la violence comme arme. C'est un choix en faveur de la bienveillance et de l'entraide, et non une adhésion aux rôles de genre. Il s'agit plutôt d'une stratégie politique employée lorsque d'autres formes d'action sont bloquées ou criminalisées.
Lorsque l'État s'appuie sur la guerre, la soumission et le contrôle physique, les initiatives féminines locales offrent une base alternative, aussi fragile soit-elle. Grâce à la bienveillance, à l'entraide et aux liens horizontaux, elles trouvent un moyen non seulement de survivre, mais aussi de préserver un espace dans lequel elles peuvent rester humaines.
Il ne s'agit pas d'un geste désespéré ou d'un idéal abstrait. Vivre autrement est un choix réel et reproductible. Il ne s'agit pas de se soumettre, mais de se soutenir. Il ne s'agit pas de peur, mais de travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre moyen d'assurer l'avenir.
Liliya Vezhevatova
Publié dans Posle,
https://www.posle.media/article/fabric-of-resistance-womens-activism-in-times-of-war
Traduction Deepl revue ML, corrigée pour le blog
https://www.reseau-bastille.org/2025/07/03/federation-de-russie-le-militantisme-feministe-en-temps-de-guerre/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] « organisations indésirables »

Ukraine : entretien avec les féministes de Bilkis

Manifestation de juillet, droit à l'avortement, Espaces des choses et luttes féministes, activités internationales... entretien avec Yana du groupe féministe ukrainien Billais.
Parlons d'abord des manifestations de juillet qui s'opposaient aux menaces du gouvernement contre l'indépendance des agences anti-corruption, NABU et SAP. Vous y avez participé activement. Pourquoi ? et comment avez-vous vécu ces manifestations ? Il semble qu'il y avait beaucoup de jeunes présents et de femmes.
Bilkis est une communauté de personnes conscientes qui se soucient de l'avenir de notre société. C'est pourquoi nous avons rejoint les manifestations, car nous ne pouvions pas rester à l'écart. La corruption est l'un des principaux obstacles à la démocratie, à l'égalité, à la justice et, en fin de compte, à la sécurité. Même si nous ne sommes pas des militantes qui travaillent quotidiennement sur les questions de lutte contre la corruption, il s'agit clairement d'une de nos valeurs, et nous estimons qu'il est de notre responsabilité d'intervenir chaque fois qu'il y a un risque de recul.
Oui, la plupart des manifestants étaient des jeunes, et beaucoup d'entre eux étaient des femmes. C'est compréhensible : un grand nombre d'hommes servent actuellement dans l'armée et défendent notre pays (les femmes sont également présentes dans l'armée, mais les hommes sont encore nettement plus nombreux). Les femmes constituent aujourd'hui un élément essentiel du front intérieur, qui est absolument indispensable à l'armée qui se bat littéralement pour notre droit d'exister. Il existe actuellement un dicton populaire en Ukraine : « Vous êtes soit dans l'armée, soit pour l'armée. » Je l'étendrai ainsi : « Vous êtes soit dans l'armée, soit pour l'armée, soit pour la construction d'un État social-démocratique fort en Ukraine. » Cependant, il y avait également des hommes aux rassemblements, principalement des étudiants, mais aussi quelques soldats.
À ma connaissance, les manifestations ont commencé à Kyiv et à Lviv, et le lendemain, elles se sont étendues à de nombreuses autres villes, environ 15 à 20 à travers le pays. Il s'agissait de rassemblements pacifiques, au cours desquels les participant·es brandissaient des affiches et des banderoles et prononçaient des discours en faveur du NABU et du SAP (remarque : NABU — Bureau national anticorruption d'Ukraine, un organisme indépendant chargé de lutter contre la corruption à haut niveau ; SAP : le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, qui supervise les enquêtes du NABU et le représente devant les tribunaux). Le Parlement ukrainien avait décidé de leur retirer leur indépendance, et le président avait initialement soutenu cette décision. La principale revendication des manifestants était donc très claire : rétablir l'indépendance de ces institutions de lutte contre la corruption.
Sur les photos on voit que les gens semblaient heureux de manifester malgré les risques en raison de bombardements ?
Malheureusement, les Ukrainiens sont habitués au bruit des explosions, qui font désormais partie de leur quotidien, mais cela ne les a pas empêchés de descendre dans la rue. Heureusement, personne n'a été blessé par les attaques de missiles ou de drones russes pendant ces manifestations. La joie que l'on peut observer sur les visages des personnes sur les photos, malgré les risques, provient de deux éléments : premièrement, le sentiment de force que procure le nombre, le fait de réaliser combien d'autres personnes partagent vos valeurs, et deuxièmement, l'expérience stimulante de l'action directe. Vous ressentez que c'est votre pays, votre foyer, et que vous pouvez vous exprimer, manifester votre désaccord, et que cela a vraiment de l'importance.
Le gouvernement Zelensky a reculé. Pensez-vous que cette victoire soit définitive ?
Quant à savoir s'il s'agit d'une victoire définitive, il est difficile de se prononcer. Pour l'instant, il semble que oui, le gouvernement de Zelensky ait reculé. Cependant, nous continuons bien sûr à suivre la situation de près et n'excluons pas la possibilité que les autorités tentent à nouveau de limiter l'indépendance des organismes de lutte contre la corruption.
Le 7 juin dernier, le conseil municipal d'Ivano-Frankivsk a lancé un appel la Verkhovna Rada visant à interdire l'avortement. Il y a eu une pétition dans cette ville contre cet appel et la Marche des femmes veut poursuivre en justice le conseil municipal. Pouvez-vous parler du droit à l'avortement en Ukraine et des menaces qui pèsent contre lui ?
En Ukraine, comme dans de nombreux autres pays, l'avortement est soumis à certaines restrictions, mais dans l'ensemble, notre législation est assez libérale. Jusqu'à 12 semaines de grossesse, l'avortement est accessible sur demande, sans qu'il soit nécessaire d'en expliquer les raisons. Entre 12 et 22 semaines, il n'est autorisé que dans des circonstances spécifiques définies par la loi et avec l'accord d'une commission médicale spéciale. Plusieurs tentatives ont été faites au Parlement pour introduire des projets de loi visant à restreindre les droits des femmes en interdisant l'avortement, mais aucun d'entre eux n'a dépassé le stade de la première lecture. De temps à autre, des voix conservatrices, qu'il s'agisse de députés, de prêtres ou de personnalités publiques, se font entendre pour réclamer de telles interdictions, mais elles ne bénéficient pas d'un soutien significatif de la part de la population. À notre avis, il n'y a actuellement aucune menace directe pour le droit à l'avortement en Ukraine. On a presque l'impression que ce droit fait désormais naturellement partie de l'État, car lorsque l'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991, elle a conservé la loi de la période soviétique — et en Ukraine soviétique, l'avortement était légal depuis 1920 (à l'exception de l'interdiction stalinienne de 1936 à 1955). Cela dit, la situation est loin d'être idéale. Bien que l'avortement soit protégé par la loi, la stigmatisation qui l'entoure reste très forte en Ukraine. Ce n'est toujours pas un sujet dont on parle ouvertement, et les femmes sont souvent jugées pour cela, en particulier dans les petites villes et les villages. Les Églises jouent également un rôle important dans la diffusion de discours anti-avortement et stigmatisant.
Une des activités les plus réussies de Bilkis est l'Espace des choses qui fonctionne à Lviv depuis août 2022. Plus de trois d'années d'activités ! Pouvez-vous nous dire où vous en êtes avec la gestion de cet espace ?
Nous vous remercions pour cette question. En effet, l'Espace des choses existe depuis trois ans maintenant, et il semble qu'il soit sur le point de subir une transformation. Jusqu'à présent, le projet a été financé par des subventions qui couvraient le loyer, les charges, le mobilier et les salaires. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne disposons de financements que jusqu'à la fin de l'année 2025, et nous devons réfléchir à l'avenir au-delà de cette date. Nous avons recherché de nouvelles opportunités, telles que des subventions écologiques ou sociales, mais nous n'avons malheureusement rien trouvé de convenable jusqu'à présent. C'est pourquoi nous envisageons de devenir financièrement indépendants et de modifier légèrement le format. Pour nous, le principe d'altruisme a toujours été très important. Les gens nous apportent des objets gratuitement, et nous les distribuons gratuitement. Cependant, il est malheureusement nécessaire de disposer de fonds pour louer un espace pour ce projet. Nous envisageons donc d'adopter un modèle d'entrepreneuriat social.
Qu'est-ce que cela signifierait concrètement ?
Une partie des articles donnés serait vendue, et les recettes serviraient directement à financer l'Espaces des choses. Parallèlement, nous continuerions à gérer le projet comme nous l'avons toujours fait, avec un espace où les gens peuvent venir prendre gratuitement ce dont ils ont besoin. L'accès gratuit aux articles restera donc possible, mais certains articles seront également vendus afin de soutenir la pérennité du projet.
Vous êtes très actives sur différents sujets. De plus vous avez réussi à organiser un rassemblement le 8 mars 2025 à Lviv avec Feminist workshop. Une première dans cette ville. Par exemple récemment vous vous êtes intéressées aux questions du logement mais aussi par exemple à la question décoloniale. Pouvez-vous nous dire quelques mots de toutes vos activités si diverses ?
Oui, et en juin, nous avons également organisé, en collaboration avec Feminist Workshop, une action dans le cadre du Mois des fiertés à Lviv — le premier événement de ce type dans la ville. Lorsque Bilkis a vu le jour, nous avions trois valeurs fondamentales : le féminisme, la justice économique et l'horizontalité. Aujourd'hui, ces valeurs sont passées à cinq (qui en englobent en réalité davantage) : le féminisme queer, l'intersectionnalité, l'horizontalité, l'égalité socio-économique et la décolonialité. Nous réfléchissons également beaucoup à l'écologie et à l'impact du patriarcat et du capitalisme sur notre planète. Notre mission est de sensibiliser le public au féminisme et aux questions LBTQI+, d'impliquer les jeunes femmes et les personnes queer dans l'activisme et de lutter contre les discours patriarcaux, homophobes et transphobes dans la société ukrainienne. Notre activité principale est le travail médiatique, à travers lequel nous menons à bien cette mission. Nous créons du contenu vidéo, des textes analytiques et divertissants, que nous publions principalement sur Instagram. En outre, nous organisons occasionnellement des événements éducatifs tels que des conférences, des ateliers et des projections de films, ainsi que des actions de rue. Et bien sûr, nous gérons notre projet social et écologique l'Espaces des choses, où les gens peuvent donner des objets dont ils n'ont plus besoin et prendre gratuitement ceux qui leur sont utiles.
Vous avez également une intense activité internationale. Les membres de Bilkis défendent la cause de femmes ukrainiennes à Bruxelles, New York, Stockholm, Strasbourg... Quel bilan faites-vous de ces déplacements à l'étranger, comment avez-vous été accueillies ?
Nous venons tout juste de commencer notre travail de sensibilisation à l'échelle internationale. Nous souhaitons à la fois en apprendre davantage sur le contexte mondial des luttes pour les droits des femmes, y compris les conflits dans d'autres pays et divers discours (anti)coloniaux, et partager l'expérience de l'Ukraine : notre combat pour les droits des femmes et notre résistance à l'impérialisme russe. Jusqu'à présent, nous pouvons affirmer que ces voyages ont été très inspirants. À chaque fois, nous revenons avec un sentiment renouvelé de l'importance de la solidarité internationale et de la nécessité de prêter attention à d'autres contextes, dans la mesure du possible. Les gens remarquent souvent notre logo (ce qui est compréhensible) et le complimentent fréquemment, ce qui est toujours agréable.
3 septembre 2025
Entretien réalisé par Patrick Le Tréhondat

Malgré les interdits talibans, l’inextinguible désir d’école des filles afghanes

Quatre ans après le retour des talibans au pouvoir, les habitants du pays sont quasiment unanimes. De Kaboul à Hérat, en passant par les vallées reculées du Badakhchan, tous réclament, à contre-courant des pouvoirs publics, le retour de la scolarisation des filles.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Alors que, partout dans le monde, la plupart des filles en âge d'être scolarisées s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, en Afghanistan, c'est une tout autre date qui marque leur calendrier : quatre ans d'interdiction d'enseignement secondaire par les talibans.
Mais selon une enquête nationale publiée vendredi par ONU Femmes, 92% des Afghans jugent « important » que les adolescentes poursuivent leur scolarité secondaire – un soutien massif qui transcende les clivages géographiques, de genre et d'origine sociale.
Dans les campagnes, l'agence onusienne militant pour l'égalité des sexes révèle que 87% des hommes et 95% des femmes défendent ce droit. En ville, la proportion atteint 95% pour les deux sexes. Un plébiscite silencieux, qui contraste avec l'interdiction toujours imposée par les autorités de facto aux filles en âge de se rendre au collège et au lycée de poursuivre leur éducation.
Selon les données récentes del'UNESCO, l'agence onusienne chargée de la défense de l'éducation, elles sont aujourd'hui près de 2,2 millions à être privées d'enseignement secondaire et supérieur, en raison de plus de 70 décrets talibans bafouant leur droit à l'éducation.
« C'est presque toujours la première chose que nous disent les filles : elles brûlent d'apprendre et réclament simplement une chance d'aller à l'école », confie Susan Ferguson, représentante spéciale d'ONU Femmes en Afghanistan. « Les familles expriment aussi le souhait que leurs filles puissent réaliser ce rêve. Elles savent que l'alphabétisation et l'éducation peuvent transformer le destin d'une enfant, dans un pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté ».
Un quotidien de plus en plus contraint
L'enquête nationale menée par ONU Femmes, auprès de plus de 2 000 Afghans met aussi en lumière l'effet corrosif des restrictions accumulées. Dans les régions où l'interdiction pour les femmes de travailler pour des ONG est appliquée, 97% d'entre elles disent en subir directement les conséquences dans leur vie quotidienne. Plus de la moitié des organisations humanitaires affirment ne plus pouvoir atteindre les bénéficiaires féminines avec des services pourtant vitaux.
Mené en coopération avec la mission politique de l'ONU en Afghanistan (MANUA) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'enquête d'ONU Femmes dessine un paysage d'isolement et d'effacement. Trois quarts des Afghanes déclarent n'avoir aucune influence sur les décisions de leur communauté et la moitié n'en ont pas davantage au sein de leur famille élargie. Seules 41% sortent de chez elles chaque jour, contre 88% des hommes.
Entre désespoir et persistance
La charge mentale est écrasante : près des trois quarts des femmes, toutes régions confondues, décrivent leur santé psychologique comme « mauvaise » ou « très mauvaise ». Et pourtant, malgré la fermeture de l ;espace public, 40% continuent de croire qu'un avenir plus égalitaire reste envisageable.
Cette obstination, conjuguée au soutien quasi unanime de la population pour l'éducation des filles, révèle un fossé grandissant entre la société afghane et ses dirigeants. Tandis que le régime verrouille l'espace des femmes, les familles persistent à rêver d'un tableau noir, d'un cahier ouvert, d'une vie différente pour leurs filles.
https://news.un.org/fr/story/2025/08/1157375
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afghanistan : le combat de l’ombre des femmes sous le joug taliban

Elles ont été effacées des écoles, des parcs, des tribunaux, des bureaux, des écrans. Mais elles n'ont pas disparu. Depuis que les talibans ont repris les rênes du pouvoir en août 2021, les femmes afghanes luttent pour exister dans un pays qui orchestre savamment leur disparition de l'espace public.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/15/afghanistan-le-combat-de-lombre-des-femmes-sous-le-joug-taliban/?jetpack_skip_subscription_popup
En peu de temps, ce qui avait mis deux décennies à se construire a été démantelé : le droit à l'éducation, à l'emploi, à la liberté de mouvement. Pourtant, dans les interstices du régime taliban qui les bâillonne, certaines Afghanes résistent encore. C'est le cas d'Athar, Mehrgan ou encore Lina, qui luttent pour créer leur entreprise, gérer une association ou travailler comme journaliste.
À l'occasion du quinzième anniversaire d'ONU Femmes, l'agence, basée à New York, est allée à la rencontre de celles qui, contre toute logique, refusent de renoncer à leur avenir en Afghanistan.
« Parfois, je me demande comment garder espoir dans ces ténèbres », murmure Fariba, qui venait tout juste de commencer ses études lorsque les femmes ont été interdites de se rendre à l'université. Tout comme les autres Afghanes interrogées dans cet article, son nom a été modifié par souci de sécurité. « Mais je reste optimiste », confie-t-elle. « L'obscurité finira par se dissiper ».
Une terre de non-droit
Selon l'indice de genre pour l'Afghanistan 2024, le pays accuse un retard qualifié de « catastrophique » en matière d'égalité. Près de 80% des jeunes femmes sont sans emploi, sans formation, sans école. Aucune ne siège au gouvernement ni dans les instances locales.
Depuis 2021, plus de 80 décrets, édits et interdictions ont méthodiquement démantelé ce qu'il restait des droits féminins : fin de l'enseignement secondaire, des carrières professionnelles, de l'accès aux parcs, aux salles de sport, aux lieux de loisirs. Une vie faite de murs et de silence.
Pourtant, dans cette longue nuit, des voix s'élèvent encore. Celle d'Athar, par exemple, qui rêvait de devenir ingénieure et qui est parvenue à monter une boutique en ligne. « Il y a toujours une issue aux difficultés », affirme-t-elle.
Une solidarité persistante
Depuis quinze ans, ONU Femmes accompagne les Afghanes sans relâche. Présente sur le terrain, l'agence reste aujourd'hui l'un des rares piliers internationaux encore debout à leurs côtés.
« Il ne s'agit pas seulement des droits – et de l'avenir – des femmes et des filles afghanes », déclare Susan Ferguson, une employée d'ONU Femmes. « C'est une question de principes universels. Si nous laissons les femmes d'Afghanistan réduites au silence, nous envoyons le message que les droits des femmes dans le monde entier peuvent être sacrifiés ».
Cet engagement ne faiblit pas. En 2024, plus de 200 organisations dirigées par des femmes ont été soutenues par l'agence. Le programme Reconstruire le mouvement des femmes, financé par plusieurs gouvernements européens, agit dans les 34 provinces afghanes. Il a permis à 140 structures locales de survivre, de rouvrir leurs portes, d'accueillir, de former, de créer des espaces sûrs et solidaires. Plus de 16 000 femmes en ont déjà bénéficié.
À Kunduz, Mehrgan dirige l'une de ces organisations. Faute de moyens, elle avait dû suspendre ses activités. Grâce à ONU Femmes, elle a relancé son action, aidant désormais d'autres collectifs à faire de même. « Je continuerai à être solide, en tant que femme, pour en soutenir d'autres », affirme-t-elle. « J'écoute leurs histoires. Cela leur donne de l'espoir. Et moi aussi, cela me renforce ».
À la frontière, une écoute féminine
Depuis septembre 2023, plus d'un million d'Afghans sont rentrés chez eux, après avoir trouvé refuge au Pakistan. Parmi eux, de nombreuses femmes et filles, épuisées, inquiètes, souvent seules.
À leur arrivée, parler de leurs besoins devient un défi, surtout face à des hommes. Pour y répondre, ONU Femmes a mis en place des guichets réservés aux femmes, tenus par des travailleuses humanitaires et des ONG locales. Ces espaces de parole sécurisés leur offrent réconfort, informations et orientation vers les services de base.
« Beaucoup racontent les circonstances bouleversantes de leur expulsion », confie l'une de ces travailleuses. « Nous les rassurons… Nous sommes comme vous. Voici les aides auxquelles vous pouvez accéder ».
Redonner une voix au silence
Depuis 2022, ONU Femmes organise, chaque trimestre, des consultations dans les 34 provinces. Dans un pays où les femmes sont exclues de la vie publique, ces réunions sont essentielles. Des milliers d'entre elles, même dans les régions les plus isolées, ont ainsi pu faire entendre leur voix. Leurs témoignages orientent les actions de terrain et alimentent les débats au Conseil de sécurité de l'ONU et dans la presse internationale.
Une lumière ténue, mais vivace
Chaque formation, chaque emploi, chaque service soutenu est une flamme qui tient dans la tempête. Le retour des femmes sur la scène publique n'est pas une hypothèse lointaine : c'est une promesse qu'elles s'échinent à préserver.
« Les couleurs de l'arc-en-ciel se sont éteintes dans ma vie », souffle Anita. « Mais à mes sœurs, je dis : n'abandonnez jamais… Les obstacles ne doivent pas nous arrêter ».
Et Lina, ancienne journaliste, de conclure : « Les femmes veulent avoir le droit de décider, pas seulement chez elles, mais aussi au gouvernement et ailleurs. Elles veulent une éducation. Elles veulent leurs droits ».
Elles n'ont pas disparu. Elles attendent. Elles s'organisent. Et, un jour, elles reprendront leur place au cœur de l'histoire afghane.
https://news.un.org/fr/story/2025/07/1156956
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mères colombiennes : un courage indomptable contre le recrutement forcé de jeunes mineur.es à la guerre !

Dans le sud-ouest de la Colombie, où la jungle dissimule des noms et la guerre déchire des enfances, un groupe de personnes courageuses, principalement des femmes, refuse de baisser les bras pour contrer le recrutement forcé de jeunes mineur.es pour la guerre.
Tiré de l'infolettre du Journal des Alternatives
Par Isabel Cortés -26 juillet 2025
Solanyi Guejia, autochtone Nasa, et Emilse Jiménez de la communauté afrodescendante, dirigent la Garde interculturelle humanitaire et le Mouvement national des mères et femmes pour la paix, qui ont sauvé depuis janvier neuf jeunes mineur.es des griffes de groupes armés dans le Cauca, épicentre actuel de cette tragédie. Elles ont obtenu quatre mesures de protection de la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH) pour protéger les filles et garçons victimes de recrutement forcé.
Ce mouvement reflète la douleur et la détermination de directions autochtones, afrodescendantes et paysannes qui recherchent leurs proches avec un courage défiant menaces et violence. Cet article veut rendre hommage à leur résistance et dénoncer un crime qui continue de déchirer la Colombie.
La Garde interculturelle : une résistance diverse et unie
La Garde interculturelle humanitaire, fondée en décembre 2024, est la première initiative en Colombie à réunir des communautés autochtones, afrodescendantes et paysannes pour combattre le recrutement forcé. Sous la direction de Solanyi Guejia, du resguardo Nasa de Yumbo, ce réseau opère sans siège fixe, se coordonnant virtuellement pour localiser des jeunes capté.es par des groupes tels que les dissidences des FARC et l'État-major central (EMC). En 2025, ils ont documenté plus de 200 cas dans le Cauca et réussi à libérer neuf personnes mineures, incluant une jeune fille de 14 ans, sur le point d'être transférée aux Llanos del Meta.
Guejia, qui porte l'écusson de la Garde sur son foulard, affirme : « Nous nous sommes unis parce que seulement en communauté pouvons-nous pénétrer dans des territoires interdits et retrouver nos enfants, filles et jeunes. » La Garde cartographie la présence de groupes armés, partage des informations entre les communautés et plaide pour la libération des mineurs.
Leur travail fait face à une tactique cruelle des groupes armés : ceux-ci font signer des « contrats » sous contrainte, présentés comme des accords volontaires pour contourner le Droit international humanitaire qui interdit la participation de personnes de moins de 18 ans dans les conflits armés.
La douleur des familles : des histoires de perte
Emilse Jiménez, responsable de la Garde Cimarrona de Buenos Aires, Cauca, porte le poids d'une tragédie personnelle. Son neveu, Derian David Carabalí, a été recruté à 17 ans par les dissidences en septembre 2022. « Il n'apparaît ni vivant ni mort, » partage Lucila Carabalí, mère de Derian. Ces histoires de perte reflètent la souffrance de nombreuses familles confrontées à l'incertitude et à la violence.
Un crime en augmentation : les chiffres de l'horreur
Le recrutement forcé en Colombie a pris des proportions alarmantes. Selon le Défenseur du peuple, 55 cas ont été enregistrés entre janvier et juin 2025, bien que des organisations comme Coalico rapportent 60 cas et la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), 140 entre janvier et avril. Les responsables communautaires, toutefois, documentent plus de 200 plaintes dans le Cauca, où le conflit armé et l'exclusion sociale transforment les jeunes en cibles faciles. Un rapport de l'ONU (2024) a vérifié 450 cas de recrutement à l'échelle nationale, une hausse de 60 % par rapport à 2023, les enfants autochtones et afrodescendants étant les principales victimes.
Les groupes armés, comme l'État-major central EMC, l'Armée de libération nationale (ELN) et le Clan du Golfe, emploient des tactiques de plus en plus sophistiquées, incluant des promesses d'argent, de biens ou une manipulation via les réseaux sociaux pour attirer des jeunes. Selon l'UNICEF, ces promesses sont des leurres qui emprisonnent enfants, filles et jeunes dans un cycle de violence, d'exploitation et de mort.
Les chiffres d'expansion, comme l'augmentation de 84 % de la présence du Clan du Golfe entre 2019 et 2024, témoignent d'un renforcement de ces groupes au milieu de la faiblesse étatique et de la fragmentation des processus de paix. La perception que ces groupes « tiennent la Colombie en échec » souligne l'urgence d'aborder leurs activités criminelles ainsi que les conditions sociales qui leur permettent de prospérer.
La crise de l'exploitation sexuelle des filles recrutées
Au cœur de ce problème réside une tragédie silencieuse. Le recrutement forcé des filles en Colombie ne se limite pas à leur dépossession de liberté, il les plonge dans un cycle de violence sexuelle laissant des cicatrices indélébiles.
Des filles, certaines de seulement 10 ou 11 ans, sont recrutées par des groupes armés et soumises à de l'exploitation sexuelle, selon un rapport dévastateur de la Coalition contre l'engagement d'enfants, de filles et de jeunes dans le conflit armé en Colombie (Coalico). Publié en juillet 2025, ce rapport expose comment elles affrontent non seulement la perte de leur enfance, mais aussi une manipulation émotionnelle et des violences sexuelles utilisées comme outils de contrôle.
Hilda Molano, membre de Coalico, met en garde que ces filles sont choisies selon la logique « plus elles sont jeunes, mieux c'est », les intégrant dans des stratégies de violence sexuelle qui perpétuent des cycles de traumatisme et de nouveaux recrutements. L'absence de présence étatique et la crainte de représailles aggravent le sous-enregistrement, réduisant au silence victimes et familles.
La Juridiction spéciale pour la paix (JEP), dans son dossier sur le recrutement et l'utilisation de jeunes mineur.es, a documenté que la violence sexuelle contre les filles n'est pas un fait isolé, mais une pratique systématique dans le conflit armé colombien. En 2025, la JEP poursuit la collecte de témoignages qui contredisent les affirmations d'anciens membres des FARC niant des schèmes de violence sexuelle, soulignant la nécessité de vérité et de justice pour les victimes.
La lutte pour l'espoir
Le Mouvement national des mères et femmes pour la paix, aux côtés de la Garde interculturelle, ne se contente pas de rechercher les jeunes, il défie l'indifférence institutionnelle. Sofía López, avocate de la Corporation Justice et Dignité, souligne que la rapidité des plaintes est cruciale pour les libérations. Lorsqu'une famille signale un cas, la Garde diffuse de l'information sur les réseaux sociaux et coordonne avec des leaders communautaires pour localiser les jeunes. « L'information partagée par la communauté est notre plus grande force », affirme Jiménez.
En février 2025, le Mouvement national des mères et femmes pour la paix, avec les Corporations Justice et Démocratie et Justice et Dignité, a porté son message en Europe. Depuis le Sud-ouest colombien, où enfants, filles et jeunes sont arrachés des écoles pour combattre, les responsables de ces organisations ont dénoncé le recrutement forcé qui fait disparaître des vies dans la jungle. Sans ressources, mais avec la force de la vérité, leur tournée à Genève, Barcelone et Madrid a mis en lumière une crise qui, en 2025, a généré plus de 200 plaintes rien que dans le Cauca, l'enfance autochtone étant la principale victime.
Toutefois, le mouvement dénonce la Procureure générale de la Nation qui ne répond pas avec l'urgence requise, priorisant des crimes comme le narcotrafic. Face à l'inaction institutionnelle, le Mouvement exige que la Procureure développe des protocoles spécialisés pour enquêter sur le recrutement forcé, particulièrement dans les communautés ethniques, où la moitié des jeunes mineur.es recruté.es sont autochtones. Les mesures de protection de la CIDH constituent un pas vers la sauvegarde, mais les dirigeantes insistent : sans enquêtes efficaces et confidentielles, le cycle de violence persistera. Leur appel résonne comme un cri mondial pour la défense des enfances volées par la guerre.
Sources :
Mouvement national des mères et femmes pour la paix — Colombie.
Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés, 2024.
Coalition contre l'engagement d'enfants, de filles et de jeunes dans le conflit armé (Coalico), 2025.
Défenseur du peuple, Rapport sur le recrutement forcé, juillet 2025.
Juridiction spéciale pour la paix, Rapport Macrodossier 07, 2025.
Entretiens avec Solanyi Guejia et Emilse Jiménez, juillet 2025.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Soudan du Sud, les filles et les femmes sont constamment menacées

Les enlèvements, les attaques contre les écoles et les viols devraient inciter le gouvernement à agir contre ces violences
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/10/au-soudan-du-sud-les-filles-et-les-femmes-sont-constamment-menacees/?jetpack_skip_subscription_popup
Les récentes attaques contre des filles et des jeunes femmes au Soudan du Sud illustrent les risques auxquels elles sont exposées et le manque de protections adéquates.
Le 25 juin, selon les médias, des hommes armés ont enlevé quatre lycéennes dans la commune Pochalla North (État de Jonglei), alors qu'elles se rendaient à leur école pour y passer des examens de fin d'année scolaire. Malgré les recherches menées par la communauté locale, les quatre lycéennes sont toujours portées disparues.
Le 19 juin, la police a annoncé l'arrestation de sept suspects dans l'affaire du viol collectifd'une adolescente de 16 ans à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Une vidéo présumée de l'attaque avait circulé en ligne et suscité l'indignation du public. Suite à cet incident, la ministre sud-soudanaise du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale a appelé à une enquête approfondie et à la reddition de comptes. Des activistes ont réclamé des réformes juridiqueset organisé des forums pour encourager les survivantes à s'exprimer. Mais même lorsque les affaires suscitent un tel intérêt public, les condamnations sont rares.
En mai, un groupe de jeunes hommes armés a encerclé un pensionnat pour filles à Marial Lou, dans l'État de Warrap, piégeant au moins 100 élèves à l'intérieur. Selon la mission de maintien de la paix des Nations Unies, les enseignants ont verrouillé les portes jusqu'à ce queles Casques bleus sécurisent l'école et négocient la fin du siège.
Ces incidents sont tristement courants au Soudan du Sud, où les filles subissent constamment des menaces, qu'il s'agisse de leur corps, de leur éducation ou de leur avenir. Des anciens conflits, l'accès généralisé aux armes et les coutumes patriarcales, menant parfois à des mariages forcés, ont depuis longtemps transformé les corps de filles et de femmes en champs de bataille, utilisés comme butin de guerre ou monnaie d'échange dans des conflits intercommunautaires.
La mobilisation de communautés pour protéger les filles permet d'espérer que ces comportements et pratiques peuvent changer, mais une protection efficace dépend avant tout du respect par l'État de ses obligations légales.
Le Soudan du Sud est un État partie à laConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (acronyme anglais CEDAW). Ce pays a également ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, s'engageant ainsi à protéger les élèves et étudiantes contre des attaques. Le ministère du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale, ainsi que le ministère de la Justice, ont promu un projet de loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre et visant une meilleure protection de l'enfance. Ce projet de loi renforcerait les protections juridiques, criminaliserait les mariages forcés et les mariages d'enfants, et garantirait aux survivantes un soutien médical et psychosocial gratuit. Le Parlement devrait donner la priorité à l'adoption de ce projet de loi.
Le gouvernement devrait également renforcer les institutions sud-soudanaises chargées de faire respecter l'état de droit, et garantir la reddition de comptes pour les abus. Il est essentiel de protéger les écoles contre les attaques, notamment en renforçant la présence des forces de sécurité, en organisant des dialogues avec les jeunes personnes et en mettant en œuvre des processus de désarmement respectueux des droits.
Au Soudan du Sud, les filles devraient pouvoir se rendre à l'école à pied et poursuivre leur éducation sans crainte ; et les autorités devraient agir pour garantir ces droits fondamentaux.
Nyagoah Tut Pur
Chercheuse, division Afrique
https://www.hrw.org/fr/news/2025/07/02/au-soudan-du-sud-les-filles-et-les-femmes-sont-constamment-menacees
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Égypte tente de jouer le médiateur à Gaza

Depuis plusieurs années, l'Égypte – qui a récemment annoncé que le Hamas avait accepté une proposition de cessez-le-feu négociée au Caire – joue un rôle d'intermédiaire dans le conflit à Gaza, explique un excellent article du site « The Conversation » qui nous autorise à reprendre leur texte.
Tiré de MondAfrique.
Seul pays arabe partageant une frontière avec l'enclave palestinienne, l'Égypte poursuit des objectifs stratégiques combinant enjeux sécuritaires et contraintes domestiques – des objectifs mis sous tension par la politique expansionniste d'Israël. Faute de solution diplomatique, la situation à Gaza pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour le régime d'Abdel Fattah Al-Sissi, dont les options, face à son opinion publique, restent limitées pour éviter l'accusation d'indifférence et masquer son impuissance face à Tel-Aviv.
Le 18 août dernier, l'annonce d'un cessez-le-feu accepté par le Hamas, négocié au Caire sur les bases d'un plan des États-Unis, a mis en lumière le rôle de médiateur tenu par les autorités égyptiennes dans la guerre menée par Israël à Gaza.
Ce rôle demeure essentiel, même si l'action du Qatar a souvent été plus médiatisée, du fait de la proximité de l'émirat avec le Hamas.
Un rôle clé et historique de médiateur
Sans remonter à la création de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) ni aux accords de paix égypto-israéliens de 1979, Le Caire est de longue date un acteur incontournable du conflit israélo-palestinien grâce à sa capacité de négociation entre Israël et les Palestiniens. L'Égypte de Hosni Moubarak (1981-2011) a joué un rôle majeur dans la plupart des accords conclus entre l'OLP et Israël après Oslo (1993) et a été active pour maintenir un canal de discussion avec Israël pendant la seconde Intifada (2000-2005).
Après la victoire du Hamas aux législatives palestiniennes de 2006 et la prise de Gaza en 2007 par ce dernier, l'Égypte intervient dans les négociations bilatérales aussi bien entre le Hamas et le Fatah qu'entre le Hamas et Israël, lors des conflits de 2008-2009, de 2012, de 2014 et de 2021, dont les victimes sont majoritairement des civils.
L'accession au pouvoir d'Abdel Fattah Al-Sissi en 2014, après le renversement du président Mohamed Morsi (2013), issu des Frères musulmans, suscite des tensions avec le Hamas, proche du mouvement islamiste. Des ajustements ont été nécessaires, mais les services de renseignement égyptiens ont maintenu une liaison discrète avec le Hamas et ont continué à exercer des missions de médiation avec Israël ou avec l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.
Depuis le 7 octobre 2023, aux côtés du Qatar et des États-Unis (seul acteur à même de faire pression sur Israël), l'Égypte est à nouveau au cœur des négociations, que celles-ci se déroulent à Doha ou au Caire. Un premier accord sous le parrainage des trois États avait été trouvé en janvier 2025. Préalablement, en décembre 2024, l'Égypte avait négocié un accord entre le Fatah et le Hamas pour ériger une administration autonome à l'issue de la guerre.
Une ligne rouge face à l'expansionnisme israélien ?
Au cours des derniers jours, face à la politique expansionniste d'Israël, l'Égypte a multiplié les déclarations sur la situation de Gaza. Les autorités du Caire se sont dites favorables à la mise en place d'une force d'interposition internationale mandatée par l'ONU, tout en démentant la rumeur selon laquelle elles auraient proposé un transfert des armes du Hamas vers l'Égypte.
À Rafah (Égypte), dans une interview à CNN, le ministre des affaires étrangères Badr Abdelatty a réaffirmé le rejet d'un déplacement massif des Palestiniens, ce qu'il a qualifié de « ligne rouge ».
Plus tôt, le président Al-Sissi avait franchi un cap rhétorique en dénonçant une « guerre de famine et de génocide » et réitéré son refus de tout projet de déplacement. L'Égypte soutient par ailleurs la plainte sud-africaine devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention sur le génocide, sans rejoindre les parties prenantes.
Ces déclarations interviennent dans un double contexte de blocage des négociations et d'accélération des opérations israéliennes, avec, à la clé, des ambitions territoriales israéliennes qui pourraient signifier la fin de toute possibilité d'une solution à deux États et un déplacement massif de population en dehors de Palestine, en particulier vers l'Égypte.
Le cessez-le-feu négocié au Caire par des médiateurs égyptiens et qatariens reprenait dans les grandes lignes le plan de l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et traduit donc une réelle avancée par rapport à la situation début juin, quand les États-Unis avaient refusé, conjointement avec Israël, la proposition formulée par le Hamas pour mettre en œuvre une trêve. Une avancée qui, pour autant, ne se traduit pas par un déblocage : une semaine plus tard, Israël n'a pas encore répondu à la proposition des négociateurs.
L'annonce du cessez-le-feu accepté par le Hamas intervient en outre alors que le cabinet de sécurité israélien a validé, le 8 août, un plan visant à prendre le contrôle de Gaza et que l'ONU, après plusieurs alertes, a déclaré l'état de famine dans la bande de Gaza. Les différentes déclarations égyptiennes font aussi écho à la vision d'un « Grand Israël » récemment mise en avant par Benyamin Nétanyahou et qui renvoie aux frontières bibliques d'Israël incluant des territoires actuellement jordaniens, libanais et syriens, ainsi qu'une partie du Sinaï.
L'idée de déplacer la population palestinienne en dehors de Gaza n'est pas nouvelle même si elle était plutôt marginale jusqu'à présent. Dernièrement, Nétanyahou a publiquement envisagé de délocaliser les Gazaouis dans les pays arabes ou en Afrique (des tractations en ce sens ont été évoquées plusieurs fois).
Le Sinaï, un enjeu sécuritaire clé pour l'Égypte
L'Égypte, qui partage avec l'enclave palestinienne une frontière de 14 kilomètres, le « couloir de Philadelphie », est également un acteur sécuritaire parce qu'elle joue un rôle clé, presque au sens propre, dans le blocus exercé par Israël sur la bande de Gaza (à la fois en ce qui concerne son maintien et/ou son allègement).
À cet égard, l'Égypte d'Abdel Fattah Al-Sissi n'est pas épargnée par les critiques qui dénoncent son inaction alors que, de l'autre côté de la frontière, la guerre menée par Israël s'apparente de plus en plus à une épuration ethnique, sinon à un génocide.
Les griefs sont nombreux et concernent notamment le blocage des ravitaillements au passage de Rafah en territoire palestinien, le traitement sécuritaire réservé aux réfugiés gazaouis – environ 100 000 Palestiniens ont trouvé refuge en Égypte depuis le début de la guerre, en payant des frais élevés à la compagnie Hala, qui s'est spécialisée dans la « coordination » du passage de Rafah – ou encore la gestion sécuritaire des manifestations pro-Gaza, au Caire comme dans le Sinaï.
Rappelons que l'Égypte a administré Gaza de 1948 à 1967, avant que la bande tombe sous contrôle israélien. Depuis, la posture du Caire vis-à-vis de Gaza a toujours été profondément influencée par la situation au Sinaï, grande zone désertique où se trouve la frontière entre l'Égypte et Gaza.
Après 2011, un mouvement djihadiste local, rallié en 2014 à l'État islamique, y a prospéré, avant d'être progressivement endigué par l'armée égyptienne au terme d'une « sale guerre » qui a fait plusieurs milliers de victimes (plus de 3 200 morts parmi les forces de sécurité, le nombre de victimes civiles n'étant pas connu). Sissi a proclamé la victoire en 2023, les opérations ayant pris fin entre 2019 et 2020.
Pour Le Caire, la gestion de Gaza est avant tout sécuritaire. Il s'agit de contenir les trafics, d'empêcher l'infiltration de groupes armés plus radicaux que le Hamas, dont le plus actif est le Djihad islamique, et d'éviter un afflux de réfugiés palestiniens, du fait de son incapacité logistique à organiser un tel accueil. Au-delà de la question logistique, les dirigeants égyptiens redoutent une situation qui se transformerait en état de fait. Ils ont à l'esprit les précédents libanais et jordanien, où l'installation de réfugiés palestiniens a débouché sur les événements de Septembre noir au royaume hachémite et sur la guerre civile au Pays du cèdre.
Cette position est ancienne&. En 2008 déjà, l'entrée par la force de milliers de Palestiniens dans le Sinaï avait été perçue comme une transgression de la souveraineté nationale, dont la répétition est à éviter « à tout prix ».
Pour autant, l'Égypte se défend de participer au blocus ou d'être inactive face au drame vécu par les Palestiniens. Le président Sissi a apporté lui-même une réponse à ces reproches, rappelant que c'est Israël qui a bombardé à plusieurs reprises le passage de Rafah et qui contrôle le côté palestinien de Rafah.
Israël, qui s'est retiré de Gaza en 2005, a repris le contrôle du couloir de Philadelphie en mai 2024. Les médias égyptiens, reprenant les éléments de langage du gouvernement, mettent en avant les convois humanitaires envoyés depuis l'Égypte : plus de 45 000 camions, soit 70 % de l'aide humanitaire, auraient ainsi ravitaillé Gaza depuis octobre 2023 (sachant que le passage ne peut se faire qu'avec l'accord d'Israël et à ses conditions en termes de sécurité).
Entre contraintes externes et pressions internes
Sur la question palestinienne, l'Égypte défend l'établissement d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États. Il s'agit d'un positionnement historique, défini par Anouar El-Sadate dans son discours à la Knesset en novembre 1978.
Il se traduit par des actions diplomatiques mais, depuis 2008, chaque guerre israélienne à Gaza met en lumière la portée limitée de l'engagement égyptien. Or, pour Sissi, cet engagement comporte des contraintes domestiques. La situation désespérée des Gazaouis trouve un large écho en Égypte comme dans toute la région et suscite un fort sentiment de solidarité.
Ici aussi, le gouvernement égyptien est pris dans ses contradictions. Pour bon nombre d'Égyptiens, le Hamas n'est pas tant un mouvement terroriste qu'un mouvement de résistance à Israël : d'ailleurs, même Le Caire ne l'a pas classé comme organisation terroriste, contrairement aux Frères musulmans égyptiens.
D'un côté, les autorités égyptiennes répriment toute manifestation qu'elles n'organisent pas elles-mêmes et qui pourrait remettre en cause le régime. Une méfiance à l'égard de la rue qui renvoie à l'importance des mobilisations de soutien aux Palestiniens dans la trajectoire militante qui a conduit à la révolution de 2011. D'un autre côté, le président et le gouvernement doivent prendre en compte la sensibilité de l'opinion publique et montrer qu'ils ne sont pas impuissants. À cet égard, accepter le déplacement des Palestiniens dans le Sinaï ferait d'eux des complices aux yeux des Égyptiens.
Quoi qu'il en soit, le rôle de l'Égypte paraît difficilement pouvoir aller au-delà d'une aide humanitaire et des négociations diplomatiques. La paix avec Israël demeure un pilier de la politique étrangère égyptienne. Le Caire ne mettra pas en danger sa relation bilatérale avec Israël au point de menacer d'entrer en conflit armé avec ce dernier.
Pas uniquement pour des raisons économiques, ou parce qu'une partie des approvisionnements en gaz de l'Égypte dépend d'Israël – même si ceux-ci peuvent représenter un levier. Sur beaucoup d'aspects, l'alliance avec Israël est cruciale pour Sissi : au-delà du soutien qu'a pu lui apporter Nétanyahou en plaidant sa cause à Washington après le putsch contre Morsi (2013), l'État hébreu est un partenaire économique, mais également un partenaire sécuritaire pour lutter contre les groupes djihadistes encore présents dans le Sinaï. Si des lignes rouges sont énoncées, aucune réelle menace n'a été proférée.
Pour autant, des rumeurs émanant de sources gouvernementales avaient circulé en février 2024 : elles évoquaient la menace d'une suspension du traité de paix en cas d'invasion israélienne de Rafah. Las, les troupes israéliennes occupent la zone frontalière depuis le mois de mai 2024 sans que l'Égypte n'ait réagi autrement que verbalement. Il semble en particulier exclu que l'armée égyptienne puisse être mobilisée pour s'interposer en dehors d'un cadre onusien et sans l'accord d'Israël.
La diplomatie pour ne paraître ni indifférent ni impuissant ?
On comprendra, dès lors, que les déclarations récentes de l'Égypte s'inscrivent dans une politique de long terme et n'indiquent pas un changement de ligne. La politique expansionniste d'Israël met en tension les objectifs stratégiques de l'Égypte : l'établissement d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États, la préservation de la souveraineté de l'Égypte dans le Sinaï et de sa sécurité, et, enfin, l'adhésion de l'opinion publique égyptienne.
Alors qu'Israël a répondu à l'annonce du Caire par la mobilisation de 60 000 réservistes pour exécuter son projet d'occupation de Gaza, la question de la soutenabilité de la posture d'équilibriste se pose et expose Le Caire à la réalité. Seul, le régime de Sissi ne peut rien contre Israël.
S'il est peu probable que le président égyptien prenne le risque de s'opposer militairement, il semble alors condamné à paraître indifférent ou impuissant. Une humiliation sur le dossier gazaoui pourrait coûter cher en interne à l'autocrate et avoir des conséquences dramatiques pour la région. Ne reste alors à l'Égypte que la voie diplomatique pour sortir de l'ornière. D'abord négocier un cessez-le-feu et ensuite parvenir à une issue alternative à l'occupation israélienne de Gaza. Cette dernière pourrait nécessiter un retour de l'Égypte dans la bande de Gaza. Mais l'Égypte est-elle vraiment prête à prendre sa part dans une solution à Gaza au-delà des négociations diplomatiques ?

La Mauritanie et le Maroc, pivots de l’influence américaine au Sahel

Un rapport publié le 20 août 2025 par le think tank New lines institute analyse la révision du positionnement américain au Sahel. Intitulé « A U.S. Sahel Strategy Anchored in Morocco and Mauritania), le document explique comment, face à l'effondrement du partenariat sécuritaire avec les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Washington cherche, désormais, à replacer son dispositif à la périphérie du champ, en s'adossant au périmètre Maroc-Mauritanie.
Tiré de MondAfrique. Un article de « Veille sahélienne », un site partenaire.
Les auteurs rappellent que les États-Unis et la France maintenaient, pendant près de deux décennies et sans discontinuer, une prééminence forte au sud du Sahara. Or, la succession de coups d'État en Afrique de l'Ouest, de 2020 à 2023, aura entraîné l'expulsion des troupes alliées et la fermeture des bases américaines de drones au Niger. La rupture, amplifiée par le rejet croissant de l'influence de l'Occident, rend la région plus vulnérable à l'activisme du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim Alqaïda) et de l'État islamique au Sahel (Eis). Les deux coalitions ennemies sont responsables de milliers de morts, de blessés, disparus et déplacés, durant l'année 2024, soit plus de la moitié des victimes du terrorisme mondial. Dans le même temps, les trafics d'armes, de drogues et de migrants ont prospéré à travers de vastes territoires, de moins en moins sous contrôle.
Tandis que Washington réduisait son empreinte, d'autres puissances renforçaient la leur. La Russie, via la société de mercenaires Wagner devenu Africa Corps, a consolidé son ancrage – encore vacillant – grâce à l'obtention de concessions minières et à un soutien direct aux juntes. La Chine a accru une présence durable sur les corridors logistiques et les ressources du sous-sol, notamment en Guinée et au Nigeria. L'Iran, plus discret, a élargi son audience sous couvert de ventes d'armes, de partage d'expérience et de relais chiites, parfois liés au Hezbollah libanais. Une telle redistribution des cartes s'est traduite par le recul marqué de l'influence des États-Unis, au niveau de la diplomatie et de l'engagement militaire.
Un « pare feu » fonctionnel
Dans cet environnement concurrentiel, « New lines institute » met en avant le rôle du Maroc et de la Mauritanie comme deux amarrages stables et fiables. Le duo est qualifié de « pare-feu fonctionnel », permettant aux États-Unis de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, contenir la nuisance des entités hostiles et filtrer la propagation du terrorisme et de l'illégalité transfrontalière.
Le Maroc, partenaire historique de Washington, accueille, chaque année, l'exercice de défense African Lion et veut utiliser son Initiative atlantique pour offrir, aux pays enclavés du Sahel, un accès à ses ports de Dakhla et de Laâyoune, pourtant éloignés de l'hinterland. La Mauritanie, quant à elle, assure la fonction de tampon, le long d'une frontière poreuse avec le Mali et reçoit, de ses amis occidentaux, une assistance en matière de renseignement et de formation au combat.
Le think tank recommande, aux États-Unis, d'adopter une posture dite du « périmètre ». L'approche consiste à s'ancrer, de manière indirecte et souple, en bordure nord du Sahel plutôt qu'au cœur de ses foyers instables. Washington préserverait, ainsi, un accès modulable à l'aire de belligérance et se prémunirait des coûts et risques d'une implication prolongée au Sahel. Selon le New Lines Institute, il ne s'agirait pas d'un retrait mais d'un recalibrage pragmatique.
Il importe de le souligner, le gouvernement fédéral récolte, d'une multitude de boîtes à penser, d'experts et de laboratoires intellectuels du Traité de l'Atlantique nord (Otan), quantité d'analyses et de prospectives d'une qualité variable. Leur incidence sur sa politique étrangère demeure difficile à mesurer.

RDC : La paix introuvable

La guerre continue malgré l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington sous les auspices de Trump.
Dès le début, les observateurs étaient circonspects sur l'arrêt du conflit du fait de la mise en place de deux processus de paix parallèles bien qu'intimement liés.
Deux accords de paix
Le premier, parrainé par les USA est un accord entre états, la RDC et le Rwanda. Il a été signé le 27 juin dernier mais de l'avis même des acteurs prend du retard notamment sur la question du retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Il est conditionné à la mise hors-jeu par les forces armées de la RDC (FARDC) des FDLR, une milice composée d'anciens génocidaires dont le Rwanda surestime le danger, considérant qu'elle représente une menace existentielle.
Le second accord toujours en discussion est celui de Doha, cette fois ci entre la RDC et la milice M23/AFC massivement soutenue par le Rwanda. Elle a conquis une large part du territoire de l'est du pays en occupant les principales villes de Goma et Bukavu. Les pourparlers piétinent. Les autorités congolaises exigent de recouvrer leur autorité sur l'ensemble du territoire, quand le M23/AFC parle de cogestion de la région. Si le M23 au début était une rébellion strictement militaire, elle s'est transformée en force politique avec l'adjonction de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) dirigée par Corneille Nangaa.
Régime parallèle
Cette milice a rapidement installé une nouvelle administration pour gérer les territoires conquis. Des gouverneurs ont été nommés, des tribunaux institués et depuis peu une police a été créée avec l'embauche de nouveaux fonctionnaires. Les chefs coutumiers opposés à ce nouveau pouvoir ont été écartés et parfois éliminés physiquement. L'autre problème épineux est celui de la démobilisation des forces du M23. Ces combattants exigent d'être intégrés à l'armée. Tshisekedi, le président de la RDC, refuse catégoriquement considérant qu'une telle intégration serait une épée de Damoclès pour son régime.
Pour mener la guerre contre le M23/AFC le gouvernement congolais a largement fait appel à de nombreuses milices qui sévissent dans la région. Elles agissent sous le nom générique de Wazalendo (les patriotes en kiswahili). Officiellement leurs membres ont le statut de « réserve armée de la défense ». Dans les faits les Wazalendo bénéficient d'une grande indépendance et considèrent qu'ils ne sont pas tenus par les engagements pris à Doha car absents des discussions. En effet ces derniers avaient demandé à participer aux réunions mais le refus tant du gouvernement congolais que du M23/AFC aboutit à ignorer les revendications de ces groupes armés. Déjà apparaissent les premières escarmouches entre milices Wazalendo et FARDC. La dernière en date s'est déroulée à Uvira provoquant la mort d'une dizaine de personnes.
Contrairement à ce que Trump déclare lorsqu'il affirme avoir mis fin à une guerre de trente ans. Le conflit perdure poussant les populations civiles, victimes des exactions perpétrées de toutes parts, à prendre le chemin de l'exil.
Paul Martial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les droits souverains des héritiers légitimes de Dessalines sur l’île d’Haïti ne sont pas négociables.

Chaque jour, les fils et les filles d'Haïti sont contraints de fuir pour sauver leur vie.
Plus de 1,3 million de personnes seraient actuellement déplacées par la violence, soit le nombre le plus élevé de l'histoire d'Haïti, selon un récent rapport des Nations Unies. Face à cette catastrophe, Solidarité Québec-Haïti (SQH) tient à rappeler que les droits souverains des héritiers légitimes de Dessalines sur l'île d'Haïti ne sont pas négociables.
Si aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité légitime en Haïti, alors que les terroristes se nourrissent du sang du peuple, ce n'est pas une malédiction qui nous frappe. Des terroristes sanguinaires, des politiciens corrompus, un réseau de mafias économiques de mèche avec une occupation militaire étrangère ont complètement détruit l'Etat.
À l'origine de ce chaos sans fin, il y a une invasion militairemenée par les États-Unis, la France et le Canada le 29 février 2004. Cet horrible crime multinational a ensuite été consolidé par 21 ans d'occupation étrangère d'Haïti, soutenue par les Nations unies.
C'est avec consternation que nous constatons l'audace des criminels malveillants qui continuent d'opérer au niveau national et international, offrant au peuple haïtien toujours plus de poison, censé guérir un fléau qu'ils ont eux-mêmes créé. Le fait que le gouvernement de Mark Carney prétende apporter de l'aide à Haïti alors que le Canada est assis sur une pile de documents, y compris des preuves recueillies sur de puissants criminels présumés de tous bords, est une véritable tragicomédie. En effet, de nombreux ressortissants haïtiens, parmi lesquels des politiciens, des hommes d'affaires et des chefs de gangs, sont accusés par le gouvernement canadiend'alimenter le réseau terroriste « Viv Ansanm ». Parmi eux : Michel Martelly, Gilbert Bigio, Reynold Deeb, Izo (Johnson André), Dimitri Hérard, Jimmy Cherizier (Babekyou), Vitelhomme Innocent, André Apaid, et bien d'autres.
Si ces accusations ne servent pas uniquement à faire bonne figure, le système judiciaire canadien, haïtien et la justice internationale doivent se mobiliser de manière appropriée afin que la société puisse utiliser ces preuves contre les présumés criminels et en faveur des victimes. Il est grand temps que tous les biens associés aux réseaux terroristes soient nationalisés et deviennent la propriété de l'État haïtien.
Jusqu'à ce que justice soit faite, SQH déclare : A bas l'impérialisme sous toutes ses formes ! – même lorsque des hypocrites sournois figurent parmi les coupables.
SQH rappelle que les principes fondamentaux suivants sont absolument non négociables :
1.Le peuple haïtien exige que tous les vautours étrangers soient expulsés et exclus des affaires haïtiennes. Laissez les Haïtiens respirer !
2.Seuls les Haïtiens ont le droit de choisir des dirigeants légitimes pour leur pays, et cela doit se faire pacifiquement. Aucune marionnette, aucun traître, aucune cinquième colonne imposée par d'autres ne doit être tolérée, quelle que soit la couleur de leur peau.
3.Qu'il s'agisse de criminels associés aux Nations Unies, à l'OEA, de mercenaires « à la peau noire et au masque blanc » du Kenya ou d'ailleurs, de mercenaires blancs racistes qui ont signé des contrats illégaux avec des « leaders » illégaux imposés de l'étranger en Haïti, de l'Institut Macaya, d'Erik Prince, ou d'autres criminels associés… Le peuple haïtien jette tous ces projets diaboliques dans les toilettes.
Que chacun, y compris le gouvernement du Canada, en prenne acte : le temps des projets néocoloniaux et des complots racistes contre le peuple haïtien est révolu.
Enfin, Solidarité Québec-Haïti continue d'exiger que le Canada se retire du club impérialiste appelé« Core Group« . Le Canada doit soutenir un embargo mondial efficace sur les armes américaines qui alimentent le terrorisme dans les Caraïbes, en particulier en Haïti. Le Canada doit adopter une politique étrangère courageuse, indépendante des États-Unis et surtout respectueuse de la souveraineté d'Haïti. Nous exigeons des restitutions et des réparations de la part des gouvernements de tous les pays du Core Group, des Nations Unies et de l'OEA pour les multiples crimes qu'ils ont commis à l'encontre du peuple haïtien.
– 5 septembre 2025 –
Pour plus d'informations, contactez-nous :
Solidarité Québec-Haïti
Facebook Twitter : Solidarité Québec-Haïti
Courriel : solidaritekebekayiti@gmail.com
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Haïti : entre l’amnésie historique, la manipulation idéologique et le sous-développement

« La conscience historique est le premier moteur de la dignité d'un peuple » soutient Cheikh Anta Diop, figure emblématique de l'histoire décoloniale et de l'anthropologie culturelle africaine. Dans son réquisitoire décolonial, il dénonce la manière dont les historiens occidentaux ont systématiquement nié sinon gommé les apports de l'Afrique noire à la civilisation humaine. Pour lui, l'histoire constitue la mémoire collective d'une formation sociale, la marque identitaire d'un peuple, le socle sur lequel s'édifie son identité. Elle forge sa conscience politique. Cependant, il y a beaucoup de peuples qui, par ignorance ou manipulation, sont déconnectés de leur propre histoire. Haïti en est une parfaite illustration.
Par Desroses Bleck Dieuseul
Chez nous, l'enseignement de l'histoire est souvent réduit à des faits glorifiés sans analyse critique. Les curriculums sont souvent inspirés de modèles occidentaux particulièrement ceux de la France et du Canada francophone et mal adaptés aux réalités socio-anthropologiques et ethnologiques haïtiennes. Beaucoup d'enseignants n'ont pas la formation adéquate en didactique de l'histoire. Ces derniers privilégient l'approche évènementielle axée sur la mémoire des faits sans esprit critique. Certains gouvernements, groupes politiques ou classes sociales dominantes exploitent souvent l'histoire à des fins de propagande, en occultant des vérités jugées dérangeantes pour leurs intérêts.
La méconnaissance sinon la falsification de l'histoire n'est pas sans conséquences sur le destin du pays. Elle fragilise ses fondements aussi bien sur le plan identitaire que sur le plan politique et économique. Dans le cadre de cet article, je me propose d'analyser comment l'amnésie historique pourrait affecter la cohésion sociale, tout en exposant les risques de manipulation et de dépendance qu'elle pourrait entrainer.
La connaissance de l'histoire permet à un peuple de préserver son identité culturelle et de transmettre des valeurs fondamentales aux générations futures. Cela permet de créer un fort sentiment d'appartenance, la base d'une personnalité équilibrée et authentique. Or, lorsque cette mémoire collective est absente ou occultée , on assiste à une véritable aliénation culturelle : les repères traditionnels s'effacent au profit de modèles culturels imposés par des étrangers, souvent perçus comme supérieurs. La langue, les coutumes, les croyances et les héros nationaux deviennent alors secondaires, voire oubliés ou falsifiés.
La connaissance de l'histoire favorise la cohésion sociale, unit une communauté autour des valeurs partagées. Sans des repères historiques communs, les membres d'une société ne partageront non plus les mêmes références. Ce qui pourrait occasionner des divisions ethniques, sociales ou régionales. Le noirisme, théorisé par des penseurs comme Antênor Firmin et le Dr Jean Price-Mars sur la base des références scientifiques, a été récupéré par des figures politiques dont le Dr François Duvalier. Il s'est basé sur cette doctrine pour renforcer le ressentiment des masses noires contre l'élite mulâtre tout en attisant la haine contre les Mulâtres qu'il présentait comme des traîtres à la nation.
Dans le cas la jeunesse contemporaine, déconnectée de son patrimoine historique et culturel, se retrouve sans repères, sans modèles inspirants issus du passé glorieux. C'est en ce sens qu'Aimé Césaire souligne : « Il n'est point de peuple sans mémoire, point de peuple sans histoire. »
Le cas d'Haïti est pathétique. Dans l'esprit du jeune écolier haïtien, seuls les penseurs occidentaux particulièrement Platon ont émis des idées pour la gestion de la cité. Demesvar Delorme, Louis Joseph Janvier, Antênor Firmin, Jean Price-Mars et Leslie Manigat ne sauraient être considérés comme des penseurs politiques. La raison est alors simple : les Occidentaux ne les considèrent pas comme tels. Donc, ils ne le sont pas. Leurs noms ne figurent pas dans les manuels scolaires de la France ou du Canada francophone. Les idées de ces derniers ne sont pas suffisamment pertinentes pour être enseignées à la jeunesse haïtienne soutiennent les défenseurs de l'école coloniale. Cependant, celles de Rabelais et de Montaigne sont mises à l'honneur. Loin d'être partisan d'un repli sur soi ou d'un ethnocentrisme identitaire révolu, je suis plutôt pour la double conscience c'est -à-dire la capacité de se voir comme un héritier d'une histoire spécifique, tout en se reconnaissant membre d'une humanité plurielle, solidaire et diverse. Une telle digression n'était pas importance. Elle vise à dégager la colonialité de la question. Je reviens immédiatement au problème de l'enseignement de l'histoire.
En Haïti, l'enseignement de l'histoire est bâclé. Les manuels ne sont pas adaptés. Sur le problème d'incohérence dans l'agencement du programme vient se greffer celui de la formation des enseignants n'ont pas toujours les compétences requises. Rares sont ceux qui ont étudié cette discipline dont ils ont la charge d'enseigner.
Au lieu d'enseigner l'histoire (science historique), ils racontent des histoires (blagues) aux apprenants. Plutôt que de se servir des approches approches critique et réflexive, interactive et numérique et/ou étude de cas pour mieux asseoir leur enseignement, la plupart des enseignants bossant parfois dans les établissements scolaires les plus prestigieux de la République, et malgré la généralisation de l'Approche par compétence (APC) dans le cadre du secondaire rénové, se plaisent à remplir les tableaux de notes, s'accrochent à la méthode traditionnelle consistant à déballer des discours magistraux souvent à effets de style ratés. L'apprenant reste alors passif sans être outillé pour la remise en question des biais idéologiques et politiques dans le récit des faits.
Cette passivité fera de lui plus tard un citoyen soumis inapte à participer dans la construction du débat démocratique. Son indifférence ou son désintérêt ouvre la voie à des leaders populistes (démagogues) ou autoritaires qui peuvent restreindre les libertés publiques sans opposition populaire. En témoigne l'attitude des dirigeants de l'État en Haïti vis-à-vis des deniers publics et le silence des citoyens. En Haïti, la passivité des citoyens devient une forme de "complicité silencieuse" face aux dérives des autorités.
L'on doit, par ailleurs, admettre que l'ignorance du passé offre un terrain fertile à la manipulation idéologique. Les classes dominantes ou les puissances étrangères, peuvent alors imposer une version falsifiée de l'histoire, justifiant des systèmes d'oppression, qu'il s'agisse de colonisation, de dictature ou de domination socio-économique. En témoigne l'attitude de François Duvalier entre 1957 et 1971.Il s'est auto-proclamé l'héritier direct de Dessalines, fondateur de la patrie haïtienne tout en occultant le rôle joué par les mulâtres dans la geste de 1804. L'historien Michel-Rolph Trouillot, dans Silencing the Past (1995), montre comment les régimes autoritaires manipulent les silences historiques pour légitimer leur pouvoir. Frantz Fanon le rappelait avec force : « Un peuple sans mémoire historique est un peuple sans avenir. » La perte de la mémoire conduit inévitablement à la répétition des erreurs du passé, car un peuple incapable de comprendre ses luttes et ses défaites est condamné à retomber dans les mêmes pièges.
L'école haïtienne, au lieu de favoriser l'appropriation des outils scientifiques par la jeunesse pour appréhender les faits historiques, ne fait que renforcer son complexe d'infériorité par rapport à l'étranger, élargir le clivage de couleur et de classes et l'aliénation culturelle. En général, nos jeunes laissent l'école classique avec peu connaissances historiques lorsqu'ils n'en sont pas totalement dépourvues. Jusqu'à très récemment, les bacheliers haïtiens en classe de philosophie ne maitrisent-en deçà des attentes-que les 40 années qui ont suivi l'indépendance. La deuxième moitié du XIXe siècle et le XXe siècle étaient totalement méconnus aussi bien par les élèves que par les enseignants. Il y a moins d'une décennie qu'on commence-dans le cadre de la réforme des curriculums- à enseigner ces deux tranches d'histoire. Encore selon les mêmes méthodes traditionnelles avec tous défis du système : élèves sans manuels ni motivation, établissements scolaires sans bibliothèques ni cafeterias, professeurs sans qualifications ni compétences, salaire-horaire misérable par rapport au coût de la vie, infrastructures scolaires inadaptées etc.
Ce problème constitue un véritable frein au développement autonome de l'Haïtien qui reste toujours dans l'attentisme. Il attend les solutions des problèmes nationaux de l'extérieur. Le manque de connaissance sur les fondements de l'organisation sociale et économique traditionnelle du pays porte les gouvernants à adopter des modèles exotiques souvent inadaptés à la réalité socio-anthropologique et ethnologique haïtienne. Autrement dit, ils mettent en place des politiques publiques inadaptées aux besoins réels de la population. Cela favorise la dépendance économique et la perte de souveraineté, avec des conséquences durables sur le développement national. En clair, le manque de conscience historique empêche de comprendre les racines des inégalités sociales et des injustices structurelles. À ce sujet, Benoit Joachin affirme que ‘' le sous-développement d'Haïti est d'abord le résultat de structures politiques, économiques et sociales héritées de la colonisation esclavagiste et aggravées par une élite déconnectée des masses populaires, perpétuant un modèle de dépendance et d'exclusion ‘'.
Dans le Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain rappelle, par ailleurs, le rôle que pourrait jouer le ‘' konbitisme ‘' dans le développement national dans le cadre de l'unité nationale. Pour le romancier de l'École indigéniste, le sous-développement d'Haïti est d'abord le résultat de la division, de la méconnaissance de la solidarité collective et de l'oubli des valeurs paysannes ; seule l'unité du peuple et la reconquête de la terre peuvent permettre la renaissance du pays.
De tout ce qui précède, il en découle qu'un peuple qui ne connait pas son histoire court un grand risque. C'est une des plus grandes menaces pour son identité, sa liberté et son développement. Cela ouvre la voie à la manipulation, affaiblit sa conscience collective et perpétue ses erreurs du passé. « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter », lançait George Santayana. Ainsi, apprendre à connaitre son histoire, la valoriser et la transmettre devient un devoir vital pour toute formation sociale soucieuse de son avenir. Comme le disait Marcus Garvey : « Un peuple sans connaissance de son passé, de son origine et de sa culture est comme un arbre sans racines ». Et cette carence est souvent exploitée par les démagogues et les populistes à des fins politiciennes. Benoit Breville semble avoir conforté les manipulateurs en disant que : « la mémoire collective est une construction qui varie au gré des époques, des rapports de forces, des intérêts du moment »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rencontre internationale de rébellions en territoire zapatiste

Plus de trois décennies après le soulèvement de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), la rencontre « Quelques parties du tout » réunit les luttes et résistances de collectifs mexicains et d'une dizaine de pays. L'espace vise à nourrir l'organisation et à partager les erreurs et réussites des constructions autonomes. Les défis face aux mégaprojets extractivistes et le regard des prochaines générations y sont au centre.
18 août 2025 | tiré de Rebelion | Sources : Agencia Tierraviva
https://rebelion.org/encuentro-internacional-de-rebeldias-en-territorio-zapatista/
Au Chiapas, dans le sud du Mexique, de vastes étendues de territoire voient les peuples indigènes zapatistes construire leur vie dans l'autonomie et la démocratie directe. Là, ils rejettent le gouvernement national, qui n'a jamais veillé aux droits ni aux besoins des communautés, et se déclarent en résistance et en rébellion. Les zapatistes ont réussi à édifier leur propre système de santé autonome, leur propre éducation, leur système de gouvernement local et horizontal, leur sécurité, tout en dénonçant les programmes sociaux que met en œuvre le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum (Morena) pour fragmenter les communautés paysannes.
Trente et un ans après le soulèvement armé de l'EZLN, où ils ont lancé leur cri de « Ya basta ! » et exigé « Plus jamais un Mexique sans nous », le dimanche 3 août a débuté la rencontre « Quelques parties du tout », organisée par le mouvement zapatiste afin de partager les luttes et résistances à travers le monde. Ils avaient déjà organisé plusieurs rencontres pour échanger avec d'autres collectifs en rébellion, tant au niveau national qu'international. Durant la pandémie, ils avaient suspendu tout contact avec l'extérieur, par mesure de protection, mais ils ont repris aujourd'hui l'organisation de rencontres internationales pour mettre en dialogue les formes de résistance de chaque territoire.
La rencontre a commencé au Caracol Tourbillon de nos paroles — les « caracoles » étant les communautés autonomes de prise de décision dans le territoire zapatiste — situé dans la localité de Morelia, à quelques kilomètres d'Altamirano, l'une des quatre villes occupées par les zapatistes à l'aube du 1er janvier 1994. L'inauguration s'est ouverte avec l'entrée de la milice au centre du caracol. Le sous-commandant Moisés, porte-parole du mouvement, a prononcé un discours de moins de cinq minutes, souhaitant la bienvenue à « toutes, tous et tou·te·s » à la rencontre, et a déclaré clairement : « Aujourd'hui, nous sommes toutes une petite fille palestinienne, nous sommes tous un petit garçon palestinien ». Un profond silence a suivi. À ce moment, chaque milicien et milicienne de l'EZLN a déployé un drapeau de la Palestine. Le lien entre les opprimé·es du monde contre le système et les guerres capitalistes était ainsi établi.
Espaces de partage
Dans la rencontre, chaque collectif dispose d'un moment pour présenter le contexte dans lequel il se trouve, ses défis et les actions concrètes qu'il mène. Le Congrès national indigène (CNI), qui rassemble et met en dialogue les luttes des divers peuples indigènes à travers tout le territoire mexicain, a ouvert les tables de partage. Plusieurs porte-paroles de différentes communautés ont exposé les processus d'autonomie, la présence du crime organisé et des mégaprojets extractivistes sur les territoires ancestraux, ainsi que les projets gouvernementaux qui fragmentent les communautés, parmi d'autres problématiques.
Un exemple est le programme gouvernemental Sembrando Vida, qui oblige les communautés à posséder 2,5 hectares avec titres individuels pour y accéder, poussant ainsi de nombreuses communautés à privatiser leurs terres communales.
Le CNI est une organisation clé dans le contexte mexicain. Il a acquis une grande visibilité en consolidant le Conseil indigène de gouvernement qui, en 2017, a choisi Marichuy — María de Jesús Patricio — comme porte-parole et candidate indépendante à l'élection présidentielle de 2018. Cette initiative a lancé une vaste campagne depuis la base, en contre-proposition au système de pouvoir gouvernemental.
Les mères chercheuses — collectif de femmes qui recherchent leurs fils et filles disparu·es — ont pris la parole ensuite. Au Mexique, on compte déjà plus de 120 000 disparu·es, et le nombre augmente chaque jour à cause de la violence entretenue par la complicité entre crime organisé et autorités nationales, étatiques et municipales. Ce sont les familles qui assument la lourde tâche de chercher leurs proches parmi les décharges, ravins et décombres. Des dizaines de groupes de familles s'organisent à travers le pays, subissant stigmatisation, abandon de l'État, persécutions, et plusieurs ont même été assassinés durant leurs recherches.
Autonomie et avenir zapatiste
Chaque après-midi de la rencontre, les jeunes zapatistes présentent des œuvres artistiques où l'on ne voit pas d'individualités mais des collectifs travaillant ensemble. Ils partagent poèmes et chansons, souvent dans leurs langues maternelles et parfois en castillan. La relève générationnelle est un défi central du zapatisme : comment transmettre le sens de la lutte à celles et ceux qui n'ont pas vécu l'oppression capitaliste, mais sont né·es et ont grandi dans les caracoles ?
Dans les écoles autonomes, les jeunes montent des pièces de théâtre retraçant l'histoire du mouvement, incluant ses erreurs et ses réussites. Fort d'un esprit critique aigu, le zapatisme a revisité ses pratiques pyramidales et, en 2023, a annoncé une transformation de sa structure de gouvernement autonome. L'organisation pyramidale des Juntas de Buen Gobierno, où l'information et les décisions se concentraient entre quelques mains, a été remplacée par un système d'assemblées de base en dialogue permanent avec l'ensemble du territoire.
Aujourd'hui, dans chaque communauté et territoire communal, fonctionne un Gouvernement autonome local élu et rotatif, qui se réunit selon les besoins en Collectifs de gouvernements autonomes locaux dans les caracoles respectifs et, si nécessaire, en Assemblée de collectifs de gouvernements autonomes locaux.
Le jeudi 7 août, une brigade internationale a visité le bloc opératoire autonome en construction dans la Selva Lacandona, au Caracol Dolores Hidalgo. Le plan a été réalisé par sept compagnons zapatistes de la base de soutien et la construction a été organisée avec la participation des bases de soutien des différents caracoles qui travaillent chaque semaine. Ils ont également raconté, lors d'une présentation à l'auditorium du caracol, que des personnes extérieures au mouvement, y compris certaines proches du parti au pouvoir Morena, ont participé et contribué à cette construction, comprenant que ce bloc opératoire est un bénéfice pour toutes et tous.
Ce travail est collectif et pour le commun. La décision de le construire est née des besoins du peuple, l'hôpital le plus proche se trouvant à Ocosingo, à deux heures de route. Le bloc opératoire représente une avancée majeure pour le système de santé autonome, qui dispose de salles dans chaque communauté et de promoteurs de santé combinant savoirs ancestraux et formation médicale. Chaque caracol possède aussi une ambulance.
Un horizon à long terme
Toute la rencontre — qui peut être suivie sur le site web de l'EZLN — a pour axe central le travail en commun et la lutte pour le jour d'après la tempête capitaliste : l'extractivisme des ressources naturelles, la destruction de la nature, les monocultures, entre autres facteurs. Le zapatisme poursuit sa voie sans s'écarter de l'autonomie, avec pour horizon qu'une petite fille, dans sept générations, puisse vivre libre et sans peur.
Source : Agencia Tierraviva

Les frappes russes continuent de paralyser les mines et les communautés d’Ukraine

Les affiliés ukrainiens d'IndustriALL signalent une escalade dramatique des attaques contre les travailleurs et les lieux de travail au cours des derniers mois. Au cours des sept premiers mois de 2025, en raison de l'agression russe, 676 travailleurs et travailleuses ont été blessés sur leur lieu de travail et 146 ont été tués à la suite de tirs de missiles et d'obus d'artillerie sur les domaines des entreprises, de frappes aériennes et d'attaques de drones FPV par les forces armées de la Fédération de Russie contre des sites industriels, des installations de production et des véhicules de transport.
22 août 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/03/les-frappes-russes-continuent-de-paralyser-les-mines-et-les-communautes-dukraine/
Les attaques russes continuent de dévaster les villes minières d'Ukraine, mettant les mineurs et leurs familles en danger extrême. Les bombardements constants et les frappes de drones bloquent les évacuations à Rodynske, Bilytske, Bilozerske, Dobropillya et dans les villages environnants de la région de Donetsk.
Le 8 août dernier, les bombardements ont provoqué l'inondation de la mine de Dobropilska, mettant en danger les mineurs et contaminant la région. Les attaques ont également coupé l'électricité à la mine d'Almazna. Ces mines font vivre les économies locales et leur destruction menace des milliers d'emplois, les moyens de subsistance qui y sont associés ainsi que la sécurité environnementale.
Depuis le 13 août, les attaques russes ont provoqué des coupures d'électricité dans trois grandes mines de la région. Les bombardements ont également empêché les travailleurs et travailleuses de déplacer des équipements essentiels des entreprises, équipements qui préservent les emplois, garantissent le droit au travail, maintiennent l'approvisionnement en électricité et permettent à l'économie de l'Ukraine de fonctionner.
Les missiles et les drones russes dévastent également les infrastructures civiles, la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine exprimant sa profonde inquiétude face au nombre croissant de victimes civiles.
Mykhailo Volynets, Président du Syndicat indépendant des mineurs d'Ukraine (NPGU), a déclaré :
« Chaque jour, le secteur énergétique et les charbonnages d'Ukraine ont été et restent l'une des cibles prioritaires des forces russes. Les attaques de missiles et de drones coupent constamment l'électricité dans les mines, mettant les travailleurs et travailleuses en danger de mort. Tout est mis en œuvre pour garantir une saison de chauffage stable pour 2025-2026, afin de préserver la sécurité énergétique du pays, d'éclairer les foyers et d'alimenter les hôpitaux en électricité ainsi que de subvenir aux besoins des familles. Les mineurs ukrainiens méritent véritablement une protection et un soutien sans faille. Les membres du NPGU continuent de résister en se consacrant à leurs tâches sur leur lieu de travail, en se portant volontaires et en défendant des vies et la paix en première ligne. Nous appelons tous nos camarades, toutes nos organisations sœurs, à continuer de nous aider. »
Dmytro Zelenyi, qui dirige la section locale de Dobropillia du Syndicat indépendant des mineurs d'Ukraine, a déclaré :
« Je tiens à souligner que les mineurs sont des personnes courageuses, car ils travaillent sous terre, sous des attaques constantes, et qu'ils sont également des défenseurs de l'Ukraine sur le front. Parmi nos membres, nous comptons des réfugiés de Myrnohrad, Pokrovsk et d'autres villes minières. En tant que syndicat, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver les emplois, soutenir les mineurs et évacuer nos membres, les mineurs et leurs familles. Malheureusement, en raison de l'agression russe en cours, nos ressources sont réduites. Nous serons reconnaissants pour toute aide apportée à nos mineurs et à leurs familles. »
Yaroslava Bytiutska, responsable de la section de base du NPGU à la dixième unité de sauvetage minier, a déclaré :
« Il y a tout juste un an encore, j'étais chez moi à Myrnohrad (région de Donetsk), où vivait ma famille et où mon petit-fils allait à l'école. Nous avons continué à travailler là-bas malgré les bombardements russes, mais nous avons ensuite dû évacuer vers la ville de Dobropillia et maintenant nous avons dû partir de là aussi. Le 30 avril, le site de relocalisation de notre unité à Dobropillia a été détruit. L'un de nos collègues, Roman, a été gravement blessé et brûlé. Pendant plus de 20 ans, Roman a sauvé des vies et aujourd'hui, c'est lui qui a besoin d'être soigné et de bénéficier de toute urgence d'une rééducation. Aujourd'hui, les sauveteurs miniers sont devenus la cible des forces russes. Notre collègue Anton Zemlianyi, commandant de l'équipe opérationnelle de sauvetage, a été tué alors qu'il sauvait des vies et aidait bénévolement les habitants de la communauté de Pokrovsk en juin dernier. »
IndustriALL et ses affiliés ukrainiens formulent une demande d'intervention urgente.
« Nous appelons l'OIT et la communauté internationale à agir immédiatement pour protéger les travailleurs et les travailleuses ukrainiens et fournir une aide humanitaire aux mineurs déplacés ainsi qu'à leurs familles » a déclaré Atle Høie, Secrétaire général d'IndustriALL.
À la veille de la journée des mineurs d'Ukraine, le 31 août, IndustriALL exprime sa solidarité sans faille avec les mineurs d'Ukraine et leurs familles.
« Nous revendiquons la fin immédiate de la guerre d'agression et de l'occupation menées par la Russie » a martelé Atle Høie.
Russian strikes continue to cripple Ukraine's mines and communities
https://www.industriall-union.org/russian-strikes-continue-to-cripple-ukraines-mines-and-communities
Los ataques rusos siguen paralizando las minas y las comunidades de Ucrania
https://www.industriall-union.org/es/los-ataques-rusos-siguen-paralizando-las-minas-y-las-comunidades-de-ucrania

À la source de l’impasse politique française, la crise économique

Le récit dominant tente de faire de l'économie française une victime innocente de la crise politique. Elle est en réalité la source de l'instabilité politique et de la profonde crise démocratique que traverse le pays.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
5 septembre 2025
Par Romaric Godin
Pour son premier journal de 20 heures, lundi 1er septembre, la journaliste de France 2 Léa Salamé avait invité Michel-Édouard Leclerc. Le patron de la distribution était venu se lamenter des effets néfastes de « l'incertitude politique » sur l'économie. Le 3 septembre, Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, abondait dans ce sens au micro de France Inter. La veille, Le Monde avait entonné ce même refrain, voyant dans les troubles politiques une source de « fragilisation » de l'économie française.
Et ce ne sont là que quelques exemples parmi une montagne de sujets identiques. Car la figure est désormais classique. À chaque menace sur le gouvernement, l'économie est présentée comme la victime innocente des déboires de la politique française. Cette forme n'est pas innocente : elle participe à la construction d'un imaginaire où la politique serait une force autonome, indépendante de la situation économique.
Ainsi, les forces économiques, elles, seraient immédiatement dégagées de toute responsabilité. Mais c'est un discours étrange qui vient se lamenter sur un potentiel « décrochage » de la croissance pour raison politique en feignant d'ignorer que le décrochage de la croissance a précédé la crise politique.
La France en pleine crise économique
D'ailleurs, ce discours s'accompagne en permanence d'un autre : celui d'une économie française « qui ne va pas si mal ». Alors même que, au premier semestre, l'acquis de croissance n'est que de 0,5 % avec une contribution des stocks, c'est-à-dire une production non vendue qui a apporté 1,1 point de PIB… C'est ce qu'on pourrait appeler une croissance largement fictive qui sera compensée à un moment ou à un autre.
En réalité, il suffit d'observer un graphique de l'évolution du PIB français pour comprendre que le pays tend à la stagnation. Selon la Banque mondiale, le PIB par habitant français en dollars constants et en parité de pouvoir d'achat a progressé de 8,59 % entre 2007 et 2024. C'est 3,5 fois moins que l'augmentation des dix-sept années précédentes, entre 1990 et 2007, qui était de 29,75 %.
Ce ralentissement sévère s'est accompagné d'une dégradation des gains de productivité : selon la Banque de France, les gains de productivité calculés sur la population en âge de travailler sont passés de 1,5 % en moyenne entre 1998 et 2007 à 0,4 % entre 2019 et 2023.
Le discours dominant inverse donc la réalité. La crise politique française ne peut se comprendre indépendamment des conditions de ce qui constitue le mouvement fondamental qui organise les sociétés capitalistes, l'accumulation du capital. Le ralentissement de cette accumulation conduit à des perturbations qui, nécessairement, ont des impacts politiques.
Le pays, comme, du reste, l'économie mondiale, ne s'est jamais remis de la crise de 2007-2008. Le « gâteau » augmentant désormais de plus en plus lentement, le combat pour son partage est nécessairement plus âpre. Pendant les années 2010, les politiques monétaires et la radicalisation des politiques néolibérales permettent d'assurer une redistribution favorable au capital. Les alternances de cette époque, en 2012 et 2017, sont alors de pure forme : la politique poursuivie est celle de l'affaiblissement du monde du travail (réformes du marché du travail), le soutien direct au capital (réformes fiscales de 2018) et la pression sur l'État social (santé, retraite, chômage).
Mais la croissance ne repart pas davantage que la productivité. La crise sanitaire et ses suites inflationnistes achèvent alors d'affaiblir la capacité des économies à produire de la valeur dans le cadre néolibéral, c'est-à-dire dans celui du marché concurrentiel international. Au sein du capital, cette nouvelle étape dans la crise conduit naturellement à une fragmentation, selon plusieurs lignes.
La dépendance aux exportations
La première ligne de fracture est la dépendance au soutien de l'État. Comme l'a montré une étude récente, l'État français avait déjà été mis très largement au service du capital durant les années néolibérales. Des transferts massifs ont été organisés vers le secteur privé dès les années 1990. Mais au début des années 2020, le mouvement s'accélère et s'amplifie avec de grands plans de relance et de nouvelles exonérations fiscales. Certains secteurs deviennent hautement dépendants de ces aides comme l'industrie et le commerce.
La deuxième ligne de fracture est la dépendance aux exportations. Certains secteurs, dans le cas français les plus grandes entreprises, profitent de leur exposition aux marchés internationaux. Ils n'ont donc aucun intérêt à une politique de défense du marché intérieur. Le patron de LVMH, Bernard Arnault, a ainsi pris la défense de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis signé fin juillet, mais, en parallèle, la concurrence internationale fragilise des pans entiers de l'économie française qui réclament davantage de protections.
La troisième ligne de fracture est la capacité à échapper à la concurrence par la mise en place de rentes. Ces rentes peuvent prendre des formes diverses. On trouve des oligopoles classiques, comme dans la finance, la distribution ou l'énergie, mais aussi des formes plus modernes fondées sur l'abonnement qui permet d'imposer une vente indépendamment de la consommation réelle de biens et de services. L'existence de ces secteurs est devenue évidente avec l'inflation des années 2022-2024, qui a principalement été causée par la hausse des profits dans certains secteurs.
La réalité est encore plus complexe que ce qui est décrit ici, mais, globalement, la fragmentation des intérêts du capital est un phénomène classique en cas de crise structurelle du capitalisme. Dans son ouvrage sur la crise économique allemande des années 1930, Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus (Suhrkamp, 1973, à paraître en français prochainement sous le titre Industrie et national-socialisme aux éditions La Tempête), le philosophe et historien allemand Alfred Sohn-Rethel décrit comment la crise de 1929 avait conduit à fragmenter l'économie allemande en deux camps : le camp monopoliste favorable à l'autarcie qu'il appelle le « camp du Harzburg »,du nom de l'alliance entre les nazis et les conservateurs, et le camp exportateur qu'il appelle le « camp de Brüning », du nom du chancelier austéritaire qui a gouverné de 1930 à 1932.
Un phénomène comparable se produit dans la France des années 2020, mais la question centrale y est celle du budget de l'État. Ce dernier doit soutenir massivement des secteurs entiers, alors même que la fin du soutien des banques centrales aux marchés conduit le secteur financier à demander des garanties aux États pour assurer sa rente. Globalement, les secteurs rentiers appellent à réduire le rôle de l'État parce qu'ils prétendent à la remplacer et qu'ils font de la baisse des impôts leur priorité.
Un conflit autour du budget au sein du capital devient donc inévitable. En schématisant, le secteur financier réclame une réduction rapide du déficit pour garantir leurs actifs, tandis que plusieurs secteurs, du commerce à l'industrie, réclament la poursuite des aides massives. Pour l'économie française, une telle contradiction est hautement dangereuse. Le modèle économique français repose sur deux pôles opposés : une mince couche de « champions » de l'exportation et une profonde financiarisation. Ce sont précisément ces pôles qui s'opposent sur le budget.
La stratégie unitaire du capital
Pour conserver leur position de défenseurs du camp du capital, les anciens néolibéraux, c'est-à-dire ce que les observateurs politiques ont appelé le « bloc central », tentent de maintenir coûte que coûte la cohérence interne du capitalisme français. C'est d'ailleurs une différence notable avec la stratégie de Brüning qui, en 1930-1932, assumait, dans sa politique de soutien aux exportateurs, le conflit interne au capital. Sauf que, dans la France de 2020, ce sont les deux secteurs qui soutenaient jadis le chancelier qui sont en opposition.
Cette cohérence interne du capital peut alors se fonder sur une poursuite de la logique néolibérale, c'est-à-dire sur l'ajustement du monde du travail et de l'État social aux besoins du capital. L'accord proposé est donc simple : on maintient le transfert de fonds de l'État vers le secteur privé, tout en réduisant le déficit par une contribution croissante du travail et des services publics. Bref, c'est une austérité ciblée sur le travail, ennemi commun des deux camps opposés du capital.
C'est sur ce principe que les budgets ont été construits depuis 2022. Et c'est aussi pour cette raison que la situation budgétaire s'est dégradée. Cette politique n'a, en effet, pas pour fonction d'augmenter les recettes fiscales ou la croissance, mais de maintenir à flot une partie du capitalisme français. Alfred Sohn-Rethel résumait ce type de politique par cette formule : il s'agit de gérer une économie en ruine en la perpétuant dans cet état.
Dans ces conditions, le déficit public ne peut que rester très élevé et le « rendement » de la dépense publique, c'est-à-dire son impact sur la croissance, doit rester très faible. Mais, dès lors, cette gestion de la ruine déploie sa propre logique : au fil du temps, la pression pour réduire le déficit par la destruction de l'État social ne peut que croître. Et plus on détruit l'hôpital, l'école, les transports, l'assurance-chômage, plus il faut aller loin.
Or, en parallèle, la situation des ménages ne cesse de se dégrader et rend la pression de cette politique intenable. Les inégalités se creusent, la pauvreté progresse et les salaires stagnent. Selon la Dares et l'Insee, les salaires nominaux ont ainsi progressé de 13 % entre mars 2021 et mars 2025, soit un peu moins que les prix sur la même période (+ 13,7 %). En quatre ans, la rémunération réelle des travailleurs a ainsi grosso modo stagné. Mais, en réalité, cela signifie que, depuis quatre ans, leur niveau de vie est resté dégradé.
Très concrètement, les ménages, et en particulier les plus modestes, sont les principales victimes de la stagnation de l'économie française. Si le PIB stagne et qu'il faut continuer, par l'intermédiaire de l'État, de soutenir le taux de rendement du capital, la conséquence inévitable est que la masse de la population doit voir sa part du gâteau se réduire. On se souviendra, à cet égard, que l'Insee avait souligné en 2021combien l'accès aux services publics et la sécurité sociale participaient à la baisse des inégalités réelles dans le pays. Les attaquer de front, c'est donc mener une guerre sociale pour le compte du capital.
L'impasse du « bloc central »
Logiquement, la stratégie unitaire du capital du « bloc central » est extrêmement impopulaire. Elle ne regroupe, au mieux, qu'un petit tiers de l'électorat et, au fil du temps et du déploiement de cette logique, cette part recule. Le maintien au pouvoir du « bloc central » repose alors uniquement sur la division indépassable des oppositions entre gauche et extrême droite. Mais c'est un pouvoir qui n'a plus de base démocratique solide.
C'est bien pour cette raison que, depuis 2022, il a perdu toute chance d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et que, partant, les budgets doivent passer en force depuis lors. Soit à coups de 49-3 comme en 2022 et 2023, soit après une motion de censure pour le budget de cette année.
Cette situation conduit inévitablement à une crise démocratique. Le régime institutionnel est incapable de régler la réalisation politique de la crise économique, c'est-à-dire l'opposition radicale entre la stratégie d'unité du capital et les vœux de la population. Le « bloc central » est incapable de gérer une telle opposition puisque sa priorité reste l'unité du capital.
Le capital français peut alors faire un choix cynique : puisqu'il existe une opposition entre démocratie et capitalisme, il faut sacrifier la démocratie.
Toute réduction des aides aux entreprises, toute remise en cause des réformes fiscales de 2018 ou tout renoncement à réduire le budget pourraient satisfaire en partie la demande démocratique, mais provoqueraient une fragmentation interne au capital qui affaiblirait le modèle économique du pays et la fonction sociale du « bloc central ». C'est aussi pour cette raison que tout compromis réel est impossible avec la gauche. Quant à l'extrême droite, elle se présente, on le verra, comme une alternative au « bloc central » pour le capital.
L'impasse est donc totale. Et dans ce cadre, la stratégie de François Bayrou se comprend, mais elle est dérisoire. La dramatisation de la dette publique en la réduisant aux effets de la dépense sociale permet de trouver une justification morale et financière au maintien de la stratégie d'unité du capital. Mais c'est en réalité un désastre. La culpabilisation d'une population qui a un sentiment justifié de perte de contrôle démocratique et de perte de niveau de vie conduit à creuser encore le fossé.
La stratégie du « bloc central » est donc un échec démocratique. Certes, il peut encore survivre en détachant une partie de la gauche pour l'intégrer dans la stratégie d'unité du capital. Il peut encore jouer sur la « menace des marchés » pour imposer sa politique au centre-gauche. Mais le problème est que ce transfert ne peut se faire qu'au prix d'un suicide politique tant cette stratégie est impopulaire. Ce n'est donc qu'un report temporaire du problème.
Quelles portes de sortie ?
Globalement, deux résolutions semblent possibles à la crise française. La première est celle d'une reprise du mouvement social pour briser la politique favorable au capital. Mais la situation du capitalisme français est telle qu'aucune solution de compromis de classes ne semble possible. Les PME françaises sont hautement dépendantes des grandes entreprises et de la pression sur le coût du travail.
Si le mouvement social veut être une porte de sortie, il doit donc assumer de penser une autre organisation sociale. Dans le cas contraire, il ne peut qu'être éphémère et stérile politiquement comme cela a été le cas pour le mouvement Nuit debout, celui des « gilets jaunes » ou celui contre la réforme des retraites de 2023. Pour le moment, cette hypothèse est donc quasiment purement théorique. En attendant le 10 septembre, du moins.
L'autre hypothèse est, là encore, décrite avec précision par Alfred Sohn-Rethel : l'extrême droite se présente comme une alternative pour certains secteurs du capital en s'appuyant sur le mécontentement populaire. Dans le cas allemand des années 1930, l'économie de guerre nazie permettait de régler (temporairement et au prix de la guerre) le problème global de valorisation de l'économie de ruine et donc de nombreux secteurs victimes de la crise. Mais elle a supposé d'intégrer de gré ou de force en son sein le secteur exportateur partisan de Brüning.
Dans le cas français, l'extrême droite n'a aucune stratégie économique claire. Mais elle a un atout : sa capacité à mobiliser une partie de l'opinion. Face à l'échec du « bloc central », le capital français peut alors faire un choix cynique : puisqu'il existe une opposition entre démocratie et capitalisme, il faut sacrifier la démocratie. Un régime autoritaire permettrait alors d'appliquer la stratégie d'unité du capital de façon plus efficace et plus violente, avec la mise en place de discriminations, de dérégulations sociales et environnementales, de baisses massives d'impôts sur le capital et de mise à mort de l'État social.
Dans les faits, la traduction politique de ce choix serait la fusion entre le bloc central et son idéologie et l'extrême droite et ses méthodes. Une fusion qui est déjà en cours et dont les capitalistes français, petits et grands, constituent le fondement social.
Cette option est aujourd'hui une épée de Damoclès sur le pays. C'est pour cette raison que beaucoup peuvent encore faire le choix du « moindre mal » du « bloc central ». Mais plus celui-ci reste au pouvoir, plus sa situation se fragilise et plus sa pratique tend vers l'autoritarisme. Aussi y a-t-il urgence à sortir des illusions naïves d'une économie victime de la politique et encore capable de sauver le pays. Et de comprendre que la source de la crise actuelle est avant tout la crise structurelle de l'économie française qui n'est qu'une part de celle du capitalisme contemporain.
Romaric Godin
P.-S.
• « À la source de l'impasse politique, la crise économique ». Mediapart, 5 septembre 2025 à 18h11 :
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/050925/la-source-de-l-impasse-politique-la-crise-economique
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

10 septembre : ce que les assemblées générales révèlent du mouvement

Mouvement nébuleux d'extrême droite, renouveau des gilets jaunes ou réunion de militants de gauche ? Depuis août, des assemblées générales préparent le mouvement de blocage du 10 septembre dans plus de 60 villes. Décryptage.
2 septembre 2025 | tiré de Basta.media
https://basta.media/10-septembre-ce-que-les-assemblees-generales-revelent-du-mouvement
Il se passe quelque chose en cette rentrée 2025. Le 28 août, 400 personnes se sont réunies dans le parc de la Villette, à Paris, pour la première assemblée générale du mouvement du 10 septembre en Île-de-France. Cette même semaine, 200 personnes se sont rassemblées à Montpellier, Grenoble, Lille… 300 à Lyon. Les villes moyennes, voire petites, ne sont pas en reste : 60 personnes à Alès, une cinquantaine au Havre, une soixantaine à Aix-en-Provence et à Lorient, ou encore une vingtaine à Souillac dans le Lot, ou à Romans-sur-Isère. Selon notre décompte, plus d'une soixantaine de villes ont déjà vu éclore des AG.
Le passage du numérique au physique n'était pourtant pas acquis pour le mouvement du 10 septembre. Lancée en plein mois de juillet par un groupuscule complotiste d'extrême droite nommé « Les Essentiels », la première action prévue à cette date n'était autre qu'un appel à « l'auto confinement généralisé ». L'objectif était flou : « reprendre le contrôle sur nos vies » et le mot d'ordre peu propice à la rencontre. Mais au fur et à mesure de l'été, à la faveur de boucles Telegram souvent intitulées « Bloquons tout » ou « Indignons-nous », la couleur politique du 10 septembre a changé.
L'appel des Essentiels a peu à peu été marginalisé. Sa chaîne Telegram peine à dépasser les 500 membres quand les boucles concurrentes « Bloquons tout » avoisinent désormais les 10 000 membres et se multiplient pour couvrir une diversité de zones géographiques. Pour le 10 septembre, l'appel à « l'auto-confinement » et à la grève de la consommation s'est globalement mué en organisation d'assemblées générales qui incitent aux blocages, aux grèves et aux manifestations.
L'objectif de court terme est désormais de s'opposer au « budget Bayrou », qui promet plus de 40 milliards d'euros d'économie en coupant dans le financement de la sécurité sociale, de la fonction publique, ou encore en supprimant deux jours de congé. Le probable départ du Premier ministre le 8 septembre, suite au vote de confiance de l'Assemblée nationale qu'il a lui-même requis, n'y change rien. « On parle d'austérité et plus de Bayrou dans les AG, mais le fond du propos n'a pas changé », explique Pierre*, impliqué dans les AG du 10 septembre à Alès.
Retour des gilets jaunes ?
« Oui, il se passe quelque chose. Il y a une impulsion, ça donne envie de s'y impliquer, mais il est bien difficile de dire ce qui va se passer le 10 septembre », confie Gaël*, militant libertaire ayant participé à l'AG de Montpellier. Pour tenter d'y voir plus clair, de nombreux observateurs comparent le 10 septembre 2025 au 17 novembre 2018, date de début du mouvement des gilets jaunes.
Tout comme ce dernier, le mouvement du 10 septembre est d'initiative citoyenne, indépendant des syndicats et des partis. La présence de militants qui se revendiquent « gilets jaunes » dans les assemblées du 10 septembre aide aussi à tracer un tel parallèle. « La première AG montpelliéraine a été organisée par les gilets jaunes d'un rond point toujours actif dans la ville », explique Gaël*.
Pourtant, les différences avec le mouvement social de 2018-2019 sont nombreuses. À commencer par les liens potentiels avec l'extrême droite. Le début du mouvement des gilets jaunes était marqué par une présence – certes marginale – de militants d'extrême droite. Elle semble cette fois cantonnée à internet. « J'ai vu surtout des militants de gauche et des syndicalistes », estime Cyril*, jeune militant qui a participé à l'AG de Saint-Denis. Gaël abonde : « Pour moi, à Montpellier, il n'y avait pas de "fachos". Par contre il y avait des primo-militants ».
À Paris, ou encore à Toulouse, la nécessité d'éloigner l'extrême droite a été clairement évoquée : « Si on voit une personne réac en AG, on discute, si c'est un militant d'extrême droite, on le dégage », peut-on lire dans un compte rendu. Les thématiques du mouvement tournent autour de la justice sociale, de la démocratie, ou de l'écologie. La question palestinienne, la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies, la nécessité de parler aux quartiers populaires, sont aussi souvent évoquées.
« Je ne trouve pas que le parallèle avec les gilets jaunes soit bon. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. À l'époque, les revendications précises ont mis longtemps à émerger, là on gagne peut-être du temps », suggère Cyril* de Saint-Denis. D'autres sont moins optimistes. « Je ne sais pas encore à quel point le 10 septembre arrivera à sortir du cadre militant, comme a su le faire le mouvement des gilets jaunes », ajoute Pierre*, autrefois très impliqué dans la mobilisation citoyenne à Alès.
Chez les indés
La revue de presse du journalisme engagé : une sélection d'enquêtes, de récits, et d'alternatives parues dans la presse indépendante, directement dans votre boîte mail.
Mon adresse email :
Entrez votre adresse email...
En m'inscrivant j'accepte la politique de confidentialité et les conditions générales d'utilisation de Basta !
Partis de gauche et syndicats en appui
Autre différence notable avec le mouvement au gilet fluo : le rapport aux partis politiques, aux syndicats et organisations classées à gauche. S'ils étaient restés distants, voire méfiants à l'approche du 17 novembre 2018, les partis de gauche (PC, LFI, PS, EELV) et les syndicats (Solidaires et CGT) ont cette fois signifié leur soutien au mouvement du 10 septembre, avec plus ou moins d'insistance. Attac ou les Soulèvements de la terre ont fait de même. Les partis de droite et le RN se sont au contraire éloignés de ce dernier, voire l'ont condamné.
Dès le début du mois d'août, plusieurs fédérations de la CGT, comme la FNIC-CGT (industries chimiques), la CGT commerce et service, ou certaines unions départementales, comme celle du Nord, ont de leur côté appelé à une grève le 10 septembre. Ces organisations ont pour point commun de se montrer critiques de la stratégie confédérale de la CGT.
Leurs appels ont peu à peu été appuyés par diverses unions locales ou syndicats d'entreprises. Finalement, le 26 et le 27 août, la confédération CGT, qui a réuni ses fédérations et ses unions départementales, a décidé d'inclure le 10 septembre à son agenda de mobilisation du mois. Pas un appel ferme à la grève mais une incitation à « débattre avec les salariés et à construire la grève partout où c'est possible », qui montre une sympathie pour le mouvement citoyen.
Côté Solidaires, de grosses fédérations professionnelles (Sud-Rail, Sud-Industrie, Sud-PTT et Finances publiques) ont également appelé à cesser le travail ce jour-là. Le 27 août, l'union syndicale Solidaires tout entière a finalement opté pour un appel à la grève et au blocage. La Confédération paysanne s'est elle aussi jointe au mouvement.
La date du 10 septembre n'a toutefois pas été retenue par l'intersyndicale (FO, CFDT, CFE-CGC, Solidaires, CGT, CFTC et UNSA) qui lui a préféré celle du 18 septembre pour une « journée de mobilisation y compris par la grève et la manifestation ». Mais des initiatives intersyndicales de plus petite ampleur sont à l'œuvre. À l'appel du STJV, de Solidaires Informatique et de la CGT (syndicats minoritaires dans le secteur), les salariés de l'informatique, du conseil et des bureaux d'études se réuniront le 8 septembre à la Bourse du travail de Paris pour préparer la grève ensemble.
En Seine-Saint-Denis, les syndicats enseignants de la FSU, de Solidaires et de la CGT ont signé un communiqué commun pour appeler à la grève le 10. « Dans mon secteur, il est très facile de parler du 10 septembre avec les collègues », témoigne Cyril qui travaille dans la fonction publique territoriale. De même, « les syndicalistes sont aussi présents dans les AG. À Paris, ils interviennent en leur nom, parlent de la grève et de leur secteur », confirme Quentin*, néo-militant syndical à Paris.
Quelles actions ?
En attendant le 10 septembre, les actions se préparent dans les AG et les boucles Telegram. L'une d'entre elles pourrait même intervenir avant la date fatidique. « Le 8 septembre à 20h, retrouvons-nous sur la place des Terreaux pour une grande fête populaire : le pot de départ de Bayrou ! Une soirée pour créer du lien, s'amuser et s'unir avant le 10 septembre », résume un post Telegram de la chaîne Lyon Insurrection, suivie par 10 000 personnes. Cet appel à rassemblement devant les mairies s'est déjà dupliqué dans plusieurs villes.
Et le jour J ? « On a prévu un rassemblement le matin sur une des places principales de la ville. L'idée est de se rendre visible et de rassembler un maximum de gens pour décider de ce qu'on fait », détaille Pierre d'Alès. À Paris l'AG d'Île-de-France n'avait pas vocation à fixer d'action, prérogative plutôt dévolue aux AG de villes. « Les initiatives proposées différent forcément en fonction des profils des gens. Les syndicalistes parlent de grève quand d'autres évoquent des occupations de rond point ou des blocages symboliques. Pour le moment à Montpellier il semble qu'il y aura des blocages le matin, puis un rassemblement dans l'après-midi pour se compter et enfin une AG », énumère Gaël.
*Les militants interviewés dans cet article ont souhaité rester anonymes.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.