Derniers articles

Rodéo sanglant et opportunité pour le ministre des Finances canadien

Vous trouverez une communication à l'attention de mon député et ministre fédéral des Finances, M. François-Philippe Champagne.
Photo Serge D'Ignazio
Shawinigan, 11 septembre 2025
À l'attention de : M. François-Philippe Champagne
En ce moment se déroule l'un des plus importants festivals western du pays, celui de Saint-Tite, dans la circonscription de mon député et ministre fédéral des Finances, M. François Philippe Champagne. Événement haut en couleurs qui rassemble des milliers de citoyens canadiens. Vous êtes venus pour y serrer des mains et exposer votre gentillesse. Au même moment se déroule l'une des plus horribles histoires de notre pays, celle du génocide d'un peuple et la complicité de notre gouvernement. Vous y brillez par l'absence de vos actions ; évitez les mains rachitiques ou ensanglantées, sans exposer de solidarité.
En fait, vous n'êtes pas absent du conflit palestinien puisque notre gouvernement entretient des liens avec des compagnies impliquées de près ou de loin avec les massacres en cours et le nettoyage ethnique de la région. Le Canada tire même profit de la situation. À mots couverts par des intérêts pécuniaires et régionalistes, vous chuchotez gentiment votre désapprobation.
À titre d'individu et dans votre travail, vous portez de lourdes responsabilités et effectuez avec docilité, les tâches demandées. Vous financez une nouvelle course à l'armement sans y joindre de forts gestes politiques et économiques en faveur de la paix et du dialogue (sauf exception de l'Ukraine). En ne faisant que la tâche qui vous incombe vous semblez oublier la complexité sociale et les impacts de vos actions. Sans le savoir ou en ne cherchant pas à le savoir, vous menacez notre sécurité locale et globale. Votre inaction radicale à l'égard du génocide alimente le conflit et légitime les régimes autoritaires de ce monde, dont certains sont déjà à nos portes. Cela m'apparaît davantage préoccupant que des tarifs douaniers. Avez-vous sombré dans le piège de la banalité du mal ? Un état d'esprit qui suspend la pensée critique.
M. Champagne, je vous implore de prendre un instant, afin de « ressentir » : regardez, écoutez, respirez et touchez à l'horreur du génocide actuel. Je souhaite que votre carapace sociale, votre statut social, s'effrite un peu pour laisser passer le soleil et éclairer votre humanité. Je fais appel au retour de votre Être politique afin d'incarner un réel citoyen responsable, connecté aux Autres. En tant que ministre des finances et proche du Premier ministre Carney, vous avez un rôle de premier plan dans ce conflit et une opportunité en or pour dynamiser la paix. Vous avez même une obligation légale de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait « Jamais plus » de génocides comme l'ont répété tour à tour des survivants juifs, rwandais, bosniaques, guatémaltèques…
Lors du prochain Festival western de Saint-Tite, j'ose espérer ne pas seulement rencontrer un gentil politicien, mais un digne citoyen en selle pour nous défendre et promouvoir nos intérêts et nos valeurs de Vivre-ensemble.
Humainement vôtre.
Sébastien Bois, Citoyen de Saint-Maurice / Champlain
P.S. Je remercie la philosophe juive Hannah Arendt qui m'a inspiré ce texte à votre attention.
C.C.
Premier ministre du Canada, Mark Carney
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada a une occasion et une responsabilité d’être un artisan de la paix

Le Congrès du travail du Canada exhorte le premier ministre Carney à réitérer sa déclaration du 30 juin reconnaissant le statut d'État de la Palestine lors de 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ce mois-ci.
« Le Canada a une occasion et une responsabilité d'être un artisan de la paix. En temps de conflit, notre engagement à l'égard de la diplomatie, du droit international et des droits de la personne doit orienter nos actions en vue d'un règlement juste et durable », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC, dans une lettre adressée au premier ministre en juin, qui appelait également à la cessation de toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza et à la facilitation immédiate de l'acheminement de l'aide humanitaire.
Le groupement Global Unions appelle à la reconnaissance de la Palestine
À la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs fédérations syndicales internationales appellent tous les gouvernements à reconnaître l'État de Palestine.
La Confédération syndicale internationale (CSI) demande également que des mesures soient prises d'urgence pour protéger les civils, notamment une force internationale de maintien de la paix à Gaza.
Le groupement Global Unions, représentant plus de 200 millions de travailleurs et de travailleuses dans le monde par le biais de la CSI, de neuf fédérations syndicales internationales (FSI) et de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC), soutient pleinement, dans sa déclaration, l'engagement croissant des gouvernements à reconnaître la Palestine. D'ores et déjà, 147 des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont reconnu l'État de Palestine.
Le secrétaire général de la CSI, Luc Triangle, a déclaré : « Nous soutenons les moyens pacifiques et diplomatiques pour concrétiser la solution des deux États – un État d'Israël sûr et un État de Palestine souverain vivant côte à côte dans une paix juste et durable. Cela suppose la reconnaissance de la Palestine et, surtout, la fin de l'occupation. Dans cet esprit, la proposition d'établir une force internationale de maintien de la paix à Gaza constitue un pas dans la bonne direction. Cette mesure concrète vise à protéger les civils, à stabiliser la situation sur le terrain et à frayer la voie à un processus politique crédible. »
« Cet appel est fondé sur l'engagement du mouvement syndical en faveur de la démocratie, des droits humains et de l'État de droit. La reconnaissance de la Palestine ne doit pas être retardée ni considérée comme une récompense à l'issue des négociations ; elle constitue un élément essentiel d'une paix juste et une étape nécessaire en vue du rétablissement de la parité d'estime et de pouvoir à la table des négociations. »
« Les travailleurs et les travailleuses du monde entier ont le droit de vivre dans la liberté, la dignité et la sécurité. Le peuple palestinien ne mérite rien de moins. La reconnaissance de la Palestine et l'adoption de mesures concrètes visant à protéger les civils et à mettre fin à l'occupation sont les moyens dont dispose la communauté internationale pour contribuer à traduire les déclarations de principe en actions en faveur de la paix et de la justice ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qui inspire vraiment François Legault en matière de droits syndicaux ?

Face à tout gouvernement et à ses remaniements, il est toujours possible d'opiner à un côté aigre ou amer, tout en essayant aussi de virevolter en découvrant un autre côté plus facile à avaler, parce que meilleur au goût et donc plus sucré. Allons-y dans la succession, en nous intéressant particulièrement ici aux propos tenus lors du récent remaniement ministériel du gouvernement de la CAQ en ce qui concerne les syndicats.
Le difficile à avaler
Lors de la séance de dévoilement de son nouveau Conseil des ministres, le premier ministre, monsieur François Legault, y est allé d'une déclaration de guerre à l'endroit des syndicats. Il a confié au ministre du Travail, monsieur Jean Boulet, le mandat suivant : « moderniser le régime syndical ». Cela fait plusieurs années que monsieur Legault rêve de moderniser – en dépeçant — les droits des salariéEs syndiquéEs. Il faut lire à ce sujet l'article de Maude Messier paru dans « L'Aut'journal », le 12 mars 2012 (il y a plus de 13 ans), intitulé : « Legault et les politiques antisyndicales conservatrices ». Déjà, à cette époque, il annonçait vouloir restreindre le champ d'action et d'intervention des organisations syndicales à la seule négociation de la convention collective. Autrement dit, fini l'action politique syndicale. Dans son annonce, toujours à cette époque, s'ajoutaient le vote secret obligatoire et le dévoilement des états financiers.
Monsieur Legault sait qu'il n'est plus au pouvoir pour très longtemps. L'avenir de sa coalition politique se présente dans un horizon — très — limité dans le temps. Il est même question, à ce moment-ci, sur la base des sondages d'opinion, à une disparition de la scène parlementaire de la CAQ.
Mais pour ce dernier droit avant l'élection générale d'octobre 2026, monsieur Legault semble déterminé à mener ses derniers combats réactionnaires et conservateurs. Son discours de présentation de ses ministres relevait d'une rhétorique partisane pouvant être jugée déplacée : « mettre nos culottes », « traitement choc », « couper profondément dans la bureaucratie », « faire le ménage », etc.. Voilà des formules indiquant « un virage à droite », pour un gouvernement qui n'a jamais campé ni à gauche ni au centre… Bref, rien de nouveau sous le soleil de ce côté « amer ».
Manifestement, l'homme d'affaires François Legault, devenu par la suite politicien, ne semble jamais avoir compris le rôle véritable des syndicats dans notre société. Le syndicalisme, dans une société capitaliste, correspond à un contrepoids indispensable pour améliorer les conditions de vie et d'existence des salariéEs. Il s'agit de la seule véritable organisation qui appartient en propre aux salariéEs pour résister à l'arbitraire patronal et étatique. L'action syndicale ne peut en aucun cas se limiter à la seule entreprise. Il s'agit d'une institution qui doit intervenir sur le terrain politique en vue de réformer le système économico-social. Vouloir restreindre le champ d'action des syndicats à la seule entreprise et à une simple question de négociation d'une convention collective montre que la pensée sociale de monsieur Legault s'inscrit dans une logique corporatiste pouvant même remonter aux années trente du siècle dernier. Se pose dès lors la question suivante : monsieur Legault a-t-il comme modèle d'inspiration, en apportant les nuances qui méritent d'être appliquées, deux hommes politiques honnis de cette époque, dont les initiales sont B.M. et A.H. ? En passant, l'un dominait en Italie, l'autre en Allemagne.
D'accord, la dernière allusion s'avère forte, mais tient compte d'une volonté à enrégimenter les travailleurEUSEs en vue de cette guerre économique destinée à engraisser un trésor, dont quelques-unEs en profiteront plus que les autres. Nous sommes alors loin d'une éthique politique selon laquelle le tiers-État doit agir en responsabilité de TOUTES et tous, parce que l'autre doit passer avant soi. À ce titre, le syndicalisme représente un garde-fou contre les dérives dictatoriales de tout gouvernement, surtout celui croyant, comme dans le cadre actuel, détourner la responsabilité publique vers une culpabilité individuelle, advenant des difficultés subies par le régime. Cela veut donc dire une déresponsabilisation accrue de l'État envers ses citoyenNEs, afin de se concentrer sur les attentes des entreprises, à savoir des personnes morales qui devraient un jour voter aux élections, si on se fait prophète d'un tournant historique plausible en raison de l'idéologie capitaliste qui domine et peut-être même à l'approche de son apogée.
Après cette montée émotive, comment maintenant entrevoir le côté sucré ? Voilà une tâche ardue, mais non impossible.
Ce qui s'avale mieux
Bien que l'État ne soit pas une entreprise et doit accepter la présence des syndicats dans le paysage, il n'y a pourtant rien de surprenant à voir monsieur Legault s'en prendre à eux, dans la mesure où, aux yeux de certaines personnes critiques, ils n'ont pas fait leur travail depuis quelques décennies. Autrement dit, malgré des parutions dans les médias, les récentes grèves et des revendications au nom de milliers de travailleurEUSEs syndiquéEs, l'impression générale a été de constater une certaine « bonne entente » avec le patronat, qui a pu pousser davantage la note sans rencontrer trop d'obstacles. Les grandes centrales ont alors engraissé leur propre trésor, et ce sur le dos de leurs membres, sans chercher à se renouveler et à s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Par conséquent, ce traitement choc que désire réaliser le premier ministre Legault servirait peut-être aussi d'électrochoc à un renouvellement souhaitable de domaine syndical.
Par ailleurs, l'État québécois possède ses limites, surtout sur le plan budgétaire. Dans une société où les individus en demandent toujours plus, il faut savoir un jour cibler l'horizon de la capacité de payer, afin de garantir un avenir. Tant et aussi longtemps que nous évoluerons dans un régime capitaliste et néolibéral, le facteur croissance laisse croire en une assurance de pouvoir répondre aux besoins communs. Mais il faut être ingénieux, afin de faire face aux difficultés économiques. Augmenter la taille de l'État signifie de détourner des fonds vers des structures au lieu de répondre directement sur le terrain ; autrement dit, on ne peut demander à un éléphant de courir comme le léopard. Et l'embonpoint gouvernemental accentue les échelons hiérarchiques et les risques de perte de contrôle. Voilà aussi ce qui peut expliquer certaines bévues dans la gestion des grands projets, alors que l'information peut se perdre entre les échelons et démontrer ainsi l'inefficacité des organes de l'État et de ses avatars. Ce travail d'assainissement exige donc un « tour de force » nécessaire, alors que les syndicats doivent mettre l'épaule à la roue. Dans ce contexte, leur tâche consiste à garantir le meilleur milieu de travail, avec des conditions d'emploi dignes d'un gouvernement innovateur. Toutes les travailleuses et tous les travailleurs des secteurs public et parapublic de la province jouiraient des meilleurs environnements de travail, si l'État était optimisé tant dans sa taille que dans son mode de fonctionnement. Ainsi, il faudrait orienter le « traitement choc » vers une réforme de l'administration gouvernementale au sens large, non dans une visée consistant seulement à « sabrer » dans la masse salariale et donc dans la masse des travailleurEUSEs. Le gouvernement doit accepter, encourager et reconnaître le rôle des personnes dans la fonction publique qui décident d'agir en tant que lanceurs d'alerte. Sabrer dans le nombre de fonctionnaires est une simple et bête opération comptable, qui n'assure aucun résultat sur le plan de l'efficacité gouvernementale.
Étiqueter cette démarche énoncée par le premier ministre lors de son remaniement ministériel comme étant un tournant vers la droite serait réducteur et facile à dire. Il faudrait peut-être profiter de l'occasion, afin d'effectuer un tournant vers le haut — en pelletant quelques nuages —, dans le sens d'une transformation idéologique plus profonde, là où le régime capitaliste serait enterré pour y faire pousser la graine d'une orientation nouvelle valorisant un bien-être collectif — et non totalisé — plutôt qu'un bien-être constamment recherché, parce que la croissance et l'accumulation ne nous rassasient jamais. À ce titre, le syndicalisme actuel doit se responsabiliser non seulement envers leurs membres, mais envers toute la population, et ce dans l'avancement de notre société par un marché du travail ouvert à la réalisation d'un bien-être différent.
Que monsieur Legault aspire ou non à remporter un autre mandat, il doit non pas se faire ennemi des syndicats, mais travailler avec eux à ce tournant nécessaire du régime sociétal que le Québec a besoin. Ainsi, les changements qu'il propose seront meilleurs au goût.
Conclusion
Il n'est jamais vendeur de se lancer dans une élocution en disant vouloir « contrôler les autres », « couper profondément dans les emplois » ou y aller de « traitement choc ». Minimiser le rôle important des contre-pouvoirs ou oser même envisager de les museler, s'avère totalement opposé à ce pourquoi nous évoluons en démocratie. Les syndicats ne sont pas parfaits, comme tout gouvernement ne l'est pas non plus. Dans l'adversité, il faut savoir s'allier, communiquer, coopérer, au lieu d'imposer des idées, de ramener même au jour des façons de faire rétrogrades qui rappellent en plus de mauvais souvenirs. Automatiquement, un goût amer nous vient. Et ce côté nous pousse vers des émotions vives, susceptibles d'animer des diatribes qui peuvent être justifiées jusqu'à un certain point. Mieux vaut ouvrir les yeux, porter le regard sur ce qui ne fonctionne pas, au-delà des seuls besoins pécuniaires, afin d'accepter les lacunes du régime actuel. Déjà là, le goût s'améliore quelque peu. De nouvelles habitudes peuvent être prises, en reconnaissant la valeur à la fois des syndicats et du patronat, parce que chacun participe à faire du Québec un environnement meilleur. Viser le sucré suppose d'édulcorer certaines prises de position, d'un côté comme de l'autre. Comme dirait un vieux sage : « Mieux vaut le sucré du raisin sec que de boire le contenu de la bouteille devant soi, dont la plus petite gorgée soit-elle révèle son vinaigre ».
Guylain Bernier
Yvan Perrier
Dimanche, 14 septembre 2025
20h
Référence
Messier, Maude (2012). Legault et les politiques antisyndicales conservatrices. L'Aut'Journal. 12 mars. Repéré à https://www.lautjournal.info/20140312/legault-et-les-politiques-antisyndicales-conservatrices. Consulté le 14 septembre 2025.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La FIQ lance son nouveau magazine La Résonance !

La FIQ dévoile aujourd'hui la toute première édition de La Résonance, un magazine pensé pour ses membres et consacré aux grands enjeux de société qui traversent le réseau de la santé.
Les membres recevront la version papier dans leur boîte aux lettres au cours des prochains jours et peuvent dès maintenant le découvrir en ligne en suivant ce lien.
Pour cette première édition, la réforme Dubé s'impose comme thème central. Pourquoi le ministre tente-t-il une nouvelle refonte du réseau de la santé alors que les précédentes réformes n'ont pas donné les résultats attendus ? Pourquoi choisir de modifier les structures plutôt que d'investir dans les employé-e-s et, par le fait même, dans les services à la population ? Autant de questions auxquelles ce numéro propose des pistes de réflexion.
La Résonance a été créée pour offrir aux membres des textes clairs et stimulants, afin de mieux comprendre les grands dossiers menés par la Fédération. Ce projet vise à rejoindre les membres partout au Québec, à transmettre de l'information pertinente et à mettre en lumière les luttes syndicales et féministes qui nous animent.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Moratoire de quatre générations

ENFIN, après deux décennies de luttes citoyennes, le projet de loi 21 exige de fermer définitivement les puits de gaz de schiste fracturés de la province.[1] On doit se rappeler qu'après avoir acheté notre sous-sol à vil prix entre 2004 et 2010, les gazière proclamaient victorieusement la révolution des gaz de schiste par une série de trois soirées dites « d'information » tenues durant le mois de septembre 2010. Mal leur en prit car ces conquistadors ont eu la désagréable surprise de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus.
L'opinion publique québécoise, indignée par leurs méthodes douteuses, a tordu le bras au gouvernement de M. Charest pour exiger d'être véritablement consultée au cours d'audiences du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE). Malgré un mandat très restreint, ce BAPE a marqué un temps d'arrêt ; cette pause nous a permis de nous mobiliser tout en comblant un grave déficit démocratique. Il a fallu un courage exemplaire d'une multitude de personnes qui ont oeuvré avec un sens du bien commun extraordinaire pour arrêter le rouleau compresseur de l'industrie gazière.
Lors d'une audience de ce BAPE, la vice-présidente de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a lancé : « Je m'appelle Kim Cornelissen et je demande un moratoire d'une génération ! ». Plusieurs autres jeunes ont défilé les uns à la suite des autres avec la même phrase faite au nom de la jeunesse car ce sont eux qui auront à vivre avec les conséquences à long terme de ce projet de 20 000 puits fracturés au Québec. Heureusement, le commissaire du BAPE ne s'est pas formalisé de cette mise en scène qui flouait la règle de fonctionnement quasi-judiciaire du BAPE où il est interdit de manifester son approbation ou son désaccord.
Cette idée d'un moratoire a germé. Des pancartes rouges arborant le slogan « Non aux gaz de schiste ; un moratoire dès maintenant » se sont multipliées de façon exponentielle. Au printemps 2011, un groupe de jeunes ont décidé de faire un pèlerinage de Rimouski jusqu'à Montréal pour réclamer ce moratoire et en faire la promotion.[2] Le 18 juin, une grande manifestation devait les accueillir à leur arrivée dans la métropole.[3]
J'étais responsable d'un autobus qui se rendrait à Montréal pour appuyer les manifestants.[4] C'est avec stupeur que je vois arriver un groupe familial qui avait participé activement à notre manif du 28 mai devant le « puits qui fuit » de La Présentation.[5] Ce qui me sidère, c'est que Marie-Soleil, qui a accouché voilà seulement 4 jours, arrive avec son nouveau-né dans une poussette ; elle est accompagnée par sa mère, son père et sa grand-mère !
Je sais que pour une jeune femme en pleine forme dans la vingtaine, accoucher est un processus naturel. Aujourd'hui, le trajet en autobus prendra environ une heure dans chaque sens, avec en plus une grosse manifestation bruyante ponctuée par de nombreux discours. Mille scénarios catastrophes se bousculent dans ma tête ! Ça implique qu'une fois en route, on ne pourra pas revenir à cause des autres participants. D'une voix la plus neutre possible, je leur demande ; « Êtes-vous certains de vouloir y aller avec le bébé ? » On me répond : « C'EST POUR LE BÉBÉ QU'ON LE FAIT ! »
Cette réplique me frappe avec la force d'un train lancé à toute vapeur ; le but premier de la lutte contre les hydrocarbures, c'est de protéger la génération naissante ! Dilemme ! Que faire ??? Je connais l'implication sociale de cette famille. Le bébé, Étienne, est accompagné de 4 adultes responsables et bien équipés. C'est avec la gorge nouée par le poids de cette décision que je les invite à monter à bord ! Je me sens responsable de ce poupon. Tout au long de la manifestation, j'étais comme une ourse méfiante qui est à l'affût de tout indice de danger qui pourrait menacer son petit ; un contremanifestant qui aurait voulu faire du grabuge aurait reçu un coup de griffe de l'ourse protectrice !
Dans mon coeur, cette journée du 18 juin ne fut pas simplement le moratoire d'une génération, mais celui de quatre générations qui unissaient leurs forces pour empêcher le saccage de la vallée du Saint-Laurent par la politique du « Drill, baby, drill ». L'action de cette famille rejoint le discours de la jeune Greta Thunberg qui disait au siège de l'ONU le 23 septembre 2019 : « Vous avez volé nos rêves avec vos paroles creuses...Des écosystèmes entiers s'effondrent et tout ce dont vous nous parlez, c'est d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle ! Comment osez-vous ! [6]
Ainsi va la vie ! Les aînés doivent assurer l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, le bébé Étienne est devenu un adolescent de 14 ans alors que son arrière grand-mère, Denise, est malade. La fermeture définitive des puits, exigée par la loi, se veut un moratoire permanent. Au Québec, cette solidarité exemplaire a empêché la fracturation hydraulique à grande échelle de notre sous-sol. Espérons que cette même solidarité saura voir le jour dans d'autres terres saccagées comme la Pennsylvanie, le Texas ou l'Alberta….
PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT !
Gérard Montpetit
Comité Non Schiste La Présentation
le 10 septembre 2025
2] https://www.journaldequebec.com/2011/05/16/une-marche-de-rimouski-a-montreal
5] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/517572/manif-schiste-presentation
6] Greta Thunberg par Maëlla Brun, 2020, Édition de l'archipel, 237 pages. Citation à la page 122
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les infrastructures de Stablex prises d’assaut par une mobilisation populaire à Blainville

Blainville, 13 septembre 2025 - Samedi dernier, plusieurs centaines d'habitants de Blainville et des municipalités environnantes ainsi que des alliés venus de diverses régions du Québec ont pris pour cible le principal site de la compagnie de gestion de déchets toxiques Stablex, à Blainville.
Sous le signe du Grand Héron et au rythme d'une fanfare, les manifestants ont contourné le dispositif de sécurité et sont introduits sur le site pour le redécorer gaiement aux couleurs de la résistance populaire et pour perturber l'activité économique de la compagnie. « Séance de désintox » peut-on maintenant lire sur l'un
des bâtiments de la compagnie. Une dizaine de véhicules de service de la compagnie ont aussi été mis hors d'état de nuire. La pesée, passage obligatoire des camions chargés de boue toxique, a aussi été visée. Les manifestants ont détruit sa façade et endomagé le matériel électronique. Cette action de résistance est une
réponse à l'appel des Soulèvements du fleuve à bloquer, désarmer et à démanteler l'expansion industrielle prédatrice qui ravage les territoires.
Une mobilisation de longue date
Cette manifestation s'inscrit dans une longue mobilisation locale et écologiste contre l'entreprise Stablex, filiale de la multinationale américaine Republic Services. Les habitants de Blainville et leurs alliés ont mené de nombreuses actions durant les dernières années afin d'exiger que cesse l'importation de déchets dangereux près de leurs foyers : rencontres citoyennes, manifestations, dépôts de mémoires, échantillonnage citoyen, coups d'éclat, formations en résistance citoyenne, blocages... Une coalition de groupes (Action Environnement Basses-Laurentides, Coalition Alerte à l'enfouissement Rivière-du-Nord, Eau Secours, Mères au front Rivière-Des-Mille-Îles, Mouvement d'action régionale en environnement, Société pour vaincre la pollution) ainsi qu'une coalition citoyenne ont été formées afin de résister à la compagnie toxique.
Un procédé défaillant
Les citoyens de Blainville, le BAPE, ainsi que des commissions d'analyses externes sont formels : le procédé de Stablex n'est pas "stable et inerte", contrairement à ce qu'affirme la multinationale. Les cellules d'enfouissement requièrent une surveillance à perpétuité pour gérer le lixiviat toxique qui s'écoule de ceux-ci, et les effets du
temps, du gel et du dégel auront vite raison des matériaux d'isolation des bassins, qui ne pourront plus protéger les réserves d'eau de Blainville. Les conséquences sont déjà visibles : des niveaux de cadmium 320 supérieurs aux normes québécoises avec des concentrations alarmantes d'arsenic, de cuivre et de zinc sont déjà
observés. Ces résidus toxiques menacent toute la région, des champs agricoles aux cours d'eau qui se jettent dans le fleuve.
Tapis rouge pour l'Industrie asphyxiante
Et pourtant, nous augmentons encore et toujours nos capacités à polluer. Stablex continue de s'étendre pour importer et enfouir toujours plus de déchets issus des industries minière et phamarceutique, des États-Unis, de l'Ontario et du Québec.
Près de 65 hectares d'écosystèmes sensibles, de milieux humides comme la Grande Tourbière ainsi que de zones boisées seront saccagés pour enfouir des déchets toxiques générés par des filières indifférentes à la vie des populations et des prochaines générations habitant le territoire. Le tout effectué avec la complicité gouvernementale qui a fait passer sous bâillon l'expropriation du terrain de la Ville, contre la volonté locale et régionale. Ce projet montre encore que nous n'avons plus rien à espérer de nos institutions publiques et des entreprises privées, et que notre avenir repose sur nos capacités à résister.
Ni ici ni ailleurs : non à l'intoxication et l'exploitation
Ce qui se passe aujourd'hui à Blainville n'est pas différent de ce qui se passe à Rouyn-Noranda, à McMasterville, sur les rives de Contrecœur, sur le terrain vague d'Hochelaga, sur les deux tiers du territoire forestier public, en territoire non cédé. Il s'agit de la même logique : sacrifier le territoire et ses habitants au profit d'une
poignée d'exploitants.
Nous ne souhaitons pas déplacer le problème ailleurs. Nous souhaitons voir se multiplier les résistances locales. Que vous soyez face au Golfe, ou le long des rives du Saint-Laurent, dans les forêts de l'Abitibi et du Nitaskinan ou dans les cantons de l'Est, vous êtes conviés à vous joindre aux Soulèvements du fleuve et aux habitants
en lutte sur le territoire. Toutes ces résistances locales se rapportent à une seule riposte contre l'intoxication et l'exploitation des territoires à nos dépens. Accepter d'élargir nos capacités de stockage de déchets toxiques, c'est se permettre de produire et de polluer toujours plus. Il faut refuser d'augmenter encore et toujours
notre tolérance aux projets destructeurs qui ne répondent qu'à la loi du profit. Le triste devenir qui attend la tourbière est partout le même, si nous n'intervenons pas par tous les moyens possible.
Pour plus d'informations :
Mouvement Soulèvement du Fleuve :
soulevements_du_fleuve@riseup.net
Coalition des citoyens de Blainville contre STABLEX :
coalitioncitoyenscontrestablex@gmail.com
******













******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

1000 personnes rassemblées pour la Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus

Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées cette année à Montréal, Rouyn-Noranda, Jonquière et Québec, pour dénoncer les décisions des gouvernements du Québec et du Canada
8 septembre 2025, Montréal / Tiohtià:ke (Québec) - Depuis maintenant trois ans, les Mères au front et leurs allié·e·s se réunissent pour souligner la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus [2], journée qui vise à rappeler que la pollution de l'air touche tout le monde et menace à la fois la santé mondiale en plus de contribuer à
accentuer la crise climatique.
Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées cette année à Montréal, Rouyn-Noranda, Jonquière et Québec [3], pour dénoncer les décisions des gouvernements du Québec et du Canada qui permettent à des projets industriels tels que la Fonderie Horne, Northvolt, Stablex, le Port de Contrecoeur, de détruire des milieux naturels à haute valeur écologique, de fragiliser la biodiversité, en plus de contribuer à la perte de terres agricoles. Conséquemment, ces projets industriels menacent la santé des québécois·e·s et des canadien·e·s et l'avenir des générations futures. Les enjeux locaux pour lesquels les groupes citoyens militent sont variés, mais menacent
tous le droit de vivre dans un environnement sain, un droit reconnu en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [4]. L'environnement est un bien commun, et essentiel pour la santé des
populations et l'adaptation face à la crise climatique.
Ce dimanche, 7 septembre, les groupes locaux Mères au front et autres groupes citoyens ont organisé des rassemblements créatifs et conviviaux, alliant l'art à leurs causes. Une grande marche a été organisée à Rouyn-Noranda, un sit-in, doublé d'un die-in, ont eu lieu à Montréal, en plus de rassemblements comprenant un die-in se sont tenus à Limoilou et à Jonquière. Plusieurs membres de groupes citoyens, de mouvements partageant les luttes ont pris la parole lors des rasemblements.
«
Nous sommes littéralement l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit et la terre qui nous nourrit. Choisir de la détruire comme le font les politiques du gouvernement Legault, c'est choisir l'auto-destruction. »_ - Laure Waridel, écosociologue et co-fondatrice du mouvement Mères au front
« Nous demandons au gouvernement la révision voire l'abandon des projets de développement industriels comme Northvolt, Stablex, le Port de Contrecoeur et le projet de loi 97 sur le régime forestier qui contribuent à détruire le territoire et la biodiversité ce qui va à l'encontre du bien-être des communautés et de la population. Pas de futur, sans nature ! »_ - Isabelle Senécal, porte-parole pour Mères au front - Montréal
« Le gouvernement du Québec bafoue le droit à la santé et à un environnement sain de nos enfants et de toute la population de Rouyn-Noranda. Nous exigeons que le gouvernement fasse appliquer les mêmes normes pour la qualité de l'air partout sur le territoire »_ - Isabelle Fortin-Rondeau, chargée de mobilisation et de la campagne Rouyn-Noranda
« Tant qu'il y aura de la colonisation, aucun de nous ne pourra être libre. »_ - Karen Lajoie, du Front de Résistance Écologique et de Défense Autochtone (FREDA)
Source
Maude Desbois pour Mères au front
À propos de Mères au front | meresaufront.org [6]
Avec plus de 30 groupes locaux, situés principalement à travers le Québec, mais aussi au Canada et jusqu'en Belgique, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié·e·s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu·e·s de mettre
en place des mesures fortes et immédiates qui s'imposent pour répondre à l'urgence environnementale et à la dégradation des écosystèmes.
Nous osons faire de l'amour, de la beauté, de l'art, et de la colère maternelle, un levier inébranlable de transformation sociale et écologique.
#Mèresaufront
meresaufront.org [6]
[7] [8] [9] [10] [11]
Links :
[1] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=trbe2dk2YmeMQoMAVUWBMub6AaPr2c5e4ppfOTT3PwJQUEx5vDgG8UUA_kV0rWMo-4FEdsa43GDUCWQG9OylSw-kAlFkHtimd4a3HF3fW9PUdkEmjx4ACZJ8M7-BeT53
[2] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=oo7-vD62prurrLAv1kOhXpkMH1oSkd37FfvBqRutHpXYpdPCZD4vudlF7QPSTNot-vxsGeEk2bZe6S-NLEk7U7pesmkh3q4WaEbmAmkdpIzf6LI96QL-5n1J83sYAe9z
[3] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=Ef8_z36kYPevpd2TlZSPzNSvkLM6Tjw-9eNiYRLlULtRDpIypP9MZKocnzVDf95dt6tx5n8Ecw1qrSpOpLnkBQx6A_ujDp3jE95QfKzU5n8lNTQACwoxXPPiV2v6FaLq
[4] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=S5gaq1slugjQCmWwRP6XalDLwPaYIbWfpee0QR3qkHEgYvnvCSDgniBTAksID8g5-OPzwd6oj51Aq3q-9pdY9fg8c92BSn-5IJP0YkFg9Gf_mE8WRqt46IDnWYdAs78t
[5] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=n5JFMsUbqUOieJITKYoszy83ErICmatAUbGDeQJcJ5lEMbxM3w7i_Ksscws8RRZEb7OaIU2mg8iYUpzFd3xlJ9ALL4iYDU-dlRNBPe4VW1u7AsIWm6ithl8p64zN4PlF
[6] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=f9_EdgvN_m4fO0oyTKOYzDLq-0DFnYeiW7ly5DuF3uj1H7xX_GoKgQegnmSQEALoV0j8tqicOjZNOTLjcvzkx2OA_hccrDN87B3yRnvgJPJ-5ZtDD2RB5ad-jrVAQgAO
[7] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=TNtZjS9XtNzn8qmtj4Y019YZQLxYnSqTrU71pbezcRmAPr9OIFBOCMtGTC9jwRUKoXPDCN6viGAcI_X8iiDoxqEsr_mXfmOuffqRUf6qUrZ-3zVq_27lh28eu0_zpAsk
[8] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=BUfoSrdZQwEKalwK30sISPNgTF81pEeJp9-QotBBtWKft-c9hUqrx1omWCqLMJfoH-aHWqnPI5mfW4nqKb72W0d6lKGW-O4_HE4PhmgsmU9tldIc-Y41EnOdt_GdGJty
[9] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=0IjWTS8eanLjneRcp6VUWO9nNLyBM8wOd66_Utuj0poAXMK6Kdg4wkjW_T73WtP9EdIYKNrmZppaMbmfEnmq2ajRDIUHI1XkLwbO--3vSQC8L4foi0VS5cx-kv6Nn87T
[10] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=kzXWpV4DXi-QOjG8BLH4EJ_G5fL5G5INkrYW1b86rFBExeSiLkA3QQVZPW_iI0DuYkg_xDyyCNU7KL8U66HDXpSjQddhB8R-nCTS6FohwfkI3mhDIxjj_KVRJm4Dv1Pc
[11] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=01LnffE4MRkVHx5aLsHnPnFKo4jTKCIHMZhMQQs3P1tns5z55fl775rjf2VEEI8lRu622Q1I9dYMCo6w4dSxkLCnGa3acvonUjR6SgJ9iuey9_cEg3kHW74esq_yIbkO
[12] https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
[13] https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=33aNu2jcfPH_l97vQx5WDkm7yBZOaoLi4qfvWZgQEPngeSU-Z3LojZu0rsnQ1YMu75xRmzpFcXJsm73XEUQWUY2FPw4kC8u-ojf8pYnPor4VVOHacmI42y7Gi2opWD2bR9Fx2FkWfYjZLptXPw8ePw~~
[14] https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=33aNu2jcfPH_l97vQx5WDkm7yBZOaoLi4qfvWZgQEPngeSU-Z3LojZu0rsnQ1YMu75xRmzpFcXJsm73XEUQWUY2FPw4kC8u-ojf8pYnPor4VVOHacmI42y7Gi2opWD2bR9Fx2FkWfYjZLptXPw8ePw~~
[15] https://www.cyberimpact.com?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Stop au Code minier : les océans ne sont pas à vendre

L'heure est grave pour les profondeurs océaniques : ne donnons pas le feu vert à la destruction des grands fonds marins.
L'entreprise minière canadienne The Metals Company tente d'exploiter les grands fonds marins, un territoire vierge et inexploré, par tous les moyens nécessaires. Elle s'est alliée à Trump afin de s'affranchir des négociations internationales et d'inaugurer une nouvelle ère d'extraction destructrice où le profit prime sur la nature et la coopération entre les pays du monde [1] [2].
Le gouvernement canadien doit intervenir sans attendre
Au cours de la dernière décennie, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a travaillé à l'élaboration d'un ensemble de règles – connu sous le nom de Code minier – qui pourrait légaliser l'exploitation minière en eaux profondes et ouvrir de vastes zones de l'océan aux activités extractives [3].
Mais en avril dernier, Trump, par le biais d'une série de décrets, a unilatéralement accéléré l'octroi de permis d'exploitation minière en eaux profondes. Ce faisant, il a ouvert la voie aux projets miniers de Gerard Barron, aspirant tech bro et PDG de The Metals Company – et ce, malgré l'absence de règles en place [4]. Ce nouveau développement n'a rien d'une innovation : il avalise le pillage des fonds marins, et nous ne pouvons pas tolérer cela.
Jusqu'à présent, le gouvernement de Carney est resté dangereusement silencieux, mais il est temps pour le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Anand d'agir de manière résolue en faveur de la protection des océans.
Alors que la science met en garde contre les dommages irréversibles que causerait l'exploitation minière des fonds marins et que Trump et Barron persistent dans leur comportement irresponsable, il est désormais clair que cette industrie est incompatible avec le bien-être des océans et qu'elle ne devrait même pas voir le jour [5].
Nous demandons à Carney et à Anand de :
– Renforcer le soutien du Canada à un moratoire international sur l'exploitation minière en eaux profondes ;
– S'opposer à la mise en œuvre d'un Code minier bâclé qui légaliserait l'exploitation des fonds marins ;
– Faire obstacle à la cupidité de Trump et de The Metals Company.
Les grands fonds marins ne sont pas une ressource à piller pour le profit. Ajoutez votre nom pour exiger que le Canada empêche les industries extractives de s'en emparer.
Sources
[1] ‘Unleashing America's offshore critical minerals and resources' executive order, 24 avril 2025, Maison-Blanche (disponible en anglais seulement)
[2] World First : TMC USA Submits Application for Commercial Recovery of Deep-Sea Minerals in the High Seas Under U.S. Seabed Mining Code, 29 avril 2025, The Metals Company (disponible en anglais seulement)
[3] Le Code minier, Autorité internationale des fonds marins (disponible en français en sélectionnant l'onglet « French » en haut à droite)
[4] BC mining firm seeking U.S. approval to dig in international waters, 3 avril 2025, CBC News (disponible en anglais seulement)
[5] The impact of deep-sea mining on biodiversity, climate and human cultures, 1 mars 2024, National Committee of the Netherlands of the International Union for Conservation of Nature (disponible en anglais seulement)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Du Canada à Gaza : « une histoire de génocide »

Depuis près de deux ans, Gaza est ravagée par les bombardements israéliens, qui ont fait plus de 60 000 morts. Dans un récent rapport, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, met en lumière le rôle moteur des multinationales dans le maintien du processus génocidaire en cours. Nidhi Srinivas, économiste et professeur de management à The New School, à New York aux États-Unis, explique en quoi ce rapport est important.
Tiré du Journal des alternatives.

Vous êtes signataire d'une lettre ouverte avec plusieurs autres économistes en soutien à Francesca Albanese, qui a publié un rapport sur les mécanismes économiques qui permettent le génocide en cours à Gaza. En quoi ce rapport est-il important ?
Il y a eu de nombreuses études sur l'économie en Palestine. Mais ce que fait Francesca Albanese avec ce rapport est de mettre à jour ces recherches et d'en faire un dialogue plus large. En général, quand on parle d'Israël dans la littérature économique, nous ne parlons pas de la Palestine, et nous ne parlons pas de la manière dont les entreprises sont complices des abus contre les droits humains… Nous évoquons rarement comment des entreprises comme Caterpillar ou Google font du profit avec les massacres de la population palestinienne. Ce rapport est, en ce sens, un rapport historique. J'aimerais croire que d'ici dix ans, il deviendra une référence.
Pourquoi avoir choisi de signer cette lettre et de lui apporter votre soutien ?
Dans le domaine de l'économie et de la gestion des entreprises, historiquement, nous avons considéré les sociétés comme accomplissant un bien public. Pour vous donner un exemple : au Canada, quand j'y ai grandi, la Compagnie de la Baie d'Hudson était perçue comme « the Bay ». J'allais souvent dans leurs magasins pour acheter des vêtements. La Compagnie de la Baie d'Hudson était comme la Compagnie des Indes orientales, une entreprise qui a tiré profit du colonialisme de peuplement. L'histoire du Canada est une histoire de génocide. On peut débattre pour savoir si c'était la même chose que l'histoire du colonialisme de peuplement aux États-Unis, mais personne ne peut nier le fait que les peuples autochtones ont été délibérément tués.
Aujourd'hui, quand on regarde la Compagnie de la Baie d'Hudson, personne ne se souvient qu'elle a en réalité contribué à la mort des peuples autochtones, qu'elle a contribué à l'arrachement et la destruction de la vie de personnes qui avaient vécu sur ces terres pendant des siècles. C'est pourquoi j'ai décidé de signer cette lettre de soutien : pour dire que dans notre domaine, économie et management des entreprises, on continue de voir les entreprises comme innocentes dans les génocides. Mais il est temps de reconnaître que nous regardons une économie de génocide…
Comment cette « économie du génocide » peut-elle être un outil analytique utile pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, non seulement à Gaza, mais dans les conflits modernes en général ?
Tout d'abord, dans le champ du management, sans exception, il n'existe aucune école de commerce — en France, aux États-Unis, au Canada, en Inde, nulle part dans le monde — qui énonce ce fait pourtant évident : le management est né du colonialisme. Essentiellement, le management et tous ses principes trouvent leur origine dans l'exploitation des ressources matérielles au profit de sociétés étrangères. Ce qui incluait aussi l'exploitation des êtres humains, et je devrais dire, des esclaves. Maintenant, on peut débattre de la pertinence de ce constat. Par exemple, cela signifie-t-il qu'aujourd'hui le management considère son personnel comme des esclaves ? Je ne le pense pas. Mais si nous ne reconnaissons pas l'histoire du management, nous ne pouvons pas voir comment il façonne le présent. Par exemple, nous ne pouvons pas reconnaître que lorsque vous surmenez votre personnel et que vous le justifiez, c'est comme quand on justifiait historiquement le surmenage des esclaves.
Ensuite, la plupart des scientifiques de gauche reconnaissent que l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons atteint un point de crise extrême. Nous vivons dans un monde où il n'y a tout simplement pas assez de gens capables d'acheter les produits qui sont mis sur le marché. Dans une telle situation, l'une des nombreuses choses que font les capitalistes, c'est passer d'une forme d'exploitation à une autre pour continuer à générer du profit. Pendant le coronavirus, les capitalistes ont littéralement commencé à faire de l'argent à partir de la mort. Ils ont commencé à gagner de l'argent en offrant, par exemple, des primes pour que des gens risquent leur vie afin de livrer de la nourriture, des produits. Parfois, ils ne donnaient même pas de primes parce qu'il n'y avait pas de syndicats pour négocier. En ce sens, l'« économie du génocide » dont parle Albanese dans son rapport est simplement une nouvelle manière pour le capitalisme de survivre. Le capitalisme est arrivé à un stade où la seule façon de survivre est de mettre réellement en danger ceux et celles qui consomment.
Vous avez grandi au Canada, vous y avez étudié et travaillé. Avez-vous un message à adresser à la population du Canada ?
Déjà, il faut demander au Canada de reconnaître la Palestine [NDLR Le Canada a annoncé qu'il allait reconnaître la Palestine en septembre depuis]. Il faut prendre une position forte : censurer l'État d'Israël, mais aussi implémenter ses propres protocoles des droits humains, pas seulement pour les Autochtones, mais pour la population palestinienne. Je ne peux pas accepter le fait que le Canada continue aujourd'hui d'être un complice du projet colonial central d'Israël. Je ne peux pas accepter que le Canada continue de, malgré l'agression des États-Unis, de soutenir ses positions par rapport à Israël.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
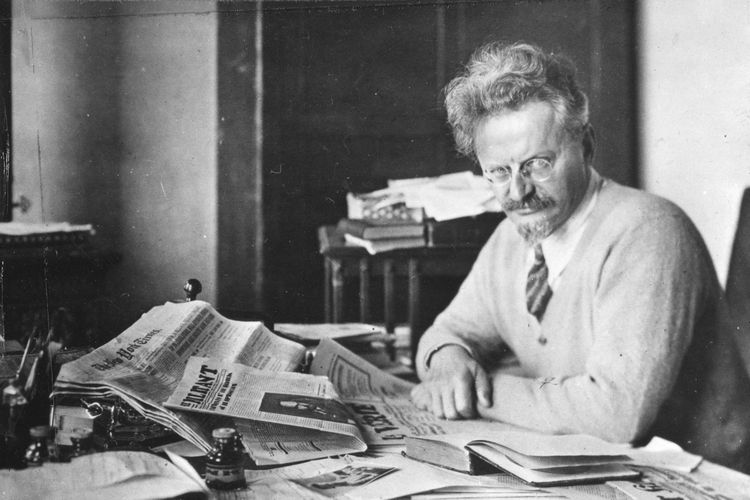
Pourquoi les marxistes s’opposent au terrorisme individuel
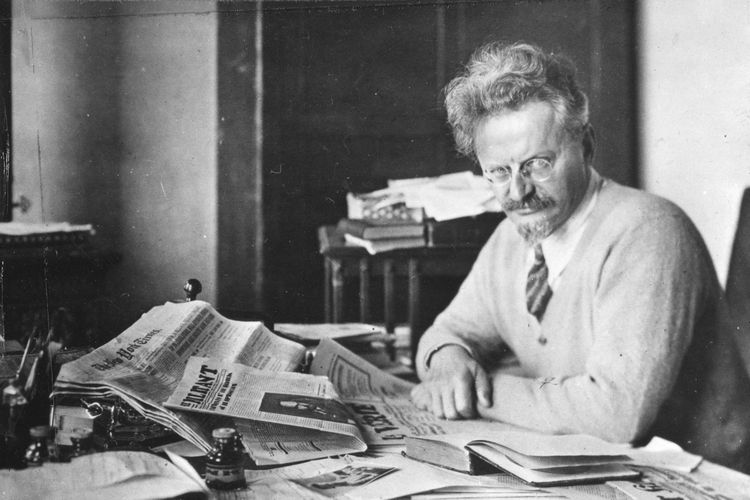
Nos ennemis de classe ont l'habitude de se plaindre de notre terrorisme. Ce qu'ils entendent par là n'est pas très clair. Ils aimeraient qualifier de terrorisme toutes les activités du prolétariat dirigées contre les intérêts de nos ennemis de classe. La grève, à leurs yeux, est la principale méthode de terrorisme. Une menace de grève, l'organisation de piquets de grève, le boycott d'un patron esclavagiste, le boycott moral d'un traître de nos propres rangs - ils appellent tout cela terrorisme et bien plus encore. Si on conçoit de cette façon le terrorisme comme toute action inspirant la crainte, ou faisant du mal à l'ennemi, alors, naturellement, la lutte de classe toute entière n'est pas autre chose que du terrorisme. Et la seule question restante est de savoir si les politiciens bourgeois ont le droit de déverser le flot de leur indignation morale à propos du terrorisme prolétarien, alors que leur appareil d'État tout entier avec ses lois, sa police et son armée ne sont rien d'autre qu'un appareil de terreur capitaliste !
Cependant, il faut dire que quand ils nous reprochent de faire du terrorisme, ils essaient, - bien que pas toujours sciemment - de donner à ce mot un sens plus étroit, plus indirect.
Dans ce sens strict du mot, la détérioration de machines par des travailleurs, par exemple, est du terrorisme. Le meurtre d'un employeur, la menace de mettre le feu à une usine ou une menace de mort à son propriétaire, une tentative d'assassinat, revolver en main, contre un ministre du gouvernement - toutes ces actions sont des actes terroristes au sens complet et authentique. Cependant, quiconque ayant une idée de la vraie nature de la social-démocratie internationale devrait savoir qu'elle s'est toujours opposée à cette sorte de terrorisme et le fait de la façon le plus intransigeante.
Pourquoi ? Faire du terrorisme par la menace d'une grève, ou mener de fait une grève, est quelque chose que seuls les travailleurs de l'industrie peuvent faire. La signification sociale d'une grève dépend directement de : premièrement, la taille de l'entreprise ou du secteur industriel qu'elle affecte, et, deuxièmement, du degré auquel les travailleurs y prenant part sont organisés, disciplinés, et prêts à l'action. Ceci est aussi vrai d'une grève politique que cela l'est pour une grève économique. Cela continue à être la méthode de lutte qui découle directement du rôle productif du prolétariat dans la société moderne.
La terreur individuelle déprécie le rôle des masses
Pour se développer, le système capitaliste a besoin d'un superstructure parlementaire. Mais comme il ne peut pas confiner le prolétariat moderne à un ghetto politique, il doit tôt ou tard permettre aux travailleurs de participer au parlement. Dans toutes les élections, le caractère de masse du prolétariat et son niveau de développement politique - quantités qui, une fois de plus, sont déterminées elles aussi par son rôle social, c'est-à-dire, par dessus tout, son rôle productif - trouvent leur expression.
Dans une grève, de même que dans des élections, la méthode, le but, et les résultats de la lutte dépendent toujours du rôle social et de la force du prolétariat en tant que classe. Seuls les travailleurs peuvent mener une grève. Les artisans ruinés par l'usine, les paysans dont l'eau est polluée par l'usine, ou les membres du lumpen proletariat, avides de saccage, peuvent briser les machines, mettre le feu à une usine ou assassiner son propriétaire. Seule la classe ouvrière, consciente et organisée, peut envoyer une foule en représentation au parlement pour veiller aux intérêts des prolétaires. Par contre, pour assassiner une personnage officiel en vue, on n'a pas besoin d'avoir derrière soi les masses organisées. La recette pour fabriquer des explosifs est accessible à tous, et on peut se procurer un Browning n'importe où. Dans le premier cas, il s'agit d'une lutte sociale, dont les méthodes et les moyens découlent nécessairement de la nature de l'ordre social dominant du moment, et, dans le second, d'une réaction purement mécanique, identique n'importe où - en Chine comme en France - , très frappante dans sa forme extérieure (meurtre, explosions, ainsi de suite… ) mais absolument inoffensive en ce qui concerne le système social.
Une grève, même d'importance modeste, a des conséquences sociales : renforcement de la confiance en soi des travailleurs, renforcement des syndicats et même, assez souvent, une amélioration de la technologie de production. Le meurtre du propriétaire d'usine ne produit que des effets de nature policière, ou un changement de propriétaire dénué de toute signification sociale. Qu'un attentat terroriste, même "réussi", jette la confusion dans la classe dirigeante, dépend des circonstances politiques concrètes. Dans tous les cas, cette confusion ne peut être que de courte durée ; l'État capitaliste ne se fonde pas sur les ministres du gouvernement et ne peut être éliminé avec eux. Les classes qu'il sert trouveront toujours des remplaçants ; la machine reste intacte et continue à fonctionner.
Mais le désordre introduit dans les rangs des masses ouvrières elles-mêmes par un attentat terroriste est plus profond. S'il suffit de s'armer d'un pistolet pour atteindre son but, à quoi bon les effets de la lutte de classe ?
Si un dé à coudre de poudre et un petit morceau de plomb sont suffisants pour traverser le cou de l'ennemi et le tuer, quel besoin y a-t-il d'une organisation de classe ? Si cela a un sens de terrifier des personnages hauts placés par le grondement des explosions, est-il besoin d'un parti ? Pourquoi les meetings, l'agitation de masse, et les élections, si on peut si facilement viser le banc des ministres de la galerie du parlement ?
À nos yeux, la terreur individuelle est inadmissible précisément parce qu'elle rabaisse le rôle des masses dans leur propre conscience, les faits se résigner à leur impuissance, et leur fait tourner les yeux vers un héros vengeur et libérateur qui, espèrent-ils, viendra un jour et accomplira sa mission. Les prophètes anarchistes de le "propagande de l'action" peuvent soutenir tout ce qu'ils veulent à propos de l'influence élévatrice et stimulante des actes terroristes sur les masses. Les considérations théoriques et l'expérience politique prouvent qu'il en est autrement. Plus "efficaces" sont les actes terroristes, plus grand est leur impact, plus il réduisent l'intérêt des masses pour l'auto-organisation et l'auto-éducation.
Mais les fumées de la confusion se dissipent, la panique disparaît, le successeur du ministre assassiné apparaît, la vie s'installe à nouveau dans l'ancienne ornière, la roue de l'exploitation capitaliste tourne comme auparavant ; seule la répression policière devient plus sauvage, plus sûre d'elle-même, plus impudente. Et, en conséquence, au lieu des espoirs qu'on avait fait naître, de l'excitation artificiellement soulevée, arrivent la désillusion et l'apathie.
Les efforts de la réaction pour mettre fin aux grèves et au mouvement de masse des ouvriers en général se sont toujours, et partout, soldés par un échec. La société capitalistes a besoin d'un prolétariat actif, mobile et intelligent ; elle ne peut, donc, maintenir le prolétariat pieds et poings liés pendant très longtemps. D'autre part, la propagande anarchiste de "l'action" a montré chaque fois que l'État est plus riche en moyen de destruction physique et de répression mécanique que ne le sont les groupes terroristes.
S'il en est ainsi, où cela laisse-t-il la révolution ? Est-elle rendue impossible par cet état de choses ? Pas du tout. Car la révolution n'est pas un simple agrégat de moyens mécaniques. La révolution ne peut naître que de l'accentuation de la lutte de classe, et elle ne peut trouver une garantie de victoire que dans les fonctions sociales du prolétariat. La grève politique de masse, l'insurrection armée, la conquête du pouvoir d'État - tout ceci est déterminé par le degré auquel la production s'est développée, l'alignement des forces de classes, le poids social du prolétariat, et enfin, par la composition sociale de l'armée, puisque les forces armées sont le facteur qui, en période de révolution, détermine le sort du pouvoir d'État.
La social-démocratie est assez réaliste pour ne pas essayer d'éviter la révolution qui se développe à partir des conditions historiques existantes ; au contraire, elle évolue pour affronter la révolution les yeux grands ouverts. Mais, contrairement aux anarchistes, et en opposition directe avec eux, la social-démocratie rejette toutes méthode et tous moyens ayant pour but de forcer artificiellement le développement de la société et de substituer des préparations chimiques à la force révolutionnaire insuffisante du prolétariat.
Avant d'être promu au rang de méthode de lutte politique, le terrorisme fait son apparition sous la forme d'actes de vengeance individuels. Ainsi en était-il en Russie, terre classique du terrorisme. Le fait qu'on eût donné le fouet à des prisonniers politiques poussa Véra Zassoulitch à exprimer le sentiment général d'indignation par une tentative d'assassinat du général Trepov. Son exemple fut imité dans les cercles de l'intelligentsia révolutionnaire qui manquait de tout support de masse. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance non réfléchi se développa pour devenir tout un système en 1879-1881. Les vagues d'assassinat commis par les anarchistes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord viennent toujours après quelque atrocité commise par le gouvernement - le fait de tirer sur des grévistes ou l'exécution d'opposants politiques. La source psychologique du terrorisme la plus importante est toujours le sentiment de vengeance à la recherche d'un exutoire.
Il n'est pas besoin d'insister sur le point que la social-démocratie n'a rien de commun avec ces moralistes vénaux qui, en réponse à tout acte terroriste, font des déclarations à propos de la "valeur absolue" de la vie humaine. Ce sont les mêmes qui, en d'autres occasions, au nom d'autres valeurs absolues - par exemple l'honneur de la nation ou le prestige du monarque - sont prêts à pousser des millions de gens dans l'enfer de la guerre. Aujourd'hui, leur héros national est le ministre qui accorde le droit sacré de la propriété privée et, demain, quand la main désespérée des travailleurs au chômage se serre en un poing ou ramasse une arme, ils profèrent toutes sortes d'inepties à propos de l'inadmissibilité de la violence sous quelque forme que ce soit.
Quoi que puissent dire les eunuques et les pharisiens de la moralité, le sentiment de vengeance a ses droits. Il accorde à la classe ouvrière le plus grand crédit moral : le fait qu'elle ne regarde pas d'un œil indifférent, passivement, ce qui se passe dans ce meilleur des mondes. Ne pas éteindre le sentiment de vengeance inassouvi du prolétariat, mais au contraire l'attiser encore et encore, le rendre plus profond, et le diriger contre les causes réelles de toute l'injustice et de la bassesse humaine - c'est là la tâche de la social-démocratie.
Si nous nous opposons aux actes terroristes, c'est seulement que la vengeance individuelle ne nous satisfait pas. Le compte que nous avons à régler avec le système capitaliste est trop grand pour être présenté à un quelconque fonctionnaire appelé ministre. Apprendre à voir tous les crimes contre l'humanité, toutes les indignités auxquelles sont soumis le corps et l'esprit humain, comme les excroissances et les expressions déformées du système social existant, dans le but de diriger toutes nos énergies en une lutte contre ce système - voilà la direction dans laquelle le désir brûlant de vengeance doit trouver sa plus haute satisfaction morale.
Source : https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1911/110000.htm

Marxistes et religion, hier et aujourd’hui

Les marxistes ne sauraient chercher à récolter des votes à n'importe quel prix, tels des politiciens opportunistes prêts à tout pour être élus. Il est des soutiens, comme celui du cheikh Al-Haddad, qui sont des cadeaux empoisonnés. Il faut savoir désavouer ceux dont ils émanent : la bataille pour l'influence idéologique au sein des populations issues de l'immigration est d'une importance beaucoup plus fondamentale qu'un résultat électoral, aussi exaltant soit-il.
Tiré de Inprécor
1 septembre 2025 par Gilbert Achcar
1.L'attitude théorique (« philosophique ») du marxisme classique en matière de religion combine trois dimensions complémentaires, que l'on trouve déjà en germe dans l'Introduction à De la critique de la philosophie du droit de Hegel du jeune Marx (1843-1844) :
d'abord, une critique de la religion, en tant que facteur d' aliénation . L'être humain attribue à la divinité la responsabilité d'un sort qui ne lui doit rien (« L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. ») ; il s'astreint à respecter des obligations et interdits qui, souvent, entravent son épanouissement ; il se soumet volontairement à des autorités religieuses dont la légitimité se fonde soit sur le fantasme de leur rapport privilégié au divin, soit sur leur spécialisation dans la connaissance du corpus religieux.
ensuite, une critique des doctrines sociales et politiques des religions. Les religions sont des survivances idéologiques d'époques révolues depuis fort longtemps : la religion est « fausse conscience du monde » ; elle l'est d'autant plus que le monde change. Nées dans des sociétés précapitalistes, les religions ont pu connaître - à l'instar de la Réforme protestante dans l'histoire du christianisme - des aggiornamentos, qui restent forcément partiels et limitées dès lors qu'une religion vénère des « écritures saintes ».
mais aussi, une « compréhension » (au sens wébérien) du rôle psychologique que peut jouer la croyance religieuse pour les damné/es de la terre. « La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. »
Ces trois considérants débouchent, au regard du marxisme classique, sur une seule et même conclusion énoncée par le jeune Marx : « Le dépassement ( Aufhebung ) de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence de son véritable bonheur. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions sur sa condition, c'est exiger qu'il soit renoncé aune condition qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe , la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l'auréole . »
2. Pour autant, le marxisme classique n'a pas posé la suppression de la religion comme condition nécessaire et préalable de l'émancipation sociale (le propos du jeune Marx pourrait se lire : afin de pouvoir surmonter les illusions, il faut d'abord mettre fin à la « condition qui a besoin d'illusions »). En tout état de cause, tout comme pour l'État, pourrait-on dire, il ne s'agit pas d'abolir la religion, mais de créer les conditions de son extinction. Il n'est pas question de prohiber « l'opium du peuple », et encore moins d'en réprimer les consommateurs. Il s'agit seulement de mettre fin aux rapports privilégiés qu'entretiennent ceux qui en font commerce avec le pouvoir politique, afin de réduire son emprise sur les esprits.
Trois niveaux d'attitude sont ici à considérer :
• Le marxisme classique, celui des fondateurs, n'a pas requis l'inscription de l'athéisme au programme des mouvements sociaux. Au contraire, dans sa critique du programme des émigrés blanquistes de la Commune (1874), Engels a raillé leur prétention d'abolir la religion par décret. Sa perspicacité a été entièrement confirmée par les expériences du XXe siècle, comme lorsqu'il soutenait que « les persécutions sont le meilleur moyen d'affermir des convictions indésirables » et que « le seul service que l'on puisse rendre encore, de nos jours, à Dieu est de proclamer l'athéisme un symbole de foi coercitif ».
• La laïcité républicaine, c'est-à-dire la séparation de la religion et de l'État, est, en revanche, un objectif nécessaire et imprescriptible, qui faisait déjà partie du programme de la démocratie bourgeoise radicale. Mais là aussi, il importe de ne pas confondre séparation et prohibition, même en ce qui concerne l'enseignement. Dans ses commentaires critiques sur le programme d'Erfurt de la social-démocratie allemande (1891), Engels proposait la formulation suivante : « Séparation complète de l'Église et de l'État. Toutes les communautés religieuses sans exception seront traitées par l'État comme des sociétés privées. Elles perdent toute subvention provenant des deniers publics et toute influence sur les écoles publiques. » Puis il ajoutait entre parenthèses ce commentaire : « On ne peut tout de même pas leur défendre de fonder, par leurs propres moyens, des écoles, qui leur appartiennent en propre, et d'y enseigner leurs bêtises ! »
• Le parti ouvrier doit en même temps combattre idéologiquement l'influence de la religion. Dans le texte de 1873, Engels se félicitait du fait que la majorité des militants ouvriers socialistes allemands était gagnée à l'athéisme, et suggérait de diffuser la littérature matérialiste française du XVIIIe siècle afin d'en convaincre le plus grand nombre.
Dans sa critique du programme de Gotha du parti ouvrier allemand (1875), Marx expliquait que la liberté privée en matière de croyance et de culte doit être définie uniquement comme rejet de l'ingérence étatique. Il en énonçait ainsi le principe : « chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez ». Il regrettait, en même temps, que le parti n'ait pas saisi « l'occasion d'exprimer sa conviction que la bourgeoise “liberté de conscience” n'est rien de plus que la tolérance de toutes les sortes possibles de liberté de conscience religieuse, tandis que lui [le parti] s'efforce de libérer les consciences de la fantasmagorie religieuse ».
3. Le marxisme classique n'envisageait la religion que sous l'angle du rapport des sociétés européennes à leurs propres religions traditionnelles. Il ne prenait pas en considération la persécution des minorités religieuses, ni surtout la persécution des religions de peuples opprimés par des États oppresseurs appartenant à une autre religion. À notre époque marquée par la survivance de l'héritage colonial et par sa transposition à l'intérieur même des métropoles impériales - sous la forme d'un « colonialisme intérieur », dont l'originalité est que ce sont les colonisés eux-mêmes qui sont expatriés, c'est-à-dire « immigrés » - cet aspect acquiert une importance majeure.
Dans un contexte dominé par le racisme, corollaire naturel de l'héritage colonial, les persécutions de la religion des opprimé/es, ex-colonisé/es, ne doivent pas être rejetées seulement parce qu'elles sont « le meilleur moyen d'affermir des convictions indésirables ». Elles doivent être rejetées, aussi et avant tout, parce qu'elles sont une dimension de l'oppression ethnique ou raciale, aussi intolérable que le sont les persécutions et discriminations politiques, juridiques et économiques.
Certes, les pratiques religieuses des populations colonisées peuvent apparaître comme éminemment rétrogrades aux yeux des populations métropolitaines, dont la supériorité matérielle et scientifique était inscrite dans le fait même de la colonisation. Mais ce n'est pas en imposant le mode de vie de ces dernières aux populations colonisées, contre leur gré, que sera servie la cause de leur émancipation. L'enfer de l'oppression raciste est pavé de bonnes intentions « civilisatrices », et l'on sait à quel point le mouvement ouvrier lui-même fut contaminé par la prétention bienfaitrice et l'illusion philanthropique à l'ère du colonialisme.
Engels avait pourtant bien mis en garde contre ce syndrome colonial. Dans une lettre à Kautsky, datée du 12 septembre 1882, il formula une politique émancipatrice du prolétariat au pouvoir, tout empreinte de la précaution indispensable afin de ne pas transformer la libération présumée en oppression déguisée.
« Les pays sous simple domination et peuplés d'indigènes, Inde, Algérie, les possessions hollandaises, portugaises et espagnoles, devront être pris en charge provisoirement par le prolétariat et conduits à l'indépendance, aussi rapidement que possible. Comment ce processus se développera, voilà qui est difficile à dire. L'Inde fera peut-être une révolution, c'est même très vraisemblable. Et comme le prolétariat se libérant ne peut mener aucune guerre coloniale, on serait obligé de laisser faire, ce qui, naturellement, n'irait pas sans des destructions de toutes sortes, mais de tels faits sont inséparables de toutes les révolutions. Le même processus pourrait se dérouler aussi ailleurs : par exemple en Algérie et en Égypte, et ce serait, pour nous certainement, la meilleure solution. Nous aurons assez à faire chez nous. Une fois que l'Europe et l'Amérique du Nord seront réorganisées, elles constitueront une force si colossale et un exemple tel que les peuples à demi civilisés viendront d'eux-mêmes dans leur sillage : les besoins économiques y pourvoiront déjà à eux seuls. Mais par quelles phases de développement social et politique ces pays devront passer par la suite pour parvenir eux aussi à une structure socialiste, là-dessus, je crois, nous ne pouvons aujourd'hui qu'échafauder des hypothèses assez oiseuses. Une seule chose est sûre : le prolétariat victorieux ne peut faire de force le bonheur d'aucun peuple étranger, sans par là miner sa propre victoire. »
Vérité élémentaire, et pourtant si souvent ignorée : tout « bonheur » imposé par la force équivaut à une oppression, et ne saurait être perçu autrement par ceux et celles qui le subissent.
4. La question du foulard islamique (hijab) condense l'ensemble des problèmes posés ci-dessus. Elle permet de décliner l'attitude marxiste sous tous ses aspects.
Dans la plupart des pays où l'islam est religion majoritaire, la religion est encore la forme principale de l'idéologie dominante. Des interprétations rétrogrades de l'islam, plus ou moins littéralistes, servent à maintenir des populations entières dans la soumission et l'arriération culturelle. Les femmes subissent le plus massivement et le plus intensivement une oppression séculaire, drapée de légitimation religieuse.
Dans un tel contexte, la lutte idéologique contre l'utilisation de la religion comme argument d'asservissement est une dimension prioritaire du combat émancipateur. La séparation de la religion et de l'État doit être une revendication prioritaire du mouvement pour le progrès social. Les démocrates et les progressistes doivent se battre pour la liberté de chacune et de chacun en matière d'incroyance, de croyance et de pratique religieuse. En même temps, le combat pour la libération des femmes reste le critère même de toute identité émancipatrice, la pierre de touche de toute prétention progressiste.
Un des aspects les plus élémentaires de la liberté des femmes est leur liberté individuelle de se vêtir comme elles l'entendent. Le foulard islamique et, à plus forte raison, les versions plus enveloppantes de ce type de revêtement, lorsqu'ils sont imposés aux femmes, sont une des nombreuses formes de l'oppression sexuelle au quotidien - une forme d'autant plus visible qu'elle sert à rendre les femmes invisibles. La lutte contre l'astreinte au port du foulard, ou autres voiles, est indissociable de la lutte contre les autres aspects de la servitude féminine.
Toutefois, la lutte émancipatrice serait gravement compromise si elle cherchait à « libérer » de force les femmes, en usant de la contrainte non à l'égard de leurs oppresseurs, mais à leur propre égard. Arracher par la force le revêtement religieux, porté volontairement -même si l'on juge que son port relève de la servitude volontaire - est un acte oppressif et non un acte d'émancipation réelle. C'est de surcroît une action vouée à l'échec, comme Engels l'avait prédit : de même que le sort de l'islam dans l'ex-Union soviétique, l'évolution de la Turquie illustre éloquemment l'inanité de toute tentative d'éradication de la religion ou des pratiques religieuses par la contrainte.
« Chacun - et chacune - doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels » - les femmes porter le hijab ou les hommes porter la barbe - « sans que la police y fourre le nez ».
Défendre cette liberté individuelle élémentaire est la condition indispensable pour mener un combat efficace contre les diktats religieux. La prohibition du hijab rend paradoxalement légitime le fait de l'imposer, aux yeux de ceux et celles qui le considèrent comme un article de foi. Seul le principe de la liberté de conscience et de pratique religieuse strictement individuelle, qu'elle soit vestimentaire ou autre, et le respect de ce principe par des gouvernements laïcs, permettent de s'opposer légitimement et avec succès à la contrainte religieuse. Le Coran lui-même proclame : « Pas de contrainte en religion » !
Par ailleurs, et pour peu que l'on ne remette pas en cause la liberté d'enseignement, prohiber le port du foulard islamique, ou autres signes religieux vestimentaires, à l'école publique, au nom de la laïcité, est une attitude éminemment antinomique, puisqu'elle aboutit à favoriser l'expansion des écoles religieuses.
5. Dans un pays comme la France, où l'islam fut pendant fort longtemps la religion majoritaire des « indigènes » des colonies et où il est depuis des décennies la religion de la grande majorité des immigrés, « colonisés » de l'intérieur, toute forme de persécution de la religion islamique - deuxième religion de France par le nombre et religion très inférieure aux autres par le statut - doit être combattue.
L'islam est, en France, une religion défavorisée par rapport aux religions présentes depuis des siècles sur le sol français. C'est une religion victime de discriminations criantes, tant en ce qui concerne ses lieux de culte que la tutelle pesante, empreinte de mentalité coloniale, que lui impose l'État français. L'islam est une religion décriée au quotidien dans les médias français, d'une manière qu'il n'est heureusement plus possible de pratiquer contre la précédente cible prioritaire du racisme, le judaïsme, après le génocide nazi et la complicité vichyste. Un confusionnisme mâtiné d'ignorance et de racisme entretient, par médias interposés, l'image d'une religion islamique intrinsèquement inapte à la modernité, ainsi que l'amalgame entre islam et terrorisme que facilite l'utilisation inappropriée du terme « islamisme » comme synonyme d'intégrisme islamique.
Certes, le discours officiel et dominant n'est pas ouvertement hostile ; il se fait même bienveillant, les yeux rivés sur les intérêts considérables du grand capital français - pétrole, armement, bâtiment, etc. - en terre d'Islam. Toutefois, la condescendance coloniale à l'égard des musulman/es et de leur religion est tout autant insupportable pour elles et eux que l'hostilité raciste ouvertement affichée. L'esprit colonial n'est pas l'apanage de la droite en France ; il est d'implantation fort ancienne dans la gauche française, constamment déchirée dans son histoire entre un colonialisme mêlé de condescendance d'essence raciste et d'expression paternaliste, et une tradition anticolonialiste militante.
Même aux premiers temps de la scission du mouvement ouvrier français entre sociaux-démocrates et communistes, une aile droite émergea parmi les communistes de la métropole eux-mêmes (sans parler des communistes français en Algérie), se distinguant notamment par son attitude sur la question coloniale. La droite communiste trahit son devoir anticolonialiste face à l'insurrection du Rif marocain sous la direction du chef tribal et religieux Abd-el-Krim, lorsque celle-ci affronta les troupes françaises en 1925.
L'explication de Jules Humbert-Droz à ce propos, devant le comité exécutif de l'IC, garde une certaine pertinence :
«
La droite a protesté contre le mot d'ordre de la fraternisation avec l'armée des Rifains, en invoquant le fait que les Rifains n'ont pas le même degré de civilisation que les armées françaises, et qu'on ne peut fraterniser avec des tribus à demi barbares. Elle est allée plus loin encore écrivant qu'Abd-el-Krim a des préjugés religieux et sociaux qu'il faut combattre. Sans doute il faut combattre le panislamisme et le féodalisme des peuples coloniaux, mais quand l'impérialisme français saisit à la gorge les peuples coloniaux, le rôle du P.C. n'est pas de combattre les préjugés des chefs coloniaux, mais de combattre sans défaillance la rapacité de l'impérialisme français.
»
6. Le devoir des marxistes en France est de combattre sans défaillance l'oppression raciste et religieuse menée par la bourgeoisie impériale française et son État, avant de combattre les préjugés religieux au sein des populations immigrées.
Lorsque l'État français s'occupe de réglementer la façon de s'habiller des jeunes musulmanes et d'interdire l'accès à l'école de celles qui s'obstinent à vouloir porter le foulard islamique ; lorsque ces dernières sont prises comme cibles d'une campagne médiatique et politique dont la démesure par rapport à l'ampleur du phénomène concerné atteste de son caractère oppressif, perçu comme islamophobe ou raciste, quelles que soient les intentions affichées ; lorsque le même État favorise l'expansion notoire de l'enseignement religieux communautaire par l'accroissement des subventions à l'enseignement privé, aggravant ainsi les divisions entre les couches exploitées de la population française - le devoir des marxistes, à la lumière de tout ce qui a été exposé ci-dessus, est de s'y opposer résolument.
Ce ne fut pas le cas pour une bonne partie de celles et ceux qui se réclament du marxisme en France. Sur la question du foulard islamique, la position de la Ligue de l'Enseignement, dont l'engagement laïque est au-dessus de tout soupçon, est bien plus en affinité avec celle du marxisme authentique que celle de nombre d'instances qui disent s'en inspirer. Ainsi peut-on lire dans la déclaration adoptée par la Ligue, lors de son assemblée générale de Troyes en juin 2003, ce qui suit :
« La Ligue de l'Enseignement, dont toute l'histoire est marquée par une action constante en faveur de la laïcité, considère que légiférer sur le port de signes d'appartenance religieuse est inopportun. Toute loi serait soit inutile soit impossible.
Le risque est évident. Quelles que soient les précautions prises, il ne fait aucun doute que l'effet obtenu sera un interdit stigmatisant en fait les musulmans. [...]
Pour ceux ou celles qui voudraient faire du port d'un signe religieux l'argument d'un combat politique, l'exclusion de l'école publique n'empêchera pas de se scolariser ailleurs, dans des institutions au sein desquelles ils ont toutes chances de se trouver justifiés et renforcés dans leur attitude. [...]
[L'] intégration de tous les citoyens, indépendamment de leurs origines et de leurs convictions, passe par la reconnaissance d'une diversité culturelle qui doit s'exprimer dans le cadre de l'égalité de traitement que la République doit assurer à chacun. À ce titre, les musulmans, comme les autres croyants, doivent bénéficier de la liberté du culte dans le respect des règles qu'impose une société laïque, pluraliste et profondément sécularisée. Le combat pour l'émancipation des jeunes filles, en particulier, passe prioritairement par leur scolarisation, le respect de leur liberté de conscience et de leur autonomie : n'en faisons pas les otages d'un débat idéologique, par ailleurs nécessaire. Pour lutter contre l'enfermement identitaire, une pédagogie de la laïcité, la lutte contre les discriminations, le combat pour la justice sociale et l'égalité sont plus efficaces que l'interdit. »
Dans son rapport du 4 novembre 2003, remis à la Commission sur l'application du principe de laïcité dans la République (dite Commission Stasi), la Ligue de l'Enseignement traite admirablement de l'islam et des représentations dont il fait l'objet en France, en des pages dont on ne citera ici que quelques extraits :
« Les résistances et les discriminations rencontrées par “les populations musulmanes” dans la société française ne tiennent pas essentiellement, comme on le dit trop souvent, au déficit d'intégration de ces populations mais bien à des représentations et à des attitudes majoritaires qui proviennent en grande partie d'un héritage historique ancien.
La première tient à la non-reconnaissance de l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la culture mondiale et à notre propre culture occidentale. [...]
À cette occultation et à ce rejet s'est ajouté l'héritage colonial [...] porteur d'une tradition de violence, d'inégalité et de racisme, profonde et durable, que les difficultés de la décolonisation, puis les déchirements de la guerre d'Algérie ont amplifiée et renforcée. L'infériorisation ethnique, sociale, culturelle et religieuse des populations indigènes, musulmanes des colonies françaises a été une pratique constante, au point de retentir dans les limitations du droit. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'Islam, il a été considéré comme un élément du statut personnel et non comme une religion relevant de la loi de séparation de 1905. Durant tout le temps de la colonisation, le principe de laïcité ne s'est jamais appliqué aux populations indigènes et à leur culte à cause de l'opposition du lobby colonial et malgré la demande des oulémas qui avaient compris que le régime de laïcité leur rendrait la liberté du culte. Comment s'étonner dès lors que pendant très longtemps la laïcité, pour les musulmans, ait été synonyme d'une police coloniale des esprits ! Comment veut-on que cela ne laisse pas des traces profondes, tant du côté des anciens colonisés que du pays colonisateur ? Si de nombreux musulmans aujourd'hui encore considèrent que l'Islam doit régler les comportements civils, tant publics que privés, et, sans revendiquer de statut personnel, ont parfois tendance à en adopter le profil, c'est que la France et la République laïque leur ont intimé de le faire pendant plusieurs générations. Si de nombreux Français, parfois même parmi les plus instruits et qui exercent des responsabilités en vue, se permettent des appréciations péjoratives sur l'Islam dont l'ignorance le dispute à la stupidité, c'est qu'ils s'inscrivent, le plus souvent inconsciemment et en s'en défendant, dans cette tradition du mépris colonial.
Un troisième aspect vient faire obstacle à la considération de l'Islam sur un pied d'égalité : c'est que religion transplantée, il est aussi une religion de pauvres. À la différence des religions judéo-chrétiennes dont les pratiquants en France se répartissent sur l'ensemble de l'échiquier social, et à la différence en particulier du catholicisme historiquement intégré à la classe dominante, les musulmans, citoyens français ou immigrés vivant en France, se situent pour l'instant, pour une grande majorité, en bas de l'échelle sociale. Là encore, la tradition coloniale se poursuit, puisque à l'infériorisation culturelle des populations indigènes s'ajoutait l'exploitation économique, et que celle-ci a longtemps pesé aussi très fortement sur les premières générations immigrées, tandis qu'aujourd'hui leurs héritiers sont les premières victimes du chômage et de la relégation urbaine. Le mépris social et l'injustice qui frappent ces catégories sociales affectent tous les aspects de leur existence, y compris la dimension religieuse. On ne s'offusque pas des foulards sur la tête des femmes de ménage ou de service dans les bureaux : il ne devient objet de scandale que s'il est porté avec fierté par des filles engagées dans des études ou des femmes ayant le statut de cadres. »
L'incompréhension manifestée par les principales organisations de la gauche marxiste extraparlementaire en France à l'égard des problèmes identitaires et culturels des populations concernées est révélée par la composition de leurs listes électorales aux élections européennes : tant en 1999 qu'en 2004, les citoyen/nes originaires de populations naguère colonisées - du Maghreb ou d'Afrique noire, en particulier - ont brillé par leur absence dans le peloton de tête des listes LCR-LO, contrairement aux listes du PCF, parti tant de fois stigmatisé pour manquement à la lutte antiraciste par ces deux organisations. Ce faisant, elles se sont également privées d'un potentiel électoral parmi les couches les plus opprimées de France, un potentiel dont le score réalisé en 2004 par une liste improvisée comme Euro-Palestine a témoigné de façon éclatante.
7. En mentionnant « ceux ou celles qui voudraient faire du port d'un signe religieux l'argument d'un combat politique », la Ligue de l'Enseignement faisait allusion, bien entendu, à l'intégrisme islamique. L'expansion de ce phénomène politique dans les milieux issus de l'immigration musulmane en Occident, après sa forte expansion depuis trente ans en terre d'Islam, a été, en France, l'argument préféré des pourfendeurs/ses de foulard islamique.
L'argument est réel : à l'instar des intégrismes chrétiens, juif, hindouiste et autres, visant à imposer une interprétation rigoriste de la religion comme code de vie, sinon comme mode de gouvernement, l'intégrisme islamique est un véritable danger pour le progrès social et les luttes émancipatrices. En prenant soin d'établir une distinction claire et nette entre la religion en tant que telle et son interprétation intégriste, la plus réactionnaire de toutes, il est indispensable de combattre l'intégrisme islamique idéologiquement et politiquement, tant dans les pays d'Islam qu'au sein des minorités musulmanes en Occident ou ailleurs.
Cela ne saurait, cependant, constituer un argument en faveur d'une prohibition publique du foulard islamique : la Ligue de l'Enseignement a expliqué le contraire de façon convaincante. Plus généralement, l'islamophobie est le meilleur allié objectif de l'intégrisme islamique : leur croissance va de pair. Plus la gauche donnera l'impression de se rallier à l'islamophobie dominante, plus elle s'aliènera les populations musulmanes et plus elle facilitera la tâche des intégristes musulmans, qui apparaîtront comme seuls à même d'exprimer la protestation des populations concernées contre « la misère réelle ».
L'intégrisme islamique est, cependant, un phénomène très différencié et l'attitude tactique à son égard doit être modulée selon les situations concrètes. Lorsque ce type de programme social est manié par un pouvoir oppresseur et par ses alliés afin de légitimer l'oppression en vigueur, comme dans le cas des nombreux despotismes à visage islamique ; ou lorsqu'il devient l'arme politique d'une réaction luttant contre un pouvoir progressiste, comme ce fut le cas dans le monde arabe, dans la période 1950-1970, quand l'intégrisme islamique était le fer de lance de l'opposition réactionnaire au nassérisme égyptien et à ses émules - la seule attitude convenable est celle d'une hostilité implacable aux intégristes.
Il en va autrement lorsque l'intégrisme islamique se déploie en tant que vecteur politico-idéologique d'une lutte animée par une cause objectivement progressiste, vecteur difforme, certes, mais remplissant le vide laissé par la défaite ou la carence des mouvements de gauche. C'est le cas des situations où les intégristes musulmans combattent une occupation étrangère (Afghanistan, Liban, Palestine, Irak, etc.) ou une oppression ethnique ou raciale, comme de celles où ils incarnent une aversion populaire à l'égard d'un régime d'oppression politique réactionnaire. C'est aussi le cas de l'intégrisme islamique en Occident, où son essor est généralement l'expression d'une rébellion contre le sort réservé aux populations immigrées.
En effet, comme la religion en général, l'intégrisme islamique peut être « d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation contre la misère réelle », à la différence près qu'il s'agit dans son cas d'une protestation active : il n'est pas « l'opium » du peuple, mais plutôt « l'héroïne » d'une partie du peuple, dérivée de « l'opium » et qui substitue son effet extatique à l'effet narcotique de celui-ci.
Dans tous ces types de situations, il est nécessaire d'adapter une attitude tactique aux circonstances de la lutte contre l'oppresseur, ennemi commun. Tout en ne renonçant jamais au combat idéologique contre l'influence néfaste de l'intégrisme islamique, il peut être nécessaire, ou inévitable, de converger avec des intégristes musulmans dans des batailles communes - allant de simples manifestations de rue à la résistance armée, selon les cas.
8. Les intégristes islamiques peuvent être des alliés objectifs et circonstanciels dans un combat déterminé, mené par des marxistes. Il s'agit toutefois d'une alliance contre-nature, forcée par les circonstances. Les règles qui s'appliquent à des alliances beaucoup plus naturelles, comme celles qui furent pratiquées dans la lutte contre le tsarisme en Russie, sont ici à respecter à plus forte raison, et de façon plus stricte encore.
Ces règles ont été clairement définies par les marxistes russes au début du XXe siècle. Dans sa Préface de janvier 1905 à la brochure Avant le 9 janvier de Trotsky, Parvus les résumait ainsi :
« Pour faire simple, en cas de lutte commune avec des alliés d'occasion, on peut suivre les points suivants : 1) Ne pas mélanger les organisations. Marcher séparément, mais frapper ensemble. 2) Ne pas renoncer à ses propres revendications politiques. 3) Ne pas cacher les divergences d'intérêt. 4) Suivre son allié comme on file un ennemi. 5) Se soucier plus d'utiliser la situation créée par la lutte que de préserver un allié. »
« Parvus a mille fois raison » écrivit Lénine dans un article d'avril 1905, publié dans le journal Vperiod , en soulignant « la condition absolue (rappelée fort à propos) de ne pas confondre les organisations, de marcher séparément et de frapper ensemble, de ne pas dissimuler la diversité des intérêts, de surveiller son allié comme un ennemi, etc. ». Le dirigeant bolchevique énumérera maintes fois ces conditions au fil des ans.
Les mêmes principes furent défendus inlassablement par Trotsky. Dans L'Internationale communiste après Lénine (1928), polémiquant au sujet des alliances avec le Kuomintang chinois, il écrivit les phrases suivantes, particulièrement adaptées au sujet dont il est ici question :
« Depuis longtemps, on a dit que des ententes strictement pratiques, qui ne nous lient en aucune façon et ne nous créent aucune obligation politique, peuvent, si cela est avantageux au moment considéré, être conclues avec le diable même. Mais il serait absurde d'exiger en même temps qu'à cette occasion le diable se convertisse totalement au christianisme, et qu'il se serve de ses cornes [...] pour des œuvres pieuses. En posant de telles conditions, nous agirions déjà, au fond, comme les avocats du diable, et lui demanderions de devenir ses parrains. »
Nombre de trotskystes font exactement l'inverse de ce que préconisait Trotsky, dans leur rapport avec des organisations intégristes islamiques. Non pas en France, où les trotskystes, dans leur majorité, tordent plutôt le bâton dans l'autre sens, comme il a été déjà expliqué, mais de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne.
L'extrême gauche britannique a le mérite d'avoir fait preuve d'une bien plus grande ouverture aux populations musulmanes que l'extrême gauche française. Elle a mené, contre les guerres d'Afghanistan et d'Irak, auxquelles a participé le gouvernement de son pays, de formidables mobilisations avec la participation massive de personnes issues de l'immigration musulmane. Dans le mouvement antiguerre, elle est même allée jusqu'à s'allier à une organisation musulmane d'inspiration intégriste, la Muslim Association of Britain (MAB), émanation britannique du principal mouvement intégriste islamique « modéré » du Moyen-Orient, le Mouvement des Frères musulmans (représenté dans les parlements de certains pays).
Rien de répréhensible, en principe, à une telle alliance pour des objectifs bien délimités, à condition de respecter strictement les règles énoncées ci-dessus. Le problème commence cependant avec le traitement en allié privilégié de cette organisation particulière, qui est loin d'être représentative de la grande masse des musulmans de Grande-Bretagne. Plus généralement, les trotskystes britanniques ont eu tendance, à l'occasion de leur alliance avec la MAB dans le mouvement antiguerre, à faire l'opposé de ce qui est énoncé ci-dessus, c'est-à-dire : 1) mélanger les bannières et les pancartes, au propre comme au figuré ; 2) minimiser l'importance des éléments de leur identité politique susceptibles de gêner les alliés intégristes du jour ; et enfin 3) traiter ces alliés de circonstance comme s'il s'agissait d'alliés stratégiques, en rebaptisant « anti-impérialistes » ceux dont la vision du monde correspond beaucoup plus au choc des civilisations qu'à la lutte des classes.
9. Cette tendance s'est aggravée avec le passage d'une alliance dans le contexte d'une mobilisation antiguerre à une alliance électorale. La MAB n'a, certes, pas adhéré en tant que telle à la coalition électorale Respect, animée par les trotskystes britanniques, ses principes intégristes lui interdisant de souscrire à un programme de gauche. Mais l'alliance entre la MAB et Respect s'est traduite, par exemple, par la candidature sur les listes de Respect d'un dirigeant en vue de la MAB, l'ex-président et porte-parole de l'association.
Ce faisant, l'alliance passait à un niveau qualitativement supérieur, tout à fait répréhensible, lui, d'un point de vue marxiste : autant il peut être légitime, en effet, de nouer des « ententes strictement pratiques », sans « aucune obligation politique » autre que l'action pour les objectifs communs - en l'occurrence, exprimer l'opposition à la guerre menée par le gouvernement britannique conjointement avec les États-Unis et dénoncer le sort infligé au peuple palestinien - avec des groupes et/ou des individus qui adhérent, par ailleurs, à une conception foncièrement réactionnaire de la société, autant il est inacceptable pour des marxistes de conclure une alliance électorale - type d'alliance qui suppose une conception commune du changement politique et social - avec ce genre de partenaires.
Par la force des choses, prendre part à une même liste électorale avec un intégriste religieux, c'est donner l'impression trompeuse qu'il s'est converti au progressisme social et à la cause de l'émancipation des travailleurs... et des travailleuses ! La logique même de cette espèce d'alliance pousse celles et ceux qui y sont engagés, face aux critiques inévitables de leurs concurrents politiques, à défendre leurs alliés du jour et à minimiser, sinon cacher, les divergences profondes qui les opposent à eux. Ils en deviennent les avocat/es, voire les parrains et marraines auprès du mouvement social progressiste.
C'est ainsi que Lindsay German, dirigeante centrale du Socialist Workers Party britannique et de la coalition Respect, a signé dans The Guardian du 13 juillet 2004, un article qualifié de « merveilleux »(« wonderful ») sur le site web de la MAB. Sous le titre « Un insigne d'honneur » (« A badge of honour »), l'auteure défend énergiquement l'alliance électorale avec la MAB, en expliquant que c'est un honneur pour elle et ses camarades de voir les victimes de l'islamophobie se tourner vers eux, avec une justification surprenante de l'alliance avec la MAB. Résumons-en l'argumentaire : les intégristes musulmans ne sont pas les seuls à être anti-femmes et homophobes, les intégristes chrétiens le sont également. D'ailleurs, de plus en plus de femmes parlent pour la MAB dans les réunions antiguerres (comme dans les meetings organisés par les mollahs en Iran, pourrait-on ajouter). Les fascistes du BNP (British National Party) sont bien pires que la MAB.
« Certes, poursuit Lindsay German, certains musulmans - et non musulmans - ont, sur certaines questions sociales, des vues qui sont plus conservatrices que celles de la gauche socialiste et libérale. Mais cela ne devrait pas empêcher de collaborer sur des questions d'intérêt commun. Insisterait-on dans une campagne pour les droits des gays, par exemple, pour que toutes les personnes qui y participent partagent le même point de vue sur la guerre en Irak ? »
L'argument est tout à fait recevable s'il ne concerne que la campagne antiguerre. Mais s'il est utilisé pour justifier une alliance électorale comme Respect, au programme beaucoup plus global qu'une campagne pour les droits des gays et des lesbiennes, il devient tout à fait spécieux.
10. L'électoralisme est une politique à bien courte vue. En vue de réaliser une percée électorale, les trotskystes britanniques jouent, en l'occurrence, un jeu qui dessert les intérêts stratégiques de la construction d'une gauche radicale dans leur pays.
Ce qui les a déterminés, c'est d'abord et avant tout, un calcul électoral : tenter de capter les votes des masses considérables de personnes issues de l'immigration qui rejettent les guerres en cours menées par Londres et Washington (notons, en passant, que l'alliance avec la MAB s'est faite autour des guerres d'Afghanistan et d'Irak, et non autour de celle du Kosovo - et pour cause !). L'objectif, en soi, est légitime, s'il se traduit par le souci de recruter parmi les travailleurs et travailleuses d'origine immigrée, par une attention particulière prêtée à l'oppression spécifique qu'ils/elles subissent, et par la mise en avant, à cette fin, de militant/es de gauche appartenant à ces communautés, notamment en les plaçant en bonne position sur les listes électorales. Tout ce que n'a pas fait l'extrême gauche française, en somme.
Par contre, en choisissant de s'allier électoralement - même si ce n'est que de façon limitée - avec une organisation intégriste islamique comme la MAB, l'extrême gauche britannique sert de marchepied à celle-ci pour sa propre expansion dans les communautés issues de l'immigration, alors qu'elle devrait la considérer comme une rivale à combattre idéologiquement et à circonscrire du point de vue organisationnel. Tôt ou tard, cette alliance contre-nature se heurtera à une pierre d'achoppement, et volera en éclat. Les trotskystes devront alors affronter ceux-là mêmes dont ils auront facilité l'expansion pour le plat de lentilles d'un résultat électoral, dont il est loin d'être sûr, en outre, qu'il doit beaucoup aux partenaires intégristes.
Il n'est qu'à voir avec quels arguments les intégristes appellent à voter pour Respect (et pour d'autres, dont le maire de Londres, le labouriste de gauche Ken Livingstone, bien plus opportuniste encore que les trotskystes dans ses rapports avec l'association islamique). Lisons la fatwa du cheikh Haitham Al-Haddad, datée du 5 juin 2004 et publiée sur le site de la MAB.
Le vénérable cheikh explique qu'« il est obligatoire pour les musulmans qui vivent à l'ombre de la loi des hommes d'agir par tous les moyens nécessaires pour que la loi d'Allah, le Créateur, soit suprême et manifeste dans tous les aspects de la vie. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, il devient alors obligatoire pour eux de s'efforcer de minimiser le mal et de maximiser le bien. » Le cheikh souligne ensuite la différence entre « voter pour un système parmi un nombre d'autres systèmes, et voter pour choisir le meilleur individu parmi un nombre de candidats dans un système déjà établi, imposé aux gens et qu'ils ne sont pas en mesure de changer dans l'avenir immédiat ».
« Il ne fait pas de doute, poursuit-il, que le premier type [de vote] est un acte de Kufr [impie], car Allah dit “Il n'appartient qu'à Allah de légiférer” », tandis que « voter pour un candidat ou un parti qui gouverne selon la loi des hommes n'implique pas d'approuver ou d'accepter sa méthode ». Il s'ensuit que « nous devons participer au vote, avec la conviction que nous tentons ainsi de minimiser le mal, tout en soutenant l'idée que le meilleur système est la Charia, qui est la loi d'Allah ».
Le vote étant licite, se pose alors la question de savoir pour qui voter. « La réponse à une telle question requiert une compréhension profonde et précise de l'arène politique. Par conséquent, je crois que les individus doivent éviter de s'impliquer dans ce processus et confier plutôt cette responsabilité aux organisations musulmanes éminentes [...]. Il incombe donc aux autres musulmans d'accepter et de suivre les décisions de ces organisations. »
En conclusion de quoi, le vénérable cheikh appelle les musulmans de Grande-Bretagne à suivre les consignes électorales de la MAB et termine par cette prière : « Nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin et d'accorder la victoire à la loi de notre Seigneur, Allah, dans le Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde. »
Cette fatwa se passe de commentaire. L'opposition profonde entre les desseins du cheikh sollicité par la MAB et la tâche que les marxistes se fixent, ou devraient se fixer, dans leur action auprès des populations musulmanes est flagrante. Les marxistes ne sauraient chercher à récolter des votes à n'importe quel prix, tels des politiciens opportunistes prêts à tout pour être élus. Il est des soutiens, comme celui du cheikh Al-Haddad, qui sont des cadeaux empoisonnés. Il faut savoir désavouer ceux dont ils émanent : la bataille pour l'influence idéologique au sein des populations issues de l'immigration est d'une importance beaucoup plus fondamentale qu'un résultat électoral, aussi exaltant soit-il.
La gauche radicale, de part et d'autre de la Manche, doit revenir à une attitude conforme au marxisme dont elle se revendique. Faute de quoi, l'emprise des intégristes sur les populations musulmanes risque d'atteindre un niveau dont il sera fort difficile de la faire reculer. Le fossé entre ces populations et le reste des travailleuses et des travailleurs en Europe s'en trouverait élargi, alors que la tâche de le combler est l'une des conditions indispensables pour substituer le combat commun contre le capitalisme au choc des barbaries.
Le 15 octobre 2004
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
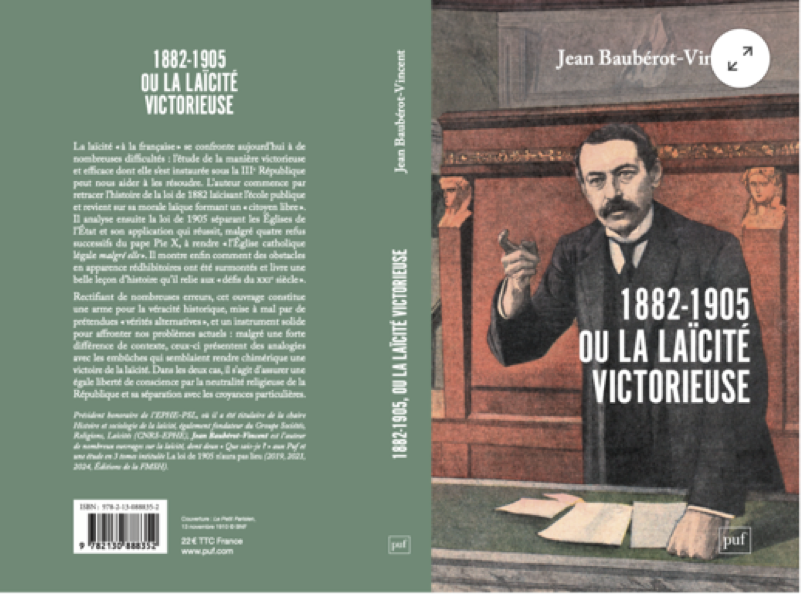
La laïcité victorieuse
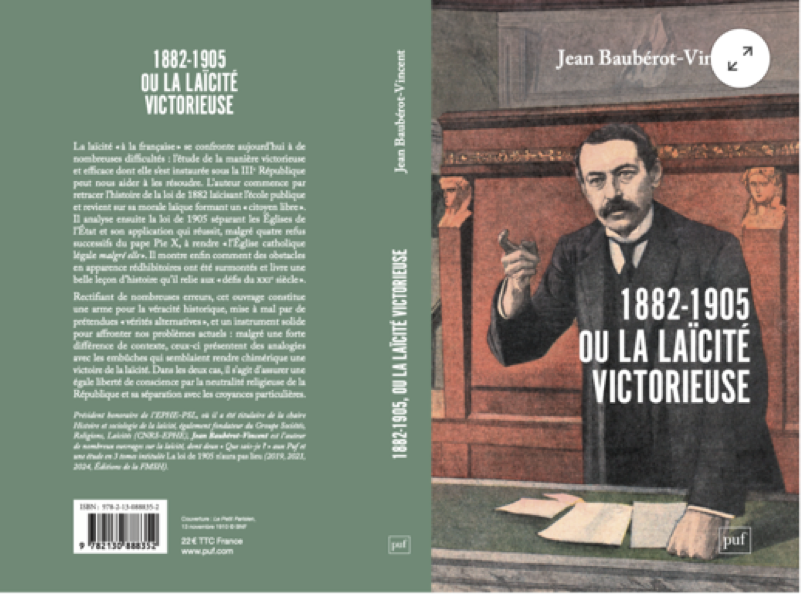
L'été a été vraiment éprouvant, voire déprimant, aussi bien en ce qui concerne la situation nationale qu'internationale. Et la rentrée risque fort de ne pas être meilleure. Il faut tenter de se remonter le moral. Il faut tenter de se remonter le moral. Parmi les mille choses possibles, j'ose vous proposer la lecture de mon nouveau livre 1882-1905 ou la laïcité victorieuse (PUF) !
Tiré du blogue de l'auteur.
En effet, il tente de montrer comment des obstacles, en apparence rédhibitoires, ont été surmontés et comment les républicains de l'époque ont réussi, malgré leurs divisions et à travers beaucoup de difficultés, à instaurer une laïcité à la fois victorieuse et pacificatrice. En un certain sens, d'ailleurs, elle fut victorieuse parce que pacificatrice car la victoire implique de pouvoir faire la paix. Si connaitre la façon dont la laïcité s'est instaurée victorieusement (et efficacement) ne fournit aucune recette à appliquer mécaniquement aujourd'hui, cela constitue, néanmoins, un instrument pour affronter les défis actuels, pour pouvoir construire, et non subir, un avenir qui s'affranchisse des impasses du présent
Bien sûr, l'apaisement réalisé n'a nullement signifié un calme plat : le conflit frontal de ‘deux France' (la France traditionnelle, « fille aînée de l'Eglise » catholique, selon la formule consacrée, et la France moderne, issue de la Révolution de 1789) a été ramené aux tensions inhérentes à un régime démocratique, où le dissensus est le corolaire de la liberté. Mais la laïcité est devenue hégémonique à un point tel que le régime de Vichy n'a pas osé supprimer les deux lois qui la fondent (celle de 1882 laïcisant l'école publique ; celle de 1905 séparant les Eglises de l'Etat), même s'il a trahi leur esprit. Au sortir de la guerre, en 1946, la Constitution a affirmé : « La République est […] laïque » et l'établissement d'un « enseignement laïque » est un « devoir de l'Etat » (termes réitérés par la Constitution actuelle). Mieux : alors qu'au moment même de l'élaboration de la loi de 1905, des intellectuels des deux bords, dialoguant dans une association intitulée l'Union pour l'action morale (UAM), estimaient qu'il y aurait longtemps des troubles dans les églises et qu'il faudrait les faire garder par la force publique pendant plus de 20 ans, dès 1908 les messes se déroulent tranquillement. Le calme est revenu et la séparation fonctionne, malgré quatre refus successifs des lois françaises par le pape Pie X, cherchant à entrainer la République dans la voie de la « persécution » (= la fermeture des églises). Le pire n'est donc pas toujours sûr : cette ‘leçon' de l'Histoire doit nous donner de l'énergie par les temps qui courent !
Depuis bien quarante ans, je laboure (en bon petit-fils de paysan) le champ de l'histoire et du présent de la laïcité. Le moment est venu pour moi de m'atteler à un autre champ d'études et c'est ce que je fais actuellement. J'ai voulu, cependant, clore mon travail par un ouvrage de synthèse destiné à ce que l'on appelle le « grand public cultivé », notamment les enseignant.e.s, les militant.e.s associatifs et toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur la laïcité, son passé et son devenir. Je me suis rendu compte que si certains livres portaient sur la création de l'école laïque et quelques autres sur la loi de séparation, aucun d'eux ne liait ensemble ces deux événements[1], ne montrait leur cohérence profonde et, à fortiori, ne les situait dans la perspective des défis que la laïcité affronte aujourd'hui.
A mon sens, cette mise en perspective ne pouvait être faite, notamment parce que ces études minimisaient un aspect essentiel de chacune de ces deux lois : si leur cause était l'affrontement de deux France qui semblaient incapables de vivre ensemble – il faut qu'une France meurt pour que l'autre vive prétendait le quotidien La Croix lors du centenaire de la Révolution- leur fabrication s'est effectuée à travers un conflit interne aux républicains. Très schématiquement, pour faire court, deux laïcités se sont opposées, une batailleuse, voulant une laïcité dominatrice (elle se qualifiait elle-même de « laïcité intégrale ») et une autre plus conciliatrice, souhaitant une laïcité hégémonique mais non dominatrice, car conciliable avec diverses convictions, à partir du moment où ces dernières ne s'imposaient pas par la force. Certains laïques ont navigué de l'une à l'autre suivant les moments et les problèmes et chaque mouvance regroupait des personnes ayant des opinions pas forcément identiques.
1882 : la laïcisation de l'école publique au cas par cas
Deux conflits superposés donc. En mettant la focale sur le seul conflit de deux France, des événements importants se sont trouvés minimisés, ou même passés sous silence par certains historiens. C'est le cas pour la laïcisation de l'école. Un seul exemple : on a abordé la loi de 1882 sans analyser la circulaire d'application qui, pourtant, déclencha un beau tollé, en privilégiant le cas par cas dans l'enlèvement du crucifix des salles de classes : il ne faut pas « porter le trouble dans les familles ou dans les écoles » affirme ce texte, car la loi laïcisatrice « n'est pas une loi de combat », mais « une de ces grandes lois organiques destinées à vivre avec le pays, à entrer dans ses mœurs ». Certains protestent : « ce qui sera légal à Landerneau deviendra-t-il subversif à Brive ? », mais cela revient à créer « le régime de la légalité facultative » ! C'est, néanmoins, cette méthode, cette stratégie qui s'est révélée « efficace » (terme utilisé dans la circulaire) et a permis à l'école laïque de l'emporter.
Si la mémoire collective, les romans comme ceux de Marcel Pagnol, ont mis en scène l'opposition du curé et de l'instituteur, l'historien Yves Deloye, montre, à partir d'un très minutieux travail d'archives, que la « mobilisation » catholique a touché « un peu moins de 6% des communes » et n'a que « très rarement débouché sur des incidents violents ». Rapidement l'école publique laïque est devenue celle de la grande majorité des élèves ; elle est -effectivement- entrée dans les « mœurs » de la France métropolitaine.
Autre aspect capital souvent oublié (qui a fait que, même si l'école laïque s'est imposée, une querelle scolaire a subsisté) : la volonté récurrente de certains d'un monopole de l'enseignement laïque c'est-à-dire la création d'une « école gratuite, laïque et obligatoire » (et, inversement, bien sûr, la volonté catholique de retrouver une forte influence sur l'école). La formule est souvent utilisée, or elle est fausse : l'enseignement public est laïque, l'instruction est obligatoire. Les arguments invoqués par les deux camps laïques dans ce conflit sur le « monopole » au début du XXe siècle sont très utiles à connaitre pour mieux comprendre les problèmes actuels de la laïcité scolaire.
1905 et « l'Eglise catholique légale malgré elle »
Ce qui est vrai de la loi de 1882, laïcisant l'école publique, s'avère encore plus exact concernant la loi de 1905, séparant les Eglises de l'Etat. Ainsi, à propos de l'article clef -l'article 4- , un virulent conflit oppose deux mouvances de gauche, pendant plus d'un mois (20 avril-27 mai), faisant craindre un échec final de la loi[2]. Pourtant, in fine, ‘l'éthique de responsabilité' prévalant sur ‘l'éthique de conviction', l'ensemble de la gauche vote le texte. Mais cette gauche n'est pas au bout de ses peines : un mythe (la « déchristianisation de 1793 recommence »), porté par toute une campagne de désinformation, incite, en effet, les catholiques à la violence et des affrontements se produisent autour des églises (où, inversement, avant la séparation, des messes étaient interrompues par des interpellations du « citoyen-prédicateur »). Comme je l'ai indiqué, ce n'est pas un (comme le prétend une histoire classique) mais quatre refus que le pape oppose à la séparation : il demande non seulement aux catholiques de ne pas se conformer à la loi de 1905, mais également de s'opposer aux solutions dites de « droit commun » concoctées par Briand. La réponse logique est alors la fermeture des églises. Pour l'éviter, il a fallu, et cela ne s'est pas réalisé sans tiraillements internes ni péripéties nombreuses, rendre « l'Eglise catholique légale malgré elle ».
Le chroniqueur du Figaro, Julien de Narfon, note le 30 décembre 1906 : « Qu'y a-t-il de plus drôle en soi que l'attitude respective des partis à l'égard de la fermeture éventuelle des églises, d'une part, un gouvernement areligieux que le souci de la paix publique autant que de sa propre sécurité obligent à entasser les circulaires sur les lois à la seule fin de pouvoir presque légalement laisser les églises ouvertes, dans quelque situation que se placent les catholiques vis-à-vis de ces circulaires et de ces lois ; d'autre part des gens qui se réclament de la religion et dont toute la politique tend à l'acculer à fermer ces mêmes églises, escomptant par avance à leur profit le mécontentement des populations. » Narfon ajoute : « Je regrette que ni ma foi religieuse ni mon patriotisme ne me permette d'assister en spectateur, intéressé uniquement à l'originalisé du spectacle, au drame qui se déroule sous nos yeux, et dont j'appréhende trop, hélas, comme catholique et comme Français, le dénouement, pour jouir pleinement de la force comique qu'en dégagent certaines scènes. » Propos très significatifs !
1882, 1905 face aux défis du XXIe siècle
Le « drame qui se déroule sous nos yeux » dont le « dénouement » va être tragique : celles et ceux qui prétendent que la laïcité de 1905, trouvant face à elle, le catholicisme, n'avait pas à affronter « des problèmes de la gravité de ceux d'aujourd'hui » se montrent naïfs et feraient bien de prendre connaissance de telles déclarations. Le contexte est, bien sûr, très différent (dans ma dernière partie, j'analyse sept dissemblances entre 1882-1905 et aujourd'hui). Il n'empêche : le piège dans lequel Pie X, et les catholiques intransigeants qui l'influençaient, voulait faire tomber la République de 1905 n'est pas sans analogie avec le piège que l'islamisme radical tend aujourd'hui à la République (en arriver à une laïcité discriminante face à l'islam, pour attirer des musulmans, notamment des jeunes, dans leur orbite). La Troisième République a su l'éviter ; je montre que, malgré les apparences, données actuellement par une laïcité dominante médiatique et politique (qui reprend bien des arguments des laïques intégralistes, vaincus en 1882 et en 1905-1908), la partie est loin d'être perdue pour autant.
La laïcité a été victorieuse grâce à des « accommodements » (le terme n'était pas péjoratif et le discours de Briand le plus louangé, significativement oublié aujourd'hui, a porté sur le refus de « victoires excessives » qui engendrent « des rancœurs et des haines »). Cependant, la nature, l'ampleur de ces accommodements ne présentait aucun caractère d'évidence. En effet, ils étaient consentis au profit de la pratique religieuse et ne comportaient guère d'équivalent pour les personnes sans religion. L'égalité dans la liberté de conscience allait-elle, alors, être réellement respectée ? Ne s'agissait-il pas de concessions à des adversaires de la laïcité qui les mettraient à profit pour lui nuire ? Ce genre de question s'est posé sous la Troisième République, tout comme elles se posent aujourd'hui. Mais le succès de la laïcité est advenu par le fait que le dissensus n'a pas entrainé une rupture entre républicains, que la plupart d'entre eux ont compris qu'un jusque-boutisme serait contre-productif en favorisant ceux qu'il fallait isoler (= rendre non-attractif) pour pouvoir être victorieux.
De même aujourd'hui, le plus insupportable est la prétention orthodoxe de réduire « la » laïcité à la conception que l'on en a. Le débat entre laïques est légitime et nécessaire, maintenant comme autrefois. Personne ne possède toute la ‘vérité'. C'est pourquoi j'ai tenté d'exposer les différentes pièces du dossier, sans cacher leur ambivalence. Ferry, Buisson, Briand, Jaurès, Clemenceau, …[3] : toutes ces figures ont eu leur part d'ombre et aucun d'eux n'a été un ‘saint laïque'. Chacun d'entre eux, pourtant, a apporté une pierre à l'édifice en prenant une relative distance avec les idées dominantes de l'époque. J'ai recherché à rendre compte de la véracité historique et à clarifier les enjeux actuels, pour décanter le débat et non pour le clore.
Notes
[1] Ainsi que sur la morale laïque de la Troisième République, à la laquelle je consacre un chapitre car, malgré ses failles, elle constitua une réelle instruction à une citoyenneté libre. Je publie d'ailleurs, en excursus, un étonnant (mais significatif et savoureux) devoir d'une écolière sur le sujet suivant : « Expliquez à un vieux paysan de vos voisins comment se fait une loi ».
[2] Chez certains auteurs ce conflit est l'objet d'un déni, d'autres le minimisent fortement (réduisant le camp vaincu à quelques socialistes-révolutionnaires ou racontant l'histoire uniquement du point-de-vue des vainqueurs). A mon humble avis, aucun d'eux ne lui restitue son ampleur et ce n'est pas un hasard.
[3] Tous des hommes : j'aborde le problème de la laïcité face aux femmes, hier et aujourd'hui.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
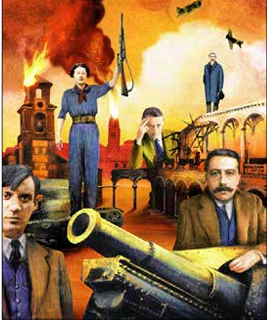
Les gauches et la question militaire
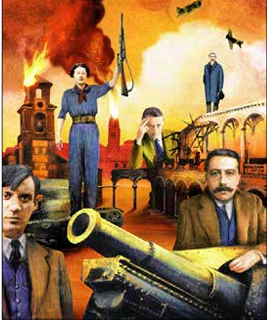
La première réunion que nous avons tenue sur le thème « Les gauches et la question militaire » a surtout permis de comprendre à quel point les questions de défense populaire et de conscription ont été absentes de la réflexion des gauches depuis plusieurs dizaines d'années. Questions balayées d'un revers de déclarations sur la paix, la guerre est un drame pour la population… Reprenant souvent des arguments des années 1950 sans même voir que l'URSS qui les distillait avait disparu en 1992.
Pour télécharger la revue, cliquez sur l'icône :
Point de mire Édito
Michel Lanson
La population ukrainienne est pour la paix ; elle voudrait travailler, s'aimer, se divertir, vivre en paix. Les Ukrainien·nes pensent, savent, ressentent dans leur chair que la guerre est un drame. Mais que faire lorsque votre pays est attaqué par l'impérialisme voisin ? Que faire d'autre que résister ? Résister pour défendre aussi les acquis du Maïdan.
Nous continuons de soutenir cette résistance et aussi d'étudier les formes d'organisations mises en place par la population elle-même pour se défendre.
Nous analyserons aussi les changements de stratégies, l'apparition d'une nouvelle forme de guerre (guerre des drones) imposés le plus souvent par l'infériorité numérique et le manque d'armement face à un envahisseur surarmé de façon classique et qui continue d'appliquer les théories de Joukov [1] de submersion par l'infanterie au mépris de la vie de ses propres soldats.
Les gauches nordiques et scandinaves, sans doute plus proches du conflit ou plus avancées poitiquement, abordent plusieurs points que nous de vons prendre en compte. Un point essentiel au moment de l'exacerbation des conflits dans le monde et de la montée des fascismes : il n'y a pas de politique progressiste et d'émancipation qui ne comprenne une politique de défense populaire. Comment prétendre changer la société sans penser à la défendre ?
Peut-on confier cette défense à une armée composée de mercenaires et commandée par une longue tradition d'extrême droite ? C'est une contradiction majeure ou, pire, un mensonge volontaire pour se glisser dans les institutions du monde existant.
La question de la défense populaire intégrée dans une politique sociale d'émancipation demande de revisiter bien des points. La défense ne peut être déléguée uniquement à une armée de métier. La question de la réserve ne peut être abordée indépendamment de celle de la conscription, bien sûr, repensée entièrement. Le modèle finlandais peut servir d'appui à la réflexion.
L'organisation du système de défense doit être démocratique ; l'exemple ukrainien est là encore intéressant, même si les avancées démocratiques ne sont pas généralisées. Organisation à la base des comités de défense, syndicats dans les unités, élections de certains officiers… Si bien sûr l'unicité du commandement ne peut être remise en cause pas souci d'efficacité (le commandement dépendant du pouvoir politique donc là encore la question sociale et politique ne peut être dissociée de la question militaire), des comités élus de soldats peuvent intervenir à tous les niveaux.
La question de l'armement et la domination ac tuelle des complexes militaro-industriels est aussi un point de blocage, une contradiction liée à la question du pouvoir. D'abord un aspect financier et technique, la production actuelle est principalement tournée vers l'exportation lucrative au point que le matériel manque dans l'armée nationale alors que les ventes enrichissent les sociétés d'armement. Or, l'Ukraine a montré que l'armement change en fonction de la stratégie. L'importance prise par l'IA et les drones est considérable. L'inventivité, la créativité, la maîtrise des nouvelles techniques prend le pas sur le savoir des ingénieurs spécialistes des chars et des porte avions. Une large partie du savoir tend à sortir de la seule industrie militaire. [2]
Souvent, à gauche, on se contente de formules cosmétiques pour aborder la démocratie appliquée au domaine militaire. Sur la question de l'armement, on ajoute « sous contrôle démocratique » et pour renforcer l'idée on parle de « nationalisation ». Mais là en core c'est bien la question du pouvoir qui est en jeu. Qui peut imposer un réel contrôle démocratique si ce n'est un pouvoir réellement démocratique ? Qui peut imposer la nationalisation des usines d'armement au complexe militaro-industriel si ce n'est un gouvernement réellement démocratique soutenu par le prolétariat. On discutera sans doute plus avant des questions de nationalisations qui, à ce stade, semblent des raccourcis qui masquent la question centrale : qui peut appliquer une politique militaire démocratique, une politique militaire industrielle adaptée, une politique sociale en s'appuyant sur des structures auto-organi sées et populaires ?
Surtout, lorsque la montée des politiques autoritaires se fait sentir, nous devons discuter du fond du problème. Il n'y a pas de raccourci dans l'histoire ni de formules magiques, en revanche le courage politique est essentiel.
Il faudra aussi aborder la question du niveau solide d'élaboration d'une telle politique. Bien souvent, il est évoqué surtout dans les sphères politiques et médiatiques du niveau européen (le plus souvent pour s'éloigner d'un contrôle populaire possible). Mais la « coordination des volontaires » vient de mettre le dernier clou dans le cercueil de la défense européenne. Si nous pensons qu'il faille une politique militaire démocratique et populaire, si nous ne voulons pas laisser la politique militaire à la bourgeoisie, il faut qu'elle soit élaborée et contrôlée au plus près du « peuple » c'est-à-dire sans doute le niveau national sans aucun doute articulé à celui des territoires.
Au lieu de se réfugier dans une rhétorique vide, la gauche doit façonner de manière proactive les solutions. La gauche doit s'unir pour promouvoir une stratégie de défense ou`la sécurité´ n'est pas financée par la réduction des programmes so ciaux mais par l'augmentation des impôts sur les ultra-riches [3]
Les questions sont multiples, les problèmes immenses et le temps compté pourtant nous de vons nous atteler à la tâche tout en affrontant les manœuvres opportunistes, les mensonges éhontés et les attaques des ennemis du « peuple souverain ». Je terminerai par cette citation d'Oleksandr Kyselov, militant de Sotsialnyi Rukh, dans son dis cours de Copenhague à l'invitation des « Rouges et verts » danois : « On ne peut pas combattre le fascisme avec des fleurs »
(Encore moins avec des fleurs de rhétorique).
[1] Gueorgui Joukov devient chef d'état-major de l'armée soviétique en 1941. Il est réputé pour sa stratégie qui consistait à envoyer en masse l'infanterie en vagues successives au mépris de la vie de ses soldats.
[2] En cherchant des réponses à cette infériorité, la société civile et la société militaire ukrainienne ont su entrer en synergie pour intégrer les nouvelles technologies dans leurs réalisations et pour les mettre industriellement en fabrication.
[3] Hanna Perekhoda, « L'isolationnisme de gauche : le chemin vers l'insignifiance politique dans le débat sur la défense européenne », Lignes de mire, n° 1. Voir également dans ce numéro, p. 52.

Gaza, le point de bascule ?

L'indignation internationale n'a pas eu raison du génocide infligé à la population gazaouie par Netanyahou, sous l'œil bienveillant et approbateur de Donald Trump. Au cours de ces dernières 24 heures, 34 Palestiniens sont tombés sous les balles de l'occupant, portant le nombre total des victimes à plus de 64 905. A Paris, euroPalestine dénonce une barbarie !
De Paris, Omar HADDADOU
De quelle encre s'écriront les mémoires des génocidaires ?
A question niaise, réponse laconique : Du sang de leurs victimes ! Le projet E1, cher à Netanyahou, porté par le promoteur de la colonisation, Ministre des Finances, B. Smotrich, approuvé le 20 août 2025, prévoit, en guise de point d'orgue le nettoyage ethnique, la construction de 34 000 logements dans la bande de Gaza et l'annexion de la Cisjordanie.
Une feuille de route actant l'inopérance des Instances internationales et l'hégémonie implacable étasunienne. Bibi, fidèle à son fantasme de Messie du grand Israël, fauchant les vies des enfants palestiniens comme on fauche du blé, tonitrue à ses extrémistes et à la face du monde, le 11septembre 2025 : « Nous allons tenir notre promesse : « Il n'y aura pas d'Etat palestinien ! Et cet endroit nous appartient ! ».
Un message tranchant adressé en premier lieu au Président français Emmanuel Macron, résolu à reconnaitre, le 22 septembre prochain, l'Etat palestinien, une sorte de baroud d'honneur avant la fin de son second mandat. Rappelons que l'Algérie est le premier pays parmi les 148 à avoir reconnu l'Etat de Palestine, le 15 novembre 1988 à Alger. Elle demeurera un fervent défenseur de sa souveraineté.
Présentement, seuls 5 pays sont passés à l'action par des mesures concrètes à savoir, l'Irlande, la Slovénie, la Turquie, la Belgique et dernièrement l'Espagne.
Mais les décisions en faveur de la Palestine dont le nombre de victimes est de 64 905 et 316 blessés, selon le Ministère de la Santé palestinien, restent entravées par le véto américain. Dans un document rendu public cette semaine, l'Etat hébreu aurait violé les 5 conditions énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948.
Le sauvetage des 2 millions de Palestiniens, livrées à l'horreur d'une l'extermination véloce assistée par l'IA, devient un cri d'alarme planétaire. Nombre d'observateurs insistent sur la nécessité pressante de l'ONU de recourir à la résolution 377, connue sous le nom « Uniting for Peace », Union pour le Maintien de la Paix. Un mécanisme qui éclaire sur un cas de figure où le Conseil de Sécurité se retrouve dans l'impasse. En effet, si ce cas venait à s'imposer, le pouvoir d'agir est transféré à l'Assemblée générale, et le droit de Véto devient caduc. Une Force de Protection prend alors les choses en main.
Indubitablement, nous sommes à un moment crucial de la destinée de Gaza et la diplomatie s'emballe au gré des rebondissements sur le terrain et les nouveaux positionnements des protagonistes.
A Doha, hier, le Qatar a rassemblé des dirigeants du monde musulman, après les tirs de missiles tirés par l'Etat hébreu, mardi 9 septembre, selon une source française, au moment où les médiateurs du Hamas se réunissaient dans leur bureau. L'Emir du Qatar a pointé du doigt Israël de « vouloir faire dérailler les négociations sur Gaza après ces frappes ». Sur un ton véhément, le Premier ministre, déclare : « Le temps est venu pour la Communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis ! »
Les liens entre les deux pays semblent compromis.
En visite à Jérusalem, le Secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a expressément affiché son soutien Benyamin Netanyahou, réaffirmant la relation américano israélienne face aux menaces régionales. Dans leur agenda figurent l'élimination du Hamas et la mise en échec de la menace iranienne.
L'appel, hier d'Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste afficher le drapeau palestinien sur les Mairies, le 22 septembre, jour où la France doit reconnaitre l'Etat palestinien !
Le leader du PS a trouvé la très bonne parade pour rebondir et effacer sa trahison et sa disgrâce. Comme disait toujours ma mère : « Après avoir prouté, elle a ramassé ses jambes ! »
Du doliprane, SVP, pour le NFP qui voit l'Histoire s'écrire à contre-poil !
Oui, la cause palestinienne est désormais planétaire. Il y a cette déferlante « Free Palestine » que nul ne peut contenir. Il y a la flottille SOUMOUD « Résistance » qui lève l'ancre, ameutant d'autres embarcations. Il y a surtout la rue qui s'égosille, comme celle de Paris, ce samedi à la Place d'Italie : « Génocide à Gaza, on ne se taira pas ! On est là, on est là ! Pour la Palestine et les enfants qu'on assassine ! »
Initiée par EuroPalestine, la mobilisation avait pour séquences poignantes, la marche funèbre rythmée par un roulement sourd de tambour, des scènes de cadavres bombardés, des slogans d'indignation et des discours de responsables de collectifs au vitriol contre les promoteurs de la mort collective.
Hier, 20 000 Gazaouis (es) ont été chassés de leurs foyers.
O.H





France - Valérie Masson-Delmotte : « Il y a un déni des risques climatiques, un déni de responsabilité »

Canicules, sécheresses et incendies. Après cet été brûlant, la climatologue Valérie Masson-Delmotte déplore que le gouvernement se cantonne à de la gestion de crise. « On n'a aucun cap au-delà de 2030 », résume-t-elle.
Tiré de Reporterre
6 septembre 2025
Par Jeanne Cassard
Il a démarré par une canicule exceptionnellement longue et précoce et s'est terminé par des cumuls inédits de pluie dans le sud-est du pays. Entre les deux, une seconde canicule, des incendies dévastateurs et un déficit de précipitations entraînant 45 départements en crise sécheresse.
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, membre du Haut Conseil pour le climat et ancienne coprésidente du groupe 1 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), prévient : cet été nous donne un avant-goût de ce que sera le climat dans quelques décennies.
Reporterre — Quel regard portez-vous sur l'été que nous venons de vivre ?
Valérie Masson-Delmotte — Au-delà de la succession de canicules, sécheresses, incendies et pluies diluviennes, je retiens surtout une grande inquiétude. Lors de mes vacances en Lozère et en Bretagne, j'ai échangé avec des personnes au hasard, dont des éleveurs touchés par la sécheresse. Lorsque je leur disais que j'étais climatologue, ils me demandaient à quoi ressembleront nos étés dans vingt-cinq ans. Dans une France à +2,7 °C par rapport à l'ère préindustrielle, scénario vers lequel nous nous dirigeons en 2050, des records de chaleur jusqu'à 50 °C seront possibles, l'été que nous venons de vivre sera la norme. D'ici 2100 dans une France à +4 °C, le nombre de jours de vagues de chaleur serait multiplié par dix, entre mi-mai et fin septembre.
À chaque fois, je voyais la gravité dans les yeux de mes interlocuteurs et ils me posaient la même question : comment fera-t-on ? C'est là tout le problème, j'ai été frappée par le décalage entre cette grande inquiétude et l'absence de cap politique pour y répondre.
Les gouvernants ne sont pas à la hauteur de l'urgence...
L'été 2025 nous montre à quel point nous ne sommes pas prêts pour faire face au dérèglement climatique. On n'est pas assez dans l'adaptation : la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie a été encore repoussée, on ne sait pas quand sortira la stratégie nationale bas carbone et le plan national d'adaptation au changement climatique n'est pas accompagné de financements suffisants.
On reste dans la gestion de crise, sortant d'une crise avant de passer à la suivante avec des dégâts humains et matériels toujours plus importants. C'était pourtant l'un des messages clés du rapport du Haut Conseil pour le climat publié début juillet, il rappelait que le coût de l'inaction climatique est nettement supérieur aux investissements nécessaires pour atteindre la neutralité carbone.
Parallèlement, le rythme de baisse des émissions a fortement ralenti depuis 2023. Les dernières estimations du Carbon Monitor suggèrent une hausse des émissions en France sur le premier semestre 2025 par rapport à la même période l'an dernier. C'est lamentable compte tenu de notre responsabilité historique, de notre niveau de richesse et donc de notre capacité à agir.
Entre l'instabilité politique avec la chute annoncée du gouvernement Bayrou et la rigueur budgétaire, le pilotage de la transition écologique ne semble pas être la priorité du moment…
C'est extrêmement préoccupant, un gouvernement sur la sellette ne peut pas proposer un cap clair sur le sujet. Depuis la dissolution, le manque de stabilité des différents gouvernements ne permet pas d'avoir une réponse politique à la hauteur des enjeux. On se retrouve avec des politiques publiques qui changent tous les trois mois, il y a sans cesse des tergiversations. L'instabilité des dispositifs comme MaPrimRénov' envoient un signal flou aux ménages qui ont besoin de lisibilité. Dix ans après l'Accord de Paris sur le climat, on n'a aucun cap au-delà de 2030. À cause de ce manque de constance, on se retrouve dans une situation budgétaire complexe qui n'arrange rien.
« Il y a un déni des risques climatiques, un déni de responsabilité »
Ces difficultés pour dégager un cap clair et financer les investissements nécessaires nourrissent un sentiment d'impuissance. Il y a un déni des risques climatiques, un déni de responsabilité, un déni de capacité à agir.
Comment sortir de ce déni ?
Je suis climatologue, pas spécialiste en sciences politiques, mais ce que je peux dire, c'est que la délibération est un levier essentiel. Je crois qu'il est encore possible d'obtenir des consensus sur des sujets d'intérêt général. Si le personnel politique n'arrive pas à se mettre d'accord, on a vu que cela pouvait fonctionner avec des citoyens.La Convention citoyenne pour le climat a montré que des citoyens d'horizons différents peuvent s'accorder sur des points d'intérêts communs. C'est essentiel d'avoir ce genre de délibérations pour avoir une adaptation juste socialement, en tenant compte des vulnérabilités de chacun, puisque les conséquences du dérèglement climatique ne touchent pas tout le monde de la même manière.
Les difficultés démocratiques que connaissent notre pays en ce moment et les difficultés à agir face au changement climatique sont évidemment liées.
Vous observez une montée du déni climatique ?
On n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis avec un déni climatique brutal et assumé, en France, c'est plus insidieux. On assiste tout de même à une montée en puissance de groupes qui font en sorte de saper toute action climatique. Cela passe d'abord par la désinformation, celle-ci ne s'exprime pas uniquement sur les réseaux sociaux ou des chaînes télévisées de groupes privés, on a vu des exemples lors de débats parlementaires.
En février, lors d'un débat sur la loi Duplomb [qui prévoyait notamment de réautoriser des pesticides interdits], des sénateurs avaient proposé de reconnaître dans la loi le besoin de mobiliser les compétences scientifiques pour réduire l'empreinte carbone du monde agricole, pas seulement pour l'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Cela a été rejeté sous prétexte que cela stigmatisait le monde agricole. C'est pourtant le deuxième secteur le plus émetteur derrière les transports. Ce refus illustre une forme de déni face au rôle de l'agriculture dans la crise climatique.
À côté de la désinformation, certains groupes font tout pour paralyser la vie démocratique en polarisant le débat : pour ou contre le nucléaire ? Pour ou contre la climatisation ? Pour ou contre les éoliennes ? Cette stratégie, en n'apportant que des réponses simplistes, empêche tout débat de fond.
Malgré le sombre tableau que vous venez de dresser, croyez-vous encore au sursaut ?
Oui, la situation est grave, tant sur le plan climatique que démocratique. La seule chose positive que je retiens de cet été est l'avis rendu par la Cour internationale de justice. Les juges ont estimé que le changement climatique est « une menace urgente et existentielle » et que tous les États ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour garantir les droits fondamentaux, comme le droit à la santé, à l'eau et à l'alimentation. C'est historique, j'espère que cela va renforcer le cadre juridique de l'action pour le climat.
Pour ce qui est de la France, j'espère aussi que les élections municipales de mars 2026 seront l'occasion d'avoir de véritables échanges et réflexions sur les sujets d'adaptation. Qu'il s'agisse des bâtiments, des mobilités, de la gestion de l'eau... ces questions sont très importantes à l'échelle des villes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les travailleurs du denim au Mexique : exploitation et terreur au milieu de journées épuisantes

Dans l'industrie textile qui fournit Zara et d'autres marques, les mauvaises conditions de travail sont devenues la norme, en particulier dans le Sud global où se trouvent la grande majorité de ces entreprises.
https://www.lahaine.org/mundo.php/trabajadores-de-la-mezclilla-en-mexico-explotacion
8 septembre 2025
Laura Rosas travaille dans l'usine textile Nien Hsing, à Tamaulipas, où la température atteint 50 °C et où le bruit des machines est si intense qu'il a détérioré son audition. Pour faire son travail, elle doit rester debout sur un banc pendant toute la journée, tandis que les superviseurs étrangers lui crient dessus pour la forcer à aller aussi vite que possible. Ainsi, entre le bruit et la chaleur, Laura endure une fatigue extrême pour obtenir le salaire qui lui permet de nourrir sa famille. Son travail épuisant n'est pas un cas isolé, mais fait partie intégrante de la précarisation du travail que le capitalisme mondial impose aux travailleurs pour maintenir ses profits.
Dans l'industrie textile, les mauvaises conditions de travail sont devenues la norme, en particulier dans les pays du Sud où se trouvent la grande majorité des entreprises du secteur. Cette industrie s'est reconfigurée à l'échelle mondiale en raison des différentes crises économiques que le capitalisme a traversées. À partir des années 70, l'un des moyens de renverser la tendance à la baisse des taux de profit du grand capital a consisté à délocaliser les entreprises dans des pays sous-développés, dans le but d'augmenter leurs profits grâce aux différences salariales.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'entreprise taïwanaise Nien Hsing qui, en 1991, a implanté une usine au Lesotho, en Afrique, puis au Mexique en 1998, quatre ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain, qui lui a accordé des exonérations tarifaires.
Nien Hsing continue d'opérer au Mexique, car la main-d'œuvre y est encore très rentable, ce qui lui permet de réaliser des profits plus importants. Cependant, les travailleurs font les frais de cette situation : ils touchent un salaire de misère et travaillent dans des conditions déplorables, comme le souligne Laura. De plus, l'organisation des travailleurs en syndicats n'a pas entraîné d'améliorations sur le plan des conditions de travail. Les dirigeants syndicaux ont été cooptés par l'entreprise pour travailler dans son intérêt. Tout cela porte atteinte aux conditions de vie des travailleurs.
Nien Hsing : la multinationale
Nien Hsing Textile est une entreprise multinationale renommée qui possède des usines au Mexique, au Lesotho, au Vietnam et à Taïwan. Son usine de Ciudad Victoria, dans l'État de Tamaulipas, emploie 796 personnes. Elle produit principalement du tissu denim et a une capacité de production quotidienne de 60 960 mètres de tissu. Elle compte quatre départements : filature, teinture, tissage et finition. Ses principaux clients sont les marques renommées Levi Strauss & Co., Abercrombie & Fitch et VF, selon les informations disponibles sur le site web de l'entreprise.
La majeure partie de sa production est exportée vers d'autres pays, principalement vers les États-Unis, mais aussi vers le Panama et le Nicaragua.
Selon l'agence de presse Reuters, en 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 6 420 millions de dollars taïwanais, soit 201 millions de dollars américains, avec un bénéfice net de 7,6 millions de dollars américains. Une ouvrière devrait travailler 1 400 ans au salaire minimum pour atteindre le bénéfice net annuel de l'entreprise.
Comment cette entreprise parvient-elle à réaliser des bénéfices dans un secteur hautement concurrentiel ? Elle y parvient en précarisant les conditions de travail.
Conditions de travail
En été, la température à Ciudad Victoria dépasse les 40 °C. À l'intérieur de l'usine, la température atteint 50 °C, en raison de la chaleur dégagée par les machines. Logiquement, le corps humain a besoin de s'hydrater dans ces conditions, mais les patrons refusent même de fournir ce liquide vital. « Nous nous évanouissons presque. Nous demandons seulement de l'eau fraîche, mais même cela nous est refusé », affirme Verónica Gallardo, employée dans le secteur de la finition.
Iván Ríos, superviseur du secteur du tissage, marche sans arrêt un kilomètre et demi par kilomètre et demi (28 000 pas par équipe) dans l'atmosphère assourdissante et chaude du secteur du tissage. « C'est une épuisement physique brutal. Pas même un verre d'eau, pas même un Gatorade, mais allez, marche et marche, ne t'arrête pas et ne parle pas », nous dit-il.
Cet environnement de travail aggrave les maladies dont souffrent les travailleurs, telles que l'hypertension, auxquelles s'ajoute le stress quotidien lié au travail. « Le bruit est assourdissant, c'est désespérant. Il est impossible de discuter avec ses collègues. Certains souffrent d'acouphènes ou perdent une partie de leur audition. Ce que je crains, c'est d'avoir une crise cardiaque, car cela est déjà arrivé à d'autres », explique Laura Rosas, ouvrière dans le secteur du filage.
Dans la chaleur, le bruit et l'épuisement extrême, les travailleurs produisent chaque jour 60 960 mètres de tissu que l'entreprise vend à des marques prestigieuses. Mais ce n'est pas tout : les ouvriers affirment que la violence physique et psychologique est monnaie courante.
Violence au travail, mauvais traitements et humiliations
« Les Chinois nous crient dessus et nous réprimandent pour un rien. Ils nous ont même frappés sur les mains, ils ne comprennent pas que nous ne pouvons pas aller plus vite que les machines », explique Verónica.
L'usine fonctionne selon un régime disciplinaire fondé sur la violence. Les superviseurs taïwanais et indonésiens haussent le ton et infligent des punitions physiques. « Une chef indonésienne m'a frappée sur les mains, m'a crié dessus et s'est moquée de moi. J'étais seulement en train d'apprendre. Je suis rentrée chez moi en pleurant, impuissante », se lamente Laura.
Iván était superviseur et a quitté son emploi parce qu'il ne supportait plus la pression inhumaine qui lui était imposée. Il affirme que l'entreprise impose un système de peur : « Le directeur crie et jette des objets. Il fait pleurer beaucoup de femmes, dans tous les services, y compris les femmes de ménage. Elles ne savent pas comment réagir. Elles m'ont demandé de l'aide à plusieurs reprises, mais je ne pouvais rien y changer. C'est un cercle vicieux ».
Il témoigne également que l'entreprise corrompt certains services qui jouent le rôle de superviseurs dans différents domaines. L'un d'entre eux concerne la stabilité mentale et émotionnelle des travailleurs. « La représentante de l'organisme vient nous faire passer un test psychologique. Ils nous font passer dix par dix. Ils nous demandent : « Vous êtes-vous senti sous pression ? Avez-vous des pensées suicidaires ? Considérez-vous que l'environnement de travail est source de stress ? », entre autres. Les résultats sont si mauvais que les ressources humaines se chargent de remplir de nouveaux questionnaires avec des données inventées afin que, après une petite vérification, la superviseuse les emporte. »
Sanctions financières illégales
Les travailleurs sont également victimes de sanctions et d'amendes constantes qui leur sont infligées sans raison et qui ne sont même pas prévues par la législation mexicaine. « Le fil est souvent de mauvaise qualité et se casse quand on l'assemble, ce qui entraîne une amende. C'est toi qui dois la payer », explique Laura.
Les absences au travail donnent également lieu à des retenues exorbitantes. « Il y a deux semaines, j'ai manqué le travail parce que je devais emmener mon fils chez le médecin, et quand j'ai reçu ma fiche de paie, on m'avait déduit 500 pesos. J'ai failli m'arracher les cheveux tellement j'étais impuissante. Je me suis plainte, mais ça ne sert à rien, ils ne font rien. » Il faut noter que Laura ne gagne que 272 pesos par jour, ce qui rend cette retenue totalement disproportionnée.
De son côté, Iván, en tant que superviseur, avait un salaire brut de 380 pesos, le salaire maximum qu'il pouvait gagner. Il nous a raconté : « J'ai demandé la permission à mon chef de m'absenter parce que ma fille sortait de la maternelle, il m'a signé l'autorisation et je suis parti. Quelle surprise quand j'ai reçu ma fiche de paie et qu'on m'avait déduit 900 pesos. C'est là que j'ai décidé de démissionner ».
Les réductions injustifiées des salaires des travailleurs ont un impact très important sur leur pouvoir d'achat, d'autant plus que la grande majorité d'entre eux vivent au jour le jour.
Une usine avec une hiérarchie raciale
L'usine emploie non seulement des Mexicains, mais aussi des Philippins, des Nicaraguayens et des Indonésiens. Cependant, l'organisation interne reproduit une hiérarchie raciale qui, dans les relations personnelles, place les travailleurs mexicains à l'un des échelons les plus bas de la hiérarchie professionnelle. « Les cadres supérieurs sont taïwanais. Viennent ensuite les autres Chinois. Viennent ensuite les Indonésiens, les Philippins, puis nous. Les Nicaraguayens sont amenés ici presque comme des esclaves. Ils sont moins bien payés et ne reçoivent pas de papiers, ce qui les conditionne », explique Laura.
Cette hiérarchie raciste se manifeste dans la violence qu'ils exercent. Iván nous raconte : « Quand ils sursautent, ils vous crient « toi, ordure ! », parfois ils vous crient en taïwanais, vous ne comprenez peut-être pas les mots, mais vous voyez l'expression sur leur visage. Une fois, j'étais debout et il m'a crié : « toi pas bien ta tête, toi pas penser, toi mexicain ». Juste parce que j'étais debout.
La colère est telle qu'on pourrait penser qu'une grave erreur a été commise, mais Iván nous prévient que ces désagréments sont infondés : « Si vous les regardez, ils vous crient dessus, si vous vous levez, ils vous crient dessus, si vous allez aux toilettes, ils vous crient dessus, ils se fâchent pour un rien, ils vont même jusqu'à jeter des objets. Certains collègues les justifient en disant que c'est une question de culture ».
La peur du licenciement
Cette situation de précarité professionnelle, voire de violence, nous amène à nous demander pourquoi elle n'est pas stoppée, pourquoi elle n'est pas dénoncée. Iván répond : par peur. Les gens ont des dettes auprès de Fonacot, Elektra, Coppel, il est donc difficile d'agir. Imaginez qu'avec autant de dettes, ils vous suspendent trois jours pour « avoir fait le pitre », ou pire encore, qu'ils vous licencient. Comment allez-vous manger ? C'est la peur de se retrouver sans travail.
À Ciudad Victoria, capitale de l'État de Tamaulipas, seules cinq maquiladoras sont en activité : APTIV, Kemet, Spring Windows Fashion, Bulk Pak et Nien Hsing. Ensemble, elles emploient environ 8 000 travailleurs. L'emploi formel dans cette ville est limité et ce contexte nous aide à comprendre pourquoi les travailleurs tolèrent les abus et les conditions d'exploitation de la part des entreprises.
La pénurie d'emplois maintient les travailleurs dans une situation de vulnérabilité. « J'ai peur de dénoncer la situation. Je suis déjà âgée et mère célibataire. J'ai quatre enfants à charge. Je sais que c'est horrible de travailler ainsi, je n'en peux plus, mais je dois supporter cette situation, je n'ai pas d'autre choix », confie Verónica.
Les rumeurs de licenciement circulent constamment : on dit qu'ils vont faire venir davantage de travailleurs du Nicaragua et d'Indonésie pour remplacer les locaux « qu'ils exploitent davantage, car ils n'ont ni papiers ni lois pour les protéger ici ».
Ainsi, la menace de licenciement est une arme utilisée par les patrons pour imposer des conditions de travail précaires aux travailleurs.
Syndicalisation
Nous avons demandé aux travailleurs si le syndicat, en tant que représentant, discutait avec l'entreprise pour présenter les demandes et les revendications de ses membres. La réponse négative à cette question a été unanime : « La seule chose à laquelle sert le syndicat, c'est à nous voler l'argent que nous avons sur notre compte épargne », commente Gallardo.
Il est regrettable que le syndicat ne les soutienne pas, car entre les mains des travailleurs, il peut être un outil puissant pour contrebalancer les abus des entrepreneurs, c'est-à-dire des capitalistes. Ceux-ci imposent toujours le salaire, les conditions de travail et la quantité à produire. Ils essaient toujours de payer le moins possible et d'exiger le plus possible.
Le syndicat regroupe les travailleurs et agit comme un négociateur avec le capitaliste, exigeant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. La Constitution politique des États-Unis mexicains et la loi fédérale sur le travail lui confèrent de grands pouvoirs. Cependant, au Mexique, les syndicats ont toujours été cooptés par l'État, par les entrepreneurs ou par les deux. Dans le langage populaire, on les appelle les syndicats charros, blancs ou jaunes.
« Il y a environ deux ans, le syndicat actuel a remplacé l'autre, qui était très corrompu, c'était un syndicat charro, mais celui-ci est pareil, il a continué à faire exactement la même chose », a déclaré Iván.
En mai 2023, les travailleurs auraient légitimé la convention collective conclue entre le syndicat Unión de Trabajadores de la Industria Textil en General de la República Mexicana (Union des travailleurs de l'industrie textile en général de la République mexicaine) et l'employeur Nien Hsing. 428 travailleurs ont voté, soit un peu plus de 50 %. Cependant, les ouvriers affirment qu'ils sont contraints de voter, que l'entreprise leur impose le syndicat et qu'ils ne participent jamais aux négociations collectives.
« Le représentant syndical est une marionnette de l'entreprise, il les aide à intimider les autres travailleurs qui osent dénoncer les injustices. Dans l'usine, nous l'appelons « le fou », imaginez un peu », raconte Laura.
Nous voyons donc que l'outil qui devrait leur servir à lutter pour de meilleures conditions de travail leur a été retiré. Cette situation reflète également le fait que la réforme du travail mise en œuvre en 2019 n'a pas eu l'impact escompté, elle n'a pas réussi à transformer le syndicalisme charro en un syndicalisme véritablement ouvrier.
Lutte des classes
L'absence de syndicalisation dans des syndicats véritablement ouvriers a favorisé des conditions de travail très précaires. À cela s'ajoute le ralentissement de la création d'emplois et la perte d'emplois formels à Tamaulipas et, plus généralement, dans tout le pays. Les travailleurs sont pratiquement dans l'impossibilité de négocier de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour la vente de leur force de travail.
Cependant, ces phénomènes qui contribuent à maintenir des conditions précaires ne sont qu'une partie de la logique du capitalisme mondial. Le grand maître du prolétariat, Karl Marx, l'a analysé et expliqué de manière convaincante : « L'histoire de toutes les sociétés est une lutte des classes ».
D'un côté, la classe capitaliste (les patrons) est propriétaire des moyens de production, c'est-à-dire de l'usine, des machines qui s'y trouvent, du fil, des tissus, etc. De l'autre côté, il y a les travailleurs qui vendent leur force de travail pour travailler dans ces usines et qui sont ceux qui produisent la richesse.
Ce sont les deux classes dont parle Marx, entre lesquelles il y a une lutte parce que leurs intérêts s'opposent. Le patron veut obtenir plus de profits et le travailleur veut obtenir de meilleurs salaires. Si le travailleur a un meilleur salaire, le patron pense avoir moins de profits. Le patron paie donc le minimum. Comme Iván nous l'a bien expliqué dans l'interview : « L'entreprise essaie de dépenser le moins possible pour tout ce qui concerne les travailleurs. Si nous demandons des bottes, elles sont considérées comme une dépense inutile, et si elles sont jugées indispensables, elles achètent les moins chères, presque inutilisables. Et ainsi de suite pour tout. »
Nous voyons donc que la précarisation du travail, la corruption des syndicats aux mains des patrons et même la délocalisation des entreprises dans leur tentative de renverser le taux de profit font partie de la lutte des classes mondiale. Ce sont des phénomènes que le système lui-même crée naturellement et qui lui servent à soumettre les travailleurs à des conditions de travail épouvantables, comme en témoignent les voix de Laura, Iván et Verónica. Transformer la réalité implique de récupérer les syndicats comme véritables instruments de défense du prolétariat, pour ensuite former une seule force syndicale qui regroupe tous les travailleurs et qui serve à équilibrer la lutte des classes mondiale.
Cependant, les travailleurs du monde entier ne doivent pas seulement aspirer à équilibrer la lutte, ils doivent envisager de la gagner et, en ce sens, la question fondamentale que nous devons nous poser est de construire un parti politique de notre classe qui prenne le pouvoir et soit capable d'affronter le grand capital non seulement dans l'usine, mais dans tout le système économique de la société contemporaine.

Quand l’intelligence artificielle bouscule le journalisme

L'intelligence artificielle (IA) semble aujourd'hui offrir à la profession de journaliste le meilleur… comme le pire.
10 septembre 2025 | tiré de The conversation
D'un côté, des usages portés par la rigueur et l'excellence, comme en témoignent plusieurs finalistes et lauréats du prestigieux prix Pulitzer. Par exemple, le New York Times a utilisé l'IA pour détecter des cratères de bombes sur images satellites à Gaza, prouvant des frappes en zones civiles.
De l'autre, des usages plus préoccupants : production de contenus trompeurs, standardisation du travail et suppressions de postes dans des rédactions déjà fragilisés par plus d'une décennie de crise.
Depuis 2022, ce tournant technologique s'est nettement accéléré avec la diffusion massive d'outils d'IA générative accessibles au grand public, dont ChatGPT est devenu la figure de proue.
Nous sommes des chercheurs et professeurs au sein du département de Département de gestion des ressources humaines de HEC Montréal. Notre équipe a mené, à la fin de l'année 2024, une enquête auprès de 400 journalistes canadiens et internationaux. Cinq enjeux en ressortent, qui dessinent autant de défis à venir pour les journalistes et les rédactions.
Enjeu #1 : un risque de polarisation de la profession
L'IA générative est déjà bien implantée dans les rédactions. Deux journalistes sur trois déclarent y avoir déjà eu recours et près d'un tiers l'utilisent au moins trois fois par semaine. Son adoption reste toutefois inégale : les jeunes journalistes et les pigistes en font un usage plus fréquent.

Ces écarts générationnels et statutaires laissent entrevoir une possible fracture au sein du métier. D'un côté, les journalistes les plus stables, souvent mieux rémunérés et plus encadrés, pourraient tirer profit de ces outils pour gagner du temps ou améliorer leur production. De l'autre, les professionnels plus jeunes et plus précaires risqueraient davantage d'être mis en concurrence avec la machine pour l'exécution de tâches routinières ou peu valorisées. Une telle polarisation de la profession pourrait constituer un premier enjeu de taille pour les journalistes, d'autant que ce type de phénomène a déjà été largement documenté dans d'autres secteurs suite à l'introduction de nouvelles technologies.
Read more : L'intelligence artificielle à la rescousse du journalisme
Enjeu #2 : à qui profiteront les gains de productivité ?
Les journalistes qui utilisent l'IA en tirent souvent des bénéfices concrets. Ils évoquent les gains de temps et l'amélioration de la qualité du travail produit, en particulier pour la collecte et l'analyse de données, ainsi que pour la production et l'édition de textes.

Mais ces bénéfices perçus soulèvent un enjeu central : comment serait utilisé le temps nouvellement « libéré » par la machine ? Servirait-il à produire mieux, ou simplement plus ? Profiterait-il aux journalistes, ou aux organisations qui les emploient ? Cet enjeu du partage des gains de productivité se posera avec d'autant plus d'acuité que, dans certains cas, les journalistes participeront eux-mêmes à l'entraînement de ces outils.
Enjeu #3 : le risque d'une diminution de l'effort intellectuel
Malgré son apparition récente, l'IA générative suscite déjà un sentiment de dépendance chez près d'un quart des journalistes. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes journalistes, pour qui ces outils sont présents dès le début de carrière.
En déléguant régulièrement des tâches telles que la structuration d'un raisonnement ou l'organisation d'un récit, les journalistes risqueraient d'affaiblir certaines compétences fondamentales, voire d'en retarder l'acquisition. Des recherches menées dans d'autres professions évoquent même le risque d'une « paresse métacognitive » : une diminution de l'effort intellectuel induite par une confiance excessive dans la machine.
Enjeu #4 : plus on s'en sert, moins on s'en méfie
De nombreux journalistes sondés expriment des craintes liées à l'usage de l'IA générative, notamment en ce qui concerne la qualité et l'authenticité des contenus produits.
Toutefois, ces craintes ne sont pas réparties de manière homogène au sein de la profession. Elles sont particulièrement vives chez les non-utilisateurs, au point de s'apparenter, dans certains cas, à une forme de résistance.
À l'inverse, elles tendent à s'atténuer chez les utilisateurs réguliers : plus l'usage devient fréquent, plus la vigilance éthique diminue. Plus frappant encore, les journalistes se déclarant les plus dépendants à l'IA générative sont aussi ceux qui expriment le moins de craintes vis-à-vis de cette technologie.
Enjeu #5 : une régulation qui reste largement à construire
La régulation de l'IA générative dans les rédactions reste embryonnaire. Seul un tiers des journalistes déclarent que leur rédaction dispose d'une politique claire encadrant l'usage de ces outils. Plus étonnant, ils sont encore plus nombreux (36 %) à ne pas savoir si une telle politique existe.
Nos résultats montrent pourtant que, lorsque ces politiques sont connues, elles influencent directement les usages de l'IA générative. En revanche, la présence syndicale ne semble pas jouer, à ce stade, un rôle significatif dans l'appropriation de ces outils. Cette absence de balises collectives s'explique notamment par le manque de recul, mais aussi par la prudence des employeurs, qui hésitent à freiner l'innovation.
Quel avenir pour le journalisme à l'heure de l'IA générative ?
Sans verser dans l'alarmisme, cette étude met en lumière des transformations rapides et encore insuffisamment encadrées. L'IA générative peut faire gagner du temps et améliorer la qualité des contenus, mais elle pourrait aussi, selon les usages, renforcer la précarité, affaiblir certaines compétences ou accentuer les inégalités professionnelles.
Face à ces enjeux – qu'ils touchent à l'emploi, à l'autonomie, à la rémunération ou aux conditions de travail – la mise en place de garde-fous collectifs apparaît essentielle pour préserver un avenir souhaitable pour la profession.
Nous tenons à souligner l'importance des contributions de Xavier Parent-Rocheleau, Nicolas Turcotte-Légaré, Marie-Claude Gaudet et Antoine Bujold à la réalisation du rapport.

La place des gens d’affaires au gouvernement

Dans un précédent article[1], nous avons suggéré l'abstention de faire participer à certains ministères, voire même de faire voter sur certaines lois, des éluEs ayant un intérêt économique susceptible d'être avantagé durant l'exercice de leur fonction de législateurTRICE. Il s'agit peut-être d'une prise de position trop rapide, dans la mesure où cela implique d'ignorer le monde dans lequel nous vivons.
En effet, notre solution reste utopique et un bémol doit y être apporté, puisque le régime capitaliste domine largement les mentalités, ce qui en fait une distinction par rapport à d'autres, y compris les époques. La réflexion est donc lancée.
Nos représentantEs à l'image de notre société
Un simple regard vers l'arrière nous mène à revenir à la conception même de l'État. Au-delà de constituer un regroupement d'humains sur un territoire identifié, il engage tout ce qui concerne le gouvernement. Même si archaïque à l'origine, il n'en demeure pas moins que les règles et les lois servaient à assurer une adhésion – avant la cohésion –, et ce, sous l'égide d'un pouvoir et de ses représentants. La loi du plus fort dominait alors, supposant un monde de guerriers ; d'où à la tête des cités-États des rois-guerriers, car les conquêtes, exigeant tout autant le besoin de se défendre, étaient monnaie courante à une époque où les frontières des royaumes s'agrandissaient. Par contre, ces rois-guerriers étaient chapeautés par des représentants des dieux et ensuite du Dieu unique, qui exerçaient une influence importante. Et ce n'est pas sans oublier les ambitions terrestres papales qui les faisaient ressembler à des souverains, en songeant à l'histoire des guerres d'Italie de la Renaissance racontée par Guichardin. Ainsi, les représentants de la religion s'immisçaient dans les affaires terrestres, au point de relier les conquêtes aux desseins de Dieu.
Avec l'apparition d'une certaine stabilité des frontières et la lassitude de la guerre, les monarchies se sont pacifiées ou ont été critiquées de façon à revendiquer un nouveau type de gouvernement. Les révolutions favorables au régime démocratique ont alors procuré aux populations le droit de choisir leurs représentants, ce qui a eu aussi pour effet de minorer l'influence religieuse, jusqu'à un certain point. Mais ces personnes devaient avoir une connaissance des lois, d'où pourquoi les magistrats ont été privilégiés. Car il fallait refonder les États sur une politique conséquente, à partir d'une structure de débats. Automatiquement, les représentants devaient aussi être d'excellents orateurs, et aux magistrats aristocratiques se mêlèrent des individus bourgeois loquaces, d'abord une bourgeoisie « petite élite », tels que des avocats et des propriétaires de journaux. Ainsi, du roi-guerrier des conquêtes, puis des monarques-dieux, apparaît l'ère des magistrats et sénateurs – inspirée paradoxalement du passé antique qui faisait état d'essais démocratiques soi-disant prodigieux –, puis des petits bourgeois révélés à l'époque de la politique pure.
Mais ce tournant démocratique s'inscrit aussi dans une réalité économique marchande en pleine expansion, d'où la possibilité de garnir des trésors comme jamais et sans envisager la prise des armes. Ce changement marque un passage vers l'économie politique, alors que le bourgeois prend du galon. Des richesses se fondent à partir des marchés et des parquets boursiers. Le bourgeois se transforme en capitaliste et est perçu comme le modèle de la réussite. Ainsi, l'ère moderne construit le capitaliste qui use de son argent pour supporter des représentants capables de veiller à ses intérêts. Mais les choses changent rapidement. La néolibéralisation de l'État, après des endettements providentialistes, rappelle à l'ordre les gouvernements pour plus d'efficacité, d'efficience et de productivité. L'État moderne doit se conformer à la réalité économique, étant à la base de son existence. Des représentants de l'économie se font désormais élire, en raison de leur réussite qui augure leurs aptitudes à redresser les finances publiques. Des lois, nous passons donc à la gestion budgétaire et à la croissance de l'économie. Inévitablement, des représentants chefs d'entreprise sont élus et légifèrent sur des questions touchant leur secteur d'activités. Voilà que s'expose l'éthique, qui suggère l'abandon de leur participation au sein des compagnies sous leur contrôle. Or, il s'agit d'un retrait temporaire, puisque les titres sont transférés dans des fiducies, ce qui n'enlève point l'intérêt économique. C'est donc là où nous sommes renduEs. Il n'empêche qu'un élément de précision peut être avancé, dans la mesure où si des représentantEs économiques peuvent s'occuper de l'industrie, des finances et des budgets, d'autres domaines profitant de ministères sont représentés également par des personnes possédant une expérience et une expertise en la matière. Par exemple, nous voyons des médecins devenir ministre de la Santé, des défenseurs de l'environnement s'occuper du ministère qui concerne cet aspect, des artistes pour la Culture, d'ancienNEs athlètes pour les Sports, puis des directeurTRICEs de commission scolaire ou d'école pour l'Éducation, etc. Il s'agit d'une logique de la représentativité basée sur les connaissances et les compétences. Cependant, se constate très rapidement une subordination de ces ministères et de leurs enjeux sociaux, culturels et environnementaux aux questions économiques ; car l'argent ou la richesse reste le nœud de la guerre.
L'idéologie capitaliste entre-t-elle simplement dans la continuité ?
Ce portrait dépeint en des traits vifs omet toutefois de faire ressortir ce qui se trouve normalement à la base des transformations de l'État. Au-delà de l'économie tangible apparaît un type de mentalité, voire une vision du monde qui participe aux orientations du gouvernement et donc au choix des meilleurEs représentantEs pour l'occasion. Il est question ici d'une idéologie, à savoir justement une vision du monde avec un ordre à respecter, en se fiant à Mannheim (2003[1929], p. 65) qui précise le rôle de ces idées « situationnellement transcendantes » à des fins de « motifs bien intentionnés de la conduite subjective » des individus. Ainsi, pour l'État, l'idéologie est une façon de s'interpréter, en produisant des politiques publiques qui servent à sa promotion et à son adhésion par la population (Gaxie, 2002).
Si la conquête et encore la domination de l'Homme sur terre – voulue par Dieu – ont pu valoriser les plus forts et engager des populations entières dans les élans ambitieux de leurs gouvernants, cette réalité pluriséculaire ne s'épuise pas, mais se raffine à partir d'autres idéologies. Le développement technique et technologique, associé à l'expansion des marchés, a contribué à la fois à vouloir éviter la guerre meurtrière et à entreprendre une rivalité marchande moins dommageable, à tout le moins en pertes humaines de consommateurTRICEs. Il existe donc un parallèle intéressant entre l'art de la guerre militaire et l'art de la guerre industrielle qui s'est transformée encore pour devenir plus globalement économique au sens large. La discipline, la rigueur, la stratégie, le calcul, les attaques et contre-attaques, etc., forment des points de ressemblance qui sautent aux yeux. Mais l'idéologie derrière reste la même : le gain pour la richesse et le bien-être à relativement long terme. Et des ajustements se produisent évidemment selon les contextes, alors que désormais la question des changements climatiques influe sur les interventions de l'État, afin d'éviter des nuisances à la vie humaine, pour ne pas dire à la vie économique humaine. Ce facteur idéologique environnemental devient capital dans la mesure où les représentantEs économiques de l'État peuvent être confrontéEs à des militantEs, mais aussi à d'autres représentantEs issuEs cette fois de la science qui revendiquent des transformations aux moyens de production et de consommation afin qu'ils deviennent moins néfastes pour l'environnement. Mais le capitalisme se trouve en pleine hégémonie, ce qui signifie une inclination plus lourde à une ploutocratie[2], même si elle semble déjà suffisamment dominante. Néanmoins, si le point de bascule n'a pas été atteint, rien n'empêche l'intrusion d'une nouvelle idéologie qui fera son chemin afin de rééquilibrer la balance entre l'économie et les autres enjeux notamment climatiques ; car la guerre qui les concerne suggérera des transformations techniques et technologiques, comme elles ont servi aux guerres militaires et économiques antérieures.
La quantité compte plus pour l'intérêt
Par ailleurs, l'interprétation de l'idéologie amène à favoriser des types de représentantEs politiques, tout en faisant état de circonstances de corruption et de conflit d'intérêts. Le népotisme, les exactions, les concussions, les spoliations et ainsi de suite, semblent être constants à toutes les époques, toujours dans le sens de privilégier quelques-unEs, de prendre plus que le nécessaire ou encore de prendre sans en avoir le droit. Il s'agit de quantité ou d'étendue, en termes de terrain, de territoire, de ressources, d'argent, de richesses et de biens. Normalement, la gestion de l'État doit viser le bien-être collectif, tandis que le choix d'accepter des gens issus du milieu des affaires au sein des gouvernements repose sur leur expertise à faire bénéficier à toutes et à tous, alors qu'inévitablement l'orientation donnée à certaines lois fera en sorte de les avantager aussi dans leur domaine d'activités. Dès lors, la morale de l'histoire veut que si les décisions prises avantagent les affaires de la représentante ou du représentant et non la population, dans ce cas il y a abus, tandis que si les décisions prises l'avantage autant que la population, voilà une bonne représentante ou un bon représentant, en simplifiant les choses ainsi. Mais si elle ou il en profite plus que la population qui en bénéfice aussi, cette personne élue demeure-t-elle une bonne représentante ou tombe-t-elle de son piédestal pour devenir une abuseuse ? Certes, la ligne peut être difficile à tracer.
Au fond, cette évaluation concerne autant la représentante ou le représentant issuE du monde des affaires que n'importe quelle autre personne élue. Le problème repose sur les fondements de l'abus jugé, c'est-à-dire souvent à partir de données économiques ; donc, faisant en sorte de doubler la critique à l'endroit de la représentante ou du représentant économique. Voilà une différence majeure par rapport au magistrat, dont la fonction d'origine se résume à servir l'État et qui demeure son seul intérêt. Par contre, ce facteur justifie aussi pourquoi l'allusion de corruption ou d'abus à son égard entraîne une forte réprobation publique. D'une certaine façon, la représentante ou le représentant économique peut alléguer la méconnaissance des rouages de la politique pour se défendre et ainsi atténuer le jugement public, à condition toutefois de ne pas avoir trop abusé, alors que l'échelle reste variable en fonction du contexte et du moment.
Tout compte fait, la société elle-même s'avère responsable de son sort, elle qui a accepté de suivre une idéologie capitaliste et qui conçoit le bénéfice de choisir des représentantEs ayant l'expertise économique pour gérer les budgets, tout en favorisant une meilleure croissance, parce qu'en réalité elle se compose d'individus qui souffrent de la marotte d'en avoir toujours plus. Dans ce cas, il faudrait accepter les faux pas de ces représentantEs économiques, à condition de les voir se reprendre et défendre le bien commun. D'ailleurs, on se fie à leurs compétences qui doivent permettre d'élaborer de meilleures lois afin d'assurer le développement économique espéré, ce qui revient à maintenir l'ordre vanté par l'idéologie dominante. Empêcher ces éluEs de voter sur les questions économiques reviendrait à court-circuiter le fonctionnement de la démocratie, non seulement au niveau de la Chambre ou de l'Assemblée, mais au sens large, puisqu'une communauté a choisi cette personne pour la représenter, parler et voter en son nom. Pouvons-nous alors supposer vraisemblablement des intérêts similaires pour cette représentante ou ce représentant à ceux de son électorat ? Si oui, pourquoi lui enlever son vote ? Mais les réponses ne sont pas si faciles à donner. Nous en revenons au jeu des calculs visant à définir « qui a le plus grand intérêt à » ou « qui en bénéficie plus que », ce qui aura pour effet de perdre de vue la nature de la loi sur laquelle le vote porte. Car chaque loi produira un impact variable sur chaque citoyenNE, au même titre que celles et ceux qui sont aussi des éluEs.
L'enjeu repose sur une définition de l'économie politique sur laquelle s'appuie notre régime, c'est-à-dire une volonté de s'enrichir par l'échange et de partager cette conviction bien décrite par Adam Smith (2009[1776], pp. 146-147) en ces termes : « Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il [l'individu] travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler ». Autrement dit, l'intérêt constitue dans l'idéologie dominante – inspirée de l'époque bourgeoise – le principal but de l'action, pour ne pas dire la principale motivation qui permet à la fois de satisfaire l'individu et sa société. Alors, pourquoi ne pas capitaliser sur l'intérêt des représentantEs économiques pour le bénéfice de toute la population ? Cette question est répondue de façon à ne pas anéantir leur intérêt, en déplaçant leur participation dans des fiducies au lieu de leur imposer de s'en départir définitivement. Être en désaccord sur ce principe exige de revendiquer un changement au sein du régime en vigueur. Pour ce faire, quelle serait la maxime utile pour renverser le motif de l'intérêt ? Il faut se rappeler des tentatives passées, puisque le remplacement de l'intérêt individuel par celui de la collectivité a inspiré notamment le régime communiste qui a subi des dérives pour devenir un totalitarisme brimant l'individu. Et c'est sans oublier les ratés des utopies communautaristes à la Owen, Fourier, Blanc et autres, avec la perte de leur raison d'être et des déroutes. Nietzsche a peut-être raison lorsqu'il dit : « La volonté de faire triompher un idéal social n'est jamais que l'expression d'un tempérament individuel, l'effet des instincts vitaux les plus profonds vraiment dominateurs de l'individu ». Dans ce cas, si l'intérêt personnel ne peut-être effacé, l'attention devrait porter sur sa connotation économique. Il s'agirait d'une voie simplifiée sur laquelle plusieurs groupes capitalisent déjà de façon à vanter un intérêt social, environnemental ou climatique, dans une alternative d'équilibre humain/nature, qui placerait l'économie dans une position différente de celle actuelle. Tout repose encore une fois sur la capacité de rendre communs des intérêts particuliers.
Conclusion
Suggérer d'enlever le poste de ministre ou même le vote aux éluEs issuEs de milieux économiques, susceptibles d'être avantagés par leurs décisions, repose sur la crainte de voir un gouvernement favoriser quelques-unEs au détriment de la majorité. Or, cette crainte a toujours fait partie de l'État depuis ses origines, dont plusieurs épisodes de l'histoire en ont été des illustrations révélatrices. En passant de la loi du plus fort aux prescriptions de Dieu et à la prédominance des lois de l'Homme, nous sommes entréEs dans l'ère d'une économie politique capitaliste, faisant de moins en moins la distinction entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, dans la mesure où l'enrichissement de l'individu peut profiter à tout le monde, justifiant même l'intérêt de profiter de son expertise dans la gestion des fonds publics. Or, il n'est pas seulement question de gestion, mais de législation. En ce sens, les lois votées favorables aux individus devraient logiquement s'étendre sur toute la société. Voilà une idéologie, différente du passé, sans pour autant rejeter la loi du plus fort. Tout compte fait, les mesures visant à forcer les éluEs à se départir pour un temps de leur participation dans des entreprises, servent seulement à atténuer des craintes d'abus et d'accaparement de ce qui n'est pas sienNE. Mais l'intérêt économique d'un individu reste fort, puisque la société peut en bénéficier ; c'est le gage en jeu. Sur cette base, il n'y aurait pas lieu d'empêcher des représentantEs économiques de faire leur devoir de politicienNEs. S'y opposer suppose une revendication idéologique, voire un changement de régime ou une réforme majeure, afin de prêcher la donne environnementale ou tout autre enjeu qui remet en cause l'idéologie du bonheur par l'accumulation. Ainsi, ce qui se construit aura un impact plus tard, comme Smith en a eu de nos jours, alors que des éluEs de son époque votaient pour changer leur monde.
À cette étape-ci de notre réflexion, nous sommes d'avis que la défaite électorale pour les gens d'affaires est probablement le meilleur antidote à la corruption du pouvoir politique par cette catégorie de richissimes citoyenNEs.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
Notes
[1] Voir Bernier, G., & Perrier, Y. (2025, 14 juin). De la cryptomonnaie dans une réserve étasunienne. Élan réflexif sur les régimes monétaires et une administration intéressée. Presse-toi à gauche ! Repéré à https://www.pressegauche.org/De-la-cryptomonnaie-dans-une-reserve-etasunienne
[2] Régime politique au sein duquel les richissimes personnes tirent de leur puissance économique une influence politique — indue ou non.
Références
Gaxie, D. (2002). La mise en scène de l'action publique. Dans S. Wachter, L. Davezies, P. Duran, C. Emalianoff, D. Gaxie, V. Renard & J. Theys, L'aménagement en 50 tendances (pp. 23-28). Paris, France : l'aube datar.
Mannheim, K. (2003[1929]). Idéologie et utopie. Une introduction à la science de la connaissance (version numérique réalisée par J.-M. Tremblay en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi). Chicoutimi, QC : Les classiques des sciences sociales.
Smith, A. (2009[1776]). La richesse des nations. Paris, France : Flammarion.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 16 septembre 2025


Le manifeste des parvenus
Julia Posca
Quel essai choc et décapant ! Quelle belle surprise aussi ! Je ne m'attendais pas à tant de ce beau petit livre sur le caractère décomplexé des fossoyeurs de notre société. À une époque où les élites politiques et économiques québécoises se tiennent main dans la main en prenant soin de se défendre dans leurs faits et gestes, le temps est maintenant venu de démonter leur projet de société. Ce manifeste des parvenus nous invite ainsi à nous interroger sur les problèmes criants qui découlent de l'enrichissement continuel des instances de pouvoir et de l'idéologie de l'entrepreneuriat, avec pour clef la croissance des inégalités et la subordination des travailleurs. Dans cet essai, qui tient à la fois de la satire et de l'analyse, Julia Posca passe au crible le discours décomplexé de l'élite québécoise, qui rêve d'un Québec peuplé principalement de patrons et de rentiers. À travers l'exposition des six commandements qui composent ce manifeste - « L'argent, tu honoreras », « À plus petit que toi, tu ne t'intéresseras pas », « Une économie de dirigeants, tu bâtiras », « Par l'impôt, tu ne te laisseras pas dérober », « Le Bien, tu convoiteras » et « La réalité de la vie, c'est l'entreprise privée » –, l'essayiste nous livre avec ironie et lucidité les leçons que l'on peut tirer de notre classe politique. Julia Posca est chercheuse à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), un institut qui publie plusieurs bons textes sur l'économie et la société – à mille lieues de ceux de l'Institut économique de Montréal.
Extrait :
L'élite politique au pouvoir considère comme admirable la caste d'entrepreneurs dont sont issus bon nombre de ses dirigeants. Les plus faibles qui n'en viennent pas – députés d'arrière-ban, hauts fonctionnaires, petits serviteurs de tout genre, journalistes, etc. - se conforment ensuite à cette idée, non sans quelques maladresses, comme en témoigne l'affaire du jambon à la commission Charbonneau. Faisant autorité, cette caste fait passer pour normal auprès du public que l'État soutienne continuellement des gens qui se présentent comme puissants, plutôt que de présenter comme puissants ces gens parce que l'État les soutient continuellement.

Adrien Arcand
Jean-François Nadeau
Jean-François Nadeau, qui publie chaque semaine une chronique dans Le Devoir, est aussi un historien et un biographe remarquable. Cette biographie d'Adrien Arcand, personnage oublié de nos jours, vous fera pet-être découvrir un monde inconnu, mais pourtant si proche. Un silence gêné règne toujours au Québec et au Canada sur les liens que des personnages publics ont entretenus avec des idéologies proches du nazisme. Durant les années 1930, alors que la faim, la misère, le chômage et les menaces de guerre écrasent le quotidien des classes populaires, Adrien Arcand prend la tête de groupuscules d'extrême droite qu'il unit sous le signe de la croix gammée. Son programme : faire émerger de la misère existentielle le triomphe du fascisme. Premier président du syndicat des journalistes de La Presse, puis animateur de journaux satiriques d'extrême droite, Arcand va croiser sur son chemin l'écrivain Louis-Ferdinand Céline et se lier aux milieux politiques fascistes internationaux, en particulier dans le monde anglo-saxon impérialiste auquel il s'identifie. Emprisonné pour ses activités durant la guerre, Arcand reprendra son programme avec un certain succès, notamment auprès de membres de l'Union nationale du premier ministre Maurice Duplessis. L'histoire de cet homme s'inscrit dans la nôtre, notre histoire...
Extrait :
Avant 1930, il n'y a qu'une rare mention de Mussolini dans un éditorial d'Arcand, et c'est par la ban de qu'il est question du dictateur italien. Le Goglu des débuts ne peut être analysé par une mise en correspondance point par point avec le fascisme, encore moins avec le nazisme allemand. Mais à compter de 1930, on voit vite se multiplier les références au fascisme à l'italienne, alors populaire au Canada français en partie parce que le Duce a signé avec le Vatican des accords de coopération. « Le fascisme a le conservatisme pour père et l'absolutisme religio-national pour héritier », écrit Arcand afin de situer sa pensée.

L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir
Rosa Montero
Traduit de l'espagnol
Ce roman porte essentiellement sur la vie de Marie Curie, cette femme exceptionnelle qui se méritera le prix Nobel de physique en 1903, avec son époux Pierre Curie et Henri Becquerel, et le prix Nobel de chimie en 1911. À partir de son expérience propre, à un siècle de distance, l'auteure y explique particulièrement sa douleur à la suite du décès prématuré de son époux à l'âge de 46 ans. Elle y rappelle également les difficultés innombrables auxquelles cette importante femme de science a dû et su faire face à cette époque où les femmes occupaient encore si peu de place dans la société. Ce roman magnifique, qui est en réalité bien plus proche d'une biographie ou d'un essai que d'un roman, est rédigé de manière fluide – fluide et émouvante.
Extrait :
Dans son bref journal de deuil, Marie note avec une obsession du détail les derniers jours qu'elle a vécus avec Pierre, ses dernières actions, les derniers mots. C'est l'incrédulité face à la tragédie : la vie s'écoulait, si normale, et, soudain, l'abîme.

Sept brèves leçons de physique
Carlo Rovelli
Traduit de l'italien
Je n'avais pas lu de livre sur le sujet depuis « Une belle histoire du temps » de Stephen Hawking. L'auteur y dresse un tableau succinct, en sept leçons, des principaux domaines de la recherche fondamentale en physique, en commençant d'abord par la théorie de la relativité générale d'Einstein, puis en poursuivant avec les quanta, qu'il réussit en bonne partie à rendre intelligibles pour les profanes comme moi. Un excellent bouquin en mon sens, qui nous permet de mieux connaître l'étendue de nos connaissances dans ces domaines pointus de la recherche… et tout ce que nous ignorons encore.
Extrait :
Il y a vingt ans, le brouillard était dense. Aujourd'hui, il existe des pistes qui ont suscité de l'excitation et de l'optimisme. Il en existe plus d'unes, signe que le problème n'est pas encore résolu. La multiplicité engendre des dissensions, mais le débat est sain : tant que le brouillard ne se sera pas complètement dissipé, il est bon que s'opposent les opinions et que la critique soit vive. Un axe de recherche majeur centré sur la tentative de résoudre le problème est la gravité quantique « à boucles », développée par une patrouille de chercheurs disséminés dans plusieurs pays du monde, dont la France est un des premiers.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L’heure de se mettre à table
J'en connais des centristes. Bien ancrés dans la classe moyenne ou la bourgeoisie, ils et elles sont réfléchis et intelligents, font l'apologie de l'équilibre dans le traitement de l'information et passent bien souvent pour la voix de la raison et de la majorité.
Ce sont des centristes instruits et formés, des enseignants, des ingénieures, des travailleurs sociaux, des médecins, des journalistes, des avocates, des restaurateurs et des fonctionnaires. Instruits et formés, leurs réflexions sont souvent balisées par les particularités de leur métier et elles ne tiennent parfois pas compte du contexte ni des leviers du pouvoir toujours en opération en arrière-plan. Leurs conclusions aux débats de société se situent donc autour de la populaire zone grise, du fameux « ce n'est ni blanc ni noir », de l'incontournable « envers de la médaille ». Si un parti politique disait que le ciel est vert, ces gens ne trouveraient pas de reproche à une nouvelle titrée « l'Assemblée nationale ne s'entend pas sur la couleur du ciel ».
C'est peut-être pour cette raison que ces centristes se rebutent et trouvent ma position extrême quand j'énonce sans broncher, comme si c'était aussi naturel, logique et indiscutable que la force de la gravité : « eat the rich ». Surement aussi parce qu'ils se disent (avec raison) que je parle de certains d'entre eux.
N'en déplaise, je persiste et signe, on doit se défaire des riches. Il n'y a aucune autre issue. Il n'y a pas deux côtés équivalents à cet enjeu. Il n'y a aucune façon de travailler aves les riches pour une société équitable. C'est une équation à somme nulle : ce que les uns gagnent est perdu par les autres (et vice versa) étant donné que les ressources réelles sont limitées et qu'elles appartiennent toutes déjà à quelqu'un.
En effet, Bill Gates est le plus grand propriétaire privé de terres cultivables aux États-Unis,1 Bayer (acheteur de Monsanto) est propriétaire des semences et contrôle une partie non négligeable de l'offre alimentaire mondiale,2 Kraft Heinz, Pepsi et une poignée d'autres contrôlent les produits en épicerie,3 et Glencore, BHP et Rio Tinto sont d'importants propriétaires miniers.4 Tout l'immobilier a un propriétaire quelque part, la main d'œuvre est utilisée presque pleinement et on peut même inclure les milieux naturels protégés car ils appartiennent supposément à l'ensemble des résidents d'un territoire sous la tutelle des gouvernements.
Et donc ? Et donc, la possession et l'utilisation d'une ressource par un acteur veut nécessairement qu'un autre n'y ait pas accès. Pour construire les logements, les écoles et les CHSLD dont nous avons besoin, pour s'occuper de ceux et celles dans le besoin, pour offrir des services de base et pour protéger les écosystèmes, il faut prendre du travail, des matériaux, de la nourriture, du temps et de l'argent à quelqu'un quelque part. Pour bâtir un logement abordable, il faut des travailleurs autrement occupés à rénover la cuisine de France-Élaine au goût du jour. Pour une école, il faut le bois, les métaux et les services d'ingénierie utilisés pour construire le RoyalMount. Pour contrer les îlots de chaleur il faut réimaginer les terrains urbains appartenant à la famille Broccolini, à Giorgio Tartaglino et d'autres James Essaris.5
Au même titre, l'entreprise privée a besoin du temps, de l'effort et de la santé des travailleurs pour créer de la valeur. Elle doit prendre les forêts aux Premières Nations pour produire du carton d'emballage pour le commerce en ligne. Elle doit prendre l'eau potable aux résidents pour refroidir les centres de données.6 Elle doit exploiter le sol pour assembler des VUS passant la majorité du temps stationnés sur l'asphalte chaud du Premium Outlets à Mirabel ou pris dans la congestion de la route 132 à Lévis. Il faut aussi dilapider le trésor public afin d'investir chez Air Canada, Pizza Salvatoré, Northvolt et Bombardier entre autres. Et c'est sans même parler de l'utilisation de ressources pour alimenter le complexe militaro-industriel qui s'enrichit à même la mort le génocide à Gaza.7
Sans surprise, on sait qui a tendance à gagner ce bras de fer à forces inégales pour la maîtrise des ressources. Qui décide comment elles sont utilisées ? Qui a plus d'influence auprès des décideurs ? Est-ce Stablex ou les citoyens de Blainville ? Les forestières ou le Conseil de la Nation Atikamekw ? La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ou l'Accueil Bonneau ? Les syndicats ouvriers ou les propriétaires du capital ? Il n'y a que l'argent qui croît infiniment et spéculativement, pas les forêts, les logements abordables ou les terres cultivables. En résulte de l'inflation, des crises du logement et des finances publiques parce qu'il y a une lutte directe entre les riches et les autres pour un nombre limité de ressources réelles et tangibles.
L'idée de s'enrichir individuellement est conséquemment une aberration. On ne devient pas riche en vase clos seulement grâce à la sueur de son front et à son effort individuel. Afin de pouvoir m'acheter deux Mercedes, un bateau et un chalet, des billets pour le concert de Taylor Swift et me payer des vacances familiales en Italie l'été, il faut que je cause ou que j'entérine mille et une iniquités sociales :
Je dois exploiter le travail d'autrui ou du moins me foutre du travail mal ou non rémunéré des agentes et agents de bord, des cheminots et des factrices.
Je dois accepter que des travailleurs puissent à peine assumer le coût des besoins de base en raison de ma prérogative à la maximisation du profit.
Je dois encourager la gentrification et l'évincement de ménages moins nantis en achetant des propriétés d'accommodation à court terme (e.g. AirBnB).8
Je dois monopoliser l'accès aux cours d'eau publics en achetant mon chalet au bord d'un lac.9
Je dois faire semblant que les coupes à blanc et la pollution de l'air, des sols et de l'eau n'existent pas.
L'enrichissement individuel est au mieux problématique et au pire criminel. Tant qu'il y aura des gens sans logement adéquat, dans la faim ou n'ayant pas accès à des soins adaptés et tant qu'il y aura des écoles farcies de moisissure et que continuera la destruction infatigable des écosystèmes, les grands nantis n'auront pas lieu d'être. À la question s'il existe une position centriste par rapport à l'existence des riches, je dis, sortons nos plus beaux couverts, c'est l'heure de manger.
Notes
1. The Guardian. Bill Gates is the biggest private owner of farmland in the United States
2.International Institute for Sustainable Development. Bayer Tightens Control Over the World's Food Supply
3.The Guardian. The true extent of America's food monopolies
4.S&P Global Mining Companies Market Cap
5.TVA Nouvelles. À qui appartient Montréal ?
6. The Guardian. Big tech's new datacentres will take water from the world's driest areas
7. CBC. Report suggests arms still flow from Canada to Israel despite denials
8.McMaster University. How Airbnb may be fuelling gentrification
9.Radio-Canada. 98 % des berges inaccessibles
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Revenir au Nous pour aller quelque part ensemble...
Je suis une personne humaine. Je suis Québécois. Je suis citoyen du monde. Je suis perdu dans ce monde actuel. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus où je vais sur cette planète Terre qui tourne trop vite. J'ai un gros char et une grosse maison mais je ne suis plus quoi me faire livrer sur le perron. J'ai de l'argent en masse mais je ne sais plus quoi faire avec. Je suis anxieux mais je ne sais pas pourquoi. Mon téléphone me parle de l'Ukraine et de la Palestine chaque jour. La télé me parle sans arrêt de ce qui va mal. Je suis anxieux mais je ne sais pas pourquoi. Je me cherche et je ne ne me sens pas bien tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui me contrôle. Je suis anxieux mais je ne sais pas pourquoi. J'ai besoins de sentir les autres me rassurer, me serrer dans leurs bras mais on ose pas le faire dans le métro. J'ai besoin des autres pour savoir qui je suis et ce que je veux. Les autres c'est sans doute le Nous mais je ne les connais pas et ils,elles me font peur. Je pense parfois m'acheter un robot et faire l'amour avec. J'étouffe et j'ai peur de péter ma coche.
J'ai voté pour le banquier parce que j'ai peur de Trump. Le banquier comme Trump ne pense qu'à l'argent et au pétrole. Il est petit, gentil, souriant et va à la messe le dimanche mais il commence à me faire peur lui-aussi. Il vote des lois la nuit pendant que je dors pour aller plus vite avec ses projets de business. Il fait passer des hélicoptères de l'armée et des avions de chasse au-dessus de ma tête pour préparer je ne sais quelle guerre contre qui. Mon oncle François veut encore une fois assurer notre sécurité à tout prix malgré nous mais il est dépassé. Les deux veulent couper en masse dans les services publics mais je me console en me disant que je pourrai me payer moi-même ce dont j'ai besoin. Le bordel est encore pogné en France et je me demande si ça peut arriver ici.
J'ai envie de parler à d'autres Québécois,ses pour savoir ce qu'ils,elles pensent.
Peut-être qu'on pourrait se parler les huit millions que nous sommes devenus,es. En parlant ensemble on pourrait voir si on partage encore des valeurs en commun et quelles sont ces valeurs. Si oui, on pourrait parler de notre vie ensemble au Québec. On pourrait parler de comment on se sent, de ce qui nous habite, de comment on pense, de ce que l'on fait de notre vie et partager notre espoir et combattre notre impuissance. On pourrait parler de notre nid, notre logement. On pourrait parler du temps qu'il fait. On pourrait parler de nos enfants et de nos petits enfants. On pourrait parler des paysages québécois à couper le souffle. On pourrait parler de santé plutôt que de maladie. On pourrait parler d'éducation. On pourrait parler de travail. On pourrait parler de la planète Terre. On pourrait parler de santé plutôt que de maladie. On pourrait rêver et faire des petites et des grandes choses ensemble. On pourrait parler de comment on voit les choses pour maintenant et demain et voir s'il y a un ensemble possible. Si oui, on pourrait parler s'emballer et construire le Pays ensemble.
Yves Chartrand
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le choix des mots Une société égalitaire… ou équitable ?
(Ce texte a d'abord été publié dans l'édition du mois de septembre du journal Ski-se-Dit.)
On ne parle plus autant d'égalité de nos jours qu'on le faisait il y a moins d'un siècle. Ce bel idéal s'est lentement vu supplanter, dans la plupart des domaines, par le concept infiniment plus subjectif d'équité. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'on présente aujourd'hui le concept d'équité comme un concept beaucoup plus flexible que celui d'égalité – ce premier concept permettant en quelque sorte de parer au caractère supposément rigide du second.
Mais qu'en est-il ? Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'idéal d'égalité, qui nous vient principalement du siècle des Lumières en France au XVIIIe siècle et qui a été repris sous la plume de Robespierre lors de la Révolution française avec ce qui deviendra la devise de la France, « Liberté, égalité, fraternité », est un concept objectif qui tend vers un idéal concret et donc mesurable. Et que le concept d'équité, fort ancien lui aussi, est un concept beaucoup plus – sinon entièrement – subjectif.
La notion d'égalité ne prête pas à interprétation. Une société égalitaire en est une où l'on vise à ce que Paul et Julie aient un égal accès à l'éducation, au travail, aux loisirs, aux biens et aux richesses. C'est un idéal concret qui se marie bien avec ceux de liberté et de fraternité. La notion d'équité, elle, dépend entièrement de la conception que l'on se fait de la justice, conception qui varie selon les époques, les milieux et – disons-le – les idées reçues et les préjugés. Une société peut fort bien se juger équitable, comme elle l'a souvent fait et le fait encore, en admettant d'énormes écarts de revenus et d'accès à ces mêmes ressources. Il est par exemple parfaitement équitable, de nos jours, que Julie puisse avoir le même accès que Paul à une position dominante dans une société parfaitement inégalitaire.
La droite et l'extrême droite, qui ne voient le monde que comme une jungle ou une montagne d'égoïsmes, assimilent bien sûr cette notion d'égalité à un traitement uniforme pour tous, comme si nous n'étions pas tous des membres actifs de la société ; et comme si le fait d'accéder tous à une vie meilleure, dans un véritable esprit de fraternité, de sororité et de solidarité, ferait à terme de nous des copies conformes les unes des autres. Bref, quand on est de mauvaise foi…
L'effacement de l'idéal d'égalité, comme l'effacement progressif de l'idéal de liberté et de ceux de fraternité et de sororité (que je préfère encore à celui de solidarité), au profit de concepts vaseux et même réactionnaires, modèle notre façon de penser et de concevoir le monde. Nous devons entre autres, pour changer le monde, changer le choix de nos mots qui régit notre façon d'envisager ce monde.
Nous ne voulons pas une société équitable, nous voulons une société égalitaire, une société fondamentalement juste ! Nous ne voulons pas la liberté des entreprises ou la liberté commerciale, nous voulons la liberté des individus, d'ici et de partout dans le monde ; pas la liberté des libertariens, cette fausse liberté de l'extrême droite, celle du plus fort d'abuser du plus faible, mais la liberté pour tous, dans le respect des libertés de chacun ! Nous ne voulons pas des petites solidarités des mieux-nantis et des privilégiés, nous voulons la fraternité universelle, pour tous, une fraternité tributaire d'une société… égalitaire.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Attaques de Trump : les climatologues étasuniens ripostent

Rapports accablants, site internet indépendant... Des climatologues des États-Unis ripostent au climatodénialisme de Trump. Une résistance encore difficile, tant le milieu reste « sous le choc » des attaques du président.
Tiré de Reporterre
12 septembre 2025
Par Vincent Lucchese
L'administration Trump a licencié près de 900 employés de la Noaa (ici dans les bureaux à Miami, le 30 mai 2025) et supprimé les sites web gouvernementaux contenant des données sur le climat. - © Chandan Khanna / AFP
« Ils cachent la vérité. Nous ripostons. » Les mots claquent à la une du site Climate.us. Cette plateforme en cours de construction vise à remplacer le site Climate.gov. Un portail anglophone d'information et de vulgarisation sur le changement climatique qui était extrêmement réputé et fréquenté aux États-Unis, avant d'être fermé en juin par le gouvernement de Donald Trump.
Rebecca Lindsey, ancienne rédactrice en cheffe de climate.gov, avait été brutalement licenciée dès février, en même temps que près de 900 employés de l'Administration océanique et atmosphérique nationaleétasunienne (Noaa), dont dépendait ce site. Une énième occurrence des attaques massives menées par Donald Trumpcontre les sciences du climat.
Censure, licenciements, menaces, coupes budgétaires : la violence de l'autoritarisme exercé depuis début 2025 par le gouvernement des États-Unis a assommé la communauté des climatologues.
« Ils cachent la vérité. Nous ripostons », prône la une du site Climate.us. Capture d'écran/Climate.us
La rentrée de septembre semble toutefois sonner le réveil, si ce n'est la révolte, des scientifiques. Le 4 septembre, Rebecca Lindsey et une partie de ses anciens collègues ont annoncé fièrement le lancement officielde Climate.us. Beaucoup reste à faire pour que ce nouveau site « indépendant, à but non lucratif et immunisé contre la politique » restaure l'ensemble des données de l'ancien site fédéral, mais l'équipe de bénévoles disait avoir déjà récoltéplus de 50 000 dollars (plus de 43 000 euros) de dons.
Deux jours plus tôt, le 2 septembre, les climatologues étasuniens relevaient déjà la tête en publiant un rapport de plus de 400 pages démontant point par point les mensonges climatosceptiques du gouvernement fédéral. Le document, qui a mobilisé 85 experts du climat, constituait une réponse à un rapport du département de l'énergie (DOE) du gouvernement étasunien publié début août et qui remettait en cause le consensus scientifique sur le changement climatique. Un rapport officiel qui pourrait n'être qu'un prélude à une dérégulation environnementale massive.
Riposter pour sauver la parole scientifique
« L'ampleur et la vitesse de la réponse des chercheurs, aux États-Unis et au-delà, étaient réconfortantes, dit à Reporterre Andrew Dessler, professeur en sciences atmosphériques à l'université A&M du Texas et initiateur de la contre-expertise des climatologues. Je crois que les scientifiques ont compris que la science elle-même était en danger, et qu'ils sont déterminés à repousser ces forces antiscience. »
Rebecca Neumann, professeure à l'université de Washington et coautrice de ce rapport, confie elle aussi avoir « un fort désir de riposte ». « Il y a un élan croissant au sein de la communauté scientifique pour s'engager auprès des élus locaux et fédéraux, et écrire des éditoriaux pour défendre la science et son financement », témoigne-t-elle.
Cette contre-attaque des climatologues peut sembler symbolique, voire timide, face à la violence de la politique trumpiste. Mais elle a le mérite d'exister. « Il y a eu un certain silence au départ. Avec des exceptions importantes comme les marches Stand Up for Science [Debout pour la science], mais c'était un mouvement pour les sciences en général. Là, on voit une coordination se mettre en place sur le climat plus spécifiquement », note Michael Stambolis-Ruhstorfer, sociologue des sciences et maître de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès.
« Dénoncer ces désinformations massives »
La prise de parole des climatologues est d'autant plus importante que se joue actuellement une lutte pour le contrôle du discours scientifique aux États-Unis. Le rapport officiel du DOE, même s'il bafoue les principes fondamentaux de la science et multiplie les contresens, comme le démontrent les 85 scientifiques, cherche à se donner l'apparat de la science.
« L'administration Trump ne rejette pas ouvertement la science, elle cherche au contraire à en récupérer la légitimité, dit Michael Stambolis-Ruhstorfer. Leur stratégie consiste à aller chercher des scientifiques marginaux dans leur domaine, mais qui leur fournisse des arguments politiques. »
« On voit la même chose sur le climat que sur les vaccins et d'autres sciences : les agences fédérales sont invitées à se méfier des consensus scientifiques, à produire ce qu'ils appellent du “désaccord informé”. C'est-à-dire à mettre sur le même plan des connaissances scientifiques solides et des théories marginales. C'est important que la communauté scientifique s'exprime pour dénoncer ces désinformations massives », explique le sociologue Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS.
La politique de la peur
Le travail critique mené par les 85 climatologues devrait bientôt recevoir le renfort de l'Académie des sciences des États-Unis. Celle-ci a annoncé le 7 aoûtqu'elle publierait en septembre une analyse rapide de l'état des connaissances sur les conséquences des gaz à effet de serre.
Une réponse directe au rapport fallacieux du DOE, qui doit lui-même servir de justification à l'Agence de protection de l'environnement étasunienne pour révoquer son « constat de mise en danger » (« endangerment finding »). Ce document crucial, publié en 2009, expose les dangers pour la santé humaine des gaz à effet de serre et sert de base à toute la législation climatique des États-Unis. Autrement dit : c'est l'effondrement de toute la politique climatique de la première puissance mondiale qui se joue dans la controverse actuelle.
Les dénonciations des climatologues, aussi outrées et rigoureuses sont-elles, n'auront toutefois pas le pouvoir d'empêcher l'administration Trump d'agir, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, fin 2026.
Quant à influencer l'opinion publique d'ici là, le défi reste énorme pour les scientifiques. Derrière ces récentes initiatives encourageantes, beaucoup d'entre eux restent paralysés par la peur et la sidération.
« La majorité des chercheuses et chercheurs des États-Unis avec qui je travaille sont dans une forme de résignation, témoigne Roland Séférian, climatologue au Centre national de recherches météorologiques, à Toulouse. Ceux qui sont à l'université sont relativement protégés de l'administration, ce n'est pas le cas de ceux en agence fédérale. Et même les universitaires sont sous perfusion d'argent public. »
« La communauté scientifique est encore sous le choc »
« Par rapport au premier mandat de Trump, les attaques sont beaucoup plus massives. Les coups de marteau tombent sur toutes les têtes, des postes et des projets sont supprimés du jour au lendemain, les libertés académiques sont attaquées. La communauté scientifique est atone, elle est encore sous le choc », décrit Michel Dubois.
Quelques victoires éparses émergent au compte-gouttes. Le 3 septembre, la justice a annulé le gel des subventions fédérales — quelque 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) — décidé par Donald Trump contre l'université Harvard, accusée de dérives « woke ».
La résistance manque toutefois d'unité : chaque institution ou université tente de sauver les meubles sans trop se préoccuper de ses voisines. « Le tissu universitaire et scientifique des États-Unis est très structuré par la compétition. Entre universités et même au sein d'une institution. Lorsque l'université Columbia a été attaquée par Trump à cause de manifestations de soutien à Gaza, ce sont les sciences humaines et sociales qui ont été visées. De grands noms de scientifiques d'autres disciplines au sein même de Columbia n'ont rien dit, car leurs subventions n'étaient pas touchées. Il y a une forme de cynisme dans la situation », déplore Roland Séférian.
Le sociologue Michael Stambolis-Ruhstorfer note aussi une scission entre des universitaires qui voudraient s'engager et les administrateurs plus frileux de ces établissements : « Certains commencent à réfléchir à organiser la science autrement, à rejeter ce système dépendant de financements exorbitants, cette compétition à outrance et ce “modèle de l'excellence” qui met tout le monde en concurrence et se révèle assez fragile face à une menace autoritaire. »
Une prise de conscience qui entrouvre quelques pistes d'espoir, lointaines, pour réinventer la manière de produire de la science, au service du bien commun. À court terme toutefois, l'entreprise de destruction massive des sciences climatiques enclenchée par l'administration Trump est encore loin d'être entravée. Dans son sillage, ce sont l'ensemble des politiques climatiques s'appuyant sur ces sciences qui menacent d'être balayées.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tempête dans une tasse de café – un catalogue des effets du réchauffement climatique

Que nous dit la crise de l'industrie du café sur le réchauffement climatique ? Phil Hearse montre les liens entre climat, économie et précarité des travailleurs.
02 septembre 2025 | tiré d'Anticapitalist Resistance
https://anticapitalistresistance.org/storm-in-a-coffee-cup-a-catalogue-of-global-warming-effects/
Vous avez 2 milliards de livres sterling qui dorment ? Voici une opportunité d'investissement. Coca-Cola, propriétaire de la chaîne de cafés Costa Coffee, veut s'en débarrasser. Les analystes estiment que le prix demandé est de 2 milliards, mais l'affaire pourrait probablement se conclure autour de 1,5 milliard.
Alors, qu'y a-t-il derrière cette décision – une forte décote par rapport aux 3,9 milliards que Coca-Cola avait payés en 2018 ? Le principal facteur est la flambée des prix pour les consommateurs, causée en grande partie par la crise climatique, qui a durement frappé les producteurs au Brésil, au Vietnam et en Colombie.
Les augmentations dans des chaînes comme Starbucks, Pret a Manger et Costa ont été spectaculaires. Les prix dans les cafés sont difficiles à établir avec précision, car les établissements « premium » en centre-ville facturent davantage, et les points de vente situés dans les aéroports et les grandes gares encore beaucoup plus. Starbucks affiche un latte “tall” à 3,65 £, mais il est difficile de trouver ce prix : en centre-ville, on est plus proche de 4,50 £, et dans les aéroports bien au-delà de 5 £.
Pour les employés de bureau ou de commerce – ces salariés à temps plein bénéficiant de six semaines de congés – acheter un café en allant travailler coûte désormais autour de 900 £ par an. Certes, on peut s'attarder dans un Starbucks et faire durer un café pendant 90 minutes ou plus. Mais pas quand on court au travail.
Le changement climatique est le principal facteur de hausse des prix, mais il y en a d'autres : l'augmentation du prix des engrais, causée par la perturbation des exportations russes – une nouvelle conséquence de la guerre de Poutine en Ukraine sur l'économie mondiale. S'y ajoute la perturbation de l'approvisionnement par le détroit d'Hormuz, due aux attaques houthis contre les navires, en solidarité avec le peuple palestinien.
L'impact du réchauffement climatique sur le café ressemble à un catalogue des effets du dérèglement planétaire. Le Brésil, premier producteur mondial de grains Arabica, a subi de fortes gelées, des sécheresses et des tempêtes. Les gelées, en particulier, ont détruit de jeunes caféiers qui mettent 20 ans à être remplacés. La récolte de Robusta au Vietnam – le principal grain utilisé dans le café instantané – a été ravagée par les tempêtes et la sécheresse. La Colombie a connu des malheurs similaires. Les experts estiment que d'ici 2050, 40 % des terres actuellement cultivées en café ne seront plus adaptées à cette culture.
Costa Coffee serait en discussions avec Apollo Global Management, un immense fonds de capital-investissement présent dans de nombreux secteurs et propriétaire notamment de la chaîne Wagamama. Ses trois fondateurs ont laissé des géants financiers comme BlackRock et Vanguard prendre des participations minoritaires.
Qu'est-ce qu'Apollo pourrait voir dans Costa ? Peut-être une version allégée qui conserve uniquement les sites stratégiques – comme le centre de Londres et les aéroports – où l'on peut pratiquer des prix premium. Le reste pourrait être revendu morceau par morceau. Une autre option serait de transformer certains cafés en restaurants de la chaîne Wagamama.
Mais les opérations de ce type sont généralement de mauvaises nouvelles pour les salarié·e·s, qui voient souvent disparaître des emplois et se dégrader leurs conditions. La situation actuelle n'est déjà pas brillante : les baristas à temps plein dans les principales chaînes de café gagnent à peine plus que le salaire minimum national – environ 18 000 £ par an pour une semaine de 37,5 heures. Un revenu qui semble impossible à vivre quand le loyer moyen d'un appartement une chambre à Londres est de 1 500 £ par mois, et qu'un deux pièces tourne autour de 1 900 £. Dans les quartiers branchés, c'est encore plus élevé.
Pour les jeunes qui vivent seuls – ou même en couple avec un partenaire qui ne gagne pas beaucoup plus – le coût de la vie est écrasant. Deux conséquences en résultent : l'endettement croissant, les gens comptant sur les cartes de crédit pour leurs dépenses quotidiennes ; et, à l'extrémité la plus dure, l'itinérance, notamment parmi les hommes d'âge moyen peu qualifiés.
Le retrait de Coca-Cola du café reflète un changement de stratégie vers des boissons jugées plus « saines ». Le café avait supplanté le thé en Grande-Bretagne à la fin du XXᵉ siècle, mettant fin à deux siècles de domination. Désormais, la consommation régulière de café « premium » – tout ce qui dépasse l'instantané – semble destinée à devenir de plus en plus l'apanage des classes moyennes.

Tribune féministe internationale contre l’instrumentalisation du discours pacifiste au service du statu quo colonial en Palestine, et pour le boycott du Forum Mondial des Femmes pour la Paix

Nous, militantes et organisations féministes, dénonçons et appelons au boycott international du
Forum Mondial des Femmes pour la Paix, organisé par le mouvement Guerrières de la Paix les 19 et 20
septembre à Essaouira, au Maroc.
(Essaouira, 19–20 septembre)
Créé en France en 2022, Guerrières de la Paix se présente comme un collectif de femmes juives et musulmanes « pour la paix, la justice et l'égalité ». Depuis le déclenchement de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, il déploie une intense propagande qui instrumentalise une rhétorique humaniste pour défendre le statu quo colonial. Sa mise en avant par les médias dominants – notamment en France – contribue à marginaliser les voix qui dénoncent le génocide.
Dans son discours, le collectif met sur un même plan l'État sioniste et la résistance palestinienne, réduisant la réalité coloniale à un « conflit » symétrique entre deux camps. Selon sa fondatrice Hanna Assouline, « il va falloir panser de nombreuses plaies, être capables de pardonner. La liberté et la sécurité des deux peuples sont interdépendantes » (Sud-Ouest Dimanche, 10 novembre 2024). Une telle vision nie l'asymétrie entre une puissance coloniale d'occupation et un peuple opprimé qui lutte pour sa survie et sa dignité. Alors qu'Israël intensifie son oensive pour imposer l'occupation totale de Gaza et poursuivre la colonisation en Cisjordanie, Guerrières de la Paix réduit cette violence structurelle à la seule politique du gouvernement Netanyahou, sans remettre en cause le sionisme comme projet colonial génocidaire.
Le collectif, qui prétend incarner une voix nuancée, renvoie pourtant dos à dos les soutiens des massacres commis par Israël et le mouvement de solidarité internationale avec le peuple palestinien qui réclame une fin au génocide.
Guerrières de la Paix en appelle à la « responsabilité des femmes » et au « rapport pragmatique qu'elles ont à la vie et à l'engagement » pour mettre fin au « conflit ». La sororité, érigée en socle du mouvement féministe, est ainsi convoquée pour exiger que les femmes israéliennes et palestiniennes refusent toute assignation à un camp et agissent main dans la main. Ce narratif est d'ailleurs mis en scène lors de mobilisations comme à Paris ou à Cannes, où des femmes juives et arabes se sont réunies derrière des slogans humanistes volontairement vagues et consensuels qui occultent les massacres quotidiens infligés depuis près de deux ans au peuple palestinien par l'armée d'occupation israélienne, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants.
Un tel discours efface également le rôle décisif joué par les femmes dans les luttes de libération nationale, y compris dans la résistance palestinienne. Il s'inscrit dans la continuité de l'instrumentalisation du féminisme par les puissances impérialistes, qui l'utilisent pour légitimer leurs guerres coloniales et diviser les peuples opprimés.
Ce féminisme pacifiste incarné par les Guerrières de la Paix, qui trouve un large écho dans les médias et auprès de certaines élites politiques, économiques et culturelles en Occident et dans le monde arabe, met en avant la résolution 1325 adoptée par l'ONU en 2000 qui promeut une participation accrue des femmes dans les processus de paix, comme aime à le rappeler Hanna Assouline. Mais pour le collectif, le recours au droit international est sélectif : les droits que l'ONU reconnait au peuple palestinien — autodétermination, droit au retour, légitimité de la lutte armée — sont niés, et la résistance assimilée au terrorisme. Par ailleurs, l'organisation refuse de parler de génocide malgré les constats de l'ONU et de la Cour Internationale de Justice, préférant utiliser un langage édulcoré pour qualifier la barbarie israélienne.
En mai 2025, le collectif a accompagné une délégation de députés français au Sommet pour la Paix à Jérusalem, organisé par des ONG israéliennes, alors que plusieurs élu·es français·es et européen·nes s'étaient vu interdire l'entrée en Israël en raison de leur critique du gouvernement Netanyahou et de sa politique. Tandis que la bande de Gaza traversait une crise humanitaire extrême, les discours du Sommet appelaient à la paix et à la reconnaissance de l'État palestinien, dans des termes aux contours flous. Les interventions les plus concrètes furent celles du président Emmanuel Macron (par message vidéo) et du tandem Ehud Olmert, ex-Premier ministre israélien qui a mené la guerre contre le Liban, et Nasser Al-Kidwa, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne : reconnaissance d'un Etat palestinien, mais dans des conditions qui en font de facto un État vassalisé.
En août 2025, le collectif a promu des rassemblements organisés récemment à Beit Jala en Cisjordanie contre la famine à Gaza, réunissant Israélien·nes et Palestinien·nes. En présentant ces mobilisations comme porteuses d'espoir et en contribuant à invisibiliser le fait qu'Israël a annoncé, quelques mois plus tôt, le développement de nouvelles colonies dans la région de Beit Jala, le collectif participe de fait au blanchiment de crimes coloniaux.
La stratégie des Guerrières de la Paix est claire : dépolitiser la solidarité internationale pour la réduire à sa dimension humanitaire et évacuer la question centrale, à savoir la libération de la Palestine. L'organisation du Forum mondial des Femmes pour la Paix à Essaouira s'inscrit dans cette même logique de légitimation d'Israël et de promotion de la normalisation de ses relations avec les régimes arabes, malgré le rejet massif des peuples de la région.
Présenté comme un rassemblement international de militantes israéliennes, palestiniennes, iraniennes, afghanes, marocaines et autres, ce forum ambitionne de lancer un « appel international des femmes pour la paix ». En réalité, il cherche à imposer un « nouveau narratif de paix » visant à neutraliser la mobilisation féministe internationale, aujourd'hui fortement engagée aux côtés du peuple palestinien dans une tradition anti-impérialiste et internationaliste.
En tant que féministes, nous dénonçons avec force l'instrumentalisation de nos luttes pour blanchir les crimes commis par l'État colonial israélien. Nous affirmons haut et fort : la Palestine est une lutte féministe. C'est pourquoi nous rejetons toute rhétorique de paix qui ne s'accompagne pas d'un soutien clair et explicite au mouvement de libération du peuple palestinien.
Pas de paix sans justice, pas de justice sans libération de la Palestine.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Discriminées en tant que femmes, réprimées en tant qu’Ukrainiennes

Il existe un mythe selon lequel la science soviétique était progressiste, se développait rapidement et rivalisait avec les découvertes scientifiques au niveau international. Dans les bureaux et les laboratoires, les hommes faisaient des découvertes d'envergure mondiale. Et le parti orientait avec assurance les scientifiques vers le communisme progressiste.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Qu'en est-il de la vérité ? Comment l'URSS a-t-elle inventé des mythes et instauré la terreur contre la science ? Et pourquoi savons-nous encore si peu de choses sur les femmes scientifiques réprimées et « oubliées » par l'Union soviétique ? Yaryna Dehtiar, militante de l'Atelier féministe, a évoqué ce sujet lors d'une conférence sur la science à l'époque de l'URSS, sur les femmes scientifiques ukrainiennes d'hier et d'aujourd'hui, que nous avons organisée.
L'Atelier féministe
*-*
À propos du développement de la science en URSS
En 1928, un agronome inconnu, Trofim Lyssenko, a annoncé la découverte de la vernalisation. Il s'agissait d'une technique inefficace de semis des céréales, qui avait déjà été découverte avant Lyssenko. Mais le pouvoir soviétique a célébré avec enthousiasme Trofim Lyssenko comme un génie unique et autodidacte. Et dans les rapports sur l'efficacité de la vernalisation, on mentait effrontément et on accusait les prétendus « koulaks » d'être responsables des mauvais résultats.
La période Lyssenko, c'est la science de l'époque soviétique. Le parti niait la génétique, les lois de la physique et de la chimie, et à la place, on soignait toutes les maladies avec du bicarbonate de soude.
En outre, les dirigeants du parti ne mettaient à l'Académie des sciences que « leurs » gens, qui obéissaient au pouvoir. Ceux qui étaient talentueux mais ne voulaient pas obéir aux ordres du parti étaient accusés d'espionnage et de terrorisme. Les scientifiques étaient de plus en plus souvent qualifiés de « bourgeois » et d'être « serviles envers l'Occident ». De telles accusations signifiaient la prison, l'exil et la mort.
La science progressiste en URSS était en réalité une fiction construite sur le mensonge et la répression. La fin du lyssenkisme a commencé à la mort de Staline. Cependant, personne n'a jamais été puni pour avoir falsifié des recherches scientifiques et pour l'arrestation et la mort de scientifiques talentueux.
Kateryna Yuchtchenko : l'Ukrainienne qui a créé l'un des premiers langages de programmation
En 1937, le père de Kateryna a organisé pour ses enfants une excursion sur les lieux du passé militaire des Cosaques. Pour cela, il a été accusé d'être un nationaliste ukrainien et arrêté avec la mère de la jeune fille. Kateryna elle-même a été reconnue comme fille d'un « ennemi du peuple » et exclue de l'Université nationale de Kyiv. La jeune fille s'est retrouvée seule. Elle s'est lancée dans la programmation et a été l'une des premières à travailler sur ordinateur.
À l'été 1937, Kateryna Yuchtchenko entre à l'université d'État d'Ouzbékistan à Samarcande. À 30 ans, elle soutient sa thèse de doctorat. Selon son fils, Kateryna Yuchtchenko vivait modestement, sans aspirer à une vie luxueuse. Elle subvenait aux besoins de ses trois enfants, de sa Kateryna Yuchtchenko mère et de sa belle-mère. Elle était toujours occupée à quelque chose, sans jamais se reposer. Le doyen Mykola Hlybovets se souvient :
Je suis venu chez Kateryna pour obtenir une recommandation, car elle faisait partie de mon jury de thèse. Elle m'a accueilli dans la cuisine, tenant ma thèse dans ses mains, la lisant, la feuilletant tout en préparant des crêpes.
Kateryna Yuchtchenko est l'auteure du premier manuel de programmation en URSS. Membre de l'Académie internationale des sciences informatiques, elle a reçu l'Ordre de la princesse Olga. Le père de la cybernétique, Norbert Wiener, a alors affirmé que l'URSS était en avance sur les États-Unis dans le développement de la théorie de l'automatisation. C'est Kateryna Yuchtchenko qui dirigeait le département d'automatisation de la programmation de l'Institut de cybernétique !
Natalia Lukyantchikova : une physicienne reconnue dans le monde entier
Lauréate du Prix national ukrainien dans le domaine des sciences et des techniques, Natalia est la fondatrice d'une école renommée spécialisée dans l'étude des processus photoélectriques et luminescents. Plus de 200 articles scientifiques, neuf élèves devenus docteurs et candidats au doctorat, six mois de travail en Allemagne en tant que professeure invitée. Impressionnant, n'est-ce pas ?
Née en 1937, Natalia a travaillé à l'Institut de physique des semi-conducteurs de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine. Elle était membre permanent du Comité international, dont l'une des tâches était de définir les priorités de la recherche mondiale dans le domaine du bruit. Pendant plusieurs décennies, elle a collaboré avec des scientifiques de renom de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France et des États-Unis.
Ses recherches ont influencé le développement de la recherche sur le bruit. Dans la littérature scientifique sur le bruit, on trouve souvent le terme « rapport de Lukyantchikova »
Valentina Radzymovska : militante et docteure en médecine
Valentina Radzymovska, professeure de microbiologie et fondatrice de l'école ukrainienne de biochimie a été contrainte d'émigrer à l'étranger pour échapper aux persécutions du pouvoir soviétique.
Valentina est née dans la région de Poltava dans une famille de militants ukrainiens. Après avoir terminé ses études secondaires à Kyiv en 1903, Valentina part étudier à Saint-Pétersbourg. Elle y participe activement aux réunions de l'intelligentsia ukrainienne du Parti révolutionnaire ukrainien et lit les œuvres de Lesia Oukrainka [NdT – Écrivaine ukrainienne (1871-1913), militante pour l'indépendance de son pays, pionnière du féminisme. Voir L'Ukraine en toutes lettres , Syllepse, 2023.].
Sa maison devient le lieu de rassemblement du mouvement national ukrainien. À plusieurs reprises, Valentina cache des documents et des armes. Après le début de la révolution de 1917, Valentina s'est concentrée sur la science et l'enseignement. Professeure à l'Institut médical de Kyiv en 1924, elle a dirigé un département à l'Institut panukrainien d'éducation populaire et un autre l'Institut scientifique et pédagogique.
Valentina Radzymovska est l'auteure d'une étude sur l'impact des bouleversements sociaux et des révolutions depuis 1917 sur l'organisme des enfants. Les résultats ont montré une influence négative évidente : petite taille, prise de poids et sous-développement de certains organes.
Arrêtée en août 1929 pour espionnage, Valentina Radzymovska a passé plus d'un an en prison, où elle a subi des tortures morales et physiques. Le parti l'a qualifiée de « peu fiable ». Il n'était plus question de science ni de recherche. Valentina part à l'étranger, où elle poursuit son travail. Le cœur de Valentina Radzymovska s'est arrêté de battre le 22 décembre 1953 dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Olena Kurylo : créatrice de la terminologie scientifique ukrainienne
En 1908, Olena a commencé à étudier au département de philologie de la faculté de philosophie de l'université de Königsberg. Le linguiste ukrainien Yevhen Tymtchenko fut le premier à intéresser Olena Kurylo à la culture ukrainienne et au mouvement de libération. Le deuxième fut son mari, Dmytro Kurylo, qui servit comme officier supérieur dans l'armée de la Ré- publique populaire ukrainienne et fut membre de la mission diplomatique ukrainienne à Varsovie.
Pendant la République populaire ukrainienne, Olena a vécu à Kyiv et a rédigé un manuel de grammaire ukrainienne pour les enfants. À la même époque, la linguiste a commencé à travailler à l'élaboration d'une terminologie ukrainienne. En 1918, elle a publié un Petit dictionnaire russo-ukrainien de terminologie médicale. Olena était également collaboratrice de la Commission folklorique et ethnographique, membre de la Commission d'histoire locale et de la Commission d'histoire de la chanson de l'Académie des sciences de l'Ukraine, membre de la Commission dialectologique de l'Académie des sciences de l'Ukraine.
Elle a participé à des expéditions dans les régions de Tchernihiv et de Poltava pour y recueillir les chants funèbres, les chansons, les contes et les légendes ukrainiennes.
Au début des années 1930, une campagne de persécution des linguistes ukrainiens a commencé et ses travaux ont été interrompus. Après 1932, aucun de ses travaux n'a été publié. Le mari d'Olena a été envoyé en exil et elle a été condamnée à huit ans de camp. Il existe des mentions indiquant qu'Olena aurait réussi à rester en vie et à sortir du camp le 5 octobre 1946. Mais les informations sur sa vie s'arrêtent là.
Double oppression
Nous savons peu de chose sur les femmes scientifiques ukrainiennes, car elles étaient victimes d'une double oppression : l'URSS et le patriarcat. Les Ukrainiennes talentueuses ont été réprimées, persécutées et leurs travaux interdits. Celles qui ont réussi à se faire une place dans le monde scientifique à l'époque de l'URSS devaient en plus s'occuper de leurs tâches ménagères, de leur mari et de leurs enfants. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de l'URSS et quelle est la situation actuelle des femmes scientifiques ukrainiennes ?
Selon les données de l'Institut de statistique de l'Unesco, les femmes représentent 47% des scientifiques en Ukraine. Elles sont représentées à égalité avec les hommes dans les sciences naturelles et agricoles, la construction mécanique, la médecine et les technologies. Cependant, les stéréotypes sociaux à l'égard des femmes et le manque de financement empêchent encore les femmes scientifiques ukrainiennes de réaliser leur potentiel. Voici comment Elena Vaneeva, mathématicienne et docteure en sciences physiques et mathématiques, explique cette situation :
J'ai été confrontée à cette situation lorsque je me suis inscrite en doctorat. Ils ont appelé le directeur de mon mémoire pour qu'il donne son avis sur moi. Et il a répondu : « Je ne sais pas, vous pouvez la prendre ou non. Mais je pense qu'elle n'écrit pas tout elle-même, c'est un camarade de classe qui lui donne les réponses ».
Natalia Atamas, candidate en sciences biologiques et vulgarisatrice scientifique, partage également son expérience des stéréotypes :
La saison des expéditions commence en avril, quand l'eau des rivières est encore froide. Qu'est-ce que j'entends ? « Ma fille, comment tu peux te baigner dans l'eau froide, tu vas accoucher ! »
Les femmes scientifiques ukrainiennes ont brisé le « plafond de verre » et démystifient les stéréotypes sur les femmes. Après tout, nous avons une forte tradition de pensée scientifique, créée et développée par les femmes au même titre que les hommes. Comme c'était le cas autrefois. Comme c'est le cas aujourd'hui.
Yaryna Dehtiar
Yarina Dehtiar est membre de l'Atelier féministe.
Publié dans : Soutien à l'Ukraine résistante. N° 39-40 – 1er juillet 2025
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/30/soutien-a-lukraine-resistante-n-39-40-1er-juillet-2025/
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-39-40-40_compressed.pdf
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ne leur fermons pas la porte

Enquête sur l'impact des restrictions budgétaires sur l'accompagnement des femmes victimes de violences
Tiré de Entre les lignes et les mots
Des structures en détresse, des femmes en danger.
Il ressort de notre enquête auprès du secteur associatif féministe, que l'année 2025 semble marquer la fin de la période de soutien à la lutte contre les violences conjugales qu'avait initiée le Grenelle et qui avait eu des effets positifs sur les chiffres des féminicides. Plus de 70% des associations déclarent aujourd'hui que leur santé financière est dégradée, majoritairement à cause des baisses de subventions. Il est à prévoir un réel impact pour les femmes particulièrement en milieu rural et sur les actions de prévention si rien n'est fait pour corriger ces baisses, ainsi que sur les équipes des associations, déjà épuisées.
Enquête sur 148 associations du secteur féministe, dont 122 associations accompagnant du public
Depuis le début de 2025, les alertes se multiplient
La Fondation des Femmes, qui redistribue les dons qu'elle reçoit depuis bientôt 10 ans, est en lien constant avec le tissu associatif féministe, en particulier en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Ce sont 14 millions d'euros qu'elle a pu attribuer à des centaines d'associations, et qui lui ont permis d'être le témoin privilégié de leurs difficultés récurrentes à trouver les moyens nécessaires à leurs actions.
La Fondation des Femmes évalue régulièrement les besoins du secteur et les efforts réalisés par les pouvoirs publics pour répondre aux défis engendrés par les violences masculines.
Le rapport « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes » évaluait en 2023 les besoins réels entre 2,6 et 5,4 milliards d'euros par an, quand l'État y consacrait 184 millions, soit, 0,04% de son budget.
Face à cela, la grande précarité des associations de terrain venant en aide aux femmes n'est pas nouvelle. Elle est même à l'origine de la création de la Fondation des Femmes en 2016. Mais la période actuelle est marquée par un contexte budgétaire particulièrement dégradé, sans précédent depuis 15 ans. La Fondation des Femmes a été alertée à de nombreuses reprises depuis le début de l'année 2025 par les associations – qu'elles soient locales ou de grands réseaux nationaux – sur l'impact délétère de ce contexte à travers de nombreuses baisses de financements de la part des pouvoirs publics locaux et nationaux.
Devant la gravité et la récurrence des retours, la Fondation des Femmes a d'abord alerté sur la situation aux côtés de plus de 100 associations dans une tribune « Non aux coupes budgétaires qui mettent les femmes en danger ! » dans la Tribune du dimanche le 6 juin 2025, doublée d'une pétition. Elle a aussi décidé de conduire une enquête auprès de son réseau pour collecter des données et documenter les coupes budgétaires, ainsi que leur impact sur l'accueil des femmes dans les territoires.
Cette enquête a été rédigée par la Fondation des Femmes et administrée via un questionnaire transmis aux associations spécialisées dans l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes faisant partie de la base de données de la Fondation des Femmes, soit 1 065 associations entre le 17 juin et le 2 juillet. Au total, près de 148 associations ont répondu au questionnaire dont 122 ont des missions d'accompagnement des publics.
Cet échantillon est représentatif de l'accompagnement des femmes par les associations féministes spécialisées en France et de leur répartition des sur le territoire. Toutefois les chiffres et pourcentages communiqués se limitent à ces associations répondantes, et ne peuvent être simplement extrapolés à l'ensemble des associations féministes françaises sans risquer des biais. La méthodologie et les caractéristiques de l'échantillon sont détaillées à la fin de l'enquête.
L'état consacre 184 millions d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, soit 0,04% de son budget.
Télécharger le rapport : FDF-Rapport-Enquete-12pages-WEB3
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violences sexuelles liées à la guerre : l’ONU dénonce une forte hausse et ajoute le Hamas à sa liste noire

Ils sont plus de 4 600 survivants dans le monde – femmes, hommes, enfants – à avoir subi des violences sexuelles à des fins guerrières en 2024. Une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente, selon un rapport de l'ONU publié jeudi, qui cite pour la première fois le Hamas parmi les auteurs de ces crimes.
La République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Haïti, la Somalie et le Soudan du Sud figurent en tête des 21 États pour lesquels l'ONU dispose d'informations vérifiées. Les personnes touchées ont entre un et 75 ans et sont issues de toutes les catégories sociales, y compris des minorités ethniques ou sexuelles et des personnes handicapées. Plus de neuf survivants sur dix sont des femmes.
Des violences d'une extrême brutalité
Arme de guerre, instrument de torture, outil de répression politique ou de domination territoriale, les agressions sexuelles décrites dans le rapport sont souvent accompagnées de violences physiques graves, allant jusqu'aux exécutions sommaires après le viol.
Dans de nombreux cas, les enfants nés de ces crimes vivent, avec leurs mères, dans la stigmatisation et l'exclusion sociale. Une tendance marquante relevée dans le rapport concerne les violences sexuelles commises dans les lieux de détention – officiels ou clandestins. Utilisées pour humilier ou extorquer des informations, ces dernières sont en augmentation et visent principalement des hommes et des garçons.
La prolifération des armes légères, les déplacements massifs et l'insécurité alimentaire accroissent les risques. Des groupes armés recourent au viol pour consolider leur contrôle sur des territoires, exploiter des ressources ou imposer une idéologie. La traite à des fins d'esclavage sexuel, y compris par des groupes terroristes visés par des sanctions de l'ONU, est également une réalité.
Des soins vitaux hors de portée
Malgré l'augmentation des besoins, l'accès à l'aide reste limité, voire bloqué. « L'ampleur inédite de la destruction des établissements de santé, ainsi que les attaques, le harcèlement et les menaces visant les prestataires sur le terrain, ont gravement entravé l'accès à une assistance vitale pour les survivantes dans les zones de conflit », constate Pramila Patten, la Représentante spéciale chargée des violences sexuelles commises en période de conflit, dans un communiqué de presse accompagnant la publication du rapport. « Les services sont le moins disponibles précisément au moment où les survivants en ont le plus besoin ».
Après un viol, les survivantes doivent recevoir des soins médicaux dans un délai de 72 heures pour prévenir certaines infections, traiter les blessures ou éviter la transmission du VIH. Mais la plupart d'entre elles n'ont malheureusement pas accès à de telles interventions, qui figurent parmi les moins financées dans les plans de réponse humanitaire.
Le document appelle à renforcer le Fonds commun pluri-partenaire de l'ONU et à déployer davantage de conseillers pour la protection des femmes.
Sanctionner les responsables
Ce seizième rapport annuel fournit une liste de 63 acteurs étatiques et non étatiques soupçonnés de violences sexuelles dans des conflits figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. L'ONU recommande à ce dernier de recourir davantage à des sanctions ciblées contre les auteurs récurrents.
C'est déjà le cas pour certains groupes terroristes, notamment Daech et Al-Qaida, qui peuvent faire l'objet de sanctions spécifiques pour des violences sexuelles et sexistes.'
Le Hamas épinglé Israël et la Russie sur la sellette
De nouveaux acteurs font leur entrée dans la liste : le groupe RED-Tabara, une faction armée burundaise active dans l'est de la République démocratique du Congo et impliquée dans un viol de masse en 2024 ; l'Agence de dissuasion pour la lutte contre le crime organisé et le terrorisme (DACOT) et le Département de lutte contre la migration illégale (DCIM), deux entités gouvernementales libyennes accusées de violences sexuelles en détention ; et, de manière notable, le Hamas, pour des faits survenus en Israël lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et à l'encontre des otages retenus depuis par le groupe à Gaza.
« Il existe des motifs raisonnables de penser que certains otages emmenés à Gaza ont subi diverses formes de violences sexuelles durant leur captivité, ainsi que des preuves claires et convaincantes que de telles violences ont également eu lieu lors des attaques du 7 octobre 2023, dans au moins six localités », note le communiqué de presse.
Une annexe préliminaire prévient aussi certaines forces armées – israéliennes et russes – d'une possible inscription dans le prochain rapport, en raison de soupçons de violences sexuelles commises en détention.
Devoir envers les survivantes
Le Secrétaire général de l'ONU, qui commandite chaque année le rapport, exhorte dans ce dernier toutes les parties à mettre en place des mesures précises : ordres formels interdisant les crimes sexuels en temps de guerre, poursuites judiciaires et accès sans entrave aux équipes de l'ONU.
Et Pramila Patten d'ajouter : « Nous devons aux survivants bien plus que notre solidarité. Nous leur devons une vie dans la dignité, et des actions efficaces et décisives pour prévenir et éradiquer ces crimes ».
https://news.un.org/fr/story/2025/08/1157294
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des « cas horribles » de violence sexiste dans les conflits en RDC, au Soudan, en Israël et à Gaza

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/12/des-cas-horribles-de-violence-sexiste-dans-les-conflits-en-rdc-au-soudan-en-israel-et-a-gaza/?jetpack_skip_subscription_popup
Alors que les conflits se multiplient et s'étendent à travers le monde, la violence à l'égard des femmes et des filles dans les situations de conflit, d'après-conflit et humanitaires est en augmentation, a dénoncé mardi le chef des droits de l'homme de l'ONU.
Lors d'un panel organisé en marge de la 59e session du Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire a indiqué que ces dernières années, son Bureau et des commissions d'enquête du Conseil ont documenté des milliers de cas horribles de violence sexiste, notamment en République démocratique du Congo (RDC), au Myanmar, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, y compris Gaza et la Cisjordanie, ainsi qu'en Ukraine.
« La violence sexuelle liée au conflit est un crime qui peut et doit être prévenu et puni. »
En Haïti, les femmes et les filles sont de plus en plus souvent victimes de violences sexuelles, y compris d'esclavage sexuel. « Un décret récent établissant deux unités judiciaires spécialisées, soutenues par mon Bureau, marque un progrès décisif dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles dans le pays », a déclaré dans un message vidéo, Volker Türk.
Viol collectif lié au conflit omniprésent au Soudan
Au Soudan, « le viol collectif et d'autres formes de violence sexuelle » liés au conflit sont omniprésents et, dans l'ouest du Darfour et dans d'autres régions, ils sont même utilisés comme « arme de guerre lors d'attaques à motivation ethnique ».
« C'est abominable. Les combattants sont encouragés à victimiser les femmes, souvent en tant qu'arme de guerre délibérée, pour terroriser les communautés et les forcer à fuir, et pour faire taire les voix des femmes qui s'élèvent contre l'incitation à la guerre et cherchent à construire la paix », a fustigé M. Türk.
Or malgré ce sombre tableau, la plupart des auteurs de violences sexistes continuent « de s'en tirer à bon compte, y compris des hommes directement responsables d'agressions sexuelles massives et brutales qui devraient choquer la conscience de tout être humain ».
Or le Bureau des droits de l'homme de l'ONU estime que les récentes coupes dans les budgets de l'aide mondiale limitent considérablement le travail des groupes de femmes. « Nombre de ces groupes sont des partenaires proches de mon bureau, qui s'efforce de soutenir les survivants de la République centrafricaine, de la Colombie, de la RDC, du Soudan du Sud et d'ailleurs », a ajouté M. Türk, relevant que « l'absence de soutien psychosocial laisse les jeunes filles et les femmes seules, exclues et traumatisées ».
Cruauté inimaginable
De son côté, la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit s'est inquiétée de l'aggravation des violences sexuelles liées aux conflits dans le monde.
Selon Pramila Patten, la militarisation croissante créée les conditions « d'une cruauté inimaginable et implacable ». Le viol collectif, l'esclavage sexuel et d'autres formes brutales de violence sexuelle sont ainsi utilisés comme tactiques de guerre, de torture et de terrorisme, pour soumettre et déplacer les populations.
La Représentante spéciale en a d'ailleurs profité pour présenter le rapport annuel 2024 du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, qu'il présentera en août prochain au Conseil de sécurité. Le document fait état de plus de 4 500 cas dans 21 pays, les femmes et les filles représentant plus de 90% des victimes. Si le rapport fait état de la gravité et de la brutalité des incidents vérifiés, il ne prétend pas refléter l'ampleur ou la prévalence mondiale de ce crime chroniquement sous-déclaré et historiquement caché.
Des réseaux de trafiquants
« Nous savons que pour chaque femme qui se manifeste, beaucoup d'autres sont réduites au silence par peur des représailles et en raison de l'insuffisance des services. En outre, la stigmatisation, enracinée dans des normes sociales néfastes, entraîne l'exclusion socio-économique et l'appauvrissement des survivantes », a affirmé Mme Patten.
D'une manière générale, le rapport met en lumière la vulnérabilité des déplacées, des réfugiées et migrantes, qui continuent d'être confrontées à des risques accrus de violence sexuelle, notamment « d'enlèvement et d'esclavage sexuel, dans les situations de conflit, telles que le Burkina Faso, la RDC, Haïti, la Libye, la Somalie et le Soudan ».
Au Myanmar, en Ukraine, au Soudan et ailleurs, des femmes et des filles fuyant pour leur sécurité sont devenues « la proie de réseaux de trafiquants et de criminels sans scrupules, pour qui le déplacement forcé de civils n'est pas une tragédie, mais une occasion d'exploitation ».
Avoir des préservatifs pour chercher de la nourriture
« Dans l'est de la RDC, des femmes ont rapporté qu'elles se déplaçaient avec des préservatifs lorsqu'elles cherchaient de la nourriture ou ramassaient du bois et de l'eau. Ces femmes sont confrontées à un choix inacceptable entre la subsistance économique et la violence sexuelle, entre leurs moyens de subsistance et leur vie », a déclaré Mme Patten, soulignant que « la violence sexuelle reste une caractéristique persistante de l'économie politique de la guerre ».
Une façon de rappeler que le viol n'est pas « une conséquence inévitable de la guerre », mais qu'il peut être évité grâce à une approche concertée et stratégique.
« Nous devons rassurer les populations à risque en leur montrant qu'elles ne sont pas oubliées et que le droit international n'est pas une promesse vide de sens. À l'heure du retour en arrière et de la régression, l'incapacité à maintenir les progrès accomplis ne ferait que trahir les survivants et enhardir les auteurs de ces actes », a conclu la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit.
https://news.un.org/fr/story/2025/06/1156716
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment agir le 21 septembre pour promouvoir la paix ?

Peut-on aider à réaliser les objectifs de la journée internationale de la paix qui demande un cessez-le-feu dans les zones de combat du monde entier et une résolution pacifique des conflits ?
L'idéal de la paix qui a dominé sur la scène internationale pendant la deuxième moitié du XXe siècle est de moins en moins en vogue. À l'heure que résonnera le 21 septembre à New York la Cloche de la paix sur laquelle est inscrit « Longue vie à la paix dans le monde » et qui a été fabriquée à partir de pièces de monnaie données par des enfants de partout sur la planète, que peut-on attendre de cette journée internationale de la paix qui a comme thème cette année : agissons pour un monde pacifique ?
Quels sont les dangers ?
L'Europe vit depuis février 2022 avec un ennemi décomplexé qui a décidé de délaisser la coexistence pacifique et de consolider une économie de guerre qui menace la paix sur le continent. Le conflit le plus grave en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale a fait des dizaines de milliers de morts, entrainer le déplacement à l'étranger de 6 à 7 millions d'Ukrainiens et aucun arrêt des combats est en vue. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmait le 12 septembre que les négociations de paix avec l'Ukraine étaient en pause. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'objectif de Poutine est toujours d'occuper toute l'Ukraine et il a appelé les Occidentaux à faire pression sur la Chine, proche du Kremlin, pour qu'elle use de son influence pour mettre fin à la guerre. « Nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre ouverte depuis la Seconde Guerre mondiale », a récemment affirmé le premier ministre polonais Donald Tusk.
Le plus complexe danger pour la paix dans le monde est actuellement à Gaza. Tout pointe vers encore plus de violence avant l'atteinte d'une possible cessation des hostilités et une paix encore très mal définit qui risque dans la plupart des hypothèses d'être injuste.
La paix est aussi menacée par la Chine qui n'exclut pas le recours à la force pour prendre le contrôle de Taïwan. Elle a accru ces dernières années sa pression économique et militaire sur le régime démocratique dont l'armée doit faire face à une présence grandissante d'avions militaires chinois, de navires et de drones.
Autre danger, le meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis pourrait mener à d'importantes violences cette année. L'assassinat de l'ultraconservateur dans un campus de l'Utah a touché directement les divisions politiques des États-Unis. Bien qu'en 2020, l'extrême droite reprochait à la gauche d'utiliser la mort d'un Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, asphyxié par un policier blanc, pour dénoncer les violences policières, cinq ans plus tard, elle s'identifie maintenant à la victime, une situation préoccupante qui pourrait dégénérer rapidement.
Comprendre la paix
Faire la paix est un processus qui permet d'éliminer ce qui cause les conflits. La paix est d'abord un état d'esprit et une volonté animant les communautés humaines. Elle n'est pas seulement le silence des armes et la fin des hostilités. Pour faire la paix, il faut savoir ce qui mène à faire la guerre.
Un processus de paix peut impliquer une mobilisation des populations pour convaincre l'opinion publique et reposée sur les nouvelles technologies numériques ou des influenceurs pouvant convaincre des millions de personnes. Il peut cependant être déjoué par des puissances diffusant de fausses informations et pratiquant une désinformation systématique.
Un bon processus de paix est essentiel parce qu'il encourage l'empathie envers autrui et le respect des différences culturelles. Il prévient les conflits en favorisant le bien-être des individus et la réduction des tensions qui mènent à la violence.
La vie politique internationale s'est accélérée avec la circulation rapide des informations. La paix moderne se fonde davantage sur le collectif que l'ancienne. En ce sens, l'assemblée générale des Nations unies permet aux chefs d'État de défendre leur vision des conflits, peut assembler des troupes et des moyens pour la résolution des conflits partout sur la planète. Pour faire en sorte que les actions en faveur de la paix résonnent plus fort que les mots, le monde a plus que jamais besoin de la solidarité.
Quoi faire ?
Les objectifs de la Journée internationale de la paix sont multiples, mais elle vise avant tout à encourager la non-violence et la résolution pacifique des conflits. Elle met également en avant l'importance du respect des droits humains, du dialogue et de la tolérance. La coexistence peut être considérée comme le cœur de la paix moderne. Il est maintenant possible de réagir rapidement à des événements s'étant produits de l'autre côté de la planète.
Il existe de nombreuses manières d'agir. Un concert gratuit pour la paix, Live Peace, sera organisé le 21 septembre à Berlin et Hambourg en Allemagne. L'objectif est de réunir de nombreux citoyens à travers le monde, pour demander la paix par la musique.
En réaction à la guerre en Ukraine, le Japon vient de renforcer ses sanctions contre la Russie, abaissant le plafond de prix du pétrole russe, gelant les avoirs de 51 organisations et de 14 dirigeants d'entreprises prorusses. Ce pays abaissera aussi le plafond instauré en 2022 par le G7 du prix du pétrole russe de 60 à 47,60 $ le baril.
La résistance occidentale à la menace russe passe actuellement par l'axe Paris-Londres-Berlin qui n'a jamais été aussi important pour la sécurité de l'Europe et mérite d'être renforcé. Sans la « coalition de volontaires », l'Ukraine serait condamnée à une négociation avec Moscou en position de faiblesse.
Aux États-Unis, les dirigeants pourraient s'efforcer de trouver un processus menant à une paix qui permettrait de montrer leurs valeurs communes. Dans l'actuel ordre mondial bouleversé, s'intéresser à la journée internationale de la paix pourrait montrer comment elle est essentielle.
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.





















