Derniers articles
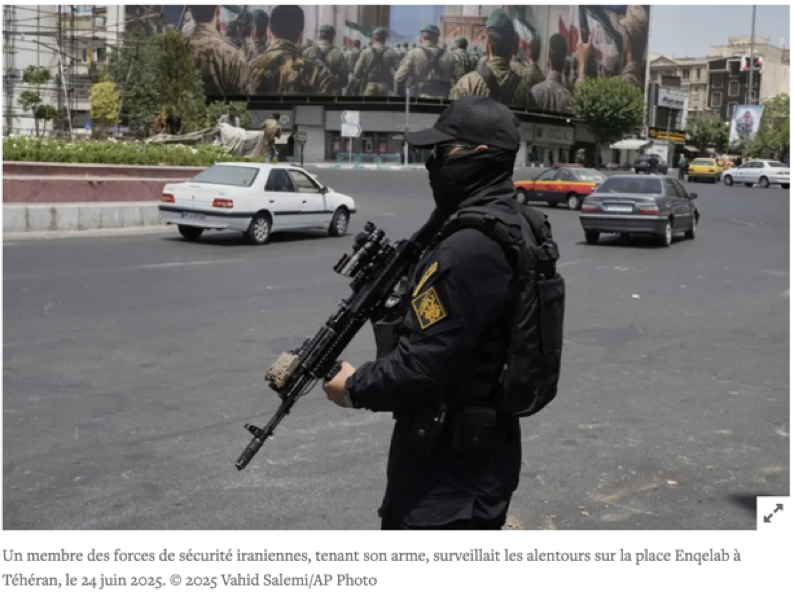
Iran : Vague de répression après les hostilités avec Israël
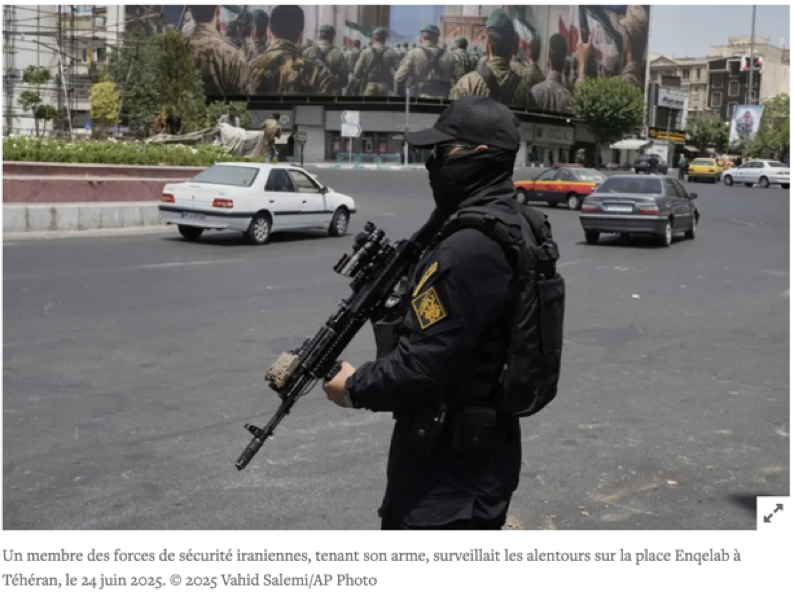
(Beyrouth) – Les autorités iraniennes mènent une répression terrifiante sous prétexte de renforcer la sécurité nationale suite aux hostilités avec Israël en juin, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch. Cette crise croissante met en évidence la nécessité urgente pour la communauté internationale de prendre des mesures concrètes visant l'obligation de rendre des comptes pour diverses violations.
Tiré de Human rights watch.
Depuis le 13 juin 2025, les autorités iraniennes ont arrêté plus de 20 000 personnes, dont des dissidents, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des utilisateurs des réseaux sociaux, des familles de victimes illégalement tuées lors de manifestations nationales et des ressortissants étrangers. Parmi les autres personnes ciblées figurent des Afghans, des membres des minorités ethniques baloutches et kurdes, ainsi que des membres des minorités religieuses bahaïe, chrétienne et juive.
« Alors que la population peine à se remettre des effets dévastateurs du conflit armé entre l'Iran et Israël, les autorités iraniennes se livrent à une répression terrifiante », a déclaré Sara Hashash, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. « Le dispositif répressif des autorités dans le pays reste implacable ; elles intensifient une surveillance déjà oppressive et généralisée, les arrestations de masse, ainsi que l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence à l'égard des minorités. »
Les forces de sécurité ont tué des personnes aux points de contrôle de véhicules, dont une fillette de 3 ans. Des responsables et des médias affiliés à l'État ont appelé à des exécutions accélérées, prônant dans certains cas une répétition des massacres de 1988 dans des prisons, au cours desquels de hauts responsables avaient ordonné l'exécution sommaire et extrajudiciaire de milliers de prisonniers politiques. Au moins neuf hommes ont été exécutés pour des motifs politiques et/ou des accusations d'espionnage pour le compte d'Israël, et un projet de loi parlementaire visant à élargir encore le champ d'application de la peine de mort est en attente d'approbation définitive.
« Depuis juin, la situation des droits humains en Iran s'est aggravée, les autorités iraniennes désignant et ciblant les dissidents et les minorités comme boucs émissaires d'un conflit dans lequel ils n'ont joué aucun rôle », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « La répression brutale menée par les autorités iraniennes contre un peuple encore sous le choc de la guerre laisse présager une catastrophe imminente en matière de droits humains, en particulier pour les groupes les plus marginalisés et persécutés du pays. »
Les autorités iraniennes devraient immédiatement instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort, libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et veiller à ce que toutes les autres personnes détenues soient protégées contre les disparitions forcées, la torture et autres mauvais traitements. Les autres pays devraient enquêter sur les crimes de droit international commis par les autorités iraniennes et engager des poursuites en vertu du principe de compétence universelle, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.
Arrestations massives et appels alarmants à accélérer les procès et exécutions
Les services de renseignement et de sécurité iraniens ont commencé à procéder à des arrestations massives quelques jours après l'escalade des hostilités avec Israël, sous couvert de sécurité nationale.
Gholamhossein Mohseni Eje'i, le chef du pouvoir judiciaire, a annoncé le 22 juillet que de lourdes peines, y compris la peine de mort, seraient infligées aux personnes qui, selon lui, avaient « coopéré avec Israël ». Dans une déclaration du 12 août, Saeed Montazer Al-Mahdi, porte-parole de la police, a annoncé qu'environ 21 000 personnes avaient été arrêtées.
De hauts responsables ont réclamé des procès et des exécutions accélérés pour « soutien » ou « collaboration » avec des États hostiles. Les médias affiliés à l'État ont prôné la répétition des massacres de 1988 dans les prisons, notamment dans un article de Fars News, affirmant que « les éléments mercenaires… méritent des exécutions similaires à celles de 1988 ».
Les autorités judiciaires ont également annoncé la création de tribunaux spéciaux pour poursuivre « les traîtres et les mercenaires ». Le Parlement a accéléré l'adoption d'une législation d'exception, en attendant l'approbation finale du Conseil des gardiens, qui étendrait le recours à la peine de mort, y compris pour des accusations vagues liées à la sécurité nationale, telles que « coopération avec des gouvernements hostiles » et « espionnage ».
Les détenus sont exposés à un risque élevé de disparition forcée, de torture et d'autres mauvais traitements, de procès inéquitables et d'exécutions arbitraires, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.
Intensification de la répression contre les minorités ethniques
Les autorités ont également utilisé le climat d'après-conflit comme prétexte pour intensifier la répression contre les minorités ethniques opprimées.
Amnesty International a documenté que les forces de sécurité de la province du Sistan-Baloutchistan ont tué illégalement deux femmes appartenant à la minorité ethnique baloutche opprimée d'Iran lors d'un raid sur le village de Gounich le 1er juillet. Une source principale a indiqué à l'organisation que des agents avaient tiré des plombs métalliques et des balles réelles sur un groupe de femmes, tuant l'une d'elles, Khan Bibi Bamri, sur place, et blessant mortellement Lali Bamri, décédée plus tard à l'hôpital. Au moins dix autres femmes ont été blessées.
Les agents de forces de sécurité ont avancé des justifications contradictoires pour justifier le raid, invoquant la présence d'un « groupe terroriste », d'« Afghans » et « [d'agents d'] Israël ». Une vidéo de l'incident examinée par Amnesty International montre des agents en uniforme du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pointant leurs armes à feu vers les femmes tandis que des coups de feu répétés retentissent.
Le 25 juin, les médias d'État ont annoncé l'arrestation de plus de 700 personnes à travers le pays pour collaboration présumée avec Israël. Les provinces de Kermanshah et du Khuzestan, où vivent des minorités ethniques, notamment des Kurdes et des Arabes ahwazis, figurent parmi celles ayant enregistré le plus grand nombre d'arrestations. Selon le Réseau des droits humains du Kurdistan, au 24 juillet, les autorités avaient arrêté au moins 330 personnes issues de la minorité ethnique kurde.
Les autorités ont également mené contre des personnes afghanes une campagne massive d'arrestations et d'expulsions, ainsi que de diffamation dans les médias d'État.
Répression contre les minorités bahaïe, chrétienne et juive
En outre, les autorités iraniennes ont exploité le climat sécuritaire tendu pour intensifier la répression à l'encontre des minorités religieuses.
Les membres de la minorité bahaïe ont été particulièrement ciblés par une campagne de propagande coordonnée de l'État, incitant à l'hostilité, à la violence, à la discrimination et à la désinformation, accusant à tort les bahaïs d'espions et de collaborateurs d'Israël. Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère du Renseignement a qualifié la foi bahaïe de « secte sioniste ». Le 18 juin, Raja News, média affilié au CGRI, a accusé les bahaïs d'être « des mandataires et des espions d'Israël ».
L'enquête d'Amnesty International et de Human Rights Watch a révélé que les mesures prises contre les bahaïs comprennent des arrestations et des détentions arbitraires, des interrogatoires, des perquisitions à leur domicile, la confiscation de biens et la fermeture d'entreprises.
Dans un cas, une source bien informée a indiqué aux organisations que les autorités avaient arrêté Mehran Dastoornejad, 66 ans, lors d'une perquisition à son domicile à Marvdasht, dans la province de Fars, le 28 juin, après l'avoir battu et confisqué ses biens. Les autorités ont refusé à l'avocat désigné par sa famille tout accès à lui et toute information sur les accusations portées contre lui. Il a été libéré sous caution de la prison de Chiraz le 6 août. Une autre source a indiqué à Human Rights Watch que Noyan Hejazi et Leva Samimi, un couple marié, avaient été arrêtés dans la province de Mazandaran les 25 juin et 7 juillet respectivement, et privés de l'accès à un avocat jusqu'à leur libération sous caution le 3 août.
Fin juin, les autorités iraniennes ont convoqué et interrogé au moins 35 membres de la communauté juive de Chiraz et de Téhéran au sujet de leurs liens avec des proches en Israël et les ont mis en garde contre tout contact, selon Human Rights in Iran, une organisation basée hors d'Iran.
Malgré les démentis initiaux des médias d'État, fin juillet et début août, des publications sur la chaîne Telegram d'un député juif, Homayoun Sameyeh Najafabadi, ont confirmé que des membres de la communauté juive iranienne avaient été arrêtés dans trois provinces et que plusieurs d'entre eux avaient été jugés devant un tribunal révolutionnaire à Téhéran pour des chefs d'accusation non identifiés. Ces publications indiquaient que les personnes arrêtées à Téhéran étaient accusées d'espionnage, mais que ces accusations avaient été abandonnées.
Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère iranien du Renseignement a accusé des secteurs de la communauté chrétienne d'être des « mercenaires du Mossad » ayant des liens avec Israël, et les médias d'État ont diffusé des « aveux » de chrétiens détenus le 17 août, suscitant de vives inquiétudes quant à leur extorsion sous la torture. Le 24 juillet, une association de défense des droits humains hors d'Iran a signalé l'arrestation d'au moins 54 chrétiens depuis le 24 juin.
Recours illégal à la force meurtrière aux points de contrôle de sécurité
Les points de contrôle de véhicules mis en place depuis le conflit de juin sont devenus un autre instrument de répression. Les autorités ont procédé à des fouilles intrusives de véhicules et de téléphones portables, arrêtant des personnes pour « collaboration » avec Israël, souvent sur la seule base de publications sur les réseaux sociaux, selon les médias d'État. Les points de contrôle ont également été utilisés pour arrêter des ressortissants « non autorisés », un terme discriminatoire utilisé par les autorités pour désigner les Afghans.
Le 1er juillet, les forces de sécurité de Tarik Darreh, dans la province de Hamedan, ont abattu deux personnes et en ont blessé une troisième sous prétexte qu'elles fuyaient les points de contrôle, selon les médias. Dans un communiqué du 2 juillet, Hemat Mohammadi, chef de l'Organisation judiciaire des forces armées de la province de Hamedan, a déclaré qu'une enquête était en cours, mais a affirmé que les forces de sécurité avaient tiré sur un véhicule qui tentait de fuir. Sur les réseaux sociaux, des activistes ont identifié les deux hommes tués comme étant Alireza Karbasi et Mehdi Abaei.
D'après les médias d'État et les déclarations officielles, le 17 juillet, les forces de sécurité de Khomein, dans la province de Markazi, ont également abattu quatre membres d'une famille voyageant à bord de deux voitures : Mohammad Hossein Sheikhi, Mahboubeh Sheikhi, Farzaneh Heydari et une fillette de 3 ans, Raha Sheikhi. Vahid Baratizadeh, le gouverneur de Khomein, a indiqué que les forces de sécurité avaient tiré sur deux voitures « suspectes ». Le 12 août, un porte-parole du gouvernement a annoncé, sans plus de précisions, l'arrestation de plusieurs agents impliqués dans la fusillade.
Selon les déclarations des autorités, rien ne prouve que les personnes tuées par balle lors de ces incidents représentaient une menace imminente de mort ou de blessure grave. En vertu du droit international, le recours à une force potentiellement létale à des fins de maintien de l'ordre est une mesure extrême, qui ne doit être utilisée qu'en cas de stricte nécessité pour protéger des vies ou prévenir des blessures graves dues à une menace imminente.

Les leaders lilliputiens européens et le mécanisme de snapback contre l’Iran

La photo dont dans son commentaire, Yanis Varoufakis utilise le terme « Lilliputiens » pour les guides européennes est vraiment crue.
Kaveh Boveiri
Ce ministre des Finances dans le gouvernement d'Aléxis Tsípras et le lanceur du Mouvement pour la démocratie en Europe 2025 (DiEM25) voit ces leaders « comme les élèves méchants dans le bureau de l'instituteur ».
Dans leur acte d'obéissance moutonnière, le plus récent, le 28 août, trois leaders de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont demandé dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU le déclenchement du mécanisme de « snapback » (réactivation automatique) contre l'Iran. Ainsi, une fois mises en pratique, les sanctions de l'ONU seront réimposées contre l'Iran après avoir été levées dans lecadre d'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. Et la réaction des États-Unis ? La réponse officielle est sans équivoque : Les États-Unis saluent le déclenchement du mécanisme de snapback.
Mais aucune de ces leaders ne critique Washington de se retirer unilatéralement de cet accord en 2018. Personne ne critique l'Israël d'avoir mis fin à une telle négation le 13 juin 2025, juste la veille du sixième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran.
Et les cas semblables sont nombreux.
Dans sa déclaration du 13 juin de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et à la suite de bombardements de site nucléaires iraniens, Rafael Mariano Grossi, le Directeur général de l'Agence dit : « J'ai rappelé à maintes reprises que les installations nucléaires ne devaient jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car tant les populations que l'environnement pourraient en pâtir. Ces attaques sont lourdes de conséquences pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, et nuisent également gravement à la paix et à la sécurité régionales et internationales ». Ces leaders en restent silencieux.
À la suite de bombardement de trois autres sites nucléaires de l'Iran le 22 juin, cette fois par les États-Unis, le même directeur dit : « Le régime de non-prolifération nucléaire qui a sous-tendu la sécurité internationale depuis plus d'un demi-siècle est en jeu ». Ni cette agence ni les leaders présents dans cette photo n'ont pas les moyens ou la volonté de demander à Israël ni les États-Unis de se joindre à ce régime. De plus, ils ne se trouvent pas responsables d'une clarification de la part du régime génocidaire de l'Israël concernant leurs armes nucléaires.
Selon Amnesty International : « Les frappes aériennes délibérées de l'armée israélienne contre la prison d'Evin, à Téhéran, le 23 juin 2025, constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre ». Les leaders en restent silencieux.
Un regard plus attentif relève un autre aspect dans cette photo. Un nombre de cadeaux se trouve sur le pupitre de l'instituteur Trump. Ce sont les carottes de Trump, et le bâton ? Les tarifs, entre autres.
Cette obéissance peut être vue dans uneautre occasion. C'est le moment où le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ose se protester pas contre l'investissement militaire, mais seulement contre l'augmentation d'un tel investissement. Cette fois, les leaders de l'OTAN accompagnés par Vladimir Zelensky gardent leur distance.
Bienvenue à l'ère de Trump ! Une ère qui n'est pas, ou très peu, résistée par les leaders de pays occidentaux. Un auteur compétent doit faire un suivi du statu quo de La haine de l'occident (2008) décrit par Jean Ziegler.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le règlement de comptes horrifique du Népal avec sa classe politique défaillante

Après des manifestations anticorruption de la génération Z et un soulèvement meurtrier qui ont forcé le premier ministre et le gouvernement à démissionner, le Népal recherche une nouvelle politique capable de se débarrasser de son establishment défaillant.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les Népalais ne prêtent pas souvent attention à la politique de leurs voisins sud-asiatiques au-delà de l'Inde. Mais quand les Sri-Lankais se sont soulevés en 2022 pour chasser le régime Rajapaksa [1], ils ont pris note. Puis est venu le Bangladesh et sa Révolution de juillet l'année dernière, avec Sheikh Hasina [2] et tout le système politique qui l'entourait dans le viseur du public. Encore une fois, le Népal a pris note. Dans de nombreuses conversations à Katmandou [3], lors de ces deux occasions, j'ai entendu le même refrain : notre tour viendra.
Alors le voici maintenant. Des jeunes, sous la bannière des « manifestations Gen Z », sont descendus dans la rue le 8 septembre – fatigués d'un système politique corrompu et d'une classe politique corrompue, fatigués de voir les mêmes vieux hommes discrédités se relayer pour diriger et piller le pays, fatigués de ne voir d'autre avenir que de partir travailler à l'étranger, ce que font des milliers de personnes chaque jour. Les manifestations pacifiques ont soudain basculé dans la violence, et après que la police a ouvert le feu, le bilan est monté à 19 morts, avec des hôpitaux bondés de blessés. Ce fut la journée de manifestation la plus meurtrière que le Népal ait jamais connue.
Le gouvernement de K P Oli du Népal a assassiné 19 personnes
Le matin du 9 septembre, la douleur et la rage ont fait sortir des milliers de personnes, défiant les couvre-feux. Dans tout le pays, tout ce qui était lié au gouvernement et à l'establishment politique est soudain devenu une cible légitime. Les bureaux des partis et les maisons des politiciens sont partis en fumée. Dans l'après-midi, de lourdes colonnes de suie s'élevaient de la cuvette de la vallée de Katmandou. Le principal aéroport du pays a été fermé, les vols détournés. Aux nouveaux quartiers ministériels dans le sud de la capitale, des hélicoptères ont atterri pour évacuer les résidents vers la sécurité. Puis, plus de coups de feu, plus de sirènes, d'explosions, des panaches de fumée encore plus épais.
Les ministres ont commencé à démissionner, suivant l'exemple du ministre de l'Intérieur, qui avait démissionné la nuit précédente. Les parlementaires de l'opposition ont démissionné en masse, les appels se multipliant pour dissoudre le gouvernement et organiser de nouvelles élections. Avant 15h, le premier ministre, K P Sharma Oli [4] – dans son troisième mandat au pouvoir, et aussi têtu et égoïste qu'ils le sont – a également annoncé qu'il démissionnait.
Au fur et à mesure que la journée avançait, les choses ont complètement échappé à tout contrôle. Ce n'étaient plus les manifestants de la génération Z de la veille. La foule avait pris le relais. Des vidéos ont circulé montrant des dirigeants politiques se faire tabasser, leurs maisons être lapidées et incendiées. La maison du premier ministre brûlait, la résidence du président, la Cour suprême, le parlement, les supermarchés, les postes de police, et bien plus encore. Et, bien sûr, plus de morts à compter. Le chef de l'armée a fait une apparition pour appeler à la retenue et au calme, mais cela n'a guère permis d'arrêter les pillages et la violence. Finalement, bien avant dans la nuit, est venue l'annonce que l'armée était déployée pour restaurer l'ordre.
Aujourd'hui, le Népal s'est réveillé dans une profonde incertitude. Le sentiment est que le gouvernement devait répondre des 19 morts, qu'Oli et la vieille garde devaient partir. Mais l'ampleur des incendies criminels, l'effusion de sang, la foule en liberté – au-delà du voile rouge de la colère, peu peuvent justifier tout cela. Personne ne sait qui est maintenant aux commandes. Personne ne peut dire ce qui va se passer ensuite.
Les événements de ces deux derniers jours, avec leur rapidité et leur ampleur, défient presque l'entendement. Mais il y a des schémas du passé qui se feront sentir alors que les Népalais se tournent vers la question de ce qui va suivre.
La fin incomplète de la monarchie hindoue du Népal
Premièrement : cela fait longtemps que ça couvait, et le système enraciné nécessitera un démantèlement sérieux. La colère évidente dans les réactions aux soulèvements du Sri Lanka et du Bangladesh s'était accumulée pendant des années. La sortie du Népal de sa guerre civile [5], terminée il y a presque deux décennies, avait été pleine d'espoir. Les partis de l'establishment – au premier rang desquels le Congrès népalais et le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) d'Oli, les mêmes partis qui dirigeaient le gouvernement qui vient de tomber – avaient promis une nouvelle aube démocratique après s'être finalement retournés contre la monarchie [6]. Les maoïstes, ayant déposé les armes et accepté de se présenter aux élections démocratiques, avaient vendu des rêves d'une société plus juste à des millions de Népalais qui n'avaient jamais eu leur chance équitable. Puis, dans l'ensemble, les espoirs ont été brisés, les promesses rompues.
Les maoïstes ont remporté le premier vote d'après-guerre, signe de la soif de changement du peuple népalais. Mais ils ont échoué à avoir un réel impact et sont rapidement devenus juste un autre parti de l'establishment. Leur échec est mieux symbolisé par la façon dont leur dirigeant – le président Prachanda [7] lui-même – est rapidement devenu plus connu pour sa richesse personnelle que pour ses références révolutionnaires. Un nouveau projet de constitution, choquamment progressiste dans le contexte historique du Népal, a été retardé et retardé jusqu'à ce qu'il soit adopté de force après un édulcorement considérable. Les élections suivantes ont vu le vote largement fragmenté entre les trois partis de l'establishment, avec des accords en coulisses et des trahisons publiques livrant un carrousel rotatif des mêmes dirigeants discrédités allant et venant du pouvoir.
Le Népal a progressé dans les années qui ont suivi la guerre, mais cela a été lent et tortueux, et plus souvent gagné malgré le gouvernement qu'à cause de lui. Les services publics restent lamentables, même si les charges fiscales sont élevées. Pour la plupart des Népalais, les principales sources d'espoir et d'élévation sont les envois de fonds de leurs proches qui peinent à l'étranger, beaucoup d'entre eux dans des conditions terribles [8]. Pendant ce temps, ceux de l'élite politique – dominée, comme elle l'a longtemps été, par des hommes de caste dominante de la région Pahad du pays [9] – s'en sortent très bien, et ont soigneusement cultivé leurs capitalistes de connivence préférés. Une longue série de scandales de corruption ces dernières années impliquant des politiciens, des bureaucrates et des hommes d'affaires de tout l'éventail de l'establishment n'a fait que renforcer la vision sombre du système par le public.
Deuxièmement : les Népalais savent quelque peu comment mener une révolution populaire, mais ils n'ont jamais vraiment compris comment la faire durer. Le premier élan démocratique du pays, dans les années 1950, a déposé les premiers ministres héréditaires Rana [10] et a donné au peuple un vote libre. Mais la monarchie, libérée d'un siècle de contrôle Rana, s'est rapidement retournée contre les partis démocratiques naissants, et la dynastie Shah a réaffirmé son pouvoir. Après des décennies de régime Panchayat [11] – une sorte de démocratie gérée et factice sous la monarchie – les Népalais se sont à nouveau soulevés en 1990. Cette révolution a ramené les partis démocratiques au pouvoir, quoique avec le roi comme monarque constitutionnel, avant qu'elle aussi ne s'effondre. La mauvaise gouvernance et une insurrection maoïste qui s'intensifiait ont ouvert la porte à un coup d'État royal en 2005 [12]. Puis est venue la fin de la guerre, en 2008 ; la fin de la monarchie ; et tous les espoirs trahis.
Ce moment est la dernière tentative de correction du Népal. Elle ne passera peut-être pas à l'histoire comme une révolution – certainement personne ne demande de renverser le système de gouvernement – mais ce que le peuple veut, c'est un changement sismique dans les règles du pouvoir. Malheureusement, le passé est un ennemi puissant, et les anciennes façons du Népal se sont trop souvent réincarnées avec de nouveaux visages. L'humeur publique maintenant est de se tourner vers une nouvelle garde apparente : des figures émergentes comme Rabi Lamichhane [13], un présentateur de télévision devenu politicien, ou Balen Shah [14], un rappeur devenu maire de Katmandou. Le premier a fondé un nouveau parti à la mi-2022, et il a remporté un stupéfiant 10 pour cent des voix lors d'une élection nationale quelques mois plus tard seulement. Le second est sorti de nulle part la même année pour bouleverser deux candidats de l'establishment en remportant l'élection municipale de la capitale. Mais les antécédents de ces deux hommes laissent plus qu'un peu de place à l'inquiétude, même si de nombreux Népalais pourraient ignorer cela dans une recherche de sauveurs.
Lamichhane est poursuivi par de nombreuses polémiques, y compris des accusations de corruption qui l'ont mis derrière les barreaux jusqu'à ce qu'il soit libéré au milieu du soulèvement. Ces accusations sont politiquement motivées, une façon pour l'ancien establishment de battre un challenger – mais il n'est pas clair non plus si elles sont totalement infondées, et Lamichhane a du travail à faire pour prouver qu'il est propre. De plus, Lamichhane n'a montré aucun scrupule à se joindre aux mains de l'ancien ordre lors d'un bref passage au gouvernement après l'élection de 2022. Le mandat de Shah en tant que maire a été entaché par un dysfonctionnement administratif, et sa principale réalisation reste le culte de la personnalité qu'il s'est construit en ligne. Si la vieille garde doit vraiment partir, les Népalais peuvent-ils être sûrs qu'une telle nouvelle garde sera meilleure ?
Les résultats électoraux de Lamichhane et Shah, donnant des coups de poing dans l'œil aux anciens partis, étaient les signes avant-coureurs de la colère anti-establishment qui a maintenant débordé. Si le Népal retourne aux urnes de sitôt, les paris intelligents seront sur un vote qui basculera durement contre les anciens partis. Mais cela seul ne peut garantir de nouveaux dirigeants avec les moyens de résister aux tentations qui ont défait ceux qui les ont précédés, ou un gouvernement qui apportera un vrai changement. Quand il s'agit de corrections systémiques, de vraiment réinventer la politique du pays, le Népal s'aventure en territoire inexploré.
Avec le soulèvement du Népal qui s'ajoute à ceux du Bangladesh et du Sri Lanka, il est tentant de voir un Printemps sud-asiatique, semblable au Printemps arabe du début des années 2010 [15]. Les éléments sont là : des gouvernements pourris, des gens excédés, un soulèvement lié au suivant. Mais aussi : la mort, la dévastation, et aucun chemin sûr vers un meilleur endroit. Il est inquiétant de se rappeler comment le Printemps arabe a fini, avec la démocratie étouffée à nouveau par l'autocratie. Au Bangladesh, les foules ont aussi eu leur façon après la chute nécessaire du gouvernement Hasina, et un gouvernement intérimaire a eu du mal à nettoyer le système alors que le pays approche d'une nouvelle élection nécessaire. Le prochain gouvernement là-bas pourrait bien ramener certains anciens pouvoirs, et avec eux d'anciennes façons. Au Sri Lanka, un nouveau gouvernement dépourvu de l'ancien establishment brise ses promesses antérieures une par une [16]. Il n'y a pas eu d'aube nouvelle éclatante. Et maintenant le Népal, depuis son abîme actuel, rêve d'une nouvelle politique qui fonctionne réellement pour le peuple. Qu'il n'ait pas à voir plus de sang dans ses efforts.
Pour l'instant, il y a toute l'horreur à traiter de ces jours, des corps encore à incinérer, un semblant d'ordre à restaurer. Rien de ce qui vient ensuite ne sera facile.
Roman Gautam
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] La famille Rajapaksa a dominé la politique sri-lankaise pendant des décennies. Mahinda Rajapaksa a été président de 2005 à 2015, suivi par son frère Gotabaya de 2019 à 2022, avant d'être chassé par un mouvement populaire
[2] Sheikh Hasina Wajed, fille du fondateur du Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, a dirigé le pays de 2009 à 2024 avant d'être renversée par un soulèvement populaire
[3] Capitale du Népal, située dans la vallée de Katmandou, comptant environ 1,5 million d'habitants
[4] Khadga Prasad Sharma Oli, membre du Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié), a été premier ministre à trois reprises : 2015-2016, 2018-2021, et 2024-2025
[5] La guerre civile népalaise (1996-2006) opposait les forces gouvernementales aux maoïstes du Parti communiste du Népal, faisant plus de 17 000 morts
[6] La monarchie népalaise a été abolie en 2008, mettant fin au règne de la dynastie Shah qui dirigeait le pays depuis 1768
[7] Pushpa Kamal Dahal « Prachanda » (« le Féroce »), dirigeant historique des maoïstes népalais et ancien premier ministre
[8] Plus de 2 millions de Népalais travaillent à l'étranger, principalement dans les pays du Golfe, en Malaisie et en Inde, leurs envois représentant environ 25% du PIB du pays
[9] Les Pahads sont les collines du centre et de l'ouest du Népal, traditionnellement dominées par les castes Brahman et Chhetri
[10] La dynastie Rana a régné sur le Népal de 1846 à 1951 en tant que premiers ministres héréditaires, réduisant les rois Shah à un rôle de figure
[11] Le système Panchayat (1962-1990) était une démocratie dirigée et factice sous la monarchie, interdisant les partis politiques
[12] Le roi Gyanendra a pris le pouvoir absolu en février 2005, suspendant le gouvernement démocratique
[13] Rastriya Swatantra Party (Parti national indépendant), fondé en 2022 par cet ancien présentateur télé
[14] Balendra Shah, rappeur devenu maire indépendant de Katmandou en 2022
[15] Le Printemps arabe (2010-2012) fut une série de soulèvements populaires dans le monde arabe, commencée en Tunisie et s'étendant à l'Égypte, la Libye, la Syrie et d'autres pays
[16] Référence au président Anura Kumara Dissanayake, élu en 2024 sur une plateforme de changement radical mais qui a dû faire des compromis une fois au pouvoir
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration à propos des manifestations actuelles en Indonésie

Prabowo, Halte à la violence d'État ! Suppression des avantages et indemnités parlementaires ! Fin de la répression contre le peuple ! Justice pour les victimes !
Tiré de Entre les lignes et les mots
Depuis le 25 août 2025, une vague de manifestations populaires a déferlé sur différentes régions. Ces actions ont d'abord été provoquées par l'augmentation insensée des indemnités des membres de la Chambre des représentants Dewan Perwakilan Rakyat ou DPR, alors que le peuple est confronté à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Le mécontentement de la population face à son sort a atteint son paroxysme, attisé par des mesures économiques et politiques qui, loin d'apporter la prospérité, sont devenues de plus en plus étouffantes. Cependant, cette colère s'est rapidement étendue à un autre problème tout aussi profond : la violence policière.
La tragédie a frappé lorsqu'un chauffeur de taxi-moto en ligne, Affan Kurniawan, a été tué après avoir été écrasé par un véhicule de combat de la brigade mobile Brimob [1] pendant les manifestations. Cet incident a été le catalyseur de la propagation des manifestations et a exacerbé la colère populaire dirigée contre l'État.
Le 31 août 2025, le président Prabowo Subianto [2] a répondu à la vague d'actions populaires qui avait déferlé sur différentes régions depuis le 25 août en recourant aux méthodes de manipulation caractéristiques de ce gouvernement.
Au lieu de reconnaître les échecs de l'État, il a choisi de classer les aspirations populaires en deux catégories, les manifestations « pures » et « impures », refusant de donner une réponse sérieuse à la répression policière et ne faisant aucune mention des manifestant.e.s qui ont perdu la vie à cause de la violence étatique.
De plus, il a qualifié de manière ambiguë les manifestations populaires d'« actions anarchiques », présentant les personnes qui ont manifesté leur opinion comme des menaces pour la stabilité de l'État. Pourtant, si Prabowo était véritablement attaché à la démocratie, il aurait dû répondre aux demandes du peuple. Ignorer cela ne fait que révéler encore plus clairement le visage militariste de Prabowo.
En date du 3 septembre 2025, 10 personnes ont été tuées lors de manifestations dans différentes villes. Des violences policières ont eu lieu à Jakarta [3] et Yogyakarta [4], tandis qu'à Makassar [5], l'incendie du bureau du Conseil régional des représentants du peuple DPRD [6] a également entraîné des pertes humaines. Des rapports d'origine locale font état de décès à Solo [7] et Manokwari [8], qui seraient dus à l'exposition aux gaz lacrymogènes employés massivement par les forces de sécurité. Outre les décès, le LBH-YLBHI [9] a recensé au moins 3 337 personnes arrêtées et 1 042 blessées et transportées à l'hôpital.
Les manifestant.e.s n'ont pas été les seules cibles : des journalistes et des auxiliaires de justice ont également subi des mauvais traitements de la part des forces de sécurité, comme cela s'est produit à Jakarta, Manado [10] et Samarinda [11]. Le 1er septembre 2025, peu avant minuit, Delpedro Marhaen, directeur exécutif de la Fondation Lokataru [12], a été arbitrairement arrêté par la police de Metro Jaya [13] dans les locaux de Lokataru. La police a inculpé Delpedro en vertu de l'article 160 du Code pénal KUHP [14] et de la loi sur les informations et les transactions électroniques UU ITE [15], des lois floues qui ont été utilisées pour criminaliser les militant.e.s et faire taire les critiques populaires. Ce type de comportement montre que la violence étatique ne vise plus seulement les voix populaires, mais aussi celles qui exercent des fonctions démocratiques de surveillance, de dénonciation et de défense. Les arrestations arbitraires semblent être devenues une pratique légitimée ; les manifestants sont arrêtés au hasard, avant même que les actions ne commencent. La police procède à des rafles systématiques à divers endroits, traquant et arrêtant les personnes qui ont l'intention de manifester. De telles actions violent non seulement la loi, mais portent aussi ouvertement atteinte à la démocratie.
Bizarrement, au lieu de réformer complètement l'institution, le président Prabowo Subianto a demandé au chef de la police nationale, le général Listyo Sigit, de donner des promotions spéciales aux policiers blessés lors des récentes manifestations. En même temps, l'impunité continue de régner au sein des forces de police, ce qui montre clairement que l'État est du côté des appareils répressifs, et pas de celui des personnes qui en sont victimes.
L'État devrait garantir la protection des libertés civiles et politiques conformément aux mandats constitutionnels et aux normes internationales en matière de droits humains. Pourtant, c'est le contraire qui se produit : l'État utilise son pouvoir pour faire taire les voix critiques par la criminalisation, l'intimidation et la violence à l'encontre des citoyen.ne.s qui exercent leurs droits. Kontras [16] a ouvert un guichet de dépôt de plaintes pour répondre aux nombreuses signalements de personnes disparues lors des manifestations du 25 au 31 août 2025. À ce jour, au moins 23 personnes sont signalées comme disparues et leur sort reste inconnu.
Cette situation révèle la pratique des disparitions forcées organisée par l'État, une pratique qui est strictement interdite par le droit international et qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. Elle est encore aggravée par le fait que les campus universitaires, qui devraient être des lieux sûrs où la liberté académique et la liberté d'expression sont garanties, n'ont pas échappé à ce type de manœuvres d'intimidation. À l'université islamique de Bandung Unisba [17] et à l'université Pasundan Unpas [18], les forces armées et la police [19] ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, faisant des espaces universitaires la cible de la répression étatique.
La présence de soldats dans les espaces civils, en particulier lors de manifestations, avec leur équipement complet, des véhicules de combat et des armes à gros calibre, aggrave non seulement la situation, mais sème également la peur parmi la population. La présence militaire dans les espaces civils montre le visage de plus en plus militariste de l'État, loin des principes démocratiques. L'action d'aujourd'hui est une forme de protestation née du rejet de la violence et de la brutalité des unités TNI et Polri, ainsi que d'une affirmation des positions prises contre les méthodes militaires qui continuent d'être utilisées pour faire taire les voix populaires.
Nous rejetons le discours construit par le régime de Prabowo, qui associe les manifestations à des accusations de trahison et de terrorisme. MANIFESTER n'est pas un crime, mais un DROIT démocratique dont jouit chaque citoyen.ne. Interdire, restreindre ou dénigrer les manifestations est la manière la plus sournoise de réprimer la démocratie. Malheureusement, les manifestations populaires sont souvent réprimées par l'État avec violence, par l'intermédiaire de la police et de l'armée. Pourtant, les cris du peuple sont l'expression de la revendication de droits fondamentaux : des moyens de subsistance décents, un environnement sain et une véritable protection juridique. Au lieu de remplir ces obligations, l'État adopte des politiques qui perpétuent la confiscation des droits du peuple et l'exploitation des ressources naturelles.
Dans ces situations où l'État ne se range pas du côté du peuple, les femmes subissent le poids de différents éléments de vulnérabilité qui s'accumulent. La violence sexiste n'est jamais isolée, mais elle est exacerbée par le croisement des identités : femmes handicapées, femmes ayant des identités de genre et des orientations sexuelles variées, femmes issues de minorités religieuses, femmes issues de communautés autochtones et locales, femmes pauvres des villes et des villages, travailleuses migrantes et ouvrières, survivantes de conflits et de catastrophes. Chaque strate d'identité accroît les inégalités, tandis que l'État continue de manquer à son devoir de protection.
C'est pourquoi l'Alliance des femmes indonésiennes (API) exige que :
* le président Prabowo mette fin à toutes les formes de violence étatique, notamment en retirant les forces armées (TNI) et la police (Polri)
* le président Prabowo, le ministre de la Défense Sjafrie Sjamsoeddin [20] et le commandant des forces armées Agus Subiyanto [21] retirent immédiatement les troupes engagées aux côtés de la police dans le maintien de la sécurité et de l'ordre publics
* le chef de la police nationale Listyo Sigit démissionne immédiatement de son poste et que la police libère sans condition tous les membres de la communauté arrêtés
* le président Prabowo mette fin à toute forme de criminalisation à l'encontre de la population, des militant.e.s, des journalistes et des auxiliaires de justice, et libère sans condition toutes les personnes détenues
* Prabowo renvoie l'armée dans ses casernes et mette fin à toute forme d'implication de l'armée dans les affaires civiles
la garantie intégrale des droits constitutionnels des citoyen.ne.s à se réunir, à s'associer et à exprimer leurs revendications en public sans intimidation ni violence
Alliance des femmes indonésiennes (API)
Contact médias
Mutiara Ika | Ija Syahruni | Eka Ernawati
L'Alliance des femmes indonésiennes (API) est un espace de regroupement politique initié par des organisations et des mouvements de femmes ainsi que par divers groupes de la société civile tels que des journalistes, des personnes handicapées, des travailleurs domestiques, des syndicats, des groupes LGBTIQ+, des étudiants, des organisations de défense des droits humains et des communautés autochtones. L'API a pour objectif de faire face à la détérioration de la vie démocratique et au renforcement des pratiques militaristes qui intensifient la violence à l'égard des femmes et d'autres groupes vulnérables.
Cet article a été publié pour la première fois le mercredi 3 septembre 2025 sur le site web féministe indonésien Perempuan Mahardhika
https://mahardhika.org/5093-2/
Traduit pour ESSF par pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76109
Notes
[1] Force de police paramilitaire indonésienne.
[2] Président de l'Indonésie depuis le 20 janvier 2025, ancien général et gendre de l'ancien dictateur Suharto
[3] Capitale de l'Indonésie
[4] Grande ville du centre de Java.
[5] Capitale de la province du Sulawesi du Sud.
[6] Parlement régional.
[7] Capitale de la province de Papouasie occidentale.
[8] Ville du centre de Java.
[9] Fondation indonésienne d'aide juridique
[10] Capitale de Sulawesi du Nord
[11] Capitale de Kalimantan oriental
[12] Organisation de défense des droits humains.
[13] Police métropolitaine de Jakarta
[14] Code pénal indonésien datant de l'époque coloniale.
[15] Loi controversée sur la cybercriminalité fréquemment utilisée pour criminaliser la dissidence.
[16] Commission pour les disparus et les victimes de violences, organisation indonésienne de défense des droits humains
[17] Université islamique privée de Java occidental
[18] Université privée de Bandung
[19] Forces armées nationales indonésiennes et police nationale.
[20] Ancien général et ministre de la Défense.
[21] Commandant des forces armées indonésiennes
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’attaque contre le Qatar montre qu’Israël ne veut pas d’un cessez-le-feu à Gaza

Netanyahu ne cesse de changer de position sur un cessez-le-feu à Gaza, utilisant différentes stratégies pour poursuivre la guerre.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Depuis près de deux ans, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait tout son possible pour éviter d'accepter un cessez-le-feu à Gaza.
En novembre 2023, un accord a permis la libération de 110 otages capturés lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
Mais une semaine plus tard, Netanyahu a refusé de prolonger le cessez-le-feu, laissant les autres otages sur le carreau.
Depuis lors, chaque fois qu'un cessez-le-feu semblait à portée de main, Netanyahu a changé les règles du jeu. En mai 2024, le Hamas a accepté un accord proposé, mais Israël a refusé de l'approuver et a envahi Rafah à la place. En septembre, Netanyahu a introduit une nouvelle condition : le contrôle permanent par Israël du corridor de Philadelphi, la zone située entre l'Égypte et Gaza, que Le Caire et le Hamas ont tous deux rejetée.
Plus tard, après avoir insisté sur le fait que seul un accord partiel serait accepté, Netanyahu a changé les paramètres et a insisté pour qu'Israël n'accepte qu'un accord prévoyant la libération de tous les prisonniers, et non en échange de la fin de la guerre.
Même lorsque ses alliés ont présenté des propositions, Netanyahu les a éludées. Toujours en mai 2024, le président américain de l'époque, Joe Biden, a annoncé qu'Israël avait proposé un plan de cessez-le-feu, mais Netanyahu est resté silencieux et aucun accord n'a suivi.
Lorsqu'un accord a été conclu et mis en œuvre, Netanyahu a fait en sorte qu'il échoue. En janvier 2025, sous la pression du nouveau président américain Donald Trump, Netanyahu a accepté un accord de cessez-le-feu progressif qui se poursuivrait jusqu'à ce qu'un accord final mettant fin à la guerre soit conclu. Pourtant, en mars, Israël l'a violé unilatéralement, reprenant les bombardements et le blocus.
Et la semaine dernière, alors que les négociateurs du Hamas se réunissaient à Doha pour discuter d'une nouvelle proposition soutenue par les États-Unis, Israël les a bombardés, sabotant ainsi les pourparlers.
Un jeu d'équilibriste
Le gouvernement israélien insiste sur le fait qu'aucun accord n'a été conclu parce que le groupe palestinien Hamas n'a pas été un intermédiaire honnête et qu'il doit être éradiqué, car il tentera de se réarmer.
Mais après l'attaque de Doha, Einav Zangauker, la mère de Matan Zangauker, un Israélien retenu captif à Gaza depuis près de deux ans, sait clairement qui est responsable.
« Pourquoi le Premier ministre [Netanyahu] insiste-t-il pour faire échouer tout accord qui semble sur le point d'aboutir ? Pourquoi ? », demande-t-elle de manière rhétorique.
Pourquoi, en effet.
Netanyahu est le Premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps. L'une des raisons de son succès est sa capacité à mener plusieurs projets de front, à jongler avec différentes priorités, même si elles sont parfois contradictoires, sans les résoudre complètement.
Cette capacité lui permet de repousser les décisions qui pourraient lui faire perdre le soutien du public ou de ses alliés politiques. Et dans un pays comme Israël, où la politique parlementaire repose sur la capacité à maintenir la plus grande coalition possible, cela est essentiel.
Netanyahu est également confronté à des problèmes juridiques au niveau national – il est jugé pour corruption – et rester au pouvoir est probablement son meilleur moyen d'éviter la prison.
Pour en revenir à la question d'un cessez-le-feu à Gaza, Netanyahu est confronté à un problème fondamental : il est redevable à l'extrême droite messianique qui soutient son gouvernement, et celle-ci a clairement fait savoir qu'une fin de la guerre à ce stade la conduirait à se retirer de la coalition du Premier ministre, ce qui entraînerait presque certainement son effondrement.
L'extrême droite – des Israéliens comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich – veut chasser les Palestiniens de Gaza et faire venir des colons israéliens pour vivre sur les terres laissées vacantes par ceux qui ont été victimes du nettoyage ethnique.
Netanyahu n'est peut-être pas totalement opposé à cet objectif, mais il comprend également la difficulté de le réaliser. Même Israël serait mis à rude épreuve sur le plan militaire s'il tentait de conquérir et de conserver l'ensemble de la bande de Gaza, et des mois ou des années de conflit intense provoqueraient davantage de dissensions au sein d'une armée qui dépend fortement de la mobilisation de milliers d'Israéliens en tant que réservistes.
Et, bien sûr, une tentative aussi effrontée de nettoyage ethnique isolerait davantage Israël sur la scène internationale.
Que va-t-il se passer ensuite ?
Au lieu de cela, Netanyahu continue de jouer sur tous les tableaux. Il garde Ben-Gvir et Smotrich de son côté en refusant systématiquement de mettre fin à la guerre, il mène les médiateurs en bateau en envoyant des équipes de négociation discuter de propositions qu'il n'acceptera jamais, et il ne s'engage jamais pleinement dans la lutte militaire qui serait nécessaire pour tenter de prendre complètement le contrôle de Gaza.
Il insiste sur le fait que le Hamas ne peut pas être autorisé à diriger Gaza et rejette l'Autorité palestinienne qui gouverne l'enclave, tout en affirmant qu'Israël ne veut pas la contrôler.
Combien de temps Netanyahu pourra-t-il tenir ? Il y a eu des moments où il a connu des difficultés et où tout a failli s'effondrer.
En janvier, Trump a refusé d'entendre un « non », forçant Netanyahu à accepter un accord qui était sur la table depuis plus de six mois. Cela a conduit Ben-Gvir à démissionner de son poste au gouvernement et Smotrich à menacer de démissionner si l'accord aboutissait et mettait fin à la guerre.
Comme mentionné précédemment, cela n'a pas été le cas. Et Ben-Gvir est rapidement revenu. Trump tient des propos contradictoires sur la fin de la guerre, sans jamais demander fermement à Netanyahu d'y mettre un terme.
Les prochaines élections israéliennes doivent avoir lieu avant octobre 2026. Peut-être Netanyahou sera-t-il en mesure de présenter suffisamment de victoires à l'électorat – il peut déjà affirmer qu'il a affaibli le Hamas, vaincu le Hezbollah et bombardé les sites nucléaires iraniens – pour obtenir un soutien suffisant afin de ne plus dépendre de Ben-Gvir et Smotrich et de pouvoir mettre fin à la guerre selon ses propres conditions, quelles qu'elles soient.
Ou peut-être que la guerre se poursuivra, avec éventuellement des pauses, pour qu'Israël recommence à bombarder Gaza lorsqu'il en ressentira le besoin.
Sinon, la poursuite de la guerre sans fin en vue pourrait accroître l'opposition tant étrangère que nationale, augmentant la pression sur Netanyahu jusqu'à ce qu'il soit contraint de prendre une décision pour mettre fin à la guerre ou qu'il soit confronté à une défaite aux urnes en 2026.
Les Palestiniens de Gaza – dont Israël a tué plus de 64 800 – sont les victimes ultimes de la prolongation de cette guerre, tout comme les prisonniers israéliens toujours détenus à Gaza.
Pour l'instant, ils continueront à souffrir, tandis que Netanyahu continuera à jongler avec les différents enjeux.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Al Jazeera
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Haaretz : Vous refusez de croire que les Gazaouis meurent de faim ? Voyez ce qui arrive aux Palestiniens dans les prisons israéliennes

Depuis le début de la guerre, des ONG et des médias ont documenté la torture, les mauvais traitements et la famine généralisés dans les prisons israéliennes. Il a fallu 18 mois, mais la Cour suprême israélienne a interpellé l'État et exigé qu'il fournisse aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité « les conditions de base pour exister ». Des pétitions similaires concernant Gaza continuent d'être ignorées.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Les gardiens israéliens font subir des abus aux détenus palestiniens à la prison de Meggido, avril 2025 © Motassem A Dalloul
La Haute Cour de justice israélienne a statué dimanche que l'État devait garantir un niveau minimum d'alimentation aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes pour des raisons de sécurité. Cette décision fait suite à une requête déposée en avril 2024 par deux organisations israéliennes de défense des droits humains, l'Association pour les droits civils en Israël et Gisha – Centre juridique pour la liberté de circulation, après la multiplication des preuves de torture, de mauvais traitements et de privation de nourriture.
Les trois juges « ont statué à l'unanimité que le service pénitentiaire est tenu par la loi de fournir aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité les conditions de base nécessaires à leur existence, y compris la quantité et les types de nourriture appropriés pour maintenir leur santé », selon le résumé de la Cour.
Noa Sattath, directrice exécutive de l'ACRI, a déclaré dans un communiqué que cette décision « représente une victoire cruciale pour l'État de droit et la dignité humaine. La Cour suprême a rejeté sans équivoque la politique de privation systématique de nourriture menée par le ministre [Itamar] Ben-Gvir, affirmant que même en temps de guerre, Israël doit respecter les normes fondamentales en matière de droits humains ».
Cette décision est arrivée trop tard pour un nombre indéterminé de prisonniers qui ont été maltraités, torturés et affamés depuis le 7 octobre.
Fin août, Haaretz a rapporté que l'administration pénitentiaire refusait de restituer le corps d'un prisonnier palestinien de 17 ans décédé en détention. Il était en bonne santé lorsqu'il a été arrêté et accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov. Il est mort après six mois de prison ; l'autopsie officielle a révélé qu'il souffrait de « malnutrition, de scorbut et d'une infection intestinale ». Dans une autre affaire, un homme de 40 ans faisant l'objet d'une enquête du service de sécurité Shin Bet est mort après être tombé d'un étage élevé, alors qu'il était menotté.
S'agit-il d'incidents malheureux, mais inhabituels ?
Alex de Waal, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de famine et d'affamement, a déclaré à Haaretz en juillet que « tout ce que nous savons sur le déroulement d'une famine nous indique que ce sont les actions d'Israël qui ont créé ces conditions ». Il a ensuite écrit dans le New York Times que « la famine prend du temps ; les autorités ne peuvent pas affamer une population par accident ». Si tel est le cas, les prisonniers des prisons israéliennes ne peuvent certainement pas être affamés ou maltraités accidentellement. De plus, ces pratiques n'étaient ni cachées, ni récentes.
Les médias israéliens ont fait état de graves abus commis à l'encontre de prisonniers palestiniens détenus pour des raisons de sécurité depuis le début de la guerre, notamment Haaretz, +972 Magazine et son site hébreu Local Call. Les rapports datent de fin 2023 et début 2024. En mars de cette année-là, Hagar Shezaf, journaliste à Haaretz, a révélé que 27 détenus de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre ou depuis le début de la guerre étaient morts dans des établissements israéliens. En avril 2024, les organisations de défense des droits humains ont déposé leur requête auprès de la Haute Cour.
Fin juillet 2024, tous les grands médias israéliens ont rapporté un cas de sodomie commise par des gardiens sur un prisonnier à la prison de Sde Teiman, mais comme ces médias couvraient rarement le sujet, la plupart des Israéliens y ont vu une anomalie, comme d'habitude. En août 2024, B'Tselem a publié un rapport accablant documentant les abus systématiques dont sont victimes les prisonniers sécuritaires.
En d'autres termes, le public aurait pu être au courant, mais il ne l'était pas, ou s'en moquait. Une poignée de personnes ont même participé à une émeute pour soutenir les auteurs des abus à Sde Teiman. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, responsable du service pénitentiaire israélien, est fier de sa politique, même si les rapports faisant état d'abus et de privation de nourriture se sont succédé presque sans interruption de fin 2023 à 2025. Le 6 juillet, Shezaf a rapporté que 73 prisonniers ou détenus palestiniens étaient morts en détention, selon le Club des prisonniers palestiniens.
Revenons à la décision rendue dimanche par la Haute Cour : la longue attente du verdict, près de 18 mois après le dépôt de la requête, « semble sans précédent », a déclaré Tania Hary, directrice de Gisha, dans une interview accordée à Haaretz. La requête d'avril 2024 a été présentée comme urgente lors de son dépôt, et Tania Hary pose la question suivante : « Y a-t-il un cas qui mérite davantage le qualificatif d'« urgent » que [la question de savoir] si les gens ont suffisamment à manger ? »
Mais la cour que les libéraux israéliens traditionnels aiment et soutiennent massivement ces dernières années a largement échoué à protéger les droits humains des Palestiniens. La cour que la droite israélienne adore détester a statué en avril dernier qu'Israël n'occupe ni ne contrôle Gaza, et n'est pas tenu d'apporter une aide humanitaire aux civils qui s'y trouvent, mais seulement de la laisser entrer, en vertu du droit de la guerre.
Il est à noter que bon nombre des excuses avancées par Israël pour justifier la famine dans la bande de Gaza se concentrent sur le sort malheureux de l'aide une fois qu'elle entre dans la bande. La Cour n'a même pas tenu d'audience sur une autre requête urgente visant à mettre fin à la famine à Gaza, déposée en mai ; les requérants ont demandé à la retirer en signe de protestation.
Après la fusillade meurtrière perpétrée lundi par des Palestiniens, qui a fait au moins six morts dans un bus à Jérusalem, et après la mort de quatre soldats supplémentaires de l'armée israélienne à Gaza, il sera trop facile pour beaucoup de minimiser l'importance des droits fondamentaux des prisonniers, dont certains ont participé à des attentats terroristes (tandis que d'autres n'ont jamais été condamnés et que certains n'ont même jamais été inculpés). Mais les Israéliens qui nient la famine à Gaza auront beaucoup plus de mal à se décharger de leur responsabilité dans la famine, les mauvais traitements, la torture et la mort des Palestiniens dans les prisons israéliennes, sur un territoire souverain, où il n'y a pas de complot du Hamas, de l'ONU ou des médias internationaux à blâmer.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En septembre, « all eyes on Gaza » 11 septembre...

L'été a été terrifiant en Palestine. À Gaza tout d'abord avec l'accélération de la famine, mais aussi en Cisjordanie où les offensives israéliennes se sont multipliées. Mais de flottilles en manifestations, la résistance s'organise après près de deux ans de génocide.
Tiré de Inprecor 736 - septembre 2025
11 septembre 2025
Par Antoine Larrache
© CC BY-SA 3.0
L'UNRWA souligne que la malnutrition a atteint 28,5 % dans la ville de Gaza et qu'elle a examiné 100 000 enfants de moins de 5 ans depuis mars. Selon elle, la famine sévit dans le gouvernorat de Gaza s'étendra à ceux de Deir al Balah et Khan Younis d'ici la fin du mois de septembre (1). MSF a effectué plus de 1 000 consultations par semaine pour des cas de diarrhées aqueuses aiguës, conséquence du manque d'eau potable. 70 % de l'eau qui circule dans les canalisations à Gaza est perdue en raison des fuites causées par les bombardements (2). Et les points de distribution de nourriture sont attaqués par l'armée israélienne ou des milices qu'elle finance.
En Cisjordanie, selon MSF, 40 000 personnes ont été « déplacées » depuis le début de l'année, dans le cadre de l'opération militaire israélienne Iron Wall (mur de fer). « La plupart des villages de Masafer Yatta, au sud-est d'Hébron, sont confrontés quotidiennement à des attaques de colons et à des perquisitions militaires » (3). À Hébron, la compagnie des eaux israélienne a réduit l'approvisionnement, entraînant une baisse de plus 50% de l'approvisionnement public en eau.
Mobilisations et accélérations morbides
Mais, en ce mois de septembre, les rapports de forces pourraient évoluer. D'abord parce que les mobilisations de solidarité ont repris, pour exercer une pression sur les gouvernements européens. Ainsi, 300 000 personnes ont manifesté en Italie, avec la participation du Parti démocrate, du Mouvement 5 étoiles, des verts et de la gauche. Le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, a été l'occasion de voir des actions dans de multiples villes. 20 000 personnes ont défilé à Londres le 7 septembre contre le génocide et contre l'interdiction de Palestine Action, la police ayant arrêté environ 900 personnes lors de cette manifestation. Le même jour, 70 000 personnes ont défilé à Bruxelles.
Des manifestations qui ont aussi eu lieu dans l'État colonial. Des centaines de Palestinien·nes manifestent régulièrement, malgré une répression intense, dans les territoires de 48. Et 700 000 personnes auraient défilé mi-août pour l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Ces dernières manifestations sont ambiguës dans leurs objectifs, mais s'opposent clairement à la politique de Netanyahou et Trump. Alors que ceux-ci ont refusé les propositions de cessez-le-feu, Trump a annoncé avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas concernant la libération des otages et Netanyahou a annoncé une « extension des opérations militaires dans et autour dans la ville de Gaza ».
Un mois de septembre chargé de mobilisations
Il est donc clair que le pouvoir génocidaire entend poursuivre son offensive. L'abject plan américain pour l'après-guerre prévoit le « déplacement volontaire » de 2 millions de gazaouis (4). Les mobilisations qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le monde se poursuivront, notamment autour du 7 octobre prochain. Dans le monde entier, on manifestera, et la pression s'exercera davantage sur les grandes puissances. Le projet de reconnaissance de l'État palestinien par différents pays apparaît de plus en plus comme un mirage visant à détourner les yeux du génocide en cours.
La flottille Global Sumud, en revanche, montre une autre logique : puisque nos dirigeants de font rien, alors les peuples doivent casser le blocus et ouvrir un couloir humanitaire par eux-mêmes. Plusieurs dizaines de bateaux devraient s'approcher de Gaza vers le 15 ou le 20 septembre. Plus de 30 000 personnes se sont portées volontaires, depuis de nombreux pays. L'État colonial israélien sera en grande difficulté politique lorsqu'il voudra les intercepter, d'autant que les dockers et d'autres professions promettent de bloquer le commerce avec Israël en cas d'attaque contre les bateaux. Les organisations syndicales ont une occasion de renforcer leur implication. Nos actions militantes pèseront dans ces rapports de forces politiques. La flottille montre la voie, celle d'une coordination internationale de nos actions anticoloniales, par en bas, visant à soutenir la nécessaire révolte populaire de masse au Moyen-Orient.
Le 8 septembre 2025
2. « Gaza : la privation d'eau s'inscrit dans la campagne génocidaire israélienne », 21 août 2025, MSF.
4. « Gaza postwar plan envisions ‘voluntary' relocation of entire population », Karen DeYoung et Cate Brown, 2 septembre 2025, The Washington Post.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les objecteurs de conscience de l’armée israélienne bravent la répression en s’opposant au génocide

Face à des peines de prison plus longues et à une hostilité publique grandissante, une nouvelle génération de réfractaires considère le refus du génocide à la fois comme un devoir moral et un acte porteur d'espoir.
Tiré d'Agence médias Palestine. En collaboration avec Local Call
Mi-juillet, quelques dizaines de jeunes militants juifs israéliens ont défilé dans les rues de Tel Aviv pour protester contre le génocide en cours à Gaza. La manifestation s'est terminée sur la place Habima, au centre-ville, où dix participants ayant reçu des convocations de l'armée les ont brûlées et ont publiquement déclaré leur refus de s'enrôler.
L'acte a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux israéliens, déclenchant une vague de messages privés — certains de soutien, d'autres hostiles— ainsi que des appels à la violence lancés par des pages de droite.
« Tous les jours après avoir brûlé nos convocations, je recevais des appels », raconte Yona Roseman, 19 ans, l'une des participantes, dans un entretien avec +972. « Je ne sais pas si ce geste à lui seul peut changer les choses, mais si ne serait-ce qu'un seul soldat prend parti contre ce génocide, c'est déjà une victoire. »
Roseman est l'un.e des sept jeunes Israélien.nes emprisonné.es en août pour avoir refusé d'effectuer leur service militaire, en signe de protestation contre le génocide et l'occupation menés par Israël. Selon le réseau d'objecteurs de conscience Mesarvot, il s'agit du nombre le plus élevé d'objecteurs incarcérés au cours de la même période depuis la création du collectif en 2016. Leurs peines varient de 20 à 45 jours, probablement suivies de nouvelles convocations, et de plusieurs autres peines de prison avant d'être officiellement exemptés.
Au total, 17 jeunes Israéliens ont été emprisonnés pour avoir publiquement refusé la conscription depuis le début de la guerre. Le premier, Tal Mitnick, a passé 185 jours derrière les barreaux. Un autre, Itamar Greenberg, est resté incarcéré près de 200 jours — la plus longue peine infligée à un objecteur de conscience depuis plus d'une décennie. Ces deux situations reflètent le durcissement de la position de l'armée : selon Mesarvot, celle-ci semble avoir abandonné sa politique précédente de libération des réfractaires après 120 jours, faisant désormais des peines prolongées la nouvelle norme de la répression.
Si l'objection de conscience parmi les jeunes appelés reste rare dans la société israélienne, l'agression d'Israël contre Gaza a déclenché une vague de refus plus conséquente parmi les réservistes . Plus de 300 d'entre eux, la plupart ayant été rappelés pour servir dans la guerre contre Gaza, ont demandé du soutien au mouvement de refus Yesh Gvul (« Il y a une limite »).
« Ce qui distingue cette vague de refus, contrairement à celles liées à la Première guerre du Liban ou aux Intifadas, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de réfractaires sélectifs, qui refusaient de partir au Liban ou en Cisjordanie », explique Ishai Menuchin, président de Yesh Gvul. « Aujourd'hui en revanche, la plupart des réfractaires refusent en bloc de participer à l'armée, et donc à la machine du génocide. »
Parmi les 300 réservistes soutenus par Yesh Gvul, seuls quatre d'entre eux ont été traduits en justice. En effet, l'armée choisit généralement soit de libérer rapidement les réservistes réfractaires, soit de trouver d'autres arrangements, à l'inverse du traitement réservé aux jeunes objecteurs n'ayant pas encore été appelés .
« La décision de refuser est beaucoup plus simple aujourd'hui »
Le 17 août, le jour où Roseman a annoncé son refus, environ 150 manifestants se sont rassemblés devant le bureau de recrutement de sa ville natale, Haïfa. Roseman, elle-même arrêtée six fois lors de manifestations dirigées par des Palestiniens à Haïfa, a assisté à l'intervention rapide de la police qui a déclaré la manifestation illégale et, comme c'est régulièrement le cas lors des rassemblements anti-guerre palestiniens dans la ville, a violemment arrêté dix personnes.
« Une véritable prise de conscience de l'ampleur de la destruction que notre État orchestre, de la souffrance qu'il inflige à ses citoyens, exige une action en conséquence », a déclaré Roseman à la foule avant que la manifestation ne soit dispersée. « Si vous percevez l'ampleur des atrocités et que vous vous considérez comme des êtres moraux, vous ne pouvez pas continuer à faire comme si de rien n'était, quelque soit le coût social ou légal de vos actions. »
Roseman avait pris la décision de refuser la conscription dès début 2023, alors qu'elle participait aux manifestations hebdomadaires contre les efforts du gouvernement pour affaiblir le pouvoir judiciaire. À l'époque, elle défilait avec le « bloc anti-occupation », une petite section qui militait pour établir le lien entre la réforme judiciaire et l'occupation continue par Israël des territoires palestiniens — au grand dam des organisateurs de manifestations plus traditionnels. Elle faisait également partie des 230 jeunes ayant signé, quelques semaines avant le 7 octobre, la lettre « Jeunesse contre la dictature », s'engageant à « refuser de rejoindre l'armée tant que la démocratie ne sera pas garantie pour tous ceux qui vivent sous la juridiction du gouvernement israélien ».
« Je pense que la décision de refuser est bien plus simple aujourd'hui, dit Roseman. Le militarisme et l'obéissance ne sont plus des sujets de débat, car un génocide est en cours, et il est évident qu'on ne s'engage pas dans une armée qui commet un génocide. »
Déjà très impliquée dans l'activisme avec les Palestiniens — en assurant une “présence protectrice” dans les communautés rurales palestiniennes de Cisjordanie face à la violence des colons et de l'armée, et en rejoignant les manifestations contre le génocide à Haïfa — Roseman a déclaré que ses relations personnelles avec des militants palestiniens n'ont fait que renforcer sa décision de ne pas s'engager sous les drapeaux. « Si vous voulez être partenaire des Palestiniens, vous ne pouvez pas intégrer l'armée qui les tue, dit-elle. Ce sont des personnes que vous connaissez, dont on a détruit les maisons, ou qui sont assassinées ».
Son œuvre de solidarité avec les Palestiniens lui a également fait comprendre les limites de toute tentative de réformer le système de l'intérieur. « Il arrive qu'un soldat me lance une grenade assourdissante, ou m'arrête, j'ai assisté à la démolition de maisons dans lesquelles j'avais dormi, les maisons de camarades militants palestiniens. Cela change vraiment votre perspective, vous comprenez réellement que cette armée n'est pas la vôtre, qu'elle est en fait contre vous. »
Outre les effets sur sa vie de militante, la décision de Roseman de refuser l'appel a également un coût personnel. « Certain·es camarades de classe ont coupé les ponts avec moi à cause de cela. J'ai quitté mon programme d'année de césure plus tôt en raison des difficultés liées à mon refus, » expliqua-t-elle. Sa famille « est restée à ses côtés en tant que fille, mais ce n'est pas une décision qu'ils ont soutenue. »
Contrairement à la plupart des objecteurs emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes, Roseman passe la majeure partie de ses journées en isolement. En tant que prisonnière trans, elle n'est autorisée à sortir que pour de courtes pauses, en dernier dans la file, conformément à la politique de l'armée, également subie cette année par une autre objectrice trans, Ella Keidar Greenberg.
« Il est important pour moi de le souligner, surtout après avoir été traitée de manière humiliante lors de mon arrestation pendant des manifestations : l'attitude de l'État à l'égard des personnes queer n'est libérale et progressiste que dans des conditions bien précises, dit-elle. Dès que vous ne correspondez plus aux critères nationaux, vos droits vous sont retirés. »
« Nous n'en sommes pas là par hasard »
Le 31 juillet, quelques semaines avant l'incarcération de Roseman, deux Israéliens de 18 ans — Ayana Gerstmann et Yuval Peleg — ont été condamnés respectivement à 30 et 20 jours de prison pour avoir refusé de s'enrôler. Gerstmann a depuis été libérée, tandis que Peleg a écopé d'une peine supplémentaire de 30 jours. Au vu de cas similaires, il est probable que sa peine soit prolongée 4 ou 5 fois avant qu'il ne soit libéré de ses obligations militaires.
« Je suis ici pour avoir refusé de prendre part à un génocide et pour envoyer un message à quiconque veut bien l'entendre : tant que le génocide continue, nous ne pouvons pas vivre dans la paix et la sécurité », a déclaré Peleg avant d'entrer en prison.
Issu d'une famille sioniste libérale de la ville aisée de Kfar Saba, Peleg explique que sa décision de refuser la conscription est récente. « À la maison, on ne parlait jamais du refus. On parlait beaucoup de Bibi [Netanyahou], et un peu de l'occupation », a-t-il expliqué dans une interview commune avec Gerstmann avant leur incarcération.
Pour Peleg, la découverte de médias en ligne non israéliens, dans les premiers jours de la guerre, a constitué un tournant. « Cela m'a donné une perspective que je n'avais pas en grandissant. À un moment donné, j'ai compris que l'armée israélienne n'était pas l'armée droite, protectrice et juste que je croyais. »
Peu à peu pendant la guerre, à mesure que l'ampleur de l'offensive israélienne contre Gaza devenait plus claire, « la décision de ne pas m'enrôler est devenue relativement facile, » explique-t-il. Le refus lui a aussi offert une possibilité d'exprimer sa dissidence. « Il n'y a pratiquement aucun endroit dans ce pays où l'on peut dire ce genre de choses. »
Pour Gerstmann, qui a grandi dans la banlieue de Tel-Aviv, à Ramat Gan, la décision de refuser l'appel s'est construite sur plusieurs années. « En cinquième, on nous avait donné un devoir pour la Journée de Jérusalem : écrire sur des lieux de Jérusalem. C'était censé éveiller des sentiments patriotiques, mais pour moi, cela a eu l'effet inverse », se souvient-elle.
Bien que l'occupation ait souvent été discutée à la maison, elle ne l'avait réellement découverte qu'à ce moment-là. « Ma mère m'a suggéré d'aller voir le site de B'Tselem et de lire sur Jérusalem-Est pour le projet scolaire, » a-t-elle raconté à +972. « C'était la première fois que je voyais ce qui s'y passait. J'ai été choquée. »
Dans le système éducatif israélien, ajoute-t-elle, « on parle toujours de Jérusalem-Est uniquement dans le contexte de ‘l'unification' de la ville, et on glorifie la guerre de 1967 [au cours de laquelle Jérusalem-Est a été prise]. Soudain, j'ai découvert toutes les injustices et les souffrances que cela impliquait. »
À 16 ans, elle avait déjà pris la décision de ne pas s'enrôler dans l'armée. « J'ai dit à une amie que je voulais obtenir une exemption pour raison de santé mentale parce que je m'opposais à l'occupation, » raconte-t-elle. Son amie l'a mise au défi : « Si ce sont tes convictions, pourquoi ne pas simplement les assumer et les dire ? Pourquoi as-tu besoin de te cacher derrière des mensonges ? »
« C'est à ce moment-là que ça a fait tilt pour moi, » se souvient-elle. « J'ai compris qu'elle avait raison — que je devais crier mon refus haut et fort, clairement et publiquement. »
À l'instar de Roseman et Peleg, Gerstmann a réalisé que les raisons de refuser l'appel devenaient évidentes, et ce dès le début de la guerre à Gaza, avec l'intensification de l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. « Il est devenu beaucoup plus clair que ce refus était le bon choix, qu'il ne fallait en aucun cas coopérer avec les agissements de l'armée à Gaza ».
Gerstmann et Peleg espèrent que chaque soldat envoyé à Gaza lira leur refus comme un message exprimant la liberté de choisir. « Pendant des années, on nous a conditionnés à croire qu'il fallait s'enrôler, qu'il était impossible de remettre cela en cause. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, c'est la ligne rouge qui prouve qu'il existe bel et bien un choix. »
« Nous avons atteint un niveau de violence et de destruction inégalé dans l'histoire de cette terre, » a déclaré Peleg. « Israël ne redeviendra jamais ce qu'il était le 6 octobre 2023. Il est clair qu'un génocide se déroule autour de nous. Face à cela, nous refusons. »
Pour Peleg, il était important de souligner que la campagne d'anéantissement d'Israël à Gaza ne surgit pas de nulle part. « Nous n'en sommes pas arrivés là par accident, » explique-t-il. « Israël a toujours porté en lui des éléments d'occupation, de fascisme et de racisme envers les Palestiniens — depuis 1967 bien sûr, mais depuis la Nakba en réalité. Le génocide actuel contre les Palestiniens suit la même logique ».
Même si l'opinion publique israélienne tend de plus en plus vers la droite, Gerstmann espère toujours que ses actes auront une influence. « La phrase « Il n'y a pas d'innocents à Gaza » est entendue fréquemment, elle se banalise. C'est très inquiétant ; mon refus de l'appel est en réalité une façon de lutter contre le désespoir », a-t-elle expliqué. « J'espère que cela ouvrira les yeux de certains et leur permettra de réfléchir et de comprendre ce que l'armée fait en leur nom. »
Toutes deux disent avoir peur de déclarer publiquement leur refus de la conscription, dans une société où un tel acte est assimilé à de la trahison. « Bien sûr, c'est effrayant, mais cela ne m'a pas dissuadée », a déclaré Gerstmann. « Au contraire, ce que nous voyons depuis le début de cette guerre m'a fait comprendre que je devais absolument m'opposer à la conscription »
« Je ne peux plus en faire partie »
Deux autres objecteurs de conscience ont été emprisonnés le mois dernier. Ils se sont confiés à +972, tout en choisissant de rester anonymes pour des raisons personnelles et familiales.
R., un jeune homme de 18 ans originaire de la ville de Holon, a été condamné à 30 jours de prison. « J'ai décidé de refuser l'appel avant le 7 octobre, mais après avoir vu la destruction à Gaza, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à hésiter », a-t-il déclaré. « À partir de là, m'enrôler était tout simplement hors de question pour moi. »
Son message à l'intention des autres jeunes est direct : « Refusez, tout simplement. Dans le climat actuel, au vu de ce qui se passe à Gaza, il faut résister. »
Un autre objecteur, B., a suivi un parcours plus atypique. À 19 ans, il s'était enrôlé dans l'Administration Civile — l'organisme militaire qui dirige les Palestiniens en Cisjordanie. Il a toutefois décidé, après huit mois de service, de refuser l'appel, ce qui lui a valu une peine de 45 jours de prison.
« Avant de m'enrôler, j'étais allé en Cisjordanie, j'y ai rencontré des gens et j'ai compris la situation sur place », se souvient B. « C'était déjà difficile pour moi à ce moment-là, je n'avais vraiment pas envie de rejoindre l'armée. [Mais ensuite] j'ai parlé avec certaines personnes, et elles m'ont convaincu de le faire malgré tout. »
Ce qu'il a vu à la base militaire a confirmé son choix de refuser la conscription. « Pendant l'entraînement et sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses et je me suis dit : “Waouh, je ne peux plus faire partie de ça.” L'attitude des autres soldats — la manière dont ils parlaient, dont ils se comportaient — des gens animés par un racisme extrême, a motivé ma décision en grande partie. »
La brutalité, selon lui, était omniprésente. « J'ai vu des Palestiniens se faire frapper sans aucune raison. Ils les attachent, les laissent menottés en plein soleil pendant 24 heures, face contre terre, à genoux, sans eau ni nourriture. Les soldats passaient à côté et leur donnaient des coups de pied. J'étais choqué. »
« Dès mon deuxième jour, j'ai vu un détenu et j'ai demandé ce qu'il avait fait. On m'a dit qu'il ‘n'avait pas obéi'. Puis j'en ai vu un autre attaqué à coups de pied. On m'a dit : ‘Il le mérite.' Ces situations étaient fréquentes. »
Un incident le hante encore. « Un soldat parlait en hébreu à un Palestinien, et quand celui-ci répondait en arabe, le soldat lui a violemment cogné la tête contre un mur en disant : ‘Tu es en Israël, parle hébreu.' Je lui ai dit : ‘Il ne comprend pas.' On voyait ce genre de violence tout le temps. »
Personne n'est à l'abri de tels abus— pas même les personnes âgées. « J'ai vu un Palestinien de 70 ans battu comme plâtre. Quand j'ai demandé aux autres soldats ce qu'il avait fait, ils m'ont répondu qu'il avait ‘manqué de respect aux militaires'. »
« Ils n'avaient rien à lui reprocher, alors ils l'ont retenu pendant 14 ou 15 heures, sans nourriture ni eau, puis lui ont dit : ‘La prochaine fois, ne le refais pas.' Ils ne l'ont même pas transféré à la police — qu'auraient-ils bien pu lui reprocher ?
Oren Ziv est photojournaliste, reporter pour Local Call, et membre fondateur du collectif de photographie Activestills.
Traduction : CB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chicago veut repousser les forces trumpistes.

Trump avait annoncé la bataille de Chicago pour son investiture, c'est-à-dire le lâcher des troupes de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) sur les migrants et étrangers réels et supposés et leurs proches, et s'était dégonflé. La mobilisation s'était amorcée, autour notamment des écoles et du syndicat de l'enseignement, le Chicago Teachers Union, pour' protéger les enfants et les familles latinos et au delà.
7 septembre 2025 | tiré du site aplutsoc
https://aplutsoc.org/2025/09/07/chicago-veut-repousser-les-forces-trumpistes/
La bataille de Chicago a été annoncée par un incroyable tweet de Trump, pas du tout un fake, datant du 7 septembre au matin. Entre janvier 2025 et maintenant l'affrontement, démocratique et donc social, n'a cessé de grandir aux Etats-Unis. L'ICE a massivement recruté des nervis : l'équivalent des milices fascistes s'y concentre. Le langage et les objectifs du pouvoir sont clairement la guerre : la guerre, la Civil War, aux Etats-Unis, contre les pouvoirs locaux et contre la démocratie. Et il fait référence au ministère des Armées, confié au taré masculiniste Egseth, qu'il vient précisément de rebaptiser ministère de la Guerre. Voici le tweet de Trump :
Il fut un temps, pas lointain, où un POTUS (président des Etats-Unis) qui annonçait ainsi vouloir anéantir militairement une grande ville du pays, car à la lettre c'est cela le message de Trump, subissait immédiatement une procédure de destitution. Ne cherchons pas à faire l'autruche en disant « oui mais c'est du Trump, c'est du cinéma, on voit bien qu'il fait le bravache et qu'il s'amuse ». Qu'il fait le bravache, certainement. Qu'il s'amuse, non : Trump ne sait pas ce que c'est. La référence est le colonel fou du film Apocalypse Now qui fait bombarder au napalm les villages vietnamiens au son de la chevauchée des Walkyries de Wagner. Symbole de la connerie furieuse impérialiste, symbole connoté très positivement pour Trump, qui paraphrase sa phrase fétiche, « J'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner » : « J'aime l'odeur des déportations au petit matin ».
Voici le fascisme 2.0, nourri à l'Axe Trump/Poutine et à la synthèse MAGA-libertarianisme-masculinisme-accélérationnisme du capital-extractivisme fou. « Oui mais où sont les Sections d'Assaut qui détruisent le mouvement ouvrier organisé ? », réciteront encore quelques fossiles politiques incapables de saisir le réel. Faut-il attendre que les Sections d'Assaut aient fait leur office pour reconnaître l'ennemi mortel ?

Les habitants de Chicago ne s'y sont pas trompés. C'est la plus grande manifestation de cette année qui a éclaté à Chicago en réaction au tweet de Trump.
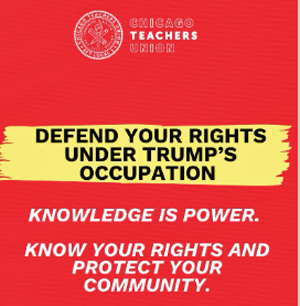
Le Chicago Teachers Union appelle à la mobilisation, sans toutefois envisager l'organisation de l'autodéfense physique pour interdire à l'ICE et éventuellement à la Garde nationale et à l'armée l'entrée dans la ville et les quartiers, cela bien lorsqu'il parle de résistance à l'occupation annoncée.
Mais une rumeur concernant le maire démocrate de Chicago (où le conseil municipal ne comporte pas de républicains et comprend une opposition de gauche formée d'élus socialistes-démocratiques par ailleurs liés au Chicago Teachers Union), Brandon Johnson, selon laquelle il avait donné un signal fort en faisant intervenir les services municipaux pour disposer des sacs de sable et de sel sur les lieux d'entrée dans la ville, et positionner les camions anti-neige en barricades, rumeur à laquelle nous avons cru car elle a dominé pendant quelques heures les réseaux sociaux américains … s'est avérée fausse.
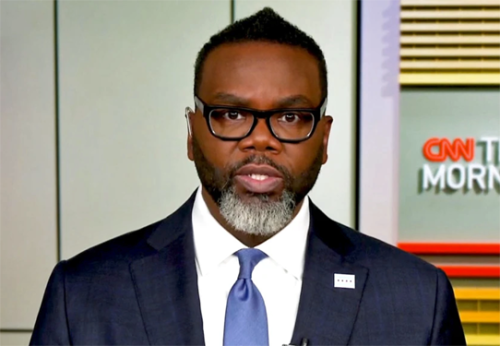
Le maire n'a pas voulu faire de la résistance passive à l'ICE suggérant en fait une résistance active. En fait, ce positionnement de camions serait une mesure banale liée à des manifestations dans la ville …

N'empêche : la rumeur ne dénonce-t-elle pas la nécessité ? Ne faut-il pas des barricades modernes, avec les travailleurs organisés pour repousser et infliger, avec le moins de pertes possibles, la raclée nécessaire aux bandes de l'ICE ? Un peu plus sérieuse en effet que les alignements de camions à sel, qui donnent quand même une idée !
Oui, il faut organiser l'auto-défense physique et donc armée quand c'est nécessaire contre les raids trumpistes ! L'illégalité est de leur côté : la défense de la démocratie est avec la résistance, et la résistance doit passer à la contre-attaque :
CONTRE TRUMP ET SES BANDES
GREVE ET AUTODEFENSE SONT INDISPENSABLES !
Le 07/09/2025.

Trump veut une Amérique plus militariste et belliqueuse

Derrière ses prétentions à incarner la paix, Donald Trump multiplie les actes militaires et les menaces d'escalade. Rebaptisant le département de la Défense en département de la Guerre, il affiche sa volonté d'une Amérique plus belliqueuse, au-dehors comme au-dedans.
Tiré de Inprecor
10 septembre 2025
Par Dan La Botz
Les membres du deuxième gouvernement de Donald Trump posent pour une photo dans le bureau ovale.
Donald Trump a rebaptisé le département de la Défense des États-Unis, qui s'appelle désormais le département de la Guerre. Ce changement de nom suggère que Trump veut un pays encore davantage tourné vers la guerre, malgré ses affirmations selon lesquelles il serait un artisan de la paix. En réalité, l'administration Trump affiche déjà un bilan impressionnant en matière d'actions militaires.
Un « artisan de la paix » aux bilans inexistants
Trump a pratiquement supplié qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix, affirmant qu'il avait mis fin à six ou sept guerres dans différents pays. Il dit avoir instauré des relations pacifiques entre Israël et l'Iran, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Thaïlande et le Cambodge, l'Inde et le Pakistan, l'Égypte et l'Éthiopie, ainsi que la Serbie et le Kosovo. Pourtant, aucun de ces conflits n'a réellement été réglé. Et il n'a rien fait pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et la guerre d'Israël contre Gaza.
De l'Iran au Venezuela, Trump sème la guerre
Le président autoproclamé de la paix s'est en réalité livré à plusieurs actes violents et guerriers. En janvier 2020, Trump a ordonné une frappe de drone qui tua le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, sans approbation du Congrès ni du gouvernement irakien, alors que les États-Unis n'étaient pas en guerre avec l'Iran. En juin 2025, lors de la guerre israélo-iranienne, l'aviation et la marine américaines ont frappé trois installations nucléaires iraniennes, sans déclaration de guerre.
Plus récemment, Trump a fait couler un « bateau de drogue vénézuélien », supposément lié au cartel Tren de Aragua, sans preuve et au mépris du droit international, causant la mort de 11 personnes. Son geste, salué par le sénateur Lindsey Graham, a été présenté comme un avertissement, et Trump a promis d'autres attaques similaires avec son équipe.
Dans les Caraïbes, la marine américaine a renforcé sa présence avec huit navires de guerre et un sous-marin, tandis que Trump a doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, qu'il accuse de narcotrafic. Certains redoutent une guerre ouverte, d'autant que Trump a aussi évoqué l'idée de s'emparer du Groenland ou de « reprendre » le Panama.
Frappes extérieures et militarisation intérieure
Depuis des mois, Trump autorise des attaques militaires non médiatisées dans plusieurs régions du globe. Le projet ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) a rapporté ce mois-ci que, depuis son retour à la présidence, les États-Unis ont mené 529 frappes aériennes dans 240 lieux différents au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique. Ce chiffre est proche du total de 555 frappes menées par l'administration de Joe Biden pendant l'intégralité de son mandat de 2021 à 2025.
Mais Trump ne veut pas seulement employer l'armée à l'étranger : il se prépare aussi à faire la guerre au peuple américain. Il prévoit maintenant d'envoyer des troupes à Chicago, comme il l'a déjà fait à Los Angeles et à Washington D.C. Trump a publié : « Chicago va bientôt découvrir pourquoi on appelle ça le département de la GUERRE. »
Trump se transforme en dictateur agressif, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et c'est au peuple de l'arrêter.
Traduit par L'Anticapitaliste. Le 8 septembre 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis. Israël au cœur des divisions de MAGA

La victoire de Donald Trump a été possible par sa capacité à unir sur son nom trois courants de la politique étatsunienne : la mouvance évangélique, les néoconservateurs et les nationalistes protectionnistes. Mais s'ils se reconnaissent dans le même homme, ils ne partagent pas les mêmes objectifs, notamment sur le plan international, comme l'illustrent leurs prises de position divergentes sur l'Iran et le Proche-Orient.
Tiré d'Orient XXI.
Le 18 juin 2025, six jours après les premiers bombardements israéliens de sites d'enrichissement nucléaire iraniens, menés avec l'aide logistique de l'armée étatsunienne, Steve Bannon, une des grandes figures publiques de la sphère MAGA (Make America Great Again, « Restaurer la grandeur de l'Amérique »), qui regroupe les partisans de Donald Trump, dénonce publiquement la politique de son président en des termes peu amènes. « Le peuple américain vous dit qu'il faut sortir du Proche-Orient. Nous ne voulons plus de guerres interminables » (1). Trois jours plus tard, il réitère, rappelant à Trump qu'il a été réélu sur un programme dont « un des fondements » était de « mettre fin aux guerres sans fin » des États-Unis. Bannon n'est pas n'importe qui. Il a été le premier conseiller stratégique de Trump après son élection en 2016. Et il s'exprime sur un sujet de première importance — quelle est la stratégie de politique étrangère des États-Unis, dans le cas présent au Proche-Orient ? Enfin, son attaque pointe les divergences internes à MAGA, donc les fragilités de Trump.
Le président étatsunien, depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, peut déjà se targuer de beaucoup plus de succès (de son point de vue) qu'après sa première élection. Mais il affronte aussi des difficultés multiformes. Ses mesures tarifaires dans le commerce international sont beaucoup critiquées. Et il multiplie les changements de cap. Ainsi, il a récemment annulé sa promesse d'interdire l'entrée de 600 000 étudiants chinois aux États-Unis durant les deux ans à venir. Sur Fox News, la chaîne à sa dévotion, la présentatrice Laura Ingraham s'étrangle : « C'est à n'y rien comprendre ! Six cent mille places échappent aux jeunes américains. » Quant à sa politique étrangère, elle est souvent erratique. Il a échoué à faire plier le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président russe Vladimir Poutine. Au contraire, chaque fois qu'il a cru pouvoir clamer un succès, une concession sur Gaza comme sur l'Ukraine, les deux hommes n'en ont fait qu'à leur tête.
Trois piliers
L'apparition de dissensions internes à la sphère MAGA n'est pas due qu'à la nature versatile du chef. Elle tient aussi à la composition de sa base, qu'il se doit de câliner. Or, elle est constituée de tendances diverses, et parfois divergentes.
- Trump doit satisfaire un électorat idéologiquement composite, dont le socle est composé de fractions qui partagent des idées et des priorités différentes, voire, parfois, carrément antagoniques.
L'alliance qui a ramené Trump au pouvoir est fondée sur trois piliers. Le premier est trumpiste par pur intérêt opportuniste : il s'agit de la très puissante mouvance politique évangélique. Comment un mouvement qui professe la crainte de Dieu et le respect absolu de l'héritage du Christ peut-il massivement vénérer un homme, Trump, qui ne professe aucun autre culte que celui de Mammon (2), qui a fauté en divorçant deux fois et qui se vante d'« attraper les femmes par la chatte » ? L'explication est analogue à celle de la montée en puissance du messianisme en Israël. Les rabbins les plus fanatiques y expliquent que le sionisme, né comme un mouvement laïc, n'a contribué, en érigeant un État mécréant, qu'à accélérer sans en être conscient l'arrivée prochaine du Messie. Une partie massive du bloc évangélique étatsunien adhère aujourd'hui à une vision qui fait du « Grand Israël » et du rétablissement du « royaume de David » le prélude obligatoire au retour du Christ sur terre.
Le second pilier du trumpisme est constitué d'une partie de la mouvance néo-conservatrice qui connut son apogée sous la présidence de George W. Bush (2001-2009), lequel lui octroya une place politique de premier plan dans son administration. Un jeune politicien israélo-étatsunien dénommé Benyamin Nétanyahou avait très tôt adhéré au néoconservatisme. Il y a joué un rôle prépondérant, notamment en théorisant « la guerre contre le terrorisme ». Ces partisans développent une vision expansionniste de la promotion de la démocratie dans le monde, au bénéfice prioritaire de la « destinée exceptionnelle » des États-Unis, qui sont nés pour diriger la planète. Et cette mission ne sera menée à bien que par la projection de la puissance étatsunienne sur le reste du monde, si nécessaire par la force armée.
Le troisième est celui des nationalistes, et particulièrement des nationalistes protectionnistes, ceux qui, durant les deux guerres mondiales du XXe siècle, par exemple, ont mis très longtemps à s'y engager. Cette mouvance considère qu'il ne faut entrer en guerre que si les intérêts directs des États-Unis sont immédiatement menacés. Cette droite n'est pas que protectionniste au plan international, elle est aussi puissamment « nativiste », selon le terme étatsunien. « Natif », à ses yeux, ne désigne pas les Amérindiens. Non, les « natifs » sont ceux qui, en conquérant le territoire des États-Unis, s'y sont imposés comme les fondateurs. En conséquence, les nationalistes protectionnistes sont aussi férocement hostiles aux immigrés et, de tout temps, aux citoyens qui ne sont pas blancs, qu'ils soient méditerranéens ou asiatiques (le « péril jaune » est né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle). Au nom du « nativisme », le célèbre aviateur étatsunien Charles Lindbergh fut en 1941 un des initiateurs d'un courant nommé… « America First », l'Amérique d'abord, un slogan que Trump n'a pas repris à son compte par mégarde.
Une alliance puissante mais divisée
Ces trois piliers forment une alliance puissante. Elle a permis à Trump, à deux reprises, d'accéder à la présidence, et à ne pas s'effondrer politiquement lorsqu'en 2020, il fut battu par Joe Biden. Ils disposent de « passerelles » qui tentent de les coaliser. La principale est la frange dite NatCon (nationaux conservateurs) qui tente de réunir ces trois piliers sous le drapeau du primat de la culture « judéo-chrétienne », dont l'idéologue est l'Israélo-étatsunien Yoram Hazony. Chacune des trois tendances est entrée dans l'alliance pour faire progresser sa propre emprise sur la Maison Blanche. Trump doit donc satisfaire un électorat idéologiquement composite, dont le socle est composé de fractions qui partagent des idées et des priorités différentes, voire, parfois, carrément antagoniques. Son talent consiste à leur donner des gages et à éviter que les frictions internes ne dégénèrent. Des trois, les évangéliques sont les plus nombreux ; les néoconservateurs, longtemps affaiblis, connaissent un regain de forme. Les nationalistes protectionnistes forment un groupe un peu moins important, mais qui se perçoit comme la « vraie » incarnation de MAGA. Trump ne peut pas les ignorer s'il veut préserver sa majorité. Surtout, cette mouvance politique est celle qui lui est la plus chère, parce qu'elle est celle dans laquelle il a été politiquement éduqué, et dont la pensée lui est la plus proche.
Le vent de révolte des cercles nationalistes dans MAGA a bondi en mai 2025 lorsque l'éventualité d'une attaque israélienne imminente contre l'Iran est revenue en tête de l'actualité. Les nationalistes s'y opposaient, dénonçant le risque d'une guerre en Iran entrainant les États-Unis dans un bourbier pire que ceux rencontrés en Afghanistan puis en Irak. L'enjeu iranien ravive aussi l'hostilité de certains cercles MAGA à la relation entretenue par Washington avec Tel-Aviv. Ainsi, le 29 mai, le représentant républicain du Kentucky à la Chambre, Thomas Massie, clamait que « la guerre d'Israël à Gaza est si déséquilibrée qu'il n'y a aucun argument rationnel pour que les contribuables américains paient pour cela » (3).
« Plus de guerres stupides et sans fin »
D'autres voix appelaient à la cessation des fournitures gratuites d'armes à Israël, rappelant répétitivement le slogan de campagne de Trump : « Plus de guerres stupides et sans fin. » Ceux-là n'avaient pas de mots trop durs pour Lindsay Graham, le sénateur de Caroline du Sud, porte-parole de la fraction néoconservatrice, qui martelait sur Fox News : « Il faut être à fond pour aider Israël à éliminer la menace nucléaire. S'il faut fournir des bombes, fournissons-les. Et s'il faut voler à leurs côtés, faisons-le. » Mais le matin avant les bombardements, Tal Axelrod, analyste du journal en ligne Axios, citait les propos de certains leaders d'opinion nationalistes pronostiquant un possible « schisme profond » au sein de MAGA (4). Il citait Jack Posobiec, un podcasteur d'extrême droite très influent, assurant qu'« une frappe directe contre l'Iran diviserait de façon désastreuse la coalition Trump » (5).
- L'opinion républicaine est entrée dans un processus de distanciation critique vis-à-vis de Tel-Aviv, y compris parmi les « conservateurs » et « très conservateurs » — c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, l'électorat le plus acquis à Trump.
Les frappes israéliennes ont eu lieu et n'ont donné suite à aucun schisme dans MAGA. Mais les propos tenus par une flopée de nationalistes ont montré combien les tensions sont fortes au sein de la sphère trumpiste. Des influenceurs politiques de premier plan comme Steve Bannon, Tucker Carlson, Matt Gaetz, Joe Rogan et d'autres ont poursuivi leur travail de sape. Le premier tançait, en particulier, le risque que constituait Nétanyahou pour les États-Unis, lui lançant, le 19 juin : « Bon Dieu, pour qui vous prenez-vous pour vouloir entraîner l'Amérique dans une guerre avec l'Iran ? » (6). Après avoir évoqué la poursuite des frappes israéliennes visant un « changement de régime » en Iran, Bannon ajoutait, à l'attention de Trump : « Le peuple américain vous dit massivement que nous voulons sortir du Proche-Orient. Nous ne voulons plus de guerres éternelles. »
Fin juin, le rejet des « guerres sans fin » menées par Nétanyahou amenait pour la première fois une élue républicaine à prononcer le « mot qui commence par G ». Le 28 juillet, Marjorie Taylor-Greene, représentante de Géorgie et porte-parole en vue de MAGA, devenait la première républicaine à qualifier les actes perpétrés à Gaza par Israël de « génocide ». « Bien sûr, disait-elle, nous sommes opposés au terrorisme radical islamiste, mais nous sommes aussi opposés au génocide » (7). Son parti ne l'a ni exclue ni réprimandée, et elle ne s'est pas rétractée. Le lendemain, Donald Trump évoquait une « vraie famine » à Gaza.
Le désenchantement de MAGA envers Israël
Depuis, les critiques de MAGA envers la Maison Blanche se sont progressivement résorbées, au vu de la brièveté de l'attaque israélienne et de sa dimension plus modeste que ce que Nétanyahou et Trump avaient initialement proclamé. Mais la crise interne au camp trumpiste a laissé des traces qui pourraient être le prélude d'une crise plus ample demain. Entre nationalistes isolationnistes et néo-conservateurs, les relations sont plus que fraîches. Début août, The Economist titrait en une sur « Le désenchantement de MAGA envers Israël » (8). L'hebdomadaire anglo-étatsunien accompagnait son article d'un graphique exposant l'évolution de ses sondages depuis le 7 octobre 2023 sur le rapport aux Israéliens et aux Palestiniens dans la société étatsunienne. Ils montrent non seulement un recul progressif du soutien de l'opinion démocrate à Israël, c'était déjà connu. Mais ils montrent aussi que l'opinion républicaine est entrée dans un processus de distanciation critique vis-à-vis de Tel-Aviv, y compris parmi les « conservateurs » et « très conservateurs » — c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, l'électorat le plus acquis à Trump.
- L'alliance des mouvances évangélique et néoconservatrice sur le dossier israélo-palestinien reste clairement dominante dans MAGA.
Le podcasteur Jack Posobiec évoque l'apparition d'une « fracture générationnelle » dans MAGA. Chez les moins de 40 ans, dit-il, le rapport à Israël va « du scepticisme à la volonté de couper tout lien ». D'autres observateurs indiquent que la « hasbara », la communication de l'État d'Israël niant non seulement tout génocide, mais même toute famine à Gaza, apparaît de moins en moins crédible à l'opinion étatsunienne. Quant aux médias les plus impliqués dans le soutien à Donald Trump, ils sont eux aussi divisés. Enfin, de même qu'elle est hostile à la poursuite de la fourniture d'armes à l'Ukraine, la mouvance nationaliste isolationniste est aussi devenue publiquement hostile à l'aide militaire gigantesque de Washington à Tel-Aviv. Elle reste très minoritaire sur ce point, mais sa voix influence désormais d'autres cercles conservateurs.
Mais bien qu'en recul, l'alliance des mouvances évangélique et néoconservatrice sur le dossier israélo-palestinien reste clairement dominante dans MAGA. Un exemple : l'activiste Charlie Kirk, très hostile à une attaque israélienne contre l'Iran, déclara une fois qu'elle fut lancée : « Dans de tels moments, j'ai une confiance totale et entière dans le président Trump » (9). De même, Laura Loomer, une activiste proche de Trump mais hostile aux engagements armés étatsuniens, déclara soudainement : « L'Amérique d'abord, c'est ce que dit le président Trump ». (10) Pour la plupart de ses fidèles, la parole du Guide est insurpassable.
Notes
1- Joseph Cameron, « Bannon warns Trump against heavy US involvement in Iran », The Christian Science Monitor, 18 juin 2025.
2- Mammon désigne la richesse ou le gain, souvent mal acquis. Dans les Évangiles, le terme personnifie l'argent qui asservit le monde.
3- « Republican Says US Should End All Military Aid to Israel », Newsweek, 29 mai 2025.
4- Tal Axelrod, « MAGA warns Trump of ‘massive schism' », Axios, 12 juin 2025.
5- Ibidem.
6- « 'Who in the hell are you ?” Bannon blasts Netanyahu for dragging US toward potential war with Iran », Reuters – TRT Global, 20 juin 2025.
7- Robert Jimison et Annie Karni, « Greene Calls Gaza Crisis a ‘Genocide,' Hinting at Rift on the Right Over Israel », The New York Times, 29 juillet 2025.
8- « MAGA's disenchantment with Israël », The Economist, 5 août 2025.
9- Huo Jingnan, « Pro Trump media figure split over the U.S. role in the israeli-iran conflict », National Public Radio (NPR), 18 juin 2025.
10- Ibidem.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le génocide qui étouffe la vérité à Gaza
21 septembre : une journée de la paix dans un contexte de guerre !
« Nuns vs Vatican » : quand le cinéma braque ses projecteurs sur le silence de l’Église
Les travailleurs du secteur public de la C.-B. intensifient leur grève

Réparer le tissu social

Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) a été fondé le 11 septembre 2001. Quelles sont ses particularités et comment se déploie-t-il ? Propos recueillis par Isabelle Bouchard.
À bâbord ! : Qu'est-ce qui a donné naissance au CSJR ?
Estelle Drouvin : Dans les années 1990, l'aumônier de prison David Shantz se questionnait : « Comment faire pour réparer sachant que je ne dispose que d'une moitié de l'histoire, celle de la personne incarcérée ? ». S'inspirant des bons résultats d'une démarche réparatrice en Ontario, l'aumônier a eu l'idée de la transférer auprès de personnes détenues en sécurité médium. À l'époque, mettre en contact des personnes détenues avec leurs victimes directes était trop avant-gardiste. C'est pourquoi Shantz a eu l'idée de faire rencontrer, sur une base volontaire, des personnes détenues et des personnes qui ont été victimes de crimes semblables, avec des citoyen·nes qui s'engagent à leurs côtés dans le processus. Même si aujourd'hui, il y a des démarches de justice réparatrice qui placent en relation le duo « victime et agresseur réel·les », nous, nous avons choisi de poursuivre en rencontres indirectes, car des rencontres directes ne sont pas toujours possibles. C'est la mission du Centre.
Thérèse de Villette, qui a participé à des rencontres entre détenu·es et victimes avec David Shantz, a souhaité que cette démarche soit mieux connue à l'extérieur des pénitenciers. Aujourd'hui, le CSJR organise des rencontres de justice réparatrice à la fois dans les pénitenciers, et en dehors des murs (avec des ex-détenu·es).
ÀB ! : Une des raisons d'être du Centre est de « réparer la toile humaine dans sa dimension collective ». Qu'est-ce que cela signifie ?
E. D. : Les crimes ont un caractère social. Ils entraînent des conséquences sur l'entourage proche, évidemment, mais aussi sur l'ensemble du tissu social. Ainsi, pour le CSJR, la justice réparatrice, c'est l'idée de regarder les conséquences d'un crime dans toutes ses dimensions. Et ne l'oublions pas, il y a aussi des causes collectives à certaines violences (discriminations multiples, racisme, colonialisme, cléricalisme, patriarcat…). C'est pourquoi nous avons réalisé des projets pilotes qui abordent cette dimension collective (des agressions sexuelles par exemple, ou des relations entre personnes issues des communautés autochtones et allochtones). Pour nous, le vivre-ensemble passe par un tissu social sain. Lorsque de la violence ou des abus sont commis, c'est comme si on créait des trous dans la toile de confiance humaine. L'adoption de comportements de méfiance et de peur agrandit ces trous. C'est pourquoi, derrière notre vison de la justice réparatrice, il y a l'idée de réparer la toile dans sa dimension collective. Après tout, lorsqu'une personne ayant commis ou ayant subi une agression se remet debout de manière ajustée, c'est la communauté en entier qui en bénéficie !
ÀB ! : Quels sont les services offerts par votre Centre ?
E. D. : Nous offrons trois principaux services. ll y a les rencontres de justice réparatrice, lesquelles se divisent en deux types. Il y a le « face à face », qui ouvre le dialogue entre une personne détenue (ou ex-détenue) et une personne victime (ayant porté plainte ou non) d'un crime ou d'une violence apparentée. À ces personnes s'ajoutent deux personnes animatrices et un·e citoyen·ne. Puis, il y des rencontres de justice réparatrice, qui se déroulent en groupe en présence de douze personnes : quatre victimes, quatre personnes ayant été reconnues coupables ou ayant causé des torts, deux citoyen·nes et deux personnes animatrices.
Depuis 2016, nous organisons aussi des ateliers de guérison des mémoires grâce à notre partenariat avec l'Institut Healing of Memories en Afrique du Sud. Ces ateliers ont été créés dans ce pays à la suite de la Commission vérité et réconciliation. Ils permettaient la rencontre entre des personnes blanches et noires qui acceptaient de parler de leur histoire et d'écouter l'histoire de l'autre. Au Québec, il y a aussi des blessures historiques, entre francophones et anglophones ou entre Autochtones et Allochtones. C'est pourquoi il nous est apparu important de se former à cette démarche. Ces ateliers de 24 personnes, offerts deux fois par an durant une fin de semaine, ouvrent la possibilité d'explorer et de reconnaître les blessures émotionnelles que portent les personnes participantes sur les plans individuel et collectif.
Le troisième volet de nos services vise la sensibilisation auprès du grand public. À ce chapitre, le Centre est l'initiateur de toute une série d'activités, il est aussi présent dans des cours de cégep et d'université. Des personnes qui ont participé à nos démarches acceptent souvent de témoigner de leur expérience.
ÀB ! : Quelles sont les attentes des participant·es ?
E. D. : Le but des rencontres est tout simple : ouvrir un espace sécuritaire de dialogue. On souhaite que les gens se sentent assez en confiance pour s'ouvrir sur ce qui peut être profondément blessé ou honteux en eux. Les motivations sont variées. Certaines personnes espèrent être apaisées, dans le sens de diminuer leur peur, leur anxiété ou leur colère. Pour d'autres, iels souhaitent tourner une page de leur histoire. D'autres viennent avec des objectifs de justice sociale et veulent notamment contribuer à la non-récidive en cherchant à faire comprendre aux détenu·es les conséquences de leurs actes. Parfois, les personnes responsables de torts souhaitent montrer qu'iels ont changé ou qu'iels peuvent participer à la réparation des traumas.
ÀB ! : Quels liens établir entre art et justice réparatrice ?
E. D. : L'association avec l'art a été naturelle. À l'origine, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour des cas d'inceste. Dans ces situations, le dessin pour libérer la parole est tout indiqué. Même si les personnes qui participent sont adultes, elles ont été blessées alors qu'elles étaient enfants, et leur enfant intérieur n'a pas toujours les mots pour faire le récit de ce qu'il a vécu. Le dessin permet aussi à l'inconscient de s'exprimer. Le CSJR utilise des activités de créativité autant dans les rencontres de justice réparatrice que lors des ateliers de guérison des mémoires. On a aussi remarqué qu'une quantité de personnes qui sortent de nos activités se mettent à créer (dessins, photo, dance, etc.) comme si en reléguant le passé au passé, elles avaient désormais de la place pour du nouveau. C'est le signe d'une transformation intérieure, ça donne beaucoup d'espérance.
Estelle Drouvin est directrice des services du CSJR.
Illustration : Ramon Vitesse
Justice réparatrice et privilège de la blanchité
Après 17 ans passés en prison, Jon Romano, un homme blanc auteur de tir dans une école en 2004 ayant blessé un professeur, bénéficie aujourd'hui d'une certaine notoriété sur TikTok, où il partage sa quête de rédemption. Ce dernier utilise activement ses plateformes pour dénoncer la violence armée et plaider en faveur d'un contrôle accru. Dans l'une de ses vidéos les plus populaires, il discute de l'importance de la santé mentale et suggère que si les enseignant·es étaient plus attentif·ves aux besoins de leurs élèves, certaines tragédies pourraient être évitées. Il exprime aussi régulièrement ses profonds regrets d'avoir commis un acte de violence et souhaite désormais apporter son aide à la communauté. Bien que je trouve qu'il établit un lien un peu hâtif entre la santé mentale et la violence, ce qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il soit présenté comme un exemple de justice restaurative.
L'approche coloniale de la justice punitive
Lorsqu'on évoque la justice réparatrice comme une alternative, c'est parce que d'autres voies sont possibles, mais surtout nécessaires. Le système actuel est défaillant et s'empire avec les générations. La justice punitive se focalise sur l'infraction elle-même. Elle opère sur la notion que les coupables ont perturbé l'harmonie sociale et méritent une sanction. Les besoins de la victime ou de sa communauté sont relégués au second plan. Ce dont iels ont besoin n'a que peu de conséquences. L'important est de punir, l'important est de contrôler, l'important est de rétablir l'ordre – et vient la question : de quel ordre parle-t-on ? Dans les faits, la justice punitive perpétue avant tout un système profondément inégalitaire.
Dans les contextes coloniaux comme le nôtre, la justice punitive, et tout particulièrement son bras armé, le système carcéral, ont été et sont toujours utilisés comme outils de contrôle des populations autochtones et des populations racisées, notamment les populations noires. Par exemple, selon Statistique Canada, les communautés autochtones représentent seulement 3 % de la population adulte du pays, pourtant entre 2015 et 2016, iels comptaient pour 26 % des admissions en prison. Cette disproportion ne s'explique pas par des taux de criminalité plus élevés, mais est le résultat de politiques pénales discriminatoires, de pratiques policières ciblées et de préjugés systémiques, entre autres. Ainsi, une littérature abondante existe pour dénoncer le système de justice pénale, incluant le système carcéral et ses abondants manquements, comme la surpopulation chronique des prisons qui entraîne des conditions de vie inhumaines pour les personnes en détention.
Par ailleurs, le système ne punit pas uniquement les personnes ayant commis les fautes, mais également leur famille et, par extension, leur communauté (par la séparation forcée, les effets sur la santé mentale des détenu·es comme de leur famille, les coûts liés aux visites de proches emprisonné·es, etc.). Une victimisation supplémentaire se produit du fait des violences qui occurrent dans la prison, mais également en raison de la stigmatisation à vie et des mesures discriminantes pour les personnes ayant un casier judiciaire. Tout cela et plus encore est dénoncé par la justice réparatrice qui vise à restaurer l'harmonie entre la victime, l'auteur·e du crime et la communauté. Contrairement à la justice punitive, les besoins des personnes qui ont été affecté·es par les crimes sont au cœur de l'approche. Aussi, cela nécessite que la ou les personnes victimisées, la communauté et le, la ou les responsables travaillent conjointement à rétablir une harmonie. L'agentivité des personnes concernées est centrale à cette approche, contrairement à la justice punitive qui les en prive.
Repenser la justice au-delà de la cage
Dans ce contexte, je repose la question : la visibilité actuelle de Jon Romaro, son usage des plateformes et les gains qui en découlent s'inscrivent-ils dans une application pratique de justice réparatrice ? La réponse est complexe, mais la conclusion reste la même : non. En réalité, il s'agit plutôt d'un exemple concret du détournement de l'approche alternative qui est mis en évidence d'autant plus aisément dans le contexte de la justice transformatrice.
La justice transformatrice va au-delà de la justice réparatrice et prend en compte les causes profondes qui ont mené à la faute. Elle interroge les racines structurelles et se détache donc de l'individu pour tenir également le système responsable. C'est une vision plus large et une approche plus holistique. C'est aussi une réponse directe à notre société actuelle dont les structures de pouvoir ont historiquement été utilisées pour asseoir et maintenir la suprématie blanche. La justice transformatrice, tout comme la justice réparatrice, repose d'ailleurs sur des approches issues directement des communautés autochtones à travers le monde. Ainsi, notre système actuel mène certaines communautés à être criminalisées plus que d'autres. C'est aussi un système au sein duquel le privilège de la blanchité se manifeste, même parmi ses fautif·ves reconnu·es.
Maintien du statu quo
Au contraire, la justice transformatrice interroge le système : qui en bénéficie ? Comment en est-on arrivé là ? Comment changer les choses ? Comment, en tant que société, échouons-nous à protéger les individus ? Qui condamnons-nous par rapport à qui ? La justice transformatrice, dans le cas de Jon Romano, c'est prendre en compte que la majorité des cas de tirs et meurtres de masse dans les écoles sont perpétrés par de jeunes hommes blancs, quand les populations racisées sont les plus à risque de subir l'exclusion scolaire, la surveillance policière, les discriminations et l'association au crime. La justice transformatrice nous oblige à prendre en compte qui a le plus de chance d'être toujours en vie après une attaque armée dans une école et l'intervention de la police. Jon serait-il encore en vie s'il avait été un homme noir ? La justice transformatrice, c'est prendre en compte que dans le contexte d'une absence de législation efficace des armes à feu, il n'y a pas de justice possible. C'est aussi prendre en compte quelle parole, quel parcours, quel discours sera plus entendu, célébré et applaudi sur les réseaux sociaux par rapport à qui. C'est interroger pourquoi un homme blanc devient un exemple de justice réparatrice, et peut, de manière très concrète, notamment financière, en bénéficier par rapport à d'autres ? À maintes reprises, on a pu voir de quelle manière il est bien plus aisé pour des personnes blanches de bénéficier de leurs crimes. Netflix regorge de séries et de documentaires basés sur leur histoire. S'interroger sur la justice réparatrice et transformatrice en lien avec le cas de Jon Romano, c'est comprendre toutes les ramifications du système, ne pas se montrer conciliant·e.

Justice réparatrice par et pour les communautés noires

L'idée derrière Justice hoodistique est née en 2019 lors du forum social de l'organisme Hoodstock. L'objectif était d'apporter une solution aux problèmes du profilage racial, du racisme systémique, et de la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice québécois. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, Justice hoodistique entame sa deuxième année d'activité à titre de projet-pilote de justice réparatrice par et pour les personnes noires vivant au nord-est de l'île de Montréal.
L'idée derrière Justice hoodistique est née en 2019 lors du forum social de l'organisme Hoodstock. L'objectif était d'apporter une solution aux problèmes du profilage racial, du racisme systémique, et de la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice québécois. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, Justice hoodistique entame sa deuxième année d'activité à titre de projet-pilote de justice réparatrice par et pour les personnes noires vivant au nord-est de l'île de Montréal.
Ce projet-pilote s'intègre dans le programme de mesure de rechange général (PMRG) du ministère de la Justice du Québec, qui a pour principal but la réparation des torts causés aux victimes. Comme indiqué par le ministère, le programme permet « aux adultes accusés de certaines infractions criminelles, la possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes et de régler le conflit qui les oppose à la justice autrement qu'en étant assujettis aux procédures judiciaires usuelles prévues par le Code criminel ». Ce programme de déjudiciarisation, si complété, permet aux participant·es de voir leurs accusations rejetées.
Justice hoodistique met de l'avant une approche holistique, multidisciplinaire et intersectionnelle. Ici prime une vision dans laquelle l'être humain est considéré dans toute sa complexité, et non pas seulement à travers le prisme punitif de la criminalité et de la victimisation. Qu'elles soient envers la collectivité ou envers la victime, la réparation du tort et la reconstruction de soi sont au cœur du projet-pilote. Le projet s'adresse aux personnes noires âgées de 18 à 64 ans qui résident soit à Montréal-Nord ou dans les arrondissements de l'Est de l'Île de Montréal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Ahuntsic, Saint-Léonard, Anjou et Rivière-des-Prairies—Pointes-aux-Trembles). Il s'adresse plus précisément aux personnes noires ayant commis une infraction admissible dans le cadre du PMRG et qui sont à risque d'avoir un casier judiciaire ou des condamnations additionnelles. Pour prendre part au programme, il est demandé que la personne reconnaisse les faits à l'origine de l'infraction et qu'elle ait la volonté de participer au projet de Justice hoodistique.
Les objectifs derrière ce projet sont multiples. Nous cherchons d'abord à nous interroger sur les causes sous-jacentes de la criminalité chez les personnes noires, de même que réduire la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale. Il nous incombe également d'offrir un espace de réflexion pour la personne accusée et la victime afin de les appuyer dans leurs processus de guérison. Justice hoodistique tend à encourager la réintégration des personnes accusées à une participation sociale positive pour elles et les communautés. À travers les cercles hoodistiques, le projet-pilote vient favoriser l'implication de la personne accusée, de la victime et de leur cercle social respectif aux décisions prises à leur égard. Les ateliers afrocentriques qui sont le noyau de ce projet permettent de reconnecter les communautés noires à leurs cultures d'origine et cet esprit est maintenu par Justice hoodistique en offrant des mesures ainsi que des services culturellement adaptés. Le projet-pilote tend à augmenter l'accessibilité à la justice pour les personnes noires et il donne accès à des ressources pour que la personne accusée, la personne victime et leurs familles puissent régler la situation.
Une première au Canada
S'inspirant du programme de mesure de rechange pour les adultes autochtones et du programme de justice réparatrice de la Nouvelle-Écosse, la Justice hoodistique serait cependant une première au Canada puisqu'elle aborde la réparation du tissu social selon les spécificités culturelles et traditionnelles des communautés noires.
L'intervenant·e sociojudiciaire ainsi que le·la professionnel·le faisant les suivis psychosociaux rencontrent la personne admissible afin de lui expliquer le processus et de se familiariser avec ses besoins et ses attentes. Par la suite, la personne participe à deux retraites de guérison lors desquelles elle suit des ateliers afrocentriques.
Suite à ce processus de réflexion, la personne admissible détermine quelle mesure elle devra prendre pour réparer les torts causés avec l'aide de son cercle social, le cercle hoodistique. La mesure peut prendre la forme d'une médiation avec la victime, de service et de dédommagement à la collectivité, d'une mesure de sensibilisation, mais également de suivis psychosociaux individuels et familiaux, ou encore du mentorat et de l'accompagnement scolaire.
Lorsque la victime veut s'impliquer, le processus est le même à l'exception des retraites. La victime détermine le type de réparation souhaitée avec l'aide de son cercle hoodistique et s'ensuit une rencontre avec la personne accusée. Depuis le lancement officiel de Justice hoodistique, l'ensemble des participant·es ont complété leur mesure et nous en sommes à la septième cohorte (celles-ci peuvent dénombrer jusqu'à cinq personnes).
Un projet à pérenniser
Nous remarquons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires qui sont représentées dans le PMRG, bien qu'il y ait une surreprésentation connue de personnes noires dans le système judiciaire. Nous gagnerons à avoir des données claires sur le pourcentage de personnes noires qui sont dirigées vers des programmes de déjudiciarisation comparativement à celles qui sont judiciarisées. L'hypothèse principale de l'équipe de Justice hoodistique suppose la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale, mais une sous-représentation de ces dernières au sein des programmes de déjudiciarisation. Il nous est pourtant impossible de prouver cela, étant donné que les données nécessaires ne sont pas récoltées. C'est l'un des points mis de l'avant dans le rapport de recherche Justice hoodistique : à l'intersection de la justice réparatrice et transformative par et pour les communautés noires : « [I]l est difficile de prouver la sous-représentation des adolescent·es noir·es dans les programmes de sanctions extrajudiciaires. Pourtant, l'hypothèse est là. Cette impression que les jeunes noir·es sont plus souvent orienté·es vers les mesures judiciaires et ont moins accès aux mesures réparatrices serait à valider par des statistiques ethnoraciales que les organismes publics et parapublics ne colligent pas. » [1]
Un second enjeu important est la pérennisation du projet-pilote. Malgré les résultats favorables du projet-pilote, le financement de l'Agence de la santé publique du Canada se termine à la fin mars 2024. Nous devons donc trouver un nouveau financement pour permettre la survie de Justice hoodistique.
QUI EST HOODSTOCK ?
Hoodstock est un organisme à but non lucratif né en 2009 à Montréal-Nord après la mort de Fredy Alberto Villanueva, un jeune de 18 ans d'origine hondurienne abattu par un policier du Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Cet événement tragique a mené un collectif de résident·es à présenter cinq revendications aux autorités locales, dont l'une d'elles consistait à mettre fin aux pratiques abusives de la police. La mission de Hoodstock est de générer des espaces de dialogues, des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires, inclusives, sécuritaires et dynamiques.
[1] Chanel Gignac, Dominique Bernier et Nancy Zagbayou. Justice hoodistique : à l'intersection de la justice réparatrice et transformative par et pour les communautés : rapport de recherche. Montréal : Service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal, 2023, p. 20.
Nancy Zagbayou est chargée de projet à Hoodstock.
Illustration : Ramon Vitesse

Responsabilité, guérison et transformation

Au cours d'une décennie de vie collective et d'organisation anarchiste, abolitionniste, féministe et queer, Geneviève Parisien, Charlotte Sansfaçon-Lévesque et moi-même avons été impliqué·es dans ce qu'on appelle couramment des « processus de justice transformatrice » en réponse aux violences sexuelles et conjugales. Inspiré·es par ces expériences, nous avons entrepris de développer un modèle de processus de responsabilité, de guérison et de transformation, actuellement en cours d'élaboration sous forme de livre. Notre objectif est de fournir des outils basés sur nos succès, nos échecs et nos recherches sur le sujet afin de contribuer aux réflexions existantes sur la justice transformatrice.
Aspects pratiques
Nous avons identifié quatre types de participant·es que l'on retrouve dans tout processus de justice transformatrice : la personne qui a vécu la violence et son cercle de soutien, celle qui a commis la violence et son cercle de son soutien ; des membres de la communauté où la violence s'est produite ; et les personnes qui accompagnent et facilitent le processus de responsabilité, de guérison et de transformation.
Les processus de justice transformatrice doivent être amorcés une fois que la situation de violence a cessé. Bien sûr, il est possible que la mise en place d'un processus se fasse dans le même élan que les mesures prises pour faire cesser la violence. Il se peut aussi que des démarches informelles de responsabilisation et de guérison aient déjà été entamées à travers des discussions et des actions concrètes. Lorsqu'un processus formel s'impose, il est souvent amorcé par les personnes directement impliquées dans la situation de violence ou par leurs proches.
Nos expériences personnelles nous ont fait comprendre l'importance de sortir de l'urgence lorsqu'on met en place un processus de justice transformatrice. Il est crucial de prendre le temps de bien réfléchir à la démarche à prendre, même si l'on sent que les comportements et les croyances qui ont mené à la situation de violence auraient dû changer hier. L'urgence nous déconnecte souvent du présent et de nos capacités émotionnelles et relationnelles, et nous fait faire des erreurs qui peuvent miner la confiance dans le processus.
Avant d'entamer un processus, il faut d'abord s'assurer qu'on fait bel et bien face à une situation de violence. Par exemple, il se peut qu'une personne affirme vivre de la violence, et qu'il n'y ait pas de bris de consentement, de torts ou de dommages causés, mais qu'elle soit plutôt déclenchée à cause de traumatismes, ou encore que la situation relève d'un conflit particulièrement envenimé ayant une charge émotionnelle très négative, mais qu'il soit difficile d'identifier des actes précis de violence. On suggère d'aller consulter des sources fiables offrant des définitions de violence (émotionnelle, physique, psychologique, sexuelle, économique, etc.) et d'identifier les comportements et les dynamiques qui relèvent véritablement de la violence. La personne qui facilite le processus a la responsabilité particulière de recevoir les témoignages des personnes impliquées, voire de témoins, et de comprendre la situation dans toute sa complexité pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'une situation de violence.
Le processus implique l'élaboration d'un calendrier à durée déterminée : quelques mois, un an, voire deux, en fonction des besoins et des objectifs ciblés. Il implique aussi de déterminer les modalités de communication : qui parle à qui, par quels moyens, à quelle fréquence, et pour communiquer quel genre d'informations ? Il peut aussi être nécessaire de discuter de la manière dont les espaces seront navigués (ceux où on coexiste, ceux où on se croise, ceux qu'on ne partage pas), et de ce qu'on décide de communiquer aux membres de la communauté à l'extérieur du processus.
Les personnes touchées par une situation de violence peuvent prendre part à différents degrés aux processus de transformation, de guérison et de responsabilité. Dans ce contexte, une clé de la réussite d'un processus réside dans la capacité à définir des objectifs réalistes pour soutenir la trajectoire de tous les participant·es. Parmi les objectifs possibles : trouver un nouvel appartement ou un emploi stable, s'engager dans une activité régulière qui soutient la connexion avec son corps et ses émotions, consulter un·e thérapeute spécialisé·e en traumatismes ou en violences pendant un nombre de séances donné, participer à des discussions thématiques liées à l'oppression raciale ou genrée, tenir un journal des activités en lien avec le processus, etc. Chaque personne impliquée dans le processus est responsable de participer à l'élaboration des objectifs, de même qu'à l'élaboration de l'échéancier pour atteindre ces objectifs, en fonction de ses capacités et de ses besoins, tout en tenant en compte ceux des autres.
La création d'un processus de justice formel demande beaucoup d'énergie à toutes les personnes impliquées et n'est pas nécessairement le moyen indiqué pour se responsabiliser dans toutes les situations de violence et d'abus. Par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire, dans le cas où les personnes impliquées sont capables de se parler, d'arriver à des ententes ou de chercher du soutien afin de changer les conditions qui ont mené à la violence. C'est lorsque les pratiques informelles ne suffisent pas qu'un processus structuré permet de fournir aux différent·es participant·es un soutien tangible et un contexte de responsabilité plus explicite, grâce aux rôles de soutien et à la facilitation qui s'engagent à faire le suivi, à soutenir les différentes démarches entreprises et à aider à atteindre les objectifs ciblés.
Principes directeurs
Il est important de comprendre que les chemins de transformation et de guérison de chaque personne ne sont pas linéaires et ne peuvent pas être forcés, bien qu'on puisse les soutenir et les encourager. Cela implique une certaine capacité à laisser aller, tout en étant capable de continuer à se soucier des gens et de leur devenir. Évidemment, cela n'implique pas d'accepter la persistance de la violence, et on doit toujours faire notre possible pour la faire cesser.
La personne responsable de la violence doit accomplir trois étapes essentielles : reconnaître ses gestes et les conséquences de ceux-ci, offrir des excuses, des réparations ou des compensations aux personnes l'ayant vécue et/ou à la communauté impactée, et amorcer une démarche de guérison et de transformation de ses comportements, de ses attitudes et des croyances à la source de la violence.
Pour être authentique, la prise de responsabilité ne doit pas être imposée de l'extérieur, mais bien être une démarche volontaire. Sa richesse est intimement liée à la capacité d'une personne d'honorer son besoin d'intégrité par rapport à ses valeurs et à ses actions. La prise de responsabilité doit donc non seulement être quelque chose qu'on fait par rapport aux autres, en prenant acte des conséquences de nos gestes, mais d'abord et avant tout face à soi-même.
D'un autre côté, le processus doit également aspirer à soutenir la capacité de la personne ayant subi la violence à prendre en main sa propre guérison et sa responsabilité face à elle-même. Notons que son cheminement de guérison peut ne pas correspondre au calendrier prévu du processus et peut prendre des années en raison des blessures et des traumatismes vécus. Si une personne qui a vécu de la violence résiste à s'engager dans certaines démarches, on ne doit pas la forcer. Dans ce genre de cas, on continue simplement à lui offrir un environnement qui soutient sa capacité à guérir et à continuer de se transformer à son rythme. Bien sûr, la guérison ne doit pas dépendre de la capacité de la personne qui a commis la violence à assumer ses actes. De même, la volonté de la personne responsable doit persister, peu importe l'attitude de la personne ayant subi la violence, car sa responsabilisation demeure cruciale tant pour elle-même que pour le reste de la communauté.
Le processus décrit revêt une double fonction : préventive et réparatrice. Il contribue à renouer les liens au sein de la communauté, à restaurer la confiance, sans nécessairement chercher à ramener les relations à leur état antérieur. En dernière instance, les processus de justice transformatrice ne doivent pas se limiter à remplacer les procès et les peines prononcées par les tribunaux. Ils doivent être envisagés dans un cadre plus vaste de pratiques et de valeurs axées sur l'autonomisation des individus et des communautés. Nous invitons chacun·e à poursuivre l'expérimentation des pratiques de responsabilité et de justice transformatrice, en soutien à la destitution et à l'abolition de l'État colonial canadien, de la police et des prisons, et pour bâtir des communautés autonomes et responsables.
Will V. Bourgeois, militant·e et thérapeute somatique.
Illustration : Ramon Vitesse
Dans une université de C‑B, une concierge meurt surchargée de travail

Les ruses de la réaction

Au fil de ses défaites et de ses retours, la réaction affine ses stratégies et pose un défi de décodage qui en dupe plusieurs.
Selon le Dictionnaire de l'Académie française, le fait de prôner le rétablissement d'un régime aboli et de s'opposer au progrès social et à l'évolution des mœurs forme le noyau idéologique de la réaction. Rattachée depuis le 18e siècle aux anti-Lumières et à la contre-révolution, elle n'est pas une mouvance modérée qui accompagne le siècle, mais un refus de l'égalité des droits doublé d'un combat contre toute volonté de concrétiser ce principe par des revendications sociales.
Les réactionnaires sont tout d'abord d'excellents faussaires. L'enjolivement de l'Ancien Régime et la définition du progrès comme une « nouvelle religion » caractérisent leur manipulation de l'histoire. L'instrumentalisation des conquêtes sociales, qui sont vidées de leur portée, définit aussi leur manipulation des mots : la démocratie se mute en plébiscite, la laïcité en loi du contrôle et le féminisme en révolution déjà achevée. L'abandon du lexique d'antan au profit de formes au goût du jour marque enfin leur manipulation de la réalité : l'inégalité ne concerne plus tant les « races » que les « cultures » tout en servant la même essentialisation de groupes nécessairement inférieurs et ennemis.
Aujourd'hui, ces faussaires se considèrent comme des dissident·es. Lorsqu'on les prend au mot, par sympathie ou par paresse, leur posture de « contestataires » devient un outil de marketing qui fait mouche. Mais lorsqu'on use de sens critique, tel que nous y invite Philippe Bernier Arcand, il est aisé de déconstruire cette « tentative d'inverser les rôles de la victime et du bourreau pour que la figure du rebelle change de camp [1] ». En effet, cette inversion des rapports de force n'a d'autre but que de maquiller les dominé·es en dominant·es. C'est pourquoi la référence à la « tyrannie des minorités » est toujours brandie afin de consacrer une suprématie majoritaire faussement posée en victime. De la même manière, l'antiracisme essuie une fin de non-recevoir puisqu'il s'agirait d'un « racisme anti-blanc ».
De la conservation à la réaction
La tradition conservatrice a pourtant promu des politiques plus mesurées : le parti conservateur du Canada a lutté contre l'Apartheid sud-africain et la démocratie chrétienne en Europe a soutenu la construction de l'État-providence. Que s'est-il passé ? Selon Natascha Strobl, il n'y a rien de surprenant dans le retour de la réaction, car les rapports du conservatisme avec l'État social (à sa gauche) et la tentation fasciste (à sa droite) sont aussi mobiles que précaires. Les tendances extrémistes au sein de ce qu'elle appelle le « conservatisme radicalisé [2] » se sont graduellement fortifiées et ont résolu d'employer tous les moyens possibles (du mensonge au complotisme) sur le front de la guerre culturelle lancée contre la démocratie libérale.
Afin de rendre cette offensive plus digeste, certains esprits naïfs voient dans ce printemps des populismes une occasion d'affirmer des « valeurs républicaines et citoyennes » qui soient « aveugle aux différences ». Pour Jean-Fabien Spitz, cette tentative de subsumer les inégalités économiques par la référence à une République qui renonce d'emblée aux leviers de l'égalisation et à la lutte contre les dominations est devenue « l'étendard du parti de l'ordre contre les mouvements qui aspirent à l'émancipation ». En sus de l'extrême centre et du néolibéralisme en crise de légitimité, les ruses de la réaction innervent aussi ce « discours pseudo-républicain [qui] s'emploie en réalité à nier les inégalités et les discriminations pour ne pas avoir à les combattre [3] ».
[1] Philippe Bernier Arcand, Faux rebelles, Montréal, Poètes de brousse, 2022.
[2] Natascha Strobl, « The radicalisation of Austrian conservatism », International Politics and Society, 15 octobre 2021. En ligne : tinyurl.com/ybj487w4
[3] Jean-Fabien Spitz, La République ? Quelles valeurs ?, Paris, Gallimard, 2022.
Jean-Pierre Couture est professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.
Illustration : Alex Fatta

Nation-anxiété

2022 a vu la publication de trois essais écrits par de jeunes intellectuels ouvertement conservateurs et nationalistes. Si ces trois textes sont caractérisés par la peur anxieuse de voir la nation québécoise disparaître, les lire révèle en fait la nullité absolue de leur idée de nation, de l'usage stratégique de cette notion, et des visées éminemment autoritaires des auteurs.
La nation qui n'allait pas de soi, d'Alexis Tétreault ; La pensée woke, de David Santarossa ; Le schisme identitaire, d'Étienne-Alexandre Beauregard : lire ces trois livres bout à bout consiste en une expérience pénible témoignant du pourrissement de l'intelligentsia québécoise. Car la mesquinerie y règne. On ne s'étonnera pas d'y lire, sous la plume de Beauregard, que le nationalisme s'oppose à l'éthique du care, en ce que cette dernière refuse le « Soi et l'universel » propre au nationalisme (p. 50-51). Feignons notre surprise quand Santarossa défend que la pensée woke soit aveugle à la réalité québécoise au point où elle perdrait de vue que les Québécois·es, eux aussi, « sont des autochtones » (p. 66). Soulignons ce brillant tour de passe-passe révisionniste où Tétreault explique que la crise du code de vie d'Hérouxville consiste en fait en une « dénonciation […] rustique du modèle canadien » (p. 223).
On peut se questionner quant à la possibilité même d'un dialogue face à de tels producteurs de discours réactionnaires. Mais il ne s'agit pas ici de dialoguer avec ces textes, ni même de les réfuter. Plutôt, les lire ensemble, même si chacun envisage différemment le concept de nation [1], révèle qu'ils sont tous trois de la même trempe.
Un concept de nation qui n'allait pas de soi
La nation québécoise, d'expression française, habitant l'Amérique du Nord depuis la colonisation française, et laïque, possèderait un droit à l'existence puisqu'elle refléterait une « majorité ». Cette nation serait toutefois niée par la volonté belliqueuse du Canada anglophone, multiculturaliste et « postnationaliste », et les démarches sournoises de l'idéologie woke, véritable cinquième colonne récusant tout référent national au nom de la défense des identités.
Que le Québec forme une société distincte, que cette société puisse s'incarner dans un État souverain et puisse aspirer à cet égard au titre de nation, sont des thèses tout à fait défendables.
Là où on s'indigne, c'est au niveau de la méthode. Dans ces essais pour lesquels le concept de nation joue un rôle si important, ce concept n'est jamais présenté. On cherchera en vain des statistiques, des données ou des sondages sur des sujets aussi cruciaux que la démographie, l'identité politique ou l'immigration, mais on ne trouvera qu'une référence à une notion de nation posée d'avance, tenue pour acquise dès le début. Tétreault évoquera au mieux vouloir « monter la garde » de « l'âme » du Québec (p. 11), tandis que Beauregard défendra fermement le « lien sacré entre État et nation » (p. 112). Quant à Santarossa, bien que son essai ne porte pas directement sur la nation québécoise, celui-ci dénoncera toutefois que le wokisme ne reconnaît pas ce fait « allant de soi », soit que le peuple québécois est « une nation minoritaire enracinée en cette terre, avec sa langue et culture, sur cette terre qu'elle occupe depuis le dix-septième siècle » (p. 65) [2].
Déployer de la sorte un tel concept sans jamais prendre la peine d'expliciter à quoi il réfère nous oblige à l'accepter comme allant de soi : « la nation », ses prétentions, sa situation. La « nation » implique déjà la lutte contre sa « vulnérabilité », pour ne pas dire son état de « guerre culturelle » : accepter de suivre le chemin de nos auteurs, c'est déjà accepter cet état de siège contre la « majorité ». Beauregard peut ainsi se permettre de réécrire l'histoire du Québec pour l'articuler comme une « guerre culturelle » depuis la Conquête de 1760 : méthodologiquement, on soulignera cet effort grossier de révision historique.
Cette stratégie est malhonnête, pour ne pas dire enrageante. Elle polarise à outrance en imposant l'existence périlleuse de la nation québécoise, au-delà de tout dialogue critique. Défendre l'inverse nous pose en effet en position de fossoyeur du Québec, donc d'ennemi. Il s'agit autrement dit d'un faux dilemme. Mais en s'y attardant, on découvre qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter la nation telle que décrite par Tétreault, Santarossa ou Beauregard. Il faut s'y soumettre.
Le fétiche de l'autorité
Tétreault écrit que, sous la menace multiculturaliste, « La référence [nationale] devient l'objet de la négociation, alors que dans la société de la démocratie nationale, elle était sa condition » (p. 203). Deux visions de la collectivité s'affronteraient : une où ses membres délibèrent sur la référence culturelle qui les lie, l'autre où l'acceptation de ce référent est la condition à l'intégration à la communauté.
Répétons : pour s'identifier à la communauté et y participer, la condition préalable est d'accepter « la référence culturelle » qui définit la nation. La nation promeut ses propres normes auxquelles il faudrait obéir (« c'est comme ça qu'on vit », disait le premier ministre [3]). La nation n'est pas seulement le sentiment partagé par plusieurs personnes vivant sur un même territoire, partageant une même langue et liées à une même histoire, elle est avant tout le nom donné à un projet politique éminemment conservateur faisant de sa propre survie sa justification. Ainsi, Tétreault peut défendre l'ignoble loi 21 de la laïcité comme une « tentative de consolidation d'un modèle québécois ancré dans la tradition politico-culturelle de la majorité » (p. 228). Promouvoir la nation québécoise, c'est accepter cette loi, avec tout ce qu'elle comporte de discrimination, mais ce serait aussi le triomphe d'un Québec passant de la vulnérabilité à la « normalité » (p. 235). Brillant !
Il est fascinant de voir comment nos auteurs défendent que le premier réflexe de la « majorité » consisterait à déployer sa force pour asseoir son règne. Nos trois jeunes lumières fétichisent de la sorte le pouvoir d'une majorité à travers l'État et l'autorité de ce dernier à laquelle il faudrait se soumettre. En dehors de cette autorité, point de salut pour l'avenir du Québec. Beauregard est, cela dit, le plus explicite à cet égard quand il défend que la nation commande une « éthique de la loyauté » héritée de la Révolution tranquille (p. 33), que le mode de scrutin actuel uninominal à tour est préférable à un mode plus proportionnel, car davantage au diapason de « l'unité nationale » (p. 245), ou que François Legault doive littéralement entretenir une « scission » entre le programme de la CAQ et les autres organisations de la société (médias, groupes de pression) afin de continuer à incarner le « gros bon sens » du Québec des banlieues (p. 153) – et ainsi ne devoir rendre de comptes à personne [4].
De surcroît, la nation n'exige pas soumission seulement parce qu'elle est et qu'elle s'inscrit dans une histoire commune, mais aussi parce qu'elle sauvegarde la possibilité même de la démocratie. Essentiellement, nos lurons mettent ensemble nation québécoise et délibération civile contre la dissolution sociale promue par l'alliance du Canada multiculturaliste et du postmodernisme. Tétreault déplore la perte de la « citoyenneté abstraite » où tous seraient égaux (p. 200), mais nous rassure que la loi 21 est le produit de la délibération démocratique québécoise (p. 217). Dans une veine similaire, Beauregard jumelle « héritage de loyauté, universalité et affirmation nationale » (p. 272).
C'est à Santarossa qu'il revient toutefois d'éclairer pleinement ce maillage entre nation et raison. Santarossa écrit que le wokisme serait une « attaque en règle contre tous les fondements des sociétés occidentales » (p. 102). Par cette phrase, il sous-entend la supériorité des sociétés occidentales sur la base qu'on y pratique la délibération rationnelle et raisonnable : tous sont égaux au sein du dialogue. En effet, nous rappelle heureusement Santarossa, ce sont les pays occidentaux les premiers qui ont aboli l'esclavage, brillante démonstration qu'il n'y a pas d'autres « civilisations qui sont allées plus loin dans la lutte contre le racisme » (p. 81-82). Une telle position sur la supériorité politique des États occidentaux est pratique, car elle fait de la sauvegarde de l'ordre politique libéral existant son critère pour séparer bien autoritairement ce qui est recevable de ce qui ne l'est pas. Bien entendu, la nation québécoise fait partie de ces sociétés évoluées, et en dénoncer les injustices, par exemple le racisme systémique, serait s'en prendre à la nation québécoise et aux régimes politiques existants. Ce serait déraisonnable. Ainsi, Santarossa peut rejeter le phénomène du racisme systémique parce qu'il nierait notre « humanité commune » (p. 60), et écrire du même souffle que l'intégration des personnes migrantes à leur société d'accueil consiste pour celles-ci en un « devoir moral » en raison du « cadeau » qu'on leur fait en les accueillant (p. 52). Raisonnablement, la nation québécoise peut imposer son conformisme aux populations migrantes : critiquer cela reviendrait à nier le droit d'existence de la nation québécoise.
Dialectique ou décadence
Penser de la sorte est proprement décadent. La décadence se manifeste dans le fait que Tétreault, Santarossa ou Beauregard sont non seulement rigoureusement incapables d'apprécier les lignes de force objectives qui structurent les rapports sociaux, mais qu'ils proposent des solutions superficielles servant à les voiler. C'est là que s'inscrit le caractère conservateur de leur projet : imposer la nation comme salut social au détriment de toute autre perspective, et par cela fixer le statu quo de l'ordre social existant. Un statu quo où eux, bien entendu, ne s'en tirent pas trop mal, mais où d'autres continuent de souffrir.
La décadence ne doit pas toutefois être comprise comme une faute intellectuelle individuelle, mais comme le symptôme de contradictions sociales structurantes. Là est l'intérêt de lire ces trois essais : non pas comme de simples idées lancées en l'air, mais comme l'expression d'un ordre social réagissant à sa propre décomposition. Il suffit de regarder l'actualité économique et environnementale pour se convaincre de la nécessité de changements sociaux radicaux. En ce sens, la décadence de nos jeunes intellectuels est proprement scandaleuse.
La force de la pensée critique et de l'engagement politique militant aura été de dépasser la superficialité du conservatisme et de révéler comment la société est organisée de telle sorte à perpétuer l'exploitation et la domination.
En un mot, c'est la pensée dialectique qui ici se retrouve étranglée au profit de la propagande. La pensée dialectique est spécifiquement ce qui permet de relier l'individu à la société. En étant sensible à l'opposition qui unit ces deux composantes, elle explique comment nous sommes avant tout le produit de notre milieu : il s'agit du soubassement logique d'idées comme patriarcat, racisme systémique ou aliénation du travail. La propagande, elle, propose une pseudo-solution – la dérive autoritaire nationaliste – à un problème réel – la société québécoise incapable d'être à la hauteur de ses promesses. Et elle est décadente, car volontairement sourde aux hurlements de ce qui tente de se montrer.
Lire Tétreault, Santarossa et Beauregard nous apprend la valeur d'une pensée intelligente, d'un engagement réel. À eux, nous ne leur répondrons que par le mépris et le dégoût. Mais pour nous, voyons-y les exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a toute une société à (re)bâtir et plein de gens brillants qui préfèreront construire ensemble la société de demain plutôt que de se faire imposer celle d'hier.
OUVRAGES RECENSÉS
Alexis Tétreault, La nation qui n'allait pas de soi : la mythologie politique de la vulnérabilité du Québec, Montréal, VLB, 2022, 256 p.
David Santarossa, La pensée woke : analyse critique d'une idéologie, Montréal, Liber, 2022, 184 p.
Étienne-Alexandre Beauregard, Le schisme identitaire, Montréal, Boréal, 2022, 282 p.
[1] Le livre La nation qui n'allait pas de soi consiste en une enquête historique sur la manière dont des figures intellectuelles québécoises ont compris et déployé le concept de nation. La pensée woke dénonce le wokisme au nom du dialogue rationnel, mais à peu près tous les exemples sont de nature nationaliste. Le schisme identitaire expose comment la nation québécoise est présentement menacée par différentes tendances politiques.
[2] Bien entendu, aucune mention des revendications des Premières Nations ne se retrouve dans la logorrhée de nos paladins du Québec.
[3] Par un heureux hasard, c'est aussi le titre du récent essai de Francine Pelletier sur le nationalisme identitaire et conservateur.
[4] Il est inquiétant que Beauregard ait été – et semble encore – à l'emploi de la CAQ.
Illustration : Alex Fatta
France : mobilisations « Bloquons tout » contre la politique budgétaire
Opinion—Derrière la mort de Charlie Kirk, un monde qui craque sous les contradictions
Le soulèvement populaire en Indonésie révèle une crise sociale qui s’aggrave
Changement de culture : Combien d’animaux sont morts pour notre assiette ?
Du Canada à Gaza : « une histoire de génocide »

Réflexions et propositions sur le Cahier de propositions de Québec solidaire

Le 8 septembre, les membres de Québec solidaire recevaient une version actualisée du Programme de Québec solidaire et un Cahier propositions. Ce dernier doit faire l'objet de discussions dans les associations du parti. Les propositions pourront être amendées et la date limite de ces amendements est le 8 octobre prochain. Le 23 octobre, le cahier de synthèse des propositions et des amendements sera à son tour disponible. C'est ce dernier qui sera soumis au congrès du parti qui doit se tenir les 7, 8 et 9 novembre prochain. Dans le cadre de la discussion sur l'actualisation du programme de Québec solidaire, ce texte présente des remarques tant sur l'analyse de la situation et des propositions qui visent à répondre à cette situation dans une option d'émancipation politique et sociale. Nous abordons ici proposition par proposition les Blocs 1 et 2 du Cahier de propositions qui correspondent au premier chapitre du programme intitulé Créer une économie verte et solidaire.
L'ébauche du programme actualisé se limite à une « vision politique » et une « philosophie gouvernementale générale » au détriment d'analyses concrètes de la situation actuelle, de revendications précises et d'une stratégie de lutte permettant d'amorcer un processus de transformation sociale. Cette posture a) évite d'évaluer les rapports de forces sociaux et le rôle des mouvements sociaux comme acteurs des transformations sociales ; b) neutralise le programme en le réduisant à des politiques gouvernementales d'un éventuel gouvernement solidaire, empêchant ce programme d'outiller le parti pour les luttes concrètes extra-parlementaires ; c) déconnecte le projet de société de ses conditions de possibilité en négligeant d'élaborer des stratégies précises.
Le programme doit redevenir un outil stratégique complet, intégrant analyse, propositions et stratégies concrètes de transformation sociale, articulées aux luttes présentes. Il s'agit de proposer un programme qui dépasse l'approche centrée uniquement sur l'éventuelle gestion d'un gouvernement de Québec solidaire, et d'esquisser un programme d'action articulé aux luttes sociales et au processus constituant produit par ces luttes. L'exercice proposé ne vise qu'à identifier les amendements et ajouts au programme en partant du Cahier de propositions.
Bloc 1 : Économie et transition socioécologique – Éclairer le rôle de l'économie dans la transition
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.1 Les objectifs de l'économie solidaire.
Québec solidaire vise une économie décarbonée en 2050. Un gouvernement de Québec solidaire appliquera dans un premier temps un plan de transition énergétique visant l'élimination des hydrocarbures dans la production et la consommation d'énergie. Un gouvernement de Québec solidaire se dotera de nouveaux outils de planification et d'orientation économique pour améliorer le bien-être collectif et assurer le respect des droits de toutes et tous.
Critiques
Si on peut se questionner sur ce que signifie l'expression du dépassement à terme du capitalisme. Parler d'un système plus juste, inclusif et viable, c'est flou à souhait. On a ici une bonne illustration de ce que l'on entend par la réduction du programme à une vision politique. En fait, dans cette approche, l'analyse de la situation économique et politique est escamotée, les classes sociales, leurs intérêts divergents et les rapports de force entre ces dernières sont invisibilisés. On verra que cela demeure une constante dans l'ensemble du texte de l'ébauche.
Le mode de production capitaliste conduit à une prédation qui détruit systématiquement des forêts et des espèces animales, terrestres et marines.
Cette seule priorité d'une économie décarbonée pour 2050 ne se distingue en aucune façon de celle avancée par les autres partis politiques au Canada et au Québec. Aucune cible pour 2030 ; aucune reprise des propositions du GIEC et des groupes écologistes en termes de cible. On se contente de généralités sur l'accélération de la transition socioécologique sans en définir le contenu.
Amendements et ajouts
Il faut définir des objectifs intermédiaires pour l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et reprendre les objectifs avancés par les groupes écologistes.
Mais un frein significatif à la catastrophe climatique et la perte de la biodiversité ne peut être construit que par l'élimination de la poursuite d'une croissance sans entrave favorisant l'accumulation capitaliste. Il faut défendre une décroissance véritable en donnant la priorité à l'économie d'énergie, l'économie des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Cela passe par :
• la production de biens répondants aux besoins sociaux et non à une consommation débridée stimulée par la publicité ;
• la priorité donnée aux travaux qui vise l'économie d'énergie, comme la construction et la réparation de logements et d'édifices sobres en consommation d'énergie ;
• l'arrêt de l'obsolescence planifiée des produits et la facilitation des réparations ;
• la relocalisation au plus près des usagers et usagère des productions pour éviter les transports aériens et maritimes sur de grandes distances de marchandises coûteuses en énergie ;
• une planification démocratique et citoyenne de ce qui doit être produit rompant avec la seule poursuite de profits.
Défendre la biodiversité exigera :
• le passage d'une agriculture industrielle à une agriculture biologique qui évite la surfertilisation, l'usage de pesticides, et sa réorientation vers la production de protéines végétales au lieu de protéines animales ;
• la sortie d'une agriculture centrée sur la production carnée en mettant fin aux élevages industriels ;
• la fin de la déforestation par l'exploitation privée des forêts et une gestion qui tend à diminuer la variabilité des espèces d'arbres sur un territoire ;
• L'arrêt d'une pêche industrielle qui détruit les ressources halieutiques.
Arguments pour l'ajout
Pour ce qui est de l'objectif de la décarbonation pour 2050, un horizon aussi éloigné ne permet pas de fixer des objectifs de lutte immédiats pour les mouvements sociaux et de soutenir les objectifs des groupes et mouvements écologistes.
Pour ce qui est de la décroissance et de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, cela ne peut être le seul résultat d'une action gouvernementale à venir. Il faut mettre de l'avant des revendications qui peuvent être reprises par les mouvements sociaux. La lutte contre la production des biens sociaux et des dépenses ostentatoires sont des combats qui doivent être livrés maintenant. Cela est aussi vrai de la lutte contre l'obsolescence planifiée et pour la réparabilité des produits menée par des mouvements de consommateur-ices, les syndicats, les groupes écologistes.
Pour ce qui est de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, on ne peut se contenter de parler d'aires protégées, c'est tout le rapport à la nature qui doit être transformé et cela implique une rupture avec la logique de croissance infinie pour la recherche de profits.
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.2 (1.2.1) Diversifier les modèles économiques
Il faut que la logique de l'accumulation des profits cesse pour laisser plus d'espace à l'économie sociale. L'économie doit revenir entre les mains des communautés québécoises.
Critiques
Ces propositions sont des abstractions. La propriété privée des moyens de production et d'échange par les monopoles qui sont souvent des multinationales étrangères et les grandes banques doit être remise en question, car ce sont les acteurs majeurs du système économique qui déterminent la logique d'évolution qui conduit à la prédation et à la destruction de la nature.
Amendements et ajout
L'économie ne peut revenir entre les mains de la majorité populaire sans la socialisation des grandes entreprises des secteurs stratégiques de l'économie. Cette socialisation passe par la nationalisation, puis la démocratisation de ces entreprises pour donner le contrôle aux travailleurs, aux travailleuses, et aux citoyen-nes.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
On ne peut en reste à des formulations qui ne permettent pas à la majorité populaire et aux mouvements sociaux d'agir concrètement dans le sens des objectifs visés.
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.3 (1.2.1) Diversifier les modèles économiques
On propose trois critères pour une nationalisation : 1. son caractère stratégique ; 2. la grande quantité de capital nécessaire ; 3. la démonstration de l'échec du secteur privé.
Critiques
Si on peut nationaliser sans démocratiser (soit étatiser), on ne peut socialiser les secteurs économiques appartenant au grand capital sans nationaliser (les banques, les grandes entreprises d'exploitations minières, forestières ou les grandes industries de transformation et de transport). Elles doivent devenir du domaine public si on veut pouvoir opérer dans ces dernières une démocratisation véritable donnant le pouvoir aux travailleuses, aux travailleurs et aux citoyen-nes.
Si le critère 1 pour la nationalisation peut être à considérer, le critère 2 montre que la proposition ne considère pas la nationalisation sans compensation et la démocratisation qui devrait s'ensuivre ; le critère 3 de l'échec du secteur privé équivaut ni plus ni moins à faire prévaloir la recherche du profit sur les besoins sociaux.
Amendements et ajouts
La socialisation des grandes entreprises et des banques passe par leur nationalisation et la démocratisation de leur fonctionnement.
Les critères 2 et 3 sur la nationalisation doivent être biffés.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
La démocratie économique ne peut être réalisée si une minorité possédante continue d'avoir le contrôle des choix d'investissement et de mobilisation de l'argent, alors que cette minorité se constitue en force à de blocage de la transition écologique et sociale, comme la conclusion de ce chapitre du programme révisé le reconnaît.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Participation des travailleuses et travailleurs à la transition socioécologique
1.4 (1.2.3) Protection et participation des travailleuses et des travailleurs dans la transition socioécologique
Un gouvernement de Québec solidaire applique le principe de Zéro perte d'emploi net à l'intérieur de chaque région. Il assurera la diversification des économies locales. Il favorisera des investissements dans les secteurs peu polluants et la requalification de la main-d'œuvre. Un gouvernement de Québec solidaire encouragera la participation des travailleuses et des travailleurs dans la gestion des impacts de la transition écologique.
Critiques
Quelle sera la politique d'investissement d'un gouvernement solidaire pour diversifier l'économie d'une région ? Comment et avec quels moyens un gouvernement solidaire investira-t-il dans les secteurs peu polluants ? Comment les travailleuses et les travailleurs seront-ils impliqués dans les choix gouvernementaux ?
Encourager la participation dans la gestion des impacts est pour le moins timide ; la question est celle d'assurer non seulement la participation, mais aussi la prépondérance des travailleurs et travailleuses.
Amendements et ajouts
Pour Québec solidaire, cela passera par la proposition de créer des conseils régionaux de planification démocratique, où siégeront côte à côte des élu-es, des syndicats, des collectifs écologistes et des associations citoyennes et communautaires. Ces conseils doivent être ouverts, transparents et redevables devant la population. Les grandes orientations économiques, énergétiques et sociales doivent être débattues publiquement et tranchées collectivement. Les assemblées citoyennes locales, les budgets participatifs et le droit de référendum sur les projets destructeurs sont des outils indispensables pour briser l'opacité du pouvoir et donner une voix directe au peuple.
Québec solidaire soutiendra que les travailleuses et travailleurs doivent occuper une place centrale dans ce processus. Eux seuls connaissent la réalité des emplois, les conditions de travail et les besoins de reconversion. Ils doivent avoir un droit de regard sur chaque projet régional, notamment dans les secteurs stratégiques, comme l'énergie, le transport, la forêt, l'agriculture ou l'industrie.
Enfin, pour éviter que ce processus ne soit confisqué par les institutions, il faut mettre en place des observatoires citoyens et syndicaux chargés de surveiller la mise en œuvre des décisions et de forcer les autorités à rendre des comptes régulièrement. Les bilans doivent être publics, débattus et rectifiés collectivement.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
La protection des travailleuses et des travailleurs ne peut se contenter d'un encouragement à la participation. Cette protection ne peut être assurée que par un processus de démocratisation économique qui ne doit pas s'arrêter à la porte des entreprises ou des institutions publiques.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Soutien aux municipalités dans la transition écologique
1.5 (1.2.4) Soutenir les municipalités dans la transition écologique
Un gouvernement solidaire soutiendra adéquatement les municipalités dans la mise en œuvre de la transition socioécologique. Il donnera aux régions les moyens d'organiser leur développement économique et la socialisation. Un gouvernement solidaire confiera à de nouveaux conseils régionaux la planification de la transition socioécologique.
Critiques
Le soutien adéquat, cela ne signifie rien de précis. Le moyen d'organiser la mise en œuvre de la transition n'est pas non plus définie. Il s'ensuit que l'on en reste à un discours sans ancrage dans le réel.
Amendements et ajouts
Il faudra assurer le transfert du budget de l'État vers les municipalités, instaurer la mise en place de budgets participatifs et instaurer un fond de solidarité inter municipalités.
Arguments en faveur de l'Amendement
Les propositions avancées ne sont pas uniquement conditionnées à une éventuelle prise du pouvoir par Québec solidaire. Elles peuvent favoriser les mobilisations citoyennes pour remettre en cause le contrôle bureaucratique et étatique de l'état sur les municipalités tel que le prévoit la loi actuelle.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Encadrer le commerce le libre échange et le financement
1.6 (1.2.5) Encadrer le commerce, le libre-échange et le financement
Un gouvernement de Québec solidaire imposera des obligations environnementales, sociales et de gouvernance renforcée pour les entreprises québécoises à l'étranger. Les organismes publics devront respecter les mêmes normes.
Critiques
La question du commerce et du libre-échange ne saurait concerner que les seuls investissements étrangers des entreprises québécoises. Ce qui est en jeu avec la finance, c'est la capacité de financer les investissements publics permettant une véritable transition socioécologique.
Amendements et ajouts
Il est nécessaire de dénoncer les traités qui portent atteinte à la souveraineté démocratique et aux droits sociaux et environnementaux, notamment l' Accord Canada–États-Unis–Mexique, l'Accord économique et commercial global, et le Partenariat transpacifique global. Il faut exclure explicitement les services publics et la culture des clauses de libéralisation et d'investissement, et abolir les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, qui favorisent injustement les multinationales au détriment des intérêts collectifs.
Pour encadrer les entreprises québécoises à l'étranger, une loi sur la responsabilité extraterritoriale doit être adoptée, obligeant les entreprises et investisseurs publics québécois à respecter des normes rigoureuses en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Pour refonder nos rapports à la finance mondiale, il convient d'instaurer une taxe sur les transactions financières (TTF) ainsi que sur les profits bancaires, d'interdire toute relation avec des paradis fiscaux officiellement reconnus et d'imposer la transparence bancaire, notamment par la levée du secret bancaire. Par ailleurs, les produits financiers spéculatifs nuisibles doivent être interdits afin de réduire les risques systémiques et la financiarisation de l'économie.
Québec solidaire doit appeler à la socialisation des banques et des assurances.
Bloc 2 : Habitation, énergie, ressources naturelles et travail
Habitation
Résumé des propositions soumises à la discussion
2.1 (1.3.1.2) Réguler et bâtir habitations et logements (2,3,4,5) Un gouvernement de Québec solidaire s'attaquera frontalement aux spéculateurs, élargira et durcira l'éventail des sanctions. Les projets publics et privés de construction et de rénovation devront obéir à des normes écologiques. Les projets immobiliers devront répondre aux besoins de proximité des services publics afin de résoudre les problèmes liés à l'étalement urbain. Le secteur privé devra consacrer un pourcentage minimal des nouvelles habitations aux logements sociaux. Les Cégeps et universités devront offrir des lieux de résidences à prix modiques. Un gouvernement solidaire renforcera de manière drastique le rôle de l'État dans la construction et la gestion du parc public de logements. Il protégera le parc locatif et l'accès à la propriété individuelle et collective. Il prendra des mesures pour éviter que des personnes consacrent plus que 30% de leur revenu à leur loyer.
Critiques
Les propositions concernant l'habitation sont précises et répondent aux problématiques en matière d'habitation. Il reste qu'elles s'inscrivent essentiellement dans la conception du programme où tout n'est que le résultat de l'action d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire.
Amendements et ajouts
Les actions citoyennes sont essentielles pour renforcer les droits et remettre les décisions entre les mains des collectivités. Québec solidaire soutiendra les initiatives visant la mise en place d'assemblées citoyennes régionales qui pourront encadrer les grands projets et permettre une véritable planification citoyenne de la gestion des milieux de vie. Les communautés devront bénéficier d'un droit d'achat préférentiel lors des ventes de terrains ou d'immeubles stratégiques. Les actions citoyennes et de différents mouvements sociaux aideront à garantir l'inclusion systématique des Premiers Peuples dans tous les processus décisionnels liés au territoire. Des Conseils d'aménagement territoriaux régionaux seront mis en place, composés d'élu-es, de citoyen-nes, d'organismes locaux, d'organisations syndicales et communautaires ainsi que de représentant-es autochtones pour élaborer démocratiquement des plans d'aménagement régionaux.
Énergie :
2.2.(1.3.2) Pour la conservation de notre eau et de notre énergie
Résumé des propositions soumises à la discussion
Québec solidaire s'oppose à la construction de tout nouveau pipeline. La collectivité, ce qui inclus les salarié-es et citoyen-nes et les Premières nations, doivent établir démocratiquement la stratégie de l'État Québécois. Il est urgent de lancer un vaste chantier pour accroître la production d'énergies renouvelables et non polluantes – solaire, géothermique et éolienne. Un gouvernement de Québec solidaire donnera les pleins pouvoirs d'étude et de recommandations au BAPE avant tout nouveau projet de développement hydroélectrique. Il stoppera les projets de développement énergétique qui ne sont pas responsables et durables sur le plan écologique. Il instaurera un programme d'efficacité énergétique comprenant la réduction d'énergie dans les milieux domestiques, du secteur public et des transports, la rénovation écologique des bâtiments et le resserrement des normes…
Critiques
Ici encore, les revendications et actions proposées par le projet de programme se limitent à décrire l'intervention gouvernementale. Les acteurs et actrices et les mobilisations qu'ils ou elles pourraient entreprendre pour transformer maintenant la situation ne sont pas envisagés… Il faut ajouter cette dimension.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra la mise en place d'une planification écologique et démocratique qui réponde de manière résiliente aux besoins énergétiques de la population aux échelles locales, régionales et nationales, et qui donne un rôle primordial et décisionnel aux travailleuses et travailleurs concerné-es dans la gestion des ressources énergétiques. Il soutiendra les municipalités dans le développement et la gestion des microréseaux intelligents énergétiques adaptés à leurs besoins et se mobilisera avec les militant-es écologises pour refuser la relance de la filière nucléaire, y compris l'exploitation de l'uranium.
Arguments en faveur des ajouts
Ces ajouts visent à enrichir le programme au niveau de la démocratisation et la socialisation de ces propositions dans une démarche basée sur les mobilisations citoyennes et de différents acteurs sociaux.
Ressources naturelles
2.3 (1.3.5.2) Pour des pêcheries à l'échelle humaine.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire inclura le milieu des pêcheries dans sa stratégie agroalimentaire afin de diminuer notre dépendance aux marchés internationaux, garantira la traçabilité, créera des chaînes d'approvisionnement locales, commercialisera les produits locaux partout au Québec et développera une aquaculture durable. Un gouvernement de Québec solidaire soutiendra la concertation élargie des actrices et acteurs de l'industrie des pêches en incluant les peuples autochtones et en respectant les droits ancestraux. Il repensera aussi le modèle actuel d'attribution des permis et quotas pour favoriser les pêcheurs et pêcheuses ancrées dans nos communautés.
Critiques
Les revendications et actions proposées par le projet de programme se limitent à décrire l'intervention gouvernementale. Les acteurs et actrices et les mobilisations qu'ils pourraient entreprendre pour transformer maintenant la situation ne sont pas envisagés… Il faudrait ajouter cette dimension.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra les revendications et les moyens d'action des pêcheurs et pêcheuses du Québec qui visent à assurer la viabilité économique de leur métier et la protection durable des ressources halieutiques. Cela passe par des luttes (manifestations, grève de pêches, pressions politiques sur les autorités) pour un accès équitable aux quotas de pêche, en s'opposant à leur concentration entre les mains de grandes compagnies ou d'investisseurs financiers.
Québec solidaire contribue à favoriser des alliances avec ces travailleurs et travailleuses pour améliorer leur rapport de force.
Québec solidaire appuiera la collaboration des artisan-es avec les communautés autochtones et les chercheur-euses, ainsi que les expérimentations locales de quotas collectifs autogérés, afin de mieux équilibrer exploitation et préservation. et soutiendra les initiatives des pêcheur-euses pour la protection des stocks halieutiques et leur implication dans des partenariats scientifiques pour assurer un suivi régulier des stocks.
Québec solidaire joindra sa voix à leurs revendications et à leurs actions en alliances avec les organisations environnementales pour la protection des habitats marins menacés par la pollution, le chalutage de fond et la destruction des écosystèmes.
Arguments en faveur des ajouts
On ne peut concevoir le passage à des pêcheries à l'échelle humaine en excluant les acteurs et les actrices de cette industrie, en ne disant rien sur leurs revendications actuelles et sur leurs actions et sur la nécessité pour Québec solidaire de s'impliquer en soutien avec les luttes pour leur reprise de contrôle sur les pêcheries, la protection des ressources halieutiques et la protection des milieux marins.
2.4 (1.3.5.3) Pour des mines et des forets gérées responsablement (3)
2.5 (1.3.5.3) Pour des mines et des forêts gérées responsablement(4)
2.5 (1.3.5.3) Pour des mines et des forêts gérées responsablement (6)
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire placera l'industrie minière sous une étroite surveillance, en nationalisant au besoin certains minéraux stratégiques. Il élaborera une nouvelle loi sur les mines suivant une consultation populaire. Il mettra en place un système de redevance pour les entreprises exploitant les ressources naturelles afin d'encourager l'utilisation de ressources renouvelables en s'assurant que les ressources soient équitablement réparties – entre les régions, les Premières Nations et l'État québécois. Il garantira que la restauration complète des sites miniers soit assumée par les entreprises minières..
Un gouvernement de Québec solidaire adoptera une stratégie de gestion durable et d'adaptation de la foresterie aux changements climatiques, en collaboration avec les communautés touchées, particulièrement les Premières Nations et les Inuit, l'industrie et les travailleurs et travailleuses.
Un gouvernement de Québec solidaire en coopération avec les Premières Nations et les Inuit renouvellera le secteur forestier en surveillant et évaluant en continu les entreprises publiques et privées ou coopératives à partir de critères socio-économiques. Il élaborera des politiques publiques favorisant une plus grande utilisation de produits du bois provenant d'une exploitation durable.
Critiques
Il faut préciser ce que fera Québec solidaire comme parti, d'ici à ce qu'il soit au pouvoir.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra les actions citoyennes pour la démocratisation de la gestion des ressources naturelles et leur appropriation collective.
Québec solidaire encouragera la création et l'animation d'assemblées citoyennes dans les régions ressources afin de débattre de la gestion locale des mines et des forêts. Il favorisera des initiatives de consultation populaires, comme des référendums citoyens sur des projets contestés. Il défendra non seulement la nationalisation des ressources stratégiques, mais plaidera en faveur de leur socialisation ou la coopérativisation et soutiendra des campagnes publiques en faveur de la socialisation des entreprises exploitant des minéraux stratégiques et des grandes entreprises forestières.
Il soutiendra les luttes autochtones pour la protection du territoire par sa présence sur le terrain, ainsi qu'un appui juridique et médiatique.
Québec solidaire appuiera la mise en place d'institutions du pouvoir populaire, comme la création de comités de veille citoyenne sur les processus de consultation et d'évaluation environnementale. Il appuiera la mise en place de commissions de vigilance citoyenne semblables à des « sentinelles écologiques » qui pourraient documenter les atteintes au territoire. Québec solidaire favorisera enfin la création de tables de solidarité autochtone-allochtones locales pour favoriser le dialogue et la mise en œuvre concrète d'une cogestion territoriale démocratique.
Arguments en faveur des ajouts
Cet ajout, vise à enrichir le programme afin qu'il ne les limite pas à une description d'une éventuelle politique gouvernementale. Il s'agit ici encore d'ancrer le programme, et par le fait même Québec solidaire, comme acteur des luttes qui se mènent actuellement et qui visent à renforcer le pouvoir populaire.
Droit des travailleuses et des travailleurs
2.7 (1.4.2) Pour la syndicalisation des milieux de travail sains (1)
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire reverra le rapport de force entre employeurs et salarié-es et améliorera leurs conditions de vie. Il prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses puissent se syndiquer et exercer leurs droits syndicaux. Il inscrira le droit de grève dans la Charte des droits et libertés de la personne et interdira les lockout. Il révisera en profondeur la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il veillera à leur respect pour protéger l'ensemble des travailleuses et travailleurs, incluant les temporaires.
Critiques
Ce sont là des revendications justes pour améliorer les conditions de travail, de vie et d'organisations des travailleuses et des travailleurs, mais ces transformations sont reportées à une éventuelle prise de pouvoir par Québec solidaire. Pourtant, face à l'offensive néolibérale et la montée de l'extrême droite et le tournant autoritaire et antisyndical des gouvernements, il y a des tâches pour un parti politique qui ne peut être remis à plus tard. Le programme de Québec solidaire ne peut passer sous silence les tâches qui découlent de cette situation. Le programme du parti doit donc préciser le travail qui doit être fait maintenant pour contribuer à renforcer le rapport de force en sa faveur et pour contrer l'offensive du patronat et des gouvernements à son service.
Amendements et ajouts
Le mouvement syndical québécois est confronté à une offensive patronale et gouvernementale sans précédent, il doit répondre à des défis majeurs : restriction des droits syndicaux, précarisation du travail, privatisation des services publics, explosion des inégalités et crise écologique. La fragmentation du salariat – marquée par la multiplication des emplois temporaires, de l'économie de plateforme et du travail ubérisé – rend l'organisation collective plus difficile, tandis que l'austérité et les PPP grugent nos services essentiels.
Face à ces défis, le mouvement syndical québécois revendique des hausses salariales substantielles, indexées au coût de la vie et la pleine reconnaissance des droits syndicaux dans tous les secteurs. Il exige un réinvestissement massif dans la santé, l'éducation et les services sociaux, ainsi que la construction de logements sociaux accessibles. Dans le contexte de la crise climatique, il met de l'avant la nécessité d'une transition juste : reconvertir les emplois polluants en emplois verts et socialement utiles, développer massivement le transport collectif et reprendre démocratiquement le contrôle des secteurs stratégiques, comme l'énergie, les mines ou le numérique.
Québec solidaire doit soutenir activement les luttes du mouvement syndical pour ces revendications et les défendre sur toutes les tribunes. Cela implique de renforcer la mobilisation de son secteur de travailleurs et travailleuses syndiqués afin de favoriser la mobilisation de l'ensemble de ses membres et de son soutien populaire dans ces combats.
Québec solidaire doit contribuer à construire des alliances solides entre le mouvement syndical et différents secteurs de la société (mouvement étudiant, mouvement féministe, mouvement écologique, mouvement communautaire, mouvement anti-raciste et autochtone), afin de créer un véritable front populaire dans lequel le mouvement syndical est appelé à jouer un rôle essentiel.
Arguments en faveur des ajouts
Si une gestion gouvernementale de gauche apporterait un renforcement essentiel à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, le soutien à la défense de ces droits ne sauraient être reporté à l'éventuelle prise du pouvoir par Québec solidaire. C'est pourquoi il faut que le programme décrive les buts et les formes de l'implication de Québec solidaire dans ce combat.
Intelligence artificielle
2.8 Pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire instaurera un cadre réglementaire concernant les technologies basées sur les principes de transparence, de transition socioécologique, de respect de l'identité et de la culture québécoise et de respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteurs. Il créera un filet de sécurité pour les travailleurs et travailleuses touchées par l'automatisation. Il exigera une étude d'impact éthique et sociale pour tout déploiement de l'intelligence artificielle dans les services publics. Il s'assurera que la mise en place d'infrastructures numériques se fasse de façon écoresponsable.
Critiques
Ici comme ailleurs, ce sont des propositions importantes, mais elles remettent l'initiative à un éventuel gouvernement de Québec solidaire et à son pouvoir de gestion. Pourtant des acteurs et actrices (syndicats, écologistes, pacifistes, scientifiques) agissent déjà sur le terrain pour contrer les effets négatifs que provoquent déjà la généralisation de l'IA sous l'initiative des grands patrons de la Silicon Valley. Il est donc important que QS se mobilise en alliance avec ces acteurs et actrices pour participer aux combats en cours. Le programme du parti doit refléter cette volonté.
Amendements et ajouts
Face à la généralisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les milieux de travail, d'étude et de vie quotidienne, différents acteurs sociaux formulent actuellement des revendications et mettent en œuvre des moyens d'action pour en encadrer l'usage et en réduire les effets négatifs. Québec solidaire doivent soutenir les actions des syndicats qui exigent que l'automatisation ne soit pas synonyme de licenciements massifs et qui demandent que l'introduction de l'IA permette la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire.
Québec solidaire soutiendra les revendications des salarié-es qui dénoncent l'utilisation de l'IA visant à renforcer leur surveillance ou à dégrader leur dignité au travail. Québec solidaire se joindra aux campagnes publiques des syndicats visant à dénoncer la surveillance algorithmique ou les suppressions de postes. Québec soutiendra les luttes pour l'imposition de normes communes pour protéger les salarié-es.
Québec solidaire sera partie prenante des actions des militant-es écologistes, qui soulignent l'empreinte écologique et matérielle de l'IA et dénoncent la consommation colossale d'énergie des centres de données et l'extraction de métaux rares nécessaires à son déploiement. QS défendra avec les organisations environnementales les choix technologiques des citoyens-nes et les communautés. QS participera aux campagnes de sensibilisation et aux actions militantes des écologistes pour bloquer l'arbitraire des dirigeants de la tech.
Québec solidaire reprendra à son compte les critiques des scientifiques qui revendiquent un accès public aux codes et aux bases de données, ainsi qu'une évaluation indépendante des impacts sociaux et environnementaux de l'IA. Ils exigent que certaines applications soient interdites, notamment les armes autonomes, les systèmes de notation sociale ou les dispositifs de manipulation politique de masse.
Québec solidaire s'impliquera dans les combats pour refuser que l'IA soit abandonnée au seul pouvoir des grandes entreprises et des gouvernements et pour la soumettre à un contrôle démocratique, transparent et citoyen.
Arguments en faveur des ajouts
En amont d'une éventuelle gestion gouvernementale par Québec solidaire de l'intelligence artificielle, le programme de Québec solidaire, comme parti des urnes et de la rue, doit baliser l'intervention du parti autour de ces enjeux.
Conclusion : les réels enjeux du débat programmatique à Québec solidaire
Le débat sur le programme à Québec solidaire a pour une grande part été présenté comme ayant pour objectif de le rendre plus pédagogique et accessible pour la majorité de la population. En fait, l'ébauche du programme met de côté les engagements politiques liés aux mouvements sociaux et présente essentiellement les politiques d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire.
L'enjeu de ce débat est donc, essentiellement, soit de définir le programme comme un plan de gestion d'un gouvernement en attente (ce qui nous est proposé dans le Cahier de propositions), soit comme celui d'un parti des urnes et de la rue qui avance, bien sûr, les orientations d'un gouvernement solidaire, mais qui propose surtout des mesures articulées aux luttes en cours afin d'enraciner le parti dans les mouvements sociaux et de faire du programme un outil de lutte s'adressant à la majorité populaire et à ses organisations : syndicats, groupes féministes, écologistes, étudiants, communautaires et autochtones.
Le programme devient alors une boussole pour la mobilisation et la construction du pouvoir populaire. Les amendements et ajouts proposés ne sont que des pistes pour réinscrire dans le programme une véritable démarche d'un parti des urnes et de la rue.
Je suis « pauvre conne »
Des groupes dénoncent un projet de loi 33 « carcéral » de Doug Ford
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











