Derniers articles
La Palestine, notre avenir – un Forum social Maghreb-Machrek
Amazon en guerre avec le Code du Travail après l’accréditation d’un syndicat à Laval
Préserver la presse locale
« Les structures fondamentales des sociétés humaines » de B. Lahire
Déculotter les idées fausses
Les sionistes et les pro-israéliens nous servent toujours des arguments similaires pour justifier leur position et dénigrer leurs opposants, au point que c'en est lassant de devoir les démonter sans cesse. Au pire, ces idées reçues tiennent de l'imposture intellectuelle, au mieux de demi-vérités ou de demi-mensonges, choisissez.
Commençons par le premier argument le plus répandu et qui a le plus longtemps prévalu, celui d'Israël comme seule démocratie au Proche-Orient. Formellement, c'est vrai. Le but des fondateurs de l'État hébreu consistait à fournir enfin une patrie aux Juifs et Juives persécutés, coiffée d'un régime libéralo-électoral. Mais pour ce faire, ils ont délogé de force une bonne partie de la population d'origine arabe établie là depuis toujours. Ils l'ont ainsi transformée en peuple exilé dans les pays voisins. Que ces gens-là et leurs descendants veuillent récupérer les terres dont ils ont été chassés et y reprendre leur place est légitime et se comprend très bien. Ça n'a rien à voir avec de "l'antisémitisme" comme certains partisans de l'État d'Israël l'affirment de manière plus ou moins détournée. Les Palestiniens refusent d'acquitter la facture de l'Holocauste. Ils n'ont rien contre les Juifs en soi mais ils prennent légitimement les armes contre les gens qui les ont dépossédés en 1947-1948 ; ceux de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, conquis par Israël en 1967, font pareil. Tous en ont contre la colonisation israélienne qui y étend ses tentacules chaque jour davantage.
On pointe ensuite l'extrémisme de certaines organisations de résistance palestinienne (le Hamas et le Hezbollah), tout comme on a démonisé autrefois l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), présidée par Yasser Arafat. Il serait impossible de négocier avec ces groupes "pas parlables". L'OLP a finalement accédé pour l'essentiel aux exigences américaines lors des Accords d'Oslo conclus en septembre1993 dans un contexte de semi-capitulation palestinienne, notamment en reconnaissant, selon la formule éculée, "le droit d'Israël à l'existence", ce qui équivalait à renoncer aux territoires confisqués par les sionistes en 1947-1948. Mais pour faire court, la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est s'est poursuivie d'abord au ralenti, puis s'est accélérée après l'arrivée au pouvoir en 2009 de Benjamin Netanyahou. La politique expansionniste israélienne et le blocage du processus de paix qui s'en est ensuivi a discrédité auprès de la population palestinienne les modérés et renforcé les "extrémistes". Avec les résultats que l'on connaît...
En réalité, beaucoup des pro-israéliens soutiennent avant tout le nationalisme israélien, mais ils sont trop hypocrites pour en convenir. Pour se justifier, ils dénigrent les régimes politiques arabes qui entourent Israël, lequel formerait par comparaison une oasis démocratique.
Mais il faut admettre que les notions de liberté et de bonheur sont relatives, variant dans le temps et l'espace ; tout dépend des critères que l'on utilise pour les définir. Oui, Israël est un État démocratique, mais qui s'est édifié sur les ruines de l'ancienne Palestine arabe. Dans ce contexte, comment les Palestiniens pourraient-ils accepter une paix avec Israël qui ressemblerait à une capitulation ? Encore une autre...
D'ailleurs, en matière de politique étrangère, plusieurs pays occidentaux n'ont pas de leçons à donner aux Arabes. Le colonialisme européen notamment a pesé lourd sur ce qu'aujourd'hui on nomme le Tiers-Monde. Un impérialisme économique, commercial et parfois militaire y a de nos jours succédé, ce qui devrait interdire aux dirigeants occidentaux de prétendre donner des leçons de liberté aux sociétés arabes.
Que cela plaise ou non, les organisations vues comme extrémistes et intraitables forment un des visages de la résistance palestinienne ; les tenir à l'écart équivaut à empêcher tout un pan de la population palestinienne de participer aux futures négociations de paix (qui finiront bien par venir un jour). Il existe une vérité fondamentale en politique, tant étrangère qu'intérieure : on ne choisit pas ses interlocuteurs. Ils sont là et il faut s'en accommoder. On doit donc laisser les Palestiniens et Palestiniennes choisir librement leurs représentants qui participeront aux négociations de paix.
Le problème majeur réside dans le fait que la plupart des classes politiques occidentales et au premier chef l'américaine, traditionnelle protectrice de l'État hébreu tentent depuis des décennies d'imposer au peuple palestinien une paix à rabais. Cette politique contraste avec l'infinie complaisance qu'elles démontrent envers leur protégé israélien. Cette complaisance, à sa face même constitue une bonne partie du problème, mais elle commence peut-être à se fissurer.
Pour conclure, nous ne sommes pas en présence d'une lutte entre la démocratie israélienne et l'autoritarisme palestinien, mais entre l'expansionnisme israélien et la volonté d'émancipation d'un peuple dépossédé.
Jean-François Delisle

Établissement d’un nouveau campement Pro-Palestine à l’UQAM ;

Après les universités de McGill, d'Ottawa et de Toronto, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) se joint
au mouvement étudiant international en solidarité à la lutte du peuple palestinien contre l'apartheid, le
génocide et la violence coloniale d'Israël.
Implanté au Cœur des sciences de l'UQAM à l'approche de la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba palestinienne, l'Université Populaire Al-Aqsa (UPA-UQAM), exige le retrait de l'injonction contre le campement de McGill et dénonce toute tentative de judiciarisation de la lutte pour la Palestine, l'implantation d'un boycott académique contre l'entité génocidaire israélienne, à l'UQAM comme au sein du réseau universitaire québécois contre l'entité génocidaire israélienne, la divulgation publique de toutes les collaborations et liens avec Israël, l'abolition du bureau Québec-Israël ainsi que l'abrogation de toutes ententes interétatiques ou inter-institutionnelles avec Israël.
"Alors que les forces d'occupation intensifient leur agression meurtrière contre Rafah, nous, étudiant·es et travailleur·euses, refusons de garder le silence face à l'apartheid, le génocide et les crimes coloniaux de l'État d'Israël", explique Leila Khaled, porte-parole de l'UPA-UQAM. "Nous nous adressons à l'UQAM, mais également à l'État québécois et l'État canadien pour qu'ils prennent des actions pour mettre fin à leur collaboration et leur complicité avec l'État voyou."
Les militant·es n'entendent pas quitter le campement de l'UQAM tant que leurs demandes ne seront pas satisfaites et encouragent l'implantation de campements similaires sur les autres campus universitaires et collégiaux du Canada.
L'intifada étudiante ne fait que commencer
Lancé à l'Université de Columbia, un mouvement étudiant combatif, d'une ampleur sans précédent, secoue les universités du monde, surtout en Amérique du Nord et en Europe. La vague d'occupation atteint désormais plus de 145 universités. Le 27 avril 2024, cet élan de solidarité et de libération s'est propagé jusqu'à Tiohtià:ke (Montréal) avec la mise en place d'une zone libre à McGill, soutenue par la communauté étudiante de l'Université Concordia et de l'UQAM. Depuis, neuf autres camps ont été érigés sur les campus d'universités canadiennes. On en compte maintenant un de plus.
L'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM
Les étudiants militants du campement de l'UQAM ont choisi de le nommer "Université Populaire Al-Aqsa de l'UQAM" afin de rendre hommage à l'une des 12 universités de la bande de Gaza détruites par « l'éducide » commis par Israël, soit la destruction organisée et systématique du système éducatif et universitaire palestinien. Trois présidents et près de 100 doyen·nes et professeur·es ont été tué·es lors des plus récentes agressions sionistes. Plus de 3/4 de toutes les infrastructures scolaires et académiques de l'enclave ont été endommagées ou sont complètement détruites au début du mois de janvier, selon l'ONU.
En solidarité avec le camp de McGill
L'occupation du Coeur des sciences de l'UQAM exige aussi le retrait immédiat de l'injonction contre le campement de McGill. Nous exprimons notre solidarité inconditionnelle avec leurs revendications et condamnons catégoriquement toute forme de judiciarisation de la lutte pour la Palestine. Le campement perdurera tant et aussi longtemps que les militant·es de McGill et de Concordia n'auront pas obtenu ce qu'iels exigent depuis des années. Pour l'UPA-UQAM, il est impératif que le Comité des investissements de Concordia (Concordia Investment Committee) et le Conseil d'administration de McGill (Board of governors) divulguent le montant des investissements dans les entreprises complices. McGill et Concordia doivent immédiatement retirer les dizaines de millions de dollars qu'elles ont investi dans des entreprises complices du colonialisme israélien.
Bloquons la militarisation du savoir
L'UPA-UQAM exige l'adoption immédiate au sein de l'UQAM et dans l'ensemble du réseau universitaire québécois, d'une politique de boycott académique vis-à-vis des universités israéliennes participant à la colonisation de la Palestine. Nous soutenons que les universités israéliennes sont des complices majeurs du régime israélien d'occupation, de colonisation et d'apartheid. Ces dernières jouent un rôle clé dans le développement de systèmes d'armes et de doctrines militaires, dans la justification de la colonisation en cours des terres palestiniennes, dans la rationalisation des crimes contre l'humanité commis à l'égard de la population palestinienne, dans la justification morale des exécutions extrajudiciaires et dans d'autres violations implicites et explicites des droits de la personne et du droit international. Nous exigeons également de l'UQAM la pleine divulgation publique de toutes ses collaborations et liens avec Israël. "Il est inacceptable que le Québec, par ces ententes inter-universitaires, permettent à des étudiants, des étudiantes et à des chercheurs et des chercheuses de contribuer à de tels crimes contre l'humanité", affirme Leila Khaled.
Abolition du bureau Québec-Israël
L'UPA-UQAM défend que le bureau diplomatique que le gouvernement québécois projette de développer en Israël doit simplement être aboli. Accroître les relations commerciales et la coopération diplomatique avec Israël ne fera que légitimer et contribuer au nettoyage ethnique du peuple palestinien. Nous exigeons également l'abrogation de toutes ententes interétatiques ou interinstitutionnelles avec Israël. Intensifions la lutte dans tous les recoins de l'Empire par tous les moyens possibles ! Paralysons le système aussi longtemps qu'il sera nécessaire.
Depuis les terres non cédées du soi-disant Québec, nous appelons tous les cégeps et universités de la province à se soulever et à exiger le boycott académique d'Israël et l'abolition du bureau Québec-Israël. Solidarité avec le camp de l'université McGill !
Palestine libre ! Intifada jusqu'à la victoire !
« La lutte palestinienne a été et demeura toujours une source d'inspiration pour nos propres
luttes, nous guidant ainsi vers notre libération collective »
النضال الفلسطيني كان وسيبقى النضال الذي نقتدي به، وسيحررنا جميعا
Solidarité pour les droits Humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHPP) basé à l'UQAM sdhpp.uqam@gmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La ville gagnante
Éditorial
Chères lectrices,
chers lecteurs,
Bien que l’élection de Gustavo Petro en Colombie et le retour de Lula da Silva au Brésil ont pu laisser présager un virage à gauche en Amérique latine, l’année 2023 a mis fin à cette illusion. C’est plutôt la tendance au « dégagisme » des élites qui persiste, favorisant l’accession au pouvoir de politiciens « anti-establishment » de droite tels que Daniel Noboa en Équateur, Santiago Peña au Paraguay et Javier Milei en Argentine. L’élection de Bernardo Arévalo au Guatemala, autoproclamé « social-démocrate », confirme la tendance au rejet des figures politiques traditionnelles.
L’année dernière a été marquée par d’importantes confrontations sociales et politiques. Dès janvier, des manifestations ont éclaté contre le gouvernement de Dina Boluarte au Pérou et ont été réprimées sévèrement par les forces de l’ordre. Au Panama, des activistes se sont mobilisés contre le renouvellement d’un contrat d’exploitation minière accordé par le gouvernement à une entreprise canadienne, First Quantum Minerals (Minera Panamá S.A.). Au Guatemala, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer la démission de hauts responsables tentant d’annuler les résultats des élections présidentielles. L’Argentine a également été secouée par des tensions après l’élection du président ultralibéral Javier Milei en novembre, avec une manifestation majeure organisée par le principal syndicat de travailleurs et travailleuses.
Ces mobilisations ont en commun le rejet des classes politiques au pouvoir, tenues responsables de la corruption et de l’insécurité, à l’origine des problèmes économiques et sociaux. C’est dans ce contexte que des figures politiques marginales, le plus souvent sans le soutien d’une infrastructure politique, ont réussi à défier l’hégémonie de partis traditionnels. Plusieurs de ces nouveaux et nouvelles dirigeant·e·s ont fait campagne sur les valeurs de l’ordre, de l’autorité et de la nécessité de combattre le narcotrafic et la criminalité. Mais cette dérive autoritaire préoccupe. En effet, l’Amérique latine a connu la plus forte régression démocratique de toutes les régions depuis le début du siècle.
Face à cette dérive vers l’autoritarisme en Amérique latine et dans les Caraïbes, les réponses sociales qui en émergent et qui se transforment portent sur la résistance, la défense et la reconquête des espaces démocratiques. Dans ce premier numéro du volume 38 de la revue Caminando, différents points de vue nous informent sur le rôle, l’impact, mais aussi les défis des différentes formes de résistance face à l’autoritarisme.
Nous nous penchons sur l’Argentine, qui se retrouve au cœur des débats actuels sur la démocratie et la gouvernance depuis l’élection de Milei. Silva Avalos fait des parallèles dans son article entre ce dernier et le président salvadorien Nayib Bukele, soulignant leur tendance à concentrer le pouvoir et à rejeter des principes démocratiques. L’entrevue avec Dario Aranda, chercheur et journaliste argentin, souligne quant à elle les racines de l’ascension de Milei dans une démocratie défaillante, mettant en évidence les mesures radicales de ce celui-ci qui menacent les droits des peuples autochtones et des communautés paysannes. Puis, le texte de Félix Riopel expose la montée de la droite néolibérale en Argentine, incarnée par Milei, et les défis économiques et sociaux qui en découlent. Ces analyses insistent ainsi sur l’importance d’une résistance continue pour défendre les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux en Argentine.
Longtemps dominé par des régimes autoritaires et soumis à l’influence des pays occidentaux, Haïti se trouve à être aujourd’hui un exemple classique d’État failli. Ce pays est omniprésent dans l’actualité depuis la flambée de violence générée par les gangs armés en mars dernier, après l’évasion massive de détenus ayant contraint le gouvernement à déclarer l’état d’urgence. Ce numéro inclut deux textes sur Haïti, mettant en lumière le rôle de l’histoire néocoloniale, de la présence d’organisations internationales et de la pluralité d’acteurs locaux, entre autres, dans la situation politique actuelle du pays.
Nous examinons aussi dans ce numéro comment la transition démocratique du Chili est encore entachée par les réflexes autoritaires du pinochetisme qui se manifestent notamment lors des mobilisations sociales. Le résultat du plébiscite chilien de 2022 sur le démantèlement de la Constitution mise en place durant la dictature militaire d’Augusto Pinochet fut une défaite importante pour les femmes mapuches, qui continuent de lutter pour leurs droits à travers les mouvements sociaux.
Au Mexique, le zapatisme fait son retour dans les sphères médiatiques et publiques. Le mouvement a récemment annoncé l’adoption de nouvelles formes organisationnelles, tout en maintenant une présence armée dissuasive pour protéger les territoires zapatistes et promouvoir des solutions politiques et pacifiques aux problèmes sociaux et économiques du Chiapas.
Plusieurs articles traitent de problèmes socioéconomiques étroitement liés à l’augmentation de l’insécurité qui contribue à légitimer les dirigeants autoritaires. L’article d’Alexis Legault explore les impacts sociaux et écologiques de la croissance économique, tels que l’accroissement des inégalités socioéconomiques, et propose le rôle crucial d’une éducation à l’engagement écocitoyen. Les thèmes de la migration et des droits des femmes sont aussi abordés ; dans son texte, Gladys Calvopiña rend hommage à Ana Karen, décédée en tentant de traverser la frontière canado-américaine à pied. Le poème inspirant de Mavi Villada, quant à lui, insiste sur l’importance d’unir nos voix et lutter pour que les femmes puissent un jour profiter de la liberté et de leurs droits.
Nous remercions toutes les personnes ayant généreusement contribué de diverses manières à ce numéro : auteurs·trices, illustrateurs·trices, traducteurs·trices, réviseur·e·s, ainsi que les membres du comité éditorial. La magnifique illustration de la couverture de ce numéro a été réalisée par Liana Perez, à qui nous sommes reconnaissantes pour son dévouement et sa créativité. Nous tenons également à remercier tous nos partenaires qui soutiennent financièrement la revue ou nous aident à la promouvoir et à la diffuser.
Nous espérons que ce numéro vous plaira et stimulera votre désir de solidarité envers les peuples et les mouvements sociaux.
Bonne lecture !
The post Éditorial first appeared on Revue Caminando.
Heureuse désobéissance civile
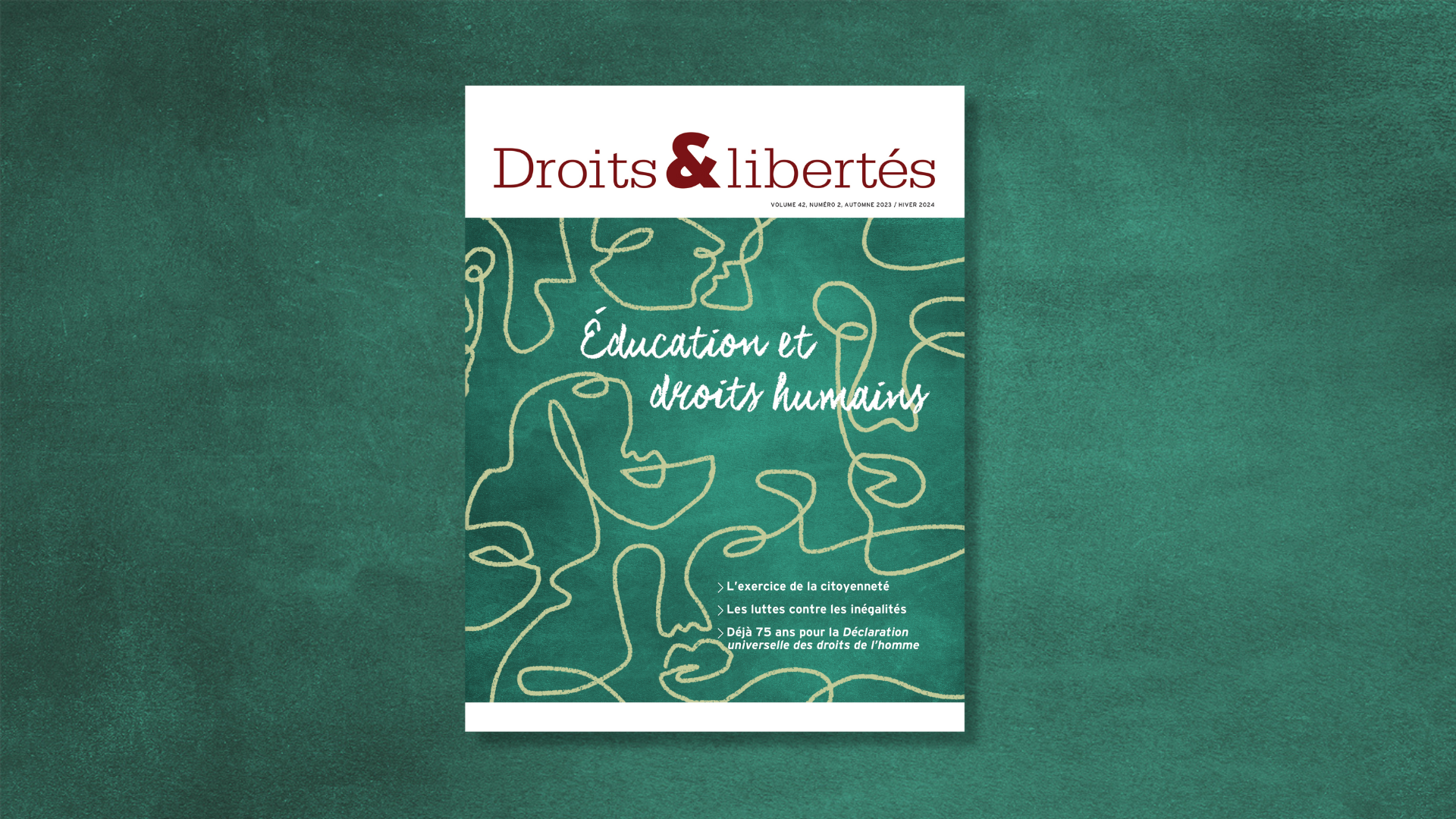
L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative
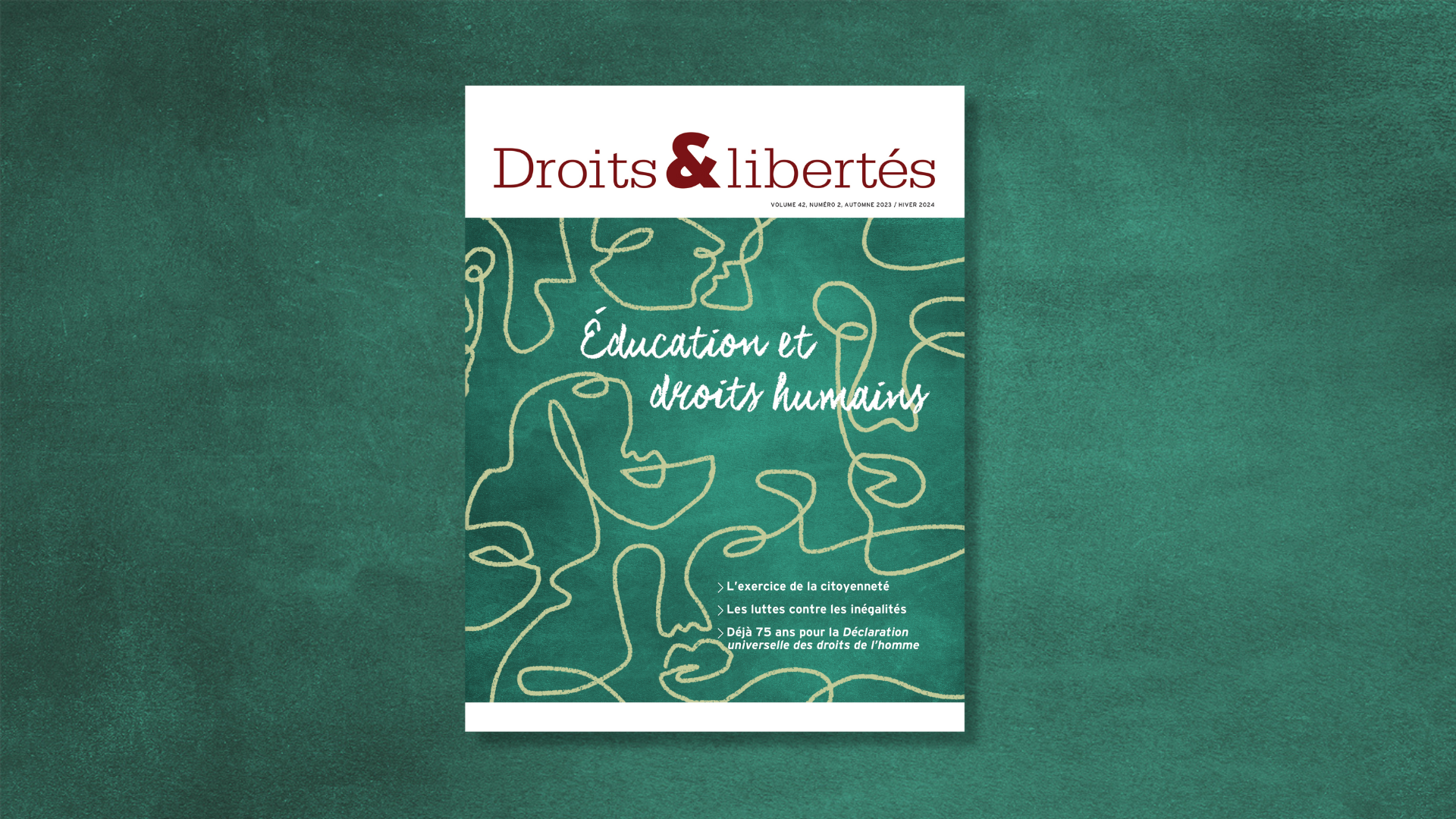
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative
Alexis Legault, étudiant-chercheur en éducation à l’Université de Sherbrooke Ronald Cameron, enseignant à la retraite Les mandats de l’éducation se résument traditionnellement à trois mots clés : instruire, socialiser et qualifier. Ce sont là les grandes missions qui visent à concrétiser que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits1». C’est suivant cette mission que les jeunes des pays occidentaux, mais aussi de plus en plus des pays des Suds sont aujourd’hui scolarisés, comme le souhaitait la Déclaration universelle des droits de l’homme. La valorisation du droit à l’éducation et à son accessibilité universelle a favorisé une participation citoyenne accrue des jeunes générations aux transformations sociales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Néanmoins, progressons-nous vers une société plus égalitaire et plus juste ? L’égalité des chances permet-elle la mobilité sociale ? En dépit d’un certain recul de l’extrême pauvreté dans le monde au cours des années précédant la pandémie, le XXIe siècle est globalement synonyme d’accroissement des inégalités dans des proportions inouïes. Par ailleurs, les capacités des populations adultes de pays pourtant pleinement scolarisées demeurent insuffisantes pour relever les défis contemporains d’une ampleur inédite. Le dernier rapport du Programme pour l’évaluation interna tionale des compétences des adultes (PEICA)2 révélait que la moitié de la population adulte du Québec présente un niveau de littératie ne leur permettant pas de comprendre et d’intégrer des textes denses. Aussi une personne sur cinq présente des niveaux si faibles que leur capacité de participer à la vie en société est entravée. Il s’agit d’une forme d’exclusion au cœur du respect de leurs droits.La faute au système scolaire ?
Beaucoup s’en prennent au système scolaire. Et il est vrai qu’il présente d’énormes travers. Entre instruire et qualifier, la fonction de socialiser peine à trouver sa place à l’école. Le développement de l’agir citoyen y occupe un espace limité, coincé entre les matières dites prioritaires, considérées plus neutres et évaluées par des examens ministériels. Les apprentissages sociaux (ex. citoyenneté, environnement, médias), devant en principe s’intégrer dans chacune des matières, ne se retrouvent finalement nulle part, quand ils ne sont pas le théâtre de controverses. Le débat public autour du cours Culture et citoyenneté québécoise, qui a remplacé l’Éthique et culture religieuse, en est un exemple. Il constitue d’ailleurs l’un des seuls refuges pour ces types d’apprentissage citoyen, dans un contexte où la neutralité éducative sert trop souvent d’argument pour limiter l’espace à la réflexion critique, ce qui contribue à favoriser le choix du statu quo du système en place. Cependant, le travers le plus lourd dans un projet d’école émancipatrice et dans la perspective de l’égalité en droit est le choix décomplexé d’un système à trois vitesses. L’écart au sein du système public se creuse entre le niveau scolaire des personnes les plus favorisées et celui des plus vulnérables. La persistance des écoles privées assure encore et toujours l’avantage aux familles qui ont les moyens. Au Québec, on constate d’ailleurs une tendance à l’accroissement de la place du privé3. L’école à trois vitesses ramène un système foncièrement discriminatoire. Il s’agit d’un obstacle majeur au respect du droit à une éducation de qualité pour toutes et tous. Ce droit est concrètement mis en péril par les nombreuses inégalités d’accès offertes aux élèves selon la vitesse à laquelle ils ont accès : services psychosociaux ; personnel de soutien ; installations sportives ; maté riel pédagogique ; sorties culturelles ; activités parascolaires ; etc.Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.En ce sens, ce système constitue un recul majeur, à l’instar de l’accroissement des inégalités sociales auxquelles il contribue. Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.
Pour transformer la société
Même si l’éducation à la citoyenneté devait prendre l’espace qu’elle mérite dans les écoles et qu’elle porte à conséquence sur la jeunesse scolarisée, devons-nous attendre que ces jeunes atteignent l’âge adulte pour changer la société ? Pour relever les défis auxquels font face les populations – enjeux écologiques et climatiques, de justice sociale, de discriminations, de pauvreté, de conditions de vie et de logement, de compétences numériques, d’accès à l’information, de santé publique – pouvons-nous attendre que ces jeunes soient en position d’agir ? L’urgence est maintenant ! Nous avons besoin de mobiliser les jeunes et les adultes dans un projet de transformation sociale. Or, le droit à l’éducation tout au long de la vie subit les mêmes pressions sociales que l’école publique. L’éducation populaire occupe la fonction de socialisation en éducation des adultes. Or, cette mission peine cependant à trouver sa place entre celle d’instruire en formation de base et celle de qualifier en formation liée à l’emploi. Force est de constater que l’éducation populaire est à l’éducation des adultes, ce que cette dernière est au système éducatif : parent pauvre, puisque lentement définancé et invariablement sous-considéré dans les politiques éducatives gouvernementales ! Dans un monde dominé par la diplomation, les compétences et la performance, les parcours non formels en éducation populaire sont perçus comme peu utiles.L’éducation à la citoyenneté en mouvements
Il est vrai que l’explosion des mécanismes d’éducation informelle, surtout avec la révolution technologique, élargit l’accessibilité à des connaissances et favorise le développement des capacités des individus pour agir sur leur vie quotidienne. Toutefois, au-delà du développement culturel personnel, l’éducation populaire de transformation sociale, plus particulièrement dans sa forme contemporaine d’éducation à la citoyenneté, est indissociable de ses dimensions collectives et communautaires.En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire.Les mouvements sociaux et les réseaux qui les réalisent sont des milieux présentant un riche potentiel éducatif, mais dont le sous-financement et la marginalisation restreignent la portée. Le milieu communautaire, mais aussi de nombreuses personnes chercheuses en éducation, appelle depuis des décennies à une meilleure reconnaissance financière et symbolique de ces groupes systématiquement sousfinancés et sous sollicités4. Ce sont ces mouvements qui favorisent le respect des droits humains. En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire5. C’est un exemple du refus du système de soutenir le développement des apprentissages de contestation. C’est aussi le cas des organismes environnementaux, malgré les tentatives de l’école à fournir une éducation environnementale et écocitoyenne. Ils sont très peu mis à contribution, alors que leurs aptitudes éducatives ne sont plus à démontrer6.
Pour qu’un autre monde soit possible
Parmi les écrits les plus célèbres de Paulo Freire, on retrouve ce passage dans La pédagogie des opprimé.es, qui résume bien sa pensée : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul », les êtres humains s’éduquent ensemble7. La pédagogie de l’éducation populaire de conscientisation ne se réalise pas dans un rapport d’extériorité avec la réalité des personnes apprenantes. La connaissance des faits sert à démontrer l’évidence, mais, dissociée des réalités sociales, elle est impuissante à transformer le monde ! Dans l’optique de contrer la montée de l’intolérance et de l’autoritarisme et pour développer un projet social plus égalitaire et inclusif, la contestation sociale s’impose comme nécessaire à l’exercice d’une démocratie susceptible de permettre aux collectivités de transformer la société. Finalement, si l’éducation est émancipatrice, c’est parce qu’elle constitue un terreau à l’exercice de la citoyenneté. Pour Freire, l’éducation populaire de conscientisation permet justement une prise de conscience citoyenne qui fait corps avec l’agir collectif. Elle offre aux personnes les plus démunies des moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer.- Organisation des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, article premier, 1948.
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Perspectives de l’OCDE sur les compétences : premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, Éditions OCDE,
- Anne Plourde, Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?. IRIS , Collectif Debout pour l’école !, Une autre école est possible et nécessaire, Del busso éditeur, 2022.
- Réseau québécois de l’action communautaire autonome, L’action communautaire autonome,
- Conseil supérieur de l’Éducation, L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie,
- Sauvé, H. Asselin, C. Marcoux et J. Robitaille, Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté. Les Éditions du Centr’ERE, 2018.
- Freire, La pédagogie des opprimé·es. Éditions de la rue Dorion, 2021.
L’article L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
Un bouleversement se préparant depuis 200 ans

ENTRETIEN – Autour du Livre 2 du Capital avec Guillaume Fondu
Les Éditions sociales ont publié récemment une réédition du Livre 2 du Capital qui vient avec une traduction rafraîchissante. Archives Révolutionnaires s’est entretenu avec l’un de ses traducteurs, Guillaume Fondu, spécialiste de Marx et de la réception de ses textes économiques chez les marxistes russes et allemands entre 1880 et 1914.

Archives Révolutionnaires : Bonjour Guillaume Fondu. Les Éditions sociales viennent de sortir une nouvelle édition du Livre 2 du Capital (2024). Ce projet s’inscrit dans le projet de la Grande Édition Marx et Engels (GEME) auquel contribuent les Éditions sociales depuis 2003. Avant d’aborder plus directement le contenu et la réception du Livre 2 du Capital, pourrais-tu nous en dire davantage sur ce projet ?
Guillaume Fondu : Bonjour et merci pour la proposition d’entretien ! Il s’agit d’un projet de longue date puisqu’on a commencé à réfléchir à ce volume il y a plus de cinq ans. Deux questions se croisaient au sujet de ce volume. La première a trait aux évolutions générales de la traduction de Marx en France. Depuis les années 1980, l’équipe menée par Jean-Pierre Lefebvre a installé de nouveaux standards en matière de traduction marxienne avec leurs éditions du Livre I du Capital, des Grundrisse, etc. Et il nous semblait qu’en appliquant ces standards, qui consistent notamment à rendre lisible un certain nombre de concepts philosophiques présents dans le texte marxien, au Livre II, c’était l’occasion de faire lire un ouvrage assez mal connu et mal aimé même dans la tradition marxiste, à quelques exceptions près (celle de D. Harvey notamment). En outre, il fallait également utiliser le travail considérable réalisé par les éditeurs allemands de la MEGA2, ce qui est l’un des principes de la GEME. Et c’est ce que nous avons essayé de faire.
AR : On pourrait peut-être enchaîner avec une question « intéressée » : pourquoi faut-il lire le Livre 2 du Capital en 2024 ? Les critiques un peu pressées de Marx se sont efforcées de nous répéter que l’étude économique du Capital est centrée sur l’Angleterre du XIXe siècle, ce qui ferait de lui un outil dépassé pour comprendre le capitalisme actuel. Que répondrais-tu à cet argument, concernant l’actualité du Livre 2 du Capital ?
GF : Une réponse complète supposerait de rentrer dans le « dur » du contenu du Livre II mais pour le dire de manière très générale, Marx décrit dans Le Capital le fonctionnement « pur » du capitalisme. Et paradoxalement, les reculs du mouvement ouvrier et l’offensive capitaliste de ces quarante dernières années ont façonné un univers qui correspond finalement assez bien aux analyses de Marx, par opposition au capitalisme « fordiste » avec ses institutions sociales-démocrates qui venaient limiter ce fonctionnement capitaliste pur. C’est notamment le cas de ce qui est décrit dans le Livre II, c’est-à-dire l’exigence capitaliste d’une rotation accélérée du capital, ce qui signifie des rythmes de consommation, de production et de circulation tendanciellement de plus en plus rapides au nom de la profitabilité. Et le grand degré d’abstraction des analyses de Marx permet de retrouver dans ses analyses des phénomènes très contemporains : la violation des rythmes naturels, l’obsolescence programmée, la centralité de la question logistique, etc.

AR : Cette nouvelle édition du Livre 2 s’accompagne d’une nouvelle traduction, à laquelle tu as participé aux côtés d’Alexandre Ferron et d’Alix Bouffard. La traduction du Capital n’est pas chose aisée, compte tenu de la technicité de son appareil conceptuel. On sait par exemple que Marx avait été très déçu de la première traduction française effectuée par Joseph Roy (brouillon qu’il avait lui-même révisé en le sauvant de ses principaux contresens à l’aide d’une « réparation bricolée[1] »). Comme tu l’as mentionné, depuis le travail de Jean-Pierre Lefebvre (1983), de grandes avancées ont été faites dans le programme de traduction en français du Capital. Dans sa préface, Lefebvre revient notamment sur la traduction du concept de Mehrwert par le terme de « plus-value », tel que l’avait fait Roy, et suggère de le remplacer par celui de « survaleur ». En effet, le premier, en plus de tirer son origine du monde de la comptabilité bourgeoise et d’ainsi obscurcir la nouveauté conceptuelle qu’il aurait dû traduire[2], évacue la symétrie formelle des termes allemands tels que Mehrarbeit / Mehrprodukt / Mehrwert (surtravail / surproduit / survaleur) qui permet justement d’en marquer la parenté théorique[3]. En ce qui concerne le Livre 2, la dernière traduction française en date a été réalisée par Maximilien Rubel dans les années 1960… et est déjà réputée dépassée. Doit-on s’attendre à une révision importante de la traduction originale qu’avaient offerte les Éditions sociales ? Avez-vous conservé, pour la traduction du deuxième Livre la traduction de Mehrwert que préconise Lefebvre ? Enfin, considérez-vous les choix éditoriaux et la traduction de Rubel comme une contribution importante à votre propre travail d’édition du deuxième Livre ?
GF : Je commencerai par saluer le travail de M. Rubel. À titre personnel, je ne suis pas du tout d’accord avec ses perspectives, mais il faut reconnaître qu’il a abattu un travail considérable, et parfois très intéressant, dans les manuscrits. Mais le pari que nous avons fait est de considérer que le Livre II du Capital était désormais, après plus d’un siècle d’histoire du marxisme, un ouvrage à part entière qu’il fallait traiter comme tel au lieu de s’interroger sur l’authenticité présumée du texte marxien brut. Pour ce qui est de la traduction, nous avons conservé « survaleur », oui, considérant que le terme s’était à peu près imposé dans le vocabulaire marxiste. Pour le reste, on ne prétend pas révolutionner la lecture du Livre II avec notre traduction, mais on essaie tout de même de rendre sensible le caractère extrêmement logique des raisonnements de Marx et la manière dont il invente une conceptualité pour décrire les différents mouvements du capital : sa rotation, son cycle, la manière dont il passe d’un état fluide à l’immobilité (dans la production, par exemple, qui prend un temps incompressible quoique devant être minimisé par le capitaliste), etc. Et on espère ainsi que cette conceptualité sera davantage mise au travail pour décrire des phénomènes contemporains.
AR : Le Livre 2 traîne une assez mauvaise réputation. Il est souvent considéré comme le plus difficile, le plus technique et… le plus ennuyant des trois Livres du Capital. Cela s’explique-t-il principalement par le fait qu’il s’agit d’une œuvre posthume, retravaillée par Engels à partir des manuscrits et brouillons épars qu’avait laissés Marx ? Ou, au contraire, doit-on penser qu’il existe des raisons plus profondes à cette difficulté ?
GF : Il y a bien évidemment, c’est tout à fait juste, des raisons éditoriales. Engels a essayé de coller au mieux aux manuscrits laissés par Marx et ces derniers étaient en partie redondants ou inachevés, ce qui rend parfois le propos difficile. Nous avions d’ailleurs au départ envisagé la publication d’une somme d’extraits choisis, considérant que ce serait plus lisible pour un large lectorat. Ce projet n’est d’ailleurs pas abandonné, les éditions sociales comprenant une collection pédagogique d’ouvrages d’introduction (les Découvrir notamment). Mais il y a une seconde raison à la sécheresse de l’ouvrage. Il s’agit du dernier livre sur lequel Marx a travaillé et on a l’impression, à la lecture, que Marx a fait un effort de « scientifisation » de son propos, notamment par le recours aux mathématiques. Et pour des raisons diverses, il n’a quasiment pas eu recours à l’algèbre (c’est-à-dire la mise en fonction de variables), mais principalement à des exemples arithmétiques qui courent sur des pages entières et perdent le lecteur par leur caractère extrêmement laborieux. Mais cela ne doit pas masquer le fait qu’il y a de nombreuses pages lumineuses dans ce livre, qui n’ont rien à envier aux envolées conceptuelles les plus impressionnantes du Livre I.

AR : Qu’est-ce que Marx cherche à faire dans le Livre 2 ? Quel rôle joue-t-il dans l’architecture générale du Capital ?
GF : Le Livre I décrivait la « production » du capital, c’est-à-dire principalement les deux moments de l’exploitation et de l’accumulation qui correspondent respectivement à la transformation de capital en survaleur (comment le capital produit) et de survaleur en capital (comment le capital est produit). On était, comme l’écrit Marx, dans l’antre de la production, dans l’usine pour le dire vite. Avec le Livre II, on en sort pour identifier ce qui se passe entre la production des marchandises et le recommencement de la production, c’est-à-dire la conversion des marchandises en argent et la reconversion de cet argent en moyens de production. Marx étudie donc davantage la « circulation », en prêtant attention par exemple aux crises commerciales, à la nécessité de réduire sans cesse la durée de cette circulation, etc. Et il traite également de la manière dont cette circulation suppose une certaine répartition des activités matérielles afin que les capitalistes trouvent des acheteurs et des moyens de production pour recommencer le cycle productif. Ce sont les fameux schémas de reproduction, qui constituent la section 3 du Livre II.
AR : Et, là-dessus, pourrais-tu nous en dire davantage sur les schémas de reproduction ? Pour Marx, l’une des clés pour comprendre la reproduction du capital à l’échelle de la société est la distinction qu’il pose entre les deux branches de la production : la branche I (production des moyens de production) et branche II (production des moyens de consommation). Peux-tu revenir sur l’importance de cette conception dans notre compréhension du capitalisme ?
GF : Il faut d’abord dire peut-être que, si l’on met les physiocrates à part, il s’agit d’une entreprise intellectuelle inédite : désagréger une économie donnée en différentes branches pour identifier comment elles fonctionnent en harmonie (ou pas). En l’occurrence, la première désagrégation à laquelle se prête Marx est celle qui permet d’opposer deux grandes branches de l’économie : la production de moyens de production et la production de moyens de consommation. C’est fondamental puisque cela permet par exemple de penser les conditions d’une industrialisation rapide – qui ne peut se faire qu’au détriment de la consommation (et ces schémas seront d’ailleurs utilisés comme tels en URSS ou dans d’autres pays se réclamant du socialisme). Mais Marx passe outre cette première désagrégation pour séparer également, au sein de la branche des biens de consommation, ceux consommés par les salariés et ceux consommés par les capitalistes. Là encore, c’est extrêmement intéressant puisque cela pose la question de la destination de ce qui est produit dans une économie donnée : une économie « égalitaire » se traduit également par une production de nature différente (moins de yachts et plus de vélos par exemple). Cela permet vraiment d’aller plus loin dans la question qui est à mes yeux la question fondamentale que pose Marx à tout système économique : qui travaille pour qui ?
AR : Question directe : existe-t-il quelque chose comme une « théorie des crises » dans le Livre 2 ? La tradition marxiste, dans la lignée de figures telles que Paul Mattick, s’est généralement centrée sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, exposée dans le troisième Livre, afin d’expliquer les crises économiques. Rosa Luxemburg, dans L’accumulation du capital, avait quant à elle fait l’argument que les conclusions logiques du Livre 2 impliquent que le capitalisme soit incapable de se reproduire dans un circuit fermé. Sa démonstration veut que la survaleur représente par définition un excédent du système productif, où le capital est toujours en problème de débouchés (problème de surproduction). L’écoulement des marchandises pour réaliser la survaleur doit donc se faire dans un « ailleurs » non capitaliste (notamment dans les colonies). Elle désigne l’intégration des économies précapitalistes comme la solution à ce problème, c’est-à-dire l’impérialisme (ce qui pose d’autres contradictions, comme les rivalités inter-impérialistes et le militarisme). Contre ces idées, on a soutenu (Bauer, Hilferding, Pannekoek, et même Lénine) que l’accumulation dans un circuit fermé était possible ; les schémas de la reproduction du Livre 2, qui illustrent arithmétiquement la reproduction élargie du capital et ses conditions d’équilibre, en constitueraient précisément la « preuve ». Que penser d’une telle polémique ? Pour toi qui a longuement travaillé sur ce texte, quel statut doit-on accorder à ces fameux schémas ?
GF : Je fais partie de ceux qui ne croient pas en une théorie marxienne unifiée des crises du capitalisme. Il existe de nombreux facteurs de crise, que Marx décrit longuement, ce qui produit une tendance globale au déséquilibre et pousse le capital à recourir à des moyens divers de rétablir la profitabilité, la solvabilité des consommateurs ou la disposition des moyens de production sur le marché. Mais si l’on prend par exemple les schémas de reproduction, il y a un vrai souci à parler de théorie des crises : la plupart du temps, avec Luxemburg, on assoit cette théorie des crises sur une impossibilité de la part du capital à écouler les biens de consommation et à trouver des moyens de production sur son propre marché. Mais des exemples arithmétiques ne sauraient logiquement fournir la moindre démonstration d’impossibilité. Ce ne sont que des exemples et il est d’ailleurs très facile d’inventer des exemples où l’équilibre est possible. On a là, me semble-t-il, une utilisation trop rigide des analyses du Capital. Je trouve qu’il est bien plus intéressant de partir du constat que le capitalisme « fonctionne » malgré les facteurs de crise identifiés par Marx et de se poser la question de tous les bricolages qui rendent possible ce fonctionnement, au prix de catastrophes sociales, environnementales, militaires, etc. Et de ce point de vue, il me semble qu’il y a des choses très intéressantes chez Luxemburg, dans l’esprit général de son travail.
AR : Sur le même thème, les vieilles Éditions sociales avaient fait le choix, pour l’édition du Livre 2, d’insérer en annexe un certain nombre d’extraits issus de publications de Lénine ayant trait au problème de la reproduction élargie et de la réalisation[4]. Or, ces extraits vont nettement en faveur des critiques de Luxembourg. En effet, dans chacun de ces extraits, Lénine cherche à montrer, par différents arguments, qu’en circuit fermé, il n’y a pas de limitation intrinsèque à l’accumulation : l’accumulation crée sa propre demande, le marché n’est jamais une limite absolue. Mais de son côté, la version québécoise coéditée par les Éditions sociales et Nouvelle frontière (Paris / Montréal, 1976) avait plutôt fait le choix de placer en annexe les « Notes sur Wagner » de Marx. Qu’avez-vous choisi de faire à cet égard, et pourquoi ?
GF : Lénine répondait, dans ces textes, à des questions politiques qui avaient pour lui une certaine actualité puisqu’il s’agissait de défendre l’existence d’un développement capitaliste en Russie et la nécessité de s’appuyer sur la classe ouvrière montante plutôt que sur la paysannerie. Le souci est qu’on a fait de ces textes, comme de Lénine en général, des textes théoriques à validité absolue. Les « Notes sur Wagner » me semblaient bien plus légitimes à intégrer l’édition du Livre II. Mais nous n’avons pas souhaité, quant à nous, encadrer le Livre II par des textes annexes. On a fait le pari que le texte se suffisait à lui-même et qu’il y avait déjà fort à faire pour venir à bout de l’ouvrage. On propose donc, en introduction, une étude de la genèse du livre, un plan détaillé et quelques éléments concernant sa réception, mais c’est tout. Il est un peu agaçant, me semble-t-il, de voir des traducteurs se substituer aux commentateurs et profiter de leur position d’éditeurs pour imposer telle ou telle lecture.
AR : C’est très bien dit. Il y a-t-il de nouvelles discussions concernant le Livre 2 desquelles il faudrait rester attentif·ve·s ?
GF : Je pense que le Livre II offre des perspectives intéressantes sur une question actuellement au cœur des débats politiques, la question écologique. Il me semble que le Livre II donne des instruments pour penser le caractère absolument destructeur de l’environnement du capitalisme. Quelqu’un comme Kohei Saito, dans ses ouvrages récents, cite quelques passages du Livre II et je pense que c’est quelque chose qui se poursuivra. De même, on peut espérer que le caractère manifeste des crises du capitalisme invite la profession des économistes à se tourner davantage vers les analyses de Marx et la manière dont elles ont été poursuivies au long du XXe siècle.
AR : Enfin, la réédition du troisième Livre est-elle déjà sur la table ?
GF : On a mis plus de cinq ans pour le Livre II, comptons donc une dizaine d’années pour le III! Plus sérieusement, la réflexion est en cours, oui. Le souci étant que c’est un gros travail, qu’il est toujours difficile de mener un tel projet à bien pour une maison d’édition relativement modeste et que cela suppose un certain engagement de long terme des traducteurs et traductrices. Mais on y travaille !
- Le questionnaire de l’entretien a été réalisé par Nathan Brullemans et Pierre-Olivier Lessard
[1] Lefebvre, « Introduction », Le Capital, Livre I, PUF, 2014, p. XLIII.
[2] Ibid. p. XLV.
[3] Ibid. p. XLV-XLVII.
[4] Issus des quatre textes suivants : De la caractéristique du romantisme économique (1897), Remarque sur la question de la théorie des marchés (1899), Une fois encore à propos de la théorie de la réalisation (1899), Le développement du capitalisme en Russie (1899).
Les jeunes sénégalais.es songent à retourner dans leur pays
Guerre en Ukraine : La résistance, la solidarité et la gauche
9 avril 2024 | tiré du site du NPA - L'Anticapitaliste
Entretien avec Patrick Silberstein, des éditions Syllepse, pour évoquer la résistance de la gauche ukrainienne sur le front social et sur le front militaire, les initiatives de solidarité et la gauche française face à la question ukrainienne, au soutien à la résistance et face au régime de Poutine.

La privation de monde face à l’accélération technocapitaliste

La pandémie de COVID-19 a conduit à un déploiement sans précédent de l’enseignement à distance (EAD), une tendance qui s’est maintenue par la suite, et cela malgré les nombreux impacts négatifs observés. De plus, le développement rapide des intelligences artificielles (IA) dites « conversationnelles » de type ChatGPT a provoqué une onde de choc dans le monde de l’éducation. La réaction des professeur·e·s à cette technologie de « disruption[1] » a été, en général, de chercher à contrer et à limiter l’usage de ces machines. Le discours idéologique dominant fait valoir, à l’inverse, qu’elles doivent être intégrées partout en enseignement, aussi bien dans l’élaboration d’une littératie de l’IA chez l’étudiant et l’étudiante que dans la pratique des professeur·e·s, par exemple pour élaborer les plans de cours. Nous allons ici chercher à montrer qu’au contraire aller dans une telle direction signifie accentuer des pathologies sociales, des formes d’aliénation et de déshumanisation et une privation de monde[2] qui va à l’opposé du projet d’autonomie individuelle et collective porté historiquement par le socialisme.
L’expérience à grande échelle de la pandémie
Les étudiantes, les étudiants et les professeur·e·s ont été les rats de laboratoire d’une expérimentation sans précédent du recours à l’EAD durant la pandémie de COVID-19. Par la suite, nombre de professeur·e·s ont exprimé des critiques traduisant un sentiment d’avoir perdu une relation fondamentale à leur métier et à leurs étudiants, lorsqu’ils étaient, par exemple, forcés de s’adresser à des écrans noirs à cause des caméras fermées lors des séances de visioconférence. Quant aux étudiantes et étudiants, 94 % d’entre eux ont rapporté ne pas vouloir retourner à l’enseignement en ligne[3]. Des études ont relevé de nombreuses répercussions négatives de l’exposition excessive aux écrans durant la pandémie sur la santé mentale[4] : problèmes d’anxiété, de dépression, d’isolement social, idées suicidaires.
Le retour en classe a permis de constater des problèmes de maitrise des contenus enseignés (sur le plan des compétences en lecture, en écriture, etc.) ainsi que des problèmes dans le développement de l’autonomie et de la capacité de s’organiser par rapport à des objets élémentaires comme ne pas arriver à l’école en pyjama, la ponctualité, l’organisation d’un calendrier, la capacité à se situer dans l’espace ou à faire la différence entre l’espace privé-domestique et l’espace public, etc.
D’autres études ont relevé, au-delà de la seule pandémie, des problèmes de développement psychologique, émotionnel et socioaffectif aussi bien que des problèmes neurologiques chez les jeunes trop exposés aux écrans. Une autrice comme Sherry Turkle par exemple note une perte de la capacité à soutenir le regard d’autrui, une réduction de l’empathie, de la socialité et de la capacité à entrer en relation ou à socialiser avec les autres.
Tout cela peut être résumé en disant qu’il y a de nombreux risques ou effets négatifs de l’extension des écrans dans l’enseignement sur le plan psychologique, pédagogique, développemental, social, relationnel. Le tout est assorti d’une perte ou d’une déshumanisation qui affecte la relation pédagogique de transmission en chair et en os et en face à face au sein d’une communauté d’apprentissage qui est aussi et d’abord un milieu de vie concret. Cette relation est au fondement de l’enseignement depuis des siècles; voici maintenant qu’elle est remplacée par le fantasme capitaliste et patronal d’une extension généralisée de l’EAD. Or, il est fascinant de constater qu’aucun des risques ou dangers documentés et évoqués plus haut n’a ralenti le projet des dominants, puisqu’à la suite de la pandémie, les pressions en faveur de l’EAD ont continué à augmenter. À L’UQAM, par exemple, les cours en ligne étaient une affaire « nichée » autrefois; après la pandémie, on en trouve plus de 800. L’extension de l’EAD était aussi une importante demande patronale au cœur des négociations de la convention collective dans les cégeps en 2023, par exemple. Il sera maintenant possible pour les collèges de procéder à l’expérimentation de projets d’EAD même à l’enseignement régulier !
Une société du « tele-everything »
Toute la question est de savoir pourquoi la fuite en avant vers l’EAD continue malgré les nombreux signaux d’alarme qui s’allument quant à ses répercussions négatives. Une partie de la réponse se trouve dans le fait que l’EAD s’inscrit dans un projet politique ou dans une transformation sociale plus large. Comme l’a bien montré Naomi Klein[5], la pandémie de COVID-19 a été l’occasion pour les entreprises du capitalisme de plateforme ou les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) de déployer le projet d’une société du « tele-everything » où tout se ferait désormais à distance grâce à une infrastructure numérique d’une ampleur sans précédent. Cela signifie non seulement un monde avec beaucoup moins d’enseignantes et d’enseignants, puisque les cours seront donnés en ligne ou éventuellement par des tuteurs-robots, mais cela concerne aussi un ensemble d’autres métiers dont les tâches sont d’ordre cognitif, puisqu’il s’agit précisément d’automatiser des tâches cognitives autrefois accomplies par l’humain. De nombreux métiers sont donc menacés : journaliste, avocat, médecin, etc. Désormais chacun pourra accéder, par exemple, au téléenseignement, à la télémédecine, au divertissement par la médiation d’un écran et depuis son foyer. Nous pouvons donc parler d’un projet politique visant à transformer profondément les rapports sociaux au moyen de l’extension d’un modèle de société technocapitaliste ou capitaliste cybernétique intercalant la médiation des écrans et de la technologie entre les sujets.
Vers une société cybernétique
Nous pouvons, en nous appuyant sur des philosophes comme le Québécois Michel Freitag ou le Français Bernard Stiegler, relever que la société moderne était caractérisée par la mise en place de médiations politico-institutionnelles devant, en principe, permettre une prise en charge réfléchie des sociétés par elles-mêmes. Plutôt que de subir des formes d’hétéronomie culturelles, religieuses ou politiques, les sociétés modernes, à travers leurs institutions que l’on pourrait appeler « républicaines », allaient faire un usage public de la raison et pratiquer une forme d’autonomie collective : littéralement auto-nomos, se donner à soi-même sa loi. La condition de cette autonomie collective est d’abord, bien entendu, que les citoyennes et citoyens soient capables d’exercer leur raison et leur autonomie individuelle, notamment grâce à une éducation qui les ferait passer du statut de mineur à majeur. Le processus du devenir-adulte implique aussi d’abandonner le seul principe de plaisir ou le jeu de l’enfance pour intégrer le principe de réalité qu’implique la participation à un monde commun dont la communauté politique a la charge, un monde qui est irréductible au désir de l’individu et qui le transcende ou lui résiste dans sa consistance ou son objectivité symbolique et politique.
D’après Freitag, la société moderne a, dans les faits, été remplacée par une société postmoderne ou décisionnelle-opérationnelle, laquelle peut aussi être qualifiée de société capitaliste cybernétique ou systémique. Dans ce type de société, l’autonomie et les institutions politiques sont déclassées au profit de systèmes autonomes et automatiques à qui se trouve de plus en plus confiée la marche des anciennes sociétés. De toute manière, ces dernières sont de plus en plus appelées à se dissoudre dans le capitalisme, et donc à perdre leur spécificité culturelle, symbolique, institutionnelle et politique. Ces transformations conduisent vers une société postpolitique. Elles signifient que l’orientation ou la régulation de la pratique sociale ne relève plus de décisions politiques réfléchies, mais se voit déposée entre les mains de systèmes – le capitalisme, l’informatique, l’intelligence artificielle – réputés décider de manière plus efficace que les individus ou les collectivités humaines. Bref, c’est aux machines et aux systèmes qu’on demande de penser à notre place.
Les anciennes institutions d’enseignement se transforment en organisations calquées sur le fonctionnement et les finalités de l’entreprise capitaliste et appelées à s’arrimer aux « besoins du marché ». Plus les machines apprennent ou deviennent « intelligentes » à notre place, et plus l’enseignement est appelé, suivant l’idéologie dominante, à se placer à la remorque de ces machines. Désormais, la machine serait appelée à rédiger le plan de cours des professeur·e·s, à effectuer la recherche ou à rédiger le travail de l’étudiante ou de l’étudiant; elle pourra même, en bout de piste, corriger les copies, comme cela se pratique déjà en français au collège privé Sainte-Anne de Lachine. L’humain se trouve marginalisé ou évincé du processus, puisqu’il devient un auxiliaire de la machine, quand il n’est tout simplement pas remplacé par elle, comme dans le cas des tuteurs-robots ou des écoles sans professeurs, où l’ordinateur et le robot ont remplacé l’ancien maître. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évoque déjà dans ses rapports un monde où les classes et les écoles physiques auront tout bonnement disparu. Ce projet participe aussi d’un processus de délestage ou d’« extranéiation » cognitive qui est à rebours de la conception moderne de l’autonomie, et qu’il convient maintenant d’expliciter.
Délestage ou extranéiation cognitive
Le philosophe français Eric Sadin[6] estime qu’un seuil inquiétant est franchi à partir du moment où des facultés ou des tâches cognitives spécifiques à l’humain sont remises entre les mains de systèmes d’intelligence artificielle, par exemple l’exercice du jugement ou le fait de poser un diagnostic médical. Automatiser le chauffage d’une maison ou les lumières d’un immeuble de bureaux est beaucoup moins grave que de transférer le jugement humain dans un système extérieur. Certains intervenants et intervenantes du monde de l’éducation s’enthousiasment devant ce processus, estimant que le délestage cognitif en faveur des machines permettra de sauver du temps qui pourra être utilisé à de meilleures fins[7]. Il faut au contraire insister pour montrer que ce processus pousse la destruction de l’idéal du citoyen – ou de la citoyenne – moderne encore plus loin, puisque celui-ci est remplacé par un individu assisté ou dominé par la machine, réputée penser, juger ou décider à sa place. L’individu n’exerce plus alors la réflexivité, l’autonomie, la liberté : « il faut s’adapter », comme le dirait Barbara Stiegler.
Il est frappant de constater à quel point les technoenthousiastes prennent position sur les nouvelles technologies sans jamais se confronter à l’immense corpus de la philosophie de la technique ou la technocritique, ceci expliquant cela… La position technocritique est généralement ridiculisée en l’assimilant à quelque peur comique du changement semblable à la crainte des minijupes et du rock’n’roll dans les années 1950… Pourtant, les dangers relatifs à ce mouvement de délestage (Entlastung) ou d’extranéiation cognitive ont bien été relevés, et depuis longtemps, par les Arnold Gehlen, Günther Anders ou Michel Freitag, pour ne nommer que ceux-là.
Dès 1956, Anders développe dans L’Obsolescence de l’homme une critique du rapetissement de l’humain face à la puissance des machines. Le concept de « honte prométhéenne » désigne le sentiment d’infériorité de l’ouvrier intimidé par la puissance et la perfection de la machine qui l’a dépassé, lui, l’être organique imparfait et faillible. Le « décalage prométhéen » indique quant à lui l’écart qui existe entre la puissance et les dégâts causés par les machines d’un côté, et la capacité que nous avons de les comprendre, de nous les représenter et de les ressentir de l’autre. Les machines sont donc « en avance » sur l’humain, placé à la remorque de ses productions, diminué et du reste en retard, largué, dépassé par elles.
Anders rapporte un événement singulier qui s’est déroulé à la fin de la guerre de Corée. L’armée américaine a gavé un ordinateur de toutes les données, économiques, militaires, etc., relatives à la poursuite de la guerre avant de demander à la machine s’il valait la peine de poursuivre ou d’arrêter l’offensive. Heureusement, la machine, après quelques calculs, a tranché qu’il valait mieux cesser les hostilités. On a conséquemment mis un terme à la guerre. D’après Anders, c’est la première fois de l’histoire où l’humain s’est déchargé d’une décision aussi capitale pour s’en remettre plutôt à une machine. On peut dire qu’à partir de ce moment, l’humanité concède qu’elle est dépassée par la capacité de synthèse de la machine, avec ses supports mémoriels et sa vitesse de calcul supérieure – supraliminaire, dirait Anders, puisque débordant notre propre capacité de compréhension et nos propres sens. Selon la pensée cybernétique[8] qui se développera dans l’après-guerre, s’il s’avère que la machine exécute mieux certaines opérations, il vaut mieux se décharger, se délester, « extranéiser » ces opérations dans les systèmes. La machine est réputée plus fiable que l’humain.
Évidemment, à l’époque, nous avions affaire aux balbutiements de l’informatique et de la cybernétique. Aujourd’hui, à l’ère du développement effréné de l’intelligence artificielle et de la « quatrième révolution industrielle », nous sommes encore plus en danger de voir une part croissante des activités, orientations ou décisions être « déchargées » de l’esprit humain en direction des systèmes cybernétiques devenus les pilotes automatiques du monde. Il faut mesurer à quel point cela est doublement grave.
D’abord, du point de vue de l’éducation qui devait fabriquer le citoyen et la citoyenne dont la république avait besoin, et qui produira à la place un assisté mental dont l’action se limitera à donner l’input d’un « prompt[9]» et à recevoir l’output de la machine. Un étudiant qui fait un travail sur Napoléon en demandant à ChatGPT d’exécuter l’ensemble des opérations n’aura, finalement, rien appris ni rien compris. Mais il semble que cela n’est pas très grave et que l’enseignement doit aujourd’hui se réinventer en insistant davantage sur les aptitudes nécessaires pour écrire des prompts bien formulés ou en mettant en garde les étudiantes et étudiants contre les « hallucinations », les fabulations mensongères fréquentes des machines qui ont désormais pris le contrôle. « Que voulez-vous, elles sont là pour rester, nous n’avons pas le choix de nous adapter… », nous dit-on du côté de ceux qui choisissent de garnir les chaines de l’ignorance des fleurs de la « créativité », car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’enseignement de l’ignorance comme l’a écrit Michéa[10], le décalage prométhéen comme programme éducatif et politique.
Deuxièmement, ce mouvement de déchargement vers la machine vient entièrement exploser l’idéal d’autonomie moderne individuelle et collective et réintroduire une forme d’hétéronomie : celle du capitalisme cybernétique autonomisé. Comme le remarque Bernard Stiegler, le passage du statut de mineur à celui de majeur, donc le devenir-adulte, est annulé : l’individu est maintenu au stade infantile et pulsionnel, puis branché directement sur la machine et le capital. Il y a donc complicité entre l’individu-tyran et le système une fois court-circuitées les anciennes médiations symboliques et politiques de l’ancienne société. Suivant une thèse déjà développée dans le néolibéralisme de Friedrich Hayek, notre monde serait, du reste, devenu trop complexe pour être compris par les individus ou orienté par la délibération politique : il faut donc confier au marché et aux machines informatiques/communicationnelles le soin de devenir le lieu de synthèse et de décision de la société à la place de la réflexivité politique. Or, ce système est caractérisé, comme le disait Freitag, par une logique d’expansion infinie du capital et de la technologie qui ne peut qu’aboutir à la destruction du monde, puisque sa logique d’illimitation est incompatible avec les limites géophysiques de la Terre, ce qui mène à la catastrophe écologique déjà présente. Cela conduit à une forme exacerbée de la banalité du mal comme absence de pensée théorisée par Hannah Arendt, cette fois parce que le renoncement à penser ce que nous faisons pour procéder plutôt à un délestage cognitif de masse mène dans les faits au suicide des sociétés à grande échelle à cause du totalitarisme systémique capitaliste-cybernétique. Nous passons notre temps devant des écrans pendant que le capitalisme mondialisé sur le « pilote automatique » nous fait foncer dans le mur de la crise climatique.
Accélérationnisme et transhumanisme
Ce mouvement de décervelage et de destruction de l’autonomie individuelle et collective au profit des systèmes ne relève pas seulement d’une dérive ou d’une mutation propre à la transition postmoderne. Il est aussi revendiqué comme projet politique chez les accélérationnistes, notamment ceux de la Silicon Valley. Une des premières figures de l’accélérationnisme est le Britannique Nick Land, ancien professeur à l’Université de Warwick, où il a fondé le Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) dans les années 1990. Land dit s’inspirer de Marx (!), de Deleuze et Guattari, de Nietzsche et de Lyotard pour conclure que l’avenir n’est pas de ralentir ou de renverser le capitalisme, mais d’accélérer son processus de déterritorialisation. Cette idéologie favorise ainsi l’accélération du capitalisme, de la technologie et se dit même favorable au transhumanisme, à savoir la fusion – partielle ou totale – de l’humain avec la machine dans la figure du cyborg[11]. Après avoir quitté l’université, Nick Land, notamment à cause de son usage de drogues, sombre dans la folie et l’occultisme. Il devient également ouvertement raciste et néofasciste. Il disparait pour refaire surface plusieurs années plus tard en Chine, une société qui, selon lui, a compris que la démocratie est une affaire du passé et qui pratique l’accélérationnisme technocapitaliste. Ses idées sont par la suite amplifiées et développées aux États-Unis par Curtis Yarvin, proche de Peter Thiel, fondateur de PayPal. Cela a engendré un mouvement de la néo-réaction ou NRx qui combine des thèses accélérationnistes et transhumanistes avec la promotion d’une privatisation des gouvernements, une sorte de technoféodalisme en faveur de cités-États gouvernées par les PDG de la techno. Il s’agit donc d’un mouvement qui considère que la démocratie est nuisible, étant une force de décélération, un mouvement qui entend réhabiliter une forme de monarchisme 2.0 mélangé à la fascination technique. On pourrait dire qu’il s’agit d’une nouvelle forme de technofascisme.
Ajoutons qu’une partie des idées de Land et de Yarvin nourrit non seulement l’« alt-right », mais aussi des mouvements ouvertement néonazis dont la forme particulière d’accélérationnisme vise à exacerber les contradictions raciales aux États-Unis pour mener à une société posteffondrement dominée par le suprémacisme blanc. Il existe également une forme d’accélérationnisme de gauche, associé à une figure comme celle de Mark Fisher, qui prétend conserver l’accélération technologique sans le capitalisme. Mais la majeure partie du mouvement est à droite, allant de positions anciennement libertariennes jusqu’à des positions néoautoritaires, néofascistes, transhumanistes ou carrément néonazies. Cette nébuleuse accélérationniste inspire les nouveaux monarques du technoféodalisme de la Silicon Valley, les Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreesen[12]. Ceux-ci pensent que l’humain doit fusionner avec l’IA pour ensuite aller coloniser Mars, la Terre étant considérée comme écologiquement irrécupérable. Il n’est donc pas suffisant de parler d’un projet de scénarisation de l’humain par la machine au moyen du délestage cognitif, puisque ce qui est en cause dans le projet accélérationniste et transhumaniste implique carrément la fin de l’humanité telle qu’on l’entendait jusqu’ici. L’anti-humanisme radical doit être entendu littéralement comme un projet de destruction de l’humanité. Il s’agit d’un projet de classe oligarchique et eugéniste qui entend bien donner tout le pouvoir à une nouvelle « race » de surhommes riches et technologiquement augmentés dont le fantasme est de tromper la mort par le biais de la technique pour pouvoir jouir de leur fortune éternellement, à tel point qu’ils modifient actuellement les lois aux États-Unis pour pouvoir déshériter leur descendance et contrôler leurs avoirs éternellement lorsque la technologie les aura rendus immortels…
L’oubli de la société
Ce délire se déroule aussi sur fond « d’oubli de la société », comme le disait Michel Freitag[13], à savoir qu’il implique la destruction des anciennes médiations culturelles et symboliques aussi bien que celle des anciennes sociétés, comprises comme totalités synthétiques ou universaux concrets. Marcel Rioux l’avait déjà remarqué dans les années 1960, l’impérialisme technocapitaliste étatsunien conduit à la liquidation de la langue, de la culture et de la société québécoise. Du reste, comme le souligne Freitag, le fait d’être enraciné dans un lieu et un temps concret est remplacé par un déracinement qui projette le néosujet dans l’espace artificiel des réseaux informatiques ou de la réalité virtuelle. Du point de vue de l’éducation, à quoi sert-il alors de transmettre la culture, la connaissance du passé, les repères propres à cette société concrète ou à son identité, du moment qu’on ne nait plus dans une société, mais dans un réseau ? La médiation technologique et les écrans, en tant que technologie de disruption, viennent contourner les anciennes médiations et le processus d’individuation qu’elles encadraient, produisant des individus socialisés ou institués par les machines. Il devient alors beaucoup plus important d’anticiper l’accélération future et d’enseigner à s’y adapter, beaucoup plus important que d’expliquer le monde commun et sa genèse historique. De ce point de vue, l’ancien instituteur, « hussard noir de la République[14] », doit être remplacé par un professeur branché qui s’empresse d’intégrer les machines à sa classe, ou carrément par ChatGPT ou par un quelconque tuteur-robot. Ainsi la boucle serait complète : des individus formés par des machines pour vivre dans une société-machine, où l’ancienne culture et l’ancienne société auraient été remplacées par la cybernétique.
Une aliénation totale
Nous l’avons dit : les jugements enthousiastes sur cette époque sont généralement posés sans égard au corpus de la théorie critique ou de la philosophie de la technique. Il nous semble au contraire qu’il faille remobiliser le concept d’aliénation pour mesurer la dépossession et la perte qui s’annoncent en éducation, pour les étudiants, les étudiantes, les professeur·e·s, aussi bien que pour la société ou l’humanité en général. L’aliénation implique un devenir étranger à soi. En allemand, Marx emploie tour à tour les termes Entaüsserung et Entfremdung, extériorisation et extranéiation. La combinaison des deux résume bien le mouvement que nous avons décrit précédemment, à savoir celui d’une extériorisation de l’humanité dans des systèmes objectivés à l’extérieur, mais qui se retournent par la suite contre le sujet. Celui-ci se trouve alors non seulement dépossédé de certaines facultés cognitives, mais en plus soumis à une logique hétéronome d’aliénation qui le rend étranger à lui-même, à sa pratique, à autrui, à la nature et à la société – comme l’avait bien vu Marx –, sous l’empire du capitalisme et du machinisme. Le sujet se trouve alors « privé de monde[15] » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Ce processus concerne aussi bien la destruction de la société et de la nature que celle de l’humanité à travers le transhumanisme. Nous pouvons ainsi parler d’une forme d’aliénation totale[16] – ou totalitaire – culminant dans la destruction éventuelle de l’humanité par le système technocapitaliste. Ajoutons que le scénario d’une IA générale (AGI, artificial general intelligence) ou de la singularité[17] est évoqué par plusieurs figures crédibles (Stephen Hawking, Geoffrey Hinton, etc.) comme pouvant aussi conduire à la destruction de l’humanité, et est comparé au risque de l’arme nucléaire. L’enthousiasme et la célébration de l’accélération technologique portés par les idéologues et l’idéologie dominante apparaissent d’autant plus absurdes qu’ils ignorent systématiquement ces mises en garde provenant pourtant des industriels eux-mêmes. Sous prétexte d’être proches des générations futures, soi-disant avides de technopédagogie, on voit ainsi des adultes enfoncer dans la gorge de ces jeunes un monde aliéné et courant à sa perte, un monde dont ils et elles ne veulent pourtant pas vraiment lorsqu’on se donne la peine de les écouter, ce dont semblent incapables nombre de larbins de la classe dominante et de l’accélérationnisme technocapitaliste, qui ont déjà pressenti que leur carrière actuelle et future dépendait de leur aplaventrisme devant le pouvoir, quitte à tirer l’échelle derrière eux dans ce qu’il convient d’appeler une trahison de la jeunesse.
Conclusion : réactiver le projet socialiste
Nous avons montré précédemment que l’extension du capitalisme cybernétique conduit à des dégâts : psychologiques, pédagogiques, développementaux, sociaux/relationnels. Nous avons montré que le problème est beaucoup plus large, et concerne, d’une part, le déchargement de la cognition et du jugement dans des systèmes extérieurs. D’autre part, il participe de la mise en place d’un projet politique technocapitaliste, celui d’une société postmoderne du « tout à distance » gérée par les systèmes, ce qui signifie la liquidation de l’idéal d’autonomie politique moderne. Cela entraine bien sûr des problèmes en éducation : formation d’individus poussés à s’adapter à l’accélération plutôt que de citoyens éclairés, fin de la transmission de la culture et de la connaissance, oubli de la société, etc. Plus gravement, cela participe d’une dynamique d’aliénation et de destruction du rapport de l’individu à lui-même, aux autres, à la nature et à la société. Ce processus culmine dans le transhumanisme et la destruction potentielle aussi bien de l’humain que de la société et de la nature si la dynamique accélérationniste continue d’aller de l’avant. Ce qui est menacé n’est donc pas seulement l’éducation, mais la transmission même du monde commun à ceux qu’Arendt appelait les « nouveaux venus », puisque ce qui sera transmis sera un monde de plus en plus aliéné et en proie à une logique autodestructive. Les Grecs enseignaient, notamment dans le serment des éphèbes, que la patrie devait être donnée à ceux qui suivent en meilleur état que lorsqu’elle avait été reçue de la génération antérieure. Les générations actuelles laissent plutôt un monde dévasté et robotisé, tout en privant celles qui viennent des ressources permettant de le remettre sur ses gonds.
Il convient évidemment de résister à ces transformations, par exemple en luttant localement pour défendre le droit à une éducation véritable contre la double logique de la marchandisation et de l’automatisation-robotisation. On peut encore réclamer de la régulation de la part des États, mais il est assez évident aujourd’hui que le développement de l’IA a le soutien actif des États – « comité de gestion des affaires de la bourgeoisie », disait Marx. Mais il faut bien comprendre que seule une forme de société postcapitaliste pourra régler les problèmes d’aliénation évoqués ci-haut. Il sera en effet impossible de démarchandiser l’école et de la sortir de l’emprise de la domination technologique sans remettre en question la puissance de ces logiques dans la société en général.
Depuis le XIXe siècle, la réaction à la destruction sociale engendrée par l’industrialisation a trouvé sa réponse dans le projet socialiste[18], qu’il s’agisse de la variante utopique, marxiste ou libertaire. On trouve aussi aujourd’hui des approches écosocialistes, décroissancistes ou communalistes[19]. Cette dernière approche, inspirée par l’écologie sociale de Murray Bookchin, préconise la construction d’une démocratie locale, écologique et anti-hiérarchique. Ce sont là différentes pistes pouvant nourrir la réflexion sur la nécessaire reprise de contrôle des sociétés sur l’économie et la technologie, dont la dynamique présente d’illimitation est en train de tout détruire. Cela laisse entière la question du type d’éducation qui pourrait favoriser la formation des citoyennes et citoyens communalistes dont le XXIe siècle a besoin. Chose certaine, il faudra, à rebours de ce que nous avons décrit ici, que cette éducation favorise l’autonomie, la sensibilité, la compassion, l’altruisme; qu’elle donne un solide enracinement dans la culture et la société, qu’elle apporte une compréhension de la valeur et de la fragilité du vivant et de la nature. Bref, elle devra former des socialistes ou des communalistes enracinés au lieu de l’aliénation et du déracinement généralisé actuels.
Par Eric Martin, professeur de philosophie, Cégep St-Jean-sur-Richelieu
NOTES
- Ce type de technologie cause un bouleversement profond dans les pratiques du champ où elle apparait. ↑
- Franck Fischbach, La privation de monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin, 2011. ↑
- Carolyne Labrie, « Les cégépiens ne veulent plus d’enseignement à distance », Le Soleil, 27 février 2023. ↑
- Pour un développement détaillé de ces constats, voir Eric Martin et Sebastien Mussi, Bienvenue dans la machine. Enseigner à l’ère numérique, Montréal, Écosociété, 2023. ↑
- Naomi Klein, « How big tech plans to profit from the pandemic », The Guardian, 13 mai 2020. ↑
- Eric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un anti-humanisme radical, Paris, L’Échappée, 2021. ↑
- « L’intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l’enseignement ? », La tête dans les nuances, NousTV, Mauricie, 29 mai 2023. ↑
- Céline Lafontaine, L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004. ↑
- NDLR. Prompt : il s’agit d’une commande informatique destinée à l’utilisateur ou l’utilisatrice lui indiquant comment interagir avec un programme, ou dans le cas de ChatGPT, des instructions envoyées à la machine pour lui permettre de faire ce qu’on lui demande. ↑
- Jean-Claude Michéa, L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes, Castelnau-le-Lez, Climats, 2006. ↑
- NDLR. Cyborg (mot formé de cybernetic organism) : personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et de parties mécaniques. ↑
- Marine Protais, « Pourquoi Elon Musk et ses amis veulent déclencher la fin du monde », L’ADN, 20 septembre 2023. ↑
- Michel Freitag, L’oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2002. ↑
- En 1913, l’écrivain français Charles Péguy qualifie les instituteurs de « hussards noirs ». Combatifs et engagés, ils défendent l’école de la République.
- Fischbach, La privation de monde, op. cit. ↑
- Voir la présentation de Gilles Labelle lors du séminaire du Collectif Société sur l’ouvrage Bienvenue dans la machine, UQAM, 28 avril 2023. ↑
- D’après Wikipedia, « La singularité technologique (ou simplement la Singularité) est l’hypothèse selon laquelle l’invention de l’intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l’œuvre que d’intelligences artificielles qui s’auto-amélioreraient, de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement dans une « explosion d’intelligence », débouchant sur une puissante superintelligence qui dépasserait qualitativement de loin l’intelligence humaine ». Cette thèse est notamment défendue par le futurologue transhumaniste Ray Kurzweil. ↑
- Jacques Dofny, Émile Boudreau, Roland Martel et Marcel Rioux, « Matériaux pour la théorie et la pratique d’un socialisme québécois », article publié dans la revue Socialisme 64, Revue du socialisme international et québécois, n° 1, printemps 1964, p. 5-23. ↑
- Eric Martin, « Communalisme et culture. Réflexion sur l’autogouvernement et l’enracinement », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 24, automne 2020, p. 94-100. ↑
Vandalisme ou sabotage sur le chantier du pont de l’A-20

Réaction de la Commission nationale des femmes aux événements de la dernière semaine

Article tiré de la page facebook de la Commission nationale des femmes
La Commission nationale des femmes de Québec solidaire désire exprimer sa profonde tristesse et sa colère à la suite de la démission d'Émilise Lessard-Therrien. Nous considérons que sa démission est un double revers pour Québec solidaire. La parole des femmes en prend un coup, de même que la main tendue pour une croissance des régions. En effet, l'ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue était la seule qui ne venait pas d'un des grands centres urbains de la province. Elle représentait l'espoir d'une autre vision, complémentaire et nécessaire. Compte tenu de tous les efforts et des fonds qui ont été investis dans la course au porte-parolat féminin et dans la tournée des régions, nous estimons qu'il faut revoir nos façons de faire de toute urgence. Un constat s'impose : il est impératif de laisser parler les femmes et d'arrêter de museler leurs idées ou leurs interventions pour correspondre à une certaine image.
Au cours des dernières années, la Commission nationale des femmes a tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises. Les témoignages d'ex-candidates déçues, de membres démobilisées, de femmes de plusieurs circonscriptions, associations ou instances, ainsi que les tensions récurrentes sur les questions de parité s'accumulent et constituent un ensemble préoccupant qui met en lumière un enjeu crucial auquel il est impératif de s'attaquer pour que Québec solidaire continue de représenter une véritable alternative féministe et progressiste pour le Québec.
Fondé sur des principes écologiste, antiraciste, syndicaliste, indépendantiste et féministe, Québec solidaire s'est toujours démarqué par son approche politique alternative. Un récent sondage de Pallas Data a d'ailleurs confirmé que Québec solidaire demeure une source d'espoir privilégiée pour les femmes, puisqu'elles votent pour notre parti en plus grand nombre que les hommes. La représentativité de la voix des femmes au sein du parti est donc d'une importance capitale.
La Commission nationale des femmes constate avec préoccupation que les voix masculines dominent de plus en plus au sein des instances, du personnel et des élu·e·s de Québec solidaire. Des principes fondamentaux du parti, comme la parité, sont remis en question ou étiquetés “radicaux” avec le risque de faire taire de nombreuses femmes. Québec solidaire devrait tirer une grande fierté de se positionner comme un parti féministe intersectionnel, particulièrement dans un contexte mondial marqué par un virage à droite et une montée en puissance de mouvements qui menacent les droits des femmes. Des études révèlent un clivage croissant entre les jeunes femmes et les jeunes hommes quant à leurs orientations politiques, les femmes étant plus enclines à se tourner vers la gauche et les hommes vers la droite. Face à cette tendance inquiétante, Québec solidaire doit se positionner comme un rempart et proposer un projet de société rassembleur et ambitieux, un nouveau Québec, qui ne peut se construire sans la pleine participation des femmes. L'indépendance ne se fera pas sans les voix des femmes.
La démission d'Émilise Lessard-Therrien met en lumière une crise profonde au sein de Québec solidaire, une crise qui remet en question la place des femmes et la voix des militant·es dans le parti. La Commission nationale des femmes s'inquiète de l'influence croissante de personnes non élues démocratiquement, qui prennent des décisions cruciales sur la communication et l'orientation médiatique du parti sans être tenues redevables devant les membres. Québec solidaire regorge de talent et d'expertise militante, une richesse inestimable qu'il est urgent de revaloriser. Une meilleure écoute des voix des militant·es, et en particulier des femmes, est indispensable pour sortir de cette crise et retrouver le cap des valeurs fondatrices écologiste, antiraciste, syndicaliste, indépendantiste et féministe du parti.
Si Québec solidaire aspire véritablement à incarner ces valeurs, il faut réajuster le cap. Tirons les leçons qui s'imposent. Agissons autrement.
Signé
Royse Henderson, responsable de la Commission nationale des femmes (CNF)
ET les membres de la CNF
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Des travailleurs d’hôtels réclament une augmentation salariale de 9% par an

Réaction de la Commission nationale des femmes aux évènements de la dernière semaine

tiré de la page facebook de la Commission nationale des femmes | https://www.facebook.com/CNFQS
La Commission nationale des femmes de Québec solidaire désire exprimer sa profonde tristesse et sa colère à la suite de la démission d'Émilise Lessard-Therrien. Nous considérons que sa démission est un double revers pour Québec solidaire. La parole des femmes en prend un coup, de même que la main tendue pour une croissance des régions. En effet, l'ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue était la seule qui ne venait pas d'un des grands centres urbains de la province. Elle représentait l'espoir d'une autre vision, complémentaire et nécessaire. Compte tenu de tous les efforts et des fonds qui ont été investis dans la course au porte-parolat féminin et dans la tournée des régions, nous estimons qu'il faut revoir nos façons de faire de toute urgence. Un constat s'impose : il est impératif de laisser parler les femmes et d'arrêter de museler leurs idées ou leurs interventions pour correspondre à une certaine image.
Au cours des dernières années, la Commission nationale des femmes a tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises. Les témoignages d'ex-candidates déçues, de membres démobilisées, de femmes de plusieurs circonscriptions, associations ou instances, ainsi que les tensions récurrentes sur les questions de parité s'accumulent et constituent un ensemble préoccupant qui met en lumière un enjeu crucial auquel il est impératif de s'attaquer pour que Québec solidaire continue de représenter une véritable alternative féministe et progressiste pour le Québec.
Fondé sur des principes écologiste, antiraciste, syndicaliste, indépendantiste et féministe, Québec solidaire s'est toujours démarqué par son approche politique alternative. Un récent sondage de Pallas Data a d'ailleurs confirmé que Québec solidaire demeure une source d'espoir privilégiée pour les femmes, puisqu'elles votent pour notre parti en plus grand nombre que les hommes. La représentativité de la voix des femmes au sein du parti est donc d'une importance capitale.
La Commission nationale des femmes constate avec préoccupation que les voix masculines dominent de plus en plus au sein des instances, du personnel et des élu·e·s de Québec solidaire. Des principes fondamentaux du parti, comme la parité, sont remis en question ou étiquetés “radicaux” avec le risque de faire taire de nombreuses femmes. Québec solidaire devrait tirer une grande fierté de se positionner comme un parti féministe intersectionnel, particulièrement dans un contexte mondial marqué par un virage à droite et une montée en puissance de mouvements qui menacent les droits des femmes. Des études révèlent un clivage croissant entre les jeunes femmes et les jeunes hommes quant à leurs orientations politiques, les femmes étant plus enclines à se tourner vers la gauche et les hommes vers la droite. Face à cette tendance inquiétante, Québec solidaire doit se positionner comme un rempart et proposer un projet de société rassembleur et ambitieux, un nouveau Québec, qui ne peut se construire sans la pleine participation des femmes. L'indépendance ne se fera pas sans les voix des femmes.
La démission d'Émilise Lessard-Therrien met en lumière une crise profonde au sein de Québec solidaire, une crise qui remet en question la place des femmes et la voix des militant·es dans le parti. La Commission nationale des femmes s'inquiète de l'influence croissante de personnes non élues démocratiquement, qui prennent des décisions cruciales sur la communication et l'orientation médiatique du parti sans être tenues redevables devant les membres. Québec solidaire regorge de talent et d'expertise militante, une richesse inestimable qu'il est urgent de revaloriser. Une meilleure écoute des voix des militant·es, et en particulier des femmes, est indispensable pour sortir de cette crise et retrouver le cap des valeurs fondatrices écologiste, antiraciste, syndicaliste, indépendantiste et féministe du parti.
Si Québec solidaire aspire véritablement à incarner ces valeurs, il faut réajuster le cap. Tirons les leçons qui s'imposent. Agissons autrement.
Signé
Royse Henderson, responsable de la Commission nationale des femmes (CNF)
ET les membres de la CNF

Rompre avec la croissance capitaliste, pour une alternative écosocialiste

Manifeste du marxisme révolutionnaire à l'ère de la destruction écologique et sociale du capitalisme
La direction de la Quatrième Internationale a approuvé, en tant que premier projet, un Manifeste écosocialiste, qui sera discuté lors de notre prochain Congrès mondial en février 2025 (voir ci-dessous).
Ce document est basé sur notre conviction qu'une société écosocialiste, libérée de la domination de classe, de genre, de race ou coloniale, est nécessaire et ne peut être réalisée que par une révolution. Le Manifeste tente d'évaluer les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif.
Nous serions intéressé·es par les commentaires, les critiques et les arguments des scientifiques concernés, des penseurs marxistes et des mouvements sociaux et politiques significatifs. Nous ne prétendons pas détenir le monopole de la vérité et nous pensons que le dialogue avec d'autres forces radicales et révolutionnaires est nécessaire, voire indispensable, si nous voulons avancer dans la lutte.
Version PDF
Introduction
INTR.1.1. Ce Manifeste est un document de la Quatrième Internationale, fondée en 1938 par Léon Trotsky et ses camarades pour sauver l'héritage de la Révolution d'Octobre du désastre stalinien. Refusant un dogmatisme stérile, la IVe Internationale a intégré dans sa réflexion et sa pratique les défis des mouvements sociaux et de la crise écologique. Ses forces sont limitées, mais elles sont présentes sur tous les continents et ont activement contribué à la résistance au nazisme, à Mai 68 en France, à la solidarité avec les luttes anticoloniales (Algérie, Vietnam), à l'essor du mouvement altermondialiste et au développement de l'écosocialisme.
La IVe Internationale ne se considère pas comme la seule avant-garde ; elle participe, dans la mesure de ses forces, à de larges formations anticapitalistes. Son objectif est de contribuer à la formation d'une nouvelle Internationale, à caractère de masse, dont elle serait l'une des composantes.
INTR.1.2. Notre époque est celle d'une double crise historique : la crise de l'alternative socialiste face à la crise multiforme de la "civilisation" capitaliste.
INTR.1.3 Si la IVe Internationale publie ce Manifeste en 2025, c'est parce que nous sommes convaincu·es que le processus de révolution écosocialiste à différentes échelles territoriales, mais à dimension planétaire, est plus que jamais nécessaire : il s'agit désormais non seulement de mettre fin aux régressions sociales et démocratiques qui accompagnent l'expansion capitaliste mondiale, mais aussi de sauver l'humanité d'une catastrophe écologique sans précédent dans l'histoire humaine. Ces deux objectifs sont inextricablement liés.
INTR.1.4. Cependant, le projet socialiste qui est à la base de nos propositions nécessite une large refondation nourrie par l'évaluation pluraliste des expériences et par les grands mouvements de lutte contre toutes les formes de domination et d'oppression (classe, genre, communautés nationales dominées, etc.). Le socialisme que nous proposons est radicalement différent des modèles qui ont dominé le siècle dernier ou de tout régime étatiste ou dictatorial : c'est un projet révolutionnaire, radicalement démocratique, nourri par l'apport des luttes féministes, écologiques, antiracistes, anticolonialistes, antimilitaristes et LGBTQI.
INTR. 1.5. Nous utilisons le terme d'écosocialisme depuis quelques décennies, car nous sommes convaincus que les menaces et les défis globaux posés par la crise écologique doivent imprégner toutes les luttes au sein de/ contre l'ordre globalisé existant et nécessitent une reformulation du projet socialiste. La relation avec notre planète, le dépassement de la "fracture métabolique" (Marx) entre les sociétés humaines et leur milieu de vie, le respect des équilibres écologiques de la planète ne sont pas seulement des chapitres de notre programme et de notre stratégie, mais leur fil conducteur.
INTR.1.6. La nécessité d'actualiser les analyses du marxisme révolutionnaire a toujours inspiré l'action et la pensée de la Quatrième Internationale. Nous poursuivons cette démarche dans notre travail de rédaction de ce Manifeste écosocialiste : nous voulons contribuer à la formulation d'une perspective révolutionnaire capable d'affronter les défis du XXIe siècle. Une perspective qui s'inspire des luttes sociales et écologiques, et des réflexions critiques authentiquement anticapitalistes qui se développent dans le monde.
1. La nécessité objective d'une révolution écosocialiste, antiraciste, antimilitariste, anticolonialiste et féministe
1.1. Le capital triomphe, mais son triomphe le plonge dans les contradictions insurmontables mises en évidence par Marx. Face à celles-ci, Rosa Luxembourg lance son avertissement en 1915 : "Socialisme ou barbarie". L'actualité de cet avertissement est plus brûlante que jamais, car la catastrophe qui se développe autour de nous est sans précédent. Aux fléaux de la guerre, du colonialisme, de l'exploitation, du racisme, de l'autoritarisme, des oppressions de toutes sortes, s'ajoute en effet un nouveau fléau, qui exacerbe tous les autres : la destruction accélérée par le capital de l'environnement naturel dont dépend la survie de l'humanité.
1.2. Les scientifiques identifient huit indicateurs mondiaux de durabilité écologique. Les limites du danger sont estimées pour sept d'entre eux. En raison de la logique capitaliste d'accumulation, sept d'entre elles au moins sont déjà franchis : (climat, intégrité fonctionnelle des écosystèmes, cycle de l'azote, cycle du phosphore, eaux douces souterraines, eaux douces de surface et superficie des écosystèmes naturels, dont six dépassent même le "plafond" (seul le climat ne le dépasse pas)). Les pauvres sont les principales victimes, surtout dans les pays pauvres.
1.3. Sous le fouet de la concurrence, la grande industrie et la finance renforcent leur emprise despotique sur les humains et la Terre. La destruction se poursuit, malgré les cris d'alarme de la science. La soif de profit, tel un automate, exige toujours plus de marchés et toujours plus de marchandises, donc plus d'exploitation de la force de travail et de pillage des ressources naturelles.
1.4. Le capital légal, le capital dit criminel et la politique bourgeoise sont étroitement liés. La Terre est achetée à crédit par les banques, les multinationales et les riches. Les gouvernements étranglent de plus en plus les droits humains et démocratiques par la répression brutale et le contrôle technologique. Un nouveau fascisme offre ses services pour sauver le système par le mensonge, le racisme, le sexisme et la démagogie sociale.
1.5. C'est peu dire que les limites de la soutenabilité sont également franchies au niveau social.
1.6. Avec leurs yachts, leurs jets, leurs piscines, leurs immenses terrains de golf particuliers, leurs nombreux SUV, leur tourisme spatial, leurs bijoux, leur haute couture et leurs résidences luxueuses aux quatre coins du monde, les 1 % les plus riches possèdent autant que 50 % de la population mondiale. La "théorie du ruissellement" est un mythe. C'est vers les riches que la richesse "ruisselle", et non l'inverse. La pauvreté augmente même dans les pays "développés". Les revenus du travail sont comprimés sans pitié, les protections sociales - quand elles existent - sont démantelées. L'économie capitaliste mondiale flotte sur un océan de dettes, d'exploitation et d'inégalités.
1.7. La répartition inéquitable des ressources engendre des catastrophes environnementales parmi les différents groupes ethniques et raciaux. Par exemple, dans les sociétés capitalistes développées ou en développement, les pauvres et les personnes racisées habitent généralement les territoires les plus touchés par la pollution, avec une plus grande concentration de déchets, ainsi que les zones à risque dépourvues de planification urbaine, telles que les pentes et les collines. Le racisme environnemental est un autre visage de l'exclusion que le capitalisme impose aux personnes racisées et pauvres.
1.8. Les inégalités et les discriminations touchent particulièrement les femmes, qui continuent d'assurer la majeure partie du travail domestique et de soins, qu'il soit gratuit ou rémunéré. Elles ne perçoivent que 35 % des revenus du travail. Dans certaines régions du monde (Chine, Russie, Asie centrale), leur part diminue, parfois de manière significative. Au-delà du travail, les femmes sont attaquées sur tous les fronts en tant que femmes, par la violence sexiste et sexuelle, dans leurs droits à l'alimentation, à l'éducation, leurs droits d'être respectées et de disposer de leur propre corps.
1.9. Si les personnes âgées des classes populaires (et aussi d'une partie de la classe moyenne") sont mises au rebut, la vie des générations futures est généralement mutilée à l'avance. La plupart des parents des classes populaires ne croient plus que leurs enfants vivront mieux qu'elle et eux. Un nombre croissant de jeunes observent avec effroi, rage, tristesse et chagrin, la destruction organisée de leur monde, violé, éventré, noyé dans le béton, englouti dans les eaux froides du calcul égoïste ; la destruction programmée de leur avenir.
1.10. Les fléaux de la famine, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition avaient reculé à la fin du XXe siècle ; ils resurgissent aujourd'hui en raison de la convergence catastrophique du néolibéralisme, du militarisme et du changement climatique : près d'une personne sur dix a faim, près d'une sur trois souffre d'insécurité alimentaire, plus de trois milliards n'ont pas les moyens de se nourrir sainement. Cent cinquante millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance dû à la faim.
1.11. L'espoir d'un monde pacifique à court terme s'évanouit. Plus de 30 pays du monde sont ou ont été récemment en proie à des guerres de grande ampleur, notamment le Soudan, l'Irak, le Yémen, la Palestine, la Syrie, l'Ukraine, la Libye, la République Démocratique du Congo et le Myanmar. La crise climatique elle-même, les phénomènes météorologiques et les flux migratoires intenses qui en résultent alimentent de nombreux conflits dans le monde. Les souffrances, les déplacements et la mort de populations sont immenses.
1.12.. Alors que les impérialismes se chamaillent, les mesures urgentes pour la transition climatique et un avenir durable sont remises en question. Les guerres, outre le fait qu'elles sont calamiteuses en termes de vies humaines, qu'elles s'attaquent au corps des femmes, qu'elles utilisent le viol comme instrument de terreur et qu'elles déshumanisent la vie collective, sont néfastes pour la planète sur laquelle nous vivons. Elles détruisent les habitats, provoquent la déforestation, empoisonnent les sols, les eaux et l'air, et sont des sources majeures d'émissions de carbone.
1.13. La guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine en 2022 et le nouveau degré de nettoyage ethnique perpétré dans la guerre de Gaza en 2023/24 contre le peuple palestinien sont des crimes majeurs contre l'humanité. Ces deux cas confirment la nature barbare du capitalisme actuel. L'agression impérialiste russe contre l'Ukraine en 2022 a favorisé les tensions géopolitiques à l'échelle mondiale. Elle confirme l'entrée dans une nouvelle ère de compétition inter-impérialiste pour l'hégémonie mondiale, avec les États-Unis et leurs alliés d'un côté, la Chine et ses alliés de l'autre. Les ressources foncières, énergétiques et minérales jouent un rôle important dans cette compétition inter-impérialiste.
1.14. Tout le monde pourrait avoir une bonne vie sur la Terre, mais le capitalisme est un mode de prédation exploiteur, machiste, raciste, guerrier, autoritaire et mortifère. Le productivisme est un destructivisme. En deux siècles, il a conduit l'humanité dans une profonde impasse écosociale.
1.15. Le changement climatique est l'aspect le plus dangereux de la destruction écologique, c'est une menace pour la vie humaine sans précédent dans l'histoire. La Terre risque de devenir un désert biologique inhabitable pour des milliards de pauvres qui ne sont pas responsables de ce désastre. Pour arrêter cette catastrophe, nous devons réduire de moitié les émissions mondiales de dioxyde de carbone et de méthane avant 2030, et les éliminer avant 2050. Il faut donc en priorité bannir les énergies fossiles, l'agro-industrie, l'industrie de la viande et l'hyper-mobilité... c'est-à-dire produire moins globalement.
D'une part, la folie de l'accumulation capitaliste confronte l'humanité au besoin urgent d'une décroissance globale de la consommation d'énergie finale et, par conséquent, de la production matérielle et du transport. D'autre part, trois milliards de personnes, principalement dans les pays du Sud Global1 , vivent dans des conditions épouvantables, du fait du capitalisme et de l'impérialisme. La justice sociale exige de développer certaines productions pour répondre à leurs immenses besoins insatisfaits : de bons systèmes de santé, des logements décents, une bonne alimentation, une bonne éducation, des transports publics, de l'eau propre, une sécurité sociale pour tou·tes…
1.17. Existe-t-il un moyen de sortir de cette contradiction ? Oui. Il est possible pour les humains de vivre bien tout en consommant beaucoup moins qu'auparavant, notamment grâce aux progrès technologiques dans les domaines de la médecine, de la construction, de l'efficacité énergétique, entre autres. L'impact sur le climat des productions destinées à satisfaire les besoins humains - surtout lorsqu'elles sont planifiées démocratiquement et assumées par le secteur public dans un contexte d'égalité sociale - est bien moindre que celui des productions destinées à satisfaire les besoins des riches par la croissance du PIB et la concurrence aveugle du marché pour le profit. Le 1% le plus riche émet près de deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Les 10 % les plus riches sont responsables de plus de 50 % des émissions de CO2. Les pauvres émettent beaucoup moins que 2-2,3 tonnes de CO2 par personne et par an (le volume moyen à atteindre en 2030 si nous voulons parvenir à des émissions nettes nulles en 2050 avec une probabilité de 50 %). Répondre à leurs besoins aurait un impact écologique limité. En fait, pour arrêter la catastrophe, il faut une société qui assure le bien-être et garantisse l'égalité comme jamais auparavant. Une perspective souhaitable, mais les 1% de riches devraient diviser leurs émissions par trente dans quelques années. Mais ils refusent de faire le moindre effort ! Au contraire : ils veulent toujours plus de privilèges !
1.18. Les gouvernements se sont engagés à rester en dessous de +1,5°C, à préserver la biodiversité, à atteindre un soi-disant "développement durable" et à respecter le principe des "responsabilités et capacités communes mais différenciées" dans la crise écologique,... tout en produisant toujours plus de marchandises et en utilisant toujours plus d'énergie. Il est exclu que ces promesses conjuguées soient tenues par le capital. Les faits le montrent :
1.18.1. - Trente-trois ans après le Sommet de la Terre de Rio (1992), le bouquet énergétique mondial est encore entièrement dominé par les combustibles fossiles (84 % en 2020). La production totale de combustibles fossiles a augmenté de 62 %, passant de 83 térawattheures (TWh) en 1992 à 136 TWh en 2021. Les énergies renouvelables viennent s'ajouter au système énergétique principalement fossile, offrant davantage de capacités et de nouveaux marchés aux capitalistes.2
1.18.2. - Avec la crise énergétique déclenchée par la pandémie et aggravée par la guerre impérialiste russe contre l'Ukraine, toutes les puissances capitalistes ont relancé le charbon, le pétrole, le gaz naturel (y compris le gaz de schiste) et l'énergie nucléaire.
1.18.3. - Principal responsable historique du dérèglement climatique, l'impérialisme américain dispose d'énormes moyens pour lutter contre la catastrophe, mais ses représentants politiques subordonnent criminellement cette lutte à la protection de leur hégémonie mondiale, quand ils ne la refusent pas tout simplement.
1.18.4. - Les mesures que les grands pollueurs mettent en œuvre sous le label "décarbonisation" non seulement ne répondent pas à l'ampleur de la crise climatique mais accélèrent l'extractivisme, surtout dans les pays dominés, mais aussi au Nord et dans les océans, au détriment des populations et des écosystèmes.
1.18.5. - Cette soi-disant "décarbonisation" exacerbe l'accaparement impérialiste des terres et l'exploitation de la main-d'œuvre dans le Sud, avec la complicité des bourgeoisies locales (comme l'illustrent différents projets d'investissement basés sur l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne, en particulier dans les "zones franches" des pays pauvres, afin de produire de "l'hydrogène vert" destiné à approvisionner les industries des pays développés).
1.18.6. - Les "marchés du carbone", les "compensations carbone", les "compensations biodiversité" et les "mécanismes de marché", fondés sur la compréhension de la nature comme un capital, pèsent sur les moins responsables, les pauvres, en particulier les populations autochtones, les populations racisées et les populations du Sud en général.
1.19. Valables en théorie, les concepts abstraits tels que " économie circulaire ", " résilience ", " transition énergétique ", " biomimétisme " deviennent en pratique des formules creuses dès lors qu'ils sont mis au service du productivisme capitaliste. S'il n'y a pas de plan de reconversion de la production mis en œuvre par l'ensemble de la société, les améliorations techniques (par exemple pour rendre la production d'énergie moins chère) ont souvent un effet rebond3 : une réduction du prix de l'énergie entraîne généralement une augmentation de la consommation d'énergie et de matières.
1.20. Face à la crise climatique, le fétichisme capitaliste de l'accumulation ne laissera finalement que deux options : déployer des technologies d'apprentis sorciers (nucléaire, capture-séquestration du carbone, géo-ingénierie...)... ou laisser la "nature" éliminer quelques milliards de pauvres dans les pays pauvres.
1.21. Politiquement, l'impuissance et l'injustice du capitalisme vert font le jeu d'un néo-fascisme fossile, complotiste, colonialiste, raciste, violemment machiste et LGBTQIphobe, que cette seconde possibilité ne rebute pas. Une fraction des riches marche vers un immense crime contre l'humanité, pariant cyniquement que sa richesse la protégera, laissant mourir les pauvres.
1.22. Le capitalisme vert néolibéral et le néofascisme climato-négationniste ne sont pas la même chose, le second étant bien pire, mais aucun de ces régimes ne pourra empêcher le réchauffement climatique de se poursuivre, avec des conséquences désastreuses, et le premier nourrit le second. Si les victimes sont plus nombreuses dans les pays pauvres, les pays riches subiront également des pertes dramatiques. Le capitalisme mondial ne progresse pas graduellement vers la paix et le développement durable, il régresse à grands pas vers la guerre, le désastre écologique, le génocide et la barbarie néo-fasciste.
1.23. Face à ce défi, il ne suffit pas de remettre en cause le régime néolibéral et de revaloriser le rôle de l'État. Il ne suffirait même pas d'arrêter la dynamique d'accumulation (un objectif impossible sous le capitalisme !) La consommation finale mondiale d'énergie doit diminuer radicalement, ce qui signifie produire moins et transporter moins à l'échelle mondiale.
1.24. Pour respecter cette contrainte éco-climatique, l'orientation même de l'économie doit changer de fond en comble : la science et les avancées technologiques doivent être utilisées pour satisfaire les besoins sociaux de l'humanité et régénérer l'écosystème global, au lieu de satisfaire la course au profit des capitalistes. C'est la seule solution qui permette de concilier le besoin légitime de bien-être pour tou·tes et la régénération de l'écosystème mondial. La juste suffisance et la juste décroissance - la décroissance écosocialiste - est une condition sine qua non du sauvetage.
1.25. Sortir de l'impasse productiviste n'est possible qu'aux conditions suivantes :
1.25.1. - abandonner le "technosolutionnisme", c'est-à-dire l'idée que la solution viendra des nouvelles technologies dont on présente la face écologique sans mesurer la consommation des énergies et ressources préjudiciable que leur production et usage induisent . Dans un souci de sagesse écologique, décider d'utiliser les moyens dont nous disposons, ils suffisent à répondre aux besoins de tou·tes.
1.25.2. - réduire radicalement l'empreinte écologique des riches pour permettre une bonne vie à tou·tes
1.25.3. - mettre fin au libre marché du capital (bourses, banques privées, fonds de pension) ;
1.25.4. - réguler les marchés de biens et de services ;
1.25.5. - maximiser à tous les échelons de la société les relations directes entre producteurs et consommateurs, et les processus d'évaluation des besoins et des ressources sous l'angle des valeurs d'usage et des priorités écologiques et sociales.
1.25.6. - déterminer démocratiquement quels besoins ces valeurs d'usage doivent satisfaire et comment ;
1.25.7. - placer au centre de cette délibération démocratique la prise en charge des humains et des écosystèmes, le respect attentif du vivant et des limites écologiques ;
1.25.8. - supprimer en conséquence les productions et les transports inutiles, refonder toute l'activité productive, sa circulation et sa consommation.
1.26. Ces conditions sont nécessaires, mais pas suffisantes. La crise sociale et la crise écologique ne font qu'une. Il faut reconstruire un projet émancipateur pour les exploité·es et les opprimé·es. Un projet de classe qui, au-delà des besoins fondamentaux, privilégie l'être au lieu de l'avoir. Un projet qui modifie en profondeur les comportements, la consommation, le rapport au reste de la nature, la conception du bonheur et la vision que les humains ont du monde. Un projet anti-productiviste pour vivre mieux en prenant soin du vivant sur la seule planète habitable du système solaire.
1.27. Le capitalisme a déjà plongé l'humanité dans une situation aussi sombre, notamment à la veille du premier conflit mondial. L'hystérie nationaliste s'est emparée des masses et la social-démocratie, trahissant sa promesse de répondre à la guerre par la révolution, a donné le feu vert aux pires tueries de l'histoire de l'humanité. Néanmoins, Lénine définissait la situation comme "objectivement révolutionnaire" : ”seule la révolution peut arrêter le massacre”, dit-il. L'histoire lui a donné raison : la révolution en Russie et la crainte de son extension ont contraint les bourgeoisies à mettre fin au massacre. La comparaison a évidemment ses limites. Les médiations vers l'action révolutionnaire sont aujourd'hui infiniment plus complexes. Mais le même sursaut des consciences est nécessaire. Or, face à la crise écologique, une révolution anticapitaliste est encore plus objectivement nécessaire. C'est ce jugement fondamental qui doit servir de base à l'élaboration d'un programme, d'une stratégie et d'une tactique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter la catastrophe.
1.28. Tout dépend des résultats des luttes. Quelle que soit l'ampleur du désastre, à chaque étape, les luttes feront la différence. Au sein des luttes, tout dépend de la capacité des militant·es écosocialistes à s'organiser pour s'orienter dans la pratique selon la boussole de la nécessité historique objective.
2. Le monde pour lequel nous nous battons
2.1. Notre projet de société future articule l'émancipation sociale et politique avec l'impératif d'arrêter la destruction de la vie et de réparer autant que possible les dégâts déjà causés.
2.2. Nous voulons (tenter d') imaginer ce que serait une vie bonne pour tou·tes et partout en réduisant la consommation de matière et d'énergie, et donc en réduisant la production matérielle. Il ne s'agit pas de donner un modèle tout fait, mais d'oser penser un autre monde, un monde qui donne envie de se battre pour le construire en se débarrassant du capitalisme et du productivisme.
« Oui, c'est pour le pain que nous nous battons, mais nous nous battons aussi pour les roses. »
2.3. Une vie bonne pour tou·tes exige que les besoins humains fondamentaux - alimentation saine, santé, logement, air pur et eau propre - soient satisfaits.
2.4. Une bonne vie est aussi une vie choisie, épanouissante et créative, engagée dans des relations humaines riches et égalitaires, entourée de la beauté du monde et des réalisations humaines.
2.5. Notre planète dispose (encore) de suffisamment de terres arables, d'eau potable, de soleil et de vent, de biodiversité et de ressources de toutes sortes pour répondre aux besoins humains légitimes en renonçant aux combustibles fossiles nuisibles au climat et à l'énergie nucléaire. Cependant, certaines de ces ressources sont limitées et donc épuisables, tandis que d'autres, bien qu'inépuisables, nécessitent pour leur consommation humaine des matières épuisables, voire rares et dont l'extraction est écologiquement dommageable. En tout état de cause, leur utilisation ne pouvant être illimitée, nous les utilisons avec prudence et parcimonie, dans le respect de l'environnement.
2.6. Indispensables à notre vie, ils sont exclus de l'appropriation privée, considérés comme des biens communs, car ils doivent bénéficier à l'ensemble de l'humanité aujourd'hui et à long terme. Afin de garantir ces biens communs dans le temps, des règles collectives définissant les usages, mais aussi les limites de ces usages, les obligations d'entretien ou de réparation, sont élaborées.
2.7. Parce qu'on ne soigne pas une mangrove comme une calotte glaciaire, une zone humide comme une plage de sable, une forêt tropicale comme une rivière, parce que l'énergie solaire n'obéit pas aux mêmes règles, n'impose pas les mêmes contraintes matérielles que l'éolien ou l'hydraulique, l'élaboration de règles ne peut être que le fruit d'un processus démocratique impliquant les premier·es concerné·es, travailleur·ses et habitant·es.
2.8. Notre commun, c'est aussi l'ensemble des services qui permettent de répondre de manière égalitaire, et donc gratuite, aux besoins d'éducation, de santé, de culture, d'accès à l'eau, à l'énergie, à la communication, aux transports, etc. Ils sont, eux aussi, gérés et organisés démocratiquement par l'ensemble de la société.
2.9. Les services consacrés aux personnes et aux soins dont elles ont besoin aux différentes étapes de leur vie, brisent la séparation entre le public et le privé, l'assignation des femmes à ces tâches en les socialisant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'elles soient l'affaire de l'ensemble de la société. Ces services de reproduction sociale sont des outils essentiels, parmi d'autres, pour lutter contre l'oppression patriarcale.
2.10. Tous ces "services publics" décentralisés, participatifs et communautaires constituent la base d'une organisation sociale non autoritaire.
2.11. À l'échelle de la société dans son ensemble, la planification écologique démocratique permet aux populations de se réapproprier les grands choix sociaux relatifs à la production, de décider, en tant que citoyen·nes et usager·es, de ce qu'il faut produire et comment le produire, des services qui doivent être fournis, mais aussi des limites acceptables pour l'utilisation des ressources matérielles telles que l'eau, l'énergie, les transports, le foncier, etc. Ces choix sont préparés et éclairés par des processus de délibération collective qui s'appuient sur l'appropriation des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou issues de l'expérience des populations, sur l'auto-organisation des opprimé·es (mouvements de libération des femmes, peuples racisés, personnes handicapées, etc).
2.12. Cette démocratie économique et politique globale s'articule avec de multiples collectifs/commissions décentralisés : ceux qui permettent de décider au niveau local, dans la commune ou le quartier, de l'organisation de la vie publique et ceux qui permettent aux travailleur·ses et aux producteur·rices de contrôler la gestion et l'organisation de leur unité de travail, de décider de la manière de produire et donc de travailler. C'est la combinaison de ces différents niveaux de démocratie qui permet la coopération et non la concurrence, une gestion juste d'un point de vue écologique et social, épanouissante d'un point de vue humain, au niveau de l'atelier, de l'entreprise, de la branche... mais aussi du quartier, de la commune, de la région, du pays et même de la planète !
2.13. Toutes les décisions relatives à la production et à la distribution, à la manière dont nous voulons vivre, sont guidées par le principe suivant : décentraliser autant que possible, coordonner autant que nécessaire.
2.14. Prendre sa vie en main et participer à des collectifs sociaux demande du temps, de l'énergie et de l'intelligence collective. Heureusement, le travail de production et de reproduction sociale n'occupe que quelques heures par jour.
2.15. La production est exclusivement consacrée à la satisfaction des besoins démocratiquement déterminés. La production et la distribution sont organisées de manière à minimiser la consommation de ressources et à éliminer les déchets, les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre, elle vise en permanence la sobriété et la "durabilité programmée" (par opposition à l'obsolescence programmée du capitalisme, qu'elle soit planifiée ou simplement due à la logique de la course au profit). Produire au plus près des besoins à satisfaire permet de réduire les transports et de mieux appréhender le travail, les matériaux et l'énergie nécessaires.
2.16. Ainsi, l'agriculture est écologique, paysanne et locale afin d'assurer la souveraineté alimentaire et la protection de la biodiversité. Des ateliers de transformation et des circuits de distribution permettent de produire la plupart des aliments en circuit court.
2.17. Le secteur de l'énergie basé sur les sources renouvelables est aussi décentralisé que possible afin de réduire les pertes et d'optimiser les sources. Les activités liées à la reproduction sociale (santé, éducation, soins aux personnes âgées ou dépendantes, garde d'enfants, etc.) sont développées et renforcées, en veillant à ne pas reproduire les stéréotypes de genre.
2.18. Bien que le travail occupe moins de temps, il occupe une place essentielle, car, avec la nature et en prenant soin d'elle, il produit ce qui est nécessaire à la vie.
2.19. L'autogestion des unités de production combinée à la planification démocratique permet aux travailleur·ses de contrôler leur activité, de décider de l'organisation du travail et de remettre en cause la division entre travail manuel et travail intellectuel. La délibération s'étend au choix des technologies selon qu'elles permettent ou non au collectif de travail de maîtriser le processus de production. En privilégiant la connaissance concrète, pratique et réelle du processus de travail, les savoir-faire collectifs et individuels, la créativité, elle permet de concevoir et de produire des objets robustes, démontables et réparables, réutilisables et, le cas échéant, recyclables, et de réduire les consommations de matières et d'énergie de la fabrication à l'utilisation.
2.20. Dans tous les domaines, la conviction de faire quelque chose d'utile et la satisfaction de le faire bien se conjuguent. En ce qui concerne les tâches fastidieuses comme le ramassage des ordures, chacun veille à en réduire la lourdeur et la pénibilité. Il reste cependant une part incontournable que chacun·e accomplit à tour de rôle.
2.21. Une grande partie de la production matérielle, parce que le volume en est fortement réduit, peut être désindustrialisée (tout ou partie de l'habillement ou de l'alimentation) et les savoir-faire artisanaux, auxquels tout le monde pourrait être formé, devraient être valorisés.
2.22. Libérer le travail de l'aliénation permet d'abolir la frontière entre l'art et la vie dans une sorte de "communisme du luxe". Nous pouvons garder ou partager des outils, des meubles, un vélo, des vêtements... toute notre vie parce qu'ils sont ingénieusement conçus et beaux.
Être plutôt qu'avoir
"Seul ce qui est bon pour tous est digne de vous. Seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. » (A. Gorz).
2.23. La liberté ne réside pas dans une consommation illimitée, mais dans une autolimitation choisie et comprise, conquise contre l'aliénation consumériste. La délibération collective permet de déconstruire les besoins artificiels, de définir des besoins "universalisables", c'est-à-dire non réservés à certaines personnes ou à certaines parties du monde, qui doivent être satisfaits.
2.24. La véritable richesse ne réside pas dans l'augmentation infinie des biens - avoir - mais dans l'augmentation du temps libre - être. Le temps libre ouvre la possibilité de s'épanouir dans le jeu, l'étude, l'activité civique, la création artistique, les relations interpersonnelles et avec le reste de la nature.
2.25. Nous ouvrons donc la voie à de nombreux travaux parce que nous avons le temps d'y réfléchir et parce que nous pouvons le faire en mettant au centre l'attention portée aux personnes et au reste de la nature.
2.26. Les lieux où nous vivons, chaque espace dans lequel nous nous socialisons, nous appartiennent pour construire d'autres relations sociales interpersonnelles. Libérés de la spéculation foncière et de la voiture, nous pouvons repenser l'usage des espaces publics, combler la séparation entre le centre et la périphérie, multiplier les espaces récréatifs, de rencontre et de partage, désartificialiser les villes avec l'agriculture urbaine et le maraîchage de proximité, restaurer les biotopes insérés dans le tissu urbain... Et au-delà, mettre en œuvre une politique à long terme visant à rééquilibrer les populations urbaines et rurales et à dépasser l'opposition entre ville et campagne afin de reconstituer des communautés humaines vivables et durables à une échelle permettant une réelle démocratie.
2.27. Nos désirs et nos émotions ne sont plus des choses qui s'achètent et se vendent, l'éventail des choix est considérablement élargi pour chacun·e. Chacun·e peut développer de nouvelles façons d'avoir des relations sexuelles, de vivre, de travailler et d'élever des enfants ensemble, de construire des projets de vie de manière libre et diverse, dans le respect des décisions personnelles et de l'humanité de chacun·e, avec l'idée qu'il n'y a pas une seule option possible, ou une option meilleure que les autres. La famille peut cesser d'être l'espace de reproduction de la domination, et cesser d'être la seule forme possible de vie collective. Nous pouvons ainsi repenser la forme de la parentalité de manière plus collective, politiser nos décisions personnelles en matière de maternité et de parentalité, réfléchir à la manière dont nous considérons l'enfance et le rôle des personnes âgées ou handicapées, aux relations sociales que nous établissons avec elles, et à la manière dont nous sommes capables de briser les logiques de domination que nous avons intériorisées, héritées des sociétés antérieures.
2.28. Nous construisons une nouvelle culture, à l'opposé de la culture du viol, une culture qui reconnaît les corps de toutes les femmes cis et trans, ainsi que leurs désirs, qui reconnaît chacun·e comme un sujet capable de décider de son corps, de sa vie et de sa sexualité, qui rend visible le fait qu'il y a mille façons d'être une personne, de vivre et d'exprimer son genre et sa sexualité.
2.29. Une activité sexuelle librement consentie et agréable pour toutes celles et tous ceux qui y prennent part est en soi une justification suffisante.
2.30. Nous devons apprendre à penser l'interdépendance des êtres vivants et développer une conception des rapports de la relation entre l'humanité et la nature qui ressemblera probablement à certains égards à celle des peuples indigènes, mais qui sera néanmoins différente. Une conception selon laquelle les notions éthiques de précaution, de respect et de responsabilité, ainsi que l'émerveillement devant la beauté du monde, interféreront constamment avec une compréhension scientifique à la fois de plus en plus fine et de plus en plus consciente de son incomplétude.
3. Notre méthode transitoire
3.1. Notre analyse du capitalisme, et plus particulièrement des politiques de la classe dirigeante en relation avec les dangers écologiques et le changement climatique, nous conduit à affirmer ce qui suit :
3.2. Premièrement, la nécessité d'une alternative globale et d'un projet de société basé sur la production de valeur d'usage plutôt que sur la valeur d'échange. Tourner telle ou telle vis à l'intérieur du système et sans changer le mode de production ne permettra pas d'éviter ni même d'atténuer de manière significative les crises actuelles et les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés et qui surviendront en raison de la persistance du système capitaliste. L'une des tâches importantes de la politique révolutionnaire est de transmettre cette idée.
3.3. La compréhension de la nécessité d'un changement révolutionnaire global est une tâche qui ne peut être résolue directement et sans difficulté dans la pratique. C'est pourquoi, deuxièmement, il est important de combiner la présentation de la perspective globale avec la diffusion de revendications immédiates pour lesquelles des mobilisations peuvent effectivement être développées ou promues.
3.4. Troisièmement, il faut le souligner : Convaincre les gens ne peut se faire uniquement par l'argumentation. Pour convaincre les gens de se détourner du système capitaliste et les encourager à résister, il faut des luttes réussies qui donnent du courage et démontrent que des victoires partielles sont possibles.
3.5. Quatrièmement, pour que les luttes soient couronnées de succès, il faut une meilleure organisation. C'est toujours vrai en principe, mais aujourd'hui - à une époque où les syndicats ont (dans de nombreuses parties du monde) largement disparu politiquement et où la gauche est fragmentée - il est important de promouvoir la coopération pratique de manière non sectaire, en particulier au sein de la gauche anticapitaliste, et en même temps de soutenir les travailleur·ses dans leur auto-organisation.
3.6. D'une part, le temps presse si nous ne voulons pas voir des points de basculement cruciaux franchis et le réchauffement climatique s'accélérer de manière incontrôlable. D'autre part, la grande majorité des gens ne sont pas prêts à se battre pour un autre système, c'est-à-dire pour renverser le capitalisme. Cela est dû en partie à un manque de connaissance de la situation générale, mais plus encore à un manque de vision de ce à quoi l'alternative pourrait ou devrait ressembler. En outre, le rapport de forces social et politique entre les classes n'encourage pas vraiment la confrontation avec les dirigeants et les profiteurs de l'ordre social capitaliste.
3.7. Par ailleurs, un programme qui veut réformer le capitalisme ou le dépasser au coup par coup (de surcroît avec une politique venant d'en haut) n'a pas non plus de chance de réussir. Les réformes qui respectent les règles du système capitaliste ne sont pas en mesure de relever les défis de la crise écologique. Et les changements progressifs dans l'économie et l'État n'ont jamais conduit à un changement de système. Les propriétaires et les profiteurs du capitalisme n'assisteront pas tranquillement à la confiscation de leurs richesses et à la privation de leur mode d'enrichissement, morceau par morceau.
3.8. Le temps presse et des mesures urgentes s'imposent. Certains opposants à l'écosocialisme plaident pour des réformes légères "parce que nous ne pouvons pas attendre la révolution mondiale". Les partisan·es de l'écosocialisme n'ont pas l'intention d'attendre ! Notre stratégie est de commencer MAINTENANT, avec des revendications transitoires concrètes. C'est le début d'un processus de changement global. Il ne s'agit pas d'étapes historiques distinctes, mais de moments dialectiques dans un même processus. Chaque victoire partielle ou locale est une étape dans ce mouvement, qui renforce l'auto-organisation et encourage la lutte pour de nouvelles victoires.
3.9. Dans les luttes de classes à venir - qui constituent la base de la bataille pour l'hégémonie impliquant des couches plus larges de la classe ouvrière, les jeunes, les femmes, les indigènes, etc. - il doit être clair qu'en fin de compte, il n'y a aucun moyen d'échapper à un véritable changement de système et à la question du pouvoir. La classe dirigeante doit être expropriée et son pouvoir politique renversé.
Pour un programme de transition anticapitaliste
3.10. La méthode transitoire était déjà suggérée par Marx et Engels dans la dernière section du Manifeste communiste (1848). Mais c'est la Quatrième Internationale qui lui a donné sa signification moderne, dans le Programme de transition de 1938. L'hypothèse de base est la nécessité pour les révolutionnaires d'aider les masses, dans le processus de la lutte quotidienne, à trouver le pont entre les revendications actuelles et le programme socialiste de la révolution. Ce pont devrait inclure un système de revendications transitoires, découlant des conditions actuelles et de la conscience actuelle de larges couches de la classe ouvrière, l'objectif est de conduire les luttes sociales vers la conquête du pouvoir par le prolétariat.
3.11. Bien entendu, les révolutionnaires n'écartent pas le programme des vieilles revendications "minimales" traditionnelles : ils défendent évidemment les droits démocratiques et les conquêtes sociales des travailleur·ses. Cependant, ils proposent un système de revendications transitoires, qui peut être compris de manière appropriée par les exploité·es et les opprimé·es, mais qui est en même temps dirigé contre les bases mêmes du régime bourgeois.
3.12. La plupart des revendications transitoires mentionnées dans le Programme de 1938 sont toujours d'actualité : échelle mobile des salaires et échelle mobile des heures de travail ; contrôle ouvrier des usines, ouverture des comptes "secrets" des entreprises ; expropriation des banques privées ; expropriations de certains secteurs capitalistes… L'intérêt de telles propositions est d'unir dans la lutte les masses populaires les plus larges possibles, autour de revendications concrètes qui sont en contradiction objective avec les règles du système capitaliste.
3.13. Mais nous devons mettre à jour notre programme de revendications transitoires, afin de prendre en compte les nouvelles conditions du XXIe siècle, et en particulier la nouvelle situation créée par la crise écologique et le danger imminent d'un changement climatique catastrophique. Aujourd'hui, ces revendications doivent avoir une nature socio-écologique et, potentiellement, écosocialiste.
3.14. L'objectif des revendications écosocialistes transitoires est stratégique : pouvoir mobiliser de larges couches de travailleur·ses urbains et ruraux, de femmes, de jeunes, de victimes du racisme ou de l'oppression nationale, ainsi que les syndicats, les mouvements sociaux et les partis de gauche dans une lutte qui remette en cause le système capitaliste et la domination bourgeoise. Ces revendications, qui combinent des intérêts sociaux et écologiques, doivent être considérées comme nécessaires, légitimes et pertinentes par les exploité·es et les opprimé·es, en fonction de leur niveau de conscience sociale et politique. Dans la lutte, les gens prennent conscience de la nécessité de s'organiser, de s'unir et de se battre. Iels commencent également à comprendre qui est l'ennemi : non seulement les forces locales, mais le système lui-même. L'objectif des revendications écosociales transitoires est de renforcer, grâce à la lutte, la conscience sociale et politique des exploité·es et des opprimé·es, leur compréhension anticapitaliste et, espérons-le, une perspective révolutionnaire écosocialiste.
3.15. Certaines de ces demandes ont un caractère universel : par exemple, la gratuité des transports publics. C'est une revendication à la fois écologique et sociale, qui porte en elle les germes de l'avenir écosocialiste : services publics contre marché, gratuité contre profit capitaliste. Cependant, leur signification stratégique n'est pas la même selon les sociétés et les économies. Les revendications écosocialistes de transition doivent prendre en compte les besoins et les aspirations des masses, en fonction de leur expression locale, dans les différentes parties du système capitaliste mondial.
4. Les grandes lignes d'une alternative écosocialiste à la croissance capitaliste
INTR.4. Satisfaire les besoins sociaux réels tout en respectant les contraintes écologiques n'est possible qu'en rompant avec la logique productiviste et consumériste du capitalisme, qui creuse les inégalités, nuit au vivant et « ruine les deux seules sources de toute richesse : la Terre et les travailleurs » (Marx). Briser cette logique implique de lutter en priorité pour les lignes de force suivantes. Elles forment un ensemble cohérent, à compléter et à décliner selon les spécificités nationales et régionales. Bien sûr, dans chaque continent, dans chaque pays, il y a des mesures spécifiques à proposer dans une perspective de transition.
4.1. Contre les catastrophes, des plans publics de prévention adaptés aux besoins sociaux, sous contrôle populaire
Certains effets de la catastrophe climatique sont irréversibles (élévation du niveau de la mer) ou dureront longtemps (canicules, sécheresses, précipitations exceptionnelles, tornades plus violentes, etc.) Les compagnies d'assurance capitalistes ne protègent pas les classes populaires, ou (au mieux) les protègent mal. Face à ces fléaux, les riches n'ont que le mot "adaptation" à la bouche. "L'adaptation au réchauffement, pour eux, sert 1°) à détourner l'attention des causes structurelles, dont leur système est responsable ; 2°) à poursuivre leurs pratiques néfastes axées sur le profit maximum, sans se soucier du long terme ; 3°) à offrir de nouveaux marchés aux capitalistes (infrastructures, climatisation, transports, compensation carbone, etc.) Cette "adaptation" capitaliste technocratique et autoritaire est en fait ce que le GIEC appelle une "maladaptation". Elle accroît les inégalités, les discriminations et les dépossessions. Elle accroît également la vulnérabilité au réchauffement, au risque de compromettre gravement la possibilité même de s'adapter à l'avenir, en particulier dans les pays pauvres. A la "maladaptation" capitaliste, nous opposons l'exigence immédiate de plans publics de prévention adaptés à la situation des classes populaires. Elles sont les principales victimes des phénomènes météorologiques extrêmes, surtout dans les pays dominés. Les plans publics de prévention doivent être conçus en fonction de leurs besoins et de leur situation, en dialogue avec les scientifiques. Ils doivent concerner tous les secteurs, notamment l'agriculture, la sylviculture, le logement, la gestion de l'eau, l'énergie, l'industrie, le droit du travail, la santé et l'éducation. Ils doivent faire l'objet d'une large consultation démocratique, avec un droit de veto des communautés locales et des collectifs de travail concernés.
4.2. Partager les richesses pour prendre soin des humains et de notre environnement de vie, gratuitement
4.2.1. Des soins de santé de qualité, une bonne éducation, une bonne prise en charge des jeunes enfants, une retraite digne et une prise en charge respectueuse de la dépendance, un logement accessible, permanent et confortable, des transports publics efficaces, des énergies renouvelables, une alimentation saine, une eau propre, un accès à internet et un environnement naturel en bon état : tels sont les besoins réels qu'une civilisation digne de ce nom devrait satisfaire suffisamment pour tous les humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leurs convictions. Ceci est possible tout en diminuant de manière significative la pression globale sur notre environnement. Pourquoi ne l'avons-nous pas ? Parce que l'économie est réglée sur la consommation induite créée en tant que sous-produit industriel par les capitalistes. Ils consomment et investissent toujours plus pour le profit, s'approprient toutes les ressources et transforment tout en marchandises. Leur logique égoïste sème le malheur et la mort.
4.2.2. Un virage à 180° s'impose. Les ressources naturelles et les connaissances constituent un bien commun à gérer prudemment et collectivement. La satisfaction des besoins réels et la revitalisation des écosystèmes doivent être planifiées démocratiquement et soutenues par le secteur public, sous le contrôle actif des classes populaires, et en étendant le plus possible le libre accès. Ce projet collectif doit mettre l'expertise scientifique à son service. La première étape nécessaire est la lutte contre les inégalités et les oppressions. La justice sociale et le bien vivre pour tous sont des exigences écologiques !
4.3. Développer les biens communs et les services publics contre la privatisation et la marchandisation
4.3.1. C'est l'un des aspects clés d'une transition sociale et écologique, dans de nombreux domaines de la vie. Par exemple :
4.3.2. - L'eau : la privatisation, le gaspillage et la pollution actuelles de l'eau - rivières, lacs et nappes phréatiques - constituent un désastre social et écologique. La pénurie d'eau et les inondations dues au changement climatique sont des menaces majeures pour des milliards de personnes. L'eau est un bien commun et devrait être gérée et distribuée par des services publics, sous le contrôle des consommateurs. Les paysages et les villes devraient être désimperméabilisées, capables de stocker l'eau afin d'éviter les inondations massives.
4.3.3. - Le logement : Le droit fondamental de toutes les personnes à un logement décent, permanent et écologiquement durable ne peut être garanti sous le capitalisme. La loi du profit implique des expulsions, des démolitions et la criminalisation de celleux qui résistent. Elle implique également des factures d'énergie élevées pour les pauvres et des énergies renouvelables subventionnées pour les riches. Le contrôle public du marché immobilier, l'abaissement et le gel des intérêts et des profits des banques, l'augmentation radicale du nombre de logements sociaux et coopératifs, un processus public d'isolation climatique des habitations et un programme massif de construction de bâtiments énergétiquement autonomes sont les premières étapes d'une politique alternative.
4.3.4. - La santé : le bilan de la pandémie de COVID-19 est limpide : les privatisations et les coupes dans le secteur des soins fragilisent les classes populaires - en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées - et font peser de lourdes menaces sur la santé publique en général. Ce secteur doit être refinancé massivement et remis intégralement entre les mains de la collectivité. Les investissements doivent aller en priorité à la médecine de première ligne. L'industrie pharmaceutique doit être socialisée.
4.3.5. - Les transports : Le transport individuel dans le capitalisme privilégie les voitures individuelles, ce qui a des conséquences désastreuses sur la santé et l'écologie. L'alternative est un système large et efficace de transports publics gratuits, ainsi qu'une grande extension des zones piétonnes et cyclables. Les marchandises sont transportées sur de grandes distances par des camions ou des porte-conteneurs, avec d'énormes émissions de gaz ; la réduction du gaspillage, la relocalisation de la production et le transport des marchandises par le train sont des mesures immédiates et nécessaires. Le transport aérien devrait être réduit de manière significative et supprimé pour les distances qui peuvent être couvertes par le train.
4.4. Prendre l'argent là où il est : les capitalistes et les riches doivent payer
Une stratégie globale de transition digne de ce nom doit articuler le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, la protection contre les effets déjà perceptibles du changement climatique, la compensation des pertes et préjudices, l'aide à la reconversion (notamment la garantie de revenu des travailleur·ses concerné·es) et la réparation des écosystèmes. Les besoins financiers nécessaires d'ici 2050 s'élèvent à plusieurs milliers de milliards de dollars. Qui doit payer ? les responsables du désastre : les multinationales, les banques, les fonds de pension, les États impérialistes et les riches du Nord et du Sud. L'alternative écosocialiste passe par un vaste programme de réforme fiscale et de réduction radicale des inégalités pour aller chercher l'argent là où il se trouve : imposition progressive, levée du secret bancaire, cadastre des actifs, taxation du patrimoine, impôt unique exceptionnel à taux élevé sur le patrimoine foncier, élimination des paradis fiscaux, abolition des privilèges fiscaux des entreprises et des riches, ouverture des livres de comptes des entreprises, plafonnement des hauts revenus, abolition des dettes publiques reconnues comme "illégitimes" (sans compensation, sauf pour les petits investisseurs), compensation par les pays riches du coût de la renonciation à l'exploitation de leurs ressources fossiles par les pays dominés (projet de parc Yasuni).
4.5 Pas d'émancipation sans lutte antiraciste
L'oppression raciale est un élément structurel et structurant du mode de production capitaliste. Elle a garanti l'accumulation primitive du capital, rendue possible par la colonisation, la traite des Noirs et l'esclavage.
La construction d'un nouveau monde libéré de toute oppression et de toute exploitation exige que nous nous opposions frontalement au racisme, ce qui constitue une tâche centrale de la stratégie écosocialiste. Nous devons reconnaître que le racisme façonne les relations sociales, renforce et complexifie les mécanismes de l'exploitation bourgeoise et de l'accumulation des richesses. La diversité qui s'écarte des normes de la blancheur est transmutée en oppression.
Le déplacement forcé de millions d'Africains, leur commercialisation dans les Amériques et l'exploitation de leur travail ont assuré l'enrichissement des Européens et garantissent encore aujourd'hui leurs privilèges. Il faut rompre avec la logique génocidaire contre les groupes non blancs et renforcer la lutte anti-prison contre l'incarcération de masse, notamment à travers la tactique libérale de la prétendue guerre contre la drogue,
La lutte contre la militarisation de la police doit être au cœur de la lutte antiraciste, tout comme l'accès à des conditions de vie décentes en général.
Le racisme se manifeste de manière centrale comme un mécanisme d'oppression de secteurs de la classe ouvrière jusqu'à nos jours, configurant des positions spécifiques et des accès socialement déterminés pour les blancs, c'est-à-dire le sujet supposé universel, et pour les personnes perçues comme racisées.
Il est nécessaire de combattre toutes les politiques d'austérité, qui aggravent la précarité de la vie de la classe ouvrière dans son ensemble et touchent principalement et de plus en plus lourdement les personnes non blanches. Elles structurent le racisme environnemental qui, dans cette situation d'urgence climatique, répartit inégalement les conséquences mortelles de la production capitaliste.
4.6. Liberté de circulation et de séjour sur Terre ! Personne n'est illégal !
La catastrophe écologique est un facteur de migration de plus en plus important. Entre 2008 et 2016, une moyenne annuelle de 21,5 millions de personnes ont été déplacées de force en raison d'événements météorologiques. La plupart d'entre elles sont des personnes pauvres venant de pays pauvres. Les migrations climatiques devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies : 1,2 milliard de personnes pourraient être déplacées dans le monde d'ici à 2050. Contrairement aux demandeur·ses d'asile, les "réfugié·es climatiques" n'ont même pas de statut. Ils ne portent aucune responsabilité dans la catastrophe écologique mais le vrai responsable, le système capitaliste, les condamne à venir grossir les rangs des 108,4 millions de personnes dans le monde qui ont été déplacées de force en 2020 en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de l'homme. Les droits fondamentaux de ces personnes sont constamment attaqués : le droit d'être protégé contre la violence, d'avoir suffisamment d'eau et de nourriture, de vivre dans un logement sûr, de garder sa famille unie, de trouver un emploi décent. Un nombre croissant d'entre elles (10 millions) sont même considérées comme apatrides par l'UNHDR. Tout cela est contraire à la justice la plus élémentaire. Il nourrit les fascistes qui font des migrant·es des boucs émissaires et les déshumanisent. C'est une menace énorme pour les droits démocratiques et sociaux de tou·tes. En tant qu'internationalistes, nous nous battons pour des politiques restrictives contre le capital, pas contre les migrant·es. Nous nous opposons à la construction de murs, à l'enfermement dans des centres, à la construction de camps, aux expulsions, aux déportations et à la rhétorique raciste. Personne n'est illégal sur Terre, tout le monde doit avoir le droit de se déplacer et de partir partout. Les frontières doivent être ouvertes à tou·tes celleux qui fuient leur pays, que ce soit pour des raisons sociales, politiques, économiques ou environnementales.
4.7. Éliminer les activités économiques inutiles ou nuisibles
L'arrêt de la catastrophe climatique et du déclin de la biodiversité passe impérativement par une réduction très rapide et significative de la consommation d'énergie finale au niveau mondial. Cette contrainte est incontournable. Les premières étapes consistent à réduire drastiquement le pouvoir d'achat des riches, à abandonner la fast fashion, la publicité et la production/consommation de luxe (croisières, yachts et jets ou hélicoptères privés, tourisme spatial, etc.), à réduire la production de masse de viande et de produits laitiers et à mettre fin à l'obsolescence accélérée des produits, en allongeant leur durée de vie et en facilitant leur réparation. Le transport aérien et maritime des marchandises devrait être réduit drastiquement par la relocalisation de la production, et remplacé par le transport ferroviaire chaque fois que cela est possible. Plus structurellement, la contrainte énergétique ne peut être respectée qu'en réduisant le plus rapidement possible les activités économiques inutiles ou nuisibles. Les principaux secteurs productifs à considérer sont : la production d'armes, l'énergie fossile et la pétrochimie, l'industrie extractive, la fabrication non durable, l'industrie du bois et de la pâte à papier, la construction de voitures personnelles, les avions et la construction navale.
4.8. Souveraineté alimentaire ! Sortir de l'agro-industrie, de la pêche industrielle et de l'industrie de la viande
Ces trois secteurs font peser de graves menaces sur le climat, la santé humaine et la biodiversité. Leur démantèlement nécessite des mesures au niveau de la production mais aussi des changements importants au niveau de la consommation (dans les pays développés et chez les riches de tous les pays) et de la relation avec le vivant. Des politiques volontaristes sont nécessaires pour stopper la déforestation et remplacer l'agro-industrie, les plantations industrielles et la pêche à grande échelle respectivement par l'agroécologie paysanne, l'écoforesterie et la pêche artisanale. Ces alternatives consomment moins d'énergie, emploient plus de main-d'œuvre et sont beaucoup plus respectueuses de la biodiversité. Les agriculteur·ices et les pêcheur·ses doivent être correctement indemnisé·es par la communauté, non seulement pour leur contribution à l'alimentation humaine, mais aussi pour leur contribution écologique. Les droits des peuples premiers sur la forêt et les autres écosystèmes doivent être protégés. La consommation mondiale de viande doit être réduite de manière drastique. L'industrie de la viande et des produits laitiers doit être démantelée et il faut promouvoir une alimentation basée principalement sur la production locale de légumes. Ce faisant, nous mettons fin au traitement abject des animaux dans l'industrie de la viande et la pêche industrielle. La souveraineté alimentaire, conformément aux propositions de la Via Campesina, est un objectif clé. Elle passe par une réforme agraire radicale : la terre à celleux qui la travaillent, en particulier les femmes. Expropriation des grands propriétaires terriens et de l'agro-industrie capitaliste qui produisent des biens pour le marché mondial. Distribution de la terre aux paysan·nes et aux paysan·nes sans terre (familles ou coopératives) pour la production agrobiologique. Abolition des anciennes et des nouvelles cultures OGM en plein champ et élimination des pesticides toxiques (à commencer par ceux dont les pays impérialistes interdisent l'usage mais dont ils autorisent l'exportation dans les pays dominés !)
4.9. Réforme urbaine populaire
Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes de plus en plus grandes. Dans le même temps, les régions rurales se dépeuplent, sont ruinées par l'agro-industrie et l'exploitation minière et sont de plus en plus privées de services essentiels. Les pays dominés possèdent certaines des plus grandes mégapoles de la planète (Jakarta, Manille, Mexico DF, New Delhi, Bombay, Sao Paulo, et d'autres), un nombre croissant de sans-abri et des bidonvilles où des millions d'êtres humains (autour de Karachi, Nairobi, Bagdad,...) survivent et travaillent de manière informelle dans des conditions indignes. C'est l'un
Le Journal des Alternatives à New York pour la conférence « No War, but Class War »

Plusieurs centaines de personnes défilent dans les rues de Québec à l’occasion de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Québec, ce 1er mai 2024, Journée internationale des travailleuses et travailleurs, sous le thème « Uni.e.s pour nos conditions de travail et de vie » pour dénoncer les impacts de l'explosion du coût de la vie, de la détérioration de leurs conditions de travail, de logements et des services publics.
Presse-toi à gauche ! publie ci-dessous les interventions de certain-e-s représentant-e-s de différentes organisations à l'ouverture et à la clôture de la manifestation.
7 mai 2024 | Photo : DDP
Les manifestant-e-s ont critiqué les politiques du gouvernement de la CAQ qui ne servent que les patrons et les grands propriétaires au détriment des travailleuses et des travailleurs.
Durant cette manifestation, les participant-e-s ont particulièrement dénoncé la privatisation du système de santé, les conditions de travail et de vie des femmes, la pauvreté, les permis de travail fermés imposés aux migrants temporaires, le niveau des prestations d'aide sociale, la faiblesse de l'augmentation du salaire minimum, le refus d'une salarisation équitable des stagiaires, le manque de logements et ont apporté leur appui aux luttes syndicales.
Le premier intervenant est François Proulx Dupéré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches
Les organisations suivantes ont été à l'initiative de la manifestation : Action-Chômage de Québec, Association des étudiant.e.s en sciences sociales de l'Université Laval (AESS), Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes (IWC-CTI), Conseil central de Québec et Chaudière-Appalaches (CSN), Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12), Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN), Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ), Syndicat de professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À Gaza, des activistes dénoncent un crime d’écocide

Agriculture détruite en grande partie, pollution, déchets… À Gaza, des voix s'élèvent pour dénoncer un écocide et demander des poursuites pénales contre Israël.
Tiré de Reporterre.
Beyrouth (Liban), correspondance - Des champs retournés, des arbres déracinés, une terre contaminée au phosphore blanc : à Gaza, l'environnement est la victime silencieuse de la guerre. À la place des vergers, des plages de sable et des champs de fraise, qui faisaient la fierté des Gazaouis, se dresse un paysage dystopique fait de bases militaires, de cratères et de ruines. « Nous vivons actuellement une catastrophe environnementale qui engendrera d'autres catastrophes à l'avenir », dit Samar Abou Saffia, activiste écologiste gazaouie.
Ses notes vocales, envoyées par WhatsApp à Reporterre, brossent un portrait sombre de la situation sur place. « Plus de 80 000 tonnes de bombes israéliennes n'ont épargné ni les champs, ni les oliviers, ni les citronniers. Ces destructions environnementales accompagnent les massacres et le génocide, dit celle qui vit maintenant sous une tente à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Lorsque les chars d'assaut pénètrent sur nos terres, ils en détruisent également la fertilité. »
Après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, l'offensive israélienne à Gaza entre dans son huitième mois, tuant plus de 34 000 Gazaouis et faisant 77 000 blessés. Alors que plus de la moitié de la population de Gaza est au bord de la famine, des voix s'élèvent pour critiquer la destruction de l'environnement et de la production alimentaire à Gaza.
Une guerre contre l'environnement
« L'environnement n'est pas juste un dommage collatéral, mais bien une cible de l'armée israélienne », affirme Lucia Rebolino, coautrice d'une étude de Forensic Architecture, un collectif qui travaille avec des données satellites en open source.
« Des bulldozers rasent des champs et vergers pour dégager une zone tampon de plus de 300 mètres de profondeur » le long de la frontière au nord entre Israël et la bande de Gaza, explique-t-elle à Reporterre. « L'armée y construit des digues, des monts en terre, afin de protéger ses tanks et de dégager la vue. »
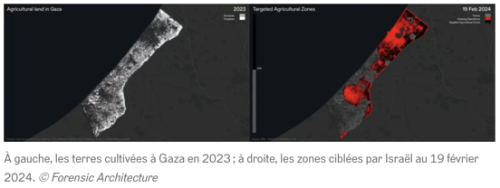
Les chiffres de son étude parlent d'eux-mêmes : sur les 170 km2 de terres agricoles que comptait Gaza avant la guerre — soit la moitié du territoire —, 40 % auraient été détruites. 2 000 sites agricoles, dont des fermes et des serres, ont été bombardés. Le nord de Gaza étant le plus touché, avec 90 % de ses serres disparues.
Une étude conjointe menée par l'Organisation des Nations unies (ONU), la Banque mondiale et l'Union européenne estime à plus de 1,5 milliard de dollars (environ 1,4 milliard d'euros) les dommages causés à l'agriculture, aux aires naturelles et aux infrastructures de traitement des déchets — sans même compter la restauration et la reconstruction de l'environnement.
« Guerre herbicide »
Ces destructions sont partie intégrante d'une stratégie israélienne affirmée depuis une dizaine d'années, explique Lucia Rebolino. Lors des guerres de 2014 et 2021, Israël avait également pris des installations agricoles pour cibles, mais à moindre échelle.
« Nous avons régulièrement observé des avions israéliens larguer des herbicides sur des zones agricoles frontalières au début et à la fin des saisons de récolte de 2014 à 2019, profitant de vents favorables pour toucher le maximum de surface », témoigne-t-elle. Forensic Architecture a publié plusieurs rapports sur cette « guerre des herbicides », qui aurait ainsi détruit les moyens de subsistance de nombreux agriculteurs.

Un autre exemple frappant, plus au sud, est la réserve naturelle de Wadi Gaza, rivière dont les berges ont été nettoyées à grands frais par des ONG internationales quelques mois avant la guerre. « C'était redevenu une région pleine de vie et d'agriculture, dotée de bonnes infrastructures, dit Samar Abou Saffia dans une note vocale. Maintenant, tout est détruit et il est interdit aux Palestiniens d'y entrer, c'est très dangereux. » La zone est traversée par une route militaire qui sépare Gaza en deux, un no man's land de terre déblayé à coups de bulldozers et devenu un champ de bataille.
Pollution de l'eau, de l'air, des sols
Outre les objectifs militaires israéliens, la guerre génère une pollution importante. Les émissions de gaz à effet de serre générées au cours des deux premiers mois de la guerre à Gaza ont été plus importantes que l'empreinte carbone annuelle de plus de vingt des nations les plus vulnérables au climat dans le monde, selon une étude anglo-américaine. Elle équivaudrait ainsi à la combustion d'au moins 150 000 tonnes de charbon. De quoi enfoncer la région encore plus profondément dans la crise climatique.
L'ONU estime en outre que les bombardements ont créé 37 millions de tonnes de débris. « C'est plus que toute l'Ukraine en deux ans », souligne Wim Zwijnenburg, chercheur sur les effets des conflits sur l'environnement à PAX, une organisation néerlandaise. Or, les dangers sont multiples : contamination à l'amiante et aux métaux lourds, poussières et particules fines, déchets toxiques des hôpitaux et industries, les maladies propagées par les corps en décomposition… « Comment va-t-on disposer de tous ces débris, alors qu'il n'y a aucune infrastructure de tri des déchets encore debout ? »

Alors que la majeure partie des infrastructures publiques sont détruites, des décharges improvisées ont vu le jour un peu partout dans la bande de Gaza. « Grâce aux images satellites, on peut observer comment des milliers de polluants infiltrent les sols et les eaux souterraines, et même comment des fumées toxiques rendent l'air irrespirable », explique-t-il. En parallèle, plus de 130 000 m3 d'eaux usées seraient déversés chaque jour dans la mer Méditerranée, causant d'importants dégâts pour la faune et flore sous-marine, avertit l'ONU.
Accusations d'écocide
Des organisations accusent Israël de commettre un génocide doublé d'un écocide. « La destruction de la terre est une pratique génocidaire systématique au même titre que la destruction de la production alimentaire, des écoles, des hôpitaux », affirme ainsi Lucia Rebolino, de Forensic Architecture.
Pour Saeed Bagheri, conférencier en droit international humanitaire à l'université de Reading, en Angleterre, la réponse est moins tranchée. « Du point de vue juridique, l'écocide n'a pas de définition claire. La Convention de Genève et le Statut de Rome listent des crimes de guerre contre l'environnement et les civils, mais encore faut-il pouvoir remplir leurs critères », explique-t-il à Reporterre. La discussion entre juristes porte sur la notion de proportionnalité. « En vertu du droit international, même si l'on admet qu'Israël a le droit de se défendre en attaquant le Hamas, l'environnement naturel ne peut être pris pour cible, sauf nécessité militaire impérative ».
« Récupérer nos terres et rétablir nos sols, nos nappes phréatiques et notre mer »
C'est donc ainsi que l'armée israélienne tente de se justifier. « Le Hamas opère souvent à partir de vergers, de champs et de terres agricoles, explique ainsi un porte-parole, cité par le Guardian. L'armée ne porte pas intentionnellement atteinte aux terres agricoles et s'efforce d'éviter tout impact sur l'environnement en l'absence de nécessité opérationnelle. »
Mais, pour Saeed Bagheri, « le principe d'humanité prime sur tout le reste, c'est-à-dire l'obligation de ne pas causer de souffrances inhumaines et évitables » aux civils et à l'environnement. Et c'est là qu'Israël pourrait être poursuivi devant la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice. « Dans tous les cas, il doit y avoir une enquête », affirme le juriste.
Signe de la gravité de la situation, l'ONU a ouvert une enquête sur la destruction de l'environnement. Ces démarches prendront du temps, et il faudra attendre la fin de la guerre pour en connaître les conclusions. C'est aussi ce qu'attendent les Gazaouis, piégés dans une dystopie sanglante. « Je souhaite seulement que la guerre prenne fin pour que nous puissions récupérer nos terres et rétablir nos sols, nos nappes phréatiques et notre mer, qui ont été détruits par les Israéliens », soupire Samar Abou Saffia.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Anniversaire du Rana Plaza : les députés européens doivent soutenir la diligence raisonnable, aujourd’hui !

24 avril, 2024. Ce jour marque l'anniversaire de l'homicide industriel de 2013 qui a tué plus de 1 100 personnes et en a blessé des milliers d'autres, lorsque le Rana Plaza s'est effondré sur des ouvriers et ouvrières de la confection au Bangladesh, à Dacca. Cette année, cet anniversaire coïncide avec le vote final du Parlement européen sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité qui, si elle est adoptée, rendra obligatoire le respect des normes environnementales, des droits de l'homme et des droits des travailleurs tout au long des chaînes de valeur mondiales.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/02/anniversaire-du-rana-plaza-les-deputes-europeens-doivent-soutenir-la-diligence-raisonnable-aujourdhui/
Pour que cette diligence soit efficace, les accords contraignants suscitent un intérêt croissant, car il est de plus en plus admis que l'audit social volontaire est un mécanisme inefficace, tant en termes de protection des droits des travailleurs que de réduction des risques pour les acheteurs des marques multinationales et leurs investisseurs.
Judith Kirton-Darling, Secrétaire générale d'industriAll Europe, a déclaré :
« Aujourd'hui, les députés européens ont la possibilité d'apporter un réel changement positif dans la vie des travailleurs et travailleuses, y compris dans le secteur international du textile, qui reste malheureusement tristement célèbre pour ses violations des droits des travailleurs. Tous et toutes méritent de travailler dans des environnements sûrs et dans des conditions décentes et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une autre catastrophe comme celle de Rana Plaza. Nous avons besoin de règles européennes strictes en matière de diligence raisonnable afin que les entreprises soient tenues responsables de leurs chaînes d'approvisionnement, où qu'elles se trouvent ».
La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité imposera aux entreprises européennes et non européennes réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 450 millions d'euros dans l'UE de faire preuve de diligence en matière de droits de l'homme et d'environnement dans l'ensemble de leur chaîne de valeur.
Oliver Roethig, Secrétaire régional d'UNI Europe, a déclaré :
« La directive sur le développement durable apportera des avancées essentielles en garantissant qu'une entreprise ne puisse plus décider unilatéralement de son approche de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Au contraire, il sera obligatoire d'impliquer les syndicats de manière significative dans le processus de diligence raisonnable. Lorsque la directive entrera en vigueur, ces dispositions garantiront que les nouvelles exigences constituent un progrès substantiel par rapport aux approches ratées de la responsabilité sociale des entreprises ».
Créé à la suite de l'effondrement de l'usine de confection du Rana Plaza par des fédérations syndicales internationales, l'Accord international, juridiquement contraignant, pour la santé et la sécurité dans l'industrie du textile et de la confection a été signé à ce jour par plus de 200 des plus grandes marques et détaillants de mode du monde. Il a donné lieu à plus de 56 000 inspections indépendantes dans les usines des fournisseurs, plus de 140 000 problèmes de sécurité ont été résolus et 2 millions de travailleurs et travailleuses ont reçu une formation en matière de santé et de sécurité. L'Accord contribue aujourd'hui à sauver des vies au Pakistan.
Le Secrétaire général d'IndustriALL, Atle Høie, a déclaré à ce sujet :
« Bien que nous soyons fiers du travail accompli dans le cadre de l'Accord, nous appelons à davantage d'actions au plan international pour que les marques de textile rendent des comptes. Si elle est adoptée, la directive européenne améliorera la vie de millions de travailleurs et travailleuses. L'ironie du fait que le vote final tombe le même jour que l'anniversaire du Rana Plaza n'est pas vaine et les travailleurs du textile au Bangladesh appellent aujourd'hui le Parlement européen à soutenir la directive et à faire en sorte que les marques internationales de textile rendent des comptes ».
Christy Hoffman, Secrétaire générale d'UNI Global Union, a déclaré :
« Tout comme UNI et IndustriALL sont entrés dans l'histoire lorsque nous avons négocié l'Accord il y a 11 ans, les députés européens qui votent aujourd'hui ont la possibilité de changer le paysage de la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier. L'Accord montre la différence que les syndicats et les entreprises peuvent faire lorsque nous élaborons des règles contraignantes ayant un impact sectoriel. La directive sur la responsabilité sociale des entreprises fait passer la responsabilité au sein des chaînes d'approvisionnement à un niveau supérieur et constitue un grand pas en avant pour faire en sorte que « Rana Plaza, plus jamais ça » devienne plus qu'un simple slogan ».
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : Défendons une augmentation générale des salaires, et contrecarrons les attaques anti-ouvrières du régime islamique et des employeurs

L'augmentation des salaires est devenue une nécessité inévitable étant données les conditions déplorables actuelles.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/02/iran-defendons-une-augmentation-generale-des-salaires-et-contrecarrons-les-attaques-anti-ouvrieres-du-regime-islamique-et-des-employeurs/
Les salaires fixés par le régime islamique, via le ministère du travail et les soi-disant représentants des salarié.es nommés par le pouvoir au sein du conseil suprême du travail, ne permettent en aucun cas de couvrir les dépenses de subsistance de la classe ouvrière.
Depuis des années, les salarié.es se mobilisent contre cette paupérisation généralisée et le dénuement dans lequel ils/elles se trouvent. Dans les usines, les ateliers, les centres chargés de l'éducation et des soins de santé, ainsi que dans la rue, ils/elles expriment leurs revendications et leur volonté de faire valoir leurs droits
Les mobilisations hebdomadaires continuelles des retraité.es (qui forment une partie inséparable de la classe ouvrière), la grève de l'usine sidérurgique d'Isfahan, et celle de l'usine d'Ahwaz du groupe sidérurgique National Steel ces dernières semaines, sont des exemples de leurs mobilisations incessantes en faveur de leurs droits et le périmètre de leurs revendications.
Le principal objectif des travailleurs qui protestent est d'obtenir une augmentation des salaires et avantages liés à leur emploi.
Au cours de ses 45 ans de règne, le régime islamique a toujours défendu dans la lutte entre travailleurs/euses et patronat, les intérêts d'un capitalisme brutalement exploiteur.
La première raison en est que le régime islamique est lui-même le plus rapace des capitalistes.
La seconde est que son élite dirigeante dispose du monopole du pouvoir, de l'absence de mécanismes de contrôle, de l'absence d'audit, etc.
S'appuyant sur la corruption totale de ce régime réactionnaire, cette élite s'est emparée d'une grande partie des moyens de production, ainsi que des richesses du pays.
Toute personne réclamant des droits est combattue par la répression, l'emprisonnement et l'expulsion du lieu de travail.
Tant que la résistance et la lutte de la classe ouvrière à l'échelle nationale n'auront pas lieu, la condition des travailleurs/euses de notre société s'aggravera de jour en jour. Ceux qui sont à l'origine de l'extrême pauvreté et de l'impuissance de la majorité des 90% de la population de notre société ne veulent pas et ne peuvent pas prendre de mesures pour mettre fin aux souffrances des masses laborieuses. C'est pourquoi les travailleurs/euses eux/elles-mêmes doivent se préoccuper de leurs intérêts économiques, sociaux et culturels. D'autres forces n'ont pas la capacité de faire un tel effort ou ne le veulent pas, car leurs intérêts sont contraires à ceux de la classe ouvrière.
Les travailleurs/euses n'ont pas d'autre revenu que leur salaire, à condition bien sûr d'avoir un emploi. Mais leurs salaires ont toujours été quatre ou cinq fois inférieurs aux aux dépenses courantes d'une famille moyenne de salarié.e.
Par exemple, le dernier salaire minimum fixé par le régime islamique et le conseil suprême du travail pour l'année 2023 incluant l'ensemble des avantages liés à l'emploi – qui ne sont pas accordés à tous/toutes les salarié.es – était d'environ 135 euros par mois !
En 2023, ce montant couvrait à peine les dépenses hebdomadaires d'un ménage urbain moyen.
En effet, selon les statistiques officielles, les dépenses moyennes d'une famille de quatre personnes en 2023 étaient d'environ 562 euros par mois.
De même, sur la base des prévisions du taux d'inflation en 2024, le coût de la vie moyen d'un ménage urbain ne sera pas inférieur à environ 830 euros par mois.
Pour obtenir une augmentation des salaires, il n'y a pas d'autre moyen que de lutter sans relâche contre le régime islamique rapace, les employeurs réactionnaires et les capitalistes pilleurs.
Le régime islamique et les employeurs n'ont aucune intention d'augmenter les salaires. Avec tous les moyens légaux et illégaux dont ils disposent, ils essayent d'utiliser de fausses excuses pour empêcher les augmentations de salaires : lutter contre l'inflation, créer des emplois, favoriser la compétitivité, encourager des capitalistes à investir, ou ce mensonge flagrant selon lequel l'économie iranienne n'est pas capable de verser des salaires plus élevés que ceux actuellement perçus.
En contradiction avec la loi, le gouvernement soumet toute augmentation et tout versement de salaire à la définition préalable d'un « salaire conventionnel » réputé être basé sur un accord entre employeur et employé.
Les autorités veulent ainsi contourner la loi sur le salaire minimum, et ouvrir la voie à une exploitation accrue en retirant aux salarié.es des moyens pour résister en amendant le code du travail
* soit en y introduisant un alinéa
* soit en modifiant un alinéa
* soit en supprimant un alinéa
Les ouvrier.es et employé.es, ainsi que les membres de leur famille, représentent environ 60% de la population du pays. Plus de 80% de la production totale de la société est le fruit de leur travail.
Leurs salaires ne devraient pas être inférieurs au coût de la vie moyen d'un ménage urbain moyen.
Comme indiqué précédemment, le coût de la vie moyen d'un ménage urbain de quatre personnes devrait être en 2024 d'au moins 830 euros par mois.
Nous invitons donc tous les salarié.es de l'industrie, des services, de l'agriculture, de la construction, des mines, etc., dans les secteurs privé et public, à lutter sur leurs lieux de travail et de vie, pour un salaire minimum de 830 euros par mois.
Un autre point fondamental qu'il ne faudrait pas oublier est que dans la lutte pour l'augmentation des salaires, comme dans d'autres domaines de la lutte de classe, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière sont indispensables. Pour cette raison, l'existence d'organisations durables (syndicats, associations professionnelles, ou organisations similaires) sont d'une importance capitale.
Simultanément, la lutte des travailleurs/euses dans les domaines économique et social ne peut à elle seule parvenir à atteindre les résultats souhaités. C'est pourquoi, parallèlement à la lutte pour les revendications économiques, la promotion, la formation et les activités pratiques pour la fondation de la lutte politique indépendante de la classe ouvrière et de ses organisations sont également nécessaires.
La lutte de classe des salarié.es n'est en effet possible que si elle est unie, organisée et basée sur des objectifs à long terme.
Pour cette raison, les objectifs immédiats de la classe ouvrière ne peuvent être atteints qu'avec la participation large et active des masses.
Syndicat du sucre de canne d'Haft Tappeh
Section des retraité.es du Comité de coordination d'aide à la construction d'organisations syndicales
Travailleurs/euses retraité.es du Khuzestan
Et aussi, sur le salaire minimum à 250 euros, l'expression du Syndicat des travailleurs/euses de la compagnie d'autobus de Téhéran et sa banlieue (Vahed)
Alternative workers news Iran
https://laboursolidarity.org/fr/n/3121/defendons-une-augmentation-generale-des-salaires-et-contrecarrons-les-attaques-anti-ouvrieres-du-regime-islamique-et-des-employeurs
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Témoignages de deux infirmières ukrainiennes au congrès de l’Union syndicale Solidaires

À l'occasion de son congrès national, qui se tenait du 22 au 25 avril 2024 à Labège (31), l'Union syndicale Solidaires a accueilli plusieurs délégations internationales. Dès l'ouverture du congrès, la parole a été donnée à deux d'entre elles : celle venue d'Ukraine et celle venue de Palestine.
D'Ukraine, étaient présentes Yulia Lipich Kochirka et Oksana Slobodyana, représentantes du Syndicat régional de Lviv du personnel médical et de Sois comme Nina. Elles ont pu s'adresser aux quelque 400 syndicalistes Solidaires présent∙es. Cette invitation faisait suite aux contacts entretenus depuis avril 2022, à travers les trois convois du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, les échanges visio, les liens à travers le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, les collectes solidaires, l'envoi de matériel, la présence à la 5e rencontre du Réseau syndical international de solidarité et de luttes en septembre dernier à São Paulo, etc. Nous reprenons ici les informations délivrées par les deux militantes, qui se sont aussi s'entretenues de manière informelle avec les délégué∙es au congrès.
Christian Mahieux, avril 2024.
La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans. Le personnel médical joue un rôle important, notamment en première ligne et dans les villes de la zone de front. De nombreux et nombreuses membres de Sois comme Nina se trouvent actuellement dans la zone de guerre. Au péril de leur vie, ils et elles sauvent celle des soldats et des civil∙es.
Nous avons édité un document sur activités qui est à votre disposition, mais aujourd'hui je vous parlerai brièvement de certains et certaines de nos collègues qui ont consciemment changé leur blouse blanche pour un uniforme militaire. Leur témoignage direct est important.
Olena Lyasheva, une militante de Sois comme Nina, n'a pas de diplôme de médecine, mais au terme d'une lutte épuisante et prolongée, elle a été obligée de devenir infirmière pendant la guerre. « La situation sur la ligne de front est telle qu'aucune main ne sera superflue. J'ai milité toute ma vie d'adulte et la décision de m'engager dans l'armée était la suite logique de mon parcours de militante. Si nous voulons vivre dans une société juste, nous devons maintenant la protéger des occupants. Mon choix de spécialité a été largement influencé par la communication avec Sois comme Nina. Ces femmes incroyables se battent pour les droits sociaux et les droits du travail à la maison et dans l'armée. Et ce n'est pas une coïncidence si ce sont les infirmières qui sont en difficulté en Ukraine. Parce que la lutte est une question de soins, de protection et d'assistance mutuelle. Je me suis toujours sentie solidaire d'elles, et maintenant je suis moi-même en train de devenir personnel médical, bien que, malheureusement, dans le cadre d'une procédure accélérée dans les conditions de la guerre », nous a écrit Olena.
Maria Koroleva n'a que 26 ans. Elle est également infirmière de combat au front. Alors qu'elle n'avait pas du tout envisagé de lier sa vie à la médecine, elle a changé d'avis à cause de la guerre. « Au front, on se rend compte qu'il faut vivre ici et maintenant, car tout peut changer radicalement en une seconde. Nous avons admis un jeune homme avec trois amputations, des brûlures au visage et aux deux yeux – zéro pour cent de chance de voir sa vue restaurée. Avant la guerre, il était un jeune homme prospère avec de bonnes perspectives. Dans ces moments-là, on commence à apprécier la vie, chaque minute. En première ligne, le personnel médical s'épuise rapidement, ils et elles ne supportent pas psychologiquement. Mais nous n'avons pas le droit de nous concentrer sur nos expériences personnelles, surtout en temps de guerre », nous a dit Maria. Oleh Horoshenko a failli mourir dans la zone de combat. « Quatre fois pendant la guerre, j'ai cru que j'allais mourir. Étonnamment, cela ne vous fait pas peur. Vous le ressentez calmement : les regrets, les projets, la vie, mais sans horreur. À Irpin, ils ont commencé à nous tirer dessus au phosphore. J'étais allongé et j'ai réalisé que nous tous – huit personnes – allions brûler vifs. C'était pénible. Mais le vent nous a sauvés parce qu'il a balayé les flammes. J'ai été blessé dans le secteur de Kharkiv. Nous avons été bombardés par l'artillerie. Des éclats d'obus ont touché mon bras. En sautant du camion, j'ai endommagé les ligaments de mon genou. Je n'ai pas remarqué ma blessure au début, j'ai couru pour sauver la vie de mes camarades. Nous avons eu quatre morts et douze blessés. Dans des conditions de combat, il est très difficile de trouver les blessés. Parmi les morts, j'ai vu un combattant vivant. Il avait reçu une balle dans la jambe. Ils lui ont posé un garrot et un bandage, l'ont mis dans un minibus et l'ont emmené à l'hôpital. Quelques heures plus tard, ma jambe blessée a gonflé et je ne pouvais plus marcher. J'avais moi-même besoin d'une aide médicale », se souvient Oleh.
Les personnes du secteur de la santé sont des gens héroïques. Malgré leurs bas salaires et leur lourde charge de travail, lorsque la guerre a commencé, ils et elles n'ont pas fui à l'étranger ou ne se sont pas caché·es, mais ont revêtu l'uniforme militaire. Des centaines d'entre eux et elles ont déjà été tuées sur le champ de bataille. Cela n'a pas empêché leurs collègues de continuer à sauver des vies.
Sois comme Nina est une organisation créée en 2019 par des travailleuses et travailleurs de la santé. Il n'existait pas d'équivalent en Ukraine jusqu'alors. Depuis, l'association protège les droits des travailleuses et travailleurs de la santé, en luttant pour des salaires décents et des conditions de travail correctes. Quand les problèmes ne peuvent pas être résolus paisiblement, nous organisons des manifestations (actuellement, sous la loi martiale, elles sont interdites). La tâche principale de notre organisation est d'améliorer les conditions de travail et la formation des travailleuses et travailleurs du secteur médical. À cette fin, nous utilisons toutes les méthodes, dans le respect de la loi.
Le nom « Mouvement médical Sois comme Nina » vient du nom de l'initiatrice de la première protestation des infirmières, Nina Bondar. Travaillant dans un hôpital de Kyiv, Nina a décidé, un soir, de décrire son mécontentement quant à ses conditions de travail, à son salaire et à l'attitude des patrons envers les infirmières. Elle a publié ce message – un cri du cœur – sur Facebook. Du jour au lendemain, il a bénéficié de plus de 20 000 vues. Depuis, les professionnel∙les de la santé s'unissent pour défendre ensemble leurs droits professionnels. Comme Nina, tous et toutes veulent cesser de passer sous silence toutes les violations auxquelles ils et elles sont confronté·es sur leur lieu de travail.
Depuis lors, nous sommes devenus une communauté (Facebook) de 85 000 personnes. Notre organisation a été créée sans aucun soutien étatique ou de parti politique. Nous promouvons la création de syndicats dans toute l'Ukraine. Nous avons organisé les premières manifestations dans plusieurs villes au cours de l'hiver 2019. Nous avons exigé des salaires plus élevés pour les travailleuses et travailleurs de la santé, une augmentation des dépenses de santé en général, et que nos voix, les voix des travailleuses et travailleurs de la santé, soient entendues dans toute réforme des soins de santé en Ukraine. Nous avons répété ces manifestations en 2020 et 2021 et avons progressé. Ainsi, nous avons réussi à réintégrer des infirmières licenciées illégalement et à faire payer des arriérés de salaires dans plusieurs établissements.
Avant la guerre, la contre-réforme des soins de santé a commencé en Ukraine. Depuis, beaucoup d'établissements médicaux ferment, les hôpitaux sont « optimisés » et fusionnés. Cela a un impact important sur les travailleuses et travailleurs de la santé, qui perdent leur emploi. Ce processus ne s'est pas arrêté pendant la guerre. Au contraire, la situation s'est considérablement aggravée : de nombreux établissements médicaux ont été fermés à la suite de bombardements et de tirs d'artillerie. La perte d'emplois, l'occupation du territoire par les troupes russes, la migration à grande échelle et les licenciements ne sont pas les seuls problèmes auxquels nous sommes confronté·es aujourd'hui. Les économies réalisées par les autorités locales sur le soutien financier pour le droit à la santé, sur les salaires des infirmières et autres personnels médicaux, conduisent à l'appauvrissement de la population dont nous protégeons les droits.
La guerre à grande échelle qui a commencé le 24 février 2022 a causé encore plus de problèmes, non seulement pour les travailleuses et travailleurs de la santé, mais pour tous et toutes les Ukrainien·nes en général. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir vers les pays voisins et plus de 6 millions d'Ukrainien·nes ont été déplacé·es à l'intérieur du pays. Des villes et des villages ont été détruits. Nos hôpitaux et nos installations énergétiques ont été pris pour cible par l'ennemi.
Nous avons réalisé que nous ne pourrions pas faire face à cette situation sans l'aide de partenaires internationaux. C'est pourquoi nous avons convenu avec nos partenaires allemands de Medico International d'un projet commun pour aider les Ukrainien·nes touché·es par la guerre. Grâce à cette coopération, nous avons pu loger temporairement 45 familles avec de jeunes enfants et des parents retraités. 452 familles en situation très difficile ont reçu de la nourriture et des produits d'hygiène. Nous sommes également en mesure d'apporter un soutien psychologique et juridique. Il est également très important d'apporter une aide en matière de traitement médical. En effet, certaines personnes ont perdu tout espoir de guérison. Grâce à notre projet, elles ont amélioré leur état de santé et sont en mesure de travailler et de vivre à nouveau pleinement leur vie. Malheureusement, ce projet a pris fin le 31 décembre 2023. C'est pourquoi nous recherchons activement des organisations internationales avec lesquelles nous pourrions coopérer et continuer à aider les médecins, les infirmières, et les Ukrainien·nes en général.
Nous attendons la fin de la guerre et voulons nous rapprocher de la victoire par tous les moyens et toutes les méthodes. Nous sommes convaincu·es que nous parviendrons à reconstruire l'Ukraine, où les droits syndicaux seront respectés dans tous les secteurs et où les employé·es recevront des salaires décents et auront des conditions de travail satisfaisantes.
Ce ne sera pas facile. Mais vous avez vu notre force et notre engagement pendant la guerre.
Publié dans Les Cahiers de l'antidote : Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 29)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/28/lesprit-de-haymarket-square/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des violations des droits des enfants passées sous silence en raison de la crise de financement à l’ONU

Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a annulé la tenue d'une session prévue
Dans une décision sans précédent, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a annulé la tenue d'une série de réunions en raison d'un manque de fonds.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/28/des-violations-des-droits-des-enfants-passees-sous-silence-en-raison-de-la-crise-de-financement-a-lonu/
Ce déficit est dû au fait que certains États membres ne se sont pas encore acquittés de leurs cotisations.
Il s'agit du dernier exemple en date de la fragilisation du rôle de surveillance des droits humains de l'ONU en raison d'un manque de fonds budgétisés. Ceci fait suite au gel des recrutements au sein de l'organisation mondiale, et à une réduction forcée des enquêtes menées sur le terrain par ses experts en droits humains.
Lors de la session désormais annulée du Comité des droits de l'enfant, des experts devaient s'entretenir – dans un environnement sûr et confidentiel – avec des enfants, des organisations de la société civile et des agences des Nations Unies de la situation des droits de l'enfant dans huit pays.
Cette annulation se traduira par une surveillance diminuée de l'évolution de la situation en Équateur, où l'escalade de la violence et de la criminalité organisée a un impact désastreuxsur les droits des enfants, en particulier des filles dont le droit d'étudier en toute sécurité est menacé.
Cela signifie également que la situation en Éthiopie risque de passer encore plus inaperçue, même si des enfants y sont tués et blessés et font l'objet d'agressions sexuelles ; en outre, des écoles sontattaquées etutilisées par les forces militaires dans le cadre des conflits qui sévissent dans le nord du pays.
Les experts n'auront pas l'occasion d'en apprendre davantage sur certaines filles indonésiennes qui pourraient avoir été contraintes de quitter l'école sous une forte pression, en raison de leur décision de ne pas respecter laréglementation relative au port obligatoire du hijab.
Il sera désormais plus difficile pour le Comité d'en savoir plus sur les mauvais traitements infligés aux enfants dans les centres de détention gouvernementaux en Irak, ou sur la décision du gouvernement de ne pas interdire les châtiments corporelscontre les enfants.
- Et les voix des filles incapables d'exercer leur droit à l'éducationau Pakistan continueront d'être réduites au silence.
Si le Comité n'est pas en mesure de prendre connaissance de ces problèmes, il ne pourra pas non plus formuler de recommandations en faveur de changements.
Les gouvernements mauvais payeurs qui n'ont pas encore versé leurs contributions au budget ordinaire de l'ONU devraient s'acquitter de leur quote-part, sous peine d'aider les auteurs de violations des droits de l'enfant à se soustraire à leurs responsabilités.
Bede Sheppard
Directeur adjoint, division Droits des enfants
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ne comprend pas les réalités du système prostitutionnel

Lettre collective Lettre ouverte de 14 organisations représentant plus de 2000 organisations de terrain, féministes et de survivantes en réponse au commentaire de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur la prostitution.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/30/la-commissaire-aux-droits-de-lhomme-du-conseil-de-leurope-ne-comprend-pas-les-realites-du-systeme-prostitutionnel/
Nous, organisations féministes, de terrain et de survivantes, sommes consternées par le commentaire de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur la « protection des droits humains des travailleurs du sexe », tant du point de vue de la méthodologie utilisée que du contenu développé. Les femmes et les filles en situation de prostitution méritent mieux que ce qui ne peut être considéré autre qu'un tract de propagande déconnecté.
Une consultation opaque exclusivement ouverte aux organisations défendant le « travail du sexe » ? Nos 14 organisations, représentant plus de 2 000 associations féministes de terrain et de survivantes, ont soutenu l'année dernière plus de 18 000 personnes prostituées dans le monde entier, presque exclusivement des femmes et des filles issues des communautés les plus marginalisées. Etonnamment, aucune de nos organisations n'a été incluse dans les consultations ayant mené à cette déclaration, la Commissaire ayant priorisé l'accès aux organisations n'ayant aucune expérience sérieuse en matière de soutien de terrain sur le long terme aux personnes prostituées.
Le commentaire exclut donc les perspectives et expériences des personnes prostituées soutenues par nos organisations. La Commissaire promeut ainsi la Belgique comme modèle de référence alors que ce pays est une plaque tournante de la prostitution et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle en Europe, et que des organisations locales ont alerté à plusieurs reprises sur l'impact désastreux de la législation belge sur les personnes prostituées.
Etant donné l'apparente incapacité de la Commissaire à contacter les associations de terrain et de survivantes, nous aimerions lui offrir notre aide sous la forme d'une proposition concrète : Madame la Commissaire, nous vous invitons à venir voir par vous-même les réalités de la prostitution, en Belgique ou ailleurs, en rencontrant une ou plusieurs de nos organisations de terrain et de survivantes. Les réalités que vous y découvrirez seront probablement très différentes du récit développé dans votre commentaire. Une explosion de violence et d'exploitation là où les recommandations de la Commissaire aux droits de l'homme ont été mises en œuvre.
Nos organisations observent au niveau local, l'impact désastreux des politiques décriminalisant les proxénètes et les acheteurs de sexe recommandées par la Commissaire aux droits de l'homme. En Allemagne, pays qui a légalisé la prostitution en 2002, les résultats sont sans équivoque :
Les plus hautes estimations évaluent à 400 000 le nombre de personnes en situation de prostitution dans le pays, seules 23 000 faisaient la demande pour le statut officiel de « travailleuses du sexe » en 2021 ;
81% des femmes officiellement enregistrées étaient étrangères en 2021 :
Les bordels tirent profit de l'exploitation des plus vulnérables : depuis la guerre en Ukraine, le nombre de femmes réfugiées ukrainiennes enregistrées dans le quartier rouge de Berlin a été multiplié par 5 ;
La décriminalisation de l'achat d'actes sexuels entraîne une explosion de la demande : en Allemagne 26% des hommes déclarent avoir acheté des actes sexuels au moins une fois dans leur vie, contre 7% en Suède ;
Pour s'adapter à cette demande, les bordels vendent des femmes à une échelle industrielle dans des « mégabordels » offrant des forfaits à 70€ comprenant une femme, une bière et un une saucisse ou des formules « à volonté ».
Les résultats néfastes de l'approche allemande conduisent à une prise de conscience collective et à un changement de paradigme dans le pays : le groupe parlementaire CDU/CSU et le chancelier (SPD) ont récemment pris position pour mettre fin à l'approche du « travail du sexe ».
Cette explosion et cette normalisation de l'achat d'actes sexuels ont un impact sur toutes les femmes et les filles et fait pression sur les plus marginalisées d'entre elles. Aux Pays-Bas, pays qui a légalisé la prostitution en 2000, il est désormais légal pour les moniteurs d'auto- école de proposer des actes sexuels à leurs élèves comme mode de paiement. Cette pratique est communément appelée « a ride for a ride ».
En Belgique, dans la rue d'Aerschot à Bruxelles, connue pour sa prostitution de rue, « chaque personne prostituée paie en moyenne 250€/jour aux gérants de bordels afin de louer une vitrine. Ce loyer est équivalent à 7500€/mois pour une personne payant chaque jour ces frais. Cela signifie que la personne prostituée doit endurer 150 actes sexuels « gratuits » avant de toucher 1 seul euro pour elle », selon l'ONg de terrain Isala.
Ainsi, au prétexte d'améliorer les conditions de vie des personnes prostituées, le modèle réglementariste de la prostitution renforce la mainmise des proxénètes – poliment rebaptisés « tiers » – par la Commissaire. Ils bénéficient de différents statuts juridiques, tels que « propriétaires de maisons closes » ou « entrepreneurs », et perpétuent l'exploitation sexuelle et économique des plus vulnérables en toute impunité.
Nous partageons le constat que la prostitution se situe à l'intersection de multiples discriminations et que les femmes et les filles les plus marginalisées sont surreprésentées dans ce système (70% des personnes prostituées en Europe sont des femmes migrantes).Cependant, contrairement à la Commissaire, nous ne mettons pas les victimes et les exploiteurs sur le même plan, les derniers exploitant les vulnérabilités des premières.
« Nous n'avons pas besoin de syndicats, d'assurance maladie ou d'un salaire minimum. Nous avons besoin de psychothérapie, de programmes de sortie, de protection et d'une aide financière. Nous n'avons pas besoin de droits du travail, mais nous avons besoin des droits qui découlent de notre reconnaissance en tant que victimes de violence ». Collectif de survivantes #Intedinhora (« #Pastapute »), Suède.
La prostitution dans le droit international des droits humains : ni un travail, ni du sexe, mais une violation de la dignité humaine ! Il est particulièrement troublant de constater que la Commissaire se réfère à une « approche fondée sur les droits humains » en ce qui concerne le « travail du sexe », sans citer un seul traité international de droits humains qui soutienne concrètement cette approche. Et pour cause, les traités universels des droits humains contraignants sont sans équivoque sur l'obligation faite aux États de criminaliser le proxénétisme et de décourager la demande qui favorise la traite à des fins d'exploitation sexuelle :
La Convention onusienne de 1949 reconnaît spécifiquement la prostitution comme « incompatible avec la dignité de la personne humaine ». Il est donc inconcevable qu'une activité violant la dignité humaine puisse être soudainement reconnue comme un travail par le Conseil de l'Europe, particulièrement quand celui-ci promeut et défend l'accès à un « travail décent » ;
Cette même convention oblige les États membres à ériger en infraction pénale toute personne qui « exploite la prostitution d'une autre personne même consentante et qui « tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution » ou encore « donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution » ;
En outre, l'article 6 de la convention CEDEF impose aux États membres de réprimer l'exploitation de la prostitution des femmes et des filles, c'est-à-dire le proxénétisme.
L'article 9, paragraphe 5, du protocole de Palerm impose aux États membres de « décourager la demande qui engendre la traite à des fins d'exploitation sexuelle ».
La pénalisation du proxénétisme et de l'achat d'actes sexuels sont par ailleurs des mesures qui font l'objet d'un consensus quant à leur efficacité dans la lutte contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle,recommandées par l'OSCE, le Parlement Européen, l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, et la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes.
« L'argument selon lequel la dépénalisation de la demande d'achat d'actes sexuels améliore la sécurité, la dignité et les conditions de vie des femmes prostituées ne semble pas être étayé factuellement. La prostitution entraîne de graves violations des droits humains pour les femmes et les filles concernées ». Rapporteure Spéciale des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, Reem Alsalem (2023)
Le langage agrée des Nations Unies et de l'Union européenne est et demeure « prostitution » et « personne en situation de prostitution ». Nous déplorons l'utilisation répétée du terme « travail du sexe » dans le commentaire, qui est un terme de propagande destiné à dissimuler la violence inhérente au système prostitutionnel et les schémas d'oppression sexiste, raciste et de classe qui l'alimentent ainsi qu'à promouvoir la légalisation de la prostitution.
« Notre conviction profonde, en tant qu'ONU Femmes, est que toutes les femmes impliquées dans cette industrie sont des victimes, peu importe si elles se revendiquent travailleuses du sexe, ou qu'elles considèrent cela comme un travail, nous les considérons comme des victimes et ceux qui achètent ce service comme des auteurs de violence à l'égard des femmes » Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne directrice exécutive d'ONU Femmes (2020).
Il existe une (véritable) approche de la prostitution fondée sur les droits humains : elle protège les victimes et lutte contre l'impunité des auteurs. La Suède, la Norvège, l'Islande, l'Irlande, l'Irlande du Nord, le Canada et la France, ainsi que le Parlement européen, ont adopté une approche féministe et fondée sur les droits humains sur la prostitution. Ces pays reconnaissent la prostitution comme un système de violence et d'exploitation. Ce « modèle abolitionniste » différencie les victimes des exploiteurs : il décriminalise les personnes prostituées, leur donne accès à des programmes de sortie et pénalise l'achat d'actes sexuels – à la racine du système prostitutionnel – tout comme le proxénétisme.
En Suède, pays ayant adopté un modèle abolitionniste en 1999 :
La demande a réduit de moitié du fait de la pénalisation de l'achat d'actes sexuels. 13,6% des hommes en Suède déclaraient avoir acheté un acte sexuel une fois dans leur vie en 1996, contre 7% en 2023 ;
La baisse de la demande a fait de la Suède un territoire peu attractif pour les réseaux de traite qui s'en sont détournés ;
La loi a eu un effet normatif sur les mentalités : alors que 3⁄4 des suédois.e.s étaient contre la pénalisation des clients en 1996, moins de 10 ans après, en 2008, cette mesure est largement soutenue par 70% de la population ;
Depuis l'adoption de la loi, aucune personne prostituée n'a été tuée en Suède, contre au moins 84 en Allemagne. En France, pays ayant adopté le modèle abolitionniste en 2016 :
0 personne en situation de prostitution n'a été pénalisée depuis la loi ;
1 247 personnes ont bénéficié d'un parcours de sortie de la prostitution en mars 2023 donnant droit à un permis de séjour pour les victimes étrangères, un logement, une aide financière mensuelle, du soutien à la réinsertion professionnelle, un soutien psychothérapeutique avec un taux de réussite de 95% ;
de 8 000 clients ont été pénalisés d'une amende ou ont dû suivre un stage de sensibilisation aux réalités de la prostitution ;
+54% de hausse de procédures contre les proxénètes sont constatées entre 2016 et 2019 ainsi que 7 fois plus de compensation pour les victimes.
La constitutionnalité de la loi française a été entérinée par le Conseil Constitutionnel dans des termes forts. Le Haut Conseil à l'égalité en France a reconnu que cette approche « contribue à construire une société d'égalité formelle et réelle entre les hommes et les femmes » et des survivantes de plusieurs pays ont récemment exprimé leur soutien collectif à la législation. La Commissaire ne semble pas consciente de ces éléments et ne se réfère au droit français que dans le contexte d'une décision de recevabilité sur une procédure en cours, ce qui ne préjuge en rien de la décision de la Cour. Cette procédure est par ailleurs soutenue par les mêmes organisations auxquelles la Commissaire a réservé les consultations pour son commentaire. Nous convenons de la nécessité pour les États membres de veiller à ce que leurs lois soient conformes à la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, pour ce faire, ils doivent mettre en œuvre une approche aux antipodes de celle recommandée par la Commissaire. Alors que l'Europe connaît un changement de paradigme en faveur du modèle abolitionniste, le commentaire de la Commissaire appelant à la décriminalisation des auteurs de violence constitue un recul historique sur les droits des femmes. La voie à suivre ne peut être que l'abolition du système sexiste, raciste et de classe de la prostitution, et non sa « décriminalisation totale ».
Nous demandons donc à la Commissaire de réviser et d'amender son commentaire sur la base d'un processus de consultation éthique, objectif et inclusif.
Signataires : La Coalition pour l'abolition de la prostitution, Le lobby européen des femmes, le Réseau européen des Femmes migrantes, SPACE International, la Coalition Against Trafficking in Women, l'Initiative Féministe EuroMed, le Bruxxels Call, le Swedish Womens's lobby, la Coordination européenne du Lobby européen des femmes, Osez le féminisme !, Rights4Girls, le Bündnis Nordisches Modell, la Fédération Nationale Espagnole des Femmes Abolitionistes.
Courrier N°430 de la Marche Mondiale des Femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des réparations vont être versées aux survivantes de violences sexuelles commises pendant la guerre en Ukraine

Les premiers paiements effectués dans le cadre d'un conflit en cours constituent « un pas important vers le rétablissement de la justice », a déclaré la première dame, Olena Zelenska.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/01/des-reparations-vont-etre-versees-aux-survivantes-de-violences-sexuelles-commises-pendant-la-guerre-en-ukraine/
Les premières réparations seront versées dans les prochaines semaines aux survivantes de viols commis par des soldats russes pendant l'invasion de l'Ukraine, une initiative que la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a qualifiée d'« étape importante vers le rétablissement de la justice ».
Jusqu'à 500 Ukrainiennes ayant survécu à des violences sexuelles liées au conflit ont été identifiées et ont reçu des réparations provisoires cette année, notamment un soutien financier, médical et psychologique.
Mme Zelenska a déclaré : « Les réparations accordées aux victimes de violations flagrantes des droits des êtres humains, notamment aux victimes de violences sexuelles liées au conflit, ne se limitent pas à un soutien économique. Il s'agit d'une étape importante vers le rétablissement de la justice.
« Et cette justice n'est pas seulement nécessaire en Ukraine », a-t-elle ajouté. « La justice pour les victimes ukrainiennes de la violence est désormais un miroir pour le monde entier ».
Selon le Fonds mondial pour les survivant·es, qui gère le projet avec l'Ukraine grâce à des fonds provenant de gouvernements donateurs, ce sera la première fois que des survivant·es se verront accorder des réparations au cours d'un conflit actif.
« La réhabilitation et l'indemnisation sont un élément des réparations, mais ce que les survivantes trouvent très important, c'est la reconnaissance », a déclaré Esther Dingemans, directrice du fonds, qui a été lancé en 2019 par les lauréats du prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege et Nadia Murad, pour aider les survivantes de violences sexuelles liées à un conflit à accéder à des réparations.
« Le système de réparation offre une confirmation que ce qui leur est arrivé est officiellement reconnu. Cela envoie également un message à l'ensemble de la communauté », a ajouté Mme Dingemans.
Le nombre total d'Ukrainiennes ayant subi des violences sexuelles infligées par les forces russes est inconnu, car la plupart des survivantes ne signalent pas ces crimes. Le Global Survivors Fund l'estime à plusieurs milliers.
Pramila Patten, représentante spéciale des Nations unies pour les violences sexuelles dans les conflits, a accusé la Russie d'utiliser le viol comme « stratégie militaire », citant des cas de soldats « équipés de Viagra ».
Lyudmila Huseynova était l'une des huit civiles ukrainiennes libérées dans le cadre du premier échange de prisonnières exclusivement féminin avec la Russie, aux côtés de 100 soldats ukrainiens, en octobre 2022. Elle a été emprisonnée pendant trois ans par les forces séparatistes dans la province orientale de Donetsk.
« Je suis libre depuis plus d'un an et je n'arrive toujours pas à dormir la nuit », a-t-elle déclaré. « Je me réveille en ressentant la façon dégoûtante dont ils m'ont touchée ».
« Malheureusement, il y a encore beaucoup d'accusations portées à l'encontre des victimes, surtout dans les petites communautés rurales. Lorsque j'ai été libérée, nous ne savions même pas ce qu'était la violence sexuelle liée au conflit. »
Lorsque les forces séparatistes ont occupé sa ville natale de Novoazovsk, dans la province de Donetsk, en 2014, Huseynova s'est impliquée dans l'aide aux enfants orphelins sur la ligne de front en collectant des dons dans toute l'Ukraine. Mais les livres en ukrainien qu'elle fournissait aux enfants l'ont conduite en détention.
« Pendant trois ans et treize jours, j'ai été enfermée dans une prison surpeuplée », a-t-elle déclaré. « Je ne voyais pas le ciel et l'air était chargé de fumée de cigarette ».
« Lorsque j'ai été libérée, j'ai dû réapprendre à utiliser mes jambes et à respirer avec toute ma poitrine ».
Après sa libération, elle a été emmenée dans un hôpital militaire de Dnipro, mais le personnel n'était pas en mesure de s'occuper correctement d'une survivante de la torture sexuelle.
« L'hôpital était surpeuplé et manquait de personnel », a déclaré Huseynova. « Je ne blâme pas du tout les médecin·es, mais elles et ils n'étaient pas préparé·es à s'occuper d'une personne comme moi ».
« Elles et ils ne savaient pas comment m'approcher ou me parler, ce qui a causé plus de dommages psychologiques à long terme ».
C'est son expérience qui a poussé Huseynova à travailler avec le Fonds mondial pour les survivant·es et à défendre les survivant·es et les autres femmes encore emprisonnées. Elle espère que les victimes de violences sexuelles seront désormais entourées du soutien et de la compréhension dont elle n'a pas pu bénéficier.
« Les survivant·es quittent la détention sans rien », a-t-elle déclaré. « Elles n'ont pas de vêtements, pas de maison, pas de communauté. Souvent, tous leurs biens sont restés dans les territoires occupés et elles ne peuvent pas trouver de travail car tous leurs documents sont restés dans leur pays d'origine ».
« Les réparations peuvent aider, mais elles doivent inclure un soutien holistique en matière de santé physique et mentale. Les femmes doivent avoir accès à un psychologue – pas seulement pour quelques séances, mais aussi longtemps qu'elles en ont besoin. Le traumatisme de la violence sexuelle ne disparaît pas ».
Mme Huseynova a déclaré qu'elle restait en contact avec d'autres femmes de Donetsk qui avaient été détenues pendant des années. « Je fais de mon mieux pour leur envoyer des colis. Aucune mission humanitaire ne travaille là-bas. Aucune aide humanitaire n'y est envoyée. Lorsqu'elles ont leurs règles, ces femmes utilisent le rembourrage d'un vieux matelas ».
Dingemans a déclaré que la société civile ukrainienne et le gouvernement avaient réussi à lutter contre la stigmatisation des survivantes, soulignant le plaidoyer vocal de Mme Zelenska sur la question ainsi que les nouvelles lois en cours d'adoption par le parlement. Si elles sont adoptées, ces lois définiront les violences sexuelles liées aux conflits comme un crime distinct et mettront en place un registre national pour enregistrer les cas.
Des hommes et des garçons figurent également parmi les victimes présumées de viols commis par des soldats russes en Ukraine, des dizaines de cas de violence sexuelle ayant fait l'objet d'une enquête dans les mois qui ont suivi l'invasion.
Fedir Dunebabin, représentant du Fonds mondial pour les survivant·es en Ukraine, a déclaré : « Nous savons, grâce à d'autres contextes, que les hommes ayant survécu à des violences sexuelles liées à un conflit cherchent rarement de l'aide, mais il est surprenant de constater que ce n'est pas le cas en Ukraine. De nombreux survivants masculins se battent pour leurs droits et la justice ».
Mme Dingemans a déclaré qu'elle espérait que d'autres pays examineraient ce que faisait le gouvernement ukrainien et que la communauté internationale « pourrait soutenir les survivant·es d'autres conflits de la même manière qu'elle soutient les survivant·es en Ukraine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant ».
Les organisations suivantes peuvent fournir des informations et un soutien à toute personne touchée par des problèmes de viol ou d'abus sexuels.
Au Royaume-Uni, Rape Crisis offre un soutien au 0808 500 2222 en Angleterre et au Pays de Galles, au 0808 801 0302 en Écosse ou au 0800 0246 991 en Irlande du Nord.
Aux États-Unis, Rainn offre une assistance au 800-656-4673.
En Australie, l'assistance est disponible au 1800Respect (1800 737 732). D'autres lignes d'assistance internationales sont disponibles sur https://ibiblio.org/rcip/internl.html
Weronika Strzyżyńska
https://www.theguardian.com/global-development/2024/apr/26/reparations-survivors-wartime-sexual-violence-by-russian-soldiers-ukraine-war-olena-zelenska
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











