Derniers articles

Le PL 51 : quand la modernité des chantiers rime avec diversité et instrumentalité

L'industrie de la construction constitue un secteur d'emploi majeur au Québec ; elle génère directement plus d'un emploi sur vingt[1]. L'industrie de la construction est par ailleurs au cœur des efforts de relance économique depuis le début de la pandémie de la COVID-19.
Plusieurs initiatives ont ainsi été déployées dans les dernières années afin d'encourager la croissance du secteur et de sa productivité, notamment pour attirer de nouveaux et nouvelles travailleur·euse·s dans l'industrie. À cet égard, les groupes historiquement exclus, dont les femmes, ont fait l'objet d'une attention constante et soutenue, grâce à la mise en œuvre de différents programmes et assouplissements dédiés à faciliter et accélérer leur entrée dans l'industrie. En 2023, Action travail des femmes (ATF) publiait les résultats d'une vaste étude qui documentait ces initiatives et critiquait l'approche utilitaire adoptée envers les femmes. De plus, elle ne tient pas suffisamment compte du problème historique de leur maintien dans l'industrie[2].
27 avril 2024 | tiré de L'esprit libre
Le projet de loi no 51, Loi modernisant l'industrie de la construction (PL 51) s'inscrit dans la continuité de ces initiatives. Plusieurs des modifications législatives et réglementaires proposées visent en effet à répondre à la « pénurie de main-d'œuvre », cette fois en facilitant l'accès des « personnes représentatives de la diversité de la société québécoise », soit : « les [A]utochtones, les personnes immigrantes, les minorités visibles ou ethniques ainsi que les personnes handicapées ». Cette attention en apparence vertueuse envers les groupes historiquement exclus de l'industrie de la construction ne doit pas nous confondre. Les intentions du ministre du Travail et son souci pour la productivité des entreprises de l'industrie de la construction sont clairement explicités dans l'analyse des répercussions du règlement effectué par le Ministère :
Les mesures implantées ayant contribué à attirer les femmes dans l'industrie de la construction devraient favoriser l'attractivité de cette industrie auprès des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise. L'inclusion de ces nouveaux groupes permettrait d'élargir le bassin potentiel de travailleurs et de répondre à la demande de main-d'œuvre de l'industrie de la construction. Les propositions n'entraîneraient pas de coûts supplémentaires pour les entreprises.[3]
Combinées aux mesures implantées en vertu de l'entente Québec-Ottawa conclue en 2021 qui exemptent les employeurs d'obtenir une évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) pour la majorité des métiers de la construction (et donc de faire la démonstration de l'échec de leurs efforts de recrutement au niveau local), les modifications réglementaires prévues par le PL 51 ont cependant tout pour dérouler le tapis rouge du recrutement des travailleur·euse·s temporaires, et surtout, leur exploitation éhontée — au nom de la diversité — sur les chantiers du Québec.
Cette orientation, qui assimile les bénéfices de la diversité à leur rentabilité, est hautement problématique. En effet, elle subordonne les droits fondamentaux en matière d'égalité en emploi des personnes concernées à des impératifs économiques conjoncturels, et, par conséquent, conditionne l'atteinte de l'égalité réelle à des considérations commerciales qui risquent à terme de contribuer au fractionnement des luttes sociales. Les femmes et les autres groupes ciblés par le PL 51 méritent mieux qu'une politique qui les assigne au rang d'armée de réserve.
Après les femmes, les « personnes représentatives de la diversité »…
Jusqu'au dépôt du PL 51, les femmes constituaient le seul groupe à l'égard duquel la Commission de la construction du Québec (CCQ) avait jusqu'alors prévu des normes réglementaires différentes en vertu de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Ces dispositions[4] font l'objet d'une attention soutenue par ATF depuis plusieurs années en raison de leurs effets inégaux et parfois même contre-productifs sur l'accès à l'égalité en emploi des femmes dans la construction. Pourtant, c'est précisément leur extension systématique aux « personnes représentatives de la diversité de la société québécoise » que le PL 51 propose.
Pour rappel, les femmes constituent, à l'heure actuelle en 2024, moins de 3,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre sur les chantiers de construction[5]. Tel que le reconnaît la Commission de la construction du Québec (CCQ), la très lente progression de leur taux de représentativité est directement liée aux problématiques de discrimination et de harcèlement qui font qu'elles sont surreprésentées parmi les travailleur·euse·s qui quittent l'industrie dans les cinq premières années : en 2017, 52 % des femmes qui avaient intégré l'industrie depuis 1997 l'avaient quitté après 5 ans, contre 32 % des hommes[6].
La majorité des mesures mises en place depuis l'adoption en 1996 du premier Programme d'accès à l'égalité pour les femmes (PAEF) continue cependant d'insister sur l'accès des femmes à l'industrie, sans tenir compte ni de la qualité des emplois, ni des conditions d'exercice qu'elles sont à même d'obtenir une fois qu'elles y sont, ni pour les problèmes de maintien qu'elles y rencontrent.
Pensons, par exemple[7], au supposé avantage qui permet aux femmes d'intégrer l'industrie de la construction et d'y exercer le métier de leur choix sans avoir complété un diplôme d'études professionnelles (DEP) sitôt que la disponibilité de main-d'œuvre pour ledit métier dans une région donnée est de 30 % ou moins. Les hommes non diplômés, de leur côté, doivent pour leur part attendre les « ouvertures de bassins » qui surviennent lorsque ce taux est de 5 % ou moins. Une telle mesure a pour effet de détourner la majorité des femmes qui désirent intégrer l'industrie de la poursuite d'une formation professionnelle, alors que le DEP est un facteur de rétention avéré autant chez les hommes que les femmes. LL'augmentation du ratio apprenti/compagnon qui est accordée aux employeurs qui embauchent des travailleuses apprenties a des effets similaires. Mis en place afin de permettre aux employeurs d'augmenter le nombre d'apprenti·e·s sur leurs chantiers, cet assouplissement législatif renvoie une fois de plus les femmes au statut de main-d'œuvre d'appoint, en plus de nuire à la qualité de la supervision et du transfert de compétences. Par la même occasion, cela rend plus difficile la montée en grade et à l'accès au statut de compagnon·gne (et à leur avantage salarial). Enfin, on ne saurait passer sous silence le Carnet référence construction, une plateforme électronique mise en place avec l'intention, certes louable, de promouvoir l'embauche des femmes auprès des employeurs en recherche de main-d'œuvre. Parce qu'il se limite à hypervisibiliser les candidatures des travailleuses sur les listes de références de main-d'œuvre, le Carnet n'offre non seulement aucune garantie aux candidates qu'elles seront embauchées pour des emplois intéressants, mais il contribue de surcroît à entretenir le préjugé selon lequel les femmes bénéficient d'une place privilégiée au sein de l'industrie et à renforcer le sentiment d'hostilité à leur égard.
Ces quelques exemples démontrent que la mise en place d'interventions centrées sur l'accès ne peut, à elle seule, neutraliser les biais systémiques qui font que les travailleuses de la construction peinent à progresser sur le plan professionnel et à se maintenir dans le milieu. Bon nombre de ces mesures ont en outre des effets préjudiciables sur l'intégration des femmes dans les équipes de travail, puisqu'elles alimentent le mythe selon lequel ces dernières bénéficieraient de passe-droits dans l'industrie, et, incidemment, qu'elles n'y mériteraient pas leur place au même titre que leurs confrères masculins. Loin d'avoir fait leurs preuves en matière d'égalité en emploi, ces mesures contribuent donc plutôt au maintien des travailleuses dans la précarité et à leur circulation perpétuelle.
La proposition du PL 51 d'élargir systématiquement la portée de ces mesures originellement pensées pour favoriser la présence des femmes aux « personnes représentatives de la diversité » — en mode one size fits for all et sans diagnostic préalable — soulève donc d'importants enjeux. Tel que l'a dénoncé ATF dans son mémoire soumis à la Commission de l'économie et du travail, cette approche rompt non seulement avec les principes censés guider la mise en place de réelles mesures d'accès à l'égalité (évaluer le système d'emploi relativement à chaque groupe ciblé, identifier les obstacles propres à chacun d'entre eux, déterminer des cibles réalistes et souhaitables, etc.), mais surtout, témoigne du rôle cosmétique qu'accorde le ministre du Travail à la « diversité ». Non seulement à aucun endroit, ni dans le mémoire qu'il a soumis au Conseil des ministres ni dans l'analyse d'impact réglementaire produite par son ministère, les mots « égalité » ou « discrimination » n'apparaissent, mais la motion pour faire entendre l'analyse d'ATF en consultations particulières de l'étude du projet de loi s'est vue fermement refusée par les commissaires de son parti[8].
En misant uniquement sur l'intérêt des employeurs à recruter les personnes qu'il assimile à la diversité québécoise pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, le PL 51 n'offre ainsi aucune garantie pérenne sur leur accès à l'égalité en emploi et leur capacité à affronter les effets des fluctuations économiques de l'industrie. Les mesures « diversitaires » du PL 51 sont en ce sens univoques de l'intention du ministre de pourvoir à l'exploitation d'une main-d'œuvre jetable. Elles visent sciemment à répondre à des besoins ponctuels créés par une surchauffe de l'industrie à laquelle le gouvernement a lui-même contribué — comme l'illustre le développement récent de la filière des batteries[9].
En dérive, l'immigration au secours de la diversité
La vision instrumentale du gouvernement à l'égard de la diversité est rendue d'autant plus évidente qu'il prend soin de spécifier la définition qu'il entend des « personnes immigrantes » faisant partie des « personnes représentatives de la diversité de la société québécoise » : un résident permanent ou ressortissant étranger. Cette définition est, d'une part, restrictive, puisqu'elle exclut les personnes immigrées qui vivent sur le territoire et qui ont été naturalisées, et, d'autre part, extrêmement inclusive puisqu'elle considère comme personne immigrante toute personne relevant d'un autre État qui résiderait sur le territoire canadien. Elle inclut donc les personnes dotées d'un statut d'immigration non permanent, dont celles qui auraient été recrutées par les entreprises via le Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET).
Voilà plusieurs années que le ministre du Travail lorgne ce bassin de main-d'œuvre prospectif. Pensons à ses déclarations dans le cadre du lancement de l'Opération main-d'œuvre en 2021[10]). Il n'est donc pas surprenant de voir que le PL 51 prévoit des mesures afin d'aménager la législation conformément aux désirs des entreprises. En faisant implicitement des travailleur·euse·s temporaires des « personnes immigrantes » et, incidemment, des « représentants de la diversité » en vertu de la Loi, le PL 51 abat donc les dernières contraintes législatives qui restreignaient le recours au PTET.
En vertu des modifications réglementaires mentionnées précédemment, ces travailleur·euse·s recruté·e·s à l'international pourront désormais intégrer l'industrie de la construction sitôt que la disponibilité de main-d'œuvre enregistrée par la CCQ sera de 30 % ou moins pour le métier visé, peu importe les qualifications détenues ou leur reconnaissance formelle. Ielles seront aussi plus aisément « déplaçables » à l'échelle de la province, grâce aux dispositions du PL 51 qui prévoient l'octroi de critères de mobilité régionale préférentiels pour les femmes et les personnes représentatives de la diversité — avec tous les risques de ressac que cela suppose.
Le PTET est cependant un programme tristement célèbre en raison de ses effets délétères sur les conditions de vie et de travail qu'il impose aux travailleur·euse·s qui viennent travailler au Canada avec un permis de travail fermé, comme c'est le cas aussi dans le secteur agricole. Tel que le dénoncent des organisations locales de défense des droits comme le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) depuis de nombreuses années, le fait que le permis de travail soit lié à un employeur unique renforce la vulnérabilité des travailleur·euse·s à différentes formes d'exploitation et de violations des droits que les organisations comme la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) peinent à endiguer véritablement[11]. C'est pour cette raison que, en octobre 2023, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage de l'Organisation des Nations unies (ONU) intimait au gouvernement fédéral de mettre en place un meilleur accès à la résidence permanente[12].
Dans le domaine de la construction plus particulièrement, une étude réalisée par Marie-Jeanne Blain et Lucio Castracani, en partenariat avec la CCQ et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), démontrait pour sa part l'existence de liens ténus entre la croissance de l'immigration temporaire et l'apparition de « zones grises de l'industrie » où sont refoulé·e·s les travailleur·euse·s sans permis de travail pour effectuer des tâches illégales et dangereuses[13]. Dans les autres provinces canadiennes, plusieurs cas d'abus graves impliquant des personnes migrantes détenant un statut d'immigration précaire ont ainsi été répertoriés[14], ce qui a permis de justifier la mise en place d'un programme de régularisation pour les travailleur·euse·s de la construction « sans-papiers » dans la région du Grand Toronto par le gouvernement fédéral en 2019[15].
Ces observations n'empêchent pas les associations patronales du Québec de déplorer la « sous-utilisation » du PTET par rapport au reste du Canada, et de revendiquer des assouplissements afin de faciliter la venue de travailleur·euse·s migrant·e·s pour résoudre leurs problèmes de dotation de personnel[16]. La crainte de voir ces travailleur·euse·s devenir du cheap labor avait d'ailleurs été balayée du revers de la main par le ministre du Travail Jean Boulet en octobre 2023, quelques jours seulement après la déclaration du Rapporteur spécial de l'ONU[17].
À l'heure actuelle, les travailleur·euse·s temporaires forment une très faible minorité sur les chantiers du Québec — 0,5 % selon la CCQ — notamment parce qu'ils et elles sont sous-représenté·e·s dans le secteur par rapport aux autres secteurs d'activité[18]. Les modifications réglementaires prévues par le PL 51 ont cependant tout pour dérouler le tapis rouge du recrutement des travailleur·euse·s temporaires, et surtout, leur exploitation éhontée — au nom de la diversité — sur les chantiers du Québec. À cela s'ajoute les mesures implantées en vertu de l'entente Québec-Ottawa conclue en 2021, qui exemptent les employeurs d'obtenir une évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) pour la majorité des métiers de la construction et, par conséquent, de faire la démonstration de l'échec de leurs efforts de recrutement au niveau local.
Conclusion : des pistes de solution concrètes
« Dernier bastion de la masculinité »[19] ou encore « forteresse de béton armé »[20], les métiers et les occupations de l'industrie de la construction forment l'un des secteurs d'emploi les plus homogènes au Québec.
Le PL 51 manque cependant une occasion unique de progresser vers l'égalité de fait dans le secteur de la construction, une opportunité qui, compte tenu du rythme des réformes législatives, pourrait mettre encore plusieurs années à se matérialiser. Selon l'article 126.0.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20), la CCQ est tenue de consulter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour l'élaboration de ses mesures visant à favoriser l'accès, le maintien et l'augmentation du nombre des femmes dans l'industrie de la construction. Tel que l'observe ATF depuis plusieurs années, la CCQ adopte cependant une vision étroite de cette obligation, ce qui explique que bon nombre des mesures n'ont pas livré les effets escomptés en matière de représentativité des femmes. Une réforme de l'industrie de la construction axée sur la promotion de l'égalité et de la participation de tous·tes à la mise en œuvre des chantiers de demain devrait donc renforcer les mécanismes de reddition de comptes de la CCQ à l'égard de la CDPDJ. Elle devrait aussi pouvoir assurer la conformité des mesures qui sont mises en place pour les femmes et les groupes nouvellement ciblés aux cadres législatifs en matière d'accès à l'égalité en emploi et de droits de la personne.
L'assujettissement de l'industrie de la construction au Programme d'obligation contractuelle (POC), revendiqué depuis le début des années 1980 par ATF, est par ailleurs la manière qui permettrait au gouvernement d'agir de la façon la plus structurante sur l'accès à l'égalité en emploi dans l'industrie[21]. L'introduction d'obligations contractuelles, dans une formule spécifique à l'industrie de la construction prenant en compte la petite taille de bon nombre d'entreprises et les chaînes de sous-traitance qui les lie, obligerait en effet les employeurs et leurs sous-traitants à adopter des pratiques de recrutement et d'embauches justes à l'égard des groupes sous-représentés, sous peine de sanctions en cas de non-conformité. Il s'agit d'un levier d'action effectif qui donnerait au gouvernement le pouvoir d'agir de façon systémique sur le secteur, tout en favorisant l'accès des individus historiquement concernés par la discrimination aux emplois les plus stables et rémunérateurs de l'industrie. En accord avec les principes de la Charte des droits et libertés de la personne, de telles obligations pourraient donc favoriser une vraie représentativité de la société québécoise sur les grands chantiers qui sont financés par l'État, et donc par l'ensemble des Québécois·e·s. Une véritable diversité sur les chantiers ne serait-elle pas le réel signe de l'entrée de l'industrie dans la modernité ?
Le manque de main-d'œuvre et la crise du logement ne devraient en outre pas nous détourner des considérations humanitaires qui sont censées être au cœur d'une politique d'immigration solidaire, inclusive et vectrice de richesses collectives. L'octroi de permis de travail ouverts, la régularisation du statut des personnes migrantes sans-papiers, l'accès facilité à la résidence permanente et la simplification des mécanismes de reconnaissance des qualifications et compétences acquises à l'étranger devraient ainsi apparaître en tête de liste de toute initiative visant à favoriser la présence des travailleur·euse·s issu·e·s de l'immigration sur les chantiers du Québec. Les projets d'infrastructures qui marqueront la prochaine décennie bénéficieront à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire ; aucune raison ne justifie que les personnes qui les construisent ne soient pas également reconnues et protégées.
Laurence Hamel-Roy et Katia Actif
CRÉDIT PHOTO : Flickr/Peter Burka
[1] Plan d'action pour le secteur de la construction, Québec : Gouvernement du Québec, Mars 2021.
[2] Laurence Hamel-Roy, Élise Dumont-Lagacé et Sophie Pagarnadi, Maintien et stabilisation des travailleuses de la construction au Québec : une industrie à la croisée des chemins, Montréal : Action travail des femmes (ATF), 2023.
[3] Ministère du travail, Analyse d'impact réglementaire : projet de loi modernisant l'industrie de la construction, Québec : Gouvernement du Québec, Janvier 2023, p. 25.
[4] Particulièrement, celles contenues dans le Règlement sur la délivrance des certifications de compétence (r.5) et dans le Règlement sur le Service de référence de main-d'œuvre de l'industrie de la construction (r.14.1).
[5] CCQ, « Les femmes plus nombreuses dans l'industrie de la construction », 8 mars 2024, https://www.ccq.org/fr-CA/Nouvelles/2024/journee-des-femmes(link is external)
[6] CCQ, Les femmes dans l'industrie de la construction - portrait statistique 2022, 2023.
[7] Pour plus d'informations sur ces mesures, voir Laurence Hamel-Roy, Élise Dumont-Lagacé et Sophie Pagarnadi, Op. cit.
[8] Étude détaillée du projet de loi n° 51, Loi modernisant l'industrie de la construction, 28 mars 2024. Voir le Journal des débats de la Commission de l'économie et du travail, Vol. 27, n° 49.
[9] Louis Cloutier, « Filière batterie : la Mauricie manquera de travailleurs de la construction », TVA Nouvelles, 9 décembre 2022, https://www.tvanouvelles.ca/2022/12/09/filiere-batterie-la-mauricie-manquera-de-travailleurs-de-la-construction(link is external)
[10] Conférence de presse concernant l'Opération main-d'œuvre du premier ministre François Legault, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration Jean Boulet et de la ministre de l'Enseignement supérieur Danielle McCanne, 20 novembre 2021.
[11] Voir par exemple Oona Barret, « Des travailleurs migrants dénoncent du travail forcé dans une usine », Pivot, 1er août 2023, https://pivot.quebec/2023/08/01/des-travailleurs-migrants-denoncent-du-travail-force-dans-une-usine-quebecoise/(link is external)
[12] « Canada : Ancrer la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage dans les droits de l'homme, demande un expert ONU », Communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), 6 septembre 2023, https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2023/09/canada-anchor-fight-against-contemporary-forms-slavery-human-rights-un(link is external)
[13] Marie-Jeanne Blain et Lucio Castracani, Les obstacles et facteurs de succès à l'intégration et au maintien en emploi des personnes immigrantes dans l'industrie de la construction, Montréal : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, Équipe de recherche ÉRASME et Savoirs Partagés, Octobre 2023.
[14] Michelle Buckley, Adam Zendel, Jeff Biggar, Lia Frederiksen et Jill Wells, Migrant Work & Employment in the Construction Sector, Genève : Bureau international du travail (BIT), 2016.
[15] Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Politique d'intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) – Prorogation, Ottawa : Gouvernement du Canada, 18 décembre 2023, https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/politiques-interet-public/residence-permanente-travailleurs-construction-sans-statut-rgt-prorogation.html(link is external).
[16] Voir par exemple Jean-Philippe Cliche, « Programme de travailleurs étrangers temporaires en construction », ACQ Construire, 14 septembre 2022, https://www.acqconstruire.com/actualites/2699-programme-de-travailleurs-etrangers-temporaires-en-construction#:~:text=Un%20programme%20sp%C3%A9cifique%20pour%20l,est%20normalement%20de%20deux%20ans(link is external) et Jean-Sébastien Plourde, « Des talents internationaux pour nous aider à bâtir ! », ACQ Construire, 18 décembre 2023, https://www.acqconstruire.com/relations-du-travail/2963-des-talents-internationaux-pour-vous-aider-a-batir(link is external)
[17] Francis Halin, « Le ministre Boulet veut plus de travailleurs étrangers en construction », Le Journal de Montréal, 23 octobre 2023, https://www.journaldemontreal.com/2023/10/28/le-ministre-boulet-veut-plus-de-travailleurs-etrangers-en-construction(link is external)
[18] CCQ, Analyse provinciale des données sur les personnes immigrantes et résidents non permanents, recensement 2021 de Statistique Canada, Mars 2024.
[19] Geneviève Dugré, Travailleuses de la construction, Montréal : Éditions du remue-ménage, 2006.
[20] Marie-Thérèse Chicha et Éric Charest, Le Québec et les programmes d'accès à l'égalité : un rendez-vous manqué ?, Montréal : Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CETUM), Avril 2013.
[21] L'application du POC à l'industrie de la construction fait consensus au sein des cinq organisations syndicales de l'industrie depuis de nombreuses année. Au lendemain du dépôt du PL 51, cet appui avait d'ailleurs été réitéré dans une lettre ouverte demandant au gouvernement Québecois d'intervenir en ce sens. Laurence Hamel-Roy, Katia Atif et Élise Dumont-Lagacé, « Des mesures de diversité qui tombent à plat et rien de plus pour les femmes avec le PL51 », Le Devoir, 14 février 2024, https://www.ledevoir.com/opinion/idees/807865/idees-mesures-diversite-tombent-plat-rien-plus-femmes-pl51(link is external)
Laurence Hamel-Roy est candidate au doctorat au Centre for Interdisciplinary Studies on Society and Culture (CISSC) de l'Université Concordia, où elle mène un projet qui retrace l'histoire des transformations législatives de l'industrie de la construction et leurs répercussions sur les trajectoires professionnelles et militantes des travailleur·euse·s de l'industrie.
Katia Atif est directrice d'Action travail des femmes (ATF), un organisme de défense des droits des femmes, qui soutient depuis près de 50 ans les démarches des femmes de tous âges et origines pour l'accès à des emplois décents et bien rémunérés, particulièrement dans les domaines dits non traditionnels. Cet article est inspiré de l'avis Le projet de loi no 51 : des solutions mal avisées qui confondent les problématiques conjoncturelles et les inégalités systémiques rencontrées par les femmes. Ce dernier a été déposé au nom d'ATF dans le cadre des consultations relatives au projet de loi 51, Loi modernisant l'industrie de la construction. Elles dénoncent les dispositions de ce projet de loi comme témoignant du rapport instrumental du gouvernement à l'égard des groupes sous-représentés dans l'industrie : les femmes, les personnes autochtones, les personnes immigrantes, de minorité visible ou ethnique et les personnes en situation de handicap. À terme, il risque de nuire à l'atteinte de l'égalité en emploi sur les chantiers.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le sort de la Palestine à la lumière de l’attaque contre Gaza

L'offensive en cours contre la bande de Gaza, accompagnée d'une dangereuse escalade des attaques sionistes en Cisjordanie, constitue sans aucun doute l'étape la plus grave de l'agression sioniste qui se poursuit sur la scène palestinienne depuis la Nakba de 1948.
Tiré du site d'Inprecor
1 mai 2024
Par Gilbert Achcar
C'est donc un grand paradoxe que cette attaque paroxystique puisse produire des résultats complètement opposés à ceux de la guerre qui a eu lieu il y a plus de trois quarts de siècle. Après sa naissance tumultueuse en 1948, l'État sioniste était considéré comme une entité coloniale illégitime par les pays arabes, en dépit de la légitimité que lui avaient accordé les Nations Unies. La vérité est que l'organisation internationale était à cette époque sous la domination totale de pays du Nord à la tête d'empires coloniaux, tandis que la plupart des États membres actuels de l'organisation étaient sous le joug colonial, sans représentation dans les forums internationaux.
La défaite arabe de 1967 a conduit les États arabes à battre en retraite de cette position historique et à accepter la légitimité de l'État sioniste à l'intérieur de ses frontières préalables à la guerre des Six Jours. Ce fut par l'acceptation de la résolution n° 242 du Conseil de sécurité de l'ONU ( 22 novembre 1967), adoptée moins de trois mois après qu'un sommet arabe réuni dans la capitale soudanaise, Khartoum, eut proclamé trois Ni : « Ni conciliation, ni reconnaissance, ni négociation ». Les refus de Khartoum étaient en fait contredits par leur contexte même, qui appelait à des « efforts politiques » visant à « éliminer les résultats de l'agression » en obtenant le retrait de l'armée sioniste vers les frontières préalables à la guerre.
Quant à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), après avoir catégoriquement rejeté la résolution 242 dès sa publication, elle s'y est progressivement adaptée, en adoptant le programme d'un « État palestinien indépendant » aux côtés de l'État sioniste, jusqu'à accepter officiellement la résolution en 1988, lors d'une réunion de son Conseil National tenue à Alger. Cela fut suivi par le marché conclu à Oslo en 1993 par Yasser Arafat et Mahmoud Abbas dans la conviction qu'il apporterait « l'État indépendant » souhaité, même s'il ne stipulait même pas le retrait de l'armée sioniste des territoires de 1967, mais seulement son redéploiement en dehors des zones à forte densité de population palestinienne, ni le démantèlement des colonies, ni même le gel des activités de colonisation, sans parler de l'annulation de la décision d'Israël d'annexer Jérusalem-Est et du droit au retour des réfugiés.
L'accord d'Oslo ouvrit la voie au Royaume de Jordanie pour se joindre à l'Égypte et à l'OLP dans la « normalisation » de ses relations avec l'État sioniste. Le régime de Sadate avait saisi l'occasion de la troisième défaite égyptienne en 1973, qu'il avait qualifiée de « guerre de la traversée » (du canal de Suez) et présentée comme une victoire, afin de conclure un accord séparé avec l'État sioniste, inspiré par la résolution 242. L'Égypte récupéra ainsi la péninsule du Sinaï avec une souveraineté réduite et sans la bande de Gaza qui y était rattachée administrativement avant la guerre de 1967. En échange, l'Égypte accepta une « normalisation » complète de ses relations avec Israël au prix d'une rupture temporaire de ses relations avec les pays arabes.
Cinquante ans après la « guerre de la traversée » de Sadate et trente ans après l'accord d'Oslo, survint l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », conçue pour être une seconde « guerre de la traversée ». Elle a en réalité conduit à une seconde Nakba, plus désastreuse que la première du point de vue de l'ampleur du massacre génocidaire, des destructions et du déplacement de population. Alors que d'autres pays arabes s'étaient joints au camp de la « normalisation » en 2020, à savoir les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Royaume du Maroc (en plus de la clique militaire soudanaise), le royaume saoudien s'apprête désormais à les rejoindre afin de compléter les conditions de l'établissement d'une alliance militaire régionale réunissant les monarchies du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc avec l'État sioniste sous la protection et la supervision militaire des États-Unis, contre l'Iran et toute autre menace pouvant mettre en péril la sécurité des membres régionaux de l'alliance et les intérêts de leur parrain américain.
Quant au sort des Palestiniens, « remettre la question sur la table » – ce que le Hamas est fier d'avoir réussi grâce à son opération, malgré l'énorme coût humain de cette « réussite » – a en fait conduit au déploiement de vigoureux efforts internationaux, principalement par les États-Unis, pour relancer le projet d'Oslo d'une manière encore pire qu'il y a trente ans. L'objectif est d'établir un État croupion palestinien sur des parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, soumis à un contrôle militaire strict exercé par l'État sioniste à travers la présence permanente de ses forces à l'intérieur des deux zones, sans parler des terres de Cisjordanie qui sont sous le contrôle de l'armée et des colonies sionistes, qu'Israël pourra officiellement annexer en échange de son acceptation de la création du mini-État.
Certes, si Washington parvient à imposer ce scénario, cela constituera une frustration (temporaire) des intentions de l'extrême droite sioniste de réaliser le « Grand Israël » du fleuve à la mer. Cependant, ces intentions étaient de toute façon hors de portée avant que le « Déluge d'Al-Aqsa » ne fournisse à l'armée sioniste l'occasion de réoccuper la bande de Gaza et intensifier ses opérations en Cisjordanie, parallèlement aux attaques des colons. Il n'en reste pas moins que la meilleure « solution » qui pourrait résulter de la guerre génocidaire actuelle menée par l'État sioniste est pire que celle qui existait avant elle, et certainement pire que ce qui apparaissait à l'horizon après l'accord d'Oslo.
Le peuple palestinien devra s'accrocher à sa terre, rejeter le déplacement « doux » (les incitations à émigrer) après le déplacement forcé, et poursuivre la lutte selon une stratégie qui lui permette de faire progresser sa cause à nouveau, après le grand déclin qui a suivi les progrès importants réalisés par cette cause au plus fort de la première Intifada en 1988, un déclin qui a maintenant atteint son point le plus bas. La lutte palestinienne devrait viser à diviser politiquement la société israélienne plutôt que de l'unir par des actes sans discernement, en subordonnant les formes nécessaires de résistance armée aux exigences de l'action politique et de masse, et cela afin de revenir aux conditions qui ont suivi l'invasion du Liban en 1982 et la première Intifada qui a suivi, lorsqu'un courant a commencé à croître parmi les Juifs israéliens, qualifié à l'époque de « post-sioniste », qui combinait rejet de l'occupation et soutien à la désionisation de l'État israélien afin de le transformer en « un État de tous ses citoyens ».
[Traduction de ma tribune hebdomadaire->L'offensive en cours contre la bande de Gaza, accompagnée d'une dangereuse escalade des attaques sionistes en Cisjordanie, constitue sans aucun doute l'étape la plus grave de l'agression sioniste qui se poursuit sur la scène palestinienne depuis la Nakba de 1948. ] dans le quotidien de langue arabe,Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 30 avril en ligne et dans le numéro imprimé du 1er mai. Vous pouvez librement le reproduire en en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux États-Unis, les manifestations étudiantes en faveur de la Palestine s’étendent malgré la répression

Des milliers d'étudiants dans des dizaines de campus à travers les États-Unis ont participé en avril et continuent aujourd'hui à se joindre à des manifestations pro-palestiniennes qui ont parfois donné lieu à une répression policière brutale, à des arrestations et à des suspensions ou à des expulsions de l'université.
Tiré de Inprecor 719 - avril 2024
30 avril 2024
Par Dan La Botz
Manifestation et campement pro-palestinien sur la White Memorial Plaza de l'université de Stanford à la fin du mois d'avril 2024. © Suiren2022 - Own work, CC BY 4.0
Les manifestations ont débuté à l'université de Columbia, puis se sont étendues à d'autres prestigieuses universités privées telles que Yale et Harvard, ainsi qu'à l'université de Californie du Sud, avant d'englober des universités d'État telles que les campus de l'université de Californie à Berkeley et Los Angeles et l'université du Michigan. À Columbia, à l'université Emory à Atlanta et à l'université du Texas à Austin, des policiers en tenue anti-émeute ont dispersé des campements sur les campus, frappé et arrêté des étudiants. Sur certains campus, la police a également arrêté des professeurs.
Le mouvement étudiant a commencé par une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien, appelant à un « cessez-le-feu immédiat » et à la fin du financement américain de l'armée israélienne. Rapidement, les étudiants ont également exigé que leurs universités se désengagent des entreprises israéliennes, en particulier des sociétés de renseignement et des fabricants d'armes, et certains ont également demandé la fin des liens académiques avec les institutions israéliennes. Les étudiants ont dressé des tentes et se sont installés sur les places des universités pour protester pacifiquement. Ils n'ont pas eu recours à la violence, n'ont pas endommagé de biens et n'ont pratiquement pas interrompu les activités de l'université. De nombreux manifestants étaient des Palestinien·nes et des juifs, mais aussi d'autres personnes.
Les présidents d'université, d'autres administrateurs universitaires, des politiciens et certains médias ont qualifié les manifestations d'antisémites, ont affirmé qu'elles intimidaient et menaçaient les étudiants juifs et ont prétendu qu'elles étaient violentes. Nemat Shafik, président de l'université de Columbia, a été le premier à faire appel à la police, ce qui a conduit à des passages à tabac et à des arrestations, indignant les étudiants et de nombreux membres du corps enseignant. Des centaines de personnes ont été arrêtées sur différents campus du pays. Bien qu'il y ait eu sans aucun doute quelques remarques antisémites, elles étaient de rares exceptions et les manifestations étaient fondamentalement antisionistes et ne menaçaient pas les étudiants juifs.
« Les étudiants sont ici parce que cela fait plus de 200 jours qu'ils assistent à un génocide. Parce que les gens sont fatigués de voir leurs amis se faire battre, arrêter, suspendre et expulser pour avoir osé élevé la voix pour mettre fin à la complicité de leur université dans le système », explique Cyn, étudiant à l'université de Berkeley. « Chaque année, nos universités envoient des millions et des millions de dollars à des entreprises qui fabriquent des armes et des équipements de surveillance utilisés pour harceler, intimider et brutaliser les Palestinien·nes, et ensuite nos universités retournent ces mêmes tactiques contre nous. Notre solidarité va à tous ceux qui luttent pour une Palestine libre ».
Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, dans un geste politique choquant et sans précédent, s'est rendu à l'université de Columbia et a pris la parole, qualifiant les manifestants pro-palestiniens de « foule » qui avait menacé des étudiants juifs et « soutenu des terroristes ». Il a exigé que le président de l'université de Columbia, M. Shafik, maîtrise les manifestations ou démissionne. Les sénateurs républicains Tom Cotton (Arkansas) et Josh Hawley (Missouri) ont appelé à l'envoi de troupes pour écraser les manifestations pro-palestiniennes sur le campus.
D'autres manifestations appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fin du financement d'Israël par les États-Unis se poursuivent, comme celle à laquelle j'ai participé, un sit-in organisé devant le domicile de Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, à Brooklyn, qui a bloqué une artère principale et a donné lieu à 300 arrestations.
Malgré la répression, les étudiant·es semblent déterminés à poursuivre les manifestations et à obliger leurs universités à se désinvestir d'Israël et à empêcher leur gouvernement d'aider l'armée israélienne. Mais les cours se terminent en mai. Où ira le mouvement ? Certains prévoient de se rendre à la convention du Parti démocrate à Chicago du 19 au 22 août. S'agira-t-il d'un nouveau 1968 ?
28 avril 2024, publié par International Viewpoint
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
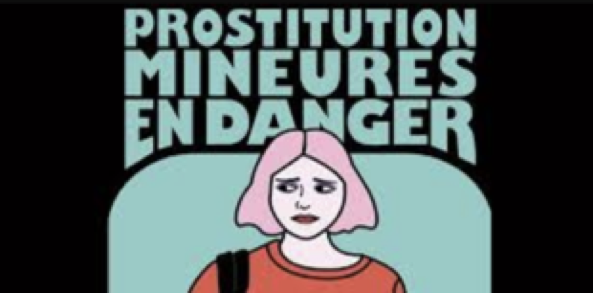
La prostitution des mineur.es, partie intégrante de l’industrie du sexe
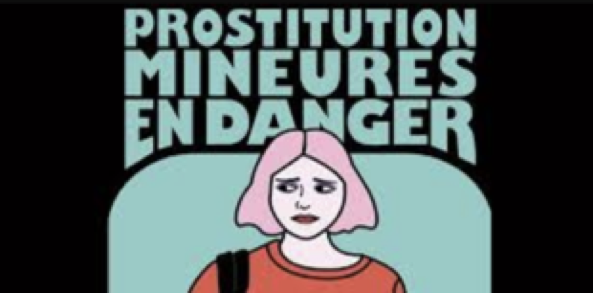
Richard Poulin est professeur émérite de sociologie (université d'Ottawa) et professeur associé à l'Institut de recherches et d'études féministes (UQAM). Il est l'auteur d'ouvrages sur les industries du sexe, les questions ethnico-nationales, les violences meurtrières, ainsi que le socialisme et le marxisme. Il vient de publier la traduction et la préface du livre de Karl Kautsky « L'origine du christianisme » (Paris, Syllepse) et un roman co-écrit avec son fils sous pseudonyme, « On aurait dû vous croire » (Montréal, M Éditeur).
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/03/la-prostitution-des-mineur-es-partie-integrante-de-lindustrie-du-sexe/
Interview de Richard Poulin par Francine Sporenda
Avant de répondre à vos questions, j'aimerais préciser que mon livre Les enfants prostitués (publié par Imago) constituait le premier volet d'une étude sur l'exploitation sexuelle mondialisée des enfants. Le deuxième volet portait sur la pornographie. Il s'intitulait Sexualisation précoce et pornographie (publié par La Dispute). Outre l'analyse de l'exploitation sexuelle des enfants dans la pornographie, il s'attachait à montrer l'influence de la pornographie sur l'hypersexualisation des filles, et l'impact de la pornographisation sur les codes sociaux et culturels, ce qui joue un rôle fondamental dans la banalisation sociale et politique de la prostitution.
Dans les deux cas – prostitution et pornographie –, il y a un tronc commun, à savoir l'agression sexuelle lors de l'enfance. Environ 85% des femmes prostituées ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Il n'y a pas d'enquêtes similaires dans le cas des « stars » de l'industrie pornographique (les hardeuses), mais à lire leurs biographies et autobiographies, on s'aperçoit que les violences sexuelles subies dans l'enfance sont courantes. J'ai mené une enquête auprès de danseuses nues (échantillon de 25). Quelque 80 % d'entre elles m'ont révélé avoir été victimes de viols incestueux.
Ce facteur est important, voire décisif, pour expliquer le recrutement dans les industries du sexe. Pour survivre à l'agression sexuelle subie lors de leur enfance, les filles fuguent. Elles tentent ainsi d'échapper à leur enfer familial. Par ailleurs, pour survivre, elles développent une dissociation de soi qui protège leur esprit pendant que leur corps subit des avanies. Elles apprennent l'indifférence à leur propre corps et à ses sensations. Cela se traduit par une absence à soi-même, une anesthésie sensitive et une réactivité affective amoindrie, ce qui, en même temps, leur permet de survivre. Mais avec une piètre estime de soi.
Cet état de dissociation est souvent une condition essentielle à l'activité prostitutionnelle et pornographique. Rappelons que les proxénètes utilisent la violence sexuelle, notamment les viols à répétition et les viols collectifs pour briser psychologiquement les femmes et les filles qu'ils entendent prostituer chez eux ou à l'étranger. Pour survivre psychologiquement, les victimes de ces violences sexuelles à répétition finissent par dissocier leur moi de leur corps, arrivent à faire de leur corps un objet extérieur à elles-mêmes. Une fois ce processus achevé, ce corps peut être mis sur les marchés du sexe. Les proxénètes ont moins à utiliser de tels moyens avec les filles qui ont déjà subi des viols à répétition lors de leur enfance.
Les jeunes fugueuses sont facilement repérées et recrutées par les proxénètes comme le montre l'ensemble des études sur les « réseaux sexuels » criminalisés. Ce n'est donc pas surprenant que l'âge moyen de l'entrée dans la prostitution dans les pays capitalistes développés tourne autour de 14-15 ans (certaines études aux États-Unis estiment que l'âge de recrutement est de 13-14 ans). Il est encore plus jeune dans les pays du Sud, particulièrement dans les pays de tourisme prostitueur.
FS : Vous dites que la prostitution des mineur.es est, de pair avec la traite, partie intégrante de l'industrie du sexe. Peut-on réglementer ou décriminaliser « l'industrie du sexe » tout en combattant la prostitution des enfants ?
RP : Les organisations et les États favorables à la décriminalisation de l'industrie de la prostitution soutiennent qu'il existerait à côté de la prostitution « forcée » (dont la prostitution des enfants) qui, elle, serait insupportable et constituerait une violation des droits humains, une prostitution « volontaire » et donc acceptable, où la personne prostituée est définie comme une « travailleuse du sexe » et le proxénète comme un « manager » ou un « homme d'affaires ». « La liberté de se prostituer » ferait même partie pour certain.es des droits que les femmes doivent conquérir ! En fait, l'accès des hommes aux femmes, au moyen du sexe tarifé, est appelé liberté tant pour eux que pour elles.
Pour revendiquer la décriminalisation ou la réglementation de la prostitution, il s'agit de banaliser la prostitution (ainsi que la traite des femmes à des fins de prostitution) et d'en faire un « métier » comme un autre. Les organisations favorables au « travail du sexe » prétendent que les personnes prostituées font un choix économique rationnel. Elles expliquent que ce choix découle très souvent d'un désir d'échapper à une situation de pauvreté. Dans ce cadre, la traite des femmes est banalisée : elle devient une simple migration de femmes pour offrir des services sexuels. Cela sera dû à l'absence de perspectives d'emploi et de travail dans leur propre pays.
Ces organisations et États dénoncent à l'occasion la « prostitution forcée », qui ne peut être que très minoritaire, selon leur point de vue, tout en faisant la promotion de la prostitution comme travail ou métier. Ils sont d'accord pour dire que l'« exploitation sexuelle des enfants » est abominable et qu'elle relève du crime, même si tous n'ont pas la même définition de l'enfant et du crime.
L'âge de l'interdiction de la prostitution varie entre 14 et 18 ans en Europe. En Roumanie, les prostitueurs peuvent se payer des enfants âgés de 14 ans. En Russie, au Portugal, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni, les prostitueurs peuvent légalement se payer des enfants de 16 ans.
La prise de conscience internationale de l'intensification et de la massification de la prostitution des enfants, de leur traite à des fins de prostitution, qui est liée, entre autres, au tourisme prostitueur, et leur utilisation accrue dans la pornographie, a engendré des campagnes internationales contre l'« exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ». Or, ces campagnes ont le défaut de ne pas cibler la prostitution et la pornographie comme les causes essentielles de cette « exploitation », mais de restreindre, pour des raisons qui relèvent peut-être de la stratégie, mais peut-être aussi de l'acceptation de l'exploitation de la prostitution des adultes, le problème à l'âge du consentement sexuel.
Limiter le combat contre l'« exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales » à la notion de consentement fait le jeu des réglementaristes pour qui cette notion est fondamentale dans la légitimation même de la prostitution.
Les victimes enfantines de l'industrie du sexe atteignent un jour leur majorité et, ce jour-là, elles cessent légalement d'être « exploitées sexuellement » : elles sont désormais, pour nombre d'États, des personnes qui font le commerce de leur corps de façon consentante, en toute liberté, en connaissance de cause. Si elles le font hors de leur pays, car victimes de la traite à des fins de prostitution ou de pornographie, elles sont criminalisées en tant qu'immigrantes illégales.
Combattre uniquement la prostitution « forcée », c'est mettre le fardeau de la preuve sur la personne prostituée, qui devra prouver cette contrainte. Combattre la prostitution des mineurs, c'est éviter de combattre celle des adultes. C'est également dédaigner la lutte contre la marchandisation de ces personnes. C'est l'acceptation de l'extension des valeurs marchandes au corps des femmes et des enfants.
FS : Vous signalez que le tourisme sexuel est florissant. La proportion d'enfants exploités dans le tourisme sexuel varie selon les pays mais elle tourne en moyenne autour de 30%. Qui sont ces enfants, et qui sont les individus qui sont les « clients » ?
RP : Les « clients » sont très majoritairement des hommes, sans doute à 95 ou à 96%, les prostitueurs internationaux sont issus de pratiquement toutes les classes sociales, à l'exception des plus pauvres. Pour nombre de touristes, qu'ils soient d'affaires ou de loisir, profiter de la prostitution des enfants constitue l'un des objectifs de leur voyage. Par ailleurs, les touristes sexuels d'occasion qui n'organisent pas nécessairement leur déplacement dans l'intention d'exploiter la prostitution d'enfants, des individus qui, une fois sur place, se laissent « tenter » et passent à l'acte.
Les touristes prostitueurs d'occasion sont nombreux. Leur achat du sexe d'un enfant ou d'une jeune personne résulte de plusieurs facteurs, qui dérivent de la situation particulière d'un voyage dans un pays étranger. Ils se permettent des actes qu'ils ne commettraient pas nécessairement chez eux. Loin de leur pays d'origine, ils se sentent libres des contraintes sociales et morales qui règlent leur comportement dans la vie quotidienne. Un homme qui n'aurait jamais envisagé de se rendre dans un bordel dans sa ville de résidence peut très bien le faire dans un pays étranger où il y a peu de chances d'être reconnu. Il a un sentiment d'impunité grâce à son anonymat. Selon un proverbe japonais, le voyageur ne connaît point de honte. En outre, les prostitueurs internationaux ont souvent un sentiment de suprématie sur les populations des pays du tiers-monde ou de l'Est du fait de leur supériorité économique. Ils désirent également vivre de nouvelles expériences, de l'« aventure », de l'exotisme. L'indifférence portée à la personne prostituée, la banalisation de l'acte tarifé, l'idée que, dans les pays du tiers-monde, les enfants sont sexuellement matures très jeunes, etc., sont des facteurs qui les désinhibent et leur permettent de passer à l'acte. Certains vont même jusqu'à se convaincre qu'ils aident financièrement ces enfants et leur famille, bref, qu'ils font une bonne action.
Selon une étude de l'Unicef, 10 % des touristes qui parcourent le monde auraient le sexe pour motivation.
Les enfants prostitués pour l'industrie du tourisme sexuel sont parfois vendus par leurs parents, entre autres, pour payer les dettes familiales. D'autres sont recrutés dans les rues. Ils peuvent aussi avoir été kidnappés. Certaines mineures sont séduites par de fausses promesses de mariage ou par la perspective d'un bon emploi. D'autres sont vendues à des temples pour devenir des « prostituées sacrées », particulièrement en Inde et au Népal, mais aussi au Togo, au Nigeria, au Bénin et au Ghana.
Les jeunes et les enfants sont la cible de prédilection des proxénètes trafiquants. Les enfants ont plusieurs avantages dont, entre autres, le fait qu'ils sont moins susceptibles d'avoir une infection sexuellement transmissible, d'où leur attrait particulier en ces temps de sida. Au Sri Lanka, sur 100 enfants d'une école, 86 avaient eu une expérience sexuelle à l'âge de 12 ou de 1 ans avec un touriste étranger. L'association anglaise Save the Children précise que de nombreux prostitueurs « recherchent des filles et des garçons de plus en plus jeunes, souvent vierges, et qui ont moins de chance d'avoir contracté le virus du sida ». Certains réseaux de prostitution infantile se targuent « de disposer d'enfants testés et déclarés séronégatifs ».
FS : Pour certains pays, comme la Thaïlande, le Cambodge, etc. la prostitution des jeunes filles et des enfants représente un pourcentage important de leur PIB et sont comme tels ouvertement favorisés par leurs gouvernements, et les prostitueurs protégés par leur police. Pouvez-vous nous en parler ?
RP : La prostitution enfantine n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son internationalisation et son industrialisation. Par conséquent, la demande d'enfants pour les industries du sexe est en croissance partout dans le monde. Une véritable économie mondiale parallèle, ayant souvent pignon sur rue, s'est mise en place dans le dessein d'accroître l'offre prostitutionnelle et de stimuler la demande. Pour les États dont la monnaie ne vaut rien sur le marché mondial, il est impératif de développer des stratégies pour que des devises fortes affluent chez eux, d'où les recommandations de la Banque mondiale et du FMI, qui ont offert à ce sujet de généreux prêts : ces contrées devaient investir dans le tourisme et l'industrie du divertissement, étant entendu que ce « divertissement » ne consistait pas à ériger des parcs du style Walt Disney World Resort. Il s'agit ici de la Thaïlande, des Philippines, du Guatemala et de bien d'autres pays. Dans tous les cas, l'industrie de la prostitution a explosé et ces pays ont connu une forte croissance du tourisme, particulièrement du tourisme sexuel et pédocriminel. L'intérêt de la Banque mondiale et du FMI et, par conséquent, des pays capitalistes dominants est simple à comprendre : le remboursement de la dette ne peut être fait qu'avec des devises fortes.
Le royaume de la Thaïlande a déjà fait une promotion internationale pour attirer les touristes dans le pays en vantant ses « jeunes filles délicieuses ». Environ le tiers des personnes prostituées de Thaïlande est d'âge mineur.
En 1998 déjà, l'Organisation internationale du travail (OIT) a estimé que la prostitution représentait entre 2 et 14% de l'ensemble des activités économiques de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines. En 1998, l'OIT a évalué que de 0,25 à 1,5% de la population féminine de ces quatre pays d'Asie était livrée à la prostitution et que plusieurs millions de personnes tiraient directement ou indirectement un revenu de cette activité.
La prostitution en Thaïlande est illégale depuis 1960, mais les fonctionnaires du pays s'organisent pour qu'elle prospère. En fait, il y a une section spéciale de la police gouvernementale – la police des touristes – qui a été spécifiquement créée pour manipuler tous les « problèmes » de la mise en œuvre de la loi. Leurs devoirs sont de protéger les clients et de s'assurer que les touristes sexuels obtiennent ce pour quoi ils payent et ne payent pas pour ce qu'ils n'obtiennent pas.
FS : Pouvez-vous nous parler du phénomène des « enfants des rues » et du problème des mineur.es demandeurs d'asile dans les pays occidentaux et du lien de ces phénomènes avec la prostitution des enfants ?
RP : Les politiques néolibérales ont pour effet, entre autres, d'accroître les inégalités sociales tant sur le plan mondial qu'à l'intérieur des pays, ce qui implique un appauvrissement grandissant de certains secteurs de la population. Il y a donc eu depuis les années 1980 une multiplication des enfants des rues, estimés à plus de 100 millions par l'Unicef. C'est le vivier dans lequel les prédateurs sexuels — proxénètes et prostitueurs — plongent leurs filets. Des enfants, fillettes et garçons, qui peinent à survivre, vivotent dans les rues en mendiant, en volant, en faisant les poubelles, en s'organisant en gangs ou en étant embrigadés dans la prostitution. Ils sont des proies facilement détectables. Ceux qui forment des gangs de rue exploitent très souvent la prostitution des filles (j'y reviens plus loin).
Aux Pays-Bas, les travailleurs sociaux dans les centres de demandeurs d'asile ont remarqué que beaucoup de jeunes filles de pays d'Afrique occidentale disparaissaient peu après le dépôt de leur demande d'asile. La police a retrouvé certaines d'entre elles dans des maisons closes aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, pays où la prostitution est réglementée.
Le nombre de mineurs non accompagnés demandeurs d'asile a considérablement augmenté. Chaque année, la part des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile est toujours plus importante par rapport au nombre total de demandeurs d'asile. Plus de la moitié des enfants interpellés dans les rues des grands centres urbains de Grèce vivaient dans le pays sans leur famille et, dans leur grande majorité, avaient été amenés en Grèce par un tiers, qui les avait « achetés » à leurs parents. En Belgique, les jeunes filles et les jeunes femmes d'Europe orientale, qui sont vendues à des fins de prostitution, sont en grande partie des réfugiées.
FS : Frédéric Mitterrand, écrivain et neveu du président Mitterrand, n'a pas caché dans ses écrits (La Mauvaise Vie) avoir pratiqué le tourisme sexuel en Thaïlande, pourtant sa mort récente a été saluée par des commentaires élogieux. Vos commentaires ?
RP : Il y a quelque chose d'incompréhensible et de surréaliste dans les mœurs des élites bien-pensantes de France. Au Québec, on ne peut pas imaginer qu'un ministre de la Culture et de la Communication, poste qu'occupait Frédéric Mitterrand au moment où le scandale a éclaté, ne soit pas forcé de démissionner après avoir admis avoir été un touriste sexuel en Thaïlande. Mitterrand se défend d'avoir abusé d'un prostitué d'âge mineur en prétendant que, dans son livre, il utilisait les mots « garçon » et « gosse » dans le sens de jeune homme. Ce qui est douteux.
Son livre a été publié en 2005. Or, la loi française permet de poursuivre les ressortissants français touristes sexuels depuis 1994. Non seulement Mitterrand n'a pas été poursuivi, mais il a accumulé les honneurs. En 2016, il a été nommé président du Festival du cinéma américain de Deauville, puis il a été élu membre de l'Académie des beaux-arts en 2019.
Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le cas de Gabriel Matzneff. Dans ses livres ouvertement autobiographiques, il décrit ses rapports sexuels avec des enfants et de jeunes adolescent.es, qui sont, selon la loi au Canada, des agressions sexuelles aggravées, c'est-à-dire des viols. Il a bénéficié d'importants appuis dans la sphère littéraire et médiatique. Lui aussi a été couvert d'honneurs. Quand la Québécoise Denise Bombardier l'a dénoncé avec véhémence en 1990 à Apostrophes, l'émission littéraire animée par Bernard Pivot, elle a été violemment critiquée pour s'être opposée à l'apologue de la pédophilie. C'est elle qui a été ostracisée par l'élite bien-pensante française, pas l'agresseur pédocriminel, touriste pédosexuel qui plus est, qui a pu poursuivre sa carrière littéraire jusqu'à ce que l'une de ses victimes, Vanessa Springora, publie, en 2020, son ouvrage Le Consentement.
Heureusement, entre-temps, il y a eu la déferlante #MeToo… Et les Mitterrand et Matzneff et autres prédateurs sexuels de France n'ont plus les coudées aussi franches qu'auparavant, même si leur liberté d'action due à une justice défaillante est de loin supérieure à celle des prédateurs d'autres pays. Or, ils ont bénéficié d'une impunité totale avant le mouvement #MeToo et ont reçu l'appui indéfectible des élites médiatiques, culturelles et politiques du pays.
Le délabrement moral de cette élite donne froid dans le dos.
FS : Pouvez-vous nous parler de l'impact du développement de la prostitution dans une société, en particulier sur l'existence de réseaux mafieux ?
RP : Les industries du sexe sont largement contrôlées par le crime organisé. S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que la prostitution est illégale ou prohibée. Dans les pays où la prostitution est réglementée – Allemagne, plusieurs provinces australiennes, Autriche, Grèce, Hongrie, Nevada (États-Unis), Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suisse –, comme dans ceux où des bordels sont propriétés d'État – Indonésie, Turquie – ou dans les pays qui la reconnaissent comme une industrie vitale à l'économie nationale – Philippines, Thaïlande, etc. –, le rôle du crime organisé reste fondamental dans l'organisation des marchés. Toutefois, la réglementation de la prostitution dans plusieurs pays capitalistes dominants en Europe de l'Ouest et dans le Pacifique Sud a offert aux criminels des occasions de loin supérieures à celles qui prévalaient antérieurement pour rendre licites leurs activités. Elle a en outre permis de les légitimer comme des hommes d'affaires respectables, leur conférant ainsi une influence économique, sociale et politique inégalée ainsi qu'un pouvoir de corruption accru.
Les Pays-Bas avaient évoqué, parmi les raisons pour légaliser la prostitution en bordels et dans des zones de tolérance, la nécessité d'éradiquer le contrôle du crime organisé sur l'industrie. Toutefois, les autorités municipales d'Amsterdam, après enquête, ont conclu que la situation s'était dégradée à la suite de la légalisation du proxénétisme et de la prostitution en bordels et dans des zones de tolérance. La municipalité a adopté une série de mesures pour changer la vocation du célèbre quartier rouge de la ville. Selon les données de la municipalité, il y avait 142 bordels dans la ville, avec quelque 500 vitrines ; une bonne partie des bordels licenciés exploitant des femmes « immigrantes » illégales, c'est-à-dire des victimes de la traite criminelle à des fins de prostitution.
L'argument selon lequel la légalisation devait supprimer les éléments criminels de l'industrie du sexe par un contrôle strict s'est donc révélé faux. Le véritable développement de la prostitution en Australie, depuis l'entrée en vigueur de la légalisation, s'est produit dans le secteur illégal. Depuis le début de la légalisation, le nombre de maisons closes a triplé et leur taille a augmenté – l'immense majorité n'ayant pas d'autorisation, mais faisant sa propre publicité et opérant en toute impunité.
Le crime organisé est un monde de gars particulièrement machiste. Dans le milieu criminel, les femmes sont essentiellement des marchandises, des femmes-objets qui peuvent être offertes en cadeaux lors de « réunions d'affaires ». Le mépris à leur endroit est une règle universelle. En effet, les milieux criminels ont une piètre estime des femmes qui sont à la fois des trophées, prouvant leur virilité ultra-machiste, et des corps à utiliser et à exploiter, sauf bien évidemment dans le cas des femmes qui leur sont apparentées — mère, sœur, fiancée et épouse —, où la relation est privatisée et n'est pas l'objet d'une socialisation masculine, contrairement aux autres femmes.
Dans les gangs de jeunes criminels, comme chez les motards où d'autres groupes du même acabit, le partage des filles est la norme. Le gang bang ou viol collectif scelle la complicité masculine des membres du groupe. Cela a pour effet, notamment, comme dans tout viol opéré par les proxénètes, de conditionner les jeunes filles à leur prostitution future. Il est, entre autres, destiné à « initier » les jeunes filles à une sexualité non désirée, sans relation affective, et à leur enseigner la soumission au désir de tous les hommes.
Le viol collectif a également pour fonction de marquer l'appropriation du corps et du sexe des jeunes filles par le groupe tout en révélant la hiérarchie sociale des sexes au sein du groupe et en renforçant les connivences masculines. La participation des jeunes hommes de la bande au gang bang fait partie de la désensibilisation affective qui rendra possible l'apprentissage du métier de proxénète.
L'implication des gangs de rue dans la prostitution, qui est par essence une prostitution juvénile, c'est-à-dire des filles recrutées à l'adolescence, est le changement le plus marquant des dernières décennies. L'appartenance à un gang de jeunes criminels, qui est valorisée dans plusieurs milieux, joue un rôle d'attraction majeur pour nombre de jeunes filles qui risquent de plonger rapidement dans la prostitution et d'être victimes d'une vente et d'une revente à différents réseaux de proxénètes. Cette prostitution est le socle sur lequel se développe la traite des êtres humains à laquelle participent de plus en plus les gangs de rue criminels.
FS : Vous parlez au sujet de la prostitution des enfants et des jeunes filles dans le cadre du tourisme sexuel dans certains pays, d'une « recolonisation » de ces pays, d'un « impérialisme sexuel » des pays occidentaux. Pouvez-vous commenter ?
RP : Avec le tourisme sexuel, on assiste plus à une sorte de « recolonisation » des pays du tiers-monde par la prostitution des corps et des sexes des femmes et des enfants au profit du plaisir des prostitueurs, notamment des prostitueurs internationaux en provenance des pays impérialistes. C'est une exploitation de la misère des femmes et des enfants pauvres du monde entier.
L'intensification du sexe vénal en Thaïlande, qui a débuté en tant que lieu de repos et de récréation pour les soldats étatsuniens engagés dans la guerre au Vietnam, a entraîné des changements dans l'organisation de sa production. Son association avec le développement du tourisme international ainsi que son industrialisation grandissante ont engendré un accroissement général du contrôle des personnes prostituées. L'organisation du tourisme dans le Sud-Est asiatique au profit des pays industrialisés relève d'un « impérialisme sexuel » dont bénéficient les prostitueurs desdits pays industrialisés, ce qui entraîne des changements dans les structures sociales et mentales de la société, dont une prostitutionnalisation du tissu social. Cette prostitutionnalisation se traduit par une croissance importante du nombre de prostitueurs locaux. Désormais, 75 % des Thaïlandais sont des prostitueurs occasionnels ou réguliers. Dans le nord du pays, où les femmes et les fillettes des minorités ethniques sont victimes de la traite interne à des fins de prostitution vers le Sud, la prostitutionnalisation entraîne une valorisation des naissances féminines, car la naissance d'une fille est promesse, pour la famille, de revenus supplémentaires !
Le concept de recolonisation fait également référence aux faits que les femmes et enfants des minorités ethniques ou nationales sont surexploité.es par les industries du sexe. C'est notamment le cas des minorités ethniques du nord de la Thaïlande et au Myanmar. Les personnes originaires de la minorité hongroise en Roumanie, de la minorité russe dans les pays baltes et des minorités tsiganes un peu partout en Europe de l'Est sont surreprésentées parmi les personnes prostituées dans leur propre pays ainsi qu'en Europe de l'Ouest. Les Autochtones du Canada et ceux de nombreux pays latino-américains sont également « surreprésentées » parmi les personnes prostituées de leurs pays respectifs. C'est également le cas des Afro-Américaines aux États-Unis.
À l'échelle mondiale, les prostitueurs du Nord profitent de femmes et d'enfants du Sud et de l'Est, ainsi que des femmes et des enfants des minorités ethniques ou nationales. Au Sud, les prostitueurs nationaux exploitent sexuellement des femmes et des enfants de minorités nationales.
27 avril 2024
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2024/04/27/la-prostitution-des-mineur-es-partie-integrante-de-lindustrie-du-sexe/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
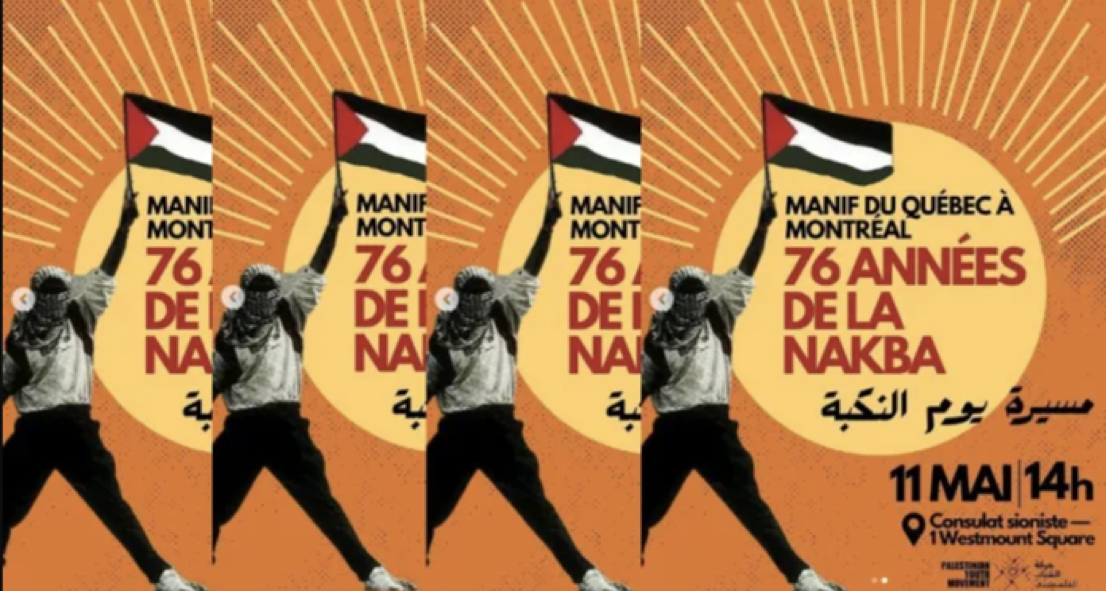
76 ans de la Nakba : manifestation du Québec à Montréal
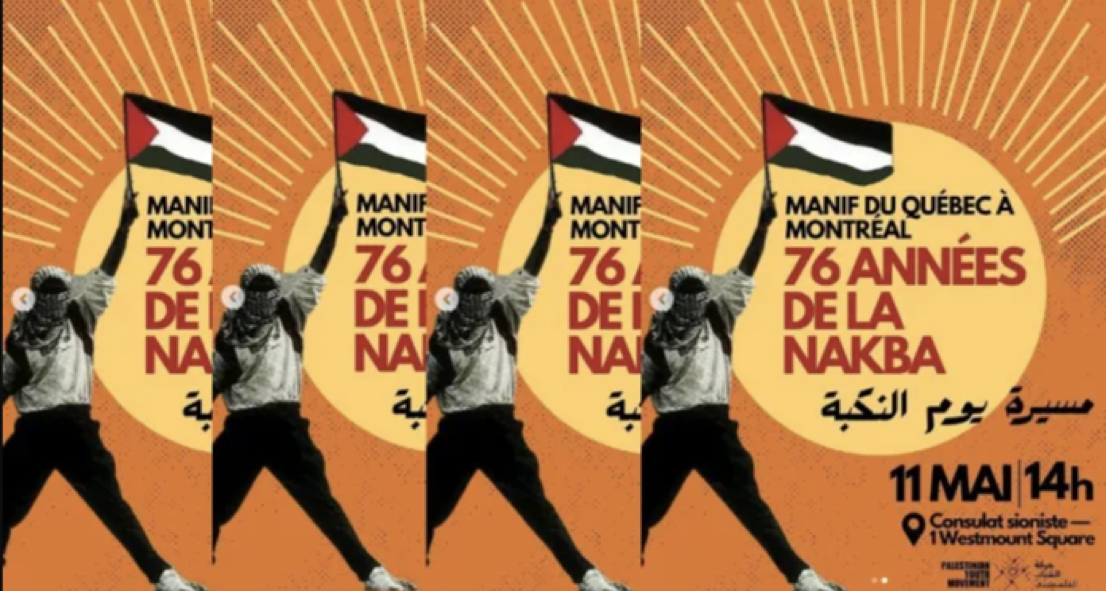
Quoi : 76 ans de la Nakba : manifestation du Québec à Montréal
Quand : 11 mai, 14 hres
Où : Consulat sioniste, 1 Westmount Square, Montréal
Cette année, le 76e anniversaire de la Nakba est marqué par un assaut violent contre notre peuple à Gaza, qui fait face à un génocide israélien soutenu par les États-Unis depuis plus de six mois. Ce dont nous avons été témoins ces derniers mois à Gaza se trouve dans le cadre d'un projet colonial permanent visant à nettoyer ethniquement les Palestiniens de leur terre depuis la Nakba, qui a débuté en 1947-1948. La Nakba a entraîné le déplacement de plus de 700 000 Palestiniens, le massacre de milliers d'entre eux et l'élimination de centaines de villages palestiniens.
Les Palestiniens du monde entier vont prendre les rue pour commémorer le 76e anniversaire de la Nakba, mais aussi pour commémorer la fermeté du peuple palestinien et sa résistance. Depuis plus de 76 ans, Israël et ses alliés impérialistes conspirent pour détruire la volonté de libération palestinienne et depuis plus de 76 ans, les Palestiniens résistent à leurs oppresseurs.
Cette Marche de libération pour la Nakba 76 rassemblera des personnes venant de toute la région du Québec et convergera vers Montréal pour exiger la justice. Ce sera le moment de renverser la vapeur et de mettre fin à la complicité du Québec dans le génocide et l'occupation sioniste. Ensemble, nous exigerons :
1- La fin du génocide à Gaza ;
2- La fin de tout soutien du Québec à l'occupation sioniste - de la livraison d'armes à l'érection du bureau du Québec à Tel Aviv ;
3- La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens ;
4- Une aide humanitaire immédiate et un investissement dans les efforts de secours pour aider à reconstruire Gaza ; et
5- La fin de l'occupation sioniste de la Palestine.
Nous invitons toutes les organisations palestiniennes, arabes et progressistes ainsi que les personnes de conscience de la région du Québec à marcher avec nous pour la libération à Montréal ce 11 mai ! Nous invitons toutes les organisations à appuyer cette manifestation de masse en soutien à notre peuple en Palestine.
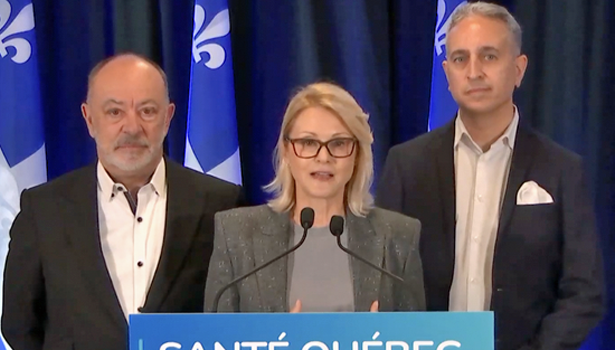
Une boss au secours du réseau de la santé ?
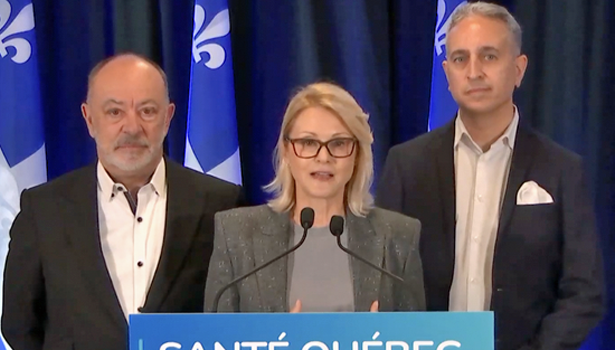
D'une réforme à l'autre, d'une mesure à l'autre, le projet politique de la CAQ se précise.
La nomination cette semaine à la tête de l'agence Santé Québec de Geneviève Biron, qui était avant présidente de Biron Groupe Santé, nous a rappelé combien la foi de ce gouvernement dans le secteur privé était grande. Après tout, c'est de là que viennent bien des membres de la députation caquiste, dont le ministre de la Santé Christian Dubé.
Certes, le réseau de la santé et des services sociaux est traversé par d'importants problèmes qui minent l'accès aux soins. C'est ce qui explique en partie que la population exprime des réserves quant à la manière dont sont gérés les deniers publics. Pour remédier à la situation, le gouvernement a imposé de manière autoritaire une réforme qui risque fort, cela dit, de rater sa cible. Adopté à la fin de 2023, le projet de loi 15 modifiera pour une énième fois la structure administrative du réseau, concentrera davantage le pouvoir dans les mains de ses gestionnaires (surtout les plus haut placés) et facilitera le recours aux entreprises privées pour la prestation de services.
Cette pénétration grandissante des méthodes et des acteurs du privé est inquiétante puisqu'il est bien connu que l'approche du secteur à but lucratif n'est pas adaptée au secteur public – et encore moins aux services qui reposent sur des relations humaines tels que les soins de santé ou les interventions psychosociales. Mais c'est aussi le fonctionnement extrêmement hiérarchique de l'agence Santé Québec qui est préoccupant. Croire qu'une personne pourra résoudre les problèmes d'un réseau de plus de 325 000 employé·e·s et 1500 installations est au mieux naïf, au pire dangereux. Dans une étude parue l'an dernier, nous avons au contraire montré que la gestion décentralisée (à l'échelle locale) et démocratique (impliquant le personnel et les usagers, les usagères) est plus efficace pour répondre aux besoins de la population, en plus de s'avérer moins coûteuse. En clair, les solutions existent, mais tout indique qu'elles ne sont pas compatibles avec les intérêts que défend la CAQ.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bonification annoncée d’Équimobilité

Québec, le 2 mai 2024 – Des organismes et regroupements communautaires applaudissent la bonification annoncée d'Équimobilité au 1er juillet 2024, qui marque une étape importante en termes d'amélioration de l'accessibilité et de l'abordabilité du transport collectif pour les personnes à faible revenu. Ayant collaboré sur le comité conseil sur la tarification sociale avec la Ville de Québec, nos organismes considèrent que la Ville s'est montrée à l'écoute de leurs demandes et des besoins du milieu.
À l'issue des rencontres du comité conseil, et ce dans un esprit de transparence et de collaboration, la Ville s'est engagée à réduire de près de 50% les tarifs pour les personnes admissibles à la mesure et à ce que le tarif demeure le même pour une période de 2 ans. « C'est une bonne nouvelle pour les personnes en situation de pauvreté, car cette réduction supplémentaire fera une bonne différence dans notre budget et permettra de se procurer la passe. Le fait d'avoir un chiffre rond et non un pourcentage de rabais, ça aidera la compréhension de beaucoup de monde ! » dit Monique Toutant, citoyenne utilisatrice du Réseau de transport de la Capitale (RTC), adhérente à ÉquiMobilité et membre du Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ).
Un comité conseil qui poursuit sa collaboration avec la Ville
Les groupes membres du comité conseil soulignent aussi que « cette bonification additionnelle d'ÉquiMobilité est une étape significative et qu'ils souhaitent poursuivre la collaboration avec la Ville afin de multiplier les efforts en termes de diffusion et de promotion de la mesure, mais aussi dans une perspective d'élargir le principe de tarification sociale à d'autres types de mobilité ».
« En comparant à d'autres municipalités québécoises, nous pouvons affirmer que la Ville de Québec a bien fait en termes de nombres d'inscriptions pour une première année d'implantation. En plus des moyens déjà déployés, tels que des représentations dans des événements communautaires, l'affichage dans les autobus, les capsules vidéo, plus d'actions doivent être entreprises afin que le programme se fasse connaître par un plus grand nombre de personnes admissibles. Cette bonification y contribuera certainement, » déclare Emilie Frémont-Cloutier, animatrice sociale pour le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ).
« La clientèle « aînée » et admissible à ÉquiMobilité sera avantagée par cette phase 2 du programme, alors que les personnes à faible revenu de tout âge auront droit à un rabais augmenté » ajoute Nicole Laveau, représentante de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-nationale.
« Partout, tous et toutes ne sont pas égaux en matière de mobilité. L'accessibilité financière des transports étant un frein à l'adoption de certains modes, nous considérons que cette bonification s'inscrit en toute cohérence avec le caractère essentiel du transport en commun. » dit Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès transports viables.
« Dans une ville où se déplacer à pied reste difficile pour de nombreuses personnes handicapées, l'accès à diverses mobilités à coût abordable est une nécessité. Équimobilité est un choix politique majeur dans la bonne direction. Travaillons désormais à l'étendre aux autres modes comme l'autopartage, àVélo et le taxi tout comme à rendre ces modes plus accessibles aux personnes handicapées ! » ajoute Véronique Vézina du Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP03)
« Nous tenons à souligner que la mise en place de parcours facilitateurs est un geste de reconnaissance et de soutien envers les personnes ayant des besoins particuliers, notamment pour une meilleure intégration des personnes nouvellement arrivées. » ajoute Aïcha Mansoor, Directrice générale du Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI).
Groupes signataires :
Accès transports viables
AGIR en santé mentale
Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ)
Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches (RÉPAC 03-12)
Regroupement pour l'Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ)
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC-03)
Regroupement des personnes handicapées de la région 03 (ROP03)
Service d'aide à l'adaptation des immigrantes et immigrants (SAAI)
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale
Sources :
Marie Soleil Gagné
Directrice générale
Accès transports viables
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
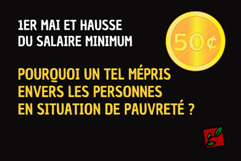
Pourquoi un tel mépris envers les personnes en situation de pauvreté ?
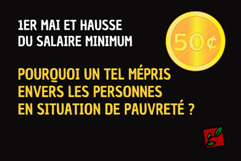
Québec, le 1er mai 2024. – Le salaire minimum augmente aujourd'hui de 0,50 $, pour passer à 15,75 $ l'heure. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté s'explique mal le mépris qu'affiche le gouvernement du Québec à l'égard de tous les travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle qui, même en travaillant à temps plein, demeureront dans la pauvreté et, pour plusieurs, devront continuer de visiter les banques alimentaires.
Une invitation à fréquenter les banques alimentaires
Faut-il le rappeler, les travailleurs et travailleuses au salaire minimum arrivent tout juste à couvrir leurs besoins de base. En travaillant 35 heures par semaine à 15,75 $ l'heure, ces personnes compteront sur un revenu disponible d'environ 26 300 $. C'est à peine plus que le seuil de la Mesure du panier de consommation, qui est évalué à 24 200 $ pour une personne seule. Ce montant, c'est le strict minimum, le montant nécessaire pour arriver à couvrir ses besoins essentiels (logement, alimentation, transport, habillement et autres nécessités), ce qu'il faut pour atteindre « un niveau de vie modeste » selon Statistique Canada.
« En pleine crise du logement et avec une augmentation annuelle de près de 10 % du prix des aliments, cette hausse du salaire minimum est nettement insuffisante pour seulement faire face à la hausse du coût de la vie, rappelle le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Souvenons-nous que 10 % de la population québécoise a dû recourir aux banques alimentaires l'an dernier et que 18,5 % de toutes ces personnes avaient un emploi comme principale source de revenus. Aujourd'hui, avec sa hausse ridicule du salaire minimum, le gouvernement met la table pour une nouvelle augmentation du recours aux banques alimentaires. »
Ce qu'il faudrait pour sortir de la pauvreté
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté soutient que le travail à temps plein devrait minimalement permettre aux travailleuses et aux travailleurs de sortir de la pauvreté. Il est difficile d'établir un seuil à partir duquel on sort de la pauvreté, mais le Revenu viable de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) nous donne une bonne idée du revenu dont devrait disposer une personne pour être considérée hors de la pauvreté. Il indique ce qu'il faut pour atteindre « un niveau de vie digne, au-delà de la seule couverture des besoins de base. Cela signifie notamment de pouvoir faire des choix et d'être en mesure de faire face aux imprévus. »
Le 29 avril, l'IRIS dévoilait que, pour disposer d'un revenu viable en 2024, « une personne seule qui travaille à temps plein [35 heures] doit avoir un salaire horaire entre 20 $ (Trois-Rivières) et 30 $ (Sept-Îles). » À Montréal, par exemple, il faudrait un salaire de 27 $ à une personne travaillant à temps plein par semaine pour atteindre le revenu viable.
Pour qui travaille ce gouvernement ?
« Devant de tels chiffres, le gouvernement devrait avoir honte de ne rien proposer de mieux qu'un salaire minimum à 15,75 $ l'heure, soutient Serge Petitclerc. En refusant de l'augmenter pour la peine, il encourage un système qui est brisé, où des travailleuses et des travailleurs peinent à couvrir leurs besoins essentiels et doivent fréquenter les banques alimentaires, même en travaillant à temps plein. Tout cela après que le premier ministre soit monté aux barricades pour défendre l'idée que les député.es, pour leur part, méritaient une hausse instantanée de 30 000 $ de leur salaire. Il est permis de se demander pour qui travaille ce gouvernement… »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Communautaire : ÉcoeuréEs d’être mépriséEs

ÉcoeuréEs d'être mépriséEs, les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux s'affirment pour que cesse le saccage du filet social.
Montréal, le 1er mai 2024. La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (Table) [1] invite les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) à participer aux actions de grève sociale se déroulant cette semaine. La pertinence de cette action était déjà grande en raison de l'insuffisance de l'indexation et du rehaussement accordé par le Budget, mais les propos entendus lors de l'Étude des crédits ont ravivé la motivation des OCASSS.
Par la campagne_ CA$$$H _(_Communautaire autonome en santé et services sociaux - Haussez le financement_), [2] la Table invite les OCASSS à participer aux actions prévues tout au long de la semaine en solidarité de tous les groupes participant au mouvement Ensemble pour la grève sociale [3]. Cette semaine d'actions se terminera par une journée de grève sous la thématique « Le renforcement du filet social et des
services publics bien financés, accessibles et gratuits pour toutes et tous », le vendredi 3 mai. Dans le cadre de cette journée bien spéciale, les OCASSS sont conviés au rassemblement national qui se tiendra devant les bureaux montréalais du Premier ministre François Legault, dès 11h30 [4].
Pour revendiquer la fin du saccage du filet social, la Table se joint au mouvement et prévoit réduire ses activités au minimum ce vendredi. Elle sera au rassemblement national vendredi et invite les OCASSS à la rejoindre pour créer une œuvre collective qui servira à imager l'écœurement ressenti au sein du mouvement communautaire. En vue de ce rassemblement, la Table invite les OCASSS à afficher l'illustration de
leurs besoins, telle qu'ils l'ont créée avec l'action On s'affirme [5] ! et à l'accompagner d'une affiche au slogan évocateur : [6] « Les OCASSS tissent le filet social. Bien les financer est une nécessité. ÉcoeuréEs du saccage…On s'affirme ! Ensemble ! » Cette affiche est aussi disponible pour la diffusion sur les réseaux sociaux, sous forme de vignette [7].
Les OCASSS sont écœurés pour plusieurs raisons.
Les OCASSS sont écœurés parce que le Budget de 2024 n'a ajouté que 10M$ aux subventions pour la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) administré par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). « Tant qu'un rehaussement substantiel ne sera pas injecté, les montants accordés ne pourront rejaillir sur les 3000 OCASSS, puisqu'ils ne permettent que de donner un peu d'air aux plus pauvres parmi les plus pauvres. Dans le contexte où la campagne _CA$$$H_ a estimé les besoins non comblés à 1,7G$, [8] les 10M$ annoncés sont vraiment insignifiants. N'ajouter que 1,27% à l'enveloppe actuelle montre clairement que le gouvernement ne comprend pas les réalités des OCASSS » s'insurge Stéphanie Vallée, présidente de la Table.
Les OCASSS sont écœurés parce que le gouvernement n'a indexé que de 2,7%, les subventions du PSOC pour la mission globale pour 2024. « L'Indexation accordée est famélique et ne permettra pas aux OCASSS d'assumer la hausse de leurs coûts de fonctionnement. La Table a pourtant développé une méthode d'indexation adaptée, l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC) [9], qui aurait résulté
en une indexation de 3,6%. Il est temps que le gouvernement démarre des travaux pour discuter d'une indexation en phase avec les réalités des OCASSS » souligne Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table.
C'est justement pour concrétiser les réalités des OCASSS qu'un recueil contenant les illustrations produites dans le cadre de l'action _On s'affirme_ de la campagne _CA$$$H_ [10] a été remis, le 25 avril dernier, à Monsieur Lionel Carmant, Ministre Responsable des Services sociaux, « Les OCASSS n'en peuvent plus d'attendre. Chaque image de ce recueil rappelle leur sous-financement, auquel le budget de 2024 ne répond pas. Nous invitons le Ministre Carmant à le feuilleter pour constater l'ampleur de l'effort budgétaire nécessaire pour faire le « rattrapage », qu'il nous a indiqué vouloir accomplir durant l'année » rappelle Loc Cory, du comité de coordination de la campagne _CA$$$H._ La Table espère que le souhait du ministre se concrétisera, puisque des paroles semblables ont été prononcées à la même époque l'an dernier, sans résultat.
Ayant suivi les sessions d'Étude des crédits du Budget 2024, la Table a entendu des propos illustrant encore davantage l'ampleur de l'incompréhension du gouvernement face aux réalités des OCASSS. « Il était frappant d'entendre le ministre responsable des Services sociaux, la ministre Responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, ainsi que par la Présidente du Conseil du Trésor amalgamer
systématiquement les montants budgétés pour rehausser les subventions avec ceux dédiés au versement de l'indexation annuelle. Or, il s'agit de deux choses bien différentes, dans leurs natures comme dans leurs retombées » de dire Madame Roberge. « Le rehaussement du PSOC découlant des choix budgétaires du gouvernement, il est variable selon les années et les conjonctures. Mais l'indexation annuelle des subventions doit être un mécanisme automatique qui ne dépend pas des choix budgétaires du gouvernement. L'indexation vise à assurer la continuité face à l'année précédente, afin que la hausse des coûts n'empêche pas la réalisation des actions et des activités d'un groupe. Il est très inquiétant de constater que des ministres propagent cette confusion pour gonfler les sommes, plutôt que de viser des solutions pérennes pour traiter les OCASSS et les membres de leurs communautés avec le respect qu'ils méritent » complète Madame Vallée.
Alors que le gouvernement démontre qu'il ne comprend pas les réalités des OCASSS, d'offrir la direction de l'agence Santé Québec à une entrepreneure ayant contribué à la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux ne va pas dans la bonne direction.
Les OCASSS se reconnaissent pour diverses raisons dans le slogan de la semaine d'actions, « ÉcoeuréEs d'être mépriséEs ». La Table encourage chaleureusement les OCASSS à participer aux activités de la semaine et à faire connaître leur ressentiment face aux politiques et à la vision du gouvernement. Le saccage du filet social a assez duré. _On s'affirme !_ Ensemble !
Liens et notes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les 3 grands défis de la gauche de QS

Je pense à ceux et celles qui ont fondé Québec solidaire : à Amir Khadir et Françoise David bien sûr, mais pas seulement, à tous ces militants et militantes qui ont mis sur pied l'Union des Forces Progressistes et Option citoyenne et ont préparé la naissance de QS en 2006. Quelques soient leurs divergences et leurs sensibilités propres, ils avaient au delà de toutes les ambiguïtés du moment, un objectif très simple. Ils voulaient réunir la gauche sociale et politique du Québec et créer une formation politique qui puisse se faire entendre de manière professionnelle sur la scène électorale, mais sans rien oublier pour autant des aspirations à des changements structurels pensés par les différents mouvements sociaux : altermondialiste, autochtone, écologiste, féministe, indépendantiste, étudiant, syndicaliste, etc.
Il s'agissait, comme une évidence, de mener les deux tâches en même temps, de tenir les 2 bouts de la chaîne bien fermement, comme une impérative condition pour que les changements structurels envisagés puissent devenir effectifs et que le parti ne se transforme pas en un Parti québécois bis, social-libéralisé, ayant repoussé aux calendes grecques l'exigence de l'indépendance. Et il y avait pour cela une formule à QS qui en résumait la nécessité : « être un parti des urnes autant que de la rue ».
Un premier défi : être des urnes autant que de la rue
Voilà un premier acquis qu'il serait nécessaire de bien garder en tête dans le débat qui va se donner à QS dans le sillage des volontés déclarées de Gabriel Nadeau Dubois de faire de QS d'abord « un parti de gouvernement ».
Car ce qui fait partie de l'ADN historique de QS, ce n'est pas que QS se refuse d'aller au gouvernement —bien au contraire—, mais qu'il se donne les moyens d'y aller, en ayant en même temps stimuler et accumuler les forces sociales nécessaires pour disposer du rapport de force politique lui permettant de mettre en branle les changements structurels que son programme appelle.
La question aujourd'hui est donc tout autant celle d'améliorer notre présence dans les urnes, en ayant plus de députés, que de participer à une réactivation du mouvement social, à une relance des différents mouvements sociaux, à une résurgence joyeuse de la rue, condition de possibilité de tout changement sociétal de fond.
Ainsi, plutôt que de rêver de recentrage de QS ou de pragmatisme nécessaire, comme semble l'évoquer Gabriel Nadeau Dubois, cela devrait être la priorité numéro 1 de QS : renforcer la dimension parti de la rue de QS, la dimension mobilisation sociale de son intervention, comme d'ailleurs cherchait à sa manière à le faire Émilise Lessard-Therrien en se proposant d'être —ainsi qu'elle l'a fait contre les diktats de la fonderie Horne— la voix des régions oubliées, sanitairement, écologiquement, socialement, économiquement, etc.
Car à l'heure actuelle, la mobilisation sociale orientée autour d'objectifs communs, c'est ce qui nous manque le plus, c'est le domaine dans lequel s'est accumulé le plus de retard.
Et si bien sûr, comme beaucoup de femmes militantes l'ont fait remarquer, on est encore loin du compte en termes d'égalité effective hommes/femmes dans QS (tout comme d'ailleurs dans la société entière), il reste qu'un avancement réel à ce propos, passe nécessairement –y compris au sein de QS— par la convergence des luttes et la relance de la mobilisation sociale conduisant à des victoires en termes de justice sociale collective. D'où la nécessité d'avoir à QS une vision stratégique d'intervention politique pensée sur le long terme, pas simplement pour la prochaine élection, pas seulement sur le mode électoral, mais aussi sur le mode social, au sein même du tissus social de société québécoise.
Le second et difficile défi de l'indépendance
Les fondateurs et fondatrices de QS avaient cependant rencontré à propos de la question nationale une difficulté de taille. S'il était relativement facile de mettre de l'avant la question sociale face à la gestion économique sociale-libérale voire néolibérale du PQ, il était beaucoup plus difficile de parler d'indépendance, en se différenciant vraiment du PQ. Il avait d'ailleurs été difficile de convaincre Option citoyenne —une des organisations, avec l'UFP, fondatrice de QS— de prendre à bras le corps cette question.
QS y était cependant finalement arrivé en mettant de l'avant —dans le processus d'accès à l'indépendance— la nécessité d'une assemblée constituante ainsi qu'en imaginant cette assemblée comme un lieu d'expression démocratique privilégié de la volonté populaire, comme le moyen par excellence pour stimuler la mobilisation citoyenne, faire de la question de l'indépendance la question de tous et toutes, en faire un processus démocratique d'indépendance en acte à travers lequel toutes les questions sociales trouveraient en même temps leur place.
C'est là le second défi — très lié cependant au premier —qui se dresse devant celles et ceux qui souhaiteraient que QS garde son élan transformateur des origines et ne se transmue pas en une sorte de NPD progressiste et « provincialisé » (et dont d'ailleurs tant d'observateurs et médias institutionnels semblent souhaiter la venue !).
Avec la remontée du PQ dans les sondages, avec la probabilité non négligeable qu'il puisse arriver au gouvernement en étant minoritaire, le contexte politique qui s'offre à QS risquerait de devenir tout autre, tout comme la nécessité de se doter d'une orientation politique stratégique claire à ce propos. Dès lors, comment faire pour que l'indépendantisme de QS ne se transforme pas en un nationalisme de façade, et ne fasse que s'adapter mollement aux inéluctables compromissions dans lesquelles le projet péquiste -en l'état actuel des choses— à toutes les chances de s'engluer ?
On le voit, ce second défi apparait encore plus délicat que le premier. D'autant plus que depuis la fusion avec Option nationale, cette question de l'indépendance —aussi étrange que cela puisse paraître— a plutôt été mise de côté et n'a pas été collectivement approfondie au sein de QS, comme elle aurait dû l'être pour nous permettre de faire face à des situations devenues soudainement difficiles ainsi que nous les connaissons aujourd'hui.
Le 3ième défi : faire naître une alternative crédible
On comprendra dans ce contexte, qu'il ne s'agit pas de pointer seulement du doigt les abandons que sous l'égide de Gabriel Nadeau-Dubois, QS risquerait d'entériner à l'avenir, mais aussi d'être capable de travailler collectivement à dessiner au sein de QS des alternatives viables à un tel recentrage annoncé. Des alternatives politiques qui puissent convaincre, et être reprises par une majorité de militantes et militants de QS au congrès de l'automne 2024. Et qui puissent être susceptibles de l'emporter politiquement sur la vision pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois et de ceux et celles qui l'entourent ; eux qui sont déjà bien installés au commande du parti, prêts à toute éventualité pour avoir gain de cause.
À n'en pas douter, c'est là —pour ceux et celles qui se retrouvent dans le projet initial de QS – une bataille qui n'est pas gagné d'avance et qui sera loin d'être simple.
Le jeu n'en vaut-il pas cependant la chandelle, et ne faut-il pas oser parier sur ces volontés de changement structurel si nécessaires aujourd'hui ; celles-là même qui ont donné ses lettres de noblesse à QS et sont à l'origine de ce qu'il est devenu aujourd'hui ?
Pierre Mouterde
Sociologue, essayiste
Le 5 mai 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le ménage du printemps

Québec solidaire vit un moment de crise après plus de dix ans de domination des spécialistes de la comm sur le parti et l'échec consommé de leur stratégie.
Tiré de Pivot
PAR JUDITH LEFEBVRE ● CHRONIQUES ● 2 MAI 2024
Je n'ai jamais été fan de Québec solidaire, un parti sans grande substance et trop de compromis, jusqu'à l'impertinence consommée.
L'exemple le plus flagrant et certainement le coup de grâce pour les électeur·trices de gauche aura été cet appui grotesque au projet de loi 96 sur la langue française de la CAQ. Après avoir utilisé les nations autochtones pour le dénoncer, QS a finalement voté en faveur. Le message était clair : QS est un parti colonial.
Récemment, devant la montée de la droite, le parti se lançait d'ailleurs dans la promotion du nationalisme.
Pris collectivement dans un jour de la marmotte quelque part en 1995, les Canadien·nes français·es hors de l'île ne se suffisent plus du retour de La Petite Vie, illes veulent un nouveau référendum perdant, si on en croit QS. Question de redonner un peu de vigueur à notre religion du ressentiment qui a remplacé les soutanes il y a quelques décennies, et qui commence à perdre des ouailles après 30 ans.
L'art de la défaite
Pour les personnes un peu familières avec la politique interne de QS, il n'y a pas grande surprise aux déclarations successives de Catherine Dorion et Émilise Lessard-Therrien.
En 2012, devant la débandade du plus grand mouvement social de l'histoire du Québec (rappelons qu'une grève étudiante historique a débouché sur une hausse des frais de scolarité), un petit groupuscule de personnes beaucoup plus investies de la comm que de la lutte a réussi deux coups impressionnants : 1) faire passer le plus grand échec politique d'une génération comme une victoire ; et 2) se garantir un emploi à Québec solidaire par la même occasion.
Je comprends QS de s'être amouraché de cette clique, enfin mise en lumière par la co-porte-parole démissionnaire, puisqu'à l'époque, faire passer une hausse des frais de scolarité qui n'a jamais été acceptée par les assemblées générales pour une victoire politique après six mois de brutalité quotidienne, c'est du gaslighting digne d'un futur premier ministre.
Convaincre les gens
Gabriel Nadeau-Dubois doit quitter, mais pas seulement lui. Il y a trop de personnel de communication à Québec solidaire qui refuse de faire son travail et essaie de vendre GND comme on vend du Pepsi.
Si le parti veut éventuellement arrêter de plafonner dans les sondages, peut-être devrait-il se remettre au travail après cette longue pause. Plutôt que de convaincre les électeur·trices que son porte-parole est un bon père de famille comme tout le monde, que ce n'est pas tellement différent que de voter pour le PQ et qu'il va faire la guerre aux Montréalais·es au moins autant que les autres partis, peut-être devrait-il essayer de nous convaincre d'un projet politique ?
Parce qu'à ce jour, j'ai peine à comprendre à quoi ressemblerait un gouvernement solidaire.
Un parti de gauche sans la gauche
Et pour être honnête, le conservatisme apparent du parti m'inquiète. Toujours à parler des petites familles, de la classe moyenne, de la majorité francophone et du « vrai monde ». J'ai peine à croire que cette rengaine ait quelque intérêt pour la coalition de gauche qui s'est formée dans la société civile pendant que le parti dormait au gaz.
L'antiracisme, la décolonisation, les droits des personnes migrantes, les luttes trans, la décriminalisation du travail du sexe, le définancement de la police, le droit au logement, la justice écologique et les luttes anti-capacitistes sont les thèmes centraux de la gauche en ce moment. Ça et le génocide à Gaza.
QS ne représente, même vaguement, aucun mouvement social réellement actif. C'est une coquille vide, une machine à faire de communiqués, des mèmes et des vidéos TikTok du chef qui promène sa poussette avec un chandail des Canadiens. C'est probablement comique d'impertinence pour la génération Z, mais pour les vieilles comme moi, qui ont connu le parti de Françoise David et Amir Khadir, c'est une tragédie.
Je ne suis pas une grande porteuse de la stratégie électorale, mais je ne crois pas que nous ayons le luxe de choisir nos fronts de lutte en ce moment. Et avoir perdu toute forme d'appui sur le plan parlementaire est une situation périlleuse pour la gauche.
Émilise Lessard-Therrien devrait être célébrée par son parti pour avoir nommé l'innommable. GND et sa clique ont aliéné les mouvements sociaux, les jeunes et la gauche. En sacrifiant sa place comme co-porte-parole, la politicienne a mordu le fruit de la connaissance et a offert un immense cadeau aux militant·es du parti : celui du choix.
Choisir entre une stratégie de communication ruineuse dont les résultats sont décevants et tirent le parti vers la droite, ou alors revenir à une stratégie qui vise à convaincre le public des positions adoptées par les membres.
Auteur·e
JUDITH LEFEBVRE
Judith Lefebvre est une militante transféministe et queer. Elle fait des zines sur papier et des infographies sur Canva. Inspirée par celles qui l'ont précédée, elle se nourrit à la pensée de Sandy Stone, Emi Koyama et Viviane Namaste pour faire vivre une parole transféminine libérée du regard cishétéropatriarcal. À travers sa chronique, elle veut faire voir les pratiques, les ambitions et les contradictions de la communauté queer montréalaise.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
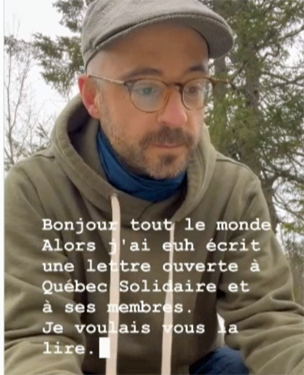
Lettre ouverte à Québec solidaire et à ses membres
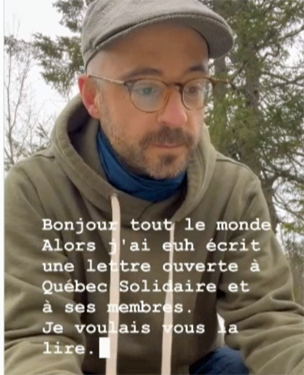
Québec solidaire, précieux parti indépendantiste de gauche de mon cœur, Courageux parti-mouvement tissé d'espoir et de rêves porteurs, Parti d'humains à l'écoute des solutions terrain, faites maison et locales, pleines de bon sens et d'audace, Parti de révolution tranquille ou pas, mais pleine d'amour vrai, parti rempart contre la honte d'être qui nous sommes, Parti de la beauté qui sauvera le monde, Parti de la liberté contagieuse, Je t'aime.
Sol Zanetti, 4 mai 2014
C'est la crise. Ben oui. C'est douloureux, mais ce n'est pas désespérant : c'est l'occasion de faire des choix.
Le départ d'Émilise est une immense perte pour notre organisation et le minimum que nous puissions faire pour honorer son engagement lumineux et inspirant des six dernières années à nos côtés, c'est de faire les bilans politiques qui s'imposent afin d'émerger de cette crise collectivement plus sages.
Depuis le jour 1, je veux qu'on soit un parti de gouvernement, mais pas un parti ni un gouvernement comme les autres. Tout le monde que je connais à QS veut qu'on forme le gouvernement. Pour moi, il faut surtout discuter en profondeur de la manière d'y arriver.
La crise qui suit le départ d'Émilise nous force à trouver des solutions pour assurer l'égalité entre nos porte-parole féminin et masculin. Le problème que nous avons vécu dans les derniers mois, c'est qu'il y avait une grande inégalité de moyens et d'influence entre nos deux porte-parole. Ce n'est pas un problème insoluble. Notre présidente et notre directrice générale s'occupent de ce chantier et j'ai pleinement confiance en elles pour consulter la base militante et proposer les changements requis.
Lorsque notre parti-mouvement est entré au Parlement, il est entré dans le cadre de la monarchie parlementaire canadienne. Ce système est patriarcal et colonial, centralisateur et peu démocratique. Qu'avons-nous mis en place pour protéger nos valeurs féministes et démocratiques, et éviter de nous faire avaler par ce système ? Quelques coutumes démocratiques informelles de bonne foi, mais ce n'est pas suffisant, les événements des dernières semaines en témoignent.
Comment assurer une égalité entre nos porte-parole dans un pareil système ? Si nous sommes sérieux dans notre approche politique de transformation, nous allons au moins poser ces questions et doter l'aile parlementaire de statuts démocratiques. Créons notre propre cadre plutôt que de nous conformer à celui qui est là.
Un autre choix difficile nous attend : un choix que nous avons à faire pour ne plus perdre des Catherine et des Émilise. Il relève d'un enjeu plus fondamental, mais aussi plus difficile à nommer. Je vais faire de mon mieux, mais je compte sur notre intelligence collective pour le cerner dans les prochaines semaines.
Cet enjeu, c'est notre rapport au système politique dans lequel nous baignons et que nous voulons changer. Devons-nous nous conformer à ses exigences ou les questionner ? Devons-nous devenir bons dans ce cadre-là ou le faire évoluer en prenant le risque de mettre régulièrement un pied en dehors ? Je pense qu'il ne faut pas laisser le cadre nous araser. Il faut prendre la liberté de le dépasser. Si le fondement de notre action politique vise à changer un système que nous trouvons vicié et aliénant pour l'être humain, qu'avons-nous à gagner en nous soumettant toujours à ses exigences ? Ne risquons-nous pas ainsi de lui donner de la légitimité ? De lui donner une apparence de valeur ? N'allons-nous pas renforcer le système que nous voulons transformer ? S'il est évident que l'indépendance nécessitera de mettre un pied en dehors du système politique canadien, c'est aussi vrai pour la gauche.
Manon a fait évoluer le cadre étroit de la politique québécoise en prenant le risque d'être elle-même. C'est d'ailleurs lors de sa campagne comme aspirante première ministre que nous avons vécu la croissance la plus phénoménale. C'est à ce moment que je suis devenu député avec ma pote Catherine et le reste de la bande des 10. Un petit miracle politique.
On n'essayait pas de répondre aux exigences de la machine à temps plein. On a pris le risque d'assumer ce qui nous mobilisait pour vrai en sachant que certains allaient trouver ça ridicule, mais en espérant que d'autres salueraient notre courage, notre authenticité et notre sincérité.
Nous avons remporté ce pari et nous pouvons le remporter encore. Avec Gab, Christine, Ruba, Manon, tout le caucus. Avec les militantes et militants de 2006 et de 2024. Avec la gang qui a travaillé si fort pour faire élire Émilise. Les débats et les discussions s'en viennent à l'interne, la parole est à nous.
On est capables. J'y crois.
Nous sommes des bêtes féroces de l'espoir
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
.
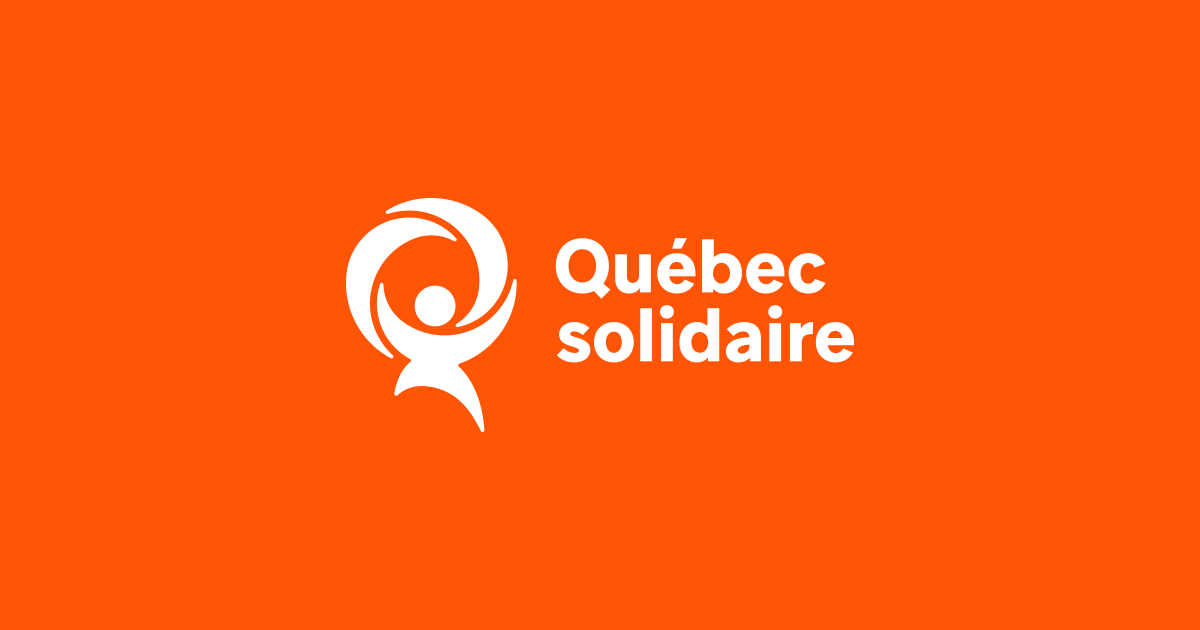
La crise à Québec Solidaire
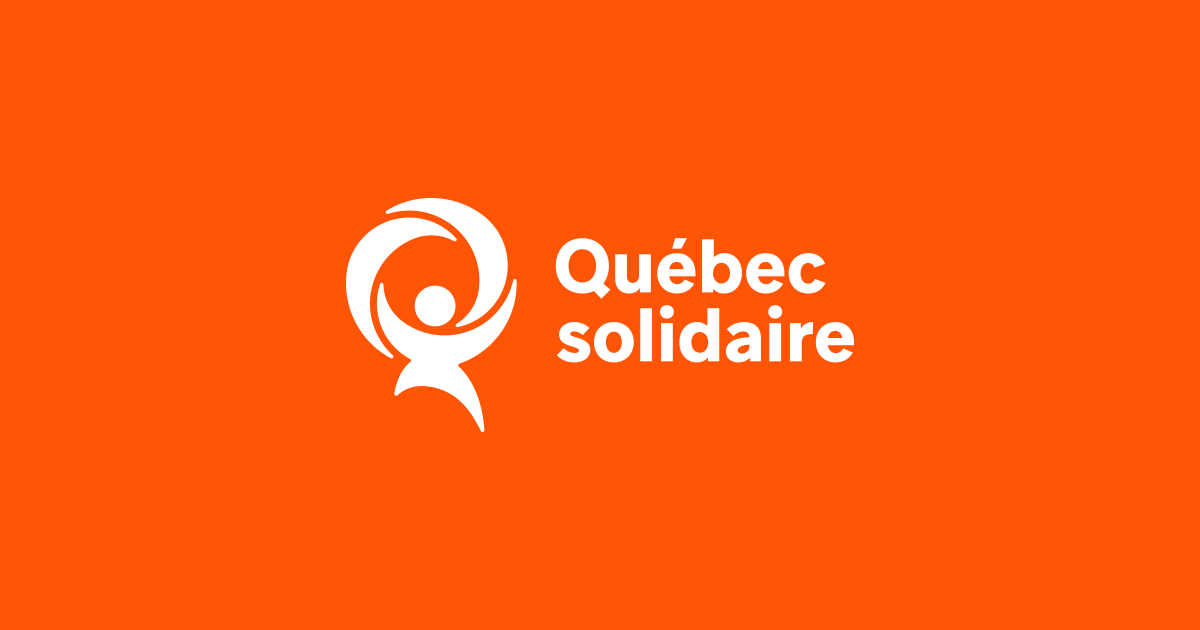
Que ce soient les pragmatiques qui l'emportent ou les plus « idéalistes », i.e. le courant le plus à gauche, le problème de Québec Solidaire restera la social-démocratie.
Ce qui s'est avéré être la tare du PQ, c'est que, des courants qui cohabitent à l'intérieur, la droite peut l'emporter et c'est la trahison. Et quand la gauche l'emporte et que le parti se hisse au pouvoir, il n'a pas la référence de classe pour envisager un changement profond dans les rapports de production. Ce qui le guide, sans un parti communiste fort pour l'influencer, c'est l'idéologie petite bourgeoise qui vacille entre le capitalisme et le socialisme, entre des mesures qui confortent le statu quo ou l'ébranle, entre des mesures qui affrontent le patronat ou des politiques qui lui cèdent du terrain pour le maintenir au pouvoir, des décisions qui font reculer le capitalisme ou des aspiration à changer le système du tout au tout en direction d'un pouvoir sur leur vie plus grand pour les ouvriers.
La référence de classe n'est pas anodine puisque c'est elle qui décide qu'elle direction prendra le parti une fois au pouvoir. Déjà avant même la prise du pouvoir, on peut assister aux hésitations de la petite bourgeoisie dans les fondements même du parti. S'il n'y a pas de volonté au départ d'exproprier les capitalistes, on peut se demande à quoi rime un régime qui laisse intouchée la propriété des moyens de production. Maus encore là, on peut vouloir nationaliser les grands moyens de production et d'échange et se placer entre le capitalisme d'État et une gestion ouvrière de la production. C'est toute la différence entre une position de classe et un réformisme de bon aloi qui ne va pas plus loin qu'une adaptation du capitalisme à ce que la compétition engendre comme nouveauté dans le mode de production pour maintenir les rapports entre les classes ouvrière te bourgeoise. Sans ce bouleversement dans les structures de la société, la classe dominante l'emporte et se maintient toujours au pouvoir.
Ainsi que Québec Solidaire aille au pouvoir pace que les pragmatiques l'auront emporté dans la crise actuelle, la question de la classe et de l'histoire de la prise du pouvoir par cette classe restera en plan parce que le programme de Québec Solidaire reste celui de « dépasser le capitalisme » et non d'en finir avec celui-ci.
Bien sûr, comme pour le PQ, on peut s'attendre de Québec Solidaire qu'il provoque certaines réformes qui constitueront des progrès de société, mais les désistements enregistrés à la suite des démissions annoncent des dissentions insolubles entre une gauche réformiste qui est pressée d'exercer le pouvoir et une autre qui se concentre sur les luttes politiques qui forcent les changements indépendamment de qui exerce le pouvoir. On peut penser que la dernière lutte du Front Commun, si elle avait été menée à terme et conduite de manière à forcer le gouvernement par la grève, ou autrement grâce à l'opinion, à reculer pour des réinvestissements massifs dans le public, qu'elle aurait constitué une victoire notable de la classe ouvrière québécoise. Elle n'aurait pas en elle-même changé les rapports de pouvoir, mais elle aurait été une avancée majeure dans la façon dont les décisions se prennent à la tête de l'État de manière à renforcer la situation d'égalité entre les citoyens. Elle aurait ainsi accordé une plus grande marge de manœuvre aux travailleurs et aux autres classes dans la société.
Même si Québec Solidaire appuyait les travailleurs (le PQ le faisait aussi) il n'est pas dit que ce parti au pouvoir aurait consenti aux revendications de syndicats puisqu'il aurait été pris entre une volonté patronale, i.e. des propriétaires des grands moyens de production, de ne pas y céder et une volonté populaire d'y donner suite. Sur une lancée de mobilisation de la population peut-être y aurait-il acquiescer, mais ce serait immédiatement poser la question des revenus pour payer ces augmentations de salaires et d'investissements dans le public. Ce serait en même temps poser la question de la démocratisation des moyens de production pour consolider ces revenus. Qu'aurait fait Québec Solidaire ? On ne peut présupposer des résultats sans prêter mauvaise foi à la social-démocratie. Mais on peut supposer que sans la pression des communistes et d'une aile gauche radicale, les sociaux-démocrates auraient à nouveau penché en faveur du patronat. C'est l'éternelle question de classe qu'il y a à trancher.
Et le débat qui s'annonce à Québec Solidaire ne se posera pas en terme de quelle classe ce parti représente sinon pour répéter les bonnes intentions de ne jamais trahir et d'assurer à tout le monde que des réformes majeures suivront l'accession au pouvoir, mais la trace est déjà là pour confirmer que l'on restera entre la capitalisme et le socialisme que l'on conditionnera les réformes à la capacité de convaincre le patronat que celles-ci seront à son avantage pour maintenir son pouvoir intact.
De plus on peut se demander si, dans la compétition avec le PQ pour accéder au pouvoir, où le sectarisme de Québec Solidaire le conduira. Amènera-il ce parti vers une radicalisation qui irait dans le sens des expropriations ? On peut en douter, mais il ne faut jurer de rien et penser que la gauche radicale du parti réussira à convaincre du bien fondé de nationaliser, comme la démocratisation l'exige, les grands moyens de production et d'échange ainsi que le parc immobilier pour assurer le droit à un logement public.
Inscrit à son programme, la nationalisation serait la démarcation d'une social-démocratie à l'offensive qui marquerait une tournant en faveur des couches populaires. Et si les pragmatiques devaient l'emporter, ils n'iraient pas au pouvoir sans un programme à réaliser qui laisserait une marque historique sur un Québec indépendant.
Guy Roy
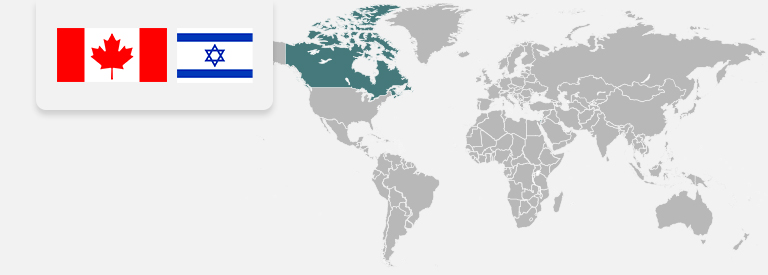
Stephen Harper et Israël à Gaza
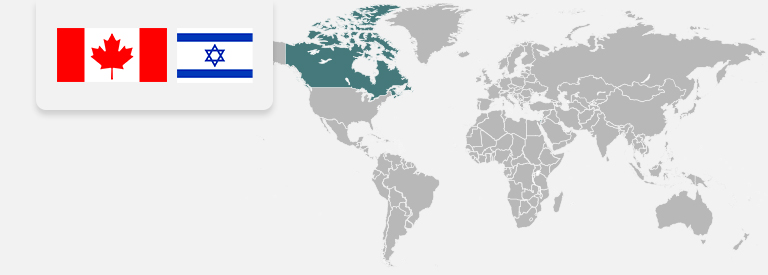
L'ancien premier ministre contrôle des fonds. Il est l'investisseur principal dans une compagnie israélienne qui a développé un système de reconnaissance faciale par IA qui est utilisé pour identifier les Palestiniens.nes.
Tim Graves et Martin Lukacs,
The Breach, 10 avril 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Un fonds d'investissement dirigé par l'ancien Premier ministre conservateur, Stephen Harper, qui doit lancer des entreprises de sécurité en Israël a du succès : il aide les militaires de ce pays a opérer une surveillance de masse de la population de Gaza en total secret.
Selon le New York Times, des centaines de Palestiniens.nes ont été ciblés.es durant une opération d'espionnage « étendue et expérimentale pour constituer un catalogue » de leurs figures. Certains.es ont été « identifiés.es par erreur » comme des militants.es du Hamas, ce qui n'a pas empêché qu'ils et elles soient interrogés.es et torturés.es.
Israël utilise le système créé par Corsight. Elle a été fondée en 2019 et officiellement lancée après un investissement de cinq millions de dollars par Awz Ventures, la compagnie où S. Harper joue un rôle de premier plan à titre de président du comité conseil.
Trois des cinq membres de la compagnie israélienne qui siègent au bureau de direction sont des partenaires de M. Harper dans Awz Ventures. Donc, la compagnie de l'ancien premier ministre contrôle effectivement Corsight.
Avec cette technologie l'armée israélienne a pu arrêter le poète palestinien, Mosab Abu Toha à un point de contrôle à la mi-novembre. Il s'apprêtait à partir en Égypte avec sa famille. Il a été détenu et battu.
C'est l'élite de la cyber surveillance de l'armée israélienne qui opère ce programme, l'Unité 8200. Le brigadier général Ehud Schneorson, retraité de l'armée israélienne, est aussi conseiller partenaire de la firme de M. Harper, Awz Ventures. Selon un reportage du magazine israélien +972, cette unité supervise aussi le système de ciblage par IA qui a identifié des dizaines de milliers de Gazaouis pour mise à mort.
Le voyage de solidarité de S. Harper en Israël
Depuis le 7 octobre (2023) l'armée israélienne a tué plus de 33,000 Palestiniens.nes à Gaza. Des centaines font face à la famine à cause du blocus israélien sur les biens essentiels.
Dans une précédente enquête, The Breach avait constaté que Awz Ventures avait investi un total de 350 millions de dollars dans les compagnies qui soutiennent l'industrie de sécurité et militaire israélienne.
S. Harper soutenait avec ardeur Israël durant son mandat de premier ministre. Il a fait la promotion de Awz Ventures dans les journaux israéliens en disant que la compagnie était une chance de « poursuivre ce que j'ai fait au gouvernement ».
Il a fait une visite « de solidarité » en Israël en février dernier où il a été reçu à la Knesset par son Président, M. Amir Ohana qui l'a qualifié « d'un des meilleurs amis d'Israël de tous les temps ».
Il a aussi rencontré le Premier ministre Nétanyahou et le ministre du renseignement, M. Gila Gamliel. Dans une lettre ouverte dans le National Post à ce moment-là, S. Harper compare le Hamas aux nazis et déclare que les attaques sur Gaza « devraient finir de la même façon que notre guerre contre les nazis, par la capitulation compète des auteurs (des crimes) ».
Fin mars, le New York Times rapportait que Corsight et sa technologie de reconnaissance faciale avait été utilisée pour la première fois pour rechercher les otages capturés le 7 octobre (2023) par le Hamas. Elle a aussi été introduite par l'armée durant l'offensive terrestre à Gaza pour créer un programme de reconnaissance faciale.
Après s'être rendu compte que Corsight donnait des faux positifs, les militaires ont ajouté le programme gratuit de partage de photos de Google à leur arsenal.
Membre du comité de direction de Corsight le major général retraité, Giora Eiland, a plaidé en faveur du nettoyage ethnique de Gaza dans des journaux israéliens. En octobre il écrivait qu'Israël : n'a le choix que de faire de Gaza un lieu où, temporairement ou de façon permanente, la vie sera impossible, et créer une crise humanitaire est nécessaire pour y arriver ». Plus tard, il ajoutait que « Gaza deviendra un endroit où aucune vie humaine ne pourra exister ».
Constats
La compagnie de Stephen Harper investi 350 millions pour développer la technologie militaire d'Israël.
Les compagnies canadiennes partenaires d'Israël, ont vendu plus d'armes létales qu'annoncé.
BMO (la banque de Montréal) a prêté 90 millions à des fabricants d'armes israéliens.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les premiers pas de la longue marche vers la grève climatique

Samedi le 27 avril à l'UQÀM, les Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC) tenaient leur première assemblée générale en présentiel (avec possibilité de zoom) depuis leur fondation en 2021 en pleine pandémie. Y ont participé une trentaine de membres provenant très majoritairement de syndicats de professeur-e-s de cégeps. On a d'abord constaté que TJC recense comme membres 11 syndicats comptant en tout 10 000 personnes, qu'un noyau militant du secteur de la santé a été organisé, qu'un autre est en cours d'organisation pour le secteur privé, qu'un manifeste a été rédigé (et quelques tracts) et qu'on a obtenu une subvention d'une fondation privée. L'assemblée a ensuite fait le point sur ses quatre « axes stratégiques ».
Des conventions collectives à la grève climatique en passant par les lieux de travail
Côté inclusion de clauses climatiques dans les conventions collectives, TJC a réussi à faire inscrire « une clause écologique dans le cahier des demandes du secteur cégep et la prioriser » mais n'est pas arrivé à la faire inscrire dans la convention collective malgré une lettre ouverte signée par une quinzaine de syndicats de l'éducation et associations étudiantes publiée par La Presse. TJC compte étudier des parcours ayant mené à des victoires similaires dont Healthy Green Schools à Los Angeles et aussi de se former au potentiel des « négociations ouvertes », mises en pratique par des syndicats des universités McGill et Concordia. Celles-ci permettent à la militance d'influencer directement les négociations et d'accélérer la circulation de l'information vitale pour un fonctionnement plus démocratique.
L'axe de transformation des lieux de travail s'est traduite par l'initiation de la campagne « Sortons le gaz » des lieux de travail en association avec la campagne plus connue de sortir le gaz des municipalités à laquelle a récemment adhéré partiellement la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La campagne a été récemment lancée et un argumentaire développé mais elle n'a pas encore été enracinée dans un lieu de travail bien qu'elle ait été adoptée en principe par cinq syndicats d'enseignement de cégep. L'atelier lui étant consacré a aussi constaté la difficulté de construire une campagne au niveau primaire et secondaire étant donné le grand nombre d'intervenants malgré la centralisation des décisions. Pour percer quelque part, au-delà des résolutions, il faudra un noyau de gens sur le terrain qui prennent le dossier à bras-le-corps.
Cet axe comprend aussi la préparation d'États généraux pour une éducation environnementale cohérente visant le milieu de l'éducation et prévus pour la fin du printemps 2025. Comme outil de mobilisation, un plaidoyer a été développé. Une proposition de soutien en vue des prochains congrès FNEEQ-CSN et du conseil général FEC-CSQ y sera présentée et dont l'adoption semble très probable. Un autre axe vise l'étude des opportunités de collectivisation économique ou de nationalisation pour réduire le pouvoir de l'entreprise privée. Le comité de travail de cet axe étudie la faisabilité de construire un fonds de collectivisation pour ce faire. (N'y a-t-il pas là une fausse piste qui cherche à mobiliser le capitalisme — car d'où viendront les fonds ? — contre le capitalisme alors qu'il y faudrait une mobilisation proprement politique pour forcer la socialisation des entreprises visées ?)
Un dernier axe et pas le moindre puisqu'il justifie en dernière analyse la raison d'être des TJC, fut la « revendication du droit à la grève climatique ». Force d'admettre que pour cet axe, les objectifs ne sont pas atteints soit « créer un comité de travail » et « proposer un plan de campagne ». La situation objective est même en recul comme l'a admis le responsable de cet axe. Une telle grève hors convention collective est illégale. La dernière en date de 24 heures en septembre 2022 concernait 15 000 travailleuses et travailleurs, essentiellement des professeur-e-s de cégeps et des étudiant-e-s employé-e-s, et près de 146 000 étudiant-e-s d'universités et de cégeps. L'absence de sanction et de poursuite s'expliquait sans doute par la campagne électorale alors en cours. En plus de sortir du monde de l'éducation, le défi clef consiste à gagner le droit de grève sociale y compris pour le climat. On ne peut que réaliser que le sentiment d'échec de la grève du secteur public dénoté par un vote scindé par le milieu a créé une démobilisation peu propice à un nouvel essai.
Investir le transport en commun et considérer une panoplie de revendications
Subséquemment aux rapports sur les axes, l'assemblée a planché sur certaines thématiques particulières. On a souligné qu'en plus de sortir le gaz des lieux de travail, l'enjeu du transport en commun, en particulier de sa gratuité totale ou partielle mais aussi du service hors centres urbains y compris la nationalisation du transport interurbain en chute libre, est susceptible de mobiliser tant la gent travailleuse que celle étudiante. On note un intérêt dans certains cégeps pour cette lutte. La revendication de la gratuité peut mettre à contribution autant l'employeur que l'État. On a souligné la liaison avec les syndicats du transport en commun, surtout en temps de grève, comme l'a fait en Allemagne Fridays for Future vis-à-vis les syndicats de ce secteur.
Un autre atelier s'est attaqué au défi de la mobilisation du secteur privé dont plusieurs sous-secteurs devront accepter une décroissance y compris de l'emploi. À cet égard, il faut dans les revendications distinguer l'emploi du travailleur ou de la travailleuse. On pense ici au syndicat de la fonderie Glencore à Rouyn-Noranda. La culture hermétique de TJC n'est pas toujours propice à l'inclusion du secteur privé comme l'ont montré certaines prises de bec lors d'assemblées pluri-syndicales. Il faut d'abord s'informer de ce que pensent les membres du syndicat quitte à faire des contacts un à un comme l'a fait un syndicat UNIFOR, et aussi de ce que font déjà ces syndicats en matière d'environnement. Cette démarche permet en plus d'identifier les meneurs naturels.
Cet atelier a en quelque sorte été relayé par celui sur la tactique d'introduction de clause écologique dans les conventions collectives. La porte d'entrée est souvent l'enjeu de la santé-sécurité ou celui à la mode de l'ESG (environnement, social, gouvernance) lequel, par exemple, donne lieu à trois rencontres annuelles paritaires dans un syndicat UNIFOR. Les deux enjeux peuvent être combinés, ce qui facilite la libération d'un travailleur ou travailleuse et même la mise sur pied d'un fonds d'éducation. Dans le secteur santé mais pas seulement, on peut mettre sur la table la conséquence des pandémies souvent provenant de zoonoses, des canicules et même des impacts des feux de forêt. Les enjeux spécifiques peuvent varier, de la carboneutralité des lieux de travail jusqu'au transport en commun en passant par des points spécifiques comme le retour à la stérilisation au lieu du jetable et une option végétarienne à la cafétéria.
L'austérité contre l'adaptation climatique et sauver les travailleurs, pas leur emploi
Plus globalement au niveau de l'argumentaire, particulièrement dans le secteur de la santé mais aussi de l'éducation, on peut attirer l'attention sur la contradiction entre austérité, conséquence en grande partie de la générosité gouvernementale gargantuesque pour la filière batterie, et l'augmentation de la lourdeur de la tâche due à la crise climatique. Du côté secteur privé, surtout pour les emplois qui doivent disparaître et donc les travailleurs recyclés, on peut soulever l'enjeu de la reconversion industrielle dont le fer de lance actuel est sans doute la lutte- reconversion contre la fermeture de GKN Driveline (ex-FIAT) à Florence.
(Lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire avait proposé, pour la fonderie Glencore, en cas d'un refus ou de l'impossibilité d'une modernisation écologique que ce soit par l'entreprise elle-même ou par l'État suite à une nécessaire expropriation, une reconversion par exemple pour fabriquer du matériel pour la rénovation écoénergétique des bâtiments ou des pièces pour des moyens de transport en commun, le syndicat se serait peut-être rallié à cette proposition entraînant derrière elle la population laborieuse de Rouyn-Noranda. La circonscription serait probablement restée dans le giron Solidaire… et la présente crise existentielle aurait pu être évitée. Cette heureuse issue aurait été causée par une radicalisation de la plateforme à l'encontre de son centrisme pragmatique.)
Dans l'atelier concernant les liens avec la population étudiante, il a été constaté que le mouvement étudiant est passablement démobilisé et qu'il est à se restructurer. En l'absence de fédération forte, il faudrait mettre l'emphase sur les liaisons locales. Il a été suggéré que TJC, dans ces circonstances, accueille les organisations étudiantes en son sein. Cette proposition a soulevé des réticences dans le sens de confondre des sensibilités et problématiques trop dissemblables. Il faudra en rediscuter. Ce pourrait être à l'occasion de la prochaine assemblée générale de la mi-juin qui sera aussi en mode hybride, à la demande générale, car il faudra discuter et adopter le plan d'action que les riches et prolongés débats de cette assemblée-ci n'ont pas permis d'adopter. Voilà une première tâche pour la nouvelle coordination élargie de cinq à sept personnes dont toutes les personnes sortantes qui ont renouvelé leur mandat. Pour terminer, il a été décidé de faire enquête sur ce qui se fait au niveau du transport en commun et de contacter les syndicats de ce secteur ; de considérer les liens avec le privé ; un plaidoyer pour le secteur santé ; et la possibilité de tenir des états généraux décentralisés sur l'éducation en préparation de ceux généraux.
La grève de masse climatique, une tâche gigantesque et indispensable
Comme membre non-votant de TJC — seuls les syndicats membres peuvent voter mais les individus peuvent être membres et pleinement participer — même si je suis à la retraite depuis belle lurette, je tiens à cette participation. Comment en effet renverser le rapport de forces entre la gouvernance du monde par le 1%, la bourgeoisie financière-oligopolistique, qui mène allègrement le monde vers la catastrophe de la terre-étuve en passant par de grandes guerres, et le 90%, le peuple travailleur. Autant l'histoire révolutionnaire du XXe siècle dans les pays industrialisés a démontré qu'on ne saurait concevoir un renversement du capitalisme sans une grève de masse pro-active bloquant tant l'accumulation du capital que visant la prise du pouvoir, autant cette grève au XXIe siècle sera une grève de masse, une grève sociale comme on dit au Québec, climatique. Il y a bien sûr loin, très loin, de la coupe aux lèvres tant au Québec qu'ailleurs. Les TJC ont entrepris de faire les premiers pas pour l'accomplissement de cette tâche gigantesque et indispensable.
Marc Bonhomme, 5 mai 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dévoilement de la stratégie caribou : entre compromis et cafouillages

Nouvelle (Gaspésie), Val-d'Or (Abitibi), 30 avril 2024 -Environnement Vert Plus et l'Action Boréale condamnent la stratégie divulguée aujourd'hui par M. Charette et Mme Blanchette-Vézina, respectivement ministres de l'environnement et des forêts du Québec.
La CAQ aura attendu à la dernière minute de l'échéance fixée par le ministre fédéral de l'environnement, Steven Guilbeault, pour divulguer, lors d'une visite en Gaspésie presque sans communiqué officiel, un projet de stratégie amputé de la plupart des hardes prioritaires.
Les retards dans la divulgation de la stratégie et son amputation de la harde de Pipmuacan/Péribonka résultent selon nos informations des pressions de l'Alliance forêt boréale. Ces pressions s'appuient sur des craintes que
les industriels du Lac St-Jean et de la Côte-Nord subissent une diminution de la disponibilité de bois, en lien avec la protection d'un territoire suffisant pour conserver les hardes menacées. On présente maintenant la
partie gaspésienne de la stratégie comme une démonstration pour amadouer les industriels jeannois et nord-côtiers.
“Ce énième compromis en faveur des industriels est inacceptable. Le forestier en chef a choisi de maintenir artificiellement élevée la possibilité forestière au Lac et sur la Côte-Nord, malgré les feux
historiques de l'été 2023, comme s'il ne s'agissait que d'un épisode isolé. L'histoire récente de la côte ouest nord-américaine(1) nous a pourtant montré que les premiers feux records liés au réchauffement global n'étaient
que le prélude d'une série exponentielle.
Le forestier en chef reporte de l'ajustement de la possibilité forestière jusqu'en 2029(2) et, ce faisant,
refuse toujours la création d'une réserve pour ce type “d'imprévus”. Les travailleurs du secteur ne seront que plus durement touchés lorsqu'on devra d'urgence réduire la capacité industrielle suite aux prochains feux.
L'amputation actuelle de la stratégie caribou au service des industriels se fait donc aussi au détriment des travailleurs” explique Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus.
“L'absence des hardes de Val-d'Or et de Pipmuacan du projet de stratégie est de mauvais augure. Chaque harde qui disparaît menace toutes les autres de disparaître plus facilement. La harde gaspésienne, dernier vestige de la
population de caribous du sud du St-Laurent, qui s'étendait auparavant jusqu'au Maine, pourrait subir le même sort sans une stratégie globale et solide pour protéger toutes les hardes menacées du Québec. Il faut manquer
de courage politique pour céder encore une fois aux chantages de l'Alliance boréale” conclut Henri Jacob, président de l'Action Boréale.
(1)
https://www.nationalobserver.com/2021/08/12/analysis/dixie-fire-latest-town-eating-monster-californias-exploding-megafire-crisis
(2)
https://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Effet-des-feux-de-foret-2023-sur-les-possibilites-forestieres-2023-2028.pdf
Environnement Vert Plus
Action Boréale
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trois-Rivières, Bti et girouette

Depuis un moment déjà, l'intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres. Et elle semble servir dans un nombre grandissant de domaines. Des interfaces IA sont accessibles en ligne et quiconque le souhaite peut poser LA ou LES questions qui lui brûle.
Le larvicide Bti contre les moustiques et ChatGPT
C'est ce qu'a fait une entreprise de contrôle des insectes piqueurs, la plus grosse entreprise en fait, qui arrose nos milieux humides au larvicide Bti, pour détruire les moustiques et les mouches noires. Voici la question que l'entreprise a posée à ChatGPT, le robot conversationnel vedette ces jours-ci :
« Le Bti est-il dangereux pour l'environnement ? » La réponse, en gros, du système d'intelligence, toute artificielle, fut ceci :
« Le Bti est largement utilisé pour le contrôle des larves de moustiques, de moucherons et d'autres insectes nuisibles dans les zones où les larves d'insectes aquatiques posent un problème de santé publique ou agricole. Il agit de manière sélective en ciblant spécifiquement les larves aquatiques. Il ne nuit généralement pas aux autres organismes aquatiques tels les poissons, amphibiens ou microorganismes, est biologique, non persistant et il réduit l'utilisation des insecticides chimiques. »
On croirait lire une information sur le site de la compagnie.
Notre question à ChatGPT
L'entreprise mentionne sur sa page avoir posé la question par curiosité. Par curiosité, nous avons, nous aussi, posé une question sur ce larvicide au tout-puissant ChatGPT, mais avec une tournure un brin différente :
« Quels sont les dangers du Bti pour l'environnement ? » La réponse, essentiellement :
« Le Bti peut encore présenter certains risques potentiels, dont : impacts sur les espèces non-cible, dégradation de l'habitat, résistance des insectes, effets sur les organismes terrestres et effets sur la chaîne alimentaire. »
Pas tout à fait la même réponse… pour ne pas dire, à peu près le contraire que la réponse version 1. Dans les 2 cas par contre, la réponse faisait dans le flou, manquait de précision. En fait, avec ChatGPT, la seule phrase qui nous paraît rigoureuse est celle inscrite tout en bas des réponses que génère le nébuleux cafouilleur automatique : « ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information. »
Étant donné que nous considérons le sujet des pesticides comme étant important - leur impact sur le vivant surtout - plutôt que de nous tourner vers une girouette artificielle, nous jugeons préférable de nous informer, dans le cas du Bti et de tout autre sujet jugé important, auprès de sources basées sur la science indépendante.
ChatGPT ou virer à tout vent
N'en déplaise à la nouvelle star, ChatGPT, études à l'appui depuis plus de 15 ans maintenant : le Bti n'est pas sélectif, car il s'attaque à n'importe quelle larve sur son passage qui fait partie des nématocères (un des groupes d'insectes vitaux pour assurer l'intégrité de la chaîne alimentaire) ; il détruit notamment les proches cousins non-piqueurs des moustiques, soit les chironomes, une copieuse et précieuse source de nourriture pour la vie aquatique et terrestre ; il nuit aux poissons, qui se gavent de chironomes là où ils en trouvent ; le Bti affecterait aussi le développement et le microbiote des grenouilles ; et il est loin d'être biologique puisque plus de 80% des produits Bti sont composés d'une soupe d'additifs divers.
La COP 15 a vivement sonné l'alarme par rapport à la crise de la biodiversité et le déclin généralisé des insectes. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs recommande d'appliquer le principe de précaution concernant le Bti (c.-à-d., dans le doute, s'abstenir d'en utiliser). Il existe des solutions simples et sans impacts sur l'eau et sur la diversité de la vie pour éviter les moustiques (protections personnelles, bornes à base de CO2 recyclé). Alors qu'est-ce que la municipalité de Trois-Rivières attend pour rompre avec cette pratique des années 80 ? Une réponse claire de ChatGPT peut-être ?
Danièle Dugré
Christiane Bernier
Coalition biodiversité-Non au Bti
https://www.nonaubti.org
https://www.facebook.com/NonBti
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Crise du financement des transports collectifs : l’électrification doit se faire à bon rythme

Un regroupement d'organismes environnementaux appelle le gouvernement du Québec à revoir son échéancier pour l'électrification des autobus, afin de réallouer ces montants dans la qualité et la bonification des services.
Alors que l'offre de service de transport collectif a stagné voire diminué au cours des dernières années, et que le manque à gagner pour l'année à venir seulement est de plus de 600M$ pour l'ensemble du Québec, ce qui pourrait mener à de graves réductions de service, le Plan pour une économie verte prévoit actuellement des dépenses 524,6 M$ au cours des quatre prochaines années pour l'électrification des autobus urbains. Les investissements totaux nécessaires d'ici 2030 s'élèveraient quant à eux à 13 G $ d'ici 2030.
Bien qu'elles saluent que le Québec soit un leader nord-américain de l'électrification des transports, les organisations soulignent que l'objectif premier pour chacune des sociétés de transport au Québec doit être la qualité et la croissance de l'offre de service. D'ailleurs, jeudi dernier, le ministre de l'Économie et de l'Énergie « Pierre Fitzgibbon a affirmé qu'il préférerait retarder l'électrification des autobus au Québec plutôt que de donner davantage de subventions ».
« Pour l'atteinte de nos cibles de réduction de GES et économiser de l'énergie renouvelable, il faut donner des alternatives aux personnes qui désirent diminuer l'utilisation de leur voiture, en répondant à leurs besoins de mobilité, que ce soit avec des autobus électriques ou hybrides. Bien qu'il soit pertinent de substituer des autobus en fin de vie par des autobus électriques, les fonds très importants qu'on dédie à l'électrification de nos autobus pourraient donc avoir un plus grand impact s'ils étaient alloués à une augmentation de l'offre, et c'est ce qu'on demande au gouvernement de permettre », déclarent les représentants d'organisations réunis.
« Pour le dire de manière imagée, mieux vaut deux autobus hybrides sur nos routes, plutôt qu'un seul 100% électrique. Présentement, la priorité doit être de transférer des déplacements réalisés en voitures et camions légers (17,2 % de nos émissions de GES) vers les transports en commun, et non de décarboner au plus vite nos flottes de bus urbains qui ne comptent que pour 0,4% de nos émissions de GES. Il est inacceptable que l'on parle actuellement de coupures de service alors qu'un important surplus dort actuellement au Fonds vert. Le gouvernement du Québec peut en faire plus pour assurer la qualité de l'offre à court terme. »
Un rythme adapté en fonction de chaque région
Les organismes environnementaux n'appellent évidemment pas à suspendre en totalité l'électrification des autobus qui présentent à long terme des avantages non négligeables en réduction des coûts d'entretien et de carburant. « Nous demandons donc au gouvernement de s'asseoir avec les sociétés de transport et de convenir d'un plan d'électrification qui reste ambitieux, mais qui respecte un rythme plus réaliste compte tenu des réalités propres à chacune d'elles. Surtout, un plan qui mise sur une croissance soutenue des services, afin de réduire les émissions de GES. » soulignent-ils.
La qualité et la croissance de l'offre, une responsabilité partagée
La rencontre prévue ce lundi entre la ministre Geneviève Guilbault et les maires et mairesses des grandes villes du Québec devra mener à des objectifs minimums de croissance de l'offre à atteindre dans chacune des sociétés de transport. Aux yeux des groupes, la ministre doit faire preuve de vision et adopter une cible d'augmentation de l'offre de service, tout en s'assurant de contribuer financièrement à l'atteinte de cette cible et en appuyant les élus municipaux. Il est de leur responsabilité conjointe d'atteindre et de financer une croissance des services dès cette année.
Se satisfaire d'une stagnation de l'offre serait inacceptable et irresponsable, c'est pourquoi aux yeux des groupes il est pertinent de réorienter les fonds destinés à l'électrification vers la qualité et la croissance de l'offre .
Évidemment, il ne s'agit pas de la seule solution à la crise du financement des transports collectifs. Pour en connaître davantage, consultez les recommandations de l'Alliance TRANSIT.
Signataires du communiqué
Anne-Catherine Pilon, analyste - mobilité durable, Équiterre
Christian Savard, directeur général, Vivre en Ville
Sarah V. Doyon, directrice générale, Trajectoire Québec
Charles Bonhomme, responsable affaires publiques et communications, Fondation David Suzuki
Martin Vaillancourt, directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie, Greenpeace Canada
Patricia Clermont, organisatrice-coordonnatrice, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Action de visibilité : 10 féminicides en 2024

Québec, 2 mai 2024 - Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une action de visibilité suite à l'annonce du 10e féminicide depuis le début de l'année. Suzanne Fortin a été tuée le 25 avril à Montmagny. L'action, qui a réuni plusieurs militantes au coin des rues Cartier et René-Lévesque sur l'heure du midi, visait à briser le silence, exprimer notre colère, visibiliser les féminicides et exiger du gouvernement de faire de la lutte aux violences faites aux femmes et aux enfants une priorité.
Les féminicides : des violences banalisées et normalisées
Ces violences sont le fruit d'un rapport de domination des hommes sur les femmes que la société tolère et banalise. L'agresseur était connu des policiers pour harcèlement criminel et vivrait avec un trouble de santé mentale et. « Nous dénonçons les lacunes au niveau des services et de l'encadrement pour les personnes vivant avec une problématique de santé mentale. Ces trous de services laissent les personnes vivant avec un trouble livrées à elles-mêmes. Nous devons à tout prix éviter que certaines personnes se désorganisent et en viennent à poser des gestes d'une telle violence » soutient Catherine Gauthier co-coordonnatrice au RGF-CN.
Les femmes aux intersections de plusieurs systèmes d'oppression tels les femmes immigrantes, les femmes autochtones, celles en situation de handicap, les jeunes femmes, les femmes des communautés LGBTQIA, les femmes âgées, en situation d'itinérance, en situation de dépendance économique, et les femmes que la société racise sont parmi les plus à risque de subir une ou plusieurs formes de violences, elles sont surreprésentées dans les victimes de féminicides.
Pas une de plus
Il faut refuser de baisser les bras et d'accepter que d'autres femmes et enfants soient agressées, violentées, tuées. Des solutions pour mettre fin à la violence envers les femmes, il en existe ! Ça passe notamment par l'augmentation du financement en prévention, en accompagnement et en hébergement des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et genrées, par des formations obligatoires et continues sur la violence conjugale pour tous les acteurs et les actrices qui interviennent auprès des femmes et des enfants, par des changements en profondeur de la
culture de notre système de justice où les agresseurs peuvent récidiver en attente de leur procès,
par une éducation à la sexualité axée sur des modèles de relations positifs basés sur l'égalité entre
les femmes et les hommes. Les solutions sont multiples et doivent dénoncer le caractère
inacceptable et criminel de la violence envers les femmes et renforcer la confiance des victimes et
du public dans l'administration de la justice.
Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille la
défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, l'égalité des femmes entre elles, l'amélioration des conditions de vie.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Prise de parole 1er mai 2024

Le revenu viable pour 2024 a été dévoilé. C'est quoi le revenu viable ? C'est le revenu nécessaire pour vivre hors de la pauvreté. Pour la région de Québec, le revenu viable pour une personne seule est de 35 000$. C'est 13 % de plus que l'année dernière. Ça veut dire que ça nous prendrait 13% de plus de revenus que l'année dernière pour faire face à l'explosion du coût de la vie et vivre en dehors de la pauvreté. Est-ce que qu'une personne ici a vu ses revenus augmenter de 13 % depuis l'année dernière ?
Et ce n'est pas avec le maigre 0,50$ d'augmentation du salaire minimum que les gens vont pouvoir sortir la tête de l'eau. On le sait, travailler n'est pas synonyme de sortie de la pauvreté. Un salaire minimum à temps plein ne permet pas une vie sans pauvreté. Une vie de travail à temps plein ne permettra pas, pour tant d'entre nous, une retraite sans pauvreté. Survivre avec un indécent chèque d'aide sociale ne permet pas de vivre dignement et de couvrir les besoins de base.
Le fonctionnement de notre société, son organisation sociale et familiale, se basent sur l'exploitation économique et sociale des femmes. Les femmes occupent la majorité des emplois précaires, sous-payés, sans protection, la majorité des emplois à temps partiel, au salaire minimum. Ce sont elles qui portent jour après jour nos organismes communautaires. Ce sont elles qui se sont levées dans les derniers mois pour la sauvegarde de nos écoles et notre système de santé publics.
C'est au péril de leur santé physique et mentale que les femmes maintiennent à bout de bras le tissu social et familial. Les femmes consacrent, encore aujourd'hui, 54 minutes/jour de plus que les hommes pour les tâches ménagères, une heure/jour de plus de soins aux enfants.
La pauvreté vécue par les femmes s'accentue lorsqu'elles sont âgées de plus de 65 ans, lorsqu'elles sont immigrantes, proches aidantes, autochtones, en situation de handicap, responsables de famille monoparentale.
La crise du logement affecte directement les femmes qui constituent la majorité de la liste d'attente d'un logement subventionné (tout particulièrement les femmes seules). La pénurie des logements abordables, salubres, sécuritaires, de qualité, à proximité des services et du transport, adaptés aux personnes à mobilité réduite…cette pénurie de logements peut faire basculer plusieurs femmes au bord du gouffre. Quels sont leurs choix ? Retourner avec un conjoint violent ? S'épuiser à faire le tour de toutes les banques alimentaires ? Être contrainte de rendre des services sexuels pour boucler leur fin de mois ? Couper dans leurs besoins essentiels ? Éviter tout déplacement coûteux et donc s'isoler ? Bien qu'elle soit souvent cachée et invisible, l'itinérance des femmes, trop souvent associée à des vécus de violence, est bien réelle et présente dans notre région.
Il faut profiter du prochain plan de lutte à la pauvreté pour mettre en place des mesures structurantes pour lutter contre la pauvreté. Il faut un revenu qui permette de vivre dignement. Il faut un réinvestissement massif dans nos services publics et nos programmes sociaux, qui sont un rempart essentiel contre les inégalités sociales. Il faut investir dans le logement social. Il faut une véritable répartition de la richesse et, pour ça, il faut que les plus riches et les grandes entreprises paient leur juste part. C'est en s'attaquant au capitalisme tant défendu par les gouvernements qui se succèdent ici et ailleurs dans le monde qu'on va pouvoir rêver d'une société plus juste, plus égalitaire, plus verte et inclusive !

Iran : 26 personnes dont le rappeur Toomaj Salehi risquent d’être exécutées en lien avec les manifestations

Au moins 26 personnes risquent d'être exécutées en lien avec la vague de soulèvement qui balaie le pays, alors que les autorités iraniennes ont déjà exécuté arbitrairement deux personnes condamnées à l'issue de parodies de procès iniques, dans le but d'instiller la peur parmi la population et de mettre fin aux manifestations. Sur ces 26 personnes, au moins 11 sont condamnées à mort et 15 sont inculpées d'infractions punies de la peine capitale, et attendent leur procès ou comparaissent devant les tribunaux.
Tiré du site d'Amnistie internationale Canada.
Une lettre à envoyer
Monsieur le Responsable du pouvoir judiciaire,
Je suis vivement préoccupé·e par le fait qu'au moins 26 personnes risquent d'être exécutées par les autorités iraniennes à l'issue de parodies de procès manifestement iniques, pour des accusations telles que « inimitié à l'égard de Dieu » (mohareb), « corruption sur terre » (ifsad fil Arz) et « rébellion armée contre l'État » (baghi), en lien avec les manifestations d'ampleur nationale. Au moins 11 d'entre elles ont été condamnées à mort : Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sadrat (Sedarat) Madani et Manouchehr Mehman Navaz, jugés séparément par des tribunaux révolutionnaires à Téhéran ; ainsi que Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou et le rappeur kurde Saman Seydi (Yasin), jugés collectivement par un tribunal révolutionnaire à Téhéran. Les autorités ont aussi condamné à mort pour « corruption sur terre » Hamid Ghare-Hasanlou, Mohammad Mehdi Karami, Seyed Mohammad Hosseini, Hossein Mohammadi et une personne dont on ignore le nom lors du procès collectif de 16 accusés devant un tribunal révolutionnaire à Karaj, dans la province d'Alborz. Au moins 15 autres risquent elles aussi d'être exécutées. Il s'agit d'Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharagholou et Saeed Shirazi, jugés pour des infractions passibles de la peine capitale. Toutefois, aucune information n'a été rendue publique sur le verdict ni l'avancement de leur affaire. Les autres attendent leur procès ou comparaissent actuellement en justice pour des infractions passibles de la peine capitale. Il s'agit d'Akbar Ghafari et Toomaj Salehi à Téhéran ; Amir Nasr Azadani, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi dans la province d'Ispahan ; Ebrahim Rigi (Riki), membre de la minorité baloutche d'Iran, et les frères Farzad (Farzin) Tahazadeh et Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Hajar Hamidi et Shahram Marouf-Mola, de la minorité kurde d'Iran, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental.
Ces 26 personnes n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, qui englobe le droit à une défense adéquate, le droit de consulter l'avocat de son choix, d'être présumé innocent, de garder le silence et de bénéficier d'un procès public et équitable. D'après les informations dont dispose Amnesty International, au moins 10 d'entre eux, dont Hamid Ghare-Hasanlou, Toomaj Salehi et Mohammad Ghobadlou, ont été torturés et leurs « aveux » entachés de torture, comme ceux d'autres accusés, ont été retenus à titre de preuves. Les médias d'État ont diffusé les « aveux » forcés de plusieurs accusés avant leur procès.
Je vous prie instamment d'annuler immédiatement toutes les condamnations et les peines de mort, de vous abstenir de requérir de nouvelles condamnations à mort et de veiller à ce que toute personne accusée d'une infraction pénale prévue par la loi soit jugée dans le cadre d'une procédure conforme aux normes internationales d'équité, sans recours à la peine de mort. Je vous demande instamment de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux et de permettre aux détenu·e·s de voir leur famille et les avocats de leur choix, de les protéger contre la torture et les mauvais traitements et d'enquêter sur les allégations de torture, en vue de traduire les responsables de ces actes en justice dans le cadre de procès équitables. Par ailleurs, je vous demande d'accorder aux observateurs indépendants des ambassades en Iran l'accès aux procès des personnes passibles de la peine de mort en lien avec les manifestations. Enfin, je vous prie d'instaurer sans attendre un moratoire officiel sur les exécutions, première étape vers l'abolition de la peine capitale.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Responsable du pouvoir judiciaire, mes salutations distinguées.
Appels à :
Responsable du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Ambassade d'Iran auprès de l'Union européenne
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgique
Copies à :
Mélanie Joly
Ministre des Affaires étrangères
111, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Aucun timbre requis
Courriel : melanie.joly@parl.gc.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’UNEQ s’affilie à la CSN

C'est dans une proportion de 82 % que les membres de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) ont fait le choix de s'affilier à la CSN et à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN). Réunis en assemblée générale à Montréal, à Québec et en virtuel samedi, les membres de l'UNEQ ont ainsi donné leur aval à cette proposition émanant du conseil d'administration de l'UNEQ, au terme d'une tournée de consultations effectuée plus tôt cette année.
« On est très heureux du résultat, s'est réjoui le président de l'UNEQ, Pierre-Yves Villeneuve. En approuvant l'affiliation avec la FNCC–CSN, les écrivaines et les écrivains se dotent d'outils qui vont permettre à l'UNEQ de remplir son mandat syndical. Cela montre aussi leur détermination à amorcer les négociations visant à établir les premières ententes collectives dans le secteur de l'édition. La route est encore longue, mais cette décision rapproche l'UNEQ de son objectif de mieux encadrer les pratiques de travail des artistes de la littérature et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. »
En modifiant la loi sur le statut de l'artiste, en juin 2022, l'Assemblée nationale a octroyé pour la première fois aux écrivaines et aux écrivains québécois le droit à la négociation collective, un droit constitutionnel dont ils étaient jusqu'alors privés. Cette réforme faisait suite aux pressions exercées par une vaste coalition d'associations d'artistes et de travailleuses et de travailleurs du milieu culturel, dont l'UNEQ et la FNCC–CSN.
Avant d'entreprendre ces négociations, l'UNEQ procèdera prochainement à une vaste consultation de ses membres en vue d'établir leurs priorités de négociations. Une fois adoptés en assemblée générale, ces cahiers de revendications seront déposés auprès des groupes d'éditeurs œuvrant au Québec.
« Nous connaissons tous la très grande précarité financière dans laquelle une vaste majorité d'écrivaines et d'écrivains sont confinés, d'affirmer la présidente de la FNCC–CSN, Annick Charette. Il est temps de mettre en place les conditions leur permettant de créer librement tout en gagnant leur vie dignement. »
« C'est tout le mouvement CSN qui se réjouit aujourd'hui d'accueillir les membres de l'UNEQ, a pour sa part souligné la présidente de la centrale syndicale, Caroline Senneville. Les écrivaines et écrivains du Québec pourront non seulement compter sur notre expertise de négociation et de mobilisation, ils pourront également compter sur l'appui et la solidarité de nos 330 000 membres. »
Fondée en 1977, l'UNEQ est un syndicat professionnel qui œuvre à valoriser la littérature québécoise et à défendre les droits socioéconomiques des artistes de la littérature. Elle regroupe aujourd'hui près de 1800 membres représentant toutes les pratiques littéraires.
La FNCC–CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
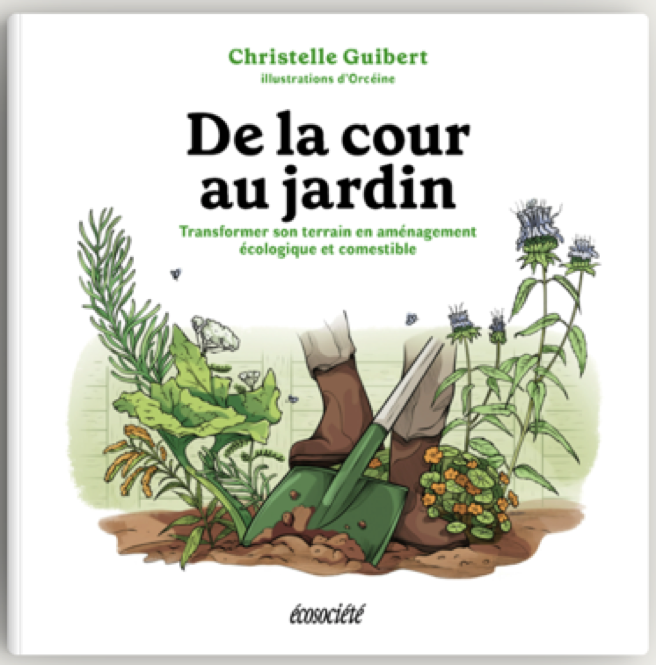
Remplacer la tondeuse par de la... cueillette ? Mai est le mois du fameux Défi pissenlits, mais l’autrice Christelle Guibert pense qu’on peut aller plus loin
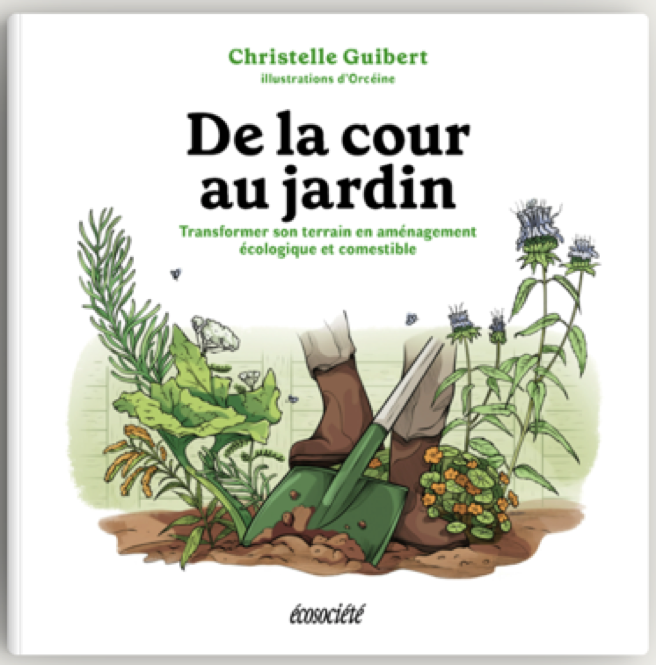
Plutôt que de simplement attendre à la fin mai pour tondre son gazon, pourquoi ne pas aménager son terrain en espace écologique et comestible, et ne plus tondre du tout, ou presque ? C'est ce que propose Christelle Guibert, autrice du guide pratique De la cour au jardin - Transformer son terrain en aménagement écologique et comestible.
Aller plus loin que le Défi pissenlits
L'initiative Défi pissenlits (Mai sans tondeuse, En mai laissez pousser !, No mow may), qui incite le public à ne pas tondre leur gazon trop tôt pour contribuer à la santé des pollinisateurs et favoriser la biodiversité, fait son chemin au Québec. Bien qu'il s'agisse d'une excellente nouvelle, il est peut-être temps d'aller plus loin. Plutôt que de simplement attendre à la fin mai pour tondre son gazon, pourquoi ne pas aménager son terrain en espace écologique et comestible, et ne plus tondre du tout, ou presque ? Pourquoi ne pas remplacer la tondeuse par de la cueillette ?
C'est la proposition de l'autrice Christelle Guibert dans son guide pratique De la cour au jardin. Que l'on habite en ville, en banlieue ou à la campagne, il est possible d'aménager son espace extérieur en îlots de verdure enchanteurs et comestibles. Véritable mine d'informations, De la cour au jardin met l'accent sur la plantation d'arbres, d'arbustes fruitiers et de plantes vivaces dans le but de créer un aménagement qui s'entretient facilement, à moindre coût, et qui se mange.
Au bout de quelques années, les efforts investis seront largement récompensés. Oui, un terrain gazonné, stérile, peut devenir un véritable petit écosystème comestible. De quoi ravir autant les pupilles que les papilles !
À propos de l'autrice
Christelle Guibert est ingénieure de formation et passionnée de jardinage. D'origine française, elle travaille actuellement comme gestionnaire en environnement dans la région de l'Outaouais. De la cour au jardin est son premier livre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Revue de livres : Arun Kundnani propose une extension innovante du marxisme - Qu’est-ce que le racisme et l’antiracisme ?

WHAT IS ANTI-RACISM ? And Why It Means Anti-capitalism ? (Qu'est-ce que l'antiracisme ? Et pourquoi il est synonyme d'anticapitalisme) expose une analyse radicale du racisme fondée sur les travaux de plusieurs théoriciens, écrivains et éducateurs importants. L'auteur met en évidence deux récits qui s'affrontent sur les origines et la reproduction du racisme, mais s'il considère que l'un en perce les mystères , il considère que l'autre est une simple diversion.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Paru en anglais sur Against the current no 230 mai-juin 2024.
What Is Anti-racism ? And Why It Means Anti-capitalism, par Arun Kundnani, Verso Books, 2023, 24,95 $ papier.
Arun Kundnani est l'ancien rédacteur en chef de Race and Class, le magazine de l'Institute of Race Relations en Grande-Bretagne, un groupe de réflexion sur le racisme et l'impérialisme. Il est également un militant de longue date des mouvements antiracistes en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Auteur de The Muslims Are Coming ! Spooked et The End of Tolerance, Kundnani écrit en antiraciste passionné.
Dans « Qu'est-ce que l'antiracisme ? » Kundnani se penche sur les théories tant libérales qu'émancipatrices qui portent sur la manière dont les sociétés catégorisent les personnes comme « inférieures » en raison d'une différence partagée et identifiable.
La théorie libérale combat l'idéologie raciste avec l'objectif d'enseigner aux gens comment repérer et éliminer les préjugés cachés et les peurs.
Kundnani présente Magnus Hirschfeld, un opposant aux nazis, comme le premier à avoir utilisé le mot « racisme » pour identifier ces croyances non scientifiques. Dans Rassismus (Racisme), Hirschfeld, un psychiatre radical qui était à la fois juif et homosexuel, a dressé la liste des hypothèses non scientifiques sur l'ethnicité/la couleur de la peau depuis l'aube des Lumières jusqu'au 20e siècle, en mettant en évidence leur caractère irrationnel.
Hirschfeld et son œuvre ont été qualifiés de dégénérés par les nazis. L'Institut des sciences sexuelles qu'il a fondé est fermé, ses 10 000 livres sont brûlés et il s'exile. Face à cette réalité bouleversante, Hirschfeld considère le racisme comme une doctrine à laquelle on peut croire ou ne pas croire. Il propose donc un programme éducatif qui permettrait d'apprendre aux gens à surmonter ces préjugés grossiers.
Peu après la publication de Rassismus, les anthropologues américains Franz Boas et son élève Ruth Benedict ont présenté le mot « racisme » au public américain. Dans son ouvrage Race : Science and Politics (1940), Benedict définit le racisme comme « ...le dogme selon lequel un groupe ethnique est condamné par la nature à une infériorité congénitale et un autre groupe est destiné à une supériorité congénitale ». (35)
Kundnani attache une grande importance au fait que Benedict ait regroupé trois questions qui étaient auparavant considérées comme distinctes : le sort réservé aux descendants des esclaves noirs aux États-Unis, celui des Juifs en Europe et celui qui a été infligé par le colonialisme occidental aux peuples d'Afrique, d'Asie, des Amériques et des Caraïbes. Benedict a souligné la similitude des arguments irrationnels invoqués pour justifier l'oppression.
Kundnani relève que ces éléments ont été dilués lors de la campagne que le gouvernement américain avait menée pour opposer à l'idéologie suprématiste nazie une apologie de la prétendue diversité des États-Unis. Bien que la ségrégation ait prévalu dans l'armée pendant toute la durée de la guerre, Washington a voulu donner l'image d'un pays démocratique et intégrateur.
Si la publication en 1944 de l'ouvrage de Gunnar Myrdal, An American Dilemma (1944), a révélé l'écart entre la réalité de l'époque Jim Crow et la proclamation de cet égalitarisme américain, c'est que le racisme était une contradiction fondamentale à laquelle il convenait de trouver une solution. Une fois de plus, le postulat de départ était que les valeurs égalitaires triompheraient grâce à l'éducation.
Racisme et Empire
Considérant cette floraison de textes comme une réponse à la montée du fascisme en Allemagne, Kundnani en vient à ce qu'il considère comme le cœur du problème, citant C.L.R. James : « Il n'y a pas une seule forme de discrimination raciale pratiquée par les nazis à l'encontre des Juifs qui ne soit pas pratiquée par les Européens au Kenya à l'encontre des Africains. » (66)
Comme le note également Kundnani, Aimé Césaire est parvenu à la conclusion que l'idéologie raciale nazie était le résultat de l'étude et de l'application des leçons employées dans les colonies lointaines de l'Europe et dans le Sud des États-Unis.
Les crimes d'Hitler ne sont uniques, a déclaré Césaire, que dans la mesure où il a a mis en œuvre des méthodes coloniales qui ne s'appliquaient auparavant qu'aux non-Européens. (75) Césaire, comme James, considère que le racisme est un phénomène enraciné dans la domination coloniale. Cette perspective est le fondement de « Qu'est-ce que l'antiracisme ? »
Kundnani étudie les travaux de plusieurs théoriciens et militantss issus de la tradition marxiste ou qui s'en sont inspirés. Il s'agit notamment de W.E.B. DuBois, Lénine, M.N. Roy, C.L.R. James, Claudia Jones, Aimé Césaire, Franz Fanon, Oliver Cromwell Cox, Stuart Hall, Cedric Robinson et A. Sivanandan. Tous considèrent que le racisme est relié à l'exploitation de classe, mais qu'il possède sa propre dynamique.
Kundnani commence par l'activiste anticolonialiste Anton de Kom. Il qualifie son livre de 1934, We Slaves of Suriname (Nous, les esclaves du Suriname), d'« œuvre phare de la littérature anticoloniale des Caraïbes ». (9)
De Kom raconte que l'école lui a appris « qu'un Noir doit toujours et sans restrictions être l'inférieur de n'importe quel Blanc ». Alors que les Néerlandais ont aboli l'esclavage avant sa naissance, de Kom a montré comment le système d'organisation esclavagiste des plantations n'a pas pris fin, mais a au contraire perduré sous des formes nouvelles et tout aussi oppressives.
Après avoir organisé une manifestation de travailleurs noirs et asiatiques devant le bureau du gouverneur, de Kom a été arrêté, emprisonné et plus tard exilé, pour finalement mourir de la tuberculose dans un camp de concentration allemand.
La réflexion de De Kom est omniprésente dans le livre de Kundnani, tandis que d'autres figures s'avancent pour analyser le racisme, pour conclure en mettant l'accent sur la manière dont il peut être éradiqué. Tout en mettant en valeur ces personnalités, les différents chapitres présentent le contexte historique, à partir de 1400, lorsque l'Inde et la Chine étaient les deux pays les plus riches du monde. Grâce à leur grande capacité de production, ils ont ouvert et entretenu des routes commerciales lucratives.
Encore au début des années 1800, l'industrie textile du Bengale employait un million de travailleurs et dominait le marché mondial. Mais la Grande-Bretagne et les autres puissances européennes ont su combiner le pillage de leurs colonies américaines avec leur puissance militaire pour développer leurs routes commerciales et finalement détruire l'industrie textile du Bengale. Comme le souligne Kundnani, « contrairement au mythe selon lequel le colonialisme a apporté la modernité à une société préindustrielle, la révolution industrielle de la Grande-Bretagne a été rendue possible par le déclin industriel de l'Inde ». (45)
La clé du colonialisme est l'assujettissement des peuples et de leurs terres à la « mère » patrie, ce qui favorise « un capitalisme inégal et déséquilibré ». (46) Le processus de conquête brutale trouve sa normalisation par l'exacerbation des différences ethniques et culturelles. Kundnani montre clairement que le gouvernement britannique (et le français tout autant !) était passé maître dans l'art de privilégier une caste ou un groupe ethnique par rapport à un autre afin de maintenir sa propre domination. Le colonialisme entraîne famines, épidémies, violences sexuelles, surveillance, répression et appauvrissement.
Le racisme est structurel
En mettant en évidence la façon dont le colonialisme cimente le racisme, Kundnani est amené à rechercher comment son poison peut être éradiqué. Pour Kundnani et les auteurs qu'il évoque, le racisme est structurel.
Il rend hommage à Marx et Engels qui ont su voir dans la classe ouvrière l'agent révolutionnaire à même de renverser le capitalisme dans les pays industrialisés. Toutefois, quelle est la solution pour le monde colonial, où vit la majorité de la population mondiale ?
Les masses doivent-elles attendre que le prolétariat industriel fasse des révolutions dans les pays capitalistes avancés, ou doivent-elles, dans la lutte contre le colonialisme subordonner leurs revendications à celles de leurs propres capitalistes émergents ?
Ces scénarios excluent les travailleurs réduits en servitude et les paysans de la carte de l'histoire. Il est même probable qu'ils ne soient même pas une réponse au racisme qui s'est incrusté dans les pays industrialisés.
Si Kundnani reconnaît que les questions coloniales sont appréhendées avec une certaine déséquilibre par Marx, il ne prend pas le temps de se plonger dans les réponses partielles qu'il a apportées aux cas de l'Irlande, de l'Inde, de la Russie ou des États-Unis, et préfère se tourner vers un débat qui a eu lieu en 1907 au sein de la Seconde Internationale.
Le congrès de Stuttgart avait adopté une résolution selon laquelle « la mission civilisatrice revendiquée par la société capitaliste ne sert que de prétexte pour couvrir sa soif d'exploitation et de conquête ». Le vote fut cependant serré. Délégué au congrès, Lénine fut troublé par la discussion, au cours de laquelle Eduard Bernstein, l'un des dirigeant de la social-démocratie allemande, avait objecté qu'« une certaine tutelle des peuples civilisés sur les peuples non civilisés est une nécessité ». [Sur cette question, voir le compte rendu de Wiliam Smaldone dans Reform, Revolution, and Opportunism. Debates in the Second International, 1900-1910 dans notre précédent numéro, ATC 229 -ed.].
Autodétermination et anticapitalisme
Lorsque Lénine a commencé à analyser ce qu'il a qualifié de « chauvinisme colonial », il est arrivé à la conclusion que les capitalistes de certains pays tiraient davantage de profits des colonies que de la production intérieure. Cela fournissait donc une base matérielle et économique pour contaminer les travailleurs de ces pays avec ce chauvinisme. (56-57).
En appuyant le droit des nations à l'autodétermination, Lénine était arrivé à la conclusion qu'une lutte menée par des forces bourgeoises telles que le Congrès national indien pourrait renverser la domination européenne.
Mais, étant donné leur composition, elles ne chercheraient pas à supprimer les structures hiérarchiques. L'exploitation se poursuivrait, au moins jusqu'à ce qu'une nation indépendante, dotée de droits politiques et civils, établisse la base requise pour le développement de la direction de la classe ouvrière nécessaire au renversement du capitalisme.
En même temps, conclut Lénine, les socialistes doivent soutenir les luttes anticoloniales, et dans le cadre du mouvement unifié plus particulièrement aider les ouvriers .
Il soutenait que la lutte pour la libération nationale, malgré ses limites, affaiblirait le capitalisme. Kundnani commente : « Pour Lénine, l'oppression nationale, y compris l'antisémitisme et la domination blanche, était un domaine de lutte distinct de l'exploitation de classe, mais qui lui était lié. L'oppression nationale n'était pas simplement le reflet de la lutte des classes - elle avait sa propre dynamique autonome. Mais elle était également rattachée à la lutte des classes de diverses manières ». (59)
Kundnani explique comment, pendant les débats de l'Internationale communiste en 1920, M.N. Roy a remis en question l'hypothèse de Lénine sur la manière dont la lutte pour la libération nationale pouvait se dérouler. Il a mis en avant son expérience de militant révolutionnaire en Inde, aux États-Unis et au Mexique.
Roy en tirait la conclusion qu'à la suite de la révolution mexicaine de 1910, les paysans étaient politiquement plus avancés que les travailleurs européens. Kundnani écrit :
« [Roy] pensait que l'Est et l'Ouest seraient des acteurs de premier plan sur la scène mondiale. Les travailleurs révolutionnaires des nations colonisatrices devaient agir de concert avec les travailleurs et les paysans révolutionnaires des nations colonisées. Ces deux forces doivent être coordonnées si l'on veut garantir le succès final de la révolution mondiale. »(62)
Au cours de la discussion, le point de vue initial de Lénine sur la nécessité d'un processus révolutionnaire en deux étapes dans le monde colonial a été abandonné au profit d'une approche qui envisageait une interrelation entre les luttes anticoloniales et les luttes anticapitalistes. En conséquence, les Thèses sur les questions nationales et coloniales arrivaient à la conclusion que la révolution n'était pas seulement possible dans les pays industrialisés, mais aussi dans ceux que l'Europe avait sous-développés.
Malheureusement, Kundnani ne traite pas des discussions qui ont eu lieu chez les révolutionnaires russes avant 1917. Alors que les socialistes s'accordaient sur la nécessité d'une révolution « démocratique bourgeoise » dans la Russie despotique, trois théories ont vu le jour.
Selon les mencheviks, les forces bourgeoises prendraient le pouvoir, ouvrant ainsi une période prolongée de garantie des droits démocratiques au cours de laquelle les conditions indispensables à une révolution socialiste pourraient se développer. Les bolcheviques, sous la direction de Lénine, ont élaboré le mot d'ordre de « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie », une formulation ambiguë : quelle force devait diriger la révolution ?
Trotsky avait un troisième point de vue : puisque la bourgeoisie était trop faible, corrompue et lâche pour résister à l'impérialisme, la révolution serait dirigée par les travailleurs en alliance avec les masses urbaines et rurales. Même si cette alliance devait réaliser des réformes démocratiques, elle se verrait obligée de prendre des mesures plus radicales. Ce processus révolutionnaire, connu sous le nom de théorie de la « révolution permanente », exigerait finalement une extension de la révolution à l'Europe occidentale, où le mouvement ouvrier était puissant.
Après la Première Guerre mondiale et la révolution russe, le débat a été tranché et transcrit dans les « thèses » du Comintern de 1920. En plus des références à la révolution « bourgeoise » française de 1789 et à la révolution socialiste de 1917, Kundnani relève que la révolution haïtienne éclaire cette compréhension.
Un troisième modèle révolutionnaire
Les Jacobins noirs de C.L.R. James (1938) est une étude de la révolution haïtienne (1789-1803), la seule rébellion d'esclaves victorieuse au monde. Il décrit comment le système d'oppression esclavagiste des plantations se maintenait « par la soumission en associant abaissement et dégradation avec la marque distinctive la plus évidente de l'esclave : la peau noire ». Les riches propriétaires étaient des entrepreneurs soucieux de maintenir leurs profits et leur pouvoir.
Pour James, le racisme n'est pas constitué d'un simple ensemble de croyances, mais de « règles sociales et politiques » qui rendent possible l'exploitation. Il est l'effet de la structure et non sa cause. En d'autres termes, James considère les préjugés racistes comme une variable, et non comme la cause première. (65, 68)
James en concluait que ce ne sont pas de simples préjugés qui permettent à ces propriétaires de plantations de terroriser et de déshumaniser leur main-d'œuvre, mais que pour que le travail soit rentable, les esclaves devaient être soumis à la coercition et privés de leur humanité. Il soulignait que c'est l'ordre social qui déshumanise la population d'esclaves. Cela renvoie à la prise de conscience par De Kom du fait qu'il était issu d'une souche subalterne.
Mais si les esclaves amenés d'Afrique étaient traités comme des êtres inférieurs, leur souvenir d'un monde d'avant la capture leur permettait de construire un récit alternatif. Cette culture, forgée à partir du besoin de maintenir une humanité collective dans l'avilissement, a permis aux esclaves haïtiens de se forger une idée de la liberté qui a soutenu leur résistance collective. Kundnani note que ce processus révolutionnaire fait écho au récit de W.E.B. DuBois sur la « grève générale » que les esclaves noirs ont menée contre les esclavagistes confédérés. Par cette lutte, ils ont non seulement obtenu leur libération, mais aussi contribué de manière décisive à la victoire dans la guerre de Sécession.
En conquérant leur liberté, les Haïtiens se sont inscrits dans un front commun contre l'aristocratie française. À ce titre, ils ont su tisser des liens avec les jacobins français. Mais lorsque la contre-révolution s'est abattue sur la France, cette alliance a été rompue et les Jacobins noirs ont été contraints de poursuivre leur chemin seuls.
Le modèle de la révolution haïtienne est une source d'inspiration, mais il est aussi porteur d'une mise en garde. La coopération entre les masses opprimées et les jacobins français a été interrompue. Kundnani ne mentionne pas le prix payé par les Haïtiens, mais le pays a été boycotté et contraint de payer 150 millions de francs français en guise d'indemnité pour des réclamations de propriété. Il a fallu plus d'un siècle à la nation pour rembourser cette dette, ce qui explique en partie pourquoi Haïti est aujourd'hui un pays déshérité et désorganisé.
Kundnani évoque brièvement les années passées par C.L.R. James aux États-Unis, où, en tant que membre dirigeant du SWP, il a rédigé la résolution de 1939 sur la lutte des Noirs. James considérait que le mouvement noir se situait au-delà de la lutte des travailleurs et qu'il possédait une dynamique propre. Kundnani explique qu'il ne s'agissait pas d'un raisonnement de nationaliste noir, mais que James considérait que « la lutte pour le socialisme et la lutte contre le racisme s'entrecroisent ». (72)
Lorsque Kundnani aborde la période des révolutions coloniales réussies qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, il ajoute à sa boîte à outils l'analyse d'Aimé Césaire sur la manière dont les colonisateurs imposent leur violence aux sujets colonisés.
Dans le Discours sur le colonialisme, Césaire souligne que les colonisateurs, pour se donner bonne conscience une fois leurs sévices accomplis, qualifient souvent d'« animaux » ceux qu'ils ont colonisés. Mais par là même, le colonisateur devient un animal. Césaire souligne que « c'est le système qui a fait le raciste et non l'inverse ». (75)
En outre, pour Césaire comme pour son élève Frantz Fanon, la violence est nécessaire pour conquérir et maintenir la domination sur autrui. Mais elle a pour conséquence d'empoisonner l'ensemble de la société. Si Hirschfeld n'a pas tiré cette conclusion de ses examens psychologiques de soldats allemands revenus d'Afrique,traumatisés par leur participation à la déportation des Hereros dans le désert de Kahari et la mort de 80% d'entre eux, Fanon, lui, l'a tirée de son expérience. Sa clinique en Algérie soignait aussi bien les torturés que les tortionnaires.
Fanon a compris la nécessité d'utiliser les outils de Marx pour analyser le colonialisme tout en tâchant d'« étirer légèrement » l'analyse qui en résulte. Si pour Marx et Engels, le prolétariat industriel était bien l'agent révolutionnaire, le colonialisme modifie cette conclusion sur plusieurs points.
Tout d'abord, Marx a analysé comment la base économique d'une société détermine sa superstructure idéologique. Pour Fanon, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit dans les colonies. Le colonialisme a imposé sa superstructure idéologique pour façonner la base économique de la colonie.
L'oppression va plus loin que la discrimination, c'est toute une « constellation sociale » qui dissimule la véritable nature de l'économie. Le racisme ne sert pas seulement à masquer les inégalités et la déshumanisation, il est une réalité matérielle à lui tout seul. Fanon a estimé que cette boucle de rétroaction peut se maintenir lorsque les sociétés coloniales accèdent à l'indépendance formelle.
En second lieu, le colonialisme a mis en place un moins grand nombre d'institutions éducatives et culturelles destinées à lubrifier les relations entre les classes, de sorte que la classe dirigeante doit dépendre davantage de la force directe de la police et de l'armée.
Troisièmement, la classe ouvrière des sociétés coloniales est peu nombreuse et relativement privilégiée. Cela minimise sa capacité à être un agent de changement. Fanon note également que les éléments bourgeois sont principalement liés au marché de l'exportation et n'ont donc que peu d'intérêt à développer la production pour nourrir, vêtir et loger la population.
En outre, Fanon a constaté que le capitalisme, en tant que système mondial, était en train de changer. Comme il était engagé dans un processus de restructuration, sa base économique et sa superstructure idéologique subissaient des altérations. Dans un monde post-colonial, le racisme et la violence qui l'accompagne devraient être dissimulés derrière des mécanismes économiques plus discrets.
L'évolution du capital racial
Kundnani s'intéresse à la manière dont le racisme évolue, depuis ce que Fanon appelle des croyances « vulgaires, primitives et simplifiées » (par exemple, la prétendue différence biologique) jusqu'au racisme caché derrière des lois et des règlements apparemment neutres. Dans l'Amérique de l'après-Jim Crow, les campagnes du gouvernement américain telles que la « guerre contre la drogue », la « guerre contre le terrorisme » et la guerre de plus en plus importante contre les immigrants sont des phénomènes où la couleur de la peau ou l'appartenance ethnique ne sont pas explicitement en cause, mais où un nombre disproportionné de personnes de couleur sont tuées, emprisonnées, exclues et expulsées.
Pour Kundnani, ce sont les travaux de James, Césaire et Fanon qui expliquent le racisme structurel. Celui-ci peut être considéré comme un ensemble de lois et de procédures qui opèrent à « un niveau plus profond et caché que les lois consignées dans les codes juridiques que les humains ont élaborés de manière consciente ».
Kundnani fait référence à des auteurs américains - de W.E.B. Du Bois à Martin Luther King, en passant par Coretta Scott King et Jamil Al-Amin (anciennement connu sous le nom de H. Rap Brown) - qui considèrent eux aussi que le racisme est structurel. Il note qu'en parlant des villes du Nord, Martin Luther King décrivait les communautés noires comme des « colonies internes » et préconisait des méthodes qui rappelaient les luttes africaines : boycotts, grèves des loyers, blocage de routes.
Mais aujourd'hui, nous prévient Kundnani, l'idée même que le racisme pourrait être structurel est rejetée par la droite, qui prétend que la discrimination ne peut être prise en compte que si son caractère « intentionnel » est prouvé.
Kundnani traite également du problème théorique que les marxistes ont rencontré lorsque le gouvernement du Parti national sud-africain a fait de l'apartheid sa politique officielle en 1948. Comme les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud était un pays indépendant dirigé par des descendants de colons blancs. Mais contrairement à ces autres pays industrialisés, la majorité de la population y était noire.
Lorsqu'ils ont étudié la structure économique et politique de l'Afrique du Sud après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de marxistes indépendants a mis en évidence un mode de gouvernement qui organisait une société capitaliste moderne pour la minorité blanche mais imposait des « réserves » à la majorité de la population . La surveillance, appuyée sur les « lois sur les laissez-passer », permettait de faire respecter l'apartheid.
Les hommes noirs étaient employés dans les usines modernes de construction automobile, de production d'acier ou de textile, ils étaient également un demi-million à travailler dans les mines, mais leurs familles restaient dans les zones rurales. La ségrégation raciale et la propriété « n'étaient pas une manœuvre idéologique destinée à manipuler les travailleurs blancs, mais constituaient plutôt l'infrastructure matérielle de l'ensemble des systèmes politiques et économiques sud-africains ». (131)
L'apartheid sud-africain était différent de l'oppression nationale qui bloque une économie colonisée - c'était une forme différente de colonialisme interne. L'apartheid, ont estimé ces marxistes dans les années 1970, « était la conséquence du développement capitaliste ».
Une brochure rédigée par Martin Legassick et David Hemson, intitulée Foreign Investment and the Reproduction of Racial Capitalism in South Africa (1976), affirmait que l'apartheid n'était pas le produit de préjugés irrationnels, mais l'aboutissement logique d'un système qui contrôlait les Africains et maximisait les profits. (Neville Alexander, qui a passé dix ans sur l'île de Robinson, Bernard Magubane et Harole Wolpe faisaient eux aussi partie du groupe de ces marxistes indépendants).
Dans les régions où vivaient les Africains, des communautés reposant sur des réseaux familiaux exploitaient les terres communales. La répartition s'effectuait selon les règles de la parenté et non selon les mécanismes du marché. L'existence de ces deux modes de production faisait en sorte que l'économie de subsistance subventionnait l'économie capitaliste. Ainsi que Kundnani a résumé leurs conclusions, l'apartheid était « la frontière idéologique et matérielle entre les deux systèmes distincts ». (132-137)
Contrairement à la façon dont l'économie capitaliste s'est développée en Angleterre, le capitalisme n'a pas éliminé la production précapitaliste, mais l'a placée dans une position subordonnée au sein de la structure capitaliste. L'échec de la généralisation du travail salarié est le produit d'institutions étatiques qui perpétuent le racisme, la violence et la coercition.
Le racisme n'était pas tant un héritage du passé qu'une force matérielle opérant dans le présent, « qui divisait le travail des Noirs et des Blancs sur le plan matériel comme sur le plan idéologique ». La conclusion qui en découle est que, selon les termes de Kundnani :
Il y avait donc peu de chances que les Noirs et les Blancs prennent conscience de leurs véritables intérêts communs, conformément au vieux mot d'ordre « unissez-vous pour lutter ». C'est plutôt une lutte autonome des Noirs contre le capitalisme racial qui s'imposait". (137)
Analyses complémentaires
Passant ensuite à l'analyse de l'œuvre de Cedric Robinson, Kundnani souligne son intérêt pour la manière dont le capitalisme utilise une variété de formes économiques pour contraindre sa force de travail. Le capitalisme n'était pas une force uniformisante, il était capable de mélanger des aspects préexistants avec les plus modernes, y compris l'esclavage, la servitude pour dettes, le travail « libre », le travail « contractuel » et le travail « occasionnel ».
Les divers types de relations au travail impliquaient des droits et des privilèges différents et augmentaient la profitabilité pour les capitalistes. Il y avait des barrières entre les citoyens et les non-citoyens, entre le travail libre et le travail non libre, entre ceux qui avaient des emplois protégés et ceux qui n'en avaient pas.
Robinson a avancé la thèse selon laquelle le racisme et le capitalisme n'étaient pas des systèmes autonomes dotés de leur propre dynamique, mais qu'ils se rejoignaient au sein d'une seule et même explication. Il en résulte que « le capitalisme n'a pas fait disparaître ces structures racistes préexistantes, mais les a au contraire intégrées dans un processus de médiation ». (143) Cela signifie que le capitalisme sud-africain n'était pas exceptionnel, mais révélait la réalité universelle du capitalisme racial. Cette analyse souligne le rôle de l'État dans le maintien des barrières.
Kundnani récapitule ainsi les deux questions centrales qui préoccupaient Robinson : trouver les origines du racisme et déterminer comment le racisme continue à se reproduire. En situant les « sensibilités racistes » dans le regard que les Européens portent sur les Slaves, les Irlandais, les Juifs et les Musulmans, au moins depuis le XIIe siècle, Robinson a retracé l'évolution du racisme. Il a identifié son impact à la fois sur les relations de production et sur les formes de conscience.
Pour Robinson, le racisme ne naît pas avec le capitalisme mais précède la traite transatlantique et le colonialisme. L'histoire des origines du racisme met en lumière sa capacité à conserver son emprise dans la durée.
Si Robinson a pu montrer que l'évolution de l'économie capitaliste modifiait les formes de racisme, il a également observé que le racisme était capable de se régénérer. Il en déduisait que le racisme ne pouvait s'expliquer en termes de relations de propriété et de travail, mais qu'il trouvait son origine dans « la transmission des normes culturelles occidentales ». (145)
Mais considérer le capitalisme racial comme un système homogène ne conduit pas à mettre en veilleuse la lutte contre le racisme. Pour Robinson, une voie vers la révolution passait par la « tradition radicale noire ». Cette solution était envisageable dans la mesure où la façon dont elle concevait la « propriété » était différente de celle qui dominait à l'Ouest.
Pour Stuart Hall, un Jamaïcain qui a émigré très tôt en Angleterre, le capitalisme est une construction complexe qui doit composer avec des modes de production et des systèmes juridiques variés. Le racisme a pour fonction - au moins de manière temporaire - de faire paraître naturel le fait que certains groupes ne soient pas libres, en occultant le processus historique qui a conduit à leur déficit de liberté.
Contrairement à Robinson, Hall ne considérait pas que le racisme était ancré dans la culture occidentale, mais il pensait qu'il lui était nécessaire pour survivre de se remodeler à chaque nouvelle génération. L'histoire ne fournit pas la réponse à la persistance du racisme. Il faudra la faire apparaître dans les relations interraciales qui sont directement liées à des processus économiques bien précis : « Les attitudes et les croyances racistes découlent de la division raciale du travail dans le capitalisme ; elles ne la produisent pas. » (151)
En d'autres termes, Hall - l'un des fondateurs et rédacteurs en chef de la New Left Review - n'était pas intéressé par l'identification du « moment fondateur » du racisme, qu'il s'agisse de la défense de l'esclavage par Aristote ou des conséquences de la rébellion de Bacon dans la Virginie du XVIIe siècle (th ). Le passé ne peut servir d'alibi au présent. Nous devons nous pencher sur la manière dont le racisme fonctionne dans le monde d'aujourd'hui.
Hall a examiné les niveaux de discrimination auxquels les immigrants afro-caribéens et sud-asiatiques étaient confrontés au sein d'une classe ouvrière britannique stratifiée et intérieurement antagoniste. Cela pourrait avoir pour conséquence qu'eux-mêmes ou leurs enfants fassent partie de la population « excédentaire » qui fait l'objet d'une surveillance policière. Dans ce cas, les relations raciales pourraient remplacer la classe sociale en tant qu'élément structurel du travail segmenté. Comme l'écrit Hall dans Policing the Crisis : Mugging, the State, and Law and Order (1978) : « La race est la modalité dans laquelle la classe est vécue ». (154)
Quelques conclusions
Dans sa conclusion, après étude de ces écrivains militants, Kundnani constate que le racisme a la capacité de se modifier lui-même. Il commence par citer A. Sivanandan, le fondateur et rédacteur en chef de Race and Class :
« Le racisme ne reste pas figé ; il change de forme, de dimensions, de contours, d'objectifs, de fonctions - avec les changements dans l'économie, la structure sociale, le système et, surtout, les remises en question, les résistances au système ». Le racisme n'a survécu qu'en s'adaptant et en se reconfigurant constamment en fonction des résistances. Comme les traces de ces résistances se retrouvent toujours inscrites dans les structures, le racisme ne peut être bien compris sans prendre en considération ses ruptures autant que ses continuités. Pour avoir quelque chance de succès, l'antiracisme ne peut ni se contenter de discours abstraits, ni refaire les batailles du passé ; il doit se confronter à la singularité du contexte dans lequel il s'inscrit". (151-152)
Que je sois ou non d'accord avec la façon dont Kundnani retrace une partie de l'histoire qu'il retrace, son approche représente une perspective matérialiste bien étayée. Il va de soi que, même si la race peut être étroitement assimilée à la classe, les antiracistes sont bien avisés de faire la distinction.
En tant qu'ancien membre du SWP, j'ai constaté que les écrits de Trotsky et de C.L.R. James m'aidaient à considérer que la classe et la race étaient liées, mais pas identiques. Les discussions qui ont eu lieu en 1939 au Mexique entre Trotsky et les dirigeants du SWP (dont James) ont non seulement clarifié ce lien, mais en ont aussi aussi conclu que les Afro-Américains étaient « potentiellement l'élément le plus révolutionnaire de la population ».
Malgré la rapide évocation des écrits de Claudia Jones sur l'oppression des travailleuses noires, Kundnani n'intègre pas la dynamique de l'oppression de genre dans ce récit. Même si cela aurait donné un livre beaucoup plus long, cela laisse de nombreuses questions sans réponse.
Les derniers chapitres du livre décrivent comment le capitalisme dirige le monde et remodèle le racisme pour répondre à ses besoins propres. Ce caractère inégal et combiné peut être résumé par la géographe radicale Ruth Wilson Gilmore comme suit : « Le capitalisme exige l'inégalité et le racisme la consacre. » (149)
Comme le souligne Stuart Hall, le capitalisme déguise le racisme à travers ses règles apparemment neutres. Il est encadré par des limites, qu'il s'agisse de frontières ou de prisons, ce qui nécessite un appareil de sécurité pour les faire respecter.
Avant que le « siècle scientifique » des Lumières n'apporte des explications rationnelles, l'inégalité était simplement une réalité vécue. Mais une société où tout le monde semble avoir les mêmes droits se doit d'expliquer les exceptions. Quoi de plus « naturel » qu'une explication enracinée dans une différence physique ou ethnique ?
Kundnani reproche à l'antiracisme libéral son incapacité à comprendre ce piège. Il relie cette compréhension limitée du racisme aux anciens programmes sociaux-démocrates du New Deal américain et du gouvernement travailliste britannique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ces programmes ont soit créé des exceptions, soit ignoré purement et simplement les « structures juridiques et politiques, ainsi que les pratiques économiques et institutionnelles plus généralement répandues ». (250)
On pourrait toutefois se demander quelle est la force de l'agent révolutionnaire aujourd'hui. Nous pouvons certes mettre en avant le rôle de premier plan que jouent les populations autochtones dans les luttes environnementales à travers le monde. Et comme les esclaves haïtiens, ils ont eux aussi un passé qui leur permet d'imaginer un avenir non capitaliste.
Si les exploité.e.s et les opprimé.e.s ont la capacité de transformer le monde, le slogan qui continue à sauter les frontières est celui de Lénine et de Roy : « Travailleurs du monde et peuples opprimés, unissez-vous ».
L'auteur appelle de ses vœux « un rouge plus foncé » et rappelle le propos de Césaire selon lequel il existe deux pièges : la ségrégation par des murs et la dilution dans l'universel. Au lieu de cela, Césaire imagine un universel « enrichi de tout ce qui est particulier ». (251) Le dernier paragraphe du dernier chapitre dresse le tableau d'une immense marche où des contingents distincts rejoignent la même destination.
« What Is Anti-racism ? And Why It Means Anti-capitalism » constitue une récapitulation de la manière dont le racisme est ancré dans la culture de l'impérialisme et remodelé à chaque génération. L'objectif de cette analyse est de mettre en lumière les lois et les politiques « neutres » qui lui permettent de prospérer. Plus que toute autre chose, cela veut dire qu'il faut se donner les moyens appropriés pour en finir avec lui.
Dianne Feeley
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec DeepLpro.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Adresses : internationalisme et démocratie : Introduction au numéro 2

Un petit saut dans le temps : octobre 1956. Hongrie/Égypte. Les violations du droit international des uns facilitent les violations du droit international des autres. En réponse à la révolte des populations hongroises contre l'ordre imposé par le gouvernement « communiste », les troupes soviétiques envahissent Budapest et d'autres régions hongroises.
Pour lire le numéro, cliquez sur l'icône :
« Force impériale » contre la liberté et la démocratie avec le soutien des différents partis communistes à travers le monde. L'idée même de solidarité internationale était fortement écorchée par ce mépris de la démocratie et de l'autodétermination des populations. Le campisme, les chars comme quelques années plus tard le mur de la honte contribuèrent à briser l'espoir d'un avenir commun.
Le nouveau pouvoir en Égypte nationalise la société qui exploite le canal de Suez. Les forces armées de la Grande-Bretagne, de la France et d'Israël (il n'y avait pas alors de ministres d'extrême droite comme aujourd'hui) interviennent militairement contre Égypte.
« Force impériale » et affiliés contre le droit des peuples à décider par et pour eux-mêmes. En intervenant au côté de puissances coloniales, le gouvernement israélien, comme il le fera plus tard en défendant l'apartheid en Afrique du Sud, affiche clairement son orientation.
Dans un cas comme dans l'autre, des États étrangers interviennent contre le droit d'un peuple. Hier comme aujourd'hui, certain·es préfèrent choisir de soutenir un « camp » plutôt que le droit inaliénable des peuples…
Un tel choix ne relève ni du réalisme, ni de simples choix « idéologiques ». Un pareil choix sape les solidarités humaines et toute légitimité politique. Il contribue à fermer les voies de l'émancipation possible de toutes et tous.
Si certain·es ne veulent toujours pas soutenir les populations ukrainiennes et leur résistance contre l'invasion armée de la Fédération de Russie, toujours pas soutenir les refuzniks et les réfractaires en Russie et au Bélarus, les autres ne veulent pas stopper immédiatement l'intervention de l'État d'Israël à Gaza malgré la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (CIJ). Massacres et violences sexuelles, probables crimes de guerre, possibles crimes contre l'humanité (crimes relevant de la Cour pénale internationale – CPI). Nul·le ne devrait se taire quels qu'en soient les auteurs et les complices : colons israéliens, hiérarchie militaire et membres du gouvernement israélien, membres des bandes armées du Hamas ou autres, industriels et gouvernements livreur d'armes.
- Impérialisme et colonialisme, quels sens ont eu ces mots, comment analyser la domination d'un État sur un autre État ou sur des populations assujetties ?
- Faisons un détour par l'histoire de l'Irlande, de sa colonisation par l'Angleterre. Quels sont les effets produits sur les populations colonisées comme sur les populations du pays colonisateur ?
- Mais qu'en est-il aux marches des empires, par exemple de l'empire tsariste, de l'URSS après la révolution d'octobre puis la dictature stalinienne, de la Fédération de Russie au capitalisme autoritaire ?
Il faudrait aussi revenir sur les pays à décoloniser (liste des territoires non autonomes selon l'ONU), dont par exemple la Nouvelle-Calédonie/Kanaky et Mayotte (séparée des Comores en violation du droit international, un peu comme la Crimée par Vladimir Poutine). Parler de colonisation, de décolonisation, implique aussi de parler de son propre pays… et de débattre de la polysémie des mots et des notions employées par les un·es et les autres…
Aujourd'hui, si le capitalisme domine sous diverses formes tous les continents de la planète, les contradictions ne cessent de s'accumuler. Les regroupements des États par pôles « les collaborations contradictoires et conflictuelles » entre eux, l'importance prise par les grandes entreprises multinationales, l'allongement et la complexification des chaînes de production de la valeur, le rôle désormais politique et déterminant des GAFAM participent ensemble à la montée des conflits, à la marche à l'armement sinon à la guerre.
Il y a, aujourd'hui encore, beaucoup d'illusions réelles ou entretenues sur les modalités de construction et de fonctionnement politique des BRICS+. Le peu de place (un euphémisme) accordée à la démocratie politique et sociale ou à l'autodétermination des peuples en est une, la référence aux « pays non alignés » en est une autre. Sous couvert d'indépendance, de rupture avec l'« impérialisme dominant » se crée sous nos yeux un collectif de dictatures plus ou moins maquillées. Laissons l'illibéralisme aux illettré·es. Ce nouvel alignement doit être étudié précisément.
Il n'est pas non plus inutile de rafraîchir nos mémoires avec des débats plus anciens portés par exemple par Otto Bauer ou Rosa Luxemburg…
Restent des apories dans les projets résolument internationalistes et démocratiques. Penser une construction d'éléments de droit international, définir la défense des droits des êtres humains comme cadre général, imaginer une souveraineté populaire non réductible aux États sont des défis qu'il convient aussi de relever.
Enfin, si, comme indiqué depuis le numéro 0, « Cette revue en devenir n'a pas (encore) de comité de rédaction », au-delà de discussions collectives dans divers réseaux, il fallait en assumer les premiers numéros. Ce que nous avons fait à trois, Didier Epsztajn, Michel Lanson et Patrick Silberstein. Trois, ce n'est pas beaucoup… et c'est peu divers.
Il faut donc avancer pour répondre à toutes celles et à tout ceux qui nous ont fait part de leur intérêt pour notre démarche.
Avancer, c'est offrir la possibilité aux lecteurs et aux lectrices et aux futur·es collaborateurs et collaboratrices de se rencontrer et d'échanger sur les positions qui ont fait accord, en particulier sur l'Appel pour une gauche démocratique et internationaliste.
Les 25 et 26 mai, au Maltais rouge, Adresses avec Left Renewall organise des Rencontres internationalistes avec des « ateliers » sur Israël/Palestine, urgences démocratiques, colonialisme et antisémitisme et la guerre en Ukraine, résistance d'un peuple à l'impérialisme russe et potentialisation de la lutte de classe en temps de guerre.
Un débat sur l'avenir de la revue Adresses conclura les travaux de ces deux jours.
À vos agendas et faites-nous connaître, dès maintenant, votre participation sur notre mail pour une meilleure organisation de ces rencontres.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Libre fil

Le vent souffle
Un fil, emporté, ondule,
Puis s'échoue dans les ramures d'un arbre dénudé
Où d'autres fils le rejoignent peu à peu.
Ils sont là, imbriqués, soudés,
Par la tempête.
Qu'adviendra-t-il du fil libre,
Unique, précieux ?
Déjà, on ne le distingue plus
Dans l'amas tortueux
Gainant l'arbre,
Tissé serré.
J'aime que la trame soit souple
Que la lumière traverse, laisse deviner, caresse,
Hors du lycra moulant, étouffant, de nos sociétés,
Que les idéaux s'ouvrent aux débats,
Que le fil ait de l'espace,
Qu'il aille librement,
Sans qu'une main lourde
Lui assigne une place.
J'aime les mailles à l'envers,
Les voiles ajourées,
Qui dévoilent et préservent
Notre mystère,
Notre singularité,
Notre différence,
Notre liberté.
Tant mieux si tout ça fait étoffe,
Tant mieux si tout ça forme nous,
Un nous en mutation,
Tissé, peut-être,
Mais pas trop serré
Manon Ann Blanchar
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Après l’entrisme, bientôt l’auto-critique ?
Que d'émotions la semaine dernière. Assez pour me sortir de mon détachement de la politique québécoise. La « gang à Gab » – expression forgée par la dissidence de Québec solidaire – a enfin tombé les masques. Plus le choix. L'enfumage systématique ne pouvait plus passer. On a vu trop tard la pente glissante nationaliste. Plus tard a été déchiffré le virage électoraliste. Et dernier coup de théâtre médiatique : la révolution citoyenne solidaire sera finalement… sociale-démocrate ! Le modèle contre lequel Québec solidaire a été précisément créé.
L'empathie aura duré une journée pour un GND, « ébranlé ». Bientôt flanqué de sa future co-porte-parole féminine pragmatique par intérim, il s'est et a assumé : QS doit changer de fond en comble. D'une pierre deux coups : on tente de reprendre le contrôle du narratif et on joue à quitte ou double (moi ou le déluge). Coky.
Ça ne vous étonnera pas, j'avais compris le stratagème entriste après la fusion avec Option nationale1. Mais avant ça, je n'ai pas cru les personnes qui prévenaient. Je tiens à m'excuser auprès d'elles. Parce que j'ai lutté contre elles avec les mêmes armes qu'eux.
Après mon départ de QS2, on ne m'a pas cru non plus.
Heureusement que je suis privilégié : je n'ai eu le droit qu'aux procès d'intentions complotistes et au tone policing. Mes ami·e·s ex-solidaires – dont certain·e·s ont fait élire une partie de la députation grâce à leur travail gratuit – ont souffert tellement ! Et leur souffrance se réveille encore à chaque épisode, car le déni continue. Ça les a même dégoûtés de la politique.
Moi je le croyais aussi, être dégoûté de la politique. Mais fuir l'aliénation des réseaux sociaux, mettre en pause mon travail syndical non local, se repassionner pour la politique française et étasunienne… tout ça m'a fait un bien fou. Moins de colère. Et l'envie de participer à nouveau aux débats de la gauche québécoise, toujours avec irrévérence.
Des souffrances non reconnues
Depuis 2017, nombreux·ses sont les militant·e·s qui ont alerté sur la manière d'être traité. Les personnes qui osaient parler ou dévier d'un pouce, étaient ramenées à leur place par un système de gaslighting interne et externe, y compris publiquement quelques fois. Souvenons-nous du Collectif antiraciste décolonial, ce ramassis de « wokes victimaires importé·e·s » expliquant qu'à QS, les militant·e·s racisé·e·s n'ont que la place qu'on leur donne.
Malgré ces alertes, l'aveuglement volontaire l'a emporté sur ce que des militant·e·s sans pouvoir questionnaient : le harcèlement et les discriminations systémiques découlant de la gestion des ressources humaines3 et militantes du parti. Pas capable de simple humanisme. Pourquoi ?
Car leur projet pour sauver le Québec est plus important que les sorties médiatiques contre les camarades (sic.), même si cela vaut à ces derniers des tombereaux d'insultes4 et de menaces de mort. Sur ça aussi, les personnes dirigeantes ont été alertées. Ignorance intentionnelle.
La fin justifie les moyens
Ainsi, la purge des « problématiques » s'est déroulée trop d'accros, aidée de l'alliance objective avec la classe médiatique, y compris la plus nauséabonde : journaux poubelles, twitto(facho)sphère et autres trolls. Le moulinet de la déradicalisation5 et de la respectabilité s'est porté comme un charme : décoloniaux, autochtones6, anglos, travailleuses du sexe7, fédéralistes (ou non-alignés, mais c'est pareil, puisqu'anyway « y'en a pas de fédéralistes à QS »). Récemment, c'était le tour des personnes trans et/ou migrantes8, puis des féministes (puisque leur co-porte-parolat est un boulet).
Au nom du Pays et donc on l'aura compris du « pragmatisme », c'était éthique d'engager juste les potes, de prendre et d'accaparer le pouvoir au sein d'un parti « irréaliste » qu'on n'a pas fondé. Notamment à l'aide de toutes les techniques de disqualification et de domination des classes dominantes : projection, dénigrement, rumeur, convocation, censure, favoritisme, cooptation, népotisme, diffamation, intimidation, mensonge, cyber raid, procès à charge, menace verbale et judiciaire, conciliation de grief.
Tout ça, la conscience tranquille, boss !
J'espère sincèrement que d'autres victimes oseront témoigner.
Pragmatisme néo-solidaire : les jeux sont-ils faits ?
Il y a deux étapes à passer pour rendre QS « gouvernemental » et sous la coupe définitive du clan des spin doctors9.
La première : la réforme de ses statuts et de son programme. Il parait que les régions québécoises sont pas assez vites pour les comprendre. Il faut donc simplifier pour accélérer 10. On verra aux prochaines instances nationales de QS si les délégué·e·s accepteront ce hold-up patiemment travaillé en coulisse.
À la seconde étape – les élections provinciales de 2026 – la question nationale11 va probablement être à nouveau au centre du jeu politique (si la tendance se maintient). PSPP ne pourra pas prendre le risque d'une victoire plus courte que prévue.
Si GND gagne son pari, l'accord électoral avec les péquistes, qu'il désire depuis si longtemps, semble inexorable12. Les signes religieux risquent d'en prendre un nouveau coup13, mais des ministères seront négociés. C'est mieux que des amendements, pensent-on…
Si GND ne réussit pas son pari, la question nationale divisera quand même la gauche, et QS devra se régénérer.
Dans les 2 cas, quelles options pour les personnes non nationalistes de la gauche québécoise ? L'abstention ou la résignation comme en 2022 ? Comment convaincre la moitié des personnes qui votent ou votaient pour QS de recommencer après la brutalisation vécue, aperçue et maintenant sue ? Comme Jean-François Lisée le souligne avec une délectation légitime : quel espace politique pour ce « 2ème PQ » ?
J'y reviendrai bientôt.
En attendant, un examen de consciences s'impose. Ils doivent bien ça à toutes les personnes rabaissées par l'autoritarisme et calomniées par la meute.
Notes
1.Clin d'œil à JP… La flottille : la classe. Et merci sincèrement d'avoir essayé !
3. Je ne vous parle même pas des négociations syndicales internes, on pourrait en faire cas d'école de duplicité.
4.En même temps, pour les québécoises qui portent un signe religieux, c'est random.
5.https://www.pressegauche.org/Quebec-solidaire-de-radicalisation
8.https://onjase.org/post/2019/03/15/408-L%E2%80%99insoutenable-legerete-des-droits-fondamentaux
9.https://pivot.quebec/2024/05/02/le-menage-du-printemps/
10.https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2024-05-04/caq-qs-et-le-syndrome-de-la-locomotive.php
12. https://www.pressegauche.org/LES-SOLIDAIRES-A-LA-CROISEE-DES-CHEMINS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les combattant.tes en Amérique latine : la lutte périlleuse pour le droit à l’avortement
Les deux nations interpénétrées
Dans mon texte de la semaine dernière, je mentionnais "l'imposture multiculturaliste". J'utilisais le concept des deux nations, le Québec français et le Canada anglais qui forment la trame politique et culturelle très contrastée du pays, ou plutôt des deux pays qui se côtoient dans un État : le Canada.
J'écrivais :
"La persistance du nationalisme québécois sous sa forme autonomiste et souverainiste contredit les thèses du courant d'idées multiculturaliste. Une simple observation pour quiconque a déjà fait le tour du Canada permet de constater la réalité des deux nations." Je devrais ajouter trois si on compte les membres des Premières nations.
Ce qui permet aux tenants et aux tenantes du multiculturalisme de tenir leur discours, c'est qu'il existe des francophones hors Québec et des non francophones au Québec même. Or, nous ne sommes pas en présence de groupes homogènes dans un cas comme dans l'autre. Plusieurs francophones en dehors de la "Belle Province" sont voués à l'assimilation à la société majoritaire anglophone, quand ce n'est pas déjà fait. Examinons cela de plus près.
On retrouve au Canada anglais des Québécois et Québécoises allés s'établir là pour des motifs professionnels ou personnels à une date récente. Ils forment de petits groupes dispersés, très minoritaires et obligés par la force des choses de s'assimiler à la majorité anglophone qui les entoure. D'autres francophones plus nombreux, eux aussi d'origine québécoise vivent eux aussi au Canada anglais depuis quelques générations (et parfois depuis plus longtemps encore). Ils utilisent encore leur langue à la maison parce qu'ils sont assez nombreux ; à force de pressions, ils ont obtenu des institutions sociales et culturelles comme des commissions scolaires et des bibliothèques. Leur situation varie donc au gré des rapports de force qu'ils sont arrivés à établir avec les autorités locales et régionales. Mais ils doivent souvent lutter pour conserver leurs modestes avantages.
Ensuite, il faut souligner qu'on oublie souvent les importantes minorités historiques suivantes : les Acadiens des Maritimes et les Métis de l'Ouest, en particulier ceux de la Saskatchewan.
Les premiers, regroupés surtout au Nouveau-Brunswick, sont des francophones de vieille souche, descendants des Acadiens et Acadiennes déportés par les Britanniques de l'actuelle Nouvelle-Écosse en 1755. Il en subsiste encore quelques groupes dans cette dernière province. Au Nouveau-Brunswick, on les rencontre surtout le long du golfe, de Bouctouche environ à Caraquet.
Les Métis, eux, vivent surtout en Saskatchewan et dans une moindre mesure au Manitoba. Ils descendent d'unions entre voyageurs canadiens et Amérindiennes aux dix-huitième et dix-neuvième siècles. Ceux et celles qui ont conservé le français sont assez peu nombreux mais ils affirment tout de même une présence francophone en plein milieu du Canada anglais.
On note ailleurs la présence d'autres communautés francophones qui sont arrivées à continuer de pratiquer leur langue et qui possèdent certaines institutions comme des bibliothèques, à Vancouver par exemple.
Toutes ces communautés francophones hors Québec affichent une conscience très vive de leur spécificité. Elles considèrent le Québec comme une espèce de grand frère de qui elles attendent soutien et encouragement. Pendant longtemps, Québécois et Québécoises les ont vues comme une extension nationale hors de leurs frontières. On est bien loin du multiculturalisme à la Trudeau.
Passons maintenant aux non francophones du Québec.
Ils se divisent en deux groupes principaux : ceux de vieille souche (anglo-saxonne et certaines communautés comme les Italiens et bon nombre de Chinois) d'une part, et d'autre part ceux arrivés assez récemment, en particulier de Grèce, ou plus récemment encore d'Asie, comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Certains de ces derniers éprouvent des difficultés à s'intégrer à la majorité francophone pour différentes raisons mais pas forcément à cause d'une mauvaise volonté réciproque. Il faut bien le dire aussi : en Amérique du Nord, l'anglais est la "lingua franca", la langue des affaires et de la promotion sociale.
Ceux qui s'assimilent le plus volontiers aux francophones semblent être ceux qu'on appelle les Latinos, c'est-à-dire les gens d'origine latino-américaine, peut-être en raison d'affinités culturelles.
Pour conclure, chaque nation principale au Canada possède donc ses "succursales" ou encore ses "antennes" au sein de sa voisine : pour le Québec, les francophones au Canada anglais et pour celui-ci, les non-francophones au Québec.
Ironiquement, leur présence respective confirme la thèse des deux nations bien plus que celle, éculée, du multiculturalisme.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
« VEYE YO ! PINGA ! » – Déclaration de la diaspora haïtienne
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











