Derniers articles

Pourquoi je reprends le slogan « Du fleuve à la mer » ?

Les partisans de la libération de la Palestine scandent le slogan « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » depuis de nombreuses années. Moi-même, défenseur juif de l'égalité humaine – membre de Independent Jewish Voices Canada –, je me suis rallié avec enthousiasme à cette devise pendant des décennies.
Tiré d'À l'encontre.
Larry Haiven est professeur émérite en sociologie du travail à l'université Saint Mary's, à Halifax, en Nouvelle-Ecosse. Il est membre du comité exécutif de Independent Jewish Voices Canada.
Cependant, depuis le 7 octobre 2023, les défenseurs d'Israël ont commencé à insister sur le fait que le slogan est antisémite, qu'il s'agit en fait d'un appel au massacre ou à l'anéantissement des Juifs.
En fait, un député (Kevin Vuong, de la circonscription électorale Spadina-Fort York, Ontario) a déposé une pétition signée par 13 000 Canadiens demandant que le slogan soit considéré comme un discours de haine.
Rendre toute critique d'Israël « schtumm »
Il y a deux façons diamétralement opposées de considérer cette accusation.
La première consiste à prendre cette accusation comme la calomnie ridicule qu'elle est. Il est certain que l'appel à la « liberté » est un simple appel à l'égalité des droits civils pour les Juifs et les Palestiniens dans l'Etat d'Israël et dans les territoires occupés, quelle que soit la configuration politique que ces territoires prendront à l'avenir.
Les Palestiniens de Cisjordanie sont constamment persécutés depuis la guerre des Six Jours de 1967, avec la confiscation pure et simple des terres par Israël, la détention arbitraire, la torture et l'humiliation quotidienne, voire la mort aux mains des forces armées israéliennes et des colons fanatiques.
Gaza est soumise, au mieux, à un blocus étouffant et à un enfermement terrestre, aérien et maritime. Au pire, elle fait l'objet d'un génocide et d'une famine périodiques, comme c'est actuellement le cas.
Et même au sein de l'Etat d'Israël, 20% de sa population sont des Palestiniens – des citoyens d'Israël qui souffrent, comme le décrit Human Rights Watch qui, de paire avec l'organisation israélienne B'Tselem et Amnesty International, d'« apartheid » :
« une structure de citoyenneté à deux niveaux et une scission de la nationalité et de la citoyenneté [qui] font que les citoyens palestiniens ont un statut inférieur aux citoyens juifs en vertu de la loi. Si les Palestiniens d'Israël, contrairement à ceux des territoires palestiniens occupés (TPO), ont le droit de voter et de se présenter aux élections israéliennes, ces droits ne leur permettent pas de surmonter la discrimination institutionnelle à laquelle ils sont confrontés de la part du même gouvernement israélien, notamment les restrictions généralisées d'accès aux terres qui leur ont été confisquées, les démolitions de maisons et les interdictions effectives de regroupement familial. »
Ainsi, le slogan « De la rivière à la mer… » peut être considéré comme aussi innocent que n'importe quel poème, chanson ou slogan qui promeut les droits de l'homme. La tentative de le qualifier d'antisémite fait partie de la campagne bien orchestrée par les fervents partisans d'Israël pour rendre toute critique d'Israël « schtumm » [en yiddish : muet dans le sens de ne pas divulguer d'information], silencieuse, pour transformer le discours, et pour supprimer notre aptitude à parler de la Palestine et de son peuple.
Et ce slogan semble bien timide comparé aux chants des partisans du ministre israélien Itamar Ben-Gvir, récemment rapportés par le journal israélien Haaretz :
« Ils ont entonné des chants et des slogans racistes au cœur de la vieille ville, notamment des refrains tels que “Shoafat s'enflamme”, “Un Juif est une âme, un Arabe est un fils de pute”, “Mort aux Arabes”, “Mahomet est mort”, et “Que leur village brûle”. » [Voir aussi l'article d'Oren Ziv sur la « marche annuelle des drapeaux » publié sur le site alencontre.org]
Plus inquiétant
Mais il y a une autre façon, plus inquiétante et plus cynique, de voir « From the River… ». Peut-être que les partisans d'Israël savent quelque chose que nous ignorons. Peut-être ont-ils une autre façon de définir le terme « libre ».
Prenons l'exemple de l'hymne national israélien « Hatikvah » (ou « L'espoir »). Les paroles originales ont été écrites en 1878 par Naftali Herz Imber, un poète juif né dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui a émigré en Palestine ottomane. Ses paroles exprimaient le désir ardent des Juifs de retourner sur la terre de Sion. Lorsqu'il a récité la Hatikvah devant les premiers colons juifs, l'un d'entre eux l'a accompagnée d'un vieil air roumain et le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire.
J'ai appris cette chanson lorsque j'étais enfant dans mon Talmud Torah, ou école hébraïque [instruction religieuse], à Toronto, dans les années 1950. Nous la chantions tous les jours au début de la classe. Nous la chantions également lors des mariages et des bar mitzvahs [communion pour les garçons à 13 ans] et bat mitzvahs [communion pour les filles à 12 ans].
Il y a un vers dans Hatikvah : « Lihyot am chofshi beartzenu. Eretz Zion. Yerushalayim. » Traduite en français, cette phrase signifie « Etre un peuple libre sur notre propre terre. La terre de Sion, Jérusalem. »
Cette phrase de la Hatkvah mentionnant le mot « libre » n'était-elle donc qu'un appel à l'égalité des droits pour les Juifs dans le Yishuv (la « Terre sainte ») ? Peut-être s'agissait-il d'un appel à l'égalité et à la coexistence entre Juifs et Palestiniens ?
Pas dans votre conception. Au fil des ans, l'histoire a prouvé ce que ces mots de la Hatikvah signifient réellement, du moins pour les dirigeants israéliens et leurs partisans. Ce que « Lihyot am chofshi beartzenu » signifie réellement dans la pratique, c'est l'expulsion active et la dépossession, le nettoyage ethnique – partout où c'est possible et de quelque manière que ce soit – des Palestiniens de leurs terres ancestrales. Il s'agit de s'emparer d'un maximum de territoires avec un minimum de population palestinienne, voire aucune. Du Jourdain à la Méditerranée.
Le parti politique israélien fondé en 1948 par Menahem Begin – terroriste de l'Irgoun [organisation militaire nationale de la droite sioniste, née en 1931 et dirigée dès 1943 par Menahim Begin] – s'appelait d'ailleurs le parti Hérout (« Liberté »). Begin a été élu Premier ministre en 1977. Le parti Hérout s'est ensuite transformé en Likoud, dirigé par l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahou.
Ainsi, lorsque les partisans d'Israël entendent le mot « libre », ils paniquent. Ils se réfèrent automatiquement à ce que le mot « libre » de la Hatikvah a fini par signifier dans la realpolitik israélienne, et ils nous transmettent leur interprétation.
Quelqu'un a-t-il qualifié ces mots dans la Hatikvah pour ce qu'ils représentent réellement ? Non.
D'une certaine manière, il est tout à fait acceptable que les Juifs chantent la liberté dans le pays et que les gens ignorent ce que cela signifie réellement. Mais lorsque les Palestiniens et leurs alliés expriment des paroles similaires, l'accusation calomnieuse d'antisémitisme est lancée, et dans certains milieux, elle est crue.
Soutenir la liberté
Il y a quelques années, lors d'un rassemblement, un organisateur palestinien m'a demandé de revoir sa liste des chants. J'étais flatté du respect qu'il me témoignait et heureux de lui donner des conseils. L'un de ses chants était « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». Je lui ai dit qu'à mon avis, ce n'était pas antisémite, mais que certains fervents supporters d'Israël le qualifiaient ainsi. Il m'a répondu : « Oh, je vais laisser celle-là de côté. J'en ai beaucoup d'autres. »
A l'époque, j'étais satisfait qu'il laisse ce chant de côté. Je pense que beaucoup de choses qualifiées d'antisémites par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA-Centre for Israel and Jewish Affairs), B'nai Brith (plus vieille organisation juive) et le Centre Simon Wiesenthal n'ont absolument rien à voir avec cela. Mais il est parfois politique de faire preuve d'une certaine discrétion et de ne pas être délibérément provocateur. Il existe tant d'autres moyens efficaces de critiquer la politique et les actions israéliennes et de soutenir la Palestine. Parfois, le simple fait de souligner les exactions israéliennes suffit. En dire plus, c'est renchérir.
Mais les choses ont changé. Quelles sont les choses qui ont changé ? Environ 40 000 choses. Les gens, bien sûr. L'ampleur de la sauvagerie israélienne à Gaza, sans parler des destructions innommables commises par les colons et les forces israéliennes en Cisjordanie, exige que nous affinions notre langage et que nous renforcions notre rhétorique.
Et c'est précisément parce que les chantres d'Israël insistent vicieusement sur le fait que le slogan « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre » est antisémite qu'il y a une bonne raison de reprendre ce slogan, de se l'approprier à nouveau et de marcher fièrement en son nom.
Article publié sur le site canadien Bullet le 11 juin 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La décision du ministre Charrette dans le dossier de Stablex est plus qu’irresponsable

Le masque de la CAQ tombe enfin. Le parti de François Legault s'assume maintenant ouvertement et sans complexe comme étant du côté des gros pollueurs.
Le jupon dépasse. Question d'en ajouter, le ministre Charrette fait désormais dans l'intimidation face à la mairesse de Blainville et brandit des menaces d'expropriation, sous de fausses mises en garde que des problèmes résulteraient de la rupture du service d'enfouissement de déchets toxiques.
En plus d'utiliser un discours trompeur à propos de la fausse sécurité du procédé de Stablex, qui, rappelons-le, a été breveté, puis abandonné en Grande-Bretagne pour non-conformité, le ministre passe outre les recommandations du BAPE.
Il a le pouvoir de doubler la durée de vie de la cellule actuellement en exploitation, en faisant passer l'autorisation d'importer des déchets des États-Unis émises à Stablex de 45 % à 0 %, se donnant donc le temps de trouver un site alternatif, ainsi qu'un autre procédé pour la disposition des déchets toxiques québécois.
Avec cette décision, le ministre Charrette vient de perdre son titre de ministre de l'Environnement. Il est désormais le ministre toxique des lobbys pollueurs. »
SOURCE :
climat.quebec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les soulèvements du fleuve revendiquent le désarmement de la machinerie de Ray-Mont Logistiques

Montréal / Tio'tia:ke / Moonyang, 16 juin 2024 – Les Soulèvements du fleuve se sont attaqués à un emblème de la conteneurisation du fleuve St-Laurent aujourd'hui en désarmant la machinerie de l'entreprise Ray-Mont Logistiques (RML) installée dans Hochelaga-Maisonneuve. Des grues, conteneurs et infrastructures ont été couverts de peinture afin de nuire aux opérations de l'entreprise et ralentir sa marche vers la destruction du vivant.
Joignant la lutte pour la défense du terrain vague menée depuis 7 ans par le mouvement populaire Mobilisation 6600, les Soulèvements du fleuve contrecarrent la violence et l'arrogance hallucinante avec laquelle Ray-Mont Logistiques s'approprie depuis 7 ans les espaces vivants d'Hochelaga-Maisonneuve, abattant les arbres, asphaltant des millions de pied carré de territoire, construisant des rails, amenant des milliers de camions à sillonner les rues, et accélérant le transport de marchandises par bateau sur le fleuve St-Laurent. À coup de poursuites contre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement du Québec, RML spolie le droit des communautés à vivre en santé et à définir leurs milieux de vie, en négociant à huit-clos l'aménagement de nouvelles autoroutes à conteneurs et la réduction de la réglementation sur le bruit.
Contre Ray-Mont Logistiques et contre le Projet St-Laurent
Le projet de Ray-Mont Logistiques vise à construire la plus grande plateforme de transbordement de marchandises céréalières en Amérique du Nord à une centaine de mètres de logements sociaux, CHSLD, et des plus beaux boisés du quartier. Ce projet de plateforme logistique cadre dans la dernière lubie du gouvernement du Québec : le Projet St-Laurent. Véritable programme de reconfiguration de l'économie, ce projet vise à transformer les basses-terres du Saint-Laurent en une sorte de « Silicon Valley » québécoise. Plusieurs initiatives destructrices en témoignent déjà : la méga-usine Northvolt en Montérégie, les projets de pôles industrialo-portuaires sur les terres de Rabaska à Lévis et à Contrecoeur, le projet Innovitam à Québec, l'apparition de la Vallée de la transition énergétique et de ses nombreuses infrastructures, et bien sûr la plateforme intermodale de Ray-Mont Logistiques. Fondées sur une idée de la transition énergétique qui mise sur l'excès et non la sobriété, cette arnaque vise en premier lieu la croissance de l'économie, au détriment de toutes les formes de vie.
Par ailleurs, la course aux minéraux « critiques et stratégiques » comme le lithium, le graphite, le cuivre et le nickel qui alimente la filière batterie signe une nouvelle étape du projet colonial mené par l'État québécois. En dépit de toutes considérations relatives aux souverainetés autochtones, à la santé des populations locales, ou aux bouleversements climatiques, nos gouvernements veulent accélérer l'extraction des minéraux du Nord et faciliter la circulation des marchandises en agrandissant les ports et en creusant le fleuve pour y faire passer des bateaux à encore plus gros tonnage.
Dans Hochelaga, les conteneurs s'empilent déjà par centaines là où le vivant avait repris ses droits, là où s'étendait une friche, là où il faut encore lutter pour conserver un des rares espaces verts dans l'Est de la ville, un refuge pour les habitant.e.s, les renards, les couleuvres, les grenouilles et les monarques. L'artificialisation des berges du Saint-Laurent vers laquelle mène le projet d'agrandissement et de modernisation de tous les ports en eau profonde se conjugue à la privation de tous les autres usages possibles.
Première saison : contre la conteneurisation du fleuve
Dans les dernières décennies, la croissance earénée du commerce international a provoqué une augmentation sans précédent du transport maritime : plus de croissance, plus de marchandises, plus de navires et plus de berges ensevelies sous le béton. L'accès à l'estuaire du Saint-Laurent a été d'abord colonisé puis privatisé, avant d'être ensuite accaparé par les industries et les plus riches sans égard pour les communautés, les faunes et flores riveraines. Outil et symbole de cette mondialisation spoliatrice, la conteneurisation consiste finalement à « enfermer le monde dans des boîtes métalliques » standardisées pour vendre aux plus privilégié.e.s et jeter l'excédent chez les plus exploité.e.s. Le conteneur et sa logistique sont le symbole des crises sociales et écologiques actuelles : c'est donc à cette conteneurisation que nous nous attaquons pour la première saison de nos soulèvements.
Les Soulèvements du fleuve appellent à résister concrètement à la transformation du fleuve en autoroute maritime. Nous refusons que nos lieux de vie soient quadrillés de routes, de rails et de conteneurs. Se rassembler, construire, bloquer et désarmer par amour pour une friche, un champ, une forêt, une rivière ou par solidarité avec une population qui en vit marque les bases d'une résistance à la conteneurisation dufleuve et trace les possibilités d'un autre monde. Nous nous soulevons à la défense du fleuve,de ses berges et du Vivant. Nous sommes le fleuve, défendons-nous !
À propos des Soulèvements du fleuve
Les Soulèvements du Fleuve sont nés de la rencontre de plusieurs luttes locales disséminées sur les territoires avec comme volonté de mettre en branle un mouvement de résistance au développement industriel, colonial et extractiviste. Une réponse à l'appel international des Soulèvements de la Terre à rassembler les forces brutes et à s'en prendre directement à ceux qui exploitent et détruisent le vivant. Nous nous soulevons à la défense du fleuve, de ses berges et du Vivant.
Source : Les soulèvements du fleuve
Informations : https://soulevementsdufleuve.or
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’avenir de nos dernières terres agricoles

Québec, 13 juin 2024 – En avril dernier, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a organisé des consultations publiques pour présenter le concept préliminaire du projet de l'Agro-Parc et invitait ensuite la population à faire parvenir leurs commentaires ou un mémoire à cet effet.
L'avenir de ces terres, dans les dernières de la ville de Québec, est un dossier important au sein des AmiEs de la Terre de Québec depuis très longtemps.
C'est pourquoi l'équipe a tenu à se positionner sur certains aspects ainsi qu'à questionner les réelles volontés derrières les visées de l'Agro-parc. Selon nous, trois considérations devraient être transversales au projet d'Agro-parc ; Privilégier un projet nourricier, mettre en place une gouvernance participative et déployer des mesures d'accessibilité qui soient écologiques et pensées pour tous.tes, sans exception.
Appartenant anciennement à la congrégation des Sœurs de la Charité, ces 203 hectares de terres arables procuraient, entre autres, la nourriture à ceux et celles dans le besoin. Acquises maintenant par le gouvernement à l'automne 2022, les citoyens.nes s'inquiètent que cette mission nourricière et d'inclusion sociale soit négligée par rapport aux autres fonctions prioritaires présentées par le MAPAQ telles que la recherche et l'innovation. Ainsi, considérant la crise climatique actuelle, l'augmentation incessante des coûts des denrées alimentaires et la hausse des inégalités sociales, il est essentiel que ce projet d'ampleur inclue les organismes de la société civile et les citoyens.nes dans sa mise en œuvre et priorise la vocation nourricière dans le but de renforcer l'autonomie alimentaire de la ville de Québec.
Ainsi, nous tenons à vous faire parvenir le mémoire des AmiEs de la Terre de Québec qui a été remis au MAPAQ, rendu public et qui sera ajouté sous peu au catalogue de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale.
À propos des AmiEs de la Terre de Québec
Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) forment un mouvement citoyen favorisant la transition vers une société écologiste et socialement responsable. Notre mission consiste à s'organiser collectivement pour promouvoir et défendre nos droits à Toutes et Tous à un monde écologiquement viable, juste et solidaire pour les générations actuelles et futures, ici et ailleurs sur la planète.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour une politique antigaspillage plus ambitieuse

Québec, le 4 juin 2024 - Au lendemain du jour de la Terre, le 23 avril, le Parti Québécois a proposé un projet de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le projet de loi no. 697. Le projet vise la mise en place d'Une stratégie nationale et un plan d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire, ce que nous demandons depuis des années à Sauve ta bouffe, un projet des AmiEs de la Terre de Québec !
Fort de ses 12 ans à lutter contre le gaspillage alimentaire, Sauve ta bouffe a analysé le Projet de loi 697 et a émis différentes recommandations pour que le Québec se dote d'une loi antigaspillage qui est vraiment efficace et ancrée dans son milieu.
Pourquoi une telle stratégie est essentielle ?
Si vous n'êtes pas familier avec les enjeux du gaspillage alimentaire, nous vous recommandons de lire notre article qui fait état de la situation du gaspillage alimentaire dans le monde, au Canada et plus précisément, au Québec. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gaspillage alimentaire est un problème à la fois économique, social et qui a un empreinte écologique considérable ! Il est estimé que ce serait le tiers des aliments qui seraient gaspillés dans le monde, soit plus d'un milliard de repas chaque jour ! Réduire le gaspillage alimentaire serait même LA SOLUTION à privilégier pour lutter contre les changements climatiques selon le Drawdown project ; un regroupement d'experts en environnement.
Le Québec gaspille aussi des quantités honteuses de nourriture, soit 1,2 million de tonnes selon un rapport deRecyc-Québec paru en 2022. Les ménages québécois sont responsables de 28% du gaspillage dans la province. Ce sont donc 72% des aliments qui sont jetés avant même d'entrer dans nos frigos. Sauve ta bouffe fait sa part pour aider les mangeurs et mangeuses à moins jeter, mais il y a encore beaucoup à faire pour le reste de la chaine agroalimentaire. L'État doit aussi faire sa part. Certains pays, comme la France, ont mis en place une loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), une loi qui a probablement inspiré le Parti Québécois. Or, comme le Québec est encore à la traine dans ce dossier, profitons de ce retard pour apprendre des leçons qu'ont tirées les autres pays avant de se lancer dans notre propre projet.
Description de la stratégie
Mais tout d'abord, que prévoit cette stratégie et plan d'action pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Voici les faits saillants :
Réduire le gaspillage alimentaire au Québec de moitié d'ici 2030 ;
Obliger les transformateurs, distributeurs et détaillants d'établir des ententes de dons de leurs invendus encore comestibles à des organismes ;
Se doter d'un registre public pour recenser les produits invendus des fabricants, distributeurs et détaillants ;
Interdire de rendre volontairement impropres les invendus (en aspergeant les poubelles d'eau de javel par exemple).
Il y a toute une section dans le projet de loi sur l'économie circulaire et sur la lutte contre le gaspillage d'objets. Nous saluons cette initiative, mais nous n'en ferons pas mention ici.
Un projet qui ajoute de la pression sur les organismes en sécurité alimentaire
La situation de précarité dans laquelle se retrouvent plusieurs Québécois.e.s est inacceptable. En effet, les demandes d'aide alimentaire n'ont jamais été aussi élevées. Obliger les transformateurs, distributeurs et détaillants à rediriger tous les aliments qui sont actuellement gaspillés pourrait grandement aider la capacité des banques alimentaires à répondre à la demande grandissante. Or, il faut offrir plus de moyens à ces organismes. Certes, le manque de denrées est criant, mais souvent, ceux-ci n'ont tout simplement pas les ressources pour accueillir plus de denrées : faute de moyens, ils n'ont pas suffisamment d'espace de frigo, ils n'ont pas de camion pour aller chercher les denrées et/ou ils manquent de personnel pour la réception, la manutention et la distribution des denrées. Ainsi, cette loi doit absolument venir avec davantage de ressources financières pour les organismes en aide alimentaire si on veut que les aliments donnés servent à nourrir des gens. Comme l'objectif est de réduire de moitié le gaspillage, ce serait dommage de détourner le problème en retrouvant les aliments donnés dans des poubelles d'organismes plutôt que celles des grossistes ou des épiciers !
Pour éviter un coup d'épée dans l'eau : l'exemple de la France
Comme mentionné précédemment, une loi similaire à celle proposée par le PQ a été mise en place en 2020 en France : l'AGEC. De nombreux organismes environnementaux français, notamment nos collègues, les AmiEs de la Terre de France, ont analysé cette loi et ont produit le documentÉvaluation de la loi AGEC. Le constat est sans équivoque : de nombreux acteurs du secteur alimentaire français font fi de la loi, car il n'y a pas d'inspecteurs ou bien de sanctions suffisantes pour les contrevenants. La recommandation principale de nos collègues français pour que la loi soit réellement efficace : il doit y avoir des inspections régulières et des sanctions. Ainsi, le ministre doit être très rigoureux dans l'application de la loi pour éviter qu'elle ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Apprenons des erreurs des autres pour que notre stratégie ait l'impact souhaité !
Et les agriculteurs ?
Cette loi vise un grand pan de la chaine agroalimentaire, mais les agriculteurs, à la base de la chaine, ne sont pas mentionnés. Pourtant, au Québec, 14% du gaspillage se fait chez les producteurs. Ont-ils été oubliés volontairement, car on veut leur éviter un poids supplémentaire ? Dans ce cas, la loi pourrait proposer un plan d'accompagnement des producteurs pour les aider à réduire leur gaspillage et pour encourager les producteurs à donner leurs surplus à des organismes. Une autre bonne façon de lutter contre le gaspillage chez les agriculteurs est le glanage. Pour en savoir plus sur cette initiative, lisez notre article ou écoutez notrebalado à ce sujet. Pour résumé, le glanage, ce sont des bénévoles qui vont chercher les surplus de récoltes directement au champ. Habituellement, un tiers des récoltes est redonné aux producteurs, un tiers, aux organismes en sécurité alimentaire et un tiers, aux cueilleurs. En investissant dans ce genre d'initiative, le gouvernement allègerait le gaspillage chez les producteurs agricoles sans leur ajouter une charge de travail supplémentaire.
Un pas dans la bonne direction
Ce serait injuste de notre part de ne pas souligner que ce projet de loi va dans la bonne direction. Bien qu'il n'aborde pas suffisamment l'impact social du gaspillage alimentaire, il adresse son impact écologique, un aspect qui est encore trop méconnu. Le registre des invendus permettra de constater l'ampleur du problème et c'est souvent de ce constat qu'émergent les solutions les plus pertinentes !
Un petit message à nos représentants politiques : SVP, consultez le milieu communautaire pour concevoir la Stratégie et le plan d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à cette collaboration, vous obtiendrez une loi efficace dans le contexte québécois et enracinée dans sa communauté. La porte de Sauve ta bouffe vous est ouverte !
Gabrielle Dessureault, coordonnatrice de Sauve ta bouffe
Lisez le projet de loi complet ** :
Médiagraphie
Assemblée nationale du Québec (avril 2024). Projet de loi no. 697 : Loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-697-41-1.html?appelant=MC
Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (avril 2024). La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire . https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
Recyc-Québec (juin 2022). Rapport final : Étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaires au Québec. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-quantification-pertes-qc-fr.pdf
Reduced food waste. (s. d.). Project Drawdown. https://drawdown.org/solutions/reduced-food-waste
United Nations Environment Programme (2024). Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save : Tracking Progress to Halve Global Food Waste. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/45230.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des questions toujours sans réponses

Longueuil, 11 juin 2024.- Une soixantaine de citoyennes et citoyens se sont présenté.e.s hier soir à la séance du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert pour faire part de leur désaccord avec le développement de l'aéroport de Saint-Hubert et demander aux conseillères et conseillers de l'arrondissement de porter leur message d'un moratoire sur
ce développement.
Répondant à l'appel de la Coalition Halte-Air Saint-Hubert et du CAPAL, et faisant suite à l'assemblée publique du 8 mai dernier à Saint-Hubert, ces citoyen.ne.s s'étaient donnés rendez-vous avant le début de la séance pour faire du bruit et manifester ensemble en scandant de nombreux slogans imageant l'inacceptabilité du projet d'aéroport, les dangers qu'il présente à la santé de la population et la demande d'un moratoire.
« Il n'y a pas d'acceptabilité, vous le savez, madame Fournier ! », « Il n'y a pas d'acceptabilité, un sondage ne peut pas décider » , « Quand on lui parle de leucémie, elle nous répond « économie », « Agir comme le veut, la mairesse, c'est sacrifier toute la jeunesse », « On vous le rappelle, Madame la mairesse, faut diminuer les G.E.S. », « DASHL sait que ses activités portent atteinte à notre santé », « Pollution sonore, particules fines, qu'ils ne disent pas que c'est des vitamines », « On demande un moratoire, notre air n'est pas un dépotoir », « Il faut agir ici, maintenant pour le futur de nos enfants », « Conseillères et conseillers, votre job c'est de nous représenter », entre autres slogans, ont retenti à l'entrée de l'Hôtel de Ville de Longueuil pendant une bonne vingtaine de minutes, avant que les gens n'entrent pour assister à la séance.
Le Conseil a reçu une douzaine de questions en lien avec ce développement mortifère de l'aéroport qui n'a jamais été soumis à la consultation. Comme ça en est devenu maintenant l'habitude, le président Cueto a accumuilé les questions sans que les élu.e.s ne répondent à chacune, ce qui a fait bondir M. Réjean Leduc qui a demandé : « Les gens posent des questions. Qui répond à quoi ? Quand allez-vous répondre ? » Il a été suivi par M. Michel Desgagné qui a demandé : « C'est quoi la démocratie pour vous ? J'ai pas l'impression que c'est un exercice démocratique que nous faisons actuellement ! »
Les conseillères et conseillers n'ont finalement répondu qu'à quelques-unes des questions, suivis par le président Cueto qui a terminé en répétant à nouveau que l'aéroport n'était pas de la responsabilité de la Ville de Longueuil, mais plutôt du gouvernement fédéral.
Cette réponse est en contradiction flagrante avec le fait que la mairesse est allée sur toutes les tribunes médiatiques depuis le 27 février 2023 pour défendre le projet de l'aéroport, et continue de le faire, prétextant une acceptabilité sociale du projet, alors que le rapport de l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL) demandait clairement
que DASHL dépose les études économiques, sanitaires, environnementales et climatiques à l'appui de son projet avant de décider si on devait l'appuyer, ce qui n'a jamais été fait.
A la fin de la période de questions, les citoyen.ne.s se sont regroupés à l'extérieur pour partager leurs impressions et discuter ensemble de ce à quoi ils et elles venaient d'assister. Les gens étaient très insatisfaits des réponses données qui révélaient plutôt l'ignorance des enjeux de la part de plusieurs conseiller.ère.s. Comme le disait un participant : « On aurait pu les remplacer par des mannequins ! »
Les gens sont repartis, non sans s'être promis de ne pas en rester là et de poursuivre les actions pour obtenir l'écoute à laquelle ils et elles ont droit pour eux, leurs familles et leurs enfants.
Comme le disaient si bien deux slogans :
« C'est pour ça que ce soir, on vient vous voir, vaut mieux pas nous décevoir
Si vous ignorez nos solutions, on va se revoir aux élections »
Pour information : coalition.halteair@gmail.com
Suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/coalitionhalteairSH
instagram.com/coalitionhalteairsh/
https://twitter.com/Coalition_YH
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation 6600 Parc-nature MHM installe un campement au Boisé Steinberg en opposition à l’implantation de Ray-Mont Logistiques et à la construction de nouvelles routes dans le secteur

Montréal, 13 juin 2024 – Des centaines de personnes sont attendues ce week-end, du 13 au 16 juin, au boisé Steinberg dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour participer au Camp climat S'enraciner et fleurir, organisé par le mouvement populaire Mobilisation 6600 Parc-nature MHM.
« Nous occupons le boisé Steinberg pour manifester notre colère envers la Ville de Montréal et le Ministère des transports et de la mobilité durable du Québec (MTQ) qui souhaitent prolonger le boulevard de l'Assomption et l'autoroute Souligny pour faciliter le transport de marchandises par camions et servir ainsi les intérêts privés du Port de Montréal et de Ray-Mont Logistiques », a affirmé Anaïs Houde, co-porte-parole de Mobilisation 6600. « Ces grands espaces verts que sont le Boisé Steinberg et la friche ferroviaire doivent être protégés et revenir à la communauté. Mobilisation 6600 revendique depuis 2016 le droit pour les habitant·e·s de déterminer l'avenir de leur milieu de vie et nous prenons tous les moyens pour nous l'approprier, jusqu'à y camper ! » a-t-elle ajouté.
Cassandre Charbonneau-Jobin, co-porte-parole du mouvement, réside dans les environs et rappelle les nuisances engendrées par les activités portuaires et l'implantation de l'entreprise Ray-Mont Logistiques à proximité des maisons. « Le mois dernier mois a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète ; comment peut-on penser que la solution passe par plus d'asphalte et plus de routes ? Qui peut honnêtement justifier la destruction d'un des derniers poumons verts de l'Est de Montréal ? ».
Les projets de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'autoroute Souligny sont d'ailleurs liés à l'implantation de Ray-Mont Logistiques dans le quartier qui poursuit actuellement la Ville de Montréal pour 373 millions de dollars en dommages. « Nous savons qu'avec un tel montant en poche, utilisé comme bâillon, Ray-Mont est en train de négocier des dérogations réglementaires, des mesures de mitigation payées avec l'argent des contribuables, et probablement le tracé de nouvelles routes pour ses camions. C'est inadmissible qu'une entreprise privée puisse, à coups de poursuites, déterminer l'aménagement d'un quartier, nuire à la qualité de vie des résident·e·s et forcer les gouvernements à se plier à sa quête de profit ! » a affirmé Anaïs Houde. « C'est pourquoi encore une fois, nous manifestons notre détermination à nous réapproprier nos espaces de vie en occupant le boisé Steinberg ».
Le Camp climat sera l'occasion pour les militant·e·s pour la justice sociale et environnementale de se réunir au boisé Steinberg. Des ateliers de formation, des projections, des activités ludiques pour les familles, une plantation de saules, un campement dans les arbres, des randonnées guidées sont parmi les activités organisées par le groupe citoyen qui revendique la création d'un parc nature dans l'ensemble dusecteur Assomption-sud de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.L'événement se terminera par un grand rassemblement festif intitulé « Floraison contre le béton », le dimanche 16 juin, à 13h, au boisé Steinberg.
« Nous portons une vision d'avenir pour le quartier : la protection du vivant et le soin de notre communauté. Nous allons faire la fête, semer des rêves et des idées pour que les champs de fleurs remplacent l'asphalte et les conteneurs » a conclut Anaïs Houde.
À propos de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM
Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM est un mouvement populaire qui lutte depuis 2016 pour la préservation des espaces verts, de la santé et de la qualité de vie de la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il revendique la création d'un Parc nature dans le quadrilatère Viau-Dickson-Hochelaga-Notre-Dame et s'oppose à l'installation de Ray-Mont Logistiques. Site web : https://resisteretfleurir.info
Source : Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nouvelle politique québécoise de financement des universités : plus de questions que de réponses

Le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) a rendu publique, lundi matin dernier, le 10 juin, sa nouvelle politique québécoise de financement des universités. Cette nouvelle politique en a laissé plus d'un sur son appétit, notamment du côté de la Table des partenaires universitaires (TPU).
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
Un certain mystère planait depuis quelques mois quant à l'éventuelle nouvelle politique québécoise de financement des universités. Une consultation lancée à peu près à pareille date l'an dernier par le MES avait été l'occasion, pour la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ), d'émettre dix-huit recommandations pour mieux soutenir nos communautés universitaires.
Un résultat mitigé
Ultimement, le résultat suggère que le MES a davantage tendu l'oreille à ses collègues des autres ministères qu'auprès des personnes qui connaissent le mieux les universités. La hausse de la part de financement inconditionnel aux établissements a de quoi réjouir, tout comme l'attention portée à la vitalité et au rayonnement des activités des universités en région. En revanche, cette nouvelle politique rate complètement la cible des besoins mis de l'avant par les personnes qui travaillent dans les milieux.
Faire les poches aux étudiants internationaux pour financer le réseau
Déjà, il n'est pas question du réinvestissement nécessaire dans le réseau. Aucune nouvelle somme n'est prévue, mais plutôt un remaniement des enveloppes déjà en place. Pour remplir les coffres, le MES persiste et signe sur son annonce du 13 octobre dernier. Les étudiants internationaux débourseront désormais un minimum de 20 000 $ pour une année d'études au Québec dans une université anglophone. Ce sera 12 000 $ pour des étudiants canadiens non résidents du Québec.
Des programmes laissés pour compte ?
Plus inquiétant encore, on annonce des sommes supplémentaires pour les inscriptions et la diplomation des effectifs étudiants dans certains programmes d'études liés à l'Opération main-d'œuvre du gouvernement et au programme des Bourses Perspectives. L'effet positif de ces bourses sur les inscriptions demeure à être démontré. Rien ne permet présentement de conclure qu'elles ont pesé fortement dans la balance pour les choix de programmes collégiaux et universitaires.
De même, il faudra surveiller la mise à jour des pondérations du financement alloué selon les domaines et les cycles d'études. D'aucuns pressentent que le gouvernement pourrait être tenté de surpondérer les familles de programmes plus près de ses actuels objectifs à court terme, au détriment des autres.
Université VS université ?
La nouvelle politique est également susceptible de mettre en place une nouvelle forme de compétition entre universités québécoises : celle qui les oppose entre elles pour le recrutement en génie, technologies de l'information, enseignement ou santé et services sociaux. Elle envoie aussi un signal d'un potentiel système universitaire à deux vitesses entre les familles de programmes privilégiés par le gouvernement et tous les autres.
Cette nouvelle politique, comme le PL44 avant elle, laisse ainsi un goût amer chez les personnes qui travaillent au quotidien dans nos universités. Après s'être accaparé les Fonds de recherche du Québec (FRQ), on décèle dans cette politique une énième tentative de ce gouvernement d'orienter les énergies du Québec vers la seule croissance économique à court terme, quitte à le faire au détriment du développement social, culturel ou à long terme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Christian Dubé devant la CCMM | Un comité d’accueil pour rappeler au ministre que sa réforme est tout, sauf santé !

Profitant du passage du ministre de la Santé, Christian Dubé, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), les organisations syndicales en santé et services sociaux ont voulu lui rappeler que sa réforme est tout, sauf santé ! Depuis le dépôt du projet de loi créant l'agence Santé Québec, les organisations syndicales multiplient les dénonciations face à une réforme centralisatrice, antidémocratique et qui offre une place de choix au privé en santé.
« L'absence d'écoute et de dialogue social du ministre est déplorable. Sa réforme va à l'encontre de solutions qui font largement consensus de la part des intervenant-e-s du terrain et du milieu de la recherche », lancent d'une seule voix Robert Comeau de l'APTS, David Bergeron-Cyr de la CSN, Réjean Leclerc de la FSSS-CSN, Isabelle Dumaine de la FSQ-CSQ, Jessica Goldschleger de la FP-CSN, Isabelle Groulx de la FIQ, Fanny Demontigny du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP), Martin Trudel du SPGQ et Sylvie Nelson du SQEES-FTQ.
Plusieurs dizaines de militant-e-s et de membres des organisations syndicales en santé et services sociaux étaient aux abords du Palais des congrès de Montréal pour accueillir le ministre Dubé invité à prendre la parole devant des membres issu-e-s de la communauté des affaires. Le réseau de la santé et des services sociaux sera frappé de plein fouet par une énième réforme et les expériences du passé devraient allumer de nombreux voyants rouges sur le tableau de bord du ministre Dubé. « La visite du ministre Dubé devant la CCMM n'est pas sans intérêt. Alors que monsieur Dubé rencontre les gens du milieu des affaires, il refuse de rencontrer ceux et celles qui sont concerné-e-s au premier chef, les travailleur-euse-s du réseau. Par ailleurs, dans sa réforme, l'ouverture sans précédent du privé aux services publics est hautement préoccupante. Qu'est-ce que ça va lui prendre pour comprendre que ce n'est pas d'une réforme de structure que les Québécois-e-s ont besoin ? La population veut avoir accès à de meilleurs soins et services, et ce, dans un réseau public, gratuit et accessible », de poursuivre les porte-parole.
Pour les organisations syndicales, ni la voix des citoyen-ne-s ni celles des travailleur‑euse‑s ne sont prises en compte actuellement par le ministre Dubé. « Comment peut-il lancer une réforme d'une telle ampleur dans le réseau de la santé et des services sociaux en réfutant les nombreuses questions sur la centralisation accrue qui éloignera la prise de décisions du plancher, sur l'insuffisance des mécanismes de reddition de compte et sur l'ouverture inédite à la privatisation ? Ni l'offre de soins et de services, ni les listes d'attentes, ni les problèmes de pénurie de main-d'œuvre ou ni la capacité du réseau d'attirer et de retenir du personnel en santé et services sociaux ne seront améliorés dans la forme actuelle de sa réforme. Que le ministre se le tienne pour dit, nous ne lâcherons pas le morceau ! Pour le bien des travailleur-euse-s et celui des patient-e-s du Québec ».
Sources
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
Fédération de la Santé du Québec (FSQ–CSQ)
Fédération des professionnèles (FP–CSN)
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ)
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des chefs syndicaux internationaux affirment leur appui aux syndicats et au peuple palestiniens

Cette semaine, des dirigeants de sept fédérations syndicales internationales (FSI) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) se sont rendus à Ramallah pour manifester leur solidarité aux syndicats de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ces organisations représentent des personnes travaillant dans presque tous les secteurs de l'économie mondiale et ont plus de 200 millions de membres dans plus de 150 pays. De concert avec leur affiliés palestiniens et d'autres, ces FSI et tous les membres du Conseil des Syndicats mondiaux (CGU) se sont engagés à intensifier les efforts faits pour aider les syndicats locaux à traverser cette période difficile pour les travailleurs et travailleuses et à jouer leur rôle de facteurs clés de changement en Palestine.
La délégation, qui comprenait les secrétaires généraux de la CSI et des FSI ainsi que de nombreux dirigeants syndicaux principaux du monde entier, a rencontré des représentants de la Fédération générale des syndicats de Palestine (FGSP) et des dirigeants syndicaux représentant les travailleurs et travailleuses de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Elle a aussi rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas, le premier ministre Mohammad Mustapha et plusieurs ministres gouvernementaux pendant la mission du 28 au 30 mai 2024. Plusieurs syndicats mondiaux collaborent déjà étroitement avec leurs collègues palestiniens, tous engagés à appuyer la lutte des travailleurs et travailleuses de Palestine.
La délégation a indiqué clairement ce qui suit : « nous exprimons notre solidarité à l'égard des syndicats et des travailleurs palestiniens en ces temps difficiles. Nous nous inquiétons grandement de la grave crise humanitaire que vit la population de la bande de Gaza et nous épaulons les Palestiniens, les Israéliens et les gens du monde entier qui appellent à la paix, à l'égalité et à la justice ».
Les priorités immédiates doivent comprendre un cessez-le-feu immédiat et permanent et le plein respect du droit humanitaire international, l'accès immédiat à l'aide humanitaire, la libération de tous les otages et les autres personnes détenues sans qu'ait été suivie une procédure judiciaire appropriée et le retour chez eux en sécurité de tous les travailleurs et travailleuses piégés par le conflit.
La délégation a rappelé la politique de longue date de la CSI et d'autres syndicats mondiaux en faveur d'une solution à deux États et de l'appel à une paix juste et durable par la pleine mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU pour faciliter un avenir économique valable dans une Palestine indépendante. Cela comporte la fin de l'occupation de la Cisjordanie, le démantèlement de toutes les colonies illégales et la reconnaissance des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien.
La délégation a incité les gouvernements à rétablir et à accroître le financement de l'UNRWA. « Le rôle de l'UNRWA est crucial pour la prestation de services essentiels et le soutien des Palestiniens à un moment où ils en ont le plus besoin. »
« Nous sommes venus renforcer et approfondir notre engagement à l'égard des travailleurs et travailleuses palestiniens et de leurs syndicats – nous faisons tous partie de la même grande famille. Notre objectif est d'instaurer une Palestine démocratique et souveraine, vivant en paix et en sécurité justes et durables aux côtés d'Israël. Nous savons que les syndicats sont un élément essentiel de toute démocratie et que des syndicats indépendants forts et démocratiques seront un des principaux facteurs de l'atteinte de cet objectif en Palestine. »
La délégation a indiqué qu'elle avait entendu d'émouvants témoignages de Palestiniens qui avaient payé un prix terrible pendant la guerre en cours. Outre la réalité déchirante des destructions et des pertes de vies dans la bande de Gaza, nous avons entendu parler de la violence des colons et de restrictions des droits de la personne tels que la liberté de circulation ainsi que de difficultés économiques en Cisjordanie.
Néanmoins, ce qui ressort, c'est l'engagement à l'égard du syndicalisme et de son potentiel d'aider à un juste règlement dans le chaos plus large de ce conflit.
« Notre responsabilité de syndicalistes mondiaux est de nourrir ce sentiment, et nous appelons le mouvement syndical mondial à mettre en pratique ses principes de paix, d'humanité, de démocratie et de solidarité. Il peut y arriver notamment en continuant à investir dans un dialogue constructif avec les syndicats tant d'Israël que de Palestine qui reconnaissent le rôle critique qu'ils sont appelés à jouer dans leurs sociétés respectives. »
« Les organisations syndicales internationales n'oublieront ni ne délaisseront leurs consœurs et confrères de Palestine. Nous redoublerons d'efforts pour soutenir vos syndicats et vous soutenir. Les syndicats sont restés constants – démocratiques, enracinés dans leurs communautés et bien équipés pour apporter un soutien concret pendant la reconstruction, qui devrait intégrer les principes du travail décent et des services publics de qualité. »
De nombreux syndicats internationaux ont déjà apporté une aide importante aux travailleurs et travailleuses par l'intermédiaire des syndicats de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. L'Internationale de l'éducation a fourni une aide financière à plus de 1 000 enseignants en Palestine et des abris à plus de 5 000 enfants à Rafah. La Fédération internationale des journalistes apporte un soutien direct aux reporters de la bande de Gaza et gère un centre de solidarité doté d'un espace de travail et d'équipements à Khan Younis. La Fédération internationale des ouvriers du transport et l'Internationale des services publics ont toutes deux lancé des fonds de solidarité pour apporter une aide immédiate et un soutien à plus long terme aux travailleurs et travailleuses palestiniens des transports et des services publics et à leurs familles. L'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois a fourni une aide humanitaire et des abris aux travailleurs de la construction et à leurs familles.
La délégation a conclu : « Les syndicats font partie du mouvement mondial pour la paix. Nous défendons la paix au même titre que des valeurs aussi importantes que la démocratie et l'humanité. C'est pourquoi nous sommes ici. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration (France) : Urgence face à la montée de l’extrême-droite

URGENCE, face à la montée de l'extrême-droite nous faisons le choix d'un espoir de construction sociale et politique libre, juste, solidaire, hors des dominations de l'argent et du masculin triomphant, machiste et misogyne
Tiré de Europe Solidaire
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71090
vendredi 14 juin 2024,
par MMF France
Depuis le 9 juin cette construction parait encore plus difficile, les forces d'extrême droite, fascistes, racistes, misogynes, ont fait passer tous leurs mensonges pour un futur rassurant.
Hier, nous avons toutes et tous subi un terrible choc. Comme une épidémie, le virus de l'extrême droite frappe dans un nombre impressionnant de pays. C'est un phénomène de société développé par le système d'individualisation extrême, où le collectif est dévalorisé. La pensée est niée, seuls comptent la satisfaction immédiate, le développement individuel, le moi démesuré, la consommation à outrance comme vecteur de bien être.
Cette société alimentée par les média aux mains des plus grandes fortunes, cette société s'est construite depuis une quarantaine d'années, pour ouvrir les portes au parti politique et au gouvernement qui servira le mieux les intérêts de ceux qui ne veulent pas perdre la domination des peuples.
Nous sommes face à une destruction, qui se veut massive, des acquis sociaux, sociétaux, économiques du plus grand nombre des citoyen.ne.s. Ce n'est pas seulement une erreur politique, une mauvaise passe, non, le phénomène est international, la peste brune s'installe en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine. La peste brune grandit partout et contamine l'esprit des femmes et des hommes.
L'urgence est grande, il faut absolument reconstruire une unité qui rassemble toutes les forces vives. Lorsque les citoyennes et des citoyens s'organisent pour construire un monde plus juste et solidaire, leur pouvoir est réellement efficient.
Nous souhaitons une vie juste et digne pour le plus grand nombre, plutôt que la richesse sans limite pour quelques-uns.
Nous voulons la solidarité et la sororité, plutôt que la division, l'empathie plutôt que la rivalité. Nous voulons une éducation laïque et non sexiste. La liberté de choisir la maternité ou pas, et donc le droit à l'IVG et le mariage pour toutes et tous quels que soient nos choix, ne doivent être mis en cause.
Nous devons dénoncer les double discours concernant les droits des femmes du Rassemblement National. Le RN est l'ennemi des femmes. Le retour de l'extrême droite au pouvoir c'est le retour à une société archaïque et masculiniste.
Le projet que nous portons, nous les féministes, est incontournable et indispensable aux changements, pour que les femmes participent enfin à la construction politique, sociale, économique.
Nous faisons le choix de nous battre, car en nous attaquant à la racine des inégalités, nous portons des solutions pour un avenir juste, solidaire, émancipateur, égalitaire.
AUJOURD'HUI IL EST PLUS QUE JAMAIS URGENT DE REFLECHIR ET D'AGIR ENSEMBLE.
MMF France
• Entre les lignes entre les mots. 17 juin 2024 :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/17/contre-lextreme-droite-dans-la-rue-et-dans-les-urnes-divers-textes/
Copyright
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La syndicalisation d’Amazon aux États-Unis : s’organiser face à la nouvelle barbarie capitaliste

Léo Palardy a participé à la délégation du Journal des Alternatives à la conférence No War, But Class War à New York. Il a rencontré Justine Medina, travailleuse au site Amazon JFK8 à New York et qui est impliquée dans l'organisation du syndicat Amazon Labor Union.
12 juin 2024 | tiré du site du Journal des alternatives
https://alter.quebec/la-syndicalisation-damazon-aux-etats-unis-sorganiser-face-a-la-nouvelle-barbarie-capitaliste/
Léo Palardy – JdA-PA. À quoi ressemblent les conditions de travail dans les entrepôts Amazon ?
Avant de joindre l'Amazon Labor Union, Justine Medina, à droite, fut organisatrice centrale de campagne d'Alexandria Ocasio-Cortez, à gauche, membre, députée de Democratic Socialists of America (DSA) sous la bannière démocrate.
Justine Medina : Les conditions de travail chez Amazon sont horribles. À Amazon JFK8, il y a sans cesse des blessures et des ambulances visitent l'entrepôt presque tous les jours. Et ce ne sont que les blessures qui sont déclarées, d'autres sont complètement ignorées par la compagnie.
Une enquête a démontré qu'il y a deux fois plus de blessures chez Amazon que le ratio normal de blessures dans un entrepôt semblable et qu'il est plus élevé que le ratio de blessures dans l'industrie moderne d'extraction du charbon.
Dans d'autres entrepôts, des gens sont littéralement morts au travail. Les quarts de travail sont de 10 à 12 heures, au moins quatre jours par semaine. Durant les périodes de pointe, nous sommes forcé·es à faire du surtemps. On doit alors travailler 60 heures par semaine en étant toujours debout. Amazon cherche constamment à accélérer la production et à imposer des rythmes très rapides. Les travailleur·euses ne sont pas en mesure de s'asseoir, même si ce sont des personnes âgées, voire handicapé·es ou enceintes.
Très souvent, Amazon viole la loi en refusant de donner des accommodements ou de les respecter s'il y en a. C'est un des principaux problèmes que le syndicat cherche à régler. Nous défendons les personnes lésées devant les ressources humaines afin qu'elles obtiennent les accommodements dont elles ont besoin. Nous veillons à ce qu'elles connaissent leurs droits, notamment celui de refuser de travailler si on leur demande d'exécuter un travail dangereux ou si leurs accommodements ne sont pas respectés.
L.P. À propos du cadre juridique, est-ce la législation qui est mauvaise ou est-ce plutôt qu'elle n'est pas appliquée ? Ou peut-être une combinaison des deux ?
J.M. : Un peu des deux. La législation n'est définitivement pas assez forte. Depuis Taft-Hartley, qui est une loi qui remonte à 1947, au début du Red Scare1, les pénalités envers les compagnies qui brisent le code du travail sont très légères : ce ne sont qu'une petite tape sur les doigts pour ces méga corporations. Il est aussi très difficile de les faire appliquer. Le Labor Department et le National Labor Relations Board ont tous les deux été sévèrement sous-financés. Ça prend des années pour faire appliquer ces lois par la Cour. En conséquence, les compagnies violent la loi constamment.
Le cadre légal est toutefois utile comme outil d'agitation et de sensibilisation. Dans l'État de New York, par exemple, nous avons soutenu l'adoption d'une loi appelée la Warehouse Worker Protection Act, qui assure le respect de droits de base. Par exemple, si vous travaillez dans un entrepôt, vous avez le droit d'aller aux toilettes ou d'aller boire de l'eau sans vous faire renvoyer. Ce qui vient en même temps réduire le rythme de la production bien entendu.
Avec le Warehouse Worker Protection Act, c'est aujourd'hui devenu plus difficile pour Amazon de mettre des gens à la porte pour avoir eu recours à un droit prévu dans la loi, surtout lorsqu'on demande son respect en affirmant : « Non, ce sont mes droits ! ». On se sert du code du travail comme un outil de lutte. Bien sûr, une application plus forte de la loi et des lois plus contraignantes seraient utiles aux travailleur·euses.
L.P. À propos du nombre d'heures de travail par jour, y a-t-il des restrictions aux États-Unis ? Et si oui, est-ce qu'Amazon les respecte ?
J.M. : Au niveau fédéral, après avoir travaillé 40 heures, vous devez être payé·es en temps supplémentaire et on ne peut pas travailler plus de 60 heures par semaine pour un travail unique. Certains États calculent le surtemps en fonction du nombre d'heures par jour, mais la plupart le font par semaine. C'est ainsi qu'Amazon réussit à imposer des journées de 12 heures. Ils respectent la loi de cette manière.
Cependant, Amazon est aussi très reconnu pour faire du vol de paye, surtout vis-à-vis de ses chauffeur·euses. Ils refusent de leur donner les bonus et les pourboires qui leur sont dus. Amazon trouve aussi des moyens d'éviter de payer quand il y a des blessures et travaille très fort à voler une partie des salaires des travailleur·euses tout en semblant respecter la loi.
L.P. Et face à cela vous vous organisez ?
J.M. : Oui, nous le faisons, ou du moins nous y travaillons.
L.P. Vous avez eu des succès ?
J.M. : Dans certains cas, oui. Amazon JFK8 a été le premier entrepôt Amazon en Amérique du Nord à réussir à se syndiquer2. La décision du National Labor Relations Board aux États-Unis est une très grande victoire considérant qu'il s'agit d'un entrepôt de plus de 5000 travailleur·euses. Plus récemment, un autre emplacement, un centre de livreur·euses a réussi à se syndiquer sous les Teamsters, ce centre emploie par sous-traitance environ 150 travailleur·euses.
Mais ce n'est pas tout, il y a beaucoup d'autres mobilisations qui ont lieu en même temps. Il y a présentement des comités dans près d'une centaine d'Amazon à travers les États-Unis. Certains essaient de se syndiquer, mais d'autres cherchent simplement à faire de l'agitation contre les politiques d'Amazon. Il peut s'agir d'enjeux de racisme, de sexisme, d'homophobie ou de transphobie. Il y a aussi la campagne du mouvement No Tech For Apartheid, qui lutte entre autres contre les politiques pro-guerres et pro-apartheids d'Amazon, qui supporte l'IDF par le biais de contrats avec l'armée américaine.
L.P. Avec cette lutte directe pour de meilleures conditions de travail, est-ce que la conscience de classe des travailleur·euses se développe ?
J.M. : Je peux définitivement dire qu'à mon entrepôt, le JFK8, la conscience de classe est beaucoup plus forte qu'il y a trois ans. Vous savez, même si le syndicat est toujours faible en termes de participation des membres, il y a une conscience de classe qui se développe chez les travailleur·euses. Certain·es commencent à dire qu'iels méritent d'être mieux payé·es. D'autres résistent individuellement à travailler dans des conditions dangereuses. D'autres encore commencent à refuser de travailler dans d'autres entrepôts par lesquels iels n'ont pas été embauché·es.
Parfois les travailleur·euses reprennent les arguments du syndicat, mais même si ce n'est pas toujours le cas, on sait que nous avons fait un bon travail sur le plan de l'éducation aux droits. Quand j'ai commencé à travailler à JFK8, j'allais voir les gens et je leur parlais du mouvement et du combat syndical. La plupart n'en n'avaient jamais entendu parler et ne savaient pas vraiment ce que voulait dire être syndiqué·e. Depuis ce temps, nous voyons définitivement une progression dans la conscience de classe ainsi que dans le combat collectif. La prochaine étape est simplement d'organiser ces travailleur·euses de manière à les unir et à passer à l'action.
L.P. Merci beaucoup pour votre disponibilité.
J.M. : Vous êtes le bienvenue.
Peur Rouge, expression qui veut caractériser le sentiment qui prévaut dans la population américaine durant la période de l'offensive anticommuniste et antisyndicale du sénateur McCarthy aux États-Unis. [↩]
Au Québec, c'est le 10 mai 2024 que fut reconnu un premier syndicat chez Amazon au Canada par le Tribunal administratif du travail, suite au dépôt de signatures majoritaires par la CSN : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2072208/syndicat-entrepot-amazon-laval-canada [↩]
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nouveau Front Populaire : Contrat de législature

Voici le programme du Nouveau Front populaire, candidat à l'élection législative déclenchées par Macron en réponse à la poussée de l'extrême droite aux récentes européennes.
14 juin 2024 | tiré du site alencontre.org |Photo : La présentation du programme du Nouveau Front populaire à Paris le 14 juin. © JULIEN DE ROSA / AFP
Partie 1
15 premiers jours
LA RUPTURE
Une seule priorité pour le gouvernement du Nouveau Front Populaire dès son installation : répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Nous en finirons avec la brutalisation et la maltraitance des années Macron. Nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, au défi climatique, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde. Pour que la vie change dès l'été 2024.
Décréter l'état d'urgence sociale
- Bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret, et renforcer le bouclier qualité-prix pour les outre-mer
- Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron passant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ainsi que la réforme de l'assurance-chômage
- Augmenter le minimum contributif au niveau du SMIC et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté
- Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600€ net, par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaire (intégralement compensée pour les collectivités territoriales), augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants
- Engager les négociations commerciales en garantissant un prix plancher et rémunérateur aux agriculteurs et en taxant les superprofits des agro-industriels et de la grande distribution
- Revaloriser les APL [Aide personnalisée au logement] de 10%
Relever le défi climatique
- Décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières
- Adopter un moratoire sur les méga-bassines
- Mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités
Défendre le droit au logement
- Relancer la construction du logement social en revenant sur les coupes de Macron pour les organismes HLM de 1,4 milliard d'euros annuels
- Créer les places d'accueil d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abris
Réparer les services publics
- Organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital public afin d'éviter la saturation pendant l'été, proposer la revalorisation du travail de nuit et du week-end pour ses personnels
- Redonner à l'école publique son objectif d'émancipation en abrogeant le « choc des savoirs » de Macron, et préserver la liberté pédagogique
- Faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école : cantine scolaire, fournitures, transports, activités périscolaires
- Augmenter le montant du Pass'Sport à 150 euros et étendre son utilisation au sport scolaire en vue de la rentrée
Apaiser
- Relancer la création d'emplois aidés pour les associations, notamment sportives et d'éducation populaire
- Déployer de premières équipes de police de proximité, interdire les LBD et les grenades mutilantes, et démanteler les BRAV-M [brigade de répression de l'action violente motorisée]
Retrouver la paix en Kanaky-Nouvelle Calédonie
- Abandonner le processus de réforme constitutionnelle visant au dégel immédiat du corps électoral. C'est un geste fort d'apaisement qui permettra de retrouver le chemin du dialogue et de la recherche du consensus. À travers la mission de dialogue, renouer avec la promesse du « destin commun », dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa et d'impartialité de l'État, en soutenant la recherche d'un projet d'accord global qui engage un véritable processus d'émancipation et de décolonisation.
Mettre à l'ordre du jour des changements en Europe
- Refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire
- Proposer une réforme de la Politique agricole commune (PAC)
L'urgence de la Paix
Promouvoir une diplomatie française au service de la paix
Faire des propositions en vue d'une diplomatie de promotion des biens communs planétaires :
- Une diplomatie qui préserve notre environnement : reconnaissance du crime d'écocide, protection des fonds marins, défense de la gestion des pôles comme bien communs de l'humanité, soutenir la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale
- Une diplomatie au service de la santé : défendre la levée des brevets sur les vaccins et les moyens médicaux de lutte contre les pandémies
- Une diplomatie qui garantit la démilitarisation et la dépollution de l'espace
Adopter une diplomatie féministe en augmentant les financements internationaux pour les droits des femmes et en poussant l'adoption de la clause de la législation la plus favorisée en Europe
Faire respecter l'engagement de la France d'attribuer 0,7% de son RNB à l'aide publique au développement
Promouvoir une diplomatie française au service de la paix
Pour faire échec à la guerre d'agression de Vladimir Poutine, et qu'il réponde de ses crimes devant la justice internationale : défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien ainsi que l'intégrité de ses frontières, par la livraison d'armes nécessaires, l'annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs des oligarques qui contribuent à l'effort de guerre russe dans le cadre permis par le droit international, l'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires, dans un contexte international de tensions et de guerre sur le continent européen et œuvrer au retour de la paix.
Agir pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour une paix juste et durable
- Rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahu pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et faire respecter l'ordonnance de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui évoque, sans ambiguïtés, un risque de génocide
- Agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas, dont nous rejetons le projet théocratique, et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens
- Soutenir la Cour Pénale Internationale (CPI) dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement de Netanyahu
- Reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU
- Décréter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël
- Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahu tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie
- Demander la suspension de l'accord d‘association Union européenne – Israël, conditionné au respect des droits humains
- Permettre l'organisation d'élections libres sous contrôle international pour permettre aux Palestiniens de décider de leur destin
- Faire respecter la souveraineté du Liban et la protection des 700 Français engagés sous casque bleu pour le droit international
Partie 2
100 premiers jours
L'ÉTÉ DES BIFURCATIONS
Passés les 15 premiers jours, une session extraordinaire s'ouvrira à l'Assemblée nationale, où les groupes du Nouveau Front Populaire sont majoritaires, puis une seconde à la rentrée, après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Parlement tient une place beaucoup plus importante dans le type de gouvernement promu par le Nouveau Front Populaire.
Les députés sont particulièrement associés et / ou à l'initiative de 5 paquets législatifs pour amorcer les grandes bifurcations dont le pays a besoin. D'abord, à la suite des mesures d'urgence par décret, la présentation d'une grande loi permet de rattraper et d'améliorer la situation sociale des Français grandement paupérisés par 7 ans de macronisme et 3 ans d'inflation. Deux grandes lois permettront d'entamer la reconstruction des deux services publics les plus cruciaux : santé et éducation.
Une loi énergie climat permettra de jeter les bases de la planification écologique. Enfin, le premier projet de loi de finances rectificative sera présenté pour abolir les privilèges des milliardaires.
Faire une grande loi pour le pouvoir d'achat
- Organiser une grande conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification
- Indexer les salaires sur l'inflation et porter l'Allocation d'Autonomie Handicapée (AAH) au niveau du SMIC
- Abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie, annuler la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet, plafonner des frais bancaires, faire la gratuité des premiers kWh, abolir les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz (hors trêve hivernale), annuler les réformes Macron sur le revenu de solidarité active (RSA)
Faire une grande loi santé
- Réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux et rétablir des permanences de soin des soignants libéraux dans les centres de santé
- Conditionner l'ouverture des cliniques privées à la participation à la permanence des soins et à la garantie d'un reste à charge zéro
- Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social (médecins, infirmiers, aides-soignants, personnels administratifs) et de revalorisation des métiers et des salaires
- Créer un pôle public du médicament avec renforcement des obligations de stocks
- Interdire tous les polluants éternels (PFAS) pour toutes les utilisations, notamment les ustensiles de cuisine
Faire une grande loi éducation
- Réduire les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne de 19 élèves
- Moduler les dotations des établissements scolaires – y compris privés – en fonction de leur respect d'objectifs de mixité sociale
- Démocratiser l'université en abolissant Parcoursup et la sélection dans l'université publique, instaurer le repas à 1 euro dans les Crous [Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires]
- Investir dans l'Éducation nationale à hauteur des besoins en engageant la revalorisation des grilles de salaires, en réinvestissant dans les locaux scolaires, en renforçant les effectifs de la médecine scolaire – en garantissant le nombre de personnels par établissement – et de la vie scolaire en reconnaissant leur rôle pédagogique, en créant un service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap, en formant et titularisant les actuelles accompagnantes d'élèves en situation de handicap (AESH)
- Mettre en place une garantie d'autonomie qui complète les revenus des ménages situés sous le seuil de pauvreté (accessible dès 18 ans pour les personnes indépendantes fiscalement et dès 16 ans pour les élèves de l'enseignement professionnel)
Entamer la planification écologique
- Faire voter une loi énergie-climat
- Inscrire le principe de la règle verte
- Mettre en place un plan climat visant la neutralité carbone en 2050
- Assurer l'isolation complète des logements, en renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes
- Accélérer la rénovation des bâtiments publics (écoles, hôpitaux, etc)
- Renforcer la structuration de filières françaises et européennes de production d'énergies renouvelables (de la fabrication à la production)
- Faire de la France le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes
- Revenir sur la fusion entre l'Agence de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire (IRSN)
- Refuser la privatisation des barrages hydroélectriques
Lutter contre toutes les formes de racismes, contre l'antisémitisme et l'islamophobie
Au moment où l'extrême droite menace, nous rappelons que la parole et les actes racistes, antisémites et islamophobes se propagent dans toute la société et connaissent une explosion inquiétante, sans précédent. Aucune tolérance n'est de mise face à ces menaces et à ces comportements d'où qu'ils viennent.
S'attaquer à nos compatriotes pour leur couleur de peau ou leur religion supposée ou réelle, c'est s'attaquer à la République. En voir certains quitter ou vouloir quitter notre pays est un échec collectif.
Nous nous engageons à :
- Donner à la justice les moyens de poursuivre et de sanctionner les auteurs de propos ou actes racistes, islamophobes et antisémites
- Instaurer un Commissariat à l'égalité doté d'un Observatoire des discriminations et de pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel
- Adopter et mettre en œuvre un plan de lutte contre les discriminations, notamment à l'embauche, à la santé et au logement, et le renforcement des sanctions
L'antisémitisme a une histoire tragique dans notre pays qui ne doit pas se répéter. Tous ceux qui propagent la haine des juifs doivent être combattus.
- Nous proposerons un plan interministériel pour comprendre, prévenir et lutter contre l'antisémitisme en France, notamment à l'école et contre ses effets sur la vie des populations qui le subissent.
- Une autre haine cible particulièrement les musulmans ou les personnes assimilées à cette religion. Elle découle notamment de l'omniprésence des discours islamophobes dans certains médias, de presse écrite ou audiovisuelle.
- Nous proposerons un plan interministériel pour comprendre, prévenir et lutter contre l'islamophobie en France, et contre ses effets sur ceux qui la subissent.
- Nous assurerons la sécurité des lieux cultuels et culturels (juifs, musulmans, chrétiens) de notre pays en renforçant si nécessaire toutes les mesures de protection policières dont elles bénéficient.
Abolir les privilèges des milliardaires
Adopter un projet de loi de financement rectificative le 4 août, pour se doter d'une politique fiscale juste avec notamment les mesures suivantes :
- Accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches
- Rendre la CSG [Contribution sociale généralisée] progressive
- Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) renforcé avec un volet climatique
- Supprimer la flat tax et rétablir l'exit tax [peut s'appliquer lorsqu'un contribuable français transfère son domicile fiscal hors de France]
- Supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes
- Réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines et instaurer un héritage maximum
- Instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés
Partie 3
Les mois suivants
LES TRANSFORMATIONS
Une fois ces grands chantiers lancés, tout reste à faire pour tout changer ! Ce sera la tâche du gouvernement et des députés du Nouveau Front Populaire, en lien constant avec la société mobilisée, notamment les syndicats, associations, collectifs.
L'ambitieux programme législatif de transformation que le Nouveau Front Populaire se fixe pour les mois suivants est largement issu des propositions et revendications produites par cette société mobilisée. Sa cohérence globale c'est l'application pleine et entière du programme suivant : liberté, égalité, fraternité. Son cap c'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature.
Le service public est de retour
- Lancer le rattrapage des postes manquants de fonctionnaires à l'hôpital public, dans le soin et le médico-social, à l'école publique, dans la justice, dans les services et les agences de l'État, en revalorisant les métiers et les salaires
- Garantir l'accès aux services publics à toutes et tous sans condition de nationalité et sur tout le territoire par un plan d'investissement : personne ne doit habiter à plus de trente minutes d'un accueil physique des services publics
- Garantir l'accès à chaque famille à un mode de garde adapté grâce à un service public de la petite enfance ouvrant 500 000 places en crèches ou autre solution de garde
- Organiser des états généraux des quartiers populaires et des états généraux des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale, notamment dans les services publics
- Lancer un plan Grand âge en rénovant les EHPAD, en augmentant et en formant les professionnels du grand âge
- Interdire des placements hôteliers dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance et interdire les sorties sèches à 18 ans
- Faire une loi de programmation de la recherche plus ambitieuse
Garantir le droit au logement
Construire 200 000 logements publics par an pendant cinq ans aux normes écologiques les plus ambitieuses
Adopter une grande loi pour garantir le droit au logement effectif comprenant notamment :
- L'abrogation de la loi Kasbarian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement
- L'encadrement des loyers de manière obligatoire dans les zones tendues ainsi que des prix du foncier
- La garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et les locataires
- Aucune remise en cause de la loi SRU [Loi relative à la solidarité et au renouvellement urgain] et l'aggravation des sanctions contre les communes hors la loi
- L'ouverture du prêt à taux zéro à tous les ménages primoaccédants sans distinction géographique ou entre neuf ou ancien
Le nouveau droit à la retraite
Réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans
- Rétablir les facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron
- Prendre en compte le RSA pour valider des trimestres en vue de la retraite
- Indexer le montant des retraites sur les salaires
- Soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne salariale, les rachats d'action, les heures supplémentaires
- Augmenter de 0,25 point par an pendant 5 ans les cotisations vieillesse et moduler les cotisations sociales patronales
- Créer une surcotisation sur les hauts salaires
Vers une 6e République
Abolir la monarchie présidentielle dans la pratique des institutions :
- Instaurer la proportionnelle
- Revitaliser le parlement
- Abroger le 49.3
- Défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la République
Instaurer le référendum d'initiative citoyenne (RIC) et renforcer le référendum d'initiative partagée en abaissant notamment le seuil de signatures citoyennes pour son déclenchement
Passer à une 6e République par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue
Sûreté, Sécurité et Justice
- Assurer la sécurité de la population par le rétablissement de la police de proximité, la suppression de la réforme Darmanin qui a affaibli la police judiciaire, le maintien de l'ensemble des gendarmeries, l'augmentation des effectifs de police judiciaire, technique, scientifique, du renseignement, des unités en charge du narcotrafic, de la délinquance financière, du trafic d'êtres humains et du démantèlement des réseaux mafieux
- Revoir et allonger la formation des policiers
- Mettre en place un nouveau code de déontologie, supprimer l'IGPN [Inspection générale de la police nationale] et l'IGGN [Inspection générale de la gendarmerie nationale] et les remplacer par un nouvel organisme indépendant, rattaché à la Défenseure des droits
- Augmenter les moyens de la justice pour garantir un traitement juste et dans un délai raisonnable de l'ensemble des procédures, notamment par l'embauche de magistrats, greffiers, agents de la protection judiciaire de la jeunesse
- Agir contre la surpopulation carcérale, assurer des conditions dignes de détention et donner les moyens à l'administration pénitentiaire et judiciaire de réaliser sa mission en toute sécurité
- Mettre en place les récépissés pour les contrôles d'identité
Faire bifurquer l'économie et réindustrialiser la France
- Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et de l'Europe dans les domaines stratégiques (semi-conducteurs, médicaments, technologies de pointe, voitures électriques, panneaux solaires, etc.)
- Réaliser un diagnostic préalable des ressources naturelles avant implantation industrielle
- Encadrer la sous-traitance, garantir la responsabilité du donneur d'ordre et mettre en place des quotas de sous-traitants issus du tissu de TPE/PME et de l'artisanat local
- Conditionner les aides aux entreprises au respect de critères environnementaux, sociaux et de lutte contre les discriminations au sein de l'entreprise. Les inscrire dans une stratégie industrielle publique. Exiger le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties
- Faire des salariés de véritables acteurs de la vie économique, en leur réservant au moins un tiers des sièges dans les Conseils d'Administration et en élargissant leur droit d'intervention dans l'entreprise
- Réglementer la banque et la finance pour éviter de nouvelles crises et financer l'économie réelle :
- Augmenter les réserves des banques pour faire face aux risques climatiques
- Zero financement des banques pour les énergies fossiles en commençant par les nouveaux projets
- Taxation renforcée des transactions financières
- Créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous la forme d'une coopérative
- Accompagner les reprises des entreprises en SCOP par les salariés
- Créer un pôle public bancaire s'appuyant sur la caisse des dépôts et des consignations et la banque publique d'investissement qui aura notamment pour tâche d'affecter la collecte de l'épargne réglementée vers les besoins sociaux et écologiques
Défendre les droits des travailleurs
- Organiser une conférence nationale sur le travail et la pénibilité visant au rétablissement de la durée effective hebdomadaire du travail à 35 heures, au passage aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit immédiatement et son extension par la négociation collective
- Adopter un plan d'action « zéro mort au travail » par le rétablissement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'embauche d'inspecteurs du travail et de médecins du travail, la mise à jour du tableau des maladies professionnelles en intégrant notamment le burn-out
Développer les transports publics et écologiques
- Garantir des tarifs accessibles et des mesures de gratuité ciblée (jeunes, précaires, etc.) dans les transports publics et baisser la TVA sur la tarification des transports en commun à 5,5%
- Mettre en place un plan rail et fret, créer des services express régionaux, adopter un moratoire sur la fermeture des petites lignes et les rouvrir dès que possible, revenir sur la privatisation de Fret SNCF
Conserver la biodiversité
- Défendre les zones agricoles, naturelles et les zones humides, doubler et améliorer la protection des aires maritimes protégées
- Protéger la forêt en garantissant la diversité des essences, avec une filière sylvicole respectueuse de la biodiversité et des sols, garantissant les qualifications et les emplois des forestiers
- Rétablir les milliers de postes supprimés dans le service public de suivi et de protection de la nature : à l'Office national des forêts, à l'Office français de la biodiversité, à Météo France, au Cerema [Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement]
L'eau, notre bien commun
- Passer à la gestion 100% publique de l'eau en régies locales : pour la gratuité des premiers mètres-cubes indispensables à la vie et la tarification progressive et différentielle selon les usages
- Atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux) et réserves souterraines et faire contribuer les industriels à la dépollution des nappes et des sols
- Mailler le territoire de fontaines à eau, de douches et de sanitaires publics et gratuits
Pour une agriculture écologique et paysanne
- Annuler l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (CETA) ; renoncer à l'accord du Mercosur et protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale
- Interdire l'importation de toute production agricole ne respectant pas nos normes sociales et environnementales
- Lutter contre l'accaparement des terres et permettre à chaque agriculteur qui souhaite s'installer d'accéder à une exploitation pour préserver le modèle agricole familial
- Soutenir la filière du bio et l'agroécologie, encourager la conversion en bio des exploitations en reprenant leur dette dans une caisse nationale et garantir un débouché aux produits bio dans la restauration collective
- Rétablir le plan Ecophyto, interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes avec accompagnement financier des paysans concernés
Pour l'émancipation de la jeunesse
- Arrêter le Service National Universel (SNU) pour soutenir à nouveau les associations de jeunesse et d'éducation populaire
- Créer un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes permettant d'accéder à l'ensemble des trains, transports en commun ainsi qu'aux vélos et voitures en libre service du territoire français
Étendre les droits des femmes et des personnes LGBTQI
- Adopter une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en portant le budget à 2,6 milliards d'euros comme demandé par les associations
- Instaurer l'égalité salariale et créer un congé menstruel dans les entreprises et administrations
- Prendre en charge par la Sécurité sociale les protections menstruelles et sanctionner les fabricants qui ne respectent pas le contrôle sanitaire et la régulation des prix
- Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la procréation médicalement assistée (PMA), la rendre accessible aux personnes trans
- Mettre en œuvre un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTQI
- Autoriser le changement d'état-civil libre et gratuit devant un officier d'état civil
- Faire face à l'offensive transphobe : lutter contre la transphobie et augmenter les moyens dans la santé pour les transitions
Rompre avec la maltraitance animale
- Sortir des fermes-usines, améliorer le bien-être animal et interdire l'élevage en cages d'ici la fin de mandature
Un service public des arts et de la culture et des médias au service de l'émancipation
- Renforcer le budget public consacré à l'art, la culture et la création pour le porter à 1% du PIB par an
- Limiter strictement la concentration dans les industries culturelles et les médias dans les mains de quelques propriétaires et exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes
- Défendre l'indépendance des rédactions face à leurs propriétaires
- Garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel en instaurant un financement durable, lisible, socialement juste et en garantissant son indépendance
- Étendre la gratuité dans tous les musées nationaux, garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusifs des lieux privés
- Défendre et améliorer le régime des intermittents et aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes-auteurs
Une République laïque
- Engager un vaste plan de formation des fonctionnaires à la laïcité, aux principes juridiques de la loi de 1905, renforcer la pédagogie de la laïcité dans l'Éducation nationale pour accompagner les professeurs
- Augmenter les moyens de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et élargir son domaine d'intervention au domaine de la formation professionnelle et de la santé publique
- Refuser les financements publics pour la construction de nouveaux édifices religieux, dédiés aux activités cultuelles ou d'établissements confessionnels
Pour un sport populaire
- Fixer la pratique de l'EPS à quatre heures hebdomadaires tout au long de la scolarité et créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré
- Porter un plan de 10 000 équipements sportifs supplémentaires, pensé pour favoriser la pratique du sport féminin et du parasport.
- Rénover les équipements sportifs existants, notamment dans les universités
- Porter les moyens du ministère des sports à 1% du budget de l'État
- Développer des maisons de Sport-Santé dans tout le pays et rembourser le sport sur ordonnance
Les Outre-mer, avant-postes de la planification écologique
- Réglementer les tarifs de desserte aérienne
- Mettre en place un taux maximal de sucre dans les aliments transformés
- Organiser un congrès général des territoires éloignés et insulaires pour établir un plan d'action partagé pour l'égalité et l'autonomie dans les Outre-mer sur la base des cahiers de revendications et des « plans pays » et la mise en place d'un plan quinquennal d'investissement
- Organiser la distribution de bouteilles d'eau et plafonner le prix de l'eau partout où le service d'eau potable est défaillant via modification du plan ORSEC-eau, et mettre en place de grands travaux de rénovation des canalisations
- Créer un fonds d'indemnisation et de prévention contre les pollutions pour indemniser et assurer la prise en charge médicale des victimes du chlordécone et des sargasses et investir dans la dépollution et la décontamination des sols et des eaux (chlordécone et glyphosate aux Antilles, mercure en Guyane, essais nucléaires en Polynésie…)
- Cesser de faire de Mayotte un territoire de seconde zone de la République. Étendre l'aide médicale d'État, aligner les niveaux du RSA et du SMIC sur le reste du pays et scolariser systématiquement tous les enfants
- Prendre systématiquement en compte les outre-mers dans chaque texte législatif
- Lutter contre les situations de monopole dans les Outre-mer
- Proposer un principe de faveur des ultra-marins sur les postes à responsabilité et favoriser le retour des fonctionnaires d'État
- Favoriser l'enseignement des langues régionales en outre-mer
- Lancer un plan spécifique de rattrapage en matière de désenclavement routier et ferroviaire en Guyane
Garantir un accueil digne
- Abroger les lois asile et immigration de Macron
- Mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre, dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile
- Assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile
- Faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence
- Créer un statut de déplacé climatique
- Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire
- Créer des voies légales et sécurisées d'immigration
- Réviser le pacte asile immigration européen pour un accueil digne des migrants
- Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile
- Renforcer les politiques de co-développement aux services des populations
- Garantir l'accès à l'aide médicale d'État
- Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l'obtention de la nationalité française
Défendre les libertés publiques
- Abroger le contrat d'engagement républicain liberticide pour les associations
- Organiser des États généraux sur les libertés publiques
- Abroger les dispositions liberticides des lois sécurité globale, séparatisme, et les lois qui instaurent un état d'urgence permanent et portent atteinte à nos libertés individuelles et collectives, et réviser la loi et la doctrine sur l'ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d'obtempérer
- Interdire la reconnaissance faciale et évaluer de manière indépendante les dispositifs de vidéosurveillance en lien avec le défenseur des droits
- Protéger les lanceurs d'alerte
- Défendre et renforcer les libertés syndicales et associatives et en finir avec leur répression
Europe
- Refuser le pacte de stabilité budgétaire
- Proposer un pacte européen pour le climat et l'urgence sociale
- Proposer une réforme de la Politique agricole commune (PAC)
- Mettre fin aux traités de libre-échange
- Instaurer un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe
- Adopter un mécanisme d'harmonisation sociale par le haut entre les États pour mettre fin aux politiques de dumping social et fiscal
- Réindustrialiser l'Europe : numérique, industrie du médicament, énergie, etc.
- Instaurer une règle verte pour prioriser des investissements verts
- Taxer les plus riches au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l'Union européenne
- Généraliser la taxation des superprofits au niveau européen
- Modifier le droit de la concurrence en Europe pour garantir le droit de monopole public au niveau national
- Passer au vote à la majorité qualifiée au conseil pour les questions fiscales
Conformément à ce que nos groupes ont voté à l'Assemblée nationale, nous refuserons, pour l'application de notre contrat de législature, le pacte budgétaire, le droit de la concurrence lorsqu'il remet en cause les services publics et nous rejetterons les traités de libre-échange.
*****
« Emmanuel Macron voulait nous diviser, il nous a en réalité rassemblé. Maintenant tous en campagne ! » – Manon Aubry
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « Sud global » avec Poutine ?

Le 10 juin 2024, les résultats sont tombés ; le délégué de la principale centrale syndicale Russe, la FNPR, est élu comme membre adjoint au Conseil d'administration du Bureau international du travail (BIT), avec 65 voix sur 126 votant·es (voir document joint).
À deux voix près, le représentant de la centrale ouvertement pro-Poutine et soutien affiché à « l'Opération spéciale » en Ukraine, n'aurait donc pas été élu. Cela aurait été une première au sein de l'OIT, une « humiliation », selon Frédéric Koller un journaliste Suisse qui a suivi ces élections. De fait, les candidat·es, préalablement identifiés et sélectionnés par les syndicats, « sont habituellement élus avec une centaine de voix ou sans opposition lors d'un scrutin à bulletins secrets ».
Dans le même sens, le journaliste relève que le représentant Chinois de la Fédération nationale des syndicats de Chine (FNSC-ACFTU), une autre gigantesque centrale syndicale (plus de 130 millions de membres) complètement inféodée au pouvoir, a été élu plus difficilement qu'à l'accoutumé : « [a]vec 88 voix, le candidat chinois, autre surprise, est lui aussi l'un des plus mal élus » des représentants des travailleurs et des travailleuses.
Un syndicaliste ukrainien a quant à lui été élu sans contestation, par consensus, comme membre suppléant au Conseil d'administration du BIT ; c'est également une première. Un représentant des syndicats du « territoire palestinien occupé », selon la formule de l'OIT a également été élu.
Trois éléments ressortent en particulier de ce résultat.
En premier lieu ce vote rappelle une nouvelle fois que, comme ailleurs, les positions politiques des travailleurs et des travailleuses du « Sud » ne sauraient être mécaniquement associées à celles de leur dirigeant·es. De fait, nombre de dirigeant·es du « Sud global » soutiennent ouvertement Poutine ou Xi Jinping, au nom d'une prétendue solidarité anticoloniale, d'une lutte contre l'impérialisme occidental ou, plus surement encore, de la promotion d'un « monde multipolaire », c'est-à-dire d'un monde aux multiples régimes autoritaires. A contrario, le vote des délégué·es syndicaux à l'OIT - à bulletin secret - révèle que nombre d'entre eux et elles ne sont pas dupes et que la classe ouvrière n'a rien à gagner à les soutenir. Il est donc faux de marteler, comme le font certain-es à gauche, que la « moitié de l'humanité » appuie Poutine et la colonisation de l'Ukraine par exemple [1].
Le nouveau représentant syndical ukrainien à l'OIT, Vasyl Andreyev, souligne en ce sens :
« On nous disait qu'il y aurait un vote du Sud global contre le Nord global. La réalité est différente. Le faible résultat du candidat russe montre qu'il y a de moins en moins de soutien aux va-t-en-guerre. »
Dans le même sens, Luca Cirigliano, un syndicaliste suisse également élu au CA, relève :
« Le score russe surtout, mais aussi le chinois sont une immense gifle. Cela démontre que la diplomatie du chéquier, pratiquée par Moscou et Pékin, n'a pas fonctionné. C'est un très bon signe pour l'OIT et le syndicalisme international. »
Le deuxième élément à retenir est beaucoup moins réjouissant pour le syndicalisme international. Ce vote a en effet été l'occasion d'apprendre que la Confédération syndicale internationale (CSI-ITUC) a ouvertement déconseillé au candidat Ukrainien de déposer sa candidature face à celle du candidat Russe de la FNPR ; celui-là même qui a finalement été élu de justesse au poste d'adjoint au Conseil d'administration. La CSI craignait une vague d'opposition du « Sud global » et la remise en cause de la solidarité internationale. C'est du moins ce qu'affirme Vasyl Andreyev, après le vote, regrettant alors de ne pas avoir déposé sa candidature malgré tout :
« C'est notre faute, explique-t-il, nous n'avons pas osé le faire. » Pourquoi ? Parce que les dirigeants de la Confédération syndicale internationale ont fait comprendre aux Ukrainiens qu'ils n'auraient aucune chance en raison du soutien du « Sud global » à la Russie et qu'il valait mieux « ne pas rompre la solidarité internationale ». « C'était prendre le risque de perdre dans un vote de blocs ».
Ainsi, au nom d'une présumée « solidarité internationale » des syndicalistes du « Sud global » avec la Russie coloniale, la direction de la CSI aurait demandé au représentant de travailleurs et travailleuses ukrainien·nes, qui vivent quotidiennement sous les bombes de Poutine, de retirer sa candidature au profit d'une centrale syndicale qui milite ouvertement pour coloniser l'Ukraine. Il est difficile de penser que la solidarité syndicale internationale sorte grandie d'une telle prise de position qui n'est ni plus ni moins qu'un renoncement à l'internationalisme et à la solidarité de la classe ouvrière au profit de calculs stratégiques pusillanimes.
Enfin, dernièrement, ce vote révèle à quel point au Québec et au Canada, comme ailleurs, la démocratie syndicale a des progrès à faire. À notre connaissance, aucune centrale canadienne n'a communiqué sur le sujet. Nous ne savons donc toujours pas quelles positions ont été défendues par nos représentant.es lors du vote à l'OIT, comme auparavant lors des discussions à la Confédération syndicale internationale (CSA-ITUC) et encore avant à la Confédération syndicale des Amériques (CSA-TUCA). Tout au plus, grâce à l'OIT cependant, on sait que Mme Lily Chang, ancienne trésorière du Congrès du travail canadien (CTC), a été élue membre permanente du Conseil d'administration de l'OIT comme représentante des travailleurs et travailleuses.
Reste maintenant à savoir quelles positions politiques elle défendra en notre nom et ce que revendiqueront nos directions syndicales à l'OIT au nom de l'internationalisme.
Martin Gallié
Le 14 juin 2024
Ce texte fait suite à un premier texte paru dans l'édition précédente de presse toi à gauche.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Voir par exemple l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale française en 2022 : « A l'ONU, dans le vote sur la résolution à propos de l'Ukraine, notant l'abstention de l'Inde et de la Chine, c'est-à-dire de 50 % de l'humanité. C'est un signal d'une extrême importance. Un autre ordre géopolitique du monde s'installe déjà, à partir de l'Asie. Il est temps alors d'actualiser nos conceptions ». https://lafranceinsoumise.fr/2022/02/28/guerre-en-ukraine-intervention-de-jean-luc-melenchon-a-lassemblee-nationale/

Législatives (France) - Nouveau Front populaire : un programme économique d’alternative au macronisme

Présenté le 14 juin, le programme économique de l'alliance de gauche est classiquement social-démocrate : il met l'accent sur le rôle de l'État, la lutte contre les inégalités et le détricotage des réformes macronistes.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
14 juin 2024
Par Romaric Godin
La part économique du « contrat de législature » du Nouveau Front populaire (NFP) n'est pas à proprement parler un programme. On n'y trouvera pas d'éléments de chiffrage, mais c'est le corollaire naturel d'une campagne courte. En revanche, ce contrat dessine un certain nombre d'actions prévues selon un calendrier en trois phases : dans les deux premières semaines, dans les cent jours et dans le reste de la législature.
Cette division chronologique permet de distinguer les priorités et de déployer une action en posant les fondements de décisions plus profondes. En cela, ce projet n'abandonne pas une ambition de transformation qui constitue sa troisième partie. Mais il prend en compte la situation politique et sociale qui impose d'abord de réparer un pays soumis à la violence néolibérale depuis près de quinze ans.
Soutien au niveau de vie
La première étape pourrait donc être qualifiée de « défensive », il s'agit d'en finir avec la violence néolibérale de l'ère Macron, en prenant des mesures de protection et en revenant sur certaines réformes. Il y aura donc une abrogation dela réforme des retraites de 2023et de la réforme de l'assurance-chômage (rien n'est précisé concernant les trois précédentes réformes).
La protection, elle, passe par une tentative de maîtrise de l'inflation par « le blocage des prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants ». Dans le domaine agricole, la garantie du prix plancher est ainsi compensée par une taxation des superprofits de l'agro-industrie et de la grande distribution, empêchant le cercle vicieux de l'effet d'aubaine pour les profits qui a enflammé les prix en 2022 et 2023.
Mais la question du niveau de vie est moins aujourd'hui l'augmentation actuelle des prix que leur niveau depuis trois ans au regard de l'évolution des salaires. C'est pour cette raison que les mesures proposées sont d'abord centrées sur le renforcement des revenus : augmentation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, l'augmentation du Smic à 1 600 euros net, hausse de 10 % du point d'indice des fonctionnaires.
Cette politique peut être qualifiée de « réparatrice » pour venir compenser la baisse du niveau de vie que l'inflation a induite depuis 2021. Ces premières mesures peuvent paraître relativement modestes et elles le sont, mais elles sont aussi les seules qui peuvent être prises rapidement par la décision d'un gouvernement. Compte tenu de l'état désastreux du secteur du commerce en France, ces mesures ne peuvent cependant qu'être un soutien, au moins provisoire, à l'activité dans les premières semaines.
Le projet de loi de finances rectificative du 4 août viendra rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) « renforcé avec un volet climatique ».
Les cent premiers jours du gouvernement de ce Nouveau Front populaire verront l'élargissement des mesures de soutien à l'économie. L'union de la gauche propose ainsi le rétablissement dans les trois mois de l'indexation des salaires sur l'inflation en parallèle d'une grande « conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification ». L'articulation de ces deux mesures reste en grande partie à construire et le projet ne précise pas quels seront les objectifs de ladite conférence. Une chose est certaine : après quatre décennies de néolibéralisme, l'État devra soutenir fermement les intérêts du travail contre la tentation du chantage à l'emploi que le capital ne manquera pas d'entonner rapidement.
L'indexation des salaires sur l'inflation arrivera sans doute un peu tard, mais c'est une garantie minimale de protection de leur niveau de vie pour les salariés. Une telle mesure sera-t-elle inflationniste ou récessive dans la mesure où elle pèsera sur les profits ? pas nécessairement. Elle permettra d'éviter tout recul de la consommation comme ce fut le cas en 2023 en France et donc assurera des débouchés sur le marché intérieur pour les entreprises nationales.
Certes, sans augmentation de la productivité, il pourrait y avoir un effet inflationniste. Mais là encore, l'indexation des salaires sur l'inflation, en faisant pression sur la rentabilité des entreprises, est une incitation directe pour les entreprises à investir et à améliorer leur productivité pour, précisément, réduire la part du travail dans leurs coûts.
Rappelons que quarante ans de politiques néolibérales ont prétendu améliorer les gains de productivité alors même qu'elles ont conduit à une réduction de ces gains. Concernant la France, les aides massives au capital et la baisse du coût du travail ont même eu un effet désincitatif qui a conduit à privilégier les emplois peu productifs, conduisant à un fait inédit depuis plusieurs décennies, une baisse notable et durable de la productivité.
Planification écologique et égalité fiscale
Bref, le projet du NFP n'est pas « anti-économique » ni « absurde » économiquement, même si, on le verra, il convient d'apporter quelques réserves. C'est un pari que le moteur du redressement de la productivité réside non pas dans un soutien aveugle au capital, mais dans un appui aux salaires et dans une politique ambitieuse d'investissements publics.
À ce sujet, le NFP entend mettre en place des investissements ambitieux, notamment dans la transformation écologique. Les aides aux ménages seront « renforcées », permettant d'assurer « l'isolation complète des logements », la rénovation des bâtiments publics sera « accélérée », les « filières françaises et européennes de production d'énergies renouvelables » seront « renforcées ». Ce dernier point reste assez flou, il sera déployé dans la phase suivante, après les cent jours.
Dans cette phase, le NFP propose une politique de « reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et de l'Europe dans les domaines stratégiques », qui sera accompagnée d'une inscription dans cette stratégie industrielle des aides publiques aux entreprises, lesquelles seront conditionnées à des critères environnementaux et sociaux. Un pôle public bancaire viendra collecter l'épargne pour le financement de cette politique. Ce dernier élément mis à part, on n'est pas très loin d'une ambition proche des plans de Joe Biden aux États-Unis, qui a mis en place un fléchage des investissements et des aides, accompagné de mesures protectionnistes (défendues par le NFP sous la forme d'une « taxe kilométrique sur les produits importés »). Tout cela est totalement différent des « arrosages massifs » de la politique défendue par Emmanuel Macron.
Ce pôle bancaire public n'est alors pas anecdotique. Il permet précisément de contourner le « privilège exorbitant » que représente le dollar pour les États-Unis. Il s'agit de passer le moins possible par les marchés financiers pour financer des mesures cruciales et urgentes et bien plutôt de piocher dans l'abondante source de l'épargne des ménages.
Le projet du RN, fondé sur l'exploitation économique des minorités et la discrimination, […] s'inscrit largement dans la continuité néolibérale.
Logiquement, pour rendre ce pôle public attractif, le NFP doit brider la finance et propose d'encadrer les investissements bancaires et de mettre en place une taxe sur les transactions financières. En parallèle, les finances publiques seront renforcées, dès les cent jours (le projet évoque la date symbolique du 4 août) par une remise en cause des politiques fiscales anti-redistributives de l'ère Macron.
Ce projet de loi de finances rectificative du 4 août viendra ainsi rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) « renforcé avec un volet climatique » qui pourrait venir frapper les activités les plus écocides. L'« exit tax », venant taxer les plus-values de cession des entreprises délocalisées, détricotée par Emmanuel Macron, sera aussi rétablie. Le projet du NFP propose aussi de supprimer les « niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes ».
Ces mesures ne visent pas qu'à financer la politique proposée, mais aussi à réduire les inégalités dont les conséquences néfastes sur l'économie ont été largement documentées. Ainsi, il sera proposé de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu avec quatorze tranches (contre cinq aujourd'hui), ce qui rendra les effets des hausses de salaires moins violents. La CSG deviendra aussi plus progressive (il existe aujourd'hui seulement quelques taux différenciés dans certains cas). Enfin, l'impôt sur l'héritage sera plus progressif et ciblera les plus hauts patrimoines, avec la mise en place d'un héritage maximum.
Un projet irréaliste ?
Ce projet mériterait encore d'être précisé, la campagne le permettra peut-être, mais il a le mérite de fixer un cap. Et il convient d'emblée d'écarter les critiques venant de la droite et de l'extrême droite et jouant sur les ressorts classiques de l'impossibilité et du caractère dangereux de ce projet. Ce levier classique a déjà été activé par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Mairele 14 juin sur France Info qui, sans avoir vu l'ébauche du programme, publié trois heures plus tard, a déjà promis « le retour du chômage de masse » dans le cas de son application.
La réalité est que, face à ce projet, les deux alternatives ne sont pas plus raisonnables, loin de là. Passons rapidement sur le projet du Rassemblement national, fondé sur l'exploitation économique des minorités et la discrimination et qui ne finance aucune dépense sérieusement et s'inscrit largement dans la continuité néolibérale. Mais le camp macroniste est-il en condition de donner des leçons ?
L'actuelle majorité présidentielle passe son temps à se gargariser de son « succès économique », mais celui-ci est une chimère. La baisse du chômage s'explique en grande partie par la baisse de la productivité et des aides publiques qui financent des bas salaires. La politique menée depuis 2017 a conduit à une dégradation nette et constante des finances publiques par l'affaiblissement des recettes à coups de cadeaux fiscaux pour les entreprises. La croissance, pourtant élevée au rang de vertu cardinale par la majorité sortante, est en berne : le PIB du dernier trimestre se situe encore 1,8 % en deçà de ce qu'aurait été son niveau si la tendance 2009–2019 s'était poursuivie. Et cela, malgré les milliards déversés. Mais, on l'a vu, la crise du niveau de vie est passée par là.
Pour régler cette situation inextricable et compte tenu d'une dégradation historique de la productivité, la seule proposition de la majorité sortante est la répression sociale par l'austérité et par la réduction des droits des travailleurs. C'est la seule façon de rétablir une forme de politique consensuelle au sein du capital entre ceux qui bénéficient des aides publiques et ceux qui veulent des garanties de remboursement de la dette publique. Cette politique a d'ailleurs commencé : après la réforme des retraites en 2023 et la coupe de 10 milliards d'eurosdans le budget en début d'année 2024, le gouvernement n'a d'autres promesses qu'une nouvelle réforme de l'assurance-chômage et de nouvelles coupes budgétaires massives.
La rhétorique des « réformes douloureuses, mais nécessaires » est un classique du néolibéralisme, mais après sept ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée, elle est clairement émoussée. S'il est une chose que prouve cette dissolution en panique, c'est bien l'échec patent de cette politique et son rejet massif par la population française. En cela, les leçons d'économie des partisans du chef de l'État traduisent davantage les positions de classe de ceux qui les formulent qu'une réalité quelconque.
Le projet du Nouveau Front populaire prend acte de cet échec et cherche en partie son inspiration dans la politique de Joe Biden. C'est un projet keynésien et social-démocrate cherchant à rééquilibrer la distribution de richesses et à stimuler l'investissement par la demande et la dépense publique.
Les obstacles
Un tel chemin n'est cependant pas sans obstacles. Compte tenu de l'état du capitalisme, il est difficile d'envisager qu'une quelconque politique économique se résume à une promenade de santé. La question n'est pas réellement là, mais bien plutôt dans les priorités qui sont posées. Doit-on protéger d'abord les salariés et, parmi eux, les plus faibles, ou favoriser l'accumulation du capital ? Doit-on faire de l'écologie une priorité absolue face à la croissance ? Ces questions vont inévitablement se poser à un potentiel gouvernement de gauche.
La politique préconisée par le NFP vient rompre l'alliance scellée par le macronisme entre le capital financier et le capital industriel que l'on vient de décrire. Inévitablement, le premier et une partie du second, effrayés par la politique de redistribution, entreront en conflit avec le gouvernement français. Ce dernier, comme durant la période 1981-1983 ou celle du quinquennat Hollande, sera sous la pression des classes dominantes qui, se sentant attaquées, vont riposter par des fuites de capitaux et par un chantage à l'emploi.
Si la Banque centrale européenne (BCE) dispose désormais des moyens de contrer une véritable crise de la dette publique, on a vu dans le cas grec voici dix ans que cette institution pouvait n'être pas aussi neutre politiquement qu'elle le prétend. Francfort pourrait faire pression sur Paris et, là encore, il faudra tenir et placer la BCE face à ses responsabilités.
Il en sera de même avec Bruxelles. Le projet du NFP insiste sur son rejet de l'austérité et des nouvelles règles budgétaires européennes. Mais là encore, cela implique de ne pas se soumettre aux demandes de la Commission et d'en assumer les conséquences. La France est un pays clé de la zone euro et une source de matière première incontournable pour les marchés financiers.
Une crise de la dette française risquerait de tourner en une crise financière généralisée. Il faudra donc tenir le cap et ne pas céder à la panique et aux pressions. Pour cela, il semble indispensable que se construise un mouvement social fort en soutien à cette politique et conscient des sacrifices à faire pour construire un avenir durable hors du néolibéralisme.
Il reste un autre écueil à ce projet. Le pari qui est fait ici est celui d'une possibilité du « capitalisme vert et social ». C'est ce qui fait que ce projet est authentiquement social-démocrate, il entend donner une chance au système actuel d'être, avec l'appui de l'État, plus vertueux socialement et écologiquement. Le projet n'évoque aucun projet de dépassement de la croissance comme horizon, ni de renforcement majeur du pouvoir des travailleurs (ni même de l'État).
Or, il existe une hypothèse que ce projet soit au-delà des forces du capitalisme actuel et qu'il faille engager une transformation beaucoup plus profonde du système économique pour faire face aux crises écologiques et sociales, notamment remettre en cause la logique des besoins capitalistes et l'accumulation même du capital. Dans ce cas, quel sera le chemin choisi par cette alliance politique ? Tout retour en arrière supposera une aggravation de l'exploitation de la nature et du travail.
L'urgence de ces élections législatives a conduit l'alliance de gauche à favoriser un projet permettant de lisser ses divergences internes sur l'économie, notamment sur la question de la croissance, essentielle pour faire face aux crises actuelles. Mais l'exercice du pouvoir ne manquera pas de ramener ces questions au premier plan. L'enjeu sera alors de construire un nouveau compromis, permettant d'affronter ces difficultés.
Il faut noter cependant que ces difficultés, contrairement à ce que l'on entend souvent, ne sont pas le signe d'un irréalisme de la politique proposée, mais bien plutôt du fait que les priorités énoncées permettent de se confronter réellement à la situation concrète du capitalisme contemporain. C'est donc une option difficile, mais profondément réaliste. À l'inverse, l'option néolibérale se berce dans l'illusion que faciliter l'accumulation du capital permettra de résoudre l'ensemble des problèmes sociaux et écologiques.
Le projet du Nouveau Front populaire n'est donc pas la caricature que ses adversaires en font. Mais si l'on considère que son esprit est la priorité donnée à la résolution de la double crise environnementale et sociale, son principal obstacle réside bien davantage dans sa détermination politique que dans de supposées « lois économiques » immuables.
Romaric Godin
P.-S.
• Mediapart, 14 juin 2024 à 19h01 :
https://www.mediapart.fr/journal/politique/140624/nouveau-front-populaire-un-programme-economique-d-alternative-au-macronisme
Législatives (France) - Nouveau Front populaire : un programme économique d'alternative au macronisme
vendredi 14 juin 2024, par GODIN Romaric
mailfacebooklinkedinnetvibesprinterreddittechnoratitumblrtwitterviadeo
programme (économique)
Alternatives (Fr)
Nouveau Front Populaire (France)
Présenté le 14 juin, le programme économique de l'alliance de gauche est classiquement social-démocrate : il met l'accent sur le rôle de l'État, la lutte contre les inégalités et le détricotage des réformes macronistes.
Sommaire
Soutien au niveau de vie
Planification écologique (...)
Un projet irréaliste ?
Les obstacles
La part économique du « contrat de législature » du Nouveau Front populaire (NFP) n'est pas à proprement parler un programme. On n'y trouvera pas d'éléments de chiffrage, mais c'est le corollaire naturel d'une campagne courte. En revanche, ce contrat dessine un certain nombre d'actions prévues selon un calendrier en trois phases : dans les deux premières semaines, dans les cent jours et dans le reste de la législature.
La présentation du programme du Nouveau Front populaire à Paris le 14 juin. © JULIEN DE ROSA / AFP
Cette division chronologique permet de distinguer les priorités et de déployer une action en posant les fondements de décisions plus profondes. En cela, ce projet n'abandonne pas une ambition de transformation qui constitue sa troisième partie. Mais il prend en compte la situation politique et sociale qui impose d'abord de réparer un pays soumis à la violence néolibérale depuis près de quinze ans.
Soutien au niveau de vie
La première étape pourrait donc être qualifiée de « défensive », il s'agit d'en finir avec la violence néolibérale de l'ère Macron, en prenant des mesures de protection et en revenant sur certaines réformes. Il y aura donc une abrogation de la réforme des retraites de 2023 et de la réforme de l'assurance-chômage (rien n'est précisé concernant les trois précédentes réformes).
La protection, elle, passe par une tentative de maîtrise de l'inflation par « le blocage des prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants ». Dans le domaine agricole, la garantie du prix plancher est ainsi compensée par une taxation des superprofits de l'agro-industrie et de la grande distribution, empêchant le cercle vicieux de l'effet d'aubaine pour les profits qui a enflammé les prix en 2022 et 2023.
Mais la question du niveau de vie est moins aujourd'hui l'augmentation actuelle des prix que leur niveau depuis trois ans au regard de l'évolution des salaires. C'est pour cette raison que les mesures proposées sont d'abord centrées sur le renforcement des revenus : augmentation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, l'augmentation du Smic à 1 600 euros net, hausse de 10 % du point d'indice des fonctionnaires.
Cette politique peut être qualifiée de « réparatrice » pour venir compenser la baisse du niveau de vie que l'inflation a induite depuis 2021. Ces premières mesures peuvent paraître relativement modestes et elles le sont, mais elles sont aussi les seules qui peuvent être prises rapidement par la décision d'un gouvernement. Compte tenu de l'état désastreux du secteur du commerce en France, ces mesures ne peuvent cependant qu'être un soutien, au moins provisoire, à l'activité dans les premières semaines.
Le projet de loi de finances rectificative du 4 août viendra rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) « renforcé avec un volet climatique ».
Les cent premiers jours du gouvernement de ce Nouveau Front populaire verront l'élargissement des mesures de soutien à l'économie. L'union de la gauche propose ainsi le rétablissement dans les trois mois de l'indexation des salaires sur l'inflation en parallèle d'une grande « conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification ». L'articulation de ces deux mesures reste en grande partie à construire et le projet ne précise pas quels seront les objectifs de ladite conférence. Une chose est certaine : après quatre décennies de néolibéralisme, l'État devra soutenir fermement les intérêts du travail contre la tentation du chantage à l'emploi que le capital ne manquera pas d'entonner rapidement.
L'indexation des salaires sur l'inflation arrivera sans doute un peu tard, mais c'est une garantie minimale de protection de leur niveau de vie pour les salariés. Une telle mesure sera-t-elle inflationniste ou récessive dans la mesure où elle pèsera sur les profits ? pas nécessairement. Elle permettra d'éviter tout recul de la consommation comme ce fut le cas en 2023 en France et donc assurera des débouchés sur le marché intérieur pour les entreprises nationales.
Certes, sans augmentation de la productivité, il pourrait y avoir un effet inflationniste. Mais là encore, l'indexation des salaires sur l'inflation, en faisant pression sur la rentabilité des entreprises, est une incitation directe pour les entreprises à investir et à améliorer leur productivité pour, précisément, réduire la part du travail dans leurs coûts.
Rappelons que quarante ans de politiques néolibérales ont prétendu améliorer les gains de productivité alors même qu'elles ont conduit à une réduction de ces gains. Concernant la France, les aides massives au capital et la baisse du coût du travail ont même eu un effet désincitatif qui a conduit à privilégier les emplois peu productifs, conduisant à un fait inédit depuis plusieurs décennies, une baisse notable et durable de la productivité.
Planification écologique et égalité fiscale
Bref, le projet du NFP n'est pas « anti-économique » ni « absurde » économiquement, même si, on le verra, il convient d'apporter quelques réserves. C'est un pari que le moteur du redressement de la productivité réside non pas dans un soutien aveugle au capital, mais dans un appui aux salaires et dans une politique ambitieuse d'investissements publics.
À ce sujet, le NFP entend mettre en place des investissements ambitieux, notamment dans la transformation écologique. Les aides aux ménages seront « renforcées », permettant d'assurer « l'isolation complète des logements », la rénovation des bâtiments publics sera « accélérée », les « filières françaises et européennes de production d'énergies renouvelables » seront « renforcées ». Ce dernier point reste assez flou, il sera déployé dans la phase suivante, après les cent jours.
Dans cette phase, le NFP propose une politique de « reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et de l'Europe dans les domaines stratégiques », qui sera accompagnée d'une inscription dans cette stratégie industrielle des aides publiques aux entreprises, lesquelles seront conditionnées à des critères environnementaux et sociaux. Un pôle public bancaire viendra collecter l'épargne pour le financement de cette politique. Ce dernier élément mis à part, on n'est pas très loin d'une ambition proche des plans de Joe Biden aux États-Unis, qui a mis en place un fléchage des investissements et des aides, accompagné de mesures protectionnistes (défendues par le NFP sous la forme d'une « taxe kilométrique sur les produits importés »). Tout cela est totalement différent des « arrosages massifs » de la politique défendue par Emmanuel Macron.
Ce pôle bancaire public n'est alors pas anecdotique. Il permet précisément de contourner le « privilège exorbitant » que représente le dollar pour les États-Unis. Il s'agit de passer le moins possible par les marchés financiers pour financer des mesures cruciales et urgentes et bien plutôt de piocher dans l'abondante source de l'épargne des ménages.
Le projet du RN, fondé sur l'exploitation économique des minorités et la discrimination, […] s'inscrit largement dans la continuité néolibérale.
Logiquement, pour rendre ce pôle public attractif, le NFP doit brider la finance et propose d'encadrer les investissements bancaires et de mettre en place une taxe sur les transactions financières. En parallèle, les finances publiques seront renforcées, dès les cent jours (le projet évoque la date symbolique du 4 août) par une remise en cause des politiques fiscales anti-redistributives de l'ère Macron.
Ce projet de loi de finances rectificative du 4 août viendra ainsi rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) « renforcé avec un volet climatique » qui pourrait venir frapper les activités les plus écocides. L'« exit tax », venant taxer les plus-values de cession des entreprises délocalisées, détricotée par Emmanuel Macron, sera aussi rétablie. Le projet du NFP propose aussi de supprimer les « niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes ».
Ces mesures ne visent pas qu'à financer la politique proposée, mais aussi à réduire les inégalités dont les conséquences néfastes sur l'économie ont été largement documentées. Ainsi, il sera proposé de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu avec quatorze tranches (contre cinq aujourd'hui), ce qui rendra les effets des hausses de salaires moins violents. La CSG deviendra aussi plus progressive (il existe aujourd'hui seulement quelques taux différenciés dans certains cas). Enfin, l'impôt sur l'héritage sera plus progressif et ciblera les plus hauts patrimoines, avec la mise en place d'un héritage maximum.
Un projet irréaliste ?
Ce projet mériterait encore d'être précisé, la campagne le permettra peut-être, mais il a le mérite de fixer un cap. Et il convient d'emblée d'écarter les critiques venant de la droite et de l'extrême droite et jouant sur les ressorts classiques de l'impossibilité et du caractère dangereux de ce projet. Ce levier classique a déjà été activé par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire le 14 juin sur France Info qui, sans avoir vu l'ébauche du programme, publié trois heures plus tard, a déjà promis « le retour du chômage de masse » dans le cas de son application.
La réalité est que, face à ce projet, les deux alternatives ne sont pas plus raisonnables, loin de là. Passons rapidement sur le projet du Rassemblement national, fondé sur l'exploitation économique des minorités et la discrimination et qui ne finance aucune dépense sérieusement et s'inscrit largement dans la continuité néolibérale. Mais le camp macroniste est-il en condition de donner des leçons ?
L'actuelle majorité présidentielle passe son temps à se gargariser de son « succès économique », mais celui-ci est une chimère. La baisse du chômage s'explique en grande partie par la baisse de la productivité et des aides publiques qui financent des bas salaires. La politique menée depuis 2017 a conduit à une dégradation nette et constante des finances publiques par l'affaiblissement des recettes à coups de cadeaux fiscaux pour les entreprises. La croissance, pourtant élevée au rang de vertu cardinale par la majorité sortante, est en berne : le PIB du dernier trimestre se situe encore 1,8 % en deçà de ce qu'aurait été son niveau si la tendance 2009–2019 s'était poursuivie. Et cela, malgré les milliards déversés. Mais, on l'a vu, la crise du niveau de vie est passée par là.
Pour régler cette situation inextricable et compte tenu d'une dégradation historique de la productivité, la seule proposition de la majorité sortante est la répression sociale par l'austérité et par la réduction des droits des travailleurs. C'est la seule façon de rétablir une forme de politique consensuelle au sein du capital entre ceux qui bénéficient des aides publiques et ceux qui veulent des garanties de remboursement de la dette publique. Cette politique a d'ailleurs commencé : après la réforme des retraites en 2023 et la coupe de 10 milliards d'euros dans le budget en début d'année 2024, le gouvernement n'a d'autres promesses qu'une nouvelle réforme de l'assurance-chômage et de nouvelles coupes budgétaires massives.
La rhétorique des « réformes douloureuses, mais nécessaires » est un classique du néolibéralisme, mais après sept ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée, elle est clairement émoussée. S'il est une chose que prouve cette dissolution en panique, c'est bien l'échec patent de cette politique et son rejet massif par la population française. En cela, les leçons d'économie des partisans du chef de l'État traduisent davantage les positions de classe de ceux qui les formulent qu'une réalité quelconque.
Le projet du Nouveau Front populaire prend acte de cet échec et cherche en partie son inspiration dans la politique de Joe Biden. C'est un projet keynésien et social-démocrate cherchant à rééquilibrer la distribution de richesses et à stimuler l'investissement par la demande et la dépense publique.
Les obstacles
Un tel chemin n'est cependant pas sans obstacles. Compte tenu de l'état du capitalisme, il est difficile d'envisager qu'une quelconque politique économique se résume à une promenade de santé. La question n'est pas réellement là, mais bien plutôt dans les priorités qui sont posées. Doit-on protéger d'abord les salariés et, parmi eux, les plus faibles, ou favoriser l'accumulation du capital ? Doit-on faire de l'écologie une priorité absolue face à la croissance ? Ces questions vont inévitablement se poser à un potentiel gouvernement de gauche.
La politique préconisée par le NFP vient rompre l'alliance scellée par le macronisme entre le capital financier et le capital industriel que l'on vient de décrire. Inévitablement, le premier et une partie du second, effrayés par la politique de redistribution, entreront en conflit avec le gouvernement français. Ce dernier, comme durant la période 1981-1983 ou celle du quinquennat Hollande, sera sous la pression des classes dominantes qui, se sentant attaquées, vont riposter par des fuites de capitaux et par un chantage à l'emploi.
Si la Banque centrale européenne (BCE) dispose désormais des moyens de contrer une véritable crise de la dette publique, on a vu dans le cas grec voici dix ans que cette institution pouvait n'être pas aussi neutre politiquement qu'elle le prétend. Francfort pourrait faire pression sur Paris et, là encore, il faudra tenir et placer la BCE face à ses responsabilités.
Il en sera de même avec Bruxelles. Le projet du NFP insiste sur son rejet de l'austérité et des nouvelles règles budgétaires européennes. Mais là encore, cela implique de ne pas se soumettre aux demandes de la Commission et d'en assumer les conséquences. La France est un pays clé de la zone euro et une source de matière première incontournable pour les marchés financiers.
Une crise de la dette française risquerait de tourner en une crise financière généralisée. Il faudra donc tenir le cap et ne pas céder à la panique et aux pressions. Pour cela, il semble indispensable que se construise un mouvement social fort en soutien à cette politique et conscient des sacrifices à faire pour construire un avenir durable hors du néolibéralisme.
Il reste un autre écueil à ce projet. Le pari qui est fait ici est celui d'une possibilité du « capitalisme vert et social ». C'est ce qui fait que ce projet est authentiquement social-démocrate, il entend donner une chance au système actuel d'être, avec l'appui de l'État, plus vertueux socialement et écologiquement. Le projet n'évoque aucun projet de dépassement de la croissance comme horizon, ni de renforcement majeur du pouvoir des travailleurs (ni même de l'État).
Or, il existe une hypothèse que ce projet soit au-delà des forces du capitalisme actuel et qu'il faille engager une transformation beaucoup plus profonde du système économique pour faire face aux crises écologiques et sociales, notamment remettre en cause la logique des besoins capitalistes et l'accumulation même du capital. Dans ce cas, quel sera le chemin choisi par cette alliance politique ? Tout retour en arrière supposera une aggravation de l'exploitation de la nature et du travail.
L'urgence de ces élections législatives a conduit l'alliance de gauche à favoriser un projet permettant de lisser ses divergences internes sur l'économie, notamment sur la question de la croissance, essentielle pour faire face aux crises actuelles. Mais l'exercice du pouvoir ne manquera pas de ramener ces questions au premier plan. L'enjeu sera alors de construire un nouveau compromis, permettant d'affronter ces difficultés.
Il faut noter cependant que ces difficultés, contrairement à ce que l'on entend souvent, ne sont pas le signe d'un irréalisme de la politique proposée, mais bien plutôt du fait que les priorités énoncées permettent de se confronter réellement à la situation concrète du capitalisme contemporain. C'est donc une option difficile, mais profondément réaliste. À l'inverse, l'option néolibérale se berce dans l'illusion que faciliter l'accumulation du capital permettra de résoudre l'ensemble des problèmes sociaux et écologiques.
Le projet du Nouveau Front populaire n'est donc pas la caricature que ses adversaires en font. Mais si l'on considère que son esprit est la priorité donnée à la résolution de la double crise environnementale et sociale, son principal obstacle réside bien davantage dans sa détermination politique que dans de supposées « lois économiques » immuables.
Romaric Godin
P.-S.
• Mediapart, 14 juin 2024 à 19h01 :
https://www.mediapart.fr/journal/politique/140624/nouveau-front-populaire-un-programme-economique-d-alternative-au-macronisme
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le sport et les jeux olympiques de Paris

Par souci de clarté et à l'invitation de Jean-Marie Brohm, nous avons parfois réécrit et précisé des éléments de réflexion en s'inspirant de formules qu'il emploie dans son ouvrage « Théorie critique du sport », Quel sport ?, 2017.
Propos recueillis par Gary Libot, journaliste au Chiffon.
30 décembre 2023 | tiré du site Le chiffon
https://www.lechiffon.fr/entretien-avec-jean-marie-brohm-presque-plus-personne-ne-critique-lideologie-et-la-pratique-sportive/
Le Chiffon – Quand le sport apparaît-il ? Est-il consubstantiel à l'activité physique humaine ?
Jean-Marie Brohm – Il y a deux réponses possibles. La première provient de l'idéologie sportive traditionnelle. Des auteurs très sérieux expliquent que depuis des temps immémoriaux l'homme est un sportif qui pratique la natation, la course, la lutte, la boxe, etc.
La seconde réponse cherche à distinguer plusieurs choses. D'une part, elle rappelle qu'il y a des « activités corporelles » constitutives de l'humain depuis son hominisation. C'est ce que le grand anthropologue Marcel Mauss va appeler les « techniques du corps ». C'est le fait de savoir marcher, sauter, courir, nager, faire l'amour, accoucher, etc. Ces techniques du corps sont en partie variables d'une culture à l'autre et peuvent être considérées comme des activités physiques.
D'autre part, il y a le « sport » proprement dit, c'est-à-dire l'institution de la compétition physique codifiée. On le voit apparaître dans l'Antiquité. Mais il y a une césure très nette entre le sport dit « antique » (Grec) qui était un acte cultuel et le sport dit « moderne ».
Globalement, le sport moderne commence à se forger vers 1750 en Angleterre, c'est-à-dire là où le capitalisme s'ébauche . Les premiers sports institués avec des fédérations, des règlements, des records, vont être le rugby, le football, l'athlétisme, l'équitation et le tennis.
Le sport s'organise autour de trois caractéristiques majeurs. Primo, la compétition systématique comme finalité. Secundo, l'entraînement régulier comme préparation à la compétition. Tertio, l'insertion dans une structure institutionnelle organisant et contrôlant l'activité sportive (fédérations, clubs, comités, etc.) selon des règles strictes (classes d'âge et de poids, licences, conditions d'accès aux épreuves, etc.). Mais les frontières entre activités physiques et pratiques sportives peuvent être perméables. En outre, il y a une tendance à la professionnalisation (via le salariat) des sportifs, c'est-à-dire leur transformation en capital. C'est ce qu'entament les premiers clubs anglais de football qui vont ensuite s'exporter en France, notamment au Havre.
En somme, je distinguerais les « techniques du corps » spécialisées de l'être humain – que l'éducation physique contemporaine permet de stimuler – et le sport proprement dit qui est éminemment lié au capitalisme.
Pouvez-vous revenir sur les fondamentaux de la critique du sport ?
Rentrons un peu plus dans le détail. Le sport s'est avant tout organisé autour de la compétition qui est chronométrage (dimension temporelle) et mesure au millimètre près (dimension spatiale). Il faut la distinguer de l'agôn grecque qui était une confrontation dans l'effort physique sans découpage mesuré des performances.
Le sport moderne commence en Angleterre avec la chronométrie. Soit dit en passant, c'est pour cela que nous avions pour épigraphe de la revue Chrono enrayé « Les chronomètres n'ont fait jusqu'ici que mesurer les efforts aliénés de l'humanité, il s'agit à présent de les briser ». Cette compétition implique la lutte contre soi (dépassement de soi), contre les concurrents (dépassement des limites, quête de l'exploit suprême) et contre la nature (maîtrise des éléments et des situations).
Chez les Grecs, ce cadre compétitif n'était pas clairement défini. Même s'il faut noter que l'on a très peu d'information sur le déroulé des Jeux olympiques antique qui sont supposés avoir commencé au VIIe siècle avec J.C. dans la ville d'Olympie. Au début du XXe siècle, Pierre de Coubertin a profité de ce flou pour le combler par son imagination, forgeant l'idéologie olympique. Mais il a créé une vision imaginaire et fantasmée d'Olympie et des Grecs1.
Puis, il y a la professionnalisation. Dans les années 1920, il y avait des débats pour savoir si un sportif amateur pouvait être un vrai sportif. Les réponses apportées par les Étasuniens, les Anglais, les Allemands ou les Français ont tendu à dire que non. Lorsque Juan Antonio Samaranch, ex-franquiste, prend les rênes du Comité international olympique en 1980, il dit en gros « l'amateurisme c'est terminé », alors les sportifs vont de plus en plus être des salariés rémunérés pour faire carrière. Ça, c'est la structure globale du sport.
Ensuite, il y a ce que j'ai appelé la « sportivisation » de la société. C'est-à-dire que toutes les activités physiques aujourd'hui sans exception ont tendance à être transformées en sport. Par exemple les balades à vélo, la course à pied, le badminton, le ping-pong, etc. tendent à passer sous la coupe de la compétition. De plus en plus souvent, lors d'un jeu il faut savoir qui est le meilleur.
Le sport a en définitive pour caractéristique de cliver à l'infini le corps social : pratiquants et non pratiquants, hommes et femmes, jeunes et vieux, valides et invalides, vainqueurs et perdants, dopés et non dopés, professionnels et amateurs, masse et élite, experts et débutants, etc.
Je tiens à ajouter qu'en plus de cela, le sport a trois piliers idéologiques. À savoir : « Quel est le meilleur sportif de tous les temps ? », et ce pour chaque discipline. C'est ce sur quoi spécule très bien le journal L'Équipe par exemple. Ensuite : « Jusqu'où pourront aller les records ? » (« Plus vite – Plus haut – Plus fort », comme le dit bien devise olympique). Enfin : « Le potentiel du corps humain est-il illimité ? ».
C'est sur ce dernier point que se greffe entre autre la pratique du dopage qui cherche à augmenter les potentialités biologiques, psychologiques, alimentaires, cardiaques, respiratoires de l'être humain. Aujourd'hui, le dopage se prolonge dans les discours sur le « post-humain » qui s'appuient sur la recherche scientifique et technologique pour poursuivre avec de nouveaux moyens (prothèses, biotechnologies, etc.) l'« amélioration » des performances physiques.
La Théorie critique du sport a pour but de rappeler que le sport, c'est avant tout cela. Et il faut notamment le faire comprendre aux professeurs d'éducation physique et sportive (EPS). J'ai essayé d'expliquer à mes collègues à l'École émancipée2 que l'éducation physique ce n'est pas le sport. Que le sport n'est pas un moyen privilégié d'éducation physique puisque précisément, il consiste à éviter la solidarité, à augmenter la violence de la compétition et le narcissisme égotique.
L'une des objections que l'on pourrait vous faire consisterait à dire que le sport n'est pas le problème en prenant l'exemple de la danse ou des échecs qui sont eux aussi soumis à la compétition et à la professionnalisation de la pratique. Cela est-il pour autant néfaste ? Peut-on dire que la danse et les échecs sont des sports ?
Là, il faut revenir à des questions fondamentales. Que produit un sportif ? Pas grand-chose, à part de la sueur et du spectacle. Alors, vous me direz que les danseurs ou les joueurs d'échec produisent aussi sueur et spectacle. Mais la différence essentielle, c'est que les danseurs sont au service d'une œuvre. Si l'on prend un danseur du Sacre du Printemps mis en scène par Maurice Béjart, par exemple, il participe à une œuvre immortelle.
En contre-point, que produit du point de vue esthétique et culturelle le sportif ? Presque rien. Ce dernier tend à être oublié rapidement après son apogée, englouti dans le renouvellement incessant des champions.
À ce moment-là, il faudrait distinguer sport et culture. Quels seraient les critères pour séparer l'un de l'autre ?
Le sport n'est pas une culture. C'est comme si l'on disait que la guerre, c'est une culture. Nous pourrions aussi dire cela après tout ! Qu'il y a une « culture guerrière », une « culture militaire ». Mais si tout est culture, plus rien n'est culture.
Nombreux sont les philosophes, notamment Platon, à avoir fait la distinction entre ce qui élève l'intelligence (la noblesse d'âme, nous pourrions dire) et la culture de masse. Je dis qu'une culture de masse est rarement une culture. C'est un pléonasme. À contrario, le sport est aujourd'hui un élément de contrôle social massif.
Herbert Marcuse écrit dans Éros et Civilisation que l' « Éros » ce n'est pas seulement faire l'amour, mais que cela a à voir avec la culture comme force de pacification générale des sociétés. Il y a certes un côté utopique là-dedans. Nous sommes en tout cas bien loin de l'affrontement institué par la pratique sportive. La culture, c'est autre chose que l'affrontement de bovins qui font 120 kilos dans la première ligne de rugby en se rentrant dans le lard avec une violence inouïe. C'est autre chose que le rassemblement de meute de spectateurs. C'est autre chose que la violence et l'infantilisation émotionnelle des supporters. Ce n'est pas cela la culture.
Le sport est aussi un instrument de massification totalitaire. Aujourd'hui il n'y a pas un État, qu'il soit dit « libéral », autoritaire ou totalitaire, qui n'utilise massivement le sport. Et ce grâce à une homologie structurelle entre le défilé militaire et défilé sportif. Le tout pour la pérennisation des régimes en place. Le sport est un instrument d'asservissement politique et cela est vrai mondialement : à l'Est comme à l'Ouest (avec le sport dit « socialiste » comme « capitaliste » au XXe siècle), au Nord comme au Sud. Le sport joue le même rôle de stabilisateur de l'ordre établi, quels que soient les régimes politiques des sociétés qui sont toutes sous l'hégémonie du capital financier international. Cela ne fait pas du sport une culture.
Si l'on prend le Sacre du Printemps ou la cinquième symphonie de Beethoven, elle peut être utilisée par les pouvoirs en place (les nazis l'ont fait par exemple) mais l'œuvre transcende, dépasse largement ces régimes. Alors que la « culture de masse » dont fait partie le sport s'épuise dans le moule des régimes politiques, elle ne peut les dépasser. Elle en est le produit. C'est une des raisons pour laquelle c'est une culture abrutissante, une culture Prisunic. Ce qui est terrible, c'est qu'une grande partie de la jeunesse – et notamment gauchisante – passe une partie de son temps à la consommer, par l'intermédiaire des écrans entre autre.
Quels pourraient être selon vous les progrès dans l' « aliénation sportive » observables depuis dix ans ?
Aujourd'hui la critique du sport est ultra-minoritaire. Presque plus personne ne critique l'idéologie et la pratique sportive : nous passons pour des hurluberlus ! En 1980 aux Jeux olympiques de Moscou, ou en 2008 aux Jeux de Pékin, il y avait encore des comités de boycott. Aujourd'hui, ce type d'action et de critique me semble plus marginale. C'est ce qui me fait notamment dire que – par exemple – le passage de la flamme olympique dans les différentes bourgades françaises ne sera pas contesté.
Pour la quasi totalité des observateurs des pratiques sportives le sport serait en effet ni aliénation, ni émancipation, ni de gauche, ni de droite, ni répressif, ni permissif, ni réactionnaire, ni progressiste, mais tout cela à la fois dans un melting pot idéologique « à la carte ». Actuellement, nous pourrions évoquer les réflexions de Pascal Boniface, de Stéphane Beaud ou George Vigarello.
De la même manière, tous les syndicats sans exception [NDLR : la Confédération nationale du travail (CNT) et l'Union syndicale Solidaires s'opposent à la tenue des JO] ont accompagné l'accueil des JO de Paris et diront que cet événement est magnifique. Le problème dans tout cela c'est que l'idéologie sportive demeure largement impensée. Les gens peuvent admettre que le fascisme ou le libéralisme sont des idéologies politiques contestables. Mais le sport, lui, paraît propre, pur et universel. Et Pierre de Coubertin, je le rappelle, est la mère pondeuse de cette idéologie.
Votre analyse repose sur une vision du corps modelée par le freudo-marxisme, courant intellectuelle qui se structure dans les années 1950. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous définissez le corps et un quoi la pratique sportive l'aliène selon vous ?
Ma vision s'appuie sur celle de penseurs très importants comme Sigmund Freud, Herbert Marcuse ou Wilhem Reich. La question du corps est une question, au fond, philosophique. Il n'y a pas de corps en dehors d'une subjectivité. Et la subjectivité du sportif en tant que sportif n'existe pas, il ne fait que travailler sa capacité d'obéissance et de « résilience ». Sa subjectivité est atrophiée parce que le sportif est sous les ordres d'un entraîneur et contraint à un effort morcelé et rationalisé qui ne lui appartient pas.
Le corps se construit aussi dans l'intersubjectivité : dans le rapport aux autres. Et donc dans l'interculturalité, dans le rapport aux cultures dont sont porteur les autres. Le corps est une histoire, une singularité. La pratique sportive alliée à la publicité qui en est faite tend à homogénéiser les corps. La préoccupation devient la forme des muscles, le tracé des abdominaux, etc. Dans ce cadre, la subjectivité s'homogénéise, la dimension culturelle du corps est niée. Les corps perdent petit à petit leur histoire propre.
Dans la perspective du corps sportif, la question n'est plus : « Comment puis-je explorer mon corps, et m'épanouir à son contact ? », elle devient : « Comment peut-on augmenter mon corps ? ». Question qui a à voir avec les recherches menées dans le cadre du transhumanisme et du post-humain dont je viens de parler3. Ces dernières tendent aussi à nier le caractère biologique du corps, en plus de son caractère culturel. Le transhumanisme pense le corps comme une construction sociale modifiable à volonté pour se mettre au service des fins recherchées. Alors que le corps a un aspect biologique irrécusable. Il est en réalité un entremêlement de dimensions biologique, médical, psychologique, culturelle, spirituelle et philosophique. Et il faut bien dire que la pratique sportive encadre les pratiques corporelles et les aliènent à son principe de rendement.
À quoi pourrait ressembler une pratique physique qui soit émancipatrice ?
Je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce que le fondement de la subjectivité corporelle, c'est d'une part la famille et d'autre part le travail. Tant que ce socle constitutif du corps n'aura pas été transformé en son fond, il n'y aura pas de libération de notre rapport à notre corps parce qu'il continuera d'être soumis à un principe de rendement, comme Herbert Marcuse en a d'ailleurs ébauché une critique remarquable.
En revanche, il est possible de trouver ici ou là des pratiques de transition qui ne soit pas totalement inféodées à la société capitaliste. À vrai dire, cela n'a rien de rédhibitoire de faire une partie de ping-pong entre copains, un peu de natation ou du canoë-kayak.
Mais si vous prenez une bande de potes qui jouent au foot le dimanche, très vite il va falloir trouver un arbitre parce que les deux équipes vont se chamailler pour gagner. Le principe compétitif est tellement implanté dans nos cervelles qu'il réapparaît automatiquement. Si on joue au ping-pong, c'est jamais marrant de se faire balader à gauche, à droite. On va alors rapidement se rebiffer et chercher à écraser l'autre.
Il faut bien comprendre que l'humain est porteur d'un principe de concurrence. Il faut l'accepter pour chercher à le détourner. C'est ce que le sport fait pour placer les uns vis-à-vis des autres en contradiction, en opposition. Il faut détourner cette concurrence – comme l'avaient fait les Grecs avec l'agôn – et tenter de la mettre au service de pratiques physiques imaginatives et profondément sociales.
Vous parlez dans l'un de vos ouvrages de la nécessité d'une transition d'un « corps fonctionnel » à un « corps ludique », que les aspects sensoriels du corps doivent primer sur les aspects moteurs, pouvez-vous revenir sur ces points ? Que pourrait donner ces pratiques physiques imaginatives ?
J'ai été pendant 25 ans professeur d'éducation physique et sportive. J'avais à m'affronter à des lycéens, globalement porteurs de l'idéologie de la compétition. J'essayais de leur faire comprendre, par le jeu, que l'on pouvait manipuler des ballons autrement que dans les règles instituées de la compétition, que c'est bien plus marrant et d'une certaine manière plus difficile.
Par exemple, je leur proposais de jouer au volley-ball avec un ballon de rugby, ce qui est loin d'être évident. Ou bien, je les faisais jouer au football (garçons et filles mélangées, ce qui n'était pas facile à l'époque) sur un terrain de basket. L'objectif était alors de toucher le poteau de basket avec la balle. Cela les stimulaient. Ensuite, je leur expliquais pourquoi nous explorions ces pratiques et cherchions à remettre en question le cadre. Vous imaginez que tout cela n'était pas très bien vu par mes collègues et surtout par l'inspection.
Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le sport et le sportif sont aujourd'hui programmés. Il y a les catégories d'âge : minime, cadet, junior, senior, etc. avec un volume d'entraînement correspondant. Tel entraînement et régime alimentaire le matin, tel autre le soir. Cela n'est plus une vie. Nous retrouvons des logiques similaires avec les pratiques de coaching sportif où les gens forcent l'effort comme des malades mentaux, et se marrent bien peu . Il faut s'opposer dans notre vie quotidienne à cette programmation.
Mais tout cela est très difficile à critiquer. Il faut comprendre que le sport est un fait social total qui demande un certain nombre de références théorique pour être bien compris. Cela n'est pas évident, mais c'est cette compréhension que nous devons viser.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pas de Jeux olympiques ordinaires. Rejoignez la campagne pour #BanIsraël

Plus de 300 équipes sportives palestiniennes demandent l'exclusion d'Israël des Jeux olympiques en raison du génocide perpétré contre les Palestiniens de Gaza. Comme l'a dit le journaliste sportif Dave Zirin, « le Comité international olympique (CIO) n'agira pas tant que nous ne l'aurons pas fait ». Alors faisons-le.
20 février 2024 | Auteur : By Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)
Rejoignez la campagne mondiale pour perturber pacifiquement la route vers Paris 2024 en appelant le CIO à #BanIsraël jusqu'à ce qu'il mette fin à ses crimes contre les Palestiniens et reconnaisse nos droits stipulés par l'ONU.
Inscrivez votre groupe pour participer à la campagne
Il ne peut y avoir de Jeux olympiques ordinaires tant qu'Israël continue d'intensifier son génocide contre les Palestiniens de Gaza et d'asseoir son régime d'apartheid. Les organismes internationaux dominés par l'Occident, comme le CIO, qui avaient exclu l'Afrique du Sud par le passé, autorisent aujourd'hui non seulement Israël, un Etat d'apartheid, à participer aux Jeux olympiques, mais ils défendent également sa participation avec véhémence ! L'hypocrisie coloniale n'a jamais été aussi grande.
Voici ce que vous pouvez faire.
Protester devant les bureaux olympiques
Répondez à l'appel des équipes palestiniennes à votre Comité national olympique, aux Fédérations sportives internationales et aux Fédérations sportives reconnues. Organisez des manifestations, des sit-in, des perturbations pacifiques ou des événements de sensibilisation aux attaques israéliennes contre les sports palestiniens. Inscrivez votre groupe pour plus d'informations.
Qualifications et épreuves olympiques
D'ici au début des Jeux olympiques en juillet, la route vers Paris sera jalonnée d'occasions de rappeler au CIO que les auteurs de génocides n'ont pas leur place aux Jeux olympiques. Au début du mois, quatre coureurs ont porté le message #CeasefireNow au marathon olympique de Floride, franchissant la ligne d'arrivée avec des drapeaux palestiniens. Trouvez des informations sur les épreuves olympiques chronométrées et les épreuves de qualification (également ici) ou d'autres événements liés aux Jeux olympiques dans votre région. Inscrivez votre groupe pour plus d'informations.
Chassez l'apartheid israélien du sport
Votre pays est-il signataire de la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports ? Si c'est le cas, il a l'obligation de « prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir l'expulsion d'un pays pratiquant l'apartheid des organismes sportifs internationaux et régionaux ». Inscrivez votre groupe pour savoir ce que vous pouvez faire.
Signez la pétition DiEM25 pour bannir Israël du sport mondial
Rejoignez plus de 92 000 personnes du monde entier qui ont signé la pétition appelant à bannir Israël du sport international.
Ajoutez votre signature ici
Signez la pétition Eko pour l'exclusion d'Israël des Jeux olympiques et de la FIFA
Rejoignez les 140 000 personnes qui ont demandé l'exclusion d'Israël du sport international, y compris des Jeux olympiques et de la FIFA.
Demandez à ce qu'il n'y ait pas de Jeux olympiques ordinaires tant qu'Israël, pays génocidaire, n'est pas banni.
Utilisez les hashtags #BanIsrael et #Paris2024. Partagez le texte ci-dessous à partir de vos comptes.
Dans le cadre de son #GazaGenocide, Israël commet également un sporticide, en tuant les entraîneurs et les athlètes palestiniens des @Olympiques et en détruisant les stades.
Joignez-vous et demandez « Pas de Jeux olympiques ordinaires » #BanIsrael
https://bdsmovement.net/banisrael
À Gaza, Israël a tué l'entraîneur de football olympique palestinien Hani Al Masdar, détruit les bureaux du Comité olympique palestinien et transformé des installations sportives en centres honteux de détention de masse et de torture.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que le CIO permet à Israël d'utiliser les Jeux olympiques pour laver sportivement son génocide à Gaza et son régime d'apartheid contre les Palestiniens partout dans le monde. Soutenez l'appel des équipes palestiniennes. Rejoignez la campagne pour #BanIsraël des Jeux Olympiques et perturbez pacifiquement la route vers les Jeux de Paris 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Jeux olympiques n’ont pas eu lieu

Décortiquant la Charte olympique et les documents liants le Comité international olympique à ses partenaires, Marc Perelman décrypte ce qui s'avère être une idéologie autoritaire et plus soucieuse de profits que d'écologie, de santé publique, de respect des territoires, d'éducation, malgré des promesses vertueuses. Il analyse « le coeur du projet olympique et de ses valeurs, ainsi que les conséquences sociopolitiques sur nos territoires et dans nos vies ».
Non seulement les Jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris en 2024 occupent d'ores et déjà une partie de l'actualité mais aussi le « terrain » avec pas moins de 7000 points de travaux en cours dans la capitale et la Seine-Saint-Denis, pour le plus vaste et le plus long chantier depuis Hausmann. Marc Perelman consacre un long chapitre à la confiscation mémorielle opportunément réalisée par la concordance décidée entre la date de l'ouverture des jeux et celle de la fin de la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est toute la ville qui sera ainsi « durablement colonisée par l'olympisme » puisque cette « olympisation » (le terme est de Coubertin) s'étendra à d'autres monuments : compétitions d'équitation au château de Versailles, d'escrime au Grand Palais, de beach-volley près de la Tour Eiffel, de vélo sur les Champs Élysée, de tir à l'arc aux Invalides, de triathlon au Trocadéro, de nage libre dans la Seine,… La rénovation de l'île de la Cité préconise sa « mise en tourisme » pour la rendre « conforme à l'urbanisme de la capitale du XXIe siècle » c'est-à-dire en transformant « l'actuel piéton en superconsommateur ».
Le Dossier de candidature de Paris 2024 ne s'embarrasse pas d'euphémismes. Il s'engage « à réduire tout risque potentiel de perception négative des Jeux » ! Les quelques opposants politiques ne remettent jamais en question l'idéologie des Jeux, ni n'analysent « les JO comme une institution intégrée à l'ordre capitaliste, structurellement liée à la compétition qui en est la seule matrice ». Les Insoumis se contentent de dénoncer le mercantilisme et les écologistes parisiens proposent d'organiser des Jeux écolos. L'auteur s'attarde peu sur le budget annoncé, fixé à 6,8 milliards. Même s'il rappelle que ceux des Jeux précédents dépassaient en moyenne de 179% les prévisions. Il s'intéresse surtout à « la façon dont les JO parviennent à faire partager l'idéologie de la compétition des uns contre les autres au nom du bonheur d'être ensemble, de la citoyenneté partagée, de la santé, de l'éducation, de la culture pour tous, etc. » « Dans le sport, personne ne conteste la compétition, qui en est aussi le moteur et reste surtout son “point aveugle“. Et pourtant le sport de compétition ne ressemble en rien au jeu ou à l'activité ludique, qui eux font appel à la liberté de se mouvoir quand on veut et où on veut, à la gratuité, à la non discrimination entre les sexes, à l'accueil de corps différents, à l'indifférence quant aux résultats, aux refus de la performance, du record et de la prouesse, au rapport libre, organique et plastique avec une nature non artificialisée. » « Les JO fabriquent un monde à l'image d'une immense compétition. Ils fabriquent ou plutôt redoublent le monde de la compétition économique capitaliste par une compétition, pour le coup, musculaire entre les individus censés représenter leurs nations (il est pourtant précisé dans la Charte olympique que les compétitions se déroulent entre athlètes ou entre équipes, et non entre nations). »
La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), créée en février 2017, s'est engagée à ce que les nouvelles constructions protègent et développent la biodiversité, atténuent le réchauffement climatique. Marc Perelman, architecte de formation, y voit surtout une « architecture sans âme, (…) subordonnée à l'urbanisme actualisé du greenwashing » et une smart city dont la consommation d'énergie ne sera certainement pas en baisse. Les organisateurs ne parlent que des « 100% de spectateurs se déplaçant en transports en commun », sans tenir compte des moyens utilisés pour rejoindre la capitale. Il est également permis de douter des promesses de « zéro imperméabilisation » des sols, de « 100% de l'alimentation » en filière locale (avec Coca Cola comme partenaire officiel !).
La lecture du contrat liant la ville hôte au CIO est affligeante : la ville est responsable de tout tandis que le CIO empoche des royalties, y compris sur l'utilisation des symboles olympiques, sans être jamais redevable d'impôts directs ou indirects. Aucun autre événement ne peut avoir lieu, avant ou après les Jeux, sans l'accord préalable du CIO. Le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux a été voté en mars 2018 et se présente comme « l'ultime ordre de soumission aux oukases du CIO ». Article 10 : « les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ».
La Charte olympique, véritable « codification de l'olympisme », défend une « philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels », dans le complet déni d'un olympisme « entaché de tant et tant de méfaits, de forfaitures, de mensonges réguliers, de dissimulations, de ruses, de mascarades, quand ce ne sont pas prévarications, concussions et malversations ». Quand elle évoque le « sport », elle ne parle que de compétition, « c'est-à-dire d'une activité codifiée, institutionnalisée, développant sa propre logique avec ses records, sa violence partout déployée », l'inverse du jeu, « une activité désintéressée, sans but lucratif, ludique, libre ».
Si toute forme de discrimination est proscrite, les JO ont bel et bien renforcé le régime nazi en 1936 et à Mexico, en 1968, quelques jours après le massacre de trois cents étudiants, Tommie Smith et John Carlos ont été exclus pour avoir levé leurs poings gantés de noir en signe de protestation contre le racisme aux États-Unis.
Si la Charte stipule donc bel et bien que les compétitions voient s'affronter des athlètes, « en épreuves individuelles ou par équipes et non entre pays », tout dans leur déroulement, depuis l'ouverture « quasi militaire », les hymnes nationaux, les classements, prouve le contraire.
L'auteur étudie ensuite l'impact des Jeux en Seine-Saint-Denis où la construction du village olympique, par exemple, implique le « déménagement » de vingt-cinq entreprises, d'une école d'ostéopathes, d'un foyer de migrants, d'un lycée professionnel, du réfectoire et de l'internat d'une école d'ingénieurs. Il rappelle le coût exorbitant de l'entretien du Stade de France pour 20 à 30 événements par an, réglé par les habitants, jusqu'à ce que la société d'e-sport Team Vitality (dont l'équipe de jeu vidéo de football Fifa !) ne s'engage comme club résident.
Pierre de Coubertin étant déjà l'objet de nombreuses études, l'auteur nous propose quelques échantillons significatifs de ses déclarations pour découvrir le personnage. Extraits :
« La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. Sans naturellement s'abaisser à l'esclavage ou même à une forme adoucie de servage, la race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée. »
« Ô sport, tu es la Fécondité ! Tu tends par des voies directes et nobles au perfectionnement de la race en détruisant les germes morbides et en redressant les tares qui la menacent dans sa pureté nécessaire. »
Suivent vingt-et-une « thèses », série de réflexions philosophiques ou sociologiques sur les « ressorts structurels du sport », parmi lesquelles nous avons glané quelques bribes pour donner le ton et aussi envie d'en lire plus :
« Intégrée à l'ensemble des institutions que les hommes se sont donnés, et jusque dans l'école, la compétition assigne les individus de leur naissance à leur mort à une société dont la matrice politique est la lutte de tous contre tous. »
« Le sport nait à la fin du XIXe siècle et se déploie en tant que projet politique et idéologique dans un cadre économicopolitique capitaliste structuré par la forme compétitive de l'organisation globale des rapports sociaux. »
« Les manifestations sportives déversent sans interruption des flots de résultats, de statistiques et d'anecdotes qui saturent l'espace comme le temps. “Le sport ne s'arrête jamais“ afin qu'on “oublie la politique“, comme l'énonce la chaîne de télévision quatari BeIN sport ».
« Le dopage, la violence ou encore le racisme (antisémitisme inclus) sont consubstantiels au sport. Ils ne l'altèrent pas ; ils n'en sont pas des excroissances monstrueuses : ils sont la vérité du sport. »
« La critique du sport n'a pas de projet et elle n'est pas un projet puisque son seul objectif est la disparition de son objet : le sport. »
N'en doutons pas, cet ouvrage suscitera de nombreuses réactions. Il a l'immense mérite de pulvériser un discours dominant.
2024 – LES JEUX OLYMPIQUES N'ONT PAS EU LIEU
Marc Perelman
192 pages – 18 euros
Éditions du Détour – Bordeaux – Janvier 2021
editionsdudetour.com/index.php/2024-les-jeux-olympiques-nont-pas-eu-lieu
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

État d’urgence olympique

Derrière la mise en place, pour la tenue des JO 2024, de mesures dites « exceptionnelles » visant au bon déroulement de l'exception, se profile un « état d'urgence olympique ». Sécurités, libertés et droits se voient reconfigurés, la « fête » olympique constituant avant tout la célébration d'un certain ordre, nouvelle étape de l'imposition d'un projet autoritaire, sous couvert de célébration sportive.
10 juin 2024 | tiré de la lettre d'AOC.media
« Exceptionnel ». Le mot est partout : à moins de deux mois des JO 2024. Fête exceptionnelle, cérémonies exceptionnelle, sites exceptionnels, ferveur exceptionnelle… Cette volonté d'ériger les Jeux de Paris en célébration de l'exception, affirmée dès l'origine (le mot figurait déjà 58 fois dans le dossier de candidature), se retrouve aujourd'hui dans une formule à la tournure proverbiale, dont la pauvreté langagière masque mal l'autoritarisme : « À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles ».
Peut-être faut-il voir dans cette récurrence un aveu. On peut s'étonner en effet d'entendre qualifier aussi souvent d'exceptionnel un événement organisé tous les quatre ans, prévu depuis près de dix ans, planifié à la minute près, et qui n'a donc, en fait, rien d'un « événement » au sens propre du terme, du fait dont l'irruption nous surprend, du major event derridien déchirant la toile de nos jours.
Or, derrière cette maxime maintes fois répétée se cache aussi une équivalence entre les Jeux eux-mêmes, décrits d'avance comme un moment unique par ses dimensions et son retentissement, et les « mesures » adoptées depuis la désignation de Paris comme ville hôte et que l'on peut mieux décrire, selon une acception plus étroitement juridique, comme des mesures d'exception.
Il faut dire que la France a fait depuis près de dix ans l'expérience de l'extension progressive, et quasiment irrésistible, de l'exception au service du pouvoir. La vague d'attentats vécue au mitan des années 2010 – tout particulièrement ceux de Paris en janvier et novembre 2015 – a souvent été invoquée comme moment fondateur de l'unanimité autour de l'organisation de JO. Jusque-là, le projet suscitait en effet plutôt les doutes, voire les résistances (celle de la maire de Paris notamment, tardivement ralliée au projet). Or, ces mêmes attentats constituent aussi le point de départ d'une politique de l'urgence qui n'a pas seulement traduit une réponse au terrorisme, mais aussi, et peut-être d'abord, la généralisation d'une véritable technique de gouvernement, pour la mise en ordre d'un certain nombre de mouvements sociaux. On le sait en effet, les lois votées dans le cadre de l'état d'urgence antiterroriste et, par la suite, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont largement accru les pouvoirs dont disposent les préfets et les forces de l'ordre : des pouvoirs exceptionnels en matière d'interdiction de rassemblements publics, ainsi que de contrôle et de restriction des déplacements, y compris individuels.
Très rapidement, les pouvoirs ouverts par l'état d'urgence déclaré au soir du 13 novembre furent ainsi très largement utilisés pour empêcher un certain nombre de manifestations et de rassemblements publics, politiques ou syndicaux. On peut ainsi rappeler que l'usage des pouvoirs d'urgence contre des mobilisations populaires a été observé dès la fin de 2015 lorsque, à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 21), organisée à Paris du 30 novembre au 12 décembre, de nombreux militants écologistes se sont vus touchés par des assignations à résidence, avec obligation de pointer plusieurs fois par jour au poste de police. Même chose en 2016, pour endiguer l'opposition à la loi travail (ou « loi El Khomri ») portée par le président Hollande et le gouvernement Valls, étape majeure dans la destruction des droits des salariés. Contre la contestation syndicale et populaire, le gouvernement, par l'intermédiaire de ses préfets, a alors pris, en s'appuyant sur les pouvoirs exceptionnels ouverts par l'état d'urgence, pas moins de 574 mesures individuelles à l'encontre de militants, pour empêcher leur participation aux rassemblements prévus.
Ces usages ont persisté, et ont été amplifiés sous la présidence Macron, dont le premier quinquennat s'est déroulé en majeure partie (35 mois sur 60) sous régimes d'état d'urgence – celui régi par la loi de 1955, activé au lendemain des attentats et resté en vigueur jusqu'au 1er novembre 2017, et l'état d'urgence sanitaire créé en mars 2020. Le recours à l'état d'urgence et aux possibilités qu'il offre aux autorités est d'ailleurs souvent évoqué pour contrer des vagues de protestations populaires, comme à l'époque du mouvement des « gilets jaunes », ou encore pour répondre aux émeutes consécutives à l'assassinat du jeune Nahel Merzouk lors d'un contrôle de police en juin 2023, même si sa mise en œuvre la plus récente est plus localisée, retrouvant les origines coloniales du dispositif, dans le cadre du regain de tensions en Nouvelle-Calédonie.
Surtout, ces pouvoirs exceptionnels ont été pour leur plus grande partie intégrés au droit commun après l'adoption de la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » en octobre 2017, et celle de la loi dite « sécurité globale » en mai 2021. C'est donc bien une transformation des mesures exceptionnelles en pouvoirs permanents qui a eu lieu, et cet arsenal juridique permet d'assurer de façon courante la restriction des libertés, en ciblant les mouvements sociaux et écologistes, souvent touchés par ces mêmes mesures de surveillance accrue, d'assignation à résidence, ou d'interdiction de déplacement. Ce fut de nouveau le cas à l'encontre des manifestations faisant suite au projet de réforme des retraites au printemps 2023, et violemment réprimées tandis que la loi était adoptée par recours à l'article 49.3 de la constitution. Ainsi appliqué, l'état d'urgence en France, et l'ensemble des mesures auxquelles il ouvre, souvent elles-mêmes rendues après coup permanentes, ont en premier lieu visé à saper les moyens de lutte sociale et de contestation contre différents projets d'inspiration néolibérale.
Or, après l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire, la caractérisation des JO de 2024 comme un événement « exceptionnel » requérant des mesures « exceptionnelles » aboutit aujourd'hui à la formulation discrète, mais politiquement et juridiquement tangible, de ce que l'on pourrait appeler « état d'urgence olympique ».
Les JO sont l'occasion de l'instauration d'un véritable autant que discret régime d'état d'urgence.
Comme souvent par le passé, et d'une façon parfois particulièrement tragique, comme à Pékin ou à Rio – et quoi que l'on aurait pu espérer autre chose dans le cadre d'un État à référentiel démocratique – c'est dans le cadre des chantiers pour l'organisation des Jeux que l'exception a fait son entrée. En mars 2018, déjà, une loi avait allégé les procédures d'urbanisme pour les constructions des JO, que le président Macron lui-même avait décrite comme une « loi d'exception ». À cela s'ajoutent, de façon tout aussi classique (ce qui ne les rend pas moins discutables) un certain nombre de dérogations accordées pour l'occasion aux organisateurs, au Comité international olympique, aux sponsors, comme diverses exonérations fiscales, ou encore l'autorisation plus triviale de consommer de l'alcool dans les stades dans les espaces « VIP », en contradiction avec la loi Evin s'appliquant aux spectateurs lambda.
Mais pour les Jeux de Paris, l'exception olympique ne s'arrête pas là et a investi d'autres domaines, au point de produire un effet profond et durable sur la démocratie française elle-même. La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques (ou « loi JO ») a ainsi ajouté un grand nombre de mesures dérogatoires à celles existantes, y compris d'ailleurs des dérogations concernant le droit du travail, par exemple pour l'assouplissement des règles sur le travail dominical pendant la durée des Jeux. Les « besoins exceptionnels » résultant des Jeux permettront ainsi aux commerçants des communes où sont situés les sites, ou dans les communes limitrophes, de ne pas respecter l'interdiction du travail dominical, y compris dans le domaine de l'habillement, de l'électronique, ou encore pour les coiffeurs, même si l'on ne voit pas trop en quoi le repos dominical dans ces secteurs doit garantir la bonne tenue des Jeux olympiques.
D'autres mesures surtout concernent de façon importante la sécurité et le maintien de l'ordre, renforçant l'arsenal juridique formé cette dernière décennie et justifiant de reconnaître dans le contexte actuel un véritable « état d'urgence olympique » – alors même que le caractère organisé, planifié des JO, aurait dû nous préserver de toute la « suspension » de la normalité, de la rationalité, de la légalité, qu'ont pu entraîner les actes terroristes ou la pandémie de Covid, épisodes à côté desquels l'été olympique parisien tient plutôt du simulacre d'événement.
À ainsi été adoptée dans cette « loi JO 2024 » une technologie de « vidéosurveillance intelligente » permettant de détecter des comportements suspects grâce à un traitement algorithmique des images collectées par les caméras installées dans l'espace public, et par les drones équipant les forces de l'ordre. En somme, c'est bien une forme dite « atténuée » de reconnaissance faciale qui entre en vigueur, pour la première fois dans l'Union européenne d'ailleurs, un système dont les dangers pour la vie privée et la liberté d'expression ont été largement soulignés. Rappelons en particulier que tout système de vidéosurveillance algorithmique tend à renforcer des biais discriminatoires et racistes déjà très largement à l'œuvre dans les pratiques de maintien de l'ordre.
Ce dispositif annoncé comme « exceptionnel », c'est-à-dire en théorie temporaire, est entré en vigueur dès sa promulgation, et peut donc d'ores et déjà être utilisé (et il l'est) pour toute manifestation (sportive ou non), dans à peu près tout lieu fréquenté par le public. Elle restera par ailleurs applicable bien au-delà de la fin des Jeux olympiques, c'est-à-dire jusqu'à la fin mars 2025. Le temps, peut-être, sans doute même, d'en rendre l'usage définitif. Bien évidemment, il est en effet question que ce dispositif « temporaire », « exceptionnel », lié aux besoins « spécifiques » des Jeux olympiques soit rendu permanent, comme tant d'autres dispositifs exceptionnels avant lui. On peut imaginer (et frémir d'ailleurs à cette idée) l'usage très large qui pourrait être fait de ces technologies dans le cadre de la surveillance des manifestations contre les réformes économiques ou sociales du gouvernement, ou pour « encadrer » toutes sortes d'événements politiques et de rassemblement militants.
Le gouvernement français a d'ailleurs très rapidement après l'adoption de la loi JO évoqué, par la voix de la ministre des Sports et brièvement de l'Éducation nationale, Mme Oudéa Castera, son souhait de pérenniser ce dispositif s'il « fait ses preuves » pendant la période d'expérimentation. Cette condition est évidemment suffisamment floue pour ne pas manquer d'être remplie : qu'est-ce qu'un dispositif de sécurité qui fait ses preuves ? Si la sécurité est assurée, on pourra assurer que les caméras dites « intelligentes » y sont pour quelque chose. Si un quelconque événement survient, on y verra une raison de pérenniser ce moyen supplémentaire dans les mains des forces de l'ordre. Et si des excès surviennent dans les usages de cette technologie, voire des bavures, bien évidemment nous n'en saurons rien, et cela ne changera rien, puisque c'est là le quotidien de la police en France.
On peut aussi ajouter que si la vidéosurveillance « biométrique » a ainsi été autorisée par la loi JO de 2023, celle-ci ne constitue d'une certaine façon qu'une occasion pour la mettre en œuvre, puisque ce type de technologie lui-même était déjà connu, ayant été acheté depuis une dizaine d'années déjà par l'Intérieur comme par de nombreuses collectivités territoriales. La reconnaissance faciale a ainsi été expérimentée hors de tout contrôle et de tout encadrement juridique – la CNIL a lancé à ce sujet une procédure de contrôle en novembre 2023, dont les résultats restent attendus. Il ne restait donc plus qu'à autoriser cette technologie. Or, si les textes se limitent à la « vidéosurveillance intelligente », le logiciel Briefcam utilisé par les forces de l'ordre comprend aussi une fonction de reconnaissance faciale dont l'activation ne peut être totalement contrôlée. La France, premier pays de l'UE à autoriser ce type de technologie, a par ailleurs largement poussé, lors des débats sur l'IA Act (adopté par le Parlement européen le 13 mars dernier), contre toute interdiction totale de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Que l'autorisation de la reconnaissance faciale ait vocation à être mise à l'ordre du jour ne fait donc aucun doute, et les mesures sécuritaires exceptionnelles adoptées pour les Jeux de Paris constituent, sur ce chemin, une étape décisive.
La cérémonie évoque les entrées royales qui élaboraient une représentation codifiée du pouvoir.
N'oublions pas enfin, parmi les mesures d'exception liées aux JO, les restrictions de circulation étendues à l'échelle de la région-capitale dans son ensemble, ainsi que quelques mesures notables de police sociale : les étudiants qui ont récemment dû libérer leur logement en pleine période d'examens, et trouver à se loger ailleurs jusqu'à l'automne ; ou encore la multiplication ces dernières semaines des actions des forces de l'ordre contre les campements de migrants, contre les sans domicile fixe, les personnes marginales, pauvres, qui dorment dans leur voiture, dans des squats ou des abris de fortune, et qui sont aujourd'hui victimes d'un nettoyage social silencieux mais méthodique et systématique, partout à Paris et en proche banlieue. La ville et ses habitants se trouvent ainsi soumis à Paris à une « violence olympique » récemment soulignée par la journaliste Jade Lindgaard dans son livre sur le sujet, Paris 2024 (éd. Divergences).
En cela, les JO sont bien l'occasion de l'instauration d'un véritable autant que discret régime d'état d'urgence propre au caractère artificiellement engendré de l'« exception » olympique. Au profit de qui ? Qu'est-ce qu'une fête populaire tournée contre les citoyens censés constituer cette fiction du peuple français ?
Toute fête est assurément politique. L'affirmation tient de la tautologie, en même temps qu'elle reste vague. La grande machinerie olympique ne peut quant à elle se défaire d'une logique de démonstration, de représentation d'un pouvoir pour lequel les Jeux représentent avant tout l'opportunité d'accroître les moyens légaux d'un autoritarisme de plus en plus affirmé. En cela d'ailleurs, la décision visant à faire sortir la cérémonie inaugurale du cadre habituel du stade (et qui ne faisait pas partie des plans annoncés dans la candidature parisienne) participe aussi d'un détournement de l'événement sportif vers une politisation radicale. Dans moins de deux mois, en effet, glissera sur la Seine le spectacle par lequel la ringardise du récit national, masquée pour l'occasion sous un accoutrement pop, s'offrira au reste du monde.
Par quelques aspects, la cérémonie prévue évoque quelques exemples historiques plus particuliers. Elle paraît tenir des entrées royales qui, à partir de la fin du Moyen Âge, avaient élaboré une représentation codifiée du pouvoir, comme l'ont jadis montré Bernard Guenée et Françoise Lehoux dans leur anthologie sur le sujet : à la fois « spectacle bruyant et coloré » et véritable « Fête-Roi », mettant en scène la rencontre du monarque et du peuple pour mieux asseoir, sous l'apparence du serment et de l'échange, la souveraineté du premier s'affirmant sur le second. Ou encore, de la festivité louisquatorzienne, véritable continuation de la politique (et de la guerre) par d'autres moyens, selon Louis Marin dans Le Portrait du roi, et moment par lequel « le coup d'État du Prince est représenté dans le miracle de la fête » – moment de révélation du pouvoir, de retour à son fondement, « apocalypse de son origine » retrouvée par le spectacle de la force.
Voilà donc ce à quoi l'on peut s'attendre, ce qui nous sera bientôt donné à voir : la représentation de l'ordre même, spectacle du pouvoir et de la fiction nationale s'imposant aux spectateurs conviés, chacun tenu à sa place et selon son rang social, depuis les spectateurs munis de billets gratuits et qui seront massés sur les quais haut, jusqu'aux ponts privatisés pour l'occasion, à 9 500 euros la place. Chacun, filmé, analysé par les algorithmes policiers, occasion vivante de mettre en œuvre à grande échelle les nouvelles mesures d'exception issues de cet « état d'urgence olympique » introduit clandestinement – et de faire la preuve de leur efficacité dans la perspective de leur intégration permanente au droit.
NDLR : Julien Le Mauff a récemment publié L'Empire de l'urgence, ou la fin de la politique aux PUF
Julien Le Mauff
HISTORIEN, POLITISTE, ATER EN SCIENCE POLITIQUE À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le RES avec le Front populaire

Le réseau éco-syndicaliste est né en 2021 à la suite d'un appel signé par plus d'une centaine de syndicalistes. Aujourd'hui plus que jamais, la mobilisation de toutes les forces progressistes, à commencer par les forces syndicales, alliées aux forces de l'écologie, dans un front populaire uni, est indispensable pour faire barrage au rassemblement national.
Tiré du blogue de l'auteur.
Le réseau éco-syndicaliste est né en 2021 à la suite d'un appel signé par plus d'une centaine de syndicalistes. C'est un réseau intersyndical qui fait le lien entre syndicalisme et écologie, entre justice sociale et justice environnementale, à partir des premier.es concerné.es, les travailleurs et travailleuses eux mêmes.
Aujourd'hui plus que jamais, la mobilisation de toutes les forces progressistes, à commencer par les forces syndicales, alliées aux forces de l'écologie, dans un front populaire uni, est indispensable pour faire barrage au rassemblement national et l'empêcher d'accéder au pouvoir dans les institutions, mais aussi dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos vies.
Depuis 3 ans, nous avons été aux côtés des travailleurs et des travailleuses les plus concernées par les questions sociales écologiques : soutien à la mobilisation des salarié.es de l ONF, tribune et aide logistique aux salarié.es des déchets pendant la réforme des retraites, participation active à la mobilisation des travailleurs sans papiers face à la loi immigration, soutien aux agricultrices et agriculteurs en colère face à l agro-industrie et aux supermarchés, soutien aux travailleurs de la logistique, campagne sur les accidents et les morts au travail avec les travailleurs de la construction, notamment dans la demande de justice pour Amara Dioumassy sur le chantier d'Austerlitz.
Ces salarié.es sont à la fois les premiers acteurs et les premier.es impacté.es par la destruction du vivant causée par l'activité humaine. Soumis à l'agrobusiness qui tue la terre et qui finira par tous nous affamer si nous ne faisons rien, les travailleurs et travailleuses agricoles sont aussi les premières victimes des cancers liés aux pesticides. Les salarié.es des déchets et de la propreté se mettent chaque jour en danger pour rendre vivables nos villes, face aux conséquences terribles de la croissance infinie qui engendre un telle production de déchets qu'elle pollue l'eau, le sol, et l'ensemble de la vie. Une semaine de grève des éboueurs et tout notre système sanitaire s'affole. Les travailleurs de la construction sont les premiers témoins de l'artificialisation des terres, mais aussi les premières victimes des accidents, morts au travail et maladies professionnelles liées aux produits toxiques et à l'usure des corps.
Ces trois secteurs d'activité : agriculture industrielle, déchets, construction, ont un impact considérable sur la qualité de l'air, de l'eau et des sols dont dépend notre survie pour boire, manger, et respirer. On ne fera pas d'écologie sans le monde du travail. C'est évident. C'est la raison d'être du RES.
On constate aussi que ces secteurs, les plus pénibles, sont particulièrement concernés par la division raciale du travail et le racisme environnemental : les travailleurs agricoles, des déchets, de la propreté, de la construction, sont souvent immigrés ou descendants de la colonisation française. Avec la catastrophe climatique, certain.es sont déjà des réfugié.es climatiques. Ils seront aussi les bouc émissaires et les premières victimes des actes racistes qui se multiplieront si l'extrême droite arrive au pouvoir.
Aujourd'hui l'extrême droite a gagné en partie la bataille des idées : elle reprend à son compte le slogan du front populaire de 1936 : pain, paix, liberté. Face aux ravages du néolibéralisme, elle promet aux travailleurs pauvres, aux laissé.es pour compte, que la vie sera plus facile si les entreprises produisent plus, et si les gouvernants instaurent la préférence nationale et le racisme en acte, renforcent la liberté d'opprimer.
– L'extrême droite au pouvoir, c'est le productivisme à outrance, le soutien à l'agrobusiness, aux énergies fossiles, à la destruction de la planète
– C'est la répression syndicale et politique, la casse du code du travail, l'impunité face aux discriminations
– C'est enfin le soutien à toutes les forces réactionnaires dans la rue et dans nos vies, les ratonnades, la peur de l'autre
Plus que jamais, il est indispensable que le syndicalisme, les forces de l'écologie et les forces anti racistes se conjuguent pour lutter contre l'extrême droite, dans la rue, dans les urnes, dans les entreprises, mais aussi dans dans la bataille des idées, avec nos familles, nos collègues qui sont tentés par les sirènes de Bardella.
Pour toutes ces raisons, le RES se tient aux côtés des travailleurs, travailleuses et des forces progressistes ce samedi 15 juin, mais aussi dans toutes les initiatives qui se tiendront par la suite.
L'assemblée de rentrée du RES aura lieu le samedi 21 septembre à Paris, et nous déterminerons ensemble, en fonction de la situation politique, la meilleure façon de contribuer à la lutte pour le respect de l'égalité des droits, du monde du travail et de la planète, notamment à travers les questions de racisme et de santé au travail.
Le RES, le 15 juin 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

EXISTANTES Pour une philosophie féministe incarnée

Cécile Gagon
Marie-Anne Casselot
Remettre à l'ordre du jour des sujets traditionnellement boudés par la philosophie occidentale : voilà le mandat que se donne cet essai écrit à quatre mains par des philosophes féministes. Elles y dévoilent les dynamiques de domination à l'œuvre dans les concepts classiques tels que la raison, la justice ou l'autonomie, et remettent en question le prétendu sujet universel.
Explorant une philosophie du quotidien, ancrée dans l'expérience sensible, les autrices tracent de multiples chemins vers une autre subjectivité politique. Ainsi se construit une pensée à la fois critique, vulnérable et incarnée, qui fait écho aux grandes idées qui traversent un champ en pleine effervescence.
Plusieurs théoriciennes sont ici présentées, notamment Simone de Beauvoir, Judith Butler, Elsa Dorlin, Kristie Dotson, Camille Froidevaux-Metterie, Emilie Hache, Patricia Hill Collins, Monique Wittig et Iris Marion Young.
Originaire de Québec, CÉCILE GAGNON est chargée de cours et doctorante en philosophie à l'Université de Montréal.
MARIE-ANNE CASSELOT est doctorante en philosophie à l'Université Laval. Elle a codirigé l'ouvrage Faire partie du monde : réflexions écoféministes.
photo ©Katya Konioukhova
En librairie le 28 mai 2024 | 22,95$ | 184 pages
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La crise du logement

La crise du logement fait régulièrement les manchettes depuis des mois, et pour cause, elle s'avère particulièrement aiguë depuis quelques années, en Europe comme en Amérique du Nord.
Que ce soit le récent moratoire de trois ans sur les évictions, mis de l'avant par la ministre de l'Habitation du Québec France-Élaine Duranceau, ou le mépris du gouvernement Macron pour la question du logement, les gouvernements ne s'attaquent pas aux causes du problème.
Selon David Madden et Peter Marcuse, auteurs de Défendre le logement. Nos foyers, leurs profits, (à paraître le 4 juin), la crise du logement est l'état normal, voire optimal, du marché immobilier en régime capitaliste. Les « solutions » temporaires ou technocratiques, comme le développement de meilleures technologies de construction ou l'accès facilité à la propriété, bien que parfois utiles, ne suffiront donc jamais. Le logement doit être considéré comme un besoin vital et exige des réponses radicales de réappropriation des espaces. Une lecture essentielle pour penser la crise en cours et la marchandisation sans précédent du logement.
À l'occasion de la parution de cet essai incontournable, la librairie La Livrerie (Montréal) et Écosociété organisent une causerie le mardi 11 juin avec Marcos Ancelovici (préfacier du livre) et ses invité⋅es.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la crise du logement n'est pas causée par le manque d'unités locatives, des taux d'intérêt élevés ou une conjoncture économique défavorable. Selon l'urbaniste Peter Marcuse et le sociologue David Madden, c'est l'état normal – voire optimal – du marché immobilier en régime capitaliste. Cela fait cent ans qu'il y a une « crise », notamment pour les plus vulnérables. Il s'agit d'une conséquence logique et prévisible de notre système économique : « [...] l'habitation n'est pas produite et répartie afin de fournir un toit à chacun, mais comme une marchandise destinée à enrichir une minorité. »
Défendre le logement nous plonge dans un conflit opposant deux conceptions du logement. D'un côté, on le considère – à juste titre – comme un droit fondamental, un foyer défini par sa valeur d'usage ; de l'autre, il devient sans problème un privilège, un bien immobilier qui possède d'abord et avant tout une valeur d'échange.
Cet ouvrage essentiel met ainsi le doigt sur les processus de marchandisation du logement qui, au cours des dernières années, ont atteint des sommets inégalés, notamment avec l'essor des plateformes comme Airbnb et l'utilisation de l'immobilier comme instrument d'accumulation financière. Une situation qui ne fait que creuser les inégalités dans la ville : quand le profit prend le pas sur le droit de se loger, les loyers augmentent, leur qualité diminue et les communautés sont confrontées à la violence des expulsions, de la gentrification, de la stigmatisation et de la honte. Voilà ce que Madden et Marcuse nomment l'aliénation résidentielle.
Essai incontournable pour comprendre les causes et conséquences du problème du logement, il fait aussi le point sur les solutions progressistes et montre combien cet enjeu ne peut être résolu par des solutions technocratiques : meilleures technologies de construction, aménagement plus intelligent du territoire, nouvelles techniques de gestion, accès facilité à la propriété... Parfois utiles, ces changements ne suffiront jamais. La crise du logement a des racines politiques et économiques profondes et nécessite une réponse radicale de réappropriation des espaces, une réponse qui dépasse la reconnaissance symbolique d'un droit. Le logement est d'abord politique.
David Madden est professeur assistant au département de sociologie et au programme des villes de la London School of Economics. Auteur de nombreux ouvrages, Peter Marcuse (1928-2022) était professeur émérite en urbanisme à la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de l'Université Columbia. Tous deux ont été publiés dans de nombreux journaux et magazines.
En librairie le 4 juin au Canada / 30 août en Europe
Préface de Marcos Ancelovici
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Julien Besse
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Résistances et ripostes contre l’ordre du monde

Nous avons le plaisir de vous présenter le No 17 de la revue
l'internationaliste sur le thème
Résistances et ripostes contre l'ordre du monde
Mai 2024
G7 et Sud global « philosophiques » : les conditions d'un dialogue juste et
équitable
*Nkolo Foé *
RASA, une initiative inspirant des stratégies et la réflexion prospective
aux souverainistes africains
*Cheikh Gueye *
Référentielles pour comprendre la crise actuelle en Ayiti
*James Darbouze *
« DU BLOCUS RENFORCÉ À LA RÉSISTANCE CRÉATRICE ». In-
interview du Président cubain Miguel Díaz-Canel
*Ignacio Ramonet *
Le Sahel africain entre attaques terroristes, crise de la démocratie et
revendications de souveraineté
*Téguewindé Sawadogo*
*CIRFA*
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
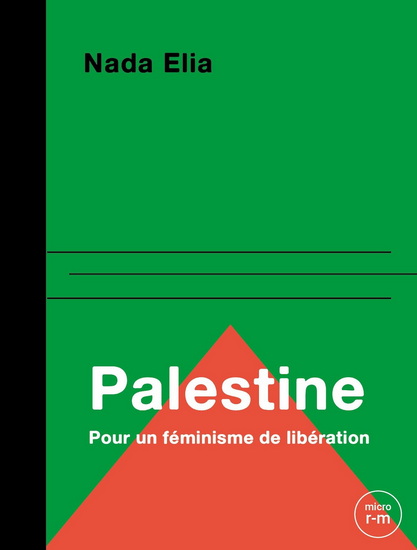
PALESTINE Un féminisme de libération
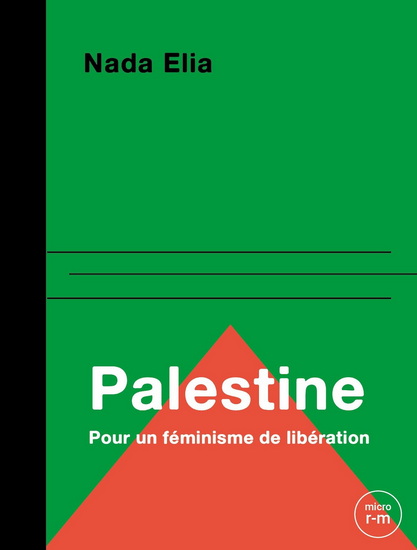
Nada Elia
Pour reconnaître que la lutte palestinienne pour la liberté et l'autodétermination est, plus que jamais, un enjeu féministe.
Comment expliquer qu'Israël, malgré ses attaques meurtrières à Gaza et sa violation du droit international, reste à l'abri de toute véritable critique ? Pourquoi de nombreuses féministes du Nord global, si promptes à dénoncer l'impact du « fondamentalisme islamique » sur les femmes palestiniennes, restent-elles silencieuses quand il s'agit de décrier l'occupation et le génocide que perpétue l'État israélien en Palestine ?
En déconstruisant les associations fallacieuses entre antisionisme et antisémitisme, la professeure et militante palestinienne Nada Elia rappelle la place des femmes et des personnes queers dans la lutte pour la libération de la Palestine, et revendique le démantèlement des structures coloniales qui écrasent la population à Gaza et en Cisjordanie.
Palestinienne de la diaspora née en Irak, 𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗟𝗜𝗔 vit aux États-Unis, où elle enseigne les études culturelles et arabo-américaines au Fairheaven College de l'Université
Western Washington.
Elle est notamment l'autrice
de 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑂𝑢𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠 : 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟/𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚, 𝑎𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒 (Pluto Press, 2023).
En librairie le 11 juin 2024 | 15,95$ | 128 pages
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Travailleuses de la résistance

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/04/travailleuses-de-la-resistance/
Contre les attentes de Kremlin, qui espérait que son opération militaire spéciale ne durerait que trois jours, l'Ukraine continue à présent à résister efficacement aux forces d'occupation. Si le rôle de la mobilisation populaire, à travers les innombrables initiatives bénévoles qui ont parsemé le pays, a souvent été souligné, nous ne disposons encore que de peu de travaux sur l'organisation concrète de cette résistance sur le plan local, ainsi que sur les rapports de classe et de genre qui la traversent.
En s'appuyant sur une enquête de terrain menée à Kriviy Rih, grand centre d'extraction minière et de métallurgie situé en Ukraine centrale, ce livre s'intéresse à la manière spécifique dont les hommes et les femmes des classes populaires, souvent russophones et anti-Maïdan, s'engagent dans le mouvement de solidarité avec l'armée et les populations civiles touchées par la guerre. Comment s'organisent-ils face à l'agression russe, quelles sont leurs motivations, leurs préoccupations, leurs activités et leurs modes de fonctionnement ? Quel est le degré d'autonomie de leurs initiatives et quels rapports entretiennent-elles avec l'Etat et les pouvoirs locaux, les partis politiques, les syndicats, les ONGI et les organisations des classes moyennes et supérieures ? Le choix méthodologique d'aborder le bénévolat sous l'angle de la sociologie du travail permet en outre d'interroger l'articulation entre le travail bénévole, le salariat et le travail domestique, et de montrer comment l'Etat s'appuie sur cet élan spontané de solidarité, qui met à sa disposition des masses colossales de travail gratuit, pour assurer les services publics cruciaux tout en poursuivant les réformes néolibérales entamées en 2014.
Le livre s'intéresse enfin plus largement aux points de vue exprimés par les membres des classes populaires sur la situation économique, sociale et politique de leur pays. Que pensent-ils des évènements qui secouent l'Ukraine depuis 2013 ? Comment évaluent-ils les réformes de ces dix dernières années, les batailles autour de la mémoire historique et de la question linguistique ?
Points fort : S'éloignant des approches géopolitiques de la guerre en Ukraine, l'ouvrage en éclaire les enjeux du point de vue de l'expérience de la résistance.
L'ouvrage s'appuie sur un travail de terrain de trois mois qui a permis de réaliser une quarantaine d'entretiens individuels et collectifs à Kriviy Rih et à Kiev. L'auteure a pu également observer et participer au travail de deux organisations bénévoles, et les accompagner dans plusieurs missions humanitaires. En se donnant pour objet l'activité bénévole des classes populaires à Kriviy Rih, l'auteure a voulu étudier un cas-limite de la résistance ukrainienne.
Les enquêtés étaient en effet en grande partie opposés au soulèvement de l'Euromaidan en 2013-2014 ; ils continuent à parler russe ou un mélange de russe et d'ukrainien, et ont de la famille en Russie ; la référence à l'URSS reste ancrée dans leur mémoire collective. L'ouvrage remet ainsi en question le stéréotype de la division profonde de l'Ukraine entre l'Ouest pro-européen à l'Est pro-russe. Grâce à l'apport méthodologique de la sociologie du travail bénévole, l'ouvrage aborde la résistance ukrainienne comme un phénomène social hétérogène traversé par des rapports de classe et de genre, ce que les approches en termes d'« engagement citoyen » ignorent généralement.
Biographie : Daria Saburova est née à Kiev en 1989. Elle est doctorante en philosophie au laboratoire Sophiapol (Université Paris Nanterre) et membre du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine.
*-*
Mon livre « Travailleuses de la résistance » est parti chez l'imprimeur !
À paraître bientôt aux éditions du Croquant.
Ce livre est issu d'une enquête de terrain que j'ai menée entre janvier et mars 2023 à Kryvyï Rih. En prenant du recul par rapport aux approches géopolitiques de la guerre, je pose la question des rapports de classe et de genre qui traversent la résistance ukrainienne, en m'intéressant spécifiquement aux organisations bénévoles des femmes des classes populaires.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce livre par les récits qui l'ont nourri, par les lectures et les relectures, les discussions et les encouragements !
Daria Saburova
https://www.facebook.com/people/Ukraine_CombArt/100090567559766/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
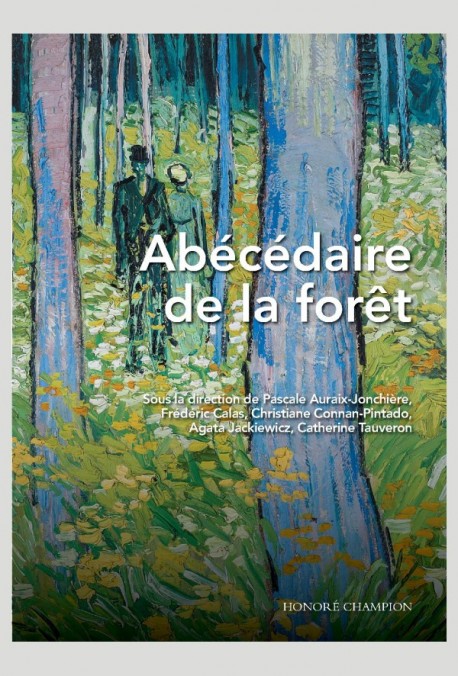
« Abécédaire de la forêt »
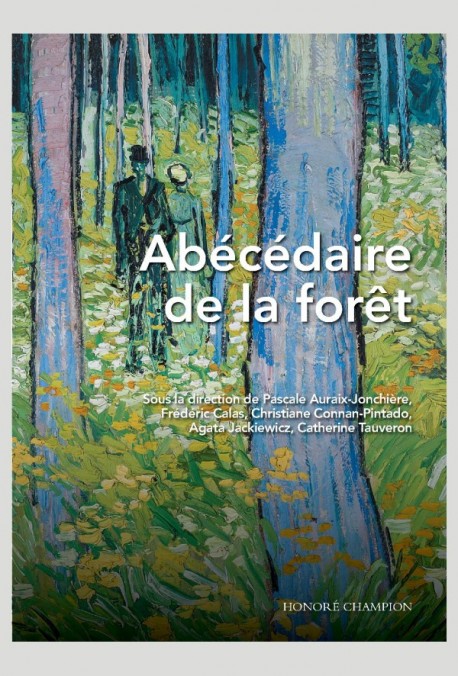
Information publiée le 5 juin 2024 par Marie Berjon < fabula.cnrs[a]fabula.org > sur le site internet « Fabula – La Recherche en littérature » < www.fabula.org/actualites/121193/pascale-auraix-jonchiere-frederic-calas-christiane-connan-pintado-agata-jackiewicz-et-catherine.html <http://www.fabula.org/actualites/12...> >
Source : Honoré Champion < champion[a]honorechampion.com >
L'/Abécédaire de la forêt/n'est pas un dictionnaire comme les autres : le genre y est en parfaite harmonie avec l'objet d'étude. Telle la forêt, où s'ouvrent sentiers et chemins de traverse, l'Abécédaire croise les analyses de biologistes, littéraires, linguistes, juristes, écologues et vétérinaires sur un espace qui ne semble unique qu'en apparence : la forêt et ses composantes, végétales ou animales, visibles ou invisibles, que scrutent des regards croisés entre disciplines artistiques et scientifiques. Il s'agit d'un kaléidoscope raisonné, non exhaustif mais éclectique, miroir des questionnements actuels sur la forêt, aussi merveilleuse que menacée.
Le lecteur peut à son goût suivre l'alphabet, qui le mène d'« Album » à « Zoonoses », trouvant sur sa route aussi bien les réalités de l'écosystème forestier ( Arbre, Champignons, Essences, Mycorhize…) que les fictions et inventions de nos imaginaires ( Baba Yaga, Blanche-Neige, Loup, Perché, Sorcières et fées… ). Libre à lui de tracer son propre parcours et, comme les auteurs, d'emprunter une première allée avant d'en suivre une autre, qui bifurque.
Il (re)découvre ainsi les univers boisés, leur histoire, leur actualité, les risques que présente leur avenir. Il enrichit son expérience et sa représentation de la forêt, immense et mystérieux domaine de nos rêves.
Avec les contributions de : Pascale Auraix-Jonchière, Sandra Barantal, Sébastien Baudoin, Fabienne Bercerol, Katia Blairon, Frédéric Calas, Marie Chanderlier, Christiane Connan-Pintado, Corinne Fournier Kiss, Anne-Marie Garagnon, David Gomis, Agata Jackiewicz, Caroline Lardy, Esther Laso y Leon, Françoise Laurent, Camila Leandro, Aurore Leocadie, Catherine Lenne, Jacques Marckert, Jordan Martel Lanneyn, Xavier Morin, Guillaume Papuga, Catherine Tauveron, Frédérique Toudoire sur la Pierre.
Extrait de l'introduction... <https://www.honorechampion.com/fr/i...>
Table des matières... <https://www.honorechampion.com/fr/e...>
« Abécédaire de la forêt » par Pascale Auraix-Jonchière, Frédéric Calas, Christiane Connan-Pintado, Agata Jackiewicz et Catherine Tauveron (dir.), Éditions Honoré Champion, collection "Champion les dictionnaires", Paris, 2024. EAN : 9782380960822. 400 pages, Prix : 25 euros. Date de publication : 23 mai 2024 < www.honorechampion.com/fr/book/9782380960822 <http://www.honorechampion.com/fr/bo...> >.
*Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal, le 11 juin 2024*
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
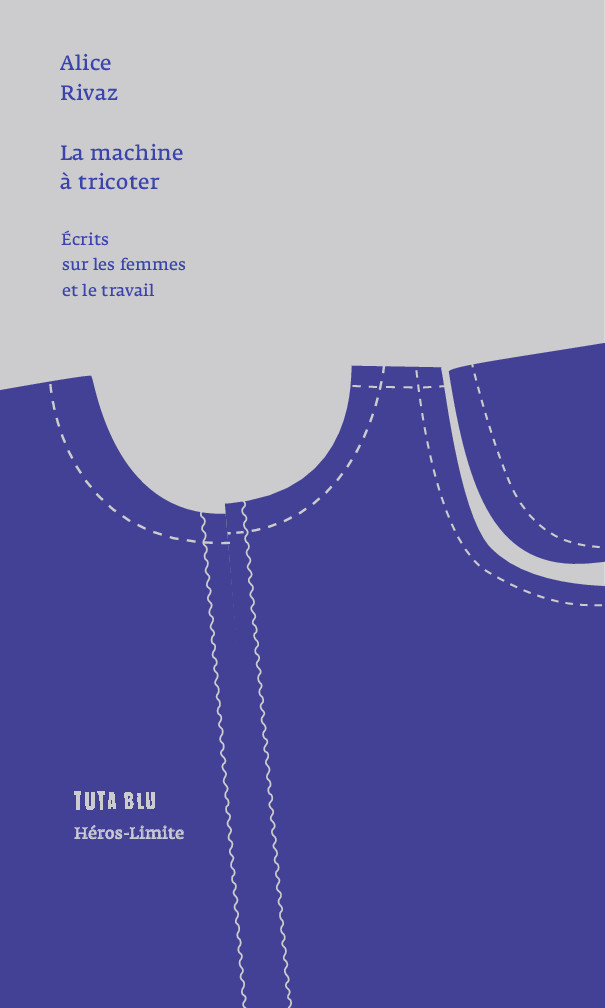
"La machine à tricoter. Écrits sur les femmes et le travail"
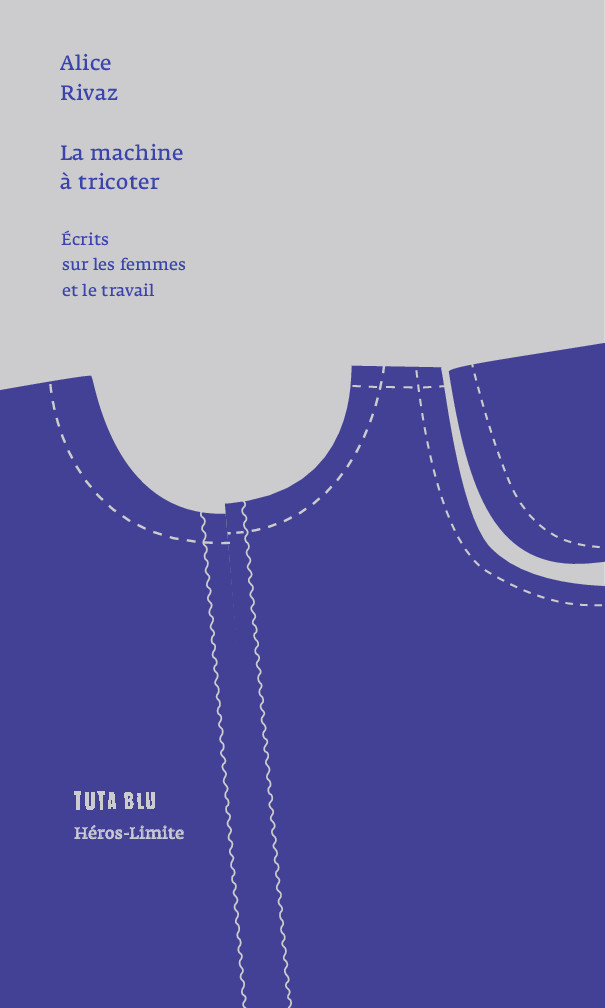
Dès le mois de septembre 1944, Alice Rivaz écrit pour l'hebdomadaire "Servir" une série d'enquêtes consacrées à des métiers féminins. Elle y décrit les conditions de travail de femmes de ménage et de travailleuses à domicile dont elle rapporte les propos. Le ton de ces articles est résolument empathique : il s'agit, comme le titre de la série l'indique, de se mettre « à l'écoute de celles qui travaillent », autrement dit à l'écoute de celles dont la parole n'est guère entendue ou considérée.
« La machine à tricoter. Écrits sur les femmes et le travail, par Alice Rivaz, éditions Héros-Limite, collection "Tuta Blu", Genève, 2024.EAN : 9782889550999. 192 pages. Prix : 18 euros. https://heros-limite.com/livres/la-machine-a-tricoter/
Information publiée le 10 juin 2024 par Faculté des lettres - Université de Lausanne < marc.escola[a]unil.ch >, sur le site internet « Fabula – La Recherche en littérature ».
Source : Jacob Lachat < Jacob.Lachat@unil.ch >
L'écrivaine ne se contente pas d'exposer des parcours de vie laborieuse de manière impartiale ; elle s'implique dans le portrait des femmes qu'elle rencontre tout en donnant à voir leurs gestes et leurs savoir-faire. Elle les interroge aussi sur les aspects les plus matériels de leurs tâches ( activités, emploi du temps, revenu chiffré, budget familial, etc. ) en cherchant à mettre au jour la réalité matérielle de leurs métiers précaires.
Dans ses articles, Alice Rivaz s'essaie à différentes formes d'écriture et se confronte à des enjeux politiques et sociaux qui ne cesseront de faire retour dans la plupart de ses livres : la condition ouvrière, la question sociale, la guerre, le suffrage féminin, ou encore la situation des femmes dans le monde des lettres.
Sur 20 pages***=> Parcourir la Table des matières et lire la Préface de Jacob Lachat… <https://www.fabula.org/actualites/d...> *
* --------------------------------------------------------------
* *Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal, Québec, le
16 juin 2024 *
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
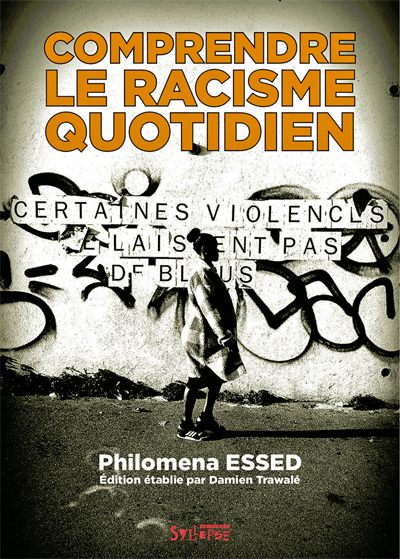
Préface de Silyane Larcher au livre de Philomena Essed : Comprendre le racisme au quotidien
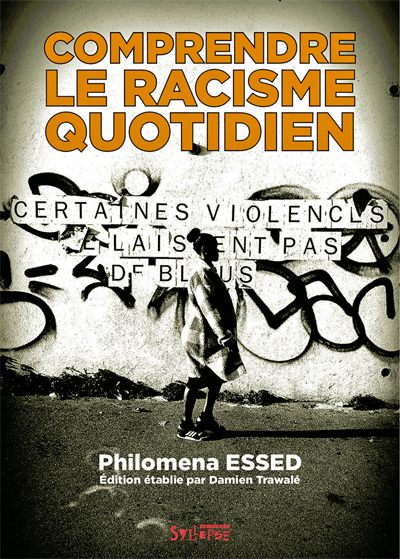
Madeline est directrice du département juridique de la filiale française d'une multinationale japonaise1. Près d'une vingtaine de personnes, secrétaires, analystes financiers et avocat·es, travaillent sous ses ordres. À l'exception du personnel de sécurité et de ménage, elle est la seule salariée noire de l'entreprise. Les personnes qui l'ont embauchée sont étasuniennes et japonaises. Ses employeurs sont très satisfaits de ses compétences et de son travail. Pourtant lorsqu'elle se déplace en Suisse ou au Luxembourg pour représenter le groupe afin d'établir de gros contrats, elle rencontre toujours des réactions spontanées, souvent contenues, parfois explicites, d'étonnement. Elle n'est jamais celle à laquelle client·es ou collaborateur·trices s'attendaient a priori. Ce qui dans ce monde très socialement privilégié peut occasionner quelques quiproquos. Les contrôleurs de train inspectent méthodiquement ses papiers d'identité lorsqu'elle voyage en classe business. Un matin où elle se rendait plus tôt qu'à l'accoutumée au bureau, habillée en leggings et en baskets afin de profiter de la salle de sport du dernier étage de l'immeuble de l'entreprise, l'un des gardiens l'intercepte avant qu'elle ne monte dans l'ascenseur. Il craignait une intrusion inopportune dans les lieux. Pourtant, elle avait utilisé son badge pour entrer… Comme ses revenus confortables le lui autorisent, il lui arrive de se rendre dans des boutiques de luxe de l'avenue Montaigne à Paris pour faire du shopping. Elle est très souvent suivie de près par les vigiles qui anticipent un possible vol ou alors les vendeuses s'adressent spontanément à elle en anglais, persuadées qu'elle est Africaine-Américaine. Pourtant, Madeline est d'origine guadeloupéenne, donc Française.
Maman d'une petite Ana de 10 ans, elle reçoit aussi les plaintes de sa fille qui s'est vue écartée d'un concours très sélectif de danse classique en raison de ses courbes, jugées trop « généreuses pour une fillette de son âge », et de sa coiffure, tenue pour non conforme aux exigences de la scénographie d'un prestigieux ballet ; sans parler de ces moments d'amusements où les petits camarades d'Ana lui intiment, dans des jeux de rôles, d'occuper la position de servante « pour rigoler », entraînant chez cette dernière incompréhension et désolation. Ces situations saturent la vie quotidienne de cette Française cadre supérieure racialisée comme noire dans ses activités les plus ordinaires, qu'elles soient professionnelles, familiales ou de loisir. Leur accumulation et leur caractère routinier décrivent ce que Philomena Essed qualifie de « racisme quotidien », objet du présent livre, qui définit aussi ce que c'est d'être « racisé·e », terme issu de la sociologie française entré au dictionnaire de la langue française en 2019.
Dans un contexte français où les notions d'« intersectionnalité » et de « racisme systémique » se banalisent dans le vocabulaire politique courant, autant qu'elles font l'objet de controverses politiques et universitaires, il faut se réjouir que les lectrices et lecteurs français·es et francophones puissent découvrir le travail pionner de Philomena Essed. Rendu désormais accessible par une remarquable traduction de Damien Trawalé et Patricia Bass, sous le titre Comprendre le racisme quotidien. L'étude que l'on va lire ici a une histoire et une postérité particulières à l'étranger d'abord, mais aussi en France dans une certaine mesure. J'y reviendrai. Pour comprendre le caractère en son temps pionnier de la recherche dont ce livre est tiré, il faut néanmoins dire quelques mots du contexte dans lequel elle a vu le jour.
Sociologue née aux Pays-Bas de parents de la classe moyenne supérieure, originaires du Suriname (ou Guyane Hollandaise), Philomena Essed a passé sa vie entre cette ex-colonie2néerlandaise d'Amérique du Sud où elle a grandi, les Pays-Bas où elle arrive avec sa famille à l'âge de 14 ans, et les États-Unis où elle réside depuis plus de vingt ans3. Dans ces circulations transatlantiques, le racisme et l'analyse critique de la race, les engagements féministes et en faveur de la justice sociale, ont été indissociablement au cœur de ses préoccupations politiques, sociales et scientifiques. C'est comme étudiante en anthropologie sociale, à la frontière entre monde immigré – condition qui ne fut pas vraiment la sienne, mais définissait plutôt celle de ses parents et de son entourage – et monde intellectuel néerlandais, c'est-à-dire national et bourgeois, qu'elle s'est intéressée à la question raciale, et plus singulièrement à l'expérience vécue du racisme aux Pays-Bas. Basé sur une enquête qualitative par entretiens approfondis et non-directifs conduits à la fin des années 1980 auprès de 55 femmes afro-descendantes diplômées du supérieur, réparties entre les Pays-Bas et les États-Unis (la Californie),Comprendre le{} racisme quotidien est devenu un classique de la sociologie du racisme et des études de genre outre-Atlantique en raison de son approche novatrice du racisme et des dynamiques de racialisation. Après une précédente recherche menée à une plus petite échelle auprès de femmes migrantes de milieux sociaux variés, originaires du Suriname vivant aux Pays-Bas, Philomena Essed a étendu son exploration de l'expérience vécue du racisme auprès de femmes de même origine migratoire, mais de classes moyennes supérieures, et auprès de femmes Africaines-Américaines, également de classes moyennes supérieures. En s'inscrivant au croisement de la psychologie sociale, de la sociologie et de l'analyse de discours, ce travail venait bousculer les approches dominantes du racisme et des relations entre groupes racialisés qui se concentraient le plus souvent soit sur l'étude des préjugés et des croyances raciales, soit sur l'étude des manifestations institutionnelles du racisme, notamment sous le prisme de l'approche par les discriminations et les politiques publiques. Autre élément majeur du début des années 1990, Philomena Essed venait défier le consensus politico-moral, ancré dans l'opinion majoritaire néerlandaise, qui affirmait que les Pays-Bas étaient – en dépit d'une histoire coloniale qui embrassait la traite esclavagiste atlantique et la colonisation de l'Afrique du Sud ! – un pays de traditions culturelles pluralistes peu touché par le racisme, alors identifié à une réalité historique des États-Unis. Le choix de comparer, au niveau de la recherche doctorale dont sera plus tard tiré ce livre, l'expérience vécue de femmes afro-descendantes diplômées des Pays-Bas et des États-Unis ne doit rien au hasard. Il s'agissait pour la jeune chercheuse, d'une part de contourner l'idée admise que le racisme relevait d'une idéologie du rejet ou de la haine peu présente parmi les élites occidentales cultivées, dites éclairées et progressistes, et d'autre part, de contester l'autre idée de sens commun selon laquelle le racisme se traduirait essentiellement par des discriminations, c'est-à-dire l'inégal accès à des droits et à des opportunités (logement, travail, accès à la santé, etc.).
En se penchant prioritairement sur des femmes noires et métisses de classe moyenne supérieure, souvent universitaires, la sociologue s'est de surcroît donné les moyens d'abstraire l'interprétation de l'expérience de la racisation de logiques d'infériorisation d'emblée déterminées par les conditions socio-économiques de vie des personnes qu'elle a interrogées. De manière très heuristique, cette stratégie méthodologique vient opposer un démenti à la thèse, très en vogue en France – où la recherche s'est longtemps concentrée sur le vécu des travailleuses et travailleurs issu·es de l'immigration postcoloniale, surreprésenté·es dans les classes populaires –, qui assimile les logiques de racialisation à des mécanismes symboliques, parmi d'autres, de mise à l'écart des classes subalternes. Ainsi, là où d'aucuns voudraient voir des logiques de race dans la production des discriminations et des inégalités sociales se trouverait en vérité une reconfiguration de la lutte des classes4. À l'instar de l'expérience de Madeline présentée en ouverture de ce texte, les résultats des travaux de Philomena Essed nous enseignent que les classes supérieures diplômées non-blanches n'échappent pas à des logiques de racialisation, de minorisation, de contrôle, de mise à l'écart et de subalternisation, donnant toute son épaisseur, sa multi-dimensionnalité et son hétérogénéité au « racisme quotidien ». Enfin, focaliser l'analyse sur les femmes a pour autre vertu heuristique d'inscrire la compréhension du racisme de facto dans sa relation coextensive avec le genre. Sans que Philomena Essed forge le concept à peu près contemporain d'« intersectionnalité » – que l'on doit à Kimberlé Crenshaw (1989) –, elle théorise toutefois l'imbrication du genre et de la race dans les rapports sociaux de pouvoir qu'elle qualifie de « racisme genré » (gendered racism). Il faut en effet souligner la dimension véritablement imbriquée, indissociable, de l'identité genrée et de l'assignation raciale dans l'approche du racisme menée ici, tant une réception devenue courante de l'intersectionnalité en France tend à laisser croire que l'analyse intersectionnelle consisterait en l'analyse d'une concaténation ou combinatoire de segments sociaux (classe, race, genre, âge, etc.) juxtaposés dont l'élucidation permettrait de rendre compte de la domination sociale5. Il n'y a donc pas d'un côté le racisme et de l'autre, le sexisme que les chercheur·euses devraient se donner pour tâche de démêler. Au contraire, l'autrice considère qu'il est analytiquement difficile – sinon impossible – de distinguer dans l'expérience de la racisation les aspects qui relèveraient strictement de l'assignation raciale et à l'opposé, ceux qui ne relèveraient que de l'oppression sexiste. Ainsi, uniment race et genre procèdent ensemble des modalités par lesquelles la racisation, dans un contexte spécifique, inscrit un sujet social identifié à un groupe essentialisé dans une place, un rôle ou une fonction fantasmée et généralement à la fois subalterne et genrée.
Ce sont les limites de sa socialisation d'étudiante féministe qui ont confronté Philomena Essed à ses premières interrogations touchant spécifiquement au racisme. Cette précision est importante. Car depuis cette position singulière, la conscience des points aveugles du « nous » rassembleur du mouvement féministe néerlandais a conduit la jeune chercheuse, au début des années 1980, à interroger l'expérience des femmes afro-surinamaises des classes populaires et moyennes parmi lesquelles elle gravitait. On aurait pu croire que l'analyse féministe aurait conduit à l'analyse antiraciste. Tout autre chose s'est pourtant joué dans cette position à la fois politique et épistémique ou « positionnalité » (positionality) selon le terme anglophone, condition d'un regard spécifique et d'émergence d'une question sur le monde social. L'isolement expérientiel, donc intellectuel, parmi des féministes aveugles à l'ampleur de l'expérience du racisme et des discriminations dans la vie des femmes surinamaises a imposé l'investigation du racisme en tant que tel, autrement dit à investir l'invisible pour un regard ou « point de vue » majoritaire. La construction de l'objet de recherche a ainsi soigneusement découlé de la rencontre intime avec l'hégémonie des luttes politiques progressistes aveugles à la race et les discours de déni quant aux formes diverses d'expression du racisme dans le tissu social lui-même. Indissociable de sa socialisation régulière avec des immigré·es du Suriname de classes sociales variées et de sa propre expérience en tant qu'afro-descendante et militante féministe, la démarche de Philomena Essed, qu'il faut donc comprendre comme une véritable entreprise de dévoilement, s'est fondée sur une hypothèse forte : le racisme traverse l'ordre social et imprègne, à divers degrés et de manière différenciée, la vie sociale des personnes noires ou non-blanches plus largement. Et pour démontrer qu'il n'est pas une « affaire étasunienne », il fallait apprécier l'expérience de femmes noires et métisses des Pays-Bas à l'aune de celle de femmes Africaines-Américaines et ainsi donner à lire ce qu'elles ont en partage, mais aussi de distinct, dans leur confrontation ordinaire à la racisation. Paru initialement en anglais chez un éditeur étasunien distribué en Grande-Bretagne et en Inde car l'autrice avait délibérément fait le choix de ne pas écrire sa thèse en néerlandais, Understanding Everyday Racism, a d'abord fait l'objet d'un accueil controversé aux Pays-Bas tout en étant loué aux États-Unis pour son inventivité méthodologique, en même temps que pour son originalité et son audace compte tenu de l'approche comparative inédite qu'il proposait. Venant enrichir les approches courantes de la race et du racisme, il s'est aujourd'hui imposé dans bien des bibliographies de sociologie du racisme et d'études de genre de par le monde.
Traduit en français plus de trente ans après sa publication à l'attention d'un lectorat francophone, les analyses de Philomena Essed font étrangement écho à des débats français incessants. On trouvera en effet de nombreux traits communs entre ce qu'elle décrit de la société néerlandaise du tournant des années 1980-1990 et la société française d'aujourd'hui, plus de vingt ans après le début du 21e siècle. Pourtant, sans doute en raison de sa forte dimension méthodologique qui peut lui donner une apparence aride, en France l'ouvrage est resté connu essentiellement des spécialistes sans qu'il n'ait été jugé utile d'envisager sa traduction, donc de lui offrir une vie au-delà des milieux scientifiques. On le trouve ainsi régulièrement cité dans les travaux de sociologie des discriminations6, entre l'interprétation du racisme comme épreuve morale et comme vécu des « micro-agressions », terme du registre psycho-émotionnel qui n'apparaît pas sous la plume de Philomena Essed7. Il fait partie de l'attirail méthodologique de nombreuses thèses de sociologie consacrées à la race et aux discriminations racistes. Mais cette connaissance ancienne de l'ouvrage ne semble pas avoir entraîné de prise au sérieux des résultats de la recherche ni de discussion large de ses enjeux pour la conceptualisation même de l'objet « racisme » dans un pays comme la France8. Certes, le mot même de « racisme » se révèle ductile dès lors qu'il désigne aussi bien une idéologie ou une doctrine, généralement assimilée aux théories pseudo-scientifiques du 19e siècle, que l'hostilité à l'égard d'un ou plusieurs membres d'un groupe situé au bas d'une hiérarchie entre groupes humains en cela constitués en races. Cette hostilité elle-même fondée sur la croyance dans la supériorité d'une « race » par rapport à d'autres se trouve par exemple cristallisée dans des pratiques institutionalisées (en particulier juridiques), telles qu'on peut l'observer dans la ségrégation du Sud des États-Unis ou dans l'apartheid de l'Afrique du Sud, mais aussi dans la mise en œuvre du code de l'Indigénat dans les colonies françaises ou même dans la division de couleur entre libres et esclaves qui régit les sociétés de plantation des Amériques (Caraïbe, Amériques du Sud et du Nord).
Dans le fond, la notion de « racisme quotidien » théorisée par Philomena Essed perturbe un consensus d'ordre psychologique, en même temps qu'un dogme moral – fruit de l'éthos des démocraties dites « modernes » –, en vertu duquel le racisme serait une réalité du passé et ses résurgences, la pure expression de l'attachement anachronique à de « vieilles idées » antimodernes, à des « passions tristes » dont les groupes minoritaires construits en bouc-émissaires seraient les cibles privilégiées. Ce mot de « racisme » serait donc bien malvenu dans une république qui fonde son pacte social sur le lien civique entre des individus abstraits, toutes et tous membres d'une même communauté d'égaux. Pour peu qu'on veuille lire Comprendre le racisme quotidien autrement que comme un ouvrage offrant un protocole d'enquête à des chercheur·euses, que l'on consente encore à se départir des définitions étroites – et rassurantes – du racisme pour mieux le sociologiser, on se rendra vite compte que la démonstration confronte à l'idée dérangeante que le racisme est une réalité prégnante du présent, qu'il est mobile, voire ubiquitaire. C'est sans doute l'une des difficultés théoriques et épistémologiques de l'analyse : si le racisme est partout, c'est qu'il n'est peut-être nulle part après tout ! Or l'intérêt de l'ouvrage, qui explique sa postérité, est d'offrir l'appareillage théorique permettant d'identifier et d'analyser, donc de comprendre, les manifestations contemporaines du racisme dans des démocraties hétérogènes ou pluriethniques en raison des legs sociaux de l'esclavage et des migrations venues des anciennes colonies. Le racisme quotidien n'est pas ici celui de l'insulte, du trait d'humour sans équivoque ou de l'agression raciste susceptible de faire l'objet d'un dépôt de plainte, ni celui de l'interpellation policière fondée sur le délit de faciès, ni même celui du militantisme politique ou médiatique de groupuscules d'extrême droite inquiets du « grand remplacement ». La contemporanéité du racisme que décrit Essed s'inscrit dans l'étoffe même du social, dans la banalité du quotidien, et à ce titre se caractérise, non par son éclat ni son bruit, mais bel et bien par son invisibilité, par son caractère microscopique. Ni racisme idéologico-politique ni racisme institutionnel stricto sensu, le racisme quotidien « est l'intégration du racisme dans des situations quotidiennes par le biais de pratiques (cognitives et comportementales […]) qui activent des relations de pouvoir sous-jacentes9 ». Défini de la sorte, il est un racisme actif ou en acte, processuel et relationnel, produit dans les relations sociales elles-mêmes, celles-ci impliquant des rapports de pouvoir entre individus appartenant à des groupes minoritaires et majoritaires. Plus encore, précise la sociologue, « le racisme quotidien n'existe pas au singulier, mais seulement au pluriel, en tant que complexe de pratiques et de situations cumulatives et liées les unes aux autres10 ».
Le livre restitue en une analyse longuement détaillée l'expérience de Rosa N., afro-surinamaise, médecin gériatre en établissement hospitalier, présentée en cas idéal-typique de la réalité hétérogène du « racisme quotidien ». « L'histoire de Rosa N., explique Essed, ne rapporte pas d'idéologies racistes ou de mouvements racistes ou fascistes organisés. Elle relate simplement ses expériences quotidiennes dans des situations de routine impliquant des personnes “normales”11. » Il ne s'agit pas pour l'autrice de restituer le vécu au sens simplement émotionnel ou moral des personnes enquêtées dont Rosa N., mais bel et bien de reconstituer de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de leur perspective (donc de leur point de vue et de leur position sociale), le savoir expérientiel qu'elles élaborent à titre personnel et par interconnaissance à propos de situations accumulées, répétées dans la vie de tous les jours et contextualisées rendant compte du maillage socio-racial qui les enserre et dessine les contours de ce racisme spécifique qu'est le racisme quotidien. Les détails et éléments de contexte rapportés par Rosa N. permettent à la sociologue de resituer l'enquêtée dans une structure relationnelle et institutionnelle plus large qui la dépasse et sans laquelle il ne serait pas possible de comprendre les enjeux et la nature de son expérience sociale. Ainsi, précise Essed :
En raison de sa profession, un nombre proportionnellement élevé de membres du groupe dominant auxquels elle est confrontée dans ses interactions quotidiennes appartiennent à l'« élite » néerlandaise éduquée. Les relations entre Rosa N. et les membres du groupe dominant sont racialisées parce qu'elles sont structurées par les stratifications plus larges de la société.
Dans le même sens, l'expérience de Madeline évoquée précédemment n'est pas réductible à sa seule interaction, prise isolément, avec l'agent de sécurité de l'immeuble de son entreprise par exemple, ni encore à l'étonnement de la vendeuse qui découvre qu'elle n'est pas Africaine-Américaine. Elle ne peut être comprise qu'au regard de la position de Madeline dont l'identité de femme, noire, en outre isolée dans son milieu social et professionnel élitiste, la singularise par rapport à la norme définie par le groupe majoritaire, implicitement blanche. Le racisme quotidien dans la vie de Madeline ne se comprend qu'à l'aune de cette accumulation routinière de circonstances qui l'inscrivent à côté de la place qu'elle occupe socialement et qui ce faisant, définissent la place à laquelle elle est a priori attendue, sa place, supposément « naturelle » et généralement inférieure à celle du groupe majoritaire – ceci pouvant arriver par exemple, même quand le vigile dans l'immeuble ou le contrôleur est une personne noire comme elle, car il n'appartient pas à la norme de majorité. On comprend par-là, et Philomena Essed y insiste plusieurs fois dans le livre, que le racisme quotidien n'est pas un phénomène individuel ni psychologique, simple affaire de préjugés ou d'hostilité à l'égard d'un·e autre, ni même un phénomène étroitement institutionnel, mais bel et bien un processus fluide et relationnel qui traverse les interactions sociales, celles-ci étant sous-tendues par des dynamiques de pouvoir et des hiérarchies sociales historiquement construites. En effet, Rosa N. et Madeline ne correspondent pas à l'idée préconçue, tenue pour évidente, au préjugé donc, de l'expert dans un cas et de la femme fortunée, dans l'autre. Parce qu'elles ne sont pas à leur place présumée, elles sont rappelées à l'ordre racial par des tiers (supérieurs hiérarchiques, collègues, interlocuteurs ordinaires) sous la forme, selon Essed, de la marginalisation, de la « problématisation » (le fait par exemple que leur présence soit remise en cause ou tenue pour incongrue ou qu'elles soient encore sous-estimées) et de la neutralisation (containment). Pour le dire autrement, leur présence « détonne » dans des milieux sociaux dont la hiérarchie n'est pas seulement socio-économique, mais aussi, on le voit à travers ces interactions, en dernière instance racialisée (et genrée).
La force du travail de Philomena Essed fut de saisir, sans doute avec plus de finesse que ne le permet la notion englobante de « racisme systémique », les intrications entre micro-interactions et macrostructures dans le cours ordinaire de la quotidienneté et de les analyser dans leur interdépendance. En déconstruisant les modalités de formation de la connaissance interne du racisme par les personnes qui le vivent au quotidien – des femmes afro-descendantes –, le livre montre de manière détaillée que les routines de pensée (cognitions) qui associent mécaniquement et régulièrement une couleur de peau, un genre, des traits ou phénotypes, à des comportements, des places ou fonctions sociales, et qui sont elles-mêmes indissociables de pratiques sociales exercées par des acteurs tant individuels qu'institutionnels, sont enracinées dans des représentations sociales dominantes héritées. Ces routines de pensées, manières ordinaires de voir le monde et d'interagir avec lui, font en effet peser sur des corps des attentes sociales spécifiques déterminées par des préjugés historiques. Il en découle que dans des sociétés façonnées, même à des degrés divers, par l'histoire coloniale, l'ordre social se présente nécessairement comme un ordre racial. Toute la tâche de la recherche est alors d'aider à discerner l'ampleur de ces effets d'héritage dans les représentations sociales et surtout leur part agissante dans les relations sociales, nécessairement inscrites dans des situations sociales spécifiques et contextualisées. De manière plus cruciale et au-delà du monde universitaire, dans un pays où l'idéal universaliste se confond en pratique avec le déni du caractère racial de l'ordre social ou avec le tabou de la race comme rapport social, on peut faire le pari que l'ouvrage de Philomena Essed offrira à ses lectrices et lecteurs français·es, les outils intellectuels pour dessiller les yeux et décrypter les ressorts cachés de la domination raciale dans leur quotidien comme dans celui de leur entourage. S'il n'est pas possible de combattre le racisme quotidien sans interroger le caractère d'évidence des valeurs hégémoniques de l'ordre social, une telle entreprise réclame au moins de recouvrer la vue sur l'ordinaire des relations sociales.
Silyane Larcher
Chargée de recherche au CNRS en sciences politiques et professeure associée en Études de genre et des sexualités à l'université Northwestern (États-Unis).
Philomena Essed : Comprendre le racisme au quotidien
Edition établie par Damien Trawalé
Traduit de l'anglais par Damien Trawalé et Patricia Bass
https://www.syllepse.net/comprendre-le-racisme-quotidien-_r_22_i_1072.html
Notes
1. NdÉ. Madeline est ici le prénom fictif d'une connaissance proche qui existe réellement et dont j'ai toutefois modifié quelques caractérisations pour protéger l'anonymat. Cette situation ordinaire permet d'introduire le sujet de l'ouvrage ici donné à lire, mais aussi les effets très concrets de socialisation des femmes universitaires afrodescendantes, également objet du texte d'Essed.
2. Le territoire devient largement autonome en 1954, puis officiellement indépendant en 1975.
3. Pour en savoir plus sur le parcours biographique et intellectuel de l'autrice, voir Philomena Essed et Silyane Larcher, « Conversation avec Philomena Essed », Raisons politiques : revue de théorie politique, n° 89, février, 2023, p. 77-95.
4. Ce problème fut au cœur de la controverse qui opposa Gérard Noiriel, historien de l'immigration, et Éric Fassin, sociologue du genre, sur la pertinence du recours à la catégorie analytique de race et à l'usage de l'intersectionnalité dans la sociologie française. Voir Abdellali Hajjat et Silyane Larcher (dir.), « Intersectionnalité », Mouvements, 2019, https://mouvements.info/intersectionnalite/. Voir aussi Sarah Mazouz, Race, Paris, Anamosa, 2021.
5. Pour une analyse plus détaillée de cette réception on lira avec profit Evélia Mayenga, « Les traductions françaises de l'intersectionnalité : race, mondes académiques et profits intellectuels », Marronnages : les questions raciales au crible des sciences sociales, n° 2 (1), https://doi.org/10.5281/zenodo.10246750. Contre l'appauvrissement de l'intersectionnalité dans ses usages et circulations, voir, par Jennifer, Nash, une des figures montantes du féminisme noir étatsunien, Réinventer le féminisme noir : au-delà de l'intersectionnalité, Nantes, Aldéia, 2022. Voir également Jules Falquet, Imbrication : femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, Vulaines-sur-Seine, Le Croquant, 2019.
6. Voir Didier, Fassin, « Nommer, interpréter : le sens commun de la question raciale », dans Didier Fassin et Éric, Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, p. 35 ; François Dubet et col., Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations, Paris, Le Seuil, 2013, p. 11 ; Julien Talpin et col., L'épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires, Paris, Alpha, 2023, p. 29. Sur les microagressions, terme forgé en 1970 par un psychologue africain-américain, voir plus largement Derald Wing Sue, Microagressions in Everyday Life. Race, Gender and Sexual Orientation, New York, Wiley Press, 2010.
7. Un article récent souligne cette mésinterprétation de la recherche consistant à assimiler le « racisme quotidien » aux « micro-agressions », deux concepts pourtant distincts, les secondes ne constituant qu'une dimension du premier. Voir Dounia Bourabain et Pieter-Paul Verhaeghe, « Everyday Racism in Social Science Research. A Systematic Revie », Du Bois Review. Social Science Research on Race, n° 18-2, 2021, p. 221-250.
8. Chose que saisit très bien la sociologue africaine-américaine Trica Keaton dans un ouvrage récent, explicitement inspiré des travaux de Philomena Essed. Voir Trica Keaton, #You Know You're Black in France When : The Fact of Everyday Antiblackness, Cambridge, MIT Press, 2023.
9. Philomena Essed, Understanding Everyday Racism. An Interdisciplinary Theory, Newbury Park, Sage, 1991, p. 50.
10. Ibid., p. 147.
11. Ibid., p. 164.

Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme de Shlomo Sand

La création d'un État binational où Israéliens et Palestiniens seraient citoyens du même État a jadis été l'aspiration de nombreux intellectuels juifs critiques, de gauche comme de droite. Les prises de position en faveur du binationalisme, d'Ahad Haam dès la fin du xıxe siècle à Léon Magnes en passant par Hannah Arendt et beaucoup d'autres, pour qui le désir de créer un État juif exclusif sur une terre peuplée en majorité par des Arabes entraînerait un conflit violent et insoluble, se sont révélées tout à fait exactes. Avec l'arrivée aux affaires de l'extrême droite en Israël, les massacres perpétrés par le Hamas et les bombardements de la bande de Gaza, la question d'un État binational est devenue une urgence pour toute la région. Lui tourner le dos n'y changera rien.
Deux peuples pour un État ? Relire l'histoire du sionisme
par Shlomo Sand
Traduit par : Michel Bilis
Éd. du Seuil
Paru le 05/01/2024
Le binationalisme ne relève pas seulement du vœu pieux, mais aussi de la réalité présente : 7,5 millions d'Israéliens-juifs dominent, par une politique d'expulsion, de déplacement, de répression et d'enfermement, un peuple palestinien-arabe de 7,5 millions de personnes, dont une grande partie est privée de droits civiques et des libertés politiques élémentaires. Il est évident qu'une telle situation ne pourra pas durer éternellement.
Shlomo Sand est un historien israélien, professeur émérite à l'université de Tel-Aviv, et auteur de nombreux livres, dont certains ont suscité de vifs débats (Comment le peuple juif fut inventé, Fayard, 2008). Son dernier ouvrage au Seuil, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, a été publié en 2020.
Traduit de l'hébreu par Michel Bilis
___
Sommaire
Avant propos
1. « Terre des ancêtres » ou terre des indigènes
Le foyer ancestralÀ propos de la nationEthnocentrismeBinationalisme ?
2. « Un esclave qui vient à régner » : une question cachée
L'amant d'autres ?Centre spirituel ?Ignorer l'autre
3. Alliance pour la Paix contre « Muraille d'acier »
Les débuts de l'AllianceLa fraction « extrémiste »Hans Kohn et la fin de l'Alliance
4. Martin Buber, Hannah Arendt et le binationalisme
Du Volkisme à Je et TuVers l'idée binationaleHannah Arendt et l'antisémitismeUn État-nation juif ?
5. Théopolitique et l'association Ihoud
Un Américain pas tranquilleLe chancelier prophèteL'association IhoudLe dernier des Mohicans
6. La gauche et « La fraternité entre les peuples »
Le marxisme sionisteCommunistes en PalestineFin d'une idée
7. L'Action sémite et un État arabo-hébraïque
Le contexte « cananéen »Une gauche « sémite »La Charte hébraïque
8. 1967 : un pays à partager ou un pays à unifier ?
Trois pétitionsMenahem Begin contre l'apartheidLa détresse du sabra blancFissures à gaucheLa désillusion : suiteLa sensibilité s'aiguise
9. « On ne peut pas applaudir d'une seule main »
Curiosité et réconciliationL'idée nationale palestinienneÉtat démocratique unique ?Le paradigme binational
10. Conclusion. Apartheid, transfert ou État binational ?
La patrie s'élargit. Les nouveaux pionniers. Hégémonie sur le terrain. Stychie et catastrophe. L'option cachée. Alternatives imaginaires. Utopies et calamités.

L’État d’Israël contre les Juifs de Sylvain Cypel

Après le massacre commis par le Hamas près de Gaza le 7 octobre 2023, ayant causé la mort de 1 140 personnes, la guerre menée par Israël a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes chez les Palestiniens et déplacé par la force 80 % d'entre eux, suscitant des plaintes internationales pour crimes " de génocide " et " contre l'humanité ". Ce livre explique en quoi les agissements de l'armée israélienne sont l'aboutissement d'une longue maturation.
Imagine-t-on en France une loi qui établirait deux catégories de citoyens : par exemple, les " Français de souche " et les autres, qui ne bénéficieraient pas de droits égaux ? Une telle loi a été votée par le Parlement israélien en 2018, au bénéfice des seuls citoyens juifs. De par le monde, les dirigeants " illibéraux " plébiscitent désormais Israël, fascinés par sa capacité à imposer une idéologie " identitaire ", où xénophobie et islamophobie bénéficient d'un large soutien populaire. Avec quelles conséquences, pour les Palestiniens comme pour les Israéliens ?
En France, le CRIF, représentant du judaïsme et lobby pro-israélien, promeut un soutien sans faille aux actions des gouvernants d'Israël. Mais, aux États-Unis, des responsables juifs et plus encore la jeunesse juive dénoncent l'occupation indigne des Territoires palestiniens. Va-t-on vers un divorce irrémédiable entre Juifs israéliens, engoncés dans le tribalisme, et Juifs américains, qui redécouvrent les attraits de la diaspora ?
Sylvain Cypel a été directeur de la rédaction de Courrier international et rédacteur en chef au Monde. Il a couvert la seconde Intifada en 2001-2003 et a été correspondant du Monde aux États-Unis de 2007 à 2013.
Table des matières
Préface. Dahiya – " Le destin de notre génération "
La politique comme continuation de la guerre
Le point Godwin du débat
Le Hamas, la résistance et l'échec
Une société démembrée, une autre ensauvagée
" Génocide ", " crime contre l'humanité "... Les mots et les faits,
Biden, Macron et la faillite de l'" Occident "
Introduction
" Ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient en usant de plus de force "
La fascination pour Israël des nouveaux dirigeants identitaires
1. " L'imposition de la frayeur ". La réalité de l'occupation militaire
L'armée la plus morale du monde
L'enseignement du mépris
" L'épanouissement d'un Ku Klux Klan juif "
Israël, champion de la " guerre au terrorisme "
2. " Uriner dans la piscine du haut du plongeoir ". Ce qui a changé en Israël en cinquante ans
La fin du déni
L'affaire Azaria
L'impunité et la brutalisation de la société
L'" odeur du fascisme "
3. " Mais quel est ton sang ? ". L'État-nation du peuple juif
" Une loi mauvaise pour Israël et mauvaise pour le peuple juif "
Le triomphe de l'ethnocratie
" L'espace vital du peuple juif "
4. " Ils ne comprennent pas que ce pays appartient à l'homme blanc ". Une idée émergente : la pureté raciale
Haro sur les " infiltrés " noirs
Les liens avec les " suprémacistes " blancs
La quête du gène juif
5. " Localiser, pister, manipuler ". La cybersurveillance, nouvelle arme politico-commerciale d'Israël
La tradition des ventes d'armes
La cybersurveillance dernier cri
" Agir sous les radars "
Israël et l'affaire Khashoggi
Après les Palestiniens, la surveillance des Israéliens déviants
6. " L'État du Shin Bet est arrivé ". Quand le peuple plébiscite la " démocratie autoritaire "
Des Palestiniens, Israël étend ses filets aux Juifs mal-pensants
BTS, l'ennemi intérieur
BDS, la " menace stratégique "
L'État sécuritaire en action
7. " Une espèce en voie de disparition ". La société civile israélienne en souffrance
Qui a encore besoin d'une Cour suprême ?
Le désarroi de l'opposition citoyenne
8. Quand Hitler " ne voulait pas exterminer les Juifs ". Netanyahou, l'histoire " fke " et ses amis antisémites
Le mufti de Jérusalem instigateur de la Shoah ?
Le ciment de l'islamophobie
L'alliance avec le vieil antisémitisme d'Europe de l'Est
Le cas Soros : Trump est-il antisémite ?
9. " Il n'est pas nécessaire ni sain de se taire ". Crise au sein du judaïsme américain
Ces Juifs américains qui tournent le dos à Israël
Pourquoi ce tournant intervient-il aujourd'hui ?
Crise au parti démocrate
La contestation du statut d'Israël aux États-Unis
10. " Pas ça ! Vous ne me citez pas là-dessus... ". L'aveuglement des Juifs de France
De l'adhésion à la Révolution française au sionisme d'extrême droite
Le CRIF, organisme communautaire ou lobby pro-israélien ?
L'entre-soi ethnique et le poids de la couardise
11. " Je suis épuisé par Israël, ce pays lointain et étranger ". Schisme dans le judaïsme ?
" Quel Israël soutenez-vous, exactement ? "
" Là se situe la faiblesse qui nous fera choir "
" Renouveau diasporique " aux États-Unis
Vers une scission dans le judaïsme ?
12. La " relation spéciale " avec Israël, jusqu'à quand ?
L'affligeant legs de Donald Trump
Un État d'apartheid
Biden a-t-il une stratégie crédible ?
Conclusion. " Israël contre les Juifs ".
Tony Judt, in memoriam
Remerciements.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.















