Derniers articles
Deuxième édition du festival ARCHIPEL

C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Un trio législatif… accommodant pour l’industrie
Anne Pineau, membre du comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés Le lancement du robot conversationnel ChatGPT-4 au printemps 2023 a créé une véritable onde de choc, au point d’amener des experts et industriels du secteur de l’intelligence artificielle (IA) à réclamer une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants1. Comme si les experts n’avaient pas vu venir le train ; et comme si l’encadrement sécuritaire de tels outils pouvait se résoudre en 6 mois ! Le besoin pressant d’un cadre législatif solide en matière d’IA coule de source. Mal conçue ou mal utilisée, cette technologie peut être dommageable : hameçonnage, cyberharcèlement, discrimination, désinformation, manipulation, surveillance, atteinte à la vie privée et au droit d’auteur, impacts sur l’emploi et l’environnement, etc. Mais l’urgence ne saurait justifier l’adoption d’une loi au rabais.
La Charte du numérique
Depuis quatre ans, Ottawa tente de moderniser le régime fédéral de protection des renseignements personnels (RP) dans le secteur privé. Le projet de loi C-11, déposé en 2020, est mort au feuilleton en 2021. Il a été remplacé en juin 2022 par le C-27. Alors que C-11 ne concernait que les RP et la création d’un Tribunal des données, C-27 ajoute en catimini un troisième volet sur l’intelligence artificielle. C-27 vise donc l’édiction de trois lois : partie 1 : Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) ; partie 2 : Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (Loi sur le Tribunal) ; partie 3 : Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD). C’est le ministre de l’Industrie (Innovation, Science, ISDE) qui pilote le projet, ce qui en dit déjà long sur l’orientation donnée au dossier. Le C-27 est en examen devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) depuis septembre 2023. Plus de 100 mémoires ont été soumis2 plusieurs critiquant vivement l’ensemble de l’œuvre. Nous faisons un survol des principaux reproches formulés à l’endroit de ce projet de loi omnibus.1. LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES CONSOMMATEURS
La Loi fédérale qui encadre actuellement les renseignements personnels dans le secteur privé a été adoptée en 20003. Une modernisation tenant compte des avancées technologiques s’impose. C’est ce que tente de faire la LPVPC, la partie 1 de C-27. Notons que dans les provinces disposant d’une loi essentiellement semblable à la LPVPC, c’est la loi provinciale qui s’applique. Ainsi, la LPVPC n’aura pas d’application au Québec.Droit à la vie privée
La LPVPC vise, selon son titre, à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels utilisés dans le cadre d’activités commerciales. Son objet est défini à l’article 5 : dans un contexte où « une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels », la loi vient fixer des « règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte, à la fois, du droit fondamental4 à la vie privée des individus […] et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels […] ». On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir ! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus. Comme le souligne le Centre pour la défense de l’intérêt public dans son mémoire : « Les récentes modifications apportées par le ministre dans le but d’ajouter la vie privée comme droit fondamental au préambule et à l’objet du projet de loi sont inutiles, car rien d’autre dans le projet de loi et, plus largement dans le cadre juridique, ne protège la vie privée en tant que droit de la personne ».Sans consentement
En principe, le consentement est nécessaire pour recueillir, utiliser ou communiquer des RP. Mais en réalité le C-27 établit une multitude d’exceptions (art. 18 à 52). Certaines sont reprises de la loi actuelle. Mais plusieurs sont nouvelles. Il sera notamment possible de faire usage de RP à l’insu et sans le consentement de la personne concernée (voir encadré ci-dessous).| Exceptions prévues dans la Loi pour l’usage sans consentement des renseignements personnels :
• pour des activités d’affaires art. 18 (1) • en vue d’une activité dans laquelle l’organisation a un intérêt légitime qui l’emporte (selon elle !) sur tout effet négatif que la collecte ou l’utilisation peut avoir pour l’individu art. 18 (3) • à des fins de recherche, d’analyse et de développement internes, si les RP sont d’abord dépersonnalisés art. 21 • communication à des fins de statistiques ou d’étude ou de recherche lorsque le consentement est pratiquement impossible à obtenir art. 35 • entre organisations en vue de la détection d’une fraude art. 27 • à une institution gouvernementale pour une fin socialement bénéfique (si les RP sont d’abord dépersonnalisés) art. 39 • pour l’application de la loi art. 43 à 46 et 49 • à une institution gouvernementale (à sa demande ou de la propre initiative de l’organisation en cas de soupçons que les RP concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales) art. 47-48 |
On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus.Il sera aussi permis d’utiliser les RP sans contrainte en les anonymisant puisqu’ils se trouvent alors exclus de la loi. Or, on sait que l’anonymisation est un procédé faillible et qu’un risque de réidentification demeure toujours possible. De plus, même anonymisés, les RP sont porteurs d’informations qui devraient faire l’objet d’un contrôle, comme le constate Brenda McPhail : « Considérant que même l’anonymisation des renseignements personnels est inefficace contre les pratiques de tri social, qui sont à l’intersection de la vie privée et de l’égalité, toutes les données dérivées de renseignements personnels, qu’elles soient identifiables, non personnalisées ou anonymisées, devraient faire l’objet d’une surveillance proportionnelle par le commissaire à la vie privée6 ».
Système décisionnel automatisé
L’organisation qui utilise un système décisionnel automatisé (SDA) pour faire une recommandation ou prendre une décision ayant une incidence importante sur une personne doit, à sa demande, lui fournir une explication (renseignements utilisés, principaux facteurs ayant mené à la décision). Ce droit à l’explication est fort restreint. Le CPVP note que « le fait de limiter cette obligation aux décisions qui pourraient avoir une incidence importante ne permettrait pas d’assurer la transparence des algorithmes ». Qui plus est, la loi n’offre aucun recours : pas le droit de s’opposer à ce qu’une décision soit prise par SDA et aucun droit d’appel de la décision.Pouvoirs du CPVP
La loi accorde un nouveau pouvoir d’ordonnance au CPVP. Et les organisations pourraient écoper de fortes sanctions administratives en cas d’infraction à certaines dispositions de la loi. Malheureusement le commissaire ne peut que recommander et non imposer lui-même7 ces sanctions qui sont de la compétence du nouveau Tribunal des données.2. LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DES DONNÉES
Cette loi (partie 2 de C-27) instituerait un nouveau Tribunal, agissant en appel des conclusions et décisions du CPVP. Ce tribunal statuera aussi sur les recommandations de sanctions administratives du commissaire. Il se compose de trois à six membres choisis par le gouverneur en conseil (gouvernement) sur recommandation du ministre. Plusieurs groupes ont condamné la création de ce Tribunal qui ne fera qu’étirer les délais et saper l’autorité du CPVP. De l’avis du CPVP dans son mémoire sur C-27 : « La création du Tribunal ajoute donc un palier de contrôle supplémentaire dans le processus causant des délais et des coûts additionnels ». Le commissaire propose plutôt de limiter les recours à un contrôle judiciaire directement en Cour d’appel fédérale.3. LOI SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES DONNÉES
La LIAD (partie 3 de C-27) n’a fait l’objet d’aucune consultation avant son dépôt, sauf peut-être auprès de l’industrie et de certains experts. De très nombreux groupes, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), ont dénoncé ce fait et demandent le retrait de cette partie de C-27 jusqu’à la tenue de véritables consultations publiques8. On conteste également que le ministère de l’Industrie (ISDE) soit le principal voire l’unique rédacteur d’un projet de loi qui aura des impacts sur l’ensemble de la société.Exclusion du secteur public
La LIAD se limite au secteur privé ; elle ne s’applique pas aux institutions fédérales (ministères, organismes publics, sociétés d’État). Elle ne s’applique pas non plus à l’égard des produits, services ou activités relevant : a) du ministre de la Défense ; b) du SCRS ; c) du Centre de la sécurité des communications ; d) de toute autre personne désignée par règlement. L’exemption gouvernementale a été décriée par de nombreux intervenants, dont la LDL. L’utilisation de l’IA par les institutions fédérales et organismes de sécurité doit faire l’objet d’un encadrement légal assurant un contrôle indépendant et public.Objet de la loi
La LIAD vise l’établissement d’exigences canadiennes pour la conception, le développement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (SIA) ainsi que l’interdiction de certaines conduites relativement aux SIA qui peuvent causer un préjudice sérieux aux individus (physique ou psychologique, dommages aux biens, perte économique) ou un préjudice à leurs intérêts. La loi ne prend donc en compte que le préjudice personnel et non les graves préjudices collectifs que peuvent engendrer les SIA. Cela est fortement critiqué.Système d’IA à incidence élevée
La LIAD impose diverses obligations au responsable d’un système d’IA à incidence élevée (SIÉ), obligations qui peuvent varier selon qu’il gère ou rend disponible ce système : évaluation des effets négatifs potentiels, la prise de mesures pour évaluer et atténuer les risques, la mise en place d’une surveillance humaine, le signalement d’incidents graves, la publi- cation sur un site web de la description du SIÉ et la tenue de registres pertinents. Les amendements déposés en novembre dernier étendent ces obligations aux systèmes à usage général comme ChatGPT (voir l’encadré ci-dessous).| Ces amendements établissent en outre sept classes d’activités où l’utilisation de l’IA est considérée à incidence élevée : 1. décisions concernant l’emploi (recrutement, embauche, rémunération, etc.) ; 2. décision de fournir ou non un service à un particulier (ex. : prêt, assurance) ; 3. le traitement de données biométriques relativement à : a) l’identification d’une personne (sauf consentement) ou ; b) l’évaluation du comportement ou de l’état d’esprit d’une personne physique ; 4. la modération ou la priorisation de contenu sur les plateformes en ligne ; 5. les services de santé ou d’urgence ; 6. la prise de décision par les tribunaux ou les organismes administratifs ; 7. pour assister un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions liées au contrôle d’application de la loi. |
Mécanismes non indépendants
Le ministre de l’Industrie (ISDE), rédacteur de la LIAD, serait aussi chargé de sa règlementation, de sa surveillance et de son application. Le ministre pourra aussi désigner un cadre supérieur de son ministère au poste de Commissaire à l’IA. Le conflit d’intérêts est patent. Le ministre chargé de la promotion de l’industrie de l’IA ne saurait agir en toute indépendance dans l’application de la loi ; pas plus que son subordonné, le commissaire à l’IA. Cette faille a été signalée par de nombreux groupes, dont la LDL.Conclusion
Le projet de loi C-27 a de la suite dans les idées. En multipliant les exceptions au consentement, il facilite la circulation, l’accès, l’utilisation et la communication de renseignements personnels (qu’ils soient nominatifs, dépersonnalisés ou anonymisés). Ce qui ne manquera pas de servir l’industrie de l’IA, toujours avide de données. Ce secteur économique profitera en outre d’un encadrement législatif minimal, supervisé par un ministre gagné à sa cause. Cela dit, évidemment, si C-27 est adopté dans sa forme actuelle…- En ligne : https://futureoflife.org/open-letter/stoppons-les-experimentations-sur-les-ia-une-lettre-ouverte/
- Pour accéder aux différents mémoires cités dans ce Voir : https://www.noscommunes.ca/committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=12157763
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, C. 2000, ch. 5.
- Le mot fondamental a été ajouté par un amendement déposé à l’automne par le ministre. Voir : https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/INDU/WebDoc/WD12633023/12633023/MinisterOfInnovationScienceAndIndustry-2023-10-20-f.pdf
- En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/memoires-presentes-dans-le-cadre-de-consultations/sub_indu_c27_2304/
- Témoignage de Mme Brenda McPhail (directrice exécutive par intérim, maitresse de programme de politique publique dans la société numérique, McMaster University, à titre personnel) devant le comité INDU, le 26 octobre 2023. En ligne : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/fr/44-1/INDU/reunion-92/temoignages
- Sauf si violation d’un accord de conformité.
- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle
- En ligne : https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/441/ETHI/Reports/RP11948475/ethirp06/ethirp06-pdf
- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle/
L’article C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
La CIA, un instrument central de l’hégémonie américaine
Bali : les intérêts privés dominent au 10e Forum mondial de l’eau
Comprendre les dynamiques d’oppression dans un monde interconnecté
L’arnaque des fondations créées par Ottawa
RELÂCHE
Bientôt la conscription ?
Avant que le Québec ne fonde

Northvolt : Critique d’un mégaprojet industriel

Le réseau militant écologiste de Québec solidaire organise une rencontre citoyenne le 22 juin prochain à Montréal en compagne du député solidaire Haroun Bouazzi et d'invités de la société civile sur le projet Northvolt. Retrouvez-nous au à 14h au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet).
Cette activité fera la critique de la démarche suivie par le gouvernement de la CAQ pour réaliser ce projet et mettra de l'avant la position de Québec solidaire et celles des syndicats et des groupes écologistes impliqués dans les mobilisations actuelles.
Rencontre citoyenne - Northvolt, critique d'un mégaprojet industriel
Date et heure 22 juin 2024 14:00
MANIÈRES DE REJOINDRE ZOOM
1. Rejoindre ZOOM avec un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android
Rejoindre la réunion
Si le bouton ci-dessus ne fonctionne pas, collez cet élément dans votre navigateur :
https://quebecsolidaire-net.zoom.us/w/81192581439?tk=n7LEY_kttTAYL8CIy9WnUUwxkzbIVW7LkxIVhGhGNrg.DQYAAAAS53R5PxZhekVmZjdsdFR6U3dsck1NejFuNnFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Conférence sur Haïti à New York : intervention vs révolution ?
Une gauche unie pour s’opposer à l’extrême droite
Le vent, une ressource (in)finie ?
L’échange inégal fait souffrir les pays à faibles revenus

Déclaration du CISO sur la liberté d’expression en solidarité avec la Palestine

Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et ses membres saluent l'engagement des étudiant.e.s se mobilisant dans les campus universitaire afin de demander la fin du génocide envers les Palestiniennes et Palestiniens et le désinvestissement d'industries israéliennes complices des graves violations des droits humains, du droit international humanitaire et de crimes contre l'humanité à Gaza.
Leur mobilisation contribue non seulement à rehausser la pression en faveur du respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, mais aussi, à défendre le respect du système de droit international, fragilisé par les actions d'Israël et la complaisance de nombreux États, dont le Canada.
Le CISO, à l'instar de la Ligue des droits et libertés du Québec, rappelle aux forces policières et aux dirigeant.e.s universitaires « que toutes les mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des manifestant.e.s, de même que pour respecter et protéger le droit de manifester. Il s'agit d'un droit reconnu par les Chartes québécoise et canadienne, et non un simple privilège dépendant du bon vouloir des autorités ou bien, de certaines personnes ou organisations ».
Dans un contexte :
– où se déroule présentement, de l'avis de nombreux expert.e.s des droits humains, dont à l'ONU, un génocide en Palestine ;
– où, malgré les multiples mises en garde d'organisations internationales, de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, Israël bombarde des écoles et des camps de réfugié.e.s qui n'ont nulle part où aller et qui souffent de la faim à Rafah et ailleurs ;
– où des demandes d'injonction ont été déposées contre les campements universitaires, et
– où la répression policière semble imminente ;
La participation à des manifestations et la liberté d'expression sont des droits fondamentaux dans une société démocratique, c'est pourquoi le mouvement syndical considère qu'ils doivent absolument être défendus. Ce sont quelques-uns des outils les plus puissants dont nous disposons pour défendre nos droits et nous les défendrons partout où les gens demandent justice.
Le CISO et ses membres réaffirment leur attachement envers ces droits, ils rappellent que ces occupations en milieu universitaire visent à dénoncer une situation d'une extrême gravité. En conséquence, ils demandent de ne pas judiciariser ces actions militantes, ni de réprimer ces mouvements solidaires par des interventions policières, que ce soit à l'Université McGill, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval ou ailleurs au Québec ou au Canada.
Le CISO rappelle que les dénonciations des actions illégales d'Israël ne constituent pas des actes antisémites, mais bien des actions légitimes de solidarité internationale avec le peuple palestinien.
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Si vous êtes membre du CISO et que vous voulez co-signer cette lettre, vous pouvez envoyer un courriel au ciso@ciso.qc.ca.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : Aller de l’avant, en toute transparence

À la suite de l'annonce du gouvernement Legault donnant le feu vert au projet Northvolt pour aller de l'avant avec la construction des premiers bâtiments de sa méga-usine de cellules de batteries en Montérégie, nous, Mères au front – Rive-Sud, avons choisi de faire une mise à jour concernant notre positionnement tant sur nos demandes à Northvolt qu'à nos gouvernements devant les prochaines étapes annoncées.
Les impacts directs et indirects ne sont plus à démontrer, et pourtant, il nous faudra demeurer vigilantes et vigilants.
Nous tenons à rappeler que notre demande d'un examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pour ce qui s'inscrivait comme étant le projet industriel le plus important de l'histoire récente du Québec a non seulement été refusée, mais son rejet a été accompagné d'explications très discutables et non satisfaisantes aux yeux de la population, des organisations impliquées et des journalistes, qui se sont fait un devoir de donner l'heure juste.
Nous avons soulevé des questions sur la qualité de l'eau, de l'air ; sur les aspects écologiques et économiques du projet ; à propos de l'impact sur les écoles, les CPE, la circulation routière dans le secteur touché, et plus encore.
Des préoccupations pour la rivière Richelieu
La qualité de l'eau du Richelieu nous préoccupe particulièrement, puisque le terrain est fortement contaminé par endroits. Avec le déboisement et les travaux de construction, il y a des risques que ces éléments se retrouvent dans la rivière. De plus, les sédiments contaminés au fond de la rivière sont à risque d'être soulevés par les grandes quantités d'eau utilisées puis rejetées par Northvolt, libérant ainsi lesdits contaminants.
Sans compter les rejets d'eau potentiellement pollués par les processus de transformation, qui se retrouveront dans la rivière, sans avoir été testés dans leur intégralité par les usines d'épuration des eaux.
Entre mensonges et demi-vérités, ou simplement le néant du silence, nos questions sont demeurées, pour la plupart, dans les limbes des dédales administratifs et bureaucratiques du gouvernement et dans le secret des dieux des dirigeants de Northvolt.
Se positionner aujourd'hui, pour la suite
Voilà pourquoi nous nous positionnons haut et fort contre la manière dont le projet Northvolt a été mené jusqu'à maintenant – tant par l'entreprise que par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Nous, à l'instar de plusieurs groupes et comités citoyens de la région et d'ailleurs au Québec, exigeons d'une même voix que cette façon de mener les projets cesse immédiatement.
Considérant que nous n'avons toujours pas pu nous prononcer en faveur du projet Northvolt en raison des manquements énumérés précédemment, nous aimerions en revanche insister sur le fait que nous sommes pour :
– que les gouvernements et l'usine s'assurent que la qualité de l'air et de l'eau ne soit pas compromise par le projet Northvolt ;
– que les gouvernements et l'usine s'engagent à préserver la biodiversité restante sur le site en plus de compenser réellement celle perdue dans le processus.
Pour atteindre ces deux objectifs et rebâtir la confiance de la population envers nos décideurs et l'entreprise elle-même, nous demandons aux gouvernements et à Northvolt de changer d'approche et d'attitude en regard à la population dans tout ce qui suivra dans le déploiement du projet Northvolt. Nous demandons :
1- Un respect sans restriction et sans dérogation des normes et des règlements existants sur la qualité de l'air et de l'eau.
2- La création de normes et de règlements rigoureux pour les substances impliquées dans les processus de Northvolt, qui ne font l'objet d'aucune réglementation à l'heure actuelle.
3- Un programme de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau développé conjointement par Northvolt, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et des experts externes, et dont les résultats seront rendus publics de manière régulière, transparente et sans délai.
4- La communication des mesures de compensation prévues par Northvolt, ainsi qu'un suivi serré des investissements prévus, des échéanciers et des retombées attendues et réelles.
5- Une participation de citoyennes, citoyens, expertes et experts dans le processus d'autorisation en cours pour les usines de cathode et de cellules, en amont des décisions.
Bref, nous leur demandons d'être transparents, ouverts aux avis externes, et de considérer véritablement les impacts irréversibles sur la biodiversité, l'air et les cours d'eau.
Nous avons toujours considéré nos demandes comme légitimes et fondamentales. Bien qu'elles aient été rejetées par le passé, nous souhaitons vivement que ces exigences ajustées soient sincèrement prises en compte et mises en œuvre, au bénéfice de la population et des générations futures.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Presse-toi à gauche prend une pause estivale

Vous lisez présentement la dernière édition de PTAG avant la pause estivale. Nous serons de retour le 20 août. D'ici là nous ferons la mise à jour régulière de la section des communiqués. Il est également possible que, compte tenu de l'importance de ces événements, nous placions un article couvrant ces sujets d'intérêt : la situation en France avec le déclenchement des législatives et la mise sur pied du Nouveau Front Populaire et le génocide qui se poursuit à Gaza. Nous vous souhaitons un été rempli de belles rencontres, de lectures passionnantes et de réflexions constructives. Refaire le plein pour de nouvelles mobilisations à l'automne est une bonne façon de passer les prochaines semaines. Préparer la rentrée, les débats dans QS, les mobilisations contre les féminicides, la lutte contre les changements climatiques,... L'agenda sera bien rempli. D'ici là, bon été.

La coalition Non au troisième lien réagit à la « résurrection » du 3e lien autoroutier

La coalition nationale Non au troisième lien se désole des engagements du premier ministre concernant l'idée de relancer, planifier et construire le projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.
« Il est décevant qu'une grande annonce comme celle du tramway soit assombrie par l'entêtement du gouvernement à maintenir en vie son projet de troisième lien autoroutier, et ce, malgré les nombreux avis défavorables des expert(e)s qui s'accumulent depuis des années, dont celui de la CDPQ Infra », affirment les membres de la coalition.
Les membres rappellent également qu'il est complètement irresponsable de s'engager à construire un troisième lien autoroutier alors qu'il n'y a encore aucune étude sur la table nous permettant de connaître tous les tenants et aboutissants du projet.
Par ailleurs, le rapport de la CDPQ Infra démontre clairement qu'un 3e lien risque d'augmenter la congestion dans la ville de Québec et qu'aucun des scénarios envisagés ne répondait aux besoins de mobilité dans la région.
À ce stade, ramener le 3e lien sur la table à dessin ne fait qu'ajouter plus de cynisme face aux décisions politiques, en plus d'engager des dépenses inutiles.
La mobilisation nationale Non au troisième lien a été initiée en mai 2021 par Accès transports viables, le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Trajectoire Québec et Vivre en Ville.
Toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que les organisations désirant dénoncer ce projet autoroutier peuvent signer la pétition, désormais rendue à plus de 50 000 signataires, sur le site nonautroisiemelien.quebec <https://www.nonautroisiemelien.quebec/> .
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pierre Poilievre ami de la classe ouvrière ?

Le leader conservateur recherche l'appui des travailleurs.euses aux dépends des Libéraux et du NPD. À moins de 18 mois des prochaines élections fédérales, le leader du parti conservateur se tourne et se retourne pour augmenter sa base et s'assurer d'une forte majorité de gouvernement. Plusieurs pensent qu'il réussira.
Paul Moist, Canadian Dimension 11 juin 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Il est clair que les Conservateurs.trices ont considérablement amélioré leurs atouts après la pauvre performance des chefs précédents, Andrew Sheer et Erin O'Toole.
Il faut dire que P. Poilievre est un très bon communicateur, capable de maintenir son message. Son parti a 20 points d'avance sur les Libéraux. Rien de ce qu'ils peuvent dire ne se reflète dans les sondages. Il pousse le parti libéral et le N.P.D. vers le bas et Maxime Bernier a complètement disparu.
Il a non seulement maintenu la base conservatrice de Stephen Harper dans le parti mais il s'est tourné vers la classe ouvrière et y a fait des progrès aux dépends des deux autres partis.
En avril dernier, Ginny Roth écrivait à ce sujet dans The Hub : « plusieurs de ceux et celles qui constituaient traditionnellement la base du N.P.D., donc membres des syndicats ouvriers, se tournent vers le chef conservateur ».
Dans un article dans Canada's National Observer, Max Fawcett fait remarquer que les supporters libéraux qui quittent le parti ne se tournent pas vers le N.P.D. Les données publiées par Abacus démontrent que « 10% de ceux et celles qui ont voté pour le N.P.D. en 2021, soutiennent maintenant P. Poilievre et le P.C.C.
M. Fawcett cite également un sondage Angus Reed qui révèle que « plus d'un tiers, (36%) des électeurs.trices du N.P.D. disent qu'il leur serait possible de se tourner vers le parti Libéral ».
On pourrait s'acharner à disséquer le parcours parlementaire de P. Poilievre pour conclure qu'il n'offre rien aux travailleurs.euses et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais ça n'expliquerait en rien sa stratégie populiste actuelle, les raisons pour lesquelles il semble avoir autant de succès comme ses semblables dans la récente élection européenne.
Il s'est saisi de certaines plaintes de la population canadienne : les revenus stagnants, le coût de l'alimentation qui ne cesse de monter et l'accès impossible à la propriété.
Bien sûr, 18 mois c'est une éternité en politique spécialement en période d'incertitude économique et politique mondiales. Mais, il est de plus en plus clair que les Conservateurs.trices sont susceptibles d'avoir une majorité parlementaire. Si ce succès s'avérait, il s'expliquerait par divers facteurs dont l'habileté de P. Poilievre à s'emparer des frustrations de la classe ouvrière. D'une certaine façon, il est la réponse en lui- même. Il est habile avec les médias sociaux et il a admis que la population est en peine partout dans le pays. L'inflation frappe à l'épicerie, le prix du loyer et des hypothèques. Les salaires augmentent mais pas au niveau de l'inflation de l'an passé ni à celui des pertes réelles qui se sont accumulées depuis deux décennies.
Les taux d'intérêt sont toujours élevés comparativement à ce qu'ils étaient antérieurement. 60% des hypothèques arrivent à échéance au pays. Elles avaient été contractées avant la hausse des taux. Donc, chaque jour, les Canadiens.nes prennent conscience de la détérioration de leur situation par rapport à ce quelle était en 2021 lorsque les Libéraux de J. Trudeau ont obtenu un 3ième mandat, un 2ième minoritaire.
Laissons de côté P. Poilievre pour le moment. Il y a toujours d'autres forces qui ont une influence pour expliquer que les Conservateurs aient 20 points d'avance aujourd'hui (dans les sondages). D'abord et avant tout, il y a le fait que Justin Trudeau soit hors- jeu aux yeux de l'électorat. Beaucoup ne le croient plus. La plupart pense qu'il a fait son temps. Il semble bien qu'il demeurera le leader du parti. Ce qui est moins évident, c'est ce qui se produira avec un caucus réduit après la prochaine élection qui devrait arriver en octobre 2025 ou plus tard.
Mais le plus étonnant est que ces pertes chez les libéraux se portent presque exclusivement chez les Conservateurs. On aurait pu penser que le N.P.D puisse en profiter lui qui recherche ses appuis dans les mêmes talles que les Libéraux, qu'il aurait donc pu bénéficier de leur déclin. Tel n'est pas le cas.
Un sondage publié fin mai 2024 montre que le N.P.D. se situe à 17% des intentions de vote soit un de moins que lors de la décevante élection de 2021. Il semble bien qu'il paye un lourd tribut pour s'être accroché aux Libéraux avec l'entente apport et confiance de 2022.
C'était pourtant habile. Personne ne voulait d'une 3ième élection en 30 mois et il se plaçait, avec 25 députés.es, dans une position pour exercer son influence bien au-delà de son nombre de sièges. D'ailleurs il a réussi à faire adopter des lois qui sont d'importance en matière de politiques sociales : les frais de garde des enfants à 10$ par jour, le plan de soins dentaires pour les familles à faibles revenus et pour deux millions de personnes âgées en plus de préparer un programme d'assurance médicaments.
Cette majorité libérale et néo-démocrate a fait adopter à l'unanimité, une loi anti briseurs de grève qui s'appliquera dans les entreprises et agences fédérales.
Ces accomplissements d'une certaine importance coûtent cher au N.P.D. Dans les grandes villes les listes d'attente pour les places de garderies à 10$/jour sont longues ce qui hypothèque les bénéfices politiques pour le N.P.D. La plupart des travailleurs.euse ont déjà une assurance dentaire liée à leur travail. Ce qui ne veut pas dire que ces succès ne soient pas significatifs mais ils ne rendent pas les fruits politiques attendus.
On peut se demander pourquoi le N.P.D. persiste à honorer son entente avec les Libéraux qui permet à P. Poilievre de parler du « gouvernement libéral-néo démocrate ». Selon un néo démocrate de longue date, qui soutient le lien entre le parti et les travailleurs.euses qui ont aidé à le créer : « qu'il ne soit pas encore sorti de cette entente est à la fois surprenant et décevant pour plusieurs y compris l'auteur de ces lignes ».
Les Canadiens.nes font face à une crise du coût de la vie. L'augmentation des prix de l'alimentation et des loyers a mis les familles ouvrières à la marge de l'économie et elles ne font plus confiance la J. Trudeau pour aller de l'avant. Le profil du leader néo démocrate est faible et il est parfois réduit au rôle de figurant dans les conférences de presse quand on lui demande comment il voterait au parlement.
Plus l'alliance avec les Libéraux se prolonge plus le N.P.D. ne représente plus une option valide pour les Canadiens.nes. Il se peut que la situation de 1993 se répète : le gouvernement progressiste conservateur a été pour ainsi dire éliminé réduit à deux sièges et le N.P.D. n'en a eu que neuf. À l'époque il avait un leader peu connu et lors de cette élection de changement, il a payé un lourd tribut.
Ce fut très différent en 1984 quand les Conservateurs. trices de Brian Mulroney ont gagné 211 sièges. Les Libéraux ont été assommés mais les néo démocrates avec un chef crédible, Ed. Broadbent, ont recueilli 20% des votes et gardé leurs 31 sièges.
Si l'élection se tenait aujourd'hui, si les Conservateurs.trices se retrouvaient au-delà de la majorité absolue, il est plus que probable que le N.P.D. se retrouverait avec moins que les 25 sièges qu'il a gagnés en 2021. Difficile de croire qu'il y a moins d'une décennie il formait l'opposition officielle à Ottawa.
Les gouvernements perdent leurs élections plus souvent qu'ils ne les gagnent. En ce moment, P. Poilievre profite de ce que le gouvernement libéral soit fatigué et ne produise pas grand-chose Nonobstant le fait que les libéraux aient gouverné le pays pendant la majeure partie de l'histoire canadienne, ils ont été envoyés au banc des punitions pour une ou deux périodes électorales régulièrement. C'est le cas en ce moment. Ça ne devrait surprendre personne.
Ce qui est surprenant c'est que les sociaux-démocrates et leur option ne soient pas en progression alors qu'il est si important que les services universels dispensés aux citoyen.nes de ce pays soient protégés. Le N.P.D. doit prendre la place pour laquelle P. Poilievre se bat en appelant au renvoie du Gouverneur de la Banque du Canada parce qu'il aurait désavantagé les familles ouvrières en combattant l'inflation pour ainsi dire à tout prix.
Mais, les Conservateurs.trices n'offrent rien aux familles ouvrières. Leur discours se limite à dire à la population dans quelle mauvaise situation elle se trouve, ce qui est vrai par ailleurs. Je m'attends à ce qu'en 2025, la participation au vote continue à diminuer. Cela aussi va être un avantage pour le parti conservateur et va s'ajouter à celle de leur solide base et à celle venant d'autres allégeances.
Il reste du temps pour donner une jambette aux Conservateurs.trices à condition de poser des gestes allant dans le bon sens, dont :
|- Donner son plein appui au congrès du Syndicat canadien du travail et de s'y affilier pour mener une campagne d'information vers les 3 millions et demis de ménages syndiqués sur le véritable dossier politique de P. Poilievre. En 20 ans de carrière parlementaire il s'est constamment opposé à toutes les réformes en faveur des travailleurs.euses. Les syndicats ne peuvent se contenter de soutenir la campagne qu'en la finançant. Ils doivent s'impliquer, encourager tous les affiliés à rejoindre leurs membres grâce à des membres liaison, à des plans d'intervention sur les lieux de travail et en exposant les positions des conservateurs.trices.
|- Le caucus fédéral du N.P.D. doit révoquer l'entente avec le gouvernement libéral immédiatement. Il s'agit de déclencher une élection dès maintenant qui offrirait au N.P.D. l'occasion de se présenter comme la seule force militant pour des changements positifs pour les familles ouvrières.
|- Le dernier défi est de pouvoir présenter en 2025, aux électeurs.trices , une plateforme solide et progressiste qui aille au cœur de ces familles et atteigne leurs sentiments du moment. Il faut confronter les deux autres partis à leurs politiques et en présenter qui s'accordent à ce que la population attend et mérite de la part d'un pays social-démocrate. Il est fondamental que le N.P.D. offre un tel leadership pour travailler à un Canada prospère et socialement juste pour la totalité de ses citoyens.nes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Northvolt Critique d’un mégaprojet industriel : entre écoblanchiment et extractivisme

Nous publions ici un texte du Réseau Militant Écologiste de Québec solidaire sur la filière batterie. Cette analyse sera présentée dans une rencontre publique du RMÉ le 22 juin prochain.
Le Réseau militant écologiste de Québec solidaire (QSRMÉ) rassemble les membres qui militent dans les groupes écologistes ou qui souhaitent participer aux luttes actuelles et à venir.
Le Réseau diffuse le programme du parti par des rencontrespubliques, des interventions médiatiques et des publications. Également, il aspire à créer des liens forts avec tous les groupes écologistes dans une perspective de changements profonds dans les rapports économiques, environnementaux et sociaux et, à terme, pour une sortie du capitalisme.
1. Introduction
Ce document analyse l'installation de l'usine de fabrication de batteries de Northvolt au Québec. Il met en évidence la politique utilisée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour faciliter la réalisation de ce projet sans considération de ses
risques sociaux, environnementaux et financiers.
L'analyse discutera d'abord du contexte énergétique québécois et examinera l'écoblanchiment employé par ce gouvernement et l'entreprise pour masquer l'extractivisme minier qui sous-tend ce projet. Le texte se termine par un résumé des revendications de Québec solidaire (QS) concernant cet enjeu et un bref rappel de son programme.
2. Le contexte
Le développement de la filière batterie et la hauteur des subventions pour en favoriser la croissance sont l'expression d'un nouveau modèle économique pour le Canada et le Québec reposant sur le renforcement des liens de dépendance avec l'économie américaine et internationale. Ce modèle ne répond en rien à l'urgence de la crise climatique et environnementale. Il va directement à l'encontre d'une lutte conséquente contre ces dernières. En effet, la filière batterie est avant tout une pérennisation de la société capitaliste actuelle et une « solution » technocentrique des crises climatique, écologique et de leurs conséquences.
Manipulateur, le gouvernement de la CAQ est dans une démarche de prophétie autoréalisatrice : il crée une demande gigantesque d'électricité en favorisant l'installation, par des multinationales, de grands projets de productions énergétiques. [1]Ces projets répondent plus au besoin croissant de profit de ces firmes qu'à une augmentation réelle de la consommation énergétique. Ainsi, « Hydro-Québec calcule qu'il faudra 150 à 200 TWh additionnels pour répondre à la demande d'électricité du Québec à l'horizon 2050 » [2]. Ce qui représente deux fois plus QS-RMÉ – Northvolt – Critique d'un mégaprojet industriel – Juin 2022 d'électricité que celle produite actuellement et ne tient aucune considération de sobriété. Après les 940 MW réservés pour 11 entreprises, dont Northvolt en novembre 2023, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, prévoit allouer 600 à 700 MW supplémentaires [3] . Pour y parvenir, la société d'État entend notamment « ajouter de la capacité de production hydroélectrique ». Cela se fera en augmentant « la puissance de centrales existantes ainsi qu'en en créant de nouvelles ». Le ministre poursuivra la privatisation d'Hydro-Québec en ouvrant la production de l'électricité et sa distribution au libre marché : chaque appel d'offres est le fruit d'un décret ministériel qui identifie certains types de production énergétique et les volumes associés. L'éolien a contribué pour 77 % de l'énergie postpatrimoniale au Québec en 2023 (postpatrimoniale signifie d'origine privée et dépassant un quota public arbitraire dit patrimonial de 165 TWh au prix de vente de 2,79 ¢/kWh déterminé par décret en 2001 en préparation de la privatisation d'HydroQuébec) [4] . À coups d'appels d'offre, Fitzgibbon projette de quadrupler la production actuelle de 4 TW des 40 parcs éoliens d'ici 15 ans. [5]
D'ailleurs, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a été contourné par la CAQ pour que Northvolt s'installe au Québec [6] . En février 2023, sachant que Northvolt allait produire 56 000 tonnes de cathodes, le gouvernement de la CAQ a haussé le plafond pour déclencher une étude du BAPE à 60 000 tonnes.
L'exigence de la tenue d'un BAPE [7] a été au centre d'intenses protestations populaires qui exigent un processus de décision démocratique et transparent dans les questions de protection de l'environnement, de santé publique et contre l'accaparement des biens publics par le privé.
3. Un modèle économique extractiviste et son écoblanchiment
Les données scientifiques du GIEC ne peuvent être plus claires : la décarbonation - toute forme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la sobriété [8] sont les bases pour répondre à l'urgence climatique et environnementale. En ce qui concerne les véhicules électriques et leurs batteries, il est évident que le tout à l'auto électrique est un modèle incompatible avec une gestion écologique des ressources minières locales et mondiales et de l'énergie renouvelable [9] .
Cette évidence semble avoir complètement disparu du radar de la CAQ.
L'usine de Northvolt produira des batteries composées notamment de nickel, de manganèse, de cobalt et de lithium. Ce projet nous est présenté comme étant une réponse à l'urgence climatique ; un développement technologique pour la transition énergétique à haute valeur ajoutée pour le Québec. Le gouvernement de la CAQ prétend que les retombées positives de ce projet pour le Québec seront l'accélération de la décarbonation et l'électrification de l'Amérique du Nord [10] ! En fait, l'implantation d'une méga usine de fabrication de batteries et des projets extractivistes très dépendants des énergies fossiles, remettent en question la décarbonation propre que met de l'avant la CAQ. Le développement de la filière batterie ne prend pas en considération une planification de la mobilité durable et omet le questionnement nécessaire de la rationalité de l'automobile comme moyen de transport préférentiel. Le gouvernement de la CAQ joue sur la vision d'un « développement durable » qui ne tient pas compte de la réalité des flux physiques d'énergie et de matériaux et ni du fait que la croissance infinie est impossible dans un monde fini.
De plus, ce gouvernement prétend que les batteries de Northvolt seront vertueuses car elles sont les plus vertes [11] et produites par les mines les plus propres du monde avec l'énergie hydroélectrique du Québec ! Or, les mines propres n'existent pas et l'implantation de l'usine ne réduira pas les émissions des gaz à effet de serre au Québec et accaparera une portion non négligeable de l'électricité produite par Hydro-Québec [12]. En réalité, ce gouvernement met ainsi de l'avant un plan économique qui n'est qu'une partie d'un réseau mondial d'entreprises [13] dont juste quelques-unes seront québécoises. Même si la CAQ met de l'avant le potentiel minier du pays, il n'existe aucune transparence au sujet de la provenance des minerais et des quantités qui seront utilisées par l'usine en question puisque Northvolt se cache derrière des secrets industriels [14]. Il n'y aura pas plus de transparence au sujet de la destination finale, certainement internationale, de ses produits. Il est à remarquer que les industries de l'auto en Ontario comme Ford, GM, Volkswagen Stellantis et Honda, comptent dans leurs filières leurs propres usines de fabrication de batteries et pourraient ne pas avoir besoin de la production de Northvolt.
Force est d'admettre que le Québec n'est qu'un satellite dans le grand ensemble des fabricants de pièces pour véhicules électriques.
En conclusion, la CAQ défend une politique croissantiste et use de tactiques d'écoblanchiment en prétendant l'existence de retombées positives sur le climat par la réduction des émissions de GES alors que dans les faits ses processus décisionnels sont orientés vers le profit, basés sur une croissance soi-disant « verte » et sans réelles considérations pour l'environnement.
4. La filière batterie et ses conséquences pour le Québec
Depuis octobre 2018 le gouvernement de la CAQ a développé le concept de « zones d'innovation », avec « de l'instinct [15] »…
Le développement de Northvolt est un cas représentatif de la filière batterie tout entière et le questionnement sur le bien-fondé de cette usine doit s'appliquer à l'ensemble de cette filière. En effet, l'installation de Northvolt est subventionnée avec profusion par des dollars publics. Alors même que cette implantation a des retombées environnementales désastreuses et met en péril, par exemple, les ressources en eau des populations riveraines. Il en va de même pour l'ensemble de la filière. Ceci inclut d'autres sites industriels, l'exploration et l'exploitation des mines mais aussi les aménagements d'infrastructures payées par le public, comme des routes, qui permettront le développement de la filière. En date du 12 mars 2024, le gouvernement de la CAQ reconnaît qu'à elles seules, les onze entreprises de la filière batterie totalisent plus que 3,29 milliards de dollars du trésor public québécois. On peut émettre l'hypothèse que des sommes aussi colossales feront passer le profit avant la nature et avant la population québécoise [16] !
On peut résumer ainsi les conséquences de la situation : des investissement risqués, des prêts ou des prêts pardonnables et des garanties de prêts transférés à des multinationales privées, ce qui impose des budgets austéritaires pour les services publics, les infrastructures publiques, la lutte et l'adaptation aux changements climatiques alors que le gouvernement de la CAQ prévoit 8,8 milliards de dollars de déficit pour l'exercice 2024-25 [17]. De plus, le contexte légal favorable et l'activité des lobbys donnent l'occasion aux multinationales de polluer et de détruire des milieux naturels et des milieux de vie. Selon une évaluation récente, la restauration des sites miniers coûte plus de 1,2 milliards de dollars au trésor public. [18]
L'usine de Northvolt à elle seule bénéficie d'un soutien de 7,3 milliards de fonds publics fédéraux et du Québec. Pour le Québec ce sont 1,37 milliards pour la construction, puis de 1,5 milliards pour la production des batteries à partir de 2032 [19].
Plus largement, selon Investissement Québec [20], 5,9 milliards de dollars, soit 54% de la valeur totale des projets seront investis par Québec dans les principaux programmes de la filière batterie.
Dans le contexte mondial compétitif, rien ne permet d'exclure que les largesses pour Northvolt ne se font pas en pure perte. [21]
La population québécoise connaît bien les effets du laxisme des gouvernements successifs en matière de protection environnementale. Les cas de la fonderie Horne à Rouyn Noranda, l'aluminerie Rio Tinto au Saguenay ou le port de Québec font craindre que la filière batterie bénéficiera du même traitement complaisant.
En soustrayant le projet de Northvolt à un examen du BAPE, l'enfumage du gouvernement de la CAQ met en évidence que dans le livre néolibéral, les considérations économiques, même risquées, priment sur l'environnement, la lutte au changement climatique, le soutien aux services publics et à toute fin utile au bien-être de la population québécoise. L'autorisation pour la construction de l'usine Northvolt ne tient pas compte de l'étude précédente du BAPE qui s'opposait à la construction d'un ensemble immobilier dans ce même milieu humide abritant des espèces en péril. Ironiquement, l'usine de Northvolt ne respecte pas 5 des 23 cibles de l'entente des parties de la COP15 signée à Montréal en 2022. [22]
De plus, en date du 21 mars 2024, Northvolt propose d'utiliser des sols toxiques [23] pour remblayer ces milieux humides. Les risques de rejets toxiques dans la rivière Richelieu liés à l'imperméabilisation des sols lors la construction de l'usine, les futurs rejets toxiques dans l'air et dans l'eau de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, où Northvolt installe son usine, n'ont pas été évalués par le ministère de l'Environnement.
Cette approche permissive du gouvernement de la CAQ est absurde face à la multiplication de l'implantation des industries de la filière. Il faut baisser les seuils admissibles plutôt que de les augmenter pour tenir en compte des impacts négatifs potentiellement synergiques des diverses installations industrielles [24] : Northvolt et Lithion Technologies se concentrent à Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et Saint-Bruno de Montarville. General Motors, Ford, Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite et le futur développement de Vale se concentrent à Bécancour. Il n'existe pas d'évaluation environnementale globale des retombées dangereuses de la filière batterie au Québec.
La CAQ étend sa volonté de privatisation et son indifférence pour l'environnement à l'ensemble de son plan d'électrification du secteur énergétique québécois. Ce serait une erreur de penser que la situation de Northvolt est isolée. Les installations liées à la filière batterie sont multiples et s'insèrent dans des processus d'extraction, de purification des métaux, de transport et de fabrication des composantes et des batteries qui utilisent des quantités faramineuses d'énergies fossiles, d'eau et de réactifs chimiques. Y sont associés les rejets de gaz à effet de serre, la pollution chimique et thermique des cours d'eau, la pollution des aquifères ainsi que les émanations gazeuses. Au Québec, les mines sont les plus grandes utilisatrices d'eau après les papetières. [25] Des mines jusqu'aux batteries, chaque maillon de la chaîne de production nécessite des volumes d'eau immenses avec les risques afférents de pollution lorsqu'elle est rejetée dans la nature. Les mines produisent des quantités ingérables de déchets de roches et de boues et il n'existe pas de processus de purification et de concentration des métaux qui soit propre et sans effluents liquides et gazeux. [26]
L'impact de l'exploitation des mines exige une refonte de la Loi sur les mines. Il n'existe pas de mine propre, ceci d'autant plus que cette loi n'a guère évolué depuis 150 ans. [27]
Pour ajouter l'insulte à l'injure, les « claims » miniers (titres miniers), couverts par cette même loi, mettent en danger les terres agricoles, les villes, les villages, les collectivités autochtones situées à proximité des filons et toutes les agglomérations qui subiraient, aussi à distance, les émissions polluantes produites par l'industrie minière.
Les projets d'exploitation minière grugent les terres agricoles et cela ne fait que commencer à cause de la recherche des minerais stratégiques, particulièrement du graphite dans le sud du Québec. La Commission de protection du territoire agricole du Québec a accordé aux minières 100 % des demandes d'exploration en milieu agricole et a autorisé 97 % des projets d'infrastructures liés au transport et à la production d'électricité ainsi que 99 % des demandes d'implantation des parcs éoliens sur les terres agricoles. [28]
5. Le constat
Par son implantation tentaculaire au travers de la géographie québécoise, le développement de la filière batterie et de ses mines se fait au détriment des populations locales, des droits des peuples autochtones et de l'environnement. L'exploitation des mines et le développement des entreprises multinationales de cette filière se fera aussi aux dépens de la lutte contre les changements climatiques et de l'adaptation.
Voilà donc le modèle de développement que veut nous imposer le gouvernement de CAQ : refuser de remettre en question le libre accès aux ressources minières (free mining) et le pillage de nos ressources ; soutenir les multinationales qui veulent faire mainbasse sur la production des énergies renouvelables ; mettre fin au monopole d'Hydro-Québec sur la production de l'énergie électrique ; fermer les yeux et permettre à des entreprises polluantes de ne pas tenir compte des normes environnementales ; refuser de donner la priorité au développement des transports publics ; refuser de s'engager dans une politique de sobriété énergétique et d'extraction ; balayer du revers de la main les propositions écologiques des citoyens et citoyennes des différentes régions et des institutions qui les représentent.
6. Ce que nous voulons
Face à la banalisation du risque lié à la filière batterie de la CAQ, il paraît évident que les analyses du BAPE - sans interférence du premier ministre et de ses subordonnés - sont plus que jamais nécessaires pour évaluer les projets de développement énergétique. Nous voulons un BAPE générique applicable sur l'avenir énergétique du Québec. Cela inclut Northvolt. Mais, il n'est pas suffisant de remettre en cause les politiques néolibérales du gouvernement de la CAQ, ni les outils financiers qu'il utilise pour réaliser son plan énergétique, notamment les ponctions dans le trésor public, ni l'oblitération des procédures démocratiques de décision.
La véritable question est le type de société dans laquelle nous voulons vivre ; la véritable question est la lutte contre la crise climatique, le dépérissement de la biodiversité et la destruction de l'environnement. Les développements technologiques doivent être systématiquement évalués à l'aune de leur intégration possible et désirable dans une planification démocratique compatible avec les notions de décarbonation et de sobriété. Avant tout, il faut éviter l'inadaptation qui utilise la technologie comme solution prépondérante et qui finalement aggrave les vulnérabilités aux changements climatiques. [29] . Les projets qui ne contribuent pas à la décarbonation doivent être abandonnés tout comme ceux qui
s'opposent à la décroissance énergétique en prétendant simplement remplacer les hydrocarbures par de l'électricité « propre ». Il en est de même pour les projets visant la production de la richesse et sa concentration dans les mains de la classe dominante.
Le programme de Québec solidaire présente une vision écologique qui respecte et favorise la diversité des écosystèmes et la protection du patrimoine naturel du Québec. Il propose un système économique écologiste privilégiant la production de biens et services en respectant les limites de l'environnement. Il s'engage à réduire les émissions de GES « d'au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030, en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 % ».
Également, il rejette l'extractivisme et veut en finir avec le libre accès aux ressources minières (free mining) imposé par la loi des mines. Il propose la nationalisation des énergies renouvelables et refuse la privatisation de la production de l'énergie. De plus, il donne la priorité au transport publics et à l'économie d'énergie.
C'est une alternative concrète à la politique énergétique du gouvernement de la CAQ.
Téléchargez ce document en version PDF
Rencontre Citoyenne
Northvolt :
critique d'un mégaprojet industriel :
entre écoblanchiment et extractivisme
22 juin 2024
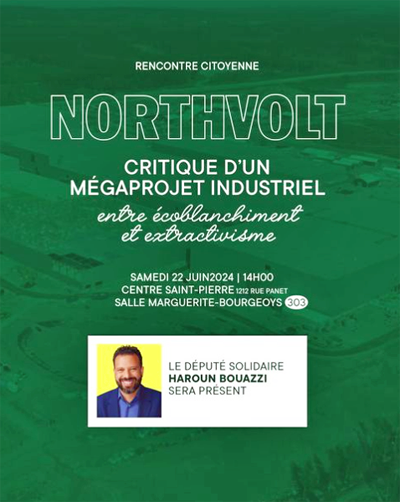
Le réseau militant écologiste de Québec solidaire organise une rencontre citoyenne le 22 juin prochain à Montréal en compagne du député solidaire Haroun Bouazzi et d'invités de la société civile sur le projet Northvolt. Retrouvez-nous au à 14h au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet).
Cette activité fera la critique de la démarche suivie par le gouvernement de la CAQ pour réaliser ce projet et mettra de l'avant la position de Québec solidaire et celles des syndicats et des groupes écologistes impliqués dans les mobilisations actuelles.
[1] Martine Ouellet, "Le détournement de la transition énergétique", https://www.facebook.com/watch/live/ ? ref=watch_permalink&v 1=1615855215869611
[2] Hydro-Québec dévoile un plan « ambitieux » de transition énergétique, https://www.ledevoir.com/economie/801249/hydro-quebec-devoile-planambitieux-transition-energetique
[3] Les entreprises se bousculent pour les mégawatts d'Hydro-Québec, https://www.lesaffaires.com/secteurs/ressources-naturelles/les-entreprisesse-bousculent-pour-les-megawatts-dhydro-quebec/648659
[4] https://irec.quebec/publications/rapports-de-recherche/la-privatisation-delenergie-eolienne-et-limpact-sur-la-mission-dhydro-quebec
[5] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1963989/pierre-fitzgibbon-annonceappel-offres-1500-mw-energie-eolienne
[6] Mission du BAPE, https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/bape/role-bape/
[9] Est-ce qu'il y a assez de minéraux au Québec pour les voitures électriques https://pivot.quebec/2024/03/22/est-ce-quil-y-a-suffisamment-de-minerauxau-quebec-pour-les-voitures-electriques/
[10] À propos du projet d'implantation du fabricant de cellules de batteries Northvolt, https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/ developpement-filiere-batterie/northvolt/a-propos
[11] Northvolt, le « plus beau projet privé » jamais vu au Québec, https://lecollectif.ca/northvolt-le-plus-beau-projet-prive-jamais-vu-auquebec/
[12] Northvolt ne réduira pas les GES du Québec, https://www.ledevoir.com/environnement/809334/northvolt-ne-reduira-pasges-quebec
[13] Le projet Northvolt est-il bon pour le Québec ? https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/editionspeciale/le-projet-northvoltest-il-bon-pour-le-quebec/
[14] Quel rôle pour les minéraux québécois chez Northvolt ? https://www.ledevoir.com/economie/800869/quel-role-mineraux-quebecoisnorthvolt
[15] Pierre Fitzgibbon : « Dans la filière batterie, on est rendu trop loin pour reculer », https://www.lesaffaires.com/secteurs/manufacturier/pierrefitzgibbon---dans-la-filiere-batterie-on-est-rendu-trop-loin-pour-reculer-/649597
[16] Retombées de Northvolt sur l'économie, https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/ developpement-filiere-batterie/northvolt/retombees-economiques#c255819
[17] Discours du budget, https://www.finances.gouv.qc.ca/Budget_et_mise_a_jour/budget/discours.as p# : :text=En%202024%E2%80%912025%2C%20apr%C3%A8s %20la,1%2C5%20%25%20du%20PIB
[18] https://www.ledevoir.com/environnement/675513/des-sites-miniers-pluscouteux-de-prevu-pour-le-quebec
[19] Une facture bien moins salée pour l'Allemagne, https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2024-01-19/future-usinequebecoise-de-northvolt/une-facture-bien-moins-salee-pour-lallemagne.php#:~:text=Dans%20le%20cas%20de%20Northvolt,plafonn%C3%A9es%20%C3%A0%204,6%20milliards
[20] Filière batterie, Investissement Québec, https://filierebatterie.investquebec.com/#guide-fournisseurs
[21] Québec doit-il investir autant dans la filière batterie https://www.ledevoir.com/economie/800867/politique-industrielle-etatquebecois-doit-il-mettre-autant-fonds-publics-filiere-batterie
[22] https://www.ledevoir.com/environnement/809631/projet-northvolt-nerespecterait-pas-accord-mondial-biodiversite
[23] Northvolt a proposé de remblayer des milieux humides avec des sols contaminés, https://www.ledevoir.com/environnement/809400/northvoltpropose-remblayer-illegalement-milieux-humides
[24] Pas de BAPE pour nombre de projets phares, https://www.lapresse.ca/affaires/2024-01-31/filiere-des-batteries/pas-debape-pour-nombre-de-projets-phares.php
[26] Sources de pollution : traitement des métaux et des minéraux, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/ gestion-pollution/sources-industrie/traitement-metaux-mineraux.html
[27] Mémoire concernant la consultation sur l'encadrement minier, https://eausecours.org/sites/eausecours.org/wp-content/uploads/2023/06/ Memoire-Eau-Secours-Consultations-sur-lencadrement-minier.pdf
[28] La filière batterie menace le territoire agricole, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2013448/terres-agriculture-minesbatteries-cptaq-quebec

400 organisations et personnalités LGBTI appellent à faire barrage à l’extrême droite

Près de 400 organisations et personnalités LGBTI ont signé une tribune dans l'Humanité, appelant à voter pour les candidat·e·s du Nouveau Front Populaire aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet pour sanctionner le gouvernement et contrer l'extrême droite.
Tiré du blogue de l'auteur.
Initiée par le collectif "Les Inverti·e·s" et publiée le 17 juin 2024 dans le journal l'Humanité, la tribune intitulée "LGBTI, soyons fier.e.s de faire Front populaire" rassemble plus de 377 signatures de militant·e·s, artistes, lieux communautaires, collectifs, et organisations politiques, syndicales et associatives LGBTI. Cette liste s'est allongé depuis lundi.
Voir la tribune dans l'Humanité
Suite au score historique de l'extrême droite aux élections européennes, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée Nationale. Son gouvernement composés d'ancien·nes de La Manif Pour Tous, a promulgué des lois racistes, antisociales et transphobes, et favorisé l'extrême droite, menaçant les droits des LGBTI et autres opprimés. L'extrême droite, opposée de longue date aux droits LGBTI, est un danger mortel en France comme en Europe. Les signataires appellent à l'unité et à la lutte collective pour contrer cette menace dans la rue et dans les urnes et construire un nouveau front populaire avec des forces sociales, féministes, antiracistes et écologistes. Le Nouveau Front Populaire doit s'ouvrir plus largement aux organisations LGBTI et leur faire une place pour gagner de nouveaux droits, et lutter contre les LGBTIphobies.
Parmi les signataires notables figurent Felix Maritaud, Virginie Despentes, Fatima Daas, Paloma (Hugo Bardin), Sara Forever (Matthieu Barbin), Andy Kerbrat, Ségolène Amiot, Lou Trotignon, Océan, Aloïse Sauvage, Catherine Corsini, Claire Burger, Kalika, Paul B. Preciado, Tahnee et Les Vulves Assassines et bien d'autres.
Parmi les organisations signataires, outre les inverti·e·s, ont signé Act Up (sud ouest et Paris), Acceptess-t, Toutes des Femmes, Queer Education, Les degommeuses, Le couvent de paname les soeurs de la perpetuelle indulgence, La MIF, Centre LGBTQIA + KAP Caraïbe de Martinique et les commissions LGBTI+ du NPA, LFI, Generation·s, Les écolos et HES et près de 200 autres organisations.
Le mois des fiertés sera aussi une période de lutte contre le fascisme, car l'extrême droite est notre ennemi mortel !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Selon une enquête du Guardian, "Ampleur sans précédent" des violations commises à l’encontre des enfants à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, selon un rapport de l’ONU

Selon un rapport des Nations unies qui doit être publié cette semaine, les violations graves commises à l'encontre des enfants à Gaza, en Cisjordanie et en Israël ont été plus nombreuses que partout ailleurs dans le monde l'année dernière.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Réduction de moitié de l'aide humanitaire entrant à Gaza en février © UNRWA
Le rapport sur les enfants et les conflits armés, dont le Guardian a eu connaissance, a recensé plus de cas de crimes de guerre contre des enfants dans les territoires occupés et en Israël que partout ailleurs, y compris en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Somalie, au Nigeria et au Soudan.
"Israël et les territoires palestiniens occupés présentent une échelle et une intensité sans précédent de violations graves à l'encontre des enfants", indique le rapport.
L'évaluation annuelle - qui doit être présentée à l'assemblée générale des Nations unies dans le courant de la semaine par le secrétaire général, António Guterres - mentionne Israël pour la première fois dans une annexe des États responsables de violations des droits de l'enfant, ce qui a suscité l'indignation du gouvernement israélien.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que les Nations unies s'étaient "ajoutées à la liste noire de l'histoire en se joignant à ceux qui soutiennent les assassins du Hamas".
Le rapport ne détaille que les cas que les enquêteurs de l'ONU ont pu vérifier, et ne représente donc qu'une partie du nombre total de morts et de blessés parmi les enfants au cours de l'année dernière.
Au total, les Nations unies ont vérifié "8 009 violations graves à l'encontre de 4 360 enfants" en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, soit plus de deux fois les chiffres de la RDC, deuxième pays le plus touché par la violence à l'encontre des enfants.
Sur le nombre total d'enfants victimes vérifiés, 4 247 étaient palestiniens, 113 étaient israéliens.
Au total, 5 698 violations ont été attribuées aux forces armées et de sécurité israéliennes, et 116 à la branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam. Les colons israéliens ont été jugés responsables dans 51 cas, et les brigades al-Quds du Jihad islamique palestinien ont été impliquées dans 21 cas.
Entre le 7 octobre et la fin décembre de l'année dernière, l'ONU a vérifié le meurtre de 2 051 enfants palestiniens, et a déclaré que le processus d'attribution des responsabilités était en cours, mais le rapport note : "La plupart des incidents ont été causés par l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées par les forces armées et de sécurité israéliennes."
Le rapport reconnaît qu'il ne reflète qu'une image partielle de la situation à Gaza.
"En raison de graves difficultés d'accès, en particulier dans la bande de Gaza, les informations présentées ici ne reflètent pas toute l'ampleur des violations commises à l'encontre des enfants dans cette situation", indique le rapport.
Le rapport fait également état de graves abus commis par les forces israéliennes en Cisjordanie, avec 126 enfants palestiniens tués et 906 détenus. L'ONU a vérifié cinq cas où les soldats ont utilisé des garçons "pour protéger les forces pendant les opérations de maintien de l'ordre".
Au cours de l'année 2023, avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les Nations unies ont déclaré que les branches armées du Hamas et du Jihad islamique palestinien avaient organisé des "camps d'été", dans lesquels les enfants étaient exposés à "un contenu et des activités militaires".
Au cours des trois premiers mois de la guerre, l'ONU a vérifié 23 cas distincts de refus d'accès humanitaire par les autorités israéliennes "liés au refus de coordination des missions d'aide humanitaire et à l'empêchement de l'accès aux soins médicaux".
Au cours de l'offensive israélienne à Gaza, l'ONU a constaté que "la quasi-totalité des infrastructures, installations et services essentiels ont été attaqués, notamment les sites d'hébergement, les installations des Nations unies, les écoles, les hôpitaux, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les moulins à grains et les boulangeries".
"Les enfants sont menacés de famine, de malnutrition sévère et de mort évitable", indique le rapport de l'ONU.
"Je suis consterné par l'augmentation spectaculaire et l'ampleur et l'intensité sans précédent des violations graves commises à l'encontre des enfants dans la bande de Gaza, en Israël et en Cisjordanie occupée", déclare M. Guterres à l'Assemblée générale dans le rapport.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’écosocialisme pour tout changer

Les 10 et 11 mai derniers, en Argentine, se sont déroulées les sixièmes Rencontres écosocialistes internationales. Elles avaient lieu pour la première fois ailleurs qu'en Europe, une décennie après la première édition en Suisse, à Genève, en 2014.
Tiré de Quatrième internationale
12 juin 2024
Par Germán Bernasconi
Argentine
Le projet de la dernière édition a commencé il y a plus d'un an, lorsque ATTAC et Poder Popular ont été contactés afin de savoir s'il était possible de les organiser. Après des mois de débats traversés par la dure réalité argentine, avec la campagne électorale, nous avons dû suspendre l'évènement prévu initialement en 2023, mais nous avons continué le travail et nous nous sommes fixé des objectifs politiques.
Les réunions suivantes du groupe de travail, où étaient présent·es des camarades du Brésil, du Chili, du Pays basque et du Portugal, ont été renforcées par une série de réunions internationales, où nous avons été rejoint·es par l'organisation locale Marabunta (Argentine). Après la période électorale et la victoire de Javier Milei, nous avons décidé de continuer la préparation des rencontres pour le mois de mai. Elle fut validée immédiatement après la victoire du candidat libertarien, au vu de son programme d'ajustement structurel du capitalisme contre la classe travailleuse, car la solidarité internationale est vitale pour déjouer ses plans.
Quelques objectifs des Rencontres
Le mouvement pour le climat dans notre pays est ample et divers. Les luttes contre l'extractivisme, contre les OGM et l'utilisation de pesticides en font l'un des secteurs les plus dynamiques, et qui touche énormément les plus jeunes générations. Cependant, la perspective écosocialiste n'est pas encore suffisamment entendue. Nous voyons donc les Rencontres comme une plateforme visant à réunir l'ensemble des militant·es qui s'inscrivent dans cette perspective.
L'objectif était de donner une continuité politique et militante, de consolider les débats, s'homogénéiser et tracer de véritables perspectives programmatiques et stratégiques, à la hauteur du défi que représente la crise climatique, résultat direct du système productiviste capitaliste.
Finalement, l'organisation de la COP30 à Belem en 2025 imposait un nouveau débat sur les rapports avec cet évènement, ainsi qu'au contre-sommet en préparation.
Le déroulement des Rencontres
Après près d'un an de travail, les 10 et 11 mai, plus de 200 personnes se sont réunies dans l'Auditorium central de l'Association des travailleurs/ses de l'État et les deux auditoriums de l'hôtel Quagliaro, qui lui appartient également. Le 9 mai, des activités étaient prévues, mais elles ont été suspendues en raison de la nécessaire grève générale convoquée ce jour-là par tou·tes les travailleurs/ses argentin·es, dans le contexte des attaques de grande ampleur mises en œuvre par le gouvernement de Javier Milei.
Au cours des deux journées suivantes, différents thèmes de l'agenda écosocialiste ont été abordés, en commençant par l'histoire des Rencontres elles-mêmes, sachant que chaque lutte doit avoir une mémoire pour ne pas avoir à repartir de zéro. Les problèmes de l'écomarxisme, la spoliation des territoires, la dette et le commerce, avec un point de vue écosocialiste, la montée du militarisme et de l'extrême droite et la répression ont été quelques-uns des thèmes de la première journée, qui s'est clôturée par un panel représentant les grandes luttes environnementales qui ont eu lieu en Argentine au cours des dernières décennies.
Le samedi 11 a commencé par une intervention de Michael Löwy sur le débat entre le centre et la périphérie, suivie d'un débat approfondi sur ce qu'il faut faire face à la COP30. La souveraineté alimentaire, l'écoféminisme, l'énergie et les classes sociales ont animé l'après-midi.
Le dernier panel a traité de l'état actuel du mouvement écosocialiste et de ses perspectives d'avenir, avec une intervention vidéo de l'une des figures du mouvement écosocialiste, Daniel Tanuro.
La Rencontre a été couronnée par la promesse d'une triple continuité : la participation au contre-sommet de Belem, en y organisant la Deuxième rencontre écosocialiste d'Amérique latine et des Caraïbes ; l'organisation des 7e Rencontres écosocialistes internationales en Belgique, autour de la Gauche anticapitaliste. Et la poursuite du débat programmatique et stratégique au sein d'un réseau international qui tiendra sa première réunion dans les prochaines semaines.
Quelques conclusions
Les 6e Rencontres ont été un succès. Avec la participation de plus de 40 organisations et de plus de 15 pays, ainsi que d'une grande partie des provinces argentines, le mouvement écosocialiste dispose d'une base solide pour mieux intervenir dans le mouvement environnemental. Le défi consiste maintenant à donner une continuité à ses propres instances permanentes de réflexion et de construction, ainsi qu'à intervenir de manière unie dans la lutte contre les négationnistes d'extrême droite de la crise climatique et à être toujours vigilants pour ne pas tomber dans les fausses solutions du capitalisme vert. Aujourd'hui, nous sommes plus proches d'une alternative écosocialiste systémique qui permettra à la classe ouvrière de jouir d'un environnement sain, d'un temps de travail réduit et de plus de temps pour la jouissance collective. Il est temps de passer à l'offensive et d'articuler un programme systémique contre la barbarie climatique et sociale du capitalisme.
Le 20 mai 2024
* Germán Bernasconi est membre de Poder Popular en Argentine. Traduit par Félix B.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le fascisme aux portes du pouvoir

Les idées d'extrême droite, certaines d'entre elles, par le véhicule des mots sont déjà au pouvoir. Une partie du projet Le Pen est déjà appliquée et il faut en prendre acte. Penser le fascisme est une nécessité tout comme le combattre, et pour ces deux actions les modalités temporelles sont différentes. Il faut pourtant allier le temps long de la pensée avec le temps court du sursaut comme on allie le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.
Depuis le cœur et la raison, en pensant à nos intérêts de classe comme au sort de l'humanité dans son ensemble il faut donc penser et combattre le capitalisme autoritaire qui s'apprête à laisser la main à un projet fascisant voir fasciste.
La question du fascisme
On ne va pas donner l'ensemble des réponses complètes et complexes à ce que fut le fascisme et ce qu'il est aujourd'hui, mais donner quelques repères nécessaires pour appréhender le phénomène fasciste et pour le contester. Dans la lignée de ce que disait l'intellectuel allemand de l'école de Francfort, Max Horkheimer, on considère que si on n'a rien à dire sur le capitalisme on n'a rien à dire sur le fascisme. Il ne faut pas rester au plan des idées mais étudier les conditions matérielles qui leur ont permis d'éclore. Une analyse matérialiste est de mise pour comprendre le monde, la dimension destructrice du capitalisme et la progression de courants politiques autoritaires et racistes.
Avant de s'arrêter sur le XXème siècle il faut remonter à l'impérialisme, père de la modernité. L'entrée se fait avec la conquête de l'Amérique en 1492. Point d'origine du projet colonial qui donne naissance à la division sexuelle, sociale et raciale du travail. Ces divisions restent très présentes au XXème siècle et encore aujourd'hui. Les rapports sociaux et les migrations sont définis par la classe dominante émergente qui utilise les êtres humains comme de simples outils de production. Les mouvements migratoires seront légions et ne poseront aucun problème tant que c'est la classe capitaliste qui a les rênes et qui décide sur qui doit aller où et pour quoi faire. Les frontières qui traversent l'humanité portent alors le sceau de la race, du sexe et de la classe dès le début, et c'est la pratique impériale qui vient d'abord (les théories racistes et sexistes suivront) et fabrique ces divisions. Les premiers capitalistes au début de l'âge moderne vont biologiser les êtres humains afin de mieux naturaliser un ordre du monde qui commence à se structurer autour de ces trois catégories, la race, le sexe et la classe sociale. Ce triptyque va permettre de soumettre le peuple et de briser les éléments émancipateurs qu'il y avait dans l'ordre ancien comme la sororité, les relations communautaires fortes pour l'Europe et la gestion collective et spirituelle des affaires de la cité en Abya Yala (Amérique), une sorte de “communisme primitif” dira Marx, brisé par le système plantationnaire esclavagiste et l'introduction forcée de la propriété privée sur le territoire. Les oppressions multiples se renforcent l'une l'autre et dès les premières conquêtes les classes possédantes ont su jouer sur ces frontières pour atténuer la force de frappe du peuple en accordant par exemple un privilège blanc aux travailleurs dans les pays colonisés pour pallier aux crises économiques et éviter que le chômage de masse engendré par le capitalisme lui-même entraine des mouvements de foule et une instabilité pour le pouvoir en place. Tout signe de solidarité entre les classes, que ce soit entre les femmes et les indigènes, ou les travailleurs blancs avec les travailleurs racisés fut combattu dès le départ. Parler du fascisme, on le voit, c'est aborder la genèse du capitalisme. Le projet impérial est fondé sur l'extermination coloniale, le pillage, les guerres et l'exploitation. Justement, le fascisme va puiser ses racines dans le projet impérial qui vient de loin et s'étend sur plusieurs siècles si bien que la folie génocidaire nazie ne vient pas de nulle part. Pour ne prendre qu'un exemple il y a eu le génocide des Héréros et des Namas perpétré sous les ordres de Lothar von Trotha dans le Sud-Ouest africain allemand (Deutsch-Südwestafrika, actuelle Namibie) à partir de 1904 : violence extrême (dénoncée par la révolutionnaire Rosa Luxemburg qui a réfléchit et écrit sur le lien entre impérialisme et capitalisme) annonciatrice de la violence nazie. On a donc une affinité évidente entre l'impérialisme européen et le fascisme.
Le fascisme est un projet colonial et impérial. C'était vrai hier et c'est vrai aujourd'hui. Sans se limiter à ça il est toujours opposé aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, il repose donc sur cette même idée qu'il y ait une hiérarchie raciale et sociale et que certains pays ou certains peuples soient dominés pour assurer “l'espace vital” d'autres peuples ou classes sociales. De plus, au début du XXème siècle, le projet fasciste semble être la roue de secours de la bourgeoisie lorsqu'elle est désavouée en raison des crises internes du système de par ses contradictions, et en raison des grèves et luttes sociales. Il apparaît en réaction au risque révolutionnaire. Il est un mode de gestion autoritaire et antidémocratique qui s'appuie sur la police et l'armée pour rassurer la bourgeoisie inquiète, et pour empêcher une transformation sociale. Le fascisme vise à endiguer la dynamique révolutionnaire mondiale, en cela, c'est une idéologie bourgeoise défendue par la petite bourgeoisie. On a des éléments de comparaison entre l'extrême droite d'hier et celle d'aujourd'hui ; les soutiens d'hier et ceux d'aujourd'hui. L'extrême droite actuelle dans ses différentes composantes est toujours colonialiste et nationaliste, antirévolutionnaire, et de nombreux bourgeois aujourd'hui sont dans la même optique que la bourgeoisie des années 1930 qui considérait (à l'instar d'Emmanuel Mounier) qu'il valait mieux Hitler que Blum. Christophe Barbier comme d'autres éditorialistes ou intellectuels de plateaux considèrent qu'il vaut mieux Marine Le Pen à Jean Luc Mélenchon. La bourgeoisie est prête à tout pour empêcher qu'une amorce se fasse dans la contestation de l'ordre économique si bien que l'entreprise de légitimation et de banalisation de l'extrême droite s'est accompagnée d'attaques et de diffamations pour les courants politiques (comme le NPA ou LFI) qui sont dans une perspective anticoloniale et de défense des droits humains.
En résumé, pour le fascisme, on peut parler d'un “système politique autoritaire, inégalitaire et conservateur, qui s'appuie sur un État fort, militarisé et policier, et qui implique une réduction drastique des libertés politiques et syndicales, le tout dans un déni total des droits humains.” Si on regarde les attaques récentes contre les droits et les libertés publiques en France depuis le 7 octobre, on observe que la macronie a déjà préparé le terrain en menaçant, en interdisant, en diffamant ou en convoquant ceux et celles qui critiquent le pouvoir et les guerres impérialistes. Les concernés sont nombreux et nombreuses ; on pense par exemple à Olivier Cuzon, secrétaire départemental de Sud 29, directeur de publication d'une brochure syndicale. Il a été convoqué le 19 avril au commissariat de Brest et interrogé par un policier sur ordre du procureur de la République qui obtempère à une plainte déposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour « Diffamation et injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie ». La simple critique de la militarisation d'une partie de la jeunesse voulue par l'Etat n'est pas permise ; elle n'est pas passée. Ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est aussi la pensée critique que le pouvoir veut mettre au garde-à-vous.
On ne vit pas dans un Etat fasciste et il suffit de regarder l'histoire pour s'en convaincre mais il y a un processus de fascisation inquiétant. Si le pouvoir déroule le tapis rouge à l'extrême droite en s'attaquant aux droits et aux libertés, ceux qui risquent de le piétiner prochainement pourraient être bien plus dangereux. Les premiers attaqués seront les étrangers, les femmes, les musulman.es, les syndicalistes, les écologistes et l'ensemble des travailleurs à commencer par les travailleurs pauvres et ceux et celles qui ont un engagement dans la lutte antiraciste ou dans la lutte des classes.
Détournement et confusion
Comme on le voit dans l'histoire, le fascisme arrive à point nommé pour empêcher la victoire du communisme et la remise en cause des intérêts de la bourgeoisie. Il n'aurait jamais pu voir le jour sans l'appui de la petite bourgeoisie et des industriels comme on l'a dit. On sait que l'industriel Henry Ford faisait distribuer des flyers antisémites dans ses usines pour détourner la colère ouvrière. Les capitalistes et la petite bourgeoisie ont donc fait monter l'antisémitisme pour semer la confusion et épargner les grands patrons. Faire croire que les juifs sont l'ennemi relève d'une manipulation qui a pu se faire grâce à la propagande patronale et nazie, et grâce au contrôle accru sur la langue et la pensée établi par le régime hitlérien qui a organisé, progressivement, un nouveau rapport aux mots et à la pensée. Ce contrôle sur l'évolution de la langue a été repéré par le linguiste allemand Klemperer qui a écrit, dans la gueule du loup, La langue du IIIème Reich. La destruction du sens et la propagation des mensonges vont peser négativement sur l'engagement et brouiller les pistes. Aujourd'hui encore, le mensonge domine, et ils sont bien trop peu à rétablir la vérité. Les diffamations vont bon train. Les mots lâchés, repris, légitimés, pavent le chemin des jours tragiques, comme “décivilisation”, “grand remplacement”, “déclin”, “islamo-gauchisme”, “ensauvagement.” Ils résonnent avec l'imaginaire colonial qui fut envisagé comme une aventure destinée à “civiliser” les “sauvages.” Les relations calomnieuses et mensongères entre immigration et délinquance, ou immigration et chômage sont dans les tuyaux depuis longtemps. Malgré la propagande, ces associations ne passent pas l'épreuve des faits. On laisse croire aussi que l'immigration pèse sur les salaires pour mieux laisser oublier que la pression est exercée par le Capital ; là encore, l'image créée ne passe pas l'épreuve des faits.
Les amalgames continuent mais ne choquent personne car il y a un déni, déni du racisme dans la police et plus largement, du racisme dans la société si bien qu'on est prêt à croire que l'autre, les autres, étrangers et racisés, sont responsables de la délinquance, du chômage ou des bas salaires. S'il y a eu une augmentation inquiétante des actes antisémites ces derniers mois, on s'étonne que l'augmentation des actes et des discours racistes et islamophobes depuis de nombreuses années passent sous les radars et que personne ne semble s'en inquiéter. La première augmentation semble être plus individuelle, la seconde en revanche revêt d'une attaque collective contre “les banlieues” ; autrement dit, contre les habitants racisés souvent accusés de faire sécession. C'est tout un groupe social qui est attaqué avec des discours au relent raciste et colonialiste. Les propos ambiguës ou discriminants des politiciens et des journalistes sont vraiment nombreux mais il est assez rare qu'on mette un Macron, un Darmanin ou un François-Xavier Bellamy face à leurs mots, leurs tweets et leur responsabilité. Si les militants de la paix et des droits humains comme Rima Hassan doivent rendre des comptes tout le temps, le pouvoir médiatique et politique peut quant à lui disséminer des contrevérités sans être inquiété.
Le discours de l'extrême droite dominait la vie politique des années 1930 comme il domine aujourd'hui l'espace médiatique qui appartient à quelques milliardaires qui s'accommodent très bien du racisme et des mensonges. Or, s'habituer aux mensonges et au racisme c'est déjà être prêt pour basculer dans le régime fasciste. Les propos d'un député du centre républicain en 1933 sont un peu ceux de l'époque, et pas seulement en France.
“Il y a en France 331 000 chômeurs. En rapprochant ce chiffre des 1 200 000 travailleurs étrangers, il est facile de se rendre compte que si les ouvriers étrangers quittaient la France, la question du chômage serait pour nous résolue (applaudissement à droite)”
On peut encore entendre ce type de phrase aujourd'hui. On sait que Le Pen a mis la citation en affiche mais d'autres phrases ont pu être dites, toutes aussi choquantes, ou il est considéré qu'un groupe humain de par son lieu de naissance est naturellement enclin à la délinquance. L'expulsion et l'enfermement deviennent alors magiques face à une menace inventée de toute pièce. Ils permettent tout à la fois de punir et de lutter contre le chômage et contre l'insécurité.
En dépit de la vérité, de ce qu'il en est vraiment, ces croyances - qui se superposent avec celles des années 1930 - sont importantes parmi ceux qui soutiennent un projet fasciste.
Le jugement contre la pensée critique
Le jugement à l'emporte-pièce permet de faire du mal aux autres le jour des élections, ce qui est un peu la jouissance des électeurs de la droite dure et de l'extrême droite : supprimer les droits, les aides, les mécanismes de protections et de solidarités.
On ne les connait pas, mais on préjuge de tout et de tout le monde. Cela se fait en appliquant une sociologie en bas de chez soi : n'assurer son propos d'aucun appui scientifique, faire que le jugement domine et qu'il n'y ait zéro espace pour la pensée critique. Jugement bourgeois classique de type extrême droite : ils ne veulent pas travailler, ils sont sauvages, casseurs, décivilisés, assistés, profiteurs, islamisés ; elles sont soumises. En d'autres termes, certain.es ne méritent pas de vivre. Or, cette haine de l'autre pour être étranger et précaire est aussi une haine du pauvre responsable de son propre sort. Autant dire que la pensée d'extrême droite est symétrique à la pensée bourgeoise qui ne juge que par l'individu et le rend responsable de tout. Cette façon de penser exclut la compassion, ce qui déshumanise l'autre. La colère ne tombe pas contre les rapports sociaux de dominations responsables de la pauvreté, mais contre les pauvres. C'est une pensée qui s'attaque à l'individu et qui fait comme si le sort de chacun était dans ses propres mains, ce qui a le grand mérite d'exonérer les contraintes qui façonnent nos vies rendant invisible la situation sociale et écologique dans laquelle on évolue et les traumatismes historiques que l'on porte depuis longtemps en raison d'oppressions, dont la plus ancienne est probablement la patriarcale. La séparation matérielle entraîne la séparation avec les mots et la suspicion permanente pour ses camarades de classe (adelphes) et ses frères humains. C'est parce qu'on est divisé socialement avec des conditions de vie et de travail individualisées que l'on juge l'autre et qu'on se soucie si peu de lui, d'elle, et du sort commun. Jusqu'où ? Quand va-t-on se lasser de se comparer (public, privé, chômeurs, travailleurs, français, étranger, etc) de se juger sans se connaître, de se suspecter tout le temps ? Il faut bien comprendre que ces discours se traduisent en loi, comme celle de l'assurance-chômage et qu'en fin de compte ça fait que les gens pauvres deviennent plus pauvres, plus précaires, plus contrôlés.
Ces jugements attaquent les pauvres et les chômeurs mais pas le chômage, ils remettent en cause un élément fondamental pour vivre en société : la confiance aux autres.
Mépris des pauvres et des étrangers : le carburant de l'extrême droite
Contrairement aux idées reçues, le chômage aujourd'hui est structurel si bien que contraindre les chômeurs en leur mettant le couteau sous la gorge ne résoudra pas le chômage. Là n'est pas le but. Tout comme le chantage au RSA, la contre-réforme de l'assurance-chômage est destinée à soumettre ceux et celles qui pourraient se rebeller face à l'autorité patronale et à la dégradation du salaire et des conditions de travail. Le besoin de main d'œuvre dans certains secteurs aurait pu créer un rapport de force pour que les travailleurs imposent leur voix et fasse valoir une amélioration des conditions de travail et des salaires, et c'est tout ce que les “réformes” antisociales successives, comme celle de l'assurance-chômage, ont cherché à éviter. Applaudir ces contre-réformes c'est se réjouir du travail forcé, du rétablissement de l'autorité patronale et de la soumission ouvrière. “Accepte ce que le patron te donne”, c'est-à-dire, les conditions d'exploitation telles qu'elles sont fixées ou bien meurs à petit feu dans la précarité et la misère. Les résultats se font déjà sentir. On est passé d'un chômeur sur deux indemnisé à un sur trois. Le chômage c'est de la souffrance, de la maladie, des suicides. Le chômage tue 14.000 personnes par an.
Ces mesures antisociales brutales furent justement celles qui menèrent les nazis au pouvoir si bien que résister au fascisme c'est forcément les abroger et en finir avec leur philosophie basée sur l'humiliation et la servilité. En effet, la politique austéritaire de Heinrich Brüning (homme d'Etat allemand, chancelier dès 1930) et la baisse des aides sociales ont permis, fortement contribué, à l'accession des nazis au pouvoir. Il faut le garder en tête pour développer un antifascisme conséquent. Lorsqu'on s'attaque aux pauvres, on s'attaque souvent aux étrangers derrière et vice-versa.
Alors qu'on suspecte les pauvres d'avoir des aides qui sont pourtant toujours inférieures au minimum pour vivre décemment, on ne dit absolument rien de ceux qui prennent le surplus, se gave par le vol et la destruction, ou sur le fait que les aides aux entreprises augmentent trois fois plus vite que les aides sociales. Bloquer la machine austéritaire qui produit misère et mensonge serait donc une mesure antifasciste en plus d'être une mesure sociale. Les travaux de Herbert Kitschelt tels qu'il les a présentés dans son livre The Radical Right in Western Europe (1995) font le lien entre racisme et politique antisociale. Il précise notamment que les personnes socialement démunies “soutiennent un certain type d'économie de marché et une réduction des mesures de redistribution parce qu'ils y voient le seul moyen de priver les immigrés et les demandeurs d'asile de leurs aides sociales.” L'exclusion de l'autre crée un semblant de privilège et motive les foules le jour de l'élection. Le positionnement antisocial et raciste est souvent symétrique. Dans les deux cas on remet en cause le droit de vivre de l'autre pour ce qu'il est, parce que soi-disant il ne travaille pas ou ne le mérite pas.
Antifasciste, donc anticapitaliste
Les fake-news que les journalistes de plateaux laissent passer (ou assènent) infusent dans la société. Le public non averti peut considérer LFI comme un parti d'extrême gauche, au mépris de l'histoire et de ce qu'il en est vraiment. Cela permet de mettre dans le même sac, nouvelle classification, “les extrêmes”. La bourgeoise l'a martelé. On se rappelle de Borne aux élections législatives de 2022 qui expliquait que tous les extrêmes se rejoignent et doivent être combattus. Rien n'est plus faux. Ça ne résiste pas à l'expérience des faits. Renvoyer les “extrêmes” dos à dos est une terrible erreur. Si la presse bourgeoise a intérêt à le laisser croire, que les deux se valent, une analyse sérieuse des discours, des programmes et des votes suffit à rétablir la vérité. Sur la forme comme sur le fond, le RN est davantage compatible avec l'autoritarisme et le néolibéralisme de la minorité présidentielle. Ses mots sont repris et certaines de ses mesures sont même appliquées (comme la loi asile immigration).
Sur les textes de loi du gouvernement, à 42%, les députés RN votent pour. Mais à 22% seulement, ils votent contre. A titre de comparaison LFI vote à 69% contre les textes de loi du gouvernement et jamais une seule fois pour. Lorsqu'on a un minimum le souci de la vérité, on sait qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas.
Pour Saïd Bouamama, sociologue et militant antiraciste “le mouvement ouvrier, le mouvement antifasciste et le mouvement anticolonial ont imposé durablement une frontière de légitimité rendant impossible ou difficile de se revendiquer explicitement du fascisme aujourd'hui. Le fascisme est ainsi contraint de se présenter différemment, de faire passer en contrebande sa marchandise en quelque sorte.” Les mouvements fascistes, explique t-il, “peuvent prendre des visages multiples pour neutraliser la frontière de légitimité posée par nos luttes : défense de la République, défense de la Nation, défense de la laïcité et même national-communisme, nationalisme socialiste, etc.” Le brouillage des pistes est récurrent chez eux. Cela nous invite à être vigilant et clair sur ce qu'on veut, sur qui nous sommes et sur qui ils sont, pour savoir déraciner les germes fascistes avant qu'ils n'éclosent. Si le déguisement change, le fond reste. Le fascisme n'est jamais un mode de pensée matérialiste. Il est toujours anhistorique, enclin à s'attaquer aux personnes, jamais aux structures ; il est du côté de la suspicion de son prochain et du jugement permanent, opposé à la pensée critique et à la confiance en l'être humain. Il faut donc rester sur une ligne matérialiste, antifasciste, donc anticapitaliste.
Aujourd'hui, il est clair qu'il faut une alliance antifasciste mais la question se pose de savoir avec qui car ceux qui ont allumé la mèche par leur discours et leur politique sécuritaire ou anti-immigré ont une lourde responsabilité. Il faut se démarquer du fascisme, de ce qui fait son lit, et organiser une résistance qui soit radicale et unitaire. Pour Saïd Bouamama, “il n'y aura pas de pratique antifasciste efficace sans théorie antifasciste clarifiant les causes, enjeux et cibles.”
Si on prend le danger fasciste au sérieux alors il faut une alliance stratégique et durable des forces de gauche mais il serait contre productif qu'elle se fasse avec des forces politiques néolibérales et colonialistes qui, ces dernières années ont cautionné des politiques impérialistes et fait passer des lois nocives pour les travailleurs comme la loi travail. Autant dire que l'alliance est aussi importante que l'est la rupture avec l'ordre capitaliste. Sans ça, l'unité serait vaine.
L'extrême droite cogne : il est temps de préparer l'offensive pour défendre le sort de l'humanité, de la biodiversité et des travailleurs, et on peut le faire dans une perspective internationaliste en soutenant le combat contre l'extrême droite au niveau mondial, qu'elle soit au Salvador, en Argentine, en Inde, en Israël, ou en Hongrie, on se doit d'être solidaire. Les organisations du sud global ont ouvert un espace de discussion avec la conférence mondiale antifasciste de Porto Alegre qui s'est tenue du 17 au 19 mai 2024, juste après La 6e Rencontre écosocialiste internationale et la 1re Rencontre écosocialiste d'Amérique latine. Il faut maintenant travailler à la révolution au niveau mondial, seule façon de se prémunir de l'extrême droite et de la catastrophe capitaliste et climatique. Préparons-nous pour la bataille, les élections, les soulèvements, sans perdre de vue les enjeux aux niveaux internationaux.
Face à la barbarie capitaliste et au risque de bascule fasciste, ici comme ailleurs, il faut préparer la bataille culturelle qui est aussi une bataille féministe et sociale. Il faut tenir puis passer à l'offensive. La grève, l'occupation et la lutte des classes peuvent vaincre la résignation et raviver l'espoir d'un autre monde possible.
Maxime Motard, membre de la cimade et militant écosocialiste
Notes
1. Pour l'anecdote, assez révélatrice en fait, parmi les colons responsables on trouve Heinrich Göring (le père de Hermann Göring)
2.Parmi les intellectuels à avoir travaillé sur la question, il y a le marxiste William Edward Burghardt Du Bois qui a pensé le lien entre l'oppression raciale et l'oppression capitaliste. Hannah Arendt quant à elle est davantage connue ; elle expose, en continuité avec ce que les marxistes hétérodoxes ont pu souligner, que le racisme et l'antisémitisme nazis ont des sources occidentales, et même des filiations nord-américaines. On peut voir la démonstration pertinente en ce qui concerne le colonialisme, l'impérialisme et l'antisémitisme européens dans le premier et le second volume des Origines du totalitarisme. On renvoie également à l'excellent ouvrage d'Enzo Traverso qui permet de penser la violence nazie : La violence nazie, Paris, La Fabrique, 2002
3. “Pour l'historien britannique Ian Kershaw, c'est la complaisance d'élites bourgeoises convaincues, à tort, de pouvoir les manipuler qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir en 1933.” Nouvel Obs, 28 juillet 2013. https://www.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130726.OBS1194/hitler-n-aurait-pu-prendre-le-pouvoir-sans-la-complicite-d-elites-bourgeoises.html
4. Voir l'émission “C à vous” où il fût invité récemment. N'oublions pas que pour les élections législatives de 2022 la macronie n'a pas du tout appelé à faire barrage face au RN. A l'inverse elle a pu appeler à faire un “front républicain” contre Rachel Keke, comme s'il s'agissait de la peste ; laissant entendre que la République ce n'est pas une femme noir, femme de chambre et insoumise.
5. MIGUEL SCHELCK, “Au origine du fascisme, le capitalisme.” 5 mai 2023. https://lavamedia.be/fr/aux-origines-du-fascisme-le-capitalisme/
6. Abraham Léon, intellectuel trotskiste, a souligné comment le mythe du “capitalisme juif” a été entretenu par les masses petites-bourgeoises. “La petite-bourgeoisie, “ruinée et dépouillée par le grand capital” veut être anticapitaliste sans cesser d'être capitaliste. Elle veut détruire le caractère mauvais du capitalisme, c'est-à-dire les tendances qui la ruinent, tout en conservant le caractère bon du capitalisme qui lui permet de s'enrichir.” Voir “La Conception matérialiste de la question juive.” https://www.marxists.org/francais/leon/CMQJ00.htm
7. Voir Max Wallace, The American Axis. Henry Ford, Charles Lindbergh and the Rise of the Third Reich, New York, St. Martin's Press, 2004. L'ouvrage de Max Wallace analyse les rapports avec le nazisme de deux icônes américaines du 20ème siècle : le constructeur automobile Henry Ford et l'aviateur Charles Lindbergh.
8. Sur les mots, voici ce qu'il disait dans son livre : « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps l'effet toxique se fait sentir »
9. Et ça continue encore aujourd'hui. Dès octobre 2023, le média “Là-bas si j'y suis” a compilé un florilège de fake-news préféré à l'encontre de LFI, et plus largement, à l'encontre de la gauche. “La France insoumise antisémite ? Le déluge de mensonges.” https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/la-france-insoumise-antisemite-le-deluge-de-mensonges
10. Exception faite de la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT (à l'initiative d'Aurélien Saintoul) qui a obligé certains journalistes à rendre des comptes quant à leur travail.
11. Journal officiel des débats parlementaires, 24 mars 1933. Dimitri Manessis, Jean Vigreux, Avec tous tes frères étrangers, Libertalia, 2024. p. 49.
12. Emma Bougerol, 14 000 décès par an liés au chômage : « Ce n'est pas du tout une priorité de l'État », Bastamag, 13 novembre 2023. https://basta.media/14-000-deces-par-an-lies-au-chomage-pas-du-tout-une-priorite-de-l-etat-France-Travail
13. Pour plus de clarification voir Libération : même pour le Conseil d'Etat LFI et le PCF appartiennent au bloc de gauche. https://www.liberation.fr/politique/le-conseil-detat-est-formel-le-rassemblement-national-est-bien-dextreme-droite-20240311_NTEK4OFJVFG2TLVKFEU5VJZARQ/
14.Voir le travail de Blast : https://www.youtube.com/watch?v=nMcmBUwZB70
15. Voir le documentaire : “Macron en marche vers l'extrême droite.” (off investigation).
16. SAÏD BOUAMAMA : COMPRENDRE ET COMBATTRE LE FASCISME ET LA FASCISATION
27 mars 2021 https://acta.zone/said-bouamama-comprendre-et-combattre-le-fascisme-et-la-fascisation/
17. SAÏD BOUAMAMA : COMPRENDRE ET COMBATTRE LE FASCISME ET LA FASCISATION
27 mars 2021 https://acta.zone/said-bouamama-comprendre-et-combattre-le-fascisme-et-la-fascisation/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une publicité pour la prévention mais une insulte pour les travailleur-euses de la route

Récemment, le gouvernement Legault a agi. Une publicité pour sensibiliser sur la situation des surveillants et surveillantes de chantiers routiers inonde les écrans de tv. Ce message se veut clair et pertinent avec une touche d'humour.
Le Syndicats des Métallos de la FTQ pose ainsi le problème :
« « L'été n'est même pas encore commencé et il y a déjà deux morts qui s'ajoutent aux 19 décès survenus au cours des 16 dernières années. Nous avons formulé en avril plusieurs recommandations pour redresser la situation et sécuriser le travail des signaleurs. Le gouvernement n'y a pas donné de suite. Québec doit agir rapidement pour mettre de l'ordre dans l'industrie de la signalisation », tonne la présidente de la section locale 9005 représentant les travailleur.euses de la signalisation routière, Nathalie Perron. » (tiré du site web Syndicat des Métallos | Unité et force pour les travailleuses et travailleurs (metallos.ca) )
Récemment, le gouvernement Legault a agi. Une publicité pour sensibiliser sur la situation des surveillants et surveillantes de chantiers routiers inonde les écrans de tv. Ce message se veut clair et pertinent avec une touche d'humour.
Mais l'effet reçu est tout autre.
Sur les routes au Québec
D'abord, l'insistance à parler des routes du Québec dans le contexte actuel de crise écologique, c'est prendre la défense de l'auto solo.
« Que ce soit pour aller travailler, faire nos courses ou nous rendre à nos activités favorites, le transport routier fait partie intégrante de nos vies. D'ailleurs, selon l'Institut de la statistique du Québec, le transport représente la deuxième dépense en importance des ménages québécois.
Le Québec possède un réseau routier important avec ses 185 000 kilomètres de routes. Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le nombre de voitures en circulation a augmenté de 2,1 % en moyenne par année entre 1978 et 2015. » (Tiré du site web https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/transport-routier/index.htm)
La notion de transport collectif n'est pas devenu un préoccupation dans l'ensemble de la population québécoise. La publicité gouvernementale a donc une bonne assise pour élaborer son message sur les routes. Mais cela corrrespond aussi à la philosophie du gouvernement. Il suffit de demander à Bruno Marchand :
« Je n'ai pas confiance en Mme Guilbault parce qu'il n'y a pas de vision pour la mobilité durable. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes […] Avec ça, on revient au Temps d'une paix. Ce n'est pas le Québec auquel je rêve », a lancé M. Marchand, en référence à cette populaire série québécoise campée dans l'entre-deux-guerres.
Le transport automobile est aussi une cause de pollution de l'air.
« Le transport routier est une source importante de polluants atmosphériques qui proviennent majoritairement des gaz d'échappement des voitures (Santé Canada). Les principaux polluants émis sont le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils (COV), les particules fines (PM2,5), le dioxyde de soufre (SO2) et l'ammoniac (NH3) (Santé Canada). Le transport routier est aussi une source non négligeable d'autres polluants comme certains métaux, le carbone noir (BC) et les particules ultrafines (PM0,1) (EPA). L'ozone (O3) est un autre polluant associé aux émissions routières. Cependant, il n'est pas directement émis dans l'atmosphère par le transport routier. Il est plutôt le résultat de réactions photochimiques entre des rayons ultraviolets (UV) et les NOx, le CO et les COV. » (tiré du site web https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/transport-routier/index.htm)
Donc, le message gouvernemental insiste sur les routes, en arrière plan les automobilistes, sans tenir compte de la pollution atmosphérique. Le contenu de la publicité n'abordera pas la nécessité du transport collectif pour lutter contre les effets de l'auto solo. Cela peut se comprendre dans le cadre du métier des surveillants et surveillantes routières. Le message ne s'élargira cependant pas non plus à la courtoisie, à la nécessité de ralentir lors de travaux, à faire preuve de patience, à penser au danger que subissent ces travailleurs et travailleuses.
Les routes du Québec
Certains et certaines y verraient une pointe d'humour pour caricaturer le PQ. D'autres y trouveraient le vernis nationaliste dont le gouvernement Legault veut se revêtir. Et certaines personnes penseraient que ce message est en fait une caricature du gouvernement Legault : environnement au banc, priorité aux routes et non au transport collectif, avec vernis nationaliste.
Mais qu'est ce que cela a à voir avec les surveillants et surveillantes routières ? Sinon un déplacement de ton, d'un message à saveur de santé publique et de santé sécurité au travail vers un message politique.
Et les contrôleurs et contrôleuses routières dans tout cela ?
Et voilà où le bât blesse. Les gens vont davantage se souvenir du message pour l'humour, la pointe nationaliste mais le problème des décès des travailleurs et travailleuses de la route passera sous le radar. Il y a pourtant là un grave problème de santé et sécurité au travail. Les gens meurent en travaillant.
C'est donc une sensibilisation publique qui passe à côté de son objectif. C'est en fait une insulte aux travailleurs-ses de chantier des routes.
Non seulement le gouvernement ne fait rien dans ce dossier, mais quand il le fait c'est un recul.
Chloé Matte Gagné
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Climat Québec déçu mais pas surpris du choix irrationnel la CDPQ-infra

Le choix de la vieille technologie complètement dépassée du tramway traditionnelle avec rails et fils est une hérésie qui s'explique seulement par le conflit d'intérêt de la Caisse comme actionnaire important d'Alstom.
La CDPQ a complètement ignoré la technologie du TSRi, Tramway Sans Rail intelligent proposée par Climat Québec qui permet le même confort, le même volume et la même rapidité que le tramway traditionnel mais à près de 4 fois moins cher que la proposition de la CDPQ. Le TSRi est implanté en France, en Chine, en Australie. Nous avons même une « start up » québécoise qui possède des brevets améliorant grandement les technologies chinoise et européenne mais la Caisse n'a même pas daigné l'inclure dans son tableau comparatif. Les surcoûts qu'implique le choix irrationnel de la Caisse devraient être payés par l'ensemble des contribuables québécois.
Climat Québec tient à souligner toutefois qu'au moins la vision présentée ne se limite pas à un axe est-ouest mais considère Lévis et les banlieues nord. Malheureusement, la Caisse a conservé l'axe René Lévesque au lieu d'aller sur Charest pour le transport structurant, probablement lié à leur choix de la technologie du tramway qui n'est pas du tout adapté aux côtes de Québec. Et du côté de Lévis, le lien structurant est repoussé à la phase 3, autant dire aux calendes grecques. De plus, le choix du tunnel, qui coûte une fortune, est encore lié aux limites de la vieille technologie du tramway. Encore des surcoûts que devraient assumer les contribuables.
Concernant le 3e lien, le rapport de la Caisse confirme ce que l'ensemble des experts avaient déjà exprimé et qu'Infoman avait démontré de façon éloquente que le besoin n'est pas présent et que cela ne ferait que déplacer le problème. Le 3e lien n'est qu'un hochet électoral qu'agite la CAQ depuis le début. La CAQ n'a plus aucune crédibilité dans ce dossier »
SOURCE :
climat.quebec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les grands gagnants de la crise du logement

Dans un contexte de crise aiguë du logement au Québec, un consensus semble avoir émergé quant à la nécessité d'accroître rapidement l'offre de logements. Pour résoudre la crise, le milieu des affaires préconise une stimulation sans contrainte de la construction résidentielle qui passerait par l'intensification de l'usage du sol, l'allégement de la réglementation et des contraintes au développement privé, et une modernisation de l'industrie de la construction. Ce plaidoyer, récemment repris par le gouvernement du Québec, sous-entend généralement que la crise du logement est un phénomène récent ayant émergé durant la pandémie de COVID-19. En nous appuyant sur des statistiques sur l'investissement résidentiel et les revenus découlant de cette activité au cours des 20 dernières années, nous constatons plutôt qu'en dépit des nombreuses contraintes desquelles elle se dit accablée, l'industrie de l'immobilier résidentiel s'en sort très bien.
Faits saillants
L'actuelle crise du logement n'est pas un phénomène récent et les statistiques des 20 dernières années révèlent que les causes du problème doivent être cherchées ailleurs que dans un déficit d'investissement causé par une réglementation trop contraignante.
Au cours des deux dernières décennies, alors que la crise du logement prenait de l'ampleur, l'investissement résidentiel a connu une croissance très importante, notamment dans le marché hypothécaire et dans la construction résidentielle.
Dans cinq grandes villes du Québec, la construction résidentielle a suivi, voire surpassé, la croissance du nombre de ménages et l'investissement privé « par porte » (par nouveau logement) n'a pas semblé affecté par la hausse du prix des terrains et des coûts de construction.
Les très faibles taux d'inoccupation observés dans ces villes semblent davantage s'expliquer par des choix d'investissement qui ont systématiquement privilégié la propriété lucrative au détriment du logement locatif financièrement accessible (social et privé).
La rentabilité des investissements dans la propriété locative, la construction et le marché hypothécaire s'est soit maintenue à des niveaux appréciables ou a considérablement augmenté.
Sans remettre en question le besoin de construire davantage de logements, et plus rapidement, pour répondre à la crise du logement, les constats présentés dans cette note nous obligent à repenser les modèles d'investissement et de développement résidentiels qui ont prévalu jusqu'ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur la nécessité d’une cible ambitieuse

D'après l'article 14 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le gouvernement doit établir dans chacun de ses plans d'action des cibles d'amélioration du revenu pour les personnes assistées sociales et les travailleurs et travailleuses pauvres. Lors de l'étude des crédits budgétaires, le 25 avril dernier, la ministre Rouleau a affirmé qu'il y aurait « certainement » de telles cibles dans le quatrième plan d'action.
Tiré de Soupe aux cailloux NO 467 13 juin 2024
Fixer des cibles
Est-il permis d'espérer que ces cibles seront moins ridi-cules que les cibles du dernier plan d'action ? Pour rappel, le troisième plan d'action fixait deux cibles d'amélioration du revenu. La première était de sortir 100000 personnes de la pauvreté. La seconde était d'augmenter le revenu disponible des personnes assistées sociales considérées comme sans contraintes à l'emploi (celles qui touchent de l'Aide sociale) afin qu'il corresponde à 55% du seuil de la Mesure du panier de consommation (MPC).
100000 personnes
Le gouvernement comptait principalement sur la mise en place du programme de Revenu de base pour sortir 100000 personnes de la pauvreté. Le 3e plan d'action pré-voyait que les personnes avec des contraintes à l'emploi sévères de longue durée auraient, une fois le Revenu de base mis en œuvre, un revenu disponible équivalent au seuil de la MPC — soit environ 24200$ à l'heure actuelle.
Un an après l'entrée en vigueur de ce programme, on constate toutefois que leur revenu disponible n'atteint toujours pas le seuil de la MPC. Même si le revenu disponible des prestataires du Revenu de base était actuellement à la hauteur de la MPC, il ne leur permettrait pas pour autant de sortir de la pauvreté, la MPC n'étant pas officiellement un indicateur de sortie de pau-vreté (du moins au Québec, car du côté du gouvernement fédéral, c'est une autre histoire). La MPC indique plutôt le revenu nécessaire pour couvrir les besoins de base. Comme le répète depuis longtemps le Collectif, couvrir ses besoins
Revenu disponible du programme de Revenu de base, 2024 de base, ce n'est pas suffisant pour sortir de la pauvreté.
Prestations 19524 $
Crédit d'impôt pour solidarité 1 221$
Crédit TPS 340$
Revenu disponible 21085 $
% de la MPC
87 %
Même si le revenu disponible des prestataires du Revenu de base était actuellement à la hauteur de la MPC, il ne leur permettrait pas pour autant de sortir de la pauvreté, la MPC n'étant pas officiellement un indicateur de sortie de pau-vreté (du moins au Québec, car du côté du gouvernement fédéral, c'est une autre histoire). La MPC indique plutôt le revenu nécessaire pour couvrir les besoins de base. Comme le répète depuis longtemps le Collectif, couvrir ses besoins de base, ce n'est pas suffisant pour sortir de la pauvreté.
Vivre hors de la pauvreté, c'est entre autres pouvoir faire face aux imprévus. C'est aussi avoir une plus grande liberté de choix économique.
55%
En 2024, le revenu disponible des personnes au programme d'Aide sociale correspond à 46% de la MPC. On est donc encore loin de la cible de 55% que le gouvernement s'était donnée. Il y a quelque chose de scandaleux dans le fait de s'être fixé une cible qui maintient les personnes assistées sociales en état de grande pauvreté. Mais plus scandaleux encore, c'est le fait de ne pas avoir atteint cette cible ridicu-lement basse !
Revenu disponible du programme d'Aide sociale, 2024, personne seule
Prestations 9684$
Crédit d'impôt pour solidarité 1 221$
Crédit TPS 340$
Revenu disponible 11 245 $
% de la MPC 46 %
La MPC comme cible urgente à atteindre
Le gouvernement doit voir au respect des droits sociaux et économiques des personnes en situation de pauvreté en leur assurant un revenu au moins égal à la MPC. Tout le monde devrait avoir un revenu suffisant pour pouvoir se loger convenablement, se nourrir suffisamment, se vêtir et se déplacer. On parle ici d'un minimum vital, d'un simple premier pas vers l'élimination de la pauvreté.
Malheureusement, tout porte à croire que ce n'est pas l'atteinte de cette cible qui guide le gouvernement dans l'élaboration de son 4e plan de lutte contre la pauvreté.
Comme le budget du Québec 2024-2025 prévoit quatre fois moins d'argent pour le prochain plan d'action que pour le précédent, il serait surprenant d'y retrouver des
mesures qui auront un impact à la fois immédiat et à long terme sur les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec doit être sans but lucratif

La Coalition Solidarité Santé interpelle aujourd'hui, le 13 juin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'adresse aux membres et aux partenaires de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Nous le mettons en garde, le réseau de la santé n'est pas à vendre.
L'autrice est coordonnatrice de la Coalition solidarité santé.
Ces conférences lui offrent, sans surprise, une occasion pour rallier le secteur privé et, ainsi, vampiriser encore davantage le réseau public en prétendant faussement le sauver. La nouvelle équipe de direction de Santé Québec, dont les maillons forts proviennent du milieu des affaires, en est à nos yeux une démonstration éloquente.
Pour notre Coalition, les intentions du gouvernement sont claires et alignées sur les intérêts pécuniaires de la CCMM. Or, la privatisation et la marchandisation de nos services publics qui s'opèrent depuis plus de 20 ans laissent les citoyennes et citoyens avec des problèmes d'accessibilité croissants. Pendant ce temps, les questions et les solutions provenant de la société civile demeurent ignorées.
Priorité
Nous avons le droit de savoir ce que comptent faire le ministre et le gouvernement de notre système public de santé. Pourquoi ne s'engagent-ils pas formellement à consolider prioritairement notre réseau public, le seul à pouvoir assurer un accès équitable aux soins et aux services de santé et à répondre adéquatement en contexte de crise sanitaire ?
Rappelons que malgré la venue de l'Agence Santé Québec, le ministre Dubé conserve la responsabilité de déterminer les priorités, les objectifs et les orientations du réseau de la santé et des services sociaux. De plus, lors de l'étude du projet de loi no 15 en commission parlementaire, tous les amendements et toutes les propositions visant à préserver et à renforcer notre réseau public ont été ignorés. Le ministre a refusé que le texte de la loi prévoie les éléments suivants :
– Priorisation de l'offre de services des établissements publics par Santé Québec ;
– Droit de la population québécoise à la gratuité des services de santé et des services sociaux ;
– Inclusion des principes d'accessibilité et d'universalité des services ;
– Octroi de ressources suffisantes aux établissements publics pour l'atteinte de leurs objectifs ;
– Maintien et développement de l'expertise publique par Santé Québec.
Questions
Encore plus préoccupant, le ministre a refusé d'enchâsser dans la loi que Santé Québec soit à but non lucratif. Est-ce parce que le ministre envisage vendre nos données de santé ? Souhaite-t-il implanter de nouvelles tarifications de services ? Permettra-t-il la facturation de services par des partenaires privés qui devront payer des contributions à Santé Québec pour que celle-ci verse par la suite des dividendes au gouvernement, un peu comme doit le faire Hydro-Québec ? N'est-ce pas dans le rôle d'une société d'État ? Est-ce que de nouveaux partenariats public-privés sont envisagés ? Nous exigeons des réponses à nos questions.
Moins le Québec finance adéquatement son réseau public, plus il ouvre la porte au secteur privé, moins nous avons accès à des soins efficaces et plus notre facture collective augmente. Si le ministre ne fait pas cette équation, qu'il sache que la société civile l'a faite et que de plus en plus de citoyens en sont aussi conscients.
Le secteur de la santé et des services sociaux ne doit pas devenir une stratégie de développement économique au détriment de la santé des citoyens du Québec. Le ministre nous demande de croire aveuglément à l'efficacité du secteur privé en santé, laquelle n'a jamais été démontrée. Pour la société civile, tant que le ministre ne se positionnera pas différemment, il permet au secteur privé en santé de maximiser ses profits en tant que marchand de la maladie.
Monsieur Dubé, vous n'avez pas été élu par la chambre de commerce. Une telle façon de faire est totalement antidémocratique. C'est le temps de préciser que Santé Québec n'est pas à but lucratif !
Sophie Verdon, Coordonnatrice, Coalition Solidarité Santé
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gabriel Nadeau-Dubois et Québec Solidaire : Après le « pragmatisme », le « populisme » ?

« Proche du monde » (Déclaration de Saguenay), « Pour une gauche au service des gens » (Le Devoir, 21 mai 2024), les slogans dernière mouture de QS brillent par leur ambiguïté et leur double sens malgré leur apparente simplicité, voire le simplisme du message qu'ils veulent transmettre.
Tout le monde semble d'accord pour dire que, en politique, le choix des mots utilisés est d'une grande importance parce qu'ils recèlent toujours une double signification : le sens « littéral » (premier degré de signification) et le sens « non-littéral » (deuxième degré de signification). Quand GND titre son article dans Le Devoir du 21 mai dernier : « Pour une gauche au service des gens », il dit deux choses en même temps même s'il semble n'en affirmer qu'une. D'abord, le sens « littéral » (le premier degré) du slogan va de soi ; GND, co-porte-parole de QS, un parti de « gauche », tient à ce que l'électorat sache que lui et son équipe sont entièrement disponibles, que leur raison d'être est de « servir » la population. Normal pour une formation politique qui aspire au pouvoir dans une démocratie parlementaire et qui doit, pour cela, briguer les suffrages.
Mais il y a un deuxième sens, sous-jacent (le deuxième degré), qui pose problème car, sans le dire explicitement, il renvoie à cette idée reçue que, traditionnellement, dans sa culture même et dans sa pratique, la gauche n'est pas au service des gens et qu'avec l'arrivée de QS sur la scène politique provinciale, les choses vont changer. Au service de quoi est-elle donc ? peut-on alors se demander. On est face au même problème avec le mot d'ordre de la Déclaration de Saguenay : « Proche du monde ». De quel « monde » s'agit-t-il exactement ? Qui fait partie de ce « monde » et qui n'en fait pas partie ? Encore là, cette façon d'inaugurer un Conseil National draine avec elle son lot de non-dits et laisse transparaître une intention qui n'a rien d'« innocent » car, comme on l'a dit plus haut, aucune prise de parole « officielle » n'est neutre et sans conséquences sur le plan politique.
Ce qui se profile devant les instances du parti depuis la déception électorale de 2022, c'est un attrape-nigaud qui a pour nom « électoralisme », « marketing », « auto-flagellation » sur la place publique où on s'excuse d'être à gauche et où on veut à tous prix rassurer les Québécois-es et les médias sur la non-dangerosité de QS. Tous ces slogans, ces interventions médiatiques, ces mises au point idéologiques, bref cette volonté affichée de recentrement s'inscrit dans une soi-disant « nécessité » de diluer les principes progressistes du programme, de les homogénéiser, de les rendre plus acceptables et digestibles pour la majorité dont a besoin une formation politique pour « gouverner », étant donné que GND a décrété l'« urgence » de prendre le pouvoir pour régler les graves problèmes qui nous affectent collectivement (environnement, logement, coût de la vie, inégalités, appauvrissement généralisé, etc.)
À moins d'avoir une baguette magique pour renverser la situation, les problèmes sont devenus « chroniques » parce qu'à la base, ils sont « structurels » et que la grande majorité des politicien-nes n'ose s'y attaquer sérieusement (à part la traditionnelle et répétitive déclaration de vœux pieux qui ne va pas plus loin que le banc des député-es et ministres qui les incantent pour soigner leur image). Car ce faisant, ils et elles s'attaqueraient aux fondements même de leurs privilèges de classe et/ou à l'essence même de leur vision du monde (sans parler d'une large part de la population qui rechigne déjà à l'idée d'adopter un autre mode de vie ─ plus frugal, moins consumériste, moins trépidant, moins battant, plus convivial, plus détendu et réflexif). Un tel exercice d'auto-critique et d'auto-réflexion serait beaucoup leur demander. Même un changement « pas-si-révolutionnaire-que-ça » (la réforme du mode de scrutin) est toujours remis aux calendes grecques pour des raisons délibérément « corporatistes » et « opportunistes » qu'on ne prend même pas la peine de cacher sous d'autres considérations plus « vertueuses »…
Précisons que tout ce qui vient d'être mentionné s'inscrit dans ce qui « est » (tous les obstacles à franchir pour atteindre nos objectifs) et non dans ce qui « devrait être » (QS au pouvoir, élu à la majorité, avec les coudées franches pour appliquer son programme). Il est important de rappeler que l'essentiel consiste dans les Idées, les Valeurs, les Projets qui animent QS et non le parti lui-même (il n'est qu'un véhicule). Cela étant entendu, il vaut mieux un Québec dirigé par des réactionnaires obligés de faire de « vraies » concessions à gauche à cause d'une forte opposition, bien structurée et organisée, avec une solide base populaire et citoyenne qui appuie concrètement les initiatives des progressistes au Parlement plutôt qu'un mandat solidaire, mi-figue, mi-raisin, dont les représentant-es seront lié-es par leur positionnement centriste et redevables de leur engagement à ne pas trop brasser la cage. Si la stratégie de GND s'avère fructueuse (ce qui est peu probable), il risque de se retrouver piégé et d'être en porte-à-faux avec ses véritables intentions, obligé de souffler à la fois le chaud et le froid.
Dernière considération : le contexte international. L'extrême-droite se rapproche de plus en plus dangereusement du pouvoir (législatif et présidentiel) en France. Aux États-Unis, Donald Trump a de sérieuses chances de remplir un deuxième mandat (autant sinon plus chaotique que le premier). Au Canada, malgré (ou grâce à) sa vulgarité, Poilievre est un sérieux candidat à la succession de notre Justin national dont le charme enjôleur ne séduit plus personne depuis longtemps. Et chez nous, le Parti Conservateur d'Éric Duhaime, fervent défenseur d'une économie libertarienne (à la sauce anarcho-capitaliste), frappe aux portes de l'Assemblée Nationale avec, derrière lui (sauf mon respect), tout ce que le Québec profond peut receler de « ploucs » en mal de « libârté ». Notre petit Peuple n'est pas imperméabilisé à tous ces courants dominants qui parcourent la planète dans tous les sens. Qu'ils soient au pouvoir ou non, les Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal et autres Christine Labrie devront faire avec.
Une note d'espoir pour terminer : Même s'il est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer avec certitude, certain-es analystes prévoient un prochain gouvernement péquiste minoritaire. Ce qui signifie que QS pourrait bénéficier de la balance du pouvoir. Étant donné que les deux partis souverainistes ont des atomes crochus, ce serait l'occasion de faire adopter des projets de lois « progressistes » (environnement, logement, santé, mode de scrutin) en échange, peut-être, de certaines concessions quelque peu « crève-cœur ». On n'a jamais rien pour rien, surtout dans un système politique partisan…
Mario Charland
Shawinigan
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











