Derniers articles

Hydro-Québec, base de notre indépendance

Samedi le 8 juin dernier, le Mouvement Québec Indépendant organisait une conférence sur la politique énergétique du gouvernement de la CAQ. « Aujourd'hui on assiste à un mouvement inverse où s'accélère le processus de privatisation de notre production électrique. Alors que la question de l'indépendance revient à l'avant-scène politique en vue de l'élection de 2026, peut-on faire l'indépendance en continuant ainsi de dilapider notre principale richesse naturelle ? Poser la question c'est y répondre. »
Nous avons retenu deux présentations : celle de Robert Laplante qui a brossé l'historique du « processus de privatisation et qui en a souligné les impacts négatifs majeurs » et celle de Martine Ouellet qui a mis « en évidence le front de résistance en train d'émerger actuellement en faveur du maintien d'Hydro-Québec sous le contrôle public. »
-
-
-
Robert Laplante
-
-
-
-
-
Martine Ouellet
-
-
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : Les citoyen.nes s’organisent

Le Comité Action Citoyenne - Projet Northvolt, un groupe de citoyennes et citoyens bénévoles ayant à cœur, comme vous tous, de protéger la SANTÉ, la VIE et le VIVANT, vient de lancer une campagne de sociofinancement. Notre objectif est de recueillir 20 000$.
2024/06/05 | Par Collectif
Les fonds serviront dans un premier lieu à ce que des prises d'échantillons citoyens, sous la supervision d'un expert, soient faites selon les méthodes scientifiquement reconnues et que ces échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant, afin que l'entreprise et le gouvernement n'aient d'autre choix que de reconnaître les résultats.
Cette levée de fonds vise aussi la création d'un fonds générationnel pour assurer une surveillance citoyenne pour la santé et le bien être des générations à venir, car cette surveillance citoyenne devra avoir lieu sur une base continuelle pour de nombreuses décennies
Dans un deuxième temps ces fonds serviront à consulter un avocat spécialisé en droit municipal afin de savoir exactement comment et pourquoi le droit fondamental à un référendum nous a été enlevé et comment nous pouvons être assuré.es que les décisions présentes et futures dans le projet en cours, suivent les procédures normales et surtout légales. Nous voulons aussi obtenir les avis légaux nécessaires pour que la démocratie de notre société soit respectée et protégée.
Nous avons besoin de votre soutien afin de protéger notre source d'eau potable. Pour contribuer, cliquez ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Retour sur l’événement L’égalité en action

Après Paris (2014), New Delhi (2017) et Mayence (2019), c'est à Montréal que s'est tenu le Congrès pour mettre fin à l'exploitation sexuelle organisé par CAP International et quatre organisations nord-américaines, dont la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES).
Martine B. Côté
doctorante en Droit, UQAM, coautrice de Faire corps, Éditions Atelier 10
L'événement a commencé le samedi 1er juin par la toute première marche mondiale des survivantes de la prostitution, organisée par le Réseau international de survivantes SPACE International. Parties de la place Emilie -Gamelin, les 250 personnes réunies ont fait des arrêts à plusieurs endroits stratégiques : la Cour municipale, l'Hôtel de ville et le Palais de justice. Sur les pancartes, on pouvait lire des messages réclamant l'adoption et l'application du modèle nordique en matière de prostitution, c'est-à-dire la décriminalisation des femmes en situation de prostitution et la criminalisation des proxénètes et des clients. Des groupes de Suède, le premier pays à avoir adopté ce cadre législatif, étaient présents ainsi que des groupes et des survivantes notamment venus de France, d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, des États-Unis et de la Belgique.
Le congrès s'est ouvert par un panel intitulé Femmes et filles autochtones en Amérique du Nord : le système prostitutionnel comme continuation des oppressions historiques. Les panélistes-survivantes ont été chaudement applaudies par la salle après des prises de parole souvent chargées d'émotions. Le public a notamment pu entendre la juriste américaine Catharine Mackinnon, l'avocate française Lorraine Questiaux, qui a raconté son combat pour les victimes de pornographie, la sénatrice canadienne indépendante Julie Miville-Dechênes, Suzanne Jay, de Asian Women for Equality, la députée socialiste espagnole Andrea Fernández Benítez, venue parler de ses tentatives de faire adopter des lois contre le proxénétisme ainsi que de nombreuses intervenantes-survivantes, dont Amelia Tiganus (Présidente de FEMAB) Melanie Thomson, de l'organisme Coalition against trafficking and women (CATW) et Luba Fein (Voices of Israeli Sex trade Survivors).
La Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles, Reem Alsalem a été ovationnée après la présentation de son rapport, rédigé à la suite de l'audition de plus de 300 témoignages d'organisations et de personnes provenant des deux courants idéologiques sur la question de la prostitution. Son rapport décrit la prostitution comme un système d'exploitation et une forme globale de violence masculine contre les femmes et les filles qui recoupe d'autres formes de discrimination structurelle. Elle appelle notamment à adopter le cadre juridique abolitionniste et ses cinq piliers : décriminalisation des femmes en situation de prostitution ; fourniture d'un soutien complet et de voies de sortie ; criminalisation de l'achat d'actes sexuels ; criminalisation de toutes les formes de proxénétisme ; et organisation de campagnes de sensibilisation en direction des acheteurs d'actes sexuels.
L'événement s'est conclu par une déclaration pour appeler à instaurer une société d'égalité et de justice sociale, une société sans prostitution. Rédigé par des survivantes de la prostitution, des femmes autochtones, des militantes féministes, des travailleuses de terrain, des représentantes syndicales et des juristes, la déclaration a déjà été signée par une cinquantaine d'organisations dans le monde.
Au final, ce sont plus de 400 participant.e.s venus de plus de 35 pays différents qui se sont regroupés pendant trois jours à Montréal. La 5e édition aura lieu dans deux ans dans un pays qui sera annoncé ultérieurement.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Ne nous sauvez pas, on s’en charge ! »

Une cinquantaine de personnes ont répondu aujourd'hui à l'appel du Comité autonome du travail du sexe (CATS) et ont manifesté en réponse à une marche appelée par la Coalition Abolition Prostitution et SPACE International. Les manifestant.e.s critiquent la tenue d'un congrès pour l'abolition de la prostitution cette fin de semaine dans la métropole, dont la marche s'inscrit à la programmation. Le CATS revendique plutôt la décriminalisation du travail du sexe et des droits du travail pour combattre les violences dans l'industrie.
« La police ne règle pas la violence dans l'industrie du sexe ! »
Contrairement aux demandes des organismes impliqués dans le congrès, le CATS affirme que davantage de criminalisation des milieux de travail pénalise de fait les travailleuses du sexe. « Si mon patron est criminalisé, comment je peux faire pour dénoncer les abus sans perdre mon emploi ? Les travailleuses du sexe ne veulent pas vivre de violence au travail, mais elles veulent pouvoir garder leur boulot ! » fait valoir Adore, qui est travailleuse du sexe et militante au CATS. Selon elle, les dénonciations de conditions abusives dans le modèle actuel mèneraient à l'arrestation du patron pour proxénétisme et à la fermeture de son milieu de travail. « La police qui rentre dans un milieu de travail, ça peut aussi mener à la déportation des travailleuses migrantes. » rajoute-t-elle.
« Il faut se rappeler que ces organisations défendent un modèle déjà en vigueur depuis dix ans ; pourtant on continue de vivre des violences au quotidien. Elles prétendent qu'on ne subit pas les impacts de la criminalisation, mais c'est faux. On est criminalisées dès qu'on veut travailler à plusieurs », affirme sa collègue Cherry. Le Canada a adopté en 2014 la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Cette loi est inspirée du modèle scandinave, revendiquée partout dans le monde par les féministes anti-prostitution. La loi criminalise les clients et toute personne tirant profit du travail sexuel d'autrui.
La décriminalisation et des droits du travail
Le comité propose plutôt que le travail du sexe soit décriminalisé pour que les travailleuses puissent s'organiser en syndicats. Melina, aussi militante au CATS, pense que ce serait la solution pour améliorer ses conditions de travail. Elle fait valoir que cela permettrait de dénoncer les employeurs abusifs via des mécanismes légaux et d'obtenir des compensations monétaires, tout en bénéficiant d'une sécurité d'emploi. « Si on pouvait s'organiser ensemble contre les abus des patrons, ça ferait une grande différence, mais en ce moment c'est difficile parce que les collègues ont peur que ça fasse des problèmes avec la police » avoue-t-elle.
Comité Autonome du travail du sexe
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 69 : vers la fin du monopole d’Hydro-Québec sur la distribution d’électricité ?

Le gouvernement de la CAQ a déposé aujourd'hui un projet de loi sur le cadre réglementaire entourant la production et la distribution d'énergie au Québec. Parmi les modifications législatives prévues, on retrouve la mise en place d'un modèle favorisant la production et la vente d'électricité par des producteurs privés. Que faut-il comprendre de cette plus grande place faite au privé et quels sont les objectifs poursuivis par la CAQ ? Ce billet jette un éclairage sur cet aspect spécifique du projet de loi, dont les autres dimensions (politique tarifaire et industrielle, pouvoir et gouvernance, etc.) seront abordées dans des interventions futures de l'IRIS.
Colin Pratte est chercheur à l'IRIS.
6 juin 2024 | tiré du site de l'IRIS
https://iris-recherche.qc.ca/.../reforme-hydro-quebec.../...
Description du modèle actuel et de la modification envisagée
Contrairement à une idée reçue, la société Hydro-Québec ne détient pas le monopole de la production d'électricité. En effet, 17% de l'électricité produite au Québec est de source privée. Par exemple, les installations hydroélectriques de Rio Tinto Alcan représentent environ 5% de la puissance hydroélectrique d'Hydro-Québec. L'aluminerie utilise l'énergie produite pour ses propres besoins industriels.
À l'heure actuelle, les surplus que les producteurs privés ne consomment pas sont obligatoirement achetés par Hydro-Québec Distribution, qui détient le monopole de la vente d'électricité. Le schéma ci-dessous illustre le modèle actuel.

Source : Éric Pineault, « Appropriation énergétique des territoires et capacité de planification », présenté dans le cadre du webinaire HEC-UQÀM Quelle place à la production privée et à la vente libre d'électricité dans la transition au Québec ?, 13 mars 2024, en ligne, https://www.youtube.com/watch?v=3LMovII5TRY.
Le projet de loi déposé aujourd'hui modifie cette prérogative et permet à des producteurs privés de vendre par eux-mêmes de l'électricité à des consommateurs privés adjacents au site de production d'électricité. La CAQ facilite ainsi la création d'un marché de production et de vente de gré à gré dont la société d'État Hydro-Québec est exclue. Le schéma ci-dessous illustre cette libéralisation.

Source : Éric Pineault, « Appropriation énergétique des territoires et capacité de planification », présenté dans le cadre du webinaire HEC-UQÀM Quelle place à la production privée et à la vente libre d'électricité dans la transition au Québec ?, 13 mars 2024, en ligne, https://www.youtube.com/watch?v=3LMovII5TRY.
Faire comme l'Alberta ?
Le projet de loi déposé aujourd'hui, dont l'objectif est de transformer le cadre réglementaire entourant la distribution et la production d'électricité au Québec de manière à attirer des investissements privés, s'inspire du modèle développé en Alberta. Dans cette province, le secteur de l'électricité est libéralisé, c'est-à-dire que la production et la distribution sont contrôlées par des entreprises privées, à l'instar de l'époque pré-nationalisation au Québec. Cette volonté de s'inspirer du modèle albertain en dépit de ses échecs est questionnable, mais n'étonne pas : tout indique au contraire qu'il s'agit du modus operandi de la CAQ en matière de réforme des services publics. Par exemple, la réforme Dubé du réseau de la santé et la création de l'agence Santé Québec est un copier-coller du modèle albertain, malgré l'existence d'une documentation étoffée sur les faillites de cette approche centralisatrice.
Quels objectifs poursuit la CAQ ?
Les modifications réglementaires proposées dans le projet de loi 69 ont pour objectif d'attirer des capitaux privés afin d'augmenter les investissements dans la production d'électricité renouvelable et ainsi augmenter la capacité du Québec à accueillir des entreprises désireuses de développer des projets industriels alimentés en énergies renouvelables. Le but est d'accroître la production d'électricité sans engager les fonds publics colossaux requis. Cette approche s'appuie sur deux piliers principaux : (1) élargir l'accès du secteur privé à la possibilité de réaliser des profits sur la vente d'électricité ; et (2) laisser au secteur privé les gisements électriques (gisements éoliens, remplacement de turbines de barrages) les plus intéressants sur le plan commercial afin de stimuler des investissements. À ce titre, les crédits d'impôt remboursables du gouvernement fédéral pour la production d'énergies renouvelables stimulent les investissements privés dans ce secteur, tel que le projet de production d'hydrogène par énergie éolienne de l'entreprise TES Canada, en Mauricie.
La société Hydro-Québec, troisième plus grande entreprise d'hydroélectricité au monde, dispose pourtant d'une partie des leviers financiers nécessaires pour engager des investissements dans de nouvelles infrastructures ou pour la rénovation des infrastructures existantes. Le fait qu'elle doive remettre à l'État 75% de ses bénéfices annuels, plutôt que 50% comme c'était le cas jusqu'en 2008, amoindrit cependant sa capacité d'investissement. De plus, au lieu de mobiliser ces fonds pour faire des investissements structurants, la CAQ entend s'en remettre à des capitaux privés pour financer en partie le plan d'action d'Hydro-Québec, qui prévoit des investissements additionnels de 180 milliards $ d'ici 2035.
Les entreprises privées du secteur de l'énergie et le précipice écologique
En permettant à des entreprises privées de produire et de vendre de l'électricité de façon autonome sur le territoire québécois, la CAQ empêche la planification de la transition énergétique et l'allocation de cette ressource publique à des fins de viabilité tant écologique qu'économique. Pour la CAQ, l'apparition d'un champ d'éoliennes privé alimentant une usine voisine de batteries destinées à propulser des VUS électriques est synonyme de développement économique et de transition. Or, il s'agit d'une politique énergétique et industrielle de courte vue qui repousse le moment d'une véritable transition écologique. La libéralisation du marché de production-distribution d'électricité rend difficile la planification publique de la consommation des ressources d'électricité, qui doit avant tout être guidée par des principes de diminution de la consommation énergétique.
La plus grave crise de l'histoire des sociétés humaines — la crise écologique et les changements climatiques — est causée en grande partie par le fait que le secteur névralgique de l'énergie a été laissé aux mains de grandes entreprises fossiles, qui l'ont alors réduit à une occasion d'affaires, en dépit des conséquences écologiques de cette approche. Le développement des bien mal nommées « énergies renouvelables », qui demeurent dépendantes de ressources rares, doit au contraire absolument être affranchi de la logique de profitabilité et orienté vers la transition énergétique ainsi que la diminution de la demande énergétique.
Conclusion : la privatisation de la transition
La CAQ considère la transition énergétique comme une occasion d'affaires et met de l'avant une politique énergétique qui favorise la surconsommation d'électricité. Or, la sortie des énergies fossiles, dont la consommation énergétique québécoise demeure dépendante à 50%, implique plus que jamais de conserver le caractère public du secteur de l'électricité au Québec, afin d'en faire un outil de transition écologique et de planification économique. Tout indique que le projet de loi déposé aujourd'hui nous en éloigne.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Répression du droit de manifester et brutalité policière à Québec lors des actions du 1er juin pour le droit à l’avortement

Québec, 10 juin 2024- Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN), la Coalition pour le droit de manifester à Québec ainsi que la Ligue des droits et libertés - section de Québec (LDL-Qc) joignent leurs voix pour dénoncer la répression du droit de manifester ainsi que la brutalité policière du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) lors des actions pour le droit à l'avortement du 1
er juin 2024.
Le samedi 1er juin, sur l'heure du dîner, quelques centaines de manifestant·es se sont rendu·es devant le Parlement pour faire du bruit en marge du rassemblement anti-avortement organisé par la Campagne Québec-Vie. À peine 5 minutes après leur arrivée, une travailleuse du RGF-CN, une des organisatrices de l'action, s'est fait violemment maîtrisée et remettre une contravention pour avoir traversé la rue.
De plus, vers 14h30, une quinzaine de minutes seulement après l'arrivée de la manifestation Riposte Pro-choix devant l'Assemblée nationale les forces de police ont expulsé et escorté l'ensemble des manifestant·es pro-choix jusqu'au boulevard René-Lévesque, pour laisser la zone de manifestation aux militants anti-avortement. Le SPVQ était pourtant bien informé de cette action. Le cordon de police a été rapide et
brusque avec les manifestantes pro-choix : elles ont été bousculées, levées de force de la pelouse, etc.
« La LDL-Qc est profondément troublée par la restriction de la liberté d'association et de réunion pacifique des citoyen·nes qui s'étaient réuni·es à Québec pour réitérer l'importance du droit à l'avortement. L'organisme exprime sa plus haute consternation devant la brutalité et la disproportionnalité des gestes posés par le SPVQ lors de l'arrestation d'une des organisatrices. Elle joint sa voix au mouvement de dénonciation présentement en cours pour exiger des autorités de faire la lumière sur les événements du 1er juin. La Ville de Québec et le SPVQ doivent s'engager à renverser la tendance dangereuse à museler et judiciariser les mouvements sociaux », rappelle Sophie Marois de la Ligue des droits et libertés - section de Québec
« Je ne pouvais plus bouger mon bras, qui était maîtrisé à l'arrière de mon dos. C'était douloureux. Pourquoi le policier a-t-il refusé de me parler lorsque je l'ai abordé dès notre arrivée pour lui expliquer le déroulement de notre action ? Pourquoi cette contravention alors que la rue était alors fermée à la circulation ? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit que j'étais en état d'arrestation ? » s'insurge Anne-Valérie Lemieux Breton du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. « Alors que nous étions présentes pour dénoncer les tentatives de contrôle du corps des femmes et des personnes trans, la police - composée majoritairement d'hommes - a fait le choix de nous interdire l'occupation de l'espace public et d'utiliser la violence pour nous faire taire. Leur choix était fait : protéger et laisser toute la place aux anti-choix ».
« Je n'aurais jamais pensé vivre tant d'insécurité dans une manifestation et encore moins que celle-ci serait causée par le comportement de la police. Alors que des discours anti-avortement résonnaient, un policier m'a menacée d'arrestation parce que je sifflais trop fort ! Alors que je jasais avec des amies dans un parc à plus de 500 mètres de la scène, une dizaine de policiers nous ont intimées de quitter l'endroit afin de ne pas déranger les anti-choix qui revenaient. Malgré mes questions, ils n'ont fait référence à aucun règlement justifiant notre expulsion. Plus tard, j'ai compté 24 policiers qui nous entouraient, comme si c'était nous les dangereux-ses, alors que sur la scène un homme vociférait des propos violents envers les femmes ayant eu recours à un avortement ! C'était surréel et intimidant ! », dénonce Naélie Bouchard-Sylvain du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.
« Je m'étais retirée de la manif pour rejoindre des personnes à l'autre extrémité du parlement. On est trois filles assises, bien zen, à se mettre à jour sur nos vies, et en quelques minutes, il y a un cercle de policiers autour de nous. L'image est quand même forte, nous en bas, eux debout, en hauteur, plus nombreux et imposants. On
repassera pour le sentiment de sécurité. Quel message tordu ça envoie aux anti-choix et à la société québécoise en général ? “Gênez-vous pas les boys pour revenir l'année prochaine, on sera vos gardes du corps privé, on va sortir de force toutes les opposantes à votre mission divine pour que vous vous sentiez bienvenus !” Parce que c'est ça qui s'est passé : ils se sont mis à deux pour me lever de terre et nous forcer à partir », dénonce Marie-Hélène Fortier de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF).
Le 18 juin 2024, la Coalition pour le droit de manifester à Québec organise un rassemblement devant l'Hôtel de Ville de Québec pour dénoncer le recul du droit de manifester avec notamment l'adoption par l'administration Marchand il y a près d'un an du Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie
publique (R.V.Q. 2817).
Pour information :
Catherine Gauthier, Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale
Josyanne Proteau, Ligue des droits et libertés (section de Québec) :
Vania Wright-Larin, Coalition pour le droit de manifester à Québec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Europe - Qui sème des politiques d’extrême droite... récolte des politiques d’extrême droite

Ce dimanche, les élections européennes se sont achevées et ont permis d'élire les députés européens qui composeront la dixième législature. Il n'est jamais inutile de rappeler que ces élections sont l'occasion de renouveler la structure de gouvernance de l'UE (Parlement et Commission européenne). Pour tenter d'éviter l'image d'un appareil bureaucratique hiérarchisé et peu contrôlé démocratiquement, répondant à un équilibre des pouvoirs étatiques fondé sur l'hégémonie de l'axe Berlin-Paris. Ce processus s'achèvera, quelques mois plus tard, par la ratification par le Parlement du président de la Commission européenne et du collège des commissaires préalablement négociés par les États membres.
Tiré de Inprecor 721 - juin 2024
10 juin 2024
Par Miguel Urbán Crespo
Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
Les progrès de l'extrême droite
Le fait le plus marquant de cette élection est peut-être la progression de l'extrême droite, qui consolide une droitisation de l'UE qui couvait depuis longtemps. La dispersion actuelle de l'extrême droite, en trois groupes au Parlement européen, brouille l'image de son résultat électoral, mais on ne peut ignorer qu'elle a été la deuxième force ayant obtenu le plus de voix en Europe, avec un peu plus de 20 % des suffrages, devant les sociaux-démocrates. Ainsi, l'extrême droite a réussi à devenir la première force en : Italie, France, Hongrie, Belgique, Autriche et Pologne, et la deuxième force en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis que le Parti socialiste européen n'a réussi à gagner qu'en Suède, en Roumanie, à Malte et à faire jeu égal avec la droite au Portugal.
Le parti de Le Pen, le Rassemblement national (RN), a réussi non seulement à remporter à nouveau les élections européennes en France pour la troisième fois consécutive, en obtenant deux fois plus de voix que le parti au pouvoir, mais aussi à devenir le parti qui compte le plus grand nombre de députés au Parlement européen, ce qui illustre bien la force de l'extrême-droite européenne. Un résultat qui a provoqué un véritable séisme en France, où Macron a été contraint de convoquer des élections législatives d'urgence.
En effet, l'extrême droite n'a cessé de progresser en Europe depuis le début du siècle, partant d'un nombre de députés à peine suffisant pour former un groupe au Parlement européen pour devenir la deuxième force lors de ces élections. En dix ans, elle a doublé son soutien et émerge comme une force qui pourrait déterminer les majorités parlementaires lors de la prochaine législature. La bureaucratie eurocrate de Bruxelles prend cette possibilité très au sérieux et, à cette fin, a entamé une campagne visant à faire la distinction entre une bonne et une mauvaise extrême droite, c'est-à-dire entre l'extrême droite qui adhère sans ambiguïté à la politique économique néolibérale, à la remilitarisation et à la subordination géostratégique aux élites européennes et à l'OTAN, et l'extrême droite qui continue à les remettre en question, bien que de plus en plus timidement.
Les tentations de relooking
Dans la campagne électorale elle-même, la candidate du PPE à la présidence du Collège des Commissaires, Ursula von der Leyen, a ouvert la porte à un pacte avec une partie de l'extrême droite, représentée par Meloni, la "bonne extrême droite". En ce sens, le président du Parti populaire européen (PPE) lui-même, l'Allemand Manfred Weber, s'était déjà prononcé en faveur d'un accord avec l'extrême droite lors d'une rencontre avec la présidente italienne Georgia Meloni l'année dernière. Des approches qui contribuent à normaliser l'extrême droite en tant que partenaire acceptable, légitimant non seulement son espace politique, mais aussi ses politiques et ses discours de haine qui gagnent de plus en plus d'audience auprès de l'électorat européen. C'est un bon exemple du rôle de premier plan que l'extrême droite devrait jouer dans cette nouvelle législature, où elle jouera un rôle clé dans l'obtention de majorités parlementaires.
En ce sens, il semble que Le Pen ne veuille pas être une fois de plus écartée de cette opération de relooking ; elle est consciente qu'elle doit achever son processus particulier de dédiabolisation, non seulement pour avoir son mot à dire dans le prochain Parlement européen, mais surtout pour avoir une chance lors de la prochaine élection présidentielle française. Ainsi, l'extrême droite française a frappé à la porte de Meloni pour tenter d'unir ses forces et devenir la deuxième force politique au Parlement européen. Au cours des trois prochaines semaines, période durant laquelle les groupes politiques du Parlement européen doivent être constitués, nous déchiffrerons tout le mystère du choix de Meloni. Pour le chant des sirènes du groupe Populaire ou pour diriger un grand groupe d'extrême droite. Jorge Buxadé (Vox) lui-même l'a rappelé à Alberto Núñez Feijóo lors de sa campagne : "Ne vous énervez pas parce que Giorgia Meloni est l'une des nôtres". Il semble que des semaines intéressantes et complexes attendent la droite et l'extrême droite pour voir comment les groupes politiques du Parlement européen seront finalement configurés.
La fin du bipartisme ?
Peut-être qu'un autre des titres de ces élections est la tendance à l'érosion du bipartisme européen, si déjà en 2019, pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, les Populaires (PPE) et les Sociaux-démocrates (S&D) n'ont pas réussi à atteindre une majorité absolue. Lors de ces élections, cinq ans plus tard, les socialistes ne sont plus la deuxième force recueillant le plus de suffrages, pour être relégués par l'extrême droite à une troisième place historique. Les socialistes et le Parti populaire n'ont pas le vent en poupe et doivent de plus en plus élargir avec de nouvelles forces la grande coalition qui a gouverné l'Europe jusqu'à présent.
En fait, dès la dernière législature, les libéraux d'Europe Renouveau et, à certaines occasions, les Verts, ont joué un rôle fondamental dans la formation de majorités au Parlement et dans l'approbation des principales mesures de cette législature (Pacte vert, remilitarisation européenne, Pacte sur l'immigration et l'asile, etc.) Ce sont précisément ces deux groupes, Renew Europe et les Verts, qui ont subi la plus forte érosion électorale lors de ces élections, perdant respectivement 20 et 18 sièges. Si, en 2019, ils se sont imposés, dans une certaine mesure, comme des forces de renouvellement et de modernisation d'une gouvernance bipartisane dépassée, leur incapacité à répondre aux attentes les a conduits à payer un coût électoral élevé. Malgré cela, ils apparaissent comme deux forces fondamentales pour assurer les majorités de la grande coalition.
L'exemple le plus clair de l'érosion de la formule politique de Renew Europe est peut-être incarné par Emmanuel Macron en France, dont le parti n'a même pas atteint 15 % des voix. Macron représente une sorte de figure politique vide, un étendard de la sortie de la crise de représentation du bloc de pouvoir et de la corruption des grands partis, qui a été vendue comme une formule condensant l'extrême centre en un seul parti. Un politicien modèle issu du monde de la gestion d'entreprise et perçu, précisément, comme un gestionnaire de la "société civile » disparate, mais garant du (dés)ordre néolibéral. En bref : une sorte d'outsider pour maintenir le statu quo.
En fait, Macron s'inscrit dans une tendance globale d'émergence de caudillos populistes néolibéraux autoritaires issus du monde des affaires et de la finance, qui ne font plus confiance aux politiciens professionnels, mais qui dirigent plutôt leurs propres intérêts d'élite à partir de la ligne de front de la politique. Ces élections ont non seulement condamné le déclin du macronisme en tant que prince de l'européanisme néolibéral qui devait remplacer la grande coalition, mais elles ouvrent également un scénario incertain pour les élections législatives anticipées (juin) et pour les élections présidentielles françaises. En ce sens, ceux qui ont tenté de se présenter comme les représentants du macronisme hispanique, Ciudadanos, sont définitivement morts dans ces élections, perdant leurs huit eurodéputés.
Protestation et recomposition droitière
Il semble que nous ayons un nouveau groupe au Parlement européen autour des Italiens de Cinq Étoiles et des Allemands de l'Alliance Sahra Wagenknecht -Pour la Raison et la Justice-. Un espace politique mal défini construit sur des partis qui ont en commun de trouver difficile de s'intégrer dans l'un des autres groupes formés au Parlement, soit en raison de différences politiques, soit en raison du veto d'autres forces, comme cela a été le cas historiquement avec Cinq Étoiles. Un groupe similaire à ce qu'était l'Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) lors de la législature 2014/2019. Même s'il reste à voir s'ils obtiendront des alliés pour respecter la règle parlementaire d'un minimum de 25 eurodéputés issus d'au moins sept pays différents de l'UE.
Plus de 100 eurodéputés élus n'ont pas de groupe clair au Parlement européen, ce qui montre bien le poids du vote protestataire anti-politique, étranger aux groupes établis au Parlement européen, lors de ces élections. Un bon exemple de ce phénomène est Fidias Panayiotou, un tiktoker chypriote de 24 ans, qui a été la deuxième force, remportant deux sièges au Parlement européen avec plus de 20 % des voix, et Alvise Pérez, le candidat de Se Acabó La Fiesta, l'une des surprises de la journée électorale en Espagne, qui a obtenu trois députés européens avec 800 000 voix.
Un vote de protestation mobilisé pour "récupérer la démocratie kidnappée" par l'oligarchie politique corrompue, traditionnellement qualifiée de "partidocratie" par l'ultra-droite, avec pour conséquence la défense d'une sorte d'anti-politique. Le succès électoral de cette bannière qui prétend sauver une démocratie kidnappée par les élites ne peut être compris sans évaluer le déficit démocratique des sociétés dans lesquelles elle émerge. En ce sens, ce n'est pas un hasard s'il s'exprime particulièrement lors des élections européennes, de la transformation systémique d'une société mondialisée et de la délégitimation du politique et de la politique qui s'est produite en son sein face à la dévalorisation des idéologies. A l'intérieur et à l'extérieur du système, l'extérieur continue à gagner toujours plus de poids politique au sein du Parlement européen.
Quelles perspectives à gauche ?
Si la gauche continue d'occuper la dernière place au Parlement européen en attendant la création d'un nouveau groupe, elle parvient, contrairement à 2019, à atténuer sa chute et pourrait même légèrement progresser en nombre, lorsque la répartition des nouveaux eurodéputés non inscrits à un groupe sera confirmée dans les semaines à venir. Particulièrement pertinents ont été les résultats en Finlande, où elle est deuxième force, en Italie, où la gauche a retrouvé une représentation, et avec la France Insoumise, qui a fourni le plus grand groupe de députés à la gauche.
Ces élections ont une fois de plus montré la perte croissante de légitimité de l'UE parmi les mouvements sociaux dans toute l'Europe, l'abstention l'emportant à nouveau dans presque tous les pays. L'UE a de plus en plus de mal à être associée aux "valeurs européennes" telles que la démocratie, le progrès, le bien-être ou les droits de l'homme. Une crise organique au sens gramscien du terme, résultat et approfondissement de la crise du modèle de capitalisme européen post-Maastricht qui a été une véritable camisole de force néolibérale, avec une combinaison mortelle d'austérité, de libre-échange, de dette prédatrice et de travail précaire et mal rémunéré, l'ADN du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui.
Cette crise de légitimité des institutions ne signifie pas seulement que les décisions de l'UE tentent à tout prix de contourner les parlements nationaux, mais aussi que tout référendum ou consultation des citoyens concernant directement ou indirectement les questions européennes est considéré avec suspicion et effroi. Chaque jour, de plus en plus de personnes se réveillent du rêve européen et se retrouvent à la dérive entre un européanisme néolibéral et militariste défendu par les élites de l'UE et un nationalisme d'exclusion qui se développe au niveau des États. Une crise organique du projet européen qui génère des vides propices aux mutations, aux réajustements, aux recompositions et surtout aux monstres comme nous l'avons vu lors de ces élections.
Des élections qui confirment : le glissement de l'Europe vers la droite, où l'extrême droite n'apparaît plus comme eurosceptique mais comme euro-réformiste, se réservant un siège dans la gouvernance de l'UE ; la faillite des anciennes majorités de grande coalition ; la fin du macronisme et de sa tentative de grand centre-droit européen ; la montée des options outsiders de protestation anti-système et anti-politique ; et la croissance de l'abstention et du désenchantement européen à l'égard de la machinerie de l'UE. Le tout dans un contexte où les tambours de guerre battent dans les chancelleries, nous rapprochant dangereusement du scénario d'une nouvelle confrontation militaire mondiale, sur fond d'urgence climatique et de démantèlement de la gouvernance multilatérale et du droit international qui régissent le monde depuis la Seconde Guerre mondiale.
Un cocktail dangereux qui laisse présager de nouveaux conflits, une recomposition des acteurs, un élargissement du champ de bataille et, surtout, une accélération des tendances nouvelles et anciennes. Mais une leçon se détache de ces élections européennes : quand on sème des politiques d'extrême droite - le Pacte sur les migrations en est un exemple parmi d'autres - on récolte... des politiques d'extrême droite.
Publié par Público. le 10 juin 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La trêve à Gaza et les dilemmes de Netanyahu et du Hamas

Depuis la fin de la semaine dernière, les nouvelles liées à la guerre génocidaire en cours dans la bande de Gaza ont été éclipsées par le projet de trêve annoncé vendredi par le président américain Joe Biden, qui l'a attribué à « Israël », sans préciser quelle instance gouvernementale israélienne l'avait approuvé. (Traduit de l'arabe.)
5 JUIN 2024
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Les commentateurs dans les médias ont trouvé plutôt étrange qu'une proposition israélienne soit annoncée par le président américain au lieu d'être annoncée par des sources officielles israéliennes. La confusion s'est accrue lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé vouloir se démarquer du projet en affirmant des conditions qui le contredisent en apparence ou le compliquent – la plus importante étant son insistance à vouloir poursuivre l'offensive jusqu'à ce que les capacités militaires et politiques du Hamas soient complètement éliminées et le contrôle sécuritaire israélien sur l'ensemble de la bande de Gaza assuré.
La vérité est que ce désordre apparent reflète un véritable état de confusion qui concerne principalement Netanyahu lui-même. En effet, le leader sioniste est pris entre deux feux : la pression américaine soutenue par l'opposition israélienne et par un groupe au sein de son propre parti, le Likoud, dirigé par le ministre de la « défense » Gallant, et la pression en sens contraire exercée par les alliés de Netanyahu appartenant à l'extrême droite sioniste. Quelle est la nature de ces deux pressions opposées ?
Commençons par celle qu'exercent les deux blocs « néo-nazis » avec lesquels Netanyahu s'est allié il y a un an et demi pour obtenir une majorité à la Knesset lui permettant de revenir au pouvoir. On sait que ces deux blocs estiment qu'il ne sert à rien de conclure un accord avec le Hamas, même temporaire, et que l'objectif de la guerre en cours doit être pour l'État sioniste de s'emparer de l'ensemble de la bande de Gaza et de l'annexer à son territoire en tant que partie d'« Eretz Israël » (la Terre d'Israël) entre le fleuve et la mer. (C'est devenu l'objectif commun de l'extrême droite sioniste après qu'elle ait été contrainte de réduire la taille du projet du « Grand Israël » en l'arrêtant aux frontières du Sinaï au sud et du Jourdain à l'est, tout en l'étendant au nord jusqu'au plateau du Golan et en convoitant une partie du Sud-Liban.) Les dirigeants de l'extrême droite sioniste aspirent à expulser les Gazaouis de la bande de Gaza – ou à les inciter à la quitter « volontairement », comme ils prétendent avec hypocrisie et cynisme – et à les remplacer par des colons juifs. Ils considèrent également cet objectif comme plus important que la vie des captifs restant détenus par le Hamas et autres factions palestiniennes à Gaza.
D'autre part, les deux principales ailes partidaires de l'impérialisme américain considèrent qu'il va des intérêts de leur État de former une alliance militaire régionale qui inclurait l'État sioniste et les alliés arabes de Washington, à savoir, de l'Océan au Golfe : le Royaume du Maroc, l'Égypte, le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres monarchies du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le Royaume hachémite de Jordanie. C'est un projet pour lequel Donald Trump a déployé beaucoup d'efforts lorsqu'il était à la Maison Blanche, des efforts qui ont été poursuivis par son successeur, Biden, dont la politique en ce qui concerne le « Grand Moyen-Orient » est presque impossible à distinguer de celle de son prédécesseur. La réalisation de ce projet nécessite cependant une « solution » à la question palestinienne fondée sur la création d'un « État palestinien » qui l'avaliserait, de sorte à duper l'opinion publique arabe (c'est du moins ce qu'espèrent les gouvernements concernés).
Quant au sort de Gaza selon cette vision, il serait réglé par un retour au cadre des accords d'Oslo, c'est-à-dire une Autorité palestinienne chargée de gérer des zones palestiniennes densément peuplées, tandis que l'armée sioniste encercle ces zones et en assure la sécurité en sus de ladite autorité. Mais l'expérience a prouvé qu'une Autorité palestinienne coopérant avec l'occupation n'est pas capable de contrôler seule la résistance populaire. Les responsables américains et leurs alliés arabes conviennent également que l'actuelle Autorité basée à Ramallah est incapable d'empêcher le Hamas de reprendre le contrôle de Gaza si l'armée sioniste se retirait des zones peuplées de l'enclave. Ils estiment donc que la solution idéale serait de déployer une « force de maintien de la paix » arabe dans ces zones peuplées, une force sur laquelle l'Autorité palestinienne collaborant avec l'occupation pourrait s'appuyer pour contrôler la population. Citant des sources occidentales, le Financial Times a révélé que trois États arabes ont exprimé leur disposition à envoyer des forces à Gaza : l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis.
Biden a besoin d'une trêve qu'il pourrait attribuer aux efforts de son administration auprès de l'opinion publique américaine, notamment auprès des électeurs traditionnels du Parti démocrate, afin de limiter la perte électorale qu'il risque de subir dans certains milieux. Son administration a déployé des efforts considérables pour persuader le cabinet de guerre israélien établi à la suite de l'opération « Déluge d'al-Aqsa » d'accepter un projet de deuxième trêve, dont la première phase consisterait en un cessez-le-feu de six semaines au cours duquel un certain nombre de captifs israéliens et un nombre plus grand de détenus palestiniens, comme de coutume, seraient libérés, parallèlement au retrait de l'armée sioniste des zones densément peuplées de Gaza (comme stipulé dans les accords d'Oslo). Ces zones ont en fait été considérablement réduites en surface, la plupart des Gazaouis ayant été déplacés et confinés dans des zones de refuge restreintes.
Alors que le projet prévoit une deuxième phase au cours de laquelle les prisonniers israéliens restants et un groupe supplémentaire de détenus palestiniens seraient libérés, Netanyahu a publiquement nié avoir promis un retrait israélien complet de Gaza au cours de cette deuxième phase, soulignant que l'armée sioniste ne mettrait fin à la guerre qu'après avoir assuré l'élimination complète du potentiel du Hamas dans la bande de Gaza. Mais ce que veulent réellement Biden et les membres du cabinet de guerre sioniste n'est rien d'autre qu'une trêve temporaire conduisant à la libération de tous les captifs israéliens, à l'exception des soldats de sexe masculin, afin qu'ils puissent affirmer devant l'opinion publique qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver ceux qui pouvaient l'être. Les autres seront considérés comme faisant partie du coût normal de la guerre que les soldats sont prêts à payer lorsqu'ils rejoignent les forces armées. Les membres du cabinet de guerre savent que l'achèvement de leur occupation de la région de Rafah entraînera probablement la mort des captifs qui constituent la dernière carte entre les mains des dirigeants du Hamas à l'intérieur de l'enclave. Ils veulent donc réduire le nombre de ces prisonniers à ce que l'opinion publique israélienne pourrait supporter.
Quant à cette deuxième phase du projet et à la troisième (reconstruction de la bande de Gaza), elles ne verront pas le jour car la trêve n'ira pas au-delà de la première phase. C'est ce qui a convaincu Netanyahu d'accepter le projet en premier lieu – même si ce fut à contrecœur, car il savait que ses alliés d'extrême droite le rejetteraient. C'est la raison de la confusion apparue ces derniers jours : Netanyahu tente de persuader ses alliés de ne pas rompre leur alliance avec lui et de ne pas retirer le soutien de leurs blocs à son maintien au poste de premier ministre, ce qui le forcerait à s'appuyer sur l'opposition, tant le parti de Gantz, qui a rejoint le cabinet de guerre, ou celui de Lapid, qui a refusé d'y adhérer. Les deux partis ont exprimé leur disposition à soutenir le maintien de Netanyahu à son poste jusqu'aux prochaines élections législatives s'il acceptait la trêve et, derrière elle, le projet de règlement fondé sur l'implication de forces arabes aux côtés des forces sionistes dans le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.
C'est un choix difficile auquel Netanyahu est confronté aujourd'hui, résultat inévitable de sa dépendance envers deux groupes extrémistes, en comparaison desquels le parti Likoud lui-même, malgré ses origines fascistes, semble « modéré ». C'est un choix tout aussi difficile, sinon plus difficile, auquel les dirigeants du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza sont confrontés pour leur part, puisqu'il leur est demandé de renoncer à la dernière carte dont ils disposent pour assurer leur survie, en échange de quelques semaines de trêve accompagnée d'un influx massif d'aide indispensable pour éviter la mort d'un grand nombre supplémentaire de Gazaouis, en particulier d'enfants.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 4 juin en ligne et dans le numéro imprimé du 5 juin. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant. Voir aussi mon article dans Le Monde diplomatique de juin.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Une paix populaire, pas une paix impériale

Chers camarades,
Les mois à venir seront très difficiles pour la résistance ukrainienne contre les forces d'occupation russes. Dans le même temps, des efforts diplomatiques sont déployés pour trouver une forme d'accord. En coordination avec le gouvernement ukrainien, le gouvernement suisse organisera une conférence de paix internationale près de Lucerne les 15 et 16 juin.
Nous pensons que cette conférence de paix est une occasion importante de sensibiliser à la lutte d'autodéfense du peuple ukrainien contre l'occupation russe du point de vue des travailleurs. C'est pourquoi nous voulons opposer aux ambitions de la conférence de paix officielle une perspective internationaliste basée sur la solidarité et orientée vers une transformation sociale et écologique radicale dans toute l'Europe. Nous nous engageons ensemble pour l'autodétermination de l'Ukraine et en faveur du renversement démocratique du régime de Poutine.
Le Bewegung für den Sozialismus /Mouvement pour le socialisme (BFS/MPS) et SolidaritéS - organisation anticapitaliste, féministe et écosocialiste en Suisse, l'ONG socialiste démocratique Sotsialnyi Rukh en Ukraine, le collectif russe Posle Media et Emanzipation - Zeitschrift für ökosozialistische Strategie ont convenu de promouvoir une proclamation commune pour intervenir dans les débats internationaux sur les perspectives de paix.
Cette déclaration commune vise à atteindre trois objectifs :
1. Initier un processus commun de compréhension entre les organisations, initiatives et collectifs médiatiques signataires sur la manière dont nous pouvons contribuer à consolider la solidarité avec la résistance ukrainienne.
2. Stimuler des discussions approfondies sur l'autodétermination nationale, la rivalité interimpérialiste, la réflexion sur les blocs géopolitiques, le réarmement, les stratégies anti-impérialistes et écosocialistes et, en général, les mobilisations émancipatrices de la classe ouvrière, en particulier au sein des mouvements sociaux progressistes tels que le mouvement féministe, le mouvement écologiste, la solidarité migratoire et les syndicats.
3. Initier un dialogue entre les signataires pour une compréhension programmatique et stratégique plus complète d'une transformation anticapitaliste et écosocialiste de l'ensemble du continent européen dans une perspective de solidarité mondiale.
Nous demandons aux organisations socialistes, écosocialistes, féministes, non-autoritaires, anarchistes et écologistes radicales, aux initiatives et aux collectifs médiatiques en Europe et au-delà de l'Europe de signer cette déclaration d'ici le 14 juin.
Nous essaierons de publier la déclaration aussi largement que possible au niveau international. Nous invitons toutes les organisations et tous les collectifs médiatiques intéressés à diffuser la déclaration.
Sur la base de la déclaration commune et de la discussion qui a été suscitée, nous aimerions continuer et approfondir la discussion entre les organisations signataires, les initiatives et les collectifs de médias.
Nous commencerons cette discussion en organisant une conférence en ligne le 15 juin. Lors de cette conférence, des intervenants des organisations promotrices présenteront le contenu et les objectifs les plus importants de cette déclaration et suggéreront des idées pour la poursuite du débat politique et de la collaboration (de plus amples informations suivront).
Veuillez envoyer la confirmation de votre signature avant le 14 juin à Joao_Woyzeck@proton.me et redaktion@emanzipation.org.
En toute solidarité,
Joao Woyzeck pour le Mouvement pour le Socialisme et Christian Zeller pour emanzipation
DECLARATION Ukraine : Une paix populaire, pas une paix impériale
Déclaration commune d'organisations écosocialistes, anarchistes, féministes, environnementales et de groupes en solidarité avec la résistance ukrainienne et pour une reconstruction sociale et écologique autodéterminée de l'Ukraine.
Le gouvernement suisse organisera les 15 et 16 juin 2024 une conférence internationale pour un processus de paix en Ukraine sur la montagne Bürgenstock, près de Lucerne. Le gouvernement ukrainien soutient cette conférence.
Cette conférence a lieu dans une phase décisive de la guerre. Depuis des mois, les forces d'invasion russes percent des brèches dans les défenses ukrainiennes et les repoussent, au prix de lourdes pertes. Les dirigeants russes ont annoncé une offensive majeure et s'en prennent à la population de Kharkiv, une ville qui compte des millions d'habitants.
Nous soutenons toutes les mesures visant à instaurer une paix qui permette au peuple ukrainien de reconstruire le pays d'une manière autodéterminée. La paix exige le retrait complet des forces d'occupation russes de l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Dans cette optique, nous espérons que la conférence de paix en Suisse contribuera au rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine.
Les conditions pour y parvenir sont extrêmement difficiles. Les représentants du régime de Poutine proclament régulièrement qu'ils ne reconnaissent pas une Ukraine indépendante et nient l'existence du peuple ukrainien. Le régime de Poutine poursuit un projet de Grande Russie, soumet les populations des territoires occupés à la terreur et vise à éradiquer la culture ukrainienne. Le régime au pouvoir en Russie commet régulièrement des crimes de guerre contre la population ukrainienne.
L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée le 24 février 2022, ne remet pas seulement en question l'indépendance de l'Ukraine. Elle encourage également d'autres régimes autoritaires à menacer les populations voisines, à occuper des territoires et à y expulser massivement des populations. Afin d'éviter toute résistance chez elle, l'armée russe recrute désormais aussi des habitants des pays voisins et du Sud pour servir de chair à canon.
En raison de la résistance massive - et étonnante - de la population ukrainienne, les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord ont commencé à soutenir l'armée ukrainienne dans sa défense contre les forces d'occupation russes. Cependant, ils soutiennent l'Ukraine pour affirmer leurs propres intérêts dans la rivalité impérialiste mondiale. Les États-Unis visent à affaiblir leur contrepartie russe tout en montrant leur force face à la Chine montante et en donnant le ton aux puissances européennes qui sont à la fois partenaires et rivales. Pourtant, bien que le Congrès américain ait finalement approuvé le 20 avril 2024 un programme d'aide conséquente pour l'Ukraine, qui avait été bloquée par le Parti républicain pendant neuf mois, le soutien à l'Ukraine est toujours resté sélectif et insuffisant.
De même, les sanctions économiques imposées par les gouvernements de l'UE et des États-Unis à l'encontre de la Russie et des représentants du régime de Poutine sont sélectives, mal ciblées et insuffisantes. Elles n'empêchent pas la Russie de continuer à exporter du pétrole et du gaz, ainsi que d'autres matières premières stratégiquement importantes, qui alimentent son trésor de guerre. Certains pays européens ont même considérablement augmenté leurs importations de GNL en provenance de Russie depuis le début de la guerre. D'autres, comme l'Autriche, obtiennent plus de 90 % de leurs importations de gaz naturel de la Russie. Les gouvernements de ces pays obligent les consommateurs de gaz à financer la guerre de Poutine contre la population ukrainienne.
Le gouvernement suisse, hôte de la conférence de paix, a non seulement accordé des allègements fiscaux aux oligarques russes pendant des décennies, mais il a également refusé de confisquer les actifs de ces oligarques depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. En tant que plaque tournante majeure du négoce international de matières premières, la Suisse offre depuis de nombreuses années aux capitaux russes d'excellentes possibilités d'acquérir des richesses. De nombreux politiciens bourgeois ont accueilli avec plaisir ces entreprises en Suisse. Par la vente de produits à double usage, la Suisse contribue à l'équipement de la machine de guerre russe. Enfin, le secteur financier suisse facilite le commerce du pétrole russe.
Tant aux États-Unis qu'en Europe, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de l'establishment politique et économique pour subordonner leur soutien à l'Ukraine à certaines conditions. Leur objectif est de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède de vastes territoires et plusieurs millions d'habitants au régime de Poutine. Une telle paix, imposée par des puissances impériales majeures, renforcerait le régime de Poutine et ne parviendrait pas à jeter les bases d'une reconstruction démocratique durable de l'Ukraine.
Nous avons besoin d'une paix fondée sur les intérêts de la population et des travailleurs d'Ukraine et de Russie, et soutenue par eux. Une telle perspective ne peut aboutir que si les syndicats, les organisations de femmes, les initiatives environnementales et diverses organisations de la société civile d'Ukraine et de Russie aboutissent aux pourparlers de paix.
L'occupation est un crime ! Nous sommes guidés par les principes d'auto-libération, d'émancipation et d'autodétermination de la classe ouvrière et de tous les peuples opprimés, au-delà des considérations géopolitiques. En ce sens, nous sommes également solidaires du peuple palestinien, qui lutte pour son autodétermination depuis des décennies. De même, nous soutenons les peuples kurde et arménien et tous les autres peuples menacés par l'oppression liée à une occupation, nationale et culturelle.
Sur la base de notre positionnement, en soutenant la résistance ukrainienne contre l'occupation russe, nous voulons contribuer à développer une perspective européenne commune pour des réformes socio-écologiques radicales et, à terme, pour une transformation écosocialiste de l'ensemble du continent européen dans le cadre d'une solidarité mondiale.
En soumettant cette déclaration à la discussion, nous voulons contribuer à un processus transnational de compréhension et de clarification politique entre les forces de gauche qui partagent ces convictions importantes dans toute l'Europe et au-delà.
12 Principes pour une paix juste en Ukraine dans une Europe basée sur la solidarité et l'écologie
Nous, les organisations et initiatives soussignées, voulons promouvoir un processus de paix qui adhère aux 12 principes suivants.
1. La réalisation d'une paix socialement juste et écologiquement durable exige le retrait inconditionnel et complet des forces d'occupation russiennes de l'Ukraine, le retour de l'ensemble du territoire à ses frontières internationalement reconnues.
2. La Russie détruit systématiquement les villes, les infrastructures et l'environnement pour démoraliser la population et susciter une grande vague de réfugiés. Contre cette terreur quotidienne, nous exigeons que les gouvernements « occidentaux » soutiennent l'Ukraine dans la protection de sa population et de ses infrstructures contre les bombardements et les attaques par les missiles de la puissance d'occupation russe. Nous sommes favorables à un soutien humanitaire, économique et militaire massif des pays riches d'Europe en faveur de l'Ukraine. La population ukrainienne a un besoin urgent de protection contre les bombes et les roquettes russes.
3. Nous nous opposons aux tentatives des gouvernements « occidentaux », des représentants de l'OTAN et de l'UE de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions massives à la puissance occupante russe. Nous nous opposons à l'idée que l'Ukraine doive céder plusieurs millions de personnes au régime de Poutine. C'est uniquement au peuple ukrainien de décider comment faire face à cette situation atroce d'occupation continue et probablement croissante. Nous soutenons la résistance armée et non armée des Ukrainiens contre la puissance d'occupation russe.
4. Nous demandons que tous les Russes qui refusent le service militaire se voient accorder un statut de résident sûr dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La désertion massive est importante pour affaiblir la machine de guerre russe.
5. Nous soutenons la lutte politique des syndicats ukrainiens, des organisations de femmes et des initiatives environnementales contre les politiques néolibérales anti-ouvrières du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Ces politiques sapent la défense sociale de l'Ukraine contre l'occupation russe et rendent impossible une reconstruction socialement juste et écologiquement durable.
6. Nous sommes solidaires du mouvement anti-guerre, de l'opposition démocratique et des luttes ouvrières indépendantes en Russie. Nous sommes également solidaires des nationalités opprimées en Russie qui souffrent particulièrement de la guerre et luttent pour leur autodétermination. C'est leur jeunesse qui est utilisée comme chair à canon par le régime de Poutine. Ces mouvements sont un facteur clé pour parvenir à une paix juste et à une Russie
démocratique.
7. La Russie a emprisonné de nombreuses personnes originaires d'Ukraine en tant que prisonniers politiques. Beaucoup ont été condamnés à des décennies de prison et de camps pénitentiaires. Nous demandons leur libération inconditionnelle. Nous exigeons que la Croix-Rouge internationale soit autorisée à maintenir des contacts réguliers avec tous les prisonniers de guerre. La libération des prisonniers de guerre est une condition préalable à toute paix juste.
8. La Russie doit payer des réparations au peuple ukrainien. Les oligarques de Russie et d'Ukraine doivent être expropriés. Leurs biens doivent être mis à la disposition de la reconstruction de l'Ukraine et, après la chute du régime de Poutine, du développement démocratique de la Russie.
9. Nous exigeons que les gouvernements « occidentaux » annulent immédiatement les dettes de l'Ukraine. C'est une condition essentielle pour la reconstruction souveraine du pays. Les Etats riches d'Europe et d'Amérique du Nord doivent mettre en place des programmes de soutien complets et étendus en faveur du peuple ukrainien et de la reconstruction du pays. Cette reconstruction doit se faire sous le contrôle démocratique de la population, des syndicats, des initiatives écologiques, des organisations féministes et des quartiers organisés dans les villes et les villages.
10. Nous nous opposons à tous les projets des gouvernements européens et nord-américains, ainsi que des organisations internationales, visant à imposer un programme économique néolibéral au peuple ukrainien. Cela prolongerait et aggraverait la pauvreté et la souffrance. Nous dénonçons également tous les efforts visant à vendre les biens et les actifs de la population ukrainienne à des sociétés étrangères. Le redressement et la réorganisation de l'agriculture, de l'industrie, des systèmes énergétiques et de toute la base sociale doivent servir à la transformation socio-écologique de l'Ukraine, et non à la fourniture de main-d'oeuvre, de céréales et d'hydrogène bon marché aux pays d'Europe occidentale.
11. Un soutien militaire efficace à l'Ukraine ne nécessite pas une nouvelle vague d'armements. Nous nous opposons aux programmes de réarmement de l'OTAN et aux exportations d'armes vers des pays tiers. Il faut au contraire que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord fournissent, à partir de leurs immenses arsenaux existants, les armes qui aideront l'Ukraine à se défendre efficacement. En ce sens, nous demandons que l'industrie de l'armement ne serve pas les intérêts de profit du capital - au contraire, nous voulons travailler à l'appropriation sociale de l'industrie de l'armement. Cette industrie doit servir les intérêts immédiats de l'Ukraine. En même temps, pour des raisons écologiques sociales et urgentes, nous soulignons l'impératif de convertir démocratiquement l'industrie de l'armement en une production socialement utile à l'échelle mondiale.
12. Nous voulons lancer un débat sur une réorganisation radicale de l'Europe. Nous voulons contribuer au développement d'une perspective européenne commune pour des réformes socio-écologiques radicales, et en particulier pour une transformation écosocialiste fondamentale de l'ensemble du continent européen dans le cadre d'une solidarité mondiale. Dans ce cadre conceptuel, nous soutenons la volonté du peuple ukrainien d'adhérer à l'UE, bien que nous rejetions les fondations néolibérales de l'UE qui appauvrissent des millions de personnes et favorisent un développement non quali- fié en Europe. Nous considérons la perspective d'une adhésion de plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est comme une occasion de réfléchir ensemble à la manière dont un changement socio-écologique aussi radical peut être initié dans toute l'Europe, y compris une stratégie énergétique commune, une conversion industrielle écologique, des systèmes de retraite par répartition, une réglementation du travail social, une politique migratoire solidaire, des paiements de transfert interrégionaux et une sécurité militaire ralliant la sortie de l'industrie de l'armement. Les forces syndicales, féministes, écologiques, anti-autoritaires et socialistes d'Europe de l'Est devraient jouer un rôle important dans ce débat.
Cette Déclaration a été initiée conjointement par Sotsialnyi Rukh (Mouvement social) en Ukraine, Posle Media Collective en Russie, Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le Socialisme et solidaritéS - mouvement anticapitaliste, féministe, écosocialiste en Suisse, emanzipation - Zeitschrift für ökosozialistische Strategie (DE, AT, CH).
Nous invitons toutes les organisations, groupes, initiatives et collectifs médiatiques intéressés à diffuser et à signer cette Déclaration d'ici le 14 juin. Veuillez envoyer la confirmation de votre signature à Joao_Woyzeck@proton.me et redaktion@emanzipation.org
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bien que le campement UPA-UQAM plie bagage, l’intifada continue !

*Tiohtia:ke, Montréal, le 6 juin 2024* - Le campement de l'Université populaire Al-Aqsa à l'UQAM (UPA-UQAM) dénonce la lâcheté du recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, lors de la Commission des études (CÉ) du 4 juin dernier, malgré la résolution adoptée, et déplore l'instrumentalisation des négociations à des fins de récupération par l'administration et la non-reconnaissance du génocide en cours en Palestine.
Le 29 mai 2024, suite aux pressions du campement de l'UPA-UQAM, le conseil d'administration (CA) de l'UQAM a adopté une résolution demandant notamment à l'Université de veiller à ce qu'aucune de ses ententes académiques actuelles et futures, dont celles avec des universités israéliennes n'entrent en conflit avec les principes de respect du droit international mentionnés dans la résolution. Elle demande également à la Fondation de l'UQAM de s'assurer de n'avoir aucun investissement direct dans des fonds ou compagnies qui profitent de l'armement et de divulguer chaque année la liste de ses investissements.
Le 4 juin 2024, la CÉ a adopté une résolution ayant pour mandat de mettre en oeuvre la résolution adoptée par le CA, en définissant les exigences éthiques et légales pour les partenaires académiques de l'UQAM, proposant une méthodologie de suivi et une évaluation de ces exigences, et conseillant sur la gestion des ententes académiques. Il doit également informer la CÉ sur les implications des institutions académiques dans les violations des droits, y compris la participation des universités israéliennes dans l'occupation des territoires palestiniens et les violations du droit international qui en découlent.
Or, une personne déléguée étudiante à la CÉ rapporte que le recteur a avoué, durant les discussions en CÉ, qu'il ne considérait pas la résolution adoptée en CA comme un boycott académique. M. Pallage aurait déclaré que : « L'UQAM est allée très très loin. Par contre, elle s'appuie sur des faits. Si l'UQAM dénonce un génocide, ça c'est moins factuel. Les faits nous sont dictés par le droit international ».
« Nous dénonçons une telle minimisation de la violence coloniale et génocidaire de l'État israélien à l'égard du peuple palestinien », affirme Sara Hamadi, étudiante et campeuse à l'UPA-UQAM.
De même, l'UPA-UQAM dénonce ainsi la stratégie médiatique du recteur présentant la gestion de la situation du campement comme un modèle « avant-gardiste ». Pour l'UPA-UQAM, les résolutions adoptées par le CA et le CÉ sont loin d'être satisfaisantes pour la lutte palestinienne. Il reste primordial de souligner que l'*objectif* *réel du boycott académique *international d'Israël selon les lignes directrices du PACBI (*Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel*) implique le boycott explicite de toutes les universités israéliennes, sans exception.
« Malgré la fin du campement, nous poursuivrons la lutte puisque nous ne pouvons nous contenter de déclarations performatives donnant une image trompeuse d'un soi disant engagement de l'université », déclare Sara Hamadi. « Le comportement du recteur nous impose une vigilance continue et une attitude critique soutenue de la part de la communauté universitaire », ajoute-t-elle.
*Blocage à la Commission des études*
L'UPA-UQAM se désole que la CÉ du 4 juin ait balayé du revers de la main l'ajout d'une reconnaissance du génocide en Palestine ainsi que du nettoyage ethnique de son peuple.
Présenté comme un amendement par les délégués étudiants sur le CÉ, cet ajout à la résolution a d'abord réussi à être adopté. Néanmoins, les pressions du recteur M. Pallage sur les commissaires indécis lui ont permis, in extremis, de revenir sur la décision.
Aux yeux de l'UPA-UQAM, pour considérer cette entente comme une réelle « forme d'avancée », les exigences minimales d'un boycott académique devaient être respectées. Or, les voici oblitérées par une simple déclaration symbolique, non contraignante ainsi que par l'indifférence et la complicité de ces organes académiques aux crimes sionistes.
Malgré l'adoption des résolutions, il est donc crucial de maintenir un œil critique sur les actions de l'administration de l'UQAM.
L'UPA-UQAM avait annoncé lever son campement le 6 juin 2024, suite à l'adoption des balises concrètes de mise en œuvre du boycott académique par la Commission des études du 4 juin. Considérant l'adoption de la résolution par la CÉ, l'UPA-UQAM quitte aujourd'hui, le 6 juin 2024, le campus du Complexe des sciences. Nous réitérons que ce départ n'est pas la fin, mais la continuité de longues luttes à venir !
*La lutte continue*
Le campement a permis de rendre l'UQAM responsable de ses actions en la plaçant sous les projecteurs de l'opinion publique. Cette initiative a renforcé les solidarités entre les communautés étudiantes, professorales et syndicales de l'UQAM. Grâce à cette présence constante dans l'espace public, une pression soutenue a été exercée sur les instances décisionnelles, les forçant ainsi à prendre position par rapport à la guerre coloniale, quoique de manière fortement insatisfaisante. On ne peut soutenir que, désormais, l'UQAM est du « bon côté de l'histoire ».
Enfin, l'UPA-UQAM souhaite saluer la solidarité des associations étudiantes et des syndicats universitaires qui ont adopté des résolutions en soutien à la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) et au camp.
Nous souhaitons également remercier les groupes étudiants, les avocat-es, les personnes militant-es du campement de McGill, et surtout les personnes qui se sont déplacées pour soutenir le campement pour leur appuie indéfectible
Nous invitons le recteur, le Conseil d'administration et la Commission des études à prendre exemple sur sa communauté universitaire et sa capacité d'action.
Dans un contexte où les atrocités commises à Gaza s'intensifient et où le Sud du Liban devient aussi une cible des attaques meurtrières par Israël, nous invitons l'ensemble de la population à continuer à se mobiliser, notamment l'extérieur des campus, et à participer à la manifestation pour l'abolition du Bureau du Québec à Tel-Aviv qui aura lieu aujourd'hui à 19h l'UPA-UQAM au 175 av. Président-Kennedy.
*Le combat se poursuit, jusqu'à la libération de la Palestine de notre vivant !*
Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHPP) basée à l'UQAM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Professeur.es, chercheur.ses, chargé.es de cours se prononcent sur les campements !

Nous, professeur.es, chercheur.ses, chargé.es <http://xn--charg-fsa.es> de cours impliqué.es <http://xn--impliqu-hya.es> au sein de nos communautés universitaires, tenons à apporter publiquement notre soutien aux campements universitaires qui ont lieu à Montréal (Universités populaires Al-Aqsa Uqam et McGill) et ailleurs afin de faire cesser le génocide en cours en Palestine.
Ces initiatives sont parfaitement conformes non seulement avec les principes de liberté d'expression et de liberté de rassemblement politique, mais également avec le principe de circulation des savoirs critiques connectés aux pratiques concrètes de transformation du monde orientées vers plus de justice.
La violence de l'État d'occupation d'Israël contre les Palestinien.nes se doit d'être arrêtée sans plus tarder. Nous soutenons les initiatives des campements universitaires comme un mouvement politique important visant à faire cesser l'intolérable.
Nous saluons le courage des personnes et des groupes qui font vivre un campement contre des autorités souvent hostiles et arrogantes. Nous dénonçons à cet égard les démarches des administrations qui, comme à l'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM, déposent des demandes d'injonction afin de démanteler les campements au moment où elles devraient se positionner pour exiger avec les étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es>
le démantèlement de l'apartheid et la fin du génocide.
Nous soutenons les revendications principales des campements puisque nous sommes convaincu.es que les établissements universitaires peuvent aisément :
– reconnaitre et dénoncer les crimes de guerre et les pratiques coloniales d'éradication du peuple palestinien en cours ;
– dénoncer la destruction des établissements universitaires et la mort d'
étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es> et collègues de Palestine ;
– encourager la communauté universitaire d'éviter toute collaboration avec
le gouvernement israélien et à promouvoir plutôt la collaboration avec les
universités palestiniennes, leurs étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es>
et leurs chercheur.es.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Boycottons Israël !

Tiohtià:ke/Montréal - 06 juin 2024 - En réponse à l'entêtement du gouvernement de la CAQ pour maintenir l'ouverture de son bureau diplomatique du Québec à Tel-Aviv (SDHPP-UQÀM) invite la population à une grande manifestation le 6 juin à 19h, qui commencera au camp Al-Aqsa, dans le Complexe des sciences de l'UQÀM.
*Manifestation pour l'abolition du bureau du Québec à Tel Aviv*
Face aux horreurs perpétuellement vécues par le peuple palestinien depuis presque 8 mois, le groupe exige que le bureau du Québec à Tel-Aviv soit aboli et que soient cessés tous liens économiques et politiques avec l'entité sioniste à l'origine de ces horreurs.
Après avoir d'abord remis en doute en novembre dernier l'ouverture du bureau à Tel-Aviv, le gouvernement de François Legault souhaite maintenant son ouverture au plus vite afin, dit-il, d'être là « pour le peuple » et « pour des échanges commerciaux ». Par souci de maintenir des relations internationales, même avec les États coupables de crimes de guerre, et en s'acharnant à poursuivre ses intérêts commerciaux, le gouvernement ferme les yeux sur le génocide commis par l'État israélien et s'en rend ainsi complice.
« S'entêter à vouloir ouvrir le bureau du Québec à Tel-Aviv cet été, alors que des centaines de bombes tombent encore sur Gaza, démontre la déconnexion totale du gouvernement. Il est de notre devoir de se soulever pour en annuler l'ouverture et l'abolir ! » rajoute Leila Khaled, porte-parole du SDHPP-UQÀM.
Le groupe dénonce également les 1,2 milliard de dollars investis en 2023 par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), responsable des pensions de plus de six millions de Québécois·es, dans plus de onze entreprises reliées au génocide du peuple palestinien. Ce montant a été plus que doublé entre 2022 et 2023. Pour ne citer qu'un exemple, le Devoir révélait en février que 62 millions de dollars US sont investis en parts dans Lockheed Martin, une compagnie d'armement qui fournit des avions militaires à l'armée israélienne. Alors que Conrad Harrington, porte-parole de la CDPQ, indique que celle-ci « prend très au sérieux toute allégation relative aux droits de la personne », le désinvestissement de ces entreprises violant le droit international est toujours attendu.
« C'est notre argent, celui qu'on a cotisé à ces fonds de pension publics, et que l'on utilise pour financer le génocide en cours. C'est inacceptable ! » dénonce Leila Khaled, porte-parole du SDHPP-UQÀM.
Puisque la CDPQ a déjà joué un rôle dans le désinvestissement des entreprises complices des crimes de guerre israéliens, notamment en poussant l'entreprise G4S à cesser ses activités en Israël en juin 2023, le SDHPP-UQÀM encourage les syndicats et la société civile à s'engager dans la lutte afin de mettre de la pression sur la CDPQ pour venir à un désinvestissement complet de toute entreprise impliquée dans la perpétuation du génocide des Palestinien·nes et dans le soutien à l'État israélien.
Alors que l'État israélien déchaîne son sinistre arsenal sur Rafah, il est évident qu'il faut rompre les liens avec l'État israélien et non les approfondir. Soulevons-nous contre la collaboration impérialiste ! Rendons la complicité insoutenable !
Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHPP) basée à l'UQAM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Immigration et crise du logement : des nuances s’imposent

L'Observatoire des Inégalités Raciales au Québec (OIRQ) et l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) lancent demain, le 11 juin 2024 à 18h au café les Oubliettes, la série Égalités <https://oriq.info/publications/> qui rassemble un ensemble d'études portant sur les inégalités raciales au Québec.
Le 10 juin 2024 Montréal, Québec
« Pour le premier numéro de la série *Égalités*, nous avons choisi d'examiner un débat qui a pris de l'ampleur ces derniers mois dans l'espace public, soit celui de la crise du logement et de l'immigration. Ce numéro propose une analyse de cet amalgame afin de démystifier certains mythes et d'examiner les effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur notre société », explique Victor Armony, co-fondateur de l'OIRQ.
*Une augmentation de 659% de l'association entre crise du logement et immigration dans les médias*
Depuis la fin de l'année 2023, la crise du logement a été associée de manière soutenue à l'immigration dans les médias au Québec. L'analyse de quatres quotidiens québécois (Le Devoir, Le Droit, La Presse et Le Soleil) a permis de constater l'explosion de la coprésence des termes « immigration/immigrants » et « logement » dans les articles publiés entre
2019 à 2024. En effet, les mentions conjointes des mots « immigration » et « logement » ont augmenté de 659 % dans ces journaux en cinq ans.
« Sachant que cette augmentation ne tient pas compte des données du Journal de Montréal, on peut penser que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Dire que la hausse de l'immigration est la cause principale de la crise du logement n'est toutefois pas fondée », remarque Geneviève Vande Wiele, chercheuse à l'OIRQ et autrice de l'étude publiée aujourd'hui.
*Attention aux amalgames*
Les données montrent que les populations immigrantes ne peuvent être tenues responsables de la faible disponibilité de logements locatifs. En effet, plusieurs villes frappées par la crise du logement, et dont les taux d'inoccupation sont particulièrement bas comme Drummondville, Trois-Rivières ou Saguenay, ont aussi une proportion d'immigrants moindre, soit en dessous de 1 % de leur population totale.
« Beaucoup trop de nuances s'imposent pour affirmer qu'il y a un lien de cause à effet entre l'immigration et la crise du logement. Cet amalgame tend également à occulter la multiplicité de facteurs qui affecte l'abordabilité du marché locatif et le fait que celle-ci s'explique en grande partie par l'offre de logements inadaptée aux besoins des ménages », ajoute la chercheuse.
Selon un récent rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, en 2021, le taux d'inoccupation des logements neufs construits à Montréal au cours des trois années précédentes était de 4,2%, un taux beaucoup plus élevé que le taux d'inoccupation de l'ensemble des logements locatifs, qui était de 2,7%. Les nouvelles constructions ont donc tendance à rester vacantes plus longtemps puisqu'elles sont plus dispendieuses que les autres logements sur le marché.
*Recentrer le débat pour des solutions efficaces !*
La littérature scientifique ainsi que les expériences du passé montrent l'existence d'une tendance infondée à faire des populations immigrantes la cause des crises sociales. Le mythe des immigrants « voleurs de jobs » qui a tendance à ressurgir lors de périodes de précarité économique illustre bien ce phénomène.
« En période de crise - et l'histoire peut en témoigner -, les immigrants sont d'excellents boucs émissaires. Or, tant et aussi longtemps que les médias et la classe politique continuent de relayer ces affirmations sans nuances, nous continuerons à mettre en place des politiques incomplètes et inadaptées au problème identifié », déplore la chercheuse
« L'histoire semble se répéter avec le gouvernement Legault, qui a été très vocal sur les enjeux d'immigration dans les derniers mois. Dans un même temps, le gouvernement ne semble pas prendre au sérieux les solutions mises de l'avant par plusieurs experts pour contrer la crise du logement, comme l'atteste l'adoption de la loi 31. »
*À propos de l'OIRQ*
L'Observatoire des inégalités raciales au Québec, c'est un groupe de réflexion, d'action de production du savoir. Il a pour mission et mandat de veiller au suivi des enjeux sous-jacents au phénomène du racisme au Québec en vue de faire avancer la lutte contre le racisme systémique.
Le numéro est téléchargeable ici
<https://oriq.info/wp-content/upload...>
*https://oriq.info/ <https://oriq.info/> *
*La date et l'heure du lancement ;* 11 juin 2024 à 18h
*Le lieu du lancement ;* Café les Oubliettes, 6201 Rue de Saint-Vallier,
Montréal, QC H2S 2P6
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Retour à zéro pour les OCASSS

Le 29 mai dernier, plus de 3000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) ont eu la désagréable surprise d'apprendre que les subventions du PSOC pour la mission globale ne seraient pas rehaussées en 2024-2025 et qu'aucun groupe ne pourra y obtenir un premier financement.
5 juin 2024
Alors que depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ se vantait d'avoir fait mieux que les gouvernements précédents en rehaussant chaque année lessubventions à la mission des OCASSS, voilà qu'elle nous ramène à la période d'avant 2017. Elle revient de plus sur l'engagement pris en 2013par le MSSS de « veiller à ce que le rehaussement en soutien à la mission globale du financement des organismes communautaires ne passe pas uniquement par les crédits additionnels liés aux priorités ministérielles ».
Mais pour expliquer la cause de cette surprise, il faut revenir au moment du dépôt du budget 2024. La Table apprenait alors, du bureau du ministre Carmant, que 10M$ seraient alloués au financement à la mission globale à l'intention de l'ensemble des OCASSS. Or, presque 3 mois plus tard, on découvre que ce famélique montant ne sera pas distribué pour le fonctionnement général des groupes. Pire, il semble qu'il faudra attendre plusieurs semaines pour savoir si les conditions de financement choisies instrumentaliseront les groupes.
Pour comble d'insulte, tant le bureau du ministre que les fonctionnaires du MSSS ont caché aux OCASSS cette information cruciale pour leur planification budgétaire : pas un sou de plus cette année. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué pour donner l'heure juste. À quoi le ministre s'attendait-il en retenant cette mauvaise nouvelle ? Cette situation révèle un manque flagrant de considération et de respect envers les milliers de personnes qui s'investissent au quotidien pour faire vivre les organismes communautaires.
Au quotidien, la population québécoise est témoin, autant par les médias qu'au coin de sa rue, de la hausse des besoins sociaux. Plus que jamais, les gens se tournent vers les organismes communautaires autonomes pour trouver du soutien et de l'accompagnement, pour contribuer à leur façon à la société, pour répondre autrement à leurs besoins. Les groupes communautaires sont des lieux d'appartenance, de contribution sociale, de participation à la vie démocratique. Ils sont plus que des ressources où trouver réponse à des besoins urgents : ils permettent d'améliorer la société. Leur action est vaste et contribue à la réalisation du droit à la santé. Toute la population du Québec en bénéficie, directement ou indirectement.
L'actualité fait la preuve jour après jour des retombées du travail des OCASSS. Or, ils sont au bout de leurs ressources. À force de répondre aux crises, ils n'arrivent plus à agir autant qu'ils le voudraient sur les déterminants sociaux de la santé, par pour et avec les personnes directement concernées.
Le gouvernement choisit d'appauvrir les groupes en ne donnant pas un sou de plus pour 2024. Tout ce que ces derniers recevront c'est l'indexation automatique de leur subvention de l'année précédente, de surcroît au taux insuffisant de 2,7%. Pour assurer le plein accès de toute la population aux activités des groupes qu'elle s'est donnés, la campagne CA$$$H(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement) évalue que l'enveloppe actuelle du PSOC pour la mission globale devrait tripler,en ajoutant 1,7G$, pour atteindre 2,5G$ par an.
Le ministre Carmant a du travail à faire pour rétablir les liens de confiance, non seulement pour destiner les 10 M$, comme il l'a laissé entendre en mars, au fonctionnement des 3000 OCASSS et démontrer son appréciation de leurs missions en leur obtenant un rehaussement véritablement à la hauteur des besoins. Les OCASSS attendent une réponse et du soutien.
Co-signataires, pour l'ensemble des 45 membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Stéphanie Vallée
présidente
L'R des Centres de femmes du Québec
Jocelyne Gamache
secrétaire
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Michel-Alexandre Cauchon
trésorier,
Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Vincent Marcoux
officier
Association québécoise des centres d'intervention en dépendance
Isabelle Brisebois
officière
Association des organismes de justice alternative du Québec
Fernando Rotta
officier
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
Suite des signataires comme membres de la Table
À cœur d'homme
Sabrina
Nadeau
Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux
Jérôme
DiGiovanni
Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
Maud
Pontel
Aphasie Québec - Le Réseau
Marie-Claude
Lemire
Association des centres d'écoute téléphonique du Québec
Pierre
Plourde
Association des Grands Frères et des Grandes Soeurs du Québec
Suzie
Gauthier
Association des groupes d'intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
Steven
Collin-Basquill
Association québécoise de prévention du suicide
Solène
Tanguay
Association québécoise des centres communautaires pour aînés
André
Guérard
Association québécoise des centres d'intervention en dépendance
Vincent
Marcoux
CAP Santé mentale
René
Cloutier
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA
Ken
Monteith
Connexion >TCC.QC (Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec)
Marjolaine
Tapin
Équijustice
Luc
Simard
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
Mariepier
Dufour
Fédération des CAAP
Marie
Gagnon
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
Mylène
Bigaouette
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Jess
Legault
Fédération Nourri-Source
Julie
Richard
Intergénérations Québec
Fatima
Ladjadj
Les Banques Alimentaires du Québec
France
Deschênes
Mouvement allaitement du Québec
Alexandra
Maltais
Mouvement Santé Mentale Québec
Renée
Ouimet
Proche aidance Québec
Loriane
Estienne
Regroupement des associations de parents PANDA du Québec
Frédéric
Boisrond
Regroupement des auberges du cœur du Québec
Paule
Dalphond
Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec
Claudia
Charron
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Nicholas
Legault
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Louise
Riendeau
Regroupement Naissances Renaissance
Marie-Ève
Blanchard
Regroupement des organismes communautaires Québécois pour le Travail de rue
Audrey
Sirois
Regroupement des organismes ESPACE du Québec
Janie
Bergeron
Regroupement québécois des CALACS
Gabrielle
Comptois
Regroupement québécois du parrainage civique
Loc
Cory
Réseau québécois d'action pour la santé des femmes
Lydia
Assayag
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Anne-Marie
Boucher
Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec
Boromir
Vallée Dore
Société québécoise de la fibromyalgie
Valérie
Reuillard
Victimes des Pesticides du Québec
Pascal
Priori
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
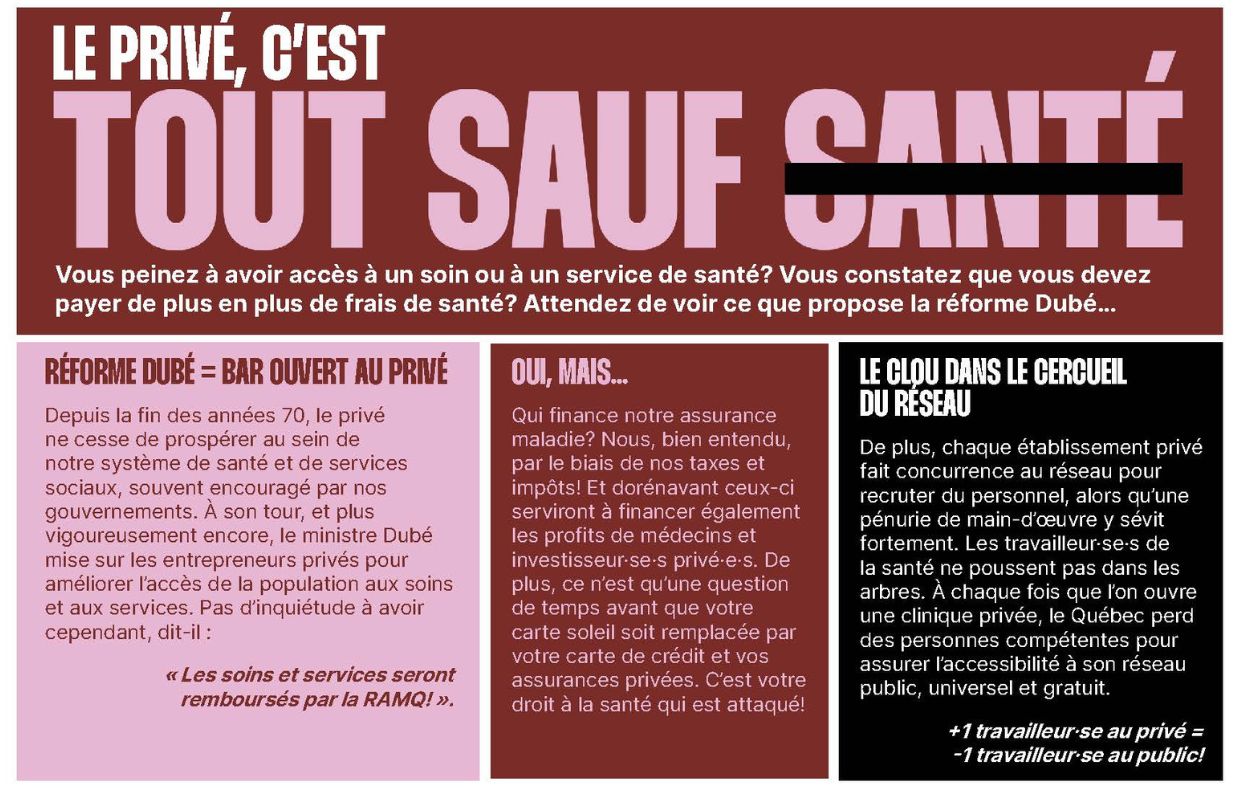
Le privé, c’est tout sauf santé !
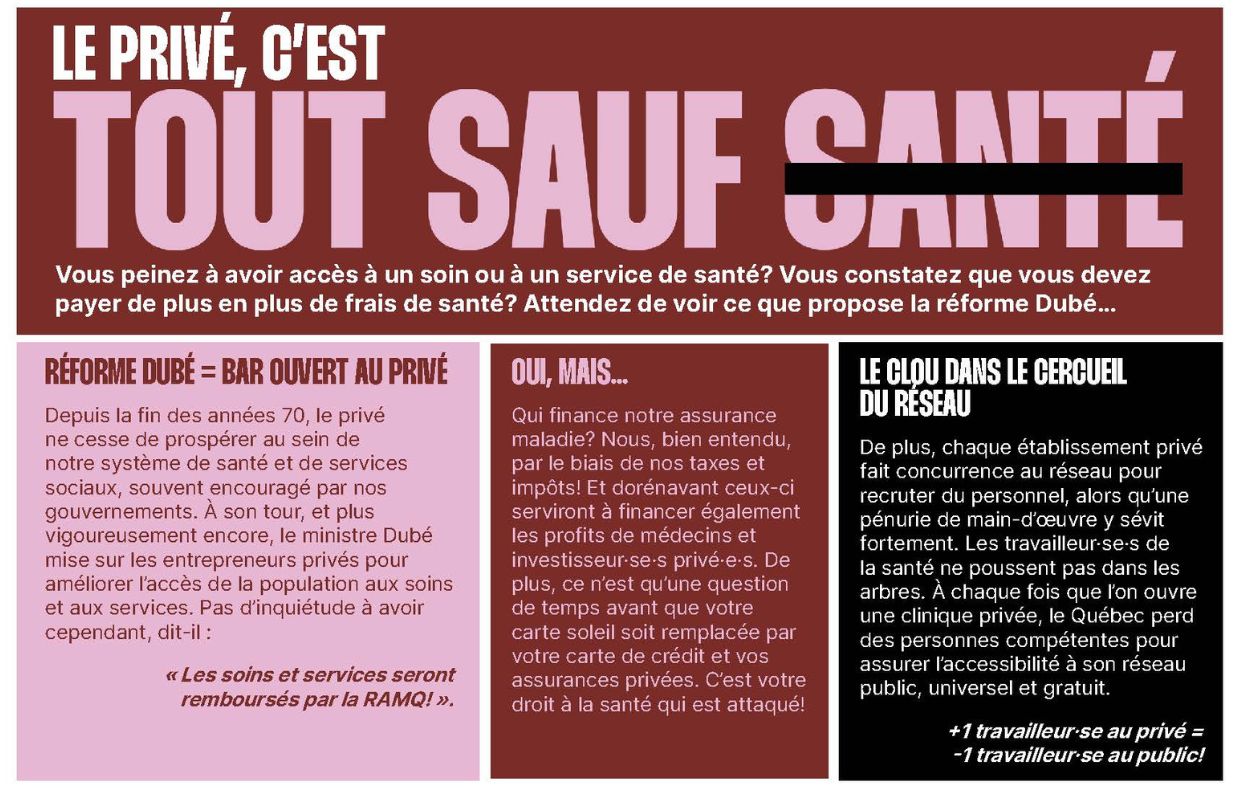
Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches, 3 juin 2024 Notre coalition d'organisations de la société civile de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a organisé une conférence de presse rassemblant plusieurs regroupements et dénonçant la réforme Dubé devant le siège social de Santé Québec au 930 chemin Ste-Foy, Québec.
Au lendemain de la pandémie, le ministre Dubé a promis à la population québécoise de mettre fin au statu quo et d'appliquer un plan d'action pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux. Le dépôt, puis l'adoption sous bâillon, du controversé projet de loi 15 créant l nouvelle agence Santé Québec, nous oblige plutôt à constater que le gouvernement de la CAQ continue l'œuvre des précédentes réformes de la santé en centralisant et privatisant toujours plus notre réseau public.
En effet, le gouvernement choisit d'orchestrer un système où l'État subventionne les compagnies privées pour qu'elles dispensent des soins de santé. On rassure la population en lui disant qu'elle n'aura rien à payer, car ce sera couvert par la carte d'assurance-maladie, mais au final ce sont les Québécois.e.s qui, collectivement par le biais de leurs impôts, assumeront des coûts beaucoup plus élevés en santé afin de couvrir la portion importante de profits inhérente à la médecine privée.
Pour nos organisations, le gouvernement du Québec fait fausse route. « Le ministre dit aux Québécois.e.s que l'ouverture au privé est la solution aux problèmes d'accessibilité au réseau public alors qu'on sait très bien que c'est plutôt l'origine des difficultés ! Chaque clinique ou hôpital privé qui ouvre, vient drainer les ressources du public et ainsi, aggrave les problèmes d'accès. Les médecins et le personnel de la santé et des services sociaux ne poussent pas dans les arbres, chaque travailleur.se qui va vers le privé est un.e travailleur.se de moins dans le public. On ne peut juste pas se permettre de voir le privé s'accaparer les précieuses et rares ressources du public », déclare Sophie Verdon, co-coordonnatrice à la Coalition solidarité santé.
« Dans le contexte d'une recherche d'efficacité, de privatisation des services et de
sous-traitance, le ministre Dubé endosse-t-il la décision du ministre Carmant de détourner le rehaussement prévu au financement à la mission des organismes communautaires au bénéfice de ceux qui répondront à ses priorités » dit Karine Verreault du Regroupement des organismes communautaires de la région 03.
« Comment une région peut-elle espérer être entendue devant une structure centralisée où les pouvoirs appartiennent à un seul CA qui a préséance sur tout ? Il serait utopique de croire que nous arriverons à faire reconnaître les réalités et besoins régionaux devant cette méga structure étatique. » dit Murielle Létourneau de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches.
« Le PL15 qui comprend près de 1200 articles, et qui, au final, a été adopté sous le bâillon met en péril les fondements mêmes de notre système de santé. » dit Pascal Côté de la Centrale des syndicats du Québec « Le gouvernement se félicite de la nomination de gens d'affaire, les fameux “top gun” du privé, à la tête de Santé Québec mais personne ne semble s'inquiéter de la faiblesse de la représentation des gens issus du réseau public et notamment de la portion “services sociaux” du système de santé, ça nous semble la recette d'un désastre annoncé. » dit Pierre Émond du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).
« Avec la création de Santé Québec, on consolide le système de santé à deux vitesses où une poignée de privilégiés peuvent avoir accès à des soins plus rapidement et où l'État, via nos impôts, finance les profits des cliniques privées dont les soins coûtent beaucoup plus cher. C'est toujours la même rengaine ; ils s'enrichissent alors qu'on s'appauvrit. » dénonce Naélie Bouchard-Sylvain du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire 03-12.
« Le système de santé a besoin de soin et d'investissement. C'est la détérioration des conditions de travail dans le public qui a incité le personnel du réseau à aller au privé ou à quitter la profession. Malheureusement, on peut s'attendre à des résultats similaires avec la loi 15 et Santé Québec. Et cela aura des effets sur les femmes, les travailleuses de la santé et des organismes communautaires, sur la population entière du Québec » dit Élise Landriault-Dupont du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.
« Santé Québec contrôlera tout à partir de Québec. Même les organismes communautaires devront se plier aux exigences de l'agence et ce, au détriment de notre autonomie d'action et des besoins des citoyens et citoyennes de la région » dit François Winter de la Table régionale des organismes communautaires actifs en santé mentale de Chaudière-Appalaches.
C'est donc avec conviction, espoir et détermination que le Regroupement des organismes
communautaires de la région 03, le Regroupement d'éducation populaire en action
communautaire 03-12, la Table régionale des organismes communautaires de
Chaudière-Appalaches, la Table régionale des organismes communautaires actifs en santé
mentale de la région 12, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, la Centrale des Syndicats du Québec, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de Québec et Chaudière-Appalaches et le Conseil central de Québec – Chaudière-Appalaches CSN, participent à la Semaine nationale d'actions régionales (du 26 mai au 31 mai 2024) de la Coalition Solidarité santé. Dans différentes régions du Québec, des actions sont organisées pour dénoncer la privatisation et la centralisation du réseau public de santé et de services sociaux.
Parce que Le privé, c'est tout sauf santé !
Source : Regroupement des organismes communautaires de la région 03
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Un petit pas pour Sabia, un grand pas pour la privatisation ! »

Le 30 mai dernier, Michael Sabia présentait la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, affirmant reprendre le contrôle du développement de l'éolien, et répétant plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de privatisation.1
Jacques Benoit et Michel Jetté
GMob (GroupMobilisation)
Pour beaucoup, ce fut comme une presque victoire, interprétant même ce geste comme une opposition qu'aurait gagnée Sabia contre le super-ministre Fitzgibbon. Mais qu'en est-il vraiment ?
Tout d'abord, outre le fait que répéter plusieurs fois un mensonge n'en fait pas une vérité, quelqu'un croit-il vraiment que Michael Sabia, ce top gun de la privatisation, se soit converti à la défense et à la préservation du bien commun ?
Alors que dit sa stratégie ?
Vrai qu'elle n'annonce pas de privatisation des actifs actuels d'Hydro-Québec. Mais dans les dernières semaines, la société a vendu des actifs, invoquant vouloir se concentrer sur son « cœur de métier », un cœur qui semble pourtant avoir changé puisque dans le document, on peut lire qu'Hydro-Québec aurait un nouveau rôle :
« Maître d'œuvre, actionnaire, acheteur de l'électricité » (p. 3)
Le maître d'œuvre peut concevoir le projet, établir les plans, élaborer les documents techniques, coordonner les travaux, mais il ne se charge pas de la construction ou des travaux. On peut donc lire plus loin qu'il s'agit d'« une occasion à saisir ». Pour qui ?...
« …une occasion de croissance inédite pour l'ensemble des acteurs de l'industrie éolienne, dont les manufacturiers, les développeurs, et les entreprises du secteur de la construction. »(p. 10)
Une occasion d'affaires ! La seule façon pour le gouvernement Legault de comprendre la lutte aux changements climatiques : croissance et développement !
Comment cela se fera-t-il ?
« La planification coordonnée du développement éolien et une approche de partenariat favoriseront l'acceptabilité sociale. » (p. 3)
« Les Premières Nations et les municipalités seront, si elles le souhaitent, des partenaires financiers dans les projets éoliens. » (p. 8)
« Pour chaque projet, les partenaires pourraient s'adjoindre un partenaire de l'industrie. » (p. 9)
« Selon les circonstances et préférences des Premières Nations et municipalités, l'industrie pourrait prendre une participation financière aux projets. » (p. 11)
Bref, l'homme des partenariats public-privé (PPP) impose l'actionnariat public-privé (APP). Et quand on laisse ouverte la porte du poulailler, le loup finit par entrer :
« Par ailleurs, l'autoproduction pourrait avoir un rôle à jouer dans certains cas. » (p. 7)
« En collaboration avec ses partenaires, et selon leurs besoins, Hydro-Québec pourrait ensuite lancer un processus compétitif pour mettre à profit l'expertise des acteurs du secteur éolien. » (p. 8)
« L'élaboration de projets à grande échelle […] qui pourraient atteindre au-delà de 1 000 MW, sont nécessaires afin de répondre à la croissance de la demande […] Pour les projets à petite échelle […] allant jusqu'entre 300 et 350 MW. Les appels d'offres demeureront ainsi l'approche privilégiée pour ces projets. (p. 9)
Donc, les appels d'offres seront « privilégiés » pour des parcs éoliens « à petite échelle », comme maintenant. Pour les grands projets, rien n'est précisé, mais rien n'est exclu. Sans compter que 3 projets de 350 MW atteignent au-delà de 1 000 MW.
« Les partenaires établiront les grandes zones à potentiel de développement éolien aux endroits les plus propices sur le territoire […] Avec ses partenaires, Hydro-Québec définira les secteurs géographiques de développement de manière à assurer l'arrimage avec l'évolution optimale du réseau de transport d'électricité. » (p. 8)
Il y a peu de chances qu'on favorise laconstruction d'éoliennes dans les réservoirs existants ou sur leur pourtour.
« Le premier défi du développement éolien identifié est l'acceptabilité sociale ! (p. 6)
« L'acceptabilité sociale et la confiance du public devront constituer les fondements des projets énergétiques à venir […] Le statut d'institution publique d'Hydro-Québec, son expertise […] en font le maître d'oeuvre tout désigné pour […] favoriser l'acceptabilité sociale » (p.5)
« L'acteur tout indiqué pour inspirer la confiance et […] sa légitimité en tant que maître d'oeuvre du développement énergétique de demain. » (p. 8)
Ainsi donc, la course à l'énergie éolienne au Québec, où on bouscule tout le monde se négociera à travers une acceptabilité sociale où H-Qc mettra sa crédibilité en jeu pour forcer l'acceptation des projets.
Certains ont pourtant déjà expliqué à qui serviraitla fin du monopole d'Hydro-Québec. Des élu.e.s municipaux ont aussi pris position contre la dépossession du bien éolien commun. D'autres ont montré que les Québécois ont payéplus de 6,09 G$ pour prioriser l'énergie éolienne privatisée. N'empêche :exit le débat sur la transition énergétique par laquelle le gouvernement justifie ses choix de développement industriel et énergétique !
Ainsi, la stratégie Sabia ne correspond pas au maintien de la propriété publique de la production, du transport et de la distribution électrique au Québec, pas plus qu'elle ne permet le débat sur la finalité de cette propriété publique, à savoir la nécessaire et prioritaire décarbonation pour répondre à la catastrophe climatique en cours.
Et le Projet de loi que déposera Fitzgibbon ce jeudi 6 juin viendra renforcer cette orientation délétère.
Note
1. Adaptation libre de la phrase célèbre de Neil Armstrong.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sabia au sommet de son art : le marketing de la privatisation !

Jeudi dernier, nous avons été témoins d'une démonstration magistrale des compétences en marketing de Michael Sabia.
À quelques jours du dépôt du controversé projet de loi du ministre Fitzgibbon, censée ouvrir la porte à une privatisation accrue de l'électricité, il a présenté un Plan intitulé « Tracer la voie vers une réussite collective, Stratégie de développement de l'éolien ». Bien que ce plan soit habilement présenté comme une solution bénéfique pour tous, il dissimule une réalité inquiétante : la poursuite insidieuse de la privatisation de l'électricité. En réduisant Hydro-Québec, les municipalités et les Premières nations à de simples actionnaires, M. Sabia réussit à les enfermer dans la logique marchande propre au secteur privé. C'est un véritable tour de force de la part de celui qui a fourbi ses armes avec la privatisation du CN et du REM, de véritables fiascos pour les citoyens.
Hydro-Québec, actionnaire comme le privé ou propriétaire à 100% public ?
Sous le couvert de termes séduisants comme "réussite collective", le plan de Sabia renforce en réalité la privatisation progressive et l'influence du secteur privé. Hydro-Québec se voit reléguée au rang d'actionnaire aux côtés d'actionnaires privées. Ce changement de rôle est non seulement radical mais aussi problématique. En tant qu'actionnaire, l'objectif premier devient le profit, déviant ainsi du mandat initial d'Hydro-Québec qui est de servir le bien commun.
Cette situation crée un conflit d'intérêt indéniable. Prenons l'exemple du Projet Éolien Des Neiges. Hydro-Québec, en tant qu'actionnaire avec Boralex et Énergir, cherchera à maximiser le prix du kwh. Comme acheteur, elle visera, au contraire, à acheter au plus bas prix. Cette dualité de rôle est inconciliable. Hydro-Québec doit être propriétaire à 100% des futurs parcs éoliens et maître de ses décisions.
Retombées locales : par l'actionnariat comme le privé ou par les redevances ?
Le plan de M. Sabia incite également les communautés locales à devenir actionnaires pour bénéficier des retombées économiques. Les communautés ne devraient pas être obligées de s'endetter pour participer aux bénéfices des projets éoliens. Une formule de redevances serait beaucoup plus avantageuse, permettant aux communautés de bénéficier des retombées sans les risques financiers associés à l'actionnariat. De plus, l'actionnariat, par sa nature privée, les détournerait de leur rôle premier qui consiste à la protection du territoire.
L'Autoproduction, une nouvelle forme de privatisation
Pour en ajouter, le Plan inclut l'autoproduction d'électricité, une première depuis la nationalisation. C'est une nouvelle forme de privatisation. C'est écrit spécialement pour TES Canada (Power corporation), un projet d'hydrogène dénoncé par de nombreux experts, véritable cheval de Troie de la privatisation rampante. L'autoproduction additionné à la vente « entre voisins » envisagée par le ministre Fitzgibbon, c'est le début de la fin du modèle public d'Hydro-Québec.
L'électricité est une ressource stratégique. Qui contrôle l'électricité, contrôle l'économie. Ici c'est un contrôle public que nous avons choisi pour le plus grand bien des citoyens du Québec.
Martine Ouellet
Cheffe Climat Québec
Ancienne ministre des Ressources naturelles
Ancienne gestionnaire chez Hydro-Québec
SOURCE :
climat.quebec
communications@climat.quebec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
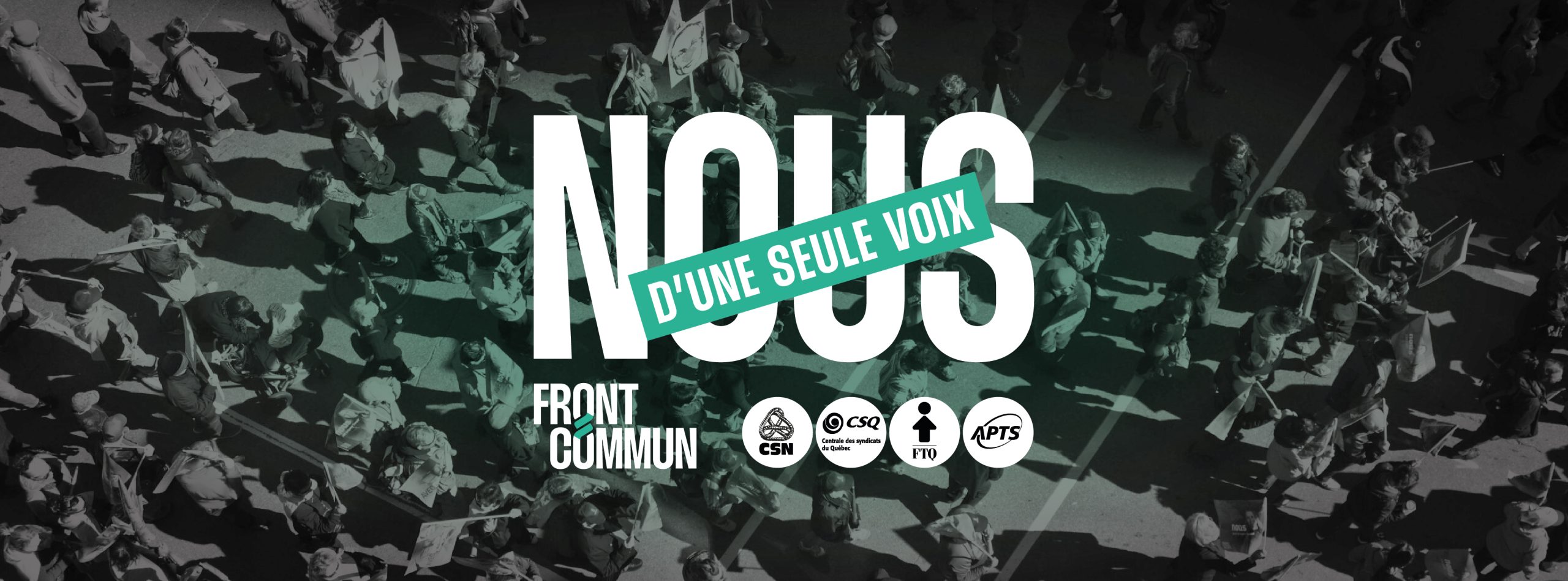
Il est toujours trop tôt pour faire le point…
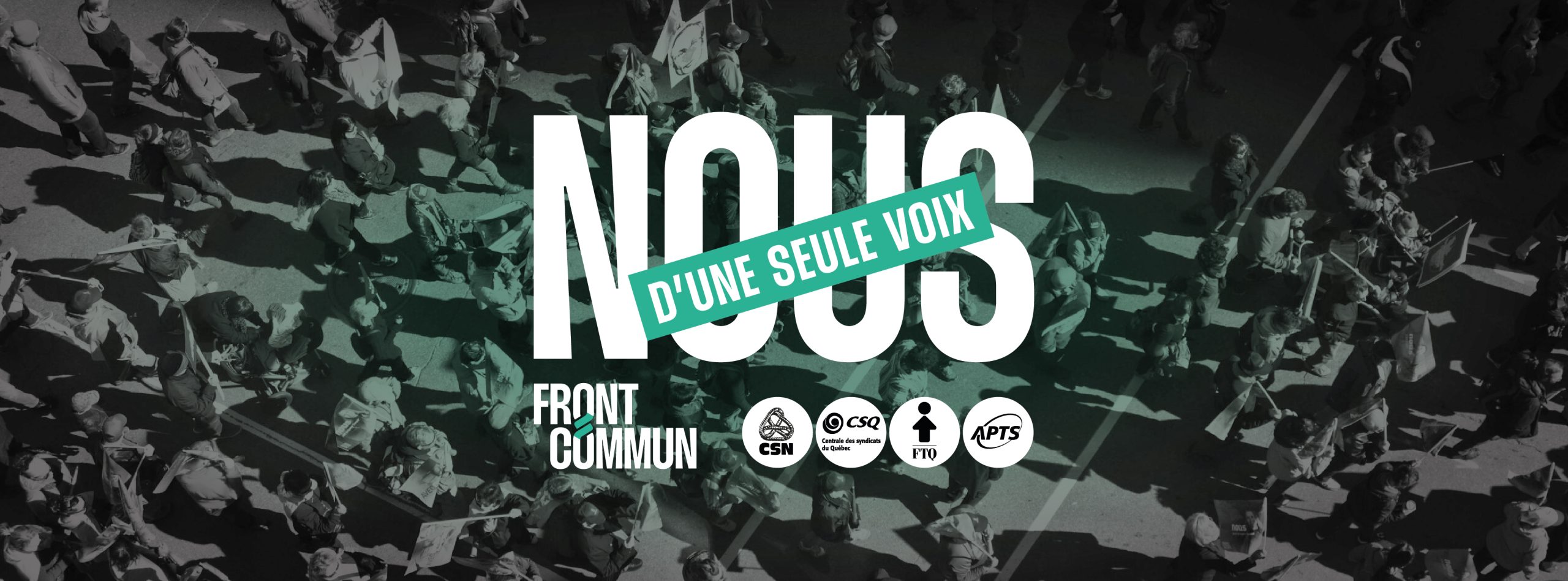
Au moment où arrive enfin, pour certaines et pour certains, la période des vacances estivales le temps est venu de faire le point sur certains aspects de la vie sociale ou de reporter à plus tard cette activité.
Nous soutenons qu'il est toujours trop tôt pour dresser le bilan de la présente ronde de négociation dans les secteurs public et parapublic. Si certains groupes ont signé en bonne et due forme leur convention collective version 2023-2028, d'autres sont toujours en rencontre à face-à-face avec les négociatrices et les négociateurs du Conseil du trésor. Tout ce qu'il nous est permis de dire à ce moment-ci c'est qu'il aura fallu plus de cinq mois à certains groupes pour convertir l'entente de principe du mois de décembre 2023 en convention collective. Il ne sera pas facile d'effectuer ce bilan de la présente ronde de négociation, il va falloir attendre jusqu'en mars 2028 pour être en mesure de constater si le pouvoir d'achat de la totalité des 600 000 salariés syndiqués a été entièrement protégé . Il va falloir également prendre connaissance des bilans qui seront établis par les organisations syndicales et la partie gouvernementale. L'auteur des présentes lignes réalise de plus en plus qu'il est quasi vain de commenter ces négociations à partir de simples données impressionnistes. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Yvan Perrier
9 juin 2024
8h45
yvan_perrier@hotmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte - La démocratie en santé et services sociaux, une grande force menacée

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux aura été un moment marquant de la session parlementaire qui prend fin cette semaine. Plus d'un an après le dépôt du projet de loi créant l'agence Santé Québec, nous demeurons très inquiets, non seulement en raison de la place que le gouvernement fait au privé et de l'extrême centralisation, mais également face aux reculs démocratiques dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Tout le processus ayant conduit à l'adoption de ce projet de loi en dit long sur l'état de notre démocratie. Au lieu d'écouter l'intelligence collective des Québécois et des Québécoises et de s'y fier, le gouvernement a plutôt conçu cette réforme en vase clos et sans véritables consultations. Sans surprise, celle-ci va à l'encontre de plusieurs solutions qui font largement consensus de la part des intervenants et intervenantes sur le terrain et du milieu de la recherche.
La population ne souhaitait pas une énième réforme de structures, mais des solutions concrètes pour un meilleur accès à un médecin de famille, de meilleurs soins et un panier de services élargi (ex. soins à domicile, santé mentale, etc.).
L'adoption du projet de loi sous bâillon constitue une autre illustration des dérives démocratiques. On observe ce même phénomène ailleurs, que ce soit l'ouverture majeure consentie au privé en télémédecine par simple règlement ou encore dans la remise en question de l'universalité et de la gratuité de soins par la commissaire à la santé et au bien-être, sur la base d'un sondage en ligne et de l'opinion de quelques personnes ciblées.
Quant à Santé Québec, nous craignons que cette structure gigantesque éloigne encore plus les citoyens et les citoyennes de leur réseau. Cette agence ne doit pas devenir une grosse boîte noire, inaccessible et opaque. Son conseil d'administration ne peut fonctionner comme celui de n'importe quelle entreprise privée. Les services publics remplissent des missions et assument des responsabilités bien particulières, qui n'ont rien à voir avec une entreprise et ses actionnaires.
Des mesures doivent être envisagées pour renforcer la participation démocratique de la population et des groupes qui ont à coeur le réseau de santé et de services sociaux. Cela pourrait commencer par accorder des places au conseil d'administration et aux conseils d'établissement pour une représentation de la société civile et des travailleurs et travailleuses et, également, par instituer des espaces locaux de participation citoyenne dotés de réels pouvoirs.
Depuis 30 ans, le système de santé s'est transformé à coups de réformes à courte vue, lesquelles ont été instaurées du haut vers le bas. Celles-ci ont imposé toujours plus de contrôle sur les équipes de travail, qui finissent par ne plus se reconnaître dans ce grand ensemble impersonnel. Plutôt que de confier l'avenir du système de santé et de services sociaux à des gestionnaires du privé, on doit faire autrement en favorisant une reprise de possession collective.
Il est urgent de rétablir et de renforcer plusieurs leviers : l'accès à l'information, le débat public, la prise de décision partagée. Pour assurer le respect des droits fondamentaux, les structures de gouvernance doivent tenir compte des diverses réalités et expertises et doivent mettre en place des mécanismes permettant à la société civile d'être informée, de surveiller et d'influencer les grandes orientations et les travaux qui transforment notre système public de santé et de services sociaux.
La démocratie doit cesser d'être perçue comme une embûche ou un mal nécessaire et être reconnue pour ce qu'elle est : une grande force.
Cette lettre a été publiée dans Le Devoir le 10 juin 2024.
Robert Comeau, Éric Gingras, Caroline Senneville, Magali Picard et Julie Bouchard
Les auteurs sont respectivement président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ils cosignent cette lettre avec six autres organisations : Fanny Demontigny, présidente du Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique (CPAS-SCFP-FTQ) ; Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) ; Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ; Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN) ; Sylvie Nelson, présidente du Syndicat des employés et employées de services (SQEES-298) ; Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manifestations contre le privé en santé à Laval et en Gaspésie

Nos syndicats de la santé ont organisé des actions dans le cadre de la Semaine nationale d'actions régionales de la Coalition Solidarité Santé. Au son de l'iconique Danger Zone, ils ont rappelé que les vrais « Top Gun » en santé, ce sont les membres du personnel !
Tiré de Ma CSQ cette semaine.
Une centaine de membres du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), profitant de leur assemblée générale de déléguées et délégués, se sont invités devant le Laboratoire Biron express de Laval pour dénoncer la privatisation en santé.
Des « Top Gun » à la rescousse !
Arborant la symbolique du film Top Gun (lunettes de soleil proéminentes et avions miniatures en prime !), les membres sont venus dénoncer le mirage que représentent le secteur privé et l'arrivée de gestionnaires-héros qui vont tout régler.
« Santé Québec contrôlera tout à partir de Québec. Que restera-t-il comme autonomie pour les régions ? Avec la création de Santé Québec, on dévalorise encore le travail du personnel du réseau public et on favorise le développement de l'entreprise privée à but lucratif. Pour nous, la santé de la population ne devrait jamais être liée à la recherche de profits de quelques privilégiés », affirme Lise Goulet, présidente de la Coalition Solidarité Santé.
Quand le public subventionne le privé !
Le gouvernement choisit d'orchestrer un système où l'État subventionne les compagnies privées pour qu'elles dispensent des soins de santé. On rassure la population en lui disant qu'elle n'aura rien à payer, car ce sera couvert par la carte d'assurance maladie, mais finalement ce sont les Québécoises et les Québécois qui, collectivement, par le biais de leurs impôts, assumeront des coûts beaucoup plus élevés en santé afin de couvrir la portion importante de profits inhérente à la médecine privée.
« En centralisant aux niveaux régional et national avec les réformes Barrette et Dubé, on rend de plus en plus inefficace le réseau de la santé. Nous croyons que ces échecs sont planifiés par ceux qui initient et appuient ces réformes. On affaiblit le réseau pour en faire un mauvais compétiteur et ainsi mieux le privatiser et augmenter les profits des entrepreneurs privés. Quant aux problèmes des citoyennes et citoyens lavallois, ils se trouvent totalement ignorés », souligne Déreck Cyr, président du SIIIAL-CSQ.
« Le privé n'a simplement pas sa place dans les soins à la population, ajoute Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ). Notre message à nous, c'est qu'on veut donner des soins plus humains à la population. Ça ne passe pas par la privatisation de pans entiers de notre système, ça passe par des conditions de travail plus humaines pour nos membres et une gestion axée sur l'humain et non sur les tableaux Excel ! »
« Le ministre dit aux Québécoises et aux Québécois que l'ouverture au privé est la solution aux problèmes d'accessibilité au réseau public alors qu'on sait très bien que c'est plutôt l'origine des difficultés ! Chaque clinique ou hôpital privé qui ouvre vient drainer les ressources du public et, ainsi, aggrave les problèmes d'accès. Les médecins et le personnel de la santé et des services sociaux ne poussent pas dans les arbres, chaque travailleuse et chaque travailleur qui va vers le privé est une travailleuse ou un travailleur de moins dans le public », conclut Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un pas de plus vers la création d’une assurance-médicaments universelle pour les Canadiens

Le Canada n'a jamais été aussi près d'obtenir un régime public universel d'assurance-médicaments. La Loi sur l'assurance médicaments, présentée au Parlement en février 2024, a été adoptée hier soir. Ce cadre fournira une couverture immédiate pour les médicaments contre le diabète et les contraceptifs, ouvrant la voie à l'élargissement de la couverture de tous les médicaments essentiels pour tous les habitants du Canada.
« Ce fut possible grâce aux alliés et militants syndicaux qui œuvrent inlassablement depuis des décennies pour la création d'une assurance-médicaments, déclare Siobhan Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada. Cette législation permettra aux travailleuses et travailleurs et aux employeurs d'économiser de l'argent, réduisant ainsi le fardeau financier causé par un système d'assurance morcelé. C'est un pas vers l'obtention de meilleurs soins de santé, en réduisant la pression exercée sur notre système de santé en évitant les visites coûteuses à l'hôpital et aux médecins », ajoute madame Vipond.
Chaque année, un million de Canadiens et de Canadiennes doivent choisir entre acheter les nécessités de base ou leurs médicaments. Par exemple, les médicaments pour le diabète de type 2 peuvent coûter jusqu'à 10 000 $ par année, et les contraceptifs oraux coûtent 240 $ par année.
Le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, établit un cadre pour un régime universel d'assurance-médicaments à payeur unique. Cette réalisation, qui résulte de l'influence du NPD dans un parlement minoritaire et de la collaboration avec le ministre de la Santé Mark Holland, est l'amélioration la plus importante apportée aux soins de santé au Canada depuis l'instauration de l'assurance-maladie publique.
Pour le moment, le chef conservateur Pierre Poilievre n'a toujours pas pris d'engagement quant à savoir si un gouvernement conservateur démantèlerait des programmes comme les soins dentaires et l'assurance-médicaments.
« Les conservateurs s'opposent systématiquement aux investissements dans les services de garde d'enfants, les soins de santé publics et l'assurance-médicaments, se rangeant souvent du côté des intérêts des PDG de Bay Street et des lobbyistes patronaux. Et ils continueront de soutenir les grandes sociétés pharmaceutiques au lieu des besoins des familles canadiennes », ajoute Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « L'assurance-médicaments offrira de meilleurs soins de santé à des millions de Canadiens, allègera leur situation financière et leur donnera les moyens de mieux contrôler leur santé sexuelle et reproductive », affirme-t-elle.
Si l'on veut assurer la réussite de l'assurance-médicaments, l'appui des provinces est primordial. Avec le régime actuel d'assurance-médicaments hybride du Québec, qui combine une couverture publique et privée, les coûts des médicaments sont encore inabordables pour de nombreuses personnes. Cette approche morcelée profite aux compagnies d'assurance et aux grandes sociétés pharmaceutiques en maintenant les marges bénéficiaires élevées. Un régime d'assurance-médicaments exhaustif qui privilégie les besoins des individus plutôt que les profits est la voie à suivre.
Les travailleuses et les travailleurs de partout au pays nous disent constamment que l'assurance-médicaments est d'une importance capitale pour eux et leurs familles. Le message est sans équivoque : les décisions en matière de soins de santé doivent être prises entre vous et votre médecin, et non dictées par votre situation financière.
Les syndicats du Canada demandent au Sénat d'adopter rapidement le projet de loi C-64, qui permettra d'améliorer les soins de santé pour des millions de personnes, d'alléger le fardeau financier des familles et de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes aient le contrôle sur leur santé sexuelle et reproductive.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Passer à l’action contre l’extrême-droite

Les 13 (Montréal) et 16 mai (Québec) La FTQ organisait des journées de formation sur la montée de l'extrême-droite dans le monde et au Québec. Cette journée se voulait une "journée de réflexion visant à comprendre et contrer la montée des nouvelles droites au Québec, un phénomène qui façonne de manière préoccupante notre paysage sociopolitique.(...) Cette journée a été "l'occasion d'identifier les menaces que ces nouvelles droites font peser sur la vie syndicale et démocratique, et de réfléchir ensemble aux pistes d'action et de résistance.
Presse-toi à gauche ! publie le chapitre 5 sur l'organisation de la riposte syndicale à cette montée de l'extrême-droite. Il rend disponible également, l'ensemble du document qui a servi de base à cette importante journée de formation.
Pour lire l'ensemble de cahier de formation, cliquez sur l'icône :
CHAPITRE 5 Passer à l'action
Comment faire face à la montée des nouvelles droites ? On peut se pincer le nez et espérer que ça passe. Le danger est de se retrouver dans la même situation qu'aux États-Unis où, selon certains, les syndicats sont mal outillés pour constituer un contrepoids à la progression de l'extrême droite et du fascisme. Il faut donc agir plus tôt que tard.
Il faut donc agir plus tôt que tard. En 2021, la Confédération européenne des syndicats (CES) a par exemple adopté une feuille de route comprenant 15 actions à mettre en œuvre. Il n'existe pas de solution unique et les organisations syndicales devront choisir les mieux adaptées à leur contexte. Quelques bonnes pratiques plus généralisables méritent cependant d'être présentées pour inspirer les différents acteurs préoccupés par le phénomène.
Sur le plan des idées : s'engager dans la « guerre culturelle » Réaffirmer nos valeurs syndicales
En tant que centrale, la FTQ a la responsabilité de se porter à la défense de la démocratie à tous les niveaux de la société et de combattre les nouvelles droites qui cherchent à affaiblir le pouvoir des travailleurs et des travailleuses. Elle doit accompagner et soutenir ses syndicats affiliés ainsi que ses conseils régionaux dans cette lutte. Cela implique d'avoir des positions claires, de les faire connaître auprès des membres et du public et de dénoncer lorsqu'elles sont attaquées, comme le fait la CFDT avec la démocratie.
Aussi, il apparaît essentiel de souligner (et de répéter) que les valeurs de la FTQ sont aux antipodes de celles des nouvelles droites. Ses Statuts, en particulier à son article 4, reflètent cette opposition en détaillant les fins et les moyens de la centrale. Certains sont plus pertinents pour notre propos. Les voici :
b) défendre les principes du syndicalisme libre ;
d) combattre toute forme de discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de grossesse, d'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, d'état civil, d'âge sauf dans les mesures prévues par la loi, de religion, de convictions politiques, de langue, d'origine ethnique ou nationale, de condition sociale, ou de handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap ;
f) travailler à instaurer au Québec un régime de justice sociale, de dignité de l'individu et de liberté démocratique ;
i) défendre la liberté de l'information et encourager la presse syndicale de même que tout autre moyen d'assurer l'information des travailleurs et travailleuses ;
Défendre le syndicalisme, combattre les discriminations, promouvoir la démocratie et assurer la liberté d'information : voilà des principes inscrits au cœur des statuts de la FTQ depuis des décennies, et même depuis sa création. La lutte aux idées toxiques ne constitue donc pas une activité périphérique, mais fait partie de son core business. Malheureusement, les statuts de la centrale, ses valeurs et sa raison d'être sont souvent peu connus des membres. Il y aurait lieu de mieux les communiquer. C'est la première étape pour positionner la FTQ, sans équivoque, contre le projet politique des nouvelles droites.
Un retour dans le passé montre également que la FTQ se préoccupait de certains courants politiques. Dans les premiers statuts de la centrale, de ses débuts en 1957 jusqu'à l'imposante réforme statutaire de 1965, on pouvait y lire qu'elle se donnait comme fins et buts de :
…protéger le mouvement syndical contre toute influence corruptrice et toute tentative de saper son action de la part d'organisations communistes, fascistes ou autres organisations totalitaires dont la philosophie et les moyens d'action sont contraires à l'exercice de la démocratie et du syndicalisme libre.
– FTQ, Modifications aux statuts, 10e Congrès, 1967, p.1 (article 2, section 1, paragraphe 9).
Pourquoi cette section des statuts a-t-elle été retirée ? Il faudrait fouiller dans les archives pour en avoir le cœur net, mais on peut penser qu'elle était tombée en désuétude considérant l'affaiblissement des forces fascistes après la Deuxième Guerre mondiale et d'un anticommunisme moins virulent dans les années 1960 avec la fin du maccarthysme et du duplessisme. Dans le contexte actuel, serait-il pertinent de réintégrer de telles dispositions (avec les adaptations qui s'imposent) pour lutter contre la montée des nouvelles droites ? La question mérite d'être soulevée.
Être présents sur toutes les tribunes
Les leaders syndicaux doivent exprimer clairement leur opposition face à la montée des nouvelles droites et participer activement à la lutte contre l'extrême droite. Cet engagement envoie un signal d'appui fort pour les militants et les militantes. Le mouvement syndical a toujours été à la pointe du combat. C'est une question de survie ! À la CFDT, l'ancien secrétaire général, Laurent Berger a répété inlassablement que son organisation allait toujours se battre contre l'extrême droite. Il en est de même de la CGT et de son ex-dirigeant, Philippe Martinez. Sans compromis, sans ambiguïté ! Au Canada, plus récemment, la présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, a démenti les propos du chef conservateur Pierre Poilievre qui se dit l'allié des travailleurs et travailleuses. En début d'année, la présidente de la FTQ, Magali Picard, s'est aussi positionnée en affirmant que les valeurs de ce dernier étaient loin de celles de la centrale
Décrypter les nouvelles droites
Les nouvelles droites se présentent souvent comme les grands défenseurs des travailleurs et travailleuses et du « monde ordinaire ». La montée de l'insécurité et de la précarité est en soi une opportunité pour les groupes et les partis politiques qui s'inscrivent dans ce courant. Ils peuvent facilement pointer du doigt l'échec des institutions et de l'establishment à protéger les plus vulnérables. Certains partis vont même proposer des mesures pour charmer la classe ouvrière et donner un vernis social à leur programme. Une tromperie, un écran de fumée, pour usurper le rôle et les fonctions des syndicats. D'où l'importance de démasquer les messages manipulatoires de cette mouvance politique. La FTQ et ses affiliés doivent être alertes pour débusquer les discours radicaux qui sont aujourd'hui très lissés. Il est rare de lire ou d'entendre un parti politique revendiquer ouvertement l'abolition des organisations syndicales ou le renvoi des personnes immigrantes « chez elles ». Il est important d'analyser l'argumentaire, fouiller les propositions, et surtout surveiller leurs actions. Les tenants des nouvelles droites qui cherchent à obtenir du pouvoir et de l'influence adoptent des stratégies truffées de subtilités pour gagner le vote populaire. Par exemple, le parti d'extrême droite belge Vlaams Belang promet des « mesures sociales » qui peuvent séduire en apparence, mais qui se traduisent par des pertes pour les travailleurs et travailleuses, en particulier les plus vulnérables.
Il faut ainsi décoder le message des droites radicales et extrêmes lorsqu'elles parlent d'enjeux sociaux et du travail. Quand discutent-elles du déséquilibre de pouvoir entre les employeurs et les travailleurs et travailleuses ? De la nécessité de taxer les ultrariches, d'investir dans les services publics ? Poser la question, c'est y répondre.
L'extrême droite a une profonde aversion envers les syndicats et les représentant·es des travailleur·euses et propose des amendements pour augmenter le nombre de salarié·es à partir duquel des obligations (représentation du personnel, informations…) sont imposées à l'employeur. Il ne manquerait plus que la main-d'œuvre bon marché puisse être représentée et se défendre. Ainsi les députés RN ont proposé un amendement visant à interdire la présence d'étrangers au sein des Instances Représentative du Personnel (IRP) et pour limiter le droit de vote des travailleurs précaires aux élections professionnelles. Leur modèle reste le corporatisme historique et ils ne manquent pas une occasion pour critiquer les mouvements de grève et cognent régulièrement sur notre organisation syndicale.
– Extrait du document de la CGT : 10 points sur lesquels l'extrême droite relève de l'imposture sociale
S'engager dans la bataille des idées
Les syndicats sont parfois perçus comme de grosses machines intégrées au système et déconnectés des préoccupations des gens ordinaires même si leurs revendications ont le potentiel d'améliorer concrètement les conditions de vie et de travail de ces derniers. Force est de constater que le mouvement syndical a du retard à rattraper face aux nouvelles droites qui ont repris l'offensive sur le mode de la révolte ou de la rébellion . Pour les combattre, la FTQ doit gagner la bataille des idées. Il ne s'agit donc pas de diaboliser le discours de l'opposant ou de moraliser sans rien proposer. Cela serait contre-productif. Il faut promouvoir une vision qui parle aux gens, qui propose des solutions aux situations qu'ils vivent.
Les syndicats doivent donc reprendre le contrôle du débat selon leurs propres termes. Nous n'avons rien à gagner à emprunter les thèmes des nouvelles droites ou à tenter de les accommoder. Au contraire, il apparaît nécessaire de soutenir et défendre des mesures progressistes et inclusives qui combattent les inégalités et la précarité. Le projet de société de la FTQ doit faire rêver davantage et susciter la mobilisation. Les syndicats doivent ainsi proposer des alternatives et les pousser sans relâche dans l'arène politique. Par exemple, l'universalité est un principe plus capital que jamais qui peut renverser les injustices grandissantes et l'insécurité économique, tout comme l'importance d'assurer à chaque personne un emploi décent. Même si des revendications syndicales datent de plusieurs décennies, elles sont plus que jamais pertinentes.
Cela dit, nous ne pouvons gagner cette bataille des idées sans une brillante stratégie de communication, un domaine où les nouvelles droites excellent. Il faut donc développer des messages qui rassemblent et mobilisent, et repositionner les revendications syndicales pour intéresser davantage tous les travailleurs et les travailleuses. Il faut être particulièrement actif en période électorale pour influencer l'opinion publique en plaçant les thèmes syndicaux et nos solutions aux problèmes économiques au cœur des débats.
Dans les milieux de travail : réduire l'influence des droites
D'après nos entretiens avec plusieurs syndicalistes, on peut affirmer que les nouvelles droites ne constituent pas une menace sérieuse à l'action syndicale présentement. Il s'agit là d'une bonne nouvelle, mais attention ! Cela ne signifie pas l'absence de problèmes ou que ceux-ci ne puissent pas éventuellement prendre de l'ampleur. Tout en parlant de phénomènes marginaux, ponctuels, on note de plus en plus de commentaires d'intolérance ou de « blagues » sur des thèmes comme l'identité de genre, la religion, la nationalité et les travailleuses et les travailleurs étrangers temporaires. Une stratégie en deux volets peut constituer un bon point de départ. D'abord, il faut écouter, dialoguer, mais sans moraliser. Ensuite, il peut être nécessaire de mettre des limites si certains propos ou gestes risquent de briser la solidarité.
Faire preuve d'ouverture
On peut retrouver dans les syndicats des personnes qui s'associent aux nouvelles droites pour signifier leur mécontentement ou pour protester contre les partis dominants et les institutions. Elles sont souvent animées par des considérations économiques et un sentiment d'insécurité. Syndicalement, nous avons un devoir d'aller à la rencontre de ces membres, de les écouter et d'ouvrir un dialogue.
Écouter et dialoguer sans moraliser
Selon des experts et des expertes, si des personnes sont attirées par les nouvelles droites c'est qu'elles ont été délaissées et ne se sentent pas écoutées par la gauche. En Allemagne, le syndicat IG Metall explique la montée de ZA (Zentrum Automobil, un groupe implanté dans les conseils du travail avec une orientation de droite radicale) par une absence de présence quotidienne de ses représentants et représentantes dans les milieux de travail, une déconnexion avec la base, des relations sous-développées, et une trop grande proximité avec l'employeur . Autrement dit, le bon vieux syndicalisme de terrain s'impose plus que jamais.
L'adhésion à des idées des nouvelles droites peut ainsi témoigner d'une déconnexion ou d'un désenchantement à l'égard des syndicats et des valeurs qu'ils défendent. Maintenir un bon contact avec les membres est une condition essentielle pour ne pas avoir l'air distant ou trop institutionnalisé. Écouter et questionner permet aussi de mieux comprendre les positions prises par les travailleurs et travailleuses.
Pourquoi aller à la rencontre de l'autre ?
[…] aller à la rencontre des gens dans une posture d'écoute permet de dépasser les a priori et d'obtenir une vision plus subtile de leur vie quotidienne. Une telle approche offre l'occasion de se mettre à leur place, ne serait-ce qu'un instant, et de considérer leurs problèmes, mais aussi leurs espoirs, avec leurs propres yeux.
– Johannes HILJE, Les oubliés. Entretiens sur les terres où prospère le vote extrême, Das Progressive Zentrum, 2022
Faire la morale en diabolisant les nouvelles droites, chercher à dicter le vote ou condamner des individus pour leurs croyances sont des stratégies vouées à l'échec et une invitation à fuir l'organisation syndicale. Dialoguer avec respect est de loin préférable. Et surtout, il faut faire confiance à l'intelligence des travailleurs et travailleuses. Ouvrir la discussion, c'est aussi une occasion pour rappeler les positions et les valeurs du syndicat comme l'équité, la lutte à la discrimination et la solidarité. Convaincre est toujours plus payant que d'ignorer, rejeter ou penser que l'autre a tout faux. Cela dit, on peut rester ferme sur les principes fondamentaux. Comme nous rappelle une personne experte sur la question : « Il faut donc maintenir le lien, mais sans trop concéder sinon on abdique devant le discours de l'autre ».
Ainsi, en présence d'une personne qui partage des idées associées à la droite radicale sans qu'elle soit une adepte de tels mouvements, il est recommandé d'aller à sa rencontre pour lui poser des questions, lui demander de motiver ses convictions et expliquer celles du syndicat. On peut par ailleurs l'enjoindre à ne pas imposer ses opinions à ses collègues et à rester respectueuse des autres travailleurs et travailleuses.
Former pour mieux échanger
L'éducation syndicale est évidemment incontournable pour combattre les nouvelles droites. Elle fournit un lieu pour écouter les membres, dialoguer et partager des idées. La création d'espaces de discussion animés par les pairs, principale approche pédagogique du service de l'éducation de la FTQ, est à privilégier selon plusieurs. Quand cela vient du groupe, l'impact est toujours plus fort.

Le contenu des formations doit permettre d'ouvrir le dialogue sur des enjeux politiques, sociaux et citoyens qui impactent le quotidien des travailleurs et travailleuses (logement, racisme, identité de genre…). Des trousses préparées par la FTQ, comme celle sur le racisme, peuvent être utiles à cette fin. Son service d'éducation offre aussi une formation sur l'action politique qui vise à outiller les militants et les militantes pour agir comme agents multiplicateurs dans leur milieu en mettant en valeur le projet de société de la FTQ.
À la CGT (France), l'éducation interne a été priorisée pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses sur la montée des nouvelles droites. Des journées de formation ont été déployées dans toutes les régions pour outiller les militants et militantes sur des sujets comme l'antiracisme et l'antagonisme avec les valeurs et les programmes du Rassemblement national. Des fiches pratiques ont aussi été produites sur ces thématiques. Le groupe Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (VISA) qui rassemble des syndicats français dans la lutte contre l'extrême droite propose également plusieurs formations pour contrer la diffusion de telles idées.
Soutenir par l'exercice d'un leadership collectif
Dans la lutte contre les nouvelles droites, il faut aussi penser au soutien à apporter aux personnes déléguées, conseillères ou élues. Il faut les outiller par la formation, mais aussi les accompagner dans leur rôle de paratonnerre et de gardiens et gardiennes des valeurs syndicales. Une approche à encourager est l'autorégulation et l'exercice d'un leadership collectif. Autrement dit, lorsqu'un membre tient des propos ou pose des gestes blessants ou méprisants envers un autre, il est recadré par le groupe. On évite ainsi de faire porter à quelques individus toute la charge de préserver l'harmonie et le respect au sein du syndicat.
Mettre des limites claires pour protéger les membres et le syndicat
Comme mentionné antérieurement, la majorité des membres qui adhèrent à certaines propositions des nouvelles droites le font en raison de préoccupations légitimes sur l'économie ou l'emploi, par exemple. Mais une faible minorité d'entre eux soutient ces groupes par idéologie et par conviction profonde. Engager un dialogue apparaît alors non seulement impossible, mais contre-productif. Certains intervenants nous ont même rapporté des cas de conversions radicales où un délégué ayant un bon potentiel de militance s'est rallié aux idées de droite radicale, notamment contre les mondialistes et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les syndicats doivent donc se préparer à de telles situations afin de protéger leurs membres et leur organisation.
Se démarquer des nouvelles droites
Une stratégie employée par la grande majorité des syndicats consiste à se démarquer des idées et des pratiques des nouvelles droites. Il ne faut pas hésiter à rappeler et mettre les limites qui s'imposent en s'appuyant sur les valeurs, les statuts et règlements du syndicat. Les organisations syndicales ont un devoir, celui de combattre un mouvement politique qui menace son projet de société et son existence. Il importe de faire preuve de courage, être franc et transparent pour indiquer clairement que les discours et les revendications des droites radicales et extrêmes ne seront jamais les bienvenus. Il faut par ailleurs accepter que l'on ne puisse faire adhérer tout le monde aux valeurs syndicales.
Un chercheur à qui nous avons parlé a observé que des directions syndicales, dans certains milieux de travail, ont tendance à se taire et reculer lorsque confrontées à des attaques de personnes adhérant à des mouvements de droite radicale. Elles craignent la réaction des membres, l'isolement ou la critique. En réalité, plusieurs responsables syndicaux peuvent se sentir désemparés, et pour cause. Pour la cohorte de syndicalistes des 20-30 dernières années, le phénomène est relativement récent. Ces personnes ont été formées pour défendre les travailleurs et travailleuses face aux employeurs et non pour gérer les charges, parfois internes, provenant des nouvelles droites. Mais le contexte a changé et de nouveaux réflexes doivent être développés.
L'adoption d'un positionnement sans équivoque par des syndicalistes, autant élus que conseillers, a un impact positif. On nous a rapporté que les membres ayant des idées très à droite ne se sentaient pas à l'aise de partager leurs convictions aux responsables syndicaux qui affirmaient haut et fort les valeurs du syndicat. Dans nos entretiens avec des organisations hors Québec, on mentionne également qu'une telle posture rend le syndicat beaucoup moins attrayant et hospitalier pour les personnes qui soutiennent idéologiquement les nouvelles droites. Elles sont donc moins susceptibles d'occuper des fonctions officielles au sein de l'organisation. Ainsi, mettre des balises claires fait partie des stratégies pouvant être adoptées afin de protéger les milieux de travail, les syndicats et la solidarité.
Limiter la propagation des idées toxiques
Les idées des nouvelles droites doivent être perçues comme des contaminants qui constituent un risque à la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses ainsi que des personnes élues et conseillères des organisations syndicales. Pour le moment, les idées toxiques des nouvelles droites ne semblent pas constituer un risque majeur, bien que leurs impacts puissent être très négatifs. Il faut rappeler que certains groupes sont plus vulnérables, car directement visés par les discours de ces droites, par exemple, les personnes racisées, issues de l'immigration ou appartenant à des minorités sexuelles. Et comme il faut éliminer les risques à la source, les syndicats doivent jouer un rôle actif pour limiter la propagation des nouvelles droites dans les milieux de travail. Tout en maintenant la stratégie d'ouverture décrite plus haut, il faut aussi intervenir rapidement en présence de comportements ou de propos inappropriés. En gestion de conflit, l'évitement peut permettre de gagner du temps, mais il ne règle pas le différend et contribue à détériorer les relations.
De manière générale, les membres adhérant à des idéologies extrêmes participent peu aux activités syndicales car ceux-ci ne font pas confiance aux institutions, incluant les syndicats. Ils sont donc plutôt en retrait. Face à ces individus très antisyndicaux et radicalisés, des responsables syndicaux nous ont mentionné qu'ils gardaient leurs distances tout en continuant de tendre la main. Cependant, certaines personnes radicalisées peuvent exercer une influence sur le reste de l'unité. Dans ce dernier cas, il importe d'intervenir pour corriger des propos erronés ou discriminatoires envers d'autres membres. Plusieurs actions sont alors possibles en fonction de la gravité des gestes et de leur fréquence : rappeler les valeurs de l'organisation, clarifier le rôle du syndicat, demander que de tels propos cessent, exercer un leadership collectif comme décrit plus haut ou déposer un grief à l'employeur (voir ci-bas).
Les syndicats peuvent aussi assurer un rôle de vigie en surveillant les communications verbales ou écrites qui circulent sur les lieux de travail. Si elles outrepassent la liberté d'expression et qu'elles renvoient à des idées racistes, sexistes ou autres qui heurtent les valeurs du syndicat, ils peuvent faire cesser leur diffusion. Les syndicats peuvent également s'appuyer sur les politiques des employeurs concernant l'affichage et la distribution de contenus. C'est toutefois principalement sur les réseaux sociaux que se manifestent les idées toxiques des nouvelles droites. Dans certains syndicats, des conseillers et des conseillères modèrent les commentaires sur leurs pages (Facebook, Instagram, etc.). Dans certains cas, on participe activement sur les pages du syndicat pour éliminer tout propos problématique et on évite d'engager des discussions stériles avec des individus irrespectueux. Autrement dit, ne nourrissez pas les trolls ! Dans d'autres, on laisse libre cours aux débats et on agit lorsque des affirmations inadmissibles sont publiées en avisant la personne en message privé qu'elle peut commenter, mais dans un langage acceptable. Si cela se poursuit, elle est bannie de l'espace virtuel. « Il faut montrer que l'on n'est pas intimidé », nous a-t-on expliqué. Certains syndicats vont aussi cibler les membres qui tiennent des propos inacceptables pour intervenir directement auprès d'eux ou d'elles afin de faire cesser de tels comportements.
Faire pression sur l'employeur
Plusieurs syndicats nous ont confié avoir forcé l'employeur à prendre ses responsabilités pour assurer un milieu de travail sain et exempt de harcèlement en vertu de la Loi sur les normes du travail. Comme organisation syndicale, on peut veiller à ce qu'il adopte et mette en œuvre les meilleures politiques et pratiques en la matière. Si un gestionnaire ou un travailleur ou une travailleuse harcèle un membre de l'unité d'accréditation en tenant des propos racistes, sexistes ou autre, il faut agir. Certains représentants syndicaux vont en discuter avec l'employeur et en cas d'inaction de sa part, un grief est déposé contre ce dernier pour faire cesser ces comportements. Il est du rôle du syndicat d'intervenir rapidement dans de telles situations même si cela implique parfois de gérer des conflits entre deux personnes salariées.
Mise en situation
Vous êtes président, présidente, de votre section locale. Un de vos membres vient de recevoir une sanction disciplinaire de l'employeur en conformité avec la convention collective. On lui reproche d'avoir tenu des propos transphobes auprès d'un client. Il y a des témoins crédibles de l'événement, des personnes salariées de votre unité. Que faites-vous ? Faites-vous un grief pour représenter cette personne parce que vous croyez que c'est votre rôle comme syndicat, même si vous pensez, voire espérez, le perdre ? Ou, vous jugez que ces comportements ne peuvent être défendus d'aucune manière car ils vont à l'encontre des politiques de harcèlement et des valeurs de votre syndicat ?
En dernier recours : l'expulsion peut être envisagée
Les syndicats disposent de leurs propres règles et façons de faire pour gérer les propos ou gestes désobligeants ou de nature discriminatoire. Mais quoi faire lorsque des personnes élues, conseillères ou déléguées militent activement pour des partis politiques de droite radicale ou d'extrême droite ? Comment réagir quand un membre s'engage dans une lutte qui va à l'encontre des valeurs même de l'organisation ? Ces questions touchent des cordes sensibles et les pratiques en la matière sont loin d'être uniformes d'un syndicat à l'autre.
Pour limiter l'influence des nouvelles droites, quelques organisations syndicales à travers le monde vont jusqu'à expulser des membres qui se livrent à de l'agitation politique en faveur des partis de droite radicale ou d'extrême droite. En Belgique, un syndicat effectue un dépistage à partir des listes de candidats et candidates du parti d'extrême droite (Vlaams Belang). Les membres qui y militent sont confrontés à un choix : se distancer du parti ou être expulsés du syndicat. À la CGT (France), il existe une procédure d'expulsion pour les syndicalistes qui se portent candidats pour des partis d'extrême droite ou agissent comme activistes de ce mouvement notamment en distribuant de la propagande. On estime à environ 40 le nombre de personnes qui ont été exclues dans les 6-7 dernières années . Lors de nos entretiens au Québec, un représentant syndical nous a confié avoir déjà écarté des membres de fonctions officielles en raison de leurs positions incompatibles avec les valeurs et statuts de l'organisation. Nous ignorons toutefois quelle est l'ampleur de ce phénomène parmi les syndicats québécois.
Évidemment, le modèle québécois de relations de travail diffère grandement de ceux présents en Europe, particulièrement lorsque l'adhésion à un syndicat est volontaire. Il y a quelques années, la CFDT a exclu un membre qui était aussi candidat pour le Front national. L'expulsion a été validée par les tribunaux étant donné que l'adhésion syndicale implique aussi une adhésion aux valeurs de l'organisation. Au Québec, la situation est quelque peu différente alors que tous et toutes doivent payer une cotisation si une majorité de personnes salariées choisit de se syndiquer. Expulser un membre de la base sous prétexte qu'il se présente pour un parti politique de droite radicale ou d'extrême droite pourrait soulever des enjeux en matière de liberté d'expression. Toutefois, la question se pose plus sérieusement pour les personnes, élues ou conseillères, qui sont censées souscrire aux valeurs de l'organisation. Est-il logique pour un ou une syndicaliste de militer pour une formation politique qui souhaite la destruction des syndicats ou l'affaiblissement de la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses ?
Pense-bête !
Que disent les statuts et règlements de votre syndicat ? Permettent-ils de suspendre ou d'expulser un membre ou de le relever de ses fonctions pour avoir tenu des propos non conformes aux valeurs de votre organisation ? Votre syndicat fournit-il des balises claires pour interdire l'expression de discours racistes, sexistes, tratransphobes ou autres ? Utilise-t-il des critères de sélection pour l'octroi de postes de responsabilité ?
Dans la société : miser sur l'action politique Isoler les partis politiques extrémistes
Certains partis politiques soutiennent des idéologies et des programmes qui mettent en péril la démocratie, le vivre-ensemble et l'existence même du mouvement syndical. Dans plusieurs pays d'Europe, nombreuses organisations (politiques, sociales, syndicales) ont établi un « cordon sanitaire » autour des partis d'extrême droite afin de limiter la propagation d'idées toxiques dans la société. À titre illustratif, la Confédération européenne des syndicats (CES) a adopté une règle qui interdit les contacts avec les membres d'extrême droite du Parlement européen ou d'autres pays, à moins d'une demande expresse d'un syndicat affilié. D'autres syndicats ont également adopté des lignes de conduite similaires. Après tout, comme le mentionne la CFDT, « On ne débat pas avec l'extrême droite : on la combat ! »
Des partis politiques refusent également de collaborer ou de former des gouvernements de coalition avec des forces réactionnaires et antidémocratiques. Les médias, comme en Belgique, réduisent la visibilité de ces idées dangereuses en limitant leur présence dans les journaux, à la télé ou à la radio. La société civile et les groupes progressistes peuvent également perturber les rencontres et les événements des nouvelles droites et ainsi les empêcher de fonctionner correctement. Cependant, avec la normalisation des idées de droite radicale et d'extrême droite, le cordon sanitaire s'est fragilisé dans plusieurs pays.
L'approche du cordon sanitaire semble plus que pertinente, mais elle n'est pas sans soulever d'importantes questions. Les débats sur l'action politique dans la centrale ont surtout porté sur son autonomie vis-à-vis les partis ainsi que sur les critères d'un éventuel appui lors d'une élection . Et même lorsque les valeurs de certaines formations politiques étaient éloignées de celles de la FTQ, la centrale a toujours maintenu un dialogue. Elle a généralement privilégié la pratique de la concertation à celle de la chaise vide. Mais que faire lorsque des partis politiques basent leur programme sur la haine et le mépris de la démocratie ? Si ceux-ci menacent l'existence même des syndicats ? Est-ce que la FTQ devrait couper les ponts avec de telles organisations ? Il pourrait s'agir d'une avenue à emprunter. Préserver le dialogue avec des formations politiques radicales ou extrêmes pourrait générer des tensions à l'intérieur du mouvement syndical. Ce fut le cas aux États-Unis lorsque le président d'un grand syndicat a rencontré Donald Trump, et ce, malgré les comportements antidémocratiques et anti-travailleurs de l'ex-président. Si un parti issu des nouvelles droites est élu, est-ce que la FTQ maintiendra sa participation dans les organismes créés par l'État ? Il y a lieu de se préparer à de telles éventualités.
Question
Est-ce que la FTQ et ses syndicats affiliés devraient maintenir le dialogue avec toutes les formations politiques ? Par exemple, il est connu que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a des positions farouchement antisyndicales. Faut-il développer et garder des contacts avec ce parti ? Quels sont les risques de le faire ou de ne pas le faire ?
En France, la CFDT a un slogan : ni neutre, ni partisan ! Ce qui signifie qu'elle participe au débat politique, sans faire de partisanerie. Les statuts de la CFDT indiquent aussi qu'une personne ne peut cumuler à la fois des responsabilités syndicales et politiques. Elle a également choisi de ne pas communiquer avec les partis d'extrême droite ni de leur transmettre son programme ou demandes de crainte qu'ils les détournent à leur propre fin.
Confronter l'extrême droite sur le terrain
Pour combattre les nouvelles droites, la FTQ doit se montrer, manifester et agir ! Ces groupes sont de plus en plus présents sur le terrain, comme en témoignent les nombreuses démonstrations contre les droits des personnes trans, les drag queens ou l'avortement. Les syndicats peuvent afficher leur désapprobation en participant à des contre-manifestations. Dans plusieurs pays où les organisations d'extrême droite sont mieux structurées qu'au Québec, il n'est pas rare qu'elles aient pignon sur rue. C'est pourquoi la société civile et les syndicats se mobilisent pour fermer de tels locaux qui répandent la haine.
Des actions sont également entreprises pour contrecarrer la tenue de rassemblements ou d'événements associés à l'extrême droite, par exemple en contactant les propriétaires de salles ou de bars. Dans d'autres cas, des manifestantes et des manifestants réussissent à faire annuler des spectacles. Parfois, ce sont les travailleurs et les travailleuses du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui sonnent l'alarme empêchant ainsi les extrémistes de se réunir.
Les entretiens avec d'autres syndicats à l'international soulignent également l'importance pour les organisations syndicales de s'impliquer dans des associations et groupes à l'échelle locale pour limiter l'influence des droites radicales et extrêmes. En effet, lorsque celles-ci sont bien implantées, ses représentants et représentantes s'engagent dans les villes et les villages pour être en contact direct avec les citoyens et les citoyennes. Les forces progressistes doivent donc prendre leur place partout sur le territoire pour éviter de laisser le champ libre aux nouvelles droites.
Nouer des alliances
Chez les nouvelles droites du monde entier, les idées circulent et les pratiques sont partagées dans le but de faire avancer un agenda commun. Pour combattre cette internationale réactionnaire, la FTQ et ses affiliés devront faire de même et nouer des alliances avec les autres organisations syndicales et groupes progressistes.
Dans chaque pays, il existe des mouvements antifascistes qui confrontent les forces d'extrême droite. Plusieurs de leurs membres font partie des syndicats et y militent, ce qui semble être également le cas au Québec. En France, le groupe Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (VISA) a été mis sur pied en 1996 par plusieurs organisations syndicales. Ce regroupement produit des analyses et des argumentaires, planifie des manifestations, offre des formations, entre autres. Au Québec, on ne trouve pas un tel équivalent. Cependant, plusieurs collectifs antifascistes autonomes existent à plusieurs endroits, par exemple à Montréal et à Québec. Ainsi, les syndicats locaux et les conseils régionaux pourraient envisager de tisser des liens de solidarité avec des groupes qui luttent également contre le programme politique des nouvelles droites.
À l'échelle internationale, les syndicats européens ont élaboré des stratégies communes au sein de la Confédération européenne des syndicats. Le Réseau international des syndicats antifascistes a également été mis sur pied au début de 2023. Celui-ci a publié un manifeste qui dénonce sans ambiguïté les mouvements néo-fascistes et d'extrême droite. Pour défendre ses membres des prochaines menaces, la FTQ pourrait maintenir les contacts avec les autres organisations syndicales afin de partager les meilleures pratiques et mieux comprendre les approches des nouvelles droites.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enfouissement de déchets toxiques sur les berges du Lac des Deux Montagnes – les militant.es de Kanesatake et des allié.es réagissent

Kanesatake et Montréal, 10 juin 2024 – les militant.es de Kanesatake et leurs allié.es <http://xn--alli-epa.es> expriment leur frustration suite à la publication d'une enquête du Rover démontrant que des douzaines de camions déposent quotidiennement des tonnes de sols contaminés directement sur les berges du Lac des Deux Montagnes.
Les militant.es de Kanesatake, qui doivent cacher leur identité par peur de représailles, ont communiqué leurs inquiétudes à la ministre Hajdu dans une lettre publiée la semaine dernière <http://peopleoftheflint.org/fr.html> , sans obtenir de réponse.
« C'est simple, » explique la militante Pink, « Tant que l'état de non droit s'éternise à Kanesatake, il sera impossible d'arrêter l'enfouissement de déchets toxiques. »
« Les habitants de Kanesatake, les Okois, la société civile, tout le monde appelle au rétablissement de l'ordre. Donc qu'attendent Patty Hajdu et Ian Lafrenière ? » ajoute une seconde militante, Optimum.
L'asphalte concassé déposé sur les berges du lac contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques, une substance cancérigène. Leur accumulation au bord de la source d'eau potable de la Ville de Montréal représente donc un risque croissant pour la santé publique.
« Une telle situation serait inimaginable à Trois-Rivières ou à Québec. Nous assistons véritablement à du racisme environnemental. C'est tout à fait inacceptable d'un point de vue social, environnemental et même économique » de mentionner Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
« Le lac des Deux Montagnes alimente en eau potable près d'un million de personnes à proximité et en aval du lac. Il serait complètement irresponsable de nos dirigeants de permettre la continuation des activités de déversements de sols sur les berges du lac ou toute autre forme de déversements non-conformes près des cours d'eau dans la région » selon Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.
« Traverser le territoire autochtone et voir se multiplier le déversement de terres contaminées et l'aménagement des bandes riveraines du lac des Deux-Montagnes est extrêmement inquiétant lorsqu'on connait leur rôle essentiel au niveau de la santé d'un plan d'eau. Et pourtant ça continue à tous les jours ! Qu'attendent les différents paliers politiques pour réagir fermement ? »Sylvie Clermont, Écocitoyenne engagée.
Les révélations de The Rover font suite à l'annonce du gouvernement fédéral que les travaux de décontamination d'un autre dépotoir situé à 10 kilomètres, G&R Recycling, commenceront au printemps. Un article paru le 10 juin dans La Presse confirme ces constats.
communications@eausecours.org
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Transformer les terres de Rabaska en projet de démonstration d’économie circulaire intégrée au cycle du carbone serait une bonne idée » dit VRIc

Québec, le 7 juin 2024. VRIc demande au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, de transformer les terres de Rabaska en projet de démonstration d'économie circulaire intégrée au cycle du carbone.
Ce projet pourrait, éventuellement, s'inspirer à la fois de celui des terres des Sœurs de la Charité, l'Agro-parc et des principes de cette économie en émergence.
L'urgence climatique requiert des acteurs économiques et environnementaux qu'ils
s'assurent que des projets comme Rabaska et l'Agro-parc puissent poursuivre leur
vocation de puits carbone, c'est-à-dire, de capter le carbone de l'atmosphère par les
arbres et les champs afin de contribuer à refroidir le climat tout en participant à ce que le Québec réduise son empreinte carbone.
Par ailleurs, VRIc regrette que le gouvernement n'ait pas accepté la demande du Groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu (GIRAM) de laisser le Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'émettre son avis sur les orientations concernant les activités économiques sur ce territoire.
Cependant, la proposition des agriculteurs et de leurs alliés à l'effet de mettre les terres de Rabaska en fiducie est excellente. Ainsi les risques que des activités d'économie linéaire se développent sur ce territoire comme c'est le cas sur les terres de Northvolt, sont moins grands.
VRIc est un OBNL qui fait la promotion de l'économie circulaire en mettant en valeur ses composantes que sont les personnes et les collectivités impliquées dans les entreprises privées et publiques, les parcs industriels, les villes, les régions, dans les domaines de l'éducation, de la R&D, des transferts technologiques. L'implantation de l'économie circulaire est porteuse de la deuxième industrialisation et urbanisation des villes et des régions du Québec.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
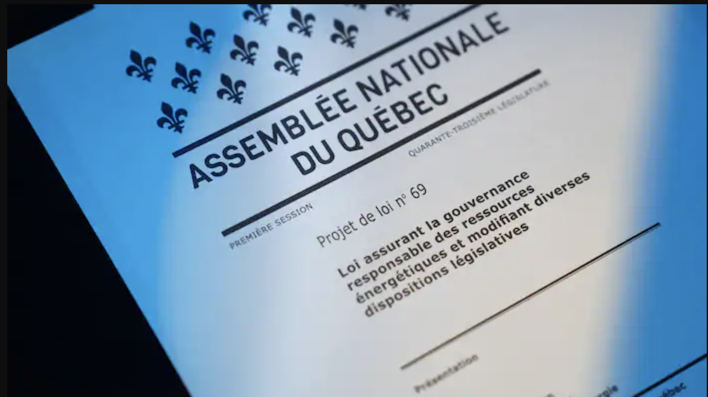
Réactions à la publication du PL-69
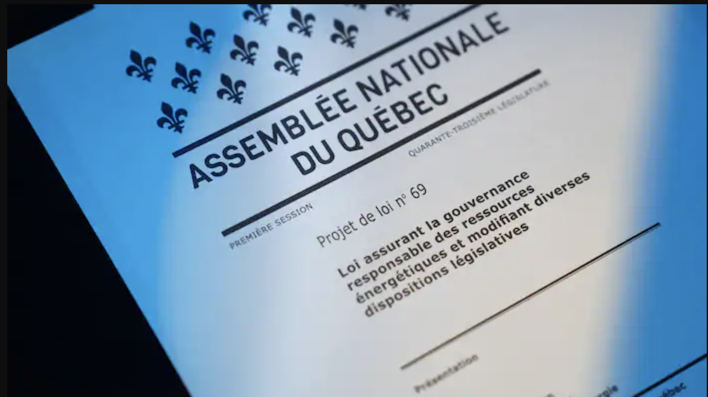
Le projet de loi PL-69 intitulé « Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives » a été présenté ce matin par le ministre Pierre Fitzgibbon. Les attentes étaient grandes, mais le résultat est décevant à plusieurs niveaux.
Une nécessité de décarboner la société québécoise doit être la priorité, mais il semble encore une fois que le développement de l'industrie soit le moteur de la réforme proposée. Une décarbonation ne doit pas être articulée uniquement sur une production supplémentaire d'énergie, il est essentiel que des programmes d'efficacité et de sobriété énergétique soient mis de l'avant. Dans le projet de loi présenté il est question d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, mais cela semble référer à des mesures ponctuelles et rien en termes de vision d'ensemble. Quant au mot « sobriété » il n'apparaît nulle part. Une vision globale n'est donc pas la priorité du gouvernement pour prendre des décisions. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les décisions hâtives peuvent très souvent entraîner des problèmes pour le futur.
Autre considération, aller vite c'est aussi consulter qu'en surface et surtout ne pas permettre à la population plus large de prendre part au débat, c'est un déni de démocratie. Au gouvernement nous décidons, ils payeront, c'est l'idée générale. La transition énergétique est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains d'un seul ministre, c'est une transformation profonde qui demande l'assentiment de la majorité de la population pour que le mouvement soit compris et accepté par la majorité. Une pédagogie doit se faire, mais le gouvernement ne veut pas convaincre, il veut imposer, c'est plus rapide. Maître mot dans la bouche du ministre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pas si vite !

Le 1er mai dernier, soit deux jours après l'annonce du départ d'Émilise Lessard-Therrien, Gabriel Nadeau-Dubois affirmait lors d'une sortie médiatique que Québec solidaire devait devenir un parti de gouvernement, faisant ainsi d'une pierre deux coup. Il fermait le débat concernant les causes de la démission d'Émilise en annonçant une perspective qui impliquait à mots couverts un recentrage des politiques du parti : « Afin de prendre le pouvoir, la formation devra toutefois changer des choses et faire des choix. Je pense que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. Notre structure doit être plus efficace, moins lourde et plus simple ».
Mais ce n'est pas ce que les membres ont adopté comme position au Conseil national du 25 et 26 mai dernier. Le texte initial proposé se lisait comme suit : « Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus de modernisation de son programme, qui sera suivi par l'adoption de la plateforme électorale. Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'élaboration d'un nouveau programme, pour adoption lors d'un Congrès spécial en 2025. »
Le texte amendé stipule maintenant : « Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus d'actualisation de son programme… Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'actualisation du programme… »
Il faut ajouter que la proposition adoptée contenait également cette partie : « Que le programme soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques ». Donc on a donné un mandat à la Commission politique, au Comité de coordination national et aux commissions thématiques d'actualiser le programme et non de le moderniser. On leur a retiré le mandat d'élaboration d'un nouveau programme, mais on a inclus qu'il soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques.
On peut dire que cette dernière partie (politiques trop spécifiques) est disposée par la décision d'actualiser et de retirer le mandat d'élaborer un nouveau programme. Il est difficile de retirer les engagements trop spécifiques sans réécrire le programme. Il y a fort à parier que la direction de QS n'en tiendra pas compte.
Cette ambiguïté dans le vote indique que nous n'avons pas discuté du fond de la question, des raisons qui motivent réellement la stratégie de réécriture du programme, raisons qui auraient certainement éclairé le choix des personnes déléguées.
On sentait une pression comme si nous étions à la veille de prendre le pouvoir, qu'il fallait balayer tout ce qui pouvait nous empêcher de gagner un nouvel électorat. Au pas camarades, mais sans analyse politique ni plan stratégique. La déclaration de Saguenay représentait l'autre front de ce même objectif, modifier les positions historiques de QS. Ce rapport de la tournée des régions s'est ainsi transformé en déclaration politique. Le tout dans une ambiance où la pression était palpable.
Le dernier sondage Leger accorde une légère remontée à QS. A deux ans des élections on peut difficilement s'imaginer aux portes du pouvoir. Il souligne également une perte significative d'adhésion des jeunes à QS, alors que cela a toujours été notre force.
Ce recentrage que GND nous propose, qu'il qualifie de « souci d'efficacité » ou encore de « pragmatisme », exige des explications et une mise en situation. Quelle est la stratégie qui, dans ce contexte, nous amènera au gouvernement dans deux ans ? Jusqu'à maintenant nous n'avons eu droit à aucune analyse qui pourrait appuyer cette perspective.
Les débats soumis au Conseil National avaient, dans ce contexte de non-dit, un air surréel. On recentre sans l'avouer, pour être un parti de pouvoir, sans plan précis ni stratégie, ni analyse sérieuse de la situation politique, quels sont nos alliés, sur quelle base s'appuiera-t-on ? Tenant compte que l'appui des jeunes régresse.
La montée du PQ dans les sondages et même sa possible élection fait certainement partie de l'équation. Mais est-ce une raison d'édulcorer notre programme afin de plaire à cet électorat ? Auquel cas le réflexe est toujours d'adopter l'original et non la copie, sans parler des progressistes, des jeunes et des femmes qui ne s'y reconnaîtront plus. GND et la direction de QS le savent certainement.
Ce débat concerne en fait un plan stratégique et non des questions sémantiques d'écriture de texte. Une question essentielle se pose avec urgence, quel est le vrai plan ?
Le 1er mai 2009, Québec solidaire publiait un manifeste, « Pour sortir de la crise : dépasser le capitalisme ? ». Ce texte est un exemple de la façon dont on doit poser un débat. Une mise en contexte qui pose les origines et les effets de la crise sociale et économique, en fait une analyse et propose des issues. Cela a aussi l'avantage d'alimenter la réflexion politique, essentielle dans un parti de gauche qui revendique la justice sociale.
GND affirme que le Québec a changé et que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. Ce manifeste publié il y a 15 ans, qui a inspiré plusieurs éléments de notre programme, faisait état de la crise. « La crise comme prétexte, c'est la crise, donc passons à l'exploration gazière dans le magnifique fleuve St-Laurent. C'est la crise ! Alors on ne peut pas combattre la pauvreté : l'État n'a plus d'argent ! Mais on en trouvera toujours pour renflouer des banques déjà milliardaires ; pour engraisser des papetières qui vont toujours plus loin raser nos forêts ; pour subventionner des minières qui pillent l'or et les métaux qui nous appartiennent ! »
Qu'est ce qui a changé ? Est-ce que la crise s'est estompée ? Non elle est pire, 100 fois pire.
S'il y a une chose essentielle ce n'est pas d'aseptiser mais d'actualiser notre programme et nos perspectives à cette réalité en osant poser les bonnes questions. Voici quelques exemples de questions que le manifeste soulevait :
« La crise actuelle est-elle causée simplement par les excès du système financier, par des fraudeurs et des financiers qui ont agi en bandits de grand chemin ? Cette crise reflète-t-elle des problèmes inhérents au système économique lui-même ? Ne devons-nous pas nous demander si ce système contient des éléments qui aggravent les inégalités sociales et la dégradation de l'environnement ? »
Une crise mondiale
Grande absente de cette discussion de « prise du pouvoir », la crise internationale économique, sociale et environnementale atteint maintenant des sommets inégalés.
Au moment où la situation politique se complexifie et que les pressions de la droite s'intensifient, nos réponses doivent être plus élaborées, nos débats et réflexions politiques plus profonds. La lutte que nous menons au Québec doit s'inscrire dans une perspective de solidarité internationale. Le pouvoir de changer la société c'est reprendre le contrôle de notre vie, de notre environnement et de notre économie. C'est reprendre le contrôle de notre territoire usurpé par les multinationales et les consortiums financiers.
Depuis le début du printemps, le Sud global est secoué par des événements climatiques extrêmes accentués par le phénomène météo El Niño. En Asie, ces catastrophes ont des conséquences sociales délétères, qui touchent en premier lieu les enfants et les femmes. Mardi 28 mai dernier, New Delhi, capitale de l'Inde, enregistrait une température record de 49,9 °C.
« Ce qui est vertigineux, c'est qu'on a désormais fréquemment en Asie des températures qui frôlent les 50 °C. En France, un pic de chaleur à 40 °C est devenu habituel, alors que c'était exceptionnel il y a une quarantaine d'années. Nous nous accoutumons à un climat qui est déjà à + 1,2 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, alors qu'on s'attend déjà à dépasser les + 1,5 °C dans dix ans, commente pour Mediapart Magali Reghezza-Zitt, géographe et maîtresse de conférences à l'École normale supérieure. [1]
Contre le cul de sac du pragmatisme, pour des perspectives de lutte
Quels que soient les cas de figure de l'orientation « pragmatique » proposée par la direction de QS, ils nous amènent inévitablement vers un cul de sac. Si les motifs du recentrage visent à séduire la base péquiste c'est une erreur magistrale, ils et elles n'ont pas besoin d'un 2e PQ. Au final, dans cet exercice de recentrage accéléré, sans débat de fond, nous perdrons en plus les outils fondamentaux qui font notre force et nous rassemblent, la politisation par le débat et le respect de la démocratie.
Rien n'est encore joué, les différents réseautages militants ont joué un rôle majeur au Conseil National et ont réussi à imposer un réel débat sur les enjeux. L'avenir de QS comme parti des urnes et de la rue réside dans ce militantisme en marche qui saura imposer un réel débat politique concernant les perspectives de luttes et de rassemblement contre cette société corrompue. C'est ce à quoi nous devons travailler maintenant !
Contre le pragmatisme qui nous mène à l'échec ! Pour des débats éclairants et pour la démocratie !
Épilogue
Dans son livre « Voyage au bout de la mine » Pierre Céré citait le commentaire suivant « François Legault est revenu dans la dernière semaine de campagne pour faire de cette élection une question référendaire sur la Fonderie Horne : si vous votez pour Émilise, vous votez pour fermer la Fonderie Horne. » [2]
Il concluait ce chapitre ainsi : « Est-ce que Québec solidaire s'est fait piéger par cette stratégie de la CAQ alliée aux élites économiques de Rouyn-Noranda ? Pouvait-il en être autrement ? Si nous portons un héritage, il ne faudrait pas oublier qu'il est aussi celui d'un combat qui s'inscrit dans le temps, et celui-ci se transmet. » [3]
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
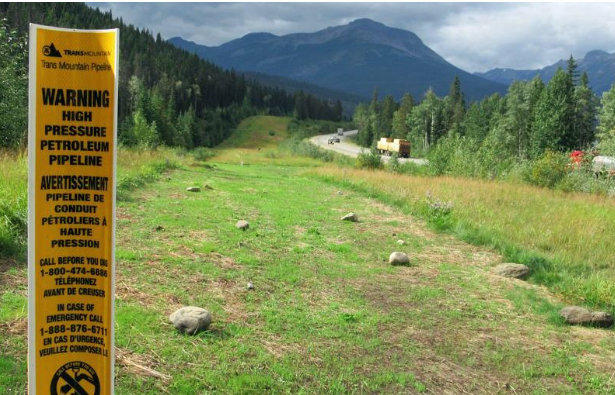
Alors que la crise climatique s’aggrave, le Canada continue de s’incliner devant les grandes compagnies pétrolières
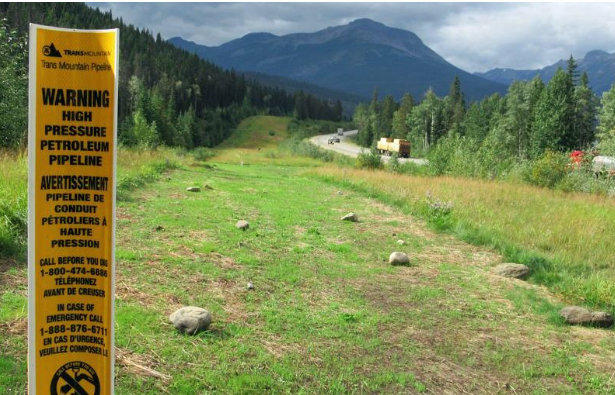
Les climatologues ont été clairs : le seul véritable espoir d'éviter une catastrophe climatique réside dans l'accélération spectaculaire de la transition vers l'énergie propre en construisant de nouveaux parcs éoliens et solaires à une vitesse vertigineuse. Mais ce n'est pas le cas.
24 mai 2024 | tiré de Rabble.ca | Photo : Le pipeline Trans Mountain qui longe la route Yellowhead et transporte du pétrole d'Edmonton, en Alberta, à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Sur la photo, un panneau d'avertissement faisant référence au pétrole à haute pression qui traverse la conduite. Crédit : David Stanely / Flickr Crédit : David Stanely / Flickr
L'ouverture de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain ce mois-ci – largement célébrée dans les médias – nous rappelle que le Canada est toujours sous l'emprise des grandes compagnies pétrolières.
Cette expansion de 34 milliards de dollars a été financée par Ottawa et équivaut à une subvention publique massive pour l'industrie pétrolière – à un moment où nous devrions de toute urgence financer les énergies renouvelables, et non les combustibles fossiles.
Le célèbre climatologue américain James Hansen a déclaré que les sables bitumineux étaient un pétrole si « sale et à forte intensité de carbone » que s'ils devaient être pleinement exploités, ce serait la « fin de la partie » pour la planète.
Pourtant, nous applaudissons le triplement de la capacité de l'oléoduc à transporter le pétrole des sables bitumineux, même si cela nous rapproche de la fin de la partie.
Un rapport publié la semaine dernière a révélé que les meilleurs climatologues du monde pensent que le monde se dirige dans une direction effrayante – vers plus de 2,5 degrés Celsius de réchauffement, dépassant l'objectif international de 1,5 °C, au-delà duquel les incendies, les inondations et les vagues de chaleur deviennent gravement imprévisibles.
Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 1,2 °C de réchauffement et regardez le gâchis dans lequel nous sommes. Déjà cette saison, les feux de forêt sont hors de contrôle en Colombie-Britannique et en Alberta.
Les climatologues ont été clairs : le seul véritable espoir d'éviter une catastrophe climatique réside dans l'accélération spectaculaire de la transition vers l'énergie propre en construisant de nouveaux parcs éoliens et solaires à une vitesse vertigineuse.
Mais ce n'est pas le cas, même si le prix de l'énergie éolienne et solaire est devenu très compétitif. C'était censé être le point de déclenchement à partir duquel le marché commencerait à jouer en notre faveur, avec des énergies renouvelables moins chères que les combustibles fossiles, facilitant la transition vers une énergie propre.
Les énergies renouvelables ne cessent de devenir moins chères. Le prix de l'énergie solaire a chuté de 90 %, mais Big Oil reste dominant.
En effet, avec son monopole établi de longue date et son soutien gouvernemental étendu, Big Oil est beaucoup plus rentable – et donc plus attrayant – pour les grands investisseurs financiers que les entreprises compétitives en difficulté qui composent le secteur émergeant des énergies renouvelables, note Brett Christophers, économiste politique à l'Université d'Uppsala en Suède.
De toute évidence, compte tenu de l'urgence climatique, nous ne pouvons pas laisser la tâche vitale de la transition vers les énergies renouvelables aux caprices des investisseurs financiers, dont le seul intérêt est de maximiser leurs rendements.
Les gouvernements doivent s'impliquer beaucoup plus et ils doivent passer des grandes compagnies pétrolières aux énergies renouvelables.
L'administration Biden a pris cette direction, avec des mesures radicales visant à doubler la capacité renouvelable aux États-Unis au cours de la prochaine décennie. Pendant ce temps, le gouvernement Trudeau est déterminé à servir l'immensément puissante industrie pétrolière.
Au cours des quatre dernières années, Ottawa a fourni 65 milliards de dollars en soutien financier pour le pétrole et le gaz, mais seulement une fraction pour les énergies renouvelables. Son principal programme de subvention des énergies renouvelables fournit moins d'un milliard de dollars par an, explique Julia Levin, directrice associée d'Environmental Defence.
L'étendue de la volonté d'Ottawa d'accommoder les grandes compagnies pétrolières est devenue évidente en 2018 lorsqu'elle a pris en charge l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, plutôt que de laisser le projet s'effondrer après que ses bailleurs de fonds initiaux aient menacé de se retirer en raison d'une vive opposition environnementale.
Ottawa prévoit maintenant dépenser 10 milliards de dollars, peut-être beaucoup plus, pour subventionner les efforts futiles mais coûteux des grandes compagnies pétrolières afin de réduire leurs émissions de carbone par le biais du « captage et du stockage du carbone » – malgré de nombreuses preuves que la technologie est très inefficace pour réduire ces émissions.
Cela permet aux grandes compagnies pétrolières de prétendre qu'elles sont sérieuses au sujet de la réduction des émissions, en faisant croire aux Canadien-nes que nous faisons des progrès en matière de climat, alors que nous ne faisons que tourner en rond et gaspiller beaucoup d'argent public dans le processus.
Pendant des années, il y a eu la pensée réconfortante que, lorsque les horreurs du changement climatique deviendraient vraiment claires, les humains seraient assez intelligents pour trouver une solution. Cela s'est avéré vrai. C'est juste que nous n'avons pas trouvé comment remplacer les puissants pour pouvoir mettre en œuvre la solution.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sans arrêt, des attaques fusent contre le programme fédéral d’assurance des médicaments sans que les liens avec les grandes pharmaceutiques ne soient mentionnés

Dans des douzaines de lettres publiques, des auteurs.es s'opposent au programme fédéral sur les médicaments sans que leurs conflits d'intérêt ne soient dévoilés. Pendant que le gouvernement libéral et les néo-démocrates mettent au point les détails du programme national d'assurance médicaments qui devrait améliorer grandement leur accès à des millions de Canadiens.nes, les critiques et les oppositions s'expriment dans les grands médias du pays.
Nikolas Barry-Shaw et Donya Ziaee
The Breach, 10 mai 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Le National Post dans une annonce prévient les Canadiens.nes : « Ce programme est une bombe qui va faire exploser votre prime ». Dans The Hill Times, on peut lire : « qu'il n'y a rien de plus effrayant » que la volonté du gouvernement de faire baisser le prix (des médicaments). On y compare le programme à « une guerre de guérilla » contre l'industrie pharmaceutique.
Les auteurs.es de ces propos, comme ceux d'une douzaine d'autres, ont été identifés.es comme des experts.es en politique, indépendants.es, travaillant dans des instituts de recherche.
Mais, une enquête du Conseil des Canadiens révèle que tous et toutes ont des liens avec les pharmaceutiques et les compagnies d'assurance. Ce sont les industries qui ont le plus à perdre avec l'introduction de ce programme. Plusieurs sont, soit leurs employés.es, leurs lobbyistes ou consultants.es. Tous et toutes travaillent pour des groupes de réflexion fondés par des manufacturiers de médicaments comme Pfizer, Johnson & Johnson et des groupes de lobbying comme Innovative Medicines Canada. Ou encore pour des compagnies où les membres des conseils d'administration sont issus.es des pharmaceutiques, des lobbys à leur service ou des compagnies d'assurance.
Depuis l'introduction de ce projet de loi, à la fin de l'année dernière, les interventions venant de ce secteur se sont multipliées pour faire dérailler et reporter toute tentative d'aller vers un système à payeur unique.
Depuis mars 2022, 49 articles attaquant le programme ont été publiés. 25 interventions du même genre ont été repérées dans les réseaux sociaux et les journaux.
Les liens avec l'industrie ne sont pas rendus publics
Les grandes pharmaceutiques et les compagnies d'assurance ont exercé un lobbying vigoureux contre ce programme universel qui devrait limiter leur pouvoir de fixation des prix pour ce qui est des pharmaceutiques et l'étendue de leurs marchés pour ce qui est des assureurs.
Avec l'entente entre le gouvernement libéral et le NPD sur le fait que l'approvisionnement un élément fondamental de la loi, les interventions d'opposition se sont déchainées dans les médias. Ce fut pire encore quand la loi a été introduite au parlement en février dernier.
Les conflits d'intérêt de tous ces commentateurs et commentatrices qui s'exprimaient couramment sur le sujet n'ont absolument pas dérangé les médias canadiens.
Par exemple, Brett Skinner, du Canadian Health Policy Institute, a passé des années à attaquer ce genre de programme en publiant des articles avec des titres comme « Électeurs.trices prenez garde : le programme national sur les médicaments est inutile, mauvais pour les Canadiens.nes déjà assurés.es et cher pour les contribuables ». Et « Des coûts plus élevés et moins de couverture. Pourquoi les Canadiens.nes voudraient de ce programme ».
Plusieurs de ces articles ont été écrits alors qu'il travaillait pour Innovative Medicines Canada le plus grand groupe de lobbying de la pharmacie au Canada. En plus il y était directeur des politiques en santé et en économie. Aucun des médias qui a publié ses articles, n'ont mentionné ce fait.
D'autres lettres ouvertes et articles écrits par des personnes liées à l'industrie ont été diffusés sur les sites de nouvelles consultés par des employés.es du gouvernement et des législateurs.trices ; par exemple, The Hill Times et National Newswatch, les services en lignes de The Canadian Press et des médias nationaux comme la CB, The Globe and Mail, Global News et The Toronto Star. L'enquête s'est limitée aux médias en ligne et écrits, ce qui a exclu les télévisions, les radios et les entrevues en balado-diffusion.
Un réseau de groupes de réflexion proches de l'industrie pharmaceutique
Les opposants.es au projet de loi C-64 ont compris depuis longtemps que pour protéger leurs profits, il leur fallait contrôler le discours public (à ce sujet). Mais ils et elles sont très conscients.es que les Canadiens.nes ne leur font pas confiance pour obtenir des avis fiables sur le système de soins. C'est pour cela que ces industries ont soutenu pendant des décennies des groupes de réflexion qui se chargeaient de publiciser leur message aux législateurs.trices et au grand public.
Les grandes pharmaceutiques ont financé les groupes de réflexion de droite grâce à des dons et des parrainages. Par exemple, Pfizer, Merck, Roche, Johnson & Johnson et AstraZeneca ont donné à The Macdonald-Laurier Institute et aux deux plus grands groupes de lobbying dans le domaine des médicaments et de la pharmacie, au Canada et aux États-Unis.
Le Canadian Health Policy Institute assure que, son mandat lui permet de publier des résultats de recherches qui concernent le système de santé grâce à « des politiques basées sur des preuves ». Mais ces recherches sont payées de gré à gré par des compagnies pharmaceutiques et portent sur les sujets qui les intéressent y compris le programme fédéral d'assurance médicaments.
Le Conference Board of Canada, un groupe de réflexion qui se dit « non partisan », est couramment cité dans les médias à propos de ses analyses sur une variété de sujets. Il a reçu des fonds du plus important lobby de l'industrie pharmaceutique du Canada, Innovative Medicines Canda pour des rapports où la nécessité du programme est minimisée.
Sa plus récente production financée ainsi, avance que 97% des Canadiens.nes détiennent déjà une assurance médicament. Ce résultat a été largement citée dans les médias alors que les plus éminents.es experts.es le dénonce comme le plus pernicieux des mensonges jamais émis par les compagnies opposantes au projet de loi. Les données pour ce travail avaient été fournies par Canadian Life and Health Insurance Association, le groupe dominant du lobby des assurances.
Il arrive aussi que les liens entre les pharmaceutiques et les compagnies d'assurance dépassent les simples financements. Dans beaucoup de cas, les dircteurs.trices ou les lobbyistes siègent sur les conseils d'administration. Cela leur donne la possibilité de diriger les recherches et de surveiller les positions que ces organisations prennent à propos du programme. Par exemple, à l'Institut économique de Montréal, Mme Hélène Desmarais préside le conseil d'administration. Elle est l'héritière de la famille Desmarais qui est propriétaire de Canada Life, le plus grand assureur du pays.
L'institut C.D. Howe se vante que ses recherches sont « non partisanes, basées sur des preuves et soumise à la révision d'experts.es ». Mais quand il s'agit du projet de loi C-64, ce sont souvent les grandes pharmaceutiques et des représentants.es des compagnies d'assurance qui assurent ce service. Les cadres et les lobbyistes de l'industrie occupent un tiers des sièges de l'Institute's Health Policy Council.
Trop souvent, les experts.es qui supposément fournissent des analyses « indépendantes et non biaisés » sur le programme fédéral sur les médicaments ont des liens directs avec les compagnies pharmaceutiques et d'assurance. Malgré leurs titres quasi universitaires, plusieurs en sont d'anciens.nes employés.es, des lobbyistes ou des consultants.es. Par exemple, Nigel Rawson a publié des douzaines d'articles où il attaque le projet de loi . Il se présente comme « Senior Fellow » du Macdonald-Laurier Institute et « universitaire affilié » du Canadian Health Policy Institute. Mais en fait il est consultant pour l'industrie pharmaceutique et un ancien employé d'un manufacturier de médicaments. Marcel Saulnier, un des « Senior Fellow » du C.D. Howe Institute, est un lobbyiste d'une compagnie ayant des relations avec le gouvernement et qui représente les compagnies pharmaceutiques. Il exerce ses fonctions auprès du gouvernement au nom de Johnson & Johnson relativement au programme fédéral. Il était une tête d'affiche d'un récent événement chez C.D.Howe à propos de ce programme commandité par Johnson & Johnson.
Introduire du brouillage pour masquer les faits
Selon une enquête du New York Times, pendant des décennies, les grands de la pharmacie ont dépensé des millions pour monter ce que leurs documents internes désignent comme des « lieux de résonnance intellectuelles, d'organisations de même sensibilité ».
Selon l'historien Edward Nik-Khah, ces relations financières de longue date signifient que les grandes pharmaceutiques « peuvent un moment donné, faire appel à un groupe d'économistes qui pourront leur fournir un message finement conçu pour atteindre un but politique ». La lutte actuelle autour du projet de loi C-64 est un de ces moments.
Le premier objectif de ces « lieux de résonnance intellectuelles » d'opposition au programme fédéral a été d'anticiper les règles pour biaiser le discours public à leurs propos. Plutôt que de s'opposer directement à l'idée d'une assurance universelle des médicaments sous ordonnances, idée qui est soutenue par la vaste majorité de la population, les grandes compagnies pharmaceutiques et leurs alliés.es ont tenté de semer le doute et la confusion.
Tout ce beau monde a minimisé l'efficacité de la portée de la couverture du programme. L'idée que le prix des médicaments au Canada, le deuxième le plus élevé dans le monde après les États-Unis, soit excessif, a été ridiculisé. De vieux arguments démentis à propos du programme ont été ressortis après avoir servi de multiples fois dans le passé.
Les groupes de réflexion de cette industrie sont des brouilleurs d'idées qui cherchent à masquer les faits dans les discussions sur la politique mais rejoignent parfois les plus hautes sphères des législateurs.trices. Depuis des années, ils ont visé les caucus, les membres du cabinet (fédéral) et leur ont servi de la désinformation pour ralentir les progrès vers la loi sur l'assurance médicaments.
Le Dr. Doug Eyolfson, ancien député libéral était membre du Comité sur la santé de 2016 à 2019. Il décrit comment les groupes financés par les pharmaceutiques ont affaibli la volonté du gouvernement Trudeau dans le projet de loiC-64 : « Les plus importantes hésitations vis-à-vis ce programme (y compris chez le gouvernement libéral dont j'étais membre), venait de l'immense désinformation venant de divers secteurs, chacun avec leur propre programme. Le lobbying était agressif, des articles de divers groupes réussissaient à convaincre beaucoup de gens que le programme couterait bien trop cher, qu'il n'était pas nécessaire et qu'il pourrait retarder l'émergence de nouveaux médicaments ».
Il faut un mur pare-feu entre les grandes pharmaceutiques et les décideurs.euses
La première phase de ce programme universel, à payeur unique qui couvre la contraception et les médicaments pour le diabète ne va affecter les profits des manufacturiers de médicaments et les assureurs qu'à la marge.
Mais la loi est quand même venue les hanter parce qu'elle mettra en place un programme bien plus important. Mais les délais d'introduction vont grandement leur bénéficier. Un gouvernement conservateur avec P. Poilievre pourrait facilement défaire un programme qui n'existe pour ainsi dire que sur papier. Déjà il répète ce qui lui vient des groupes de réflexion financés par l'industrie, comme nous en avons fait état dans le passé.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les industriels.les réussissent à renverser des politiques gouvernementales. L'an dernier, une de nos enquêtes a révélé que le ministre fédéral de la santé était de mèche avec les grandes pharmaceutiques pour ralentir des réformes qui auraient épargné des milliards de dollars aux Canadiens.nes en coût de médicament.
Un ex-membre du conseil d'administration du comité de fixation des prix des médicaments, Matthew Herder, a récemment mis en garde contre l'influence excessive de l'industrie au moment de l'adoption de la loi sur l'assurance médicament. Il avait démissionné de son poste pour protester contre cela : « Je l'ai observé de première main. J'ai vu comment le processus a été influencé et contrôlé par l'industrie et ses multiples organisations sœurs. Avec ce programme, nous ne devons pas fermer les yeux sur les effets insidieux des conflits d'intérêts ».
Au moment de l'adoption de la loi, un comité de cinq experts.es sera mis en place pour superviser l'implantation du programme universel et public. M. Herder insiste sur l'obligation de n'y admettre aucun.e membre ayant des liens financiers avec l'industrie : « Le gouvernement doit ériger un mur pare-feu entre ces intérêts et les membres du comité (d'implantation). Si non, la loi C-64 peut devenir un autre échec dans la lutte pour que les Canadiens.nes aient accès à des médicaments essentiels et abordables pour tous et toutes ».
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation massive au Panama contre la minière canadienne First Quantum

Mining Watch Canada lance une pétition
Entrevue avec Vivuana Herrera, Mining Watch Canada
Des manifestations massives au Panama se sont produites à l'automne dernier contre un nouvel accord que le gouvernement a annoncé avec l'entreprise canadienne First Quantum pour permettre la poursuite des activités de son immense mine de cuivre. Située dans la zone écologiquement protégée de la forêt tropicale panaméenne Donoso, la concession a été déclarée inconstitutionnelle en 2017 par la Cour suprême de Panama.
4 juin 2024 | tiré du Journal des alternatives | Photo : Panama - manifestations populaires de l'automne dernier contre la minière canadienne Credit : Olmedo Carrasquilla Aguila (CNW Group/MiningWatch Canada)
https://alter.quebec/mobilisation-massive-au-panama-contre-la-miniere-canadienne-first-quantum/
Des coalitions d'organisations de conservation et de protection de l'environnement, ainsi que des mouvements citoyens du monde agricole, du travail, de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de communautés indigènes — ont manifesté pendant près de deux mois pour dénoncer la manière et les dommages environnementaux et sociaux par les opérations minières. Toute la mobilisaiton a amené la fermeture de la mine depuis ce temps, en conformité avec la décision de la Cour insitutionnelle..
Aujour'hui, le groupe MiningWatch Canada (MWC), de concert avec des réseaux citoyens de Panama, ont lancé une pétition pour que la ministre canadienne du Commerce retire son soutien à First Quantum. La campagne de MWC demande que le gouvernement canadien respecte la décision de la Cour suprême panaméenne sur l'inconstitutionnalité du contrat et la volonté de la population panaméenne qui dit que « le Panama vaut plus sans l'exploitation minière ».
Viviana Herrera @Mining Watch Canada

Nous avons rencontré Viviana Herrera, responsable de campagne à MiningWatch Canada pour qu'elle nous explique les tenants et aboutissants de la mobilisation.
JdA : D'abord merci Viviana pour cette entrevue. Pouvez-vous nous résumer les dommages que cause l'exploitation du cuivre à Panama ?
Viviana : La réponse courte serait l'impact sur la biodiversité et sur la qualité et la quantité de l'eau en raison de l'emplacement et de la contamination de la mine de cuivre. Le Panama est un pays où la biodiversité est énorme et où les précipitations sont élevées. Toute activité minière aura des conséquences majeures et graves pour le pays et la région.
Les forêts tropicales du Panama jouent un rôle essentiel dans la santé du corridor biologique méso-américain, un ensemble d'aires protégées et de points chauds de la biodiversité qui s'étendent du sud du Mexique au Panama. C'est justement sur le site de l'énorme mine de cuivre à ciel ouvert Cobre Panama de la société canadienne First Quantum Minerals, la seule mine industrielle en activité du pays.
La mine de cuivre est donc un point chaud pour la population en raison de la déforestation et de la pollution qu'elle a causées. Les communautés touchées par ce projet et les groupes environnementaux, tels que Panamá Vale más sin minería (Panama vaut plus sans mines), ont dénoncé les dommages environnementaux et sociaux, notamment les rejets d'eaux usées, la déforestation et les dommages causés aux animaux endémiques et aux récoltes.
Les organisations environnementales telles que le Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (Centre de défense de l'environnement) ont systématiquement documenté et dénoncé les graves manquements aux engagements environnementaux du projet et à la législation environnementale en vigueur dans le pays. Selon le CIAM, l'entreprise a enregistré plus de 200 violations des engagements environnementaux et des rapports de contamination de l'eau et du sol.
Maintenant que la mine a été fermée à la suite des manifestations historiques de décembre 2023, les communautés et les organisations s'inquiètent du plan de fermeture de la mine. Elles exigent un plan de fermeture de la mine solide et sécuritaire qui évite d'autres impacts environnementaux et sociaux dans la région.
JdA : Quel est le soutien que le gouvernement Trudeau accorde à minière canadienne devant la décision de la Cour de Panama ?
Malgré l'opposition pacifique du peuple panaméen et la violence à laquelle il a été confronté pour avoir exercé son droit constitutionnel de contestation, le gouvernement canadien a continué à soutenir la First Quantum Minerals. La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, a été très claire à ce sujet. Elle a déclaré à plusieurs reprises dans les médias que son travail consistait à défendre les entreprises canadiennes. Lors d'une entrevue accordée à CTW5, Madame Ng a déclaré à propos de la situation de First Quantum :
« Mon travail en tant que ministre du commerce est de m'assurer … de toujours continuer à défendre une sociéte minière canadienne, qu'elle opère au Panama ou n'importe où dans le monde ».
De même, l'ambassade du Canada au Panama a largement promu le contrat minier avec First Quantum, ella a également défendu la société minière dans le cadre du discours sur l'exploitation minière durable. Le Canada est un pays qui prétend respecter les droits humains, les droits des peuples autochtones, des femmes et la démocratie. La Cour suprême panaméenne a déclaré inconstitutionnels deux contrats miniers avec l'entreprise canadienne. Il est clair que le Canada doit retirer son soutien à cette société minière.
C'est pour cette raison que nous avons lancé, avec nos alliés étasunien, Earthworks, et panaméens, une pétition demandant de soutenir la lettre ouverte à la ministre canadienne exigeant le retrait de son soutien à la minière canadienne.
JdA : La pétition se poursuit jusqu'en septembre prochain. Pourquoi un délai aussi long. Quel est le calendrier de la campagne et que se passera-t-il à ce moment ?
Oui, nous collectons d'un côté, des signatures pour la pétition auprès des résidents et des citoyens canadiens/canadiennes, et de l'autre côté, un soutien institutionnel de la part d'établissements universitaires, d'artistes et d'activistes environnementaux. L'été est à porté de main et nous savons que de nombreuses organisations partent en vacances.
Nous souhaitons également recueillir un grand nombre de signatures, ce qui nécessitera beaucoup de diffusion et de temps. L'idée est de lancer et de remettre la lettre ouverte au ministre en septembre, au début de la nouvelle session parlementaire.
JdA : Merci viviana
Viviana : Merci beaucoup pour l'espace et l'entrevue.
Pour en savoir plus : Dossier de Mining Watch Canada en français
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Karl Marx et l’écologie

Il est indéniable que Marx s'est intéressé aux problèmes de l'environnement à son époque, et a critiqué les dégâts provoqués par le mode capitaliste de production. Mais il faut reconnaitre que les thèmes écologiques ne prennent pas une place centrale dans le dispositif théorique marxien et que les écrits de Marx sur le rapport entre les sociétés humaines et la nature sont loin d'être univoques et peuvent donc être l'objet d'interprétations différentes.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Beaucoup d'écologistes font des critiques à Marx, et somment les marxistes d'abandonner le paradigme rouge pour adopter le vert. Quelles sont leurs principaux arguments ?
Selon les écologistes, Marx, suivant en cela l'économiste anglais David Ricardo, attribuerait l'origine de toute valeur et de toute richesse au travail humain, négligeant l'apport de la nature. Cette critique résulte d'un malentendu : Marx utilise la théorie de la valeur-travail pour expliquer l'origine de la valeur d'échange dans le cadre du système capitaliste. En revanche, la nature participe à la formation des vraies richesses, qui ne sont pas les valeurs d'échange, mais les valeurs d'usage. Cette thèse est très explicitement avancée par Marx dans la Critique du programme de Gotha (1875), texte dirigé contre les idées du socialiste allemand Ferdinand Lassalle et de ses disciples :
« Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle !) que le travail, qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail de l'homme [1]. »
Les écologistes accusent Marx et Engels de productivisme. Cette accusation est-elle justifiée ?
Non, dans la mesure où personne n'a autant dénoncé que Marx la logique capitaliste de production pour la production, l'accumulation du capital, des richesses et des marchandises comme un but en soi. L'idée même de socialisme – au contraire de ses misérables contrefaçons bureaucratiques – est celle d'une production de valeurs d'usage, de biens nécessaires à la satisfaction des nécessités humaines. L'objectif suprême du progrès technique selon Karl Marx n'est pas l'accroissement infini de biens (l'« avoir »), mais la réduction de la journée de travail, et l'accroissement du temps libre [2] (l'« être »).
Cependant, il est vrai que l'on trouve souvent chez Marx ou chez Engels (et encore plus dans le marxisme ultérieur) une posture peu critique envers le système de production industrielle créé par le capital, et une tendance à faire du « développement des forces productives » le principal vecteur du progrès. De ce point de vue, le texte « canonique » est la célèbre préface à la Contribution à la critique de l'économie politique (1859), un des écrits de Marx les plus marqués par un certain évolutionnisme, par la philosophie du progrès, par le scientisme (le modèle des sciences de la nature) et par une vision nullement problématisée des forces productives :
« À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants […]. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. […] Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir [3]. »
Dans ce passage célèbre, les forces productives existantes ne sont pas mises en question, et la révolution n'a pour tâche que d'abolir les rapports de production qui sont devenus une « entrave » à un développement illimité de celles-ci.
Le passage suivant des Grundrisse (« Principes », 1857-59, esquisse du Capital) est un bon exemple de l'admiration trop peu critique de Marx pour l'œuvre « civilisatrice » de la production capitaliste, et pour son instrumentalisation brutale de la nature : « Ainsi donc, la production fondée sur le capital crée […] un système d'exploitation générale des propriétés de la nature et de l'homme. […] Le capital commence donc à créer la société bourgeoise et l'appropriation universelle de la nature et établit un réseau englobant tous les membres de la société : telle est la grande action civilisatrice du capital. Il s'élève à un niveau social tel que toutes les sociétés antérieures apparaissent comme des développements purement locaux de l'humanité et comme une idolâtrie de la nature. En effet la nature devient un pur objet pour l'homme, une chose utile. On ne la reconnaît plus comme une puissance. L'intelligence théorique des lois naturelles a tous les aspects de la ruse qui cherche à soumettre la nature aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production [4]. »
Cette vision encore peu critique du rapport du capitalisme à la nature sera dépassée dans les années suivantes. En réalité, il faut considérer les écrits de Marx (ou Engels) sur la nature non comme un bloc uniforme, mais comme une pensée en mouvement. C'est la contribution qu'apporte un ouvrage récent d'un jeune chercheur japonais Kohei Saito, Karl Marx's Ecosocialism. Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy (2017) : il montre l'évolution des réflexions de Marx sur l'environnement naturel, dans un processus d'apprentissage, rectification et reformulation de sa pensée.
Certes, sur certaines questions il y a une grande continuité dans ses écrits. C'est le cas notamment du refus de la « séparation » capitaliste entre les êtres humains et la terre, c'est-à-dire la nature. Marx était persuadé que dans les sociétés primitives il existait une sorte d'unité entre les producteurs et la terre, et il voyait comme un des tâches importantes du socialisme de re-établir cette unité, détruite par la société bourgeoise, mais dans un niveau supérieur (négation de la négation). Cela explique l'intérêt de Marx pour les communautés prémodernes, aussi bien dans sa réflexion écologique – par exemple à partir de Carl Fraas – que dans sa recherche anthropologique – Franz Maurer, deux auteurs qu'il considérait comme des « socialistes inconscients ».
Mais sur la plupart des questions au sujet de l'environnement, Saito met en évidence des changements notables. Avant Le Capital (1867) on trouve dans les écrits de Marx une vision plutôt acritique du « progrès » capitaliste. Cela est évident dans le Manifeste Communiste, qui célèbre l'« assujettissement des forces de la nature » et le « défrichement de continents entiers » par la bourgeoisie.
Les changements commencent à partir de 1865-66, quand Marx découvre, en lisant les écrits du chimiste agricole Justus von Liebig, les problèmes de l'épuisement des sols, et la rupture métabolique entre les sociétés humaines et la nature. Cela le conduira, dans le volume 1 du Capital (1867) mais aussi dans les deux autres volumes, inachevés, a une vision beaucoup plus critique des dégâts du « progrès » capitaliste.
On verra ainsi, dans plusieurs passages du Capital qui concernent l'agriculture, s'esquisser une vraie problématique écologique et une critique radicale des catastrophes résultant du productivisme capitaliste : Marx avance une sorte de théorie de la rupture du métabolisme entre les sociétés humaines et la nature, qui résulterait du productivisme capitaliste. L'expression « Riß des Stoffwechsels », littéralement « rupture » ou « déchirure » « du métabolisme » ou « des échanges matériels », apparaît notamment dans un passage du chapitre 47, « Genèse de la rente foncière capitaliste », au livre III du Capital :
« D'une part, la grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum en déclin constant, d'autre part, elle lui oppose une population industrielle toujours en croissance, entassée dans les grandes villes : elle crée par conséquent des conditions qui provoquent une rupture irréparable (unheilbaren Riß) dans la connexion du métabolisme (Stoffwechsel) social, un métabolisme prescrit par les lois naturelles de la vie [5]. »
Comme dans la plupart des exemples que nous verrons par la suite, l'attention de Marx se concentre sur l'agriculture et le problème de la dévastation des sols, mais il rattache cette question à un principe plus général : la rupture dans le système des échanges matériels (Stoffwechsel) entre les sociétés humaines et l'environnement, en contradiction avec les « lois naturelles » de la vie.
Le thème de la rupture du métabolisme se trouve aussi dans un passage du livre I du Capital. C'est un des textes de Marx où il est le plus explicitement question des ravages provoqués par le capital sur l'environnement naturel ; s'y fait jour une vision dialectique des contradictions du « progrès » induit par les forces productives :
« La production capitaliste […] détruit non seulement la santé physique des ouvriers urbains et la vie spirituelle des travailleurs ruraux, mais trouble encore la circulation matérielle (Stoffwechsel) entre l'homme et la terre, et la condition naturelle éternelle de la fertilité durable (dauernder) du sol. […] En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en sapant (untergräbt) en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur [6]. »
Plusieurs aspects sont notables dans ce texte : tout d'abord, l'idée que le progrès peut être destructif, un « progrès » dans la dégradation et la détérioration de l'environnement naturel donc. L'exploitation et l'abaissement des travailleurs et de la nature sont mis ici en parallèle, comme résultat de la même logique prédatrice, celle qui prévaut dans le développement de la grande industrie et de l'agriculture capitalistes.
Cette association directe faite par Marx entre l'exploitation du prolétariat et celle de la terre, initie bien une réflexion sur l'articulation entre lutte de classes et lutte en défense de l'environnement, dans un combat commun contre la domination du capital.
Après l'épuisement du sol, l'autre exemple de catastrophe écologique évoqué par fréquemment par Marx et Engels est celui de la destruction des forêts. Il apparaît à plusieurs reprises dans Le Capital :
« Le développement de la civilisation et de l'industrie en général […] s'est toujours montré tellement actif dans la dévastation des forêts que tout ce qui a pu être entrepris pour leur conservation et leur production est complètement insignifiant en comparaison [7]. »
Les deux phénomènes – la dégradation des forêts et celle du sol – sont d'ailleurs étroitement liés dans leurs analyses.
Comment Marx et Engels définissent-ils le programme socialiste par rapport à l'environnement naturel ? Quelles transformations le système productif doit-il connaître pour devenir compatible avec la sauvegarde de la nature ?
Les deux penseurs semblent souvent concevoir la production socialiste comme l'appropriation collective des forces et moyens de production développés par le capitalisme : une fois abolie l'« entrave » que représentent les rapports de production et en particulier les rapports de propriété, ces forces pourront se développer sans entraves. Il y aurait donc une sorte de continuité substantielle entre l'appareil productif capitaliste et le socialiste, l'enjeu socialiste étant avant tout la gestion planifiée et rationnelle de cette civilisation matérielle créée par le capital.
Par exemple, dans la célèbre conclusion du chapitre sur l'accumulation primitive du capital, Marx écrit : « Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe vole en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. […] La production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature [8]. »
Indépendamment du déterminisme fataliste et positiviste qui le caractérise, ce passage semble laisser intact, dans la perspective socialiste, l'ensemble du mode de production créé « sous les auspices » du capital, ne mettant en question que l'« enveloppe » de la propriété privée, devenue une « entrave » pour les ressorts matériels de la production.
Cependant, on trouve aussi d'autres écrits qui prennent en considération la dimension écologique du programme socialiste et ouvrent quelques pistes intéressantes. Plusieurs passages de Marx semblent tenir la conservation de l'environnement naturel comme une tâche fondamentale du socialisme. Par exemple, le volume III du Capital oppose à la logique capitaliste de la grande production agricole, fondée sur l'exploitation et le gaspillage des forces du sol, une autre logique, de nature socialiste : le « traitement consciemment rationnel de la terre comme éternelle propriété communautaire, et comme condition inaliénable (unveräußerlichen) de l'existence et de la reproduction de la chaîne des générations humaines successives ». Un raisonnement analogue se trouve quelques pages plut haut :
« Même une société tout entière, une nation, enfin toutes les sociétés contemporaines prises ensemble, ne sont pas des propriétaires de la terre. Ils n'en sont que les occupants, les usufruitiers (Nutznießer), et ils doivent, comme des boni patres familias, la laisser en état amélioré aux futures générations [9]. »
Il ne serait pas difficile de trouver d'autres exemples d'une réelle sensibilité à la question de l'environnement naturel de l'activité humaine. Il n'en reste pas moins qu'il manque à Marx et à Engels une perspective écologique d'ensemble.
S'il est vrai que l'écologie n'occupe pas une place centrale dans le dispositif théorique et politique de Marx et Engels – parce que la crise écologique n'était pas encore, comme aujourd'hui, une question vitale pour l'humanité – il n'est pas moins vrai qu'il est impossible de penser une écologie critique à la hauteur des défis contemporains, sans prendre en compte la critique marxienne de l'économie politique et son analyse de la rupture du métabolisme entre les sociétés humaines et la nature. Une écologie qui ignore ou méprise le marxisme et sa critique du fétichisme de la marchandise est condamnée à n'être qu'un correctif des « excès » du productivisme capitaliste.
À partir des écrits de Marx et Engels, s'est développéz aux États-Unis une réflexion marxiste écologique dont le pionnier est John Bellamy Foster, avec la participation de Paul Burkett, Brett Clark, Fred Magdoff et plusieurs autres – et le soutien de la Monthly Review, une des plus importantes publications de la gauche nord-américaine – qui se définit comme l'école de la rupture métabolique. Ces auteurs on fait une notable contribution à la redécouverte de la dimension écologique dans l'œuvre des fondateurs du communisme moderne, même si l'on peut critiquer leur tendance à exagérer cette dimension.
On ne peut pas penser une alternative écosocialiste au processus actuel de destruction des fondements naturels de la vie sur la planète, sans prendre en compte la critique de Marx et Engels au capitalisme, à la logique aveugle de la valeur, à la soumission brutale des êtres humains et de la nature aux impératifs de l'accumulation du capital. Et l'on ne peut pas penser à un avenir communiste sans se référer à leurs propositions : collectivisation des moyens de production, production de valeurs d'usage et non de valeurs marchandes, planification démocratique de la production et de la consommation. Mais il faut en même temps intégrer à la réflexion marxiste les défis écologiques du 21e siècle : la lutte contre le changement climatique, la suppression des énergies fossiles, la réduction massive des productions inutiles, le développement des énergies renouvelables, l'agriculture organique à la place de l'industrie agricole fondé sur les pesticides, la reconnaissance de la dette écologique envers les pays du Sud, etc. Les marxistes de notre époque doivent suivre l'exemple de Karl Marx : réagir, en utilisant la méthode dialectique, aux nouveaux problèmes posés par le changement historique.
Michael Löwy
Notes
[1] Karl Marx, Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, Paris, Éditions sociales, 1950, p. 18. Voir aussi Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, I, p. 47 : « Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père, et la terre, la mère, comme dit William Petty. »
[2] Sur l'opposition entre « avoir » et « être », voir Manuscrits de 1844, op. cit., p. 103 : « Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit, plus tu accumules de ton être aliéné. » Sur le temps libre comme principale base du socialisme, voir Das Kapital, III, op. cit., p. 828.
[3] Karl Marx, Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, Paris, Éditions sociales, 1977, p. 3
[4] Karl Marx, Fondements de la critique de l'économie politique, Paris, Anthropos, 1967, pp. 366-367.
[5] e reprends ce terme, et l'analyse qui s'en suit, à l'important ouvrage de John Foster Bellamy, Marx's Ecology. Materialism and Nature, N. York, Monthly Review Press, 2001, pp. 155-167.
[6] Karl Marx, Le Capital I, op. cit., p. 363, revue et corrigé d'après l'original allemand, Das Kapital I, op . cit, pp. 528-530.
[7] Das Kapital, II, op. cit., p. 247.
[8] Karl Marx, Le Capital, I, op. cit., pp. 566-567.
[9] Karl Marx, Das Kapital, III, op. cit. p. 784, 820. Le mot « socialisme » n'apparaît pas dans ces passages, mais il est implicite.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











