Derniers articles

L’artiste israélienne Ruth Patir ferme son exposition à la Biennale de Venise en attendant un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages

L'artiste représentant Israël à la Biennale de Venise a appelé mardi à un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza et a déclaré que son exposition resterait fermée jusqu'à ce que les otages soient libérés. L'installation vidéo de Ruth Patir, intitulée "M/otherland", devait être inaugurée samedi au pavillon national d'Israël à la Biennale internationale d'art, mais la veille d'une présentation aux médias, elle a déclaré qu'elle resterait fermée pour l'instant.
Tiré de France Palestine Solidarité. Article paru à l'origine dans The New Arab. Photo : Biennale arte 2024 - Stranieri Ovunque - Strangers Everywhere © Biennale de Venise
"J'ai le sentiment que le temps de l'art est perdu et j'ai besoin de croire qu'il reviendra", a-t-elle écrit dans un message sur Instagram.
Elle a ajouté qu'elle et les commissaires Mira Lapidot et Tamar Margalit "sont devenues l'actualité, pas l'art".
"Et donc si l'on me donne une scène aussi remarquable, je veux faire en sorte qu'elle compte", a-t-elle écrit.
"J'ai donc décidé que le pavillon n'ouvrirait que lorsque les otages seraient libérés et qu'un accord de cessez-le-feu serait conclu".
Des milliers d'artistes, d'architectes et de conservateurs ont signé une pétition au début de l'année pour demander aux organisateurs de la Biennale de bannir Israël en raison de ses actions à Gaza, une demande condamnée par le ministre italien de la culture qui l'a qualifiée de "honteuse".
"En tant qu'artiste et éducateur, je m'oppose fermement au boycott culturel", a poursuivi Mme Patir.
"Mais comme j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de bonne(s) réponse(s) et que je ne peux faire que ce que je peux avec l'espace dont je dispose, je préfère élever ma voix avec ceux que je soutiens dans leur cri, cessez le feu maintenant, ramenez les gens de leur captivité."
"Nous n'en pouvons plus."
Le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque sans précédent contre le sud d'Israël, causant la mort de 1 170 personnes, selon les chiffres israéliens. Le groupe palestinien affirme que l'attaque a été lancée en réponse à l'occupation de la Palestine par Israël et à son agression continue contre le peuple palestinien, ainsi qu'à son siège de la bande de Gaza.
L'impitoyable offensive aérienne et terrestre d'Israël a tué plus de 33 800 personnes à Gaza depuis lors, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé. Elle a poussé l'enclave au bord de la famine et a rendu une grande partie de la bande de Gaza inhabitable.
Israël estime que 129 des 250 otages saisis lors de l'attaque du 7 octobre se trouvent toujours à Gaza.
La Biennale Arte 2024, l'une des plus importantes expositions internationales d'art, se déroule du 20 avril au 24 novembre.
Traduction : AFPS

Au Soudan, résister en dessinant

Contraints de fuir la guerre qui ravage leur pays depuis plus d'un an, les dessinateurs soudanais mettent leur talent au service de l'information et de la paix malgré les dangers. Lancé début 2024, le magazine en ligne Khartoon Mag vise à les soutenir et à donner une visibilité à leurs caricatures.
Tiré d'Afrique XXI.
Le bougainvillier magenta arrosé tendrement par sa mère. Des rires, des pleurs. Le placard rempli de vaisselle uniquement destinée aux grandes occasions. Les livres minutieusement collectionnés au fil des années, qui ne seront jamais lus... Quand elle a fui la guerre, Shiroug Idris a emporté une somme de détails, et en parcourant ses illustrations soignées le lecteur devine que ces objets pèsent dans son cœur autant que s'ils avaient pu être transportés.
La dessinatrice a quitté sa maison trois semaines après l'éclatement de la guerre au Soudan, en avril 2023. Quelques mois plus tard, la voilà de nouveau déplacée. Elle garde une image de cet exode, qu'elle fige sur son carnet à dessins. Elle, assise dans un bus côté fenêtre où elle plonge son regard ; en dessous de son portrait, la jeune femme de 26 ans note : « Malgré la peur, j'ai vu la plus belle scène de coucher de soleil se reflétant sur les champs de mil – sous les pieds nus des passagers qui s'y balançaient. » Shiroug est l'une des trois contributrices actuelles de la résidence virtuelle du magazine en ligne Khartoon Mag. La première syllabe pour Khartoum, la capitale du Soudan, et Khalid, du prénom du fondateur ; et la seconde pour cartoon, dessin en français.
L'aventure éditoriale débute en janvier 2024 alors que la guerre ravage toujours le pays. L'objectif est de donner tous les trois mois la possibilité à trois dessinateurs soudanais, sur place ou en exil, de raconter le conflit en postant chaque semaine leurs dessins. Du témoignage personnel à la caricature politique, les artistes de différentes générations documentent les violations en cours, dénoncent les auteurs de crimes, reviennent sur les origines du mal, sèment l'espoir. « Un espace libre » et « sans censure » conçu par Khalid Albaih.
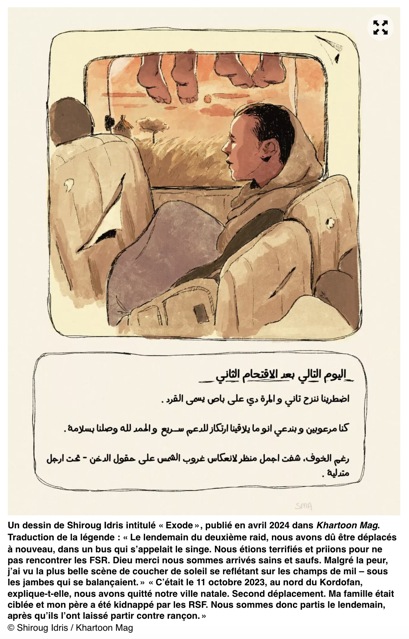
Ce dessinateur soudanais, qui a vécu aux quatre coins du globe et de manière épisodique au Soudan (son père était diplomate), est convaincu que, aussi simple soit-il, un dessin est un puissant outil politique. Notamment parce qu'« il parle à tous et ouvre des conversations », soutient-il. Les siens ont été largement diffusés sur la toile au moment des « printemps arabes », au début des années 2010. Fort de cette reconnaissance internationale, ce révolutionnaire virtuel se bat pour donner à voir le travail de ses pairs au Soudan. Ces dernières années, il a initié plusieurs projets allant dans ce sens, comme la création d'un fonds pour soutenir la communauté artistique (Sudan Artist Fund) ou encore l'édition de Sudan Retold, une collection d'œuvres de 31 artistes explorant l'histoire de la nation. Une nouvelle fois avec Khartoon Mag, Khalid mise sur la force de l'art pour instiller un changement positif : « Utiliser l'art pour parler à notre peuple, faire comprendre aux Soudanais la complexité de leur identité, cela nous guérira. Le Soudan est un grand pays, très diversifié. Dans chaque maison nous trouvons l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya... Seuls l'art et l'éducation peuvent nous aider à vivre ensemble. »
Le bruit des bombes
Deux figures politiques reviennent souvent sous les coups de crayon des dessinateurs : Abdelfattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti », chef des Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire. Dans un dessin du mois d'avril 2024, Ahmed Fouad (nom d'artiste : Ben) représente le futur sous la forme d'un jeune homme étranglé de la poigne des deux guerriers. Ce sont les principaux visages de ce conflit dévastateur. Le 15 avril 2023, des premiers échanges de tirs retentissent à Khartoum. Les deux camps revendiquent mutuellement le contrôle des principaux sites gouvernementaux et la population est prise en otage. Tayeb Hajo (nom d'artiste : Too Dope), tout à la fois musicien, compositeur et dessinateur, résume ce brutal changement de décor dans le titre d'un autoportrait : « From Rap & Boom Bap to War & Boum Bombs ». Dans ses oreilles, le bruit des bombes est venu remplacer celui des rythmiques de rap.
Le déclenchement de cette nouvelle guerre s'inscrit dans une longue histoire tumultueuse. Les protagonistes sont bien connus des observateurs de la vie politique que sont les caricaturistes. Dans une bande dessinée intitulée sobrement Hemetti, Yousif Elamin retrace en long et en large l'ascension de cet homme. Il nous rappelle qu'il était le vice-président du Conseil militaire de transition, dirigé par Abdelfattah al-Burhan, son adversaire actuel. Les deux s'étaient alliés en 2019 après la chute du dictateur Omar al-Bachir, dont le peuple avait réclamé le départ lors d'immenses manifestations populaires. Le pouvoir n'a jamais été pleinement remis aux civils. Si Hemetti a participé au renversement de l'ancien président, il n'a pas toujours été son opposant. « L'histoire de Hemetti commence en 2003 », nous raconte Yousif. Il remonte ainsi la chronologie du seigneur de guerre au génocide du Darfour, pour lequel Omar al-Bachir a été accusé par la Cour pénale internationale (CPI). Des massacres auxquels les milices de Hemetti ont participé.
En contrepoids à ce récit, dans une autre publication au narratif plus personnel, Yousif explique comment sa vision de l'armée s'est transformée au fil des années. Nourri à la propagande militaire depuis l'enfance, les images glorieuses diffusées par la télé ont été petit à petit entachées par ses relations tendues avec les représentants de l'ordre (la police mais aussi les agents administratifs), puis par l'alliance des forces armées avec les milices génocidaires.
« Documenter ce qu'il se passe »
Le site se revendique comme indépendant et entend offrir des « sources impartiales » aux internautes sur la situation au Soudan. Les artistes ont à cœur de dénoncer les exactions des deux camps. « Je dessine autant sur l'armée que sur les FSR. Ce qui m'importe, c'est que toutes ces injustices cessent, insiste Osman Obaid. Malgré la guerre, les politiciens restent concentrés sur le pouvoir. Mon rôle est de documenter ce qu'il se passe... Faire pression sur eux et leur dire qu'ils n'ont pas le droit de s'accaparer le pouvoir. » Une tâche qui n'est pas sans risque : les dessinateurs sont nombreux à avoir reçu des insultes, voire des menaces, sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, le rédacteur en chef, Ahmed Mahgoub, a dû se résoudre à supprimer une caricature de l'un de ses dessinateurs vivant au Soudan. Elle représentait les deux belligérants chacun sur une pile de cadavres, l'un invoquant « la démocratie », l'autre « la patrie ». « Notre priorité est la sécurité de notre équipe. Nous avons décidé de retirer le dessin, mais d'une certaine façon cela montre que notre travail suscite des réactions », estime Ahmed.
La majeure partie des textes des dessins sont en arabe, car ils s'adressent d'abord à la population soudanaise. Quelques-uns sont en anglais. Un partenariat avec la plateforme internationale Cartoon Movement, qui promeut des artistes du monde entier, vise à donner davantage de visibilité aux dessinateurs. Dans un de ses dessins, Ben a glissé le hashtag #talk_about_Sudan, que l'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux (ainsi que #keepEyesOnSudan). La guerre au Soudan ne bénéficie pas de la même attention médiatique que celle qui se déroule à Gaza. « Il y a une couverture médiatique, mais les médias étrangers parlent des crimes sans les condamner », regrette Shiroug.
Sous la plume d'Osman, nous voyons un membre des FSR bâillonner de sa main la planète entière. La justesse de son trait lui permet souvent de se passer de mots. Il partage l'avis de sa consœur : « En tant qu'artistes, nous pensons que le monde a besoin de prendre une position plus forte et d'arrêter de soutenir les parties en conflit. » Al-Burhan est un proche du chef d'État de l'Égypte voisine ou encore de l'Iran, et les FSR sont secrètement armées par les Émirats arabes unis. Ces alliances sont connues mais souvent tues par les représentants de la diplomatie internationale.

Les négociations entre les deux parties en conflit sont pour l'instant dans l'impasse, et les conditions de vie de la population se dégradent. Plus de la moitié des Soudanais, soit 24 millions de personnes, sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Environ 15 000 personnes sont décédées depuis le 15 avril 2023, selon les Nations unies. Un chiffre probablement en deçà de la réalité puisque les experts de l'ONU ont recensé un nombre équivalent de morts uniquement à Geneina, au Darfour, où les FSR et des milices alliées ont délibérément visé la communauté des Massalits.
« Un moyen de fixer les souvenirs et d'oublier la guerre »
Les artistes sont comme les autres Soudanais, leur vie est durement affectée par la guerre. Les six résidents ont jusqu'à présent pu être rémunérés grâce à l'International Media Support (IMS), une organisation à but non lucratif basée au Danemark qui soutient des médias locaux dans des contextes de crise. Khalid Albaih cherche une autre source de financement pour que le magazine puisse continuer d'exister. Khartoon Mag entend donner l'opportunité aux dessinateurs de poursuivre leur travail, malgré le chemin de l'exode ou de l'exil que tous ont dû emprunter. Début juin 2024, l'ONU recensait 12 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer, dont 2 millions de réfugiés dans les pays voisins.
Shiroug et sa famille ont trouvé refuge dans l'est du pays. Des voisins les ont avertis que des membres des RSF occupaient maintenant leur ancienne habitation. Dans sa dernière série d'illustrations, elle raconte avoir vu un jour, en se rendant à l'hôpital où elle travaille comme médecin, des miliciens des RSF en train de voler la seule ambulance de la ville. La jeune femme a continué sa route et a fait comme si elle n'en avait pas été témoin. Dessiner est pour elle « un acte de résistance », mais aussi « un moyen de fixer les souvenirs et d'oublier la guerre ». « De nombreuses personnes s'identifient à mes histoires, confie-t-elle. Quand les personnes ont faim et sont déplacées, c'est difficile d'apprécier l'art. Ça l'est aussi de dessiner, mais il est nécessaire d'informer le monde sur ce qu'il se passe. »
Ben aussi a été plusieurs fois déplacé. Il n'a pas d'électricité et n'a que partiellement accès à Internet dans le village du nord du pays où il se trouve. Avant la guerre, ce jeune homme de 26 ans arrivait à vivre de son art. Ce n'est plus le cas. Mais malgré les conditions de vie difficiles, il n'a pas cessé de raconter les souffrances de son peuple. Ses vignettes colorées aux traits enfantins contrastent avec la violence des scènes qu'il dépeint : des millions d'individus qui ont perdu tous leurs biens matériels, les actes de pillage des FSR, les quartiers entièrement brûlés, les disparitions, les viols... « Alors que les violations sont évidentes, certains refusent d'y croire », dénonce le dessinateur.
De la révolution à la guerre
Nader Genie confie avoir perdu sa personnalité d'artiste pendant les premiers mois de la guerre, le cœur brisé par la perte de ses biens et l'effondrement de sa nation. « Mon studio personnel contenait des équipements numériques, beaucoup de peinture, des archives, des livres, des outils pour dessiner. Je n'ai plus rien. Ma voiture a été touchée par balles le premier jour de la guerre et c'est ce qui m'a obligé à quitter rapidement Khartoum. J'ai essayé de trouver un lieu décent pour ma famille, de la nourriture et un travail pour payer le loyer et assurer les autres dépenses », témoigne le caricaturiste âgé de 46 ans et finalement réfugié avec ses proches en Égypte au bout d'un long voyage.
Nader a retrouvé la force de résister en militant du côté de la paix. Dans une publication de Khartoon Mag datant du 25 avril, il écrit :
- Devant moi se trouve une caricature représentant un énorme crocodile essayant d'avaler un peintre. Ce dernier a mis son crayon dans le sens inverse des mâchoires [du reptile, qui] ne peut plus l'attaquer. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la grandeur de la machine de guerre, elle peut s'arrêter si nos modestes efforts sont placés au bon endroit.
Il se réfère à une œuvre du dessinateur français Plantu, qui avait effectué une visite en 2009 dans les locaux du journal soudanais où travaillait alors Nadir. Comme un clin d'œil, un des dessins qui illustrent l'article représente le visage d'un soldat belliqueux vers lequel sont pointés deux pistolets qui ne risquent pas de tuer : deux colombes sont nichées dans leurs canons. À côté de son travail pour le magazine en ligne, Nader a réalisé un livre, Salam Salah (« Paix et Arme ») à paraître prochainement, regroupant une trentaine de dessins visant à documenter les étapes du conflit.
Avant d'être emportés par la guerre et de s'engager pour la paix, nombreux ont été les membres de Khartoon Mag à avoir mis leur art au service de la cause révolutionnaire. En février 2019, Nader avait été sollicité pour créer une association regroupant les caricaturistes. Une page Facebook, « Les caricatures de la révolution soudanaise », regroupant tous les dessins autour du soulèvement avait vu le jour. Internet et les réseaux sociaux ont été de véritables bulles d'air durant cette période.
Tous connectés
Comme Nadir, Osman fait partie de ces caricaturistes soudanais qui vivent de leur art depuis plus d'une dizaine d'années. Il a connu le contrôle systématique des services de renseignements du régime d'Omar al-Bachir et la censure au sein des rédactions. « Après la chute d'Al-Bachir, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de liberté d'expression, nous avons essayé de la conserver, mais nous avons échoué. Pendant la période de transition, même quand il y avait des civils au pouvoir, il y avait encore des pressions en interne », se remémore le dessinateur, aujourd'hui exilé en Ouganda.
Malgré l'état de peur qui persistait à cette époque, Ahmed Mahgoub a constaté un intérêt renouvelé de l'opinion publique pour la politique. Il a été à l'origine en 2015 de la première maison édition consacrée entièrement à la bande dessinée pour jeunes adultes, Kanoon Al Fan. « Nous avons donné la possibilité à de nombreux artistes d'être publiés, d'être visibles à l'international en participant à des foires. Leur niveau de confiance s'est amélioré », estime le trentenaire. Une nouvelle génération d'artistes a été formée. « Auparavant, les contributeurs se concentraient davantage sur des sujets sociaux, et là tout le monde voulait entendre parler de politique et de la révolution. » De nouveaux thèmes sont apparus, tels que le racisme. Ben pense que la révolution, en éveillant les consciences, est « l'une des meilleures choses qui soient arrivées au Soudan et à sa jeunesse ». « Je suis devenu un artiste politique plus que de divertissement », dit-il.
Kanoon Al Fan et d'autres initiatives ont cessé, mais les dessinateurs n'ont pas disparu. Khartoon Mag illustre la résilience de la communauté artistique soudanaise. « Je me suis toujours battu pour un Soudan où je pourrais vivre. Avec la guerre, je lutte pour un meilleur Soudan pour mes enfants », témoigne Khalid, avant de conclure : « C'est pour le monde, pas seulement pour le Soudan, nous sommes tous connectés. Si le Soudan va mieux, le Tchad ira mieux, l'Égypte aussi. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le combat de naître femme en Iran sous la perspective de l’artiste Sayeh Sarfaraz

« On ne naît pas femme on le devient » écrivait Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe (1949). C'est encore plus le cas en Iran lorsque les femmes sont aliénées dès la naissance par la culture dominante masculine. Plus encore, par la théocratie exclusivement masculine.
Tiré de Journal des Alternatives
Klara Alkalla, collaboratrice
Parce qu'être une femme en Iran c'est vivre sous l'emprise du régime des Mollahs. C'est subir le Code pénal islamique qui détermine le statut de la femme comme inférieur. C'est se voir imposer des restrictions sévères sur sa liberté, ses droits et son autonomie. Ce n'est pas vivre sous les ordres d'un homme mais sous la contrainte du genre. Car naître femme est réduit à n'être qu'une femme, son genre la condamne à se taire et à agir sous les diktats d'une société patriarcale et répressive.
Être une femme en Iran, c'est être forte. C'est lutter pour soi et son prochain. Être femme en Iran, c'est résister. Résister à la souffrance, la brutalité, l'humiliation et le désespoir qui sont à l'image du travail de la police des mœurs. C'est porter le voile sous peine d'emprisonnement, c'est être Fatemeh Abdullahi (27 ans), pendue pour avoir désaimé son mari, c'est être accusée pour avoir subi un viol ou encore mourir pour aimer une autre femme. C'est aussi être Monireh Noori-Kia, dont l'exécution a été annoncée sans aucune justification.
FEMMES, VIE, LIBERTÉ : le mouvement des survivantes

Photographie de Sayeh Sarfaraz Credit phoo @ Gallea
Dépeint ainsi, le sort des femmes semble voué au néant. Pourtant, l'artiste-peintre Sayeh Sarfaraz propose un corpus de tableaux qui illuminent la pièce et le regard de la personne qui les voit. Son exposition Femme-Objet se poursuit jusqu'au 1er septembre au Centre d'exposition Letherbridge à Montréal.
Sa démarche soutient les Iraniennes dans leur mouvement au lendemain du meurtre de Masha Amini, le 16 septembre 2022, pour « port du voile inapproprié » à Téhéran, depuis lequel de nombreux.se Iranien.ne.s manifestent contre le fondamentalisme religieux.
« Femme, vie, liberté » est scandé dans les rues. Ce mouvement historique est plein d'espoir. Être une femme devient plus que jamais en Iran, une force. Sayeh Sarfaraz montre des femmes fortes, pleine de vie face à la mort.
Photos de l'exposition Femme-Objet – Crédit @ Klara Alkalla
Elles sont entourées d'objets d'espoir tels que des bougies allumées qui symbolisent leur résilience et détermination à lutter pour leurs droits et leur liberté. Aussi, beaucoup de fleurs et de bijoux que l'artiste justifie par l'héritage perse. Elle affirme que le sort des femmes aujourd'hui n'est pas à méprendre avec celui de leurs ancêtres et que leur lutte actuelle s'enracine dans une longue tradition de courage et de résistance. Face aux armes qu'elle peint, c'est la vie que nous voyons. Ces femmes sans visage incarnent l'image de toutes les femmes iraniennes, soulignant l'universalité et la puissance de leur combat.
Un combat de tous, pour toutes
La lutte des Iraniennes est un rappel poignant que la quête d'égalité et de liberté est universelle. En se tenant au côté de ces femmes, le monde peut montrer que leur combat n'est pas vain et que la solidarité mondiale est plus puissante que la répression.

Marche Mondiale – Femme – Vie – Liberté à Montréal @ Crédit photo André Querry via Flickr_files
L'exposition Femme-Objet démontre d'une solidarité qui transcende les frontières et renforce la détermination collective pour un avenir où chaque femme, partout dans le monde, pourra vivre dignement. L'engagement international pour les droits humains et l'égalité des sexes sont essentiels pour faire reculer les injustices et soutenir les luttes locales, comme celle des Iraniennes, en leur offrant l'espoir et la force nécessaires pour continuer leur combat. Parce qu'être une femme ne doit plus être un combat, mais un droit.

*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

WECH’ ?

– On le tient, mon Adjudant !
– Assurez-vous que c'est bien lui !
– Affirmatif !
- Mettez-le dans le panier à salade sans l'abîmer !
- Il a déjà l'arcade amochée et la jambe sanguinolente.
– Votre œuvre ?
- La cavale, mon Adjudant.
– Tachez de le ramener entier au Commissariat !
(Wech' ? est menotté dans le bureau du Commissaire Serjouin, après une longue traque) - Vous savez pourquoi on vous a coffré au terme d'une éprouvante filature ?
- Non, Monsieur.
– Monsieur qui ?
- Le Commissaire.
(L'Officier pivote sur ses talons, furibard. Il dit, cependant :)
– J'aime les mal-dégrossis de votre acabit.
– Je ne suis pas un clandestin, se défend « Wech' ? », encore moins le père de la vague migratoire. Laissez-moi partir !
– Vous avez intérêt à changer immédiatement de ton ! Vous êtes à la Une de tous les médias, défrayant la chronique en l'Hexagone et bientôt dans toute l'Europe.
– Pourquoi autant d'incandescence ?
- Monsieur joue l'ignorant, hein ?
– Je vous jure que…
- Ne jurez pas ! Vous avez la tête d'un arracheur de dents.
(Courroucé, le Commissaire glapit :)
- Drôle de façon de « vous vous cachez derrière votre petit doigt ».
– J'peux pas, je mesure 1,80.
– La ferme !
- Les menottes me serrent trop, j'ai mal.
– La commande des menottes capitonnées arrive lundi.
- S'il vous plait, pourquoi cette arrestation ? Ma famille doit s'inquiéter (L'Officier se déchaîne )
- Parce que vous avez tué notre « ALORS ? » interrogatif pour prendre sa place.
– Mais je ne peux pas commettre une telle abomination, Monsieur le Commissaire.
– Etes-vous conscient, vous le Maghrébin ! de votre émancipation en France / ?
- (…)
- Tout l'Monde se met au diapason de : « Wech' ? », « Wech' ? » Wech' ? ».
Les Jeunes, les écoliers, les élus (es), vous adoptent religieusement en disant « Wech' ? » à la place d'« Alors ? » ou « Comment ça va ? ». Même l'Aristocratie s'y met. Chez les filles c'est carrément l'inoculation d'un nouvel ADN. A ce rythme, on « éponymera » une exoplanète : « Wech' ? ».
- Enrichissement néologique, Monsieur le Commissaire.
– Et mon poing sur la figure, c'est pas de la chirurgie réparatrice ?
-Je vous assure que ce n'est pas moi qui ai tué « Alors ? ».
– Parole de Fellaga !
- J'aimerais bien.
– Bouclez-la ! Vous êtes le signe avant-coureur du Remplacement ! Une calamité lexicale invasive. Vous venez d'où ? Répondez !
- D'Al…
– Parlez sinon j'emploie les gros moyens !
- D'Alger, Monsieur le Commissaire.
–Et voilà ! J'en étais sûr. Foyer des Rebelles !
- Mais je vous l'atteste encore une fois, que je n'ai aucun rapport avec « Alors ? ».
– Adjudant ! Appelez-moi le chef de l'établissement pénitentiaire et mettez ce Subversif en cellule du Quartier d'Isolement pour éviter toute dissémination endémique de « Wech' ? » sur notre territoire national !
(De retour, les hommes du Commissaire Serjoint croisent une brigade d'un autre département. Paulo, le Sergent franco italien qui ignore l'objet de la mission des revenants, demande à son collègue Antoine) :
– Wech' ? Antoine, on a mouillé son treillis ?
Texte et dessin : Omar HADDADOU
NB : 1) Quand le locuteur dit : « Wech' ? » les Jeunes, ça va ? ou « Wech' ? » il t'a collé un zéro ? » : (WECH' ? est ici une interjection interrogative appelant une réponse plus au moins détaillée).
2) Quand X hèle Y, ce dernier rétorque par « Wech' ? » pronom interrogatif, cela signifie : qui y a -t-i, quoi ?
3) Wech' ? a surtout gagné en prépondérance dans l'oralité, occupant la première place de la phrase : « Wech' ? on t'a appelé deux fois, mais tu n'as pas répondu ».
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La conquête de la Palestine - De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans par Rachad Antonius

Pour comprendre l'horreur qui perdure à Gaza, il faut rappeler l'histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine. Un essai qui remet les pendules à l'heure.
L'essai *La conquête de la Palestine - De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans*, du sociologue Rachad Antonius, paraît en librairie le 20 août.
En bref : selon Fabienne Presentey, membre de Voix juives indépendantes Canada et préfacière du livre, « L'auteur ne nous livre justement pas un livre de réponses toutes faites, mais un ouvrage engagé qui a le mérite de nous offrir des clés essentielles pour mieux saisir pourquoi Israël est devenu ce qu'il est. »
À propos du livre
Ce livre n'est pas une histoire du conflit entre Israël et la Palestine. Il n'aborde qu'un seul aspect de ce conflit, le plus central, et pourtant le moins considéré : l'histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine depuis plus de 100 ans et l'expulsion massive des Palestinien·nes qui l'a accompagnée. Tenir compte de cette vérité élémentaire permet de remettre les pendules à l'heure sur certains débats qui occupent l'espace public, surtout depuis la guerre de Gaza de 2023-2024. Car le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023, dans la foulée de l'attaque meurtrière du Hamas. Il est impossible de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et ce qui a suivi, si on ne prend pas en considération tout ce qui a précédé cette date fatidique.
Rachad Antonius raconte ainsi la conquête de la Palestine à partir de trois moments structurants : la Déclaration Balfour et le Mandat britannique (1917-1922, préparation de la conquête), la création de l'État d'Israël (1947-1949, conquête par la guerre et l'occupation) et les accords d'Oslo (1993-1995, conquête sous couvert de processus de paix). Colonisation, dépossession, violations des droits humains, apartheid : il rappelle une histoire qui ne doit pas être oubliée si l'on souhaite lui donner un autre avenir.
Le sociologue aborde ensuite des questions délicates, et souvent controversées, qui ont été exacerbées dans la foulée de la guerre de Gaza : l'opposition au projet politique sioniste est-elle une forme d'antisémitisme ? Quelle est la place de la violence de part et d'autre du conflit ? Pourquoi les divers plans de paix ont-ils échoué ? Le droit international peut-il mener à la paix ? Que dire de la politique canadienne à l'égard de la situation au Proche-Orient ?
S'appuyant sur des travaux d'historiens israéliens et des traités internationaux, *La conquête de la Palestine* nous permet de jeter sur les événements un regard différent de celui qui domine au sein des grands médias et des élites politiques occidentales, un regard animé par la défense des droits humains. Seul un renversement de cette dynamique de conquête, peu probable dans l'immédiat mais possible à moyen terme, permettra d'en arriver à une solution durable et d'éviter des catastrophes encore plus coûteuses tant pour les Palestinien·nes que pour les Israélien·nes.
À propos de l'auteur
Rachad Antonius est professeur titulaire retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont *Islam et islamisme en Occident *(avec Ali Belaidi, PUM, 2023). Il intervient régulièrement dans les médias au sujet de l'Islam et du Proche-Orient.
Parmi ses dernières interventions :
–
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/429010/islam-islamisme-occident-elements-pour-un-dialogue-rachad-antonius
–
https://ici.radio-canada.ca/rci/fr/nouvelle/1947817/entrevue-canada-islam-islamisme-islamophobie-rachad-antonius-ali-belaidi
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
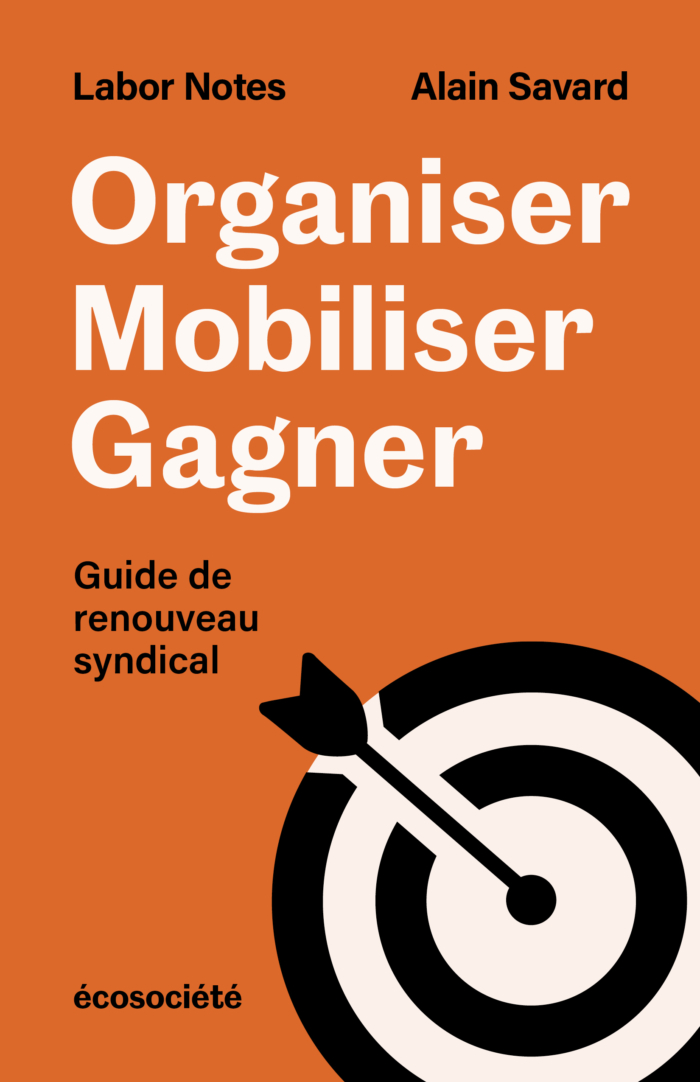
La bible de la mobilisation ! | Le guide Organiser, mobiliser, gagner paraîtra le 27 août | Par Labor Notes et Alain Savard
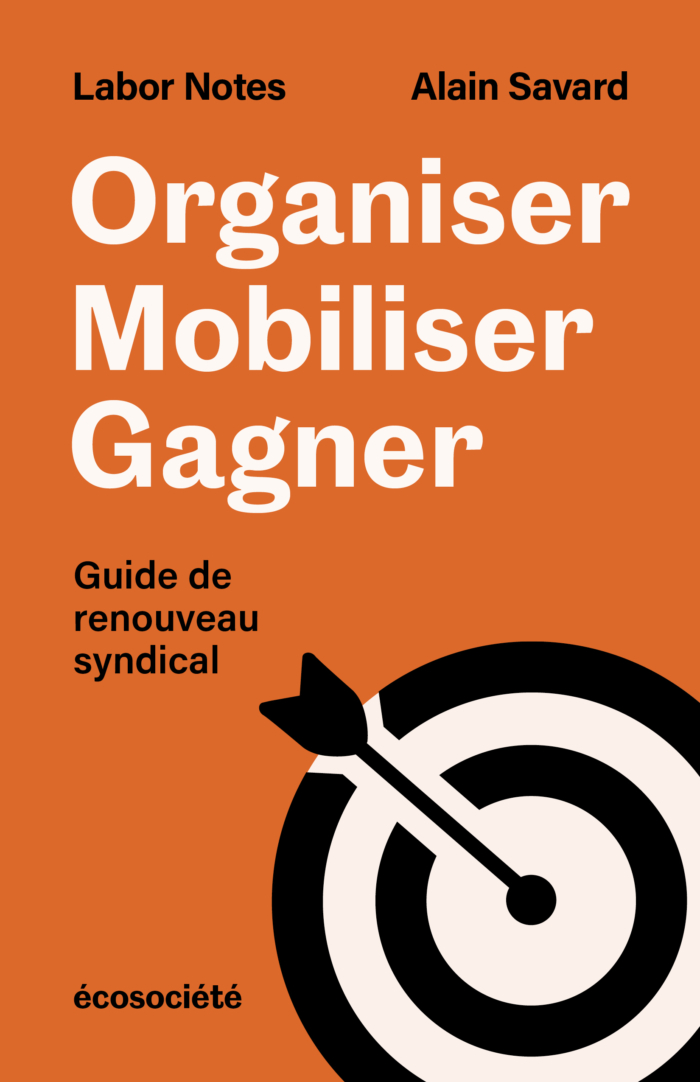
La bible de la mobilisation ! Adaptation québécoise de la célèbre formation Secrets of a Successful Organizer (Labor Notes), ce guide de renouveau syndical nous outille pour transformer ensemble nos milieux de travail et nos communautés.
Le livre Organiser, mobiliser, gagner, de l'organisation américaine Labor Notes avec la collaboration d'Alain Savard (adaptation et traduction), va paraître en librairie le 27 août.
En bref : Que l'on souhaite dénoncer un patron toxique, améliorer ses conditions de travail, convaincre ses collègues de se syndiquer, repeupler ses assemblées générales ou même, avec un peu d'imagination, mobiliser les membres de sa communauté ou de son voisinage, ce guide de renouveau syndical est l'outil idéal pour planifier des actions collectives qui fonctionnent. Après les guides de croissance personnelle, voici ce qu'on pourrait qualifier de guide de « croissance collective ».
À propos du livre
Que l'on souhaite dénoncer un patron toxique, améliorer ses conditions de travail, convaincre ses collègues de se syndiquer, repeupler ses assemblées générales, aider son syndicat ou même, avec un peu d'imagination, mobiliser les membres de sa communauté ou de son voisinage, ce guide de renouveau syndical est l'outil idéal pour atteindre ses objectifs. Il propose une démarche, étape par étape, pour planifier des actions collectives qui fonctionnent.
Les principes fondamentaux de l'organisation syndicale sont présentés sous la forme de 47 « secrets », regroupés en 8 leçons, chacune d'entre elles étant illustrée par des exemples concrets provenant des États-Unis, du Canada et du Québec. Chaque leçon comporte également des conseils, des exercices et des documents de formation à télécharger.
Organiser, mobiliser, gagner est une adaptation québécoise de la célèbre formation Secrets of a Successful Organizer, elle-même le fruit de 40 années d'expérience sur le terrain de l'organisation américaine Labor Notes. Cette formation a d'ailleurs joué un rôle déterminant dans la syndicalisation du premier entrepôt d'Amazon au Québec par la CSN en avril 2024, sans parler de son impact important aux États-Unis (notamment chez GM, Ford, Chrysler et UPS).
S'inscrivant dans la mouvance du « syndicalisme de transformation sociale », ce guide s'adresse à la fois aux personnes qui débutent leur implication dans le monde syndical et aux militant·es d'expérience à la recherche de pratiques inspirantes. Devant les défis que posent l'économie mondialisée et les mutations du monde du travail, ce livre nous rappelle tout le pouvoir de l'action collective et nous outille pour transformer ensemble nos milieux de travail, et nos communautés.
À propos de l'auteur
Alain Savard est conseiller syndical et docteur en sciences politiques (Université York). Il a coécrit Pour une écologie du 99 %, avec Arnaud Theurillat-Cloutier et Frédérick Legault (Écosociété, 2021).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, de Daria Saburova

Daria Saburova nous livre une passionnante enquête de terrain en temps de guerre déployée pendant trois mois dans la cité minière de Krivih Rih. Elle se centre sur le « travail de résistance » bénévole des femmes des classes populaires de cette ville. C'est une enquête « située » : elle rompt avec les approches « géopolitiques » qui dominent une partie de la gauche ignorant la société ukrainienne agressée et résistante. Elle rejette également certaines présentations positives mais essentialisées de l'Ukraine résistante occultant les clivages et contradictions (de classe, de genre, voire d'éthnicité) qui la traverse.
Hebdo L'Anticapitaliste - 714 (27/06/2024)
Par Catherine Samary
Éditions du Croquant, 2024, 256 pages, 17 euros.
Daria Saburova nous dit aussi, après l'émotion de plusieurs rencontres et récits, se sentir « incapable de trouver les mots », sauf de façon indirecte, « pour décrire la violence de l'occupation et de la guerre » (p. 33) – des documentaires ou la poésie peuvent mieux l'exprimer, ajoute-t-elle. C'est avec une impressionnante richesse et sensibilité « politique » au sens le plus complexe qu'elle nous fait découvrir des vécus, des perceptions du passé et des comportements populaires qui résistent aux normes (néolibérales ou linguistiques) que voudraient imposer les dominants – d'où qu'ils viennent. Le point de vue genré et de classe se combine à une approche contextualisée qui rejette les stéréotypes et visions linéaires de l'histoire. C'est un ouvrage précieux qui aide à voir l'inattendu et à penser.
Carence de l'État social : travail bénévole des femmes et exploitation accrue
Daria Saburova veut ancrer son étude à partir du point de vue des travailleuses bénévoles interrogées. Elle en révèle l'ambivalence entre « résistance populaire » (pour aider les hommes au front) et « travail gratuit » de femmes des classes populaires. L'analyse souligne sur ce plan les transformations produites par la guerre au cœur des mécanismes de la « reproduction sociale », quand l'invisibilité de l'espace privé des tâches habituellement « domestiques » des femmes devient « socialisation » via les solidarités auto-organisées, vers les combattants. Daria poursuit l'analyse du dit « travail bénévole » incorporant une hétérogénéité et des hiérarchies sociales insérées dans un système : les grandes organisations humanitaires captent des ressources spécifiques et rémunèrent quant à elle leurs « bénévoles » des classes moyennes – femmes et hommes occupant des fonctions spécifiques de responsabilité.
C'est ce que le deuxième chapitre explore. Daria Saburova y souligne comment, après des décennies de démantèlement de l'État social, s'insèrent les « lois du marché humanitaire global » (et de ses grandes ONG) qui affectent leurs règles et sous-traitance, en bout de chaîne, sur le terrain, vers le travail bénévole et gratuit des femmes populaires. Ce faisant, l'analyse et le concept contradictoire de « travail de résistance » éclaire à la fois les « capacités d'auto-organisation des classes populaires » dans les espaces de carence de l'État social – et l'aggravation de l'exploitation que cela couvre, au sein de la reproduction sociale genrée.
Deux modèles de capitalisme
Le troisième chapitre de l'ouvrage fournit alors des éclairages historiques sur les restructurations économiques et les luttes politiques sous-jacentes à ces mécanismes affectant l'Ukraine, « de l'indépendance à la guerre ». Daria Saburova explicite ici la problématique et la périodisation proposées par Denys Gorbach (1) analysant les tensions entre « deux modèles de capitalisme » – le « capitalisme paternaliste » porté par les « forces pro-russes » (prédominant à Krivih Rih) et le capitalisme néolibéral « porté par les élites national-libérales pro-occidentales ». L'enquête et les commentaires de Daria Saburova soulignent les vécus spécifiques (dans la région de Krivih Rih) des grandes crises et bifurcations de l'histoire de l'Ukraine indépendante – de 1991 à la « révolution de Maidan » ; le basculement de l'annexion de la Crimée et de la guerre hybride dans le Donbass de 2014 à 2022, puis l'invasion. Daria Saburova fait apparaître ce passé présent d'où émergent des identités différenciées, bousculées et revisitées par la guerre.
Des pratiques linguistiques mêlant russe et ukrainien
L'ouvrage se termine sur « le nouvel ordre symbolique » produit par les interactions de transformations profondes à diverses échelles spatiales et sociales. Comment la guerre – et les injonctions opposées d'appartenance ethnique et linguistiques – transforme-t-elle les comportements et choix des couches populaires étudiées dans cette région massivement « russophone » ? Et que veut dire – et « faire dire » selon certaines approches – un tel qualificatif ? Daria Saburova revient à ce propos sur les stéréotypes ethnicisant la politique. Et elle nous fait à nouveau découvrir les comportements et choix ambivalents populaires résistant sur plusieurs fronts dans cette région qui fut massivement « anti-Maidan ». Ces ambivalences se condensent dans la pratique linguistique du (voire des) sourjyk mêlant le russe et l'ukrainien. Comment l'invasion russe impacte-t-elle les rapports à la langue – russe et ukrainienne ? « La situation linguistique en Ukraine », nous dit Daria Saburova « n'est aujourd'hui réductible ni aux processus de “décolonisation” revendiquée par les élites ukrainiennes, ni à “l'oppression des russophones” brandie par la classe dominante russe pour justifier sa guerre d'agression ».
Travail de résistance
Ce refus des présentations binaires simplistes est profondément à l'œuvre dans l'ensemble de l'ouvrage, est au cœur du concept du « travail de résistance » qu'Étienne Balibar explore dans sa préface. Face aux discours normatifs, Daria analyse à quel point les mots eux-mêmes – comme « bénévolat » – sont ambivalents et bousculés par la guerre, recouvrant aussi des réalités sociales différenciées. Les nouveaux mots associés à la guerre font ainsi passer du « bénévolat » au « volonterstvo », notion plus englobante qui devient, nous dit Daria Saburova, « l'un des principaux régimes de mobilisation du travail en temps de guerre dans toutes les couches de la population ». Mais le concept de « travail de résistance » qu'invente Daria lui permet aussi – au-delà des dimensions féministes et de classe – d'établir un lien entre enjeux humanitaires et enjeux politiques, associés à la guerre. Il s'agit d'un de ces multiples terrains où « l'issue de la guerre déterminera les possibilités de reconfiguration des rapports de force » – une des questions ouvertes par cet émouvant et passionnant ouvrage. Il faut, tout simplement, le lire. Le livre est désormais disponible en librairie (faites-en la demande !) et sur le site de l'éditeur.
Catherine Samary
1. Pour les anglophones : Denys Gorbach, The Making and Unmaking of the Ukrainian Working Class : Everyday Politics and Moral Economy in a Post-Soviet City, Berghahn Books, 2024. Espérons une version populaire en français de cette approche complexe des « régimes » ou logiques socio-économiques et politiques contradictoires qui interagissent au sein de la « cité » minière de Krivih Rih. Denys Gorbach y interroge les transformations et comportements de la classe ouvrière « post-soviétique » et d'une nouvelle « politique économique » composite. On peut au moins lire en français une partie de son approche dans son chapitre (« L'économie politique de l'Ukraine de 1991 à 2022 : régimes de propriété, politiques institutionnelles et clivages politiques ») dans l'ouvrage collectif, Karine Clément, Denys Gorbach, Hanna Perekhoda, Catherine Samary, Tony Wood, L'invasion de l'Ukraine. Histoires, conflits et résistances populaires. La Dispute, 2022.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’antifascisme : Son présent, son passé et son avenir

Un inquiétant bruit de bottes résonne à nouveau partout en Europe et en Amérique, marquant la fin d'une période de latence que d'aucuns ont interprétée comme une victoire contre le fascisme. Héritiers de la résistance contre Mussolini et Hitler pendant les années 1920 et 1930, les antifascistes, eux, n'ont jamais baissé la garde et ont bâti une longue tradition de lutte contre l'extrême droite que chacun d'entre nous gagnerait à mieux connaître aujourd'hui.
Dans cette captivante enquête, Mark Bray donne un aperçu unique de l'intérieur de ce mouvement et écrit une histoire transnationale de l'antifascisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Rédigé à partir d'entretiens menés avec des antifascistes du monde entier, L'antifascisme. Son présent, son passé et son avenir dresse la liste des tactiques adoptées par le mouvement et en analyse la philosophie. Il en résulte un éclairant portrait de cette résistance méconnue, souvent mythifiée, qui lutte sans relâche contre le péril brun.
•
« J'y avance que l'antifascisme militant est une réponse sensée et historiquement fondée à la menace fasciste qui a persisté après 1945 – et qui n'a jamais été aussi vivace que ces dernières années. Peut-être ne refermerez-vous pas ce livre en antifasciste convaincu, mais au moins aurez-vous compris que l'antifascisme est une tradition politique légitime, héritière d'un siècle de luttes dans le monde entier. »
Mark Bray est historien et enseigne à l'université Rutgers. Il a été l'un des organisateurs du mouvement Occupy Wall Street.
En librairie le 22 août | 16,95$ | 328 pages
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La réduction à la source une priorité
La réduction à la source devrait être la priorité de la gestion des matières résiduelles. Pour y arriver les plans de gestion des matières résiduelles des villes et des MRC devraient inclure une section importante sur l'information et la sensibilisation à la réduction. Les pratiques québécoises jusqu'à date mettent l'accent presque exclusivement sur le recyclage, alors que la théorie de la récupération prône l'intervention par les 3RV soit : réduction, réemploi, recyclage et valorisation et ce dans l'ordre hiérarchique.
Pour mieux comprendre la réduction à la source voici le développement de cinq thèmes : la réduction de la consommation, la dématérialisation de la consommation, le partage des biens matériels, l'utilisation accrue de la location et du prêt et finalement l'habitude des achats responsables.
La réduction de la consommation passe d'abord par une prise de conscience des comportements que l'on peut souvent associer à de la surconsommation, si répandus dans notre société. Ensuite cette réduction pourrait être facilitée en diminuant l'exposition à la publicité. Elle peut aussi prendre la forme d'une plus grande utilisation d'Internet dans les communications par exemple le paiement des factures, l'acheminement de formulaires, etc. Il existe bien sûr plusieurs autres moyens pour réduire le gaspillage et la production de déchets tels l'utilisation des sacs de magasinage réutilisables, faire les photocopies recto/verso, faire les achats en formats familiaux, l'élimination du suremballage, etc.
La réduction à la source peut également se réaliser par la dématérialisation de la consommation. Par exemple, je peux m'inscrire à une saison de théâtre plutôt que de m'acheter une deuxième télévision, faire du badminton avec mon enfant aux loisirs municipaux plutôt que d'acheter des équipements d'exercices sophistiqués pour la maison, etc. La dématérialisation des achats réduit l'utilisation des ressources naturelles, de l'énergie et de la pollution sans diminution du niveau ou de la qualité de vie.
Le partage des biens matériels est une autre façon de réduire à la source. Dans notre société, de plus en plus individualiste, on se trouve bien des raisons pour ne pas partager, par exemple l'échelle ou la tondeuse avec le voisin. Ce serait cependant une excellente façon de maintenir des liens sociaux, d'économiser argent et ressources naturelles et de réduire les déchets.
L'augmentation des services de location et de prêt pour les accessoires de bébé et les articles de sports par exemple, seraient des façons d'accroître les pratiques déjà existantes comme les bibliothèques municipales, les joujouthèques et les commerces de location d'outils.
Finalement, dans le cadre de la réduction à la source, la question des achats responsables mérite une attention toute particulière de la part du consommateur. En effet, ai-je vraiment besoin de ce bien ? Puis-je me le procurer autrement qu'en l'achetant ? Le bien est-il durable, réparable, réutilisable, recyclable ? Est-ce qu'il polluera à l'enfouissement ou à l'incinération ? Toutes ces questions méritent une réponse sensée avant d'acheter.
Cette question de la réduction à la source peut sembler quasiment révolutionnaire dans notre monde capitaliste. En effet, celui-ci est caractérisé par la course à la consommation, stimulée par une publicité omniprésente et une croyance que les possibilités de croissance sont sans limites.
N'est-il pas plus que temps de rationaliser le capitalisme pour le mettre véritablement au service de la qualité de vie et ce dans le respect des capacités de l'environnement.
Pascal Grenier sec.-très.
Nos choses ont une deuxième vie
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Pour contrer le gaspillage d’objets seconde main
Bien qu'il existe toutes sortes de façons de se procurer des articles seconde main, l'achat de ceux-ci fait souvent l'objet d'un mépris. Ce phénomène, additionné au bas prix des produits importés, provoque un immense gaspillage.
Quantités de produits seconde main en bonne état, sont systématiquement éliminées dans nos sociétés hyper consommatrices. Plusieurs phénomènes dont « le jeu de la publicité », lancent les gens dans une consommation à outrance et provoquent des sentiments de rejet, voire de mépris, pour tout ce qui n'est pas de derniers cris. Le respect de l'objet a disparu pour faire place au culte de la nouveauté.
Non seulement les objets deviennent désuets à cause des changements apportés par les designers et les améliorations technologiques, mais aussi parce que les réparations sont devenues « non rentables » à cause du phénomène du double coût, soit le coût élevé de notre main-d'œuvre et les bas coûts des produits importés, spécialement d'Asie. La rareté de la main-d'œuvre qualifiée et aussi des pièces de rechanges compliquent les réparations. Ceci entraîne la mise au rebut d'objets aussi récents que des lecteurs DVD. Alors imaginez où se retrouve votre VHS. Vous croyiez qu'en le donnant à une œuvre de charité, on aurait trouvé quelqu'un pour le réparer ? Ou encore plus difficile, pour le racheter ?
Personnellement, j'ai vu chez des organismes caritatifs, des montagnes de sacs contenant des vêtements usagés lesquels étaient vendus à quelques sous la livre pour l'exportation. Bien qu'il n'y ait pas d'autres solutions pour les organismes ceci constitue une sorte de « dumping » néfaste pour les économies locales du sud. Vous aurez sans doute observé à l'occasion d'une collecte des encombrants dans votre quartier, combien il se gaspille d'objets encore utilisables. C'en est triste …
Pour contrer ce gaspillage, personnellement j'ai d'abord adopté l'habitude de rechercher, systématiquement, une version seconde main des objets dont j'ai besoin. J'ai constaté, après plusieurs années de ce comportement, que j'ai adopté une méthode de recherche efficace, (ex : Kijiji, groupes Facebook tels Marketplace, Buy Nothing, À Donner Québec, ATCT/VTCT) que je me suis bâti un répertoire de lieux d'approvisionnement et que je peux presque toujours me procurer une version seconde main de l'objet recherché, et ce à environ 25% du prix du neuf ou simplement gratuitement. Il en résulte que l'environnement et mon portefeuille se portent beaucoup mieux. Pour chaque objet à trouver c'est maintenant un vrai défi et un réel plaisir d'entreprendre les démarches.
Concernant les réparations des appareils électriques et électroniques, je fais appel aux techniciens bénévoles du « Café Réparations » de l'organisme La Patente de Limoilou qui font les réparations pour un montant forfaitaire de 5$.
Ces façons de procéder, si elles se généralisaient constitueraient des éléments importants d'un rempart contre certains effets pervers de la mondialisation néolibérale. En plus d'être des mesures majeures pour réduire le gaspillage et protéger l'environnement, elles permettraient de créer ici beaucoup d'emplois dans les domaines de la vente et de la réparation de produits seconde main, tout en améliorant indirectement le niveau de vie de ceux qui achèteraient des objets ayant déjà servi.
Pascal Grenier sec.-très
Nos choses ont une deuxième vie
Québec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Liquider sa chair rien que pour la survie de la chair de sa chair
« Elles sont des victimes d'un système qui prône l'exclusion juvénile, des femmes cocues, des Mamans précoces, qui, pour préserver la vie de leurs enfants se voient obligées de donner la leur en échange. Existe-il un acte plus héroïque que celui-là ? Que peut-on faire de plus humain ? »
Alors que plus d'un l'ignore, le centre-ville de Port-au-Prince est sur le point de s'ériger en bastion de la prostitution. Au vu et au su de tous, presqu'à chaque rue est exposé un bordel truffé de jeunes femmes bien portantes. Ainsi, le côté économique de l'affaire apportant gros surtout aux proxénètes fait poindre ces petites boites exponentiellement.
Rien qu'au cœur de Portail Léogane on compte environs onze (11) bordels, néanmoins cela semble ne pas suffire puisque l'effectif des prostituées se révèle indénombrable. De ce fait, du matin au soir, elles occupent les moindres recoins de la zone, leur nudité cachée derrière une mini-jupe et une culotte tanga. Portail Léogane qui n'était qu'une station de transport en commun brodé de braves âmes qui, à toute heure, liquident de produits divers, aujourd'hui est enjolivé de jolies créatures s'apprêtant à offrir leur corps en échange de quelques gourdes. Désormais, on y va plus que pour le transport en commun, mais aussi pour s'acheter du Sexe. Oui du sexe dans le vrai sens du thème, en compagnie de jeunes femmes qui s'y connaissent en matière de séduction. Des gonzesses bien armées pour apaiser la soif sexuelle des clients même les plus coriaces.
Parmi cette trâlée de vendeuses de sexe se trouve Kethia (un nom emprunté), âgée de vingt-neuf (29) ans, de teint noir fin, apparemment l'une des premières bénéficiaires de la beauté divine, avec une architecture corporelle indescriptible en charme, déjà mère d'une petite fille de 13 ans. Dans son secteur, on la surnomme Neymar pour sa manière de se coiffer, aussi parce qu'elle a battu un record majeur. Rien qu'à sa première journée de travail, elle a desservi, avec expertise 60 clients.
Pratiquant ce métier depuis l'âge de 16 ans, quelques mois après avoir mis au monde sa fille. Elle raconte ne pas se voir comme une pute car, de son point de vue, la prostitution comme tout autre métier devrait se faire avec non seulement le corps, mais aussi l'âme et le cœur. Ce qui n'est pas le cas ici ! L'unique motif c'est l'argent ! D'enchaîner, elle avoue ne jamais penser à se livrer à une telle pratique, cependant une fois que son père l'ait abandonnée, l'obligation lui était faite de se bouger les coudes pour pouvoir subvenir à ses plus faibles besoins. Et, ce fut la prostitution que la vie lui a offerte comme première option. Elle a tout de même tenté d'autres coups avant de s'y lancer. Elle faisait la lessive pour des gens, mais cela lui rapportait très peu. « Dans un pays comme Haïti où tout va pour le pire, et se sentir complètement seule avec un bébé à prendre en charge, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment diable préserver son amour propre ? Des heures de ménage ou la lessive, certes, mais combien cela nous apporterait-il ? Il n'y a avait pas vraiment 36 solutions pour une personne comme moi », nous a-t-elle avoué larme à la gorge.
Faute de grive on mange des merles
Sans vouloir culpabiliser les prostituées. Il y a une chose sur laquelle Kethia ne doute pas une seconde. C'est que la majeure partie des femmes qui se prostituent, le fait avec leur âme détachée de leur corps. Quand ce n'est pas pour se nourrir elles-mêmes et leurs enfants, c'est parce qu'elles se trouvent en position de minable proie face à la dure réalité de vivre. « Je doute qu'une femme normale accepterait de vendre volontairement sa chair. Déjà, rien n'est plus désobligeant que de se voir chosifier, bestialiser ou esclavager, rien que pour quelques sous. C'est répugnant d'entendre quelqu'un nous dit rudement ‘' konbyen w fonksyone ? (C'est à combien la passe ?)'' ? Et, ces drôles de manière nous obligent parfois à nous noyer dans l'alcool ou de fumer de produits stupéfiants. Etait-ce évident ? C'est toujours une aventure infernale de se voir faire des choses à des mecs que l'on trouverait repoussant hors de la prostitution », Argue-t-elle.
Tous les bordels n'ont pas le même décor, mais elles s'y arrangent comme elles peuvent
Dans certains bordels, Elles subissent toute sorte de violence, et sont sans défense. Quelques unes, pour se remédier, s'arment d'un poignard ou d'un rasoir. Cependant, aussi surprenant que cela puisse avoir l'air, dans le secteur de Kethia, les prostituées vivent comme de vraie famille. Elles ont un patron philanthropique. Elles s'entraident mutuellement, organisent des activités leur permettant d'économiser de l'argent. Il arrive même qu'elles partagent de clients pour s'assurer que tout le monde sortira avec quelques sous, et ceci quel qu'en soit l'allure du jour. Ainsi, elles paient sans gueule de bois l'écolage de leurs enfants, se prennent en charge, et même épauler certains proches. « En Haïti, la prostitution est vue comme un métier discriminatoire, pourtant beaucoup de gens, plus particulièrement des enfants en dépendent. Sans qu'on le sache, il y a cette pratique un peu partout. Dans quelques institutions d'état ou privé. Elle se présente juste sous une autre forme », nous confie-t-elle avec un air certain.
L'abandon serait le bienvenu, mais il doit être suivi d'un mieux-être.
Ne se sentant pas dans sa peau, elle ne se voit pas pour autant quitter subitement son métier. D'ailleurs, sa plus grande peur, c'est que sa fille ne l'apprenne. Pour quelqu'un de son niveau scolaire (elle a abandonné ses études en classe de 3eme secondaire), elle doute fort de pouvoir trouver mieux à faire. Déjà, elle déclare assister à des milliers de jeunes diplômés se vautrant au chômage. Son cas serait donc pire ! « Je finirai quand même par quitter cette pratique un jour. La prostitution ne rime pas avec la vieillesse, et on ne peut s'empêcher de vieillir. De plus, certains clients raffolent les nouvelles chattes et les plus jeunes. Néanmoins, je compte tenir le coup autant que la vie me le permettra. » A-t-elle martelé.
Ce n'est plus un constat, c'est un fait ! Vue son ampleur, le secteur de la prostitution mérite bien d'être mis sous le feu des projecteurs. Ainsi, on saurait comment les adeptes y vivent ; pourquoi elles le font ? Si oui ou non elles sont protégées ? Etc. Il s'avère donc raisonnable de comprendre que la prostitution n'est pas si dédaigneuse comme le croit plus d'un. Elle est une mode de vie ! Un brave moyen de tenir debout face aux intempéries !
Marvens JEANTY
Linguiste et journaliste
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nada Alliance appelle à l’action contre le génocide ciblant les femmes

L'Alliance Nada a condamné le génocide systématique contre les femmes, en particulier les femmes kurdes/yézidies, afghanes, soudanaises et palestiniennes. Elle a appelé les autorités compétentes à reconnaître le génocide contre les femmes, à traduire les auteurs en justice et à faire pression pour que les condamnations à mort prononcées contre les militantes en Iran cessent.
Tiré de Entre les lignes et les mots
L'Alliance Nada a publié aujourd'hui une déclaration écrite concernant les attaques génocidaires visant les femmes à Shengal, au Soudan et en Afghanistan. La déclaration stipule :
« Dix ans se sont écoulés depuis que l'EI, un produit des puissances hégémoniques mondiales, a attaqué le mont Şengal (Sinjar) dans la région du Kurdistan irakien, ciblant le peuple yézidi pacifique et culturellement riche, profondément enraciné dans cette ancienne montagne. Cette attaque flagrante de l'EI contre Şengal visait à détruire les valeurs humaines et l'une des civilisations anciennes de la région, avec l'intention d'annihiler le peuple yézidi en brisant la volonté des femmes yézidies et en les exterminant. Cela a été fait physiquement par leur meurtre et leurs mauvais traitements, ainsi que psychologiquement et culturellement par leur déplacement, leur enlèvement, leur réduction en esclavage et leur vente sur les marchés aux esclaves, leur islamisation forcée et celle de leurs enfants, et le recrutement de leurs enfants comme « petits du califat » après leur lavage de cerveau. La souffrance de ce peuple reste une blessure mondiale et une tache sur l'humanité, en raison du manque de reconnaissance par de nombreux États et institutions concernées que ce qui s'est passé à Şengal est un génocide, et du fait qu'il s'agit également d'un génocide. Un génocide systématique contre les femmes yézidies.
Les Yézidis ont tiré des leçons importantes de toutes les persécutions qu'ils ont endurées tout au long de l'histoire, en particulier des attaques de l'EI et de ceux qui les ont soutenues ou facilitées. Nous mettons particulièrement en lumière les femmes yézidies qui, en retroussant leurs manches, ont créé des forces d'autodéfense pour se protéger, protéger leur patrie, leur culture et leur civilisation. Elles ont créé leurs propres organisations et systèmes de femmes sous l'administration autonome de Şengal, contribuant aux côtés des hommes yézidis à empêcher toute possibilité de nouveau génocide. C'est ainsi que les femmes yézidies ont cherché à se venger de toutes ces persécutions et de l'EI, et leur lutte organisée et consciente se poursuit jusqu'à ce que chaque fille et femme yézidie kidnappée soit libérée et que le sort des disparues soit connu. Elles reconnaissent que c'est la seule façon de garantir leurs réalisations et de garantir la paix et la sécurité à Şengal et dans tout l'Irak.
Nous approchons également du troisième anniversaire de la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, qui a marqué le début de leur règne après l'accord de Doha, inaugurant une nouvelle ère tragique pour le peuple afghan en général et pour les femmes afghanes en particulier. En raison des politiques religieuses extrémistes imposées par les talibans, les femmes afghanes ont dû faire face à des souffrances accrues, ont été privées de leurs droits et libertés fondamentaux et soumises à des fatwas restrictives les confinant chez elles. À cela s'ajoutent des cas d'assassinat, de meurtre, d'enlèvement et de mutilation, entre autres violations flagrantes. En réponse, les femmes afghanes ont tiré de grandes leçons de la révolution des femmes au Rojava et dans le nord-est de la Syrie, ainsi que de la résistance des femmes yézidies sur le mont Şengal, et ont commencé à se défendre et à défendre leur patrie contre l'oppression et la répression. Leur lutte résiliente continue.
En général, on peut dire que toutes les femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord souffrent énormément de la Troisième Guerre mondiale et de ses répercussions catastrophiques sous diverses formes et dans divers domaines, de la Palestine, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak, du Kurdistan et de l'Iran à la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et le Sahara occidental. L'exploitation sexuelle et la violence sont devenues des outils de guerre contre les femmes dans les zones de conflit, en plus du chômage, des déplacements, des migrations ou des expulsions forcées, et de la privation des droits à l'éducation et aux soins de santé. L'extrême pauvreté, la faim, la soif, les mariages forcés et les mariages d'enfants sont également répandus.
Nous soulignons en particulier la tragédie du peuple soudanais et des femmes soudanaises, qui souffrent énormément en raison des conflits internes et des interventions extérieures. La violence sexuelle, les agressions, les viols collectifs et l'esclavage font désormais partie intégrante de la politique d'oppression et de vengeance contre les femmes soudanaises, qui ont déclenché la révolution kanakdienne. Cela s'ajoute aux autres impacts susmentionnés des guerres et des conflits internes sur elles.
Nous devons également condamner les attaques flagrantes contre le peuple palestinien et les femmes palestiniennes, ainsi que les condamnations à mort prononcées contre des militants kurdes en Iran, en particulier contre les militants Sharifa Mohammadi et Bakhshan Azizi. Nous soulignons que tout cela se produit en présence de pays, d'organisations et d'institutions internationales qui restent inactifs malgré leur engagement proclamé en faveur des droits de l'homme et des femmes. C'est la preuve la plus claire de l'hypocrisie et du deux poids, deux mesures dans le respect des normes humanitaires définies dans divers accords et traités internationaux, et dans la mise en œuvre ou la responsabilisation de ceux qui les violent.
Par conséquent, au nom de « Nada Alliance », nous condamnons le génocide systématique contre toutes les femmes de la région, comme en témoigne le génocide infligé aux femmes yézidies, afghanes, soudanaises et palestiniennes. Nous réitérons notre solidarité, notre soutien et notre appui à la lutte et à la résistance des femmes yézidies, afghanes, soudanaises, palestiniennes et de toutes les femmes libres de la région et du monde entier. Nous appelons les organismes et institutions internationaux concernés à rompre leur silence et à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces graves violations contre les femmes. Nous les exhortons à demander des comptes aux gouvernements et aux entités responsables de ces violations des droits humains, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et atteignent le niveau d'un génocide systématique à leur encontre. Nous appelons également à la reconnaissance du génocide systématique contre les femmes en général, et les femmes yézidies en particulier, et à faire pression sur les autorités compétentes pour qu'elles mettent fin aux condamnations à mort prononcées contre des militantes en Iran. »
Kurdistan, nada alliance chiede di agire contro il genocidio delle donne
https://andream94.wordpress.com/2024/08/09/kurdistan-nada-alliance-chiede-di-agire-contro-il-genocidio-delle-donne/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le rôle crucial des syndicats dans la lutte pour la démocratie et la paix

Le résultat du second tour des élections législatives du 7 juillet en France a surtout montré une chose : la montée de l'extrême droite peut être stoppée, les libertés démocratiques et les droits sociaux peuvent être défendus. L'important est de réagir, de ne pas tomber dans le fatalisme et de construire l'unité la plus large possible, sans sectarisme.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il reste beaucoup à faire pour renverser les politiques antisociales des gouvernements français passés et récents, qui sont à l'origine du désespoir croissant d'une grande partie de la classe ouvrière. En exploitant l'impact négatif de ces politiques, l'extrême droite s'est employée à semer la division parmi les travailleurs.
Néanmoins, la réponse combinée des syndicats français a constitué, dès le début, le ciment qui a permis à différentes forces politiques de s'unir dans un front commun visant à défendre les acquis sociaux et les droits démocratiques des travailleurs français, menacés à la fois par le Rassemblement national de Marine Le Pen et par le « centre » néolibéral du président Macron.
Les luttes unitaires de l'Intersyndicale française, d'abord contre le recul de l'âge de la retraite, puis pour la défense de l'Ukraine, ont constitué des étapes importantes sur la voie de la mobilisation derrière le nouveau Front populaire qui a relégué l'extrême droite à la troisième place le 7 juillet.
¡No pasarán ! La lutte contre le danger du fascisme en Europe se déroule sur plusieurs fronts.
Le plus cruel et le plus vicieux se trouve sur la ligne de front en Ukraine, mais le danger concerne tous les pays. La réorganisation de l'extrême droite en Europe, avec le leader hongrois Orbán, la française Le Pen, l'espagnol VOX et d'autres qui se rassemblent au sein du groupe parlementaire européen pro-Poutine « Patriotes pour l'Europe », montre deux choses : que les luttes nationales contre l'extrême droite sont de plus en plus liées et que le lien avec le régime autoritaire de la Russie est commun à tous les partis et gouvernements qui présentent des traits de fascisme.
Le Kremlin les alimente en propagande, les soutient économiquement et favorise leurs alliances internationales. Comme au XIXe siècle, la Russie est à nouveau la grande puissance la plus réactionnaire et la plus agressive de notre époque. Espérer que cette menace disparaisse – ou même qu'elle soit apaisée – serait aussi suicidaire que lorsque les démocraties européennes ont fermé les yeux, dans les années 1930, sur l'expansionnisme d'Hitler
Exemples, positifs et négatifs
Le succès français, dû à l'application d'une approche de résistance unie et de mobilisation, montre à quel point le rôle des syndicats est essentiel pour renforcer la confiance et le moral de la classe ouvrière organisée et pour créer un pôle d'attraction pour des millions de travailleurs moins organisés, voire totalement inorganisés.
En revanche, une vision étroite et pessimiste au sein des directions syndicales peut signifier que l'on évite les batailles de peur de les perdre. C'est ce qui s'est passé lors de la 113e session de la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), dont il est question dans le numéro 10 de cette lettre d'information. Les dirigeants de la Confédération syndicale internationale (CSI) ont hésité à s'opposer au poutinisme, pensant que de nombreux syndicats et pays du soi-disant Sud mondial voteraient en faveur du maintien du « syndicat » complaisant du Kremlin, la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), au sein du Conseil d'administration de l'OIT. Ils ont fait pression sur les syndicats ukrainiens pour qu'ils ne contestent pas ce qui était considéré comme la « place de la FNPR ».
Mais il s'est avéré que cet appareil et son homologue chinois (la Fédération des syndicats de Chine), qui soutiennent tous deux ouvertement des régimes antidémocratiques, dictatoriaux et hostiles aux travailleurs, ont obtenu les pires votes de leur histoire, le représentant de la FNPR n'étant élu qu'à une voix près. Le représentant de la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU) aurait pu être élu au conseil d'administration du BIT en tant que délégué à part entière si on ne lui avait pas conseillé de ne pas se présenter.
Faire le bilan des victoires et des défaites
Notre mouvement doit faire le point sur le prix que nous payons pour cette neutralité et cette tiédeur, pour avoir laissé passer d'importantes opportunités, pour avoir évité la lutte frontale contre ceux qui font partie intégrante des régimes autoritaires.
Le rôle joué aujourd'hui par les syndicats français et les résultats positifs obtenus montrent qu'il faut une sorte de « tournant français » adapté, bien sûr, aux particularités de chaque pays. Nos institutions syndicales internationales doivent prendre ce virage.
Les besoins des travailleurs sont plus pressants que jamais. Les salaires perdent chaque jour de leur valeur face à l'inflation. Les prix des denrées alimentaires augmentent et le coût du logement monte en flèche. L'éducation, la santé et les services sont de plus en plus dégradés, en sous-effectif ou sous-payés. Derrière tout cela, le grand capital, en particulier le secteur financier, s'en met plein les poches comme jamais auparavant, tandis que l'environnement continue de se dégrader parce que la transition écologique juste dont toute l'humanité a besoin est bloquée. La perspective globale est celle de la peur, du chaos et de l'instabilité.
En Ukraine, cette sombre perspective est aggravée par la guerre et par des atrocités telles que le tir de missile du 8 juillet sur l'hôpital pour enfants de Kyiv. Les syndicats ukrainiens luttent pour résister aux attaques contre le niveau de vie et les conditions de travail, en partie à cause de la guerre, mais surtout à cause de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre des « réformes » radicales axées sur le marché. Les dettes salariales s'accumulent, les heures travaillées augmentent et les conditions de travail abusives se multiplient.
Lors de la manifestation organisée le 10 juin par la Fondation Frederick Ebert en marge de la conférence sur le redressement de l'Ukraine qui s'est tenue les 11 et 12 juin à Berlin, Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, a dénoncé devant le ministre ukrainien de l'économie la violation par son gouvernement de 22 conventions internationales du travail dans 50 textes législatifs ukrainiens récents ( voir le moment 1:31:30 de cette vidéo de la manifestation).
Plus les droits démocratiques et le bien-être social de l'Ukraine sont menacés, plus la conviction et l'engagement nécessaires pour défendre le pays sont grands. C'est le message des syndicats ukrainiens dans tous les forums économiques et sociaux, et c'est un message que nous devons soutenir. Nous devons renforcer la vigilance, le pouvoir des syndicats. C'est la meilleure garantie de la résilience de la société face à l'envahisseur. Plus la classe ouvrière ukrainienne sera forte et organisée, moins les troupes d'occupation russes et leur « syndicat » pourront s'en tirer. Aider à renforcer le rôle et le pouvoir des syndicats en Ukraine est une tâche vitale pour le syndicalisme de classe partout dans le monde.
Le syndicalisme doit également être soutenu et renforcé dans les pays voisins de l'Ukraine, en particulier en Russie et au Belarus. Contribuer au démantèlement des régimes autoritaires de Poutine et de Loukachenko ne se fait pas seulement de l'extérieur – par exemple en maintenant la pression sur nos gouvernements pour qu'ils fournissent à l'Ukraine l'armement dont elle a besoin – mais aussi en soutenant et en encourageant ceux qui s'opposent à ces régimes del'intérieur. Elle se fait aussi en soutenant et en encourageant ceux qui s'opposent à ces régimes
de l'intérieur, en aidant et en faisant connaître leurs véritables syndicats, souvent clandestins,qui organisent la résistance dans les entreprises, les villes et les services.
Cette lettre d'information vise à donner un espace croissant aux expressions de la lutte syndicale dans ces pays, même si elles n'en sont qu'à leurs débuts. C'est à partir de ces petites graines que pourront émerger et se développer les futurs liens de solidarité entre les travailleurs de tous les pays.
NOTE : Le taux de change de la hryvnia ukrainienne (UAH) par rapport à l'euro utilisé dans ce numéro de la lettre d'information est celui en vigueur le 12 juillet 2024.
Télécharger le bulletin Bulletin d'information syndicale Juin-Juillet 2024 n°11 : ENSU-RESU Trade Union Newsletter Number 11 June-July 2024_FR
Éditorial
Le tir de missile russe sur l'hôpital national spécialisé pour enfants Okhmatdyt, à Kyiv
Lutte des travailleurs en Ukraine – mineurs de charbon, travailleurs de la santé et coursiers
Luttes communautaires en Ukraine
Lutte des femmes en Ukraine
Lutte des étudiants en Ukraine
Luttes des LGBTI+ en Ukraine
Autres nouvelles et analyses sur l'Ukraine
Solidarité avec les travailleurs et les syndicats ukrainiens
Lutte des travailleurs au Belarus
<
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Royaume-Uni, la riposte antiraciste mobilise davantage que les émeutes de la haine

Alors que les autorités britanniques s'attendaient à des centaines de rassemblements d'extrême droite, les manifestants antiracistes étaient bien plus nombreux et la majorité des rassemblements n'ont pas été perturbés.
8 août 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
Birmingham (Royaume-Uni).– « Ils n'ont pas osé venir à Birmingham ! », lance un des orateurs du rassemblement organisé par l'association Stand up to Racism dans cette ville du centre de l'Angleterre. « Je n'ai jamais été plus fier de Birmingham, s'exclame un autre. La seule ville où les fascistes n'ont pas osé venir. » Birmingham a été relativement épargnée par les affrontements ces derniers jours.
Ce mercredi soir a été plus calme que ce que beaucoup craignaient dans tout le Royaume-Uni. Si des affrontements sporadiques ont eu lieu, à Londres notamment, les centaines de rassemblements d'extrême droite auxquels la police s'attendait ne se sont pas matérialisés. Ou alors ils étaient moins nombreux et violents que les jours précédents.
À Birmingham, l'adresse d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit à l'immigration circule sur les boucles Telegram d'extrême droite, comme point de rendez-vous à 20 heures. Plusieurs dizaines d'autres bureaux d'avocats sont listés : « Mercredi soir, les gars. Ils n'arrêteront pas de venir tant qu'on ne le leur dira pas. Plus d'immigration. 20 heures. Venez masqués. » Mais ni à cette adresse en plein quartier des joailliers de Birmingham, ni à quelques centaines de mètres sur Saint-Paul Square, autre lieu de rassemblement possible, ni même autour des militant·es de Stand up to Racism, les extrémistes ne se sont manifestés mercredi soir.
À Birmingham, comme dans plusieurs villes du Royaume-Uni, les militants antiracistes ont été bien plus nombreux que les fauteurs de troubles. © Photo Marie Billon / Mediapart
Ce n'est pas la première fois localement qu'une menace de rassemblements d'extrême droite ne se matérialise pas, ce qui n'étonne pas Jack. « C'est parce que Birmingham est une ville multiculturelle qu'elle a été épargnée par la violence, dit-il. Parce que nous sommes une ville solidaire. » Jack est commerçant, il travaille dans une boutique d'ameublement dans un quartier « ethniquement divers », dit-il. Il redoutait cette soirée, mais espérait que les premières condamnations d'émeutiers à de la prison ferme dissuaderaient les fauteurs de troubles : « Si on les arrête et qu'on les met derrière les barreaux, j'espère que cela mettra fin à tout ça, et que les gens pourront en tirer les leçons nécessaires. »
« Nous, nous rassemblons. Eux, ils divisent »
Mustapha, lui, va garder les planches pour protéger les vitres de son restaurant pendant encore quelques jours, « au cas où ». Il les a installées mercredi, craignant des violences autour du rassemblement de Stand up to Racism prévu juste en face. « Ça coûte quelques centaines de livres sterling d'installer ces protections, dit-il, mais si des émeutiers cassent les vitres, ce sera bien plus cher. » En tant que restaurateur turc, Mustapha craignait d'être particulièrement vulnérable, mais la chaîne de café britannique installée à côté et le magasin de proximité en face avaient pris les mêmes précautions que lui.
Les commerçants n'étaient pas les seuls à s'attendre au pire. En face du restaurant de Mustapha, deux jeunes hommes sont arrivés en fin d'après-midi et ont attendu que les manifestant·es antiracistes commencent à affluer pour se rapprocher du lieu de rendez-vous. Mark et Saah veulent chacun être « un corps à interposer » en cas d'attaque d'extrême droite, mais ne souhaitent pas « provoquer », assurent-ils.
Comme beaucoup d'autres jeunes gens – des hommes surtout –, ils cachent leur visage sous les cagoules noires. « C'est à cause des réseaux sociaux, dit Mark. Je vis dans un quartier où beaucoup de gens sont relativement racistes. On ne sait pas qui raconte quoi, si quelqu'un voudra me prendre pour cible… Et aussi je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec la police. » Saah dit que, comme Mark, il a été fouillé plusieurs fois sans autre raison que « la couleur de [s]a peau » et préfère aussi n'être pas identifiable.
Mustapha a décidé de barricader les vitres de son restaurant mercredi, de peur que des violences n'éclatent. © Photo Marie Billon / Mediapart
Quelques minutes plus tard, deux policiers les accostent. Tous quatre se saluent poliment. Et quand l'un des agents demande aux jeunes hommes pourquoi ils cachent leur visage, ils rétorquent : « Il n'y a pas d'EDL ici ! » L'EDL, c'est l'English Defence League, un parti d'extrême droite qui n'a aujourd'hui plus d'existence légale mais qui reste un point de ralliement pour les émeutiers. Les deux policiers repartent, apparemment satisfaits des réponses de Mark et Saah.
Si les membres des forces de l'ordre sont nombreux ici, mercredi, à Birmingham et que les agents gardent un œil sur les jeunes encagoulés, les seules fois où ils élèvent la voix ou lèvent un bras sont pour pousser la foule qui écoute les discours de Stand up to Racism sur le bitume, malgré la circulation des voitures. Plusieurs automobilistes signalent d'ailleurs leur soutien en klaxonnant, ou en lançant des insultes contre l'EDL depuis leur volant.
« Nous sommes ici ce soir parce que nous aimons nos voisins, dit un intervenant de Stand up to Racism. Ils pensaient que personne ne leur tiendrait tête et ne dénoncerait leur idéologie toxique. Mais nous, nous manifestons, eux, ils créent des émeutes. […] Nous, nous rassemblons. […] Eux, ils divisent. »
Si des musulmans provoquaient des émeutes, détruisaient des commerces, brisaient des vitres, blessaient des gens, ils nous traiteraient de terroristes. Mais parce que ce sont des Blancs qui le font, c'est de l'activisme.
Une jeune musulmane de Birmingham, sous couvert d'anonymat
Après une grosse heure de discours prononcés sur le point de rendez-vous, les manifestant·es marchent vers le centre-ville de Birmingham, en scandant : « Les réfugiés sont bienvenus » ou « Racistes, rentrez chez vous », mais aussi des slogans propalestiniens et hostiles à Israël. Quand certains entonnent « Allahou Akbar », les organisateurs noient les cris avec d'autres slogans dans les mégaphones. Mais ces mots ne dérangent pas Eilish : « Dire que Dieu est grand, c'est une opinion. Si c'est ce que vous pensez, je ne vois pas le souci, quelle que soit la langue dans laquelle c'est prononcé. »
Cette Anglaise de 31 ans avait hésité à venir ce soir au rassemblement de Stand up to Racism. « J'étais persuadée qu'il allait y avoir des contre-manifestants, et je craignais de la violence, raconte-t-elle. Mais je pense que ce qui s'est passé au cours des dernières vingt-quatre, quarante-huit heures, a montré que la police réagit vigoureusement face aux violences. » Eilish a suivi les fils d'actualité sur son téléphone et elle se réjouit de voir que dans tout le pays, les manifestant·es antiracistes sont nombreux. « L'extrême droite est dépassée en nombre », annonçaient plusieurs médias dès mercredi soir.
Les manifestant·es et les autorités espèrent qu'un tournant a eu lieu et que se profile la fin des violences racistes ayant prospéré sur l'instrumentalisation et la manipulation des faits liés à l'attaque au couteau de Southport, qui a coûté la vie à trois petites filles le 29 juillet. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, le suspect n'est ni musulman ni un demandeur d'asile arrivé illégalement dans le pays.
« J'ai vécu ici toute ma vie, disait mercredi après-midi une jeune fille portant un hidjab, mais je ne me suis jamais sentie aussi peu en sécurité qu'en ce moment même. J'ai l'impression que lorsque je sors de chez moi, je dois regarder de tous les côtés. J'ai peur que quelqu'un me crie dessus, m'insulte ou m'attaque. » La jeune femme de 21 ans a tenu à rester anonyme, tout comme l'amie qui marche à côté d'elle. Elles ne veulent pas se promener seules en ville en ce moment, disent-elles, et elles ne vont que là où il y a du monde pour se sentir moins vulnérables.
Même quand elles passent devant un camion de policiers, elles ne sont pas rassurées. « Si des musulmans provoquaient des émeutes, détruisaient des commerces, brisaient des vitres, blessaient des gens, ils nous traiteraient de terroristes, remarque-t-elle. Mais parce que ce sont des Blancs qui le font, c'est de l'activisme. » Toutes deux voudraient que les émeutiers soient accusés d'actes terroristes. Une possibilité envisagée pour certains cas par les autorités judiciaires, mais d'autres estiment que cela donnerait un vernis idéologique à des agissements opportunistes. Le premier ministre insiste depuis le surgissement des événements sur le fait que les fauteurs de troubles seraient avant tout des « voyous ».
Keir Starmer a aussi martelé qu'ils « n'échapper[aient] pas à la justice ». Mercredi, trois émeutiers ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de vingt mois à trois ans. Plus de 500 places dans au moins trois maisons d'arrêt sont préparées pour recevoir les fauteurs de troubles qui seront reconnus coupables dans les prochains jours. Le gouvernement travailliste accélère son programme de libération de certaines détenues à 40 % de leurs peines, pour faire de la place dans les centres d'incarcération.
Ancien procureur général, Keir Starmer estime qu'une justice rapide et intraitable peut dissuader les fauteurs de troubles. Mais quand l'atmosphère sera plus sereine, le Royaume-Uni ne pourra pas faire l'économie d'un examen de conscience.
« Pour beaucoup, ce qui se passe en ce moment est la répétition des tensions raciales que nous avons connues dans les années 1960, 70 et 80, a déclaré un des orateurs de Stand up to Racism. Cette fois-ci, nous devons mettre fin pour de bon à cette menace fasciste. » La foule a applaudi copieusement, mais ces troubles et émeutes pour demander la « fin de l'immigration » s'appuient sur une structuration difficile à contrer, comme l'a montré le haut score (4 millions de votes) du parti populiste Reform UK lors des élections du 4 juillet.
Marie Billon
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand l’accusation d’antisémitisme devient une arme entre les mains du néofascisme

Netanyahu est devenu le chouchou de l'extrême droite mondiale, non seulement en tant que modèle, mais aussi en raison de ses efforts assidus pour laver ses camarades du monde entier de l'accusation d'antisémitisme et l'attacher à ceux qu'ils haïssent... (traduit de l'arabe).
3 JUILLET 2024
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Les Arabes sont habitués à être accusés d'antisémitisme chaque fois que les sionistes et leurs partisans sont incapables de réfuter leur critique de la réalité de l'État d'Israël et de son comportement colonial oppresseur. Les critiques d'origine juive du sionisme sont d'ailleurs eux-mêmes habitués à être soumis à la même calomnie, avec une sévérité accrue puisque les sionistes les considèrent comme des « traîtres » ou les accusent de « haine de soi » selon la logique raciste qui veut que tout Juif devrait être sioniste (la même logique qui prévaut chez ceux dont l'hostilité au sionisme sert de mince voile à une position raciste hostile aux Juifs dans leur ensemble).
Ce qui est nouveau ces dernières années, c'est l'élargissement du champ des personnes accusées d'antisémitisme pour y inclure un large éventail de critiques de gauche de l'État d'Israël, dont la position critique s'inscrit dans une longue histoire politique et qui, durant des décennies de critique des gouvernements israéliens pour leurs pratiques racistes coloniales envers les Palestiniens, étaient convaincus de partager cette position avec les Juifs israéliens de gauche. Ce changement a accompagné une dérive croissante de la scène politique mondiale vers la droite et l'extrême droite, dérive propulsée et stimulée par cette dernière.
Benjamin Netanyahu en a été un pionnier. Le premier ministre sioniste est, à plus d'un titre, un pionnier de l'extrême droite mondiale. Il a notamment joué ce rôle après son retour au pouvoir en 2009 et sa longévité au gouvernement, établissant le record de durée du mandat de premier ministre de l'État d'Israël, ayant occupé ce poste pendant plus de douze ans jusqu'en 2021, avant de revenir et le réoccuper à partir de la fin de 2022. Au cours de ces années, Netanyahu a été un modèle pour l'extrême droite mondiale par son opportunisme éhonté, sa capacité à mentir sans vergogne, son recours sans scrupules aux méthodes politiques les plus viles contre ses adversaires israéliens et son aptitude sans précédent à surenchérir sur tout le monde dans l'excommunication sioniste des adversaires, qu'il a transformée en arme idéologique de prédilection.
Netanyahu est devenu le chouchou de l'extrême droite mondiale, non seulement en tant que modèle, mais aussi en raison de ses efforts assidus pour laver ses camarades du monde entier de l'accusation d'antisémitisme et l'attacher à ceux qu'ils haïssent. Cela a bien cadré avec la coïncidence entre la montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale et la montée de l'islamophobie, en conséquence de la combinaison entre l'hostilité raciste envers les immigrants provenant de pays à majorité musulmane et l'idéologie de la « guerre contre le terrorisme » stimulée par les attentats criminels menés par Al-Qaïda et Daech dans le Nord mondial.
Dans son effort pour exonérer de l'accusation d'antisémitisme les sources de l'antisémitisme traditionnel à l'extrême droite afin de rejeter cette même accusation sur tous les critiques du sionisme, Netanyahou est allé jusqu'à tenter d'absoudre partiellement Adolf Hitler lui-même de la responsabilité de la perpétration du génocide des Juifs européens, en attribuant cette responsabilité à Amin al-Husseini d'une façon qui a suscité la protestation et la dénonciation de tous les historiens de la Shoah. L'intention de Netanyahu n'était pas seulement d'amplifier l'hostilité raciste envers les Arabes et les musulmans à travers le personnage d'Al-Husseini, argument favori de la propagande sioniste pendant plus de quatre-vingts ans en raison du mal qu'il a fait à la cause palestinienne en collaborant avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intention du premier ministre israélien était également d'exonérer l'extrême droite européenne antisémite à travers le personnage de Hitler.
C'est ainsi que Netanyahou est devenu le prétexte favori des dirigeants de l'extrême droite mondiale pour dissimuler leur antisémitisme, même lorsqu'il est flagrant. De Viktor Orban, le premier ministre hongrois dont la haine pour les Juifs n'est un secret pour personne, à Donald Trump, qui estime qu'il est du devoir des Juifs américains d'être inconditionnellement loyaux envers l'État d'Israël et son gouvernement, à Vladimir Poutine, autre modèle de l'extrême droite mondiale, et à Marine Le Pen qui s'efforce de dissimuler l'antisémitisme historiquement inhérent au mouvement qu'elle dirige, une longue lignée de figures de l'extrême droite mondiale sont devenus les meilleurs amis de Netanyahu et de son gouvernement sioniste d'extrême droite, leur semblable. Ils ont surenchéri sur tout le monde dans le soutien qu'ils leur ont manifesté, y trouvant un moyen bon marché de camoufler leur antisémitisme passé et présent, d'autant plus que le nombre des Juifs européens est devenu très limité depuis le génocide nazi, tandis que les immigrants en provenance du Sud mondial sont devenus le nouveau bouc émissaire préféré de l'extrême droite au Nord.
Un cas très révélateur par rapport à tout cela est l'annonce par Amichai Chikli, ministre de Netanyahu et membre de son parti, le Likoud, que l'ensemble du gouvernement israélien s'est réjoui de la victoire remportée par le parti de Le Pen au premier tour des élections législatives françaises dimanche dernier. Chikli détient un portefeuille ministériel spécialisé dans les « affaires de la diaspora et la lutte contre l'antisémitisme » ! Le pire, c'est que les partis politiques du « centre » ont choisi de profiter de l'instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme à des fins droitières dans leur lutte contre leurs adversaires de gauche, comme dans la campagne odieuse menée en Grande-Bretagne par la droite conservatrice et la droite du Parti travailliste (« centriste ») afin d'éliminer politiquement Jeremy Corbyn, et la campagne similaire menée contre Jean-Luc Mélenchon en France par le « centre-droit » représenté par l'actuel président Macron, et la droite de la gauche, dite « centre-gauche ».
En participant à ces campagnes de calomnie sans même diriger leurs tirs en même temps contre l'extrême droite et dénoncer son hypocrisie au sujet de l'antisémitisme, les forces « centristes » ont contribué à couvrir l'extrême droite et à crédibiliser sa prétention d'être innocente d'antisémitisme, tout en donnant la priorité à cette considération sur la condamnation du racisme antinoirs et antimusulmans et de la xénophobie en général que l'extrême droite ne prétend nullement avoir surmontées, mais dont elle est plutôt fière, les utilisant comme argument idéologique central dans son activité. C'est ainsi que l'éventail politique « centriste », de droite à gauche, a fini par participer à des manifestations contre l'antisémitisme en commun avec l'extrême droite antisémite, comme cela s'est produit en France à la suite de l'opération menée par le Hamas dans la bande de Gaza.
En conclusion, faire de l'accusation d'antisémitisme un mal absolu au point de déprécier tous les autres aspects du racisme et d'accepter que « les Juifs » soient représentés par un gouvernement sioniste dirigé par un parti d'origine fasciste et auquel participent des ministres « néonazis » et des intégristes religieux juifs, un gouvernement qui a rapproché « l'État juif » de la « gestion de la barbarie » selon le modèle incarné par « l'État islamique », ce comportement des forces « centristes » a contribué et continue de contribuer grandement à renforcer l'extrême droite mondiale, de même que leur émulation de cette extrême droite dans d'autres domaines, en particulier l'hostilité raciste envers les immigrés.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 2 juillet en ligne et dans le numéro imprimé du 3 juillet. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Après les lois sur le soutien immédiat à Israël et contre des sanctions visant ses forces : Washington valide 5 contrats de vente d’armes à Tel-Aviv

Cinq contrats de ventes d'armes sur les neuf que Washington a validés, durant les deux premières semaines du mois en cours, sont destinés à Israël pour « renforcer ses capacités de protection ».
Tiré d'El Watan.
D'un côté, elle appelle les parties à conclure un accord de cessez-le-feu à Ghaza, où 40 000 Palestiniens ont été tués en dix mois, et d'un autre, elle dote Israël des armes les plus sophistiquées et les plus dévastatrices pour soutenir son effort dans la guerre génocidaire.
L'administration Biden vient de valider la vente d'une importante cargaison d'armes pour un montant de 20 milliards de dollars, notamment de nouveaux avions de combat F-15 et des dizaines de milliers d'obus de char et de mortiers, sous prétexte de l'aider à se protéger « des menaces iranienne ».
Les nombreux appels des experts de l'ONU « à l'embargo sur les armes à destination de Tel-Aviv et l'ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction ONUsienne, qui a déclaré Israël comme force occupante sur les Territoires palestiniens, ne devant pas être soutenue militairement par les Etats membres de l'ONU, ainsi que les poursuites pour crimes de guerre, engagées par la Cour pénale internationale (CPI) », contre les dirigeants israéliens, n'ont malheureusement pas freiné le transfert d'armes vers l'Etat hébreu.
Durant les deux semaines seulement de ce mois d'août, Washington a accordé cinq marchés sur les neuf qu'elle a signés. Le dernier accord d'aide militaire, un des plus importants, concerne, selon le communiqué de l'Agence américaine de sécurité et de défense, « la vente militaire étrangère au gouvernement israélien d'avions F-15IA et F-15I+ et d'équipements connexes pour un coût estimé à 18,82 milliards de dollars », précisant que le gouvernement israélien « avait demandé l'achat d'un maximum 50 nouveaux avions de combat multirôles F-15IA, ainsi que des kits de modification de mise à jour à mi-vie pour 25 avions de combat multirôles F-15I existants, 120 moteurs F110-GE-129 ; 90 processeurs d'affichage de base II avancés, 75 radars à balayage électronique actif APG-82(V)1 ; 50 nacelles de navigation AN/AAQ-13 Lantirn avec conteneurs ; 320 lanceurs de missiles air-air de moyenne portée avancés LAU-128 ; 25 canons M61A Vulcan ; 180 dispositifs de système de positionnement global/système de navigation inertielle intégrés avec code M.
Le coût total affirme la même source, est de 18,82 milliards de dollars. L'agence a ajouté en outre que les Etats-Unis « sont attachés à la sécurité d'Israël et il est essentiel pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à maintenir une capacité d'autodéfense forte et opérationnelle » en soulignant par ailleurs : « L'intégration des F-15IA dans la flotte d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne améliorera l'interopérabilité d'Israël avec les systèmes américains et renforcera ses capacités aériennes pour faire face aux menaces ennemies actuelles et futures, renforcer sa défense nationale et servir de moyen de dissuasion face aux menaces régionales. »
Le maître d'œuvre de ces acquisitions est la société Boeing Corporation, qui fait partie d'une kyrielle d'entreprises américaines et européennes, épinglées par le Conseil ONUsien des droits de l'homme et des Ong internationales de défense des droits de l'homme et contre lesquelles ils ont demandé un embargo et des sanctions.
Travail en coulisse
Le maître de l'ouvrage pour ce contrat est General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., situé au Québec, Canada. Une société également dans le viseur des Ong internationales de défense des droits de l'homme.
L'autre accord porte sur la vente « de camions cargo de 8 tonnes supplémentaires de la famille de véhicules tactiques moyens (FMTV) M1148A1P2 modifiés, qui seront ajoutés à un dossier de ventes militaires à l'étranger (FMS) précédemment mis en œuvre dont la valeur était inférieure au seuil de notification du Congrès », selon l'agence américaine.
Pour la presse américaine et israélienne, l'obtention de tels contrats est « le résultat » « travail en coulisses » de Yoav Gallant, ministre de la Défense de l'Etat hébreu, concerné par une demande de mandat d'arrêt international, du procureur en chef de la CPI, au même titre que le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, et dont les réponses devraient intervenir, selon la presse américaine, durant la deuxième quinzaine de septembre prochain.
Yoav Gallant et grâce à ses relations privilégiées avec certains hauts responsables américains, notamment le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a lors de ses visites à Washington, il y a quelques semaines, abordé avec ses interlocuteurs la question du renforcement des capacités militaires de son pays.
Dans son communiqué, la Maison-Blanche a expliqué que ces ventes d'armes « soutiendront la sécurité à long terme d'Israël en réapprovisionnant les stocks de munitions essentielles et en investissant dans des améliorations à long terme des capacités ».
Pour le journal de gauche Hareetz, ces importantes ventes font partie d'un « accord discuté entre de hauts responsables israéliens et américains, ainsi qu'avec des constructeurs aéronautiques ».
Au mois d'avril dernier, le président Biden avait approuvé un plan de soutien financier à Israël, d'une valeur de 26 milliards de dollars, dont environ 14 milliards de dollars pour le soutien militaire. Un mois plus tard, la « loi de soutien immédiat à Israël » est adoptée, par le Congrès sous la pression du camp républicain, rejoint par plusieurs démocrates.
Cette loi rend obligatoire les transferts de certaines armes vers Israël, dans les 30 jours qui suivent leur acquisition et s'applique principalement à l'arsenal approuvé dans le cadre du plan d'aide étrangère de 95 milliards de dollars adopté au mois d'avril dernier, soit un mois auparavant. Le gel des opérations de transfert d'armes, notamment des bombes à destruction massive de plus de 900 kg, en raison des dérives de l'armée israélienne à Ghaza, n'a pas tardé à être levé.
La visite du Premier ministre israélien à Washington, à l'invitation du Congrès, et son discours devant les deux Chambres réunies, pendant que la guerre génocidaire se poursuivait à Ghaza, a suscité colère et réprobation, notamment contre l'administration américaine, apparue comme complice des crimes commis contre la population de Ghaza.
Même les sanctions qu'elle avait annoncées contre les membres de l'Unité de l'armée israélienne, « Netzah Yehuda », pour graves violations des droits de l'homme en Cisjordanie occupée (commises avant le 7 octobre dernier), viennent d'être abandonnées.
Elle a annoncé avoir mis fin à l'enquête ouverte et aux sanctions qu'elle avait pourtant annoncées, dans le but évident de démontrer que l'armée israélienne a pris des mesures contre les violations des droits de l'homme commises par ses forces comme l'a exigé l'ordonnance de la CIJ. Bien plus.
Une sanction contre des militaires israéliens serait en contradiction avec la législation américaine qui interdit toute aide financière ou de formation du programme du ministère de la Défense, aux forces de sécurité, militaires et de police étrangères soupçonnées d'avoir commis des violations des droits de l'homme.
Lors des débats de la réunion du Conseil de sécurité mardi dernier, consacrée à la situation à Ghaza, particulièrement aux frappes contre l'école Tabeen, qui abritait des déplacés, de nombreux délégués ont accusé les Etats-Unis de complicité dans la guerre génocidaire contre les Ghazaouis, en raison de l'aide financière, militaire et politique apportée à Israël, au moment où ses dirigeants sont accusés de crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
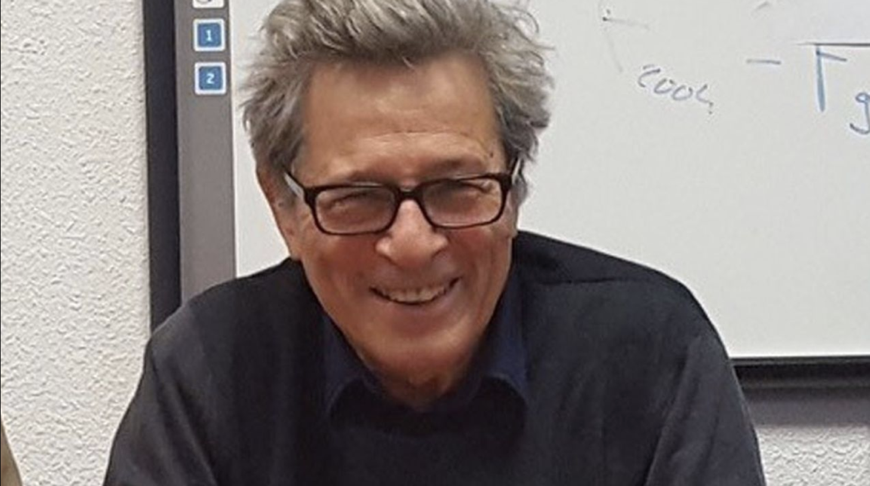
Pierre Salama, l’infatigable défenseur de l’altermondialisme, est mort
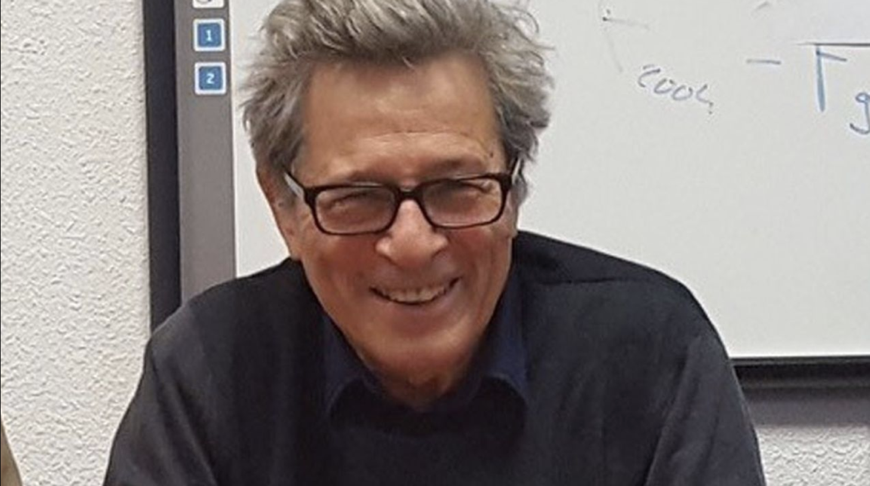
Économiste marxiste réputé, Pierre Salama est mort le 9 août à 82 ans. Réactualisant toute pensée de l'économie politique, il laisse une somme de travaux sur l'évolution des pays émergents, les inégalités et la mondialisation, à partir de son champ de recherche privilégié : le continent sud-américain.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Il était un des économistes altermondialistes les plus réputés, mais peu cité en dehors des cercles universitaires et de recherche : il était un économiste marxiste. Professeur émérite à Paris Sorbonne Nord, membre du conseil scientifique d'Attac depuis sa création , ce pédagogue, décrit comme « brillant », « chaleureux », « drôle » a consacré l'essentiel de ses travaux aux devenirs de l'Amérique du Sud, entraînant à sa suite une génération de jeunes chercheurs dans ces chemins peu empruntés des pays émergents. Pierre Salama est mort à Paris le 9 août à 82 ans.
S'il fallait résumer en quelques mots ses travaux – exercice par nature périlleux – ce serait peut-être par cette phrase de Marx qu'il reprend à son compte : « Les hommes font librement leur histoire mais dans des conditions qui ne sont pas librement décidées par eux. » En d'autres termes, les concepts ne fixent rien en soi mais se déclinent en fonction d'une situation donnée. Entre l'idéalisme et le déterminisme, il y a des chemins possibles, des choix économiques et politiques qui peuvent faire bifurquer l'histoire.
Car pour Pierre Salama, l'économie est politique. Cette conviction a d'ailleurs été la matrice de sa carrière et de sa vie. Élève brillant, il se destine au départ à devenir ingénieur. Ses rencontres universitaires de l'époque en décideront autrement.
Militant contre la guerre en Algérie, il adhère vite à l'Unef, le puissant syndicat étudiant où tous les mouvements de gauche contestataires en ce début des années 1960 se retrouvent, discutent , s'écharpent. La guerre du Vietnam, les mouvements d'émancipation du tiers-monde , la remise en cause du capitalisme sont alors au cœur de toutes les discussions. Pierre Salama participe à tout et décide alors d'abandonner ses études d'ingénieur pour étudier l'économie. « Le choix de faire de l'économie, et de l'économie marxiste qui plus est, répond à une volonté militante », expliquera-t-il plus tard.
Devenu membre de la Ligue communiste révolutionnaire, Pierre Salama entame alors un chemin de défrichage ardu. Les études économiques en France sont alors un domaine poussiéreux, dominé par la pensée des économistes autrichiens. Le PCF de son côté a plongé la pensée marxiste dans le formol.
Dès ses débuts, Pierre Salama entreprend de réveiller tout cela. Afin de ne laisser aucune prise à ses détracteurs, il développe des modèles économétriques, pratique une rigueur scientifique dont il ne se départira jamais.
Dans sa thèse, Essai sur les limites de l'accumulation nationale du capital dans les économies semi-industrialisées, il donne déjà la direction de ses travaux futurs. Tout y est : les concepts revisités de production et de formation du capital dans les économies des pays émergents et surtout le rôle de l'État dans leur transformation économique. Un rôle sur lequel Karl Marx s'est peu penché, se concentrant surtout les forces antagonistes du capital et du travail. Sa thèse remporte un succès si vif qu'elle est traduite au Brésil. Un long dialogue avec les universitaires et les responsables des gauches sud-américaines s'engage. Il ne s'arrêtera plus.
Une réhabilitation de l'économie politique
Soucieux d'élargir la recherche sur les dynamiques du capitalisme, Pierre Salama crée avec Jean-Luc Dallemagne et Jacques Valier la revue Critiques de l'économie politique, sous l'égide de l'éditeur François Maspero. Point de rencontre des débats qui animent toutes les gauches de l'époque, la revue, parue pour la première fois en septembre 1970, durera sept ans. Il deviendra par la suite un des fondateurs et animateur de la revue Tiers-Monde.
En parallèle , Pierre Salama multiplie les publications sur la valeur, l'économie politique et surtout de ses travaux pionniers au sujet du tiers-monde avec des ouvrages comme la dollarisation de l'économie.
La montée en puissance du néolibéralisme à partir de la fin des années 1970 puis de la mondialisation l'oblige à élargir ses champs de recherche. C'est au travers du continent sud-américain dont il connaît remarquablement l'histoire, la structuration politique , économique et sociale de chaque pays, qu'il décrypte encore ces déferlantes.
L'évolution du continent sud-américain au cours des dernières décennies met en lumière les principes d'intrication entre les forces économiques et l'État, les bourgeoisies de chaque pays et les mouvement sociaux, qui sont au fondement de ses recherches.
Alors que l'Asie – la Chine en premier lieu – tire parti de la mondialisation grâce notamment à des politiques étatiques volontaristes, les pays d'Amérique du Sud, à partir de la crise de la dette des années 1980, renoncent à toute politique d'indépendance et de souveraineté. Ouvrant leur économie aux quatre vents, ils acceptent une désindustrialisation massive, pour ne plus miser que sur les richesses extractives ou agricoles, comme au Brésil, choisissant d'ignorer la dangerosité écologique et sociale de ces choix. La bourgeoisie argentine poussant le renoncement plus loin, en acceptant une dollarisation complète de son économie, de ses finances publiques et même de ses échanges intérieurs.
Le défi des inégalités
Parce que le phénomène est bien plus enraciné qu'ailleurs , qu'il crée une violence sociale qui s'impose quotidiennement dans pratiquement tous les pays du continent, Pierre Salama étudie avec minutie les inégalités et ses conséquences. Dans son livre Le Défi des inégalités (éditions La découverte) qui fait suite à un précédent ouvrage écrit avec Jacques Valier, Pauvretés et inégalités dans le tiers-monde (éditions La découverte) , il insiste sur le caractère profondément dangereux du creusement des inégalités, créant des sociétés instables et excluantes. Un danger – volontairement ou non – ignoré par la majorité des économistes.
Reprenant la comparaison avec l'Asie, il souligne une nouvelle fois le rôle déterminant d'autres acteurs comme celui de l'intervention ou non de l'État, des politiques publiques, du degré d'ouverture des marchés dans le creusement ou non des inégalités. L'échec des gouvernements de gauche au Brésil, en Bolivie ou ailleurs dans les années 2010 est, selon lui, à lire à partir de cette grille. Certes, les politiques keynésiennes de relance, d'aides sociales et de redistribution sont nécessaires mais elles ne peuvent suffire en soi car elles ne modifient pas les défaillances structurelles qui nourrissent ces inégalités. La pandémie du Covid et les réponses apportées par les différents gouvernements sud-américains viendront consolider ses convictions.
Continuant à être un observateur assidu de l'Amérique du Sud, Pierre Salama s'inquiétait encore dernièrement de la puissance des mouvements évangélistes au Brésil , force motrice de l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Tout comme il prédisait à l'été 2023 la faillite économique inéluctable du gouvernement péroniste argentin d'Alberto Fernandez et l'arrivée de l'extrême droite avec Javier Milei et son traitement de choc. Pierre Salama voyait dans ces mouvements le désespoir des classes populaires qui se raccrochent à des pensées magiques, faute d'avoir su trouver une écoute et une traduction politique de leurs problèmes auprès de la gauche. L'analyse n'est peut-être pas réservée qu'aux gauches sud-américaines.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nouvel âge des fléaux du capitalisme. La révolution de l’élevage en Chine (VI)

Quinze mois avant le Covid-19, une pandémie a éclaté en Chine.
Tiré de A l'encontre
1er juillet 2024
Par Ian Angus
La peste porcine africaine (PPA) [1] est endémique chez les sangliers et les porcs d'Afrique subsaharienne depuis des siècles. Au début des années 1900, elle est passée des sangliers aux porcs domestiques importés d'Europe au Kenya par les colons. Depuis lors, des épidémies se sont déclarées dans diverses parties du monde, causées dans certains cas par des porcs sauvages et des sangliers, dans d'autres par des humains transportant des porcs infectés ou des aliments contaminés. Il n'existe ni traitement ni vaccin, et près de 100% des animaux infectés meurent.
Lorsque la peste porcine africaine a été diagnostiquée dans des élevages de porcs du nord-est de la Chine en août 2018, le gouvernement chinois a immédiatement ordonné l'abattage de tous les porcs de la région – 38 000 au total. Malheureusement, comme l'a prouvé une analyse génétique ultérieure, la maladie circulait déjà sans être détectée depuis plusieurs mois, de sorte que l'abattage fut trop tardif. Le virus était déjà en mouvement. En peu de temps, des foyers sont apparus dans toutes les provinces et la peste s'est propagée à 14 autres pays de la région Asie-Pacifique. Officiellement, entre 2018 et 2019, le nombre de porcs d'élevage en Chine a chuté de 28%, passant de 428 millions à 310 millions. La production de porc a plongé et le prix de vente au détail du porc – la viande la plus populaire en Chine – a plus que doublé [2].
La propagation rapide de la peste porcine africaine a été le résultat direct de changements radicaux dans l'industrie de l'élevage en Chine. L'adoption quasi universelle de la production de masse dans des installations confinées a rendu inévitable une pandémie de peste porcine africaine. Les mêmes changements ont contribué à la propagation rapide du Covid-19.
***
La question de savoir si la société chinoise dans son ensemble est socialiste, capitaliste ou quelque chose de nouveau et d'unique fait l'objet d'un débat permanent au sein de la gauche. Je ne tenterai pas de résoudre ou même d'aborder cette question ici, mais je pense qu'il ne fait aucun doute qu'au cours des dernières décennies, le secteur agricole chinois est devenu nettement capitaliste. C'est particulièrement vrai pour le bétail, où le modèle de production développé par Tyson Foods [le siège social se trouve à Springdale en Arkansas, cette firme a fait l'objet de nombreuses critiques d'Oxfam sur « sa gestion de la force de travail », entre autres] et d'autres firmes agroalimentaires états-uniennes a été presque universellement adopté.
La transformation a commencé en 1978, lorsque les communes agricoles de l'ère Mao ont été démantelées, remplacées d'abord par des exploitations familiales individuelles, puis par un système de marché largement non réglementé dans lequel des millions de petites exploitations ont été évincées par des sociétés agro-industrielles. Dans le secteur de l'élevage, ce changement a d'abord touché la volaille.
« Jusqu'au milieu des années 1980, la production de volailles était une activité secondaire mineure pour les ménages ruraux, en complément d'autres activités agricoles. Des millions de petits agriculteurs produisaient quelques poulets ou, au plus, quelques dizaines de poulets. A l'exception de quelques fermes d'Etat situées à l'extérieur des grandes villes, il n'y avait pas d'élevages commerciaux de volailles à grande échelle. Entre 1985 et 2005, 70 millions de petits éleveurs de volailles ont quitté le secteur. En l'espace de quinze ans (1996-2011), le nombre total d'élevages de poulets de chair en Chine a diminué de 75%. » [3]
La plupart des élevages de volailles en Chine sont encore de petite taille, mais la majorité des poulets de chair sont désormais élevés en intérieur, avec des milliers de volailles confinées dans de petits espaces. La production d'œufs est également concentrée : à la fin de 2022, Beijing Deqingyuan, qui comptait alors 20,6 millions de poules pondeuses, a annoncé son intention de tripler ce chiffre, ce qui en ferait le plus grand producteur d'œufs au monde [4].
***
La production de porc a connu une transformation similaire.
« Jusqu'en 1985, jusqu'à 95% de toute la viande de porc en Chine était produite par de petits exploitants agricoles qui élevaient moins de cinq porcs par an sur des parcelles familiales… En 2015, le secteur porcin était principalement composé d'exploitations familiales de taille moyenne (jusqu'à 500 porcs par an), d'exploitations commerciales de grande taille (500 000 à 10 000 porcs par an) et de méga-exploitations (plus de 10 000 porcs par an). » [5]
Contrairement aux producteurs de viande aux Etats-Unis, les entreprises chinoises n'ont pas eu à expérimenter diverses approches de l'industrialisation : elles ont rapidement adopté les méthodes les plus performantes mises au point par l'agro-industrie occidentale. En Chine, les exploitations d'alimentation intensive d'animaux confinés sont « construites à partir des mêmes matériaux, des mêmes plans et de la même notion de production moderne que les fermes industrielles du monde entier ; une exploitation d'alimentation intensive d'animaux confinés en Chine ressemble à une exploitation d'alimentation intensive d'animaux confinés dans l'Iowa, même si c'est parfois à une plus grande échelle et avec davantage de bâtiments reliés entre eux » [6].
L'agro-industrie chinoise a utilisé des méthodes développées aux Etats-Unis pour dépasser en termes de production ses initiateurs. Aujourd'hui, la Chine produit plus de la moitié de la viande de porc et des œufs dans le monde, et l'agro-industrie chinoise se développe à l'échelle mondiale. En 2013, la société chinoise ShuangHui International a racheté le géant américain de l'agroalimentaire Smithfield Foods pour 4,7 milliards de dollars : la firme issue de ce rachat, WH Foods [siège à Hongkong], est le plus grand producteur de porc au monde.
La production de viande en Chine n'est pas (encore) aussi concentrée qu'en Amérique du Nord, mais le modèle d'entreprise le plus courant a été directement copié sur le système de contrats mis au point par les géants occidentaux de l'agroalimentaire. Les entreprises verticalement intégrées – connues officiellement en Chine sous le nom d'entreprises à tête de dragon, évoquant la position de direction dans les danses cérémonielles du dragon – fournissent des poussins, des porcelets, des aliments, des antibiotiques et d'autres intrants aux agriculteurs sous contrat, qui hébergent et élèvent les animaux selon les instructions de l'entreprise. Comme l'affirme Richard Lewontin, dans le cadre de ces arrangements, l'agriculteur sous contrat semble indépendant, mais n'a en réalité « aucun contrôle sur le processus de travail ou sur le produit aliéné ». Le système Dragonhead transforme l'agriculteur « d'un producteur indépendant […] en un prolétaire sans alternative » [7].
La consolidation de la production de viande dans de grandes installations centralisées s'est accompagnée d'une expansion rapide des infrastructures de transport. « En 2000, par exemple, la Chine comptait 1,4 million de kilomètres de routes asphaltées, et en 2019, ce nombre avait plus que triplé, atteignant 4,8 millions de kilomètres. Le développement des chemins de fer a progressé encore plus rapidement, passant de 10 000 à 139 000 kilomètres entre 2000 et 2019 [8]. Ces réseaux de transport permettent aux animaux et aux produits d'origine animale de se déplacer rapidement des fermes aux marchés urbains. Ils permettent également, comme l'ont montré les pandémies de peste porcine africaine et de Covid-19, aux maladies infectieuses de se propager rapidement, bien au-delà de leur point d'origine, échappant ainsi aux mesures de santé publique.
Certaines des plus grandes entreprises leader construisent aujourd'hui des installations de production encore plus grandes. New Hope Group, par exemple, peut élever jusqu'à 120 000 porcs par an dans trois « hôtels à porcs » de cinq étages récemment achevés près de Pékin. Le complexe de plusieurs étages de Guangxi Yangxiang, près de Guigang, sera bientôt la plus grande exploitation d'élevage porcin au monde, abritant 30 000 truies et produisant plus de 800 000 porcelets par an.
Comme nous l'avons vu dans les articles précédents, le regroupement de milliers d'oiseaux ou d'animaux génétiquement identiques dans des installations confinées crée des conditions idéales pour la mutation, l'émergence et la propagation de nouvelles maladies infectieuses. La machine à pandémie, inventée aux Etats-Unis, a trouvé un nouveau foyer en Chine.
Les élevages industriels, les investissements importants, les contrôles environnementaux laxistes et le soutien de l'Etat ont tous contribué à la croissance spectaculaire de la production de viande. Entre 1980 et 2010, le nombre d'animaux et d'oiseaux d'élevage a triplé, et le nombre de fermes industrielles a été multiplié par 70. [9] La production de masse a fait baisser les prix de détail, rendant les protéines de haute qualité accessibles à des centaines de millions de personnes qui, auparavant, ne mangeaient de la viande que lors d'occasions spéciales, voire pas du tout. « La consommation moyenne de viande, de lait et d'œufs par habitant a été multipliée par 3,9, 10 et 6,9, respectivement, entre 1980 et 2010, ce qui représente de loin la plus forte augmentation au cours de cette période dans le monde. » [10]
Mais, comme l'a écrit Karl Marx, le système fondé sur le profit est comme une « hideuse idole païenne, qui ne boirait le nectar que du crâne des immolés » [11]. La croissance capitaliste a toujours un coût mortel. Outre les graves effets sur la santé de l'augmentation des graisses alimentaires, la marchandisation des porcs et des volailles a pollué l'eau, l'air et le sol, transformé une grande partie de l'utilisation des terres pour l'alimentation humaine en alimentation animale, augmenté les émissions de combustibles fossiles, forcé la migration de millions d'agriculteurs en faillite vers les bidonvilles urbains – et provoqué d'importantes épidémies de maladies infectieuses, notamment la grippe aviaire, le SRAS, la peste porcine et le virus du Covid-19.
En bref, l'adoption par la Chine de l'agriculture industrielle est à l'origine de catastrophes écologiques. La septième partie examinera son rôle dans l'une des pires pandémies des temps modernes. (A suivre – Article publié sur le blog de Ian Angus Climate&Capitalism le 25 juin 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre. Voir les cinq premières contributions publiées sur ce site les 12, 16, 27 mars, le 24 avril et le 15 mai)
[1] Il ne s'agit pas d'une grippe et n'a pas de lien avec la grippe porcine.
[2] Fred Gale, Jennifer Kee, and Joshua Huang, eds.,How China's African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, Economic Research Report Number 326, 2023, 12, 25.
[3] Chendog Pi, Zhang Rou, Sarah Horowitz, “Fair or Fowl ? Industrialization of Poultry Production in China,” Global Meat Complex : The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 21.
[4] “Which Are Asia's Largest Egg Producers ?,” WATTPoultry.com, December 27, 2022.
[5] Brian Lander, Mindi Schneider, and Katherine Brunson, “A History of Pigs in China : From Curious Omnivores to Industrial Pork,” The Journal of Asian Studies 79, no. 4 (November 2020) : 11–12.
[6] Mindi Schneider and Shefali Sharma, “China's Pork Miracle ? Agribusiness and Development in China's Pork Industry,” Global Meat Complex : The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 31.
[7] Richard C. Lewontin and Richard Levins, Biology under the Influence : Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health (New York : Monthly Review Press, 2007), 340.
[8] Li Zhang, The Origins of COVID-19 : China and Global Capitalism (Stanford, California : Stanford University Press, 2021), 34.
[9] Zhaohai Bai et al., “China's Livestock Transition : Driving Forces, Impacts, and Consequences,” Science Advances 4, no. 7 (July 6, 2018) : 7.
[10] Bai et al., “China's Livestock Transition.”
[11] Karl Marx, “The Future Results of British Rule in India,” New-York Daily Tribune, 8 août 1853.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nouvel âge des fléaux du capitalisme. Elevages d’animaux sauvages et marchés clandestins (VII)

A la fin des années 1980, le gouvernement chinois a commencé à encourager les agriculteurs qui avaient été évincés des marchés du porc et de la volaille à se tourner vers l'élevage non traditionnel. L'Assemblée nationale populaire de 1988 a déclaré que la faune sauvage était une ressource à utiliser pour le développement économique et, en 2004, l'élevage commercial de 54 espèces sauvages a été officiellement approuvé. Les agences nationales et étatiques ont été chargées de « promouvoir activement l'élevage et l'approvisionnement du marché en animaux sauvages terrestres pour lesquels une technologie d'élevage mature a été développée » [1].
Tiré de A l'encontre
16 juillet 2024
Marché humide.
Par Ian Angus
Cette ouverture a attiré des investissements privés et une croissance rapide : en 2016, l'Académie chinoise d'ingénierie a estimé que l'industrie légale des espèces sauvages employait plus de 14 millions de personnes et que les ventes totalisaient près de 74 milliards de dollars par an. Aucune statistique détaillée n'est disponible, mais en 2020, il a été rapporté que près de 20 000 fermes élevaient des animaux sauvages pour les vendre comme nourriture [2], notamment des rats des bambous, des pangolins, des paons, des civettes palmistes, des chiens viverrins, des porcs-épics, des sangliers et bien d'autres espèces encore.
Le mythe de l'alimentation traditionnelle
Les articles de presse sur le commerce des animaux sauvages en Chine décrivent souvent la consommation d'animaux exotiques comme une caractéristique ancienne de la culture chinoise, perpétuée par des paysans ignorants qui ont migré vers les villes. Il s'agit souvent d'une caricature raciste, preuve que les pratiques alimentaires des Chinois sont impures, cruelles et barbares.
En fait, comme l'affirme le Dr Peter J. Li, autorité en matière de bien-être animal en Chine, « la majorité des Chinois ne mangent pas d'animaux sauvages » [3].
« L'affirmation selon laquelle la consommation d'animaux sauvages est traditionnelle, qu'elle remonte à la Chine ancienne et qu'il existe une demande de viande d'animaux sauvages est une information erronée diffusée et perpétuée par les éleveurs d'animaux sauvages du pays et les propriétaires de restaurants de produits exotiques. J'ai étudié l'élevage d'animaux sauvages et l'industrie de la restauration en Chine au cours des deux dernières décennies. Je n'ai jamais trouvé de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle la Chine avait une tradition de consommation généralisée d'animaux sauvages…
L'élevage massif d'animaux sauvages en Chine et les activités connexes telles que la production d'aliments pour animaux sauvages, le transport transprovincial d'animaux vivants élevés en captivité ou chassés, la production de médicaments vétérinaires et les centaines de milliers de restaurants de produits exotiques font partie d'un empire commercial qui a vu le jour au cours des 40 dernières années. Attribuer cet empire d'exploitation de la vie sauvage à la culture traditionnelle chinoise, et suggérer ainsi qu'il y a de quoi être fier, est une tactique conçue par les entreprises pour faire taire les critiques. » [4]
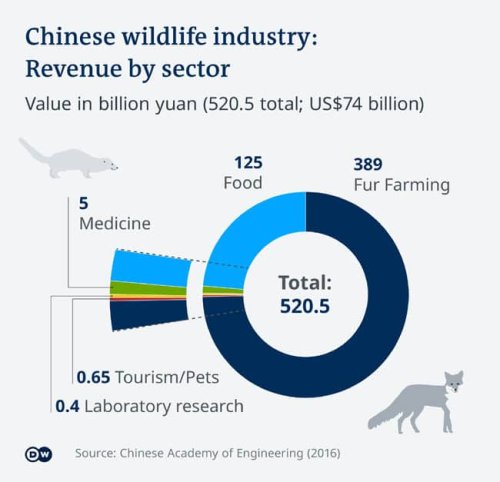
Une étude réalisée en 2020 a révélé que 97% des Chinois s'opposaient à la consommation d'animaux sauvages et 79% à l'utilisation de fourrure et d'autres produits issus d'animaux sauvages [5]. Une étude réalisée en 2014 a montré que la consommation d'animaux sauvages faisait partie « d'un style de vie à la mode et d'un symbole du statut de l'élite » et que « les consommateurs ayant des revenus et un niveau d'éducation plus élevés avaient des taux de consommation d'animaux sauvages plus élevés et constituaient le principal groupe de consommateurs d'animaux sauvages » [6].
La plupart des animaux sauvages élevés pour l'alimentation sont vendus à des restaurants qui s'adressent à l'élite urbaine – des cadres et des fonctionnaires qui peuvent s'offrir des repas dispendieux et pour qui manger et servir des animaux exotiques est une forme respectée de consommation ostentatoire.
(Il convient de noter que la consommation ostentatoire d'animaux sauvages par les riches n'est pas propre à la Chine. « Les chasseurs de trophées américains paient cher pour tuer des animaux à l'étranger et importent plus de 126 000 trophées d'animaux sauvages par an… juste pour se vanter. » [7])
L'élevage d'animaux sauvages n'est donc pas une continuation des pratiques traditionnelles, mais une extension de l'industrialisation et de la marchandisation de tout le bétail – dans ce cas, l'industrialisation et la marchandisation d'aliments de luxe pour les riches. Il ne s'agit pas d'une tradition, mais du capitalisme moderne en action.
Les marchés humides
Les marchés humides [marchés pour les produits frais, pouvant être des animaux vivants ou déjà abattus] sont des centres de vente au détail d'aliments périssables. Ils sont humides parce que l'eau et la glace conservent la fraîcheur et la propreté des produits. La plupart ne vendent que de la viande de boucherie, des fruits de mer, des légumes et des fruits. Pour des centaines de millions de personnes dans le monde, en particulier en Asie de l'Est et du Sud-Est, ces marchés sont des sources essentielles de nourriture et d'alimentation. Malgré les idées fausses répandues en Occident, les animaux vivants ne sont pas vendus et abattus dans tous les marchés humides, et seule une minorité de vendeurs d'animaux vivants – principalement des grossistes qui vendent à des restaurants et à des traiteurs – vendent des animaux sauvages d'élevage ou chassés.
Néanmoins, le commerce d'animaux sauvages peut présenter des dangers importants pour la santé humaine. Le président de l'Association médicale chinoise et directeur de l'Institut des maladies respiratoires de Guangzhou [Canton] a tiré cette conclusion de l'épidémie de SARS (acronyme anglais, en français : Syndrome respiratoire aigu sévère) de 2002-2003,
« Les marchés d'animaux sauvages représentent une source dangereuse d'éventuelles nouvelles infections qui pourraient compromettre la prévention du SARS… De nombreux marchés sont mal gérés et insalubres, de sorte que des infections croisées, des transmissions entre espèces, des amplifications, des convergences génétiques et des mélanges de coronavirus peuvent se produire. Les négociants en animaux qui se trouvent à proximité de ces animaux infectés peuvent être affectés, tout comme les entreprises de transformation des aliments qui abattent les animaux infectés dans les cuisines des restaurants, ce qui entraîne la propagation du SARS-CoV de la faune à l'homme, puis d'homme à homme. » [8]
Plus récemment, un rapport publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a mis en garde contre le fait que « toute augmentation significative de l'élevage d'animaux sauvages risque de “reproduire” l'augmentation des zoonoses qui a probablement accompagné la première domestication d'animaux à l'ère néolithique, il y a environ 12 000 ans » [9].
« En théorie, les fermes d'élevage d'animaux sauvages pourraient offrir des conditions sanitaires adéquates qui réduiraient le risque de transmission de maladies. Mais en réalité, le risque de transmission de maladies dans les élevages d'animaux sauvages est important…
Un mélange d'espèces animales est commercialisé sur les marchés – sauvages, élevées en captivité, d'élevage et domestiques – dans les véhicules de transport et dans les cages des marchés…
Le contact étroit entre l'homme et différentes espèces d'animaux sauvages dans le cadre du commerce mondial des espèces sauvages peut faciliter la propagation d'animaux à l'homme de nouveaux virus capables d'infecter diverses espèces hôtes. Cela peut déclencher des maladies émergentes à fort potentiel pandémique, car ces virus sont plus susceptibles de se multiplier par le biais de la transmission interhumaine, et donc de se propager à grande échelle. » [10]
Une évolution constante
Les virus ne cessent d'évoluer, et les coronavirus évoluent particulièrement vite. Dans la réalité, nous ne voyons que les succès de l'évolution, car les échecs ne survivent pas et ne se reproduisent pas. Nous n'avons donc aucun moyen de savoir combien de virus mutants sont passés sans succès des animaux sauvages aux animaux d'élevage.
Ce que nous savons, c'est qu'en 2002, un coronavirus inconnu jusqu'alors, probablement apparu récemment chez la chauve-souris fer à cheval [rhinolophe], a infecté des civettes palmistes d'élevage dans le sud de la Chine. Les civettes infectées ont été transportées vers des marchés humides de la province de Guangdong, où le virus s'est propagé à d'autres civettes, mutant encore avant de se transmettre à l'homme [11].
Le résultat a été le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS), la première pandémie du XXIe siècle. Cette maladie, qui s'apparente à une pneumonie, s'est déclarée à Guangdong en novembre 2002, puis s'est propagée à 29 autres pays, infectant environ 8100 personnes et en tuant au moins 774.
Le lien étroit entre l'épidémie initiale et les marchés d'animaux vivants a été évident dès le début. « Environ 40% des premiers patients étaient des manutentionnaires d'aliments ayant eu des contacts probables avec des animaux ; la plupart de ces patients vivaient plus près des marchés d'animaux vivants que des élevages, ce qui suggère que les marchés, et non les élevages, ont été la source initiale de transmission. » [12] L'interdiction de la vente de petits mammifères pour l'alimentation, associée à un abattage massif des civettes d'élevage, a contribué à l'éradication rapide du SARS.
Malheureusement, ces interdictions ont été rapidement levées sous la pression des lobbyistes de l'industrie alimentaire. Au cours des 15 années suivantes, l'élevage industriel d'animaux sauvages s'est développé parallèlement à l'élevage industriel de volailles et de porcs, utilisant les mêmes méthodes de production, les mêmes systèmes de transport et souvent les mêmes marchés.
Finalement – on peut même dire inévitablement – l'évolution implacable a produit un autre nouveau coronavirus, moins mortel mais beaucoup plus contagieux que le SARS. Il s'est d'abord formé chez des chauves-souris sauvages, puis est passé à des animaux sauvages d'élevage mis en vente à Wuhan, la septième plus grande ville de Chine. La voie de transmission exacte n'est pas encore actuellement connue, mais fin 2019, le nouveau virus s'est transmis à l'homme sur le marché de gros des fruits de mer de Huanan, le plus grand marché d'animaux vivants du centre de la Chine.
L'hypothèse selon laquelle le virus proviendrait d'un laboratoire avait une certaine crédibilité au début de la pandémie, mais elle a été réfutée depuis longtemps. La synthèse la plus récente et la plus complète des recherches publiées n'a relevé aucune preuve que le virus provenait d'un laboratoire et a conclu que « les données disponibles indiquent clairement une émergence zoonotique naturelle au sein du Huanan Seafood Wholesale Market de Wuhan, ou étroitement liée à celui-ci » [13].
Un virus en mouvement
Au cours des deux dernières semaines de 2019, 41 personnes ont été hospitalisées à Wuhan pour une maladie inconnue jusqu'alors, semblable à une pneumonie, et les deux tiers d'entre elles avaient été directement exposées au marché Huanan. Le 1er janvier, les autorités ont fermé et désinfecté le marché, mais le virus s'était déjà échappé.
Wuhan est depuis longtemps un centre de transit important, mais le nombre de trains à grande vitesse, de voies rapides et de vols qui la relient au reste de la Chine et au monde a augmenté de façon considérable depuis 2000.
« Le temps de trajet entre Wuhan et Pékin ou Guangzhou est passé d'environ douze à quatre heures, et le nombre annuel de passagers ferroviaires est passé d'environ 1 milliard en 2000 à plus de 3,3 milliards en 2018… En 2000, l'aéroport principal de Wuhan a accueilli 1,7 million de passagers pour 34 000 vols intérieurs. En 2018, plus de 27,1 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Wuhan sur 203 000 vols, dont soixante-trois liaisons internationales. » [14]
Ces liaisons, produits directs de la croissance économique spectaculaire de la Chine, ont diffusé le nouveau virus à une vitesse sans précédent. Il a été transporté par des personnes qui ne pouvaient pas savoir qu'elles étaient infectées, car le SARS-CoV-2 est contagieux pendant plusieurs jours avant l'apparition des symptômes. Des millions de personnes ont littéralement quitté Wuhan en janvier, la plupart rentrant chez elles pour la fête annuelle du printemps et, comme c'est toujours le cas lors des épidémies, beaucoup espérant échapper à la nouvelle maladie mystérieuse.
En quelques semaines, le virus a atteint la plupart des provinces chinoises et au moins une douzaine d'autres pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale », terme officiel pour désigner une pandémie. Le 11 février 2020, le Comité international de taxonomie des virus a confirmé que le nouveau virus était génétiquement apparenté à celui qui avait causé le SARS en 2002 et l'a baptisé SARS-CoV-2. Le même jour, l'OMS a baptisé la maladie COVID-19 [15].
La menace demeure
En réponse à la pandémie de COVID-19, Chiba a imposé une interdiction permanente de l'élevage d'animaux sauvages à des fins alimentaires. Si elle est effectivement appliquée, il s'agit d'une mesure de santé publique que d'autres pays devraient imiter, mais elle est loin de constituer une réponse adéquate à la menace des zoonoses. Deux problèmes cruciaux se posent.
Premièrement, l'interdiction ne s'applique qu'aux fermes qui élèvent des animaux sauvages pour l'alimentation, ce qui représente moins d'un quart des revenus de l'industrie de la faune sauvage. Les exploitations qui élèvent des animaux sauvages pour la fourrure, la médecine traditionnelle et d'autres usages sont exemptées, même si certains de ces animaux sont connus pour être porteurs de coronavirus et d'autres agents pathogènes potentiels, de sorte que plusieurs milliers d'élevages d'animaux sauvages (et de virus sauvages) restent en activité. Les animaux ne peuvent pas être consommés ou vendus sur les marchés humides, mais comme la plupart des maladies virales peuvent être contractées par respiration ou par contact physique, elles peuvent infecter les personnes qui travaillent avec eux et se propager par leur intermédiaire.
Deuxièmement, et plus important encore, l'interdiction ne concerne pas les volailles, les porcs et les autres animaux « domestiques » qui sont élevés dans des installations bien plus grandes et plus nombreuses que les élevages d'animaux sauvages. Comme nous l'avons vu dans la partie VI, 1er juillet 2024, il existe une tendance constante – fortement soutenue par les politiques de développement économique du gouvernement – à construire des installations d'alimentation animale concentrée de plus en plus grandes, ce qui accroît le risque d'apparition de nouveaux foyers de zoonoses de plus en plus graves.
Comme l'écrit Li Zhang, la seule méthode efficace pour inverser la tendance à l'augmentation des zoonoses consisterait à « démanteler ces agro-industries non durables […] et à déconcentrer les animaux et les humains des métropoles non urbaines » [16]. Si les méga-fermes continuent de croître et de s'étendre, en Chine, aux Etats-Unis et ailleurs, il est très probable que la production industrielle de bétail provoquera une nouvelle pandémie mondiale. (A suivre – Article publié sur le blog de Ian Angus Climate&Capitalism le 14 juillet 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre. Voir les six premières contributions publiées sur ce site les 12, 16, 27 mars, le 24 avril, le 15 mai et le 1er juillet)
[1] Amanda Whitfort, “COVID-19 and Wildlife Farming in China : Legislating to Protect Wild Animal Health and Welfare in the Wake of a Global Pandemic,” Journal of Environmental Law 33, no. 1 (April 23, 2021) : 57–84.
[2] Michael Standaert, “Coronavirus Closures Reveal Vast Scale of China's Secretive Wildlife Farm Industry,” The Guardian, February 25, 2020, sec. Environment.
[3] Peter J. Li, Vox interview, March 6, 2020.
[4] Peter J. Li, Animal Welfare in China : Culture, Politics and Crisis (University of Sydney, N.S.W : Sydney University Press, 2021), 213–14.
[5] Anna McConkie, “Illegal Wildlife Trade in China,” Ballard Brief, Fall 2021.
[6] Li Zhang and Feng Yin, “Wildlife Consumption and Conservation Awareness in China : A Long Way to Go,” Biodiversity and Conservation 23, no. 9 (August 2014) : 2279.
[7] Humane Society of the United States, “Banning Trophy Hunting,” 2024.
[8] Nanshan Zhong and Guangqiao Zeng, “What We Have Learnt from SARS Epidemics in China,” BMJ 333, no. 7564 (August 19, 2006) : 389–91.
[9] Delia Grace Randolph, “Preventing the Next Pandemic : Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission” (Nairobi : United Nations Environment Program, 2020), 16.
[10] Delia Grace Randolph, 33.
[11] Jie Cui, Fang Li, and Zheng-Li Shi, “Origin and Evolution of Pathogenic Coronaviruses,” Nature Reviews Microbiology 17, no. 3 (March 2019) : 181–92.
[12] Bing Lin et al., “A Better Classification of Wet Markets Is Key to Safeguarding Human Health and Biodiversity,” The Lancet Planetary Health 5, no. 6 (June 2021) : e386–94.
[13] Edward C. Holmes, “The Emergence and Evolution of SARS-CoV-2,” Annual Review of Virology, April 17, 2024. See also Phillip Markolin's excellent technical report, “Treacherous Ancestry : An Extraordinary Hunt for the Ghosts of SARS-CoV-2,” Protagonist Science, April 11, 2024.
[14] Li Zhang, The Origins of COVID-19 : China and Global Capitalism (Stanford, California : Stanford University Press, 2021), 34–35.
[15] Dali L. Yang, Wuhan : How the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China Spiraled out of Control (New York, NY : Oxford University Press, 2024), 2.
[16] Zhang, The Origins of COVID-19, 133.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nouvel âge des fléaux du capitalisme. La chaleur mortelle (VIII)

Les articles précédents de cette série se sont concentrés sur deux tendances mondiales qui alimentent l'émergence de nouvelles maladies virales à notre époque. La déforestation et la croissance urbaine ont réduit ou éliminé les barrières naturelles qui empêchaient la plupart des virus de se propager de la faune sauvage aux animaux d'élevage et aux humains. La concentration du bétail dans les fermes industrielles a créé des environnements idéaux pour que ces virus évoluent vers des formes plus contagieuses et plus mortelles.
Tiré de A l'encontre
3 août 2024
Par Ian Angus
Une analyse complète des nouveaux fléaux du capitalisme doit également tenir compte de l'impact de la crise climatique mondiale. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, habituellement prudent, conclut, avec un degré de confiance très élevé, que « les risques climatiques contribuent de plus en plus à un nombre croissant d'effets néfastes sur la santé ».
« La variabilité et les changements climatiques (y compris la température, l'humidité relative et les précipitations) ainsi que la mobilité des populations sont associés de manière significative et positive aux augmentations observées de la dengue au niveau mondial, du virus du chikungunya en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe (degré de confiance élevé [c'est-à-dire fondé sur des informations de haute qualité]), du vecteur de la maladie de Lyme Ixodes scapularis en Amérique du Nord (degré de confiance élevé) et du vecteur de la maladie de Lyme et de l'encéphalite à tiques Ixodes ricinus en Europe (degré de confiance moyen). La hausse des températures (confiance très élevée), les fortes précipitations (confiance élevée) et les inondations (confiance moyenne) sont associées à une augmentation des maladies diarrhéiques dans les régions touchées, notamment le choléra (confiance très élevée), d'autres infections gastro-intestinales (confiance élevée) et des maladies d'origine alimentaire dues à Salmonella et Campylobacter (confiance moyenne). » [1]
En effet, comme le souligne Colin Carlson, du Center for Global Health Science and Security de l'université de Georgetown, « le changement climatique d'origine humaine a déjà provoqué des décès massifs de l'échelle d'une pandémie ».
« Si l'on exclut le COVID-19 […], le changement climatique a dépassé le nombre de morts combiné de toutes les urgences de santé publique reconnues par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui suscitent des inquiétudes au niveau international. Chaque année, le changement climatique tue 14 fois plus de personnes que l'épidémie d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest. » [2]
Les inondations, les incendies de forêt et les sécheresses font partie des conséquences mortelles du changement climatique, mais nous nous concentrons dans cette série sur les maladies qui touchent le corps humain. A cet égard, les principales menaces que le réchauffement planétaire fait peser sur la santé humaine sont les vagues de chaleur potentiellement mortelles, l'élargissement de l'aire de répartition des vecteurs et la perturbation du virome mondial [le virome est l'ensemble des génomes des virus].
Vagues de chaleur
Si aucune mesure décisive n'est prise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique finira par rendre inhabitables de vastes régions de la Terre, caractérisées pendant la majeure partie ou la totalité de l'année par des températures auxquelles le métabolisme humain ne peut pas survivre. Mais le chemin vers la Terre-Serre n'est pas linéaire. Sauf sous l'effet d'une catastrophe généralisée, nous assistons déjà à une multiplication des vagues de chaleur – des intervalles de températures extrêmes qui peuvent provoquer un épuisement par la chaleur, des crampes de chaleur et des coups de chaleur, conduisant souvent à une mort prématurée. Entre 1990 et 2019, les vagues de chaleur qui ont duré deux jours ou plus ont causé plus de 153 000 décès supplémentaires par an. Près de la moitié des décès sont survenus en Asie, et environ un tiers en Europe [3]. Une seule vague de chaleur européenne, en 2022, a tué 62 000 personnes.
Les vagues de chaleur étant de plus en plus fréquentes, longues et intenses, elles touchent chaque année un plus grand nombre de personnes. The Lancet Countdown on Health and Climate Change, l'évaluation la plus complète sur le sujet, nous l'apprend :
« Les adultes de plus de 65 ans et les nourrissons de moins d'un an, pour qui la chaleur extrême peut être particulièrement dangereuse, sont aujourd'hui exposés à deux fois plus de jours de canicule qu'ils ne l'auraient été en 1986-2005… Plus de 60% des jours qui atteindront des températures élevées dangereuses pour la santé en 2020 sont deux fois plus susceptibles de se produire en raison du changement climatique anthropique et les décès liés à la chaleur chez les personnes âgées de plus de 65 ans ont augmenté de 85% par rapport à la période 1990-2000. » [4]
Le rapport du Lancet prévoit que même si l'augmentation de la température mondiale est maintenue juste en dessous de 2ºC, il y aura toujours une augmentation de 1120% de l'exposition aux vagues de chaleur pour les personnes âgées de plus de 65 ans d'ici 2041-2060, et une augmentation de 2510% d'ici 2080-2100. « Dans un scénario où aucune autre mesure d'atténuation n'est prise, les augmentations prévues sont encore plus importantes, passant à 1670% au milieu du siècle (2050) et à 6311% d'ici 2080-2100. » [5]
Dès lors, en l'absence d'efforts d'atténuation majeurs, une augmentation de la température mondiale d'un peu moins de 2°C devrait entraîner une hausse de 370% du nombre annuel de décès liés à la chaleur d'ici 2050 [6].
Gamme de vecteurs
Environ 17% de toutes les maladies infectieuses, et plus de 30% des nouvelles maladies infectieuses émergentes, sont propagées par des vecteurs – insectes, tiques et autres organismes qui transportent des parasites, des bactéries ou des virus de l'homme ou de l'animal infecté à l'homme non infecté. L'exemple le plus connu et le plus mortel est le paludisme : transmis par les moustiques, il tue chaque année plus de 400 000 personnes, principalement des enfants de moins de cinq ans. Parmi les autres maladies transmises par les moustiques figurent la dengue, le virus du Nil occidental, le chikungunya, la fièvre jaune, l'encéphalite, le Zika et la fièvre de la vallée du Rift.
Avec l'augmentation des températures mondiales, les zones géographiques dans lesquelles les moustiques et les tiques porteurs de maladies peuvent survivre et se reproduire s'étendent, exposant un nombre toujours plus grand de personnes à l'infection. Le virus du Nil occidental, autrefois limité à certaines régions d'Afrique centrale, est désormais présent en Amérique du Nord et en Europe. Les cas de dengue ont doublé chaque décennie depuis 1990 – The Lancet estime que « près de la moitié de la population mondiale est désormais exposée au risque de cette maladie potentiellement mortelle » [7].
D'ici le milieu du siècle, une augmentation de la température mondiale de seulement 2°C entraînera une expansion de 23% des zones du monde dans lesquelles les moustiques du paludisme peuvent prospérer[8], et au moins 500 millions de personnes auparavant hors zone seront exposées aux moustiques porteurs de la dengue, du chikunguyna, du Zika et d'autres agents pathogènes [9].
Perturbation du virome
Comme nous l'avons vu, la majorité des nouvelles maladies émergentes sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles proviennent d'animaux sauvages et se transmettent à l'homme, souvent par l'intermédiaire d'espèces intermédiaires.
On sait qu'environ 263 virus infectent l'homme [10] et, bien qu'ils aient causé des dommages considérables, ils ne représentent qu'une petite fraction de la menace virale. « Au moins 10 000 espèces de virus ont la capacité d'infecter l'homme, mais à l'heure actuelle, la grande majorité circule silencieusement chez les mammifères sauvages. » [11] Pendant des millénaires, chaque groupe de virus n'a circulé que parmi quelques espèces de mammifères, simplement parce que les aires de répartition de la plupart des espèces ne se chevauchaient guère.
Aujourd'hui, cependant, le changement climatique oblige les animaux à se déplacer ou à quitter leurs territoires traditionnels, emportant leurs virus avec eux.
« Même dans le meilleur des cas, les aires de répartition géographique de nombreuses espèces devraient se déplacer d'une centaine de kilomètres ou plus au cours du siècle prochain. Dans ce processus, de nombreux animaux apporteront leurs parasites et leurs agents pathogènes dans de nouveaux environnements. Cela représente une menace tangible pour la santé mondiale. » [12]
Dans une importante étude publiée dans Nature en 2021, Colin Carlson, Greg Alpery et leurs collègues ont cartographié les déplacements probables de l'aire de répartition géographique de 3129 espèces de mammifères jusqu'en 2070.
Ils ont constaté que même en cas de réchauffement modéré, des centaines de milliers d'animaux n'ayant jamais interagi auparavant se rencontreront, ce qui entraînera au moins « 15 000 événements de transmission inter-espèces d'au moins un nouveau virus (mais potentiellement beaucoup plus) entre deux espèces hôtes non infectées » [13]. Le recul à long terme des forêts et des zones sauvages signifie que les nouvelles zones de propagation et d'évolution virale chez les mammifères se trouveront probablement à proximité des centres de population et des exploitations agricoles. Cela augmentera la probabilité que de nouvelles zoonoses infectent l'homme.
« Les effets du changement climatique sur les modèles de partage viral chez les mammifères sont susceptibles de se répercuter en cascade sur l'émergence future de virus zoonotiques. Parmi les milliers d'événements de partage viral attendus, certaines des zoonoses ou zoonoses potentielles les plus dangereuses sont susceptibles de trouver de nouveaux hôtes. Cela pourrait éventuellement constituer une menace pour la santé humaine : les mêmes règles générales de transmission entre espèces expliquent les schémas de débordement des zoonoses émergentes, et les espèces virales qui réussissent à passer d'une espèce sauvage à l'autre ont la plus forte propension à l'émergence de zoonoses…
Le changement climatique pourrait facilement devenir la force anthropique dominante dans la transmission virale inter-espèces, ce qui aura sans aucun doute un effet en aval sur la santé humaine et le risque de pandémie. » [14]
Fait particulièrement préoccupant, l'étude a révélé que même si des migrations importantes se poursuivront au cours du siècle à venir, « la majorité des premières rencontres auront lieu entre 2011 et 2040 » [15].
En bref, le changement climatique impose déjà une redistribution mondiale de la faune et de la flore sauvages et, ce faisant, rapproche des milliers de virus potentiellement pathogènes de l'homme. Dans les années à venir, le virome mondial massivement perturbé sera plus dangereux que jamais.
Comme l'a déclaré Greg Alpery au Guardian, « ce travail apporte des preuves incontestables que les décennies à venir ne seront pas seulement plus chaudes, mais aussi plus pathogènes » [16]. (A suivre – Article publié sur le blog de Ian Angus Climate&Capitalism le 27 juillet 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre. Voir les six premières contributions publiées sur ce site les 12, 16, 27 mars, le 24 avril, le 15 mai et les 1er juillet et 14 juillet)
Notes
[1] Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability : Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (Cambridge University Press, 2023), 1045.
[2] Colin J. Carlson, “After Millions of Preventable Deaths, Climate Change Must Be Treated like a Health Emergency,” Nature Medicine 30, no. 3 (March 2024) : 622–623, .
[3] Qi Zhao et al., “Global, Regional, and National Burden of Mortality Associated with Non-Optimal Ambient Temperatures from 2000 to 2019 : A Three-Stage Modelling Study,” The Lancet Planetary Health 5, no. 7 (July 2021) : e415–25.
[4] “The 2023 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change : The Imperative for a Health-Centred Response in a World Facing Irreversible Harms,” The Lancet 402, no. 10419 (December 2023) : 1.
[5] Ibid., 13.
[6] Ibid., 2.
[7] Ibid., 17.
[8] Ibid., 17.
[9] Sadie J. Ryan et al., “Global Expansion and Redistribution of Aedes-Borne Virus Transmission Risk with Climate Change,” PLOS Neglected Tropical Diseases 13, no. 3 (March 28, 2019) : e0007213.
[10] Dennis Carroll et al., “The Global Virome Project,” Science 359, no. 6378 (February 23, 2018) : 872–74.
[11] Colin J. Carlson et al., “Climate Change Increases Cross-Species Viral Transmission Risk,” Nature 607, no. 7919 (July 21, 2022) : 555–62.
[12] Ibid., 555.
[13] Ibid., 558.
[14] Ibid., 559, 561.
[15] Ibid., 560.
[16] Oliver Milman, “‘Potentially Devastating' : Climate Crisis May Fuel Future Pandemics,” The Guardian, April 28, 2022.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une syndicaliste condamné à mort en Iran

Condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi (militante ouvrière) : Une nouvelle étape dangereuse dans la répression des militants civils et politiques en Iran
**Iran** - Sharifeh Mohammadi, militante ouvrière et sociale, a été condamnée à mort le 5 juillet 2024 par le tribunal révolutionnaire islamique de la ville de Rasht (capitale de la province de Gilan, dans le nord de l'Iran) pour l'accusation de "baghy" (rébellion armée contre le régime). Elle avait été arrêtée en décembre 2023 en raison de son appartenance au "Comité de coordination pour l'aide à la création de syndicats ouvriers".
Mme Mohammadi avait initialement été arrêtée le 5 décembre 2023 à son domicile à Rasht pour "activité de propagande contre le régime". Immédiatement après son arrestation, elle a été transférée dans un centre de détention sécuritaire à Sanandaj, où l'accusation de "baghy" a été ajoutée à son dossier. Selon des rapports, elle a été soumise à des tortures et des pressions sévères pendant sa détention pour la contraindre à avouer, et elle a été privée de ses droits fondamentaux tels que le contact avec sa famille et la nomination d'un avocat.
Finalement, la première chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht, présidée par Ahmad Darvish-Goftar, l'a reconnue coupable de "baghy" et l'a condamnée à mort. Le tribunal a affirmé que le "Comité de coordination pour l'aide à la création de syndicats ouvriers" était lié à l'organisation armée "Komala" (qui lutte contre le régime de la République islamique),
mais le comité a rejeté cette accusation, la qualifiant de prétexte pour réprimer les militants sociaux et ouvriers.
Cette condamnation est choquante et inacceptable, même selon les normes de la République islamique d'Iran, car c'est la première fois qu'une personne est condamnée à mort pour ses activités en faveur des droits des travailleurs et son appartenance à un syndicat ouvrier. Après la condamnation à mort d'un chanteur (Toomaj Salehi), le régime se prépare maintenant à exécuter une militante ouvrière. Sans une réaction appropriée
de la communauté internationale, ces condamnations pourraient marquer une nouvelle étape très dangereuse dans la répression des contestataires et des militants en Iran.
Bien que la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi ait déjà suscité de larges réactions de la part des organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales, ainsi que des militants politiques et civils, des actions plus sérieuses et efficaces sont nécessaires pour obtenir sa libération complète. La République islamique doit savoir que le monde ne restera pas silencieux face à ses actions inhumaines. Sinon, le
régime iranien n'imposera aucune limite à la répression de son peuple, mettant en danger la vie de milliers de prisonniers incarcérés dans les prisons iraniennes.
### Réactions à la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi
– **Amnesty International** a exhorté les autorités iraniennes à annuler immédiatement sa condamnation et sa peine de mort, et à ne pas utiliser la peine de mort comme outil de répression politique.
– **Utilisateurs des réseaux sociaux**, militants et organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales ont lancé une tempête de tweets et un appel à la "Campagne de défense de Sharifeh Mohammadi" le mardi 9 juillet pour protester contre cette condamnation.
– **Front Line Defenders**, une organisation de défense des droits humains, a lancé un appel urgent pour la libération immédiate de cette militante sociale en Iran.
– **Le syndicat des travailleurs du bâtiment en Australie** a adressé une lettre à l'ambassade d'Iran dans ce pays pour protester contre la condamnation à mort de cette militante ouvrière et demander sa libération.
– **Gohar Eshghi** (mère de Sattar Beheshti, un ouvrier tué en détention par la République islamique), a déclaré que Sharifeh Mohammadi est innocente et a écrit sur Instagram : "Qu'a-t-elle fait d'autre que réclamer les droits bafoués des ouvriers épuisés comme Sattar et mon fils Mohammad ?"
– **16 femmes détenues**, dont Narges Mohammadi (lauréate du prix Nobel de la paix), ont écrit dans une déclaration : "Ce n'est pas seulement la condamnation à mort de Sharifeh, mais celle de nous toutes, militantes ouvrières, politiques, civiles, des droits de l'homme et des droits des femmes."
– **85 prisonniers politiques à la prison d'Evin** ont entamé une grève de la faim le jeudi 11 juillet 2024 pour protester contre cette condamnation.
En conclusion, il est essentiel de souligner que la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi illustre l'intensification de la répression des militants ouvriers et sociaux en Iran. La réaction nationale et internationale à cette condamnation montre l'inquiétude profonde de la communauté mondiale face à la situation des droits de l'homme en Iran. Il
est attendu que les pressions internationales sur les autorités iraniennes augmentent pour empêcher l'exécution de cette peine et libérer les autres militants sociaux et ouvriers en danger en Iran.
Pour plus amples informations ou une entrevue sur le sujet n'hésitez pas à
nous contacter.
Centre socio-culturel des Iraniens de Québec "Simorgh"
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
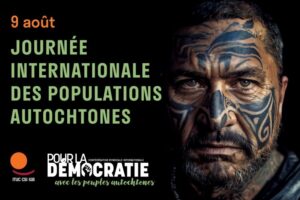
Journée internationale des peuples autochtones : les syndicats réclament le droit à l’autodétermination
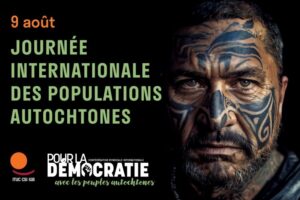
À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août, la CSI réclame le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le monde entier.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le secrétaire général de la CSI, Luc Triangle, a déclaré : « Cette journée rappelle l'importance de la riche diversité culturelle, de la contribution historique et des luttes permanentes auxquelles sont confrontées les communautés autochtones. Les peuples autochtones sont victimes d'une discrimination systémique, d'une marginalisation et de la violation de leurs droits. Diverses questions, telles que l'exploitation des ressources naturelles sur les terres autochtones sans consentement et l'invasion de leurs territoires, nécessitent une attention immédiate ».
D'après les conclusion d'un rapport de l'Organisation internationale du Travail (OIT) :
* plus de 86% de la population autochtone mondiale travaille dans l'économie informelle, contre 66 % de la population non autochtone ;
* les populations autochtones présentent près de trois fois plus de risques de vivre dans l'extrême pauvreté que les non-autochtones ;
* la proportion de travailleurs salariés est beaucoup plus faible chez les autochtones (27,9%) que chez les non-autochtones (49,1%) ;
* au niveau mondial, les autochtones gagnent 18,5% pour cent de moins que les non-autochtones.
Luc Triangle a poursuivi : « Le droit à l'autodétermination est au coeur des luttes des peuples autochtones ; c'est sur lui que repose leur capacité à déterminer librement leur statut politique et à assurer leur développement économique, social et culturel. Ce principe est non seulement un droit, mais également une nécessité pour préserver l'identité, la culture et le mode de vie des peuples autochtones.
« Nous sommes solidaires des peuples autochtones dans leur quête de justice, d'égalité et d'autodétermination. Nous appelons les gouvernements, les entreprises et les organismes internationaux à ratifier et à mettre en oeuvre la convention n°169 de l'OIT afin de protéger les droits des peuples autochtones dans le monde entier. »
La convention n°169 porte sur les droits des peuples autochtones et tribaux. Elle offre un cadre complet pour protéger leurs droits sociaux, économiques et culturels, et souligne l'importance de leur participation aux décisions ayant une incidence sur leur vie et leurs terres. Ceci est essentiel à la durabilité des politiques et des programmes visant à relever des défis, tels que la pauvreté, l'inégalité, les conflits sociaux et le changement climatique.
Outre la ratification et la mise en oeuvre de la convention n°169, la CSI réclame :
* le respect des droits fonciers : avant d'entreprendre des projets sur les territoires des autochtones, les gouvernements et les entreprises ont l'obligation d'obtenir leur consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause ;
* la protection et la célébration du patrimoine culturel : les traditions et les langues des peuples autochtones doivent être préservées pour les générations futures ;
* un développement inclusif : les politiques doivent respecter les droits et les besoins des communautés autochtones et inclure ces dernières dans la prise de décisions.
Les syndicats renforcent la représentation des peuples autochtones dans leur organisation et établissent des alliances avec les organisations de peuples autochtones afin d'aborder des questions d'intérêt mutuel, notamment le respect de la convention n°169 de l'OIT :
§ Nouvelle-Zélande : les syndicats promeuvent une législationvisant à rendre obligatoire le signalement des écarts de rémunération selon le genre et l'appartenance ethnique. Cette transparence est essentielle pour réduire l'écart de rémunération considérable entre hommes et femmes auquel sont confrontées les femmes autochtones. Alors que, dans l'ensemble, l'écart de rémunération entre hommes et femmes en Nouvelle-Zélande est de 8,6%, les femmes du Pacifique en Nouvelle-Zélande gagnent environ 26,5% de moins que les hommes non autochtones.
§ Australie : les syndicats s'efforcent degarantir une forte représentation des travailleurs aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en leur donnant les moyens d'obtenir des salaires justes, une protection sociale et un emploi autodéterminé et épanouissant.
§ Norvège : la Confédération des syndicats de Norvège (LO, Norvège) promeut la culture et l'identité des peuples autochtones moyennant lesfonctions de direction, la diffusion culturelle et le soutien au processus de vérité et de réconciliation.
§ Amérique latine : pour demander des comptes aux gouvernements, les syndicats utilisent les mécanismes de contrôle de l'OIT, en mettant notamment l'accent sur des questions telles que la sécurité au travail et le travail forcé.
*Les observations de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) mettent en évidence les lacunes des procédures judiciaires concernant l'assassinat de dirigeants syndicaux autochtones, le harcèlement permanent auquel sont confrontées les familles des victimes et le trafic illicite de bois, favorisé par la pratique de l'« habilitación », qui consiste à soumettre des membres des communautés autochtones au travail forcé (15 septembre 2023).
*Les observations de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) et de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) font référence aux conditions préoccupantes de sécurité au travail pour les travailleurs issus des communautés autochtones et signalent des actes de violence et un recours excessif à la force de la part de la police durant des manifestations. La CTA fait également état de l'absence de consultation durant le processus de réforme de la Constitution de la province de Jujuy en 2023. Les déclarationsdes délégués des travailleurs à la Commission de l'application des normes de la 109e Conférence internationale du Travail (2021) sur l'application de la convention n° 169 par le gouvernement du Honduras font état d'actes de violence commis à l'encontre des peuples autochtones.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La loi sur le hijab en Iran et le contrôle électoral

Au milieu du simulacre ou de l'orchestration de l'élection présidentielle en Iran, une sombre réalité s'impose. Des femmes sont violemment arrêtées par la police des moeurs pour avoir refusé de se conformer aux règles du hijab obligatoire ou pour avoir porté un hijab « inapproprié », surnommé « mauvais hijab ».
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/29/la-loi-sur-le-hijab-en-iran-et-le-controle-electoral/
Cette réaction misogyne fait suite au soulèvement historique de 2022 « Woman Life Freedom », mené par des femmes iraniennes. Malgré des sanctions sévères, des femmes courageuses ont persisté dans leur résistance, marquant un tournant dans la lutte contre le hijab obligatoire.
Alors que l'élection présidentielle se poursuit, après le décès d'Ebrahim Raisi, l'examen des opinions des candidats révèle qu'aucun d'entre eux n'est susceptible d'apporter un changement significatif aux droits des femmes et à la liberté de choix vestimentaire. Un seul candidat s'abstient de soutenir ouvertement la répression actuelle. La guerre de l'État contre les femmes ne se limite pas à la répression autour du port obligatoire du hijab. Elle englobe les condamnations judiciaires injustes et les violations des droits des femmes dans les prisons.
L'emprisonnement de Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, et la lourde peine de 21 ans infligée à Zhina Modares Gorgi, militante kurde des droits des femmes, témoignent de la position inflexible du régime. L'application du hijab obligatoire a atteint un point de non-retour et le gouvernement iranien a déjà perdu la bataille dans la guerre contre les femmes et les filles.
La répression actuelle en Iran, qui fait suite à l'inspirant mouvement Woman Life Freedom, a déclenché une vague de violence et de répression aussi dure qu'on puisse l'imaginer. En réalité, les dirigeants iraniens ont non seulement ignoré les demandes des femmes et des jeunes, mais ils ont aussi réagi avec une brutalité encore plus grande, conformément aux schémas historiques : Lorsque les gouvernements sont confrontés à l'instabilité ou à la faiblesse, ils ont souvent recours à des mesures plus répressives pour garder le contrôle. Les dirigeants iraniens ne font pas exception. La combinaison de la corruption, de la polycrise et du mécontentement populaire a conduit à une répression plus sévère visant à préserver leur emprise sur le pouvoir.
Il y a plus de deux mois, au petit matin du dimanche 14 avril, la République islamique d'Iran a lancé une attaque sans précédent contre Israël, déployant plus de 300 missiles de croisière, missiles balistiques et drones. Il s'agissait du premier engagement militaire direct entre le gouvernement iranien et Israël. Parallèlement à cette escalade militaire, la République islamique a annoncé la mise en œuvre du plan ou de la campagne « Light » ou « Noor », qui vise à intensifier les mesures contre les opposants au hijab obligatoire. Le gouvernement iranien a justifié ce plan comme une réponse aux plaintes des citoyens concernant le nombre croissant de femmes ne portant pas le hijab obligatoire dans les espaces publics. Toutefois, les activistes civil·es et politiques iranien·nes suggèrent que le véritable objectif du plan Noor est d'anticiper les protestations et l'opposition potentielles dans le contexte de la vulnérabilité actuelle du gouvernement. Ce plan vise à faire appliquer les lois de la charia islamique et le hijab obligatoire en Iran, qui obligent les femmes à se couvrir les cheveux et à porter des vêtements modestes, le non-respect de ces règles étant passible d'une réprimande publique, d'une amende ou d'une arrestation. Cette évolution met en évidence l'interaction complexe entre les tensions géopolitiques et les politiques intérieures de l'Iran, ce qui justifie un examen et une analyse plus approfondis de la part des universitaires, des journalistes et des militant·es.
La récente vague de répression à l'encontre des femmes ne respectant pas le hijab obligatoire a ravivé 45 ans d'histoire de répression, de harcèlement et de déni des droits des femmes en raison de leur présence dans les espaces publics, en particulier dans les rues. La campagne Noor, mise en œuvre pour imposer le hijab obligatoire et ignorer la part des femmes dans l'espace public et la sécurité des rues, répète les tentatives précédentes infructueuses depuis l'établissement de la République islamique d'Iran. Le souhait de la majorité de la société iranienne est la liberté de choisir ses vêtements, et le hijab par choix !
Depuis 45 ans, l'histoire de l'imposition du hijab obligatoire et de la résistance contre celui-ci se poursuit. Les sons inquiétants du slogan « soit un foulard, soit un coup sur la tête » sont encore présents dans la mémoire de celles qui ont manifesté lors de la première manifestation contre la République islamique, le 8 mars 1979. Si, avant la révolution de 1979, les femmes étaient victimes de harcèlement et de harcèlement sexuel dans les lieux publics, elles n'étaient pas systématiquement arrêtées, battues et détenues.
Depuis 45 ans, le hijab obligatoire est imposé par le biais de divers plans, notamment le « plan hijab et chasteté » et le « plan de sécurité morale », qui utilisent des outils tels que les camionnettes vertes et les patrouilles Irshad (illumination) pour contrôler les espaces publics et créer un environnement sexué, tendu et peu sûr pour les femmes. Ces plans ont gaspillé des fonds considérables pour créer une atmosphère préjudiciable à la sûreté et à la sécurité, au lieu d'autonomiser et d'améliorer la vie des gens.
Le bien-être mental et physique de la moitié de la société – les femmes et les filles – ne devrait pas être lié au hijab obligatoire. L'histoire nous rappelle que partout où il y a oppression, la lutte est inévitable. Comme l'a poétiquement demandé Langston Hughes, « Qu'advient-il des rêves différés ? Sèchent-ils comme un raisin sec au soleil ? Ou explosent-ils ? »
Le mouvement des femmes iraniennes incarne cette lutte. Elles ont continuellement contesté l'imposition du hijab obligatoire et l'effacement de leur présence dans les espaces publics depuis la création de la République islamique.
La première vague de protestations a éclaté le 8 mars 1979, lorsque les femmes sont descendues dans les rues de plusieurs villes, défiant les tentatives du régime autoritaire de les réduire au silence. Le soulèvement révolutionnaire de 2022, baptisé « Femme, vie, liberté », a été l'aboutissement de décennies de colère et d'aspirations réprimées, les femmes et les jeunes filles réclamant la place qui leur revient dans les espaces publics et dans les rues.
Les jeunes femmes, en particulier, ont joué un rôle central dans cette lutte, en occupant courageusement les espaces publics et en affirmant leur pouvoir face à la répression systémique. Le plan Noor est la dernière itération de cette oppression, visant à imposer le hijab obligatoire et à restreindre l'autonomie des femmes sur leur corps et le choix de leurs vêtements. Toutefois, ce plan a été largement condamné au niveau national et international, des universitaires comme Tahira Taleghani (fille du défunt ayatollah Taleghani) soulignant que le hijab obligatoire porte atteinte à la liberté et à la dignité des femmes. Même certains membres du parlement se sont opposés au projet, reconnaissant son illégalité et sa futilité.
Malgré les efforts du régime pour réprimer la dissidence au moyen de policiers en civil, de caméras de reconnaissance faciale et de charges de sécurité, la volonté de la majorité des Iranien·nes reste inébranlable. Le plan Noor n'a fait qu'exacerber les tensions sociales et les crises, creusant le fossé entre le peuple et le gouvernement.
En réalité, la rue appartient aux citoyen·nes. Les femmes et les jeunes filles, qui constituent la moitié de la société iranienne, exigent leur part d'espace public et de sécurité. Elles recherchent un environnement sûr où leurs droits humains, y compris le port volontaire du hijab, l'égalité des sexes et la justice sociale, sont respectés et protégés par la volonté politique du gouvernement. Aujourd'hui, la rue est devenue une plateforme pour l'action des femmes, qui affirment leur présence de manière créative et innovante, multipliant le courage et plantant des graines d'espoir dans les cœurs.
Comme nous le rappelle Arundhati Roy, « un autre monde n'est pas seulement possible, il est en route. Par temps calme, je peux l'entendre respirer ».
Elahe Amani
Elahe Amani est présidente du réseau interculturel des femmes, membre du conseil d'administration de l'Association nationale pour la médiation communautaire, émérite de l'université d'État de Californie et rédactrice en chef de la section féminine du journal mensuel Peace Mark, une publication des militant·es des droits humains en Iran (HRA).
https://newpol.org/irans-hijab-law-and-electoral-scrutiny/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hausse de la demande d’actes sexuels tarifés dans le cadre des JOP : confirmée par les données sur Internet

Il est donc possible d'affirmer que la tenue de grands évènements sportifs favorise l'augmentation de la demande des « clients », par l'afflux de supporters et la diversité des législations de leurs pays d'origine, alors même que l'achat d'acte sexuel est interdit en France depuis la loi de 2016, comme le rappelle la campagne « c'est combien ? » lancée par l'Etat à l'occasion des JOP.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/02/hausse-de-la-demande-dactes-sexuels-tarifes-dans-le-cadre-des-jop-confirmee-par-les-donnees-sur-internet/
Sans fournir d'étude définitive, mais en prenant en compte les données observées par l'Amicale du Nid sur l'un des principaux sites d'annonces en ligne d'actes sexuels tarifés au cours des cinq derniers mois, nous affirmons qu'une hausse de la demande dans le cadre des JOP a bien lieu (pour rappel, selon l'Office Central pour la Répression de la Traite des Êtres Humains à des fins d'exploitation sexuelle – OCRTEH – la part de l'« offre » sur Internet est passée de 35% en 2011 à 90% en 2022 dans la mise en contact avec les acheteurs).
Au regard des diverses données collectées au niveau national et départemental, une augmentation générale et conséquente de l'« offre prostitutionnelle » en ligne a été constatée entre le 14/02/2024 et le 10/07/2024 par l'Amicale du Nid :
* 42 970 offres en février contre 50 526 en juillet pour l'ensemble du territoire français, soit une hausse de 17,6%.
* Les deux départements accueillant le plus d'épreuves olympiques ainsi que le village olympique, voient apparaître une hausse de 34,2% à Paris et de 27% en Seine-Saint-Denis.
* En Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, lieu d'accueil du village olympique connait la plus forte augmentation (+ 58,5%), suivie par La Courneuve (+51,2%) et Aubervilliers (+36,6%).
https://www.pressegauche.org/ecrire/?exec=article_edit&new=oui&id_rubrique=160#
En outre, un « rajeunissement » des « offres » est observé (entre 55 et 62% de 18-25 ans sur ces trois villes de Seine-Saint-Denis) pour répondre à la demande des acheteurs, pédocriminels pour certains, qui cherchent précisément des personnes mineures, qui ne peuvent être déclarées comme telles dans le cadre des annonces en ligne.
Il est donc possible d'affirmer que la tenue de grands évènements sportifs favorise l'augmentation de la demande des « clients », par l'afflux de supporters et la diversité des législations de leurs pays d'origine, alors même que l'achat d'acte sexuel est interdit en France depuis la loi de 2016, comme le rappelle la campagne « c'est combien ? » lancée par l'Etat à l'occasion des JOP.
Cet interdit a été confirmé hier, 25 juillet, comme ne violant pas l'article 8 de la Convention Européenne des Droits Humains relatif au respect de la vie privée et familiale, par arrêt de la Cour Européenne des Droits Humains (CEDH) pris à l'unanimité et sans ambiguïté.
Les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains s'organisent notamment « par plan », suivant des modes opératoires dématérialisés, sauf l'acte tarifé :
* Un contexte spécifique : un festival, un évènement sportif pendant une durée limitée,
* Une exploitation des victimes en appartement ou hôtel (de préférence sans personnel d'accueil), avec hébergement de courte durée pour échapper aux forces de l'ordre,
* Une organisation ficelée et contrôlée par le réseau : transport, logement, nourriture, boissons, alcool et stupéfiants.
L'Amicale du Nid rappelle son engagement dans la lutte contre le système prostitutionnel qui se situe à l'intersection des oppressions de genre, économique et raciste, et dans l'accompagnement des victimes depuis 1946.
A l'occasion de cet évènement sportif international, l'Association a engagé une chargée de mission Prévention et Sensibilisation au sein de son équipe de Seine-Saint-Denis.
Plusieurs enjeux entourent cette mission : L'observation des annonces en lignes, la sensibilisation des acteurs (justice, police, communes, gardiens d'immeuble… déjà 420 professionnel.les sensibilisé.es entre mars et juillet 2024) et des campagnes de prévention auprès des victimes ou en risque de l'être.
L'Amicale du Nid publiera l'ensemble de ses évaluations chiffrées et analysées dans le cadre des JOP fin novembre 2024.
Pour en savoir plus :
*L'arrêt de la CEDH du 25 juillet 2024 : La CEDH conforte la loi française. Un signal fort pour l'Europe, une victoire pour toutes les victimes du système prostitutionnel, dans leur grande majorité des femmes ! Amicale du Ni
* La campagne nationale rappelant la pénalisation des acheteurs d'actes sexuels
https://amicaledunid.org/actualites/lamicale-du-nid-soutient-la-campagne-nationale-pour-linterdiction-de-lachat-dactes-sexuels-en-france-dans-le-cadre-des-jop/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
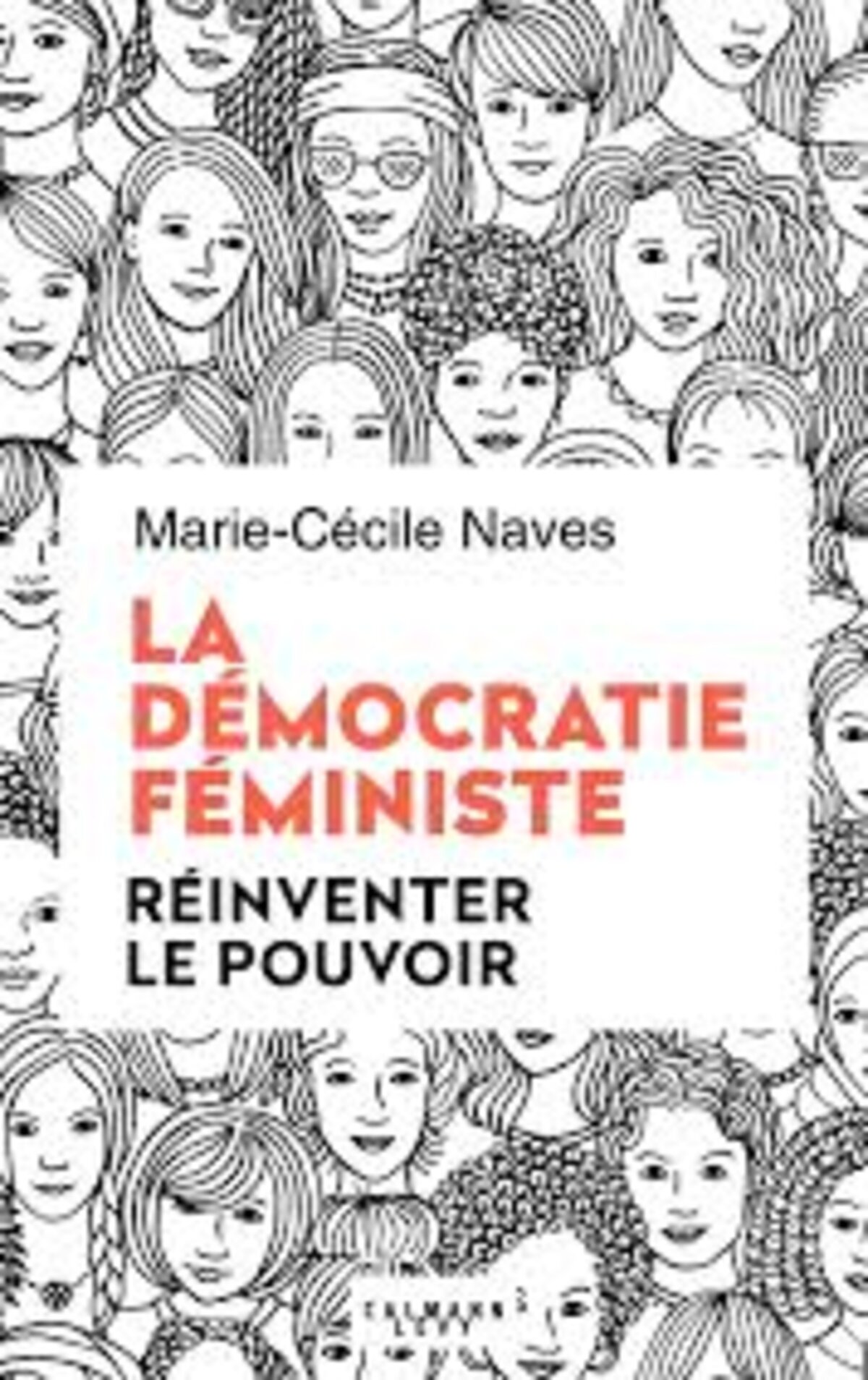
France : Cette élection est l’échec du virilisme. L’heure est à la démocratie féministe
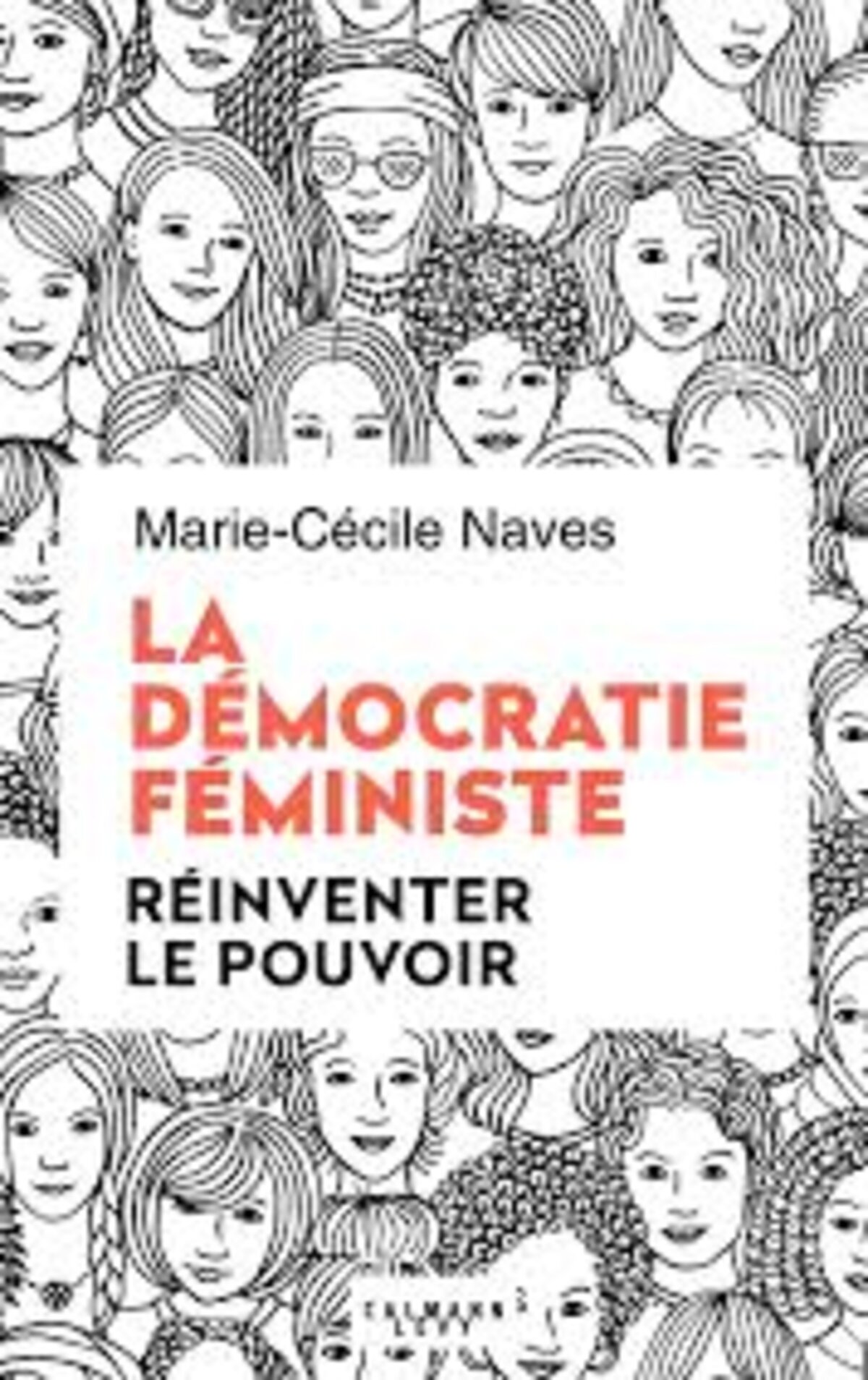
La campagne législative a montré la ringardisation du virilisme. Pour se renouveler, la politique gagnera à s'appuyer sur un récit, un programme et une méthode féministes
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il y a trois ans, je publiais dans Le Monde une tribune intitulée « Le féminisme permet de renforcer les deux piliers, libéral et démocratique, de nos sociétés ». Ce lendemain d'élections législatives anticipées confirme ce constat. Il le renforce, même. J'écrivais que « le pouvoir, dans les sphères politique, économique et médiatique, en demeurant profondément excluant, se prive de compétences, de regards sur le monde et prend l'énorme risque de l'inefficacité et de la défiance ». Il me semble que la preuve est faite.
Ainsi que l'a abondamment documenté la presse, la dissolution de l'Assemblée nationale a été préparée par un boys' club archétypal d'un entre-soi sûr de lui et convaincu, à tort, que la France est majoritairement craintive, aigrie et nostalgique. En outre, pendant la campagne express, de nombreux plateaux de télévision ont, une fois de plus, donné la part belle aux hommes, qu'il s'agisse de politiciens dépassés et n'exerçant souvent aucun mandat, ou d'éditorialistes entretenant la confusion avec le journalisme, incapables de lâcher les rênes de la notoriété, s'accrochant à une illusion d'influence et refusant de partager le verbe et l'espace. Certains excluant même de débattre avec des femmes.
Nous avons vu les invectives, la violence verbale, la haine du débat démocratique, et même la dénégation des résultats des urnes. Autant de poisons dont l'extrême droite est la championne mais non la seule dépositaire. Nous avons vu l'arrogance, la mauvaise foi, les amalgames. Nous avons vu la désinformation répétée de médias déjà, ou désormais, acquis à l'extrême droite et qui n'ont de médias que le nom puisqu'ils mentent en toute conscience à des fins électoralistes.
Pour un récit émancipateur
Mais ce que nous avons vu aussi, c'est l'expression et l'expertise d'hommes et surtout de femmes politiques, de responsables d'associations et de syndicats, de chercheuses et de chercheurs prônant le dialogue, revendiquant une parole et une visibilité, appelant à réhabiliter les corps intermédiaires si malmenés, une société civile dotée d'une immense force mobilisatrice et d'une grande capacité de propositions pour l'avenir de notre pays. C'est cette vitalité-là, aussi, qu'il faut retenir de cette campagne. Il est temps que le champ politique se rende compte qu'il ne détient pas le monopole de l'expertise.
La séquence qui s'achève dit donc trois choses.
Premièrement, nous sommes, sur le fond, à l'aube d'un nouveau moment émancipateur pour bâtir un agenda programmatique tout autant soucieux des injustices territoriales, sociales, d'origine et de genre (les quatre s'entrecroisant de manière complexe) que des richesses (économiques, intellectuelles, scientifiques, associatives, culturelles ou encore citoyennes) inexploitées de notre société.
Deuxièmement, la démocratie est vivante : elle se réinvente sans cesse, elle se bat pour sa survie jusqu'à déjouer les pronostics. La démocratie ne cesse de nous surprendre. Elle est un processus toujours à construire et à reconstruire. L'immense mouvement collectif engagé pour faire battre le RN est une leçon de démocratie citoyenne qu'il est impératif de traduire en démocratie participative large. Nous avons pour cela besoin d'espaces de discussion, de parole et donc d'écoute. Il y a, dans ce pays, une immense soif de comprendre et d'échanger : multiplions ces lieux de médiation. Nous, chercheuses et chercheurs, le constatons dans les conférences auxquelles nous participons dans tout le pays : l'affluence est immense, les gens lisent, discutent, se parlent. Il faut dès lors réhabiliter les conditions, les lieux, les cadres et le temps d'un débat démocratique très largement confisqué par la polémique perpétuelle, le clash, le buzz, le bruit.
Troisièmement, on ne peut plus gouverner à coups de menton et de « grenades dégoupillées ». C'est une évidence. La masculinité hégémonique est ringardisée, elle doit en prendre acte.
Le féminisme : un projet global et une méthode
Le moment est historique, nous devons le saisir. En vérité, nous n'avons pas le choix. Il nous faut bâtir un récit rassembleur, fondateur, programmatique. À propos d'insécurité : va-t-on agir efficacement, aussi, contre les féminicides et les violences faites aux enfants ? Lutter véritablement contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme ? À propos de reconnaissance, va-t-on, enfin, faire en sorte de passer des lois aux pratiques, donner leur place aux femmes dans les postes à responsabilité, agir pour la mixité des métiers ? À propos de redistribution, va-t-on réhabiliter l'École publique, si malmenée, payer correctement les enseignantes et les enseignants, financer l'université et la santé à la hauteur de leurs besoins ? Déployer une offre de services publics adaptée ? À propos de durabilité, va-t-on se décider à mettre en place une transition environnementale équitable ?
La responsabilité est collective dans le moment démocratique qui s'affirme aujourd'hui, afin de (re)créer un « nous », large et inclusif, qui permette l'expression pacifique des désaccords – lesquels sont l'essence même de la démocratie –, tout en conduisant à une société réconciliée avec elle-même. En d'autres termes, un « nous » qui ne s'oppose pas à un « eux », celui des boucs émissaires que l'extrême droite construit dans le but de prospérer et de danser sur le volcan des divisions mortifères.
Pour y parvenir, les outils sont nombreux et mobilisables. Le féminisme en fait partie, comme projet global et comme méthode. Il sait bousculer les conformismes et contester les injustices de naissance et de condition. Il sait également créer et animer des lieux de conversation, faciliter la circulation des savoirs entre les sphères académique, militante et politique, permettre le conflit d'idées argumentées et prendre le risque stimulant de la confrontation d'opinions. Il sait penser la complexité pour agir plus efficacement, passer de la contestation à la proposition. Il y a aujourd'hui de l'impatience. Il y a par-dessus tout un désir de changement, de reconnaissance, de participation, mais aussi de consensus. Si l'on décide de « transformer la colère en plaisir », on peut « expérimenter le plaisir de s'en sortir », ainsi que l'écrit la philosophe Elsa Dorlin.
Nous avons besoin d'une société qui « dé-fige » les individus et les groupes, qui rouvre le champ des possibles, des libertés et du progrès, pour toutes et tous. Une société qui rassemble. L'heure n'est plus à la violence. Le virilisme en politique a vécu. Le féminisme est l'avenir de la démocratie.
Marie-Cécile Naves
Politiste, Directrice de recherches à l'IRIS
https://blogs.mediapart.fr/marie-cecile-naves/blog/090724/cette-election-est-l-echec-du-virilisme-l-heure-est-la-democratie-feministe
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ces Tunisiennes qui font trembler Kais Saied

Elles sont issues de tous bord : militantes associatives, journalistes, femmes politiques. Elles subissent les foudres d'un régime qui tend à brider les voix discordantes. Comme les hommes, elles font les frais de leur activisme.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/07/ces-tunisiennes-qui-font-trembler-kais-saied/
Elles s'appellent Cherifa Riahi, Saadia Mosbah, Sonia Dahmani, Chaima Issa, Chadha Hadj Mbarek, Leila Kallel, Mariem Sassi, Abir Moussi. Ce sont des femmes politiques, des journalistes, des militantes associatives. Et elles croupissent en prison.
Elles font partie de la longue liste des femmes victimes d'intimidations judiciaires ou exilées, à l'instar de Bochra Bel Haj Hmida, Ghofrane Binous, Fatma Ezzahra Ltifi, Feryel Charfeddine, Arroi Baraket, Amel Aloui, Wifek Miri et bien d'autres.
« C'est une situation inédite pour les femmes », lance Nabila Hamza, membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne des femmes démocrates (Atfd) lors d'une conférence de presse de la dynamique féministe, le 24 juillet.
Cette dynamique féministe regroupe plusieurs organisations de la société civile militant pour la cause féminine. Il s'agit de l'Atfd, Aswat Nissa, Beity, l'Association de la femme et de la citoyenneté du Kef, Amal pour la Famille et l'Enfant, Calam, l'association Tawhida Ben Cheikh et Intersection pour les droits et les libertés.
Toutes appellent à la libération immédiate de ces femmes emprisonnées et à l'arrêt des poursuites judiciaires visant toutes les activistes.
A l'occasion de ladite conférence de presse, ces organisations ont annoncé le lancement de la campagne de libération des prisonnières détenues en raison de leur activisme au sein de l'espace public. Elles s'engagent à défendre toutes les victimes du système sans exception.
La campagne aura lieu du 25 juillet au 13 août 2024. Ces associations exhortent toutes les forces politiques, civiles, syndicales, culturelles, académiques, progressistes et démocrates à se mobiliser à leurs côtés dans le cadre de leurs diverses actions. Cette campagne s'achèvera le 13 août, la Journée nationale des femmes tunisiennes, avec une manifestation devant le théâtre municipal de Tunis.
Un climat politique hostile aux femmes
Les poursuites judiciaires ont clairement pour objectif de « réduire au silence les voix des femmes », dénonce Sarah Ben Saied, directrice exécutive d'Aswat Nissa. Car les enquêtes visant ces figures féminines sont « vides », souligne Ghofane Friji, chercheuse à l'association Intersection. Cette organisation recense les violations des droits et des libertés en Tunisie. « Il s'agit d'accusations arbitraires et infondées », dénonce-t-elle.
En effet, le régime de Kais Saied mène une chasse aux voix dissidentes ou à ses supposés détracteurs. Les chefs d'accusation retenues contre les femmes activistes varient entre « diffamation », « atteinte à la sûreté de l'Etat » ou encore « blanchiment d'argent ».
Il s'agit d'une politique « méthodique » visant à clouer le bec de l'opposition qu'elle soit politique, civile ou syndicale, dénonce Sarah Ben Said. « Elle intervient dans un contexte marqué d'ores et déjà par la violence cybernétique envers les femmes actives dans la sphère publique. Celles-ci sont constamment menacées et insultées sur les réseaux sociaux. Le but est de les empêcher de prendre part aux débats publics », renchérit-elle.
La dynamique féministe a illustré l'ampleur de l'injustice dont sont victimes les femmes engagées à travers les témoignages de Ramla Dahmani, la sœur de Sonia Dahmani, l'avocate et chroniqueuse emprisonnée, et de l'ancienne maire de Tabarka, Amel Aloui. Dahmani et Aloui ont été condamnées sur la base du décret-loi 54.
Paradoxalement, des femmes mettent en application la politique liberticide de Saied, à l'image de l'ancienne cheffe du gouvernement Najla Bouden ou encore l'actuelle ministre de la Justice Leila Jaffel. Rien « d'étonnant » qu'elles jouent un tel rôle, affirme la figure féministe Sana Ben Achour, à Nawaat.
Les femmes ne naissent pas féministes. Car le féminisme est une conscience politique dont ces femmes sont dépourvues. Sana Ben Achour
Et de regretter : « Elles reproduisent et consolident le système d'oppression patriarcale qui les réprime. Ce sont ses instruments. Ces femmes sont les ennemies de leurs consœurs ».
En revanche, pour le régime actuel, le féminisme est un mouvement élitiste. Et les femmes activistes n'ont aucune légitimité, tient également à rappeler Nabila Hamza.
Un déclin à différentes échelles
Au-delà des rhétoriques s'opposant à l'égalité entre les hommes et les femmes, Saied a concrétisé son idéologie en sapant les acquis durement arrachés des femmes.
En faisant référence à la religion dans la Constitution de2022, en renonçant à la parité, le chef de l'Etat a acté ses menaces visant les droits des femmes, a déploré Fathia Saïdi, militante féministe. Et cela se manifeste dans la régression de la représentativité politique des femmes.
En 2017, un amendement à la loi électorale a obligé les partis politiques à faire en sorte que la moitié de leurs listes candidates soient dirigées par des femmes lors des élections locales. Ce texte de loi a permis l'établissement de conseils municipaux composés à hauteur de 47% de femmes lors des élections de 2018.
La nouvelle loi électorale a remplacé l'ancien système de représentation proportionnelle par un scrutin uninominal, sans exiger l'égalité de représentation des sexes aux élections.
Résultat : Le parlement actuel est dominé par les hommes. 25 femmes uniquement y siègent contre 129 d'hommes. Quant au Conseil National des Régions et des Districts, il est composé de 67 hommes et de seulement 10 femmes.
« Saied a enterré tous les débats sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions parlementaires ou locales », ajoute Nabila Hamza. D'après elle, le pouvoir en place empêche l'émergence de modèles de femmes politiques pouvant inspirer les futures générations. « Il veut cantonner les femmes dans la sphère privée », lance-t-elle.
L'emprisonnement des femmes activistes, les poursuites et intimidations les ciblant interviennent dans un climat marqué par la précarité féminine.
« Des travailleuses agricoles meurent encore sur la route, le nombre des féminicides est alarmant, l'Etat rechigne à appliquer la loi 58 sur l'élimination des violences envers les femmes », martèle Hamza. Dans ce contexte, les féministes sont plus que jamais amenées à lutter sur tous les fronts.
En muselant la liberté d'expression des femmes, le régime entrave les possibilités de porter et de défendre d'autres causes féminines, à l'instar des droits socio-économiques ou encore des droits sexuels et reproductifs.
Rihab Boukhayatia
Spécialisée en droits et libertés, je suis journaliste à Nawaat depuis 2019, où je traite aussi des sujets de société. Juriste de formation, je poursuis, en parallèle à mon activité professionnelle, des recherches en sciences politiques.
https://nawaat.org/2024/07/29/ces-tunisiennes-qui-font-trembler-kais-saied/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lancement du processus d’organisation du Forum social mondial 2026 au Bénin !

Tiré de Le Journal des Alternatives
https://alter.quebec/lancement-du-processus-dorganisation-du-forum-social-mondial-2026-au-benin/
31 juillet 2024
Communiqué de la Convergence globale des luttes pour la Terre et l'Eau (CGLTE OA)
Sous le regard attentif des chefs traditionnels et coutumiers, des autorités et des acteurs de la société civile, la Convergence globale des luttes pour la Terre et l'Eau d'Afrique de l'Ouest (CGLTE OA) a lancé officiellement ce 31 juillet 2024, le processus d'organisation du Forum social mondial (FSM) prévu pour 2026 à Cotonou.
Les objectifs de cette rencontre étaient de partager des informations sur le FSM, de renforcer la collaboration entre les membres de la société civile, les chefs traditionnels et coutumiers, ainsi que les autorités locales. Cette journée a été marquée par plusieurs discours marquants, notamment celui du porte-parole de la CGLTE, Massa Kone, et du président de l'Alliance des chefs coutumiers et traditionnels de l'Afrique de l'Ouest.
Dans son discours, le porte-parole a mis en exergue le choix du Bénin pour l'organisation du prochain forum, soulignant l'hospitalité exemplaire qui règne dans le pays. Il a également insisté sur l'importance de cette rencontre, déclarant que l'Afrique, riche de ses valeurs culturelles, doit valoriser ses aînés, symbolisés par les chefs traditionnels et coutumiers. L'engagement des aînés et des autres parties prenantes, notamment les Brésiliens, a renforcé la détermination à obtenir l'organisation du forum. Cet engagement ne serait pas possible sans l'accompagnement des autorités et des chefs coutumiers.
Le président de l'Alliance des chefs coutumiers et traditionnels de l'Afrique de l'Ouest a, quant à lui, lancé un appel aux chefs traditionnels et aux autorités pour leur accompagnement et leur soutien dans la mobilisation des populations.
L'ordre du jour incluait une présentation des enjeux du FSM et de sa charte, ainsi que des réflexions sur les retombées positives des éditions précédentes. Ces discussions visaient à identifier les meilleures approches pour garantir le succès de l'édition de 2026.
Les personnes participantes ont également pris part à des travaux de groupe, au cours desquels furent présentés la note conceptuelle, la feuille de route du forum et le plan d'action des chefs coutumiers et traditionnels de l'Afrique de l'Ouest.
Ce processus collaboratif marque le début d'un parcours ambitieux vers un FSM inclusif et porteur de changements positifs pour la région et au-delà, car le Bénin accueille, mais c'est l'Afrique qui organise.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face à l’extrême droite : « Les seules batailles perdues sont celles qu’on renonce à mener »

Spécialiste des inégalités sociales et ethno-raciales, le sociologue Ugo Palheta, co-directeur de la revue marxiste Contretemps, est de ceux qui prennent depuis longtemps au sérieux « la possibilité du fascisme ». Il fait paraître à la rentrée aux éditions Amsterdam un ouvrage collectif, Extrême droite : la résistible ascension, qui décortique les ressorts de la dynamique néofasciste contemporaine. Socialter l'a interrogé pour mieux comprendre la tentation autoritaire et raciste qui traverse le pays et évoquer les moyens de déjouer la catastrophe que représenterait la tentation autoritaire et raciste qui traverse le pays et évoquer les moyens de déjouer la catastrophe que représenterait l'accession du RN au pouvoir.
Hugo Palheta Maître de conférences en sociologie à l'université de Lille, Ugo Palheta travaille sur les inégalités sociales, raciales et de genre. Co-directeur de la revue marxiste Contretemps, auteur de plusieurs livres, dontLa Possibilité du fascisme. France : trajectoire du désastre (La Découverte, 2018), il anime un podcast, Minuit dans le siècle, consacré aux extrêmes droites contemporaines. Il participe aux travaux de l'Institut La Boétie, laboratoire d'idées de La France Insoumise.
août — septembre 2024 | tiré de la revue Socialter | Photos : propos recueillis par Elsa Gautier photos Antoine Seiter
Vous observez depuis des années les dynamiques du « néofascisme » et vous alertez dans plusieurs livres parus depuis 2018 sur « la trajectoire du désastre » dans laquelle semble engagée la société française. Comment analysez-vous le moment d'accélération qu'a déclenché en juin la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron ?
La crise politique que connaît la France depuis 15 ans est entrée dans une phase aiguë, qui constitue une épreuve de vérité. La France se singularise depuis 2017 par une tripartition du champ politique, avec des pôles qui étaient de force à peu près égale, du moins en 2022 : un pôle néolibéral dirigé par Macron, un pôle de gauche – dominé par LFI depuis plusieurs années – et un pôle d'extrême droite, où le RN est de très loin la force dominante.
Cette situation ne pouvait pas durer éternellement, à la fois parce que Macron n'a plus depuis 2022 de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais aussi parce que le pôle néolibéral a connu un recul électoral aux élections européennes.
Macron disposait déjà d'une base sociale étroite, dès son arrivée au pouvoir en 2017, en raison de son projet de régression sociale, mais cette base s'est encore rétrécie depuis, n'étant compensée que par le ralliement de secteurs de l'électorat de droite qui votait antérieurement LR. Au point que les économistes Julia Cagé et Thomas Piketty ont pu affirmer, à partir d'une étude empirique des élections en France depuis la Révolution française, qu'en 2022 le vote Macron était « le plus bourgeois de l'histoire de France ». Si on ajoute à cela la défiance très profonde dans le pays à l'égard des élites politiques, en particulier macronistes, et les importantes luttes sociales qui ont déstabilisé depuis 2017 encore un peu plus le pouvoir – Gilets jaunes, mouvements contre la réforme des retraites, mobilisations dans la santé publique, etc. – il est clair que la Macronie n'était plus du tout en mesure d'entraîner des forces derrière elle et que la situation était devenue en grande partie ingouvernable.
Comment lisez-vous le résultat inattendu sorti des urnes le 7 juillet ? Faut-il y voir davantage qu'un sursis offert face à la menace d'une conquête du pouvoir par le RN ?
Ce n'est pas une large victoire pour la gauche, mais c'est clairement une défaite pour le RN par rapport à ce que ses membres espéraient, même s'ils voient leur nombre de députés progresser. Il y a d'abord eu un sursaut du peuple de gauche. Beaucoup de gens ont fait une première expérience de militantisme pour obtenir la victoire de tel ou tel candidat du Nouveau Front populaire. Sans cela, rien n'aurait été possible. Et puis évidemment on a pu mesurer que, malgré toute l'opération de « dédiabolisation » orchestrée par Marine Le Pen, dont de nombreux médias ont été complices ces dix dernières années, l'extrême droite reste perçue comme une menace pour la démocratie, les conquêtes sociales, les droits des minorités, les mouvements d'émancipation. Donc il y a eu aussi un vote barrage.
Ce sursaut peut être davantage qu'un sursis pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela met en doute le récit lepéniste selon lequel l'extrême droite parviendra inévitablement au pouvoir. Ensuite, cela fait de la coalition de gauche la principale opposition, donc la principale alternative, au moins pour un temps, au macronisme. Enfin, imposer une défaite – même partielle et provisoire – au camp ennemi est toujours un point important dans une bataille de longue haleine, parce que la défaite démoralise, désoriente et désorganise toujours ; plus ou moins il est vrai, selon l'habileté des dirigeants adverses.
« L'unité est un combat » écriviez-vous en juin dans un édito de la revue Contretemps. Le Nouveau Front populaire, né dans l'urgence et sorti en tête des législatives anticipées, apparaît extrêmement fragile. L'éclatement est-il évitable ?
Il faut prendre au sérieux le fait que le Nouveau Front populaire est un front, donc rien d'étonnant à ce qu'il soit sensible aux divergences, voire aux antagonismes politiques entre ses composantes, en particulier entre LFI et le PS. On doit se garder de dépolitiser les clivages en son sein en les ramenant –comme le font les médias dominants– à des querelles d'ego ou à des intérêts de boutique, même si bien sûr cela existe aussi
« Imposer une défaite au camp ennemi est toujours un point important dans une bataille de longue haleine, parce que la défaite démoralise, désoriente et désorganise toujours. » À partir de là, dire que l'unité est un combat doit s'entendre au moins en trois sens. Le plus évident, c'est qu'à ce stade on a besoin de cette unité pour vaincre le macronisme et le lepénisme, donc il faut se battre pour la maintenir. Mais faire l'unité ne veut pas dire qu'il faut cesser de débattre au sein de la coalition et de sa base sociale sur des questions politiques, programmatiques ou stratégiques : la Palestine, les réformes en matières économique et sociale, l'Europe… Enfin, il y a le combat pour faire entrer au sein de cet espace unitaire les préoccupations et les actions des mouvements sociaux : syndicats, collectifs antiracistes et féministes, associations environnementales…
Pour éviter l'éclatement, il ne faut pas simplement parier sur la droiture de tel dirigeant ou telle dirigeante. Le plus crucial, c'est d'élargir et d'approfondir politiquement la mobilisation unitaire, de manière à accroître le coût de la division pour les forces qui composent la coalition et qui, à un moment, pourraient être tentées de jouer une autre carte que le renforcement du NFP.
Quels sont les principaux ressorts à vos yeux de la montée en puissance continue de l'extrême droite, que l'on constate dans les urnes depuis 15 ans ?
Il faut d'abord préciser que la percée de l'extrême droite au niveau national date de l'élection européenne de 19841 . Le FN/ RN dispose donc d'une assise ancienne, qui n'a pas été érodée par des expériences de pouvoir à l'échelon national puisque ce parti a toujours refusé de gouverner en position subalterne dans le cadre d'une coalition de droite. Il peut jouer ainsi une carte « dégagiste » ou « anti-système », même si son programme économique est aujourd'hui en pleine continuité avec les partis qui se sont succédé au pouvoir depuis 40 ans : une politique libérale, en faveur des entreprises et qui n'apporterait rien de bon, au contraire, aux salariés. Au cœur des succès de l'extrême droite, il y a le fait qu'elle est parvenue à politiser les peurs qui traversent notre société – en particulier la peur du déclassement, pour soi ou ses enfants, la peur du chômage, de la précarité, de l'insécurité – sous l'angle de la menace de l'immigration, des étrangers, des musulmans. Elle a réussi à transformer ces peurs en l'espoir qu'on pourrait vivre mieux si on stoppait l'immigration, si on « mettait au pas » les minorités. Cela a pu fonctionner parce que, dans le même temps, les forces politiques dominantes ont elles-mêmes diffusé des discours xénophobes, islamophobes, sécuritaires. Une autre raison importante, c'est que les coalitions de gauche qui sont parvenues au pouvoir sous la domination du PS – dans les années 1980, entre 1997 et 2002, puis entre 2012 et 2017 – ont suscité une très forte déception et désorientation dans les classes populaires et plus largement parmi les salariés, en menant des politiques économiques très similaires à celles de la droite. Si le « ni droite ni gauche » a pu si bien fonctionner, c'est que la gauche, sous Hollande notamment, a gouverné à droite. En outre, tout un matraquage politique et médiatique a imposé l'idée dans une bonne partie de la population que, de toute façon, il n'est pas possible de parvenir à un partage des richesses plus égalitaire entre travailleurs et patrons, entre riches et pauvres, qu'on ne peut plus vraiment changer la société. La montée de ce fatalisme de classe à partir des années 1980 a en quelque sorte été compensée par la progression d'un volontarisme raciste. Tout ça a favorisé l'idée que la seule chose qu'il est possible d'espérer, c'est une politique consistant à prendre aux étrangers pour donner aux Français – ou aux « vrais Français » dans une vision raciste. C'est toute la politique de « préférence nationale » devenue « priorité nationale »
Quels sont les différents groupes sociaux qui composent aujourd'hui l'électorat RN ? Que nous disent les travaux récents des sciences sociales sur les motivations du vote d'extrême droite ?
L'électorat de l'extrême droite est loin d'être composé uniquement d'ouvriers ou de membres des classes populaires comme on le dit parfois, et apparaît davantage comme un conglomérat. Lors de la dernière présidentielle, Zemmour a fait d'excellents scores dans des communes ou des quartiers riches, mais le FN/RN est parvenu aussi à divers moments de son histoire à attirer des électeurs des classes favorisées. C'est le cas aujourd'hui, de manière croissante, à mesure que s'effondre le macronisme et que l'extrême droite apparaît à une partie des riches et des patrons comme une alternative à la gauche unifiée. Cela étant dit, il y a des zones de force pour le FN/RN et des facteurs qui prédisposent au vote d'extrême droite. D'un point de vue de classe, l'extrême droite est particulièrement forte parmi les petits indépendants – commerçants, artisans, chefs de petites entreprises – mais aussi dans les fractions stables des classes populaires, notamment parmi les travailleurs blancs. Cet ancrage social est d'autant plus fort que ces personnes habitent dans les petites villes ou dans ce que le sociologue Benoît Coquard a nommé les « campagnes en déclin » (ce qui ne signifie pas toutes les campagnes), particulièrement dans les régions historiquement hostiles à la gauche.
Il faut par ailleurs tordre le cou à deux idées communes, faisant du FN/RN le parti des pauvres et des jeunes. Lors du premier tour de la présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon faisait jeu égal avec Marine Le Pen parmi les personnes gagnant moins de 1 250 euros et se situait devant elle parmi celles et ceux gagnant entre 1 250 et 2 000 euros, alors que le RN le distançait chez les revenus situés entre 2 000 et 3 000 euros. Et si l'extrême droite a progressé parmi les jeunes par rapport aux années 1990, Marine Le Pen a été battue nettement en 2022 par Jean-Luc Mélenchon, aussi bien chez les 25-34 ans que chez les 18-25 ans.
Concernant les motivations de l'électorat d'extrême droite, il faut insister sur le fait que fonctionnent ensemble la volonté d'avoir davantage de pouvoir d'achat et la volonté de s'en prendre aux « immigrés », aux « étrangers », aux « minorités » – ces catégories étant utilisées de manière volontairement f loue par l'extrême droite. En effet, le tour de force du FN/RN a consisté à nouer un lien étroit entre le « social », l'idée d'améliorer les conditions matérielles d'existence, et le « racial », le projet de défendre les « nationaux ». Avec une conception implicitement raciste des « nationaux », puisqu'à l'extrême droite on oppose les « Français de souche », autrement dit les « vrais Français », et les « Français de papier ».
Quel est l'impact selon vous des transformations récentes du champ médiatique, sous l'influence d'actionnaires puissants acquis, à l'instar de Vincent Bolloré, aux idées réactionnaires ?
Les médias dominants ont eu un rôle important dans tout le processus politique qui a permis la progression de l'extrême droite. Si l'on schématise, on peut dire qu'il y a d'abord une première période, des années 1980 aux années 2000, dans laquelle l'extrême droite était peu présente dans les médias. Seul Jean-Marie Le Pen était invité et c'était encore assez rare. Mais les obs2sions du FN – autour de l'insécurité et de l'immigration notamment – ont pris une place de plus en plus importante dans la presse, les journaux télévisés, les émissions de débat. À cette atmosphère de plus en plus anxiogène, s'est ajoutée la fabrication d'un sentiment généralisé d'impuissance sur les questions économiques et sociales, en matraquant qu'il n'y avait pas d'alternative à l'austérité néolibérale, aux privatisations, aux régressions en matière de droit du travail, de retraites, etc.
Boite : la résistible ascension Collectif, dirigé par Ugo Palheta (préface de Johann Chapoutot) Éditions Amsterdam 6 septembre 2024 280 pages - 18 € Au fatalisme de certains discours politiques et médiatiques, qui installent l'idée d'une arrivée inéluctable du RN au pouvoir, cet ouvrage collectif, nourri des travaux les plus récents en sciences sociales et coordonné par Ugo Palheta, oppose une analyse minutieuse des forces mais aussi des failles de l'extrême droite. Ses contributeurs décortiquent les dynamiques sociales qui alimentent la poussée du RN, mais aussi les réseaux d'influence et les formes médiatiques par lesquelles les discours racistes, antiféministes et homophobes s'installent dans l'espace du débat public.
Dans une deuxième période, qui commence dans les années 2010, l'extrême droite commence à coloniser l'espace médiatique. D'abord, on voit bien davantage de responsables politiques du FN invités sur l'ensemble des plateaux, y compris les radios publiques. Mais c'est surtout la constitution de l'empire Bolloré qui va changer la donne en décuplant l'audience de pseudo-journalistes, véritables idéologues racistes et réactionnaires, issus des médias Valeurs actuelles, Causeur, Boulevard Voltaire, et en décomplexant certains vieux briscards de la presse de droite tels que Éric Zemmour, Yves Thréard… Le cocktail est assez terrible puisqu'à la « fachosphère » – qui était déjà puissante sur le web et les réseaux sociaux – s'est ajouté un certain nombre de médias traditionnels (CNews, Europe 1, le JDD) diffusant en continu le sens commun de l'extrême droite.
Pourquoi la gauche, malgré ses propositions sociales, rencontre-t-elle l'indifférence, voire l'hostilité de certains groupes populaires acquis au RN ?
D'abord il faut préciser qu'il y a toujours eu une partie des classes populaires qui votaient à droite, avec des variations territoriales importantes : une partie de l'électorat populaire du FN/RN procède ainsi d'un électorat anciennement de droite et qui s'est radicalisé à partir des années 1980. Mais il y a bien eu ce que les politistes nomment un « désalignement » entre la gauche et les classes populaires, qui s'est réalisé en plusieurs étapes.
Pourquoi la gauche ne parvient-elle pas davantage à parler aux classes populaires ?
La première raison, à mon sens, c'est l'échec de toutes les expériences de pouvoir de gauche dominées par le Parti socialiste – de Mitterrand à Hollande en passant par Jospin – dans la mesure où ces gouvernements ont pour l'essentiel trahi les espérances qui avaient été placées en eux. Mitterrand devait « changer la vie », il a opéré le tournant de la rigueur. Jospin prétendait rompre avec les gouvernements Balladur et Juppé, il a privatisé plus que tous les gouvernements de droite réunis. Hollande affirmait « mon ennemi c'est la finance », il a fait une politique de l'offre hyper favorable aux riches et au capital. Il y a d'autres aspects évidemment, par exemple la légitimation d'idées racistes et sécuritaires du fait notamment du matraquage médiatique et de leur reprise par des dirigeants politiques de premier plan.
Mais c'est d'abord le bilan de la gauche au pouvoir, en particulier du Parti socialiste, que l'on doit affronter. Le paradoxe, c'est qu'une partie des classes populaires pense que la gauche et les élites les ont abandonnées au profit des immigrés, alors que ces derniers (et bien souvent leurs enfants) sont les premiers à avoir pâti, et à pâtir, en tant que travailleurs et travailleuses notamment, des politiques de régression sociale, du chômage, de la précarité.
Vous écrivez que le désastre est possible mais « résistible ». Y a-t-il des exemples de territoires, en France ou à l'étranger, où on observe un recul de l'extrême droite ? Autrement dit, y a-t-il des stratégies efficaces contre l'extrême droite ?
Il y a des territoires où l'extrême droite n'a pas réussi à percer électoralement, comme la Belgique wallonne, sans doute parce qu'on y a maintenu un « cordon sanitaire » : on n'invite pas dans les médias des représentants d'extrême droite. Mais aussi parce que le mouvement ouvrier traditionnel, notamment syndical, avec ses solidarités concrètes, a gardé là-bas un poids important. Il faut cependant comprendre qu'il n'y a aucune recette miracle pour faire régresser l'extrême droite. Quand elle s'installe dans le jeu politique, elle ne disparaît pas, y compris après un passage au pouvoir, comme on l'a vu dès les années 1990 en Italie ou en Autriche, dans le cadre de coalitions avec la droite.
Il y a donc un travail de long terme à mener, au moins à trois niveaux. Il y a d'abord le militantisme de terrain, particulièrement là où la gauche, les syndicats et les mouvements sociaux sont peu présents : territoires ruraux, petites villes, petites et moyennes entreprises. Il ne s'agit pas simplement de réfuter les mensonges de l'extrême droite, sur l'immigration notamment, mais de faire exister un discours d'égalité et de justice social, construire des solidarités, défendre l'idée qu'il est possible collectivement de bâtir un avenir meilleur en s'en prenant non pas aux immigrés ou aux minorités, mais en imposant un rapport de force avec les classes possédantes.
Il y a ensuite la bataille politico-culturelle, qui passe par ce travail de terrain où on diffuse des idées mais aussi par la construction de médias indépendants, la production et la diffusion de savoirs critiques sur les inégalités, les discriminations, les violences… Et il y a enfin la question de l'alternative politique : on ne fera pas régresser durablement l'extrême droite si un gouvernement de gauche ne parvient pas à montrer concrètement qu'améliorer les conditions de vie de la majorité – par des hausses de salaire, la baisse de l'âge de la retraite, la diminution du temps de travail – n'est pas contradictoire avec le fait d'accueillir dignement les exilés, qu'ils ou elles soient d'ailleurs reconnus ou non comme réfugiés.
Au vu de l'exercice du pouvoir des extrêmes droites contemporaines (Italie, Hongrie, Argentine), à quoi pourraient selon vous ressembler les premiers mois d'un gouvernement Bardella ?
Si elle parvient au pouvoir, l'extrême droite cherchera à donner des gages à son électorat, mais aussi à rassurer le pouvoir économique et à s'attaquer aux secteurs militants capables de contester sa domination. Donner des gages à son électorat ne passera pas par des mesures sociales : toutes les annonces de Bardella pendant la campagne des législatives montrent qu'ils sont en train de renoncer à toutes les mesures « sociales » de leur programme. Cela signifiera une intensification des attaques racistes ciblant déjà depuis des années les groupes constitués comme « ennemis de l'intérieur » : les exilés, les musulmans, les Roms, les quartiers populaires et d'immigration. Avec des conséquences immédiates en matière de traque et d'expulsion des sans-papiers, de remise en cause du droit d'asile, du droit des étrangers et des droits des minorités notamment religieuses, mais aussi des atteintes aux ressources déjà maigres de nombreuses familles, donc y compris pour beaucoup d'enfants, du fait de la « priorité nationale » consistant à réserver les aides sociales, les emplois et les logements sociaux aux Français.
Rassurer le pouvoir économique impliquera de prolonger la politique de l'offre qui a été appliquée par tous les gouvernements avant eux : baisses d'impôts pour les entreprises et pour les riches, application des réformes des retraites et de l'assurance-chômage initiées par la Macronie, coupes budgétaires drastiques dans les budgets publics pour compenser l'affaiblissement des recettes liées aux baisses d'impôts évoquées, etc.
Et il ne faut pas oublier qu'en accédant au pouvoir, l'extrême droite contrôlera l'institution policière, dont les membres sont déjà largement acquis à ses idées et qui attendent avec impatience un grand « nettoyage ». Affrontant une société civile vigoureuse, où les luttes populaires ont été importantes ces dernières années, il n'y a aucun doute sur le fait que le FN/RN utilisera des motifs fallacieux et des lois déjà existantes pour saper les résistances en allant bien plus loin que Darmanin : dissolution de nombreux collectifs, criminalisation des idées et mouvements contestataires, arrestations ciblées, entraves à l'action syndicale, restriction du droit de grève, etc. « L'un des enjeux centraux dans les prochaines années, c'est de faire revivre une gauche militante partout où elle n'existe pas ou peu, de s'implanter et de se structurer à partir de combats concrets. »
La question de la (re)conquête de territoires ruraux et de la « France des bourgs », pour reprendre les termes de François Ruffin, nourrit les débats à gauche et dans les mouvements écologistes. La gauche peut-elle sortir de l'entre-soi urbain et diplômé ?
D'abord ces territoires sont plus hétérogènes politiquement que ce qu'on prétend généralement, et la gauche peut y trouver aussi certains points d'appui – par exemple dans la lutte pour le maintien des services publics, dans des réseaux syndicaux affaiblis mais qui persistent. Il est vrai que, dans une partie de ces territoires, c'est le FN/RN qui est aujourd'hui hégémonique, qui donne le ton. Cela n'a pas été vrai de toute éternité – l'ancrage électoral du FN il y a 30 ans était plutôt urbain – et ce qui a été fait pourrait être défait. Mais à condition que la gauche sorte effectivement de ses zones de confort militantes, pas simplement au moment des élections mais toute l'année. Certains le font déjà mais il faut que cela soit pris en charge à une échelle beaucoup plus large et de manière volontariste, en se disant que les seules batailles perdues sont celles qu'on renonce à mener.
L'un des enjeux centraux dans les prochaines années, c'est donc de faire revivre une gauche militante partout où elle n'existe pas ou peu, de s'implanter et de se structurer à partir de combats concrets. Ce n'est certainement pas de pratiquer une politique d'« apaisement » (en direction de qui ?) ou de s'ajuster au sens commun, qui comporte toutes sortes d'éléments contradictoires – certains progressistes, d'autres conservateurs ou carrément racistes. On peut s'appuyer sur des éléments progressistes, de contestation des inégalités par exemple – qui était au cœur du mouvement des Gilets jaunes – pour refaire exister une perspective de gauche là où elle s'est affaiblie, voire a disparu. Une première version de cet entretien est parue sur le site de Socialter pendant la campagne des législatives et a été traduite par le média américain Jacobin. Il a depuis été actualisé et complété à la lumière des résultats de l'élection de juillet dernier.
Une première version de cet entretien est parue sur le site de Socia/ter pendant la campagne des législatives et a ètè traduite par le mèdia amèricain Jacobin. Il a depuis ètè actualisè et complètè à la lumière des rèsultats de l'élection de juillet dernier.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Imane Khelif rafle l’or et saisit la justice contre les racistes !

Revanche historique ! La jeune boxeuse algérienne, victime d'une campagne immonde de cyber harcèlement xénophobe, misogyne et de collusion, se fait, le 9 août à Paris, justice par l'exploit homérique.
« La brindille que tu dédaignes, pourrait t'aveugler » (Adage populaire arabe)
De Paris,
Les larmes d'une jeune femme blessée, se sont mues en aura planétaire ! Le préjudice moral infligé à la Championne olympique de boxe, est d'une cruauté abyssale.
Contre la haine, Imane n'a pas déposé les armes. Elle flamboie !
Murés dans l'imprescriptibilité de leur supériorité et le rejet de l'autre, les Occidentaux répugnent qu'un l'Africain (e) déshérité inscrive sa prouesse sur leur trajectoire. Eux qui qui ont édifié une civilisation par le cimeterre et la spoliation de cet même être vulnérable, s'adjugent l'autre médaille, celle des Champions du dénigrement, de l'exclusion et de la jalousie !
Ces J.O 2024, dispendieux, se sont illustrés par des manœuvres absconses, de déchaînement haineux, de cabales dans les officines sibyllines et impénétrables citadelles des Instances du « noble Art » dont la Fédération Internationale de Boxe, pour dézinguer une jeune étoile porteuse de valeurs, réfractaire à l'humiliation, l'abus, l'atteinte à l'honneur et le racisme. C'est aux moyens d'ostracisation et d'oppression (Hogra) qu'on décapite le rayonnement de l'autre.
Dans le peloton de ces bourreaux de l'excellence arabo musulmane, appelés à rendre des comptes devant la Justice, (Attendons-nous à un classement sans suite) figurent plusieurs personnalités : Elon Musk, patron d'entreprises technologiques qui risquerait une peine de 5 ans de prison et 250 000 euros pour avoir participé à la diffusion de messages injurieux et d'attaques personnelles sur sa plateforme, ainsi que l'inconsolable et ulcéré Donald Trump, fier de son ineptie diffamatoire : « Qui veut voir les hommes pratiquer du sport à haut niveau aux côtés des femmes ? »
Parmi les lyncheurs (ses) portant atteinte à l'honneur d'Imane Khellif, présentement dans le viseur du parquet chargé de lutter contre la haine en ligne, la romancière américaine J.K Rowling. Soucieuse de l'étendue de son notoriété sur le Net, elle adresse un message avec photo à ses 14,2 millions d'abonnés dans lequel elle « accuse la sportive d'être un homme ».
L'impact sur les réseaux sociaux est dévastateur. Mais Imane, sans verser dans le pamphlet, sait déjà qu'elle est une Icone !
Les scénaristes et les écrivains vont se l'arracher
A Paris, la machine judiciaire se met déjà en branle. Sur le pied de guerre, le cabinet de l'avocat au barreau, Nabil Boudi, fait part de la résolution d'Imane Khelif de « déposer plainte pour faits de cyber harcèlement aggravé auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne »
L'Avocate palestino-américaine Lina Hadid emboite le pas à son collègue pour plaider la cause d'Imane : « Je ferai partie de cette équipe juridique, bénévolement » promet-elle.
Sa dignité, son amour propre, éraflés, l'Athlète de 25 ans issue d'une bourgade rurale déshéritée, déclare aux médias algériens : « Je pense que mon Honneur est maintenant intact. Mais les injures dont j'ai été victime étaient accablantes. Ça fait basculer une vie. Je suis née femme, j'ai grandi en tant femme et concouru comme femme. Ceux qui ont douté de ma féminité, sont les ennemis de la réussite. Les attaques rendent la Médaille plus belle ! » répond avec sagesse la Lauréate.
Prenant cause et fait pour Imane, le Président du Comité International Olympique (C.I.O), l'allemand Thomas Adams, débusque la « cuisine » assassine de la Fédération Internationale de Boxe pour bannir l'Algérienne : « Le test, la méthode utilisée, l'idée même de ce test, rien de tout cela n'est légitime et ne mérite donc aucune réponse » s'insurge ce dernier.
Même pot aux roses pour la médaillée Kaylia Nemour.
La vidéo d'un Marocain outré par la connivence, fera le tour du monde : « Vous voyez ces larmes ? Vous allez le payer cher ! Comment ? Elle va rafler la médaille. Dieu ne tolère pas la Hogra ! ».
Le jour du triomphe. Dans un café parisien plein comme un œuf, Place de la République, la tension est à son paroxysme avant le début de la finale avec la chinoise Yang Liu. La médiatisation de l'injustice avait ameuté un bataillon de femmes de tout âge, mais aussi d'hommes que l'on voit affluer, drapeau algérien sur les épaules.
Il y a plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'estaminet. Les téléphones portables vont faire du RTT jusqu'à l'aube : « Vite ! A'MMA » s'écrie une jeune femme à sa mère complètement essoufflée sous son hijab. La maman décline l'offre de s'asseoir sur une chaise. Toutes les deux s'approprient l'ambiance explosive nationaliste, l'adrénaline à fleur de peau. Toutes les deux sont marocaines venues soutenir Imane, l'emblème de l'Algérie flottant au-dessus de la tête.
Le combat tient en haleine la planète. Il se clôt par un jeu de jambes à la Mohamed Ali et une victoire de l'Algérienne qui reçoit - alors qu'elle n'a pas quitté le Ring - un coup de fil du Président Tebboune, irradié de bonheur.
Extatique, la communauté arabo- musulmane de par le monde, prend toutefois acte, que les zones d'ombre dans lesquelles on l'assigne, ne sont pas le fruit du hasard.
Maître de son savoir-faire et savoir- être, Imane Khelif est entrée dans l'Histoire par la grande porte !
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une société en miettes : pourquoi les Sud-Africains ont puni l’ANC

Le Gatsby est un sandwich emblématique de la ville du Cap : on coupe un pain en deux et on le fourre d'une variété d'ingrédients, laissant souvent des miettes éparses lorsqu'on le mange. Dans notre étude « From Gatsby to crumbs, material and immaterial responses to infrastructural precarity », nous explorons les effets du délestage, c'est-à-dire des pénuries d'électricité programmées et prolongées qui se produisent régulièrement en Afrique du Sud.
Tiré d'Afrique en lutte. Photo : Des agents de la police métropolitaine du Cap tentent d'arracher un morceau de fil électrique branché illégalement à des habitants d'un quartier informel appelé Oasis Farm, près du Cap, le 13 septembre 2023. Rodger Bosch/AFP

Nous constatons que ces pénuries, qui ont un impact différent sur la dynamique de la solidarité civique selon les classes sociales et les races, privent uniformément les citoyens de toute participation politique et de tout engagement gouvernemental, ce qui évoque une société réduite à l'état de miettes « à la Gatsby ».
« Racisme énergétique »
L'histoire de l'Afrique du Sud est étroitement liée aux questions énergétiques. Avant la fin de l'apartheid en 1994, selon diverses sources, entre un tiers et la moitié de la population avait accès à l'électricité. Alors que la majorité des Blancs y avaient accès, seule une petite partie des ménages noirs et métis en bénéficiaient, ce qui a conduit à la montée de ce que l'on a appelé le racisme énergétique.
Le programme de reconstruction et de développement (RDP) du gouvernement post-apartheid lancé en 1994 s'est attaché à corriger les déséquilibres sociaux créés par l'ancien régime pour la majorité de la population sud-africaine. Le RDP visait à augmenter le nombre de connexions électriques domestiques, se fixant l'objectif d'atteindre au moins 95 % avant 2022.
Cependant, la mauvaise gestion, la corruption et la mauvaise planification ont abouti à une crise pour Eskom, le producteur public d'électricité. Pour éviter que le réseau ne s'effondre, Eskom a mis en place depuis 2007 un système de niveaux de délestage (Stage 1 à Stage 8) qui détermine la gravité et l'intensité des coupures. Chaque niveau représente une quantité croissante de charge à réduire. L'objectif est de répartir équitablement les coupures afin de minimiser l'impact sur les résidents et les activités économiques.
Le délestage est réparti de manière planifiée entre différentes régions du pays. Eskom et les municipalités locales publient des horaires de coupures à l'avance pour informer les citoyens et les entreprises des périodes de délestage. Les coupures sont généralement planifiées par tranches de 2 à 4 heures, selon le niveau de délestage et la demande sur le réseau. Le délestage est déclenché par divers facteurs, notamment des pannes imprévues dans les centrales électriques, des problèmes de maintenance, une demande exceptionnelle due à des conditions météorologiques extrêmes, ou des contraintes sur l'approvisionnement en combustibles. En 2017, l'Afrique du Sud était confrontée à 836 heures de délestage par an. En 2023, les Sud-Africains ont subi plus de 6 800 heures de coupures d'électricité au début du mois de décembre, ce qui a conduit le président Cyril Ramaphosa à déclarer qu'il s'agissait d'une urgence nationale.
En tant que chercheurs en sociologie politique et spatiale, nous cherchons à comprendre comment les problèmes d'infrastructures affectent la participation civique et politique. Nous avons enquêté sur les conséquences quotidiennes du délestage, sur la manière dont les gens y faisaient face et sur les personnes qu'ils blâmaient. Au cours du premier semestre 2023, en interrogeant 25 habitants de différents quartiers du Cap (Muizenberg, Beacon Valley, Khayelitsha), l'une des villes les plus inégalitaires et ségréguées au monde, nous avons découvert que les sentiments et les perceptions du délestage différaient considérablement selon que les habitants réfléchissaient aux effets des délestages sur la vie quotidienne ou sur leurs causes plus abstraites, souvent politiques.
Des réactions aux délestages très contrastées
Parmi les divers groupes sociaux et raciaux du Cap, les réactions au délestage varient considérablement, un peu comme les divers ingrédients d'un sandwich Gatsby. Alors que les personnes riches, isolées, disposant de revenus et de ressources supérieurs à la moyenne et celles vivant dans deux des communautés les plus défavorisées du Cap (Khayelitsha) ont manifesté des sentiments et des réactions presque nulles, celles vivant dans des communautés intermédiaires (Muizenberg, Beacon Valleys) ont manifesté plusieurs formes d'engagement et de soutien.
Dans ces communautés intermédiaires, la solidarité et la résilience sont fortes face à des défis tels que le délestage. Les habitants se soutiennent mutuellement par le biais d'une assistance communautaire et d'initiatives locales, souvent ancrées dans une identité commune. À Beacon Valley, les habitants collectent des fonds pour s'assurer que personne ne souffre de la faim. À Muizenberg, les habitants aident les petites entreprises en collectant des fonds et en organisant des soupes populaires. Ces communautés s'engagent également auprès des autorités locales par le biais de pétitions et de courriels, souvent accueillis par le silence, appelant à un meilleur dialogue pour résoudre des problèmes tels que le délestage.
Pour les personnes aisées, qui vivent détachées de tout sens de la communauté, les défis pratiques posés par le délestage sont considérés au pire comme des inconvénients mineurs. Dans le meilleur des cas, ils sont même reconfigurés en symbole de statut social, illustrant leur détachement des préoccupations quotidiennes. Au sein de ce groupe, les générateurs et les panneaux solaires sont des solutions courantes. Le programme « Power Heroes », qui vise à protéger les citoyens des délestages tout en réduisant la demande d'électricité au Cap, encourage cette démarche en permettant aux propriétaires de produire de l'électricité et de la revendre à la ville. Pour bénéficier de telles initiatives, il faut être propriétaire de son logement, avoir des capacités financières et être capable de s'y retrouver dans des procédures administratives complexes.
C'est les communautés à faibles revenus, majoritairement noires, que le délestage affecte le plus durement, exacerbant les difficultés et les inégalités existantes. Les coupures d'électricité perturbent des activités cruciales comme la cuisine et le travail indépendant, qui sont indispensables à la subsistance des habitants.
Les petites entreprises et les cliniques se débattent sans électricité, ce qui affecte les revenus et les soins de santé. Les appareils ménagers sont souvent endommagés, ce qui alourdit la charge financière. La tension économique prolongée a déplacé l'attention vers la préservation et l'intérêt personnel, ce qui a entraîné une diminution des protestations et des efforts d'organisation des communautés pour relever les défis liés aux infrastructures.
La criminalité exacerbe la situation, avec des branchements électriques illégaux, des vols et des actes de vandalisme qui compromettent la sécurité et la cohésion de la communauté. Dans ces communautés, il est évident que le délestage aggrave les fractures socioéconomiques et raciales existantes, érodant la cohésion communautaire et la résilience collective au sein des groupes défavorisés.
Désillusion vis-à-vis de la chose politique
Dans une société de miettes, malgré ces différentes expériences, lorsque l'on considère le délestage à une échelle plus large, nombreux sont encore ceux qui le considèrent comme un défi collectif, partagé de manière similaire, sinon égale, par tous les citoyens sud-africains. Le délestage est souvent comparé à des crises telles que le changement climatique et la pandémie de Covid-19, plutôt qu'à des problèmes spécifiques d'infrastructure liés à l'accès à l'eau ou à la construction de logements publics.
Les pannes d'électricité représentent un point de basculement dans une crise sociopolitique plus profonde, qui mine la confiance dans les partis politiques et favorise l'apathie et l'isolement des citoyens. C'est là qu'émerge une société de miettes, née d'une frustration et d'une désillusion profondes, propres à toutes les races et de tous les groupes sociaux. Le gouvernement, en particulier le Congrès national africain (ANC), est tenu pour responsable de la crise due à la mauvaise gestion et à la corruption d'Eskom, le fournisseur d'énergie appartenant à l'État. Cette érosion de la confiance s'étend au processus électoral : de plus en plus de citoyens remettent en question l'efficacité du vote en raison des promesses non tenues par la démocratie post-apartheid. Toutes les actions, y compris le vote, sont perçues comme inefficaces. Cette méfiance généralisée et ce manque d'engagement politique et civique peuvent expliquer les résultats décevants de l'ANC lors des dernières élections.
De manière plus générale, nos conclusions soulignent la façon dont les contraintes structurelles et les réalités quotidiennes peuvent fortement diminuer l'engagement collectif et la confiance dans la politique, même dans des cas comme celui de l'Afrique du Sud où l'ANC est soutenu par l'histoire de Nelson Mandela et des mouvements anti-apartheid.
Franco Bonomi Bezzo, Dr., Ined (Institut national d'études démographiques) et Laura Silva, Post-doctorante en sociologie, Paris School of Economics, Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












