Derniers articles

Rachel Bédard, éditrice féministe

À quelques minutes de marche de la station de métro Parc à Montréal se trouve la Maison Parent-Roback. Nommée en l’honneur de deux grandes militantes féministes, cette maison rassemble sous un même toit des organismes sans but lucratif voués à la cause des femmes. Par une froide soirée de novembre, je m’y suis rendu pour rencontrer Rachel Bédard aux éditions du Remue-ménage. Pendant plus de 40 ans, Rachel s’est consacrée à l’édition féministe. En compagnie de Valérie Lefebvre-Faucher, qui a été sa collègue à Remue-ménage pendant plusieurs années et qui est maintenant codirectrice de la revue Liberté, on discute des choix éditoriaux de la maison d’édition, de l’évolution du mouvement des femmes et de la fondation de la Maison Parent-Roback.
Guillaume Tremblay-Boily – Est-ce que tu peux me dire de quel milieu social tu viens, dans quel contexte tu as grandi ?
Rachel Bédard – Je viens de la classe moyenne. Mes parents étaient engagés dans les associations parents-maitres. Ils étaient passionnés des questions d’éducation. Dans les années 1960, à Beloeil où on habitait, ils avaient décidé de s’impliquer dans le Nouveau Parti démocratique (NPD), dans un comté où il y avait vraiment du patronage et des libéraux bien établis qui dirigeaient tout. Ils se sont dit : « On va leur chauffer les fesses un peu ». Thérèse Casgrain et Michel Chartrand étaient venus faire des discours. Le NPD est arrivé deuxième. Mes parents ne s’étaient pas présentés eux-mêmes parce que mon père passait pour une tête brûlée. Ils avaient recruté un digne médecin de Saint-Hyacinthe… Ils ont obtenu un bon résultat, alors que le NPD avait fait patate à l’échelle du Québec. Ils ont bien aimé cet épisode-là. Je peux donc dire que j’ai des parents engagés.
G.T.-B. – Donc ça jasait politique chez toi ?
R.B. – Oui, tout à fait. Et l’esprit critique était encouragé. Ma mère s’occupait d’une famille de sept enfants et mon père était réalisateur à Radio-Canada. Son école de militantisme avait été la grève des réalisateurs en 1959. Il y a des familles où l’on se raconte des souvenirs de guerre. Mon père, lui, parlait de la grève et des personnes qu’il avait admirées comme René Lévesque ou Jean Duceppe. La grève a été un moment charnière pour lui. J’avais six ans, mais souvent j’ai questionné mes parents sur ce qui s’était passé à l’époque. Je regrette de ne pas l’avoir fait davantage.
Valérie Lefebvre-Faucher – Je ne savais pas que ton père était réalisateur.
R.B. – Oui, il faisait de la fiction. Cela m’a aidée dans mon travail d’éditrice parce qu’il retravaillait les textes, il collaborait avec les scénaristes.
G.T.-B. – Tu as étudié dans quel domaine ?
R.B. – Au cégep, j’ai commencé en lettres mais j’ai terminé en sciences humaines. Cela a été des années très formatrices. J’ai essayé un peu de tout. Ensuite, je me suis inscrite en linguistique à l’UQAM. J’aimais les mots et leur dimension sociale. Je me suis spécialisée en sociolinguistique durant une maitrise que je n’ai pas terminée. Pendant que j’étais en rédaction de mémoire, j’enseignais le français langue seconde et je travaillais chez Remue-ménage. Puis, je me suis dit que comme je ne voulais pas travailler à l’université, ce n’était pas essentiel de finir mon mémoire. C’est comme ça que j’ai laissé tomber, ce qui était idiot. Depuis ce temps, à toutes celles qui menacent d’abandonner la rédaction de leur mémoire alors qu’il ne leur reste que des corrections à faire, je dis: « Eh! finis donc ».
V. L.-F. – Ça t’est resté, la frustration de ne pas avoir eu ton diplôme de maitrise ?
R.B. – Pas le diplôme, mais le sentiment de ne pas avoir fini quelque chose que j’avais commencé. C’est juste ça. Parce que non, je n’aurais pas fait carrière à l’université ni en recherche linguistique. J’aimais mieux enseigner et travailler à Remue-ménage.
G.T.-B. – Tu travaillais déjà chez Remue-ménage à ce moment-là ?
R.B. – Oui. En 1980, je faisais mon terrain de maitrise en même temps qu’on s’apprêtait à publier le premier tome de l’autobiographie de Simonne Monet-Chartrand. C’était assez prenant.
G.T.-B. – À ce moment-là, avais-tu des implications militantes ?
R.B. – J’étais proche de personnes qui militaient dans le Comité de lutte pour l’avortement libre et gratuit. Mais ma principale implication était à Remue-ménage.
G.T.-B. – Comment as-tu été en contact avec l’équipe de Remue-ménage ?
R.B. – Par amitié. Il s’est trouvé que ma coloc, Suzanne Girouard, était proche de Remue-ménage. Elle a été la première employée des éditions. Forcément, j’en entendais parler !
V. L.-F. – Ça se passait chez vous !
R.B. – Oui, il y avait beaucoup d’affaires qui rebondissaient chez nous ! Même avant que Suzanne soit employée, sa sœur Lisette avait traduit le livre d’Adrienne Rich[1] et elle faisait partie du collectif. Il y a eu un malentendu parce que la gang de Remue-ménage s’est dit qu’on devait être bonnes en français puisqu’on étudiait en linguistique, alors qu’on étudiait la linguistique générative et tout ça. C’est Nicole Lacelle qui est venue nous voir pour nous demander de faire de la révision de textes. Bien sûr que ça nous intéressait ! On a dû dissiper le malentendu en disant que ce n’était pas parce qu’on était en linguistique qu’on était bonnes en révision, mais qu’on allait faire notre possible [Rires]. J’ai donc fait des révisions bénévoles, comme ça. Le travail à Remue-ménage a été bénévole pendant longtemps. À certaines périodes, on a eu des subventions et on en a profité, mais c’était surtout un travail bénévole.
G.T.-B. – Donc tu travaillais ailleurs en même temps ?
R.B. – Oui, je n’étais pas à temps plein comme enseignante, je donnais des cours du soir. Cela permettait donc de faire en même temps de la révision bénévole. Quand on m’a offert de travailler à temps plein pour Remue-ménage, j’ai bien sûr accepté, mais je voulais continuer à enseigner. J’ai essayé pendant quelques années de combiner les deux, mais ça devenait fatigant.
G.T.-B. – Qu’est-ce qui t’interpellait au départ chez Remue-ménage ?
R.B. – Plein d’intérêts conjugués. C’était à la fois les livres et le féminisme. Parce que j’étais dans la vingtaine. Et puis j’aimais aussi les femmes qui étaient là. C’était par amitié. Il y avait ma coloc, sa sœur, et puis Nicole Lacelle qui était venue nous rejoindre. Participer à des réunions chez Remue-ménage, ce n’était pas ennuyant ! Je me portais aussi volontaire pour toutes sortes de tâches. Il y avait beaucoup de travail de bras à faire, comme distribuer les livres, envoyer les communiqués. Aujourd’hui, ça se fait par infolettre, mais dans les débuts, on le faisait en collant des timbres. J’étais une petite rapide pour faire l’adressage et tout !
G.T.-B. – Ta conscience féministe venait d’où ? Qu’est-ce qui t’avait amenée à développer une sensibilité féministe ?
R.B. – Il y a l’histoire familiale. Je suis l’ainée d’une famille de sept enfants, et la seule fille. J’ai été élevée dans un milieu où ce n’était pas parce que j’étais une fille que j’allais être la servante de mes frères. J’ai donc été très encouragée à m’affirmer. Mais la conscience féministe est arrivée assez tardivement, dans la vingtaine. Je me suis tout à coup décidée à lire des livres de femmes. Ça pouvait être Simone de Beauvoir, Margaret Atwood… Ça n’a pas vraiment été une décision consciente. Mes intérêts me portaient vers ça. Et, coudonc, je suis devenue féministe.
V. L.-F. – Avais-tu l’impression d’être marginale ?
R.B. – Autour de moi, non. À vrai dire, je ne me suis même pas vraiment posé la question. Et comment dire… On choisit aussi nos amitiés. On voit les affinités qu’on a avec les personnes. L’engagement féministe ne posait pas problème autour de moi ni l’intérêt pour les livres écrits par des femmes : on lisait toutes Benoîte Groult.
V. L.-F. – Mais vous lisiez toutes ça dans un groupe qui était marginal ?
R.B. – Oui, je suis à l’aise dans les ghettos ! [Rires] On a une vie à vivre. Je me suis dit : « Pourquoi pas dans un ghetto féministe ? ».
V. L.-F. – Parce qu’honnêtement, je ne sais pas comment c’est d’arriver à Remue-ménage aujourd’hui, mais à différentes époques, en arrivant à Remue-ménage, tout le monde a cette impression qu’on respire, qu’on est dans un univers où on peut parler de ce qu’on aime pour vrai. On est dans un univers exceptionnel.
R.B. – J’étais déjà dans ce genre d’univers quand on m’a recrutée pour Remue-ménage. À l’université, en linguistique, on était beaucoup de femmes, et je ne me souviens pas d’adversité. Je n’étais pas en littérature… ou dans des domaines où il y a plus d’adversité, de l’hostilité même.
V. L.-F. – La solidarité était donc plus forte ? La complicité dans le groupe effaçait le reste, l’hostilité de l’extérieur ?
R.B. – Oui. Tu sais, les combats pour le droit à l’avortement, en linguistique, je pense que personne n’était contre.
V. L.-F. – Mais il y avait quand même les flics qui débarquaient au bureau !
G.T.-B. – Aux bureaux de Remue-ménage ?
R.B. – Oui ! C’est parce qu’il y avait des militantes du Comité de lutte pour l’avortement libre et gratuit, on partageait des locaux avec elles. Je dis « on », mais je n’y étais pas, je n’ai donc pas vécu ces évènements-là.
V. L.-F. – Mais la légalisation de l’avortement, c’est en 1989. Tu as donc édité des livres qui étaient quand même dangereux…
R.B. – Oui, oui. J’ai travaillé avec Lise Moisan sur La résistance tranquille[2].
G.T.-B. – As-tu l’impression que vous étiez à contre-courant de la société dans votre travail ?
R.B. – Il y a eu plusieurs phases. Je dirais que l’accueil était assez bienveillant. Je pense à la collection théâtre, par exemple. C’est plus à la fin des années 1980, juste après la tuerie de Polytechnique, que j’ai vu que le féminisme avait mauvaise presse, on était perçues comme ringardes. C’est vraiment là que j’ai senti le backlash.
V. L.-F. – Ça s’exprimait comment ?
R.B. – En même temps qu’il y avait un bon réseau de groupes de femmes et d’organisations féministes, il y avait une espèce de repli dans les médias, mais aussi dans les projets d’écriture qu’on nous proposait. Dieu merci, il y a eu l’essor des études féministes dans les universités. C’est vraiment dans ces années-là que ça a émergé. Des contacts se sont créés entre Remue-ménage et les études féministes et ce dynamisme s’est reflété dans nos publications. Mais c’était dans un climat d’adversité.
V. L.-F. – Les groupes militants se taisaient à cette époque-là ?
R.B. – Ils ne se taisaient pas, mais on recevait moins de propositions de leur part. On en recevait plus des études féministes.
G.T.-B. – Vous avez donc pris un virage un peu plus universitaire ?
R.B. – À ce moment-là, oui. Dans les médias, c’était vraiment plus difficile de faire passer nos messages. C’était avant le tournant plus militant pris par la Fédération des femmes du Québec (FFQ) à partir du milieu des années 1990 avec la marche Du pain et des roses, puis la Marche mondiale des femmes en 2000. C’était aussi avant le mouvement altermondialiste, Occupy, etc. Ces mouvements ont ramené les gens dans la rue pour manifester. Mais la première moitié des années 1990 a été une période vraiment dure.
V. L.-F. – Est-ce que tu as l’impression qu’on s’en va vers une période difficile ?
R.B. – Sais-tu, je me pose la question. Comment cela se fait-il qu’on ne soit pas plus dans la rue maintenant ?
V. L.-F. – Comment sort-on d’un backlash ? Qu’est-ce qui est arrivé pour que la mobilisation revienne ?
R.B. – Eh ! Ne me demande pas d’expliquer l’altermondialisme, Occupy et tout ça !
G.T.-B. – Mais prenons la marche Du pain et des roses, qu’est-ce qui a donné l’énergie et l’élan pour que ça se fasse ?
R.B. – Pour ça, je voudrais rendre crédit à la Fédération des femmes du Québec et au tournant pris par le réseau de l’R des centres de femmes. Elles se sont dit qu’il fallait mobiliser le monde ! Il ne faut pas sous-estimer l’impact de Polytechnique… Après cette tuerie, un essai masculiniste, le Manifeste d’un salaud[3] avait reçu une bonne publicité dans les médias. Dans l’espace public, on entendait : « Le féminisme est allé trop loin. Taisez-vous ! ».
G.T.-B. – Dans les années 1980, tu avais l’impression qu’il y avait encore un élan favorable au féminisme ?
R.B. – Oui, mais ça s’est durci à la fin des années 1980.
G.T.-B. – Une chose m’intéresse à la suite de ma thèse en sociologie des mouvements sociaux et en histoire, c’est de réviser un peu les lieux communs sur les vagues militantes. On entend souvent que les années 1960, c’était donc militant, c’était merveilleux. Les années 1970 aussi, dans une certaine mesure. Après, à partir des années 1980, c’est le virage néolibéral et l’effondrement des groupes militants. Mais dans les faits, il y a des auteurs et des autrices qui ont montré que c’est aussi le moment où le mouvement féministe se renforce et crée des organisations. Il a émergé en grande partie dans les années 1970, mais il se consolide dans les années 1980.
R.B. – Oui, puis il y a aussi les comités de condition féminine dans les syndicats. Il y a eu vraiment une consolidation. Il y a eu de beaux « 8 mars » !
V. L.-F. – C’était comment, les 8 mars ?
R.B. – C’était très festif. J’ai aussi le point de vue d’une personne qui participait aux salons du livre. On rencontrait notre public dans ces évènements-là. On voyait vraiment l’enracinement des groupes en Outaouais, à Québec et ailleurs dans les régions, pas juste à Montréal. C’était très fort au Salon du livre de Gatineau, on sentait un intérêt. On était bien reçues par les féministes sur place. Il y avait manifestement des femmes dans l’organisation du salon qui se disaient: « Faut que Remue-ménage y soit », et elles étaient contentes de nous y voir. Il faut dire qu’on allait là avec Simonne Monet-Chartrand qui a publié les quatre tomes de son autobiographie pendant les années 1980. Le premier est paru en 1981, le dernier en 1992 avant sa mort. C’était une belle période. Elle voulait aller dans tous les salons du livre et elle connaissait tout le monde! Les personnes qui venaient la rencontrer avaient milité avec elle dans toutes sortes d’organismes à travers le Québec. C’est sûr qu’il se passait quelque chose là !
On a sollicité Simonne Monet-Chartrand parce qu’on savait qu’elle écrivait sa biographie et on voulait qu’elle la publie chez nous. D’autres maisons d’édition la désiraient tout autant puisqu’elle était très populaire. Quand elle nous a annoncé qu’elle voulait publier avec Remue-ménage, pour nous, ça témoignait de son engagement envers le mouvement féministe. On la voulait également parce qu’on se disait qu’on aurait un best-seller. Et ce fut le cas. Pour qu’une maison d’édition vive, il faut un peu de tout, il faut aussi des livres qui rejoignent un large public. Santé, Simonne !
G.T.-B. – Dans les années 1980, quels projets vous animaient ? Quels thèmes vouliez-vous mettre de l’avant ?
R.B. – À sa fondation en 1976, Remue-ménage se voyait vraiment comme une maison d’édition qui allait rendre disponibles des textes pour le mouvement des femmes, mais il y avait aussi un souci d’éducation populaire. Et l’objectif de faire des textes accessibles pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Finalement, un peu plus tard, on s’est dit qu’il y avait des textes plus « nichés » qui feraient aussi avancer le mouvement des femmes. On a voulu refléter cela, d’où l’ouverture à des textes d’écrivaines ou d’universitaires qui étaient plus compliqués que Môman a travaille pas, a trop d’ouvrage, le premier livre publié par Remue-ménage. Cet élargissement s’est fait au début des années 1980. On voulait continuer à faire de l’éducation populaire, mais on voulait aussi publier de la poésie, publier des écrivaines qui retravaillaient la langue. Des Louky Bersianik, des Nicole Brossard. Ce n’est pas de la littérature populaire, mais c’est un travail de remise en question de la langue. On a pris ce virage en même temps que la publication de textes comme Fragments et collages de Diane Lamoureux[4], une étude du mouvement des femmes. Il y avait déjà à ce moment-là un souci de documenter le mouvement et de préserver sa mémoire. L’anthologie de Têtes de pioche[5], le recueil de Québécoises deboutte[6], c’était aussi dans ces années-là. Des revues avaient cessé de publier. On a voulu les reprendre pour en faire une anthologie. C’était donc très varié. Les écrits restent, une maison d’édition, après tout, ça sert à ça. J’ai du mal à dire qu’il y avait une seule direction, une préoccupation centrale.
G.T.-B. – Aviez-vous une vision particulière de ce que devait être le féminisme ? Qu’est-ce qui guidait vos choix ?
R.B. – On a toujours été très œcuméniques, si l’on peut dire. On s’est donné un mandat très large d’alimenter et de nourrir le mouvement des femmes. On voulait accueillir le plus largement possible ce qui fait le mouvement féministe. Il n’y a pas de limites à ce qu’on peut aborder. J’aime bien répéter ce que dit Francine Descarries : s’il y a un livre sur les bûcherons avec une perspective féministe, on va le faire. On vient de faire un livre sur les femmes et le sport. En termes de thématiques, ça peut aller dans tous les sens et c’est tant mieux.
V. L.-F. – Mais il y a quand même des tendances théoriques qui peuvent s’opposer. Y a-t-il des moments où Remue-ménage a choisi d’accueillir des tendances opposées ?
R.B. – Oui, en sachant que ça allait déplaire. Si on parle de travail du sexe, par exemple, c’est un enjeu qui divise le mouvement. On a donc publié Andrea Dworkin, très critique du travail du sexe, et on a publié Luttes XXX[7], qui est protravail du sexe. Voilà où on en est. Il n’a jamais été question pour nous de refuser une perspective parce qu’on avait déjà publié un livre de la perspective opposée.
G.T.-B. – Et comment te positionnais-tu dans ces débats-là ? Quand il y avait des tensions comme ça, où est-ce que tu te situais ?
R.B. – Personnellement, plutôt pour la défense des travailleuses du sexe. Mais dans le livre d’Andrea Dworkin qu’on a publié, il y avait aussi des choses intéressantes. De plus, c’est tellement une penseuse importante, on ne l’a donc pas écartée.
V. L.-F. – Est-ce que ça vient d’un souci de montrer le mouvement féministe dans toute sa pluralité ?
R.B. – Oui, c’était aussi ça. En tous cas, c’est comme ça qu’on l’a défendu. On fait des choix éditoriaux.
G.T.-B. – Comment ont évolué vos liens avec le mouvement des femmes au fil du temps ?
R.B. – Je dirais d’abord que notre déménagement dans la Maison Parent-Roback a resserré les liens, ne serait-ce qu’à cause de la proximité avec les autres groupes. On est voisines, les gens pensent plus à nous. Quand la question de l’avortement a commencé à barder, par exemple, on a pu descendre d’un étage pour aller voir les femmes de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et leur dire qu’on aimerait qu’elles écrivent là-dessus.
La Maison Parent-Roback, c’est le projet de deux groupes, Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féministe (CDÉACF) et Relais-Femmes, mais Remue-ménage a été un des premiers groupes contactés. On a sauté là-dedans à pieds joints. C’était en 1995-1996, une période où on essayait de resserrer nos liens avec le mouvement communautaire, qu’on sentait se ranimer autour de la Fédération des femmes du Québec qui organisait la marche Du pain et des roses. À la fondation de la Maison Parent-Roback, on voulait renouer avec la vocation initiale de Remue-ménage fondé en 1976, en pleine effervescence du mouvement des femmes. Et par des femmes qui étaient vraiment en phase avec tout ce qui se passait. Je te parle d’une histoire à laquelle je n’ai pas participé parce que je suis arrivée à Remue-ménage cinq ans plus tard. Mais j’étais déjà dans les parages. Donc pour nous, en 1995, la Maison Parent-Roback, c’était une belle occasion de renouer avec les groupes de femmes.
V. L.-F. – Est-ce qu’il y a eu des publications autour de la Maison Parent-Roback ?
R.B. – Il n’y a pas eu de publications comme telles, mais on avait travaillé avec Nicole Lacelle qui avait fait des entretiens avec Madeleine Parent et Léa Roback. Le fait que la Maison porte le nom de ces deux femmes-là – je ne sais qui a eu cette idée brillante –, ça donne d’emblée l’image de solidarité qu’on voulait projeter.
G.T.-B. – Et avant la Maison Parent-Roback, vous étiez où ?
R.B. – On a été locataires de plusieurs bureaux. Au moment de la fondation de Remue-ménage, on partageait des locaux, au coin des rues Henri-Julien et Villeneuve, avec un centre de documentation féministe qui n’existe plus. On a hérité de beaucoup de ses affaires. On a aussi partagé des locaux avec la Coordination nationale pour l’avortement libre et gratuit. On a déménagé plusieurs fois. Juste avant la Maison Parent-Roback, on était dans un local au coin du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Mont-Royal, et nos voisines étaient la Fédération du Québec pour le planning des naissances.
G.T.-B. – Vous avez toujours été dans une bâtisse avec d’autres groupes féministes ?
R.B. – Non, mais on s’est ennuyées quand on ne l’a pas été ! Donc oui, on a avantage à avoir un environnement qui nous ressemble.
V. L.-F. – Il y a des gens qui considèrent que l’édition, ce n’est pas de l’engagement. Ça m’énerve ! Tu as passé 43 ans à faire de l’édition féministe. C’est du militantisme, non ?
R.B. – Bien oui ! Ne serait-ce que parce qu’on accepte nos conditions de travail. On est souvent moins bien payées que dans des groupes comme les syndicats. Le milieu culturel, c’est un engagement ! On y met du nôtre.
G.T.-B. – Qu’est-ce qui fait qu’on garde la flamme ?
R.B. – Il y a tellement de gratifications qui viennent avec le métier ! Premièrement, on a des résultats, les livres. Et même si on fait abstraction de la réception dans les médias, je pense que la relation qu’on établit avec les personnes qui écrivent, c’est gratifiant. De voir aboutir quelque chose. Tu as le livre dans les mains. C’est excitant ! Aujourd’hui, on vient d’en recevoir un et on sait que les autrices vont être absolument excitées. C’est un plaisir renouvelé à chaque livre. On n’est pas blasées quand on ouvre la boite d’une nouvelle parution avec l’exacto !
V. L.-F. – Est-ce que tu le vois aussi pour les idées ? Est-ce que tu considères que Remue-ménage a contribué à mettre de l’avant certaines idées ?
R.B. – Pour ça, je serais plus humble. Je pense que Remue-ménage a fait sa place, a aidé à soutenir des voix. On a pérennisé l’histoire du mouvement. Il y a des livres qui ont été marquants. On a documenté la grève des stages, par exemple. C’est un mouvement qui continue. Mais on est plus dans un rôle de soutien que dans un rôle proprement militant.
V. L.-F. – Quel est le livre dont tu es la plus fière ?
R.B. – Ah, je n’oserais pas… Peut-être La lettre aérienne de Nicole Brossard[8] parce que cela a cassé mon syndrome de l’imposteur. J’étais une jeune éditrice et Nicole Brossard était un monument. Je prenais des gants blancs pour dire: « Ça a l’air d’une faute » alors que je savais bien que c’était une subversion de la langue. Mais elle m’a dit : « Tu as raison. Il ne faut pas qu’une transgression ait l’air d’une faute ». On a donc arrangé ça. C’était un défi, mais il fallait que je fasse mon travail d’éditrice.
G.T.-B. – Est-ce qu’il y a des collaborations avec certaines autrices qui t’ont paru particulièrement fructueuses, qui t’ont marquée ?
R.B. – Je pense beaucoup aux livres plus récents, comme celui de Florence-Agathe Dubé-Moreau[9] sur les femmes et le sport. C’est un engagement féministe qui me touche beaucoup. Elle est dans un milieu où il y a de l’hostilité et elle se dit: « J’y vais ! » J’admire les autrices en général. Je suis déjà nostalgique des rencontres que j’ai faites. Gabrielle Giasson-Dulude, quelle femme lumineuse ! Soleil Launière aussi !
V. L.-F. – C’est tellement ton genre de parler de tes rencontres marquantes les plus récentes ! C’est une attitude d’éditrice, je trouve. De toujours penser au prochain livre, d’être constamment à la recherche. Se demander ce qui nous manque, ne pas regarder ce qu’on a déjà fait.
R.B. – Oui. Et se demander c’est quoi le potentiel d’une autrice. Aujourd’hui, on a vraiment des publications diversifiées. Je peux dire que je prends ma retraite en étant confiante pour la suite. Je ne l’aurais pas prise sinon.
G.T.-B. – Qu’est-ce qui te donne confiance ?
R.B. – Les personnes qui sont en place, les projets qui nous sont proposés, l’effervescence du mouvement. Je me dis qu’on n’est pas dans un creux de vague. Même si les temps sont durs, la résistance est là.
G.T.-B. – Alors qu’à la fin des années 1980, c’était différent ?
R.B. – On dirait que les femmes avaient moins envie d’écrire et qu’il y avait moins de canaux pour s’exprimer. Les grands médias écoutaient moins les voix féministes.
V. L.-F. – Il y a eu des époques vraiment hostiles. J’ai vu des salons du livre où les gens venaient nous insulter. Ils faisaient des détours en nous regardant avec dégoût.
R.B. – On prépare un livre avec la Coalition des familles LGBT. Ils célèbrent un anniversaire et ils ont un projet d’expo photo, mais ils ont aussi fait des entretiens avec des familles. La notion de famille est incarnée dans toutes sortes de configurations. Ce sont des personnes qui se faisaient insulter dans les salons du livre. D’un autre côté, il y avait Léa Roback qui venait nous voir et qui nous disait: « J’aime tellement ce que vous faites ! » Et Madeleine Parent qui assistait à nos lancements.
V. L.-F. – Ça, c’est super beau : la continuité des femmes, les militantes, les autrices et les fondatrices qui viennent voir les générations suivantes.
R.B. – Et qui se réjouissent du fait qu’il y a une relève. À un moment donné, notre public vieillissait. Mais il a pris un grand coup de jeunesse dans les dernières années ! Ça m’émeut à chaque salon du livre.
G.T.-B. – Ça s’est passé à quel moment ?
R.B. – C’est graduel, mais ça s’est accéléré dans les dernières années. Des filles de 15-16 ans des écoles secondaires viennent squatter notre stand et se plonger dans nos livres. À chaque fois, je n’en reviens pas ! C’est bon signe, des féministes décomplexées comme ça. On pourrait croire à un effet de mode, mais c’est plus que ça. Il y a un mouvement de fond.
Par Guillaume Tremblay-Boily, chercheur à l’IRIS.
- Adrienne Rich, Les femmes et le sens de l’honneur, Montréal, Remue-ménage, 1979. ↑
- L’avortement : la résistance tranquille du pouvoir hospitalier, une enquête de la Coordination nationale pour l’avortement libre et gratuit, Montréal, Remue-ménage, 1980. ↑
- Roch Côté, Manifeste d’un salaud, Québec, éditions du Portique, 1990. ↑
- Diane Lamoureux, Fragments et collages. Essai sur le féminisme québécois du début des années 70, Montréal, Remue-ménage, 1986. ↑
- Armande Saint-Jean, Les Têtes de pioche. Collection complète des journaux, 1976-1979, Montréal, Remue-ménage, 1980. ↑
- Véronique O’Leary et Louise Toupin, Québécoises deboutte ! tome 1. Une anthologie du Front de libération des femmes (1969-1971) et du Centre des femmes (1982-1985), Montréal, Remue-ménage, 1980. Le tome 2, Collection complète des journaux, 1972-1974, a été publié en 1983. Une nouvelle édition des deux tomes a été publiée en 2022.↑
- Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, Luttes XXX. Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Montréal, Remue-ménage, 2011. ↑
- Nicole Brossard, La lettre aérienne, Montréal, Remue-ménage, 1985. Nouvelle édition en 2022. ↑
- Florence-Agathe Dubé-Moreau, Hors jeu. Chronique culturelle et féministe sur l’industrie du sport professionnel, Montréal, Remue-ménage, 2023. ↑
World Press Photo : la tragédie du monde, jusqu’où ?
Entretien avec Iss, militante anarcha-féministe algérienne | Georges Rivière, Algérie
Les femmes autochtones et défenseures équatoriennes face à l’accord de libre-échange Équateur-Canada

Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité
Daniel Poulin-Gallant, criminologue, directeur chez Alter Justice Le Protecteur du citoyen (PC) joue un rôle bien particulier qu’il est important d’examiner. Créée en 1968 à la suite de l’adoption de la Loi sur le Protecteur du citoyen (LPC), cette organisation a le mandat de recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes des citoyen-ne-s envers l’administration publique1. Sa mission est d’assurer le respect des droits des citoyen-ne-s dans leurs relations avec les services publics ainsi que de veiller à l’intégrité et à l’amélioration desdits services. Le PC se veut donc, en quelque sorte, le chien de garde de la société vis-à-vis du gouvernement du Québec. [caption id="attachment_20273" align="aligncenter" width="448"] E-motion, Ya basta!, La liberté est l’oxygène de l’âme.
E-motion, Ya basta!, La liberté est l’oxygène de l’âme.Artistes : Caroline, Marie-Pier, Esther, Mélanie.[/caption] L’organisation a le rôle tout particulier d’être l’ombudsman correctionnel en ce qui concerne les prisons gérées par le gouvernement du Québec. Il surveille donc les instances de contrôle des populations criminalisées et de la gestion des sentences ordonnées par l’appareil de justice pénale. Autrement dit, le PC scrute les actions du ministère de la Sécurité publique et des établissements de détention afin de s’assurer qu’ils respectent leurs obligations légales et les droits des personnes incarcérées. Son rôle est similaire à celui des organismes parapublics que l’on retrouve dans d’autres provinces (Ombudsperson British Columbia, Alberta Ombudsman, Ombudsman Ontario, etc.).
Des constats récurrents
Dans ses rapports annuels – et ses rapports d’enquêtes spéciales – plusieurs constats reviennent de façon assez régulière, et ce, depuis au moins le début des années 1980. Il est question entre autres d’atteintes aux droits des personnes incarcérées prévus dans la Loi sur le système correctionnel du Québec et protégés par les Chartes québécoise et canadienne, de délais et d’attentes déraisonnables pour avoir accès à des services de base (soins de santé, programmes, visites, etc.) ainsi que de lacunes dans la gestion des sentences. Les rapports annuels d’Alter Justice, organisme en défense des droits des personnes judiciarisées et incarcérées, abondent en ce sens. Lorsque le PC reçoit des plaintes des citoyen-ne-s, en communauté ou en prison, une évaluation est effectuée afin de savoir si la plainte est recevable. La plainte peut ensuite être prise en compte et examinée, ou rejetée. Il arrive aussi qu’aucune suite ne soit donnée aux plaintes, parce que la personne plaignante qui était incarcérée a été libérée avant le traitement de sa plainte. En 2022-2023, un peu moins de 10 % des appels et des plaintes déposées au PC ont été considérées comme fondées. Cette faible proportion est constante depuis au moins 2018-2019. C’est donc dire que la majorité des plaintes sont jugées non fondées ou sont réorientées vers d’autres ressources externes2. Est-ce le rôle de l’organisation qui est mal compris par la population carcérale, comme on l’entend parfois, ou la situation appelle-t-elle plutôt à examiner le traitement des plaintes qu’effectue le PC et à envisager une réforme de son rôle ?L’opacité des travaux et enquêtes du Protecteur du citoyen en matière correctionnelle fait écho à l’opacité des services correctionnels du Québec. Comment faire, dans une telle situation, pour obtenir de l’information claire, précise et à grande échelle sur les réalités carcérales ?Cette question mérite d’être posée et fait écho aux expériences partagées par des femmes interviewées dans le cadre d’une recherche d’Ismehen Melouka (2021), candidate au doctorat en criminologie à l’Université de Montréal3. Les femmes rencontrées à l’Établissement de détention pour femmes de Laval (appelé le Leclerc) ont presque toutes mentionné que les processus de plaintes ne leur sont pas expliqués et que c’est souvent par les propos rapportés par d’autres détenues qu’elles s’informent. Les intervenant-e-s d’Alter Justice entendent aussi de tels témoignages dans leur pratique, et ce, assez régulièrement. Pourtant, l’information nécessaire à la défense de ses droits devrait être clairement offerte aux personnes incarcérées par les autorités carcérales. Des femmes interrogées par Melouka font également part du fait qu’elles se retiennent de formuler des plaintes, non seulement par manque de connaissances, mais également par manque de confiance, par peur de représailles par des agents correctionnels et d’autres détenues, ainsi que par crainte d’aggraver la situation. Et lorsque des femmes entreprennent un processus de plainte, plusieurs conséquences sont relatées, telles qu’une perte de privilèges (se promener librement, travailler et passer du temps à l’extérieur de la cellule) et des mesures disciplinaires non justifiées à leur endroit ainsi qu’à l’ensemble de leur unité (obligation d’effectuer des travaux, fouilles de cellules abusives et deadlocks). Nombreux sont les témoignages de personnes disant que « cela ne sert à rien » ou relatant que la situation problématique n’a pas changé à la suite d’une plainte. Le PC n’évalue pas l’appréciation des personnes incarcérées concernant son traitement des plaintes. En réponse à une demande d’accès à l’information, le PC déclarait en juin 2023 que « les personnes incarcérées ne sont pas sondées dans le cadre de [ses] sondages de satisfaction de la clientèle ». Mentionnons par ailleurs que les rapports annuels du PC ne font pas mention des problématiques sur lesquelles l’organisation se penche et de celles sur lesquelles elle refuse de se pencher. En effet, les rapports annuels et les informations rendues publiques sont avares de détails, outre quelques cas triés sur le volet et présentés dans des encadrés. Il est difficile dans un tel contexte de connaître la nature des informations transmises par l’équipe du PC aux personnes incarcérées et la pertinence de ces informations.
Visites des établissements de détention par le Protecteur du citoyen, 2015-2023
| Établissements | 2015- 2016 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023* | Total |
| Amos | 1 | 1 | |||||||
| Baie-Comeau | 1 | 1 | |||||||
| Montréal- Bordeaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Hull | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Leclerc-Laval | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| New-Carlisle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Percé | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Québec (homme) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Québec (femmes) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Rivières-des- Prairies (RDP) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Rimouski | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Roberval | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Sept-Iles | 1 | 1 | |||||||
| Sherbrooke | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Sorel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Saint-Jérôme | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Trois-Rivières | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Total | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 50 |
Peu de collaboration avec le communautaire
Les organismes travaillant en défense collective des droits mentionnent n’avoir pas ou peu de relation avec le PC. Aucune mention n’est faite sur le site Web du PC concernant une collaboration avec des organisations de la société civile, par exemple des organismes communautaires œuvrant pour la défense des droits des personnes incarcérées. La seule exception se trouve dans le plan stratégique 2023-2028, où il est fait mention de partenaires autochtones et inuit. Autrement, la seule mention d’organisations, sans en préciser la nature, se retrouve dans le processus de plaintes, signalant que celles-ci peuvent être déposées au nom de citoyen-ne-s. Cela suggère que pour le PC, le rôle des organismes communautaires se résume à une courroie de transmission des plaintes des populations visées. Cela donne une apparence de travailler en solo, tout en se souciant peu de la rétroaction des organismes sur le terrain, alors que ceux-ci soutiennent les personnes vivant des difficultés et peuvent identifier des problématiques systémiques au sein du système carcéral.Un manque de transparence
Le PC effectue très peu de visites des établissements de détention du Québec, ce qui soulève des questions sur son travail d’enquête. Selon des données obtenues par le biais de la Loi de l’accès à l’information4 par la Ligue des droits et libertés (LDL) et Radio-Canada, le nombre de visites annuelles, entre 2015-2016 et 2022-2023, est faible5. Au 28 août 2023, il y a cinq établissements de détention qui n’ont pas reçu de visite du PC depuis 2018-2019 ce qui inclut la période de la pandémie. Le PC ne rend pas publics ni les rapports sur les enquêtes qu’il effectue à la suite de plaintes, ni les rapports de ses visites des établissements de détention ou les enjeux sur lesquels il enquête : « […] les rapports produits suivant les visites demeurent confidentiels, tant pour les citoyens que pour les médias6 ». Cette citation provient d’un article journalistique au sujet de l’absence de visites à la prison de Hull en six ans, et la fin de non-recevoir opposée au journaliste ayant formulé une demande d’accès à l’information. Le Protecteur justifie ce refus de divulguer des documents et informations par le fait que ses enquêtes sont conduites privément en vertu de la LPC. « Les renseignements et documents obtenus lors d’une enquête sont confidentiels et inaccessibles, même pour la personne concernée » peut-on lire sur le site Web de l’organisation. L’opacité des travaux et enquêtes du PC en matière correctionnelle fait écho à l’opacité des services correctionnels du Québec. Comment faire, dans une telle situation, pour obtenir de l’information claire, précise et à grande échelle sur les réalités carcérales ? Cela est d’autant plus vrai sachant que plusieurs personnes incarcérées ne portent pas plainte lorsque leurs droits sont bafoués, par peur de représailles. Cette opacité est exacerbée par le peu de communications publiques du PC, en dehors de ses rapports annuels et des rapports spéciaux portant sur des enjeux spécifiques.Conclusion
La lecture des rapports annuels du PC permet de constater que l’institution prend au sérieux son rôle d’enquêteur des institutions publiques, notamment du milieu correctionnel. Il est indéniable que la société québécoise gagne à avoir un organisme public de surveillance des institutions publiques. Toutefois, l’opacité des processus et le manque de collaboration avec les acteurs communautaires sont le bât qui blesse. Comment faire confiance à une institution qui garde pour elle ses résultats d’enquête et qui les partage uniquement dans des contextes bien paramétrés ? Il est compréhensible de vouloir protéger la vie privée des personnes touchées par ces révélations, mais des façons de faire existent afin de garantir l’anonymat tout en alertant le public de situations problématiques. Une action pertinente de décloisonnement serait d’établir des relations de concertation avec les acteurs du milieu communautaire. Plusieurs voix demandent que des comités d’experts, des élu-e-s et des organisations de la société civile puissent également visiter de façon régulière et aléatoire tous les centres de détention du Québec. Alter Justice affirme même que ces visites devraient être faites plus souvent que le plan peu ambitieux annoncé par le Protecteur dans son rapport annuel 2023 qui est d’un minimum d’une fois aux quatre ans pour chaque centre de détention. Bref, il y a matière à se questionner sur la vision que le PC a de son rôle en tant qu’ombudsman correctionnel tout en exigeant beaucoup plus de transparence de sa part.- Ministères et organismes publics, réseau de la santé et des services sociaux, et services
- Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2022-2023, 124. Les autres catégories sont les plaintes interrompues et celles sur lesquelles le Protecteur déclare ne pas pouvoir se prononcer.
- I. Melouka, A., Manirabona, J-A. Wemmers, Un accès difficile et une mobilisation déficiente : rapport sur les expériences des femmes incarcérées et l’usage des mécanismes de plaintes et de griefs en établissement carcéral, Rapport, Université de Montréal, 2021.
- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
- Voici la réponse de la personne responsable de l’accès à la suite d’une question de la LDL demandant s’il existe une définition du mot visite : « Il n’y a pas de définition officielle de ce que constitue une visite d’un établissement de détention. De manière générale, ce genre de visite vise la grande majorité des secteurs, sans nécessairement inclure l’ensemble de ceux-ci. Il peut également arriver qu’une visite soit effectuée pour un mandat précis. Puisque nos enquêtes sont menées privément, nous ne pouvons détailler davantage tous les cas de figure. »
- C. Lalande, 2023, 22 septembre. Op. cit.
L’article Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
LIEUES : Quelque part sur la map
Napoléon Gratton
Une région ressource peut-elle dire non à un projet minier ?
Coupes budgétaires dans les cégeps
À quoi sert au juste le poste d’Amira Elghawaby ?

Lancement du numéro 101

Le 9 octobre 2024 à 18h30 on lance notre 101è numéro !
Ça se passe à la Coop l'Agenda (6692 rue St-Denis, Montréal). Bienvenue à toutes et à tous !
Le 9 octobre 2024 à 18h30, lancement double !
Numéro 101 de la revue À bâbord ! : Qui échappe à l'extractivisme ?
Livre L'antiwokisme en débats de Learry Gagné (Éditions de la rue Dorion)
À la Coop l'Agenda (6692 rue St-Denis, Montréal). L'événement Facebook est ici.
Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !
L’Islam au Népal : entre tolérance et défis contemporains

Qui échappe à l’extractivisme ?

Le 9 octobre 2024 à 18h30, lancement double !
Numéro 101 de la revue À bâbord ! : Qui échappe à l'extractivisme ?
Livre L'antiwokisme en débats de Learry Gagné (Éditions de la rue Dorion)
À la Coop l'Agenda (6692 rue St-Denis, Montréal). Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !
L'extraction des ressources naturelles est une affaire bien canadienne, mais aussi bien québécoise. On creuse des mines pour extraire les minerais du sol ; on coupe des forêts pour extraire les matières ligneuses ; on bâtit de grandes infrastructures hydroélectriques pour extraire l'énergie de la force hydraulique. Ce mode de « création de richesses », aussi destructeur soit-il, est rarement remis en question dans les sphères politiques. Pour preuve, dans les dernières années, la question de l'extraction du lithium s'est articulée autour de l'opposition privatisation/nationalisation de la ressource, plutôt que de générer un débat sur la validité de la filière batterie pour répondre aux enjeux bien réels liés aux changements climatiques. Est-ce que la perpétuelle extraction de ressources énergétiques règlera plus de problèmes sociaux et environnementaux qu'elle n'en créera ? Un pipeline peut-il vraiment être une réponse à la crise climatique ?
Au Canada, l'extractivisme est un paradigme dominant. C'est ce que ce dossier vous invite à considérer. L'extractivisme est aussi une manière de se comprendre collectivement : Chléo Pelletier nous montre comment le nationalisme québécois est indissociable de l'hydroélectricité, un mode tout particulier de prise de possession du territoire et d'affirmation nationale. Aujourd'hui, ce nationalisme énergétique semble vouloir se renouveler dans la foulée de la transition énergétique avec le Projet Saint-Laurent, que notre collaborateur Quentin Lehmann décortique pour nous. Jean-Philippe Sapinski nous amène quant à lui au Nouveau-Brunswick, où le tentaculaire empire des Irving s'est emparé de l'appareil médiatique et politique de la province. Dans les Prairies, ce sont les champs desquels on extrait, depuis des décennies, des ressources agricoles et énergétiques, ainsi que de la valeur spéculative. L'extraction de ressources s'est d'ailleurs construite sur tout un dense et complexe échafaudage financier. Dans une entrevue avec Divest McGill, nous nous rendons au cœur de la lutte qui cherche à pousser les institutions à retirer leurs investissements des combustibles fossiles. Enfin, le collectif de MiningWatch Canada nous offre une rétrospective de plus de 25 ans de militantisme contre l'extractivisme au Canada et à l'étranger.
Plus qu'un système économique, l'extractivisme, en tant que conception du monde, dérobe les vies. Dans un texte très documenté, Philippe Blouin nous fait le récit des enfances arrachées et monétisées des orphelins de Duplessis et des enfants autochtones pour lesquels les Mères mohawks luttent sans relâche depuis des années. À l'université, ce sont les savoirs autochtones que l'on extrait au détriment des communautés selon Geneviève Sioui.
Tous ces appels à la prudence, à la responsabilité et à la résistance nous enjoignent de déceler, de dénoncer et d'échapper à l'extractivisme sous toutes ses formes, partout où il se cache.
Dossier coordonné par Arianne Des Rochers, Miriam Hatabi, Louise Nachet et Samuel Raymond
Illustré par Elisabeth Doyon
Avec des contributions de Philippe Blouin, Catherine Coumans, Val Croft, Arianne Des Rochers, Viviana Herrera, Jamie Kneen, Quentin Lehmann, André Magnan, Diana Martin, Chléo Pelletier, Jean Philippe Sapinski, Geneviève Sioui et Rodrigue Turgeon
Illustration : Elisabeth Doyon

Contrer l’extrême droite au Canada

Le 9 octobre 2024 à 18h30, lancement double !
Numéro 101 de la revue À bâbord ! : Qui échappe à l'extractivisme ?
Livre L'antiwokisme en débats de Learry Gagné (Éditions de la rue Dorion)
À la Coop l'Agenda (6692 rue St-Denis, Montréal). Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !
Dans un an auront lieu les prochaines élections au Canada. Si l'échéance peut sembler lointaine, le résultat anticipé s'annonce inquiétant. L'avance de Pierre Poilievre et du Parti conservateur dans les sondages est si grande qu'elle pourrait être difficile à surmonter.
Le chef du parti a clairement montré ses couleurs : celle d'une droite radicale décomplexée qui s'inspire clairement, tant par ses politiques que par sa rhétorique ultra simpliste et alarmiste, des autres extrêmes droites dans le monde, notamment celle des États-Unis rassemblée derrière le délirant Donald Trump.
Cette montée de l'extrême droite est déjà une catastrophe. Elle facilite des reculs majeurs sur le plan de la justice sociale, de la protection de l'environnement et des droits des femmes, tout en déshumanisant et violentant des communautés déjà marginalisées (personnes de confession musulmane et personnes LGBTQ2S+, entre autres). Ainsi faut-il se réjouir des récents sursauts contre l'extrême droite dans le processus électoral en France et aux États-Unis.
Alors que le Rassemblement national se dirigeait vers une victoire quasi assurée aux élections législatives en France, les partis de gauche se sont unis en formant le Nouveau Front Populaire, laissant de côté ses nombreuses dissentions et réussissant, avec une rapidité surprenante, à s'organiser efficacement, ce qui lui a permis de devenir la première force politique de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, alors que l'élection de Trump semblait inéluctable tant les difficultés de Joe Biden étaient évidentes, l'arrivée de Kamala Harris et Tim Walz a créé un revirement majeur révélé à la fois par les sondages et par l'enthousiasme que suscite leur candidature.
Le Parti démocrate ne s'est jamais éloigné des élites financières, surtout dans les années néolibérales, avec les gouvernements de Clinton et d'Obama. Dans la dernière année, son appui indéfectible à Israël l'a même amené à se rendre complice d'une campagne génocidaire à Gaza. Sans espérer de miraculeux retournements, il faut toutefois reconnaître que sous l'inspiration de Bernie Sanders et de celles et ceux qui l'ont soutenu, les progressistes au sein du parti se font beaucoup mieux entendre, comme en témoigne la nomination de Tim Walz comme candidat à la vice-présidence.
Certes, les élections ont le plus souvent des résultats limités. Il nous a été démontré à tant d'occasions que l'alternance du pouvoir mène en fait à favoriser la même élite d'affaires qui parvient le plus souvent à obtenir ce qu'elle veut des gouvernements, peu importe leur allégeance. Cette complicité des gouvernements d'orientation libérale contribue à la popularité de discours d'extrême droite.
Les émeutes racistes et islamophobes en Grande-Bretagne de cet été illustrent bien les limites de la voie électorale pour barrer la route à l'extrême droite. Quelques semaines à peine après l'élection du Parti travailliste mené par le mièvre Keir Starmer, des regroupements haineux s'en sont pris violemment à des réfugié·es et des personnes musulmanes. C'est une imposante mobilisation citoyenne antifasciste qui a permis d'y mettre un frein.
Pour combattre le radicalisme de droite en politique, il semble donc clair que les partis de gauche sont les mieux placés pour répliquer, si on prend l'exemple de la France et des États-Unis. Les politiques néolibérales ne sont plus envisageables ; elles ont même pavé la voie à l'extrême droite.
Au Canada, les succès des conservateurs sont moins dus à l'attraction de leurs idées, qui n'ont pas encore été vraiment soumises au débat public, qu'à une réelle lassitude de la population après neuf ans de gouvernement Trudeau. Le discours démagogique de Pierre Poilievre se nourrit pleinement de cette situation et annonce des reculs majeurs dans de nombreux secteurs et pour plusieurs segments de la population.
Malgré les particularités de notre situation politique et les importantes difficultés que nous aurons à surmonter, l'exemple de la résistance à l'extrême droite en contexte électoral, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi au Brésil et en Pologne, entre autres, devrait nous inspirer pour éviter le pire. Nous avons encore un an pour nous préparer. Souhaitons que les mouvements de gauche canadiens sauront s'organiser et se mobiliser sur des bases unitaires, combattives, rassembleuses et inspirantes.

Sommaire du numéro 101

Le 9 octobre 2024 à 18h30, lancement double !
Numéro 101 de la revue À bâbord ! : Qui échappe à l'extractivisme ?
Livre L'antiwokisme en débats de Learry Gagné (Éditions de la rue Dorion)
À la Coop l'Agenda (6692 rue St-Denis, Montréal). Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !
Travail
Négociation ouverte à McGill. Tous·tes invité·es à la table de négociation / Alex Pelchat et Cloé Zawadzki-Turcotte
Le syndicalisme basque. Un cousin pas si éloigné / Thomas Collombat
Politique
Remontée du Parti québécois / Philippe Boudreau
Mémoire des luttes
Révolution québécoise. Une revue « pour l'établissement d'un véritable socialisme » / Alexis Lafleur-Paiement
Éducation
ChatGPT. Pour une résistance collective en enseignement / Philippe de Grosbois
Société
Grève sociale dans le communautaire. Écoeuré·es d'être méprisé·es / Hind Fazazi et Marie-Christine Latte
Logement social. Des leçons européennes d'ambitions / Chantal Desjardins et Clothilde Parent‑Chartier
Médias
Dans le ciel médiatique, L'Étoile du Nord brille / Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Samuel Raymond
Regards féministes
Écrire l'Histoire de la marge au centre… ensemble / Kharoll-Ann Souffrant
Mini-Dossier : Tour d'horizon sur les communs
Coordonné par Samuel Raymond et Marie-Soleil L'Allier
Des communs qui s'ignorent. Appel à la (re)connaissance et au (re)groupement des communs / Marie-Anne Perreault, Emanuel Guay et Christelle Fournier
Une introduction féministe aux communs / Charmain Levy et Chiara Belingardi
Les communs pour une souveraineté alimentaire / Christelle Fournier
Les communs libristes. Coincés entre privé et public / Yannick Delbecque
Communs, décolonisation et avenirs autochtones / Entretien avec Samantha Lopez Uri, Stella Warnier et Françoise de Montigny-Pelletier. Propos recueillis par Marie-Soleil L'Allier
Dossier : Qui échappe à l'extractivisme ?
Coordonné par Arianne Des Rochers, Miriam Hatabi, Louise Nachet et Samuel Raymond. Illustré par Elisabeth Doyon
Hydro-Québec. L'emblème du nationalisme québécois / Chléo Pelletier
Filière batterie. Transition en déroute / Quentin Lehmann
Nouveau-Brunswick. Au pays d'Irving / Jean Philippe Sapinski
Prairies canadiennes. Cultiver l'extractivisme / André Magnan
Divest McGill. Lutter pour responsabiliser nos institutions / Entretien avec Laura et Emily, membres de Divest McGill. Propos recueillis par Arianne Des Rochers et traduits de l'anglais par Amadou Ballo
Savoirs autochtones. Les minéraux critiques de la recherche universitaire / Geneviève Sioui
Enfances extraites. Mères mohawks et orphelin·es de Duplessis / Philippe Blouin
MiningWatch Canada. 25 ans de lutte contre les injustices / Catherine Coumans, Val Croft, Viviana Herrera, Jamie Kneen, Diana Martin et Rodrigue Turgeon
International
Élections aux États-Unis. Deux visions, deux mondes / Claude Vaillancourt
Sous les JO, le ravage / Louise Nachet
Trente ans d'insurrection au Chiapas
L'inaction face au génocide de la Palestine. Un acte de complicité / Rehab Nazzal et Norma M. Rantisi
Culture
Changer de classe sociale : trois modes d'emploi / Claude Vaillancourt
À tout prendre ! / Ramon Vitesse
Recensions
Couverture : Elisabeth Doyon

3 octobre : « Les Kings à Québec » : manif nationale de la Coalition Main Rouge

Le 3 octobre 2024 marquera le 2ème anniversaire de la ré-élection de la CAQ. Dénonçons ses choix budgétaires inégalitaires ! Alors que les Kings de Los Angeles arrivent en ville pour un match de hockey financé à même les fonds publics, rejoignez des dizaines d'organisations sociales, communautaires, syndicales et féministes pour défendre les services publics, les programmes sociaux et la justice sociale.
Les décisions de la CAQ favorisent les riches et le secteur privé : privatisation croissante, centralisation des pouvoirs en santé et en éducation, financement insuffisant du logement social, baisses d'impôts qui profitent aux plus fortunés, etc… Ces choix creusent les inégalités, entrainent plus de souffrance sociale, des files d'attente aux banques alimentaires et une augmentation des personnes en situation d'itinérance. La fiscalité doit redistribuer la richesse, pas la laisser s'accumuler dans les poches d'une minorité. La CAQ détourne les fonds publics et privatise nos services. Ça suffit !
La Coalition Main Rouge, RÉPAC 03-12, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches - CSN vous invitent à une grande manifestation à Québec. Faisons entendre notre voix !
📍Rendez-vous à Québec le 3 octobre 2024, à 12h00. Départ au Parc Cartier Brébeuf (175 Rue de l'Espinay), dans Limoilou.
🗓️Événement Facebook : https://facebook.com/events/s/manifestation-les-fonds-public/792891606150194/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La (très) grande évasion, film en tournée au Québec

À partir du 22 septembre, le film documentaire La (très) grande évasion, une enquête dévoilant les mécanismes des paradis fiscaux, entame une tournée à travers le Québec. Ce film offre une analyse approfondie de l'évasion fiscale permettent aux plus riches de dissimuler leur fortune, souvent au détriment des citoyens ordinaires.
🎤 Chaque projection sera suivie d'une discussion avec le philosophe Alain Deneault, auteur d'essais critiques, notamment sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie, il apportera un éclairage unique sur les enjeux abordés dans le film, favorisant ainsi une réflexion collective sur la justice fiscale et la responsabilité sociale.
📚 Vous pourrez retrouver une sélection des livres d'Alain Deneault, des éditions écosociété, en vente avant et après les projections.
📅 DATES ET LIEUX DE LA TOURNÉE
22 septembre à 13h - Carleton-sur-Mer — Studio du Quai des arts
23 septembre à 19h30 — Rimouski - Coopérative Paradis (Paraloeil)
24 septembre à 19h - Québec — Musée de la civilisation
26 septembre à 19h — Montréal — Cinéma Beaubien
Vendredi 27 septembre à 19h — Montréal — Cinémathèque québécoise - 🎟 COMPLET
28 septembre à 19h — Gatineau — Cinéma 9
30 septembre à 18h30 — Sherbrooke — Maison du cinéma
10 octobre à 19h00 - Caraquet – Cinéma du Centre Caraquet
27 novembre à 19h - Salaberry-de-Valleyfield — La Factrie, café culturel – contribution volontaire
📽 Du 27 septembre au 3 octobre - Cinémathèque québécoise, Montréal 📽
Billets disponibles ici.
📚 Vous pourrez retrouver une sélection des livres d'Alain Deneault, des Éditions Écosociété, en vente durant les projections.
Cette tournée est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires : Funambules Médias, la caisse d'économie solidaire Desjardins, le syndicat des metallos, l'AREQ, Échec aux paradis fiscaux, Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais, ATTAC Québec, les Éditions écosociété.

17 octobre : Manifestation – En lutte contre la pauvreté !

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre 2024, le Collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP-03) et le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) sont En lutte contre la pauvreté. Les groupes populaires vous invitent à une grande manifestation pour exiger un revenu et un toit qui permettent de vivre dans la dignité.
Les loyers continuent à augmenter drastiquement et les lignes aux banques alimentaires s'agrandissent de jour en jour. Pendant ce temps le gouvernement provincial réagit timidement avec une stratégie sur le logement qui investit très peu dans le logement social et une réforme d'assistance sociale qui n'augmente pas les revenus des personnes les plus pauvres de notre société. Dans le pire contexte inflationniste des dernières années, la CAQ préfère prendre parti avec les propriétaires et les patrons et privatiser les services publics. Nous devons rappeler au gouvernement qu'il se doit de lutter contre la pauvreté, sans quoi nous serons dans son chemin !
Quand : 17 octobre 2024, 15h
Où : Parc de l'Université de Québec
Tous les détails sur l'événement Facebook !
Affiche et tract en pièces jointes : PARTICIPEZ À L'ACTION DE COLLAGE DU CLAP-03 : Complétez la phrase Un revenu digne pour…/Un logement digne pour… et venez le 17 octobre coller vos messages.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

28 septembre : Journée internationale du droit à l’avortement

📢 SOS Grossesse Québec et SOS Grossesse Estrie vous invitent à vous mobiliser pour la Journée internationale du droit à l'avortement le 28 septembre 2024 à la Place de l'Université du Québec.
Faisons entendre nos voix pour garantir que ce droit soit accessible, sécurisé et respecté partout dans le monde ! Venez nombreuses et nombreux pour montrer notre solidarité et notre détermination ✊
Détails de l'évènement sur Facebook
Où : Place de l'Université du Québec, boulevard Charest Est
Quand : 28 septembre 2024 de 10h30 à 12h
Quoi : prise de paroles des organisateurs et d'invité‧e.s (avec interprétation LSQ), slogans, musique, distribution de matériel.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Extrait du mémoire du Front commun pour la transition énergétique sur le projet de loi 69

Nous publions si dessous le résumé fait par le Front commun pour la transition énergétique de son mémoire soumis dans le cadre de la discussion sur le projet de loi 69, Loi assurance la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.
Pour lire l'ensemble du mémoire du FCTE, cliquez sur l'icône
RÉSUMÉ
Plusieurs organisations ont analysé le projet de loi n° 69 (PL-69), Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, qui fait l'objet de consultations particulières devant la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles jusqu'au 19 septembre 2024. Ces organisations s'appuient sur une réflexion collective, préalable au projet de loi, qu'elles ont présenté dans un Manifeste pour un avenir juste et viable appuyé par plus de 200 signataires.
Compte tenu de la nature des propositions du projet de loi, qui touchent 15 lois et 7 règlements, ainsi que de leurs profonds impacts sur la société et l'environnement, nous sommes d'avis que cette réforme législative, dans sa forme actuelle, serait mal avisée. C'est pourquoi nous demandons de suspendre les procédures menant à son adoption et de retourner à la planche à dessin à la suite d'un réel débat public sur l'avenir énergétique du Québec.
- Le PL-69 ne mène pas à la décarbonation puisqu'il ne contient aucune disposition assurant l'abandon des énergies fossiles
- Le PL-69 favorise un développement industriel énergivore effréné
- Le PL-69 reporte injustement le coût de ce développement industriel sur les tarifs d'électricité
-
- Ce qui est une injustice sociale
- Et une injustice environnementale
-
- Le PL-69 aide le secteur privé à s'approprier notre patrimoine énergétique en ouvrant de nouvelles portes vers la privatisation d'Hydro-Québec ou d'une grande partie de ses actifs
- Le PL-69 aurait des impacts catastrophiques sur le territoire
- Le PL-69 ignore les mesures pourtant incontournables à prendre pour favoriser la sobriété collective :
-
- Nécessaire pour une transition énergétique moins coûteuse.
- Nécessaire pour respecter les limites des territoires.
- Nécessaire pour éviter le nucléaire.
-
- Le PL-69 repose sur des orientations qui n'ont jamais été présentées à la population et n'ont jamais été débattues ;
Nous croyons que l'ensemble de ces considérations justifient de lancer rapidement le débat de société qui devrait servir de socle au plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) que le gouvernement s'est engagé à élaborer, et de déposer un projet de loi sur l'énergie fondamentalement remanié, une fois cet exercice complété. ____________________________________________________________________________
INTRODUCTION
En vue du projet de loi n° 69 (PL-69), Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, la Coalition large sur l'énergie a rédigé un Manifeste pour un avenir juste et viable qui trace les contours des enjeux de la transition du système énergétique et présente 14 revendications :
1. Pour une énergie publique sous contrôle démocratique ;
2. Pour un débat sur l'énergie au Québec ;
3. Pour une nouvelle politique énergétique au Québec ;
4. Pour une planification intégrée des ressources ;
5. Pour des mesures qui favorisent la réduction des demandes en énergie ;
6. Pour des plans contraignants visant une sortie graduelle et prévisible, mais rapide des énergies fossiles ;
7. Contre le principe du pollueur-payé ;
8. Contre la privatisation totale ou partielle d'Hydro-Québec ;
9. Pour la sauvegarde et le renforcement des pouvoirs de la Régie de l'énergie ; 10. Pour une transition juste pour les travailleurs et travailleuses ;
11. Contre une augmentation des tarifs résidentiels d'électricité qui accentuerait la précarité et risquerait de ralentir la transition énergétique ;
12. Pour la protection du territoire ;
13. Pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones ;
14. Pour le consentement des populations locales ;
Plusieurs organisations ont analysé le PL-69 à la lumière de ce Manifeste. Le PL-69 fait l'objet de consultations particulières devant la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles jusqu'au 19 septembre 2024. Compte tenu de la nature des propositions, qui touchent 15 lois et 7 règlements, ainsi que de leurs profonds impacts sur la société et l'environnement, nous sommes d'avis que cette réforme législative, dans sa forme actuelle, serait mal avisée. C'est pourquoi nous demandons de suspendre les procédures menant à son adoption et de retourner à la planche à dessin à la suite d'un réel débat public sur l'avenir énergétique du Québec.
D'une part, le PL-69 ne contient aucune disposition assurant l'abandon des énergies fossiles. Il favorise un développement industriel effréné et fait reposer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques nécessaires à ce développement sur les tarifs d'électricité, ce qui constitue une injustice à la fois sociale et environnementale. Il ouvre de nouvelles portes vers la privatisation d'Hydro-Québec ou d'une grande partie de ses actifs. D'autre part, il risque d'avoir des impacts catastrophiques sur le territoire et il ignore les mesures pourtant incontournables à prendre pour favoriser la sobriété collective, tout cela sans que les orientations qui le sous-tendent aient été présentées à la population et aient été débattues.
Nous croyons que l'ensemble de ces considérations justifient de lancer rapidement le débat de société qui devrait servir de socle au plan PGIRE que le gouvernement s'est engagé à élaborer, et de déposer un projet de loi sur l'énergie fondamentalement remanié, une fois cet exercice complété.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
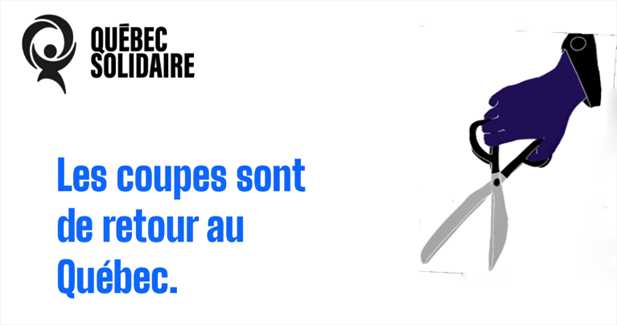
Ça commence à sentir l’austérité au Québec
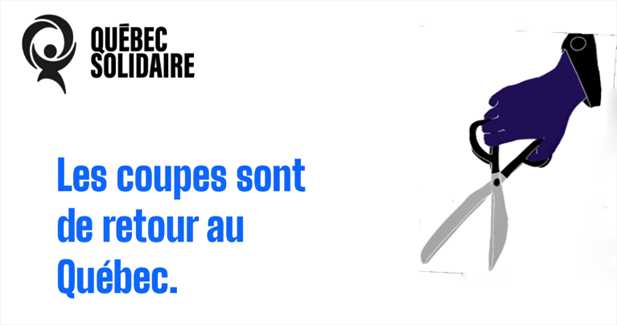
Nous publions un extrait du point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois e de Christine Labrie qui dénoncent la politique d'austérité du gouvernement Legault et appellent les citoyens et citoyennes du Québec à signaler diverses coupes sur un site que Québec solidaire a lancé à cette fin.
Transcriptioin : Secrétariat de l'Assemblée nationale
Gabriel Nadeau Dubois : Ça sent de plus en plus l'austérité, et ça, c'est une odeur que les Québécois puis les Québécoises n'aiment pas. On l'a vu, la semaine dernière, avec la démission de Youri Chassin, il y a des pressions internes de plus en plus fortes sur François Legault pour qu'il y ait des coupures rapidement, et on ne peut pas se permettre ça au Québec, on ne peut pas se permettre une autre ronde d'austérité. Nos services de santé et nos services d'éducation ne peuvent pas se permettre ça.
Et, ce matin, un article de Mme Lajoie qui vient alimenter les craintes de plusieurs Québécois, de plusieurs Québécoises. Dans plusieurs ministères au Québec, il y a des directives de coupures, de restrictions budgétaires qui commencent à être données. On se croirait de retour à l'ère Philippe Couillard. C'est ce que les gens sur le terrain commencent à dire. C'est très, très inquiétant.
On l'a vu dans les cégeps et dans les universités, on l'a vu dans le transport en commun, en francisation, il y a des coupures qui commencent au Québec. Donc, à Québec solidaire, on lance un appel à la vigilance de la population. Si vous voyez, autour de vous, des coupures dans un service public, allez sur servicescoupes.com et parlez-nous de ce que vous voyez sur le terrain. On a besoin, donc, de la vigilance des citoyens et des citoyennes pour faire le portrait de ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas se permettre ça, plus d'austérité au Québec, encore. Donc, si vous voyez de l'austérité, écrivez-nous.
Mme Labrie : Merci, Gabriel. Effectivement, les gens nous demandent souvent ce qu'ils peuvent faire pour nous aider dans notre travail de parti d'opposition ici, à l'Assemblée nationale. La meilleure façon de nous aider, c'est de nous transmettre de l'information sur ce qui se passe sur le terrain. Ce que vous voyez comme usagers des services, comme employés du secteur public, on veut le savoir. Parce que François Legault ne fera pas de communiqués de presse pour annoncer les coupures, il n'a pas le courage politique de faire ça puis de dire la vérité aux Québécois sur les décisions qu'ils sont en train de prendre par en arrière.
Donc, on a lancé ce site-là, servicescoupes.com. Déjà, on a reçu près de 150 témoignages, là, en quelques heures. Ça me fait penser à quand j'avais lancé un site, aussi, pour récolter des témoignages sur ce qui se passe dans le système d'éducation. Il y avait eu un bel engouement. Les gens veulent dénoncer ce qui les indigne sur le terrain, des témoignages qui parlent, par exemple, de postes qui ne sont pas remplacés en santé, de diminution de transport en commun. Donc, on va être très à l'affût de tout ça. On invite vraiment les citoyens et citoyennes à être à l'affût et à nous signaler ce qui se passe sur servicescoupes.com. On ne laissera pas la CAQ ramener l'austérité. On n'a même pas réussi encore à se rétablir au Québec de l'austérité libérale. On ne peut pas commencer des nouvelles vagues d'austérité.
******
Visite le site APPUYEZ QUÉBEC SOLIDAIRE :
https://appuyez.quebecsolidaire.net/services-coupes
Les coupes sont de retour au Québec.
Avec son déficit record de 11 milliards, le gouvernement caquiste de François Legault a commencé à couper dans les cégeps et les universités du Québec. Quelles seront les prochaines coupes à venir dans nos services publics ? Nous avons besoin de vous pour documenter la situation et alerter la population.
Si vous êtes témoin d'un service coupé sur votre milieu de travail, dans l'école de vos enfants ou dans les soins de santé de votre région, alertez Québec solidaire.
EXEMPLES
- Mon bus ou mon train passe moins souvent qu'avant
- L'école de mes enfants n'a plus de psychoéducatrice ou d'orthopédagogue
- L'éducatrice de ma fille est partie sans se faire remplacer
Personne ne veut revenir aux années sombres de l'austérité libérale. Aidez-nous à défendre les services de qualité auxquels nous avons droit au Québec.
VOUS ÊTES TÉMOIN D'UN SERVICE COUPÉ ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’armée israélienne attaque le siège d’Al-Jazeera en Cisjordanie et interdit sa diffusion pendant 45 jours

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024, dans le cadre d'un raid de grande ampleur sur la ville de Ramallah, les troupes israéliennes ont pris d'assaut le siège palestinien de la Chaîne de Télévision Al-Jazeera. Les soldats israéliens sont venus dans l'optique de délivrer une interdiction officielle de filmer et de diffuser des images de la Cisjordanie occupée pendant 45 jours.
Tiré de France Palestine Solidarité.
Le directeur du bureau, Walid Al-Omari, a même été expulsé du bâtiment en pleine retransmission en direct.

Les troupes israéliennes ont même communiqué et saisi du matériel audiovisuel et des dizaines de documents concernant de nombreuses enquêtes journalistiques. Pendant l'opération militaire, les troupes israéliennes ont même saisi les micros à nouveau au milieu d'une retransmission en direct.

La chaîne d'information a déjà eu à faire face à une immense répression de la part des autorités israéliennes. Sa diffusion a été interdite sur le territoire israélien, plusieurs de ses plus éminents journalistes ont été assassinés durant la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien à Gaza et ce à peine deux après l'assassinat de la journaliste Shireen Abou Akleh alors qu'elle couvrait une agression militaire israélienne à Jénine.
Sources : Syndicat des Journalistes Palestiniens / Alice Froussard / Younis Tirawi / Sami Abou Shahadeh / Al-Jazeera / Shireen Abu Akleh Foundation / Quds News Network
Photo : Sami Abou Shahadeh
Les troupes israéliennes lors de leur irruption au siège d'Al-Jazeera à Ramallah.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le discours biaisé de nos médias sur la Palestine

Israël en situation de légitime défense ?
C'est sans doute l'idée la plus farfelue dans le débat actuel. Le fait que des ministres, des premiers ministres, des éditorialistes, des chefs d'antenne répètent qu'Israël a « le droit de se défendre » après l'attaque du 7 octobre 2023 est un indicateur fort de l'intériorisation du récit israélien par les élites politiques et médiatiques en Occident, combinée à une incompréhension par ces élites de ce qui se passe sur le terrain.
18 septembre 2024 | tiré de l'Aut'journal
https://www.lautjournal.info/20240918/le-discours-biaise-de-nos-medias-sur-la-palestine
Ceux et celles qui font valoir le mythe selon lequel Israël ne fait que se défendre feignent d'oublier des données empiriques pourtant évidentes. Rappelons que depuis 1967, Israël occupe militairement les 22 % du territoire restant de la Palestine et prend des mesures quotidiennes pour consolider cette occupation. Il existe un large consensus mondial, y compris chez les alliés les plus fidèles d'Israël, voulant que les territoires palestiniens conquis, c'est-à-dire la Cisjordanie (incluant la partie arabe de Jérusalem) et Gaza, sont des territoires occupés militairement et qu'Israël n'a pas le droit de les conserver.
La quatrième Convention de Genève de 1949, qui protège les civils en temps de guerre, notamment en territoire occupé, est reconnue par l'ensemble des puissances occidentales comme étant applicable en Cisjordanie et à Gaza. Or, Israël installe sa propre population en territoire occupé, en violation de l'article 49 de cette convention. Rappelons aussi qu'Israël contrôle toutes les frontières de la bande de Gaza et lui impose un blocus qui l'étouffe depuis 17 ans.
Le droit international reconnaît aussi à un peuple occupé le droit de se défendre, y compris par la lutte armée. Ce sont donc les Palestiniens qui sont en posture de défense et non pas Israël, qui est clairement en posture d'agression. La guerre actuelle vise à maintenir l'occupation et à chasser le maximum de Palestiniens en rendant leur vie dans la bande de Gaza impossible. Si l'objectif réel était de faire disparaître le Hamas afin de se protéger, il y aurait une excellente façon de le faire : c'est de lui faire perdre sa raison d'être, en établissant une paix véritable et en mettant fin à l'occupation.
(…)
Des illustrations
Qu'on en juge par un indicateur fort : plusieurs mois après le début de l'offensive israélienne, les grands médias continuent de parler de la « guerre entre Israël et le Hamas » alors que le massacre intentionnel de civils (au moins les deux tiers des 35 000 personnes tuées) se déroule sous nos yeux.
Même si, de toute évidence, cette représentation du conflit est objectivement fausse, elle a été répétée en boucle, comme une incantation, et a fini par s'imposer dans l'imaginaire comme une évidence, une « vérité alternative » ou fake news.
En février 2024, j'ai écrit à un journaliste qui avait qualifié le massacre de « guerre entre Israël et le Hamas » pour lui demander combien de morts de civils ça prendrait pour qu'il accepte l'idée qu'il s'agit d'une guerre contre les Palestiniens, et non pas contre le Hamas.
En réponse, il a accepté de réaliser une entrevue avec moi sur la question. Or, la direction du journal a refusé de publier son article, sous prétexte qu'il ne tenait compte, selon elle, que d'un seul point de vue. Cela signifie que, même si c'est le point de vue d'Israël qui est repris en permanence et partout, dans les rares occasions où une autre perspective est présentée, il faut quand même rappeler le narratif dominant qui falsifie la réalité et le présenter comme la version légitime de l'histoire, même si celle-ci est contredite par les faits.
(…)
La hasbara
Ce n'est pas un hasard si le récit israélien a fini par s'imposer, à toutes fins pratiques, comme la « vérité par défaut ». Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : la culpabilité par rapport au génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, la proximité culturelle entre Israël et l'Occident, le fait que le projet sioniste est aussi un projet colonial occidental qui a été conçu et réalisé en collaboration avec les puissances occidentales, et les réalisations technologiques israéliennes qui en font un partenaire privilégié pour l'Occident.
Il y a toutefois un facteur supplémentaire qui joue un rôle important, à la fois dans le milieu des médias et auprès des élus : c'est la propagande systématique, bien organisée et bien financée d'Israël. Cette propagande fait partie intégrante de la stratégie de conquête de la Palestine, présentée comme une entreprise hautement morale.
Les stratèges sionistes l'ont appelée hasbara, ou « diplomatie politique », ou encore « explication » – un euphémisme pour dire propagande et désinformation. Israël a mis sur pied plusieurs programmes et institutions dont la fonction essentielle est la hasbara. Il existe, par exemple, un programme de bourses offertes aux jeunes citoyens juifs vivant à l'extérieur d'Israël, qui leur fournit des outils pour influencer leurs réseaux respectifs dans leur pays d'origine (surtout occidentaux).
Aux États-Unis, une initiative connue sous le nom de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) a pour fonction principale de s'assurer que les élus américains vont voter dans le sens souhaité par Israël sur toutes les questions qui le concernent : appui politique, aide militaire, coopération, etc. De nombreuses études se sont penchées sur l'influence de l'AIPAC. Or, les orientations politiques dominantes aux États-Unis, surtout celles des grands médias américains, établissent une norme suivie ailleurs dans le monde occidental.
Ce qui est affirmé de façon consensuelle par CNN, le New York Times ou le Washington Post devient ce qu'il est acceptable de dire, y compris au Canada. Cela ne s'applique pas aux chaînes telles que Fox News, qui se situe bien plus à droite que les autres. De plus, les orientations politiques sur le Proche-Orient associées à la mouvance démocrate – très biaisées en faveur des politiques israéliennes – sont généralement considérées comme « modérées » et le fait de s'aligner sur elles est vu comme un gage d'objectivité.
Ces orientations politiques affectent la couverture médiatique au Canada et en diverger est souvent interprété comme une marque de biais journalistique qui contrevient au code de déontologie. Si Radio-Canada, par exemple, s'aventurait à faire référence au système d'apartheid en Israël, ou au nettoyage ethnique, ou encore au génocide en cours, les journalistes responsables de la diffusion de cette nouvelle se feraient vite ramener à l'ordre par la haute direction de la société d'État et seraient sans doute blâmés par l'ombudsman. Même le simple fait d'inviter un expert qui proposerait une analyse critique d'Israël peut mettre les journalistes sur la sellette…
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quelles perspectives énergétiques pour le Québec

PTAG publie des vidéos de la rencontre organisée par l'Association Maurice Richard de Québec solidaire. Cette rencontre s'est tenue au Cégep Ahuntsic le 21 septembre dernier. Jean-François Blain (analyste indépendant en réglementation de l'énergie), Mélanie Busby (Front commun pour la transition énergétique) et Haroun Bouazzi (député de Québec solidaire dans Maurice-Richard) ont ouvert la rencontre. Cette dernière a été animée par Karine Cliche du Réseau Militant Écologiste (RMÉ). André Frappier nous a fait parvenir ses enregistrements vidéos de l'événement. Nous publions ci-dessous les vidéos de chacune de ces interventions.
Intervention de Jean-François Blain sur les orientations du gouvernement Legault en matière d'énergie
Intervention de Mélanie Busby du Front commun pour la transition énergétique
Intervention d'Haroun Bouazzi sur les ambitions des grandes entreprises du secteur de l'énergie et les réponses des groupes écologistes
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le GNR et ses « bibittes »

« Je roule au gaz naturel produit ici ». C'est le slogan qu'on peut lire sur les portières des véhicules de la ville de Saint-Hyacinthe.
Nous avons applaudi la mise en marche de cette usine de biométhanisation voilà déjà quelques années. La production de biogaz parfois appelé « gaz naturel renouvelable » (GNR) est une façon de retirer le méthane des matières putrescibles et de le réutiliser à la place du gaz fossile dit naturel. Cela fait partie du « cycle court » du carbone. Le résidu (appelé digestat) peut devenir un engrais utile.[1] D'un point de vue climatique, il vaut donc mieux brûler le méthane que le laisser filer vers le ciel. Donc, en théorie, récupérer le méthane qui serait éventuellement rejeté dans l'atmosphère et gérer utilement les boues de l'usine d'épuration sont de très bonnes idées.
À l'usage, on découvre quelques pépins. Le procédé de biométhanisation se fait dans un biodigesteur, sorte « d'estomac » géant où des millions de milliards de bactéries digèrent la matière organique. Normalement, ça va bien. Cependant, il arrive que les bactéries aient une « indigestion ».[2] Comme pour un être humain qui a une indigestion, l'entourage doit subir des odeurs et des rejets peu ragoûtants qui sont l'antonyme du bon goût. Dans un tel cas, nous sommes tentés de dire au malotru : « Va péter ailleurs ! »
L'utilisation des boues d'épuration dans une usine de biométhanisation est une bonne idée, mais parfois, elle dérange. Depuis le 30 mai, quatre articles, deux éditoriaux et deux lettres ouvertes du maire de Saint-Hyacinthe se sont retrouvés dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe pour faire état de ces problèmes. Comme dommages collatéraux, les odeurs intermittentes obligent la ville à geler le développement immobilier dans ce secteur pour trois ans sans oublier une poursuite judiciaire contre la ville par le groupe immobilier Robin.[3] Voilà quelques exemples concrets des désagréments que la biométhanisation peut faire subir au voisinage lorsqu'il y a des dérapages de ce procédé. En terre maskoutaine, nous avons présentement deux de ces usines qui sont en opération : celle de la ville sur la rue Girouard, et CTBM à Saint-Pie. On peut également penser à un projet de traitement du lisier que la Coop de Saint-Jean-Baptiste prévoit implanter à Saint-Damase.
Dans le cas de Saint-Pie, ce sont parfois des rejets d'une eau de couleur douteuse dans le ruisseau des glaises qui posent problème.[4] Pour respecter la qualité de l'eau qui sort de son usine, le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM ) expédie les résultats de 3 inspections par année à un laboratoire mandaté. Comme la compagnie n'enverra jamais des échantillons lorsque les « bactéries sont en grève », ces tests sont peu utiles. Des citoyens riverains ont demandé que des inspections soient faites sans préavis par ce laboratoire. La compagnie s'y objecte. Pourtant, une usine de filtration ou de purification de l'eau d'une municipalité doit fournir des tests de la qualité de l'eau quotidiennement. Pourquoi CTBM aurait-elle la présomption de fournir seulement 3 tests annuellement ? Tout comme à Saint-Hyacinthe, c'est la qualité de l'eau du bassin versant de la Yamaska et les citoyens qui vivent à proximité de l'usine qui subissent les contrecoups lorsque « ça va mal » !
Si elle est bien faite, la biométhanisation peut être une bonne manière de gérer les boues d'épuration et certaines matières putrescibles. Mais cette technologie sera toujours une façon marginale de produire du méthane. N'en déplaise à la publicité quasi-mensongère d'Énergir, cela ne représente qu'environ 1% de ce qui circule dans les tuyaux de la compagnie, même si on espère pouvoir augmenter ce ratio légèrement.[5] Bien sûr, cette production de méthane peut faire rouler la flotte de véhicules de Saint-Hyacinthe, mais c'est nettement insuffisant pour tous les besoins d'énergie du Québec, qu'ils soient thermiques ou électriques. Le reste du gaz dit naturel provient de la fracturation hydraulique. Donc, la très vaste majorité du gaz « naturel » d'Énergir est un carburant fossile dont l'empreinte totale est pire que celle du charbon. Alors, il faut prendre la publicité d'Énergir avec des pincettes [6] car, dans ce dossier et dans le cadre des changements climatiques, l'objectif est de gérer les boues et les lisiers sans oublier la qualité de l'eau de la Yamaska. La biométhanisation ne doit jamais être un remède qui soit pire que la pollution originale !
En recherche et développement, il est normal qu'une nouvelle technologie ait besoin d'une période de rodage avant d'être complètement à point. Dans une lettre ouverte en date du 13 juin, le maire de Saint-Hyacinthe, M. Beauregard affirmait que « la ville a décidé de s'attaquer à la situation afin de diminuer, voire d'enrayer, cette source de désagréments. » Le nez collectif des Maskoutains a bien hâte que ces améliorations deviennent réalité. Il en va de même pour les Saint-Piens !
Gérard Montpetit
membre du CCCPEM
le 8 septembre 2024
3] liste des parutions dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe depuis le 30 mai 2024 :
Le Courrier de Saint-Hyacinthe, édition du 30 mai 2024,
a) page 9, article par Sarah-Eve Charland « Les mauvaises odeurs reviennent de façon intermittente » ;
b) page 10, éditorial par Martin Bourassa dont le titre est « Que nous cache-t-on ? »
Le Courrier de Saint-Hyacinthe, édition du 13 juin 2024,
a) page 11, Lettre ouverte du Maire « Des travaux essentiels pour une gestion durable des eaux »
Le Courrier de Saint-Hyacinthe, édition du 15 août 2024,
a) page 15, article par Sarah-Eve Charland « Filière biométhanisation ; revoir les attentes » ;
b) page 16, article par Sarah-Eve Charland « Plus de questions que de réponses »
Le Courrier de Saint-Hyacinthe, édition du 5 septembre 2024,
a) page 10, éditorial par Martin Bourassa, dont le titre est « Le trop-plein » ;
b) page 11, Questions et réponses sur ce sujet par le maire de Saint-Hyacinthe, M. Beauregard,
sous le titre « Le maire fait le point » ;
c) page 15, article d'Adaée Beaulieu dont le titre est « La ville de Saint-Hyacinthe interdit l'ajout de
logements et de commerces dans ce secteur »
5] https://www.ledevoir.com/economie/770944/energir-rate-la-cible-de-1-de-gnr
6] https://www.energir.com/fr/a-propos/nos-energies/gaz-naturel/gaz-naturel-renouvelable/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les attentats d’Israël au Liban sont du terrorisme d’État

Le moins qu'on puisse dire c'est que la dernière vague d'attentats israéliens au Liban n'a guère suscité d'émotion dans les médias et les opinions publiques occidentales, qui les ont à peu de choses près présentés comme la riposte inévitable (voire justifiée) d'Israël aux actions que mène le Hezbollah contre Israël et au son soutien qu'il accorde au Hamas.
Tiré du site de la revue Contretemps. Article initialement publié sur le site de Jewish Voice For Peace : The Wire. Illustration : Wikimedia Commons.
Le 19 septembre, Le Monde titrait ainsi « le Hezbollah pris au piège dans son soutien au Hamas ». D'autres médias donnent complaisamment la parole à des spécialistes et des anciens agents du renseignement qui s'extasient devant cette prouesse du Mossad. Pourtant, même s'il est supposé viser des combattants ennemis, l'usage détourné d'appareils civils à des fins létales en dehors des zones de combat est illégal au regard du droit humanitaire, comme l'a rappelé le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans l'une des très rares déclarations de responsables d'organismes internationaux condamnant ces attentats.
La directrice pour le Moyen Orient et l'Afrique du nord de Human Rights Watch Lama Fakih a souligné de son côté que « le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'engins piégés, c'est-à-dire d'objets susceptibles d'attirer les civils ou associés à un usage civil quotidien normal, précisément pour éviter d'exposer les civils à un risque grave et de produire les scènes dévastatrices qui continuent de se dérouler dans tout le Liban aujourd'hui. Une enquête rapide et impartiale sur ces attaques doit être menée d'urgence. »
En effet, une proportion indéterminée (pour l'instant) des 3000 blessés et des dizaines de morts sont de simples civils, souvent des enfants, qui se trouvaient à proximité de utilisateurs des bipeurs ou des autres appareils piégés de télécommunications lorsque ceux-ci ont explosé, c'est-à-dire, la plupart du temps, dans des commerces, dans la rue, dans des espaces publics très fréquentés ou dans le domicile.
Selon Amnesty International, qui demande également une enquête internationale pour établir la responsabilité de ces attentats, « les éléments dont [nous] disposons indiquent que les bipeurs n'ont pas seulement été distribués à des combattants, mais probablement aussi à des employés d'institutions du Hezbollah qui travaillent à titre civil. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué publié le 17 septembre que les téléavertisseurs appartenaient à des ‘employés de diverses unités et institutions du Hezbollah'. Le ministre de la santé du Liban a déclaré à l'organisation qu'au moins quatre professionnels de la santé avaient été grièvement blessés lors de ces attaques. Deux d'entre eux (…) sont décédés des suites de leurs blessures ».
Le but premier de ces attentats est en effet de semer la terreur dans la population libanaise et préparer le terrain à des attaques d'ampleur, voire à une guerre en bonne et due forme, contre ce pays martyrisé à plusieurs reprises au cours des dernières décennies par les agressions et l'occupation infligées par Israël.
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le volet proprement militaire de ces actes terroristes, à savoir désorganiser temporairement une partie du système de communication du Hezbollah, tout en poursuivant les assassinats de ses figures dirigeantes. En ligne de mire, l'embrasement de toute la région et une guerre avec l'Iran, qui impliquerait les Etats-Unis et les puissances occidentales, objectif stratégique d'Israël, et tout particulièrement de Netanyahou, depuis plusieurs décennies.
Quant aux médias et aux responsables politiques, en France plus particulièrement, on notera leur silence, qui vaut complicité, face à ce terrorisme d'Etat. Les vies de civils libanais, arabes, musulmans, ne méritent aucun acte, même formel, de contrition ou de compassion. Seule exception, une fois de plus, parmi les formations représentées à l'assemblée, la France insoumise, qui souligne, dans son communiqué, que « ces actes de guerre ont touché indistinctement les personnes présentes autour des appareils piégés, tuant ou mutilant notamment des enfants.
Quelles que soient les justifications avancées, ces attaques constituent de nouvelles violations du droit international, et de la souveraineté du Liban ». Dans un message sur son compte X, Jean-Luc Mélenchon est encore plus explicite : « Netanyahou massacre à présent aussi au Liban. Après l'assassinat des porteurs de bipeurs, de nouveau des frappes visant à terroriser la population non-combattante ». Mais comme le Figaro, non sans malice, le relève : « Si La France Insoumise est rapidement montée au créneau, ses partenaires de gauche sont pour le moment bien silencieux ».
Les attentats ont également été vigoureusement condamnés à l'extrême gauche, notamment par le NPA, qui pointe dans son communiqué « le cynisme et la cruauté d'un État sans aucune limite et dont l'objectif principal est d'entraîner l'ensemble de la région dans une guerre totale et de poursuivre la colonisation effrénée de la Palestine et bientôt du Liban sud ».
Dans l'article qui suit, Madeleine Hall, responsable des médias numériques de Jewish Voice For Peace, le réseau de militant·es Juif·ves basé aux Etats-Unis qui se mobilise massivement contre le génocide à Gaza et en soutien du peuple palestinien, analyse la signification de ces attentats et pointe les responsabilités écrasantes des Etats-Unis, de leur politique étrangère et du poids de leur complexe militaro-industriel.
Stathis Kouvélakis
***
Israël a perpétré deux attentats terroristes au Liban cette semaine, amenant un peu plus la région entière au bord dela guerre totale. Ces actes sont ceux d'un État voyou et le résultat direct d'un sentiment d'impunité totale. Mardi et mercredi, ce sont den effet des milliers de bipeurs et de walkies-talkies chargés d'explosifs qui ont explosé dans tout le Liban. Les explosions ont eu lieu dans des supermarchés bondés, sur des routes très fréquentées, dans des maisons, des écoles et des hôpitaux. Cette vague d'attentats a mutilé plus de 3 000 personnes et tué au moins trente, dont des enfants.
« Israël n'a ni confirmé ni nié son rôle dans les explosions », rapporte le New York Times, « mais 12 responsablesactuels et anciens de la défense et du renseignement [des Etats-Unis] qui ont été informés de l'attaque affirment que lesIsraéliens en sont à l'origine, décrivant l'opération comme complexe et longue à mettre au point ».
Des voitures et des appartements ont été incendiés et les hôpitaux ont été submergés par des milliers de victimes. Comme les engins en question émettaient des signaux sonores répétés avant d'exploser, de nombreuses victimes les tenaient près de leur visage lorsqu'ils ont explosé, provoquant des blessures horribles.
Une grande partie des médias occidentaux s'est émerveillée de la soi-disant « précision » et de la « sophistication » de l'attaque, la présentant comme une opération destinée uniquement à cibler les membres du Hezbollah. C'est manifestement faux, car de nombreux civils ont été blessés et tués.
Le véritable objectif d'Israël était clair : susciter la peur et la panique au sein d'une population entière. Lors de la deuxième attaque, mercredi, des explosions ont été entendues pendant les funérailles de quatre personnes tuées laveille. Selon des informations non confirmées, des panneaux solaires et des distributeurs automatiques de billets ont également explosé lors des attentats. Les habitants de toutes les régions du Liban ont déclaré qu'ils avaient peur d'utiliser des appareils électroniques.
Il existe un mot pour cela : le terrorisme.
Netanyahou, la guerre sans fin pour rester au pouvoir
Les attentats terroristes perpétrés au Liban sont des actes qui pourraient entraîner toute la région dans la guerre, lesautorités israéliennes menaçant d'une invasion imminente le sud du pays.
Le génocide perpétré par Israël à Gaza a dévasté sa propre économie et suscité l'indignation et la condamnation de la communauté internationale. Pourtant, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a toujours intérêt à ce que la guerre s'éternise. C'est la raison pour laquelle il a à chaque fois fait échouer les négociations sur le cessez-le-feu, en insistant sur des conditions impossibles à satisfaire pour prolonger indéfiniment le génocide à Gaza.
C'est également la raison pour laquelle il tente d'entraîner toute la région dans une guerre plus vaste. Après tout, legouvernement israélien bombarde le Liban depuis le début du génocide à Gaza. Ces bombardements ont comporté de nombreuses attaques au phosphore blanc dans des zones peuplées, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. En octobre, quelques jours seulement après le début du génocide, une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué un reporter de Reuters et blessé six autres journalistes.
Netanyahou veut une guerre sans fin parce qu'il veut rester au pouvoir. Sa coalition gouvernementale est faible et elles'effondrera probablement lorsque l'assaut génocidaire d'Israël sur Gaza prendra fin. Une invasion du Liban entraînerait l'Iran et la Syrie dans la mêlée et transformerait le génocide de Gaza en une guerre sur plusieurs fronts. Il est alors probable que la coalition autour de Netanyahou puisse se maintenir et que son procès pour corruption soit évité.
La guerre signifie plus d'armes pour Israël et plus d'argent pour les entreprises de défense étatsuniennes
Les États-Unis ont déclaré qu'ils s'opposaient à toute nouvelle « escalade » et qu'ils soutenaient une « solution diplomatique » au conflit entre Israël et le Hezbollah. Quoi qu'en disent les responsables étatsuniens, une guerre d'Israël contre le Liban garantira à Israël davantage d'armes et de financements militaires américains – et remplira les poches des fabricants d'armes basés aux États-Unis.
Quand la région est au bord de la guerre, les entreprises de défense comme Lockheed Martin voient leurs actions grimper en flèche. Elles font, en effet, partie d'une industrie dont le chiffre d'affaires est de plusieurs milliards de dollars qui a tout intérêt à ce que la guerre s'éternise.
Voici comment cela fonctionne : les États-Unis envoient à Israël des milliards d'argent du contribuable qui sont ensuite utilisés pour acheter des armes sur le marché américain, produits par des industriels de l'armement basés aux États-Unis, qui exercent une influence énorme sur la politique étrangère et de défense des États-Unis et ont un impact massif sur leur économie.
Israël s'appuie sur un flux constant d'armes étatsuniennes pour maintenir un « état de guerre permanent », y compris son occupation militaire de plusieurs décennies sur des millions de Palestinien.nes et près d'un an degénocide à Gaza. En échange du soutien militaire et diplomatique indéfectible des États-Unis, Israël joue le rôle de pilier central de la domination américaine dans la région en protégeant ce que l'on appelle les « intérêts américains ». Les fabricants d'armes étant très influents, les « intérêts américains » s'alignent généralement sur ceux des entreprises basées aux États- Unis qui fabriquent les bombes.
Israël est un État voyou. S'il continue à bénéficier de l'impunité, il n'y aura que davantage de morts et de destructions. Le seul moyen de mettre fin au génocide à Gaza et d'empêcher une guerre régionale est que le gouvernement américain cesse d'armer Israël, un point c'est tout.
*
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump et les Haïtiens "mangeurs de chiens" : pourquoi son grand-père en a peut-être consommé

Histoire. En accusant les immigrés de "manger du chien", le candidat républicain a oublié que l'Allemagne, dont est originaire sa famille paternelle, a longtemps pratiqué la cynophagie. Et que les Etats-Unis doivent aux immigrés allemands le fameux "hot dog"…
Tiré de l'Express du 16 septembre 2024. L'auteur est directeur adjoint de la rédaction de l'Express.
« À Springfield, ils mangent des chiens, ils mangent des chats. Les gens qui viennent, ils mangent les animaux de compagnie des habitants ». En relayant, lors de son débat du 10 septembre face à sa rivale démocrate Kamala Harris, une fake news particulièrement grotesque sur les immigrés haïtiens qui se nourriraient d'animaux domestiques dans cette commune de l'Ohio, Donald Trump a provoqué une polémique comme il en a le secret. Mais l'ex-président américain a aussi mis en lumière un tabou, censé distinguer notre civilisation d'autres cultures jugées barbares : la cynophagie, ou le fait de manger de la viande de chien. En Occident prédomine aujourd'hui l'idée que ceux qui mangent des animaux canins, devenus les plus proches amis de l'homme, ne peuvent être que des cannibales.
Bas du formulaire
Le Vietnam, la Chine ou l'Afrique tropicale n'ont pourtant pas le monopole de la cynophagie. Il fut un temps, pas si lointain, où mettre un chien dans la casserole n'avait rien de honteux en Europe. L'ironie, c'est que le pays dont est originaire le grand-père de Donald Trump, l'Allemagne, a longtemps manifesté un véritable "amour" pour la consommation de chiens, attendant les années 1980 pour officiellement prohiber la pratique. Jusqu'à cette époque, des bêtes y étaient abattues dans des abattoirs contrôlés par l'Etat. Comme le rappelle le magazine Der Spiegel, qui cite l'ouvrage historique de Rüdiger von Chamier intitulé Hunde essen, Hunde lieben, "ce n'est qu'en 1986 que la loi a interdit de tuer les canidés (chiens) et les félidés (chats) pour obtenir de la viande".
235 144 chiens abattus en Allemagne entre 1905 et 1940
En Europe, la cynophagie a été particulièrement pratiquée en temps de crise. Au XIXe siècle, des scientifiques et autorités ont ainsi mis en avant les atouts protéinés et à bas coûts de la viande canine. "La nature et le goût de la viande de chien ne doivent pas donner lieu à un sentiment de dégoût. Elle peut être consommée sans inconvénient avéré en période de pénurie", déclarait par exemple en 1848 un vétérinaire nommé Höhning. Des boucheries canines se développent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le kilo de viande de chien coûte alors près de trois fois moins cher que celui de bœuf ou de porc. En France aussi, ces boucheries connaissent un essor durant la guerre franco-prussienne de 1870. "Quelques-uns nous quittèrent/Devant une boucherie canine/Pour y acheter leur repas du soir", témoigne le poète Guillaume Apollinaire dans Alcools en 1913.
A l'argument économique s'ajoute alors une croyance, répandue depuis des siècles, que la graisse de chien a des vertus curatives, notamment en cas de maladies des voies respiratoires. Selon une statistique officielle, 235 144 chiens sont abattus entre 1905 et 1940 en Allemagne, chiffre qui ne prend pas en compte les abattages clandestins. La consommation de viande de chien a particulièrement augmenté pendant la Première Guerre mondiale et la crise économique des années 1920. Amoureux des chiens, Hitler n'a rien fait pour empêcher cet abattage, se contentant d'introduire en 1933 l'obligation d'étourdissement pour les animaux de boucherie. Si le miracle économique allemand de l'après-guerre met un gros coup de frein à la consommation canine, ce n'est qu'en 1985 que le dernier abattoir de chiens, situé à Augsbourg, cesse son activité.
Le "chien chaud" des immigrés allemands
Aujourd'hui, manger du chien est devenu le tabou culturel absolu. Disparu en 2018, le prince Henrik de Danemark, époux de la reine Margrethe II, pourtant grand fan de teckels, avait fait scandale en avouant avoir mangé du chien, comparant son goût à celui du veau. Même le Parlement coréen vient, en début d'année, de voter à l'unanimité l'interdiction de la consommation de cette viande à partir de 2027, un tournant historique sous l'impulsion de la Premier dame Kim Keon-hee, ardente défenseuse du bien-être animal. Nommé "boshintang", le ragoût de chien était en Corée du Sud considéré comme un mets délicat, mais en perte de vitesse chez les jeunes générations. Pourtant, au cœur de l'Europe, en Suisse, la consommation de chien reste toujours autorisée à titre personnel et dans le cadre de l'usage privé. La pratique se perpétuerait discrètement dans des cantons ruraux. En 2014, une association de protection des animaux assurait qu'"environ 3 % des Suisses" mangeraient encore "en cachette du chat ou du chien". La viande de chien serait principalement utilisée pour faire des saucisses et de la graisse contre les rhumatismes.
L'autre ironie historique de la sortie de Donald Trump, c'est qu'au moment même où son grand-père Frederick Trump (né Friedrich Trumpf) émigrait du Palatinat vers New York en 1885, ce n'étaient pas les Haïtiens, mais les immigrés allemands qui, aux Etats-Unis, étaient associés à la viande de chien. A la fin du XIXe siècle, les saucisses dites Frankfurter se popularisent dans le sillage de l'importante vague migratoire venue des ports de Hambourg ou Brême. Mais la rumeur selon laquelle la viande de chien serait utilisée dans sa conception lui vaut rapidement l'appellation de "dog". En anglais, le terme "chien" comme synonyme de "saucisse" est ainsi utilisé depuis 1886.
Selon la tradition, c'est un boulanger originaire de Hanovre, Charles Feltman, qui, le premier à Coney Island, a commencé à vendre des saucisses dans des petits pains allongés, pratiques pour ne pas se brûler les mains. Cet aliment bon marché se répand, notamment via les matchs de base-ball, autre fleuron de la culture américaine. Le "hot dog", ancêtre des fast-foods, est né. En 1913, la chambre de commerce de New York a beau interdire l'utilisation de ce nom à Coney Island pour éviter une mauvaise publicité, le "chien chaud" devient l'une des gloires de la "gastronomie" américaine. Jusqu'à figurer, en 1939, au menu officiel d'un pique-nique organisé à New York par le président Roosevelt pour le roi George VI, au plus grand bonheur du souverain anglais.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité

Cette année, l'ONU a choisi pour thème de la Journée internationale de la paix (21 septembre) « Promouvoir une culture de paix ». Entre pays, cela implique minimalement l'exigence du respect du droit international et des droits humains par tous.
Depuis un peu plus de deux ans, les postures diamétralement opposées prises par le Canada face à la guerre en Ukraine, puis face à l'assaut génocidaire d'Israël contre Gaza, nous ont révélé à quel point son attachement au droit international et aux droits humains est factice et instrumentalisé.
Condamnations et sanctions contre la Russie
Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, le Canada et tous les pays occidentaux ont instantanément sonné l'alarme. La Russie viole « l'ordre mondial basé sur des règles », cible des infrastructures civiles, crée des millions de réfugié·e·s et des milliers de victimes civiles, annexe illégalement des territoires, etc. Toutes choses vraies, bien sûr… mais un seul côté de la médaille, occultant l'autre, celui de leurs propres responsabilités.
Le Canada a aussi immédiatement mis en branle tout un train de sanctions contre des proches collaborateurs du pouvoir, des « entités » financières de défense et d'énergie et des banques. Il a interdit les exportations pouvant profiter à l'armée russe et celles de services essentiels au fonctionnement des industries pétrolière, gazière et chimique de la Russie, etc. À peine une semaine après le début de la guerre, avec 38 autres États, le Canada a demandé au Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) d'enquêter sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Et deux mois plus tard, le Parlement canadien a adopté une motion condamnant « des actes de génocide contre le peuple ukrainien » !
Mais face à l'horreur sans fin à Gaza, rien de tout ça
Depuis octobre 2023, le blocus total et l'assaut monstrueux d'Israël ont à la fois réduit en ruines la bande de Gaza et plongé toute la population dans des conditions d'errance, de famine, d'insalubrité, d'épuisement et de traumatismes. En se basant sur les chiffres du ministère de la Santé, grandement sous-estimés selon plusieurs experts, on calcule aisément que plus de 3 600 civils ont été tués en moyenne chaque mois à Gaza, contre moins de 400 par mois en Ukraine (selon les chiffres de l'ONU). À Gaza, plus de 1 400 enfants ont été tués en moyenne chaque mois, contre 23 en Ukraine. Où sont les condamnations et les sanctions du Canada à la hauteur de ces crimes ?
À Gaza, selon les grandes organisations internationales humanitaires et de droits humains, l'échelle des violations du droit et des souffrances infligées aux humains est sans précédent. L'ampleur de la destruction généralisée des infrastructures est sans précédent. La rapidité avec laquelle toute une population a été plongée dans une situation de famine est sans précédent. Jamais une crise n'a vu autant d'agences et de rapporteurs spéciaux des Nations Unies sonner l'alarme. À répétition. Sans compter qu'en août 2024, l'organisation israélienne B'Tselem a publié un rapport intitulé « Bienvenue en enfer : le système pénitentiaire israélien, un réseau de camps de torture ». Où sont les condamnations et les sanctions du Canada à la hauteur de ces crimes ?
Dès le 13 octobre 2023, les organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme ont lancé un appel auxÉtats tiers à intervenir d'urgence pour protéger le peuple palestinien contre un génocide. Par la suite, de très nombreux experts internationaux, dont le dernier en lice est Omer Bartov, éminent historien de la Shoah et des génocides du 20e siècle, ont qualifié de génocide les actions israéliennes à Gaza.
De plus, la Cour internationale de Justice (CIJ) a statué, le 26 janvier 2024, qu'il était plausible qu'Israël commette des actes de génocide à Gaza. Le24 mai, elle a ordonné à Israël de cesser son offensive militaire à Rafah. Le 20 mai, le procureur du TPI, Karim Khan, a demandé des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le premier ministre et le ministre de la Défense israéliens. Pour toute réponse, Israël a qualifié la CIJ et le procureur du TPI d'antisémites.
Où sont les condamnations et les sanctions du Canada pour s'acquitter de sa responsabilité de prévenir un génocide en vertu de la Convention internationale dont il est signataire à cet égard ?
Instrumentalisation des droits et répression
Face à tout cela, donc, le Canada n'a rien fait de ce qu'il a fait dans le cas de l'Ukraine. Que devrait-on en comprendre ? Simplement, que face aux violations commises par des rivaux stratégiques (Russie, Chine) de l'hégémonie étasunienne, ou face à des pays qui refusent cette hégémonie (Cuba, Iran, Venezuela), le Canada et les autres pays occidentaux – menés en cela par les États-Unis, maître d'œuvre de l'OTAN – montent une propagande, dénoncent et sanctionnent tous azimuts. Alors que face aux violations d'un allié, coupable de pire, on regarde ailleurs, on feint la compassion pour les victimes, on répète des paroles creuses ad nauseam et on ne fait rien.
Pour défendre l'indéfendable, on va même plus loin : on vilipende celles et ceux qui dénoncent sans relâche les crimes d'Israël et la complicité du Canada, en assimilant leur action à de l'antisémitisme, et on les réprime.
Notre devoir d'humanité et notre survie
Les tendances lourdes à l'œuvre au Canada et dans les autres sociétés occidentales sont antinomiques d'une culture de paix. Rhétorique de confrontation avec les pays « menaçant » l'hégémonie occidentale, militarisation et course aux armements accélérées, montée du racisme, de la xénophobie, de l'islamophobie et de l'intolérance au sein de nos sociétés, tout cela gangrène de plus en plus notre commune humanité et nos chances de survie comme espèce, advenant une troisième guerre mondiale vers laquelle on semble vouloir absolument nous mener !
Promouvoir une culture de paix, c'est d'abord et avant tout avoir le courage de s'opposer à ces courants de toutes nos forces. Et cela passe urgemment par la solidarité grandissante avec le peuple de Palestine, la dénonciation du génocide et du soutien inconditionnel de nos gouvernants à Israël.
Jean Baillargeon
Judith Berlyn
Martine Eloy
Raymond Legault
Suzanne Loiselle
– Porte-paroles du Collectif Échec à la guerre
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Ville que nous voulons appuie le Collectif Avenir Saint-Patrick

Le collectif _La Ville que nous voulons_ a pris connaissance récemment d'un projet visant à récupérer l'école Saint-Patrick qui sera transférée dans un nouvel établissement en contruction ce qui devrait permettre la réalisation de projets utiles pour le quartier à la suite du transfert de l'école de la rue de Maisonneuve en 2027.
Le _Collectif Avenir Saint-Patrick propose les objectifs suivants :
* Bâtir des logements abordables et sociaux organisés en cooporative d'habitation
* Préserver et bonifier l'espace vert public qu'est la cour de l'école
* Intrégrer des principes écologiques dans l'aménagement de la coopérative et du centre communautaire
* Mettre ce lieu à l'abri de la spéculation immobilière et le collectiviser
* Renforcer et bonifier l'offre en services communautaires dans le quartier, au sein d'une structure à but non lucratif
* Devenir un pôle, un lieu dynamique et rassembleur, un acteur important de la vie du quartier
* Conserver et valoriser le patrimoine bâti, ainsi que l'héritage culturel anglophone des lieux
Ces objectifs rejoignent parfaitement ceux du Collectif La ville que nous voulons. En ce qui concerne le logement il est bien connu que de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens se voient privé.e.s d'un logement abordable et coopératif ce qui les place dans une situation de pauvreté inacceptable.
Notre société est confrontée à des enjeux majeurs : réchauffement climatique, inégalités sociales et économiques, aménagements axés en fonction des projets des promoteurs, démocratie déficiente, pour ne citer que les plus criants. De nombreuses organisations sociales agissent à longueur d'année pour défendre les intérêts de la population avec des succès mais aussi avec des difficultés dues à une vision dépassée du pouvoir municipal actuel qui piétine sur les questions urgentes comme le transport collectif, la construction de logements sociaux, l'aménagement viable et une densification intelligente sur l'ensemble du territoire, la protection des terres agricoles présentes à Québec, etc.
Le projet proposé pour l'avenir de l'école Saint-Patrick permet d'apporter une contribution au renforcement de la vie sociale et solidaire dans ce secteur important et vivant de Québec. La Ville de Québec devrait donc soutenir le projet du Collectif _Avenir Saint-Patrick_ notamment en prenant les dispositions afin de garantir l'acquisition des lieux par les organisateurs des projets de ce Collectif.
Il est donc essentiel d'exprimer notre appui à ce projet et d'inviter le plus grand nombre d'organismes et de personnes à faire de même.
– - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour plus d'information communiquez avec le courriel suivant :
villequenousvoulons@reseauforum.org
à l'attention de Serge Roy
xxxxxxxxxxxxxx
Voici également l'accès à une lettre d'appui que vous pouvez signer et transmettre à titre personnel au Collectif Avenir Saint-Patrick :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBkkc5TKja0UHHDeDxFpEimp9_DTzUa1pZpcYrIjMoxXynhA/viewform
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

VJI condamne la campagne de terreur menée par Israël au Liban

Ces derniers jours, une campagne de terreur a semé la désolation et la mort au Liban. Mardi, une explosion coordonnée de téléavertisseurs dans tout le Liban a fait 12 morts, des centaines de personnes dans un état critique et des milliers de blessés. Mercredi, une explosion coordonnée similaire d'appareils de communication tels que des téléphones et des « talkies-walkies » a fait 14 morts et des centaines de blessés.
19 septembre 2024 IJV Canada
Bien que les autorités israéliennes n'en aient pas encore assumé la responsabilité, plusieurs rapports ont confirmé que l'explosion avait été orchestrée et planifiée des mois auparavant par les services de renseignement israéliens.
Plusieurs médias grand public et experts ont déformé cette campagne de terreur israélienne contre la population civile du Liban en la présentant comme une attaque ciblée et sophistiquée contre de hauts responsables du Hezbollah. Nous savons que ce n'était pas le cas. L'attaque israélienne sur les méthodes de communication a visé et tué des civils, dont Fatima Abdullah, âgée de 9 ans.
Certains responsables canadiens, comme l'ancien conseiller spécial sur l'antisémitisme de l'université d'Ottawa, Artur Wilczynski, ont fait l'éloge du déploiement de terreur qu'Israël a déclenché au sein de la société libanaise. Des groupes de pression pro-israéliens tels que le CIJA ont également publié des déclarations faisant l'apologie de la mort et de la destruction engendrées par la campagne de terreur israélienne. Soyons clairs : le meurtre indiscriminé de civils et l'utilisation d'infrastructures civiles comme armes létales sont des crimes au regard du droit international.
La démission de M. Wilczynski est la première étape d'un mouvement plus large de responsabilisation des fonctionnaires et des lobbyistes, et la confirmation que le public canadien et les Juif.ve.s canadiens n'accepteront jamais l'idée que le recours à la terreur est digne d'éloges.
Bien que les actions d'Israël doivent être dénoncées avec la plus grande fermeté, ces crimes n'ont malheureusement pas reçu la condamnation universelle qu'ils méritent.
Alors que nous sommes sur le point de marquer le premier an du génocide israélien contre le peuple palestinien de Gaza, la campagne meurtrière d'Israël semble s'étendre à la Cisjordanie et aux pays voisins tels que le Liban. Les crimes du gouvernement israélien risquent d'embraser toute la région.
Le Canada doit condamner cet acte d'agression israélien et sa campagne visant à terroriser la population civile du Liban. Le Canada doit prendre toutes les mesures diplomatiques, politiques et économiques nécessaires pour sanctionner les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par Israël à Gaza, en Cisjordanie et au Liban.
Le gouvernement canadien doit honorer ses obligations internationales, condamner la campagne de terreur d'Israël et prendre les mesures nécessaires pour prévenir d'autres violences en sanctionnant Israël et ses dirigeants civils et militaires, qui ont violé les normes les plus élémentaires du droit international humanitaire.
VJI se tient aux côtés du peuple libanais à la suite de ces horribles attaques et continuera à travailler avec ses allié.e.s en vue d'un avenir meilleur empreint de justice, d'égalité et de paix pour tous.tes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











