Derniers articles

Aysenur Ezgi Eygi abattue par les FDI comme une « incitatrice »

Aysenur Ezgi Eygi défendait la justice pour la Palestine. Pour Israël elle a été abattue « par les tirs non ciblés et non intentionnels des FDI qui visaient un incitateur clé » ! « Mort aux incitateurs » : Daniel Hagari, porte-parole des FDI. « un meurtre de sang froid » ? Une incitatrice ? Mais alors les manifestant.es à Tel-Aviv : des incitateurs et incitatrices ?... Gideon Levy, Haaretz.
Tiré du blogue d'Yves Romain.
Quand les FDI disent « Mort aux incitateurs », c'est ainsi qu'une manifestante américaine est tuée
(When the IDF Says 'Death to Inciters,' That's How an American Protester Gets Killed)
Gideon Levy, Haaretz, 11 septembre (Traduction DeepL)

Les FDI sont redevenue l'armée la plus morale du monde. Quatre jours seulement se sont écoulés depuis que ses soldats ont tué la militante américaine des droits de l'homme Aysenur Ezgi Eygi, avant que l'enquête approfondie lancée par l'armée ne s'achève, aboutissant à la conclusion purificatrice que « le civil a été touché par les tirs non ciblés et non intentionnels d'une force des FDI qui visait un incitateur clé ». Des tirs non ciblés et non intentionnels qui visaient... Vous avez compris ? J'en doute.
Pendant que le porte-parole des FDI descendait le long d'une corde dans une vidéo montrant le tunnel dans lequel six otages avaient été exécutés, afin de montrer au monde les terribles conditions dans lesquelles ils avaient été détenus (quand nous emmèneront-ils à la base militaire de Sde Teiman pour nous montrer les conditions choquantes de détention des Palestiniens menottés et kidnappés qui s'y trouvent ?) les soldats de sa propre unité étaient en train de reconstituer l'explication alambiquée du meurtre criminel d'une femme innocente.
Il est inutile de rappeler que cette enquête approfondie n'avait pour but que d'apaiser les Américains, dont le président s'était dit « troublé » par l'assassinat d'un citoyen de son pays. Ne vous inquiétez pas, l'annonce contournée de l'armée suffit à apaiser les inquiétudes présidentielles. La dernière chose qui dérange la Maison Blanche, c'est l'assassinat d'une militante qui s'identifie aux Palestiniens. Ceux qui auraient dû être troublés par cette explication sont ceux qui ne s'intéressaient pas à toute l'histoire au départ : les Israéliens.
Le porte-parole des FDI a déclaré : mort aux incitateurs. Des soldats ont tiré sur un incitateur pour l'exécuter, touchant par erreur un autre incitateur. Ce sont des choses qui arrivent. En d'autres termes : un changement radical des règles d'engagement, maintenant officiellement déclaré.
Si, par le passé, il était nécessaire de prouver la présence d'un danger, il suffit aujourd'hui de discerner l'incitation. Et qui est au juste un incitateur ? Quelqu'un qui appelle à la libération du peuple palestinien lors d'une manifestation ? Quelqu'un qui demande le démantèlement de l'avant-poste imprudent d'Evyatar ? Quelqu'un qui manifeste pour ses droits sur sa terre ? En d'autres termes : Lorsque les soldats de Tsahal discernent une incitation, ils tirent désormais pour tuer l'instigateur, sur ordre.

Comment l'avons-nous dit ? L'armée la plus morale du monde. Il est fort douteux que le porte-parole de l'armée russe ose admettre que son armée a tiré pour tuer des incitateurs.
Pour les soldats de l'armée de propagande du porte-parole Daniel Hagari, « l'incitation », quelle qu'elle soit, est une raison d'exécuter quelqu'un. Tout ce qui reste à prouver, c'est la mauvaise maîtrise du tir des soldats, qui visaient un incitateur (le « principal ») mais en ont touché un autre. Rien n'est plus facile que de qualifier la militante américaine d'incitatrice : Elle était en faveur de la justice pour les Palestiniens. Les procédures seront affinées et les soldats seront envoyés au stand de tir pour s'entraîner davantage. Veuillez vérifier les passeports avant la prochaine exécution. Il vaut mieux ne pas frapper les Américains. Personne n'enquêtera sur l'assassinat d'une jeune Palestinienne de 13 ans le même jour, dans un village voisin. Personne n'est troublé par cette affaire. Peut-être qu'elle aussi incitait à la violence alors qu'elle se tenait à sa fenêtre ?
Un soldat tire pendant une manifestation et un manifestant est tué. Quoi de plus normal ? Mais notre collègue Jonathan Pollak, qui se trouvait dans le village lors de la fusillade, affirme que les soldats ont abattu l'activiste 20 minutes après la fin des affrontements. Si c'est le cas, il s'agit d'un meurtre de sang-froid. C'était la première et dernière manifestation d'Aysenur Aysenur's first.
Mais ce qui devrait vraiment nous préoccuper, c'est le sous-texte de l'annonce du porte-parole des FDI : L'incitation est une cause d'exécution. Mais l'incitation a plusieurs visages. Si un appel à la liberté des Palestiniens est une incitation passible de la peine de mort, on s'engage sur une pente glissante. Pourquoi la police n'est-elle pas autorisée à tuer les incitateurs des manifestations de la rue Kaplan ? Et que dire des plus grands incitateurs au sein du gouvernement et des médias, qui appellent à « raser » Gaza ou à « tondre la pelouse », estimant que les habitants de cette région méritent tous de mourir. Tireurs d'élite, ouvrez le feu. Vous avez été autorisés à le faire par Hagari.
Gideon Levy, Haaretz, 11 septembre (Traduction DeepL) https://www.haaretz.com/opinion/2024-09-12/ty-article-opinion/.premium/when-the-idf-says-death-to-inciters-thats-how-an-american-protester-gets-killed/00000191-e21d-d119-a1db-e2dd45c60000
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël recrute des demandeurs d’asile africains pour ses opérations à Gaza, selon “Ha’Aretz”

Selon une information du journal israélien de gauche “Ha'Aretz”, l'État hébreu aurait mis en place un système de recrutement de demandeurs d'asile afin qu'ils s'engagent dans le conflit à Gaza en échange de l'obtention d'un statut de résident permanent.
Tiré de Courrier international.
“Les institutions de la défense en Israël proposent à des demandeurs d'asile africains qui contribuent à l'effort de guerre à Gaza une aide à l'obtention de la résidence permanente en Israël”, révèle Ha'Aretz. Le quotidien israélien de gauche s'appuie sur des documents internes et des sources citées sous le couvert de l'anonymat.
Près de 30 000 demandeurs d'asile originaires d'Afrique vivraient actuellement en Israël – dont 3 500 Soudanais, dont le pays est en proie à un violent conflit interne. Trois demandeurs d'asile sont mortslors des attaques du 7 octobre menées par le Hamas, rappelle le journal.
“Des responsables de la défense ont compris qu'ils pouvaient avoir besoin de l'aide des demandeurs d'asile et les inciter en exploitant leur souhait d'obtenir la résidence permanente en Israël. […] Les dimensions éthiques n'ont pas été envisagées”, continue Ha'Aretz.
Aucun document délivré
Pour illustrer la procédure de recrutement, le journal retrace l'expérience d'un homme désigné par la lettre “A.”. Durant “l'un des premiers mois de la guerre”, celui qui dispose d'un statut de réfugié temporaire reçoit un appel d'un homme se présentant comme un policier lui demandant, sans explications, de se rendre sur un site des forces de sécurité. Sur place, il rencontre ce qu'il définit comme des “hommes liés à la sécurité”. A. raconte à Ha'Aretz :
- “Ils m'ont dit qu'ils cherchaient des personnes particulières pour s'engager dans l'armée. Ils m'ont dit que cette guerre était une question de vie ou de mort pour Israël.”
D'autres prises de contact s'ensuivront, dont une où on lui aurait proposé 1 000 shekels (environ 240 euros) en liquide pour couvrir les jours de travail qu'il a perdus à cause de ces entretiens. Finalement, A. déclinera l'offre d'engagement.
Contrairement à A., d'autres demandeurs d'asile se sont engagés avec Tsahal et ont participé à des opérations militaires dans la bande de Gaza, dont la nature précise n'est pas détaillée par Ha'Aretz. Et le quotidien de préciser que, “à ce jour, aucun demandeur d'asile ayant contribué à l'effort de guerre n'a obtenu de papiers”.
Le journal a également appris que le ministère de l'Intérieur avait aussi étudié la possibilité d'enrôler dans l'armée les enfants de demandeurs d'asile scolarisés dans des écoles israéliennes. “Il est déjà arrivé que le gouvernement autorise les enfants de travailleurs étrangers à s'engager dans l'armée d'Israël en échange de papiers pour les membres de leur famille immédiate.”
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sacrifier ou libérer les otages ? Les manifestantEs israéliens ont choisi leur camp

Pour Benyamin Netanyahou, les manifestations de masse qui ont éclaté dans tout le pays visaient à le renverser, lui et son gouvernement. Cet objectif a été explicitement énoncé par presque toutEs les orateurEs montés sur scène lors de la principale manifestation à Tel Aviv, où plus de 300 000 IsraélienNEs ont envahi les rues après que l'armée a récupéré les corps de six otages de Gaza. […]
Hebdo L'Anticapitaliste - 720 (12/09/2024)
Par Meron Rapoport
Crédit Photo
Itai Ron/Flash90
La libération des otages avant tout
Dans l'ensemble, l'opposition à la poursuite de la guerre n'est pas motivée par des préoccupations morales : les actions génocidaires d'Israël à Gaza n'ont pas été mentionnées, et aucun appel à la réconciliation ou à la paix avec les PalestinienNEs n'a été lancé. Les manifestantEs se préoccupent avant tout de leurs concitoyenNEs détenuEs à Gaza et réclament un « Deal Now » qui aboutirait à leur libération. Néanmoins, ces appels ont une portée considérable.
Même dans l'éventualité d'un cessez-le-feu temporaire qui faciliterait un premier échange d'otages et de prisonnierEs, tel que celui envisagé par l'accord actuellement sur la table, il semble que Netanyahou craigne la difficulté à renouveler l'effort de guerre, une fois l'armée retirée des corridors de Philadelphie et de Netzarim, et après que des centaines de milliers de PalestinienNEs auront été autorisés à retourner dans le nord de la bande de Gaza. […]
Les manifestantEs ne croient pas que l'arrêt de la guerre, du moins à ce stade, constitue une menace pour leur existence, contrairement à ce que prétendent Netanyahou et ses porte-parole depuis les premiers jours des combats. Bien au contraire, ils et elles perçoivent la poursuite de la guerre comme une menace directe pour la vie des otages et, dans une certaine mesure, pour la leur. C'est le sens subversif de l'appel au « Deal Now », même si toutes celles et ceux qui l'ont lancé n'en ont pas compris l'implication.
Un choix entre « Deal Now » et « Sacrifice Now »
La droite israélienne continue d'affirmer que ce n'est pas le corridor Philadelphie qui fait obstacle à un accord, mais plutôt le chef du Hamas Yahya Sinwar et ses conditions impossibles. La plupart des analystes israélienNEs de haut niveau en matière de sécurité rejettent désormais cet argument, insistant plutôt sur le fait que ce sont les conditions fixées par Netanyahou, sous la pression de Bezalel Smotrich et d'autres membres de l'extrême droite de son gouvernement, qui sabotent l'accord — même après que le Hamas a surpris Israël en acceptant une proposition qu'Israël avait lui-même soumise. […]
Le choix est maintenant, quoique tardivement, clair pour tous et toutes : poursuivre la guerre indéfiniment en mettant en danger la vie des otages ou mettre fin à la guerre pour les libérer. La droite israélienne choisit la première solution, tandis que les centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue estiment qu'aucun objectif de guerre ne vaut le sang des otages. […]
Il est difficile de prévoir si cette large mobilisation débouchera sur un changement politique ; cela dépendra de nombreux éléments sans rapport avec le mouvement de protestation, y compris la pression américaine. Le défi est énorme : non seulement renverser un gouvernement et contrecarrer son projet législatif, mais aussi arrêter la guerre la plus longue et la plus sanglante de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Mais un refus massif d'accepter le récit qui vient d'en haut est un premier pas important — et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Meron Rapoport, le 4 septembre 2024, traduction JB pour l'Agence Media Palestine
À lire en intégralité : « Sacrifier ou libérer les otages ? Les manifestantEs israéliens ont choisi leur camp » https://agencemediapales…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gouvernance du Hamas plus unie qu’on ne veut le croire

Les médias ont mal compris le fonctionnement du Hamas, opposant de façon simpliste le “modéré” Haniyeh au “radical” Sinwar. En réalité, le processus décisionnel du Hamas est infiniment plus structuré. Sur l'image ci dessus Yahya Sinwar (à droite) et Ismail Haniyeh (à gauche) en mars 2017, lors des funérailles d'un responsable du Hamas.
Tiré de MondAfrique.
Après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, l'organe consultatif suprême du mouvement, le Conseil de la Choura, a rapidement et unanimement choisi Yahya Sinwar pour lui succéder. Au moment de son assassinat, Haniyeh avait pris les rênes du Hamas dans les négociations de cessez-le-feu avec les médiateurs, et de nombreux analystes ont affirmé que l'ascension de Sinwar marquait une rupture totale avec les politiques de Haniyeh et d'autres membres du bureau politique de haut rang.
Une grande partie de cette analyse repose sur des informations erronées.
Elle trahit une compréhension superficielle non seulement des dirigeants du Mouvement de résistance islamique (Hamas), mais aussi de la résistance dans son ensemble. L'hypothèse selon laquelle le leadership de Sinwar constitue une rupture avec le passé suit une tendance de l'analyse occidentale à considérer les dirigeants palestiniens selon des schémas vagues et simplistes tels que “faucon contre colombe” ou “modéré contre partisan de la ligne dure”. Ces étiquettes cachent plus qu'elles ne révèlent.
La fixation sensationnaliste sur la psychologie de Yahya Sinwar ne fait qu'aggraver ce vice d'analyse. Cette approche réduit la complexité de la politique à des personnalités et suppose que la prise de décision du Hamas est largement dictée par les individus plutôt que le produit de débats internes et d'élections sérieuses, de délibérations et de consultations complexes, et d'une responsabilité institutionnelle.
Malgré ces insuffisances dans le débat général, il convient néanmoins d'examiner dans quelle mesure le mandat de Sinwar sera différent de celui de Haniyeh en tant que chef du bureau politique. S'agit-il là d'un signe de rupture ?
Défier l'isolement
Pour évaluer la question de la rupture, il convient d'examiner certains parallèles dans les trajectoires de Haniyeh et de Sinwar. Au niveau le plus évident, chacun d'entre eux a fini par devenir chef du gouvernement de Gaza, puis chef du bureau politique du Hamas. Nés dans les camps de la bande de Gaza au début des années 1960, Haniyeh et Sinwar sont venus au monde en tant que réfugiés, une existence fondée sur l'exclusion, la dépossession et la marginalisation. En dépit de ces réalités, les deux dirigeants ont rejoint le mouvement islamique à Gaza et se sont retrouvés encore plus isolés et marginalisés : Haniyeh s'est exilé dans la ville libanaise de Marj al-Zouhour en 1992, et Sinwar a été emprisonné en 1988 et condamné l'année suivante à une quadruple peine de prison à perpétuité. Ces difficultés n'ont pas empêché ces deux dirigeants de développer non seulement leurs propres compétences politiques, mais aussi de jouer un rôle dans le développement du Hamas lui-même.
Dans les conditions difficiles de son exil à Marj al-Zouhour, Haniyeh a acquis de l'expérience dans la coordination des actions avec les Palestiniens en dehors du Hamas, dans le renforcement des liens avec le Hezbollah et la coopération avec les États arabes et la communauté internationale, notamment par l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant au retour des Palestiniens, ce qu'ils ont réussi à faire un an plus tard. Cette expérience de la diplomatie et de la négociation avec les groupes palestiniens suivra Haniyeh plus tard dans sa carrière. En 2006, Haniyeh est devenu le tout premier Premier ministre palestinien démocratiquement élu. Bien que la mise en échec de ce gouvernement d'unité palestinienne ait conduit à des combats intenses entre factions, et au début du blocus israélien de Gaza, il a passé des années à œuvrer en faveur de la réconciliation et de l'unité nationales, en plus de ses actions au niveau diplomatique.
Depuis sa prison, Sinwar a continué à développer les capacités de contre-espionnage du Mouvement, un processus lancé avec la création de l'“Organisation de sécurité et de sensibilisation” connue sous le nom de “Majd” en 1985, dans le but de fournir une formation en matière de sécurité et de contre-espionnage, et d'identifier les collaborateurs présumés. Lorsque Sinwar est arrêté en 1988, un mois seulement après le début de la première Intifada, il a été accusé d'avoir exécuté douze collaborateurs ayant renseigné l'occupant. En tant que prisonnier, Sinwar a poursuivi sa mission de renforcement du contre-espionnage du mouvement et de développement des compétences des prisonniers palestiniens. Il parle couramment l'hébreu et est un lecteur passionné. Cette expertise a eu un impact sur le développement du mouvement au fil du temps, et a contribué à consolider la place de Sinwar en tant qu'autorité du mouvement en prison.
Un chapitre important et mieux connu de l'expérience politique de Sinwar est son rôle clé dans les négociations qui ont permis la libération de plus de 1 000 prisonniers palestiniens en 2011, dont Sinwar lui-même, en échange de Gilad Shalit, un soldat israélien capturé par des combattants des Brigades Qassam en 2006. Un aspect moins connu du temps passé par Sinwar en prison est le soin avec lequel il s'est engagé et a rallié les Palestiniens au-delà des lignes de faction dans le cadre des grèves et des protestations dans les prisons. Immédiatement après sa libération, il a été en mesure d'utiliser ces compétences pour créer un effet de levier auprès d'Israël, et trouver des points d'unité avec les Palestiniens d'autres factions.
Les négociations après la prison
Peu après son retour à Gaza, Sinwar a été élu au bureau politique du Hamas en 2012. Cinq ans plus tard, il est élu à la tête de la direction du Hamas à Gaza, succédant à Ismail Haniyeh en 2017. Les premières années de Sinwar à Gaza sont souvent évoquées comme une période au cours de laquelle le Hamas a resserré les rangs en interne, et s'est engagé dans des campagnes publiques contre la collaboration avec Israël, bien que sous une forme assez différente des premiers jours de Majd.
Moins médiatique et moins sujet à la dramatisation, Sinwar s'est également engagé dans plusieurs négociations complexes qui ont influencé la trajectoire du mouvement en tant que chef de la direction basée à Gaza.
Dix ans après le début du blocus israélien sur Gaza, les difficultés quotidiennes de deux millions de Palestiniens commençaient à empirer en 2017, lorsqu'une série de décisions de Mahmoud Abbas a accentué l'impact économique de l'isolement de Gaza. En mars 2017, l'Autorité palestinienne (AP) basée à Ramallah a réduit les salaires des employés de l'AP à Gaza jusqu'à 30 %, et en juin, les salaires des prisonniers palestiniens “déportés” à Gaza en 2011 ont été complètement supprimés. Ensuite, dans un geste controversé considéré comme une mesure de punition collective, Abbas a effectivement coupé l'approvisionnement en carburant de Gaza en annulant une exonération fiscale, provoquant une crise énergétique qui a réduit l'approvisionnement en électricité disponible pour les Palestiniens de Gaza d'environ huit à quatre heures par jour. Par la suite, la seule centrale électrique de Gaza a été contrainte de fermer.
Dans un geste qui a pris de nombreux observateurs de court, Sinwar a conclu un accord avec l'ancien chef des forces de sécurité préventive de l'Autorité palestinienne, Muhammad Dahlan, afin de résoudre les crises provoquées par les changements de politique opérés à Ramallah. Dahlan, né comme Sinwar dans le camp de réfugiés de Khan Younis, est devenu un dirigeant clé du Fatah jusqu'à ce qu'il se brouille avec la direction du parti en 2011, et s'est ensuite installé aux Émirats arabes unis. L'idée d'un accord entre le Hamas et celui qui a mis en œuvre les souhaits de l'administration Bush de perturber le gouvernement d'unité palestinienne dirigé par le Premier ministre récemment élu, M. Haniyeh, était inconcevable au début de la scission entre Gaza et la Cisjordanie, il y a dix ans. Les questions intérieures et régionales exigeaient cependant que les dirigeants du Mouvement s'adaptent, et Sinwar était prêt à discuter.
L'accord Hamas-Dahlan a connu un succès limité, mais il a mis en évidence deux aspects essentiels du mandat de Sinwar à la tête de la bande de Gaza : aplanir les divergences avec d'autres secteurs politiques et sociaux palestiniens, et équilibrer les relations extérieures dans un nouveau paysage régional. Plus précisément, grâce à ses liens étroits avec les gouvernements des Émirats arabes unis et de l'Égypte, Dahlan a obtenu l'entrée de carburant par le point de passage de Rafah. Ce point est important, car les relations entre l'Égypte et le Hamas étaient les plus tendues au début du premier mandat de Sinwar à la tête de la bande de Gaza.
Au fil du temps, Sinwar a pu continuer à apaiser les tensions avec l'Égypte dans les mois et les années qui ont suivi. En s'appuyant sur les mobilisations populaires palestiniennes indépendantes connues sous le nom de Grande Marche du retour (2018-19) et sur une tentative ratée du Mossad d'infiltrer et de placer des équipements de surveillance à Gaza en novembre 2018, la direction du Hamas a obtenu un certain nombre de concessions qui ont atténué l'impact du blocus israélien sur Gaza, notamment un assouplissement des restrictions sur les déplacements au point de passage de Rafah avec l'Égypte, un plus grand nombre de camions transportant des marchandises et de l'aide entrant quotidiennement à Gaza, et de l'argent liquide pour payer les salaires des fonctionnaires.
Il est largement reconnu que M. Sinwar a joué un rôle majeur dans l'amélioration des relations du Hamas avec les autres membres de l'“Axe de la résistance” après que la direction du Hamas a quitté Damas en 2012 au milieu du soulèvement et de la guerre civile en Syrie. Le rôle de Sinwar dans l'amélioration et la renégociation des relations du Hamas avec d'autres acteurs régionaux en dehors de ses alliances étroites n'est pas aussi largement reconnu. L'accent mis sur ses liens avec l'“Axe” limite la discussion sur le leadership de Sinwar dans les limites d'un certain courant idéologique, mais sa volonté de négocier signale une approche plus élaborée de l'équilibre des puissances régionales que ne le permettent ces étiquettes arbitraires.
Sinwar et ses prédécesseurs
Deux concepts stratégiques du lexique politique du Hamas – le cumul et la concertation – sont essentiels pour comprendre le fonctionnement du mouvement et de ses dirigeants. Toute compréhension du mouvement en général, ou du mandat de Sinwar sur Gaza en particulier, doit prendre en compte ces composantes indispensables du dynamisme institutionnel et du pouvoir en constante évolution du Hamas.
La notion de cumul est couramment utilisée pour décrire les avancées militaires au fil du temps. Il est également utile de considérer ce phénomène en termes de compétences et d'expérience politiques que les dirigeants du Hamas apportent à la table des négociations pour résoudre les questions difficiles de la gouvernance sous blocus, pour répondre aux besoins humanitaires en situation de siège, aux phases d'isolement régional, aux étapes de la construction et de l'étalonnage d'alliances régionales et à la réconciliation nationale avec les autres factions palestiniennes. Poser les bases des succès politiques et des avancées militaires se prête plus souvent à la continuité qu'à la rupture.
La concertation définit les pratiques et les structures les plus efficaces au sein du Hamas. Le mouvement dispose d'organes consultatifs à différents niveaux qui fonctionnent comme des structures de responsabilité et de conseil pour la direction politique. Les membres sont élus et représentent les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, de la diaspora et des prisons. L'organe consultatif de haut niveau, le Conseil général de la Shura, nomme les membres d'un organe indépendant qui coordonne et supervise les élections du Bureau politique afin de garantir la transparence. Bien que peu d'informations sur ces structures soient rendues publiques, un scénario d'urgence comme pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh a révélé que le Conseil général de la Choura nomme un successeur dans des circonstances exceptionnelles (Sinwar a été élu à l'unanimité).
La pratique et la structure de la consultation ne se limitent pas à l'aile politique du Hamas. L'aile militaire du mouvement, les Brigades Qassam, dispose également de procédures de consultation – en fait, Sinwar a joué le rôle de coordinateur entre l'aile militaire et l'aile politique après avoir rejoint le Bureau politique. Zaher Jabareen, qui a créé les Brigades Qassam dans le nord de la Cisjordanie, a expliqué que les récits sur la centralisation de l'appareil Majd sont inexacts, car les décisions ne sont pas entre les mains d'une seule personne – elles font l'objet de procédures en plusieurs étapes, ainsi que d'enquêtes supplémentaires menées par un “dispositif professionnel” distinct. M. Jabareen a fait remarquer qu'il existe de sérieuses clauses de responsabilité en cas de mauvaise gestion par les services de sécurité.
Suivant cette même dynamique, lorsqu'un dirigeant comme Sinwar ou Haniyeh prend une décision majeure, non seulement il y parvient après avoir consulté des personnalités compétentes, mais il est également responsable devant les groupes d'intérêt au sein du mouvement ou de la société en général qui font pression sur lui pour qu'il prenne une décision. En tant que chefs de la direction et du bureau politique de Gaza, Sinwar et Haniyeh ont travaillé ensemble, et ont souvent participé à des réunions publiques avec divers groupes d'intérêt afin de les rallier à la réconciliation nationale. Pour eux, la réconciliation nationale ne consistait pas seulement à faire amende honorable auprès du Fatah et à unir le corps politique palestinien, mais aussi à combler d'autres formes de fossés politiques, ainsi que les problèmes sociaux et socio-économiques à Gaza. Tout cela pour se préparer à la bataille à venir, acquérir la force militaire, le soutien populaire et l'unité politique nécessaires. Il semble que les consultations se fassent à la fois du haut vers le bas et du bas vers le haut.
Les déclarations de Sinwar et de deux de ses prédécesseurs montrent comment le cumul des pouvoirs et des réalisations a favorisé la continuité entre chaque nouvelle ère. Khaled Meshaal a défini les priorités de son dernier mandat lors d'une interview en mai 2013 :
– la résistance
– le recentrage de Jérusalem comme cœur de la cause palestinienne
– la libération des prisonniers
– la lutte pour le droit au retour et le rôle de la diaspora dans la lutte
– la réconciliation nationale entre les factions palestiniennes qui unit et rassemble le corps politique palestinien autour de la résistance
– l'engagement de la nation arabe et islamique
– l'engagement de la communauté internationale aux niveaux populaire et officiel, et
– le renforcement des institutions internes du Hamas, l'extension de son pouvoir et l'ouverture du Mouvement vers d'autres formations palestiniennes, et vers d'autres Arabes et Musulmans en général.
La remarque de M. Meshaal concernant les prisonniers mérite d'être soulignée. Il les a décrits comme la “fierté de notre peuple”. Lorsqu'on lui a demandé des détails sur le plan visant à garantir leur liberté et s'il impliquait la capture d'autres soldats israéliens, Meshaal a refusé de s'étendre sur le sujet. Deux mois plus tard, le renversement du gouvernement Morsi en Égypte allait complètement bouleverser le mode de fonctionnement du Hamas, ce qui a probablement entraîné un rééquilibrage de la direction du bureau politique. Malgré les défis que cela représentait pour le Hamas, juste un an plus tard, lors de la guerre israélienne de 51 jours contre Gaza en 2014, des combattants Qassam ont pénétré en Israël, visant ses bases militaires à au moins cinq reprises, et ont capturé deux soldats lors des combats. Aujourd'hui, cette logique de cumul et de continuité se retrouve dans les déclarations des dirigeants du Hamas qui expliquent que l'objectif de l'opération du 7 octobre consistait à capturer des soldats israéliens en vue d'un échange de prisonniers.
Au début du dernier mandat de Meshaal, lui et Haniyeh ont publiquement rejeté les rumeurs de tensions entre eux. Ces rumeurs ont persisté au fil des ans, sans que l'on accorde suffisamment d'attention aux messages cohérents de chaque dirigeant, témoignant de priorités communes.
La vision, les messages et les priorités partagés se sont poursuivis avec Haniyeh à la tête du Bureau politique. Après la guerre israélienne de 2021 contre Gaza, surnommée “La bataille du glaive de Jérusalem” par les Palestiniens – coïncidant avec un soulèvement palestinien connu sous le nom d'“Intifada de l'unité” qui s'est propagée de Jérusalem à la Cisjordanie, aux citoyens palestiniens d'Israël et aux communautés de réfugiés palestiniens au Liban et en Jordanie – Ismail Haniyeh a prononcé un discours de victoire qui souligne le rôle central de la continuité et du cumul au sein du Mouvement.
M. Haniyeh a qualifié la bataille de “victoire stratégique” et a déclaré que la suite “ne ressemblera pas à ce qui a précédé”, ajoutant qu'il s'agit d'une “victoire divine, stratégique et complexe” sur le plan de la scène nationale palestinienne, de la nation arabe et islamique, des masses mondiales et de la communauté internationale. Le discours a mis l'accent sur le cumul des atouts et l'engagement des priorités et des efforts des époques précédentes du mouvement, qui ont permis d'aboutir à cette victoire. Il préfigurait également les changements majeurs à venir.
Dans la période précédant le 7 octobre, Sinwar a prononcé un discours dans lequel il déclarait :
“Dans une période de quelques mois, que j'estime ne pas dépasser un an, nous forcerons l'occupant à faire face à deux options : soit nous la forçons à appliquer le droit international, à respecter les résolutions internationales, à se retirer de la Cisjordanie et de Jérusalem, à démanteler les colonies, à libérer les prisonniers et à assurer le retour des réfugiés, pour parvenir à la création d'un État palestinien sur les terres occupées en 1967, y compris Jérusalem. Soit nous plaçons cette occupation dans un état de contradiction et de conflit avec les règles de l'ordre international, nous l'isolons de manière extrême et puissante, et nous mettons fin à son intégration dans la région et dans le monde entier, en nous attaquant à l'effondrement constaté à tous les niveaux de la résistance au cours de ces dernières années. «
Dans ce contexte, il faut se demander si Sinwar est vraiment aussi imprévisible que le prétendent les experts. Ces déclarations viennent également contredire la présentation de l'ascension de Sinwar comme étant en rupture totale avec le passé du mouvement.
Le Hamas en tant que médiateur
La personnalité de Yahya Sinwar a fait l'objet d'un sensationnalisme dans les médias occidentaux (et même arabes). D'une manière générale, les débats sur le Hamas reposent souvent sur des rumeurs, des insinuations et des affirmations non fondées qui tendent à accentuer les désaccords entre les différents membres de la direction du mouvement, en opposant les dirigeants aux “modérés favorable à la diplomatie et les négociations” aux “faucons militants”. En examinant certains aspects des carrières de Sinwar et de Haniyeh, on comprend mieux que si les personnalités et les spécificités du parcours de chacun des dirigeants ont un impact sur leur prise de décision, ce n'est qu'une part de la façon dont ces dirigeants, et le mouvement dans son ensemble, prennent des décisions.
Au fil des ans, le Hamas a démontré sa capacité à tirer parti de la diversité du parcours de ses dirigeants pour renforcer ses capacités sur les fronts militaire, politique, diplomatique et populaire. Enraciné dans les principes de consultation et de cumul, le Hamas est à la fois un mouvement horizontal, et un mouvement composé d'institutions. Des institutions efficaces telles que le Conseil de la Choura ont aidé le mouvement à traverser des moments d'incertitude, comme l'assassinat d'Ismail Haniyeh.
C'est le dernier exemple en date du dynamisme et de la flexibilité institutionnels du Hamas, sans commune mesure avec l'histoire de la construction institutionnelle des factions palestiniennes.
Dans ce contexte, ce qui peut apparaître comme des différences significatives entre dirigeants peut devenir une véritable force pour le mouvement, lui permettant d'équilibrer les exigences parfois contradictoires de divers groupes, en particulier dans son processus de prise de décision à des niveaux élevés de surveillance, sous la menace constante de l'assassinat et de l'emprisonnement de ses dirigeants, et dans les attaques permanentes contre ses structures et ses institutions.
Il ne s'agit pas de nier qu'il existe parfois des désaccords entre les dirigeants du mouvement, qui ont existé depuis la création de l'organisation en 1987. Cependant, le Hamas est aussi un mouvement doté d'institutions, de procédures et de mécanismes de responsabilité. La règle générale a été la consultation, le cumul et l'équilibre entre les besoins des différents groupes d'intérêt. La preuve en a été donnée publiquement et de manière cohérente dans les messages des dirigeants de l'organisation, non seulement tout au long de la guerre génocidaire en cours, mais tout au long de ses 37 ans d'histoire.
À la suite de l'opération “Al-Aqsa Flood” du 7 octobre 2023 et du génocide qui s'en est suivi à Gaza, de nouvelles questions se posent sur le Hamas en général, et sur la personnalité de Yahya Sinwar en particulier. Nombreux sont ceux qui considèrent encore Sinwar comme le cerveau imprévisible des opérations, soutenant un récit dans lequel Sinwar aurait eu à lui seul le pouvoir de mener une opération sans précédent contre Israël, avec toutes les implications locales, régionales et internationales complexes qui en résultent. Il ne s'agit pas de privilégier le Hamas, ni de rejeter la faute sur une “pomme pourrie” pour permettre le retour d'un Hamas “démilitarisé” à la tête de l'État. Pour certains experts autoproclamés, le recours à cette explication découle d'une compréhension superficielle du mouvement. Pour d'autres, il s'agit de couvrir Israël pour ses échecs militaires au cas où il capturerait Sinwar et de substituer cela à la “victoire totale”. Si Sinwar est le Hamas et si le Hamas est Sinwar, l'élimination de l'un mettrait fin à l'autre.
En réalité, ce que nous pensons savoir de la planification et de l'exécution de l'offensive du 7 octobre – et des opérations ultérieures du Hamas face à la guerre génocidaire d'Israël – n'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais les données publiques disponibles nous montrent que Yahya Sinwar n'est pas si imprévisible que cela. À l'instar de ses prédécesseurs, il s'est montré très ouvert et lucide sur la direction que prenait l'organisation. Les signes étaient visibles partout depuis au moins deux ans, tant au niveau officiel qu'au niveau de la base. Les grandes puissances ont été choquées parce qu'elles ont sous-estimé et ignoré le mouvement, et non parce qu'elles auraient été dupées. Le récit autour de Sinwar fournit également un prétexte aux “experts” pour expliquer leur connaissance superficielle du mouvement, au mieux, ou leur analyse fallacieuse, au pire.
Ce que les analystes auraient dû savoir, c'est que le Hamas est un mouvement doté d'institutions et que, comme n'importe quel autre mouvement de masse, il rassemble différents courants et orientations politiques pouvant être en désaccord sur la tactique, mais pas sur la stratégie. La règle de cette organisation a été celle de la continuité malgré la fragmentation géographique et les différentes écoles de pensée sur la façon d'aller de l'avant. Il y a eu des moments de débats acharnés et de désaccords publics, mais ils n'ont rien de secret et se déroulent parfois dans des lieux publics. Cela correspond à la dynamique d'une organisation dont les élections internes sont rigoureuses et participatives.
Les informations attribuées à des “sources anonymes proches du Hamas” sur les désaccords internes au sein du Hamas ou sur la restructuration du mouvement par Sinwar sont très peu étayées. Il est possible que les activités du mouvement changent au cours de la guerre et que ses institutions évoluent en conséquence. Toutefois, tant que des preuves tangibles ne seront pas disponibles, les analystes seraient bien avisés de fonder leurs réflexions sur les nombreux écrits, discours et interviews mettant en lumière les aspects injustement mystifiés du Hamas et de ses dirigeants. Il n'existe aucune preuve crédible suggérant que Sinwar a totalement remanié la structure du mouvement et centralisé le pouvoir autour de sa personne. Cependant, de nombreux éléments montrent que Sinwar n'est pas seulement un produit du mouvement, mais quelqu'un qui a passé des décennies à le construire et qu'il est peu probable qu'il ait négligé ceux avec qui il a grandi politiquement et les processus qu'il a contribué à mettre en place.
Un jour, après la fin de cette guerre génocidaire, de nouvelles informations apparaîtront peut-être, qui modifieront la compréhension du Hamas et contrediront les hypothèses qui circulent aujourd'hui. Lorsque cela se produira, il serait judicieux de replacer ces nouvelles preuves dans leur contexte historique et d'exiger des “experts” qui ont manqué de professionnalisme qu'ils respectent des normes plus rigoureuses.
– Hanna Alshaikh est doctorante en histoire et en études du Moyen-Orient à l'université de Harvard.
*Source : Spirit of Free Speech
Version originale : Mondoweiss
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un embargo sur les armes à destination d’Israël n’est pas une idée radicale : c’est la loi

L'arrêt de l'aide militaire à Israël est le strict minimum que les États-Unis peuvent faire pour mettre fin au génocide de Gaza. Un embargo sur les armes n'est pas seulement soutenu par 80 % des électeurs du Parti démocrate, il est exigé par le droit international et américain.
Tiré de Agence médias Palestine.
Alors qu'Israël lance son plus grand assaut militaire en Cisjordanie depuis vingt ans, je ne peux m'empêcher de penser aux personnes que j'ai rencontrées dans le territoire occupé. Je pense à cette mère de Jénine qui était au téléphone avec ses deux fils quelques secondes avant que leur maison ne soit incendiée lors d'un raid israélien. Je pense à cette femme au mari détenu dans une prison israélienne sans inculpation ni jugement qui m'a demandé : « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ? Mon mari est en train de mourir. » Je pense à l'agriculteur qui m'a offert un melon alors qu'il pouvait à peine mettre de la nourriture sur sa propre table et que je n'étais là que pour une courte période, voyageant et faisant du bénévolat avec Faz3a, une organisation internationale de présence protectrice.
Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, les Palestinien·nes de Cisjordanie subissent ce que beaucoup appellent un « génocide lent ». Chaque jour, des colons israéliens attaquent des familles palestiniennes pour les expulser de leurs terres privées. Ils détruisent les puits d'eau, brûlent les maisons et agressent les familles. Les Palestinien·nes qui restent sur leurs terres risquent d'être arrêtés. Au cours des dix derniers mois, 9 000 Palestinien·nes de Cisjordanie ont été arrêté·es et détenu·es sans inculpation ni jugement, et nombre d'entre elles et eux ont été torturé·es.
En juillet, la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction mondiale, a jugé illégale l'occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. La Cour a estimé que le régime de ségrégation dans lequel vit le peuple palestinien – avec des routes séparées, un accès rationné à l'eau et un système juridique distinct fondé sur le droit militaire – s'apparente à de l'apartheid. La Cour a ordonné à Israël de retirer ses colons du territoire palestinien occupé, de payer des réparations et de respecter le droit des Palestinien·nes à l'autodétermination.
Un jour plus tard, des ami·es américain·es ont été violemment attaqué·es par des colons en Cisjordanie. Ils et elles accompagnaient des agriculteur·ices palestinien·nes dans leurs oliveraies lorsque des colons de la colonie voisine d'Esh Kodesh sont descendus et les ont frappés à l'aide de tuyaux métalliques. Ce mois-ci, un autre volontaire américain non armé de l'organisation internationale de présence protectrice Faz3a a été blessé par balle à la jambe par l'armée israélienne. Le département d'État américain est resté largement silencieux.
Alors que le parti démocrate se bat pour gagner des voix, nombreux·ses sont celles et ceux qui ont demandé aux États-Unis d'imposer un embargo sur les armes à Israël afin de signifier au Premier ministre Netanyahou qu'il ne peut continuer à violer le droit international en toute impunité. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un embargo sur les armes n'est pas seulement souhaité par 60 % des Américain·es et près de 80 % des électeurs démocrates, mais qu'il est en fait déjà exigé par la loi.
La loi fédérale américaine est claire : les pays qui reçoivent des fonds militaires américains doivent respecter les normes en matière de droits de l'homme sous peine de perdre leur financement.
La loi sur l'aide à l'étranger stipule qu'aucune aide ne peut être fournie à un pays « qui se livre à des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme internationalement reconnus ». La loi Leahy interdit la fourniture d'armes « à toute unité […] d'un pays étranger si le secrétaire d'État dispose d'informations crédibles selon lesquelles cette unité a commis une violation flagrante des droits de l'homme ».
Les violations flagrantes comprennent « la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la détention prolongée sans inculpation ni jugement, […] et tout autre déni flagrant du droit à la vie ou à la liberté », autant d'actes dont Israël est reconnu coupable par la CIJ, les Nations unies et même les experts et les tribunaux israéliens en matière de droits de l'homme.
Nos lois américaines exigent donc que nous suspendions le financement militaire d'Israël jusqu'à ce qu'il remédie à son bilan en matière de droits de l'homme en acceptant un cessez-le-feu permanent à Gaza et en se conformant à la décision de la CIJ de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens.
Une telle pause – ou un « embargo sur les armes » – n'est pas sans précédent. En 2021, les États-Unis ont retenu 225 millions de dollars de financement de l'Égypte et ont suspendu la vente d'armes offensives à l'Arabie saoudite en raison des violations des droits de l'homme commises par ces pays. Alors pourquoi les États-Unis appliquent-ils leurs lois de manière sélective ?
Le 8 février, le président Biden a signé le mémorandum 20 sur la sécurité nationale qui, au moins, faisait un clin d'œil à nos lois fédérales. Ce mémorandum exige du secrétaire d'État qu'il obtienne des « assurances écrites crédibles et fiables » de la part des bénéficiaires étrangers de l'aide militaire qu'ils utilisent les armes américaines dans le respect du droit international. Ceux qui ne fournissent pas ces assurances ou qui font des déclarations non étayées par des preuves devraient voir leur aide interrompue.
En mars, le département d'État a admis qu'il existait « des rapports crédibles faisant état de violations présumées des droits de l'homme par les forces de sécurité israéliennes, notamment des exécutions arbitraires ou illégales, des disparitions forcées, des actes de torture et de graves abus dans le cadre de conflits ». Pourtant, le Département a approuvé sans discussion les « assurances » du gouvernement israélien et la Maison Blanche a continué à approuver des milliards de dollars de transferts d'armes en dépit des violations reconnues du droit international.
Selon un récent rapport du ministère israélien de la défense, les États-Unis ont envoyé plus de 50 000 tonnes d'armes et d'équipements militaires à Israël depuis le 7 octobre, soit une moyenne de deux livraisons d'armes par jour.
Tout cela m'écraserait s'il n'y avait pas mes ami·es palestinien·nes qui m'ont appris à quoi ressemblent une foi et un engagement inébranlables dans la vie.
Je vous pose donc la question, Madame la vice-président Harris : si vous êtes élue présidente, veillerez-vous à ce que les lois des États-Unis soient fidèlement exécutées, comme l'exige notre Constitution ? Respecterez-vous systématiquement les lois fédérales qui interdisent le financement des gouvernements étrangers qui commettent des violations des droits de l'homme, quelle que soit la puissance de ces gouvernements ou de leurs lobbies ? Respecterez-vous l'engagement que vous avez pris lors de la convention nationale du parti démocrate « de mettre fin à cette guerre de manière à ce qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté et à l'autodétermination » ?
Pour ce faire, nous devons joindre le geste à la parole, et non nous contenter de parler. Cela exige que nous changions de politique et que nous ne nous contentions pas d'exprimer nos préoccupations. La suspension du financement militaire d'Israël est le strict minimum nécessaire pour mettre fin aux bombardements d'innocent·es et pour nous rappeler que nous sommes, après tout, une nation fondée sur des lois.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les attaques de Trump contre Harris : racisme, sexisme, vulgarité et mensonges

Trump se présente sur une posture, celle d'attaques répétées contre Kamala Harris, la dénigrant en raison de son sexe et de sa race.
Hebdo L'Anticapitaliste - 720 (12/09/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia commons
Le programme de campagne de l'ancien président Donald Trump comprend une taxe de 10 % sur toutes les importations et de 60 % pour les produits chinois, il veut réduire les impôts sur la fortune, et envisagera des coupes dans Medicare et la sécurité sociale, supprimera le département de l'éducation, et dans son précédent mandat, il avait coupé dans les crédits de la santé et du logement.
Mais en tant que candidat à la présidence pour la troisième fois, Trump ne se présence pas tant sur un programme politique que sur une posture, une attaque vicieuse contre Kamala Harris, la rabaissant en raison de son sexe et de sa race. Il laisse en effet entendre que sa race et son sexe font d'elle une personne intellectuellement inférieure et socialement et culturellement étrangère. Il la qualifie également de « marxiste et communiste », des termes qui font d'elle une « non-américaine ».
Des propos visant à faire de Kamala Harris une « non-américaine »
Selon Trump, Kamala Harris n'est pas l'une des nôtres. En 2020, Donald Trump avait laissé entendre qu'Harris, alors candidate à la vice-présidence, n'était pas une citoyenne américaine et qu'elle n'avait donc pas le droit de se présenter aux élections parce qu'aucun de ses parents n'était citoyen américain au moment de sa naissance. C'est faux, car la Constitution américaine prévoit le droit à la citoyenneté à la naissance. Ainsi, quelle que soit la citoyenneté de ses parents, lorsque sa mère a accouché à Oakland, en Californie, en 1964, elle était une citoyenne née aux États-Unis. Trump s'est engagé à mettre fin à la citoyenneté de naissance.
Il a également laissé entendre que l'identité de Kamala Harris était en question. S'exprimant lors d'une conférence de journalistes noirs, Trump a déclaré : « Elle a toujours été d'origine indienne, et elle ne faisait que promouvoir l'héritage indien ». « Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'elle est devenue noire, et maintenant elle veut être reconnue comme noire. Je ne sais donc pas si elle est Indienne ou Noire ». Bien que Kamala Harris soit diplômée d'une université historiquement noire et qu'elle appartienne à une sororité noire. Cependant, Trump signalait à sa base qu'elle était autre, étrangère. Étant donné que 10 % des AméricainEs sont métis, on ne sait pas très bien comment cette tactique va fonctionner.
Sexisme et diabolisation
Trump s'en est également pris à son intelligence, la qualifiant de « stupide » et de « folle ». D'autres républicains ont qualifié Harris d'« embauche DEI », c'est-à-dire une personne embauchée dans le cadre des politiques de diversification et d'inclusivité de l'emploi, mais qui n'est pas vraiment compétente pour occuper le poste.
Selon Trump, Harris est « diabolique ». Un mot qui en dit long à ses partisans chrétiens évangéliques, qui croient effectivement que Kamala Harris et d'autres démocrates sont « diaboliques ». Et cela résonne avec les adeptes de Q-Anon qui soutiennent que les dirigeants du Parti démocrate sont des pédophiles adorateurs de Satan qui ne peuvent être arrêtés que par Trump. En fait, K. Harris est connue pour ses efforts visant à mettre fin au trafic d'enfants par le biais d'actions en justice et de lois.
Les attaques de Trump sont devenues très vulgaires. Il a retweeté sur son site Truth Social une photo de Kamala Harris et d'Hillary Clinton avec la légende suivante : « C'est drôle comme les pipes ont eu un impact différent sur leurs carrières... », faisant allusion à la liaison de Bill Clinton avec Monica Lewinsky et à la relation amoureuse de K. Harris avec Willie Brown, le chef du parti démocrate californien. D'autres ont laissé entendre que K. Harris avait couché pour arriver au sommet. Dans un discours récent, J.D. Vance, le candidat à la vice-présidence de Trump, a déclaré : « Kamala Harris peut aller en enfer ».
Des mensonges qui laissent Trump en tête dans les sondages
Et puis, Trump ment tout simplement au sujet de Kamala Harris. Il a déclaré : « Harris est totalement contre le peuple juif ». Une affirmation étrange étant donné que son mari, l'avocat Doug Emhoff, est juif.
En critiquant la position de Harris sur les droits reproductifs, Trump a affirmé de manière grotesque : « Elle veut des avortements au cours des huitième et neuvième mois de grossesse, cela lui convient, jusqu'à la naissance, et même après la naissance – l'exécution d'un bébé ». Il a également affirmé de manière bizarre et infondée que « Kamala veut même faire passer des lois pour interdire la viande rouge afin de stopper le changement climatique ».
Cela fonctionne-t-il ? Trump est à 48 ou 47 % au niveau national et est en tête dans les swing states (les États en balance entre républicains et démocrates), bien que les différences se situent dans la marge d'erreur — une égalité statistique.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis – Gaza. Avec Kamala Harris, un changement de façade

Le soutien de l'administration de Joe Biden à Israël a été tel depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, que le changement de casting côté démocrate a suscité chez une partie des électeurs l'espoir d'une inflexion dans la politique étrangère américaine. Une attente rapidement balayée lors de la convention du parti puis lors du débat Kamala Harris-Donald Trump.
Tiré de Orient XXI
12 septembre 2024
Par Sylvain Cypel
Chicago, 22 août 2024. La vice-présidente et candidate pour l'élection présidentielle états-unienne Kamala Harris sur la scène de la convention démocrate.
Lorie Shaull / Flickr
Alors que les parents de Hersh Goldberg-Polin, otage israélo-américain capturé par le Hamas le 7 octobre 2023 et mort entre les mains de l'organisation palestinienne peu avant la convention démocrate, à la mi-août, ont été invités à s'y exprimer, la demande de nombreux cercles démocrates pour qu'un Palestinien puisse faire de même, après des semaines de négociations, a été refusée par ses organisateurs. Une initiative, intitulée le « Uncommitted movement » (le « mouvement des non-engagés », sous-entendant qu'ils ne sont pas sûrs de voter pour Harris (1), avait réuni des centaines de milliers de signatures pour réclamer que la voix de la Palestine soit entendue à la convention. La secrétaire du parti au Michigan, Lavora Barnes, les représentants à la Chambre Ro Khanna (Californie) et Ruwa Romman (Géorgie) et bien d'autres aussi. Brandon Johnson, maire de Chicago, où avait lieu la convention, le demanda également. Il nota que le comté de Cork, où elle se déroulait, est celui qui dispose de la plus forte population américaine d'origine palestinienne aux États-Unis.
Rien n'y fit : la réponse de l'appareil démocrate est restée négative. La représentante à la Chambre basse Cori Bush, devant une assemblée du groupement des « non-engagés » à l'ouverture de la convention, appela la gauche du parti à ne pas abandonner le combat : « Nous sommes et restons démocrates. Nous disons juste : ‘écoutez-nous, parce que ça compte' ». Chacun a compris la référence à Black Lives matter. Comme celle des Noirs, la vie des Palestiniens compte.
Chicago, 22 août 2024. Les déléguées du « mouvement des non-engagés », Meryem Maameri (à gauche) et Asma Mohammed (à droite), se serrent les bras à l'entrée de la Convention nationale du Parti démocrate.
Lorie Shaull / Flickr
« Restez silencieux »
Mais Kamala Harris, en déplacement au Michigan quelque temps avant et confrontée à des protestataires contre la politique de l'actuelle Maison-Blanche envers la Palestine, leur avait répondu : « Restez silencieux si vous ne voulez pas faire élire Trump » (2). L'épisode n'est guère rassurant quant à l'attitude que pourrait avoir, si elle est élue, la prochaine présidente des États-Unis vis-à-vis du Proche-Orient.
Pourtant, certains analystes veulent croire qu'un accès de Kamala Harris au pouvoir marquerait « la fin d'une ère où les présidents américains avaient un attachement personnel à Israël » (3), comme l'a été en particulier Joe Biden. Mais jusqu'ici, ce n'est pas ce qu'elle a montré. La Plateforme démocrate pour l'élection, rédigée sous Biden, n'a pas été modifiée d'un iota après qu'il s'est retiré de la course. Certes, Harris a un peu desserré le carcan de soutien inconditionnel américain dans lequel Biden et Antony Blinken, son secrétaire d'État, avaient enserré la guerre contre Gaza, laissant libre cours à Benyamin Nétanyahou pour empêcher tout cessez-le-feu. À la convention, Harris est apparue plus ouverte à la cause palestinienne, déclarant qu'elle ne resterait pas « silencieuse » si perdurait une tragédie des Gazaouis qui « brise le cœur ».
Elle a aussi implicitement accusé le premier ministre israélien d'être le principal obstacle à une sortie de crise. Peu après, dans un entretien à CNN le 29 août, elle a proclamé que les Palestiniens devaient « accéder à leur droit à la dignité, la sécurité, la liberté et l'autodétermination ». Des propos qui ne pouvaient pas plaire à Nétanyahou ni à la quasi-totalité de la classe politique israélienne. Mais ceux-ci s'en accommoderont si demain une administration Harris ne se comporte pas différemment de celle de Biden, c'est-à-dire, qu'elle leur laisse de facto les mains libres. Or, dans la même interview, Kamala Harris a confirmé que l'accord de livraisons annuelle d'armes à Israël pour 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) (4) restera, si elle est élue, un pivot de la politique américaine au Proche-Orient.
Un logiciel devenu caduc
Mais que craignent donc les dirigeants démocrates pour refuser de tenir compte de l'opinion de leurs propres électeurs ? De nombreux commentateurs aux États-Unis ont considéré que la direction du parti fait fi de l'évolution profonde que connait son propre camp. Les sondages Gallup montrent que 44 % de l'électorat démocrate se prononce désormais pour un abandon de la fourniture systématique d'armes américaines à Israël, quand seuls 25 % la soutiennent encore. La jeunesse universitaire n'est pas seule à s'insurger : d'importants syndicats, ceux de l'automobile, le United Auto Workers (UAW), de la poste, de l'éducation publique et d'autres, longtemps fervents supporteurs de l'État israélien, ont eux aussi appelé Biden à « mettre fin à l'aide militaire à Israël ». À un degré moindre, cette tendance s'affirme aussi au sein des électeurs « indépendants ». Dès lors, s'interroge le journal en ligne Slate, comment expliquer que la convention démocrate n'ait offert qu'une litanie de déclarations d'appui à Israël ? (5)
L'appareil du parti semble s'accrocher à un logiciel devenu caduc. Selon le site Middle East Eye (6). Kamala Harris, peu au fait des problèmes du Proche-Orient, formerait une équipe issue des milieux ayant agi sous les présidences de Barack Obama et qui serait dirigée au département d'État par Phil Gordon. Ce choix serait l'incarnation même d'une pérennité annoncée du statu quo en ce qui concerne la Palestine et Israël. L'homme ayant occupé des postes de plus en plus éminents dans toutes les administrations démocrates depuis les années Clinton, il ne cesse de marteler sur le sujet les propos de tous ses prédécesseurs aux affaires étrangères, comme si rien n'était advenu en trente ans. Le 24 juin 2024, Gordon participait à la conférence d'Herzliya, un forum annuel qui réunit la crème des milieux diplomatiques et sécuritaires israéliens, et accueille de nombreux invités étrangers. Gordon y a fortement plaidé pour un accord rapide sur un cessez-le-feu à Gaza et les bénéfices qu'Israël en tirerait. En mots choisis, il a critiqué le rejet israélien de facto du plan Biden pour un cessez-le-feu. Gordon a également insisté sur l'isolement international croissant d'Israël, y compris aux États-Unis, où « des segments bruyants de l'opinion publique s'opposent à cette guerre ». Et il a conclu avec quelques mises en garde :
La réalité est qu'il n'y aura pas de défaite du Hamas sans un gouvernement et une sécurité alternatifs à Gaza – et nous avons appris quelques leçons à nos dépens de nos expériences irakiennes et afghanes.
Il n'y a que deux options, a clôturé Phil Gordon : soit la reconstruction d'une bande de Gaza palestinienne sans direction du Hamas, soit :
un conflit sans fin […], avec des tensions et de la violence croissante en Cisjordanie et l'absence de tout horizon politique pour les Palestiniens, ce qui ne bénéficie qu'au Hamas et aux autres groupes terroristes palestiniens, et enfin la menace imminente d'une escalade régionale importante et une isolation aggravée d'Israël sur la scène internationale. […] Si Israël prend le chemin de l'espoir, les États-Unis seront avec lui à chaque pas. […] Là est son intérêt. Mais là est aussi l'intérêt de l'Amérique. (7)
Il n'a pas spécifié ce que Washington ferait si Israël ne se soumettait pas à ses suggestions. C'était il y a deux mois et demi. Depuis, rien n'a évolué : Benyamin Nétanyahou a montré le peu de cas qu'il fait de Biden, de Gordon et des plans de l'administration démocrate.
Un soutien militaire américain sans limites
Devant l'absence avérée d'impact des « pressions verbales » américaines sur la poursuite des bombardements israéliens et des massacres dans la population gazaouie, le refus d'une cessation des livraisons d'armes devient un symbole de l'impuissance de la politique menée par la Maison-Blanche. Harris répète que les ventes d'armes restent un intouchable de la diplomatie américaine, la clé de sa « relation spéciale » avec Israël. Mais aux États-Unis, cette question devient le carburant de la mobilisation pour mettre fin aux exactions israéliennes.
La candidate démocrate pourrait-elle l'entendre ? Et si oui, quand ? Récemment, Peter Beinart, le directeur du magazine juif progressiste Currents, publiait dans le New York Times une contribution où il expliquait que l'obstacle à une cessation des livraisons d'armes à Israël n'avait rien à voir avec une potentielle opposition du Congrès. Si une administration Harris le décide, il lui suffira juste… « d'appliquer la loi » américaine, plaide-t-il (8). Car le Congrès a voté en 1997 une loi de « limitation du soutien aux forces de sécurité » qu'il a renforcée en 2008, appelée Loi Leahy (du nom de son auteur, Patrick Leahy, sénateur du Vermont de 1975 à 2023). Cette loi interdit aux secrétariats d'État américains des affaires étrangères et à celui de la défense de soutenir d'une quelconque manière toute force armée étrangère qui commettrait des « violations flagrantes » du droit humanitaire. Beinart rappelle que cette loi a été utilisée depuis « des centaines de fois » par Washington, y compris contre des pays amis des États-Unis — le Mexique, par exemple. Mais cette loi peut ne pas s'appliquer aux armées étrangères dans leur totalité, seulement à des unités spécifiques, celles ayant commis des actes illégaux notoires.
Or, il existe un pays qui, depuis l'adoption de cette loi il y a 27 ans, a mené de nombreuses guerres avant celles en cours à Gaza, dans lesquelles son armée a, par exemple, largué massivement des bombes à fragmentation et d'autres types de matériaux interdits par le droit de la guerre ; qui plus est, il l'a fait contre des populations civiles (à Gaza et au Liban, en particulier). Beinart note que cette loi ne lui a « jamais été appliquée » : il s'agit évidemment d'Israël, l'État étranger qui, de très loin, perçoit le soutien militaire annuel américain le plus important depuis cinq décennies. Patrick Leahy n'a-t-il pas déclaré que l'absence absolue et répétée d'imposition de sa loi à Israël la « tourne en dérision » ?
Lors de son débat avec Donald Trump, le 10 septembre, Kamala Harris a continué de plaider son mantra : « Israël a le droit de se défendre », mais « trop de Palestiniens innocents sont morts » . Cependant, si elle entend sincèrement s'impliquer dans une résolution de la question palestinienne, elle devra se soumettre à ce qu'un nombre incalculable d'experts américains, diplomates et militaires savent depuis longtemps sans jamais l'évoquer publiquement, à savoir que pour résoudre le problème, à commencer par la fin de l'occupation par Israël des Territoires palestiniens occupés, il faudra que Washington change de paradigme, et impose à Israël des sanctions tangibles et efficaces s'il n'obtempère pas. Kamala Harris le comprend-elle ? Le veut-elle ? La question de l'indéfectible « relation spéciale » qui lie les États-Unis à Israël a fait l'objet d'innombrables analyses. Certains évoquent une alliance naturelle des messianismes juif et évangélique. D'autres le poids du lobby pro-israélien. On se contentera, ici, de constater que plus les États-Unis fournissent gratuitement des armes aux Israéliens qui en font de plus en plus usage, et plus le contribuable et le trésor favorisent l'enrichissement du complexe militaro-industrieldes États-Unis. Cet argument pèse lourd dans les décisions des dirigeants américains.
Mais le seul motif du soutien indéfectible de Washington n'est pas uniquement dû aux intérêts des sociétés d'armement. Les craintes de l'impact qu'un affaiblissement de la place politique et sécuritaire d'Israël au Proche-Orient ferait peser sur le poids des États-Unis dans la région est, sans doute, un frein plus important encore à l'abandon de cette « relation spéciale ». Une relation dont les Palestiniens sont la victime récurrente. Il n'est pas un président américain qui ne l'ait pas compris.
NOTES
1. Le « mouvement des non-engagés » se définit comme « luttant pour un Parti démocrate qui représente la majorité anti-guerre et pro-palestinienne ».
2. Joey Cappelletti : « Pro-Palestinian democrats say their request for a speaker at DNC rejected after weeks of négociations », Associated Press, 22 août 2024.
3. Ron Kampeas : « Biden withdrawal marks the end of an era of democrat presidents with personal Israel attachment », The Forward, 22 juillet 2024.
4. Après les accords de paix entre Israël et l'Égypte en 1978, la Maison-Blanche s'engagea à livrer annuellement et gracieusement des armes aux deux pays. En 2024, les montants se situent à 3,8 milliards de dollars pour Israël et 1,3 milliard (1,1 milliard d'euros) pour l'Égypte.
5. Alexander Sammon, « I went to a Zionist democrats party at the DNC, what I saw made me think there‘s a policy shift coming », Slate, 21 août 2024.
6. Sean Mathews, « What a Kamala Harris Middle East policy team could look like », Middle East Eye, 2 septembre 2024.
7. The White House, « Remarks by National Security advisor to the vice-president Dr. Phil Gordon at the Herzliya Conference », 24 juin 2024.
8. Peter Beinart, « Harris can change Biden's policy on Israel just by upholding the law », The New York Times, 18 août 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Italie – Giorgia Meloni et l’érosion démocratique

France. « La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans » par Bruno Le Maire

Bruno Le Maire [ministre démissionnaire des Finances] entrera dans l'histoire, c'est une certitude. D'abord parce qu'il aura été le plus long titulaire du ministère des Finances depuis plus de deux siècles. Mais, en politique, record ne signifie pas succès et entrer dans l'histoire ne signifie pas y laisser une marque positive. Avec ces sept ans et quelques mois à Bercy [site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique], notre recordman ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes.
10 septembre 2024 | tiré du site alencontre.org
http://alencontre.org/europe/france-la-crise-des-finances-publiques-est-dabord-lechec-de-la-politique-de-loffre-menee-depuis-sept-ans-par-bruno-le-maire.html
Se revendiquant écrivain de talent, Bruno Le Maire [auteur, entre autres, de La Fugue américaine, de L'Ange et la bête…] a tenté de forger un récit qui a longtemps tourné dans la sphère médiatique : celui du « bon bilan économique ». Ce récit est bancal dès le départ et n'a jamais convaincu qu'une sphère restreinte et non la masse des Français et Françaises qui, à plusieurs reprises, ont sanctionné le gouvernement pour son bilan économique. La réindustrialisation est une chimère, l'attractivité un miroir aux alouettes et la croissance économique s'est affaiblie.
Mais, depuis quelques mois, notre conteur est rattrapé par la réalité. La dégradation des comptes publics n'est, en effet, pas l'effet d'une orgie de dépenses du système social ou d'un prétendu financement de la paresse des travailleurs français comme le discours austéritaire le prétend déjà. Sa source est d'abord et avant tout l'échec monumental et complet de la politique même de Bruno Le Maire.
Le ministre est, reconnaissons-lui ce caractère, un homme de conviction. Rien ne le fera dévier de ses certitudes : l'impôt sur les plus riches est un mal absolu, la fiscalité sur les entreprises doit être abaissée et le capital, toujours et partout, doit être aidé. La seule « politique raisonnable » pour lui est la politique de l'offre [1].
Il en a, au reste, reçu l'hommage appuyé et émouvant du Mouvement des entreprises de France (Medef) lors de leur dernière université d'été, fin août 2024. Patrick Martin, le patron des patrons, l'a félicité, tutoiement à la clé, comme on félicite un employé zélé : « Tu as été un artisan déterminant et déterminé de la politique pro-entreprise. » Et c'est d'ailleurs la seule explication plausible de sa longévité à Bercy, car il est, sur ce point, en accord parfait avec Emmanuel Macron, qui a bien fait comprendre à chacun cet été que la démocratie ne pouvait remettre en cause cette orientation.
Une politique qui ne profite qu'aux détenteurs de capital
L'ennui, c'est que ce sont ces convictions mêmes qui ont conduit à la dégradation du déficit public. Les chiffres sont sans appel : ce ne sont pas les dépenses qui sont responsables de l'état des finances, ce sont bel et bien les recettes. Ces dernières sont, depuis deux ans, en chute libre par rapport aux prévisions, ou plutôt devrait-on dire, aux promesses du gouvernement. Or ce fait est un désaveu de toute la politique de l'offre, c'est-à-dire de la politique dite du « ruissellement ».
Rappelons brièvement la logique de cette politique. Elle repose sur l'idée que la croissance est entravée par des « blocages » qui empêchent les entreprises d'investir. Ces blocages, pour aller vite, c'est tout ce qui réduit la rentabilité des entreprises. On y trouve donc les salaires, et c'est l'objet des réformes du marché du travail, mais aussi la fiscalité.
En baissant les impôts sur le capital au sens large, c'est-à-dire tant sur les entreprises que sur les propriétaires des entreprises, on permettrait une augmentation du potentiel de croissance. Et comme la croissance augmente, les recettes doivent suivre et, en conséquence, venir réduire le déficit public. Telle est la promesse des politiques menées par Bruno Le Maire.
Or cette belle mécanique ne fonctionne pas. Le soutien au taux de profit ne se traduit pas par une accélération de la croissance parce que, précisément, la rentabilité ne progresse que grâce au soutien public et à la modération salariale. L'affaiblissement des gains de productivité et la tertiarisation de l'économie rendent de plus en plus difficile de dégager de la plus-value. Il est donc peu attrayant d'investir, alors même que les structures productives demandent de plus en plus de moyens (on le voit notamment avec les dépenses d'informatique qui ont absorbé l'essentiel de l'investissement comptable ces dernières années).
En parallèle, la financiarisation de l'économie permet de placer ces profits accumulés de façon attrayante, d'autant que la réforme de 2018 en France a abaissé l'impôt sur les revenus du capital. En d'autres termes : cette politique ne profite qu'aux détenteurs de capital qui, pour maintenir leur rythme d'accumulation, doivent toujours faire pression sur les salarié·e·s, les consommateurs et l'Etat. Il n'y en a jamais assez puisque la croissance n'est pas suffisante pour maintenir « naturellement » l'accumulation. Il faut donc toujours réduire les impôts en voyant toujours les déficits se creuser.
Persévérer dans l'erreur
L'histoire du passage à Bercy de Bruno Le Maire [en fonction depuis mai 2017] pourrait ainsi se résumer à une suite de propositions de nouvelles baisses d'impôts à laquelle s'est ajoutée une suite de subventions toujours croissante au secteur privé. Le tout pour une croissance déclinante. En résumé, le capital coûte de plus en plus cher et rapporte de moins en moins à l'Etat. Qui peut alors s'étonner que le déficit reste abyssal ?
Les chiffres pour prouver ce piège où la politique de l'offre a plongé les finances publiques ne manquent pas. On en citera un. En termes nominaux, le PIB français a augmenté de 101 milliards d'euros environ entre 2018 et 2023. Les dépenses de l'Etat ont progressé de 100 milliards d'euros, soit une évolution proche de celui du PIB. Mais les recettes de l'Etat, elles, ont progressé de seulement 10,8 milliards d'euros, soit dix fois moins. C'est que tout est absorbé par les compensations d'exonérations, donc par le financement des baisses de cotisations et d'impôts.
C'est la preuve que le capital coûte plus cher que ce que son aide ne rapporte. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec ce que beaucoup estiment être un « paradoxe » mais qui n'en est un qu'en apparence : la France affiche à la fois un déficit considérable et des services publics qui se dégradent. C'est simplement parce que le déficit n'est pas lié aux dépenses liées au service public, mais à un Moloch, la politique de l'offre, qui engloutit les milliards et appauvrit tout le monde, sauf les plus fortunés.
Face à ce désastre, Bruno Le Maire n'a pas bougé d'un iota ses convictions. Tout écrivain qu'il est, le ministre est enkysté dans ce qu'il faut bien appeler une idéologie, c'est-à-dire une conviction qui ne saurait être modifiée par le réel. Aussi, lorsque l'échec de sa politique est devenu impossible à dissimuler, il a décidé de lancer un nouveau récit, fort classique au demeurant, celui de l'austérité et de la destruction de l'Etat social. On a ainsi vu le bourreau des finances publiques se mettre à son chevet et réclamer qu'on prenne au plus tôt des mesures de « redressement » fondées inévitablement sur des économies massives.
Notre ministre-écrivain s'est alors livré à une véritable bouffonnerie. Dès février, il a annoncé en grande pompe un coup de rabot de 10 milliards d'euros sur le budget qu'il avait entièrement conçu et fait passer par le levier de l'article 49-3. Depuis, Bruno Le Maire passe son temps à en réclamer plus et à se draper dans les habits neufs de combattant du déficit.
Mensonge, irresponsabilité, incompétence, déni ? Ces hypothèses ne peuvent être écartées, bien sûr. Bruno Le Maire, malgré le record de longévité dont il est si fier, s'efforce depuis des mois de reporter la faute de la situation actuelle sur les autres, des syndicats à l'administration en passant par les oppositions. Mais il faut aussi rappeler que ces deux discours, politique de l'offre et austérité, quoique, en apparence, contradictoires, se complètent parfaitement.
Vers l'austérité
L'austérité sert à la fois à ne pas remettre en cause le problème de la politique de l'offre en concentrant le blâme du déficit sur les dépenses, et à détruire l'Etat social, ce qui, directement et indirectement, contribue à faire avancer la marchandisation de la société et ouvre de nouveaux marchés pour le capital. En réalité, l'austérité est aussi une politique de l'offre qui vise à ramener la demande au niveau de l'offre en maintenant le soutien au capital.
Notre ministre démissionnaire n'a donc aucune raison de prendre aucune responsabilité ni de devoir faire face à ses contradictions. Il est, à sa façon, logique. Pour lui, la société est au service du capital et elle doit payer le prix de cette subordination. Si le capital financier réclame des gages et que le capital industriel veut conserver son flux d'argent public, ce sera au pays de s'ajuster.
Il y a donc moins de l'aveuglement qu'une constance remarquable dans une politique de classe dont Bruno Le Maire n'a jamais dévié et que le nouveau premier ministre ne semble pas vouloir remettre en cause. Michel Barnier, « l'Européen » [désigné à la fonction de Premier ministre par Emmanuel Macron, le 5 septembre 2024], ne reviendra sans doute pas sur les nouvelles règles budgétaires européennes, aussi absurdes fussent-elles.
Ce week-end [7-8 septembre], en visite à l'hôpital Necker de Paris, le nouveau premier ministre a repris la vieille chanson selon laquelle les maux du système de santé tenaient moins aux moyens qu'à son organisation. Un discours qui a toujours accompagné la réduction des moyens pour l'assurance-maladie. Quant à ses promesses de « justice fiscale », avancées vendredi 6 septembre dans sa première intervention télévisée en tant que chef du gouvernement, elles sont d'autant plus douteuses qu'Emmanuel Macron a refusé tous les candidats à Matignon qui entendaient aller dans ce sens.
La France se dirige donc vers une cure d'austérité qui s'annonce particulièrement douloureuse. Le dernier point de conjoncture de l'Insee souligne ainsi que la demande intérieure est au plus faible et que les ménages, inquiets, renforcent leur épargne. Désormais, les entreprises signalant des problèmes de demande sont plus nombreuses que celles signalant des problèmes d'offres.
Se lancer dans ces conditions dans une politique de contraction de la dépense publique, un des derniers piliers de la croissance française, pour maintenir une politique d'offre inefficace, ne peut que provoquer un choc négatif sur l'économie nationale, alors même que la situation politique et sociale est tendue.
Mais le « bloc central » et ses soutiens médiatiques semblent avancer vers l'abîme en chantant, assurant qu'il n'y a pas d'autres options que la réduction des dépenses. On se croirait revenu en 2009, au moment des discours sur « l'austérité expansive ». Bruno Le Maire, qui mène la procession, voulait rester dans « les mémoires » comme un Chateaubriand moderne, mais son nom pourrait ne venir s'ajouter qu'à la liste déjà longue des idéologues inconscients dont les folies conduisent au désastre. (Article publié par Mediapart le 9 septembre 2024)
[1] Le 2 mai 2021, Romaric Godin, à l'occasion d'un entretien avec l'économiste Gilles Raveaud, économiste à l'Université Paris VII et auteur de Economie : on n'a pas tout essayé ! (Ed. du Seuil 2018), présentait ainsi les lignes de force de la politique de l'offre : « Depuis des décennies, le néolibéralisme s'est emparé des « politiques de l'offre » pour projeter sa propre vision de la production. S'appuyant sur l'idée que l'offre devait être guidée par les demandes du marché, ces politiques ont eu pour ambition première de favoriser l'adaptation des entreprises au marché et d'attirer les investissements par la perspective de rendements plus élevés. D'où les « réformes structurelles », la demande de « flexibilité », les partenariats public-privé et la baisse continue des impôts pour les entreprises et les plus riches. » (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les « Mavkas en colère », ces femmes en première ligne de la résistance ukrainienne

Diffuser de la littérature pro-ukrainienne, taguer des graffitis, vandaliser des symboles russes ou signaler les mouvements des troupes de Moscou à l'armée ukrainienne : telles sont les actions que mène le mouvement de résistance féminin ZlaMavka dans les zones occupées de l'Ukraine.
Tiré de Entre les lignes et les mots
En mars 2023, trois femmes, fondatrices du collectif « ZlaMavka » [« Mavkas en colère », ndlr.], se sont mobilisées pour faire comprendre aux soldats russes qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la ville, même un an après leur arrivée. En réponse à une campagne de propagande de l'armée russe – une distribution de fleurs aux retraités locaux – l'une d'entre elles, peintre de profession, a dessiné une affiche devenue depuis populaire dans toute la ville. « Je ne veux pas de vos fleurs, je veux mon Ukraine », pouvait-on lire sur celle-ci.
Depuis – d'après uneinterview anonyme donnée par l'une des trois militantes au média allemand Deutsche Welle (DW)– des centaines de femmes se sont identifiées au mouvement des mavkas et résistent quotidiennement. Comme beaucoup d'autres groupes partisans ukrainiens, ZlaMavkaa commencé à agir sur les réseaux sociaux et la plateforme de messagerieTelegram. Les affiches de l'artiste peuvent d'ailleurs être téléchargées au format PDF, ce qui les rend d'autant plus faciles à diffuser.
La mavka, un emblème de la culture ukrainienne
En Ukraine, la mavka est une figure folklorique, une variante locale de la « Rusalka », un personnage de la mythologie slave. C'est une femme évoquant l'amazone et associée aux cours d'eau. Dans certaines croyances populaires ukrainiennes, les mavkas sont des femmes mortes noyées ; dans d'autres, ce sont celles qui n'ont jamais été baptisées. Elles sont mentionnées pour la première fois dans l'Eneïda, une parodie de l'œuvre de Virgile imaginée par Ivan Kotliarevsky, un des pères de la littérature moderne ukrainienne à la fin du XVIIIe siècle.
Sous sa plume, les sirènes virgiliennes deviennent des mavkas des Carpates. La variation linguistique adoptée par le poète dans son œuvre – empruntée au dialecte ukrainien parlé dans la ville de Poltava – a permis de poser certaines règles grammaticales de la langue ukrainienne.
C'est à l'autrice et poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka que l'on doit l'importance de la mavka dans la littérature ukrainienne. Cette militante féministe et progressiste – une des figures de proue du mouvement pour l'indépendance de l'Ukraine pendant la période tsariste dite de la « prison des peuples » – a également participé à la fondation du Parti social-démocrate ukrainien. Quelques mois avant sa mort en 1911, elle consacrait à ces figures mythologiques aux cheveux verts un poème dramatique en trois actes.
Au printemps 2023 sortait d'ailleurs un film d'animation ukrainien inspiré de l'œuvre de Lessia Oukraïnka. Dans Le Royaume de Naya, le personnage principal est une jeune femme aux cheveux verts, semblable aux descriptions des mavkas présentes dans la littérature ukrainienne et dans les légendes populaires. Curieusement, son image s'est même répandue auprès des cinéphiles occidentaux au moment même où les trois résistantes de Melitopol ont commencé à l'utiliser comme symbole contre l'occupation russe.
Résister, une vie semée d'embûches
Dans le sud de l'Ukraine, l'armée russe et ses services administratifs tentent de légitimer leur présence, ou du moins de pousser la population locale à l'accepter sans résistance. L'espoir illusoire que ses soldats caressaient aux premiers jours de l'invasion, imaginant que les Ukrainiens accueilleraient l'armée de Poutine avec des fleurs et des larmes de joie, semble avoir disparu depuis longtemps.
Seule une minorité d'habitants vit encore dans la région, par choix ou par contrainte. De petites villes comme Vouhledar comptentparfois moins d'un trentième de leur population en 2021. Pour les journalistes occidentaux et locaux, ces irréductibles restent une énigme. Difficile de comprendre leurs opinions et leur mode de vie tout en évitant la propagande du Kremlin (qui est omniprésente, mais pas absolue), notamment parce que tout journaliste qui n'est pas accrédité auprès des autorités russes se voit refuser l'accès à la région.
Dans les territoires occupés par Moscou depuis le 24 février 2022, la majorité des survivants sont des personnes âgées. Elles ne sont pas en mesure de se réfugier ailleurs ou ne veulent simplement pas quitter leur maison, même si celle-ci a été endommagée lors des combats. L'intransigeance de ces habitants a beau être d'une humanité désarmante, ça n'empêche pas les Russes d'essayer de transformer leur épuisement et leur indifférence en loyauté.
Marianna Soronevitch, une militante italo-ukrainienne, raconteque de nombreux habitants de Melitopol ne rechignent pas à encaisser l'allocation retraite offerte par Moscou (tout en continuant de recevoir celle distribuée par le gouvernement ukrainien) ou à profiter des aides humanitaires russes. Tant que la Russie peut distribuer ces aides, cela suffit à apaiser une partie de la population qui ne cherche qu'à survivre. Ce genre de manœuvres peut en partie expliquer pourquoi il n'y a pas encore eu de grande rébellion dans les zones de l'Ukraine illégalement occupées par la Russie.
Néanmoins, rien de tout ça n'a empêché la naissance d'un mouvement de résistance clandestin au sein de la population plus jeune et plus motivée qui a décidé de rester à Berdiansk, Marioupol, Melitopol et Volnovakha.
Même en Crimée – d'où la plupart des Ukrainiens et des Tatars opposés à Moscou ont été contraints de fuir en 2014 – un groupe d'environ sept mille partisans tatars, ukrainiens et russes ethniques continue ses actions. Connu sous le nom d'Atech, il agit depuis un an dans d'autres zones occupées et même sur le territoire russe. Au début du mois de mai, Atech a revendiqué une tentative d'assasinat de l'écrivain nationaliste Zakhar Prilepine. Depuis 2014, ce dernier – partisan du leadeur national-bolchévique Edouard Limonov – amplifie ses attaques vis-à-vis de l'Ukraine, s'en prenant même aux artistes russes opposés à l'invasion, comme Oleg Kulik.
Prix à payer
Certains mouvements de résistance sont connectés les uns aux autres, notamment grâce à des groupes Telegram. L'un des plus importants est probablement le mouvement de résistance civile « Yellow Ribbon » (« Ruban jaune », ndlr.), créé à Kherson pendant l'occupation de la ville en mars 2022, et devenu entre-temps de plus en plus actif dans d'autres régions, y compris en Crimée et dans le Donbass.
Moscou est persuadée de pouvoir maîtriser les pires révoltes grâce à ses méthodes habituelles : la peur et la répression. Mais dans un contexte où même des enfantssont tués pour des tentatives de sabotage (comme cela a été le cas pour Tigran Ohannisyan et Nikita Khanganov à Berdiansk), et où une publication sur Facebook peut vous envoyer sept ans en prison, chaque geste, aussi petit soit-il – comme celui des mavkas – prend une importance extraordinaire.
Oleksandra Matviïtchouk, fondatrice du Centre pour les libertés civiles – une ONG ukrainienne lauréate du prix Nobel de la paix 2022, aux côtés de l'activiste biélorusse Alès Bialiatski et de l'ONG russe Memorial – soutient les mavkas. « Les Ukrainiennes sont en première ligne contre l'occupant et apportent une énorme contribution, aussi bien au front dans les territoires occupés qu'à l'arrière. Ne mettez pas les Ukrainiennes en colère ! Le courage n'a pas de genre »souligne-t-elle dans un appel.
Refuser un passeport ou une allocation russe, taguer un mur en jaune et bleu, peindre un trident ukrainien sur une clôture, ou simplement refuser de coopérer avec les occupants peuvent paraître des actes de protestation bien anodinscomparés à la violence extrême observée partout ailleurs pendant cette guerre. À Melitopol – à l'époque où le mouvement des mavkasémergeait – un groupe inconnu avait par exemple fait exploser la voiture dans laquelle se trouvait le maire placé par les Russes.
Mais ce serait oublier les risques liés aux gestes publics d'opposition au régime russe et l'importance de ces actions coordonnées et réfléchies.
Dans une interview, le fondateur de Yellow Ribbon souligneque de nombreux citoyens des zones occupées se méfient des formes de protestation, même symboliques, et craignent que les services secrets ou les autorités russes surveillent et poursuivent les Ukrainiens « politiquement dangereux ».
Les risques sont d'autant plus grands pour les femmes, notamment celles qui vivent seules ou dans des endroits isolés des zones occupées. Sur les chaînes prorusses qui tournent dans les foyers de Melitopol, une véritable « chasse aux femmes » est mise en œuvre, et les mavkas y sont dénoncées comme des saboteuses.
Les soldats russes sont connus pour leur brutalité ; à l'égard des femmes, elle prend la forme de violences sexuelles. De nombreux témoignages émergent des zones nouvellement libérées par les forces ukrainiennes, suivis par de nombreuses enquêtes et investigations.
Dans un tel climat, toute forme de résistance a de la valeur. Les Ukrainiens habitant dans les zones occupées ont adopté une stratégie de survie passive. Cependant, des mouvements comme celui des mavkas suivent une autre approche : celle de ne pas renoncer, même si le prochain acte de résistance pourrait, malheureusement, être le dernier.
Source : Andrea BRASCHAYKO in Valigia Blu, traduit par Gabriella GRUSZKA
https://solidarity-ukraine-belgium.com/les-mavkas-en-colere-ces-femmes-en-premiere-ligne-de-la-resistance-ukrainienne/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Journée internationale de la démocratie - Mouvement Démocratie Nouvelle
15 septembre 2024 | lettre
Bonjour Bernard,
En cette Journée internationale de la démocratie, qui a lieu le 15 septembre de chaque année, permettez-nous de souligner l'historique du Mouvement Démocratie Nouvelle, de faire état de la situation de la démocratie représentative, en particulier au Québec, et de présenter les objectifs du mouvement pour les prochaines années.
Le Mouvement Démocratie Nouvelle a été fondé en 1999, suite à la distorsion qui avait permis au Parti Québécois de Lucien Bouchard, l'année précédente, de former le gouvernement avec moins de votes que le Parti libéral ; la même distorsion s'était produite en 1966 quand les libéraux avaient perdu le pouvoir aux mains de l'Union nationale, alors qu'ils avaient récolté 150,000 voix de plus que l'UN ; Ce genre de distorsion s'est produit cinq fois depuis 1792.
Le MDN s'est donné pour objectif de faire la promotion du mode de scrutin à finalité proportionnelle, afin de mieux refléter la volonté populaire, viser une représentation égale des femmes et des hommes, incarner la diversité québécoise, permettre le pluralisme politique, et enfin assurer l'importance des régions dans la réalité québécoise.
Ce mode de scrutin proportionnel mixte, s'il était mis en place comme le proposaient le projet de loi 39 déposé par la CAQ et le projet de loi 499 de Québec Solidaire, réduirait les distorsions qui se sont produites lors de l'élection générale d'octobre 2022, au cours de laquelle la CAQ a formé le gouvernement avec un peu moins de 40% du vote et 90 députés sur 125, alors que le PQ, le PLQ et QS ont chacun recueilli à peu près 14% des voix ; mais à cause de la concentration de leur vote à Montréal, le PLQ a fait élire 21 députés, QS 11 députés, tandis que le PQ, dont le vote était réparti sur l'ensemble du territoire québécois, n'a récolté que 3 députés. Le Parti conservateur, de son côté, s'est vu attribuer environ 13% du vote, mais aucun député.
Le MDN fait donc la promotion du mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire, où la moitié des députés seraient élus avec le système actuel, tandis que l'autre moitié serait élue en fonction de l'appui accordé par les électeurs aux partis politiques. Le terme « compensatoire » signifie que l'appui des électeurs aux partis politiques compense les distorsions dont nous avons parlé plus haut. Cette méthode existe en Allemagne, en Écosse et en Nouvelle-Zélande et y est généralement très appréciée ; les partis y sont obligés de former des coalitions durables ce qui fait qu'il n'y a pas là-bas davantage d'élections que nous n'en connaissons au Québec et que les gouvernements y sont stables. Dans un tel système, les citoyens ont véritablement l'impression que leur voix compte et que leur point de vue est pris en considération.
Contrairement à ce que les opposants à la proportionnelle mettent de l'avant, il n'y aurait pas deux classes de députés (locaux et régionaux). En Écosse, par exemple, les députés locaux et régionaux ont la même obligation de défendre les citoyens et leurs intérêts ; avec ce mode de scrutin, la représentation régionale serait plus forte, plurielle et arc-en-ciel.
Au Québec, notre système électoral n'a jamais réellement conduit à une démocratie vraiment représentative, à cause de ses constantes distorsions. Quand Robert Bourassa, en 1973, avait recueilli environ 50% du vote exprimé, le résultat avait été l'élection de 102 députés libéraux sur 110. L'objectif démocratique poursuivi par le MDN serait, en regard de cette distorsion, que, lorsqu'un parti politique reçoit 50% du vote, il fasse élire, plus ou moins, 50% des députés.
Le MDN : souhaite que les politiciens (CAQ, PQ, QS, Parti vert) respectent leur parole donnée solennellement en 2018 (le PLQ n'avait pas voulu signer). Que tous les partis, même le PLQ, confiné depuis 2022 dans le West Island, se rendent compte que seule la proportionnelle mixte compensatoire peut leur permettre une représentation dans toutes les régions du Québec.
Mouvement pour la Suite du Monde
Nous désirons de plus vous rappeler que le Mouvement pour la Suite du Monde, auquel s'est joint le MDN, organisera de grandes marches à Montréal, Québec et dans d'autres villes, marches pour lesquelles nous sollicitons votre participation, le 27 septembre prochain. Voici à ce sujet le communiqué de presse du mouvement, publié le 29 août dernier. Vous trouverez également sur Facebook les détails sur ces différentes marches et manifestations. Au plaisir de vous y voir !
Le Mouvement pour la Suite du Monde revendique que cesse la prise de nombreuses décisions en déni de toute démocratie et qu'un véritable engagement soit pris par nos gouvernements pour faire face à la transition sociale et environnementale. Le site web est https://pourlasuitedumonde.ca/
Appuyez le Mouvement Démocratie Nouvelle !
Devenez membre du MDN et/ou contribuez en vue d'une plus juste démocratie !

La presse algérienne dénonce le score « soviétique » du Président Tebboune

Le miracle s'est produit en ce jour de pluie et d'inondations sur la terre d'Algérie. Le président algérien sortant, Abdelmadjid Tebboune, a été réélu pour un deuxième mandat avec près de 95% des voix, a annoncé dimanche le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Sur un total de 5.630 millions de « votes enregistrés, 5.320 millions ont voté pour le candidat indépendant » Tebboune, « soit 94,65% des voix », a déclaré Mohamed Charfi. Le président de l'Anie n'a pas fourni de nouveaux chiffres sur le taux de participation, après avoir annoncé dans la nuit « un taux moyen de 48% à la fermeture des bureaux », samedi à 20h00 (19h00 GMT).
Tiré de MondAfrique.
Le score du Président sortant est contesté par de nombreux observateurs. Abdelmadjid Tebboune aurait été gratifié d'une « réélection » avec un taux à la soviétique, d'après un éditorial de Yacine K. dans Le Matin d'Algérie
N'en jetez pas plus. Tebboune (79 ans) voulait être réélu avec un score qui ferait pâlir Kim Jong-un, le voilà bien servi ! Donc, l'Algérie est repartie pour 5 ans avec un chef d'Etat jamais avare de grandes déclarations… sans lendemains.
En revanche, ses faiseurs de roi n'ont eu aucune pitié pour ses deux lièvres,Youcef Aouchiche (2,16%) et Abdelaali Hassani Cherif (3,17 %). Ils les ont pourvus de taux particulièrement ridicules. Ils auraient pu leur renvoyer l'ascenseur pour services rendus. Même pas… Comme quoi, il n'y a absolument rien à attendre de ce régime.

Tout indiquait que cette élection n'en serait jamais une. Avec un ministre de l'Intérieur, comme directeur de campagne du chef de l'Etat, fallait-il attendre autre chose ? Le régime a tout balisé depuis des mois. Répression tous azimuts, musellement des voix dissidentes, association des médias lourds et journaux dans une entreprise de manipulation à grande échelle pour faire avaler les potions les plus imbuvables que pouvaient imaginer les crânes d'oeuf de Tebboune.
Ensuite, il y a eu l'épisode des annonces des taux de participation hier par Mohamed Charfi. Le taux de participation a commencé modestement le matin avant de bondir dans l'après midi. Puis à 17h, les chiffres s'affolent dans la bouche de l'auguste président de l'ANIE. Ils passent sans coup férir de 26,45% à 48,03%. Et 19,57% pour la communauté nationale établie à l'étranger. Ces taux restent provisoires ce soir.
Et comme les réjouissances ne sont pas finies, demain, le taux de participation au niveau national franchira allègrement les 50%. Voilà qui confortera l'oncle Tebboune qui s'estimait mal élu en décembre 2019. Ainsi, il pourra poursuivra, sans retenue, son oeuvre d'immobilisme mortifère du pays.
Quant à ses deux lièvres, finis les plateaux télé, les sorties publiques… ils se feront oubliés dès demain pour leur formidable participation à cette parodie.
*Source : Le Matin d'Algérie
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Diviser pour mieux régner

Avez-vous remarqué que la CAQ a sans cesse recouru à un discours clivant pour gagner des votes durant la dernière élection ? Plusieurs fois pendant la campagne, nous avons entendu François Legault prétendre que Montréal, son apparente hantise, méprisait les résident·es de la ville de Québec et des régions en général. « Les gens de Montréal », comme il les appelle, en donnant l'impression qu'il s'agit d'étranger·es. Au lendemain des élections, la carte électorale semblait néanmoins rendre compte de cette segmentation politique selon le lieu d'habitation.
Il serait alors tentant de croire que cette opposition entre Montréal et le reste du Québec se reflète réellement dans les valeurs politiques des électeurs et électrices. Plusieurs grands médias ont également relayé ce constat au lendemain des élections. Plus on le dit, plus ça existe. Ce type de discours est une stratégie qui impose une vision qui ne reflète pas la réalité et alimente les clivages, la marginalisation de certaines pensées et les préjugés.
Pendant la campagne, ce discours s'est aussi fait entendre lors de nombreuses prises de parole de la part de plusieurs partis au sujet de l'immigration. La venue de nouveaux et nouvelles arrivant·es sur le territoire a souvent été présentée comme une menace à la cohésion sociale et à la survie de la nation. Même le ministre sortant responsable de l'immigration a tenu des propos révoltants sur les personnes immigrantes, en suggérant qu'elles ne souhaitent ni s'intégrer ni travailler ou parler français. Il y a longtemps qu'une campagne électorale québécoise avait donné dans les attaques aussi gratuites et violentes à l'endroit de personnes qui ont d'abord et avant tout besoin de notre accueil et de notre soutien.
Aucune région du Québec n'est un bloc monolithique. À Montréal, le Parti conservateur du Québec est arrivé deuxième ou troisième dans dix circonscriptions. Ailleurs au Québec, Québec solidaire a fait des gains importants en termes de pourcentage de votes dans plusieurs régions, obtenant le deuxième ou troisième rang dans plusieurs circonscriptions. L'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a d'ailleurs démontré que les questions identitaires comme l'immigration, la langue ou la laïcité orientent peu le choix électoral des électeur·rices. Associer des courants politiques à des régions du Québec en se basant uniquement sur le résultat du vote est une forme de raccourci intellectuel. Les forces progressistes sont actives partout au Québec, bien que le résultat des élections tende à le masquer.
Ne nous laissons pas piéger par une interprétation du vote de la dernière élection qui simplifie les enjeux. Il sera essentiel de nous concentrer sur les attaques contre le filet social qui nous attendent avec le gouvernement caquiste. Sans oublier les projets néfastes dont il faudra se défendre, son capitalisme vert entre autres. Peu importe où on habite au Québec, de l'Abitibi à la Gaspésie en passant par les grandes villes, il faudra compter sur la force des mouvements sociaux, sur leurs capacités à s'organiser et résister, pour former une véritable opposition au gouvernement hors des partis politiques.
Comme média indépendant de gauche, À bâbord ! en appelle à ne pas se laisser contaminer par une politique partisane qui cherche à diviser pour mieux régner. Ne perdons pas de vue que ce qui nous unit est plus important que ce qui semble parfois nous séparer. Une grande force progressiste existe toujours au Québec et œuvre quotidiennement, dans ses mouvements sociaux, dans ses syndicats, dans ses organismes communautaires, à protéger les acquis et à améliorer les conditions de vie de tou·tes dans une visée de réelle justice sociale et environnementale.

Sommaire du numéro 94

Pour vous procurer une copie papier de ce numéro, rendez-vous sur le site des Libraires ou consultez la liste de nos points de vente.
Sortie des cales
On en est rendu à argumenter sur La Petite Sirène… / Jade Almeida
Mémoire des luttes
Direct Action : Une expérience radicale / Alexis Lafleur-Paiement et Mélissa Miller
Élections provinciales
Oser prendre toute la place à gauche / Benoit Renaud
Une hégémonie de longue durée ? / Philippe Boudreau
Regards féministes
Pour une relance féministe, verte et juste / Kharoll-Ann Souffrant
Analyse du discours
Comment rendre l'extrême droite présentable / Claude Vaillancourt
Économie
Tous égaux face à l'inflation ? / Julia Posca
Environnement
Résister et fleurir dans Hochelaga / Estelle Grandbois-Bernard
Société
Aider, mais pas n'importe comment ! / Jérémie Lamarche
Éducation
CAQ : Cette priorité prioritaire qui se cherchait une crise à résoudre / Wilfried Cordeau
Culture numérique
Facebook : la tyrannie de la popularité / Yannick Delbecque
Environnement
Le pétrole au secours de l'écologie / David Beauchamp
Mini-Dossier : Nommer pour mieux exister
Coordonné par Isabelle Bouchard, Elisabeth Doyon et Miriam Hatabi
Apprendre à nous écrire / Entrevue avec Magali Guilbault Fitzbay / Propos recueillis par Isabelle Bouchard
Toponymie autochtone - la racine des cultures / Adam Archambault
Bilinguisme officiel, traduction et langues autochtones / René Lemieux
Les food trucks, de Galarneau aux bobos / Pascal Brissette et Julien Vallières
La langue is never about la langue / Arianne Des Rochers
Dossier : Financiarisationdu logement. Champ libre au privé
Coordonné par Francis Dolan et Claude Vaillancourt
Photos par Rémi Leroux
Que signifie la financiarisation du logement ? / Louis Gaudreau
Prolifération des condos, densification et exclusion / Marc-André Houle
Les gouvernements ont affaibli le filet social / Véronique Laflamme
Locataires, on se mobilise ! / Martin Blanchard
Au cœur d'une crise excentrée / Cédric Dussault
Pas de plan Marshall en vue, les locataires prennent la rue ! / Comité d'action de Parc-Extension
Un travail invisible et essentiel / Marie-Ève Desroches
Mainmise sur les terrains publics : Sevrer la bête / Karine Triollet, Margot Silvestro et Francis Dolan
La campagne pour le Right to Counsel à New York / Marcos Ancelovici
Culture
Recensions
À tout prendre ! / Ramon Vitesse
Couverture : Rémi Leroux

On est rendu à argumenter sur La petite sirène...

En juillet 2020, on annonce que le rôle iconique de la petite sirène sera interprété par la chanteuse afro-américaine Halle Bailey : c'est le scandale sur les réseaux sociaux. Une analyse du débat en ligne à travers le concept de « racebending » s'avère nécessaire.
Ariel est une princesse qui vit sous l'océan, fascinée par le monde des humains, elle rêve de « partir là-bas » un jour. Elle nage souvent jusqu'à la surface et finit même par tomber amoureuse d'un humain. Lorsque son secret est découvert, et face à la colère de son père, elle passe un pacte avec une femme mi-octopus, Ursula, pour échanger sa queue de poisson contre des jambes. Tout ici fait donc appel à l'imagination. Après tout, son meilleur ami, jaune et bleu, s'appelle Polochon, et un goéland lui vient en aide pour que le prince Éric l'aime en retour.
Pour autant, dès l'annonce du casting de Halle en juillet 2020, internet explose. Dans les heures qui suivent, le mot-clic #NotMyAriel (#PasMonAriel) est en trending mondial sur Twitter, tandis que des adultes d'âge mûr se filment en train de mettre à la poubelle ou de mettre le feu à leur DVD de La Petite Sirène. Iels affirment qu'Ariel ne peut pas être incarnée par une jeune femme noire (parce que, bien évidemment, c'est de cela qu'il s'agit) et voilà que les détracteur·trices s'accaparent des termes comme « appropriation culturelle », « effacement de l'héritage », certain·es allant plaider une attaque envers la culture européenne.
Internet ayant la mémoire courte, le débat s'apaise. Mais voilà, en septembre 2022, un premier extrait de la bande-annonce est rendu public et le hashtag #notmyariel repart de plus belle. Des semaines plus tard et nous en sommes encore à argumenter pour défendre le casting d'une princesse mi-poisson qui chante « sous l'océan ». Et par nous, j'entends la communauté noire, mais aussi pas mal d'autres communautés racisées, malheureusement habituées à subir les flammes de la suprématie blanche.
Ces cris d'orfraie, qui sonnent aussi faux qu'Eurêka sous la pleine lune, témoignent en réalité d'une incompréhension fondamentale de la différence entre « whitewashing » et « racebending » et, de manière plus générale, d'une incompréhension de ce qu'est l'appropriation culturelle ainsi que d'un total refus de comprendre le racisme systémique.
Whitewashing, racebending
Le « whitewashing » ou blanchiment est le fait d'utiliser des acteur·rices blanc·hes pour jouer le rôle de personnages racisés. L'histoire cinématographique états-unienne en est jonchée d'exemples : pensez, John Wayne pour Genghis Khan, Rooney Mara pour la « princesse indienne » de Peter Pan, Tilda Swinton pour Yao alias l'Ancien de Dr. Strange, quasiment tout le casting d'Avatar : le dernier maître de l'air, le film Gods of Egypt, et j'en passe des plus ridicules… Certains de ces rôles étaient d'ailleurs joués de sorte à se moquer de la communauté dépeinte (c'est le cas avec Mickey Rooney qui caricature un personnage supposé être japonais dans Petit déjeuner chez Tiffany), mais elle est d'autant plus dommageable lorsqu'on prend en compte le faible nombre de personnages racisées offerts dans les médias. Ainsi, les opportunités de casting pour les acteur·rices racisé·es sont risibles comparativement à leurs collègues blanc·hes, et si des changements s'opèrent très récemment, on reste extrêmement loin de l'historique d'opportunités et de représentations offertes au public blanc depuis l'invention du cinéma.
De l'autre côté, nous avons le « racebending », qui consiste à changer l'appartenance raciale d'un personnage. Alors que « whitewashing » consiste à choisir une personne blanche pour incarner une personne racisée, le « racebending » consiste à changer l'appartenance raciale d'un personnage, lorsque cette appartenance n'a pas de lien avec l'histoire, et choisir un·e acteur·rice racisé·e pour l'incarner. Les occasions de « racebending » sont donc bien spécifiques. Par exemple, il est impossible de le faire avec Mulan. En dépit de toutes les libertés que le studio Disney a pris avec la Ballade de Mulan, livre sur lequel est basée le dessin animé, le fait que Mulan soit chinoise reste au cœur de ses motivations. Toute l'histoire est modelée par le fait qu'elle se déroule en Chine et par son appartenance à ce territoire. Mulan prend les armes pour défendre la Chine contre une invasion extérieure, après tout. Black Panther est supposé être un roi d'un territoire en Afrique, isolé du reste du monde. Dans ce contexte, il ne peut être joué que par une personne noire pour que l'histoire ait du sens. Ainsi, l'appartenance raciale et ethnique de ces personnages est profondément liée à leur raison d'être.
Racebending et culture populaire
Au contraire, Spiderman n'a pas une appartenance raciale particulière par rapport à son histoire, il offre donc une possibilité de « racebending », ce que bon nombre de fans ont déjà souligné. Après tout, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit avec ses grands-parents dans un quartier défavorisé, dont un membre de sa famille est tué par arme à feu en pleine rue, un meurtre que la police échoue à élucider. En faire un personnage noir, dans ce contexte, offre une dimension de critique sociale, voire une profondeur supplémentaire à la trajectoire du héros. Autre exemple : récemment, un·e utilisateur·rice d'un forum en ligne argumentait que Wolverine pourrait être interprété par une personne autochtone. Il s'agit d'un personnage qui a subi la torture du gouvernement canadien, à qui on a délibérément effacé les souvenirs et qui a été maintenu captif, instrumentalisé puis qu'on a tenté de détruire. Au regard de l'histoire coloniale du pays, le fait d'avoir un personnage dont on a effacé la mémoire pour le contrôler pourrait symboliser les tentatives de génocide. C'est le genre de pratique qui rentre dans la définition du « racebending ».
En ce qui concerne Ariel, plusieurs détracteurs ont déclaré que le conte originel était danois et que, par conséquent, il s'agissait d'appropriation culturelle. Bien essayé, mais non. Tout d'abord, le conte originel de La Petite Sirène est certes un texte danois, mais il s'agit d'un récit bien différent de la version Disney. Résumé rapidement, la princesse se suicide à la fin et son âme se voit condamnée à 100 ans de servitude. On est très loin du concert sous la mer et du mariage sur le bateau. Il est donc tout à fait hypocrite de vouloir défendre la version originale quand personne n'a levé un sourcil en 1989 et qu'aucune critique n'était faite dans l'annonce de la version live avant le casting de Halle.
De plus, certes le conte est danois, mais Ariel n'a absolument rien à voir avec la culture danoise, elle n'est pas codée comme telle, ni dans la version originale et encore moins dans celle de Disney. À l'inverse, regarder Mulan sans comprendre qu'elle est chinoise est impossible. Et, bien évidemment, des personnes danoises noires, cela existe, mais si on commence à vouloir faire dans la finesse, on va en perdre beaucoup. Enfin, le « racebending » est aussi une critique du traitement de la blanchité comme associée à la neutralité dans les médias. Il est intéressant de remarquer qu'on a souvent fait le choix d'un·e acteur·rice blanc·he pour incarner un personnage racisé, mais qu'on refuse qu'une personne racisée puisse incarner la blanchité. Bien qu'on n'essaie pas de faire passer Ariel pour une femme blanche dans le cas qui nous occupe, ces dynamiques sont tout de même à considérer.
Potentiels symboliques
Bien qu'il s'agisse d'un film Disney, et donc les attentes sont à modérer, le spin d'en faire une princesse noire offre une dimension intéressante à l'histoire. Comme je l'ai vu passer à plusieurs reprises sur Twitter, vu le nombre d'Africain·es jeté·es à l'eau durant le commerce esclavagiste, l'idée qu'un peuple noir se serait développé sous l'océan est presque touchant à imaginer. Et j'ai bien conscience que ma chronique a pris un tournant drastique très vite, mais n'oublions pas que ma chronique s'intitule « Sortie des cales », les cales du navire négrier, ces funestes bateaux dont les « pertes » se trouvent au fond de l'océan. Si Ariel doit être une princesse de ce royaume, qu'elle soit noire.
Illustration : Ak Rockefeller (CC BY 2.0)

Direct Action. Une expérience radicale

Les années 1980 marquent un ressac de la gauche, notamment révolutionnaire, partout en Occident. Le déclin du prestige des pays socialistes, la restructuration des milieux de travail et surtout la répression étatique ont peu à peu raison des organisations militantes. Dans ce contexte, des groupes travaillent au renouvellement de leur stratégie comme de leurs pratiques. C'est le cas de Direct Action, un collectif canadien anarchiste, écologiste, féministe et anti-impérialiste qui mène une série d'attaques contre l'État et l'industrie de 1980 à 1983.
À la suite des grands cycles de luttes des années 1960 et 1970 marqués par les grèves ouvrières, la puissance des partis communistes, la « New Left », l'Autonomie [1] ainsi que l'anti-impérialisme et la décolonisation, la gauche faiblit durant la décennie suivante. Les modèles soviétique et chinois sont de moins en moins attrayants : l'URSS connaît une stagnation politique et économique sous la direction de Léonid Brejnev (1964-1982) alors que la Chine se libéralise sous l'impulsion de Deng Xiaoping (1978-1989). Les organisations de gauche ont aussi de la difficulté à résister à la restructuration du travail et aux politiques néolibérales qui transforment les lieux de production. Le roulement et la précarisation des employé·es ainsi que la délocalisation nuisent aux groupes qui s'organisent historiquement dans les milieux de travail. Enfin, la violente répression étatique des années 1970 a détruit partout en Occident les mouvements révolutionnaires, du Black Panther Party aux États-Unis en passant par l'Autonomie italienne, sans compter la multiplication des interventions impérialistes contre les régimes de gauche, comme au Chili en septembre 1973. Dans ce contexte, les militant·es cherchent à redéfinir leur stratégie, comme c'est le cas de Direct Action au Canada.
Dans l'ambiance morose des années 1980, les révolutionnaires sont forcé·es de reconsidérer les raisons de leur échec et leurs manières de lutter. On voit par exemple émerger la revue Révoltes (1984-1988) au Québec qui ouvre le dialogue entre libertaires et marxistes. Dans le même sens, des militant·es relancent le débat sur les causes de l'oppression tout en cherchant les meilleures méthodes pour renverser l'injustice. À la fin des années 1970, la scène anarcho-punk de Vancouver joue un rôle important dans ce renouveau. Une réflexion critique du colonialisme, du capitalisme et de l'impérialisme, tournée vers un horizon égalitaire, féministe et écologiste, se développe au sein du journal Open Road (1975-1990). De ce milieu émerge, en 1980, le collectif Direct Action qui veut mener des attaques contre des symboles et des infrastructures capitalistes afin de sensibiliser la population à certains enjeux et pour nuire au système lui-même. Contrairement aux groupes armés des années 1970, souvent des factions militarisées d'un mouvement de masse, Direct Action souhaite, par son action, être un agent de la relance de la gauche au Canada.
Repenser le rapport de force
En raison de son analyse, le groupe préconise de mener des luttes de solidarité avec les peuples autochtones, d'affronter le patronat et l'État bourgeois, de participer aux campagnes antiguerres, d'attaquer l'industrie pornographique, etc. Direct Action tente de s'intégrer à l'ensemble de ces combats en se donnant la tâche spécifique de mener des actions d'éclat lorsque la situation est totalement bloquée. Le groupe espère relancer des luttes qui stagnent en faisant la démonstration qu'un nouveau rapport de force peut émerger grâce à l'action armée, comme moyen de dernier recours et en évitant de blesser ou de tuer des individus. Par une activité soutenue, on souhaite plus largement redynamiser et radicaliser la gauche canadienne. Le groupe propose une réflexion théorique tout en jouant un rôle « d'avant-garde tactique ».
Direct Action procède d'abord à des actes de vandalisme contre l'entreprise minière Amax, puis les bureaux du ministère de l'Environnement. Une première attaque d'envergure cible, le 30 mai 1982, les transformateurs de Cheekye-Dunsmuir sur l'île de Vancouver. Cette station fait partie d'un immense projet hydro-électrique particulièrement nuisible à l'environnement que les luttes populaires n'avaient pas été en mesure de bloquer. L'attentat relance le débat concernant le projet, mais celui-ci est tout de même achevé et mis en service.
Quelques mois plus tard, le 14 octobre, une seconde bombe explose, cette fois à Toronto. L'attentat vise Litton Industries, une société qui concentre tous les problèmes que dénoncent Direct Action. Cette entreprise, honnie par les citoyen·nes, produit des systèmes de guidage pour les missiles de croisière américains. Elle est financée par le gouvernement canadien et procède à des tests dangereux et polluants en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment en terres autochtones. Litton est une pièce maîtresse de l'appareil étatique, capitaliste et militaire occidental. L'attaque est annoncée par Direct Action afin d'éviter de faire des victimes, mais Litton n'écoute pas et plusieurs personnes sont blessées. Malgré tout, cette action est relativement bien perçue par les milieux militants opposés depuis des années au complexe militaro-industriel. De grandes manifestations anti-Litton suivent l'attaque et l'usine finit par perdre son financement gouvernemental.
Peu après, Direct Action se recompose sous le nom de la Wimmin's Fire Brigade et incendie, le 22 novembre 1982, trois succursales de Red Hot Video. Cette entreprise américaine se spécialise dans la distribution de films pornographiques à la limite de la légalité, globalement dégradants et apologétiques du viol. L'attaque féministe est particulièrement bien reçue par la gauche canadienne qui lutte depuis longtemps contre la chaîne. La dynamique entre action citoyenne et action directe fait le succès de l'opération ; les autorités, d'abord complaisantes, lancent des enquêtes contre Red Hot Video et six de ses boutiques finissent par fermer. À peine quelques semaines après ce succès, les cinq membres de Direct Action sont pourtant arrêté·es. Le procès de ceux qu'on surnomme les « Vancouver Five » mène à de lourdes peines.
De la lutte armée à la lutte populaire
L'arrestation des membres de Direct Action témoigne d'une limite de leur action : leur aventurisme et leur isolement les exposaient à la répression. L'usage de l'action armée, même en évitant de cibler des personnes, était aussi à double tranchant : elle permettait d'attirer l'attention sur un enjeu précis, voire d'instaurer un rapport de force direct avec l'État ou une industrie, mais pouvait effrayer les militant·es moins radicaux·ales et diviser les luttes. Sans moraliser le débat, on peut légitimement se demander si la tactique de Direct Action était suffisamment arrimée aux mouvements populaires, et si elle participait d'un horizon stratégique à même d'ébranler l'État colonial canadien et le régime capitaliste.
Ce qui est certain, c'est que le groupe a su renouveler avec pertinence l'analyse de la conjoncture canadienne, tout en ayant l'audace de rouvrir la question de la stratégie et de la tactique révolutionnaire dans un moment de ressac. En liant les questions du colonialisme, du capitalisme, de l'écologie, du patriarcat et de l'impérialisme, Direct Action a aidé les mouvements canadiens à mieux comprendre ses adversaires – l'anarcho-indigénisme de la Colombie-Britannique en témoigne encore de nos jours. La matrice théorique développée dans les années 1980 a contribué à la critique des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver qui ont eu lieu en terres volées en 2010 et informe toujours la gauche, comme on le voit dans les luttes de solidarité avec les Wet'suwet'en depuis 2019. L'activité de Direct Action pousse à réfléchir à ce qui peut être fait lorsqu'une situation politique est bloquée. Comment la gauche doit-elle agir lorsque les cadres légaux l'empêchent objectivement d'avancer, lorsque le monopole étatique de la violence lui est imposé ?
Lors de son procès, Ann Hansen, membre de Direct Action, demandait : « Comment pouvons-nous faire, nous qui n'avons pas d'armées, d'armement, de pouvoir ou d'argent, pour arrêter ces criminels [les capitalistes] avant qu'ils ne détruisent la terre ? » Une partie de la réponse se trouve dans la construction de mouvements populaires eux-mêmes en mesure de dépasser la légalité bourgeoise lorsque la situation l'exige. Cette stratégie évite l'isolement d'un groupe comme Direct Action sans confiner la gauche à la défaite lorsque l'État le décide. Un horizon commun est aussi nécessaire afin de déconstruire le capitalisme et de produire une société émancipée.
[1] La « New Left » et les mouvements autonomes (italien et français) des années 1960-1970 s'inspirent du marxisme, tout en élargissant leur champ d'action à d'autres thèmes que le travail.
Alexis Lafleur-Paiement et Mélissa Miller, pour le collectif Archives Révolutionnaires (En ligne : https://archivesrevolutionnaires.com)
Photo : Archives révolutionnaires

Pour une relance féministe, verte et juste

On sait déjà depuis longtemps : les changements climatiques pourraient entrainer la pire crise migratoire de l'histoire de l'humanité. Les femmes du Sud global sont au front de cette lutte.
Comme dans toute chose, nous ne sommes pas tous·tes égaux·ales face à la crise climatique. C'est ici que le concept de justice climatique prend tout son sens. Selon l'organisation Greenpeace, la justice climatique réfère à un mouvement qui consiste à « demander des comptes aux industries et aux entreprises climaticides pour les dommages irréversibles qu'elles provoquent, c'est-à-dire à les tenir légalement responsables des dégâts humains et environnementaux dont elles sont la cause ». Qui plus est, le concept de justice climatique comprend des dimensions morale, éthique, politique ainsi que de justice sociale. Elle surpasse donc la simple responsabilité individuelle pour s'étendre à la responsabilité des corporations.
Selon la jeune militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate, il ne peut y avoir justice climatique sans égalité entre les genres. Les pays où les jeunes filles sont les moins susceptibles d'être scolarisées sont également ceux où la crise climatique frappera le plus fort. Dans une perspective de justice climatique, il faut s'atteler à scolariser ces jeunes filles afin qu'elles soient outillées devant ce qui nous attend collectivement. De plus, les premier·ères concerné·es doivent être à la table des décisions, là où se font les choix qui affecteront notre planète. On n'a qu'à penser aux différents sommets sur le climat.
En effet, les pays occidentaux sont les plus grands responsables de la crise climatique actuelle, notamment en raison de la pollution qu'ils génèrent. Paradoxalement, ce sont les pays du Sud global, et en particulier les femmes qui y habitent, qui subissent les pires conséquences du réchauffement climatique. L'Afrique est responsable de moins de 4 % des émissions globales de gaz à effet de serre [1]. Pourtant, ce continent subit déjà les contrecoups très importants du réchauffement climatique même si ce fait ne figure pas sur les pages couverture des médias du monde occidental.
Ainsi, il est fallacieux de parler de la crise environnementale comme quelque chose qui affectera uniquement les prochaines générations. La crise climatique est déjà commencée et bouleverse actuellement de nombreux pays, au présent. Prétendre le contraire trahit un certain biais et privilège. Notamment, un rapport de 2016 du gouvernement du Canada estimait déjà que d'ici 2050, le nombre de réfugié·es climatiques avoisinerait les 25 millions à un milliard de personnes. Ces mouvements migratoires de masse sont déjà en cours en raison du fait que certaines régions deviennent inhabitables. Les images spectaculaires des inondations monstres au Pakistan à l'été 2022 en sont un triste exemple.
Bien qu'elle ait été éprouvante, qu'elle ait fauché la vie et endeuillé des millions de personnes dans son sillage, la pandémie de COVID-19 nous offre une fenêtre d'opportunité pour repenser notre monde de fond en comble, voire retourner à certaines sources. Or, cette fenêtre d'opportunité est en train de se refermer petit à petit.
En effet, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui regroupe des sommités en matière d'environnement, le monde n'a que quelques années – trois ans selon son dernier rapport – pour faire un virage vert. Il est plus qu'important de prendre la balle au bond pour une relance féministe, intersectionnelle, verte et juste. Nous le devons aux générations actuelles et aux prochaines. C'est maintenant ou jamais.
[1] Selon un communiqué de ONU Changements Climatiques qui cite l'Agence internationale de l'énergie, disponible à l'adresse suivante : https://unfccc.int/fr/news/la-semaine-africaine-du-climat-2022-vise-a-exploiter-les-possibilites-d-action-en-faveur-du-climat
Photo : Oxfam International (CC BY-NC-ND 2.0)

Comment rendre l’extrême droite présentable

Les succès considérables de l'extrême droite dans le monde risquent-ils de se reproduire chez nous ? Peu réceptives d'emblée à ce mouvement, les populations québécoise et canadienne sont confrontées à une grande opération de séduction des partis de cette tendance.
À l'échelle internationale, l'extrême droite est une nébuleuse qui échappe à une définition précise. Cette difficulté à bien la cerner, ses multiples visages, ses actions à la fois au sein et à l'extérieur de la politique partisane, et surtout sa présence et ses objectifs variables d'un pays à l'autre rendent difficile les actions concertées contre elle.
Ainsi, on pourrait opposer l'extrême droite libertarienne d'Amérique du Nord à celle affichant un racisme décomplexé dans plusieurs pays d'Europe. La principale préoccupation du mouvement nord-américain semble surtout d'atteindre un libéralisme économique total, avec son corolaire, un État dont le champ d'intervention se réduit comme une peau de chagrin. Les libertariens, en principe, accueillent tout le monde dans le rang, à condition qu'on adhère à leur vision d'un monde économique sans réglementation, y compris les nombreux religieux conservateurs qui viennent souvent brouiller les cartes.
En Europe, c'est surtout le rejet de l'immigration qui réunit les extrêmes droites. Celle-là est vue comme une grande menace et s'appuie, dans sa veine la plus paranoïaque, sur la théorie du grand remplacement, selon laquelle les personnes d'origine étrangère en viendraient à marginaliser les populations locales. Du point de vue de la politique partisane, cela donne lieu à des politiques anti-immigration, soient bien réelles comme en Hongrie, soit en progrès comme en France, soit en voie de devenir beaucoup plus radicales comme en Italie.
Pourtant, la distinction entre l'extrême droite européenne et américaine est loin d'être aussi nette qu'elle le semble. Les libertariens des États-Unis se sont accommodés des politiques anti-immigrant·es sous le gouvernement de Trump, dont la construction d'un mur à la frontière du Mexique. De plus, des liens tacites avec certains groupes armés et suprémacistes blancs, avec les complotistes, dont ceux de QAnon, obscurcissent le portrait, entre autres au sein du parti républicain.
En Europe, l'extrême droite s'accorde très bien avec des politiques économiques ultralibérales, comme en Hongrie, en Pologne, ou comme le souhaite Georgia Meloni en Italie. Malgré certaines promesses de soutenir les perdant·es de la mondialisation et des discours contre les grandes institutions internationales, plusieurs pays dont on qualifie les gouvernements d'« illibéraux » ont adopté des choix politiques clairs : une réduction des droits et un rétrécissement de la démocratie, tout en accordant une grande liberté à l'entreprise privée.
La formule québécoise et canadienne
Au Canada, un peu comme aux États-Unis, mais à un degré nettement moindre, l'extrême droite joue sur deux fronts. Un front militant défend, entre autres, des positions radicales en faveur de l'accès aux armes à feu, contre l'avortement et contre les mesures sanitaires liées à la COVID, sans oublier un scepticisme devant le réchauffement climatique et une forte résistance devant les mesures à prendre pour le limiter. L'occupation des camionneurs à Ottawa à l'hiver 2022 a montré les capacités de mobilisation de ce front et sa capacité d'aller chercher du financement (10,7 millions $ accumulés dès le début de l'occupation [1]). Recueillir une pareille somme si rapidement montre que le mouvement a d'importants appuis dans le milieu des affaires.
Le front politique de l'extrême droite est dans une situation plus délicate. La population canadienne, en grande partie, a peu de sympathie naturelle pour cette tendance politique. Cela d'autant plus qu'elle a subi de plein fouet les conséquences de mesures d'austérité tant à l'échelle nationale que provinciale qui lui ont rappelé les méfaits du désengagement de l'État. Arriver avec un programme libertarien qui replongerait les gens dans ce qu'ils ont si peu apprécié, et reculer en plus sur les questions sociale et environnementale n'est pas attrayant pour elle. Les partis conservateurs d'extrême droite doivent donc ajuster leurs programmes et leur stratégie de communication en conséquence.
Un œil sur le programme de Parti conservateur du Québec (PCQ) réserve de réelles surprises. Nous sommes loin des revendications bruyantes et provocantes du Réseau Liberté-Québec, fer de lance des idées libertariennes au Québec, et dont l'un des principaux représentants était Éric Duhaime. Mais le bel emballage dans lequel on formule les éléments du programme et la retenue relative de certaines propositions (les baisses d'impôts, par exemple, ne concernent que les deux premiers paliers d'imposition) ne cache pas de nombreux aspects inquiétants.
En environnement, on souhaite continuer à exploiter les ressources, en remettant à plus tard « l'adaptation aux changements climatiques » (« causés ou non par l'activité humaine [2] » !) On prétend résoudre la crise du logement en donnant plus d'allant aux mesures qui l'ont accentuée, en accordant notamment plus de pouvoir aux propriétaires. Quant à l'immigration, on avance, pour mieux la contrôler, la notion de « compatibilité civilisationnelle », très difficile à évaluer, et qui ouvrira grand la porte à la discrimination et à l'expression de préjugés. L'appui on ne peut plus favorable au privé dans tous les domaines est un leitmotiv qui revient du début à la fin du programme.
Aux dernières élections, le PCQ profitait, selon plusieurs journalistes, d'un vent favorable, avec un chef médiatisé et un fort soutien conjoncturel des anti-masques et des anti-vaccins. L'appui significatif de 13 % des voix pourrait ne plus se reproduire, selon plusieurs analystes. La menace la plus significative de l'extrême droite en politique vient sans aucun doute du niveau fédéral.
Un nouvel élan au Parti conservateur du Canada
L'élection de Pierre Poilievre à la tête du PCC est une nouvelle relance pour l'extrême droite, du moins au Canada anglais, après les années Harper. Le nouveau chef a tout contre lui : fortement prohydrocarbure, anti-taxe sur le carbone, fièrement anti-woke, libertarien – au point de s'en prendre à la banque du Canada et de préférer les très instables cryptomonnaies –, opposé au financement des médias publics. De plus, l'emballage de ses idées va avec leur contenu, Poilievre ne craignant pas la provocation, les coups d'éclat, les déclarations à l'emporte-pièce, adaptant, avec quelques réserves, le modèle Trump aux réalités canadiennes.
Avec de telles prises de position, sa non-réélection pourrait sembler assurée. Un recentrage factice et formaté pour remporter la victoire aux prochaines élections pourrait cependant lui donner de l'allant. Rappelons que son prédécesseur, Erin O'Toole, avait lui aussi flatté l'aile droite du parti avant d'entreprendre un virage centriste une fois élu chef (il avait même utilisé le terme « progressiste » pour qualifier son parti, en souvenir d'une époque où ce parti portait ce mot dans sa dénomination). Surtout, le jeu de l'alternance du pouvoir et la lassitude envers Justin Trudeau et les libéraux le mettront dans une position très avantageuse.
S'inquiéter ou pas ?
La tentative de l'extrême droite québécoise et canadienne de se rendre présentable ne semble cependant pas, dans l'ensemble, remporter de grands succès pour le moment. La progression du mouvement à l'échelle internationale demeure malgré tout très inquiétante : combien de temps saurons-nous résister à ces assauts ?
L'extrême droite a tendance à se nuire elle-même par l'affrontement entre ses diverses tendances. Le conservatisme social, le libertarianisme, les défenseur·euses de politiques racistes, les tenant·es de l'autoritarisme et de la force militaire n'arrivent pas toujours à bien s'entendre, un peu comme la gauche qui s'affaiblit à force de se diviser. Mais contrairement à la gauche, elle a trouvé un point de ralliement à l'épreuve de tout, son soutien au libéralisme économique qui lui assure sa force et sa cohésion.
L'extrême droite, même dans sa version relativement « adoucie », sème sa part de problèmes. Rappelons-nous de tous les reculs pendant les années du gouvernement Harper : compressions budgétaires massives et diminution majeure de l'appareil d'État ; négociations d'ententes avec des paradis fiscaux et d'accords de libre-échange ; diminution et forte conditionnalité de l'aide étrangère (et appui à des organisations antiavortement) ; politiques anti-palestiniennes ; etc.
Plusieurs personnes qui ont commenté la dernière campagne électorale au Québec ont affirmé que le PCQ offrait des options absentes des plateformes des autres partis, ce qui lui assurait une indubitable légitimité.
Certes, la démocratie doit permettre l'expression de tendances les plus variées au sein de l'électorat. Mais la tendance soft de l'extrême droite fait sa part de ravages qu'il est long à rectifier par la suite. Elle ne peut qu'engendrer des reculs importants sur des questions qu'on croyait réglées. En notre ère d'urgence climatique, elle cause des retards désastreux dans les politiques à adopter. Et surtout, elle pourrait ouvrir la porte à un radicalisme violent, rétrograde, dévastateur, comme on en a eu un inquiétant aperçu, entre autres, dans les États-Unis de Trump. D'où la nécessité de bien la tenir à l'œil.
Illustration : Ramon Vitesse
The first proclamation of anarchist communism in history (Mexico, 1912)
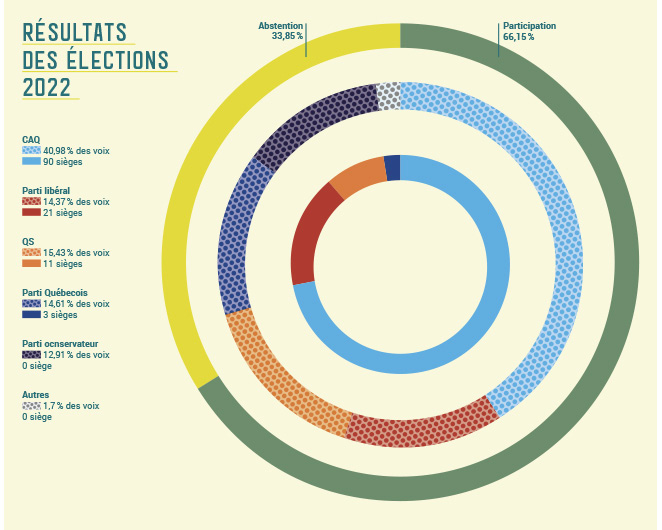
Une hégémonie de longue durée ?
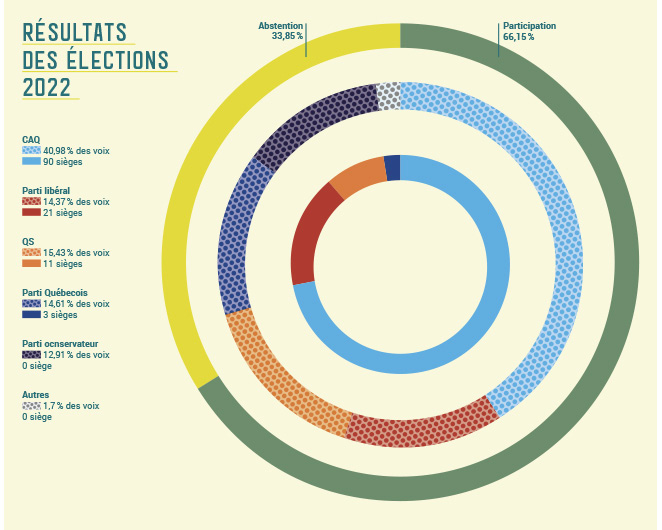
Au-delà du décompte des voix et des sièges, quelles sont les tendances lourdes des dernières élections provinciales ? Quelle analyse faire de ces résultats ?
Les forces de droite ont remporté une éclatante victoire le 3 octobre dernier, les trois principaux partis à leur service récoltant ensemble 68 % des voix. Deux d'entre eux s'en sortent considérablement mieux, l'un reconduisant, avec 41 % des voix et 90 sièges, sa mainmise sur l'État québécois pour quatre années supplémentaires, l'autre formant l'opposition officielle avec 14 % des voix et 21 sièges. Le troisième est condamné jusqu'à nouvel ordre à mener une existence extraparlementaire, bien qu'il ait obtenu 13 % des suffrages. Mais au-delà du décompte des voix et des sièges, quelles sont les tendances lourdes ? Quelle analyse faire de ces résultats ?
Dans un premier temps, notons que le réalignement électoral ayant mis fin le 1er octobre 2018 au vieux duopole exercé par le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) a donné naissance à un nouveau système partisan caractérisé par la domination de la Coalition avenir Québec (CAQ). Cette formation a manifestement trouvé une niche gagnante grâce à ce que le politologue Frédéric Boily appelle le néonationalisme autonomiste caquiste, inscrit dans la filiation directe du nationalisme de l'État provincial légué par Honoré Mercier, Maurice Duplessis, Daniel Johnson et Robert Bourassa.
Ce néonationalisme autonomiste combine divers éléments de nature économique et identitaire, permettant à la CAQ de tirer son épingle du jeu dans un contexte où le clivage souverainisme/fédéralisme s'affaiblit au profit de deux autres axes de polarisation. Le premier clivage oppose, d'une part, la défense d'une culture québécoise de référence (langue française, laïcité et soi-disant « valeurs québécoises ») à laquelle doivent s'assimiler les immigrant·es et, d'autre part, une approche pluraliste et inclusive de la gestion de la diversité. Le second oppose le productivisme (croissance ininterrompue, extractivisme, développement autoroutier, étalement urbain…) à une politique économique conçue pour faire face au défi des changements climatiques et pour s'attaquer aux inégalités sociales.
Dynamiques structurelles
Analysée sur le temps long, c'est-à-dire sur quelques décennies, la politique partisane québécoise présente somme toute un visage relativement stable, inscrite qu'elle est dans des structures robustes et durables, en l'occurrence des rapports de classe et des institutions parlementaires britanniques.
Au chapitre des rapports de classes, les périodes de grands bouleversements sociaux, quoique rares, interviennent parfois spectaculairement dans la joute partisane, bouleversant l'échiquier et – éventuellement – provoquant un phénomène de réalignement électoral. C'est ce dont nous avons été témoins entre autres durant la première moitié de la décennie 1970, le phénomène de réalignement culminant en 1976 avec la victoire historique du PQ. À son tour, durant la décennie 2010, le Printemps érable a accéléré une recomposition de l'échiquier partisan sur le flanc gauche et a contribué à imposer la grammaire gauche/droite comme axe déterminant de polarisation dans le cadre électoral.
Le Québec Inc lui-même a donné à fond dans la lutte des classes durant cette fameuse décennie 2010. Avec le néolibéralisme aux commandes durant l'ère Jean Charest, puis à nouveau durant les années d'austérité sous la houlette du trio Leitão-Coiteux-Couillard, la polarisation gauche/droite était à l'épicentre de la vie politique. La bourgeoisie est sortie gagnante de cette guerre de tranchées, parvenant à rendre méconnaissable l'État providence et à obtenir aussi, par ailleurs, des taux de croissance économique et des dividendes fort avantageux pour le 1 %.
Le PLQ, alors qu'il lui avait été pourtant si loyal, semble avoir été peu à peu abandonné par le Québec Inc. Celui-ci a désormais jeté son dévolu sur la CAQ, la marque libérale s'étant progressivement discréditée durant ladite décennie 2010 sous l'effet de différents facteurs, comme le financement occulte du parti, la brutalité des mesures d'austérité et une incapacité à entrer en symbiose avec la majorité nationale francophone. Tant et si bien que le PLQ est devenu un tiers parti et pourrait être réduit, possiblement, à sa fonction de groupe de pression au service de la minorité anglo-québécoise.
Le Québec Inc ayant besoin de stabilité économique et de continuité politique, le règne de la CAQ pourrait éventuellement dépasser les huit ans. Notre régime parlementaire s'y prête fort bien, pourvu qu'il reste défini par ses institutions usuelles, dont le mode de scrutin avec les effarantes distorsions qu'il génère au profit du parti vainqueur et de celui formant l'opposition officielle. Dans un tel régime, le bipartisme peut même devenir notoirement facultatif. C'est ce que suggère la configuration du système partisan actuel, pouvant être qualifié d'unipolaire puisque la CAQ domine outrageusement face à un assortiment de tiers partis : PLQ, Québec solidaire, PQ et, dans une moindre mesure, Parti conservateur du Québec (temporairement absent de l'Assemblée nationale).
Ce système partisan unipolaire fondé sur l'hégémonie caquiste ressemble à s'y méprendre à celui qui marquait la période 1993-2006 à Ottawa. En effet, le Parti libéral du Canada (PLC) régnait en roi et maître face à une opposition durablement fragmentée, divisée qu'elle était entre le Bloc québécois, le Nouveau parti démocratique (NPD), le Parti conservateur (PC) et le Reform Party/Alliance canadienne. Notre régime parlementaire s'accommode fort bien de cette situation où le parti vainqueur n'est pas menacé de l'intérieur du système, pouvant ainsi gouverner sans interruption pendant l'équivalent d'une demi-génération.
Et l'alternance, alors ?
Sur la scène fédérale canadienne, c'est le processus de réorganisation de la droite, couronnée par la fusion du PC et de l'Alliance canadienne, qui a permis de mettre un terme en 2006 au long règne du PLC. Parmi les scénarios envisageables pour la politique québécoise en 2026 ou en 2030, il ne faut surtout pas écarter la possibilité d'une certaine recomposition des forces partisanes à droite.
Dans une bonne mesure, la CAQ elle-même est le résultat d'un semblable processus. À la suite de scissions au sein des élites dirigeantes, notamment celles liées au PLQ ou au PQ, la CAQ est fondée en 2011 par François Legault, l'homme d'affaires Charles Sirois et quelques autres personnalités politiques. Le parti, qui se définit alors comme une coalition arc-en-ciel, réussit également sa fusion avec l'Action démocratique du Québec. Rien n'empêche qu'un tel processus de recomposition devienne à nouveau nécessaire d'ici 2030, à plus forte raison si une part notable des forces de droite reste systématiquement exclue de la vie parlementaire. En effet, le courant qui se reconnaît actuellement dans le PCQ doit en toute logique pouvoir se matérialiser à l'Assemblée nationale d'une façon ou d'une autre, donc déboucher sur un résultat institutionnel tangible.
Une autre avenue, moins prévisible et plus exigeante, repose sur l'approfondissement des contradictions du capitalisme, donc sur l'exacerbation de rapports sociaux antagoniques. L'incapacité de la CAQ à faire face à des défis urgents, comme celui du réchauffement climatique, ou de la dégradation des services publics, pourrait militer en faveur d'un tel processus.
Cette éventualité exige une période de résurgence de l'action mouvementiste. Comme durant la décennie 1970 et comme avec le Printemps érable, les mouvements sociaux et populaires peuvent détenir la clef d'un réalignement électoral qui pourrait mettre fin au long règne de la CAQ.
Pour le dire autrement, le changement à gauche ne proviendra pas d'abord de l'intérieur du système partisan ou des institutions étatiques. Par exemple, la fameuse réforme du mode de scrutin ne sera pas initiée par la CAQ. Une étape préalable devra être franchie du côté des forces de la société civile, qui auront à déployer, avant toute chose, une formidable pression pour qu'ensuite puisse apparaître une configuration de l'échiquier partisan susceptible de bouleverser le statu quo.
Il en va de même pour que QS s'affranchisse de sa condition de tiers parti et gravisse les marches de l'escalier conduisant à la direction de l'État : constituer l'opposition officielle, puis faire partie du gouvernement, voire le diriger seul. À moins de vouloir faire un NPD de lui-même, c'est-à-dire un parti social-libéral, prisonnier de la structure politique et économique, QS devra refaire le plein d'énergie mouvementiste pour pouvoir goûter un jour au pouvoir. Telle est sa vocation, s'il entend rester fidèle à sa nature profondément duale : être à la fois le parti des urnes ET de la rue.
Philippe Boudreau est professeur de science politique au Collège Ahuntsic.

Oser prendre toute la place à gauche

À première vue, les résultats de Québec solidaire (QS) aux élections du 3 octobre 2022 sont assez décevants. Ce maintien des acquis devient troublant quand on le compare à la trajectoire de progression constante qu'a connue QS depuis ses débuts [1]. Pour progresser d'ici 2026, QS doit passer de la consolidation de sa base à la conquête de nouveaux territoires politiques.
L'apparition de Québec solidaire sur la scène politique est essentiellement le résultat d'une série de mouvements sociaux massifs, allant de la Marche mondiale des femmes de 2000 à la grève étudiante de 2005, en passant par le mouvement altermondialiste (Québec 2001) et l'opposition à la guerre en Irak (2002-2003). Le bond de moins de 4 à près de 8 % des voix entre 2008 et 2012 s'explique en bonne partie par la grève générale étudiante et le positionnement très clair du député Amir Khadir et du parti en appui à ce mouvement. De 2014 à 2018, l'usure du pouvoir a frappé durement le PLQ pendant que le PQ n'arrivait pas à se redéfinir. Tant la montée de la CAQ que celle de QS pouvaient s'expliquer par la crise des deux partis qui avaient gouverné le Québec depuis 1970.
Entre 2018 et 2022, les luttes sociales ont été mises en veilleuse en grande partie dans le contexte de la pandémie. Notamment, les négociations du secteur public se sont conclues par une sorte de trêve, avec la signature de contrats de trois ans. Le gouvernement Legault remettait alors à après l'élection générale suivante son ambition d'imposer des reculs majeurs aux personnes qui travaillent dans les services publics et la fonction publique. Dans ce contexte de tranquillité sociale du côté des forces progressistes, ce sont les mouvements populistes de droite et l'extrême droite qui ont occupé beaucoup de place, alimentant la montée inattendue du Parti conservateur du Québec, avec ses 12 % des voix. Globalement, la période actuelle est marquée par le succès de la droite populiste, notamment sur le thème de l'hostilité face à l'immigration, et l'échec des forces de gauche, y compris avec de nouveaux partis, face aux défis d'une véritable rupture avec le capitalisme mondialisé.
Dans ce paysage politique densément occupé et ce contexte social et idéologique assez morose, on peut comprendre que la direction de QS a décidé d'opter pour une stratégie essentiellement défensive, mettant de l'avant les thèmes les plus évidents pour un parti réformiste de gauche : le climat et la justice sociale. Mais une telle stratégie avait ses limites, et il va falloir voir les choses autrement si on veut éviter que le phénomène Québec solidaire devienne une belle aventure à la marge, sans espoir d'arriver un jour au gouvernement.
Nous avançons que la stratégie qui pourrait permettre à QS de connaître un nouveau saut qualitatif d'ici 2026 devrait s'articuler autour du principe d'une offensive sur les terrains que nos adversaires considèrent comme leur force. Il ne devrait plus y avoir de mauvais sujets pour le parti, des sujets qu'on évite ou qui nous font marcher sur des œufs. On doit mettre de l'avant des idées claires et fortes sur toutes les questions susceptibles de définir le paysage politique et de déterminer les choix de la population. Le parti doit aussi mobiliser toutes ses capacités en appui aux luttes sociales et à leur convergence. Ultimement, c'est ce qui se passe dans la rue qui va déterminer les résultats dans l'urne.
Projections 2026
Les résultats du 3 octobre 2022 constituent une sorte de photo. Tentons donc de déterminer dans quel film cette image se situe, quelles tendances on peut projeter.
La CAQ pourrait difficilement aller plus haut. L'usure du pouvoir après deux mandats devrait avoir raison de l'expansion continue de cette force politique. Le caractère de coalition du parti de Legault devrait commencer à lui causer des maux de tête, avec un caucus de 90 personnes plus hétérogène que la masse de petits patrons de 2018. Le rassemblement autour d'un nationalisme superficiel et d'un pragmatisme tendant vers la résignation ne pourra pas résister indéfiniment à la pression des luttes sociales et aux impacts de la stagnation économique.
Le PLQ pourrait difficilement descendre plus bas. Réduit à ses châteaux forts de la région de Montréal et du Pontiac, il pourrait profiter de l'épuisement de la CAQ pour reconquérir une partie de l'électorat de centre droit fédéraliste francophone qui s'est rallié à la CAQ en ٢٠٢٢ après être demeuré sceptique en ٢٠١٨. Bref, le PLQ et la CAQ sont en partie des vases communicants, et si rien d'autre ne se produit de significatif dans le paysage social et politique, les malheurs des uns pourraient amener le bonheur des autres.
Le PQ va perdurer. L'élection de son chef et un vote populaire équivalent à ceux du PLQ et de QS ont déjà convaincu la base péquiste qu'il y a encore de l'espoir. Les orientations du parti combinent des idées de centre gauche sur les questions environnementales, économiques et sociales – ce qui crée des points de convergence avec QS – et des idées conservatrices sur l'immigration, la langue, la laïcité et la lutte contre le racisme, plaçant le PQ dans le même camp que la CAQ et le PCQ. Cet écartèlement est maintenu en place par l'évocation rituelle du projet souverainiste. Est-ce que le PQ va continuer à décliner comme il le fait depuis son sommet à 49 % des votes en 1981 ? Probablement. Est-ce qu'il pourrait rebondir un peu à la faveur des faiblesses de ses adversaires ? Sans doute.
Le PCQ va chercher à se tailler une place. Fermement installé comme la voix des antivaccins, des progaz, des antiféministes et de la xénophobie ordinaire, il va continuer à talonner la CAQ dans ses bastions de la grande région de Québec, moussé par les radios-poubelles dont son chef est issu. Est-ce que la CAQ va se déplacer vers la droite en réponse aux luttes sociales et à ses contradictions internes ? Est-ce que le PQ va chercher à occuper le terrain de la politique anti-immigration pour rallier l'électorat conservateur ? En tout cas, sans l'élection de députés en 2026, le PCQ pourrait retourner dans la marginalité.
Frapper là où l'adversaire se croit fort
Ce qui tient la coalition de la CAQ ensemble est principalement sa rhétorique nationaliste. Pour miner son unité et dévoiler l'absence de substance de son autonomisme, il faudra insister sur l'échec de ses multiples demandes face au gouvernement fédéral et mettre clairement de l'avant la nécessité de l'indépendance. Sur ce terrain, l'accord avec le PQ sera évident. D'un côté, cette convergence au niveau du discours devrait permettre de continuer à éroder le discours des péquistes fâché·es qui accusent QS de ne pas être vraiment indépendantiste. De l'autre, ce sera un argument pour les métapéquistes qui rêvent encore à une alliance PQ-QS.
Les libéraux sont plus que jamais le parti de la défense des intérêts des minorités, en particulier de la communauté anglophone. Son nationalisme canadien masque des divisions de classe profondes. D'ailleurs, les communautés anglophones sont davantage polarisées sur le plan socio-économique que la majorité francophone. QS va devoir contester ce rôle de tribun des minorités en menant une bataille soutenue contre la Loi 21 et pour un rétablissement du principe de l'égalité des droits. Il devra aussi mettre de l'avant sa critique de la Loi 96 sur la langue, notamment en ce qui concerne le statut particulier que devraient avoir les langues autochtones et le retrait de la clause des six mois pour les nouveaux·elles arrivant·es.
Bien entendu, cet effort de QS en direction d'une partie de la base du PLQ va irriter au plus haut point les éléments les plus conservateurs du PQ et contribuer à écarter l'idée d'un pacte électoral souverainiste. Les péquistes qui en auront assez du virage identitaire pourront toujours choisir de se rallier à QS, le seul parti indépendantiste avec un réel potentiel de croissance et des appuis dans la jeunesse et chez les néo-Québécois·es.
En plus de la souveraineté, ce qui a permis au PQ de se distinguer et de mobiliser ses membres récemment est la question linguistique. En s'appuyant sur une interprétation catastrophiste des données statistiques récentes, il a insisté sur des politiques comme l'application de la loi 101 au cégep et la réduction des seuils d'immigration à 35 000 personnes par année. QS doit répondre à cette rhétorique en démontrant clairement qu'une immigration massive en bonne partie francophone, combinée avec une vigoureuse politique de francisation, constitue en fait la seule stratégie permettant de freiner le déclin démographique du Québec tout en préservant son caractère français.
Bref, il s'agit de rendre le PQ redondant sur l'indépendance et sur la langue tout en prenant la place du PLQ sur le terrain de la défense des droits de la personne et des minorités. Dans le contexte d'un deuxième mandat de la CAQ, la forme de cet effort de ralliement d'une partie de la base du PQ et du PLQ devrait être une série d'attaques contre le gouvernement de la CAQ. Un élément positif de la récente campagne a été l'effort mis de l'avant par la CAQ et François Legault pour attaquer QS. Il faut encourager cette polarisation CAQ vs QS à chaque occasion. La CAQ est le parti du passé, de la routine, de la résignation. QS est le parti de l'avenir, du changement et de l'audace.
Bien entendu, l'esquisse de stratégie que nous présentons ici est rudimentaire, très générale et sujette à révision à la lumière de l'expérience. Mais une chose est claire, on n'arrivera pas à doubler ou tripler les appuis à QS (ce qui est nécessaire pour gagner une élection générale) sans passer à l'offensive, tant sur le plan des idées que de la mobilisation sur le terrain.
[1] C'est la stagnation en comparaison avec la percée historique de 2018. On passe de 10 à 11 député.e.s, le pourcentage des votes baisse légèrement de 16,10% (649 503) à 15,42% (633 414). La deuxième place en pourcentage des votes est symboliquement positive, mais due au déclin du PQ et du PLQ, pas à une montée des votes solidaires. Aux élections de mars 2007 et de décembre 2008, QS avait obtenu un peu moins de 4% des voix (3,64 et 3,78). Pour celles de septembre 2012 et d'avril 2014, c'était 6,03% et 7,63%. Le 1er octobre 2018, QS a connu un bond en avant avec 16,10%. Alors comment expliquer l'absence de progression quatre ans plus tard ?
Benoit Renaud est militant à Québec solidaire depuis la fondation.
Une manifestation contre « l’esclavage moderne » devant le bureau du ministre Boulet
La Prochaine Revue
Des travailleurs de Walmart votent sur leur syndicalisation
Bock-Côté et les sandwiches au jambon
L’indépendance pour mettre fin à l’anormalité du Québec

Pinel : Les cas complexes crient au secours !

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Pinel : Les cas complexes crient au secours !
Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communications, Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal 1961 : Jean-Charles Pagé publie Les fous crient au secours, le récit de son internement de près d’un an à l’asile Saint-Jean-de-Dieu, devenu plus tard l’hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine et aujourd’hui l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal1. Il consacre un chapitre aux sinistres Salles à cellules, le repaire des malades qui ont manqué à la discipline :« La façade comprend de lourdes portes de bois ayant au moins six pouces d’épaisseur, consolidées de deux verrous aux extrémités. Au centre, une énorme chaîne et un robuste cadenas. Sur l’uniformité de la porte, un judas de huit pouces carrés muni d’un carreau détachable qu’ouvrent les gardiens à l’occasion, afin de vérifier si le captif n’est pas mort. […]
Dans la pénombre d’une cellule, on aperçoit un homme maigre n’ayant pour tout vêtement que la salopette gris-bleu spéciale à cette salle. […]
-
-
- Depuis combien de jours es-tu ici ?
- Un an, quatre mois, dix-sept jours.
- Sans jamais sortir de cette cellule ?
- Non, toujours enfermé. […]
-
À voix basse, je demande au gardien la cause de son incarcération.
Il a frappé une sœur. »
On pourrait penser que ces méthodes brutales, arbitraires, inhumaines et dégradantes n’ont plus cours de nos jours dans nos établissements de santé mentale où règnent l’excellence, les bonnes pratiques et l’amélioration continue. Malheureusement, elles existent toujours… 2024 : Après avoir commis un crime violent, Gilbert2 est détenu depuis six ans à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel (Pinel). À la suite de conflits qui l’ont opposé à des membres du personnel, il est confiné depuis sept mois à sa chambre, 24 heures par jour. S’il doit sortir, par exemple pour aller à la douche, il est menotté aux poignets et enchaîné aux chevilles. Lors de très rares et très courtes sorties à l’extérieur, il est enchaîné à un fauteuil roulant. Gilbert est un cas complexe, selon la terminologie de l’établissement. Sa situation n’est pas exceptionnelle. Des dizaines de personnes incarcérées à Pinel subissent ou ont subi un traitement semblable au sien.« Je suis un sportif, j’aimerais dépenser mon énergie, ça m’aiderait à me recentrer et ça me permettrait peut-être de diminuer mes doses de médicaments. Je voudrais apprendre un métier et reprendre une vie un peu plus normale. Au lieu de ça, je perds mon temps dans ma cellule à regarder les murs » déplore Gilbert.
Le Code criminel prévoit que les mécanismes liés à la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux n’ont pas pour but de punir les personnes concernées, puisque l’acte qu’elles ont posé n’engage pas leur responsabilité criminelle. À l’usage, pourtant, les conséquences de ce plaidoyer peuvent être beaucoup plus contraignantes qu’une peine d’emprisonnement. Elles sont si contraignantes que ce sont souvent les procureur-e-s de la Couronne qui enclenchent le processus. Contrairement à une sentence de prison, un suivi par la Commission d’examen des troubles mentaux3 (CETM) n’a pas de durée prédéfinie et peut être beaucoup plus difficile à vivre qu’un séjour en prison.En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force.On retrouve des personnes suivies par la CETM dans différents établissements du réseau de la santé mais c’est l’Institut Pinel qui porte le mandat de « l’évaluation, la garde et le traitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables et soumis à une décision de détention stricte en raison du risque très élevé qu’ils représentent pour la sécurité publique4 ». C’est à cet endroit que se concentrent la plupart des cas complexes, comme Gilbert. Pinel fait étalage de sa vision où « le patient est au centre des soins et services qu’il reçoit, où la primauté de l’individu est un enjeu quotidien et qui se distingue par son désir de toujours être à l’affût des meilleures pratiques5 ». En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s, que Jean-Charles Pagé a très bien décrite au fil de son récit. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force. Si la personne collabore au traitement préconisé par les soignant-e-s, elle sera valorisée et cheminera sur la voie du rétablissement. Si elle s’oppose ou émet des réserves ou des questionnements, souvent en raison des importants effets secondaires physiques et psychiques que les médicaments provoquent chez elle, elle fera face aux contraintes, à l’intimidation et à l’autoritarisme et même à l’hostilité des soignant-e-s, souvent amplifiés par des décisions obtenues auprès des tribunaux.
Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister.À Pinel, la culture des asiles d’aliéné-e-s est d’autant plus présente qu’elle est légitimée en amont par le tribunal et qu’elle s’appuie sur la commission passée d’un acte criminel. La personne n’est pas que folle, elle a aussi un passé violent qui légitime les abus de droit dont elle fait l’objet. Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister. À Saint-Jean-de-Dieu, dans les années 1960, on avait une expression pour ça. Les gardien-ne-s disaient : Y va d’y goûter comme il faut… Résultat, un nombre non négligeable de personnes référées vers Pinel pour y obtenir des soins favorisant leur réinsertion sociale n’en sortiront jamais plus. Elles y auront vécu, parfois pendant des décennies, une accumulation de frustrations et de vexations qui ont aggravé les difficultés émotionnelles réelles avec lesquelles elles étaient aux prises et qu’on devait les aider à surmonter. À Pinel, comme dans tout le réseau québécois de la psychiatrie, il faut explorer des avenues autres que la médication, améliorer la capacité d’écoute des équipes soignantes et associer davantage les personnes concernées à l’élaboration de leurs traitements. En d’autres termes, délaisser l’approche autoritariste traditionnelle pour miser davantage sur les forces des personnes, sur leurs talents et sur leur motivation à acquérir le maximum d’autonomie. Moins d’un mois après la publication de Les fous crient au secours, le gouvernement Lesage mettait en place une commission d’étude des hôpitaux psychiatriques, la Commission Bédard, qui a mené à des changements importants dans les conditions d’hébergement et de traitement des personnes porteuses de diagnostic en santé mentale. Plus de 60 ans après la Commission Bédard, le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux devraient de nouveau prendre les moyens pour mettre un terme aux privations de droits et de dignité imposées quotidiennement aux cas complexes de Pinel et à de trop nombreux autres utilisatrices et utilisateurs de services en psychiatrie.
- Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours, réédition présentée par Jérémie Dhavernas et Anaïs Dupin, Montréal, Éditions Écosociété,
- Le nom de la personne a été changé pour préserver sa vie privée.
- « La Commission d’examen des troubles mentaux relève du Tribunal administratif du Québec. Elle a entre autres pour mandat d’évaluer « l’importance du risque que représente une personne accusée [d’un délit criminel] pour la sécurité du public, en fonction, notamment, de son état Elle décide si la personne doit être libérée, avec ou sans condition. Si elle décide que la personne doit être détenue dans un hôpital, elle fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité du public. » En ligne : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale/commission-d-examen-des-troubles-mentaux/role
- En ligne : https://pinel.qc.ca/qui-sommes-nous/
- Ibid.
L’article Pinel : Les cas complexes crient au secours ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Tous égaux face à l’inflation ?

Faut-il à ce point se méfier de l'inflation ? Si la question peut étonner, la poser nous permet de souligner que ce phénomène n'a pas les mêmes conséquences pour tous et toutes, mais aussi que la manière d'y réagir entraîne des effets différents selon la position que chacun·e occupe dans l'économie.
Le thème de l'inflation était absent de l'espace public au Québec comme au Canada depuis plus de trente ans. Or, en 2022, il ne s'est pratiquement pas déroulé une semaine sans qu'il en soit question. Les premières interventions de Pierre Poilievre à titre de chef du Parti conservateur du Canada ont porté sur la « Justinflation » et le rôle présumé des dépenses du gouvernement fédéral dans la hausse des prix pendant la pandémie. Au Québec, François Legault a cherché à en faire « la question de l'urne » lors de la dernière élection provinciale.
Faut-il donc à ce point se méfier de l'inflation ? Au moment d'écrire ces lignes, la hausse des prix atteignait des niveaux jamais vus depuis trente ans. En effet, l'inflation a atteint 7,0 % au Canada et 7,1 % au Québec en août 2022 par rapport au même mois l'année précédente, alors qu'elle avait été sous la barre des 3 % presque chaque année depuis le début des années 2000. La même tendance s'observe dans la plupart des économies du monde entier depuis 2021. Alors qu'elle s'élevait en moyenne à 1,24 % dans les pays de l'OCDE en décembre 2020, l'inflation avait atteint 10,27 % en juin 2022.
Des causes multiples
Plusieurs facteurs expliquent cette conjoncture particulière, mais contrairement à ce que prétendent certains (dont M. Poilievre), l'inflation actuelle découle avant tout de problèmes rencontrés par les producteurs de biens et de services (l'offre) et non des comportements des consommateurs et des consommatrices (la demande).
En effet, la pandémie a entraîné une paralysie des chaînes d'approvisionnement qui a réduit l'offre pour plusieurs biens, une situation qui commence à peine à se résorber. Au même moment, les pays producteurs de pétrole réduisaient leur offre pour soutenir le cours de l'or noir, avec pour résultat un prix à la pompe en hausse dès la fin de 2020. La recrudescence et l'intensification des catastrophes naturelles
en raison des changements climatiques ont en outre nui aux récoltes et aux exportations, tirant ainsi le prix des denrées vers le haut. La guerre qui fait toujours rage en Ukraine, un important producteur agricole, n'a fait qu'empirer la situation. La crise sanitaire a par ailleurs alimenté la spéculation sur le marché immobilier et exacerbé la tendance à la hausse des prix des maisons, qui est cela dit soutenue depuis deux décennies au Canada. Enfin, la hausse des profits des entreprises, qui ont vraisemblablement profité du contexte inflationniste pour augmenter leurs prix, est un facteur à considérer bien qu'il soit largement passé sous le radar de nombre d'analystes.
Cette inflation est problématique pour les travailleurs et les travailleuses, puisqu'à moins que leur salaire ne suive le rythme de l'augmentation des prix, elle a pour effet de réduire leur pouvoir d'achat. Au Québec, le salaire horaire moyen des employé·es a augmenté de 8,1 % entre juillet 2021 et juillet 2022, mais cette hausse n'avait été que de 1,0 % l'année précédente (et de 3 % en moyenne dans les cinq années qui ont précédé la pandémie). Il faudra voir si cette tendance se maintient et si elle permet le rattrapage qui était nécessaire dans les secteurs à plus faibles salaires.
En revanche, l'inflation a l'avantage de réduire le poids des dettes des ménages et de plomber les revenus qu'en tirent les créanciers. Autrement dit, une inflation modérée peut avoir un effet positif (ou du moins neutre) sur la situation financière de travailleurs et de travailleuses dont l'endettement est une source de profits pour les banques. Elle entraîne aussi une hausse des revenus des gouvernements, qui peuvent utiliser ces fonds supplémentaires pour venir en aide aux ménages. Tant Québec qu'Ottawa ont d'ailleurs réagi dans les derniers mois en procédant à des transferts, quoique pas toujours bien ciblés, aux citoyen·nes comme moyen d'augmenter leurs revenus en cette période inflationniste.
Les retombées de la politique monétaire
Puisque l'inflation s'est installée en dehors de sa cible de 1 % à 3 %, la Banque du Canada a commencé à intervenir – c'est son principal mandat – pour freiner la hausse des prix. Pour ce faire, elle utilise le seul outil dont elle dispose, à savoir le taux directeur. En haussant ce dernier, la banque centrale fait augmenter le coût des emprunts pour les entreprises comme pour les ménages. Elle espère ainsi faire reculer la demande et relâcher la pression sur les prix. Alors qu'il était à 0,25 % en janvier 2022, le taux directeur a été porté à 3,25 % en septembre 2022 et devrait être rehaussé à nouveau dans les prochains mois.
Quel est le problème avec cette stratégie ? D'une part, comme l'action de la banque a un effet sur la demande plutôt que sur l'offre qui, comme nous l'avons vu plus haut, est à l'origine de la poussée inflationniste, l'efficacité de cette stratégie est incertaine. Au moment d'écrire cet article, elle avait commencé à reculer très légèrement pour un deuxième mois de suite, principalement en raison du recul des coûts de l'énergie (et du pétrole en particulier) à l'échelle mondiale. Pour le reste, la hausse des taux s'est jusqu'ici surtout fait ressentir sur le marché immobilier, alors que des données de Desjardins montrent que les ventes et le prix des maisons au Canada étaient en baisse depuis le printemps, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique.
D'autre part, une hausse prolongée du taux directeur s'accompagne d'un risque non négligeable de provoquer une récession. En effet, si la demande se resserre trop, les entreprises peuvent en venir à reporter des investissements et à embaucher moins, ce qui ferait augmenter le chômage et plomberait le revenu des ménages. L'économiste David MacDonald, du Centre canadien de politiques alternatives, rappelait dans un article paru en juillet dernier que chaque fois que la banque centrale a voulu réduire l'inflation en haussant le taux directeur depuis les années 1960, elle a provoqué une récession, et donc une baisse de l'emploi et une hausse du chômage. Plusieurs autres économistes et analystes ont aussi souligné dans les derniers mois l'existence de ce risque, et ce même chez les économistes orthodoxes.
Combattre les effets de l'inflation
Vu les causes et le niveau actuel de l'inflation, il serait préférable de mettre en place des moyens d'atténuer ses effets sur les ménages. Les entreprises doivent octroyer des hausses de salaire à leurs employé·es pour s'assurer qu'ils et elles ne s'appauvrissent pas en travaillant. Tant que ces hausses couvrent l'inflation, elles ne risquent pas d'y participer, car les salaires ne sont qu'une des dépenses auxquelles les entreprises doivent faire face. Il serait alors difficile pour ces dernières de justifier auprès de leur clientèle des hausses équivalentes du prix des biens ou des services qu'elles offrent.
Les gouvernements disposent pour leur part de plusieurs outils pour soutenir les ménages, particulièrement ceux à faible revenu. Si les aides ponctuelles qui ont été versées dans les derniers mois témoignent du souci des gouvernements d'agir face à la situation, l'absence de solutions plus structurantes participe d'un refus de s'attaquer, à plus long terme, à certains problèmes structurels que l'inflation actuelle met en lumière.
En effet, la paralysie des chaînes d'approvisionnement a mis en évidence la fragilité de nos économies mondialisées et le besoin de relocaliser la production de certains biens essentiels ; la vulnérabilité de l'agriculture aux conditions météorologiques rappelle l'importance de s'attaquer aux changements climatiques, à défaut de quoi le coût du panier d'épicerie pourrait durablement en subir les conséquences ; l'explosion des prix de l'immobilier est le reflet d'un marché peu régulé et de l'échec des gouvernements à protéger le droit au logement ; enfin, les fluctuations des prix de l'énergie rappellent l'urgence de modifier nos modes de transport et de réduire la dépendance à l'automobile et aux combustibles fossiles qui l'alimente.
La question de l'inflation nous rappelle combien les réponses aux problèmes économiques, si elles ne tiennent pas compte des inégalités qui traversent les économies capitalistes, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les salarié·es et les ménages vulnérables. Cette conjoncture particulière met aussi en lumière le rôle évident que peut jouer l'État pour stabiliser l'économie et mieux encadrer les marchés afin de protéger la qualité de vie de la population de manière pérenne.
Julia Posca est chercheuse à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

Des essais pour ados

La maison d'édition Écosociété s'est taillé une place de choix dans le monde des essais québécois au fil de ses 30 années d'activités. Pour son anniversaire, elle lance une nouvelle collection destinée aux adolescent·es et aux jeunes adultes. À bâbord ! s'est entretenue avec Pauline Gagnon, directrice de la collection Radar.
Propos recueillis par Philippe de Grosbois
À bâbord ! : Écosociété souligne ses 30 ans cette année. Comment en êtes-vous arrivé·es à l'idée de vous adresser plus spécifiquement aux ados et aux jeunes adultes ?
Pauline Gagnon : Depuis longtemps, l'équipe souhaitait offrir des livres destinés à un lectorat plus jeune. D'ailleurs, on nous le demandait régulièrement lors de rencontres avec nos lecteurs et lectrices dans les Salons du livre. Comme on trouve d'excellents documentaires pour les plus jeunes et très peu d'essais destinés aux 15 ans et plus, le projet d'une collection pour les ados s'est rapidement imposé. Ainsi, Radar – le nom choisi pour la collection – viendra combler un important vide éditorial. L'adolescence est une période tellement charnière. C'est le moment où l'on commence à mieux comprendre le monde, les injustices qui le traversent et cela nous révolte ! C'est aussi un moment où l'on se cherche, où l'on fait des rencontres et des apprentissages qui forgent l'adulte en devenir. Bref, c'est un moment où les questionnements politiques pointent leur nez. Pourquoi ne pas assumer la nécessité de parler d'enjeux sociaux et politiques avec cette tranche d'âge qui vit aussi de grands bouleversements en comprenant l'urgence climatique ?
Et, pour souligner nos 30 ans d'existence, nous ne pouvions nous offrir plus beau cadeau que d'agrandir notre lectorat !
AB ! : La littérature jeunesse est maintenant bien développée au Québec. Dans ce qui s'adresse aux adolescent·es, on trouve une fiction de grande qualité, mais peu d'essais. Comment expliquer cette absence ? Est-ce que ça a déjà existé par le passé ? Est-ce que ça se fait actuellement ailleurs dans le monde ?
P. G. : C'est certain que, pour une maison d'édition, créer une collection d'essais pour ados demeure un défi de taille, autant dans l'ensemble de la francophonie qu'ici, au Québec ! Ce n'est pas un hasard si ce segment de l'édition n'est pas aussi développé que celui des documentaires jeunesse. Ce groupe d'âge, les 15 ans et plus, navigue entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte ; et on y trouve un lectorat extrêmement diversifié. C'est aussi un moment de la vie où les centres d'intérêt sont multiples et parfois aussi une période où la lecture devient moins prioritaire. C'est là qu'il devient essentiel de miser sur leur curiosité, sur leur besoin de trouver des réponses aux nombreuses questions qu'iels se posent. Ça demande aussi une certaine part d'audace, un pari qu'un éditeur doit faire lorsqu'on désire rejoindre les adolescent·es en leur offrant des livres qui ouvrent aux multiples manières de voir et penser le monde.
AB ! : Comment aller chercher l'intérêt pour des enjeux plus vastes ? Comment savoir ce qui peut intéresser les jeunes de ce groupe d'âge ?
P. G. : Les adolescent·es s'intéressent déjà à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux ; plusieurs sont impliqué·es dans des mouvements qui revendiquent des changements. Iels mesurent bien la complexité du monde qui les entoure et ont une conscience planétaire que nous n'avions pas à leur âge. L'objectif est d'atteindre autant les plus militant·es que celleux dont on entend peu la parole. Comment les intéresser ? En leur offrant des livres qui abordent des sujets qui les préoccupent sous un angle original, afin de les aider à mieux comprendre le monde dans lequel iels vivent. Dès que je suis entrée en poste, j'ai voulu aller confirmer ou infirmer mes intuitions sur les thématiques que je voulais aborder dans Radar. Nous avons donc fait circuler un sondage auprès de 200 adolescent·es, qui ont fait ressortir plusieurs thématiques que je me suis ensuite attelée à explorer avec les auteur·es. Cela allait de la place de l'anxiété face aux changements climatiques ou de la performance à la sexualité en passant par l'amitié, les enjeux de genre et des enjeux propres aux communautés LGBTQ+. Une grande place était aussi consacrée à l'environnement dans les préoccupations des jeunes. Cela m'a beaucoup guidée tout au long du travail éditorial pour approcher les auteur·es. Par ailleurs, nous croyons fortement en la nécessité de transmettre les thématiques que nous abordons déjà pour les adultes aux jeunes. Il faut donc trouver un équilibre entre les sujets que nous voulons proposer à réfléchir et ceux qu'il faut absolument aborder pour répondre à leurs préoccupations. Évidemment, les deux peuvent se rejoindre.
AB ! : Un premier essai porte sur l'amitié. Écosociété étant une maison d'édition qui aborde surtout des enjeux sociaux et écologiques, je suppose qu'il y avait là un certain défi d'articuler l'intime et le politique ?
P. G. : Cet essai sur l'amitié, il est tout à fait dans l'esprit de la collection Radar. L'amitié, c'est beaucoup plus subversif qu'on ne le croit ! D'ailleurs le titre est, à cet effet, fort éloquent : S'engager en amitié. Non seulement le lien amical est un outil d'émancipation individuelle, mais il permet également de déconstruire certains modèles sociaux que, trop souvent, on oublie de questionner. Camille Toffoli parle d'amitié d'une façon tout à fait originale et qui fait tellement de bien. Pour faire le lien avec le politique, elle rappelle l'importance d'instaurer des « espaces de vulnérabilité » dans notre rapport à l'amitié. Ces communautés, dans lesquelles on peut parler librement de ce qui nous affecte, peuvent nous donner envie de nous mobiliser pour améliorer nos conditions de vie et celles des gens qui vivent des problèmes semblables aux nôtres.
AB ! : L'autre essai porte sur les GAFAM. Ici, le défi était peut-être la vulgarisation de questions complexes… Comment vous y êtes-vous pris ?
P. G. : Parce qu'il enseigne depuis plus de 30 ans à des ados l'éducation aux médias, l'auteur Philippe Gendreau présente une impressionnante somme d'informations avec une grande simplicité. Il débroussaille le sujet, montre les rouages de ces grandes entreprises, met en évidence certains de leurs côtés plus obscurs tout en démontrant la place prépondérante qu'elles occupent dans nos vies. Nous avons travaillé à responsabiliser, sans culpabiliser. Philippe donne des clés pour ouvrir les multiples portes que ces entreprises ont érigées entre eux et nous. Cet essai va aider les ados à se retrouver dans cet univers complexe.
AB ! : D'ailleurs, j'imagine que le ton à utiliser pour cette collection a dû susciter plusieurs questionnements. Comment être accessible sans être racoleur, comment être pédagogue sans sursimplifier ?
P. G. : C'est là que se trouve le vrai défi pour Radar ! Les auteur·es présentent l'information de manière simple, efficace et concise. Évitant les raccourcis et les longues tirades, on s'adresse à eux et elles en faisant appel à leur capacité à comprendre les grands enjeux sociaux et environnementaux.
Il faut aussi mettre de côté ses a priori et s'abstenir de toute complaisance. Surtout, l'important pour nous est de ne pas sous-estimer les lecteur·rices, ni les prendre de haut, tout en leur offrant des textes accessibles dans une présentation graphique qui va leur plaire et leur donner envie de lire.
Avec les titres de la collection Radar, on souhaite que les essais figurent dans le choix de lectures des ados, au même titre que les ouvrages de fiction.
Illustration : Elisabeth Doyon

Q comme qomplot. Comment les fantasmes du complot défendent le système

Wu Ming 1, Q comme qomplot. Comment les fantasmes du complot défendent le système, Traduit de l'italien par Anne Echenoz et Serge Quadruppani, Lux, 2022, 576 pages.
Wu Ming est le nom d'un collectif d'écrivains italiens fondé en 2000. Wu Ming signifie « anonyme » en mandarin. Le groupe est reconnu entre autres pour son projet Luther Blisset et son livre Q publié en 1999.
Pavé de 576 pages, Q comme qomplot est un livre titanesque, bourré d'informations diverses. Son objectif principal est de faciliter la compréhension du mouvement QAnon et des théories du complot pour mieux les combattre.
Le livre est divisé en deux parties fort différentes l'une de l'autre. La première partie est un véritable fourre-tout d'histoires et de récits sur le complotisme, que ce soit sur l'origine de QAnon sur le forum web 4chan ou encore la conspiration concernant la mort de Paul McCartney dans un accident de voiture. Dans son analyse, l'auteur décide de différencier les hypothèses de complot (spécifiques et situés ayant un but précis – pensons au Watergate) des fantasmes du complot. Ces derniers « concernent toujours une conspiration universelle, qui a comme but la conquête ou la destruction du monde entier par des sociétés secrètes, des confraternités occultes, des races sournoises (…) ou des conquérants extraterrestres. »
La deuxième partie se lit comme une fascinante fresque historique sur la genèse des plus importants fantasmes du complot. L'auteur remonte à plusieurs siècles pour expliquer les origines du complot juif, des Illuminati et du satanisme. Ces chapitres nous rappellent les moments peu glorieux de notre histoire collective comme les paniques sataniques, les chasses aux sorcières ou encore la persécution du peuple juif. L'auteur tient à historiciser tous ces faits pour une raison simple, mais importante : en comprenant d'où ces fantasmes proviennent, on peut mieux les déconstruire.
Facile à lire, mais parfois difficile à suivre : le livre de Wu Ming 1 est captivant, mais manque souvent de cohérence, particulièrement dans la première partie. Le fil directeur est flou ; les chapitres se suivent, mais ne se ressemblent pas. La deuxième partie est la plus prenante ; le dévoilement historique qui s'impose à nous entraîne de nombreux moments de subites illuminations et encourage une réflexion approfondie.
Cette différence entre les deux parties se retrouve aussi dans le style narratif : la première partie est très explicative ; on décrit des faits, on énumère des arguments et on définit des termes. La deuxième partie est plus poétique ; l'auteur raconte un rêve dans lequel il enseigne à un groupe de personnes les origines des fantasmes du complot.
Tout au long du livre, l'auteur ne ridiculise pas les fantasmes du complot ni ses adeptes : il a la volonté louable de vouloir disséquer ce qui se cache derrière ceux-ci et de comprendre pourquoi certains y adhèrent. Selon lui, le conspirationnisme offre une porte d'entrée à toute personne désireuse de changer le monde ; il offre des causes pour lesquelles militer et donne en bonus une explication aux petits et grands malheurs qui ponctuent notre vie. Les fantasmes du complot deviennent alors la réalité des complotistes et leur raison d'être. C'est une fascination qui ne cesse d'être alimentée par les réseaux sociaux et la communauté qui s'y investit.
La masse d'informations que cet ouvrage contient et sa longueur pourront en décourager certains. C'est à se demander si celui-ci n'aurait pas dû être divisé en deux volumes plus courts. Toutefois, il est décidément un ouvrage majeur pour aider à comprendre les origines de Qanon et les fantasmes du complot en général.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












