Derniers articles

Au nom des femmes

Sara R. Harris, Au nom des femmes, M Éditeur, 2022, 304p.
L'autrice Sara R. Farris est professeure en sociologie à l'Université Goldsmith de Londres. Elle s'intéresse aux mouvements féministes, au racisme et au marxisme. En 2017, elle publie la version originale de son livre In the Name of Women's Rights : The Rise of Femonationalism aux Presses universitaires de Duke. Dans cet ouvrage, elle expose sa thèse sur le fémonationalisme : elle est la première à introduire ce terme dans l'analyse politique.
Pour Farris, le fémonationalisme est l'exploitation des termes féministes par les parties nationalistes de droite et néo-libéraux qui renforcent leurs campagnes anti-Islam et anti-immigration au nom de l'égalité des genres. La notion de fémonationalisme offre un cadre théorique permettant l'analyse du déploiement de l'égalité des genres dans les campagnes xénophobes et dans les programmes politico-économiques visant notamment l'intégration civique des immigrant·es. L'autrice démontre que la revendication de l'inclusion des genres est imposée comme une valeur supérieure qui est fondamentale à l'intégration des immigrant·es dans une société occidentale. Cependant, cette valeur renforce le caractère raciste et nationaliste de leurs programmes et leurs campagnes en décrivant les Autres masculins, les non-Occidentaux, comme des oppresseurs, et les Autres femmes comme étant des victimes, des femmes qu'il faut sauver. Cette notion de « racialisation du sexisme » (p. 81) renforce la propagande des partis nationalistes de droite : les Autres ne représentent pas les valeurs occidentales. Cette formation idéologique s'inscrit dans des contextes spécifiques permettant l'instrumentalisation ou l'institutionnalisation du fémonationalisme.
L'ouvrage académique est divisé en cinq chapitres étayant l'instrumentalisation du fémonationalisme et les paradoxes de cette stéréotypisation dans les rôles sociaux et économiques des femmes. Par exemple, l'autrice nous démontre comment le rôle des femmes dans l'économie alimente paradoxalement la féminisation et la racialisation des marchés du travail au lieu de favoriser l'émancipation des droits des femmes. Par conséquent, il y a une contradiction lorsque les féministes ou les fémocrates poussent l'émancipation des femmes musulmanes et non occidentales tout en les orientant dans les secteurs domestiques peu rémunérateurs et précaires comme femme de ménage, gardienne, assistante pour les personnes âgées, tandis que le mouvement féministe cherche à libérer les femmes de ces secteurs (p. 33). Dans son analyse multidimensionnelle des dynamiques sociales, politiques et économiques, elle démontre que ce n'est pas une simple contradiction rhétorique, mais une « contradiction performative ». (p. 33).
L'autrice se réfère au contexte des Pays-Bas, de la France et de l'Italie depuis les années 2000 pour l'étude du fémonationalisme. Elle tente de faire ressortir les parallèles sur les contextes nationaux et les acteurs et actrices politiques pour démontrer le caractère transnational du fémonationalisme (p. 35). Elle offre cette théorisation pour mettre une analyse politique de ce phénomène dans la politique nationale des pays d'Europe occidentale, mais pour l'Occident en général (p. 36).

Ray-Mont Logistiques : Résister et fleurir dans Hochelaga

Dans Hochelaga-Maisonneuve, des citoyen·nes se mobilisent depuis six ans contre l'implantation d'une plateforme de transbordement de marchandises à quelques mètres de leur maison. Récit d'une lutte sans relâche pour la justice environnementale.
Tout à l'est du quartier Hochelaga-Maisonneuve existe un grand terrain vague formé de boisés et de friches industrielles, à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Le site est situé aux abords d'une coopérative d'habitation, de rues résidentielles et de ruelles vertes, d'un parc de quartier et d'un CHSLD. S'il a été longtemps occupé par des installations industrielles, le terrain s'est reverdi avec les années, et il est maintenant habité d'une végétation florissante et d'une faune diversifiée. Il accueille quotidiennement les promeneur·euses, les sportif·ves et les familles du quartier, venus profiter de ce qui ressemble aujourd'hui à un immense parc-nature.
En 2016, une partie de ce terrain a été achetée par l'entreprise Gaïa inc. pour les activités de Ray-Mont Logistiques (RML), qui planifie y installer l'une des plus grandes plateformes de transbordement de marchandises en Amérique du Nord. Déjà implantée à Pointe-Saint-Charles, RML opère une plateforme intermodale permettant de transborder du grain arrivant par train des Prairies et du Mid-West américain dans des conteneurs maritimes transportés par camion vers le port de Montréal. L'acquisition d'un terrain de 2,5 millions de pieds carrés dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve lui permet de rapprocher ses activités des terminaux du port et d'en augmenter de dix à quinze fois le volume. À terme, le projet vise à transborder 100 wagons de train par jour, ce qui impliquerait d'être en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela générerait un millier de déplacements de camion par jour, un brouhaha constant lié au passage de trains et l'entreposage de plus de 10 000 conteneurs sur le site alors complètement asphalté. Les nuisances principales attendues, identifiées par l'entreprise, sont le bruit et les vibrations sonores, la pollution atmosphérique, lumineuse et visuelle, la création d'îlots de chaleur ainsi que la présence de vermine et de parasites.
Historique de la mobilisation
Dès l'achat du terrain en 2016, les résident·es des alentours sont alerté·es par le bruit lié aux travaux de concassage et la destruction des espaces boisés qui se trouvaient sur le site. Ils et elles s'organisent rapidement pour exiger d'être consulté·es sur les développements prévus dans leur quartier, et lancent une pétition en vertu du droit d'initiative en consultation publique de la Ville de Montréal. La mobilisation citoyenne « 5000 signatures pour MHM » voit alors le jour. En moins de trois mois, c'est finalement 6600 signatures qui sont amassées, menant à la tenue en 2019 d'une consultation publique sur l'avenir du secteur Assomption-sud-Longue-Pointe. Le nom du regroupement Mobilisation 6600 Parc-nature MHM porte le souvenir de cette victoire citoyenne.
Lors de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), plus de cinquante mémoires sont déposés. Des projets de création d'un parc-nature, d'agriculture urbaine ou de réhabilitation d'un ruisseau enfoui sont présentés aux commissaires. La Direction régionale de santé publique présente aussi un mémoire recommandant la réduction des nuisances dans le secteur de Viauville, où les résident·es, la plupart socioéconomiquement défavorisé·es, subissent déjà les préjudices de la circulation sur la rue Notre-Dame et des activités du port de Montréal.
Par ailleurs, en 2017, l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve refuse de délivrer le permis de construction demandé par Ray-Mont Logistiques, jugeant que les installations prévues pour son projet de plateforme intermodale ne respectent pas le cadre réglementaire du secteur. Poursuivi en justice par l'entreprise pour ce refus d'émission de permis, l'arrondissement perd une première fois en Cour supérieure en 2018, puis en cour d'appel en 2021. Forcé de délivrer le permis en avril 2021, l'arrondissement est aujourd'hui poursuivi en justice par RML pour des dommages évalués à 373 millions $.
Développements récents
La victoire de RML en cour d'appel donne un nouveau souffle à la mobilisation citoyenne. En 2021 et 2022, des manifestations rassemblant jusqu'à un millier de personnes sont organisées pour dénoncer le projet de Ray-Mont, demander la préservation de tous les espaces verts du terrain vague (le boisé Vimont, le boisé Steinberg, la friche ferroviaire et le terrain de Ray-Mont) ainsi que la création d'un parc-nature sur le site. Le slogan « Résister et fleurir » est alors adopté par les militant·es, et des semaines d'actions donnent lieu à de nombreuses activités : randonnées guidées du terrain, activités artistiques pour la famille, conférences, jardinage, flash mob, barbecues militants et rencontres entre luttes citoyennes pour la justice environnementale. Une pétition comptant plus de 8000 signatures est déposée à l'Assemblée nationale à l'automne 2021 pour demander au ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, de soumettre le projet de RML à une évaluation environnementale complète menant à une évaluation du BAPE. De plus, en mars 2022, plus de 70 commerçant·es et organismes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve, des médecins et les élu·es provinciaux et fédéraux du secteur se lient à la mobilisation dans le cadre d'une déclaration conjointe contre Ray-Mont Logistiques, demandant un développement économique à échelle humaine pour le quartier. Mobilisation 6600 reçoit aussi l'appui de nombreux organismes et mouvements œuvrant en environnement, comme Nature Québec, la Fondation David Suzuki, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social.
La créativité et l'audace des militant·es de la mobilisation ont mené à l'organisation de nombreux blocages du chantier et à des coups d'éclat comme la plantation symbolique d'une forêt de conifères (des sapins de Noël récupérés) sur le terrain de Ray-Mont, ou le dévoilement, en septembre 2022, d'une immense bannière entre les cheminées de l'ancien incinérateur Dickson. Les citoyen·nes mobilisé·es ont aussi réussi à retarder l'arrivée des conteneurs, initiée en mars 2022, en interpellant la Direction régionale de l'environnement. L'entreprise, qui ne détenait pas les autorisations nécessaires pour débuter ses travaux, a été rappelée à l'ordre par le ministère, et est actuellement en attente de l'autorisation qui lui permettra d'entamer le déménagement de ses activités dans Hochelaga-Maisonneuve.
Pour la justice environnementale
Les militant·es de Mobilisation 6600 Parc-nature MHM n'ont pas dit leur dernier mot. Le travail d'éducation et de mobilisation se poursuit actuellement par l'organisation de conférences, de projections de films militants, de visites du terrain pour les groupes scolaires et universitaires, et d'une tournée des associations étudiantes sur les enjeux de la mobilisation. Mobilisation 6600 présentera par ailleurs son projet de Parc-nature dans le cadre des activités entourant la COP15 à Montréal et les militant·es se tiennent prêt·es à accueillir les conteneurs dans le cas où l'entreprise recevrait ses autorisations.
La bataille menée par Mobilisation 6600 est une lutte pour la justice sociale et environnementale. Comme l'affirme la Fondation David Suzuki, les quartiers et les populations historiquement défavorisés sur les plans économique et social subissent plus souvent les nuisances de projets industriels qui ne verraient jamais le jour dans des quartiers comme Westmount ou Outremont. Pourtant, les impacts du bruit sur la santé des populations sont bien documentés et ceux des îlots de chaleur peuvent être fatals pour les populations à risque. La santé et la vie des personnes d'Hochelaga ou de Mercier-Est valent-elles moins que celles des personnes vivant dans des quartiers plus riches ? Valent-elles moins que les éventuels profits d'une entreprise déjà millionnaire ?
Le modèle de développement qui sous-tend le projet de RML est insoutenable sur les plans environnemental et social. À l'heure des bouleversements climatiques, nous nous devons de réduire le transport lié au commerce international, de miser sur l'agriculture de proximité et l'autonomie alimentaire des villes et des quartiers, sur le logement social et la densification urbaine, sur la décontamination des sites industriels et la préservation de tous les espaces verts. Nous ne pouvons plus nous permettre, en 2022, de couper des arbres pour asphalter des terrains où stationner des conteneurs.
Mobilisation 6600 Parc-nature MHM milite pour que les espaces en friche d'Hochelaga reviennent à la communauté, pour qu'ils deviennent un lieu où se retrouver et imaginer de nouvelles manières d'habiter la ville et d'aménager nos quartiers. Les militant·es sont déterminé·es et confiant·es : ils et elles savent que de la résistance émerge les plus belles floraisons.
Estelle Grandbois-Bernard est militante de Mobilisation 6600 Parc-nature MHM.
Illustration : Elisabeth Doyon
Décision décevante :
Le ministère de l'Environnement finalement autorisé la mise en œuvre de la phase 1 du projet de transbordement de Ray-Mont Logistiques le vendredi 4 novembre 2022. Certaines contraintes ont été imposées à l'entreprise, notamment en ce qui concerne le bruit. Certain·es résident·es sont toutefois insatisfait·es de ces mesures, puisqu'on autorise tout de même le passage de 1500 camions par jour dans le quartier, ce qui aura des conséquences importantes sur la qualité de l'air et causera de la pollution sonore.
Pour rester connecté·e : Suivez Mobilisation Parc-nature MHM sur Facebook, Instagram, Twitter et sur resisteretfleurir.info.
La SAAQ, un enfer bureaucratique écrasant pour des accidentés de la route

Itinérance. Aider, mais pas n’importe comment

Nos concitoyen·nes de la rue sont les premier·ères à subir les conséquences des crises multiples que nous traversons –, pandémie, crise du logement, coût de la vie, surdoses, crise climatique… Or, plutôt que de considérer les besoins de ces personnes et de soulever les dénis de droits qu'elles subissent au sein du système, on perpétue les préjugés, la stigmatisation et une vision pour le moins réductrice de l'itinérance.
Comment considérons-nous collectivement l'itinérance ? En tant que problématique sociale ou conséquence de « mauvais » choix individuels ? Comment ces conceptions influencent-elles nos gouvernements et, donc, les réponses publiques à l'itinérance ? Quels sont les acteurs qui profitent de ces réponses ?
Depuis les 25 dernières années, trois manières distinctes de considérer l'itinérance dans le discours public ont été identifiées : écosanitaire, salutaire et démocratique. Ces conceptions sont explicitées par Michel Parazelli et une équipe de chercheur·euses dans le livre Itinérance et cohabitation urbaine paru en 2021 [1]. Chacune de ces conceptions est associée à un idéal et dirige des actions à prendre en lien avec l'itinérance. Elles sont aussi, sur plusieurs points, en opposition les unes des autres.
L'itinérance comme une vermine
La conception écosanitaire de l'itinérance fait référence à l'idée qu'un équilibre social serait menacé par les personnes habitant l'espace public. Dans cet idéal, toutes et tous seraient des citoyen·nes « civilisé·es » qui respectent les conventions sociales et ainsi, maintiendraient un climat de sécurité. Les personnes en situation d'itinérance sont ici considérées comme des menaces à cet équilibre social.
Pour illustrer cette conception, on peut penser aux discours qui associent l'itinérance à la criminalité. On justifiera alors une présence accrue de policier·ère·s pour maintenir cet équilibre pour la population en général. C'est aussi sous cette conception qu'on associe l'itinérance à la malpropreté. On peut penser à certaines demandes des milieux du commerce ou du tourisme d'être « libérés » de la présence de personnes en situation d'itinérance qui « entachent » la réputation des commerces ou de la ville ou « font peur aux client·es ». Les « pics anti-itinérant·es » installés sur au moins une façade d'un commerce de Montréal en 2014 sont un bon exemple de réponse écosanitaire aux enjeux d'itinérance.
Bref, cette conception considère l'itinérance comme une nuisance au bon cours des activités « normales » de la société et vise à maintenir « l'ordre et la sécurité ». Évidemment, respecter les droits et répondre aux besoins des personnes vivant l'itinérance n'est pas une priorité ici. Dans une certaine mesure, on pourrait aussi considérer la frénésie presque hégémonique pour l'approche « logement d'abord » comme une réponse écosanitaire. Dans cette approche, l'objectif est de donner un logement aux personnes itinérantes en priorité sous prétexte que c'est en logement qu'elles pourront s'attaquer à d'autres enjeux qu'elles vivent. Les personnes ayant accès à un logement ne se retrouveront donc plus dans les quartiers centraux et commerçants à « déranger » les activités commerciales et touristiques des « bon·nes citoyen·nes ». D'autant plus que le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM), fervent défenseur de ladite approche, compte deux anciens dirigeants de la société de développement commercial Destination Centre-Ville parmi ses membres.
L'itinérance comme une erreur de parcours
Pour ce qui est de la conception salutaire de l'itinérance, elle se rapproche de la vision judéo-chrétienne qui, bien qu'on tende à dire le contraire, n'est pas si loin de notre époque et continue de l'influencer. En effet, cette conception sous-entend que les personnes en situation d'exclusion sociale et de marginalité urbaines se seraient « égarées du droit chemin » et devraient donc être prises en charge et « sauvées » par des membres de la société qui auraient « le cœur à la bonne place ». On reconnaît ici la logique de la charité. On souhaiterait donc que les personnes qui « échoueraient » en situation d'itinérance – en consommant des substances psychoactives, en étant absent·es du marché du travail et en n'ayant pas de numéro de porte – s'intègrent à la société en se défaisant de ces « vices ». L'itinérance, sous cette conception, est vue comme étant négative en soi ; on veut s'assurer de « motiver » les personnes qui la vivent à s'en sortir à tout prix.
Le programme Objectif-emploi de l'aide sociale qui contraint toute personne qui en fait une première demande à entamer des démarches de réinsertion à l'emploi est un bon exemple de réponse salutaire. On vise à aider les personnes, mais à condition qu'elles se « prennent en main » et qu'elles n'aient plus besoin de cette aide à court terme. Dans le même sens, on pourrait nommer certains programmes d'hébergement
pour personnes consommant des substances psychoactives qui exigent que ces dernières entament des démarches vers la sobriété pour être admises. L'approche « logement d'abord » répondrait aussi à cette conception en envoyant les personnes le plus directement possible dans un logement, élément fondamental d'une « bonne » vie en cité. La conception salutaire a d'ailleurs plusieurs atomes crochus avec la conception écosanitaire. Encore une fois, cette conception accueille les personnes vivant dans l'espace public, mais en considérant que la situation d'itinérance elle-même est à faire disparaître, ce qui peut interférer avec les besoins réels des personnes qui vivent la rue.
L'itinérance comme une conséquence de systèmes d'oppression
La troisième vision de l'itinérance est la conception démocratique et c'est celle qui nous rejoint le plus comme regroupement d'action communautaire autonome. L'idéal, sous cette conception, serait que les personnes en situation d'exclusion sociale et de marginalité urbaine soient traitées avec équité et dignité à l'égard des autres citoyen·nes, qu'elles puissent choisir par et pour elles-mêmes ce qui est le mieux pour elles. Ce sont la dignité humaine et l'approche basée sur les droits de la personne qui doivent déterminer les réponses démocratiques. De ce fait, on exige la prise en compte des besoins des personnes dans les politiques publiques.
Cette conception prend souvent la forme de contestation d'injustices que subissent les membres de la communauté itinérante. On peut penser aux profilages social et racial, qui ne sont plus à prouver, et à l'inaccessibilité de services de santé qui correspondent à la vie dans la rue. Pour ce qui est du pôle de l'autonomie, on est ici en contradiction avec la conception salutaire : plutôt que d'imposer de manière top down des « solutions » aux personnes (un logement, un arrêt de consommation ou une intégration au marché du travail), on privilégie une posture d'écoute et de respect du rythme des personnes. La personne concernée devient l'experte de ce qui est bon et nécessaire pour elle-même. Un exemple d'autonomie donnée aux personnes concernées peut être l'organisme par et pour les travailleur·euses du sexe Stella, l'amie de Maimie. Finalement, on dénonce l'exclusion des personnes de leur milieu de vie, comme le démantèlement du Campement Notre-Dame qui a été vivement critiqué par le RAPSIM et ses membres qui interviennent sur le terrain, notamment les organismes en travail de rue.
Dans cette conception à laquelle adhère le RAPSIM, les actions à prendre en lien avec l'itinérance doivent être dans l'intérêt des personnes qui la vivent. Un premier pour personnes consommant des substances psychoactives qui exigent que ces dernières entament des démarches vers la sobriété pour être admises. L'approche « logement d'abord » répondrait aussi à cette conception en envoyant les personnes le plus directement possible dans un logement, élément fondamental d'une « bonne » vie en cité. La conception salutaire a d'ailleurs plusieurs atomes crochus avec la conception écosanitaire. Encore une fois, cette conception accueille les personnes vivant dans l'espace public, mais en considérant que la situation d'itinérance elle-même est à faire disparaître, ce qui peut interférer avec les besoins réels des personnes qui vivent la rue.
L'itinérance comme une conséquence de systèmes d'oppression
La troisième vision de l'itinérance est la conception démocratique et c'est celle qui nous rejoint le plus comme regroupement d'action communautaire autonome. L'idéal, sous cette conception, serait que les personnes en situation d'exclusion sociale et de marginalité urbaine soient traitées avec équité et dignité à l'égard des autres citoyen·nes, qu'elles puissent choisir par et pour elles-mêmes ce qui est le mieux pour elles. Ce sont la dignité humaine et l'approche basée sur les droits de la personne qui doivent déterminer les réponses démocratiques. De ce fait, on exige la prise en compte des besoins des personnes dans les politiques publiques.
Cette conception prend souvent la forme de contestation d'injustices que subissent les membres de la communauté itinérante. On peut penser aux profilages social et racial, qui ne sont plus à prouver, et à l'inaccessibilité de services de santé qui correspondent à la vie dans la rue. Pour ce qui est du pôle de l'autonomie, on est ici en contradiction avec la conception salutaire : plutôt que d'imposer de manière top down des « solutions » aux personnes (un logement, un arrêt de consommation ou une intégration au marché du travail), on privilégie une posture d'écoute et de respect du rythme des personnes. La personne concernée devient l'experte de ce qui est bon et nécessaire pour elle-même. Un exemple d'autonomie donnée aux personnes concernées peut être l'organisme par et pour les travailleur·euses du sexe Stella, l'amie de Maimie. Finalement, on dénonce l'exclusion des personnes de leur milieu de vie, comme le démantèlement du Campement Notre-Dame qui a été vivement critiqué par le RAPSIM et ses membres qui interviennent sur le terrain, notamment les organismes en travail de rue.
Dans cette conception à laquelle adhère le RAPSIM, les actions à prendre en lien avec l'itinérance doivent être dans l'intérêt des personnes qui la vivent. Un premier pas dans la bonne direction serait d'écouter ce qu'elles nous disent sur le terrain !
[1] Ce texte est librement inspiré de Michel Parazelli et al., Itinérance et cohabitation urbaine, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2021, pp. 117 à 142.
Jérémie Lamarche est organisateur communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).
Illustration : Ramon Vitesse

Deuxième mandat de la CAQ : Cette priorité prioritaire qui cherchait une crise à résoudre

Réélu, le gouvernement Legault veut redonner la priorité à l'éducation. Or, après un début de règne marqué par des mesures audacieuses, bien que fort discutables (abolition des commissions scolaires, généralisation des maternelles 4 ans, harmonisation de la taxe scolaire, abolition du cours ECR), le projet de la CAQ pour l'éducation semble s'essouffler. De quelle « priorité des priorités » parle-t-elle donc ?
Selon les dictionnaires, une priorité est le caractère de ce qui vient en premier, qui prévaut, qui a préséance. En clair : rien ne devrait être égal ou supérieur à ce qui fait l'objet d'une priorité. Encore faut-il que cette dernière ait un sens, une substance propres. Bref, qu'elle traduise un projet.
Au sommet : priorité à la continuité
Prioritaire, l'éducation l'est pour la CAQ depuis sa fondation en 2012. Son chef François Legault en fait en 2018 la « première priorité » de son gouvernement, proclamant le « redressement national ». Des mots et un ton forts, qui laissent entendre qu'il y a 1. un problème fondamental, voire une crise ; 2. urgence d'agir, et donc ; 3. nécessité d'un coup de barre pour reprendre le contrôle et donner une direction claire. L'ennui, c'est qu'on n'a jamais trop compris quelle était la crise ni perçu l'urgence pour un gouvernement qui, par contre, tenait à donner des coups de barre, malgré la réprobation générale, pour bien affirmer son leadership. Quant au redressement national, il se fait toujours attendre…
De la petite enfance à l'université, la question de l'éducation a pourtant brillé par son absence durant la dernière campagne électorale. Et pour cause : reléguée à l'avant-dernière section de la plateforme électorale caquiste (à la page 40 !), ce qui est désormais « la priorité des priorités » semble en panne de projet pour les quatre prochaines années. Les grands jalons de son programme posés dans le premier mandat, la CAQ semble vouloir se satisfaire désormais d'une confortable gouvernance tranquille, plein cap sur la hausse des taux de diplomation. Position surprenante de la part d'un gouvernement ultra majoritaire, qui aurait pu se permettre davantage d'audace. Plus qu'une dissonance, l'absence de proposition structurée, claire et originale traduit un problème profond de vision pour une éducation qui n'a plus de priorité que le nom.
À la base : priorité à la refondation
Bien qu'invisible à l'œil du gouvernement, la crise de notre système éducatif s'avère pourtant de plus en plus évidente à celles et ceux qui réclament en conséquence depuis plusieurs années de faire de l'éducation une priorité nationale. Essentiellement, les espoirs formulés lors des États généraux en 1995-1996 ont été trahis par des gouvernements qui disaient avoir l'éducation pour priorité, à travers des politiques néolibérales et d'austérité, des réformes managériales, et l'arrimage du système éducatif à l'économie du savoir. Sur ces constats, une douzaine d'organisations syndicales et étudiantes réclamaient en 2008 que « l'État québécois assume pleinement ses responsabilités démocratiques et se dote d'une véritable politique nationale de l'éducation publique réellement fondée sur les valeurs humanistes de justice sociale, d'égalité des chances, de solidarité et de coopération. » [1]
À l'occasion des 50 ans du Rapport Parent, en 2013, Paul-Gérin Lajoie s'inquiétant des « inégalités éducatives et culturelles » persistantes, appelait à une nouvelle commission d'enquête pour un nouvel élan collectif : « une deuxième Révolution tranquille doit être mise en chantier pour assurer l'exercice du droit de tous les jeunes et des moins jeunes à une éducation de qualité » et « mobiliser la collectivité autour des injustices scolaires. » [2] L'idée de cette commission 2.0 a depuis fait son chemin dans l'espace public, notamment en réaction aux réformes de structures à l'emporte-pièce, aux politiques d'austérité ou au déni obstiné de reconnaître les effets ségrégatifs d'un système éducatif à trois vitesses.
Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a mis au jour toutes les vulnérabilités de notre système scolaire, depuis la vétusté de ses équipements et infrastructures, jusqu'à sa gouvernance opaque et chancelante, en passant par l'insuffisance des moyens déployés pour accompagner les élèves à besoins particuliers, la difficulté du réseau public à soutenir et retenir ses élèves comme son personnel, pour n'en nommer que quelques-unes. Essoufflée, l'école québécoise semblerait craquer jusque dans ses fondations. La crise existe. L'urgence est là. La grande discussion collective sur les coups de barre à donner ne saurait attendre davantage.
Vers des forums citoyens…
Las du déni et de l'inaction gouvernementaux face aux problèmes de fond et devant l'absence d'orientations structurantes pour repositionner l'école québécoise, des groupes citoyens ont choisi de ne plus attendre après le gouvernement pour s'y attaquer. Créé en 2017, le collectif citoyen Debout pour l'école ! s'est donné comme mission de refaire de l'éducation un enjeu social et politique, accessible et discuté par la population, à qui les institutions scolaires et leurs finalités appartiennent. Rédigé par une centaine de ses membres, l'ouvrage Une autre école est possible et nécessaire [3] propose un diagnostic large des enjeux et défis actuels de l'école québécoise, et convie la population à réagir à la dérive marchande et à la dépossession de l'éducation dans une grande discussion nationale.
Cette discussion, les collectifs Debout pour l'école !, Je protège mon école publique, École ensemble, et Mouvement pour une éducation moderne et ouverte (MEMO) ont décidé de l'organiser en marge des autorités gouvernementales, avec le soutien de quelques dizaines d'organisations partenaires de la société civile. Dès le printemps 2023, et sous la gouverne d'un groupe de commissaires dont l'autorité et l'expertise sont reconnues, une vingtaine de forums citoyens se succéderont dans autant de villes à travers le Québec pour se porter à l'écoute de la population, recueillir ses idées, imaginer des solutions et dégager des consensus pour influencer les décideurs et politiques publiques. Des sujets importants y seront soumis à la discussion, tels que la mission de l'école québécoise face aux défis actuels et futurs, l'égalité des chances face au contexte de compétition scolaire, l'inclusion et l'adaptation de l'école à l'heure de la diversité sociale et culturelle, la reconnaissance et le soutien des personnels scolaires, la participation démocratique au sein du système scolaire face à la régulation managériale, etc.
Inédit, cet exercice invite certainement à une grande mobilisation citoyenne et à un acte de réappropriation de la chose éducative par la population du Québec. Plus encore, il faut qu'il puisse jeter les bases d'une véritable refondation de l'institution scolaire et d'un projet rassembleur, clairvoyant et structurant pour l'avenir de notre société.
Forger une priorité nationale ?
Ces dernières années, l'éducation est redevenue un enjeu important pour la population du Québec, une priorité sociale. Occupant davantage le débat public, elle réunit et met en mouvement des milliers de citoyens et citoyennes, parents ou membres de la communauté éducative autour de collectifs, de débats, d'idées. Pour un gouvernement qui se targue d'en faire sa priorité politique, ce devrait être un signal positif et une invitation à construire ensemble un édifice plus solide. Malheureusement, la CAQ a choisi d'abolir la démocratie scolaire et de renforcer l'opacité et les silos qui dépossèdent la population de son institution. François Legault avait rapidement fermé la porte à une commission Parent 2.0, se disant plutôt à l'étape de l'action. Il faut croire que les caquistes savent ce qui est bon pour l'éducation de la nation, et qu'ils ne s'abaisseront pas à en discuter avec elle. Ni en campagne électorale, ni jamais.
C'est dans ce contexte que Bernard Drainville s'installe au ministère de l'Éducation. Lui qui plaidait en 2011 que la classe politique et la gouvernance devaient se rapprocher des citoyens, dit ne pas fermer la porte pour l'instant à un grand rendez-vous pour parler des problèmes du système d'éducation, si cela peut permettre d'identifier des priorités d'action. Dès la fin de l'hiver, des forums citoyens clés en main lui seront offerts sur un plateau d'argent : définition des problèmes et des solutions incluse. À défaut d'avoir un plan ou un projet fort pour répondre à cette crise de l'éducation qu'il ne voit pas, le ministre serait bien avisé de se présenter dans un de ces forums où l'avenir de notre système d'éducation et de notre société pourrait bien se forger autour de celles et ceux qui font et vivent l'école. À lui de décider si la priorité des priorités gouvernementale est suffisamment prioritaire pour s'abreuver à la volonté populaire et en faire une réelle priorité nationale.
[1] Manifeste. Faire de l'éducation publique la priorité nationale du Québec, 2008, p.14. numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3748255
[2] Paul Gérin-Lajoie, « Je ne peux demeurer « tranquille », même à l'approche de mes 94 ans », Le Devoir, 21 septembre 2013.
[3] Collectif Debout pour l'école !, Une autre école est possible et nécessaire, Montréal, Del Busso Éditeur, 2022, 472 pages.
Photo : MR (CC BY-ND 2.0)

GA(F)AM : la tyrannie de la popularité

Si on compare les cinq géants technologiques par leur capitalisation boursière, Facebook arrive en dernière position. Difficile de quitter Facebook sans compromettre les liens avec nos proches.
Le site est lancé dans la controverse en 2004 comme outil de réseautage entre étudiantes et étudiants d'Harvard. L'utilisation de photos sans consentement a presque mené son créateur à l'expulsion de l'université. Le site sera par la suite offert à d'autres universités américaines pour être ouvert au public à partir de 2006. Il sera rejoint par un nombre de personnes en croissance régulière pour atteindre aujourd'hui 2,7 milliards d'utilisateur·rices actif·ves mensuellement, soit approximativement un tiers de la population mondiale. C'est le troisième site Web le plus visité et il est utilisé par près de 6 internautes sur 10. Un site aussi populaire est une mine d'or publicitaire que le géant exploite au maximum. Ainsi, près de la totalité de ses revenus de 118 milliards $ US en 2021 proviennent de la publicité ciblée affichée sur ses différentes plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp). À l'instar des autres géants technologiques, Facebook a pratiqué pendant des années l'évitement fiscal à grande échelle.
Facebook a utilisé à maintes reprises l'achat de concurrents potentiels à coups de milliards pour conserver sa position dominante. Pensons notamment à Instagram en 2012 ou WhatsApp en 2014, le réseau de clavardage avec des centaines de millions d'usager·ères. Ces deux acquisitions ont placé Facebook dans une position dominante qui a mené en 2020 la Federal Trade Commission et une coalition d'états états-uniens à porter plainte pour pratiques anticoncurrentielles. La cause a été rejetée par le tribunal en 2021. Le géant a aussi absorbé plusieurs autres entreprises pour prendre le contrôle des technologies qu'elles ont développées. On pense par exemple à Face.com en 2012 pour la technologie de reconnaissance faciale qui sera intégrée aux fonctionnalités de Facebook et à Oculus VR, acheté en 2014 afin de mettre la main sur sa plateforme de réalité virtuelle. Le géant utilise enfin une stratégie qui lui est propre pour lutter contre les concurrents qu'elle ne peut acheter : utiliser à son avantage sa capacité à copier très rapidement leurs produits pour les intégrer dans les siens, espérant ainsi que la masse de ses usager·ères adopte sa copie plutôt que l'original de ses rivaux. Ce stratagème est par exemple celui adopté contre TikTok.
Après une croissance ininterrompue sur une décennie, Facebook cherche maintenant à se redéfinir pour faire face à la stagnation de son nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices, notamment à cause de pertes grandissantes au profit de nouveaux concurrents. L'entreprise est aussi soumise à des règles plus sévères de protection de la vie privée qui limitent sa capacité à récolter l'information nécessaire à son lucratif ciblage publicitaire. Facebook décide de se rebaptiser « Meta Platforms ». Tout en maintenant ses plateformes actuelles, elle décide de développer ses activités dans le monde de la réalité virtuelle en cherchant à devenir une force centrale dans l'adoption du « metavers ». Celui-ci est un environnement virtuel et interactif à la croisée des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Le PDG de Meta le conçoit d'ailleurs comme l'avenir d'Internet. Le géant présente le métavers comme une manière d'enrichir les contacts humains ayant lieu par l'entremise d'Internet, ce qui devrait lui faire occuper une place croissante dans nos vies. On peut cependant se questionner sur les effets potentiels d'une éventuelle adoption généralisée de l'univers virtuel de Meta, car il sera ultimement construit selon la vision capitaliste de la compagnie : monnaie électronique, marché spéculatif d'art et d'objets numériques mus par une rareté artificielle créée technologiquement, travail à distance dans des bureaux virtuels, surveillance patronale accrue, multiplication des occasions d'accumulation de données personnelles pour des fins publicitaires, etc. Le métavers de Meta est un projet qui n'est pas encore rentable et qui est accueilli avec scepticisme par divers analystes et même au sein de l'entreprise.
Un média perturbateur
L'arrivée des « médias sociaux » a été présentée dans les « médias traditionnels » comme une nouvelle curiosité technologique à décrire et à vulgariser avec un certain enthousiasme et peu de critiques. Cela n'a pas manqué d'alimenter la popularité des principales plateformes du genre comme Facebook et Twitter. Ironiquement, cette popularité a fini par détourner l'attention du public de la télé, de la radio et de la presse écrite en faveur des nouvelles plateformes, diminuant ainsi les revenus publicitaires des médias traditionnels. De plus, il est reconnu que le partage de contenus créés par les « anciens médias » contribue aux revenus publicitaires de Facebook et cie. Par exemple, Jean-Hugues Roy de l'école des médias de l'UQAM a estimé qu'en 2017 Facebook a reçu 23 millions $ en revenus publicitaires grâce aux médias du Québec et que le géant aurait dû leur donner en retour 11,5 millions $.
Dans plusieurs pays, dont le Canada avec l'actuel projet de loi C-18, on tente de mettre en place des lois visant à forcer les géants technologiques à partager leurs revenus publicitaires avec les médias créateurs de contenu. De telles règles ne font cependant que reconnaître la suprématie des plateformes les plus populaires, où les médias locaux doivent maintenant diffuser leurs contenus pour atteindre leurs publics, contribuant ainsi par rétroaction à la popularité − et aux revenus − de Facebook et de ses semblables.
Des expériences de manipulation sociale
Facebook a un immense pouvoir d'influence sociale, démontré par quelques expériences menées par l'entreprise visant à influencer l'humeur ou le comportement des usager·ères de ses sites. Ces expériences ont été dénoncées et critiquées, mais elles peuvent faire perdre de vue que l'expérimentation sociale est constante chez Facebook. Elle cherche depuis ses débuts à maximiser l'« engagement » des usager·ères, c'est-à-dire leur tendance à utiliser ses plateformes activement sur une base régulière. Cela est quantifié de différentes manières afin d'améliorer l'efficacité des annonces publicitaires. La valeur boursière de l'entreprise dépend tellement de cette mesure qu'elle est publiée dans ses rapports financiers.
À l'époque où Facebook atteignait la barre du milliard d'usager·ères, afin de s'assurer de poursuivre sa croissance, la compagnie a remplacé le travail d'expérimentation des ingénieur·euses visant à maximiser l'engagement par l'utilisation de l'intelligence artificielle. On analyse les données amassées pour créer des modèles qui seront premièrement testés à petite échelle afin de déterminer de quelle manière les mesures d'engagement sont modifiées pour ensuite être rejetées ou être utilisées sur l'ensemble du site. Ce cycle est maintenant répété régulièrement, de nouveaux modèles pouvant être testés quotidiennement.
Ces expériences peuvent avoir des effets collatéraux : l'engagement dans les discussions sur Facebook semble favorisé par la controverse et la désinformation. Ainsi, la plateforme propose à ses usager·ères de joindre des groupes où règne la controverse, ce qui va souvent de pair avec la circulation d'idées extrémistes. Amnistie internationale accuse d'ailleurs Meta d'avoir alimenté la haine envers les Rohingyas au Myanmar par l'effet de leurs choix algorithmiques, ce qui a encouragé la persécution des Rohingyas. Les messages haineux et les appels au meurtre ont été diffusés par la plateforme, qui mettra des années à intervenir.
Le principal produit de Meta étant sa connaissance fine de ce qui influence ses usager·ères, il n'est pas surprenant que ce pouvoir d'influence soit aussi utilisé à des fins politiques. C'est exactement l'activité de compagnie Cambridge Analytica, dont les services ont été utilisés par la campagne de Trump.
La double tyrannie
La tyrannie de la popularité de Facebook est double. La plateforme a été conçue à une époque où différents sites ont expérimenté pour trouver les meilleurs moyens de devenir populaires en nous présentant sur Internet le reflet de notre popularité personnelle. Facebook a sans doute été le site le plus habilement construit, au point où sa popularité est devenue une tyrannie tant il est difficile de sortir de son emprise. Il est impossible de passer à une plateforme moins populaire sans avoir l'impression de perdre contact avec ses proches, mais surtout de ne plus jouir de l'attention que notre cercle social nous procure à coups de petits signaux appréciatifs répétés

Terre-Neuve-Et-Labrador : Le pétrole au secours de l’écologie

Le 6 avril dernier, Steven Guilbeault donnait son aval au controversé mégaprojet pétrolier Bay du Nord au large de l'île de Terre-Neuve. Cette nouvelle a été accueillie très favorablement par des milliers de personnes qui travaillent et dépendent de l'industrie pétrolière. Bien qu'une grande portion de la population de la province appuie le projet, un clivage social s'est creusé par rapport à ce dernier et a divisé cette province où l'extraction de ressources naturelles est toujours centrale.
Ce projet se veut l'un des plus ambitieux projets d'extraction pétrolière que le pays ait connus. La firme pétrolière norvégienne Equinor en est devenue responsable après avoir trouvé, en 2013, des gisements pétroliers à plus de 1 170 mètres de profondeur, sous le sol océanique et à 500 km au large de l'île de Terre-Neuve. D'autres gisements potentiels ont aussi été découverts entre 2016 et 2020 dans le même secteur. L'entreprise propose une exploitation pétrolière en cohérence avec sa vision d'un « futur neutre en carbone » [1] grâce à sa plateforme de forage pétrolier amovible plus performante que celles utilisées habituellement. Grâce à cette innovation, la province de Terre-Neuve-et-Labrador serait plus compétitive dans l'industrie pétrolière mondiale.
Solution au réchauffement climatique ?
Cette proposition a immédiatement piqué l'intérêt du gouvernement fédéral, qui a commandé une étude des potentiels impacts environnementaux. En 2022, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) dépose son rapport concluant que l'extraction pétrolière du sol océanique « n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ». Le projet est ensuite autorisé, sous réserve de mesures strictes visant à protéger l'environnement. Toujours selon l'AEIC, Bay du Nord cadre avec le plan du gouvernement fédéral d'atteindre la neutralité en carbone d'ici 2050. Le rapport stipule que : « le projet d'exploitation de Bay du Nord est un exemple de la façon dont le Canada peut tracer la voie à suivre pour produire de l'énergie à la plus faible intensité d'émissions possible tout en envisageant un avenir carboneutre. »
Même son de cloche du côté du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, pour qui ce mégaprojet constitue une des solutions pour la transition écologique. « Notre gouvernement provincial a travaillé sans relâche pour défendre cette décision prudente du gouvernement fédéral, surtout que les bénéfices environnementaux et économiques du projet Bay du Nord sont maintenant clairs » [2], expliquait Andrew Furey le 6 avril 2022 dans un communiqué de presse par rapport à la décision positive d'Ottawa.
Ces deux exemples représentent bien la logique gouvernementale derrière ce projet. Le gouvernement fédéral, tout comme celui provincial à Terre-Neuve-et-Labrador, sont d'avis que l'extraction pétrolière peut être faite de manière à respecter les plans fédéraux en vigueur de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans contrevenir à l'objectif d'atteindre la carboneutralité dans les prochaines décennies. Cette logique est d'autant plus appuyée par l'idée que la population mondiale a toujours besoin de pétrole. Ceci permet de justifier la nécessité d'explorer et d'exploiter encore plus de gisements dans des milieux de plus en plus à risque.
« I Love NL Oil and Gas », et les autres
Avant même qu'Ottawa n'approuve le projet, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) avait déjà signalé l'impossibilité de réconcilier exploitation pétrolière et lutte au réchauffement climatique. En ce qui a trait à Bay du Nord, le GIEC avait estimé le potentiel de pollution de Bay du Nord de 7 à 10 millions de voitures à essence sur les routes chaque année, traduisant les risques d'une augmentation accrue des gaz à effet de serre émis au Canada. Cela n'a pas convaincu Ottawa de faire marche arrière sur le projet.
Deux camps irréconciliables se sont formés par rapport à ce projet : d'un côté celles et ceux qui croient que le projet est une bonne nouvelle sur le plan économique ; de l'autre, beaucoup moins nombreuses sont les personnes convaincues que ce projet est une erreur monumentale dans un monde où la crise climatique affecte un plus grand nombre de gens chaque année. Les détracteurs et détractrices du projet ne comptent que pour 8 % de la population de Terre-Neuve : une grande acceptabilité sociale se dégage de la province par rapport à ce projet extractif. Chacun des deux camps considère les priorités de l'autre comme étant responsable d'une potentielle réduction de la qualité de vie de la population de la province, mais les voix contre Bay du Nord peinent à se faire entendre dans l'espace public.
Je me suis entretenu avec deux militantes de la Social Justice Co-operative of Newfoundland-Labrador, une organisation communautaire de luttes aux inégalités sociales et économiques dans la province, pour mieux comprendre leurs positions face à ce projet pétrolier.
Pour Kerri Claire Neil, co-présidente de la Social Justice Co-op, le projet Bay du Nord a mené la population de la province à se politiser. Selon la militante, le secteur pétrolier mise sur le patriotisme terre-neuvien-et-labradorien pour justifier le projet, en utilisant notamment des stratégies de marketing, comme des vêtements ou des autocollants où l'on peut voir le slogan « I Love NL Oil & Gas ». Cela effraie beaucoup de gens qui souhaiteraient se positionner contre le projet ou simplement débattre du potentiel de ce dernier. « L'industrie mise sur ce sentiment de patriotisme avec des formules du genre “ Si vous ne supportez pas le projet, vous ne supportez pas la province ”. Ça fait en sorte que les écologistes et les gens qui sont contre Bay du Nord sont perçus comme des ennemis et sont souvent associés au socialisme et à la mauvaise santé financière de Terre-Neuve-et-Labrador », explique-t-elle. Cette peur est alimentée en outre par l'absence de perspectives pour les travailleurs et travailleuses, surtout dans le domaine pétrolier, où la propagande misant sur cette insécurité est palpable.
Ainsi, plusieurs progressistes ont qualifié l'approbation du projet Bay du Nord d'un manque de vision pour la province. Pour Sarah Sauvé, militante au sein de la Social Justice Co-op, l'absence de diversification économique et d'investissements dans de réelles alternatives énergétiques ne peut que rendre Terre-Neuve-et-Labrador plus vulnérable aux changements climatiques. De plus, les promesses faites par l'industrie pour alimenter l'approbation sociale face à leur projet ne sont bien souvent que des mots qui ne se concrétisent pas. Comme l'explique Sarah Sauvé, les engagements de l'industrie pétrolière afin de renflouer les coffres et payer les dettes de la province ne se sont jamais matérialisés, malgré tous les mégaprojets et toutes les promesses de retombées économiques. En quoi le projet Bay du Nord serait-il différent ?
Il faut aussi souligner la faiblesse des mouvements communautaires et sociaux qui pourraient contester Bay du Nord dans la province. Ce qui fait la force de la Social Justice Co-op dans ses luttes sociales contre le projet Bay du Nord, c'est qu'elle est un mouvement populaire entièrement financé par la base, contrairement à la majorité des autres organismes, qui sont subventionnés par le gouvernement. « Puisque les autres organismes reçoivent l'argent du gouvernement propétrole et pro-Bay du Nord, ils doivent faire des compromis et adopter des postures moins critiques, ce qui nuit à la contestation du projet et donne plus de raisons au gouvernement d'aller de l'avant », précise Kerri Claire Neil.
Ainsi, la coopérative est l'un des seuls groupes organisés qui peuvent protester contre le projet. Les militant·es au sein de l'organisation sont malgré tout marginaux·ales et marginalisé·es en raison de leur insistance sur un changement de paradigme énergétique et une juste transition écologique.
[1] Tel que décrit sur le site Web de l'entreprise Equinor, « The Bay du Nord project » : www.equinor.com/where-we-are/canada-bay-du-nord
[2] Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, « Premier Furey and Minister Parsons Comment on Bay du Nord Development Project ». En ligne : www.gov.nl.ca/releases/2022/exec/0406n06/
David Beauchamp est journaliste et ancien résident de Terre-Neuve.
Photo : Kerri Claire Neil pour la Social Justice Co-op
Les Soulèvements du Fleuve
La bataille de Saint-Léonard, un documentaire de Félix Rose
Quelques faits saillants (et scandales) de la carrière politique de Fitzgibbon
Stoppons le financement du Fonds National Juif
Le 5 septembre dernier, Journée internationale de la charité instaurée par l'ONU dans le but de sensibiliser et mobiliser les acteurs de la société civile au besoin de lutter contre les inégalités dans le monde, a été retenu par le Mouvement pour une Paix juste, l'Institut canadien de politique étrangère et Voix juives indépendantes, afin d'exiger la fin du financement au Canada au Fonds national juif (FNJ) et aux organismes similaires qui soutiennent le génocide du peuple palestinien qui a cours.
Des rassemblements ont été tenus dans 20 villes canadiennes devant les bureaux de l'Agence de revenu du Canada (ARC). Le statut d'organisme de charité a été révoqué au FNJ le 10 août dernier après plus d'une dizaine d'année de lutte. Toutefois le FNJ est en appel de cette décision et c'est pourquoi cette mobilisation pancanadienne s'est tenue.
À Montréal, une militante rappelait que le JNF Canada a depuis longtemps violé la loi fiscale canadienne et s'est soustrait aux réglementations gouvernementales. La révocation du statut d'organisme de charité au FNJ indique que cette victoire est le prélude à la poursuite de la lutte contre les nombreux organismes de bienfaisance au Canada qui continuent de soutenir les poussées expansionnistes israéliennes tant à Gaza, qu'en Cisjordanie et à Jérusalem Est grâce à leur statut d'organisme de charité qui leur est toujours octroyé.

Northvolt, développement durable ou pas endurable ?

À la lumière des dernières informations recueillies dans Le Devoir, la situation avec l'usine Northvolt s'annonce périlleuse dans tous les sens du terme pour tout le monde. (1)
Rappelons-nous les paroles même du Ministre de l'environnement, Benoit Charrette, qui disait : « on ne fait pas de BAPE, car ça n'aurait pas passé… », ou « si on avait fait un BAPE la compagnie serait allée aller ailleurs… ». En fait, si la compagnie était allée à New-York, nous aurions économisé 7 milliards de dollars et nous pourrions tout de même acheter leurs batteries.
Le BAPE n'aurait pas passé ; devrions-nous interpréter cela comme le projet n'a pas d'allure ou n'est pas assez bon ? En fait le gouvernement a changé la Loi afin de permettre à Northvolt d'échapper au BAPE. C'est alors qu'on nous a laissé entendre que la fenêtre requise pour l'implantation et la mise en production de l'usine Northvolt était étroite ; ils avaient un carnet de commandes et il n'y avait pas de temps à perdre dans cette course contre la montre pour aller vers le bon développement vert et « durable ». Cherchez l'erreur… maintenant lorsque la compagnie nous dit qu'elle doit revoir ses plans et se mettre sur pause momentanément afin de résoudre certains problèmes… ! Mais lesquels ?
La police suédoise enquête au sujet d'employés qui ont été victimes d'accidents. La presse anglophone relate quatre morts. La compagnie a dû ralentir. Leur carnet de commande est en train de se vider et d'autres compagnies optent pour les modèles de voitures hybrides.
Lors des séances tenues avec les citoyens de McMasterville et de St-Basile, les représentants du gouvernement ont maintes fois mentionné qu'ils n'avaient pas les réponses à nos questions et qu'il n'y a pas de normes pour ce genre d'industrie au Québec. Pas de normes ! Doit-on comprendre cela comme : ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ! ? Ce serait un vœu pieux de penser que le bon gouvernement établira de bonnes normes, lorsqu'on sait qu'ils ont rehaussé les normes pour le nickel dans l'air près du port de Québec et pour plaire ou faciliter les choses à la Fonderie Horne. Cette fonderie est l'exemple criant que le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatique ne se tient pas debout.
Selon Northvolt qui a besoin de 9 milliards de litre d'eau annuellement, l'eau rejetée dans la rivière après avoir été utilisée dans son complexe industriel ne représentera pas de risque pour l'environnement, puisqu'elle sera « traitée par une usine de traitement sur le site ». Elle promet de se conformer aux « normes de rejet qui seront établies pour le projet de Northvolt Six selon la qualité de la rivière Richelieu à l'état actuel… Nous attendons patiemment de connaître ces normes… Et selon le directeur de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP), M Branchaud, les informations que nous avons ne sont pas rassurantes. Le principe de précaution devrait s'appliquer pour le chevalier cuivré et il faudra faire beaucoup de tests avant de déterminer les rejets adéquats pour la faune (1) et j'ajouterais pour le citoyen qui boit l'eau de la rivière Richelieu. Fait à noter, le gouvernement Legault s'est opposé à la Loi de protection du chevalier cuivré en 2021, pour des raisons économiques. (2)
Le gouvernement nous a présenté Northvolt comme une compagnie exemplaire, mais elle accumule les calamités financières : on voit des gains privés et des pertes socialisées et c'est nous qui payons toutes les factures en bout de ligne.
« Aux larmes citoyens » n'est pas une option envisageable. Nous ne les laisserons pas saccager notre eau et notre environnement. Les armes que nous avons sont multiples : des plumes bien aiguisées, des langues bien pendues qui transmettent toute l'information et la vérité aux voisins et aux élus, en formulant toutes nos réticences et inquiétudes qui jusqu'à maintenant n'ont pas été prises en considérations : BAPE écarté, normes inexistantes ou rehaussement des niveaux pour divers contaminants dont le nickel. C'est inquiétant pour les abeilles qui y sont très sensibles et pour nos pommiculteurs dans la région qui ont besoin de ces pollinisateurs.
Nous avons sauvé les baleines avec l'invention du kérosène autour des années 1850. Ça ne veut pas dire que les baleines vont très bien. Et nous pourrions avoir à sauver les humains prochainement si nous ne pensons pas à nous développer de façon véritablement durable. Le nombre de claims miniers a bondi de 83,000 au cours de la dernière année, ce qui représente 10% du territoire. (3) Il est question de claims pour extraire le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite et j'en passe.
Et encore une fois, si c'est nous qui devrons payer pour la décontamination de ces sites miniers, on est du bon monde ! Ecologie ou escrologie ! On a qu'à penser aux sous que Fitzgibbon donne à Nemaska Lithium. (4)
Il y a plusieurs années, Pierre Béland, écotoxicologue, ramassait des carcasses de bélugas le long du Fleuve St-Laurent et à quelques reprises il en a fait acheminer vers l'Institut Vétérinaire de St-Hyacinthe. Nous apprenions qu'un de ces bélugas était tellement contaminé, que le transporter aurait pu être illégal. C'est connu, les toxines s'accumulent dans nos tissus graisseux. Des études en témoignent. (5) Si Northvolt s'installe dans notre région, il n'y aura pas que les bélugas qui vont souffrir, mais toute la faune et les citoyens de la région. Pensez-y.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Québec solidaire, l’indépendance et la lutte dans l’État canadien

Dans un communiqué envoyé récemment, la direction de Québec solidaire exprimait sa position concernant les élections fédérales à venir. Elle rappelait que les instances du parti n'appuyaient aucun parti ou candidature et que ce devoir d'impartialité s'appliquait à toutes les personnes élues et porte-paroles des instances locales et régionales.
Cette position n'est pas complètement différente de ce qui a été décidé par le passé, le CCN s'est toujours abstenu d'appuyer un parti politique lors des élections fédérales.
Lors du Conseil national de mars 2019 les membres avaient adopté la position suivante :
Il est proposé qu'en prévision des prochaines élections partielles fédérales et des
élections générales qui se tiendront à l'automne :
a) Les instances de Québec solidaire (Comité de coordination national, comités de
coordination régionaux et locaux, Aile parlementaire, etc.) n'appuient directement
ou indirectement aucun parti ou candidature ;
b) Que ce devoir d'impartialité s'applique également aux personnes élues des
instances nationales de Québec solidaire ainsi qu'aux porte-parole des instances
locales et régionales ;
c) Qu'aucune ressource humaine, logistique, informationnelle ou financière de
Québec solidaire et de ses instances ne soit mise à la disposition d'un parti
politique fédéral ;
d) Que les autres membres de Québec solidaire, sur une base individuelle, soient
invités à soutenir le parti qui représente le mieux leurs valeurs en s'engageant à y
défendre les principes et le projet de société de Québec solidaire.
Le problème majeur cependant, est que cette position évacue tout le débat politique concernant notre stratégie dans l'État canadien.
Par le passé, la direction de QS considérait important de se préoccuper de la solidarité avec les travailleurs et travailleuses et les mouvements sociaux du Reste du Canada, même si la consigne de vote est demeurée complexe au niveau fédéral.
Lors des élections de 2015 le CCN (dont je faisais partie) avait décidé ce qui suit : « Que dans le cadre de l'élection fédérale, QS intervienne publiquement sur les enjeux qu'il jugera prioritaire pour mettre de l'avant sa propre vision solidaire. Que QS continue à s'impliquer dans la solidarité des peuples dans l'État canadien sur des questions comme l'austérité et les changements climatiques et qu'il fasse la promotion du droit à l'autodétermination du Québec. On convient de la nécessité de faire le bilan de notre position de neutralité après la tenue des élections. »
Le CCN avait mis sur pied un sous-comité de réflexion qui avait produit le document suivant :
Texte du sous-comité de réflexion : A : Élections fédérales
« Quelle que soit notre position, les élections fédérales nous interpellent. D'une part parce que la politique fédérale nous concerne. Le débat engendré au Québec par les politiques conservatrices et le désir de chasser Harper le démontre. D'autre part il y a un lien politique et organisationnel évident entre le BQ et le PQ. La gouvernance fédéraliste vient compléter la gouvernance souverainiste. Il y a ici une confusion des genres. Le Bloc est une extension du PQ qui vient couvrir leur angle mort sur la scène fédérale, ce faisant il s'adresse en bonne partie à nos militants et militantes et à notre clientèle électorale. Pour ces raisons nous serons toujours la cible des bloquistes même si nous ne prenons pas position, ou plutôt parce-que nous ne prenons pas position pour eux. Il sera donc nécessaire de nous démarquer afin de sortir de notre position défensive. Il n'y a pas beaucoup d'issue, tenant compte de notre position d'abstention. Cependant si nous avons une position de neutralité quant à l'élection, nous ne sommes pas neutres en ce qui concerne les enjeux.
Nous pouvons mettre l'accent sur les enjeux énergétiques en démystifiant les positions des partis concernant le pétrole et Énergie Est.
Notre travail de solidarité avec les progressistes du reste du Canada et les peuples autochtones met en lumière notre vision différente de la souveraineté ; construire une solidarité des peuples contre l'austérité mais aussi solidaires de la lutte sociale pour la souveraineté au Québec. »
Le CCN avait ensuite adopté en décembre 2016 une résolution visant à formaliser le travail pancanadien :
« André Frappier présente le document déjà envoyé et les objectifs poursuivis. Cela fait deux ans qu'il a entamé ces travaux avec d'autres progressistes canadiens. Il fait également état des activités et conférences organisées régulièrement. L'expérience de Québec solidaire a su inspirer plusieurs groupes progressistes du reste du Canada. Ce serait bien que ce travail soit un peu plus formalisé et que ce dossier soit reconnu au sein du comité de coordination national. Ainsi, ce pourrait être d'autres personnes du CCN qui participe à ces activités et, si nécessaire, un soutien financier pourrait être accordé. »
« Que ce travail avec les progressistes canadiens soit formalisé en confiant cette responsabilité aux porte-parole (qui pourront déléguer au besoin) et qu'un budget soit accordé lorsqu'il y a représentation formelle au nom de QS. Qu'on informe autant que possible nos membres sur la gauche canadienne. »
Durant cette période plusieurs militants et militantes de QS, dont Amir Khadir, Benoit Renaud, Jessica Squires, Roger Rashi, Andrea Levy et moi-même, ont participé ou initié des conférences dans le Reste du Canada et travaillé à créer un réseau militant qui a duré quelques années.
Bien que cette résolution soit toujours valide, cette perspective a été mise de côté. Depuis 2018 la direction de QS n'a effectué aucun travail dans ce sens.
Quelles perspectives ?
Le changement de société que nous revendiquons ne peut se réaliser dans le cadre de l'État canadien, qui a démontré son rôle antidémocratique à plus d'une reprise envers les décisions du Québec. Le Canada est un État impérialiste où les partis bourgeois sont les accessoires, les portes tournantes entre les fonctions ministérielles et celles des chefs d'entreprise en font foi.
Plus de 75% des sociétés mondiales d'exploration ou d'exploitation minière ont leur siège social au Canada et près de 60% de celles cotées en Bourse s'enregistrent à Toronto à cause des avantages juridictionnels et réglementaires réservés par le Canada à ce secteur d'activité. L'ex premier ministre Brian Mulroney et l'investisseur Paul Desmarais ont fait partie du Conseil international de Barrick Gold, une des pétrolières présentes au Nigéria TG World Energy Corp. de Calgary était représentée par l'ancien premier ministre Jean Chrétien et Joe Clark a représenté les intérêts de First Quantum Mining en Afrique. [1]
Par son historique politique et culturel et d'oppression nationale, le Québec constitue le maillon faible où il est possible de réaliser un projet de société au moyen de l'indépendance. Mais ce projet ne se fera pas sans riposte. Le scandale du programme des commandites (1996 à 2004) dont les malversations avaient été révélées par la commission Gomery en 2004 n'est qu'un pâle exemple des capacités dont l'État canadien peut utiliser pour conserver le statu quo fédéral. Le love-in d'octobre 1995 à Montréal au moment du référendum du PQ, où des milliers de citoyens et citoyennes de Reste du Canada sont venus influencer le vote référendaire le démontre également. Parmi les milliers de personnes qui investissent le centre-ville de Montréal, on trouve des Néo-Brunswickois venus dans des autocars nolisés par la pétrolière Irving, des étudiants venus d'aussi loin que Vancouver grâce à un rabais de 90 % d'Air Canada, des employés de la municipalité d'Ottawa-Carleton qui ont obtenu un congé payé, etc. [2]
Pour contrer ces offensives, l'indépendance du Québec ne pourra se réaliser que par une mobilisation large de la population du Québec dans un projet de société démocratique, inclusif et égalitaire. Mais ce projet doit dès maintenant interpeller les progressistes de Reste du Canada au fait qu'ils ont intérêt à appuyer la lutte d'émancipation sociale au Québec et qu'il en va également de leur avenir. Dans ce combat, soutenir la bourgeoisie canadienne irait contre leurs propres intérêts.
Si les options soumises lors des élections fédérales ne sont pas appropriées et que le choix pour la direction de QS s'avère la neutralité, il demeure à tout le moins essentiel de construire un réseau de solidarité avec les progressistes du Reste du Canada et en lien avec les peuples autochtones. Il faut trouver des pistes alternatives, on ne peut pas seulement demeurer neutre et attendre que le train de droite nous passe dessus.
Nos camarades catalans de la CUP ont innové lors des deux dernières élections espagnoles et ont décidé de présenter leurs propres candidatures (en Catalogne). Au printemps dernier, j'ai tenté d'organiser une rencontre virtuelle avec ces camarades et des membres de la direction de QS afin de discuter avec eux des conclusions de leurs expériences. Le processus a finalement échoué par manque de disponibilité.
Il faut persévérer dans cette réflexion, s'inspirer des expériences internationales et trouver nos propres solutions alternatives. Chose certaine, avec la montée de l'extrême droite nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de demeurer les bras croisés.
André Frappier
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Soulèvements du fleuve : ces cousins québécois des luttes françaises

Au Québec, le fleuve Saint-Laurent et ses berges sont artificialisés. Les collectifs de défense se regroupent au sein des Soulèvements du fleuve, inspirés des Soulèvements français.
3 septembre 2024 | tiré du site reporterre.net
Du haut de ce talus en plein cœur de Montréal, nous sommes en équilibre entre deux mondes. D'un côté, le quartier de Maisonneuve, avec des enfants qui jouent, des gens qui se baladent dans la forêt, ce poumon vert qui accueille des chauves-souris, et la migration du papillon monarque, une espèce protégée. De l'autre, du béton, du macadam et des centaines de conteneurs de toutes les couleurs empilés sur des dizaines de mètres de hauteur.
« Ici, c'étaient des bois auparavant. C'est là que nos enfants ont appris à marcher. On faisait des pique-niques tous les week-ends. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout est asphalté », dit Anaïs Houde, militante de Mobilisation 6600, un regroupement citoyen qui s'oppose à la réindustrialisation des berges du fleuve Saint-Laurent.
Agrandissement de ports, nouvelles autoroutes ou zones industrielles... Dans la province du Québec, les projets portés par le lobby de la logistique fleurissent — tout en bétonnant et privatisant les berges du fleuve. Depuis l'été, tous les collectifs en lutte contre cette Silicon Valley québécoise ont décidé de se regrouper à travers Les Soulèvements du fleuve, un mouvement inspiré des Soulèvements de la Terre en France. L'idée ? « Montrer que nous ne sommes pas des luttes locales isolées, mais que l'on se bat pour un enjeu global. Et au passage, fournir un discours théorique et politique sur ce que ce monde-là nous prépare », explique Joris Maillochon, lui aussi membre de Mobilisation 6600.
D'ici, on ne voit même pas le fleuve Saint-Laurent, pourtant tout près, caché par d'immenses grues. « Oh, un renard qui se balade au milieu des conteneurs », s'amuse Joris Maillochon. C'est une partie du boisé Steinberg, au sud de Montréal, que la compagnie privée Ray-Mont Logistics veut raser pour y implanter la plus grande plateforme de transbordement d'Amérique du Nord. Cette installation permettrait à l'entreprise de multiplier son activité par quinze.
Balance ton mégaport
Plus au nord de Montréal, le port de Contrecœur devrait, lui, doubler sa capacité actuelle, dans le but d'accueillir 1 million de conteneurs par an. « Pour cela, ils vont couper 22 000 arbres, c'est énorme, explique Gilles Dubois, militant d'une vigie citoyenne qui s'oppose à ce mégaprojet. Sans compter les milliers de camions qui vont venir ici chaque jour pour décharger des marchandises. »
À Lévis, petite ville en face de Québec, le Collectif Sauvetage veut sauvegarder 272 hectares de terres agricoles, de forêts et d'érablières vouées à disparaître pour un « complexe industriel et portuaire ». « Nous sommes près de superbes falaises, où je me balade souvent en kayak. C'est une bordure sauvage, sans aucun habitant, avec beaucoup d'arbres, de fleurs et d'animaux rares. Ce sont les terres de mes grands-parents. Rien à faire, ils veulent détruire encore et encore », souffle Michel Bégin-Lamy, militant du collectif.

Alors, les militants s'organisent. Le 16 juin dernier, après le camp climat organisé au boisé Steinberg, Les Soulèvements du fleuve sont entrés par effraction sur le terrain de la plateforme Ray-Mont Logistics pour « désarmer » le lieu. Ils ont, entre autres, couvert des engins de peinture, crevé des pneus et ouvert des conteneurs à la meuleuse.
À travers Les Soulèvements du fleuve, ces militants masqués veulent ouvrir la porte à une radicalité plus assumée. « L'action directe, pourquoi pas, ça permet de rendre les contradictions plus visibles. Mais la lutte ne peut pas être totalitaire, elle ne doit pas oublier le reste », analyse Gilles Dubois. « D'un côté, on organise des manifestations familiales et pacifistes, des barbecues, des ateliers, une foire paysanne, des jeux pour les enfants... Et de l'autre, des personnes masquées construisent un mur de briques sur un boulevard ou taguent des machines. C'est le fun de travailler ensemble », sourit Anaïs Houde.
« Quand j'ai vu ce que Les Soulèvements de la Terre ont fait cet été en bloquant le port de La Rochelle, j'étais vraiment impressionné, dit Joris Maillochon. Les militants sont allés jusqu'au bout de la chaîne pour montrer jusqu'où vont les dangers de l'agro-industrie. C'est cohérent et ça permet de peser dans les médias. On a compris qu'il fallait que l'on sorte de notre quartier pour gagner !

Sur le talus du boisé Steinberg, la présence des militants n'est pas la bienvenue. Une compagnie de sécurité privée surveille l'endroit 7j/7. Ils redescendent. En contrebas, les habitants des résidences voisines ont installé des pancartes sur des grilles : « Le port nous envahit », « Canopée en phase terminale » ou encore « Résister et fleurir ». Si le projet de plateforme logistique voit le jour, des dizaines de rails ferroviaires vont être construits ici. Au-dessus de nos têtes, un échangeur d'autoroute sortira de terre pour « fluidifier » le trafic. Les riverains s'inquiètent de l'augmentation de la circulation qui affecterait grandement la qualité de l'air.
Dans le bas Saint-Laurent, des militants s'opposent au prolongement de l'autoroute 20 entre Rimouski et Trois-Pistoles, un projet directement lié à l'explosion de l'activité économique en bord de fleuve. « C'est une question de santé mentale, explique Sébastien Rioux, du collectif Non à la 20. L'autoroute va passer juste à côté du village, là où les gens se baignent tous les jours. Ils se vantent de vouloir construire le plus haut pont du Québec. Quelle fierté, waouh ! »
Le silence complice du gouvernement
« À chaque fois, ce sont les pouvoirs publics qui construisent avec notre argent des infrastructures qui servent uniquement aux intérêts des grandes compagnies privées », se désole Joris Maillochon.
Pour l'agrandissement du port de Contrecœur, les gouvernements du Canada et du Québec vont, par exemple, investir plus de 1,4 milliard de dollars dans le cadre du plan de stratégie maritime « Avantage Saint-Laurent ». « On investit des milliards pour seulement créer un millier d'emplois, ce n'est rien du tout », argue Gilles Dubois.

Au boisé Steinberg, ancienne friche industrielle, le ministère de l'Environnement a même soutenu que raser la forêt et mettre de l'asphalte était la meilleure solution pour sauvegarder la faune et la flore. « Évidemment, quand il n'y a plus de nature, tout est protégé », ironise Anaïs Houde. Contacté, le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec n'a toujours pas répondu à notre demande d'interview.
Ces projets de bétonisation des berges du fleuve datent tous de plusieurs décennies. « On croirait que nos politiques sont encore dans les années 1950, où l'on pensait que la croissance économique allait sortir les gens de la pauvreté. Avec les enjeux écologiques actuels, cette logique-là ne tient plus la route », poursuit Gilles Dubois. « On veut réussir ici ce qui se passe en France, bien que la situation soit différente du point de vue colonial et historique, conclut Joris Maillochon. Créer des cortèges comprenant un large spectre qui va des élus et familles aux groupes anarchistes autonomes. C'est vraiment inspirant. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De Fitzgibbon à Fréchette : l’objectif de privatisation de l’électricité reste le même

À l'aube de l'étude du fumeux PL 69 sur la dépossession de notre bien commun qu'est l'électricité, nous venons de vivre un réel séisme politique et ce n'est pas un hasard. Pierre Fitzgibbon, le père du projet de loi controversé, s'est fait montrer la porte qu'il avait lui-même entrouverte. Pour réussir à faire passer la couleuvre qu'est PL 69, le miel est de mise. La stratégie bulldozer du ministre aux propos provocateurs qui a permis à la CAQ d'opérer un siphonnage sans précédent de milliards et milliards de $ d'argent public vers des affairistes aux projets douteux a atteint ses limites.
Il a même réussi à avoir la réputation de ne pas avoir la « langue de bois », tant il s'amusait à mêler des vérités de la palisse et des faussetés. Un savant mélange qui ne faisait que détourner l'attention du public des véritables enjeux de privatisation du bien commun qui se jouent en coulisse.
Le choix de Christine Fréchette comme ministre remplaçante qui est aux antipodes de son prédécesseur démontre l'habileté des apparatchiks caquistes. Décrite comme studieuse et efficace, elle évite habilement de contredire le premier ministre. Elle a un ton plus posé et une attitude moins arrogante. Toutefois, cela ne devrait pas nous faire oublier que le changement de joueur vise principalement à faire baisser la pression de la mobilisation contre le PL 69 sans en changer les fondamentaux.
L'abandon du Pl 69 serait la meilleure solution
Marwah Rizqy du PLQ, QS ainsi que plusieurs groupes environnementaux, de consommateurs et syndicaux ont raison de demandé l'abandon pur et simple du pl 69 et la mise en place d'une vaste consultation publique sur l'énergie. Le PL 69 n'est tout simplement pas réformable. Malheureusement, la CAQ en choisissant de changer de porte-parole à la veille du début des audiences ne permet pas au mouvement de prendre l'ampleur nécessaire.
La seule alternative : filibuster le PL 69
Comme la CAQ est majoritaire, la seule chose que les oppositions contrôlent c'est le temps. Elles peuvent proposer amendement après amendement et utiliser tout le temps permis par député et ainsi aaaaallllllonger l'étude du projet de loi à ne plus finir. Il n'y a que le bâillon qui permettrait à la CAQ de couper court et de voter le PL 69. Or, cette procédure exceptionnelle ne peut être utilisée qu'une seule fois par session. C'est pourquoi il faudrait filibuster également un 2e projet de loi encore plus cher aux yeux de la CAQ, afin que le bâillon soit utilisé sur ce 2e projet de loi.
Comme ma demande de participer aux consultations du PL 69 a été refusée, j'offre mon aide à un ou des partis d'opposition qui voudrait filibuster le PL 69. J'ai acquis à l'Assemblée nationale une assez bonne expérience en ce domaine.
Martine Ouellet, ing., MBA
Cheffe de Climat Québec
Ancienne ministre des Ressources naturelles
SOURCES :
climat.quebec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - Harris, en quête d’une majorité, passe à droite

La vice-présidente Kamala Harris, qui est désormais la candidate démocrate d'un parti enthousiaste, a connu un succès initial phénoménal.
Hebdo L'Anticapitaliste - 719 (05/09/2024)
Par Dan La Botz
Depuis son entrée en lice le 21 juillet, elle et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont levé 540 millions de dollars, organisé des appels Zoom impliquant des centaines de milliers de partisanEs et tenu des rassemblements de milliers de personnes. Les NoirEs, les Latinos, les femmes et les jeunes électeurEs sont à l'origine de sa montée en puissance. Son parti la soutenant fermement, elle s'est tournée vers la droite pour tenter de rallier les indépendants et peut-être même certains républicains.
Du centre à la droite
En tant que candidate à la présidence lors des primaires démocrates de 2020, Kamala Harris s'est d'abord présentée comme une progressiste. Mais lorsqu'elle a été critiquée, elle s'est rapprochée du centre libéral, puis a perdu des soutiens en raison de ses hésitations, et a finalement abandonné avant les élections primaires. Cette fois-ci, elle n'a pas l'intention de commettre une telle erreur. Elle est au centre et apprend à droite.
Dans son discours d'acceptation à la Convention nationale du parti démocrate (DNC), elle s'est montrée ardemment patriotique. L'Amérique, a-t-elle déclaré, « est la plus grande nation du monde » et « la plus grande démocratie de l'histoire du monde ». Elle a promis qu'« en tant que commandante en chef, je veillerai à ce que l'Amérique dispose toujours de la force de frappe la plus puissante et la plus meurtrière au monde. » Et elle a ajouté : « Je veillerai à ce que ce soit l'Amérique, et non la Chine, qui remporte la compétition du 21e siècle. Et que nous renforcions – et non abdiquions – notre leadership mondial ». Les organisateurs de la Convention ont veillé à ce que la salle soit remplie de milliers de drapeaux américains et à ce que les déléguéEs scandent « USA », deux caractéristiques généralement associées aux républicains.
Renoncements sociaux et écologiques
Kamala Harris a modéré ses positions antérieures sur plusieurs autres questions. Autrefois opposée à l'assurance maladie privée et partisane d'une assurance publique universelle, elle a abandonné cette position en 2020. Autrefois opposée à la fracturation hydraulique, elle l'accepte aujourd'hui car s'y opposer pourrait lui coûter l'État clé de Pennsylvanie, où cette activité est un élément important de l'économie et un pourvoyeur d'emplois. Elle a également soutenu la position selon laquelle toutes les voitures devraient avoir zéro émission d'ici à 2040, mais elle ne soutient plus l'idée d'une subvention pour les véhicules électriques. De même, après l'affaire Black Lives Matter, elle était favorable à la réduction des budgets de la police et à l'augmentation des fonds alloués aux services sociaux. Elle n'est plus favorable à la réduction des budgets de la police. Elle s'est d'abord opposée au mur frontalier de l'ancien président Donald Trump, puis, lorsque le président Joe Biden a accepté l'idée, elle a fait de même. Elle déclare aujourd'hui que si le projet de loi bipartisan prévoyant un mur frontalier est adopté par le Congrès, elle le signera. En 2020, elle a soutenu un programme de rachat obligatoire des armes d'assaut de type militaire (Lillis et Schnell, « 5 issues », The Hill, 29/08/24)
La question de la Palestine
À propos du Moyen-Orient, elle adhère au soutien de Biden à Israël tout en soutenant nominalement un cessez-le-feu. Elle a déclaré dans son discours d'acceptation : « Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité. À la Sécurité. À la liberté. Et à l'autodétermination ». Des mots nobles. Mais ils ne sont accompagnés d'aucune proposition concrète susceptible d'aboutir à un tel résultat, comme la réduction de l'aide militaire à Israël.
L'approche de Harris semble fonctionner. Le dernier sondage réalisé par USA Today et Suffolk University montre qu'elle devance Trump de 48 % à 43 %, et qu'elle a mis en balance quatre États qui penchaient auparavant en faveur de Trump : l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord. Tous ces États sont déterminants pour l'élection. Harris et Trump débattront le 10 septembre.
Avant l'entrée en lice de Harris, des centaines de milliers d'électeurEs du Parti démocrate opposéEs à la politique des États-Unis à l'égard de la Palestine ont voté sans s'engager lors des élections primaires. La question de savoir comment ils voteront lors de l'élection du mardi 5 novembre reste ouverte. Malgré toutes les positions problématiques de Harris, elle reste le seul moyen de vaincre Trump.
Dan La Botz, traduit par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Olympiques du climat

Alors que Paris a célébré les Jeux olympiques et paralympiques pendant quelques semaines, les Olympiques du climat, eux, se déroulent chaque jour partout dans le monde et se poursuivront pendant les années à venir.
Jacques Benoit,
Co-initiateur de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique - DUC
Co-rédacteur duPlan de la DUC
Membre de GMob.
Et le Canada y bat un à un ses propres records. Parmi les “médailles d'or” climatiques canadiennes 2024, on retrouve :
• le plus grand incendie de forêt en 100 ans dans le parc national de Jasper,qui a rasé 30 % de la ville touristique du même nom ;
• des grêlons de la taille d'un œuf de poule qui ont endommagé biens privés et publics, dont une partie de l'aéroport international de Calgary ;
• des pluies diluviennes qui se sont abattues au Québec battant tous les records existants, 194 municipalités touchées par les inondations,70 000 réclamations comptabilisées au 22 août, des factures de plusieurs millions de dollars pour les assureurs qui entraîneront des hausses de primes et de franchises, 170 routes endommagées, l'autoroute 13 fermée, plusieurs municipalités sans eau courante, l'état d'urgence déclarée en plusieurs endroits, sans compter les effets sous-estimés sur la santé mentale des sinistré.e.s.
À quand la prochaine fois ? À quelle fréquence ? Quelle durée ? Et sous quelle forme : canicule ? Sécheresse ? Inondation ? Tornade ? Même pandémie ?… Impossible de le prédire, mais ça se reproduira, n'en doutons pas.
Ces extrêmes découlent du réchauffement climatique causé par nos émissions de gaz à effet de serre (GES), qu'on ne cesse d'accroître. L'Accord de Paris pour contrer les changements climatiques signé il y a dix ans visait à ce que l'augmentation de la température planétaire ne dépasse pas 2 °C d'ici 2100, bien en dessous de 1,5 °C. Conséquemment, il fallait réduire fortement et rapidement nos émissions de GES. Cette infographie de 2019 du Programme des Nations Unies pour l'Environnement montrait bien que plus on perd de temps, plus les efforts à fournir seraient élevés.
Mais nos gouvernements ont préféré répéter que nous devions nous adapter. Or, vouloir s'adapter sans s'attaquer aux causes est un cul-de-sac. Avant le 9 août, il y a eu Baie-Saint-Paul en 2023, les inondations de 2019, de2017, etc.
Oubliez 2100 : nous nous dirigeons plutôt vers une augmentation de 1,5 °C aussitôt qu'en 2025, pouvant atteindre 2 °C avant 2040, comme nous en ont alerté des scientifiques australiens en 2020 !
Nos gouvernements de tous les paliers doivent prendre leurs responsabilités et agir pour que l'addition de tous les gestes individuels de leurs citoyen.ne.s ne soit pas annulée par des actions irréfléchies, le plus souvent celles des acteurs économiques.
Le gouvernement Trudeau a fait beaucoup de déclarations climatiques ici et à l'international, mais la réalité est que sous son règne, parmi les pays du G20, le Canada arrive au deuxième rang de ceux qui financent le plus les projets de combustibles fossilesavec des fonds publics.
Ayons cela en tête en repensant à sa visite à la mairesse de Longueuil le 22 février 2023.
Couvrant l'événement, LeCourrier du Sud écrivait que le premier ministre se considérait « aligné [avec la mairesse] sur plusieurs dossiers, comme ceux de la lutte aux changements climatiques… »
Sa visite avait débuté par l'atterrissage de son avion à l'Aéroport de Saint-Hubert moins d'une semaine avant une conférence de presse où la mairesse trônait fièrement pour annoncer le développement de ce même aéroport.
Sachant que l'aviation commerciale est responsable de 3 % à 6 % du réchauffementclimatique mondial, on comprend mieux en quoi le premier ministre et la mairesse s'entendaient si bien sur la lutte aux changements climatiques. Malgré leurs vertes déclarations, leur message était « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! »
Parce qu'en soutenant un développement de l'aéroport qui fera passer de 11 000 à 4 millions le nombre de passagers par année, qui se traduira par plus d'une centaine de vols par jour, 6 à 8 vols par heure, la mairesse soutient une hausse importante de la pollution atmosphérique affectant sa population et une augmentation des émissions de GES qui fera disparaître tout effet positif de son plan climatique à venir, pour lequel elle a reçu 3,1 M$ de Québec, le montant le plus élevé du programme "Accélérerla transition climatique locale".
Si dans les 30 dernières années, la consommation de kérosène des avions a diminué de 70 %, le trafic, lui, a été multiplié par 13 et devrait tripler d'ici 2050, selon Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile et… directeur scientifique de l'aéroport Saint-Hubert !
L'avion électrique, qui fait étinceler les yeux de la mairesse quand elle parle de sa Zone d'innovation aéroportuaire, c'est comme la capture du carbone pour le gouvernement Trudeau : ça paraît bien sur papier et dans des déclarations, mais c'est un gouffre à argent public et c'est totalement insuffisant pour le défi climatique auquel nous faisons face. Au mieux, ça prendra des décennies à se réaliser, des décennies que nous n'avons pas dans la lutte aux changements climatiques.
Ça suffit !
La mairesse devrait se souvenir à quoi devait servir la chaise des générations qu'elle avait commandée à Mères au front Rive-Sud et fait placer dans la salle du Conseil municipal : à rappeler aux dirigeant.e.s que le futur des enfants se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui.
Alors s'il vous plaît, monsieur Trudeau, madame la mairesse : exit discours, excuses, projets inutiles et nuisibles.
Place à l'action conséquente pour que nos enfants aient un futur possible.
4 septembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Grande transition 2025 : Raviver les solidarités post-capitalistes

Le Collectif La Grande transition appelle toutes les personnes souhaitant construire un avenir plus juste à proposer des activités pour la cinquième édition de sa conférence internationale. Celle-ci vise à réfléchir ensemble aux manières de renforcer les gauches, les mouvements sociaux et les groupes militants, tant dans leurs pratiques que dans leurs analyses théoriques. Cette année, La Grande transition s'inscrit dans le cadre du premier Forum social mondial des intersections, qui invite au décloisonnement des luttes, aux rencontres, aux alliances, aux fronts communs élargis.
Tiré d'Alter-Québec.
Le monde brûle. Les feux de forêt, les sécheresses et les inondations se multiplient à travers le monde. L'État israélien massacre la population palestinienne avec la complicité des puissances occidentales, mettant à risque la région. Les inégalités augmentent un peu partout sur la planète. Des gens sont évincés de leur logement et d'autres peinent à payer leur loyer tandis que les propriétaires s'enrichissent. L'épicerie coûte de plus en plus cher alors que les grands commerces d'alimentation réalisent des profits records. Des migrant·e·s se noient en traversant le Rio Grande et la Méditerranée pendant que leurs confrères et leurs consœurs sont exploité·e·s et sous-payé·e·s dans les champs, les entrepôts et les hôpitaux du Nord global.
Il est de plus en plus urgent de mettre en œuvre des solutions de gauche radicale : socialiser les moyens de production ; créer des coopératives de travail et de consommation ; verdir et désasphalter nos milieux de vie ; développer des logements hors marché ; décentraliser le pouvoir ; partager collectivement le travail de soins ; démilitariser nos sociétés. Ces mesures apparaissent comme le minimum nécessaire pour créer les conditions d'une vie décente pour toutes et tous. Il semble évident que le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme doivent être démantelés.
Pourtant, la droite autoritaire et l'extrême droite montent en puissance. Elles ont pris le pouvoir dans plusieurs pays ; elles sont aux portes du pouvoir dans plusieurs autres. Comme elles l'ont toujours fait, elles détournent l'attention des vrais problèmes en s'attaquant à des boucs émissaires comme les personnes racisées ou les personnes LGBTQ+. Même si elles poursuivent des politiques favorables au grand capital, elles se donnent parfois une image « sociale » ou se drapent dans un discours soi-disant anti-élite. Force est d'admettre qu'elles réussissent à convaincre une partie des classes populaires.
La gauche a connu récemment certains succès électoraux et certaines mobilisations importantes, mais ses propositions les plus fortes peinent à s'imposer. Souvent, les mouvements politiques de gauche se cantonnent à la protection des acquis sociaux. Comment reprendre l'offensive ? Comment contrer à la fois le discours néolibéral et celui de l'extrême-droite ? Comment changer le rapport de forces pour que les idées et les pratiques de gauche s'implantent durablement ?
La pandémie a brisé une vague de contestation qui semblait prendre de l'ampleur ; du Chili à Hong Kong, en passant par le Liban et le Soudan, des soulèvements populaires ébranlaient le pouvoir, et les manifestations climatiques rassemblaient de plus en plus de gens. Pour cette cinquième édition de la Grande transition, nous souhaitons retrouver cet élan et renouer avec l'énergie créatrice des mobilisations d'envergure.
Nous voulons aussi trouver des manières pour la gauche de rejoindre nos voisin·e·s, nos collègues et nos concitoyen·ne·s, de s'ancrer dans nos milieux de vie, de développer des liens de confiance avec ceux et celles qui nous entourent, de créer des communautés. Ces alliances seront nécessaires pour lutter contre l'exploitation et l'expropriation de masse, protéger nos espaces naturels et construire ensemble des quartiers et des villages vivants et habitables.
Raviver les solidarités post-capitalistes, c'est aussi reconnaître la richesse des expériences qui préfigurent le monde à bâtir. Il s'agit de s'inspirer par exemple des pratiques autochtones de protection du territoire, des communautés qui ont su mettre en œuvre une réelle autogestion ou encore des services publics démocratiques qui accroissent notre liberté et notre autonomie.
L'heure est venue de dépasser la critique pour s'organiser et aller de l'avant. Nous vous invitons à proposer pour la Grande transition 2025 des ateliers et des communications sur les tactiques, les stratégies, les bilans d'expériences passées et récentes et les modèles alternatifs qui nous aident à avancer vers un monde post-capitaliste.
Pour soumettre une activité cliquez ici
Comment contribuer ?
Nous encourageons les activités qui sortent du format « panel » classique : ateliers pratiques, partages d'expériences, discussions stratégiques, débats, mémoires de luttes, remue-méninges, performances artistiques et culturelles, actions militantes, etc. Les activités donnant la parole à plusieurs participant·e·s seront favorisées, mais les propositions individuelles seront aussi considérées. Nous accueillons avec un enthousiasme accru les soumissions provenant de personnes marginalisées et issues de la diversité. Il est possible que les propositions qui ne tiennent pas compte de cet idéal de diversité soient refusées. Notez aussi que nous encourageons les activités qui visent à initier le public à un thème dans une perspective d'éducation populaire. L'évènement sera principalement en français et en anglais. Nous avons hâte de lire vos idées les plus audacieuses !
Qu'est-ce que le Forum social mondial des intersections (FSMI) ?
Cette édition thématique du Forum social mondial promeut une conception de l'intersection en tant que démarche concrète pour favoriser des changements systémiques. Dans un contexte où l'intersectionnalité met en lumière les croisements entre oppressions et privilèges, il s'agit plutôt de créer des opportunités de co-apprentissage qui mènent à l'action, en décloisonnant les différents milieux tels que l'urbain et le rural, l'action environnementale et sociale, les féminismes et l'action climatique, l'académie et l'activisme, etc. Ce concept préconise une approche intergénérationnelle et relie les échelles locales et globales pour la multiplication de transformations profondes et inclusives.
Comme La Grande transition 2025 sera tenue dans le cadre du FSMI, nous vous invitons à soumettre des propositions qui s'inspirent de cette volonté de croiser des expériences et des expertises dans l'espoir de créer des solidarités post-capitalistes sans frontières.
Exemples de thèmes
– Transformation du capitalisme à l'ère des changements climatiques
– Décroissance, transition juste et création de nouveaux communs
– Mouvements de solidarité internationale (Boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État d'Israël (BDS) ; Black Lives Matter ; mouvements anti-paradis fiscaux, Marche mondiale des femmes, etc.)
– Luttes syndicales et luttes pour le droit à la mobilité et à la dignité de travailleurs et travailleuses temporaires, de migrants et migrantes, de sans papiers
– Mouvements pour le droit au logement et pour le droit à la ville, résistance contre des mégaprojets urbains
– Initiatives locales et internationales d'émancipation, d'éducation populaire et de démocratisation
– Luttes contre la hausse du coût de la vie, réponses collectives contre la pauvreté et l'exclusion
– Coopératives d'habitation, squats, occupations et autres solutions contre la crise du logement
– Bilans des campements de solidarité avec la Palestine
– Mouvements pour la démilitarisation et contre la guerre
– Blocages et résistance contre des projets écocidaires et extractivistes
– Relations entre différents mouvements sociaux : créer des alliances, des convergences, élaborer des stratégies communes, mener ensemble des campagnes d'action
– Définancement de la police et opposition à la répression
– Réflexions sur le rapport de la gauche à l'État
– Alternatives féministes, queers, décoloniales, antiracistes et anticapitalistes au système actuel
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les inégalités en éducation persistent

Malgré le mouvement de démocratisation qui a accompagné la mise en place des cégeps, il y a plus de 50 ans, le revenu et le niveau de scolarité des parents influencent encore aujourd'hui l'accès aux études postsecondaires et la réussite des étudiantes et étudiants, révèle la seconde édition du Bulletin de l'égalité des chances en éducation, publié récemment par l'Observatoire québécois des inégalités.
Tiré de Ma CSQ cette semaine. L'auteur et l'autrice sont conseiller.ère.s. à la CSQ.
L'édition 2024 du Bulletin, qui présente une foule d'indicateurs clés de l'égalité des chances de la petite enfance à l'enseignement supérieur, met cette année l'accent sur les études postsecondaires grâce à une analyse thématique et à un sondage Léger sur les cégeps. Les données révèlent que « l'origine sociale affecte encore les trajectoires scolaires » des jeunes.
« C'est avec inquiétude que nous prenons connaissance des conclusions du plus récent Bulletin de l'égalité des chances en éducation. La réussite tout autant que l'accès peuvent et doivent être également accessibles à toutes les personnes étudiant dans nos cégeps », a dit la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Anne Dionne.
C'est d'ailleurs l'une des préoccupations qui est ressortie du Congrès de la CSQ tenu en juin dernier. Non seulement les obstacles à un accès juste et équitable à l'éducation doivent être levés, mais les étudiantes et étudiants doivent avoir des conditions de vie leur permettant d'achever leur parcours d'études.
À ce chapitre, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur (ORES) propose, dans un dossier thématique au sujet de l'accessibilité financière aux études réalisé en 2023, des pistes de solutions qui méritent d'être prises en compte.
Regard sur la petite enfance et le préscolaire
Dans son Bulletin, l'Observatoire québécois des inégalités propose une nouvelle section sur le secteur de la petite enfance et met en lumière des données inédites permettant, notamment, de connaître la répartition des centres de la petite enfance selon l'indice de défavorisation matérielle et sociale des régions administratives.
Le Bulletin révèle que, depuis 2012, une augmentation graduelle de la proportion d'enfants dits vulnérables dans au moins un domaine de leur développement à la maternelle 5 ans est observée.
Remettre l'égalité des chances au cœur des préoccupations
Les constats tirés du Bulletin de l'égalité des chances en éducation rappellent l'importance des politiques éducatives et sociales destinées à contrer les inégalités. Le Bulletin est une source d'informations fiable et sérieuse qui peut assurément nourrir la réflexion collective en éducation dont le Québec a tant besoin.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le transport scolaire au Québec. Portrait d’un service public mis à mal

Au Québec, près de 580 000 élèves du primaire et du secondaire empruntent quotidiennement quelque 11 000 véhicules scolaires pour se déplacer vers leur école [1]. Depuis les dernières années, on observe une augmentation des bris de service de transport scolaire, d'ailleurs rapportés périodiquement par des articles de presse [2]. La présente étude brosse un portrait de ce service public de transport en commun, justifié par ses récents bouleversements et le peu de documentation à jour pour comprendre les enjeux contemporains entourant le transport scolaire au Québec.
4 septembre 2024 | tiré du site de l'IRIS
https://iris-recherche.qc.ca/publications/transport-scolaire/
Pour lire l'ensemble de la recherche, cliquez sur l'icône :
Faits saillants
Les bris de service en transport scolaire au Québec ont été en moyenne de 200 par jour lors de l'année scolaire 2022-2023 et de 137 par jour en 2023-2024, soit une moyenne respective de 8 000 et 5 500 élèves sans service. Ces nombres contrastent avec les années précédentes, où les bris de service étaient exceptionnels. La pénurie de personnel et les conflits de travail sont les deux facteurs premiers de ces bris de service.
Les données du ministère des Finances du Québec démontrent que le taux de bénéfice moyen avant impôt des entreprises de transport scolaire a été de 13,5 % entre 2012 et 2019. Durant la même période, le taux de bénéfice moyen avant impôt des entreprises non financières au Canada a été de 6,5 %. Transport scolaire Sogesco, qui contrôle environ 12 % du marché québécois, affiche un taux de rendement moyen avant impôt de 15,5 % entre 2014 et 2023.
En 2011, un rapport du Vérificateur général du Québec estimait que 10 entreprises contrôlaient 35 % de l'industrie du transport scolaire au Québec, ce qui posait un risque financier important pour les finances publiques, d'autant plus que la quasi-totalité des contrats de service est toujours conclue de gré à gré. Les 10 premières entreprises de transport scolaire contrôle désormais environ 40 % du marché.
Certains projets pilotes de transport scolaire menés par les organismes scolaires eux-mêmes ont permis de diminuer les bris de service causés par un manque de personnel entre les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ; jusqu'à 95 % dans le cas du centre de services scolaire des Affluents, dans Lanaudière.
Le recours systématique à la sous-traitance privée est l'exception plutôt que la règle au Canada. La flotte de véhicules scolaires de plusieurs provinces canadiennes est en tout ou en partie publique. Afin de faire contrepoids à la concentration de l'industrie et de lutter durablement contre la pénurie de main-d'œuvre, l'État québécois devrait augmenter la proportion publique des véhicules scolaires, qui est à l'heure actuelle de moins de 1 %.
3. Conclusion et recommandations
Environ 40 % du marché du transport scolaire est contrôlé par 10 entreprises. Faute de mesures politiques conséquentes pour faire suite au rapport du VG en 2011, qui indiquait clairement une tendance à la concentration de l'industrie, la situation s'est aggravée depuis. Les données présentées dans cette étude démontrent une prise de bénéfice importante de la part du secteur privé.
Comparativement au rendement raisonnable moyen de 8 % avancé par la firme comptable Deloitte pour ce secteur économique, certaines entreprises obtiennent un taux de rendement moyen doublement supérieur. Afin de contrer cette dynamique et de freiner l'oligopolisation de l'industrie du transport scolaire, des efforts de décentralisation doivent être accomplis. À cet égard, et à partir des modèles pratiqués dans d'autres provinces canadiennes et par certains organismes scolaires du Québec, l'État doit faire contrepoids au secteur privé en augmentant la proportion de véhicules scolaires détenus par le public.
Dans un contexte de ruptures de service de transport scolaire, il importe de réitérer les mérites de ce service public. En plus de ses bienfaits écologiques, par sa qualité de transport collectif, le transport scolaire est un mode 72 fois plus sécuritaire que le transport à l'école par automobile62. Sa gratuité est également un atout pour la fréquentation scolaire et l'inclusion sociale, particulièrement pour les ménages moins nantis qui peuvent ne pas avoir accès à d'autres modes de transport alternatif pour assurer les déplacements scolaires des enfants et adolescent·e·s. Une étude en ce sens aux États-Unis a révélé la prévalence des familles à faible revenu dans le recours au service de transport scolaire, ce qui, à notre connaissance, n'a pas été accompli à ce jour au Canada63.
Les analyses présentées dans ce document ont abordé divers aspects du transport scolaire au Québec et permettent de dresser les constats suivants :
- Les interruptions de service, à raison de plus ou moins 170 par jour scolaire dans les deux dernières années, sont principalement attribuables à des questions de main-d'œuvre.
- Il n'existe pas de procédure et de norme communes de compilation des bris de service à l'échelle du Québec.
- Le nombre de détenteurs et détentrices de certificat de compétence de transport scolaire semble engagé dans une tendance baissière. La proprotion des conducteurs et conductrices âgé·e·s de 55 ans et plus atteint désormais près de 70 %.
- À ce jour, l'approche des primes salariales a constitué la principale réponse des pouvoirs publics à l'égard des bris de service systémiques.
- Les entreprises de transport scolaire affirment qu'elles ne disposent pas de marge de manœuvre financière et réclament du financement public supplémentaire. Pourtant :
- Le ratio entre les bénéfices nets avant impôts et les revenus bruts des entreprises privées de transport scolaire ont avoisiné 13,5 % durant la période de 2012 à 2019, soit un taux supérieur à la norme proposée par une étude de la firme comptable Deloitte en 2008.
- Durant la période de 2019 à 2023, le taux moyen des bénéfices nets avant impôt sur les revenus bruts a été de 16,86 % pour l'entreprise Transport scolaire Sogesco, le plus important transporteur du Québec.
- Les avertissements du VG émis en 2011 à propos des risques posés par la concentration du marché du transport scolaire au Québec sont demeurés lettre morte. Selon nos estimations, les 10 entreprises de transport scolaire les plus importantes contrôlent désormais environ 40 % du marché, comparativement à 35 % en 2011. Les acquisitions récentes d'entreprises de transport scolaire par de grands groupes indiquent qu'en l'absence d'intervention politico-économique, l'oligopolisation de l'industrie du transport scolaire se poursuivra dans les années à venir et représentera un risque accru lors du renouvellement des règles budgétaires du transport scolaire en 2027-2028.
- Le rehaussement sans condition du financement public du transport scolaire ainsi que le programme de primes salariales comportent le risque de subventionner les profits du secteur privé, de plus en plus composé de fonds d'investissements privés étrangers.
- Au Canada, le modèle économique et politique du transport scolaire est majoritairement public, et la sous-traitance systématique est, au vu des informations disponibles, le fait des seules provinces de Québec et de l'Ontario.
- Le gouvernement du Québec a entrepris, de concert avec certains CSS, et malgré l'opposition des transporteurs privés, des projets pilotes de transport scolaire en régie. Cette initiative a eu des effets positifs marqués : les bris de service du CSS des Affluents, dans Lanaudière, ont diminué de 95 % entre les années 2022-2023 et 2023-2024, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'environ 6 500 bris à 324 pour l'année 2023-2024, en date du 21 mai.
Les réponses politiques aux constats ci-dessus sont complexifiées par le caractère de sous-traitance du transport scolaire, où les actifs de ce service public n'appartiennent pas à l'État. Une partie des problèmes constatés découlent d'ailleurs de cet aspect. Dans une perspective de résilience du réseau et de rééquilibrage des rapports de force entre une industrie de plus en plus concentrée et un État et des organismes scolaires dépendants de ceux-ci pour la prestation du service, la constitution progressive d'une flotte publique partielle ou totale représente une avenue de réforme porteuse, à l'instar d'autres provinces canadiennes. Voici la synthèse des recommandations évoquées dans les chapitres d'analyse de cette étude :
- Établir une compilation détaillée des bris de service de transport scolaire à l'échelle du Québec, dans une perspective de meilleure compréhension et d'amélioration de ce service public.
- Introduire une rémunération minimale des conducteurs et conductrices dans le cadre de l'élaboration quinquennale des règles budgétaires du transport scolaire, de manière à assurer des conditions de travail attractives et éviter le risque de subventionner un taux de surprofit privé en rehaussant sans condition le financement du transport scolaire.
- Établir au sein du MEQ une politique de compilation d'informations relatives aux entreprises privées de transport scolaire – nombre, taille, circuits de transport scolaire sous contrat, informations aux états financiers – et rendre disponibles au public les informations pouvant l'être. Cette pratique constituerait une forme renouvelée de publication d'« indicateurs de gestion » produits jusqu'en 2012-2013 par le MEQ.
- Étudier davantage les barrières à la concurrence et les causes de la prévalence des ententes de gré à gré entre les organismes scolaires et les transporteurs privés, afin d'envisager des politiques réglementaires de protection de la concurrence telles que celles entourant la disponibilité des cours d'entreposage de véhicules scolaires à proximité des organismes scolaires.
- Profiter du renouvellement en cours du parc de véhicules scolaires dans le cadre de la politique d'électrification du secteur pour favoriser la détention publique des véhicules et le transport en régie. Cette approche est de nature à diminuer les risques économiques posés par la concentration progressive de l'industrie du transport scolaire, en plus de prévoir des conditions de travail accrues.
- Faire l'acquisition publique d'entreprises de transport scolaire privées, surtout celles susceptibles d'être vendues à de grands groupes ; intégrer leurs actifs dans les organismes scolaires à proximité par le biais du transport en régie. Cette démarche peut contribuer à rééquilibrer le rapport de force entre l'industrie du transport scolaire et l'État pour les questions entourant la concentration croissante du marché.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Compilation des rapports financiers (TRAFICS) respectifs des 72 organismes scolaires du Québec pour l'année 2022-2023, tableau « Dépenses du transport quotidien ».
[2] AGENCE QMI, « Environ 1500 circuits d'autobus scolaires annulés depuis le début de l'année scolaire », Le Journal de Montréal, 7 octobre 2021, www.journaldemontreal.com/2021/10/07/environ-1500-circuits-dautobus-scolaires-annules-depuis-le-debut-de-lannee-scolaire-1.

Pour que l’humain demeure au cœur des services publics !

Le Québec doit conserver des services publics en personne et maintenir des alternatives au numérique. Il doit garantir l'accès à des services de qualité pour tous et toutes en simplifiant ses écrits, son langage et ses procédures et en humanisant ses services. Il faut également trouver des solutions pour remédier aux fractures numériques, notamment en offrant l'accès à Internet et aux outils numériques à faible coût.
On dit que le numérique ça facilite notre vie. Ce n'est pas vrai.
Personne participante de la Marée des Mots
Pour inscrire son enfant à la garderie, prendre un rendez-vous médical ou remplir des papiers administratifs, ça se passe de plus en plus en ligne. Quand tout fonctionne bien, c'est un gain de temps et d'énergie pour la plupart d'entre nous. Mais quand ça bogue, on est vite démunis derrière notre écran.
Pour les personnes qui rencontrent des difficultés avec les ordinateurs et Internet, tout devient encore plus complexe. Pour elles, le numérique, c'est un mur. Un mur infranchissable. Un mur qui exclut.
Et on ne parle pas d'une poignée de personnes. Les gens qui ont des difficultés avec le numérique sont plus nombreux qu'on ne le pense ! Il y a des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, des personnes immigrées, autochtones, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et même des jeunes !
Ça s'en vient compliqué la vie…
Personne participante de CLEF Mitis-Neigette
Depuis quelques années, le Québec accélère le virage numérique des services publics. D'ici 2025, il compte implanter l'Identité numérique, qui deviendra alors le premier point d'accès pour les services gouvernementaux1. Pourtant, plusieurs drapeaux rouges devraient alerter le gouvernement sur la faisabilité de ce projet. Par exemple, en 2022, il a dû reculer sur le déplacement en ligne du carnet de réclamation des personnes bénéficiaires de l'aide sociale, à la suite de la forte mobilisation des groupes qui les soutiennent2. On se souvient aussi du lancement chaotique de la SAAQclic au printemps 2023, qui a révélé les ratés d'une transition numérique faite à la va-vite, sans prendre en compte la réalité de la population3.
Le virage numérique restreint les droits de nombreuses personnes, notamment leur droit d'être informés et d'avoir accès aux services publics.
Avec la fermeture des guichets, le renvoi vers des boites vocales ou des formulaires en ligne, elles ont plus de difficultés à obtenir du soutien en personne ou au téléphone. Elles risquent de ne pas demander les services et aides auxquels elles ont droit par manque d'information, par incompréhension de l'information, mais aussi et surtout, parce qu'elles ont trop de difficultés à faire leurs démarches en ligne4. Ceci a de graves conséquences sur leurs revenus, leur état de santé et leur qualité de vie, qui dépendent justement des services et aides du gouvernement !
Je me sens mise à part dans la société.
Personne participante de la Maison populaire d'Argenteuil
On ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique en laissant de côté les personnes qui en sont exclues !
Le Québec doit conserver des services publics en personne et maintenir des alternatives au numérique. Il doit garantir l'accès à des services de qualité pour tous et toutes en simplifiant ses écrits, son langage et ses procédures et en humanisant ses services. Il faut également trouver des solutions pour remédier aux fractures numériques, notamment en offrant l'accès à Internet et aux outils numériques à faible coût.
Ensemble, traversons l'écran pour que l'humain demeure au cœur des services publics !
Pour appuyer nos demandes et signer notre déclaration, rendez-vous sur : https://rgpaq.qc.ca/traversons#déclaration
Signataires
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Fédération des mouvements personne d'abord du Québec
Front commun des personnes assistées sociales du Québec
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
Notes
1. https://www.lapresse.ca/contexte/2022-11-20/identite-numerique/une-solution-mille-interrogations.php
2.https://www.lesoleil.com/2022/11/27/dematerialisation-des-services-dassistance-sociale-des-effets-prejudiciables-0db6932fbff4a11d67a5496391198909/?fbclid=IwAR3NZym3kfyuuUHMUN8notWM1aCsdGfzkzGKgAtRVxiQHHi0bMp3tpbqD1c
3.https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1975312/saaq-automobiliste-delai-retard-portail-numerique
4.ACORN Canada, Barriers to digital equity in Canada, 2019, p.10. URL : https://acorncanada.org/resources/barriers-digital-equality-canada/.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une capsule vidéo contre une idée fausse sur la pauvreté

Dans le cadre de sa vaste campagne pour combattre les idées fausses sur la pauvreté, le Mouvement ATD Quart Monde lance aujourd'hui la troisième capsules vidéo.
Trop d'idées fausses sur la pauvreté influencent négativement les personnes en position de pouvoir, celles qui conçoivent les programmes et mettent en place des services de lutte à la pauvreté. Cela fait en sorte que trop souvent ces actions ratent leur cible. Déjà les personnes manquent de revenu, mais elles souffrent en plus du jugement social qu'imposent ces idées fausses.
On n'a pas les moyens d'en finir avec la pauvreté - FAUX !
Si nous croyons que les pauvres ne veulent pas travailler et qu'on vit bien sur le BS, il est certain que nous aurons l'illusion que lutter contre la pauvreté coûte cher. Ces idées fausses influencent donc les décisions de la société. Pourtant, ce qui coûte cher c'est de ne pas agir contre la pauvreté : un lit dans un refuge pour sans-abri coûte 1932$ par mois, un séjour en prison coûte 4333$ par mois et un lit à l'hôpital coûte 10900$ par mois. Au Québec, les coûts indirects de la pauvreté sont estimés à 17 milliards de dollars. Or, une étude très récente a évalué qu'avec 3 milliards de dollars, le Gouvernement du Québec pourrait permettre à tous et toutes de combler ses besoins de base.
Par conséquent, hausser les revenus des plus pauvres profiterait à tous et toutes, car ces revenus se retrouvent dans l'économie locale, sans compter la réduction de dépenses en soins de santé et en frais juridiques. D'ailleurs, sur une période de dix ans, le nombre de familles ayant recours à l'aide sociale a diminué de 46% parce que le Gouvernement du Québec avait augmenté l'aide financière aux familles.
Le Fonds monétaire international (FMI) affirme que quand les plus riches d'un pays s'enrichissent, la richesse globale du pays diminue. Au contraire, lorsque les plus pauvres s'enrichissent, la richesse augmente, et tout le monde en profite.
Ces données nous amènent à changer notre regard sur la pauvreté et nos stratégies pour l'éliminer tout en respectant la dignité de ceux et celles qui la vivent.
En finir avec la pauvreté, c'est d'abord en finir avec les idées fausses
[Regardez la capsule vidéo](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1557&qid=80812)
https://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/FAUX-EnFinirAvecPauvrete_RectoVerso.png
Consultez la fiche
La fiche contre l'idée fausse "On vit bien sur le BS" est disponible pour diffusion dans vos médias et réseaux sociaux.
Vous pouvez les imprimer librement également pour faire changer les idées sur la pauvreté.
[Aller sur le site Internet](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812)
https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812
Des outils pour un regard juste sur la pauvreté
Ces capsules vidéo sont des outils qui viennent enrichir nos moyens afin de rétablir un regard juste sur les personnes qui vivent la pauvreté. [Les fiches cartes-postales sont déjà disponibles sur notre site Internet.](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812) Le manuel d'accompagnement de la campagne sera mis en ligne gratuitement le 10 septembre. Des commandes pour des copies papier de ces outils sont également possibles.
[Visiter le site de la campagne](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enquête. Les forêts anciennes du Canada mises à mal par des coupes à blanc certifiées durables

Une enquête révèle qu'au Canada des entreprises forestières certifiées par des organismes environnementaux comme ayant des produits fabriqués de manière responsable exploitent des forêts anciennes, essentielles pour contenir le réchauffement climatique. Ces forêts ont connu en vingt ans un déclin parmi les plus importants au monde.
Tiré de Courrier international.
S'étendant sur 347 millions d'hectares, les forêts du Canada représentent 9 % de la superficie forestière du monde, faisant du pays le troisième plus boisé de la planète. Le Conseil canadien des ministres des forêts, qui présente ces chiffres, ajoute que “les forêts et autres écosystèmes riches en dioxyde de carbone représentent probablement la solution naturelle la plus connue pour lutter contre les changements climatiques”.
Une enquête de Reuters remet sérieusement en question cette solution. L'agence affirme que les opérations d'exploitation forestière présentées comme “durables” sont des coupes à blanc dans ces forêts. En analysant des données forestières de la province de l'Ontario, Reuters dit avoir constaté qu'environ 30 % des forêts boréales certifiées exploitées entre 2016 et 2020 avaient au moins 100 ans.
- “Cela a entraîné la perte de 960 km² de ces forêts anciennes, soit une superficie de la taille [combinée des villes de] New York et de Washington.”
L'exploitation de ces zones “a eu lieu malgré le fait que 94 % des forêts aménagées de la province sont certifiées par l'un des deux principaux organismes de certification environnementale au Canada”.
La situation n'est guère mieux en Colombie-Britannique, dont “plus de la moitié [des] forêts anciennes [a] disparu au cours des deux dernières décennies”. La chaîne CTV News rapporte qu'un organisme de surveillance des pratiques forestières dans cette province affirme que, en raison de l'absence d'une supervision des coupes, il y a désormais un risque que l'île côtière de Quadra n'ait plus suffisamment de forêts anciennes à l'avenir.
Vive réaction
Interviewé par Reuters, le biologiste Dominick DellaSala du groupe environnemental Wild Heritage est sidéré :
- “Pourquoi diable autorisent-ils l'exploitation forestière certifiée dans des forêts primaires vieilles de plus de cent ans ? Il est ridicule pour le Canada de prétendre qu'il pratique une gestion durable.”
Autre problème de taille : les innombrables routes d'exploitation forestières, minières et pétrolières qui sillonnent le pays – la CBC estime qu'elles couvrent plus de 1,5 million de kilomètres en 2022. Une recherche publiée en juillet par la Fondation David Suzuki, un groupe environnemental, indiquait que leur prolifération “était incompatible avec l'arrêt et l'inversion de la dégradation des forêts et de la perte de biodiversité”.
L'industrie de la certification se défend
Le Conseil international de gestion forestière (FSC) et le programme d'aménagement forestier durable (SFI), impliqués dans la certification des produits forestiers, n'ont pas commenté les résultats de l'enquête de Reuters. La FSC s'est bornée à parler de normes de certification “robustes et crédibles”. Et le SFI a affirmé que sa certification est devenue “une solution hautement fiable” pour répondre à une demande croissante de produits issus de forêts gérées de façon durable.
Ce qui est sûr, regrette l'Encyclopédie canadienne, c'est que les forêts anciennes, autrefois partie intégrante du paysage forestier du Canada, “n'existent désormais que sous forme de petites parcelles fragmentées en raison de l'exploitation forestière intensive […], de la conversion des forêts à l'agriculture, des épidémies d'insectes […], des incendies de forêt et des maladies”.
Martin Gauthier
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La stratégie québécoise en habitation en est une qui oublie les besoins des femmes !

Saint-Lambert, le 9 septembre 2024 - Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est extrêmement déçu par la Stratégie québécoise en habitation présentée en catimini le 22 août dernier par la ministre responsable de l'habitation France-Élaine Duranceau. Attendue depuis plus d'un an, cette stratégie échoue à présenter des mesures qui contribueraient à résoudre de manière systémique cette crise du logement qui touche particulièrement les femmes à travers le Québec.
« Alors que le cabinet de la ministre responsable de l'Habitation promettait, à l'occasion d'une rencontre en octobre dernier, que la nouvelle Stratégie prendrait en considération les besoins spécifiques des femmes, le gouvernement écarte de la main les solutions proposées qui y répondraient réellement », déplore Audrey Gosselin Pellerin, du RTRGFQ.
« L'intégration d'une analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) lui aurait permis d'éviter cet angle mort », ajoute-elle.
En effet, bien que les femmes soient affectées d'une manière disproportionnée par cette crise, comme le démontre son analyse féministe, le RTRGFQ a constaté que le mot « femme » n'apparaît qu'une seule fois dans la Stratégie !
Comme plusieurs organismes de défense du droit au logement, le RTRGFQ dénonce le manque de nouvelles actions structurantes dans cette Stratégie qui présente plutôt un portrait des initiatives passées ou en cours du gouvernement. Ce dernier s'entête à miser sur l'accélération de la construction de nouveaux logements et le marché privé au lieu de mettre en place des mesures qui régleront véritablement cette crise sans précédent, telles qu'investir massivement dans le logement social et instaurer un contrôle des loyers. La création de logements sociaux est essentielle pour répondre aux besoins urgents des femmes locataires étant donné qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, soit 27 %, à consacrer une part démesurée de leur revenu à se loger.
« Si le gouvernement cessait de mettre la faute sur l'immigration et ciblait les réelles causes de la crise du logement, il appliquerait peut-être les bonnes solutions », soulève Audrey Gosselin Pellerin, du RTRGFQ.
Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est un organisme féministe de défense collective des droits travaillant sur les questions touchant les intérêts et les droits des femmes en tenant compte de l'intersection des divers systèmes d'oppression. Il s'agit d'un regroupement provincial composé des Tables régionales de groupes de femmes représentant les 17 régions du Québec. Le RTRGFQ est en action depuis 2001 pour favoriser l'égalité pour toutes les femmes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La réélection de Trump pourrait compromettre l’accès à l’avortement à travers le monde

Les prochaines élections présidentielles américaines seront déterminantes pour l'accès à l'avortement dans les pays à faibles revenus qui reçoivent du financement des États-Unis. En effet, l'élection du Parti républicain pourrait mener à la restitution d'une politique étrangère antiavortement du nom de Protecting Life in Global Health Assistance (PLGHA).
Tiré de The conversation.
Au cours de sa première année de mandat, en 2017, l'ancien président américain Donald Trump a rapidement instauré la PLGHA. Cette politique faisait suite à une longue lignée de politiques similaires surnommées Global Gag rule (règle du bâillon mondial).
La règle du bâillon mondial a eu des impacts majeurs sur la santé des femmes dans plusieurs pays à faibles revenus. Candidate au doctorat en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, j'étudie l'accès à l'avortement en milieu sécuritaire en Afrique Sub-Saharienne, sous la direction du professeur Thomas Druetz. Je propose ici une synthèse des résultats d'études ayant examiné cette politique et une critique des enjeux éthiques qu'elle soulève.
La règle du bâillon mondial
La règle du bâillon mondial a été abrogée par chaque nouveau gouvernement démocrate et réinstaurée par chaque nouveau gouvernement républicain depuis 1984.
Initialement instaurée par le gouvernement Reagan, cette politique obligeait les organisations non gouvernementales (ONG) non américaines à certifier qu'elles ne pratiqueraient pas et ne feraient pas la promotion de l'avortement si elles souhaitaient recevoir un financement du gouvernement américain. En 2017, elle a non seulement été réinstaurée par le gouvernement Trump, mais sa portée a été considérablement élargie. Cette nouvelle version s'intitulait Protecting Life in Global Health Assistance.

Effectivement, dans les versions antérieures de la politique, les restrictions liées à l'avortement n'étaient imposées qu'aux ONGs financées par des fonds d'aide à la planification familiale provenant de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID). À titre d'indication, ce fonds représentait un montant d'environ 600 millions USD, en 2017.
Sous le gouvernement Trump, les restrictions ont été élargies tant et si bien qu'elles s'appliquaient désormais aux ONGs financées par tout fonds d'aide en santé mondiale provenant de tout département ou agence du gouvernement américain. Or, l'enveloppe de ces fonds était près de 15 fois supérieure, et s'élevait en 2017 à un montant total annuel de 8,8 milliards USD. Les ONGs qui souhaitaient pouvoir bénéficier de ces fonds devaient alors se conformer aux restrictions.
Une diminution de l'offre de services d'avortement et de contraception
Dans plusieurs pays à faibles revenus, le secteur non gouvernemental est considérablement impliqué dans la fourniture de services de santé reproductive.
Devant choisir entre la certification de la PLGHA ou le refus de s'y conformer, plusieurs ONGs ont vu leurs activités perturbées. D'un côté, les ONG certifiant la PLGHA ont dû cesser d'offrir des services liés à l'avortement. D'un autre côté, celles refusant de la certifier se sont vu imposer des coupures considérables.
Les services d'avortement et de contraception étant souvent offerts par les mêmes ONGs, les coupures ont également affecté l'offre de contraception. Deux des ONGs les plus importantes dans le domaine de la contraception, International Planned Parenthood Federation et MSI Reproductive Choice ont notamment refusé de certifier la politique.
Des études de l'Université Colombia et de Population Action International (PAI) rapportent une désorganisation et une fragmentation des services de santé sexuelle et reproductive, un blocage des activités de sensibilisation sur le sujet ainsi qu'une perturbation des programmes de formation des prestataires de santé sur l'avortement sécuritaire.
Une étude de l'institut Guttmatcher a noté une réduction de l'offre de services de contraception, ainsi qu'une augmentation de 6,1 % des ruptures de stock de contraceptifs sous la PLGHA en Éthiopie.
Une augmentation du recours aux avortements non sécuritaires
Ces réductions dans l'offre de services d'avortement et de contraception par les ONGs affectées n'ont pas été sans conséquences sur la santé des femmes. Plutôt que de réduire le recours à l'avortement, tel qu'anticipé par ses créateurs républicains, la règle du bâillon mondial a plutôt eu l'effet inverse.
Une étude de l'Université Stanford démontre que sous l'administration Bush (2001 à 2008), le recours à l'avortement dans les pays bénéficiaires de fonds états-uniens a connu une augmentation brute de 4,8 avortements par 100 000 femmes-années. Une diminution de la capacité des femmes à planifier leurs grossesses en raison de la réduction de l'offre de contraceptifs serait à l'origine de ce phénomène, les forçant à avoir davantage recours à l'avortement, et souvent à des méthodes non sécuritaires.

Bien que les impacts de la PLGHA de Trump sur le recours à l'avortement n'aient pas encore été clairement établis, plusieurs études indiquent des effets similaires.
Une étude de l'Institut Guttmatcher note une réduction de l'utilisation des contraceptifs modernes sous la PLGHA en Éthiopie, ainsi qu'une stagnation des progrès dans la réduction des grossesses et des grossesses non désirées en Ouganda, notamment dans les districts les plus exposés à la politique.
Les mêmes auteurs ont identifié une augmentation de 15.5 % de patientes admises à l'hôpital pour des soins post-avortement en Ouganda, suggérant une augmentation des complications liées aux avortements et, indirectement, une augmentation du recours aux avortements non sécuritaires. En effet, en restreignant l'accès aux avortements sécuritaires, la PLGHA a forcé les femmes a se tourner vers des méthodes plus risquées. Les femmes marginalisées et vulnérables auraient été particulièrement affectées par la politique.
Abus de pouvoir et néo-colonialisme : une entrave au droit à l'autodétermination des pays concernés
Les droits à l'avortement ont considérablement progressé mondialement depuis la fin des années 1990. Bien qu'il ait été entièrement illégal dans de nombreux pays par le passé, la majorité des pays du monde ont maintenant légalisé l'avortement dans certaines circonstances.
Il convient donc de souligner qu'en s'opposant au cadre juridique de plusieurs pays, la PLGHA va à l'encontre du principe éthique de l'autodétermination.
En effet, cette politique entrave la fourniture de services d'avortements dans des pays où l'avortement a été légalisé par décision des autorités locales. En 2016, 37 pays sur 64 recevant du financement américain avaient des lois nationales autorisant l'avortement dans des circonstances non autorisées par la PLGHA.
L'exportation d'idéologies par les États-Unis au-delà des frontières américaines peut être considérée comme un impérialisme moral rendu possible par une position économique favorable.
Alors que le domaine de la santé mondiale tente de s'éloigner des dynamiques de pouvoirs entre le nord global et le sud global, cette politique reproduit ouvertement un néo-colonialisme destructeur.
À quoi s'attendre si Trump est réélu ?
Alors que les sondages affichent une lutte serrée entre Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats à la présidence américaine, les organisations luttant pour améliorer l'accès à l'avortement dans les pays à faibles revenus devraient s'inquiéter.
Bien que des discussions aient eu lieu sous le gouvernement Biden pour abroger de façon permanente la PLGHA, aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent.
La position du Parti républicain sur le droit à l'avortement se radicalise, comme en témoigne le candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, qui s'est positionné pour l'interdiction nationale de l'avortement aux États-Unis. S'il est réélu, il est attendu que Trump réinstaure la PLGHA.
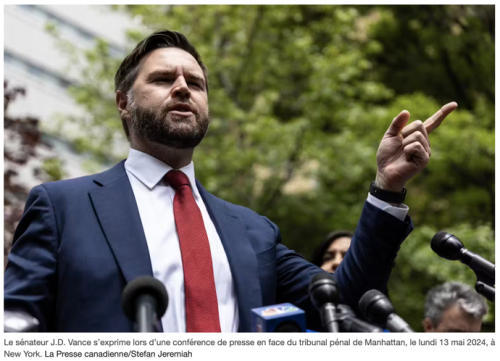
Il est également probable que le parti républicain élargisse encore davantage sa portée, comme cela a été recommandé par Project 2025- une série de propositions recommandée par une coalition d'organisations conservatrices.
Project 2025 recommande notamment d'élargir les restrictions à tout fonds d'aide étrangère, aux ONGs américaines, aux instances publiques étrangères et aux ententes bilatérales entre gouvernements, affectant potentiellement un montant de 51 milliards de dollars.
Ces ajouts pourraient mener à une réduction encore plus prononcée des services d'avortement et de contraception accompagnée d'une augmentation probable de la mortalité maternelle, en plus d'entraver la coordination de systèmes de santé déjà précaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Démission du ministre Fitzgibbon : Des groupes de la société civile demandent la suspension des travaux parlementaires entourant le projet de loi 69

Des groupes de la société civile réagissent à la démission du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, en demandant la suspension des procédures parlementaires sur le projet de loi n° 69 (PL-69), Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives et sa révision approfondie, après une véritable consultation mettant à profit la participation de la société civile.
Alors que l'étude en commission parlementaire de ce projet de loi, déposé par le ministre le 6 juin dernier, devait normalement se dérouler du 10 au 19 septembre prochain, les groupes font valoir que le gouvernement doit profiter du départ de M. Fitzgibbon pour retravailler ce dossier pour plusieurs raisons.
S'il était adopté, ce projet de loi aurait des implications importantes pour tout le secteur de l'énergie puisqu'il modifie 7 règlements et 15 lois, et qu'il en édicte une nouvelle. Le ou la ministre qui prendra la relève devra prendre du temps pour s'approprier le dossier et se familiariser avec les enjeux. L'avenir énergétique québécois ne peut être ainsi passé d'une main à une autre, il doit être traité par un ou une ministre bien en selle qui aura vraiment eu le temps de se saisir de toutes les nuances nécessaires. Le projet de loi 69 doit d'autant moins être pris à la légère puisqu'il aurait des impacts allant bien au-delà du système énergétique, par exemple sur le budget des ménages, sur la transformation du territoire, sur les problèmes de santé environnementale et humaine et sur notre capacité collective à prendre en main notre avenir énergétique et à lutter contre la crise climatique.
Par ailleurs, alors que la portée du cadre qui sera mis en place par le projet de loi aura des impacts significatifs sur la société québécoise à court et à long terme, les orientations qui le sous-tendent devraient être discutées et émaner largement d'un débat véritablement plus démocratique. Or, ces orientations n'ont été ni présentées à la population dans la plateforme électorale du parti ni débattues, elles ont plutôt été déterminées par un nombre restreint de personnes, dont le ministre Fitzgibbon lui-même, derrière des portes closes. Les groupes signataires soulignent que ces orientations vont également à contre-sens des objectifs fondamentaux de la nationalisation de l'électricité, dans les années 1960, qui avait alors fait l'objet d'un débat public et d'une élection référendaire.
De plus, les groupes signataires sont convaincus que le processus parlementaire de ce projet de loi doit être revu en profondeur et en dialogue avec la société civile parce qu'il est préoccupant à plusieurs égards :
– il omet de réellement lier la gouvernance énergétique à la crise climatique ;
– il ne contient aucune disposition assurant l'abandon des énergies fossiles ;
– il favorise un développement industriel effréné et fait reposer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques nécessaires à ce développement sur des tarifs d'électricité plus élevés, ce qui constitue une injustice sociale et environnementale ;
– il franchit des pas vers l'éventuelle privatisation d'Hydro-Québec ou d'une grande partie de ses actifs ;
– il risque d'avoir des impacts importants sur le territoire et les écosystèmes et ;
– il ignore les mesures pourtant incontournables à prendre pour favoriser la sobriété collective.
Les organisations signataires invitent le gouvernement à retirer le projet de loi 69 pour plutôt lancer rapidement le débat de société qui devrait servir de socle au plan de gestion intégrée des ressources énergétiques qu'il s'est engagé à élaborer, et lui offrent leur collaboration pour que cet exercice démocratique, qui est d'ailleurs réclamé depuis près de deux ans, se réalise. C'est après cet exercice capital qu'un nouveau projet de loi sur l'énergie pourra véritablement être légitime et être discuté en commission parlementaire.
Signataires
Jacques Benoit, GMob (GroupMobilisation)
Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal
André Bélanger, Fondation Rivières
Andréanne Brazeau, Fondation David Suzuki
Bruno Detuncq, Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)
Charles-Edouard Têtu, Équiterre
Jean-Pierre Finet, Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)
Patricia Clermont, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Carole Dupuis, Mouvement écocitoyen UNEplanète
Lucie Lamontagne C.A.C.P.N.V
François Geoffroy, Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique
Johanne Dion, Collectif Entropie
Alice-Anne Simard, Nature Québec
Patrick Bonin, Greenpeace Canada
Gilles Cazade, Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec
Sylvie Berthiaume Solidarité Environnement Sutton
Christian Savard, Vivre en Ville
Annie Macfhay C.A.C projet Northvolt.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des citoyens d’Oka et de Kanesatake tiendront une formation au contrôle routier pour freiner le dompage illégal à Kanesatake

Oka, 3 septembre 2024 – Solidaire avec les militant.e.s Mohawks qui luttent pour la sécurité publique dans la région, le collectif de résidents Okois ReconciliAction Kanesatake/Oka organisera, le 8 septembre, une formation à la désobéissance civile pour préparer les citoyen.ne.s à exercer le contrôle routier eux-mêmes.
Le grand chef de Kanesatake appuie la manifestation Okoise de dimanche
VICTOR BONSPILLE, GRAND CHEF DU CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE, APPUIE LA
FORMATION AU CONTRÔLE CITOYEN PAR LE COLLECTIF RÉCONCILIATION, APPELLE À LA
PARTICIPATION AUTOCHTONE
Kanesatake, 5 septembre 2024 - Le Grand Chef du conseil Mohawk de
Kanesatake, Victor Bonspille, exprime son soutien aux alliés Okois qui font
campagne pour la sécurité publique et la fin de l'enfouissement illégal de
déchets à Kanesatake et encourage les gens à assister à leur formation le 8
septembre.
Les citoyens d'Okois tiendront une formation pour préparer les gens à
d'éventuels contrôles routiers le 8 septembre 2024, à Oka. Le but de cette
formation est de démontrer au ministre de la Sécurité publique, M. François
Bonnardel, que les membres de la communauté sont prêts à appliquer
eux-mêmes les lois environnementales par la non-violence si son ministère
ne le fait pas.
Cette campagne est une réponse à un problème de déversement illégal à
Kanesatake qui dure depuis plusieurs années et qui a été fortement
médiatisé. Ce problème est favorisé par l'effondrement de la loi et de
l'ordre dans la communauté.
« Si nous voulons parvenir à la paix et à la sécurité, nous devons
travailler ensemble pour tenir tête au gouvernement qui nous a abandonnés
», a expliqué le Grand Chef.
« Il faut montrer au ministre de la sécurité publique, François Bonnardel,
que la population soutient un plan de sécurité publique à grande échelle
pour la région. Nous espérons que personne ne sera obligé de faire le
travail de la police à sa place. Mais c'est maintenant au ministre de
décider ».
ReconciliAction, reconciliaction@proton.me
LE 8 SEPTEMBRE.
Plus de cinquante personnes sont déjà inscrites et ce nombre croît de jour
en jour.
Les médias sont convoqués à 9h à Oka (lieu exact dévoilé la veille) pour un
rassemblement et une démonstration des méthodes de contrôle routier, visant
le professionnalisme, la sécurité, et la minimisation des perturbations de
la circulation.
Le collectif de lanceurs d'alerte Mohawks à l'origine de nombreuses
révélations concernant Kanesatake appuie explicitement la démarche du
collectif Okois. Une déclaration à cet effet peut être trouvée en annexe.
La formation sera donnée par un expert québécois internationalement reconnu
en matière de lutte non violente, Mr. Philippe Duhamel
<http://www.resistancecivile.org/phi...>
. Les citoyens
apprendront à exercer le contrôle routier selon les normes du ministère des
transports, munis de panneaux et d' équipements de sécurité.
Le collectif estime que la préparation à un éventuel contrôle citoyen est
rendu nécessaire à cause de l'inaction de la SQ et du ministre de la
sécurité publique, François Bonnardel :
- Des agents de la SQ ont dit à plusieurs citoyens qu'ils avaient l'ordre
de ne pas intervenir.
-Les opérations limitées de la SQ à Oka en juillet, fortement
médiatisées, n'ont duré que quelques heures. Les citoyens et la mairie
d'Oka constatent, sans surprise, que le va-et-vient des camions a repris
depuis la fin des vacances de la construction.
-Depuis, les camions continuent leur travail malgré l'action plus
importante du MLECC. Cette action a d'ailleurs évité de nombreux sites
dangereux pourtant bien connus des autorités.
-Les propos des agents locaux de la SQ dans La Presse en juillet, qui
minimisent la criminalité dans le secteur, ont laissé les citoyens déçus
par leur manque de sérieux. Plusieurs affirmations des officiers
interviewés sont d'ailleurs erronées (voir annexe).
-A part quelques commentaires publics évasifs des ministres
Bonnardel,Leblanc et Hajdu, il n'y a eu aucune rencontre entre ces paliers
de gouvernement afin d'élaborer un plan d'action. Ces ministres refusent à
l'unanimité de rencontrer les citoyens.
Annexe 1 : Déclaration de Pink et Optimum à lire aux personnes rassemblées à
Oka le 8 septembre
Aux personnes rassemblées ici aujourd'hui en solidarité avec nous, sachez
que nous nous réjouissons de cette manifestation de soutien de la part de
nos alliés allochtones. Toutes les communautés qui nous entourent dépendent
de l'environnement que les décharges et sites d'enfouissement illégaux
empoisonnent. Nous voulons que tout le monde soit libéré de l'exploitation
et de l'intimidation qui maintiennent ces décharges en activité contre la
volonté de nos communautés.
Nous souhaitons toutefois rappeler à tous, que tant que les problèmes de
sécurité et les violations des droits fondamentaux ne seront pas réglés
dans notre communauté, les atteintes à notre terre natale et à ses
habitants, comme ces décharges illégales, continueront de se produire.
Depuis des années, nous nous adressons au conseil de bande, ainsi qu'aux
politiciens provinciaux et fédéraux, pour leur demander de nous aider à
rétablir la sécurité publique à Kanehsatà:ke. Mais tout cela est tombé dans
l'oreille d'un sourd, car il n'y a eu que de la rhétorique politique et
personne n'est venu nous aider à nous protéger.
Nous restons tous vulnérables face à la criminalité, à la corruption et à
l'anarchie dont nous sommes témoins.
Afin de faire toute la lumière sur les nombreux facteurs qui permettent le
règne de la peur et le contrôle criminel sur Kanehsata:ke, nous demandons
qu'une équipe indépendante d'enquêteurs des droits humains soit créée et
que cette équipe consulte les membres de notre communauté sur la manière de
résoudre cette crise tout en assurant leur sécurité personnelle.
Cette équipe doit également être indépendante de tous les niveaux de
gouvernement.
Cette équipe devrait également se pencher sur les réseaux criminels, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté, qui continuent à dominer
notre vie publique par la peur, ainsi que sur la manière dont les actions
du conseil de bande et des agences gouvernementales provinciales et
fédérales ont contribué à la situation actuelle.
Grâce à ce processus de rétablissement de la paix, nous espérons trouver
des solutions pour la guérison à long terme, la sécurité et la justice dans
notre communauté, afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité tout
en protégeant les quelques terres qui nous restent. Nous espérons que les
élus de tous les niveaux de gouvernement utiliseront leurs vastes
ressources pour nous soutenir dans cette démarche.
Nous vous remercions tous pour vos efforts et votre soutien à vos voisins
kanien'kehá:ka.
Niawenkó:wa
Dans la paix et le respect
Annexe 2 : vérifications des commentaires de la SQ à La Presse
Affirmation de la SQ
Informations publiques contraires
« Comme partout en province, oui, il y a la présence de crime organisé, la
présence de gangs de rue, mais pas plus qu'ailleurs et je vous dirais même
inférieur qu'ailleurs », souligne l'inspecteur-chef, Michel Patenaude
Consulat américain de Montréal, 2004 :
<https://cryptpad.fr/file/#/2/file/p...> “The Mohawk
territory of Kanesatake has become a haven for marijuana cultivation, drug
dealing, arms possession, and other organized criminal activity.”
Une firme de détectives privés, citée par La Presse
<https://www.lapresse.ca/affaires/de...>
:« Nous avons consulté nos sources policières qui connaissent très bien le
secteur et selon eux, l'environnement n'est pas sécuritaire pour nos
enquêteurs. Il semble selon nos sources que le territoire est surveillé à
l'entrée par les gangs de rue et le crime organisé. Même les équipes
policières n'y vont pas sans une bonne escorte armée. » [ courriel à
disposition des journalistes sur demande ]
Entre autres, la couverture de La Presse montre que les investisseurs
originaires du dépotoir G&R ont des liens avec les Hells Angels et la Mafia
Italienne
<https://www.lapresse.ca/actualites/...>
.
En 2021, un membre de gang est tué à Kanesatake. L'enquête vise des membres
du crime organisé
<https://www.lapresse.ca/actualites/...>
.
En 2023, une perquisition à Kanesatake vise « Un Hells »
<https://www.lapresse.ca/actualites/...>
.
Le crime organisé est-il impliqué dans les nouveaux déversements de sols
qui ont eu lieu au cours des derniers mois sur le territoire mohawk ? « Il
n'y a pas de renseignements criminels à cet effet-là », répond-il.
Encore une fois, La Presse publie en août 2024 qu'un investisseur
originaire de G&R, lié à la mafia et poursuivit pour trafic de stupéfiants
par le FBI aurait vendu un dépotoir à Nexus, justement la compagnie montrée
du doigt au sujet des nouveaux déversements
<https://www.lapresse.ca/actualites/...>
.
Kanesatake n'est pas une zone de non droit
Après 7 ans d'incendies criminels, la SQ n'a fait aucune arrestation
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France : Ce n’est qu’un début …

Avec toutes ses limites – avant tout l'absence des directions syndicales, une préemption LFI sur la ligne bleue horizon de l'article 68 de la constitution, des préparations rarement unitaires et cohérentes …- les manifestations et rassemblements de ce 7 septembre ont été le début de l'inévitable irruption de celles et de ceux d'en bas contre le mensonge et le déni de démocratie.
8 septembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale | Pour le reportage photos cliquez sur le lien ci-dessous.
https://aplutsoc.org/2024/09/08/ce-nest-quun-debut/
Mensonge et déni excellement résumés samedi matin par le député RN Thomas Ménagé questionné sur sa satisfaction de ce que M. Barnier va s'entretenir avec le RN avant de constituer son gouvernement : « C'est très bien que l'opposition soit reçue par la majorité. »
Tout est dit : le RN est « l'opposition » faiseuse de roi, qui décerne le titre de « majorité » à l'exécutif le plus minoritaire et le plus illégitime de toute l'histoire de la V° République. Ce n'est pas seulement la base sociale et électorale du NFP qui est ainsi exclue, c'est la masse de la population, dont bien des électeurs RN trompés, qui veut l'abrogation de la réforme des retraites, la hausse des salaires et le rétablissement de l'école publique et de la santé publique.
Beaucoup de participants ont décidé de venir depuis la nomination de Barnier. Nul doute qu'un appel unitaire clair, même la veille, avec les syndicats, aurait permis un déferlement.
Travaillons à réunir les conditions de l'unité pour affronter et chasser la bande Macron/Barnier/Le Pen, donc leur régime, celui de la V° République. Le 1° octobre devra s'imposer comme la grève politique contre eux !
A Paris et Marseille notamment, puissance et détermination de cortèges massifs et jeunes, de dizaines et de dizaines de milliers.
Barnier-Macron-Le Pen : DEHORS.
5 septembre 2024 |Arguements pour la lutte sociale
Macron a donc nommé Michel Barnier. Il met donc à Matignon un représentant de LR, le vieux parti de la V° République qui a commencé à se disloquer vers le RN, et qui est le principal battu des législatives.
C'est pire encore que s'il avait nommé un représentant du soi-disant “bloc central” !
Première caractéristique de cette nomination : elle est faite après avoir recherché, pendant deux semaines, le soutien du RN. Macron a échoué à former un exécutif avec Bardella le 7 juillet dernier. Il a obtenu l'accord de non-censure du RN pour ses recherches de premier ministre, puis le RN a renforcé sa pression. Barnier en est le produit.
Immédiatement, Mme Maréchal-Le Pen l'appelle à « tenir ses promesses » : elle exige « moratoire sur l'immigration, limitation drastique du regroupement familial, fin des régularisations, fin de l'AME, expulsions facilitées, réforme du droit d'asile, référendum ». Elle récapitule des positions prises par Barnier à un moment ou un autre (v. ci-dessous). C'est le RN qui a choisi Barnier, écartant Bertrand et contraignant, avec l'aide de Sarkozy, Wauquiez à lever son veto …
Seconde caractéristique de cette nomination : elle arrive après des semaines de palinodies, de coquecigrues et de contorsions, comme un pis-aller, qui ne convient qu'à la Commission « européenne » qui attend de Barnier l'austérité budgétaire contre les services publics, les droits sociaux et la population.
Il y a coup de force, mais le plus poussif et souffreteux des coups de force, entre ridicule et déni total de démocratie sous l'oeil et l'ombre du RN. Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Macron dure déjà depuis trois mois en affichant ses aspirations autoritaires sans pouvoir les réaliser. Mieux encore, Macron s'est piégé lui-même en proclamant, pour interdire la seule candidate légitime à Matignon, qu'il lui appartenait de faire aussi le travail de l'Assemblée nationale en anticipant les motions de censure.
L'exigence démocratique et populaire adressée à l'Assemblée nationale est que, convoquée ou pas, elle se réunisse et censure l'exécutif Macron/Barnier sans lui laisser le temps de nuire contre les salaires et les services publics. Cette exigence est bien sûr celle de la base sociale et électorale du NFP, mais elle va très au delà, car elle repose sur l'aspiration à la hausse des salaires, à l'abrogation de la réforme des retraites, à laa défense des services publics.
Ils ne doivent pas continuer à nuire !
Exigences sociales et démocratiques se rejoignent. Cela va se voir dans les rassemblements de ce samedi 7 septembre et au delà, rapidement. Nous œuvrerons pour cela. L'issue est dans l'affrontement social pour imposer la démocratie : dégager Macron et le régime de la V° République dont la bande à Le Pen est la quintessence.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation pour la qualité de l’air

Mères au front de la ville de Québec, le Mouvement pour une Ville Zéro Déchet (MVZD), et Parents de Limoilou - regroupés sous le nom Vigilance Canari en collaboration avec la Table citoyenne Littoral Est, vous invitent à une grande mobilisation pour la qualité de l'air dans le cadre de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus.
Plusieurs études montrent que dans la Ville de Québec, comme ailleurs dans la province, la mauvaise qualité de l'air affecte la santé des résident.es. De Limoilou à Rouyn-Noranda en passant par Arvida, les efforts pour diminuer la pollution de l'air ne sont pas suffisants. Le droit d'empoisonner l'air octroyé par nos gouvernements aux grandes compagnies comme Glencore ou Rio Tinto, le manque d'organisation dans la gestion des déchets, le retard dans la construction des transports en communs et le développement industriel faisant fi des impacts sur la santé des citoyens est inacceptable.
On se mobilise parce que la pollution atmosphérique est la plus grande injustice environnementale que subissent nos voisin.ines de quartier. On se mobilise pour sortir nos concitoyen.nes de l'impuissance, de l'écoanxiété et du déficit de compréhension qu'on souhaite leur faire porter. On dénonce ainsi le fait que cet enjeu clé, qui se vit dans Limoilou depuis le siècle dernier, n'est pas encore traité à l'échelle nationale.
On revendique le droit à un environnement sain, pour nos enfants et pour les générations futures. On demande que les trois paliers de gouvernement honorent leurs devoirs d'exemplarité et que le principe de précaution soit toujours respecté. Après les rapports, les comités indépendants, les portraits de la situation et les commissions, on exige un effort concerté : des solutions locales reproductibles à l'échelle nationale !
Venez ajouter votre voix à la nôtre, dans une ambiance familiale et festive ! Sur la 9e avenue, vous serez accueillis par le musicien Bosco Baker's do Makers et vous pourrez visiter les tables de Mères au front de la ville de Québec et celle du MVZD dès 10h30. À 11h notre animatrice Maude Lafond, vous accueillera et présentera le Dre Johanne Elsener qui nous parlera de la qualité de l'air. Ensuite Olive Caron et son papa viendront nous projeter dans l'avenir d'un quartier où il fera bon vivre.
Par la suite, nous exprimerons notre solidarité et notre détermination à faire changer les choses avec nos corps, dans une action artistique à laquelle chacun et chacune sera invité·e à participer. Tous et toutes habillé.es en bleu, nous nous rassemblerons autour des immenses lettres du mot INSPIREZ. À ce moment, l'artiste Benoît Pinet (Tire le Coyote) nous bercera de sa poésie par une prestation unique. Un drône prendra des images de nous amalgamés comme les composants de l'air pur du ciel bleu que l'on se souhaite.
Nous demandons à nos dirigeant.es d'inspirer un grand coup pour trouver le courage politique de faire changer les choses. De créer et d'appliquer des règles strictes pour protéger la population. Nous leur demandons de devenir inspirant.es par leur courage, leur empathie et leurs actions. Nous invitons les citoyen.nes à venir inspirer avec nous pour retrouver le plaisir d'être ensemble et la force du groupe pour former la ville de demain.
QUAND ? Samedi le 7 septembre de 11h à 12h
OÙ ? 9e avenue entre la 4e rue et la rue Hedleyville
Stationnement disponible au centre Horizon.
Arrêt de bus à proximité #2563 (des capucins/ 4e rue) desservant la 800, 54 et 133
Station À Vélo 1ere avenue / 6e rue
DÉROULEMENT :
Accueil musical de Bosco Baker's do Makers
Présentation des différents groupes partenaires : Vigilance Canari
Mot du Dre Johanne Elsener, Association québécoise des médecins pour l'environnement
Mot du coeur d'Olive et de son papa
Moment d'inspiration
Prestation de Benoît Pinet, Tire-le-coyote
Conclusion et échanges
Venez en grand nombre !
Portez du bleu, la couleur du ciel et de l'air pur !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment peut-on vraiment déterminer quand et jusqu’à quel point la qualité de l’air est bonne dans notre ville ?

Une bonne nouvelle, c'est qu'un règlement de la ville de Québec oblige maintenant à se débarrasser des vieux poêles à bois les plus polluants et surtout des foyers décoratifs même récents, car ils sont encore plus polluants.
La combustion du bois entraîne non seulement la production de particules fines, mais également d'autres polluants très nocifs.
Toutefois, en mettant de l'avant la combustion du bois comme source de pollution, il ne faut pas ignorer les autres polluants. Par exemple, une station du ministère de l'environnement, située près d'une école à l'ouest de Ste-Foy, est capable d'identifier le contaminant caractéristique de la combustion du bois. Mais elle n'enregistre pas la plupart des polluants reliés au transport routier et aérien alors que cette école est située près de l'aéroport et ceinturée par de grandes voies de circulation.
Vu que le ministère de l'Environnement ne mesure pas tous les polluants qui devraient être mesurés, comment peut-on vraiment déterminer quand et jusqu'à quel point la qualité de l'air est bonne dans notre ville ?
Les particules fines sont constituées de plusieurs polluants. Mais le ministère de l'environnement n'a pas les effectifs pour déterminer de quels polluants il s'agit. Comment peut-on alors déterminer les causes locales d'une mauvaise qualité
de l'air ?
On entend souvent que la pollution peut venir de loin. C'est vrai. Mais en réalité, la pollution qui a le plus d'impact, qui est la plus concentrée, c'est celle qui se situe localement. La pollution du port de Québec a certainement plus d'impact sur les gens de Limoilou et de la ville de Québec que la pollution en provenance des Grands Lacs. Et si on construit un quartier industriel dans le boisé des Châtels et un autre au sud de l'aéroport, les gens de ces secteurs seront directement impactés. Même si des normes étaient rigoureusement appliquées, il y aura une augmentation de la pollution à Québec.
Le ministère de l'environnement est sous-financé par nos gouvernements depuis des décennies. (On parle bien d'augmenter les budgets de l'armée, alors que les budgets occidentaux qui sont déjà énormes, mais qui défend l'augmentation des budgets en matière environnementale ?)
Il y a un autre parent pauvre dans les budgets, c'est le transport en commun.
On n'a pas besoin d'instruments de mesure pour savoir que nous allons respirer mieux s'il y a moins d'autos sur les routes. Et si on cesse de dépenser des centaines de millions pour construire des autoroutes, on conservera plus d'arbres, qui pourront nettoyer les contaminants atmosphériques par leur respiration et produire de l'oxygène, tout en contribuant à notre qualité de vie.
Une fois qu'un problème est constaté, le régler, en plus, c'est une autre paire de manche. Prenons par exemple à Rouyn-Noranda, la fonderie Horne…On peut aussi penser à l'usine de batteries Northvolt, que les gouvernements vont subventionner et pour laquelle ils
devront créer de nouvelles normes pour les polluants que cette usine va générer… si nous, les citoyennes et citoyens, la laissons s'établir !
Actuellement, on génère des problèmes de pollution, on les mesure partiellement, on fait des études sur les populations, nous les cobayes, pour pouvoir démontrer jusqu'à quel point notre santé est impactée. Et puis, si on a un gouvernement plus favorable à l'environnement qu'aux grandes entreprises, on réajuste les normes pour qu'elles soient plus acceptables, jusqu'à ce que de nouvelles études les remettent en question ces normes. C'est sans compter que les entreprises déjà établies peuvent bénéficier d'exemptions par rapport à ces nouvelles normes. Avec ces exceptions et tous
ces délais, non seulement les humains voient leur qualité de vie et, dans certains cas, leur espérance de vie, diminuer, mais les animaux également. Car les normes sont établies seulement en fonction de la santé humaine et non pas en fonction de l'ensemble du vivant dont nous dépendons.
Imaginez… si on faisait, vraiment, de la prévention en matière de santé humaine et de la planète… Plutôt que de générer des problèmes de pollution, on les éviterait au maximum… Ça ne prend pas l'intelligence artificielle pour planifier cela, mais plutôt une sensibilité bien ajustée
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











