Derniers articles

Après la défaite de l’extrême droite en France, nous avons plus que jamais besoin du féminisme

Pour une fois, je me permets de commencer cette newsletter sur une note personnelle. Je tiens à remercier toutes les personnes en France qui ont voté contre l'extrême droite et son programme de haine, de peur et de division ce dimanche.
tiré de NPA 29
Comme beaucoup d'immigrant·es dans ce pays sans droit de vote, j'ai suivi ces dernières semaines de campagne en France avec un sentiment de terreur croissante : de la défaite de Macron aux élections européennes, à son pari risqué d'amener des élections législatives anticipées, au résultat dévastateur du premier tour où le Rassemblement National d'extrême droite a terminé en tête. J'ai fait ce que je pouvais : j'ai écrit, j'ai lu, j'ai manifesté,
j'ai tenté de tirer la sonnette d'alarme sur les risques d'un gouvernement d'extrême droite. Et hier soir, quand les premiers sondages ont été publiés à 20h et ont montré une victoire du Nouveau Front Populaire, j'ai ressenti de l'espoir pour la première fois. De l'espoir, du soulagement et de la gratitude envers mes voisin·es, mes ami·es, les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et celles qui le sont – envers toutes les personnes qui se sont mobilisées dans des proportions sans précédent pour dire non au racisme, à la xénophobie, à l'islamophobie, à l'antisémitisme, à l'homophobie, à la transphobie et à la misogynie du Rassemblement National.
Le combat est loin d'être terminé. Le Rassemblement National a fini troisième, mais il a gagné plus de 50 sièges de plus au parlement et recueilli les voix de plus de 8 millions de personnes. Le parti restera une force majeure en Europe, où il a de nombreux alliés d'extrême droite à travers le continent – des allié·es qui souhaitent interdire l'avortement et les transitions de genre, des allié·es qui ciblent les familles queer. Le racisme et la xénophobie décomplexés qui ont été déchaînés pendant cette campagne violente ici en France ne seront pas facilement oubliés.
Le front républicain français a une fois de plus triomphé, et j'en suis éternellement reconnaissante. Mais il reste encore du travail. L'extrême droite ne disparaîtra pas d'elle-même : la cheffe du Rassemblement National, Marine Le Pen, a déclaré que la victoire de son parti n'était “que différée”. Pour éviter une catastrophe à l'avenir, la France devra continuer à contrer l'extrême droite partout où elle se trouve. La lutte n'est pas encore terminée, et avec plus de femmes que jamais qui votent pour l'extrême droite, nous aurons besoin de réponses féministes dans les années à venir.
Heureusement, il y a des féministes partout dans le monde qui ont l'expérience de résister aux forces de l'extrémisme, et elles ont beaucoup à nous apprendre, où que nous soyons, et que nous puissions voter ou non. La semaine dernière, j'ai écrit à certain·es de ces activistes pour leur demander des conseils sur la manière de continuer à affronter l'extrême droite en France.
Debora Diniz connaît trop bien les dangers des forces d'extrême droite. Elle a reçu des menaces de mort pour avoir témoigné devant la Cour suprême du Brésil lors d'une audience sur la décriminalisation de l'avortement, et a été placée sous protection policière et finalement exilée à cause de son travail. Elle est considérée comme la première personne contrainte à l'exil sous le gouvernement de droite dure du Brésil, dirigé par Jair Bolsonaro, un politicien souvent comparé à Donald Trump.
“Il y a deux leçons principales que je tire des moments difficiles de Jair Bolsonaro au pouvoir au Brésil. La première est la manière dont l'extrême droite fonctionne en répandant la peur, et comment cela peut paralyser le courage et la créativité féministes”, a-t-elle expliqué. Mais “nous ne pouvons pas changer des normes injustes par la peur.”
“La deuxième leçon est qu'il faut ignorer la fausse prophétie du retour de bâton contre les idées féministes”, a-t-elle ajouté. Les manifestations de masse au Brésil à la veille des élections sous le mot d'ordre ”Pas lui” rappellent la mobilisation féministe que nous avons vue dans les rues de France avant le premier tour des élections le mois dernier. “Le récit du retour de bâton est un récit qui tente de contrôler notre élan de mobilisation et de participation politique”, analyse la militante. Bolsonaro a perdu le pouvoir en 2022 face au candidat de gauche Lula da Silva.
La philosophe Marcia Tiburi a également quitté le Brésil en raison des menaces de mort de l'extrême droite, et a vécu en exil à Paris pendant les années Bolsonaro. “J'ai passé quatre ans en France à souffrir de la situation au Brésil et maintenant je suis au Brésil à souffrir de la situation en France,” déclare-t-elle. “Bolsonaro a laissé en héritage des horreurs et des personnages tout comme lui au sein du congrès national… Que la France ait réussi à stopper l'avancée de l'horreur hier est une chose à célébrer, mais nous devons rester vigilants.“
Nous aurons également besoin de construire des réseaux à travers l'Europe, d'après Zsofi Borsi, la cofondatrice de Lazy Women, un collectif né en Hongrie avec pour mission d'apporter des perspectives autres que celles d'Europe occidentale au discours féministe dominant. Dans son pays natal, le président d'extrême droite Viktor Orbán a fait passer des lois anti-LGBT et des restrictions sur les soins liés à l'avortement, tout en diabolisant les migrant·es. Son parti a rejoint un bloc d'extrême droite avec le Rassemblement National au parlement européen.
“Que ce soit une ‘guerre' contre les immigré·es, George Soros, l'UE ou le genre, en Hongrie, la machine de propagande d'Orbán abreuve la population de différents ennemis, et détruit systématiquement la tolérance du public pour la diversité, et la société civile dans son ensemble”, raconte Zsofi Borsi. Avec les forces d'extrême droite s'unissant à travers l'Europe, elle dit que les féministes devront faire de même. “Construire des réseaux de solidarité entre les petites organisations féministes pour élever les voix des un·es et des autres localement et dans la région – où de nombreux pays voisins font face à des défis similaires – joue un rôle crucial.”
Depuis presque dix ans, les féministes d'Argentine sont des leaders mondiales qui ont réussi à transformer leur société pour le mieux. L'activiste Verónica Gago a été l'une des voix majeures du mouvement #NiUnaMenos qui a protesté contre les violences de genre à partir de 2015, et donné naissance à une nouvelle vague de discours féministes dans le monde, y inclus la “vague verte” qui a permis à de nombreux pays d'Amérique latine d'obtenir le droit à l'avortement. Mais l'élection récente en Argentine prouve que les victoires féministes ne peuvent jamais être prises pour acquises : en l'espace de quelques mois seulement, le président ultraconservateur Javier Milei a décimé nombre de ces droits durement acquis.
“L'extrême droite au gouvernement, cela veut dire un recul absolu des conditions qui rendent possibles nos luttes”, a déclaré l'activiste et autrice argentine. “En tant que féministes, notre engagement est de lutter contre le fascisme de toute notre force. C'est ce que nous faisons ici. Il est aussi essentiel de renforcer les luttes transféministes. Nous devons continuer à nous organiser et, surtout, à construire et élargir nos alliances.”
Ces dernières années, l'Inde a été témoin de la montée du nationalisme hindou et des idéologies d'extrême droite. Mais les dernières élections ont vu le parti nationaliste Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis 2014. Teesta Setalvad est une militante féministe, journaliste et fondatrice de Sabrang Trust et Citizens for Justice and Peace. Elle a longtemps milité pour les victimes des émeutes du Gujarat en 2002 et a été détenue pour son activisme par le gouvernement. “L'extrême droite dans différents pays, contextes et cultures présente une similarité étrange, voire effrayante”, a-t-elle remarqué. “Il est plus que temps de forger des alliances internationales.”
“L'Inde a vécu cela, l'a vu et en sort lentement (espérons-le), bien que marquée et blessée… Nous souhaitons bonne chance à nos sœurs en France alors que nous-mêmes luttons pour respirer un peu plus facilement tout en étant encore menacé·es par des nuages noirs en Inde.”
Des millions de personnes en France, et celles qui nous regardent partout dans le monde, respirent un peu plus facilement aujourd'hui. Une fois de plus, l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Une fois de plus, elle a été repoussée par une population qui a choisi l'espoir plutôt que la haine. Une fois de plus, les féministes ont montré la voie.
Dès aujourd'hui, la lutte continue, mais rappelons-nous : nous sommes plus nombreuses et nombreux qu'eux.
Megan Clement
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - « La Convention du Parti démocrate ignore pour l’essentiel la question morale la plus pressante de notre époque : Gaza »

Les prestations de la première nuit de la Convention nationale du Parti démocrate ont été impeccables. Les réactions aux discours tenus dans l'enceinte de la convention et aussi dans la fraction des réseaux sociaux libéraux [progressistes] ont été enthousiastes.
Tiré de A l'Encontre
23 août 2024
Par Natasha Lennard
Aux cris de « We love Joe », le président Joe Biden a accordé sa bénédiction d'homme d'Etat à sa future successeure, la candidate démocrate Kamala Harris. Hillary Clinton a parlé de briser le « plafond de verre ». Le sénateur Raphael Warnock (Géorgie), un pasteur baptiste, a prononcé un éloge vibrant selon lequel « un vote est une sorte de prière ». Et la représentante Alexandria Ocasia Cortez [New York, figure de la gauche démocrate et écartée de DSA pour son soutien à la politique de Biden face à Israël] a qualifié Donald Trump de « briseur de syndicats à deux balles » sous les acclamations de « AOC, AOC ».
La démonstration de l'unité du Parti démocrate était aussi parfaite qu'elle était sourde à ce qui est sans doute la question morale la plus urgente de notre époque.
Au-delà de clins d'œil, vous n'auriez pu saisir aucune mention effective de la guerre génocidaire qu'Israël, soutenu par les Etats-Unis, continue de mener contre les Palestiniens de la bande de Gaza.
Le fait que des dizaines de milliers de manifestant·e·s anti-guerre se soient rassemblés en solidarité avec les Palestiniens [devant la Convention réunie à Chicago], dès le matin du lundi 20 août, n'a pratiquement pas été mentionné à la convention lundi soir. Le silence a persisté alors que la campagne de Kamala Harris pourrait souffrir du prix de plus d'un demi-million de voix [1] dans des Etats clés, en particulier le Michigan, pour avoir refusé d'arrêter le flux d'armes à destination d'Israël.
Pendant que Biden parlait, un petit groupe de participants a déployé en silence une bannière sur laquelle on pouvait lire « Stop Arming Israel » (Arrêtez d'armer Israël). Prem Thakker, de Zeteo [organe de critique des médias dominants, animé entre autres par Mehdi Hasan], a rapporté depuis le United Center de Chicago que les chants « We Love Joe » des participants proches se sont alors renforcés. « Les lumières de la salle omnisports se sont alors éteintes et la bannière a été arrachée », a écrit Prem Thakker sur X.
Les quelques mentions fugaces ayant trait à la guerre, à Israël et à la Palestine dans les discours de lundi soir étaient insignifiantes et trompeuses, tout en dévalorisant les vies des Palestiniens par rapport à celles des Israéliens.
Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré sous un tonnerre d'applaudissements : « Kamala travaille sans relâche pour un cessez-le-feu. » C'est peut-être vrai ou non, mais une telle approche trancherait avec le bilan de l'administration Biden-Harris. Depuis que Kamala Harris a accepté la candidature à la présidence, l'administration Biden-Harris a approuvé une vente d'armes à Israël pour un montant de 20 milliards de dollars, et cela sans aucune condition. Si c'est cela « travailler sans relâche » pour mettre fin aux combats, Kamala Harris n'est pas à la hauteur de la tâche proclamée.
Le fait que les appels au cessez-le-feu aient été chaleureusement accueillis dans le parterre de la convention pourrait être considéré comme un signe prometteur – une autre indication adressé à l'establishment démocrate qu'il existe un soutien populaire pour un cessez-le-feu permanent de la part du grand public. Mais c'est déjà le cas depuis longtemps. Il n'y a rien d'encourageant à applaudir un geste vide de sens en faveur de l'idée d'un cessez-le-feu, qui dissimule la complicité de l'administration dans la guerre.
Dans son discours, Joe Biden a fait un clin d'œil aux manifestations devant la Convention : « Ces manifestant·e·s dans la rue n'ont pas tort. Beaucoup d'innocents sont tués des deux côtés. » Pourtant, même ce clin d'œil a réussi à dénaturer les positions, établies de longue date, du mouvement de solidarité avec la population de Gaza.
Les manifestations contre la guerre de Gaza – qu'elles aient eu lieu au cours des dix derniers mois, cette semaine à Chicago ou par la présence de délégués « non engagés » (« uncommitted ») à la Convention – n'ont pas pour but de faire valoir que des innocents sont tués « des deux côtés ». Elles font partie d'une mobilisaton internationale contre le génocide et le nettoyage ethnique des Palestiniens par l'armée israélienne soutenue par les Etats-Unis.
Ce que veulent les manifestant·e·s
Plus tôt dans la journée de lundi, la DNC a accordé à la campagne « Uncommitted » un espace pour organiser une table ronde (forum) distincte consacrée à Gaza et aux droits de l'homme des Palestiniens. Selon les rapports, des centaines de personnes ont assisté et écouté les récits intolérables de médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux dévastés de Gaza, où un grand nombre des patients qui arrivent sont des enfants mutilés.
La Dresse Tanya Haj-Hassan [membre de Médecins sans frontières], une chirurgienne américano-palestinienne qui a soigné des patients à Gaza, a raconté l'histoire d'un petit garçon qui avait perdu tous les membres de sa famille et qui a déclaré qu'il souhaitait mourir lui aussi parce que tous ceux qu'il aimait « sont maintenant au paradis ».
Tanya Haj-Hassan a expliqué que même les enfants qu'elle avait réussi à soigner et à faire sortir de l'hôpital risquaient de mourir à cause des bombardements, de la famine et de la déshydratation. Des « rapports alarmants » font état des premiers cas confirmés de poliomyélite infantile à Gaza.
Une autre participante, Hala Hijazi, s'est décrite comme une démocrate « de longue date » et « modérée », qui a travaillé comme collecteuse de fonds pour le parti, récoltant plus de 12 millions de dollars dans le passé. « Je suis ici parce que ma famille est morte », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle avait perdu plus de 100 membres de sa famille large au cours de l'offensive actuelle.
Hala Hijazi, qui siège au conseil d'administration du comité d'action politique pour les droits génésiques NARAL Pro-Choice California, a déclaré au public qu'elle se battait pour les libertés génésiques dans son pays, « mais que je ne pouvais pas aider les femmes de Gaza qui sont enceintes en ce moment ». Ces remarques étaient un rejet tacite des critiques selon lesquelles ceux qui poussent Kamala Harris à s'engager en faveur d'un embargo sur les armes sont des électeurs qui ne s'intéressent qu'à un seul sujet [la Palestine], négligeant d'autres domaines comme, par exemple, la menace qu'une deuxième administration Trump ferait peser sur les droits reproductifs aux Etats-Unis.
C'est pourquoi les organisateurs de la manifestation, les manifestant·e·s et les personnes concernées qui sont venus à Chicago ne se contenteront pas d'un forum mis à l'écart et d'un discours spécieux de la part des politiciens sur la scène principale. A l'heure actuelle, la plateforme de 92 pages du Parti démocrate ne mentionne pas un conditionnement des livraisons d'armes à Israël, et encore moins l'embargo sur les armes réclamé par les 30 délégués non engagés (uncommitted) et les plus de 200 groupes de la Coalition to March on the DNC (Coalition pour une marche sur la DNC).
Les spectacles de lundi soir n'ont pas donné l'impression que la campagne de Kamala Harris, certes rafraîchie et alimentée en émotions, changerait de cap sur la Palestine, se concentrant plutôt sur l'avortement, la menace autoritaire de Trump pour la démocratie et la protection des travailleurs et travailleuses. Dans un contexte de stricte politique interne, ce serait une bonne chose. Je pourrais moi aussi rire avec le réjouissant président des United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, qui fait référence à une chanson du rappeur Nelly et traite Trump de briseur de grève [2]. Mais pas le même jour où, dans le même centre de la Convention, parmi d'autres horreurs, un chirurgien a décrit le traitement d'un enfant de Gaza dont le visage avait été arraché lors d'une frappe israélienne.
A l'heure d'une guerre génocidaire menée avec les armes, les dollars et le soutien diplomatique des Etats-Unis – une offensive militaire qu'un président américain pourrait sérieusement limiter –, la Convention nationale du Parti démocrate ne peut rester une sphère myope et fermée.
Alors que les débats se poursuivent jusqu'à jeudi soir, 22 août, les protestations [Coalition to March on the DNC] se multiplient et le désespoir s'intensifie. Si la campagne de Harris décide qu'elle peut gagner sans écouter, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. (Article publié par The Intercept le 20 août 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
[1] Selon Ben Samuels dans Haaretz du 22 août, « le Mouvement national non engagé [« uncommitted », qui refuse de voter démocrate à cause de la politique de l'administration Biden envers Netanyahou] représenté au sein de la DNC-Democratic National Convention par 30 délégués qui représentent eux-mêmes 700 000 votes de protestation contre la politique israélienne de l'administration Biden, était un enjeu d'importance au début de cette semaine ». (Réd.)
[2] Le président de l'United Automobile Workers, Shawn Fain, a pris la parole lors de la première nuit de la convention nationale du Parti démocrate 2024 à Chicago. Shawn Fain a cité le rappeur Nelly, disant « il commence à faire chaud ici », avant d'enlever sa veste pour montrer un t-shirt sur lequel était écrit « Trump est un briseur de grève ». (Réd.)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Québec Solidaire : Le train de Gabriel Nadeau-Dubois déjà entré en gare
Comme membre de Québec Solidaire j'ai reçu cette semaine des informations préliminaires sur le congrès de novembre prochain qui sera EN MODE VIRTUEL si j'ai bien compris. Je pensais déjà après le conseil national du printemps dernier que le train de Gabriel Nadeau-Dubois était sur le point d'entrer en gare et je me demandais s'il y avait moyen de le faire dérailler avant pour avoir une discussion franche et ouverte impliquant tous les membres sur l'avenir du parti avant l'étape de préparation du congrès, des pour ou contre les propositions qui y seraient présentées. Je me suis pour ma part essayé en demandant à la présidente de l'association locale de mon comté de tenir une assemblée générale spéciale en juin pour comprendre ce qui s'est passé au conseil national et se faire un idée sur le suite des choses avant la lancée de fin d'été vers le congrès. Sa réponse a été de m'inviter à prendre une bière avec d'autres membres…et alors que j'insistais en prenant cette bière elle m'a dit qu'elle en parlerait avec le comité de coordination, puis je n'ai plus eu de nouvelles depuis...
J'ai compris en recevant cette semaine les premières informations concernant le congrès de novembre qui portera sur les changements au statut que le train était déjà en gare, alors que ce congrès aurait pu être l'occasion de revenir sur le choix de notre co porte-parole masculin de plonger notre parti dans le pragmatisme électoraliste en jetant aux poubelles l'autre aspect de la mission de notre parti, soit sa présence dans la rue des villes et dans les rangs de campagnes. Du même coup c'est la victoire du cérébral avant tout masculin et la mise au rancart de la voie du coeur avant tout féminine incarnée par Catherine Dorion et plus récemment par Emilie Lessard-Therrien. Alors que pour moi le pragmatisme et le rêve, la folie et la fantaisie ne s'opposent par et ces deux composantes auraient pu continuer à se compléter représentées par deux co porte-paroles complémentaires, mais trop tard après le coup d'état de Gabriel Nadeau-Dubois et sa clique, et leur prise de contrôle du parti.
Je reviens sur le choix d'un congrès virtuel sans contact physique et affectif entre les délégués,es au congrès en l'absence de rencontres informelles et de délibérations en présence des humains en chair et en os. Il n'y a pas de plus merveilleuse façon de contrôler le déroulement d'un congrès chacun,e assis,e derrière un ordinateur à la merci des personnes qui ‘' dirigent ‘' le congrès vers un objectif déterminé d'avance.
Poutine ou Xi Jinping ne pourraient faire mieux.
Si je reviens à moi, comme notre parti devenu uniquement électoraliste tentant de ne fâcher personne et d'aller chercher le plus de votes en rêvant un jour de prendre le pouvoir, ne remettant plus en question le système capitaliste néolibéral mondial, il ne m'inspire plus et il ne me reste plus que de mettre ma carte du parti aux poubelles comme je l'ai fait avec celle de la SAQ qui ne m'inspirait plus... Comme je suis un fervent indépendantiste et ancien prisonnier de la Crise d'Octobre je vais peut-être retourner au Parti Québécois social-démocrate comme Québec Solidaire l'est devenu, pour rêver et peut-être réaliser l'indépendance du Québec, et dont le chef m'inspire plus que le nôtre. Je ne crois plus trop aux miracles, et vous ?
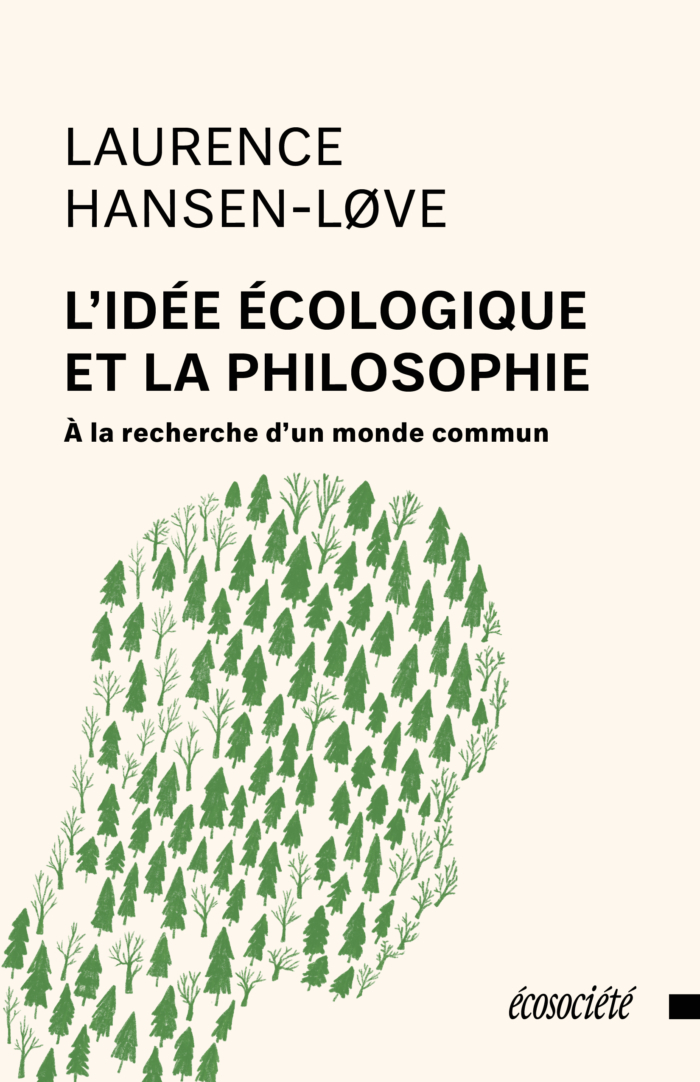
L’idée écologique et la philosophie - À la recherche d’un monde commun | À paraître le 3 septembre
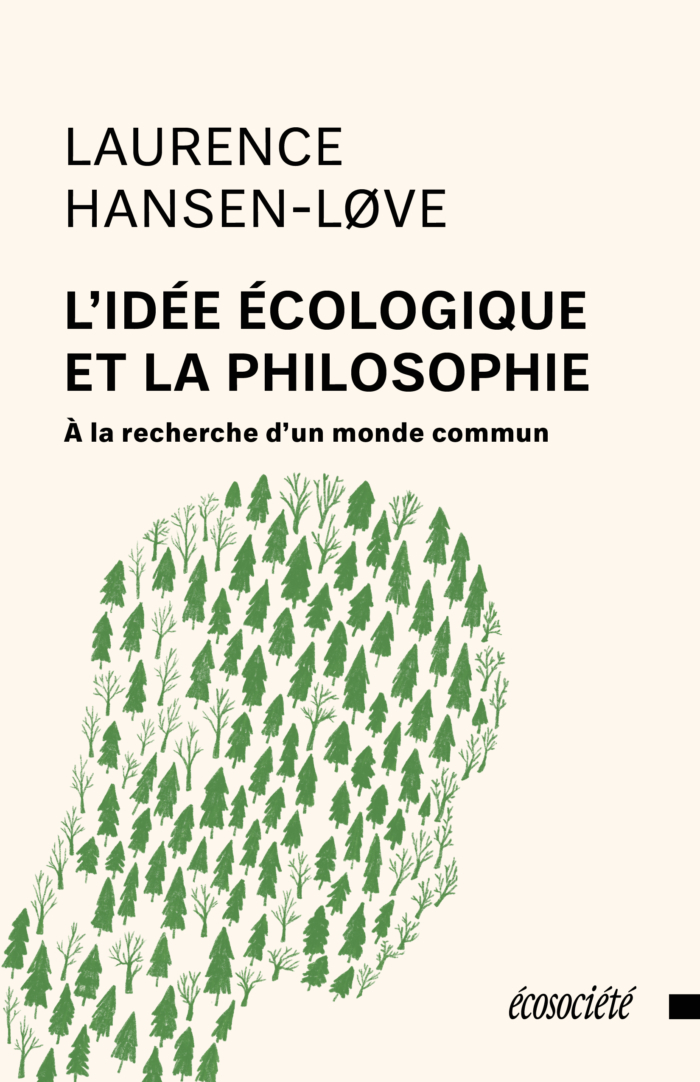
Comment les philosophes ont-ils pensé la place de l'humain dans son
environnement ? Des philosophes grecs aux écoféministes, un voyage captivant
au cœur des fondements philosophiques de l'écologie.
L'essai *L'idée écologique et la philosophie - À la recherche d'un monde
commun*, de la philosophe française Laurence Hansen-Løve, va paraître *en
librairie le 3 septembre.*
*En bref* : À l'heure du péril écologique, renouer avec la clairvoyance, la
prudence et l'esprit de responsabilité des plus grands philosophes, de
Aristote et Épicure à Hans Jonas et Günther Anders, est devenu notre
impératif et notre espérance.
Pour recevoir un exemplaire en service de presse, merci de me fournir
votre adresse postale en cas de télétravail.
*À propos du livre*
Pour de nombreux philosophes contemporains, la maîtrise de la nature est
devenue la source des multiples crises auxquelles nous sommes confrontés.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ils sont même plusieurs à avoir
applaudi et encouragé cette maîtrise au fil du temps, en séparant
artificiellement « nature » et « culture ». Pourtant, dès ses origines, en
tant que recherche de la vérité et de la sagesse et par sa condamnation de
la démesure, la philosophie fut doublement concernée par l'idée écologique.
Dans ce captivant voyage, Laurence Hansen-Løve remonte aux fondements
philosophiques de l'écologie. Elle montre l'importance des pensées antiques
de la sagesse contre l'hubris et de la représentation critique de la nature
qu'ont formulée nombre de philosophes à travers les âges (Aristote,
Spinoza, Rousseau, Thoreau, etc.). Un périple qui nous conduit jusqu'à nos
jours, avec l'essor de pensées résolument écologistes comme l'écologie
politique (Ellul, Charbonneau, Gorz, Næss, etc.), l'écoféminisme
(d'Eaubonne, Starhawk, etc.) ou la communauté terrestre (Mbembe).
À l'heure du péril écologique, renouer avec la clairvoyance, la prudence et
l'esprit de responsabilité des plus grands philosophes, de Aristote et
Épicure à Hans Jonas et Günther Anders, est devenu notre impératif et notre
espérance. Grâce à l'apport des philosophies matérialistes mais aussi
animistes ou panthéistes inspirées de penseurs de tous les continents, la
philosophie écologique contemporaine a partiellement renoué avec la sagesse
des Anciens. Celle qui nous invite à envisager la nature avec affection,
considération et bienveillance.
*À propos de l'autrice*
Laurence Hansen-Løve est professeure agrégée de philosophie et autrice de
nombreux ouvrages, dont *Planète en ébullition* (Écosociété, 2022), *La
violence. Faut-il désespérer de l'humanité ?* (Du retour, 2020) et *Cours
particulier de Philosophie*. Questions pour le temps présent (Belin, 2006).
Elle a aussi codirigé, avec Laurence Devillairs, *Ce que la philosophie
doit aux femmes *(Robert Laffont, 2024).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La menace de l’ ultra-droite en France

Jacques Leclercq, chercheur indépendant spécialiste des extrêmes politiques, dresse un
état des lieux précis et actualisé de la mouvance radicale de l'extrême-droite.
Outre des rappels historiques, de nombreuses thématiques sont traitées, dont les projets
d'attentats, l'infiltration dans la police et l'armée, le mercenariat et trafic d'armes, les
condamnations prononcées par la justice, les dissolutions de structures ou l'activisme sur le
net.
Une étude objective et factuelle permettant de mieux cerner la dangerosité de ce courant.
Jacques Leclercq, 67 ans, est un ancien formateur. Il a publié dix ouvrages chez
L'Harmattan.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L
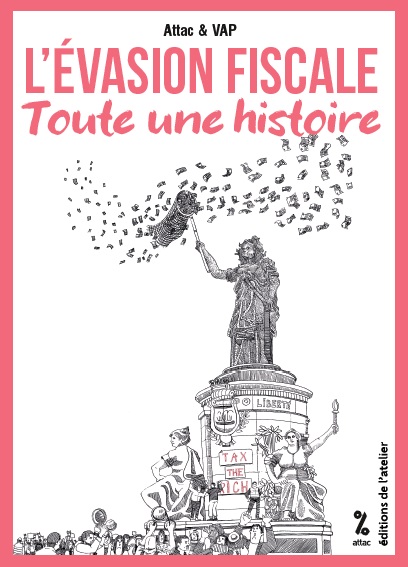
L’évasion fiscale, toute une histoire
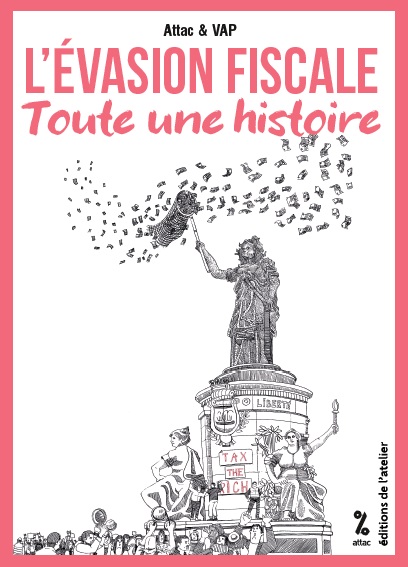
Nouveau livre d'Attac : L'évasion fiscale, toute une histoire
*A paraître* 30 aout 2024
*Le nouveau livre d'Attac et de la dessinatrice VAP*, */L'évasion fiscale, toute une histoire/ <https://adherez.attac.org/civicrm/m...> *,*sort en librairie le *30 aout*. En texte et en bande dessinée, cet ouvrage raconte l'histoire de l'évasion fiscale, décortique ses mécanismes avec humour et pédagogie et avance des pistes pour en finir avec ce fléau.*
*Le livre est d'ores et déjà disponible à la commande* *sur le site d'Attac <https://adherez.attac.org/civicrm/m...> *.
Présentation du livre
*À première vue, l'évasion fiscale apparaît comme une question bien éloignée de notre quotidien : une affaire de riches et de grandes entreprises, de pratiques obscures et complexes dans des îles lointaines et paradisiaques.
Et pourtant, cette question nous concerne toutes et tous ! Car les sommes évadées sont autant d'argent soustrait aux budgets publics, autant de moyens en moins pour nos services essentiels (santé, éducation…), ou encore pour faire face à la crise climatique.*
*En texte et en BD, avec pédagogie et humour, cet ouvrage décortique les mécanismes de ces pratiques scandaleuses, raconte l'origine et l'histoire de l'évasion fiscale, jusqu'aux affaires les plus récentes (SwissLeaks, Pandora Papers...), et revient sur les combats et mesures qui permettent, petit à petit, de la faire reculer – grâce, notamment, aux lanceurs et lanceuses d'alerte.*
*Ce livre avance également des propositions pour poursuivre la lutte contre l'évasion fiscale, qui doit s'appuyer sur des mobilisations citoyennes, la mise en place de réglementations efficaces et la création d'organismes de contrôle nationaux et internationaux. Pour que toute cette histoire ait une fin !*
**Vous pouvez* consulter ici <https://adherez.attac.org/civicrm/m...> *un extrait du livre.**
*VAP* est illustratrice et autrice de BD pour plusieurs revues et associations.
*John Christensen*, co-fondateur de Tax Justice Network, signe la postface du livre.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
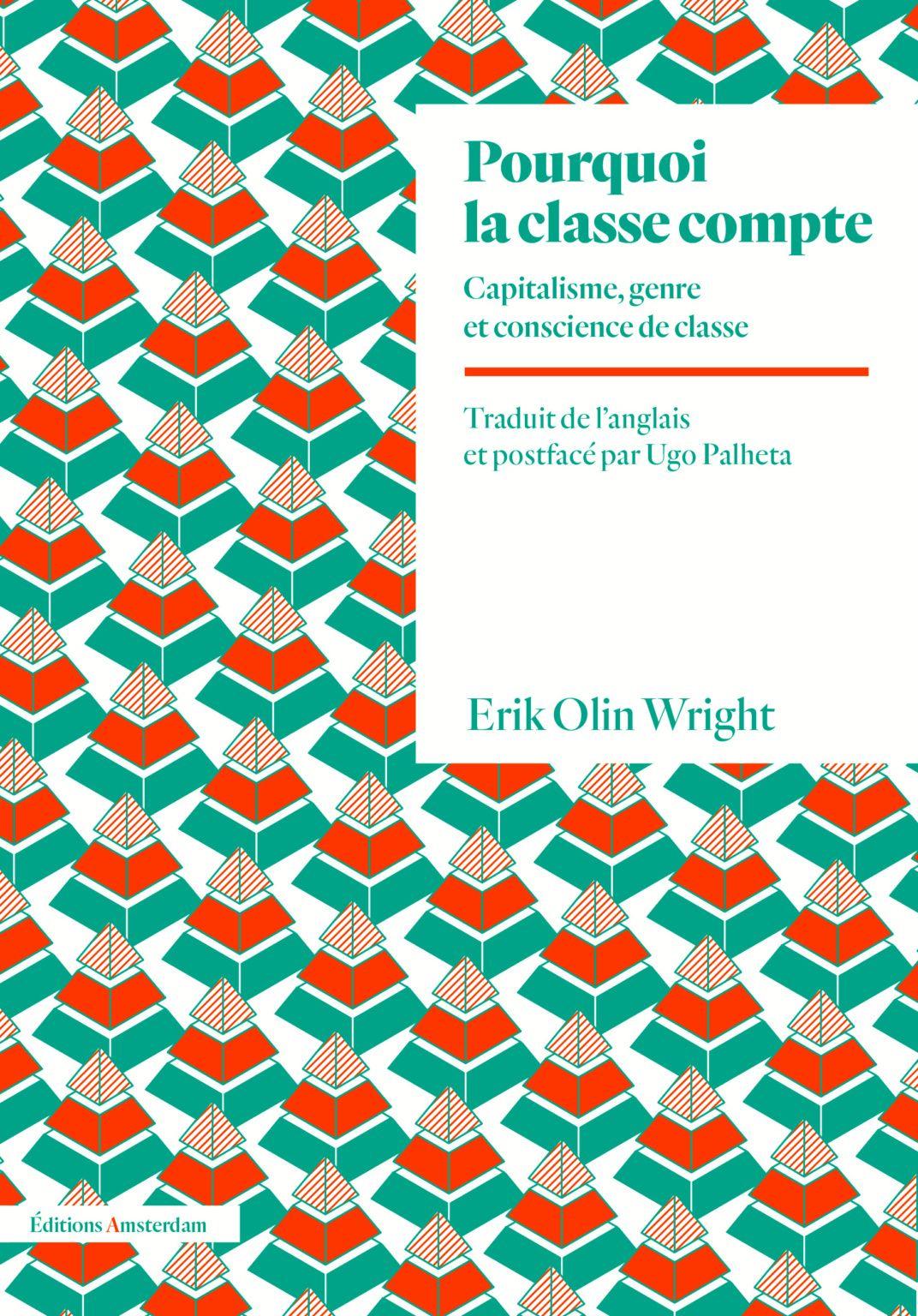
Pourquoi la classe compte. Capitalisme, genre et conscience de classe
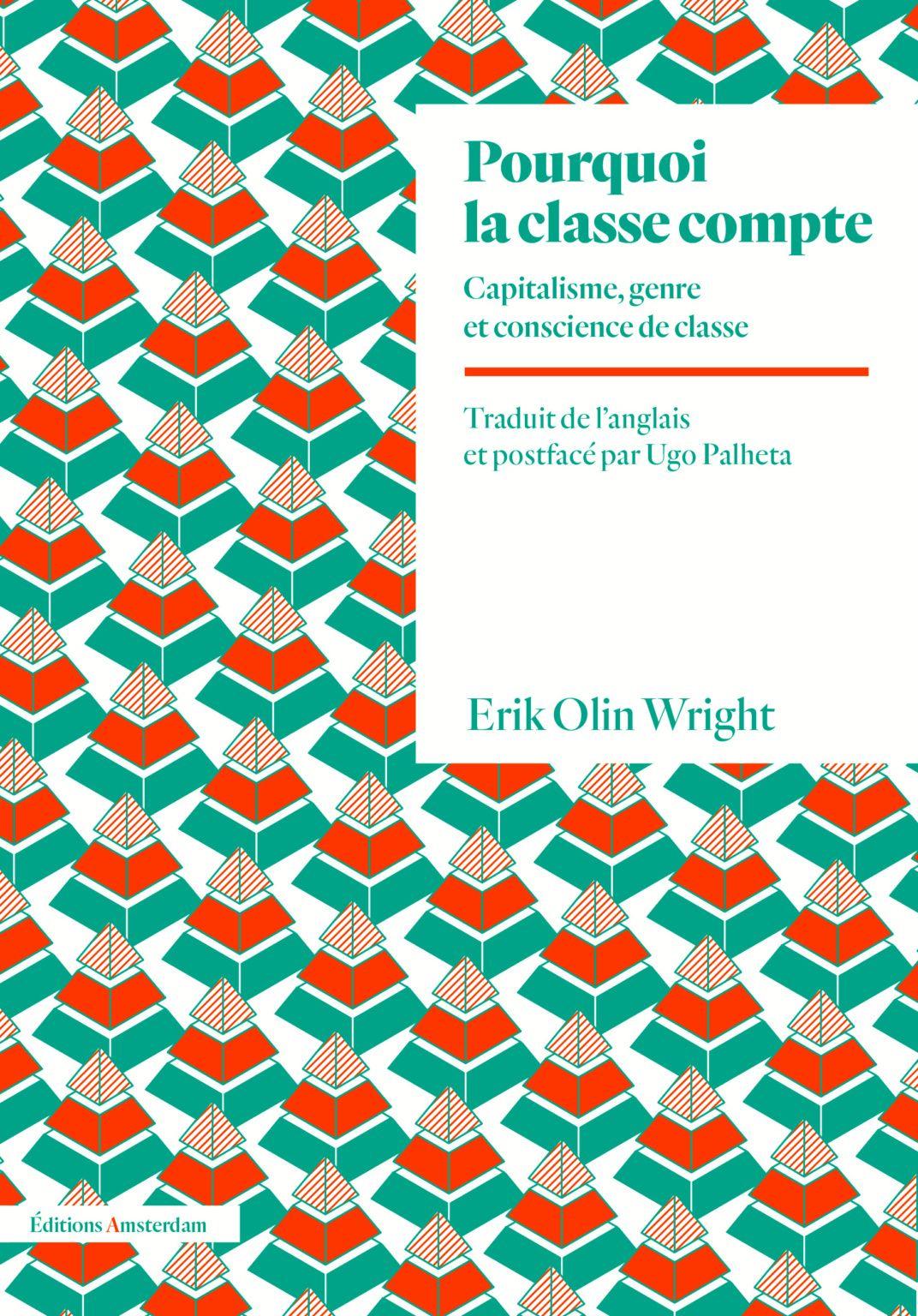
« Pourquoi la classe compte », autrement dit pourquoi la structure de classe a des conséquences sur, non seulement, les champs « macros » (évolutions et affrontements sociaux et politiques) mais sur la conscience des individus et des groupes jusqu'aux rapports interindividuels.
Tiré de Inprecor 722-223 juillet-août 2024
Par Norbert Holcblat
Erik Olin Wright, Pourquoi la classe compte. Capitalisme, genre et conscience de classe
Cet ouvrage (paru initialement en 2000) du sociologue américain Erik Olin Wright (1947-2019) apporte un éclairage original et important à l'étude des classe sociales. Edité en français en 2024, il a été traduit et postfacé par Ugo Palheta. « Le mot de classe ne sera jamais un mot neutre aussi longtemps qu'il y aura des classes » a écrit Pierre Bourdieu (1) ; la formule est juste même s'il peut paraître paradoxal de citer Bourdieu (dont la sociologie, aux apports indéniables, se différenciait du marxisme) au début d'un article consacré au livre d'un auteur qui, pour sa part, s'est durant la plus grande partie de son itinéraire, référé au marxisme tout en étant soucieux de le confronter inlassablement à la réalité.
Dans cet ouvrage, la démarche d'Olin Wright se différencie donc largement de celles de la plupart des chercheurs marxistes. Ceux-ci, comme il le note dans ses conclusions, « se fondent traditionnellement plutôt sur des méthodes historiques et qualitatives dans leurs recherches empiriques ». Cela, on le sait, a donné lieu à des travaux qui ont fait progresser la connaissance (2) . Olin Wright, pour sa part, utilise ici les méthodes de l'analyse quantitative (enquêtes par questionnaires) pour faire apparaitre en quoi la classe « compte » ou ne compte pas.
Dépasser l'analyse schématique
Mais, en préalable, il construit une structure de classe qui ne dérive pas des catégories de la population active construites, en France par exemple, par la statistique officielle (les PCS de l'INSEE en France) mais est fondée sur le marxisme et la place fondamentale des rapports de propriété et de l'exploitation (il se démarque ainsi d'autres d'analyses des classes, telles celles de Max Weber et de Bourdieu). Cela le conduit à opérer une première distinction, fondé sur la propriété des moyens de production, entre ceux qui ne peuvent subsister qu'en vendant leur force de travail et ceux qui détiennent un capital, eux-mêmes subdivisés entre capitalistes (au moins dix salariés), petits employeurs (2 à 9), petite bourgeoisie (1 au maximum).
Mais Olin Wright entend aussi et surtout analyser le conglomérat majoritaire que constituent les salariés sans adopter la solution habituelle qui consiste à regrouper dans une « classe moyenne » (parfois qualifiée de petite bourgeoisie) à géométrie et à fondements variables ceux qui ne peuvent être classés ni parmi les prolétaires ni parmi les bourgeois. Il souligne que s'en tenir au critère de la propriété des moyens de production « amène à positionner 85 à 90 % de la force de travail des pays capitalistes les plus développés dans une seule classe (la classe travailleuse). En un certain sens, cela reflète une vérité profonde concernant le capitalisme à savoir qu'une large partie de la population est séparée des moyens de production et doit vendre sa force de travail sur le marché du travail pour survivre. » Néanmoins, c'est insuffisant, « si l'on souhaite notamment que la structure de classe nous aide à expliquer la conscience de classe, la formation de classe et le conflit de classe ». Dans le schéma d'Olin Wright, la condition de salarié·e ne suffit pas à caractériser une seule position de classe. La « classe moyenne » salariée correspond à « un ensemble de positions liées au processus d'exploitation et de domination de manière contradictoire ».
Distinguer les classes sociales
Pour analyser le salariat dans sa totalité, il introduit donc deux types de distinctions : la place dans la hiérarchie et l'autorité d'une part, les qualifications d'autre part. Ainsi parmi les travailleurs « de base » non-encadrants, Olin Wright distingue trois positions selon le niveau de qualification : non qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés. Il procède de même pour les cadres supérieurs et le petit encadrement. Cela le conduit à distinguer neuf catégories parmi les salariés. Olin Wright remarque que le schéma ainsi construit n'inclut pas, par exemple, les « capitalistes qui ne sont pas techniquement des “employeurs” », c'est-à-dire ceux qui vivent essentiellement de revenus du capital sans être eux-mêmes des patrons. Mais son objectif est d'abord de construire un schéma théorique apte à être utilisé dans des enquêtes quantitatives produisant des résultats comparables dans divers pays, enquêtes qui confirmeront ou infirmeront la solidité de ses hypothèses.
Olin Wright met l'accent sur l'importance d'étudier les différences et les similitudes entre les salariés non prolétariens et les prolétaires au sens strict. Les premiers, donc, occupant des « positions contradictoires au sein des rapports de classe », à la fois exclus de la propriété des moyens mais en même temps distincts – dans une mesure plus ou moins grande – de la « classe travailleuse ». Les réponses aux questionnaires permettent d'en appréhender certaines dimensions, notamment pour ce qui est de la vision du conflit capital-travail : la « classe travailleuse », qualifiée ou non, est toujours la plus anticapitaliste et l'encadrement supérieur hautement qualifié se rattache à la coalition idéologique bourgeoise. Par ailleurs, si le degré de sentiment anticapitaliste varie selon les pays dans la « classe travailleuse » (et semble dépendre de l'importance d'organisations ouvrières indépendantes), la classe bourgeoise est partout clairement pro-capitaliste, ce qui d'une certaine façon rejoint les observations de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur la bourgeoisie française comme classe consciente et mobilisée (3).
Penser la complexité
Il faut souligner qu'Olin Wright ne s'engage pas dans le modèle ternaire avancé par certains économistes ou sociologues comme Gérard Duménil et Dominique Lévy qui font de l'encadrement une classe sociale à part et n'excluent pas que « le capitalisme pourrait laisser la place à un nouveau mode de production post-capitalisme, dit “cadrisme”, dont la classe supérieure serait celle des cadres » à moins que la lutte des classes populaires ne conduise à une alliance entre les cadres (ou certains membres de cette classe) et celles-ci (4). On peut penser que Olin Wright a eu raison de ne pas céder à ce type d'extrapolations, qui d'ailleurs n'est pas récent, tant parmi ceux qui ont pu se réclamer du marxisme comme James Burnham dans les années 1930 et 40 (5) que parmi des économistes ou sociologues non-marxistes comme d'une certaine façon John Kenneth Galbraith dans les années 1960 (6).
Dans sa postface, Ugo Palheta rappelle que certains attribuent souvent et hâtivement aux marxistes une forme de « réductionnisme de classe ». Ce travers a pu exister mais il n'est aujourd'hui en aucun cas général. En tout cas, il en innocente à raison Olin Wright. D'aucune matière, celui-ci ne soutient que la classe explique tout. S'il reconnait que le facteur racial n'est abordé que de manière sommaire dans son ouvrage (à propos des USA) et qu'il mériterait d'autres investigations, quatre chapitres du livre sont consacrés aux questions de genre.
On ne reprendra pas ici les débats actuels sur l'intersectionnalité qui mériteraient de longs développements. Sur ce point, on se bornera pour conclure à reprendre le titre de l'ouvrage : « la classe compte ». Et l'éluder conduit à des impasses, théoriques et politiques, comme le rappelle Jean-Marie Harribey dans un article récent de la revue du conseil scientifique d'ATTAC : « si l'exploitation du travail au sens du prélèvement de la plus-value par le capital ne résume pas la totalité des dominations dans la société, sans le concept d'exploitation d'une classe par une autre la société devient incompréhensible » (7).
Norbert Holcblat, le 10 mai 2024
Notes
1. Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, éditions de Minuit, 1984-1982, qui poursuit assez justement « La question de l'existence ou de la non-existence des classes un enjeu de lutte entre les classes ».
2. Nous nous contenterons ici de deux références La formation de la classe ouvrière anglaise de E.P. Thompson (The Making of the English Working Class), Le Seuil, collection Points, 2012 (édition française la plus récente) et Les ouvriers dans la société française, 19e-20e siècle, de Gérard Noiriel, Paris, Le Seuil, collection Points, 2011 (édition la plus récente).
3. M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot, Sociologie de la bourgeoisie, Collection « Repères », La Découverte, souvent réédité.
4. Gérard Duménil et Dominique Lévy ont exposé cette thèse dans de nombreux textes, voir notamment une interview à Contretemps « A propos de « La grande bifurcation ». Entretien avec Gérard Duménil et Dominique Lévy »
5. les managers. Plus tard, il devint un idéologue de l'impérialisme américain.
6. Pour ce dernier, auteur du Nouvel État industriel (1967), i l y a une forme de divorce entre la détention du pouvoir juridique (celui des actionnaires) et l'exercice réel du pouvoir par les managers, la technostructure qui a pour objectif la croissance à long terme de l'entreprise. Le néolibéralisme a asséné un coup fatal à cette hypothèse.
7. « L'invisibilisation des classes populaires ». Dans cet article plutôt polémique et avec différentes cibles mais argumenté, J-M Harribey déplore le développement exagéré à gauche d'un « fond de référence identitaire plutôt que de classe pour caractériser individus et groupes sociaux ».
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le chemin qui mène à la paix est... l’apaisement
Cette formule résume bien l'actuelle situation calamiteuse qui afflige Gaza et les Gazaouis. En effet, depuis des mois, on discute d'une trêve (toujours insaisissable) dans le conflit entre le Hamas et Israël.
Pour les Américains, il faudrait une trêve de six mois qui permettrait la libération des otages israéliens toujours détenus par le Hamas d'une part, et d'autre part de prisonniers palestiniens qui croupissent dans les sinistres prisons israéliennes. Le Hamas, lui, exige un cessez-le-feu permanent d'abord, suivi de l'élargissement des otages et des taulards palestiniens.
Pendant ce temps, le gouvernement Netanyahou continue de bombarder sans arrêt Gaza ainsi que ses opérations militaires au sol, multipliant ce qu'on appelle pudiquement les victimes civiles ; et ce, sans même mentionner la résistances croissante des Palestiniens et Palestiniennes en Cisjordanie, qui fait elle aussi l'objet de la répression israélienne. On craint, à tort ou à raison, un élargissement dangereux du conflit dans une bonne partie de la région du Proche-Orient, ce que redoute par dessus tout l'administration Biden.
Deux remarques s'imposent. L'une découle de l'autre. Tout d'abord, le gouvernement américain fait tout pour obtenir un cessez-le-feu, sauf le nécessaire : l'adoption de mesures de rétorsion contre son homologue israélien. Tant que le soutien financier et militaire américain au cabinet Netanyahou va se poursuivre, ce dernier ne verra aucun intérêt à assouplir sa position vis-à-vis du Hamas. C'est élémentaire. Biden et consorts ne l'envisagent même pas. Ils prétendent vouloir obtenir un cessez-le-feu (temporaire, répétons le, ce qui est inacceptable pour le Hamas) tout en fournissant armes et munitions à Tel-Aviv et sans s'engager sur le long terme. Cette politique complaisante durcit l'intransigeance de Netanyahou à l'égard de Gaza et nourrit le sentiment d'injustice des Gazaouis.
De toute manière, au mieux, si une trêve permanente s'établissait, cela signifierait le retour au statu quoi : Gaza redeviendrait une prison à ciel ouvert et le paupérisme continuerait d'y sévir, le tout à cause du blocus israélien.
Il faudrait plutôt procéder à l'inverse : un cessez-le-feu d'abord, suivi de négociations entre le Hamas et le gouvernement israélien. Dans une optique plus large, si on tient à régler enfin le conflit israélo-palestinien, il importerait d'engager des négociations décisives à ce sujet au plus vite après le règlement de la guerre Israël-Gaza.
Plusieurs observateurs et analystes craignent, à tort ou à raison, un élargissement du conflit à toute la région du Proche-Orient si l'affrontement Israël-Hamas perdure. En particulier. certains redoutent que Téhéran ne se dote de l'arme nucléaire pour faire contrepoids à l'État hébreu.
On ne peut souhaiter le pire, bien entendu. Mais il est permis aussi de se demander si le danger d'un tel élargissement ne forcerait pas Israël à entendre raison et par conséquent, à négocier enfin de bonne foi avec la Palestine. Tant que l'extrême-droite israélienne demeurera au pouvoir, on ne peut espérer aucun progrès dans les relations entre les deux nations.
La clé de la paix au Proche-Orient passe par la résolution du conflit israélo-palestinien. Elle ne réglerait pas tous les problèmes de cette zone, mais vu son importance symbolique auprès des populations arabes, elle contribuerait à l'apaiser. D'ailleurs, la sécurité de l'État hébreu emprunte le long chemin de son acceptation par ses voisins. Toutes les parties gagneraient à une paix durable entre ces deux entités, y compris l'Occident.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Feux dans le monde : en 1 an, des émissions équivalentes à 22 fois celles de la France

Une étude parue mercredi 14 août dans le journal Earth System Science Data, révèle que les incendies dans les milieux naturels ont provoqué à eux seuls l'émission de plus de 8,6 milliards de tonnes de CO2 dans le monde entre mars 2023 et février 2024. Ce chiffre est en hausse de 16 % par rapport à la moyenne et représente l'équivalent de vingt-deux fois les émissions de la France en 2023.
12 août 2024 | tiré de reporterre.net
Selon l'étude State of wildfires, près de 3,9 millions de kilomètres carrés sont partis en fumée. Plus fréquents et plus dévastateurs, notamment à cause des sécheresses à répétition, ces feux ont ravagé des zones entières en Amazonie (Brésil, Bolivie, Pérou, Venezuela), à Hawaï ou encore en Grèce. Athènes a une fois de plus été léchée par les flammes cet été. « L'année dernière, des feux ont tué des gens, détruit des maisons et des infrastructures, causant des évacuations de masse, menaçant les sources de revenus et endommageant des écosystèmes vitaux », alerte aussi Matthew Jones de l'université d'East Anglia, l'auteur principal du rapport. « Ces incendies deviennent plus fréquents et intenses avec le réchauffement du climat, et à la fois la société et l'environnement en subissent les conséquences », déplore-t-il.
Les émissions provenant des incendies dans les forêts boréales du Canada ont été plus de neuf fois supérieures à la moyenne des deux dernières décennies, et ont contribué à près du quart des émissions mondiales liées aux incendies. « Plus de 232 000 personnes ont été évacuées au seul Canada, ce qui souligne la gravité de l'impact humain », insiste l'étude. D'autres régions ont particulièrement souffert, notamment en Amazonie.
Selon les auteurs, le changement climatique a augmenté la probabilité de conditions météorologiques favorisant ces feux. D'après leurs calculs, le réchauffement d'origine humaine a augmenté d'un facteur 20 au moins la probabilité de conditions météorologiques propices aux incendies dans l'Amazonie occidentale.
À l'avenir, les auteurs de l'étude tablent sur une probabilité renforcée de ces incendies si l'humanité persiste à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Rien n'est encore écrit. D'après une autre étude publiée dans le journal Nature Ecology & Evolution en juin, le nombre et l'intensité des feux de forêt extrêmes ont plus que doublé dans le monde depuis vingt ans, en raison du réchauffement climatique dû à l'activité humaine.
Nous avons eu tort.
Quand nous avons créé Reporterre en 2013, nous pensions que la question écologique manquait de couverture médiatique.
Nous nous disions qu'il suffirait que la population et les décideurs politiques soient informés, que les journaux et télévisions s'emparent du sujet, pour que les choses bougent.
Nous savons aujourd'hui que nous avions tort.
En France et dans le monde, l'écrasante majorité des médias est désormais aux mains des ultra-riches.
Les rapports du GIEC sont commentés entre deux publicités pour des SUV.
Des climatosceptiques sont au pouvoir dans de nombreuses démocraties.

France - Indexation des salaires : une mesure économique nécessaire

Jonathan Marie, membre du collectif d'animation des Economistes atterrés, enseignant-chercheur en macroéconomie à l'université Sorbonne Paris Nord, défend la nécessité de restaurer l'indexation des salaires, mesure portée dans son programme par le Nouveau Front Populaire.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le Nouveau Front Populaire fait de l'indexation des salaires sur l'inflation l'une de ses mesures phares. D'un point de vue politique, cette promesse fait sens car la baisse du pouvoir d'achat est un des motifs du vote en faveur de l'extrême droite, bien que celle-ci n'ait effectué aucune proposition sérieuse pour la contrecarrer.
La promesse de l'indexation est importante : elle indique aux travailleurs que les augmentations futures des prix n'auront pas les mêmes conséquences négatives sur leur pouvoir d'achat que celles enregistrées depuis 2021.
L'indexation des salaires est-elle pour autant justifiée économiquement ?
Oui, dans la situation économique actuelle qui n'est pas celle des années 1970 : le pouvoir de négociation des travailleurs est affaibli. Cet affaiblissement s'est accompagné d'une diminution de la part des revenus du travail dans le PIB, aujourd'hui à un niveau historiquement faible. L'inflation récente a encore accru cette distorsion.
L'indexation fournit dès lors un filet de sécurité : le pouvoir d'achat lié aux revenus du travail serait stabilisé par l'indexation, un mécanisme légal et automatique, alors que les travailleurs ont progressivement perdu la capacité d'obtenir collectivement, par la négociation, des augmentations de salaires. En soutenant ainsi le pouvoir d'achat, l'indexation réduit les risques d'une récession économique, qui s'accompagnerait d'une augmentation du chômage. L'indexation généralisée limite aussi la smicardisation de l'économie française (le rattrapage au niveau du Smic de nombreux salaires du bas des grilles de rémunération, car le Smic est lui indexé) : la Dares a évalué à la fin de 2023 que 17,3% des salariés français étaient rémunérés au Smic, contre 12% en 2021 et 14,5% en 2022.
L'indexation est une mesure défensive : ce n'est pas elle qui provoque l'augmentation des prix. Il n'y a donc pas lieu de craindre une fameuse boucle prix-salaires. D'ailleurs, les économies européennes comme la Belgique, qui ont conservé contrairement à la France une indexation généralisée, n'ont pas connu de trajectoire inflationniste foncièrement différente depuis 2021 [1].
L'indexation se justifie aussi sur un horizon de plus long terme par le fait que l'inflation récente est due à des évènements externes, en particulier la difficile reprise de la production mondiale après la crise sanitaire et les évènements géopolitiques comme la guerre en Ukraine. Ces chocs de prix peuvent s'accompagner de boucles prix-profits, révélant que les plus grandes entreprises sont en mesure d'augmenter leurs profits.
L'inflation est surtout liée à la trop forte dépendance de nos économies à la globalisation. Cette dépendance excessive s'exprime aussi par les pénuries de médicaments, ou par les dégâts environnementaux liés aux transports des marchandises au long cours. Réduire la probabilité que de nouvelles vagues inflationnistes se produisent nécessite donc de relocaliser certaines activités et de limiter la dépendance aux matières premières importées (notamment énergétiques). Cette évolution doit se faire en articulation avec les impératifs écologiques. Elle requiert des investissements massifs, publics comme privés, qui doivent être financés. Pour cela, la politique monétaire de la Banque centrale doit être accommodante, menée de manière à limiter le niveau des taux d'intérêt directeurs. Or, la BCE a répondu à l'inflation récente en augmentant les taux d'intérêt, affaiblissant la possibilité de financer les investissements indispensables à la bifurcation. Elle veut freiner l'inflation par le ralentissement de l'économie : comme les salariés sont moins en mesure d'obtenir des hausses de salaires, à cause de la montée du chômage, les entreprises sont moins tentées d'augmenter les prix si la demande se trouve réduite. Mais les causes structurelles de l'inflation ne sont pas corrigées : de nouvelles augmentations des prix des biens importés provoqueront à nouveau des vagues inflationnistes !
Une telle politique monétaire serait justifiée, selon ses promoteurs, par le fait que l'inflation doit être combattue pour limiter les pertes de pouvoir d'achat. Mais si les salaires sont indexés, comme on l'a déjà écrit, les effets sur le pouvoir d'achat des travailleurs sont amortis et l'argument en faveur d'une politique monétaire qui génère de la stagnation économique et du chômage, et qui est contradictoire avec les financements des investissements écologiques, tombe.
L'indexation des salaires est alors aussi légitimée par le fait que c'est une mesure qui s'articule avec la bifurcation écologique qui requiert, pour être financée, une politique monétaire qui n'ait pas pour objectif de créer du chômage pour lutter contre l'inflation. La transformation de nos modes de production et de consommation pourrait générer ponctuellement des tensions inflationnistes qui ne doivent pas peser sur les salariés. Attaquer sérieusement les causes de l'inflation exige bien des mesures de réduction de la dépendance aux importations, pas une politique monétaire restrictive.
L'indexation des salaires est un outil légal de défense des revenus du travail. L'indexation des salaires est actuellement prohibée par le code monétaire et financier (voir les articles L.112-1 à L112-4). Modifier ce cadre règlementaire et légal pour indexer les salaires réduirait la capacité des dirigeants des entreprises à augmenter leurs profits au détriment des revenus du travail en cas de choc de coût sur les importations. Activer cette possibilité est nécessaire car l'inflation est toujours l'expression de rapports sociaux concernant la répartition du revenu. A fortiori dans les périodes de fortes turbulences économiques et sociales comme actuellement, le libre fonctionnement du marché n'est pas en mesure de stabiliser le pouvoir d'achat et de faciliter une répartition moins injuste socialement. C'est à la politique macroéconomique et sociale d'exercer cette fonction d'autant plus indispensable que, dans un monde soumis au changement climatique, l'inflation pourrait être durablement plus élevée que les niveaux auxquels on s'était habitué depuis les années 1990.
Pour maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs et permettre le financement d'un réel engagement contre les dégradations environnementales, l'indexation des salaires est un instrument de la politique économique qui doit être activé et qui limitera les effets des contraintes de tous ordres que va imposer la nécessaire bifurcation écologique.
[1] Selon Eurostat, si en mai 2024 le taux d'inflation estimé par l'IPCH est de 4,9 % en Belgique contre 2,6 % en France comme dans la zone Euro, en moyenne depuis janvier 2022, l'inflation a été de 6,16 % en rythme annuel chaque mois dans la zone Euro pour 5,88 % en Belgique et 5,27 % en France.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Discussion avec des militant·es pour la solidarité ouvrière entre les Etats-Unis et la Chine

L'idée de solidarité elle-même est relativement jeune, puisqu'elle est principalement issue de la révolution industrielle. Bien sûr, les communautés se sont soutenues mutuellement pendant la plus grande partie de l'histoire, mais le mot et la pratique de la solidarité telles que nous les concevons aujourd'hui sont un phénomène assez récent. Elle est née du sentiment que les gens sont tributaires les uns des autres, non seulement pour des raisons morales ou politiques, mais aussi pour des raisons économiques, grâce au développement du capitalisme.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Andrew Sebald : Merci à toustes d'être présent·es. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en matière d'organisation des travailleurs en Chine ?
Ellen David Friedman : Je suis une syndicaliste à la retraite. J'ai travaillé pendant une cinquantaine d'années dans le mouvement syndical américain, mais j'ai aussi vécu et travaillé pendant dix ans en Chine. J'ai été poussée par un besoin impérieux d'essayer de comprendre ce qui se passait en Chine après l'« ouverture » de Deng Xiaoping dans les années 1990. J'ai également milité dix années durant au sein du mouvement ouvrier à différents niveaux. Aux États-Unis, je suis principalement engagée dans le cadre du site de Labor Notes, dont j'ai l'honneur d'être la présidente du conseil d'administration.
Je suis partie en Chine il y a environ vingt-cinq ans. J'étais motivée pour m'y rendre parce que j'étais une fervente partisane de la révolution chinoise. J'avais été impressionnée et fascinée par certaines des premières réalisations de la révolution, mais j'ai ensuite vu comment les choses ont évolué. J'ai constaté des virages terrifiants vers l'autoritarisme, la mise à l'écart de la classe ouvrière, etc. À ce moment-là, j'avais près de quarante ans d'expérience dans le mouvement syndical américain, dans divers secteurs, de l'industrie manufacturière à l'enseignement public. J'étais consternée par ce que le néolibéralisme avait provoqué dans ce pays : la perte de substance de nos syndicats qui abandonnaient toute référence au pouvoir des travailleurs, et leur virage vers le recours à l'État pour résoudre les contradictions du capitalisme. Pour moi, ce n'était pas une voie qui pouvait permettre d'avancer, et j'ai donc voulu voir quelque chose de différent.
Ce que j'ai vécu en Chine a coïncidé avec une période de libéralisation conduite par Hu Jintao et Wen Jiabao, au cours de laquelle les militants étrangers ont été tolérés dans des proportions notables. J'ai pu vivre et enseigner dans une université de Guangzhou, l'université Sun Yat-Sen, où j'ai créé un centre international de recherches sur le travail. Ce centre a été subventionné pendant quatre ou cinq ans et a permis de promouvoir les échanges de militants syndicaux. Beaucoup de gens affluaient en Chine, en particulier dans le delta de la rivière des Perles, qui était devenu « l'usine du monde ». Il y avait des milliers de grèves en permanence dans des milliers d'usines. C'était passionnant, et nous avons pu faire de ces situations des sujets de recherche. Il y a eu une brève période pendant laquelle nous pouvions à la fois mener des recherches et échanger avec les travailleurs directement sur le lieu de travail, en rencontrant les gens dans leurs dortoirs, dans leurs usines, dans des lieux publics, et organiser des formations et des stages pour les animateurs de ces mouvements. Des gens venaient du monde entier pour faire des recherches dans ce domaine. C'était très fructueux et passionnant.
Puis Xi Jinping est arrivé au pouvoir et les murailles se sont refermées sur nous. En 2013 ou 2014, notre centre a été fermé. Nous n'étions plus en mesure d'inviter des étrangers. J'ai été arrêté par la direction de la sécurité nationale et on m'a demandé de quitter le pays. Depuis 2015, j'essaie de trouver des moyens de créer une solidarité ouvrière entre les États-Unis et la Chine dans des conditions extrêmement difficiles.
Kevin Lin : J'ai commencé à m'intéresser aux questions de travail en Chine entre 2009 et 2010. Ces années ont été des moments importants dans l'histoire récente du monde du travail en Chine du point de vue de l'ampleur des luttes ouvrières. J'ai eu la chance d'être attiré par le mouvement ouvrier en Chine à une époque où il y avait des luttes ouvrières dynamiques.
J'ai terminé mon diplôme de premier cycle vers 2009 – 2010. Je lisais tous les jours des informations sur les dernières nouvelles du monde du travail en Chine, qu'il s'agisse des grèves, des réformes sociales ou des catastrophes. À cette époque, les relations au travail évoluaient rapidement et les luttes des travailleurs s'intensifiaient. Je faisais partie d'une génération de jeunes qui étaient attirés par le mouvement ouvrier chinois en raison de ces luttes. Une mutation des consciences s'opérait, les Chinois ne considérant plus les travailleurs migrants ruraux comme de simples victimes d'un système oppressif. C'est au cours de cette période, entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, que la population a véritablement changé d'attitude, passant de la sympathie à la solidarité. Les Chinois ne se contentaient pas de plaindre les travailleurs migrants, ils voulaient les rejoindre dans leur lutte. C'est ce type de solidarité là qui a émergé au cours de cette période. C'est le type de solidarité auquel je crois aujourd'hui, au-delà de la sympathie de nature morale à l'égard des victimes de mauvaises conditions de travail.
Alex Tom : Je me décrirais comme un activiste et un organisateur de mouvements depuis plus de 25 ans. J'ai fait partie de la Chinese Progressive Association (CPA) à San Francisco pendant plus de 15 ans. La CPA, qui a vu le jour au début des années 70, a créé de nombreuses branches et sections dans tout le pays. La CPA a joué un rôle clé dans la communauté des immigrés chinois en réclamant la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine et en soutenant fermement la révolution chinoise. C'était une chose particulièrement difficile à faire dans Chinatown, qui à l'époque était principalement contrôlé par le Kuomintang (KMT).
Notre communauté a une tradition de coopération d'individu à individu qui fait partie de notre patrimoine. Il est également important de se rappeler que des travailleurs chinois vivaient et travaillaient aussi aux États-Unis, et que de nombreux fondateurs de la CPA étaient des travailleurs sans papiers. C'est important parce que nous voyons maintenant le potentiel d'organisation de la diaspora ici aux États-Unis.
De nombreuses scissions se sont également produites au sein de l'organisation au cours des cinquante dernières années. L'une des plus importantes a été provoquée par le massacre de la place Tiananmen. Notre organisation et d'autres sections du CPA ont décidé de soutenir les étudiants et les travailleurs. Tout le monde à gauche n'a pas défendu cette position, mais il y a eu incontestablement des militants de gauche et des organisations de masse qui l'ont fait. Ce clivage est très important car certains pensent que la diplomatie « de peuple à peuple » consiste à soutenir inconditionnellement les positions des gouvernements révolutionnaires. Mais nous devons continuer à garder les pieds sur terre et à travailler avec quiconque se fait l'expression des opinions des travailleurs, qu'elle soit au pouvoir ou non.
Lorsque j'ai commencé à travailler pour le CPA en 2004, j'ai rencontré Ellen et, plus tard, Kevin. La Chine entrait dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui marquait une étape importante dans le processus de mondialisation. En 2005, nous avons ressenti le besoin de faire venir des travailleurs chinois, des étudiants et des jeunes des États-Unis pour protester contre la réunion annuelle de l'OMC qui se tenait cette année-là à Hong Kong. Alors que beaucoup considèrent les manifestations de Seattle en 2000 comme la grande percée du mouvement antimondialisation, pour de nombreux Asiatiques, ce sont les manifestations de 2005 à Hong Kong qui ont été déterminantes. C'était la première fois que les communautés d'immigrés chinois critiquaient ouvertement la mondialisation et se mobilisaient contre elle. Certains ont perçu cela comme un « dénigrement de la Chine » au sein de notre propre communauté et parmi nos propres membres. Bien sûr, cela a changé après que nous avons organisé une plus importante campagne de sensibilisation sur les conditions de travail en Chine et dans d'autres parties de l'Asie.
La CPA existe depuis bien des décennies et a connu diverses conjonctures politiques et diverses luttes idéologiques dans ses rangs. À la fin des comptes, c'est de cette manière que nous avons maintenu notre mission et nos valeurs, en nous efforçant de refléter la conscience du peuple. Ensemble, ils ont intégré la délégation de la WT-NO, qui comprenait plus de 40 dirigeant.e ;s de Los Angeles, Philadelphie, New York et d'autres villes des États-Unis.
Au cours de l'été 2010, le CPA a organisé une veillée commémorative devant le magasin Apple de San Francisco à la mémoire des travailleurs de Foxconn qui s'étaient suicidés. Foxconn est le plus grand fabricant d'électronique au monde et l'un des principaux fabricants de produits Apple. Les conditions de travail dans l'usine sont si dures pour les jeunes travailleurs que des dizaines d'entre eux ont tenté de se suicider, mais les nombreuses actions menées pour augmenter les salaires n'ont toujours pas permis d'améliorer les conditions de travail.
Andrew : Quelles sont les points communs entre les conditions de travail auxquelles sont confrontés les travailleurs américains et chinois ?
Ellen : Après m'être installée en Chine et m'être frottée à la complexité de ses strates sociales, j'ai réalisé que la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) est avant tout une instance gouvernementale plutôt qu'une organisation de masse représentant les intérêts de la classe ouvrière. Sous la pression du néolibéralisme, l'ACFTU, même si elle a une taille énorme et possède de nombreuses ressources, est devenue une organisation creuse et verticalisée, tout à fait éloignée des besoins de ses adhérent.e.s de base. Ceux et celles d'entre nous qui pensent que les syndicats devraient être des lieux où les travailleurs apprennent à se battre pour les intérêts de la classe ouvrière comprennent que les relations patronales-syndicales sont de nature conflictuelle. Mais cette conception est totalement absente au sein de l'ACFTU. Lorsque je suis retournée aux États-Unis, j'ai constaté des problèmes similaires dans bon nombre de nos syndicats. Bien entendu, tous les syndicats américains ne sont pas des coquilles vides, et la récente poussée syndicale a clairement révélé l'existence en profondeur d'un courant favorable à des réformes démocratiques. Toutefois, aux États-Unis comme en Chine, les dirigeants syndicaux ont tendance à être très dirigistes, conservateurs, bureaucratiques et à privilégier les bonnes relations avec les responsables politiques plutôt qu'avec les travailleurs. En Chine, toute initiative prise par des travailleurs de la base pour se regrouper de manière indépendante au sein des syndicats est sévèrement réprimée, et la perspective de syndicats dirigés de manière démocratique semble très lointaine.
Kevin : Au cours des vingt ou trente dernières années, le développement économique de la Chine s'est opéré par une industrialisation axée sur l'exportation. Des usines ont poussé partout en Chine, les travailleurs ruraux ont migré vers les villes et l'industrialisation à bas salaires et à faible niveau de qualification a été le moteur de l'économie chinoise. Le cœur des luttes ouvrières en Chine se trouvait au sein de la classe ouvrière industrielle. Ce n'était pas le cas des États-Unis à l'époque. À ce moment-là, le pays s'était déjà désindustrialisé au cours des vingt ou trente années précédentes. Je me souviens d'avoir participé à des réunions avec des délégations de travailleurs chinois et des activistes avec des syndicalistes américains, et les travailleurs américains, tout en exprimant leur intérêt et leur solidarité, avaient du mal à comprendre les luttes de la classe ouvrière chinoise parce que les Américains venaient principalement du secteur des services. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins de décalage entre les classes ouvrières américaines et chinoises. La Chine est en train de vivre le début de sa propre phase post-industrialisation, et de plus en plus de jeunes Chinois sont des cols blancs qui s'orientent vers les secteurs de la technologie et des services. Les travailleurs chinois sont de plus en plus nombreux à avoir une vision sombre de leur avenir, à l'instar de ce que les travailleurs américains ont pu ressentir il y a de nombreuses années.
Je pense que la meilleure façon pour les travailleurs de construire la solidarité est d'avoir des échanges d'expériences sur des situations concrètes. Bâtir la solidarité sur la base d'abstractions moralisantes n'est pas une démarche qui peut s'inscrire dans la durée, cela ne permet pas d'organiser efficacement les travailleurs. Maintenant que les classes ouvrières américaines et chinoises commencent à connaître des luttes de même nature, un espace est en train de se dessiner où elles pourront s'organiser ensemble.
Alex : J'aimerais ajouter à cela une anecdote personnelle. Dans notre délégation du WT-NO, nous avions des travailleurs de Chinatown, dont l'une avait travaillé dans le secteur de l'habillement pendant la révolution culturelle. Avant notre voyage, les membres de notre délégation éprouvaient un sentiment de fierté à l'égard de la Chine. Nous critiquions la mondialisation et ils nous disaient souvent que nous devrions être plus « dialectiques » à ce sujet. Même si la mondialisation peut avoir des effets néfastes, il était difficile de ne pas être patriote au regard de l'ascension fulgurante de la Chine sur la scène internationale. Lorsqu'ils ont visité la Chine, ils n'ont pu que constater le développement rapide et la modernisation de leurs villes d'origine. De nombreux membres de la délégation ont cru que nous mentions sur les conditions de travail des ouvriers, estimant que nous étions trop sensibles à la rhétorique anti-chinoise. Toutefois, peu de temps après, nous nous sommes rendus dans la zone économique spéciale (ZES) de Shenzhen et les membres de la délégation ont été choqués de constater à quel point les conditions de travail étaient mauvaises. L'ouvrière qui avait travaillé dans une usine de coton pendant la révolution culturelle a rappelé que son salaire minimum était beaucoup plus élevé que dans les usines de la ZES. Elle était scandalisée par le fait que les salaires étaient si bas.
Andrew : Y a-t-il eu d'autres initiatives importantes de solidarité ouvrière entre les États-Unis et la Chine au cours des dernières décennies ? En quoi peuvent- elles nous donner des indications sur les formes que prendra cette solidarité à l'avenir ?
Ellen : Depuis 20 ans que je mène ce travail, le point culminant de la solidarité entre les États-Unis et la Chine a été pour moi la grève des dockers de Hong Kong en 2013. C'est un petit groupe de grutiers qui a lancé la grève. Bien que peu nombreux, ils étaient hautement qualifiés, de sorte que lorsqu'ils cessaient de travailler, tout le reste s'arrêtait également. La grève s'est rapidement étendue. À Hong Kong, les deux syndicats étaient alors en conflit. L'un était la Fédération des syndicats de Hong Kong (HKFTU), étroitement associée à l'ACFTU du continent et traditionnellement plus docile. L'autre était la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), favorable à la démocratie, qui a dû se dissoudre après la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale en 2020. Tous deux étaient présents, mais le dynamisme des dockers associés à la HKCTU était si grand et si convaincant qu'il a rapidement gagné un large soutien extérieur. Des étudiant.e.s, des membres d'organisations socialistes et des militant.e.s d'autres syndicats se sont regroupés pour soutenir les dockers. La mobilisation de l'opinion publique à cette échelle était incroyable.
J'étais alors à Guangzhou, ce qui m'a permis de faire des allers-retours entre Guangzhou et Hong Kong pour suivre la grève. À mon retour aux États-Unis, nous avons organisé une tournée de conférences pour les dirigeants du syndicat des dockers. Ils ont commencé par prendre part à la conférence de « Labor Notes » en 2014, puis ils ont fait une tournée éclair destinée à obtenir le soutien des syndicats de dockers de la côte ouest. C'était assez intense, mais nous avons fait le tour de tous les ports de la côte ouest où le syndicat International Longshore and Warehouse Union (ILWU) est représenté. L'ILWU a une longue histoire de syndicalisme internationaliste, c'est l'un des rares syndicats américains à avoir cette tradition. L'ILWU a organisé des discussions avec ces militants à Los Angeles, Oakland, Tacoma, Portland et dans d'autres ports encore. Ils ont collecté beaucoup d'argent pour couvrir les frais de grève. Nous avons également rencontré plusieurs groupes affinitaires et communautaires, comme le CPA. On pouvait sentir que les situations comparables vécues par les travailleurs, même si leurs syndicats étaient différents, leur permettaient de comprendre tout ce qu'il y avait de semblable et de se rendre compte du pouvoir qu'ils avaient sur le mouvement mondial du capital. C'était très impressionnant.
Je dois dire que ce genre de chose est au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Nous devons faire preuve d'une grande modération dans nos appréciations et nos attentes en ce qui concerne les possibilités de contact entre travailleurs. À l'heure actuelle, toute personne qui arriverait de Chine et prendrait publiquement position en faveur du militantisme ouvrier serait en grand danger à son retour dans son pays. Inutile de dire que ces personnes veulent éviter de s'exposer à un tel danger, si bien que de tels scénarios ne se présentent pas à nous pour l'instant.
Alex : Dans le prolongement de ce qu'a dit Ellen, le fait d'organiser des échanges de travailleur à travailleur a modifié qualitativement notre base aux États-Unis, car beaucoup parmi eux avaient peur de s'exposer. Cependant, après avoir vu comment les dockers de Hong Kong ou de jeunes travailleuses s'étaient organisés, j'ai entendu certaines de ces mêmes personnes aux États-Unis dire : « Hé bien, s'ils peuvent le faire, nous pouvons le faire aussi ». Il se crée quelque chose de très fort lorsque les gens voient la réalité de la lutte et de la contestation en Chine.
Je tiens également à souligner que le travail organisationnel se poursuit en Chine. Cependant, comme l'a dit Ellen, il est important d'avoir une évaluation sobre de ce qui est possible en Chine. Il faudra peut-être des décennies avant que les conditions ne changent. Pour aller de l'avant, il faut bien évaluer le moment présent et penser l'importance de l'organisation de la diaspora. Il y a des centaines de milliers de Chinois expatriés parmi nous. Certains d'entre eux ont participé à des mouvements en Chine, et l'une des propositions que je fais au sein de la communauté américaine d'origine asiatique est de faire participer ces étudiant.e.s chinois.e.s à l'étranger au sein de nos mouvements et de nos communautés. Ils ont besoin d'un espace qui leur permette de bâtir et de développer des stratégies autour de questions politiques : le travail, les questions de souveraineté et de démocratie en Chine, le climat, le féminisme, et bien d'autres choses encore. Nous devons donc créer un espace de réflexion stratégique qui leur permette de lutter, de construire et d'établir des liens avec d'autres mouvements.
Kevin : Je voudrais conclure par quelque chose d'un peu plus abstrait. J'ai lu deux livres récemment publiés sur la question de la solidarité. L'un est Struggle and Mutual Aid in the Age of Working Solidarity (Other Press, 2023) de Nicholas Delalande, qui est une histoire de la Première Internationale. Ce livre relate comment des liens ont été tissés entre les classes ouvrières européennes et américaine afin de dépasser les frontières nationales et d'établir des relations profondes entre elles. L'autre livre est Solidarity : The Past, Present, and Future of a World-Changing Idea de Leah Hunt-Hendrix et Astra Taylor (Penguin Random House, 2024). Ce livre nous apprend que l'idée de solidarité elle-même est relativement jeune, puisqu'elle est principalement issue de la révolution industrielle. Bien sûr, les communautés se sont soutenues mutuellement pendant la plus grande partie de l'histoire, mais le mot et la pratique de la solidarité telles que nous les concevons aujourd'hui sont un phénomène assez récent. Elle est née du sentiment que les gens sont tributaires les uns des autres, non seulement pour des raisons morales ou politiques, mais aussi pour des raisons économiques, grâce au développement du capitalisme. L'idée est que nous devons être redevables les uns envers les autres sur le plan matériel pour nous soutenir mutuellement.
Cet aspect matériel est important car la Première Internationale a démontré que la solidarité consiste pour les travailleurs à arracher le contrôle de l'économie aux capitalistes et à l'État capitaliste. Le livre m'a fait réfléchir encore plus sur ce que signifie la pratique de la solidarité, et sur la façon dont elle a pu faillir ou sur les endroits où elle a échoué. La solidarité ne se manifeste pas seulement par des manifestations de soutien visibles ; elle se construit également à travers des traductions au quotidien, une compréhension profonde des luttes des uns et des autres, et l'établissement de relations à long terme. Ce sont les fondations solides sur lesquelles nous pouvons construire notre solidarité.
Ellen : tu as bien préparé le terrain pour un point que j'aimerais ajouter, Kevin. Lorsque nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles de nombreuses personnes vivent en exil ou sont soumises à des contraintes incroyablement restrictives dans leur pays, nous pensons souvent que cet isolement constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une forme matérielle de solidarité. La forme la plus cruciale de solidarité est celle où les gens continuent à développer un ensemble de valeurs et d'outils analytiques pour évaluer la réalité et pour s'engager dans une certaine perspective sur la durée, quelles que soient les conditions qui les entourent à un moment donné. J'en ai vu de beaux exemples. Lors de la dernière conférence de Labor Notes, il y avait des personnes du monde entier qui ont mis en pratique le syndicalisme démocratique, même dans des situations où elles étaient confrontées à des conditions de plus en plus restrictives. Nous constatons une formidable soif de pratiques radicalement démocratiques, qui ne se limitent pas au vote, mais qui permettent d'apprendre à se comporter les uns avec les autres de manière fondamentalement respectueuse. Ce mouvement de solidarité en matière de convictions et d'objectifs, qui se construit au-delà des distances, sera une forme de puissance durable et pérenne qui se développera à mesure que nous avancerons.
David Friedman, Alex Tom, Kevin Lin, Andrew Sebald
https://newpol.org/issue_post/activists-on-u-s-china-labor-solidarity/
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL.
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71713
Cina, la solidarietà sindacale internazionale
https://andream94.wordpress.com/2024/08/21/cina-la-solidarieta-sindacale-internazionale/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le genre et la classe ouvrière chinoise

Pour l'exposé d'aujourd'hui, je me concentrerai principalement sur les conditions des travailleuses et Olia parlera davantage de l'auto-organisation et des ONG. Une partie de la discussion s'appuiera sur mon propre travail de terrain en Chine pendant la pandémie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Zoe Zhao
Pour comprendre les relations hommes-femmes dans la classe ouvrière chinoise d'aujourd'hui, nous devons d'abord examiner la manière dont les chaînes de production sont organisées. Au-delà des grandes usines, les petits ateliers familiaux sont les principaux fournisseurs des grandes plateformes de commerce électronique en Chine. Dans l'industrie chinoise du commerce électronique et de la mode rapide, qui est de plus en plus intégrée à la chaîne d'approvisionnement mondiale avec l'essor des deux plateformes chinoises d'achat en ligne Shein et Temu, ce modèle de production familiale s'est considérablement intensifié au lieu de s'affaiblir. Les bénéfices de Temu et de Shein sont plutôt bons. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles intensifient la concurrence entre les petits ateliers et sélectionnent le fournisseur le moins cher, qui a également tendance à avoir des pratiques d'exploitation de la main-d'œuvre plus importantes.
De nombreux ateliers familiaux sont regroupés dans des villages urbains où le loyer et la nourriture sont abordables, et les travailleurs et les travailleuses vivent parfois à proximité de leur atelier, voire à l'intérieur de celui-ci. Le problème des ateliers familiaux est qu'ils sont plus susceptibles de refléter la division sexuée du travail existant dans les familles patriarcales traditionnelles. Par exemple, dans ces ateliers, les femmes ont tendance à s'occuper de la cuisine, des courses et de la lessive, tandis que les hommes effectuent des tâches plus lourdes, telles que l'utilisation et la coupe des « tables » (les grandes surfaces planes utilisées dans l'industrie de la confection pour disposer, mesurer et couper le tissu). Les études menées par Nellie Chu, de Duke, sur les ateliers de confection ont montré qu'en raison d'une oppression commune, les ouvrières de différentes régions sont plus susceptibles de se lier les unes aux autres et même de développer un sentiment de solidarité avec les femmes propriétaires d'usine, ce qui est très différent des ouvriers qui sont souvent séparés par leur ville d'origine. Les recherches menées par Lin Zhang, de l'université du New Hampshire, révèlent la marginalisation des tisseuses rurales dans le commerce électronique. Elles se situent au plus bas de la chaîne d'approvisionnement et peuvent à peine réaliser des bénéfices.
En règle générale, les professions féminisées sont moins bien rémunérées que les professions masculines. De nombreuses industries de services dans les zones urbaines, en particulier les plus récentes telles que les boutiques de thé à bulles, attirent de jeunes travailleuses qui veulent se rapprocher du mode de vie urbain ou qui sont rejetées par les usines. J'ai vu une offre d'emploi dans un salon de thé à bulles de Shenzhen à la fin de l'année 2020 qui indiquait 3800 RMB (environ 526 $) comme salaire de départ pour une nouvelle travailleuse, ce qui est beaucoup plus élevé que le salaire de base de Shenzhen Foxconn (2650 RMB) – mais n'offre pas de rémunération pour les heures supplémentaires comme le travail en usine. Par conséquent, le revenu net et les avantages sociaux sont inférieurs à ceux des usines. De nombreuses travailleurses du secteur des services s'expriment sur leurs conditions de travail sur les réseaux sociaux. En plus de décrire la nature laborieuse du travail, elles disent aussi que le revenu réel peut être bien inférieur à ce qui a été promis, car de petites erreurs peuvent entraîner des pénalités supplémentaires sur le salaire.
En raison de l'essor des plateformes numériques et de la baisse des salaires dans les usines et dans le secteur des services urbains, les travailleurs et les travailleuses des plateformes, comme les livreurs/livreuses de repas (plus de 13 millions de personnes à l'heure actuelle), occupent une part de plus en plus importante de la main-d'œuvre en Chine, tout comme dans la plupart des autres pays. En Asie, la livraison de repas sur plateforme est un travail essentiellement masculin. Toutefois, depuis la pandémie, le nombre de femmes livreuses a augmenté de façon spectaculaire au niveau national. Environ 10% des livreurs de repas en Chine sont des femmes, et ce pourcentage est plus élevé dans les grandes villes. Le groupe de recherche de Ping Sun a estimé que le pourcentage de femmes livreuses est passé de 9% en 2020 à plus de 16% e 2021. Autre fait intéressant, les femmes sont généralement plus âgées que les hommes, car beaucoup d'entre elles ont été licenciées du secteur traditionnel des services. Dans l'ensemble, les livreuses souffrent également d'un écart de revenus et d'un harcèlement accru de la part des clients et des autres travailleurs. Pour ces raisons, nombre d'entre elles ne rejoignent pas les groupes d'entraide en ligne organisés par les livreurs, qui constituent le principal mode de communication entre les livreurs en Chine.
Il existe également une division notable du travail en fonction du sexe entre l'économie des plates-formes virtuelles et celle des plates-formes sur site. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de travailler dans des secteurs virtuels tels que la diffusion en direct et le service clientèle en ligne. De nombreuses travailleuses considèrent le travail à distance comme une option plus sûre. Dans mes propres recherches, de nombreuses femmes reconnaissent que le harcèlement sexuel endémique est l'un des principaux facteurs qui les poussent à éviter les emplois de service sur site.
Une autre tendance connexe est l'absorption de la main-d'œuvre féminine rurale excédentaire dans les nouvelles chaînes d'approvisionnement. Les travailleuses qui rentrent chez elles dans les provinces intérieures telles que le Henan et le Gansu constituent une partie essentielle de l'industrie de l'étiquetage des données qui stimule la production mondiale d'IA. Les gouvernements locaux encouragent nombre de ces initiatives dans le cadre de campagnes de lutte contre la pauvreté. Compte tenu de la forte demande des entreprises mondiales d'IA, il est fort probable que ce travail « fantôme » sexué continue à se développer.
L'augmentation du travail journalier dans de nombreuses grandes villes est l'une des tendances les plus contradictoires de la féminisation du travail au cours de la dernière décennie. La plupart des travailleurs journaliers sont des travailleurs migrants masculins. Nombre d'entre eux ont renoncé à obtenir un emploi à long terme ou un salaire. Au lieu de cela, ils se rassemblent sur de nombreux marchés du travail, essayant d'obtenir des contrats pour un jour ou deux et de se reposer le reste de la semaine. De nombreux clips vidéo sur les médias sociaux, en particulier sur Douyin et Kuaishou, montrent de jeunes travailleurs masculins qui tentent de diffuser leur expérience du travail journalier.
Cependant, il existe une autre dimension sexuée du travail journalier. Malgré la représentation plus élevée des travailleurs masculins, les travailleuses sont surreprésentées dans les agences de travail : elles servent de médiatrices entre les travailleurs masculins et les entreprises qui les embauchent. La raison en est que les propriétaires des agences estiment que les femmes sont plus aptes à communiquer avec les hommes, et aussi, ce qui est intéressant, qu'ils peuvent donner l'illusion qu'il y a beaucoup de jeunes femmes à l'intérieur des usines. L'une de ces agences de placement porte même le nom de « Good Sisters Human Resource » !
La Chine souffre également du vieillissement de sa main-d'œuvre, et nous devons donc également tenir compte des relations hommes-femmes parmi les travailleurs et les travailleuses plus âgées. L'âge moyen de la population active dans les régions urbaines et rurales augmente rapidement. Une étude réalisée par Yige Dong, sociologue à l'université de Buffalo (SUNY), sur l'industrie manufacturière, montre que le pourcentage de jeunes travailleurs et travailleuses célibataires a diminué de manière significative. Alors que Foxconn recrute toujours des personnes de moins de 40 ou 45 ans, la proportion de ses employé·es de moins de 30 ans est passée de plus de 90% à 48%. Cela est particulièrement vrai pour les usines situées dans les provinces intérieures, car elles attirent des travailleurs et des travailleuses de la même province. Il est également plus difficile pour les personnes plus âgées de se mettre en grève ou de protester, car elles ont plus à perdre et plus de membres de leur famille à s'inquiéter. Les travailleurs et les travailleuses âgées sont confrontées non seulement à une détérioration de leur état de santé et à des maladies professionnelles, mais aussi, et surtout, à un marché du travail hostile. En règle générale, les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 60 ans ont peu de chances d'être embauchés.
Je terminerai par quelques exemples d'affiches d'embauche que j'ai observées dans un quartier populaire du district de Yangpu, à Shanghai, en 2021. La majorité des annonces d'embauche ne demandent que des femmes de moins de 40-50 ans, et de moins de 60 ans pour les hommes. L'une d'entre elles recherchait explicitement des « femmes âgées de 18 à 42 ans ». Lorsque j'ai tenté de soulever la question de l'inégalité salariale et de la discrimination fondée sur l'âge auprès d'une agence pour l'emploi, on m'a répondu que « les femmes âgées devraient être reconnaissantes de pouvoir encore travailler comme nounous et gardiennes d'enfants », et j'ai ensuite été exclue sans ménagement d'un groupe en ligne. Les travailleurs et travailleuses agées peuvent contourner la limite d'âge en achetant de fausses cartes d'identité sur le marché illégal. Cependant, de nombreux et nombreuses travailleuses migrantes paraissent plus âgées que leur âge réel en raison des années de corvée, et sont donc plus susceptibles d'être interrogées par la police.
Olia Shu
En m'appuyant sur les remarques de Zoe, je parlerai principalement de l'imbrication entre l'organisation féministe et l'activisme sur le lieu de travail. Bien sûr, le simple fait de s'intéresser aux travailleuses ne nous donnera pas une image complète de la dynamique de genre dans la classe ouvrière chinoise, mais leurs expériences constituent une partie essentielle de l'histoire lorsqu'il s'agit d'interroger la dynamique d'un système capitaliste structuré par le patriarcat. Il n'est pas surprenant que les femmes aient tendance à être plus marginalisées et vulnérables dans leur vie sociale et sur le marché du travail. Les femmes chinoises passent deux fois plus de temps que les hommes à effectuer des tâches domestiques non rémunérées, sont davantage victimes de harcèlement sur leur lieu de travail et sont moins bien payées. Bien qu'il existe d'importants documentaires et d'autres images sur l'organisation des travailleuses chinoises, comme We the Workers (2017) et Outcry and Whisper (2020), ils sont rarement abordés dans les grands médias chinois et ne reçoivent que peu d'attention de la part du public. Ils montrent des exemples d'organisation militante d'action par des travailleuses, mais je souhaite également attirer l'attention sur différents modèles nuancés d'organisation qui sont devenus de plus en plus courants à mesure que l'espace pour la mobilisation est devenu plus difficile, avec des conséquences plus graves de la répression de l'État. Seules des conditions très particulières permettent des manifestations de masse et d'autres confrontations avec la police et les employeurs.
Nous devons également prendre en considération les aspects moins tape-à-l'œil de l'organisation des travailleuses, qui sont essentiels à l'activisme sur le lieu de travail aujourd'hui. Les travailleuses plus âgées qui guident les plus jeunes, ou les travailleuses parlant le même dialecte dans la même région, s'organisent souvent en petits groupes pour se soutenir mutuellement. Ces espaces constituent des points de départ essentiels qui permettent aux travailleuses de comprendre et d'évoquer les griefs collectifs et de découvrir la confiance et l'autorité nécessaires pour se battre. Les travailleuses utilisent également les médias numériques pour s'enseigner mutuellement et faire circuler le droit du travail et d'autres outils institutionnels. Alors que certain·es avocat·es, étudiant·es, activistes et journalistes qui les soutiennent reçoivent souvent le plus d'attention après les actions de celles-ci, les travailleuses ordinaires sans plateforme sont souvent confrontées aux représailles les plus directes et les plus dures. De nombreuses travailleuseuse apprennent également à s'organiser et à utiliser la loi à leur avantage, même si beaucoup d'entre elles n'ont pas de casquette professionnelle.
Le Sunflower Service Center for Female Workers est un bon exemple de ce type d'auto-organisation des travailleuses. Quelques travailleuses ont créé le centre à Guangzhou en 2011, souhaitant collaborer pour fournir des services de garde d'enfants et organiser diverses activités récréatives et culturelles. Guangzhou comptait plus de cent mille travailleuses, et le centre a accueilli de nombreux événements culturels populaires et a attiré l'attention des médias locaux, recevant même des appuis officiels pour ces événements. L'un de ces événements invitait les travailleurs, hommes et femmes, à porter publiquement des chaussures rouges pour femmes afin de sensibiliser le public aux questions de genre sur le lieu de travail. Finalement, les travailleuses de Sunflower ont commencé à cultiver davantage de connaissances juridiques et de pouvoir collectif, et les travailleuses du centre se sont rapidement conseillées les uns les autres sur la manière de négocier avec succès avec les entreprises sur les questions de vol de salaire. La nouvelle de l'existence du centre a commencé à se répandre. À un moment donné, plus d'un millier de travailleuses qui avaient travaillé dans une usine locale de jouets pendant plus de 20 ans n'ont pas reçu l'intégralité de leur rémunération et de leurs prestations de sécurité sociale lorsqu'elles ont atteint l'âge de la retraite. Elles ont contacté le Sunflower Center, qui les a aidés à gagner un important procès la même année contre l'entreprise.
Ainsi, au début des années 2010, Sunflower a commencé à passer d'activités culturelles à des actions militantes, ce qui a finalement conduit à sa répression. Depuis l'affaire des travailleuses de l'usine de jouets, l'association a commencé à subir des pressions directes et indirectes de la part des autorités et d'autres acteurs pour qu'elle ferme ses portes. À un moment donné, le propriétaire a commencé à couper l'eau et l'électricité ; un autre matin, les organisatrices ont découvert que quelqu'un avait soudé leur porte métallique au cadre, de sorte qu'ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Les autorités locales ont fini par poser un ultimatum aux représentantes du Sunflower Center : soit elles fermaient eux-mêmes, soit elles attendaient une notification officielle de fermeture. En 2015, elles ont été contraints de fermer.
Alors que l'organisation militante est devenue de plus en plus persécutée après 2015, certains centres pour les travailleuses ont continué à survivre et à travailler par des voies plus subtiles et créatives. Ding Dang, par exemple, est cofondatrice du Green Roses Center of Social Work, qui existe toujours à Shenzhen. Elle a commencé à travailler à l'âge de 14 ans et a dû abandonner l'école pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a quitté sa ville natale rurale de Gansu pour s'installer dans le centre urbain de Shenzhen, où elle a fait l'expérience de la situation difficile des travailleuses des grandes industries, ce qui l'a amenée plus tard à s'organiser. Après avoir lu et appris davantage sur le travail et les questions sociales dans un centre de travailleuses, elle a identifié le genre comme une préoccupation majeure qui a influencé ses conditions de travail et celles d'autres collègues féminines. Elle a découvert que six des dix membres de son groupe d'amies au travail avaient été abandonnées par leurs parents en raison de leur sexe. Elle a commencé à comprendre que les usines préféraient embaucher des femmes parce qu'elles pensaient que les travailleuses seraient plus faciles à gérer. Elle a remarqué que si beaucoup de ses collègues féminines étaient habituellement discrètes en public, elles partageaient ouvertement leurs pensées en privé. Elle a continué à encourager ses collègues à trouver des moyens de s'exprimer, en créant son magazine et d'autres formes de contenu public.
Le Green Roses Center of Social Work fondé par Ding organise des activités telles qu'un « spectacle de chant pour la fête des mères » et une « exposition de poésie Bread and Roses », axés sur les travailleuses, ainsi que diverses activités de garde d'enfants et d'entraide pour permettre aux travailleuses migrantes de mieux s'adapter à la vie citadine. Green Rose utilise aussi efficacement les plateformes numériques pour atteindre les travailleuses, notamment par le biais de leurs comptes publics sur WeChat, Weibo ou Xiaohongshu.
En effet, comme l'a mentionné Zoe, les plateformes numériques deviennent un outil d'organisation de plus en plus important pour les travailleuses chinoises. Les travailleuses militantes délaissent les journaux traditionnels, les magazines et les blogs en ligne au profit de modèles de reportage et d'expression plus décentralisés, comme les médias sociaux. Certaines produisent des contenus courts, tandis que d'autres produisent des bulletins d'information plus longs, des podcasts et des documentaires, tout cela pour trouver des moyens de contourner la censure imposée par l'État sur les médias sociaux chinois. Da Gong Tan, par exemple, mène des entretiens avec des travailleuses d'horizons divers, notamment des travailleuses domestiques d'usines locales et des travailleuses internationales diplômées aux États-Unis. Les enregistrements audio, l'utilisation de pseudonymes et les abonnements à des messageries privées sont autant de moyens de contourner la censure. Des blogs de travailleures comme Spicy Pepper ou Jianjiao Bu Luo diffusent et commentent des statistiques pertinentes, avec des graphiques montrant par exemple que les taux de natalité des femmes sont en baisse ou que les femmes migrent davantage vers les villes que les hommes.
Des conductrices de camion, comme Li Xin, ont lancé des blogs sur une plateforme appelée Kuai Shou pour attirer l'attention sur leurs conditions de travail. Li documente sa propre vie de conductrice de camion et de mère de deux enfants, qui se rend au travail avec son mari et ne peut rentrer chez elle qu'une fois tous les deux mois. De telles histoires attirent l'attention d'autres conductrices de camion et d'autres personnes sur les médias sociaux. Ainsi, de plus en plus de travailleuses s'appuient sur des plateformes numériques pour discuter de leurs conditions de travail. Certains cas attirent l'attention du gouvernement et sont cooptés dans des récits d'État qui glorifient leurs « sacrifices » sans faire grand-chose pour changer le soutien social et la sécurité à long terme des travailleuses. Par la suite, Li s'est davantage intégrée aux médias officiels, participant à un célèbre concours de chant, et a dû modérer son contenu pour éviter toute agitation, alors même qu'elle invitait d'autres camionneuses sur sa plateforme à parler de leurs conditions de travail, y compris le cas d'un travailleuse décédée dans un accident de la route. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'elle soit autorisée à exprimer en toute sécurité, à part le genre de sentiment avec lequel elle a terminé dans un récent vlog : « La réalité est cruelle, mais la vie doit continuer ».
Nous devons également nous rappeler que l'alphabétisation numérique et plus large n'est pas encore tout à fait courante parmi les travailleuses, et c'est pourquoi le travail clé de Green Rose et d'autres groupes de travailleuses consiste à concevoir différents types d'ateliers d'écriture et d'alphabétisation médiatique. Un cours d'alphabétisation apprend aux femmes comment les caractères écrits correspondent picturalement aux différentes parties du corps, ce qui leur permet de discuter de concepts généraux de bien-être, de santé et de soins maternels.
Je voudrais conclure en soulignant que la précarité des conditions de travail en Chine signifie qu'il n'existe pas de modèle unique pour l'organisation des travailleuses. Les militantes doivent naviguer dans des conditions difficiles pour rencontrer les gens là où ils sont, avec des ressources limitées et la menace constante de la répression.
Zoe Zhao est une chercheuse et une activiste qui s'intéresse aux intersections entre la technologie, le travail et les mouvements sociaux.
Olia Shu est une activiste qui s'intéresse aux alternatives au capitalisme et aux théories et pratiques de décolonisation.
https://newpol.org/issue_post/gender-and-the-chinese-working-class/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le virus fasciste et le risque de pandémie

Le capitalisme néolibéral pousse les régimes politiques vers des démocraties illibérales ou des autoritarismes réactionnaires, comme l'expliquent Miguel Urban et Jaime Pastor :
Des décennies de gouvernance néolibérale et ses crises dérivées, qui ont favorisé une culture politique profondément antidémocratique. Il reflète l'obsession incessante du néolibéralisme de limiter les sphères et les fonctions sociales des États, d'aligner l'action publique sur les intérêts des acteurs de l'économie privée, de remplacer la réglementation et la distribution par la liberté d'entreprise et de placer les droits de propriété au-dessus de tout autre droit fondamental. (…) C'est cette anti-politique (...) qui est à l'origine de l'autoritarisme qui imprègne toute la carte politique.
24 août 2024| tiré de Vientosur Le virus fasciste et le risque de pandémie | Article original en catalan
Dans ce texte, je propose une réflexion sur la question de savoir si, dans cette dynamique, certains éléments caractéristiques du fascisme classique sont modifiés et recombinés avec de nouveaux éléments, comme c'est le cas avec les souches modifiées d'un virus précédent, et affectent progressivement diverses parties des institutions et du corps social. Le danger est que la contagion s'accélère de telle manière (comme une pandémie) qu'elle provoque des changements substantiels et finisse par aboutir à une dictature brutale qui a suffisamment de similitudes avec le fascisme pour être considérée comme son héritière.
Dans une dynamique fasciste, il peut y avoir des étapes de contagion continue, mais lentes et relativement silencieuses, d'autres d'évolution accélérée et enfin un moment perturbateur important est nécessaire pour qu'un parti fasciste conquiert le pouvoir et se consolide.
Évidemment, nous ne sommes pas dans la situation des années 30 et aucun phénomène ne se répète de la même manière 100 ans plus tard. Le fascisme non plus. Ce que je propose de débattre, c'est de savoir si ces phénomènes de contagion d'un nouveau fascisme existent en Espagne, quel est leur degré de développement et comment ils peuvent être affrontés.
Naturellement, nous devons commencer par clarifier ce que je considère comme les traits caractéristiques du fascisme qui ont le plus grand potentiel de développement et d'opération dans la situation actuelle.
Le fascisme et les conditions de son développement
1 Le fascisme doit être compris comme une dictature dans laquelle l'appareil répressif – armée, police, justice, etc. – est renforcé par un mouvement de masse réactionnaire qui le complète par le bas, dans le but d'éliminer les organisations populaires existantes et de les remplacer par d'autres de montage et de contrôle au service des intérêts de l'État fasciste. Pour réduire les termes : le fascisme est qualitativement différent d'une démocratie abrégée, c'est une dictature ; Mais toutes les dictatures ne sont pas fascistes, pour l'être, elles ont besoin d'un mouvement de masse réactionnaire :
Une dictature militaire ou un État purement policier (...) n'a pas les moyens suffisants pour atomiser, décourager et démoraliser, sur une longue période de temps, une classe sociale consciente de plusieurs millions d'individus et empêcher ainsi toute relance de la lutte de classe la plus élémentaire (...) Pour cette raison, un mouvement de masse qui mobilise un grand nombre d'individus est nécessaire. Seul un tel mouvement peut décimer et démoraliser le rang le plus conscient du prolétariat par une terreur de masse systématique (...) et, après la prise du pouvoir, le laisser non seulement atomisé, à la suite de la destruction de ses organisations de masse, mais aussi découragé et résigné (Fascisme, Ernest Mandel, 1969).
Cependant, à l'intérieur de cette caractérisation du fascisme, il y a eu de nombreuses variantes en fonction du protagonisme et du moment où il est assumé par les différents acteurs nécessaires – en particulier l'armée et le mouvement de masse fasciste – de la manière dont le parti fasciste arrive au pouvoir et de la résistance qu'il rencontre pour le consolider. Le nazisme et le franquisme sont deux modèles extrêmes.
Dans le cas espagnol, le fascisme a pris la forme du franquisme, le rôle principal correspondait à l'armée, la façon d'arriver au pouvoir était un coup d'État militaire, et le parti fasciste (Phalange) était marginal avant le coup d'État et s'est développé et a été remodelé lorsque l'armée franquiste a gagné la guerre.
2. Une étape nécessaire et très importante dans les processus de contagion du fascisme est d'amener une partie de la population à développer un sentiment d'altérité, d'inimitié et même de haine envers l'autre, au point de le considérer comme digne de lui nier ses droits fondamentaux et de le réprimer. Et qu'un large secteur social est passif et consent à ces attaques. L'exemple typique est celui du nazisme à l'égard de la population juive.
Lorsque ce sentiment de haine envers un secteur social s'est réalisé, il est très facile de le propager à d'autres : dans le cas du nazisme, après la population juive sont venus les gitans, les homosexuels, les slaves, etc. Et il a fini par englober ceux qui n'étaient pas nazis : communistes, socialistes, démocrates,...
Il n'est pas vrai que les projets d'extermination nazis étaient réservés exclusivement à la population juive. La population tsigane a connu un taux d'extermination comparable à celui des Juifs. À long terme, les nazis voulaient exterminer une centaine de millions de personnes en Europe centrale et orientale, principalement des Slaves (« Prémisses matérielles, sociales et idéologiques du génocide nazi », Ernest Mandel, 1988).
Dans le cas espagnol, l'ennemi des années 1930 était, en théorie, la conspiration juive, maçonnique et bolchevique, mais il a rapidement été identifié aux organisations de la classe ouvrière, aux libéraux et aux nationalistes périphériques. Paul Preston a analysé ces origines de la haine dans le livre L'Holocauste espagnol (2011) :
L'idée de ce puissant complot international ---ou conspiration, l'un des mots favoris de Franco--- justifiait le recours à tous les moyens nécessaires à ce qui était considéré comme la survie de la nation (...)
L'idée que les gens de gauche et les libéraux n'étaient pas d'authentiques Espagnols et qu'ils devaient donc être détruits a immédiatement pris racine au sein de la droite (...)
José Antonio Primo de Rivera, bien qu'il ne soit pas antisémite, a également coïncidé en associant la gauche aux Maures (...) il interprète toute l'histoire de l'Espagne comme une lutte éternelle des Goths et des Berbères (...) l'incarnation de ce dernier était le prolétariat rural
3 Pour combattre violemment son ennemi social, le fascisme, il a besoin de construire une identité alternative qui dépasse et s'oppose aux divisions existantes dans la société et dans sa propre base. Historiquement, cette identité a été fondée sur un nationalisme ethniciste ou raciste. Dans le cas espagnol, il s'est combiné avec le fondamentalisme catholique.
Le nationalisme raciste était également un pilier fondamental pour justifier la conquête de l'Abyssinie par Mussolini ou l'invasion nazie de plusieurs pays européens et de l'URSS.
4 La préparation des conditions d'une dictature fasciste est lente et laborieuse, car il est nécessaire de créer les conditions d'un mouvement de masse déterminé à agir violemment contre une partie très importante de la population et à détruire ses cadres et ses organisations. Il a fallu créer un climat social favorable aux propositions fascistes, les faire pénétrer dans l'appareil d'État, les partis traditionnels, les normaliser et, même partiellement, les actions contre les secteurs populaires ont dû être acceptées, même passivement... Cette phase de préparation idéologique, politique et matérielle, que j'appelle contagion, Ugo Palheta et Omar Slaouti l'ont appelée fascisation :
« Le fascisme n'existe pas du jour au lendemain (...) ne peut surgir sans toute une étape historique d'imprégnation, à la fois idéologique et matérielle, mais une série de transformations qui modifient l'équilibre interne de l'État » (« Islamophobie, fascisation, racialisation », Viento Sur 193, juin 2024).
L'arrivée au pouvoir des partis fascistes, à la fois par un coup d'État et par des procédures parlementaires ou pseudo-parlementaires, représente un saut qualitatif et une forte accélération de toutes les attaques contre les libertés démocratiques et les organisations populaires, mais elle n'est consolidée que s'ils ne réagissent pas rapidement et de manière décisive. L'exemple le plus spectaculaire de la réaction populaire contre un coup d'État militaro-fasciste a été l'insurrection populaire du 19 juillet 1936, qui a réussi à la vaincre dans un premier temps dans la majeure partie de l'État espagnol.
5 La définition de l'ennemi à affronter, l'obtention d'un certain degré de consensus social dans les attaques contre celui-ci et l'affirmation de l'identité fasciste, sont les conditions préalables à une violence des secteurs de masse (nécessaire pour qualifier un régime de fasciste). Cela devrait aussi commencer progressivement, par tâtonnement. Si l'idéologie fasciste a pénétré le système judiciaire, la police et l'armée de manière significative, la violence peut d'abord être déléguée à ces appareils d'État, en les mettant sous pression par des manifestations ou des campagnes de rue. Lorsque la conjoncture a besoin d'un degré de violence plus élevé, l'émergence de gangs fascistes violents et massifs peut être très rapide.
6 Dans tous les cas, pour que le fascisme triomphe et puisse rester au pouvoir, il a besoin du soutien de la majorité du grand capital. Mais pour que ce soutien soit apporté, il est nécessaire qu'elle voie sa domination sérieusement menacée, car elle a l'expérience historique que la dictature fasciste peut acquérir une telle autonomie qu'elle finit par l'exproprier politiquement et la conduire au désastre, comme ce fut le cas de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
La menace du grand capital ne reviendra pas au danger communiste tel qu'il était dans les années 1930 (bien que les groupes néofascistes et d'extrême droite d'aujourd'hui qualifient tous les gens de gauche de communistes). Mais c'est peut-être l'existence de mobilisations massives et continues qui, bien qu'elles n'aient pas de direction qui cherche à s'emparer du pouvoir politique, sont suffisantes pour déstabiliser gravement le système de domination et d'accumulation du capital.
La contagion fasciste est une réalité dans l'État espagnol et pourrait s'accélérer
7 La définition des ennemis à combattre radicalement est clairement définie par Vox et le PP (en particulier par le secteur radical représenté par Ayuso) : les migrants, en particulier les musulmans ; les nationalistes pro-indépendance ou pro-souveraineté ; les féministes et les personnes LGBTI ; les écologistes qui luttent contre le changement climatique ; les militants de la mémoire historique ; et un large éventail de ceux assimilés au communisme ou à l'indépendance : Podemos, les anarchistes et, à partir de la loi d'amnistie, les sanchistas :
[l'accord d'investiture avec ERC et Junts] génère une plus grande radicalisation du bloc de droite (...) Leurs qualifications des « concessions » faites par le PSOE comme un « coup d'État » à l'instar du 23F, de la « dictature », de l'« abolition de l'État de droit » ou de la « conspiration destituante » (FAES dixit d'Aznar), ajoutées au désormais classique « l'Espagne est brisée » et à celle de « gouvernement illégitime » (et maintenant « illégal » dans la bouche de Vox), ne sont pas compatibles avec le contenu réel de ces accords. mais ils favorisent un climat politique dans lequel les groupes les plus d'extrême droite et ouvertement néonazis, protégés par Vox et une partie du PP, acquièrent une notoriété qu'ils n'avaient pas atteinte jusqu'à présent (« La question catalane et la radicalisation croissante du bloc de droite », Pastor, Jaime, 11/11/2023).
8 Les composantes de base de l'identité fasciste sont également définies : l'anti-immigration, l'espagnolisme fondamentaliste, le blanchiment du franquisme, la défense du patriarcat, le négationnisme climatique, le néolibéralisme économique, le fondamentalisme catholique,...
9 Le climat de haine contre les secteurs à combattre s'est propagé, notamment grâce à d'importants médias, réseaux sociaux, sites web, etc., qui non seulement diffusent des idées, mais recourent aussi systématiquement à la diffusion de fausses nouvelles pour justifier les attaques contre les migrants, les personnes LGBTI, contre les cliniques qui pratiquent des avortements, le soutien à l'action policière contre le référendum du 1er octobre 2017 (Attrapons-les ! ), ...
Le glissement vers des positions réactionnaires d'un large secteur social a été favorisé par la dérive antidémocratique des gouvernements au pouvoir. Principalement par ceux du PP, mais aussi par ceux présidés par le PSOE. Ce dernier a normalisé des politiques xénophobes et racistes (avec le point culminant du massacre de Melilla en juin 2022), de graves coupes dans la démocratie (non-abrogation de la loi bâillon), le refus d'appliquer la justice universelle aux crimes du franquisme et, jusqu'à récemment, la répression contre le mouvement indépendantiste (collaboration à l'application de l'article 155 qui a supprimé l'autonomie de la Catalogne). De cette façon, il a contribué à la politique de la droite réactionnaire et du néofascisme qui a conquis les esprits avant qu'il ne puisse gagner aux urnes.
Le climat de haine n'aurait pas pu autant progresser sans la collaboration d'une partie de la justice qui n'a pas hésité à qualifier la désobéissance civile pacifique et massive du 1er octobre de rébellion militaire, en accusant les organisateurs des manifestations pacifiques de tsunami démocratique de terrorisme, en contestant la souveraineté du parlement espagnol en refusant d'appliquer la loi d'amnistie aux dirigeants du processus tout en bénéficiant généreusement à la police (51 des 105 personnes amnistiées à ce jour), et en recourant à la guerre juridique contre des ennemis politiques : Puigdemont, Arnaldo Otegi, Mònica Oltra, Pablo Iglesias, Irene Montero... Ces campagnes ont atteint le président du gouvernement, qui a été contraint de dénoncer la machine à argile, mais sans prendre la moindre action énergique pour y mettre fin et démocratiser la justice.
10. La survie de l'idéologie fasciste au sein de l'armée et de la police s'explique par le fait que le passage de la dictature à la démocratie s'est fait sans purger l'appareil d'État et protéger par la loi d'amnistie les responsables de crimes et de délits graves sous le régime franquiste. Dans le cas de l'armée, cette survie est périodiquement évidente à l'occasion de crises ou de conflits politiques : des manifestes de militaires de réserve (les seuls à pouvoir les signer) ont été publiés faisant l'éloge de Franco à l'occasion de son exhumation de la Vallée des morts ou appelant à la destitution de Pedro Sánchez suite à l'approbation de la grâce contre les personnes condamnées dans le processus. Dans le cas de la police et de la garde civile, on sait que des tortionnaires bien connus sous le régime franquiste ont continué à les remplacer, ont été promus, ont été décorés et n'ont pas été poursuivis pour crimes contre l'humanité, tant en Espagne que dans le procès argentin. C'est dans ce contexte que découlent les réalités actuelles : entre 2015 et 2016, la police patriotique, sur ordre du gouvernement PP, a espionné 69 députés de Podemos à travers les bases de données du ministère de l'Intérieur ; plus récemment, l'union Jusapol a sévèrement critiqué le gouvernement à la suite de la réforme (mais pas de l'abrogation) de la loi bâillon et du rapprochement des prisonniers de l'ETA avec le Pays basque ; et le syndicat de police SUP a signé un contrat avec l'ultra-entreprise Desokupa pour former 30 000 policiers.
11 Jusqu'à présent, la violence directe a été de faible intensité (elle s'est concentrée sur les migrants, les personnes LGBTI, les expulsions de la société Desokupa,...), en partie parce que le pouvoir judiciaire et la police ont fait la plupart du travail sous le couvert de lois antidémocratiques (comme la loi bâillon), à la fois à l'époque du gouvernement du PP et du PSOE (avec un rôle de premier plan du ministre Marlaska dans ce cas).
12 En Espagne, le parti néofasciste Vox a connu une croissance importante ces dernières années : 12,4 % des voix aux dernières élections législatives et 9,6 % aux élections européennes de 2024. Il n'est pas aussi fort que ses homologues italiens, néerlandais ou français, capable de gouverner ou ayant de bonnes chances de le faire, mais il a laissé derrière lui la phase où il ne servait que de chien renifleur pour la droite, testant quelles questions pouvaient acquérir un soutien populaire et commençant à les introduire dans l'agenda politique afin que le PP puisse ensuite les récupérer. Après les élections municipales et régionales de 2023, il a réussi à faire partie des gouvernements de coalition dans 5 communautés autonomes (Estrémadure, Aragon, Communauté valencienne, Castille-León et Murcie) et conditionne le gouvernement des îles par un pacte législatif. Le 11 juillet, Vox a rompu les pactes gouvernementaux avec le PP pour protester contre la décision de ce dernier d'accueillir un quota réduit de migrants mineurs non accompagnés, mais ils peuvent être réactivés.
Si la campagne juridique qui a dénoncé Pedro Sánchez était couronnée de succès et que le PSOE perdait la possibilité de former une coalition gouvernementale, l'alternative presque certaine serait un gouvernement du PP et de Vox (ou avec leur soutien). Dans ce cas, les politiques régressives augmenteraient considérablement parce qu'un bloc réactionnaire, conservateur, néolibéral et nationaliste espagnol serait consolidé, et qu'un parti néofasciste serait légitimé en tant que parti de gouvernement. À partir de là, avoir un gouvernement néofasciste majoritaire serait beaucoup plus facile, soit en raison de la propre croissance de Vox, soit parce que la composante fasciste qui continue d'incuber au sein du PP a pris le contrôle du parti ou l'a quitté pour en créer un nouveau.
La domination d'un parti fasciste sur le gouvernement central devrait avoir le soutien d'une partie décisive du grand capital. Pour l'instant ce n'est pas le cas, car la démocratie raccourcie actuelle lui suffit et lui permet d'évoluer davantage au rythme des principaux pays de l'Union européenne. Mais ils s'orientent aussi dans une direction inquiétante, comme l'expliquent Miguel Urbán et Jaime Pastor :
un autoritarisme post-démocratique se répand dans l'UE et ses États membres, avec des frontières de plus en plus perméables entre régimes libéraux et illibéraux (...)
Il n'est donc pas surprenant que l'extrême droite opte pour la voie réformiste au sein de l'UE (« Vers un despotisme oligarchique, technocratique et militariste », vent du sud 193, août 2024).
En réalité, les démocraties espagnole et européenne sont en mutation, tout comme le capitalisme néolibéral. Et si la tendance vers des régimes plus autoritaires semble claire, ni le point d'arrivée ni les rythmes ne peuvent être prédits. Mais il convient de se demander si dans cette mutation un fascisme du XXIe siècle, tel que nous l'avons présenté au début, peut trouver son opportunité. À mon avis, c'est le cas et le déclencheur le plus probable est la crise climatique. Comme l'a dit Phil Hearse :
La catastrophe climatique créera le genre de dislocation et de bouleversement social qui ne peuvent être contrôlés, du point de vue de la classe capitaliste, que par des dictatures autoritaires basées à leur tour sur des appareils militaro-policiers, et la tentative de mobiliser les masses sur la base du nationalisme, de l'identité ethnique ou du racisme. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons du fascisme moderne (« L'effondrement climatique menace d'apporter le fascisme et la guerre », 13/07/2023).
Naturellement, cette issue n'est pas certaine, tout comme dans les premiers stades de la propagation d'un virus modifié, il n'est pas possible de savoir s'il conduira à une pandémie, même si les effets néfastes sont vérifiables, et commencer à le combattre est le seul moyen pour les gens d'éviter de souffrir et que cela se termine par une pandémie.
13 La mobilisation sociale contre la contagion fasciste doit commencer dès maintenant. Il est nécessaire de lutter contre les agressions que subissent la classe ouvrière et les secteurs populaires, en particulier celles qui sont dirigées contre les personnes que la droite radicale et le néofascisme ont désignées comme ennemies. Nous devons unir la lutte de ceux d'en bas, qui sont l'immense majorité de la population, contre la petite minorité qui est la bénéficiaire des politiques d'exclusion sociale, d'austérité, de dégradation démocratique et de complicité avec les agressions impérialistes.
Face à la dynamique d'exclusion, nous devons exiger le respect scrupuleux de toute la législation internationale pour la protection des droits humains, en particulier aux frontières, et lutter pour imposer les droits de citoyenneté, sans exclusion, à toutes les personnes résidant sur le territoire de l'État espagnol.
Face à la montée de l'autoritarisme, il est nécessaire de lutter pour une véritable démocratie, dans son sens originel de pouvoir du peuple de décider de toutes les questions de la manière la plus directe et participative possible à tout moment, sans autre limite que les droits des individus et des minorités. Le droit de décider des droits des femmes et des personnes LGBTI face au fondamentalisme religieux et à la moralité réactionnaire ; décider des mesures nécessaires pour lutter contre l'urgence climatique contre les intérêts des multinationales ; le droit de décider des relations que les peuples et les nations de l'État espagnol veulent maintenir face au dogme de l'unité indissoluble de l'Espagne ; le droit de décider des mesures à prendre pour rechercher la vérité, la justice et la réparation pour les crimes du régime franquiste face à une loi d'arrêt complet telle que l'amnistie,...
Face à l'accumulation de richesses par les multinationales et à la pauvreté de plus en plus étendue et cachée des grands secteurs sociaux, il est nécessaire d'exiger la défense et l'extension des biens communs, sans crainte d'incursions dans la propriété privée des puissants. Il n'est pas vrai qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, mais qu'elles sont détournées par une minorité qui, en plus, les utilise pour maintenir une forme de production qui nous conduit à une catastrophe climatique. Nous avons besoin d'un modèle de production alternatif basé sur des critères écologiques qui réduisent l'utilisation d'énergie et de matériaux et qui sont orientés vers la satisfaction des besoins humains fondamentaux, loin du consumérisme.
Face à la concurrence entre blocs impérialistes et à la multiplication des conflits et des guerres au nom des nationalismes identitaires ou de la civilisation occidentale, nous devons faire preuve de solidarité avec les peuples qui luttent contre toute forme d'impérialisme et pour une véritable coopération dans la lutte contre le changement climatique et pour la durabilité de la vie sur une planète habitable. Nous devons nous opposer à l'augmentation des dépenses militaires, au soutien de l'État espagnol ou de l'UE aux interventions militaires et aux guerres contre d'autres peuples, et, en particulier, au génocide du peuple palestinien perpétré par un État raciste et colonial, où le gouvernement et des parties importantes de la société sont infectés par le néofascisme.
23/08/2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Via Campesina : Les catastrophes climatiques exigent une réponse globale et urgente ! Basta les fausses solutions !

Face à une crise environnementale et climatique sans précédent touchant des pays comme le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay, l'Argentine, le Kenya, la Tanzanie, l'Afghanistan, la France, la Thaïlande, l'Indonésie, entre autres, sous forme de vagues de chaleur, de fortes pluies et d'inondations, La Via Campesina avertit sur les responsables et appelle à une solidarité internationale urgente et à une réponse concertée menée par des solutions populaires.
Tiré de NPA 29
LA TRAGÉDIE ANNONCÉE
De récentes étudesont révélé que la chaleur écrasante qui a frappé l'Asie et le Moyen-Orient fin avril, rappelant les intenses vagues de chaleur de l'année dernière, était 45 fois plus probable dans certaines régions du continent en raison du changement climatique provoqué par l'activité humaine. Au cours de cette période, des températures élevées se sont fait sentir dans de vastes régions d'Asie, s'étendant de Gaza à l'ouest – où plus de 2 millions de personnes sont aux prises avec des pénuries d'eau potable, des soins de santé inadéquats et d'autres besoins essentiels au milieu des frappes aériennes israéliennes en cours – jusqu'aux Philippines dans le sud-est. Également en Thaïlande, les vagues de chaleur détruisent les cultures et les terres paysannes. Les ressources en eau s'assèchent et les journées extrêmement chaudes rendent dangereux le travail des paysan·nes dans les champs en raison du risque d'insolation. En conséquence, de fortes pluies et d'énormes inondations ont atteint la province de Narathiwat dans la région profonde du sud de la Thaïlande en décembre 2023, provoquant les pluies les plus importantes des 50 dernières années. De nombreuses parties du continent ont connu des jours consécutifs avec des températures dépassant 40 degrés Celsius.
L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies et l'agence climatique de l'Union européenne, Copernicus, rapportent que l'Europe se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que les autres continents, avec une augmentation de 30 % des décès liés à la chaleur au cours des 20 dernières années. Ce réchauffement rapide frappe le plus durement les paysan·nes, qui luttent contre la sécheresse, les inondations et les pertes de récoltes.
Des températures océaniques supérieures à la moyenne provoquent une évaporation accrue, entraînant davantage de précipitations et d'inondations dévastatrices sur tout le continent. C'est évident en Allemagne, dans le nord de l'Italie, dans le centre de l'Angleterre et en Slovénie, où de fortes pluies ont entraîné d'importantes inondations. En France, le contraste est saisissant : le sud-est souffre d'une sécheresse sévère, tandis que le nord est confronté à des inondations dévastatrices. Les fausses solutions de l'agroibusiness, comme les mégabassines, aggravent ces conditions en monopolisant les ressources foncières et hydriques.
Les inondations qui ont submergé l'Afghanistan, le Brésil, le Burundi, le Kenya, la Thaïlande, l'Indonésie, certaines parties de la Tanzanie et de nombreux pays d'Europe sont également sans précédent. Bien que certains rapports les attribuent à l'oscillation australe El Niño (ENSO) et les considèrent comme un phénomène naturel qui se produit depuis des siècles, des rapports scientifiques ont révélé qu'un climat en réchauffement pourrait contribuer à une augmentation de la fréquence et de l'intensité du phénomène El Niño. Les impacts peuvent être importants au niveau régional. En Amérique centrale, El Niño entraîne des précipitations excessives le long des côtes des Caraïbes, tandis que les côtes du Pacifique restent sèches. Les précipitations augmentent sur les côtes de l'Équateur, la partie nord du Pérou et les zones sud du Chili. Les pays d'Afrique de l'Est connaissent également des précipitations excessives avec une intensité accrue en raison de l'aggravation du changement climatique.
L'Organisation mondiale de la santé prévient que3,6 milliards de personnes résident dans des zones vulnérables au changement climatique, ce qui pourrait entraîner 250 000 décès supplémentaires par an d'ici 2030-2050, principalement en raison de la malnutrition, du paludisme, de la diarrhée, du stress thermique et désormais des maladies transmises par les insectes, les moustiques et autres vecteurs. La contribution du changement climatique à l'escalade des maladies à transmission vectorielle dans les pays à revenu faible et intermédiaire d'Afrique, déjà lourdement grevés par de nombreuses disparités sanitaires et socio-économiques, est une préoccupation importante.
Les pays du Sud, déjà en proie à une dette sévère, ne disposent pas des ressources nécessaires pour répondre et s'adapter adéquatement à ces crises qui touchent principalement la classe ouvrière et les paysan·nes – qui souffrent également de mauvaises conditions de travail, de logements inadéquats et d'un accès limité aux soins de santé. Ces catastrophes représentent également un énorme risque pour la souveraineté alimentaire des territoires, poussant davantage de personnes dans l'extrême pauvreté et la faim. Les économies industrialisées riches qui ont créé ces crises ne sont toujours pas disposées à reconnaître leur responsabilité et à fournir les ressources et les capacités nécessaires aux pays du Sud.
L'AGROBUSINESS, L'EXTRACTIVISME ET LES MULTINATIONALES, AINSI QUE LEURS BANQUES, SONT LES PRINCIPAUX RESPONSABLES !
L'agrobusiness et l'extractivisme sont les principaux responsables de la crise, car les taux élevés de déforestation, l'accaparement des terres, la perte de biodiversité et la réduction de l'absorption des sols aggravent la crise environnementale et climatique. L'utilisation d'agrotoxiques qui détruit toute biodiversité et contribue au déséquilibre des précipitations, conjuguée au capitalisme financier, avec ses banques qui dominent le monde, et au système alimentaire industriel dominé par les grandes entreprises transnationales du Nord global, constitue les principaux moteurs du changement climatique, l'agrobusiness représentant désormais plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
L'industrie militaire du Nord global promeut les conflits armés pour vendre des armes et maintenir ses taux de profit, tandis que les guerres affectent directement nos écosystèmes et notre environnement, entraînant la mort de milliers d'êtres humains. Mettons fin à toutes les bases militaires étrangères, aux agressions et aux guerres !
La crise environnementale que le monde traverse va bien au-delà de la crise climatique et prend racine dans la manière dont le système capitaliste organise la relation entre les êtres humains et la nature. La production orientée vers le profit exploite à la fois les personnes et la nature, épuise les communs et met en péril la survie de l'humanité et de la vie sur la planète.
Les capitalistes, avec certains gouvernements, cherchent à accroître leurs profits en créant le système de crédit carbone, qui ne modifie en rien la réalité en termes de biodiversité ou d'émissions de gaz, mais génère des illusions en vendant l'oxygène des forêts. C'est une honte.
ALERTE DE LA VIA CAMPESINA !
Face à cette grave crise, La Via Campesina appelle les États et gouvernements à adopter des alternatives concrètes et résilientes pour les populations touchées. Elle insiste sur le fait que la lutte contre le changement climatique doit faire preuve de volonté politique, mais aussi garantir que les communautés aient le contrôle de leurs territoires, et non les multinationales. Il est urgent de changer le système et de transformer les systèmes alimentaires, en identifiant les responsables et leurs responsabilités, et en mettant en œuvre des solutions claires telles que la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans (UNDROP), l'Agroécologie Paysanne et la Souveraineté Alimentaire, qui créent des conditions dignes, une alimentation saine et régénèrent la vie et la nature.
L'influence des entreprises sur les États, les gouvernements et les institutions multilatérales, qui entraîne une inaction climatique et un déni absurde malgré les preuves scientifiques établies, est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer avec des politiques publiques locales et mondiales inefficaces, en mettant en œuvre des lois, des traités, des règlements et des subventions qui consolident et renforcent le capitalisme, le système alimentaire industriel et leurs intérêts corporatifs.
DES SOLUTIONS RÉELLES, PAS DES FAUSSES SOLUTIONS !
Le discours du capitalisme vert et de l'agrobusiness sur une agriculture intelligente face au climat, présentée comme régénérative, ainsi que d'autres mécanismes comme les marchés de carbone et les solutions basées sur la nature, s'inscrit dans une stratégie de greenwashing. Ces fausses solutions, historiquement dénoncées par La Via Campesina lors des sommets de la COP, ont conduit à des échecs dans les processus liés aux COP climat et biodiversité au cours des dernières années et décennies, sous l'influence du marché et des entreprises multinationales.
La COP30 Climat de 2025 au Brésil et la CBD de septembre 2024 en Colombie doivent marquer un tournant radical. Sans cela, ces processus risquent de perdre toute crédibilité et légitimité. En particulier, la CBD et la COP30 doivent mettre au centre de leur agenda la réforme agraire et l'usage des terres, de l'eau et des territoires entre les mains des populations, au service de la production d'aliments et d'autres biens indispensables à la dignité humaine, et non entre les mains des entreprises multinationales répondant aux caprices des plus riches.
Les COP devraient servir à trouver des solutions claires, à élaborer des propositions et des alternatives au changement climatique en collaboration avec les pays et la communauté scientifique. Ces espaces, désormais pris d'assaut par le lobbying pour l'expansion des multinationales et l'accumulation de richesse en pleine crise climatique, doivent se débarrasser de ces acteurs néfastes et assumer leur responsabilité historique envers les peuples du monde.
La Via Campesina plaide depuis longtemps pour des solutions réelles qui incluent les paysan·nes, les peuples autochtones et les pêcheur·euses, qui sont les gardien·nes des terres, des forêts, des zones côtières et des océans. Nous avons longtemps exigé une réforme agraire complète et des politiques d'utilisation des terres dans les pays, et la restauration de la santé des sols grâce aux pratiques agroécologiques paysannes, ainsi que des législations nationales alignées sur l'UNDROP. Plus que jamais, nous devons adapter les villes et les zones rurales pour faire face à la crise climatique.
Il est urgent d'accorder des fonds aux communautés sous forme de subventions, et non de prêts, comme réparations pour la responsabilité historique dans la crise climatique. Les réparations devront soutenir les efforts communautaires de restauration des terres dégradées par la plantation d'arbres natifs, en particulier dans les zones où ces derniers ont été détruits.
Il est impératif d'établir des programmes de production agroécologique garantissant une augmentation de la production d'aliments sains en harmonie avec la nature.
Il est essentiel de promouvoir des formes de taxation prélevant au moins 2 % sur les fortunes des milliardaires (qui ne représentent que 3 000 familles), ainsi que d'établir un impôt universel sur les bénéfices des sociétés transnationales. Avec cela, il est nécessaire de créer un fonds mondial pour lutter contre la pauvreté, l'inégalité sociale et le changement climatique.
Ces outils promeuvent une transition juste pour les paysan·nes, et plaident pour des relocalisations de la production et de la consommation alimentaires, garantissant la souveraineté alimentaire et renforçant les économies rurales. Ancrés dans les principes de justice climatique globale, nous continuons à lutter pour des réparations pour la dette et l'injustice historiques. Tous les financements climatiques doivent être entre les mains des communautés (et non des banques !), doivent prendre la forme de subventions (et non de prêts !), et doivent prioriser à la fois l'adaptation et l'atténuation.
Nous constatons comment, dans ce système capitaliste, les conséquences du changement climatique prévalent dans la plupart des pays du Sud Global, touchant principalement ceux qui produisent tout et possèdent peu : les travailleur·euses vivant dans des endroits socialement vulnérables dans les villes, expulsés par la spéculation immobilière et les actions des États légitimant l'établissement d'entreprises et de communautés fermées dans les endroits les plus privilégiés. Ainsi, en plus des problèmes sociaux comme la faim, la pauvreté, le manque d'assainissement, la violence armée ou les problèmes environnementaux, ils doivent également endurer les problèmes environnementaux que d'autres ont générés.
La lutte pour la justice environnementale et climatique, à la fois localement et globalement, est urgente et doit devenir un champ de bataille afin que nous puissions progresser dans la construction de solutions réelles et véritablement efficaces qui abordent les problèmes environnementaux et sociaux engendrés par le capitalisme.
C'est pourquoi nous exhortons notre base sociale entière – les paysan·nes du monde entier, les travailleur·euses urbain·es, les migrant·es, les jeunes, les femmes et les diversités – à s'organiser et à mener des luttes massives pour mettre un terme à cette folie capitaliste qui pourrait conduire à la mort de tous les êtres humains. Nous payons déjà un lourd tribut, avec de nombreuses vies perdues chaque jour !
3 juin 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment Israël a délocalisé ses activités polluantes en Palestine

Les zones industrielles israéliennes se dressent un peu partout en Cisjordanie occupée. Les communautés palestiniennes étouffent sous la pollution et la colonisation de leurs terres. La ville palestinienne de Tulkarem est connue pour ses agrumes, son université et pour les affrontements qui ont lieu régulièrement entre de jeunes combattants palestiniens et l'armée israélienne. Pourtant, une autre guerre s'y déroule en silence : les habitants de Tulkarem meurent cinq fois plus du cancer que les autres Palestiniens.
Photo : Une décharge sauvage palestinienne à Farkha, près de la rivière Ein al-Matwi, créée à cause du refus des autorités israéliennes de construire une véritable déchetterie en zone C (sous contrôle israélien). Ici le 4 mars 2024. – © Philippe Pernot / Reporterre
Tiré de reporterre.net
La faute à la zone industrielle israélienne nommée ironiquement Nitzanei Shalom (« germes de la paix »), installée sur des terres confisquées à la ville depuis les années 1980 — et connue des Palestiniens comme « Geshuri », du nom de l'entreprise d'herbicides qui s'est installée la première dans le parc industriel. Onze usines chimiques l'ont rejoint au fil des années. Elles se dressent, grises, entre des murs ceints de barbelés et des tours de surveillance. Une présence oppressante pour les 90 000 habitants de Tulkarem.
« Ici, nous avons deux problèmes : l'occupation israélienne et Geshuri, dit en soupirant Ahed Zanabet, responsable local de l'ONG environnementale palestinienne Parc. Les déchets chimiques provenant des usines du parc industriel s'écoulent dans les zones agricoles palestiniennes sans traitement. » Production de peinture, pesticides, gaz naturel liquéfié (GNL), nettoyage des conduites de gaz avec de l'eau sous pression… Les industries sont toutes plus toxiques les unes que les autres.
« Nous avons une incidence élevée de cancers du poumon dus à la pollution de l'air et de maladies de la peau dues aux résidus présents dans les gaz. Nos sources sont également polluées par les eaux usées des colonies », explique Ahed Zanabet. Les agriculteurs sont forcés d'utiliser des serres pour protéger leurs fruits et légumes, mais celles-ci sont vite recouvertes d'une couche de poussière toxique. « Nous ne pouvons rien faire pour stopper Geshuri, si ce n'est aider les agriculteurs dont les terres sont contaminées », dit-il avec résignation.
Dumping social et environnemental
L'usine Geshuri a été déplacée de la ville israélienne de Netanya vers Tulkarem en 1982, à la suite de plaintes d'habitants israéliens à cause de la pollution — un exemple suivi par de nombreuses autres entreprises dangereuses, relocalisées en Cisjordanie. Aux Palestiniens d'en souffrir, alors. Comme le parc industriel de Nitzanei Shalom est situé le long de la « ligne verte », à la frontière, ses rejets toxiques peuvent vite être poussés par le vent vers Israël… « Mais lorsque le vent souffle d'est vers l'ouest, les industries cessent de fonctionner pour ne pas polluer les Israéliens », s'exclame Abeer al-Butmeh, ingénieure environnementale et coordinatrice de l'association écologiste palestinienne Pengon-Amis de la Terre.
Ce sont donc les Palestiniens qui souffrent de la pollution dans l'indifférence générale. « Nous avons essayé de nous mobiliser à plusieurs reprises, en organisant des campagnes, des manifestations, des visites sur le terrain pour les missions internationales et des activistes, explique-t-elle. Rien n'a changé. »
Les ouvriers qui travaillent dans ces usines, majoritairement palestiniens, sont en première ligne. « Ils constituent une main-d'œuvre bon marché, et souffrent de nombreux accidents du travail, en particulier à Geshuri pendant les incendies liés au gaz naturel, et de maladies respiratoires », explique Abeer al-Butmeh. Au terme d'une longue grève, ils ont réussi à obtenir le salaire minimum israélien en 2016, mais leurs conditions de travail n'ont pas changé pour autant.
Des « zones sacrifiées »
Nitzanei Shalom fait partie de la soixantaine de zones industrielles israéliennes implantées en Cisjordanie occupée, selon Abeer al-Butmeh (Human Rights Watch en recense vingt). Elles profitent parfois à des multinationales étrangères — allant à l'encontre du droit international, qui considère les colonies comme illégales.
« En Israël, les entreprises doivent respecter des normes environnementales et sociales, ce qui leur coûte de l'argent. Elles transfèrent donc leurs usines polluantes en Cisjordanie, où elles ne respectent que des normes minimales, voire aucune », explique l'activiste.
L'organisation des droits de l'homme israélienne B'Tselem nomme ces aires industrielles des « zones sacrifiées », sortes de mini-paradis règlementaires où règne l'arbitraire. « Israël exploite la Cisjordanie à son profit, en ignorant presque totalement les besoins des Palestiniens et leur nuit, ainsi qu'à leur environnement », note leur rapport. C'est donc d'une guerre économique invisible que souffrent les Palestiniens, en parallèle aux raids de l'armée et des colons, qui ont fait plus de 560 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre.
19 millions de m3 d'eaux uséesCe dumping social et environnemental se répète à l'échelle de toute la Cisjordanie, polluée par 145 colonies israéliennes industrielles ou résidentielles. En 2017, ces dernières rejetaient ainsi 19 millions de m3 d'eaux usées vers les terres palestiniennes. Reporterre a ainsi observé des rejets d'eaux usées et de déchets par des colons dans les communautés palestiniennes à Wadi Fukin (près de Bethléem), à Bil'in (à l'ouest de Ramallah), ainsi que dans la région de Selfit, encerclée par l'immense bloc de colonies d'Ariel.
Presque 40 000 colons se sont implantés sur plus de 120 000 km2 de terres palestiniennes confisquées, ainsi qu'une zone industrielle nommée Barkan, qui abrite pas moins de 120 usines. Selon les calculs de la municipalité de Selfit, rien qu'Ariel produit 900 000 m3 d'eaux usées par jour. Une grande partie — ou la totalité — s'écoule à quelques mètres de la source al-Matwi. Des études de la municipalité et d'universités révèlent des traces de matière fécale, mais aussi des nitrates issus des eaux usagées des colonies. Moustiques et sangliers prolifèrent, propageant des maladies et détruisant des écosystèmes anciens.
Si l'absence de déchetteries et de stations d'épuration palestiniennes contribue à la pollution, le problème principal reste l'occupation israélienne, qui refuse plus de la moitié des projets de traitement de déchets en Cisjordanie.
Tulkarem (Cisjordanie), reportage
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Blanchissement de carbone — La « nouvelle ruée vers l’Afrique » du Golfe

Au début du mois de novembre 2023, peu avant l'ouverture du sommet COP28 à Dubaï, une entreprise des Émirats arabes unis, jusqu'alors méconnue, a retenu l'attention des médias en annonçant qu'elle avait l'intention de conclure des accords fonciers en Afrique.
14 août 2024 | tiré du site du CADTM
https://www.cadtm.org/Blanchissement-de-carbone-La-nouvelle-ruee-vers-l-Afrique-du-Golfe
Des rapports laissent entendre que Blue Carbon [1], une société privée appartenant au cheikh Ahmed al-Maktoum, membre de la famille régnante de Dubaï, a signé des accords lui promettant le contrôle de vastes étendues de terres sur tout le continent africain. Ces accords porteraient sur une superficie étonnante de 10 % de la masse continentale du Liberia, de la Zambie et de la Tanzanie, et de 20 % de celle du Zimbabwe. Au total, la superficie de ces terres équivaut à celle de la Grande-Bretagne.
La société Blue Carbon avait l'intention d'utiliser ces terres pour lancer des projets de compensation des émissions de carbone, une pratique de plus en plus répandue dont les partisans affirment qu'elle aide à lutter contre le réchauffement climatique. Les compensations carbone impliquent la protection des forêts et d'autres projets environnementaux qui sont assimilés à une certaine quantité de « crédits » carbone. Ces crédits peuvent ensuite être vendus aux pollueurs du monde entier pour compenser leurs propres émissions. Avant d'entamer les négociations de cet énorme accord, Blue Carbon n'avait aucune expérience dans le domaine des compensations carbone ou de la gestion des forêts. Néanmoins, l'entreprise s'attendait à gagner des milliards de dollars grâce à ces projets.
Les ONG de défense de l'environnement, les journalistes et les militants ont rapidement condamné ces accords en les qualifiant de nouvelle « ruée vers l'Afrique » - un accaparement des terres au nom de la lutte contre le changement climatique. En réponse, Blue Carbon a insisté sur le fait que les discussions n'étaient qu'exploratoires et qu'il faudrait consulter les communautés et poursuivre les négociations avant d'obtenir une approbation formelle.
Indépendamment de leur statut actuel, les transactions foncières soulèvent des inquiétudes concernant l'expulsion des communautés autochtones et d'autres communautés locales pour faire place aux plans de protection des forêts de Blue Carbon. Dans l'est du Kenya, par exemple, le peuple autochtone Ogiek a été chassé de la forêt Mau en novembre 2023, une expulsion que les avocats ont associé aux négociations en cours entre Blue Carbon et le président du Kenya, William Ruto. Des protestations ont également suivi les négociations à huis clos du gouvernement libérien avec Blue Carbon, les activistes affirmant que le projet viole les droits fonciers des populations autochtones inscrits dans la loi libérienne. Des cas similaires d'expulsions de terres dans d'autres pays ont conduit le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, Francisco Calí Tzay, à demander un moratoire mondial sur les projets de compensation carbone.
Au-delà de leur impact potentiellement destructeur sur les communautés locales, les activités de Blue Carbon en Afrique indiquent un changement majeur dans les stratégies climatiques des États du Golfe. Comme l'ont montré les critiques, l'industrie de la compensation carbone existe essentiellement en tant que mécanisme d'écoblanchiment, ce qui permet aux pollueurs de dissimuler leurs émissions constantes derrière l'écran de fumée de méthodes trompeuses de comptabilisation du carbone, tout en offrant une nouvelle catégorie d'actifs rentables pour les acteurs financiers. En tant que premiers exportateurs mondiaux de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, les États du Golfe se positionnent désormais à tous les stades de cette nouvelle industrie, y compris sur les marchés financiers où les crédits de carbone sont achetés et vendus. Cette évolution reconfigure les relations du Golfe avec le continent africain et aura des conséquences importantes sur les trajectoires de notre planète qui se réchauffe.
Falsification des comptes et blanchiment de carbone
Il existe de nombreuses variétés de projets de compensation carbone. Le plus courant concerne les projets de déforestation évitée qui constituent la majeure partie des intérêts de Blue Carbon dans les terres africaines. Dans le cadre de ces projets, les terres sont clôturées et protégées contre la déforestation. Les sociétés de certification de compensation de carbone - dont la plus importante au monde est la société Verra, basée à Washington - évaluent ensuite la quantité de carbone que ces projets empêchent d'être libérée dans l'atmosphère (mesurée en tonnes de CO2). Une fois évalués, les crédits carbone peuvent être vendus aux pollueurs, qui les utilisent pour annuler leurs propres émissions et atteindre ainsi les objectifs climatiques qu'ils se sont fixés.
De prime abord attrayants - après tout, qui ne souhaite pas que de l'argent soit investi dans la protection des forêts ? ces systèmes présentent deux défauts majeurs. Le premier est connu sous le nom de « pérennité ». Les acheteurs de crédits carbone obtiennent le droit de polluer ici et maintenant. Pendant ce temps, il faut des centaines d'années pour que ces émissions de carbone soient réabsorbées de l'atmosphère, et il n'y a aucune garantie que la forêt restera debout pendant cette période. Si un incendie de forêt se produit ou si la situation politique change et que la forêt est détruite, il est trop tard pour récupérer les crédits de carbone initialement accordés. Cette préoccupation n'est pas seulement théorique. Ces dernières années, les incendies de forêt en Californie ont consumé des millions d'hectares de forêt, y compris des crédits achetés par de grandes entreprises internationales telles que Microsoft et BP. Compte tenu de l'incidence croissante des incendies de forêt due au réchauffement climatique, de tels résultats deviendront sans aucun doute plus fréquents.
Encore une fois, cette estimation dépend d'un avenir incertain, ce qui ouvre d'importantes possibilités de profit pour les entreprises qui certifient et vendent des crédits de carbone.
Le deuxième défaut majeur de ces systèmes est que toute estimation des crédits carbone pour les projets de déforestation évitée repose sur un scénario hypothétique : quelle quantité de carbone aurait été libérée si le projet de compensation n'avait pas été mis en place ? Une fois de plus, cette estimation dépend d'un avenir imprévisible, ouvrant des perspectives de profit considérables. En augmentant les réductions d'émissions escomptées dans le cadre d'un projet particulier, il est possible de vendre beaucoup plus de crédits carbone qu'il n'en faut. Cette possibilité de spéculation est l'une des raisons pour lesquelles le marché des crédits carbone est si étroitement associé à des scandales à répétition et à la corruption. En effet, selon le New Yorker, après la révélation d'une fraude massive au carbone en Europe, « le gouvernement danois a admis que quatre-vingts pour cent des sociétés d'échange de carbone du pays étaient des façades pour le trafic » [2].
Ces problèmes méthodologiques sont structurellement intrinsèques à la compensation et ne peuvent être évités. Par conséquent, la plupart des crédits carbone échangés aujourd'hui sont purement fictifs et n'entraînent aucune réduction réelle des émissions de carbone. L'analyste tunisien Fadhel Kaboub les décrit comme un simple « permis de polluer » [3]. Un rapport d'enquête datant du début de l'année 2023 a révélé que plus de 90 % des crédits carbone de la forêt tropicale certifiés par Verra étaient probablement fictifs et ne représentaient pas de réelles réductions de carbone. Une autre étude réalisée pour la Commission européenne a révélé que 85 % des projets de compensation mis en place dans le cadre du Mécanisme de développement propre des Nations unies n'ont pas permis de réduire les émissions. Une étude universitaire récente portant sur des projets de compensation dans six pays a quant à elle révélé que la plupart d'entre eux ne réduisaient pas la déforestation et que, pour ceux qui le faisaient, les réductions étaient nettement inférieures à ce qui avait été annoncé au départ. Par conséquent, les auteurs concluent que les crédits carbone vendus pour ces projets ont été utilisés pour « compenser près de trois fois plus d'émissions de carbone que leur contribution réelle à l'atténuation du changement climatique » [4].
Malgré ces problèmes fondamentaux - ou peut-être à cause d'eux - l'utilisation des compensations carbone se développe rapidement. La banque d'investissement Morgan Stanley prévoit que le marché vaudra 250 milliards de dollars d'ici 2050, contre environ 2 milliards de dollars en 2020, car les grands pollueurs utilisent la compensation pour sanctionner la poursuite de leurs émissions de carbone tout en prétendant atteindre des objectifs nets de zéro. Dans le cas de Blue Carbon, une estimation a révélé que la quantité de crédits carbone susceptibles d'être accrédités dans le cadre des projets de l'entreprise en Afrique correspondrait à la totalité des émissions de carbone annuelles des Émirats arabes unis. Cette pratique, qui s'apparente au blanchiment de carbone, permet de faire disparaître les émissions en cours du grand livre de la comptabilité carbone, en les échangeant contre des crédits qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité.
La monétisation de la nature comme stratégie de développement
Pour le continent africain, la croissance de ces nouveaux marchés du carbone ne peut être isolée de l'escalade de la crise de la dette mondiale qui a suivi la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Selon une nouvelle base de données, Debt Service Watch, les pays du Sud connaissent la pire crise de la dette jamais enregistrée, un tiers des pays d'Afrique subsaharienne consacrent plus de la moitié de leurs recettes budgétaires au service de la dette. Face à ces pressions fiscales sans précédent, les prêteurs internationaux et de nombreuses organisations de développement encouragent fortement la marchandisation des terres par le biais de la compensation comme moyen de sortir de cette crise profondément ancrée.
L'African Carbon Markets Initiative (ACMI), une alliance lancée en 2022 lors du sommet de la COP27 du Caire, est devenue une voix importante dans ce nouveau discours sur le développement. L'ACMI rassemble des dirigeants africains, des entreprises de crédit carbone (dont Verra), des donateurs occidentaux (USAID, la Fondation Rockefeller et le Fonds pour la Terre de Jeff Bezos) et des organisations multilatérales comme la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Outre ses efforts pratiques pour mobiliser des fonds et encourager les changements de politique, l'ACMI a joué un rôle de premier plan dans le plaidoyer en faveur des marchés du carbone en tant que solution gagnant-gagnant à la fois pour les pays africains lourdement endettés et pour le climat. Selon les termes du document fondateur de l'organisation, « l'émergence des crédits carbone en tant que nouveau produit permet de monétiser l'importante dotation en capital naturel de l'Afrique, tout en l'améliorant » [5].
Les activités de l'ACMI sont profondément liées au Golfe. L'un des aspects de cette relation est que les entreprises du Golfe, en particulier les producteurs de combustibles fossiles, sont aujourd'hui la principale source de demande pour les futurs crédits carbone africains. Lors du Sommet africain sur le climat qui s'est tenu en septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, par exemple, un groupe d'importantes entreprises émiraties du secteur de l'énergie et de la finance (connu sous le nom d'UAE Carbon Alliance) s'est engagé à acheter à l'ACMI des crédits carbone d'une valeur de 450 millions de dollars au cours des six prochaines années. Cet engagement a immédiatement confirmé que les Émirats arabes unis étaient le principal bailleur de fonds de l'ACMI. De plus, en garantissant la demande de crédits carbone pour le reste de la décennie, l'engagement des Émirats arabes unis contribue à créer le marché actuel, à faire avancer de nouveaux projets de compensation et à consolider leur place dans les stratégies de développement des États africains. Il contribue également à légitimer la compensation en tant que réponse à l'urgence climatique, malgré les nombreux scandales qui ont entaché le secteur ces dernières années.
L'Arabie saoudite joue également un rôle majeur dans la promotion des marchés du carbone en Afrique. L'un des membres du comité directeur de l'ACMI est la femme d'affaires saoudienne Riham ElGizy, qui dirige la Regional Voluntary Carbon Market Company (RVCMC). Créée en 2022 en tant que coentreprise entre le Fonds d'investissement public (le fonds souverain d'Arabie saoudite) et la bourse saoudienne Tadawul, la RVCMC a organisé les deux plus grandes ventes aux enchères de carbone au monde, en vendant plus de 3,5 millions de tonnes de crédits de carbone en 2022 et 2023. 70 % des crédits vendus lors de ces ventes aux enchères provenaient de projets de compensation en Afrique, la vente aux enchères de 2023 ayant eu lieu au Kenya. Les principaux acheteurs de ces crédits étaient des entreprises saoudiennes, au premier rang desquelles la plus grande compagnie pétrolière du monde, Saudi Aramco.
"Au-delà de la simple appropriation de projets de compensation en Afrique, les États du Golfe se positionnent également à l'autre bout de la chaîne de valeur du carbone : la commercialisation et la vente de crédits de carbone à des acheteurs régionaux et internationaux"
Les relations émiraties et saoudiennes avec l'ACMI et le commerce des crédits carbone africains illustrent une évolution notable en ce qui concerne le rôle du Golfe sur ces nouveaux marchés. Au-delà de la simple possession de projets de compensation en Afrique, les États du Golfe se positionnent également à l'autre bout de la chaîne de valeur du carbone : la commercialisation et la vente de crédits carbone à des acheteurs régionaux et internationaux. À cet égard, le Golfe apparaît comme un espace économique clé où le carbone africain est transformé en un actif financier qui peut être acheté, vendu et faire l'objet de spéculations de la part d'acteurs financiers du monde entier.
En effet, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont tous deux cherché à établir des bourses du carbone permanentes, où les crédits carbone peuvent être achetés et vendus comme n'importe quelle autre marchandise. Les Émirats arabes unis ont créé la première bourse de ce type à la suite d'un investissement du fonds souverain contrôlé par Abou Dhabi, Mubadala, dans l'AirCarbon Exchange (ACX), basée à Singapour, en septembre 2022. Dans le cadre de cette acquisition, Mubadala détient désormais 20 % d'ACX et a créé une bourse numérique réglementée d'échange de carbone dans la zone franche financière d'Abou Dhabi, l'Abu Dhabi Global Market. ACX affirme qu'il s'agit de la première bourse réglementée de ce type au monde, et que les échanges de crédits carbone y débuteront fin 2023. De même, en Arabie saoudite, la RVCMC s'est associée à l'entreprise américaine de technologie de marché Xpansiv pour créer une bourse permanente de crédits carbone dont le lancement est prévu fin 2024.
Reste à savoir si ces deux bourses basées dans le Golfe seront en concurrence ou si elles donneront la priorité à des instruments d'échange différents, tels que les dérivés du carbone ou les crédits carbone conformes à la charia. Ce qui est clair, en revanche, c'est que les principaux centres financiers du Golfe s'appuient sur leurs infrastructures existantes pour établir une domination régionale dans la vente de carbone. Actif à tous les stades de l'industrie de la compensation - de la production de crédits carbone à leur achat - le Golfe est désormais un acteur principal des nouvelles formes d'extraction de richesse qui relient le continent africain à l'économie mondiale au sens large.
Garantir un avenir basé sur l'énergie fossile
Au cours des deux dernières décennies, la production de pétrole et surtout de gaz du Golfe s'est considérablement accrue, parallèlement à un déplacement important vers l'est des exportations d'énergie pour répondre à la nouvelle demande d'hydrocarbures de la Chine et de l'Asie de l'Est. Dans le même temps, les États du Golfe ont accru leur participation dans les secteurs en aval à forte intensité énergétique, notamment la production de produits pétrochimiques, de plastiques et d'engrais. Emmenées par Saudi Aramco et Abu Dhabi National Oil Company, les compagnies pétrolières nationales basées dans le Golfe rivalisent désormais avec les supergrands groupes pétroliers occidentaux traditionnels en termes de réserves, de capacité de raffinage et de niveaux d'exportation.
"Au contraire, à l'instar des grandes compagnies pétrolières occidentales, la vision du Golfe d'une production accrue de combustibles fossiles s'accompagne d'une tentative de s'emparer du lead des initiatives mondiales de lutte contre la crise climatique"
Dans ce contexte, et malgré la réalité de l'urgence climatique, les pays du Golfe redoublent d'efforts dans la production d'énergies fossiles, voyant tout l'intérêt de s'accrocher le plus longtemps possible à un monde centré sur le pétrole. Comme l'a promis le ministre saoudien du pétrole en 2021, « chaque molécule d'hydrocarbure sortira »[5]. Mais cette approche ne signifie pas que les États du Golfe ont adopté une posture de négation du changement climatique, la tête dans le sable. Au contraire, à l'instar des grandes compagnies pétrolières occidentales, la vision du Golfe d'une production accrue de combustibles fossiles s'accompagne d'une tentative de s'emparer du leadership dans les efforts mondiaux de lutte contre la crise climatique.
L'un des aspects de cette approche est leur forte implication dans les technologies à faible teneur en carbone, imparfaites et non avérées, telles que l'hydrogène et le captage du carbone. D'autre part, ils tentent d'orienter les négociations mondiales sur le climat, comme en témoignent les récentes conférences des Nations unies sur le changement climatique, COP27 et COP28, au cours desquelles les États du Golfe ont détourné les discussions politiques des efforts efficaces pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, transformant ces événements en un peu plus que des spectacles d'entreprise et des forums de réseautage pour l'industrie pétrolière.
Le marché des compensations carbone doit être considéré comme faisant partie intégrante de ces efforts visant à retarder, à obscurcir et à entraver la lutte contre le changement climatique de manière significative. Grâce à la comptabilité carbone trompeuse des projets de compensation, les grandes industries pétrolières et gazières du Golfe peuvent poursuivre leurs activités habituelles tout en prétendant atteindre leurs soi-disant objectifs climatiques. La dépossession des terres africaines par les pays du Golfe est un élément clé de cette stratégie, qui permet en fin de compte d'entretenir le spectre désastreux d'une production de combustibles fossiles en constante accélération.
Traduction de l'anglais par Emmanuelle Carton (CADTM)
Source :https://merip.org/2024/07/laundering-carbon-the-gulfs-new-scramble-for-africa/
Adam Hanieh est professeur auprès du SOAS, University of London. Il est l'auteur, entre autres, de Money, Markets, and Monarchies : The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East, Cambridge University Press, 2018 et Lineages of Revolt. Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Haymarket Books, 2013.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[2] Heidi Blake, “The Great Cash-for-Carbon Hustle,” The New Yorker, October 16, 2023.
[3] Katherine Hearst, “Kenya concedes ‘millions of hectares' to UAE firm in latest carbon offset deal,” Middle East Eye, November 5, 2023.
[4] Thales A. P. West et al., “Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change,” Science 381/6660 (August 2023), p. 876.
[5] “Africa Carbon Markets Initiative (ACMI) : Roadmap Report,” ACMI, November 8, 2022, p. 12.

La guerre n’a pas de visage de femme indigène

La Marche mondiale des femmes du Mato Grosso do Sul dénonce publiquement les violences subies par les peuples Kaiowá et Guarani. La violence subie par les indigènes des zones reprises Yvyajere, Pikyxyn et Kurupa Yty, situées sur la terre indigène Panambi – Lagoa Rica à Douradina, MS, a récemment été rendue publique au niveau national et international.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il convient de noter que ces zones reprises constituent ce TI (territoire indigène), qui a déjà été délimité par la Fondation nationale pour les peuples indigènes (FUNAI) et n'a pas été conclu en raison du processus de judiciarisation. Cette action, perpétrée par les propriétaires terriens de la région, a empêché la poursuite de ce processus pendant plus d'une décennie.
Depuis la mi-juin 2023, les luttes des peuples Guarani et Kaiowá se sont intensifiées dans de nombreuses zones, dans les Tekoha déjà identifiées, en particulier dans le sud de l'État. Les Tekoha sont des territoires sacrés dans lesquels les rezadoras, nhandesy (anciens du savoir traditionnel), cultivent leurs connaissances ancestrales, liées aux plantes médicinales, aux soins du corps-territoire, pour les générations à venir et pour la reproduction de la bonne vie sociale de la famille élargie.
Nous comprenons que les femmes indigènes des régions reprises subissent la violence d'un champ de bataille, d'une guerre, d'un génocide orchestré par les propriétaires terriens ruraux. Cette violence se répète, avec des assassinats de dirigeants, des tortures et des expulsions. La violence contre les femmes, en particulier les Ñandesy, pour ce qu'elles représentent dans la communauté indigène, avec leur foi, leur mbaracá, leurs prières, leurs chants et leurs danses. Persécutées, acculées, brûlées par l'intolérance religieuse, les préjugés et la xénophobie à l'encontre de ces guerrières Ñandesy. Dans « La guerre n'a pas de visage de femme », Svetlana Aleksiévitch dépeint les actions des femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autrice y raconte comment cette histoire est occultée, mais elle existe : les femmes se sont battues courageusement contre le fascisme.
Cette lutte se déroule sur des territoires ancestraux et l'État brésilien est en grande partie responsable de tout ce conflit dans le Mato Grosso do Sul. C'est l'État qui a expulsé les populations indigènes de leurs territoires au siècle dernier et depuis lors, il est resté inerte. Le gouvernement fédéral omet de régulariser la propriété foncière des territoires considérés comme sacrés par les Guarani et les Kaiowá. Ces peuples attendent le processus de régularisation depuis la Constitution fédérale (CEF/88). Le non-respect de la Constitution fédérale donne lieu à des violences qui mettent en danger la vie des personnes : hommes, femmes et enfants. Dans ce contexte, les femmes et les enfants indigènes sont cruellement exposés à la barbarie de l'agriculture.
Il faut vivre, il faut reproduire la vie au lieu d'attendre la bureaucratie étatique des territoires. Face à l'inertie et à l'omission de l'Etat, les Ñandesy doivent créer un pouls de vie : elles contribuent à la santé physique et spirituelle de leur peuple dans le processus d'auto-démarcation.
Les reprises sont des outils de la lutte indigène, fondamentaux pour l'existence d'un monde plus juste, plus égalitaire et plus fraternel. Les femmes Kaiowá et Guarani sont fondamentales dans ce processus de récupération des terres. Il s'agit d'un mouvement tout à fait légitime. Nous reconnaissons l'histoire des expulsions et des réserves, qui ont conduit à l'enlèvement de la vie des peuples indigènes, des femmes et des enfants indigènes, avec des crimes de haine, leur enlevant le droit à leur vie collective quotidienne dans leurs communautés.
La violence des propriétaires terriens est à la fois sexiste, patrimonialiste, physique et psychologique. Les vidéos de guerriers abattus d'une balle dans la tête, ensanglantés, découpés, montrent les actes que les éleveurs sont prêts à accomplir. Le Mato Grosso do Sul suit le modèle national de concentration des terres entre les mains de quelques familles et l'histoire de la spoliation des terres indigènes remonte à la compagnie Matte Laranjeira à la fin du 19e siècle, mais les « propriétaires de la terre » ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'une terre indigène, une terre de soins, une relation symbiotique entre le corps des femmes et la santé du territoire.
Comme solution, l'État brésilien présente un calendrier, une action irresponsable qui continuera à permettre la guerre et l'offensive contre la vie des peuples indigènes. Les juges qui signent les saisies, les ministres du STF qui assouplissent l'inconstitutionnalité du cadre temporel, les politiciens qui signent les nouvelles lois qui apportent l'insécurité juridique aux peuples indigènes de ce pays sont en grande majorité des hommes et des blancs.
Contre le pouvoir de la plume, du jugement et du nouveau décret-loi : les Ñandesy avec leur mbaraca, avec une attention collective, pour la survie d'eux-mêmes, du collectif et de la terre !
Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que nous soyons toutes libres !
Août 2024
Marche mondiale des femmes – MS
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/a-guerra-nao-tem-rosto-de-mulher-indigena/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les femmes sans terre construisent des territoires libres : 40 ans de lutte pour la réforme agraire au Brésil

Le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) célèbre 40 ans de lutte et de mobilisation contre la violence sexiste dans les campagnes
Tiré de Entre les lignes et les mots
Pour changer la société
Selon notre volonté
et participer sans avoir peur d'être une femme !
(Chanson tirée du recueil de chansons populaires féministes)
Dans le climat politique de résistance et de transformation sociale qui a imprégné l'Amérique latine des années 1970 et 1980, plusieurs instruments politiques de la classe ouvrière se sont formés au Brésil, dont le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST). De même qu'il est impossible de concevoir cette résistance révolutionnaire sans tenir compte de l'importante participation des femmes au sein des différents fronts de lutte, il est également impossible de penser au 40e anniversaire du MST sans appréhender cette participation comme une construction qui se produit à travers différents espaces – depuis les occupations, l'organisation des « acampamentos » et des « assentamentos », au sein de la formation et jusque dans les instances.
Réfléchir au processus organisationnel du MST, c'est réfléchir au rôle significatif joué par les femmes et à la manière dont celles-ci ont réussi à peser à partir de la matérialité de la reproduction de la vie. Comme le dit Djacira Araújo dans son articleLes femmes sans terre abattent les clôtures et écrivent l'histoire : 40 ans du MST, « dès les premières occupations de terrains, la présence de femmes et d'enfants a eu un impact en termes de sensibilisation de la société au problème de l'exclusion et de la dépossession des familles sans terre, tout en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures face au niveau de violences auquel les grands propriétaires terriens et le lobby de l'agrobusiness pouvaient parvenir ».
La vie quotidienne dans les campements (acampamentos), bien que pleine de vie et d'espoir, reste aussi très précaire, avec pour conséquence d'augmenter la demande de travail de soins – historiquement attribuée aux femmes. Il faut nourrir tout le monde, s'occuper des enfants et les éduquer, soigner les malades et stimuler la résistance. Ces demandes quotidiennes de prise en charge de la vie orientent l'organisation des secteurs et permettent la formation de groupes et de collectifs, créant des espaces de dialogue, de partage de la vie quotidienne, de la vie privée, de l'absence et de la présence de la violence, et de l'importance d'être ensemble.
Cette lutte est couplée à une journée intense de travail domestique et productif, avec de la douleur et de l'espoir, au-delà de l'amour et du travail de première ligne dans lequel les femmes utilisent leur corps comme un outil pour contenir les conflits. Malgré cela, les réunions et autres espaces de décision restent des lieux auxquels peu de femmes parviennent à participer. À travers l'histoire de la participation politique des femmes, prendre la parole peut s'avérer un défi majeur. Le pantalon et le pull large n'ont pas toujours représenté leur choix, mais une sorte de code nécessaire pour être entendues et respectéesen tant qu'activistes,et non pas harcelées et désirées en tant qu'objet sexuel. De cette manière, les femmes ont construit leur place dans les espaces de formation et de prise de décision du Mouvement. Comme nous l'avons expliqué dans la brochure de formation A conspiração do gênero (La conspiration du genre), « le processus d'insertion des femmes dans les tâches de direction de l'organisation, ainsi que celui de leur reconnaissance en tant que sujets politiques dans la lutte pour la terre et la réforme agraire, n'a pas été facile et a exigé beaucoup de persévérance et de conspiration politique ».
En parallèle au travail interne, les femmes ont tissé des liens avec des femmes d'autres organisations de la classe ouvrière à la campagne et à la ville, comme l'Articulation nationale des femmes rurales, forgeant de nombreuses luttes pour l'extension des droits à la sécurité sociale, la santé publique, un nouveau projet d'agriculture populaire, la réforme agraire, une campagne de documentation et d'autres encore. Elles ont également mis en place une formation politique et idéologique féministe destinée aux différents niveaux de militantisme et à la base.
Dans les années 2000, ce processus de construction s'est soldé par la création du secteur Genre, qui a fait valoir l'importance d'impliquer l'ensemble du mouvement dans le débat sur les relations humaines, en soulignant le rôle de la violence patriarcale dans le maintien du système latifundiaire et le défi que représente la construction de nouvelles relations de genre, liées aux rapports de pouvoir. Ceci a permis de mettre à l'agenda collectif la question de l'autonomie financière des femmes, la lutte contre la violence domestique et la prise en charge des enfants. Ce débat très important a permis d'atteindre la parité dans les organisations du MST en 2006. La présence effective des femmes dans les instances nationales et régionales a élargi l'horizon politique de leur participation au mouvement.
Les années 2000 ont également marqué un retour à l'esprit combatif du 8 mars, Journée internationale de lutte des femmes, en tant que construction de la résistance des femmes travailleuses entendant le lien entre les dominations de classe et patriarcale. Comme l'explique Djacira, « la conscience acquise à travers les expériences de l'organisation permet aux femmes sans terre de se sentir partie prenante d'un projet plus large impliquant la classe ouvrière et qui doit encore être réalisé ; de se rendre compte que des événements considérés comme des « petites choses » font partie de la lutte plus large contre le capital ».
La construction et la participation aux journées de lutte, en particulier celles du mois de mars, ont permis de comprendre l'importance de l'auto-organisation des femmes. La mobilisation de 2006, au cours de laquelle les femmes se sont unies pour lutter contre le désert vert des monocultures d'eucalyptus d'Aracruz Celulose, a particulièrement mis en avant le féminisme en tant que pratique concrète pour affronter le capital, et le féminisme paysan populaire en tant que stratégie pour construire de nouvelles subjectivités et de nouvelles sociabilités dans une perspective internationale.
En tant qu'organisation issue des expériences historiques des peuples en résistance, le MST s'est très tôt engagé dans la construction de la solidarité internationale. Cela s'est fait à travers des instruments de lutte paysanne, avec la formation de la Coordination latino-américaine des organisations paysannes (CLOC) et de la Via Campesina, ainsi que par l'organisation de formations, d'échanges d'expériences et de brigades de solidarité. L'expérience des processus internationalistes a contribué à comprendre la relation organique entre le capital, le patriarcat et le racisme, qui est profonde et internationalisée. Une organisation internationale est nécessaire pour affronter et dénoncer les ravages de ce système sur les peuples ruraux.
Avec la participation des femmes paysannes, autochtones, habitantes des eaux et des forêts au débat sur le féminisme paysan populaire, nous avons également progressé dans notre compréhension des spécificités de cet impact sur les femmes dans l'interrelation entre corps et territoire. Le féminisme paysan populaire élargit notre stratégie politique, car nous nous focalisons sur les relations égalitaires et sur les processus d'émancipation humaine. Par ailleurs, nous nous engageons en faveur de l'agroécologie en tant que production en équilibre avec la nature et en tant que reconstruction de notre humanité. Au cœur de cet engagement politique se trouve le retour aux communs et la défense des biens communs, en cherchant à construire des territoires sans violence au sens le plus large.
La lutte des femmes pour le droit à la participation politique a contribué à façonner le MST, comme le dit Djacira lorsqu'elle explique que « la nature organique du MST n'est ce qu'elle est que grâce au regard féminin, qui a mis des thèmes profonds de l'existence humaine à l'agenda, tels que l'éducation, la santé, la prise en charge et soins des enfants, la lutte contre les oppressions de genre, la construction de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Dans une large mesure, ces questions ont conduit à la nécessité de repenser la structure politique de l'organisation, en mettant l'accent sur la création de nouveaux collectifs, secteurs, fronts et de nouvelles pratiques de formation ».
La participation des femmes a permis de réaliser que la lutte contre le patriarcat, le racisme et le capitalisme, dans toutes leurs expressions politiques et culturelles, fait partie de la lutte du MST et de la classe ouvrière. C'est pourquoi il faut être vigilant et combattre les dérives éthiques et morales du sexisme, du racisme, du fascisme et de l'exploitation de classe ; être vigilant pour créer des subjectivités réorientées selon des principes humanistes, féministes, antiracistes et socialistes.
Lucineia Miranda de Freitas, 28 mai 2024
Lucineia Miranda de Freitas est une dirigeante du secteur « genre » du MST.
Édition et révision par Bianca Pessoa
https://capiremov.org/fr/experiences/les-femmes-sans-terre-construisent-des-territoires-libres-40-ans-de-lutte-pour-la-reforme-agraire-au-bresil/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Laura et Berthe Zúñiga : la lutte pour la justice pour Berta est immergée dans la lutte pour la justice pour le peuple Lenca

Bertha et Laura Zúñiga sont membres du Conseil civique des Organisations populaires et autochtones du Honduras (Copinh) et filles de la militante écologiste féministe Berta Cáceres, assassinée en 2016. Depuis huit ans, des mouvements populaires au Honduras se battent pour que justice soit rendue à Berta.
Tiré de Entre les lignes et les mots
L'une des premières revendications du mouvement dès le début était l'enquête sur les commanditaires du crime. « Nous avons une très forte demande pour montrer qui sont les acteurs, ce qui se cache derrière le meurtre de ma mère, quels intérêts voulaient bénéficier du meurtre », explique Laura.
La pression exercée pour enquêter sur l'affaire a abouti à un procès en 2018 et à la condamnation en 2019 de huit hommes, dont sept étaient les auteurs du crime et David Castillo, qui a servi d'intermédiaire entre les commanditaires et les autres. Les huit avaient des liens avec l'entreprise responsable du projet hydroélectrique dénoncé par Berta et Copinh, le projet Agua Zarca, sur la rivière Gualcarque. Malgré le procès, les coupables n'ont pas encore été condamnés, ni les auteurs intellectuels tenus pour responsables. Pour cette raison, le Copinh maintient sa pression pour la justice.
Pour Bertha et Laura, l'enquête sur le meurtre de leur mère marque un changement dans la manière dont les enquêtes sur les crimes commis contre les défenseurs et les dirigeants locaux sont menées. Selon elles, le taux d'impunité des auteurs de crimes de toutes sortes est de 90% au Honduras. « Dans ce contexte, nous considérons cela comme une victoire populaire contre un système d'impunité », a déclaré Bertha. Elle affirme que « dans le système judiciaire, certaines parties fonctionnent et œuvrent pour la persécution des leaders sociaux et l'impunité des groupes économiques. C'était un crime dans lequel nous avons pu identifier la participation de structures de tueurs à gages, de structures militaires et aussi d'un groupe économique très puissant au Honduras, qui est la famille Atala Zablah ». La famille Atala Zablah est profondément liée aux secteurs extractifs en Amérique latine, et l'un de ses membres, Daniel Atala Midence, a reçu un mandat d'arrêt pour le cas de Berta.
Dans l'interview réalisée le 5 juin 2024, Bertha et Laura ont parlé de l'avancement de l'enquête et de la condamnation. L'interview a été menée collectivement par plus de 20 médias et organisations populaires alliées qui composent l'Alba Movimentos dans plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Lisez la traduction de l'interview ci-dessous ou écoutez-la dans sa langue originale.
******
Pourquoi la détermination de la peine est-elle retardée ou reportée si longtemps ?
Laura : Elle est reportée car de nombreux intérêts font pression pour qu'il n'y ait pas de confirmation de la peine. Cela est lié au fait qu'ils essaient de retarder et de boycotter le processus de justice pour ma mère. Nous savons que, même au sein de la magistrature, il y a tout un débat sur l'ingérence qui a lieu de la part de ce puissant groupe économique. Il nous appartient maintenant, en tant que mouvements populaires, de protéger ces condamnations et leur confirmation.
Quelle est l'attitude du gouvernement hondurien à l'égard de ce cas particulier ? Pensez-vous qu'elle contribue à la cause de manière favorable ou qu'elle crée des conditions plus favorables à l'impunité ?
Bertha : Justice pour Berta Cáceres était un thème de campagne du gouvernement de Xiomara Castro, notre présidente. Au sein du pouvoir exécutif, une pétition spécifique a été mise en place et nous pensons avoir progressé dans ce domaine. Il y a un élément très important : la question de la justice pour Berta continue de dépendre presque exclusivement du pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif n'a pas formellement un niveau d'influence sur ces décisions. Jusqu'à présent, et très précisément sur la question de la résolution de ces peines, la Cour suprême de Justice n'a publié aucune communication publique. Je pense donc qu'il est très important que les organisations qui font partie d'Alba Movimentos puissent également mener des actions visant à garantir que le gouvernement maintienne la cohérence du discours et agisse pour le bien du processus de justice.
Quelles stratégies juridiques et politiques continentales peuvent être utiles dans cette phase dans laquelle nous nous trouvons maintenant ?
Laura : Nous avons fait appel à la Commission interaméricaine des droits humains sur les mesures de protection dont bénéficiait ma mère et dont bénéficient Copinh et les victimes dans cette affaire. L'une des choses que nous essayons de faire est de mettre en lumière, au niveau international, la négligence et le choix d'omettre les soins dont Berta Cáceres avait besoin. Il est également important de rester informé et, petit à petit, de briser le siège médiatique des médias hégémoniques, car cette affaire symbolise aussi le cas de nombreuses autres femmes qui ont défendu leurs territoires et qui ont fait face au système capitaliste patriarcal raciste.
Bertha : Au Copinh, nous avons défini quelques actions importantes, comme l'envoi de lettres à la Cour Suprême de Justice. Il ne s'agit pas nécessairement de personnes, d'organisations ou d'institutions dédiées au monde juridique du contentieux, mais d'organisations et de lettres générales, qui peuvent être remises directement à la Chambre pénale de la Cour suprême de justice. Toute action publique montrant une préoccupation est bonne, même les actions du gouvernement hondurien lui-même, puisqu'il s'agit d'un sujet de campagne.
Pour nous, il est très important que cela accompagne le processus organisationnel du Copinh et qu'il parvienne à donner de la visibilité à d'autres victimes qui ne sont pas directement liées à cette affaire, comme les peuples autochtones, les femmes assassinées et les défenseurs. Isolément, cela n'a pas non plus beaucoup de sens sans l'impact juridique sur l'approfondissement de nos propres capacités organisationnelles et le renforcement des propres messages de notre camarade Berta Cáceres au Honduras, à nos désirs de transformation, à la région au niveau continental.
Pensez-vous que, dans l'approche de la justice, il y a eu des progrès par rapport à la perspective de genre au cours de la période où l'affaire est en cours
Laura : Je crois que cela a également été un différend pour le Copinh de pouvoir aborder et démontrer au sein des institutions judiciaires comment une femme autochtone est agressée. Les questions de genre et de corps racialisés ont été abordées et je pense que cela a été une avancée, car il s'agissait d'une lutte dans laquelle des experts ont été amenés à enquêter sur la façon dont le tissu des communautés indigènes a été historiquement déchiré et comment ils ont cherché à détruire les communautés en attaquant spécifiquement une femme, ce qui est très différent de la façon dont les hommes sont attaqués.
En ce sens, je pense que le procès a également été un moment pour enseigner au système judiciaire hondurien comment aborder les femmes autochtones, les défenseures et les combattantes. Les médias hégémoniques cherchent à minimiser nos voix et cela a aussi à voir avec la minimisation de la diversité. Ils ont cherché non seulement à dire qu'il s'agissait d'un meurtre et rien de plus, mais aussi à dire qu'il s'agissait d'un « crime de jupe », une manière néfaste d'appeler féminicide et aussi de retirer l'élément de meurtre à une défenseure qui avait de nombreuses autres menaces et attaques.
Quelle est la situation actuelle de la lutte environnementale au Honduras et quels sont les principaux défis auxquels le mouvement environnemental est confronté en ce moment ?
Bertha : Malheureusement, le Honduras continue de figurer parmi les pays les plus dangereux pour la défense de la Terre Mère, des biens communs, de la terre et du territoire. Nous avons des cas très délicats dans notre pays, comme ceux de la région de Bajo Aguán, sur la côte nord, où de nombreux dirigeants sociaux ont été assassinés en toute impunité. Nous parlons toujours de l'articulation des groupes économiques dans notre pays. Bien qu'il s'agisse d'un cas emblématique qui a brisé toute la norme de ce qui se passe dans notre pays, il est important qu'il contribue d'une certaine manière à clarifier la situation d'autres personnes assassinées qui continue de se produire au Honduras.
Bien qu'il y ait une volonté de changement, ces structures criminelles restent intactes. Nous continuons d'essayer de lier la question financière et économique de la corruption à ce type de cas, car c'est très évident. Même la question des meurtres de femmes, des réseaux de traite et des féminicides reste une constante car la question de la justice est un défi. On finit par en savoir un peu plus sur la justice en interne. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour le dire de manière populaire, vous donne des frissons, vous fait dresser les cheveux sur la tête. Il y a de nombreux intérêts politiques et économiques de toutes sortes.
Laura : En ce qui concerne les défis, je soulèverais cette question de l'impunité. Il est difficile de continuer la lutte au milieu de tant d'impunité et de tant de crimes. C'est aussi une lutte pour vraiment faire reconnaître les droits des victimes et des organisations. Historiquement, nous avons réussi dans un procès – le procès pour corruption et fraude impliquant Gualcarque – que le Copinh et le Conseil autochtone de la communauté de Rio Blanco soient considérés comme des victimes formelles. Cela ne s'était jamais produit dans notre pays.
De plus, bien sûr, nous devons rechercher la pleine reconnaissance des droits des communautés autochtones. Parfois, la question de l'environnement a été envisagée ou abordée de manière abstraite, comme si, là où il y avait un environnement, il n'y avait pas de communautés et donc pas de droits. Nous continuons à dire : nous protégeons 85% des réserves et des forêts de notre pays. Des mesures environnementales ne peuvent être prises sans tenir compte de nos droits en tant que communautés. Les lois ne nous considèrent pas comme des gestionnaires de zones protégées. Un dernier défi est de trouver de vraies solutions. Aujourd'hui, le capitalisme lui-même a fourni tellement de fausses solutions environnementales qu'il convainc même les membres du gouvernement. Il y a une grande bataille que nous devons mener pour trouver de vraies solutions à une crise environnementale et climatique qui a signifié une violation systématique des droits des sujets dont la responsabilité est de protéger cette nature et ces biens communs.
Laura : La lutte pour la justice pour Berta est immergée dans la lutte pour la justice pour le peuple Lenca. En ce sens, nous continuons à lutter pour que la rivière Gualcarque soit libre, car elle est actuellement en concession et fait donc partie des processus de corruption pour la concession de la rivière, puisque des personnes ont été condamnées, on découvre comment fonctionne l'extractivisme au Honduras et comment cette concession a également fonctionné illégalement. Les communautés Lenca organisées au Copinh continuent de revendiquer des droits qui leur ont été historiquement refusés. L'organisation reste active.
Édition par Bianca Pessoa
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : espagnol
https://capiremov.org/fr/entrevue/laura-et-berthe-zuniga-la-lutte-pour-la-justice-pour-berta-est-immergee-dans-la-lutte-pour-la-justice-pour-le-peuple-lenca/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le féminisme est une révolution : pour la souveraineté populaire et nos corps

Voici la déclaration de la 3ème Rencontre Nationale du MMM « Nalu Faria », qui a réuni plus d'un millier de femmes du 6 au 9 juillet à Natal, Rio Grande do Norte
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/07/13/le-feminisme-est-une-revolution-pour-la-souverainete-populaire-et-nos-corps/
Renverser ce système avec force et rébellion, organiser les femmes sans perdre notre audace : rêver et lutter comme Nalu Faria ». C'est par ce chant que nous, militantes de la Marche Mondiale des Femmes, réunies à l'occasion de notre 3ème Rencontre Nationale, résumons le sens politique de notre mouvement. Nous voulons changer le monde en changeant la vie des femmes et notre stratégie pour y parvenir est l'auto-organisation dans tous les lieux où nous vivons, travaillons et agissons.
Les femmes organisées en féminisme populaire sont la tempête du patriarcat. Nous sommes des travailleuses de la campagne et de la ville, des femmes noires, des femmes aux sexualités diverses, des femmes lesbiennes et bisexuelles, des jeunes femmes, des femmes transgenres, des femmes quilombolas et indigènes, des femmes dans les syndicats et l'économie solidaire, des femmes âgées et des femmes handicapées. Nous sommes organisées dans un féminisme populaire qui est fort parce qu'il est construit au quotidien avec un programme politique qui nous organise et nous mobilise, un féminisme dans lequel nous avons toutes notre place.
Au Brésil et dans le monde entier, les femmes sont en première ligne de la résistance au fascisme. Les attaques contre nos corps et nos sexualités, la violence sous ses formes les plus extrêmes, ainsi que le renforcement du modèle familial hétéropatriarcal, augmentent la charge de travail face à la crise et à la précarité des conditions de vie.
Les attaques contre les femmes ne sont pas un écran de fumée : le conservatisme fait partie du néolibéralisme et est au cœur des actions de l'extrême droite. Ces dernières années, la mobilisation des femmes a été fondamentale dans la lutte contre Bolsonaro et dans la victoire électorale de Lula. Aujourd'hui, nous sommes en meilleure position pour organiser nos luttes, mais nous vivons une période de résistance et de confrontation avec l'extrême droite. Nous voyons et ressentons la misogynie à la radio, sur Internet et à la télévision, dans nos quartiers, nos communautés et nos territoires. Nous sommes convaincues que la force féministe organisée est capable d'imposer des défaites à l'extrême droite, comme les récentes mobilisations qui ont stoppé le traitement du projet de loi 1904.
Nous devons sortir de la résistance et construire une offensive féministe contre le conservatisme. Nous devons accroître la présence des femmes dans tous les espaces de décision politique, mais cela ne suffit pas. Nous devons accumuler des forces à l'intérieur et à l'extérieur du parlement et des institutions pour changer les structures et radicaliser la démocratie. Nous contestons la signification publique de l'État, nous luttons pour étendre les services publics et le droit à la santé et à l'éducation, aux soins et à l'alimentation, à l'eau et à l'énergie, ainsi qu'au logement.
Nous luttons pour des politiques immédiates qui changent les conditions de vie maintenant et qui créent les conditions pour des transformations structurelles. Nous nous engageons à construire une politique nationale de soins qui renforce la responsabilité de l'État en matière de soins et de reproduction sociale. Dans cette construction, nous voulons accumuler des forces pour rompre avec la dynamique de la division sexuelle et raciale du travail, afin de construire une économie dans laquelle la durabilité de la vie est au centre.
Le conflit du capital contre la vie au Brésil se manifeste par une exploitation et une expropriation accrues des corps, du travail, des vies et des territoires des femmes et de la classe ouvrière. La militarisation et la violence sont des instruments de ce conflit. La privatisation, la militarisation et le conservatisme vont de pair, comme le montrent les attaques contre l'éducation. Nous luttons pour la défense des biens communs et contre le pouvoir des sociétés transnationales.
Les entreprises transnationales personnifient le capital et avancent sur nos territoires. Nous dénonçons l'omission et la subordination de l'État aux intérêts des entreprises, comme dans le cas de la tragédie criminelle de Braskem. Au nom du climat, les entreprises transnationales s'approprient les biens communs et encerclent les territoires vitaux des peuples. Les complexes éoliens et solaires progressent, notamment dans les États du nord-est. Cette avancée sur les territoires suit la même logique que les projets miniers et de capitalisme vert : ils modifient les usages des terres et les modes de vie, en particulier des communautés indigènes et quilombolas, empêchent la libre circulation, augmentent le travail domestique et rendent les femmes malades. Il s'agit de processus violents qui aggravent la violence historique raciste et patriarcale à l'encontre des femmes.
Les propositions du capital sont de fausses solutions au changement climatique, car elles sont basées sur la logique de la poursuite de l'expansion de la demande d'énergie et de la pollution, cachée dans le discours de la neutralité carbone. Nous rejetons le maquillage vert et lilas de ce système, qui continue à détruire les biomes et à aggraver le racisme environnemental. La crise que nous vivons a de multiples dimensions et l'une d'entre elles est le climat. Les événements climatiques extrêmes sont déjà une réalité, comme les inondations dans le Rio Grande do Sul et la sécheresse en Amazonie. Sans la capacité d'organiser la solidarité, les impacts sur les populations seraient encore plus importants. Nous luttons pour la justice climatique, qui ne sera pas une réalité sans justice environnementale.
Les femmes indigènes et quilombolas nous ont appris que notre corps est notre premier territoire. Nous rejetons la logique de l'industrie pharmaceutique qui nous fragmente et nous rend malades au service des profits des mêmes entreprises transnationales qui vendent des médicaments et des pesticides.
Nous luttons pour que les femmes puissent vivre leur sexualité sans être soumises aux normes oppressives de l'hétéronormativité. Nous exigeons la légalisation de l'avortement et sa dépénalisation afin qu'aucune fille ou femme ne souffre, ne soit mutilée ou ne meure pour avoir décidé de ne pas poursuivre une grossesse non désirée. Nous dénonçons l'action du marché sur le corps des femmes, qui exploite et transforme le sexe en marchandise, la pédophilie en consommation et les corps en objets.
L'économie féministe est notre alternative et notre stratégie. Pour faire face au pillage de nos corps-territoires, de notre travail et de nos modes de vie, nous avons besoin d'une réforme agraire populaire, avec une production basée sur l'agroécologie. Les femmes construisent des alternatives concrètes dans leurs territoires, avec leurs connaissances, leurs technologies libres et leurs formes de communication populaire. Les jardins communautaires, les blanchisseries collectives, l'économie solidaire et l'agroécologie recousent d'autres formes de relations entre l'homme et la nature.
Nous luttons pour la souveraineté populaire, qui se compose de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique, de la souveraineté technologique et de la souveraineté de nos corps. Nous affrontons l'impérialisme et ses mécanismes de domination, qu'il s'agisse de coups d'État, de sanctions ou de guerres. Nous ne nous arrêterons pas tant que le génocide du peuple palestinien n'aura pas cessé, tant que la Palestine ne sera pas libre, de la rivière à la mer. La solidarité et l'internationalisme féministe sont nos piliers et nos fils conducteurs.
En tant que mouvement de base, nous avons relevé le défi de poser le pied dans chaque municipalité, village, communauté et colonie. Et organiser un mouvement de femmes massif pour que le féminisme devienne un lieu d'attention, d'affection et, surtout, de lutte.
Nous nous engageons à partager les leçons du féminisme et à apprendre des femmes afin qu'ensemble, nous puissions construire une société de liberté et d'égalité. Guidées par l'espoir et la force collective d'un millier de femmes venues de 23 États du pays, nous réaffirmons que l'aube féministe commence chaque jour jusqu'à ce que nous soyons toutes libres.
Comme nous l'avons dit dans les rues de Natal, « le féminisme est une révolution ». Notre programme ne correspond pas au modèle de société du capital. Nous affirmons nos principes d'auto-organisation des femmes et d'alliances stratégiques avec les mouvements populaires. Nous avons appris de nos alliés et avons construit ensemble des processus anti-impérialistes et des luttes pour l'intégration des peuples. Nous affirmons le socialisme comme horizon de transformation, convaincues que sans féminisme, il n'y a pas de socialisme.
Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que nous soyons toutes libres !
Nalu Faria présente !
Marche mondiale des femmes, 09 juillet 2024
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/feminismo-e-revolucao-por-soberania-popular-e-de-nossos-corpos-declaracao-do-3o-encontro-nacional-da-marcha-mundial-das-mulheres/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Recommandations du rapport CESE Genre et transition écologique

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté en mars 2023 un avis et un rapport « Inégalités de genre, crise climatique, et transition écologique ». Ces travaux ont été présentés lors de l'atelier du 22 juin, organisé par Adéquations et Wide Autriche. On trouvera ci-dessous les recommandations du rapport.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/22/recommandations-du-rapport-cese-genre-et-transition-ecologique/
Le CESE formule un ensemble de préconisations articulées en six axes :
AXE 1 : Améliorer et visibiliser la connaissance et la recherche sur l'impact différencié des effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement sur les femmes et les hommes
1 – Intégrer dans les rapports du GIEC les études et données sexospécifiques disponibles relatives au climat
PRÉCONISATION #1
Demander au GIEC de produire, en vue de son 7ème rapport et pour les suivants, un rapport spécial qui synthétise la recherche internationale existante sur les impacts différenciés du changement climatique sur les femmes et les hommes, basé sur des données sexospécifiques et insistant sur le besoin de leur développement là où elles sont insuffisantes, afin de mettre en œuvre les objectifs du programme d'action de la conférence mondiale sur les femmes de Pékin et le plan genre de la CCNUCC
2 – Construire des politiques publiques relatives au climat et la transition écologique basées sur des données ventilées par sexes
PRÉCONISATION #2
Intégrer la dimension genrée dans l'étude d'impact préalable des projets et propositions de lois qui concernent la transition écologique et dans les évaluations de leur mise en œuvre, permettant de mieux appréhender leurs effets différenciés sur les femmes et les hommes. Renforcer les moyens du Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) et repenser sa place institutionnelle afin d'en faire le service public garant de l'évaluation genrée des législations de la transition écologique.
3 – Mieux identifier, pour la promouvoir, la place des femmes dans les métiers de la transition écologique, qu'ils soient verts ou verdissants
PRÉCONISATION #3
Compléter et adapter la nomenclature de l'ONEMEV afin de rendre plus pertinents les indicateurs genre des métiers verts et verdissants pour mieux identifier les métiers qui doivent impérativement se transformer et les leviers de cette transformation pour atteindre les objectifs de transition écologique.
4 – Construire la donnée publique permettant de mieux identifier les effets différenciés des dégradations de l'environnement et des catastrophes naturelles et industrielles sur les femmes et les hommes
PRÉCONISATION #4
Systématiser aux échelles internationale, nationale et locales, le recueil de données ventilées par sexe lors de l'évaluation des effets des dégradations environnementales et des catastrophes naturelles et technologiques dans les études d'impacts environnementales des projets publics et privés.
5 – Intégrer la dimension genrée et l'exposome dans la recherche publique en santé-environnement
PRÉCONISATION #5
Initier des programmes et projets de recherche pluridisciplinaire sur l'exposome qui accordent davantage de visibilité aux impacts différenciés de l'exposition aux dégradations environnementales entre les femmes et les hommes, notamment pour mieux les prendre en compte dans la reconnaissance des maladies professionnelles ; veiller à ce que les appels à projets et partenariats noués par l'agence nationale de la recherche, l'ANSES et le CNRS, prennent en compte la dimension genrée ; intégrer ces enjeux de recherche et d'évaluation scientifique par l'exposome dans le 5ème Plan national santé environnement (PNSE) 2025-2030
6 – Identifier les comportements différenciés des femmes et des hommes dans la production et la consommation pour diffuser les bonnes pratiques
PRÉCONISATION #6
Encourager la recherche sur le rôle différencié des femmes en tant que moteur du changement en faveur des modes de production et de consommation plus durables, recueillir des données factuelles sur la manière et les secteurs où les femmes ont déjà un effet positif sur l'action climatique et l'environnement afin d'identifier les bonnes pratiques, de les soutenir et de les généraliser.
AXE 2 : Développer la diplomatie féministe en matière de politiques environnementales et de développement durable
7 – Veiller à la sécurité des personnes déplacées, en particulier les femmes et les filles, victimes du changement climatique
PRÉCONISATION #7
Intégrer dans l'article L435-1 du Code de l'Entrée, du Séjour et du Droit d'Asile (CESEDA) relatif aux titres de séjours pour motifs humanitaires, une disposition reconnaissant que les risques climatiques, environnementaux et sanitaires du pays d'origine entrent pleinement dans les critères permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons humanitaires ou motifs exceptionnels ; mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans les centres d'accueil des personnes déplacées ou migrantes pour éradiquer les violences à caractère sexiste et sexuelle, notamment le harcèlement que les femmes et les jeunes filles peuvent y subir.
8 – Évaluer la mise en œuvre des engagements internationaux de la France pour l'intégration du genre dans ses politiques climatiques et de protection de la biodiversité
PRÉCONISATION #8
Saisir la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) d'une mission de contrôle de la mise en œuvre des engagements de la France en matière de droit à l'égalité femmes-hommes dans les plans nationaux climat et les stratégies nationales pour la biodiversité, conformément à ses engagements dans le cadre des « plans genre » de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique – CCNUCC et de la Convention sur la diversité biologique – CDB.
9 – Revoir à la hausse les ambitions de la diplomatie féministe de la France et donner à celle-ci une dimension programmatique
PRÉCONISATION #9
Mieux définir, piloter et donner une dimension programmatique à la diplomatie féministe ; atteindre progressivement l'égaconditionnalité dans les politiques portées par le ministère des affaires étrangères à l'horizon 2025 et s'engager, conformément au plan d'action genre de l'UE, à ce qu'au moins 85% des financements d'aide publique au développement dédiés à l'adaptation au changement climatique visent également l'égalité de genre
10 – Aboutir à l'égaconditionnalité dans l'octroi des crédits dédiés aux investissements liés au climat et abonder le Fonds de soutien aux organisations féministes
PRÉCONISATION #10
Pérenniser et mieux doter financièrement le Fonds de Soutien aux Organisations Féministes (FSOF) et flécher les financements pour qu'émergent davantage de projets portés par des femmes ou comportant des enjeux de genre, notamment via les fonds intermédiés et permettre aux projets modestes de mieux accéder à ces financements en simplifiant les procédures d'attribution.
11 – Pérenniser la coordination de l'action internationale de la France en matière d'intégration du genre dans ses engagements internationaux climatiques et renforcer la formation et la participation des femmes aux négociations climatiques
PRÉCONISATION #11
Renforcer les moyens et pérenniser la mission de « Point focal » du ministère en charge de l'environnement et des questions climatiques, conformément aux engagements internationaux de la France ; promouvoir, soutenir et développer la formation et la participation des femmes aux négociations climatiques.
12 – Promouvoir la place des femmes dans la prévention et la résolution des conflits armés
PRÉCONISATION #12
Intégrer la thématique des femmes et du changement climatique dans le plan « Femmes paix et sécurité » et renforcer l'amélioration des conditions de vie des femmes dans les zones de conflits à travers l'aide humanitaire.
AXE 3 : Engager l'intégration croisée des politiques de réduction des inégalités liées au genre et des politiques environnementales nationales et locales
13 – Intégrer la dimension du genre dans la réforme des mécanismes de budgétisation et de fiscalité environnementale
PRÉCONISATION #13
Revoir les instruments budgétaires des investissements de la transition écologique ainsi que les instruments des fiscalités environnementale, énergétique et agricole, afin de prévenir et corriger leurs éventuels effets négatifs sur les femmes ; renforcer en particulier le critère genre dans les marchés publics des aménagements et équipements de la transition écologique.
14 – Intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques de planification environnementale
PRÉCONISATION #14
Intégrer un indicateur des inégalités de genre et, plus globalement, de la justice environnementale dans les planifications environnementales nationales : les différents scenarios de transition écologique, la Stratégie française énergie-climat (SFEC), la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui devront être adoptés au premier semestre 2024, ainsi que dans leurs déclinaisons locales.
15 – intégrer le genre dans les études d'impact des grands projets publics et privés soumis, de par leurs risques, à évaluation environnementale
PRÉCONISATION #15
Ajouter la dimension genre au critère « population et santé humaine » de l'évaluation environnementale des projets nationaux et locaux, publics et privés, soumis à cette procédure (L121-1 III 1° du code de l'environnement), et s'assurer d'une analyse complète de ce critère en particulier pour les projets d'aménagement du territoire, d'infrastructures et d'équipements publics.
16 – Favoriser le croisement des thématiques genre et environnement au sein des collectivités territoriales
PRÉCONISATION #16
Intégrer la mixité et la lutte contre les inégalités de genre dans les politiques d'aménagement du territoire et les équipements publics et encourager les collectivités locales à créer des synergies entre les services chargés de la transition écologique et ceux chargés de promouvoir l'égalité femmes- hommes ou en instaurant des services transversaux.
AXE 4 : Faire s'engager davantage les acteurs et actrices privés et publics dans une transition écologique intégratrice des inégalités de genre à la la fois comme causes et comme effets croisés
17 – Identifier les données sexospécifiques dans les bilans carbone des entreprises
PRÉCONISATION #17
Modifier l'instrument « bilan carbone » des entreprises pour pouvoir identifier des données sexospécifiques, former les experts et expertes en bilan carbone aux questions de genre et accompagner techniquement et financièrement les entreprises s'engageant dans cet exercice.
18 – Mieux identifier et intégrer plus systématiquement le volet genre dans la prévention des risques sociaux au titre du devoir de vigilance des entreprises
PRÉCONISATION #18
Dans le cadre des plans de vigilance prévus au titre du « devoir de vigilance » des entreprises, développer les analyses des éventuels effets négatifs directs et indirects des activités économiques des grandes multinationales françaises, de leurs filiales et sous-traitants sur les femmes (en termes de santé, de conditions de travail, de sécurité comme de modification des espaces constituant des ressources dont elles ont la charge) ; porter l'inscription explicite de la question de genre dans le volet « droits humains et environnementaux » dans le cadre des négociations autour de la proposition de directive européenne prévoyant d'élargir cette obligation aux entreprises européennes.
19 – Mieux intégrer les problématiques d'égalité de genre aux sujets environnementaux de la RSE et de la RSO et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises
PRÉCONISATION #19
Décloisonner, avec l'aide de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociale et sociétale des entreprises de France Stratégie, les piliers environnement et égalité des politiques RSE/RSO des entreprises privées et publiques et de la fonction publique et promouvoir un comportement responsable des entreprises en matière d'égalité femmes-hommes.
20 – Généraliser dans toute structure employeuse l'intégration du genre dans les espaces du dialogue social où les sujets environnementaux sont débattus
PRÉCONISATION #20
Généraliser l'intégration du genre dans les informations débattues dans le cadre des attributions environnementales des espaces du dialogue social : comités sociaux et économiques (CSE), comités sociaux d'administration (CSA), comités sociaux territoriaux et comités sociaux d'établissements.
AXE 5 : Former, éduquer et renforcer la mixité des métiers verts et verdissants
21 – Intégrer la justice environnementale au prisme du genre dans l'éducation à l'environnement à l'école
PRÉCONISATION #21
Dans le cadre de l'enseignement scolaire et de la formation tout au long de la vie, intégrer au sein des modules d'éducation à l'environnement les questions d'inégalités de genre ; intégrer la thématique égalité dans le vademecum pour éduquer au développement durable à l'horizon 2030.
22 – Intégrer le genre et encourager la mixité dans l'évolution des activités liées aux métiers « verts » et « verdissants »
PRÉCONISATION #22
Renforcer la mixité des métiers « verts et verdissants » et la promotion des femmes aux postes à responsabilité dans ces métiers ; intégrer une dimension genrée dans les plans de transformation des secteurs d'activités les plus concernés par la transition écologique ; communiquer sur leur attractivité et sur les valeurs qu'ils peuvent donner à celles et ceux en quête de sens dans leur vie professionnelle
AXE 6 : Démocratie environnementale : permettre aux femmes d'être des actrices centrales des débats
23 – Instaurer progressivement la parité dans la représentation française aux instances internationales en matière de climat et d'environnement
PRÉCONISATION #23
Instaurer la parité dans la représentation française aux COP et dans les instances décisionnelles des mécanismes et fonds climat tels que le Fonds vert pour le climat (GCF), le Fond pour l'environnement mondial (GEF), le Fonds d'investissement pour le climat, le Mécanisme de développement propre (CDM) et le Fonds d'adaptation.
24 – Rendre les modalités de participation citoyenne plus inclusives
PRÉCONISATION #24
Adapter le temps du débat démocratique en tenant compte des contraintes pesant sur les femmes (horaires des réunions, gardes d'enfants…) ; initier de nouveaux espaces de participation plus favorables aux femmes (living Lab, tiers lieux, maisons de projet, etc.) ; développer des techniques égalitaires et innovantes (éducation populaire ; prise de parole alternée, ateliers non mixtes etc.) ; intégrer les outils permettant de suivre à distance les grands débats et d'y prendre la parole.
http://www.adequations.org/spip.php?article2665bona
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le manque de femmes dans les instances de pouvoir mondiales entrave le progrès, selon une haute fonctionnaire de l’ONU

Selon Amina Mohammed, la sous-représentation des femmes entrave la résolution des conflits et l'amélioration de la santé et du niveau de vie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/23/le-manque-de-femmes-dans-les-instances-de-pouvoir-mondiales-entrave-le-progres-selon-une-haute-fonctionnaire-de-lonu/
Le manque de femmes aux tables de décision dans le monde entrave les progrès en matière de lutte contre les conflits ou d'amélioration de la santé et du niveau de vie, a déclaré la femme la plus haut placée des Nations unies.
« Nous représentons la moitié de la population. Et ce que nous apportons à la table est incroyablement important et manque », a déclaré Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies. « Je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart de nos indices de développement humain sont si mauvais, pourquoi nous avons tant de conflits et nous sommes incapables de sortir des conflits. »
Depuis sa nomination en 2017, Mme Mohammed n'a cessé de s'élever contre la sous-représentation des femmes dans la politique, la diplomatie et même l'assemblée générale de l'ONU. Ses efforts ont permis de mettre en lumière le fait que les femmes restent reléguées aux marges du pouvoir dans le monde entier ; l'année dernière, la proportion mondiale de femmes législateurs s'élevait à 26,9%, selon l'Union interparlementaire suisse.
S'adressant au Guardian, M. Mohammed a déclaré que « la flexion des muscles et la testostérone » dominaient souvent les tables du pouvoir dans le monde.
« Je pense que cela changerait si les femmes étaient présentes à la table des négociations », a-t-elle déclaré.
Elle a rapidement reconnu que le monde avait connu une poignée de femmes dirigeantes qui n'avaient pas utilisé leur position pour plaider en faveur d'une plus grande paix ou d'une résolution des conflits.
« Il est vrai que nous voyons des femmes au pouvoir et qu'elles sont parfois à l'image des hommes », a-t-elle déclaré. Mais elle a estimé qu'il était injuste de juger les femmes sur une base individuelle alors qu'elles se trouvaient encore dans les limites d'un système dominé par les hommes. « Nous ne jugeons pas les hommes de cette manière ».
Ses remarques interviennent au cours d'une année où le nombre de personnes appelées à voter n'a jamais été aussi élevé, mais où les candidates sont nettement moins nombreuses. Sur les 42 pays où se tiendront des élections cette année, seuls quelques-uns ont des candidates ayant une chance raisonnable de l'emporter.
Au début du mois, l'Islande a élu l'entrepreneuse Halla Tómasdóttir à la présidence, tandis qu'au Mexique, la climatologue de gauche Claudia Sheinbaum est récemment devenue la première femme présidente du pays.
Alors que l'Islande a une longue tradition d'élection de femmes, Mme Mohammed a déclaré qu'elle avait été surprise par le Mexique, « où l'on peut avoir une communauté machiste, mais où l'on voit des femmes fortes accéder à la présidence ». « Et puis l'Europe, nous pensions qu'il y en aurait plus. Pourquoi n'y en a-t-il pas ? C'est un peu étrange, n'est-ce pas ?
Les analystes ont longtemps pointé du doigt une série de facteurs, allant de la montée en flèche des abus en ligne au harcèlement sexuel, pour expliquer la faible participation des femmes à la vie politique en Europe et au-delà. À l'approche des élections européennes, les défenseurs et les défenseuses des droits des êtres humains ont mis en garde contre la montée du soutien à l'extrême droite, qui pourrait se traduire par une diminution du nombre de femmes élues, ces partis ayant tendance à moins se préoccuper de l'équilibre entre les hommes et les femmes.
Mme Mohammed a mis en évidence une autre raison de la sous-représentation des femmes, en pointant du doigt les nombreuses parties de la société qui considèrent que les femmes au pouvoir « enlèvent de la valeur plutôt qu'elles n'en ajoutent », a-t-elle déclaré. « Nous devons changer cette mentalité. »
Cependant, lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre de femmes à ces tables, les décennies de lents progrès suggèrent que l'approche actuelle n'est pas à la hauteur, a-t-elle déclaré.
« Nous n'avons cessé d'envisager des solutions de fortune : mettre des femmes au pouvoir, mettre en place des mesures de discrimination positive. Et nous n'avons jamais fait le lien avec les femmes elles-mêmes pour qu'elles se constituent un électorat et qu'elles aillent voter », a-t-elle déclaré. « Nous devons donc d'abord avoir une conversation avec les femmes. Car si nous faisons cela pour les femmes, cela ne devrait-il pas être fait par les femmes ? Je pense que nous avons raté cette étape parce que nous avons pris le train du féminisme et de la parité… nous avons laissé la base derrière nous ».
Son appel à repenser les choses est soutenu par la situation de plus en plus désastreuse à laquelle sont confrontées de nombreuses femmes dans le monde. L'année dernière, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré que les progrès mondiaux en matière de droits des femmes « s'évanouissaient sous nos yeux », citant l'effacement des femmes de la vie publique en Afghanistan et les nombreux endroits où les droits sexuels et reproductifs des femmes étaient réduits à néant. « L'égalité des sexes s'éloigne de plus en plus », a-t-il averti. « Si l'on s'en tient à la trajectoire actuelle, ONU Femmes la place à 300 ans d'ici.
Ashifa Kassam, correspondante pour les affaires de la Communauté européenne
https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/19/amina-mohammed-un-women-under-representation-at-global-tables-of-power
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour une société antivalidiste

EluEs, militantEs , militantEs antivalidistes, nous avons décidé de lancer un appel aux candidatEs du Nouveau Front Populaire afin qu'elles et ils s'engagent pour faire progresser enfin les droits et les libertés des personnes handicapées, dans le sens de leur autodétermination.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Nous insistons également sur la nécessité de mettre la solidarité nationale au coeur de ces politiques publiques, alors qu'elle est malmenée depuis plusieurs années, par la primauté donnée à la solidarité familiale au détriment de la situation des proches et des aidantEs.
Nous demandons donc aux candidatEs du Nouveau Front Populaire de s'engager publiquement pour :
La transcription dans le droit français de la Convention ONU des droits des personnes handicapées et sa mise en oeuvre effective ;
Un droit à la vie autonome des personnes handicapées entièrement financé par la solidarité nationale, des budgets d'assistance personnelle et services pour la vie autonome répondant aux besoins et aspirations des personnes handicapées, avec un échéancier de désinstitutionnalisation et un moratoire sur la création de places en institutions ;
La fin du report des obligations de mise en accessibilité (physique, communicationnelle et numérique) et l'imposition de sanctions significatives en cas de non-respect de l'accessibilité universelle ;
En matière de logement, l'abrogation de l'article 64 de la loi ELAN et un programme national de construction de logements accessibles et adaptables, assorti d'une obligation d'installation d'ascenseur dès le 1er niveau ;
Un droit inconditionnel à la scolarité de tous les enfants et à la formation de tous les adultes avec tous les moyens humains, matériels, pédagogiques et organisationnels nécessaires et des locaux permettant l'organisation du suivi médico-social en son sein ;
L'abrogation de l'article 1er de la loi de 2005 avec la fin de la confusion entre associations représentatives des personnes handicapées et associations gestionnaires d'établissements et services dont le conflit d'intérêt est dénoncé par l'ONU
Une représentation réelle et effective des personnes handicapées, avec des Conseils Départementaux Consultatifs de l'Autonomie et un Conseil National des Personnes Handicapées ayant voix délibérative et dont les membres soient éluEs localement au sein des MDPH, parmi les représentantEs de collectifs militants non gestionnaires.
Ces propositions constituent des mesures urgentes, elles n'épuisent pas le besoin criant d'agir pour les droits des personnes handicapées et de mettre en place des politiques publiques antivalidistes.
Gwenaelle Austin, Adjointe PCF au Maire du 19ème, chargée des séniors et des solidarités entre les générations, des relations avec les Foyers de Travailleurs Migrants, de la lute contre les inégalités et contre l'exclusion, et de l'accès aux droits
Cécile Bossavie, conseillère d'arrondissement PS (Paris 19ème) chargée de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap,
Laure Botella Secrétaire nationale du PS en charge de la lute contre les violences faites aux femmes et des politiques d'égalité,
Andréa Fuchs Adjointe PS au maire de Paris 19ème, chargée de la participation citoyenne et des conseils de quartier, de l'égalité femmes hommes, des droits humains et de la lute contre les discriminations,
Audrey Henocque, 1ère adjointe au maire de Lyon (69)
Andy Kerbrat, député sortant de Nantes (LFI – PEPS),
Fatima Khallouk, adjointe au Maire d'Alfortville (94) déléguée à la jeunesse, responsable de la commission nationale des droits des personnes en situation de handicap du PCF,
Samira Laal, secrétaire nationale du PS au handicap et à l'inclusion,
Odile Maurin, élue municipale (Toulouse), référente PEPS, mouvement antivalidiste),
Camille Naget, conseillère PCF de Paris, élue de Paris 19ème,
Sébastien Peytavie, député sortant de la Dordogne (Génération.s)
Marie Piéron, adjointe au maire PCF d'Ivry (94
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les experts de l’ONU s’alarment de la situation du Peuple Autochtone Kanak dans le territoire non autonome de Nouvelle-Calédonie

GENÈVE – Le Parlement français a adopté le 14 mai 2024 un projet de loi qui dégèle le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, un territoire non autonome sous administration française dans le Pacifique Sud, démantelant un des fondements de l'Accord de Nouméa, a déclaré aujourd'hui les experts de l'ONU dans un communiqué.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« Le ministère français de l'Intérieur a élaboré et présenté un autre projet de loi, connu sous le nom de « projet Marty », qui menace de démanteler les autres acquis majeurs de l'Accord de Nouméa liés à la reconnaissance de l'identité Autochtone Kanak, des diverses institutions coutumières Kanakes, ainsi que du droit coutumier, et des droits fonciers », les experts ont déclaré.
L'Accord de Nouméa est un accord-cadre signé en 1998 entre le gouvernement français, le mouvement indépendantiste dirigé par le Peuple Kanak et les partis anti-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. L'accord décrit un processus de transfert progressif et irréversible du pouvoir de la France à la Nouvelle-Calédonie, conduisant à une série de référendums d'autodétermination.
« Le Peuple Kanak occupe la région de la Nouvelle-Calédonie depuis des milliers d'années, soit depuis 3000 ans avant Jésus-Christ », les experts ont déclaré. « La tentative de démantèlement de l'Accord de Nouméa porte gravement atteinte à leurs droits humains et à l'intégrité du processus global de décolonisation ».
« Le gouvernement français n'a pas respecté les droits fondamentaux à la participation, à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé des Peuples Autochtones Kanaks et de ses institutions, y compris le Sénat coutumier », ont averti les experts.
Des dizaines de milliers de manifestants Kanaks se sont mobilisés pacifiquement depuis février pour dénoncer ces réformes. En l'absence de dialogue, un violent conflit fait rage depuis mai 2024. Le gouvernement français a déployé des moyens militaires et un usage excessif de la force ce qui aurait conduit parmi les Kanaks à plusieurs morts, 169 blessés, 2235 arrestations y compris des d'arrestations et détentions arbitraires et plus de 500 victimes de disparitions forcées.
« Nous sommes particulièrement préoccupés par les allégations concernant l'existence de milices lourdement armées de colons opposés à l'indépendance », les experts ont déclaré. « Le fait qu'aucune mesure n'ait été prise par les autorités pour démanteler et poursuivre ces milices soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'état de droit ».
Les experts ont noté que la consultation de 2021 sur la souveraineté de la colonie française de Nouvelle-Calédonie s'est déroulée en pleine pandémie de Covid-19, au mépris du deuil coutumier Kanak et malgré les objections des autorités et organisations coutumières Kanakes.
Les experts ont exhorté le gouvernement français à garantir l'État de droit et à continuer à travailler avec le Comité spécial de la décolonisation et les autorités coutumières Kanakes pour faire respecter le principe d'irréversibilité de l'Accord de Nouméa. « Les accords conclus dans le cadre de l'Accord doivent être garantis constitutionnellement jusqu'à ce que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté, conformément à l'engagement de la France », ils ont déclaré.
Les experts ont été informés qu'à l'issue des élections législatives françaises, le projet de loi modifiant la composition du corps électoral a été suspendu, mais ils ont demandé son abrogation complète.
« Nous sommes à la disposition des autorités françaises pour fournir les recommandations nécessaires », les experts ont ajouté.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quelle est la prochaine étape pour la gauche au Venezuela ?

Pour que la révolution renoue avec les succès au Venezuela, ses partisans, dans le pays et à l'étranger, doivent d'abord reconnaître qu'ils ont perdu. Au premier coup d'œil, la situation semble par trop familière. Une nouvelle élection âprement disputée au Venezuela, une nouvelle victoire du gouvernement chaviste assiégé depuis longtemps, une nouvelle série d'allégations de fraude de la part de l'opposition soutenue par les États-Unis. Il s'agit d'un scénario bien rodé qui se répète depuis près de 25 ans.
20 août 2024 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/20/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-la-gauche-au-venezuela/#more-84991
C'est ce qui s'est passé en 2004 lorsque, à la suite d'une tentative de coup d'État, d'une grève de l'industrie pétrolière et de violentes manifestations visant à évincer Hugo Chávez, les opposants ont tenté de renverser le président pour ensuite prétendre à tort qu'il y avait eu fraude alors qu'il l'avait emporté haut la main. C'est ce qui s'est passé en 2012, lorsque Chávez, rongé par le cancer, s'est assuré une nouvelle victoire éclatante alors que les sondages préélectoraux annonçaient une victoire de l'opposition, ce qui a donné lieu à de nouvelles allégations non prouvées de fraude électorale. Et c'est ce qui s'est passé en 2013 lorsque, un mois après la mort de Chávez, son successeur désigné, Nicolás Maduro, a obtenu une courte majorité pour s'emparer de la présidence, ce qui a donné lieu à des manifestations et à de nouvelles allégations de fraude, une fois de plus sans fondement.
Dans ce contexte, il peut être tentant pour ceux qui ont soutenu ou soutiennent encore ce que Chávez appelait une révolution bolivarienne – un mouvement qui vise à rendre le Venezuela, et ensuite le reste de l'Amérique latine, plus réceptif aux besoins populaires – de rejeter les affirmations de l'opposition selon lesquelles Maduro a falsifié les élections pour obtenir un nouveau mandat de six ans. D'autant plus que le gouvernement américain a annoncé qu'il reconnaîtrait la victoire de l'opposition, alors que la plupart des pays de la région se gardent bien de le faire. (Les efforts déployés par les États-Unis pour évincer Chávez, puis Maduro, sont allés des sanctions ciblées au financement d'un gouvernement fictif en exil, en passant par le lancement d'une campagne de « pression maximale » visant à isoler le Venezuela et à étrangler son économie).
Des fraudes avérées
Mais la réalité, c'est que cette fois-ci, c'est différent. Dix jours après le scrutin, il ne fait plus guère de doute que M. Maduro a perdu sa tentative de réélection et que son gouvernement a l'intention de rester au pouvoir, défiant ainsi la volonté des électeurs vénézuéliens. La preuve en est fournie en partie par le refus persistant des autorités électorales de rendre publiques les données relatives aux circonscriptions, comme elles l'ont fait rapidement lors des élections précédentes et comme la loi l'exige, ou de produire des données prouvant ce qu'elles affirment être une « campagne de piratage brutale » ayant ciblé leur système de vote. Des preuves sont également disponibles sur la plateforme en ligne de l'opposition, qui héberge des copies de ce qui paraît constituer plus de 80% des résultats des circonscriptions, donnant au candidat de l'opposition, Edmundo Gonzalez, une marge de victoire de deux contre un. Elles résident également dans les déclarations publiques de gouvernements par ailleurs favorables au chavisme – au Brésil, en Colombie et au Mexique – qui conditionnent la reconnaissance des résultats à une vérification indépendante des résultats annoncés par le Conseil national électoral.
Mais la preuve la plus solide se trouve probablement dans les rues. Dans les jours qui ont suivi la victoire supposée de M. Maduro, des manifestations parfois violentes, mais le plus souvent pacifiques, ont éclaté dans tout le Venezuela. Contrairement aux précédentes vagues d'agitation post-électorale, qui impliquaient principalement les plus fervents partisans de l'opposition parmi les classes moyennes du pays, ces manifestations ont commencé dans des zones où le chavisme a longtemps tenu le haut du pavé, dans les barrios et les secteurs populaires au cœur du projet politique de M. Chávez. À ce jour, les affrontements avec les forces de l'ordre ont provoqué près de deux douzaines de morts et plus d'un millier d'arrestations.
Les autorités accusent des agitateurs extérieurs formés au Texas. Mais le croire, c'est ignorer délibérément ce que la dernière décennie a fait comme mal au Venezuela et tout ce qu'elle a fait perdre d'attrait au chavisme, autrefois puissant et majoritairement populaire. Depuis son arrivée au pouvoir, M. Maduro a détourné les ressources, qui s'amenuisent en raison de la baisse des prix du pétrole, vers un cercle étroit de ses partisans, surtout au sein de l'armée et de l'appareil de sécurité, afin de consolider le contrôle exercé par le gouvernement. Cela a signifié la réduction ou l'élimination pure et simple des programmes sociaux et des dispositifs de participation qui caractérisaient le chavisme.
Du mécontentement aux manifestations
Lorsque le mécontentement des chavistes de base s'est transformé en mouvement de protestation, Maduro a réagi en lançant des opérations de police spéciales visant officiellement à lutter contre la criminalité mais qui ont pris pour cible la jeunesse urbaine, ce qui a donné lieu à des milliers d'exécutions extrajudiciaires destinées à empêcher les barrios de bouger. Plus récemment, afin de lutter contre l'hyperinflation et de tirer profit des envois de fonds effectués par les plus de 7 millions de migrants vénézuéliens vivant à l'étranger, Maduro a dollarisé l'économie du pays, abandonnant à leur sort ceux qui ne disposent que d'un accès minimal aux maigres aides de l'État ou aux envois de fonds des émigrés.
Certes, les sanctions américaines ont exacerbé la crise vénézuélienne. Mais elles n'en sont pas la cause et n'expliquent pas non plus pourquoi des secteurs fidèles au gouvernement depuis 25 ans s'en sont détournés lors des élections. C'est plutôt la combinaison de l'austérité, de la corruption, de la répression et de la dollarisation sous Maduro, tout ceci frappant les bases historiques du soutien au chavisme, qui a pour la première fois permis de faire basculer la présidence vers l'opposition.
Mais déterminer s'il s'agit là de la fin du chavisme, c'est une autre question, dont la réponse reposera en grande partie sur la solidarité de la gauche. Même si l'opposition a finalement remporté la présidence, elle sera confrontée à des défis gigantesques une fois au pouvoir. Depuis qu'il a remodelé l'État, le chavisme contrôle toutes les institutions gouvernementales, y compris l'Assemblée nationale, la plupart des gouvernorats et des mairies, l'armée et la police. Si elle veut être, comme elle le prétend depuis longtemps, une alternative démocratique au chavisme, l'opposition devra œuvrer au sein de l'État chaviste et non le purger. En outre, même si elle a maintenu une unité notable pendant la campagne, l'opposition se compose sur le plan idéologique d'un large éventail de protagonistes. Les voix les plus fortes ont appelé à la mise en œuvre d'un programme néolibéral orthodoxe, à la privatisation de la compagnie pétrolière d'État et de l'enseignement public ainsi qu'au démantèlement de ce qui reste des filets de sécurité sociale, et ceci en faveur du secteur privé et des capitaux étrangers. Il reste à voir si ce programme l'emportera ou s'il fracturera la coalition de l'opposition.
Mais surtout, une opposition au pouvoir devra faire face à sa principale faiblesse : considérer les secteurs populaires comme acquis ou, pire, les rejeter purement et simplement. Oui, ces secteurs se sont retournés contre ce qu'est devenu le chavisme. Mais supposer qu'ils ont donné carte blanche à l'opposition est pour le moins exagéré. Il en va de même pour l'hypothèse selon laquelle ils se sont retournés contre tout ce que le chavisme incarnait autrefois. Aider à reconstruire les programmes sociaux et les mécanismes de participation plutôt qu'à les démanteler sera déterminant dans le processus politique qui suivra. Soutenir ce travail et défendre ceux et celles qui constituaient autrefois le noyau dur du chavisme devrait être la pierre angulaire de la solidarité de la gauche. Mais pour avoir une quelconque crédibilité, la gauche doit d'abord défendre la souveraineté populaire.
Pour la gauche
Pour la gauche, il s'agit de choisir entre soutenir une personne ou un processus, un choix que Chávez lui-même avait bien compris. Face à une réélection difficile en 2012, qui s'est avérée être sa dernière, il a parlé franchement à la presse de ses perspectives. « Si je perds […], je serai le premier à l'admettre et à céder le pouvoir, et j'appellerai mes partisans, civils et militaires, des plus modérés aux plus radicaux, à obéir à la volonté du peuple. Et c'est ce qu'il faut faire, car ce ne serait pas la fin du monde pour nous. Une révolution ne se fait pas en un jour, elle se fait tous les jours ».
Le 28 juillet, Maduro a perdu. Pour que la révolution gagne à nouveau au Venezuela, ses partisans, dans le pays et à l'étranger, doivent d'abord reconnaître la défaite et les nombreux dérapages qui l'ont entraînée, puis se mettre au travail pour soutenir le chavisme dans l'opposition, et non pas au pouvoir.
Alejandro Velasco
Publié à l'origine dans The Nation
https://anticapitalistresistance.org/whats-next-for-the-left-in-venezuela/
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71726
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine - Conflit dans l’huile, un conflit de pouvoir

Le conflit entre les syndicats et les chambres de commerce du secteur des oléagineux est né de différends dans les négociations sur l'ajustement des salaires et implique également le gouvernement. Sous cette lutte de répartition se cache un autre conflit, plus politique et idéologique.
Tiré de Inprecor
16 août 2024
Par Eduardo Lucita
Chiffres et pourcentages
Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, les salaires des travailleurs des oléagineux ont augmenté de 77 %, contre un taux d'inflation de 79,8 %. L'offre des employeurs est de 12 % en juillet et de 5 % en septembre, ce qui, selon leurs estimations, donnerait une augmentation cumulée de 94 % qui dépasserait l'inflation prévue pour cette période. En revanche, pour les syndicats du secteur, l'offre patronale est insuffisante. Selon les critères qu'ils ont adoptés il y a une quinzaine d'années, lorsqu'ils ont repris le syndicat, les augmentations ne sont pas définies en pourcentage mais en fonction de la valeur d'un panier de biens de base permettant au travailleur et à sa famille de vivre dans la dignité. Ainsi, dans cette discussion, ils soutiennent que l'augmentation devrait garantir un plancher de 1 550 000 pesos (1510 €), ce qui implique une augmentation salariale de 25 %.
Guerre de communiqués
La grève nationale de l'huile décidée par la Fédération des oléagineux et la SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros - Syndicat des travailleurs et employés des oléagineux) San Lorenzo a été déclarée, lors d'une assemblée générale réunissant plus de 250 délégué·es, après trois semaines de négociations infructueuses au cours desquelles les syndicats ont exigé une proposition salariale améliorée par rapport à celle des patrons. Il s'agit d'un conflit entre une fraction du capital basée sur un secteur industriel de haute technologie, l'un des meilleurs au monde, qui réalise des profits extraordinaires, et une fraction de travailleurs, avec de bons salaires, conscients de leur rôle stratégique dans l'économie nationale, avec une organisation syndicale et une direction honnête, basée sur la tradition de la démocratie ouvrière : la consultation de la base et le respect de ce qu'elle décide.
« Nous ne voyons aucune raison objective pour que notre proposition ne soit pas acceptée et que nous puissions continuer à travailler afin de ne pas nuire davantage à l'industrie », indique le communiqué des chambres patronales. « Cette grève a commencé après trois semaines de réunions au cours desquelles ils n'ont fait que retarder le dialogue ». « Ils ont le temps, nous ne l'avons pas », répondent les dirigeants syndicaux.
Les employeurs affirment qu'ils versent des salaires parmi les meilleurs du pays, que les travailleurs gagnent 2,8 millions de pesos par mois (ce qui est difficilement vérifiable) et que les grévistes perdront le présentéisme (1) qu'ils estiment à 50 000 pesos par jour. Les travailleurs se demandent qui gagne le plus, ceux d'entre nous qui veulent vivre dans la dignité ou « les entreprises multinationales et les groupes nationaux qui triangulent les exportations, font fuir les devises étrangères et inscrivent ce qu'ils exportent dans une déclaration sous serment ».
Complications dans la chaîne de valeur
La paralysie de la production affecte l'ensemble du secteur, qu'il s'agisse des installations industrielles, de la logistique, des ports ou même des routes. Elle complique les exportations, avec des camions bloqués et des navires en attente dans les principaux ports du pays. Selon la Chambre des entrepreneurs d'oléagineux (CIARA), ce sont 15 000 camions qui n'ont pas pu être déchargés en quatre jours et 12 000 autres dont les dates de chargement et d'arrivée ont été suspendues. Vingt navires attendent également d'entrer dans les ports (on dit que certains ont déjà fait demi-tour pour charger au Brésil). Les pertes sont estimées en millions de dollars (2).
Tout cela retarde encore la liquidation d'une récolte qui avance lentement, à la fois parce que les prix internationaux sont à leur plus bas niveau des quatre dernières années, et parce que les entreprises céréalières attendent une dévaluation ou une amélioration, même indirecte, du taux de change pour liquider les restes de soja et de blé, ce qui impliquerait un revenu de 13 milliards et de 2,8 milliards de dollars respectivement.
Plus qu'un conflit salarial
Le gouvernement comprend que le conflit complique sa politique d'augmentation de l'entrée de dollars dans les réserves et d'obtention de recettes fiscales par le biais de retenues à la source, c'est pourquoi il tente d'inciter les employeurs à accepter la conciliation obligatoire. Mais les employeurs ont refusé de s'asseoir à la table des négociations si les syndicats ne lèvent pas la grève. Ils affirment que « le conflit va au-delà de la revendication salariale », soutiennent « que les syndicats remettent en cause la réforme du travail et le rétablissement de l'impôt sur le revenu pour la 4ème catégorie, ainsi que la recherche d'un espace politique au sein de la CGT », et exigent qu'ils leur « rendent les clés », en d'autres termes : ils ont perdu le contrôle du secteur. Les travailleurs répondent que les employeurs utilisent le conflit pour imposer une dévaluation, qu'ils s'en servent pour faire pression sur le gouvernement, et que nous « ne voulons pas perdre ce que nous avons gagné au cours d'années de lutte ».
La grève, initialement déclarée pour 24 heures, est devenue illimitée. Pour l'instant, après 4 jours de grève, les négociations sont suspendues et aucune solution n'est en vue.
La question de fond
La grève est plus qu'un conflit sur la répartition des revenus, mais elle ne porte pas sur la réforme du travail ou l'impôt sur le revenu, comme l'affirment les patrons. Il s'agit d'un conflit de pouvoir entre ceux qui détiennent les moyens de production et d'échange dans le secteur et les travailleurs qui sont ceux qui actionnent l'ensemble du secteur agro-industriel. Lorsqu'ils le paralysent, comme ces derniers jours, ils en disputent le contrôle (la clé). C'est à cela que réagissent les propriétaires du capital (chambres et bourses de commerce...) et leurs principaux porte-paroles médiatiques, en réagissant violemment (3), parce que cela peut être imité par d'autres travailleurs en lutte.
En fin de compte, il s'agit du conflit de classe historique dans le système du capital. Entre ceux qui produisent la richesse et ceux qui se l'approprient et en jouissent.
Le 12 août 2024, traduit par Laurent Creuse
1. En Argentine, le présentéisme est utilisé comme une incitation économique pour les travailleurs qui n'ont pas d'absences injustifiées et qui sont présents tous les jours sur leur lieu de travail. Ceux qui ne manquent pas le travail reçoivent une récompense économique, tandis que ceux qui sont absents perdent cet avantage.
2. Si l'on multiplie cette somme par le nombre de navires en attente, elle s'élève à quelque 10 millions de dollars. « Et le dernier effet est international, c'est la perte de crédibilité. L'Argentine est redevenue un port sale. La plupart des navires qui devaient arriver dans le pays ont été détournés vers le Brésil, qui prend les dollars que l'Argentine perd. Cela représentera moins de devises étrangères au cours du mois prochain.
3. Voir la vidéo du journaliste Alejandro Fantino, porte-parole privilégié du Président Milei.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche latino-américaine entre la Chine, les États-Unis, le progressisme tardif et l’extrême-droite

Claudio Katz vient de publier un livre en espagnol intitulé America Latina en la encrucijada global [1] (en français « L'Amérique latine au carrefour global » ou « L'Amérique latine à la croisée des chemins »). Claudio Katz est économiste, marxiste, professeur à l'université de Buenos Aires, auteur d'une quinzaine de livres portant sur la théorie de la Dépendance cinquante ans après, portant sur l'impérialisme aujourd'hui, sur les enjeux pour la gauche latinoaméricaine. Son nouveau livre se concentre sur l'Amérique latine et aborde les relations du continent avec la Chine et avec l'impérialisme américain.
Le livre se compose de cinq parties : dans une première partie Claudio Katz analyse la stratégie de l'impérialisme américain depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il montre que l'impérialisme américain a connu une phase montante au cours de laquelle il a remplacé les anciennes puissances coloniales comme l'Espagne et le Portugal au cours du XIXe siècle, et le Royaume-Uni à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Puis, aprè avoir dominé totalement l'Amérique latine, cet impérialisme est entré en déclin, notamment par rapport à la grande puissance montante que constitue la Chine.
11 juillet 2024 | tiré du site du CADTM | Photo : Manifestation au Chili en 2019, José Miguel Cordero Carvacho, CC, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifestaci%C3%B3n_con_bengala_en_Plaza_Italia_%282019%29.jpg
https://www.pressegauche.org/ecrire/?exec=article_edit&new=oui&id_rubrique=73
Dans cette première partie, Claudio Katz analyse également la politique de la Chine en Amérique latine et l'attitude des classes dominantes latinoaméricaines par rapport à cette nouvelle puissance.
La deuxième partie porte sur les caractéristiques de l'extrême droite en Amérique latine. Sa nature spécifique, sa manière d'opérer. Cette partie se termine par une analyse du phénomène Javier Milei qui est devenu président de l'Argentine à la fin de l'année 2023, début de l'année 2024.
La troisième partie porte sur les expériences du nouveau progressisme, issu des grandes mobilisations populaires qui ont secoué plusieurs parties de l'Amérique latine en 2019.
La partie 4 porte sur les débats au sein de la gauche au sujet de ces nouveaux gouvernements progressistes et il analyse par ailleurs spécifiquement ce qu'il considère comme les 4 pays qui composent un axe alternatif à l'impérialisme américain, à savoir le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua et Cuba. La partie 5 porte sur les nouvelles résistances populaires dans la période récente et aborde les questions de l'alternative.
Les États-Unis et la Chine vis-à-vis de l'Amérique latine
Jusqu'aujourd'hui les États-Unis, comme le montre Claudio Katz, ont une position dominante en Amérique latine. Selon Katz : « Entre 1948 et 1990, le département d'État a participé au renversement de 24 gouvernements. Dans quatre cas, les troupes américaines ont agi, dans trois cas, les assassinats de la CIA ont prévalu, et dans 17 cas, les coups d'État ont été dirigés depuis Washington. » [2] (Katz, p. 49) Ils disposent de bases militaires dans plusieurs pays, dont la Colombie, où les États-Unis possèdent neuf bases. Mais ils en disposent aussi au Sud du continent (3 bases militaires au Paraguay). Leur flotte est prête à intervenir sur tout le pourtour de l'Amérique latine, que ce soit sur la façade de l'Atlantique Sud ou que ce soit sur la façade de l'océan Pacifique.
"Les États-Unis possèdent douze bases militaires au Panama, douze à Porto Rico, neuf en Colombie, huit au Pérou, trois au Honduras et deux au Paraguay. Ils disposent également d'installations similaires à Aruba, au Costa Rica, au Salvador et à Cuba (Guantánamo). Aux îles Malouines, le partenaire britannique fournit un réseau OTAN relié à des sites dans l'Atlantique Nord. Katz, p. 50 [3] "
En même temps, Claudio Katz montre que depuis les années 2010, la Chine a réussi à entrer en compétition avec les intérêts américains en Amérique latine et aux Caraïbes avec une politique d'investissements qui permet des rachats d'entreprises et une politique de crédit très dynamique et massive. Ce qui est tout à fait intéressant dans le livre, c'est qu'il montre que la Chine utilise à son avantage les outils que, pendant près de deux siècles, les USA ont utilisé, à l'exception de l'outil militaire (ce qui extrêmement important).
De quoi s'agit-il ? En fait, les États-Unis ont réussi à convaincre les gouvernements d'Amérique latine, en particulier à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, de passer des accords de libre commerce. Comme les États-Unis avaient une économie qui était technologiquement nettement plus avancée que les pays d'Amérique latine, grâce à ces traités, ils gagnaient systématiquement par rapport aux producteurs locaux, que ce soient des capitalistes dans l'industrie ou dans l'agrobusiness ou des petits producteurs agricoles. Les produits américains avaient une supériorité en termes de productivité, de technologie et donc en termes de compétitivité.
Mais les États-Unis sont une puissance économique qui est entrée en déclin, tandis que la Chine est en plein essor. Par rapport aux économies de l'Amérique latine mais aussi par rapport aux États-Unis, elle a désormais un avantage au niveau de la productivité, dans une série de domaines au niveau technologique et donc au niveau compétitivité. Et c'est la Chine maintenant qui utilise des outils économiques auxquels recourait systématiquement les États-Unis, c'est-à-dire la signature de traités de libre commerce bilatéraux avec un maximum de pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, tandis que les États-Unis, qui avaient essayé de mettre en place un traité de libre commerce pour toutes les Amériques à des conditions dominées par lui, sous le nom de l'ALCA, a vu cet accord être abandonné suite au refus de toute une série de gouvernements d'Amérique du Sud en 2005. Depuis lors, son déclin économique s'est accentué par rapport à la Chine et les États-Unis ne sont plus vraiment en état de convaincre des pays du Sud de signer des accords de libre-échange. Et surtout, ils ne sont plus en condition de vraiment bénéficier de tels accords, à cause de la concurrence de la Chine. En conséquence, c'est la Chine qui privilégie le dogme du libre commerce et des avantages mutuels que tirent les différentes économies si elles adoptent ce type d'accords. La Chine tire avantage de cela parce que, comme Claudio Katz le montre à juste titre, ses produits sont bien plus compétitifs en Amérique latine que les produits réalisés par les économies latino-américaines ou par les États-Unis et les produits exportés par les économies d'Amérique latine vers la Chine sont essentiellement des matières premières, des minéraux, du soja transgénique. Et donc ils ne représentent pas une véritable concurrence pour les productions chinoises. La Chine tire entièrement bénéfice du type de relations qu'elle développe avec les pays d'Amérique latine, en gagnant des parts de leur marché intérieur au détriment de la production locale. On assiste à une re-primarisation des économies et ça se voit très clairement dans le type d'exportations que l'Amérique latine réalise sur le marché mondial et notamment vers la Chine, celle-ci devenant le plus important partenaire commercial de plusieurs pays d'Amérique latine, comme c'est notamment le cas pour l'Argentine et le Pérou.
Claudio Katz démontre que la Chine tire un maximum d'avantages avec l'Amérique latine, parce que les gouvernements latino-américains sont incapables de concevoir une politique commune et de mettre au point une politique d'intégration favorisant le développement du marché intérieur et de la production locale pour le marché intérieur.
Il indique que la Chine ne se comporte pas complètement comme un pays impérialiste traditionnel, elle n'utilise pas la force armée. La Chine n'accompagne pas ses investissements avec des bases militaires, contrairement aux États-Unis.
Comme indiqué plus haut, Claudio Katz fait la liste des agressions militaires auxquelles se sont livré les États-Unis en Amérique latine et cette liste est évidemment impressionnante et tranche tout à fait avec le comportement de la Chine à l'égard de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Il explique correctement que la Chine n'est pas devenue une puissance impérialiste au plein sens du terme (ce qui est différent de la Russie, c'est moi qui le précise ici). Il affirme que le capitalisme n'est pas pleinement consolidé en Chine. Cela veut-il dire que la direction chinoise pourrait effectuer un virage et s'éloigner du capitalisme ? On peut tout à fait franchement en douter. Par ailleurs, il reprend l'affirmation selon laquelle en Chine, le développement économique a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté sans expliquer sur quelles bases il affirme cela : quelles études ? quelles données chiffrées ? Cela veut-il dire par exemple que, dans les années 1970, il y avait 800 millions de pauvres de plus (c'est-à-dire avant les réformes de Deng Xiaoping des années 80) ? Pour parler de 800 millions de personnes sorties de la pauvreté, il faudrait préciser par rapport à quelle année, à la population de quelle année, dire sur quelles bases est déterminée la ligne de pauvreté.
Cette question est vraiment très importante et l'argumentation de Claudio Katz manque cruellement de fondements. Les chiffres qu'il donne sont ceux donnés par la Banque mondiale, par les autorités chinoises et j'ai montré dans plusieurs écrits que les évaluations de la Banque mondiale sont tout à fait contestables. D'ailleurs la Banque mondiale avait reconnu elle-même en 2008 avoir surestimé de 400 millions le nombre de personnes sorties de la pauvreté.
Pour en savoir plus : Les divagations de la Banque mondiale concernant le nombre de pauvres sur la planète, CADTM, 6 avril 2021
Faute de références données par Claudio Katz, on peut se demander s'il se base sur les chiffres de la Banque mondiale sans le dire et, si ce n'est pas le cas, sur quelles données statistiques. Il ferait bien d'apporter les précisions nécessaires, cela renforcerait son argumentation.
Par ailleurs, Claudio Katz reconnait sans difficulté qu'on a assisté au rétablissement d'une classe capitaliste importante en Chine et il critique ceux qui disent que la Chine est au centre du projet socialiste de notre époque. Il dit que cette classe capitaliste ambitionne de reprendre le pouvoir. Claudio Katz pense qu'une rénovation socialiste est possible mais on peut lui demander si cela peut venir de la direction du PCC. Je pense qu'il faut dire clairement que la réponse est négative : la rénovation socialiste ne viendra pas de la direction du PCC.
Claudio Katz affirme, par ailleurs, à juste titre que la Chine ne fait pas partie du Sud global.
Katz écrit : « Tous les traités promus par la Chine renforcent la subordination et la dépendance économiques. Le géant asiatique a consolidé son statut d'économie créancière, profitant de l'échange inégal, captant les excédents et s'appropriant les revenus.
La Chine n'agit pas comme un dominateur impérial, mais elle ne favorise pas non plus l'Amérique latine. Les accords actuels aggravent la primarisation et la fuite de la plus-value. L'expansion extérieure de la nouvelle puissance est guidée par des principes de maximisation des profits et non par des normes de coopération. Pékin n'est pas un simple partenaire et ne fait pas partie du Sud. » (p.73) [4]
Pour en savoir plus sur la Chine comme puissance créancière : Éric Toussaint, Série sur la Chine comme puissance créancière publiée par CADTM en février 2024
• [Partie 1] Questions/réponses sur la Chine comme puissance créancière de premier ordre
•[Partie 2] Questions/réponses sur la Chine : Comment la Chine prête-t-elle ?
• [Partie 3] Questions/réponses sur la Chine : La Chine fait-elle pareil que la Banque mondiale, le FMI et les États-Unis ?
• [Partie 4] Questions/réponses sur la Chine : La Chine pourrait-elle prêter autrement ?
Le mythe du succès des politiques néolibérales
Dans la partie 2 de son livre Claudio Katz commence par s'attaquer à la politique des néolibéraux latino-américains et montre à quel point, quand ils ont été et quand ils sont au gouvernement, comme dans une série de pays aujourd'hui, cela n'amène aucun véritable progrès pour le continent.
Claudio Katz montre que le soi-disant succès des politiques néolibérales en l'Amérique latine est un véritable mythe puisque les classes dominantes et les gouvernements à leur service restent dans une situation de soumission à l'impérialisme américain, mais en plus, s'ouvrent à la politique de la Chine, qui déplait aux USA, sans pour autant offrir une véritable alternative de développement économique et humain pour l'Amérique latine. Ce qui intéresse la Chine c'est l'exploitation des matières premières du continent et recevoir une part de celles-ci nécessaires à l'atelier du monde que constitue la Chine puis ensuite réexporter les produits manufacturés vers différents marchés dont le marché latino-américain.
Claudio Katz montre que la pauvreté reste à un niveau très élevé et même augmente, touchant 33 % de la population. L'extrême pauvreté touche 13,1 % de la population de l'Amérique latine tandis qu'il y a une augmentation des inégalités en faveur des 10 % les plus riches.
La croissance économique est très lente si on considère la croissance de la période 2010-2024 qui s'est élevée à 1,6 % annuellement. On voit qu'elle est inférieure à la période 1980-2009 où elle atteignait 3 % et à la période 1951-1979, pendant laquelle elle a atteint 5 % annuellement.
Ensuite, Claudio Katz revient sur les indépendances latino-américaines qui, pour la plupart, ont eu lieu dans les années 1820. Il montre que ces indépendances ont débouché sur un nouveau type de subordination à l'égard de nouvelles puissances, d'abord la Grande-Bretagne, qui était en lutte pour conquérir son espace au détriment de l'Espagne et du Portugal, puis, à partir de la fin du 19e, des États-Unis. Je souligne que j'avais abordé cette question dans mon livre « Le système dette » où je consacre plusieurs chapitres au 19e siècle et au début du 20e et où je démontre que c'est à la fois les accords de libre commerce d'une part et le type d'endettement auquel se sont livrés les gouvernements des pays latinoaméricains qui ont abouti notamment à un nouveau cycle de dépendance/subordination avec le rôle fondamental néfaste joué par les classes dominantes complices des différents impérialismes nouveaux.
Pour en savoir plus : Éric Toussaint, La dette et le libre-échange comme instruments de subordination de l'Amérique latine depuis l'indépendance, publié le 21 juin 2016
Éric Toussaint - Martín Mosquera, Cinq thèses contenues dans le livre « Le Système dette », Jacobinlat/CADTM, 30 mai 2022,
La montée de l'extrême-droite en Europe et en Amérique latine : spécificités et similitudes
Ensuite, dans la deuxième partie, Claudio Katz, de manière très intéressante, aborde la question de la montée de l'extrême droite en Amérique latine. Pour montrer le caractère spécifique de cette montée, il commence par analyser les caractéristiques de l'extrême droite en Europe et de sa croissance. Puis il analyse les caractéristiques propres des extrêmes droites en Amérique latine. À la différence de l'extrême droite en Europe ou aux États-Unis la question de l'immigration n'est pas au centre du discours de l'extrême droite même si, dans certains pays comme le Chili, elle utilise l'argument et l'épouvantail que représenteraient les migrant·es. Cependant, ça n'est pas généralisé, à la différence de ce qui se passe dans le discours de Trump ou le discours des différentes variantes de l'extrême droite en Europe, y compris au gouvernement.Par exemple Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, le RN en France, l'AFD en Allemagne, le VB et la NVA en Belgique, le FPÖ en Autriche,..
En Amérique latine, l'extrême droite, c'est le cas en Bolivie ou au Pérou, utilise un discours raciste, qui n'est pas dirigé contre les migrant·es, car il prend pour cible la majorité indigène, les peuples natifs. La dénonciation de la menace communiste, sous la forme du castrisme, du chavisme et d'autres expériences latino-américaines au cours desquelles la gauche radicale a marqué des points constitue un thème dans le discours de l'extrême droite, plus qu'en Europe parce qu'au cours des cinquante dernières années, la menace directe d'expériences se réclamant du socialisme n'y a pas eu la même prégnance qu'en Amérique latine. Katz montre aussi l'importance des mouvements évangéliques, extrêmement réactionnaires et la revendication par l'extrême droite latino-américaine de la suprématie blanche d'origine européenne et notamment ibérique. L'extrême droite latino-américaine magnifie la colonisation depuis Christophe Colomb comme une œuvre civilisatrice, d'où, d'ailleurs, les connexions étroites de l'extrême droite dans plusieurs pays latino-américains avec le parti Vox en Espagne qui fait de même.
Claudio Katz montre également que dans certains cas, notamment le bolsonarisme au Brésil, l'extrême droite, qui a réussi à conquérir le gouvernement en 2019 jusqu'à la réélection fin 2022 de Lula à la présidence, a fait preuve d'une capacité de mobilisation de masse. Et malgré sa défaite électorale, le bolsonarisme garde une capacité de mobilisation de masse comme il l'a montré en février 2024 en mobilisant à Sao Paulo près de 200 000 personnes. Dans le discours de l'extrême droite latino-américaine, la répression extrêmement dure à l'égard des classes « dangereuses » et des délinquants est une caractéristique importante. C'est le cas du gouvernement de Nayib Bukele au Salvador [5] qui a procédé à de nombreuses exécutions extrajudiciaires et qui a créé la plus grande prison de toute l'Amérique latine au nom de la lutte contre le narcotrafic. On peut également citer l'utilisation par Jair Bolsonaro de milices dans des quartiers populaires, notamment à Rio de Janeiro.
Une partie très intéressante de la seconde partie du livre de Claudio Katz porte sur une réflexion sur le fascisme, sur l'extrême droite aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail des concepts qu'utilise Claudio Katz, je laisse le lecteur découvrir son apport très intéressant en la matière.
Ensuite, toujours dans la deuxième partie, Claudio Katz prend plusieurs exemples de différents pays où il analyse la politique de l'extrême droite. Il prend l'exemple du Brésil de Bolsonaro puis la Bolivie, suivis du Venezuela, de l'Argentine de Javier Milei, de la Colombie puis du Pérou, avec ensuite quelques références à Nayib Bukele au Salvador et à la situation de l'Équateur ainsi qu'à celle du Paraguay, en quelques paragraphes seulement.
Parmi les éléments d'explication de la montée de l'extrême droite, il y a naturellement les déceptions dans un secteur des classes populaires par rapport aux expériences de gouvernements progressistes, mais il y aussi l'activité de l'impérialisme américain, l'activité des églises évangélistes et le manque de réaction ferme des gouvernements progressistes à l'égard de la menace d'extrême droite. Katz montre que lorsqu'il y a eu une réaction très ferme, notamment en Bolivie, cela a donné des résultats.
La nouvelle vague progressiste latino-américaine : un progressisme tardif modéré souvent porté au gouvernement par de grandes mobilisations
Avec la partie 3, Claudio Katz aborde les expériences de gouvernements progressistes. Il commence par constater qu'il y a eu une vague progressiste qui a commencé en 1999 et s'est terminée en 2014. Elle a été suivie d'un reflux conservateur qui a provoqué des mobilisations populaires dans un certain nombre de pays et qui a débouché, à partir de 2021-2022 surtout, sur une nouvelle vague progressiste. Il souligne que cette nouvelle vague progressiste est en retrait par rapport à la période 1999-2014, c'est-à-dire que les gouvernements progressistes mènent des politiques beaucoup moins radicales que celle menée, par exemple, par Hugo Chávez au Venezuela (1999-2012), Evo Morales dans la première période de son mandat en Bolivie (2005-2011) ou Rafael Correa (2007-2011). Cette vague progressiste, qui est moins radicale, touche des pays qui n'avaient pas été concernés par la vague antérieure, à savoir le Mexique, la Colombie depuis 2022 avec le gouvernement de Gustavo Petro, le Chili avec le gouvernement de Gabriel Boric.
Lecture complémentaire : Franck Gaudichaud et Éric Toussaint, Gauches et droites latino-américaines dans un monde en crise, 19 juin 2024
Claudio Katz analyse successivement l'expérience tout à fait récente, c'est-à-dire depuis le début de 2023, du retour de Lula à la présidence du Brésil, puis l'accession de Gustavo Petro à la présidence de la Colombie. Il fait un bilan d'Alberto Fernández, président de l'Argentine de 2019 jusqu'à la victoire de Javier Milei à la fin de l'année 2023. Il analyse la politique de Andrés Manuel López Obrador au Mexique depuis 2018, celle de Gabriel Boric au Chili et, enfin celle de Pedro Castillo au Pérou, qui a été renversé en 2022.
Je partage largement les jugements que Claudio Katz exprime à l'égard des gouvernements que je viens de mentionner et je recommande la lecture de cette partie.
En résumé, ce qui ressort des gouvernements progressistes de la période 2018-2019, dans le cas du Mexique et de l'Argentine et puis de la période 2021-2022 pour Brésil, Colombie, Chili et Pérou, c'est leur manque de radicalité, le fait qu'elles maintiennent largement le schéma extractiviste agro-exportateur, qu'aucun traité de libre commerce n'est abrogé. Claudio Katz est particulièrement dur dans la critique à l'égard du gouvernement de Gabriel Boric au Chili et de celui de Pedro Castillo au Pérou. Je laisse le lecteur et la lectrice lire les arguments de Claudio Katz que je partage largement.
La politique internationale de Lula
Ensuite, Claudio Katz, toujours dans la troisième partie, aborde la politique internationale et régionale de la part de certains gouvernements progressistes et notamment de celui qui est le plus important au niveau économique, à savoir le Brésil. Il montre que Lula est favorable au traité entre le Mercosur et l'UE. Une des raisons qui pousse Lula à réduire la déforestation en Amazonie est de répondre aux exigences de l'UE qui est sous la pression des lobbies industriels européens mais aussi des protestations dans les pays européens de la part des mouvements sociaux, des agriculteurs qui parle de concurrence déloyale des exportateurs brésiliens. Il y a des exigences environnementales qui sont avancées et bien sûr Lula souhaite certainement réduire la déforestation sous la pression des exigences des peuples autochtones d'Amazonie et des mouvements écologistes mais est d'autant plus convaincu de le faire que c'est une exigence de l'UE et qu'il veut mettre en place le traité Mercosur-UE.
J'ajoute que la gauche en Europe est opposée à ce traité. Il faut également souligner que la gauche des mouvements sociaux, la gauche écologiste, les mouvements des peuples originaires d'Amérique latine et du Mercosur s'opposent à la signature de ce traité, toujours en cours de négociation, et ce depuis des années.
Par ailleurs, Claudio Katz explique que le gouvernement Lula souhaite l'adoption d'une monnaie de compte entre pays du Mercosur de manière à réduire l'utilisation du dollar entre les pays. C'est important pour renforcer les relations économiques entre l'Argentine et le Brésil, parce que l'Argentine manque de réserves de change, et le Brésil, qui exporte beaucoup en Argentine a besoin qu'elle puisse lui acheter ses marchandises, notamment sous la pression du grand capital industriel brésilien qui est très fort dans le domaine de la construction automobile et pour qui le marché argentin est important. Et donc l'adoption d'une unité de compte dans le Mercosur, et notamment entre l'Argentine et le Brésil, permettrait à l'Argentine de se passer des dollars, qu'elle n'a d'ailleurs pas en quantité suffisante, et de réaliser ses achats de produits importés du Brésil. Le Brésil de Lula est aussi intéressé par l'exploitation du champ de gaz liquide appelé Vaca Muerta en Argentine à laquelle s'opposent les mouvements sociaux, la gauche et les mouvements écologistes de ce pays. L'idée de Lula, c'est d'importer du gaz liquide via un gazoduc qui arriverait au sud du Brésil, en particulier à Porto Alegre, et qui remplacerait l'approvisionnement du Brésil en gaz liquide provenant de Bolivie, parce que les réserves boliviennes sont en train de se tarir à une vitesse accélérée.
Katz explique également que Lula voudrait faire rentrer la Bolivie et le Venezuela dans le Mercosur.
À remarquer que dans ce livre, Claudio Katz n'utilise pas l'apport théorique de l'économiste marxiste brésilien Rui Mauro Marini [6], à propos du sous-impérialisme brésilien, ou de l'impérialisme périphérique brésilien et de son rôle par rapport à ses voisins. Ceci dit Claudio Katz l'a fait dans d'autres ouvrages [7] ; mais cela aurait pu être utile pour les lecteur·ices du présent livre. Une deuxième absence dans le livre de Claudio Katz (mais il ne peut pas écrire sur tout) c'est les BRICS, le rôle du Brésil dans les BRICS et les attentes de Lula à leur égard. Ce n'est pas une dimension marginale de la problématique d'ensemble qu'aborde Claudio Katz dans son livre ; le rôle des BRICS, la question de l'adoption ou non d'une monnaie commune, le rôle de la nouvelle banque de développement basée à Shanghai, qui est présidée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui avait succédé à Lula. Je pense que cela méritait un développement dans ce livre.
Pour en savoir plus sur les BRICS : Éric Toussaint,Les BRICS et leur Nouvelle banque de développement offrent-ils des alternatives à la Banque mondiale, au FMI et aux politiques promues par les puissances impérialistes traditionnelles ?, CADTM, 22 avril 2024,
Lire aussi : Centre tricontinental, BRICS ? Une alternative pour le Sud ? Cetri/Syllepse, 2024, https://www.cetri.be/BRICS-une-alternative-pour-le-Sud
Les limites des politiques des gouvernements progressistes
Ensuite, toujours dans la partie 3, Claudio Katz, après avoir abordé la politique avec le Mercosur, les traités de libre commerce, la relation économique avec les États-Unis, revient sur la politique de la Chine en Amérique latine dans une partie tout à fait intéressante que je n'ai pas le temps de résumer ici mais qu'il est important de connaitre. Je partage aussi son avis sur le fait que les gouvernements progressistes n'ont pas du tout pris une position à la hauteur du défi que représente la question de la dette, de la nécessité d'auditer les dettes réclamées à l'Amérique latine et je suis aussi d'accord sur le fait que le Brésil de Lula, lors des premiers mandats de Lula, au début des années 2000, a saboté le lancement de la Banque du Sud. J'y ai consacré récemment un article dans lequel je reviens en détail sur comment Lula a saboté la mise en activité de la Banque du Sud dans les années qui ont suivi 2007-2008, donc je partage son analyse sur la question.
Pour en savoir plus sur le blocage de la Banque du Sud : Éric Toussaint, L'expérience interrompue de la Banque du Sud en Amérique latine et ce qui aurait pu être mis en place comme politiques alternatives au niveau du continent , CADTM, 10 mai 2024.
En termes d'alternatives, Claudio Katz affirme que si les gouvernements progressistes voulaient réellement essayer de mettre en œuvre une politique continentale alternative au modèle néolibéral extractiviste exportateur, ils devraient créer ensemble une entreprise publique latino-américaine pour exploiter le lithium.
Claudio Katz affirme également qu'il faudrait que les gouvernements progressistes adoptent une politique de souveraineté financière, sortant du type d'endettement actuel et du contrôle qui est exercé par le FMI sur la politique économique de nombreux pays de la région. Il affirme qu'il faudrait un audit général des dettes et qu'une série de pays les plus fragiles devraient suspendre le paiement leur dette. Il dit que, si ce n'est pas fait, il n'y aura pas moyen de mettre en place une alternative et il affirme qu'il faudrait reprendre la voie laissée à l'abandon de la Banque du Sud, pour créer une nouvelle architecture continentale. Là aussi, on ne peut que partager son point de vue.
Les débats dans la gauche latino-américaine
Dans la partie 4 de son livre Claudio Katz aborde les débats au sein de la gauche latino-américaine et notamment l'attitude à adopter face à la droite et l'extrême droite et face aux gouvernements progressistes avec leurs limites.
Il affirme que c'est un devoir d'exprimer des critiques claires à l'égard des gouvernements progressistes sans, bien sûr, se tromper d'ennemis. Il faut sans aucun doute d'abord s'attaquer aux politiques de la droite et aux forces de droite, aux interventions impérialistes, en particulier à celles des États-Unis, mais également à la politique voulue par la Chine dans la région, mais il ne faut surtout pas se limiter à cela. Il faut aussi analyser et critiquer, quand c'est nécessaire, les limites des politiques des gouvernements dits progressistes. Claudio Katz montre l'énorme responsabilité de la gestion de la présidence d'Alberto Fernández en Argentine, à partir de 2019, dans la victoire de l'anarcho-capitaliste d'extrême droite Javier Milei.
Par rapport à ces politiques, je reprends une citation tout à fait correcte de Claudio Katz qui dit « il faut rappeler que l'option de gauche se forge en soulignant que la droite est l'ennemi principal et que le progressisme échoue par impotence ou complicité ou manque de courage par rapport à son adversaire mais qu'il ne faut pas confondre la droite au gouvernement avec ces gouvernements progressistes et dire qu'ils sont de même nature. Il y a une distinction fondamentale entre les deux et si on oublie cela on est incapable de concevoir une alternative et une politique correcte ».
"« Le progressisme échoue par impotence ou complicité ou manque de courage par rapport à son adversaire » Claudio Katz"
Pour prendre un exemple de cela il explique que l'incapacité d'une partie de la gauche en Équateur de voir le danger que représentait l'élection de Lasso a provoqué la victoire de ce banquier en 2021, alors qu'une alliance entre les composantes de la gauche aurait pu donner un résultat différent.
Comme exemple positif, il montre par contre que la compréhension qu'a eu le Parti pour le socialisme et la liberté (PSOL) en 2020-2022 de l'importance de combattre en priorité le danger d'une réélection de Jair Bolsonaro et donc d'appeler à voter dès le premier tour en faveur de Lula a été bénéfique et a permis de vaincre Bolsonaro. Car effectivement, la victoire de Lula sur Bolsonaro s'est jouée à très peu de voix et si le PSOL n'avait pas appelé à voter Lula, il est fort possible que Bolsonaro aurait été réélu. L'écrasante majorité des voix de Lula vienne de sa base électorale mais l'apport du PSOL a été important à la marge pour lui donner l'avantage.
Et là il explique que face à Javier Milei, donc très récemment, à la fin de l'année 2023, il y a eu un débat dans la gauche radicale argentine et une partie de celle-ci n'a pas voulu, pour le second tour, appeler à voter pour Sergio Massa le candidat péroniste néolibéral face au candidat d'extrême droite Javier Milei. Katz a tout à fait raison de soulever cette question et de souligner l'importance de faire front face à la droite. Ce qui est certain c'est que même si toute l'extrême gauche argentine regroupée dans le FIT-U avait appelé à voter pour le candidat néolibéral péroniste Sergio Massa, cela n'aurait pas permis la défaite de Milei, parce que celui-ci a gagné avec un avantage très important.
En prenant l'exemple du Chili, Claudio Katz souligne le fait que dans un premier temps il y a eu une grande mobilisation de la gauche en 2021 pour éviter la victoire du candidat de l'extrême droite pinochetiste José Antonio Kast, ce qui a permis au candidat de la gauche, Gabriel Boric, de gagner mais qu'ensuite, la modération de Boric, ses hésitations, ont produit la défaite sur le nouveau projet de constitution en septembre 2022 : l'interprétation qu'a donné Gabriel Boric du rejet de la nouvelle constitution, qui était pourtant très modérée, et qu'il a présentée comme trop radicale a finalement renforcé le discours de la droite, Boric allant de concession en concession à l'égard de la droite.
Claudio Katz et l' « axe radical » : Venezuela, Bolivie et Nicaragua
Après avoir analysé les politiques des gouvernements progressistes modérés, Katz aborde ce qu'il appelle l'axe radical. C'est, à mes yeux, une partie du livre qui est peu convaincante. Il range le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua dans cette catégorie et je ne comprends pas pourquoi Claudio Katz y met le Nicaragua, alors qu'il explique lui-même que le seul point commun entre ces trois pays est qu'ils sont sous le feu de l'impérialisme américain. Je ne pense pas qu'on puisse définir un pays comme faisant partie de l'« axe radical » simplement par le fait que Washington combatte ce gouvernement.
Il aurait mieux valu élaborer une catégorie spécifique dans laquelle mettre le Nicaragua. Le Nicaragua est un pays où il y a eu une authentique révolution qui a abouti à une victoire en 1979. Ensuite, une défaite électorale est arrivée en février 1990, marquant le début d'un processus de dégénérescence du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) sous la direction de Daniel Ortega. Processus suivi par une véritable trahison du processus révolutionnaire antérieur par une alliance d'Ortega avec la droite, y compris la plus réactionnaire, sur différentes questions, et notamment la question de l'avortement. Il faut aussi citer le tournant pro-Washington et pro-FMI du gouvernement de Daniel Ortega. C'est d'ailleurs la soumission au FMI qui a produit une rébellion populaire en avril 2018. Jusqu'en avril 2018, le régime de Daniel Ortega s'entendait très bien avec les États-Unis et avec le FMI. C'est le FMI qui a voulu une réforme des retraites qui a produit une révolte de secteurs populaires et notamment de la jeunesse, que Daniel Ortega a réprimé de manière absolument brutale comme le dénonce d'ailleurs de manière correcte Katz dans ce livre et dans un article datant de 2018. C'est après cette répression criminelle du mouvement social que Washington a décidé de s'opposer nettement au régime d'Ortega. Heureusement, Claudio Katz critique la répression à laquelle s'est livré Ortega et ne cache pas qu'en plus, son gouvernement a réprimé ensuite tous les candidat·es qui souhaitaient se présenter contre lui aux élections qui ont suivi. Il a, y compris, mis en prison, comme le dit et le dénonce Claudio Katz, d'anciens dirigeants révolutionnaires. Malheureusement Katz ne produit pas une analyse d'ensemble de ce qui s'est passé au Nicaragua.
Pour en savoir plus sur le Nicaragua : Claudio Katz, Le Nicaragua fait mal, CADTM, 6 août 2018
Éric Toussaint, Nicaragua : L'évolution du régime du président Daniel Ortega depuis 2007 , CADTM, 25 juillet 2018.
Éric Toussaint, Nicaragua : Poursuite des réflexions sur l'expérience sandiniste des années 1980-1990 afin de comprendre le régime de Daniel Ortega et de Rosario Murillo, CADTM, 12 août 2018.
L'analyse qu'il fait du processus en Bolivie est largement correcte à mon avis. Par contre, sur le Venezuela, il atténue très fortement ses critiques à l'égard du gouvernement de Nicolás Maduro. Il parle du chavisme en général, comme si Maduro constituait le prolongement de la politique de Hugo Chávez, alors qu'à mon avis, il y a une rupture qui s'est produite entre la politique menée par Chávez jusqu'à sa mort en 2013 et la politique introduite par Maduro. Certes, Nicolás Maduro renforce des faiblesses et des incohérences qui existaient déjà dans la politique suivie par Chávez mais les éléments les plus problématiques de la politique de Chávez sont amplifiés par la consolidation d'une ‘bolibourgeoisie' que critique d'ailleurs Claudio Katz. Katz ne cache pas qu'il y a une composante importante du gouvernement de Maduro qui est constituée d'un nouveau secteur capitaliste, né des entrailles du chavisme. Mais, malheureusement, il parle à peine de la répression des luttes sociales et du mouvement ouvrier. Il ne critique pas la manière dont Maduro combat ses anciens alliés comme le Parti communiste vénézuélien qui est quasiment mis dans l'illégalité.
Claudio Katz et Cuba
Après avoir abordé ce que Claudio Katz appelle l'« axe radical », qui serait constitué par le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua, il passe à l'analyse de Cuba. Claudio Katz montre correctement à quel point Cuba constitue un exemple, une référence et un espoir pour une grande partie de la gauche latinoaméricaine et on pourrait dire au-delà de l'Amérique latine. Il montre qu'il y a une évolution qui va vers le renforcement des inégalités à Cuba mais il met l'accent sur ce qu'il appelle la ‘prouesse' du gouvernement cubain pour affronter le blocus et les problèmes auxquels l'économie cubaine est confrontée. Tout en partageant largement une partie de l'analyse que fait Claudio Katz de Cuba, on peut souligner qu'il adopte une position insuffisamment critique par rapport à la question des relations des autorités cubaines avec le peuple au cours des dernières années, notamment au moment des importantes protestations dont parle Claudio Katz, en particulier le 11 juillet 2021. Il passe sous silence le fait que le gouvernement cubain a répondu d'une manière très maladroite dans un premier temps à la protestation du 11 juillet, en appelant les communistes à se mobiliser dans la rue, perspective que le gouvernement a ensuite très vite abandonnée parce que cela aurait pu déboucher sur des affrontements dont l'issue aurait pu être néfaste. Claudio Katz n'en parle pas du tout et il ne parle pas non plus de la vague de condamnations extrêmement lourdes prononcées par la justice cubaine contre toute une série de manifestant·es. Des condamnations qui vont de 5 ans à 20 ans de prison et qui visent à intimider les protestataires potentiels. Bien sûr, Cuba est sous la menace permanente et tout à fait concrète d'une intervention directe des États-Unis. Bien sûr, les effets de l'embargo décrété par Washington depuis 1962 sont tout à fait palpables. Bien sûr, il y a immixtion des États-Unis dans les affaires intérieures de Cuba, mais le recours à des condamnations aussi lourdes mérite d'être critiqué et, en tout cas, d'être mentionné. Katz aurait dû parler de ces condamnations et donner son point de vue.
En ce qui concerne le futur, Claudio Katz a raison de dire que ce n'est pas simplement la participation populaire, le contrôle ouvrier qui pourraient régler les problèmes de Cuba. Les problèmes de l'économie cubaine sont d'une telle nature que plus de participation populaire et citoyenne à elle seule ne permettrait pas de les résoudre. Il faudrait bien sûr opter pour une politique économique, dans un contexte tout à fait défavorable, qui réponde vraiment aux problèmes de l'économie cubaine et se poser la question de la priorité donnée au tourisme. Cette priorité est source d'une nouvelle dépendance par rapport aux rentrées en devises que génère le tourisme, alors qu'elle implique d'énormes coûts parce qu'il faut importer par exemple les aliments et d'autres produits qui sont nécessaires pour l'industrie touristique.
Je partage néanmoins l'avis de Claudio Katz sur le fait qu'il n'y a pas, jusqu'ici, reconstitution d'une classe capitaliste à Cuba. La direction cubaine ne veut pas la restauration du capitalisme et il ne faut pas confondre la possibilité qu'il y a dans le cadre du système cubain actuel d'accumuler un enrichissement dans des activités privées avec la naissance d'une véritable classe capitaliste capable de se fixer comme objectif de reprendre le pouvoir à Cuba. Par contre, il faut certainement se poser la question du risque qu'il y a qu'un secteur de la bureaucratie cubaine considère que finalement, il n'y a que la voie de la restauration du capitalisme, le modèle vietnamien ou chinois, qui permettrait une croissance économique. Dans ce cas, une partie de cette bureaucratie pourrait se fixer comme objectif de se convertir en nouvelle classe capitaliste mais cela n'a pas eu lieu. Cela ne veut pas dire que ces secteurs n'existent pas mais, pour le moment, ce ne sont pas eux qui sont à la tête du gouvernement cubain. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement cubain est dans une sorte d'impasse : il n'a pas opté pour la restauration capitaliste mais en même temps, il ne trouve pas les moyens d'adopter une politique économique et une politique de fonctionnement de la société assurant une plus grande participation citoyenne permettant à Cuba de se maintenir dans un cadre durable non capitaliste tout en améliorant les conditions de vie de la population. C'est un défi extrêmement dur à relever, mais qui est encore possible pour Cuba aujourd'hui. De toute façon, face à la politique agressive de l'impérialisme étasunien, il faut faire bloc et défendre les conquêtes de la révolution cubaine.
Les mobilisations populaires
Pour rappel Claudio Katz, correctement, considère qu'il y a eu un cycle progressiste prolongé de 1999 à 2014. On peut discuter si celui-ci a pris fin en 2014 ou si cela a eu lieu plus tôt en 2011, 2012 ou 2013, mais peu importe, le cycle a duré entre une douzaine et une quinzaine d'années, entre l'élection de Hugo Chavez fin 1998 et le reflux qu'on a connu dans différents pays d'Amérique latine. Entre 2014 et 2019, on a constaté un retour des gouvernements de droite, appliquant des politiques néolibérales dures qui ont provoqué une succession de très grandes mobilisations populaires. Cela a été le cas en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Pérou, au Honduras, au Guatemala et en Haïti.
Ces grandes mobilisations populaires de 2019-2020 ont débouché, à l'exception d'Haïti et de l'Équateur, sur l'arrivée au gouvernement de forces progressistes de centre gauche qui ont modifié la situation de prédominance de gouvernements de droite. Si bien qu'en 2023-2024, 80 % de la population de l'Amérique latine vit dans des pays à majorité progressiste. C'est très important d'indiquer, comme le fait Claudio Katz, que les victoires électorales des forces progressistes en Bolivie, Colombie, Chili, Pérou, Honduras et Guatemala n'ont été possibles que grâce aux énormes mobilisations populaires qui les ont précédées.
Argentine, Brésil et Mexique
Comme le souligne Claudio Katz, il faut ajouter trois pays, les plus peuplés, à cette liste de pays avec des gouvernements progressistes, à savoir le Mexique depuis 2018, l'Argentine entre fin 2019 et fin 2023 et le Brésil depuis janvier 2023. Dans le cas de ces trois pays, les gouvernements progressistes ne sont pas arrivés au pouvoir suite à de très importantes mobilisations populaires. En Argentine, le gouvernement d'Alberto Fernández, arrivé à la gestion des affaires du pays en 2019, n'a pas été porté là par d'énormes mobilisations populaires, même s'il y a eu des mobilisations contre le gouvernement néolibéral de Mauricio Macri, qui a présidé le pays de 2015 à 2019. Dans le cas du Mexique, Andres Manuel López Obrador (AMLO) est arrivé au pouvoir sans avoir été porté massivement dans l'année ou les deux années qui ont précédé son élection par d'énormes mobilisations. Certes, quelques années auparavant, il y avait eu de très importantes mobilisations y compris dans lesquelles il avait joué un rôle. Ces mobilisations s'opposaient à la fraude électorale qui avait empêché AMLO d'accéder à la présidence. Dans le cas de Lula, son retour au pouvoir comme président début 2023, là non plus, n'a pas été le résultat d'un énorme mouvement populaire. C'était le résultat dans les urnes de la politique désastreuse du gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro et notamment sa gestion calamiteuse de la pandémie de coronavirus.
La Bolivie, le Chili, la Colombie, le Honduras et le Guatemala
Par contre, dans les cas de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, du Honduras et du Guatemala, les gouvernements progressistes sont issus de grandes mobilisations populaires qui ont immédiatement précédé.
L'Équateur, Haïti et le Panama
Enfin, comme le fait remarquer Claudio Katz, il y a trois pays où il y a eu d'énormes mobilisations dans les rues, à répétition d'ailleurs, mais sans que cela ne débouche sur la victoire électorale de la gauche ou du centre gauche. Ces trois pays sont l'Équateur, Haïti et le Panama. En Équateur il y a une énorme mobilisation populaire en octobre 2019 qui a permis d'éviter un programme du FMI, notamment consistant en une augmentation importante du prix des combustibles. Cela a conduit à la défaite du gouvernement de Lenín Moreno et du plan du FMI en 2019, mais cela n'a pas été suivi, aux élections de 2021 par la victoire de la gauche, notamment pour les raisons invoquées précédemment dans le livre, c'est-à-dire la division entre la Conaie et le mouvement politique de Rafael Correa, en avril 2021, lorsque le banquier Guillermo Lasso a été élu.
Il y a une deuxième grande montée de luttes populaires en juin 2022, contre Guillermo Lasso qui a dû, lui aussi, comme son prédécesseur Lenín Moreno, jeté le gant et faire de très importantes concessions au mouvement populaire, ce dont j'ai rendu compte dans l'épilogue que j'ai écrit pour le livre Sinchi, portant sur la rébellion de juin 2022, publié sur le site de Contretemps.
Cette énorme mobilisation populaire, dans laquelle la Conaie a joué un rôle clé, avec d'autres secteurs de la population, n'a pas abouti non plus à la victoire d'un gouvernement de gauche aux élections qui ont suivi, là encore suite à la division entre la Conaie et le mouvement lié à Rafael Correa, dit « corréisme », qui a abouti alors à la victoire d'un multi millionnaire du secteur de la banane et de l'extractivisme, Daniel Noboa.
Puis il y le cas d'Haïti, avec des mobilisations extrêmement fortes, à répétition, mais avec une crise politique permanente, sans solution et sans arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche.
Enfin il y a le Panama, avec d'énormes mobilisations du secteur de l'enseignement et, en 2023, d'énormes mobilisations victorieuses de différents secteurs de la population (dont les enseignant·es, mais touchant tous les secteurs populaires) contre un énorme projet minier à ciel ouvert, mais ne débouchant pas sur la victoire d'un gouvernement de gauche. Aux dernières élections c'est un président de droite, José Raúl Mulino, qui a été élu.
Les alternatives
La dernière partie du livre de Claudio Katz porte sur les alternatives et il faut souligner que, de manière pertinente, il affirme qu'il faut à la fois résister à la domination exercée par l'impérialisme des États-Unis et résister à la dépendance économique qu'a générée la Chine dans les accords qu'elle a passés avec l'Amérique latine. Claudio Katz affirme qu'il faut agir par rapport à ces deux défis si on veut trouver une voie latino-américaine au développement, si on veut améliorer les revenus des secteurs populaires et si on veut réduire l'inégalité dans la région ; il dit qu'il s'agit de deux batailles différentes, que les deux ennemis ne sont pas identiques mais les deux batailles doivent être menées. Par rapport à Washington, il s'agit de récupérer la souveraineté et par rapport à la Chine, il s'agit de réagir à ce qu'il appelle une « régression productive » qui est générée par les traités signés avec Pékin. Une « régression productive », cela veut dire une re-primarisation de l'économie. En effet, comme nous l'avons expliqué plus haut, l'Amérique latine se spécialise dans ses relations avec la Chine dans l'exportation des matières premières non transformées, et importent de la Chine des produits manufacturés. Katz considère qu'il faut remettre en cause les traités de libre commerce signés avec la Chine. Il considère que l'Amérique latine devrait négocier en bloc avec la Chine, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour le moment les gouvernements des différents pays latinoaméricains, suivant le désir des classes dominantes locales, passent des accords avec la Chine. Comme ces classes dominantes se spécialisent largement dans l'import-export, elles y trouvent leur avantage mais cela ne permet absolument pas de diversifier les économies latinoaméricaines, de reprendre leur industrialisation et donc il faudrait, selon Claudio Katz, renégocier les accords avec les Chinois, de manière à ce que ceux-ci fassent des investissements dans la production manufacturière et pas simplement dans les industries extractives primaires. Il faudrait réindustrialiser, il faudrait que l'Amérique latine obtienne des transferts de technologies de façon à redémarrer un cycle de développement industriel diversifié.
Comme les gouvernements actuels et les classes dominantes locales n'adoptent pas une politique alternative aux politiques déterminées par les relations avec les États-Unis ou avec la Chine, il faut largement s'en remettre aux mobilisations des mouvements sociaux et Claudio Katz prend en exemple le positionnement et les actions menées par les organisations du réseau mondial, fortement présent en Amérique latine, de La Via Campesina. Cette organisation mondiale a intégré dans son programme d'action le rejet des traités de libre-échange.
Les mouvements sociaux et les réseaux internationaux
Claudio Katz prend note que les grandes mobilisations de la fin des années 1990 et du début des années 2000, dans le cadre du FSM, des luttes contre l'OMC à Seattle, les luttes en Europe contre l'accord multilatéral sur les investissements qui était négocié dans le cadre de l'OCDE, ont pris fin, malheureusement, et toute une série de traités de libre-échange ont été signés. Rappelons que les mobilisations, notamment en Amérique latine en 2005, avaient abouti à une victoire contre l'accord de libre commerce des Amériques voulu par l'administration de Georges W. Bush. Depuis lors, il n'y a pas eu de grandes mobilisations et dans le cadre du projet de la Nouvelle route de la soie, la Chine a réussi à imposer toute une série d'accords de libre-échange avec des pays latino-américains ou est en train de poursuivre la finalisation de nouveaux accords avec des pays qui n'ont pas encore signé avec la Chine. Il y a également des accords de libre commerce signés avec d'autres puissances.
Au niveau des accords de libre-échange signés avec la Chine, Claudio Katz mentionne l'accord signé en 2004 entre le Chili et la Chine, l'accord entre le Pérou et la Chine signé en 2009, l'accord entre le Costa-Rica et la Chine signé en 2010, et, plus récemment, l'accord avec l'Équateur signé en 2023, avec un gouvernement particulièrement de droite.
Face à cela, Claudio Katz dit très justement qu'il faut réussir à recréer les espaces d'unité régionale par en bas pour relancer une grande dynamique de mobilisations.
Au niveau des objectifs, Claudio Katz affirme correctement qu'il s'agit de récupérer la souveraineté financière, mise à mal par l'endettement extérieur et par le contrôle qu'exerce le FMI sur la politique économique. Selon Katz, il faut imposer un audit général sur les dettes et la suspension du paiement de la dette pour les pays soumis à un endettement très élevé afin de jeter les bases d'une nouvelle architecture financière. Il faut aussi avancer vers la souveraineté énergétique en créant de grandes entités inter-étatiques pour dégager des synergies et mettre en commun toute une série de ressources naturelles, les exploiter en commun et, notamment, en créant une entreprise publique latino-américaine d'exploitation et de transformation du lithium.
Claudio Katz affirme que l'alternative doit être une stratégie vers le socialisme. Selon lui Hugo Chávez a eu le mérite de réaffirmer l'actualité de la perspective socialiste et, depuis sa mort, personne d'autre ne l'a remplacé de ce point de vue. Katz affirme qu'il faut une stratégie transitoire pour rompre avec le système capitaliste. Il affirme qu'il faut lutter contre l'impérialisme américain qui s'est lancé dans une nouvelle guerre froide contre la Russie et la Chine. Il affirme également la nécessité de lutter contre l'extrême-droite et l'adaptation de la social-démocratie aux politiques néolibérales. Cette adaptation de la social-démocratie a favorisé, selon Katz, le renforcement de l'extrême-droite.
Nécessité d'un programme radical, révolutionnaire, de transition anticapitaliste
Claudio Katz en appelle à la nécessité d'un programme « radical, révolutionnaire, de transition anticapitaliste ». Il ajoute : « cette plateforme implique la démarchandisation des ressources naturelles, la réduction de la journée de travail, la nationalisation des banques et des plateformes digitales afin de créer les bases d'une économie plus égalitaire ».
Claudio Katz part de la constatation qu'il n'y a pas une actualité de victoires révolutionnaires simultanées ou successives à la différence de ce qui s'est passé au vingtième siècle avec la succession de révolutions victorieuses en Russie tsariste, en Chine, puis au Vietnam et à Cuba. Néanmoins, il estime qu'il faut réaffirmer que seule une solution socialiste à la crise du capitalisme peut offrir une véritable solution pour l'humanité. Il affirme que l'Amérique latine restera et constitue toujours une région du monde d'où peut surgir un renouvellement de la poursuite d'alternatives de type socialiste même si des processus comme celui de l'Alba, l'association entre le Venezuela, la Bolivie l'Équateur, lancé par Chávez au début des années 2000, a ont connu un repli.
Conclusion : Un livre indispensable
En somme le livre de Claudio Katz est une lecture obligatoire pour les militantes et les militants, les chercheurs et les chercheuses qui veulent comprendre la situation actuelle de l'Amérique latine du point de vue politique, économique et social. L'intérêt de l'approche de Claudio Katz est que, non seulement, il analyse les politiques suivies par les gouvernements des grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine ou d'autres grandes puissances, mais aussi les politiques des classes dominantes de la région latinoaméricaine ; il étudie la dynamique des luttes sociales et, enfin, il considère que c'est par en bas qu'on peut recréer un projet socialiste.
On peut juste regretter que la dimension de la crise écologique et l'urgence qui s'impose pour y trouver des solutions, dans un cadre socialiste, n'est pas suffisamment centrale dans le livre, y compris au niveau des conclusions, même si c'est clair que Claudio Katz soutient une démarche écologiste socialiste. Mais son livre gagnerait en force si Katz développait explicitement cet aspect à différents endroits de sa réflexion.
L'auteur remercie Claude Quémar pour sa collaboration et Maxime Perriot pour la relecture finale.
Le site de Claudio Katz en espagnol (mais pas que) : https://www.lahaine.org/katz/
Autres publications de Claudio Katz en français :
Qu'est-ce que le néolibéralisme ?
• • Samir Amin,Giovanni Arrighi, François Chesnais, David Harvey, Makoto Itoh, Claudio Katz
• • DansActuel Marx 2006/2 (n° 40)
Sous l'empire du capital. L'impérialisme aujourd'hui. Mont-Royal, M éditeur. 2014 [2011]
Trois regards sur les poussées réactionnaires latino-américaines
• Claudio Katz, Javier Tolcachier, Irene León, Traduction de l'espagnol Marleen Roosens, François Polet
• Dans CETRI, Amérique latine : les nouveaux conflits. Éditions Syllepse, 2023
• Amérique latine : essor et déclin de la doctrine Monroe
• Claudio Katz, Traduction de l'espagnol Carlos Mendoza
• Dans CETRI, Anticolonialisme(s). Éditions Syllepse, 2023
Notes
[1] Claudio Katz, America Latina en la encrucijada global , Batalla de Ideas-Buenos aires, Ciencias Sociales-La Habana, 2024, 366pp, ISBN : 978-987-48230-9-0 https://batalladeideas.ar/producto/america-latina-en-la-encrucijada-global/
[2] « Entre 1948 y 1990, el Departamento de Estado estuvo involucrado en el derrocamiento de 24 gobiernos. En cuatro casos, actuaron efectivos estadounidenses, en tres ocasiones prevalecieron los asesinatos de la CIA, y en 17 hubo golpes teledirigidos desde Washington. » Katz, p. 49.
[3] « Estados Unidos cuenta con doce bases militares en Panamá, doce en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú, tres en Honduras, y dos en Paraguay. Mantiene, además, instalaciones del mismo tipo en Aruba, Costa Rica, El Salvador y Cuba (Guantánamo). En las Islas Malvinas, el socio británico asegura una red de la OTAN conectada con los emplazamientos del Atlántico norte » Katz, p. 50
[4] « Todos los tratados que ha promocionado China acrecientan la subordinación económica y la dependencia. El gigante asiático afianzó su estatus de economía acreedora, lucra con el intercambio desigual, captura los excedentes y se apropia de la renta.
China no actúa como un dominador imperial, pero tampoco favorece a América Latina. Los convenios actuales agravan la primarización y el drenaje de la plusvalía. La expansión externa de la nueva potencia está guiada por principios de maximización del lucro y no por normas de cooperación. Beijing no es un simple socio y tampoco forma parte del Sur Global. » Katz, p. 73-74.
[5] ONU GENEVE, Arrestations massives, allégations de torture, d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées aux mains de la police et des forces armées, 18 novembre 2022, https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2022/11/dialogue-el-salvador-experts-committee-against-torture-praise Myriam Belmahdi, LA GUERRE CONTRE LES MARAS AU SALVADOR : JUSTIFICATION DES VIOLATIONS SYSTEMIQUES DES DROITS HUMAINS, 18 nov. 2023, https://reesahaixmarseille.wixsite.com/association/post/la-guerre-contre-les-maras-au-salvador-justification-des-violations-syst%C3%A9miques-des-droits-humains La Jornada, « Bukele : la ilusión de la seguridad », 27/05/2024, https://www.jornada.com.mx/2024/05/27/opinion/002a1edi
[6] Ruy Mauro Marini (1973) The Dialectics of Dependency, Monthly Review, New York, 2022 https://monthlyreview.org/product/the-dialectics-of-dependency/
[7] Claudio Katz, La teoría de la dependencia cincuenta años después, Argentine, Ed. Batalla de Ideas, 2018, https://libreriacarasycaretas.com/productos/la-teoria-de-la-dependencia

La Colombie est confrontée à « l’une des plus grandes crises humanitaires au monde » alors que les groupes armés se renforcent

Huit ans après l'accord de paix de 2016 entre les forces gouvernementales et la guérilla, qui devait mettre fin à un demi-siècle de conflit, environ 5 millions de Colombiens sont toujours déplacés à l'intérieur du pays et un nombre croissant de personnes vivent dans des zones contrôlées par des groupes armés. La violence qui sévit dans le pays a poussé de nombreuses personnes à fuir, souvent en passant par le dangereux Darién Gap entre la Colombie et le Panama voisin. Pour en savoir plus sur la situation sécuritaire en Colombie et l'état du processus de paix, nous nous entretenons avec Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, et le Dr Manuel Rozental, un médecin et militant colombien qui fait partie du groupe Pueblos en Camino, ou Personnes sur le chemin.
15 août 2024 | tiré su site democracy now !
https://www.democracynow.org/2024/8/15/colombia_violence
NERMEEN SHAIKH : Nous poursuivons notre conversation avec Jan Egeland, le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il nous rejoint depuis Bogotá, en Colombie, où il s'est penché sur la façon dont les groupes armés renforcent leur contrôle sur certaines parties de la Colombie. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, plus de 8 millions de Colombiens vivent dans des zones où des groupes armés opèrent. Il s'agit d'une augmentation de 70 % par rapport à 2021. Environ 5 millions de Colombiens sont toujours déplacés à l'intérieur du pays, huit ans après l'accord de paix de 2016. La violence en Colombie a forcé de nombreuses personnes à fuir le pays, souvent en passant par le dangereux Darién Gap, situé entre la Colombie et le Panama.
AMY GOODMAN : En plus de Jan Egeland, nous sommes rejoints par Manuel Rozental. C'est un médecin et militant colombien avec plus de 40 ans d'implication dans l'organisation politique de base avec les jeunes, les communautés autochtones et les mouvements sociaux urbains et ruraux, et a été exilé à plusieurs reprises pour ses activités politiques. Rozental fait partie du groupe Pueblos en Camino.
Jan Egeland, commençons par vous. Expliquez-nous pourquoi le Conseil norvégien pour les réfugié-e-s, pourquoi vous, en tant que son chef, êtes en Colombie en ce moment.
JAN EGELAND : Parce que c'est l'une des plus grandes crises humanitaires sur Terre, vraiment, et qu'elle est complètement négligée par le reste du monde, et qu'elle se produit au milieu de l'hémisphère occidental. Je suis rentré tard hier soir d'un voyage au fin fond de la forêt tropicale de Nariño, dans le sud-ouest de la Colombie, et j'y ai rencontré des tribus indiennes qui sont sur le point d'être exterminées à cause des conflits armés continus — il y a huit conflits armés en Colombie, entre les nombreux groupes armés et aussi avec l'armée. Et il y a toutes sortes de cartels de la drogue qui sont alimentés par le commerce de la drogue. Il en va de même pour les nombreux groupes armés. Et la population civile est sous le feu croisé. Je suis donc vraiment secoué de voir combien de personnes sont maintenant complètement sans protection dans un conflit armé qui s'étend. Soit dit en passant, beaucoup de ceux qui ne sont pas protégés sont aussi des réfugiés, des Vénézuéliens, des migrants qui marchent vers le nord pour se protéger et, qui, espèrent-ils se dirigent vers l'Amérique du Nord.
NERMEEN SHAIKH : Jan Egeland, pourriez-vous nous parler spécifiquement de l'impact de ces multiples conflits sur la région amazonienne ? La déforestation en Amazonie colombienne a augmenté, et certaines données suggèrent que la déforestation dans la région est 40 % plus élevée que l'année dernière, en raison des conflits dans la région. Pourriez-vous nous parler des groupes à qui vous avez parlé là-bas, les groupes autochtones, et des raisons pour lesquelles le conflit est particulièrement dévastateur dans cette région ?
JAN EGELAND : C'est parce qu'il n'y a pas d'État. Ils appellent cela ausencia de estado ici, qu'il n'y a pas d'appareil d'État, pas de services d'État, pas de force publique et d'ordre dans une grande partie de la Colombie, qui est un beau pays avec d'énormes forêts tropicales, des montagnes, une nature vierge.
Quelque 80 groupes autochtones sont en réalité sur le point d'être exterminés. Leur culture a vraiment disparu parce qu'ils ont été déplacés de leurs terres par ces groupes armés et les barons de la drogue — il y a souvent un chevauchement entre eux — pour la terre, pour le commerce de la coca. Il y a une augmentation de la production de stupéfiants. Et les stupéfiants sont le carburant de la violence. Et la population civile, qui n'est pas protégée, est déplacée.
Nous sommes des groupes humanitaires qui font de leur mieux pour aider. J'ai passé quatre heures avec mes collègues en bateau sur les rivières pour rencontrer certains de ces groupes autochtones et les communautés afro-colombiennes. Et ils souffrent complètement seuls. Nous pouvons leur apporter une aide humanitaire, mais nous ne pouvons pas leur donner de protection. Et puis nous voyons que des gens qui ont toutes les armes du monde brûlent la forêt, déplacent les gens et travaillent en toute impunité.
AMY GOODMAN : Je veux faire participer à cette conversation Manuel Rozental, le médecin et militant colombien, pour parler des causes profondes de la violence, Manuel, et pour parler de ce que fait le gouvernement. Des négociations de cessez-le-feu sont en cours avec les factions armées, y compris les FARC. Et quelle est l'importance de l'implication des États-Unis dans tout cela ?
M. MANUEL ROZENTAL : Merci. Bonjour. Et c'est bon d'entendre la voix de Jan Egeland. Nous nous souvenons bien de lui ici de son précédent séjour en Colombie.
Oui, l'une des choses que j'aimerais ajouter aux commentaires de M. Egeland, c'est que, oui, bien sûr, ce qu'il dit est absolument vrai en ce qui concerne la coca et les différentes factions armées, mais il faut se rappeler que lorsque l'accord de paix a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien, même avant cet accord qui a été signé en 2016, d'énormes concessions d'extraction de pétrole ont été accordées à des sociétés transnationales dans toute la région amazonienne. Il faut donc ajouter ces facteurs pour commencer à expliquer ce qui se passe.
Je vais vous donner une image de ce que M. Egeland décrit. La Colombie est en train de devenir une série, ou pourrait le devenir, si elle continue dans cette direction – elle pourrait devenir une série de territoires criminels autonomes, d'immenses territoires, non seulement ruraux, mais certainement ruraux, avec les données qui nous ont déjà été fournies, mais urbains et ruraux. Les factions armées, peu importe, elles peuvent se présenter comme de droite, de gauche, impliquées dans le trafic de drogue, etc. – d'énormes factions armées sont liées à des mafias locales qui sont également liées aux positions gouvernementales et à l'État. Et ces connexions, ces assemblées, prennent le contrôle des territoires et contrôlent les populations, de telle sorte que, par exemple, si vous voyez qu'il y a une diminution du nombre d'assassinats, d'enlèvements, etc., cela signifie généralement que ces factions armées ont pris le contrôle des territoires, et elles ont établi une forme violente de gouvernement et d'État.
Il y a donc une absence d'un État que l'on pourrait qualifier d'État idéal qui assure la santé, l'éducation, la protection, etc. Mais il y a une présence d'un autre type d'État en train de s'établir en Colombie. Et c'est ainsi, et cela peut arriver, sur fond d'inégalités sociales extrêmes, d'extrême pauvreté, qui a poussé les gens vers deux types d'économies, les économies illégales. L'une d'entre elles est de survivre grâce à ce qui est disponible, c'est-à-dire la coca, la production de marijuana. La Colombie produit 92% de la cocaïne mondiale et presque autant de marijuana. Et alors, l'autre type d'économie est la guerre elle-même. Si vous êtes recruté, vous recevez une sorte de revenu, ou vous le faites. Donc, c'est notre État. Il n'y a pas d'absence d'État ; c'est l'État de la Colombie. Et c'est lié, dans de nombreux cas et dans de nombreux territoires, à une forme de gouvernement et d'État qui s'est traditionnellement engagé dans ce genre d'activités, donc cette combinaison d'activités.
Maintenant, l'implication des États-Unis dans ce dossier, je vais juste faire un petit commentaire simple. Et ce commentaire est que le général Laura Richardson, qui est en charge du Commandement sud du Pentagone des États-Unis, a clairement indiqué que l'intérêt pour cette région, toute la région, inclut l'Amazonie et d'autres territoires pour les ressources. C'est donc le vieux discours impérial en termes de concurrence contre les Chinois et les Russes pour le contrôle de ces territoires, et le principal et seul intérêt est extractif. Le reste n'est que discours. C'est donc ce que nous vivons.
Amy, en fait, je me souvenais juste, en écoutant M. Egeland, de votre livre sur le Nigeria il y a des années. Je suis dans le nord du Cauca. M. Egeland sait que ce qui se passe ici est la même réalité qu'à Nariño. Et ce que nous vivons, c'est ce que vous avez décrit au Nigeria lorsque vous avez été arrêté par des gens armés, et que vous n'avez pas été tué, par miracle, parce que votre vie était entre leurs mains. C'est le pouvoir, le gouvernement et l'État en Colombie. Le reste n'est que discours et image. Ce n'est pas différent de ce qui se passe avec Barbecue en Haïti, bien qu'à un degré différent mais avec des spécificités.
NERMEEN SHAIKH : Alors, Manuel, pourriez-vous parler du gouvernement du président Gustavo Petro et des politiques que le gouvernement a eues en ce qui concerne ces multiples conflits armés et la crise qui se déroule, sa politique de paix totale, et qu'est-ce qui en est ressorti ?
M. MANUEL ROZENTAL : Les intentions de ce gouvernement sont excellentes, et c'est pourquoi il a reçu cet appui massif. Et sa proposition initiale en tant que candidat était la paix totale, et c'est ce qu'il fait. La paix totale signifie négocier avec tous les acteurs armés. Certains sont des acteurs politiques, ou se présentent comme des insurrections politiques, et les autres comme des groupes criminels.
Il a donc proposé une approche différenciée à chacun d'entre eux. Il devrait se soumettre à la justice à des conditions favorables en échange de la paix. Les autres négocieraient une solution politique. Après la signature de l'accord de paix en Colombie, il n'a pas été respecté par le gouvernement et a conduit non pas à l'existence d'une seule faction armée, les FARC, mais à de nombreuses factions armées. Donc, dans ce contexte, Petro propose ce processus et commence à y travailler.
Le problème de la proposition du président Petro est double. Premièrement, c'est une répétition de l'erreur commise, je pense intentionnellement, par le président Santos, qui est lauréat du prix Nobel, c'est-à-dire une négociation qui a exclu la population. Il s'agissait d'une négociation entre les factions armées, au nom du peuple, pour répartir le pays et les ressources du pays entre ces factions. Et puis, bien sûr, cela n'a pas été respecté par les gouvernements qui sont revenus. Aujourd'hui, Petro fait de même. Il négocie avec les factions armées. Et les communautés et les populations qui en souffrent, comme l'a exposé M. Egeland, sont essentiellement ignorées. C'est donc une erreur.
La deuxième erreur – et c'est une énorme erreur – est précisément dans un discours abordant l'économie de la drogue et l'économie extractiviste, mais, en pratique, ne développant pas d'alternatives réelles, concrètes, viables et réalisables à cela. Et il fait partie d'un gouvernement qui est en fait sous le contrôle d'un État qui est devenu une structure autoritaire de type mafieux. Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais les intentions sont bonnes. Le discours est bon. Mais les gens se sentent désespérés sur le terrain.
NERMEEN SHAIKH : Eh bien, nous avons Jan Egeland de retour en studio à Bogotá. Jan Egeland, pourriez-vous continuer sur ce que vous avez dit plus tôt et parler de vos rencontres avec des responsables en Colombie ?
JAN EGELAND : Il est vrai que le gouvernement essaie de faire beaucoup pour apporter la paix et le développement à tous ces groupes vulnérables. Mais le fait est que depuis l'accord de 2016, qui a apporté tant d'espoir, et le prix Nobel au président Santos, comme Manuel l'a dit, les FARC se sont démobilisées, mais ensuite beaucoup d'autres groupes ont pris leur espace, ont pris le territoire, se sont emparés du commerce de la drogue, et il n'y avait pas de gouvernement pour aider à apporter une alternative, un développement alternatif. des services alternatifs à la population. Il y avait donc un vide, et il a été comblé par d'autres hommes armés, et certains d'entre eux, des FARC, sont maintenant de retour. Je vous rencontrerai aujourd'hui — et le gouvernement doit alors en faire beaucoup plus et travailler plus efficacement avec la communauté internationale.
Je rencontrerai les diplomates ici à Bogotá aujourd'hui, et je leur dirai : « Écoutez, nous avons moins de fonds aujourd'hui pour les projets de développement, pour l'aide humanitaire, pour le soutien aux tribus indiennes en voie d'extermination. Il y a moins de soutien pour l'alternative à la guerre qu'il n'y en avait auparavant. Et on ignore que les gens perdent espoir au Venezuela voisin, dans une grande partie de la Colombie, en Équateur, en Amérique centrale et dans de nombreuses autres parties du monde. Alors, bien sûr, les gens partent vers le nord dans l'espoir d'une vie meilleure dans le Nord. Si vous ne donnez pas aux gens de l'espoir là où ils sont et de la sécurité là où ils sont, bien sûr, ils se dirigeront vers le nord, vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Je le ferais dans la même situation s'il n'y avait pas d'espoir pour moi et ma famille, ni une vie meilleure et si ne n'avais pas une certaine protection contre la violence.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed

La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 6 octobre ne compte que trois candidats, dont le chef d'État sortant Kaïs Saïed. La plupart de ses adversaires potentiels ont été évincés ou ont eux-mêmes jeté l'éponge face aux nombreux obstacles administratifs rencontrés pour se présenter. Beaucoup de Tunisiens observent de loin le glissement imperceptible du pays vers un régime de pouvoir personnel.
Tiré d'Orient XXI.
Dans l'ancien palais beylical de Ksar Saïd, à quelques mètres du parlement, Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) donne, durant une conférence de presse organisée le samedi 10 août, les noms des candidats à la présidentielle du 6 octobre 2024. Lorsqu'il s'arrête au bout de trois noms – sur les 17 candidatures déposées —, dont celui de l'actuel président de la République Kaïs Saïed, l'étonnement est palpable parmi les journalistes.
La Tunisie n'a pas connu une telle situation depuis l'élection présidentielle de 1999, sous le régime de Zine El-Abidine Ben Ali, lorsqu'une loi constitutionnelle a autorisé d'autres candidats à se présenter. Le président avait alors gagné avec 99,45 % des voix face à deux rivaux consentis pour la forme, mais qui n'avaient aucune chance dans un système dictatorial où les résultats étaient truqués et l'opposition muselée. Deux décennies plus tard, le scrutin du 6 octobre doit servir à conforter la dérive autoritaire vers laquelle s'oriente le pays.
Course d'obstacles
L'éventualité d'un second tour n'a même pas été mentionnée dans le calendrier électoral. « Tout a été fait pour dégoûter l'électeur d'aller voter, et décourager les candidats de se présenter. C'est un piège, car la faible participation, soit par boycott soit par désintérêt, facilitera la réélection de Kaïs Saïed », explique Kamel Jendoubi, militant des droits humains et premier président de l'Instance électorale de 2011 à 2014. Déjà en juillet 2023, les élections législatives avaient connu un taux de participation exceptionnellement faible de 11 %. Jendoubi fustige également le rôle ambigu et politique joué par l'ISIE dans l'enclenchement d'un processus électoral, dénoncé par la société civile et des partis politiques de gauche comme « anti-démocratique », dans un communiqué commun publié le 1er août.
Depuis le début de la date du dépôt des candidatures qui a commencé le 29 juillet, de nombreux candidats ont en effet dénoncé les obstacles administratifs insurmontables pour se présenter. Des prisonniers politiques, dont Issam Chebbi et Ghazi Chaouachi, membres des partis de centre gauche Al-Joumhoury et le Courant démocrate et qui n'ont toujours pas été jugés depuis plus d'un an, n'ont pas réussi à se procurer les formulaires nécessaires pour récolter les parrainages, malgré les procurations signées à leurs proches depuis le début de leur détention. Et pour cause : l'ISIE a exigé une autre procuration, spécifique aux élections, pour pouvoir présenter son dossier de canditature.
Pour le parrainage, 10 000 signatures d'électeurs répartis sur 10 circonscriptions sont requises, dont 500 au minimum par circonscription, « un démarchage déjà très compliqué selon le nouveau découpage électoral qui a créé 167 circonscriptions dont certaines, très petites », explique Kamel Jendoubi. L'autre alternative était de récolter 40 signatures d'élus des collectivités locales ou encore les parrainages de 10 députés, alors que les deux chambres parlementaires sont toutes les deux acquises au président sortant. Déjà avant le dépôt des candidatures, plusieurs personnes ont été arrêtées pour tentative de falsification et d'achat de parrainages. Certaines de ces tentatives sont avérées. « Nous avons voulu éviter les risques de fraudes par rapport à 2019 donc nous avons verrouillé le système », se défend un membre de l'ISIE en marge de la conférence, sans donner plus de détails sur le processus de vérification.
Dans le cas d'Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), ses avocats ont demandé à ce qu'un huissier de justice soit envoyé à la prison de la Manouba où elle est détenue depuis octobre 2023, poursuivie dans plusieurs affaires dont celle pour « attentat dans le but de changer la forme du gouvernement ». L'huissier devait attester et valider sa procuration pour déléguer son dépôt de candidature à ses avocats. Bien que sans réponse, ses avocats ont tenu à déposer un dossier incomplet, sans parrainages : « À l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons faire un recours auprès du tribunal administratif pour "fait du prince", et dénoncer la façon dont l'administration bloque de façon arbitraire les démarches d'un citoyen », explique Nafaa Lâaribi, l'un des représentants d'Abir Moussi.
Exclusion méthodique
Les obstacles administratifs n'ont pas touché que les membres de l'opposition en prison. En plus de la question des parrainages, il y a celle de l'obtention du bulletin n°3 (B3), l'équivalent de l'extrait de casier judiciaire. Cette exigence pour constituer un dossier de candidature, contestée par l'opposition, avait pourtant été rejetée par le tribunal administratif pour la présidentielle de 2014. L'obtention du B3 a ainsi été un obstacle pour plusieurs candidats annoncés, dont Mondher Zenaïdi, plusieurs fois ministre sous Ben Ali et vivant en France depuis la révolution de 2011.
Safi Saïd, essayiste, ancien conseiller de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et ancien député de tendance nationaliste arabe, a décidé de jeter l'éponge quand l'ISIE l'a informé une première fois que son dossier était « incomplet », sans B3 et sans suffisamment de parrainages validés par l'Instance : « J'ai clairement vu que les chances n'étaient pas égales et que les règles et les critères du jeu n'étaient pas clairs », a-t-il déclaré dans un communiqué en date du 9 août, ajoutant qu'il risquait de participer à un « one man show de très mauvais goût » selon ses mots, en référence à la probable réélection du président Kaïs Saïed. De son côté, l'amiral Kamel Akrout, ancien conseiller du président défunt Béji Caïd Essebssi (2014 – 2019) a qualifié de « mascarade » la liste des candidats retenus le 10 août, ajoutant qu'il allait boycotter l'élection.
Autre moyen mobilisé contre les candidats : la justice. Ainsi, la veille de la date butoir du dépôt des candidatures, la présidente du PDL est condamnée à deux ans de prison dans le cadre d'une affaire l'opposant à l'ISIE qui avait porté plainte contre elle pour avoir critiqué le processus électoral législatif en 2023. La plainte de l'ISIE s'est basée sur le décret 54, ciblant la diffusion de rumeurs ou d'intox et utilisé majoritairement pour museler toute voix dissidente. Le même jour, l'ancien ministre de la santé et ex-membre du parti islamiste Ennahda Abdelatif Mekki a également été condamné pour achat de parrainages à huit mois de prison avec sursis, et une interdiction de se présenter aux élections. Il est depuis assigné à résidence.
La même sentence a frappé le candidat déclaré Lotfi Mraïhi, également condamné le 18 juillet à huit mois de prison et à l'inéligibilité « à vie », une première. D'autres candidats disent avoir découvert pendant leur démarche de dépôt de dossier des poursuites judiciaires à leur encontre, à l'image de Néji Jalloul, ancien ministre de l'éducation (2015 – 2017), découvrant avoir été condamné par contumace en mai 2024 à 6 mois de prison pour falsification de parrainages dans la présidentielle de 2019.
Un « coup de strike » pour éliminer les adversaires politiques, selon les mots du journal en ligne Business News, (1) et qui a touché une dizaine de candidats dont l'ex-candidate à la présidentielle de 2019, Leila Hammami, ou encore l'homme de médias, Nizar Chaari.
Dans ce contexte électoral, les médias sont également sous pression. La journaliste indépendante Khaoula Boukrim s'est vu retirer son accréditation par l'ISIE pour couvrir la présidentielle car elle n'aurait « pas assuré une couverture neutre et objective du processus électoral ». Le Syndicat des journalistes a dénoncé à plusieurs reprises les ingérences de l'ISIE dans le travail et le contenu journalistique. Malgré les résistances de certains journalistes, la couverture de la campagne présidentielle risque d'être timorée et muselée, la plupart des émissions de radio de grande écoute s'étant vidées de leurs présentateurs et chroniqueurs les plus aguerris dans le débat politique, sans compter les journalistes en prison tels que Borhen Bsaies, Mourad Zeghidi et la chroniqueuse et avocate Sonia Dahmani qui avaient l'habitude d'analyser la situation politique.
Human Rights Watch a publié un article le 20 août (2) pour dénoncer ce climat d'exclusion, appelant le gouvernement à « cesser ses ingérences politiques dans le processus électoral » et exhortant la communauté internationale « à ne plus garder le silence » face « à un processus électoral d'ores et déjà terni ». Pour Bassam Kawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ONG :
- Après avoir emprisonné des dizaines d'opposants et d'activistes de renom, les autorités tunisiennes ont écarté presque tous les concurrents sérieux de la course à la présidence, réduisant cette élection à une simple formalité.
Président ou candidat ?
Selon la liste préliminaire, ce sont Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du parti nationaliste arabe Le Mouvement du peuple qui a approuvé le coup de force du 25 juillet 2021, ainsi qu'Ayachi Zammel, ex-député Nidaa Tounes en 2019 et président du parti libéral Azimoun, qui disputeront la mandature suprême face à Kaïs Saïed. Le recours de sept candidats – parmi lesquels Mondher Zenaïdi, Abir Moussi et Imad Daïmi, ancien conseiller du président Moncef Marzouki — dont les dossiers ont été refusés, a été rejeté par le tribunal administratif le week-end du 18 août. Entre les possibilités d'appel et de pourvoi en cassation, la bataille va durer jusqu'au 4 septembre, date à laquelle l'ISIE donnera la liste finale des candidats.
Dans ce contexte, Kaïs Saïed, qui a déclaré avoir récolté 242 000 parrainages lors du dépôt de sa candidature, est bien parti pour faire cavalier seul le 6 octobre. La campagne électorale semble avoir déjà été enclenchée avant son démarrage officiel, le 14 septembre, malgré un désintérêt que l'on suppose dans la population pour le scrutin et ses enjeux politiques, étant donné le faible taux de participation aux législatives de 2023 et pour le référendum constitutionnel de 2022. Depuis l'annonce du rendez-vous du 6 octobre, le président de la République, qui a fait connaître sa candidature sur la page officielle de la présidence de la République, enchaîne les déclarations sur l'état du pays et sur de nombreux problèmes qu'on peut assimiler à ceux d'une campagne électorale.
Ainsi, Kaïs Saïed multiplie les visites officielles dans le pays pour dénoncer les coupures d'eau à répétition, fruit de « sabotages » selon ses mots — et non du stress hydrique ni de l'état du réseau de distribution — ; l'état des transports publics qui l'a amené à ordonner l'acquisition immédiate de 1 000 bus ou encore les tentatives « d'ingérence et d'infiltration visant à perturber la situation sociale » qui le poussent à faire le point régulièrement avec le ministre de l'intérieur. Il a limogé inopinément son premier ministre Ahmed Hachani mercredi 7 août pour le remplacer par le ministre des affaires sociales Kamel Madouri, une décision inexpliquée rendue publique sur la page Facebook officielle de la présidence de la République.
Face aux critiques et à ce qu'il appelle une « campagne enragée contre l'État tunisien et le peuple tunisien souverain » menée par « d'aucuns » qui feraient partie de « lobbies », le président affirme que ces « élections ne sont pas une guerre », ajoutant, lors d'une réunion avec le ministre de l'intérieur le 23 août au Palais de Carthage, que « toutes les tentatives visant à envenimer la situation sont des tentatives désespérées ».
À l'approche de la rentrée, Kaïs Saïed se saisit aussi du dossier des enseignants suppléants précaires ou encore des conditions de travail des femmes agricoles à l'occasion de la Journée nationale de la femme le 13 août. Une chercheuse tunisienne qui a souhaité garder l'anonymat observe :
- Sa capacité à apporter des solutions est de plus en plus questionnée, que ce soit au niveau des commentaires, parfois critiques, sur la page Facebook de la Présidence, ou via certaines invectives d'habitants qui le prennent à parti.
Un mandat de dépôt a été émis contre un enseignant à la retraite pour une publication sur Facebook critique de la visite de Kaïs Saïed à Sidi Bouzid, berceau de la révolution, le 13 août.
La diminution des mouvements sociaux
Aux problèmes du manque d'eau qui faisaient encore l'objet des récriminations de certains habitants à Sidi Bouzid lors de la visite présidentielle s'ajoute un bilan en demi-teinte pour le chef de l'État selon l'ONG anti-corruption I-Watch. Dans un rapport publié le 27 juillet, celle-ci souligne que sur les 72 promesses émises par Kaïs Saïed depuis son arrivée au pouvoir en 2019, seulement 12 % ont été tenues, alors que l'homme dispose des pleins pouvoir depuis le 22 septembre 2022. Le document dénonce notamment le flou entourant toujours certains projets comme la Fondation Fidaa pour les blessés et martyrs de la révolution et les victimes de terrorisme – un des chevaux de bataille de Kaïs Saïed —, ou encore les entreprises communautaires, censées pouvoir résoudre le problème du chômage. Pour son travail, l'ONG a été visée par une plainte de l'ISIE mi-août, accusée d'avoir publié « des sondages en période électorale » dans son rapport des cinq ans de gouvernance du Président. I-Watch a dénoncé dans un communiqué cette plainte « visant à restreindre son action ».
La relative stabilité du pays peine à faire oublier l'inflation galopante, le taux de chômage et la croissance qui stagne à 1 %. « On observe qu'il y a eu beaucoup moins de mouvements sociaux en Tunisie [depuis 3 ans], mais cela ne reflète pas une baisse du mécontentement ou du désarroi social pour autant », selon la journaliste Rim Saoudi qui intervenait lors de la conférence de presse d'I-Watch. Elle explique :
- La baisse des protestations est liée à deux facteurs, le fait d'être taxé de « non patriote » car en bloquant la production, beaucoup de manifestants sont perçus comme des perturbateurs. Mais ils craignent aussi la criminalisation de toute forme de dissidence ou de voix critique du régime.
La journaliste oppose à la baisse de protestation sociale les chiffres alarmants de la hausse de l'émigration irrégulière : depuis le début de l'année 2024, plus de 30 000 tentatives d'émigration ont été empêchées par les autorités, et plus de 52 000 personnes ont tenté de franchir les frontières maritimes vers l'Europe, dont une majorité de Subsahariens. Dernièrement, les gardiens de but d'un club de football de Tataouine dans le sud tunisien ont fait partie de ces arrivées clandestines à Lampedusa.
Malgré ce bilan, Kaïs Saïed bénéficie encore d'un capital confiance auprès d'une partie de la population, difficile à quantifier faute de sondages. Cette frange perçoit ses campagnes de limogeages de commis de l'État ou encore ses sermons publics devant des directeurs de sociétés publiques « comme une façon d'appliquer la loi et de remettre les choses dans l'ordre », selon Boubaker, pêcheur à Radès, dans la banlieue sud de Tunis.
Pour Kamel Jendoubi, malgré le crédit dont bénéficie encore Kaïs Saïed dans certains milieux, « il faut attendre septembre pour voir si, avec les dépenses de la rentrée scolaire, les Tunisiens vont prêter attention à l'enjeu électoral et à ce qui se passe politiquement, car ce scrutin reste un enjeu très important pour l'avenir du pays », conclut-il. Pour beaucoup, la tentation du boycott reste très présente, « à cause du manque de crédibilité du processus mais surtout de l'absence d'alternative viable », ajoute la chercheuse tunisienne citée plus haut, qui attribue ce problème à plusieurs facteurs : « Le manque de charisme ou de propositions de programmes cohérents des autres candidats et aussi le vide politique qui n'a toujours pas été résorbé depuis le 25 juillet 2021. »
Notes
1- Raouf Ben Hédi, « Un strike du pouvoir élimine d'un coup dix candidats à la présidentielle », Business News, 6 août 2024.
2- « Tunisie : Des candidats potentiels à la présidence empêchés de se présenter », 20 août 2024, site de Human Rights Watch.

Rwanda-RD Congo. La guerre des récits

Alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, les régimes de Kinshasa et de Kigali se sont lancés dans une guerre de l'information qui fait la part belle aux mythes et aux intoxications. Le Rwanda peut compter sur son armée digitale sur les réseaux sociaux, et la RDC sur quelques influenceurs, à commencer par l'essayiste conspirationniste Charles Onana.
Tiré d'Afrique XXI.
Dans sa réflexion sur la photographie de guerre, Regarding the Pain of Others (Picador, 2003), la critique Susan Sontag écrit que les images d'atrocités ne provoquent pas nécessairement d'empathie. Elles peuvent susciter « un appel à la paix. Un cri de vengeance. Ou simplement une conscience étonnée, continuellement réalimentée par les informations photographiques, que des choses terribles se produisent ».
Le conflit en République démocratique du Congo (RDC) soulève une autre possibilité : que ces photos ne soient tout simplement jamais prises. Oui, il y a 7 millions de personnes déplacées par la violence – le troisième total le plus élevé au monde après le Soudan et la Syrie, selon l'ONU –, mais celle-ci est présentée comme trop complexe, avec des dizaines de groupes armés qui se battent pour une myriade de raisons, souvent très locales. Pour de nombreux Occidentaux, elle est également « trop africaine », trop périphérique par rapport aux intérêts des superpuissances. Cela conduit à des statistiques qui donnent à réfléchir : au cours de l'année écoulée, le quotidien états-unien The New York Times a publié 53 articles sur le Congo, contre 3 278 sur l'Ukraine. Le conflit dans ce pays d'Afrique centrale n'a pas fait l'objet d'un seul sujet sur la chaîne de télévision états-unienne Fox News.
Pour les personnes touchées par la violence, les images sont bien sûr gravées dans leur mémoire. Sontag, qui écrivait à la suite des attentats du 11 septembre 2001, craignait que les images de violence n'unissent pas, mais divisent au contraire ; qu'elles ne suscitent pas le dégoût de la guerre, mais un désir de vengeance. Les récits contradictoires autour du conflit congolais, instrumentalisés par les démagogues, illustrent son propos. Ces récits, souvent considérés comme de la propagande ou des conspirations diffusées par des personnes extérieures, façonnent la prise de décision et la violence sur le terrain.
« Nous sommes prêts à nous battre »
Du côté congolais, un raccourci populaire consiste à faire porter au Rwanda la responsabilité de la violence dans l'Est. Comme l'a récemment déclaré le président Félix Tshisekedi : « Une chose est responsable de cette situation, c'est l'agression rwandaise. » Lors de la campagne électorale de 2023, à l'issue de laquelle il a été réélu, il s'est lancé dans une diatribe en public : « Je veux m'adresser au président rwandais Paul Kagame, pour lui dire ceci : puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets qu'il finira comme Hitler. »
On retrouve des hyperboles similaires de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Le président Paul Kagame accuse son homologue de propager l'idéologie du génocide de 1994 contre les Tutsis (qui a fait 1 million de morts en trois mois) et affirme que le M23, un groupe armé composé majoritairement de Tutsis congolais, se bat simplement pour protéger sa communauté. Bien que Kagame ait nié soutenir le M23 (ce que confirment pourtant plusieurs enquêtes de l'ONU, dont celle-ci), il a également précisé qu'il n'avait besoin de personne pour lui donner la permission d'envoyer des troupes de l'autre côté de la frontière afin de protéger ses concitoyens contre les rebelles rwandais qui colportent l'idéologie du génocide. « Nous sommes prêts à nous battre, a-t-il déclaré à la presse, nous n'avons peur de rien. »
Il est facile de trouver des failles dans ces deux récits. Kagame ne peut être tenu pour responsable de tous les conflits qui se chevauchent et s'imbriquent chez son voisin, mais, d'un autre côté, il est malhonnête d'affirmer que les rebelles rwandais au Congo, parmi lesquels figurent des génocidaires en fuite qui ont constitué le gros des dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) en 2000, constituent encore une menace imminente pour le Rwanda. Et pourtant, ces récits fonctionnent parce qu'ils touchent des cordes sensibles.
Une guerre de perceptions
Ils trouvent un écho profond dans les deux pays car la guerre ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la conscience collective. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a accusé le Rwanda d'avoir des « ambitions expansionnistes » et de s'adonner au « pillage systématique » des ressources congolaises. Le chanteur Fally Ipupa, l'une des plus grandes stars de RDC, a déclaré qu'il ne se produirait plus au Rwanda. Le médecin congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a appelé les donateurs occidentaux à sanctionner le Rwanda. Dans un sondage réalisé en 2022, 77 % des Congolais interrogés estimaient que le Rwanda était responsable du conflit dans leur pays.
Quant au Rwanda, il est clair que le parti au pouvoir se sent injustement accusé. « Le Rwanda n'hésitera jamais et ne s'excusera jamais de protéger la sécurité de son peuple », a déclaré Paul Kagame. S'il est difficile d'évaluer l'opinion populaire dans un pays aussi autoritaire – et alors que le gouvernement diffuse souvent son point de vue par le biais d'une armée digitale sur les réseaux sociaux –, de nombreux Rwandais, notamment les plus âgés, craignent que les divisions ethniques du passé soient ravivées et que l'étincelle vienne de l'est de la RDC. Trente ans après le génocide, pas moins de 25 % de la population (1) – et davantage encore au sein des rescapés du génocide contre les Tutsis – souffre de troubles de stress post-traumatique (TSPT) (2).
Le ressentiment des Congolais à l'égard du Rwanda a des racines profondes. En 1994, lors du génocide contre les Tutsis du Rwanda, 1 million de réfugiés ont traversé la frontière pour se réfugier en RDC (à l'époque le Zaïre). Parmi eux se trouvaient des éléments de l'armée rwandaise vaincue par le Front patriotique rwandais (FPR), ainsi que des milices tristement célèbres, telles que les Interahamwe (constituées de civils), responsables des massacres pendant le génocide. Deux ans plus tard, en 1996, le nouveau gouvernement rwandais, dirigé par Paul Kagame (réélu pour un quatrième mandat le 15 juillet 2024 avec plus de 99 % des suffrages exprimés), a pris la tête d'une coalition de pays voisins qui, ensemble avec une coalition des rebelles congolais, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), a démantelé les camps de réfugiés et a fini par mettre un terme aux trente-deux années de règne de Mobutu Sese Seko.
Cette coalition a été suivie d'une série d'insurrections soutenues par le Rwanda : le RCD, le CNDP et, plus récemment, le M23. Chacune de ces rébellions s'est appuyée sur les communautés congolaises hutues et tutsies, et chacune d'entre elles s'est livrée à des violations des droits humains, souvent dans le but déclaré de défendre ces communautés. Des intérêts matériels réels contribuent à alimenter ces rébellions, comme l'exploitation des ressources minières, mais la violence a également été alimentée par des récits comportant une forte dose de démagogie et de révisionnisme historique.
Les thèses conspirationnistes de Charles Onana
L'un des protagonistes de ce révisionnisme est Charles Onana, un écrivain franco-camerounais prolifique. Grâce à sa petite maison d'édition, Duboiris, basée à Paris, il a publié vingt-six livres, au rythme de plus d'un par an pendant deux décennies. Malgré leur qualité disparate et leur rigueur douteuse, il a réussi à obtenir des soutiens importants. L'un de ses ouvrages, Ces tueurs tutsi au cœur de la tragédie congolaise (2009), a été préfacé par Cynthia McKinney, membre du Congrès américain. Un autre, Côte d'Ivoire : le coup d'État (2011), par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Son dernier livre, Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale (L'Artilleur, 2023), est présenté par l'ancien ministre français de la Défense de Jacques Chirac (1995-1997), Charles Millon.
La popularité d'Onana a augmenté en RDC ces dernières années en surfant sur la dernière offensive du M23 soutenue par le Rwanda, qui a débuté en novembre 2021. En mars 2024, il a été invité d'honneur par le gouvernement congolais, accueilli par une fanfare de la police et le déploiement d'une garde militaire lourdement armée, pour une série de conférences dans des universités publiques et au Parlement. On peut trouver son dernier livre partout à Kinshasa, sur les bureaux des parlementaires et dans des librairies pourtant peu achalandées. On peut aussi voir des affiches avec des agrandissements de la couverture de son livre dans certaines manifestations de Congolais de la diaspora.
Peu d'universitaires sérieux considèrent ce dernier livre comme un travail scientifique solide. Comme beaucoup de penseurs conspirationnistes, Onana fait passer des spéculations, des insinuations et des mensonges pour des conclusions scientifiques, avec des notes de bas de page élaborées et des références à des documents provenant des archives des gouvernements états-unien et français. Mais il est rare que ces sources étayent réellement ses affirmations.

Compte tenu de la complexité du conflit congolais, le plus grand atout rhétorique d'Onana est peut-être sa simplicité. Selon lui, la crise congolaise est orchestrée depuis le début par le gouvernement rwandais, qui est lui-même au service des États-Unis, des membres de l'élite française et des multinationales. Depuis 1990, lorsque le FPR de Kagame a lancé son offensive sur le Rwanda depuis l'Ouganda, « l'idée principale était d'installer à la tête du Rwanda un leader capable d'envahir le Congo-Zaïre et de s'emparer de ses richesses au profit des compagnies minières occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains dirigeants occidentaux », écrit-il. Résultat, selon lui : 10 millions de Congolais tués, un demi-million de femmes violées, des millions de tonnes de minerais pillées et 110 000 kilomètres carrés de forêts détruits. Des chiffres repris sans recul par le président congolais lui-même dans une interview accordée au quotidien français Le Monde en mars 2024 : « Au Congo, il y a eu 10 millions de morts », a-t-il affirmé (3).
Onana est dans la bonne moyenne, mais il manque de nuances et de rigueur. Plusieurs études de mortalité et analyses statistiques suggèrent que le nombre de décès dus aux conséquences humanitaires des conflits se chiffre en millions. Les meurtres directs sont probablement beaucoup moins nombreux, même s'ils se chiffrent en centaines de milliers. Il est également probable que des dizaines de milliers de femmes ont été violées par des groupes armés, bien que les données à cet égard soient rares.
Le génocide des Tutsis, une « supercherie »
Onana est un habitué de ce genre d'hyperboles et de déformations. Il a soutenu que « la théorie selon laquelle un régime hutu aurait planifié le “génocide” [sic] au Rwanda est l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle ». Sa version des événements au Rwanda a été contestée en France : il a été mis en examen en 2022 pour contestation publique de l'existence de crime contre l'humanité. En octobre 2019, sur la chaîne d'information LCI, l'auteur avait déclaré que, « entre 1990 et 1994, il n'y [avait] pas eu de génocide contre les Tutsis, ni contre quiconque ».
Ce sont ses écrits les plus récents qui étendent ces théories aux guerres en RDC. Voici la version condensée de son argumentation : le plan des rebelles du FPR de Kagame était depuis le début de pousser une grande partie de la population rwandaise à fuir au Congo, car cela lui fournirait – ainsi qu'à ses alliés états-uniens et aux industriels – une bonne excuse pour envahir le Zaïre, renverser Mobutu et piller les minéraux congolais.
Comme toute bonne conspiration, il est difficile de réfuter certains des éléments avancés, même si l'auteur n'apporte que peu de preuves. Il mélange des faits bien connus avec des demi-vérités et des mensonges. En 1994, quelque 1,3 million de réfugiés rwandais ont effectivement fui vers la RDC (beaucoup d'autres ont fui vers la Tanzanie). Mais cela faisait-il partie d'un complot visant à modifier la démographie rwandaise en faveur des Tutsis, et d'un stratagème visant à créer un prétexte pour envahir le Zaïre ? Malgré les documents qu'il cite, il manque de preuves. Et les éléments circonstanciels suggèrent le contraire : en 1996, lorsque la nouvelle armée rwandaise (contrôlée par Kagame) a envahi le Zaïre, la grande majorité des réfugiés sont rentrés chez eux, au Rwanda. Ceux de la Tanzanie voisine ont fini par le faire également. Si l'objectif était de modifier radicalement les proportions ethniques du Rwanda, cela n'a pas fonctionné.
L'aveuglement de Washington et le mythe d'un « Tutsiland »
Concernant le rôle des États-Unis, l'administration Clinton, qui culpabilisait d'avoir joué un rôle déterminant dans le retrait des Casques bleus pendant le génocide, s'est montrée compréhensive à l'égard du nouveau gouvernement du FPR. Elle a apporté un soutien humanitaire et a contribué à la mise en place d'une campagne visant à convaincre les réfugiés de rentrer chez eux, à la création d'un programme de déminage et, ce qui est le plus controversé, à la formation d'officiers rwandais à la contre-insurrection.
Cette politique était à courte vue. Le soutien au nouveau régime et l'empathie pour les traumatismes subis par la société rwandaise ont aveuglé la politique de Washington, l'amenant à fermer les yeux ou à ignorer les rapports faisant état des massacres commis par les nouvelles autorités rwandaises et le FPR à l'intérieur du pays et au Zaïre (renommé RDC en 1997). Les mots de l'attaché de défense états-unien en poste à l'époque à Kigali, le lieutenant-colonel Tom Odom, commentant un massacre de personnes déplacées à Kibeho, au Rwanda, en 1995, sont à ce titre révélateurs : « Les morts étaient tragiques… Par rapport aux 800 000 morts du génocide, les 2 500 morts n'étaient qu'un dos d'âne. » Néanmoins, les preuves démontrant un plan d'ensemble préconçu et soutenu par les États-Unis dans le but de piller les ressources congolaises, comme l'affirme Onana, sont faibles.
Dans la deuxième partie de son livre, l'ethnicité occupe une place prépondérante et troublante. Selon Onana, depuis les années 1980, Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni auraient l'intention de créer un « empire Tutsi-Hima » s'étendant de l'Ouganda au Rwanda, au Burundi et à la RDC. L'objectif de ce « Tutsiland », comme il l'appelle, serait de permettre aux puissances anglo-saxonnes d'exercer une influence sur l'ensemble de l'Afrique. Leurs tentacules seraient très étendues : « Un puissant lobby anglo-saxon travaille sur ce dossier depuis des années, avec des liens étroits au bureau du secrétaire général des Nations unies, dans d'autres agences de l'ONU, en Allemagne, au Congrès américain, en Grande-Bretagne et au bureau de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) [rebaptisée Union africaine en 2002, NDLR] », écrit l'auteur franco-camerounais.
Il laisse par ailleurs entendre que Kagame a utilisé des femmes pour gagner la confiance des chefs d'État du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et d'ailleurs. Les racines de ce stéréotype rappellent la propagande génocidaire : les femmes tutsies étaient souvent dépeintes comme une cinquième colonne, un ennemi intime, cherchant toujours à défendre leur « race » par des moyens détournés. On en trouve des exemples dans Kangura, la publication qui diffusait des messages de haine pendant la période précédant le génocide. Ainsi, une caricature de février 1994 suggère que Roméo Dallaire, général de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar), a choisi le camp du FPR parce que séduit par une femme tutsie...
« Ils sont tous pareils »
Des rappels de cette rhétorique restent omniprésents au Congo. En 2023, l'ancien ministre Justin Bitakwira, un allié du président congolais, a déclaré dans une interview : « Un Tutsi est un criminel né. Ils sont tous pareils. Quand on voit un Tutsi, on voit un criminel. Quand ils sont en position de faiblesse, ils peuvent dormir dans votre lit pendant six mois. Et lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils nient vous avoir jamais connu. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante. » Boketshu Wayambo, un influenceur populaire de la diaspora, a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il proclame : « Frères à Kinshasa, vous devriez cibler les Rwandais, tous les Tutsis qui sont à Kinshasa... Ils sont en train de transformer la terre de Dieu en un Tutsiland ! » Deux universitaires de la région ont dressé une liste de vingt-sept diffusions sur YouTube contenant un discours similaire et visionnées des centaines de milliers de fois (4).
Ironiquement, en dépit des références nationalistes invoquées par ces démagogues, ces obsessions ont une origine clairement coloniale. Les colons européens dans cette région, inspirés par les théories raciales en vogue aux États-Unis et en Europe à l'époque, étaient influencés par l'« hypothèse hamitique » – du nom biblique de Cham, qui déshonora son père, Noé, et fut maudit pour être le « serviteur des serviteurs » –, selon laquelle tout signe de sophistication dans l'architecture, la culture ou la politique africaines devait forcément être d'origine étrangère, apporté par les descendants des peuples du Moyen-Orient en Afrique.
En 1902, un prélat catholique français a déclaré à propos des Tutsis : « Leur apparence intelligente et délicate, leur amour de l'argent, leur capacité à s'adapter à toutes les situations semblent indiquer une origine sémitique. » (5) Un religieux belge décrivait quant à lui en 1948 les Hutus comme « le type le plus commun de Noirs, brachycéphales et prognathes, au goût et aux aptitudes agronomiques, sociables et joviaux [...] aux lèvres épaisses et au nez écrasé, mais si bons, si simples, si loyaux » (6).
Ces récits ont des impacts réels. Par exemple, Onana régurgite, dans un langage pseudo-scientifique, le mensonge selon lequel les Tutsis congolais de la province du Sud-Kivu, où ils sont appelés Banyamulenge, seraient des immigrés récents et n'auraient donc aucun droit à la citoyenneté – et donc à la terre – au Congo. Il affirme que toutes les guerres qui ont éclaté dans l'est de la RDC depuis la chute du président Mobutu ont été alimentées par les revendications « fallacieuses » des Banyamulenge.
Le croquemitaine dont le Rwanda avait besoin
Ce faisant, Onana laisse commodément de côté les nombreuses sources tirées d'histoires orales et de documents coloniaux qui montrent que cette communauté vit sur les hauts plateaux du Sud-Kivu depuis le XIXe siècle au moins, et probablement avant. Là encore, les confabulations d'Onana ne sont pas anodines : Martin Fayulu, un leader de l'opposition congolaise, a fait de la négation de l'identité banyamulenge un argument de campagne ; le député Muhindo Nzangi, qui est ensuite devenu ministre de l'Éducation, a fait des déclarations similaires en 2020 ; et les groupes armés de la province du Sud-Kivu appellent constamment à l'expulsion de tous les Banyamulenge du Congo.
Selon Charles Onana, les institutions congolaises ont été systématiquement infiltrées par des Tutsis. Dans un discours tenu à l'université de Kinshasa le 17 mars 2024, il a appelé le gouvernement à traquer et à extirper ces « traîtres ». Évoquant les nombreux rapports (de l'ONU notamment) selon lesquels l'armée congolaise est responsable d'abus généralisés dans le conflit en cours, il écrit : « Ce ne sont pas des [officiers] militaires congolais qui commettent les crimes mentionnés dans ces rapports, mais des mercenaires rwandais et burundais et des miliciens banyamulenge intégrés dans cette armée. Au sein des FARDC, ils font exactement ce qu'ils ont toujours fait en tant que miliciens ou mercenaires dans leurs “rébellions” respectives. » Inutile de dire que c'est absurde : il est largement prouvé que les soldats congolais issus d'autres communautés se sont également rendus coupables de nombreuses exactions.
Onana, de manière perverse, pourrait bien être le croquemitaine dont le Rwanda avait besoin. De leur côté, les dirigeants rwandais présentent leur propre histoire, également trompeuse, pour justifier leurs actions. Il n'y a pas d'exemple similaire à celui d'Onana pour diffuser leur version des événements. Le pouvoir de Kigali est organisé différemment, avec peu de place pour les voix indépendantes. C'est le gouvernement lui-même, par le biais de ses médias affiliés et de ses sympathisants en ligne, qui alimente les débats.
Le président Paul Kagame, arrivé au pouvoir en 2000 après avoir été vice-président et ministre de la Défense à partir de 1994, a établi un lien entre la situation actuelle en RDC et le génocide des Tutsis lors des 30e commémorations du génocide, en avril 2024. Soulignant le crescendo des discours de haine à l'encontre des membres congolais de la communauté tutsie, il a déclaré : « Les auteurs du génocide ne sont pas les seuls à avoir commis des actes de génocide. Les auteurs du génocide au Rwanda, qui ont fui en 1994, ont depuis lors collaboré avec les gouvernements de la RDC. Et ce qu'ils font aujourd'hui s'apparente à un génocide. » Son gouvernement affirme que les FDLR sont intégrées dans l'armée congolaise dans le but de retourner au Rwanda et de poursuivre leur projet génocidaire.
Prophétie autoréalisatrice
Onana est une cible privilégiée du gouvernement rwandais, en particulier de son armée numérique, hyperactive sur les réseaux sociaux. Kigali l'accuse de minimiser ou de nier le génocide de 1994 et d'attiser la haine contre la communauté tutsie. Un site lié au gouvernement qualifie son livre de « bible de la haine », un compte similaire sur X (ex-Twitter) dit qu'il est devenu « le totem de ces manifestations [anti-Rwanda], de Paris à Bruxelles, de Goma à Kinshasa » (voir ci-dessous).

Certaines parties du récit rwandais sont exactes. L'armée congolaise a une longue histoire de collaboration avec les FDLR, y compris au cours des dernières années. Et il ne fait aucun doute que la communauté tutsie congolaise souffre de discriminations et est persécutée. Le problème est que les autorités rwandaises se trompent de séquence : aucun de ces facteurs ne semble avoir provoqué leur soutien récent au M23. Au contraire, l'intervention militaire rwandaise a été une prophétie autoréalisatrice, aggravant le sentiment anti-Tutsis et relançant la collaboration entre l'armée congolaise et les FDLR.
Il est utile de remonter à janvier 2019, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Après son investiture, il a cherché à intensifier la collaboration avec le Rwanda. Il s'est rendu à Kigali et a déposé une gerbe au mémorial du génocide de Gisenyi, une première pour un dirigeant congolais. Kagame lui a rendu la pareille quelques mois plus tard en assistant aux funérailles du père de Tshisekedi à Kinshasa, sous les applaudissements de la foule dans le stade national. Le chef de l'État congolais a ensuite poursuivi la politique de son prédécesseur qui consistait à autoriser les troupes rwandaises à se déployer dans l'est de la RDC et à mener des opérations ciblées, souvent aux côtés des troupes congolaises, contre les rebelles rwandais. En septembre 2019, ils ont tué le chef des FDLR, le général Sylvestre Mudacumura. Quelques mois plus tard, ils ont éliminé Laurent Ndagijimana, le chef d'une faction dissidente des FDLR, le Conseil national pour le renouveau de la démocratie (CNRD).
Brève lune de miel
Cette collaboration militaire a duré jusqu'aux premiers mois de 2021. En juin de cette année-là, Tshisekedi a rendu visite à Kagame au Rwanda. Ils ont signé plusieurs accords, dont un qui donnait à une société proche du FPR le droit de raffiner l'or d'une importante société d'extraction aurifère de l'État congolais. En novembre 2021, Kagame a une nouvelle fois rencontré son homologue à Kinshasa – en marge d'une conférence sur la masculinité positive – où les deux hommes ont réaffirmé leur collaboration.

Pendant ce temps, la partie sud de la province du Nord-Kivu, où le M23 est apparu, était relativement calme. De nombreuses troupes congolaises s'étaient déplacées vers le nord, où elles se battaient contre des rebelles islamistes, les Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ADF, affiliées à l'État islamique en Afrique centrale). Avant le retour du M23 en novembre 2021, il y avait peu de signes d'une menace imminente de la part du gouvernement congolais ou des FDLR pour le Rwanda.
Une explication probable de ce qui a déclenché l'escalade réside dans les relations contrariées du Rwanda avec deux autres voisins. Mi-2021, Félix Tshisekedi a commencé à renforcer ses liens avec l'Ouganda, signant des accords de construction de routes et d'investissements. Puis, le 16 novembre 2021, un trio de kamikazes s'est fait exploser dans le centre de Kampala, la capitale ougandaise, tuant 4 personnes et en blessant 37. Le gouvernement ougandais a alors déployé plusieurs milliers de soldats en RDC pour mener des opérations conjointes contre l'ADF, tenue pour responsable de l'attentat. Cette projection de la puissance militaire et économique de l'Ouganda en RDC a été perçue comme une menace par les responsables de la sécurité du Rwanda.
Au même moment, le gouvernement burundais, qui avait (et a toujours) également des relations tendues avec le Rwanda, déployait son armée en RDC contre un groupe rebelle burundais basé sur son territoire. Le Rwanda s'est senti cerné par des forces hostiles et a réagi en déployant entre 3 000 et 4 000 soldats en RDC pour soutenir le M23.
D'immenses intérêts économiques en jeu
Les motifs sécuritaires et économiques sont difficiles à démêler. Le Rwanda, tout comme l'Ouganda et le Burundi, profite de l'instabilité en RDC. Même avant la crise du M23, il a tiré parti de la faiblesse de l'État pour projeter ses propres réseaux économiques dans l'arrière-pays congolais en soutenant les réseaux de trafiquants qui font passer de grandes quantités d'or, d'étain et de tungstène au Rwanda (7). Depuis 2016, l'or passé en contrebande depuis la RDC est la principale exportation de chacun de ces trois pays – certaines années, il a représenté jusqu'à la moitié de leurs exportations.
Un argument similaire peut être avancé en ce qui concerne la persécution des Tutsis congolais. Ce phénomène ne fait aucun doute. Pourtant, il n'y a pas eu de recrudescence du sentiment anti-Tutsis avant la réapparition du M23, en novembre 2021. Certes, quelque 80 000 Tutsis congolais vivent dans des camps de réfugiés au Rwanda, certains depuis près de trente ans. Et certes, le sentiment anti-Tutsis est instrumentalisé par les politiques congolais pour gagner en popularité et détourner l'attention des Congolais et ainsi éviter d'assumer leurs échecs socio-économiques. Mais il semble peu probable que cela ait été la principale motivation du Rwanda pour soutenir le M23 – dans toutes les réunions entre Tshisekedi et Kagame avant le réveil de la rébellion, dont la dernière date de mi-2021, il n'y a aucune trace publique de cette question.
Les protestations du Rwanda au sujet de la discrimination touchant les Tutsis ne correspondent pas non plus à la façon dont son gouvernement a traité les réfugiés tutsis congolais dans son propre pays. Par exemple, en 2018, la police a ouvert le feu sur une foule de réfugiés banyamulenge qui protestaient contre la réduction de leurs rations alimentaires, tuant au moins douze personnes. Le CNDP et le M23 ont aussi procédé à plusieurs reprises au recrutement forcé de civils tutsis, dont des enfants, dans des camps au Rwanda, ce qui a été documenté par plusieurs rapports (ici et là notamment) des enquêteurs de l'ONU.
Le rêve du « Grand Rwanda »
C'est plutôt en réponse à la rébellion du M23 que les persécutions contre la communauté tutsie ont augmenté en s'appuyant sur les mêmes arguments conspirationnistes qu'Onana cherche à crédibiliser et à infuser. En novembre 2023, dans la ville frontalière de Goma, une foule a lynché un soldat banyamulenge, qu'elle a accusé d'être un combattant du M23 en raison de ses traits physiques. Selon l'ONG Human Rights Watch, plusieurs Tutsis ont été tués dans des circonstances similaires, tandis que des dizaines de personnes ont été arrêtées en raison de leur identité ethnique. Le Rwanda a pu pointer du doigt ces cas de haine et d'extrémisme, arguant qu'il s'agissait là des véritables sources du conflit.
Enfin, certaines personnalités rwandaises influentes ont justifié l'intervention en RDC en évoquant un « Grand Rwanda » et en rappelant que le Rwanda a des prétentions historiques sur certaines parties de l'est de la RDC qui remontent au XIXe siècle. Il existe un précédent célèbre : alors que le Rwanda lançait sa première invasion du Zaïre, en 1996, le président de l'époque, Pasteur Bizimungu, avait montré à des diplomates la carte d'un Rwanda 50 % plus grand que ses frontières actuelles qui s'étendait à l'intérieur de la RDC. Des cartes similaires ont été montrées lors des itorero, des programmes d'éducation civique organisés dans tout le pays au cours desquels les participants ont été informés de l'âge d'or précolonial supposé du Rwanda. Kagame a repris ce thème dans un discours en 2023, en déclarant : « En ce qui concerne le M23 [...], vous devez savoir que les frontières tracées pendant la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée de côté, l'est du Congo et le sud-ouest de l'Ouganda. [...] C'est l'origine du problème. »
Même si les frontières du passé justifiaient une agression militaire (ce n'est pas le cas), la revendication du Rwanda sur l'est de la RDC est ténue. Comme l'ont souligné des historiens, les armées rwandaises n'ont occupé que brièvement des petites parties de cette région au XIXe siècle, sans jamais les contrôler totalement. Et si certains chefs locaux leur ont rendu hommage, ils étaient aussi souvent farouchement indépendants. Malheureusement, ces récits historiques renforcent également au Congo l'idée d'une volonté du gouvernement du Rwanda d'établir un « Tutsiland », fantasme colporté par Charles Onana et par d'autres.
Un discours séduisant
Malgré ses nombreuses inexactitudes, Onana a touché un point sensible. Fatigués des guerres sans fin et des interventions internationales, de nombreux Congolais – à en juger par les centaines de milliers de personnes qui ont vu ses vidéos sur YouTube – semblent être d'accord avec cette réécriture inversée des causes de la guerre. Si le Congo est dans cette situation désastreuse après vingt-huit années de conflits, c'est que quelqu'un a voulu qu'il en soit ainsi, se disent-ils. Cette logique du « cui bono » (« à qui profite le crime ? ») est séduisante. Les souffrances du Congo ont été si colossales qu'il est rassurant de penser qu'elles sont le résultat d'un complot mondial.
Il est vrai qu'en ce qui concerne le Rwanda et ses interventions répétées, la communauté internationale a été complice. Le Rwanda dépend encore largement de l'aide. Selon la Banque mondiale, le pays a reçu 1,25 milliard de dollars d'aide publique au développement en 2021, soit 74 % des dépenses du gouvernement central. Son logo « Visit Rwanda » figure sur les maillots des clubs de football d'Arsenal (Angleterre), du Bayern Munich (Allemagne) et du Paris Saint-Germain (France). En pleine offensive du M23 en 2022, des dirigeants du monde entier ont assisté au sommet bisannuel du Commonwealth accueilli par Kagame. Et, en 2023, plusieurs célébrités – dont le comédien Kevin Hart, l'acteur Idris Elba et le ministre britannique des Affaires étrangères Andrew Mitchell – ont été les invités d'honneur de la cérémonie gouvernementale de baptême des gorilles. Alors que les États-Unis, alliés traditionnels du Rwanda de Kagame, se montrent de plus en plus critiques à l'égard de son intervention en RDC, beaucoup d'autres pays continuent de souscrire à la thèse rwandaise selon laquelle il ne fait que se protéger et protéger la communauté tutsie, ou au moins détournent leur regard.
Mais il est difficile de trouver des preuves des conspirations plus vastes qu'Onana essaie de vendre. Si l'on met de côté les allégations d'empires tutsis, il y a la question plus crédible du profit des entreprises. Il ne fait aucun doute que beaucoup ont tiré parti des guerres congolaises, des marchands d'armes aux politiciens cyniques. Mais qu'en est-il des multinationales ?
Extractivisme et corruption
Lorsque le code minier a été rédigé, en 2002, avec le soutien de la Banque mondiale, sa logique était que la privatisation des ressources minérales – qui étaient toutes sous le contrôle de l'État sous Mobutu – conduirait à une plus grande prospérité. Pour ce faire, le code prévoyait de généreuses incitations fiscales pour que les étrangers investissent dans un environnement risqué. Au cours de la décennie suivante, les entreprises ont fini par s'emparer des concessions minières les plus lucratives, parfois dans des circonstances douteuses, des centaines de millions de dollars disparaissant au profit d'intermédiaires et de politiciens véreux.
Le Trésor public congolais en a aussi profité : son budget national en 2024 est au moins vingt fois plus élevé qu'il ne l'était en 2002. Et pourtant, le pays reste un lieu d'extraction de matières premières où la valeur ajoutée est faible, voire inexistante, et où de grandes quantités de capitaux s'envolent vers des paradis fiscaux offshore. Mais ces injustices sont liées à l'organisation plus large de l'économie mondiale et ne sont pas inhérentes à la RDC.

L'exploitation minière est à forte intensité de capital et nécessite une stabilité politique et des infrastructures de qualité. On voit donc mal comment cette guerre du M23 a pu favoriser le capital international. Par ailleurs, ce capital n'est pas intrinsèquement lié à la politique états-unienne : la plus grande société minière de la RDC est aujourd'hui Glencore PLC, dont le siège est en Suisse, et qui est cotée aux Bourses de Londres et de Johannesburg ; la plupart des autres grandes sociétés minières sont chinoises ; enfin, l'entrepreneur minier le plus important de la période postconflit est sans doute Dan Gertler, un milliardaire israélien qui a été sanctionné par le gouvernement états-unien pour corruption en RDC.
En outre, la quasi-totalité de ces grandes exploitations minières est située loin des zones de conflit. Là, des chaînes d'approvisionnement relient les mineurs à des négociants et à des centrales d'achat internationales basées dans le monde entier, qui expédient le minerai à l'étranger pour qu'il y soit raffiné. L'or, de loin le produit le plus précieux à l'heure actuelle, est acheminé vers les Émirats arabes unis via l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. L'étain est traité en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. De nombreux acteurs internationaux profitent donc du chaos qui règne en RDC. Cependant, une grande partie de ces profits est liée aux injustices systémiques de l'économie mondiale et non à une conspiration visant à aggraver le conflit sur place. L'apathie et le caractère exploiteur du système international, et non l'intention criminelle, sont probablement les principaux coupables.
Des visions qui alimentent les violences
Cet attentisme nous ramène aux comparaisons entre la RDC et d'autres grands cataclysmes de notre époque : Gaza, l'Ukraine, la Syrie. La crise de la RDC occupe une place médiatique et diplomatique marginale par rapport à ces conflits. Cette indifférence a permis aux relations personnelles – comme celles entre certains membres des institutions états-uniennes, françaises et britanniques et l'élite dirigeante du Rwanda – et à la culpabilité liée à l'inaction pendant le génocide de 1994 d'influencer les décisions politiques.
Les récits de certaines élites politiques de Kinshasa qui vendent une histoire unique, à savoir que le Rwanda est irrédentiste et impérial et cherche à tirer des bénéfices en faisant la guerre à son voisin, ont plusieurs conséquences néfastes : non seulement cette ligne de raisonnement peut attiser les stéréotypes ethniques et la persécution, mais elle permet aussi au gouvernement congolais de se dédouaner de ses propres manquements et de ses transgressions.
À Kigali, un scénario contradictoire, mais à bien des égards complémentaire, s'est aussi installé. Le Rwanda y est dépeint comme la victime incomprise et infortunée de militants occidentaux des droits humains en croisade et de responsables congolais aux intentions génocidaires. Le Rwanda nie officiellement être impliqué en RDC, mais affirme que s'il l'était, ce serait dans le cadre d'un combat noble pour se défendre et protéger les Tutsis congolais.
Ces deux visions qui se renforcent mutuellement alimentent la violence et empêchent de trouver des solutions à la crise persistante. Il y a aussi, bien sûr, des intérêts en jeu : les élites de la RDC et du Rwanda profitent énormément du conflit, tout comme les multinationales. Il est vrai aussi que les gouvernements d'Europe et des États-Unis ont joué un rôle important dans l'exacerbation de la crise. Pourtant, pour résoudre ces conflits, il faut s'intéresser à la manière dont ces discours sont racontés et légitimés, et aux raisons pour lesquelles ils séduisent les acteurs politiques ainsi qu'un public plus large dans la région et au-delà. Tant que Kinshasa pourra rejeter la responsabilité sur le « méchant Rwanda » et que Kigali pourra pointer du doigt les milices xénophobes en RDC, il sera difficile de trouver une solution durable au conflit.
Notes
1- Paul Nkubamugisha Mahoro, Prévalence de l'ESPT dans la population rwandaise. Diversités de figures cliniques et comorbidités, Thèse de doctorat. Université de Genève, 2015.
2- Musanabaganwa C, Jansen S, Fatumo S, Rutembesa E, Mutabaruka J, Gishoma D, Uwineza A, Kayiteshonga Y, Alachkar A, Wildman D, Uddin M, Mutesa L., « Burden of post-traumatic stress disorder in postgenocide Rwandan population following exposure to 1994 genocide against the Tutsi : A meta-analysis », J Affect Disord, octobre 2020.
3- Coralie Pierret, « Félix Tshisekedi, président de la RDC : “Le Rwanda n'est pas seul responsable des malheurs du Congo” », Le Monde Afrique, 30 mars 2024.
4- Felix Mukwiza Ndahinda, Aggée Shyaka Mugabe, « Streaming Hate : Exploring the Harm of Anti-Banyamulenge and Anti-Tutsi Hate Speech on Congolese Social Media », Journal of Genocide Research, mai 2022.
5- Cité par Gérard Prunier dans The Rwanda Crisis : History of a Genocide (1959–1994), Hurst & Co, 1995.
6- Cité par Jean-Pierre Chrétien dans L'Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d'histoire, Aubier, 2000.
7- Kigali a exporté 654 millions de dollars d'or en 2022 selon les derniers chiffres du FMI, et 176 millions de dollars d'étain et de tungstène, dont une grande partie provient probablement de l'est de la RDC.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












