Derniers articles

Immigration : comment l’Europe se durcit

De plus en plus de pays de l'Union n'hésitent pas à prendre des mesures toujours plus sécuritaires et répressives concernant les demandeurs d'asile. Offrant un boulevard idéologique aux théories de la submersion migratoire.
18 septembre 2024 | tiré de Politis.fr, hebdo no. 1828
https://www.politis.fr/articles/2024/09/analyse-immigration-comment-leurope-se-durcit/
Le grand basculement. Depuis des mois, les politiques migratoires des États membres de l'Union européenne (UE) se durcissent à la chaîne. Les revendications de l'extrême droite trouvent un écho sans précédent sur le Vieux Continent. Et si l'Europe cédait définitivement ?
Dernier exemple : l'Allemagne. À la fin du mois d'août, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a expulsé 28 ressortissants afghans vers Kaboul. Tous condamnés « pour des infractions pénales », ayant fait l'objet d'un ordre de retour et ne détenant pas de titre de séjour, selon les mots du porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit. C'est une première depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, il y a trois ans.
Le gouvernement allemand tente de faire un mimétisme avec les positions d'extrême droite.
M. Satouri
Plus récemment, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a annoncé, le 9 septembre, le retour temporaire des contrôles aux frontières intérieures pour lutter contre l'immigration illégale. Une décision prise deux semaines après l'attentat terroriste qui a fait trois morts et huit blessés à Solingen, le 23 août, quelques jours seulement après la percée de l'extrême droite lors des dernières élections régionales. Dans le Land de Thuringe, l'extrême droite de l'AfD est arrivée en tête avec 32,8 % des voix.
Dans le Land de Saxe, l'AfD (30,6 %) talonne la CDU (31,9 %). Sous la pression des conservateurs, de l'extrême droite et du récent parti de gauche, le BSW, fermement opposé à l'immigration qu'il juge « incontrôlée », Olaf Scholz a abdiqué. « Au lieu de tenir sur les valeurs et le respect du droit humanitaire, le gouvernement allemand tente de faire un mimétisme avec les positions d'extrême droite pour envoyer des messages aux électeurs », considère Mounir Satouri, eurodéputé écologiste et président de la sous-commission consacrée aux droits de l'homme à Bruxelles.
Un durcissement d'autant plus remarquable que l'Allemagne tenait le rôle de bon élève européen dans l'accueil des exilés. « En comparaison de la France ou, encore pire, du Royaume-Uni, l'Allemagne a été extraordinairement généreuse, rappelle François Héran, sociologue et titulaire de la chaire Migrations et sociétés au Collège de France, chiffres à l'appui. 53 % des Syriens qui ont demandé une protection en Europe l'ont fait en Allemagne. Contre 3 % seulement en France ! »
L'Allemagne semble donc désormais suivre le chemin tracé par le Danemark, où les socialistes au pouvoir assument depuis longtemps une politique migratoire très restrictive. « Les socialistes du Danemark donnent des gages à l'extrême droite car ils estiment que leur voisin, l'Allemagne, peut s'occuper de l'accueil à leur place », selon François Héran.
Surenchère sécuritaire
Ce basculement allemand est donc une nouvelle pierre dans une longue série de renoncements humanistes depuis 2015. « En Europe, l'extrême droite s'est bâtie sur une idée : la lutte contre l'immigration, avec un discours simpliste, et faux, qui associe l'immigration à l'insécurité, souligne Marie-Laure Basilien Gainche, professeure de droit public à l'université Jean-Moulin Lyon-III, spécialiste de la question migratoire en Europe. Et les échiquiers politiques ont endossé ce discours. Mais, en voulant contrer l'extrême droite sur son terrain, ce discours a été légitimé. Au détriment des personnes les plus vulnérables. »
Une dérive qu'a observée Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste de 2009 à 2024, ex-vice-présidente du Parlement européen et aujourd'hui présidente de l'association Forum réfugiés : « Une politique migratoire bascule parce que des forces politiques de droite et d'extrême droite, une fois au pouvoir, durcissent la ligne. Mais aussi parce que les autres gouvernements paniquent sous la pression de l'extrême droite. »
À partir de 2015, on a assisté à un tournant sécuritaire, et répressif .
M-L. Basilien Gainche
De la recherche d'un équilibre entre lutte contre l'immigration irrégulière et protection des demandeurs d'asile, la politique du Vieux Continent a, au fil des ans, jeté aux oubliettes l'un des deux objectifs. « À partir de 2015, on a assisté à un tournant sécuritaire, et répressif », note Marie-Laure Basilien Gainche, qui cite par exemple la création de « hot spots » en Grèce et en Italie, ou les accords avec des pays noneuropéens (Libye, Afghanistan, etc.) pour retenir les réfugiés hors de l'espace européen et les empêcher de partir.
Le parachèvement de cette radicalisation pourrait être le pacte asile et migration voté le 10 avril au Parlement européen. Un paquet de dix règlements et de trois recommandations qui ouvre la voie à un filtrage encore plus important des migrants aux entrées de l'Europe, à des contrôles renforcés et à la création de centres de rétention aux frontières. « L'Europe n'a jamais réussi à imposer une répartition égale de la charge. Les règlements de Dublin sont une manière, pour beaucoup de pays, d'éloigner ce “fardeau”. Mais ce pacte ne remet pas en cause ces règlements », regrette François Héran.
En outre, ce pacte a été voté alors que Frontex, l'agence de l'UE chargée du contrôle de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen, estime que les entrées irrégulières dans l'UE ont chuté de 39 % depuis début 2024.
Jordan Bardella a soutenu que ce pacte allait permettre une invasion migratoire, alors même qu'il instaure un régime de contrôles des frontières incroyablement strict.
M-L. Basilien
« Ce paquet acte le fait que l'Europe est prête à un certain nombre de compromissions sur le respect du droit humain », juge David Cormand, eurodéputé vert. « Ces mesures ne mènent pas vers plus de solidarité entre Européens, plus d'humanité par rapport à ce que subissent les migrants en Méditerranée et dans la Manche, plus d'efficacité dans les politiques qui peuvent prévenir le recours à la migration des populations principalement africaines, renchérit Mounir Satouri. On est juste dans la surenchère sécuritaire pour essayer d'endiguer la montée de l'extrême droite en Europe. »
Et la fuite en avant n'a pas de fin. « On a voté le pacte asile et migration à la toute fin du mandat du Parlement européen. Mais il n'était même pas transposé que, déjà, un certain nombre d'États membres, sans surprise, contestaient la possibilité que ce pacte soit suffisant », dénonce Sylvie Guillaume. « Jordan Bardella a soutenu que ce pacte allait permettre une invasion migratoire, alors même qu'il instaure un régime de contrôles des frontières incroyablement strict, souffle Marie-Laure Basilien Gainche. L'extrême droite a vu ses desiderata intégrés pour l'essentiel dans le pacte, ce qui l'a conduite à faire de la surenchère. »
Droits humains bafoués
Trois semaines avant les élections européennes, quinze États membres ont adressé à la Commission européenne une lettre demandant à l'UE « d'identifier, d'élaborer et de proposer de nouveaux moyens et de nouvelles solutions pour prévenir l'immigration irrégulière vers l'Europe ». La lettre est signée par la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Estonie, la Grèce, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne et la Roumanie. Leur liste de courses est longue. S'inspirant de l'accord entre l'Italie et l'Albanie, ils souhaitent que l'Europe imagine des mécanismes permettant « d'intercepter et, en cas de détresse, de secourir des migrants en haute mer et de les emmener dans un lieu sûr d'un pays partenaire hors de l'UE ».
L'extrême droite européenne dit la même chose : l'UE a des normes de protection des droits humains qui seraient trop importantes.
D. Cormand
Mais ils demandent également une « réévaluation » du concept de « pays tiers sûr » dans la loi européenne sur l'asile. Ils veulent aussi multiplier les accords avec les pays tiers situés le long des routes migratoires, afin d'y transférer les migrants dont la demande d'asile a été rejetée, en attendant qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine. Comme le partenariat conclu entre l'UE et la Turquie en 2016 et avec la Tunisie en 2023.
« Endiguer l'immigration à la source, c'est faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de traverser pour leur survie. Endiguer l'immigration, c'est arrêter de ‘contractualiser' avec les dictateurs qui maltraitent leur population. Jamais les candidats tunisiens à l'immigration n'ont été aussi nombreux depuis que le régime autoritaire de Kaïs Saïed s'est mis en place. Doit-on vraiment croire que la solution à l'immigration s'appelle Kaïs Saïed ? C'est ahurissant. Toute la politique de coopération de l'UE est à revoir », cingle l'écologiste Mounir Satouri. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, ne semble pas aller dans ce sens. Le 18 juillet, elle a plutôt promis de renforcer Frontex et de tripler le nombre de garde-frontières et de garde-côtes européens.
Le 6 septembre en Hongrie, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, Bence Retvari, a tenu une conférence de presse devant une rangée de bus à Roske, une ville proche de la frontière avec la Serbie. Le ministre de Viktor Orban a dénoncé l'amende de 200 millions d'euros infligée le 13 juin par la Cour de justice de l'UE pour non-respect d'un droit d'asile effectif.
Et il a menacé l'Europe d'envoyer des bus de migrants à Bruxelles : « Si Bruxelles veut des migrants, elle peut les avoir ! » « Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Viktor Orban… L'extrême droite européenne dit la même chose : l'UE a des normes de protection des droits humains qui seraient trop importantes. Donc il faudrait remettre en question la charte des droits fondamentaux », analyse David Cormand.
Sur le même sujet : « Nous sommes voués à élargir notre vision de l'identité française »
Rien ne semble pouvoir freiner la course sécuritaire. Dans un jeu politique néfaste, les sociaux-libéraux d'hier n'hésitent plus à prendre des mesures toujours plus répressives à l'égard des exilés. Une stratégie politique dont l'efficacité interroge toujours plus, alors que les extrêmes droites continuent de progresser partout, ou presque, sur le Vieux Continent.
ZOOM : La France au diapason de l'extrême droite
Avec la nomination de Michel Barnier à Matignon grâce à l'assentiment du Rassemblement national (RN), le prochain gouvernement pourrait durcir une nouvelle fois la politique migratoire du pays. Neuf mois seulement après la très dure loi immigration qui limite le droit du sol et durcit l'accès aux prestations sociales pour les étrangers.
Car en 2021, alors candidat à la primaire de la droite, Michel Barnier défendait un « moratoire » de trois à cinq ans, adossé à un « bouclier institutionnel » et à un référendum sur le sujet migratoire, permettant à la France de freiner les régularisations et le regroupement familial sans être condamnée par l'UE. Selon François Héran, dans une tribune publiée dans Le Monde, Barnier a « succombé à la surenchère qui a jeté LR aux portes du Rassemblement national (1) ».
Il y a trois ans, Michel Barnier ne s'empêchait pas non plus d'établir un lien entre flux migratoires et terrorisme, plaidait pour la diminution du nombre d'étudiants étrangers et proposait d'ouvrir de nouvelles négociations en Europe pour lutter contre les frontières européennes qui étaient, selon lui, des « passoires ».
Lors des négociations pour la composition du gouvernement, l'idée du retour d'un ministère de l'Immigration a surgi, comme en 2007 sous Nicolas Sarkozy. Une rumeur démentie par Matignon. Après son rendez-vous avec le nouveau premier ministre, le 6 septembre, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs républicains, lâche : « Sur l'immigration, j'ai senti que Michel Barnier voulait aller le plus loin possible. » Ça promet.
(1) Le 14 septembre 2024.
En France, la nomination de Michel Barnier (lire encadré ci-dessus) s'inscrit dans cette droite ligne. Que fera-t-il demain sur la question migratoire, alors que son gouvernement repose uniquement sur l'assentiment du Rassemblement national ? Dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde, François Héran alerte sur les risques d'une énième surenchère. « À ce jeu, c'est toujours l'extrême droite qui gagne. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Portugal dans les flammes du néolibéralisme

Une centaine d'incendies simultanés dans le nord et le centre du pays et des pompiers dépassés : pour les Portugais, l'été indien a tourné à l'enfer. Parmi les premiers exposés aux effets du changement climatique, les « bons élèves de l'Europe », qui ont déjà presque tout perdu avec le plan de sauvetage de la troïka, craignent désormais de voir leur logement partir en fumée.
19 septembre 2024 | tiré d'aoc media
https://aoc.media/opinion/2024/09/18/le-portugal-dans-les-flammes-du-neoliberalisme/?loggedin=true
Leurs maisons brûlent et nous regardons ailleurs. Je vous écris sous le nuage de cendres qui depuis plusieurs jours voile le soleil du Portugal – certains ont même ressorti les vieux masques de la pandémie. De cette brume funeste a ressurgi le spectre de juin 2017 : plus de soixante morts et 500 000 hectares dévastés.
Le mois dernier encore, les autorités se félicitaient pourtant d'avoir réduit de plus de moitié le nombre d'incendies ruraux grâce à une campagne de sensibilisation via les médias et une opération porte-à-porte réalisée par les agents de la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana), l'équivalent de notre gendarmerie. Le message ? On ne peut plus clair : « Le Portugal fait appel à vous », illustration magistrale de la sanctification de l'individualisme libéral comme philosophie du vivre-ensemble.
Comme chaque année lorsque les forêts s'embrasent, sur les plateaux des chaînes de télévision on tourne en boucle les mêmes interrogations – actes criminels ou erreurs humaines ? faute de moyens ou erreur de stratégie ? – tout en se félicitant de la solidarité européenne, qui s'est manifestée par l'envoi de huit Canadairs. A sério ? Certes, en remerciement des efforts colossaux effectués durant la récession de 2011, le Portugal voit aujourd'hui le robinet des crédits communautaires couler à gros débit. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que l'ancien Premier ministre António Costa rejoindra Bruxelles en décembre prochain pour succéder à Charles Michel à la présidence du Conseil européen : « Le pays réunit aujourd'hui les conditions financières pour réaliser de grands projets favorisant la compétitivité externe. » Comme, par exemple, la réalisation d'ici à 2031 d'une ligne TGV reliant Lisbonne à Porto. Mais qui montera dans ce train de la modernité ?
Le client des chemins de fer portugais, qui doit actuellement débourser une soixantaine d'euros pour un aller-retour en seconde classe sur cette ligne, a en effet d'autres préoccupations que celle de filer comme l'éclair du Tage au Douro. Car depuis que la troïka (Fonds monétaire international, Commission européenne et Banque centrale européenne) a visité la Lusitanie, les Portugais ont pour nombre d'entre eux de très faibles revenus.
Il y a d'un côté les chiffres toujours encourageants de l'OCDE et de l'autre la réalité salariale moyenne, que l'Institut national de la statistique (Instituto Nacional de Estatistica, INE) situe autour de 1 500 euros bruts par mois. Le salaire minimum portugais, bien que revalorisé à 820 euros en 2024, affiche l'un des pouvoirs d'achat les plus faibles du continent, en deçà du polonais. Le Portugal se situe même en queue du peloton européen en ce qui concerne la parité de pouvoir d'achat entre les personnes percevant le salaire minimum national. Également réévalué cette année, le minimum vieillesse atteint désormais royalement 319,49 euros. L'INE a calculé qu'en 1974, au sortir des années noires du salazarisme, il était de 260 euros (source : Eurostat).
C'est ainsi que des livreurs passent quinze heures sur la route six jours sur sept, que des chauffeurs Uber vous conduisant de nuit à l'aéroport vous expliquent qu'ils ont un autre job en journée, qu'un serveur vous annonce fièrement qu'il est derrière son comptoir depuis plus de cinquante ans et que des retraités de la fonction publique, incapables de survivre avec leur pension de 500 euros, se voient obligés de reprendre un travail. Près de deux millions de personnes vivraient actuellement sous le seuil de pauvreté, soit un cinquième de la population. Et tout ça, ça fait d'excellents Portugais, souvent cités comme les « bons élèves de l'Europe ».
Le Portugal est-il le synopsis du scénario néolibéral qui nous attend tous ? On n'a pas conscience à Bruxelles du sacrifice consenti. Sans doute parce que la mortification ne saute pas immédiatement aux yeux du touriste. Depuis la dictature, les gens d'ici ont développé une capacité à encaisser assez phénoménale et un sens de l'entraide peu commun.
Le nouvel Eldorado a peut-être des finances saines, mais, en attendant, le citoyen maigrement rémunéré doit en outre faire face à de lourdes charges. Si l'inflation a été ramenée officiellement à moins de 2 % le mois dernier, les prix du logement et de l'énergie ont au cours de la dernière décennie flambé comme des eucalyptus. C'est qu'en contrepartie des soixante-dix-huit milliards d'aides reçus en 2011, le Portugal a dû privatiser des pans entiers de son économie, dont précisément le secteur l'énergie. Le groupe chinois China Three Gorges a ainsi repris les 21 % détenus par l'État portugais dans Énergies du Portugal (Energias de Portugal, EDP), la principale entreprise de production d'électricité du pays. Essayez dans ces conditions d'exercer la moindre régulation.
Depuis l'Exposition universelle de Lisbonne en 2018 et l'organisation de l'Euro de football en 2004, le Portugal s'est couvert d'autoroutes à péages roulantes comme des billards, d'aéroports rutilants, de stades cinq étoiles et de centres commerciaux à l'américaine. Revers de la médaille : il a abandonné ses services publics. Après les incendies meurtriers de juin 2017, un rapport parlementaire pointait déjà la formation insuffisante des pompiers, en majorité volontaires (le Portugal compte moins de quatorze mille pompiers professionnels), un manque de moyens (seulement 0,3 % du budget consacré à la protection contre les incendies) et l'incapacité des gouvernements successifs à développer une politique concertée. Depuis, choix a donc été fait de responsabiliser les individus, en mode numéro vert pour réponse à tout.
Le projet Barroso Lithium prévoit un forage jusqu'à 1 700 mètres de profondeur sur une surface de 593 hectares […]. La pire méthode d'extraction qui soit, équivalente à celle du gaz de schiste, avec sa cohorte de dégâts collatéraux.
On aurait pourtant imaginé la réforme forestière grande cause nationale alors que le réchauffement climatique ne fait qu'aggraver la situation. « Sans un gouvernement qui assume l'importance de cette priorité, nous continuerons à être un pays fragile, à la merci d'un coup de vent qui réveille à nouveau l'enfer », écrit David Pontes, le directeur du journal Público, dans son éditorial du 17 septembre. Mais depuis deux ans, le Portugal a un autre chat à fouetter : le lithium. Selon un rapport de l'Institut d'études géologiques des États-Unis paru en 2023, le pays détiendrait les premières réserves européennes du nouvel or blanc et les huitièmes au monde. Durant la fin de son mandat, António Costa n'a cessé de répéter que le pays était assis sur un trésor. « La réalité c'est qu'il n'en sait pas plus que vous et moi car il s'agit de ressources déduites, coupe court Carlos Leal Gomes, professeur à l'Université du Minho et spécialiste du sujet. Cinquième, sixième, huitième place, pour l'heure on n'a rien du tout. On ne connaîtra ce rang que lorsqu'on commencera à produire. »
Peu importe, le coup est parti. Concession a été accordée au groupe britannique Savannah Resources Plc pour creuser en six endroits du pays, notamment dans la serra do Barroso, à l'extrême nord du Portugal, qui figure parmi les huit territoires européens classés à ce jour au Patrimoine agricole mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le projet Barroso Lithium prévoit un forage jusqu'à 1 700 mètres de profondeur sur une surface de 593 hectares et un cratère à ciel ouvert de 800 mètres de diamètre, à moins de 200 mètres des premières habitations. La pire méthode d'extraction qui soit, équivalente à celle du gaz de schiste, avec sa cohorte de dégâts collatéraux. L'extraordinaire forêt de pins qui avait réussi le prodige de se régénérer après un gigantesque incendie va encore être sacrifiée, mais délibérément cette fois. Sans compter qu'il va falloir laver ces minerais avant de les expédier, à raison d'un million de litres par tonne.
Cela tombe bien, la Communauté intermunicipale du Alto Tâmega, dont fait partie le Barroso, est l'abreuvoir du nord du Portugal. L'eau y est partout, en abondance, à tel point qu'on l'entend en continu chanter son fado. L'Office du tourisme en a d'ailleurs fait sa marque : « Le territoire de l'eau et du bien-être. » Mais l'éventration de la montagne va, bien sûr, venir perturber ce bel équilibre immémorial. Les plus anciens de la région se souviennent que l'exploitation durant la Seconde Guerre mondiale de la wolframite, minerai contenant du tungstène, métal utile à la fabrication d'armement, faillit déjà condamner la race bovine barrosã, dont le patrimoine génétique s'inscrit dans la nuit des temps. Dans l'objectif de moins polluer avec des véhicules électriques on va donc détruire tout un environnement. Comme toujours, l'oligarchie aux manettes préfère faire du profit en prétendant guérir que prévenir en s'attaquant à la cause du mal.
Dans ce contexte brûlant, les pompiers de service de l'extrême droite n'ont pas manqué de faire leur réapparition dans le foyer politique, pour la première fois depuis la révolution des Œillets et la chute de l'État nouveau (Estado Novo) en 1974. Fondé en 2019, le parti Chega [qui signifie Assez, ndlr], dirigé par André Ventura, est arrivé en troisième position aux élections législatives de mars dernier, avec 18 % des suffrages : un véritable choc dans ce pays brisé durant quarante-cinq ans. Oui, il y a le feu.
Nicolas Guillon
Journaliste
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grande-Bretagne - Les fascistes bloqués par l’action de masse

La grande manifestation antifasciste qui s'est déroulée le 7 août à Walthamstow face aux agressions d'extrême droite survenues en Grande-Bretagne a révélé autant les capacités de résistances de la population que la passivité des organisations traditionnelles, en particulier du Parti travailliste.
Tiré de Inprecor 724 septembre 2024
22 septembre 2024
Par Dave Kellaway
À Walthamstow, en sortant du train aérien de Hackney à Hoe Street, il était évident que la manifestation contre l'extrême droite allait connaître une énorme participation. Les wagons étaient déjà remplis d'une foule de la même ampleur que celles que l'on avait vues lors de nombreuses marches de solidarité avec la Palestine.
Des jeunes, d'origines ethniques variées, mêlé·es à des vieux et vieilles militant·es de gauche aisément reconnaissables, méprisaient les conseils « officiels » dispensés par la police, les responsables locaux des mosquées, les députés locaux et, plus généralement, le Parti travailliste, qui leur conseillaient de rester à l'écart. Laissons cela à Sir Keir et à son fantastique gouvernement reconnu d'utilité publique. Des peines sévères, de nouvelles escouades de police anti-émeutes et des dénonciations des violences aveugles suffisaient à régler la situation – circulez, il n'y a rien à voir.
Une mobilisation antiraciste de masse
Dès que l'on sortait du train et que l'on voyait le bout de la rue principale, les gens marchaient de front à trois ou quatre sur les trottoirs. À sept heures et quart, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes dehors pour défendre les immigrés que les fascistes avaient promis d'attaquer. À sept heures trente, on ne pouvait plus voir la fin de la manifestation qui occupait toute la rue. Quelqu'un a repéré l'agitateur d'extrême droite Calvin Robinson accompagné de quelques sympathisants, mais il est devenu rapidement évident que la droite ne pouvait pas assurer une présence réelle.
Des groupes de gauche comme le Parti socialiste (SP), le Parti socialiste des travailleurs (SWP), le Parti communiste révolutionnaire et AntiCapitalist Resistance y ont participé avec leurs banderoles. Certain·es manifestant·es portaient des pancartes, mais la grande majorité n'étaient pas membres ni même sympathisants des organisations, mais des Londonien·es consterné·es par ce que les fascistes avaient fait la semaine précédente. Des groupes sont venus depuis le sud de Londres ou des quartiers voisins. Il y avait aussi beaucoup de gens issus des communautés ethniques locales.
Des pancartes en carton faites maison avec des slogans originaux étaient brandies, un signe qu'il s'agit d'une véritable mobilisation de masse et pas simplement d'une manifestation de la gauche radicale. Stand Up to Racism (Dresse-toi contre le racisme) avait travaillé dur pour aider à coordonner les protestations. Il y avait quelques banderoles de sections syndicales locales. Au niveau national, en contraste complet avec le Parti travailliste, quelques dirigeants syndicaux avaient lancé des appels à venir et à soutenir les manifestations antifascistes.
La passivité des partis institutionnels
Les gens chantaient « Bienvenue aux réfugiés », « Quelles rues ? Nos rues ! », « Nous sommes le peuple », « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». Personne ne scandait « Non aux violences aveugles », « des peines plus fortes maintenant » ou « plus d'escadrons de police anti-émeute ».
Starmer, avec du retard, a finalement ajouté « d'extrême droite » à l'expression « violences », au moment des manifestations. Mais à aucun moment le Parti travailliste n'a lancé d'appels pour que les gens manifestent contre les fascistes. Il n'a pas non plus prononcé le moindre mot en défense des réfugié·es ou des migrant·es, dont tout le monde peut pourtant voir qu'ils sont la cible principale des fascistes.
Aucun porte-parole du Parti travailliste n'a dit la vérité sur ce que faisaient les fascistes à Rotherham, Tamworth et ailleurs. C'étaient des pogromes fascistes contre les migrant·es, les demandeurs et demandeuses d'asile, les musulman·es et les Noir·es. Ce n'étaient pas, comme l'ont présenté de nombreux médias, des « protestations contre les immigrés », comme s'ils brandissaient des pancartes ou distribuaient des tracts. Non, ils étaient sortis pour mettre le feu à des hôtels pour réfugié·es, pour blesser et tuer des gens. Des blocages routiers improvisés vérifiaient les voitures pour voir s'il y avait des Blancs ou des Noirs à l'intérieur. Sur les réseaux sociaux, des publications appelaient ouvertement à cette violence.
La complicité de nos dirigeants
Aussi bien les Conservateurs que les Travaillistes ont échoué à contester le récit des fascistes sur les immigré·es et les demandeurs et demandeuses d'asile. Ils disent qu'il faut arrêter les bateaux, ils disent qu'il y a trop d'immigré·es et soutiennent les racistes locaux qui veulent fermer les hôtels qui sont « financés par le contribuable ». Le Parti travailliste est terrifié par le fait que l'on puisse le considérer comme trop conciliant avec les immigré·es. Au lieu d'assurer des voies d'accès sûres et légales aux demandeurs d'asile ou de reconnaître que les travailleurs/ses immigré·es sont essentiel·es aux services publics et à l'économie, le Parti travailliste parle de nouveaux escadrons anti-terroristes pour arrêter les bateaux et il s'engage à réduire le nombre d'immigré·es.
Lors des récentes élections, toute la stratégie du Parti travailliste a consisté à essayer de gagner des électeurs conservateurs, notamment dans les circonscriptions du Mur rouge où se sont produites certaines des pires violences fascistes. Plutôt que de contester les préjugés et de déployer une grande campagne basée sur la réalité des faits concernant les migrant·es, ils se sont adaptés aux opinions réactionnaires. Oui, ils ont largement remporté les élections, mais Reform UK, le mouvement d'extrême droite de Nigel Farage, a gagné 4 millions de suffrages et nous faisons maintenant face à une nouvelle dynamique des bandes fascistes dans les rues.
La nuit du 7 août donne quelques espoirs. On pouvait ressentir l'euphorie et la confiance de la foule qui percevait vraiment la possibilité de reprendre la rue. Sur le plan national, les fascistes ont échoué à poursuivre les violences de la semaine précédente, ce qui souligne leurs limites organisationnelles. Bien qu'ils soient capables de rassembler 15 000 personnes à Trafalgar Square pour une manifestation ponctuelle, ils sont incapables d'organiser et de coordonner des actions dans 40 villes différentes.
L'extrême droite est massivement issue de couches atomisées de la société, parfois radicalisées par le complotisme de type « alt-right » ou QAnon, qui inculque le racisme et une bataille idéologique sur les supposés dangers des vaccins, de l'immigration et des transgenres. Elles mènent une campagne sur les réseaux sociaux, mais aussi par le biais des médias classiques, par des politiciens opportunistes et des journalistes qui accordent du crédit à ces préjugés pour construire leurs carrières.
Les enquêtes judiciaires ont démontré que beaucoup d'entre eux sont des petits entrepreneurs, bien plus que des représentant·es d'une anxiété imaginaire de la classe ouvrière face à l'érosion de vagues abstractions nationalistes. Comme c'était le cas le 6 janvier lors de l'attaque du Capitole aux États-Unis, ceux qui ont participé étaient des gens privilégiés mais précaires, perméables aux discours de division des puissants, parce qu'ils entrent en écho avec leurs existences aliénées. Mais, presque aussi inquiétants que ceux qui sont venus pour terroriser des personnes vulnérables, bien d'autres se contentent de répéter sans esprit critique des idées racistes et fanatiques.
La peur change de camp
Face à un mouvement de masse antifasciste bien organisé, les faiblesses de ces formations ont été heureusement mises en lumière. Des milliers de personnes se sont également rassemblées un jour de semaine, le soir, dans un délai relativement court, dans les villes de Newcastle, Birmingham, Bristol, Liverpool, Finchley, Oxford, Sheffield et Brighton. Les médias et les politiciens ont exagéré le rôle des réseaux sociaux afin de minimiser la manière dont le discours anti-immigré·es et l'austérité avaient aidé les fascistes. Les réseaux sociaux se placent dans un contexte social beaucoup plus large, et jouent un rôle contradictoire : beaucoup de gens ont été informés des manifestations progressistes à travers les réseaux sociaux aussi bien que grâce aux efforts des organisations antiracistes traditionnelles.
Ce matin du 8 août, en regardant les matinales des différentes chaînes de télévision, on pouvait constater que la mobilisation victorieuse avait de nouveaux partisans… Les médias et la caste politique avaient dit aux gens de ne pas participer aux manifestations, mais toutes les Unes de la presse, y compris les très réactionnaires Daily Mail et Daily Express, qui publient souvent des histoires anti-immigré·es, exultaient sur la manière dont la population s'était débrouillées pour faire reculer la violence fasciste.
Durant la matinale de la BBC, au moins un ancien chef de la police a eu la bonne grâce et l'honnêteté de reconnaître que la mobilisation de masse avait été le facteur décisif, et pas les capacités de la police ou la dissuasion par le biais des peines sévères. La députée locale de Walthamstow, Stella Creasy, qui jusque-là avait demandé aux gens de ne pas participer aux manifestations a, par la suite, hypocritement, félicité la mobilisation.
Nos ressources pour construire un mouvement antifasciste
Ce qui n'est pas dit publiquement est une réalité importante. Des courants qui sont à l'extérieur du Parti travailliste ont une certaine capacité à mobiliser des milliers de personnes de manière indépendante. On l'a vu avec le mouvement de solidarité avec la Palestine ; on le voit aujourd'hui avec le mouvement antifasciste. Il y a maintenant un certain nombre de député·es indépendant·es qui peuvent soutenir de tels mouvements ; Jeremy Corbyn et les quatre député·es « Gaza » ont publié une déclaration soutenant les contre-mobilisations. Si la gauche radicale peut travailler d'une manière non sectaire, unitaire, alors nous pourrons réaliser des progrès significatifs.
Nous avons besoin de travailler au sein des mouvements sociaux qui ont émergé contre le racisme, en solidarité avec la Palestine, pour s'opposer au réchauffement climatique incontrôlable, ainsi qu'avec les député·es indépendant·es et le petit nombre de député·es travaillistes qui contestent Starmer et, par-dessus tout, au sein des syndicats pour continuer à construire une alternative de combat à un gouvernement qui mise tout sur un partenariat avec le capital. Ses politiques ne généreront pas le changement radical qui pourrait réduire les inégalités et couper l'herbe sous le pied des fascistes qui exploitent la colère du peuple provoquée par l'austérité et la désillusion vis-à-vis des politiciens.
Hier, nous avons remporté une bataille et, comme Socialist Worker l'a judicieusement écrit, la peur a changé de camp. Néanmoins, la menace fasciste demeure, de même que l'écosystème qui la nourrit – Reform UK et le consensus politique dominant qui définit les immigré·es comme étant « le problème ». Ce qui signifie qu'ils ne vont pas disparaître de sitôt. Notre site et des groupes comme Stand up to Racism vous tiendront informés des protestations à venir.
8 août 2024. Traduit par François Coustal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France - En quoi la gauche a fait fausse route et pourquoi il est grand temps de redresser la barre

Une des principales leçons de la faillite historique de la gauche au 20e siècle est le déficit démocratique dont elle a pâti, au détriment de l'auto-organisation des masses et de leur autogestion démocratique.
Tiré de l'Anticapitaliste
20 septembre 2024
Par Gilbert Achcar et Antoine Larrache
Crédit Photo
Photothèque Rouge
Il ne s'agit pas seulement de l'effroyable dégénérescence stalinienne d'une révolution russe au cours de laquelle s'était pourtant clairement manifestée l'aspiration à une démocratie radicale, mais aussi de l'impact de cette dégénérescence sur l'ensemble du mouvement ouvrier et de la gauche organisée, dont ni les conceptions politiques dominantes, ni les modes de fonctionnement organisationnel n'ont témoigné d'un attachement primordial à la démocratie.
L'importance d'une cohérence sur la question de la démocratie
Or, cet attachement est l'une des caractéristiques majeures des générations venues à la politique après l'effondrement du bloc soviétique, d'autant plus qu'elles sont munies, grâce à la révolution technologique, de moyens d'information et de communication incomparablement supérieurs à ceux du passé.
La gauche antisystème de notre temps doit placer la démocratie radicale au cœur de sa critique du système, de son projet et de son action militante, sur un pied d'égalité avec sa dénonciation des ravages en tous genres du capitalisme. La crise de la représentation dans les régimes de la démocratie « réellement existante » n'a jamais été plus manifeste que dans cette ère néolibérale où convergent les pratiques gouvernementales des courants de la droite traditionnelle et celles des courants issus de la social-démocratie. À présent, ils sont ainsi placés ensemble, dans l'entendement général, dans un « centre » dont la gauche ressemble à s'y méprendre à la droite. À chaque fois que le choix politique concret s'est résumé à la confrontation entre ces deux pôles « centristes », l'abstention a progressé. Le vice majeur de la démocratie représentative apparaît aujourd'hui plus nettement que jamais comme ne consistant dans le fond qu'en la faculté de « décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante doit “représenter” et fouler aux pieds le peuple » au Parlement ou à la tête de l'exécutif, comme l'avait bien résumé Marx dans son commentaire sur la Commune de Paris.
À l'opposé de cette pratique, nous encourageons toutes les actions par en bas, celles qui favorisent l'auto-organisation des masses et concourent à un exercice collectif et actif de la démocratie.
S'opposer en pratique au « coup d'État permanent »
Dans la France de 2024, critiquer les institutions de la Ve République sur le plan théorique et programmatique et revendiquer une VIe République ne suffit pas si cela ne s'accompagne pas d'une critique pratique de ces mêmes institutions. De même, dénoncer l'iniquité du mode de scrutin en vigueur ne saurait convaincre si l'on n'en tire pas toutes les conséquences. Il faut une cohérence des positions en la matière.
Or cette cohérence a fait malheureusement défaut dans les positions adoptées par LFI envers les institutions du pouvoir, et cela sur deux plans. Le premier est la fixation sur l'élection et la fonction présidentielles, qui pourtant constituent toutes deux le principal vice antidémocratique de la Ve République. Le second est l'incohérence dans l'attitude à l'égard du mode de scrutin législatif, la représentation déformée des opinions populaires qu'il engendre, et la possibilité éminemment antidémocratique qui en résulte de mettre en place un pouvoir qui ne s'appuie que sur le choix d'une minorité de la population.
Cette dernière possibilité peut se réaliser soit dans l'acquisition d'une majorité institutionnelle illégitime (comme celle d'une présidence ou d'une majorité parlementaire dont l'assise électorale réelle, telle que manifestée au premier tour, est minoritaire), comme ce fut souvent le cas sous la Ve République (ainsi Emmanuel Macron a été élu bien que n'ayant recueilli au premier tour que 21 % des voix des inscrit·es en 2022, et 19 % en 2017), soit dans l'exercice du pouvoir par une majorité institutionnelle relative, c'est-à-dire une minorité de fait, gouvernant en s'appuyant sur d'autres minorités au gré des circonstances, comme ce fut le cas pour la législature issue des élections de 2022.
Gouverner avec un tiers des voix ?
En ce sens, comme il a déjà été souligné, le RN a manifesté intransigeance programmatique et attachement au mandat majoritaire en prévenant qu'il n'accepterait de prendre les rênes du gouvernement que s'il disposait d'une majorité lui permettant la mise en œuvre de son programme.
LFI a malheureusement adopté une position beaucoup moins exigeante lorsqu'au soir du 7 juillet, Jean-Luc Mélenchon a appelé le NFP à se préparer à gouverner et à appliquer son programme, « tout le programme », alors que le NFP n'avait obtenu qu'une majorité relative d'un tiers des sièges à l'assemblée nationale et seulement 28,2% des voix exprimées au premier tour (sur 66,7% de l'électorat, un tiers s'étant abstenu). Depuis lors, le NFP aiguillonné par LFI, après être parvenu difficilement à s'entendre sur la candidature de Lucie Castets au poste de première ministre, s'est heurté au rejet unanime de l'ensemble des autres forces représentées à l'assemblée nationale. La participation de LFI à un éventuel gouvernement dirigé par le NFP a été d'emblée rejetée par les autres composantes de l'assemblée nationale.
Il était correct de faire preuve d'intransigeance dans l'opposition à un gouvernement du NFP avec les macronistes ou LR, à l'encontre des tentations qui pouvaient exister dans une partie de la gauche, en particulier dans le PS et le PCF. Mais l'ambiguïté maintenue pendant plusieurs semaines sur la possibilité d'un gouvernement dans lequel LFI jouerait un rôle central et qui serait néanmoins capable de gouverner, c'est-à-dire de ne pas être censuré à l'Assemblée nationale, a conduit à un double échec : celui de renforcer les tendances à la passivité des masses mobilisées pendant les élections, et celui de mettre en lumière l'incohérence de la position de la gauche vis-à-vis du pouvoir.
Jean-Luc Mélenchon a alors offert, le 24 août, de surseoir à la participation directe de LFI afin de lever la raison invoquée par les autres groupes parlementaires pour mettre leur veto à la formation d'un gouvernement du NFP. C'était trop tard. Comme il a été déjà expliqué (1), cette attitude aurait dû être celle de LFI dès qu'il est apparu que le NFP arrivait en tête des élections tout en restant loin d'obtenir une majorité absolue à l'assemblée nationale. C'est d'ailleurs la position classique du mouvement révolutionnaire, celle qu'avait adoptée le NPA vis-à-vis de la NUPES : nous soutiendrons toute mesure que vous prendrez qui va dans le sens des intérêts des travailleurs/euses, mais nous ne participerons pas à un gouvernement de coexistence avec le système.
La faiblesse politique de la gauche a mécaniquement favorisé l'extrême droite
De fait, l'enlisement du NFP dans une position incompatible avec la réalité des rapports de force, sans agir pour les modifier par la mobilisation populaire, a profité au RN. Si LFI avait adopté d'emblée l'attitude décrite plus haut, ses partenaires du NFP auraient eu le champ libre pour former un gouvernement dirigé par le PS et négocier un accord de non-censure avec les centristes dans le prolongement du « front républicain », puisqu'un tel compromis était imposé par les rapports de force au parlement. Il aurait été alors beaucoup plus difficile pour Macron de justifier son arrangement avec le RN. Mais puisque la censure du NFP était donnée pour acquise en cas de nomination autre que celle de sa candidate choisie avec LFI, alors que cette option était dès lors rejetée par les deux tiers de l'assemblée nationale, c'est la recherche d'un accord de non-censure avec le RN qui devenait automatiquement la condition sine qua non de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le point d'équilibre de la nouvelle coalition gouvernementale s'en est ainsi trouvé porté à droite. Le résultat a été la nomination de Michel Barnier.
Le NFP n'a cessé de crier au déni de démocratie. Il est sûr que Macron a joué sur l'absence de majorité à l'assemblée nationale pour agir à sa guise, comme à son habitude. Il se serait montré non seulement plus respectueux des règles démocratiques, mais aussi bien plus fûté politiquement (ce qu'il est loin d'être malgré sa vanité incommensurable) s'il avait nommé la candidate du NFP en sachant que si elle parvenait à former un gouvernement faisant consensus dans la coalition de gauche – ce qui était loin d'être facile – ce gouvernement serait renversé illico à l'assemblée nationale. Et si la gauche avait profité de quelques jours au gouvernement pour agir à coup de décrets contre les deux-tiers de l'assemblée nationale, faisant ainsi usage de l'une des ficelles les plus antidémocratiques de la Ve République, elle aurait considérablement affaibli sa propre critique du régime. Toutefois, en qualifiant d'antidémocratique le refus par Macron de nommer Lucie Castets, le NFP a pris une position qui embrouille la critique des institutions de la Ve République et risque de se retourner contre lui aux prochaines élections législatives.
Imaginons en effet ce qui se passerait au cas tout à fait possible où le RN obtenait la prochaine fois la majorité relative à l'assemblée nationale, d'autant que le « front républicain » de juillet dernier a bien peu de chances de se renouveler dans les mêmes conditions. Imaginons que Macron revienne alors à l'intention qui lui avait été prêtée avant le deuxième tour de juillet dernier de nommer Jordan Bardella au gouvernement (tout simplement parce que Macron a toujours cherché depuis 2017 à légitimer son rôle par contraste avec le RN) et que le dauphin de Marine Le Pen accepte cette fois-ci de former un gouvernement. Le NFP ne pourrait pas protester contre cette nomination sans contredire son discours actuel, alors que l'attitude qui devrait normalement être la sienne aurait été d'appeler à continuer à faire barrage au RN à l'assemblée nationale. Et si Macron choisissait plutôt d'écarter Bardella en invoquant le fait que la majorité de l'assemblée nationale a opposé son véto à sa nomination, comme il l'a fait pour Castets, le NFP dénoncerait-il alors un nouveau « déni de démocratie » ?
Comment faire pression
Ces hypothèses soulignent l'incohérence du NFP sur la question de la démocratie, de la critique des institutions et du rapport à l'auto-organisation des masses. Qu'un parti dit « de gouvernement » sous la Ve République tel que le PS trouve normal de gouverner sans majorité populaire et même sans majorité parlementaire, c'est dans l'ordre des choses. On aurait pu cependant espérer mieux de LFI, en tant que gauche de rupture appelant à une assemblée constituante et à une VIe République. Or, le cours que LFI a suivi depuis le 7 juillet risque fort de se retourner contre elle, de casser son élan populaire et d'aboutir à une rupture du NFP dans les plus mauvaises conditions. En revanche, la position qui aurait consisté pour LFI à se déclarer d'emblée prête à soutenir un gouvernement de coalition mené par le PS sans y participer lui aurait gagné la reconnaissance de ses partenaires du NFP et de l'opinion publique, tout en renforçant son image de gauche de rupture, radicalement démocratique et critique des institutions de la Ve République, consciente pour cette même raison de ce que la mise en œuvre de son programme radical nécessite le soutien de la majorité populaire.
La dynamique très différente qu'une telle position aurait créée dans les négociations postélectorales aurait peut-être conduit à la formation d'un gouvernement de coalition PS-Écologistes avec tout ou partie du « centre » (la coalition Ensemble). Il aurait suffi de 96 voix à l'assemblée nationale, en sus des 193 voix du NFP, pour défaire toute motion de censure déposée par la droite et/ou l'extrême droite. Un tel gouvernement aurait été tributaire des pressions contradictoires des centristes et de LFI, ce qui aurait néanmoins accordé à cette dernière un important moyen de pression. Elle aurait été en mesure de « mettre au pied du mur » ses partenaires du NFP pour l'application des mesures envisagées dans le programme commun, en combinant action législative (propositions de lois) et mobilisations sociales.
La position radicale ci-dessus relève plus de l'exemple portugais de soutien sans participation du Bloc de gauche (gauche radicale) au gouvernement socialiste minoritaire en 2015 que du soutien sans participation du PCF au gouvernement du Front populaire en 1936. Aussitôt exhumée des archives par les médias après la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui fut interprétée comme un désistement de LFI par rapport à la participation à un gouvernement NFP, cette dernière analogie n'est pas la bonne. Non seulement parce que le Front populaire jouissait d'une solide majorité à la Chambre des députés et dans l'électorat (masculin) en 1936, mais aussi et surtout parce que le PCF était alors dans une démarche droitière de pression pour la modération des positions et mesures du Front populaire, se plaçant ainsi à la droite de la SFIO, ancêtre du PS. Or, la démarche préconisée ici aurait été, tout au contraire, celle d'une pression de gauche sur un gouvernement s'appuyant sur le NFP.
Renverser la table
La réaction de LFI à la position de Macron a été celle d'un appel à sa destitution – appel dont toute la presse a souligné qu'il n'avait strictement aucune chance d'aboutir par la voie constitutionnelle. Quel est donc l'objectif visé par une campagne pour la démission de Macron, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans le fond ? Ce choix politique témoigne d'une fixation sur la fonction présidentielle et du souhait qu'une nouvelle élection ait lieu dans les plus brefs délais. C'est un pari extrêmement périlleux, car il prend le risque d'une victoire de Marine Le Pen dans le cadre de la monarchie républicaine qu'est la Ve République – une victoire tout à fait possible elle aussi, notamment après la crise déclenchée par Macron et l'attitude astucieuse adoptée par le RN, et plus probable en tout cas qu'une victoire de Jean-Luc Mélenchon s'il se présentait à nouveau. Dans ces circonstances, il faut impérativement combiner la campagne contre Macron avec la campagne pour le changement de constitution. Nous ne nous battons pas pour l'abdication du roi au profit d'un autre individu qui pourrait être pire encore, mais pour l'abolition de la monarchie !
Au-delà de la présidence et de l'assemblée nationale elle-même, une gauche de rupture devrait souligner les quatre principes suivants :
Le premier est que son combat principal se déroule sur le terrain des luttes sociales, pour le changement des rapports de forces politiques par l'action des masses. Les mobilisations du 7 septembre et du 1er octobre, mais aussi celle du 10 septembre dans l'éducation et les mobilisations contre tous les racismes et en solidarité avec les peuples palestinien et kanak, sont la principale voie à suivre.
Le deuxième est que l'action au sein des institutions existantes ne saurait être que l'écho et l'adjuvant de ces luttes-là, alors que la gauche a tendance à déconnecter l'action parlementaire (motions de censures, destitution, questions au gouvernement, amendements) des mobilisations dans la rue. Les élu·es de gauche doivent se faire concrètement les porte-paroles de leurs électeurs/rices en encourageant l'expression auto-organisée et permanente de la volonté de la base électorale.
Le troisième est que l'essence même des institutions de la Ve République est bonapartiste, antidémocratique et compatible avec l'extrême droite. Alors que les grands mouvements sociaux de ces dernières années – Gilets jaunes, retraites, etc. – ont montré la soif démocratique de la population et que la gauche s'est accordée sur la revendication d'une VIe République, il est important de mettre en avant la perspective de l'élection d'une assemblée constituante à la proportionnelle et d'un gouvernement du salariat, émanant de la majorité populaire et placé sous son contrôle direct et permanent.
Afin d'y parvenir, il faut enfin œuvrer à la construction d'une « contre-hégémonie » majoritaire dans la société et pour cela, pousser à l'organisation du front populaire à la base, avec des comités dans toutes les circonscriptions, dans les quartiers, les entreprises et les lieux d'études, prenant part aux débats politiques et aux luttes sociales et agissant pour la mise en œuvre du programme du NFP et son dépassement dans le sens d'une rupture radicale avec le système politique, social et économique en vigueur.
Gilbert Achcar et Antoine Larrache (2)
Le 8 septembre 2024
1. Gilbert Achcar, « Comment une gauche de rupture devrait agir dans les circonstances présentes ? » Site web lanticapitaliste.org, 24 juillet 2024.
2. Gilbert Achcar est professeur d'études du développement et des relations internationales à la SOAS, Université de Londres. Il est l'auteur, entre autres, de : le Marxisme d'Ernest Mandel (dir.) (PUF, Actuel Marx, Paris 1999), l'Orient incandescent : le Moyen-Orient au miroir marxiste (éditions Page Deux, Lausanne 2003), le Choc des barbaries : terrorismes et désordre mondial (2002 ; 3e édition, Syllepse, Paris 2017), Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme (Sinbad, Actes Sud, Arles 2015), Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe (Sinbad, Actes Sud, Arles 2017) et La Nouvelle Guerre froide : Etats-Unis, Russie et Chine, du Kosovo à l'Ukraine (éd. du Croquant, Paris, 2023). Antoine Larrache, membre du comité executif du NPA-A et membre de la direction de la IVe Internationale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aller plus loin : batailler en commun pour imposer l’unité pour battre Macron, Barnier et Le Pen !

Il me revient de faire un compte-rendu des différents débats qui se sont déroulés à la Fête de l'Humanité 2024 au stand commun monté par L'APRES, GDS et Ensemble. (...)
18 septembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
Le cadre du stand avec sa grande banderole « Pour la Victoire du Nouveau Front Populaire » a illustré les possibilités d'avancer concrètement dès maintenant pour faire face aux défis politiques et sociaux de l'heure. Il serait idiot et réducteur de n'y voir qu'une heureuse mise en commun logistique pour avoir droit de cité dans la grande Fête de l'Huma qui, par delà les déboires et malheurs du PCF, demeure un événement populaire incontournable. Les débats menés principalement par L'APRES ont toujours associé d'une manière ou d'une autre les partenaires de la Gauche Démocratique et Sociale (GDS) et du mouvement Ensemble. Ils (voir le programme des activités ) ont aussi réuni des représentants de Génération-s, d'EELV et de Picardie Debout.
Le meeting de présentation de L'APRES, tenu samedi midi, a montré une association dont les figures fondatrices, issus du groupe des « purgés » ou « insurgés » de LFI en juin dernier, donnent une image équilibrée en termes de genre : les militantes expérimentées et solides sur leurs convictions que sont Clémentine Autain, Raquel Garrido, Danielle Simonnet et Pascale Martin ne le cèdent en rien aux figures masculines du groupe (Alexis Corbière, Guillaume Ancelet, Hendrik Davi). Toutes et tous ont pris la parole lors de cet exercice de présentation.
Plutôt que de rapporter leurs propos, nous allons commenter les différents thèmes abordés. Pour commencer, on a le sentiment, positif, d'échapper à une posture perpétuelle d'orphelins déçus de LFI. Alexis Corbière a fait quelques solides mises au point sur les attaques mensongères ou venimeuses venues de la part de leurs anciens camarades. Ceci ayant été dit, tous se sont tournés vers l'avenir, c'est à dire les taches immédiates pour faire face à la crise politique.
L'impression qui se dégage des introductions comme des discussions est celle du sursis. Le puissant mouvement d'en bas a bloqué la tentative de Macron par la dissolution du parlement proclamée au soir du 9 juin de mettre Bardella à Matignon. Ce mouvement, comme l'ont rappelé plusieurs intervenants, s'est ainsi concrétisé dans la manifestation spontanée au siège d'EELV pour faire pression sur les dirigeants de la gauche pour qu'ils s'unissent.
L'unité réalisée à travers le Nouveau Front Populaire (NFP) a permis d'infliger une défaite à Macron [qui n'a pas réussi sa manœuvre délibérée de propulser le RN à Matignon] et à Le Pen [qui n'arrive qu'en 3ème position en termes de groupe parlementaire alors que la puissance du vote RN aux européennes du 9 juin pouvait lui faire espérer plus ..]. Mais ceci n'est qu'un épisode du feuilleton. La gauche n'en est pas quitte pour autant avec les défis qu'elle doit relever.
A commencer par la question d'éventuelles élections législatives en 2025, celle des prochaines municipales en 2026, et enfin surtout, surplombant le tout, le spectre des présidentielles, que celles-ci viennent à terme en 2027 ou soient avancées par une démission de Macron. L'enjeu est considérable : d'une part, empêcher l'accession au pouvoir d'un RN qui surfe sur son capital de 11 millions de voix, mais aussi, se débarrasser de Macron et de sa politique ultra-libérale et anti-démocratique. La thématique de candidatures uniques à gauche, des municipales aux présidentielles est omniprésente. Chacun comprend que la division ne peut que faire le jeu de Macron et de Le Pen mais comment y arriver : par la seule unité fragile des sommets des 4 partis (LFI, PS, PCF, EELV) ou par un élargissement du NFP à travers une structuration de comités de base du NFP partout, ouverts à tous, encartés et sans parti, y compris syndicats et associations.
Gérard Filoche a fait une vibrante intervention pour la réalisation de l'unité en évoquant les circonstances de la fondation de la SFIO en 1905 avec 11 tendances différentes représentant des divergences doctrinales certaines. On nous dira « oui mais Gérard, il nous fait la même [intervention] à chaque fois ! » sauf que présentement, les circonstances rendent un peu plus pertinents et pressants ses propos.
En tout cas, ceci pose immédiatement le besoin d'une force politique à gauche œuvrant pour l'unité, pour la structuration démocratique de cette unité, afin d'imposer le changement social et écologique, à partir des mesures inscrites dans le programme initial du NFP et surtout le changement démocratique en se débarrassant des institutions bonapartistes de la 5ème République. Ici la responsabilité des initiateurs de L'APRES est grande, mais elle incombe aussi à la GDS et à Ensemble.
La crainte du piège du juridisme ou de l'acceptation du cadre des institutions actuelles même pour en sortir, est cependant amoindrie quand on entend des interventions comme celle de Rachel Garrido évoquant la convocation d'une assemblée constituante. Ces propos méritent d'être plus discutés et approfondis car une authentique Constituante ne saurait être octroyée, surtout dans le cadre de la 5ème et même avec la meilleure volonté du monde.
L'opération « destitution de Macron » initiée par LFI souffre du cadre de la 5ème qu'elle prétend respecter .. pour la dépasser. Pire, elle s'inscrit dans une stratégie de candidature de JLM prétendant être le dernier président de la 5ème pour l'éternité sans égard du danger Le Pen et sans égard du maintien effectif de Macron d'ici 2027. Une stratégie présidentialiste enfermée dans l'indépassable cadre présidentiel.
Un angle aveugle de la discussion renvoie à la place du mouvement social dans ces perspectives. Résister à la déferlante anti-sociale de Macron, ce qu'ont fait à leur manière le mouvement des Gilets jaunes ou le mouvement contre la réforme des retraites du premier semestre 2023, ne saurait se limiter à une seule affaire de syndicalistes. Pour gagner contre l'agenda anti-social, les syndicalistes ne doivent pas craindre de mettre à bas le pouvoir, ainsi la grève générale de 1968 n'a pas seulement donné des accords de Grenelle, elle a aussi abouti au départ différé de de Gaulle en 1969, départ qui aurait pu être largement précipité si les directions politiques et syndicales de la gauche n'avaient accepté le cadre de la 5ème République et respecté ses institutions.
Pour ne pas être condamné à reproduire des journées d'action syndicale à l'infini, il faut ne pas se limiter à la seule préparation des échéances électorales. Il faut combiner politique et syndical (*) dans la perspective de l'affrontement social. C'est à cette condition que l'ambition de reconstruire un mouvement ouvrier sous ces multiples formes, politique, syndicale, associative, culturelle, intégrant les revendications et les besoins de toutes les couches et catégories du peuple travailleur, des tours aux bourgs !, se concrétisera et permettra d'arracher à la passivité les « résignés », à l'abstention les « déçus » ou à la tentation lepeniste les électeurs « fâchés ».
Trop de militants à gauche ne voient que le verre à moitié vide, ne captent pas l'ampleur et la valeur du coup d'arrêt infligé à Macron-Le Pen les 30 juin et 7 juillet. Pour que la gauche ne soit pas en sursis, il ne faut pas accorder de sursis à Macron jusqu'en 2027. Il faut être à l'offensive pour empêcher le projet austéritaire que Barnier, premier ministre minoritaire sans gouvernement depuis une semaine ni investiture, prétend élaborer avec des ministres, démissionnaires à perpétuité, à l'insu des parlementaires appelés à voter un budget 2025 en aveugle et à la va-vite. Barnier et Macron n'ont aucune légitimité à dégrader nos vies, qu'ils cèdent la place devant la démocratie !
Pour engager tout cela, les animateurs d'un certain stand de la Fête de l'Huma 2024 portent une responsabilité cruciale pour aider à la réalisation de l'unité et à la concrétisation de la démocratie à tous les étages du mouvement général. La qualité du débat démocratique ce samedi à Brétigny augure favorablement des possibilités. Maintenant, réalisons celles-ci !
OD, le 18/09/2024.
Notes :
* la formule « politique et syndical » ne vise pas à exclure les mouvements sociaux et revendicatifs qui portent sur les questions écologiques, féministes, anti-racistes, LGBT, etc … elle entend les intégrer en une forme concentrée
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il y a une alternative à l’austérité budgétaire : c’est la justice fiscale, Monsieur Barnier

Imposer les plus fortunés, supprimer les privilèges fiscaux nuisibles à l'environnement, renforcer les moyens de lutte contre l'évasion et les fraudes fiscales… Un collectif d'associations et de personnalités de la société civile rappellent les divers moyens d'éviter l'austérité budgétaire.
19 septembre 2024 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/19/il-y-a-une-alternative-a-lausterite-budgetaire-cest-la-justice-fiscale-monsieur-barnier/#more-85815
Engager des coupes budgétaires drastiques tout en se refusant « en même temps » d'imposer les plus riches et les grandes entreprises : telle est l'orientation de la politique fiscale injuste et inefficace impulsée par Emmanuel Macron. Le président de la République a eu beau reconnaître le problème que pose la diminution des recettes fiscales, il a pourtant déclaré qu'aucune augmentation d'impôt n'était envisagée. En qualifiant l'idée d'une hausse d'impôt de « maladie française », il a confirmé qu'il n'y avait, à ses yeux, aucune alternative à l'austérité budgétaire. Loin des aspirations des Français·es qui sont favorables, selon les enquêtes d'opinion, à des hausses d'impôts à condition qu'elles ciblent les entreprises qui font le plus de profits et les plus aisés.
Ce choix a déjà eu de lourdes conséquences : les financements des services publics, de la protection sociale et de la lutte contre le dérèglement climatique sont frappés de plein fouet. Si cette politique fiscale était maintenue, il est à prévoir que les besoins sociaux et écologiques seront une fois de plus sacrifiés sur l'autel de l'austérité, aggravant davantage les inégalités. Dans une période d'affaiblissement du consentement à l'impôt, de distension du lien social, d'inquiétude face à l'avenir, l'extrême droite ne peut que tirer profit de cette politique injuste et injustifiée. Le chef de l'Etat, qui entend imposer ces vues malgré des désaveux électoraux et une situation politique complexe qu'il a lui-même créée, porterait alors une responsabilité immense dans cet échec global, démocratique, social, économique et écologique.
Répondre aux urgences sociales et écologiques
Sourd aux attentes d'une immense partie de la population, le gouvernement a multiplié les attaques contre notre modèle social, pourtant déjà bien fragilisé. Il a engagé un plan de coupes budgétaires qu'il entend mettre en œuvre coûte que coûte pour 2025. Le financement des urgences sociales et écologiques est clairement dans le viseur : aux 10 milliards d'euros d'économies prévues pour 2024 [1] pourraient s'ajouter 16 milliards d'euros d'économies supplémentaires qui toucheraient notamment le travail et la transition écologique. Le choix des secteurs visés est éloquent… Pendant ce temps, des coups répétés sont portés au logement social, au financement de l'hôpital public et de la protection sociale, et le ministre démissionnaire de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a engagé au cours des derniers mois un travail de sape de la fonction publique en remettant en cause le statut des fonctionnaires, l'un des piliers du modèle social français. Rarement un pouvoir n'aura été aussi dogmatique dans ses choix.
Face à cette orientation écologiquement, socialement et économiquement délétère, de nombreuses voix s'élèvent pour formuler des propositions à portée de la main visant à rétablir le principe de justice fiscale et rééquilibrer un système fiscal mis à mal par les politiques néolibérales. A l'évidence, un tel rééquilibrage permettrait de combattre les inégalités et de renforcer le consentement à l'impôt, pilier d'une démocratie digne de ce nom. Il permettrait également de dégager les recettes nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, relever les défis écologiques et énergétiques et contribuer à la solidarité à l'égard des pays du Sud Global, en première ligne du dérèglement du climat.
Une solution : la justice fiscale
Pour faire face à ces enjeux, nous avons besoin d'une action publique ambitieuse et d'une meilleure répartition fiscale. Nous rappelons à ce titre plusieurs principes : l'action publique et la protection sociale doivent avoir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population et pour préserver l'environnement ; les choix fiscaux et budgétaires doivent poursuivre la satisfaction de l'intérêt général et non des intérêts particuliers, ils doivent faire l'objet d'un véritable débat citoyen ; une fiscalité plus juste suppose de mettre à contribution les personnes et les entreprises de manière progressive, en fonction de leurs richesses et de leurs capacités contributives. Cela suppose de rétablir l'égalité devant l'impôt et de combattre résolument son évitement.
Sur cette base, et pour répondre au « ras-le-bol des injustices fiscales », plusieurs pistes se dessinent pour engager, à court terme, un rééquilibrage : d'abord mettre davantage les plus fortunés à contribution à travers une imposition du patrimoine juste et efficace. Ensuite, mettre fin aux privilèges fiscaux nuisibles à l'environnement et bénéficiant aux plus riches, mieux imposer les rentes de toutes sortes, comme les superprofits et les superdividendes, défendre la nécessité d'une véritable taxe sur les transactions financières et d'un relèvement de l'imposition des multinationales au sein de l'Union européenne, et enfin renforcer à tous niveaux les moyens de lutte contre les différentes formes d'évasion et de fraude fiscales.
Ces mesures sont légitimes et nécessaires. Nous appelons à participer aux différentes initiatives qui seront engagées pour défendre leur mise en œuvre, en particulier à l'occasion de la discussion sur le projet de loi de finances 2025. Nous appelons également la population à s'emparer de ces questions qui n'appartiennent qu'à elle, pour qu'un vrai débat citoyen s'engage et débouche sur des mesures de justice qui permettraient ainsi de « refaire société ».
[1] Avec notamment 200 millions de coupes sur le budget de l'apprentissage et autant sur la formation professionnelle, 400 millions d'euros pour le Fonds vert censé aider les collectivités territoriales, un milliard d'économies sur la rénovation énergétique et autant sur l'aide au développement.
Les signataires
Alexandre Derigny, secrétaire général de la fédération CGT Finances
Vincent Drezet, porte-parole d'Attac
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit Au Logement
Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France
Soraya Fettih, chargée de campagnes France 350.org
Anne Guyot Welke, porte-parole de Solidaires Finances Publiques
Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne
Organisations syndicales
Nathalie Bazire, membre du Bureau confédéral de la CGT
Caroline Blanchot, secrétaire générale de l'UGICT-CGT
Bernard Dantec, secrétaire général CGT Caisses d'épargne Ile-de-France
Daniel Fayard, secrétaire national-e du Mouvement National Lycéen
Judith Krivine, présidente du Syndicat des Avocats de France
Florentin Martorell, secrétaire général de la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL)
Julie Ferrua et Murielle Guilbert, co-déléguées de l'Union Syndicale Solidaires
Hania Hamidi, secrétaire générale de l'UNEF
Ismaël Nureni Banafunzi, membre du groupe d'animation du Syndicat de la Médecine Générale
Kim Reuflet, présidente du Syndicat de la Magistrature
Eléonore Schmitt, porte-parole de l'Union Étudiante
Benoît Teste, secrétaire général de la FSU
Associations et collectifs
Ana Azaria, présidente de Femmes Egalité
Farid Bennaï, référent national du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP)
Jean Marie Bonnemayre, président du Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire Lucie Charlès, membre du bureau national des Effronté-es
Collectif d'Accès au Droit
Coordination Féministe
Fabien Cohen et Franck Gaudichaud, secrétaire général et co-président de France Amérique Latine
Marie Cohuet et Laura Thieblemont, co-présidentes des Amis de la Terre
Sandra Cossart, directrice de SHERPA
Marie-José Del Volgo, secrétaire générale de l'Appel des appels
Noura Elouardi, coordinatrice exécutive du CRID
Enima, Riposte Alimentaire
Catherine Faucogney, présidente du Comité de Vigilance pour le maintien des services publics de Haute Saône
Charlène Fleury, coordinatrice du réseau Rester sur Terre
Pascal Franchet, président du CADTM France
Antoine Gatet, président de France Nature Environnement
Karl Ghazi et Marie-Pierre Vieu, co-président·e·s de la fondation Copernic
Léa Geindreau, porte-parole d'Action Justice Climat
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France
Eddie Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement
Stephen Kerckhove, directeur général de Agir pour l'Environnement
Christian Khalifa, président d'INDECOSA-CGT
Martin Kopp, coordinateur national de GreenFaith
Noam Leandri, président du Collectif ALERTE
Isabelle Mathurin, co-présidente de Convergence services publics
Laetitia Navarro, présidente nationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Gaëlle Nourry-Gardien, porte-parole d'Action non-violente COP21 (ANV-COP21)
Claire Nouvian, fondatrice et directrice de BLOOM
Silène Parisse, porte-parole d'Alternatiba
Evelyne Perrin, présidente de Stop Précarité
Jean-François Quantin, co-président du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP)
Suzy Rojtman, porte parole du Collectif national pour les Droits des Femmes
Kahina Saadi, secrétaire générale d'Anticor
Antoine Sueur, président d'Emmaüs France
Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous
Eric Toussaint, porte-parole du réseau international CADTM
Marie Youakim, co-présidente de ritimo
Personnalités et universitaires
Christophe Alévêque, humoriste
Bruno Amable, économiste
William Bourdon, avocat
David Dufresne, fondateur du média Au Poste
Thomas Coutrot, économiste
Alexis Cukier, philosophe
Antoine Deltour, lanceur d'alerte
Bertrand Faivre, producteur de cinéma
Eric Fassin, sociologue
Bruno Gaccio, humoriste
Yannick Kergoat, réalisateur
Razmig Keucheyan, sociologue
Thierry Lambert, président de l'Institut international des sciences fiscales (2iSF)
Raphaël Liogier, professeur des universités, Sciences Po Aix-en-Provence
Yvan Le Bolloch', artiste
Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire
Lumi, vidéaste
Monté de Linguisticae, auteur et videaste
Noël Mamère, écologiste
Gustave Massiah, économiste
Guillaume Meurice, humoriste
Corinne Masiero, actrice
Gilles Peret, réalisateur
Edwy Plenel, journaliste
Denis Robert, journaliste
Anne-Sophie Simpere, journaliste et consultante
Alexis Spire, directeur de recherche au CNRS
Fanny Taillandier, écrivaine
Dominique Vidal, journaliste et historien
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Scandale post- mortem Abbé Pierre.

C'est au Canada et aux Etats-Unis que les premiers actes déviants de la personnalité préférée des Français (es) auraient étaient décelés dès les années 50, puis tus par l'Eglise catholique de l'époque. En France, le blackboulage de l'Icone est acté.
De Paris, Omar HADDADOU
Toute sa stature s'est affaissée comme un château de cartes !
Pauvre Abbé Pierre ! Le naturel concupiscent lui revenait au galop, et ce fut de trop ! Là où il repose, la violence médiatique ne l'épargne pas.
Le Saint Siège et les paroisses se sont réveillés, en ce mois de septembre 2024, sonnés par un « excédant de scandales » liés aux mœurs, enté aussi de quelques dépenses financières abstruses au sein de l'Eglise catholique.
Et ce, au moment où le souverain pontife François, entreprenait sa tournée de 32.000 km en 12 jours, en Océanie et aux anciennes colonies pour raviver la flamme de la foi chrétienne, actuellement en déclin.
L'Abbé Pierre serait-il victime de sa faiblesse spirituelle ou coupable de ses intempérances charnelles ? Lui, l'inlassable Humaniste luttant contre l'exclusion, la pauvreté, se dévouant sous la bannière de la Fondation Abbé Pierre - Emmaüs France - pour la cause des sans-abris, était constamment sous les feux de la rampe, approché étroitement par la junte féminine en proie à l'idolâtrie ou à la détresse.
La question sus - citée fait débat chez les Politiques, les philosophes, les étudiants (es), les pieux, les adeptes des diocèses et églises catholiques, peinant à la creuser, quand le sacro-saint est terni par un « Mythe ».
A Paris et dans toute l'Hexagone, l'opprobre est abyssal !
C'est une tuile de forte densité qui vient de tomber sur les 45 000 Eglises catholiques de France, se joignant aux forfaitures de la politique macaroniste. L'effet médiatique est démolissant.
Sévèrement endurée par ce lieu de culte, l'épreuve avilissante réside aussi dans la confrontation brutale des convictions et des exégèses. En témoigne le débat à couteaux tirés, ce samedi, dans une radio parisienne à forte audience sur la restauration de la cathédrale de « Notre Dame de Paris », après la tragédie patrimoniale causée par l'incendie. Les intervenants (es) ferrés en Christianisme, s'écharpaient sur la remise en état du monument cultuel, décriant l'incongruité des nouveaux vitraux.
Pour effacer l'affront, les statues à l'effigie du dévot sont déboulonnées. Pancartes commémoratives et autres supports éponymes retirés. Déconstruire ce que cet homme frêle a ouvragé comme valeurs humaines, c'est l'impératif d'une enquête en quête d'une Vérité ou de notoriété.
Oui, il y a du « Claude Gueux » de Victor Hugo dans cette exhumation fracassante ! Nul n'avait à l'esprit qu'on allât déterrer un défunt d'une aura humaniste et religieuse planétaire pour lui faire un procès post-mortem sur ses intempérances charnelles. Combien sont-ils qui en hauts lieux versent dans des péchés dissimulés ? Quelle est la statistique, la profondeur des attouchements et trahisons conjugales quotidiennes en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Afrique, savourés en catimini dans les administrations, les hôpitaux, les entreprises privées et publiques ? Ils, elles n'ont pas de statues intemporelles et s'abreuvent de leurs déviations licencieuses comme un sommelier un bon cru !
Le mouvement Emmaüs crée et nommé par l'Abbé Pierre en 1949 pour des aides humanitaires, est éclaboussé par un rapport indépendant accablant, commandé par la Fondation dans lequel le prêtre est accusé par une vingtaine de femmes d'abus sexuels. Le Vatican en été informé, mais …
Depuis, la Fondation a décidé de changer de nom et le Conseil d'Administration l'a déchu de la mention « Fondateur Abbé Pierre » du logo. Plus violent, son nom est apparenté à celui « d'un prédateur sexuel », a reconnu le délégué général d'Emmaüs International Adrien Chaboche sur RTL, lundi 9 septembre.
Lors de son périple aux Etats-Unis en 1955, des femmes se plaignent de son comportement. Son image est aussitôt écornée et son séjour écourté. Quelques déboires de santé, suivis d'une déchéance in extrémis de décoration par le gouvernement pour son engament.
L'Archevêque de Paris adresse une missive péremptoire au Ministre : « Il vaut mieux ne pas parler de cet Abbé ! ».
Même scénario au Québec 1959-1963 où on lui enjoint de rentrer en raison de ses comportements déplacés. André Paul, théologien, témoigne : « Il m'a dit est-ce que tu es au courant ce qu'il s'est passé au Québec ? L'Abbé s'est livré à des agressions sexuelles vis-à-vis des femmes adultes ». Une consigne lui est alors notifiée, de ne plus y remettre les pieds.
L'Abbé Pierre avait récusé ses prétendues accusations. Les Evêques de France, lors de la récente Conférence, ont botté en touche, arguant que ces agissements « n'étaient pas connus de tous ».
Bataille des consciences pour une Vérité, ou quête de notoriété chez les Vivants ?
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un gouvernement de droite XXL !

La Gauche française voit sa victoire usurpée, les disqualifiés des Législatives devenir les heureux élus (es), dans un gouvernement fort en habilité manœuvrière, bricolé de coalitions dilettantes. Le casting ne passe pas ! Il est rejeté par le Nouveau Front Populaire lors de sa sortie, ce samedi à la Bastille.
France
De Paris, Omar HADDADOU
Macron fait la part belle à la Droite dure et conservatrice.
Mathilde Panot, frondeuse à en mourir et Présidente des Insoumis dans le cockpit du Nouveau Front Populaire, était à la manœuvre pour cette sortie de contestation à la Bastille, samedi 21 septembre 2024. La dissolution hâtive de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 avec un temps de vacance excessif pour la composition du nouveau gouvernement, témoigne de la crise institutionnelle que traverse la France.
Sous la menace d'une motion de censure portée par le Nouveau Front Populaire - jugée par certains observateurs d'inopérante - récupérée dans la foulée par le RN, Michel Barnier, désormais chef du gouvernement, l'artificier d'un jour, est appelé à désamorcer « la bombe des portefeuilles ministériels » et la crispation entre les Macronistes et les Républicains boudeurs (LR).
Il se voit assigner la tâche ardue de raccommoder les pièces de la politique générale, en particulier les batailles budgétaire et fiscale, les dépenses publiques, l'aménagement des niches fiscales, la lutte contre les superprofits, l'Ecologie, la Sécurité et l'Immigration, dans un contexte empreint de tragédie démocratique et de tiraillements véhéments au Palais Bourbon. Sans compter l'agenda de l'Europe, l'Ukraine et l'impact des tensions exacerbées au Moyen-Orient.
Macron fait fi de la doxa de ses adversaires qui lui claironnent qu'il est le seul Président de la V République à essuyer une mesure de destitution mettant en péril la direction du pays. Situation chaotique oblige, Barnier ne sera jamais libre de ses mouvements et pourrait à tout moment jeter l'éponge.
Le fait saillant dans la composition des 39 membres du gouvernement (Ministres et Secrétaires d'Etat) qui s'est réuni autour de Michel Barnier en Conseil des ministre ce lundi, est l'ardeur impudente de Bruno Retailleau, seul poids lourd dans un groupe de repêchés de circonstance.
Ce dernier s'est empressé à jouer le prélude sa partition intraitable au chef de l'Etat par des annonces abruptes en tant que nouveau Ministre de l'Intérieur issu de Droite inflexible, déterminé à faire sensation par une campagne imminente de décrets pour verrouiller l'immigration et supprimer des droits aux étrangers (es).
L'auteur de la sentence : « Français de papiers » « c'est dans les quartiers où il y a de forts taux migratoires », remet ça, à peine sa nomination Place Beauvau entérinée. En effet, pour en mettre plein la vue à un Macron en « désorbitation prononcée », le Ministre xénophobe veut demander aux Préfets « d'expulser plus et de régulariser moins ! ».
D'où le tollé, ce lundi 23 septembre du Coordinateur de la France insoumise, Emmanuel Bompard : « Bruneau Retailleau fait preuve de racisme ! ».
Un coup de gueule que Mathilde Panot a poussé place de la Bastille devant les manifestants (es) contre la légitimité du Gouvernement Macron-Barnier : « Nous marchons, dit-elle, pour réaffirmer qu'en République, il n'y a pas de Monarchie présidentielle. Seul le Peuple est souverain de son destin. Nous ne laisserons personne bafouer notre Dignité. Le Président refuse d'obéir au scrutin. Jamais nous cèderons et n'accepterons le coup de force ! (Ovation). La nomination de Barnier et l'annonce de quelques noms, est une insulte au Peuple. Nous nous sommes mobilisés pour barrer la route à l'extrême Droite, pas pour avoir un Ministre de l'Intérieur raciste qui n'a aucune légitimité à rester à ce poste. S'il y a un locataire à déloger, c'est celui de l'Elysées ! »
Le timbre vocal éraillé, elle conclut :
« Comme une promesse que nous tenons collectivement, nous ne laisserons jamais la Palestine disparaitre ! »
Mais la Palestine est livrée au génocide sous le regard approbateur des puissances occidentales et les Instances figuratives internationales.
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.






Ce que la percée ukrainienne de Koursk éclaire de la guerre

Le coup d'éclat de l'Ukraine, le 6 août, la percée de ses forces armées dans l'oblast de Koursk, produit toujours son onde de choc. Dans les limites de cet article 1, on notera, avec Michel Goya, spécialiste reconnu des questions proprement militaires, que « les gains stratégiques sont déjà considérables et d'abord politiques » 2.
18 septembre 2024 | tiré de Hebdo L'Anticapitaliste - 721
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/ce-que-la-percee-ukrainienne-de-koursk-eclaire-de-la-guerre
L'action de Koursk inflige un démenti cinglant aux tenants de la dynamique de la défaite, quasiment irréversible selon certains (Emmanuel Todd ou Pascal Boniface), dans laquelle seraient engagéEs des UkrainienNEs en recul, voire en débandade, sur le front. Elle vise à modifier les rapports de forces militaires, conditions mêmes de négociations.
Les Russes ne progressent pas
Les UkrainienNEs se retrouvent certes dans une difficile position défensive sur la ligne de front, et l'avancée russe dans le Donbass est réelle. Mais elle se fait au prix de pertes exponentielles, dans une logique consommatrice de chair à canon inversement proportionnelle aux gains territoriaux. Les UkrainienNEs assument, eux, une tactique maîtrisée de défense des positions jusqu'à infliger le maximum de pertes à l'ennemi, en décrochant de quelques kilomètres vers des positions tenables dès que le coût humain devient trop élevé, et ainsi de suite. Et cela dans l'attente d'avoir tous les armements de leurs alliés leur permettant de repartir à l'offensive et de se retrouver en position de récupérer du territoire.
En fait, les Russes n'ont pas progressé de façon décisive sur le champ de bataille entre novembre 2022 et août dernier : sur seulement 1 030 km2, soit 0,17 % du territoire ukrainien d'avant 2014, incluant la Crimée et les autres territoires occupés (représentant 17,78 % de ce territoire national), selon le Monde 3. La laborieuse poussée russe sur la ligne de front depuis plus de deux ans pâtit de la comparaison avec le gain de quelque 1 300 km2 obtenu par les UkrainienNEs au sud de Koursk en quatre semaines.
L'emploi d'armes et d'équipements alliés n'a pas, comme c'était prévisible, provoqué la foudre russe sur les pays fournisseurs, et ceux-ci sont obligés de suivre.
Affecter la société russe
Cette offensive prend Poutine au piège de ne pas vouloir jouer à 100 % la carte d'une guerre, dont, significativement, il ne veut pas dire le nom, qui l'obligerait, vu la résistance des UkrainienNEs, à une mobilisation générale. « Vladimir Poutine a finalement montré qu'il avait finalement plus peur des réactions internes à une mobilisation guerrière que des UkrainienNEs », selon Michel Goya.
La signification politique de l'incursion de Koursk est d'abord de chercher à produire ce que Poutine redoute, à savoir que la part protégée de la société russe soit enfin affectée par la guerre. Il s'agit aussi de remonter le moral de la population ukrainienne, cible depuis près de trois ans de crimes de guerre mais aussi de la destruction d'infrastructures essentielles face à l'hiver qui vient.
L'autre aspect important de l'opération de Koursk est le coup de force par lequel l'Ukraine a franchi ce qui est paradoxalement la seule vraie « ligne rouge » dans cette guerre. Paradoxalement, parce la ligne rouge est celle dont les alliés font profiter les Russes aux dépens des UkrainienNEs, par leur refus d'autoriser l'Ukraine à viser les sites sur sol russe où Poutine tient au chaud ses armes de destruction massive de l'Ukraine. Or, à Koursk, cette ligne rouge, sans être totalement effacée, a commencé à voler en éclats.
Bien des questions restent ouvertes : le recul et les ripostes russes diront quels seront les effets de la percée ukrainienne sur le front de Pokrovsk. Et les luttes sociales en Ukraine se poursuivent sur plusieurs fronts 4.
Antoine Rabadan
Notes
1.Pour une approche plus complète de la situation militaire, voir https://entreleslignesen…
2. Des coups et des douleurs, https://lavoiedelepee.bl…
3. https://www.lemonde.fr/l…
4. Voir les déclarations de nos camarades de Sotsialny Rukh (Mouvement social) : https://lanticapitaliste… et sur la Fête de l'indépendance fin août : https://lanticapitaliste…
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
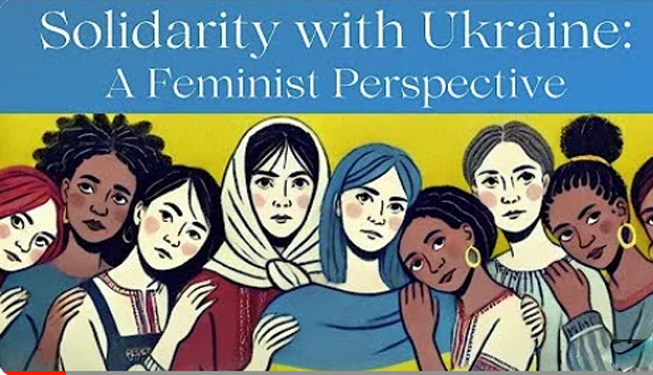
Solidarité avec l’Ukraine : Une perspective féministe
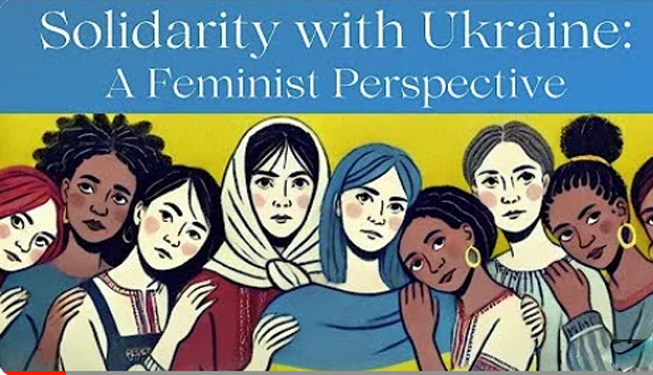
Plus de deux ans se sont écoulés depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Nous avons demandé à des féministes ukrainiennes d'expliquer pourquoi la lutte contre l'invasion impérialiste de la Russie ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'avenir de l'humanité et devrait concerner le monde entier !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’attaque israélienne contre le Liban s’inscrit dans une longue histoire et une stratégie de ciblage des civils

La dernière attaque d'Israël contre le Liban par l'explosion de milliers de bipeurs représente une extension de la doctrine Dahiya, qui vise intentionnellement les civils pour envoyer un message politique.
Tiré de l'Agence Média Palestine
18 septembre 2024
Par Jonathan Ofir
Les décombres au sud de Beyrouth, en 2006 après des frappes aériennes israéliennes massives sur la capitale libanaise.
L'attaque massivemenée au Liban contre des appareils électroniques personnels appartenant à des membres du Hezbollah, qui a déjà tué au moins 20 personnes et en a blessé environ 3 000, ne laisse planer aucun doute sur l'action d'Israël. L'attaque qui a commencé mardi s'est poursuivie pendant une deuxième journée, avec de nouveaux rapports faisant état de l'explosion d'autres appareils de communication personnels, tuant au moins neuf personnes et en blessant des dizaines d'autres mercredi, lors des funérailles de personnes qui avaient été tuées la veille lors de la première attaque.
L'attaque en cours, que l'on ne peut que qualifier de terroriste, est sans précédent par son ampleur et sa méthode, mais la nature de cette attaque aveugle est loin d'être unique pour Israël. En fait, la doctrine israélienne consistant à infliger des dommages massifs aux civils porte le nom d'un quartier de Beyrouth, Dahiya, où cette attaque était précisément centrée. Le développement le plus récent marque une avancée choquante dans le mépris total d'Israël pour la vie humaine, mais ce n'est pas nouveau, même si vous ne l'apprendriez jamais en lisant la presse occidentale.
L'interprétation des médias occidentaux
L'équipe du New York Times, composée de Patrick Kingsley, Euan Ward, Ronen Bergman et Michael Levenson, a couvert l'attaque et, bien qu'elle ait désigné Israël comme coupable, elle s'est efforcée d'inclure l'angle de communication manifestement faux d'Israël, à savoir qu'il s'agissait d'une attaque ciblée.
Le Times rapportece qui suit :
« Selon des responsables américains et autres informés de l'attentat, Israël a dissimulé des explosifs dans une cargaison de bipeurs de fabrication taïwanaise importés au Liban. L'explosif, qui ne pèse qu'une ou deux onces, a été inséré à côté de la batterie de chaque bipeur, ont déclaré deux de ces responsables. Les bipeurs, que le Hezbollah avait commandés à la société Gold Apollo de Taïwan, avaient été trafiqués avant d'arriver au Liban, selon certains des responsables. Selon un fonctionnaire, Israël a calculé que le risque de blesser des personnes non affiliées au Hezbollah était faible, compte tenu de la taille de l'explosif ».
Le Times écrit également que « les explosions semblent être la dernière salve dans un conflit entre Israël et le Hezbollah qui s'est intensifié après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre », ce qui donne à cette affaire l'allure d'une simple activité militaire, plutôt que celle d'une attaque meurtrière et manifestement imprécise contre une population civile. Le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, cité sur ce site hier, résume ainsi l'objectif et l'impact de l'attaque :
« Ce qu'Israël vient de faire est, quelle que soit la méthode utilisée, imprudent. Ils ont fait exploser un nombre incalculable de personnes qui conduisaient (c'est-à-dire des voitures hors de contrôle), faisaient des courses (vos enfants sont dans la poussette derrière lui dans la file d'attente de la caisse), etc. Il est impossible de les distinguer du terrorisme ».
L'analyste politique principal d'Al Jazeera, Marwan Bishara, fait ce rappel à la réalité, peut-être plus pertinent pour les téléspectateurs occidentaux :
« Pour nos téléspectateurs du monde entier, il est probablement utile de faire un jeu de rôle. Imaginez que 1 200 personnes, travaillant au Pentagone, au département d'État et à la CIA, se fassent exploser un bipeur au visage, au bras et à l'abdomen. Comment pensez-vous que les États-Unis réagiraient à cette situation ? »
Le Times souligne la « longue histoire de l'utilisation de la technologie par Israël pour mener des opérations secrètes contre l'Iran et les groupes soutenus par l'Iran », comme s'il s'agissait d'une réalisation technologique impressionnante. Mais en réalité, pour comprendre ce qu'Israël fait ici, nous devons examiner ses antécédents en matière d'attaques aveugles. En fait, cela n'est pas seulement pertinent d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue stratégique et géographique.
De l'attaque aveugle au génocide
Le nom de la doctrine Dahiya provient du quartier Dahiya de Beyrouth, qu'Israël a ciblé et rasé pendant la guerre de 2006, un quartier où vivaient de nombreuses familles affiliées au Hezbollah. En 2008, Gadi Eisenkot, alors chef israélien du commandement du Nord (plus tard chef d'état-major et ministre centriste), a inventé la doctrine qui décrit « ce qui arrivera » à tout ennemi qui oserait attaquer Israël :
« Ce qui s'est passé dans le quartier de Dahiya à Beyrouth en 2006 se produira dans tous les villages d'où Israël essuie des tirs… Nous appliquerons une force disproportionnée sur [le village] et y causerons d'importants dégâts et destructions. De notre point de vue, il ne s'agit pas de villages civils, mais de bases militaires ».
Israël a déjà appliqué cette méthode lors de l'attaque de Gaza en 2008 et 2009. Le « rapport Goldstone » des Nations unies de 2009 a conclu qu'Israël avait mené une « attaque délibérément disproportionnée, conçue pour punir, humilier et terroriser une population civile », et a noté que la doctrine Dahiya « semble avoir été précisément ce qui a été mis en pratique ». Je le répète : « Punir, humilier et terroriser ». Ce dernier mot, « terroriser », devrait nous faire réfléchir, surtout dans ce contexte particulier.
Le récent assaut de Gaza a été, à sa manière, la mise en œuvre de cette doctrine dans le cadre d'un génocide à part entière. Ce n'est pas surprenant, puisque la veine des dommages délibérés aux civils en tant que logique de « guerre » fait partie de l'ADN de cette doctrine depuis le début.
Aujourd'hui, Israël fait donc exploser des bipeurs. La probabilité que les médias occidentaux qualifient cette action d'acte de terrorisme est très faible. Cette notion est encore considérée comme radicale lorsqu'il s'agit d'Israël, car la terreur est un terme politique qui n'est réservé qu'aux ennemi·es de l'Occident. Pour les lecteur·ices du New York Times, il s'agit simplement d'une « dernière salve » et non d'une réflexion sur la nature même d'Israël.
Jonathan Ofir, rédacteur chez Mondoweiss, est un musicien, chef d'orchestre et blogueur/écrivain israélien basé au Danemark.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source :Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël-Liban. L’escalade sur le front nord

Gilbert Achcar (professeur à la SOAS, Université de Londres), sur son blog de Mediapart, soulignait, déjà en juin 2024, à propos des « tambours de la guerre à venir à venir contre le Liban » que « les deux parties, Netanyahou et l'opposition, estiment qu'il n'y a pas de troisième option sur leur front nord : soit le Hezbollah accepte de se retirer vers le nord […], soit ils mèneront une guerre dévastatrice contre le Hezbollah à un coût élevé qu'ils jugent tous nécessaire pour rétablir la capacité de dissuasion de leur Etat, considérablement diminuée sur le front libanais depuis le 7 octobre ».
Tiré d'À l'encontre. Introduction rédaction A l'Encontre
Il soulignait le 18 septembre : « Etant donné que l'Etat sioniste ne peut pas lancer une guerre à grande échelle contre le Liban sans la pleine participation des Etats-Unis, surtout que l'administration Biden l'a averti qu'une telle guerre se transformerait en conflagration régionale, il est difficile pour Netanyahou ou Yoav Galant (ministre de la Défense) de soutenir l'initiative de lancer une agression surprise à grande échelle contre le Liban sans feu vert de Washington. Israël n'aurait même pas pu mener sa guerre génocidaire contre Gaza sans la participation des Etats-Unis, et le Hezbollah est beaucoup plus fort que le Hamas et ses alliés à l'intérieur de la bande de Gaza. »
Intégrant cette dimension, Gilbert Achcar ajoute : « Netanyahou agit donc actuellement en gardant les yeux rivés sur les élections américaines : s'il estime que Trump va gagner, il attendra que ce soit confirmé, voire que Trump revienne à la Maison Blanche, avant de lancer une guerre contre le Liban en collusion avec lui et en préambule à une agression à grande échelle contre les réacteurs nucléaires en Iran même. Si, en revanche, il estime que la victoire de Kamala Harris est la plus probable, ou si cette victoire se produit lors des élections du 5 novembre, cela l'incitera à profiter du temps restant de la présence de Biden à la Maison Blanche pour faire escalader les choses jusqu'à l'état de guerre. Il est probable qu'il cherchera alors à s'assurer que Biden est impliqué dans le soutien à l'agression en donnant au Hezbollah un ultimatum avec un délai précis et court pour se soumettre à la pression et se retirer.
»Les récentes positions de Netanyahou, y compris son rejet du cessez-le-feu à Gaza et de l'échange de prisonniers demandé par l'administration Biden, ne peuvent en effet pas être comprises sans tenir compte des élections américaines. Contrairement aux analyses qui se sont concentrées sur la seule politique intérieure israélienne, il ne fait aucun doute que le refus de Netanyahou d'accorder à l'administration Biden ce qui semblerait être un succès politique au milieu de la campagne électorale américaine actuelle est un grand service rendu à Trump, dont Netanyahou cherchera à récolter les fruits si ce dernier remporte la présidence pour la deuxième fois. »
***
L'offensive qui se déroule ce lundi 23 septembre illustre, à sa façon, ce qui est exposé ci-dessus. Le Washington Post de cet après-midi en donne une version « factuelle » euphémisée : « Le ministère libanais de la Santé a déclaré qu'au moins 274 personnes avaient été tuées et au moins 1024 blessées lors des frappes israéliennes, faisant de ce lundi la journée la plus meurtrière du conflit au Liban depuis les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah qui ont débuté en octobre. Israël a déclaré qu'il menait des frappes “étendues et précises” contre le Hezbollah, notamment dans le sud et dans la vallée de la Bekaa, à l'est, et a appelé les civils à évacuer ou à s'éloigner des zones dans lesquelles le groupe armé opère. Le Liban n'a pas fait de distinction entre les civils et les combattants, mais a indiqué que des enfants, des femmes et des membres du personnel paramédical figuraient parmi les personnes blessées ou tuées. Le Hezbollah a tiré des dizaines de projectiles sur la frontière lundi, alors que les échanges menacent de dégénérer en une véritable guerre. »
La physionomie effective des attaques israéliennes est décrite avec plus d'exactitude par le secrétaire général – Jan Egeland – du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il a déclaré lundi que « les frappes aériennes israéliennes sur les villes et villages libanais lundi sont les plus violentes depuis 11 mois. Des zones résidentielles et des quartiers densément peuplés ont été bombardés, ce qui signifie que le bilan humain sera immense. On a dit aux familles qu'elles n'avaient que quelques heures pour quitter leur maison, et il y a maintenant de longues files de voitures alors que des familles terrifiées tentent de fuir vers Beyrouth. Plusieurs milliers de personnes seront déplacées aujourd'hui. » (Haaretz, 23 septembre)
Dans l'article d'Adam Shatz que nous publions ci-dessous, il remarque que le terme « terrorisme » ne figure pas dans les comptes rendus de cette guerre menée par Israël, le qualificatif n'est réservé qu'au Hezbollah. Dans une sorte de coïncidence chronologique, Ben Samuels, sur le site de Haaretz ce 23 septembre, écrit : « L'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, a qualifié de “terrorisme” l'opération de pose d'explosifs sur les pagers telle que menée au Liban la semaine dernière. Leon Panetta déclare : “Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait qu'il s'agit d'une forme de terrorisme”. » (Rédaction A l'Encontre)
*****
« L'escalade est-elle, peut-être, précisément ce qu'Israël recherche ? »
Par Adam Shatz
Depuis le 7 octobre, l'administration Biden a donné à Israël pratiquement tout ce qu'il demandait, des avions de chasse F-15 aux bombes au phosphore blanc en passant par la complicité diplomatique dans le cadre des Nations unies. Joe Biden et Antony Blinken ont soutenu la destruction de Gaza et la « gazafication » de la Cisjordanie, où les forces israéliennes et les colons ont tué plus de 600 personnes au cours de l'année écoulée, parmi lesquels une citoyenne états-unienne de 26 ans, Ay ?enur Ezgi Eygi, abattu lors d'une manifestation pacifique près de Naplouse.[Voir à ce propos l'article de Jeffrey St. Clair publié sur ce site le10 septembre 2024.] (Les parents d'Eygi n'ont toujours pas reçu – lors de la rédaction de cet article – d'appel téléphonique de l'administration Biden, qui prétend « réunir les faits »). Avec l'apparente carte blanche de Washington, le gouvernement Netanyahou a également intensifié sa longue guerre de l'ombre avec l'Iran, en assassinant des responsables iraniens à Damas et le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran.
***
Les Américains avaient toutefois établi une « ligne rouge », à savoir une guerre israélienne contre le Liban, pour laquelle le gouvernement Netanyahou aurait demandé l'approbation dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Netanyahou voulait ouvrir un deuxième front dans l'espoir de détruire l'organisation chiite libanaise Hezbollah [1], alliée du Hamas, mais les Américains s'y sont opposés et les Israéliens ont donc mis leurs plans en veilleuse. La guerre frontalière de faible intensité avec le Hezbollah s'est poursuivie, mais dans des limites largement respectées par les deux parties. Le Hezbollah a lancé des roquettes sur les villes frontalières du nord d'Israël, tuant deux douzaines de civils et forçant près de cent mille personnes à évacuer leur domicile. Israël a tué des centaines de personnes dans le sud du Liban, dont de nombreux civils, et en a déplacé plus de cent mille. Mais jusqu'à cette semaine, le Hezbollah et Israël semblaient calibrer leurs réponses aux attaques de l'un et de l'autre pour éviter une guerre à grande échelle. Alors que l'assaut d'Israël sur Gaza s'éternisait, son enthousiasme pour un second front semblait s'émousser : comment son armée pourrait-elle affronter le Hezbollah si elle n'était même pas capable de vaincre le Hamas ?
Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lui aussi de bonnes raisons d'éviter l'escalade. Il ne veut pas que se répète la guerre de 2006, qui a entraîné la dévastation d'une partie de Beyrouth, du Sud-Liban et de la vallée de la Bekaa, et la mort de plus d'un millier de civils libanais ; après cette guerre, Nasrallah a présenté des excuses extraordinaires pour avoir provoqué l'offensive d'Israël. Il sait également que l'Iran, son principal mécène et allié, ne veut pas que les missiles du Hezbollah, destinés à servir de bouclier contre une attaque israélienne sur le programme nucléaire iranien, soient gaspillés à Gaza : la solidarité avec la Palestine a ses limites, même pour le chef de « l'axe de la résistance ».
***
Pourquoi alors le Hezbollah a-t-il intensifié ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre ? Les commentateurs israéliens ont affirmé que le Hezbollah était responsable de ce conflit parce qu'il ne s'est pas retiré jusqu'au fleuve Litani [qui coule au sud du Liban et se jette dans la Méditerranée] et parce que Gaza n'est, a priori, pas sa guerre. Mais Nasrallah insiste sur le fait qu'il respecte sa part de l'alliance du Hezbollah avec le Hamas, l'Iran et les Houthis (la stratégie dite de « l'unité des théâtres d'opérations »), et qu'il offre un minimum de soutien à la population assiégée de Gaza, qui a été pratiquement abandonnée par les autres régimes arabes. Il a également fait savoir que les roquettes cesseraient dès qu'un cessez-le-feu serait conclu à Gaza. Comme l'a noté Amos Harel, le correspondant militaire de Haaretz, Nasrallah a fait preuve d'une grande retenue face aux provocations répétées d'Israël, notamment l'assassinat [le 30 juillet 2024] de Fouad Chokr, l'un des principaux dirigeants du Hezbollah, à Beyrouth [dans le quartier Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale].
***
Il est difficile de voir comment la prudence de Nasrallah survivra aux attentats perpétrés cette semaine à l'aide de téléavertisseurs (pagers) et de talkie-walkie (émetteur-récepteur portatif), qui ont tué au moins 37 personnes, dont quatre enfants, et en ont blessé des milliers d'autres. Avec cette opération – qui était en préparation depuis 2022, selon le New York Times, c'est-à-dire bien avant le 7 octobre – Israël a réussi, à tout le moins, à mener l'une des attaques simultanées les plus spectaculaires de l'histoire récente. Israël a frappé deux fois, en plusieurs jours consécutifs ; il n'a perdu aucun de ses hommes ; et il a forcé ses ennemis à abandonner ce que personne dans le monde moderne ne veut abandonner : leurs appareils électroniques. (Au Liban, on a vu des gens écraser leur propre téléphone). Le choc psychologique à court terme est incalculable.
***
Imaginons qu'une organisation militante, telle que le Hezbollah, ait perpétré un attentat similaire en Israël, en faisant exploser les téléphones de soldats et de réservistes et en assassinant des enfants israéliens. Les Américains n'auraient pas attendu de « réunir les faits » pour dénoncer l'attentat. La réaction d'une grande partie de la presse occidentale a également été frappante, pleine de fascination pour l'ingéniosité du Mossad. Ce que vous ne verrez pas dans ces comptes rendus, c'est le mot « terrorisme », qui est aussi tabou que le mot « génocide » lorsque l'auteur de l'attentat est Israël.
Le terrorisme, c'est-à-dire le recours à la violence contre des non-combattants pour atteindre des objectifs politiques, est une forme de propagande, un message adressé à la fois à l'ennemi et à ses propres électeurs. Quel est donc le message des attentats commis à l'aide de pagers et de talkie-walkie ? Pour le public juif israélien, encore traumatisé par le 7 octobre, et en particulier pour les Israéliens qui ont fui leurs maisons dans le nord, le message est qu'Israël rétablit la « dissuasion », le troisième pilier de l'idéologie au pouvoir (les autres étant le souvenir instrumentalisé de l'Holocauste [2] et la consolidation des colonies). Pour le Hezbollah et le peuple libanais, le message est qu'Israël peut frapper n'importe où, n'importe quand, et qu'il se soucie peu des victimes civiles (ce message est redondant, puisqu'Israël est déjà notoirement connu au Liban pour son indifférence à l'égard de la vie des Libanais).
Certains citoyens libanais hostiles au Hezbollah ont d'abord pris un plaisir indirect à ces attaques. Le Hezbollah contrôle en effet une grande partie du Liban, notamment l'aéroport de Beyrouth, et son influence est souvent mal perçue. Mais une fois qu'il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une attaque contre le Liban et qu'elle pouvait être le prélude à une invasion israélienne – comme la destruction de l'armée de l'air égyptienne le 5 juin 1967, qui a précédé la guerre des Six Jours – les gens ont cessé de rire aux dépens du Hezbollah. Encore sous le choc de son effondrement financier et de l'explosion du port en 2020, le Liban a moins de chances de survivre à une invasion israélienne que le Hezbollah.
Nasrallah est dans l'embarras. Le système de communication du Hezbollah a été gravement endommagé et il pourrait y avoir des failles au sein de l'organisation. La reconstruction de ce système et l'éradication des « mouchards » seront ses priorités. Mais il ne peut pas répondre avec la patience des Iraniens, dont le style est de promettre des représailles et d'attendre des années avant de les mettre en œuvre, parce que le Hezbollah est en première ligne dans la bataille contre Israël. Si Nasrallah ne réagit pas, sa retenue passera pour de la lâcheté, ce qui n'est pas le message qu'il souhaite envoyer à ses partisans. Mais s'il commet une erreur de calcul ou s'il réagit d'une manière qui offre aux Israéliens un prétexte pour envahir le pays, il pourrait se retrouver avec une guerre sur les bras qui surpassera de loin la catastrophe de 2006 et mettrait en péril la position du Hezbollah au Liban.
***
Israël n'a pas assumé la responsabilité officielle des attaques, mais il pavoise. Le succès à court terme est difficilement contestable. Les attaques par bipeurs ont mis le Hezbollah et l'Iran sur la défensive. Elles ont détourné l'attention des horreurs qu'Israël continue de faire subir à Gaza et à la Cisjordanie, de l'obscénité de Sde Teiman, un centre de torture, et y compris de viol [voir le quotidien L'Orient-Le-Jour du 24 août 2024, article de Mouin Rabbani] dans le Néguev où des dizaines de prisonniers de Gaza ont été assassinés, et de l'épreuve des otages, la plus grande menace qui pèse sur le poste de premier ministre de Netanyahou. Mais quelle sera la suite ? Netanyahou parie-t-il sur une réaction démesurée du Hezbollah ? Essaie-t-il d'ouvrir un second front et d'entraîner les Iraniens – et les Américains – dans la guerre ? Les attaques font-elles partie de ses efforts pour ramener Donald Trump à la Maison Blanche, ou essaie-t-il simplement de rester au pouvoir en faisant une démonstration de force militaire ? La guerre à Gaza l'a rendu plus populaire que jamais, malgré les manifestations de masse en faveur d'un cessez-le-feu [concernant les otages civils du Hamas].
Quelles que soient ses motivations, Benyamin Netanyahou a rendu la guerre beaucoup plus probable, et ce serait une guerre beaucoup plus difficile que celle de Gaza pour les troupes israéliennes déjà épuisées et démoralisées. Le Hezbollah, qui est apparu à la suite de l'invasion israélienne du Liban en 1982, est un antagoniste redoutable, probablement la force de combat arabe la plus efficace à laquelle l'Etat juif ait été confronté depuis sa création. Ses quelque 45'000 combattants sont peut-être moins nombreux et moins bien armés que les Israéliens, mais, contrairement à ces derniers, ils ont l'avantage de se battre sur leur propre territoire. Les soldats israéliens ont passé deux décennies sous le feu du Sud-Liban avant que le Hezbollah ne les oblige à se retirer unilatéralement en 2000. L'attaque des pagers, un succès tactique à tout point de vue, apparaît à première vue comme une escalade imprudente, sans horizon stratégique.
***
Mais la ligne de démarcation entre tactique et stratégie n'est peut-être pas si utile dans le cas d'Israël, un Etat qui est en guerre depuis sa création. L'identité des ennemis change – les armées arabes, Nasser, l'OLP, l'Irak, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas – mais la guerre ne s'arrête jamais, parce que l'existence entière d'Israël, sa quête de ce qu'il appelle aujourd'hui de manière éhontée « l'espace vital », est basée sur une guerre perpétuelle avec les Palestiniens, et avec tous ceux qui soutiennent la résistance palestinienne. L'escalade est peut-être précisément ce qu'Israël recherche, ou ce qu'il est prêt à risquer, puisqu'il considère la guerre comme son destin, voire sa raison d'être. Randolph Bourne [1886-1918] a fait remarquer un jour que « la guerre est la santé de l'Etat » [3], et c'est certainement le point de vue des dirigeants israéliens. Mais ce sont les civils, arabes et juifs, qui finissent par payer le prix de l'addiction de l'Etat à la force. La région continuera de s'embraser tant que l'intelligence et la créativité d'Israël seront consacrées à la poursuite de la guerre plutôt que de la paix. (Article publié le 19 septembre sur le blog de la London Review of Books ; traduction par la rédaction de A l'Encontre)
* Adam Shatz est le rédacteur en chef pour les Etats-Unis de la London Review of Books et un collaborateur régulier de la New York Review of Books, du New Yorker et du New York Times Magazine. Il est également professeur invité au Bard College et à l'Université de New York. Il est l'auteur d'une biographie de Frantz Fanon – intitulée Frantz Fanon. Une vie en révolutions – publiée en français par les Editions La Découverte, en mars 2024.
Notes
[1] Voir sur le Hezbollah l'ouvrage de Joseph Daher, Le Hezbollah, Ed. Syllepse, 2019. (Réd.)
[2] Voir à ce propos l'intervention d'Enzo Traverso intitulée « De l'usage politique de la mémoire » (vidéo) dans l'article daté du 19 avril 2024, sur le site alencontre.org. (Réd.)
[3] Son ouvrage le plus connu, resté inachevé à sa mort, a pour titre La santé de l'Etat, c'est la guerre. Version française publiée par les Editions Le passager clandestin, en mars 2012. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« S’opposer à la militarisation américaine dans la région Asie-Pacifique ne devrait pas signifier rester silencieux face à l’impérialisme émergent de la Chine »

Au Loong-Yu est un militant politique et des droits du travail de longue date à Hong Kong. Auteur de L'essor de la Chine : force et fragilité et Hong Kong en révolte : le mouvement de protestation et l'avenir de la Chine, Au vit désormais en exil. Dans cette longue interview, Au discute du statut mondial de la Chine et de ses implications pour l'activisme en faveur de la paix et de la solidarité.
Tiré de Inprecor
17 septembre 2024
Par Au Loong-Yu
L'un des plus grands défis auxquels est confrontée la gauche est de s'attaquer au statut de la Chine au sein du système capitaliste mondial. L'ascension fulgurante de la Chine a conduit de nombreuses personnes à se demander si la Chine faisait toujours partie du Sud global ou si elle était devenue un pays impérialiste. Comment comprendre le statut de la Chine aujourd'hui ?
Le problème est qu'au cours des trois dernières décennies, la Chine n'a pas été un pays à part entière du tiers monde. D'un pays largement peuplé de paysans il y a 40 ans, il est aujourd'hui urbanisé à 60 % et entièrement industrialisé. Sa fabrication déploie des produits bas et haut de gamme. En conséquence, la Chine a franchi le seuil pour devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur selon la Banque mondiale. Pourtant, dans le même temps, 600 millions de Chinois disposent d'un revenu mensuel de seulement 140 dollars américains.
La Chine contient simultanément de nombreux éléments, ce qui la rend tout à fait unique. Le simple fait de regarder le PIB par habitant ou le revenu mensuel pourrait vous amener à croire que la Chine fait partie du Sud global. Mais aucune mesure ou indicateur économique ne peut à lui seul nous fournir une réponse définitive sur le statut de la Chine. La Chine d'aujourd'hui présente encore des éléments qui rappellent ceux d'un pays du tiers monde, mais l'importance de ces éléments a diminué avec le temps. Nous ne pouvons pas les écarter, mais ils ne restent que des éléments de définition du statut de la Chine. Pour tirer une conclusion utile sur la Chine, il faut considérer le pays dans son ensemble, en prenant en considération tous ses éléments.
Mais si la Chine n'est plus un pays en développement ordinaire, cela signifie-t-il automatiquement que nous devrions la qualifier d'impérialiste ?
Le statut de la Chine est compliqué et désordonné. Il n'y a pas de réponse claire par oui ou par non ; la réponse est plutôt oui et non. Je décris la Chine comme un pays impérialiste émergent – une puissance régionale très forte avec une portée mondiale. Elle possède l'intention et le potentiel de dominer les pays de moindre importance, mais n'a pas encore consolidé sa position dans le monde.
Pourquoi cette définition ? Eh bien, commençons par les critères de base de l'impérialisme. L'analyse de [Vladimir] Lénine a besoin de nombreuses mises à jour, surtout depuis la période de décolonisation d'après-guerre. Mais si nous prenons Lénine comme point de départ, il fait référence au degré de monopole, à la fusion du capital industriel et bancaire, à la formation du capital financier et au niveau des exportations de capitaux comme des caractéristiques déterminantes de l'impérialisme. Si l'on applique ces critères à la Chine, ils sont tous présents de manière très significative.
Par exemple, nous assistons actuellement à l'éclatement de la bulle du marché immobilier chinois. On oublie souvent que ce n'est que grâce à la privatisation des terrains urbains appartenant à l'État (ou plus exactement à la vente du droit d'usage du sol) que la méga-bulle du marché immobilier existe. Le régime des « terres domaniales » détermine également les principaux acteurs du marché : les municipalités, les banques (principalement publiques) et les promoteurs. Ensemble, ils ont formé une alliance de capitaux financiers fonciers pour faciliter l'enrichissement de la bureaucratie et de ses partenaires privés.
Alors que dans d'autres parties du monde, la logique impérialiste est motivée par le capital privé avec le soutien de l'État, en Chine, l'État et le capital d'État sont les principaux acteurs. Ceci malgré le fait que le secteur privé représente plus de la moitié de l'économie. Certains pourraient répondre : « Si les sommets de l'économie sont fortement monopolisés par les entreprises d'État, alors elles relèvent de la propriété sociale ou publique, ce qui est une caractéristique du socialisme ou, au minimum, la propriété de l'État est un rempart contre la recherche du profit. capitaux privés. » C'est oublier qu'il y a longtemps, Friedrich Engels s'est moqué de ceux qui pensaient que les projets de propriété d'État de Bismarck étaient une caractéristique du socialisme. En réalité, la propriété étatique et la propriété sociale sont deux choses très différentes.
L'État chinois est un État prédateur entièrement contrôlé par une classe exploiteuse dont le noyau est constitué de bureaucrates du Parti communiste chinois (PCC). Je qualifie cette classe exploiteuse de bureaucratie d'État bourgeoisisée. Cela signifie que nous avons en Chine une sorte de capitalisme d'État, mais qui mérite son propre nom. À mon avis, le capitalisme bureaucratique est le terme le plus approprié pour désigner la Chine car il capture la caractéristique la plus importante du capitalisme chinois : le rôle central de la bureaucratie, non seulement dans la transformation de l'État (d'un État hostile à la logique capitaliste – bien qu'il n'ait jamais été véritablement engagé en faveur du socialisme) — à un capitaliste à part entière), mais aussi à s'enrichir en fusionnant le pouvoir de coercition et le pouvoir de l'argent.
Cette fusion a donné un nouvel élan à la dynamique de la bureaucratie en faveur de l'industrialisation et des investissements étatiques dans les infrastructures. C'est pourquoi la restauration capitaliste de la Chine, menée par l'État et le PCC, s'est accompagnée d'une industrialisation rapide, contrairement à la chute de l'Union soviétique. C'est aussi la raison pour laquelle les entreprises publiques chinoises sont en pratique contrôlées par la bureaucratie du parti. Par son emprise sur le pouvoir d'État, il nie continuellement à la classe ouvrière ses droits fondamentaux de s'organiser. Sur le plan opérationnel, ces entreprises sont « détenues » par différentes sections et cliques de la bureaucratie, souvent via des arrangements hautement secrets.
Il convient de rappeler deux choses. Premièrement, la Chine impériale se caractérisait également par sa bureaucratie, au point que certains sociologues considèrent la Chine comme une « société bureaucratique ». L'absolutisme de l'empire n'a été possible que parce qu'il a réussi à remplacer la classe noble par des bureaucrates loyaux dans l'administration de l'État. Lorsque des tensions surgissaient entre la bureaucratie et l'empereur, l'empereur gagnait certaines batailles mais la bureaucratie gagnait la guerre, faisant de l'empereur son chef nominal. Deuxièmement, il convient également de rappeler la longue histoire d'entreprises d'État et d'entreprises d'État de la Chine impériale. Une grande partie de la richesse générée par ces entreprises est allée dans les poches des bureaucrates qui les géraient. Cette bourgeoisification d'une partie de la bureaucratie était visible dans la Chine impériale ; il était présent sous le règne du Kuomintang (KMT) ; et réapparut sous le PCC après 1979, devenant finalement une caractéristique dominante du capitalisme chinois.
L'État chinois présente-t-il également des caractéristiques expansionnistes, caractéristiques communes aux puissances impérialistes ?
En tant qu'État capitaliste bureaucratique fort, il porte nécessairement un fort impératif expansionniste qui n'est pas seulement économique mais politique. Considérez ceci : les importantes exportations de capitaux de la Chine, qui prennent souvent la forme d'investissements à long terme, signifient que Pékin a nécessairement besoin de leviers politiques mondiaux pour protéger ses intérêts économiques. Cela encourage objectivement une logique impérialiste visant à dominer les pays de moindre importance et à rivaliser avec les principaux pays impérialistes.
Mais il existe aussi une logique politique expansionniste. L'« humiliation nationale » de la Chine sous le colonialisme entre 1840 et 1949 a conduit les élites dirigeantes du PCC à jurer de renforcer le pays à tout prix. Le rêve du [président] Xi [Jinping] pour la Chine doit être interprété à la lumière du rêve de Mao Zedong de chaoyingganmei (超英趕美, dépassant la Grande-Bretagne et rattrapant les États-Unis). Même si le slogan ne doit pas être interprété littéralement, les dirigeants ultranationalistes chinois n'accepteront pas que la Chine reste une puissance de second ordre pendant encore un siècle. Cette ambition, née de l'histoire contemporaine de la Chine et du grand nationalisme chinois Han du parti, a conduit Pékin à rechercher une influence politique mondiale. Cela les amènera également, tôt ou tard, à rechercher une puissance militaire mondiale – si la Chine parvient à consolider son statut dans la période à venir.
Toute discussion sur la Chine et l'impérialisme ne peut pas se concentrer uniquement sur les aspects économiques ; au contraire, elle doit aussi prendre en compte cet aspect politique. Les dirigeants chinois contemporains, du KMT au PCC, ont tous voulu restaurer le territoire et l'influence de la Chine impériale sous la dynastie Qing. Bien avant que Pékin ne revendique la ligne à neuf traits sur la mer de Chine méridionale, le KMT avait déjà déployé sa revendication de la « ligne à onze traits » sur la même zone. En ce sens, le PCC suit les traces impériales, sans grand succès, du KMT – mais cette fois, cela a, jusqu'à présent, fonctionné bien mieux pour lui.
En se concentrant un instant sur les aspects économiques, cela signifie-t-il que la Chine n'offre aucune alternative à l'impérialisme américain pour les pays du Sud, comme semblent le suggérer les partisans d'un monde multipolaire ?
Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle la Chine constitue une sorte d'alternative pour le Sud. Il suffit de voir ce qu'elle a fait au Sri Lanka lorsque ce dernier n'a pas pu rembourser son prêt : la Chine a obligé le Sri Lanka à céder un plus grand contrôle de son port d'Hambantota. Les entreprises chinoises, y compris celles qui appartiennent à l'État, ne fonctionnent généralement pas mieux – ni pire – que les entreprises de tout autre pays impérialiste.
Mais il faut analyser cette question à deux niveaux. La Chine, comme les États-Unis, entretient des relations avec la plupart des pays du monde. Aucune généralisation radicale n'est capable d'expliquer chacune des relations que ces deux pays entretiennent avec les autres. C'est encore plus vrai pour la Chine car elle n'est pas encore un empire mondial. Une critique générale de l'expansionnisme chinois ne doit pas nous empêcher de procéder à une analyse concrète de chaque relation. Chaque fois que nous sommes confrontés à un cas spécifique, nous devons être sceptiques quant aux actions de la Chine – et de celles de toutes les grandes puissances – mais aussi analyser la relation spécifique, en accordant une attention particulière aux voix et aux intérêts de la population locale. Ce n'est qu'en pesant à la fois le général et le spécifique que nous pouvons, en tant qu'étrangers, juger si ce que fait la Chine est bien ou mal.
Prenons par exemple l'initiative « la Ceinture et la Route ». Il est possible que certains des investissements chinois à l'étranger via ce projet profitent à d'autres pays, ou du moins causent plus de bien que de mal. Ici, les voix des populations locales peuvent nous fournir les informations les plus pertinentes dont nous avons besoin. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos critiques générales à l'égard de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Quel que soit le bien qu'un projet spécifique puisse apporter, il n'en reste pas moins qu'en général, l'initiative de la Ceinture et de la Route est motivée par la logique du profit et les intérêts géopolitiques du régime monolithique du PCC. Un scénario gagnant-gagnant pourrait émerger dans des cas spécifiques, mais il est hautement improbable que ce soit le cas pour la plupart des pays hôtes, que la BRI se solde finalement par un succès ou un échec pour la Chine.
Dans l'ensemble, la stratégie de mondialisation de la Chine, dans laquelle elle s'est lancée au début du siècle, représente une nette régression de la politique étrangère chinoise : d'un tiers-mondisme relativement progressiste à une priorité accordée aux intérêts commerciaux des entreprises chinoises et à l'influence mondiale de Pékin. Même si les performances de la Chine dans les pays en développement ne sont pas aussi mauvaises que celles des pays occidentaux, ce changement qualitatif de la promotion d'un développement autonome dans le tiers monde (comme le préconise Mao) à la recherche de profit dans le tiers monde est clairement un pas en arrière. De plus, l'entrée de la Chine dans la concurrence avec l'Occident pour les marchés et les ressources accélère nécessairement le nivellement par le bas pour les droits du travail et la protection de l'environnement.
Compte tenu de tout cela, pourriez-vous résumer votre vision du statut de la Chine aujourd'hui ?
En prenant tout cela en considération et bien d'autres encore, je pense que nous pouvons dire que la Chine est un pays impérialiste émergent. Elle est loin d'être consolidée en tant que puissance impérialiste, mais elle a le potentiel d'atteindre ce statut si elle n'est pas contestée de l'intérieur et de l'extérieur pendant assez longtemps.
Selon moi, le terme d'impérialisme émergent permet d'éviter certaines erreurs. Par exemple, certains soutiennent que puisque la Chine et les États-Unis ne sont pas sur un pied d'égalité, la Chine ne peut donc pas être impérialiste et que l'étiquette de « pays en développement » continue de s'appliquer. Cet argument ne parvient pas à rendre compte de la situation en constante évolution en Chine et dans le monde. Par exemple, l'ascension spectaculaire de la Chine jusqu'à devenir une nation industrialisée en moins de 50 ans est sans précédent dans l'histoire contemporaine.
C'est pourquoi il faut être capable d'appréhender à la fois l'universel et les particularités de la Chine. Son potentiel pour devenir une puissance impérialiste est immense. C'est également le premier pays impérialiste émergent à avoir été auparavant un pays semi-colonial. En outre, la Chine doit faire face au problème de son retard. Ces facteurs ont peut-être en partie contribué à son essor, mais certains aspects continuent également de paralyser sa capacité à se développer de manière suffisamment efficace et, surtout, de manière plus équilibrée.
Le PCC devra surmonter certains obstacles fondamentaux avant de pouvoir consolider la Chine en tant que pays impérialiste stable et durable. La clique de Xi sait qu'avant que la Chine puisse réaliser son ambition impériale, elle doit surmonter le fardeau de l'héritage colonial et du retard de la Chine. C'est pourquoi Pékin considère la « reprise » de Taïwan comme un élément stratégique pour sa sécurité nationale. Le fait que Taiwan soit restée séparée de la Chine continentale depuis que le Japon en a pris possession en 1895 hante le PCC.
Ici encore, les généralisations radicales ne nous aident pas lorsqu'il s'agit de « l'héritage colonial » de la Chine. Nous avons plutôt besoin d'une analyse concrète. L'héritage colonial de la Chine ne constitue pas dans sa totalité un fardeau pour son développement. Prenons le cas de Hong Kong. L'autonomie de Hong Kong permet à la ville de préserver son système juridique britannique, qui est sans aucun doute un héritage colonial. La Chine attaque le système juridique de la ville au nom du maintien de la sécurité nationale et du « patriotisme ». Pourtant, du point de vue du peuple, aussi imparfait que soit le système juridique britannique, il reste bien meilleur que celui de la Chine. De plus, le briser nuirait à l'intérêt collectif du capitalisme bureaucratique. C'est précisément cet héritage colonial qui a permis à la ville de devenir le centre financier dont la Chine dépend encore aujourd'hui : la moitié des investissements directs étrangers de la Chine transitent par la ville. Xi ne peut pas réaliser son rêve pour la Chine sans le capitalisme autonome de Hong Kong, du moins pour la période à venir.
Cela nous amène à la contradiction la plus flagrante que connaît aujourd'hui la Chine. Xi souhaite que la Chine fasse un grand pas en avant en termes de modernisation. Mais il n'a tout simplement pas les connaissances ni assez de pragmatisme pour transformer son rêve en plans cohérents et réalisables pouvant être mis en œuvre. L'acte insensé de se tirer une balle dans le pied lorsqu'il s'agit de Hong Kong reflète le retard culturel du parti ; son incapacité à établir une succession stable du pouvoir en est un autre exemple. Si l'on prend en compte l'échec du parti à moderniser sa culture politique de loyauté personnelle et de chefs de secte, nous comprenons pourquoi la capacité de la Chine à consolider sa position à la table des puissances impérialistes se heurte à des difficultés.
Que pouvez-vous nous dire sur les actions de la Chine en mer de Chine méridionale et comment, le cas échéant, elles ont contribué à la montée des tensions et à la militarisation dans la région Asie-Pacifique ?
La revendication chinoise de la ligne en neuf traits sur la mer de Chine méridionale a constitué un tournant fondamental, car elle a représenté le début de l'expansion de la Chine à l'étranger, politiquement et militairement. D'abord parce que sa prétention est totalement illégitime. La Chine, par exemple, revendique également l'île Senkaku, ce que conteste le Japon. Là, on peut au moins dire que la Chine a des arguments plus solides pour étayer ses affirmations, alors que le Japon n'a aucun fondement, que ce soit au regard du soi-disant droit international ou d'un point de vue de gauche. Il s'agit simplement d'une revendication impérialiste du Japon, en alliance avec les États-Unis. En revanche, la Chine n'a jamais gouverné efficacement toute la zone de la ligne en neuf traits qu'elle revendique (à l'exception de certaines îles, comme l'île Paracel). Sa revendication sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale n'est pas seulement injustifiée, elle constitue également une déclaration de ses ambitions hégémoniques en Asie, qui sont parallèles à ses ambitions économiques mondiales représentées par la BRI.
Certains diront que les actions de la Chine en mer de Chine méridionale sont largement défensives et visent à créer un tampon contre la militarisation américaine dans la région. Dans quelle mesure cet argument est-il légitime ?
Je pense que c'était le cas des actions de la Chine avant sa revendication en neuf tirets. Même si nous acceptons que la Chine continue d'agir de manière défensive et se contente de répondre à l'agression américaine, vous ne le faites pas en envahissant d'immenses territoires qui n'ont jamais appartenu à la Chine et sur lesquels les pays voisins ont des revendications – y compris certains qui ont été victimes de l'agression de la Chine impériale pendant des années. des centaines d'années. Il s'agit d'une invasion des zones économiques maritimes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Elle ne peut plus être considérée comme défensive.
Il convient également de noter qu'il n'existe pas de Grande Muraille séparant les actions défensives des actions offensives, surtout si l'on considère la rapidité avec laquelle le contexte a changé en Chine et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, Pékin a à la fois l'intention et la capacité de lancer une compétition mondiale avec les États-Unis. Du point de vue de l'intérêt collectif de la bureaucratie, il est clair que Xi a abandonné prématurément le conseil de Deng Xiaoping de « faire profil bas et d'attendre son heure ».
Bien sûr, nous devons continuer à nous opposer à l'impérialisme américain et à la militarisation dans la région, mais cela ne doit pas signifier soutenir ou garder le silence face à l'impérialisme émergent de la Chine. La question décisive à cet égard n'est pas de savoir dans quelle mesure la Chine est sur un pied d'égalité avec l'empire américain.
Comment Taiwan s'intègre-t-elle dans les tensions américano-chinoises ?
Le problème fondamental ici est que les revendications de la Chine sur Taiwan n'ont jamais pris en compte les souhaits du peuple taïwanais. C'est le point le plus important. Il y a aussi la question secondaire des tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais ces tensions n'ont aucune incidence directe sur la question fondamentale.
Le peuple taïwanais a un droit historique à l'autodétermination. La raison est simple : en raison de leur histoire distincte, les Taïwanais sont très différents de ceux de la Chine continentale. D'un point de vue ethnique, la plupart des Taiwanais sont chinois. Mais il existe des minorités ethniques, connues sous le nom de peuples austronésiens, qui habitent de grandes parties de l'Asie du Sud-Est, y compris Taiwan, depuis des milliers d'années. Le PCC ne mentionne jamais ce fait ; il prétend que Taiwan a toujours été occupée par la Chine. Ce n'est pas vrai : les peuples autochtones existent à Taiwan depuis bien plus longtemps et leurs droits doivent être respectés.
Quant à ceux qui sont d'origine ethnique chinoise, nous avons en réalité affaire à deux groupes distincts. Environ 15 %, une minorité absolue, ne se sont installés à Taiwan qu'en 1949, après la révolution chinoise. La majorité a des descendants qui vivent à Taiwan depuis 400 ans. C'est très différent de Hong Kong, où une grande partie de la population est composée de Chinois du continent qui ont des parents en Chine continentale et considèrent toujours les Chinois du continent comme leur patrie. À Taiwan, la plupart des Chinois n'ont pas de tels liens avec la Chine continentale – de tels liens ont été rompus il y a des centaines d'années. Taiwan est une nation distincte depuis de nombreuses années. Elle jouit donc d'un droit historique à l'autodétermination.
La situation n'est pas tout à fait comparable, mais je dirais aussi qu'il en va de même pour Hong Kong. Il ne faut pas oublier que pendant 150 ans, la trajectoire historique de Hong Kong a également été très différente de celle de la Chine continentale : personne ne peut le nier, ni notre droit à l'autodétermination. Tout gauchiste occidental qui nie cela est soit mal informé, soit sa prétention d'être socialiste est tout à fait discutable.
Bien sûr, il est vrai que tout cela est désormais lié aux tensions entre les États-Unis et la Chine. En ce sens, la situation est similaire à la situation ukrainienne. Dans ce cas aussi, il y a ceux qui soutiennent la Russie ou qui ont une position neutre. À mon avis, ils ont tort. Il ne fait aucun doute que les États-Unis constituent un empire mondial qui poursuit son programme partout. Je comprends que certains gauchistes occidentaux ne veulent pas être perçus comme s'alignant sur leurs propres gouvernements impérialistes. Mais notre soutien au droit des petites nations à l'autodétermination – pour autant que nous le menions de manière indépendante – n'a rien à voir avec les États-Unis, ni avec la Chine d'ailleurs.
Nous soutenons ces luttes sur la base de notre principe d'opposition à l'oppression nationale. Nos principes ne doivent pas être compromis simplement parce que notre position peut parfois coïncider avec l'agenda américain. S'opposer à sa propre classe dirigeante ne devrait pas signifier donner la priorité à sa haine plutôt qu'à la résistance des peuples à l'oppression étrangère dans d'autres parties du monde. Voir la politique de cette façon reflète largement l'arrogance de chacun et, en même temps, un sentiment d'impuissance par rapport à sa propre classe dirigeante.
Sur quel type de campagnes de solidarité la gauche devrait-elle se concentrer lorsqu'il s'agit de Taiwan ou de la mer de Chine méridionale ?
Toute campagne de solidarité dans ces deux domaines – auxquels j'ajouterais Hong Kong – devrait comporter au moins trois points : respecter le droit des peuples taïwanais et hongkongais à l'autodétermination ; accepter que la revendication de la Chine en neuf traits dans la mer de Chine méridionale n'a aucun fondement ; et reconnaître que la capacité de s'opposer à la position de la Chine appartient avant tout aux peuples de ces trois régions et des pays voisins. En ce qui concerne les États-Unis, nous devrions rester sceptiques quant à leurs motivations mais, encore une fois, lorsqu'il s'agit de questions particulières, nous devons peser le pour et le contre de manière concrète, et surtout prendre en considération les souhaits du peuple. .
Par exemple, la question de l'achat d'armes par Taïwan aux États-Unis : nous devons être conscients que tous les scénarios de jeux de guerre suggèrent que Taïwan ne serait pas en mesure de résister à une invasion chinoise pendant plus d'une semaine et, dans le pire des cas, pendant plus d'une semaine. quelques jours . Il est évident que Taiwan doit acheter des armes aux États-Unis. Rien de tout cela ne signifie que nous soutenons les droits des États-Unis sur Taiwan. L'action doit incomber à ceux qui sont directement touchés – les habitants de Taiwan, de Hong Kong et de la mer de Chine méridionale et alentour.
Dans le cadre de leur campagne de guerre contre la Chine, les dirigeants occidentaux ont cherché à attiser le nationalisme et le racisme anti-chinois. En réponse, certains à gauche ont cherché à taire leurs critiques à l'égard de la Chine afin de ne pas contribuer à la campagne réactionnaire de leur gouvernement. Que pensez-vous de la manière dont la gauche des pays occidentaux peut s'opposer à la propagande de leur propre gouvernement sans devenir un partisan inconditionnel de la Chine ?
Le nœud du problème est que la notion campiste d'« anti-impérialisme » est non seulement timide, dans la mesure où elle cible uniquement les vieux impérialismes tout en ignorant les impérialismes émergents, mais également centrée sur l'État. Leurs préoccupations portent toujours sur tel ou tel État. Ils oublient que nous ne devrions jamais donner la priorité aux États plutôt qu'aux travailleurs, là où doit résider l'action – et cela s'étend même aux « États travailleurs ».
Les véritables socialistes devraient être centrés sur le peuple. Si quelqu'un refuse de voir comment le PCC traite les travailleurs chinois et se contente de répéter la propagande de Pékin ou refuse d'écouter la voix des travailleurs, alors je dirais qu'il n'est pas de véritables socialistes. Ils se contentent d'admirer certains États, les considérant comme une sorte de rempart contre leur propre gouvernement impérialiste. Leur impuissance les amène à applaudir tout État étranger en contradiction avec leur classe dirigeante et à abandonner ceux qui subissent la répression, simplement pour satisfaire leurs propres aspirations psychologiques.
Mais vous ne vaincrez jamais votre propre nationalisme en soutenant ou en tolérant le nationalisme chinois Han. Nous pouvons soutenir, dans certaines limites, le nationalisme des nations opprimées. Mais aujourd'hui, les Chinois Han ne sont opprimés par aucune nation étrangère ; au contraire, ils sont opprimés par leur propre gouvernement. Le nationalisme chinois Han n'a donc aucune valeur progressiste.
De plus, la version du « patriotisme » du PCC est une sorte d'ethno-nationalisme, ce qui le rend encore plus réactionnaire. Il cherche une sorte de journée (大一統, grande unification) n'est pas sans rappeler celle pratiquée par le fascisme, dans laquelle les pensées des gens doivent être placées sous le contrôle du gouvernement et les livres ne promouvant pas les valeurs officielles doivent être interdits. Garder le silence sur cette version du nationalisme chinois Han, c'est oublier l'immense tragédie des Chinois Han – désormais opprimés par leurs propres dirigeants au point qu'ils se moquent d'eux-mêmes en les considérant comme n'étant guère plus que des « poireaux chinois » attendant d'être récoltés par le parti. sur des bases régulières – et la répression brutale des minorités.
En soutenant ou en s'abstenant de critiquer un État totalitaire comme la Chine, nous creusons nos propres tombes. C'est une trahison de l'internationalisme fondamental et cela discrédite la gauche. L'internationalisme est avant tout une solidarité avec les travailleurs des différentes nations, et non avec les États, et c'est sur cette base que nous devons juger les relations entre les États, et non l'inverse.
Propos recueillis par Federico Fuentes pour Linkshttps://links.org.au/au-loong-yu-ho... le 2 décembre 2023, traduit par ESSF.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Irak. Les débats sur le Code du statut personnel font rage

Les élites chiites, au pouvoir en Irak depuis 2003, essaient de remettre en cause le Code du statut personnel qui règle les affaires familiales pour tous les musulmans, chiites comme sunnites. Avec la nouvelle proposition, les Irakiens pourraient choisir le droit spécifique chiite qui, par exemple, accepte le mariage temporaire ou celui des enfants. Pour l'heure, une partie de la société civile s'oppose à cette fracture du droit qui fragiliserait le droit des femmes et les enfants.
Tiré d'Orient XXI.
Depuis une proposition d'amendement du Code du statut personnel soumise au Parlement au cours de l'été, des débats passionnés ont envahi la scène politique et médiatique irakienne. Adoptée en 1959, la loi 188 du statut personnel définit un ensemble de dispositions légales — distinct du Code civil — qui rassemble les droits et les devoirs des citoyens musulmans en matière de mariage, de divorce, de garde d'enfants et d'héritage. L'amendement proposé rompt avec le système actuel valable pour tous les musulmans et autorise des distinctions fondées sur les principes chiites et sunnites. Les mariages, par exemple, seraient contractés selon la jurisprudence choisie au lieu de se conformer à la loi existante.
D'un côté, plusieurs groupes islamistes chiites au pouvoir depuis l'invasion américaine de 2003 ont plaidé en faveur de l'introduction d'un code sectaire. Ils insistent sur l'importance d'aligner toutes les lois sur la charia et sur la jurisprudence Jaafari (1) pour les musulmans chiites. Ils accusent leurs opposants de remettre en cause les valeurs religieuses et culturelles fondamentales et d'être des agents de l'Occident. Récemment, ils ont également rejeté un article du Code du statut personnel qui accorde la garde des enfants à la mère, l'estimant en contradiction avec la « charia » qui l'attribue au père.
Entre-temps, des organisations de défense des femmes et des droits humains, un réseau d'intellectuels et de personnalités des médias, ainsi qu'un large éventail d'opposants politiques se sont fortement mobilisés contre cette proposition (2). Organisés autour de la coalition « Alliance 188 », ils ont fait valoir que cet amendement remettait radicalement en cause la loi 188 considérée comme équitable et unificatrice pour les musulmans chiites et sunnites : en l'état actuel, elle garantit les droits fondamentaux des femmes, tels que l'âge minimum du mariage, le droit au divorce et la garde des enfants. Autoriser des codes sectaires distincts est source de division, assurent-ils, dans un contexte déjà marqué par la prédominance des tensions entre communautés et l'augmentation, durant ces décennies des guerres, des normes misogynes et patriarcales, surtout lorsque la violence politique règne.
Les interprétations de l'école chiite dominante en Irak, la jurisprudence Jaafari, déterminent l'âge de la maturité pour les filles dès neuf ans et autorisent différents types de mariages précaires (3), avec très peu de droits pour les femmes. S'il est adopté, l'amendement proposé fournira un fondement juridique aux mariages d'enfants, un phénomène déjà répandu dans le pays, et aux unions matrimoniales qui n'offrent aucune protection juridique aux conjointes. En outre, l'Alliance 188 a souligné la faiblesse structurelle du Parlement et le recours, par les groupes politiques chiites, à des méthodes antidémocratiques telles que l'intimidation, la menace de violence et le manque de transparence, pour faire adopter l'amendement. (4)
Ces débats sont souvent présentés comme une lutte entre les forces religieuses qui tentent d'imposer les lois régressives et misogynes de la charia et les forces laïques qui s'opposent à la religion et défendent les droits des femmes. Mais il s'agit d'une caricature, qui ne permet pas de comprendre ce qui est réellement en jeu.
Un conflit entre forces laïques et religieuses ?
Le Code du statut personnel n'est pas une loi laïque : il ne place pas sous l'autorité du Code civil national les « questions personnelles » de tous les citoyens, de toutes les religions et de toutes les sectes. Il permet aux musulmans de bénéficier d'interprétations spécifiques des jurisprudences chiite et sunnite — lesquelles qui ont été négociées par plusieurs acteurs, y compris des oulémas (corps de savants musulmans) des deux écoles, au cours des décennies qui ont précédé l'établissement de la loi 88 en 1959.
En d'autres termes, ces débats se situent à l'intersection de la construction de l'État et de la nation aux époques coloniale et postcoloniale — un processus qui implique divers groupes sociaux et politiques en concurrence pour le pouvoir et la légitimité, et qui est profondément marqué par les questions de classes, de « races » et de genre.
Les mobilisations autour du Code du statut personnel ne sont pas nouvelles. Plusieurs groupes islamistes chiites ont fait des propositions similaires à celle de cet été, quasiment chaque année, depuis l'invasion et l'occupation menées par les États-Unis en 2003. Elles se heurtent toujours à une forte opposition de la part des féministes et des mouvements progressistes. Elles sont d'ailleurs largement rejetées par les Irakiens eux-mêmes, qu'ils soient chiites ou sunnites.
Cette obsession a commencé immédiatement après l'invasion, avec le décret 137 (5), à l'initiative d'Abdel Aziz Al-Hakim (1953-2009), alors chef du Conseil suprême islamique d'Irak, l'une des principales organisations islamistes chiites ayant pris le pouvoir à la suite de l'invasion américaine. Le décret 137 visait à abolir le Code du statut personnel et à le remplacer par des codes sectaires. Bien que cette tentative ait échoué, en partie en raison de la mobilisation des féministes, le décret a été réintroduit sous la forme de l'article 41 de la Constitution adoptée en 2005 : ce dernier prévoit la liberté pour les Irakiens de choisir leur « statut personnel » en fonction de leurs croyances religieuses et sectaires. Contesté à l'époque par les groupes féministes, l'article 41 est souvent cité par les partis politiques chiites comme fondement juridique de leur proposition d'amendement.
L'invasion de 2003 a engendré une dynamique ayant beaucoup de traits communs avec celle de l'établissement de l'État moderne pendant l'ère coloniale (6). Comme les Britanniques dans les années 1920, les Américains ont privilégié une version fragmentée, sectaire et tribalisée de la citoyenneté, en établissant un système politique basé sur des quotas communautaires, le système muhasasa, et en s'alliant avec les forces les plus réactionnaires.
À bien des égards, l'article 41, rédigé et voté dans le contexte d'une occupation brutale, et les propositions répétées visant à établir une loi sectaire sur le statut personnel, constituent une version « américanisée » du régime politique irakien que les groupes islamistes chiites au pouvoir se sont appropriés, tout comme son argument libéral de la « liberté de choix ».
Si la proposition d'amendement était adoptée, cela signifierait un retour à un système juridique remontant à l'époque de la monarchie et de ses tribunaux religieux, tribaux et sectaires, et l'effacement de l'héritage de la première République irakienne (1958-1968). Cet héritage a été façonné par la culture de gauche anti-impérialiste des années 1950 qui a établi l'autorité de l'État émergent sur diverses organisations politiques, y compris sur les puissances coloniales et sur les autorités religieuses.
En outre, l'établissement du Code du statut personnel a marqué la participation des groupes de femmes, représentés en 1959 par Naziha Al-Dulaimi (1923-2007) — communiste et dirigeante de la Ligue des femmes irakiennes, puis ministre —, à la négociation de leurs droits. Elle était alors considérée comme l'une des plus progressistes dans la région.
Au moment de sa rédaction, les groupes islamistes chiites, qui émergeaient lentement, ont contesté la loi, estimant qu'elle sapait leur pouvoir. Les principales organisations prônant une citoyenneté fondée sur l'égalité étaient les forces révolutionnaires de gauche. Dans les années 1940 et 1950, les plus radicales d'entre elles ont exigé que le « statut personnel » soit inscrit dans le Code civil, qui accorde des droits égaux à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, de leur secte ou de leur religion.
À bien des égards, on peut affirmer qu'en dépit de leur opposition affichée, les intérêts des groupes chiites islamistes coïncident avec ceux des puissances coloniales et néocoloniales d'hier et d'aujourd'hui sur un point fondamental : saper les forces politiques progressistes qui prônent une citoyenneté fondée sur l'égalité dans un État fort et souverain.
Toutefois, les partis chiites qui militent en faveur de cet amendement ne sont plus la minorité politique qu'ils étaient sous la monarchie soutenue par les Britanniques au siècle dernier. Ils sont, depuis 2003, au centre du pouvoir politique. On peut se demander ce que signifie pour eux l'affirmation de leur identité religieuse sectaire alors qu'elle est déjà hégémonique dans le pays.
Au cœur des systèmes de pouvoir
Depuis sa création, à chaque crise, à chaque tournant politique, le Code du statut personnel a fait l'objet de réformes. Le régime autoritaire du parti Baas l'a également utilisé comme outil politique à différents moments de l'histoire (7).
L'élite politique chiite portée au pouvoir en 2003, son idéologie et sa politique se sont révélées particulièrement antidémocratiques, brutales, corrompues, sectaires, misogynes et machistes. Elles ont permis la mise en place du système politique ethno-sectaire fragmenté et alimenté une violence politique à la fois sectaire et sexiste, par l'intermédiaire de ses divers groupes armés (dont beaucoup sont alliés au régime iranien). Après des décennies de guerre et de militarisation, la violence est le langage de la masculinité et du pouvoir.
Plus important encore, cette élite a également facilité le démantèlement de l'État et de ses institutions, ainsi que de tous les mécanismes de redistribution des richesses, la privatisation de tout ce qui soutient la vie urbaine, de l'accès à l'électricité, à l'eau, à la santé et à l'éducation.
Au cours de l'année écoulée, elle a lancé des attaques répétées contre les droits des femmes et l'égalité des sexes, depuis l'adoption d'une loi anti-LGBTQ jusqu'à l'interdiction de l'utilisation du mot « genre ». Les théories du complot anti-occidental et les paniques liées à la « moralité sexuelle » ont servi d'écran de fumée pour détourner l'attention de l'opinion publique et d'outil pour saper l'opposition et justifier la répression violente des manifestations comme de la dissidence.
À bien des égards, on peut considérer ces attaques comme une illustration de la perte progressive de popularité de ces groupes, perçus comme responsables des terribles réalités sociales, politiques et économiques du pays, ainsi que de la violence généralisée qui domine la vie quotidienne des Irakiens. Enfin, cette stratégie est également caractéristique de la concurrence entre chiites et chiites, chaque groupe cherchant à s'affirmer par rapport à l'autre, et de l'hégémonie de l'Iran dans les affaires politiques de l'Irak.
Ce débat montre aussi comment le pouvoir opère dans le pays et dans le monde contemporain. Les droits des femmes et les questions de genre sont au cœur des systèmes de pouvoir, un point focal sur lequel le pouvoir s'affirme, se déploie ou est confisqué. Les forces rétrogrades se présentent comme les porteurs de l'authentique culture locale et les protecteurs de la religion.
Toutefois, leur stratégie n'est qu'une version programmatique d'un discours classiquement masculiniste, néofasciste et d'extrême droite que l'on retrouve dans la région, mais aussi dans le monde — de la Hongrie au Japon en passant par les États-Unis et la France. Sans surprise, ces forces ont également en commun de supprimer toutes les protections sociales ainsi que les services publics et de priver les pauvres et les classes populaires de l'accès aux ressources et aux droits essentiels. La logique de privatisation du pouvoir, des services et des ressources est constitutive de la politique brutalement instaurée avec l'invasion américaine et mise en œuvre par ces groupes depuis 2003.
C'est ce que le soulèvement d'octobre 2019 (8) contre le régime a dénoncé avec force. Il a exigé un État démocratique, souverain, fort et fonctionnel qui traite ses citoyens sur un pied d'égalité, indépendamment de leur appartenance religieuse et de leur sexe, et qui redistribue les riches ressources du pays au profit des pauvres et des groupes marginalisés.
L'attaque systématique de l'élite politique chiite contre les mécanismes juridiques et politiques qui accordent des droits et des libertés, en particulier aux femmes et aux groupes marginalisés, a pour effet de maintenir les féministes et les groupes d'activistes progressistes dans un mode défensif : ils sont constamment obligés de se battre pour préserver les droits limités existants, au lieu de faire pression pour en obtenir davantage.
Le Code du statut personnel est patriarcal et, comme l'ont affirmé les militants dans leur campagne pour l'adoption d'une loi sanctionnant la violence domestique, les femmes et les groupes marginalisés ont besoin de plus de droits et de plus de protection. Jusqu'à présent, les efforts acharnés de l'Alliance 188 ont permis de retarder la discussion parlementaire sur la proposition d'amendement, et ainsi de travailler à son retrait pur et simple.
La mobilisation des femmes, d'un large éventail de militants et de forces intellectuelles en Irak autour de ces questions a montré que l'héritage progressiste du siècle dernier continue de resurgir contre vents et marées.
Notes
1- NDLR. Du nom de l'imam chiite Jafar Al-Sadiq (702-765), fondateur de la première école de l'islam.
2- « Iraqi women academics, writers, media professionals and artists reject proposed amendments to the Personal Status Law », Petitions.net, 14 août 2024.
3- NDLR. Les chiites reconnaissent le « mariage temporaire » dit aussi « mariage de plaisir » qui se termine sans aucune procédure au bout de la durée déterminée, théoriquement pour les deux époux mais pratiquement par les hommes.
4- Page Facebook d'Alliance 188, 3 septembre 2024, texte en arabe.
5- Zahra Ali,Women and Gender in Iraq, Cambridge University Press, 2018.
6- Lire Zahra Ali, « Genesis of the “Woman Question”.The Colonial State against Its Society and the Rise and Fall of the New Iraqi Republic (1917–1968) » in Woment and Gendrer in Iraq, op.cit.
7- Zahra Ali, « Women, Gender, Nation, and the Ba'th authoritarian regime », in Women and Gender in Iraq, op.cit.
8- Zahra Ali, « Theorising uprisings : Iraq's Thawra Teshreen », in Third WorldQuaterly, vol.45, n°10, 2023.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : une vengeance sans limites ?

Benyamin Netanyahou l'a dit : il lui fallait encore sept mois pour terminer sa guerre contre le Hamas. Juste le temps nécessaire pour que l'élection présidentielle américaine porte au pouvoir un nouveau président, en l'occurrence Donald Trump, qui lui laisserait les mains libres pour conduire la guerre à sa façon, sans soucis de préoccupation de l'opinion de la communauté internationale et avec un soutien sans failles.
Tiré de Recherches Internationales
ÉDITORIAL
MICHEL ROGALSKI
Car l'allié américain d'aujourd'hui est certes utile car sans lui cette guerre ne pourrait être poursuivie durablement, mais en même temps c'est un allié qui fixe des limites et certaines conditions. Pas de guerre régionale ou d'embrasement du Moyen-Orient ainsi qu'une totale connivence pour poursuivre à bas bruit la colonisation de la Cisjordanie et éradiquer le Hamas au prix d'une vengeance brutale, massive et indistincte sur la population gazaouie.
Car c'est bien celle-ci qui subit depuis plus de huit mois le déluge d'un tapis de bombes détruisant tout – hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs, infrastructures civiles, centrales électriques, habitations – et se voit obligée de subir des déplacements forcés et erratiques rendant la vie quotidienne un enfer. Et tout se décide à Washington dont l'intérêt pour le Moyen-Orient n'a jamais faibli et a survécu au pivot asiatique d'Obama ou à la bascule vers l'indopacifique de Biden. Dès les premiers jours du conflit les États-Unis ont acheminé sur place deux porte-avions dont l'USS Gerald Ford, le plus grand bâtiment de guerre au monde. Cibles menacées et prévenues : l'Iran, le Hezbollah, les milices chiites en Syrie et en Irak. Pour le reste, Israël a toujours su mieux gérer ses relations avec les régimes arabes qu'avec les Palestiniens. La présence militaire américaine a su contenir et éviter tout dérapage du conflit et le ramener à ce qui apparaît comme essentiel aux yeux des dirigeants israéliens dont l'extrémisme suprémaciste et religieux les conduisent à hésiter entre recoloniser Gaza ou à en faire fuir la population vers le Sinaï.
Car il faut bien s'interroger sur les buts de cette guerre – au-delà du langage convenu d'éradication du Hamas et du retour des otages – qui dépassent désormais la simple vengeance punitive excessive, que Tel Aviv avait pris l'habitude d'administrer. Quelques jours après le début du conflit, le ministre de la défense Yoav Gallant sous l'émotion de l'attaque du 7 octobre indiquait bien que la riposte visait la population autant que le Hamas : « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Et son collègue le nouveau chef du parti travailliste, Yaïr Golan, déclarait le 13 octobre à propos des Palestiniens habitant Gaza : « Jusqu'à ce que les [otages] soient libérés, ils peuvent crever de faim. C'est complètement légitime. » Et il l'a fait, amenant la Cour Internationale de Justice saisie par l'Afrique du Sud à évoquer un risque de génocide.
Le cadre du conflit est aujourd'hui connu et reconnu et s'est établi sur une injustice consécutive à la création de l'État israélien au détriment de Palestiniens chassés de leurs terres et privés d'État. Le terme de « fait colonial » souvent évoqué à raison dans une perspective d'histoire longue aurait pu être dépassé par les accords d'Oslo, mais comme on le sait ceux-ci n'ont jamais été appliqués et la colonisation de la Cisjordanie s'est poursuivie à un rythme accéléré. La perspective en termes de solutions est aujourd'hui totalement bloquée. Au fil des décennies le conflit, au départ deux peuples pour une même terre, mais l'un privé de ses droits pourtant reconnus pat les Nations unies, s'est trouvé peu à peu happé par des influences religieuses extrémistes qui ont gagné les deux parties et attisé les haines privilégiant préoccupations sécuritaires sur toute perspective de coopération ou de co-développement. Tant que ce conflit sera traversé par ces considérations religieuses voire messianiques moins il sera possible d'approcher de la paix.
Idéalement quatre solutions peuvent être imaginées.
Deux sont possibles mais réprouvables. Et deux autres sont souhaitables mais peu réalistes. Première solution, le Hamas arrive à chasser tous les juifs du « Jourdain à la mer » et à imposer sur ce territoire un califat islamique géré par les règles de la charia. On doute que le rapport de force le lui permette ou que la communauté internationale laisse faire ce qui se traduirait par des massacres sur une grande échelle. Des chefs pourraient tenir de tels propos, des fractions palestiniennes y adhérer, mais cette voie apparaîtrait très vite sans issue.
Deuxième solution, celle que pour l'instant semble caresser Israël : se débarrasse des Palestiniens par le grignotage colonial de la Cisjordanie et renvoyer la bande de Gaza à l'âge de pierre en y rendant toute vie digne impossible pour ses plus de deux millions d'habitants dans l'espoir de les chasser vers le Sinaï. L'Égypte ne voulant pas avoir à gérer d'immenses camps de réfugiés et craignant une contamination « frériste » a su résister à cette manœuvre en fermant sa frontière. Mais le pourra-t-elle longtemps ? Cette solution serait perçue comme une défaite par les Palestiniens et ne pourrait que créer l'accumulation des conditions d'un prochain conflit. Israël ne pourrait assurer les bases de sa sécurité en entreprenant au XXIème siècle une guerre de colonisation d'autant qu'il envisage de normaliser ses relations avec les pays arabes.
La troisième solution parfois évoquée renvoie à la naissance d'un État israélien d'un autre type, d'un État arc-en-ciel sur le modèle sud-africain. Initialement portée par une partie de la gauche ce projet d'État bi-national où juifs et arabes jouiraient de mêmes droits n'a pas le vent en poupe pour au moins trois raisons. D'abord parce que la gauche a quasiment disparu depuis une vingtaine d'années en Israël et que la majorité de l'opinion publique suit la politique du gouvernement de Netanyahou dans le contexte de la guerre en cours. Elle est de fait hors jeu dans le choix des options possibles. Ensuite parce qu'en 2018 il a été établi constitutionnellement qu'Israël était l'État du peuple juif, ce qui enlève toute perspective de droits égalitaires pour les Palestiniens. Enfin parce qu'il paraît assez peu réaliste que les deux communautés puissent faire société avant longtemps après l'épisode guerrier en cours qui laissera des traces durables.
Il ne faut dès lors pas s'étonner si la quatrième solution apparaît comme la seule dicible et rallie soudainement maints pays qui jusqu'à présent s'étaient bien gardés d'agir pour la faire avancer. C'est la solution de deux États se reconnaissant l'un l'autre, en paix, se donnant des garanties de sécurité et pourquoi pas coopérant. De longues négociations seraient nécessaires et devraient aborder parmi beaucoup de questions la souveraineté et la viabilité de l'État palestinien à naître, son périmètre géographique et le sort des 700 000 colons israéliens présents en Cisjordanie. Quel gouvernement israélien serait capable d'évacuer des centaines de milliers de colons pour libérer de l'espace pour un État palestinien en Cisjordanie ? Cet espoir, emprunt d'une approche irénique, a la faveur d'une majorité de pays – parfois opportuniste, comme la posture française qui s'en réclame tout en se refusant à reconnaître l'État de Palestine – mais se heurte à une opposition farouche réaffirmée à maintes reprises par le gouvernement israélien qui ne veut pas en entendre parler alléguant que ce serait créer un nouveau Hamas à ses frontières. Cette solution qui reste envisagée comme perspective lointaine est pour l'instant bloquée.
Ce conflit, sans fin prévisible, interroge sur ses motivations et ses véritables buts. Il est devenu évident qu'on est bien au-delà d'une vengeance punitive même excessive ou que la question des otages en ait été la préoccupation centrale tant la conduite de la guerre par tapis de bombes et rasage de quartiers ne pouvait que les ajouter aux victimes. Les manifestations répétées orchestrées par les familles concernées témoignent de l'incompréhension rencontrée par le gouvernement israélien sur ce dossier.
Les commentateurs ont souvent avancé que l'opération barbare orchestrée par le Hamas était un piège tendu à l'armée israélienne pour l'embourber dans un conflit sans fin l'isolant de l'opinion publique mondiale. Les enquêtes en cours qui commencent à remonter confirment plutôt que prévenu, le gouvernement israélien aurait laissé faire, dégarnissant même le front sud et aurait profiter de cet effet d'aubaine pour aller bien au-delà. Le problème de Gaza réglé, c'est-à-dire pouvant se ramener aujourd'hui à un quadrillage policier et une surveillance maillée de la population, la voie devenait libre pour s'atteler au front nord et porter de sévères coups au Hezbollah. La tension se déplace aujourd'hui vers cette zone où les combats risquent d'être encore plus meurtriers.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mémorandum sur le génocide en cours à Gaza et ses implications concernant Israël et la Palestine

Invité à un colloque qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, Etienne Balibar a rédigé ce « memorandum », exprimant, de la manière la plus synthétique possible, ses « positions » sur « Israël et la Palestine », « en tant qu'intellectuel, en tant que communiste, en tant que juif ». Avec ce texte fort, Les Temps qui restent ouvre un espace de discussion autour de cette question cruciale et douloureuse, où se mesurera la capacité de notre société à faire vivre un débat à la hauteur de la gravité des enjeux.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Ce « mémorandum », demandé par les organisateurs de la conférence « Narrative Conditions towards peace in the Middle East », constitue également ma contribution à cette conférence, organisée par le New South Institute de Johannesburg dans la série des « African Global Dialogues », du 18 au 20 Septembre 2024. Adaptation française d'Étienne Balibar.
J'exposerai mes positions de façon aussi directe que possible, en espérant que la discussion permette d'apporter les nuances et compléments nécessaires.
Je dois commencer par quelques remarques préliminaires.
Premièrement, je dois avouer que je suis terriblement pessimiste quant à l'évolution de la situation dans la « Palestine historique ». Dans une analyse publiée le 21 octobre de l'an dernier, j'exprimais la crainte que la guerre d'anéantissement lancée par Israël contre Gaza pour se venger de l'incursion sanglante du Hamas le 7 octobre n'aboutisse à une destruction totale du pays et de ses habitants. Palestine à la mort . C'est en train de se vérifier, après des mois de massacre dont le caractère génocidaire saute aux yeux. La complicité active ou passive de la communauté internationale, en dépit des appels répétés du Secrétaire Général des Nations Unies, n'a rien arrangé, à commencer par celle des Etats-Unis qui fournissent à Israël les bombes écrasant Gaza et opposent leur veto à toute résolution de cessez-le-feu effectif. Les Etats Arabes du Golfe ou l'Union Européenne ont aussi leur responsabilité. Sans doute le peuple palestinien a-t-il maintes fois démontré sa capacité de survivre et de défendre son droit, mais le pessimisme est difficile à éviter. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'imaginer l'impossible. C'est même une obligation.
Deuxièmement, je m'exprime ici en tant qu'intellectuel, en tant que communiste, et en tant que juif (parmi d'autres identités, aucune n'étant exclusive). Israël se présente toujours comme le « refuge » dont auraient besoin les Juifs du monde entier menacés par la persistance de l'antisémitisme, ce qui lui conférerait le droit de se « défendre » à n'importe quel prix. Mais le petit-fils d'un déporté du Vel' d'Hiv mort à Auschwitz ne peut pas accepter que la mémoire de la Shoah soit constamment invoquée pour justifier le colonialisme, l'apartheid, l'oppression et même l'extermination sous prétexte de « protéger le peuple juif ». Je concède que cette profession de foi de ma part jettera le doute sur la neutralité de mon jugement, mais dans cette affaire personne n'est neutre.
Troisièmement, je porte le deuil de toutes les victimes du conflit en cours, même celles dont on pourrait dire qu'elles ont une responsabilité dans ce qui leur arrive. C'est vrai pour le passé, pour le présent, mais aussi pour l'avenir, car je pense, hélas, que la catastrophe précipitée par cette guerre va encore s'étendre et menacer tous les habitants de la région. Il y aura d'autres victimes, les unes « innocentes », les autres « coupables ». Leurs actes ne se valent pas, mais leurs morts s'inscrivent toutes dans la même tragédie.
Enfin quatrièmement, je dois dire que je ne suis pas satisfait de la manière dont la présente conférence a été organisée et rendue publique. J'aurais préféré un différent « récit » introductif et une autre composition des tables-rondes. Je comprends donc que certains des participants initialement annoncés aient décidé de se retirer, même si pour ma part j'ai préféré rester et essayer de dire ce que je pense. Mais dans sa forme actuelle cette conférence n'est pas équilibrée. Elle aurait dû inclure les juristes qui ont préparé le dossier de l'Afrique du Sud soutenant l'accusation de génocide devant la Cour Internationale de Justice (ou un de leurs collaborateurs), des historiens antisionistes israéliens, des représentants des groupes militants, sud-africains ou autres, qui défendent la cause palestinienne, et non pas simplement des défenseurs de la politique israélienne dont certains plaident pour l'expulsion des Palestiniens hors de Palestine.
Je passe maintenant au résumé de mes positions sur trois points.
Le 7 octobre et ses suites. L'assaut meurtrier du Hamas contre des villages, des positions militaires, mais aussi une rave party rassemblant des milliers de festivaliers, accompagné d'assassinats de civils, de viols et d'autres brutalités, et d'enlèvement d'otages, prend place dans un contexte, venant après des années de répression et d'opérations de terreur menées par Israël contre la bande de Gaza et sa population. Sur le plan strictement militaire, ce qui l'a rendu possible était l'impéritie de l'armée israélienne et la longue complaisance de l'Etat hébreu envers l'organisation du Hamas, qui lui apparaissait comme l'adversaire idéal à cultiver. C'est ce que la vengeance actuellement exercée est censée faire oublier ou compenser. Mais cela ne justifie rien. L'attaque du Hamas n'était pas, comme on dit tendancieusement, un « pogrom » (c'est contre les villages palestiniens qu'il y a actuellement des pogroms en Cisjordanie). Mais c'était sans conteste une action terroriste. Historiquement, terrorisme et résistance ne sont pas des notions incompatibles, bien que le premier puisse entacher la légitimité de la seconde. Je continue de penser que le Hamas avait prévu que son assaut sanglant entrainerait une vengeance dévastatrice. Il a donc pris sciemment la responsabilité de sacrifier son propre peuple pour infliger une défaite « stratégique » à l'ennemi, et le prix à payer sera long et terrible.
Qu'en est-il cependant de l'autre côté ? Le gouvernement israélien avec son armée, de plus en plus soumis à l'influence du parti des colons (qui est un parti fasciste), mais pouvant aussi compter sur la compréhension de la grande majorité des citoyens juifs sûrs de leur bon droit, que leur nationalisme rend indifférents au sort des Palestiniens (avec des exceptions d'autant plus admirables qu'elles sont de plus en plus réprimées), a cyniquement exploité le traumatisme ressenti par la population et saisi cette « miraculeuse occasion » pour « finir le travail » (comme avait dit David Ben Gourion en 1948) : relancer la Nakba, étendre les colonies de Cisjordanie en expulsant et décimant les Palestiniens, raser les monuments qui témoignent de leur histoire et de leur culture. Surtout il a planifié et mis en œuvre l'un des plus grands massacres de civils de l'histoire récente, toujours en cours à cette heure. Il est impossible de ne pas parler ici de génocide. En janvier dernier la Cour Internationale de Justice, dans l'arrêt rendu à la demande de l'Afrique du Sud, a parlé à ce sujet de « risque grave et imminent ». Ce risque s'est concrétisé depuis, ce qui veut dire que le génocide est en cours. Les nouvelles, toujours partielles, qui nous parviennent du territoire de Gaza, interdit d'accès, sont insoutenables. Ainsi que l'a démontré l'arrêt ultérieur de la Cour Pénale Internationale demandant l'émission de mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et les chefs du Hamas (dont l'un a été assassiné depuis), rien de tout cela n'efface les crimes du 7 octobre. Mais la guerre d'extermination conduite par Israël opère un changement qualitatif dans le niveau de violence, qui affecte irréversiblement notre perception de la nature du conflit.
Parler de « conflit » israélo-palestinien est en réalité un euphémisme. Ce sera mon second point. Car ce conflit a toujours été profondément dissymétrique, du point de vue du rapport des forces comme du point de vue moral. Un abîme sépare les adversaires. Dès avant 1948 et surtout après, les Palestiniens ont subi la colonisation, l'expropriation (par une politique systématique de rachat, puis de séquestration des terres), le nettoyage ethnique, les discriminations raciales et la réduction au statut de citoyens de seconde zone, ce qui pris ensemble mène à l'effacement de tout un peuple sur son propre sol, avec son histoire et sa civilisation. Je ne dis pas que les Palestiniens n'ont aucune responsabilité dans la façon dont ce procès s'est enclenché et déroulé. Mais il n'y a jamais eu de symétrie et le niveau de brutalité atteint est aujourd'hui sans égal. C'est pourquoi on ne peut contester le droit que les Palestiniens ont de résister à leur anéantissement, y compris par les armes, ce qui ne veut pas dire que toute stratégie soit bonne et que toute forme de contre-violence soit juste. De l'autre côté cependant, la question de la légitimité se pose en de tout autres termes. Un dramatique renversement s'est produit. Je ne considère pas du tout que l'entité israélienne telle que reconnue par les Nations Unies en 1948 (malgré l'opposition des pays arabes) ait été illégitime. Mais je pense que la légitimité de l'Etat d'Israël était conditionnelle, et que depuis lors les conditions qu'elle supposait ont été perdues. Pourquoi ? Ce qui faisait la légitimité politique et morale d'Israël n'était évidemment pas le mythe du « retour » des Juifs exilés dans leur Terre Promise (que Golda Meir avait cru pouvoir décrire comme une « terre sans peuple pour un peuple sans terre »). Ce n'était pas non plus l'ancienneté des installations de colons Juifs en Palestine, promue par le mouvement sioniste depuis le milieu du 19ème siècle. L'historien israélien Shlomo Sand l'a bien dit dans une déclaration récente : les nations européennes, avec leur antisémitisme parfois virulent et leurs persécutions, nous ont « vomis », nous les Juifs (et il est d'autant plus ironique que les sionistes se soient ensuite présentés comme chargés d'apporter la civilisation et la modernité européennes en Orient !). Il n'en résultait évidemment aucune obligation pour les autochtones de leur ouvrir les bras (même si, idéalement, l'installation de colonies juives en Palestine aurait pu conduire à leur incorporation dans une société qui avait toujours eu un caractère multiculturel et cosmopolite). Le seul et unique fondement de cette légitimité – mais il pesait très lourd – c'était la capacité de l'Etat d'Israël d'offrir un refuge et de proposer un avenir commun aux survivants de la Shoah, que le monde entier avait rejetés. Implicitement au moins, et contrairement aux tendances profondes de l'idéologie sioniste (qui de ce point de vue est un nationalisme européen pur et simple), ce fondement s'accompagnait de deux conditions à remplir sur le long terme : 1) il fallait que l'installation des colons juifs soit acceptée par leurs voisins, à travers des négociations menant à une alliance entre les peuples, au lieu que les terres historiques des Palestiniens fassent l'objet d'un accaparement par des arrivants qui croient ou prétendent avoir sur elles un « droit immémorial » ; 2) il fallait que l'Etat d'Israël se construise comme un Etat démocratique et laïque, conférant des droits égaux et une égale dignité à tous ses citoyens. Au lieu de quoi (au prix de conflits internes et profitant de diverses circonstances internationales, dont les guerres menées ou envisagées par les Etats arabes), la discrimination ethnique s'est institutionnalisée, le terrorisme d'Etat a été systématisé, et l'Etat d'Israël n'a cessé de se soustraire au droit international, comme si sa vocation messianique le plaçait au-dessus des lois. Le processus aboutit en 2018 à la proclamation d'Israël comme « Etat-nation du peuple juif », c'est-à-dire à l'adoption d'une autodéfinition raciste, qui justifie l'apartheid et préfigure les crimes contre l'humanité. Israël a perdu sa légitimité historique – je le dis avec tristesse et inquiétude quant aux conséquences. Je n'éprouve aucune Schadenfreude.
Mon troisième point est alors celui-ci : tout peuple a droit à l'existence, je dis bien tout peuple, et par voie de conséquence c'est un crime contre l'humanité que de le lui ôter ou de le lui dénier. Ce droit inclut la sécurité, la protection, l'auto-défense. Mais il ne signifie pas que le droit à l'existence s'exerce dans n'importe quelle forme constitutionnelle, sous n'importe quel nom, dans n'importe quelles frontières, et coïncide avec l'affirmation d'une souveraineté absolue, ignorante des droits des autres peuples, comme si chacun se tenait seul sous le regard de Dieu ou de l'Histoire. Or toute la question dans le cas de la Palestine, c'est qu'au cours du dernier siècle, au travers d'un enchaînement tragique de violences et d'affrontements, elle est devenue la terre de deux peuples, une terre où des hommes et des femmes appartenant à deux lignées d'ancêtres et à deux cultures différentes enterrent leurs morts et élèvent leurs enfants côte à côte. Pour qu'ils puissent cohabiter pacifiquement, partager les ressources et le droit à l'existence qui leur appartient, il faudrait en recréer les conditions : or la guerre actuelle rend cela pratiquement impensable. A nouveau, je ne dis pas que les Palestiniens n'en portent aucune responsabilité, surtout s'ils s'en remettent à la politique du jihad. Mais c'est bien l'impérialisme israélien, auquel les « institutions démocratiques » de l'Etat juif n'opposent pratiquement aucun obstacle interne, qui en a ruiné la possibilité. Briser la fatalité reviendrait à inventer une forme ou une autre de fédéralisme et à imaginer le chemin conduisant à son acceptation par les deux peuples, avec l'appui de la communauté internationale et sous la surveillance de ses institutions. De ce point de vue les notions de « solution à un Etat » ou « à deux Etats » restent des formules abstraites, qui tournent en rond, tant que la condition imprescriptible d'un règlement n'est pas remplie, telle qu'Edward Said l'avait énoncée après Oslo en toute clarté : « l'égalité ou rien ». Ce qui veut dire aussi qu'il faut commencer par réparer les injustices subies et inverser la trajectoire. On en est plus loin que jamais. Mais il ne faut pas se lasser d'en réaffirmer le principe.
A supposer qu'on s'oriente dans cette direction, les exigences immédiates ne sont pas difficiles à formuler. Elles le sont davantage à mettre en œuvre.
Il faut un cessez-le feu inconditionnel à Gaza, suivi d'un échange des otages survivants contre les prisonniers politiques, une évacuation complète de ce qui reste aujourd'hui de Gaza par les envahisseurs, et le transfert provisoire de son administration à un ensemble d'organisations humanitaires sous l'autorité des Nations Unies. Une négociation ouverte avec le Hamas et d'autres forces palestiniennes pourrait en faciliter la réalisation.
Il faut réprimer la violence des colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et engager le démantèlement progressif des colonies, qui sont contraires au droit international, même si c'est au prix d'un changement de régime en Israël, et d'une refondation de l'Autorité palestinienne.
Il faut appliquer de façon rigoureuse et complète les décisions des tribunaux internationaux, dont la Cour Internationale de Justice à la demande de l'Afrique du Sud, dont on saluera ici le rôle déterminant. Cela inclut bien entendu les sanctions pénales et l'interdiction de livrer des armes à une armée qui massacre les civils.
Enfin il faut lever l'interdit qui pèse encore, sous la pression des Etats-Unis et de leurs alliés, sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine et sur son admission pleine et entière à l'ONU. Ce qui est un point de départ incontournable pour des négociations de paix.
A ces conditions d'une « solution du conflit » qui sont largement reconnues, sinon actuellement réalisables, je voudrais pour finir en ajouter une de plus, qui peut paraître subjective, mais qui est tout aussi politique : il faut que ceux qui se considèrent comme juifs dans le monde entier se dissocient massivement de l'idée que la « protection du peuple juif » coïncide avec le soutien au colonialisme israélien, qui est meurtrier et autodestructeur. Et qu'ils rejettent l'assimilation de la critique du sionisme avec l'antisémitisme, telle que plusieurs Etats l'ont malencontreusement officialisée. Oui, le sort de l'Etat d'Israël importe aux juifs, et les conséquences de ses politiques sont leur affaire, car leur attitude collective n'est pas sans influence sur son comportement. Mais plus généralement, ce qui est en jeu, c'est le sens que le « nom Juif » gardera dans l'histoire : honneur ou déshonneur, that is the question. Les juifs, sans doute, n'ont aucun privilège à faire valoir dans la défense des droits des Palestiniens, dont la cause est universelle ainsi que je l'avais écrit il y a très longtemps Mais en ce moment même ils ont sans doute une mission à remplir.
Etienne Balibar
Notes
– Etienne Balibar : « Palestine à la mort », Mediapart (en ligne), samedi 21 octobre 2023 : https://blogs.mediapart.fr/etienne-balibar/blog/211023/palestine-la-mort.
– Voir le site www.africanglobaldialogue.org, et pour les critiques qu'elle suscite de la part de certains mouvements de soutien à la cause palestinienne : https://www.palestinechronicle.com/genocide-washing-upcoming-liberal-zionist-conference-in-south-africa-slammed/
– Etienne Balibar : Universalité de la cause palestinienne, Le Monde Diplomatique, Mai 2004 (dossier « Voix de la résistance »).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

15 agences d’aide demandent un embargo sur les armes et la fin de l’obstruction systématique d’Israël à l’aide à Gaza

Quinze organisations humanitaires internationales se sont réunies pour appeler la communauté internationale à exercer une pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, d'un embargo sur les armes à destination d'Israël et de la fin de l'occupation du territoire palestinien.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Des familles font la queue pendant des heures pour un repas chaud à Deir al Balah, 16-02-24 © UNRWA
Dans une lettre publiée hier avant la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine, les organisations humanitaires, dont Oxfam, Christian Aid, Islamic Relief et Save the Children, soulignent que « tandis que les attaques militaires israéliennes sur Gaza s'intensifient, la nourriture, les médicaments, les fournitures médicales, le carburant et les tentes qui sauvent des vies sont systématiquement bloqués depuis près d'un an ».
Quatre-vingt-trois pour cent de l'aide alimentaire nécessaire n'arrive pas à Gaza, contre 34 % en 2023, ont-ils ajouté. « Cette réduction signifie que les habitants de Gaza sont passés d'une moyenne de deux repas par jour à un seul repas tous les deux jours.
Cette « baisse drastique de l'aide (...) entraîne une catastrophe humanitaire, l'ensemble de la population de Gaza étant confrontée à la faim et à la maladie, et près d'un demi-million de personnes risquant de mourir de faim », ont-ils averti.
Avant qu'Israël ne lance sa dernière guerre contre Gaza en octobre 2023, 500 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza, « ce qui n'était déjà pas suffisant pour répondre aux besoins de la population », ont déclaré les organisations humanitaires, ajoutant : « En août 2024, une moyenne record de 69 camions d'aide par jour est entrée dans la bande de Gaza.
Pendant ce temps, Israël impose « des retards et des refus qui limitent le mouvement de l'aide autour de Gaza ; un contrôle étroitement restrictif et imprévisible des importations ».
Jolien Veldwijik, directeur de CARE en Cisjordanie et à Gaza, a déclaré : « La situation était intolérable bien avant l'escalade d'octobre dernier et elle est aujourd'hui plus que catastrophique. En 11 mois, nous avons atteint des niveaux choquants de conflit, de déplacement, de maladie et de faim. Pourtant, l'aide n'arrive toujours pas et les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour faire leur travail alors que les attaques et les violations du droit international s'intensifient ».
Amjad Al Shawa, directeur du Réseau des ONG palestiniennes (PNGO), une organisation qui regroupe 30 ONG palestiniennes et un partenaire d'ActionAid, a déclaré :
« Il y a une pénurie de tous les articles humanitaires. Nous sommes submergés par ces besoins et ces exigences urgentes... Les gens meurent de faim en raison de la pénurie d'aide... 100 % de la population dépend de l'aide humanitaire... C'est la pire situation que nous ayons connue pendant la guerre d'Israël à Gaza (....). »
Les 15 agences ont ensuite « exigé le respect » des conclusions et recommandations de la Cour internationale de justice, la fin du siège de Gaza par le gouvernement israélien et la prise en compte de l'appel lancé par la CIJ dans son avis consultatif pour mettre fin à l'occupation du territoire palestinien.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qui a pris des mesures en faveur des droits des Palestiniens ? La « Carte de la responsabilité mondiale » est désormais en ligne

Le Palestinian Institute for Public Diplomacy (PIPD) publie cette semaine une carte interactive qui recense les mesures de désinvestissement ou de sanctions prises à l'encontre d'Israël depuis un an à travers le monde.
Tiré d'Agence médias Palestine. La carte interactive est en ligne dès à présent
La carte interactive du Palestinian Institute for Public Diplomacy (PIPD) montre les mesures et les sanctions prises depuis octobre 2023 par les États, les parlements, les tribunaux, les entreprises, les groupes de la société civile et les organisations en réponse au génocide en cours et à la Nakba en Palestine.
167 mesures sont recensées, consultables aussi sous forme de liste, et comprenant des sanctions diplomatiques, culturelles, économiques et militaires, ainsi que des actions en justice.
La carte permet une visibilité sur ce qu'il en est de la solidarité internationale avec les Palestinien·nes, au delà des discours. En effet le PIPD explique que « Les actions incluses dans la carte se réfèrent à des actions approuvées et documentées prises par des entités reconnues de la société civile, du secteur privé et des gouvernements qui demandent des comptes aux entités et aux intérêts coloniaux israéliens. Les prises de position, les déclarations, les résolutions de l'ONU, les pétitions, les manifestations et autres appels à l'action n'ont pas été pris en compte, sauf s'ils ont abouti à la mise en œuvre de mesures concrètes. »
Pour la France, malgré une mobilisation continue de la société civile depuis octobre dernier, seule 3 mesures concrètes figurent, contre 11 en Belgique et 7 au Royaume-Uni, pour ne citer que de directs voisins. Ces trois mesures comprennent l'interdiction d'entrée sur le territoire en février 2024 par le ministère des Affaires étrangères à 28 colons israéliens en Cisjordanie occupée accusés d'avoir commis des actes violents à l'égard de Palestinien·nes ; la reconnaissance, en mars 2024, de la légalité du boycott des produits israéliens ; et enfin en août 2024 la décision du groupe d'assurance AXA de se désengager de toutes les grandes banques israéliennes et du fabricant d'armes Elbit Systems.
La plupart de ces mesures font suite à la mobilisation et aux efforts inlassables des militant·es, des Palestinien·nes et de leurs allié·es dans le monde entier, qui continuent à se mobiliser pour libérer la Palestine malgré la violence des attaques et de la répression. Le combat des militant·es du mouvement BDS France pour pousser AXA à retirer ses investissements en Israël, durait depuis plus de 8 ans.
« Le désinvestissement d'AXA est un succès important pour le mouvement BDS et les activistes qui luttent pour plus de responsabilité des entreprises », se félicitait à ce sujet en septembre dernier Fiona Ben Chekroun, coordinatrice pour l'Europe du mouvement palestinien BDS, qui a lancé la campagne. « Les banques israéliennes font partie du squelette de l'entreprise coloniale israélienne. Et la participation de ces cinq banques va au-delà du simple apport financier : elles financent la construction des colonies, de leurs bâtiments et de leurs rues, mais participent aussi à la réflexion sur leur agencement et leur mise en place dans les territoires palestiniens. »
« Les efforts visant à demander des comptes au régime colonial israélien se poursuivent depuis des années, sous l'impulsion de la lutte permanente contre la Nakba et l'oppression des Palestiniens. À l'heure actuelle, notre carte ne met en évidence que les actions entreprises depuis octobre 2023, la communauté mondiale ayant renouvelé son attention sur la Palestine en raison du génocide en cours et de la poursuite de la lutte contre le colonialisme. », précise le communiqué du PIPD.
La violence du génocide en cours, sa relative et inégale couverture médiatique, auront en effet permis à renouveler une solidarité internationale, notamment de la part de la société civile d'où a émergé un mouvement social de grande ampleur pour exiger un cessez-le-feu. Si, comme l'indique cette carte, les mesures concrètes tardent à être prises par les responsables, la pression est continue et les efforts portent leurs fruits.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trois réflexions et un souhait suite au débat Trump-Harris

Au lendemain du débat qui a opposé Kamala Harris et Donald Trump dans le cadre des élections présidentielles étasuniennes, notre camarade Daniel Tanuro a formulé plusieurs réflexions, que nous republions ici.
Tiré de Gauche anticapitaliste
18 septembre 2024
Par Daniel Tanuro
1) Tout observateur raisonnable de la chose politique admettra que Kamala Harris a gagné haut la main. Son langage corporel est celui d'une personne « normale », son propos est cohérent, elle s'exprime clairement, répond plus ou moins aux journalistes, regarde son adversaire, et l'interpelle sans ménagement mais avec le minimum de respect nécessaire. La prestation de Trump est à l'exact opposé : visage ferme, regard fixe, ton hargneux, propos incohérents, mépris, calomnies. Quelles que soient les questions posées, Trump ramène tout à quelques idées fixes (principalement la frontière, les migrants criminels importés par les démocrates pour s'assurer de leur vote en leur donnant l'emploi des américains, etc.). En définitive, il ramène tout au culte de sa propre personne, jusqu'au grotesque. Kamala Harris a bien réussi, par quelques piques, à énerver Trump, qui a vite perdu les pédales. Du coup, plus encore que dans ses meetings, l'ex-président putschiste est apparu pour ce qu'il est : un déséquilibre haineux qui dit n'importe quoi, outrageusement menteur et pathologiquement narcissique. Battu à plates coutures par une femme : quelle humiliation pour celui qui se vante d'en faire ce qu'il veut en les « attrapant par la chatte » !
2) Sur la question de l'avortement, Kamala Harris a défendu avec conviction une position de principe correcte (les femmes décident). Pour le reste, elle a surtout voulu se camper comme la candidate la plus responsable du point de vue des intérêts de la classe dominante US, à l'intérieur et sur la scène internationale. C'était très clair, par exemple, quand, tout en admettant la réalité et le danger du changement climatique, elle s'est vantée de la hausse de la production pétrolière US sous Biden et s'est enorgueillie du fait que son vote en tant que vice-présidente a permis l'adoption des objectifs de fracturation hydraulique inclus dans le plan Biden de capitalisme vert (Inflation réduction act). C'était encore plus clair lorsque Trump a rabâché ses délires sur les démocrates qui veulent « exécuter les nouveaux-nés », légaliser l'avortement jusqu'à 9 mois ou faire des opérations transgenres sur les illégaux en prison (!!!) : Harris a profité de ce moment de folie manifeste pour enfermer son adversaire dans la boite de « l'extrémisme ». Elle a enchainé en appelant les électeurs et électrices républicain.e.s à voter pour elle, en suivant l'exemple de Cheney, Bolton, Pence et autres serviteurs – très « extrémistes » ! – de l'impérialisme US, au nom de la défense de l'hégémonie étasunienne dans le monde (et du soutien à Israël). Idem sur les migrant·es : elle s'est campée en défenseure de la frontière et de la lutte contre les gangs internationaux, sans même dénoncer le monstrueux plan trumpien de traque, d'enfermement et de « déportation » de 20 millions de migrant·es par la police, l'armée et la garde nationale.
3) Il ne faut pas se faire d'illusion : la défaite de Trump dans le débat ne préjuge pas de sa défaite dans les urnes. Son grand atout est d'apparaitre comme l'outsider. Bien qu'il ait trumpisé le parti républicain, une part substantielle de la population continue à le voir comme extérieur au « marais » bipartisan de l'establishment. Il se présente comme une victime de ce « marais », et cette posture entre en écho avec le ressenti de millions de gens qui, du coup, passent allégrement au-dessus de ses condamnations en justice pour fraude ou pour viol. Le comble : sa manière même de s'exprimer, ses incohérences, sa grossièreté sont vues comme des gages d'authenticité. Il est à craindre que le débat n'ait rien changé à cet état de fait. Au contraire peut-être, dans la mesure ou, comme je l'ai dit, Harris s'est vraiment posée en candidate idéale de l'establishment bipartisan et fossile face a la menace de déstabilisation populiste… On verra l'évolution des sondages post-débat. Avant le débat, c'était 50-50, avec avantage à Trump dans 4 des swing states…
4) Le manque d'une alternative de gauche anticapitaliste est criant. Les forces nées autour de la campagne de Bernie Sanders, notamment les Democrat Socialists of America, sont en difficulté, du fait de leur alignement majoritaire sur la politique de Biden, en 2020. On ne peut que souhaiter qu'elles trouvent le moyen de s'orienter dans cette situation difficile où il faut battre Trump sans tomber dans le panneau de Harris. C'est indispensable aux luttes qui, de toute manière, arriveront rapidement. Le mouvement de solidarité avec la Palestine montre qu'il y a du potentiel.
Crédit photo : licence Creative Commons
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Alerte à l’action ! Les 27 et 28 septembre, célébrez les familles d’ouvriers agricoles de Cincinnati lors du Kroger Wellness Festival !

La célèbre marionnette de CIW, Esperanza, se rend à Cincinnati – et elle a besoin de vous pour amplifier l'appel à la justice des travailleurs agricoles, à la fois dans l'Ohio et au-delà.
Tiré du site de Coalition des travailleurs d'Immokalee (CIW)
Appel à tous les membres de la Fair Food Nation !
Les travailleurs agricoles et leurs alliés se réuniront pour célébrer le bien-être des familles d'ouvriers agricoles le week-end des 27 et 28 septembre, juste devant le siège social de Kroger à Cincinnati, dans l'Ohio !
Où : Siège social de Kroger, 1014 Vine St, Cincinnati, Ohio
Quand : 10 h - 5 h, 27 et 28 septembre 2024
La démonstration de CIW à Cincinnati coïncidera avec le festival annuel du bien-être de Kroger, qui se déroulera à quelques pâtés de maisons de là. Selon Kroger, le festival « célèbre la santé physique, mentale et émotionnelle de toute la famille ».
Et pourtant, alors même que Kroger vante son engagement pour la santé de votre famille, le géant de l'épicerie a été publiquement lié à l'opération « Blooming Onion » – l'un des cas de travail forcé les plus horribles et les plus vastes de l'histoire récente : d'innombrables ouvriers agricoles retenus contre leur gré, beaucoup soumis à une violence terrible et à une exploitation brutale, deux travailleurs ont travaillé jusqu'à la mort dans la chaleur tandis qu'un autre a été tenu en esclavage sexuel.
Malheureusement, ce n'est pas nouveau pour le géant de l'épicerie : les produits sur les étagères de Kroger ont été attribués non pas à un, mais à trois réseaux de travail forcédistincts au cours des quatre dernières années. Il semble que lorsqu'il défend le bien-être de « toute la famille », Kroger n'inclut pas encore les hommes et les femmes qui récoltent les fruits et légumes qu'il vend à vous et à votre famille.
Le silence retentissant de Kroger face à cette crise des droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement est d'autant plus scandaleux qu'il refuse de rejoindre le Fair Food Program, un programme de droits de l'homme dirigé par les travailleurs, lauréat de la médaille présidentielle et ayant fait ses preuves dans l'éradication du travail forcé en donnant aux travailleurs les moyens d'être les observateurs de première ligne de leurs propres droits.
Aujourd'hui, nous vous appelons à rejoindre Esperanza, les dirigeants des travailleurs agricoles et d'autres consommateurs conscients pour une véritable célébration au Festival du bien-être de cette année en appelant Kroger à rejoindre enfin le programme d'alimentation équitable et à faire sa part pour inaugurer une nouvelle journée des droits de l'homme pour les travailleurs agricoles du monde entier !
Vous ne pouvez pas vous rendre à notre célébration ? Aucun problème ! Voici 5 autres façons de contribuer à l'appel des travailleurs agricoles pour que Kroger rejoigne le programme d'alimentation équitable :
1. Appelez Kroger
Composez le 1-800-576-4377
Pour parler à un représentant du service, appuyez sur 8 puis sur 3 après avoir écouté les options du menu. Une fois qu'ils sont en ligne, faites-leur savoir qu'il est temps pour Kroger de rejoindre le programme d'alimentation équitable ! Nous avons une suggestion de script ici, que vous pouvez lire au représentant.
2. Démarrez un chat en direct avec Kroger et copiez/collez le script
Cliquez sur « Lancer le chat en direct » à https://www.kroger.com/hc/help/contact-us
Vous pouvez sauter les options du menu en tapant « parler à un humain » dans le chat jusqu'à ce que le service automatisé vous mette en relation avec un agent. Vous n'avez pas à fournir votre nom ou votre adresse e-mail. Vous pouvez appuyer sur « Ignorer » sur toutes les options concernant le département et le problème auxquels vous souhaitez diriger votre chat. Le service automatisé de Kroger vous mettra ensuite en relation avec un agent en direct. Vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant de vous connecter à l'un d'entre eux, mais gardez l'onglet ouvert et restez en ligne ! Une fois que vous êtes connecté à quelqu'un, partagez simplement le message de la Fair Food Nation dans le chat ! Vous pouvez rester en ligne pour répondre à l'agent, ou vous pouvez simplement quitter l'onglet.
3. Envoyez un e-mail à Kroger
Envoyez un e-mail à customerservice@kroger.com avec le titre suggéré : « Il est temps pour Kroger de rejoindre le programme d'alimentation équitable » et incluez votre message dans le corps de l'e-mail. Nous avons suggéré un script, que vous pouvez copier/coller dans le corps de l'e-mail.
Vous pouvez également remplir ce formulaire rapide, qui enverra automatiquement un e-mail au service client de Kroger et aux dirigeants de Kroger avec le script.
4. Jetez un coup d'œil à nos publications Instagram et taguez Kroger ! @krogerco
Vous pouvez également commenter les publications de Kroger sur Facebook, Instagram, X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et LinkedIn pour exiger qu'ils rejoignent le programme d'alimentation équitable !
5.Envoyez une lettre à votre Kroger local pour leur demander de rejoindre le programme d'alimentation équitable
Si vous faites vos achats dans un magasin Kroger ou si vous habitez à proximité, vous pouvez imprimer la lettre du CIWet la remettre au gérant de ce magasin. Vous voulez une version numérique ? Vous pouvez également demander qu'une copie vous soit envoyée par la poste en envoyant un e-mail à workers@ciw-online.org avec la ligne d'objet « Demande de lettre Kroger ». Vous pouvez le livrer à l'un des endroits suivants : Kroger, Baker's, City Market, Copps, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry's, Gerbes, Harris Teeter, Jay C Food Store, King Soopers, Mariano's, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick 'n Save, Owen's, QFC, Ralphs, Roundy's, Ruler et Smith's Food and Drug.
La Coalition des travailleurs d'Immokalee (CIW) est une organisation de défense des droits humains basée sur les travailleurs reconnue internationalement pour ses réalisations dans la lutte contre la traite des êtres humains et la violence sexiste au travail. L'ICM est également reconnue pour avoir été l'avant-garde de la conception et du développement du paradigme de la responsabilité sociale des travailleurs, une approche de la protection des droits de la personne dirigée par les travailleurs et imposée par le marché dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises.
Bâti sur une base d'organisation communautaire des travailleurs agricoles à partir de 1993, et renforcé par la création d'un réseau national de consommateurs depuis 2000, le travail de l'ICM n'a cessé de croître au cours de plus de vingt ans
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

USA – La droite trumpiste cible les syndicats

Introduction
A l'approche du scrutin présidentiel américain de novembre 2024, il importe pour apprécier les enjeux du résultat, tant au niveau interne US qu'au niveau mondial, de se pencher sur une facette pas assez connue des projets réactionnaires du camp trumpiste.
Si le racisme illustré par l'intention d'édifier un gigantesque mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique et d'expulser jusqu'à plusieurs millions de migrants, ou le sexisme incarné par la volonté talibanesque d'interdire nationalement le droit à l'IVG sont bien connus, le sujet des droits sociaux et notamment des droits syndicaux ne l'est pas autant.
21 septembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2024/09/21/usa-la-droite-trumpiste-cible-les-syndicats/
Le candidat de Trump au poste de vice-président, J.D Vance, a réintroduit son projet de législation pour des organisations conjointes travailleurs-employeurs pour remplacer les syndicats. La proposition est également poussée par le groupe de réflexion américain Compass et dans le cadre du « Projet 2025 » pour une prochaine administration Trump.
Le projet de législation Vance n'interdirait pas les syndicats. Il vise à marginaliser les syndicats via des forums conjoints travailleurs-employeurs. La question de savoir si les syndicats épuisés seraient alors purement et simplement interdits ou autorisés à une existence marginale dépendra.
Le « Projet 2025 » propose de retirer les syndicats de certains secteurs de l'administration fédérale, tels que le Ministère de la sécurité du territoire, et demande que « le Congrès examine si tous les syndicats du secteur public sont… compatibles avec le gouvernement constitutionnel ».
Pour éclairer la réflexion, nous reproduisons deux documents. D'abord un communiqué de presse récent du sénateur Rubio qui agit de concert avec JD Vance contre les droits d'action collective des travailleurs. Ensuite, un article de 2023 de Martin Thomas sur le détail des ambitions trumpistes liberticides envers les travailleurs.
Document 1 Rubio et Vance réintroduisent un projet de loi visant à « renforcer la voix des travailleurs »
17 janvier 2024 – Communiqués de presse
Les employés qui considèrent la question de la syndicalisation en sont souvent dissuadés par les échecs du Big Labor (le syndicalisme historique), qui place trop souvent ses positions politiques avant l'intérêt supérieur des travailleurs. Malheureusement, la capacité des travailleurs à négocier efficacement avec les employeurs est entravée par un régime réglementaire qui n'a pas changé depuis la Grande Dépression.
Les Sénateurs Marco Rubio (R-FL) et J.D. Vance (R-OH) ont réintroduit la proposition de Teamwork for Employees and Managers Act of 2024 afin de donner aux employés la possibilité volontaire de négocier avec les employeurs à leurs propres conditions et sans crainte d'une action en justice ou d'une ingérence bureaucratique, une pratique actuellement interdite par les lois existantes en matière de travail. La loi TEAM donnerait également aux travailleurs une présence au sein des principaux conseils d'administration en tant que membres sans droit de vote.
« Notre système de négociation collective est censé garantir de bonnes conditions et des compensations pour les travailleurs. Au lieu de cela, il met des millions de travailleurs entre un roc et une place difficile : avoir à choisir entre rester sans représentation et une direction syndicale « woke ». Les employés méritent une autre option. Cette législation donnerait aux travailleurs cette option, améliorerait les relations entre les travailleurs et les directions et aiderait à trouver de bons lieux de travail. » – Sénateur Rubio
Document 2 – Une analyse des projets de la droite conservatrice La droite trumpiste cible les syndicats
Les groupes de réflexion aux États-Unis travaillent d'arrache-pied pour esquisser les politiques et préparer le personnel d'une administration Trump en 2025-9. Certains ont des propositions alarmantes concernant le remplacement des syndicats par une organisation de travailleurs « non conflictuelle ».
Le mandat de Trump en 2017-21 a été chaotique. Bien que Trump se soit rallié une grande partie de la base républicaine de droite incrustée depuis des décennies dans les églises, les clubs de détenteurs d'armes à feu et les organisations républicaines locales, la plupart des cadres politiques de haut niveau de la droite n'ont pas fait confiance à Trump et ne s'attendaient pas à ce qu'il remporte l'élection de 2016.
Trump n'avait pas d'équipe cohérente pour traduire sa démagogie en politiques détaillées et les faire passer à travers la machine gouvernementale, délabrée et à forte inertie, des États-Unis.
Après la tempête du 6 janvier 2021 du Capitole, il semblait d'abord que les hauts fonctionnaires de la droite américaine effaceraient Trump comme un embarras. En fait, Trump a ré-hégémonisé le parti républicain, y compris un plus grand nombre de ses cadres de haut niveau.
L'American Enterprise Institute et le Cato Institute, deux organismes partisans du marché libre, se tiennent à distance de Trump. La Heritage Foundation est plus proche. L'America First Policy Institute de Brooke Rollins et l'American Compass, dirigé par Oren Cass, jouent un rôle plus important.
L'AFPI est la plus alignée sur Trump, et dispose d'une rubrique sur son site web qui propose des « fondements bibliques » à leurs projets politiques. Sa prétention « pro-travailleurs » repose en grande partie sur l'affirmation selon laquelle la déréglementation favorise l'emploi. Cass, ancien conseiller du républicain anti-Trump Mitt Romney, a viré pro-Trump, il compte d'anciens responsables de Trump dans son équipe et offre plus de détails.
American Compass, soulignant les limites des marchés libres, fait des propositions détaillées pour « de nouvelles formes d'organisations des travailleurs qui pourraient offrir des avantages, travailler en collaboration avec la direction et négocier à l'échelle de l'industrie des conditions d'emploi de base ».
Elle propose des « comités patronaux-salariés non syndiqués » sur les lieux de travail, « des comités d'entreprise (parfois financés par l'employeur) où les représentants des salariés seraient habilités à discuter des questions d'intérêt commun avec la direction, dans une attitude non conflictuelle ». Elle prône des organisations de travailleurs plus larges dont la fonction principale est la distribution des prestations financées par l'État : « les États-Unis devraient établir des paramètres pour la création, la gouvernance et la composition des organismes de prestations aux travailleurs et les rendre éligibles à recevoir des fonds publics par l'administration des programmes publics ».
Son rapport ne dit pas explicitement que les syndicats actuels doivent être supprimés, mais seulement qu'ils doivent être exclus du champ de l'action politique. Il affirme toutefois que « la plupart des travailleurs disent préférer une organisation des travailleurs gérée conjointement par les travailleurs et la direction de l'entreprise » et suggère « une forme alternative de syndicat apolitique que les travailleurs préféreraient probablement » aux syndicats existants.
Tout cela est présenté comme une poussée en faveur des salariés, dans un style similaire à celui des mouvements d'extrême droite des années 1920 et 30 qui prétendaient que leur organisation de collaboration de classe forcée était plus avantageuse pour les travailleurs que les syndicats existants « trop politiques ».
La droite américaine ne s'inquiète pas pour l'instant du risque de voir la classe ouvrière prendre le pouvoir politique à brève échéance, comme l'extrême droite européenne s'en inquiétait dans les années 1920 et 1930. Elle diabolise le « Big Ed » (les universités), le « Big Government », considérés comme les moteurs de l'idéologie libérale ou progressiste et de réglementations gouvernementales qui entravent les affaires, et « le dirigeant syndical qui fait l'éloge de l'accès à l'avortement ou des mesures environnementales qui réduisent l'emploi [ou] qui verse les cotisations syndicales dans les caisses de guerre progressistes ».
Néanmoins la menace portée à la liberté des travailleurs d'organiser leurs propres syndicats et de déployer la force syndicale pour des causes sociales et politiques est grave.
Martin Thomas, 25/07/2023
Source : https://www.workersliberty.org/story/2023-07-25/trumpist-right-targets-unions
Traduction : aplutsoc
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. Trump se déclare comme « le parti de la classe ouvrière ». Qu’en est-il ?

Le Labor Day aux Etats-Unis [qui est fixé le premier lundi du mois de septembre, le 2 septembre cette année ; le premier a été « célébré » à New York en 1882] est traditionnellement considéré comme la fin de l'été et le début de la période la plus importante des campagnes politiques nationales. Il est l'occasion de parler beaucoup des travailleurs et des travailleuses et de l'emploi. 2024 n'a pas fait exception à la règle, et les discussions ont fusé des deux grands partis.
Tiré de A l'Encontre
22 septembre 2024
Par Lance Selfa
Shawn Fain lors de la Convention démocrate.
Du côté du Parti démocrate, cette aile du système politique états-unien promet des mesures visant à aider les travailleurs et travailleuses « non seulement à survivre, mais aussi à avancer ». Bien que la vice-présidente Kamala Harris et la plupart des politiciens démocrates affirment qu'ils font campagne pour la « classe moyenne », leurs porte-parole syndicaux ne sont pas aussi retenus. Après avoir qualifié l'ancien président Trump de « briseur de grève », le président de l'UAW (United Auto Workers), Shawn Fain, a qualifié Kamala Harris de « championne de la classe ouvrière » lors de son discours à la Convention nationale du Parti démocrate (DNC), en août [DNC réunie du 19 au 22 août à Chicago].
Du côté du GOP (Grand Old Party), l'aile républicaine, conservatrice, du système politique états-unien, la prétention est différente : le Parti républicain s'affirme désormais le « parti de la classe ouvrière ». Comment cela se fait-il ? Cela provient de sondages d'opinion et d'enquêtes à la sortie des urnes, le jour de l'élection. Ils « démontrent » que Trump et les Républicains ont rallié près de deux tiers des électeurs qui n'ont pas le baccalauréat. Il s'agit là de la définition médiatique standard de la « classe ouvrière » aux Etats-Unis.
D'un point de vue socialiste, il est plus juste de dire qu'aucun des deux grands partis – les deux partis capitalistes – n'est un parti de la « classe ouvrière », même si la plupart des personnes qui votent pour les deux partis sont, de par leur profession, des travailleurs et travailleuses non syndiqués [1]. Mais aucun des deux partis ne défend les intérêts de la classe ouvrière, même si la plupart des syndicats – à quelques exceptions notables près [2] – soutiennent les démocrates et s'efforcent de faire voter pour eux.
***
Mais commençons là où le gros des médias et la plupart des commentaires libéraux commencent : c'est-à-dire par les affirmations républicaines selon lesquelles le soutien de Trump repose sur une classe ouvrière « laissée pour compte » qui considère les démocrates comme les représentants d'une élite de la côte Est « branchée » qui les dédaigne.
Le premier point à souligner est que nous ne parlons certainement pas de la classe ouvrière états-unienne dans son ensemble. La classe ouvrière états-unienne est multiraciale et composée de manière plus que proportionnelle de personnes de couleur. Elle comprend des hommes et des femmes, des personnes aux identités sexuelles différentes, de religions différentes (et, de plus en plus, sans religion). Elle se compose de différents groupes d'âge.
Commençons donc par nous concentrer sur les membres blancs de cette classe ouvrière. Mais, dès lors, nous nous heurtons dans la foulée à d'autres problèmes de définition. Pour les experts et les chercheurs, la définition la plus courante de la « classe ouvrière blanche » est celle des Blancs qui n'ont pas obtenu le baccalauréat ou un diplôme supérieur. Bien que le niveau d'éducation soit certainement lié aux types d'emplois occupés, il est beaucoup plus facile de saisir le niveau d'éducation que la profession dans les enquêtes. Selon cette définition, les « Blancs de la classe ouvrière » représentent environ 44 % de la population états-unienne âgée de 18 ans et plus.
Le fait d'assimiler le niveau d'éducation à la classe sociale pose de nombreux problèmes. Le plus évident est que cette définition ne tient pas compte de ce qu'un marxiste considérerait comme la norme de base pour déterminer l'appartenance de classe d'une personne : son emploi et sa relation au capital (le rapport social capital-travail). En outre, comme l'a écrit Larry M. Bartels, politologue à l'université de Princeton, dans une critique [3] de l'ouvrage de Thomas Frank, paru en 2004 (Ed. Metropolitan Books), What's the Matter with Kansas ? How Conservatives won the Heart of America, la population non diplômée des Etats-Unis reflète la répartition des revenus de la population.
Mais il existe d'autres problèmes plus patents liés aux deux points ci-dessus. Le plus important est que l'exclusion [dans ce type de sondages] des personnes titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur exclut des travailleurs et travailleuses tels que la plupart des infirmières et autres employé·e·s du secteur de la santé, ainsi que la plupart des enseignant·e·s de la maternelle à la terminale. Les travailleurs et travailleuses des secteurs de l'éducation et de la santé ont été parmi les plus actifs dans l'action collective ces dernières années. Deuxièmement, si la main-d'œuvre non diplômée reflète la répartition des revenus de la population, les revenus supérieurs à la médiane sont très probablement associés aux propriétaires de petites entreprises et aux agents de maîtrise de niveau inférieur.
La partie de la population qui n'a pas de diplôme universitaire est également plus fortement représentée par les personnes plus âgées, qui ont tendance à être plus traditionnelles d'un point de vue culturel. Pour un chercheur du Beltway [région délimitée par l'autoroute périphérique qui encercle Washington] cependant, tous les Blancs de la classe ouvrière – et de plus en plus de Latinos et d'Afro-Américains non diplômés – sont facilement catalogués dans la « base » conservatrice, avec tous les stéréotypes que cette image implique : adeptes de la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), misogynes, détenteurs d'armes à feu et téléspectateurs de Fox News. Mais au-delà de la caricature, la réalité est bien plus complexe.
***
Même parmi les électeurs blancs, l'éducation n'est pas une ligne de démarcation à toute épreuve, surtout si l'on tient compte du revenu (un indicateur insuffisant, mais un peu plus direct que le baccalauréat, de la classe sociale). Les électeurs et électrices à faible revenu, toutes origines ethniques confondues, sont encore plus susceptibles de voter pour les démocrates, malgré la préférence bien documentée du parti pour les suburbains de la classe moyenne.
Pour cette raison, les responsables politiques ont toujours reconnu que le point de vue de la classe ouvrière était divisé. En fait, le service de prospection de l'AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) identifie trois groupes de travailleurs et travailleuses : les réactionnaires/conservateurs qui pourraient être considérés comme faisant partie de la base de Trump ; les libéraux/progressistes (souvent des membres actifs de syndicats) qui sont des partisans du Parti démocrate, et le reste dont les opinions politiques se situent quelque part entre les deux. Près de trois électeurs/électrices démocrates sur cinq aux élections présidentielles de 2020 n'étaient pas titulaires d'un bachelor.
Cette insistance sur les moins-éduqués, les bas-revenus comme fraction de la base électorale de Trump obscurcit le fait que le trumpisme a trouvé un fort écho chez les secteurs des classes moyennes et élevées des Etats-Unis. Il n'y a pas que les milliardaires de Wall Street et de la Silicon Valley qui ont fait parler d'eux en soutenant Trump, et il est clair qu'une « gentry » de la dite classe moyenne compte parmi ses plus fervents partisans. Le profil professionnel des plus de 1000 personnes arrêtées à la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole a révélé un pourcentage élevé de membres des forces de l'ordre, d'anciens militaires, de professions libérales et de propriétaires de petites entreprises.
S'il est vrai que la formule : « partisans de Trump = travailleurs » obscurcit plus qu'elle n'explique, cela signifie-t-il que les démocrates sont les champions de la classe ouvrière ? En un mot, non. Malgré le soutien de la plupart des dirigeants syndicaux, y compris le soutien non critique du président de l'UAW, Shawn Fain, à la vice-présidente Kamala Harris lors de la Convention démocrate du mois dernier, le Parti démocrate reste un parti entrepreneur néolibéral dont les orientations sont plus proches de la démocratie chrétienne d'après la Seconde Guerre mondiale que de la social-démocratie de l'après-guerre.
***
Le programme économique de Kamala Harris, un vague appel à la construction d'une « économie des opportunités », comprend jusqu'à présent un ensemble de politiques (sans doute testées par les sondages) : aide à l'accession à la propriété pour les primo-accédants, crédits d'impôt pour les familles avec enfants, et une déduction fiscale de 50'000 dollars pour les petites entreprises en phase de démarrage. Il est révélateur que la plus généreuse de ces mesures s'adresse aux propriétaires de petites entreprises [4]. Lors du débat qui l'a opposée à Donald Trump le 10 septembre, Kamala Harris a à peine évoqué la question de la santé, se contentant de promettre de protéger la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act, dit aussi Obamacare). Et si la défense du droit à l'avortement est certainement une question qui concerne la classe laborieuse, il en va de même pour le soutien des droits des immigré·e·s, qui constituent une part essentielle de la classe ouvrière des Etats-Unis. Mais Joe Biden et Kamala Harris ont essentiellement sacrifié la question de l'immigration (ainsi que celle de la délinquance) à la droite trumpiste [5]. Tout cela ne constitue pas un programme solide pour la classe laborieuse.
Comme toujours, les démocrates espèrent que la peur de Trump et du « Projet 2025 » [de la très conservatrice Heritage Foundation] suffira à maintenir leurs partisans dans le rang. Mais le fait que Trump reste en tête parmi les personnes qui déclarent que l'économie est leur principale préoccupation et que les inquiétudes concernant l'inflation [entre autres, les prix de l'alimentaire, de l'énergie, du logement] – qui frappe le plus durement les personnes à faible revenu – sont toujours d'actualité, cela joue en défaveur de la vice-présidente sortante.
Trump s'est peut-être approprié le créneau des racistes de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Mais pour les millions de personnes qui ne sont pas idéologiquement engagées et qui attendent de l'establishment politique qu'il s'attaque aux vrais problèmes de leur vie, Kamala Harris n'a proposé que le thé le plus léger. Il n'est pas étonnant que le « parti des non-votants » continue d'être majoritairement composé de membres de la classe ouvrière et que, malgré le programme anti-classe ouvrière de Trump, le scrutin reste trop serré pour être tranché. (Article reçu le 19 septembre 2024 ; traduction par rédaction A l'Encontre)
Lance Selfa est l'auteur de The Democrats : A Critical History (Haymarket, 2012) et éditeur de U.S. Politics in an Age of Uncertainty : Essays on a New Reality (Haymarket, 2017).
[1] En 2020, 10,8% de salarié·e·s étaient syndiqué·e·s ; en 2023, le taux de syndicalisation se situait à 10%, soit la moitié moins de ce qu'il était au début des années 1980. Dans le secteur privé, le taux s'élève à 6%, soit quelque 7,4 millions de salarié·e·s, mais le nombre de syndiqués a toutefois augmenté, de quelque 200'000. Le secteur public réunit presque la moitié des syndiqué·e·s (au total à peu près 12,5 millions), leur nombre a stagné ou reculé de 50'000 selon certaines recherches. Néanmoins, des enquêtes indiquent qu'au cours des quatre dernières années le pourcentage de salarié·e·s qui manifestent la volonté de disposer d'un syndicat a fortement augmenté, en passant de 48% à 70%. Le patronat, avec ses relais politico-judiciaires, multiplie les obstacles à la syndicalisation. (Réd.)
[2] Les Teamsters (International Brotherhood of Teamsters) organisant, entre autres, les chauffeurs routiers, ont annoncé, le 18 septembre, qu'ils ne soutenaient aucun des deux candidats. Cela en rupture avec une « tradition » remontant à 2000 : ils appuyaient depuis lors le candidat démocrate. Certes, en 1984, la direction a appuyé Ronald Reagan et en 1988 Georges H.W. Bush. Selon deux sondages, la base du syndicat semblait favorable à Trump. (Réd.)
[3] « What's the Matter with What's the Matter with Kansas », in Quarterly Journal of Political Science, 2006. (Réd.)
[4] Le quotidien français Les Echos du 5 septembre écrit : « Mardi [3 septembre], à Portsmouth dans le New Hampshire, elle [Kamala Harris] a réaffirmé son vœu de bâtir une « économie des opportunités », et expliqué comment cela profitera aux petits entrepreneurs. L'objectif est de parvenir à 25 millions de créations d'entreprises pendant son mandat si elle est élue – encore plus que le score de 19 millions sous Joe Biden. La candidate démocrate a promis de décupler la déduction fiscale applicable aux dépenses liées à la création d'entreprise, à 50'000 dollars, et de réduire les tracasseries administratives pour les entrepreneurs. Surtout, elle a annoncé une hausse de la taxation des gains en capital bien moins élevée que celle que promettait Joe Biden avant de quitter la course présidentielle. » (Réd.)
[5] Voir sur cette question, en langue français, les études de Loïc Wacquant et Didier Fassin. (Réd).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Kamala Harris s’attaquera-t-elle à la cupidité des entreprises ? Les commentaires de Ralph Nader et de Joe Stiglitz sur le débat, les tarifs douaniers de Trump et d’autres questions

Nous nous entretenons avec Ralph Nader, défenseur des consommateurs, et Joseph Stiglitz, économiste lauréat du prix Nobel, au sujet du débat de mardi entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump.
Tiré de Democracy Now
Democracy now https://www.democracynow.org/2024
Part I : Will Harris Take on Corporate Greed ? Ralph Nader & Joe Stiglitz on
Debate, Trump's Tariffs & More
traduction Johan Wallengren
Le 11 septembre 2024
Invités
• Joseph Stiglitz
Économiste lauréat du prix Nobel, professeur à l'université Columbia, président du Council of Economic Advisers (CEA, littéralement « Conseil des conseillers économiques ») sous l'administration Clinton, il est actuellement économiste en chef de l'Institut Roosevelt.
• Ralph Nader
Défenseur des consommateurs et critique de la grande entreprise, il a été quatre fois candidat à l'élection présidentielle.
Stiglitz estime que les projets politiques de Trump, qui comportent notamment de fortes hausses des droits de douane, entraîneraient « une plus forte inflation et une croissance plus lente » et feraient des ravages dans l'économie américaine. M. Nader considère qu'il est facile de faire bonne figure à côté de M. Trump, mais que Madame Harris ne remet pas fondamentalement en question la cupidité des entreprises, le rôle du complexe militaro-industriel, la destruction de l'environnement, ainsi que bien d'autres maux.
Transcription
Ceci est une traduction de la version la plus immédiate de la transcription, qui pourrait ne pas être finale.
AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now !, democracynow.org. Mon nom est Amy Goodman. Avec Juan González, nous continuons de nous pencher sur le débat de mardi soir. Voyons voir ce qui s'est dit au sujet de l'économie. Voici la vice-présidente Kamala Harris qui s'exprime lors du débat présidentiel sur ABC News.
KAMALA HARRIS : Donald Trump n'a pas de plan pour vous. Et quand vous regardez son plan économique, il ne s'agit que d'allègements fiscaux pour les plus riches. Je propose ce que j'appelle une économie offrant tout un éventail de possibilités. Les meilleurs économistes de notre pays, voire du monde entier, ont examiné nos plans portant sur l'avenir de l'Amérique. Ce que Goldman Sachs a dit, c'est que le plan de Donald Trump ferait du mal à l'économie, tandis que le mien la renforcerait. Ce que la Wharton School a dit, c'est que le plan de Donald Trump ferait exploser le déficit. Seize lauréats du prix Nobel ont décrit son plan économique comme quelque chose qui ferait augmenter l'inflation et paverait la voie à une récession d'ici le milieu de l'année prochaine.
DONALD TRUMP : Nous allons encaisser des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Je n'ai pas eu d'inflation, pratiquement pas d'inflation. Ils ont eu l'inflation la plus élevée qu'on ait vue de toute l'histoire de notre pays peut-être, parce que je n'ai jamais vu une période où les choses sont allées plus mal que ça. Les gens ne peuvent pas aller acheter des céréales, du bacon, des œufs ou quoi que ce soit d'autre. Les citoyens de notre pays sont tout simplement en train de mourir avec ce que nos adversaires ont fait. Ils ont détruit l'économie. Et il suffit de regarder un sondage. Les sondages disent à 80, 85 et même 90 % que l'économie de Trump était formidable, que leur économie a été épouvantable.
AMY GOODMAN : Se joint maintenant à nous Joseph Stiglitz, économiste lauréat du prix Nobel, professeur à l'université de Columbia, qui a été président du Conseil des conseillers économiques. Professeur Stiglitz est également l'économiste en chef de l'Institut Roosevelt et compte parmi les 16 économistes lauréats du prix Nobel qui ont mis en garde contre les politiques de Trump. Et nous sommes aussi rejoints par Ralph Nader, défenseur des consommateurs de longue date et critique de la grande entreprise qui a été candidat à l'élection présidentielle. Son dernier livre est Let's Start the Revolution : Tools for Displacing the Corporate State and Building a Country That Works for the People (traduction non officielle : Commençons la révolution : des outils pour extirper les grandes entreprises de l'appareil d'état et construire un pays qui répond aux aspirations du peuple).
Professeur Stiglitz, quelle est votre réaction à ce que nous venons de voir ?
JOSEPH STIGLITZ : Eh bien, le fait est qu'il n'a pas de plan pour l'économie. Il a fait des propositions qui conduiront à plus d'inflation et à une croissance plus lente. Non seulement il y a les problèmes à court terme, mais à long terme, il va saper la croissance du pays et faire perdre ainsi aux États-Unis leur avantage stratégique. Permettez-moi de vous donner deux exemples.
Il a proposé des droits de douane énormes. Or, les droits de douane ne sont qu'une taxe. Ils portent sur des produits que les gens achètent tous les jours. Et ces droits de douane énormes feront augmenter l'inflation. Il s'est opposé à l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation) dont une disposition importante vise à faire baisser les prix des médicaments. Cette disposition prévoit que le gouvernement peut négocier avec les entreprises pharmaceutiques pour faire baisser les prix. Or, il va abroger cette disposition. Résultat, les prix des médicaments vont grimper.
D'un autre côté, à long terme, ce qui est important, la raison pour laquelle notre économie est plus forte que celle d'autres pays, c'est notre innovation technologique, nos universités, nos activités scientifiques. Qu'a-t-il proposé ? Nous l'avons vu à l'œuvre quand il était président, avec ses coupes sombres dans les budgets consacrés à la science. L'une des raisons pour lesquelles les économistes s'accordent à dire que l'économie américaine se porte bien est l'État de droit. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour saper l'État de droit, y compris en menaçant la banque centrale de lui enlever son indépendance.
Donc, si vous examinez l'ensemble de ses propositions, vous constaterez qu'il s'agit d'un ensemble de propositions bien bonnes et bien belles pour les très riches, parce qu'il va réduire les impôts des milliardaires et des grandes entreprises qui amassent les profits, mais pour l'économie en général, il y aura une augmentation des prix, une augmentation de l'inflation, un ralentissement de la croissance, une augmentation du chômage. Pour reprendre un mot qu'il utilise lui-même, ce serait un désastre.
JUAN GONZÁLEZ : Mais, Professeur Stiglitz, sur la question des droits de douane, l'administration Biden n'est-elle pas dans une position un peu plus faible, étant donné qu'elle a maintenu les droits de douane que Trump avait imposés à la Chine, comme il l'a mentionné dans le débat, et que Biden propose, par exemple, des droits de douane encore plus élevés sur les véhicules électriques et d'autres sortes de biens en provenance de Chine ?
JOSEPH STIGLITZ : Eh bien, vous savez, l'une des différences majeures entre Trump et Harris est la modération et le sens de l'équilibre dont fait preuve cette dernière. Il y a bien des situations où on a des objectifs multiples et on doit faire très attention à trouver un équilibre entre eux. L'un de nos objectifs est de devenir moins dépendants de la Chine. Vous savez, lors de la pandémie, nous ne pouvions même pas produire les masques dont nous avions besoin. Nous avons dû les faire venir de Chine. Nous achetons des transistors à Taïwan. Nous devons devenir plus indépendants dans ce domaine également. Mais nous recevons des quantités affolantes de choses de la Chine et nous devons devenir plus indépendants, plus résilients. Et c'est là que les droits de douane imposés à la Chine envoient à nos entreprises un signal important : il faut rendre nos chaînes d'approvisionnement plus robustes. Et c'est ce qu'ils essaient de faire.
Que veut faire Trump ? Il veut augmenter ces droits de 50, 60 %. Cela entraînerait un blocage. Et qui paierait le prix de ce blocage ? Les consommateurs et les travailleurs américains. Nous recevons beaucoup de pièces détachées dont nous ne pouvons nous passer. L'industrie manufacturière en souffrirait. Toute notre économie serait mise à rude épreuve.
AMY GOODMAN : Ralph Nader, je voudrais vous faire intervenir à ce moment de la conversation. Vous avez écrit Let's Start the Revolution - Tools for Displacing the Corporate State and Building a Country That Works for the People (traduction non officielle : Commençons la révolution - des outils pour extirper les grandes entreprises de l'appareil d'état et construire un pays qui répond aux aspirations du peuple). Vous avez parlé des deux partis comme d'un duopole. Pensez-vous que le débat a couvert les sujets, les questions économiques qui comptent pour le plus grand nombre ?
RALPH NADER : Non, en fait, ça a été une occasion manquée pour Kamala Harris. Il est facile de faire bonne figure à côté de Trump. Il ment. Il fulmine. Il répète huit fois les mêmes mensonges sur l'immigration, par exemple, comme Juan l'a signalé. Mais à la base, elle a dit qu'elle voulait être la présidente de l'ensemble du peuple. Évidemment, bon, il n'y a pas grande différence entre ce qu'elle a dit ou non, par rapport à Biden.
Elle a répété encore une fois qu'Israël avait le droit de se défendre. Israël est l'auteur d'un massacre de plus de 300 000 Palestiniens déjà, procède à des bombardements au Liban, agit à sa guise en se servant d'armes américaines. Et elle n'arrive pas à dire que les Palestiniens ont le droit de se défendre. Ce sont eux qui sont occupés et opprimés depuis toutes ces décennies. Donc on voit très peu de différence.
Elle a flatté l'industrie pétrolière et gazière dans le sens du poil en soulignant que la production de pétrole et de gaz a atteint un niveau record. Elle n'a guère fait que mentionner la question de la violence climatique, sans s'encombrer de détails à ce sujet. Elle ne s'est pas prononcée en faveur d'une assurance maladie complète, rejoignant M. Biden sur ce point. Ce dernier n'aime pas l'idée d'un système complet d'assurance-maladie. Elle a rassuré le complexe militaro-industriel en affirmant qu'elle disposerait de la meilleure force de frappe au monde. Elle n'a pas vraiment abordé la question des impôts à récupérer auprès des sociétés géantes qui sont loin d'en payer assez, qui… vous le savez, nombre d'entre elles réalisent des milliards de bénéfices aux États-Unis et ne paient pas d'impôts, ou si peu.
Elle ne s'est même pas attaquée à Trump pour ses violations majeures de la loi fédérale et même de la Constitution. C'est ce qui peut nuire le plus à la réputation à Trump. C'est un violeur de lois en série.
Et le plus étonnant, Amy, c'est qu'elle n'a même pas mis le salaire minimum au cœur du débat. Les démocrates n'ont nulle considération authentique pour le salaire minimum. Il y a 25 millions de personnes dans ce pays qui gagnent moins de 15 dollars de l'heure.
C'est donc sur de tels tabous que je me concentre, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre et c'est pour cette raison que nous avons CapitolHillCitizen.com, ce site à partir duquel les gens peuvent obtenir par poste prioritaire un exemplaire de notre bulletin. En effet, si nous laissons tous ces tabous perdurer, si nous ne parlons pas des centaines de milliards de dollars d'aide aux entreprises ni des pratiques capitalistiques, des renflouements, des subventions et des cadeaux assortis de garanties du gouvernement, si nous passons sous silence la vague de criminalité d'entreprise dont la presse grand public révèle le caractère abusif, donc en l'absence de répression dirigée contre les escrocs au sein des entreprises – bien qu'elle se vante de son passé de procureure – on ne parle pas de redonner du pouvoir aux travailleurs au sein des syndicats, ce n'est pas le propos de Kamala Harris, on ne parle pas de mettre fin à l'influence du grand capital sur le jeu politique, bien sûr.
Et tout le monde se répétait dans ce débat. Voilà ce qu'il a fait… c'est le perroquet des débats. Il ne fait que parler à sa base.
AMY GOODMAN : Eh bien, Ralph, nous allons…
RALPH NADER : Mais elle a eu beaucoup d'occasions de porter les discussions à un autre niveau. Si on n'élargit pas l'horizon, si on ne structure pas le dialogue public pour lui donner plus de portée, alors on ne peut pas prêter attention aux dommages qui sont infligés à notre société démocratique...
AMY GOODMAN : Eh bien, Ralph…
RALPH NADER : … et au rôle des travailleurs et des consommateurs.
AMY GOODMAN : Ralph, nous allons poursuivre ce débat - et c'est sûr que ce sera tout un débat - entre vous et le professeur Stiglitz et après l'émission, nous publierons les échanges en ligne sur democracynow.org.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ralph Nader et Joseph Stiglitz se prononcent sur les plans économiques de Kamala Harris et l’opposition au pouvoir de la grande entreprise

Democray now https://www.democracynow.org/2024
Part II : Ralph Nader & Joseph Stiglitz on Kamala Harris's Economic Plans &
Confronting Corporate Power
Traduction Johan Wallengren
Le 11 septembre 2024
Invités
• Joseph Stiglitz
Économiste lauréat du prix Nobel, professeur à l'université Columbia, président du Council of Economic Advisers (CEA, littéralement « Conseil des conseillers économiques ») sous l'administration Clinton, il est actuellement économiste en chef de l'Institut Roosevelt.
• Ralph Nader
Défenseur des consommateurs et critique de la grande entreprise, il a été quatre fois candidat à l'élection présidentielle.
AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now !, democracynow.org, volet « Guerre, paix et présidence ». Mon nom est Amy Goodman.
À huit semaines seulement de l'élection présidentielle, nous continuons d'examiner la course présidentielle et le débat de mardi soir sur ABC News entre la vice-présidente Kamala Harris et Donald Trump. Ce débat était animé par Linsey Davis et David Muir d'ABC. Voici le président Trump.
DONALD TRUMP : J'ai construit l'une des plus grandes économies de l'histoire du monde et je vais le faire à nouveau. Elle sera plus grande, meilleure et plus forte. Mais ils sont en train de détruire notre économie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est une bonne économie. Leurs politiques pétrolières, chacune de leurs politiques… et souvenez-vous de ceci : elle est Biden. Vous savez, elle essaie de se dissocier de Biden. « Je ne connais pas ce monsieur », dit-elle. Elle est Biden. La pire inflation que nous ayons jamais eue, une économie horrible parce que l'inflation l'a rendue si mauvaise, elle ne peut pas juste s'en laver les mains.
DAVID MUIR : Monsieur le Président, merci. Votre temps est écoulé. Linsey ?
KAMALA HARRIS : Je voudrais répondre à ça, par contre. Je voudrais juste répondre brièvement.
Il est clair que je ne suis pas Joe Biden et que je ne suis certainement pas Donald Trump. Et ce que je présente, c'est une nouvelle génération de dirigeants pour notre pays, des gens qui croient aux réalisations dont nous sommes capables, qui amènent un vent d'optimisme par rapport à ce que nous pouvons faire, au lieu de toujours dénigrer le peuple américain.
AMY GOODMAN : Toujours avec nous, nous avons l'économiste Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, professeur à l'université de Columbia, ancien président du Conseil des conseillers économiques. Le professeur Stiglitz est également l'économiste en chef de l'Institut Roosevelt et l'un des 16 économistes lauréats du prix Nobel qui ont lancé une mise en garde à l'égard des politiques de Trump. Dans cette deuxième partie de notre discussion sur l'économie et le débat présidentiel, nous avons aussi à nos côtés Ralph Nader, défenseur des consommateurs de longue date, critique de la grande entreprise et ancien candidat à l'élection présidentielle. Son dernier livre s'intitule Let's Start the Revolution : Tools for Displacing the Corporate State and Building a Country That Works for the People (traduction non officielle : Commençons la révolution : des outils pour extirper les grandes entreprises de l'appareil d'état et construire un pays qui répond aux aspirations du peuple). Il est également le fondateur du mensuel Capitol Hill Citizen (citoyen de Capitol Hill).
Merci à vous deux d'être restés avec nous. Professeur Stiglitz, pouvez-vous élargir la discussion – en réagissant déjà à ce qui est dit dans le clip – et dire si vous pensez que soit Harris, soit Trump présente une approche économique qui aidera réellement l'Américains moyen ?
JOSEPH STIGLITZ : Eh bien, tout d'abord, l'une des choses que Trump prétend est qu'il a construit l'économie et que Biden l'a détruite. Chaque président est confronté à des événements qui échappent à son contrôle, et il hérite d'une économie qui… dont les fondations sont ce qui été laissé par son prédécesseur.
Dans le cas de Trump, il a hérité d'une économie qui se remettait d'une récession très profonde causée par la mauvaise gestion du secteur financier par Bush lorsqu'il était président. Lorsque Trump est arrivé dans le paysage, nous étions finalement en train de nous remettre de cette récession. Il a ensuite fait passer une loi fiscale qui était censée donner un coup de fouet à l'économie. Ce qu'elle a fait, c'est donner un coup de fouet aux rachats d'actions. Il s'agissait d'une réduction d'impôts pour les milliardaires et les grandes entreprises. Elle a exacerbé l'un des principaux problèmes de l'Amérique : l'inégalité. Vous vous souvenez certainement de sa formule : « abroger et remplacer » ; il promettait d'abroger l'Obamacare et de le remplacer par autre chose. Il n'y est pas parvenu. Il n'a pas réussi à le faire, parce qu'il n'avait aucune solution de remplacement. Et à sa grande surprise, les Américains ont apprécié l'Obamacare. Ce n'était pas parfait, mais c'était tellement mieux que ce qu'il y avait avant.
Lorsque M. Biden a pris ses fonctions, il a hérité d'un véritable gâchis, parce que – sans chercher à blâmer Trump pour la pandémie, nous pouvons cependant blâmer Trump pour la façon dont il a géré la pandémie. Et le résultat de sa mauvaise gestion à cet égard a été la mort de plus d'un million d'Américains. Biden a donc dû construire à partir du gâchis dont il a hérité. À cause de la mauvaise gestion préalable, il y a eu d'énormes interruptions de l'offre, la demande s'est déplacée, et c'est ce qui a provoqué l'inflation. Ce n'était pas le fait de Biden. Ce que Biden a fait, c'est mettre en place un certain nombre de politiques pour remédier à la situation. Et s'il avait bénéficié de la coopération – d'une plus grande coopération du Congrès -, il aurait pu faire beaucoup plus. Par exemple, l'un des problèmes au départ était la pénurie de main-d'œuvre. Lorsqu'on est confronté à une pénurie de main-d'œuvre, que fait-on ? On cherche à augmenter la population active. Comment s'y prend-on ? Eh bien, l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'Amérique est la faible participation de la main-d'œuvre au marché du travail. Ce qu'il voulait faire, c'était créer des congés familiaux, des services de garde d'enfants. Ces mesures auraient augmenté l'offre de main-d'œuvre et auraient modéré les hausses de salaires. Cela aurait permis de réduire, de tempérer l'inflation. Or, du fait d'avoir gardé le bon cap en se concentrant sur le bon diagnostic, l'inflation a bel et bien chuté.
Il y a eu un autre élément qui a fait flamber l'inflation – encore une fois, on ne peut pas blâmer Biden pour ça – et c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Celle-ci a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires, du pétrole et de l'énergie. Là encore, une main ferme, des sanctions, une forte expansion de l'énergie, ont eu pour résultat que les prix élevés du pétrole n'ont pas duré.
Ce qui est frappant à propos de Madame Harris jusqu'à présent, c'est qu'elle a gardé le bon cap sans perdre de vue les problèmes sous-jacents. Permettez-moi d'en évoquer quelques-uns. Les gens s'inquiètent toujours au sujet de l'inflation. Oui, les prix ne sont pas redescendus à leur niveau antérieur, et ils ne retomberont pas à ce point. Mais le taux d'inflation a fortement baissé, à la surprise générale. Les coûts des soins de santé constituent une part importante de l'inflation. La loi de réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) a fait baisser ces coûts. Nous sommes enfin en mesure de négocier avec les laboratoires pharmaceutiques pour faire baisser les prix des médicaments.
Elle a parlé du logement. L'un des problèmes en la matière est que nous devons construire plus de maisons. Une partie du problème du logement est que nous n'avons pas eu droit au type d'innovation dont nous aurions besoin. Toutes nos ressources en matière d'innovation ont été canalisées vers la construction d'un meilleur système publicitaire. C'est ce à quoi s'emploie la majeure partie de la Silicon Valley : construire un meilleur système publicitaire permettant de cibler les gens de manière personnalisée. Nous avons besoin de plus d'innovation pour réduire le coût de la construction, et ça fait partie de ce qu'elle a proposé.
Je pourrais creuser le sujet, mais un autre problème important est celui du pouvoir sur le marché. C'est un très gros problème et l'administration Biden-Harris a mis en place un programme concerté pour briser, limiter l'exercice du pouvoir sur le marché. Une initiative très, très importante. Si nous brisons la mécanique du pouvoir sur le marché, alors il y aura plus de concurrence et, encore une fois, les prix diminueront. Donc, si vous regardez l'ensemble des mesures prévues, ce que je vois dans le programme de Harris, c'est un diagnostic des problèmes, ainsi que des propositions concrètes pour résoudre ces problèmes aujourd'hui et construire les fondations qui prépareront une meilleure économie à l'avenir.
AMY GOODMAN : Ralph Nader, voyez-vous avec autant d'optimisme le potentiel d'une administration Harris, d'une présidence Harris, pour ce qui est de prendre soin de l'économie ?
RALPH NADER : Pour ma part, non. Je veux dire qu'elle diagnostique certains des problèmes, mais elle ne diagnostique pas les obstacles, comme la mainmise de la grande entreprise sur le Congrès, qui a fait que la machine s'est grippée, a cessé de tourner rond, de telle sorte qu'un très grand nombre de propositions que les gens de ce pays appelaient de leurs vœux, qu'il s'agisse d'assurances ou de salaire minimum vital ou de budgets de lutte contre la criminalité des entreprises ou encore de l'audit du budget militaire et de l'élimination de l'énorme gaspillage dans ce secteur et de la réattribution des fonds, ont été bloquées. C'est donc toujours ça le problème. Vous savez, ils disent qu'ils vont faire ceci et qu'ils ont un plan pour cela, mais ils ne parlent pas des obstacles que cela implique. C'est donc sur ça que je me concentre.
Et il ne s'agit pas seulement des obstacles liés au pouvoir des entreprises et à leurs agissements criminels, au financement des campagnes électorales par celles-ci et à leur influence sur les médias. Il s'agit aussi du fait que les entreprises accélèrent leur hégémonie et leur suprématie dans tous les secteurs de notre pays. Ce sont elles qui élèvent nos enfants, vous savez, dans le goulag de la Silicon Valley, cinq à sept heures par jour, en s'interposant avec l'autorité parentale. Alors c'est dire à quel point elles ont le bras long, sans parler de leur contrôle stratégique du système fiscal. Une grande partie des budgets de dépenses sont faussés. Tout travail efficace sur le dérèglement climatique est bloqué par les compagnies pétrolières et gazières. Elles pillent les terres publiques. Elles portent atteinte aux pensions privées. Elles bloquent le salaire minimum.
On ne peut donc pas se contenter de dire « j'ai un plan ». Il faut parler d'un transfert de pouvoir. Il faut donner aux électeurs, aux petits contribuables, aux consommateurs, aux travailleurs le pouvoir de s'organiser, de s'exprimer, d'avoir accès aux tribunaux et aux législateurs de leur État et de leur pays. Il y a une grande tendance au verrouillage à Washington, au Congrès et dans les organismes exécutifs. Ils ne prennent même plus la peine de répondre aux lettres et aux pétitions. Il s'agit donc d'une crise démocratique de premier ordre.
AMY GOODMAN : Pouvez-vous nous donner votre avis, Professeur Stiglitz ?
JOSEPH STIGLITZ : Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses que Ralph a dites. Je pense que les contributions aux campagnes électorales doivent faire l'objet d'une réforme de premier ordre. Je pense que les problèmes liés à la Cour suprême et à sa structure nécessitent aussi un remaniement de premier ordre. Et s'ils ne peuvent pas faire adopter un amendement constitutionnel, ce qui est certes très difficile dans le cadre de la Constitution actuelle, ils peuvent ajouter des juges. Et je pense qu'il sera absolument nécessaire, en l'absence d'un amendement constitutionnel limitant la durée des mandats et les abus de la Cour suprême, d'augmenter le nombre de juges pour rétablir l'équilibre et faire en sorte que la Cour suprême reflète les opinions du peuple américain.
Mais bon nombre des problèmes qu'il a soulevés sont déjà traités au sein de l'administration Biden. Et je pense que Harris poursuivra le travail : briser le pouvoir des entreprises en rendant les marchés plus compétitifs, augmenter les impôts sur les sociétés – au lieu de les réduire comme le voudrait Trump – afin qu'elles n'aient plus autant d'argent pour faire avancer leurs priorités à elles. Les républicains comme les démocrates sont très favorables à une mesure équivalente à ce que l'Europe appelle la Loi sur les services numériques (Digital Services Act), afin de mettre un terme aux abus dans l'espace numérique, tels que ceux émanant de Facebook, Twitter et autres – X, comme on l'appelle maintenant. Je pense que ce type de structure réglementaire est à l'ordre du jour, car les abus ont été tellement, tellement grands ! Vous savez, une des constatations qu'on peut faire au sujet de l'Amérique de la grande entreprise (« corporate America ») est qu'elle a été si avide que même les Américains modérés ont dit : « savez-vous, attendez voir, il faut faire quelque chose à ce sujet ».
AMY GOODMAN : Ralph Nader, pouvez-vous répondre à cela et développer ce que vous avez dit dans la première partie de notre discussion sur la question de l'augmentation du salaire minimum ?
RALPH NADER : Oui. Vous savez, Joe, j'ai essayé de faire en sorte que les syndicats fassent du salaire minimum le thème principal de la fête du travail. Ce projet a été très bien accueilli par Liz Shuler, la fédération syndicale AFL-CIO et d'autres grands dirigeants syndicaux. Ils ont fait passer la proposition devant le Comité national démocrate (National Democratic Committee), qui l'a rejetée. Ils ne voulaient pas d'un grand nombre d'événements partout au pays qu'ils ne pourraient pas contrôler, avec un pacte pour les travailleurs américains – pas seulement le salaire minimum, mais aussi la sécurité des travailleurs et l'abrogation de la Loi Taft-Hartley, etc., toutes ces choses qui vous sont familières.
Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Elle aurait dû insister davantage sur la suppression de votants par les républicains et Trump, car c'est l'une des raisons pour lesquelles ils perdent ces courses serrées au Congrès. Et si vous ne contrôlez pas le Congrès, vous ne pouvez rien faire de toutes ces choses. Le Congrès est le principal rempart quand il s'agit de s'opposer et la voie royale quand il s'agit de légiférer. Et ils peinent à maintenir leurs positions au Congrès face à un parti républicain pourtant plus en retrait que jamais. Il faut donc parler du Congrès sans relâche. Ce qui signifie qu'il faut parler de l'argent des campagnes électorales.
Mais plus important encore, il faut parler de la nécessité d'inciter à voter ceux qui ne seraient pas portés à le faire. Il y aura environ 100 millions de non-votants en novembre. Il faut écouter des gens comme le révérend William Barber, qui vient d'écrire un livre qui a été totalement ignoré, Joe, intitulé White Poverty, (traduction non officielle : La pauvreté des Blancs) et qui essaie de dire que la question primordiale est celle des classes sociales. Ce n'est pas juste une question de race. C'en est aussi une de classes sociales. Et les problèmes de classes sociales alimentent la discrimination raciale. Donc, si vous ne parlez pas du Congrès lorsque vous évoquez l'avenir de notre pays, vous laissez de côté la principale source d'obstruction liée au pouvoir des entreprises dans notre pays.
AMY GOODMAN : Professeur Stiglitz...
RALPH NADER : Elles rôdent dans les couloirs du Congrès.
AMY GOODMAN : Votre réaction, Professeur Stiglitz ?
JOSEPH STIGLITZ : Non, je suis d'accord avec vous. L'appareil politique – la réforme de nos institutions politiques – est une question centrale. En fait, l'un des aspects qui me préoccupe le plus est le remaniement des circonscriptions électorales. Et nous avons une Cour suprême qui dit : « Oh, laissons les États décider ». Mais, bien sûr, le charcutage se passe dans les États – et ce serait à ceux-ci de résoudre le problème du charcutage ? C'est absurde. Et c'est un autre exemple de l'absurdité de notre Cour suprême. C'est pourquoi nous devons commencer par nous attaquer aux problèmes qui touchent la Cour suprême, qui a permis à l'argent de s'immiscer dans la politique de manière si corruptrice.
AMY GOODMAN : Je voulais poser une question sur Lina Khan (c'est une question qui a déjà été soulevée), qui est à la tête de la Commission fédérale du commerce, la FTC, et sur les milliardaires qui font pression pour que Kamala Harris nomme quelqu'un d'autre à sa place. Ralph Nader, pouvez-vous nous parler de l'importance de cette question, de ce qui est en jeu, des enjeux des deux côtés de la barrière ?
RALPH NADER : Eh bien, c'est le signe de l'activation de la Commission fédérale du commerce, après des années de calme plat, dans le domaine de l'antitrust (du côté de la protection des consommateurs, ça a malheureusement moins bougé). Mais elle a lancé de nombreuses poursuites contre le « trust » de la Silicon Valley, si on peut appeler ça comme ça, et en a fait de même pour des sociétés d'autres secteurs. Je pense que son mandat est assuré si Kamala Harris devient présidente. Elle bénéficie d'un très large soutien. Même J.D. Vance s'est prononcé en sa faveur par le passé.
AMY GOODMAN : Pouvez-vous également nous expliquer, Professeur Stiglitz, les pressions exercées par les partisans de Kamala Harris, comme par exemple Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, pour ce qui est de se débarrasser de Lina Khan ?
JOSEPH STIGLITZ : Eh bien, Lina Khan a adopté une position très ferme contre le pouvoir sur le marché, contre les monopoles, contre les abus de position dominante. Et il n'est pas surprenant que, compte tenu de ces positions fermes, les gens qui ont gagné leur argent en exerçant un pouvoir sur le marché et en abusant de leur position dominante, en lésant les consommateurs, ne l'aiment pas. Ce n'est donc pas surprenant que de nombreux contributeurs aux deux partis soient considérés comme suspects.
Mais les économistes ont de façon générale choisi leur camp. Si nous voulons avoir une économie dynamique, nous avons besoin de concurrence. Elle est la plus fervente avocate de la concurrence. De fantastiques décisions de justice sont venues appuyer ses démarches : Google a été déclaré en situation de monopole sur le marché des moteurs de recherche, des procès sont en cours pour s'attaquer au monopole de Google dans la sphère de la publicité et de nombreux autres procès contre les situations de pouvoir sur le marché sont dirigés contre toutes ces entreprises puissantes.
Permettez-moi juste de prendre… une position qui diffère de celle de Ralph. Parmi les questions importantes en ce qui a trait à la protection des consommateurs, il y a les questions de protection de la vie privée. Et elle s'est également attaquée à ces questions de protection de la vie privée, de manière très importante. Je pense donc qu'il y a à la fois… c'est en fait étonnant de voir l'audace avec laquelle la Commission fédérale du commerce et le ministère de la Justice se sont attaqués à ces questions.
Et permettez-moi de rappeler à ceux qui pensent qu'il s'agit de questions très abstraites que la concurrence est vraiment importante pour notre économie, car elle conditionne son dynamisme, sa capacité d'innovation, et que la concurrence… le manque de concurrence a produit davantage d'inflation, sachant que les entreprises ont le pouvoir d'augmenter les prix, et elles ont exercé ce pouvoir durant l'ère post-pandémique. Et quand la concurrence est insuffisante, leur pouvoir sur le marché donne aux grandes entreprises la capacité de nous exploiter de toutes sortes de façons, ce qui se vérifie sans arrêt. Il suffit de regarder les abus des banques et des cartes de crédit, des sociétés pharmaceutiques ; cela se produit dans toutes les sphères, comme l'internet, toutes les sphères où nous nous sentons qu'on ne nous laisse pas le choix. Pourquoi ce manque de choix ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence efficace.
AMY GOODMAN : Ralph Nader ?
RALPH NADER : Mais il y a, Joe… il y a une autre forme d'abus qui transcende la concurrence. Il s'agit de la fraude massive sur les factures. L'expert de Harvard, Malcolm Sparrow, spécialiste en mathématique appliquée, qui a étudié cette question, estime qu'au bas mot, rien que dans le secteur des soins de santé, 350 milliards de dollars par an, soit 10 % des dépenses, sont drainés par la fraude et la tricherie en matière de facturation. Et la Commission fédérale du commerce… j'espère pouvoir m'entretenir avec certains commissaires de la Commission fédérale du commerce à ce sujet – ils m'ont invité – n'a rien fait pour lutter contre la fraude sur les factures.
Un autre phénomène qui sape la concurrence, aussi réduite soit-elle, est que toutes les entreprises ont les mêmes clauses de contrat en petits caractères qui désavantagent les consommateurs de toutes sortes de façons. Le cas des compagnies aériennes est particulièrement flagrant : elles ont toutes les mêmes clauses unilatérales en petits caractères qui privent les consommateurs de la possibilité d'intenter des poursuites ; elles peuvent modifier les contrats à volonté, ce qu'on appelle la modification unilatérale, d'où l'arbitrage obligatoire. Tout ça a des conséquences économiques et engendre des exclusions juridiques et des injustices. Mais, vous savez, ce qui a été révélateur dans le cas des démocrates, c'est qu'ils ont abandonné le salaire minimum. Je sais que...
AMY GOODMAN : Avant de parler du salaire minimum, Ralph -
RALPH NADER : … vous avez réussi à convaincre Paul Krugman d'écrire sur le sujet, finalement.
AMY GOODMAN : Ralph, avant de parler du salaire minimum, pouvez-vous réagir à ce qui vient d'être dit ?
JOSEPH STIGLITZ : Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Et il y a d'autres dispositions, comme les ententes de non-divulgation, qui ont joué un rôle très important dans beaucoup d'autres cas, notamment ceux de discrimination. Mais il y a une autre chose que je tenais à souligner : les économistes ont enfin commencé à parler du pouvoir de monopsone, le pouvoir sur le marché du travail. De même que les situations de monopole permettent de hausser les prix, rendant les travailleurs, les citoyens ordinaires, plus pauvres, le pouvoir de monopsone exerce une pression à la baisse sur les salaires.
AMY GOODMAN : Pouvez-vous épeler « monopsone » ?
JOSEPH STIGLITZ : M-O-N-O-P-S-O-N-E. C'est le pouvoir sur les travailleurs, sur les fournisseurs. Ce mot désigne le pouvoir des grandes entreprises d'exploiter les petits fournisseurs, ou celui des grandes sociétés d'exploiter les travailleurs ordinaires. L'effet de ce...
RALPH NADER : Et les petits agriculteurs.
JOSEPH STIGLITZ : Ce pouvoir sur le marché qui s'exerce sur les fournisseurs a, selon les estimations, pour effet de réduire les salaires de 30, 35, 40 %, voire davantage. Là où nous voulons en venir, c'est que le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce s'attaquent enfin au pouvoir de monopsone et à certaines des dispositions dont parlait Ralph, à savoir l'insertion dans les contrats de clauses qui renforcent le pouvoir de monopsone. Prenons un exemple : les clauses de non-concurrence. Si vous travaillez pour McDonald's ou Burger King et faites des hamburgers, votre contrat contient une clause propre à un territoire vous interdisant de travailler pour une autre entreprise – ce qui, bien sûr, affaiblit la concurrence sur le marché. L'affaiblissement de la concurrence fait baisser les salaires et augmente les profits des entreprises, accroît les inégalités et rend le marché moins efficace.
AMY GOODMAN : Ralph, vous alliez aborder la question du salaire minimum…
RALPH NADER : Oui. Eh bien, juste pour Joe, Joe, vous devriez cibler davantage les budgets d'application dérisoires de la loi de la Commission fédérale du commerce et du ministère de la Justice. Un grand cabinet d'avocats compte plus d'avocats que ceux qui travaillent sur ces questions au sein du ministère de la Justice et de la Commission fédérale du commerce, un seul cabinet d'avocats géant. Et sans budgets, il n'est pas possible de mettre en œuvre les politiques que vous préconisez.
Et la deuxième chose à laquelle il faut prêter attention, ce sont les délais. De la manière dont les tribunaux sont aujourd'hui structurés, quoi que fasse Lina Khan avec le ministère de la justice, les tribunaux peuvent laisser traîner les choses pendant des années. Tout le monde le sait. Ils peuvent les laisser traîner jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle administration ou une nouvelle Commission fédérale du commerce.
C'est pourquoi le Congrès doit être au centre des préoccupations. Le Congrès doit s'attacher à modifier la nature du pouvoir judiciaire, à déterminer quels juges sont confirmés ou rejetés. Et le Congrès doit être à la pointe de l'opposition aux cabinets d'avocats d'affaires qui bloquent les budgets d'application adéquats. C'est comme s'il fallait se contenter d'une centaine de policiers dans tout New York. Vous n'avez pas idée à quel point ces budgets sont faibles. Ils ne cessent de nous le dire… et nous, nous les questionnons : « pourquoi ne lancez-vous pas de poursuites suite à cette infraction à la loi antitrust ? Pourquoi ne vous attaquez-vous pas à ce monopole ? Pourquoi ne tombez-vous pas sur le dos des entreprises agroalimentaires qui écrasent les agriculteurs sur les marchés ? » Ils répondent : « Nous n'avons pas le personnel. Nous n'avons pas les avocats. Nous n'avons pas les procureurs. » Nous devons donc être attentifs à ces questions.
AMY GOODMAN : Joe Stiglitz...
RALPH NADER : En ce qui concerne le salaire minimum, je sais que Joe est un grand défenseur du salaire minimum vital. Mais Joe, n'êtes-vous pas étonné que cette campagne présidentielle ne mette pas – que les démocrates ne mettent pas – cette question à l'avant-plan ? Elle devrait être centrale, mais on la marginalise. Ils n'écoutent pas la parole des travailleurs quand ceux-ci expliquent ce que cela signifie d'obtenir plus d'argent par heure. Ils ne font pas vraiment d'efforts en la matière au Congrès. Elle n'en parle pas ; elle n'en parle quasiment jamais, Kamala Harris.
JOSEPH STIGLITZ : Je suis d'accord. Ils devraient parler du salaire minimum. Vous savez, les recherches menées ces dernières années par les économistes ont totalement changé notre vision de ce que signifierait un salaire minimum de 15 dollars de l'heure, voire un peu plus. On disait autrefois que le fait d'augmenter le salaire minimum créerait plus de chômage. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Une augmentation du salaire minimum par rapport au niveau extraordinairement bas où il a stagné serait en fait bénéfique pour l'emploi. Cela mettrait plus d'argent dans les mains de gens qui sont prêts à le dépenser, ce qui augmenterait la demande globale, en particulier dans certaines des communautés parmi les plus pauvres. On le voit, les villes de notre pays, comme Seattle, qui ont déjà augmenté leur salaire minimum s'en sortent en fait très bien.
AMY GOODMAN : Je voulais juste citer un article paru dans le Times il y a à peu près une semaine, qui dit que les donateurs de la campagne de la vice-présidente Harris la poussent à reconsidérer son soutien à un projet d'impôt applicable aux Américains les plus riches, dans un contexte où certains dirigeants de Wall Street et de la Silicon Valley tentent de remodeler le programme de gouvernement de la candidate démocrate. On peut aussi y lire que l'équipe de campagne de Madame Harris (...) a déclaré qu'elle soutenait les augmentations d'impôts prévues dans (...) la plus récente proposition de budget de la Maison-Blanche de Biden. L'une des mesures envisagées consisterait à obliger les Américains disposant d'un patrimoine d'au moins 100 millions de dollars à payer des impôts sur les plus-values d'investissement, même s'ils n'ont pas vendu les actions, les obligations ou d'autres actifs qui se sont appréciés. Cette catégorie de contribuables payerait un impôt de 25 % sur une combinaison de leurs revenus réguliers, comme les salaires, et de ce que l'on appelle les plus-values non réalisées. L'impôt sur le revenu minimum pour les milliardaires pourrait entraîner une lourde facture fiscale pour les personnes fortunées qui tirent une grande partie de leur richesse des actions et autres actifs qu'elles possèdent ». J'aimerais avoir vos commentaires sur cette question dans cette dernière partie de notre conversation. Ralph Nader ?
RALPH NADER : Eh bien, je vais laisser la parole à Joe. Ma principale proposition est de rétablir les taux d'imposition qui s'appliquaient aux riches et aux entreprises dans les années de prospérité de la décennie 1960, avant que nous ne les réduisions de façon spectaculaire au cours des années qui suivirent ; nous avons alors écarté toute possibilité de réforme fiscale, c'est-à-dire exclu toute réforme fiscale de la base vers le sommet et avons toléré d'énormes déficits ou des budgets de services publics de plus en plus restreints parce que les entreprises et les super-riches étaient notoirement sous-imposés.
AMY GOODMAN : Vos derniers commentaires, Joe Stiglitz ?
JOSEPH STIGLITZ : Oui.
RALPH NADER : Joe, vous pouvez répondre à cette autre partie de la question mieux que moi.
JOSEPH STIGLITZ : Il est clair que nous sommes allés trop loin, puisque nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où les ultrariches paient en fait une plus petite fraction de leurs revenus en impôts que les gens qui disposent de peu de moyens. Warren Buffett n'a pas mâché ses mots quand il a constaté que quelque chose ne va pas quand il s'en tire avec un taux d'imposition inférieur à celui de sa secrétaire.
La proposition particulière que vous avez mise sur la table s'appelle la réalisation constructive des plus-values, une solution que je préconise depuis très longtemps. Elle présente de nombreux autres avantages économiques. Ce sont des détails techniques, mais cela réduit le problème de l'immobilisation des fonds, une situation qui se produit lorsque le contribuable ne veut pas vendre un actif parce que s'il le fait, il payera un impôt prélevé lors de la réalisation du gain. Il s'agit donc d'une réforme qui rendrait l'économie plus efficace, tout en rendant le système fiscal plus équitable. Je suis donc très favorable à la question de la réalisation constructive. Ce que vous faites, c'est que vous payez la valeur estimée, puis, à la fin, lorsque vous vendez, vous pouvez faire toutes sortes de redressements, de sorte que vous ne payez jamais, jamais, trop d'impôts, dans les faits. Il s'agit simplement de vous les faire payer à l'avance, plutôt que de reporter et reporter.
Cette mesure doit être accompagnée d'une autre disposition qui est vraiment très mauvaise. Il s'agit de l'augmentation de la base d'imposition des plus-values. Il s'agit d'une disposition qui s'applique lorsque vous léguez un bien à vos enfants ou à quelqu'un d'autre. Lorsque les héritiers héritent, la valeur de référence est celle de la date de l'héritage. Cela signifie que toutes les plus-values, depuis le moment où le bien ne valait peut-être rien jusqu'au moment où vous le donnez, échappent totalement à l'impôt. Et c'est un ingrédient essentiel pour créer en Amérique cette ploutocratie d'héritiers qui sape tellement les valeurs fondamentales de notre pays.
AMY GOODMAN : Eh bien, je tiens à vous remercier tous les deux...
RALPH NADER : C'est pourquoi j'y reviens encore et encore, Amy, au Congrès, au Congrès, au Congrès. De la manière dont notre système est construit, le Congrès peut être le grand facilitateur ou le grand obstructeur. C'est pourquoi nous avons créé ce mensuel, Capitol Hill Citizen, pour lequel j'espère que vous écrirez, Joe. Les gens peuvent obtenir la version imprimée de notre bulletin en allant sur CapitolHillCitizen.com. Si vous faites un don de cinq dollars ou plus, vous recevrez sans délai un document de 40 pages par courrier prioritaire. CapitolHillCitizen.com.
AMY GOODMAN : Ralph Nader, je veux vous remercier d'avoir été avec nous. Vous êtes un défenseur des consommateurs de longue date, un critique de la grande entreprise, un ancien candidat à la présidence – quatre fois, je crois – auteur de nombreux livres, dont le plus récent est Let's Start the Revolution : Tools for Displacing the Corporate State and Building a Country That Works for the People (traduction non officielle : Commençons la révolution : des outils pour extirper les grandes entreprises de l'appareil d'état et construire un pays qui répond aux aspirations du peuple). Ralph est le fondateur du mensuel Capitol Hill Citizen. Professeur Stiglitz, économiste lauréat du prix Nobel, professeur à l'université Columbia, ancien président du Conseil des conseillers économiques, est actuellement économiste en chef à l'Institut Roosevelt. Son nouveau livre s'intitule The Road to Freedom : Economics and the Good Society (traduction non officielle : Le chemin vers la liberté : l'économie et la bonne société). Pour voir la première partie de notre discussion, rendez-vous sur democracynow.org. Mon nom est Amy Goodman. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Les accidentés de la route laissés à leur sort après 67 ans
Repensons la végétation urbaine : au-delà de l’espace vert
Des pilotes tiennent tête à Air Canada et obtiennent une augmentation de 42%
« On a écrit une page d’histoire du Canada »
Ces communautés qui maintiennent en vie l’Amazonie
Le plan de la vague réactionnaire pour mettre fin aux droits sexuels et reproductifs
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.
















