Derniers articles

Comment Joe Biden se fait mener en bateau depuis un an par Benyamin Nétanyahou

Au bout d'un an de guerre entre Israël et le Hamas, l'échec du président des États-Unis à faire valoir ses vues est patent, selon les commentateurs d'outre-Atlantique. Un allié relativement petit et dépendant dicte sa stratégie à Washington et pourrait même chambouler la politique intérieure du pays.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Joe Biden et Bennyamin Netanyahou. à Tel-Aviv, lors de la visite du président des Etats-Unis en Israël le 18 octobre 2023, peu après les attaques du Hamas. Photo Miriam Alster/Reuters.
“Nétanyahou joue plus habilement des rouages de Washington que la plupart des politiciens aux États-Unis. Et il a n'a cessé de damer le pion à Biden”, a déclaré au Financial Times le chroniqueur israélien de Ha'Aretz Alon Pinkas, un an après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël.
En 1996 déjà, le président des États-Unis Bill Clinton demandait à l'issue d'une rencontre avec Benyamin Nétanyahou, déjà Premier ministre d'Israël : “Quelle est la putain de superpuissance ici ?”
Près de trois décennies plus tard, la superpuissance semble se laisser dicter les décisions stratégiques par son protégé, déplore un commentateur de The Atlantic. Et la Maison-Blanche “se comporte comme un chien qui aurait décidé de courir derrière sa queue”.
“Biden s'est mis hors-jeu”
Le constat, sévère, est partagé par le chroniqueur de centre gauche Nicholas Kristof, du New York Times, alors que celui-ci voit plutôt d'un bon œil le président et sa politique étrangère. “Biden voulait la paix, il a pourtant permis la guerre”, résume-t-il.
“Biden plaide la retenue depuis un an mais il s'est mis hors-jeu en continuant de fournir les armes qui étaient employées au mépris de ses injonctions. Il en a appelé à la conscience de Nétanyahou, qui en est de toute évidence dépourvu”, estime le chroniqueur. Pourtant, “avant Biden, d'autres présidents des États-Unis ont été plus disposés à user du levier que constituent les livraisons d'armes à Israël”. Non sans effet.
- “Il m'est douloureux d'écrire cette chronique. Le fait est cependant qu'un an après les attentats du 7 octobre, la politique de Biden au Moyen-Orient apparaît comme un échec sur les plans pratique et moral.”
Comme l'a encore montré l'invasion du Liban par Tsahal en dépit des mises en garde de Washington, le président américain “ne cesse de se faire filouter par le Premier ministre israélien”.
Cet échec “entache son bilan”, et le pire est peut-être encore à venir, ajoute le journaliste du New York Times : “Je crains que Nétanyahou ne conduise Israël vers une guerre contre l'Iran et qu'il ne cherche à attirer les États-Unis dans la bataille”.
Et le chroniqueur d'écouter avec inquiétude certains “faucons” à Washington rêvant tout haut de “refaçonner le Moyen-Orient”. “Cela me rappelle les prévisions exaltées sur l'invasion de l'Irak, il y a vingt et un ans, qui devait ouvrir la voie à une nouvelle ère démocratique et paisible une fois Saddam Hussein chassé du pouvoir.” Entre autres exemples d'hubris aboutissant à un bourbier.
Nétanyahou tire les ficelles
Les tensions avec l'Iran laissent même envisager un scénario digne de la série House of Cards, écrit le chroniqueur du Financial Times Edward Luce. “À tout juste un mois de la présidentielle aux États-Unis, les événements du Moyen-Orient pourraient changer le résultat du 5 novembre.”
Après l'abondante salve de missiles lancée par Téhéran sur Israël, “une escalade entre les deux pays pourrait faire grimper en flèche les prix du pétrole, ce qui plomberait immédiatement le moral des consommateurs aux États-Unis, pile au moment où les électeurs se rendent aux urnes”.
De quoi mettre en péril les chances de Kamala Harris et, par conséquent, tout l'héritage de Joe Biden. Le président a déconseillé de frapper les sites pétroliers iraniens. Mais voilà : “c'est bien Nétanyahou, et non Biden, qui décide de la suite”.
Gabriel Hassan
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : La République Islamique face à la remontée des luttes

Deux ans après le déclenchement du soulèvement « Femme, Vie, Liberté » qui a ébranlé la République Islamique dans ses fondements, le pouvoir est plus que jamais crépusculaire.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Le mouvement qui avait suivi le meurtre de Jina Mahsa Amini par la « police des mœurs » avait embrasé le pays tout entier. A bien des égards, ce soulèvement était inédit. Et cela même si l'absence de grèves massives, ainsi que la faiblesse de la jonction avec le monde du travail en tant qu'acteur à part entière, ont fait partie de ses faiblesses notables.
L'ancrage territorial, la durée et la radicalité du processus « Femme, Vie, Liberté » ne pouvaient laisser indemne la mollahrchie. Deux ans après, rien n'est plus comme avant septembre 2022, et les braises du soulèvement sont toujours ardentes. Malgré le déchaînement de la répression, les femmes, les peuples d'Iran, la jeunesse et les travailleurs/euses ont aujourd'hui repris confiance dans leurs capacités de lutte.
L'intensification de multiples crises, une forte contestation populaire
Le refus toujours aussi vivace du voile obligatoire par les femmes, les luttes multiples, les grèves et les manifestations de travailleurs/euses, les combats démocratiques pour la défense des droits des prisonnierEs, la lutte contre les condamnations à mort et les exécutions, témoignent d'un rejet profond de la mollahrchie.
La faiblesse historique du taux de participation à la dernière élection présidentielle n'est pas due à un désintérêt populaire. Elle traduit un rejet massif du pouvoir et des institutions. C'est le régime dans son ensemble qui est considéré comme illégitime par la population.
Cette élection a vu la victoire de Massoud Pezeshkian, un soi-disant « modéré », succédant au « conservateur » Ebrahim Raïssi mort dans un accident d'hélicoptère.
Le choix fait par le régime de « mettre » à la présidence un prétendu « modéré » est davantage un message envoyé aux États-Unis qu'un signe d'ouverture à l'égard de la population. Il s'agit avant tout d'une main tendue à Washington, et ce afin de négocier un allégement des sanctions économiques, de tenter d'obtenir le dégel des milliards de dollars bloqués et de sanctuariser le programme nucléaire iranien.
L'économie est exsangue, du fait des sanctions mais surtout des orientations politiques et économiques catastrophiques, ainsi que de la corruption massive du régime et des Gardiens de la révolution (Pasdaran).
Les peuples d'Iran doivent faire face aux privations de liberté, à la répression, à une hyper inflation et à une misère grandissante, à de nombreux scandales de corruption touchant les sommets de la République Islamique. Cela alimente et accentue la crise politique, car une grande partie des couches traditionnellement acquises au régime s'en détachent depuis de nombreuses années.
La montée des luttes sociales et démocratiques
Sous les effets de la crise économique, sociale et politique nous assistons depuis plusieurs mois à un regain des luttes ouvrières. Divers secteurs se mobilisent régulièrement : les enseignantEs, les retraitéEs, des salariéEs de la pétrochimie…
Ces derniers mois, et cela est une première, ont eu lieu dans de nombreuses villes des manifestations et des grèves simultanées d'infirmières. Ces mobilisations pour des hausses de salaire et des conditions de travail plus dignes se poursuivent malgré la répression. Le niveau inédit d'organisation de cette lutte, ainsi que le soutien important de la population qui se reconnaît dans les revendications avancées, inquiète particulièrement le pouvoir qui craint une contagion.
Cette mobilisation, dont des femmes sont en première ligne, doit être considérée comme l'une des suites du soulèvement ayant suivi la mort de Jina Masha Amini. Cette lutte exemplaire se caractérise par un niveau de coordination nationale rarement atteint sous la dictature théocratique.
Le mouvement des infirmières comble en partie certaines faiblesses du soulèvement de 2022.
Pour la première fois, ce mouvement social qui traverse l'ensemble du pays, met sur le devant de la scène une lutte faisant converger, au travers d'un affrontement de classe, le combat des femmes et celui des minorités nationales. Il fait franchir un seuil décisif au combat contre les préjugés et méfiances régionales entretenus par le pouvoir.
Cette lutte exemplaire mérite amplement la solidarité des syndicats de la santé dans le monde entier, et plus largement de l'ensemble du mouvement ouvrier et démocratique.
Au même moment, sous l'effet du rapport de force, de la solidarité internationale et de la mobilisation de syndicats européens et notamment français (1), des figures de premier plan du syndicat Vahed (syndicat des travailleurs/euses des transports en commun de Téhéran et sa banlieue) ont été libérés.
Cela constitue un formidable encouragement pour les réseaux militants en exil, dont des organisations comme Solidarité Socialiste avec les Travailleurs d'Iran (SSTI) (2), qui n'ont cessé de militer pour que des actions de solidarité se développent à l'échelle internationale.
Enfin, dans les prisons, des détenuEs d'opinion et notamment des femmes mènent une lutte courageuse et quotidienne contre leur détention, contre la torture et les exécutions dont les prisonnierEs d'origines kurdes et baloutches sont les premières victimes, ainsi que contre la République Islamique.
Depuis l'élection de Pezeshkian, les exécutions de détenus ont augmenté, la répression des minorités nationales est permanente, le harcèlement des femmes et de la jeunesse est incessant. Le nouveau président s'inscrit à ce titre dans la lignée d'Ahmadinejad ou de Raïssi, celui que l'on a surnommé le « boucher de Téhéran » pour son rôle dans les exécutions de milliers de prisonniers/ières politiques à la fin des années 80. (3)
Le combat pour l'égalité, pour les libertés démocratiques, pour les droits des travailleurs/euses et la justice sociale sont indissociables.
Un affaiblissement de la position de la République islamique dans la région
Au cours de l'année écoulée, le régime a subi des attaques humiliantes de la part d'Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien, avec la complaisance des grandes puissances occidentales et des régimes arabes.
Israël est notamment parvenu à :
– éliminer en Syrie des commandants des Gardiens de la révolution (Pasdaran),
– assassiner le chef du Hamas Ismail Haniyeh en plein cœur de Téhéran.
Ces différentes opérations, et particulièrement l'élimination du dirigeant du Hamas, ont montré la faiblesse et l'impuissance de l'appareil de renseignement de la République Islamique, ainsi que l'importance de son infiltration par les services secrets d'Israël. Cela a mis en évidence la corruption institutionnalisée dans toute la structure politique et administrative de la République islamique, et ce jusqu'au sommet des services de renseignement des Gardiens de la révolution.
La course à l'armement du pouvoir, les milliards dépensés pour ses ambitieux projets nucléaire militaire et d'armement classique grèvent considérablement le budget de l'État. Néanmoins, celui-ci a été dans l'incapacité de riposter aux humiliations à répétition que lui a infligé l'État d'Israël.
Confrontée à une perte de légitimé irréversible, à l'accentuation de la révolte des femmes, à des luttes sociales et démocratiques de plus en plus fortes et à une incapacité de donner le change sur la scène régionale, la République Islamique d'Iran donne incontestablement des signes de faiblesses.
Les peuples d'Iran ne peuvent se libérer que par eux-mêmes. Il nous revient de les soutenir dans leur lutte pour l'émancipation, l'égalité, et la justice sociale.
Notes
1. https://solidaires.org/rechercher/?search=Iran
2. SSTI http://www.iran-echo.com/
3. Cela n'a pas empêché Youssef Boussoumah, l'un des co-fondateurs/trices du « QG décolonial » et de « Paroles d'honneur » d'appeler à prier pour que le président Raissi sorte indemne de son accident d'hélicoptère.
Pour sa part Houria Bouteldja, co-fondatrice de ces structures, avait présenté en 2016 Ahmadinejad comme étant « son héros ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Camarade président ? Changement et continuité au Sri Lanka

La victoire d'Anura Kumara Dissanayake (AKD) le 21 septembre en tant que candidat de la coalition de centre-gauche National People's Power (NPP) est extrêmement importante pour des raisons symboliques et de fond. Ses prédécesseurs appartenaient à l'élite sociale et politique qui a mal gouverné le Sri Lanka depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948. Certains sont nés au sein de cette élite, tandis que deux autres (Ranasinghe Premadasa, Maithripala Sirisena) s'y sont frayé un chemin par le biais de la politique avant d'accéder à la présidence. En revanche, la vie politique de Dissanayaka s'est déroulée en tant qu'outsider et critique de cette élite.
Tiré du site du CADTM.
Le nouveau président est né d'une famille rurale pauvre originaire des hauts plateaux avides de terres, qui, pour améliorer ses conditions d'existence, a émigré comme beaucoup d'autres dans la zone aride mais irriguée du centre-nord. Son père était un employé modeste d'un ministère et sa mère s'occupait d'une famille nombreuse tout en cultivant du riz sur leur lopin de terre. Il a été le premier de sa famille à faire des études supérieures : il a étudié les sciences physiques dans une université publique.
À la fin des années 1980, à l'université de Kelaniya, il militait au sein du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP-Front populaire de libération), alors clandestin - interdit en 1983 par le régime de droite du Parti national unifié (UNP), puis sévèrement réprimé lors de sa deuxième insurrection contre l'État entre 1987 et 1989 - avant de devenir un militant politique à plein temps après la légalisation du parti. Il s'est attelé à le reconstruire, notamment par le biais de la politique électorale. En tant que membre d'une classe exploitée et marginalisée, et en tant que dirigeant d'un parti formellement marxiste-léniniste, son élection à la tête de l'État et du gouvernement dans le système gaulliste sri-lankais a brisé le moule.
Candidat du changement
Il a fait campagne non pas sur une plate-forme socialiste ou anticapitaliste, mais plutôt en lançant un appel au « changement » dans une culture politique dégénérée vieille de plusieurs décennies, que de larges pans de la population, toutes classes, sexes, ethnies et régions confondus, tiennent pour responsable de la catastrophe économique de 2021-2022, qui a culminé avec la faillite souveraine du Sri Lanka lorsqu'il n'a pas assuré le service de sa dette extérieure, qui s'élevait alors à 32 milliards de dollars américains.
Ceux qui ont voté pour lui, et beaucoup de ceux qui ne l'ont pas fait, s'attendent à ce que son gouvernement transforme une culture politique où les politiciens imposent leurs décisions sans égard pour le peuple entre les élections, se récompensent eux-mêmes, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition, par des privilèges et des avantages, tirent profit de leur fonction en concluant des accords et en versant des pots-de-vin à d'autres partis , à des entreprises locales et étrangères, et en accédant à des appels d'offres et à des contrats gouvernementaux et internationaux, et jouissent de l'impunité face aux enquêtes, aux poursuites et à l'emprisonnement pour les abus et les crimes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions.
Tel était le sentiment du soulèvement populaire de 2022, connu sous le nom de janatha aragalaya (lutte du peuple en cinghalais). Bien que ce mouvement ait été de courte durée, il a largement contribué au bond de popularité de la coalition National People's Power, que le JVP a initiée en 2019 pour élargir sa base de classe, jusque-là, la classe ouvrière et la petite bourgeoisie de gauche, à des classes plus conservatrices, ouvrant ainsi la voie vers la présidence.
Comme son parti ne fait pas partie de la classe politique traditionnelle, qu'il n'est donc pas entaché de corruption et qu'il a fait de la lutte contre la corruption son slogan central depuis de nombreuses années, ceux qui souhaitaient ce « changement » ambigu et insaisissable se sont tournés vers lui. Ils ont rejeté à juste titre les candidats des deux principales alliances de droite (autour de l'ancien président Ranil Wickremesinghe et du chef de l'opposition parlementaire Sajith Premadasa).
Bien qu'il n'ait pas obtenu la majorité, le NPP a recueilli la plus grande part des voix, soit plus de 5,6 millions (42 %), et est arrivé en tête dans 15 des 22 circonscriptions électorales, à l'exception de celles où se concentrent les minorités ethniques dans les régions du centre, de l'est et du nord du pays. Sa base électorale est constituée en grande majorité par la nation cinghalaise majoritaire (75 % de la population). Mais cette fois, il a commencé à gagner des partisans parmi les minorités musulmanes et tamoules de l'île, en particulier parmi les jeunes.
Il ne compte que trois membres dans le corps législatif de 225 sièges, ce qui fait de son cabinet ministériel probablement le plus petit du monde. L'une des premières mesures prises par le nouveau président a été la dissolution anticipée du parlement (conformément à la constitution). Les élections générales auront lieu le 14 novembre et la première séance du nouveau parlement se tiendra une semaine plus tard. Le NPP a besoin de 113 sièges pour former un gouvernement. C'est un défi plus difficile à relever que de gagner la présidence.
La question de savoir si le gouvernement du NPP réinitialisera le système politique, comme l'espèrent ses partisans, ou s'il y sera assimilé, comme l'ont fait ses anciens rivaux de l'ancienne gauche, l'ex-trotskiste Lanka Sama Samaja Party (LSSP) et le parti communiste du Sri Lanka, reste ouverte.
La stabilité pour les riches
Le gouvernement de Ranil Wickremesinghe, qu'il a formé en partenariat avec la majorité parlementaire pro-Rajapaksa et les défections de l'opposition, a réussi à stabiliser l'économie et à relancer sa croissance, pour les classes aisées. L'inflation globale est tombée à 0,5 % le mois dernier. Les réserves de change utilisables atteignent 4,6 milliards de dollars. Le taux de change s'est renforcé pour atteindre environ 300 LKR pour un dollar américain. Le produit intérieur brut augmentera de près de 4 % cette année.
Si les pauvres comme les riches ne font plus la queue pour les produits de première nécessité que sont le carburant, la nourriture et les produits pharmaceutiques, les pauvres, contrairement aux riches, n'ont pas les moyens de les payer. Il n'y a pas de coupures d'électricité après que les tarifs ont été augmentés de 140 %, mais l'année dernière, un million de ménages ont été déconnectés du réseau parce qu'ils n'arrivaient pas à honorer leurs factures. Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par trois en moyenne, à la suite de la dernière invasion de l'Ukraine par la Russie et de la chute libre de la roupie lors du désastre économique de 2022, augmentant l'insécurité alimentaire à 24 % de tous les ménages. Un ménage sur quatre se trouve en dessous du seuil de pauvreté officiel.
En mars 2023, le Sri Lanka a conclu son 17e accord de prêt avec le Fonds monétaire international depuis 1965. La facilité de crédit étendue de 2,9 milliards de dollars US sur quatre ans est décaissée en tranches semestrielles qui sont conditionnées à la réalisation d'objectifs de progrès en matière de réforme structurelle de l'économie.
Les objectifs à atteindre sont les suivants :
– Un excédent budgétaire primaire (c'est-à-dire un excédent des recettes publiques sur les dépenses) de 2,3 % du produit intérieur brut d'ici à 2025 ;
– Réduire le besoin d'emprunt du gouvernement (besoins bruts de financement) à 13 % du produit intérieur brut entre 2027 et 2032 ;
– Réduire le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut à 95 % d'ici 2032.
En supposant que ces objectifs soient atteints - avec tous les coûts sociaux et politiques associés à la réduction des dépenses de l'État et au refus de stimuler la croissance de l'emploi et des revenus - l'encours total de la dette du Sri Lanka serait plus important en 2027 qu'il ne l'était en 2023 ; et le service de la dette extérieure engloutirait 30 % des recettes publiques en 2027, selon un ancien fonctionnaire du Trésor américain, ce qui rendrait plus probable, selon lui, l'inévitabilité d'un nouveau défaut de paiement de la dette souveraine.
Les réformes structurelles préconisées par le programme du FMI et soutenues avec enthousiasme par les acteurs politiques, administratifs et de la société civile visent à
– augmenter la fiscalité indirecte, qui est régressive puisque les pauvres paient de manière disproportionnée plus que les riches ;
– augmenter les taux d'intérêt bancaires, rendant l'emprunt plus coûteux, ce qui pénalise les micro et petites entreprises ;
– restructurer la dette intérieure, dont les fonds de retraite du secteur public étaient les principaux investisseurs, ce qui a entraîné une réduction drastique de la valeur finale des prestations ;
– réduire les effectifs du secteur public pour diminuer la masse salariale de l'État, ce qui érode encore plus les services publics et crée des opportunités de marché pour les prestataires du secteur privé ;
– supprimer les subventions sur les biens publics tels que le carburant pour le transport, la cuisine et l'électricité en laissant libre cours aux prix du marché ;
– démanteler le système de sécurité sociale au profit de « filets de sécurité sociale » qui « ciblent » des groupes spécifiques en fonction de leurs revenus et de leur patrimoine ;
– précariser le marché du travail par une déréglementation du code du travail ;
– consolider les terres agricoles en grandes exploitations pour les cultures commerciales (d'exportation) en délivrant des titres fonciers aux petits exploitants qui pratiquent actuellement la culture vivrière ; et
– geler les projets de dépenses en capital du gouvernement, avec des implications pour l'infrastructure publique, la fourniture de services publics, l'industrie de la construction et l'emploi.
Accord avec le FMI et orientation économique
Le JVP, qui est la principale composante de la coalition du National People's Power, est né de la radicalisation de la jeunesse des années 1960 en tant que parti socialiste révolutionnaire d'obédience guévariste et maoïste. Il est donc historiquement associé à une politique anti-impérialiste, hostile aux institutions de Bretton Woods telles que le FMI et la Banque mondiale.
Depuis que le JVP est entré dans la politique parlementaire à partir de 1994 - dans le contexte géopolitique de l'effondrement du bloc « socialiste » en Europe, précédé par la crise du socialisme en tant qu'alternative crédible au capitalisme, et le contre-modèle des réformes de marché de la Chine avec son intégration dans le capitalisme mondial et l'encouragement du capital privé - le parti a évolué vers l'acceptation d'une économie mixte, avec un rôle prépondérant de l'État dans l'économie. Récemment, il a cité le Viêt Nam comme l'exemple de réussite qu'il souhaite reproduire.
Bien que le JVP-NPP ne soutienne pas le néolibéralisme, il ne prône pas non plus un anti-néolibéralisme cohérent si l'on se réfère à sa campagne électorale de 2024, à son manifeste et à ses documents d'orientation. Plus important encore, le NPP - et le nouveau président l'a réaffirmé dans son premier discours au pays - s'est engagé à ne pas quitter le programme en cours du Fonds monétaire international. Il a déjà déclaré que l'accord était un fait accompli et qu'il constituait désormais une condition préalable aux négociations sur la restructuration de la dette avec les créanciers officiels et privés, ce qui laisse entendre qu'il a les mains liées et que l'opinion publique s'attend à ce que les deux accords soient menés à bien de manière satisfaisante.
Néanmoins, le NPP déclare qu'il réexaminera l'évaluation de la viabilité de la dette réalisée par le FMI, qui fournit la justification technique de ses conditionnalités politiques, y compris les mesures d'austérité draconiennes. Le nouveau gouvernement propose des changements dans le cadre actuel : réduction de l'imposition des pauvres et de la classe moyenne inférieure, maintien de certaines entreprises d'État (un secteur dans lequel le JVP a une présence syndicale importante) dans le giron public, tout en laissant la porte ouverte à la vente d'entreprises non stratégiques, et renforcement de la « consolidation fiscale » par la rationalisation des dépenses publiques et l'augmentation des recettes d'exportation tout en réduisant les dépenses d'importation grâce à l'intensification de la production intérieure, ce qui permettra d'augmenter les réserves extérieures du Sri Lanka.
De manière significative, il a également déclaré qu'il mènerait un « audit médico-légal » de la dette extérieure, ce qui suggère qu'il reconnaît qu'au moins une partie de celle-ci est odieuse et illégitime, et que les citoyens et les générations futures ne devraient pas en être accablés.
Il a insisté à plusieurs reprises sur sa fidélité à l'accord avec le FMI et au processus de restructuration de la dette en cours. Il s'agit en partie d'apaiser les craintes des responsables politiques et de larges pans de l'opinion publique, qui redoutent que la rupture de l'accord avec le FMI ne perturbe les négociations avec les créanciers extérieurs et n'entraîne une spirale d'instabilité économique. Il s'agit également de signaler que le parti souhaite être perçu, à l'intérieur et à l'extérieur du Sri Lanka, comme « responsable » plutôt que radical, et comme pragmatique plutôt que dogmatique.
Le NPP est également favorable au libre-échange, aux investissements étrangers et aux exportations. Il n'inversera pas l'expansion des services privés de santé et d'éducation, mais promet plutôt de les réglementer dans l'intérêt des utilisateurs. Il équilibre les principes néolibéraux classiques, avec des références à l'expansion de la production nationale (c'est-à-dire à la substitution des importations sans la nommer), à l'opposition à la privatisation des entreprises publiques et à l'élargissement des programmes sociaux et des allocations budgétaires pour les groupes vulnérables (personnes âgées, retraités, jeunes mères et femmes avec des enfants en bas âge, personnes handicapées et atteintes de maladies chroniques, etc.)
Il a également pris soin d'éviter toute référence au budget militaire pléthorique qui consomme 7 % du budget national, soit presque autant que la santé et l'éducation réunies. Ce scandale est politiquement inviolable en raison de l'idéologie de la sécurité nationale encouragée par l'État nationaliste cinghalais pendant près de trois décennies de guerre entre 1983 et 2009. Les références du NPP à la redistribution des richesses et des revenus sont discrètes, pour ne pas gêner les classes dont l'approbation lui importe tant.
Ce que l'on ne sait pas encore, c'est si la position du nouveau gouvernement s'effondrera lorsque le FMI insistera, comme il l'a toujours fait, sur le fait que son évaluation de la viabilité de la dette est méthodologiquement irréprochable et que son programme a été conçu de manière si parfaite qu'il ne peut être amélioré.
Comment le nouveau gouvernement va-t-il créer la marge de manœuvre budgétaire pour le niveau d'investissement public nécessaire à ses objectifs de dépenses, dans le carcan de l'accord avec le FMI ? Rouvrira-t-il les négociations récemment conclues (mais non scellées) avec les créanciers bilatéraux et commerciaux, afin d'obtenir une décote plus importante sur l'encours de la dette et, globalement, un meilleur accord que celui conclu à la hâte par le régime précédent pour contraindre le nouveau gouvernement ?
Dira-t-il au FMI et aux créanciers que sa priorité est de défendre le niveau de vie des personnes les plus durement touchées par la crise et les mesures d'austérité, et de faire croître l'économie d'une manière qui profite à la majorité ; au-delà des objectifs du FMI en matière d'excédent budgétaire primaire et de ratio de la dette au PIB, et du remboursement de la dette bilatérale et commerciale qui doit reprendre après 2027 ?
Questions relatives aux minorités
Les tensions ethniques se sont atténuées depuis le soulèvement populaire de 2022, au cours duquel des efforts conscients ont été déployés pour présenter une identité collective du « peuple » contre une « élite » décadente et son « système » qui sème la division sur la base de l'appartenance ethnique et de la foi. La campagne électorale de 2024 a été observée comme étant non seulement la plus pacifique, mais aussi celle où les tensions ethniques et religieuses (qui demeurent bien sûr) n'ont pas été attisées par les principaux candidats.
Le NPP n'est pas raciste et compte (même si ce n'est pas en grand nombre) des minorités ethniques - Tamouls originaires du nord-est, Tamouls des collines, musulmans (une identité ethno-religieuse au Sri Lanka) - parmi ses membres et ses dirigeants.
Alors que le manifeste du NPP identifie certaines des préoccupations urgentes des Tamouls du Nord et de l'Est touchés par le conflit, telles que l'abolition de la législation antiterroriste et la libération des prisonniers politiques, la vérité et la justice pour les familles des disparus, l'acquisition de terres par ll'État, le manifeste du NPP ne contient pas d'informations sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, l'accès des tamoulophones aux services publics par la mise en œuvre effective de la loi sur les langues officielles ; la réactivation du système des conseils provinciaux pour une plus grande autonomie ; les préoccupations socio-économiques des Tamouls des collines (travailleurs des plantations et leurs descendants) en matière de logement, de terre, de santé et d'éducation ; de nombreux engagements sont vagues et ne sont pas assortis d'échéances.
Le JVP-NPP a courtisé les militaires à la retraite et le clergé bouddhiste et en a fait ses partisans. Ces deux groupes sont implacablement opposés aux enquêtes et à la responsabilisation des forces de sécurité de l'État pour les crimes de guerre, ainsi qu'à la reconstitution de l'État unitaire dans le sens du fédéralisme. Lors des réunions préélectorales, le nouveau président a insisté sur le fait que le statut prioritaire accordé au bouddhisme dans la constitution actuelle (proche du statut de jure de religion d'État) est sacro-saint, tout en rassurant les chrétiens, les hindous et les musulmans sur le fait que leur droit à la liberté de culte sera protégé par l'État.
Le nouveau président promet une nouvelle constitution démocratique qui abolira l'institution autoritaire de la présidence et déléguera davantage de pouvoirs aux régions, y compris aux zones habitées par des minorités nationales. Toutefois, à moins qu'il n'obtienne une majorité parlementaire lors des élections générales qui se tiendront dans quelques semaines, et/ou qu'il ne trouve des alliés dans d'autres partis politiques, il ne dispose pas des effectifs nécessaires pour agir de manière décisive dans ces domaines.
Son parti-alliance et lui-même sont parfaitement conscients que leur principale base électorale est imprégnée de suprémacisme cinghalais depuis la décolonisation. Cette base est au mieux indifférente, au pire hostile, à l'élaboration d'une constitution qui serait perçue comme accordant plus de droits et une plus grande part du pouvoir d'État aux minorités nationales.
Le soulèvement populaire de 2022 se répercute sur le résultat de l'élection présidentielle de 2024. Les perspectives de changement progressif au Sri Lanka dépendent de la dynamique politique et sociale des prochains mois, en particulier du réveil des luttes et des organisations de travailleurs.
Balasingham Skanthakumar
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
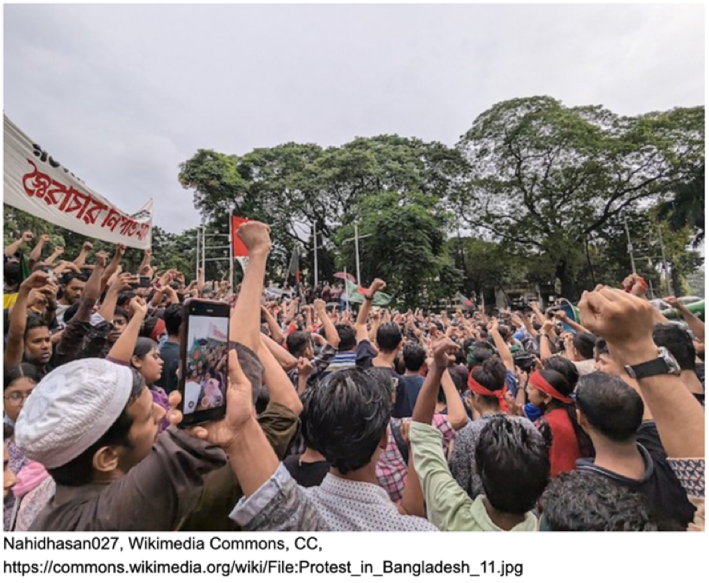
La victoire du mouvement de protestation au Bangladesh
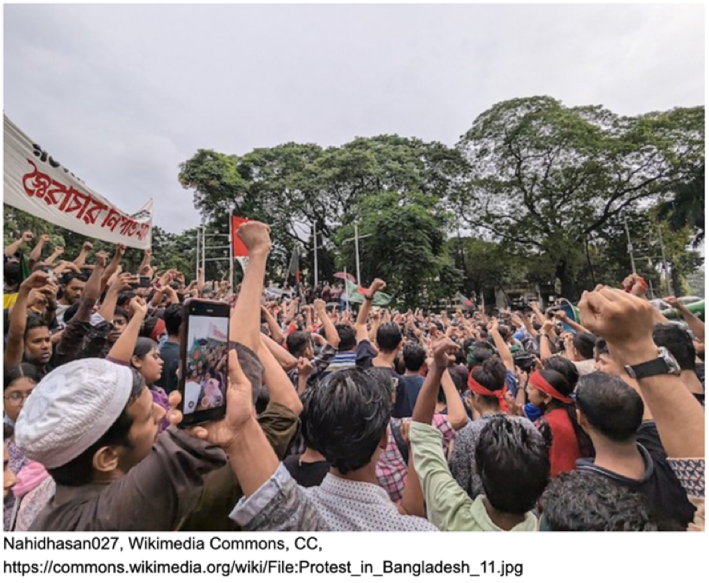
Après une répression d'état qui a provoqué des centaines de morts au Bangladesh, les manifestations de masse ont renversé Sheikh Hasina. Mais le gouvernement intérimaire dirigé par Muhammad Yunus, le gourou du microcrédit, n'est pas en mesure de s'attaquer aux graves problèmes sociaux auxquels sont confrontées les classes populaires du pays.
Tiré du site du VADTM.
Après quinze ans au pouvoir, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné et fui le pays le 5 août, chassée par de jeunes manifestant·es. Ce mouvement commencé contre les quotas dans la fonction publique s'est transformé en un soulèvement général contre le pouvoir autocratique de Hasina et de son parti, la Ligue Awami (LA).
La situation a été bouleversée en cinq semaines, et la victoire finale a été obtenue au prix de plus de quatre cents vies et de plusieurs milliers de blessé·es et de disparu·es. La tournure des événements dans ce pays d'Asie du Sud évoque ceux survenus au Sri Lanka en 2022 ou la révolte de masse qui a contraint le président des Philippines, Ferdinand Marcos, à fuir le pays en 1986, après deux décennies de régime autocratique.
Le 5 août, Hasina n'a eu que 45 minutes pour démissionner et quitter le pays, alors que des centaines de milliers de manifestant·es sont descendu·es dans la rue, prêts à défier le couvre-feu à n'importe quel prix. La veille encore, elle refusait de voir que son mandat de Première ministre était terminé. Cependant, une marée populaire l'a emportée, comme un puissant tsunami. C'est le chef de l'armée qui a facilité sa fuite.
Un cycle complet
Avec l'éviction d'Hasina, un cycle complet de la politique de la Ligue Awami a été bouclé. La dernière phase de consolidation de la Ligue a commencé avec sa victoire aux élections de 2008, lorsque l'alliance de quatorze partis qu'elle dirigeait a remporté une majorité écrasante de 263 sièges sur 300. Bien que le parti ait été au pouvoir à deux reprises entre 1971 et 1975 et entre 1996 et 2001, il s'agissait d'une victoire historique.
Les élections parlementaires initialement prévues pour janvier 2007 avaient été suspendues après des mois de bouleversements politiques. Entre-temps, un gouvernement intérimaire soutenu par l'armée a continué à gouverner, ce qui a évoqué le spectre d'une autre dictature militaire, bien que sous la forme d'une mascarade. Au cours de ses vingt premières années d'existence, pendant près de seize ans, le Bangladesh a été soit directement dirigé par les militaires, soit administré par un gouvernement soutenu par l'armée.
Considéré comme une force laïque en raison de ses racines historiques et de son rôle de leader dans la guerre de libération, le parti a accédé au pouvoir en s'appuyant sur cette histoire. Depuis 2007, un nouveau mouvement de la société civile, soutenu par la LA, a intensifié les demandes de jugement des criminels de guerre ayant collaboré avec l'armée du Pakistan occidental.
Le parti d'opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP), qui a gouverné entre 2001 et 2006, a participé aux élections en s'alliant avec Jamaat-e-Islami, un groupe islamique radical. Les observateurs ont également vu dans ces élections un rejet public des idéaux islamiques radicaux et une répudiation de la politique religieuse.
Deux tournants
En 1990, le mouvement pour la restauration de la démocratie (connu aussi sous le nom de Mouvement anti-autoritaire des années 90), après des années de régime militaire, constitue le premier tournant positif dans l'histoire du Bangladesh indépendant. À partir de novembre 1997, des millions de personnes ont défilé dans les rues pour réclamer le rétablissement d'un régime civil.
Le pays a été pris en otage par les militaires, de véritables gangsters, entre 1982 et 1990, dirigés par le chef de l'armée H. M. Ershad. Son régime a constitué un épisode sombre marqué par des meurtres et des agressions, des arrestations et des détentions arbitraires, la corruption et le pillage, ainsi que la destruction de la démocratie et des valeurs démocratiques. Un soulèvement populaire a chassé Ershad et ouvert la voie à la démocratie parlementaire.
Le mouvement a contribué à l'émergence d'une nouvelle conscience progressiste, en particulier chez les jeunes, ainsi qu'à certaines réformes constitutionnelles. Il a permis de délégitimer l'emprise de l'armée sur la politique. Les partis politiques sont parvenus à un consensus sur la future trajectoire démocratique de la nation – un consensus qui a été violé par la suite. La Ligue Awami et le BNP ont grandement bénéficié de la perception selon laquelle ils étaient à l'avant-garde de ces luttes.
Le deuxième tournant majeur, le mouvement de 2013 connu sous le nom de mouvement Shahbag, exigeait la peine capitale pour les criminels de guerre. La LA a d'abord soutenu cette mobilisation, car elle servait ses propres intérêts et objectifs. Cependant, les manifestant·es du Shahbag ont commencé à réclamer une démocratisation plus large de la société et la fin des injustices socio-économiques.
Dans un premier temps, la Ligue a tenté de contrôler le mouvement, mais n'y est pas parvenue. Elle en a alors retiré les cadres de son parti et a harcelé les dirigeants de Shahbag, tout en encourageant les querelles internes dans leurs rangs, ce qui a paralysé la lutte. La gauche bangladaise a continué à participer aux manifestations de Shahbag, mais les organisations de gauche étaient peu nombreuses et n'avaient qu'un impact limité.
En 2014, le mouvement a perdu son élan. Ce faisant, le pays a perdu l'une de ses plus grandes chances de parvenir à une véritable démocratisation et de s'attaquer aux injustices socio-économiques sous la pression des mouvements auto-organisés de la base. En fin de compte, le mouvement Shahbag a été anéanti.
Répression de l'opposition
Après avoir atteint cet objectif, la Ligue Awami a continué à démanteler son adversaire politique, le BNP. Pour la LA, le Jamaat-e-Islami et d'autres groupes islamiques étaient également un facteur à prendre en compte, mais le BNP était son adversaire électoral immédiat. Les dirigeants de la LA ont rapidement compris que le mécontentement à l'égard du bilan de leur gouvernance pouvait profiter au BNP sur le plan électoral.
Les dirigeants du BNP ont été arrêtés arbitrairement et des accusations ont été portées contre eux, ce qui a déstabilisé le parti. En outre, le BNP a longtemps bénéficié d'un soutien important de la part de l'armée. Toutefois, l'intérêt de l'establishment militaire pour le pouvoir civil ayant diminué, la force du parti s'est affaiblie.
Son bilan, lorsqu'il était au pouvoir entre 2001 et 2006, a été caractérisé par la corruption et des attaques violentes contre l'opposition, y compris une tentative d'assassinat contre Hasina, par une grenade, en 2004. Ce bilan a discrédité le parti et a contribué à son déclin constant, celui-ci étant combiné à l'utilisation impitoyable de l'appareil d'État par la Ligue Awami à l'encontre de son rival. Le BNP a tenté en vain de manipuler le système électoral pour s'accrocher au pouvoir en 2006, mais la Ligue a fait preuve d'une maîtrise supérieure dans ce domaine.
Le BNP s'est retiré des élections de 2014 au motif qu'elles se déroulaient dans des conditions inéquitables. Il a exigé la démission d'Hasina en tant que Première ministre pour laisser la place à une personnalité « impartiale » et « non membre d'un parti » pour superviser les élections. Cette abdication a simplement offert sur un plateau le pouvoir à la Ligue, 153 candidat·es sur 300 étant élu·es sans contestation.
La Ligue Awami a ensuite bloqué les activités politiques du BNP dans tout le pays, et des milliers de procès ont été intentés contre ses dirigeants et les militants, allant de la corruption à l'accusation de meurtre. Le parti n'a pas été en mesure de se remettre de toutes ces attaques et a recouru à la violence après 2014, ce qui a donné à la Ligue l'occasion de le cibler davantage. Khaleda Zia, deux fois Première ministre du BNP, a été emprisonnée pour corruption en février 2018.
Un tournant à droite
Dans le même temps, les forces de gauche engagées dans les mouvements populaires ont elles aussi été confrontées au harcèlement et à la répression. L'État a pris pour cible les dirigeant·es du mouvement Rampal en les accablant de fausses accusations et en les intimidant physiquement, et les mouvements de travailleurs/ses ont subi le même sort.
Les islamistes bangladais avaient l'habitude de soutenir le BNP lors des élections. Cependant, avec le déclin du BNP, ces forces ont commencé à participer aux joutes électorales sous leur propre drapeau. Pendant ce temps, la Ligue Awami a compromis ses références laïques historiques en formant une alliance tacite avec Hefazat-e-Islam, un groupe islamiste radical qui a été responsable du meurtre de blogueurs laïcs.
Le front politique dirigé par la LA comprenait plusieurs partis islamistes conservateurs. En outre, le gouvernement de Hasina a accordé certaines concessions aux forces islamistes, comme la validation des madrasas Qawmi, des écoles religieuses au programme conservateur qui ne sont pas réglementées par le gouvernement. Ces écoles se concentrent uniquement sur l'enseignement religieux et enferment les étudiant·es issu·es des couches les plus pauvres de la population dans des dogmes religieux mystiques. Tout cela a eu lieu malgré la prétention de la Ligue à être le sauveur suprême de la communauté religieuse hindoue minoritaire au Bangladesh.
La Ligue Awami a de plus en plus pris le contrôle de l'administration de l'État par le biais du processus des nominations de fonctionnaires et soumis les médias et l'intelligentsia à son contrôle grâce à un mélange d'incitations et de coercition. À la fin de l'année 2018, la LA possédait une emprise ferme sur la bureaucratie, le système judiciaire et même l'armée, traditionnellement considérée comme un soutien majeur du BNP.
Les résultats des élections de 2018 ont même dépassé les attentes les plus optimistes de la Ligue, ses candidats remportant 288 des 300 sièges en jeu. Les élections suivantes, en janvier 2024, ont été une mascarade, l'ensemble de l'opposition étant absente du scrutin. Cela a poussé la résistance dans l'arène extraparlementaire, culminant dans les manifestations qui ont évincé Hasina.
Le gouvernement intérimaire
Trois jours après le départ d'Hasina, l'économiste Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006, a prêté serment en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh. Officiellement appelé « conseiller en chef », M. Yunus dirigera une équipe de dix-sept personnes, composée de bureaucrates et d'officiers militaires à la retraite, de personnalités d'ONG, d'avocats, d'universitaires et d'autres personnes, ainsi que de quelques leaders étudiants impliqués dans la rébellion. La composition de l'équipe est diversifiée, tant par l'origine de ses membres que sur le plan ethnique et religieux, bien qu'elle ne comprenne aucun représentant de la classe ouvrière.
L'érosion constante des institutions démocratiques au Bangladesh a suscité une haine profonde à l'égard des partis politiques existants. Yunus était une figure appropriée pour diriger le gouvernement intérimaire car il s'agit d'une personnalité connue, avec une image s'élevant au-dessus de la politique partisane tout en promouvant le développement national. Il a également été harcelé par le gouvernement d'Hasina et a failli être contraint de quitter le pays, ce qui a renforcé la sympathie à son égard.
Pour M. Yunus, cette aventure fait suite à de précédentes tentatives infructueuses d'entrer dans le champ politique. Alors que de grandes attentes sont désormais placées en lui, nous devons garder à l'esprit son rôle antérieur, en tant que promoteur des programmes de microcrédit. Loin de représenter un remède à la pauvreté rurale, ces programmes n'ont fait qu'imposer des charges supplémentaires aux pauvres. Sa défense zélée des politiques néolibérales a fait de Yunus la coqueluche des gouvernements occidentaux et de la Banque mondiale.
L'économie au cœur de la crise
Le Bangladesh, qui a longtemps été la figure de proue du développement économique de la région, a récemment connu des difficultés. Le pays a été gravement touché par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, à l'instar du Sri Lanka et du Pakistan.
On prévoit maintenant que la croissance du PIB du Bangladesh tombera en dessous de 6 % cette année et l'année prochaine. Auparavant, le pays avait connu une croissance constante de 6 à 8 % entre la fin de la crise financière mondiale et le début de l'épidémie. La valeur du Taka a chuté par rapport au dollar américain, les prêts diminuent en raison des nombreux mégaprojets emblématiques et certains secteurs du secteur bancaire semblent instables.
Comment M. Yunus va-t-il résoudre cette crise ? Fervent partisan du fondamentalisme de marché et du capitalisme néolibéral, il demandera un renflouement au FMI, sachant pertinemment que ce dernier imposera en échange de sévères mesures d'austérité. Si de nombreux commentaires sur l'agitation politique actuelle au Bangladesh ont porté sur la tyrannie et l'autoritarisme du gouvernement de Sheikh Hasina, ils ont largement minimisé, voire complètement oublié, le changement qui s'est opéré dans l'économie du pays.
Si c'est le système des quotas qui a déclenché la rébellion, les causes sous-jacentes sont liées à des problèmes politiques et économiques plus profonds. Le Bangladesh est confronté à un chômage chronique, les deux cinquièmes des personnes âgées de quinze à vingt-quatre ans étant sans emploi et non scolarisées, selon le Bureau des statistiques du Bangladesh.
Bien que Sheikh Hasina ait affirmé qu'un miracle économique avait permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, l'essor de l'économie reposait en réalité sur le déclin de la rentabilité des capitaux bangladais. Avant la dépression provoquée par la pandémie en 2020, le rebond relatif de la rentabilité après la grande récession mondiale de 2008-2009 a commencé à s'éroder en 2013.
L'économie du pays peut-elle continuer à croître en se concentrant fortement sur la fabrication de vêtements et en exploitant une main-d'œuvre abondante et des salaires bas ? En outre, les mesures d'austérité du FMI vont recréer des conditions plus difficiles, une fois de plus, forçant les gens à descendre dans la rue après cette euphorie immédiate.
La Ligue Awami étant discréditée, les deux principales forces politiques restantes, le BNP et le Jamaat-e-Islami, espèrent que des élections anticipées les porteront au pouvoir. Cette dernière force, en particulier, semble être très bien organisée, avec des réseaux de militants dans tout le pays, et ne voudra certainement pas laisser passer cette chance.
Le soulèvement de juillet a été couronné de succès grâce à la participation d'un large éventail de forces sociales. Comme dans d'autres luttes contre des régimes autocratiques, l'aspiration populaire était celle de la liberté, largement exprimée de façon plutôt vague et abstraite. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'un mouvement guidé par des positions idéologiques clairement définies.
Les étudiant·es ont d'abord manifesté pour la réforme du système des quotas, mais la répression de l'État a déclenché un soulèvement de masse impliquant de larges pans de la classe ouvrière et de la classe moyenne bangladaises, qui s'est achevé par le soulèvement qui a balayé Hasina. Les étudiant·es ont gagné la confiance de la population et devront tracer la voie à suivre.
Le chemin à parcourir
On peut certainement espérer que l'esprit du mouvement étudiant contribuera à favoriser une prise de conscience plus claire de la nature d'un programme de transformation. Outre les demandes d'élections démocratiques et d'État de droit, les principaux points de ce programme comprendront des gains économiques tels que des salaires plus élevés et de meilleures protections sociales, ainsi qu'une action en faveur de la justice climatique – le Bangladesh est extrêmement vulnérable au changement climatique. On ne peut pas compter sur le gouvernement intérimaire ou ses successeurs probables pour relever l'un de ces défis.
À long terme, les événements de juillet ne déboucheront sur une issue positive que si la classe ouvrière et les autres groupes opprimés sont en mesure de jouer un rôle de premier plan, en surmontant les divisions religieuses et ethniques de la société bangladaise. Si les étudiant·es ont amorcé la révolution, les travailleurs devront veiller à ce qu'elle aboutisse. C'est là que réside le plus grand défi pour la gauche au Bangladesh.
Où va la gauche ?
Cependant, la gauche organisée est extrêmement faible au Bangladesh. Deux grands partis, le Parti des travailleurs du Bangladesh et une faction du Jatiya Samajtantrik Dal (JASAD), faisaient partie du gouvernement Hasina et sont complices de ses crimes. Il est vrai que les autres organisations de gauche, y compris le Parti communiste du Bangladesh, étaient dans la rue et que leurs cadres ont subi de nombreux meurtres et blessures, mais leur poids dans la politique bangladaise est extrêmement faible. La gauche, qui était autrefois une force puissante au Bangladesh, n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Il est difficile d'imaginer que la gauche a joué un rôle clé dans le mouvement linguistique de 1952 et dans le soulèvement de masse de 1969. À l'époque, elle exerçait également une influence inégalée sur les mobilisations paysannes et ouvrières. Toutefois, l'influence de la gauche s'est affaiblie après les années 1960, en partie à cause du conflit sino-soviétique qui a entraîné des divisions entre les partisans de Moscou et ceux de Pékin. Alors que l'influence chinoise a contraint une partie de la population à s'opposer activement à la guerre de libération, l'influence soviétique a poussé d'autres personnes à suivre aveuglément le premier président du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, et sa politique autoritaire. Les groupes qui s'opposaient au régime autoritaire ont été constamment persécutés. Des milliers de travailleurs/ses de gauche ont été tué·es et les espaces organisationnels tels que les syndicats et les associations d'étudiant·es ont été l'objet d'attaques violentes, une tendance qui s'est poursuivie sous le régime militaire.
Il faut une gauche indépendante
Historiquement, la gauche bangladaise a manqué de confiance pendant des années, dépendant du soutien extérieur de Moscou ou de Pékin. Au lieu de créer des organisations indépendantes et de s'unifier avec d'autres sections de la gauche dans les années 1980, elles ont mis leur force et leurs efforts au service de la Ligue Awami dirigée par Sheikh Hasina ou du BNP dirigé par Khaleda Zia, en donnant la priorité à leurs programmes plutôt qu'à ceux de la gauche.
En fait, tout au long de l'histoire du Bangladesh, les dirigeants – de Sheikh Mujibur Rahman à Ziaur Rahman, H. M. Ershad, Khaleda Zia et Sheikh Hasina – ont été en mesure d'obtenir le soutien inconditionnel de l'un ou l'autre parti de gauche. Cela a entraîné la liquidation de nombreux/ses dirigeant·es dans les partis de la classe dirigeante. Par conséquent, un nombre important d'individus de l'« ex-gauche » ont commencé à travailler pour la Ligue Awami, le BNP ou le Jatiya Parti. Actuellement, cette partie est plus importante que celle de la gauche militante. La plus grande partie de la gauche est piégée dans le crétinisme parlementaire, tandis que les autres petites organisations sont plus des ONG que des organisations politiques.
Dans ce processus, les questions de l'exploitation capitaliste ou les questions telles que les discriminations fondées sur le genre ou l'appartenance ethnique sont commodément oubliées. La seule chose positive à dire sur la gauche est qu'elle s'oppose à toute forme de fondamentalisme religieux ou de violence fondée sur l'appartenance ethnique. Le Bangladesh a besoin d'une nouvelle gauche anticapitaliste forte, dont la vision du socialisme dépasse les « socialismes réellement existants du 20e siècle », si bureaucratiques.
Une nouvelle gauche capable de faire face à la crise actuelle de la démocratie, à la montée des forces réactionnaires, à l'augmentation de la violence étatique et de la guerre, ainsi qu'à l'accroissement des inégalités, à la crise climatique, à la surveillance et au capitalisme du désastre. La gauche doit se réinventer, se réorganiser et s'unifier contre toutes les formes de domination bourgeoise. Une condition essentielle pour cela serait de défendre une identité indépendante et une vision claire et déterminée, associée à une politique créative. Une telle gauche, nouvelle, est plus que nécessaire aujourd'hui.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La jubilation barbare d’Israël face à l’assassinat de Nasrallah est un nouveau coup bas pour la société israélienne

Un journaliste de Channel 13 News a distribué du chocolat à des passants dans la ville de Carmiel samedi matin, en direct à la télévision. Un journaliste des médias de masse, qui n'a pas la moindre idée de son travail, a distribué du chocolat à des personnes épuisées qui ne se souviennent pas d'un Israël différent. Jamais auparavant du chocolat n'avait été distribué en direct à l'occasion d'un assassinat ciblé. Jamais nous n'étions tombés aussi bas.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Le 23 septembre 2024, les forces aériennes israéliennes ont lancé une troisième vague de frappes aériennes sur le Liban © Euromed rights
Un autre journaliste, bien plus important et populaire, Ben Caspit, représentant de l'imposture du « centre modéré », a écrit sur X : « [Le chef du Hezbollah Hassan] Nasrallah a été écrasé dans sa tanière et est mort comme un lézard ... une fin appropriée ». Comme s'il avait lui-même défoncé le bunker.
Ce patriotisme barbare s'est manifesté samedi, Israël s'en est réjoui. Les nazis appelaient les Juifs des rats, et Nasrallah est un lézard. Qui pourrait s'opposer à cela ? Les fascistes les plus extrémistes étaient encore terrés dans leurs synagogues, attendant les trois étoiles du crépuscule pour cracher leurs blasphèmes et leur joie maladive, mais entre-temps, l'honnête et éclairé Ben Caspits a admirablement fait le travail.
« Shehehianu vekiamanu », a écrit l'un d'entre eux, en référence à une prière de gratitude - un sentiment partagé par beaucoup. L'ampleur des pertes causées par les 80 bombes américaines n'est pas encore connue, mais les chiffres n'auront aucun effet en Israël : 100 ou 1 000 civils innocents, même la mort de dizaines de milliers d'enfants, ne changeront rien à l'état d'esprit des Israéliens. Pourquoi pas une petite bombe atomique ? Après tout, nous avons tué Hitler.
Il n'est pas nécessaire d'être un rabat-joie en série pour s'interroger sur la joie et ses raisons. La situation d'Israël est-elle meilleure le dimanche matin que le vendredi matin ? L'humeur de la plupart des Israéliens s'est améliorée après une année morose ; nous avons recommencé à vénérer l'armée (tout le monde) et à vénérer le Premier ministre Benjamin Netanyahu (pas tout le monde), mais qu'est-ce qui a changé ? Hassan Nasrallah a été désigné pour mourir parce qu'il était un ennemi acharné d'Israël (et du Liban). Son assassinat ne sauvera pas Israël.
En cette première semaine sans Nasrallah, nous ferions bien de regarder autour de nous. La Cisjordanie est au bord de l'explosion ; Israël est coincé dans une bande de Gaza en ruine, sans issue en vue, tout comme les otages ; Moody's a rétrogradé l'économie au niveau plancher ; le massacre de masse qui a commencé à Gaza se déplace vers le Liban. Un demi-million de personnes ont été déplacées de leurs maisons, en plus des deux millions de leurs semblables dans la bande de Gaza qui errent ici et là, sans ressources. Mais bon, nous avons tué Hitler.
Il est préférable de ne même pas mentionner la position internationale d'Israël ; il suffisait de regarder l'Assemblée générale des Nations unies lors du discours de Netanyahou vendredi. La situation en matière de sécurité est également plus précaire qu'il n'y paraît. Attendez la guerre régionale qui pourrait encore éclater ; nous avons fait de grands pas dans cette direction vendredi. Pendant ce temps, le pays vit dans la terreur ; vendredi, les dizaines de milliers de personnes déplacées de leurs maisons dans le nord n'ont pas fait un pas de plus vers leur retour, mais Israël se réjouit de la chute de son ennemi.
Au cours de l'année écoulée, Israël n'a parlé qu'une seule langue, celle de la guerre et de la force débridées. Il est exaspérant de penser que des millions de personnes ont tout perdu à cause de cela. Pendant que les bombardiers bombardaient Dahiyeh, sous les applaudissements en Israël, des millions de personnes à Gaza, en Cisjordanie et au Liban pleuraient amèrement leur sort, leurs morts, leurs infirmes, leurs biens perdus et les derniers lambeaux de leur dignité. Il ne leur reste plus rien.
Telle est la réalité qu'Israël promet. Nasrallah mort ou vif, un jour le volcan entrera en éruption. Dépendant de l'Amérique, complice servile du massacre de Gaza et de la guerre du Liban - qui n'a rien fait pour les éviter si ce n'est les paroles du président Joe Biden et du secrétaire d'État Antony Blinken, impuissants face à Netanyahou -, Israël pense pouvoir continuer ainsi éternellement. Il ne voit pas d'autre option.
Ce serait impossible sans le soutien de Washington. L'Amérique ne restera pas éternellement ainsi, compte tenu de ses tendances isolationnistes. Que se passera-t-il alors ? Félicitations pour avoir tué Nasrallah, mazel tov, son successeur attend dans les coulisses et, à en juger par l'expérience passée, il sera encore plus dangereux. Et Israël ? Il le tuera aussi et distribuera du chocolat aux passants.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Après un an de génocide, lutter encore et encore

« Il n'est pas invraisemblable d'estimer que jusqu'à 186 000 morts, voire plus, pourraient être imputables au conflit actuel à Gaza » (1) . Ce constat ne cesse d'empirer…
Tiré de Inprecor 725 octobre 2024
4 octobre 2024
Par Joseph Daher
Conséquences d'un bombardement dans la ville de Gaza en décembre 2023. © Tasnim News Agency – CC BY-SA 4.0
La guerre génocidaire d'Israël contre les Palestinien·nes se poursuit. Les négociations pour un cessez-le-feu définitif n'ont pas abouti, alors que Tel Aviv ajoute continuellement de nouvelles conditions et refuse de revenir sur le maintien de ses troupes à Gaza, le long des couloirs de Netzarim, au centre, et surtout de Philadelphie, à la frontière avec l'Égypte, ainsi qu'au point de passage adjacent de Rafah. Le général Elad Goren a été nommé à la tête de l'administration civile israélienne rétablie dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un nouveau poste au sein de l'unité de Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), une unité du ministère de la Défense dénoncée le 19 juillet par la Cour internationale de justice comme une continuation de l'occupation israélienne.
La Cisjordanie est le théâtre de violences et annexions de terres continues, de l'occupation israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 670 personnes y ont été assassinées et plus de 5 000 ont été déplacées de force. Plus de 2 000 hectares de terres ont été déclarés propriété de l'État israélien qui a accordé aux juifs israéliens le droit exclusif de les louer depuis le 7 octobre. L'objectif principal de la stratégie israélienne en Cisjordanie est son annexion en dépossédant les Palestinien·nes.
Israël a également intensifié ses attaques criminelles et destructrices contre le Liban, entraînant la mort de plusieurs centaines de civil·es, le déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers et des destructions massives. Tout cela se déroule avec la collaboration criminelle des puissances impérialistes occidentales qui fournissent un soutien militaire, économique et politique indispensable à l'État d'Israël.
Les classes dirigeantes partagent leurs expériences pour défendre leur ordre capitaliste autoritaire
Israël, en plus de rester un allié primordial de l'impérialisme occidental dirigé par les États-Unis, exporte dans le monde entier ses armes, ses systèmes d'armements de sécurité et ses technologies de pointe, utilisées contre les Palestinien·nes, pour aider d'autres États à réprimer leur propre population et à « militariser et sécuriser » leurs frontières contre les populations migrantes. Selon le ministère israélien de la Défense, les exportations d'armes du pays ont totalisé 13,1 milliards de dollars en 2023, un record historique, car Israël a doublé ses exportations d'armes au cours des cinq dernières années.
La guerre génocidaire contre Gaza est le reflet de la profonde crise politique mondiale. Israël est une société ouvertement raciste et répressive dans la manière dont elle traite la population palestinienne. C'est devenu un modèle que les partis d'extrême droite et de droite néolibéraux aimeraient suivre, ignorant le droit international, étant totalement libres de traiter comme ils le souhaitent les populations non blanches, que ce soit de nouveaux migrant·es ou de différentes minorités.
C'est pourquoi la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne Boycott Désinvestissement et Sanctions ont été et sont de plus en plus criminalisés dans les États occidentaux. Il s'agit d'un objectif plus large visant à cibler la gauche radicale et les mouvements de contestations progressistes et faire reculer les droits démocratiques, dirigé contre tous ceux qui défient le système capitaliste dominant.
Face au crime de génocide et aux menaces de guerre régionale, maintenir et approfondir les mobilisations populaires de solidarité
Le rôle de la gauche radicale est de participer à la construction et à la structuration des mouvements de solidarité avec la Palestine afin de défier nos propres classes dirigeantes en montrant leurs liens politiques, économiques et militaires avec l'État israélien.
Ces mobilisations populaires permettent également de créer les conditions d'une potentielle (re)structuration d'un pôle de gauche et progressiste au sein de nos sociétés, avec la conscience croissante qu'une victoire de la cause palestinienne serait une victoire de l'ensemble du camp des opprimé·es et des exploité·es opposé·es aux pulsions destructrices du capitalisme néolibéral et à la montée des mouvements fascistes, qui sont les deux projets politiques dominants menaçant les classes populaires et ouvrières.
Lutter pour la Palestine est aussi une manière de défendre les droits de tous ceux qui s'engagent dans la contestation de ce système mondial capitaliste autoritaire et inégalitaire. L'affaiblissement des classes dirigeantes occidentales et autres, c'est l'affaiblissement de l'État d'apartheid colonial et raciste d'Israël et vice versa.
Le 28 septembre 2024
1. The Lancet, 5 juillet 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il est urgent de mettre fin à la folie meurtrière de l’État d’Israël

Dans la continuité de sa guerre génocidaire à Gaza, l'État d'Israël s'est octroyé le droit d'éliminer tous ceux qu'il considère comme des alliés du peuple palestinien en général et du Hamas en particulier. Le premier ministre Netanyahou l'a revendiqué comme une évidence devant l'Assemblée générale des Nations-Unies en menaçant directement le Hezbollah libanais, les Houthis du Yemen ou les milices chiites pro-iraniennes de Syrie ou d'Irak. Point commun de toutes ces cibles pour Israël : l'Iran accusé de vouloir sa destruction.
Association France Palestine Solidarité
Solidarité avec les peuples palestinien et libanais
Le jour même, Netanyahou ordonnait à son armée une intervention dévastatrice au Liban. Après le sabotage des moyens de communications du Hezbollah qui constitue un crime de guerre supplémentaire, ont suivi les bombardements intensifs sur la population de Beyrouth et du sud Liban. Déjà plus de 900 morts (dont de nombreux enfants et une majorité de civil·es), des milliers de blessé·es et un million de déplacé·es. L'élimination du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de cadres du parti s'inscrit dans cette fuite en avant criminelle de Netanyahou et de son gouvernement. Tout comme l'invasion israélienne en territoire libanais ou les bombardements « ciblés » au Yémen, en Irak et en Syrie.
Cette agression du Liban est d'autant plus inquiétante qu'elle ne peut être que le prélude à une autre sur l'Iran. Une telle guerre plongerait alors le Moyen-Orient dans le chaos. Et pendant ce temps, les massacres commis par Israël à Gaza se poursuivent quotidiennement, bien qu'occultés médiatiquement.
Dans sa folie meurtrière le régime d'apartheid menace de destruction le peuple palestinien et risque d'entraîner tous les peuples de la région dans une guerre régionale épouvantable, et il le fait avec le soutien explicite financier, politique et militaire des États-Unis et de la France.
Israël vient d'obtenir 8,7 milliards de dollars d'aide des États-Unis pour soutenir ses efforts militaires. L'accord, conclu à Washington, est intervenu en pleine escalade avec le Hezbollah et la guerre à Gaza. Alors que la communauté internationale réclamait sans succès un cessez-le-feu, Joe Biden saluait comme « un acte de justice » l'assassinat du leader du Hezbollah libanais. Netanyahou a reçu l'autorisation des puissances occidentales pour mettre la région à feu et à sang au nom du supposé droit d'Israël « à se défendre ».
Une fois de plus, le peuple palestinien est aussi victime de la complicité active des pays occidentaux avec un État voyou coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dont la fonction reste la défense de leurs intérêts économiques et géostratégiques dans la région.
Il est urgent de mettre fin à l'engrenage meurtrier d'Israël et aux déclarations complices des chancelleries occidentales. Le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien exige du gouvernement français et de l'Union européenne qu'ils suspendent immédiatement toutes les coopérations militaires, économiques et commerciales avec Israël afin d'obtenir l'arrêt de la guerre génocidaire à Gaza et la fin de l'agression contre le Liban.
Le Bureau National de l'AFPS, le 4 octobre 2024
Photo : Une frappe israélienne sur le Liban a tué 70 personnes et en a blessé 80 autres, le 29 septembre 2024 © Times of Gaza
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un an après le 7 octobre, la mobilisation continue

Près d'un an après, les manifestations contre l'intervention israélienne à Gaza, qui s'étend aujourd'hui au Liban, sont toujours d'actualité. À Paris, une foule de 5 000 personnes, selon les autorités, a battu le pavé samedi 5 octobre, malgré un sentiment d'impuissance, avec des participants partagés entre tristesse et colère.
Tiré d'Orient XXI.
Samedi 5 octobre, place de la République. On pourrait presque croire à un événement festif, à voir tous ces drapeaux palestiniens s'agiter au rythme des slogans, sous le soleil d'automne. Mais tous ici le savent : cette manifestation est un cortège funèbre, mû par la rage et la tristesse. Les visages sont lourds, à deux jours du premier anniversaire des massacres du 7 octobre, et de tous ceux qui ont suivi depuis. La plupart des manifestants n'en reviennent pas d'être à nouveau là, une fois de plus, à marcher et à se casser la voix pour exiger la fin du génocide à Gaza. Combien de fois ont-ils traversé Paris pour cela ? Trop, sans doute.
Les étendards libanais sont particulièrement présents en ce jour. C'est même toute une forêt de cèdres qui s'ébranle, boulevard de Magenta, pour dénoncer les exactions israéliennes qui, après 11 mois de bombardement du Sud-Liban, s'étendent à la capitale et sa banlieue sud. Là aussi, le bilan s'est alourdi les dernières semaines, et le ministère de la santé libanais compte déjà plus de 2 000 morts, qui s'ajoutent aux 41 802 morts sous les bombes à Gaza, jusqu'au 4 octobre, selon le Centre d'opérations d'urgence sur place. La voix déchirante de Fairouz remplit l'espace. On entend davantage « Li Beirut » (Pour Beyrouth), son ode à la capitale libanaise, que le traditionnel « Ana dammi Falastini » (Mon sang est palestinien).
Obligés de tenir bon
Nayla* attend le début de la marche, un drapeau libanais à la main. Ses lunettes noires masquent un regard qu'on devine triste rien qu'au ton de sa voix. Elle parle avec ce calme particulier que seuls la colère et le désespoir autorisent. « Je me sens touchée dans ma chair, en tant que franco-libanaise, explique cette native de Beit Chebab, au nord de Beyrouth. Je suis touchée quand je vois des enfants mourir de faim et la communauté internationale détourner la tête ».
Cette quadragénaire n'en est pas à sa première manifestation, mais sa mobilisation pour la Palestine et le Liban cette fois a une saveur particulièrement amère. Elle commente avec lassitude :
- Durant cette année, on a vu les droits humains discrédités. Un deux-poids deux-mesures qui parle de terrorisme d'un côté, mais pas de l'autre, qui donne moins de valeur à une vie palestinienne qu'à une vie israélienne. Et maintenant le Liban va être pris en otage, encore une fois… Il faut un cessez-le-feu immédiat, et que Nétanyahou soit jugé pour crimes de guerre.

Elle n'est pas la seule à éprouver cette fatigue de répéter toujours les mêmes phrases, d'assister chaque jour à un massacre plus grave que la veille. Mais pour beaucoup, leur présence témoigne d'une irrépressible volonté de continuer à se battre même après des mois, voire pour ceux qui suivent la situation au Proche-Orient depuis longtemps, des années de lutte. « En tant que Palestinien, je me dois d'être là, estime Kenan, 26 ans. On est un peuple connu pour sa résilience et sa résistance. On sait qu'après l'orage vient le beau temps, donc on tient bon. On est obligés de toute façon. »
Il ne se rappelle pas quand date son arrivée dans le collectif Urgence Palestine, à l'origine de la manifestation du jour. Mais ces douze derniers mois, eux, sont gravés dans sa tête. « On a assisté aux pires massacres des dernières années, et on les voit en temps réel », s'indigne-t-il. L'effet sur le nombre de militants qui ont rejoint l'association en cours d'année est indéniable. « Beaucoup d'entre eux sont sur une ligne radicale, que les Palestiniens clament depuis longtemps, à savoir une Palestine libre de la mer au Jourdain. » Le jeune homme y voit la source d'une énergie supplémentaire. « On sait qu'on était là avant [la colonisation], et qu'on sera là après. Les militants nous donnent de la force, et le chaos actuel ne fait qu'accroître notre détermination. On ne lâchera jamais l'affaire. »
Se sentir moins seule
À quelques mètres de Kenan, Philippe brandit une affiche du Parti communiste révolutionnaire. À 66 ans, sa fougue reste intacte. « Je suis là depuis qu'on a commencé à embêter les Palestiniens sur leur territoire, ou presque », sourit-il derrière ses lunettes rondes. Son regard sur la colonisation israélienne s'étend sur plusieurs décennies, et il constate une forme d'indifférence dans les médias et chez les gouvernements occidentaux : « Les tueries et l'accaparement des terres n'ont fait qu'augmenter, mais les médias français sont presque unanimes pour donner un blanc-seing à Israël. Les pays européens sont tous spectateurs. » L'indignation fait trembler sa voix, mais l'espoir est toujours là : « Je pense que ça revient petit à petit. Les vraies intentions expansionnistes de Nétanyahou au Liban et en Syrie sont de plus en plus difficiles à cacher. Mais bon, il y a les États-Unis derrière… » Sa femme, Marie-Noëlle, acquiesce silencieusement.

Plus loin, à Barbès, la section d'Antony (banlieue de Paris) de l'Association France Palestine Solidartié (AFPS) cède aux appels d'une terrasse ombragée. Les kilomètres parcourus ont eu raison de leur énergie physique, mais pas de leur combativité. Si l'AFPS est une des organisations historiques de la lutte pour les droits du peuple palestinien en France, cette antenne est toute nouvelle. « On a créé ça tous ensemble, on fait tout ensemble », rit Hélène, accompagnée de son groupe d'amis. « C'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années, bien sûr, mais ce n'est que récemment qu'on a tous décidé de se mobiliser. C'est l'humanité entière qui est en danger au Proche-Orient », affirme-t-elle.
L'énergie qui les fait traverser Paris, comme le souligne son mari, c'est « l'anticolonialisme ! » et « le sentiment d'horreur, face à toutes ces victimes », ajoute Hélène. Mais c'est aussi, pour l'une d'eux, une situation personnelle qui la lie à la Palestine : « Mon mari vient de là-bas », confie Catherine*.
- Pendant près de 20 ans, je me suis tenue éloignée de la vie militante, pour rester discrète. J'avais peur de compromettre mes voyages avec mon mari dans son pays d'origine. Il m'est arrivé de venir en manifestation pour me sentir moins seule, pour me confirmer que j'étais bien lucide face à cette situation. Et après le 7 octobre, j'ai eu besoin d'avoir ce sentiment plus régulièrement, plus près de moi.
Depuis, elle n'en démord pas, ce n'est pas elle, mais bien la situation en Palestine, qui est « complètement folle ».
Plusieurs générations de manifestants
Sur un trottoir pas loin, trois femmes de trois générations différentes se sont arrêtées pour prendre en photo un graffiti en soutien aux Gazaouis. Lila est venue avec sa mère Yamina et sa fille Kamir. « À la base, on faisait juste des achats, et on est tombé sur la manifestation, alors on est venues se joindre. C'est une cause qui nous tient à cœur », explique Lila avec sincérité. « Bien qu'on soit conscientes que notre présence ici ne va rien changer », s'empresse-t-elle d'ajouter, comme pour s'excuser d'y avoir cru. La durée de la colonisation les laisse toutes trois désemparées. « On a l'impression que malgré tout ce qui se passe depuis des années, rien ne change. Que les mobilisations à travers le monde ne comptent pas », se lamente Lila. Kamir, à peine sortie de l'adolescence, se sent déjà découragée. « C'est triste de voir qu'un gouvernement peut agir ainsi sans que le monde entier ne réagisse. On se sent démunis, on a l'impression de n'avoir aucun moyen de faire bouger les choses. » La grand-mère opine, mais son regard exprime la fierté d'être là, malgré tout.
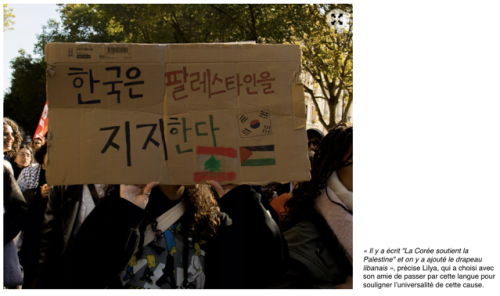
Le cortège atteint Pigalle, où les poupées ensanglantées, brandies pour rappeler les milliers d'enfants morts de Gaza, et les pancartes jurent avec les enseignes des cabarets et des sex shops. L'une d'elles, brandie timidement à bout de bras par une jeune fille aux longues boucles, est incompréhensible pour quiconque ne parlant pas coréen. « Il y a écrit "La Corée soutient la Palestine" et on y a ajouté le drapeau libanais », précise Lilya, qui a choisi avec son amie de passer par cette langue pour souligner l'universalité de cette cause. À 22 ans, c'est sa toute première manifestation. Elle explique ses motivations, soucieuse d'utiliser les bons mots. « Ça fait un an que ce génocide a commencé. Il fallait que je me mobilise. Je rentre tout juste de l'étranger où je n'en ai pas eu l'occasion, je postais uniquement des infos sur les réseaux sociaux », explique cette étudiante d'origine marocaine. « Mais la manifestation d'aujourd'hui me donne envie de m'engager plus. Il y a du monde, je suis avec mes amies, et avec notre affiche on veut dire que peu importe qui on est et où on se trouve, il faut se mobiliser pour cette cause importante. »
Place de Clichy, Marwane fanfaronne devant les CRS. Son keffieh couvre son visage et ne laisse voir que quelques boucles noires et ses yeux. La paire de lunettes de protection au sommet de sa tête dit de lui qu'il est prêt à en découdre. « Je me suis déjà fait courser par les policiers. Mais j'ai réussi à les esquiver. La dernière fois, je me suis même caché dans un hôtel », rit le jeune homme originaire de Cergy. Il participe aux mobilisations, de temps en temps, quand il peut. « Quand je vois ce qui se passe là-bas… Je ne suis pas un homme qui pleure beaucoup, mais honnêtement, ça me fait monter les larmes », admet-il. « Ça me touche beaucoup. Les Palestiniens sont déshumanisés, les actes commis là-bas ne sont pas normaux. » Que la mobilisation ne soit pas plus étendue le questionne. « J'ai l'impression que les gens ne sont pas sensibles à ce qu'il se passe, c'est terrible. Moi si je suis ici, c'est pour montrer mon côté humain. » À 19 ans, débordant d'énergie, il occupe avec ses amis différents coins de la place. Une petite bande de potes, qui se sont connus à Cergy ou en manifestation.
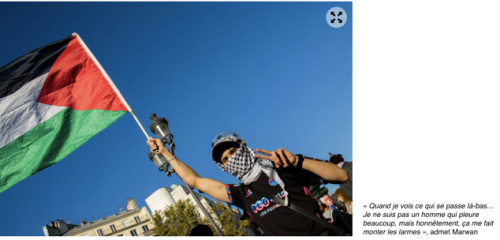
Dans la queue du cortège, un écriteau d'un bleu clair, discret, demande pardon aux Libanais, en français et en hébreu. « Quand je vois le CRIF, le grand rabbin de Paris, et toutes ces autorités juives approuver le génocide à Gaza, j'estime que ça engage ma communauté, donc j'ai envie de demander pardon », explique Serge. Deux jeunes Allemands se sont excusés auprès de lui, au nom de leur pays, pour les crimes commis envers les juifs, et lui ont donné l'idée d'en faire de même. « Ça fait trente ans que je manifeste pour la cause palestinienne. Mais le pardon est venu récemment, en réponse aux atrocités commises là-bas, soi-disant en notre nom », poursuit-il. « Exprimer ma judéité dans ce genre de rassemblement ne m'a apporté que des témoignages de fraternité. J'espère que les juifs le voient, même si ça peut les mettre mal à l'aise, ça peut les aider à avancer aussi. J'espère, en tout cas. »
Les derniers danseurs entament une dabké (1) avant que la musique ne s'éteigne. Les forces de l'ordre dispersent une foule qui ne résiste plus. Des petits groupes, malgré tout, restent discuter sous les derniers rayons de soleil de l'été indien. Malgré la lassitude et l'abattement, une énergie les retient, comme une forme de soulagement. Après un an, ils sont toujours là, malgré tout. Le temps n'a pas eu raison de leur foi. Ils ne l'espèrent pas, mais ils manifesteront une année de plus s'il le faut.

*les prénoms ont été modifiés à la demande
Notes
1- NDLR. Danse folklorique répandue dans les pays du Levant.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Du nettoyage ethnique au génocide

Je suis un survivant de la Nakba de 1948 qui a vécu pour être témoin du génocide de 2024. Je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour voir la justice rendue, mais je suis certain que notre longue lutte sera récompensée. Nos petits-enfants vivront à nouveau chez elles et eux.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Je suis un survivant de la Nakba de 1948. Depuis lors, au cours des 76 dernières années, j'ai passé ma vie à réfléchir à cette tragédie, à la documenter, à la dfaire connaitre aux gens du monde entier et à élaborer des plans pour y remédier, en réclamant le droit au retour. J'étais loin de me douter qu'un événement plus important et plus sanglant nous attendait avec la campagne de génocide qui dure depuis un an à Gaza.
Comment ces deux événements se comparent-ils pour quelqu'un comme moi, qui a vécu les deux ?
Les deux événements ont duré un an, du moins jusqu'à présent. La Nakba de 1948 a commencé en mars 1948 lorsque la Haganah, la milice sioniste, a commencé à envahir la Palestine avant que l'État d'Israël ne soit déclaré. Elle s'est conclue par la signature d'accords d'armistice avec l'Égypte, la Jordanie et le Liban, qui ont envoyé des forces pour sauver les Palestinien·nes, mais sans succès. La Syrie a signé l'accord quatre mois plus tard.
Cette campagne n'a pas fait l'objet de contestation. Les forces de la Haganah, composées de 120 000 soldat·es, dont certains étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ont formé neuf brigades et mené 38 opérations militaires. Du côté des défenseur·euses, un groupe hétéroclite de forces arabes, ne dépassant pas 10 000 combattant·es opérant sous différents commandements.
Le résultat est clair. Les forces sionistes ont occupé 20 500 km2, soit 78% de la Palestine, dépeuplé 530 villes et villages de leur population et fait deux tiers des réfugié·es palestiniens jusqu'à aujourd'hui.
À l'époque, Israël dispose d'une petite armée de l'air et d'une flotte négligeable. Il s'appuyait sur des soldat·es à pied pour occuper et gagner des territoires.
Israël a perdu 6 000 soldat·es. Il a tué 15 000 Palestinien·nes, principalement des villageoi·ses non armé·es, et en a emmené un nombre similaire dans des camps de travail forcé où elles et ils ont été utilisé·es comme esclaves pendant des années.
L'équation entre le nombre de soldat·es et la taille du territoire occupé est claire. Un nombre relativement faible de soldat·es a occupé un territoire très étendu contre une résistance marginale.
Faisons un bond en avant de 76 ans. Les descendant·es des réfugié·es de 1948 ont été entassé·es dans des camps de réfugié·es à Gaza, avec une densité de 8 000 personnes par km2. Cette densité a été doublée depuis le 7 octobre. Elles et ils ont créé un groupe de résistance d'environ 15 000 combattant·es, comme certain·es le disent. Elles et ils ont creusé des tunnels souterrains.
Pendant 12 mois, Israël a déchaîné ses forces sur elles et eux, plus d'un demi-million de soldat·es, une formidable force de chars et une force aérienne avancée et mortelle. Israël a pulvérisé le paysage de la bande de Gaza et a tué et blessé plus de 200 000 Palestinien·nes, dont la majorité étaient des femmes et des enfants. Ce fut un massacre sans précédent dans l'histoire moderne.
Le nettoyage ethnique de 1948 est devenu un véritable génocide en 2024.
Mais les défenseur·euses n'ont jamais capitulé. Elles et ils se battent encore.
Israël n'a pas réussi à occuper un kilomètre de terre de manière permanente.
Le contraste entre 1948 et 2024 est déconcertant.
En 1948, l'occupation israélienne du territoire s'est faite par des soldat·es. En 2024, les soldat·es israélien·nes sont quasiment absent·es. Si elles ou ils s'aventurent hors des chars, c'est pour être aussitôt frappé·es. Nous avons vu à la télévision que si un·e soldat·e israélien·ne était touché·e, les autres s'enfuyaient. Nous avons vu des soldat·es israélien·nes traîné·es au front à Gaza, refusant de s'enrôler ou désertant.
C'est la différence entre des soldat·es qui défendent leur pays même si elles et ils se trouvent dans des camps de réfugié·es, et d'autres qui sont amené·es à occuper une autre terre et à tuer un autre peuple.
S'asseoir derrière un écran d'ordinateur, comme le font les Israélien·nes, sélectionner une banque de cibles, envoyer des drones ou faire voler des F35 meurtriers peut causer une dévastation incroyable et des morts aveugles parmi les femmes et les enfants, mais cela ne permet pas de gagner un pouce de terrain.
La terre appartient au peuple qui meurt pour elle, face à une adversité effroyable, non seulement la mort sous les décombres, mais aussi la famine, la maladie et la perte de tous les moyens de subsistance.
Il existe une autre différence entre 1948 et 2024. Le 14 mai 1948, nous avons été attaqué·es à Al-Ma'in, ma ville natale, par 24 véhicules blindés israéliens. Ils ont détruit toutes les structures et tué tous ceux qu'ils ont trouvés. Ce jour-là, je suis devenu un réfugié. Ce même jour, Ben-Gourion a proclamé l'État d'Israël, un État de colons.
Personne en Occident n'était au courant de notre existence. Il y a eu des célébrations de victoire à Tel Aviv et à New York, saluant le triomphe de la minorité de Juifs et de Juivres combatif·ves qui se défendaient contre la majorité d'Arabes sauvages qui essayaient de les tuer.
Personne ne se souciait de nous, à l'exception de quelques personnes dévouées. Je me souviens des membres de l'American Friends Service Committee (AFSC ou Quakers) qui sont venus nous aider. Elles et ils ont construit les camps de réfugié·es, dont vous connaissez les noms aujourd'hui, à Bureij, Nuseirat, Jabalia et d'autres. Le 12 octobre 1949, un de leurs officiers écrit à son QG de Philadelphie pour décrire l'état d'esprit des réfugiés :
Par-dessus tout, elles et ils souhaitent rentrer à la maison, dans leurs terres et leurs villages qui, dans de nombreux cas, sont très proches. Apparemment, elles et ils n'hésitent pas à retourner dans la nouvelle culture qui se développe en Israël. Ce désir reste naturellement la demande la plus forte exprimée ; seize mois d'exil ne l'ont pas entamée. Sans lui, ils n'auraient aucune raison de vivre. Il s'exprime chaque jour sous de multiples formes. « Pourquoi nous maintenir en vie » en est une expression. Elle est aussi authentique et profonde que peut l'être la nostalgie d'une personne pour sa maison. Dans l'esprit des réfugié·es, la réinstallation n'est même pas envisagée.
Mais l'Occident n'a pas écouté et n'a même pas voulu savoir. Toutes les grandes agences de presse étaient occupées à proclamer la victoire des Juif·ves vertueux·ses. Leurs correspondant·es au Moyen-Orient étaient invariablement des sionistes. Parler des réfugié·es palestinien·nes était un péché impardonnable.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
En 2024, sur des centaines de campus aux États-Unis et en Europe, des jeunes ont vu la lumière là où devait se trouver la justice. Elles et ils se sont battu·es contre leurs dirigeant·es, leurs aîné·es et leurs fournisseur·euses pour prononcer une parole de justice et déclarer : « La Palestine libre, du fleuve à la mer ».
Les gens du monde entier ont entendu parler de nous et ont vu notre tragédie sur les écrans de télévision. Certain·es ont osé s'exprimer, défiant l'épée sur leur cou.
Ce fut une incroyable correction historique, payée par le sang des Palestinien·nes. Mais cela ramènera-t-il à la vie les centaines de milliers de personnes tuées, ou les parents de 18 000 orphelins ? Plus important encore, le sang des victimes permettra-t-il au droit international de punir les criminels de guerre ? Donnera-t-il à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice le pouvoir d'appliquer leurs verdicts ? La justice sera-t-elle rendue et les réfugié·es, véritables otages, rentreront-ils et elles sur leurs terres ?
Je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour voir cela se produire, mais je suis certain que cela se produira. Car le mal, aussi puissant soit-il, a une vie courte.
Lorsque la justice sera rendue et que nous, les réfugié·es palestinien·nes, rentrerons chez nous, notre longue lutte sera récompensée et les centaines de milliers de personnes qui ont été assassinées ne seront pas mortes en vain. En effet, nos petits-enfants vivront à nouveau chez elles et eux, et l'attente entre 1948 et 2024 sera terminée. Que toutes les personnes libres fassent en sorte que cela se produise.
Salman Abu Sitta est le fondateur et le président de la Palestine Land Society, à Londres, qui se consacre à la documentation de la terre et du peuple palestiniens. Il est l'auteur de six livres sur la Palestine, dont le compendium « Atlas of Palestine 1917-1966 », en anglais et en arabe, l'« Atlas of the Return Journey » et plus de 300 documents et articles sur les réfugié·es palestinien·nes, le droit au retour, l'histoire de la Nakba et les droits de l'homme. Ses mémoires « Mapping My Return », largement acclamés, décrivent sa vie en Palestine et sa longue lutte en tant que réfugié pour rentrer chez lui.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un an de guerre dévastatrice d’Israël contre Gaza

Près de 42 000 Palestinien·nes ont été tué·es, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, alors que l'enclave assiégée marque une année de guerre génocidaire de la part d'Israël.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La guerre d'Israël contre Gaza, l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire récente, a fait près de 42 000 mort·es, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, et plus de 96 000 blessé·es, selon les responsables palestiniens de la santé.
Ce bilan risque d'être bien plus lourd, car des milliers de personnes restent ensevelies sous les décombres ou dans des zones inaccessibles aux équipes médicales, dans le cadre d'une opération militaire que de nombreux gouvernements et groupes de défense des droits ont caractérisé de génocide contre les Palestinien·nes.
L'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par le groupe palestinien Hamas — au cours de laquelle, selon les autorités israéliennes, 1 139 personnes ont été tuées et environ 250 ont été faites prisonnières — a été suivie par l'offensive dévastatrice d'Israël sur Gaza.
Au cours de l'année écoulée, environ 90 % des 2,3 millions d'habitant·es de Gaza ont été déplacé·es, la plupart d'entre elles et eux à plusieurs reprises, selon les estimations des Nations unies.
Des centaines de milliers de familles palestiniennes s'entassent dans des camps de tentes tentaculaires près de la côte méditerranéenne, sans électricité, ni eau courante, ni toilettes. La faim et les maladies sont très répandues.
Le Shelter Cluster, une coalition internationale de fournisseurs d'aide dirigée par le Conseil norvégien pour les réfugié·es, explique qu'il a eu du mal à acheminer des fournitures de base en raison des restrictions israéliennes, des combats en cours et de l'effondrement de la loi et de l'ordre dans la bande de Gaza. Elle estime que quelque 900 000 personnes ont besoin de tentes et de literie.
Les Nations unies indiquent que la guerre a endommagé ou détruit plus de 92 % des routes principales de Gaza et plus de 84 % de ses établissements de santé. Elle estime que près de 70 % des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Gaza ont été détruites ou endommagées. Cela comprend les cinq installations de traitement des eaux usées du territoire, ainsi que les usines de dessalement, les stations de pompage des eaux usées, les puits et les réservoirs.
Les Nations unies estiment également que la guerre a laissé quelque 40 millions de tonnes de débris et de décombres à Gaza, soit une quantité suffisante pour remplir le Central Park de New York sur une profondeur de 8 mètres (environ 25 pieds). Il faudra jusqu'à 15 ans et près de 650 millions de dollars pour tout déblayer.
La Banque mondiale a estimé à 18,5 milliards de dollars les dégâts causés à Gaza au cours des trois premiers mois de la guerre, avant qu'Israël ne lance la plupart de ses opérations militaires. Ce chiffre équivaut presque à la production économique combinée de la Cisjordanie et de Gaza en 2022.
Israël a autorisé l'entrée de matériaux de construction à l'intérieur de la bande de Gaza avant la guerre, mais les restrictions et les retards s'accumulent. Le Shelter Cluster estime aujourd'hui qu'il faudrait 40 ans pour reconstruire toutes les maisons détruites de Gaza dans le cadre de ce système.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Al Jazeera
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entretien : « Les Israéliens sont intoxiqués par leur propre traumatisme du 7-Octobre »

Un mois après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, Omer Bartov, spécialiste du génocide, jugeait qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser un tel mot pour qualifier la réponse militaire israélienne. Mais cet historien israélo-américain a changé d'avis, et se convertit désormais en lanceur d'alerte.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Il y a plus de cinquante ans, en 1973, l'historien Omer Bartov a connu la guerre comme jeune réserviste dans l'armée israélienne. Devenu l'un des plus grands spécialistes du génocide – son dernier livre, Anatomie d'un génocide. Vie et mort dans une ville nommée Buczacz, sera publié en poche le 30 octobre –, il assiste à 70 ans, depuis les États-Unis, où il enseigne, à un nouveau conflit armé déclenché le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas.
Un choc comparable à celui provoqué le 6 octobre 1973, en pleine fête juive du Yom Kippour, par l'offensive simultanée de l'Égypte et de la Syrie dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, des territoires occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967.
En novembre 2023, Omer Bartov a publié, dans le New York Times, un texte intitulé « Ce que je crois en tant qu'historien du génocide ». « En tant qu'historien du génocide, écrit-il alors, j'estime que nous n'avons aucune preuve qu'un génocide soit en train de se dérouler actuellement à Gaza, bien qu'il soit très probable qu'y sont commis des crimes de guerre, et même des crimes contre l'humanité. » Il ajoute cependant : « L'histoire nous a enseigné qu'il est crucial d'alerter l'opinion sur le risque d'un génocide avant qu'il ne se produise, plutôt que de le condamner tardivement une fois qu'il a eu lieu. Il est encore temps de sonner l'alarme. »
L'alarme, il l'a sonnée en août, dans le Guardian cette fois. Sous le titre « En tant qu'ancien soldat des forces armées israéliennes et historien du génocide, j'ai été profondément troublé par ma récente visite en Israël », il rend compte de son déplacement dans le pays où il est né (le texte a été publié en français par Orient XXI). Et de son changement de position sur les « actions génocidaires systématiques » à Gaza. Entretien.
Mediapart : Pourquoi avez-vous changé d'avis sur l'action militaire israélienne à Gaza ?
Omer Bartov : Pour moi, le moment marquant a été la décision israélienne d'intervenir à Rafah le 8 mai, malgré les avertissements des États-Unis de ne pas s'y rendre, car environ un million de personnes s'y trouvaient. Ils ont prévenu qu'une telle action provoquerait de nombreuses pertes civiles. Les forces armées israéliennes ont répondu : « Non, tout ira bien. Nous pouvons gérer cela. »
Elles l'ont fait en déplaçant des centaines de milliers de personnes vers Al-Mawasi, dans la zone côtière du sud-ouest de Gaza. Cela signifiait que l'ensemble de la population de Gaza, plus de 2 millions de personnes, avait été déplacé plusieurs fois sans plan explicite concernant son avenir, du moins pas de plan dont nous ayons connaissance.
À ce moment-là, il m'est apparu que cela allait bien au-delà de ce que les forces armées israéliennes prétendaient, à savoir qu'elles déplaçaient la population pour sa propre sécurité, en l'éloignant des zones d'opération militaire. Il s'agissait plutôt d'un effort systématique pour rendre Gaza totalement inhabitable. Et l'on peut ajouter à cela la prise de conscience croissante que les forces armées israéliennes ont délibérément détruit toute l'infrastructure nécessaire à la vie, ainsi qu'à la culture et à l'éducation – universités, écoles, hôpitaux, mosquées, musées – de manière intentionnelle et systématique.
Il m'a semblé qu'il n'y avait pas d'autre option que de considérer cela comme une tentative de détruire cette partie de la population palestinienne, soit en rendant sa vie si misérable qu'elle mourrait progressivement, soit en provoquant des conséquences à long terme pour de nombreuses personnes, probablement la majorité d'entre elles. En plus des 40 000 personnes tuées, dont beaucoup sont probablement encore sous les décombres, les répercussions se feront sentir sur un grand nombre de gens. On s'attend à ce qu'ils meurent ou qu'ils deviennent si désespérés qu'ils fuient.
Tout cela me semble constituer une campagne génocidaire, selon la définition de l'ONU, qui considère le génocide comme la destruction d'un groupe en tant que tel.
Il y a un autre élément : il y a de plus en plus de discussions en Israël au sujet du nord du corridor de Netzarim [le corridor de Netzarim, qui traverse la partie sud de la ville de Gaza, est une route qui traverse la bande de Gaza d'est en ouest et s'étend sur 7 kilomètres de la frontière israélienne à la mer Méditerranée – ndlr],et ces discussions, en voyant ce qui se passe au Liban, semblent aller bien au-delà des paroles. On parle d'expulser les 200 000 ou 300 000 civils palestiniens qui sont encore là. Cette zone a été largement dévastée. D'après tous les rapports, il ne reste rien de Gaza City. Des camps de l'armée israélienne y ont déjà été établis, et la route a été asphaltée de Netzarim à la mer. Il semble que l'idée soit que le tiers nord de la bande de Gaza devienne complètement vide.
Des colons réclament déjà de s'installer là-bas. Cela pourrait n'être que la première étape avant de se déplacer progressivement vers le sud en chassant la population. Mis ensemble, tout cela me semble constituer une campagne génocidaire, selon la définition de l'ONU, qui considère le génocide comme la destruction d'un groupe en tant que tel.
Depuis que j'ai commencé à réfléchir à cette situation, il y a de plus en plus de preuves de ce phénomène. Cela fait clairement partie d'un plan plus large, car nous voyons ce qui se passe en Cisjordanie, où la violence de l'armée augmente. De nombreuses façons, l'armée applique les méthodes qu'elle utilise à Gaza. On assiste à une « gazaïsation » de la Cisjordanie, avec l'utilisation d'avions, etc. Parallèlement, il semble qu'il y ait un projet pour les personnes qui pourraient rester à Gaza : imposer un système d'apartheid similaire à celui qui existe en Cisjordanie, avec une prétendue Autorité palestinienne qui collaborerait essentiellement avec le régime israélien et l'entrée de plus en plus de colons juifs dans cette région.
Quelles ont été les réactions à votre texte, vous historien de la Shoah accusant Israël de mener un génocide ?
En réalité, je n'ai pas reçu beaucoup de réactions. Je ne sais pas combien de personnes en Israël lisent ce que j'écris en dehors du pays. Peut-être pas tant que cela. Cet article a été publié en hébreu, sur le site Local Call, Sikha Mekomit en hébreu, mais très peu de gens l'ont lu. Je pense que la plupart de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne prennent même pas la peine de m'écrire. Chaque jour, je reçois quelques courriels haineux, mais je ne sais souvent même pas d'où ils viennent.
Comment expliquez-vous ce silence ?
Ce silence n'est pas seulement un silence à mon égard. C'est un silence qui va au-delà de mon propre cas. C'est ce dont je parlais dans The Guardian. Je ne suis pas le seul à remarquer et à rapporter cela. Il y a une évolution des sentiments israéliens à un degré bien plus important qu'avant le 7-Octobre. Cela est clairement lié à cet événement, mais cela a aussi des racines plus profondes, notamment le fait de considérer les Palestiniens comme moins humains ou moins dignes de droits complets que nous, Israéliens. Le processus de colonisation y contribue.
Lorsque vous éloignez un peuple pendant longtemps, vous maintenez ses membres de l'autre côté de la barrière, ce qui fait que vous ne les rencontrez pas. Et quand vous les rencontrez, en uniforme, vous les traitez comme s'ils n'avaient pas de droits. Vous pouvez entrer chez eux, les frapper, faire ce que vous voulez, parce qu'ils sont en dehors de toute considération, et vous êtes au-dessus de la loi.
Mais le 7 octobre 2023, il y a eu une attaque de militants du Hamas. Pendant un moment, l'armée israélienne a peut-être perdu le contrôle. Elle n'a pas pu protéger ses propres citoyens. Les Israéliens sont intoxiqués par leur propre traumatisme du 7-Octobre. À bien des égards, je ne pense pas qu'il ait transformé les gens. Cela a en fait renforcé les sentiments qui existaient auparavant et repoussé toutes les réserves qui auraient pu être émises, à savoir : « Nous devons quand même nous comporter d'une manière humaine. Nous devons penser aux autres. »
Tout cela a été balayé par le principal argument de la prétendue gauche israélienne, pour ce qu'il en reste, à savoir que nous avons perdu nos illusions. Nous avons cru autrefois que nous pouvions parler avec les Palestiniens, bien qu'il n'y ait aucune preuve que quelqu'un ait cru pouvoir parler avec eux. Mais on a prétendu que nous y croyions autrefois, et maintenant nous n'y croyons plus parce que nous savons qu'ils veulent juste nous tuer tous. C'est pourquoi, bien sûr, le génocide, l'Holocauste s'insinuent dans le débat, et que le Hamas est qualifié de nazi. Puis, on en déduit alors qu'il s'agit de tous les Palestiniens. Et donc, la seule façon de traiter avec eux est soit de les tuer, soit de les remettre dans une cage.
L'un des passages les plus forts de votre témoignage est votre rencontre avec des jeunes gens qui reviennent de combattre à Gaza et tentent d'empêcher votre intervention. Qu'est-ce qui vous a frappé chez eux ?
La première chose qui m'a frappé, bien sûr, c'est qu'ils étaient violemment opposés à ma présence. Ils protestaient très bruyamment et tapaient sur les murs. Ils ne me menaçaient pas physiquement, mais ils étaient très physiques et très bruyants. Et l'université ne faisait rien pour y remédier, pas plus que la sécurité. Plus tard, les autorités universitaires ont déclaré qu'il s'agissait de la liberté d'expression.
Mais la deuxième chose, c'est qu'une fois que nous les avons laissé entrer, ils ont accepté de venir parler. Il s'agit de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant aux organisations d'extrême droite. Mais ce qu'ils disaient reflétait un sentiment beaucoup plus large. Ils étaient furieux d'avoir été accusés, du moins le pensaient-ils, de génocide. Ils tenaient à expliquer qu'ils étaient humains. En même temps, ils justifiaient entièrement ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient manifestement eux-mêmes participé à faire à Gaza, c'est-à-dire à détruire tout l'endroit. Ces jeunes en revenaient juste, contrairement à de nombreux commentateurs, dont je fais partie.
Il existe en Israël après le 7-Octobre un énorme sentiment d'insécurité.
J'ai étudié d'autres soldats dans d'autres guerres et j'ai trouvé ce mécanisme intéressant : d'une part, ils justifient la destruction qu'ils causent et la brutalité de ce qu'ils font et, d'autre part, ils veulent être perçus comme des êtres humains décents, alors qu'ils ne le sont pas du tout. S'ils le font, c'est parce qu'il faut le faire.
Une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'ils semblaient psychologiquement très tendus, pas seulement à propos de moi, mais de manière générale. Certains me semblent souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique non traité, et ils avaient l'impression que personne ne parlait avec eux. Curieusement, je pense que l'une des seules personnes qui aient parlé avec eux était la personne qu'ils voulaient faire taire, c'est-à-dire moi.
C'était ironique, mais ils voulaient parler, et leurs professeurs, leurs commandants, les politiciens ne voulaient pas leur parler... Et lorsqu'ils se font tuer, ce qui arrive, on les enterre. On fait un beau discours et on dit qu'ils ont été des héros, ce qu'on utilise tout le temps en Israël aujourd'hui. Et puis on les oublie tout de suite. Deux ou trois m'ont dit ne pas vouloir retourner se battre car ils sont réservistes, mais m'ont dit faire ce qu'il fallait faire et se battre pour la bonne cause.
Peut-on comparer ce moment à ce qu'ont vécu les États-Unis avec la guerre du Vietnam ?
C'est une question compliquée, mais je ne crois pas que l'analogie avec les États-Unis soit pertinente. Car ce qui a mis fin à la guerre, c'est le recours à des appelés, comme en Algérie pour la France, et pas simplement aux militaires professionnels. Quand vous appelez des jeunes pour une guerre impopulaire qui a été menée par des soldats professionnels, les gens se disent : « Je ne sais pas si cette guerre est bonne ou non, mais je ne vais pas me faire tuer là-bas. » Puis leurs parents s'impliquent aussi, et c'est toute la société qui se mobilise.
Le gouvernement essaie de [...] commémorer un événement qui n'est pas terminé.
En Israël, la société a toujours été mobilisée. Ce qui se passe actuellement renforce considérablement les sentiments des Israéliens. Mais, contrairement à la France, aux États-Unis et à d'autres pays qui ont mené des guerres coloniales, il existe en Israël après le 7-Octobre un énorme sentiment d'insécurité qui n'a pas disparu et qui est utilisé par le gouvernement et par l'extrême droite pour mobiliser les gens, mais en se basant sur la peur.
Et c'est là encore que l'Holocauste s'insinue, car c'est comme s'il allait y avoir un autre Auschwitz. Si ce discours sur un nouvel Holocauste est associé à des sirènes aériennes, à des roquettes et à la mort de personnes, il engendre l'indifférence à l'égard du sort de ceux que l'on détruit et il produit une volonté de destruction.
Qu'attendez-vous des commémorations du premier anniversaire du 7 octobre 2023 ?
Ce que je sais, c'est que les autorités israéliennes sont impuissantes dans ces moments-là. Elles essaient d'organiser une commémoration officielle à laquelle se sont opposées de nombreuses familles d'otages et des habitants des villages autour de Gaza qui ont été les plus touchés le 7-Octobre. Ces personnes organisent leurs propres événements. Elles ne font pas confiance à leur gouvernement pour de bonnes raisons, et sont très ambivalentes à l'égard de l'armée.
L'armée essaie de montrer qu'elle peut à nouveau faire des miracles, mais il y a aussi une méfiance persistante à son égard. Il semble donc que le gouvernement essaie de faire quelque chose pour tous ceux qui n'ont pas été directement touchés par le 7-Octobre, ce qui est un exercice curieux, et de commémorer un événement qui n'est pas terminé.
Tout le monde le sait, parce qu'il y a environ 100 personnes, dont la moitié sont des soldats, évidemment, qui se trouvent encore à Gaza. Dans ma propre famille, il y a des gens qui sont encore à Gaza. Le gouvernement veut commémorer l'événement comme s'il était terminé parce qu'il ne veut pas vraiment s'en occuper. Les gens le savent. Il est soutenu, bien sûr, par toutes les inepties débitées par ces ministres remarquablement incompétents et leurs assistants à l'heure actuelle. Mais une grande partie du public en est conscient et je pense qu'il n'y prêtera pas beaucoup d'attention.
Quels sont vos espoirs pour Israël, Gaza et plus largement la région ?
J'ai un espoir, mais je ne pense pas qu'il soit réaliste. Et j'ai un pronostic, et je crains qu'il n'arrive.
Cette région ne peut pas mettre de l'ordre dans ses affaires toute seule. Il n'y pas de leadership ou de public pour cela. En Israël, l'opposition dit les mêmes choses que Nétanyahou. C'est tout à fait remarquable. Le changement ne pourra venir que de l'extérieur, des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont les principaux partenaires d'Israël dans de nombreux domaines.
Si cela devait se produire, il ne serait pas très difficile d'esquisser une solution pour s'en sortir. Des voix s'élèvent en Israël pour en parler. Il faudrait commencer par un échange total des otages contre des prisonniers. Il faudrait que les dirigeants du Hamas, pour ce qu'il en reste, partent en exil. Il faudrait faire intervenir une force internationale composée essentiellement de soldats arabes. Il faudrait ensuite introduire progressivement l'Autorité palestinienne.
Mais tout cela devrait se faire dans le cadre d'une vision politique beaucoup plus large, dont peu de gens parlent, qui devrait prévoir l'autodétermination palestinienne. À mon avis, ce n'est pas mon invention, mais je l'approuve, il s'agit de la création d'une structure confédérée d'un État palestinien et d'un État israélien. Voilà donc le scénario positif. Mais je ne le vois pas se réaliser à court terme parce que le gouvernement américain n'est pas prêt à le faire. Les élections approchent. S'il y a une future administration démocrate, je ne vois pas Harris aller beaucoup plus loin que ce que faisait Biden. S'il y a une administration Trump, qui sait ce qu'il fera ? Mais ce ne sera probablement pas bon.
Ce qui se passera, c'est qu'à la fin de ce cycle de violences, Israël deviendra un État d'apartheid à part entière. Il créera l'apartheid à Gaza et en Cisjordanie, cet apartheid continuera, comme il l'a déjà fait, à s'infiltrer en Israël même, inclura la population palestinienne en Israël, ceux qui sont citoyens israéliens, érodera considérablement la démocratie, tout ce qu'il en reste. Le pays s'appauvrira et s'isolera de plus en plus, y compris d'une partie croissante de la communauté juive de la diaspora. Les pays de ce type peuvent survivre. Deux, trois décennies et il finira par imploser. Mais je ne crois pas que j'en serai le témoin. Le prix à payer sera énorme.
François Bougon
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’erreur de calcul du Hezbollah

Le parti est tombé dans le piège que lui avait tendu Israël, en insistant pour continuer à échanger des tirs avec l'État sioniste « jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza », alors qu'il devenait clair que le poids de la bataille se déplaçait de la bande de Gaza ravagée vers le Liban.
Billet de blog 2 octobre 2024
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/021024/l-erreur-de-calcul-du-hezbollah
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
La semaine dernière, nous nous demandions « si l'escalade soudaine de ce que nous avons appelé la “stratégie d'intimidation israélienne” prélude à une agression à grande échelle contre le Liban qui comprendrait des bombardements intensifs aveugles de toutes les zones où le Hezbollah est présent, y compris la banlieue sud densément peuplée de Beyrouth ». Cela nous amena à une autre question : le président américain Biden « fera-t-il suffisamment pression sur Netanyahu pour empêcher une guerre […] ou bien soutiendra-t-il une fois de plus l'entreprise criminelle de son ami, voire même en exprimant regret et rancœur afin d'esquiver le blâme de la manière hypocrite qui est habituellement la sienne et celle de son secrétaire d'État Blinken ? » (« Réflexions stratégiques sur l'escalade de l'intimidation israélienne au Liban », 24/9/2024).
La réponse à ces deux questions interdépendantes ne s'est pas fait attendre : le ministère israélien de l'Agression (faussement appelé ministère de la « Défense ») a annoncé mercredi dernier que son directeur général avait reçu un nouveau paquet d'aide d'une valeur de 8,7 milliards de dollars lors de sa visite au commandement militaire américain au Pentagone. Le ministère a commenté en disant que cela confirmait « le partenariat stratégique fort et durable entre Israël et les États-Unis et l'engagement à toute épreuve envers la sécurité d'Israël ». Deux jours plus tard, dans la nuit de vendredi, l'assaut en cours des forces armées sionistes contre le Hezbollah culminait avec l'assassinat du secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, et de plusieurs de ses dirigeants, achevant ce qui s'est avéré être une décapitation systématique du Hezbollah après avoir saboté son réseau de communication, en prélude à de nouvelles étapes sur la voie d'un assaut global sur les zones dominées par le parti, assaut qui a inclus jusqu'à présent des bombardements intensifs et concentrés et l'expansion progressive d'une invasion au sol qui, selon les sources israéliennes, devrait rester « limitée ».
Il devient clair ainsi que l'appel de l'administration américaine à un cessez-le-feu de trois semaines entre le Hezbollah et l'État sioniste, lancé sur incitation française et annoncé conjointement avec Paris, n'était nullement sincère, n'étant accompagné d'aucune pression américaine réelle. Il convient de noter à cet égard que le Washington Post a publié mercredi dernier une enquête montrant que les opinions au sujet du cessez-le-feu divergeaient au sein de l'administration Biden, certains de ses membres voyant dans l'escalade militaire israélienne « un moyen potentiellement efficace de dégrader le groupe militant libanais ». La réponse de l'administration à l'assassinat de Hassan Nasrallah, à commencer par Biden lui-même, a été d'applaudir l'opération et d'en faire l'éloge, la décrivant comme « une mesure de justice », et ce en qualifiant le Hezbollah et son secrétaire général de terroristes. Cette réaction a confirmé la complicité militaire et politique totale de Washington dans l'agression en cours contre le Liban, après sa complicité flagrante dans la guerre génocidaire en cours à Gaza.
L'hypocrisie de l'administration Biden a atteint avec cela un nouveau point bas, l'étiquetage du parti libanais comme organisation terroriste contrastant fortement avec les négociations qu'elle mène avec lui depuis plusieurs mois à la recherche de ce qu'elle a appelé une « solution diplomatique » au conflit entre lui et l'État sioniste. Comment Washington pouvait-il négocier avec une « organisation terroriste », par la médiation du président du Parlement libanais Nabih Berri, allié politique (mais pas militaire) du Hezbollah, et chercher un règlement diplomatique avec une telle organisation ? Cela sans parler du fait qu'il n'y a aucun type d'acte qui pourrait être qualifié de terroriste que l'État sioniste n'a pas commis avec une intensité et une brutalité meurtrière qui surpassent tout ce que Washington a décrit et continue de décrire comme terroriste (en ignorant ce qu'il a lui-même commis, bien entendu).
Voici une fois de plus, après la guerre génocidaire en cours à Gaza, une justification sournoise apportée à une guerre visant à éradiquer une organisation de masse qui a des élus au parlement et supervise un vaste appareil civil quasi-étatique, en la qualifiant dans son ensemble de terroriste, sans même faire de distinction entre son aile militaire et ses institutions civiles. Contrairement au cas du Hamas, dont l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » a été largement exploitée pour lui coller cette étiquette, le Hezbollah, sous la direction de Hassan Nasrallah, n'a commis aucun acte qui pourrait être qualifié de terroriste au sens d'attaquer délibérément des civils ou des non-combattants israéliens ou américains. Du coup, on a rappelé les attentats de 1983 qui visaient l'ambassade des États-Unis, et les forces américaines et françaises participant à la « Force multinationale » au Liban, et on a même attribué ces attentats à Hassan Nasrallah, qui n'était pas membre de la direction du parti à l'époque et n'avait que 23 ans ! En réalité, Nasrallah a supervisé la transformation du parti vers l'engagement dans la vie politique libanaise avec sa participation pour la première fois aux élections législatives en 1992, l'année où il a assumé le poste de secrétaire général.
Nous avons montré la semaine dernière comment le calcul du Hezbollah menant à la conduite d'une bataille limitée contre Israël en soutien à Gaza avait commencé à se retourner contre lui, au point où il s'est retrouvé « piégé dans une dissuasion mutuelle, mais inégale » avec l'armée sioniste. En vérité, le parti est tombé dans le piège que lui avait tendu Israël, en insistant pour continuer à échanger des tirs avec l'État sioniste « jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza », alors qu'il devenait clair que le poids de la bataille se déplaçait de la bande de Gaza ravagée vers le Liban. Il aurait été plus indiqué pour le parti d'annoncer publiquement son acceptation de l'appel franco-américain à un cessez-le-feu de trois semaines (d'autant plus qu'il avait un besoin urgent de reprendre son souffle et de restaurer son appareil de direction après l'explosion de son réseau de communication) et la cessation des opérations militaires de sa part, ce qui aurait mis le gouvernement sioniste dans l'embarras et l'aurait exposé à d'intenses pressions internationales pour faire de même.
Ces derniers jours ont montré que la perception par le Hezbollah de la « dissuasion mutuelle » entre lui et l'État sioniste ne tenait pas suffisamment compte de la nature inégale de cette dissuasion (une erreur de calcul similaire à celle du Hamas, bien que beaucoup moins grave), et que sa perception de l'engagement de son parrain à Téhéran à le défendre était également illusoire, l'Iran n'ayant répondu aux attaques répétées qu'Israël a lancées directement contre lui qu'une seule fois, en avril dernier, et cela d'une manière presque symbolique.
Il semble que le Hezbollah ait confirmé sa volonté de revenir à la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006, qui appelle au retrait de ses forces au nord du fleuve Litani, reconnaissant ainsi l'inégalité des forces entre lui et l'État sioniste et acceptant la condition imposée par la médiation américaine. Cette volonté a été confirmée par le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, à l'issue de sa rencontre avec Nabih Berri. Il convient dès lors de s'interroger sur l'utilité d'insister pour continuer à se battre jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu à Gaza, offrant ainsi au gouvernement sioniste un prétexte pour intensifier son assaut contre le Liban, et contre le Hezbollah en particulier.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 1er octobre en ligne et dans le numéro imprimé du 2 octobre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.

“Le Hezbollah n’est plus assez soutenu pour se lancer dans une guerre ouverte”

Le Hezbollah, organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et Israël, reste la plus grande force politique du Liban. Pourtant, depuis la précédente guerre israélo-libanaise de 2006, le parti qui rassemblait toutes les tendances religieuses a perdu ses soutiens pour ne quasiment plus reposer que sur sa base chiite. Explications de Joseph Daher, professeur à l'université de Lausanne et auteur d'un essai éclairant sur le Hezbollah.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
26 septembre 2024
Par Joseph Daher
Charles Perragin - Le Hezbollah libanais pourrait-il se lancer dans une guerre ouverte contre Israël ?
Joseph Daher : Depuis le 7 octobre 2023, le discours et le comportement du Hezbollah démontrent une volonté d'éviter une telle possibilité. Déjà, avant le déclenchement de la guerre de l'État d'Israël contre la bande de Gaza, le renforcement de l'alliance entre le Hezbollah, ses alliés palestiniens et d'autres groupes soutenus par Téhéran dans la région avait pour but de renforcer sa capacité de dissuasion à l'égard d'Israël. Cela s'est matérialisé, après le 7-Octobre, avec la stratégie dite de l'« unité des fronts ». Cependant, les premières cibles du Hezbollah étaient les fermes de Chebaa en territoire libanais occupées et non directement la terre israélienne. Par la suite, il a mené des attaques sur des sites militaires israéliens avec, récemment, une intensité croissante en réaction à l'escalade militaire et des opérations terroristes à partir de la mi-septembre dont le bilan est de 570 morts – en grande majorité des civils, dont 50 enfants, et des milliers de blessés. Les opérations militaires du Hezbollah sont néanmoins restées dans une perspective calculée – et relativement modérée comparée à la violence des attaques israéliennes.
“L'objectif du Hezbollah est d'éviter une guerre totale avec Israël”
Toujours pour ralentir l'entrée dans un conflit ouvert avec des armées au sol ?
Oui, l'objectif du Hezbollah est d'éviter une guerre totale avec Israël et de montrer sa solidarité avec ses alliés politiques palestiniens afin d'être crédible quand il mobilise la rhétorique de la résistance, tout en cherchant à protéger ses intérêts… Ses membres ne se doutaient certainement pas que cela durerait autant et qu'Israël allait monter à un tel niveau d'intensité dans ses attaques contre le Liban. En fin de compte, la guerre génocidaire continue à Gaza, malgré toutes les opérations du Hezbollah. L'unité des fronts devient donc de plus en plus difficile à défendre politiquement au sein de la population libanaise. Enfin, le Hezbollah a encore des capacités militaires, bien plus importantes qu'en 2006 – notamment au niveau de ses missiles –, même si leur communication interne a été affaiblie et un grand nombre de leurs cadres assassinés. Cependant, le coût pour le Liban est de plus en plus lourd, et l'organisation ne veut pas que ce conflit soit instrumentalisé par ses ennemis politiques intérieurs qui en feraient la principale responsable de tous les malheurs du pays.
Le Hezbollah a-t-il encore beaucoup de soutiens au Liban ?
Il reste le parti politique le plus important du pays, avec une base populaire large au sein de la population chiite libanaise, incluant des soutiens au sein des classes populaires, moyennes libérales et des fractions de la bourgeoisie. Mais, en effet, même si une solidarité nationale s'est exprimée avec les civils tués récemment, ce soutien est réduit au sein des populations libanaises des autres confessions. Cela est une différence importante comparée à la guerre israélienne contre le Liban de 2006.
Comment expliquer ce déclin ?
En mai 2008, déjà, l'organisation avait pris les armes contre d'autres Libanais, avec une invasion de certains quartiers de Beyrouth-Ouest et des combats dans d'autres régions, notamment dans le Chouf, après que le gouvernement libanais a annoncé vouloir démanteler son réseau de communication. En plus de ce conflit intérieur, elle a participé plus tard à la répression meurtrière du mouvement populaire syrien aux côtés du régime despotique de Damas, et cela a de nouveau attisé les tensions confessionnelles au Liban. Enfin, le Hezbollah fait partie de tous les gouvernements depuis 2005 et est donc perçu comme l'un des responsables de la crise économique et financière de 2019, comme les autres partis dominants libanais. Son guide religieux, Hassan Nasrallah, a même été très virulent à l'égard du mouvement de protestation cette année-là, l'accusant d'être financé par des ambassades étrangères et envoyant des membres du parti attaquer les manifestants. Ajoutons à cela d'autres incidents confessionnels impliquant le parti et, finalement, les accusations, à l'encontre du Hezbollah principalement, d'obstructions dans l'enquête sur les explosions du port de Beyrouth. Tous ces éléments ont mené à un plus grand isolement, à la fois politique et social de l'organisation. Ce manque de soutien explique en partie la volonté d'éviter une guerre totale contre Israël.
“Le Hezbollah n'est pas un simple parti. Il dispose de sa propre armée, dont la capacité est bien supérieure à l'armée libanaise, et est très certainement le plus gros employeur du pays après l'État”
Entre la guerre, la crise économique et les tensions religieuses, on peut même dire qu'il est inespéré que le « Parti de Dieu » ait encore des soutiens au Liban…
Il faut garder à l'esprit que le Hezbollah n'est pas un simple parti. Contrairement aux autres organisations politiques, il dispose de sa propre armée, très organisée, et dont la capacité est bien supérieure à l'armée libanaise. Ensuite, l'organisation est très certainement le plus gros employeur du pays après l'État. Elle structure la vie de toute une partie de la population chiite à travers sa propre société civile, notamment un réseau d'institutions et organisations de charité offrant une multitude de services sociaux, y compris aux secteurs chiites les plus populaires. Il est intéressant de remarquer que le Hezbollah, comme les autres acteurs politiques dominants libanais n'a, par ailleurs, jamais cherché à construire ou renforcer l'État et particulièrement ses services publics, précisément pour étendre et consolider une base populaire dépendante de ses propres institutions et actions de charité. C'est une raison, parmi d'autres, qui explique la permanence d'une base solide au sein de la population chiite, faute aussi d'alternative politique structurée avec un discours inclusif et promouvant droits démocratiques et sociaux pour tous.
“Le Hezbollah défend une forme d'alliance entre néolibéralisme économique et fondamentalisme religieux”
Quel est le modèle politique du Hezbollah ?
Il défend une forme d'alliance entre néolibéralisme économique et fondamentalisme religieux, alliance qu'on observe ailleurs chez les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis, les évangéliques d'Amérique du Sud, les nationalistes hindous, les Frères musulmans… Le Hezbollah a encouragé des processus de privatisation, notamment dans les télécommunications, et voit d'un mauvais œil les idéologies socialistes et communistes qui théorisent la justice sociale et l'émancipation matérielle et intellectuelle des masses populaires. L'idéologie du parti est liée à l'exportation de la Révolution islamique de Khomeini dans les années 1980, où l'on retrouve cette rhétorique de défense des opprimés contre les oppresseurs, les opprimés n'étant cependant pas associés à une classe sociale exploitée. Ce sont plutôt les sympathisants du mouvement en général, y compris les fractions de la bourgeoisie chiite du mouvement, contre tout acteur déclaré comme ennemi ! C'est pour cela que le Hezbollah dispose d'un soutien transclasse. L'idée même de lutte des classes est rejetée parce qu'elle affaiblirait l'oumma, la communauté islamique. D'où l'opposition quasi systématique aux luttes de justice sociale, des mouvements sociaux aux organisations syndicales indépendantes du Liban. Le système politique confessionnel et néolibéral libanais assure ses intérêts, comme à ceux des autres partis politiques dominants, tant que les classes populaires ne s'allient pas au-delà de leurs différences religieuses.
Cette stratégie, étant donné la fragmentation religieuse du pays, ne condamne-t-elle pas le Hezbollah à long terme ?
Depuis le 7 octobre, le parti, tout en gardant la main sur les opérations militaires, a quand même réussi à empêcher que les tensions confessionnelles ne s'enflamment au Liban en tentant d'inclure d'autres partis dans la résistance militaire contre Israël : on connaît déjà le Hamas, et d'autres partis palestiniens comme le Jihad islamique, mais on compte aussi la Jamaa Islamiya(la branche des Frères Musulmans au Liban), et le Parti social nationaliste syrien, qui dispose d'une base populaire multiconfessionnelle. Enfin, n'oublions pas le principal soutien politique, économique et militaire du Hezbollah : l'Iran. Les objectifs stratégiques de Téhéran, notamment depuis le 7 octobre, sont d'éviter une guerre régionale et d'améliorer sa position politique dans la région afin d'être le « meilleur » interlocuteur pour de futures négociations avec les États-Unis, notamment sur le nucléaire et les sanctions, et de garantir ses intérêts politiques et sécuritaires. Un affaiblissement du Hezbollah saperait inévitablement l'influence géopolitique de Téhéran dans la région. Dans ce cadre, la dernière escalade militaire meurtrière de l'armée israélienne contre le Liban constitue un défi et un dilemme pour Téhéran : comment éviter un affaiblissement trop important du Hezbollah sans s'engager dans une confrontation militaire directe avec Israël ?
Joseph Daher, propos recueillis par Charles Perragin
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Israël se tourne maintenant contre le Liban pour sécuriser sa frontière nord »

Depuis le 23 septembre, les bombardements de l'armée israélienne sur le Liban ont entraîné la mort de plus de 1 500 personnes, le départ vers la Syrie de 100 000 personnes et le déplacement d'un million de personnes, sur les quelque 5 millions d'habitantEs du Liban. Entretien avec Gilbert Achcar, militant libanais et professeur à l'université de Londres.
Hebdo L'Anticapitaliste - 723 (03/10/2024)
Par Gilbert Achcar
Crédit Photo
Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
Il y a tout à craindre que les attaques de mi-septembre au Liban aient lancé une nouvelle séquence de la guerre commencée en octobre 2023 à Gaza…
Depuis qu'Israël a en gros achevé le stade le plus intensif de sa destruction à Gaza, il se retourne maintenant contre le Liban, contre le Hezbollah, pour sécuriser sa frontière nord. Il le fait en ne laissant au Hezbollah d'autre choix que de capituler et se retirer loin de la frontière ou de subir une guerre totale. Ils ont commencé une escalade progressive de la violence qui a maintenant abouti à la décapitation du Hezbollah, y compris l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah, et refusent toute proposition de cessez-le-feu. Une capitulation pure et simple de l'organisation étant peu probable, il faut se préparer à la continuation de l'escalade, y compris l'intervention de troupes au sol dans des opérations ponctuelles, le tout visant à infliger le plus grand dégât possible à l'organisation et démanteler son infrastructure.
En quoi ce qui a lieu aujourd'hui est différent des conflits précédents : 2006, 1982 ?
En 1982, Israël avait envahi la moitié du Liban jusqu'à la capitale Beyrouth, investie par les troupes israéliennes en septembre. Très vite, la résistance, lancée au départ par les communistes, a fait reculer l'armée israélienne qui s'est cantonnée à une portion du Sud-Liban pendant plusieurs années (18 ans d'occupation) jusqu'à devoir l'abandonner en 2000. Israël a subi une défaite politique à cet égard. Autant la guerre avait marqué un point pour l'État Israël vis-à-vis de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) qui avait dû évacuer Beyrouth en 1982, autant Israël s'est montré vulnérable face à la résistance qui s'est développée au Liban. En 2006, Israël avait tenu compte des leçons de 1982 et n'envisageait donc pas d'occupation permanente. Il y a eu une incursion de troupes qui se heurtèrent à une résistance farouche, plus coûteuse que prévu. Cette guerre-là s'est aussi soldée par un fiasco pour Israël, au sens où le Hezbollah, loin d'être détruit, en est ressorti plus fort à terme puisqu'il a reconstitué son arsenal et l'a très considérablement amplifié. La leçon que l'armée israélienne a tirée de 2006, c'est de ne pas prendre de risque quand ils interviennent dans des zones peuplées comme Gaza ou le Liban, surtout les zones urbaines, mais de tout détruire avant d'entrer, ce qui s'est traduit par l'effroyable destruction de Gaza et le caractère génocidaire de la guerre menée contre l'enclave. Au Liban, ils n'en sont pas encore arrivés à ce stade, mais ils menacent ouvertement de transformer des parties du Liban en un autre Gaza.
Après la mort d'Hassan Nasrallah, que représente aujourd'hui le Hezbollah au Liban ?
L'organisation a été très affaiblie non seulement par l'assassinat de Nasrallah, mais aussi par le démantèlement de son réseau de communication interne et l'assassinat de plusieurs de ses cadres militaires. L'organisation a été véritablement décapitée. Elle va se reconstituer et tenter de reconstituer son arsenal bien qu'Israël rende la chose de plus en plus difficile en bombardant en Syrie les voies de transport par lesquelles l'armement peut arriver d'Iran au Hezbollah.
Sur le plan politique, c'est également un affaiblissement considérable de l'organisation. Le Hezbollah conserve certes sa base sociale, dont une grande partie dépend financièrement de l'organisation. Mais il y a dans la population libanaise une forte désaffection qui avait commencé avec l'intervention du Hezbollah en Syrie auprès du régime Assad. Cette intervention a beaucoup changé l'image du Hezbollah au Liban et dans la région : du combat contre Israël, l'organisation était passée au combat en défense d'un régime sanguinaire. Le Hezbollah est apparu plus que jamais comme étant avant tout un auxiliaire de l'Iran. Aujourd'hui, une grande partie de la population libanaise reproche au Hezbollah d'impliquer le Liban dans la guerre avec Israël au nom de la solidarité avec Gaza, même si c'est de façon limitée, en pointant du doigt le fait que la Syrie, qui est censée faire partie du même « axe de la résistance » et qui a certainement beaucoup plus de moyens que le Hezbollah, ne fait rien du tout. De même, l'Iran, leader du même « axe », ne fait pas grand-chose, au-delà des discours. Une seule fois, en représailles contre l'assassinat de dirigeants iraniens à Damas en avril dernier, l'Iran a lancé contre Israël des missiles et drones avec un préavis qui a contribué à en rendre l'impact négligeable.
Beaucoup au Liban demandent donc « pourquoi nous, petit pays, le plus faible de la région, devrions-nous subir des conséquences pour le compte de l'Iran ? » Ce type d'argument est devenu très fort aujourd'hui. Le Hezbollah revendiquait jusqu'ici le fait qu'il constituait une sorte de bouclier, une garantie sécuritaire pour le Liban face à Israël, mais cet argument est battu en brèche par la démonstration que fait Israël de manière spectaculaire de sa grande supériorité militaire, technologique et en renseignements.
Effectivement, avec le risque de voir le Liban détruit…
Une partie du Liban plutôt, parce qu'Israël vise spécifiquement le Hezbollah, les régions où il est présent. Il joue sur les clivages confessionnels et même les clivages au sein des chiites qui sont divisés au Liban en deux camps alliés, mais bien distincts : le Hezbollah d'une part et Amal de l'autre. Le mouvement Amal ne s'est pas impliqué dans le combat en cours contre Israël et ne dépend pas de l'Iran comme le Hezbollah. Israël joue donc là-dessus et vise spécifiquement les régions et zones contrôlées par le Hezbollah. Il y a fort à craindre que la menace de transformer cette partie du Liban en Gaza bis soit mise en œuvre.
Comment construire la solidarité pour les anticapitalistes et anticolonialistes alors que nous ne partageons pas les projets politiques des forces en présence ?
Il faut toujours concevoir la solidarité comme indépendante et critique. La notion de « solidarité inconditionnelle » ne me semble pas utile. La solidarité avec une force dont on ne partage pas le profil doit toujours être critique au sens où il faut se solidariser avec la victime contre l'oppresseur principal, sans oublier pour autant que cette victime peut à son tour être dans une position d'oppression vis-à-vis d'autres.
S'il y avait demain une offensive d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, il faudrait se mobiliser puissamment contre celle-ci en tant qu'agression impérialiste, sans pour autant soutenir « inconditionnellement » le régime iranien et encore moins le soutenir contre sa population si elle se soulevait à l'occasion. De la même façon, en 1990-1991, il fallait se mobiliser contre l'agression impérialiste contre l'Irak, sans pour autant soutenir le régime de Saddam Hussein, et encore moins sa répression sanguinaire des populations du sud et du nord du pays qui se sont soulevées à l'occasion. Il ne faut tomber ni dans un travers ni dans l'autre. Il y a des personnes à gauche qui, au nom de la nature du Hezbollah comme organisation confessionnelle et intégriste inféodée au régime iranien des mollahs, en viennent à adopter des attitudes neutres, qui frisent parfois même le soutien à Israël. Cela doit être fortement combattu : il ne faut pas du tout hésiter à se mobiliser contre l'agression israélienne, celle d'un État colonial, oppresseur et prédateur. Quelles que soient les directions politiques dominantes en face, la résistance à l'agresseur colonial est juste. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre travers qui consiste à faire du Hezbollah ou du Hamas — ou même bien pire, les Houthis du Yémen qui sont l'équivalent des Talibans — des champions progressistes. Il s'agit de forces, qui sur le plan social et culturel peuvent être tout à fait réactionnaires, et de dictatures brutales comme le sont les régimes syrien et iranien.
Propos recueillis par Fabienne Dolet, le 30 septembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël-Liban-Iran. La nouvelle phase d’escalade militaire présidée par Netanyahou. Et « la Realpolitik » cynique de Biden

Les frappes aériennes israéliennes ont fermé la route Beyrouth-Damas [poste-frontière de Masnaa], qui est le lien le plus important entre le Liban et le monde extérieur. Dans le même temps, les bombardements à proximité de l'aéroport international de Beyrouth menacent de le fermer également. Dans une grande partie du sud du Liban, Israël a ordonné à la population de fuir vers le nord, à Beyrouth, bien que la capitale subisse des attaques aériennes incessantes.
Tiré d'À l'encontre.
L'invasion israélienne est déjà en train de transformer le Liban en Gaza II, avec un bombardement aérien impitoyable qui réduit en ruines les zones bâties. L'excuse israélienne est que le Hamas et le Hezbollah sont visés par des « frappes de précision ».
Cette stratégie n'est pas une surprise puisque le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, l'a exposée lors d'une visite à la frontière israélo-libanaise en décembre dernier. Il avait déclaré : « Si le Hezbollah choisit de déclencher une guerre totale, il transformera de ses propres mains Beyrouth et le Sud-Liban, non loin d'ici, en « Gaza et Khan Younès. »
Guerre totale
En fait, c'est Israël qui a déclenché la guerre totale en envahissant le Liban le 1er octobre. Son objectif évident est d'écraser le Hezbollah, ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) n'ont pas réussi à faire au cours de l'année écoulée contre le Hamas à Gaza, une organisation militaire beaucoup plus faible.
L'ampleur de cet échec est involontairement admise par les FDI, puisqu'elles continuent de justifier les effroyables pertes civiles qu'elles infligent en affirmant que le Hamas est toujours présent partout dans la bande de Gaza et qu'il doit être éliminé. Ainsi, dans la ville palestinienne de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza – l'endroit identifié par Netanyahou il y a dix mois comme un exemple du type de châtiment qui pourrait être infligé à Beyrouth et au Sud-Liban – des frappes aériennes israéliennes et une opération terrestre menée par des chars ont tué au moins 51 personnes mardi 1er octobre, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Les forces de défense israéliennes ont expliqué que les membres du Hamas disposaient de « centres de commandement et de contrôle » à l'intérieur des écoles de filles de Muscat, Rimal, Bureij et Nuseirat.
Une dévastation similaire est maintenant infligée aux Libanais alors que l'opération israélienne s'étend vers le nord avec le même mépris total pour les victimes civiles qu'à Gaza et en Cisjordanie occupée. Dans cette « région », où vivent trois millions de Palestiniens, 18 personnes assises dans un café d'un camp de réfugiés de la ville de Tulkarem ont été tuées jeudi 3 octobre par une frappe aérienne israélienne [ce qui marque un degré supérieur d'escalade dans la répression]. Les FDI ont affirmé avoir tué le chef local du Hamas ainsi que « d'autres terroristes importants » [1].
Un fantasme dangereux
Dans la réalité, la stratégie israélienne consistant à remporter une « victoire décisive » en décapitant le Hamas et le Hezbollah par l'assassinat de leurs chefs et la destruction des « centres de commandement et de contrôle » est un dangereux fantasme. C'est aussi une stratégie qui a les conséquences les plus graves pour le Moyen-Orient et le monde. Les petites organisations peuvent être paralysées par la perte de leurs principaux dirigeants et les plus grandes peuvent être temporairement affaiblies, mais tant qu'elles conserveront un noyau dur de soutien populaire, elles survivront.
Le Hamas et le Hezbollah, mal aimés par beaucoup alors qu'ils contrôlaient leurs propres « Etats », sont aujourd'hui re-légitimés alors qu'ils combattent les FDI.
De l'IRA (Armée républicaine irlandaise) à Belfast Ouest dans les années 1970 aux Talibans dans l'Hindu Kush dans les années 2010, une occupation militaire qui inflige des punitions collectives à des communautés entières est le meilleur sergent recruteur pour un mouvement de guérilla En Afghanistan, je n'ai jamais trouvé les talibans très populaires avant qu'ils ne prennent le pouvoir ; en revanche j'ai été profondément impressionné par la détestation dont le gouvernement afghan faisait l'objet de la part de presque toutes les personnes que j'ai rencontrées.
Il est clair que les gouvernements israélien et américain ne voient pas les choses de la même manière. Les Etats-Unis, qui, il y a une semaine, appelaient à un cessez-le-feu au Liban, affirment aujourd'hui qu'une « invasion limitée » du Liban est justifiée. Ce n'est que la dernière répétition d'un schéma extraordinaire établi au cours de l'année écoulée, selon lequel Washington appelle Israël à faire preuve de retenue. Or, Israël ignore l'appel et escalade. Les Etats-Unis déclarent alors rétrospectivement qu'Israël a fait ce qu'il fallait et les livraisons d'armes américaines ne sont pas interrompues. Sans surprise, de nombreux observateurs concluent que les appels pathétiquement inefficaces de Joe Biden en faveur d'un cessez-le-feu ne sont qu'un écran de fumée permettant aux Etats-Unis de prétendre publiquement qu'ils cherchent à mettre fin à ces guerres, tout en les approuvant et en les soutenant dans la pratique.
Une « realpolitik » cynique
Il y a certainement des gens puissants à Washington qui sont d'accord avec cette « realpolitik » cynique. Le président Barack Obama a tourné en ridicule ce qu'il a appelé « le manuel de jeu de Washington », c'est-à-dire le point de vue d'une grande partie de l'establishment de la politique étrangère américaine selon lequel la plupart des problèmes peuvent être réglés par la force militaire. Il se peut également que Joe Biden doive donner l'impression de vouloir faire la paix afin de retenir les électeurs anti-guerre et les militants du parti démocrate le jour des élections, le mois prochain.
Mais cet argument n'est pas tout à fait convaincant. L'engagement d'Israël dans trois guerres n'est pas vraiment dans l'intérêt des Etats-Unis, même si elles sont menées contre des ennemis des Etats-Unis, car elles entraînent inévitablement les Etats-Unis dans des guerres qui ne sont pas si différentes de celles menées en Irak et en Afghanistan il y a 20 ans. En outre, ces guerres profiteront à Donald Trump lors des élections et démoliront la prétention de Joe Biden à restaurer la réputation de l'Amérique en tant que « garant de la paix » et de la « sécurité dans le monde ».
Les électeurs étasuniens verront sur leurs écrans la silhouette trébuchante de Biden présidant, sans grande conviction, à l'escalade d'une crise dont il est en grande partie responsable. Ce que les démocrates voulaient, c'était que les électeurs oublient Biden, comme un oncle fou enfermé dans le grenier, et se concentrent sur Kamala Harris.
Joe Biden semble assez sain d'esprit lorsqu'il s'en tient à son téléprompteur, mais lorsqu'il s'égare pour parler aux journalistes, les résultats sont spectaculairement explosifs. Interrogé jeudi sur l'attaque par Israël des installations pétrolières iraniennes, Biden a déclaré : « Nous en discutons. Je pense que ce serait un peu… de toute façon » – s'interrompant au milieu de la phrase. Cette déclaration a fait grimper le prix du pétrole de 5% !
Plus tôt dans la semaine, il avait été interrogé sur les frappes aériennes israéliennes au Yémen, ce à quoi il avait répondu qu'il était en faveur de la « négociation collective », croyant à tort qu'on l'interrogeait sur les grèves [des dockers] en tant que forme de mouvement social
Aucun des commentateurs évoquant les problèmes que le Hamas et le Hezbollah rencontreront pour remplacer leurs dirigeants assassinés n'a réfléchi au fait que les Etats-Unis sont eux aussi sans dirigeant.
Si Israël parvient à stopper les exportations de pétrole iranien ou à détruire ses raffineries [au moyen de l'offensive militaire en préparation, conjointement avec les cercles du Pentagone], l'Iran prendra très probablement des mesures contre les 30 % du commerce mondial de pétrole qui s'écoulent du Golfe par le détroit d'Ormuz. Une frappe sur les installations nucléaires iraniennes pourrait ou non réussir à détruire des équipements essentiels, mais elle propulserait certainement l'Iran vers la fabrication d'un dispositif nucléaire.
Une guerre entre l'Iran et Israël soutenue par les Etats-Unis ne changerait peut-être pas le régime de Téhéran, mais elle pourrait facilement produire un nouveau régime à Washington – dirigé par Donald Trump [souhait de Benyamin Netanyahou]. (Article publié sur INews en date du 5 octobre ; traduction par la rédaction de A l'Encontre)
[1] Pour une analyse du soubassement du « système » de légitimation de la politique répressive, génocidaire, du gouvernement Netanyahou et son « acceptation » par les gouvernements occidentaux et leurs prolongements médiatiques, nous renvoyons à l'ouvrage de Didier Fassin, professeur au Collège de France, Une étrange défaite. Sur le consentement à l'écrasement de Gaza, Ed. La Découverte, septembre 2024. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Continuons à se mobiliser pour une Palestine libre – Ruba Ghazal
Neuf organisation juives canadiennes font appel aux membres de la communauté juive pour se solidariser avec le peuple palestinien
Premier anniversaire de la guerre israélienne contre Gaza
Bibi veux tout avoir chez Wars-R-US
Diglossie maudite (Part One)
Moyen-Orient : un dialogue public à Montréal pour mieux comprendre les tensions

Hub de mobilisation pour la justice climatique

Le paysage militant du Québec peut dorénavant compter sur l'appui et les formations d'un Hub de mobilisation pour la justice climatique. Cet organisme, qui s'adresse aux militant·es, opère virtuellement et rejoint plus de 30 villes et régions à travers le pays. Quelles sont ses visées ?
Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Samuel Raymond
ÀB ! : Qu'est-ce que votre Hub ?
Jacqueline Lee-Tam : « Hub », c'est une expression qui désigne le cœur des activités. Notre Hub est donc un espace que des personnes militantes peuvent rejoindre pour apprendre différentes théories, modèles et compétences afin de surmonter leurs défis. Notre mission est de les écouter, de comprendre leurs défis et de les soutenir. Nous mettons l'accent sur le développement des capacités et l'éducation.
Notre aventure a débuté en 2020, dans un contexte où le militantisme était peu supporté par les fondations canadiennes. Notre organisation est principalement financée par les fondations familiales du Canada telles que Trottier, McConnell et Catherine Donnelly. Trois personnes salariées composent notre petite équipe, et elles s'entourent de personnes contractuelles. Nous offrons un large éventail d'activités de développement des capacités pour les organisateur·rices dans le milieu de la justice climatique. Depuis 2020, nous avons réalisé plus de 600 événements bilingues partout sur le territoire que l'on appelle Canada, pour plus de 3000 personnes.
ÀB ! : Votre organisation semble avoir un parti pris pour la décentralisation de type « organisation distribuée ». Qu'est-ce et pourquoi ?
Isabelle Grondin Hernandez : La décentralisation permet d'avoir des groupes qui sont outillés, autonomes, capables de s'organiser rapidement et d'absorber de l'énergie militante. Néanmoins, pour nous, ce n'est pas un absolu. La décentralisation est un spectre qui passe par le partage d'outils au plus grand nombre pour favoriser l'autonomie. Il est ainsi possible de favoriser le fait que des groupes soient autonomes sur certains aspects, mais coordonnés entre eux sur d'autres enjeux. Ce modèle s'appelle « l'organisation distribuée ». Il prend parti pour une union souple de groupes autonomes. Ainsi, nous n'allons jamais parler de mouvement totalement décentralisé, parce que ce n'est pas ce qui permet d'avancer lorsqu'une situation requiert une coordination.
Dans un contexte d'organisation distribuée, si des personnes viennent te voir et te communiquent leur intention de s'impliquer dans un groupe, il y a la possibilité pour ces dernières de créer une équipe de travail sans avoir l'accord d'une instance centrale. Cette façon de faire donne un plus grand pouvoir d'action à ces personnes. Surtout si on leur fournit du soutien. C'est ce que je veux dire quand je parle de l'absorption de l'énergie militante.
J. L.-T. : En 2020, les militant·es que nous avons consulté·es à propos des défis d'organisation nous ont confié que même si les mouvements aux structures verticales pouvaient sembler familiers, au Québec en particulier, iels avaient une préférence pour la formation de mouvements plus horizontaux. Disons aussi qu'il y a une résistance dans les mouvements plus alternatifs à l'organisation de style « structure verticale ».
ÀB ! : Quelles organisations ou quels individus participent à vos formations ? Quelles sont leurs principales préoccupations ?
J. L.-T. : Dans notre communauté, nous avons beaucoup d'étudiant·es, mais aussi une diversité de gens qui cherchent à développer leurs connaissances et compétences. Dit simplement, notre public est formé de personnes organisatrices qui militent tant sur la scène locale, nationale qu'internationale, et qui sont issues du milieu de la justice climatique et sociale. Elles veulent du support pour surmonter leurs plus grands défis quand vient le temps d'être en action.
Les préoccupations que nous avons entendues rassemblent des éléments communs et d'autres, plus précis. Au-delà des défis de s'organiser virtuellement, nous avons constaté que les gens cherchent de l'information et du soutien pour apprendre à s'organiser stratégiquement et structurellement dans une perspective horizontale, mais qu'ielles mènent aussi une réflexion sur les façons de favoriser l'autonomie des individus et groupes. Les gens ont aussi des difficultés à être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'anti-oppression. Puis, les gens posent beaucoup de questions à propos des moyens pour gérer les conflits dans le contexte organisationnel.
En réponse à ces éléments les plus demandés, nous avons développé des ateliers sur les stratégies, la structuration, l'anti-oppression, la gestion des conflits et aussi un nouveau sur comment prendre soin (dans le sens de care) de sa communauté. Tous ces ateliers sont donnés sur une base régulière. Nous souhaitons que ces sujets soient aussi accessibles que possible.

À propos des demandes plus précises, nous avons par exemple eu plusieurs questions à propos de la sécurité numérique, des connaissances légales sur les droits, sur l'accessibilité universelle, sur les moyens de retenir les nouveaux et nouvelles membres, à propos de la transmission des connaissances en contexte cyclique en milieu étudiant. D'autres questions portaient sur comment s'adapter à la pandémie, comment intégrer les questions queer à la justice climatique, comment favoriser la rétention des apprentissages après des événements d'ampleur historique.
Chaque semaine, nous recevons des demandes précises et nous réalisons le suivi à travers l'organisation d'événements, l'offre de coaching, de mentorat ou la tenue d'ateliers et la rédaction d'articles wiki. D'ailleurs, nos activités sont entièrement gratuites.
G. H. : Nous invitons les personnes organisatrices à ne pas hésiter à nous contacter pour recevoir du soutien.
ÀB ! : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des médias de gauche ?
G. H. : Souvent, les groupes militants savent que les médias peuvent leur donner une plus grande force de mobilisation en leur offrant de la visibilité, mais ils ne savent pas nécessairement quelles sont les pratiques pour qu'un média s'intéresse à eux ou comment les contacter. Juste le fait d'avoir des médias alliés rend le contact plus facile. Rendre visibles les ressources qu'un média peut offrir à des groupes engagés permet de faciliter la communication.
J. L.-T. : J'apprécie la façon dont vous interagissez avec nous. C'est toujours important que nos histoires soient bien comprises. Je me sens entendue et comprise. C'est une très bonne étape pour bâtir de bonnes relations. Pensez à ce que vous pouvez offrir aux mouvements et à la dimension réciproque de cette relation.
ÀB ! : Quels sont vos souhaits pour l'avenir de la justice climatique ?
I. G. H. : Mon souhait serait de faciliter la transmission des savoirs militants qui sont présents et qui évoluent chaque jour afin d'être à la fois plus intersectionnel·les, c'est-à-dire de lier les luttes pour la justice, et plus réfléchi·es, penser de façon à centrer notre but pour ce qui est d'accomplir la justice climatique.
J. L.-T. : Je proposerais deux choses qui sont interconnectées. La première, pour le Hub, c'est de faire émerger la convergence des luttes. Je pense à une plus grande et plus profonde liaison des groupes de façon à faire comprendre les liens entre justice climatique et sociale. Je nous souhaite de reconnaître que le mouvement traditionnel climatique est l'un des plus privilégiés, souvent blanc, de classe moyenne ou haute classe moyenne. Si on peut utiliser les privilèges de ce mouvement comme levier au service et en solidarité pour les mouvements pour la justice sociale, nous verrons une magnifique convergence de pouvoirs et cela pourra accroître le nombre de personnes participantes. C'est de cette façon que l'on pourra s'unir malgré les différences et les divisions imposées dans le but de transformer le système hégémonique qui rassemble la convergence de l'élite.
Je nous souhaite aussi que les mouvements soient bien soutenus, que les personnes militantes se sentent bien, solidaires et inspirées par leur travail incroyable de changement de la société pour le meilleur.

Jacqueline Lee-Tam est directrice du Hub de mobilisation pour la justice climatique. Isabelle Grondin Hernandez est bibliothécaire francophone pour le Hub.

Quelle démocratie scolaire ?

La loi 40 sur l'organisation et la gouvernance scolaires, adoptée sous bâillon en février 2020, modifie substantiellement les rôles et les responsabilités des instances de gestion scolaire au Québec. Malgré la prétention du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge de vouloir ainsi rapprocher la prise de décision de l'élève, l'adoption et la mise en œuvre de cette loi traduisent plutôt la négation des principes démocratiques et l'instauration d'une gouvernance scolaire au service du ministre de l'Éducation.
D'emblée, adopter une loi sous bâillon est une procédure antidémocratique. Il s'agit d'une mesure utilisée par un gouvernement pour limiter le temps parlementaire consacré au débat sur une motion ou sur un projet de loi, afin d'en accélérer l'adoption. Jadis, le terme « guillotine » était employé et il traduit bien la finalité de la procédure : trancher un débat en faveur du gouvernement. À peine 72 heures avant son adoption, le ministre de l'Éducation a déposé 82 amendements au projet de loi 40 ; les parlementaires et les autres acteurs scolaires n'ont pas eu le temps de les analyser en profondeur.
Sur le plan du contenu, ce projet de loi vise à revoir l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires, qui deviennent des centres de services scolaires (CSS) administrés par un conseil d'administration composé de cinq parents, de cinq personnes représentantes de la communauté et de cinq membres du personnel scolaire. Malgré un déficit de légitimité attribuable à l'anémique taux de participation aux élections scolaires, les élu·es pouvaient auparavant discuter d'un enjeu en réunion ou en comité, prendre une décision et intervenir dans l'espace public en fonction des valeurs qui les animaient. Seule la direction générale du CSS peut maintenant s'exprimer dans l'espace public sur les enjeux scolaires de son organisation, ce qu'elle ne fait pas de manière critique à cause de son devoir de loyauté à l'endroit du ministre de l'Éducation.
Du côté des membres du CA, un même devoir de loyauté à l'endroit de l'organisation – le centre de services scolaire – plutôt qu'à l'endroit de l'institution – l'École – est inscrit à un règlement ministériel en vigueur depuis mars 2022. Il est couplé à un devoir de confidentialité, car les obligations des personnes administratrices des CA sont définies en vertu du Code civil du Québec : le CSS est une personne morale de droit public. Ainsi, toute critique d'une action du CSS par une personne membre de son CA peut être interprétée comme contrevenant au devoir de loyauté et associée à une « nuisance à la réputation » du CSS. Ce devoir de loyauté n'est pas véritablement assorti de droits, ce qui est implicite dans la formation offerte aux membres des CA.
En effet, la loi impose aux membres des conseils d'administration et des conseils d'établissement l'obligation de suivre une formation « élaborée par le ministre », mais plutôt sous-traitée à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). Telle que pensée et dispensée, cette formation s'apparente à un exercice de soumission à l'évangile de la Nouvelle gestion publique (NGP). Il s'agit là d'un mode de gestion publique calqué sur le mode de gestion privée et prescrit aux ministères et aux autres organisations publiques par la Loi sur l'administration publique adoptée en 2000, et prescrit dans le réseau scolaire plus spécifiquement grâce à des modifications successives à la Loi sur l'instruction publique. La gestion axée sur les résultats est une des dimensions de la NGP.
Ajoutons que la loi 40 permet au ministre d'imposer des regroupements de services et de déterminer des cibles dans un ou des CSS, et de communiquer directement avec les employé·es des CSS et les parents. Obligation est faite aussi pour un CSS d'obtenir l'autorisation du ministre pour acquérir un immeuble et pour les municipalités de céder gratuitement des terrains aux CSS. Le pouvoir d'intervention directe du ministre de l'Éducation est ainsi augmenté par rapport à la situation d'avant la loi 40, caractérisée par une démocratie représentative certes imparfaite, mais néanmoins institutionnalisée.
Une gouvernance scolaire au service du ministre
Dans les sociétés dites démocratiques, les discours politiques associés aux changements sont ponctués d'intentions vertueuses : renforcer la démocratie, encourager la participation citoyenne, rapprocher la prise de décision du terrain. La modification aux normes et aux structures de gestion scolaire au Québec ne fait pas exception à la règle. L'intention gouvernementale déclarée était de renforcer la démocratie scolaire et la participation des acteurs scolaires à la prise de décision, et de rapprocher celle-ci de l'élève. C'est toutefois dans la mise en œuvre des lois, règlements et politiques que surgissent les manquements aux principes démocratiques. C'est le cas ici puisque la nouvelle gouvernance scolaire se traduit concrètement par un renforcement du pouvoir d'initiative et d'action du ministre de l'Éducation, au détriment des pôles locaux de gestion et de gouvernance scolaires.
Cela explique l'implosion de certains CA à cause de la démission massive de leurs membres parents, comme au CSS des Chic-Chocs en Gaspésie et au CSS des Chênes au Centre-du-Québec. Les membres parents des CA ne sont pas des technocrates à la recherche de la virgule de trop dans des documents techniques. Ce sont plutôt des personnes socialement engagées et inspirées par des valeurs fortes ; elles participent bénévolement à la gestion scolaire afin de promouvoir leurs valeurs. Des conflits de valeurs ne tardent donc pas à se profiler, à cause d'une différence d'interprétation des rôles et des fonctions des CA (CSS des Chic-Chocs) ou à cause de l'atteinte à la liberté d'expression induite par une définition stricte du devoir de loyauté (CSS des Chênes).
Les formes de démocratie sont légion, mais dans tous les cas se dégage un principe axial : est démocratique un système à l'intérieur duquel une personne peut exprimer librement son accord ou son désaccord avec une idée ou avec un projet sans pour autant craindre que cela ne lui cause préjudice. Il est possible de se questionner à savoir si les cinq membres du CA employé·es du CSS sont à l'aise pour exprimer un point de vue dissident devant la direction générale, leur supérieur et employeur, qui leur propose en réunion des recommandations fondées sur l'expertise de son équipe de direction.
En ce qui concerne les délibérations du CA, il est aussi pratique courante que les sujets délicats soient discutés en plénière lors d'une rencontre précédant une réunion officielle et publique afin d'aplanir les tensions et prétendre ensuite sur la place publique à un consensus. Enfin, rappelons que la loi accorde au CA le pouvoir de déléguer certaines de ses fonctions à la direction générale d'un CSS. Il est préoccupant que dans plusieurs CSS, les règlements relatifs à la délégation des pouvoirs aient été adoptés à la hâte lors des toutes premières réunions des nouveaux CA alors que les membres étaient peu expérimentés et pas en mesure de saisir toutes les conséquences de cet acte délégatif.
Bref, nous ne pouvons pas compter seulement sur le gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour instaurer la démocratie scolaire. Le nouveau ministre de l'Éducation Bernard Drainville ne perçoit pas « l'école à trois vitesses » comme un problème. Son objectif n'est pas non plus de rendre le système scolaire plus démocratique ; il veut plutôt le rendre plus efficient grâce à une gestion axée sur les résultats aveugles des finalités éducatives. En outre, il devra être attentif aux initiatives qui s'inscrivent dans la perspective de la démocratie scolaire participative. Notamment, les forums citoyens « Parlons éducation » se déploient au printemps 2023 dans 18 villes du Québec. Ils permettront de dégager les enjeux de l'éducation au Québec à partir des préoccupations des principales personnes concernées [1].
[1] Les idées proposées dans cet article sont développées dans cet ouvrage : Olivier Lemieux et Jean Bernatchez (2022). La gouvernance scolaire au Québec. Histoire et tendances, enjeux et défis. Presses de l'Université du Québec.
Jean Bernatchez est professeur en administration et politiques scolaires à l'Université du Québec à Rimouski.
Photo : Rosa Pollack (CC BY-NC-SA)

Les élites responsables du déficit d’empathie

Dans une lettre d'opinion publié sur Pivot, l'historienne Catherine Larochelle [1] m'a ouvert une nouvelle voie qui permet d'intégrer plus clairement la responsabilité des élites politiques et médiatiques à ma réflexion sur l'empathie et sur son déclin dénoncé à grands cris par tant de nos contemporain·es.
Deux mots m'ont fortement interpellé dans cette lettre d'opinion en réponse au texte de Gérard Bouchard publié dans l'édition du Devoir du 28 novembre 2022 [2]. À la fin de son texte, elle écrit « […] nous avons tout à gagner, individuellement comme collectivement, à voir dans le passé plusieurs histoires, complexes et même contradictoires. Cela nous portera à embrasser le présent avec un regard plus compréhensif. Pas honteux ou coupable, mais compréhensif. » En mettant ainsi en relation l'un avec l'autre « histoires » et « compréhensif », il m'a fait replonger dans mes propres réflexions quant aux liens qui unissent récits et empathie.
Un phénomène émotionnel et cognitif
Contrairement à une croyance répandue, l'empathie ne signifie pas « ressentir l'émotion d'autrui ». Cette fausse perception a amené plusieurs à la considérer comme un apitoiement lacrymal impuissant et manipulateur. C'est ce que prétendent plusieurs auteur·rices, dont Anne-Cécile Robert et Megan Boler. Dans son livre La stratégie de l'émotion, Robert qualifie ce qu'elle appelle la « mécanique de l'empathie » de « soubresauts émotionnels ou des prurits lacrymaux qui envahissent l'espace public » et qui « impose[nt] des solidarités aux spectateurs ou aux lecteurs… » [3]. Avec le même désintérêt pour la nature et le fonctionnement de l'empathie, Boler s'emploie à la dévaloriser avec cette affirmation emblématique : « la différence entre l'empathie et la sympathie est simple : on ne peut avoir de l'empathie que pour la souffrance qu'on a déjà ressentie soi-même. » [4] Ces deux exemples montrent à quel point, en évitant de véritablement plonger dans la « mécanique de l'empathie », on peut utiliser sa dévalorisation pour soutenir un tout autre propos.
À l'opposé de ces dévalorisations de l'empathie se trouvent plusieurs chercheur·euses issu·es d'une approche interdisciplinaire de l'empathie, soit celle de la convergence de la psychologie sociale, de la neuroscience et de l'anthropologie. Daniel Batson, figure de proue de ces recherches interdisciplinaires, précise huit formes répertoriées de l'empathie dans la littérature. L'une d'elles est particulièrement intéressante et entre en contraste avec la vision énoncée précédemment. Elle peut être formulée ainsi : l'empathie, c'est la faculté par laquelle nous arrivons à nous imaginer ce que pense et ressent autrui comme si nous étions cette personne [5].
Cette définition, qui a pris le relais de celle proposée par Karl Rogers à la fin des années 1970, se distingue des précédentes en mettant une certaine emphase sur la dimension cognitive de l'empathie. Imaginer l'état d'esprit d'autrui, c'est s'en faire une représentation mentale. Pour y arriver, au-delà de la reconnaissance de l'émotion elle-même, il est nécessaire d'accueillir son histoire et de la laisser prendre place en nous. Comment faire autrement ? Imaginer, n'est-ce pas littéralement se « construire une image » de ce que ressent et pense autrui ? Il ne s'agit donc pas principalement de ressentir ses émotions, mais bien de comprendre ce qui l'anime, constituer un composé complexe de son parcours sur le long terme tout autant que des événements récents qui lui sont arrivés. N'est-ce d'ailleurs pas ce qu'on fait naturellement lorsqu'on trouve une personne en pleurs et qu'on lui demande « qu'est-ce qu'il t'arrive ? » Il n'est d'empathie que dans l'admission du récit d'autrui.
La confrontation des récits
Or, en paraphrasant le titre de l'ouvrage de Philippe de Grosbois, de nos jours, certains récits entrent en collision et deviennent en quelque sorte incompatibles. L'histoire des pensionnats autochtones au Québec s'inscrit mal dans le récit national du Québécois asservi et bienveillant. Celle des migrant·es traversant le fameux chemin Roxham confronte celle de la survie du peuple valeureux assailli de toutes parts. Les témoignages répétés de profilage racial contredisent la certitude d'être la société « la plus accueillante et la plus tolérante au monde ». Parmi ces perceptions, il n'y a pas celles vraies et celles fausses, elles sont, selon les termes de Larochelle, le produit de faits historiques valorisés, choisis, pour construire une mémoire collective, un récit commun.
Cette confrontation entre des récits nouveaux à nos oreilles et celui que raconte la mémoire collective a un effet délétère documenté sur l'empathie. Sur le plan culturel, elle pose le défi d'intégrer ces mémoires réfractaires l'une à l'autre pour arriver à une nouvelle narration qui sera nécessairement plus complexe et probablement moins célébrante. Sur celui psychologique, elle force une distanciation intérieure plus inconfortable avec sa propre identité pour laisser place à un « corps étranger » qu'on doit finir par accepter sans se dénaturer.
Les recherches en neurosciences ont démontré combien les croyances, ces produits essentiellement culturels, jouent sur l'aiguillage neuronal qui traite les informations, incluant les récits d'autrui. Les histoires conformes à nos opinions sont traitées normalement par le cortex cérébral, domaine de la pensée rationnelle. À l'opposé, celles qui confrontent nos croyances sont dirigées directement vers le systèmee limbique, site des émotions. Ainsi, le cerveau humain traite les informations contraires à nos certitudes comme il fait avec un virus : il cherche à les éliminer. Ainsi, en court-circuitant la pensée rationnelle, ces histoires discordantes se trouvent simplement écartées, soustraites au traitement cognitif. En d'autres mots, pour celui qui les reçoit, elles n'existent simplement pas. Rien de surprenant à ce que certains sujets provoquent autant et si systématiquement des réactions épidermiques chez plusieurs.
La mémoire, un levier de pouvoir
C'est ici qu'intervient à nouveau le texte de Larochelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas tous·tes aussi influent·es dans la construction de la mémoire commune : les élites politiques, médiatiques et communautaires y jouent un rôle non négligeable. Par leur prise de parole, ces personnes font le lit de la conscience collective qui favorise l'accueil ou le rejet des récits d'autrui. Quand, depuis leur chaire politique ou par des textes récurrents dans un journal, plusieurs qualifient d'anecdotique l'expérience des un·es et associent le sort des autres à un risque pour la survie nationale, quand ces personnes transforment l'accueil de réfugié·es ou les demandes territoriales et culturelles des Autochtones en menaces, la possibilité pour chaque membre de la communauté d'accueillir les récits étrangers se réduit comme peau de chagrin. Et que dire de ces trop nombreuses situations où l'expérience, les aspirations et l'identité même de ces multiples « autres » se trouvent réduites à un quolibet, une étiquette. « Féministe radicale, communautariste, islamogauchiste, woke » et leur kyrielle d'équivalents n'ont comme mission que de dévaloriser, voire de déshumaniser autrui.
Tant de voix fortes se plaignent du manque de civilité, de respect, voire d'empathie dans l'espace public, qu'il soit numérique, politique ou communautaire, alors même qu'elles sont largement responsables de cette situation. Chaque personne détenant le rare privilège de se faire entendre par les différentes communautés, « majorité historique » ou minorités toutes autant historiques, doit prendre conscience de son rôle et de son devoir éthique. Il s'agit non seulement d'écrire cette nouvelle mémoire collective, mais de la définir pour qu'elle soit un terreau favorable à l'empathie et à la bienveillance.
Si les mythes président à la collaboration au niveau des grands ensembles humains, l'empathie agit à l'échelle des individus. Revalidée, elle peut reprendre le rôle historique qu'elle a joué dans l'histoire humaine. « Je te comprends, tu me comprends, dès lors nous pouvons agir ensemble pour notre bien. » Encore faut-il que la construction d'une telle société, que le discours ambiant qui la décrit comme tolérante et accueillante, soit leur véritable objectif.
[1] Catherine Larochelle, « La mémoire québécoise, au-delà de la misère canadienne-française : réponse à Gérard Bouchard — Lettre d'opinion », Pivot, 7 décembre 2022, pivot.quebec/2022/12/07/la-memoire-quebecoise-au-dela-de-la-misere-canadienne-francaise-reponse-a-gerard-bouchard
[2] Gérard Bouchard, « À la défense des Québécois », Le Devoir, 28 novembre 2022
[3] Anne-Cécile Robert, La stratégie de l'émotion, Montréal, Lux Éditeur, 2018, p. 64.
[4] Traduction de la rédaction. « Empathy is distinct from sympathy on the common sense that I can empathize only if I too have experienced what you are suffering. » Megan Boler, Feeling Power, New York, Routledge, 1999, p. 157.
[5] Daniel Batson, « These Things Called Empathy : Eight Related but Distinct Phenomena », The Social Neuroscience of Empathy, Boston, MIT Press, 2009, p.9
André Bilodeau, M.D. est professeur agrégé au département de médecine familiale à l'Université McGill.
Illustration : Elisabeth Doyon
La musique engagée
Souvent ignorée ou regardée de haut, y compris à gauche, la musique populaire a pourtant un atout considérable : elle est populaire. Elle contribue à rassembler, à fédérer.
Comme l'écrit le sociologue et philosophe Hartmut Rosa, si la musique « nous touche autant, c'est bien parce qu'elle entre en résonance (…) avec nos propres relations au monde ». La musique peut traduire des réalités partagées avec pour seuls outils des sonorités, un rythme et des paroles. Cette richesse et cette puissance de la musique populaire, on en prend la pleine mesure lorsque de l'effervescence d'un soulèvement de grande envergure émerge un hymne, un chant, un slam. La musique engagée est alors à la fois un produit du mouvement et l'un de ses catalyseurs. Le succès d'une pièce ne dépend pas seulement de la personne qui l'a produite, mais de son appropriation collective.
Au Québec, lorsqu'on pense à la musique engagée, on a tendance à évoquer Paul Piché, Richard Séguin, ou si on est (un peu) plus jeune, les Cowboys Fringants. Pourtant, la musique engagée n'est pas propre à un style : elle émane de la volonté d'interpeller ses semblables, de transmettre une réalité, d'apostropher le pouvoir par le biais d'une démarche artistique singulière. Ce mini-dossier en donne un aperçu, à travers l'hymne de la révolte iranienne contemporaine, le hip-hop montréalais, l'histoire du punk québécois, et la chanson ilnue. Vous trouverez également le top 3 de quelques membres du collectif de rédaction.
Bonne lecture !
Un mini-dossier cordonné par Isabelle Bouchard et Philippe de Grosbois
Illustrations : Ramon Vitesse

Ce que je dois à Bruno Latour

Bruno Latour, sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences français, est décédé le 9 octobre dernier. Né en 1947, il était parmi les chercheur·euses les plus cité·es dans la grande famille des sciences humaines.
Vous ne lirez pas un texte de spécialiste de Bruno Latour. En outre, je ne me consacrerai pas à une critique de son œuvre. Les prises pourraient être nombreuses (politiques, médiatiques ou intellectuelles). Mais, suivant la coutume lors d'un décès, je vais m'en tenir à ce qui mérite reconnaissance. J'ai la conviction que, comme beaucoup d'autres, j'ai une dette importante à son endroit.
J'ai été amené à découvrir Latour assez récemment. Sa lecture s'est imposée dans un moment de doute professionnel assez radical. Il y a quelques années, je donnais un cours sur les problèmes sociaux et les mouvements sociaux. Quelque chose clochait avec la série de cours sur l'écologisme. Il allait de soi que la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité devaient y occuper une place centrale.
Mais les cours sur l'enjeu écologique se présentaient comme un appendice étrange dans une session faite de sociologie par ailleurs plutôt classique : pendant une douzaine de semaines, il était question de classes sociales, d'institutions sociales, de syndicats, d'États, de monnaie, d'organisation du travail ou des soins, de domination masculine, de stigmatisation – en définitive, que des relations interhumaines. Je parlais, semble-t-il, d'un monde (et dans un monde) dépourvu de vaches, d'écureuils, d'érables ou de champignons.
Puis, soudainement, le monde se repeuplait d'une pluralité d'êtres lorsqu'on abordait les questions écologiques et climatiques – des bélugas et des baleines noires, des épinettes, des glaciers, des tourbières, du pétrole… tout un monde de codépendances fragiles et menacées se dessinait. Évidemment, ce ne sont pas les deux ou trois semaines sur la question écologique qui posaient problème… Ce sont plutôt toutes ces semaines de sociologie « normale » qui m'apparaissaient alors comme peu adaptées aux nouvelles coordonnées sociales et politiques de l'époque.
En finir avec la séparation nature-culture
L'une des lignes de force de l'œuvre tardive de Latour me semble tenir dans une attention aux manières de dire. Il s'agit en définitive de ne pas se piéger dans des problèmes mal formulés [1]. Ainsi en est-il selon lui (et d'autres, comme Philippe Descola) de la distinction entre nature et culture. Cette séparation ne recouvre rien d'observable ou d'expérimentable. Il n'y a nulle part un pôle « humain » vivace, changeant, subjectif, imaginatif, « libre » qui ferait face à un pôle « nature » a-subjectif, déterminé, fixe, répétitif et objectif.
Si cette séparation est au cœur des représentations à la base du projet de modernisation occidentale, elle ne recouvre en fait aucune réalité. Ce qui existe, nous dit Latour, c'est un enchevêtrement complexe de relations terrestres liant des vivants humains et non humains, les produits de leur action (terre arable, atmosphère, compost, etc.) et des infrastructures. Tout ça sur un même plan d'immanence, ici-bas. Il s'agit en somme de reprendre de l'intérieur, en terrestre, la tâche de description du monde. Le travail intellectuel du Latour écologiste est de donner à voir un monde dans lequel on a multiplié les puissances d'agir (des microbes aux loups, des érables au phytoplancton) contre l'extraordinaire appauvrissement moderniste qui réduit tout à l'humain. Avec Latour, ce que la pensée moderne occidentale situait comme un décor inerte et extérieur, un environnement, s'anime soudain, entre en relation, agit et réagit.
Sur cette base, Latour propose une sorte de matérialisme assez radical. Non seulement il n'y a qu'une seule terre, mais, plus précisément, il n'y a, pour nous terrestres, que la zone critique de cette terre, cette petite couche habitable de quelques kilomètres où prolifèrent, s'entrecroisent, se composent et se décomposent des formes multiples de vie. Il va même pousser cette description matérialiste dans une veine presque marxiste [2] dans Face à Gaïa. Au cœur de cette fine zone critique, nous dit-il, ce sont les vivants eux-mêmes qui produisent, par leur action et dans leurs relations, les conditions permettant la vie (de l'oxygène qu'on respire à la terre sous nos pieds). Un étrange marxisme cependant où l'on peut imaginer un camarade caribou ou un compañero champignon.
Politique : atterrir sans être réac [3]
À la fin de sa vie, Latour tentera de formuler une pensée politique en cohérence avec cet ancrage terrestre. C'est en particulier le projet Où atterrir ?. Comme toute personne sensible aux questions écologistes, il est clair pour lui que la poursuite de la modernisation (qui passe par la croissance infinie et le productivisme, entre autres) constitue un projet hors-sol auquel aucun monde concret ne correspond. Il nous faudrait, semble-t-il, 4,7 planètes pour généraliser le mode de vie canadien à l'échelle mondiale. C'est évident, il nous faudra donc revenir sur terre.
Cet atterrissage, cependant, se fera sans le secours des « élites modernisatrices ». Il semble acquis pour Latour que cette « classe dominante » prendra coûte que coûte une direction autodestructrice (et ce, en toute connaissance des ravages et de l'inanité d'un tel projet). Les exemples abondent, que ce soit François Legault – « l'environnement, mais pas aux dépens de l'emploi » – ou, plus récemment, le président français Emmanuel Macron – « qui aurait pu prédire la crise climatique ? », se demandait-il dans ses vœux de fin d'année 2022. Et, bien entendu, on pense à Donald Trump, Jair Bolsonaro, Pierre Poilièvre, Danielle Smith ou à Exxon, Total et Enbridge.
Mais il nous faut en outre signifier autrement le sol ou l'ancrage territorial où il convient d'atterrir. Il y a une idéologie nostalgique et réactionnaire, souvent raciste et patriarcale, du retour au sol (toujours national) à désactiver. « La terre ne ment pas ! » disait le maréchal Pétain, « blood and soil ! », scandaient les fascistes à Charlottesville. Plus près de nous, pensons au mythe ultraconservateur de la vocation agricole (et catholique) canadienne-française. Notre tâche politique, au contraire, est de penser une vie habitable et prospère, hospitalière et, pourquoi pas, joyeuse, mais ancrée au cœur de relations assumées de codépendances situées. Et tout ça en élargissant radicalement le cercle des êtres à inclure.
On le voit, pour Latour, il ne suffit pas d'ajouter le préfixe « éco » à un projet (socialiste ou syndicaliste, par exemple) qui resterait inchangé dans ses fondements. Il s'agit de tout repenser et de tout refaire avec l'écologisme pour boussole. Il nous incombe d'abord, pense-t-il, de redessiner un projet où il ne s'agit pas tant de s'autonomiser ou de s'émanciper que de tracer les contours d'une communauté qui assume ses codépendances. Enfin, la tâche politique écologiste consiste aussi à retisser les réseaux de solidarité et d'alliances nécessaires à la construction d'une « classe écologiste » porteuse dudit projet. Y'a du boulot…
Une constellation
Découvrir Latour, c'est enfin s'ouvrir à une constellation de pensées proches qui, chacune à leur manière, dessinent ce retour sur terre. Il y a l'extraordinaire Champignon de la fin du monde d'Anna Tsing. À partir d'un champignon qui prolifère dans les coupes à blanc du Nord-Ouest américain, le mitsutake, Tsing reconstruit une histoire concrète et relationnelle du capitalisme contemporain tout en ouvrant un questionnement éthique vertigineux : comment apprendre à habiter dans les ruines du monde ? On peut aussi penser au fabuleux L'Arbre-monde de Richard Powers. Dans ce roman, Powers nous donne à voir et à sentir de façon magistrale les rapports singuliers et multiples qui se tissent en contexte nord-américain entre des arbres et des humains.
Mentionnons aussi Timothy Mitchells qui, dans Carbon Democracy, prend au sérieux les propriétés matérielles du charbon et du pétrole. Le charbon, lourd et concentré, nécessitant une force de travail colossale, offrait tactiquement la possibilité au mouvement ouvrier de bloquer assez aisément mines et chemins de fer. En comparaison, les propriétés matérielles du pétrole n'offrent rien de tel. J'aurais dû parler du vieux chien de Donna Haraway, des oiseaux de Vinciane Despret, des loups de Baptiste Morizot, de l'histoire environnementale des idées de Pierre Charbonnier, du monde des Gwich'in ou de la rencontre avec un ours de Nastassja Martin, des forêts pensantes d'Eduardo Kohn…
Une constellation qui nous donne à voir ce monde enchevêtré et « relationniste » que décrivait Latour et qu'il nous échoit d'habiter et de défendre.
[1] C'est une idée que développe de belle façon Philippe Pignarre dans une conférence sur Latour à la Société Louise-Michel (la conférence peut être retrouvée sur ce site : www.societelouisemichel.org)
[2] C'est d'autant plus étrange quand on connait l'animosité qui a longtemps marqué les relations de Latour avec les marxistes et les bourdieusiens.
[3] On parle ici du Latour écologiste de la fin. S'il a longtemps été plutôt centriste, voire libéral, Latour se radicalise progressivement dans les années 2000.
Benoit Tellier est professeur de sociologie au collégial et militant à Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique.
Photo : Bruno Latour (Wikicommons)

Barâyé, la nouvelle révolution iranienne

Dans les heures suivant sa publication le 28 septembre 2022, la chanson « Barâyé » de Shervin Hajipour a embrasé Internet avant d'être reprise par les manifestant·es iranien·nes à travers le pays et autour du globe. En peu de temps, la chanson, dont le titre signifie « pour » ou « à cause de » en persan, est devenu l'hymne de la révolte iranienne.
Ce mouvement, mené d'abord par les femmes et les jeunes du pays, fut enclenché deux semaines plus tôt en réaction à la mort en détention de Mahsa Jina Amini, jeune femme kurde de 22 ans, arrêtée par la police de la moralité pour cause de voile mal porté. Funeste dénouement d'une intervention autrement trop familière tout autant que dérangeante pour les 40 millions de femmes iraniennes – dont plus de 50 % sont nées après la révolution de 1979. Cette mort entraînera dans la rue la multitude des mécontent·es, mais aussi des pans de la population habituellement attachés au statu quo. Jina Amini aura donc été la victime de trop dans une société où les tensions économiques, politiques et sociales étaient déjà à leur comble et qui chaque jour semblaient tâter les limites de la résilience d'un peuple. Le mouvement en cours s'inscrit dans une histoire de 44 ans de contestation de la dictature religieuse, depuis son imposition après qu'une autre révolution, celle de 1979, eut renversé la dictature précédente, celle du Shah.
Dans sa chanson, Shervin Hajipour reprend toutes les raisons barâyé (c'est-à-dire « pour ») lesquelles son peuple en vient à prendre la rue. Ses paroles sont l'assemblage d'une multitude de tweets publiés dans les premiers jours des manifestations, de gens ordinaires exprimant leur souffrance quotidienne et qui, avec une formulation commune, énoncent les raisons qui les poussent à manifester. Shervin leur prête sa voix dans une vidéo filmée dans sa chambre, image sur laquelle se superposent les tweets qui constituent la base de ce texte participatif. Son contenu est vaste et couvre, du personnel au politique, des raisons si variées qu'on ne les compte plus. Certaines sont propres au contexte théocratique et dictatorial : interdictions religieuses, inégalités de droit, endoctrinement et répression brutale, dans un Iran frappé par des sanctions économiques qui s'éternisent et leur gestion destructrice par les autorités du pays. D'autres font écho aux maux dont l'affliction est universelle : pauvreté et inégalités sociales croissantes, corruption, destruction de l'environnement, iniquités de genre, discriminations ethniques. Malgré la douleur qui se transmet au-delà du langage, la chanson est poignante par l'espoir qu'elle cherche à transmettre et qui culmine dans le slogan de la révolution en cours « Femme, Vie, Liberté », slogan que l'on doit à la culture politique kurde, résolument tournée vers l'anti-autoritarisme et l'égalité des sexes.
Vue des millions de fois avant le retrait imposé du clip, la chanson a valu à l'auteur une détention et des accusations de propagande contre le régime. Suivant sa remise en liberté sous conditions, Shervin Hajipour publie une vidéo d'aveux, que tout porte à croire qu'ils sont forcés. Or, la chanson, qui était déjà devenue un symbole au-delà de son auteur et était restée largement disponible en ligne à travers les comptes de divers usager·ères, a pris un essor suivant l'arrestation de Shervin. Elle a été chantée d'innombrables fois dans les manifestations autour du globe, arrachant à chaque coup quelques larmes, et traduite en plusieurs langues, dont le français, l'anglais et l'espagnol. Elle est maintenant en lice pour un nouveau prix aux Grammy Awards soulignant la « meilleure chanson pour le changement social », soumise par le public près de 100 000 fois.

Daria Khadir, d'origine iranienne, est étudiante en génie de la construction et a participé à la traduction de Barâyé en français ainsi qu'à la production de la version québécoise.
Voir l'adaptation française de Barâyé par des artistes québécois : youtu.be/4mMqDzofYZk
Illustration : Ramon Vitesse
La transition socioécologique est-elle de gauche ?
La prédominance du paiement par carte de crédit : enjeux et conséquences
Vous avez dit désert obstétrical ?
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












