Derniers articles
Colombie : Petro et la guerre entre les FARC et l’ELN
Piquet des travailleurs devant l’entrepôt de Laval

La montée de la droite, le Canada, le Québec et la classe ouvrière

L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis a bouleversé la situation politico-économique mondiale. Ses décisions ont un impact important sur la politique et sur l'économie canadienne ainsi qu'une déstabilisation de la question de la souveraineté au Québec.
C'est au Québec que le « sentiment d'affection profonde » envers l'Unifolié s'est le plus propagé, près d'une personne québécoise sur deux se dit fière d'être canadienne avec un taux de 58%, une augmentation de 13 % depuis décembre dernier.
Il nous apparaît dans ces circonstances imprtant de clarifier d'une part le sens de la lutte de libération nationale contre l'État impérialiste canadien et d'autre part la lutte de la classe ouvrière, seule capable de mettre fin à la montée de l'extrême droite et à apporter les solutions à la crise tant sociale qu'environnementale.
La lutte de libération nationale est une lutte historique qui a pris forme contre l'oppression de l'État canadien. L'oppression nationale du Québec est le maillon faible de l'État impérialiste canadien et dans cette mesure la lutte pour l'indépendance doit être une lutte pour un changement de société, démocratique, sous contrôle social où les grandes entreprises doivent être nationalisées. Cette lutte se fait en solidarité avec les progressistes du Reste du Canada (ROC) qui ont tout intérêt à un changement de société ainsi qu'avec les peuples autochtones pour la réappropriation de leurs droits ancestraux.
Notre défi est de lier ces luttes aux luttes sociales de la classe ouvrière du Reste du Canada dans une stratégie commune avec les nations autochtones. Nous sommes la seule force qui peut apporter une solution à la crise politique et environnementale. C'est une lutte pour la solidarité internationale des peuples. Ce ne sont certainement pas les banquiers, le monde des affaires et les politicien-es qui défendent des politiques néolibérales qui y parviendront. Leurs solutions seront toujours au détriment de la classe ouvrière et de l'environnement.
Quelles alternatives politiques ?
Les prochaines élections fédérales prendront donc une grande importance dans un contexte où le mot d'ordre semble être "sauvons le Canada". Le Parti libéral du Canada (PLC) est en remontée et se présente comme le rempart contre la droite trumpiste et, par conséquent, la nécessaire alternative aux Conservateurs. Mark Carney semble la figure dominante pour remplacer Justin Trudeau. Ce dernier a affirmé être ouvert aux projets de pipelines et, comme sa rivale Chrystia Freeland, mettrait fin à la taxe carbone. Il s'est aussi engagé à réduire la taille de la fonction publique et à baisser les impôts. Il promet que s'il devient premier ministre, le Canada atteindra la cible de 2 % du PIB en dépenses militaires en 2030. Il a aussi promis de faire passer à la trappe la hausse des impôts sur le gain en capital que les Libéraux ont pour l'instant seulement repoussé. On comprend qu'il cherche à prendre le terrain des conservateurs.
Avec un programme et une attitude qui ressemblent à Trump, la forte montée des Conservateurs devient maintenant un incitatif à ne pas voter pour eux.
Le NPD semble le seul parti qui n'est pas néolibéral et pour lequel on peut voter. Mais ses positions mitigées ne sont pas inspirantes.
Le Bloc québécois, quant à lui, partage les mêmes positions néolibérales que le PLC. Ses politiques identitaires et anti-immigrations rebutent un grand nombre de personnes et ne sont pas très loin de celles des Conservateurs. De surcroît ce parti ne peut pas structurellement aspirer au pouvoir. Il se donne le rôle de paver la voie à l'Indépendance du Québec et travaille en tandem avec le Parti Québécois avec qui il partage les mêmes politiques néolibérales et identitaires. Paul St-Pierre Plamondon se voit probablement déjà premier ministre lorsqu'il a affirmé que le Canada a été un mauvais voisin avec les États-Unis : « le Canada et le Québec ont été « des mauvais voisins » sur la question de l'immigration illégale et le trafic de fentanyl à la frontière ».
L'offensive de Trump
Les barrières économiques qu'imposeront les politiques tarifaires de Trump seront reportées essentiellement sur la classe ouvrière, mais à cause de la dynamique du fonctionnement des industries et du rôle des gouvernements tant fédéral que provinciaux de se plier à la logique entrepreneuriale, ne pourront que conduire au rétrécissement de l'État social avec pour conséquence les coupures dans les services publics, la baisse des salaires et la détérioration des conditions de travail.
Si nous n'offrons pas d'alternative à la classe ouvrière, elle suivra forcément les forces néolibérales qui, de capitulation en capitulation devant la droite, désarmeront la classe ouvrière et la laisseront au final sans force de résistance face à la droite et l'extrême droite. C'est l'histoire du mouvement ouvrier.
Il n'y a aucune réponse rationnelle à donner à Trump, son discours n'est que de la falsification et de la propagande haineuse et dépolitisantes. Trump libère les criminels d'extrême droite et se débarrasse des personnes qui ont un sens démocratique.
Notre force repose sur la politisation, sur la mobilisation. Il faut s'adresser à la population et particulièrement aux progressistes américains et construire la mobilisation avec eux. Il faut aussi défaire le mythe du Canada, le beau pays qu'on doit défendre. Ce pays est contrôlé au final par les multinationales, les minières, les papetières, les compagnies forestières, les pétrolières et les consortiums financiers.
Le ministre fédéral des finances vient d'indiquer qu'il va falloir rendre l'industrie plus compétitive. Il envisage la possibilité de leur accorder des baisses d'impôts et de réduire la taille des services publics.
Le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) propose quant à lui de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 15 à 12%, voire 10 % au fédéral et de 11,5 à 10 % au provincial.
C'est la réponse patronale au fait que le président Trump veut abaisser le taux d'impôt fédéral américain de 21 à 15 %. Avec ces changements annoncés, le taux combiné moyen tournerait ainsi autour de 19,5 % pour les entreprises manufacturières. C'est beaucoup moins qu'au Québec qui afficherait un taux d'impôt des sociétés combiné fédéral-provincial à 26,5%. Les entreprises canadiennes devraient faire à une concurrence fiscale américaine et elles ne seraient plus à armes égales pour y faire face.
Les multinationales, ces intouchables qui échappent au financement
Selon les données de 2016 de Statistique Canada, moins de 1 % des entreprises au Canada étaient des multinationales. Bien qu'elles ne représentent qu'une petite partie du nombre total d'entreprises, les multinationales ont eu un impact important sur l'économie canadienne. Ces entreprises employaient un Canadien sur quatre et possédaient 67 % du total des actifs des secteurs financier et non financier. Les multinationales ont également généré plus de revenus et détenu plus d'actifs dans presque toutes les industries canadiennes. De plus, en tenant compte de leur taille, les multinationales étaient généralement plus profitables que les entreprises qui œuvrent uniquement sur le marché canadien. La majorité des filiales de multinationales canadiennes se trouvent aux États-Unis, où se trouvent 58.3 % de sociétés mères et 49,9 % des filiales.
Si on ne prend que l'exemple des compagnies minières, une enquête du vérificateur général Renaud Lachance conclut qu'entre 2002 et 2008, 14 entreprises minières exploitantes n'avaient versé aucune redevance. ( Voir, W. Sacher et A. Denault Paradis sous terre, Les Éditions Écosociété, 2012 )
Seul le combat paiera
Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il n'est pas difficile de comprendre que la pression de Trump, sans compter celle de l'extrême droite mondiale, aura pour conséquence une offensive en règle contre le mouvement ouvrier, contre les syndicats, les salaires, les conditions de travail. Cela aura un impact sur les services sociaux, comme la santé et l'éducation, qui sont déjà dans la mire de nos dirigeants politiques.
En outre, il n'y a pas de solution viable dans une consigne de vote aux élections fédérales qui arrivent bientôt. Le PLC est en remontée suite aux interventions de Justin Trudeau qui donnent l'impression d'un certain gain ou à une sorte de répit face à l'offensive de Trump. Cela peut sembler encourageant face à Poilievre qui voguait vers une victoire assurée. Mais, appuyer le PLC, c'est appuyer un parti néolibéral au service des entreprises et des multinationales, qui nous conduira inévitablement vers des offensives antiouvrières induites par les politiques de Trump.
En deuxième lieu, si nous ne construisons pas d'alternative de classe et si nous ne mettons pas de l'avant, l'analyse politique anticapitaliste qui y est liée, cela nous empêchera de construire une résistance (à tout le moins) et une analyse politique progressiste.
Le plus important dans la période antisociale qui s'annonce c'est de politiser, de construire des mouvements de résistance, d'allier les différents secteurs populaires afin de construire un rapport de force. Si nous n'allons pas dans cette direction, nous laisserons les leaders de l'establishment (les Libéraux en l'occurrence) prendre la direction du terrain politique et imposer leurs perspectives qui auront pour effet de nous désarmer, nous laissant sans perspective.
La crise capitaliste non résolue a engendré la montée de la droite et de l'extrême droite. Il n'y aura pas de solution cosmétique ou de moindre mal. Nous n'avons pas su, tant au niveau national qu'international, construire une alternative politique de gauche. La planète est maintenant en péril, la crise climatique ne cesse de s'accentuer.
Pour Trump, la question ne se pose simplement pas. Mais l'extrême droite européenne développe d'autres stratégies qui peuvent s'avérer dangereuses. Elle s'attaque désormais aux changements de mode de vie qu'imposent des politiques environnementales. Selon cette vision, les mesures de protection du climat seraient un moyen supplémentaire pour les élites urbaines d'avoir un plus grand contrôle sur la population. L'idée, c'est d'opposer le bon sens de la terre, du paysan, contre l'idéologie urbaine bobo. En France, par exemple, Marine Le Pen promet dans son programme d'abroger des segments entiers du Pacte vert, comme l'interdiction de la vente des véhicules neufs à essence en 2035 ou le règlement sur la restauration de la nature, et souhaite imposer un moratoire sur l'éolien et le solaire.
Cela pourrait devenir le cas au Québec également si nous n'y portons pas attention. En effet, Le Parti conservateur d'Éric Duhaime (PCQ) exige que le gouvernement du Québec fasse marche arrière sur l'interdiction de la vente de véhicules à essence dès 2035 et demande la mise en place d'un moratoire sur cet enjeu.
La division régions et centres urbains peut potentiellement se révéler un écueil, si nous ne trouvons pas de revendications unificatrices. Le plan de transport proposé par Québec solidaire lors de la campagne électorale de 2022 en était un exemple. Ce plan écologique proposait l'établissement d'un système de transport en commun unifié, interrégional et à faible coût. Ce plan a malheureusement été mis de côté. Son financement, proposé lors de la campagne électorale, ciblait la classe moyenne et ne visait pas les multinationales qui ne paient pas ou peu d'impôt. Cela a provoqué un tollé et stoppé la montée de QS.
Selon le dernier sondage, QS est passé en dessous du PCQ d'Éric Duhaime. Il est plus que temps de revenir à des revendications qui ciblent les vrais dirigeants de l'économie, les grandes entreprises, qui nous amènent dans un gouffre.
L'heure est maintenant pour nous de construire la mobilisation populaire, d'unir les forces de la gauche au niveau international afin de pouvoir poser une politique et un discours alternatif. La construction d'une alternative ouvrière pancanadienne respectant le droit à l'autodétermination du Québec et des nations autochtones doit être notre priorité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Attention à la montée du « fascisme tranquille »
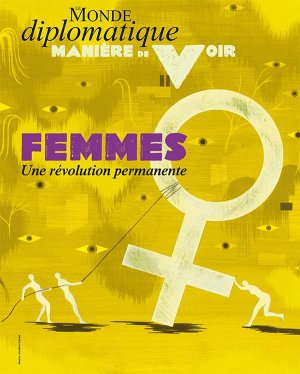
Femmes. Une révolution permanente
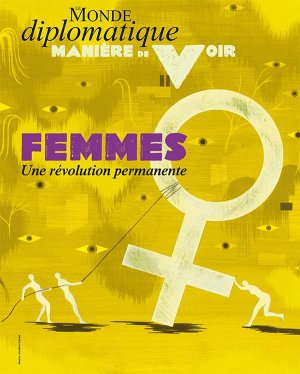
Manière de voir, n° 198, décembre 2024 - janvier 2025
Pour consultation cliquer ici
Du Chili à l'Iran, des studios de Hollywood au procès des viols de Mazan, les femmes se soulèvent dans le monde entier. Ce nouveau Manière de voir, « Femmes. Une révolution permanente », explore la décennie #MeToo, ses déclinaisons et ses conséquences à l'échelle planétaire.
• De grandes plumes – Gisèle Halimi, Geneviève Fraisse, Mona Chollet… et des reportages au cœur des luttes
• Droit à l'avortement, congé-paternité, inégalités salariales : des cartes et des graphiques pour comparer les pays
• Une bande dessinée originale de Salomé Lahoche
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
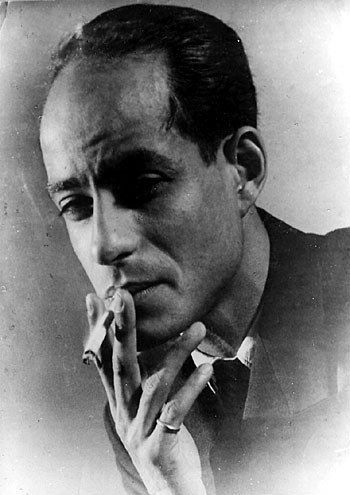
Échos de l’âme : un hommage à Jacques Roumain
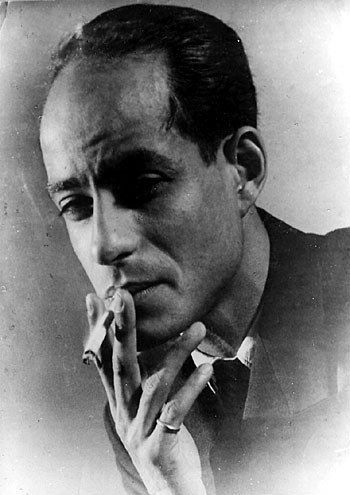
Pour commémorer les 80 ans marquant la disparition en 1944 du penseur, homme politique, romancier et poète, Jacques Roumain, une série d'activités politique et culturelles ont été réalisées à Montréal. Il s'agissait de mettre en exergue l'apport tant sur la scène politique que dans la littérature Ayitienne de cet homme vaillant fauché trop tôt. Jacques Roumain est mort à 37 ans.
Sur le plan politique, la Coalition Haïtienne au Canada contre la Dictature en Haïti (CHCDH) en collaboration avec Yves Sanon a organisé au mois de décembre un cercle de lecture avec ses membres, sur son roman phare, Gouverneur de la Rosée et son œuvre politique Analyse schématique 32-24, co-écrit avec ses camarades dont Étienne Charlier et Christian Beaulieu. Une quarantaine de militantes et militants tant de la diaspora et en Ayiti ont revisité le programme de société proposé par Roumain et ses camarades, mais surtout la vision qui a influencé tout un pan de la gauche ayitienne pendant des décennies. L'exercice consistait de partir de ces premières pierres de la gauche en Ayiti pour analyser la situation actuelle dans un continuum.
Sur le plan culturel, trois événements complémentaires ont eu lieu dans le cadre du mois de l'histoire des noir.e.s.
Un plongeon dans la poésie de Jacques Roumain a été réalisé par l'organisme KEPKAA dans le cadre d'une conférence magistralement présentée par le musicologue Claude Dauphin le 2 février 2025 à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Une exposition d'art visuel, Échos de l'âme, dont il sera question principalement ici, chapeauté par la Maison d'Haïti à la TOHU le 5 février 2025 et enfin un concert de musique classique Le deuil des roses qui s'effeuillent conçu par David Bontemps, le 6 février 2025 à la salle Pierre-Mercure de l'UQAM.
La Maison d'Haïti, dans le cadre de cette exposition unique a mis en lumière l'inspiration profonde que l'œuvre poétique de Jacques Roumain a pu exercer sur l'art pictural et visuel. Il s'agit d'une idée première de Ralph Maingrette qui a eu l'initiative de transposer sur des canevas et à travers des prismes de lumière, les mots phares et l'essence de l'œuvre poétique de Roumain. Les contacts avec les artistes ont permis, grâce au travail de l'équipe de la Maison d'Haïti (des membres : de son CA, de la direction et de son personnel) de poursuivre avec la démarche amorcée par Monsieur Maingrette, débouchant sur la poétique de ces oeuvres de très belle facture. Soulignons cependant le travail de Marjorie Villefranche et en particulier Dominique Mathon, véritable cheville ouvrière de la réalisation de cette exposition.
Le vernissage de Échos de l'âme, dont le discours d'introduction a été fait par l'autrice, a été honoré de la présence de la direction de la Tohu, Monsieur Benoit Mathieu, Directeur de l'Administration ; Madame Pascale Bélanger, Directrice de la Programmation ; Monsieur Luc Savard, Directeur adjoint de la programmation culturelle et loisirs ; Madame Éliane Bélec, Chargée des expositions et du patrimoine et son dynamique équipe dont l'infatigable Andras Csazar qui a travaillé de manière acharnée pour l'accrochage, pièce maîtresse dans la création de l'ambiance. La TOHU par son symbolisme est un cadre privilégié, idéal pour la concrétisation de cette aventure rejoignant la nature écologique, artistique et humaine des œuvres de Roumain.
Roumain personnage emblématique incontournable de la pensée Ayitienne a indéniablement une grande influence sur plusieurs générations de conceptrices et de concepteurs Aytien.ene.s et même au-delà. Son œuvre littéraire, roman et poésie ne saurait être dissociée de sa pensée et son engagement politique résolument de gauche. Et pour cause, Jacques Roumain fonde le Parti communiste Ayitien alors qu'il n'a que 27 ans.
Tout et toute artiste cherche à exprimer l'indicible, à capter cette essence fugace qui relie au monde, à l'histoire, aux racines. Jacques Roumain, à travers sa poésie vibrante et sa vision humaniste, a su, avec une rare puissance, transmettre cette même quête de sens et de beauté.

L'œuvre de Roumain trouve écho dans la lutte, la résilience, l'amour de la terre et des êtres (hommes et femmes), tout en nous invitant à revisiter notre condition humaine, à repenser nos rapports à la nature, à la société et à l'histoire. Ses mots résonnent, tantôt comme un appel à la solidarité, tantôt comme un cri de résistance face à l'injustice et à la domination. C'est ce que les artistes réuni.e.s dans cette exposition ont cherché à rendre lisible à travers leurs toiles, leurs photos : la richesse symbolique, l'intensité émotionnelle de l'œuvre de Roumain et la manière dont ses mots se transforment en formes et en couleurs.
Sans se consulter les sources d'inspirations s'entrecroisent et se chevauchent comme dans une quête mémorielle du départ pour mieux renaître. Intemporelle, la vision créatrice de Roumain imbriquée dans son analyse sociétale, révèle les mêmes iniquités qui perdurent sous d'autres formes.
Chaque tableau, chaque œuvre, chaque teinte, chaque touche de lumière présente dans cette exposition est un hommage à cet immense poète et à l'univers qu'il a su créer. En plongeant dans ses vers, ces artistes ont réussi à traduire une atmosphère, une émotion, une vision du monde. Ces œuvres ne sont pas seulement des représentations visuelles, mais bien des invitations à la réflexion, à la contemplation, à la découverte ou la redécouverte de l'œuvre de Jacques Roumain, sous un angle inédit et créatif.
Les titres évocateurs sont des imbrications d'un passé-présent pourtant non passéistes.
Cette exposition est une invitation à plonger dans cet univers de couleurs et de symboles, à laisser voguer l'imagination et vagabonder les sens. Ressentez, ressentez à travers ces images les échos de la poésie de Roumain.
Les artistes : Iris (Geneviève Lahens), Léonel Jules, Oski Awoyo (Olivier Vilaire), Peddy Multidor, NOU (Stéphane Martelly) et Valérie Gassien sont ceux et celles qui ont contribué à cette exposition et qui, par leur travail, ont permis de faire vivre cette rencontre entre la poésie, la peinture, la photographie. Il est souhaité que cette expérience les marquera, les interpellera, et suscitera le désir de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Jacques Roumain sous un jour nouveau.
L'exposition a été rehaussée et enrichie par des présentoirs grâce au prêt généreux de fonds d'archives du directeur général du CIDHICA, Monsieur Frantz Voltaire. Ainsi des livres et des photos inédites de Jacques Roumain ont pu être déployés.
Le vernissage fut un moment où toutes les personnes présentes ont pu célébrer ensemble l'art, la poésie, l'engagement et la beauté intemporelle de l'œuvre de Jacques Roumain ainsi que le talent indéniable des artistes peintres et photographe.
Cette exposition se poursuit à la Tohu jusqu'au 9 mars 2025. Je vous invite donc à prendre le temps d'aller vous immerger dans chaque œuvre et surtout de laisser libre cours à vos émotions face à ces créations.
Chantal Ismé
Membre du CA de la Maison d'Haïti
Les photos proviennent du site de la Tohu : Échos de l'Âme : hommage à Jacques Roumain - Tohu
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
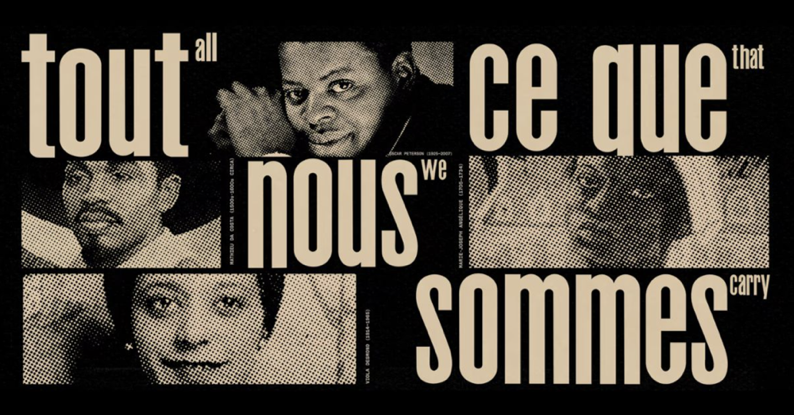
Mois de l’histoire des Noirs : luttes antiracistes et luttes ouvrières, même combat !
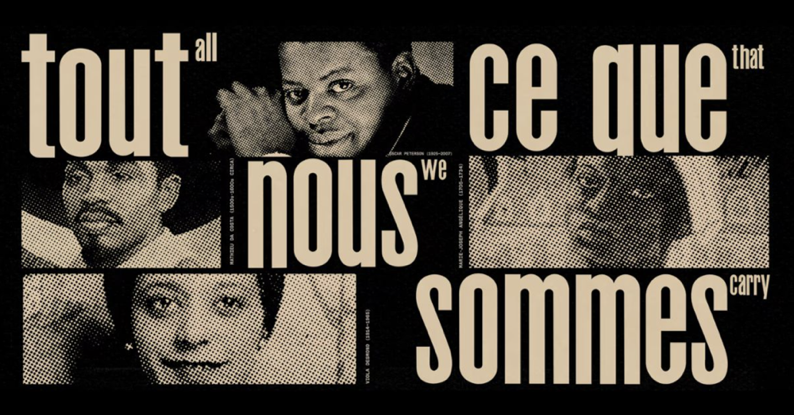
Deux facettes de l'histoire du Québec passent trop souvent sous silence : l'apport du mouvement ouvrier dans le développement de la société contemporaine et la place des personnes noires dans notre histoire collective1. Toutes les deux font pourtant partie intégrante de ce qui a mené au Québec d'aujourd'hui et elles sont intrinsèquement liées.
Tiré de Ma CSQ.
Les premiers syndicats noirs au Québec
Dès 1915, au cœur de notre histoire ouvrière, les porteurs de wagons-lits du Canadien Pacifique (CP), chargés de veiller au confort des passagers, fondent une mutuelle de protection. Celle-ci offre un soutien financier aux porteurs et à leur famille en cas de maladie ou de décès. Cette initiative est l'œuvre de Thomas Morgan O'Brien, un porteur noir montréalais. À une époque où 90 % des travailleurs noirs étaient employés par les chemins de fer, cette avancée représentait un changement majeur.
Malheureusement, à cette période, les statuts de plusieurs syndicats de métier limitaient l'adhésion aux hommes blancs. Heureusement, le mouvement syndical a considérablement évolué depuis. D'ailleurs, lors du conseil général de la CSQ de décembre 2024, les personnes déléguées de la CSQ ont voté en faveur de la création d'un comité de relations interculturelles.
Inspirations croisées : syndicalisme et luttes antiracistes
Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s'est inspiré du mouvement ouvrier et l'a inspiré et nourri en retour. Forcément, ils partagent les mêmes idéaux de justice, d'égalité et la conviction que chaque individu mérite dignité et respect.
Au Québec, la première vague d'immigration haïtienne, au début des années 1960, se compose principalement d'intellectuels et de membres de la classe moyenne haïtienne. Elle coïncide avec une période de forte effervescence dans les mouvements de gauche québécois. Trouvant des points communs dans les luttes de classe et l'anti-impérialisme, ces militantes et militants haïtiens participent certainement à façonner le syndicalisme que l'on connaît aujourd'hui et jettent les bases de la solidarité ouvrière internationale du mouvement ouvrier québécois.
Par la suite, la présence de nouveaux migrants haïtiens issus de la classe ouvrière dans des secteurs moins bien protégés, comme l'industrie du textile, le travail domestique ou encore l'industrie du taxi, place les projecteurs sur l'intersectionnalité entre le combat pour des conditions de travail justes et celui contre la discrimination et le racisme.
Cette intersectionnalité s'incarne parfaitement dans la grève des chauffeurs de taxi haïtiens de 1983, menée par l'Association haïtienne des travailleurs du taxi, qui protestent contre la ségrégation raciale dans l'industrie et les conditions de travail injustes des chauffeurs.
Cette lutte contribue à désinvisibiliser le racisme dans l'espace public et favorise une prise de conscience à long terme de l'importance de militer pour une société québécoise plus inclusive.
L'apport des organisations communautaires et des militantes noires
Il ne faut pas non plus passer sous silence la vigueur et la contribution des organismes de la communauté haïtienne, dirigés la plupart du temps par des femmes, au mouvement communautaire québécois : éducation populaire, organisation de défense des travailleuses domestiques, luttes féministes, etc. »
La contribution des militantes et militants noirs trouve encore écho dans le débat public aujourd'hui et sert de pilier à de nombreuses luttes qui demeurent d'actualité. Les valeurs de solidarité, d'égalité et de justice qui animent le mouvement syndical doivent continuer d'être mises de l'avant dans la lutte contre le racisme et les discriminations.
En ce Mois de l'histoire des Noirs, prenons le temps de reconnaître l'héritage de ces combats et de réfléchir à la façon dont les syndicats peuvent encore aujourd'hui être des acteurs du changement pour une société québécoise plus inclusive et équitable.
1- Soulignons que des 4 200 esclaves recensés en Nouvelle-France dans les années 1600, 1 400 étaient des personnes noires. Les Britanniques en ont fait venir plus de 3 000 après la conquête. Ces esclaves étaient exploités dans les hôtels et les tavernes, dans les organisations religieuses, chez des marchands et même au sein de l'armée. Ce n'est qu'en 1834 que le gouvernement britannique a aboli la pratique.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Casser les syndicats »

Il y a beaucoup de monde, ému et en colère, à l'Assemblée générale mensuelle du Conseil Central du Montréal Métropolitain CSN, en ce mercredi 29 janvier 2025. Cela fait huit ans, jour pour jour, qu'au cours de l'attaque terroriste à la Mosquée de Québec, six personnes ont été assassinées par un militant d'extrême droite.
6 février 2025
Donald Trump vient d'être réinvesti à la présidence des États-Unis. Il a déjà annoncé son plan d'annexion du Canada ; lancé, par décrets, sa chasse aux « millions et millions d'étrangers criminels » et coupé des milliards de dollars d'aides publiques destinées aux pauvres, aux femmes, aux minorités LBGTQI+, aux personnes handicapées, aux États-unis comme dans le reste du monde. Il s'est aussi ouvertement attaqué aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier aux fonctionnaires du gouvernement fédéral. Ses complices, des multimilliardaires comme lui et le grand patronat jubilent et s'accaparent davantage encore les ressources publiques.
Nombreux·ses sont celles et ceux qui se demandent si le Québec va résister face à cette vague réactionnaire, raciste et antisyndicale. Le Premier ministre du Québec continue de cibler les étranger·ères pour justifier son incompétence et l'effondrement des services publics. Et alors qu'Amazon vient de licencier 4 500 personnes pour faire comprendre à tous et toutes ce qu'il en coûte de tenter de se syndiquer, François Legault déclare « [u]n, le Canadien a encore gagné. Deux, je n'ai pas bu de jus d'orange ce matin ». Enfin, comme le rappelle la Présidente du CCMM-CSN dans son mot d'ouverture, les souverainistes du Parti Québécois appuient ouvertement la politique de Trump en matière d'immigration. Et dans ce contexte des plus décourageants, la gauche est complètement inaudible.
Pourtant, la grande salle du siège social de la deuxième centrale syndicale du Québec est pleine, à 18h. C'est la première fois depuis plus d'un an. 80, peut-être même 90 personnes, dont une dizaine debout appuyées sur les murs, sont présentes. Et l'ambiance est émouvante, chaleureuse et bien plus dynamique que lors des Assemblées de l'an passé. Cette fois-ci, à 21h30, la salle, encore remplie, scande « Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! ». Après plus de trois heures et de nombreuses interventions de travailleurs et travailleuses « crinqué·es », on vibre encore au son des « On lâchera pas ! On lâchera rien » ; « On es-tu pépés ! ouais ! ouais ! ». et on se sent porté par diverses manifestations de solidarité « on est avec vous », « lâchez pas ; il peut pas rouler la business sans vous ! » On a chaud au coeur, dans cette assemblée en colère, prête à faire front contre un patronat qui parait plus déterminé que jamais.
Car les travailleurs et les travailleuses en lutte en ont beaucoup d'« écoeurentries patronales » à partager aujourd'hui. Ce patronat québécois se montre tout aussi décomplexé et déterminé que celui de nos voisin·es à bloquer les salaires, augmenter le temps de travail, supprimer le paiement des heures supplémentaires, détruire les pensions de retraite, se retirer du financement des assurances collectives, dresser les travailleurs et travailleuses les unes contre les autres, celles et ceux qui ont la nationalité canadienne contre les migrant·es.
Difficile de nier l'attaque frontale du patronat contre « l'exception québécoise » et ses quelque 39% de syndiqué·es. Comme le souligne une vice-présidente du CCMM-CSN, comment ne pas voir une volonté de « casser les syndicats » et de briser, par là, l'un des derniers remparts contre la droite dure, sinon extrême, au Québec.
Lock out contre 600 travailleuses et travailleurs à l'Hôtel Reine Elisabeth de Montréal – 2 mois .
Une quinzaine de représentant·es des travailleuses et des travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth s'approchent les premier·es de la tribune. Comme à l'accoutumée, la salle se lève et les applaudit. Une porte-parole du syndicat, connue pour sa longue expérience militante, notamment au sein du CCMM, prend la parole, visiblement très émue.
« Je n'ai jamais cru que ce serait mon tour, que je serais ici, dans cette position.
J'ai participé à de nombreuses instances à la CSN, j'ai longtemps participé au CCMM et le moment le plus touchant pour moi c'était toujours quand j'entendais les grévistes et les lockouté·es ; je ne supportais pas... Mais je n'ai jamais cru que ce serait un jour mon tour. Aujourd'hui, ça fait 79 jours qu'on a été mis·es en lock out ».
Tandis que de nombreux hôtels ont signé des conventions collectives depuis le début des négociations coordonnées que mène la CSN dans le secteur de l'hôtellerie, la direction du Reine Elisabeth ne veut rien lâcher pour améliorer les conditions de travail des préposées aux chambres. Au contraire, elle veut faire un exemple contre un syndicat qui a conquis, en 40 ans de luttes et à coup de nombreuses grèves, l'une des conventions collectives les plus « enviables… peut-être la meilleure en Amérique du Nord », explique un intervenant au micro. C'est ce que « l'employeur ne supporte pas » : « il a congédié la secrétaire du syndicat », et « il mène une guerre personnelle en multipliant les suspensions ».
Et cet employeur, c'est la compagnie immobilière Ivanhoé Cambridge qui appartient à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), soit le « mandataire de l'État » qui gère les cotisations de retraites des Québécois·es . En fait, « de vrais voyous », selon un conseiller syndical : « [s]i vous saviez le nombre de briseurs de grève qu'ils mobilisent, ils se foutent des lois ces gens-là, même si c'est public ».
Désormais, le « modèle d'affaire » c'est le recours à des agences de placement. Mais « les agences de placement c'est un cancer, ça crève les gens » ajoute un autre travailleur de l'hôtellerie au micro. « Les agences ce sont des briseurs de grève ; ils travaillent dans l'hôtel en ce moment » rapporte un autre. « Les agences, nous on n'en veut pas et c'est pour ça qu'on est dehors, c'est pour ça qu'on est sur les lignes de piquetage » explique une gréviste.
Et la porte-parole du Reine Elisabeth de conclure :
« Je veux souligner quelque chose qui m'a touchée… le point qui me touche le plus c'est l'immigration. Je suis née dans un petit pays, (…), je suis arrivée au Québec dans les années 1980 d'un petit pays. Et dès les premiers pas, malgré l'hiver que je déteste, j'ai aimé ce pays. Mais aujourd'hui, le phénomène populiste me fait peur ; ma crainte c'est que j'entends au sein même de mon syndicat des discours qui sont très semblables à ceux de Trump … et je voulais le souligner aujourd'hui ».
Une résolution est alors adoptée à l'unanimité, appelant à la solidarité et aux dons.
Lock out des 50 salariés de Demix/Béton provincial - 2 mois
Deux représentants de l'entreprise Demix s'approchent à leur tour de la tribune. Ils sont en lock out depuis le 5 décembre 2024. De nouveau, la salle se lève et scande « Solidarité ! »
L'un des deux représentants, encore ému par les interventions précédentes, nous dit :
« Je suis intimidé par les grosses foules… Face au patron, c'est pas pareil ».
Son nouveau patron, c'est un « oligarque de Matane, André Bélanger », propriétaire de Béton Provincial, la plus importante entreprise canadienne dans l'industrie du béton. (2600 employés, 115 usines, une centaine de carrières et de gravières et une cimenterie…). Demix est l'une de ses usines, basée à Longueuil. Le syndicat représente une cinquantaine d'employés, principalement des chauffeurs de bétonneuse, tous des hommes. En avril 2024, Béton Provincial a acquis l'entreprise. En septembre de la même année, la convention collective est arrivée à échéance.
Après avoir fait trainer les négociations, le nouvel employeur a finalement « offert » aux travailleurs : 1) d'abolir sa contribution au REER collectif, soit une diminution de 5.5% du salaire ; 2) de réduire sa contribution aux assurances collectives (de 100% à 50%) ; 3) une convention de sept ans et des augmentations salariales de 0% les deux premières années et de 2% les suivantes ; 4) une prime de 0.5$ de l'heure ; et, pour finir et couronner le tout, 5) de « couper le temps supplémentaire et de supprimer le temps double le dimanche. Et ils veulent ramener le temps de travail sur 6 jours alors que c'était de cinq jours jusqu'à présent. C'est un recul de plus de 20 ans en arrière ».
Fin novembre, le syndicat s'est doté d'un mandat de grève :
« on s'était voté 10 jours de grève à prendre de manière aléatoire. Finalement, on n'a pas pris une seule journée (…) Le 5 décembre, je suis rentré chez nous à 7h du soir, j'étais avec ma femme. Pan. Courriel : lock out ».
Ainsi, juste avant les fêtes, « l'employeur nous prive de l'Assurance-chômage… on se retrouve sans rien ; il y a des gars avec leurs familles, y pouvaient plus suivre, ils ont trouvé une autre job… mais nous on lâche pas, on tient la ligne ». Le représentant poursuit et raconte :
« quelques jours après le déclenchement du lock out, juste avant Noël, on a tous reçu une lettre d'André Bélanger, qui disait qu'il offrait une dinde pour Noël à tous les employés. Mais on n'en voulait pas d'sa criss de dinde ! ».
Un conseiller syndical intervient : la Convention chez Demix est l'une des meilleures dans le secteur du béton. Selon lui :
« c'est pour ça que l'employeur veut faire un exemple il veut les casser, c'est ça le plan de match. Mais y va pas les casser…. Le patron, il a oublié que ce sont des gars qui se lèvent à tous les jours à 4 h du matin pour livrer le béton. Il a pas compris qu'il avait tous ces gars-là… ce sont des tough, que sur les lignes de piquetage ça y va et qu'y aura pas de recul. Quand les gars vont retourner dans le camion, la tête haute, c'est le boss qui va dire “pardon monsieur” ».
Une résolution est adoptée à l'unanimité, appelant à la solidarité et aux dons.
Mobilisation dans les Centres de la petites enfance – 13 000 employées
Une représentante syndicale, seule, s'approche de la tribune. Elle est membre du CPE de Montréal-Laval. On entend le « so-so-so » de la salle.
Elle nous explique que les travailleuses des CPE sont sans convention collective depuis plus d'un an et demi, soit depuis le 1er avril 2023. Le gouvernement fait délibérément trainer les négociations. Les 13 000 travailleuses affiliées à la CSN, 80% des employées dans le secteur, revendiquent principalement un allègement de la charge de travail, une augmentation salariale et des primes pour les régions éloignées.
Pour le moment, les travailleuses ont adopté 5 jours de grève à prendre au moment jugé opportun. Une seule journée de grève a été prise, à ce jour, le 23 janvier 2025.
« Il y a eu une forte couverture médiatique… mais le patron n'a pas modifié son angle d'attaque… Il est sur l'offre initiale ». En revanche, le gouvernement Legault a offert des « avancées à la CSQ », l'autre centrale syndicale présente dans le secteur, « comme quoi… il veut casser la CSN ».
Il n'a rien changé non plus dans son attitude, paternaliste, arrogante et méprisante :
« Au niveau du ton, à la table de négociation, ils commencent par dire « « au moins on ne vous propose pas de recul ; on pourrait vous donner rien », c'est cette ambiance-là à la table de négo ».
Une deuxième journée de grève a été prise le 6 février . À suivre donc…
Une résolution de solidarité et d'appel aux dons est votée à l'unanimité : « solidarité ! solidarité ! solidarité ! ».
Amazon. 4 500 emplois supprimés à la suite d'une campagne de syndicalisation.
Finalement, cinq travailleurs d'Amazon montent à la tribune. Là encore la salle se lève et plus fort encore que les fois précédentes : « Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! ».
L'un des représentants prend la parole, il a l'air jeune, très ému, sa voix tremble :
« Merci tout le monde. Merci pour la solidarité. Beaucoup d'émotions… Mercredi, je me suis réveillé comme 3 500 personnes, en apprenant qu'Amazon nous crissait dehors et attaquait le mouvement syndical québécois au grand complet. C'est pas vrai que c'est 1 700 personnes. Avec les osties de sous-traitants, c'est 3 500 personnes à la rue ».
Il s'arrête. La salle l'applaudit. Il reprend :
« S'cusez.… Amazon ferme parce que 250 employé·es ont décidé de se tenir debout, de simplement s'organiser dans un entrepôt où il y avait un accident par jour, qui sont pas déclarés. Anyway ! On voulait plus se faire traiter comme des machines, on voulait le respect… juste ça c'était inacceptable pour cette multinationale-là… »
La salle applaudit :
« Malgré les larmes que j'essaie de retenir, l'heure n'est pas aux larmes, l'heure est au combat. À la chope je me fais demander tous les jours : C'est quand la manif, c'est quand la grève ? On va pas se laisser faire… on va se mobiliser ».
Et enfin, il appelle au boycott mais surtout à l'unité des luttes et des syndicats :
« Je salue le boycott… En fait, je vous encourage à appuyer toutes les mobilisations pour résister à la tyrannie… c'est pas vrai qu'au Québec on va casser le mouvement syndical. Arrêtez d'acheter à ces criss de tabarnac-là. Ultimement, si on veut gagner contre ces criss de tabarnac-là, contre ces osties d'Américains-là… s'cusez, mais c'est ensemble, tous les syndicats ensemble…. Alors oui, prenez vos actions individuelles mais c'est le mouvement ensemble qui a la balance du pouvoir… Icit, on boycott et j'espère vous voir bientôt dans la rue avec nous ».
Les interventions qui suivent saluent le courage des travailleurs et des travailleuses, soulignent le caractère historique de cette lutte en Amérique du Nord. « Avec 3 500 personnes mises à pied pour empêcher la syndicalisation… on n'est pas capables de trouver de précédent dans l'histoire du Québec », lance un conseiller syndical. Dans tous les cas, cette lutte va marquer le mouvement ouvrier, « peut-être même qu'elle sera dans la même page d'histoire que l'emprisonnement des dirigeants syndicaux » en 1972. Effectivement, « Installer le premier syndicat dans Amazon et négocier une Convention, ça demandait un courage exceptionnel ! ». Alors, « On va leur crisser une volée et on va les sortir du Québec. Solidarité ».
D'autres intervenant·es appellent à soutenir le boycott, à lancer des procédures judiciaires contre Amazon et à augmenter les dons d'appui au Centre des travailleurs et travailleuses migrantes (CTTI), comme au Mouvement action chômage (MAC) qui sont en première ligne pour répondre aux besoins des licencié·es.
Enfin, une conseillère syndicale raconte, au sujet de la première assemblée syndicale chez Amazon.
« À l'assemblée, les gens avaient peur. Ils avaient très peur. Il y avait des femmes… Il y avait plein d'immigrantes. Je suis allée voir l'une d'elles… et la première chose qu'elle m'a dite : « Mais le boss, il va nous mettre dehors ! ». Et moi je lui ai répondu « mais non ! On a des lois au Québec… ».
Une résolution est adoptée qui appelle au boycott de la multinationale et qui accorde un don de 7 500 dollars au CTTI et au MAC .
Une manifestation contre Amazon est prévue à Montréal le samedi 15 février.
Francis Dupuis-Déri, membre du SPUQ
Elsa Galerand, membre du SPUQ
Martin Gallié, membre du SPUQ
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Le texte a été rédigé à partir des notes prises par MG lors du CCMM-CSN

Amazon abandonne le Québec, voulant frapper fort et créer une onde de choc parmi les travailleurs du monde entier

Le géant du monde des affaires craignait une « percée » après que des travailleurs québécois se soient syndiqués, mettant à leur portée la première convention collective au monde.
Tiré de The Breach
traduction Johan Wallengren
Jeudi 23 janvier 2025 / DE : Mostafa Henaway
Amazon a un message pour son armée de travailleurs précaires dans le monde entier : osez vous syndiquer et vous serez punis.
Après avoir échoué à faire dérailler une campagne de syndicalisation historique au Québec, Amazon met maintenant un terme à toutes ses activités dans cette province, privant près de 2000 travailleurs de leur emploi.
Cette contre-offensive est une tentative éhontée de punir les travailleurs de la province qui ont failli accomplir ce que beaucoup de gens considéraient impossible. En mai 2024, environ 300 travailleurs de l'entrepôt de Laval ont réussi à se syndiquer - une première historique au Canada -, et ce malgré deux années de tactiques antisyndicales, d'intimidation et de surveillance. Qui plus est, ils étaient sur le point de devenir les premiers travailleurs d'Amazon au monde à obtenir une convention collective.
Pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il ne s'agit pas seulement d'écraser les travailleurs de Laval et leur syndicat, mais de s'attaquer directement à l'ensemble de la classe ouvrière mondiale. Ce précédent s'inscrit dans une offensive de plus en plus vaste des entreprises et de la classe capitaliste, qui s'efforcent de remettre les travailleurs à leur place en recourant à des mesures d'austérité et en lançant des attaques contre les mouvements de revendication ouvrière.
Ici, au Québec, le déménagement d'Amazon laisse 1700 travailleurs - dont beaucoup d'immigrants, d'étudiants internationaux et de personnes avec des familles - sans emploi dans un contexte de hausse du chômage et d'aggravation de la crise du coût de la vie.
Pendant ce temps, l'oligarque de la technologie Bezos continue d'amasser une richesse inimaginable, sa fortune dépassant aujourd'hui les 200 milliards de dollars.
Amazon redoutait une « percée » pour les travailleurs du Québec
La présence d'Amazon au Québec a été brève, mais marquée de bout en bout par un mouvement de résistance des travailleurs.
L'entreprise a ouvert son premier centre d'exécution des commandes à Lachine en 2020 et a rapidement essaimé en ouvrant sept installations dans différentes régions du Québec. À l'hiver 2022, les travailleurs de l'entrepôt de Lachine ont lancé la première campagne prolongée pour améliorer les conditions de travail. Amazon a réagi en recourant à des tactiques antisyndicales, notamment en faisant pression sur les travailleurs pour qu'ils ne signent pas de cartes syndicales. Ces manœuvres ont par la suite été déclarées illégales dans un jugement du tribunal du travail du Québec.
La campagne menée par le groupe de travailleurs n'a pas abouti à l'accréditation syndicale, mais en mai 2024, il y a eu une percée dans l'installation de Laval - le premier entrepôt d'Amazon à avoir réussi à se syndiquer au Québec et au Canada.
Cette victoire a été obtenue de haute lutte. En tant qu'organisateur syndical ayant travaillé un certain temps comme travailleur infiltré dans cet entrepôt, j'ai vu de mes propres yeux l'exploitation, la surveillance et l'incessante intimidation antisyndicale d'Amazon à l'œuvre.
Le cas de Laval se différencie des autres campagnes de syndicalisation menées en différents endroits du monde par une disposition du code du travail québécois qui n'a pas son équivalent ailleurs : à partir du moment où un syndicat existe, l'employeur est légalement tenu de conclure une première convention collective avec celui-ci. Si les négociations entre les parties achoppent, le différend est soumis à l'arbitrage.
Les travailleurs de Laval étaient donc dotés d'un outil puissant non disponible dans d'autres territoires.
Aux États-Unis, par exemple, les travailleurs d'Amazon à Staten Island - dont la victoire syndicale historique a inspiré les travailleurs du monde entier - restent sans contrat, et cela fait plus de deux ans que cela dure. Amazon n'a même pas daigné se présenter à la table des négociations.
Une première convention collective à Laval aurait représenté une avancée majeure pour les travailleurs d'Amazon du monde entier et une potentielle source d'inspiration pour plus de 1,5 million d'employés. Cela aurait créé un précédent que l'entreprise cherchait désespérément à éviter.
Amazon a déclaré que sa décision de quitter le Québec était motivée par les coûts et la rentabilité, et non par l'activité syndicale. Or, cette société a depuis longtemps fait passer sa position dominante sur le marché avant ses bénéfices. Et elle a toujours été encline à exercer ce pouvoir monopolistique pour écraser les droits des travailleurs, même si cela impliquait de sacrifier des gains financiers à court terme.
Les véritables motifs de la récente manifestation d'intentions du géant sont clairs : il s'agit d'une campagne agressive conçue pour « frapper fort et créer une onde choc » en vue non seulement de mettre au pas les travailleurs d'ici, mais également d'envoyer un message intimidant aux travailleurs de l'ensemble de ses installations dans le monde.
Les mesures prises par Amazon au Québec, annoncées deux jours seulement après que Jeff Bezos et d'autres oligarques du secteur technologique se sont tenus aux côtés de Donald Trump lors de son investiture, sont emblématiques d'une tendance dangereuse.
Alors que des pans de plus en plus importants de notre économie sont contrôlés par de riches entreprises et les oligarques qui les dirigent, c'est l'avenir de notre démocratie qui se joue dans la lutte pour les droits des travailleurs.
Notre solidarité et notre capacité de réaction pèsent lourd dans la balance actuellement. Ce n'est pas le combat de quelques-uns, mais une lutte pour chacun de nous.
INFOLETTRE
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ce dont nous avons tant besoin aujourd’hui !

Un fier-à-bras fascisant est arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier 2025. Et depuis c'est la stupeur ou la sidération à chaque nouveau décret présidentiel que Donald Trump met en scène.
Certes, cela ne fait pas encore des USA un pays fasciste, et le Canada ou le Québec semblent encore loin de lui emboîter le pas. Mais quand l'exécutif du plus puissant pays de la planète prend une telle orientation, et quand partout au monde résonnent en écho de mêmes antiennes autoritaires d'extrême-droite, il y a lieu de se réveiller et de réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour inverser le cours des choses, a fortiori lorsqu'on partage quelques 8 891 km de frontières communes.
Bien sûr, au Québec et au Canada, nos élus —après moult courbettes et hésitations— ont fini par réagir. On haussera nos droits de douanes à la même hauteur ou presque, que ceux que les USA voudraient nous imposer, on diversifiera nos échanges commerciaux, notamment vers l'Europe, et on dénoncera haut et fort cette volonté de faire de nous un 51 ième État des USA.
Mais il ne s'agit là que des réactions de circonstances —au demeurant passablement prudentes— de dirigeants économiques, sociaux et politiques actuels dont on ne connaît que trop le parcours. Ce sont eux qui, ces dernières années, se sont avérés bien peu efficaces, pour répondre aux aspirations de changement et de justice sociale sourdrant des classes populaires, tout comme pour stopper la montée de l'extrême droite dont pourtant le danger se faisait sentir depuis longtemps.
D'ailleurs qu'ont-ils fait pour empêcher le drame de Gaza et de ses dizaines de milliers de victimes civiles assassinées, dont on veut aujourd'hui effacer toute trace en projetant d'y construire –comble de la barbarie— une « Côte d'Azur » made in US ?
On ne peut donc guère se reposer sur eux. D'autant plus qu'on sait très bien que la montée d'une extrême droite populiste et fascisante,— c'est ce que nous apprend l'histoire— est d'abord l'indice d'une attaque à venir contre les volontés démocratiques et aspirations égalitaires portées par les classes populaires et de larges secteurs de la population afin qu'existent un peu plus d'égalité sociale, de liberté collective et de fraternité humaine, et pourrions-nous rajouter, de respect pour la nature, « la mère-terre ».
En ce sens, l'exceptionnelle conjoncture que nous connaissons devrait pousser les mouvements sociaux d'origine populaire et les forces politiques progressistes ou de gauche du Québec à voir loin et grand. Elle devrait nous stimuler à trouver les moyens nécessaires pour faire face aux périls grandissants qui se dressent devant nous, en nous poussant à nous mobiliser sur la base de nos propres forces et moyens, tout en nous efforçant de nous rassembler et de travailler à l'unité sociale et politique la plus large qui soit !
Contrairement à ce que pensent certains (Le Devoir, Face à l'oligarchie, la démocratie des Multitudes, de Jonathan Folco et autres), pour "sortir de l'impuissance" et "retrouver cette autonomie" qui nous manque tant, pour créer "une force, un mouvement politique rassembleur", il ne suffit pas d'en appeler aux luttes sociales et initiatives locales des « dites » « multitudes ». En somme, il ne suffit pas d'en appeler à ce qui se fait déjà en imaginant au passage qu'émergera spontanément "une nouvelle façon de s'organiser, autonome, agile, non électorale".
Il faut oser beaucoup plus, et surtout travailler d'arrache-pied et sans exclusive aucune, au rassemblement des forces sociales et politiques progressistes qui, parce qu'aujourd'hui divisées et empêtrées dans des logiques identitaires fragmentées ou des choix politiques à courte vue, ne trouvent pas les moyens de rebondir, de prendre un nouvel élan pour qu'ensemble on puisse faire face aux défis majeurs qui se dressent devant nous. Elles ne parviennent donc pas à apparaître, autant sur la scène sociale qu'électorale, comme étant cette force collective qui au moins pourrait faire la différence et serait susceptible d'offrir de véritables alternatives, en termes certes de logements, d'alimentation, de moyens de transport, de culture, de transition vers un modèle de vie collective plus viable, mais aussi de relations nouvelles et solidaires avec toutes les forces sociales et politiques qui aux USA et ailleurs sont en train de se liguer contre le nouveau maître de la Maison Blanche.
Un peu comme la CSN l'a fait à propos d'Amazon, ce dont nous avons tant besoin, c'est donc de nous rassembler, de nous compter, de nous parler, de nous donner les moyens de comprendre ce qui se passe avec la montée de la droite extrême, de nous trouver de nouveaux alliés, d'oser le faire sans exclusive aucune, en somme de nous redécouvrir comme une force sociale et politique qui pourrait vraiment compter si elle osait s'en donner les moyens.
Et quoi de mieux que des états généraux du mouvement populaire et progressiste québécois pour y parvenir !
Qui serait prêt à en prendre l'initiative, à se coaliser avec d'autres groupes et individus pour en organiser la mise en place ?
Pierre Mouterde
Sociologue, essayiste
Québec, le 9 février 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Québec : Objectif et stratégie pour le combat contre le trumpisme

L'éditorial, pourrait-on dire, de la lettre du samedi 8 février « Sous la loupe » de l'IRIS propose une réponse de gauche à ce qu'elle appelle la « guerre commerciale » des ÉU qui a mis le Canada au pied du mur. Rappelant que « les mouvements sociaux progressistes » avaient à l'époque critiqué les accords de libre-échange, l'IRIS souligne que les réponses droitières que sont tant l'augmentation des dépenses militaires et l'abandon de l'imposition des gains en capital promis par le banquier favori au poste de chef des Libéraux fédéraux que s'attaquer au « manque de “productivité, [à] la surréglementation, [à] la bureaucratie et [à] la taxation” » du Premier ministre québécois, loin d'être un remède, n'ont comme conséquences que de lisser le règne du marché tout en se soumettant davantage aux ÉU.
Semblant aller plus loin en termes d'intervention de l'État, le Premier ministre du Québec surfe sur les « nouveaux projets d'infrastructures énergétiques » du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec et se dit prêt, avec les autres Premiers ministres provinciaux, à faciliter la déréglementation du commerce interprovincial pendant que son ministre de l'Environnement réouvre la porte aux gazoducs exportateurs. Le plan caquiste réconcilie l'extractivisme moderne à la québécoise avec celui à l'ancienne canadien… et avec le « fossilisme » trumpiste. L'IRIS propose plutôt de « diversifier l'économie canadienne (et non simplement de diversifier ses partenaires), mais aussi de réduire à la source sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures (et non simplement de produire davantage d'énergie pour le marché intérieur) » tout en renforçant les programmes sociaux.
L'ébauche du plan de l'IRIS ouvre certes des portes à gauche mais reste nébuleux. Est-ce parce que son diagnostic du problème est étroit ? Autant un Biden sortant et piteux a-t-il justement et solennellement dénoncé l'oligarchisation des ÉU, autant un Trudeau en fin de course a-t-il, à l'anglaise mais néanmoins pertinemment, mit en garde contre l'absorption du Canada par les ÉU. Le 51e état, en tout ou en partie, est appelé à devenir non seulement une réserve de ressources naturelles à portée de mains mais aussi à être le bastion militarisé pour contrôler l'Arctique. L'enjeu de la crise, du point de vue québécois et canadien, c'est non pas la seule oligarchisation des ÉU mais sa fascisation, non pas la seule « guerre commerciale » mais l'avalement du Québec et du Canada dans un État fascisant ou carrément fasciste. La gauche anticapitaliste doit se doter pour contrer ce danger mortel d'un objectif répondant tant à cette menace imminente qu'au fondamental enjeu écologique du XXIe siècle. Ajoutons-y une stratégie en mesure de mobiliser l'ensemble du peuple-travailleur au-delà de toutes ses contradictions internes exacerbées par tous les identitarismes.
L'électricité existante suffit amplement pour la solidaire décroissance matérielle
Une attaque de cette ampleur, se conjuguant avec la plongée vers la terre-étuve, exige d'engager sans tarder la lutte pour un projet de société alternatif qui soit, d'un, une autonomisation du Québec-Canada pour échapper aux griffes de l'ogre, de deux, l'édification d'une société de solidaire décroissance matérielle dont le but est le soin et le lien écoféministes et non le profit productiviste et masculiniste. Le moyen d'y arriver ne réside pas dans l'ajout gargantuesque d'électricité hydraulique et éolienne, que ce soit par Hydro-Québec ou le secteur privé — priorité de combat des vieux socialistes du XXe siècle — mais le recyclage de l'existante hydroélectricité québécoise (et des « négawatts » récupérés du secteur résidentiel) vers l'électrification mur-à-mur de l'économie québécoise en débutant par le transport en commun se substituant à l'auto solo qu'elle soit liée à l'extractivisme des hydrocarbures d'Exon-Mobil ou à celui électro-électronique d'Elon Musk. La meilleure façon de vaincre ces matamores devenant imperméables aux lois et détruisant l'État-providence est de les rendre redondants. Comment ? En socialisant le capital financier et le secteur énergétique tout en généralisant transport en commun, logements sociaux écoénergétiques, agriculture biologique, quartiers et villages 15 minutes et la durabilité et la circularité des produits indispensables mais détachés de toute publicité.
Pendant que toutes les droites, extrêmes ou pas, tapent sur les clous des nombreuses différences identitaires et sociales du peuple-travailleur pour le diviser, la catastrophe éminente va son bonhomme de chemin, envenimée par son contingent de guerres. Sans nier l'absolue nécessité des luttes contre tous les sexismes, racismes et autres statuts privilégiés, dont l'amenuisement est tout à fait nécessaire pour l'unification dans un combat commun, la meilleure tactique pour les combattre reste la lutte commune contre la catastrophe éminente et ses séquelles guerrières surtout quand elles sont génocidaires. Dans le Québec concret d'aujourd'hui ça veut dire la lutte contre le plan tout-électrique de la CAQ et en faveur d'une société de soins et de liens qui passe par la bonification des services publics austérisés et le surgissement du transport public gratuit et d'une pléthore de logements sociaux écoénergétiques, la lutte contre le génocide palestinien mais aussi celui, au ralenti, de l'Ukraine.
La lutte indépendantiste, la plus efficace si elle est internationaliste
Faut-il ajouter que le caractère planétaire de la catastrophe éminente commande une rigueur internationaliste à toute épreuve. Est-ce à dire qu'il faille laisse tomber la lutte pour l'indépendance comme le suggère la montée de l'actuel sentiment populaire pro-Canada contre l'impérialisme étatsunien ? Lâcher la proie pour l'ombre en pensant que le Quebec bashing ait disparu serait une monumentale erreur stratégique. N'en reste pas moins qu'il faille prendre note d'un début de déplacement des plaques tectoniques dans l'État canadien. Plus que jamais la lutte indépendantiste doit se présenter comme la stratégie la plus efficace vers une société canadienne, et même nord-américaine, de solidaire décroissance matérielle par la vertu de la libération nationale du peuple québécois comme « quelque chose comme un grand peuple » en mesure d'entraîner les autres. On verra plus tard pour la suite des choses. Chose certaine, cette indépendantisme n'a rien à voir avec le renforcement, au-delà même de la CAQ, de la xénophobie antiimmigrant du PQ qui le pousse dans les bras de Trump. Au contraire, l'internationalisme commande d'ouvrir les bras à tou-te-s ces damné-e-s de la terre qui fuient les catastrophes déjà en cours et dont les services essentiels québécois ont besoin en toute égalité de traitement, crise démographique oblige.
Québec solidaire saura-t-il se démarquer avec un indépendantisme écosocialiste lui qui vient de se mettre à la refondation de son programme qui a certes vieilli quoique contenant des perles anticapitalistes oubliées mais à conserver. Par où commencer dans l'immédiat ? Amazon de Jeff Bezos n'est pas autre chose que la cristallisation oligarchique du trumpisme fascisant. Sa fermeture sauvage, antisyndicale (et illégale) de ses sept entrepôts québécois offre au peupletravailleur québécois et canadien et nord-américain une poignée bien visible pour accrocher la concrète lutte de classe à la lutte anti-Trump. La CSN, qui syndique l'entrepôt Amazon de Laval, le seul syndiqué au Canada, invite tout le peupletravailleur à une manifestation ce 15 février. Puisse cette manifestation être autre chose que le baroud d'honneur habituel de la bureaucratie syndicale mais le début d'une mobilisation qui embrasera tout l'Amérique au nord du Rio Bravo/Grande.
Marc Bonhomme, 9 février 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La déportation totale n’est pas une solution

La dernière élucubration du président Trump est de vider Gaza de sa population pour ensuite se garantir des contrats juteux de nettoyage des ruines, que les bombes étasuniennes fournies allègrement à Israël ont causées, et ultérieurement s'arroger des contrats tout aussi lucratifs de construction d'une Riviera à l'image de son Mar-a-Lago. L'entrepreneur immobilier n'est jamais très loin…
Il y aurait lieu de se moquer d'une telle proposition simpliste si celui qui l'émettait n'était pas le président des USA et que le contexte n'était pas celui d'une visite du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.
En préconisant une telle solution, ces deux escrocs font fi de la Charte de l'ONU, de même que du droit de la guerre et du droit international humanitaire. Tant pour Netanyahou que pour Trump, c'est devenu une fâcheuse habitude.
Depuis octobre 2023, Gaza est soumise à une opération militaire de destruction massive que plusieurs organisations de défense des droits humains de même que diverses instances de l'ONU qualifient de génocide. Benyamin Netanyahou fait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Le Canada a d'autres sujets de préoccupation face à l'administration Trump avec la menace de tarifs douaniers usuraires, suspendus mais non révoqués, et les menaces plus ou moins sérieuses d'annexion pure et simple du Canada aux USA. Il pourrait cependant utiliser cette occasion pour se démarquer nettement des propos de l'administration Trump et lui faire sentir que le gouvernement du Canada soutient une tout autre approche de la politique au Moyen-Orient que son voisin du sud, ce qui d'ailleurs le rendrait moins intéressant à annexer.
Il est plus que temps que le Canada reconnaisse l'État de Palestine comme l'ont d'ailleurs fait 147 pays membres de l'ONU (sur 193), dont plusieurs pays européens ; le moment est plus que propice, pour employer les termes de la diplomatie canadienne, puisque la Palestine ne peut être laissée de côté dans un processus encore embryonnaire de paix dans la région, à moins de vouloir conclure une telle paix à ses dépens et dans l'injustice la plus absolue.
Benyamin Netanyahou était à Washington pour confirmer le soutien étatsunien à sa politique de nettoyage ethnique de la Palestine. Une politique au long cours puisqu'elle a commencé à être mise en œuvre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est concrétisée avec la Nakba (déportation massive de la population palestinienne et effacement de toute trace d'occupation palestinienne du territoire conquis par Israël en sus de ce que lui avait octroyé le plan de partition des Nations-Unies) et s'est poursuivie avec l'occupation et la colonisation de l'ensemble du territoire palestinien en 1967. Le génocide et le sociocide qui ont cours actuellement à Gaza n'en sont malheureusement pas le dernier épisode puisque la Cisjordanie est actuellement le lieu d'une épuration ethnique qui prend la forme de razzias de colons, soutenus par l'armée israélienne, contre la paysannerie palestinienne et de raids comme celui, récent, dans le camp de réfugié.es près de Jénine.
Netanyahou a obtenu un appui de Trump qui dépasse ses espérances. Car ne nous leurrons pas, le nettoyage ethnique de la Palestine, l'expulsion des Palestinien.nes et l'éradication de toute trace de leur présence sur la terre de Palestine, fait partie du projet sioniste depuis fort longtemps. En donnant à Netanyahou le feu vert pour y procéder à Gaza, Trump l'autorise implicitement à poursuivre le travail en Cisjordanie. Deux intimidateurs qui s'épaulent l'un l'autre !
Si le nettoyage ethnique a été dénoncé par la communauté internationale, dont le Canada, en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, il devrait en être de même en Palestine. Notre gouvernement ne peut plus se contenter de demi-mesures et de tergiversations. Il en va de l'humanité des Palestinien.nes et de la nôtre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La coalition de Trump va se désintégrer

Le trumpisme est une réponse néofasciste d'extrême droite à la crise sociale et économique de la classe ouvrière et à la crise de légitimité de l'État que cette crise socio-économique a produite. La classe ouvrière américaine a connu une déstabilisation continue de ses conditions de vie au cours de ce dernier demi-siècle de mondialisation capitaliste et de néolibéralisme, avec une détérioration particulièrement forte depuis l'effondrement financier de 2008 et dans le sillage de la pandémie de covid-19. Elle est confrontée à une précarité croissante, à l'instabilité de l'emploi, à un chômage et à un sous-emploi généralisés et croissants, à des salaires misérables, à la marginalisation et à l'effondrement social, à l'insécurité alimentaire et à la crise des soins de santé, à des logements insalubres et à l'itinérance.
6 février 2025 | tiré de La Jornada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/06/opinion/la-coalicion-de-trump-se-desintegrara-5948
En 2023, plus de 100 000 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes pour la troisième année consécutive et les chiffres ont augmenté, reflétant une crise de santé mentale explosive qui reflète à son tour la crise sociale et économique. Depuis 2021, l'insécurité alimentaire a augmenté de 40 % et, au cours de cette période, la pauvreté a augmenté de 67 %. Plus de la moitié des ménages de la classe ouvrière vivent dans la pauvreté ou juste au-dessus du seuil de pauvreté, bien que les données officielles dissimulent l'ampleur de la pauvreté en fixant un niveau ridiculement bas. Selon le gouvernement fédéral, 38 % des ménages n'ont pas assez d'argent pour couvrir une dépense d'urgence de 400 $, contre 32 % en 2021. Plus de la moitié des ménages américains ne reçoivent pas de revenu stable et comptent sur les opportunités d'emploi occasionnelles qui se présentent, tandis que 80 % déclarent vivre d'un chèque de paie à l'autre.
Le Parti démocrate a abandonné la classe ouvrière multiethnique il y a de nombreuses années. Depuis l'ère Clinton, c'est un parti du néolibéralisme, des milliardaires de Wall Street, du complexe militaro-industriel et de la guerre. Trump a prononcé un discours populiste qui a parlé de l'insécurité socio-économique croissante et de l'anxiété sociale généralisée. Il a réussi à se projeter comme un outsider politique prêt à se battre contre l'élite de Washington pour défendre l'homme ordinaire. Il a manipulé le mécontentement des masses avec ce discours populiste, raciste, nationaliste et néofasciste avec de fausses promesses de résoudre les problèmes socio-économiques des masses. Il a fait des immigrants des boucs émissaires et a suscité un mécontentement de masse envers les démocrates et l'establishment.
Le trumpisme 2.0 ne représente pas une rupture avec ce qui s'est passé au cours du dernier demi-siècle, mais son point final logique, l'élimination de tous les obstacles restants à l'accumulation effrénée du capital et le point culminant de la contre-révolution néolibérale. L'équipe de Trump a promis d'éliminer toute réglementation restante sur le capital, de réduire massivement les dépenses sociales, y compris la sécurité sociale (retraites), de réduire les impôts sur le capital et les riches, d'étendre l'appareil d'État de répression et de surveillance, et de renverser les quelques mécanismes restants de responsabilité démocratique.
Ce gouvernement propose d'y parvenir en restructurant le pouvoir de l'État pour le placer sous le contrôle le plus direct du capital, c'est-à-dire en consolidant la dictature du capital transnational par de nouvelles dispensations politiques, y compris une vaste expansion des pouvoirs de la présidence. Cependant, il y a un énorme fossé entre l'intention de Trump et sa capacité réelle à atteindre ses objectifs. La crise politique de légitimité de l'État et la crise sociale de la classe ouvrière doivent être vues, au-delà des États-Unis, dans le contexte de la crise générale du capitalisme mondial et en particulier dans sa dimension structurelle, la suraccumulation. La stagnation chronique exerce une pression croissante sur les agents politiques et militaires du capital transnational pour qu'ils ouvrent des espaces d'accumulation. La classe capitaliste transnationale (TCC) et ses agents doivent entreprendre des recherches de plus en plus désespérées pour se décharger du capital suraccumulé. Cela rend le système de plus en plus dangereux.
Les Américains du CCT ont pris le contrôle plus direct de l'État. Trump a choisi 13 milliardaires pour son cabinet. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, agit en tant que co-président non élu. Les entreprises et les milliardaires, en particulier dans les secteurs de la haute technologie, de la finance et de l'énergie, ont acheminé des millions sans précédent au comité d'investiture de Trump pour s'assurer que leurs intérêts étaient représentés. Le bloc hégémonique émergent du capital rassemble la technologie et la finance avec le complexe militaro-industriel et le capital pharmaceutique, les grandes compagnies pétrolières et l'immobilier également représentés, avec le capital financier transnational en tête.
Cela se produit parallèlement à une polarisation politique rapide à mesure que le centre s'effondre, avec l'insurrection néofasciste d'extrême droite et le contrôle du Parti républicain et des trois branches du gouvernement. Trump ne peut pas représenter les intérêts des travailleurs et du capital et n'a pas l'intention d'abandonner le capital. Outre l'extrême droite organisée en milices racistes et néofascistes comme celles qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, Trump a une base de masse dans une partie de la classe ouvrière. Ces travailleurs espèrent que Trump améliorera leur situation économique, mais cela n'arrivera pas. Au contraire, dans la mesure où Trump réussit, la situation des travailleurs se détériorera davantage. La coalition de Trump va se désintégrer. La désillusion s'installera et, à la fin, leur base de masse se désintégrera. Telles sont les conditions pour le développement d'une option populaire de gauche, mais ce sont aussi des conditions dans lesquelles la tendance fasciste pourrait se consolider dans un fascisme ouvert du XXIe siècle.
Les classes dirigeantes craignent les soulèvements populaires de masse et s'y sont préparées. Il est presque inévitable que le parti du capital s'effondre. Lorsque cela se produira, et lorsque les manifestations de masse s'intensifieront, l'État policier mondial sera encore plus déchaîné. Nous passerons très rapidement à une escalade des conflits sociaux et politiques. Trump a promis tout au long de sa campagne de réprimer la dissidence politique. La brutalité pure et simple du capitalisme mondial, telle qu'elle est maintenant exposée dans le monde entier, finira par être mise en lumière et fera des ravages sur nous aux États-Unis.
*Professeur émérite de sociologie. Université de Californie à Santa Barbara
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
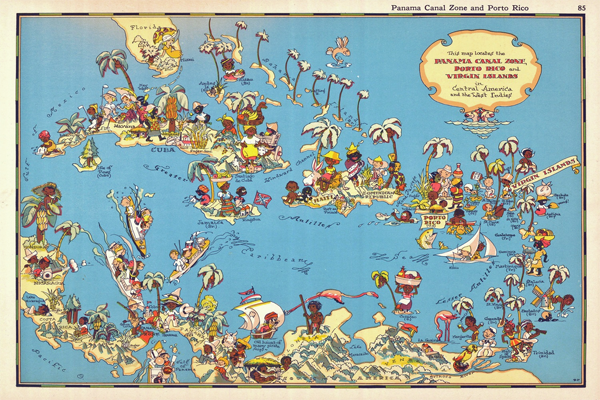
L’Amérique latine selon Trump : des menaces aux réalités
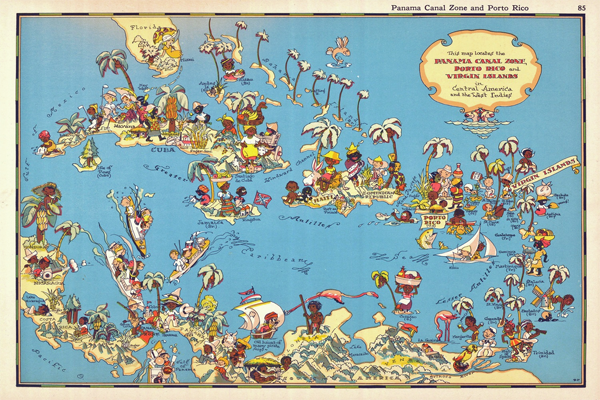
Certes les nouvelles rodomontades suprémacistes du 47e président des États-Unis et ses premiers passages à l'acte vis-à-vis de l'Amérique latine collent de près à ses folles promesses pré-investiture. Pour autant, il n'est pas écrit que leur impact sur les réalités politiques, économiques et sociales du continent tranchera radicalement avec les années Biden ou Obama.
3 février 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73514
Les propos tenus par Donald Trump à l'occasion de sa nouvelle investiture à la tête des États-Unis et la cascade de décrets présidentiels signés dans la foulée auront été à la hauteur des outrances de sa campagne électorale. Y compris, pour le cas qui nous occupe ici, vis-à-vis de l'Amérique latine, que ce soit en matière de menaces commerciales, de coercition politique ou d'éradication de la question migratoire, de la criminalité et du narcotrafic, l'élu républicain amalgamant régulièrement ces trois phénomènes. On y retrouve ses habituels positionnements à la fois transparents, sans filtre, obsessionnels, unilatéraux…, dont on sait cependant qu'ils peuvent aussi être imprédictibles, circonstanciels, contingents, voire basculer du tout au tout en fonction des rapports de force certes, mais également selon ses accointances subites avec tel nouveau « best friend » ou l'irruption d'une nouvelle lubie.
Une constance néanmoins dans ses énormités, une priorité phare : la sécurité nationale, l'exceptionnalisme états-unien, la suprématie de la 1re puissance mondiale ! Et des accents, des inclinations – possiblement contradictoires – pour atteindre le Graal, c'est-à-dire pour « rendre sa grandeur à l'Amérique » : d'un côté, des mesures protectionnistes, isolationnistes, nationalistes en rafale ; de l'autre, des visées expansionnistes, hégémoniques, impérialistes. Au total, une sorte de « protectionnisme expansionniste », osons l'ambigüité, guidé par un agenda plus affairiste qu'idéologique. Álvaro García Linera, l'intellectuel bolivien, ancien vice-président d'Evo Morales, parle, lui, de « néolibéralisme souverainiste » pour nommer cette « voie hybride testée ailleurs dans le monde, que l'on pense à Meloni en Italie, à Orban en Hongrie ou à Bolsonaro au Brésil précédemment » [1].
Soit. Qu'en sera-t-il vis-à-vis de l'Amérique latine ? Les deux principales et immédiates préoccupations de Trump tiennent en quelques mots : d'une part, y vendre plus et y acheter moins – équilibrer sa balance commerciale là où elle est déficitaire, la rendre excédentaire là où elle est équilibrée – et d'autre part, y gagner le bras de fer hégémonique engagé avec la Chine. La première, strictement mercantiliste, il la rabâche depuis toujours, avec la hausse des droits de douane comme arme de dissuasion préférée, en dépit de ses limites évidentes et de ses effets contraires selon les situations. La semaine même de son investiture, sans doute conseillé par plus outillé que lui en matière économique [2], il l'a d'ailleurs déjà infléchie… pour mieux y revenir trois jours plus tard, en menaçant la Colombie d'une taxe de 25% puis de 50% sur ses exportations si son président, Gustavo Petro, ne revenait pas sur sa décision de refouler les avions militaires remplis d'immigrés expulsés des États-Unis.
Commerce, économie…
De la cinquantaine de pays dans le monde avec lesquels Washington accuse une balance commerciale déficitaire, seulement quatre ou cinq sont latino-américains : Mexique, Nicaragua, Costa-Rica, Venezuela, Guyana… De ceux-ci, seul le Mexique pèse réellement. D'un poids très significatif, à vrai dire. À lui seul, il représente quelque 20% du déficit total des États-Unis, se classant ainsi deuxième derrière la Chine et ses 35%. Il constitue dès lors la première cible « mercantiliste » de Trump au sein du continent américain, avec le Canada (9% du déficit commercial états-unien), l'un et l'autre pourtant membres de l'« Accord Canada–États-Unis–Mexique », l'ancien « Accord de libre-échange nord-américain » déjà renégocié au cours du premier mandat trumpien. L'annonce a donc été prononcée et réitérée à l'envi par le leader populiste : une hausse des droits de douane de 25% va venir grever, à partir du 1er février, les importations mexicaines et canadiennes.
On comprend mal cependant comment la mise à exécution de cette menace profiterait aux États-Unis. Outre la forte récession qu'elle provoquerait au Mexique, leur principal partenaire commercial, et l'inflation qu'elle induirait pour les consommateurs états-uniens, elle viendrait également torpiller de plein fouet le nearshoring, cette stratégie qui consiste à relocaliser la production, notamment asiatique, à proximité des frontières. Stratégie dont profite résolument l'économie mexicaine et à laquelle s'adonne pour partie les investisseurs nord-américains qui y bénéficient d'une main-d'œuvre bien meilleur marché qu'au nord du Rio Grande.
Quant au reste de l'Amérique latine, jouer avec les tarifs douaniers sur leurs exportations pour les ramener dans le droit chemin sécuritaire ou pour les inciter à acheter plus aux États-Unis pourrait, là aussi, vite se révéler contre-productif. Tant l'Europe (premier investisseur en Amérique latine en 2022) que la Chine sont gourmandes de ces matières premières minières et agricoles produites dans le sous-continent, dont l'entrée en Amérique du Nord deviendrait trop onéreuse [3]. La rivalité avec la Chine constitue précisément la deuxième grande préoccupation évoquée ci-dessus et ressassée par le nouveau président à l'endroit de l'Amérique latine. Elle s'impose à lui comme à ses prédécesseurs depuis le début de ce siècle.
Réalité massive, la Chine est désormais le premier partenaire commercial de la plupart des pays latino-américains, de droite comme de gauche. Le volume des échanges sino-latinos, en valeur monétaire absolue, a été multiplié par vingt-cinq en vingt ans et devrait l'être par quarante entre 2000 et 2035, selon diverses estimations [4]. Le résultat d'un quart de siècle de flux de capitaux, d'investissements et de crédits orchestrés par la Chine en Amérique latine, ainsi que de constructions d'infrastructures portuaires, routières, énergétiques, ferroviaires, etc., sans conditionnalités politiques manifestes. Vingt-deux des vingt-six États latinos sont aujourd'hui engagés dans l'initiative stratégique chinoise des « Nouvelles routes de la soie ». Trump aura donc fort à faire, c'est peu dire, pour renverser la tendance, redonner la primauté des échanges aux États-Unis et y réactualiser l'historique doctrine Monroe qui considère, depuis le début du 19e siècle, toute intervention européenne – et aujourd'hui asiatique – dans les affaires des Amériques comme une menace pour la sécurité, la paix et… l'hégémonie états-unienne.
À cet égard, il n'est pas certain que menacer grossièrement le Panama de reprendre, au besoin par la force militaire, le contrôle sur son canal interocéanique (dont les ports de Balboa et de Cristóbal ont été concédés à la gestion d'une entreprise hongkongaise) soit la meilleure façon d'y parvenir. Ce le sera encore moins en appliquant un tarif douanier de 60% à toute marchandise ayant transité par l'un des quelque vingt ports sous contrôle chinois dans le sous-continent, comme le propose le nouvel émissaire de l'administration Trump pour l'Amérique latine, Mauricio Claver-Carone. Car l'enjeu pour les grandes puissances, rappelons-le, est bien de capter une part maximale des matières premières extraites des sols et sous-sols de la région. Sols que l'on n'a jamais autant creusés que depuis le début de ce siècle. Et qui devraient l'être plus encore dans les prochaines années, au vu des besoins occidentaux et chinois en ressources clés pour la numérisation, la décarbonation et l'électrification de leurs économies [5].
Migration, sécurité…
À côté de cette guerre commerciale que l'arrivée de Trump vient réagiter, l'autre grand thème de ses vociférations à l'égard de l'Amérique latine depuis son investiture est la question migratoire, le sort des immigré·es d'hier et des migrant·es d'aujourd'hui. Et là aussi, le Mexique occupe la toute première ligne, puis l'Amérique centrale, l'historique patio trasero (arrière-cour) des États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. La posture est maximaliste, doublement : expulsion systématique et refoulement systématique. Expulsion de toute personne immigrée considérée comme illégale (au nombre de 11 millions d'après les estimations les plus sobres, dont environ la moitié de Mexicain·es) et refoulement de toute tentative d'entrée illégale sur le territoire. Ajoutons-y la fermeture annoncée de toute possibilité (ou presque) de postuler pour une entrée légale à la frontière Sud.
À partir de là, la question devient vite technique et à géométrie variable, tant les statuts des personnes concernées varient selon la nature des documents (d'entrée, de résidence, de travail…) obtenus ou pas, la diversité des mécanismes d'obtention échus ou pas, le sort qui va être réservé au « droit du sol » constitutionnel, au déjà ancien « Temporary Protected Status », aux plus récents « Humanitarian Parole Program » et « CBP One App », etc. C'est entendu, Trump prétend faire table rase de toute inflexion réglementaire à la ligne dure. Comme lors de son premier mandat… dont les résultats en la matière pourtant sont restés largement en deçà de ses menaces (bien moins d'expulsions que sous Obama ou Biden, plus d'entrées illégales que sous Obama, nettement moins de kilomètres de mur frontalier construits que sous ses prédécesseurs et son successeur…).
Il avait déjà alors, comme il s'apprête à le refaire, usé du chantage économique pour contraindre le Mexique d'abord, puis les petits pays du Triangle Nord de l'Amérique centrale ensuite (avec moins de réussite) à sous-traiter l'endiguement des flux migratoires, externalisant ainsi les frontières états-uniennes le plus au Sud possible, en pays vassalisés [6]. Au-delà du coût humain désastreux de ces expulsions et refoulements manu militari auxquels le nouveau président se consacre tambour battant depuis ce 20 janvier, l'impact sur les remesas – ces envois de fonds des émigrés latinos aux familles restées à domicile – ne va pas tarder à se faire entendre dans toute la région. Au Nicaragua par exemple, ces remesas ont atteint dernièrement l'équivalent d'un tiers du PIB, soit 1,4 fois le budget national, et financent près de la moitié de la consommation des ménages.
En interne, aux États-Unis, quelles vont être les réactions, les marges de manœuvre des contre-pouvoirs potentiels ? Ils sont déjà à l'œuvre : tels ou tels juges pour défendre la Constitution, tels gouverneurs ou chambres de commerce pour défendre la main-d'œuvre immigrée, vitale dans l'agriculture, la restauration, la construction, le soin…, telle organisation sociale pour défendre les droits humains. À l'inverse, pour bien asseoir sa thèse qui fait de l'« invasion » migratoire – faite de « criminels », de « violeurs », de « vermine », d'« ordures »… – la menace principale à la « sécurité nationale », Trump y a associé très vite, par décret présidentiel le jour même de son investiture, la désignation des cartels de la drogue comme « organisations terroristes étrangères ». Désignation à laquelle pourtant le Mexique, « le pays dont les États-Unis ont le plus besoin » [7], s'oppose de longue date, pour préserver sa souveraineté. Sa nouvelle présidente, Claudia Sheinbaum, a d'ailleurs déjà rappelé au nouveau locataire de la Maison Blanche que, dans ce fléau du narcotrafic contre lequel elle lutte, si les morts sont mexicains, les armes et les consommateurs sont états-uniens [8].
Droite, gauche…
Reste bien évidemment la dimension plus politique de l'interventionnisme de Washington en Amérique latine. Pour le président lui-même, on l'aura compris, ses priorités étant de restaurer la domination commerciale des États-Unis et de renvoyer chez eux les immigrés clandestins, il n'y a pas de nations amies ou ennemies. Il le répète à qui veut l'entendre, pas de traitement de faveur. Pour autant, au vu des profils dont il s'est entouré – ne serait-ce que les deux « faucons » cubano-américains, Marco Rubio aux affaires étrangères et Mauricio Claver-Carone aux relations avec l'Amérique latine [9] –, il y a lieu de s'attendre à des alliances et à des condamnations.
Alliances sans doute avec ces leaders de la droite radicale, populiste, extrême, libertarienne, illibérale ou répressive… qui ont émergé sur presque toutes les scènes politiques en Amérique latine ces dernières années, qui tantôt occupent le pouvoir (Milei en Argentine, Bukele au Salvador, Noboa en Équateur…), tantôt l'ont déjà occupé (Bolsonaro au Brésil…) ou espèrent l'occuper à court ou moyen terme (Kast au Chili…). Et, de l'autre côté, condamnations bien sûr du régime cubain, sous embargo états-unien depuis 1962, et du régime vénézuélien, déjà mis sous « pression maximale » par le premier gouvernement Trump, en vain. Sans doute aussi sanction à l'encontre du Nicaragua ortéguiste, bien que les États-Unis en soient toujours le premier client, et de très loin. Ces ingérences bipolarisées de l'Oncle Sam participeront-elles d'une reconfiguration ultraconservatrice des politiques latino-américaines ? Ou, à l'inverse, d'une remobilisation anti-impérialiste des opinions publiques et des forces de gauche ? [10]
Une chose est sûre, parmi les pouvoirs progressistes démocratiques à l'œuvre actuellement en Amérique latine, il n'y a plus la solidité et la cohésion qui avaient permis à leurs prédécesseurs en 2005 de rejeter le projet nord-américain de zone de libre-échange sur l'ensemble du continent, l'ALCA. Et leurs initiatives, inédites alors, d'intégration régionale non subordonnée à l'hégémonie nord-américaine – dont l'UNASUR en 2008 et la CELAC en 2010 – ne pèsent plus aujourd'hui, en raison des alternances politiques, des frictions intrarégionales et, précisément, des dépendances concurrentielles à l'égard des puissances chinoise, européenne et… états-unienne. Dépendances qui empêchent les gouvernements latino-américains de mener, comme le rêvait encore le président brésilien Lula en 2023, « une action collective non alignée en faveur d'une transition économique vers des modèles diversifiés et à plus haute valeur ajoutée ». Pour sûr, Xi Jinping et Donald Trump en sont fort aise.
Bernard Duterme
Notes
[1] Vincent Ortiz et Vincent Arpoulet, « L'Amérique latine face au ‘néolibéralisme souverainiste' de Trump – Entretien avec Álvaro García Linera », Le Vent Se Lève, LVSL, 21 janvier 2025.
[2] « ‘Mettre les tarifs douaniers à 20% est une très mauvaise idée, qui pénalisera les Etats-Unis' : la réponse des deux économistes auxquels la Maison Blanche s'est référée », Le Monde, 23 janvier 2025.
[3] Ander Sierra, « Las amenazas de Trump en América Latina son una oportunidad para China », Other News, 16 janvier 2025.
[4] Ibidem.
[5] Lire CETRI, Amérique latine : les nouveaux conflits, Paris, Syllepse, 2024 et CETRI, Business vert en pays pauvres, Paris, Syllepse, 2025.
[6] Lire CETRI, Fuir l'Amérique centrale, Paris, Syllepse, 2022.
[7] Luis Gómez Romero, « La guerra de Trump contra los migrantes podría convertir en enemigo al país que más necesita : México », The Conversation, 23 janvier 2025.
[8] Ibidem.
[9] Christophe Ventura, « Donald Trump et l'Amérique latine : une diplomatie du rapport de force », Note d'actualité IRIS/AFD, janvier 2025.
[10] Observatorio en Comunicación y Democracia, « Si EEUU estornuda, a Latinoamérica le da bronquitis », Other News, 27 janvier 2025.
P.-S.
• CETRI. 3 février 2025 :
https://www.cetri.be/L-Amerique-latine-selon-Trump-des
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Airbnb ou Chasser la famille pour loger la visite

La ville ne doit pas ultimement constituer une banale et jovialiste destination inscrite sur le circuit de boulimiques mondialistes aéroportés sur nos tarmacs et parachutés au cœur de nos quartiers et planqués dans des Airbnb tout frais libérés à nos frais !
Ces lucratifs « Airbnb » si perturbants et illégaux par surcroit et qui pullulent impunément tels des pustules dans les centres-villes et leur périphérie. Cessons de saccager nos villes et de les mondialiser dans le seul dessein d'appâter des hordes de touristes aux bagages « vuitonnés » à Beijing et bardés de cartes plastiquées et platinées se comportant tels des néo-prédateurs ou des tourismophobes issus de la nouvelle Pangée planétaire. Dénonçons les paliers de gouvernement qui s'improvisent grossistes touristiques, jouent au chat et à la souris avec l'application de la règlementation et livrent sans retenue nos villes en pâture aux bagagistes porteurs de capitaux spéculatifs et à une coterie de promoteurs encourageant ainsi la marchandisation et la financiarisation du logement.
Mais sur le front du logement, voici tout de même quelques bonnes nouvelles récentes – et elles se font rares –. La Ville de Montréal vient de déclarer, ce que les groupes logement réclamaient et criaient haut et fort sur tous les toits – surtout sur ceux d'Airbnb – depuis un bon moment déjà ; que les nombreuses moutures règlementaires de Québec, même celles de Montréal, s'étaient avérées inefficaces, non respectées et difficiles d'application. En effet, même si en 2017 le contexte réglementaire était légèrement différent d'aujourd'hui, le Comité logement Ville-Marie sonnait l'alarme – tout comme d'autres Comités logement du Québec – dans unelettre d'opinion parue dans Le Devoir. L'administration Plante vient d'annoncer que la location de courte durée de type Airbnb dans les résidences principales ne sera permise que du 10 juin au 10 septembre et que ce nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 24 mars prochain– par un heureux hasard, cette date est symbolique puisque l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 24 mars (n'est-ce pas monsieur Netanyahou) : Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes aux droits de l'homme et pour la dignité des victimes –. Ainsi, elle entend serrer la vis aux contrevenants et doubler le nombre d'inspecteurs qui pourront remettre, sur-le-champ des constats d'infraction de 1000 $ pour chaque nuitée affichée ou louée illégalement. L'ajout de cette mesure fera dorénavant reposer le fardeau de preuve sur les épaules des propriétaires et non plus sur celles de la ville – en évitant ainsi de coûteuses et longues procédures judiciaires –. Autre nouvelle intéressante, la ville de Québec a déposé unavis de saisiecontre Airbnb, une première, – enfin une preuve de courage – pour percevoir une portion des amendes imposées à un promoteur d'Airbnb dans le Vieux-Québec. Bien évidemment, ces nouvelles mesures ne sont pas la panacée, mais elles représentent tout de même un pas dans la bonne direction pour mettre au pas ces plateformes d'hébergement ainsi que les promoteurs. Précisons également que même le milieu hôtelier semble s'être montré en faveur de cette nouvelle mouture réglementaire. Par contre, n'oublions pas que les établissements et les particuliers opérant dans des zones réglementaires autorisées continuerons hélas leurs activités l'année durant.
Un fait intéressant et révélateur à souligner est que suite à l'annonce de la nouvelle réglementation montréalaise : le chat, ou plutôt la chatte, est enfin sortie de son sac et a fait entendre son désaccord par le grognement de sa voix et nous a également dévoilé son visage « à la fois noirci et rougit de colère » car ces derniers développements nous ont permis de découvrir le véritable visage de la ministre Proulx et de son ministère du Tourisme. En vérité, force est d'admettre qu'au fond, ils ont toujours voulu préserver la réputation mondialisée de Montréal – la « métropooooole » du Québec – et financer et privilégier l'apport de ce type d'activités purement et hautement lucratives pour promouvoir et rehausser les profits de l'industrie touristique au Québec. Cependant, tout en n'oubliant pas de parler du côté droit de la bouche en affirmant mordicus – ils auraient plutôt dû se mordre la langue – vouloir protéger les droits des locataires …
Les villes dans le monde, en constante compétition les unes avec les autres, sont maintenant devenues des villes-musées – parlez-en aux résident-e-s- de Barcelone, de Venise et même du Vieux-Montréal et de la ville de Québec –. Mais à l'autre bout de la lorgnette capitaliste, ces anti-villes asphyxient, appauvrissent et oppressent leurs populations qui doivent lutter à armes inégales pour ne pas être évincées et rénovincées de leur logement, chassées de leur quartier, voire dramatiquement déracinées tels d'encombrant-e-s locataires. Ou pour ne pas dire, traitées tels des parias « non-collaboratifs » qu'on s'acharne à bannir et à terme révoquer leur légitime « Droit de cité ». Et, s'acharner ainsi dans l'unique but d'engranger davantage de profit en chassant des résident-e-s et en usant pour ce faire de méthodes violentes de chantage, d'intimidation et de harcèlement – et tout cela c'est sans compter les problèmes de bruit, de salubrité, de sécurité et d'incivilité que doit également subir tout le voisinage – pour ensuite pouvoir les remplacer froidement par des hordes prédatrices de visiteurs et de visiteuses. De ce fait, employer ce type de stratagème accompagné de ruses malfaisantes pourraient peut-être correspondre à une forme contemporaine, inédite et scandaleuse « d'anthropophagie ».
Airbnb, Vrbo et les autres plateformes d'hébergement touristique marchandisées afin de revamper le fameux et tonitruant « Branding » des villes avec leur panoplie complète d'artifices « bling bling » et à titre d'économies dites « collaboratives » ou dupartage – cette formule représente à un excellent exemple de pure « novlangue » – sont en vérité « dégénératives ». Ces plateformes sont tout sauf collaboratives car elles empoisonnent la vie des collectivités et ne servent encore une fois qu'à l'enrichissement de multinationales, d'opérateurs et de particuliers au détriment de la qualité de vie de la majorité et participent ainsi de l'appauvrissement et de la déprédation des populations. En vérité, on laisse croire que c'est tout comme si des humains s'étaient mystérieusement et volontairement évaporés pour aller ailleurs… Mais, où ça ailleurs ? Ajoutons que ce fléau sociétal n'est pas seulement local – sur4000 annonces de locations de courte durée à Montréal, dont au moins la moitié ne respecte pas la réglementation en vigueur – mais bien mondial. On a qu'à penser aux villes d'Amsterdam,Barcelone, Berlin, Paris, Venise, Vancouver et bien d'autres qui sont fortement aux prises avec ce fléau et qui ont décidé de s'attaquer frontalement aux graves et innombrables problèmes causés par les plateformes d'hébergement touristique. Actuellement, uniquement la plateforme Airbnb, maintenant cotée en bourse et qui en seulement un peu plus de quinze ans est parvenue à un chiffre d'affaires 9,9 milliards de dollars américains, compte plus de 7 millions d'annonces (de logements) et 50 000 activités proposées par des hôtes locaux, actives d'en plus de 220 pays différents et 100 000 villes. – Soulignons au passage que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a prêté 30 millions de dollars à une entreprise spécialisée dans la location à court terme … – Imaginez le nombre effarant de ménages expulsés et de logements goulûment et vilement avalés et par conséquent exclus des marchés de location d'habitations ! C'est pourquoi les groupes logement du Québec, soient les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)et ceux du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), – et nous ne sommes heureusement pas les seuls au Québec et dans le monde –, affirment que la seule et véritable solutionpérenne serait de bannir totalement ce type d'activités commerciales dévastatrices pour nos villes et catastrophiques pour les résident-e-s.
J'ignore si c'est le fait que nous habitions un pays nordique, mais le sport préféré – mise à part le hockey tant chérit par le ministre des finances et dont la CAQ veut en faire maintenant le sport national – de nos gouvernements ressemble trop souvent à des opérations sporadiques de pelletage en avant et uniquement poussées par de forts vents de colère légitime et ce tragique manège dure depuis plusieurs décennies. Ou, l'art de confectionner et de laisser choir des boules de neige gonflées de douloureuses problématiques et givrées de couches de déni et qui grossissent à mesure qu'elles dévalent à toute vitesse la pente de l'aveuglement volontaire pour aller s'écraser violemment contre un mur à leurs yeux inexistant : soit celui d'une crise du logement. Une crise qui en vérité s'est aggravée et malheureusement transformée en une véritable crise de société que présentement nous traversons fort mal !
Monsieur le premier ministre, sachez que bien des familles ne boivent pas de jus d'orange, non pas par conviction, mais parce qu'elles s'enlisent de plus en plus dans les marais de lapauvreté et les étangs du désespoir. Monsieur Legault et mesdames Duranceau et Proulx, connaissez-vous ce mot « pauvreté » et êtes-vous capables de le prononcer correctement et avec un peu de conviction et non uniquement par de passagères et peu convaincantes convulsions faciales ? Ce mot en « P », même s'il semble interdit dans votre vocabulaire, n'est pourtant pas « encore » à l'index et figure toujours dans tous les dictionnaires et dans toutes les langues et tout en étant douloureusement gravé au cœur et plaqué au visage de milliers de vos concitoyens et concitoyennes. La Coalition Avenir Québec (CAQ,) cette fausse coalition qui dorlote plutôt son électorat, oublie sciemment – pourtant la devise du Québec, n'est-elle pas : « Je me souviens » –, que d'abord et avant tout, la ville se doit d'être un point unique de chute et d'ancrage, un véritable milieu de vie, de rencontre et d'échange, de travail et de loisir. Un lieu d'épanouissement, de bien-être, de paix et de création pour tous ceux et celles qui l'habitent, la nourrissent, paient ses services et ses taxes, pansent son patrimoine et pensent son avenir et qui essentiellement l'aiment et la réinventent à leurs images et au gré de leurs véritables et légitimes aspirations.
Mes filles, dont l'une demeure à Montréal et l'autre dans la région de Vancouver, me demandent à l'occasion si la situation du logement qui prévaut actuellement au Québec – et celle au Canada et dans le monde – est meilleure ou pire que celle des décennies antérieures et je réponds alors sans aucune hésitation : pire, mais bien pire. Cependant, je m'empresse tout de même d'y ajouter un gros BÉMOL : à savoir qu'elle serait plus désastreuse encore si les groupes logement et de nombreux autres groupes et organisations impliqués dans la société civile n'étaient pas descendus dans des rues polluées par l'air des discours vides de sens, lézardées par la morosité environnante et souvent bordées par des forces policières pas toujours hospitalières – gazéifiées à la testostérone et gazéifiantes de gaz lacrymogènes –, produits des mémoires structurants, proposés et distribués des « tonnes de copies » de revendications pourtant réalistes, salvatrices et parfois même novatrices et qu'ils n'avaient pas tirés et agités la queue du serpent le plus souvent possible …
En définitive, nous devons impérativement continuer de défendre et faire reconnaître avec conviction le Droit au logement. Ce droit qui aurait d'ailleurs dû être enchâssé depuis longtemps dans notre Charte québécoise. Revendiquer une Politique d'habitation nationale légitimement mise en place et sauvegardée sous la responsabilité d'un véritable et autonome ministère de l'Habitation et que ce dernier soit doté d'un budget conséquent à l'accomplissement de sa mission. Et au final, avoir enfin un gouvernement entièrement responsable de l'habitation et qui prenne en main ses obligations et responsabilités et renverse les rôles en cessant d'être continuellement inféodé aux diktats du marché et du lobby et des menaces à peine voilées des promoteurs. Réclamer également sur toutes les tribunes possibles notre « Droit de cité » et en déclarant qu'il est maintenant terminé le temps de se laisser déposséder et chasser : à nous la ville et ses quartiers à notre image et la ville nous appartient. Alors, ensemble, continuons le combat car il est juste, fondamental et voire même vital non seulement pour nous, mais également et surtout pour les générations à venir !
Solidairement,
Gaétan Roberge,
Travailleur retraité du Comité logement Ville-Marie
Février 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Budget 2025 : La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles a présenté son mémoire au ministère des Finances

_Montréal, le 7 février 2025. _Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (Table) a présenté son mémoire [1] aux responsables du ministère des Finances, le 6 février.
« En 5 ans, c'était seulement la 2e fois que nous obtenions une rencontre pour présenter notre mémoire, la dernière fois étant en 2022. Dans les deux cas, il aura fallu insister lourdement pour être invités. Les discussions avec les responsables du ministère de Finances ont mis en lumière qu'ils saisissent mal les réalités des organismes immunautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS), en particulier les conséquences d'une subvention moyenne de seulement 198 816 $ en 2023-2024__[1]__. Cet écart de compréhension devrait justement les amener à rencontrer davantage les regroupements provinciaux », souligne Stéphanie Vallée, présidente de la Table.
La Table a d'ailleurs réitéré sa demande des dernières années, soit que le ministère des Finances invite davantage d'organismes communautaires à présenter leur mémoire et à assurer l'accessibilité universelle de toute documentation liée à ce dernier. Ainsi, le
gouvernement serait réellement en mesure de saisir les besoins et les aspirations de la population, notamment parce que le milieu communautaire rassemble plus de 2,25 millions de Québécoises et Québécois[2].
Dans son mémoire, la Table présente deux outils qu'elle a développés pour améliorer le financement et l'administration du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : les seuils planchers de la campagne [2]_CA$$$H [2]_ pour financer adéquatement et équitablement les OCASSS et l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC) [3] pour indexer convenablement leurs subventions.
Les seuils planchers visent d'abord à offrir des capacités optimales aux OCASSS. Les groupes doivent pouvoir compter sur des ressources suffisantes pour mener à bien les plans d'action adoptés par leurs membres. Cela signifie de mener des activités qui répondent non seulement aux besoins immédiats, mais aussi qui permettent d'agir en amont sur l'ensemble des déterminants sociaux. « Des capacités financières qui
permettent aux groupes d'offrir des conditions de travail qui favorisent la stabilité de leurs équipes feraient toute la différence. Le travail des OCASSS nécessite des liens de confiance qui demandent du temps. Sans parler des processus d'embauche qui sont de plus en plus laborieux en raison des conditions de travail qui ne sont pas attrayantes » note Loc
Cory, du comité de coordination de la campagne _CA$$$H._ « Non seulement les montants estimés comme seuils planchers prévoient des ressources humaines assez nombreuses, mais aussi de donner aux groupes les moyens financiers pour réaliser les activités que leurs membres demandent. Pour que les 3050 groupes puissent compter sur de telles capacités optimales, il faut rehausser l'enveloppe annuelle du PSOC pour la mission globale de 1.7 G$ »,continue M. Cory.
En plus de bien subventionner les OCASSS, il importe de maintenir leurs capacités financières d'année en année. « Les subventions du PSOC pour la mission globale sont mal indexées depuis toujours, les groupes s'appauvrissent constamment et cette situation intenable doit cesser. C'est pour cela que nous avons développé, puis proposé l'Indice des
coûts de fonctionnement du communautaire comme méthode d'indexation, d'abord pour les OCASSS, mais aussi en souhaitant qu'il soit appliqué par tous les ministères et organismes gouvernementaux administrant des programmes semblables au PSOC. __ __Plusieurs ministères entendent déjà les groupes de leur secteur réclamer une indexation selon le modèle de l'ICFC. Le ministère des Finances devrait saisir cette opportunité pour
simplifier l'administration des fonds publics, au bénéfice de la population » avance Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table.
« Autant les seuils planchers de la campagne CA$$$H que l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire sont simples à utiliser et s'appuient sur des statistiques irréfutables et disponibles. Leur utilisation n'apporte que des avantages, autant pour le gouvernement que pour les groupes communautaires, leurs communautés et la population en général. Les prochaines années s'annoncent économiquement difficiles. Nous entrevoyons que les OCASSS recevront encore plus de demandes. Or, ils n'arrivent déjà pas à répondre à tout le monde. Par ses propositions, la Table s'oppose à ce que la population et les groupes qu'elle s'est donnés fassent les frais de l'austérité », termine
Stéphanie Vallée.
Rappel des propositions de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1. Nous demandons que le ministère des Finances entende les organismes communautaires qui sollicitent une rencontre pour présenter leur mémoire
prébudgétaire.
2. Nous demandons que le ministère des Finances s'assure que toute consultation budgétaire soit universellement accessible.
3. Comme nous le revendiquons avec la campagne CA$$$H, nous demandons que
le ministère de la Santé et des Services sociaux applique les seuils planchers développés par cette campagne dès l'année 2025-2026 aux subventions à la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
4. Nous demandons que tous les ministères et organismes gouvernementaux appliquent des seuils planchers pour les subventions à la mission globale de leurs programmes respectifs et nous leur suggérons d'utiliser ceux développés par le RQ-ACA comme base de discussion avec leurs interlocutrices communautaires.
5. Nous demandons que le budget du Québec rehausse de 1,7 milliard de dollars le budget accordé pour la prochaine année au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le versement des subventions à la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) destiné aux organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS). Ce montant étant intégré à celui revendiqué par le RQ-ACA pour l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome, nous demandons que le budget du Québec rehausse de 2,6 milliards de dollars le budget destiné aux subventions à la mission globale de tous les organismes communautaires autonomes dès l'année 2025-2026.
6. Nous demandons que le budget du Québec pour 2025-2026 indexe l'enveloppe totale du PSOC mission globale et, conséquemment, chacune des subventions des OCASSS, selon l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC), au taux de 3,6 %. Nous demandons également que tous les ministères et organismes gouvernementaux indexent les subventions à la mission globale de leurs programmes respectifs et nous leur
suggérons d'utiliser l'ICFC comme base de discussion avec leurs interlocutrices communautaires.
7. Nous demandons que les documents déposés lors du budget du Québec fournissent des informations spécifiques sur les sommes budgétées à l'intention des groupes communautaires, à l'intérieur et à l'extérieur du PSOC, tant pour leur distribution par les CISSS-CIUSSS
que par la DSSGAC.
8. Comme l'ensemble des mouvements sociaux, nous partageons les revendications de la Coalition Main rouge et de la Coalition Solidarité santé et nous demandons que le budget du Québec pour 2025-2026 :
• Instaure des mesures fiscales progressives, plutôt que de baisser les
impôts des plus riches ;
• Instaure un régime 100 % public d'assurance médicaments ;
• Cesse la privatisation des services publics, dont le système de santé
et de services sociaux.
SOURCE :
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB), Mercédez Roberge, coordonnatrice,
À propos
Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles [7] (TRPOCB) est formée de 47 regroupements
nationaux [8], rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à
travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des
centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons d'hébergement,
des groupes d'entraide, des centres communautaires, des groupes qui
luttent contre des injustices ayant des répercussions sur la santé.
Ceux-ci représentent les ¾ des organismes communautaires autonomes du
Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous
différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes
handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé
mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.).
La Table coordonne la campagne [9]_CA$$$H [9]_ (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement [9]). Lancée le 17
octobre 2017, cette campagne vise l'amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS), au bénéfice de plus de 3 000
organismes communautaires autonomes subventionnés par le MSSS. À compter
de 2024, les revendications de la campagne _CA$$$H_ sont : L'ajout de 1,7
G$ à l'enveloppe annuelle du PSOC [10] (mission globale), l'indexation
annuelle des subventions en fonction de l'Indice des coûts de
fonctionnement du communautaire (ICFC [3]) et l'atteinte de l'équité
de financement et de traitement partout au Québec [11].
Liens utiles :
● https://trpocb.org/campagnecasssh/ [12]
● https://trpocb.org/revendication-financiere-casssh/ [10]
● https://trpocb.org/icfc/ [3]
● https://trpocb.org/seuils-planchers-campagne-casssh/ [11]
● https://trpocb.org/campagnecasssh-onsaffirme/ [13]
[1] En excluant les organismes offrant du 24/7, surtout en hébergement,
dont les subventions sont de 500 000$ et plus
[2] (L'Observateur, 2020 : 1 / 4 a fait appel à un groupe).
Vous recevez ce courriel car vous figuriez dans le communiqué de presse
de Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB). Pour vous désinscrire et ne plus recevoir de
courriels de cette organisation cliquez ici [14].
Links :
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La coalition Dorchester présente sa vision

La coalition Dorchester présente sa vision pour l'îlot du même nom et souligne que la densification des quartiers centraux doit viser la création de milieux de vie durables et agréables en concordance avec les principes de développement à échelle humaine.
La vision de la coalition s'articule autour de principes simples et évidents :
– le respect du plan particulier d'urbanisme (PPU) Saint-Roch sud,
– la préservation des percées visuelles pour les générations futures,
– une offre résidentielle répondant à une diversité de besoins, incluant un ratio significatif de logement social,
– un développement adapté et résilient aux changements climatiques.
La coalition rappelle que le plan particulier d'urbanisme (PPU) Saint-Roch sud a été adopté il y a moins d'une décennie, suite à une consultation qui a duré 5 ans et à laquelle ont participé des centaines de citoyen·nes, majoritairement de Saint-Roch. Cette vision citoyenne, illustrée par l'urbaniste Marc Boutin, est toujours vivante. Les membres de la coalition considèrent que l'îlot Dorchester doit se développer comme une extension du quartier résidentiel de l'îlot des Tanneurs et non comme un prolongement du secteur Charest, avec ses édifices de grand gabarit. Le PPU adopté en 2017, un compromis déjà insatisfaisant pour plusieurs, prévoit plutôt une zone de transition entre ces deux secteurs, afin de garantir l'harmonie de la trame urbaine. Ainsi, par respect pour les résident·es d'aujourd'hui et de demain et pour leur milieu de vie, faire respecter le PPU est un minimum.
Le PPU Saint-Roch Sud reconnaît l'importance des vues et des panoramas dans le secteur des faubourgs et prévoit une progression des hauteurs maximales de 22 à 33 mètres, soit de 6 à 10 étages du côté Saint-Vallier, en incluant deux étages en surhauteur qui comptent pour 50% de la surface. « Le panorama est un bien collectif. Nous nous opposons à la privatisation du paysage. Les percées visuelles ne sont pas un caprice, elles sont l'âme de notre ville et participent à son patrimoine vivant. D'ailleurs, nous nous attendons à ce que le Maire de Québec, qui préside l'Organisation des Villes du Patrimoine UNESCO, soit sensible à cette question », affirme Hélène Matte, artiste multidisciplinaire très active dans Saint-Roch et membre de la coalition Dorchester.
Le PPU Saint-Roch Sud prévoit aussi que l'offre résidentielle répond à une diversité de résident·es et de besoins, en exigeant que les nouveaux bâtiments comportent un ratio significatif de logements à faible coût ainsi que des grands logements pour des familles. Face à la crise actuelle de l'abordabilité des logements, il est impératif de développer davantage de véritable logement social, soit du logement hors marché privé. Il est possible d'inclure des logements sociaux dans un projet privé, ce qui n'est pas le cas dans le projet actuellement présenté. « Nous sommes extrêmement préoccupés par la crise du logement qui fait rage en ce moment. Nous souhaitons ardemment que des logements soient construits à l'îlot Dorchester. Mais force est de constater que le projet de Trudel Corporation, dans son état actuel, ne convient pas : d'abord, le quartier n'a pas besoin d'un hôtel de luxe et ensuite, la proposition ne respecte pas la trame urbaine du quartier. » poursuit Alice Guéricolas-Gagné, autrice et résidente de Saint-Roch. Elle ajoute : « Qui plus est, la Ville devrait exiger l'inclusion de 20% de logement social, communautaire et coopératif, c'est-à-dire sans but lucratif, dans toutes les grandes constructions qui sortent de terre à Québec ».
Par ailleurs, Saint-Roch est un îlot de chaleur. Dans le contexte des changements climatiques, il est impératif d'y accroître radicalement la canopée, qui était de 15% en 2020, la plus basse de la ville après Saint-Jean Baptiste (13%). Qui plus est, la circulation automobile est déjà problématique dans le quartier et affecte la qualité de l'air, le secteur de l'îlot Dorchester est congestionné aux heures de pointe. Comment peut-on en venir à penser qu'il est raisonnable d'y ajouter 550 cases de stationnements ? La mobilité doit être réfléchie autrement dans un des coins de la ville les mieux desservis par les transports en commun et comptant déjà bon nombre de stationnements souterrains.
La coalition Dorchester regroupe principalement des résident·es de Saint-Roch, mais aussi des citoyen·nes de Saint-Jean Baptiste et d'ailleurs au centre-ville, qui fréquentent Saint-Roch ou qui y travaillent. Les démarches de la coalition sont appuyées par des centaines de membres de la communauté, dont le milieu de vie sera affecté par le développement de l'îlot Dorchester. Rappelons que le milieu de vie est un déterminant majeur de la santé des individus et des communautés.
L'Engrenage Saint-Roch, ayant été au coeur des démarches de consultations citoyennes en amont plan particulier d'urbanisme (PPU) pour ce secteur, soutient le travail de la coalition Dorchester pour contribuer à ce que les préoccupations citoyennes soient entendues et supporter l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier pour ceux et celles qui l'habitent, le fréquentent ou y travaillent.
Pétition contre la construction d'une tour de 20 étages à l'Îlot Dorchester
Analyse du projet Trudel Corporation et préoccupations citoyennes
Vidéo de la conférence de presse du 3 février 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Manifestation contre le retour de l’austérité

À Québec
Le 20 février prochain, dans le cadre de notre campagne Ils s'enrichissent, on s'appauvrit, nous allons manifester contre un retour à l'austérité budgétaire.
À quelques semaines du dépôt du budget du Québec, il faut absolument s'opposer au retour à l'austérité budgétaire. L'austérité consiste à couper dans toutes les dépenses de l'État sans égard aux besoins de la population. Le gouvernement Legault affirme que ces coupures sont nécessaires en faisant référence au déficit budgétaire. Or, ce dernier est grandement dû aux politiques irresponsables du gouvernement Legault qui a accordé de généreuses réductions d'impôt aux plus riches, subventionné des événements sportifs et financé des grandes entreprises telles que Northvolt, plutôt que de conserver ses marges de manœuvre pour soutenir les missions les plus essentielles de l'État.
On voit déjà les impacts du retour à l'austérité dans de nombreux domaines. Rapport des projets de rénovations dans nos écoles, suspension des achats de livres dans les bibliothèques scolaires, coupures dans les services de francisation, compressions de 1,5G$ en santé et ce n'est que le début. Le prochain budget pourrait faire très mal à nos services publics.
Joignez-vous à nous pour envoyer un message fort au gouvernement Legault que nous n'acceptons pas qu'il saccage les services publics et les programmes sociaux. L'accès et la qualité de ceux-ci sont directement menacés ! Halte à l'austérité !
La manifestation sera suivie d'un panel sur les impacts potentiels d'une nouvelle vague d'austérité sur nos services publics, nos programmes sociaux et nos conditions de vie.
11h45 - Rassemblement devant l'Assemblée nationale
12h00 - Départ de la manifestation
13h00 - Arrivée au Centre Lucien Borne (Cafés et collations gratuites)
13h15 - Panel sur les impacts de l'austérité
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Répondre à Donald Trump par un projet démocratique populaire pour le Canada

Un appel à la gauche canadienne pour qu'elle relève le défi de construire un projet démocratique populaire viable à l'échelle nationale, La réaction fracturée et contradictoire des élites politiques et économiques canadiennes à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations canadiennes et de faire du Canada le 51e État des États-Unis a révélé la faiblesse du tissu social du pays. Les liens ténus qui unissaient autrefois les différentes nations, régions et provinces du Canada, et qui lui donnaient une certaine cohérence, ont été effilochés par des décennies de réformes néolibérales.
2 février 2025 | tiré de Canadian Dimension | Photo par Dru !/Flickr
À une certaine époque, par exemple, les élites canadiennes pouvaient se targuer d'un système de soins de santé universel relativement robuste comme source de légitimité nationale et, incidemment, comme point de différenciation par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons des systèmes de soins de santé partout au pays poussés au bord de l'effondrement, prêts à être privatisés et livrés aux géants du Canada.
Superficiellement, cette faiblesse a été confirmée par un récent sondage qui indiquait un déclin général de l'« attachement profond » et de la « fierté » au Canada. Fait intéressant, l'étude a également révélé que les Canadiens plus âgés et plus riches étaient plus susceptibles de professer leur fierté à l'égard du Canada, tandis que l'inverse était vrai pour les Canadiens plus pauvres et plus jeunes. Cela met en évidence le fait qu'un plus grand nombre de Canadiens se sentent exclus de la communauté nationale et que ce sentiment a une dimension de classe sociale visible ainsi qu'une dimension générationnelle interdépendante.
Les difficultés que rencontrent les partis politiques au pouvoir au Canada et ses élites économiques pour tenter de bricoler une réponse aux différentes menaces de Trump, après avoir tenté de l'amadouer par des concessions, suggèrent qu'ils n'ont pas les ressources hégémoniques nationales pour affronter ses menaces de front de manière unifiée et cohérente. Cela peut être contrasté avec la réponse beaucoup plus conflictuelle du Mexique contre toute politique punitive promulguée par l'administration Trump. Le Mexique, soit dit en passant, est dirigé par une présidente de gauche, Claudia Scheinbaum, qui bénéficie d'un solide soutien de l'ensemble des classes populaires de ce pays.
Quoi qu'il en soit, les défis et les contradictions auxquels les élites canadiennes seront confrontées en tentant d'apaiser ou de confronter Trump dans les semaines, les mois et les années à venir offriront des opportunités aux progressistes canadiens, y compris aux socialistes. Il ouvrira un espace pour l'articulation d'un projet démocratique populaire à l'échelle nationale en opposition à la domination américaine croissante ainsi qu'aux élites politiques et économiques dociles du Canada.
S'engager dans un tel projet pourrait, bien sûr, générer un malaise chez les socialistes canadiens, car il mettrait en lumière la question du nationalisme, et les socialistes ont historiquement eu une relation ambivalente, voire antagoniste, avec la nation et le nationalisme. Le nationalisme est perçu comme allant à l'encontre de l'engagement du socialisme en faveur de l'internationalisme et de la solidarité de la classe ouvrière au-delà des frontières. De plus, les conceptions de l'élite du nationalisme canadien ont en fait contredit les valeurs socialistes. D'une part, le nationalisme canadien multiculturel moderne articulé par Trudeau père dans les années 1970, qui prédominait jusqu'à récemment, cherchait à rendre invisible le projet colonial de peuplement du pays, à subvertir les revendications québécoises à l'autodétermination et à subsumer la lutte des classes en centrant le citoyen individuel. De plus, les manifestations du convoi de 2022 ont revigoré le principal concurrent du nationalisme multiculturel : les conceptions plus régressives de la nation canadienne, alimentées par des théories du complot et une haine obsessionnelle de Trudeau fils. Dans certains cas, elle se manifeste paradoxalement par une allégeance à Trump. Ce sont ces variantes plus réactionnaires du nationalisme qui semblent bénéficier de l'aliénation croissante de cette dernière forme, comme en témoigne le soutien croissant au Parti conservateur de Pierre Poilievre parmi les électeurs plus jeunes et de la classe ouvrière.
Malgré ces développements, le Canada demeure une entité politique importante, et les socialistes canadiens se rendraient service, ainsi qu'à la gauche internationale en général, en laissant son terrain incontesté. La catastrophe climatique qui se déroule, les inégalités croissantes, la désintégration du filet de sécurité sociale du pays et la montée de forces politiques profondément réactionnaires mais de plus en plus viables au pays et à l'étranger font en sorte qu'il est impératif pour les socialistes canadiens d'élaborer des stratégies pour commencer à défier de manière substantielle les élites canadiennes à l'échelle nationale. Cela soulève néanmoins la question de savoir si un projet démocratique populaire à l'échelle nationale doit être articulé en termes explicitement nationalistes de gauche qui rivalisent avec les variantes multiculturelles et réactionnaires du nationalisme canadien pour ses symboles. Bien que la concurrence pour des symboles concrets tels que le drapeau et des notions de bon sens telles que la « décence canadienne » puisse aider à rallier des forces sociales plus centristes et même de gauche – dans le mouvement syndical, par exemple – à un projet démocratique populaire, ces mêmes symboles et tropes ont également été utilisés pour opprimer et réduire au silence d'autres forces sociales.
Au risque d'éluder ce dilemme, il est peut-être préférable de ne pas prédéterminer le degré d'intégration des symboles nationaux existants dans un projet démocratique populaire renouvelé. La meilleure façon de résoudre ces questions est de le faire dans la pratique. Il est toutefois utile de trouver des principes et des critères dans les écrits plus journalistiques de Karl Marx et de Friedrich Engels sur le nationalisme qui pourraient aider à orienter la gauche et à négocier ce dilemme dans l'élaboration d'un projet démocratique populaire. En examinant si les mouvements nationalistes de leur époque méritaient d'être soutenus, ils ont évalué dans quelle mesure ces mouvements articulaient des positions de réciprocité internationale entre les nations ainsi que leur engagement envers des programmes de réforme sociale. À la lumière de ces deux critères, un projet démocratique populaire renouvelé devrait s'aligner sur les revendications autochtones et québécoises d'autodétermination, tout comme il devrait défier l'impérialisme canadien à l'étranger. De plus, il devrait au moins chercher à améliorer les conditions sociales et à élargir qualitativement la participation politique.
Principes directeurs pour l'élaboration d'un projet démocratique populaire
L'une des faiblesses attribuées à la gauche socialiste a été son incapacité à comprendre pleinement et à lutter contre les forces politiques nationalistes. Cette faiblesse a été attribuée en partie à l'affirmation souvent répétée que Marx et Engels n'ont pas réussi à développer une conception satisfaisante de la nation et du nationalisme. En effet, certains de leurs écrits suggèrent que la nation et le sentiment d'appartenance nationale se dissiperaient avec l'intégration et la modernisation des marchés mondiaux ainsi que l'avancée de la lutte des classes. Ce qui est souvent négligé lorsque l'on discute de cette question, cependant, ce sont leurs comptes rendus plus journalistiques et donc stratégiquement prescriptifs du nationalisme. En effet, Mike Davis a soutenu que ces articles constituent leur « théorie perdue » du nationalisme. Pris dans leur ensemble, ces écrits peuvent fournir des indications sur la façon de commencer à articuler un projet politique démocratique populaire national, sinon nécessairement nationaliste, qui peut être mis en contraste avec les récits plus exclusifs et chauvins actuellement proposés.
Dans ses Nationalismes réellement existants, Erica Benner explique que dans leurs articles journalistiques écrits dans un registre stratégique, Marx et Engels n'ont pas mis en avant une conception substantielle et historique de la nation. Il s'agissait plutôt d'une médiatisation et d'une orientation vers l'avenir, dans laquelle différentes classes sociales rivalisaient pour transmettre leurs propres aspirations à la nation. Par conséquent, pour eux, la nation elle-même pourrait être imprégnée d'aspirations démocratiques populaires tout comme elle pourrait être imprégnée d'aspirations machistes. Il est important de noter, selon Benner, qu'ils insistaient également sur le fait que les conceptions démocratiques populaires de la nation ne pouvaient pas être voulues par des idées. Au lieu de cela, les partisans d'une telle conception devraient affronter un terrain façonné par les rapports de force du capitalisme qui étaient favorables aux conceptions étatistes et/ou chauvines de la nation concordant avec les intérêts des classes dominantes, qu'elles soient bourgeoises ou aristocratiques. Par conséquent, pour affronter les conceptions réactionnaires de la nation, il fallait défier et travailler sur les relations de pouvoir, les arrangements politiques et les symboles existants.
De plus, Marx et Engels ont mis l'accent sur la dimension relationnelle et internationaliste des conceptions démocratiques populaires de la lutte nationale. Dans le Manifeste communiste, ils soutenaient que « la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est d'abord une lutte nationale. Le prolétariat de chaque pays doit, bien entendu, régler d'abord les choses avec sa propre bourgeoisie. Ils insistaient néanmoins sur le fait que les fins de telles luttes n'avaient pas besoin d'être étroitement nationalistes.
Étant donné que le capitalisme opère à l'échelle internationale à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, la lutte des classes dans un État aurait un impact sur les luttes dans d'autres. Par exemple, dans un discours prononcé devant des chartistes anglais sur l'insurrection polonaise de 1830 contre l'Empire russe, Marx a expliqué que « la Pologne doit être libérée non pas en Pologne mais en Angleterre. C'est pourquoi vous, chartistes, ne devez pas vous contenter d'exprimer des vœux pieux pour la libération des nations. Vainquez vos propres ennemis intérieurs et vous pourrez alors vous enorgueillir d'avoir vaincu toute l'ancienne société. Il s'agissait donc d'un compte rendu relationnel qui mettait l'accent sur l'interrelation entre l'exploitation de classe et la domination nationale dans l'économie capitaliste mondiale.
Il y avait bien sûr beaucoup de lacunes dans ce que Marx et Engels ont écrit sur la nation et le nationalisme, que je n'aborderai pas ici. Malgré ces limites, cependant, des critères utiles pour évaluer et construire des mouvements politiques contemporains peuvent être dégagés de leurs écrits sur la question nationale. Pour Benner, l'un de ces critères est la réciprocité internationale. Pour être clair, ils se référaient généralement à l'oppression de certaines nations par d'autres au sein d'entités souveraines uniques, qu'il s'agisse d'empires ou d'États, même si, pour eux, le concept de réciprocité ne s'arrêtait pas aux frontières de ces entités. À un niveau très fondamental, Marx et Engels soutenaient que l'oppression d'une nation par une autre était due aux relations sociales capitalistes internes d'une formation sociale. L'oppression nationale en tant que telle n'était pas due à une volonté abstraite de domination, mais plutôt à des relations de classe qui poussaient structurellement certaines nations à en opprimer d'autres et rendaient d'autres nations vulnérables à l'oppression. Ils ont en outre soutenu que l'oppression nationale était importante pour contribuer au pouvoir des régimes réactionnaires dans les nations oppressives en fournissant à ces régimes de la plus-value, d'une part, mais aussi en les ancrant dans des alliances internationales composées de forces sociales réactionnaires. Ces forces sociales, selon eux, pourraient ainsi se soutenir mutuellement pour écraser les mouvements qui cherchaient à lutter contre l'exploitation de classe dans les nations oppressives et/ou à résister à l'oppression nationale. C'est pourquoi Engels a affirmé qu'une « nation ne peut pas devenir libre et en même temps continuer à opprimer les autres nations ». Ils ont donc évalué les causes nationalistes sur la base de savoir si elles cherchaient à libérer tous les peuples de l'exploitation de classe et de toutes les formes d'oppression, y compris l'oppression nationale, ou si elles étaient plus étroitement axées sur l'affirmation de conceptions exclusives de la nation ainsi que sur l'indépendance purement formelle.
Un deuxième critère que l'on peut distiller des écrits de Marx et d'Engels, selon Benner, est la réforme sociale. Étant donné que les racines structurelles de l'oppression nationale se trouvent dans les divisions de classe générées par le capitalisme, l'oppression nationale et l'exploitation de classe ne pourraient pas prendre fin sans s'attaquer à ces mêmes divisions. Par exemple, pour Marx et Engels, la libération nationale n'était pas seulement une question d'expulser les oppresseurs nationaux, mais aussi une question de transformer les conditions mêmes qui poussent à l'oppression nationale en premier lieu. Bien que l'expulsion des oppresseurs nationaux soit un objectif louable en soi, l'indépendance formelle n'impliquait pas automatiquement la liberté totale de l'oppression et de l'exploitation tant que les relations sociales capitalistes restaient en place. De plus, la persistance de ces relations rendrait une nation vulnérable à une oppression future. Pour eux, la modification de ces conditions impliquait donc une transformation sociale à la fois dans les États oppresseurs et opprimés en améliorant les conditions sociales et en élargissant la participation politique. De plus, l'articulation d'un projet réformiste en tant que programme intermédiaire pourrait aider un tel projet à recueillir une large base de soutien parmi les forces sociales telles que les syndicats et les mouvements sociaux, ainsi qu'à développer des alliances internationales avec des mouvements partageant les mêmes idées dans le cadre d'un programme de transition visant à une transformation économique et sociale substantielle.

Le président Donald Trump signe des décrets dans le Bureau ovale. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de la Maison-Blanche/X.
Réciprocité internationale et réforme sociale dans le contexte canadien
Ce qui ressort de ces écrits, ce sont des principes qui peuvent aider à guider le développement d'un projet démocratique populaire à l'échelle nationale au Canada, compte tenu de la question épineuse de la position complexe du pays. Premièrement, le Canada peut être considéré comme subordonné à l'État impérial et au capital américains. Cela ne signifie pas que l'État canadien et ses fractions dirigeantes du capital sont dominés ou opprimés par les États-Unis contre leur propre volonté, ni que ces acteurs canadiens sont incapables de poursuivre leurs propres intérêts impériaux. En effet, l'État canadien et ses fractions de classe dirigeante ont été des participants disposés à contribuer au projet de l'Empire américain à la fois au pays et à l'étranger, qu'il s'agisse de mettre en œuvre l'austérité néolibérale à l'intérieur du pays ou de promouvoir le libéralisme commercial par le biais de projets comme la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) à l'époque de l'hégémonie américaine de l'après-guerre froide. plus récemment, en rejoignant les États-Unis dans leur tentative de contenir et de concurrencer la République populaire de Chine sur les plans économique et géopolitique. Ce que cette subordination implique, c'est plutôt qu'il y a des limites à la réalisation de projets de réforme sociale intérieure ou à la poursuite d'une politique étrangère indépendante qui irait à l'encontre des intérêts impériaux américains. Néanmoins, cette subordination pourrait certainement prendre une forme plus coercitive au cours du second mandat de Trump si son gouvernement optait pour cette voie.
Deuxièmement, le Canada peut être considéré comme une nation oppressive à la fois sur le plan national, sous la forme de l'oppression nationale, et sur le plan international, sous la forme de l'impérialisme. Le projet colonial de peuplement en cours du Canada, centré sur la contestation et le déni des revendications territoriales autochtones afin d'accéder aux ressources naturelles par le biais de projets tels que les pipelines Trans-Mountain et Coastal GasLink, ainsi que son administration de la vie autochtone par le biais de la Loi sur les Indiens paternaliste (1985), le placent dans une relation d'oppression nationale avec les nations autochtones. En même temps, l'histoire du Canada anglais, avec les Canadiens français en général et les Québécois francophones plus étroitement, constitue un deuxième axe d'oppression nationale intérieure. De même, d'un point de vue international, les élites politiques canadiennes ont participé activement à la promotion des intérêts de l'empire américain qui sont largement congruents avec les leurs dans des forums tels que l'Organisation des États américains (OEA), en plus de promouvoir les intérêts économiques des capitaux miniers et d'investissement canadiens en Amérique latine et en Afrique. Il y a un débat sur la façon d'analyser ou de nommer le rôle du Canada en tant que nation oppressive à l'étranger, mais certains chercheurs le décrivent comme un impérialisme secondaire.
Par conséquent, l'élaboration d'un projet démocratique populaire renouvelé exigerait de concilier la dynamique combinée de subordination du Canada à l'Empire américain, d'oppression nationale interne et d'impérialisme à l'étranger avec les critères de réforme sociale et de réciprocité internationale de Marx et Engels. Dans ce contexte, il est important de souligner à nouveau l'argument selon lequel l'oppression nationale et l'impérialisme sont largement structurellement propulsés par des divisions de classe au sein des formations sociales. Tout le monde au Canada n'a pas bénéficié de la même manière de la subordination du pays aux impératifs de l'empire américain au cours des dernières décennies. En fait, cette position subalterne a surtout profité à différentes fractions du capital canadien ainsi qu'à des fractions du capital étranger qui exerçait des activités au Canada. Cependant, les conséquences de cette subordination ont été très inégales pour les classes subordonnées d'un point de vue matériel et très préjudiciables d'un point de vue politique par rapport à la politique de gauche.
Bien que certains segments de la classe ouvrière canadienne aient parfois bénéficié des prix élevés des produits de base, d'autres, en particulier ceux associés au secteur manufacturier, ont été touchés négativement ou de manière négligeable. En outre, les salaires réels sont restés largement stagnants au cours des dernières décennies, avec une forte variabilité entre les secteurs. Il est important de noter que, lorsqu'il s'agit du poids politique et de l'orientation du travail, il est important de noter que les taux de syndicalisation dans le secteur privé ont considérablement diminué depuis le début des années 1980, en particulier chez les hommes, ce qui les a rendus plus ouverts aux discours réactionnaires et au recrutement par les partis conservateurs.
Compte tenu de cette dynamique, l'articulation d'un projet démocratique populaire centré sur la réforme sociale qui cherche à améliorer substantiellement les conditions sociales mettrait à l'épreuve le pouvoir des fractions canadiennes et étrangères du capital opérant au Canada. Il élargirait également la portée des réformes sociales et politiques ainsi que la base politique de la résistance à la subordination continue du Canada dans le giron impérial américain. En d'autres termes, il fournirait une coalition plus robuste de forces sociales désireuses et capables de résister à la domination coercitive proposée par Trump. La contestation des capitaux nationaux et étrangers à l'intérieur du pays donnerait également plus de marge de manœuvre pour élaborer une politique étrangère plus autonome, qui s'écarterait des priorités de l'empire américain ainsi que des intérêts impériaux du Canada. C'est là que les critères de la réforme sociale peuvent être liés à la réciprocité internationale, car la constitution d'une telle coalition nécessiterait des coalitions et des alliances fortes au niveau national et international.
Par exemple, soutenir les revendications d'autodétermination des Autochtones au sein du Canada conformément aux critères de réciprocité internationale mettrait également à l'épreuve les intérêts du capital minier et financier canadien. Toute possibilité de transformation sociale et politique sera sévèrement limitée tant que le capital canadien sera en mesure d'extraire des ressources naturelles sous le couvert du projet colonial de peuplement de l'État canadien. Le capital minier et financier canadien a joué un rôle central dans l'adoption de politiques néolibérales ainsi que dans l'affaiblissement de la qualité et du fonctionnement de la démocratie libérale au niveau fédéral et dans toutes les provinces. La remise en question de ces fractions de capital à l'échelle nationale aurait également une incidence sur le rôle impérial du Canada, car ces groupes comprennent souvent les mêmes entreprises, ou ont des liens étroits avec elles, qui exercent leurs activités en Amérique latine et en Afrique. Cela donnerait lieu à une solidarité avec les nations autochtones situées au Canada ainsi qu'avec les mouvements sociaux d'Amérique latine et d'Afrique qui luttent contre ces fractions du capital canadien dans leur propre pays.
En termes de réciprocité internationale avec le Québec, les projets de réforme sociale substantielle dans la province nécessiteront également l'absorption de fractions du capital qui y opèrent ainsi que dans le reste du pays. Comme le soutiennent Andrea Levy et André Frappier, un tel projet impliquerait non seulement la transformation de l'État provincial québécois, mais aussi de l'État fédéral canadien. Le mouvement de libération nationale au Québec devrait regarder au-delà d'une perspective nationaliste étroite et se joindre aux forces politiques du reste du Canada ainsi qu'aux nations autochtones pour construire une alliance anti-impérialiste qui remettrait en question le rôle impérialiste de l'État canadien au pays et à l'étranger. De manière critique, comme le soulignent Frappier et Levy, une telle alliance devrait reposer sur une reconnaissance mutuelle du droit à l'autodétermination nationale.
Les projets démocratiques populaires et le contexte canadien
Historiquement, il y a eu des tentatives d'affirmer des conceptions démocratiques populaires de la nation, généralement présentées comme un nationalisme de gauche. Par exemple, dans son Manifeste de Regina de 1933, la Fédération du Commonwealth coopératif (FCC) a soutenu que son objectif était d'établir un Commonwealth coopératif qui permettrait « une véritable autonomie gouvernementale, fondée sur l'égalité économique ». Bien qu'il ait affirmé qu'il ne voulait pas interférer avec les « droits culturels » des minorités, il a également appelé à donner au gouvernement national plus de pouvoir pour contrôler le développement économique national. Cet accent mis sur la centralisation du pouvoir entre les mains du gouvernement fédéral et du développement économique a placé la CCF ainsi que son successeur, le NPD, dans une relation difficile avec l'aspiration des Québécois à l'autodétermination. De plus, les gouvernements provinciaux de la CCF et du NPD ont souvent poursuivi des programmes d'extraction des ressources et de modernisation économique qui ont favorisé le projet colonial de peuplement en relation avec les nations autochtones. Il suffit de regarder, par exemple, la confrontation entre le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique et les nations autochtones au sujet du projet de barrage hydroélectrique du site C qui a inondé leurs territoires traditionnels. On peut donc dire que la conception sociale-démocrate prédominante du nationalisme de gauche canadien a fait défaut en ce qui concerne la réciprocité internationale au Canada.
Lorsqu'il s'agit des critères de réforme sociale, les réalisations législatives des gouvernements de la CCF et du NPD au niveau provincial ne doivent pas être rejetées sommairement. En fait, c'est un gouvernement de la CCF de la Saskatchewan qui a mis sur pied le premier régime d'assurance-maladie public complet du pays en 1961, ce qui, bien sûr, a joué un rôle non négligeable dans l'adoption ultérieure de la Loi canadienne sur la santé par le gouvernement fédéral. Un autre exemple de réforme sociale importante est le gouvernement néo-démocrate de Dave Barrett en Colombie-Britannique (1972-1975) qui a accordé aux employés du secteur public tous les droits de négociation, augmenté le salaire minimum ainsi que les taux d'aide sociale, entre autres choses. Il est également important de se rappeler qu'il y a des membres du NPD partout au pays qui participent à des mouvements sociaux communautaires dans leurs communautés ainsi qu'à des syndicats. Cela dit, il n'est pas clair dans quelle mesure les sections fédérales du parti ou provinciales restent engagées dans un programme substantiel de réforme sociale qui mettrait considérablement à l'épreuve les intérêts des fractions canadiennes et étrangères du capital. À tout le moins, il n'est pas controversé d'affirmer que le NPD s'est depuis longtemps écarté des engagements en faveur de la réforme sociale décrits dans le Manifeste de Regina de la CCF.
De plus, bien que Jagmeet Singh ait appelé à une réponse plus conflictuelle aux diverses menaces de Trump que celle offerte par le gouvernement fédéral jusqu'à présent, un premier ministre provincial du NPD a demandé au gouvernement fédéral d'augmenter ses dépenses militaires plus rapidement pour atteindre son objectif de l'OTAN dans le but d'apaiser le nouveau président. En somme, le NPD ne s'est pas trop différencié des autres partis politiques du Canada sur la façon de réagir à Trump. Compte tenu de cela et de la timidité des programmes législatifs de ses différentes sections à travers le pays, nous devons nous demander si le NPD, tel qu'il est actuellement constitué, serait disposé ou capable de développer et de diriger un projet démocratique populaire bénéficiant d'un large soutien pour faire face aux menaces posées par la nouvelle administration présidentielle américaine ainsi que pour faire face à de telles menaces telles que la catastrophe climatique en cours. l'inégalité croissante des revenus, ou la crise du logement au Canada et ailleurs.
Il y a eu plusieurs interventions historiques au sein du NPD qui ont cherché à l'orienter dans une dimension démocratique plus populaire. Peut-être que l'itération la plus significative du nationalisme de gauche au Canada anglais qui mérite d'être mentionnée a émergé avec le Waffle, la fraction de gauche organisée au sein du NPD qui a été formée à la fin des années 1960 et a duré jusque dans les années 1970. Fait important, le Waffle considérait le Canada comme étant sous la domination impériale des États-Unis. Son manifeste (1969) affirmait que : « La question majeure de notre époque n'est pas l'unité nationale mais la survie nationale, et la menace fondamentale est externe, et non interne. » Dans ce contexte, il soutenait que le socialisme était la seule voie pour poursuivre l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Empire américain. Le manifeste expliquait que « le nationalisme canadien est une force pertinente sur laquelle s'appuyer dans la mesure où il est anti-impérialiste ». De plus, le Waffle a reconnu haut et fort le droit du Québec à l'autodétermination, ce qui a mené à une confrontation avec la direction du parti.
En plus de son engagement déclaré à l'égard d'une réforme sociale substantielle, la reconnaissance par le Waffle du droit du Québec à l'autodétermination démontre qu'il est conscient de la nécessité d'intégrer la réciprocité internationale dans son projet « nationaliste de gauche » lorsqu'il s'agit de projets nationaux au Canada. Cependant, comme certains de ses propres dirigeants l'ont reconnu plus tard, il est resté largement silencieux lorsqu'il s'est agi des questions autochtones et a négligé la façon dont le Canada lui-même a pu être dominé économiquement par les États-Unis tout en contribuant et en bénéficiant du projet impérial américain à l'étranger, en particulier en Amérique latine. En d'autres termes, son anti-impérialisme était largement dirigé contre l'empire américain et présentait le Canada comme une victime de l'oppression sans tenir pleinement compte de la façon dont l'État canadien lui-même a participé à l'oppression nationale à l'échelle nationale par rapport aux nations autochtones et à l'impérialisme à l'étranger.
La New Politics Initiative (NPI) du début des années 2000 peut peut-être être considérée comme une deuxième tentative de faire évoluer le NPD dans une direction démocratique plus populaire. Contrairement à la Gaufre, le NPI n'a pas été conçu comme un projet nationaliste explicitement de gauche. Il s'agissait toutefois d'une tentative d'articuler une sorte de projet démocratique populaire. Dans le cadre du « processus de renouvellement » du NPD de cette période, les partisans du NPI cherchent à mettre fin à la dérive du NPD vers le centre. Le NPI a également cherché à exploiter la montée du mouvement anti-mondialisation naissant de l'époque pour le reconnecter avec les mouvements sociaux de base en mettant l'accent sur l'importance de « l'activisme pour le changement social et de la démocratie participative ». Il a promu un programme de réformes sociales qui, entre autres choses, promettait de réinvestir dans les services publics et de faire face au « pouvoir accru des entreprises ».
En ce qui a trait à la réciprocité internationale, l'IPN a été très directe dans la reconnaissance du droit du Québec à l'autodétermination ainsi que de son droit d'administrer ses propres programmes sociaux. En ce qui concerne l'autodétermination des Autochtones, l'un de ses documents de travail a fait référence à la nécessité d'obtenir « justice pour les Premières Nations », mais la question ne semblait pas être une priorité clé. De plus, ses documents étaient assez muets sur la question de l'impérialisme canadien. D'une manière qui était cohérente avec la politique anti-mondialisation de l'époque, il mettait l'accent sur le rôle des institutions intergouvernementales comme l'OMC et le FMI dans la promotion du « capitalisme d'entreprise mondial » tout en reconnaissant le rôle des États individuels dans leur établissement. Cependant, malgré l'appel à l'« internationalisme radical », il n'y a aucune mention spécifique du rôle de l'impérialisme canadien dans la promotion de ce programme ainsi que de ses activités impérialistes à l'étranger. En fin de compte, malgré tous les efforts de ses partisans, l'initiative du NPI a été rejetée par les délégués lors d'un congrès spécial du NPD en 2001.
Le fait que le NPD s'éloigne d'une réforme sociale substantielle et d'une réciprocité internationale suggère que, à lui seul, le parti ne s'engagera pas unilatéralement dans un projet démocratique populaire. De plus, les expériences du Waffle et de l'INP indiquent qu'essayer d'articuler un tel projet uniquement par l'intermédiaire du NPD en le transformant de l'intérieur se solderait probablement par une défaite. Néanmoins, un projet démocratique populaire, qu'il implique ou non la création d'une alternative politique au NPD, devrait trouver un moyen de s'engager de manière constructive avec le parti et, plus important encore, avec ses militants de base à travers le pays. Pour le meilleur ou pour le pire, le NPD demeure l'une des rares forces progressistes, avec les syndicats, à disposer d'une infrastructure organisationnelle pancanadienne.
Ces expériences passées soulèvent la question difficile de savoir à quoi pourrait ressembler concrètement un projet démocratique populaire dans la conjoncture actuelle et quelles premières mesures tangibles pourraient être prises pour construire un tel projet. Pour commencer, il pourrait être utile d'aborder ce qu'un tel projet pourrait être ou non. Il est préférable de concevoir un tel projet comme une orientation stratégique plutôt que comme un programme défini de politiques devant être mis en œuvre par un acteur politique prédéterminé (tel qu'un nouveau parti politique). Cette orientation pourrait servir de point de ralliement stratégique pour fédérer les progressistes et les socialistes à travers le pays, qui pourraient ensuite élaborer un projet commun visant à remettre en question les structures de pouvoir municipales, provinciales et nationales sur la base des principes directeurs de la réciprocité internationale et des réformes sociales substantielles. Il n'aurait pas besoin au départ de l'approbation formelle d'organisations entières, telles que les syndicats et les ONG, mais pour être viable, le projet devrait finalement attirer des militants de tous les mouvements sociaux, syndicats et partis politiques existants.
L'organisation d'une réunion ou d'une série de réunions centrées sur la construction d'un projet démocratique populaire à l'échelle nationale pourrait constituer un premier pas réalisable. Il y a un précédent relativement récent ici sous la forme des rencontres qui ont eu lieu à travers le pays en amont du Forum social des peuples à Ottawa en 2014 et qui a réuni des représentants de la gauche québécoise, de la gauche du Canada anglais et des nations autochtones. Pour être clair, ces rencontres n'ont pas abouti à l'articulation d'un projet de démocratie populaire pancanadien en termes de programme concret et d'institutions formelles pérennes. Cependant, la détérioration continue des conditions sociales, économiques et politiques au Canada ainsi que les menaces émanant des États-Unis depuis lors pourraient signifier qu'il y a plus d'appétit pour un projet aussi formel et durable. Les discussions sur la forme institutionnelle spécifique que devrait prendre un projet de démocratie populaire – par exemple, si un tel projet serait parlementaire en plus d'être extraparlementaire, ou s'il nécessiterait la création d'un nouveau parti politique – pourraient être débattues et décidées dans le cadre d'une telle initiative.
Conclusion
La gauche canadienne se trouve au bord du précipice : à moins qu'elle ne relève le défi de construire un projet démocratique populaire viable à l'échelle nationale, elle continuera de s'affaiblir face à des forces réactionnaires nationales et internationales de plus en plus puissantes. S'il opte pour la seconde, il ne pourra pas continuer à compter sur les protections juridiques formelles de la démocratie libérale, aussi limitées soient-elles, tant elles continuent d'être sapées. La réalité, c'est que bon nombre des fonctions de base du système politique canadien reposent sur des conventions non écrites, et que des normes intra-élites le rendent particulièrement vulnérable à une droite canadienne de plus en plus sans scrupules et autoritaire. Les conditions de la lutte des mouvements sociaux (protections juridiques, par exemple) au niveau local à travers le pays continueront donc à se détériorer, tout comme les conditions sociales, politiques et économiques continueront de se détériorer. De plus, le Canada serait ainsi rendu de plus en plus vulnérable au genre de menaces lancées par Trump ces derniers mois.
L'idée de construire un nouveau projet de démocratie populaire à l'échelle nationale peut susciter une certaine réticence chez les progressistes et les socialistes canadiens, pour qui elle pourrait évoquer des formes plus réactionnaires de nationalisme qui sont liées au projet colonial de peuplement du pays. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'un projet démocratique populaire soit conçu comme un projet nationaliste d'une manière qui répète les erreurs du passé, ni qu'il s'attaque à des symboles nationaux existants qui sont exclusifs ou compromis de manière globale. Un projet démocratique populaire guidé par la réforme sociale et la réciprocité internationale peut s'aligner sur les revendications d'autodétermination nationale des Québécois et des Autochtones, tout comme il peut être anti-impérialiste. Un tel projet peut et doit être aligné sur les valeurs socialistes.
Marcel Nelson est professeur de sciences politiques au Collège Sheridan, en Ontario.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tarifs et assurance-emploi : « Ne rien faire serait une grave erreur » selon le Conseil National des Chômeurs et Chômeuses

Montréal, le 5 février 2025 – Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) invite le gouvernement fédéral à agir pour que le programme d'assurance-emploi permette aux travailleurs et travailleuses de faire face aux conséquences de la guerre tarifaire avec les États-Unis, malgré le sursis annoncé lundi.
« On ne peut pas entrer dans des situations économiques difficiles sans avoir un système d'assurance emploi qui est juste, équitable et adapté aux réalités du XXIe siècle. Les travailleurs et travailleuses ont besoin de mieux, dès maintenant. Peu importe la suite des événements, avec les incertitudes, il faut vraiment solidifier notre filet social », a déclaré Selma Lavoie, co-porte-parole du CNC.
Le Conseil national des chômeurs et chômeuses considère que le gouvernement doit avoir appris sa leçon de la pandémie et des feux de forêts et mette en place des mécanismes permettant de répondre à des situations de crise qui continueront d'émerger au cours des prochaines années.
« Le système a échoué à la première semaine de la COVID-19. On ne peut pas se fier au système actuel. Et Donald Trump est encore plus imprévisible qu'une pandémie. Le gouvernement a donc le devoir de procéder à une réforme pour rendre le programme plus juste, mais aussi plus robuste et capable d'affronter les prochaines tempêtes, se basant sur les mesures temporaires de la pandémie. Ne rien faire serait une grave erreur », a déclaré Milan Bernard, co-porte-parole du CNC.
Le CNC est aussi déçu de la résignation exprimée par le Premier ministre du Québec, François Legault, qui a cavalièrement suggéré de mettre en place un programme de requalification pour les travailleurs et travailleuses qui perdraient leur emploi. Si le CNC considère qu'il est urgent que les gouvernements agissent pour préparer la transformation vers une économie durable, ces initiatives, qui doivent être sincèrement écologiques, ne peuvent et ne doivent pas remplacer le nécessaire filet social assurant la dignité des citoyens et citoyennes. Elles ne peuvent forcer qui que ce soit à quitter sa profession, sa région et son mode de vie, ni abandonner des secteurs névralgiques de l'économie québécoise.
Enfin, le CNC souhaite également démontrer sa pleine solidarité envers les victimes de l'administration Trump, notamment les membres de la diversité sexuelle et ceux et celles issus de l'immigration.
À propos du CNC :
Fondé en 2005, le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) est la force organisée de défense et de promotion des droits des chômeurs et chômeuses, et plus largement des travailleurs et travailleuses. Il rassemble une dizaine d'organismes locaux et régionaux se voulant des acteurs proactifs pour une réforme globale du programme de l'assurance-emploi.
Þ Pour en savoir plus : www.lecnc.com
Source : Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Personne n’est illégale ! Solidarité sans frontières dénonce la violence étatique envers les personnes migrantes et appelle à la solidarité

8 février 2025, Montréal - Solidarité sans frontières dénonce la violence croissante de l'État envers les personnes migrantes aux États Unis, mais aussi au Canada et au Québec, et appelle à la solidarité. Plusieurs migrant-e-s qui s'impliquent dans le réseau ont pris la parole lors d'une conférence de presse aujourd'hui.
« Je souhaite aujourd'hui envoyer un message de solidarité envers nos frères et sœurs migrantes aux États Unis, qui subissent un traitement inhumain. Ils ont dû quitter leur pays de force, souvent par la faute de l'impérialisme mis en place par les Etats-Unis eux-mêmes. Il est inhumain de détenir ces personnes, et de les déporter. Au nom de Solidarité sans
frontières, je souhaite exprimer ma solidarité aux personnes migrantes des États-Unis ; aux personnes sans papiers qui ont peur de se faire attraper ; aux familles qui sont séparées ; aux détenus de Guantanamo ; et à toutes les personnes qui cherchent la dignité. Les sans papiers ne sont pas illégaux ; personne n'est illégal, ni aux États-Unis, ni ici. », a déclaré
Cristian.
« Nous exigeons que le Canada se retire immédiatement de l'Entente sur les tiers pays sûrs avec les Etats.-Unis.. Les Etats.-Unis. ne sont pas un pays sûr pour les personnes migrantes. Nous dénonçons la décision du Canada d'accroître la surveillance policière à la frontière en réponse aux pressions de Trump. Cela ne fait que rendre la frontière encore plus dangereuse. La semaine dernière, une autre personne est décédée ; les migrants sont devenus déshumanisés au point que son nom n'a même pas été annoncé. Ouvrez les frontières ! » a continué Hady Anne.
« Nous demandons que les politiciens cessent de nous utiliser comme des boucs émissaires. Les sans-papiers ne sont pas la cause des crises de logement ni du coût de la vie. Les sans-papiers sommes parmi les plus durement touchés, les plus exploités, et souffrirons le plus d'une autre crise économique, » a proclamé Samira Jasmin.
« Les sans-papiers sont privés de soins et vivent dans la peur et le doute, séparés de leur proches. Leurs enfants, à qui ils ont promis une vie meilleure, sont plus vulnérables. Lorsqu'ils se pointent pour un travail, on leur demande un permis de travail. Sans compter les procédures bureaucratiques et souvent longues pour avoir un statut, qui parfois
n'aboutissent à rien, bien que ces immigrants aient passé de longues années au Canada et soient venus avec un statut légal, tel un permis de travail fermé, » a continué Yasser.
« C'est pourquoi la promesse non tenue de Justin Trudeau
<https://www.pm.gc.ca/fr/lettres-de-...>
et de Marc Miller pour un programme de régularisation massif est plus pertinente que jamais. La régularisation des personnes sans papiers est très importante ici, aux États unis et partout au monde. Le bon moment pour lancer un programme de régularisation massif, sans exception ni discrimination, c'est maintenant, » a déclaré Farid.
« Nous voyons la violence envers les migrant-e-s augmenter à travers le continent. Pour cette raison, nous rappelons que la Ville de Montréal a déclaré en 2017 que Montréal est une ville sanctuaire. Cela ne s'est jamais concrétisé, jusqu'à ce jour. Nous demandons encore une fois à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de créer une véritable ville sanctuaire à Montréal pour protéger les personnes sans papiers. Les gens ne devraient
pas avoir à cacher leur visage, et tout le monde devrait avoir accès aux services de la ville ! C'est également primordial de couper les liens entre la police et l'ASFC. » a poursuivi Yassine.
« Dans le contexte actuel, nous appelons à la solidarité et à l'entraide entre toutes les personnes aux premières lignes des crises économiques - migrant-e-s ou pas- au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et ailleurs dans le monde. Nous réclamons la dignité et le respect pour tout le monde : une cité sans frontières solidaire, » a dit Samira Jasmin.
« Le monde appartient à toute l'humanité, et nous méritons tous et toutes d'avoir la paix et la stabilité, sans discrimination de race, de couleur de peau, d'origine, de conditions physique, etc. Le statut ne devrait jamais être un privilège, obtenu au mérite, mais plutôt un droit, un acquis. » a conclu Bénédicte Carole Zé.
Source : Solidarité sans frontières
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le 8 mars, signez et marchez pour un avenir juste et égalitaire pour toutes !

Le collectif 8 mars joint sa voix aux messages politiques de la CQMMF afin de converger vers une société basé sur les valeurs féministes.
Le 8 mars, nous serons en action pour dénoncer ensemble :
🔥 Les violences envers les filles et les femmes
🔥 La pauvreté qui représente une violence systémique
🔥 Le capitalisme destructeur du climat et de la biodiversité
Signez cette lettre du Collectif 8 mars qui appuie nos orientations.
Pour sogner la pétition cliquez ici
Nous sommes des femmes et des personnes alliées de toutes les générations, origines, milieux et régions du Québec combattant pour un monde meilleur et plus égalitaire.
En cette Journée internationale des droits des femmes, nous appuyons le lancement des actions entourant la Marche mondiale des femmes (MMF). Ce mouvement féministe international lutte contre les violences, les inégalités économiques et les injustices sociales. Depuis 25 ans, la MMF mobilise des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour exiger des changements profonds et durables.
Au Québec, le 18 octobre prochain, au lendemain de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous marcherons pour un monde où les droits des femmes ne sont pas un privilège, mais bien une réalité. Nous marcherons avec une force collective, portée par trois grandes orientations :
1. La fin des violences faites aux femmes
En 2023, au Québec, près d'une femme sur trois a déclaré avoir subi de la violence physique ou psychologique au cours de sa vie[1]. Tous les deux jours, une femme ou une fille est assassinée au Canada, le plus souvent par un partenaire ou un ex-conjoint[2]. Ailleurs dans le monde, les femmes font aussi face à différentes formes de violences. Par exemple, dans des contextes de guerre ou d'urgence climatique, une femme réfugiée sur cinq est confrontée à des violences sexuelles. Dans plusieurs pays, de l'Afghanistan aux États-Unis, les droits des femmes régressent sans cesse. Cette réalité est insoutenable. Il faut des politiques fermes et des ressources accessibles pour mettre fin à ces fléaux.
2. L'éradication de la pauvreté vécue par les femmes
Les femmes représentent 70 % des personnes vivant dans la pauvreté à travers le monde[3]. Ici, au Québec, elles continuent d'être majoritaires dans les emplois précaires et sous-payés. Au Canada, en 2024, une femme gagne encore en moyenne 71 % du salaire annuel d'un homme. Cet écart s'élargit pour les femmes racisées, les femmes autochtones et les femmes en situation de handicap [4]. Cela doit cesser. Nous exigeons des mesures pour garantir une réelle sécurité économique à toutes les personnes.
3. La justice climatique et environnementale féministe
Les femmes, surtout les plus vulnérables, sont les premières touchées par les changements climatiques. Dans le monde, 80 % des personnes déplacées par des catastrophes climatiques sont des femmes [5]. Pourtant, elles sont souvent exclues des décisions concernant l'environnement. À la conférence sur le climat des Nations Unies en novembre 2024, seulement 24 % des personnes à la tête des délégations étaient des femmes [6] . Nous exigeons une transition écologique féministe et inclusive.
Se mettre en action pour la Marche mondiale des femmes, ce n'est pas seulement être présent-es une journée. C'est s'engager dans une lutte. C'est mobiliser notre entourage, interpeller nos élu-es, exiger des changements réels et immédiats.
Références :
[1] D'après les statistiques sur la violence conjugale de l'Institut national de santé publique du Québec.
[2] Selon une étude du « Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability » menée en 2018 et relayée par Radio-Canada en 2019.
[3] Selon les repères statistiques du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes de France.
[4] Selon la compilation de données sur l'écart de rémunération entre les genres de la Fondation canadienne des femmes.
[5] Selon l'article de l'ONUinfo intitulé « Les femmes sont les premières victimes de la crise climatique, selon la COP26 ».
[6] Selon les chiffres de l'organisation Gender Climate Tracker.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Interroger Pornhub

À vous, député.e.s le moment est venu d'interroger Pornhub sur sa responsabilité sociale envers les jeunes
Dans le cadre de la Commission spéciale sur les écrans et réseaux sociaux, vous rencontrerez les dirigeants de Pornhub et aurez l'occasion d'avoir un échange transparent avec leurs représentants. Si nous avions l'occasion d'être à vos côtés, voici ce que nous demanderions.
À la suite des nombreux recours collectifs et scandales liés à la présence de contenus pédopornographiques, de viols et de vidéos partagés de façon non consensuelle, vous avez annoncé avoir modifié le fonctionnement de votre plateforme web en supprimant 80 % des contenus jugés illégaux et en mettant en place des mesures de contrôle de l'identité des utilisateurs téléversant du contenu pornographique. Aylo a d'ailleurs précisé dans un courriel adressé à La Presse que ces mesures incluent un programme de vérification utilisant la reconnaissance faciale biométrique afin de confirmer l'identité du fournisseur de chaque vidéo téléversée et une vérification du consentement de chaque personne que la compagnie appelle des « coperformeurs ».
Est-il juste d'affirmer que le consentement des « coperformeurs » ne sont pas soumis à la même rigueur de vérification de reconnaissance faciale ? Est-il juste d'affirmer que le processus de vérification repose en grande partie sur la documentation fournie par la personne qui téléverse le contenu et que celle-ci pourrait être falsifiée ou manipulée par une personne mal intentionnée ? Pouvez-vous expliquer comment le consentement de chaque individu, chaque « coperformeur », apparaissant dans les vidéos est garanti, et pas seulement celui de la personne qui télécharge la vidéo ?
Dans la vaste enquête de Laila Mickelwait ayant mis les projecteurs sur le laxisme de Pornhub en matière de gestion de contenu pédopornographique, plusieurs victimes ont rapporté des délais importants pour faire retirer des vidéos, même après avoir fourni des preuves. On y apprenait également que le nombre de modérateurs était nettement insuffisant pour traiter efficacement le volume de contenu téléchargé. Aujourd'hui, comment fonctionne votre processus de signalement et quel est le temps moyen nécessaire pour supprimer les contenus illicites une fois signalés ? Combien de modérateurs avez-vous engagés pour traiter efficacement le volume de contenu téléchargé ?
Tout comme les entreprises de vente d'alcool et de produits du tabac ou encore les entreprises qui vendent des produits liés à la sexualité, communément appelés sexshop, ont la responsabilité de s'assurer qu'elles ne vendent pas ce type de produits aux jeunes, vous avez la responsabilité de prévenir l'accès des mineurs à des contenus pornographiques. Estimez-vous prendre des mesures aussi rigoureuses que ces entreprises pour restreindre l'accès à vos contenus ? Concrètement, quelles mesures mettez-vous en place pour empêcher l'accès des mineurs à votre plateforme ? Étant donné que vous utilisez déjà un processus de vérification de reconnaissance biométrique pour les personnes qui téléversent des vidéos sur Pornhub, pourquoi ne pas l'appliquer à tous les utilisateurs, consommateurs, du site afin de garantir que l'accès au contenu pornographique soit restreint aux adultes uniquement ?
Finalement, nous aimerions demander aux représentants de Pornhub ce qu'ils pensent des effets de la consommation d'une pornographie qui normalise et banalise trop souvent les violences faites aux femmes sur les jeunes. Estiment-ils qu'une exposition répétée à ces vidéos pourraient façonner et influencer leur développement psychosexuel ?
Signataires
Sophie Cengarle-Samak (chargée de projet aux Espaces V.I.E. et enseignante)
Martine B. Côté, doctorante en Droit
Jay Dionne, survivant.e. et militant.e. féministe
Noémie Villecourt, survivante d'exploitation sexuelle et maman
Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Julie Antoine, coordonnatrice générale de la Coalition Féministe contre la Violence envers les Femmes (CFVF)
Marie Soleil Desrosiers, intervenante liaison au CALACS de Trois-Rivières
Marie-Michèle Withlock, intervenante au CALACS Agression Estrie
Stacey Caceus, co-fondatrice Amistad PIR
Corinne Vézeau, coordonnatrice de projet à la Maison de Marthe
Sylvie Brunelle, militante féministe
Judith Sasseville, sexologue
Joannie Lasnier, militante féministe
Virginie Dostie-Toupin
Anne-Josée Péloquin, directrice adjointe de La Méridienne
Le collectif Asian Women for Equality
Bailaou Diallo, coordonnatrice Un toit pour elles
Maude Dessureault-Pelletier, M.A. T.S., Intervenante sociale en exploitation sexuelle, CALACS du Saguenay ;
Christine Audet, Responsable des luttes collectives et de la vie associative, CALACS du Saguenay
Geneviève Villeneuve, Agente administrative, CALACS du Saguenay
Virginie Tremblay, Intervenante sociale, CALACS du Saguenay
Sabrina Gobeil, Intervenante sociale, CALACS du Saguenay ;
Naomie Couture, T.T.S., Intervenante sociale, CALACS du Saguenay ;
Joannie Desbiens Dionne, T.S. Responsable du volet prévention et concertation, CALACS du Saguenay ;
Gabrielle Perron, T.S. Intervenante sociale, CALACS du Saguenay ;
Julie Durand, T.S., intervenante sociale, CALACS du Saguenay ;
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
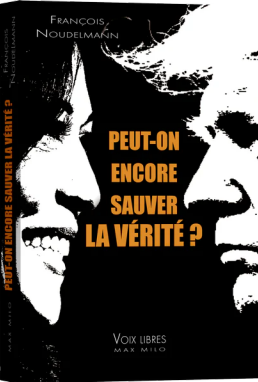
François Noudelmann, Peut-on encore sauver la vérité ?
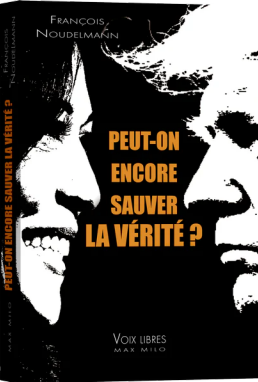
Tiré de la page web
https://www.fabula.org/actualites/125571/francois-noudelmann-peut-on-encore-sauver-la-verite.html
Paris, Max Milo, coll. "Voix libres", 2024
EAN : 9782315022656
218 pages
Prix : 19,90 EUR
Suggestion de lecture d'André Cloutier
Publié le 06 Février 2025 par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Bruno Clément)
François Noudelmann, qui enseigne dans les universités américaines depuis vingt-cinq ans, est frappé par la nouvelle pratique du mensonge en politique, et en particulier depuis l'élection de Donald Trump en 2016. Les contre-vérités sont diffusées comme des « faits alternatifs » : à chacun son interprétation. Nous serions entrés dans l'ère de la post-vérité, porte ouverte aux fake news et aux manipulations les plus grossières.
Le but de cet essai est de retracer le chemin qui a mené à ce relativisme depuis une quarantaine d'années : le règne du storytelling, l'empire de l'émotion, la politique des identités, l'idéologie victimaire, la cancel culture, la déconstruction philosophique, l'autofiction et l'exofiction, la virtualisation du monde par l'intelligence artificielle… ont démoli la raison occidentale.
Pour sauver la vérité et la positivité des faits, François Noudelmann explore dans cet essai d'autres voies particulièrement instructives et novatrices, comme l'indignation devant le mensonge ainsi que l'alliance du doute et de la révolte, qui permettent de croire encore à un langage commun.
François Noudelmann vit à New York. Il est professeur de philosophie et de littérature à New York University. Ancien président du Collège international de philosophie, il est l'auteur de nombreux essais, traduits dans une douzaine de langues. Il a notamment publié : Le toucher des philosophes. Sartre, Nietzsche et Barthes au piano (Gallimard, 2008, grand prix des Muses 2009), Les airs de famille ; une philosophie des affinités (Gallimard, 2012), Le génie du mensonge (Max Milo, 2015), Penser avec les oreilles (Max Milo, 2019), Un tout autre Sartre (Gallimard, 2020).
Url de référence :
https://maxmilo.com/products/peut-on-encore-sauver-la-verite?srsltid=AfmBOopADeS6TweTyFZGod-az9BjPWcTwTHOh0-KAhlS2mNJRrEAe5Jd
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
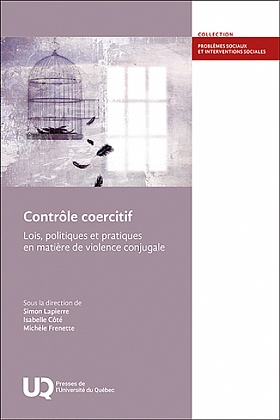
Problèmes sociaux et interventions sociales
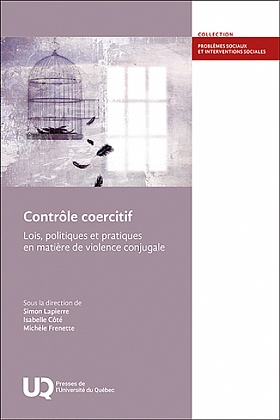
Sous la direction de
Simon Lapierre , Isabelle Côté , Michèle Frenette
Avec la collaboration de
Collaborateurs
Collection
Résumé
Qu'impliquent les notions de « contrôle » et de « coercition » pour les victimes de violence conjugale ? Comment changer de paradigme afin de considérer cette problématique à travers le prisme de la « privation de liberté » et non seulement sous l'angle de la « sécurité » des victimes ?
La conceptualisation du contrôle coercitif a été l'une des avancées les plus importantes dans le domaine de la violence conjugale. Elle permet ainsi de s'éloigner de l'accent mis sur les incidents « uniques » ou « isolés ». Néanmoins, très peu d'écrits sur le contrôle coercitif sont proposés en français. Cet ouvrage cherche à pallier ce manque.
Il aborde, d'une part, les avancées conceptuelles. Pour ce faire, il s'appuie sur des résultats de recherche ainsi que sur les écrits les plus récents dans diverses disciplines, incluant le travail social, le droit, la sociologie, la criminologie et les études féministes et de genre. D'autre part, il met de l'avant l'intégration de ce concept dans les lois, les politiques et les pratiques de divers secteurs. Bien que les contextes québécois et canadien soient privilégiés, les développements sur la scène internationale sont également abordés.
Contrôle coercitif offre au lectorat des pistes de réflexion d'action pour les secteurs de la violence conjugale, du droit et de la protection de la jeunesse.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

De plus en plus de milieux humides détruits et la solution du Ministère n’est pas la bonne

Deux sujets touchent directement les rivières : un affaiblissement de la crédibilité du BAPE et un assouplissement au programme de compensation des milieux humides et hydriques.
Juste avant Noël, le ministre de l'Environnement a déposé un important projet de loi omnibus dont les 178 modifications techniques pourraient avoir des impacts importants sur la protection de l'environnement. Deux sujets touchent directement les rivières : un affaiblissement de la crédibilité du BAPE et un assouplissement au programme de compensation des milieux humides et hydriques.
Sous prétexte d'accélérer la réalisation des projets énergétiques, le projet de loi 81 permettra au ministre d'autoriser un promoteur à réaliser des travaux pour un projet qui n'a pas encore été autorisé par le BAPE. En quoi l'audience d'un BAPE sera crédible si des pépines sont en train de déboiser des forêts ou de creuser des routes ?
Une destruction qui a presque triplé en 4 ans
Le 29 janvier, nous avons pu exposer notre point de vue au ministre de l'Environnement, Benoit Charette, en commission parlementaire. On lui a rappelé que la destruction de milieux humides et hydriques a presque triplé depuis 2020, passant de 75 ha à près de 200 ha par an et que seulement 30 ha ont été restaurés sur les 760 ha détruits.
C'est ce qu'on peut constater à la lumière de notre analyse détaillée de toutes les données disponibles sur le programme de restauration des milieux humides et hydriques entre août 2017 et février 2024. Cette analyse est complète et publique et La Presse en a fait un bon résumé.
Nos recommandations
Le système de compensation est brisé et le PL81 ne règlera pas le problème. Maëlle, Gabriel et moi, on y est donc allé de nos suggestions pour corriger le tir :
– Créer un répertoire public pour les lots disponibles à la restauration, notamment dans les zones à risque inondables.
– Exiger des compensations par travaux pour les destructions de milieux humides.
– Demander au Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) de mesurer et d'analyser la performance de ses actions d'évitement et de minimisation des impacts.
Consulter le mémoire
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
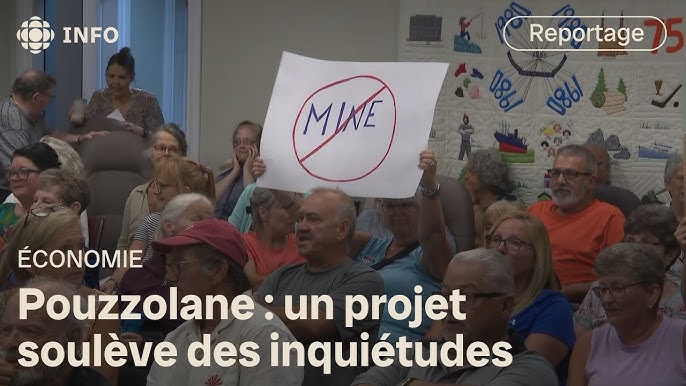
Le groupe Non Merci, Pozzolan Dalhousie ! demande une évaluation d’impact environnemental fédérale pour le projet de mine à Dalhousie
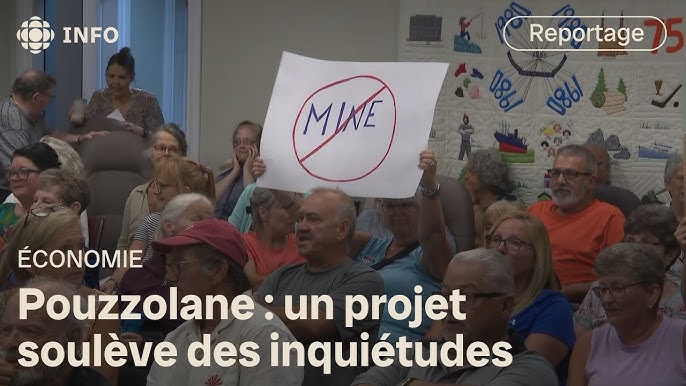
Nouvelle (Québec), 10 février 2025. – Le 10 février 2025, le groupe citoyen Non merci, Pozzolan Dalhousie ! a envoyé une lettre (en pièce jointe) à Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique,
Groupe de citoyen(ne)s gaspésien(ne)s
Nouvelle (Québec), 10 février 2025. – Le 10 février 2025, le groupe citoyen Non
merci, Pozzolan Dalhousie ! a envoyé une lettre (en pièce jointe) à Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick, à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à François Legault, premier ministre du Québec, à Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, à Louise Imbeault, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, à Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et à tou(te)s les ministre(s) concerné(e)s aux niveaux fédéral et provincial, exprimant ses inquiétudes quant aux conséquences environnementales, sociales et économiques du projet de mine de pouzzolane à ciel ouvert de la société EcoRock et demandant qu'une évaluation d'impact fédérale soit réalisée.
Selon l'échéancier prévu par la société, une évaluation d'impact environnemental sera effectuée pour le Nouveau-Brunswick, mais pas pour le Québec. Or, l'éventuelle mine de pouzzolane se trouverait à moins de trois kilomètres des rives gaspésiennes. Pour le groupe citoyen, les répercussions sur le territoire de la Baie-des-Chaleurs seraient
inévitables.
D'ailleurs, on peut lire dans le rapport émis par EcoRock
<https://www.ecorock.com/_files/ugd/...> suivant la rencontre tenue à Carleton-sur-Mer le 29 septembre 2024 : « EcoRock a reconnu l'impact que le projet pourrait avoir sur la Baie-des-Chaleurs au niveau du terminal portuaire, du dragage et des sédiments qui devront être retirés, mais ne s'est pas prononcé sans équivoque sur les autres impacts possibles sur la Gaspésie. » Dans ce même rapport, on peut lire que la société insiste toutefois que « le gouvernement du Québec n'a pas de juridiction sur le projet, qui est régi par la réglementation du Nouveau-Brunswick ».
Plusieurs des conséquences potentielles du projet cadrent dans les effets négatifs relevant de compétence fédérale, tels qu'exposés dans les modifications proposées à la Loi sur l'évaluation d'impact en vue de la rendre conforme à la jurisprudence la plus récente. Ainsi, une telle évaluation d'impact permettrait de mettre en lumière les risques réels du projet pour l'ensemble des territoires touchés par celui-ci.
Avant d'être acheminée aux différentes personnes nommées plus haut, la lettre a été envoyée à de nombreux acteurs de la Baie-des-Chaleurs, entre autres, et a recueilli 139 signatures en date de l'envoi du présent communiqué, ce qui confirme l'inquiétude partagée au sein de la population relativement à ce projet.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Sur la transition socio-écologique juste et sur l’avenir énergétique du Québec

Pour faire suite au Chantier d'avenir du 23 janvier dernier qui portait sur la transition socioécologique juste et sur l'avenir énergétique du Québec, vous trouverez en cliquant sur l'icône ci-dessous la présentation Powerpoint qui a été faite lors de ce webinaire.
– Photo : Le malheur s'acharne sur les agriculteurs du Québec, Radio-Canada, 22 juin 2020.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
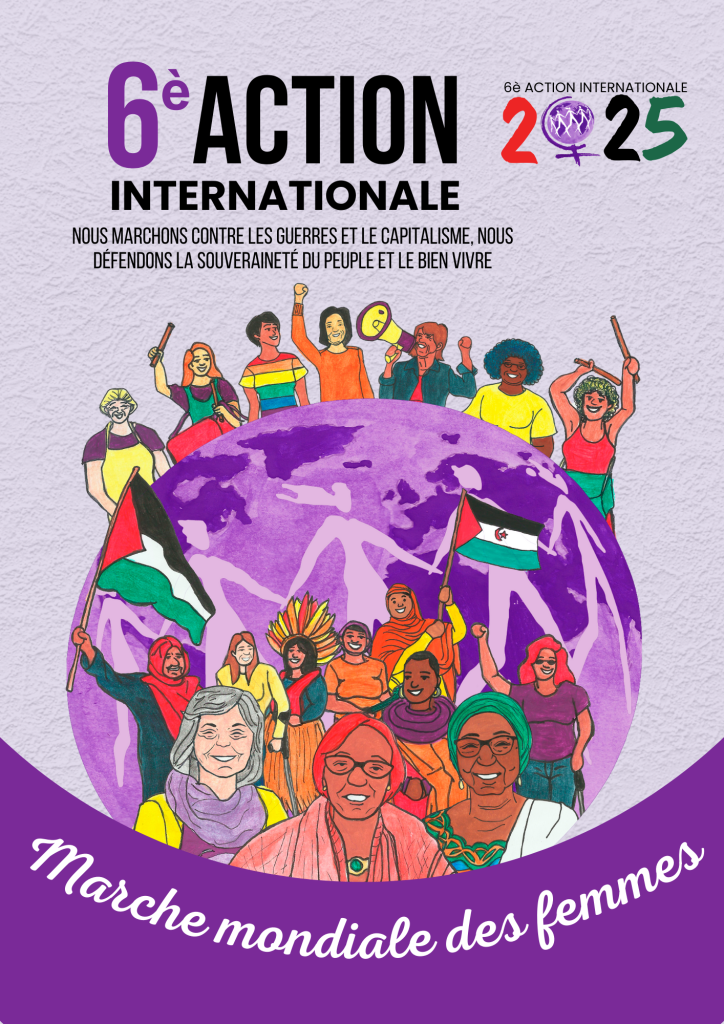
Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, nous défendons la souveraineté des peuples et le Buen Vivir !
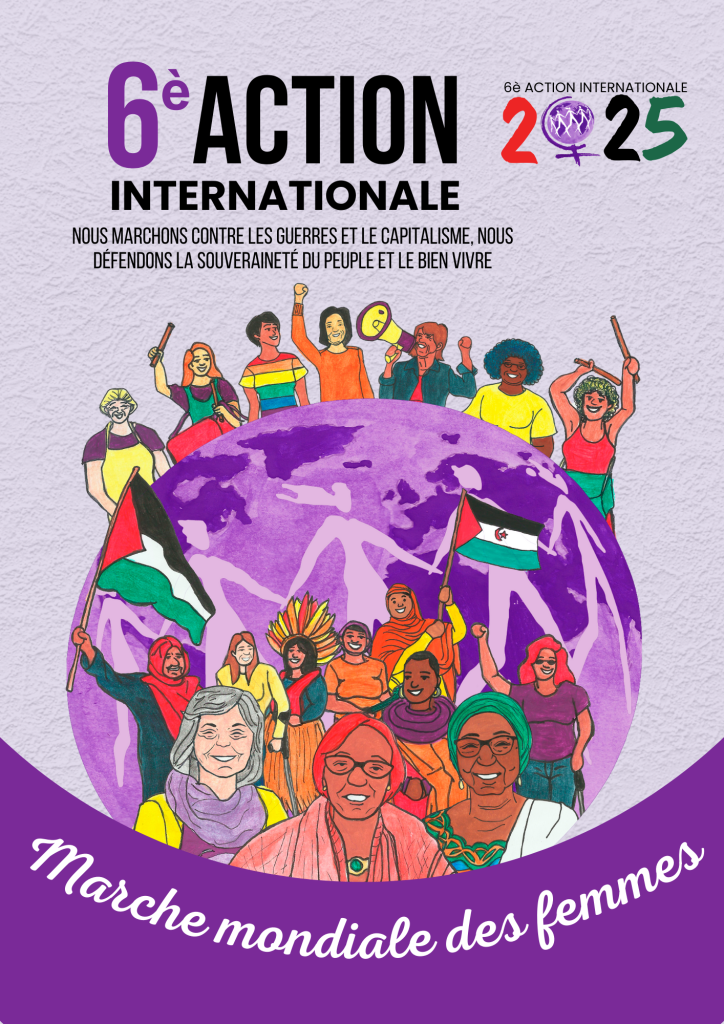
25 ans après le lancement de la Marche mondiale des femmes, cette année, en 2025, du 8 mars au 17 octobre, nous appelons les femmes des mouvements du monde entier à élever leur voix plus fort et plus fort contre les guerres et le capitalisme et pour la souveraineté des peuples et le buen vivir , en collaboration avec la Marche mondiale des femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Cette 6ème action internationale sera un moment de mobilisation globale et d'articulation aux niveaux local, régional et international. C'est le moment de rendre publiques et visibles les alternatives féministes, tout en rassemblant les femmes pour qu'elles partagent leurs idées, discutent des alternatives et construisent un internationalisme féministe de base.
Les quatre domaines d'action de la MMF en 2025 seront les suivants :
– Défendre les biens communs contre les entreprises transnationales
– Économie féministe basée sur la durabilité de la vie et la souveraineté alimentaire
– La fin de la violence contre les femmes, l'autonomie sur le corps et la sexualité
– Paix et démilitarisation
Symbole des actions de 2025 : Tente
Le symbole commun de la MMF en 2025 sera la tente qui représente non seulement le capitalisme du désastre, les guerres, les déplacements et les migrants, mais aussi un abri pour les peuples et la sagesse et la connaissance ancestrales dans de nombreuses cultures. En 2025, elle accueillera nos activités culturelles, nos débats et nos formations et sera décorée de nos symboles culturels, de nos logos et des symboles de nos luttes féministes.
18 février : Conférence de presse en prélude à la 6e action internationale
Le 18 février, Journée internationale de solidarité avec les femmes sahraouies, la MMF organisera un pré-lancement virtuel de sa 6ème action internationale. La diffusion en ligne annoncera le début des activités de la 6ème Action Internationale, prévue pour le 8 mars à Tindouf, Sahara Occidental.
Nous invitons toutes les femmes en mouvement du monde entier à se joindre à nous pour le pré-lancement de la6èmeaction internationale que nous avons organisée avec l'Union Nationale des Femmes Sahraouies à l'occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec les Femmes Sahraouies.
8 mars, début de l'action internationale
La 6ème Action Internationale débutera au Sahara Occidental le 8 mars avec des marches et actions simultanées dans le monde entier. Les 4 jours d'activités à Tindouf se dérouleront dans la « Khayma », tente sahraouie, représentant la lutte de libération du peuple sahraoui. Vous pouvez trouver le livret sur le Sahara Occidental ici.
30 mars, Journée de la Terre de Palestine
La MMF appelle les ONC à organiser des activités le 30 mars pour dénoncer le génocide et se tenir aux côtés des sœurs palestiniennes. Vous pouvez trouver la brochure sur la Palestine préparée par la région MENA ici.
Du 24 avril au Mayday : Semaine de solidarité féministe contre les entreprises transnationales
Du 24 avril au 1er mai, nous nous connecterons globalement à nos dénonciations, à nos alternatives, à notre force de femmes auto-organisées et nous articulerons les luttes locales et les résistances à notre mouvement international.
Bateau féministe pour la paix
Le Bateau Féministe pour la Paix en Méditerranée, cimetière de migrants et de réfugiés, reliera trois continents autour du bassin méditerranéen et sera accompagné d'une formation IFOS de 3 jours sur le bateau. Il naviguera de l'Algérie à la Turquie avec des escales en cours de route.
21 septembre, Journée mondiale de la paix
L'ONC du Népal accueillera, du 21 au 25 septembre, un rassemblement international réunissant des délégués des pays où se déroulent les 6e actions internationales. Les ONC devraient également mobiliser des ressources pour financer leurs délégués afin qu'ils apportent leurs symboles et les exposent dans une grande tente au Népal.
17 octobre, Action féministe de 24 heures contre le capitalisme et les guerres
Le 17 octobre est la date de clôture de l'action internationale. Les ONC sont invités à organiser des actions et des activités de midi à 13 heures dans tous les fuseaux horaires.
* Pour toute information ou question, vous pouvez contacter directement action2025@marchemondiale.org
Unissons-nous pour des économies féministes,
démilitarisons-nous pour la paix et
revendiquons l'autonomie de nos corps et de nos territoires !
https://marchemondiale.org/index.php/2025/02/03/appel-a-la-6e-action-internationale/?lang=fr
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nous ferons les films que nous voulons | Livre à paraître : 25 fév.

Province de Québec, années 70 : des femmes cherchent à briser leur isolement, à contester l'ordre, à se rendre visibles et audibles, à choisir la vie qu'elles souhaitent mener. Une série révolutionnaire de films féministes incarnera leur soif et bouleversera des vies : la série En tant que femmes.
À l'occasion du *50e anniversaire** de **la Journée internationale des femmes* (lancée le 8 mars 1975) et du 50e anniversaire de la diffusion de la série, l'essai *Nous ferons les films que nous voulons** – ONF féministe (1971-1976)* paraîtra *en librairie le 25 février** prochain*.
L'auteur Olivier Ducharme y propose une plongée fascinante dans l'histoire de ces films et tire *un portrait unique des femmes québécoises de l'époque** et de leurs luttes*. Quand les enjeux d'hier résonnent encore aujourd'hui...
En partenariat avec la Cinémathèque québécoise, le film* Souris, tu m'inquiètes* (dans lequel on retrouve Micheline Lanctôt) sera projeté le 12 mars à l'occasion du lancement du livre au Café-Bar de la Cinémathèque (lancement à 17h, projection à 19h). Les autres films de la série *En tant que femmes* seront également projetés en mars (détails à venir le 12
février).
*À propos du livre*
Montréal, 1971. Nous sommes à l'Office national du film du Canada (ONF). Des femmes cinéastes, scénaristes, monteuses, actrices, productrices et camerawomans se réunissent. Un groupe est créé, et de ce groupe naît une série : En tant que femmes. Une série féministe révolutionnaire comportant six long-métrages (documentaires et fictions) produits de 1972 à 1975.
L'objectif ? Briser l'isolement. Contester les rôles imposés aux femmes. Rendre les femmes visibles et audibles en tant que femmes et non en tant que produit du regard masculin.
Tel un kaléidoscope, chacun des films traite de thèmes différents qui composent, une fois réunis, une image plurielle de l'identité des femmes québécoises du début des années 1970. Tous les films privilégient l'interrogation à l'affirmation : on ne dit pas aux femmes quoi faire, on les invite plutôt à remettre en question le monde dans lequel elles vivent.
La seule valeur revendiquée sera la liberté pour chaque femme de choisir la vie qu'elle souhaite mener.
Si ces films sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, ils ont pourtant eu un fort impact en leur temps, comme en témoignent les centaines de lettres bouleversantes envoyées par des téléspectatrices après les projections.
C'est d'ailleurs un des grands mérites d'Olivier Ducharme que de nous replonger dans cette période de l'histoire tout en nous montrant à quel point certains enjeux d'hier résonnent encore aujourd'hui (solitude de la femme face à l'avortement et à la contraception, conciliation travail-famille, etc.).
Mobilisant habilement des témoignages et des archives surprenantes, *Nous ferons les films que nous voulons* renouvelle la forme traditionnelle de l'essai pour faire entendre des voix oubliées qui, pourtant, parlent au présent, à notre présent. Des voix dont la portée politique retentit toujours en 2025, 50 ans après leur première diffusion. Dans cette nouvelle chronique historique dont lui seul a le secret, Ducharme nous immerge ainsi
dans cette époque pas si lointaine où la place des femmes dans le cinéma, et plus largement dans la société québécoise, était loin d'être acquise.
*À propos de l'auteur*
Olivier Ducharme est analyste politique au Collectif pour un Québec sans pauvreté et essayiste. Il a publié, chez Écosociété, *À bout de patience* (2016), *Travaux forcés* (2018), *Ville contre automobiles* (2021) et *1972 : répression et dépossession politique* (2022).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













