Derniers articles
Les politiciens et les grandes entreprises ont vendu la population canadienne

Climat : une échéance cruciale ignorée par 95 % des pays

Seulement 5 % des signataires de l'Accord de Paris ont rendu leur plan pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ceux qui l'ont fait n'ont rien présenté d'ambitieux.
Tiré de Reporterre
12 février 2025
Par Emmanuel Clévenot
À peine plus de 5 %. Telle est la proportion des pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat à avoir rendu leur copie à temps. Ils avaient jusqu'au 10 février pour publier leur nouveau plan de réduction des émissions, baptisé « contributions déterminées au niveau national » dans le jargon des diplomates. Malheureusement, faute de caractère contraignant, seuls 10 des 195 signataires ont respecté cette échéance.
En signant le traité international parisien, lors de la COP21 en 2015, les États s'étaient engagés à soumettre tous les cinq ans une feuille de route détaillant leurs objectifs climatiques à l'horizon 2035. Une première série a ainsi été dévoilée en 2015. Une autre en 2020, la troisième étant attendue cette année. Si cette mise à jour tarde, la COP30 — prévue en novembre au Brésil — pourrait bien être chaotique.
Le pays de Lula da Silva a affiché l'ambition d'intensifier la lutte contre le changement climatique lors de ce grand raout. Objectif : que la Terre entre enfin dans les clous de l'Accord de Paris, autrement dit que la température mondiale soit maintenue à +1,5 °C ou 2°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels. Seulement, tant que les nouveaux plans ne seront pas publiés, les gouvernements continueront de s'appuyer sur ceux établis il y a cinq ans. Or, d'après les Nations unies, ceux-ci nous mènent droit vers une hausse des températures de 2,6 à 2,8 °C d'ici la fin du siècle.
L'UE parmi les mauvais élèves
Parmi les dizaines de retardataires figurent notamment l'Union européenne (UE), le Japon, la Chine ou le Canada. Et chacun a son excuse : tantôt des difficultés techniques, tantôt des pressions économiques, tantôt des incertitudes diplomatiques. L'élection récente d'un climatodénialiste à la tête des États-Unis a poussé les diplomates à temporiser. Certains estiment, dans les colonnes du Guardian, qu'il est désormais préférable de reporter la publication une fois la tempête Trump calmée.
Première émettrice mondiale, la Chine n'a pas communiqué la date à laquelle elle entend sortir du silence. « Son plan est extrêmement important à surveiller, mais elle montre rarement ses cartes en avance », déplore à Reporterre Gaïa Febvre, du Réseau Action Climat (RAC). De leur côté, des sources officielles indiennes avancent, dans The Indian Express, une parution de la feuille de route de l'Inde entre juin et décembre. Celle-ci devrait refléter « la déception suscitée par […] la COP29 à Bakou [en Azerbaïdjan] » et son accord « néocolonialiste ». Traduction : l'Inde ne se foulera pas.
83 % des émissions sont dus
aux pays retardataires
Du côté de l'Union européenne, on justifie le non-respect de l'échéance par la lenteur des processus d'approbation. « L'UE doit accélérer la cadence pour ne pas arriver les mains vides à Belém [à la COP30] », insiste Caroline François-Marsal, chargée des questions européennes au RAC. Qui regrette que ce dossier soit en attente depuis plus d'un an : « Alors que les attaques contre l'environnement s'intensifient de toutes parts, l'Europe doit tenir bon et constituer un rempart solide sur le climat en redevenant un pays moteur des négociations. »
Au total, d'après une analyse du média spécialisé Carbon Brief, les pays retardataires sont à l'origine de 83 % des émissions planétaires et pèsent pour près de 80 % de l'économie mondiale. Pas de quoi troubler le secrétaire exécutif de l'ONU pour le climat, Simon Stiell : « D'après les conversations que j'ai eues avec les pays, les gouvernements prennent cela très au sérieux, a-t-il déclaré le 6 février. Il est donc raisonnable de prendre un peu plus de temps pour s'assurer que ces plans soient de première qualité […] Au plus tard, l'équipe du secrétariat doit les avoir reçus d'ici septembre. » Il faut dire que l'ONU s'y est habituée : en 2020 déjà, seuls cinq États avaient tenu l'échéance de février.
Le travail de Biden balayé par Trump
Reste à savoir qui a rendu sa copie à l'heure. Du côté du G7, le Royaume-Uni a soumis son nouveau plan… tout comme les États-Unis. Baroud d'honneur climatique de Joe Biden, le texte dévoilé par le Démocrate juste avant de quitter ses fonctions est désormais symbolique. Si les États du pays peuvent s'en inspirer pour leurs politiques locales, Donald Trump a déjà amorcé le processus de retrait de son pays de l'Accord de Paris.
Ont aussi rendu leur plan : le Brésil, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Uruguay, Andorre, l'Équateur et Sainte-Lucie. Malheureusement, même dans ce lot, des pays sont réfractaires à se conformer à l'Accord de Paris.
Dans une étude menée par le projet scientifique indépendant Climate Action Tracker, les propositions brésiliennes, émiraties, étasuniennes et suisses sont « incompatibles » avec la trajectoire de +1,5 °C. Celles de la Nouvelle-Zélande n'ont pas encore été analysées, mais Carbon Brief précise qu'un expert climatique du pays les a décrites comme « incroyablement peu ambitieuses ». Des projections tracassantes à neuf mois de la COP30.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
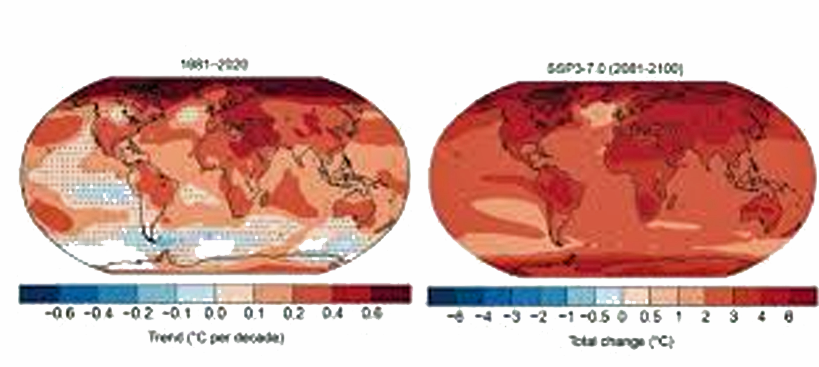
Le dernier rapport du GIEC, prisonnier du fake news des mesures terrestres de GES, contredit la vérité crue de la Courbe de Keeling
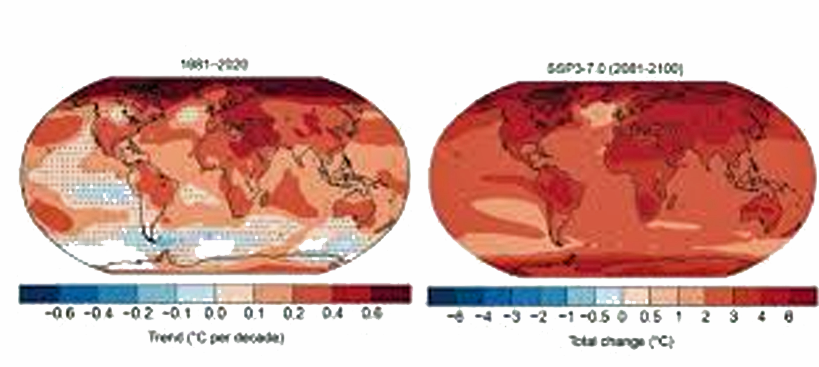
Nous publions un extrait du texte de Marc Bonhomme ayant pour titre Le dernier rapport du GIEC, prisonnier du fake news des mesures terrestres de GES, contredit la vérité crue de la Courbe de Keeling
Pour lire l'intégralité du texte, cliquez sur l'icône ci-dessous :
15 février 2025
La croissance géométrique des GES, reflet de la perdition du monde par le capitalisme
Pendant que la Courbe de Keeling mesure par défaut toutes les émanations de GES, leur comptabilisation par sources terrestres, sous la responsabilité d'États acquis corps et âme à la croissance du capital dont ils sont les garants, ouvre la porte, joyeusement prise, à toutes les manipulations minimisant leurs responsabilités. L'irrésistible tentation réside à confondre émanations de GES anthropiques et celles soi-disant naturelles que le réchauffement climatique, au niveau qu'il a atteint, a complètement dénaturés pourrait-on dire. La dramatique conséquence politique de la fake news des statistiques de l'ONU est de laisser les puissance de ce monde affirmer que les émanations de GES, en particulier du gaz carbonique, croissent à un taux décroissant, même si trop lentement.
S'ensuivrait l'atteindre d'un sommet mondial, à commencer par la Chine après que ce soit déjà fait pour la plupart des pays du vieil impérialisme, puis viendraient l'Inde, l'Indonésie, le sud-est asiatique et enfin l'Afrique. Et, nous rassure-t-on, si temporairement, les seuils de 1.5 ou même 2°C étaient franchis, il ne faudrait pas s'en faire car les technologies de capture et séquestration du carbone qui, finissant par arriver à maturité à un coût raisonnable, parviendraient à gober assez de CO2 pour diminuer le réchauffement. Quant au danger de rétroaction positive (cercle vicieux) suite au surpassement de points de bascule… on serre les dents et on ferme les yeux ! Entre-temps il faudrait investir dans l'adaptation tout en fabriquant, incité par les marchés et taxes carbone, un Everest d'autos solo électriques et de thermopompes pour bungalows. Et tout rentrera dans l'ordre avec l'atteinte du « zéro net » d'ici 2050. Telle est la grande légende urbaine du capitalisme vert.
La réalité implacable de la croissance géométrique des émanations de GES qui précipite le monde vers la terre-étuve n'est pas la substitution de l'extractivisme des hydrocarbures par celui électrique-électronique reposant sur les énergivores mines à ciel ouvert et les encore plus énergivores fermes de serveurs crachant de la soi-disant intelligence artificielle. Comme pour le pétrole par rapport au charbon au XXe siècle, le nouvel extractivisme se superpose aux hydrocarbures, inhérente croissance capitaliste oblige. Au Québec, royaume de l'électricité dit verte, le nouvel extractivisme passerait par l'augmentation de 50% de l'électricité hydraulique et éolienne d'ici 2050 afin d'alimenter une ribambelle de mines de lithium, de graphite et tutti quanti, et de polluantes usines de batteries avec leurs composantes. Toujours ce chien qui court après sa queue.
La démocratie anti « fake news » des comités pour une société de soins et de liens
L'alternative d'une société de soins et de liens aux frontières ouvertes basée sur la décroissance matérielle est pourtant, comparativement au capitalisme vert, simple à réaliser, bon marché et technologiquement mature. Où est la complexité d'une ville de quartiers 15 minutes (et de villages) où les gens habitent de collectifs logements sociaux écoénergétiques et où les liaisons se font par transport actif et en commun gratuit à travers une profusion de jardins communautaires et de parcs nature ? Où est la cherté d'une vie sans auto solo et sans bungalows, piliers des dettes des ménages ; d'un système de transport sans métros ni trains aériens car le transport actif et collectif a pris le contrôle du réseau routier ; d'une bio-agriculture non carnée qui par ses pratiques et la drastique réduction des surfaces cultivées revivifie les sols et restitue à la nature ses forêts, prairies et milieux humides ; d'une production matérielle durable, réparable, sans obsolescence, circulaire, sans asservissement à la mode et, avant tout, pour servir les besoins des services publics bonifiés y compris ces nouveaux services publics que doivent devenir les logements, un droit et non une marchandise, le transport, concrétisant le droit à la mobilité, l'électricité de base et à terme l'alimentation de base non carnée, fondements du droit à la vie.
Cette société où le bien-être réside dans le travail social autocontrôlé en réciprocité avec l'abondance des temps libres, consacrés à la science, l'art et au maillage social, et où la sécurité se trouve dans la solidarité est bien sûr incompatible avec l'accumulation matérielle dont son équivalent général, l'argent, et de son idéologie individualiste d'accaparement et de surconsommation, mal nécessaire mais vain de la solitude et du vide capitalistes. Inutile de dire que le capitalisme mène une guerre totale à la concrétisation de cette société de soins et de liens, qu'il menace de chômage, de misère et de servitude ceux et celles qui luttent contre l'exploitation du peuple-travailleur, et sa division par mille et une oppressions dont les pinacles sont le sexisme et le racisme. Il s'assure qu'au-dessus des valeurs de la révolution bourgeoise que sont la liberté, l'égalité et la solidarité trône bien en vue la propriété privée des moyens de production qui donne tous les droits et en dépouille celles et ceux qui en sont dépourvus jusqu'à aliéner leurs choix politiques. À cet ogre insatiable, le peuple-travailleur est tenu de rendre le culte de la compétition de tous contre toutes justifiant tous les péchés du monde dans une société sans foi ni loi… à la Trump.
On se rend compte que le barrage capitaliste afin de bloquer toute brèche ouvrant la voie à une société de soins et de liens remet en question jusqu'à son étroite démocratie représentative devenue gouvernance gestionnaire incapable de survivre au mensonge d'apparente bonne foi statistique — there is three kind of lies : a lie, a dam lie and statistics — systématisant et normalisant le « fake news » fascisant. En sort gagnant un capitalisme oligarchique combinant ploutocrates d'une concentration-centralisation sans précédent du capital et une gent politique d'extrême-droite enfin en mesure d'accéder au pouvoir étatique. Il va donc falloir une refondation démocratique s'enracinant dans les lieux de travail, d'étude et de résidence, sans oublier les regroupements des personnes opprimées, porteuse d'une mobilisation de tout le peuple-travailleur dans toute sa diversité capable de renverser le capitalisme pour instaurer cette société de solidaire décroissance matérielle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violences faites aux femmes : vers une compréhension politique du patriarcat

La violence à l'égard des femmes et des filles peut prendre de nombreuses formes à l'échelle mondiale, de l'absence d'autonomie personnelle à la violence sexuelle et à la violence domestique.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/12/violences-faites-aux-femmes-vers-une-comprehension-politique-du-patriarcat/?jetpack_skip_subscription_popup
Pour mieux comprendre comment la violence à l'égard des femmes affecte les femmes au Moyen-Orient en particulier, cette note d'orientation aborde divers cas de violence à l'égard des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI). Une attention particulière est accordée aux mariages forcés/arrangés, à la violence fondée sur l'honneur et aux mutilations génitales féminines, qui forment un « trio patriarcal » d'oppression : un phénomène que l'auteur a identifié et étudié de manière approfondie. Les recommandations de la note d'orientation éclairées par cette recherche sont pertinentes pour les décideurs politiques de la région du Kurdistan irakien et au-delà, y compris les États membres de l'Union européenne qui ont été confrontés à des cas troublants de violence à l'égard des femmes dans les communautés immigrées et qui sont confrontés à des défis similaires en matière de droits des femmes. L'examen des violations contre les femmes est pertinent pour de nombreuses régions du Moyen-Orient et, plus largement, pour les sociétés et les communautés où les valeurs et les normes patriarcales produisent un milieu social où la principale justification de la violence à l'égard des femmes est la protection d'une construction sociale de l'honneur. Cette note d'orientation s'appuie sur des travaux de terrain menés dans la région du Kurdistan irakien ; 55 entretiens qualitatifs avec des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies, des avocats, des universitaires, des militants, des membres de la société civile, ainsi que des femmes et des hommes victimes et auteurs de violences faites aux femmes ; et une enquête quantitative menée auprès de 200 femmes et hommes pour connaître leurs opinions sur ce phénomène aux multiples facettes. L'objectif de cette note d'orientation est de donner aux institutions publiques chargées de surveiller le bien-être des femmes une meilleure idée des défis auxquels les femmes sont encore confrontées en matière d'égalité et de proposer des pistes pour relever ces défis. [1]
Les femmes et les filles subissent de nombreuses formes de violences basées sur le genre (VBG) à l'échelle mondiale. Cette note d'orientation examine des cas spécifiques de VBG contre des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI) afin de mettre en lumière l'impact unique de la VBG sur les femmes du Moyen-Orient. Au cours de mes recherches, j'ai observé, défini et examiné une trinité d'oppression, que j'ai baptisée « trifecta patriarcale » (Hussain, 2024). Ce trio comprend les mariages forcés/arrangés, les mutilations génitales féminines (MGF) et les soi-disant « crimes d'honneur » / violences basées sur l'honneur (VHB) ; des phénomènes qui, selon moi, fonctionnent de manière symbiotique et méritent une attention particulière du point de vue des politiques publiques (Payton, 2019 ; Beghikhani, 2015 ; Haig et al., 2015 ; Ruba, 2010 ; Brown et Romano, 2016 ; Ahmady, 2018 ; Burrage, 2016 ; Barrett et al., 2021).
Les conclusions et recommandations de cette note d'orientation s'appuient sur des recherches menées entre 2022 et 2024. En 2023, j'ai mené des travaux de terrain dans les villes d'Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kelar et Xanaqin, en menant des entretiens avec 55 femmes et hommes ayant survécu ou ayant commis des violences sexistes, des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies (ONU), des avocats, des universitaires, des militants et des membres de la société civile. J'ai également mené une enquête quantitative auprès de 200 femmes et hommes sélectionnés au hasard, comme variable de contrôle pour connaître leur point de vue sur les différents phénomènes examinés dans cette note d'orientation.
Cette note d'orientation est importante au-delà du KRI, car la région du Moyen-Orient dans son ensemble est confrontée à des obstacles comparables en matière d'égalité des femmes. Cette question gagne également en importance dans les communautés de la diaspora en raison de la tension croissante entre les conceptions conservatrices et traditionalistes de l'islam au Moyen-Orient et les conceptions libérales modernistes « anglo-européennes » des droits des femmes inscrits dans la législation européenne. Un tel environnement idéologique partagé par le KRI et les diasporas des États d'Europe occidentale signifie que de nombreuses femmes survivantes sont ostracisées par la société et obligées de subir ces injustices en silence. Compte tenu de ces défis, cette note d'orientation comprend sept recommandations générales qui abordent les violations des droits des femmes.
Cette note d'orientation vise à offrir aux agences gouvernementales chargées de suivre le bien-être des femmes des informations supplémentaires sur la manière de mieux garantir l'égalité des femmes dans la société en proposant des stratégies cohérentes. Les recommandations de cette note d'orientation s'alignent étroitement sur l'Objectif de développement durable ODD) 5 des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces [2].
Mariages forcés et arrangés
Les données que j'ai recueillies au KRI ont révélé que le taux de mariage forcé parmi les filles mariées entre 14 et 17 ans et entre 18 et 24 ans était de 20% pour les deux groupes. Les mariages d'enfants et les mariages forcés découlent de divers facteurs, notamment les normes tribales et patriarcales, les pratiques culturelles, le manque d'éducation formelle, les déséquilibres de pouvoir au sein des ménages et les attentes masculines néfastes (Khan, 2020 ; Erman et al., 2021). Ces mariages ont souvent lieu dans des zones rurales régies par des coutumes qui ne respectent pas les lois de l'État.
La prévalence du mariage d'enfants au Kurdistan irakien est difficile à quantifier, mais une enquête de l'UNFPA a révélé que 20,53% des femmes âgées de 20 à 24 ans dans la région du Kurdistan et 23,02% dans l'ensemble de l'Irak étaient mariées avant l'âge de 18 ans (UNFPA, 2016). Les facteurs contributifs comprennent des coutumes désuètes, la pauvreté et un faible niveau d'éducation, qui rendent les filles vulnérables à l'exploitation et à la dépendance économique (ONU Femmes, 2018 ; 2019 ; El Ashmawy et al., 2020). Les hommes sont également touchés, car les jeunes maris sont souvent confrontés à la pression de subvenir aux besoins d'un ménage sans carrière ni revenus stables (Hussain, 2024).
Après la montée de l'État islamique (EI) en 2014, les difficultés économiques et la baisse du niveau de vie au Kurdistan irakien ont entraîné une augmentation des violences contre les femmes. De nombreuses filles ont été contraintes d'abandonner l'école et de se marier jeunes en raison de difficultés financières, de pressions familiales ou d'un contexte de travail forcé où elles étaient exposées à l'exploitation et au harcèlement sexuels.
Les familles considéraient souvent le mariage précoce comme un moyen de « protéger » leurs filles de plus grands dangers, malgré les objections de ces dernières. Les violences physiques au sein du mariage étaient normalisées par les parents, car elles considéraient que c'était une meilleure alternative que de laisser leurs filles « sans défense » et potentiellement vulnérables à de multiples abus. Les mariages arrangés étaient perçus comme des opportunités de mobilité sociale, tirant parti des structures patriarcales pour améliorer les perspectives matérielles d'une fille. Cependant, ces unions manquaient souvent d'amour et d'empathie, réduisant les mariages à des arrangements transactionnels dans lesquels les femmes étaient traitées comme des biens ou des servantes, ce qui conduisait à l'isolement et à l'enfermement.
Dans les régions rurales et tribales, la domination masculine façonnait tous les aspects de la vie. Les hommes justifiaient souvent leur contrôle par des croyances religieuses, rejetant les lois laïques protégeant les femmes comme des influences corruptrices. L'obéissance des filles et des femmes était considérée comme un impératif moral, et le fait de défier les choix parentaux en matière de mariage était considéré comme déshonorant. En fin de compte, mes recherches ont mis en évidence que les pratiques de mariage forcé étaient profondément ancrées dans les normes culturelles.
Violence fondée sur le déshonneur perçu
Les violences liées à l'honneur (VFI) demeurent courantes au Kurdistan irakien, enracinées dans les normes patriarcales et tribales ainsi que dans les perceptions culturelles du rôle « approprié » des femmes. Les données officielles montrent que 44 femmes ont été tuées pour « l'honneur » en 2022. De nombreuses autres se seraient suicidées dans des circonstances suspectes, souvent par auto-immolation, et on suppose que certains d'entre elles étaient des meurtres d'honneur mis en scène comme des suicides. Comme l'a expliqué un représentant d'ONG à Sulaymania, « il est très facile pour une femme d'être victime d'un meurtre d'honneur commis par des membres de sa famille au Kurdistan irakien ou en Irak et de s'en tirer impunément ».
Les crimes d'honneur sont commis pour des raisons diverses, notamment les relations sexuelles avant le mariage, le fait d'être victime d'un viol, le refus d'un mariage arrangé ou le fait d'épouser une personne désapprouvée par la famille. Si le meurtre est la forme la plus grave, d'autres sévices, comme les mutilations et les défigurations faciales, sont également infligés pour rendre les femmes « indésirables ».
La loi irakienne traite des crimes d'honneur mais autorise des peines réduites pour ces crimes, les considérant souvent comme des délits moins graves. Dans l'ensemble de l'Irak, les peines peuvent être aussi basses que six mois, alors que les meurtres non liés à l'honneur sont passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort (AlKhateeb, 2010). Cette clémence perpétue l'idée que les crimes d'honneur sont des réactions « naturelles » à la honte ressentie par la famille. En revanche, les autorités du Kurdistan irakien ont aboli les lois autorisant de telles peines réduites en 2000.
Contrairement aux mariages forcés, les violences sexuelles touchent tous les milieux socioéconomiques. Une enquête de l'UNICEF a révélé que 59% des femmes âgées de 15 à 59 ans trouvaient acceptables les violences physiques infligées par leur mari (AlKhateeb, 2010). De nombreuses femmes intériorisent les normes patriarcales et perçoivent ces dangers comme ne concernant que les « autres ». Les entretiens ont montré que les femmes plus âgées, notamment les mères et les tantes, considéraient souvent les crimes d'honneur comme justifiés par des transgressions morales « graves », comme la promiscuité sexuelle perçue, estimant que de tels actes ternissaient l'honneur de la famille.
Recommandations politiques
Le « trio patriarcal » – mariages forcés/arrangés (Hussain, 2024), violences basées sur l'honneur (VHB) et mutilations génitales féminines (MGF) – est un problème complexe qui nécessite des solutions globales. Pour remédier à ces abus, le gouvernement du Kurdistan palestinien doit mettre en œuvre une stratégie nationale globale. Bien que des progrès aient été constatés, notamment une diminution des MGF, ces phénomènes continuent d'avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes, les familles et les communautés.
Au niveau institutionnel, les propositions politiques prévoient notamment l'élargissement des services de réponse aux violences basées sur le genre financés par l'État, tels que les soins de santé, le soutien psychologique, l'aide au logement et les protections juridiques (Waylen, 2014 ; Piscopo, 2020). L'élimination des pratiques sexistes qui limitent l'accès des femmes au lieu de travail et aux ressources est essentielle pour renforcer leur capacité d'action économique, offrir des alternatives aux mariages arrangés et réduire le risque de crimes d'honneur (Chenoweth & Zoe, 2022 ; Hussain, 2024).
Les principaux objectifs pour atteindre ces buts sont les suivants :
– Renforcer la législation pour remettre en question les normes et croyances sexistes néfastes.
– Réduire l'acceptation sociale de la violence à l'égard des femmes (VAW) en promouvant des normes d'égalité des sexes.
– Collaborer avec des organisations dirigées par des femmes, des ONG et des dirigeants communautaires pour conduire des changements significatifs.
– Donner la priorité aux lois liées à la santé et aux mesures de responsabilisation pour atténuer la violence et favoriser l'égalité des sexes.
– Améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle, à l'emploi formel et aux droits du travail pour améliorer leurs opportunités économiques.
– Encourager une croissance économique inclusive en soutenant les entreprises qui privilégient le leadership et l'entrepreneuriat féminin.
– Coordonner les efforts intersectoriels pour aider les adolescents à lutter contre les mariages d'enfants, les MGF et la VHB.
Les réformes structurelles devraient inclure l'intégration de ces mesures dans le système éducatif. Une éducation complète à la santé reproductive peut informer les jeunes des dangers des MGF, tandis qu'assurer l'égalité d'accès à l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans peut permettre de lutter contre le désespoir économique (EGER, 2021). Les écoles pourraient également employer des administratrices et des infirmières pour répondre aux défis spécifiques des filles et fournir des conseils sur les problèmes personnels et de sécurité (World Food Program USA, 2022).
Une action législative est essentielle. Il faut interdire aux religieux d'enregistrer des mariages en dehors des tribunaux officiels, et les violences faites aux femmes et les mutilations génitales féminines devraient être sanctionnées plus sévèrement. Des unités spéciales devraient enquêter sur ces délits, et les procédures de divorce pour les femmes maltraitées doivent être simplifiées, avec l'aide de l'État pendant leur transition. Comme l'a déclaré une jeune femme du Kurdistan irakien : « Nous avons besoin que les hommes ressentent l'urgence de le faire. » Démanteler la « trilogie patriarcale » (Hussain, 2024) nécessite la participation de ceux qui en bénéficient (Levtov et al., 2015 ; Dabla-Norris et Kochhar, 2019). Les limitations des droits des femmes sont interconnectées et exigent des solutions holistiques qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'à la simple atténuation des symptômes. Ces idées et recommandations sont pertinentes bien au-delà du Kurdistan irakien, et s'étendent à des contextes mondiaux.
Par Shilan Fuad Hussain
Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :
https://www.shilanfuadhussain.com/
Texte original (en anglais) à lire ici : Hussain, Shilan Fuad. (2025). “Violence Against Women : Towards a Policy Understanding of the Patriarchy.” Policy Papers. European Center for Populism Studies (ECPS). February 5, 2025.
https://doi.org/10.55271/pop0005
Références :
Ahmady, K. (2018). “The Politics of Culture-Female Genital Mutilation/Cutting in Iran.” Journal of Humanity. Vol 4(1) (March):1-022.
AlKhateeb, Basma. (2010). Persistent gender-based violence an obstacle to development and peace. Developing Programs for Women and Youth Iraqi. Al-Amal Association, Social Watch Poverty Eradication and Gender Justice. https://www.socialwatch.org/node/12087
Barrett, H. R. ; Bedri, N. & Krishnapalan, N. (2021). “The Female Genital Mutilation (FGM) – migration matrix : The case of the Arab League Region.” Health Care for Women International, 42(2), 186–212. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1789642
Beghikhani, N. (2015). Honour Based Violence. Gill & Hague.
Brown, L., & Romano, D. (2006). “Women in Post-Saddam Iraq : One Step Forward or Two Steps Back ?” NWSA Journal, 18(3), 51–70.
https://doi.org/10.2979/NWS.2006.18.3.51
Burrage, H. (2016). Female Mutilation : The Truth Behind the Horrifying Global Practice of Female Genital Mutilation, New Holland Publishers.
Chenoweth, Erica & Zoe, Marks. (2022, March 8). “Revenge of the Patriarchs : Why Autocrats Fear Women.” Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs
Dabla-Norris, E. & Kochhar, K. (2019). “Closing the Gender Gap.” IMF Paper.
https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2019/03/closing-the-gender-gap-dabla
EGER. (2021). Girls Education Roadmap.
https://apppack-app-eger-prod-publics3bucket-elt8wyly48zp.s3.amazonaws.com/documents/Girls_Education_Roadmap_2021_Report.pdf
El Ashmawy, Nadeen ; Muhab, Norhan and Osman, Adam. (2020). “Improving Female Labor Force Participation in MENA.” The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). November 2, 2020.
https://www.povertyactionlab.org/blog/11-2-20/improving-female-labor-force-participation-mena
Erman, Alvina ; De Vries Robbe, Sophie Anne ; Thies, Stephan Fabian ; Kabir, Kayenat ; Maruo, Mirai. (2021). Gender Dimensions of Disaster Risk and Resilience : Existing Evidence. World Bank, Washington, DC.
http://hdl.handle.net/10986/35202
Haig, G. L. J. ; Öpengin, E. ; Hellinger, M. & Motschenbacher, H. (2015). “Gender in Kurdish : Structural and socio-cultural dimensions.” In : Gender Across Languages (Vol. 36, pp. 247–276). John Benjamins Publishing Company.
https://doi.org/10.1075/impact.36.10hai
Hussain, S. F. (2024). Protecting women's agency in the Middle East : Interventions and reforms to ensure women's rights. CWS Policy Insights No. 1. Center for War Studies.
Khan, A. R. ; Ratele, K. & Arendse, N. (2020). “Men, Suicide, and Covid-19 : Critical Masculinity Analyses and Interventions.” Postdigital Science and Education, 2(3), 651–656.
https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1
Levtov, R. ; van der Gaag, N. ; Greene, M. ; Kaufman, M. & G. Barker. (2015). “State of the World's Fathers : A Men Care Advocacy Publication.” Washington, DC : Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, and the Men Engage Alliance.
https://www.fatherhood.gov/sites/default/files/resource_files/e000003287.pdf
Payton, J. (2019). Honour and Political Economy of Marriage. Rutgers University Press.
Piscopo, Jennifer. (2020). The Impact of Women's Leadership in Public Life and Political Decision-Making. Prepared for UN Women's Expert Group Meeting for the 65th Session of the Committee on the Status of Women. New York : UN Women.
Ruba, S. (2010). Transnational Public Spheres from ‘Above' and from Below', Feminist Networks across the Middle East and Europe, Transnational Public Spheres.
UN Women. (2018). “Facts and Figures : Economic Empowerment.
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
UN Women. (2019). Women's Full and Effective Participation and Decision-Making in Public Life, as Well as the Elimination of Violence, for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. New York : UN Women, 2019 :
https://digitallibrary.un.org/record/3898140?ln=en
UNFPA. (2016). Child Marriage in Kurdistan Region-Iraq.
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
Waylen, Georgina. (2014). “Strengthening women's agency is crucial to underpinning representative institutions with strong foundations of participation.” Politics & Gender, 10, no. 4 : 495–523.
World Food Program USA. (2022). “Top 6 Reasons Women Are Hungrier Than Men Today.”
https://www.wfpusa.org/articles/women-in-crisis-top-ways-women-are-hungrier/
[1] Funding Details : This project was funded by UKRI, Grant Number : EP/X024857/1, carried out by Shilan Fuad Hussain at the Department of Law and Social Science, Middlesex University, United Kingdom.
[2] Geneva International Centre for Justice (GICJ), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, ‘Shadow Report on Iraq submitted by Geneva International Centre for Justice (GICJ) to the Committee of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ; 74th Session ; 21 October – 8 November 2019 ; Geneva, Switzerland', 10 October 2019. United Nations Population Fund, UN Children's Fund, UN Women, ‘Protecting Girls in Iraq from Female Genital Mutilation', 6 February 2019, from :
https://reliefweb.int/report/iraq/protecting-girls-iraq-female-genital-mutilation-enarku. The
United Nations have put forward multiple documents on the elimination of violence against women, including forced marriages, e.g., the 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women (UN Doc. A/Res/48/104). United Nations Statistics Division. United Nations Global SDG Database. Data retrieved July 2022. From :
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mars 2025 : grève féministe !

Avec les femmes du monde entier, pour les droits des femmes, toutes en grève féministe et en manifestations !
Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire !
7 février 2025 | tité du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/8-mars-2025-greve-feministe/
Le 8 mars, journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Sans les femmes, tout s'arrête ! Nous sommes déterminées à lutter, à faire entendre nos voix pour obtenir l'égalité.
Solidaires avec les femmes du monde entier !
Afghanes, Iraniennes, Palestiniennes, Soudanaises, Kurdes, Ukrainiennes, nous sommes solidaires de toutes celles qui encore aujourd'hui sont emmurées, exécutées, qui font face à des bombardements massifs, au génocide, à l'exode, sont victimes de viols de guerre, peinent à nourrir leur famille et elles-mêmes, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées aux conflits armés, aux régimes fascisants, réactionnaires, théocratiques et colonialistes.
Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique, aggravé par les politiques productivistes et capitalistes.
Non à l'Extrême Droite !
Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les LGBTQIA+ phobies, le validisme, se banalisent, et sont aux portes du pouvoir, voire y accèdent partout dans le monde, à l'image de Trump aux États-Unis… Les femmes, les minorités de genre, les migrant·es en sont les premières cibles.
En France, nous dénonçons les propos racistes du ministre de l'intérieur, nous exigeons la régularisation et l'ouverture des guichets pour que tou·te·s les immigré·es puissent rester ici. Nous refusons l'abrogation du droit du sol à Mayotte et la remise en cause de l'Aide Médicale d'État.
Nous voulons vivre et pas survivre !
Les différents gouvernements ne font rien contre les inégalités salariales et les bas salaires qui touchent particulièrement les femmes (62% des personnes payées au SMIC sont des femmes). Quant aux mères isolées touchant le RSA, elles sont confrontées à de multiples difficultés pour trouver un emploi (problème de garde d'enfants, de transports…). Particulièrement touchées par la crise du logement cher, les femmes sont majoritaires parmi les personnes expulsables et sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue. Les femmes sont majoritaires parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté !
Nous exigeons l'abandon de la réforme du RSA, qui oblige les bénéficiaires à faire 15h de travail forcé, gratuit et sans contrat !
Nous exigeons l'abrogation des réformes sur l'assurance chômage restreignant les droits des chômeur·ses.
Rémunérons le travail à sa juste valeur, à salaire égal entre femmes et hommes !
Pour l'égalité salariale, du temps pour vivre, des salaires et une retraite décente !
Le gouvernement n'a aucune volonté de réduire les inégalités salariales, de 27% en moyenne entre les femmes et les hommes. La transposition de la directive européenne sur la transparence salariale vise à renforcer l'application du principe d'une même rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale ».
Nous exigeons la transposition immédiate de cette directive, la revalorisation salariale des métiers féminisés (éducation, soins, nettoyage…)., l'interdiction du temps partiel imposé, la transformation des CDD en CDI et la réduction du temps de travail avec embauches correspondantes.
Nous nous battons pour l'abrogation de la réforme Macron des retraites, et pour une réforme des retraites favorable aux femmes, la retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités.
Des Services publics au service de nos besoins !
Malgré la paupérisation croissante et le manque crucial d'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la Santé, de l'Éducation, du Logement…. Les femmes en seront doublement pénalisées : parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique, et qu'elles devront se substituer aux services de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance.
Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du 4ème âge.
Nous exigeons la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnels dans ces structures. Nous sommes opposées à la recommandation de la Cour des comptes de développer « la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques » qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison.
Pour un réel partage du travail domestique !
Nous ne pouvons nous satisfaire que rien ne bouge dans la répartition des tâches au sein des couples et ce depuis des années. Cette inégalité dans la répartition du travail domestique se traduit par des inégalités dans la sphère professionnelle et est l'un des facteurs des inégalités salariales et patrimoniales. Nous dénonçons le mirage des « nouveaux pères » car les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes, qui de fait prennent plus souvent les tâches valorisantes, en laissant les tâches ménagères à leur compagne. C'est tout l'enjeu d'une éducation non sexiste qui puisse permettre d'en finir avec les stéréotypes de genre.
Notre corps nous appartient !
L'inscription dans la constitution de l'IVG ne doit pas masquer les obstacles liés au manque de moyens du service public de la santé pour recourir à l'IVG.
Nous réclamons la réouverture des plus de 130 centres d'interruption volontaire de grossesse fermés.
Nous dénonçons les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+ qui veulent limiter le droit de vivre librement son orientation sexuelle et son identité de genre. Nous exigeons une transition libre et gratuite pour toutes et tous.
Nous dénonçons les offensives transphobes réactionnaires, notamment les propositions de loi qui remettent en cause toute possibilité de transition des mineur·es, et nous demandons la fin des mutilations et des traitements hormonaux non consentis.
Femmes handicapées, nous subissons toutes les violences. Privées de nos droits à l'autonomie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins et à la procréation. Nous voulons notre indépendance économique, l'accessibilité universelle à l'ensemble des lieux et bâtiments.
Halte aux violences sexistes et sexuelles !
Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pélicot a rappelé que les violeurs sont des hommes ordinaires, et que la culture du viol persiste dans les différentes strates de la société. La nomination de Darmanin mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles comme garde des sceaux est une véritable provocation.
Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dont les violences obstétricales et gynécologiques, nous voulons une loi-cadre intégrale qui mette en avant prévention, éducation, protection, accompagnement, sanction et garantisse les moyens pour la prise en charge de l'ensemble des victimes, femmes, enfants et minorités de genre. Les plus touchées par les violences sexistes, dont les violences économiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : femmes victimes de racisme, migrantes, sans papiers, femmes précarisées, en situation de handicap, femmes lesbiennes et bi, femmes trans, femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie pornocriminelle. Nous demandons la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, protéger les victimes et combattre les réseaux de traite prostitutionnelle et de proxénétisme.
Nous exigeons les 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Nous refusons que les enfants violé·es, maltraité·es, incesté·es continuent le plus souvent à être abandonné·es à leur sort !
Pour l'éducation, pour les enfants, l'Éducation à la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle pour toutes et tous maintenant !
Le dernier rapport du Haut conseil à l'égalité note que le sexisme progresse chez les adolescents et les jeunes hommes. Nous dénonçons fermement les attaques portées par le précédent gouvernement contre le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) reprenant les propos des associations réactionnaires de parents qui y sont farouchement opposées. Nous exigeons l'adoption et la mise en place immédiate du projet de programme EVARS, dans la continuité des lois votées pour l'éducation à la sexualité à l'école. L'EVARS aide à déconstruire les stéréotypes, à comprendre les inégalités, à comprendre l'injustice des dominations qui s'exercent par les hommes sur les femmes, à prendre conscience de son corps et de son intimité et à respecter l'autre et soi-même.
Mobilisées tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite.
Le 8 mars, nous manifesterons, nous serons en grève féministe.
Nous serons en grève sur nos lieux de travail (santé, commerce…), en grève du travail domestique et en grève de la consommation !
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête !
Signataires et soutiens
Premières signataires de l'appel
ActionAid France, AFRICA93, APEL-Égalité, Association Panafricaniste des Droits Civiques des femmes, Attac France, CGT, Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Collective des mères isolées, Droits de l'Homme et non-violence, FAGE, Féministes Révolutionnaires Paris, Femmes Egalité, Fondation Copernic, Force Féministe (57), FSU, Fête des 3 Quartiers ( F3Q), Genre et altermondialisme, HFE /Handi Femme Epanouie, Handi-Social, Las Rojas Paris, Le Planning familial, Le Planning Familial 94, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Mouvement des Femmes Kurdes En France, Mouvement de la Paix, Organisation de Solidarité Trans (OST), Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France ( Stop-Vog ), UNEF le syndicat étudiant, Union Etudiante, Union syndicale Solidaires, Union des femmes Socialistes (SKB)
En soutien
APRES, Égalités, ENSEMBLE !, Gauche démocratique et sociale GDS, Gauche Ecosocialiste (GES), Génération.s, La France insoumise, Mouvement jeunes communistes de France, NPA-l'Anticapitaliste, NPA – Révolutionnaires, Parti Communiste Français, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti de Gauche, PEPS 31, Révolution Écologique pour le Vivant (REV), Union Communiste Libertaire
Télécharger l'appel : Appel 8 mars 2025

Pourquoi le planning familial sauve des vies ?

Sakina Sania été contrainte de se marier à l'âge de 12 ans, en pleine guerre et pénurie alimentaire dans le nord du Nigéria. Elle est tombée enceinte à 15 ans, avant de faire une fausse couche, puis d'accoucher de deux enfants en peu de temps.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« Je ne permettrai jamais à ma fille de vivre ce qui m'est arrivé », a-t-elle déclaré à l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive(UNFPA).
Que se passe-t-il lorsque des conflits déplacent des dizaines de milliers de personnes dans des zones sensibles comme le Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ukraine, et que des femmes meurent chaque jour en couches ou pendant leur grossesse ?
L'UNFPA apporte une aide vitale dans les camps de déplacés et au personnel médical.
Lorsqu'un tremblement de terre fait s'écrouler des quartiers entiers, des contraceptifs sont acheminés vers les convois de secours d'urgence, ainsi que des kits d'accouchement et des médicaments pour arrêter les hémorragies internes.
Lorsqu'un cyclone frappe des communautés insulaires, l'agence envoie des contraceptifs de la même manière qu'elle envoie du matériel médical stérile, notamment des préservatifs, des contraceptifs oraux et injectables, des implants contraceptifs et des dispositifs intra-utérins (DIU).
Pourquoi ? Parce que les contraceptifs font aussi partie des soins humanitaires susceptibles de sauver des vies.
Cela peut paraître contre-intuitif pour certains, mais c'est un fait établi du point de vue de la science médicale, des intervenants humanitaires et des femmes qui en bénéficient.
Même en dehors des situations d'urgence, l'accès à des contraceptifs modernes et sûrs permet aux femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur fertilité, ce qui réduit les grossesses non désirées et les avortements à risque, améliore les résultats en matière de santé et diminue le risque de mortalité maternelle et infantile.
En bref, le planning familial sauve des millions de vies. Voici quelques éléments essentiels sur le sujet :
Les grossesses dans les situations d'urgence
On estime que plus de 60% des décès maternels surviennent dans des situations de crise humanitaire et de fragilité, où les femmes ont du mal à accéder aux soins et à la nutrition nécessaires pour mener à bien une grossesse en toute sécurité.
Même dans les meilleures circonstances, un quart des femmes n'ont pas la capacité de refuser d'avoir des rapports sexuels, selon les données les plus récentes.
En cas de crise humanitaire, les femmes sont deux fois plus exposées aux violences de genre, à l'utilisation du viol comme arme de guerre et comme instrument de génocide et au risque accru de violence conjugale.
Tout cela accroît les risques de grossesses non désirées.
Prévenir les complications mortelles
Si la contraception est parfois critiquée – à tort – comme un phénomène nouveau, elle existe en réalité depuis des millénaires.
Les préservatifs, par exemple, sont utilisés depuis des siècles.
Les formes modernes de contraception sont parmi les médicaments les plus prescrits et les mieux étudiés qui existent. Les contraceptifs ont été étudiés non seulement par des pharmacologues et des chercheurs en médecine, mais aussi par des économistes de la santé, des épidémiologistes et des décideurs politiques.
Et les résultats sont concluants : en prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs empêchent les femmes de mourir.
Comment ? Chaque grossesse comporte un risque, et les grossesses dans les situations de crise, où les systèmes de santé sont en ruine et les soins médicaux difficiles d'accès, sont particulièrement dangereuses.
Parce que les bébés n'attendent pas
Que se passe-t-il lorsqu'une femme est prête à accoucher après un ouragan ou dans une zone de guerre ?
En RDC, en proie à une crise actuelle, l'effondrement des infrastructures de santé a fait grimper en flèche les taux de mortalité maternelle. Trois femmes y meurent toutes les heures de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement.
Selon le Dr Ikram Haboush, à Idlib, de nombreuses femmes dans le nord-ouest de la Syrie perdent la vie lors de leur transfert entre les hôpitaux, en l'absence de fournitures essentielles pour des conditions critiques.
Les grossesses non désirées sont également directement liées à des taux de mortalité maternelle plus élevés.
« C'est pourquoi tout programme de santé publique conçu pour réduire le nombre de décès maternels intègre la contraception comme l'un des piliers de l'action », indique les rédacteurs la publication annuelle phare de l'UNFPA, le rapport sur l'état de la population mondiale, « Comprendre l'imperceptible : Agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles ».
En prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs réduisent également l'incidence des blessures et des maladies maternelles, des mortinaissances et des décès néonatals.
En 2023, le partenariat dédié de l'UNFPA a permis d'acheter des contraceptifs pour un montant total de 136 millions de dollars, ce qui a permis d'éviter près de 10 millions de grossesses non désirées et plus de 200 000 décès maternels et néonatals, selon les estimations. Ces contraceptifs ont également permis d'éviter près de trois millions d'avortements à risque.
Prévenir les maladies mortelles et chroniques
Les contraceptifs, tels que les préservatifs masculins et féminins, sauvent également des vies en réduisant les risques de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH.
Même une IST traitable peut mettre la vie du patient en danger dans des environnements où l'accès aux soins médicaux est limité, comme c'est le cas pour les femmes et les filles en Haïti, par exemple, où la violence sexuelle généraliséeet incessante a entraîné une augmentation des taux de grossesses non désirées ainsi que des IST, alors que le système de santé s'est presque effondré.
Seuls 3% des survivantes en Haïti déclarent avoir reçu un traitement post-viol dans les 72 heures suivant l'agression. Ce traitement comprend une contraception d'urgence pour éviter une grossesse et la prophylaxie post-exposition pour éviter la transmission du VIH.
Les contraceptifs permettent également de traiter des problèmes de santé sans lien avec l'activité sexuelle, comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la dysménorrhée et les saignements extrêmement abondants.
Pour des femmes comme Omaira Opikuko, du Venezuela, il ne fait aucun doute que la contraception à longue durée d'action, après son sixième accouchement, lui a sauvé la vie.
Elle a souffert à la fois d'hémorragie et d'un prolapsus génital lors de son dernier accouchement.
« J'étais au bord de la mort », a-t-elle déclaré.
Le planning familial est rentable
En 2023, plus de 50 pays ayant reçu du matériel contraceptif de la part de l'UNFPA ont réalisé des économies de plus de 700 millions de dollars, au totla, grâce à la réduction des coûts de santé liés à la grossesse, l'accouchement et aux soins post-avortement.
De nombreuses études ont démontré que le planning familial est un investissement essentiel pour la société, non seulement parce qu'elle permet d'éviter les grossesses non désirées et les problèmes de santé maternelle qui les accompagnent, mais aussi parce qu'elle a un effet positif sur l'éducation et les capacités d'emploi des femmes.
Dans les situations humanitaires, les contraceptifs sont d'autant plus essentiels qu'ils aident les femmes et les familles à survivre et à se stabiliser pour mieux se redresser.
Alors que, partout,la précarité s'accroît, les catastrophes se multiplient et les déplacements augmentent, ces services représentent une lueur d'espoir pour les femmes et les filles du monde entier.
Comme l'a dit Mme Opikuko au Venezuela : « Je ne veux plus avoir peur ».
https://news.un.org/fr/story/2025/02/1152881
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Femmes kurdes : redéfinir la liberté grâce à la résilience

Quand nous parlons de lutte, nous évoquons une image aussi vieille que la civilisation humaine : la tension éternelle entre oppression et liberté, silence et voix, captivité et libération. Mais rarement dans l'histoire cette dichotomie a trouvé une expression aussi vivante que dans le voyage des femmes kurdes du Rojava (nord de la Syrie) et du Kurdistan du Sud (nord de l'Irak). Leur histoire est celle du défi, de la résilience et de la transformation, un récit qui marie poésie et résistance, et une histoire qui exige à la fois notre admiration et notre solidarité.
Tiré de Entre les liges et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/17/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/?jetpack_skip_subscription_popup
Les femmes kurdes sont depuis longtemps marginalisées, non seulement par les traditions patriarcales de leurs propres communautés, mais aussi par les régimes oppressifs qui ont cherché à effacer l'identité kurde elle-même. Pourtant, de ces cendres, telles des phénix, elles sont devenues des leaders, des guerrières et des visionnaires. Elles sont les architectes d'une révolution féministe, une avant-garde dans la lutte pour l'égalité des sexes sur l'un des terrains les plus hostiles que l'on puisse imaginer. Leur lutte, bien que spécifique à leur contexte culturel et historique, résonne universellement, nous appelant tous à réimaginer les possibilités de la liberté.
Mais pour comprendre l'ampleur de leurs réalisations, il faut d'abord prendre en compte le contexte de leur oppression. Pendant des décennies, les femmes kurdes d'Irak, de Syrie, de Turquie et d'Iran ont été triplement marginalisées : en tant que Kurdes au sein d'États-nations oppressifs, en tant que femmes au sein de sociétés profondément patriarcales et en tant qu'individus au sein d'un système mondial qui ignorait souvent leur sort. Le Rojava, la région autonome du nord-est de la Syrie, et le Kurdistan irakien sont devenus des creusets de leur résistance.
Au Kurdistan du Sud et en Irak, les cicatrices de la campagne Anfal restent gravées dans la mémoire collective : une attaque génocidaire menée sous le régime de Saddam Hussein qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de Kurdes, laissant d'innombrables femmes veuves, déplacées et vulnérables. De même, au Rojava, la guerre civile syrienne a créé un vide de gouvernance et de sécurité dans lequel la violence patriarcale, les idéologies extrémistes et la négligence systémique ont menacé d'engloutir les femmes kurdes.
Mais les femmes kurdes n'ont pas accepté le statut de victime comme leur destin. Au contraire, elles l'ont redéfini en utilisant l'oppression comme une arme de défi, en forgeant la solidarité et en créant des espaces d'autonomie, de droits et de dignité.
Nulle part cette défiance n'est plus évidente qu'au Rojava, où les femmes kurdes ont mené une révolution féministe et écologique qui remet en cause non seulement le patriarcat, mais aussi les structures mêmes de l'État et du capital. Au cœur de cette révolution se trouve le principe de la « jinéologie », une philosophie féministe kurde qui dérive du mot kurde pour « femme », jin, et qui revendique le rôle central des femmes dans la société.
La jinéologie s'éloigne radicalement des rôles traditionnels des sexes et du féminisme libéral occidental. Elle insiste sur le fait que la libération de la société dans son ensemble est impossible sans la libération des femmes. Au Rojava, cette philosophie s'est traduite par des structures de gouvernance concrètes. Les femmes occupent tous les niveaux de direction politique, des conseils locaux au commandement militaire. Le système de coprésidence impose que chaque poste de direction soit partagé par un homme et une femme, garantissant ainsi la parité des sexes dans la prise de décision.
Ce n'est pas seulement symbolique. Les femmes du Rojava ont réécrit des lois qui autrefois légitimaient les mariages forcés, les crimes d'honneur et la violence domestique. Elles ont construit des maisons pour les femmes – des centres d'éducation, de médiation et de soutien – et créé des coopératives pour promouvoir l'indépendance économique. Ce sont des actes de révolution silencieuse, qui ne reposent pas uniquement sur la théorie mais aussi sur une transformation concrète et vécue.
Le monde a pris conscience pour la première fois de la lutte des femmes kurdes lors de la bataille de Kobané en 2014, lorsque des images de jeunes femmes en treillis, armées de kalachnikovs, ont commencé à circuler dans les médias du monde entier. Ces femmes, membres des Unités de protection des femmes (YPJ), se sont retrouvées en première ligne contre l'EI, l'une des forces les plus brutales et misogynes du XXIe siècle. Leur courage et leur génie tactique ont renversé le cours de la bataille, reprenant Kobané des mains de l'EI et gagnant l'admiration du monde entier.
Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de triomphe militaire. Pour les femmes du YPJ, la résistance armée est une extension de leur idéologie féministe. Elles ne se battent pas seulement pour la souveraineté territoriale, mais pour une libération plus large du patriarcat et de l'autoritarisme. À leurs yeux, l'arme n'est pas un outil de domination mais un moyen de démanteler les structures d'oppression.
Au Kurdistan irakien, la lutte pour les droits des femmes a pris une tournure différente mais tout aussi significative. Les femmes kurdes y sont apparues comme militantes, politiciennes et militantes, remettant en cause des normes culturelles bien ancrées et faisant pression pour des réformes juridiques.
Des organisations comme l'Union des femmes du Kurdistan et l'Organisation des droits des femmes du Kurdistan mènent une campagne inlassable contre la violence sexiste, le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Leurs efforts ont conduit à d'importantes victoires juridiques, notamment la criminalisation des crimes d'honneur et la création de refuges pour les victimes de violences conjugales.
Mais les progrès sont fragiles. Les normes traditionnelles et l'instabilité politique continuent de poser des problèmes. Pour chaque femme qui entre au parlement ou qui mène une manifestation, il y en a d'innombrables autres dont la voix reste ignorée et dont les droits restent bafoués. Mais même ici, les femmes kurdes puisent leur force dans leur lutte collective, refusant de céder face à l'adversité. Il y a aussi la situation troublante où de nombreuses militantes kurdes sont la cible de frappes de drones ou d'assassinats par l'armée turque, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours des dernières années.
Mais les réalisations des femmes kurdes vont bien au-delà de leur contexte immédiat. Elles sont devenues un symbole de résistance et une source d'inspiration pour les mouvements féministes du monde entier. Leur lutte met au défi les féministes occidentales de reconsidérer les croisements entre genre, ethnie et colonialisme. Elle nous rappelle que la libération n'est pas un don d'en haut, mais une bataille acharnée menée d'en bas.
Les femmes kurdes ont également forgé des solidarités transnationales, en collaborant avec des organisations féministes du monde entier pour amplifier leur message. Leur travail nous a montré que le féminisme ne peut être dissocié des questions de justice économique, de durabilité écologique et d'autodétermination ethnique. Il doit être holistique, intersectionnel et sans compromis. À cet égard, l'idéologie du confédéralisme démocratique est significative, tout comme les écrits du leader kurde Abdullah Öcalan.
En réfléchissant sur la lutte des femmes kurdes, nous ne devons pas non plus négliger sa dimension poétique. Leur révolution n'est pas seulement un acte politique, c'est aussi un acte profondément culturel. À travers leurs chants, leurs danses et leurs récits, les femmes kurdes ont préservé leur héritage et imprégné leur résistance d'un profond sentiment d'identité et d'objectif.
Écoutez leurs voix et vous entendrez les échos de Mala Jin, les maisons des femmes kurdes qui sont à la fois des espaces de refuge et de révolution. Vous entendrez les chants de défi des femmes de Kobanê et les discours passionnés des militantes de Souleimaniyeh. Vous ressentirez les rythmes d'un peuple qui, même face à des souffrances inimaginables, refuse de renoncer à son espoir.
En conclusion, posons-nous la question suivante : qu'est-ce que la lutte des femmes kurdes exige de nous ? Au minimum, elle exige que nous en témoignions. Elle exige que nous racontions leurs histoires, que nous amplifiions leurs voix dans un monde qui les réduit trop souvent au silence. Mais plus encore, elle nous appelle à l'action. Elle nous met au défi de démanteler les systèmes d'oppression dans nos propres communautés, de lutter pour l'égalité des sexes non pas comme un idéal abstrait, mais comme une réalité vécue.
Les femmes kurdes nous ont montré ce qui est possible lorsque le courage rencontre la conviction, lorsque le féminisme n'est pas seulement une théorie mais une pratique, un mode de vie. Elles nous ont appris que la libération n'est pas une destination mais un voyage, un voyage qui nous oblige à marcher ensemble, main dans la main, vers un avenir où chaque femme, partout, pourra vivre libre. C'est la véritable essence du slogan kurde « Jin, Jiyan Azadi » (Femmes, vie, liberté), que l'on peut entendre scander partout dans le monde.
Shilan Fuad Hussain
Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes ; les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :
https://www.shilanfuadhussain.com/
Texte original (en anglais) à lire sur le site de Washington Kurdish Institute : Kurdish Women : Redefining Freedom through Resilience
https://kurdistan-au-feminin.fr/2025/02/11/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rêver ensemble. Pour un patriotisme internationaliste

À l'occasion des journées de débat sur le thème « L'alliance des tours et des bourgs ? Chiche ! », dont Contretemps a publié certaines contributions (voir ici et ici), Houria Bouteldja a prononcé une intervention, dont nous publions la version écrite. Prolongeant les thèses défendues dans son dernier ouvrage, Beaufs et barbares. Le pari du nous, elle regrette l'absence de transcendance parmi les défenseurs de l'émancipation, et défend notamment un « patriotisme internationaliste », un « Frexit décolonial » et un « communisme à visage patriote ».
Si la rédaction de Contretemps est loin d'être unanime quant à cette perspective, il nous a semblé utile de publier ce texte qui questionne le rapport de la gauche et des classes populaires à la nation, sans abandonner une perspective antiraciste et décoloniale. Nul doute que le débat sur ces enjeux, qui font écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur la « Nouvelle France », nécessite d'autres contributions qui pourront être accueillies sur le site de Contretemps.
***
11 février 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/rever-ensemble-patriotisme-internationaliste-houria-bouteldja/
Commençons par un constat froid.
Dans la période, le rêve est d'extrême droite. Seule l'extrême droite rêve. Seule l'extrême droite désire. Seule l'extrême droite a une libido.
La meilleure des gauches au mieux est matérialiste. Ce qui n'est pas un défaut en soi car dans ce monde dystopique où la vérité historique et le réel ont été abolis, l'analyse matérialiste est une condition essentielle de l'action politique. Mais cette gauche, aussi honnête soit-elle, peine à produire du rêve notamment à cause des défauts de ses qualités : elle n'est que matérialiste. Elle ne touche aucune corde sensible. Comme le faisait déjà remarquer le psychanalyste communiste Wilhelm Reich dans l'entre-deux guerres, « le mouvement socialiste ne défend pas l'affirmation de la vie en ce qui concerne les masses laborieuses mais seulement quelques revendications économiques essentielles ». Mais mieux que Reich, Otto Strasser (de la « gauche » du parti nazi) disait en s'adressant aux communistes : « Vous commettez l'erreur fondamentale de nier l'âme et l'esprit, de vous en moquer et de ne pas comprendre que ce sont eux qui animent toute chose ».
Avec cette gauche, on peut au mieux rêver de préserver ses acquis, sa retraite, le service public ou son pouvoir d'achat. Certes, il existe une autre gauche, minoritaire mais plus romantique. Celle qui est internationaliste et communiste. Sauf que son rêve n'est partagé que par une poignée d'idéalistes, tellement elle est utopiquement déconnectée, tellement le communisme a historiquement déçu, tellement il a été dévoyé d'un côté, diabolisé et ringardisé de l'autre, tellement il échoue à répondre aux besoins immédiats tant matériels que moraux des classes populaires. En d'autres termes, si cette gauche rêve, elle rêve seule. Or le thème de cette table ronde, c'est « rêver ensemble », et j'ajouterais rêver en masse. Par conséquent la question est la suivante : comment concurrencer les rêves l'extrême droite et comment rêver plus passionnément à gauche ?
J'ai eu l'occasion dans des débat récents d'être confrontée à cette question. Une première fois avec Bernard Friot, une seconde avec Frédéric Lordon. Tous deux m'ont dit, et à juste titre, que la proposition de Frexit décolonial que je propose dans Beaufs et Barbares, même si elle est nécessaire, n'est pas « kiffante ». Je le concède tout à fait. C'est pourquoi, ils, Friot et Lordon, persistent à rêver communistes. Mais en vérité, ni ce projet ni les moyens de le réaliser ne sont plus « kiffants » que le Frexit. On ne mobilise pas en effet les masses avec l'idée de salaire à vie. Et, je le crains, pas plus avec la proposition communiste de Lordon sur laquelle je vais revenir et qui se fonde sur un postulat avec lequel je suis en parfait accord et que je résume ici : il y a au coeur des classes populaires blanches des enjeux d'identification rattachés à des enjeux de survie. Le racisme, le nationalisme et le masculinisme sont toutes des solutions identificatoires de ce type quand toutes les autres ont été détruites. Il ajoute et là aussi je suis en total accord, qu'il faut inventer des solutions identificatoires de substitution si on veut aller vers un dénouement révolutionnaire, et à ce titre, ces solutions doivent être de qualité et procurer le même niveau, sinon un niveau supérieur, de satisfactions morales et psychiques que le nationalisme, le racisme et le masculinisme. Sa proposition peut se résumer comme suit : faire un détour par 1917 où selon lui trois ressources passionnelles ont été utilisées pour nourrir le souffle révolutionnaire : 1/ la colère et la haine, 2/ l'expérimentation des puissances collectives soviétiques et 3/ l'horizon positif du mot d'ordre (la terre, la paix, le pain). Je propose de les passer en revue.
1/ La colère et la haine sont effectivement des affects puissants et il faudrait selon lui les détourner de leur cible première, les noirs est les arabes, pour les orienter vers les riches. C'est évidemment dans cette direction qu'il faut aller mais là où le bât blesse c'est qu'on ne voit pas trop par quel miracle cette pulsion passionnelle, l'hostilité envers les arabes et les noirs, se retournerait spontanément contre les riches étant donné son ancrage dans la culture populaire dont je voudrais rappeler ici qu'elle tient à des conditions matérielles liées au contrat racial. Comment opérer ce détournement, c'est ce que Lordon ne nous dit pas car la conscience triangulaire des « petits blancs », qui détestent autant la France d'en haut que la France d'en dessous la France d'en bas, ne se téléguide pas, elle est trop consistante pour espérer la balayer à coup de sermons et de prêche sur l'ennemi principal que serait la bourgeoisie.
2/ Expérimenter les puissances collectives : à l'époque celle des soviets, aujourd'hui, celle des ronds-points. Pourquoi pas ? Mais cette expérimentation pour extraordinaire et créatrice qu'elle ait pu être, ne peut pas se généraliser ni se pérenniser dans le temps comme on a pu le constater. En d'autres termes comment expérimenter les puissances collectives quand le marché du travail est à ce point éclaté, morcelé, stratifié et où la classe ouvrière beaucoup plus hétérogène et concurrentielle qu'en 17 ne dispose plus de lieux comme l'usine où se mobiliser et où s'organiser ?
3/ L'horizon positif du mot d'ordre : la terre, la paix, le pain. Lordon ne dit pas qu'il faut revendiquer ces mots d'ordre précisément mais je considère pour ma part qu'ils restent valides. Sauf que pour revendiquer la terre encore faut-il une paysannerie puissante ou défendre celle qui reste, voire lui imaginer un avenir décent, mais elle a été sacrifiée par le néolibéralisme et continue de l'être. Pour revendiquer la paix encore faut-il se sentir concerné par la guerre. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nous qui mourrons en masse mais les peuples qui ne comptent pas et dont la destruction effroyable est banalisée. Reste le pain ? Il se trouve que ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui votent extrême droite. Et ceux qui très pauvres auraient toutes les raisons de revendiquer le pain, sont plutôt la frange la plus résignée de la population, qu'elle soit blanche ou non blanche. Il faut donc d'autres mots d'ordre. Mais lesquels ? Telle est la question.
Ainsi, renouer avec la proposition identificatoire du premier communisme : le pour-soi de la condition ouvrière est aujourd'hui une impasse. Comment renouer avec cette identification quand les conditions sociales de la culture ouvrière ont été détruites et que la conscience ouvrière s'est progressivement dissoute dans l'individualisme, la culture libérale, l'abstention encore la dérive droitière et raciste… ?
Malgré tout, et il faut le reconnaitre, toutes ces propositions sont justes et dignes de participer de l'élaboration d'une politique révolutionnaire mais elles ont un énorme défaut. Ce qui me frappe dans cette solution, c'est qu'elles ne salissent pas. On sort de ces propositions aussi propres qu'on y est rentrés. A aucun moment on est mis en danger alors même que Lordon affirmait je cite « qu'il n'était pas de proposition politique qui aspire à quelque succès, qui ne soit doublée d'une proposition passionnelle identificatoire forte qui s'attaque aux pulsions négatives ». Il ajoutait : « quand on soulève le capot et qu'on regarde dans la psyché des gens, on ne voit que du dégueulasse. La gauche qui refuserait de regarder ça se condamnerait. » Je ferme les guillemets.
Il a mille fois raison. Sauf que comprendre le sale, ce n'est pas encore affronter le sale et encore moins se salir. Or, le sale, dans cette proposition, est contourné. La proposition reste d'une grande pureté. Les petits blancs sont racistes ? Qu'à cela ne tienne, offrons-leur la tête des bourgeois ! Ils sont masculinistes ? Détournons leur colère contre les patrons ! Ils sont nationalistes ? Offrons-leur les joies du communisme ! Je ne veux surtout pas faire ici de mauvais procès à Lordon avec lequel j'ai beaucoup de convergences de vue car il a été l'un des premiers et des rares à prôner le retrait de l'Union européenne et a subi pour cela des attaques en souverainisme. Je ne parle bien que de cette proposition telle qu'elle a été formulée.
Je pense pour ma part, qu'on ne peut pas prétendre avoir compris la matérialité du besoin de racisme, de masculinisme ou de nationalisme sans au minimum aller tremper un orteil dans le marais de ces passions tristes, comme on ne peut pas prétendre devenir sujet d'histoire avec les classes populaires telles qu'elles sont sans partager avec elles une part du laid et sans s'enlaidir un peu soi-même. La proposition intègre et vertueuse hélas n'existe pas. Ceux qui l'espère dans un projet d'union des beaufs et des barbares sont défaits par avance. Tout projet de transformation impliquant les masses populaires des pays du centre capitaliste très fortement impliquées dans l'exploitation et le saccage du monde et ayant un fort intérêt à défendre ce train de vie est nécessairement une entreprise compromettante, dangereuse et risquée. Les forces politiques à prétention révolutionnaire seront toujours sur une ligne de crête. Car me semble-t-il, nous devons payer le prix d'être la fraction privilégiée et corrompue du prolétariat international. C'est la nature même de ce prolétariat et la tentation de la sauvegarde de ses intérêts de race garantie par l'État-nation, dans toute son ambivalence, qui rend la tâche ardue et qui fera de nous des funambules.
Alors que faire ?
Si le communisme en 1917, l'islam politique dans le monde arabe ou la théologie de la libération en Amérique latine, pour ne prendre que ces trois exemples, ont mobilisé les corps et les esprits, c'est parce qu'ils ne se contentaient pas d'être à hauteur d'hommes. Ils étaient plus grands et d'une certaine manière obligeaient à lever la tête en direction d'une utopie, ou en direction de Dieu. Si j'évoque ces exemples, c'est pour d'abord souligner une absence, une vacance, un vide de transcendance. Car oui, il nous manque une transcendance. Cette transcendance ne peut plus être le communisme pour les raisons déjà évoquées, elle ne peut plus être le christianisme car Dieu a été chassé des cœurs et des esprits par un sécularisme forcené, cette transcendance ne peut pas être l'islam (et croyez bien que je le regrette) car c'est à la fois une religion persécutée mais surtout une religion minoritaire ici en France. Or comme vous le savez, nous devons rêver ensemble. Nous devons donc nous projeter sur une transcendance collective et largement reconnue. Je m'empresse de dire que celle-ci doit être raisonnable, j'insiste sur raisonnable, car c'est l'humeur générale et le contexte qui fixent le niveau d'exaltation qui doit nous habiter, or le contexte est désenchanté. L'humeur c'est la désillusion, le sentiment d‘échec. Nous sommes tous et collectivement revenus de tout. On a tout essayé, tout expérimenté mais rien ne marche. Même pas la simple préservation des acquis. La Macronie nous dépossède tous les jours de notre puissance collective et nous nargue. C'est pourquoi, même l'idée de transcendance, il faut l'aborder de manière pondérée, c'est à dire adaptée aux conditions historiques, sociales et psychologiques du moment, soit celles des illusions perdues. Le rêve que j'imagine ne peut-être qu'un compromis entre les rêves trop grands des avant-gardes romantiques et les rêves trop petits en faveur de la retraite à 60 ans.
Pour résumer, cette transcendance doit être capable de mobiliser les affects installés et durs donc à fort potentiel identificatoire ; elle doit être saisissable immédiatement car le fascisme est à nos portes ce qui nécessite d'utiliser les affects communs à grande échelle et disponibles instantanément ; elle ne peut pas prendre la forme d'une utopie hors-sol, trop généreuse si j'ose dire, qui fantasmerait d'abord le bonheur de toute l'humanité, la fraternité humaine, sans répondre aux besoins matériels et moraux des classes populaires dont l'adhésion massive est l'une des conditions essentielles de la transformation sociale. C'est-à-dire, et au risque d'en froisser certains, en finir avec la forme éthérée de la « révolution permanente » qui est une forme abstraitement « cosmopolite » et universaliste. Enfin, elle doit compromettre notre vertu non pas parce que la souillure serait une fin en soi mais parce qu'elle est un passage obligé compte tenu de ce que j'ai dit plus haut. Nous, peuples du Nord, ne sommes pas innocents qu'on soit Blancs ou non Blancs. Nous faisons partie du problème.
Aussi, la seule transcendance que je connaisse et qui réunisse toutes ces qualités, tout le monde dans cette salle la connait intimement. Mais beaucoup la méprisent parce qu'à gauche, et dans le mouvement décolonial, pour des raisons souvent nobles, elle a été jetée avec l'eau du bain. C'est donc l'occasion pour nous, moi y compris, de faire notre auto-critique, et mener la bataille contre nous-mêmes.
Cette transcendance a un nom. Elle s'appelle France.
La France. Notre pays. Le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous élevons nos enfants, dans lequel nous nous projetons, auquel nous sommes plus ou moins attachés, que nous pouvons parfois aimer, parfois détester, qui nous fait et que nous faisons.
La France, qu'est-ce que c'est ? Je mets au défi quiconque dans cette salle de me donner une définition claire et précise de ce que c'est. On peut définir un État-nation, on peut définir la république, mais la France ? C'est déjà plus compliqué.
Parce que la France, c'est une idée. Une simple idée. Et d'une idée, on en fait ce qu'on veut. Notamment un devenir. Ce que je veux appeler ici le devenir France.
Dans son livre « Théorie du sujet », Alain Badiou commence avec cette phrase : « J'aime mon pays la France ». Plus tard, dans un débat contre Alain Finkielkraut avec qui il dit partager une forme de mélancolie dans son rapport à la France, il ajoute : « Il est difficile de trouver plus profondément français que moi ». Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est d'abord qu'un communiste non repenti exprime son amour pour son pays, ensuite qu'il le fasse en compagnie d'un ennemi qui, lui, en sa qualité de prétendant à la blanchité (je rappelle que Finkielkraut est un juif et qu'à ce titre il est une victime historique du nationalisme européen), a sur-investi l'idée de France comme le font la plupart des non blancs au point d'être devenu au fil du temps l'une des figures majeures de la réaction. Nous avons donc ici deux figures : l'une fidèle au projet communiste et l'autre réactionnaire, toutes deux amoureuses de la France. Il n'y a là qu'une contradiction d'apparence, car comme je l'ai dit plus haut, la France c'est d'abord une idée. Mais c'est aussi une histoire. Et de France, il y en a au moins deux. Celle de la révolution et celle de la contre-révolution, celle des Communards et celle des Versaillais, celle de la résistance et celle des collabos[1], celle du mouvement ouvrier qui accouche des droits sociaux et politiques et celle de la bourgeoisie qui accouche de l'Union européenne.
Je postule ici que si la gauche est plutôt l'héritière de la première et la droite de la deuxième, le peuple blanc est lui une synthèse des deux France. Il est dans ses grands traits patriote pour de très bonnes et de très mauvaises raisons. Il sort le drapeau pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il chante la marseillaise pour de bonnes et de mauvaises raisons. En d'autres termes, les deux France cohabitent en lui. C'est donc au creux de cette contradiction profonde que la bataille doit être menée. Notre objectif ultime étant que l'une des deux France l'emporte sur l'autre.
Comme je le disais, il faut apprendre à se salir les mains. C'est ici que ça commence. Le premier pas dans cette direction si on veut cheminer avec les petits blancs serait de se ré-approprier la France et plus exactement l'idée de patrie. C'est dans ce geste précisément qu'on va commencer non pas à rêver ensemble mais à être ensemble. J'insiste sur être. Car si les classes populaires sont attachées à la patrie, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont mues par des sentiments primaires et chauvins mais aussi parce que la patrie sous sa forme nationale est un bien du peuple et qu'elle est comme le souligne Poulantzas un produit de la lutte des classes. Les affects blancs patriotes sont aussi liés à des intérêts de classe comme nous le montre le mouvement dialectique de la formation nationale. Le mot patrie est polysémique. Sous l'influence de la Révolution française (puis d'autres évènements fondateurs comme la Commune ou le programme de la Résistance à la Libération), la perception populaire de la patrie est d'abord rattachée à l'affirmation de principes politiques émancipateurs, universels, étrangers à toute idée de nationalité ou de nationalisme. Ici, la patrie est indissolublement liée à la souveraineté et donc à la nation.
Mais la notion bourgeoise de nationalité de l'État-nation va évidemment contrecarrer cette conception émancipatrice de la nation : le national se définit alors comme le ressortissant de l'État, tandis que l'étranger se définit comme non-national et non-citoyen, n'appartenant pas à la communauté politique constituée en État. La nationalité moderne ne définit donc pas réellement l'appartenance à une nation, mais le rattachement à un État. Comme le dit Lochak, « le lien de nationalité est devenu un lien unilatéral et non plus contractuel, dont l'État est à peu près seul maître ». C'est ainsi que sont progressivement liquidés et la volonté générale(à la source de la souveraineté et de la Nation) et le contrat social. Ainsi, le mot « patrie » qui oscille toujours entre fraternité universelle d'une part et exclusion et racisme d'autre part est tout sauf pur mais aussi tout sauf totalement condamnable.
Si sous sa part lumineuse, la Patrie-Nation est avant tout la souveraineté nationale et populaire, il devient évident que la corrosion des services publics et du principe d'égalité et de justice est immédiatement perçue comme une perte de souveraineté. C'est ce qui pousse les dépossédés, les véritables nationaux, le corps légitime de la nation, les petits blancs au chauvinisme et donc à la défense de la frontière raciale qui devient poreuse à mesure qu'ils dégringolent dans l'échelle sociale. Leur effroi est justement qu'ils refusent de devenir des indigènes. Leur salut c'est une version exclusiviste de la patrie.
C'est pourquoi, pour rétablir une version non exclusiviste de la patrie, il faut rétablir l'État social et le service public auxquelles les classes populaires blanches sont très attachées. Il faut prouver que la justice sociale (qui passe par déposséder le bloc bourgeois) est plus profitable que récupérer les miettes des noirs et des arabes, prouver que la lutte des classes est plus profitable que le racisme. Mais pour cela, il faut rétablir la souveraineté populaire. Le thème de la souveraineté nationale telle que la définit Gramsci est aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Mais cela implique une réforme intellectuelle et morale. Cela implique aussi de construire un rapport sentimental, affectif et idéologique avec les sacrifiés du néo-libéralisme et cela ne peut se faire que par la médiation du sentiment patriotique. C'est en tant que peuple nation que nous devons redevenir les protagonistes de l'histoire car c'est à l'échelle nationale, comme l'a dit hier Stathis Kouvelakis – l'échelle qui mobilise les affects les plus puissants – que doit s'organiser l'hégémonie et plus exactement une volonté politique collective et nationale, ce que recouvre le concept gramscien de « national-populaire ». C'est dans ce cadre que le Frexit prend toute sa dimension stratégique puisqu'il propose la reconquête de la patrie et donc du bien commun et donc de la souveraineté populaire. Et là où il y a reconquête de la souveraineté populaire, il y a rapport de force. Et là où il y a rapport de force favorable, il y a le pouvoir, il y a l'existence politique, il y a la dignité retrouvée. Ajoutons ici qu'il y a une opportunité historique qui se présente à nous et qu'il serait bête de ne pas saisir. L'extrême droite soit-disant patriote n'a la confiance des classes dirigeantes qu'à la condition de se soumettre à l'européisme et par conséquent de trahir la nation. Plus elle donnera des gages comme l'a déjà fait Meloni plus elle a des chances d'accéder au pouvoir. Or, les classes populaires blanches sont plutôt anti-européennes comme l'a montré le « non » au traité constitutionnel de 2005. C'est le moment où jamais de prouver qui est véritablement avec le peuple et qui ne l'est pas.
Mais moi qui vous parle aujourd'hui, et après avoir fait cette balade dans l'univers révolutionnaire français, je n'oublie pas un instant qui je suis ou plutôt ce que je suis : une indigène de la république. Un sujet colonial. L'objet de la discorde. La variable d'ajustement. Je n'oublie pas l'autre France. Je n'oublie pas que les « fachés pas fachos » sont organiquement liés à l'autre France. Je n'oublie pas un instant le mal qu'a semé l'autre France, dans le monde, je n'oublie pas le code noir, le code de l'indigénat, je n'oublie pas les massacres de masse, l'exploitation et la spoliation de masse, je n'oublie pas la Françafrique, la Kanaky, l'abandon de Mayotte, le soutien aux génocidaires israéliens. Bref, je n'oublie pas, comme le dit Césaire que la France est indéfendable. Je n'oublie pas le constat de Césaire :
« Le fait est que la civilisation dite » européenne », la civilisation « occidentale », telle que l'ont façonnée deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance : le problème du prolétariat et le problème colonial ; que, déférée à la barre de la « raison » comme à la barre de la « conscience », cette Europe-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chance de tromper. »
Sauf qu'il se trouve que même les indigènes ont un besoin de patrie. D'ailleurs, la plupart du temps, ils aiment plus la France qu'elle ne les aime. Et ces manifestations d'amour, en fait, elles sont nombreuses. Et ils ne sont pas rares à brandir le drapeau bleu blanc rouge lors de victoires de coupes du monde, ou lors de manifestations contre le racisme où il leur sert d'alibi. Voyez à quel point nous sommes Français clament-ils. Car les indigènes sont privés de patrie. Ils ont perdu la leur et n'en ont retrouvée aucune. Et s'ils aspirent à cette adoption par la patrie France, c'est aussi pour des questions de survie, de protection, de sécurité. Avoir une patrie, c'est l'une des dimensions de la dignité humaine et en être privé est une blessure sinon comment expliquer le rapport névrotique au drapeau algérien ?
Les beaufs et les barbares, situés du même côté de la barrière de classe mais séparés par la division raciale, partagent donc le même rêve. Les uns revendiquent une patrie qui leur échappe (à cause de ce qu'ils appellent le mondialisme) ou qui les trahis (l'Union européenne), les autres revendiquent une patrie qui les exclut et les méprise. Mais à chacune de ces manifestations de désir patriotiques, les avant-gardes politiques, qu'elles soient d'extrême gauche ou décoloniales se bouchent le nez. La gauche parce qu'elle n'y voit que du chauvinisme, les décoloniaux parce qu'ils n'y voient que de l'intégrationisme. Je prétends pourtant ici que les avant-gardes qui se bouchent le nez dans les moments de liesses populaires comme les matchs de foot, ou devant les drapeaux de gilets jaunes, ou encore les manifestations comme celle contre l'islamophobie de 2019 dans lesquelles les indigènes ont brandi le drapeau bleu blanc rouge se transforment par ce geste en arrière-garde. Je sais que s'attribuer le qualificatif d'avant-garde est mal perçu dans certains milieux de gauche. J'assume malgré tout et sans fausse pudeur ce titre. Car je crois à l'importance et à la nécessité de directions politiques qui assument ce rôle d'impulser, de diriger, d'encadrer, d'organiser et de tracer des lignes stratégiques fondées sur une théorie, une pratique et une vision du monde. En revanche, je pense que si parfois nous sommes légitimes à prétendre guider les masses, en tant qu'avant-garde, nous rechignons à être guidés par elles. Pourtant nous devons apprendre à distinguer les moments où nous devons guider comme les moments où nous devons nous laisser guider. Se boucher le nez devant certaines manifestations de patriotisme ou devant l'intégrationisme spontané des indigènes c'est passer à côté de la finesse et de la subtilité des affects populaires. Ils savent très bien pourquoi ils ont besoin de ce drapeau, ils savent très bien ce qu'ils en attendent. Ils savent très bien que la France, c'est comme l'or, une valeur refuge. Et contrairement à nous, ils savent rêver à la mesure de leurs moyens. Et si la France incarne leur rêve, c'est que la France est à leur portée. Ni trop grande ni trop petite.
Et pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, je ne fais confiance ni aux indigènes ni aux petits blancs. Parce que je sais que je ne peux pas me laisser entrainer par la pente nationaliste et intégrationniste. Parce qu'au fond je sais que j'ai raison de n'être ni nationaliste ni intégrationniste. Je sais qu'ils savent quelque chose, et je sais aussi que je sais quelque chose. Je sais que la solution « patriote » ne saurait se suffire à elle-même. L'indigène décoloniale que je suis se sentirait à l'étroit. Mais plus qu'à l'étroit, se sentirait incomplète, limitée dans son être. Mais pire encore, se sentirait traitre. Car il y a les autres du grand Sud. Non pas les autres comme simple altérité mais les autres comme prolongement de notre humanité. Or ces autres, nous les malmenons, nous les torturons. S'il est un impératif à devenir pragmatiques, donc patriotes, cet impératif ne peut pas constituer une fin en soi. La défense de la patrie-nation ne sera acceptable que fraternisant avec les peuples écrasés. Aussi, ce patriotisme sera internationaliste ou ne sera pas. C'est la seule manière d'échapper à l'emprise de l'État bourgeois, que je veux appeler ici État racial intégral. La communion populaire et la communion avec les peuples opprimés par les appétits impérialistes passeront nécessairement par la rupture de la collaboration de race donc par la rupture du lien organique qui lie les classes populaires blanches à l'État bourgeois et qui lie les indigènes à ce même État bourgeois par le mirage intégrationniste. Aussi la tâche des avant-gardes politiques qui auront pris le chemin de la défense de la patrie et qui auront repris langue avec les classes populaires, qui apprendront à parler la langue des petits, ne doit en aucun cas céder à la démagogie. Car les affects des petits sont aussi dangereux qu'ils sont émancipateurs. Il faut les manipuler avec une grande prudence. Notre boussole internationaliste doit donc rester intacte. Aussi de la même manière que dans le mouvement décolonial nous disons « pas de lutte de classe sans anti-impérialisme », « pas de féminisme sans anti-impérialisme », « pas de 6eme république sans anti-impérialisme », nous disons bien évidemment pas de patriotisme sans anti-impérialisme. Et pour ceux qui douteraient de la possible résolution de cet antagonisme apparent, je renvoie à cet épisode de la Révolution française où est venue à l'ordre du jour la question de l'abolition de l'esclavage. Les colons défendaient l'idée que l'intérêt national dépendait de la production coloniale, elle-même dépendante du travail forcé et gratuit. La fameuse réplique de Robespierre : « périssent les colonies plutôt qu'un principe » est l'expression d'une rationalité. Si la révolution édicte des principes, elle doit en assumer les conséquences. Il est impossible de réduire un homme en esclavage sans être un criminel. Il faut donc en assumer les conséquences, et si les conséquences, c'est la ruine des colonies, alors c'est la ruine des colonies et c'est tout. C'est pourquoi, le vote de l'abolition de l'esclavage s'est fait sans débat, ce qui était contraire aux mœurs démocratiques. Mais c'est, comme le rappelle Badiou, que les révolutionnaires ont considéré que soumettre la question du vote au débat c'était déjà en entamer la valeur. Or on ne débat pas de savoir si un humain doit être esclave ou non. On vote contre et c'est tout. C'est ainsi que l'abolition de l'esclavage a été entérinée sans débat, car en débattre était déshonorant. Ce geste fondateur, d'une esthétique et d'une beauté sublime, doit redevenir le geste des avant-gardes politiques et doit s'étendre à la conscience collective. Ce n'est pas tout à fait un hasard, si contrairement à de nombreux pays européens, nous avons encore une gauche de rupture forte. Si nous ne sommes pas complètement défaits, c'est qu'il y a des héritages historiques forts qui innervent le mouvement social au-delà de la France insoumise. Face à la transcendance, il y a l'immanence de la volonté populaire historique. Mais attention, la tâche des avant-gardes ne s'arrête pas là, elle doit aussi proposer une vision de la totalité, une explicitation du monde. Une vision qui expliciterait les mystères de notre impuissance collective dont les classes populaires ont soif et qui les poussent dans les bras du confusionnisme et du conspirationnisme. C'est pourquoi à un phénomène total, il faut opposer une vision matérialiste de la totalité.
Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur les soubassements de cette proposition de « patriotisme internationaliste ». Je disais plus haut que le communisme ne faisait pas rêver. Certes. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait y renoncer. Je vais même faire un aveu. Je pense que le communisme est la seule et unique planche de salut pour l'humanité. Quel que soit son habillage. D'abord parce qu'il est la seule alternative rationnelle à l'ensauvagement capitaliste mais aussi parce que nous n'avons aucun autre choix devant l'impératif écologique et climatique. L'option communiste est la seule option vitale. Je le dis sans la moindre ambiguïté. C'est pourquoi, il faut rendre grâce à ceux comme Friot et Lordon qui poursuivent ce rêve, c'est pourquoi je ne l'ai jamais écarté. Si vous dépliez la proposition de patriotisme internationaliste, vous constaterez que le retour à l'échelle nationale (Frexit décolonial), la reconquête de la souveraineté nationale-populaire, le combat pour l'hégémonisation d'un bloc social accompagné d'un véritable programme de rupture avec le néo-libéralisme additionné d'un internationalisme sous sa forme anti-impérialisme – je rappelle que selon Lénine l'impérialisme et le stade suprême du capitalisme et qu'à ce titre être anti-impérialiste c'est être automatiquement anticapitaliste – constituent une proposition résolument et implacablement communiste. La différence entre un communisme qui se présente devant un peuple réfractaire à visage découvert et un communisme à visage patriote c'est que le premier rate sa cible et que le deuxième a quelques chances de l'atteindre. Mais ce communisme devra être le communisme de son temps. Il devra être décolonial. Pas seulement anti-impérialiste. Il pourra être chrétien, il pourra être islamique, il pourra être kurde, palestinien, chinois, il pourra même être régionaliste. Car pour devenir une véritable transcendance, Il doit accueillir en son sein la diversité humaine, la diversité des situations, la diversité culturelle mais aussi tous les besoins de l'âme.
Comme vous pouvez le voir, ce rêve que je promettais modeste et raisonnable est tout sauf raisonnable et modeste. Il est même un peu fou. Mais comme vous le savez, heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière.
Note
[1] La Résistance n'était pas qu'affaire de lutte armée contre l'occupant, mais également de réfléchir à quelle France construire à la Libération (d'où le fait que De Gaulle a méprisé la résistance intérieure de la France – dans laquelle les communistes ont joué un rôle important). Grégoire Madjarian écrit notamment : « ce qui se joue directement en France, ce n'est pas seulement la libération du territoire, mais aussi l'existence d'un régime, la nature du pouvoir politique et la direction de ce pouvoir. L'insurrection de l'été 1944 n'a pas simplement un caractère national : elle provoque l'effondrement de « l'État français » et elle est l'instrument d'une prise de pouvoir. ». D'où le fait que les Américains étaient très méfiants vis-à-vis de la Résistance intérieure. Bref : plusieurs conceptions de la France s'affrontent. En visite à Marseille à la Libération, où des maquisards défilaient la chemise ouverte, en tirant un véhicule allemand sur lequel se trouvait des filles en robes (il faisait chaud) qui criaient en agitant des drapeaux, De Gaulle aurait grommelé (selon Lucie Aubrac) « Quelle mascarade ». A Toulouse, la situation a failli dégénérer après que De Gaulle a ouvertement méprisé des maquisards. D'ailleurs, il est intéressant que l'une des premières demandes faites par De Gaulle aux alliés ait été la livraison d'uniformes militaires afin de distinguer les « réguliers » des irréguliers et faire disparaitre des forces armées auxquels ils étaient hostiles.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le duo Trump-Musk : Un fascisme « nouveau genre » ?

Les spécialistes de l'histoire du nazisme nous préviennent : la situation politique actuelle, à l'échelle internationale, s'apparente, sous maints aspects, à celle qui a précédé l'arrivée au pouvoir du « Parti National-Socialiste des travailleurs » d'Adolphe Hitler dans les années 1930 en Allemagne.
Au delà du salut « hitlérien » d'Elon Musk lors de l'investiture du Président le 20 janvier dernier, qui envoie déjà un signal clair quant à l'idéologie qui sous-tend les intentions du bras droit de Donald Trump, les réactions, les comportements, les attitudes, les décisions de l'élite financière et économique mondiale depuis la victoire du Républicain en novembre 2024, et surtout depuis ses déclarations de guerre commerciale à l'échelle planétaire, sont caractéristiques d'une classe sociale qui sait plus que jamais où se situe son « intérêt ».
Le fascisme ne peut s'installer, s'imposer, prospérer et dominer une société (à l'échelle nationale, régionale ou mondiale) sans l'appui indéfectible des puissances d'argent qui, comme on le sait, ne portent pas de jugement « moral » sur la nature du pouvoir en place tant et aussi longtemps que celui-ci ne nuit pas à la bonne marche des « affaires », qui plus est lorsqu'il se porte garant d'un accroissement de richesses à venir, que ce soit par l'instauration d'une fiscalité « compétitive », d'une priorité donnée aux entreprises nationales, l'accès à une main d'œuvre docile et bon marché (ou qualifiée et loyale, si besoin est), des faibles coûts de production, des prix fixes concomitant à une situation de monopole ou d'oligopole.
L'arrivée d'Adolphe Hitler au Reichstag en 1933 a été une bénédiction pour les capitalistes allemands (exception faite, évidemment, des détenteurs de capitaux d'origine juive) ; les Nazis ont relancé l'économie du pays durement touchée par le Traité de Versailles et le krach boursier de 1929 à Wall Street, interdit les syndicats, emprisonné les communistes (ainsi que les sociaux-démocrates trop critiques envers le capitalisme) et pratiqué un interventionnisme d'État à l'image du New Deal de Roosevelt aux États-Unis, quoique avec des objectifs quelque peu différent ! Avec, en prime, une fois la guerre enclenchée, le recours à une main d'œuvre plus que servile, remplaçable à souhait, reconnaissante de pouvoir offrir gratuitement sa force de travail (du moins, temporairement) plutôt que d'être gazée et finir dans les crématoires des camps de la mort.
Jusqu'au déclenchement de la guerre, Hitler et sa « horde de criminels » faisaient l'admiration d'une bonne partie du gratin du monde occidental (politiciens, aristocrates, hommes d'affaires, intellectuels d'extrême-droite ―― même Staline était impressionné par la capacité du Führer à éliminer aussi efficacement ses opposants) : le Troisième Reich était loué pour sa discipline et son ardeur au travail (« on ne fait pas “grève” en Allemagne ! »), sa capacité à reprendre sa place dans le « Concert des Nations », sa fermeté (voire sa « cruauté ») envers les forces de gauche, menace à la précieuse liberté du monde civilisé, bref, il représentait un rempart contre la montée du communisme, système politique barbare qui ne respecte rien. On a même cru, jusqu'à la dernière minute (Accords de Munich), que le chef d'État allemand était un homme de « paix ». On connaît la suite…
Bien sûr, la situation actuelle est, à bien des égards, différente de celle des années 1930. Nous ne subissons pas les contre-coups d'une crise économique à l'échelle mondiale, propice à l'émergence de solutions radicales portées par des idéologies meurtrières et défendues par des psychopathes œuvrant en groupes organisés, nos institutions légales, juridiques, politiques sont plus fortes, mieux constituées, mieux articulées pour réagir à des phénomènes extrêmes comme celui du nazisme, nous sommes plus éduqués, mieux conscientisés des dangers que représente la prise du pouvoir par l'extrême-droite populiste et nous avons pu constater, à notre corps défendant, jusqu'où peut aller une psychose collective lorsqu'elle s'alimente de ses propres phobies, ne sachant plus distinguer le vrai du faux, le Moral de l'Immoral, l'Humain de l'Inhumain.
Il n'empêche que nous vivons, collectivement, une autre sorte de crise qui génère une forme différenciée de fascisme, adapté à notre époque technologique. Le spectacle un tantinet « surréaliste » offert par la cérémonie d'investiture du Président américain constitue un instantané de la structure politico-économique qui va dominer le Monde à partir du 20 janvier 2025. Que les géants de la « Tech » se soient agglutinés autour du Matador en cette soirée officielle ne relève pas du hasard, pas plus que le geste « symbolique » d'Elon Musk, révélateur des accointances qui vont « naturellement » se nouer dans un avenir rapproché.
En cela, le processus est semblable à celui qui a abouti à la deuxième guerre mondiale, à savoir, le mariage de Raison entre, d'une part, un pouvoir politique xénophobe, liberticide, paranoïaque et, d'autre part, le pouvoir économique le plus à même de soutenir le projet démesuré du « mâle dominant » qui cherche à impressionner par des déclarations à l'emporte-pièce, des provocations récurrentes, une stratégie du chaos assumée. Nous assistons au même scénario que celui élaboré par les Nazis concernant l'Allemagne de l'époque et qui a servi de justificatif pour adopter des politiques extrêmes qui font fi des principes fondamentaux d'une démocratie libérale et du plus élémentaire droit international : les États-Unis sont exploités par le monde entier, victimes de leur généreuse richesse, ils font plus que leur part pour protéger militairement leurs alliés (contre quels ennemis, ça reste à déterminer), leur énorme déficit commercial et leur dette abyssale sont le résultat de pratiques commerciales malveillantes et déloyales de la part des Chinois, des Européens, des Canadiens, des Mexicains et tutti quanti.
Bref, l'Amérique n'a rien à se reprocher, elle n'est pas responsable des délocalisations massives des entreprises américaines vers la Chine, l'Asie, le Mexique, l'Europe de l'Est depuis plus de trente ans et qui sont à l'origine du désert industriel qui recouvre des régions entières des États-Unis, autrefois prospères, gage de leur pouvoir économique et financier, assurant leur main-mise sur les affaires du Monde ; elle n'a rien à voir non plus avec la pauvreté endémique des pays du Sud global dont les ressortissants n'ont d'autres choix que d'émigrer vers le Nord pour améliorer leurs conditions de vie, quitte à travailler illégalement à bas salaire, sans protection sociale, sans assurance-santé, risquant à tout moment d'être expulsés vers le pays qu'ils cherchent à fuir.
Ce complexe de persécution est source de violence dirigée contre tout ce qui n'est pas américain et exacerbe les tensions géo-politiques déjà manifestes dans le monde occidental. Les Allemands ont carburé à cette victimisation à tous crins, les Juifs de Palestine en font de même et, dans tous les cas, cette impression généralisée d'être injustement traités par le reste de l'humanité donne lieu à des comportements belliqueux qui abaissent dangereusement le niveau de tolérance envers les embûches rencontrées en chemin, les contradicteurs, la diversité des points de vue, les visions du monde différentes de celle du leader charismatique. Il faut prendre acte de ce fait et agir en conséquence.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« L’IA telle qu’elle est développée alimente un système d’exploitation global »

Un collectif, parmi lesquelles Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, recommande, dans une tribune au « Monde », de placer les droits humains et la justice environnementale au cœur de la régulation de l'intelligence artificielle.
10 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/lappel-dune-centaine-dong-lia-telle-quelle-est-developpee-alimente-un-systeme-dexploitation-global-manifeste/
L'intelligence artificielle (IA) connaît un développement foudroyant, et nos dirigeants ne semblent pas pressés de réfléchir aux enjeux humains, sociaux et environnementaux de ces nouvelles technologies, uniquement vues sous le prisme de la croissance, des gains de productivité et des profits. L'IA telle qu'elle est développée perpétue cependant les discriminations, aggrave les inégalités, détruit la planète et alimente un système d'exploitation global. Parce que ces constats ne figureront pas au programme officiel du Sommet mondial sur l'IA [qui se tient à Paris les 10 et 11 février], nous, organisations de la société civile, vous les rappelons ici.
Se concentrer uniquement sur d'éventuels futurs risques existentiels à venir de l'IA est un leurre : ces technologies ont déjà des effets très concrets pour les populations les plus vulnérables et les plus discriminées et portent largement atteinte aux droits humains. En s'appuyant sur des bases de données biaisées et en intégrant les préjugés de ses concepteurs, l'IA perpétue les stéréotypes, renforce les inégalités sociales et limite l'accès aux ressources et opportunités. A cela s'ajoute le fait que le déploiement de ces systèmes d'IA s'inscrit dans le contexte des structures discriminatoires et inégalitaires qui existent dans les sociétés du monde entier. Le recours à ces technologies, souvent sur fond de politiques d'austérité, amplifie les discriminations dans l'accès à la santé, à l'emploi, aux services publics ou aux prestations sociales. En témoignent les scandales ayant éclaté ces dernières années : biais sexistes et racistes des algorithmes de santé, algorithme des services de l'emploi autrichien qui refuse d'orienter les femmes vers le secteur informatique, profilage et discrimination des usagers de la Caisse nationale des allocations familiales en France, au Danemark ou aux Pays-Bas.
Or les technologies sont rarement la solution à des problèmes en réalité systémiques. Il est préférable de s'attaquer à la racine de ces problèmes plutôt que de prendre le risque d'aggraver les violations des droits humains avec des systèmes d'IA. Tandis que l'on confie de plus en plus de décisions aux algorithmes, leurs biais peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos vies. Les IA prédictives se substituent à la justice et à la police, risquant d'amplifier le racisme systémique. Par exemple, aux Etats-Unis, une IA calculant les risques de récidive désignait deux fois plus les accusés noirs comme étant « à haut risque » que les accusés blancs. Et quand bien même on réduirait ces biais, se concentrer sur les outils prédictifs nous empêche de penser à des réformes plus globales du système carcéral.
Menaces pour l'Etat de droit
Ces systèmes sont aussi utilisés à des fins de surveillance et d'identification dans le cadre du contrôle des frontières ou de conflits, comme Lavender, cette IA qui, en désignant des cibles terroristes, a provoqué la mort de milliers de civils gazaouis. Et bien souvent, ces technologies sont développées par les pays occidentaux, comme les outils créés par des pays européens utilisés pour surveiller la population ouïghoure en Chine.
Les systèmes d'IA générative sont également instrumentalisés à des fins de désinformation et de déstabilisation par des régimes répressifs et des acteurs privés. « Bots » utilisés pour manipuler l'information sur des questions liées à la santé, désinformation à caractère raciste durant les dernières élections européennes, deepfakes audios et vidéo mettant en scène des candidats aux élections : ces technologies sont autant de menaces pour l'Etat de droit. Les montages crédibles générés par IA sont aussi un danger pour les femmes et les enfants : 96% de ces deepfakes sont des contenus non consentis à caractère sexuel [selon le rapport 2019 du cabinet de conseil en gestion de risques DeepTrace], massivement utilisés dans le but de nuire aux femmes et de générer des contenus pédocriminels.
Par ailleurs, ces effets s'inscrivent dans un système d'exploitation global. L'IA, et notamment l'IA générative, constitue un véritable désastre pour l'environnement. D'ici à 2027, l'IA générative nécessitera une alimentation en électricité équivalente à celle de pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas [comme le rapporte un article du New York Times d'octobre 2023]. Les émissions de CO2 des « géants de la tech » ont augmenté de 30 à 50% en 2024 en raison du développement fulgurant de ces technologies. Et ce sont les pays du Sud global qui sont les premiers touchés : les data centers y pullulent, et l'extraction de minerais, comme le cobalt, utilisé entre autres dans les batteries, met en péril la santé des populations, entraîne la pollution des eaux et des terres et alimente violences et conflits armés.
L'affaire de toutes et tous
Les inégalités entre les pays du Nord et du Sud sont également aggravées par les technologies déployées pour la modération de contenus en ligne. Les géants du numérique qui allouent plus de moyens aux pays du Nord privilégient ainsi certaines langues et récits culturels, déjà dominants, au détriment des autres. Enfin, n'oublions pas que ces systèmes d'IA sont majoritairement entraînés par des travailleurs et travailleuses du Sud global, exploités et sous-payés. Selon les informations du magazine Time, la société OpenAI a ainsi rémunéré des Kényans moins de deux dollars (1,95 euro) de l'heure pour labelliser des contenus toxiques, un travail particulièrement violent et éprouvant.
Face à ces constats alarmants, le règlement européen sur l'IA, présenté comme un instrument de protection des droits et libertés, reste très imparfait, notamment sur les questions de surveillance et de police prédictive. Par ailleurs ce règlement ne s'appliquera pas hors des frontières de l'Union européenne, alors même que la menace pour les droits humains et l'environnement est globale et que l'exportation des IA de surveillance génère du profit pour les entreprises européennes.
Nos gouvernements ne cessent de parler de souveraineté de l'IA, mais les défis posés par ces systèmes transcendent les frontières. Loin d'être un sujet technologique, l'IA est l'affaire de toutes et tous. Tout le monde doit pouvoir choisir la direction de ses développements, quitte à les refuser s'ils ne correspondent pas à notre projet de société. Un cadre contraignant élaboré démocratiquement, dans une perspective de solidarité internationale et avec les communautés les plus touchées, qui place les droits humains et la justice environnementale au cœur de la régulation de l'IA, voilà le véritable progrès.
Premiers signataires : Erika Campelo, déléguée nationale de VoxPublic ; Laure Salmona, directrice et cofondatrice du collectif Féministes contre le cyberharcèlement ; Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France ; Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme).
Consulter la liste de l'ensemble des signataires
*******
Manifeste : L'IA contre les droits humains, sociaux et environnementaux
Ce texte est le manifeste fondateur de « Hiatus », une coalition composée d'une diversité d'organisations de la société civile française qui entendent résister au déploiement massif et généralisé de l'intelligence artificielle.
Il a été publié dans le journal Le Monde le 6 février 2025.
*-*
Tout concourt à ériger le déploiement massif de l'intelligence artificielle en priorité politique. Prolongeant les discours qui ont accompagné l'informatisation depuis plus d'un demi-siècle, les promesses abondent pour conférer à l'IA des vertus révolutionnaires et imposer l'idée que, moyennant la prise en compte de certains risques, elle serait nécessairement vecteur de progrès. C'est donc l'ensemble de la société qui est sommée de s'adapter pour se mettre à la page de ce nouveau mot d'ordre industriel et technocratique. Partout dans les services publics, l'IA est ainsi amenée à proliférer au prix d'une dépendance technologique accrue. Partout dans les entreprises, les managers appellent à recourir à l'IA pour « optimiser » le travail. Partout dans les foyers, au nom de la commodité et d'une course insensée à la productivité, nous sommes poussés à l'adopter.
Pourtant, sans préjuger de certaines applications spécifiques et de la possibilité qu'elles puissent effectivement répondre à l'intérêt général, comment ignorer que ces innovations ont été rendues possible par une formidable accumulation de données, de capitaux et de ressources sous l'égide des multinationales de la tech et du complexe militaro-industriel ? Que pour être menées à bien, elles requièrent notamment de multiplier la puissance des puces graphiques et des centres de données, avec une intensification de l'extraction de matières premières, de l'usage des ressources en eau et en énergie ?
Comment ne pas voir qu'en tant que paradigme industriel, l'IA a dores et déjà des conséquences désastreuses ? Qu'en pratique, elle se traduit par l'intensification de l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui participent au développement et à la maintenance de ses infrastructures, notamment dans les pays du Sud global où elle prolonge des dynamiques néo-coloniales ? Qu'en aval, elle est le plus souvent imposée sans réelle prise en compte de ses impacts délétères sur les droits humains et l'exacerbation des discriminations telles que celles fondées sur le genre, la classe ou la race ? Que de l'agriculture aux métiers artistiques en passant par bien d'autres secteurs professionnels, elle amplifie le processus de déqualification et de dépossession vis-à-vis de l'outil de travail, tout en renforçant le contrôle managérial ? Que dans l'action publique, elle agit en symbiose avec les politiques d'austérité qui sapent la justice socio-économique ? Que la délégation croissante de fonctions sociales cruciales à des systèmes d'IA, par exemple dans le domaine de la santé ou l'éducation, risque d'avoir des conséquences anthropologiques, sanitaires et sociales majeures sur lesquelles nous n'avons aujourd'hui aucun recul ?
Or, au lieu d'affronter ces problèmes, les politiques publiques menées aujourd'hui en France et en Europe semblent essentiellement conçues pour conforter la fuite en avant de l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas de l'AI Act adopté par l'Union européenne et présenté comme une réglementation efficace alors qu'elle cherche en réalité à promouvoir un marché en plein essor. Pour justifier cet aveuglement et faire taire les critiques, c'est l'argument de la compétition géopolitique qui est le plus souvent mobilisé. À longueur de rapports, l'IA apparaît ainsi comme le marchepied d'un nouveau cycle d'expansion capitaliste, et l'on propose d'inonder le secteur d'argent public pour permettre à l'Europe de se maintenir dans la course face aux États-Unis et à la Chine.
Ces politiques sont absurdes, puisque tout laisse à penser que le retard de l'Europe dans ce domaine ne pourra pas être rattrapé, et que cette course est donc perdue d'avance. Surtout, elles sont dangereuses dans la mesure où, loin de constituer la technologie salvatrice souvent mise en avant, l'IA accélère au contraire le désastre écologique, renforce les injustices et aggrave la concentration des pouvoirs. Elle est de plus en plus ouvertement mise au service de projets autoritaires et impérialistes. Non seulement le paradigme actuel nous enferme dans une course technologique insoutenable, mais il nous empêche aussi d'inventer des politiques émancipatrices en phase avec les enjeux écologiques.
La prolifération de l'IA a beau être présentée comme inéluctable, nous ne voulons pas nous résigner. Contre la stratégie du fait accompli, contre les multiples impensés qui imposent et légitiment son déploiement, nous exigeons une maîtrise démocratique de cette technologie et une limitation drastique de ses usages, afin de faire primer les droits humains, sociaux et environnementaux.
Premiers signataires :
Annick Hordille, membre du Nuage était sous nos pieds
Baptiste Hicse, membre de Stop Micro
Camille Dupuis-Morizeau, membre du conseil d'administration de Framasoft
David Maenda Kithoko, président de Génération Lumière
Denis Nicolier, co-animateur de Halte au contrôle numérique
Emmanuel Charles, co-président de ritimo
Éléonore Delatouche, fondatrice de Intérêt à agir
Judith Allenbach, présidente du Syndicat de la Magistrature
Judith Krivine, présidente du Syndicat des avocats de France (SAF)
Julie Le Mazier, co-secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires
Julien Lefèvre, membre de Scientifiques en rébellion
Marc Chénais, directeur de L'Atelier Paysan
Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme)
Olivier Petitjean, co-fondateur de L'Observatoire des multinationales
Raquel Radaut, porte-parole de La Quadrature du Net
Sandra Cossart, directrice de Sherpa
Soizic Pénicaud, membre de Féministes contre le cyberharcèlement
Sophie Venetitay, secrétaire générale du SNES-FSU
Stéphen Kerckhove, directeur général d'Agir pour l'environnement
Thomas Thibault, président du Mouton Numérique
Vincent Drezet, porte parole d'Attac France
Yves Mary, cofondateur et délégué général de Lève les yeux
David Maenda Kithoko, président de Génération Lumière ; Julie Le Mazier, co-secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires ; Julien Lefèvre, membre de Scientifiques en rébellion ; Marc Chénais, directeur de L'Atelier Paysan ; Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme) ; Raquel Radaut, porte-parole de La Quadrature du Net ; Soizic Pénicaud, membre de Féministes contre le cyberharcèlement ; Sophie Venetitay, secrétaire générale du SNES-FSU ; Stéphen Kerckhove, directeur général d'Agir pour l'environnement ; Vincent Drezet, porte parole d'Attac France.
Liste complète des organisations premières signataires à retrouver sur :
https://www.laquadrature.net/manifeste-hiatus/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/06/l-intelligence-artificielle-accelere-le-desastre-ecologique-renforce-les-injustices-et-aggrave-la-concentration-des-pouvoirs_6533885_3232.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Intelligence artificielle : « Nous devons combattre le fanatisme technologique »

« L'intelligence artificielle est un pur délire », résume notre chroniqueuse Celia Izoard. « Les géants de la tech sont des fondamentalistes de la religion de la technologie. » Arrêterons-nous cette folie criminelle ?
Celia Izoard est autrice et journaliste. Elle est l'autrice de La ruée minière au XXIe siècle —Enquête sur les métaux à l'ère de la transition (éd. Seuil, 2024) et d'un recueil sur les usines du numérique (La Machine est ton seigneur et ton maître Xu Lizhi, Yang, Jenny Chan, éd. Agone, 2022). Elle a traduit et préfacé 1984, de George Orwell (Agone, 2021).
7 février 2025 | tiré du site reporterre.net
Avant, pour nous vendre du maquillage, on nous montrait la photo d'un top model. Aujourd'hui, on nous montre un avatar IA (intelligence artificielle). Une critique du New Yorker, Jia Tolentino, a appelé ça le « look cyborg », ou le « visage Instagram » : impeccablement lisse, yeux en amande, regard vide. Ce nouveau standard de beauté s'est imposé à force de voir des visages retouchés par IA (les « filtres beauté ») sur Instagram ou Tiktok.
À force aussi de voir des top models et des influenceuses qui, de plus en plus... sont des robots. La haine de soi que l'industrie de la beauté inculque aux femmes depuis des générations a atteint un nouveau stade : « Ton problème, ce n'est pas seulement que tu es grosse, ou vieille, c'est que tu es humaine. »

Le top model lilmiquela, créée par intelligence artificielle, se présente comme un « robot de 21 ans vivant à Los Angeles » sur son profil. Elle est suivie par 2,4 millions d'abonnés. Instagram / lilmiquela
Le déploiement de l'IA s'accompagne d'un imaginaire qui porte en lui une dévaluation profonde de l'humanité. Sam Altman, patron d'OpenAI [l'entreprise qui a lancé ChatGPT], promet que l'intelligence artificielle va « élever l'humanité ». Mais il prend soin de rappeler que nous, les humains, sommes des êtres « limités par notre vitesse de traitement de données ». La publicité de Cruise — la branche véhicules autonomes de General Motors — affirme que « les humains sont de très mauvais conducteurs », responsables de la mort de près de 50 000 Étasuniens chaque année.
On nous inculque désormais en masse la « honte prométhéenne », selon l'expression du philosophe Günther Anders. Réfugié dans les années 1940 en Californie, il s'inquiétait de la vénération des Occidentaux pour la technologie. Ils en étaient arrivés, disait-il, à avoir honte de leur infériorité d'humains, honte de ne pas avoir été produits, fabriqués, comme des machines.
Les géants de la tech se projettent vers une humanité toute-puissante, omnisciente, démiurgique, multiplanétaire ; mais ce projet implique d'abord de boxer notre estime de nous-mêmes. C'est, en quelque sorte, ce que le marché de la cosmétique a fait aux femmes : il a fallu, pendant des décennies, nous enseigner nos laideurs pour pouvoir nous vendre des produits de beauté. Comme le décrit Thibaut Prévost dans son essai, Les Prophètes de l'IA (Lux, 2024), ChatGPT n'est qu'une « machine à bullshit ». Il faut avoir profondément atomisé et humilié les individus pour qu'ils en viennent à le considérer comme un interlocuteur valable.
La technologie comme religion
Cette manière étrange de rabaisser l'humanité tout en lui prêtant un avenir grandiose est bien plus qu'une stratégie marketing. C'est un courant religieux qui irrigue la Silicon Valley depuis ses débuts, un millénarisme technologique que l'historien étasunien David Noble a décrit dans The Religion of Technology (paru en 1997, seul un extrait a été publié en français par la revue Agone). Dans le cyberespace, un monde de purs esprits, écrit-il, ces entrepreneurs se rêvent libérés de l'enveloppe corporelle et de la finitude humaines. Ils voient l'intelligence artificielle comme une délivrance à la malédiction du travail. Et ils prévoient de monter au ciel dans les fusées de la conquête spatiale. L'humanité est maudite par la Chute ; la post-humanité sera sauvée, rendue à sa perfection par le progrès technique.
Cette religion de la technologie s'inscrit dans une tradition chrétienne que l'on peut faire remonter à la culture monastique masculine du Moyen Âge. Pour la première fois, la technique y fut constituée comme un moyen pour les hommes (et non les femmes) d'accéder au salut de leur âme et de renouer avec leur nature divine, la perfection d'Adam au jardin d'Éden. Retracer cette histoire permet de comprendre le culte des machines dans le capitalisme industriel. C'est la religion dominante (avec le fétichisme de l'argent) d'une civilisation qui s'est crue affranchie par la raison tout en plaçant ses rêves d'abondance, d'omniscience, d'immortalité et d'ascension céleste dans la technologie.
« Ces entrepreneurs se rêvent libérés de l'enveloppe corporelle »
Mais si le capitalisme industriel, depuis la fin du XVIIIe siècle, est dominé par la religion de la technologie, ce culte a toujours été pondéré, aux XIXe et XXe siècles, par d'autres forces et d'autres courants intellectuels. Les grèves et les mutuelles ont créé des rapports de force qui ont permis la redistribution et diminué les profits privés du capitalisme sauvage. Le mouvement romantique a critiqué le désenchantement et l'enlaidissement d'un monde régi par l'industrie. Le féminisme et l'écologie ont défendu le vivant face aux rêves virilistes de gratte-ciel et de missiles.
Les patrons de la tech : des gourous de sectes dangereuses
Dans la Silicon Valley, au contraire, tout se passe comme si cette religion n'avait pas connu de contre-pouvoir. Année après année, elle s'est développée sous une forme plus fanatique. Le transhumanisme, la singularité, le cosmisme — ces mystiques californiennes ne sont autres que le fondamentalisme de la religion de la technologie.
Avec la Silicon Valley et ses héritiers, le culte de la machine, dopé aux milliards de dollars, s'est radicalisé. Sam Altman veut télécharger son cerveau dans le cloud. Elon Musk (Tesla) veut coloniser Mars. Sergei Brin (Alphabet) veut nous « guérir de la mort ». Ces hommes devraient être mis hors d'état de nuire et surveillés de près, comme les gourous de sectes dangereuses.
Lire aussi : « Trump et Musk nous mènent vers un monde glacial, dominé par l'IA »
C'est bien le contraire qui se produit. Depuis le début de ce XXIe siècle, la Silicon Valley ne cesse de renforcer son hégémonie culturelle. Les géants de la tech sont les grands gagnants de cinquante ans de réformes néolibérales, cinquante ans de spoliation des peuples qui leur ont permis d'amasser une puissance et des fortunes colossales. Si les économies occidentales sont de plus en plus concurrencées par la Chine, l'Inde ou la Russie, le fanatisme technologique californien, lui, a été adopté par les élites de la quasi-totalité du globe. Ces délires technofanatiques dictent les agendas politiques de la plupart des pays.
Pourquoi essayer de nous adapter à cette folie criminelle ?
L'IA, par exemple. Déployée à grande échelle, elle sert à automatiser les tâches créatives, et n'est-ce pas la dernière chose que l'on souhaite ? Elle renforce l'arsenal des technologies de police totalitaires. C'est une machine à produire du chômage, à détruire les capacités cognitives, à manipuler les foules, à traquer les anomalies.
Quant à ses « utilisations positives », la consommation d'énergie, d'eau et de métaux de ses data centers devrait obliger quiconque à les considérer comme nulles et non avenues. L'IA est un pur délire. Alors pourquoi essayons-nous de nous adapter à cette folie criminelle, qui ne peut qu'accélérer le réchauffement climatique et les dominations ? Pourquoi les esprits critiques se contentent-ils d'imaginer une déclinaison égalitariste, ou subversive de l'IA ?
« Ne donnons aucune légitimité à ce que produit un Chatbot »
Nous devons combattre le fanatisme technologique en tant quel, et pas juste ses saluts nazis. Commençons par suivre les conseils de Thibaut Prévost, auteur des Prophètes de l'IA : « Ne donnons aucune légitimité à ce que produit un Chatbot. » Rappelons-nous que « nous sommes collectivement cette superentité intelligente et autonome ». Que « nous avons toujours été là, sous les yeux des prophètes de la superintelligence ». Et que « s'ils avaient le moindre respect pour la multitude, ils l'auraient remarqué depuis longtemps ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tarifs et protectionnisme, comme entraves au marché libéral d’autrefois

Dans le contexte actuel, un chambardement affecte les marchés en raison de l'inclination du président étasunien aux tarifs, soi-disant pour renforcer l'économie de son propre pays. Or, il s'agit d'un réflexe à la fois défensif et nuisible : d'abord, parce qu'il contraint la liberté de choix des entreprises et des personnes du territoire, ensuite parce qu'il démontre une incompréhension de l'interdépendance des marchés — à moins de vouloir imposer un nouvel impérialisme accompagné d'une nouvelle division internationale des échanges.
Des tarifs contre les autres, mais aussi contre soi-même
Comme d'autres l'ont dit — notamment les journalistes Stéphanie Bérubé de La Presse ainsi que Stéphane Bordeleau et Philippe de Montigny d'ICI Radio-Canada, Clémence Pavic du journal Le Devoir, de même que Krishen Rangasamy, Directeur, Services économiques et économiste principal de Financement agricole Canada (FAC)[1] —, les tarifs imposés sur les produits extérieurs servent certes d'entraves à leur entrée, mais ont aussi comme effet pervers de limiter les choix pour la population et les entreprises intérieures. En plus, ce sont elles qui paieront les tarifs. Dans le sens moral du terme, contraindre quelqu'un suppose d'être contraint à son tour, dans une sorte de loi du Talion, quoique la logique du marché exige d'échanger des valeurs égales pour transiger. Alors, imposer 25 % d'un côté crée un déséquilibre à réajuster, et une logique simpliste pousse à trouver une mesure d'équilibre équivalente de l'autre. Mais qui est à l'origine de ces tarifs ? Il ne s'agit pas des deux populations, mais de leurs représentant.e.s qui siègent au gouvernement. Des interventions politiques interfèrent donc dans le déroulement des échanges internationaux pour diverses raisons.
Alors qu'un nouveau régime économique visait à remplacer les systèmes mercantile et physiocratique — voyant dans les métaux précieux ou l'agriculture la richesse des nations —, Adam Smith apportait certaines explications à l'acte d'entraver les importations et celles-ci peuvent encore servir de nos jours. D'abord, il peut s'agir simplement de la décision de protéger l'industrie intérieure, capable de produire certains biens. Par contre, cela revient aussi à faire d'elle un monopole et la question est de savoir si ce geste est profitable globalement pour le pays qui entrave de la sorte ses importations. Il faut se demander si les gens sont prêts à soutenir cette industrie et même à vouloir y travailler. De plus, il faut établir son niveau de santé et sa capacité à être performante sur le long terme, au point de générer suffisamment de richesses de façon à surpasser l'offre venue d'ailleurs. Smith (2009[1776], p. 145) stipule ceci : « Il n'y a pas de règlement de commerce qui soit capable d'augmenter l'industrie d'un pays au-delà de ce que le capital de ce pays peut entretenir : tout ce qu'il peut faire, c'est de faire prendre à une portion de cette industrie une direction autre que celle qu'elle aurait prise sans cela, et il n'est pas certain que cette direction artificielle promette d'être plus avantageuse à la société que celle que l'industrie aurait suivie de son plein gré ». Autrement dit, protéger une industrie suppose d'accepter d'utiliser des richesses intérieures pour la conserver, au détriment peut-être d'autres. Pour revenir aux États-Unis actuels, la présidence semble reconnaître cette particularité et, pour remédier aux frais de maintien ou de valorisation de certaines industries, a choisi de sabrer dans la fonction publique et l'aide internationale notamment. De là, des économies compensatoires.
Au fond, cette manoeuvre diverge à première vue de l'intérêt général, afin de satisfaire un besoin de sûreté. Car une économie accueille normalement les achats à moindre coût, ce que Smith 2009[1776], p. 147) répète en ces termes : « Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelque avantage. L'industrie générale du pays étant toujours en proportion du capital qui la met en oeuvre, elle ne sera pas diminuée pour cela […] ; seulement, ce sera à elle à chercher la manière dont elle peut être employée à son plus grand avantage ». Néanmoins, il reconnaît des cas où imposer une entrave aux produits étrangers peut s'avérer avantageux, notamment lorsque l'industrie génère ce qui est nécessaire à la défense du pays. À noter présentement des tarifs de 25 % sur l'aluminium et l'acier, pouvant être revendiqués pour des raisons de sécurité nationale par les États-Unis. Doit-on y voir une préparation à la guerre ou une autre manoeuvre protectionniste ? Car il faut considérer l'avenue selon laquelle le président Trump met en branle un plan visant à mieux contrôler tout ce qui entre au pays : matières premières, capitaux, marchandises et personnes. Mais il y a surtout cette utopie caractéristique voulant que le marché étasunien soit exceptionnel, soit un privilège. Autrement dit, entraver les importations et, du coup, les exportations des autres, semble insinuer le désir de créer un marché intérieur à ce point extraordinaire que l'extérieur sera prêt à payer chèrement pour y avoir accès. S'expose en parallèle cette ambition de devenir le coeur des échanges internationaux à partir du marché intérieur étasunien ; pour ne pas dire, dominer le marché ou représenter le maître d'oeuvre du marché mondial. Par ambition, le stratagème consiste à créer un « effet d'impasse » pour forcer l'adhésion, d'une manière ou d'une autre, des pays étrangers.
Cela dit, un État fort possède une monnaie forte, ce qui le désavantage pour exporter. En revanche, il peut profiter plus largement de l'offre internationale, surtout si ses entreprises ont été en mesure de s'implanter dans des marchés à faible coût. Par le fait même, cette circonstance doit profiter à sa population, à moins de concentrer la richesse dans les mains de quelques-uns seulement. Si sur le plan global ledit pays semble effectivement s'enrichir, cette perversion par l'accumulation de quelques-uns suppose des inégalités socioéconomiques qui peuvent devenir des problèmes intérieurs. Vouloir alors imposer des tarifs sur des biens importés à moindre frais et qui satisfont les besoins généraux, risque de provoquer des frustrations internes, surtout en provenance de la population moins nantie. En ce sens, entraver les importations aux profits de quelques-uns devient une forme d'esclavagisme de la consommation au détriment même de la population nationale.
Pourquoi encore la présidence étasunienne décrète-t-elle des tarifs de 25 % ? Une hypothèse serait de déduire, par exemple, l'avantage canadien en termes de taux de change, puisqu'à un certain moment, un dollar canadien équivalait à 75 cents étasuniens. Si une logique simpliste suppose un besoin de ramener les monnaies à l'équivalence, un tarif de 25 % sur les biens canadiens importés serait justifié. Encore là, se focaliser sur la plus faible valeur de l'un par rapport à l'autre minore l'analyse, au point de devoir rappeler les avantages d'une monnaie forte. Et l'idée de l'échange consiste dans un rapport gagnant-gagnant, où les partenaires profitent de l'expertise ou des marchandises de l'un ou de l'autre, parce que cela fait leur affaire. Ainsi, imposer des tarifs sur cette base peu convaincante ramène à nouveau les explications soit sur un sentiment faussé de perte, soit sur l'ambition impérialiste dans une version 2.0.
Un empire protectionniste
Lorsque la Grande-Bretagne du XIXe siècle commença à cesser ses tarifs préférentiels envers ses colonies, en privilégiant tout autant un protectionnisme, l'idée derrière était d'assurer le renforcement de son empire. Mais au-delà des difficultés économiques rencontrées, du chômage, des luttes sociales — internes et externes —, des pressions sur l'échange et des rivalités impérialistes, comme le mentionne Karl Polanyi (1983[1944], p. 292), le siècle était plutôt occupé « à construire l'utopie libérale ». D'ailleurs, l'impérialisme avait ses limites et les colonies devenaient des boulets politiques et financiers ; autrement dit, parler de colonies était dépassé. En passant donc du régime impérial au régime libéral (et bourgeois), des tensions se firent entre l'adaptation des populations au régime industriel et à la mise en place d'un marché international autorégulateur. C'est à ce moment-là que l'interdépendance des marchés entre la métropole britannique et les colonies a été la plus affectée, d'où des frustrations qui ont mené aux indépendances.
On a vite compris toutefois qu'un marché totalement libre créait de nombreux remous. Une intervention s'avérait requise, au point de favoriser des mesures protectionnistes. Or, libéralisme et protectionnisme ne vont pas si facilement de pair, voire même semblent être contradictoires. Mais comment expliquer ce renversement ? À cause notamment de la mauvaise tendance à regarder les balances commerciales. Une analyse réductrice voudra seulement voir les gains et les déficits entre deux États, sans comprendre l'apport bénéfique de l'interdépendance de leur marché. À son époque, Smith (2009[1776], pp. 152 et 153) justifiait les entraves « à l'importation des pays avec lesquels on suppose la balance du commerce défavorable » sur la base de « préjugés » et de « haines nationales ». Selon lui, juger une balance égalitaire comme l'absence de gain et une autre déficitaire comme un rapport perdant constitue une absurdité, parce que si les échanges ont été entretenus naturellement, sans contraintes, ils sont avantageux pour les deux parties en cause. Par exemple, si l'une offre des matières premières à l'autre qui s'en sert pour sa production (et donc aussi sa consommation et/ou ses exportations), cela implique de considérer ce que la première reçoit de valable en retour et ce que les matières permettront de réaliser en richesses pour la seconde. Cette analyse exige de voir au-delà des chiffres de la balance, afin de tenir compte d'un plan global d'enrichissement. Smith (2009[1776], p. 161) poursuit son apologie du marché libre comme suit : « […] à mesure qu'un pays, qu'une ville a ouvert ses ports aux autres nations, au lieu de trouver sa ruine dans cette liberté de commerce, comme on devait le craindre d'après les principes du système, elle y a trouvé une source de richesses […] ». Et la balance qui mérite une réelle attention est plutôt celle qui fixe le rapport entre la production et la consommation annuelles, donc en lien avec l'enrichissement intérieur.
Ainsi, l'argument actuel chez la présidence étasunienne d'une balance commerciale déficitaire avec le Canada devient certes un moyen de justifier des mesures tarifaires à l'importation, mais d'autres raisons que la jalousie ou la haine doivent entrer en ligne de compte. En effet, il n'y a pas d'animosité entre le Canada et les États-Unis, ce qui signifie autre chose aux tarifs impliqués. Cependant, le Canada a aussi ses mesures d'entrave venant interférer dans les échanges avec les États-Unis. Cela justifie-t-il des tarifs élevés à titre de représailles et en plus de vouloir l'annexer ? Car annexer le Canada met en lumière un esprit de conquête et les entraves aux échanges visent à mieux faire reconnaître les avantages du marché étasunien et, en contrepartie, le prix d'entrée à devoir désormais supporter en choisissant de rester souverain. Apparaît alors une guerre économique qui sous-entend de revoir les ententes pour rétablir la paix dans le marché. Sinon, on revient à l'esprit de conquête. Vouloir agrandir le territoire étasunien devient une réponse mimétique à d'autres grandes Puissances qui cherchent également à s'imposer dans la marche du Monde. Il s'agit alors de créer un « bloc Amérique » en privilégiant un mouvement impérialiste au lieu d'alliances. Une idéologie anti-démocratie et anti-libre-marché semble être préconisée par la présidence étasunienne : la force sert donc de moyen afin de soumettre les adversaires (autrefois alliés).
Pour revenir avec l'utopie libérale du XIXe siècle, un facteur majeur entre en ligne de compte. Plus tôt, il a été question de la distinction entre une monnaie forte et une autre faible, mais à l'époque en cause, les monnaies des différents pays ou États avaient un rapport avec l'étalon-or. Selon Polanyi (1983[1944]), ce facteur a suscité l'avènement d'institutions protectionnistes —tarifs douaniers, lois sur les fabriques et politique coloniale renouvelée — dans le but de stabiliser la monnaie extérieure, voire encore d'intégrer les pays et autres territoires à la stabilité des changes. Certes, ces mesures se destinaient à encadrer l'économie de marché, mais surtout à favoriser les grands joueurs, car « [l]à où ces méthodes furent imposées, en l'absence de toute mesure protectrice, à un peuple sans défense, […] elles entraînèrent des souffrances indicibles » (Polanyi, 1983[1944], p. 297). Actuellement, comment expliquer le protectionnisme étasunien sur la base des changes ? On n'est plus au XIXe siècle et la stabilité désirée semble être chose faite. Peut-être faudrait-il regarder du côté de la cryptomonnaie, à savoir une nouveauté extrêmement spéculative et l'homme derrière la présidence étasunienne possède même la sienne. Serait-il possible, en vertu des opérations marchandes de plus en plus effectuées via les plateformes virtuelles, d'envisager un tour de force pour faire intégrer la cryptomonnaie dans le système monétaire international. Pourtant déjà, la monnaie américaine sert en quelque sorte d'étalon-or depuis plusieurs décennies. Il n'y aurait donc pas seulement la promotion des États-Unis en jeu.
Par ailleurs, si aux XIXe et XXe siècles, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, en considérant sur un autre plateau l'URSS, formaient les grandes puissances du moment, désormais il faut considérer la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, mais aussi des blocs politico-économiques comme l'Union européenne, alors qu'il y en a aussi d'autres. Et Polanyi (1983[1944], pp. 300 et 301) fait remarquer ceci :
Que la protection fût justifiée ou non, les effets des interventions firent apparaître une faiblesse du système de marché mondial. Les droits de douane à l'importation d'un certain pays entravaient les exportations d'un autre pays et les forçaient à chercher des marchés dans des régions qui n'étaient pas protégées politiquement. L'impérialisme économique était d'abord une lutte entre les Puissances pour avoir le privilège d'étendre leur commerce dans des marchés sans protection politique. La pression de l'exportation était renforcée par la ruée vers des réserves de matières premières, causée par la fièvre manufacturière. […] Le protectionnisme contribuait à transformer des marchés concurrentiels en marchés monopolistiques. On pouvait de moins en moins décrire des marchés comme étant des mécanismes autonomes et automatiques d'atomes en concurrence.
De nos jours, les pays se sont armés, de façon générale, d'outils de protection en ce sens. Par contre, la corruption des gouvernements dans certaines régions du monde rappelle en quelque sorte les propos de Polanyi. Par ailleurs, les visées de la présidence étasunienne s'inscrivent dans une ambition de « puissance », face à des leaders actifs sur la scène mondiale et pouvant être perçus comme ayant à leur tour des aspirations impérialistes. Et comme avant la Première Guerre mondiale, chaque État lorgne l'autre et réagit au mouvement en vogue. Comme préambule, le fascisme est apparu dans la première moitié du XXe siècle, démontrant à quel point l'économie de marché s'était politisée et subissait toutes sortes d'intervention. Ce qui se passe actuellement semble en être la suite, alors que des régimes autoritaires apparaissent même dans des pays dits démocratiques. En même temps, des mesures protectionnistes surviennent, ce qui n'a rien de surprenant. Le marché mondial est en train de subir une refonte, voire un repartage, comme cela s'est toujours produit. Parce que les grands joueurs évoluent, n'étant pas tout à fait les mêmes ; l'arrivée de la Chine a d'ailleurs changé la donne. Avec la présence de telles Puissances, le marché ne peut être totalement libre.
En réalité, le néolibéralisme arrive à son tour à un tournant, comme l'utopie libérale qui, elle, a été ratée par la civilisation du XIXe siècle, car au fond elle était encore impérialiste et craignait le marché autorégulateur, comme le mentionne avec assurance Polanyi (1983[1944]). Présentement, cette crainte demeure au même titre que le besoin d'affirmer sa puissance, laissant présager un nouvel épisode des empires qui a goûté au fascisme. Ainsi, les entraves au marché ou les manoeuvres tarifaires du président étasunien constituent l'apothéose d'une étape inédite de la mondialisation des marchés, alors que d'autres grandes Puissances aspirent à remporter la plus grande part.
Conclusion
Un pays puissant profite de plusieurs marchés, afin de bénéficier d'économies et de faire croître la consommation/richesse intérieure. Et ses interventions à l'international visent alors à limiter les contraintes dans les échanges. Mais en imposant soi-même des tarifs, un piège se présente, malgré le désir de vouloir réduire des balances commerciales jugées déficitaires. Faire monter les prix à l'entrée exige en contrepartie une réelle capacité de pouvoir produire ce qui est en quelque sorte refusé de l'extérieur, et ce, idéalement à moindre coût. Être incapable d'atteindre ce niveau ou encore d'y consacrer le temps et l'argent nécessaires occasionnera une baisse de régime susceptible de causer des pertes difficilement réversibles. Certain.e.s verront cette période comme une opportunité d'investissement, dont le rendement sera visible à moyen et long terme. Or, il s'agit d'un espoir, sans aucune certitude, alors que les économies étaient déjà connues et en main en faisant affaire avec un pays exportateur fiable.
Lorsqu'il est question de tarifs, apparaît non loin une idéologie de protectionnisme, visant à satisfaire des intérêts intérieurs. Mais la véritable analyse exige de reconnaître les forces et les faiblesses du pays, de statuer sur les types d'industries qui méritent un support et celles qui devraient être réorganisées. Même si chaque pays peut être en mesure de produire tout ce qui existe, il y aura toujours, pour diverses raisons (législatives, géographiques, climatiques, culturelles, esprit d'innovation, etc.), des plus performants dans un domaine comparativement aux autres. De là s'entrevoit la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, à la base des échanges internationaux. L'intention est de favoriser des rapports gagnant-gagnant entre les pays. À l'inverse, imposer des tarifs détruit ce rapport et insinue une crainte même envers l'échange. Sinon, il s'agit de vouloir créer un rapport gagnant-perdant, ce qui n'a aucun sens. Pour justifier cette crainte, il faut alors regarder non pas le marché, mais les idées préconçues ou la façon de se le représenter par les dirigeant.e.s des pays. De là s'expose un nationalisme, un chauvinisme, voire même une aspiration impérialiste qui n'a pas lieu d'être en contexte de libre marché.
Imposer des tarifs, c'est employer une mesure protectionniste qui n'a peut-être rien à voir avec la défense d'industries intérieures. Entraver le marché revient aussi à vouloir y soutirer quelque chose de plus, si ce n'est de prendre le contrôler de l'échange. Au XIXe siècle, l'utopie libérale n'a pu se réaliser, parce que le régime impérialiste devait être réformé et ajusté aux réalités plus actuelles, alors que la bourgeoisie prenait finalement son élan, tout en faisant face aux préoccupations sociales qui ont calmé les ardeurs. Mais ça prenait aussi une politique monétaire forte, une entente entre les pays pour stabiliser la monnaie. Plusieurs avancées ont eu lieu depuis. Face au retour de l'autorité impériale désormais « embourgeoisée », les régimes démocratiques subissent des contrecoups qui apparaissent sous formes d'entraves au marché par des mesures protectionnistes. Encore faut-il se demander si elles visent réellement à protéger le territoire de son auteur ou à mener une nouvelle conquête en réponse aux autres Puissances.
Quoi faire alors ? Imposer à son tour des tarifs, de façon à entrer dans la guerre économique ? Ou choisir d'aller en sens inverse, c'est-à-dire en incitant les consommateurs (personnes et entreprises) à continuer de profiter des biens importés, malgré l'état d'âme de leurs dirigeant.e.s ? Pourquoi ne pas les inciter à venir s'établir chez nous, en leur faisant éviter ce tournant vers l'autoritarisme afin de bénéficier d'une véritable liberté dans un régime démocratique ? De s'unir avec d'autres pays dans la même situation, afin de créer une nouvelle force de marché qui tient compte du rapport gagnant-gagnant ? Sinon de miser sur son propre marché intérieur et à l'attachement de la population à son pays ? Face à des mesures d'entraves, tous les moyens sont bons pour se défendre et pour reprendre en main sa propre puissance. En ce sens, il ne faut jamais renoncer à compter d'abord sur soi-même.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
16 février 2025
13h30
Références
Polanyi, K. (1983). La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps [1944]. Paris, France : Gallimard.
Smith, A. (2009). La richesse des nations [1776]. Paris, France : Flammarion.
[1] Bérubé, Stéphanie (2025, 1er février). Tarifs et boycottage | Vers un regain d'intérêt pour les produits locaux ? La Presse. Repéré à https://www.lapresse.ca/affaires/2025-02-01/tarifs-et-boycottage/vers-un-regain-d-interet-pour-les-produits-locaux.php ; Bordeleau, Stéphane (2025, 31 janvier). Comprendre | Petit guide en vue d'une guerre commerciale avec les États-Unis. ICI Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2136854/guerre-tarifaire-mode-emploi-trump-canada?depuisRecherche=true ; Montigny, Philippe de (2025, 30 janvier). Comprendre | Le Canada peut-il tirer son épingle du jeu face aux menaces de tarifs de Trump ? ICI Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2136081/economie-investissement-commerce-interieur-trump-tarifs ; Pavic, Clémence (2025, 3 février). Voici ce qu'il faut savoir concernant les tarifs douaniers. Le Devoir. Repéré à https://www.ledevoir.com/economie/838312/voici-ce-il-faut-savoir-concernant-tarifs-douaniers ? ; Rangasamy, Krishen (2025, 4 février). Que sont les tarifs et pourquoi est-il difficile d'en mesurer les impacts ? FAC. Repéré à https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/services-economiques/que-sont-tarif
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Haro sur l’aide internationale

L'aide internationale est actuellement la cible d'attaques et de remises en cause. Gelée temporairement par la nouvelle administration Trump aux États-Unis, elle fait l'objet d'importantes coupures budgétaires du côté européen, notamment en France et en Belgique. Cela témoigne tout à la fois du recul moral et des contradictions de l'aide.
CETRI - Centre tricontinental
Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine.
Frédéric Thomas est chargé d'étude au CETRI - Centre tricontinental.
11 février 2025 | tiré de mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/110225/haro-sur-l-aide-internationale
Elon Musk, en charge de « l'efficacité gouvernementale » (DOGE), vient d'annoncer la fermeture de l'agence américaine d'aide au développement, USAID, qu'il a qualifiée sur son réseau X d'« organisation criminelle » qui « devait mourir » [1]. Cet arrêt brutal suit la décision abrupte du 20 janvier dernier de geler pendant 90 jours le financement de l'aide internationale [2]. Ces diktats témoignent de la nouvelle donne politique aux États-Unis, mais ils sont également les marqueurs, au-delà des frontières nord-américaines, des contradictions de l'aide internationale et d'un repli éthique au niveau mondial.
Politique spectacle
Dès son investiture, Trump a montré qu'il entendait être le nouvel homme fort du pays, sinon du monde, gouvernant par effets d'annonce et coups de force : volonté de s'approprier le Groenland et le canal de Panama, hausse des tarifs douaniers (sur laquelle il est revenu), expulsions massives, etc. Il convient de prendre au sérieux ce virage à droite et cette politique spectacle, tout en ne se méprenant pas sur son caractère exceptionnel.
Les institutions et contre-pouvoirs auxquels Trump s'attaque avaient déjà été mis à mal par le néolibéralisme, les inégalités et les avantages accordés aux grands acteurs de la tech. Il ne s'agit pas de minimiser la violence du nouveau président, mais plutôt de prendre acte du fait que le trumpisme n'est pas hors-sol, qu'il ne constitue pas un corps étranger à la démocratie américaine. Comme l'écrit Mesrine Malik, « le rêve américain de prospérité à l'intérieur et de suprématie à l'étranger a longtemps masqué un ordre beaucoup plus cynique et transactionnel - un ordre que Trump est à la fois en train d'exposer et d'enraciner » [3].
En fin de compte, le président américain met en scène, tout en la poussant à l'extrême, une politique qui a été largement mise en œuvre par ses prédécesseurs, mais sous une forme plus diplomatique. Au niveau international, la stratégie impériale à visage humain de Biden a ainsi fait place à la stratégie sans masque de Trump. Dans les deux cas, c'est America first [4].
Failles de l'aide internationale
La décision de Trump se répercute directement et lourdement au niveau mondial, mettant en évidence l'architecture de l'aide internationale dont les États-Unis représentent plus de 40% du financement [5]. Outre qu'elle entretient le flou et la confusion quant aux exemptions actuelles – tout ce qui concerne l'aide vitale à court terme – et sur la suite, cette politique hypothèque toute idée de partenariat avec les organisations locales du Sud, dont les programmes financés par la coopération états-unienne ont dû s'arrêter du jour au lendemain, et qui sont traitées comme de vulgaires sous-traitants [6].
Apparaît de la sorte une double dépendance : celle du système de l'aide internationale et des acteurs humanitaires et de développement américains envers la Maison blanche. Dépendance d'autant plus problématique au vu de l'instrumentalisation récurrente de l'aide par Washington. Ainsi, les trois éléments essentiels mis ouvertement en avant par les gouvernements successifs pour légitimer l'aide internationale fournie par les États-Unis sont : la sécurité nationale, les intérêts commerciaux et le reflet des valeurs et du leadership global [7].
Ce qui, jusqu'à présent, était plus ou moins implicitement accepté, à savoir que l'aide sert aussi les intérêts américains, est désormais affirmé avec force comme prioritaire. Chaque dollar dépensé doit être justifié en répondant à trois simples questions, déclare ainsi Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État : cela rend-il les États-Unis plus sûrs, plus forts, plus prospères [8] ?
Désorientation éthique
Sale temps pour l'aide internationale, car ce n'est pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle est confrontée à des coupes budgétaires drastiques. De l'Allemagne à la Belgique, en passant par les Pays-Bas, le repli européen est évident, et c'est en France que la baisse, de 35%, est la plus importante. Du côté belge, le gouvernement Arizona réduira le budget de la coopération d'un quart. Si les réactions ne se sont pas fait attendre, force est de reconnaître qu'elles prennent souvent un tour défensif.
Ainsi, aux États-Unis, la majorité des ONG internationales (ONGI) ont adopté un profil bas, préférant tenter de négocier avec l'administration Trump, voire de l'amadouer. En témoigne la déclaration d'Interaction, le plus grand réseau d'ONGI, selon laquelle les organisations d'aide et de développement états-uniennes travaillaient sans relâche pour faire avancer les intérêts des États-Unis au niveau mondial et que la suspension des programmes créerait un vacuum que « la Chine et nos adversaires allaient rapidement remplir » [9]. Bien que contesté par nombre d'ONG, le positionnement d'Interaction n'en est pas moins révélateur de la confusion qui règne.
Sous un mode mineur, la ligne de défense tend à être la même du côté belge (et européen) : mise en avant du soft power, de « l'investissement stratégique », de la stabilité internationale et de la « gestion migratoire ». Il faudrait valider et s'approprier l'instrumentalisation de l'aide pour mieux la légitimer. Simple tactique ou narratif assumé, cela trahit la dépolitisation des acteurs de l'aide et du développement [10], ayant de plus en plus de mal à penser les conditions de leur fonctionnement dans un monde marqué par les inégalités, les relents réactionnaires, la montée en puissance du Sud et les rapports de force. Au risque de devenir les complices du pouvoir plutôt que des contrepouvoirs.
À défaut de réinventer l'aide en pariant sur l'intelligence sensible des gens ordinaires, qui trouvent tout simplement injuste et révoltant que des hommes, des femmes et des enfants meurent de faim ou faute de soins, sous les coups ou sous les bombes, leurs droits et leur dignité bafoués, on s'autocensure et on s'aligne sur la politique du plus fort. À l'automne 2004, Gustavo Gutiérrez (1928-2024), le « père » de la théologie de la libération, s'appuyant sur le grand philosophe et penseur juif Emmanuel Lévinas (1906-1995), affirmait la nécessité d'une « éthique de la solidarité » [11]. C'est aussi, d'abandonner ce terrain-là, déclaré perdu d'avance, en cédant sur les principes et sur les mots, au nom de la crise économique et de la realpolitik, que l'on condamne l'aide au faux dilemme du gaspillage ou de l'utilité géopolitique.
Notes
[1] Lauren Irwin, « Musk calls USAID a ‘criminal organization' that should ‘die' », The Hill, 2 février 2025, https://thehill.com/homenews/administration/5122128-musk-calls-usaid-a-criminal-organization-that-should-die/.
[2] Laurence Caramel, Philippe Ricard, Ghazal Golshiri, Piotr Smolar, Jean-Michel Hauteville, Jacques Follorou, Florence Miettaux, Bruno Meyerfel, Faustine Vincent et Laure Stephan, « Pourquoi le gel par Trump de l'aide internationale sidère le monde et provoque déjà des dégâts dévastateurs », Le Monde, 3 février 2025, https://www.lemonde.fr/international/article/2025/02/01/donald-trump-seme-le-chaos-et-la-panique-en-gelant-l-aide-etrangere_6526177_3210.html.
[3] Nesrine Malik, « Trump 2.0 is exposing American exceptionalism for what it is – and has always been », The Guardian, 3 février 2025, https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/03/donald-trump-american-exceptionalism-guantanamo-bay-imperialism-billionaires.
[4] Bernard Duterme, « L'Amérique latine selon Trump : des menaces aux réalités », Cetri, 31 janvier 2025. Lire aussi Frédéric Thomas, « Joe Biden : un impérialisme à visage humain ? », Cetri, 16 novembre 2020.
[5] OCHA, Total reported funding 2024, https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2024.
[6] Irwin Loy, « Trump stop-work orders hit local aid and frontline communities », The New humanitarian, 31 janvier 2025, https://www.thenewhumanitarian.org/news/2025/01/31/trump-stop-work-orders-hit-local-aid-and-frontline-communities ; Irwin Loy, « Inklings | What to make of the Trump aid freeze chaos ? », The New humanitarian, 29 janvier 2025, https://www.thenewhumanitarian.org/newsletter/2025/01/29/inklings-what-make-trump-aid-freeze-chaos.
[7] Congressional Research Service, U.S. Foreign Assistance, 1er novembre 2024, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10183.
[8] « Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doivent être justifiés par la réponse à trois questions simples :
Cela rend-il l'Amérique plus sûre ?
Cela rend-il l'Amérique plus forte ?
Cela rend-il l'Amérique plus prospère ?
Sous la présidence Trump, les dollars des contribuables américains qui travaillent dur seront toujours dépensés avec sagesse et notre pouvoir sera toujours cédé avec prudence — et vers ce qui est le mieux pour l'Amérique et les Américains avant tout », Marco Rubio, audition devant le Sénat américain. « Révisionnisme et désinhibition : l'Empire de Trump dans la doctrine Marco Rubio », Le Grand continent, 15 janvier 2025, https://legrandcontinent.eu/fr/2025/01/18/revisionnisme-et-desinhibition-lempire-de-trump-dans-la-doctrine-marco-rubio/.
[9] Cité dans Irwin Loy, Ibidem.
[10] Julie Godin, « ONG : dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ? », Cetri, 13 juin 2017.
[11] Et de poursuivre : « Lévinas parle par exemple par exemple, d'une ‘éthique asymétrique', il l'appelle ainsi car pour lui, l'autre est premier. C'est une façon de parler de solidarité, mais je dirais qu'elle va plus loin. C'est une perspective éthique profonde et féconde ». Anthropia, « Solidaridad y tolerancia : Entrevista a Gustavo Gutiérrez”, 2004, https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropia/article/view/11202.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le monde a changé

Ce qui suit est la mise en texte d'une présentation faite le 28 janvier 2025, soit une semaine après l'assermentation du président Trump. L'auteur répondait à une demande de la TROVEP Montérégie. Quelques mises à jour ont été faites, principalement dans les hyperliens de référence.
Dernière mise à jour : 15 février 2025
Tiré de Pressmob 16 février 2025
https://www.groupmobilisation.com/
Jacques Benoit, GMob (GroupMobilisation)
AVANT-PROPOS
L'élection de Donald Trump le 5 novembre dernier à la présidence des États-Unis n'a pas tardé à susciter des craintes et commentaires à propos du Projet 2025 qui constitue la base de son programme, mais dont il avait tenté de se distancier en campagne électorale. Les plus optimistes, sans être de ses partisans, ont répété qu'il fallait faire confiance aux contrepouvoirs existants aux États-Unis, qui l'empêcheraient de faire n'importe quoi et que, dans deux ans, aux élections de mi-mandat, les choses pourraient bien changer totalement.
Cet optimisme, tout comme les illusions sur les conséquences d'une nouvelle présidence Trump, a commencé à fondre à mesure qu'on se rapprochait de son assermentation, et elles sont parties en vrille dès la fin de sa prestation de serment. Voyons cela ensemble.
Et puisqu'une image vaut mille mots (et mille maux), attardons-nous d'abord au portrait officiel de sa présidence.
Depuis Lyndon B. Johnson, devenu président américain après l'assassinat de John F. Kennedy en 1963, tous les présidents américains ont présenté un sourire sur leur portrait officiel, pour ainsi dégager de la bienveillance et de l'espoir quant à leur présidence à venir.
Cette année, Donald Trump a brisé cette tradition sur une photo à l'éclairage cru et dramatique qui n'inspire pas la bienveillance. Cette image « de gars dur » présente une ressemblance frappante avec sa célèbre photo d'identité judiciaire. Si c'était l'effet recherché, alors sa photo nous rappelle (et rappellera aux générations futures) que quelques mois avant d'être élu, le président Trump a été reconnu coupable par un jury de 34 chefs d'accusation au criminel, qu'il est un criminel, et qu'il risque fort de se comporter comme un criminel pendant tout son mandat !
1- RECUL DE LA DÉMOCRATIE ET DES DROITS
Construire prend du temps ; détruire, un instant ! La démocratie a besoin de temps.
« La grande blague de la démocratie, c'est qu'elle donne à ses ennemis mortels les moyens de sa propre
destruction. » - Joseph Goebbels
N'ayons pas peur des mots : Donald J. Trump veut la destruction, le chaos ! Dans le chaos, pas de droit, pas de démocratie, la loi du plus fort fait loi ! Il veut détruire les institutions de l'État de droit, l'égalité de droit pour tous, tout ce qui établit des normes, notamment : santé, environnement, droits du travail, immigration, fiscalité, etc. Il veut dérèglementer tout ce qui entrave le marché, ce qui nuit aux affaires, à l'exploitation capitaliste, à l'accaparement du bien commun public, etc.
2- ACCÉLÉRATION DE LA CATASTROPHE CLIMATIQUE
Le 10 janvier dernier, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) confirmait que 2024 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température supérieure d'environ 1,55 °C aux valeurs préindustrielles, en avance de 5 à 10 ans sur les prévisions du GIEC qui prévoyait la chose aux environs de 2030-2035.
Dix jours plus tard avait lieu l'assermentation de Trump. Et l'un de ses premiers décrets concernait la sortie des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat.
3- DES IMPACTS BIEN AU-DELÀ DES ÉTATS-UNIS
Les États-Unis sont le pays le plus puissant au monde. Tout ce qui s'y passe depuis le 20 janvier a des impacts au niveau mondial, au niveau du Canada, et ici au Québec.
Nous en tenons pour preuve : l'annonce des tarifs de + 25 % sur les exportations canadiennes aux É.-U., qui ne cesse de faire courir tous nos élu.e.s et nos capitalistes d'un océan à l'autre, et les fera courir jusqu'à ce que Trump change d'idée…ou pas. Il en est de même avec tous les pays qui commercent avec les États-Unis, dont ses alliés européens. Évidemment que ce genre de mesures risque d'avoir des impacts importants sur notre économie. Mais cette annonce n'est qu'un élément parmi tout ce qui se met en place au sud de notre frontière, une pièce du puzzle Trump / Projet 2025.
En lire plus... page 3
4- LA GOUVERNANCE AMÉRICAINE
LE TRIDENT DU POUVOIR
Le système politique américain est complexe. Il est possible de résumer les institutions du pouvoir fédéral à trois branches principales :
D'abord, le pouvoir exécutif, qui met en oeuvre les lois. C'est la Maison-Blanche composée de la présidence, du gouvernement et des agences. Le président émet des décrets, qui sont des déclarations officielles sur la manière dont les agences fédérales américaines doivent utiliser leurs ressources, dans le cadre des paramètres fixés par le Congrès et la Constitution. Le président a également un droit de veto sur des lois. De plus, il nomme les chefs d'agences gouvernementales et les juges à la Cour suprême. Et en tant que commandant en chef, le président peut aussi signer des décrets visant l'armée.
En lire plus... page 6
5- LA GOUVERNANCE TRUMP
(AXE 1 DE 4) LES DÉCRETS
Le décret est l'instrument de choix des nouveaux présidents pour lancer leur administration. Les décrets – le type le plus formel des « actions exécutives » présidentielles, conférées par l'article II de la Constitution américaine – ne nécessitent pas l'approbation du Congrès et ne peuvent pas être directement annulés par lui. Toutefois, le Congrès, même aux mains des républicains, dont plusieurs MAGA, peut les bloquer en retenant des fonds ou en adoptant des mesures qui en compliquent l'exécution.
Rappelons-le encore : la démocratie prend du temps. Trump le sait, et c'est pourquoiil va fonctionner par décrets.
6- ALORS : QUE FAIRE ?
Cette question, tous les progressistes et démocrates du monde se la posent, mais les réponses ne fusent pas, étant tous et toutes autant que nous sommes sous l'effet de la stratégie d' « inondation de la zone ».
Pourtant, une réponse s'impose : RÉSISTER !
En lire plus... page 13
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour un soulèvement planétaire !

Alors où tout doit s'arrêter maintenant, les émissions de gaz à effet de serre, la production de plastique, la production d'armes, alors ou tout doit s'arrêter maintenant, le consumérisme débridé, la course au profit et à plus de compétitivité, tout continue, tout s'accélère. La crise de soutenabilité et la crise de la sensibilité sont héritières des contradictions du capitalisme qui met la planète à feu et à sang. L'effondrement de la biodiversité se fait en silence. Les oiseaux disparaissent du ciel et l'on perd une partie de nous avec l'effondrement de la vie sur terre. Cette crise profonde de sensibilité par rapport au vivant est exposée par le philosophe Baptiste Morizot qui fait référence à “l'appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser à l'égard du vivant. Une réduction de la gamme d'affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui.”1
Notre sensibilité s'érode car le Capital règne en maître. Il n'a d'autre limite que lui-même et on dépasse les nôtres pour le servir ; la planète dépasse les siennes pour le servir, et ensemble on se desserre en se rapprochant du point de rupture. La charge capitaliste est trop forte. Tout ce qui va à l'accumulation n'est pas mis sur le compte des travailleurs et alors que la croissance économique augmente, c'est une part de plus qui est volée à la biodiversité. Ce que les capitalistes gagnent d'un côté, on le perd de l'autre car la production industrielle, c'est aussi une destruction à grande échelle. Destruction souvent irréversible et malheureusement vaine car les fruits du travail salarié, de l'exploitation donc, de la destruction de la nature, ne profitent pas à tous. Il y a une partie de l'énergie humaine, manuelle et intellectuelle, qui part en fumée. C'est la même, celle souterraine des énergies fossiles qui part en fumée. Les deux sont captées et consumées pour le profit. Un rituel moderne qui tourne au sacré, et donc à la défense exclusive de la propriété privée et de ceux qui la détiennent. Cette crémation à un effet sur la planète et sur nos vies. Au bureau, à l'entrepôt, dans la salle des machines, partout où le capital est investi ou placé, il extrait de l'énergie et de la valeur. Bien qu'on n'arrive pas à le distinguer de notre salaire, le surtravail effectué ne nous revient pas, ni en temps ni en argent. On vole notre temps et au même titre qu'on vole de l'énergie humaine on vole de l'énergie planétaire accumulée sur des millions d'années. La crémation pour le profit tourne à plein régime : c'est aussi le profit pour l'incendie.
L'économie capitaliste incendiaire n'a donc aucun sens car même si les profits augmentent par rapport aux années précédentes il faut brûler encore, brûler toujours. Une démesure qui gonfle d'un côté, sur une montagne de cendre.
Dans beaucoup de pays et depuis plusieurs décennies on a un déséquilibre entre la part qui revient au salaire et celle qui revient au profit.2 Michel Husson fait partie des économistes qui ont travaillé sur ce sujet de la répartition de la valeur. Bien que décédé, son travail reste toujours d'actualité et les graphiques ci-dessous sont issus de ses travaux :

***********

Autre paramètre : ce qu'on observe ensuite jusqu'à des périodes très récentes c'est une évolution dans la répartition des profits. La part des bénéfices reversés aux détenteurs des titres, pour les principales sociétés, augmente de plus en plus. Autrement dit, les propriétaires du capital captent de plus en plus la richesse produite par ceux et celles qui travaillent. On a donc une double captation, par le profit et par les dividendes.
En France par exemple, en vingt ans, les dividendes distribués aux actionnaires des entreprises françaises du CAC 40 ont augmenté de 269 %. Autant d'argent qui ne va pas au salaire ni à l'outil productif pour le rendre moins polluant ou pour opérer, avec cet excédent, une bifurcation écosocialiste qui peut se traduire par l'arrêt, la réduction ou la transformation d'une production existante et de son procès.
Déjà, entre 2009 et 2016, 67,4 % des bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40 ont été distribués en dividendes aux actionnaires. Sur le tiers restant, seulement 27,3 % ont été réinvestis dans l'entreprise, et 5,3 % ont été reversés aux salariés.3
En 2022, encore, on a une part très importante des profits qui se transforme en dividendes. Les grandes entreprises françaises cotées en bourse enregistrent 142 milliards d'euros de bénéfice, tandis que la part qui revient aux actionnaires est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ce qui représentait à l'époque une hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Selon la lettre financière Vernimmen, les entreprises du CAC 40 ont versé en 2024 près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires, sous forme de rachats d'actions et de dividendes (les bénéfices s'élevaient quant à eux à 145 milliards d'euros). Etrangement, le nombre de salariés en France dans les entreprises du CAC 40 baisse de 12%4
La richesse nous échappe et paradoxalement on se voit souvent contraint de travailler davantage dans des conditions qui se dégradent. Plus la valeur augmente, moins elle tire à notre avantage. Cette augmentation continue de la richesse est nocive car elle implique une dégradation écologique et un appauvrissement pour des millions de personnes.
Nouvelle phase du capitalisme et nouveaux dangers pour les travailleurs, la démocratie et la planète
Si le mode capitaliste évolue, se transforme, on peine toujours à savoir au début si les évolutions technologiques nous rapprochent d'une société libre, démocratique, même si avec le temps la naïveté s'estompe. Il est difficile de retourner les outils numériques en leur contraire. Dans la société capitaliste, ils servent aux flicages et accompagnent les politiques austéritaires et la réduction du nombre de fonctionnaires. Par ailleurs, la numérisation de la société est une aubaine pour les investisseurs car elle permet l'accélération de la rotation du capital tout en sabrant dans les postes inutiles et ils sont de plus en plus nombreux à être sur la sellette. Avec la numérisation et l'automatisation du processus de production et de la société dans son ensemble, on a le fantasme de la marchandise en un clic et du profit en quelques clics. On peut rêver de devenir millionnaire sans dépendre trop des autres. Ce n'est qu'un rêve.
L'algorithme, qui semble être le nouveau régime d'accumulation, structure les rapports humains. Quand on parle de régime algorithmique comme régime d'accumulation actuel on renvoie à l'ubérisation de la société ou au capitalisme de plateforme qui passe outre les corps intermédiaires et souvent, le contrat de travail. Ces expressions sont relativement synonymes.
Avec d'autres, on considère que “les technologies algorithmiques sont principalement ou surtout développées en tant qu'outils d'accumulation du capital, tout en étant aussi utilisées dans une variété de sphères de la vie sociale avec des conséquences qui débordent largement cette finalité économique. Sans être réductibles à leur fonction lucrative, les données massives et les algorithmes sont appropriés, façonnés et déployés selon une logique qui répond aux impératifs du mode de production capitaliste et contribuent à modifier ce système en retour.”5
Nous vivons dans ce régime algorithmique, dans cette société, ou le capital a un temps d'avance et la démocratie un temps de retard. Plus les outils numériques censés nous rapprocher apparaissent, plus on semble s'éloigner les uns des autres ; et avec cet éloignement, l'espoir de fonder une communauté humaine transnationale pour vivre à l'aune d'un nouveau monde, débarrassé du nationalisme et du capitalisme. On est là malgré tout, après coup, sur la toile, à essayer de se défendre, de militer, avec un comportement un peu schizophrénique car à la fois on veut s'échapper de la surveillance, couper les liens, de l'autre on aspire à un web réellement communautaire qui puisse servir à la libération des êtres humains. La machine évolue, se complexifie. La dépendance aux énergies fossiles est de plus en plus marquée avec les nouvelles plateformes - comme Tik Tok ou Netflix - qui parfois font coup double : captation de notre attention et ponction sur nos salaires.
La réflexion sur le fait de récupérer ou briser la machine moderne est toujours ouverte. La machine algorithmique est à la fois l'outil magique et l'ouvrage final. Une dimension sacrée la recouvre, comme la promesse d'une accumulation jamais espérée auparavant. Des sommes énormes sont mobilisées. Trump envisage un investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Malgré la dépossession déjà en cours, les puissances économiques répondent à l'appel pour accomplir le rituel à coup de milliards ; multiplier la puissance et la rapidité. Un monde se lève et nous exclut, il est déjà là, et c'est depuis ce monde de course sans fin, de culte et de profit, que les sommes sont mobilisées. La croyance dans la puissance est vide finalement : aller plus vite, plus loin dans le calcul, mais pour aller où ?
Courir d'abord et réfléchir après, car une innovation en chasse une autre et le fanatisme est toujours plus grand. Aujourd'hui on veut savoir si la dernière invention en date, l'intelligence artificielle, peut apporter les miracles escomptés ; mais toute question philosophique est évacuée ; le désir de puissance l'emporte. La ligne d'horizon recule sans cesse. On ne sait plus où l'on va, où il va, car ce n'est pas réellement nous. Nous n'avons pas vraiment la main ; on subit ces changements : on est exclu du processus de décision et davantage du processus de production. L'argent est investi, la course est lancée, et dans son sillage, malgré nous, le capital amène toute la société.
Or, c'est souvent aller dans le mur si on ne réfléchit pas au préalable aux fins qu'on se donne et si on ne réfléchit pas non plus au régime de propriété et au fonctionnement des nouvelles innovations ; intelligence artificielle, ou autre. Rappelons que pendant qu'on fantasme sur les innovations et sur ce qu'elles peuvent apporter, des millions de travailleurs sont pris dans la toile, soumis à la surveillance et à la notification, payés à la mission, évoluant dans un environnement de plus en plus abstrait qui vient buter sur les limites du réel. L'évolution technologique est parfois inversement proportionnelle aux avantages sociaux. Autrement dit, si l'outil de travail évolue (certains diront s'améliore), - smartphone, ordinateur, - le droit du travail quant à lui régresse ou disparaît.
Autre point, le profit augmente au même rythme qu'il sape les conditions de vie sur terre et c'est nous qui payons la facture des contradictions du système. On paie avec notre vie. L'accumulation d'un côté crée du vide de l'autre, du chômage, de la misère et de la désolation.
Cette course, c'est aussi celle qui nous mène à l'abîme : parmi les neuf paramètres de la soutenabilité de l'espèce humaine sur cette planète, (le cycle du carbone - le climat -, la biodiversité, l'eau douce, les changements d'affectation des sols, l'acidification des océans, la pollution chimique, la pollution atmosphérique aux particules, la couche d'ozone stratosphérique, et les cycles de l'azote ainsi que du phosphore) six ou sept seuils sont déjà dépassés. D'après le dernier rapport du GIEC, près de 3,5 milliards d'individus sur Terre subissent déjà gravement les impacts du changement climatique. La continuité capitaliste est donc une folie.
Enfin, relevons que la nouvelle transformation du mode de production avec l'algorithme parachève le démantèlement de tous les obstacles qui pouvaient nuire à la libre circulation du capital sur la planète. Le régime algorithmique accélère donc la phase néolibérale du capitalisme marquée par le refus de la stabilité et du compromis, et on mesure aujourd'hui la régression sociale et écologique sans précédent, due aux choix passés. Hélas la régression ne s'arrête pas là. Lorsqu'on commence à démanteler, à déréguler, on ne s'est jamais où ça finit. Avec la simplification des règles pour les investisseurs encore à l'ordre du jour, on observe que le développement du capital ne vient pas seulement buter sur le code du travail ou les limites planétaires, et ça serait déjà assez, il vient buter sur la démocratie elle-même. Comme si finalement la complexité n'était pas seulement d'ordre technique, fiscal, juridique, ou environnementale. La démocratie apparaît maintenant comme un obstacle pour les affaires. Quinn Slobodian, historien, spécialiste du néolibéralisme, professeur à l'université de Boston et auteur notamment de Le Capitalisme de l'apocalypse. Ou le rêve d'un monde sans démocratie, a travaillé sur ce sujet. Interrogeons-nous avec lui : et si la démocratie et les aléas du suffrage universel commençaient à devenir trop gênants pour les profits et le pouvoir des milliardaires ? L'auteur nous invite à nous défaire d'un préjugé qui a atteint le summum dans les années 1990 et qui est toujours vivace, ou l'on considère que capitalisme et démocratie font forcément bon ménage, et que, par conséquent, la fin de l'URSS et l'expansion de la mondialisation capitaliste allaient immanquablement renforcer les régimes démocratiques. Au journal Le Monde, il précise : “Il faut oublier cette idée reçue selon laquelle le capitalisme et la démocratie se renforcent mutuellement” (20/01/2025). C'est un coup dur pour ceux qui pensaient bien naïvement - ou malhonnêtement - que défendre son business, son intérêt personnel, serait forcément une bonne chose pour la liberté et la démocratie dans le monde. Pour une poignée de capitalistes, les milliards sont là, et l'Etat a contribué à l'accomplissement de leur intérêt égoïste, mais depuis l'autre rive, on attend toujours les effets positifs en ricochet pour la liberté et la démocratie.
Ce qui est démontré par le professeur se vérifie souvent : moins il y a de démocratie, et notamment de démocratie sociale, et plus les investisseurs sont intéressés pour faire des affaires. En cela, la Chine reste un bon élève. En 2020, l'Australian Strategic Policy Institute (ASPI), une ONG australienne, avait montré les liens entre le monde concentrationnaire et le milieu industriel, toutes entreprises confondues (textile, électronique, etc). Dans les dernières années 83 grandes marques, (de Sony à Nike en passant par Adidas, Lacoste, Apple, Microsoft, Samsung, H&M, ou encore BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, etc) n'ont eu aucun scrupule à utiliser le travail de 80 000 ouïghours emprisonnés dans 27 usines entre 2017 et 2019. L'esclavage moderne continue. Une main d'œuvre soumise, enfermée dans des camps de concentrations, ça ne pose aucun problème aux investisseurs.
Quinn Slobodian insère une citation dans son livre qui résume bien son propos : « Le capitalisme est bien plus important que la démocratie. Je ne suis moi-même pas un fervent adepte de la démocratie. » L'auteur de cette phrase est Stephen Moore, conseiller économique de Donald Trump lors de son premier mandat. Voilà le mantra. Il est avoué aujourd'hui mais il n'est pas si nouveau.
Pour le business des plus riches on a dû vendre des acquis sociaux, remettre en cause des réglementations environnementales ou fiscales qui pouvaient freiner le commerce, doit-on maintenant vendre intégralement la démocratie et ce qu'il reste de contre-pouvoir pour que leurs vœux soient exaucés ? Voilà où mène le fanatisme de la Croissance et de la Compétitivité. Il est temps de mettre un coup d'arrêt à la sacralisation des affaires et de la propriété privée. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut pas être déchirée sous prétexte que ça nous coûterait un point de croissance de la conserver. Nos vies et la démocratie valent plus que les profits. Malgré les milliards en face, notre parole doit compter, l'habitabilité de la planète et le droit à l'existence doivent passer d'abord ; avant toute considération pécuniaire.
En définitive, la réflexion de l'auteur nous encourage à nous interroger sur la démocratie et à politiser son contenu et sa défense. La lutte anticapitaliste, en cela, est à la fois une lutte écologiste, une lutte pour l'humanité et le droit à l'existence, mais également, une lutte pour la défense et l'extension de la démocratie. Ce n'est pas seulement qu'elle disparaît à la porte de l'entreprise ; il en est ainsi depuis l'apparition de la propriété privée, c'est qu'elle disparaît sur des milliers de territoires. Quinn Slobodian explique qu'il existe une constellation de près de 5 400 « zones », des petits territoires assez différents les uns des autres (paradis fiscaux, ports francs, zones économiques spéciales, villes à charte, gated communities, duty free, plateformes pétrolières, etc.), dont le point commun est d'offrir un refuge au capital et de réduire la démocratie à son plus simple appareil, voire à tout simplement l'abolir.
Au Vénézuela, pour ne prendre que cet exemple, on a bien une symétrie entre la fin de la démocratie et la multiplication des zones économiques spéciales à partir de 2014 ou la constitution bolivarienne n'est plus du tout opérante.
Analyser et comprendre cette nouvelle phase du capitalisme est important. Attaqué sur tous les fronts, il faut défendre les conquis féministes sociaux pour défendre la démocratie, défendre les droits et l'habitabilité de la planète pour ne pas se faire écraser par le capital qui revendique notre asservissement et une souveraineté sans limite, en dépit des limites planétaires et des règles qu'on pourrait lui imposer.
Résister à l'aliénation : le cerveau, le dernier bastion
L'organisation algorithmique de la société touche à des choses matérielles sur l'organisation du travail et aussi à des choses immatérielles comme l'hégémonie culturelle et le contrôle des postulats. Comment on s'envisage et comment on se raconte.
Le point de convergence pour résister aux effets multiples de ce régime est la lutte anticapitaliste qui passe également par une lutte intellectuelle et culturelle collective pour dégager de l'espace, penser ensemble et affiner notre compréhension du réel. On a besoin de s'écouter, de s'éduquer, d'apprendre les uns des autres pour bâtir par le dialogue et la réflexion notre propre réalité. Ce qui est vécu par notre corps n'est pas forcément représenté. La réalité médiatique dominante est souvent le reflet de la lecture du monde telle qu'elle est faite par la classe dominante. On représente mal ce qui est vécu par des milliards de personnes. Nos vies et nos pensées sont sous emprise. L'emprise touche à comment on regarde, comment on parle, comment on pense, comment on rêve.
Après l'écrasement des populations et du vivant, c'est la mémoire qu'on cherche à détruire par une réécriture perpétuelle de l'histoire pour empêcher toute fuite intellectuelle dans un passé révolutionnaire ou précapitaliste qui pourrait éclairer sous un nouveau jour, ou fissurer, l'ordre existant. Dans son livre Erasing History, Jason Stanley, professeur de philosophie à l'université de Yale évoque le processus idéologique, la réécriture du passé pour mieux contrôler le futur. Cette réécriture on peut la comprendre comme une stratégie politique : la dernière bataille. Le cerveau est le territoire à conquérir car la pensée critique peut être le dernier bastion de la résistance. Alors ou le néolibéralisme a eu raison du compromis social de l'après-guerre entre le Capital et le Travail, il veut parachever sa victoire économique par une victoire idéologique en revisitant le passé pour effacer toute trace de fierté et d'inspiration dans celui-ci. Faire comme si la lutte internationale des travailleurs n'avait jamais eu lieu. Faire comme si la liberté du millionnaire serait la liberté de tous, comme s'il n'y avait pas eu de violence impérialiste, colonialiste, et laisser croire enfin que tout se vaut, que la violence des opprimés serait identique à la violence des oppresseurs. Pourtant, il n'y a pas d'équivalence malgré la symétrie des mots. Le black power pour ne prendre que cet exemple se battait pour l'émancipation, la fin de la violence raciste, quand le white power veut contrecarrer la résistance des africains américains pour qu'ils restent à leur place. La brutalité de la réaction témoigne d'une peur pas encore évacuée. Conscient de l'instabilité du système, la révolution est le cauchemar de la classe dirigeante. Tandis qu'il y a un recul révolutionnaire par rapport aux décennies précédentes, la guerre est déclarée contre les mouvements d'émancipation et pour une prise d'assaut de nos cerveaux et de nos regards. Cette guerre s'illustre sur l'espace médiatique et numérique.
Lieu d'accumulation et de consumérisme sans retenue, les plateformes servent également de canaux idéologiques pour la bourgeoisie conservatrice qui en plus de ses privilèges veut jouir d'un contrôle idéologique sur la population. C'est pour cette raison que, effrayés par la liberté, des millionnaires financent des réseaux comme le réseau Atlas afin d'éviter que les barricades ne se montent dans les têtes avant de se monter dans la rue. L'Atlas Network est une alliance de puissants think tanks diffusant des idées néolibérales, climatosceptiques et d'extrême droite. Fondé en 1981, le réseau Atlas veut cadrer le débat en recouvrant le monde de think tanks équivalents. En 2023, elle coordonne 589 laboratoires d'idées dans 103 pays, grâce à un budget de 28 millions de dollars, essentiellement issus de dons d'entreprises et de milliardaires. Parmi ses membres les plus influents figurent des associations comme le Cato Institute, financé par la famille Koch, des magnats pétroliers, ainsi que la Heritage Foundation, connue pour son rôle dans le projet 2025, au cœur des politiques de Trump malgré ses dénégations publiques. L'artillerie lourde est déployée pour que leur argumentation soit reprise.
L'objectif, partout dans le monde, est de "changer le climat des idées", légitimer le business et s'attaquer à des causes comme l'action climatique, la promotion des droits des femmes et des minorités, la justice fiscale ou encore les services publics. Asséné des milliers de fois, la propagande des millionnaires peut finir par rentrer : on peut devenir, sans s'en rendre compte, porte-parole du business, comme la chose la plus naturelle et la plus bénéfique qui soit alors qu'on ne dispose d'aucun capital. On peut finir par minimiser la situation écologique sur la planète alors que des milliards de personnes sont concernés par le réchauffement climatique. Dans une conférence, André Noël, journaliste québécois, a mis en lumière les influences du réseau Atlas au Canada et au Québec.6
Selon lui, il est important de rester vigilant dans les années à venir face à la multiplication des interventions de prétendus « experts » dans les médias ou lors de consultations, car ces gens interviennent sur des enjeux publics majeurs tels que l'énergie, l'éducation, la santé, le climat, l'environnement et les impôts, tout en dissimulant leurs affiliations. Ce qui est dit par le journaliste est valable au Canada, en France, comme ailleurs. La diffusion est d'autant plus importante qu'avec les outils actuels, comme l'intelligence artificielle, la multiplication automatique de faux comptes et de fausses informations est possible. Cela se fait grâce à l'IA générative, ce qui donne une dimension exponentielle à la guerre culturelle. Mensonges, préjugés, guerre contre les idées et les personnes : tous les coups sont permis pour empêcher la pensée critique et l'émancipation.
Nos vies et nos cerveaux sont pris d'assaut, ce qui tend temporairement à détourner les colères et à stabiliser un système de plus en plus tiraillé par ses contradictions.
On a là un croisement clair entre l'efficacité capitalistique et le contrôle idéologique de la population. Le régime algorithmique joint les deux. Il est à la fois un mode de gouvernance qui assure un maillage de propagande et un outil qui accélère la production de profit. Dans la toile, dans la société, notre vision s'amenuise tandis que les endroits ou regarder s'amplifient. Le regard est figé, capturé par les images, c'est pourquoi l'on doit changer de regard.
Changer de regard
Alors que le capitalisme nous fait passer respectivement pour un problème démographique, migratoire, un coût, sachons nous envisager plutôt que de nous craindre en résistant à cette lecture comptable et anti-humaniste. Contrairement à ce qui peut être véhiculé par le réseau Atlas ou autre laboratoire d'idées de la bourgeoisie, l'humanité n'est pas un problème et le déplacement libre des populations sur la planète n'est pas un problème non plus. En revanche, la réduction de l'humanité à une main d'œuvre seulement née pour être de la chair à patron est un vrai drame car on passe du statut de sujet à objet. Nous ne sommes, dans ces discours, dans ce monde, rien de plus que des pièces interchangeables pour la machine capitaliste. Ce traitement de l'autre comme une chose réduit notre humanité et crée une sorte d'équivalence entre la matière brute et l'humanité. Ce processus de chosification qu'on appelle aussi réification impact le regard sur soi et sur les autres ; il coupe les liens sociaux et les liens historiques qui nous ont fait et qui nous font.
La question des postulats est essentielle. Si l'homme égoïste et maximisateur est une invention sur laquelle le libéralisme repose - un choix bien pratique - nous avons aujourd'hui des postulats assez anti-humaniste qui commencent à gagner les esprits et qui renforcent l'idéologie sécuritaire et concentrationnaire. Lorsqu'on ne regarde pas le monde depuis la compassion, lorsqu'on dévalorise la réflexion et l'histoire, alors on juge depuis des catégories anti-historique, anti-matérialiste, souvent avec des critères qui tournent autour du bien et du mal. La condamnation chasse la réflexion. On confond excuser un évènement et le comprendre. Et il serait assez indécent de dire que Hannah Arendt ou Enzo Traverso, pour ne prendre que ces deux exemples, ont excusé le nazisme parce qu'ils ont essayé de le comprendre en allant au-delà des jugements moraux définitifs. Aujourd'hui encore, il ne s'agit pas d'excuser mais de comprendre les phénomènes sociaux. Lorsqu'on refuse de se voir comme des êtres humains et de comprendre l'enlacement des situations et des parcours de vie, alors on décharge la responsabilité entière sur l'individu, laissant de côté des facteurs déterminants comme les contrôles policiers, la pluralité des discriminations, les oppressions, l'exploitation. Selon les calculs du sociologue de l'université Harvard Bruce Western, pour les hommes noirs sans diplôme, la probabilité d'être incarcéré au cours de leur existence a été évaluée à 60 %. Ce taux va jusqu'à 70 % pour les cohortes nées entre 1975 et 1979.
Pour celles-ci, la prison représente à peu près la même chose que le service militaire pour les cohortes arrivées à l'âge adulte au début des années 1940 : un passage obligé du parcours de vie. La prison sert de punition parfois définitive pour les personnes et laisse un faux semblant de justice alors que la révolution c'est tout l'inverse. Ce n'est pas enfermé, c'est libéré. Pas même enfermé les exploiteurs - même si parfois ça peut être nécessaire - mais c'est se libérer de l'exploitation. Le choix de la surveillance et de la punition gagne du terrain et donc l'espoir de la révolution recule pour le moment. Malgré la violence sans précédent du système carcéral, les politiciens adeptes de cette idéologie ont une popularité assez grande, comme c'est le cas pour Bukele, dirigeant du Salvador. Ce qui est assez inquiétant. Aujourd'hui, avec 1764 détenus pour 100 000 habitants, le Salvador connaît le plus fort taux de détention au monde. Un salvadorien sur 57 est derrière les barreaux ! Plutôt que de faire la guerre à la misère, à l'exploitation et à la corruption, Bukele fait la guerre à la population.
Dans un rapport, Amnesty International précise : “Plus de 73 000 placements en détention ont été dénombrés entre le 27 mars 2022, début de l'état d'urgence, et la fin de l'année 2023. La plupart des personnes détenues étaient accusées d'« association illicite », une infraction liée aux activités des bandes armées et à l'appartenance à celles-ci. Dans la majorité des cas, les détentions relevant de l'état d'urgence étaient arbitraires dans la mesure où les garanties de procédure régulières n'étaient pas respectées. Souvent, les incarcérations n'étaient pas clairement justifiées par une décision de justice, les détentions administratives étaient prolongées, les autorités n'informaient pas la famille du lieu précis où leur proche était enfermé ou l'identité des juges saisis des affaires était maintenue secrète. L'état d'urgence pesait particulièrement sur les populations les plus pauvres et marginalisées, rendant leur situation encore plus précaire.”7
Malgré les réserves, les critiques émises par Amnesty International et d'autres, toutes les droites sud-américaines citent Bukele en exemple en matière de délinquance. Cadenassé les contre-pouvoirs, instaurer un état d'urgence permanent, menacer les journalistes, criminaliser les opposants, cela plaît énormément aux milliardaires réactionnaires comme Elon Musk, qui se félicite de sa politique carcérale. Il la considère comme “la voie à suivre”.
Cependant, c'est tirer à côté de la cible. Tant qu'il y aura de la misère et des impérialismes, la criminalisation et les extorsions continueront car elles sont le résultat des inégalités et pour cette région, des ingérences américaines. Au Salvador, la mafia ne vient pas de nulle part et si l'on n'interroge pas le contexte et les conditions de sa création - pour les Maras - on ne se donne pas la possibilité de la combattre vraiment. L'impérialisme américain a déstabilisé des régions entières en soutenant des régimes militaires ; dans un contexte de guerre froide, ça semblait légitime, et c'était la garantie de faire des affaires et d'empêcher une avancée de la révolution. Le risque d'un meilleur partage des richesses et d'une réforme agraire était écarté.
Le Salvador va alors tomber dans la guerre civile sous prétexte de lutter contre des factions marxistes (FMLN), provoquant ainsi l'exil d'une part importante de la population tant le conflit s'avère meurtrier. Selon les rapports rendus par la commission de vérité de l'ONU, les escadrons de la mort pro-gouvernementaux et la police et l'armée salvadorienne seraient responsables de 85 % des actes de violences perpétrés durant la guerre civile. Les Etats-Unis ont soutenu l'Etat sur le plan militaire, financier et diplomatique pour empêcher toute avancée sociale et démocratique. Comme on le sait, c'est loin d'être un cas isolé. La peur de la révolution, et ce dans bien des pays, à déclencher une tornade de violence avec le soutien direct ou indirect des Etats-Unis, privant la population d'exercer ses droits démocratiques (comme au Guatemala en 1954 ou au Chili en 1973, pour ne prendre que ces deux exemples) ; brisant les reins des organisations sociales, communautaires ou révolutionnaire. Le résultat sera un exil massif, parmi eux, bon nombre de jeunes salvadoriens et une partie d'entre eux va se former à la dure réalité des Etats-Unis et à la criminalité.
“À leur arrivée les conditions de vie s'avérèrent précaires : marginalisés, menacés, résidant illégalement sur le territoire américain et disposant de peu de ressources, une partie de la communauté décide alors de se regrouper entre amis, entre maras.“8
Quelques années plus tard, les immigrés salvadoriens ayant fui la guerre ont pu rentrer au pays en emportant avec eux la criminalité apprise aux États-Unis. Sous-couvert de lutter contre les Maras, l'État salvadorien s'attaque encore à la population avec la répression et la prison. Cette guerre antigang sert de caution à la guerre réelle contre la société civile ; guerre faite contre les pauvres et ceux et celles qui s'engagent pour un changement révolutionnaire. En juillet 2024, Cristosal, organisation salvadorienne de défense des droits humains, a publié un rapport faisant état de 79211 prisonniers et 265 décès en détention depuis l'instauration de l'état d'urgence, en mars 2022. L'ONG Socorro dit défendre 1500 détenus qui ne font pas partie des maras mais ont été arrêtés sur ce motif. Les disparitions sont aussi nombreuses.
Née au Etats-Unis, l'idéologie pénitentiaire fait, comme on le voit, au Salvador comme ailleurs, des émules partout sur la planète. Cette idéologie accompagne le règne du Capital. L'augmentation des lieux d'enfermements a été étudiée par le sociologue Loïc Wacquant dans son livre de référence Les prisons de la misère. Il invite à prendre la mesure du tournant qui s'opère avec la création de nouvelles prisons (comme en Californie). Ces créations nouvelles signent le passage d'un régime à un autre. La multiplication des prisons n'est ni un hasard ni un choix isolé, ça correspond au passage du Welfare state au Workfare state.
En français Loïc Wacquant parle du passage de l'État-providence à l'État-pénitence. Son analyse permet de changer notre regard. Si dans le premier régime le droit à l'existence est théoriquement garanti, car on accepte que tout le monde ait le droit à l'intégration, à l'inclusion, à la vie décente, dans le second schéma le postulat est totalement différent. Le droit à la vie au sens large, à la santé, aux aides sociales, etc, est conditionné à notre comportement. Rien n'est garanti. La vie n'est pas donnée. Les bons méritent une aide, toujours dosée, revue, conditionnée, quand les “mauvais”, ceux qui subissent une exclusion, sont considérés comme responsables de leur situation.9
On considère dans cette seconde lecture que la punition est le meilleur moyen pour gouverner la population et pour l'inciter au travail. Pas besoin d'améliorer le salaire et les conditions de travail - ce qui peut nuire à la compétitivité - ; il faut punir. Rendre les chômeurs responsables de la misère subie. La responsabilisation individuelle (et la déresponsabilisation étatique et patronale) est une méthode nouvelle qui vise à gérer par la force la misère et les instabilités que les inégalités produisent. La multiplication des prisons et de l'incarcération va donc de paire avec ce nouveau regard et ce nouveau régime.
En Europe, la défense des institutions policières et pénitentiaires pour juguler les désordres engendrés par le chômage de masse sera défendu puis mis en place par Tony Blair avant de se généraliser dans plusieurs pays européens. “Depuis l'arrivée au pouvoir des néo-travaillistes, la population pénitentiaire de l'Angleterre a cru au rythme de mille personnes - soit dix fois plus vite que sous Margaret Thatcher - pour atteindre le chiffre record de 66 800 détenus au printemps 1998 et, dès l'installation du gouvernement Blair, le budget des prisons a été augmenté de 110 millions de livres alors que les dépenses sociales stagnaient.”10 Au Pays-Bas, les effectifs carcéraux ont triplé en quinze ans. En France, le nouveau record est tout récent : au 1er juillet 2024, le nombre de détenus incarcérés dans les prisons françaises a atteint 78 509. À cette date, le nombre de places opérationnelles dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone était de 61 869, et leur taux d'occupation était de 127 %.11
Il faut prendre la mesure de cette situation. Le développement de l'extrême droite dans le monde n'est pas seulement une rupture mais sur bien des points, hélas, une continuité et une accélération dans un monde de plus en plus capitaliste et aussi, de plus en plus carcéral. La gestion sociale-libérale des années précédentes dans bien des pays, tant dans sa relation avec l'immigration que son rapport au capitalisme, a pavé la voie à une extrême droite qui assume elle aussi son amour du profit, des millionnaires et de l'incarcération de masse. Elle est à l'aise avec la nouvelle configuration qui suppose des assouplissements pour le Capital, plus de dérégulation pour le marché du travail, et de l'autre, un appareil pénal fort et une surveillance généralisée de la population perçue comme une menace. Si on a raison de s'inquiéter de l'incarcération et de la déportation de masse des étrangers aux Etats-Unis,12 on ne doit pas oublier que ceux et celles de chez nous ne sont pas toujours mieux traités. Par ailleurs, dans de nombreux pays, en Allemagne comme en France par exemple, l'heure est à la surenchère du côté de l'extrême droite. Au niveau des institutions, on continue de dire que l'immigration et les immigrés, ou descendants d'immigrés, sont au mieux un problème, au pire une menace. Cette suspicion laisse croire que la frontière nationale a du sens et peut potentiellement nous protéger. Comme-ci le crime, le viol, la fraude, l'émeute, viendraient forcément de l'autre côté de la frontière et seraient corrélés à une culture et au flux des entrées. Il n'y a rien de plus faux et rien de plus raciste.
Après la propagande, les calomnies, la mise à mort avec les mots, viennent les descentes de police. A boire les mensonges de Trump on oublie que ce qu'il dit et met en place a des conséquences ultra-violentes pour les gens. Le show est terminé. La déportation des brésiliens aux Etats-Unis témoigne de la violence de l'acte. Les déportés ont été soumis à la brutalité policière et c'est traité en tant que criminel qu'ils ont été conduits dans l'avion. Après des années à criminaliser les étrangers dans le discours, on ne voit que des numéros, ou un mal nécessaire dans ce qu'il se passe aujourd'hui. Pourtant la déshumanisation et le traitement dégradant n'ont aucun sens. Ce ne sont ni des numéros ni des criminels : ce sont des êtres humains et la décision de la déportation est irresponsable de tout point de vue.
En France, en 2023, selon plusieurs associations plus de 45 000 personnes ont été enfermées dans des centres de rétentions. Le nombre de personnes incarcérées est forcément beaucoup plus important car le chiffre des personnes passées par les locaux de rétention administrative n'est pas communiqué par l'administration. Toujours illégitime, car contraire aux Droits Humains qui assurent la liberté de circulation et d'installation, l'enfermement et les expulsions sont souvent illégales. Ce qu'on observe dans les dernières années c'est que l'incarcération devient une fin en soi. Au lieu d'être expulsés beaucoup seront libérés puis incarcérés de nouveau.
C'est une mesure punitive et dissuasive. Il s'agit de leur faire la vie dure pour leur faire payer le prix de leur venue ici. Parce que l'Etat refuse de régulariser, l'incarcération devient une menace de tous les jours. L'Etat préfère punir, humilier, soumettre, que de tout simplement régulariser et laisser les personnes vivre en toute légalité et donc avec beaucoup plus de sécurité. Par ailleurs, lorsqu'il y a expulsion, dans de nombreux cas, elle a lieu alors que le juge administratif n'a pas encore rendu sa décision, la demande d'asile est encore en cours, ou la Cour européenne des droits de l'homme a déjà suspendu l'expulsion. L'Etat passe outre la vie des personnes sans papiers mais aussi outre la justice. C'est notamment ce qui est pointé dans le rapport 2023, centres et locaux de rétentions administratives, auquel La Cimade a participé :
“Plus d'une personne sur deux a été libérée par un juge en 2023 ; ce chiffre illustre l'ampleur du non-respect par l'administration des garanties procédurales, des placements injustifiés et des mesures d'éloignement illégales, qui se mesurent au nombre de personnes libérées par les juges dans l'hexagone. Près de 93 % d'entre elles l'ont été par les juges judiciaires sanctionnant des vices de procédures, des défauts de diligence ou des manquements à la prise en compte de la vulnérabilité des personnes. En outre-mer, le régime dérogatoire applicable, qui prévoit l'absence de recours suspensif de l'éloignement et qui permet des procédures expéditives, cause de multiples et graves atteintes aux droits des personnes. Près de 30 000 personnes ont été enfermées cette année dans les CRA ultramarins, soit une augmentation de près de 9 % par rapport à l'année précédente.”
Alors que la France a déjà renvoyé des étrangers malgré la menace de mort qui pèse sur eux ou les risques pour leur sécurité, avec des expulsions vers l'Afghanistan, le Soudan, et plus récemment une expulsion de kurdes vers la Turquie, on imagine que ça ne va poser aucun problème à Trump qui veut “nettoyer” d'abord et réfléchir après. Il va plus loin, c'est sûr, mais en suivant une logique déjà installée et déjà à l'œuvre, sous une autre dimension, dans la majorité des pays riches.
Dans cette histoire, le racisme se joint aux affaires. La prison fait tout à la fois, elle gère la misère, évite l'émeute et punit ceux et celles qui réclament des droits et des papiers. Dans le même temps, l'enfermement massif est la promesse pour les entreprises spécialisées dans l'enfermement des sans-papiers d'accroitre davantage leur marge. L'enfermement est source de profit. Si c'est une tragédie pour des milliers de personnes sans papiers qui travaillent aux Etats-Unis, c'est une aubaine pour les groupes privés comme GEO qui font de la rétention d'immigré leur fond de commerce. En 2016 déjà, boosté par Trump et ses promesses de plus d'enfermement, le cours boursier des entreprises du secteur a bondi. Plus récemment, encore une fois, l'entreprise GEO cotée à New York a vu son cours bondir de 42% après les résultats de l'élection américaine. “CoreCivic et l'entreprise de prisons privées GEO Group, qui soutiennent depuis longtemps Trump, ont vu le cours de leurs actions grimper immédiatement après la victoire de Trump aux élections de novembre” écrivait ABC News.13
Selon ce journal, “l'entreprise de prisons privées CoreCivic a indiqué dans une déclaration de lobbying qu'elle avait fait don de 500 000 dollars au comité d'investiture Trump-Vance en décembre, soulignant la relation étroite entre le président Donald Trump et le secteur des prisons privées.” Tout récemment, le président américain Donald Trump a ordonné la construction d'un centre de détention de migrants à Guantanamo, qui, selon lui, pourrait accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Comme le révélait la BBC, Guantanamo dispose déjà d'une petite installation séparée, utilisée depuis des décennies pour détenir des migrants. “Connu sous le nom de Guantanamo Migrant Operations Center (GMOC), il a été utilisé par plusieurs administrations, tant républicaines que démocrates.”14
Le contrôle et le business fonctionnent ensemble. Ce n'est pas pour rien que l'association américaine pour les libertés civiles (ACLU) indiquait en 2011 que la recherche du profit à travers la prison était une des principales causes de l'inflation carcérale.
Passer à l'insurrection : écosocialisme ou barbarie ?
Les histoires semblent éloignées mais c'est le même monde : répression, prison, contrôle social, exploitation, aliénation, ubérisation de l'exploitation et numérisation des fakes news. C'est le même monde qui cogne, c'est pourquoi on doit se reconnaître dans nos parcours de vie ; victime du culte du profit, de l'incarcération, des expulsions. Ces éléments fonctionnent ensemble. La politique carcérale accompagne la privatisation du monde et l'expansion de la sphère marchande sur nos vies et la planète. En 1915, Rosa Luxemburg écrivit en prison une brochure tirant les premières leçons de l'effondrement de la social-démocratie. Le titre, “Socialisme ou Barbarie”, résonne encore aujourd'hui : “Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l'impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l'assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l'abime, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu'elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s'il cesse de jouer le rôle d'un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.” Si la force numérique du prolétariat est beaucoup plus grande aujourd'hui, la conscience de classe en revanche semble beaucoup plus faible alors que la guerre continue et qu'elle appelle encore à un sursaut collectif de notre part pour y mettre fin. La guerre est là, contre les peuples, contre la biodiversité, contre les travailleurs. Les moyens de s'auto-détruire sont beaucoup plus puissants qu'à l'époque ou Rosa Luxemburg écrivit cette brochure.
Si les incarcérations actuelles utilisent des technologies modernes, elles n'en sont pas moins inquiétantes, tout au contraire. La barbarie s'est modernisée. Les innovations sont mises au service de la déshumanisation des personnes, du mensonge, de leur contrôle et de leur enfermement. Pour ne pas revivre le cauchemar du fascisme, il faut reprendre les dynamiques révolutionnaires ouvertes hier, restées inabouties, irrégulières, puis dérobées dans le passé sous le poids de la guerre et du fascisme. Eclairons nos vies et nos doutes avec les pensées révolutionnaires égrenées au fil de l'histoire qui sont devenues actions, mouvement, et qui comme des éclairs ont brisé pour quelques instant la continuité mortifère. Plaçons-nous sur le temps long ; il ne s'agit pas seulement de survivre dans le présent mais de porter le combat au nom des générations vaincues et pour les générations futures. Se soulever ou périr : l'écosocialisme ou la barbarie.
Le soulèvement depuis cette réalité, des étrangers qu'on enferme et qu'on maltraite. Se soulever face à l'exploitation capitaliste, face aux guerres financées par de nombreux pays impérialistes à commencer par les Etats-Unis. Se soulever est une nécessité si on veut conserver une planète habitable, ici et maintenant et pour demain. La victoire d'un impérialisme néofasciste aux Etats-Unis est une nouvelle catastrophique car s'il y a un pays qui doit contrebalancer les désastres mondiaux qu'il a produit, c'est bien les Etats-Unis, tant ils sont grands. Le pays a une responsabilité historique dans le réchauffement climatique. Le projet 2025 de Trump c'est d'accélérer l'écocide. Sauf s'il parvient à être bloqué, les conséquences risquent d'être funestes pour des millions de personnes. On sait que l'exposition à la pollution de l'air extérieur est à l'origine de près de 10 millions de décès par an dû à des maladies cardiaques ou respiratoires. Continuer dans cette voie, combustion, pollution, accumulation, c'est tout bonnement criminel. Arrêter de brûler les énergies fossiles serait une mesure urgente non seulement pour réduire le réchauffement climatique, mais aussi pour améliorer la qualité de l'air, ici et maintenant, pour épargner des millions de vies soumises à la maladie et à la mort. Arrêter la combustion démesurée aurait des effets bénéfiques quasi immédiats sur la qualité de l'air : “Rien qu'aux Etats-Unis, la réduction des émissions mondiales au cours des cinquante prochaines années pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de maintenir les émissions en dessous de 2°C pourrait éviter environ 4.5 millions de décès prématurés, 1.4 million d'hospitalisation et de passage aux urgences, et 1.7 million de cas de démence. Si seuls les Etats-Unis réduisaient leurs émissions conformément à l'accord de Paris, 60 à 65% de ces avantages se concrétiseraient tout de même.”15
Au regard de la situation sociale et écologique mondiale, on ne peut que confirmer la pertinence de la voie révolutionnaire. Il est temps de sortir de la tiédeur et du renoncement. Le choix qui s'offre à nous est assez restreint : ou bien l'on change radicalement de mode de production et de consommation, et plus largement de société, soit on accélère dans un monde dystopique et invivable. Le choix le plus conséquent serait donc de ne plus accompagner le Capital qui nous mène à la chute ; de ne plus se soumettre à ses règles du jeu, mais de défendre un projet de rupture face à l'ordre du monde en mettant la priorité sur la redistribution avant toute fuite en avant productiviste (autrement dit, avant toute recherche de croissance). Seule une insurrection internationaliste est à même de mettre un coup d'arrêt à la destruction du monde, ce qui suppose l'expropriation de nombreuses entreprises et plus largement, de la bourgeoisie. On a les noms, on a les adresses. Vingt multinationales sont responsables d'un tiers des émissions de CO2 et elles s'en lavent les mains en mettant la responsabilité sur le compte de “la demande”. Ce qui n'est ni précis ni sérieux. Les quatre premières au classement sont Saudi Aramco, Chevron, Gazprom, et ExxonMobil. Sans expropriation, sans mise en commun, sans socialisation des entreprises bancaires et énergétiques notamment, il sera impossible de mettre en place une bifurcation écosocialiste. Il faut remettre en cause le sacro-saint droit de propriété privé et installer de la démocratie partout. La socialisation, c'est-à-dire, la mise sous contrôle des salariés et de la population des secteurs stratégiques pour l'économie et la planète peut permettre de passer d'une logique à une autre ; celle d'une production illimité sans autre finalité que le profit, toujours recommencé, à l'autre logique, anticapitaliste, qui refuse cet emballement productiviste de l'accumulation pour l'accumulation et lui substitue une planification démocratique écosocialiste basée sur les besoins de la population, démocratiquement établis.
Bien que ce ne soit pas une mince affaire, c'est la seule voie sérieuse si on veut garantir les besoins de base à chaque être humain, maintenir une planète habitable et créer une harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. C'est seulement en expropriant la bourgeoisie du levier de commande qu'il peut être possible de respirer en appliquant un programme d'urgence écologique et social qui peut inclure les 8 R de la décroissance : redistribuer, réduire, réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, réutiliser, recycler.
Le capitalisme fossile a ouvert de nombreuses boucles de rétroactions négatives c'est pourquoi il faut rompre avec lui. L'une d'elle fait réfléchir. Des chercheurs nous ont appris récemment comment l'augmentation de la température peut avoir un effet sur la violence dans la société. “Pendant des décennies, des chercheurs en psychologie ont démontré à travers des expériences de laboratoire que lorsqu'on monte la température de la pièce où ils se trouvent, les gens sont plus irritables et peuvent être poussés à des comportements plus agressifs. Cette réponse physiologique est également évidente dans la vraie vie : des études réalisées dans divers pays du monde ont mis en évidence l'influence de la chaleur sur l'agressivité au volant, la violence dans les sports professionnels, et l'incidence accrue des crimes violents - des violences domestiques aux meurtres, en passant par les voies de fait graves. Il est également avéré que des températures plus élevées et des variations extrêmes de précipitations accroissent la probabilité de conflits de groupes, qu'il s'agisse de violence de gangs, d'émeute populaire ou de guerre civile. De fait, au Mexique, la hausse des températures attise la violence des gangs ; en Afrique, la sécheresse et les fortes chaleurs enveniment les conflits civils ; et les épisodes El Niño provoquent une recrudescence des conflits civils dans le monde.”16
Malgré tout, malgré ça, tout continue : l'extraction des énergies fossiles tout comme la production débridé pour le profit. On n'a pas attendu Trump pour la fuite en avant. TotalEnergies annonçait le 24 février 2022 une "découverte significative d'huile légère et de gaz associé" dans sa concession sur le bassin offshore d'Orange, au large de la Namibie. Cette annonce fait suite à celle de Shell en janvier 2022 qui annonçait également une découverte importante sur le même champ pétrolier.17
Selon l'agence Reuters, il y aurait un potentiel d'un milliard de barils sur le forage répondant au nom de Venus-1X. “Cette découverte au large de la Namibie et les premiers résultats très prometteurs prouvent le potentiel du bassin d'Orange, sur lequel TotalEnergies occupe une position importante à la fois en Namibie et en Afrique du Sud", a déclaré Kevin McLachlan, directeur de l'exploration de TotalEnergies. On a là un exemple concret : sans ingérence publique, sans expropriation de l'entreprise par les travailleurs, Total continuera de collaborer au carnage planétaire et de tirer profit de la mise à mort de la planète et de millions d'êtres humains.
Conclusion
Avant les élections aux Etats-Unis, Daniel Tanuro, agronome et militant écosocialiste rappelait très justement la chose suivante : “Les patrons de la grande industrie allemande ont opté pour Hitler dans les années trente, pour que Hitler les débarrasse des syndicats. De même, aujourd'hui aux États-Unis, des patrons de la grande industrie fossile et des industries connexes sont prêts à mettre au pouvoir un néofasciste pour qu'il les débarrasse de toute limitation à leurs profits.”18
Avec l'alliance entre milliardaires et milieux néofascistes, le ciel s'assombrit. Le peu d'espace libre que nous ayons, un peu de démocratie, un peu de contre-pouvoir, un peu de redistribution et de sécurité sociale, on veut nous le reprendre. Il faut une stratégie et de la force pour ne pas capituler. Garder le cap. il reste une fenêtre de tir : il faut tenir la compassion, tenir la pensée critique. Ne pas se transformer en objet et ne pas disparaître avec l'Histoire. Repousser la crise de la sensibilité, laisser son cœur battre avec les autres, penser et sentir avec les autres : celles et ceux qu'on colonise, ceux et celles qu'on bombardent, ceux et celles qu'on exploite ou qui subissent les tornades, les cyclones, les incendies, car il est aujourd'hui certain que la multiplication de ces désastres est de source anthropiques, et plus précisément, le fruit de décennies dans le capitalisme fossile. Alors que la chosification du monde amène à une lecture fixiste de celui-ci, il faut défendre la pensée critique au même titre que la sensibilité pour rester connecter au genre humain et éclairer les logiques d'ensemble, en essayant de relier ce que la classe dominante s'acharne à ne pas connecter. Conserver la sensibilité, conserver la dialectique pour ne pas se faire totalement avaler par le règne de la Marchandise. Soutenir les autres, et pas seulement symboliquement, ceux et celles qui subissent l'oppression capitaliste et ces conséquences écologiques. Se penser ensemble et se soutenir mutuellement au-delà des frontières. Ne pas baisser les armes de la critique, ne pas renoncer, ne pas se laisser divertir et dépolitiser par l'industrie du spectacle et du divertissement des millionnaires. Il faut tenir, aimer toujours.
Être du côté de la science, de la réflexion et de la recherche scientifique. Nonobstant, pour la défense de la vie, de la dignité, de l'amour, ne pas avoir peur de rêver. Sortir du tableau Excel, aller contre tous les pronostics et se battre pour l'impossible. C'est seulement en se battant pour l'impossible que d'autres mondes nécessaires et possibles peuvent éclore. Comme disait Che Guevara, il faut être réaliste et exiger l'impossible. L'heure n'est pas au compromis, mais à l'organisation intime, collective, communautaire, pour prendre le ciel d'assaut. Pas d'autre voie que l'amour et la confiance ; la lutte toujours. Elle est à la fois un choix et une obligation. On est condamné à se croire et à s'aimer si on veut une salvation collective car il n'existe aucune échappatoire individuelle. Il faut faire le pari de la révolution. Faire ce pari dans nos vies. Parier sur l'amour, sur la confiance. Il faut qu'on croie en nous et en notre force collective plus fortement encore que les capitalistes croient en leur argent et à sa reproduction par leur seul talent ou par la force du saint esprit. Croire, aimer, se soulever, c'est une même vague à faire déborder dans les rues et dans les cœurs.
Maxime Motard, membre de la Cimade et militant écosocialiste
Notes
1. Frédéric Joignot, « NOUS VIVONS UNE CRISE DE SENSIBILITÉ MAJEURE. NOTRE RELATION AU VIVANT EST APPAUVRIE ET DESSÉCHÉE ». UN ESSAI ÉCLAIRANT DU PHILOSOPHE BAPTISTE MORIZOT, 1 février 2020. https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2020/02/01/nous-vivons-une-crise-de-sensibilite-majeure-notr e-relation-au-vivant-est-appauvrie-et-dessechee-un-nouvel-opus-du-philosophe-baptiste-morizot/
2. L'essor du crédit aux Etats-Unis vise justement à atténuer la contraction de la demande. On ne peut pas comprendre l'essor du crédit aux Etats-Unis sans comprendre au préalable le déséquilibre dans la répartition de la valeur entre le Capital et le Travail qui s'est accentué avec l'institutionnalisation du néolibéralisme sous Reagan. On ne peut pas comprendre non plus l'endettement des ménages aux Etats-Unis sans évoquer le coût de l'éducation, du logement et de la santé, entre autres. Ce déséquilibre dans le partage de la valeur est un élément important dans la crise du capitalisme de 2008. Elle est liée à la financiarisation de l'économie, la “titrisation” des créances, mais aussi, comme on l'a dit, à un problème de répartition de la valeur, un temps résorbé par le crédit. En plus de la difficulté pour des millions de personnes c'est une contradiction du système qui peut se traduire par une crise systémique comme celle de 2008 dont les effets peuvent se faire sentir encore longtemps après. C'est le cas pour la Grande Bretagne par exemple. Nick Ridpath, “Why isn't Britain getting richer anymore ?”, 29 octobre 2024. https://ifs.org.uk/articles/why-isnt-britain-getting-richer-anymore-0
3. Ce taux de rémunération fait de la France le leader mondial des dividendes pour les entreprises cotées en Bourse sur la période 2005-2015, devant l'Australie (67 %), le Royaume-Uni (60 %) et le Japon (57 %). Et très loin du Canada (52 %) ou des États-Unis (48 %). C'est deux fois plus que dans les années 2000, où « ce taux ne dépassait pas les 30 % » pour les entreprises du CAC 40. Sur ce sujet, voir le rapport de l'oxfam : https://www.oxfamfrance.org/app/uploads/2018/05/file_attachments_vfrapport_oxfam_cac40_des_profits_ sans_partage.pdf
4. Baptiste Burckel, “Bourse de Paris. Les groupes du CAC 40 ont versé un montant record à leurs actionnaires en 2024”, 14 janvier 2025. https://www.liberation.fr/economie/les-groupes-du-cac-40-ont-verse-un-montant-record-a-leurs-actionnair es-en-2024-20250114_JUVBQ2JIK5GD5EA2E3EO7QEH44/
5. Jonathan Durand Folco, Jonathan Martineau, “Vers une théorie globale du capitalisme algorithmique”, n°31, hiver 2024. https://www.cahiersdusocialisme.org/vers-une-theorie-globale-du-capitalisme-algorithmique/
6. Au Canada, ce réseau entretient des liens avec des institutions comme le Canada Strong and Free (anciennement Manning Center, proche aujourd'hui de Poilievre), le Fraser Institute et l'Institut économique de Montréal (IEDM). Pour la France, on renvoie à la vidéo d'Usul et Lumi pour Blast : INSTITUTS BIDONS, INFLUENCEURS FORMATÉS : DERRIÈRE L'EXTRÊME DROITE, LE RÉSEAU ATLAS. https://www.youtube.com/watch?v=C48PbGgqyDo&t=21s
7. Voir le rapport d'Amnesty International sur le Salvador. https://www.amnesty.fr/pays/salvador
8. Mathieu Sauvajot, “Les maras, maîtres de l'Amérique centrale ?”, 18 novembre 2019, revue Conflits (géopolitique) https://www.revueconflits.com/maras-amerique-centrale-el-salvador-trafic-de-drogue-homicides/
9. “Alors que les employés sont invités à faire preuve de leur force, les services sociaux attendent des demandeurs d'emploi qu'ils démontrent leurs faiblesses, qu'ils prouvent encore et encore qu'une maladie est suffisamment débilitante, qu'une dépression est suffisamment noire et que les chances d'être engagé sont suffisamment minces. Faute de quoi, l'aide est suspendue. Formulaires, entretiens, chèques, appels, évaluations, consultations et encore des formulaires - chaque demande d'aide a son protocole avilissant et dispendieux. “Cela piétine la vie privée et l'estime de soi à un point inconcevable pour quiconque se trouve hors du système des aides” explique une assistante sociale britannique. “Cela crée un brouillard toxique de soupçon”” Rutger Bregman, Utopies réalistes, Seuil, p. 98. Deborah Padfield, “Through the Eyes of a Benefits Adviser : A plea for a Basic Income”, opendemocracy.net, 5 octobre 2011. Sur le même sujet, on renvoie au film très émouvant de Ken Loach : “I, Daniel Blake” (2016).
10. Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Raison d'agir, p. 123.
11. Valentine Fourreau, “Les prisons françaises sont sur
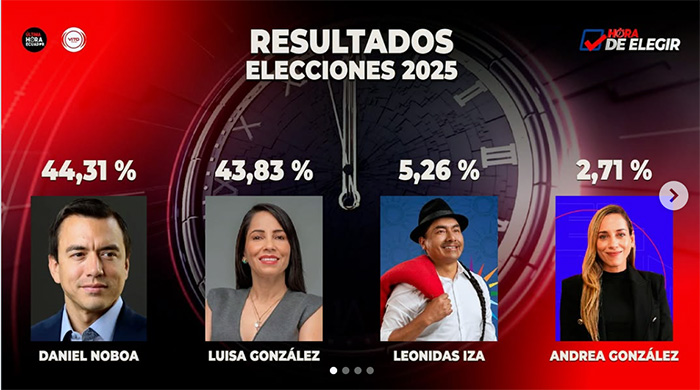
L’Équateur organise le scrutin présidentiel le...
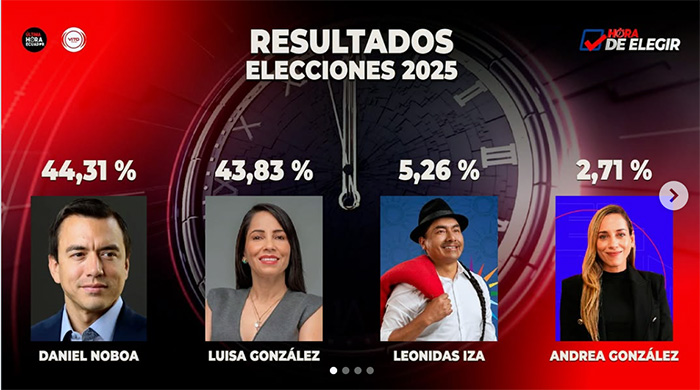
Le 9 février, près de 11 des 13 millions d'Équatoriens (83%) se sont rendus aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles et pour élire les 151 membres de l'Assemblée nationale monocamérale. Les derniers décomptes du Conseil National Electoral (CNE) font état d'une égalité technique entre le président sortant de droite Daniel Noboa, d'Acción Democrática Nacional (ADN) avec 44,16%, et la candidate progressiste de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, qui a obtenu 43,95%. Une victoire du parti progressiste Correista sera-t-elle possible lors du second tour du 13 avril ?
12 février 2025
Aucun candidat n'a obtenu la majorité requise par le code de la démocratie électorale équatorienne : la moitié plus un des votes valides, ou au moins 40 % et un avantage d'au moins 10 points de pourcentage sur le second candidat. Par conséquent, le 13 avril, Daniel Noboa et Luisa González mesureront leur soutien et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si les Équatoriens choisissent la continuité néolibérale ou le changement progressiste.
Quant aux élections à l'Assemblée nationale, bien que les résultats ne soient pas encore connus, l'Assemblée nationale servira de contrepoids car aucun parti, ni ADN ni RC, n'a obtenu les 76 sièges nécessaires à la majorité. Les résultats ont surpris. La presse, les sondages et même le sondage de sortie des urnes publié une heure après la fermeture des bureaux de vote avaient prédit une victoire du président sortant au premier tour. La suspension de toutes les célébrations prévues par Daniel Noboa le soir de l'élection reflétait sa déception face à ces résultats défavorables.
Bien que pratiquement inconnu, Noboa a remporté le second tour contre Luisa González en octobre 2023, après une campagne ciblée dans laquelle il a incarné la lutte contre la criminalité et la corruption. Noboa a été élu pour terminer le mandat présidentiel avorté de Guillermo Lasso, qui avait décrété ce qu'on a appelé une « croix de la mort » pour éviter une condamnation pour corruption. La droite équatorienne s'est ralliée à l'outsider Daniel Noboa, héritier de l'empire bananier, pour empêcher la victoire du Corréisme.
La popularité de Noboa, qui a atteint 82 % après avoir décrété l'état de guerre interne, s'est effondrée en 15 mois, malgré d'énormes dépenses dans les médias sociaux. Son principal défaut est l'équilibre mitigé de la lutte contre la violence et la corruption. Malgré la déclaration de l'état de guerre interne, soutenue par un référendum en avril 2024, et un populisme pénal proche de celui du président salvadorien Nayib Bukele. En effet, les 750 morts violentes de janvier 2025 ont dépassé les chiffres des dernières années. De plus, la torture et l'assassinat par les militaires de quatre jeunes hommes de Guayaquil le 8 décembre 2024 ont révélé les dérives de la guerre interne.
À cela s'ajoute une grave récession économique avec une baisse du PIB de 1,5 % et une contraction économique de 0,4 %, selon le Fonds monétaire international (FMI). Les mesures économiques adoptées par Noboa, telles que l'augmentation de la TVA et d'autres mesures, ont entraîné une contraction de la consommation. Sous Noboa, le taux d'emploi dit adéquat a chuté, le chômage et le travail informel ont augmenté, tandis que le taux de pauvreté a atteint 28%, le plus élevé depuis juin 2021, en pleine pandémie de Covid-19. Des coupures d'électricité récurrentes pouvant durer jusqu'à 14 heures, produit de la négligence des investissements sous les gouvernements néolibéraux depuis Lenin Moreno, ont produit une crise énergétique impopulaire.
Troisièmement, notons le style arrogant de Daniel Noboa et ses nombreuses erreurs. La dernière d'entre elles a été d'essayer d'imiter son idole Trump en imposant des droits de douane de 27% au Mexique. Une mesure ridiculisée aussi bien en Équateur qu'à l'étranger. Cela nous rappelle qu'il a violé le droit d'asile international lorsqu'il a ordonné l'invasion de l'ambassade mexicaine pour capturer l'ex-vice-président Jorge Glas, ce qui lui a valu une condamnation internationale. Noboa incarne le retour de la ploutocratie arrogante qui gouverne sans médiation politique, comme au 19ème siècle.
Les résultats du second tour de la présidentielle du 13 avril sont ouverts. Pour l'instant, Noboa et González doivent commencer par obtenir le soutien public des 14 autres candidats à la présidence. Pour sa part, Noboa a pu compter sur les 2,6 % obtenus par le candidat populiste de droite Andrea González, candidat de Construye, après l'assassinat de Fernando Villavicencio en 2023. Aucun des 12 autres candidats à la présidence n'a obtenu plus de 1 % des voix, reflétant la crise des partis traditionnels en Équateur.
Pour Luisa González, c'est Leónidas Iza, du parti indigène Pachakutik, lié à la Confédération nationale des nations indigènes de l'Équateur (CONAIE), qui détient les clés du palais Carondelet. Il a obtenu 5,3 % aux élections présidentielles et 9 sièges à l'Assemblée nationale. Leónidas Iza condamne ouvertement le modèle néolibéral de Daniel Noboa car il menace les peuples et les territoires de l'Equateur. Dans le contexte actuel, le soutien conditionnel de Pachakutik au Corréisme est possible, ce qui s'est produit sous le gouvernement de Rafael Correa.
Le 9 février, c'était le meilleur résultat du corréisme à un premier tour d'élections depuis 2017. Ce jour-là, Luisa González a déclaré : « Noboa représente la peur, nous représentons l'espoir ». Face à une crise sécuritaire, économique, énergétique et politique persistante, la plateforme progressiste anti-néolibérale du RC, « Relançons l'Équateur », pourrait ouvrir un nouveau cycle progressiste. Dans le contexte d'un retour impérialiste des États-Unis, ce serait une première réaction des peuples d'Amérique du Sud à une mise à jour de la Doctrine Monroe dans la région.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump recule d’un pas mais la menace perdure

Un jour avant l'entrée en vigueur de l'imposition de droits de douane de 25 % sur les exportations du Mexique et du Canada vers les États-Unis, et alors que les marchés financiers anticipaient une chute brutale du peso et des bourses, un appel de dernière minute a eu lieu entre la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le président des États-Unis, Donald Trump, au cours duquel ils se sont mis d'accord pour suspendre leur application pour une durée d'un mois.
Tiré de Inprecor
11 février 2025
Par Movimiento Socialista del Poder Popular - IVe Internationale
Cette « pause » reposait sur trois prémisses : le Mexique enverrait 10 000 éléments de la Garde nationale à sa frontière nord pour contenir le flux de drogues, d'armes et de travailleurs migrants ; les États-Unis prendraient des mesures pour empêcher le trafic d'armes vers les groupes criminels ; et un groupe de travail serait créé pour vérifier le respect des accords.
Cet engagement a été étendu au Canada, mais pas à la Chine, qui reste sous la menace d'un droit de douane de 10 % sur ses exportations vers les États-Unis à partir du lundi 10 février. La Chine a répliqué en adoptant une mesure similaire et en poursuivant les États-Unis, pour violation des accords commerciaux, devant l'Organisation mondiale du commerce. Pendant ce temps, la fanfaronnade interventionniste et expansionniste de Donald Tump s'est intensifiée contre des pays européens, l'Amérique latine et les Caraïbes et maintenant, de façon encore plus scandaleuse, en menaçant d'envahir la bande de Gaza et d'expulser le peuple palestinien de son propre territoire.
Jusqu'à présent, aucune des autres grandes puissances impérialistes n'a osé contester la folie de Donald Trump, elles ont timidement annoncé leur volonté de négocier, de diversifier leurs relations commerciales et de se distancier de la menace qui pèse sur la Palestine. Ce n'est pas anodin, nous vivons un fragile équilibre de forces qui peut se rompre à tout moment avec des conséquences imprévisibles.
Dans ce contexte, il convient de saluer la fermeté des présidents colombien Gustavo Petro et mexicaine Claudia Sheinbaum, qui ont tenu tête à Trump, bien qu'avec des nuances différentes. Claudia Sheinbaum a dénoncé avec fermeté et dignité l'hypocrisie de Donald Trump sur la question de la drogue, de la vente d'armes aux groupes criminels et de l'application de tarifs douaniers, mais elle a dû céder du terrain sur la question migratoire. Les migrations sont un produit du pillage des pays du Sud par les pays impérialistes, y compris les États-Unis, et aussi un produit de divers types de violence. Pour notre part, nous continuons à exiger qu'aucun être humain ne soit illégal et que la Garde nationale ne devienne pas l'agence d'immigration des États-Unis.
Le recul de Donald Trump sur l'application des droits de douane n'est pas seulement dû à l'habileté diplomatique de Claudia Sheinbaum, il y a d'autres raisons : les graves conséquences inflationnistes et financières ; l'émergence d'un processus d'auto-organisation des peuples du Canada et du Mexique qui ont lancé une intense campagne sur les réseaux sociaux pour boycotter les produits fabriqués aux États-Unis ; et la mobilisation de dizaines de milliers de travailleurs migrants dans différentes villes américaines.
Il est clair que Donald Trump, comme nous l'avions annoncé dans notre précédente déclaration, insistera pour profiter de cette période d'attente pour imposer une renégociation avantageuse de l'Accord de libre-échange entre les trois pays nord-américains. Claudia Sheinbaum doit non seulement défendre fermement les trois points essentiels de son « Plan Mexique » – augmentation du contenu national et régional des produits fabriqués au Mexique, substitution des importations, reprise du programme Made in Mexico – mais aussi exiger un plus grand transfert de technologie, une participation du gouvernement mexicain au capital social des entreprises qui investissent dans notre pays, une rémunération pour l'utilisation des infrastructures des nouveaux pôles de développement et des salaires décents pour leurs travailleurs.
Ces objectifs ne pourront être atteints sans un changement dans les rapports de forces au niveau mondial. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de créer un front de pays progressistes en Amérique latine et dans les Caraïbes qui, avec une proposition alternative de développement régional et de sa relation avec les États-Unis, fera face au provocateur. Et que dans le même temps, nous impulsions des mobilisations populaires massives, sous l'égide d'une large coalition de forces antifascistes et anti-impérialistes.
Le temps presse.
L'offensive du fascisme et de l'ultra-droite ne sera vaincue que par une mobilisation populaire internationale !
Mexico, 6 février 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Deux ans après le 8 janvier : les enquêtes révèlent les crimes de Bolsonaro et le complot du coup d’État

Le coup d'État du 8 janvier 2023 a marqué l'un des moments les plus critiques de l'histoire démocratique récente du Brésil. Des milliers de personnes ont envahi et détruit les sièges du Congrès national, du Tribunal suprême fédéral (STF) et du Palais du Planalto (respectivement, les sièges des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif), motivées par leur rejet de la victoire du président Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aux élections de 2022. Depuis lors, les enquêtes et les poursuites judiciaires se poursuivent pour élucider le complot qui a précédé la tentative de coup d'État.
08 janvier 2025
Au 26 décembre 2024, le Tribunal suprême fédéral (STF) avait condamné 310 personnes pour leur participation aux attentats. Parmi les infractions reprochées aux putschistes figurent l'association de malfaiteurs, l'abolition violente de l'État de droit démocratique et les dommages à la propriété publique. La plupart des personnes condamnées ont été arrêtées sur les lieux des attentats ou dans des camps, qui ont duré des semaines, devant les casernes et avec le consentement des forces armées, comme l'a révélé l'enquête rapportée par le ministre de la plus haute juridiction du pays (le Suprême Tribunal Fédéral), Alexandre de Moraes.
Toujours en septembre 2023, Aécio Lúcio Costa Pereira est la première personne reconnue coupable du complot du coup d'État et est condamné à 17 ans de prison. Les preuves comprenaient des vidéos réalisées par lui-même et montrant sa participation active aux actes de déprédation. D'autres condamnations ont suivi la même rigueur, renforçant le message que les attaques contre la démocratie ne seront pas tolérées par certaines institutions du pays, y compris la Cour suprême.
En même temps, le bureau du procureur général (PGR) a signé des accords de non-poursuite avec 71 accusés. Ces accords prévoient des mesures alternatives, telles que des travaux d'intérêt général et des cours sur la démocratie, pour les personnes considérées comme moins impliquées dans les événements. Au cours de l'année, certains critiques des peines légères ont mis en garde contre le risque d'impunité, tandis que les défenseurs ont mis l'accent sur la possibilité d'une éducation politique.
Connexions politiques et financières
Les financeurs des actes sont également surveillés de près. Des hommes d'affaires ont été dénoncés pour avoir financé les déplacements et l'hébergement des manifestants. Dans la sphère politique, d'anciens alliés de l'ex-président Jair Bolsonaro (PL), qui serait le principal bénéficiaire des actes de coup d'État, sont accusés d'avoir fomenté les manifestations.
Les enquêtes indiquent que des discours et des messages incendiaires sur les réseaux sociaux ont servi de catalyseurs. Bolsonaro est poursuivi devant la Cour suprême, notamment pour incitation au coup d'État, et reste inéligible à toute fonction élective dans le pays.
Deux militaires devant le tribunal
Le fait marquant des enquêtes sur les crimes commis le 8 janvier 2023 a été l'arrestation de deux des principaux noms liés au coup d'État : l'aide de camp de l'ancien président Jair Bolsonaro, le lieutenant-colonel Mauro Cid, et le général Walter Braga Netto. Ces arrestations ont permis d'accomplir des progrès significatifs dans l'élucidation des événements et dans l'établissement des responsabilités de leurs organisateurs.
Mauro Cid a été arrêté en mars 2024 pour avoir coordonné le financement et la logistique du coup d'État. Le lieutenant-colonel a été identifié comme un intermédiaire entre les financiers privés et les organisateurs des manifestations.
Le témoignage de Cid a permis des avancées cruciales. Il a mis en évidence un réseau comprenant des hommes politiques de différents États, des militaires d'active et de réserve, ainsi que des hommes d'affaires. Il a également remis des messages et des documents montrant que des actions avaient été organisées à l'avance pour empêcher l'investiture de Lula.
L'arrestation de Braga Netto, le 14 décembre 2024, a marqué un tournant dans l'enquête. Ancien ministre de la Défense et l'un des plus proches amis de Bolsonaro, ce militaire est accusé d'avoir apporté un soutien stratégique au coup d'État. Selon les enquêtes, il a participé à des réunions au cours desquelles ont été discutés des plans visant à mettre en péril la transition démocratique.
La fuite à travers le continent
La situation des fugitifs est un autre élément important. Les putschistes impliqués dans les actes antidémocratiques ont cherché refuge dans d'autres pays, en particulier en Argentine, où au moins 61 Brésiliens condamnés pour les actes du 8 janvier ont été identifiés. En novembre 2024, les tribunaux argentins ont émis des mandats d'arrêt à l'encontre de ces personnes.
Outre l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay ont signalé la présence de Brésiliens liés au coup d'État. En décembre 2024, le Pérou a signalé l'entrée de quatre suspects, qui ont peut-être fui l'Argentine après l'émission des mandats d'arrêt.
La procédure d'extradition peut être longue, surtout si l'accusé demande l'asile politique. Invoquant des persécutions politiques, certains putschistes affirment qu'ils ne peuvent pas retourner au Brésil. Toutefois, les experts soulignent que les preuves accablantes rendent difficile le soutien de tels arguments.
Parmi les personnes faisant l'objet d'une enquête figurent des chefs religieux qui ont utilisé des sermons pour inciter à participer aux actes. Le CPI (Commission Parlementaire d'Enquête) des actes de coup d'État, créé en 2023, a révélé des vidéos de pasteurs encourageant les fidèles à piller les biens publics sous une justification divine.
Un autre aspect significatif est le rôle des réseaux sociaux. Des entreprises telles que Twitter, Facebook et Telegram ont été sommées de fournir des éclaircissements sur la diffusion de contenus frauduleux. Bien que certaines aient collaboré, les critiques soutiennent que les mesures ont été prises trop tard.
Les développements juridiques comprennent également l'enquête sur le personnel militaire impliqué. Des images montrent des membres des forces armées autorisant des manifestants à accéder à des zones d'accès restreint. Le ministère de la défense collabore avec la Cour suprême pour identifier les responsables.
La grâce de Noël 2024 accordée par Lula a constitué une étape importante de ce processus. Il a explicitement exclu les personnes condamnées pour les actes du coup d'État, envoyant ainsi le message que ces crimes ne seraient pas tolérés. Cette mesure a été largement saluée.
Recouvrement
Les dommages matériels causés par ces actes sont estimés à des centaines de millions de reais. Des œuvres d'art, des meubles historiques et des documents ont été détruits. Le gouvernement brésilien a investi dans la restauration, tandis que des poursuites civiles ont été engagées pour demander des comptes aux responsables des dommages financiers.
Deux ans après le 8 janvier, le Brésil doit encore faire face aux conséquences de ces actes et le processus de responsabilisation est complexe, mais fondamental pour garantir que des événements similaires ne se répètent pas.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le PT, le PSol et le MST demandent la fin du projet de loi d’amnistie après que Hugo Motta ait nié avoir tenté un coup d’État le 8 janvier

Une semaine après avoir pris la présidence de la Chambre des députés, le député fédéral Hugo Motta (Républicains-PB) a minimisé les attentats du 8 janvier 2023. Dans une interview accordée à la station de radio Arapuan FM à João Pessoa (PB) vendredi dernier (7), M. Motta a déclaré qu'il y avait eu une « agression inimaginable » contre les institutions, mais il a nié l'intention du coup d'État derrière les actes de terrorisme.
08 février 2025
« Un coup d'État doit avoir un leader, il doit être encouragé par quelqu'un, soutenu par d'autres institutions intéressées, telles que les forces armées, et il n'y a rien eu de tel », a déclaré le dirigeant centriste. « Il s'agissait de vandales, d'émeutiers qui voulaient manifester leur colère contre le résultat des élections », a-t-il ajouté.
M. Motta a été élu successeur d'Arthur Lira* avec 464 voix, ayant pour alliés des parlementaires allant de la gauche à l'extrême droite. La déclaration du député a toutefois suscité une réaction négative parmi les politiciens du camp progressiste, en particulier le PT et le PSol, et parmi les mouvements populaires, tels que le Mouvement des travailleurs sans terre (MST).
Gilmar Mauro, dirigeant national du MST, a qualifié cette déclaration d'« absurde » et a déclaré que la classe ouvrière s'engageait à lutter contre de telles initiatives : « Pour notre part, nous lutterons en permanence contre ce type de tentative de coup d'État de la part de l'extrême droite », a-t-il déclaré à Brasil de Fato.
M. Mauro a également indiqué que, s'ils avaient une vision stratégique, le député et certains secteurs des classes dirigeantes seraient du côté de la démocratie. « S'il a, avec des secteurs des classes dirigeantes brésiliennes, la vocation de créer des vautours qui demain mangeront ses yeux et les leurs, nous n'avons aucun doute que les secteurs derrière le coup d'État au Brésil sont des secteurs de milices extrêmement rétrogrades et qu'ils exigeront un prix immense d'un point de vue économique et politique à l'avenir ».
Réaction des parlementaires
Selon la députée Fernanda Melchionna (Psol-RS), les remarques de Motta sont « extrêmement graves » car elles ignorent l'enquête de la police fédérale sur le complot du coup d'État pour maintenir Bolsonaro au pouvoir et cachent son intérêt pour l'amnistie des responsables.
« C'est une nouvelle démonstration grave et inquiétante de ce mariage de raison entre l'extrême droite et le parti centriste, qui cherche, dans ce cas, à minimiser le 8 janvier. Mais nous savons que ce qui est dans le collimateur de l'extrême droite, c'est d'essayer de faire passer le projet de loi d'amnistie et une modification de la Ficha Limpa (casier vierge) pour garantir l'éligibilité pour moins de huit ans, en unissant les corrompus et les putschistes », a-t-il déclaré au Brasil de Fato
Sans citer directement la déclaration de M. Motta, le député fédéral et président national du Parti des travailleurs (PT), Gleisi Hoffmann, s'est exprimé sur les médias sociaux.
« Il est tout simplement déraisonnable de voter sur cette question dans l'hémicycle. Il ne s'agit pas d'atteindre les objectifs politiques de tel ou tel parti, mais de défendre la démocratie, de respecter et de se conformer à la décision du tribunal sur les attaques contre les Trois Pouvoirs. Pas d'amnistie », a déclaré M. Hoffmann vendredi (7).
Le député fédéral Lindbergh Farias (PT-RJ) a souligné que « le 8 janvier était une tentative de coup d'Etat ». Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, le député a déclaré que la destruction du siège des trois branches du gouvernement n'était pas un événement isolé et qu'elle était liée au projet de coup d'État et aux réunions de Jair Bolsonaro avec des dirigeants militaires.
« Il y avait un plan pour assassiner Alexandre de Moraes, Lula et Alckmin. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État. Le 8 janvier était leur dernière tentative », a-t-il déclaré. « Les commandants de l'armée de terre et de l'armée de l'air n'étaient pas d'accord, mais la marine l'était », a ajouté M. Farias.
La sénatrice Eliziane Gama (PSD-MA), rapporteur du CPMI du 8 janvier, a également critiqué la position de M. Motta.
« Je peux l'affirmer catégoriquement : après cinq mois d'enquête, après avoir reçu des centaines de documents et entendu des dizaines de témoins, il y a eu une tentative de coup d'État et le responsable de ces attaques a un nom et un prénom. Il s'agit de Jair Messias Bolsonaro », a-t-il déclaré.
Bolsonaro révère la position d'Hugo Motta
La déclaration de M. Motta, qui nie le contenu du coup d'État des actes du 8 janvier, contredit la position qu'il avait adoptée peu après son arrivée à la tête de la Chambre, lorsqu'il avait déclaré que le projet de loi d'amnistie serait traité « de la manière la plus impartiale possible », car c'est le projet de loi qui « divise le plus » la Chambre.
Après cette déclaration, Jair Bolsonaro (PL) s'est dit fier de la décision du maire de discuter du projet de loi. L'ancien chef de l'exécutif a déclaré dans un communiqué que M. Motta avait pris la barre à un « bon moment » et l'avait traité de « salope ».
« Cet agenda humanitaire nous réjouit. J'ai discuté avec des parlementaires d'autres partis et ils partagent tous le même sentiment. Je suis également fier du jeune Hugo Motta, une salope de la peste, qui a pris la présidence de notre Chambre des députés au bon moment », a déclaré M. Bolsonaro.
Le député fédéral Ivan Valente (Psol-SP) s'est moqué de la déclaration de l'ancien président en qualifiant l'amnistie d'« agenda humanitaire ». « Qui voulez-vous tromper en jouant les victimes ? Pendant la pandémie, son 'action humanitaire' a consisté à refuser les vaccinations et à conduire des milliers de personnes à la mort. Ensuite, il a volé des bijoux et tenté un coup d'État. Il va aller en prison ! » a déclaré Valente.
*NDLR : Arthur Lira a été le président de la Chambre des députés qui a probablement le plus "marchandé" les votes de la chambre : il a créé un système de "budget secret" par lequel il "convainquait" (avec des enveloppes non-identifiées), des députés de voter dans le sens souhaité par le plus offrant (par exemple, Bolsonaro qui a créé un trou d'au moins 38 milliards de reals dans les services sociaux afin de payer des amendements municipaux).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La lutte des indigènes du Para est un exemple tout le Brésil

Une lutte indigène exemplaire se déroule actuellement (31 janvier 2025) à Belém dans l'état du Pará, au nord du Brésil. L'occupation du siège du Secrétariat à l'éducation du Pará (SEDUC) par les indigènes appartenant à plus de 14 groupes ethniques dure depuis deux semaines. Les indigènes se battent pour défendre l'éducation scolaire indigène – menacée par la loi 10.820/2024 – et contre les plans néolibéraux du Secrétaire à l'éducation Rossieli Soares et du Gouverneur de l'état du Para Helder Barbalho.
1 février 2025| tiré d'Europe solidaires sans frontières | Photo : L'occupation du secrétariat à l'éducation du Pará s'oppose au gouvernement en défense de l'éducation indigène
Au moment où Trump se pose en leader d'une extrême droite mondiale consolidée et plus agressive, avec des mesures d'impact dès les premiers jours de son mandat comme les déportations massives, l'amnistie pour les putschistes du Capitole et les attaques contre le canal de Panama, la lutte indigène au Pará montre à la gauche brésilienne la voie de la radicalité, de l'indépendance et de l'organisation populaire. Le rôle de la gauche est d'appuyer e d'impulser la lutte du mouvement indigène, et d'en faire une inspiration pour les luttes qui nous attendent contre l'extrême droite.
Une lutte qui va de l'avant et fait avancer
Adoptée fin 2024, lors d'un vote à huis clos et sous haute surveillance de la police militaire, la loi 10.820/24 abroge tout le cadre réglementaire de l'éducation scolaire indigène et met fin à l'enseignement présentiel dans les communautés indigènes. Les changements apportés au système d'éducation modulaire (SOME), qui inclut celui des communautés traditionnelles (SOMEI), a provoqué une réponse radicale et exemplaire du mouvement indigène.
L'occupation du bâtiment du SEDUC-PA par le mouvement indigène a créé une dynamique de large unité d'action, en particulier avec les travailleurs de l'éducation publique du SINTEPP (le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation publique du Pará). Les dirigeants de Quilombola, les mouvements populaires et les parlementaires de gauche se sont également joints à l'action, parmi lesquels il convient de souligner le travail de Vivi Reis (PSOL), récemment élue conseillère municipale de Belém, qui a fait la preuve de son unité et de sa solidarité active.
L'occupation du bâtiment du SEDUC-PA par le mouvement indigène a créé une dynamique de large unité d'action, en particulier avec les travailleurs de l'éducation publique du SINTEPP (le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation publique du Pará). Les dirigeants de Quilombolas, des leaders des mouvements populaires et des parlementaires de gauche se sont également joints à l'action. Mentionnons en particulier l'intervention de Vivi Reis (PSOL), récemment élue conseillère municipale de Belém, qui a fait la preuve d'unité et de sa solidarité active.
Hier, après deux semaines de lutte et en comptant sur leurs propres forces, 40 dirigeants de l'occupation se sont, pour la première fois, réunis avec Helder Barbalho et Rossieli Soares. Outre l'abrogation de la loi 10.820/24, le mouvement exige la révocation de Rossieli Soares. Les antécédents de Rossieli sont bien connus des travailleurs de l'éducation : il a été Secrétaire à l'éducation de Doria [au gouvernement de São Paulo] et ministre de l'Éducation lors du gouvernement de Michel Temer, c'est-à-dire qu'il a un long passé de persécution politique et de recettes néolibérales.
Préparer la COP-30 à Belem en novembre
« La COP 30 a déjà commencé », affichait l'une des banderoles du mouvement indigène sur la BR163 à Itaituba (commune amazonienne entre Manaus et Belém, PA). La COP-30 se tiendra à Belém en novembre 2025, la première année du nouveau mandat de Trump. Elle sera donc un théâtre important de luttes et d'affrontements avec ce gouvernement d'extrême droite dont le programme environnemental est celui d'une destruction socio-environnementale complète. Cela est démontré sans équivoque par la première mesure de Trump visant à sortir les États-Unis de l'Accord de Paris – déjà limité – ainsi que par l'ordre de procéder à une exploration pétrolière sans précédent. L'ordre de Trump est de « forer, forer et forer ».
Dans ce contexte, les yeux du monde, inquiets des projets destructeurs de l'extrême droite, seront braqués sur la COP-30 à Belém. L'occupation indigène doit donc être interprétée comme une répétition générale de la COP-30, dont la gauche et les mouvements sociaux doivent tirer des leçons importantes : un engagement déterminé dans la mobilisation, l'unité d'action dans la défense des droits et l'indépendance comme la clé pour affronter et vaincre les gouvernements néolibéraux et d'extrême-droite.
La COP-30 de Belém verra s'opposer des projets contrastés et pourrait réunir – dans les circonstances actuelles – un contre-sommet composé d'activistes, de mouvements sociaux et d'organisations politiques du monde entier autour d'une lutte commune contre l'extrême-droite. Il y a une opportunité d'avancer dans cette direction et, dès à présent, l'occupation indigène de Belém est un événement préparatoire d'une centralité absolue vers lequel nous devons tourner nos forces.
Le rôle de la gauche
Outre la lutte des indigènes et celle des travailleurs de l'éducation à Belém, d'autres luttes sont en cours dans tout le Brésil, comme celle des travailleurs de l'IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistique). La lutte de ces travailleurs, organisée par leur syndicat ASSIBGE-SN, a fait échouer la proposition de création d'un IBGE+, qui aurait fonctionné dans la pratique comme une entité privée. Le gouvernement fédéral a renoncé à sa proposition privatiste après une lutte et une mobilisation considérable des travailleurs de l'institut qui, malgré les tentatives de les délégitimer, sont allés jusqu'au bout et ont obtenu gain de cause.
Ces exemples de luttes renforcent l'orientation d'une localisation politique indépendante, qui s'appuie sur la mobilisation des travailleurs dans leurs luttes particulières et générales. C'est ce que nous avons fait à Belém, où Vivi Reis s'est engagée dans le soutient à l'occupation indigène, tout comme d'autres dirigeants du PSOL et des syndicats. Le triomphe de la lutte indigène à Belém, en soutient de laquelle nous n'économiserons pas nos efforts concrets, est une avancée fondamentale parce qu'elle constitue un exemple de la manière de combattre l'extrême droite par la mobilisation, dans l'unité d'action et l'indépendance.
Israel Dutra
P.-S.
• Revista Movimento. 1 fev 2025, 15:10 :
https://movimentorevista.com.br/2025/02/la-lutte-des-indigenes-du-para-est-un-exemple-tout-le-bresil/
• Israel Dutra est sociologue, secrétaire aux mouvements sociaux du PSOL, membre de la direction nationale du parti et du Mouvement de la gauche socialiste (MES/PSOL).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ouvre une enquête sur les atrocités commises dans l’est de la RD Congo

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé aujourd'hui par consensus d'ouvrir une mission urgente d'établissement des faits et une commission d'enquête sur les atrocités commises par toutes les parties au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil est parvenu à cette décision lors d'une session spéciale sur la crise, organisée à la demande de la RD Congo avec le soutien de 48 pays du monde entier.
Tiré du site de Human rights watch.
Au cours des combats récents dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de la ville de Goma, précédemment contrôlée par l'armée congolaise et ses milices alliées. Les groupes de défense des droits humains, l'ONU et les médias ont fait état d'exécutions sommaires, de viols, y compris de viols collectifs, de pillages, de travail forcé illégal et de conscriptions forcées illégales. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé son inquiétude la semaine dernière du fait que « cette dernière escalade risque d'aggraver encore le risque de violences sexuelles liées au conflit », qui constituent « une caractéristique effroyable des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis des décennies ».
La commission d'enquête, demandée par 79 groupes de défense des droits congolais, régionaux et internationaux, enquêtera sur et documentera les violations du droit international humanitaire et des droits humains commises par les parties belligérantes, recueillera et conservera les preuves des crimes internationaux et identifiera les personnes responsables d'avoir commis des atrocités afin de soutenir les efforts visant à leur faire rendre comptes de leurs actes.
La création d'une commission d'enquête montre la reconnaissance croissante de la communauté internationale de la nécessité de lutter contre l'impunité concernant les violations commises dans le passé dans l'est de la RD Congo ; cette impunité alimente la commission d'exactions depuis des décennies. Le nouveau mécanisme sera un outil important dans les efforts visant à faire rendre des comptes aux auteurs de crimes graves, à mettre fin au cycle des abus et de l'impunité, et à soutenir le droit des victimes et des survivants à la vérité, à la justice et aux réparations.
Jusqu'à maintenant, il a été difficile de documenter les abus commis dans les zones contrôlées par le M23, car le groupe armé a l'habitude de cibler les activistes et de restreindre les libertés d'expression, de mouvement et d'association. Le principal organe de l'ONU chargé des droits humains envoie un message clair : les abus graves seront documentés et dénoncés.
Les gouvernements préoccupés devraient ajouter à cette étape importante vers la justice d'autres mesures immédiates visant à protéger les civils, y compris les nombreuses personnes déplacées, et fournir une assistance d'urgence aux personnes touchées, y compris aux survivantes de violences sexuelles. Ils devraient faire pression sur les forces rwandaises et le M23 pour qu'ils garantissent l'accès et facilitent l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Goma, et exhorter toutes les parties à mettre fin aux abus commis contre les civils.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projets pétroliers en Ouganda : graves atteintes aux droits humains et menaces croissantes

En Ouganda, les projets pétroliers Tilenga, Kingfisher et Eacop ont engendré de nouvelles atteintes aux droits humains. Parmi celles-ci, des violations des droits des travailleur·ses et une dégradation de l'environnement. Les atteintes déjà documentées, telles que l'impact sur les droits à la terre pour les communautés, se sont également poursuivies.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le déploiement croissant de forces de sécurité autour des sites pétroliers, en particulier à Kingfisher, a donné lieu aux violations les plus graves, telles que des expulsions forcées, de l'extorsion et des violences sexuelles et basées sur le genre. Les souffrances et le climat de peur causés par ces violations ont été aggravées par les actions de la Cnooc sur le site et par le manque de contrôle de TotalEnergies, l'investisseur principal dans les projets.
Les femmes sont confrontées à l'exclusion économique et à une plus grande vulnérabilité aux violences sexuelles et basées sur le genre. Des cas d'exploitation sexuelle ont impliqué des membres des forces de sécurité et du personnel des compagnies.
Paris, Kampala, 12 décembre 2024. Un nouveau rapport révèle que l'accélération de la construction des projets pétroliers Eacop, Tilenga et Kingfisher en Ouganda a donné lieu à de nouvelles violations des droits humains, tout en aggravant celles existantes. Ces projets sont principalement détenus et exploités par TotalEnergies et la China National Offshore Oil Company (Cnooc), en coopération avec les gouvernements de l'Ouganda et de la Tanzanie.
S'inscrivant à la suite des efforts de documentation de 2020 et 2022, le rapport Pétrole, droits humains et communautés affectées en Ouganda : les projets avancent, les violations des droits humains aussi (Heated) a été rédigé par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Avocats sans frontières (ASF) et Civic Response on Environment and Development (Cred). Il a été rendu possible grâce au soutien d'Oxfam.
« Nous sommes profondément préoccupé·es par les dernières évolutions dans l'Albertine. Après avoir déplacé des milliers de personnes, l'exploitation pétrolière est en train de transformer de manière significative les réalités des communautés locales. Les travaux de construction, la forte inflation, la pression foncière, le déploiement des forces de sécurité et l'afflux de travailleur·ses ont un impact considérable et cumulé sur les droits humains. Les entreprises, le gouvernement, mais aussi les institutions financières, les assureurs et les actionnaires qui soutiennent les projets devraient tous évaluer leur implication et prendre des mesures urgentes pour s'assurer qu'ils et elles n'alimentent pas des violations des droits humains », a déclaré Sacha Feierabend, chercheur senior de la FIDH sur les entreprises et les droits humains.
Les communautés locales et les défenseur·es confronté·es à la peur et à la répression
Les atteintes les plus graves sont commises autour des sites pétroliers de Kingfisher, où l'armée ougandaise, la police et les compagnies privées de sécurité engagées par les entreprises pétrolières, ont été déployées pour « protéger les sites », selon les autorités. Plusieurs cas d'exploitation sexuelle ont été documentés à Kingfisher, où le personnel militaire a imposé aux femmes des rapports sexuels pour qu'elles puissent vendre leur poisson, le personnel de l'entreprise faisant de même à l'aide de promesses d'emploi.
L'armée aurait mené des arrestations répétées, commis des extorsions et des maltraitances flagrantes contre les communautés pour imposer les restrictions sur la pêche. Ces événements ont paralysé la principale source de revenus de la région et instillé la peur parmi les résident·es. Des témoignages font état d'expulsions forcées sous la menace d'armes par les forces de sécurité. Lors de la pandémie de Covid-19, 769 personnes ont été expulsées en même temps, et nombre d'entre elles n'ont jamais pu retourner dans leur village.
Cnooc, en tant qu'opérateur de Kingfisher, a une responsabilité particulière dans le rétrécissement de l'espace civique et ne prend aucune mesure adéquate pour remédier aux graves violations commises à sa porte. TotalEnergies, en tant que principal investisseur dans tous les projets, y compris Kingfisher, n'a pas respecté son devoir de vigilance en matière de droits humains.
Le rapport révèle également un environnement où les violences sexuelles et basées sur le genre se multiplient. Près de Kingfisher et Tilenga, la prostitution des femmes est décrite comme un phénomène à la hausse. Des mineures sont impliquées, ce qui constitue une forme d'exploitation sexuelle. Le rapport souligne aussi que les femmes subissent les conséquences les plus négatives des transformations économiques locales.
« Les nouvelles opportunités de travail liées au pétrole ont été principalement réservées aux jeunes hommes, alors que les restrictions imposées à la pêche ont eu raison d'une activité traditionnellement masculine. Les femmes et les jeunes filles subissent une forte pression pour subvenir aux besoins de leur famille tout en étant largement exclues des bénéfices du développement pétrolier », a déclaré Bashir Twesigye, Directeur exécutif de Cred.
Dans un contexte de rétrécissement général de l'espace civique, le droit de manifester et la liberté d'association sont de plus en plus restreints, les défenseur·es et les organisations faisant l'objet de surveillance, de campagnes de diffamation en ligne et de harcèlement administratif. Entre mai et début décembre 2024, au moins 96 militant·es opposé·es aux projets pétroliers ont été arrêté·es par les autorités ougandaises.
« Ce rapport révèle comment les risques signalés les années précédentes se transforment en véritables violations, en particulier à l'encontre des défenseur·es des droits. TotalEnergies se démarque des grandes compagnies pétrolières en engageant la société civile, en améliorant ses politiques en matière de droits humains et en répondant aux pressions exercées sur les défenseur·es. Néanmoins, des actions supplémentaires sont nécessaires sur tous les fronts. En tant que chef de file du projet, TotalEnergies devrait renforcer ses politiques, et surtout veiller à ce que ces politiques soient mieux appliquées par ses partenaires et sous-traitant·es. Quelles sont les lignes rouges que l'entreprise ne franchira pas lorsqu'il s'agit des risques encourus par les défenseur·es ? », a déclaré Andrew Bogrand, conseiller politique senior d'Oxfam.
Nouveaux abus et une aggravation des anciennes tendances
Le rapport explique en détail comment TotalEnergies et CNOOC n'ont pas pris de mesures efficaces pour prévenir et remédier aux nouvelles atteintes liées à la dernière phase de construction. De nombreuses violations des droits du travail ont été signalées parmi les sous-traitant·es des entreprises. Les membres de la communauté qui ont réussi à se faire embaucher - presque toujours pour des courtes périodes et sans contrat - ont été confrontés à des retards de plusieurs mois dans le paiement des salaires et à des normes de sécurité inadéquates. Ces dernières ont entraîné des blessures et des incidents mortels. Les entreprises et les régulateurs semblaient conscients de ces violations récurrentes.
De nouveaux impacts environnementaux sont survenus avec la progression des travaux de construction, en particulier pour les communautés habitant à proximité des sites pétroliers. L'augmentation de l'activité dans le parc national des chutes de Murchison aurait entraîné des incursions fréquentes et parfois mortelles d'animaux sauvages, créant un stress et des dommages supplémentaires pour les villageois·es. Par ailleurs, TotalEnergies a laissé sans réponse des centaines de demandes d'indemnisation, malgré les graves dégâts causés par les inondations liées à la construction de l'usine centrale de traitement à Tilenga.
Les mesures insuffisantes prises par les entreprises et les autorités ont également laissé de vieux problèmes en suspens. Le rapport montre que les problèmes précédemment documentés liés aux programmes de relocalisation à Tilenga, y compris les cas de compensations inadéquates, le manque d'information et les longs retards dans les compensations, se sont poursuivis le long de l'Eacop. Le gouvernement ougandais a également commencé à exproprier les ménages restants dans le cadre de procédures judiciaires expéditives.
« L'article 26 de la constitution ougandaise fournit un cadre juridique progressiste qui protège le droit à la propriété privée et limite le pouvoir de l'État d'acquérir et de prendre possession d'une propriété pour un usage public avant de verser une compensation au propriétaire. Le gouvernement a récemment tenté de modifier cette position, et des affaires judiciaires récentes ont permis aux autorités d'accéder à des propriétés contestées dès que l'indemnisation est déposée au tribunal. Cela a un impact direct sur le principe du consentement libre, préalable et éclairé ainsi que sur l'accès à la justice pour les communautés affectées », a déclaré Michael Musiime, Coordinateur pour la gouvernance des ressources naturelles pour Avocats sans frontières.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La colère des jeunes continue dans la crise oubliée de l’Afrique en Eswatini

L'Eswatini est la dernière monarchie absolue d'Afrique, dirigée par le roi Mswati III, où plus de 70 % de la population vit dans une pauvreté abjecte. La résistance des masses s'est accrue et a atteint son apogée en juin 2021. La monarchie a réagi en assassinant plus de 100 manifestants non armés et en mutilant et en blessant plus de 300 autres.
Tiré d'Afrique en lutte.
Depuis lors, l'État a mené une série d'opérations pour « rétablir la paix et l'ordre ». Parmi ces efforts pour faire taire la dissidence, on peut citer l'arrestation de deux députés qui, dans un jugement rendu par le juge Mumcy (un proche du roi), ont été condamnés respectivement à 25 et 18 ans de prison. Dans une autre mesure répressive, le gouvernement a rejeté un recours contre la loi de 2008 sur la répression du terrorisme, qui contient un certain nombre de clauses antidémocratiques et permet de cibler les partis politiques. Cette loi a également interdit le Mouvement démocratique populaire uni (PUDEMO) et le Congrès de la jeunesse du Swaziland (SWAYOCO) et porté atteinte à la liberté d'association.
Plus récemment, le président du PUDEMO a été empoisonné et a survécu de justesse après avoir été admis aux soins intensifs.
De nombreux autres membres de divers partis politiques, en particulier des jeunes, sont en exil, quittant le pays par crainte pour leur vie, mais sont toujours traqués à l'étranger. D'autres croupissent en prison, en attente de leur procès, certains depuis 2021 – soit trois ans. Dans l'un des incidents les plus choquants, Bheka Magagula, un ancien agent des services correctionnels qui a fait défection du régime, a été retrouvé mort dans un fossé en République d'Afrique du Sud le 11 octobre 2024. Le gouvernement de l'Eswatini était connu pour rechercher Magagula depuis près de deux ans et avait même offert une récompense de 200 000 euros pour sa capture.
Tout cela se passe alors que le pays est confronté à une grave crise économique et sanitaire, avec des hôpitaux sans médicaments, sans moyens de transport, sans nourriture, sans matériel de travail et avec une grave pénurie de personnel. Le secteur de l'éducation souffre également et les écoles se plaignent du manque de matériel, de personnel et de nourriture.
Cette situation est particulièrement préjudiciable aux jeunes, qui réagissent en continuant d'organiser des manifestations et en menant des actions de plaidoyer. Les jeunes tentent également d'accroître la pression sur les partenaires internationaux et les gouvernements afin qu'ils imposent des sanctions contre le gouvernement de Mswati.
Ils continueront à se battre. La question est de savoir si quelqu'un à l'extérieur du pays les écoute.
Mlamuli Gumedze est un jeune militant et ancien président de l'Union nationale des étudiants du Swaziland.
Source : https://democracyinafrica.org
Traduction automatique de l'anglais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Solidarité syndicale mondiale au travers des chaînes d’approvisionnement

Socialiste chinois, j'ai immigré aux États-Unis il y a un peu plus de deux ans. Avant cela, j'ai travaillé dans l'industrie technologique chinoise pendant de nombreuses années, et j'espère tirer parti de cette expérience dans mon intervention. Aujourd'hui, je parlerai de la solidarité du travail à travers les chaînes d'approvisionnement, en me concentrant principalement sur Foxconn.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/13/solidarite-syndicale-mondiale-au-travers-des-chaines-dapprovisionnement/?jetpack_skip_subscription_popup
L'accent mis sur Foxconn se veut un point de départ pour comprendre les possibilités d'organisation à travers les chaînes d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine. Nous pouvons appliquer bon nombre de ces observations à d'autres entreprises chinoises, et même à d'autres entreprises mondiales.
Tout d'abord, qu'est-ce que Foxconn ?
Foxconn est le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 milliards de dollars. Son siège se trouve à Taïwan, mais l'entreprise possède des usines dans toute la Chine, ainsi qu'au Brésil, en Inde, au Mexique et aux États-Unis. Foxconn est donc un véritable conglomérat mondial. Mais que fabrique Foxconn ? Entreprise de fabrication électronique sous-traitante, Foxconn ne produit rien qui porte sa marque. Cependant, la plupart des produits électroniques que nous connaissons et utilisons portent la marque Foxconn quelque part à l'intérieur. L'entreprise fabrique, par exemple, pour Apple.
Votre iPhone, votre iPad, votre Mac, etc. ont été assemblés dans une usine Foxconn ou comportent des composants fabriqués dans une usine Foxconn. En dehors d'Apple, divers composants de téléphones Androïd sont également produits dans des usines Foxconn. Votre téléphone Android peut être assemblé au Vietnam, en Thaïlande ou ailleurs, mais le module audio ou wi-fi qu'il contient peut être passé par une chaîne de montage Foxconn. PlayStation, Nintendo et toute la gamme de produits électroniques d'Amazon (c'est-à-dire l'Echo Dot et ses assistants IA) est fabriquée par Foxconn. […]
On estime que dans le monde plus de 50% des appareils électroniques contiennent des composants Foxconn, y compris les réfrigérateurs et les machines à laver qui peuvent contenir une puce Foxconn. De même que les puces 5G des téléphones, les solutions biotechnologiques, les serveurs TV, les appareils photo, etc.
Bien que Foxconn soit une entreprise taïwanaise, son principal centre de production se trouve en Chine. Foxconn a été l'une des premières entreprises étrangères à s'installer en Chine après l'ouverture du pays aux investissements étrangers sous l'impulsion de Deng Xiaoping.
C'est l'un des pionniers du modèle de fabrication chinois : les travailleurs sous-payés vivent dans de grands complexes et travaillent dans des bâtiments situés à proximité des dortoirs dans lesquels ils vivent.
Actuellement, Foxconn emploie plus de 800 000 personnes en Chine. Ce nombre fluctue chaque année, en fonction des résultats de l'entreprise et de ses quotas d'embauche et de production. En général, plus de la moitié des salariés des usines Foxconn travaillent aux expéditions (dispatch workers). Ce sont des intérimaires qui ne sont pas directement employés par Foxconn, mais qui sont sous contrat avec des agences de main-d'œuvre, lesquelles sont connues pour bafouer régulièrement le droit du travail. Foxconn sous-traite ses ressources humaines et ses services d'embauche où il faut s'inscrire pour travailler chez Foxconn.
L'avantage pour Foxconn est de disposer d'une main-d'œuvre flexible. La demande mondiale d'appareils électroniques varie d'une saison à l'autre. Par exemple, les ventes de iPhone peuvent augmenter à Noël […] alors qu'à d'autres moments, ces ventes peuvent diminuer. Foxconn doit donc faire preuve de souplesse pour répondre à cette demande changeante, ce qui explique que plus de la moitié de ses travailleurs soient des intérimaires. Toutefois, le droit du travail chinois stipule qu'au maximum 10% des effectifs d'une entreprise peuvent être intérimaires. Mais Foxconn a l'habitude d'en embaucher beaucoup plus que ce que la loi autorise.
Foxconn enfreint le droit du travail depuis des années, voire des décennies, afin de conserver une main-d'œuvre flexible et de se protéger de toute responsabilité en cas de conflit du travail. Ainsi, si Foxconn doit des salaires à des travailleurs expatriés, la société peut rejeter la responsabilité du problème sur l'agence responsable de l'expatriation.
De cette manière, Foxconn parvient à se soustraire à ses responsabilités en matière d'embauche et de fidélisation de la main- d'œuvre en Chine.
Outre la question des travailleurs détachés, Foxconn utilise également en Chine des étudiants d'écoles professionnelles comme main-d'œuvre gratuite. Certaines de ses usines ont des relations contractuelles avec des écoles professionnelles locales qui enseignent la fabrication ou l'ingénierie électronique. Ces écoles envoient leurs étudiants en tant que stagiaires chez Foxconn où ils travaillent sur les chaînes de montage sans rémunération au prétexte qu'on leur fournit une expérience professionnelle. Foxconn place ces étudiants sur la chaîne.
Les travailleuses de Foxconn sont quant à elles victimes d'un harcèlement sexuel endémique, auquel s'ajoutent les brimades, les erreurs salariales en matière d'heures supplémentaires et une formation inadéquate en matière de sécurité, notamment en matière de manipulation de produits chimiques toxiques.
Enfin, les suicides sont monnaie courante dans les usines Foxconn. Bien que les médias aient largement cessé de parler de ces suicides à partir de 2015, ils continuent de se produire chaque année.
Répression patronale et révolte ouvrière
Pendant la période Covid-19 et la politique zéro-covid en Chine, Foxconn a mis en place un système de production en circuit fermé dans son usine de Zhengzhou, située dans le centre de la Chine. Les travailleurs devaient travailler, manger, dormir et vivre à l'intérieur de l'usine, 24 heures par jour. Ils n'étaient pas autorisés à quitter les locaux de l'usine pendant la durée de leur contrat. La direction avait installé des mesures de sécurité et des barrières pour les empêcher de sortir de l'enceinte de l'usine. Il y avait beaucoup d'heures supplémentaires, très peu de repos et peu de procédures de sécurité mises en œuvre pour prévenir la propagation du Covid-19.
Le système en circuit fermé a favorisé la transmission du virus. De nombreux témoignages publiés sur les médias sociaux nous ont appris que Foxconn n'a pas fourni les services adéquats. […] Ces conditions ont conduit à un soulèvement spontané des travailleurs qui ont brisé les barrières et qui se sont tournés vers la direction pour exiger de pouvoir quitter leur emploi. Nombre d'entre eux ont franchis les barrières et sont rentrés chez eux à pied, même s'il leur a fallu un jour ou deux pour y parvenir.
C'est dire à quel point la situation était désespérée. Le gouvernement local a même envoyé des cadres pour aider à occuper les chaînes d'approvisionnement, les membres du parti jouant essentiellement le rôle de briseurs de grève, alors que les travailleurs commençaient à partir en masse, l'entreprise refusant d'abord de céder sur les revendications.
Les travailleurs ont également publié sur les réseaux sociaux des vidéos, devenues virales, de cette agitation croissante. Foxconn a appelé le gouvernement local à l'aide qui a envoyé la police contre les travailleurs qui réclamaient simplement le respect des droits de l'homme, des salaires perdus et de meilleures conditions de travail. Des policiers vêtus de combinaisons de protection blanches ont commencé à frapper les travailleurs. C'est ce que font généralement les entreprises en Chine : c'est le modus operandi de toute action syndicale en Chine.
Le soulèvement de Foxconn à Zhengzhou a fini par faire boule de neige et s'est transformé en un mouvement qui a mis fin à la politique chinoise du « zéro Covid ».
Le soulèvement de Foxconn à Zhengzhou a été suivi d'une tragédie à Urumqi, où tout un complexe d'appartements verrouillé en raison du Covid-19 a pris feu, et les pompiers n'ont pas pu entrer dans le bâtiment, de sorte que les résidents ont été asphyxiés et sont morts dans ce qui était un désastre évitable.
Les politiques « zéro Covid » ont suscité beaucoup de colère. Dans les grandes villes, comme Pékin et Shanghai, les habitants sont restés enfermés dans leur complexe résidentiel pendant des mois, sans pouvoir accéder aux produits de première nécessité. Des per- sonnes âgées sont mortes parce qu'elles ne pouvaient pas quitter leur domicile pour se rendre à l'hôpital. Toutes les lignes téléphoniques d'urgence du gouvernement ont été saturées pendant cette période.
Ce mécontentement et le soulèvement des travailleurs de Foxconn ont conduit au bref mais important mouvement des feuilles blanches, qui a vu des masses de gens descendre dans la rue dans tout le pays. Pour moi, ce mouvement a mis en lumière le pouvoir potentiel mouvement des travailleurs en Chine. Pendant cette période, les travailleurs chinois ont mené la charge et cela montre qu'à l'avenir ils peuvent être mieux organisés et agir. Il y a donc de l'espoir que le changement puisse avoir lieu en Chine.
Construire une solidarité transnationale
J'ai pris Foxconn comme exemple, mais ces tactiques peuvent être utilisées dans différentes entreprises. L'une des façons de construire cette solidarité est de frapper Foxconn là où ça fait mal, c'est-à-dire en ciblant ses partenaires à l'étranger. En effet, Foxconn fabriquant de nombreux produits pour des entreprises basées aux États-Unis, nous pouvons donc cibler de nombreux sites pour faire pression sur Foxconn et amplifier les revendications des travailleurs.
Nous pouvons tirer des leçons du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) de solidarité avec la Palestine. De nombreuses entreprises palestiniennes figurant sur la liste BDS fabriquent également des produits avec Foxconn. Par exemple, Google, Amazon, Siemens et Hewlett-Packard ont toutes des contrats avec Foxconn. Nous pouvons non seulement tirer des leçons de BDS pour soutenir les travailleurs chinois, mais aussi combiner nos mouvements. À l'instar du travail de solidarité avec la Palestine aux États-Unis, les syndicats peuvent jouer un rôle de premier plan dans la solidarité avec les travailleurs de Foxconn.
Le fait de soulever la question de la solidarité avec les travailleurs chinois dans le cadre d'initiatives syndicales émergentes, telles que l'Apple Retail Union, l'Amazon Labor Union et l'Alphabet Workers Union, peut également encourager les travailleurs américains à réfléchir de manière plus large à leurs horizons d'organisation.
Tous ces syndicats peuvent s'unir et affirmer qu'ils ne toléreront pas que leurs employeurs travaillent avec une entreprise qui traite notoirement ses travailleurs de manière aussi mal. Les syndicats des États-Unis peuvent faire pression sur Foxconn, d'autant plus que l'espace de syndicalisation en Chine se réduit rapidement en raison de la répression accrue.
Enfin, le développement de Foxconn dans la production de véhicules électriques peut constituer une autre opportunité, car le syndicat United Auto Workers (UAW) est à la tête d'une campagne visant à syndiquer les usines de véhicules électriques aux États-Unis. Les partenariats mondiaux de Foxconn pourraient déboucher sur d'autres possibilités d'associer les luttes[1].
Foxconn a récemment acheté une usine de véhicules électriques à Lordstown, dans l'Ohio. L'UAW est très actif à Lordstown, et comme nous l'avons vu avec l'organisation du travail et les négociations contractuelles de l'année dernière, l'UAW a la capacité d'exercer une pression énorme sur ces entreprises automobiles. Ce travail est également important pour fournir une alternative concrète au nationalisme antichinois larvé de certains travailleurs américains en soulignant les interconnexions organiques entre les capitalistes américains et chinois d'une part, et les travailleurs américains et chinois d'autre part.
[1] NdT. Stellantis et Foxconn ont annoncé la création en 2026 en Europe d'une « co-entreprise », SiliconAuto, qui produira des semi-conducteurs dédiées à l'industrie automobile.
Zhang Mazi
Zhang Mazi est un militant socialiste chinois. Il vit désormais à New York. Il est membre du Tempest Collective et des Democratic Socialists of America.
Source : New Politics, été 2024.
Publié dans Adresses internationalisme et démocr@tie N°8 :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/01/adresses-nc2b08.pdf
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face au coup d’État Trump-Musk, des résistances dans les tribunaux et les rues

Le président Donald Trump et le milliardaire Elon Musk se sont déchaînés, fermant des agences gouvernementales, licenciant des milliers de travailleurEs et voulant pousser deux millions d'employéEs fédéraux à démissionner.
Hebdo L'Anticapitaliste - 741 (13/02/2025)
Crédit Photo
DR
Daniel Tanuro
Des actions qui menacent le bien-être de millions d'AméricainEs : les enfants, les personnes âgées, les handicapéEs, les fonctionnaires fédéraux et d'autres personnes qui dépendent du gouvernement fédéral. Ces actions constituent une sorte de coup d'État technocratique, en cours au sommet et au sein même du gouvernement, ce que l'on appelle en Amérique latine un « auto-golpe » (un coup d'État contre son propre gouvernement), car les techniciens de Musk, pour la plupart des jeunes hommes qu'il emploie, prennent effectivement le contrôle en réquisitionnant les systèmes informatiques de l'État. L'assaut de Trump a laissé le pays dans un état de choc et de confusion.
Pression judiciaire
Dans le même temps, un mois seulement après le début de son second mandat présidentiel, Trump a galvanisé des résistances à la fois dans les tribunaux et dans la rue. Ces résistances, encore modestes et limitées, commencent cependant à prendre l'allure d'un mouvement populaire de masse.
Les procès intentés devant les tribunaux fédéraux ont au moins temporairement empêché Trump de mettre en œuvre tous ses décrets. Un tribunal fédéral a empêché Trump de geler des milliards de dollars de subventions et de prêts. Un autre a empêché Musk et son Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) d'accéder aux dossiers du département du Trésor. Un autre encore a bloqué la tentative de Trump de forcer des employéEs fédéraux à prendre leur retraite. Un tribunal l'a également empêché de mettre fin au droit de naissance à la citoyenneté. Dans certains cas, Trump et Musk n'ont pas respecté les décisions de justice. Le nombre d'actions en justice ne cesse d'augmenter : les étudiantEs intentent des procès pour empêcher la prise de contrôle du ministère de l'Éducation par le DOGE et les syndicats intentent des procès pour protéger les emplois des fonctionnaires fédéraux.
Pendant ce temps, des dizaines de millions d'AméricainEs, 1 500 par minute, appellent leurs représentants au Congrès, saturant complètement le système téléphonique du Congrès. Ils appellent pour se plaindre que leur emploi public est menacé, que l'association dont ils dépendent n'a pas reçu de paiement, ou bien leur entreprise ou enfin eux-mêmes, ou simplement pour dénoncer ce que Trump et Musk font au pays.
Le mouvement 50501
Dans la rue, des dizaines de milliers de personnes ont protesté contre les décrets de Trump dans les villes du pays. Manifestations organisées par un mouvement émergent appelé 50501, ce qui signifie 50 manifestations dans 50 États en une seule journée. Ces manifestations, dont beaucoup se sont déroulées dans les capitales des États, ont eu lieu dans au moins 40 États, tant républicains que démocrates, et ont varié en taille, d'une poignée à des centaines ou des milliers de personnes. Elles ont abordé une grande variété de questions particulières, mais aussi la grande question de la tentative d'imposer un gouvernement oligarchique autoritaire qui ignore les institutions démocratiques. Dans l'une des manifestations, une femme portait une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « C'est un coup d'État : Affrontez, ne collaborez pas ! »
Parmi les plus importantes manifestations jusqu'à présent, des milliers de personnes ont défilé à Los Angeles pour protester contre l'expulsion d'immigréEs par Trump, bloquant des rues et paralysant brièvement une grande autoroute. À New York, des milliers de personnes, dont un certain nombre d'enfants et d'adolescents non binaires, se sont rassemblées à Union Square pour protester contre l'attaque de Trump contre les soins d'affirmation de genre pour les enfants trans.
« Stop au fascisme »
Certaines de ces manifestations ont été menées par des politiciens du Parti démocrate, comme la sénatrice Elizabeth Warren qui a pris la tête d'un groupe d'éluEs, d'employéEs fédéraux et de citoyenNEs ordinaires qui ont manifesté devant le département du Trésor. Des éluEs et des fonctionnaires démocrates ont également pris la tête d'une autre manifestation à Washington DC, pour protester contre la fermeture de l'USAID, l'agence américaine d'aide et de développement.
Des manifestantEs de tous âges, de tous sexes et de toutes origines ethniques ont porté des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Stop Musk », « Stop Trump », « Arrêtez le projet 2025 » (le programme républicain), « Arrêtez le coup d'État » et « Stop au fascisme ». D'autres portaient des pancartes avec : « Chrétiens, aimez votre prochain ». Dans certaines manifestations, les manifestantEs arboraient le drapeau américain, le drapeau arc-en-ciel LGBTQ, le drapeau mexicain et le drapeau palestinien. Ce mouvement peut-il devenir un mouvement de millions de personnes capable de bloquer la politique de Trump-Musk ?
Dan La Botz,
traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Elon et ses commandos, la haine de l’USAID et les faux raids sur Google

La Lettre tech : chaque semaine, l'actualité de la Silicon Valley vue par les médias américains. Nous nous sommes quittés il y a une semaine, taraudés par le doute et réduits à l'expectative, et nous nous retrouvons dans un pays en chaos, un champ de bataille de l'absurde qui, avant toute explication rationnelle, suscite un mea culpa. Personne n'avait imaginé que l'alliance entre Donald Trump et Elon Musk pourrait déboucher, en quelques jours, sur un putsch administratif inédit dans l'histoire, une destruction aussi sordide et systématique du service public et de l'image internationale des États-Unis.
11 février 2025 | tiré du Courrier interntional
Depuis novembre, les médias glosaient sur l'avenir du tandem improbable, spéculaient sur le choc imminent de deux ego boursouflés et puérils. C'était clair : Elon, bailleur de 280 millions de dollars de fonds de campagne du populiste, buterait vite sur les limites de son influence. Le roi des mâles alpha, en son Bureau ovale, renverrait bientôt le merdeux de la tech à ses fusées et à ses voitures autonomes.
Au bout du compte, une autre réalité s'impose. À Washington, on arrache l'enseigne de l'USAID, l'agence américaine qui fournit 40 % de l'aide humanitaire mondiale. Des centaines de milliers de fonctionnaires dans le collimateur du Doge, le fameux “ministère” de l'Efficacité gouvernementale dirigé par Musk, attendent la suppression de leur poste ou de leur ministère, que, légalement, seul le Congrès devrait pouvoir décider.
Wired peut se targuer d'avoir, le premier, révélé le visage des escouades du Doge. Une bande de mômes âgés de 19 à 24 ans, codeurs émérites recrutés en douce depuis novembre parmi les stagiaires des multiples entreprises d'Elon Musk ou dans la foisonnante fachosphère de la Silicon Valley, qui débarquent en force dans les augustes administrations de la capitale, interrogent des hauts fonctionnaires de carrière sur l'utilité de leur boulot et branchent leurs ordinateurs portables sur les systèmes de paiement ultraprotégés et vitaux du Trésor. The New York Times décrit aussi ces inquisiteurs du moins d'État, en tee-shirts et baskets, couchant sur des lits de camp au milieu des emballages de pizza, entre deux audits du budget de la première puissance mondiale. L'un d'entre eux est connu comme Big Balls, “grosses couilles”, sur les réseaux sociaux ; un autre a dû démissionner quand on a découvert ses tweets de potache dans lesquels il se félicitait d'“avoir été raciste avant que cela devienne cool”. Musk et Trump veulent le réembaucher. Le journal confirme que le commando de 40 ingénieurs, déjà affairé à démanteler le ministère de l'Éducation, est guidé par des adultes, anciens du cabinet de conseil McKinsey ou de la banque d'affaires Morgan Stanley, ou revenants idéologues de la première ère Trump. Un juge fédéral vient de bloquer temporairement l'accès du Doge au Trésor. Trop tard, probablement, pour minimiser les dégâts.
Elon contre l'“organisation criminelle”
Au fait, pourquoi tant de haine ? NBC tente de comprendre l'acharnement d'Elon Musk contre l'USAID, l'agence d'aide au développement américaine présente dans plus de 100 pays, dont le budget de 50 milliards de dollars – un peu plus de 1 % des dépenses publiques des États-Unis – assure, entre autres, par ses fournitures de médicaments, la survie de 20 millions de séropositifs en Afrique et soutient des centaines d'ONG promouvant la démocratie. Trump s'est dit “favorable au concept de l'USAID”, tout en regrettant que cette administration soit remplie de “givrés d'extrême gauche”.
Musk y voit carrément “une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent”, pour avoir probablement lu trop avidement, avant de les reposter à ses 216 millions d'abonnés, les tweets d'un quarteron de trolls d'extrême droite tels Wall Street Apes, Kanekoa The Great, Autism Capital et Chief Nerd, qui s'époumonent depuis des années sur le complot mondialiste. Mais le patron de X tire avant tout son inspiration d'un dénommé Mike Benz, un ancien second couteau des services de com du département d'État durant le premier mandat de Trump, dont le fonds de commerce se résume au cassage quotidien de l'USAID sur les réseaux sociaux. La technique est simple : accuser l'aide internationale de collusion avec la CIA et avec le deep state, l'État dans l'État. Balancer des vidéos présentant, sur un ton haletant, des tableaux bourrés d'acronymes, des flèches colorées et des conclusions apocalyptiques. Agiter bien fort, puis relancer les milliers de commentaires. Elon Musk repostait ces délires en les accompagnant d'un “Wow !” ou d'un “Yes” ébaubi. Maintenant, il les met en pratique, en saccageant l'aide humanitaire.
Flics et trafics sur Google
Les expulsions massives de migrants ne sont pas si massives, en fin de compte. Trump a eu beau mobiliser toutes les polices fédérales aux côtés des agents de l'Immigration and Custom Enforcement (ICE), la police de l'immigration et des douanes, obliger des analystes du contreterrorisme du FBI à lâcher leurs dossiers pour traquer les sans-papiers mexicains dans les abattoirs de volailles, les prises sont maigres, faute de forces adéquates. Alertés par le battage médiatique, les fugitifs se planquent mieux, aussi, et les 5 000 ou 6 000 arrestations depuis le 20 janvier ne suffisent pas au plan média de la Maison-Blanche. D'où une manœuvre de génie décrite par The Guardian} : elle consiste, pour l'ICE, à manipuler les requêtes sur Google en empilant sur le web d'anciens communiqués de presse, vieux parfois d'une dizaine d'années, décrivant des raids spectaculaires, et à truquer leur date de publication pour les faire passer pour des opérations récentes. Le journal a demandé des explications à la police fédérale. Depuis lors, la glorieuse série des rafles d'immigrants s'est brusquement tarie sur le moteur de recherche.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Premiers jours de Trump au pouvoir : les États-Unis se dirigent-ils vers le fascisme ?

La courte victoire de Trump au vote populaire lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 a alimenté les spéculations sur une éventuelle dérive des États-Unis vers l'autoritarisme, voire le fascisme.
Tiré de Inprecor 729 - février 2025
13 février 2025
Par Kay Mann
Des milliers de manifestants ont participé à la Marche du peuple à Washington. Getty images/Christopher Furlong
Bien qu'une discussion approfondie et une définition du fascisme dépassent le cadre de cet article, et que la présidence de Trump ne remonte qu'à une semaine à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'avalanche de décrets présidentiels déjà émis donne une indication de ce qui nous attend.
Comme prévu, la plupart de ces décrets – et ceux à venir – visent les immigré·es, les personnes LGBTQI+, les femmes, les lois existantes en matière de protection de l'environnement, les communautés de couleur et les organisations syndicales et progressistes, tout en envoyant le message aux 1 % qu'ils pourront profiter de baisses d'impôts et d'une réduction des réglementations en matière de sécurité des travailleur·ses et de protection de l'environnement. Certains semblent avoir été conçus en partie pour tester la loyauté de ses alliés et les institutions de l'État, comme la grâce et les réductions de peine accordées à tous les insurgés du 6 Janvier, y compris ceux qui ont été condamnés pour des attaques violentes comme les policiers qui défendaient le Capitole.
Il est clair que Trump est un dirigeant de droite, un dictateur en puissance et qu'il a l'intention d'étendre le pouvoir présidentiel autant que possible. Mais l'orientation clairement autoritaire et d'extrême droite de Trump et de ses collaborateurs ne doit pas occulter les ruptures et les continuités opérées avec l'idéologie et les pratiques capitalistes contemporaines. En effet, la frontière entre les politiques capitalistes conservatrices et le fascisme n'est pas toujours claire. L'hostilité de Trump à l'égard des protections et des directives relatives à l'environnement, aux droits du travail et des consommateurs, tout cela le place complètement dans le giron néolibéral du marché libre. En effet, dans les premières 24 heures de sa présidence, Trump a annulé des dizaines de réglementations, et les inspecteurs généraux, qui sont responsables de l'application des réglementations gouvernementales, ont été remplacés par des partisans de Trump. Tous les agents fédéraux chargés de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) ont été mis en congé, prélude à la suppression de leurs postes et de leurs emplois.
Protectionniste ou libéral ?
Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé et des accords de Paris sur le changement climatique et a donné le feu vert à l'intensification de la prospection pétrolière. Les attaques de Trump contre les immigré·es et ses promesses de les expulser sont une caractéristique de son programme depuis sa première présidence, lorsqu'il a promis de construire un mur tout le long de la frontière américano-mexicaine pour dissuader l'immigration. Rappelons cependant que des traitements inhumains ont été infligés aux réfugié·es par des gouvernements de droite et les sociaux-démocrates en Europe et ailleurs, et que le gouvernement d'Obama a expulsé plus d'immigrant·es que celui de son prédécesseur, le républicain conservateur George W. Bush.
Dans le même temps, le protectionnisme proclamé haut et fort par Trump, et ses menaces d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 25 % sur les produits importés du Mexique et de Chine, le placent en porte-à-faux avec le libre-échange néolibéral. Cette contradiction révèle un un capitalisme agressif et sans concession à l'égard de ses alliés, longtemps considérés par les présidents américains et les deux partis de l'alternance comme des partenaires, mais devenus aujourd'hui des concurrents. Le protectionnisme, le nationalisme économique et le chauvinisme ont toujours été liés, mais la vision de Trump va beaucoup plus loin et vise à remodeler l'ordre capitaliste mondial pour favoriser encore plus les États-Unis. Cela explique également l'apparente contradiction entre le penchant isolationniste de Trump et ses menaces de recours à la force militaire, une nouvelle version de la Realpolitik (1).
Les présidents américains choisissent depuis longtemps des figures du capital financier et industriel comme conseillers et représentants, mais Trump s'est entouré d'une large cour de capitalistes ultra riches comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, et Jeff Bezos, trois des personnes les plus riches du monde. Musk, l'homme le plus riche du monde, qui s'est récemment adressé au parti fasciste allemand AfD, déclarant qu'il était le « meilleur espoir » de l'Allemagne, dispose d'un rôle officiel. En tant que propriétaires de X et de Facebook, Musk et Zuckerberg contrôlent des pans entiers des médias sociaux et de l'information. Leur proximité avec l'homme le plus puissant du monde, aux tendances dictatoriales, a d'énormes conséquences antidémocratiques.
Un fasciste ?
Une grande partie du programme et des premiers pas de Trump dans cette présidence ressemble donc aux gouvernements classiques, qu'ils soient conservateurs ou même libéraux, avec des caractéristiques extrêmes. Peuvent-ils donc être considérés comme fascistes ? Tout d'abord, les régimes autoritaires fascistes et d'extrême droite étendent considérablement la portée du pouvoir exécutif et suppriment les possibilités de contrôle de ce pouvoir, transformant les parlements en chambres d'enregistrement.
De même, ils cherchent à éliminer l'opposition juridique et politique. L'une des premières mesures prises par Trump a été de purger la fonction publique afin de s'assurer que le personnel gouvernemental est engagé en faveur de son programme. Bien qu'il n'y ait aucun signe d'une volonté de Trump d'interdire le Parti démocrate d'opposition, les menaces de poursuivre et d'emprisonner les membres de la commission du 6 Janvier du Congrès, tous démocrates, pourraient constituer un premier pas dans cette direction. L'un des derniers actes officiels de Biden en tant que président a été d'accorder des grâces préventives à des personnes susceptibles d'être persécutées, pour les protéger de la colère de Trump. Cette mesure est sans précédent dans l'histoire politique des États-Unis.
Deuxièmement, les régimes fascistes suspendent ou réduisent fortement les droits civils et politiques, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion. Si les menaces de Trump à l'encontre de la presse et des journalistes critiques allaient au-delà des menaces verbales actuelles, cela placerait également Trump dans le camp autoritaire/fasciste. La querelle entre Trump et l'ancien président de l'état-major interarmées, le général Mark Miley, est née du refus de ce dernier d'utiliser l'armée contre les manifestants pacifiques de Black Lives Matter. Si Trump devait recourir à la violence et à la répression de masse contre les manifestants, il ferait clairement un pas vers l'autoritarisme et le fascisme.
Un colosse aux pieds d'argile
Trump, capitaliste de second plan et star de la télé-réalité devenu 45e président, deux fois poursuivi dans une procédure d'impeachment, inculpé et condamné, et finalement réélu, devenant le caudillo incontesté du parti républicain, peut sembler invincible. Mais comme tous les dictateurs en puissance, Trump se révélera être un colosse aux pieds d'argile. Sa majorité au Congrès est très courte et, bien que la direction du Parti républicain lui ait pour l'essentiel fait allégeance, il reste des résistants indomptés, qui ralentiront son programme. On l'a vu lors du vote de confirmation du choix ultra-réactionnaire de Trump pour le poste de secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Trois républicains ont voté contre lui, ce qui a abouti à une égalité qui n'a été brisée que par la décision de Vance, le président de la Chambre. Si Trump a doté le système judiciaire fédéral, y compris la Cour suprême, de soutiens ultra-conservateurs, la Cour est loin d'être un organe d'approbation généralisée. Un juge fédéral conservateur nommé par Reagan a rejeté le pronunciamiento de Trump mettant fin au droit du sol, le qualifiant de manifestement inconstitutionnel.
Bon nombre des partisans les plus fervents de Trump sont fermement opposés à l'avortement mais Trump, conscient du nombre de républicain·es favorables à l'avortement, essaie de jouer sur les deux tableaux en s'attribuant le mérite d'avoir annulé l'amendement Roe v. Wade (qui permettait l'avortement dans tout le pays, NDLR), mais refuse de s'engager à interdire l'avortement au niveau fédéral, demandant plutôt que le droit à la reproduction soit décidé au niveau de l'État. Mais Trump ne pourra pas éluder la question longtemps et se heurtera inévitablement à l'opposition de l'un ou l'autre camp, si ce n'est des deux.
Le prix élevé des produits de première nécessité sous Biden a été l'une des principales raisons de la victoire de Trump. Lorsque le coût de la vie ne s'améliorera pas et sera aggravé par les tarifs douaniers de Trump, une grande partie de son soutien parmi les travailleur·ses et les électeur·trices des couches moyennes s'affaiblira. Un nombre alarmant de Latino-Américain·es et de Noir·es ont voté pour Trump en 2024. Les attaques contre l'IED et la discrimination positive, le renforcement de l'appareil carcéral et répressif de l'État finiront par faire apparaître ces contradictions.
Si Trump ne parvient pas à tenir ses promesses de prospérité générale, les élections législatives de mi-mandat prévues en novembre 2026 pourraient bien lui faire perdre sa majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, ce qui porterait un coup à ses ambitions, mais l'inciterait, lui et ses conseillers, à agir rapidement.
En fin de compte, le trumpisme, le fascisme et le système capitaliste qui les rend possibles ne seront vaincus que par la mobilisation de masse et l'unité des travailleur·ses et des opprimé·es, indépendamment des partis démocrate et républicain. Alors que les élections semblent refléter le désespoir et la division parmi ces derniers, l'histoire récente de la lutte antiraciste de masse observée lors des manifestations du Black Lives Matter en 2020 et des luttes ouvrières impressionnantes menées par les travailleur·ses de l'automobile, les enseignant·es et d'autres, montrent la voie à suivre et soulignent le potentiel d'une riposte unie.
Le 26 janvier 2025
1. La Realpolitik est définie par le diplomate Henry Kissinger comme « la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l'intérêt national ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Femme », « climat »... Trump interdit des mots dans les articles scientifiques

Les scientifiques étasuniens doivent désormais bannir tout un lexique environnemental et social de leurs travaux, sous peine de risquer la perte de financements. Un basculement dystopique qu'elles et ils racontent, stupéfaits.
12 février 2025 | tiré du site reporterre.net
« Je n'arrive pas à croire que j'écris ceci depuis les États-Unis. » Le 10 février, Alessandro Rigolon épanche son désarroi sur le réseau social Bluesky. Pour conserver une subvention, le professeur en urbanisme à l'université de l'Utah doit supprimer le mot « climat » du titre de ses travaux. Un infime aperçu de la liste du vocabulaire interdit dressée par le président Donald Trump.
Le 29 janvier, à Washington, son secrétaire aux Transports a autorisé une série de mesures visant à abroger les politiques « woke », portées sous l'ère Biden. En clair, ordre est donné aux agences fédérales d'identifier et d'éliminer tous les programmes, politiques, activités, règles et ordres promouvant l'activisme climatique. Et les accords de financement de la recherche n'échappent pas à l'épuration.
« Leur plan est d'utiliser l'IA [intelligence artificielle] pour détecter les mots et les contenus interdits dans tous les projets financés par le gouvernement fédéral », poursuit Alessandro Rigolon. Le chercheur précise avoir été averti par courriel qu'il est désormais déconseillé d'inclure, dans une demande de subventions, des mots comme « changement climatique », « émissions de gaz à effet de serre » ou « justice environnementale ».
« Femme », un mot interdit
Baptisé « l'abrogation Woke », ce mémorandum ne concerne pas uniquement l'écologie. Les questions d'équité raciale, de genre, de diversité et d'inclusion figurent aussi dans la liste noire du républicain climatodénialiste. Sur Bluesky, l'alternative principale au réseau social X d'Elon Musk, des scientifiques de tous domaines témoignent de leur stupéfaction.
Professeure en psychologie à l'université de Californie du Sud, Darby Saxbe a publié une liste de près de 120 mots-clés à bannir, allant de « préjugé » à… « femme ». Ce document lui a été transmis par un responsable de la National Science Foundation, une agence dotée de 9 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros) annuels, destinés à soutenir la recherche scientifique.
« Il s'agit d'une guerre contre la science »
« Il est impossible de concevoir une étude sur les humains sans utiliser au moins un des termes figurant sur la liste des interdictions, écrit-elle. Cela signifie que la recherche biomédicale, la recherche sociale et les neurosciences sont désormais gelées aux États-Unis. » À ses yeux, « il s'agit d'une guerre contre la science ».
D'après un document interne cité par le Washington Post, les demandes de subventions n'entrant pas en conformité avec ces décrets feront l'objet de « mesures supplémentaires ». En d'autres termes, elles pourraient être soumises à des modifications ou à des résiliations partielles, voire totales.
Sous couvert d'anonymat, une chercheuse a raconté au Guardian avoir dû emprunter de l'argent à ses parents pour payer son loyer, à la suite de l'annulation de son financement. Le journal britannique précise toutefois qu'un juge de la cour de district de Washington a émis, le 3 février, une ordonnance de restriction temporaire bloquant la mise en place de ces gels.
Erreur 404
Au-delà de frapper le portefeuille, la chasse aux sorcières du milliardaire new-yorkais consiste aussi à supprimer toute référence à la crise climatique des sites internet fédéraux. De la Maison Blanche au ministère de la Défense, des onglets autrefois consacrés à la question affichent désormais le message d'erreur « 404 Not Found ».
Doctorant à l'université Duke, Tyler Norris a ainsi remarqué la suppression de ses travaux sur l'interconnexion des réseaux électriques, initialement publiés sur le site du ministère de l'Énergie. Une façon pour l'administration Trump de s'éviter toute concurrence dans la promotion des combustibles fossiles. Même son de cloche du côté du climatologue David Ho, en quête de travaux sur les cycles du carbone océanique.
« Un vol aux proportions astronomiques »
« J'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'une estimation de ce que toutes ces données perdues ont coûté aux contribuables pour être développées, et ce qu'elles nous coûteront à l'avenir en raison de leur absence, a déploré sur Bluesky la docteure en biologie à l'université de Washington, Meade Krosby. Il s'agit d'un vol aux proportions astronomiques. »
Et la bataille débute à peine, prévient dans les colonnes du Guardian Gretchen Gehrke, de l'Environmental Date & Governance initiative, un réseau de surveillance indépendant : « Nous devons nous attendre à une nouvelle campagne massive de suppression d'informations. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump intimide la Jordanie et l’Égypte pour qu’elles participent au nettoyage ethnique de Gaza. Cela ne fonctionne pas

Malgré le refus de la Jordanie et de l'Égypte d'accueillir les Palestiniens expulsés, Trump ne renonce pas à son projet de développement immobilier. Le président Donald Trump a confirmé ses projets d'expulser de force les 2 millions de Palestiniens vivant à Gaza, bien qu'il soit revenu sur sa menace de suspendre des milliards d'aide à l'Égypte et à la Jordanie si elles ne coopéraient pas.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Assis à côté du roi jordanien Abdallah II lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Trump a déclaré qu'il était « au-dessus » du fait de menacer les alliés des États-Unis afin de faciliter son idée d'expulser tous les Palestiniens de Gaza. Il a également promis que la prise de contrôle de Gaza n'entraînerait aucun coût pour les Américains.
« Il n'y a rien à acheter. Nous aurons Gaza. Aucune raison d'acheter. Il n'y a rien à acheter, c'est Gaza, c'est une zone déchirée par la guerre, nous allons la prendre, nous allons la tenir, nous allons la chérir », a déclaré Trump.
Depuis des jours, Trump répète sa vision d'une Gaza sans Palestiniens et placée sous contrôle américain.
Le monde arabe a rejeté l'idée, en particulier les pays que Trump a désignés comme hôtes potentiels de la population palestinienne transplantée : l'Égypte et la Jordanie.
Face à cette résistance, Trump a lancé l'idée de retirer les milliards de dollars d'aide militaire et d'aide étrangère envoyés à l'Égypte et à la Jordanie, longtemps considérés comme le prix que les États-Unis doivent payer pour maintenir les accords de paix de ces pays avec Israël.
Les États-Unis ont envoyé des milliards de dollars d'aide militaire à l'Égypte depuis la signature de son traité de paix avec Israël en 1979, à la suite des accords de Camp David. Actuellement, les États-Unis envoient à l'Égypte 1,5 milliard de dollars par an, principalement sous forme d'aide militaire.
Le traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie est également sous-tendu par une aide annuelle des États-Unis de 1,7 milliard de dollars.
Mardi, Trump a déclaré qu'il ne menaçait plus de suspendre l'aide.
« Je n'ai pas besoin de menacer avec de l'argent », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse. « Nous contribuons avec beaucoup d'argent à la Jordanie et à l'Égypte, d'ailleurs, beaucoup aux deux. Mais je n'ai pas besoin de menacer avec de l'argent. Je pense que nous sommes au-dessus de ça. »
Bien qu'il ait adopté un ton plus conciliant lors de sa rencontre avec Abdallah, Trump a continué à s'entêter sur le déplacement massif des Palestiniens à Gaza.
« Je pense que ce sera quelque chose de magnifique pour les Palestiniens », a-t-il déclaré. « Ils vont adorer. J'ai très bien réussi dans l'immobilier. Je peux vous parler de l'immobilier. Ils vont tout simplement adorer. »
Le roi de Jordanie n'a pas directement rejeté cette idée lors de la conférence de presse, mais a déclaré plus tard sur les réseaux sociaux qu'il l'avait rejetée lors de sa rencontre avec Trump.
« J'ai réitéré la position ferme de la Jordanie contre le déplacement des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. C'est la position arabe unifiée », a-t-il déclaré sur X.
Les experts de la région ont déclaré qu'il n'était pas surprenant que Trump ait renoncé à son idée de suspendre l'aide : il était impossible que les dirigeants égyptiens et jordaniens choisissent de risquer une révolte.
« Ce ne sera pas la fin du monde pour ces pays si l'aide américaine est limitée, suspendue ou supprimée. Ce sera la fin du monde pour ces pays, cependant, s'ils participent au nettoyage ethnique des Palestiniens », a déclaré Yousef Munayyer, un analyste politique palestino-américain.
Lara Friedman, présidente de la Foundation for Middle East Peace, a déclaré que c'était un accord qu'aucun des deux pays ne pouvait se permettre de conclure.
Pour l'Égypte, a fait valoir Mme Friedman, déplacer les Palestiniens dans des « camps de concentration » le long du Sinaï les exposerait à un conflit militaire avec Israël. « Il y aura inévitablement des actions militaires récurrentes de la part des Palestiniens contre Israël, ce qui conduira à une guerre entre Israël et l'Égypte », a-t-elle déclaré.
Il existe également un large soutien national à la cause palestinienne en Jordanie, qui accueille déjà la plus grande population de réfugiés palestiniens au monde, ainsi qu'en Égypte.
« Pour la Jordanie, l'idée de dépeupler Gaza et de demander potentiellement à la Jordanie d'accueillir davantage de Palestiniens constitue une menace existentielle pour le régime jordanien », a déclaré Friedman. « D'un point de vue égyptien, politiquement et en termes de sécurité nationale, je ne vois pas comment l'Égypte pourrait céder sur ce point sans se retrouver massivement déstabilisée. »
Pour ces raisons, les rêves délirants de Trump d'une « Riviera du Moyen-Orient » ne sont pas près de se concrétiser, a déclaré l'analyste israélo-britannique Daniel Levy, président du U.S./Middle East Project. Mais il a averti que les propos désinvoltes du président constituaient néanmoins un danger pour la région.
M. Levy a rappelé l'avertissement des services de renseignement militaires israéliens selon lequel discuter du plan pourrait attiser davantage la violence, ainsi que la réponse enflammée de l'Arabie saoudite à la suggestion improvisée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une interview télévisée selon laquelle le royaume devrait accueillir un État palestinien.
« Quels nouveaux fronts cela pourrait-il ouvrir ? Je n'ai jamais vu le genre d'échanges qui ont eu lieu ces derniers jours entre Israël et l'Arabie saoudite. Je pense que c'est sans précédent, les piques sont lancées », a déclaré M. Levy.
Bien que Trump semble avoir fait marche arrière sur son idée de suspendre l'aide, M. Levy a averti qu'il avait essentiellement laissé le génie sortir de la lampe en normalisant l'idée du nettoyage ethnique comme solution.
« Quand on entre dans un espace à somme nulle, et quand la chose à somme nulle postulée est le nettoyage ethnique… c'est une situation vraiment stupidement dangereuse. Ne partez pas du principe que votre somme nulle va l'emporter », a-t-il déclaré.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : The Intercept

Au Sri Lanka, la politique du nouveau gouvernement : une opportunité historique perdue

Éric Toussaint revient sur la situation du Sri Lanka depuis 2022. Des révoltes populaires jusqu'au nouveau gouvernement de centre gauche élu fin 2024, en passant par les négociations avec les créanciers, ce tour d'horizon permet de mieux comprendre la situation riche en enseignements d'un pays dont la situation sociale, économique et politique est largement méconnue. Éric Toussaint compare ce qui se déroule au Sri Lanka avec ce qui s'est passé en Grèce en 2015 et en Argentine entre 2019 et 2023 en mettant en perspective le risque de l'arrivée d'une droite dure au gouvernement dans le futur.
Tiré du site du CADTM.
Peux-tu revenir rapidement sur la crise qu'a connu le Sri Lanka en 2022 ?
Tout d'abord, une révolte populaire a eu lieu en mars-avril 2022 et s'est poursuivie jusque juillet de la même année. Cette révolte a eu lieu après que le pays ait subi plusieurs chocs ayant provoqué une grave crise économique, avec :
– Les effets d'un acte terroriste en 2019 qui a commencé à faire chuter le tourisme
– La pandémie internationale de coronavirus qui a stoppé complètement le tourisme dans le pays à partir de 2020
– Les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a provoqué une augmentation de la facture en dollars pour payer les combustibles, les céréales et les engrais chimiques que le Sri Lanka importe.
La combinaison de ces effets a provoqué une suspension généralisée du paiement de la dette publique en avril 2022. La situation s'était brusquement aggravée à cause des effets de l'invasion de l'Ukraine sur le prix des importations dès la fin février 2022 et de la décision des Banques centrales des États-Unis, d'Europe et de Grande-Bretagne qui ont augmenté brutalement leur taux d'intérêt à partir de février-mars 2022. Cela a rendu d'autant plus intenable la situation du Sri Lanka qui n'avait pas assez de revenus pour payer sa facture d'importation de combustibles, d'aliments, d'engrais et payer en même temps le service de la dette, d'où le défaut de paiement. Quand il s'est agi de quand même trouver de l'argent, comme la Réserve fédérale des États-Unis (FED), la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre avaient augmenté leurs taux d'intérêt, c'était absolument impossible. Les fonds d'investissement comme BlackRock qui avaient acheté à profusion des titres de la dette sri lankaise au cours des années précédentes ne souhaitaient plus prêter à ce pays à moins que celui-ci n'offre un rendement très élevé avec un taux d'intérêt du genre 15% ou plus.
Ce sont donc ces facteurs économiques qui ont provoqué le soulèvement populaire ?
Oui, ils ont agi comme éléments déclencheurs. Mais la colère du peuple, pendant les manifestations, s'est tournée contre le président Gotabaya Rajapaksa, dont la famille occupait la place de Président depuis 2005 (excepté de 2015 à 2019). Le niveau de corruption du régime et l'enrichissement du clan du président avaient rendu très impopulaire le gouvernement. Le 13 juillet 2022, les manifestant·es ont réussi à obtenir la fuite du Président Gotabaya Rajapaksa vers les Maldives puis Singapour après avoir envahi le palais présidentiel et s'être baigné·es dans sa piscine.
Que s'est-il passé après la fuite du président Gotabaya Rajapaksa ?
Le problème qui s'est posé après cela, c'est qu'il n'y avait pas de force politique populaire ayant suffisamment d'assise dans la population pour remplacer le clan Rajapaksa et la population ne s'était pas donné comme objectif de prendre le pouvoir. Donc les mêmes sont restés en place, Raniil Wickremesinghe, qui était le Premier Ministre de Gotabaya Rajapaksa, est devenu Président du Sri Lanka. Puis finalement, le Président démissionnaire qui s'était exilé est revenu quelques mois plus tard sans réaction populaire.
Un autre problème a été que tous les faiseurs d'opinion mainstream, mais aussi des intellectuel·les venant du marxisme et de la famille communiste ainsi que la plupart des économistes keynésiens ont considéré qu'il n'y avait pas d'alternatives hors du recours aux prêts du Fonds monétaire international.
À partir d'avril 2022, les autorités du pays sont entrées dans une négociation avec le FMI et avec les détenteurs de titres de la dette souveraine afin d'une part, d'avoir un crédit du FMI, et d'autre part, avoir une restructuration de la dette dite commerciale avec les détenteurs de titres. L'objectif était également d'arriver à une restructuration ou à des accords de reports de paiement avec les créanciers bilatéraux, ce qui a été atteint en juin 2024.
Les négociations se sont prolongées jusqu'en mars 2023 avec le Fonds monétaire international, date à laquelle un accord a été trouvé sur un prêt d'environ 3 milliards de dollars US et le premier versement de 333 millions de dollars US effectué. Un pré-accord a également été trouvé avec les détenteurs de titres souverains en septembre 2024, deux jours avant les élections présidentielles. Par la suite cet accord a été confirmé par les nouvelles autorités.
Quelle a été l'issue des élections en 2024 ?
En septembre 2024, l'élection présidentielle a été gagnée haut la main par un Outsider de la classe politique, par rapport aux élites et aux partis qui dominaient jusque-là et contrôlaient le gouvernement, Anura Kumara Dissanayake. Il est jeune, de gauche, d'origine marxiste, ayant quand même 30 ans d'expérience parlementaire et il promet un très grand changement. Dès son arrivée au pouvoir, il a convoqué des élections anticipées du Parlement qui ont eu lieu en novembre 2024. Ces élections ont été un succès pour l'alliance politique qui le soutenait, le NPP (Pouvoir populaire national), qui a remporté 63% des suffrages et plus de deux tiers des sièges parlementaires (159 sièges sur un total de 225).

The areas in red correspond to constituencies where the NPP alliance won a majority in the November 2024 legislative elections.
Source : AntanO, CC, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2024_Sri_Lankan_parliamentary_election.svg
Le président Amnura Kumara Dissanayake et son groupe parlementaire ont donc les moyens d'adopter toutes les lois qu'il souhaiterait adopter, et même de modifier la constitution, puisque ceci requiert deux tiers des parlementaires.
Un tel changement débouche-t-il sur une remise en cause des engagements du pays pris par les gouvernements précédents à l'égard des créanciers ?
Non, l'Alliance NPP, le Président et son gouvernement assurent qu'ils assument la continuité des obligations de l'État. Cela signifie qu'ils maintiennent les accords signés par le gouvernement précédent avec le FMI, qu'ils maintiennent les accords passés avec les détenteurs de titres et les accords avec les créanciers bilatéraux.
Cela pose un énorme problème, c'est une occasion historique, unique pour le pays, qui est en train d'être perdue ou dilapidée. Car, en effet, le droit international, en cas de changement de gouvernement, ou de régime, donne la possibilité à un gouvernement de déclarer nuls les engagements antérieurs en matière de dette si la dette qui est réclamée au pays est une dette odieuse.
Ici, nous pouvons parler de changement de régime si l'alliance NPP le voulait, car le peuple a souhaité un changement de régime par son vote massif pour le NPP et ses candidats, dont la plupart sont des nouveaux venus. On peut parler de changement de régime, car les gens n'ont pas réélu des parlementaires qui pour certain·es étaient en place depuis des décennies. La population a élu de nouveaux visages avec l'espoir d'un changement fondamental. Donc, du point de vue de la majorité de la population, nous pouvons parler d'un changement de régime. L'alliance NPP a parlé de la nécessité d'un changement fondamental, mais ce changement fondamental n'inclut pas selon le gouvernement les engagements par rapport aux créanciers. Or s'il n'y a pas de remise en cause de ces engagements, il n'y aura pas d'authentique changement.
Le gouvernement sri lankais pourrait invoquer le caractère odieux de la dette publique extérieure pour la répudier.
Et, en plus, sans aller de suite vers la répudiation, dans les circonstances actuelles, le gouvernement pourrait suspendre le paiement en invoquant le changement fondamental de circonstances et les chocs externes qui se sont succédé depuis 2020 (pandémie, effets de l'invasion de l'Ukraine, augmentation brutale des taux d'intérêt par les grandes banques centrales des pays du Nord). Cette suspension de paiement serait parfaitement justifiée par le droit international, sans que les créanciers ne puissent prélever des arriérés de paiement sur les intérêts non payés.
C'est donc une opportunité historique qui est en train d'être perdue puisque les autorités assurent qu'elles vont assumer la continuité des obligations en matière de dette.
Ce qui est en train de se dérouler avec le nouveau gouvernement du NPP, ne rappelle-t-il pas ce qui s'est passé en Grèce en 2015 et en Argentine entre 2019 et 2023 ?
En effet, cela rappelle, malgré la différence de situation, ce qui s'est passé en Argentine avec les élections générales de fin 2019 et en Grèce en 2015.
Dans le cas de l'Argentine, en octobre 2019, l'alliance péroniste Frente de Todos (le « Front de Tous ») a obtenu une majorité dans les deux chambres et a fait élire à la présidence le péroniste Alberto Fernandez après avoir mené une campagne contre le président néolibéral Mauricio Macri, qui était soutenu par le FMI et Donald Trump, alors président des Etats-Unis. Pendant la campagne électorale, l'alliance qui soutenait Alberto Fernandez avait dénoncé l'accord passé par Macri avec le FMI en 2018 comme totalement illégitime et elle avait promis de changer fondamentalement les choses. Il faut savoir que le FMI avait octroyé un crédit de 45 milliards de dollars en 2018, le plus élevé de toute son histoire. Mais très rapidement, Alberto Fernandez et son gouvernement sont entrés en négociation avec le FMI et ont fini par réemprunter 45 milliards de dollars en mars 2022 afin de poursuivre les remboursements. Le gouvernement a également poursuivi une politique d'austérité à la demande du FMI et de la classe capitaliste argentine. Cela a produit une grande désillusion dans la base électorale péroniste et fin 2023, un outsider d'extrême-droite, Javier Milei a remporté les élections et a lancé une offensive anti populaire comme l'Argentine n'en n'avait plus connu depuis la dictature des années 1970.
Dans le cas de la Grèce, la coalition de gauche Syriza a remporté haut la main les élections du 25 janvier 2015, après une campagne électorale promettant une rupture profonde avec le FMI, la Banque centrale européenne et la commission européenne réunie dans la Troïka. Mais dès le 22 février 2015, moins d'un mois après la victoire électorale Syriza et le ministre de l'Économie et des finances Yanis Varoufakis demandaient à la Troïka de prolonger l'accord (appelé mémorandum) au lieu d'y mettre fin, comme promis pendant la campagne électorale. La Grèce paya en 5 mois près de 6 milliards d'euros au FMI. Ensuite malgré un référendum populaire rejetant massivement le 5 juillet 2015 les nouvelles exigences de la Troïka, Syriza et le premier ministre Alexis Tsipras ont signé un nouvel accord avec le FMI, la BCE et la Commission européenne et ont maintenu des politiques d'austérité et de privatisations pendant 4 ans. Cela a entraîné de manière durable l'arrivée de la droite dure au gouvernement en la personne de Mitsotakis qui a intégré dans son équipe d'ancien membres de l'extrême-droite.
C'est important d'avoir ces deux précédents à l'esprit car au Sri Lanka, les déceptions que vont créer l'orientation actuelle du NPP risquent également d'amener dans quelques années le retour de la droite dure au pouvoir et cela dans un contexte où l'extrême-droite est à l'offensive sur le plan mondial.
Peux-tu résumer les obligations en matière de dette que les gouvernements sri lankais précédents ont prises à l'égard des créanciers privés ?
Concernant l'accord avec les créanciers privés, il porte sur les titres souverains de la dette du Sri Lanka, qui étaient en suspension de paiement depuis mars ou avril 2022. Rappelons que les créanciers privés ont obtenu que le gouvernement précédent signe avec eux un accord de principe deux jours avant les élections présidentielles de septembre 2024. C'était contraire à la loi électorale du pays. C'était une manœuvre pour imposer au peuple et au nouveau président un accord qui va contre l'intérêt de la nation et contre la volonté populaire exprimée dans les urnes. Par la suite, le nouveau gouvernement a ratifié cet accord néfaste alors qu'il n'était pas tenu de le faire.
Revenons sur ce qui s'est passé après la suspension des paiements qui est intervenue en 2022. Le prix des titres souverains sri lankais sur le marché secondaire de la dette avait baissé jusqu'à 20% de leur valeur initiale. Donc toute une série de détenteurs de titres les ont revendus à d'autres. La négociation a abouti à un accord par lequel le Sri Lanka s'est engagé à échanger les titres en suspension de paiement contre de nouveaux titres qui représentent un peu plus de 85% de la valeur des anciens titres. Le pays s'est engagé à payer un taux d'intérêt de l'ordre de 6,5% et celui-ci passera à plus 9% à partir de 2032, il pourrait même atteindre 9,75%. Si la croissance économique reprend, les conditions seront encore meilleures pour les créanciers privés. C'est un accord extrêmement mauvais pour le pays comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous qui présente une série de réductions de dette intervenues dans différents pays depuis l'an 2000.
Graphique 1 : Décotes sur la dette souveraine après négociations pour différents pays (en %)

D'autres pays comme l'Équateur, la Russie, l'Argentine, la Serbie ou la Côte d'Ivoire, ont obtenu des restructurations de leurs dettes qui comprennent ce qu'on appelle un Haircut (une annulation partielle de dette) beaucoup plus important. L'Équateur a obtenu une annulation partielle de dette de presque 70% en 2009. L'Argentine, en 2005, lors de la première restructuration de sa dette après 3 ans et demi de suspension de paiement, avait obtenu une annulation de 76,8% de sa dette. Donc le présent accord est très mauvais pour le Sri Lanka : à peine 15% de réduction. Il faut souligner que vu les intérêts à payer, au final, le montant à rembourser effectivement sera supérieur d'au moins 2 milliards à ce qu'aurait représenté le maintien des anciennes conditions, celles qui ont précédé l'accord intervenu en septembre 2024.
Ce sont de grands fonds d'investissement comme BlackRock qui en profitent un maximum. Il faut aussi indiquer que les créanciers qui achetaient des titres de la dette d'un pays comme le Sri Lanka savaient très bien qu'ils prenaient des risques. Ils demandaient déjà un taux d'intérêt élevé avec une prime de risque, donc il aurait été absolument logique qu'ils doivent accepter une réduction beaucoup plus importante.
Pour les fonds d'investissement, les banques, qui ont acheté sur le marché secondaire de la dette les titres quand ils étaient au plus bas, cela représente un gain absolument colossal. Si vous avez acheté à 25% de sa valeur de départ, un titre sur le marché secondaire au moment le plus fort de la crise, c'est à dire au cours de 2022, et qu'ensuite on vous propose de l'échanger contre un titre à 85% de la valeur de départ, c'est un profit absolument énorme que vous pouvez réaliser. Quand l'accord a été signé le 19 septembre 2024, les titres sri lankais se vendaient sur le marché secondaire avec une décote de près de 50%, donc ce jour-là, ceux qui avaient acheté des titres à 50% de leur valeur, ont immédiatement fait une bonne affaire car ils pouvaient les échanger contre des titres valant 85% de la valeur initiale.
L'économiste sri lankais Dhanusha Gihan a procédé à une comparaison entre l'accord signé en 2024 par le Ghana et celui signé par le Sri Lanka la même année. Il faut savoir que l'accord signé par le Ghana a lui-même été largement critiqué par de nombreuses organisations actives sur la question de la dette car il est trop généreux à l'égard des créanciers privés. Or l'accord signé par les anciennes autorités du Sri Lanka avec les créanciers privés est bien plus mauvais.

Voici ce qu'en dit Dhanusha Gihan : « Le fait que l'accord de principe (du Sri Lanka) prenne en compte les intérêts des créanciers au détriment du grand public est encore plus évident si l'on compare le cas du Sri Lanka à la restructuration de la dette du Ghana. Le gouvernement du Ghana a rejeté une proposition désastreuse comme celle du Sri Lanka faite par ses créanciers internationaux. Il a conclu un accord avec 90 % des détenteurs d'obligations, réduisant considérablement les paiements du principal et des intérêts. Le Ghana a obtenu une décote de 37 % sur la dette souveraine en cours, tandis que le taux d'intérêt maximal applicable aux nouvelles obligations a été plafonné à 6 % contre 9,75 % pour le Sri Lanka. En conséquence, son allègement de la dette nominale s'élève à 4,4 milliards de dollars US (The Africa Report, 2024) contre une augmentation des paiements nominaux du Sri Lanka pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars US. » [1] Dhanusha Gihan Pathirana, SRI LANKA'S INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND RESTRUCTURING, Policy Perspectives November 2024, p. 11. https://ipe-sl.org/sri-lanka-isb-restructuring/
L'accord de principe signé par les anciennes autorités du pays deux jours avant les élections de septembre 2024, au cours desquelles elles ont été complètement désavouées, allait clairement contre l'intérêt du pays et de la population. Les nouvelles autorités auraient dû le déclarer nul afin de reprendre la négociation sur d'autres bases ou bien de répudier le montant réclamé par les créanciers privés qui ont été les complices des régimes corrompus précédents tout en faisant jusque 2022 de juteux profits. Les nouvelles autorités, en confirmant l'accord du 22 septembre 2024, sont allées à l'encontre des intérêts de la population et ont favorisé les intérêts des créanciers privés.

Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la dette bilatérale du Sri Lanka ?
Le Sri Lanka est arrivé à un accord avec les créanciers bilatéraux en juin 2024 en rapport avec des créances d'un montant de 10 milliards de dollars (sur un total de 11 milliards). Cet accord ne prévoit aucune réduction du volume de la dette réclamée par les créanciers bilatéraux. Ce qui change, ce sont les taux d'intérêt qui sont ramenés à 2% et les échéances de paiement qui sont reportées. De plus, le début du remboursement du capital est reporté à 5 ans. Les principaux créanciers bilatéraux sont la Chine (5 milliards USD), le Japon (2,5 milliards USD), l'Inde (près de 1,5 milliards USD), l'Allemagne (200 millions USD).
Quid de l'accord avec le Fonds monétaire international ?
L'accord avec le FMI porte sur un crédit d'un montant de près de 3 milliards de dollars US, comme je l'expliquais plus haut. La dette actuelle vis-à-vis du FMI s'élève à environ un milliard de dollar, elle va donc augmenter dans les prochaines années au fur et à mesure des déboursements effectués par le FMI. Ce prêt du FMI est octroyé à des conditions draconiennes. Le FMI exige du gouvernement de dégager un surplus primaire du budget public de 2,3% dès 2025. Pour pouvoir arriver à cet objectif, le gouvernement va devoir réduire très fortement les dépenses publiques. Et comme il y avait déjà très peu de dépenses d'investissement productif, il s'agira de réduire quasiment à 0 les investissements publics productifs. La contrainte consistant à dégager un surplus budgétaire primaire va porter inéluctablement sur les dépenses sociales. La pression du FMI va également très fortement s'accentuer pour faire augmenter les impôts payés par les classes populaires, car le FMI ne demande jamais qu'on augmente les impôts sur les grandes sociétés multinationales, ou de créer un impôt sur le patrimoine, sur les dividendes…
Pour vous donner une idée, le service de la dette, cette année, est supérieur aux revenus de l'État. Comme les revenus de l'État sont inférieurs au service de la dette, payer cette dette implique un effort financier énorme consistant à emprunter de l'argent, par exemple au FMI, seulement pour rembourser les intérêts sur les emprunts antérieurs. Donc c'est une situation très mauvaise pour les finances publiques et le début d'un cercle vicieux de dépendance vis-à-vis des créanciers.
Le FMI pousse également à de nouvelles privatisations d'entreprises publiques. Il y a déjà eu certaines privatisations, mais le FMI, comme il l'exige dans d'autres pays, veut privatiser un grand nombre d'entreprises supplémentaires, notamment le secteur de l'électricité qui est un secteur vital pour la population. Si on privatise le secteur de l'électricité, cela va directement entrainer une hausse des prix, des difficultés énormes pour la population et une baisse de son pouvoir d'achat.
Pour plus d'informations sur la politique du gouvernement en lien avec les exigences du FMI, lire l'encadré ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas entrer dans les détails chiffrés et techniques, vous pouvez passer cet encadré.
Encadré. Selon l'économiste Amali Wedagedara : La sortie (de l'accord avec le FMI) la plus rapide serait la meilleure pour le Sri Lanka
L'économiste sri lankaise Amali Wedagedara, membre du CADTM, qui a analysé le budget 2025 qui tient compte des demandes du FMI écrivait le 22 janvier 2025 : « Le budget 2025 illustre la difficulté de joindre les deux bouts dans une prison pour débiteurs. Le projet de loi de finances pour le budget 2025 révèle la pression fiscale et les contraintes imposées par le programme du FMI et la lutte pour mettre l'économie sur une trajectoire de développement. (…)
Au lieu de donner au gouvernement les moyens d'améliorer la structure industrielle et de renforcer le pouvoir structurel de l'économie - de stimuler les industries, de restaurer les infrastructures de développement et d'améliorer les compétences et la technologie - , le programme du FMI limite la planification et l'action au strict minimum et à des secteurs vulnérables comme le tourisme. Le projet de loi de finances et, par la suite, le budget 2025 sont des signes précurseurs des effets néfastes du programme du FMI. »
Amali Wedagedara tire une première conclusion : « La sortie (de l'accord avec le FMI) la plus rapide serait la meilleure pour le Sri Lanka. »
Elle poursuit : « Conformément aux lignes directrices du FMI, le gouvernement NPP s'efforce d'atteindre un solde primaire de 2,3 % en 2025. L'augmentation des recettes de l'État à 15,1 % du PIB, contre 11 % en 2024, est une initiative visant à atteindre l'excédent budgétaire primaire. Toutefois, les lignes directrices du FMI sur la viabilité de la dette garantissent que les augmentations des recettes publiques ne seront pas utilisées pour les activités de développement et la relance économique, mais pour satisfaire aux obligations du service de la dette. En conséquence, les objectifs de viabilité de la dette que le FMI impose à la planification budgétaire du gouvernement ne font que garantir la viabilité des créanciers.
Le gouvernement a plafonné les dépenses à 4 290 milliards de roupies (1 euro ou 1 dollar = environ 300 roupies). Les paiements d'intérêts s'élèveront à environ 3 000 milliards de roupies. Selon le gouverneur de la Banque centrale, le Sri Lanka devra assurer le service de la dette à hauteur de 4 à 5 milliards de dollars en 2025. En conséquence, la part du service de la dette dans les recettes publiques dépasse les dépenses de sécurité sociale, les services publics et les investissements dans l'économie productive. Une étude comparant les obligations de service de la dette de 145 pays en 2024 a classé le Sri Lanka au deuxième rang des pays ayant les ratios service de la dette/recettes les plus élevés au monde (Resolving the Worst Ever Global Debt Crisis : Time for a Nordic Initiative ? 2024). Au Sri Lanka, le service total de la dette représente 202 % des recettes publiques. » [2]
Quelles seraient les mesures à prendre pour sortir de ce cercle vicieux ?
Il faudrait augmenter les taxes sur ceux qui peuvent contribuer plus. Il faut savoir que les multinationales étrangères paient un impôt de 15% sur leurs bénéfices tandis que les entreprises nationales, notamment les entreprises moyennes, paient un impôt de 30%.
Les impôts indirects sur la consommation, donc les taxes comme la TVA, représentent la partie la plus importante des revenus de l'État. Sur la période janvier-août 2024, la TVA représentait un tiers des revenus du gouvernent, contre 25% sur la période janvier-août 2023 [3].
Il faudrait augmenter radicalement les impôts directs sur les revenus de ceux qui sont les plus riches et qui ont les plus grandes facultés contributives. Il faut aussi réduire les impôts indirects sur les classes populaires pour augmenter leur pouvoir d'achat. On sait que, pour les classes populaires, une baisse de taxes et une augmentation du pouvoir d'achat débouchent directement par des dépenses supplémentaires de consommation. Cela aurait donc un effet multiplicateur sur l'économie. Cela procurerait des revenus à des tiers et cela pourrait créer de l'emploi, etc.
La politique du FMI est totalement inverse : augmenter les taxes indirectes, ce qui va baisser les revenus des classes populaires, bloquer les salaires dans la fonction publique, obtenir des licenciements de fonctionnaires publics pour réduire les dépenses dans la fonction publique.
Il faut mettre fin à l'accord du Sri Lanka avec le FMI.
La dette réclamée par le FMI correspond aux deux critères qui définissent une dette comme odieuse.
- Premier critère : La dette auprès du FMI est contractée pour mener des politiques contraires aux intérêts de la population.
- En effet, les conditionnalités imposées par le FMI portent atteinte aux conditions de vie de la population et fragilisent encore un peu plus l'économie du pays.
- Deuxième critère : Les créanciers savaient cela, ils étaient complices de ces politiques.
- Dans le cas du FMI, il n'y a aucun doute qu'il sait que les politiques qu'ils recommande ou dicte sont contraires aux intérêts de la population car c'est lui-même qui impose des conditionnalités qui rendent plus difficiles les conditions de vie d'une majorité de la population.
Si le gouvernement organisait un audit à participation citoyenne pour analyser les dettes réclamées par le FMI en demandant de faire un bilan des politiques recommandées et dictées par le FMI depuis 20 ans, il pourrait avoir un outil permettant de justifier une répudiation des dettes réclamées par le FMI ou tout au moins une suspension des remboursements. Il faut également auditer les dettes octroyées par les autres institutions multilatérales : Banque mondiale (à qui le Sri Lanka devait 4,5 milliards de dollars au 3e trimestre 2024), Banque asiatique de développement (à qui le Sri Lanka devait 6,5 milliards de dollars au 3e trimestre 2024),…
Il faudrait abandonner la politique voulue par le FMI et acceptée par le nouveau gouvernement en matière d'élargissement des privatisations et de promotion des partenariats public privés.
Concernant les dettes réclamées par les créanciers privés dont le montant s'élève à environ 15 milliards de dollars, l'audit pourrait également démontrer leur caractère illégitime, voire odieux, et justifier une répudiation ou tout au moins une suspension de paiement afin d'obtenir une renégociation favorable cette fois-ci aux intérêts de la population. Les créanciers privés ont été complices du précédent régime corrompu qui a dirigé le pays entre 2005 et 2024. De plus, les créanciers ont fait des profits abusifs.
Concernant les dettes bilatérales qui s'élève à 11 milliards de dollars, il faudrait également les auditer que ce soit les dettes réclamées par la Chine, le Japon, l'Inde, par l'Allemagne ou par d'autres pays. Une grande partie des dettes bilatérales ou leur entièreté peut être considérée comme illégitime car elles n'ont pas servi à financer des projets réellement utiles pour la population, elles servaient les intérêts des pays qui soutenaient des grands projets d'infrastructures qui leur sont utiles, par exemple, la construction par la Chine d'un port en eau profonde à Hambantota.
Pour toutes les catégories de dettes, il faut que les autorités sri lankaises mettent fin à la diplomatie secrète : tous les contrats, tous les documents relatifs aux négociations sur la dette doivent être rendus publics. En effet, il faut savoir que ce qui est publié par le ministère des finances, par le FMI, la Banque mondiale, les créanciers bilatéraux et privés constituent seulement une toute petite partie de la documentation. Ce qui est publié constitue la pointe de l'iceberg et vise à légitimer la dette. Si ce qui est maintenu dans le secret était mis à la disposition du public, il y aurait une plus grande prise de conscience des dommages causés par la politique d'endettement.
Il faudrait également prendre des mesures concernant la dette publique interne qui représente 60% de la dette publique totale et atteint environ 60 milliards de dollars. En effet, la classe capitaliste locale et les membres de l'élite tournant traditionnellement autour du pouvoir ont investi dans la dette interne. Ils l'ont fait car elle leur procure une rente élevée, dans la mesure où le taux d'intérêt sur les titres de la dette interne s'élève jusqu'à 16% alors que les banques sri lankaises, qui achètent une partie des titres de la dette, se financent à un taux d'intérêt de l'ordre de 8% [4]. Elles font donc des profits juteux sur le dos des finances publiques, de même que les riches rentiers qui peuvent placer une partie de leur épargne en obtenant un rendement très élevé sans rien faire, alors que le pays a besoin d'investissements productifs. Il faudrait dans un premier temps réduire de moitié le taux d'intérêt versé par l'État aux détenteurs de titres de la dette interne.
Quid de la dette privée, de la dette des classes populaires ?
Sur cette question, il faut absolument prendre des mesures contre le microcrédit abusif et usurier, qui touche une proportion importante des femmes des classes populaires. Il faudrait que le nouveau gouvernement mette en œuvre une politique de protection des personnes endettées dans des conditions abusives. En 2017 et 2018, une première série de protestations des coopératives et des groupes de femmes dans les provinces du nord et de l'est du Sri Lanka a démontré qu'un nombre important de sociétés de microcrédit pratiquaient des taux d'intérêt usuraires, allant de 40 à 220%. Ces manifestations ont également montré que ces sociétés exerçaient des formes de violence financière et physique sur les femmes endettées.

Un rapport de l'ONU indique qu'environ 2,4 millions de femmes ont eu recours à des microcrédits en 2018 [5]. Cela équivaut à un tiers des 7,8 millions de femmes adultes au Sri Lanka (Department of Census and Statistics, n.d.). En 2022, plus de 200 femmes se sont suicidées en raison du harcèlement des prêteurs du microcrédit [6].
Le gouvernement devrait donc combattre le microcrédit abusif qui est développé au Sri Lanka par d'importantes banques locales et internationales. Il devrait fixer un taux d'intérêt maximum que les prêteurs peuvent demander. Il devrait mettre en place un système de crédit public à destination des classes populaires tout en soutenant les coopératives de femmes organisant elles-mêmes un microcrédit éthique. Le gouvernement pourrait, par la voie légale, proclamer une annulation généralisée des dettes en dessous d'un certain montant et en-dessous d'un certain revenu par personne ou foyer endetté.
Une dernière question : y a-t-il encore des secteurs dans la société sri lankaise qui adoptent un point de vue critique par rapport au FMI et par rapport à la politique du gouvernement en matière de dettes ?
Je viens de participer au Sri Lanka à un programme d'activités organisées par différentes structures : le CADTM international, le Centre Bandaranaike for International Studies, la faculté of Arts, Economics Society, de l'université de Peradeniya à Kandy, j'ai également été longuement interviewé par une télévision privée de grande audience. Au cours de ces activités, j'ai rencontré un nombre important d'économistes, de professeurs, d'étudiant-es, de journalistes, d'activistes, de responsables de mouvements sociaux qui sont critiques par rapport à la politique du gouvernement en particulier en ce qui concerne le FMI et la dette en général. Dans le cadre du programme du CADTM, nous avons également eu une réunion avec Harshana Suriyapperuma, le vice-ministre des finances du nouveau gouvernement qui a affirmé que le gouvernement allait assurer la continuité des obligations contractée par le gouvernement précédent. Quand nous lui avons fait remarquer que le programme électoral du NPP mentionnait la nécessité d'un audit des dettes, le vice-ministre a indiqué que ce serait pour plus tard, chaque chose en son temps en quelque sorte. Enfin, nous nous sommes réunis avec des organisations politiques de gauche opposées à l'accord avec le FMI. Je me suis rendu compte au cours de ce programme d'activités bien chargé qu'il y a un nombre significatif de personnes qui adoptent une critique de gauche à l'égard du gouvernement et du maintien des accords avec le FMI et les autres créanciers. Mais il est indéniable qu'il s'agit d'une minorité dans la population et qu'une course contre la montre est lancée afin qu'il y ait une prise de conscience des dangers que représente le cours actuel adopté par le gouvernement.
L'auteur remercie Amali Wadagedara pour les informations sur le microcrédit et Maxime Perriot pour la relecture.
Notes
[1] “The Agreement-in-Principle (AIP) entertaining the interests of the creditors at the expense of the general public is further revealed by comparing the Sri Lankan case with Ghana's debt restructuring. The government of Ghana rejected a disastrous proposal like that of Sri Lanka made by its international creditors. It reached an agreement with 90% of bondholders, meaningful ly reducing both principal and interest payments. Ghana secured a 37% haircut on outstanding sovereign debt, while the maximum interest rate applicable for new bonds was capped at 6% as opposed to 9.75% for Sri Lanka. As a result, its nominal debt relief amounts to US$ 4.4 billion (The Africa Report, 2024) as opposed to increase in nominal payments of Sri Lanka by up to US$ 2.3 billion.”
[2] “The Budget 2025 illustrates the drudgery of making ends meet inside a debtors' prison. The Appropriation Bill for Budget 2025 reveals the fiscal squeeze and constraints imposed by the IMF program and the struggle to set the economy on a developmental trajectory. (…) Instead of empowering the Government to upgrade the hardware and strengthen the structural power of the economy – boost industries, restore developmental infrastructure, and elevate skills and technology, the IMF program limits planning and action to the bare minimum and vulnerable sectors like tourism. The Appropriation Bill and, subsequently, the Budget 2025 are early warning signs of the harms of the IMF program. The earliest exit would mean the best for Sri Lanka.
In accordance with the IMF guidelines, the NPP Government is striving to meet a 2.3% primary account balance in 2025. Increasing the Government's revenue to 15.1% of GDP from 11% in 2024 is one initiative to meet the primary Budget surplus. However, the IMF debt sustainability guidelines ensure that the enhancements in Government revenue will not be used for developmental activities and economic recovery but to meet debt servicing obligations. Accordingly, debt sustainability targets that the IMF imposes on the Government's fiscal planning only ensure the sustainability of the creditors. The Government has capped spending at Rs. 4,290 billion. Interest rate payments will amount to around Rs. 3,000 billion. According to the Governor of the Central Bank, Sri Lanka has to service between $ 4 to 5 billion of debt in 2025. As a result, debt servicing as a share of Government revenue exceeds expenses on social security, public services and investments in the productive economy. A study comparing the debt service obligations of 145 countries in 2024 ranked Sri Lanka 2nd in terms of countries with the highest debt service to revenue ratios in the world (Resolving the Worst Ever Global Debt Crisis : Time for a Nordic Initiative ? 2024). Total debt service as a share of Government revenue in Sri Lanka is 202%.” Source : https://www.cadtm.org/Budget-2025-Adjusting-and-adapting-inside-IMF-prison and https://www.ft.lk/opinion/Budget-2025-Adjusting-and-adapting-inside-IMF-prison/14-772076
[3] Ministère des finances du Sri Lanka, « 2024 Pre Election budgetary Report », Octobre 2024, page 14, https://www.treasury.gov.lk/api/file/058b7da9-293a-4cba-8569-9b850a332342.
[4] Dhanusha Gihan Pathirana, “Sri Lanka : Fiscal and Redistributive Reform : The Burden of Interest Costs”, publié le 8 février 2025, https://www.cadtm.org/Fiscal-and-Redistributive-Reform-The-Burden-of-Interest-Costs
[5] Bohoslavsky, Juan Pablo. 2019. “Report of the Independent Expert on the Effects of Foreign Debt and Other Related International Financial Obligations of States on the Full Enjoyment of All Human Rights, Particularly Economic, Social and Cultural Rights, on His Visit to Sri Lanka.” A/HRC/40/57/Add.2. Geneva : UN Human Rights Council. https://digitallibrary.un.org/record/1663967?ln=en
[6] Finch, Gavin, and David Kocieniewski. 2022. “How Microfinance Pushes Poor Borrowers Deeper in Debt in Developing Economies.” Bloomberg.Com. May 2, 2022. https://www.bloomberg.com/graphics/2022-microfinance-banks-profit-off-developing-world/ et Fonseka, Piyumi. 2021. “Debt-Driven Suicides Continue Unabated in Sri Lanka.” Daily Mirror, March 25, 2021. https://www.dailymirror.lk/recomended-news/Debt-driven-suicides-continueunabated-in-Sri-Lanka/277-208493
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











