Derniers articles

La réélection de Trump place le Canada sous une nouvelle pression

Avec la réélection de Donald Trump, une nouvelle ère de tensions et de défis s'annonce pour le Canada. Entre protectionnisme économique et polarisation sociale, le voisin du Nord devra s'adapter à des vents contraires. A l'occasion des élections américaines, L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS), en partenariat avec l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) ont organisé un événement spécial le 5 novembre dernier à Québec, avec visionnement et annonce des résultats des présidentielles. Pour l'AQOCI, il s'agissait d'une activité dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. Une conférence a été donnée en amont ainsi qu'une analyse tout au long de la soirée sur les questions politiques, économiques et sécuritaires principalement.
12 novembre 2024 | tiré de Alter-Québec
La démocratie américaine, un modèle en décalage
Après des montagnes russes d'émotions, Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Cette réélection met en lumière les différences fondamentales entre le système électoral américain et le modèle français. Contrairement au système américain, la démocratie française repose sur un modèle de représentation plus directe. En effet, aux États-Unis, ce ne sont pas des élections directes : la population vote pour des candidatures, mais la victoire va à la personne candidate qui obtient le nombre de grands électeurs gagnés. Dans chaque État, le candidat qui obtient la majorité des voix remporte tous les mandats de cet État.
Jonathan Paquin, professeur titulaire au département de science politique de l'Université Laval et codirecteur du Réseau d'analyse stratégique rappelle qu'Hillary Clinton avait recueilli trois millions de voix de plus que Trump , lors de l'élection de 2016, Toutefois, Celui-ci a été élu parce qu'il a obtenu les votes des États clés, comme la Pennsylvanie, la Géorgie et le Wisconsin. Ce système crée alors un décalage entre le choix de l'électorat et le résultat final de l'élection.
Implications directes pour le Canada
Trump ou Kamala ? Pour le Canada, le choix n'est pas anodin. Les impacts de la réélection de Donald Trump sur le Canada suscitent de nombreuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'économie et les échanges commerciaux.
En effet lors de la première présidence de Donald Trump, en janvier 2017, la renégociation de l'Accord de libre échange Nord Américain (ALÉNA) a mis en lumière son penchant pour le protectionnisme avec la conclusion d'une nouvelle entente, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Sous l'administration Biden, cependant, aucun tarif douanier n'a été réduit, confirmant une continuité dans les politiques commerciales restrictives.
Cela dit, une certaine différence pourrait expliquer les préférences économiques du Québec et du Canada pour l'une ou l'autre des candidatures. Maintenant que Trump est réélu, il a promis d'imposer une taxe de 10 % sur tous les biens importés aux États-Unis. Une telle mesure rendrait les exportations canadiennes plus coûteuses et moins compétitives sur le marché américain.
Les entreprises canadiennes, y compris celles du secteur pétrolier, pourraient voir leurs exportations chuter. Pour le monde du travail, cela signifie moins de commandes et, vraisemblablement, moins d'emplois. Pour le Canada, dont l'économie dépend fortement de ces exportations, cela entraînerait des conséquences significatives : selon les projections, le PIB canadien pourrait chuter de 0,9 % d'ici 2029.
Pressions accrues pour accueillir plus de personnes migrantes ou réfugiées
Mais l'économie n'est pas le seul domaine touché. Sur le plan social, les répercussions pourraient être tout aussi importantes avec des impacts qui se ressentiront plus en matière d'immigration. Par exemple, les restrictions drastiques de Trump pourraient intensifier la pression sur le Canada pour accueillir un plus grand nombre de personnes réfugiés et en demande d'asile. Déjà considéré comme un pays refuge lors des premières années de la présidence Trump, le Canada pourrait être confronté à un afflux supplémentaire.
Un vent de droite souffle sur le Canada ?
Arthur Silve, professeur au Département d'économique, souligne que le Canada a historiquement tendance à se positionner à l'opposé des choix polarisants des États-Unis. Cependant, la réélection de Donald Trump pourrait influencer directement la politique canadienne et les choix de l'électorat. Des similitudes avec les slogans populistes, comme celui de Pierre Poilievre, « I will fix it » notamment, montrent que les répercussions de cette élection ne se limitent pas au Canada.
Le débat actuel sur la protection de l'industrie laitière illustre une volonté d'adaptation face aux politiques protectionnistes de Trump. Par ailleurs, la montée des discussions sur l'immigration laisse entrevoir un possible glissement vers des positions plus conservatrices au Québec et dans le reste du pays. La réélection de Trump n'est donc pas qu'un défi externe pour le Canada, mais un potentiel catalyseur de changements politiques.

La communauté du grand Montréal se rassemble pour exposer l’implication du Canada dans la chaîne d’approvisionnement du f-35

Cette manifestation fait partie de la journée d'action #ArmsEmbargoNow F-35 du 16 novembre, qui vise à exposer et à mettre fin à la complicité du Canada dans les atrocités commises par Israël.
Des membres des communautés de Montréal et de Longueuil se rassemblent aujourd'hui devant Héroux-Devtek dans le cadre d'une journée d'action nationale visant les entreprises qui produisent des pièces pour les avions de chasse F-35 utilisés pour bombarder Gaza et le Liban. Héroux-Devtek produit des trains d'atterrissage ici même, à l'usine de Longueuil. Ces composants sont ensuite incorporés dans l'avion de guerre phare de Lockheed Martin, qu'Israël utilise pour commettre des crimes de guerre.
Cette action est organisée et/ou soutenue par de nombreux groupes locaux, dont World BEYOND War, Voix Juives Indépendantes, Palestiniens et Juifs Unis (PAJU), Collectif désinvestir pour la Palestine et Labour for Palestine. Des représentants de ces groupes prendront la parole lors du rassemblement.
Cette action est l'une des 16 qui auront lieu à travers le pays, afin de démontrer que le Canada arme toujours Israël, malgré les déclarations trompeuses des députés libéraux, et d'exiger que le gouvernement impose un embargo complet et immédiat sur les armes à destination d'Israël.
« Le gouvernement canadien n'a pas encore suspendu ou annulé 88% des permis actuellement utilisés pour expédier des armes à Israël, de sorte que les fabricants d'armes canadiens continuent de faire des affaires comme d'habitude avec ce régime meurtrier. Héroux-Devtek, qui fabrique le train d'atterrissage des avions de chasse F-35 qui déciment actuellement Gaza et le Liban, n'est qu'un exemple de notre complicité continue avec la violence génocidaire d'Israël », a déclaré Cym Gomery, coordonnatrice de Montréal pour un monde AU-DELÀ DE LA GUERRE. « Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, doit immédiatement mettre fin aux exportations militaires canadiennes vers Israël et imposer un embargo complet sur les armes dans les deux sens. »
« En tant que Canadien juif, je suis horrifié par le fait que le gouvernement de mon pays semble plus intéressé par les profits de guerre que par la vie humaine », a ajouté Niall Clapham Ricardo de Voix Juives Indépendantes. « Il est profondément troublant de découvrir que la société Héroux-Devtek, située dans notre arrière-cour, produit des composants essentiels des F-35 utilisés pour commettre cette dévastation. Notre
communauté se rassemble aujourd'hui à l'extérieur pour dire à des entreprises comme celle-ci de cesser de profiter d'un génocide, et pour dire à notre gouvernement de mettre fin à sa complicité dans les crimes de guerre d'Israël. »
« Notre communauté se rassemble aujourd'hui à l'extérieur pour dire à des entreprises comme celle-ci de cesser de tirer profit d'un génocide, et pour dire à notre gouvernement de mettre fin à sa complicité dans les crimes de guerre d'Israël » a-t-il continué.
Suivez https://www.instagram.com/palsolidaritycad/ et twitter.com/wbwCanada pour des photos, des vidéos et des mises à jour de tout le pays. Un dossier de photos et de vidéos des actions du 16 novembre à travers le pays est disponible ici.
Contexte
*La ministre induit les Canadien.ne.s en erreur sur le commerce d'armes entre le Canada et Israël.*
En septembre, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré aux journalistes : « Nous ne laisserons aucune forme d'armes ou de pièces d'armes être envoyées à Gaza, un point c'est tout. La manière dont elles sont envoyées et l'endroit où elles sont envoyées n'ont pas d'importance ». Mais elle n'a pris aucune autre mesure pour combler la faille qui permet aux entreprises canadiennes de vendre des armes à Israël via les États-Unis. Cette faille continue de permettre à la technologie canadienne
d'être envoyée et utilisée par Israël, malgré les avertissements des experts de l'ONU selon lesquels les transferts d'armes vers Israël risquent de violer le droit international en matière de droits de la personne.
Entreprises canadiennes impliquées dans la production et l'entretien des F-35 utilisés par Israël à Gaza
Le F-35 Joint Strike Fighter, un avion de guerre de fabrication américaine contenant des composants canadiens, en est un exemple mortel. Les F-35 sont un outil clé de la destruction et de la violence d'Israël à Gaza et au Liban. Des responsables israéliens ont déclaré que les F-35I ont été équipés de bombes de 2 000 livres et utilisés dans le bombardement en cours de Gaza.
Les entreprises canadiennes font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de maintenance des F-35. Project Ploughshares a indiqué qu'au moins 110 fournisseurs basés au Canada ont obtenu des contrats pour le programme F-35.
Une étude commandée par Lockheed Martin en 2018 indique que chaque avion F-35 contient des composants canadiens d'une valeur de 2,3 millions de dollars américains, qu'il s'agisse de pièces de train d'atterrissage, de pièces de moteur ou de logiciels. Les avions de combat modernes comme les F-35 nécessitent une maintenance importante pour rester fonctionnels - de nombreuses pièces cassées et usées sont renvoyées à leurs fabricants d'origine pour être réparées, et la flotte israélienne est soutenue par des livraisons de pièces de rechange en provenance de pays partenaires.
Notre participation continue à la chaîne d'approvisionnement des F-35 n'est qu'un exemple flagrant de l'utilisation de composants militaires fabriqués au Canada dans les systèmes d'armement israéliens, malgré les assurances non fondées de Mme Joly.
Le Canada doit imposer un embargo sur les armes à Israël dès maintenant
Cette journée d'action s'inscrit dans le cadre de la campagne #ArmsEmbargoNow, qui exhorte le gouvernement canadien à remplir ses obligations juridiques et morales en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Palestiniens de Gaza contre le risque sérieux de génocide et contre les graves violations des droits de la personne et du droit humanitaire perpétrées par Israël dans son assaut et son siège continus de Gaza, notamment en mettant immédiatement fin au commerce d'armes et de technologies militaires avec Israël.
Depuis son lancement en mai, la déclaration a été approuvée par plus de 400 associations palestiniennes, syndicats, institutions religieuses, organisations de défense des droits de l'homme et de l'environnement et groupes communautaires à travers le Canada. Plus de 40 députés des partis libéral, néo-démocrate et vert ont signé la demande, reconnaissant la catastrophe causée par l'assaut israélien en cours sur Gaza et appelant le gouvernement canadien à imposer un embargo complet et immédiat sur les
armes à destination d'Israël. Cette journée d'action expose les entreprises impliquées dans la production et l'entretien des composants du F-35, qui sont expédiés en Israël par l'intermédiaire de la faille américaine.<<
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Solidarité avec le peuple du Mozambique en cette période de troubles politiques

La Marche mondiale des femmes fait preuve d'une solidarité inébranlable avec la MMF du Mozambique en cette période d'agitation et de troubles politiques. Nous apportons notre soutien à toutes les femmes mozambicaines, aux communautés paysannes et aux mouvements populaires qui continuent à lutter pour la justice, la paix et la dignité.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/09/solidarite-avec-le-peuple-du-mozambique-en-cette-periode-de-troubles-politiques/?jetpack_skip_subscription_popup
Face à l'instabilité croissante, à la violence et aux difficultés économiques, nous reconnaissons la force et la résilience des femmes qui sont en première ligne pour réclamer la démocratie, les droits de l'homme et la fin de l'exploitation et de la fraude électorale. Nous sommes particulièrement attristés par les assassinats politiques en cours, notamment la mort prématurée de l'avocat de l'opposition Venancio Mondlane, qui a été brutalement exécuté de 25 balles, et par de nombreux autres décès non signalés. Nous sommes profondément préoccupés par l'impact de cette agitation politique qui a conduit à la fermeture totale du pays, car les secteurs les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes et les enfants, continuent d'en subir les conséquences. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de répression ou de violence à l'encontre de ces communautés.
En tant que mouvement féministe international de base, nous réaffirmons notre engagement aux côtés du peuple mozambicain, en amplifiant sa voix et en appelant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Nous exigeons la fin de la violence et l'ouverture d'espaces démocratiques où le peuple mozambicain puisse exprimer librement sa volonté politique et ses aspirations à une société juste et pacifique.
Compte tenu des troubles politiques au Mozambique, la communauté internationale et l'Union africaine (UA) peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix, de la démocratie et de la stabilité. C'est pourquoi nous :
1. Appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de la violence : Nous exigeons de toutes les parties concernées qu'elles mettent fin à toutes les formes de violence politique et d'hostilités, en accordant la priorité à la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants et des communautés marginalisées.
2. Soutenir les processus démocratiques : Nous plaidons pour un processus politique transparent, inclusif et véritablement démocratique qui permette aux citoyens mozambicains d'exprimer librement leur volonté politique par le biais d'élections crédibles et nous demandons instamment aux observateurs internationaux et africains de surveiller, d'examiner et de rendre publiques les conclusions des activités politiques, en particulier des élections, afin de s'assurer qu'elles sont exemptes de manipulations et d'intimidations. Nous demandons également la protection des femmes et des enfants, en particulier contre la violence et l'exploitation fondées sur le sexe, qui tendent à s'intensifier pendant les périodes de troubles.
3. Exiger du parti FRELIMO qu'il rende compte des violations des droits de l'homme et faire pression pour que des enquêtes indépendantes soient menées sur toutes les violations des droits de l'homme, signalées ou non, y compris les violences contre les femmes, les détentions arbitraires et la répression des manifestants pacifiques.
4. Promouvoir la paix et la réconciliation à long terme – encourager l'établissement d'un dialogue national impliquant la société civile, y compris les mouvements féministes de base et les groupes de femmes, afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit, telles que l'inégalité, la marginalisation économique et la corruption.
5. Exiger que tout processus de paix prenne en compte la voix des femmes et garantisse des réformes sensibles au genre qui donnent aux femmes les moyens d'agir politiquement et économiquement.
Nous appelons les mouvements féministes mondiaux et les mouvements sociaux qui leur sont alliés à s'unir en solidarité avec le peuple du Mozambique, en plaidant pour la paix, l'égalité des sexes et la justice face à l'adversité. Ensemble, nous marchons vers un monde où les droits des femmes et les droits de tous sont défendus et protégés.
Nous résistons pour vivre ; nous marchons pour transformer !
Marche mondiale des femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour un accès gratuit à la contraception

Les coûts élevés des contraceptifs constituent un obstacle majeur au Québec, surtout pour les personnes à faible revenu, selon la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). Bien que certaines méthodes soient partiellement couvertes par des assurances privées ou par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ces remboursements ne couvrent souvent que 70 à 80 % des frais, laissant un fardeau financier significatif pour plusieurs. Pour cette raison, le comité d'action féministe de la CSQ encourage la population à signer une pétition visant la gratuité des contraceptifs.
La FQPN incite le gouvernement provincial à suivre l'exemple de la Colombie-Britannique, qui offre depuis avril 2023 la gratuité de tous les moyens de contraception. En supprimant cet obstacle financier, le Québec permettrait à toutes et tous de choisir librement la méthode qui leur convient, sans contrainte budgétaire.
Puisque l'accès universel aux contraceptifs est un enjeu de justice sociale et d'égalité des genres, le comité d'action féministe encourage la population à signer et à partager la pétition lancée par la FQPN dans le cadre de sa campagne Révolution contraceptive : liberté de choix, égalité d'accès.

L’Université McGill se trouve sur le territoire ancestral des peuples Haudenosaunee

Préoccupées par le niveau de violence et la suppression de la liberté d'expression des étudiants au cours de la dernière année, les femmes de la nation Kanien'kehá:ka planteront un grand pin blanc sur le terrain du campus inférieur le dimanche 17 novembre à 11 h.
photo Serge d'Ignazio
Le grand pin blanc est un symbole de paix pour les nations Haudenosaunee.
En effet, l'objectif de la cérémonie est de promouvoir la paix et la justice en Palestine et dans le monde. La communauté de McGill a été invitée à assister à la cérémonie de paix Haudenosaunee, qui réunira des membres de la nation Kanien'kehá:ka, des défenseurs palestiniens et des membres de la communauté pour réfléchir et discuter de notre cause commune.
Avisés de l'intention des femmes Kanien'kehá:ka de planter cet arbre, les représentants de McGill les ont irrespectueusement écartés dans une lettre de trois phrases. Cette cérémonie est un geste pacifique important de la part des détenteurs reconnus du titre de propriété de ce territoire.
Des représentants seront disponibles pour répondre aux questions des médias le jour de l'événement.
Quand : Dimanche 17 novembre à 11 h
Où : Université McGill, terrain du campus inférieur, près des portes
Roddick
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Journée de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes

Lors de la journée de commémoration et d'action contre les violences faites aux femmes, après 35 ans de la tuerie de Polytechnique, les féminicides et les violences envers les femmes sont toujours aussi présentes, voir même en recrudescence ! Rappelons-nous des victimes et crions notre indignation ! Joignez-vous à nous afin de dire non aux violences patriarcales.
Venez nous rejoindre pour le départ de la marche au parc de l'Amérique-Française le vendredi 6 décembre à 12h. Nous nous dirigerons vers l'Assemblée-Nationale. Portez votre ruban blanc comme symbole des violences faites aux femmes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Plan de réduction des émissions de la #fonderiehorne - Mères au front de Rouyn-Noranda déplore que Glencore abandonne le projet AERIS

ères au front de Rouyn-Noranda se désole que Glencore, malgré des profits de plus de 4 milliards de dollars en 2023, n'aille pas de l'avant avec AERIS. Pour rappel, le projet AERIS existait avant le renouvellement de l'entente ministérielle de 2023 et visait un accroissement de la production et des profits. Ce projet est devenu le principal véhicule de la fonderie pour promettre une réduction des émissions.
Or, la multinationale considère maintenant que les coûts pour la mise sur pied du projet sont trop élevés et qu'elle n'ira pas de l'avant. Elle a également mis à pied des travailleurs et travailleuses, dont certain·es à Rouyn-Noranda.
Les Mères au front se questionnent sur ce que souhaite l'entreprise. On pourrait penser que cet abandon constitue une tactique pour recevoir plus de fonds publics ou encore obtenir un report des délais pour l'atteinte du 15ng d'arsenic prévu en mars 2028.
« Peu importe les moyens et le nom du projet, nous souhaitons avant tout que la fonderie Horne respecte les normes pour tous les contaminants le plus rapidement possible » déclare Isabelle Fortin-Rondeau Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié.e.s.
Ce que sont en droit de demander les citoyen·nes de Rouyn-Noranda, c'est un environnement sécuritaire et un air sain. Il n'est pas question que la population renonce à ces droits fondamentaux pour protéger les profits d'une multinationale.

S’unir pour être plus forts contre l’industrie minière

Jusqu'à dimanche, des Autochtones de partout au Canada et aux États-Unis se retrouvent à Montréal pour échanger, parler de leurs batailles, mais aussi de leurs solutions face à l'appétit grandissant de l'industrie minière sur leurs territoires. Allier leurs forces n'a jamais été aussi important dans l'actuel contexte politique nord-américain.
Ces rencontres, ponctuées d'un nombre conséquent de conférences, se tiennent à l'occasion de la biennale du Western Mining Action Network, un organisme américain fondé en 1997 et dont le but est d'œuvrer à la protection de l'eau, de la terre et des êtres humains contre les effets de l'extraction minière.
La membre de la communauté shoshone estime que les Autochtones seront les premiers à souffrir de la transition écologique.
Par ailleurs, Earl Hatley, de l'organisme américain LEAD qui lutte contre l'exploitation minière principalement dans trois États américains (le Missouri, le Kansas et l'Oklahoma), souhaite que les Autochtones puissent avoir un droit de veto sur les projets miniers.
Nous constatons que les gouvernements canadien et américain font pression pour exploiter les terres rares qui se trouvent pour la plupart sur les territoires autochtones. Nous demandons le droit de dire non. L'exploitation minière est éternelle et elle crée un héritage permanent pour nos communautés. Une citation de Earl Hatley
George Lameboy, originaire de la communauté crie de Chisasibi, a justement souligné le manque de renseignements et de consultations concernant les projets miniers. Et ce, même lorsqu'il s'agit de la phase d'exploration, alors que les dégâts que nous observons, rien qu'à cette étape, suffisent à réveiller les occupants des territoires visés, dit-il.
Plusieurs d'entre eux ont aussi rappelé que l'un des matériaux qui suscitent les convoitises, l'or, n'est pas essentiel. La plupart ne sert qu'à fabriquer des bijoux et des lingots, affirme Jaime Lopez Wolters, un allochtone qui travaille pour un organisme qui vise entre autres à protéger la vallée de Yosemite, en Californie.
Des appels au rassemblement ont aussi été formulés, notamment par Fermina Stevens. Mon appel s'adresse aux gens, au grand public, aux Autochtones et aux non-Autochtones, parce qu'en fin de compte, tout le monde sera concerné. Nous devons donc tous nous réunir à un moment ou à un autre et déterminer comment nous allons procéder.
Plusieurs conférences sont ainsi prévues à ce sujet : comment mobiliser les membres des communautés concernées, comment créer une coalition diversifiée, comment affronter un nouveau projet minier, etc.
C'est formidable de se réunir avec des gens qui ont les mêmes idées et qui luttent contre les compagnies minières aux États-Unis et au Canada, de partager des histoires et des stratégies pour atteindre notre objectif de protéger la terre, les gens et la culture contre ces compagnies minières, ajoute Jaime Lopez Wolters.
Rodrigue Turgeon, qui est avocat pour MiningWatch, mais aussi coprésident du réseau Western Mining Action Network, estime que ces rencontres entre Autochtones de partout en Amérique du Nord sont très importantes.
On peut bien venir en tant que Blancs, experts, leur expliquer certaines choses, mais de toute évidence, on n'arrivera jamais à transmettre l'information aussi efficacement que si elle est transmise par d'autres Autochtones, explique-t-il avant d'ajouter que ce rassemblement est aussi l'occasion pour ceux qui sont aux prémices d'une lutte contre un projet minier de bénéficier des leçons de ceux qui sont sur ce champ de bataille depuis de nombreuses années.
Un sentiment ressort aussi chez différents intervenants : ils estiment qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur la mobilisation citoyenne.
Et surtout, la récente élection de Donald Trump à la présidence américaine et la montée en popularité des conservateurs au Canada n'augurent rien de bon pour les militants venus à Montréal.
Je n'ai pas d'espoir que le gouvernement nous sauve, laisse tomber Fermina Stevens.
Je ne pense pas que Trump ait la moindre considération pour l'environnement ou les peuples autochtones. Et je pense que la situation va s'aggraver au cours des quatre prochaines années.
Une citation de Fermina Stevens
La seule chose qu'on peut faire pour ralentir [les projets miniers], c'est la mobilisation citoyenne, une opposition solide et structurée. On a compris que personne ne peut nous aider, il y a juste nous autres, ajoute Louise Gagnon, une citoyenne septilienne opposée au projet Strange Lake (nouvelle fenêtre), qui verrait la construction d'une usine de transformation de terres rares dans le secteur de Sept-Îles (nouvelle fenêtre).
Earl Hatley, lui aussi, croit en la force de la base, du mouvement grassroot.
Quant à George Lameboy, une lueur d'espoir traverse son regard. Il y a environ une semaine, je n'avais aucune idée de tous les mouvements qui existent à travers l'Amérique du Nord concernant l'exploitation minière. J'espère donc obtenir des contacts et créer des alliances, dit-il.

Le Québec s’engage à éliminer le gaz fossile des bâtiments d’ici 2040, mais doit éviter les fausses solutions

La coalition Sortons le gaz est heureuse de constater que, profitant de la COP 29, le gouvernement du Québec est enfin passé de la parole aux actes pour sortir le gaz d'origine fossile du secteur du bâtiment neuf et existant d'ici 2040. En fixant un horizon clair pour l'élimination des énergies fossiles dans tous nos bâtiments, le gouvernement envoie un signal fort aux marchés, à la population québécoise et à la planète entière. Toutefois, la coalition remarque que le gouvernement continue de s'embourber dans les pièges de la biénergie et du gaz de source renouvelable (GSR).
Cette victoire significative pour l'environnement démontre à nouveau la force de la mobilisation de la société civile québécoise et l'engagement croissant des municipalités en faveur de la sortie du gaz de nos bâtiments. L'ère fossile est bel et bien derrière nous », souligne Andréanne Brazeau, analyste principale des politiques à la Fondation David Suzuki.
« L'annonce d'aujourd'hui est d'une importance capitale, marquant un engagement déterminé du gouvernement dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Toutefois, il faudra faire preuve de vigilance pour que le recours au GSR ne devienne pas une béquille pour continuer d'alimenter le réseau en gaz fossile », note Charles-Edouard Têtu, analyste des politiques climatiques et énergétiques chez Équiterre.
Par son règlement, le gouvernement du Québec soutient l'ambition climatique des nombreuses municipalités qui, depuis deux ans, avaient déjà montré la voie à suivre et publié leurs propres règlements interdisant le gaz fossile dans les nouvelles constructions du secteur résidentiel (600 m2 et moins, 3 étages et moins), commercial et institutionnel. Il vient en plus lui donner une nouvelle ampleur, en s'attaquant également aux bâtiments existants, qui composeront toujours la grande majorité du parc immobilier du Québec en 2040. Il sera crucial que le règlement provincial permette aux municipalités de mettre en place des règlements plus ambitieux si elles le désirent.
Pour renforcer la cohérence de ce tournant, le gouvernement doit appuyer sa stratégie de décarbonation sur les solutions les moins émettrices de GES et les moins coûteuses telles que les thermopompes et les accumulateurs de chaleur. Ces alternatives sont également nécessaires pour éviter l'illusion d'une solution durable par le biais du GSR, laquelle, en réalité, retarde la transition vers des sources d'énergie véritablement renouvelables.
Enfin, comme la coalition l'a rappelé récemment, l'entente biénergie gaz/électricité s'annonce un échec et comporte plusieurs enjeux. « Pour arriver à éliminer 100 % du gaz fossile d'ici 2040, il ne suffit pas de l'interdire dans les nouveaux bâtiments. Le nerf de la guerre de cette transition, c'est le remplacement des systèmes au gaz en fin de vie. Ceux-ci doivent absolument être remplacés par des systèmes électriques, combinés à des programmes de gestion de la pointe et d'efficacité énergétique. Permettre leur remplacement par des systèmes utilisant du GSR, c'est vouer la population à dépendre d'une source énergétique dont les volumes seront très incertains et dont les coûts grimperont en flèche », ajoute Emmanuelle Rancourt, coordonnatrice de la coalition Sortons le gaz !
« Nous nous apprêtons enfin à unifier la sortie du gaz fossile du secteur des bâtiments neufs et existants. C'est une excellente nouvelle car c'est une solution qui va nous permettre de nous attaquer concrètement à 7 % des émissions de GES de la province. Par contre, il est clair que le gouvernement continue de se laisser guider par le mirage de la biénergie et du GSR. Or, nous n'aurons jamais la capacité de produire les volumes nécessaires de façon durable si nous nous entêtons à vouloir le gâcher dans le secteur résidentiel », rappelle Anne-Céline Guyon, analyste Climat-Énergie pour Nature Québec. »
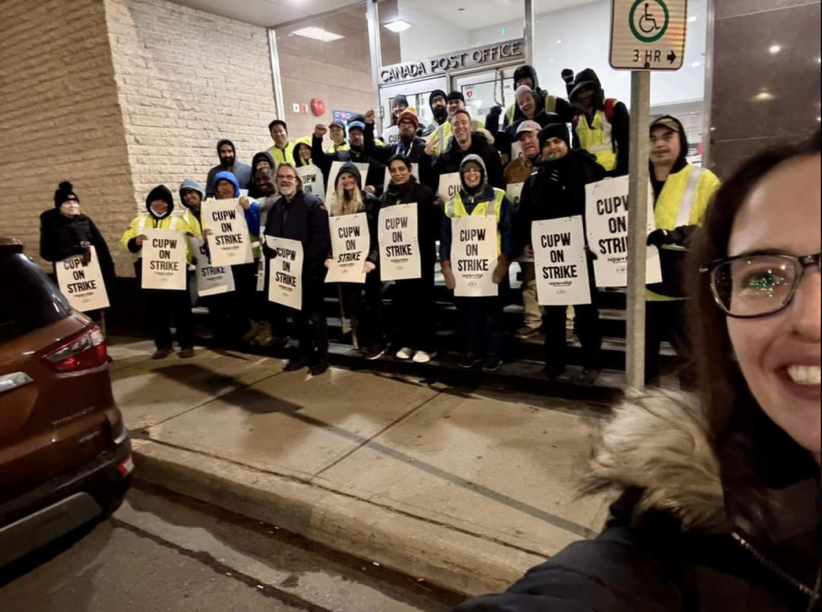
Attaque en règle contre les travailleuses et travailleurs des postes : Postes Canada impose de nouvelles conditions d’emploi aux membres des deux unités de négociation
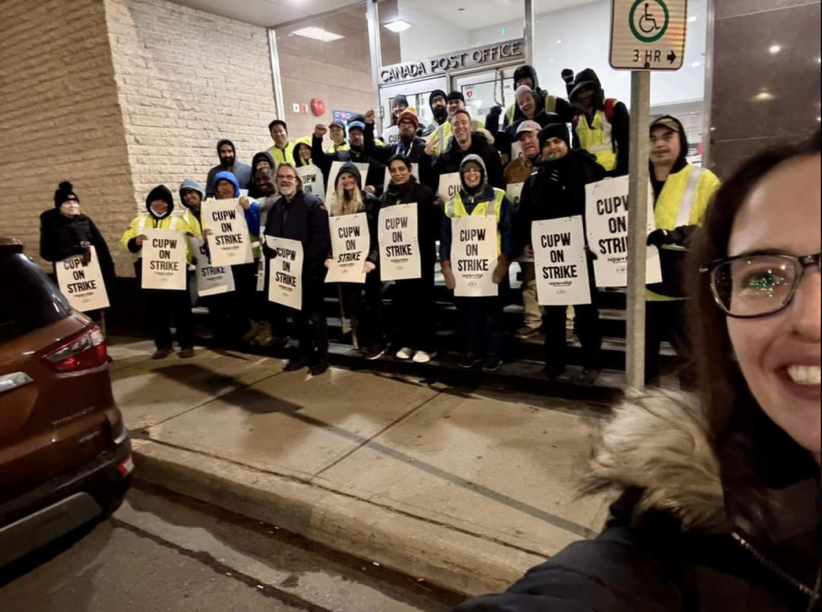
Aujourd'hui, vendredi 15 novembre, Postes Canada a informé le Syndicat qu'à partir de 8 h (heure de l'Est), les conventions collectives de l'unité urbaine et de l'unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) ne s'appliquent plus. Vous découvrez donc aujourd'hui ce que ferait Postes Canada s'il n'y avait pas de syndicat ni de convention collective pour vous protéger.
L'attaque de l'employeur comprend ce qui suit :
– Annulation de la protection du régime d'assurance-invalidité de courte durée et de tous les régimes de soins de santé, pour vous et les membres de votre famille. Évidemment, ce sont les membres les plus vulnérables qui en pâtiront le plus. Ne l'oubliez pas lorsque l'employeur vous appellera « collègue ».
– Menace de « mettre à pied » certains employés et employées « permanents », de mettre fin à toutes les affectations des employées et employés temporaires et de réduire les heures de travail des employées et employés à temps partiel.
– Annulation des indemnités. Postes Canada n'a pas précisé quelles indemnités elle verserait. Celles-ci pourraient comprendre, entre autres, la prime de quart. Elle met également fin à la rémunération au taux double des heures supplémentaires.
– Annulation des congés annuels acquis et convenus. Postes Canada a déjà tenté de le faire dans le passé et un arbitre lui a dit qu'il s'agissait d'une violation du Code canadien du travail.
Bien que Postes Canada refuse d'honorer les congés annuels, en violation du Code, elle affirme qu'elle se conformera au minimum permis pour les autres congés. Si Postes Canada n'honore pas tous les congés prévus au Code canadien du travail, veuillez en aviser votre section locale.
Le Syndicat ne pouvait pas laisser ses membres exposés à de telles conditions. Postes Canada a montré ses vraies couleurs. L'employeur n'est pas votre ami.
Pour obtenir des mises à jour sur les négociations et d'autres nouvelles du Syndicat par courriel, abonnez-vous à Somm@ire : www.sttp.ca/fr/sommaire-sttp.
Solidarité,
Jan Simpson
Présidente nationale

Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades : corriger des injustices

Nous vous transmettons ce message au sujet de la campagne que l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) vient de lancer pour corriger deux injustices qui appauvrissent les victimes de lésions professionnelles.
Le 15 octobre dernier, nous avons transmis une lettre à Jean Boulet, ministre du Travail, pour dénoncer :
– L'indemnisation sous le salaire minimum de plusieurs victimes parce que l'indexation qu'applique la CNÉSST ne suit pas les hausses du salaire minimum ;
– L'appauvrissement à la retraite que subissent toutes les victimes de lésions professionnelles parce que la CNÉSST ne verse pas les cotisations au RRQ.
Nous demandions au ministre Boulet des changements sur ces deux enjeux. N'ayant pas eu de réponse satisfaisante, nous lançons aujourd'hui une campagne de messages aux députés !
Ce que vous pouvez faire pour soutenir nos revendications :
À titre individuel, nous vous invitons à vous rendre ici : https://uttam.quebec/appauvrissement/lettre/index.php, à cliquer sur « Envoyez un message à votre député-e » et à suivre les instructions pour l'envoi du message par courriel.
Comme organisation, vous pouvez signifier votre appui formel à notre campagne et à nos revendications, en inscrivant cet appui ici. Nous vous ajouterons à la liste des groupes qui nous appuient.
Évidemment, nous vous encourageons fortement à inviter vos membres, vos contacts ou les gens qui sont sur vos listes de diffusion à envoyer un message à leur député, en diffusant le lien ! Pour une telle diffusion, nous vous suggérons un message, plus bas dans le présent courriel, que vous pouvez copier-coller et adapter librement.
Pour plus d'informations sur nos revendications et les enjeux de cette mobilisation, consultez le site de la campagne : https://uttam.quebec/appauvrissement/index.php
Merci de votre solidarité !
uttam
2348 rue Hochelaga
Montréal (Québec) H2K 1H8
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les syndicats du Canada exigent le respect des travailleurs portuaires et des négociations équitables, sans ingérence politique

La décision prise aujourd'hui par le ministre du Travail Steven MacKinnon de mettre fin aux lock-out dans les ports de la Colombie-Britannique, de Montréal et de Québec et d'imposer l'arbitrage obligatoire est une mesure troublante qui sape les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses en plus de souligner l'injustice économique croissante dans notre pays.
Les travailleurs et les travailleuses sont laissés pour compte alors que les entreprises engrangent des profits records ; c'est tout simplement injuste.
Trop de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs portuaires, mais d'un système économique dans lequel le fossé entre les riches et les travailleurs ne cesse de se creuser.
Les travailleurs et les travailleuses se battent pour des salaires équitables, une sécurité de l'emploi et des lieux de travail sécuritaire – des droits fondamentaux qui ne devraient jamais faire l'objet d'un débat.
Personne ne prend à la légère la décision d'être en grève ou d'endurer un lock-out.
Cependant, leurs choix sont limités lorsque les employeurs refusent de s'engager dans des négociations équitables, en particulier lorsque ces mêmes employeurs ont bénéficié de profits exceptionnels pendant la pandémie.
Malgré les profits records qu'ils ont réalisés pendant la pandémie, les employeurs portuaires refusent toujours de s'engager dans des négociations de bonne foi, poussant les travailleurs au bord du gouffre.
Aujourd'hui, en recourant à l'arbitrage obligatoire en vertu de l'article 107, le gouvernement envoie un message dangereux : les employeurs peuvent contourner des négociations sérieuses, mettre leurs travailleurs en lock-out et attendre une intervention politique pour obtenir un accord plus favorable.
L'imposition d'un arbitrage contraignant ou d'une législation de retour au travail porte atteinte au droit des travailleurs à la négociation collective, ce qui affaiblit leur capacité à lutter pour des salaires équitables et des lieux de travail sûrs.
L'ingérence politique fait pencher la balance du côté des employeurs et crée un dangereux précédent. Les syndicats canadiens estiment que les solutions durables sont le fruit de négociations équitables, et non d'accords imposés par le gouvernement. Le gouvernement doit laisser la négociation collective suivre son cours pour protéger les droits de tous les travailleurs.
Les travailleurs portuaires demandent simplement ce qu'ils méritent : des salaires équitables, la sécurité de l'emploi et des conditions de travail sûres. Ces demandes ne sont pas déraisonnables, d'autant plus que les employeurs ont engrangé des gains financiers extraordinaires au cours des dernières années.
Les syndicats du Canada sont unis pour demander au gouvernement de respecter le Code canadien du travail et de permettre un processus de négociation collective équitable qui respecte les travailleurs et garantit qu'ils reçoivent leur juste part à une époque où les entreprises réalisent des profits records.
Les travailleurs méritent un accord équitable, et la seule façon de parvenir à une stabilité durable est le respect mutuel et les négociations de bonne foi.
Les travailleurs ne demandent pas la lune, ils demandent leur juste part à une époque où les entreprises sont extraordinairement riches. Le gouvernement doit prendre une décision : sera-t-il aux côtés des travailleurs ou continuera-t-il à faire pencher la balance en faveur de ceux qui en ont déjà plus qu'il n'en faut ?

L’art pour visibiliser les récits palestiniens

L'exposition P pour Palestine rassemble les œuvres de huit artistes d'origine palestinienne. Le projet est présenté au centre d'exposition Plein Sud à Longueuil, et cherche à rendre visibles des récits peu présents dans l'espace artistique et médiatique.
Tiré d'alter.quebec
Dans un contexte où les « voix palestiniennes sont souvent censurées ou peinent à se faire entendre », les commissaires Ariane De Blois et Muhammad Nour ElKairy ont voulu mettre en lumière le travail d'artistes d'origine palestinienne. Les douze œuvres présentées à Plein Sud ont été choisies pour leur rapport au langage, thématique centrale de l'exposition.
« L'exposition part du principe que le langage est politique », explique Ariane De Blois dans une entrevue pour Plein Sud. Les œuvres exposées utilisent en effet le langage comme moyen de visibilisation des réalités palestiniennes, s'interrogeant sur des questions telles que l'identité, la terre, l'exil, et le génocide.
Le langage prend toutefois des formes différentes selon les œuvres : manuscrit, numérique, audio, vidéo… On retrouve par exemple l'œuvre What the actual fuck ? de l'artiste Amal Al Nakhala, un journal de guerre mêlant texte et croquis sur les déplacements forcés qu'elle a subi avec ses proches. Il y a aussi l'œuvre Vibrations de Gaza, dans laquelle Rehab Nazzal filme des enfants sourds racontant les bombardements des forces israéliennes. Dans un autre registre, un extrait du livre Les racistes n'ont jamais vu la mer de Yara El-Ghadban est affiché.

Au niveau sonore, on entend dans la salle d'exposition des bruits de drones militaires et d'un clavier numérique en train d'être tapé, provenant de deux œuvres distinctes. Une ambiance qui mêle les sonorités de la guerre et de l'écriture, plongeant le public dans la problématique portée par l'exposition. Quant à la disposition des lieux, la salle d'exposition unique permet d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les œuvres, et de s'y déplacer dans le sens souhaité. L'espace a été pensé comme une « agora », un « lieu de rencontres » autour des voix et des imaginaires palestiniens, selon les termes des commissaires d'exposition.
Un contexte particulier
Les locaux de Plein Sud étant situés dans le Cégep Édouard Montpetit, l'exposition accueille beaucoup d'étudiant·es. La directrice générale de Plein Sud, Hélène Poirier, juge cet emplacement dans un milieu scolaire « vraiment intéressant », étant donné la « mission éducative » de l'art contemporain, parfois trop isolé et réservé à une « petite élite ». Les professeur·es font également partie des visiteurs, ainsi que les amateur·ices d'art contemporain. Des groupes de nouveaux arrivants en francisation avaient aussi l'habitude de se rendre à l'exposition, mais les visites ont finalement été annulées en raison d'une « charge émotionnelle trop forte ».
C'est « la première fois qu'une de nos expositions est autant d'actualité », selon Hélène Poirier. Bien que l'art contemporain traite de plus en plus de questions sociopolitiques, P pour Palestine s'inscrit dans un contexte géopolitique et médiatique rare pour une exposition.
L'exposition P pour Palestine se tient jusqu'au 14 décembre au centre d'exposition Plein Sud à Longueuil, et en simultanée au centre d'artistes L'Œil de Poisson, à Québec, jusqu'au 15 décembre

Artistes pour la Souveraineté Alimentaire. Édition Nyéléni : « La Transformation Systémique, c’est MAINTENANT ou JAMAIS ! »

En avril 2025, lors du 3e Forum Global Nyéléni – l'événement le plus important du mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire, la transformation systémique et la justice pour tou·tes – la Galerie Virtuelle Nyéléni sera lancée comme un espace pour les artistes engagé·es dans les luttes populaires.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Rejoignez la Lutte !
Jusqu'à présent, le processus Nyéléni a rassemblé des producteurs·trices alimentaires à petite échelle, y compris des paysan·nes, des pêcheur·es et des pastoralistes, ainsi que des Peuples Autochtones, des groupes féministes, des communautés racisées, des universitaires et des défenseur·euses des droits humains du monde entier. Il est temps de renforcer nos alliances et d'unir nos forces avec celleux qui résistent à l'oppression du système.
Appel aux Artistes !
Nous invitons les artistes de tous horizons à soumettre leurs œuvres sous divers formats avant le 31 janvier 2025, dans le cadre de l'« Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni. » Cette année, notre objectif est d'élargir l'appel pour englober les luttes interconnectées pour la justice globale et la transformation systémique, en soulignant que l'art et la culture sont des formes vitales de résistance et d'activisme. La galerie virtuelle Nyéléni s'inscrit dans et élargit le projet initié par La Vía Campesina (2021) et sera présentée lors du 3e Forum Global Nyéléni en 2025 .Les œuvres sélectionnées seront cruciales pour notre défense et notre mobilisation, suscitant la réflexion collective et remettant en question les narrations dominantes.
L'Intersectionnalité du Processus
Cet appel aux artistes vise à renforcer nos convergences en tant que mouvements sociaux revendiquant la souveraineté alimentaire, la protection de nos territoires et de nos corps, les droits des travailleur·euses, les droits des Peuples Autochtones, des consommateur·trices et des petit·es producteur·trices, ainsi que les luttes pour la justice climatique et environnementale, les économies sociales et solidaires, la paix avec justice sociale, la santé et le logement pour tou·te – dans les contextes ruraux comme urbains. Voici notre défi pour le 3e Forum Mondial Nyéléni : lorsque nous nous rencontrerons, il sera temps de tracer ensemble des agendas et des stratégies communes pour stopper les crises globales provoquées par ce système capitaliste, colonial et patriarcal. Avec l'art et la culture comme outils de lutte, nous sommes convaincu·es que nous pouvons favoriser le dialogue nécessaire pour avancer vers une transformation systémique, sans laisser personne de côté.
La Culture et Notre Lutte
Tout comme l'alimentation, le logement et la santé sont des droits fondamentaux, la culture l'est également, et elle est même un puissant outil de protestation. À travers elle, nous défions les fausses narratives soutenues par les gouvernements néolibéraux et néocoloniaux, ainsi que par leurs multinationales de l'agrobusiness et de l'extractivisme.
Pour mieux comprendre le lien entre la culture et nos luttes, examinons la racine du mot « culture », qui provient du verbe « cultiver ». À l'origine, cela désignait le travail humain en relation avec la nature – comment les gens plantaient, récoltaient et produisaient pour satisfaire leurs besoins. Au fil du temps, « culture » a évolué pour englober la culture de l'âme et des sens, liée aux pratiques artistiques. Cependant, elle a toujours maintenu son lien avec la nature et les liens humains essentiels.
Face à une logique capitaliste qui privilégie les profits au détriment de la vie, nos luttes s'élèvent, défendant la reproduction de la vie, embrassant les formes populaires, la diversité culturelle et le pouvoir transformateur des peuples.
Artistes, faites résonner votre voix !
L'« Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni » invite une large gamme de productions sous divers formats : chansons, clips musicaux, poèmes, peintures, photographies, illustrations, documentaires, podcasts, etc. Après la date limite de soumission, le 31 janvier 2025, les matériaux seront sélectionnés pour une exposition virtuelle en avril 2025.
Ceux-ci seront également présentés lors d'une exposition physique durant le 3e Forum Global Nyéléni. Pour soutenir le processus créatif, nous proposons cinq axes thématiques pour les soumissions, qui peuvent être des œuvres originales ou des créations antérieures alignées avec ces thèmes :
Les défis qui nous unissent : Le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, la militarisation et le patriarcat exploitent nos vies et ravagent nos territoires. Ensemble, nous brandissons la souveraineté alimentaire et la justice comme des armes de résistance et de transformation systémique, forgeant un monde où la vie fleurit et où la dignité est non négociable.
Notre chemin commun est de forger le Pouvoir Populaire : Cela implique d'assurer la souveraineté alimentaire, le droit des peuples à des aliments sains produits de manière durable et respectueuse des cultures et de l'environnement. Il s'agit de permettre aux communautés de décider de leur propre alimentation et d'assurer leur accès aux semences, à l'eau, aux terres et aux communs essentiels à la reproduction de la vie. Grâce à des pratiques agroécologiques, nous restaurons les sols et protégeons nos écosystèmes, contribuant à refroidir la planète. Le pouvoir populaire est aussi notre voie pour lutter contre le racisme, la discrimination et revendiquer des réformes agraires, les droits des communautés autochtones, paysannes, de pêcheur·euses, pastoralistes et de la diversité de genre, tout en promouvant des économies solidaires et garantissant une santé et un logement universels pour une véritable transformation systémique.
Solidarité et Justice : Nous défendons celleux qui protègent la vie sur nos territoires, luttant contre la marchandisation et financiarisation des droits fondamentaux et plaidant pour la justice sociale, de genre, climatique, environnementale, économique, fiscale, alimentaire, agraire, territoriale, de santé, migratoire, criminelle, du travail, interculturelle, politique et dans toutes ses formes.
Féminisme, Jeunesse et Diversités : Ces luttes garantissent la justice de genre, l'accès équitable aux communs, protègent la diversité de genre, de race et d'ethnicité, et restaurent le lien vital entre l'humanité et la nature. Il est crucial de mettre en avant leurs rôles interconnectés dans notre mouvement pour la transformation systémique.
Gouvernance Communautaire et Souveraineté Populaire : Les communautés ont démontré qu'il est possible d'adopter une forme alternative de gouvernance qui valorise la vie communautaire, l'environnement et la dignité de tous les peuples. Cette approche nécessite le développement et la mise en œuvre de politiques publiques qui s'alignent sur les luttes de base, basées sur des principes de droits humains, et incluent des systèmes alimentaires centrés sur les producteur·trices et les consommateur·trices, l'autogouvernance des Peuples Autochtones, la démocratie et la participation directe, la santé et le logement universels, l'autonomie financière de nos mouvements, et plus encore. Ce système nous a tous failli, mais nous avons toujours été – et continuons d'être – la solution.
L'Art comme Force de Transformation !
L'art a longtemps été une force vitale dans les luttes pour la justice, l'accès aux communs et la production alimentaire durable – se manifestant par des chansons collectives, des anniversaires, des rituels et des assemblées. Tout au long du processus Nyéléni, l'art a été un puissant vecteur de libération, entrelaçant nos histoires et nos aspirations. Nous avons besoin de productions artistiques qui visualisent et amplifient ces luttes, impulsant la convergence de nos mouvements populaires.
Les œuvres sélectionnées seront des outils puissants pour diffuser notre message et construire une formation politique en vue du 3e Forum Global Nyéléni en 2025. Elles uniront des efforts pour transformer le système hégémonique, garantissant la vie pour la nature et les générations futures, tout en rompant les chaînes de l'aliénation et de l'individualisme imposées par les médias de masse et les grands intérêts économiques en jeu.
Nous appelons à l'Action !
Envoyez vos propositions artistiques avec l'objet « Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni » à communications@foodsovereignty.org, en incluant les informations suivantes :
Titre de l'œuvre et l'axe thématique choisi
Nom complet de l'artiste
Pays
Optionnel : Organisation et profils sur les réseaux sociaux
Langue : Nous acceptons des œuvres dans les langues coloniales comme l'espagnol, l'anglais et le français, mais nous accueillons avec enthousiasme les langues locales, tant qu'elles incluent des traductions.
Formats : Vidéo, audio, Word, JPG ou PDF, sans filigrane.
Les représentant·es du processus Nyéléni valideront la sélection et la curation des œuvres artistiques pour la galerie virtuelle du 3e Forum Global Nyéléni, qui seront également incluses dans un catalogue numérique avec les crédits appropriés. Ces œuvres seront partagées avec les mouvements et les organisations sociales de notre processus afin de soutenir la sensibilisation et la mobilisation. Nous invitons les artistes à incarner la solidarité et l'internationalisme dans leur art, renforçant ainsi les luttes du peuple.
« La Transformation Systémique,
c'est MAINTENANT ou JAMAIS ! »
FR Appel aux artistes Nyéléni : Télécharger
https://viacampesina.org/fr/artistes-pour-la-souverainete-alimentaire-edition-nyeleni-la-transformation-systemique-cest-maintenant-ou-jamais/
Call for Artists for Food Sovereignty – Nyéléni Edition | Systemic Transformation is NOW or NEVER !
https://viacampesina.org/en/call-for-artists-for-food-sovereignty-nyeleni-edition-systemic-transformation-is-now-or-never/
Llamado Internacional : Artistas por la Soberanía Alimentaria – Edición Nyéléni : “¡La Transformación Sistémica es AHORA o NUNCA !”
https://viacampesina.org/es/llamado-internacional-artistas-por-la-soberania-alimentaria-edicion-nyeleni-la-transformacion-sistemica-es-ahora-o-nunca/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les animaux se dotent de l’arme nucléaire !

( En Afrique, au plus profond bunker de l'Histoire, se tient un Conseil de Guerre du règne animal)
– Chuuut ! j'entends un bruit, prévient la fourmi
- Vas -y- ! assure l'Okapi, c'est le forage de Total Energies
- Il va bousiller toutes nos galeries, dit le Fennec, ébahi.
- Ne vous laissez pas distraire ! rugit le Lion, l'heure est grave, continue - fourmi !
- Chuuut ! j'vous dis ! ce fracas sourd nous annonce de gros ennuis.
– Elle a raison la fourmi, avertit le casoar, le regard ahuri.
(Instant de silence pesant. Et soudain ! Une ombre étrange s'encastre dans l'embrasure de l'entrée de l'abri…)
- Aaaah ! ça fait du bien de se délester des ruines des merveilles de la cuisine, se libère l'hippopotame, Dember.
– Espèce d'idiot ! tu nous as foutus une sacrée trouille avec ta détonation scatologique ! grogne le plus puissant gorille de la Terre.
– Mes excuses, les Amis (es).
– On n'est pas en Ukraine ni au Moyen-Orient, Ya Baghaloune* ! s'offusque la vipère d'Orsini.
– Mais quelle andouille, ce lourdaud ? Faut l'virer du Conseil ! ordonne l'hyène, Dent'si
- La dernière fois que t'as baillé, t'as fait fuir tous les poissons de l'Ogooué, renchérit le Wapiti
- Il y va de notre survie, mugit le calao bicornis
– La prochaine fois, peste Wing, le Panda de Qinling, ne rapplique pas avec des Pampers, mais des feuilles de Raphia Regalis, t'as saisi ?
(Furieux, le lion tape de la patte sur la table )
– Plus jamais ça ! compris ? Il y a les guerres, la domination, la misère, les profits…
– Pourquoi tu rigoles, souris ?
- Vous n'allez pas me croire, chers (es) congénères. Le monde est à une encablure d'une guerre nucléaire, et présentement se tiennent les Journées mondiales des Toilettes à Paris !
( Tonnere de rires nourris)
- Ha, ha, ha, ha ha !
- Je vous jure que c'est vrai ! demandez à notre rapporteur, le Lama ?
- C'est l'exception française ! « La frensh touch 2024 ! »... Toz ! (Pardon) la COP 29 pour le climat !
- Assez rigolé ! enjoint le lion, la parole est de nouveau à la fourmi :
– Merci ! Chers (es) Congénères. Par mesures de confidentialité, je me vois dans l'obligation d'être concise. Chacun (e) de nous ici présent (e) peut se figurer l'ampleur de la démence qui s'empare de l'Humanité. En fissurant l'atome, l'Homme a rédigé le testament de son Apocalypse. La prolifération des armes de destruction massive, a le vent en poupe. Environ 12 121 ogives nucléaires se baladent dans le monde. Les 9 puissances s'en enorgueillissent impudemment.
Le risque de notre disparition par effet d'ineptie, est effectif. Face à ce paradigme démentiel, le Conseil de Guerre animalier a fait appel à notre éminence grise, le Corbeau calédonien Stein-Ein, réputé pour son intelligence. Sa découverte va donner des sueurs froides à nos ennemis (es).
La mise au point de cette technologie anticipatrice tournera en ridicule l'IA des Super Puissances.
Des années de recherche de Stein-Ein, se sont couronnées par un succès plus que « nobélisable ».
Je vous invite à vous lever en ce moment solennel pour l'annonce de la nouveauté révolutionnaire !
A vous de conclure honorable Corbeau calédonien :
- « Plus jamais, notre destin ne sera mis en péril ! A tous (es) mes congénères, je leur dis ceci :
Le mal est banni ! Notre arsenal nucléaire a une longueur d'avance. Il est truffé d'un système innovant déroutant : La « D.P.P.S » Détection Préventive de la Pensée Subversive ! Explicitement, dès que la pensée germe dans le cerveau de notre agresseur, notre système se déclenche automatiquement » .
– Waaaouh ! Ils vont faire dans leurs frocs, les Amerlocs ! murmure l'adorable Steenbock.
Texte et dessin : O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
* Ya Baghaloune : Espèce de bourricot, mule, pour caricaturer l'ignorance de quelqu'un en langue arabe dialectale.

Comptes rendus de lecture du mardi 19 novembre 2024

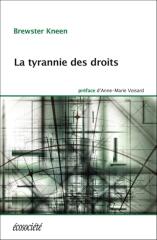
La tyrannie des droits
Brewster Kneen
Traduit de l'anglais
C'est mon deuxième bouquin de Brewster Kneen. Le premier, écrit en 2000, portait sur les aliments trafiqués - les OGM. La tyrannie des droits est encore une fois un essai qui porte à réfléchir, et cette fois particulièrement pour les gens de la gauche dont les "droits" desservent bien souvent les objectifs. Remettant en question le prétendu universalisme des droits de la personne, Kneen cite plusieurs exemples de sociétés non occidentales où la notion même de droit individuel est absente, au profit d'un langage de la responsabilité à l'égard d'autrui. Un livre à lire.
Un extrait :
Au Québec, la judiciarisation de la grève étudiante de 2012 a offert une triste illustration de la contamination du politique par le droit et du droit par les logiques du marché, alors que les tribunaux ont très largement interprété le droit à l'éducation comme le droit individuel de voir respecter le contrat unissant un client qui achète des services d'enseignement - et ultimement un diplôme - à une institution qui les lui prodigue. Ils battaient ainsi en brèche une vision collective du droit à l'éducation, comprise comme les fragiles conditions sociales et politiques assurant un accès universel à une éducation de qualité, notamment par l'instauration progressive de la gratuité.
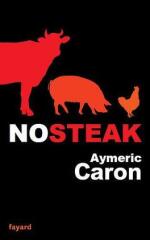
No steak
Aymeric Caron
Ce livre est un vibrant plaidoyer en faveur du végétarisme, d'abord pour des raisons éthiques, mais aussi, de façon réaliste, pour des raisons de survie. Nous ne pouvons continuer de tuer des animaux en aussi grand nombre - et à les faire souffrir comme nous le faisons - sans considérer l'impact de cette pratique sur l'environnement. Nos ressources en terres et en eau ne suffiront plus à ce mode de consommation dans quelques décennies. On sait aussi aujourd'hui, fait non négligeable, que les élevages sont responsables de 18 % de la totalité des gaz à effet de serre. C'est selon l'auteur plus que l'ensemble des transports de la planète, qui sont eux responsables de 14 % de ces gaz à effet de serre.
Un extrait :
La consommation sans cesse croissante de viande aurait, paraît-il, un effet très positif : celui de lutter contre la faim dans le monde. Cette croyance est non seulement naïve, mais même carrément fausse. Depuis trente ans, tandis que la consommation de viande explosait, le nombre de personnes sous-alimentées a doublé. On estime qu'actuellement un milliard de personnes souffrent de malnutrition, et qu'un enfant meurt toutes les six secondes par manque de nourriture.
Le facteur Armageddon
Marci McDonald
Traduit de l'anglais
Armageddon, terme biblique, est un lieu symbolique du combat final entre le Bien et le Mal. Cette vision manichéenne du monde est celle d'une droite chrétienne déconnectée de la chrétienté moderne et de la réalité, droite qui était et demeure incarnée politiquement chez nous par le Parti conservateur du Canada. « Le facteur Armageddon » nous décrit cette influence croissante de la droite religieuse, en passe de devenir une force politique durable, avec ses politiques belliqueuses, misogynes, homophobes, liberticides, antidémocratiques et inégalitaires. Il nous rappelle aussi l'importance d'élire un autre parti que le Parti conservateur du Canada lors des prochaines élections fédérales.
Extrait :
Ce mouvement nationaliste en pleine croissance tire son énergie de la foi de ses membres, convaincus que la fin des temps annoncée dans l'Apocalypse est proche. Parés pour une fin du monde imminente, ils se donnent le devoir d'assurer au Canada un rôle unique, prescrit par les Écritures, en ces jours précédant le second avènement du Christ - et leurs idées s'arrêtent à peu près là. Cette obsession pour les préparatifs des derniers jours explique probablement pourquoi un millier de jeunes évangélistes ont pu se rassembler à Stanley Park, à Vancouver, en lançant des appels passionnés pour la fin de l'avortement et des relations sexuelles avant le mariage, tout en ignorant les dangers des changements climatiques. Pour eux. l'essentiel de l'évangélisme consiste à sauver les âmes pour la moisson finale, plutôt que de combattre les dangers qui menacent un monde de toute façon condamné.

Les Patriotes de 1837-1838
Laurent-Olivier David
« Les Patriotes de 1837-1838 », écrit un peu plus de quarante ans après les événements, possède toute la saveur de l'écriture et de la culture de l'époque. Ceux qui ne connaissent cette page essentielle de notre histoire qu'à travers le très beau film « 15 février 1839 » du réalisateur Pierre Falardeau adoreront ce bouquin qui nous ressemble et nous rassemble tellement. Un livre pour les amis de la liberté...
Extrait :
De toutes les assemblées publiques qui précédèrent l'insurrection, celle de Saint-Charles fut la plus importante. Elle précipita le dénouement en activant l'agitation et en décidant les autorités à intervenir. C'était l'assemblée des six fameux comtés confédérés de Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de Verchères et de l'Acadie. Papineau, O'Callaghan , les chefs les plus distingués et les orateurs les plus populaires de la cause libérale y avaient été invités.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ukraine, mettre les compteurs à l’heure Trump

La « géopolitique » des États-Unis de Trump sera celle de « MAGA » — Make America Great Again — selon une logique à dominante dite « isolationniste ». Quelle y sera la place de l'Ukraine et de la guerre qui la ravage ?
Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)
Par Catherine Samary
Contrairement à d'autres guerres dont les États-Unis ont dû se retirer, la guerre en Ukraine n'est pas perçue aux États-Unis comme « leur » guerre. Trump n'est pas « concerné » par les « valeurs » hypocritement mises en avant par Biden pour « aider » l'Ukraine (tout en lui interdisant de viser des sites militaires russes d'où partent les missiles qui frappent les infrastructures et la population ukrainienne).
Trump ne se soucie pas non plus le moins du monde de critiquer le double langage de son prédécesseur en confrontant ces « valeurs » à la politique génocidaire d'Israël. Le racisme de Trump, envisageant d'interdire des vols amenant aux États-Unis des populations de pays arabo-musulmans, ne peut que conforter sa politique prosioniste.
Les intérêts matériels des USA d'abord
Ce sont des intérêts matériels perçus comme positifs pour son pays qui comptent à ses yeux. Même les rapports de connivence avec Poutine et la pénétration de la sphère trumpiste par la mafia et les services de sécurité russes n'impliquent aucune certitude.
Somme toute, il n'y a vis-à-vis de la Russie ni l'évidence d'une « nouvelle guerre froide » ni celle d'une quelconque amitié indéfectible (comme le disent les Chinois, non sans hypocrisie). Pas plus que le financement de l'Otan par les États-Unis trumpistes n'est assuré, l'aide à l'Ukraine ne fait partie d'une quelconque « obligation » politico-morale pour Trump et la population qui le soutient.
Un internationalisme par en bas nécessaire
Si l'aide des États-Unis baisse ou s'arrête, cela souligne combien sont importantes les tâches d'un internationalisme par en bas en lien avec les associations progressistes ukrainiennes, urgentes et essentielles. Car sous une forme ou une autre la résistance ukrainienne contre le pouvoir grand-russe se poursuivra — y compris par une guérilla permanente après un « cessez-le-feu » contraint. Pour une raison simple : la guerre est d'abord et avant tout une agression de la Russie contre l'Ukraine, niant son existence nationale et indépendante. Telle est sa nature fondamentale — et non pas un « proxy » de la géopolitique.
L'aide reçue des grandes puissances est limitée, fluctuante selon qui gouverne, et toujours « conditionnée » à des intérêts qui ne sont pas ceux d'une Ukraine indépendante et démocratique. Et c'est pourquoi notre solidarité implique d'abord une vigilance — rendue concrète et possible par notre indépendance envers tous « nos » gouvernements pour qu'aucune aide ne soit conditionnée par des politiques néolibérales. De même, nos camarades ukrainieNEs, au sein de la résistance contre la guerre, contrôlent toute concession « néolibérale » du pouvoir Zelensky contre une aide occidentale.
Une solidarité concrète
C'est pourquoi nous sommes pleinement en accord avec nos camarades de la gauche ukrainienne et à leur côté : leurs déclarations et actions depuis l'invasion russe expriment une lutte sur plusieurs fronts. Elle s'adresse au gouvernement ukrainien en toute indépendance critique, pour souligner, comme le fait O. Kyselov, que « la force principale » du pays contre l'agression russe « est intérieure ». Leurs appels soulignent — pour que la résistance soit efficace contre l'agression — l'importance d'une transparence égalitaire des conditions de la mobilisation.
Face à « nos » gouvernements, dont nous ne cessons de combattre les politiques réactionnaires, nous devons nous appuyer sur les pressions « politico-morales » en faveur de la résistance ukrainienne à une guerre d'agression pour relayer, avec nos camarades ukrainienNes, des demandes concrètes : l'annulation de la dette ukrainienne ; l'accueil de touTEs les réfugiéEs ; et face aux incertitudes de l'aide venant des États-Unis à l'Ukraine, l'envoi à ce pays de l'aide matérielle, militaire, financière qui lui permette d'affronter les missiles russes et l'hiver, alors que la moitié de ses infrastructures d'énergie ont été bombardées. Les liens directs avec les organisations progressistes, politiques, syndicales, féministes de la résistance ukrainienne sont établis depuis le début de la guerre via des réseaux solidaires. Les tâches d'un internationalisme par en bas sont plus que jamais essentielles.
Catherine Samary
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur l’armement de l’Ukraine et la lutte contre le militarisme

Le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (ENSU) a dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine dès le début et soutient pleinement le droit ukrainien à l'autodéfense. La résistance armée du peuple ukrainien est juste. Elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une agression militaire de l'OTAN, des États-Unis ou de tout autre pays occidental, mais constitue une défense contre l'objectif de guerre déclaré du président russe Vladimir Poutine : reconquérir le « monde russe » fictif prétendument perdu lors de la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Puisque la résistance armée de l'Ukraine est légitime, tous les États qui se considèrent comme démocratiques et respectueux des relations internationales régies par le droit ont la responsabilité d'aider le peuple ukrainien à vaincre l'invasion russe.
30 octobre 2024
L'ENSU demande donc à tous les gouvernements opposés à l'agression illégale de la Russie (qu'ils soient ou non membres de l'OTAN) de fournir à l'Ukraine les armes, les munitions et le soutien financier nécessaires pour expulser les forces d'invasion du territoire internationalement reconnu du pays.
Dans le même temps, la déclaration fondatrice de l'ENSU définit son orientation générale comme anticoloniale et opposée au « militarisme et à la concurrence impérialiste pour le pouvoir et le profit qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques ». Comme les peuples pacifiques de tous les pays, nous ressentons l'urgence absolue de mettre fin à la rivalité des grandes puissances, au militarisme meurtrier et à la dévastation de l'environnement qu'elle engendre.
Apporter à l'Ukraine le soutien nécessaire pour vaincre la grande puissance russe qui s'est emparée de son territoire, a détruit ses infrastructures, assassiné son peuple et empoisonné ses terres et ses rivières n'est pas en contradiction avec cette perspective. Soutenir une Ukraine libre et indépendante n'exige pas non plus une augmentation permanente des dépenses militaires mondiales, l'enracinement de blocs militaires rivaux ou la promotion sociale et politique du militarisme - même si c'est le programme de certaines forces réactionnaires qui se présentent comme les champions de l'Ukraine.
Pour soutenir l'Ukraine sans déclencher une vague de militarisme, de chauvinisme et de profits de guerre, l'ENSU inscrit sa solidarité avec le peuple ukrainien dans une perspective antimilitariste opposée au réarmement des puissances impérialistes. L'ENSU affirme que :
- l'aide militaire à l'Ukraine peut initialement provenir des stocks et de l'armement actuellement fourni aux gouvernements menant des guerres d'agression condamnées par les Nations unies ;
- la production de toutes les formes d'armement peut, et doit, être nationalisée. Cela permettrait de mettre fin aux profits de guerre obscènes et au trafic d'armes et de soumettre la production et la livraison de matériel de guerre aux droits internationalement reconnus de la souveraineté nationale et à la nécessité de s'opposer aux guerres qui les violent ;
- dans le cas où les pays auraient réellement besoin d'augmenter leurs budgets militaires pour aider l'Ukraine ou pour se défendre contre les menaces du régime de Poutine, l'augmentation devrait être financée par une taxation accrue des couches les plus riches de la société. Le soutien à l'Ukraine ne doit pas devenir un prétexte à l'austérité qui nuit à la majorité sociale.
L'ENSU souligne également la nécessité d'une propriété publique de l'industrie de l'armement afin de permettre sa conversion - après avoir vaincu des guerres d'agression - en un outil inestimable de production socialement et écologiquement utile.
Telle est l'approche démocratique, socialement juste et internationaliste pour aider le peuple ukrainien à gagner.
C'est également l'approche qui aide le plus l'opposition anti-guerre en Russie, en montrant que l'objectif de l'aide militaire à l'Ukraine n'est pas d'envahir la Fédération de Russie ou de renforcer l'OTAN, mais simplement de vaincre l'agression de Poutine.
C'est la seule approche compatible avec l'objectif d'avancer au-delà du militarisme et de la guerre vers le seul horizon souhaitable pour l'humanité : celui de peuples et de nations coexistant pacifiquement sur une planète durable.

BRICS+, en passe de perspectives

Beaucoup de regards étaient tournés vers l'Est au cours du weekend du 22, 23 et 24 octobre 2024, alors que s'est tenue la 16e réunion des BRICS+ à Kazan en Russie. Malgré et à cause de l'élargissement, les BRICS+ n'arrivent pas à clarifier leurs perspectives. Le manque de cohésion de l'alliance semble entraver leur ambition d'alternative mondiale.
Les chefs d'État brésilien, chinois, russe, indien, iranien, émirien, sud-africain, éthiopien et égyptien étaient réunis à l'occasion du sommet annuel de l'alliance 1. Chaque pays est arrivé avec son propre agenda et a voulu tirer son épingle du jeu à la fin de ces trois jours. La complexité des BRICS+ réside dans son hétérogénéité. Elle serait un avantage pour la surmonter, considérant la volonté partagée de remodeler l'ordre mondial. Or, l'alliance ne réussit pas à s'imposer comme une alternative logique à l'Occident.
Une naissance circonstancielle
Ironiquement, ce sont les États-Unis qui ont amorcé la formation des BRIC. Jim O'Neill, un des économistes en chef de Goldman Sachs, réunit dans les années 2000 le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sous l'acronyme BRIC pour distinguer ce groupe émergeant du reste du marché mondial. Cependant, le mérite ne revient pas uniquement aux États-Unis, puisque la collaboration entre ces quatre puissances est apparue indépendamment de la tutelle américaine.
Le premier sommet officiel des BRICS prit place en 2009 en Russie. Ce que les spécialistes ne comprennent pas tout à fait, c'est que les cinq puissances, l'Afrique du Sud ayant rejoint entre temps la bande des quatre, ne cherchaient pas un statut public. Il a fallu plus d'une décennie de rapprochement pour que la rencontre de 2009 confirme la naissance de ce front commun.
Aujourd'hui, les BRICS+ ont troqué l'ombre au travers de laquelle ils se sont construits. Ils réclament une place dans le système international. Malgré la médiatisation accrue autour des BRICS+, la critique qui revient souvent de la part des pays du Sud global sur l'alliance concerne le manque d'institutions et de structures claires, suscitant des questionnements quant à sa capacité à répondre aux attentes en matière de gouvernance alternative.
Lorsque ces pays prétendent être les successeurs des puissances occidentales traditionnelles, plusieurs pointent un minimum de matérialisation institutionnelle plus formelle. Certes, le projet de la Nouvelle banque de développement (NBD) s'inscrit en faux à une telle affirmation, Son incapacité à formaliser ses projets limite son potentiel transformationnel. La NBD n'est donc qu'un potentiel ad hoc gâché.
Neutralité comme mot d'ordre
Contrairement au MNA et à celui pour un Nouvel ordre économique international qui étaient guidés par un engagement politique, l'alliance BRICS+ est caractérisée par sa force économique. La dépolitisation de l'alliance n'est pas encore assumée, puisque les enjeux politiques sont toujours abordés lors des sommets. Toutefois, les États semblent s'engager timidement et défendent leurs positions à reculons.
Lors de ce 16ème sommet, la condamnation d'Israël sans utiliser le mot « génocide » a suscité l'indignation, surtout lorsqu'on sait que l'Afrique du Sud était de la partie. De même, la mise sous silence de l'invasion ukrainienne depuis 2022 conforte ce mutisme sélectif de l'alliance. Ce silence est d'autant plus frappant quand les BRICS+ choisissent de seulement dénoncer les actions des Houthis en mer Rouge et dans le détroit de Bab Al-Mandab. Rompre le silence uniquement lorsque des intérêts commerciaux sont en jeu relève d'un opportunisme, non pas d'un dévouement politique.
Dans cette même démarche de neutralité, les BRICS critiquent l'Occident pour son recours aux sanctions économiques à des fins politiques. L'alliance demande la levée des sanctions unilatérales, soulignant que ces mesures nuisent aux droits humains et entravent le développement des populations les plus vulnérables des pays ciblés. Alors que le droit international sert de fondement à ces réclamations, l'éthique des BRICS amène à s'interroger sur la cohérence de leurs positions face à leurs propres pratiques internes.
Front commun désuni ?
Les BRICS représentent avant tout un choix stratégique de leurs membres. Imaginer que ces États se réunissent chaque année par simple complaisance ne correspond pas à la réalité, tout comme supposer qu'ils partagent un consensus sur l'ensemble des enjeux abordés.
Au sein même de l'alliance, des rivalités refont surface, comme pour la Chine et l'Inde. Les deux puissances, en pleine période de froid diplomatique, ont cherché à rétablir un certain dialogue en marge du sommet. Cependant, un apaisement des tensions semble peu probable, après plus de quatre ans de dispute à propos de la frontière himalayenne.
Les divergences persistent également sur l'idéologie des BRICS. Alors que l'alliance s'est fondée sur un espoir postcolonial, les membres peinent à concorder leur vision d'un nouvel ordre mondial. Le Brésil et l'Inde demeurent prudents face à l'anti-occidentalisme prôné par la Russie et la Chine, privilégiant plutôt une stratégie de réforme des institutions existantes, sans confrontation directe avec l'ordre dominé par les États-Unis. Cela transparaît d'ailleurs dans la déclaration finale du sommet, qui ne remet en aucun cas en cause le Fond monétaire international et la Banque mondiale .
Le grand projet de monnaie commune des BRICS, qui avait suscité de vives discussions, a également généré des discordes. Quand le président brésilien Lula avait annoncé le projet au sommet de 2023, le scepticisme était déjà palpable. Un an plus tard, l'omission complète de celui-ci est notée. Certains membres craignant que cette monnaie, soit dominée par les intérêts des économies les plus influentes, comme la Chine, freinent la réflexion, renforçant ainsi les tensions de pouvoir au sein du groupe. Autant de désillusions qui éloignent les perspectives d'une coopération Sud-Sud réussie et d'un rebattement de cartes de l'échiquier mondial.
Note
L'Argentine a formellement refusé l'adhésion aux BRICS+ tandis que le statut de l'Arabie Saoudite au sein du groupe reste vague. Ont obtenu le statut de partenaires les pays suivants : Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Thaïlande, Turquie et Vietnam. [↩]

Quand La Presse+ trouve du « positif » dans la victoire de Trump

Donald Trump n'a pas encore été assermenté que nos milieux d'affaires et leurs porte-paroles dans les médias se montrent des plus serviles. Pour éviter les tarifs, ils se disent prêts à sacrifier la gestion de l'offre en agriculture lors des prochaines négociations du traité de libre-échange (ACEUM).
13 novembre 2024 | tiré de l'Aut'journal
Mais ils savent bien que ce ne sera pas assez pour assouvir l'immense appétit de Donald Trump. Alors, ils mènent une cabale dans les médias pour une augmentation des dépenses militaires et un accès subventionné aux ressources minérales stratégiques du Québec.
Stéphanie va-t'en guerre Grammond
La palme de la servitude revient à Stéphanie Grammond de La Presse+ pour son éditorial « Ce que Trump aura de positif pour le Canada » (2024-11-09). Et qu'est-ce qu'il y aurait de si « positif » pour le Canada dans cette élection ? Selon Mme Grammond, l'élection de Trump est « l'électrochoc nécessaire » à nos politiciens pour « mettre en place une véritable stratégie militaire », laquelle passe, bien entendu, par une augmentation des dépenses militaires pour atteindre le fameux 2% du PIB.
Sinon, aux abris !, nous prévient-elle, car Trump nous a prévenus : « En cas d'attaque, non, je ne vous protégerais pas. » Et qui menace de nous attaquer ? Mme Grammond ne le dit pas. Mais on imagine que, si on insiste, elle va agiter le spectre d'une invasion russe. La Russie, qui est incapable de vaincre l'Ukraine, va déferler dans le Grand Nord pour nous conquérir ! Allons, un peu de sérieux, Mme Grammond, le seul véritable ennemi du Canada, ce sont les feux de forêt. Le Canada n'a pas besoin de F-35, mais d'avions-citernes comme les Canadairs CL-215 et CL-415. Le Canada aura plus d'avions de chasse (88 F-35) que d'avions-citernes (60 Canadairs) !
Bien naïvement, l'éditorialiste essaie de nous faire croire qu'il sera possible d'encadrer cette augmentation des dépenses d'armements dans une « politique industrielle militaire », mais elle-même torpille son plan en rappelant qu'Ottawa a accordé à Boeing un contrat de neuf milliards $ sans appel d'offres pour le remplacement des appareils de patrouille maritime, plutôt que de confier le contrat à Bombardier qui était prête à relever le défi en adaptant son jet privé Global 6500.
Mme Grammond n'a pas encore compris que l'objectif de Trump n'est pas d'assurer la « défense de l'Occident », mais de procurer des contrats d'armements aux industries militaires américaines… situées aux États-Unis. Il a mis la barre à 2% du PIB, mais il a aussi évoqué de la hausser à 3% du PIB. La va-t'en guerre Grammond va-t-elle emboiter le pas ?
Mme Grammond se désole que le « prestigieux » (le qualificatif est le sien) Wall Street Journal s'en soit pris au Canada l'été dernier pour son non-respect de l'objectif fixé par l'OTAN sous la première administration Trump. Doit-on s'en étonner ? Le nom même du journal indique pourtant très clairement les intérêts qu'il défend.
Des gros cadeaux énergétiques
Dans l'espoir d'éviter l'imposition de tarifs et d'être copains-copains avec les États-Unis de Trump, les milieux d'affaires et leurs médias font miroiter auprès de l'Oncle Sam l'accès aux minéraux stratégiques du Québec et du Canada, sachant que les États-Unis, peu importe que l'administration soit démocrate ou républicaine, veulent mettre fin à leur dépendance de la Chine.
Déjà, sous l'administration Biden, le département de la Défense a investi dans deux mines au Québec. Attardons-nous à autre projet, qui est passé sous le radar, soit l'octroi par le ministre Fitzgibbon de 307 mégawatts à Hy2Gen sur la Côte-Nord.
L'hydrogène doit servir à la production d'ammoniac vert, qui sera transformé en nitrate d'ammonium, une substance utilisée comme explosif dans les mines.
Les 307 mégawatts constituent un bloc colossal d'électricité. Seul Northvolt, avec ses 354 mégawatts a obtenu plus. Trois cents sept mégawatts, c'est plus que la production du barrage de la Romaine-1 (270 MW) ou de celle du barrage de la Romaine-2 (245 MW) ou 2,3 fois la puissance nécessaire pour alimenter tous les véhicules électriques du Québec pendant la point hivernale (132 MW). Hy2Gen est une entreprise allemande, qui a des projets dans une douzaine de pays, mais pour le moment, comme Northvolt, peu de réalisations.
Des minéraux pour l'armement
Le boom minier à venir nécessitera énormément d'énergie. Il sera présenté comme une « contribution » à la transition énergétique, mais les minéraux rares et stratégiques iront en grande partie à l'industrie militaire. Alors, oubliez l'objectif la décarbonation des industries installées au Québec ! Sophie Brochu, l'ex-présidente d'Hydro-Québec, avait dénoncé un « Dollarama » de l'électricité, mais il s'agira plutôt d'un « Armorama ».
Revenons un instant à Stéphanie Grammond. Selon le Directeur parlementaire du budget à Ottawa, faire passer les dépenses militaires de 1,59 % du PIB d'ici 2026-2027 au 2 % fixé par Trump « nécessiterait un investissement annuel supplémentaire de 13 milliards $ » Une somme énorme, colossale, démesurée !
Que Mme Grammond nous indique dans quels programmes, elle suggère de couper, oui, de couper, car son « prestigieux » journal trouve le déficit fédéral déjà monstrueux. Dans les transferts en santé aux provinces ? Dans les subventions à l'habitation ? Où, madame Grammond ?

Syndicats, déréglementation et dialogue social en Ukraine

Les droits des travailleurs jusqu'en 2022 :une menace et une lutte constantes. Vitaly Dudin est l'un de ces avocats pour qui l'idée de se battre pour la justice définit sa routine professionnelle. Cela ne devrait pas nous surprendre, car c'est le fondement de toute profession juridique. Cependant, ce qui fait de Vitaliy un avocat particulier, c'est sa compréhension du fait qu'il est impossible d'obtenir une justice individuelle sans une lutte commune pour les droits. Comme il le dit lui-même, les droits du travail sont des droits collectifs.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Vitaliy ne se contente pas de défendre les droits des employés, il leur enseigne également comment défendre leurs droits dans le cadre du cours Trudoborona. En outre, il participe activement au renforcement et à l'élargissement du mouvement des syndicats indépendants en Ukraine dans le cadre de son travail au sein du Mouvement social.
La conversation avec Vitaliy s'est avérée intense et peut être divisée en deux parties, de sorte que vous pouvez commencer par l'une ou l'autre.
Dans la première partie de l'entretien, nous avons discuté de ce que l'on peut appeler le passé : comment l'idée de la déréglementation des relations de travail s'est développée et, avec elle, l'idée de la suprématie de l'employeur sur les employés s'est enracinée.
La deuxième partie de notre conversation concerne le présent : les tendances dans les relations de travail après le début de l'invasion à grande échelle, à la lumière et sans la lumière de l'intégration européenne ; les tentatives de laisser les travailleurs seuls face aux employeurs par le biais de l'individualisation des relations de travail ; et le dialogue social comme une alternative difficile mais nécessaire.
Maria Sokolova
Les droits des travailleurs jusqu'en 2022 :une menace et une lutte constantes
Jusqu'en 2022, pendant une décennie et demie, les responsables gouvernementaux se sont efforcés de déréglementer le marché du travail, de le rendre aussi « libre » que possible et de réformer radicalement la législation. On ne cesse de répéter que notre législation du travail date de l'Union soviétique, qu'elle est donc inefficace, rigide et qu'elle devrait être abandonnée, et que la société a besoin d'une nouvelle législation du travail. Je voudrais te poser quelques questions sur cette période : tout d'abord, qui a fait pression en faveur d'une déréglementation radicale ? Qui s'est opposé à cette idée ? Quelle était la logique de ces discussions ? Qu'est-ce qui a empêché la déréglementation complète du marché du travail ?
Le secteur de l'emploi en Ukraine est en déclin depuis un certain temps. Il s'accompagne d'un processus de désindustrialisation qui a débuté dans les années 1990 et se poursuit depuis lors avec une intensité variable. Moins il y a de personnes employées dans le secteur réel de l'économie, plus les voix se font entendre : « Dérégulons tout et simplifions la législation pour répondre aux besoins des employeurs qui existent ». Les employeurs les plus actifs étaient, d'une part, les grandes entreprises détenues par des oligarques et, d'autre part, de nombreux petits propriétaires, en particulier dans le secteur des services, qui n'avaient pas envie de constituer des effectifs importants. Les uns et les autres souhaitaient minimiser leurs obligations sociales. Pour les oligarques, le fait que les syndicats aient encore une influence assez forte constituait un défi de taille : les grandes entreprises comptaient de nombreux syndicats, des conventions collectives étaient conclues et, lorsque les entreprises ont été privatisées, les propriétaires prenaient souvent des engagements en matière d'investissement social. Un exemple est ArcelorMittal Kryvyi Rih, une entreprise qui a été privatisée avec la promesse du propriétaire d'investir dans l'amélioration de la santé, les sanatoriums et l'amélioration des conditions de travail.
Le nouveau propriétaire a donc dû investir non seulement dans les installations de production, mais aussi dans le soutien aux employés ?
Par exemple, il s'est engagé à améliorer les conditions sociales et de vie, et les syndicats ont été chargés d'en assurer le suivi. Mais pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises, le problème réside dans le droit du travail lui-même. Ils ne veulent pas se plier aux règles d'embauche et veulent avoir toute latitude pour licencier. Ce sont ces deux groupes – l'oligarchie industrielle et les petites et moyennes entreprises – qui ont réclamé avec force la déréglementation de la législation du travail, en particulier l'adoption d'un nouveau Code du travail ukrainien.
Depuis le début des années 2000, les premiers projets de Code du travail ukrainien ont été élaborés pour remplacer celui de 1971. À mon avis, ces projets ont été influencés par les expériences russe et bélarus. Il s'agissait de grands « livres » assez détaillés qui contenaient certaines des garanties habituelles pour les employés. Ces projets devaient être adoptés avec le soutien de la plus grande confédération syndicale, la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU). À l'époque, il existait une certaine configuration des rapports de classe : de grands oligarques qui tentaient d'influencer la politique en utilisant l'expérience des réformes russes, et des syndicats qui ne s'opposaient pas à eux, mais coopéraient.
Ainsi, ces premiers projets de Code du travail s'inspiraient principalement des modèles russes et bélarus et convenaient généralement aux plus grands syndicats qui, de fait, ne remplissaient plus leur fonction de protection des salariés ?
En effet, les syndicats qui existaient étaient pour la plupart complémentaires à l'administration, servant les intérêts du capital et essayant de rendre les frictions entre les employés et l'administration moins perceptibles. Mais si l'on regarde vers l'avenir, la situation des syndicats est en train de changer lentement.
Je ne savais pas que le Code du travail avait été discuté dans les années 2000. J'ai toujours eu l'impression que l'élaboration du Code du travail était associée aux jeunes « progressistes » qui sont arrivés au pouvoir après 2014.
Tout a commencé plus tôt. Personnellement, j'ai commencé à suivre activement ce processus en 2008. En 2010 déjà, une nouvelle configuration des forces émergeait : Viktor Ianoukovytch est arrivé au pouvoir, l'a consolidée et a déclaré l'introduction de réformes du marché, y compris l'adoption d'un nouveau Code du travail. Toutefois, l'attitude généralement critique de la population à l'égard de l'équipe au pouvoir a empêché la mise en œuvre de ces plans. Cette dernière était considérée comme oligarchique, corrompue, anti-ukrainienne, etc., et la loi a donc été adoptée avec beaucoup de difficultés, ce qui a également affecté les perspectives portées dans le Code du travail.
Les mêmes idées de déréglementation des relations de travail ont été présentées à la sauce du « renouveau de l'Ukraine » uniquement parce que leurs promoteurs sont arrivés dans la foulée des événements révolutionnaires. En fait, ces réformes n'étaient pas très différentes de ce que Ianoukovytch avait proposé. On peut dire que cette « continuité » [des événements] a été l'un des facteurs qui ont empêché le nouveau gouvernement d'adopter des changements. Mais en 2014, le Maïdan a eu lieu, et de nombreuses personnes fanatiquement attachées aux idées du marché libre, du néolibéralisme et de la déréglementation sont arrivées au pouvoir. Un nouveau facteur est également apparu : les liens entre la Fédération des syndicats d'Ukraine et le gouvernement se sont considérablement affaiblis. Pour la première fois depuis longtemps, la Fédération a commencé à lancer des slogans de protestation contre le gouvernement, exigeant une augmentation du salaire minimum, qui était alors extrêmement bas. Le gouvernement a fait des concessions partielles et a porté le salaire minimum à 3 200 UAH en 2017. Par conséquent, les projets d'adoption du Code du travail n'étaient plus à l'ordre du jour, car les tensions socio-économiques étaient déjà fortes. Par conséquent, aucun changement majeur n'a eu lieu jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky, qui était accompagné d'un groupe de nouveaux réformateurs néolibéraux. Ces derniers ont pris autant de distance que possible avec le gouvernement « précédent » et ont été perçus comme la « voix de la raison » – ce qui, bien entendu, était discutable.
Je fais tout d'abord référence à Tymofiy Milovanov, qui a pris la tête du ministère de l'Économie et a immédiatement, à la fin de l'année 2019, « adopté » un projet de loi de l'Ukraine « sur le travail » proposant une conception nouvelle. Cette initiative a marqué un nouveau cycle de confrontation entre le gouvernement et les syndicats : depuis 2019, presque tous les syndicats ukrainiens s'opposent aux initiatives du gouvernement dans le domaine des relations de travail. Le nouveau projet de loi reposait sur l'idée d'une individualisation des relations de travail. Il permettait de convenir des motifs des heures supplémentaires et des heures de travail prolongées sur une base individuelle, et autorisait l'employeur à rappeler un employé lors de son congé ou même à le licencier sans raisons spécifiques. En effet, une personne pouvait être licenciée à tout moment lorsque cela convenait à l'employeur, pour autant que ce dernier ne remplisse que quelques conditions, telles que l'indemnité de licenciement. Cette situation a fortement exacerbé la confrontation entre le gouvernement et les syndicats et s'annonçait extrêmement dangereuse, car en 2019, l'équipe de Zelensky avait la majorité au parlement et pouvait facilement faire passer n'importe quelle loi. Mais c'est grâce aux manifestations de masse que ces innovations ont été bloquées.
Je considère que le fait que ce projet de loi sur le travail n'ait pas été adopté est une grande victoire pour les syndicats et tous les travailleurs ukrainiens. Cela a notamment été facilité par la démission de Milovanov au début de l'année 2020. Le 24 février 2022, l'Ukraine s'est donc retrouvée avec une législation du travail qui offrait aux travailleurs un niveau de protection beaucoup plus élevé. À mon avis, ce facteur a permis à l'économie ukrainienne de ne pas s'effondrer complètement et de préserver les collectifs de travail qui soutiennent directement la vie de la société.
Peut-on dire que l'association avec l'UE est une autre raison pour laquelle le nouveau Code du travail n'a pas été adopté et que cette déréglementation n'a pas eu lieu après 2014 ou en 2019, lorsque Milovanov est entré en fonction ?
Plus l'Ukraine a déclaré activement sa volonté de rapprochement avec l'UE, plus il a été facile pour les syndicats de faire appel à des normes de travail spécifiques soutenues par l'UE et l'Organisation internationale du travail. Il est également devenu plus facile de demander l'aide des syndicats internationaux, y compris la Confédération syndicale internationale et la Confédération européenne des syndicats. L'attention de ces puissantes organisations, qui comptent des millions de membres dans le monde, a refroidi notre gouvernement à plusieurs reprises. Des déclarations internationales ont été faites, des visites ont été effectuées en Ukraine – tout cela a rappelé nos politiciens à leurs obligations, en particulier la députée Galina Tretyakova, qui est sans aucun doute l'une des idéologues et adeptes de la déréglementation de la législation du travail en Ukraine.
Pourtant, en 2022, de nombreux changements avaient été apportés à la législation du travail : des changements ponctuels, souvent non systématiques. Dans quelle direction ont-elles fait évoluer le système – vers la déréglementation ou la protection ?
Il s'agit bien d'une déréglementation, c'est-à-dire de la volonté d'éliminer les règles qui semblent défavorables aux employeurs et qui restreignent leur liberté. Bien entendu, les relations de travail ne sont pas une question d'égalité – l'employeur sera toujours plus fort. Par conséquent, l'élimination des règles et du contrôle de l'État, ainsi que le nivellement de l'influence des syndicats, conduisent à ce que les employés souffrent et à ce que leur vulnérabilité soit ressentie de manière beaucoup plus aiguë. En 2021, j'ai préparé pour Commons un document intitulé « Chroniques de la déréglementation » consacré au 50e anniversaire du Code du travail. Il montre de manière interactive comment les droits des Ukrainiens ont été restreints – et il y a eu beaucoup de changements. Ce document illustre comment la protection des travailleurs a été sacrifiée au profit d'une plus grande flexibilité dans la prise de décision par les dirigeants1.
À propos d'aujourd'hui
Intégration européenne et droits du travail
J'entends souvent dire que les petites et moyennes entreprises non seulement ne veulent pas employer officiellement des travailleurs, mais qu'elles ne peuvent pas le faire parce que cela détruirait leur activité. Comment pourriez-vous répondre à cette thèse ? Est-elle vraiment vraie ?
Les mécanismes de protection des travailleurs offerts par la législation actuelle sont-ils vraiment totalement inadaptés aux petites entreprises ?
La thèse selon laquelle la législation du travail est inapplicable ou même nuisible aux petites entreprises est trop abstraite. Nous devons étudier la pratique, les faits réels. Nous devons comprendre de quel type de petite entreprise nous parlons. Bien sûr, il y a des entreprises indépendantes où le propriétaire de l'entreprise est directement impliqué dans le travail. Il y a aussi des cas où de grands capitalistes utilisent un réseau d'entrepreneurs individuels pour économiser des impôts et éviter les exigences réglementaires. C'est le cas des chaînes de magasins, des restaurants, d'autres établissements de restauration, etc. Les inquiétudes concernant l'impact négatif de la réglementation sur l'économie et l'emploi sont très discutables. En 2017, lorsque le salaire minimum a été doublé et que le Service national du travail a été doté de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le travail non déclaré, il n'y a pas eu d'effets négatifs significatifs sur l'emploi en Ukraine. Au contraire, l'emploi a progressé ! Ces mesures ont peut-être choqué de nombreuses entreprises, mais en même temps, la plupart des entrepreneurs ukrainiens se sont adaptés, ont commencé à formaliser leurs relations avec leurs employés et à leur verser au moins le salaire minimum par crainte des sanctions. Je pense que des exigences plus strictes ne peuvent que contribuer à la transparence et motiver les employés à assumer des obligations spécifiques et à travailler en toute bonne foi. L'accord d'association [avec l'UE] fournit des lignes directrices claires : la nécessité de protéger les travailleurs, le dialogue social, la garantie de l'égalité, la lutte contre l'exclusion sociale et la lutte contre les diverses formes d'abus des entreprises.
Expliquez-nous nos engagements en matière d'intégration européenne. L'idée de déréglementer les relations de travail est-elle conforme aux principes de l'intégration européenne ?
Je pense que la déréglementation est en contradiction avec l'intégration européenne. En effet, l'intégration européenne repose sur les actes fondamentaux du droit primaire et secondaire de l'UE, qui parlent d'une lutte constante contre l'exclusion sociale et de la garantie de la cohésion sociale. Si nous intégrons l'Union européenne, et non pas, par exemple, les États-Unis d'Amérique, nous devons garder cela à l'esprit.
En 2014, l'Ukraine a signé un accord d'association avec l'UE, qui contient déjà certaines dispositions, notamment aux articles 419 et 420, concernant les priorités communes dans le domaine de l'emploi. Il ne s'agit pas d'une flexibilité incontrôlée en faveur de l'employeur, mais de soutenir le bien-être des employés. Dans le même temps, l'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre une douzaine de directives européennes dans le domaine des relations de travail. Ces directives concernent la lutte contre la discrimination, la création de conditions favorables pour les mères qui travaillent et les travailleurs mineurs, la santé et la sécurité au travail, les inspections du travail et la clarté des contrats de travail. L'une de ces directives traite également de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. En d'autres termes, il s'agit d'un paquet social-démocrate censé rendre la situation d'un employé plus prévisible.
La nuance est qu'au cours des dix années qui ont suivi la signature de l'accord, presque aucune de ces règles n'a été transposée dans la législation ukrainienne. Au cours de ces dix années, un certain nombre de directives européennes supplémentaires ont été adoptées, qui offrent une protection encore plus grande aux employés, mais nous ne sommes pas encore obligés de mettre en œuvre les directives adoptées après 2014. Cependant, la logique veut que si nous rejoignons l'UE, nous devrions adopter de nouvelles lois basées sur les meilleures normes européennes.
Et, bien entendu, aucune réforme ne peut être adoptée sans le consentement des syndicats. Et ce que nous avons fait en 2019 est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'UE, l'adoption de lois dans le domaine des relations de travail sans le consentement des partenaires sociaux est considérée comme une honte. Si les pays entreprennent certaines réformes risquées et s'écartent des dispositions établies, il doit y avoir des circonstances extraordinaires. Si ces réformes sont motivées par des facteurs tels qu'une crise financière, elles doivent avoir une forte justification socio-économique. C'est pourquoi l'UE, malgré son hétérogénéité et la présence d'idées néolibérales, maintient un équilibre grâce à certaines règles de procédure. Il n'est pas possible que des réformes néfastes pour les salariés soient adoptées sans discussion, sans protestation et sans l'attention des instances supranationales. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur la nature de l'UE, mais nous savons qu'il existe des outils permettant d'équilibrer la situation.
Les relations de travail en temps de guerre : l'entreprise privée comme base de la sécurité nationale ?
Vous avez dit que si certains pays de l'UE s'écartent des normes acceptées, c'est qu'il doit y avoir des raisons extraordinaires à cela. Je crois savoir que pour le gouvernement ukrainien, la guerre est devenue une telle raison. Comment le gouvernement a-t-il modifié la réglementation des relations de travail dans le contexte de la loi martiale ?
Dans des conditions démocratiques normales, les propositions élaborées par Galina Tretyakova n'auraient pas été adoptées. C'est elle qui a contribué à l'élaboration de diverses initiatives de déréglementation avant 2022 et après la déclaration de la loi martiale en Ukraine. Tout d'abord, il convient de prêter attention à la loi ukrainienne n°2136 du 15 mars 2022 sur l'organisation des relations de travail sous la loi martiale, qui a introduit un certain nombre de restrictions strictes, bien que temporaires, aux droits et garanties des employés et des syndicats. Bien sûr, elle est très proche de l'idéal des relations de travail professé par les hommes d'affaires libéraux. Pour eux, l'employeur ne doit rien à personne, l'État ne doit pas intervenir dans les relations de travail et les syndicats doivent jouer un rôle symbolique. Cette décentralisation de la réglementation engendre le chaos et l'arbitraire.
En ce qui concerne la dérogation à certains droits dans le cadre de la loi martiale, les instruments internationaux, tels que la Charte sociale européenne (révisée) de 1996, prévoient la possibilité de déroger à certains droits en cas de menace pour la sécurité nationale. La guerre, bien sûr, est une circonstance qui exige la consolidation de toutes les ressources de l'État pour repousser l'agresseur et préserver l'indépendance. Dans le même temps, la Charte stipule que les restrictions aux droits doivent être imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir l'agression. En d'autres termes, nous devons examiner de manière critique chacune des restrictions imposées pour voir si elle répond au critère de la nécessité sociale. En règle générale, les restrictions aux droits sont autorisées lorsqu'elles poursuivent un but légitime, utilisent des moyens légitimes et présentent un degré raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but. La proportionnalité est le principe essentiel sur lequel le législateur doit s'appuyer pour restreindre certains droits et libertés. Dans notre cas, il me semble que ce critère a été négligé. En mars 2022, une loi aggravant la situation des employés a été présentée à la Verkhovna Rada et a été adoptée à huis clos quelques jours plus tard. En mars 2022, la situation de l'Ukraine était extrêmement difficile. Chaque jour était devenu une lutte pour la survie. Des millions de personnes ont fui la zone de guerre pour se réfugier dans des régions plus sûres ou à l'étranger. Il n'était plus question d'exercer un contrôle public sur le parlement. Le parlement se réunissait sans annonces publiques et les citoyens ne pouvaient prendre connaissance des décisions prises qu'avec beaucoup de retard. Il me semble que Tretyakova a su profiter de l'occasion pour réaliser ses fantasmes libéraux. On ne sait toujours pas qui a voté en sa faveur. La loi a été adoptée immédiatement en deuxième lecture. Cela signifie que toutes les factions représentées au parlement ont accepté son adoption en tant que base et dans son ensemble.
Bien entendu, la justification fournie dans la note explicative était très vague. De nombreuses questions se sont posées : pourquoi aider les employeurs privés à augmenter le temps de travail, à simplifier la procédure de licenciement sans l'accord des syndicats ou pendant un congé de maladie, et à annuler les conventions collectives ? Il n'y a toujours pas de réponse claire à ces questions. Cela soulève de sérieux doutes quant à la légitimité et à la validité de la loi. À mon avis, dans un pays démocratique, le gouvernement et le parlement auraient dû préparer un rapport ou un avis expliquant pourquoi ces restrictions restent nécessaires.
Vous avez dit que la Charte sociale européenne permet de déroger à ses dispositions en cas de menace pour la sécurité nationale. Peut-on dire que dans l'esprit de nos responsables, la sécurité nationale est désormais la sécurité des entreprises ? Après tout, il semble qu'avec cette déréglementation, ils aient voulu sauver avant tout le secteur privé, et non, par exemple, l'emploi.
Je suis d'accord pour dire que, dans cette affaire, les intérêts des employeurs, en particulier des employeurs privés, ont été identifiés à tort avec les intérêts du peuple ukrainien dans son ensemble. Je suis convaincu que la mise en place d'une économie de guerre dans un conflit de grande ampleur nécessite le plein-emploi. Nous devons nous assurer que toutes les ressources humaines sont utilisées pour rapprocher la victoire. Nous n'avons pas cette priorité. Au lieu de cela, des mesures ont été introduites qui poursuivent des intérêts économiques à court terme, telles que la réduction des droits salariaux, de l'emploi et des congés, toutes ces mesures étant prises pour économiser de l'argent aux entreprises. Cette loi a créé une tentation pour les employeurs d'abuser de ces décisions impopulaires en les prenant sans le consentement des partenaires sociaux, alors même que l'unité de la société est plus importante que jamais. En outre, la limitation stricte des allocations de chômage à un maximum de trois mois et au salaire minimum a effectivement découragé de nombreuses personnes de s'inscrire auprès des centres pour l'emploi. L'État n'a donc pas été en mesure d'offrir à ces personnes un travail d'intérêt public. Il existe différentes catégories de travaux publics qui prennent une importance particulière en temps de guerre : de l'aide aux entreprises de défense au déblaiement des décombres, en passant par les soins aux blessés et l'aide aux victimes. Ainsi, cet instrument des « travaux publics » ne fonctionne pas en Ukraine, comme cela a été le cas aux États-Unis sous Franklin Roosevelt.
Il s'agit d'une contradiction évidente entre, d'une part, les choix de la déréglementation, de la réduction des coûts pour les employeurs et de la mise en œuvre de l'austérité et, d'autre part, les intérêts à long terme du peuple ukrainien. Je donnerai un exemple récent de la manière dont l'État essaie d'économiser de l'argent sur les gens en sapant la confiance dans les institutions gouvernementales en tant que telles. La loi ukrainienne n° 2980 du 20 mars 2023 sur l'aide financière unique pour les dommages causés à la vie et à la santé des employés des infrastructures critiques, des fonctionnaires et des représentants des autorités locales à la suite de l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine a été adoptée, mais le Fonds de pension de l'Ukraine, représenté par ses organes, tente d'éviter les paiements aux victimes de l'État agresseur dans les secteurs de l'énergie, de la défense et des transports en exploitant les lacunes de la législation. Par exemple, en prétendant que certaines entreprises ne font pas partie des infrastructures critiques parce qu'elles ne figurent pas dans le registre classifié2. Oui, ils économiseront de l'argent aujourd'hui, mais la question se pose : les gens voudront-ils travailler dans ces industries socialement importantes à l'avenir ?
Vous consacrez beaucoup de temps à la protection des travailleurs des infrastructures critiques et au-delà. Pourriez-vous nous parler des tendances que vous observez actuellement dans les relations de travail ?
Le principal résultat de mes observations de ce qui se passe dans la sphère sociale et du travail a été la création de ce que l'on appelle la « Liste noire des employeurs » publiée sur le site web du Sotsialnyi Rukh. Vous pouvez y lire des informations sur les employeurs qui ont osé abuser des innovations honteuses prévues par la loi n°2136 pour la période de la loi martiale. D'après l'analyse de la pratique des tribunaux, d'autres sources ouvertes et la communication avec des collectifs de travailleurs, l'abus le plus courant est la suspension des contrats de travail, lorsque les employés sont privés de la possibilité de travailler et ne reçoivent pas leur salaire. Je sais que dans environ 50% des cas, ces suspensions sont contestées. Heureusement, les tribunaux analysent chaque cas assez scrupuleusement. En outre, les cas de modification des conditions de travail essentielles sans préavis de deux mois sont fréquents. Cela signifie qu'un employé est informé du jour au lendemain d'une réduction de moitié de son temps de travail et, s'il n'est pas d'accord, il est licencié avec une indemnité de licenciement. Ces cas ont été particulièrement nombreux dans le secteur public, notamment dans le domaine des soins de santé. Des personnes ont été confrontées à la détérioration de leurs conditions de travail, ce qui les a poussées à démissionner.
Il est également courant que les employeurs suspendent certaines dispositions des conventions collectives. Cette pratique a été utilisée par des entreprises telles que Ukrzaliznytsia [exploitant du réseau ferroviaire ukrainien], la centrale nucléaire de Tchernobyl, de nombreux hôpitaux ukrainiens et Nova Poshta. Il y a eu très peu de cas de contestation de ces actions devant les tribunaux, à l'exception des poursuites contre Ukrzaliznytsia², dans lesquelles le syndicat libre des cheminots d'Ukraine a réussi à faire déclarer illégales les actions unilatérales de leurs patrons. Il n'est pas rare non plus que les employeurs refusent d'accorder des congés à leurs employés, au motif que leur entreprise ou institution est une infrastructure critique. Dans ce cas, les employeurs sont souvent de mauvaise foi et ne fournissent pas la preuve que leur entreprise est inscrite au registre correspondant. Les employés des tablissements d'enseignement, par exemple, ont été privés de ces congés. Très souvent, il s'agissait de congés sans solde, lorsque les gens partaient à l'étranger pour se sauver et sauver leur famille.
Le dialogue social contre l'individualisation des relations de travail
Vous avez évoqué l'individualisation des relations de travail et du dialogue social. Pouvez-vous nous dire en quoi l'individualisation menace le marché du travail et les salariés ? Parce qu'il y a une perception selon laquelle « c'est une bonne chose, chacun pourra négocier comme il l'entend », d'une part, mais d'autre part, comment le dialogue social s'articule-t-il avec tout cela ?
L'individualisation des relations de travail crée l'illusion que l'employé, tout comme l'employeur, peut influencer les conditions de travail. Cela peut fonctionner pour les stars d'Hollywood ou les footballeurs de haut niveau, mais pas pour les infirmières, les enseignants ou les cheminots dont le travail est extrêmement important pour la société. Si l'employeur est autorisé à introduire des motifs supplémentaires de licenciement, d'heures supplémentaires ou de rappel en congé avec le « consentement » du salarié, cela signifie qu'il devra obtenir ce « consentement » dans chaque cas individuel lors de l'embauche, pour ainsi dire, volontaire et obligatoire. Il est très difficile pour un employé de « mesurer ses forces » lorsqu'il souhaite obtenir un emploi. Cela peut donc entraîner une distorsion des droits en faveur de l'employeur.
En Ukraine, cette individualisation est partiellement mise en œuvre. Par exemple, en juillet 2022, une loi a été adoptée sur les contrats de travail à horaires variables, qui obligent les employés de travailler non pas en permanence, mais uniquement lorsque l'employeur en a besoin. Dans le cadre de ces contrats, le salaire de l'employé peut même être inférieur au salaire minimum. En outre, des motifs de licenciement supplémentaires non prévus par le droit du travail peuvent être appliqués, ce qui est contraire aux règles de l'OIT. En outre, pour la période de la loi martiale, un « régime simplifié de réglementation des relations de travail » a été introduit pour les entreprises comptant jusqu'à 250 employés. Je ne sais pas dans quelle mesure ce régime est utilisé, mais il semble attrayant pour les employeurs, car de nombreuses choses, telles que les heures supplémentaires ou la responsabilité en cas de divulgation de secrets commerciaux, peuvent être convenues au niveau d'un contrat de travail individuel. Je ne vois pas en quoi de telles mesures permettront une avancée tangible dans la sphère économique ou la création d'un grand nombre d'emplois. Tout reste à peu près au même niveau qu'à la fin de l'année 2022 : beaucoup d'offres d'emploi non pourvues et un nombre très modeste de personnes officiellement employées – environ 8 millions. Dans le même temps, la proportion de personnes gagnant le salaire minimum ou ayant des revenus inférieurs au salaire minimum augmente. En d'autres termes, la déréglementation, cet encouragement à des conditions d'emploi plus flexibles, n'a pas conduit à une croissance fulgurante de l'emploi. Il y a donc lieu de se demander si cette stratégie fonctionne vraiment lorsque l'on laisse tout « au hasard ».
Parlons du dialogue social. La guerre est un défi pour l'ensemble de la société, ce qui signifie que l'ensemble de la société devrait supporter le fardeau de la guerre et déterminer la direction du mouvement. Il serait utopique d'espérer que le gouvernement, en collaboration avec des cercles d'affaires proches, puisse trouver des solutions systémiques. Le dialogue social est donc une nécessité pratique dans un conflit de grande ampleur si l'on veut que les décisions prises par les autorités soient perçues comme légitimes, légitimes et justes. Malheureusement, il existe des innovations telles que l'introduction d'une réserve [exemption de mobilisation] économique. Elles provoquent un clivage dans la société parce qu'elles ont été élaborées sans tenir compte de l'avis des syndicats.
Le besoin de dialogue social est déjà objectivement déterminé par les circonstances actuelles et les impératifs de l'intégration européenne. Pour l'UE, les consultations entre les partenaires sociaux dans la prise de décision sont la priorité numéro un. Or, ce qui se passe en Ukraine est exactement le contraire. Un exemple récent est l'élaboration du projet de budget pour 2025, qui prévoit le gel du salaire minimum et du minimum vital pendant 3 ans, jusqu'en 2027. Une telle décision, bien sûr, sape encore plus le désir des gens de travailler en Ukraine et montre que le gouvernement méprise ouvertement l'opinion des syndicats. Le fossé entre la société et le gouvernement se creuse.
Et comment un travailleur ordinaire peut-il participer au dialogue social ?
Il existe trois niveaux de dialogue social : local, sectoriel et national. Bien sûr, il est plus facile pour un employé ordinaire de participer à ces procédures au niveau local en devenant membre d'un syndicat. Et je peux vous assurer qu'il existe des exemples où le dialogue social au niveau local fonctionne réellement et apporte certains avantages aux employés. Je citerai des entreprises comme Ukrzaliznytsia, où un grand nombre de syndicats tentent de freiner la volonté du propriétaire d'annuler certains avantages prévus dans la convention collective de cette entreprise de plusieurs milliers d'employés. Il y a aussi Energoatom [Compagnie nationale de production d'énergie nucléaire], qui est aussi directement liée à la pérennité de l'économie ukrainienne, et où il y a aussi un puissant syndicat qui contrôle toutes les décisions prises par l'administration. Ce dialogue entre les parties rend difficile toute prise de décisions qui pourraient aggraver la situation des employés.
Si nous parlons d'entreprises plus petites, je voudrais attirer l'attention sur un hôpital dans le district de Derazhnyansky, dans la région de Khmelnytsky. Un syndicat très militant y est affilié au mouvement des infirmières Sois comme Nina. Étant donné que leur convention collective contient de solides garanties procédurales, le syndicat exige que toute décision modifiant les conditions de travail essentielles soit prise en accord avec lui. C'est le cas, par exemple, pour le transfert de personnel à temps partiel. Bien sûr, la direction essaie de faire passer certaines décisions pour économiser sur les salaires, mais la convention collective reste en vigueur, et le syndicat et le conseil du travail en tirent parti. J'ai également entendu parler d'un cas à l'usine Leoni, qui est impliquée dans l'industrie automobile – elle opère également à Stryi, dans la région de Lviv. Au début de la guerre, l'employeur a pris des mesures qui ont aggravé la situation des employés, notamment en essayant de suspendre certains avantages prévus par la convention collective. Cependant, le syndicat a amené l'employeur à la table des négociations et a réussi à préserver certaines garanties pour ses membres.
Voyez-vous des perspectives de développement du dialogue social en Ukraine à l'heure actuelle ?
En conclusion, je voudrais dire qu'au cours de ces presque trois années, une strate de dirigeants syndicaux assez puissants a émergé en Ukraine, qui s'est habituée à travailler dans des circonstances d'incertitude totale et où l'État soutient les employeurs. Je pense que si ces personnes survivent à ces temps difficiles, elles seront en mesure de créer des structures fortes pendant la période de reconstruction d'après-guerre, qui exigeront de meilleures conditions de travail et l'égalisation des salaires avec la moyenne européenne. Aujourd'hui, le salaire moyen dans l'UE est d'environ 2 000 euros, et il me semble qu'au moins les travailleurs des infrastructures critiques et des industries d'exportation devraient recevoir au moins la moitié de ce montant, soit au moins 1 000 euros par mois.
Si nous voulons avancer sur la question des conditions de travail, nous devons imposer certaines obligations aux entreprises qui bénéficient de l'achat de biens et de services sur les fonds budgétaires par le biais du mécanisme d'appel d'offres. En particulier, nous devrions exiger que les accords d'adjudication prévoient la minimisation des accidents dans l'entreprise, que les employés soient impliqués dans la prise de décision et que les salaires soient également alignés sur les indicateurs européens. C'est ce que j'entends par des changements qui profiteront à l'ensemble de la société.
11 novembre 2024
Publié par Commons
Illustration Katya Gritseva
Traduction Patrick Le Tréhondat
1 Le récit sur la déréglementation des relations de travail et la destruction de l'État-providence aujourd'hui peut également être trouvé dans la conférence de Vitaliy :
https://www.youtube.com/watch?v=dO4e_M3iMLs
2 Pour bénéficier d'un tel paiement unique, l'entreprise ou l'institution où travaillait le travailleur blessé doit être inscrite au registre des infrastructures critiques. Le fonds de pension, interprétant la loi de manière restrictive, a massivement refusé des paiements si l'installation n'était pas inscrite au registre au moment de la tragédie. Pour plus de détails sur cette situation, voir l'article de Vitaliy :
https://rev.org.ua/garanti%d1%97-dlya-pracivnikiv-kritichno%d1%97-infrastrukturi/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Syndicats, déréglementation et dialogue social en Ukraine.

Les droits des travailleurs jusqu'en 2022 :une menace et une lutte constantes. À propos d'aujourd'hui Intégration européenne et droits du travail. Dans la première partie de l'entretien, nous avons discuté de ce que l'on peut appeler le passé : comment l'idée de la déréglementation des relations de travail s'est développée et, avec elle, l'idée de la suprématie de l'employeur sur les employés s'est enracinée.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La deuxième partie de notre conversation concerne le présent : les tendances dans les relations de travail après le début de l'invasion à grande échelle, à la lumière et sans la lumière de l'intégration européenne ; les tentatives de laisser les travailleurs seuls face aux employeurs par le biais de l'individualisation des relations de travail ; et le dialogue social comme une alternative difficile mais nécessaire.
Maria Sokolova
À propos d'aujourd'hui Intégration européenne et droits du travail
J'entends souvent dire que les petites et moyennes entreprises non seulement ne veulent pas employer officiellement des travailleurs, mais qu'elles ne peuvent pas le faire parce que cela détruirait leur activité. Comment pourriez-vous répondre à cette thèse ? Est-elle vraiment vraie ?
Les mécanismes de protection des travailleurs offerts par la législation actuelle sont-ils vraiment totalement inadaptés aux petites entreprises ?
La thèse selon laquelle la législation du travail est inapplicable ou même nuisible aux petites entreprises est trop abstraite. Nous devons étudier la pratique, les faits réels. Nous devons comprendre de quel type de petite entreprise nous parlons. Bien sûr, il y a des entreprises indépendantes où le propriétaire de l'entreprise est directement impliqué dans le travail. Il y a aussi des cas où de grands capitalistes utilisent un réseau d'entrepreneurs individuels pour économiser des impôts et éviter les exigences réglementaires. C'est le cas des chaînes de magasins, des restaurants, d'autres établissements de restauration, etc. Les inquiétudes concernant l'impact négatif de la réglementation sur l'économie et l'emploi sont très discutables. En 2017, lorsque le salaire minimum a été doublé et que le Service national du travail a été doté de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le travail non déclaré, il n'y a pas eu d'effets négatifs significatifs sur l'emploi en Ukraine. Au contraire, l'emploi a progressé ! Ces mesures ont peut-être choqué de nombreuses entreprises, mais en même temps, la plupart des entrepreneurs ukrainiens se sont adaptés, ont commencé à formaliser leurs relations avec leurs employés et à leur verser au moins le salaire minimum par crainte des sanctions. Je pense que des exigences plus strictes ne peuvent que contribuer à la transparence et motiver les employés à assumer des obligations spécifiques et à travailler en toute bonne foi. L'accord d'association [avec l'UE] fournit des lignes directrices claires : la nécessité de protéger les travailleurs, le dialogue social, la garantie de l'égalité, la lutte contre l'exclusion sociale et la lutte contre les diverses formes d'abus des entreprises.
Expliquez-nous nos engagements en matière d'intégration européenne. L'idée de déréglementer les relations de travail est-elle conforme aux principes de l'intégration européenne ?
Je pense que la déréglementation est en contradiction avec l'intégration européenne. En effet, l'intégration européenne repose sur les actes fondamentaux du droit primaire et secondaire de l'UE, qui parlent d'une lutte constante contre l'exclusion sociale et de la garantie de la cohésion sociale. Si nous intégrons l'Union européenne, et non pas, par exemple, les États-Unis d'Amérique, nous devons garder cela à l'esprit.
En 2014, l'Ukraine a signé un accord d'association avec l'UE, qui contient déjà certaines dispositions, notamment aux articles 419 et 420, concernant les priorités communes dans le domaine de l'emploi. Il ne s'agit pas d'une flexibilité incontrôlée en faveur de l'employeur, mais de soutenir le bien-être des employés. Dans le même temps, l'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre une douzaine de directives européennes dans le domaine des relations de travail. Ces directives concernent la lutte contre la discrimination, la création de conditions favorables pour les mères qui travaillent et les travailleurs mineurs, la santé et la sécurité au travail, les inspections du travail et la clarté des contrats de travail. L'une de ces directives traite également de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. En d'autres termes, il s'agit d'un paquet social-démocrate censé rendre la situation d'un employé plus prévisible.
La nuance est qu'au cours des dix années qui ont suivi la signature de l'accord, presque aucune de ces règles n'a été transposée dans la législation ukrainienne. Au cours de ces dix années, un certain nombre de directives européennes supplémentaires ont été adoptées, qui offrent une protection encore plus grande aux employés, mais nous ne sommes pas encore obligés de mettre en œuvre les directives adoptées après 2014. Cependant, la logique veut que si nous rejoignons l'UE, nous devrions adopter de nouvelles lois basées sur les meilleures normes européennes.
Et, bien entendu, aucune réforme ne peut être adoptée sans le consentement des syndicats. Et ce que nous avons fait en 2019 est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'UE, l'adoption de lois dans le domaine des relations de travail sans le consentement des partenaires sociaux est considérée comme une honte. Si les pays entreprennent certaines réformes risquées et s'écartent des dispositions établies, il doit y avoir des circonstances extraordinaires. Si ces réformes sont motivées par des facteurs tels qu'une crise financière, elles doivent avoir une forte justification socio-économique. C'est pourquoi l'UE, malgré son hétérogénéité et la présence d'idées néolibérales, maintient un équilibre grâce à certaines règles de procédure. Il n'est pas possible que des réformes néfastes pour les salariés soient adoptées sans discussion, sans protestation et sans l'attention des instances supranationales. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur la nature de l'UE, mais nous savons qu'il existe des outils permettant d'équilibrer la situation.
Les relations de travail en temps de guerre : l'entreprise privée comme base de la sécurité nationale ?
Vous avez dit que si certains pays de l'UE s'écartent des normes acceptées, c'est qu'il doit y avoir des raisons extraordinaires à cela. Je crois savoir que pour le gouvernement ukrainien, la guerre est devenue une telle raison. Comment le gouvernement a-t-il modifié la réglementation des relations de travail dans le contexte de la loi martiale ?
Dans des conditions démocratiques normales, les propositions élaborées par Galina Tretyakova n'auraient pas été adoptées. C'est elle qui a contribué à l'élaboration de diverses initiatives de déréglementation avant 2022 et après la déclaration de la loi martiale en Ukraine. Tout d'abord, il convient de prêter attention à la loi ukrainienne n°2136 du 15 mars 2022 sur l'organisation des relations de travail sous la loi martiale, qui a introduit un certain nombre de restrictions strictes, bien que temporaires, aux droits et garanties des employés et des syndicats. Bien sûr, elle est très proche de l'idéal des relations de travail professé par les hommes d'affaires libéraux. Pour eux, l'employeur ne doit rien à personne, l'État ne doit pas intervenir dans les relations de travail et les syndicats doivent jouer un rôle symbolique. Cette décentralisation de la réglementation engendre le chaos et l'arbitraire.
En ce qui concerne la dérogation à certains droits dans le cadre de la loi martiale, les instruments internationaux, tels que la Charte sociale européenne (révisée) de 1996, prévoient la possibilité de déroger à certains droits en cas de menace pour la sécurité nationale. La guerre, bien sûr, est une circonstance qui exige la consolidation de toutes les ressources de l'État pour repousser l'agresseur et préserver l'indépendance. Dans le même temps, la Charte stipule que les restrictions aux droits doivent être imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir l'agression. En d'autres termes, nous devons examiner de manière critique chacune des restrictions imposées pour voir si elle répond au critère de la nécessité sociale. En règle générale, les restrictions aux droits sont autorisées lorsqu'elles poursuivent un but légitime, utilisent des moyens légitimes et présentent un degré raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but. La proportionnalité est le principe essentiel sur lequel le législateur doit s'appuyer pour restreindre certains droits et libertés. Dans notre cas, il me semble que ce critère a été négligé. En mars 2022, une loi aggravant la situation des employés a été présentée à la Verkhovna Rada et a été adoptée à huis clos quelques jours plus tard. En mars 2022, la situation de l'Ukraine était extrêmement difficile. Chaque jour était devenu une lutte pour la survie. Des millions de personnes ont fui la zone de guerre pour se réfugier dans des régions plus sûres ou à l'étranger. Il n'était plus question d'exercer un contrôle public sur le parlement. Le parlement se réunissait sans annonces publiques et les citoyens ne pouvaient prendre connaissance des décisions prises qu'avec beaucoup de retard. Il me semble que Tretyakova a su profiter de l'occasion pour réaliser ses fantasmes libéraux. On ne sait toujours pas qui a voté en sa faveur. La loi a été adoptée immédiatement en deuxième lecture. Cela signifie que toutes les factions représentées au parlement ont accepté son adoption en tant que base et dans son ensemble.
Bien entendu, la justification fournie dans la note explicative était très vague. De nombreuses questions se sont posées : pourquoi aider les employeurs privés à augmenter le temps de travail, à simplifier la procédure de licenciement sans l'accord des syndicats ou pendant un congé de maladie, et à annuler les conventions collectives ? Il n'y a toujours pas de réponse claire à ces questions. Cela soulève de sérieux doutes quant à la légitimité et à la validité de la loi. À mon avis, dans un pays démocratique, le gouvernement et le parlement auraient dû préparer un rapport ou un avis expliquant pourquoi ces restrictions restent nécessaires.
Vous avez dit que la Charte sociale européenne permet de déroger à ses dispositions en cas de menace pour la sécurité nationale. Peut-on dire que dans l'esprit de nos responsables, la sécurité nationale est désormais la sécurité des entreprises ? Après tout, il semble qu'avec cette déréglementation, ils aient voulu sauver avant tout le secteur privé, et non, par exemple, l'emploi.
Je suis d'accord pour dire que, dans cette affaire, les intérêts des employeurs, en particulier des employeurs privés, ont été identifiés à tort avec les intérêts du peuple ukrainien dans son ensemble. Je suis convaincu que la mise en place d'une économie de guerre dans un conflit de grande ampleur nécessite le plein-emploi. Nous devons nous assurer que toutes les ressources humaines sont utilisées pour rapprocher la victoire. Nous n'avons pas cette priorité. Au lieu de cela, des mesures ont été introduites qui poursuivent des intérêts économiques à court terme, telles que la réduction des droits salariaux, de l'emploi et des congés, toutes ces mesures étant prises pour économiser de l'argent aux entreprises. Cette loi a créé une tentation pour les employeurs d'abuser de ces décisions impopulaires en les prenant sans le consentement des partenaires sociaux, alors même que l'unité de la société est plus importante que jamais. En outre, la limitation stricte des allocations de chômage à un maximum de trois mois et au salaire minimum a effectivement découragé de nombreuses personnes de s'inscrire auprès des centres pour l'emploi. L'État n'a donc pas été en mesure d'offrir à ces personnes un travail d'intérêt public. Il existe différentes catégories de travaux publics qui prennent une importance particulière en temps de guerre : de l'aide aux entreprises de défense au déblaiement des décombres, en passant par les soins aux blessés et l'aide aux victimes. Ainsi, cet instrument des « travaux publics » ne fonctionne pas en Ukraine, comme cela a été le cas aux États-Unis sous Franklin Roosevelt.
Il s'agit d'une contradiction évidente entre, d'une part, les choix de la déréglementation, de la réduction des coûts pour les employeurs et de la mise en œuvre de l'austérité et, d'autre part, les intérêts à long terme du peuple ukrainien. Je donnerai un exemple récent de la manière dont l'État essaie d'économiser de l'argent sur les gens en sapant la confiance dans les institutions gouvernementales en tant que telles. La loi ukrainienne n° 2980 du 20 mars 2023 sur l'aide financière unique pour les dommages causés à la vie et à la santé des employés des infrastructures critiques, des fonctionnaires et des représentants des autorités locales à la suite de l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine a été adoptée, mais le Fonds de pension de l'Ukraine, représenté par ses organes, tente d'éviter les paiements aux victimes de l'État agresseur dans les secteurs de l'énergie, de la défense et des transports en exploitant les lacunes de la législation. Par exemple, en prétendant que certaines entreprises ne font pas partie des infrastructures critiques parce qu'elles ne figurent pas dans le registre classifié2. Oui, ils économiseront de l'argent aujourd'hui, mais la question se pose : les gens voudront-ils travailler dans ces industries socialement importantes à l'avenir ?
Vous consacrez beaucoup de temps à la protection des travailleurs des infrastructures critiques et au-delà. Pourriez-vous nous parler des tendances que vous observez actuellement dans les relations de travail ?
Le principal résultat de mes observations de ce qui se passe dans la sphère sociale et du travail a été la création de ce que l'on appelle la « Liste noire des employeurs » publiée sur le site web du Sotsialnyi Rukh. Vous pouvez y lire des informations sur les employeurs qui ont osé abuser des innovations honteuses prévues par la loi n°2136 pour la période de la loi martiale. D'après l'analyse de la pratique des tribunaux, d'autres sources ouvertes et la communication avec des collectifs de travailleurs, l'abus le plus courant est la suspension des contrats de travail, lorsque les employés sont privés de la possibilité de travailler et ne reçoivent pas leur salaire. Je sais que dans environ 50% des cas, ces suspensions sont contestées. Heureusement, les tribunaux analysent chaque cas assez scrupuleusement. En outre, les cas de modification des conditions de travail essentielles sans préavis de deux mois sont fréquents. Cela signifie qu'un employé est informé du jour au lendemain d'une réduction de moitié de son temps de travail et, s'il n'est pas d'accord, il est licencié avec une indemnité de licenciement. Ces cas ont été particulièrement nombreux dans le secteur public, notamment dans le domaine des soins de santé. Des personnes ont été confrontées à la détérioration de leurs conditions de travail, ce qui les a poussées à démissionner.
Il est également courant que les employeurs suspendent certaines dispositions des conventions collectives. Cette pratique a été utilisée par des entreprises telles que Ukrzaliznytsia [exploitant du réseau ferroviaire ukrainien], la centrale nucléaire de Tchernobyl, de nombreux hôpitaux ukrainiens et Nova Poshta. Il y a eu très peu de cas de contestation de ces actions devant les tribunaux, à l'exception des poursuites contre Ukrzaliznytsia², dans lesquelles le syndicat libre des cheminots d'Ukraine a réussi à faire déclarer illégales les actions unilatérales de leurs patrons. Il n'est pas rare non plus que les employeurs refusent d'accorder des congés à leurs employés, au motif que leur entreprise ou institution est une infrastructure critique. Dans ce cas, les employeurs sont souvent de mauvaise foi et ne fournissent pas la preuve que leur entreprise est inscrite au registre correspondant. Les employés des tablissements d'enseignement, par exemple, ont été privés de ces congés. Très souvent, il s'agissait de congés sans solde, lorsque les gens partaient à l'étranger pour se sauver et sauver leur famille.
Le dialogue social contre l'individualisation des relations de travail
Vous avez évoqué l'individualisation des relations de travail et du dialogue social. Pouvez-vous nous dire en quoi l'individualisation menace le marché du travail et les salariés ? Parce qu'il y a une perception selon laquelle « c'est une bonne chose, chacun pourra négocier comme il l'entend », d'une part, mais d'autre part, comment le dialogue social s'articule-t-il avec tout cela ?
L'individualisation des relations de travail crée l'illusion que l'employé, tout comme l'employeur, peut influencer les conditions de travail. Cela peut fonctionner pour les stars d'Hollywood ou les footballeurs de haut niveau, mais pas pour les infirmières, les enseignants ou les cheminots dont le travail est extrêmement important pour la société. Si l'employeur est autorisé à introduire des motifs supplémentaires de licenciement, d'heures supplémentaires ou de rappel en congé avec le « consentement » du salarié, cela signifie qu'il devra obtenir ce « consentement » dans chaque cas individuel lors de l'embauche, pour ainsi dire, volontaire et obligatoire. Il est très difficile pour un employé de « mesurer ses forces » lorsqu'il souhaite obtenir un emploi. Cela peut donc entraîner une distorsion des droits en faveur de l'employeur.
En Ukraine, cette individualisation est partiellement mise en œuvre. Par exemple, en juillet 2022, une loi a été adoptée sur les contrats de travail à horaires variables, qui obligent les employés de travailler non pas en permanence, mais uniquement lorsque l'employeur en a besoin. Dans le cadre de ces contrats, le salaire de l'employé peut même être inférieur au salaire minimum. En outre, des motifs de licenciement supplémentaires non prévus par le droit du travail peuvent être appliqués, ce qui est contraire aux règles de l'OIT. En outre, pour la période de la loi martiale, un « régime simplifié de réglementation des relations de travail » a été introduit pour les entreprises comptant jusqu'à 250 employés. Je ne sais pas dans quelle mesure ce régime est utilisé, mais il semble attrayant pour les employeurs, car de nombreuses choses, telles que les heures supplémentaires ou la responsabilité en cas de divulgation de secrets commerciaux, peuvent être convenues au niveau d'un contrat de travail individuel. Je ne vois pas en quoi de telles mesures permettront une avancée tangible dans la sphère économique ou la création d'un grand nombre d'emplois. Tout reste à peu près au même niveau qu'à la fin de l'année 2022 : beaucoup d'offres d'emploi non pourvues et un nombre très modeste de personnes officiellement employées – environ 8 millions. Dans le même temps, la proportion de personnes gagnant le salaire minimum ou ayant des revenus inférieurs au salaire minimum augmente. En d'autres termes, la déréglementation, cet encouragement à des conditions d'emploi plus flexibles, n'a pas conduit à une croissance fulgurante de l'emploi. Il y a donc lieu de se demander si cette stratégie fonctionne vraiment lorsque l'on laisse tout « au hasard ».
Parlons du dialogue social. La guerre est un défi pour l'ensemble de la société, ce qui signifie que l'ensemble de la société devrait supporter le fardeau de la guerre et déterminer la direction du mouvement. Il serait utopique d'espérer que le gouvernement, en collaboration avec des cercles d'affaires proches, puisse trouver des solutions systémiques. Le dialogue social est donc une nécessité pratique dans un conflit de grande ampleur si l'on veut que les décisions prises par les autorités soient perçues comme légitimes, légitimes et justes. Malheureusement, il existe des innovations telles que l'introduction d'une réserve [exemption de mobilisation] économique. Elles provoquent un clivage dans la société parce qu'elles ont été élaborées sans tenir compte de l'avis des syndicats.
Le besoin de dialogue social est déjà objectivement déterminé par les circonstances actuelles et les impératifs de l'intégration européenne. Pour l'UE, les consultations entre les partenaires sociaux dans la prise de décision sont la priorité numéro un. Or, ce qui se passe en Ukraine est exactement le contraire. Un exemple récent est l'élaboration du projet de budget pour 2025, qui prévoit le gel du salaire minimum et du minimum vital pendant 3 ans, jusqu'en 2027. Une telle décision, bien sûr, sape encore plus le désir des gens de travailler en Ukraine et montre que le gouvernement méprise ouvertement l'opinion des syndicats. Le fossé entre la société et le gouvernement se creuse.
Et comment un travailleur ordinaire peut-il participer au dialogue social ?
Il existe trois niveaux de dialogue social : local, sectoriel et national. Bien sûr, il est plus facile pour un employé ordinaire de participer à ces procédures au niveau local en devenant membre d'un syndicat. Et je peux vous assurer qu'il existe des exemples où le dialogue social au niveau local fonctionne réellement et apporte certains avantages aux employés. Je citerai des entreprises comme Ukrzaliznytsia, où un grand nombre de syndicats tentent de freiner la volonté du propriétaire d'annuler certains avantages prévus dans la convention collective de cette entreprise de plusieurs milliers d'employés. Il y a aussi Energoatom [Compagnie nationale de production d'énergie nucléaire], qui est aussi directement liée à la pérennité de l'économie ukrainienne, et où il y a aussi un puissant syndicat qui contrôle toutes les décisions prises par l'administration. Ce dialogue entre les parties rend difficile toute prise de décisions qui pourraient aggraver la situation des employés.
Si nous parlons d'entreprises plus petites, je voudrais attirer l'attention sur un hôpital dans le district de Derazhnyansky, dans la région de Khmelnytsky. Un syndicat très militant y est affilié au mouvement des infirmières Sois comme Nina. Étant donné que leur convention collective contient de solides garanties procédurales, le syndicat exige que toute décision modifiant les conditions de travail essentielles soit prise en accord avec lui. C'est le cas, par exemple, pour le transfert de personnel à temps partiel. Bien sûr, la direction essaie de faire passer certaines décisions pour économiser sur les salaires, mais la convention collective reste en vigueur, et le syndicat et le conseil du travail en tirent parti. J'ai également entendu parler d'un cas à l'usine Leoni, qui est impliquée dans l'industrie automobile – elle opère également à Stryi, dans la région de Lviv. Au début de la guerre, l'employeur a pris des mesures qui ont aggravé la situation des employés, notamment en essayant de suspendre certains avantages prévus par la convention collective. Cependant, le syndicat a amené l'employeur à la table des négociations et a réussi à préserver certaines garanties pour ses membres.
Voyez-vous des perspectives de développement du dialogue social en Ukraine à l'heure actuelle ?
En conclusion, je voudrais dire qu'au cours de ces presque trois années, une strate de dirigeants syndicaux assez puissants a émergé en Ukraine, qui s'est habituée à travailler dans des circonstances d'incertitude totale et où l'État soutient les employeurs. Je pense que si ces personnes survivent à ces temps difficiles, elles seront en mesure de créer des structures fortes pendant la période de reconstruction d'après-guerre, qui exigeront de meilleures conditions de travail et l'égalisation des salaires avec la moyenne européenne. Aujourd'hui, le salaire moyen dans l'UE est d'environ 2 000 euros, et il me semble qu'au moins les travailleurs des infrastructures critiques et des industries d'exportation devraient recevoir au moins la moitié de ce montant, soit au moins 1 000 euros par mois.
Si nous voulons avancer sur la question des conditions de travail, nous devons imposer certaines obligations aux entreprises qui bénéficient de l'achat de biens et de services sur les fonds budgétaires par le biais du mécanisme d'appel d'offres. En particulier, nous devrions exiger que les accords d'adjudication prévoient la minimisation des accidents dans l'entreprise, que les employés soient impliqués dans la prise de décision et que les salaires soient également alignés sur les indicateurs européens. C'est ce que j'entends par des changements qui profiteront à l'ensemble de la société.
11 novembre 2024
Publié par Commons
Illustration Katya Gritseva
Traduction Patrick Le Tréhondat
1 Le récit sur la déréglementation des relations de travail et la destruction de l'État-providence aujourd'hui peut également être trouvé dans la conférence de Vitaliy :
https://www.youtube.com/watch?v=dO4e_M3iMLs
2 Pour bénéficier d'un tel paiement unique, l'entreprise ou l'institution où travaillait le travailleur blessé doit être inscrite au registre des infrastructures critiques. Le fonds de pension, interprétant la loi de manière restrictive, a massivement refusé des paiements si l'installation n'était pas inscrite au registre au moment de la tragédie. Pour plus de détails sur cette situation, voir l'article de Vitaliy :
https://rev.org.ua/garanti%d1%97-dlya-pracivnikiv-kritichno%d1%97-infrastrukturi/

Les infirmières iraniennes reprennent leurs manifestations pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les bas salaires

Les infirmières iraniennes ont repris leurs manifestations à Fasa (sud de l'Iran) et à Yazd (centre de l'Iran), le samedi 2 novembre 2024, alors que le gouvernement refuse de répondre à leurs demandes d'amélioration des salaires et des conditions de travail.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les femmes représentent 70 % de la main-d'œuvre infirmière en Iran, un groupe qui a été confronté à des sous-paiements systématiques, à la censure et même à l'intimidation.
Un tragique catalyseur de changement
En août, de vastes manifestationsont éclaté à la suite de la mort tragique de Parvaneh Mandani, une infirmière de 32 ans de la province de Fars. Son effondrement et son décès, attribués à un surmenage extrême, ont été rapportés dans les médias comme un cas de « syndrome de Karoshi » – un terme traditionnellement associé au Japon, qui trouve désormais une résonance dans la crise des soins de santé en Iran.
Le décès de Parvaneh est devenu un cri de ralliement, déclenchant des manifestations qui se sont étendues à plus de 50 hôpitaux dans 21 villes. Les infirmières iraniennes se sont mobilisées, exigeant une rémunération équitable et dénonçant les heures supplémentaires obligatoires, qui les obligent souvent à prendre en charge jusqu'à 50 patients simultanément.
Négligence systémique de la loi sur la tarification des soins infirmiers
Les revendications des infirmières iraniennes ne se limitent pas à des heures de travail équitables. Elles demandent l'application de la loi sur la tarification des services infirmiers, promulguée en 2006, qui vise à normaliser la rémunération en fonction de la charge de travail et des performances – une loi qui a été largement ignorée. En outre, les infirmières souhaitent avoir accès aux avantages professionnels généralement accordés aux fonctions à haut risque, tels que la retraite anticipée après 25 ans, mais ces droits ne sont toujours pas respectés.
Augmentation des taux de démission et d'émigration
Le manque de soutien gouvernemental a poussé de nombreuses infirmières à bout. L'année dernière, environ 1 590 infirmières iraniennes ont démissionné, un chiffre qui dépasse nettement le taux d'émigration des professionnels de la santé. En fait, on estime que les démissions sont deux à trois fois supérieures au taux d'émigration. En un mois seulement, plus de 200 infirmières iraniennes ont quitté le pays, ce qui souligne l'urgence de cette crise.
La légalité des heures supplémentaires forcées remise en question
Fin septembre, la commission parlementaire iranienne de la santé et des traitements a pris acte de l'augmentation des démissions et de l'émigration. Elle a reconnu que l'imposition d'heures supplémentaires obligatoires aux infirmières était illégale, citant une décision de la Cour de justice administrative. Malgré cette reconnaissance, aucune réforme substantielle ou mesure de compensation n'a été adoptée.
Néanmoins, les infirmières iraniennes restent déterminées dans leurs revendications. Elles continuent de réclamer un revenu minimum supérieur au seuil de pauvreté et un plafonnement des heures supplémentaires à 80 par mois. Il est alarmant de constater que les heures supplémentaires sont actuellement rémunérées à moins de 50 cents de l'heure.
https://wncri.org/fr/2024/11/03/les-infirmieres-iraniennes-4/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Aliyev, Orbàn, Meloni... La COP29 accueille le gratin d’extrême droite mondial

Emmanuel Macron, Joe Biden ou Lula ne viendront pas à la COP29, à Bakou. Ils laissent ainsi toute latitude aux chefs d'État d'extrême droite et à leur hôte l'autocrate Ilham Aliyev pour faire les louanges des énergies fossiles.
Tiré de Reporterre
Bakou (Azerbaïdjan), reportage
« Je veux le répéter ici devant cette audience : c'est un don de Dieu. » Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, répète son mantra au sujet du pétrole et du gaz. Le 12 novembre, au deuxième jour de la COP29 à Bakou, l'allocution de l'indétrônable autocrate s'est traduite par une défense acharnée — et transparente — de l'extraction de combustibles fossiles. Sans la moindre retenue à l'égard de ses détracteurs, le moustachu a taillé « la politique du deux poids, deux mesures, la manie de donner des leçons et l'hypocrisie » des dirigeants, activistes et médias de certains pays occidentaux.
Quittant la tribune sous les applaudissements nourris de la plénière « Nizami », le dictateur aux commandes du pays hôte depuis 2003 a échangé une chaleureuse poignée de mains avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Celui-ci n'a pas corrigé la teneur de son laïus, mais était sans doute médusé par ces propos d'une férocité quasi-inédite en diplomatie internationale. Toujours est-il que le patron de l'ONU a commencé par remercier « l'accueil et l'hospitalité » de l'homme venant de jeter un froid à l'hémicycle.
« Nous sommes dans le compte à rebours final »
« Le son que vous entendez est celui du tic-tac de l'horloge. Nous sommes dans le compte à rebours final pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C, a toutefois clamé le Portugais. Et le temps ne joue pas en notre faveur. » Dénonçant l'absurdité de poursuivre l'investissement dans les hydrocarbures, il a appelé à réduire de 30 % leur production d'ici 2030.
Un vœu aux antipodes des projections de l'État accueillant la COP, tablant plutôt sur une hausse de +14 % à l'horizon 2035.
Champ libre aux nationalistes européens
Jusqu'au crépuscule du 13 novembre, un bataillon de 82 chefs d'État et de gouvernement, vice-présidents et princes héritiers doit défiler au pupitre de l'Assemblée. Une grand-messe protocolaire, baptisée « Sommet des leaders » et boudée par tous les dirigeants des pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone. Le président des États-Unis, Joe Biden, à la légitimité terriblement fragilisée par l'élection de Donald Trump, sèche l'exercice pour la deuxième année consécutive. Les leaders du Japon, de l'Australie, de la Chine, de l'Inde, du Canada, de l'Afrique du Sud ou encore du Mexique brillent aussi par leur absentéisme. Au même titre que le dictateur Vladimir Poutine, le roi Charles et le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, pourtant hôte de la prochaine COP.
Et le tableau n'est guère plus garni du côté de l'Union européenne. Emmanuel Macron, lui aussi, a refusé de se déplacer. Une première depuis 2019, justifiée par les fortes tensions diplomatiques entretenues avec l'Azerbaïdjan depuis la condamnation par la France de l'invasion du Haut-Karabagh par l'armée d'Ilham Aliyev, en 2023. Une fenêtre de tir idéale, dont Alexandre Loukachenko, autocrate biélorusse et proche allié de Vladimir Poutine, s'est aussitôt saisi : « Quelle est l'efficacité de nos négociations sur le climat si le président français n'est même pas présent ? »
Le nationaliste hongrois, Viktor Orban, a pu dérouler à la COP des ambitions climatiques bien différentes de celles défendues par l'Union européenne. © Emmanuel Clévenot / Reporterre
Le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ne participent pas non plus au grand raout. Une aubaine pour le nationaliste hongrois, Viktor Orban, ayant pu dérouler des ambitions climatiques bien différentes de celles défendues par l'Union européenne : « Nous devons poursuivre la transition verte tout en maintenant notre usage du gaz, du pétrole et du nucléaire », a-t-il notamment déclaré à la barre. Attendue ce jour devant la plénière, son homologue italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, risque d'adopter pareille posture.
Les pays pauvres vont-ils « quitter Bakou les mains vides » ?
Visiblement plus enclins à partager le sentiment d'urgence devant « le tic-tac de l'horloge », plus d'une vingtaine d'intervenants africains ont décrit les tragiques répercussions du changement climatique que leur pays affronte au quotidien. Au même titre que le président du Népal, endeuillé par une mousson et des glissements de terrain meurtriers, ainsi que les figures d'une flopée de nations insulaires : « Tout est menacé, a déploré Ahmed Abdullah Afif Didi, vice-président des Seychelles. Nous devons déménager nos maisons. »
Hilda Heine, l'une des neuf femmes parmi les 82 leaders présents à la COP29, a fustigé la démobilisation des pays riches à l'heure de mettre la main à la poche. La présidente des Îles Marshall, un État insulaire que le Pacifique pourrait un jour engloutir, a toutefois harangué l'hémicycle : « Nous savons reconnaître le moment où la tendance s'inverse. Et en ce qui concerne le climat, la tendance s'inverse maintenant. »
Jusqu'au 22 novembre prochain, une enveloppe annuelle allant de 100 à 1 300 milliards de dollars (1 225 milliards d'euros) doit être débattue pour financer la transition des pays vulnérables au changement climatique. « [Ils] ne doivent pas quitter Bakou les mains vides », a insisté António Guterres.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
.*

COP 29 : le méthane, un don de la Trinité

Cette COP29, réunie à Bakou, est, comme les précédentes, l'occasion pour certains « acteurs » des industries fossiles, comme de leurs financiers, de répéter une fois de plus « qu'il faut prendre conscience de la situation » et pour les affabulateurs les plus hypocrites de diffuser l'idéologie « de la transition écologique ».
13 novembre 2024 Alencontre
http://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/cop-29-le-methane-un-don-de-la-trinite.html
Par rédaction A l'Encontre
Une « transition » que Jean-Baptiste Fressoz, dans son ouvrage Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie (Le Seuil, janvier 2024), qualifie « d'idéologie du capital au XXIe siècle. Grâce à elle, le mal devient le remède, les industries polluantes des industries vertes en devenir, et l'innovation, notre bouée de sauvetage. Grâce à la transition, le capital se retrouve du bon côté de la lutte climatique. Grâce à la transition, on parle de trajectoire à 2100, de voitures électriques [1] et d'avions à hydrogène plutôt que de niveau de consommation matérielle et de répartition [de la richesse produite]. » Autrement dit est évité tout pas de travers qui permettrait de déceler la logique vampiriste du capital [2].
***
Au deuxième jour de la COP29, Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan marchant dans les pas de son père autocrate Heydar Aliyev, déclamait au sujet du pétrole et du gaz : « Je veux le répéter ici devant cette audience : c'est un don de Dieu. » La figure divine est aujourd'hui d'actualité : Trump a été sauvé par Dieu à l'occasion d'une tentative d'assassinat le 13 juillet et incarne la présence de Dieu dans le champ politique selon les courants catholiques intégristes et évangélistes qui furent les anges gardiens de son élection à la présidence des Etats-Unis. Ici, la « providence divine » guide les forages et l'augmentation de l'extraction de fossile.
Au moment où António Guterres, à Bakou, indique qu'il faut réduire de 30% la production d'hydrocarbures d'ici 2030, l'hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan, selon le rapport de l'ONG OilChange International, a pour objectif d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 14% d'ici 2035. Et le futur hôte de la COP30, le Brésil, table sur une croissance de 36%.
Quant à Giorgia Meloni, selon Il Fatto Quotidiano du 13 novembre, elle joue dans son intervention la carte de la « transition écologique » (décarbonation, biocarburants, fusion nucléaire) tout en insistant sur un fait d'évidence : « Il n'y a pas d'alternative aux combustibles fossiles. » Il est vrai que l'Italie importe 57% de son pétrole et 20% de son gaz d'Azerbaïdjan.
***
Les COP ont au moins un effet stimulant : des ONG, des instituts et y compris la presse économique publient des données qui pointent les périls à venir. Ainsi, les études concernant, par exemple, les émissions de méthane sont diffusées dans les mois précédant la COP.
Ian Angus, sur son site Climate & Capitalism, le 10 septembre, rapportait les résultats établis par le Earth System Science Data sur le budget mondial du méthane pour 2024.
Ce dernier « montre une augmentation de 20% des émissions de méthane dues aux activités humaines au cours des deux dernières décennies.
»Le méthane est l'un des trois principaux gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Il ne reste dans l'atmosphère que quelques décennies, moins longtemps que le dioxyde de carbone et l'oxyde nitreux, mais son potentiel de réchauffement global à court terme est le plus élevé, car il retient davantage de chaleur dans l'atmosphère.
»Le bilan, établi par leGlobal Carbon Project, couvre 17 sources naturelles et anthropiques (induites par l'homme). Il montre que le méthane a augmenté de 61 millions de tonnes métriques par an.
“Nous avons observé des taux de croissance plus élevés pour le méthane au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022, avec un record en 2021”, explique Pep Canadell, directeur du Global Carbon Project. “Cette augmentation signifie que les concentrations de méthane dans l'atmosphère sont 2,6 fois plus élevées que les niveaux préindustriels (1750).” “Les activités humaines sont responsables d'au moins deux tiers des émissions mondiales de méthane, ajoutant environ 0,5°C au réchauffement climatique qui s'est produit jusqu'à présent.”
»Le rapport conclut que l'agriculture est à l'origine de 40% des émissions mondiales de méthane d'origine anthropique. Le secteur des combustibles fossiles en produit 34%, les déchets solides et les eaux usées 19%, et la combustion de la biomasse et des biocarburants 7%.
»Les cinq principaux pays émetteurs en 2020 étaient la Chine (16%), l'Inde (9%), les Etats-Unis (7%), le Brésil (6%) et la Russie (5%).
»L'Union européenne et l'Australasie ont réduit leurs émissions anthropiques de méthane au cours des deux dernières décennies. Toutefois, les tendances mondiales mettent clairement en péril les engagements internationaux visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030.
»Pour des trajectoires d'émissions nettes nulles compatibles avec l'objectif de l'Accord de Paris d'une augmentation maximale de la température de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions anthropiques de méthane doivent diminuer de 45% d'ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2019. »
***
Dans le Financial Times du 12 novembre, Attracta Mooney (Bakou) et Jana Tauschinski (Londres) rassemblent un cumul de données démontrant « comment les compagnies pétrolières et gazières dissimulent leurs émissions de méthane […], comment elles dissimulent régulièrement des fuites de ce gaz à effet de serre mortel, bien qu'il s'agisse de l'une des solutions les plus faciles à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. »
»Sur les rives de la mer Caspienne, à moins de 30 miles de l'endroit où les dirigeants, ministres et négociateurs du monde entier se réunissent cette semaine à Bakou dans le cadre du sommet sur le climat COP29, un puissant gaz à effet de serre s'est échappé dans l'atmosphère.
»Un capteur installé sur la Station spatiale internationale a détecté six panaches distincts de méthane entre avril et juin. Selon l'organisation californienne à but non lucratif Carbon Mapper, qui a analysé les données et les a communiquées au Financial Times, tous ces panaches proviennent de sites pétroliers et gaziers situés à la périphérie de la capitale de l'Azerbaïdjan.
»Cinq autres panaches ont été détectés sur d'autres sites du pays, notamment près du terminal pétrolier et gazier géant de Sangachal [vaste complexe industriel qui comprend un point de collecte, de traitement, de stockage et d'exportation du gaz du champ de Shah Deniz, ainsi que du pétrole d'Azeri-Chirag-Guneshli]. Bien que d'intensité variable, ces panaches étaient à la fois polluants et profondément toxiques, contenant des substances cancérigènes et d'autres gaz dangereux, ainsi que du méthane.
»Selon les militants et les analystes qui suivent la pollution par le méthane, une situation similaire se produit dans les installations pétrolières et gazières du monde entier. Dans certains cas, des fuites accidentelles sont à blâmer. Mais ailleurs, les producteurs rejettent le gaz de manière flagrante et délibérée.
»Le méthane est le principal responsable de la formation de l'ozone troposphérique [c'est-à-dire présent près du sol], un polluant atmosphérique dangereux qui cause chaque année la mort d'un million de personnes dans le monde à la suite de maladies respiratoires. Mais une menace encore plus grande pèse sur le climat.
»Même s'il ne persiste pas aussi longtemps dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, sur une période de 20 ans, le méthane est 80 fois plus puissant pour piéger la chaleur. On estime qu'il est responsable de 30% du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle.
»Une partie du méthane provient de sources naturelles telles que les zones humides et les gaz volcaniques. Mais la majeure partie des émissions est due à l'activité humaine : agriculture, déchets de décharge et industrie des combustibles fossiles.
»Le problème a longtemps été occulté en raison du manque d'outils permettant de le détecter et de le mesurer. Inodore et incolore, ce gaz est notoirement difficile à repérer. Jusqu'à récemment, les études sur le méthane s'effectuaient principalement au sol à l'aide d'appareils portatifs ou par des survols aériens qui le détectent grâce à ses interactions avec les ondes lumineuses.
»Selon une analyse du Financial Times, les entreprises du secteur de l'énergie ont trouvé de nombreux moyens de dissimuler l'ampleur de leurs émissions. « Le pétrole et le gaz émettent beaucoup plus de méthane que nous ne le pensons », affirme Eric Kort, professeur de climat, de sciences spatiales et d'ingénierie à l'université du Michigan. […] les émissions provenant de l'industrie pétrolière et gazière ne figurent pas à l'ordre du jour de cette année.
»Pourtant, les émissions du secteur de l'énergie ont atteint un niveau record en 2023 – une irritation pour certains analystes, qui soulignent qu'il s'agit de l'une des possibilités les moins coûteuses et les plus rapides de lutter contre le réchauffement climatique actuellement disponibles.
»“La réduction du méthane à court terme est le moyen le plus rapide dont nous disposons pour éviter les pires effets du changement climatique”, déclare Manfredi Caltagirone, responsable de l'Observatoire international des émissions de méthane du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). “[Et] le secteur qui présente le plus grand potentiel de réduction est l'industrie pétrolière et gazière.”
»Un précédent sommet de la COP tenu en 2021 a lancé le Global Methane Pledge, une initiative soutenue par plus de 150 pays, qui vise à réduire les émissions mondiales de 30% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Toutefois, selon des données récentes, les émissions globales de méthane continuent d'augmenter. » […]
***
Le dogme des politiques néolibérales, l'autorégulation, est invoquée de manière trompeuse car les groupes pétroliers et gaziers disent pouvoir détecter les émissions de méthane – y compris celles liées au torchage et aux accidents – grâce au développement de technologies satellitaires d'imagerie et de mesures.
Or, comme le souligne l'article du Financial Times :
« Josh Eisenfeld, qui suit les émissions de méthane à Earthworks, une organisation américaine à but non lucratif dont l'objectif est de mettre fin à la pollution énergétique, estime que l'un des principaux problèmes réside dans le fait que l'industrie “essaie de s'autosurveiller”. La plupart des équipements utilisés par les compagnies pétrolières et gazières ne parviennent même pas à repérer les petites fuites de méthane, affirme-t-il.
»Une enquête menée par Earthworks et Oil Change International a révélé que les “moniteurs d'émissions en continu”, utilisés par les producteurs pour enregistrer les rejets de polluants en temps réel, n'ont détecté qu'une seule émission au Colorado, alors que leurs propres chercheurs en ont enregistré 23. […]
»L'AIE (Agence internationale de l'énergie) estime également que les émissions mondiales de méthane provenant du secteur de l'énergie sont supérieures d'environ 70% aux quantités déclarées par les pays.
»Selon une étude publiée dans Nature au début de l'année et basée sur un million de mesures aériennes de puits, de pipelines, d'installations de stockage et de transmission dans six régions des Etats-Unis, les émissions étaient presque trois fois plus élevées que les estimations fournies par le gouvernement fédéral. »
***
Or, Donald Trump a placé l'un de ses proches à la direction de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Lee Zeldin. Selon Trump, « Lee Zeldin va s'assurer de prises de décisions rapides et justes de déréglementation qui vont permettre de doper la force des entreprises américaines, tout en conservant les plus hautes normes environnementales. » La transition est assurée.
[1] Voir à ce propos sur ce site l'article d'Alain Bihr intitulé « La voiture électrique, une alternative illusoire ». http://alencontre.org/ecologie/la-voiture-electrique-une-alternative-illusoire.html
[2] Voir l'article publié sur ce site en date du 4 mai 2021 http://alencontre.org/laune/le-vampirisme-du-capital-i.html
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
.*

La réélection de Donald Trump : quelles implications pour les politiques climatiques ?

Y aura-t-il bientôt des COP sans les États-Unis ? Ces derniers vont-ils de nouveau quitter l'accord de Paris ? Quel avenir pour les énergies renouvelables outre-Atlantique ? Alors que Trump revient à la Maison Blanche, l'économiste Christian de Perthuis nous en dit plus sur ce que l'on peut attendre de ce climatosceptique convaincu à la tête de la première puissance mondiale.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
6 novembre 2024
Par Christian (de) Perthuis
Climatosceptique affiché, Donald Trump avait fait campagne en 2016 sur la relance du charbon aux États-Unis, l'allègement des contraintes environnementales imposées par l'administration démocrate et la sortie de l'Accord de Paris.
De relance de charbon, il n'y eut point durant son premier mandat (2017-2020), l'électricité produite à partir du gaz ou des renouvelables étant bien trop compétitive. L'allègement des contraintes réglementaires a consisté à abroger le Clean Power Acthttps://www.connaissancedesenergies..., une régulation préparée sous l'administration Obama qui n'était pas entrée en vigueur faute de soutien au Congrès. Enfin, le retrait de l'Accord de Paris, décidé en juin 2017, a été sans conséquence car il exigeait, au moment où il a été décidé, un délai de quatre ans pour devenir effectif.
Au total, le premier mandat de Donald Trump n'a eu que des effets limités sur la politique climatique, tant au plan interne qu'externe. Il pourrait en aller bien différemment durant le second mandat.
L'accord de Paris soumis à rude épreuve
Le candidat Trump n'a pas fait mystère de son intention de quitter à nouveau l'accord de Paris, qualifié d'un meeting à l'autre de « ridicule », « injuste » ou encore « désastreux ». Autre argument de campagne : l'Accord coûterait des centaines de milliards aux États-Unis et rien à la Chine et aux autres pays émergents.
Un second retrait des États-Unis est donc pratiquement certain. Mais il sera cette fois-ci effectif un an seulement après avoir été signifié aux Nations unies. Cela aura donc un impact potentiellement bien plus dévastateur sur les négociations climatiques internationales. Comme l'avait été la décision de George W. Bush en 2001 de quitter le protocole de Kyoto, le prédécesseur de l'accord de Paris, entré en déshérence graduelle durant les années 2000.
Une certaine incertitude plane cependant sur un possible retrait des États-Unis de la convention-cadre sur le climat de 1992, le traité fondateur de la diplomatie climatique dont le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris ne sont que des textes d'application.
Au plan juridique, la sortie de cette convention implique en effet d'obtenir une majorité des deux-tiers au Sénat alors que quitter l'accord de Paris s'effectue par simple décret présidentiel. Si les États-Unis sortaient de cette convention, ils ne participeraient donc plus aux COP climat qui sont l'organe décisionnel de la convention.
Ce retrait attendu des États-Unis intervient à un moment charnière de la négociation climatique. À la COP29 de Bakou, il sera bien difficile d'obtenir des engagements d'accroissement des financements climatiques, l'enjeu central des discussions, avec la perspective de sortie du premier bailleur de fonds.
La réévaluation des objectifs de réduction des émissions aux horizons de 2030 et 2035 sera le principal enjeu de la COP30, à Belém (Brésil) l'an prochain. Ici encore, on voit difficilement comment parvenir à un résultat significatif sans l'implication des États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre (GES) après la Chine.
Promesses de baisses des prix de l'énergie, disparition des objectifs climatiques
D'après les évaluations indépendantes, les États-Unis ne sont pas en ligne pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de GES, au titre de leur contribution à l'accord de Paris (-50/52 % entre 2005 et 2030). Des mesures complémentaires auraient du compléter l'Inflation Reduction Act (IRA), principal outil de financement de la transition énergétique adopté sous l'administration Biden pour y parvenir.
Avec le retour de Trump, c'est un changement majeur de perspective qui s'annonce. L'objectif de réduction d'émission disparaît du paysage au profit d'une promesse, annoncée à la Convention Républicaine de juillet 2024, de diviser par deux le prix de l'énergie à la charge des ménages américains. La méthode ? « Drill, baby, drill » (en français, littéralement « fore [du pétrole], chérie, fore ! »), suivant le slogan de campagne répété à chaque meeting électoral, et la récupération des milliards gaspillés au nom de la « nouvelle arnaque verte » (« Green new scam »), expression désignant l'IRA et plus généralement le développement des énergies renouvelables soutenu par l'administration démocrate.
Vidéo : « Je m'engage devant le grand peuple américain à mettre fin immédiatement à la crise inflationniste dévastatrice, à faire baisser les taux d'intérêt et le coût de l'énergie, nous allons “Drill baby drill !” » assurait Donald Trump le 19 juillet 2024 dernier.
L'objectif de relance de l'exploration pétrolière et gazière est affiché alors que les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole et de gaz sous le mandat de Joe Biden. Avec la nouvelle majorité républicaine au Congrès, les derniers verrous qui freinaient l'extraction de pétrole et de gaz sur les terres fédérales ou protégés risquent de sauter et l'industrie de bénéficier de conditions fiscales et financières plus favorables. Cette relance du pétrole et du gaz pourrait générer en 2030 un supplément d'émission voisin de 2 Gt d'équivalents CO2 (5 fois les émissions de la France !), relativement à un scénario de simple poursuite de la politique climatique démocrate (graphique).
Fourni par l'auteur
La réalité économique comme seul garde-fou ?
Le démantèlement des soutiens aux énergies renouvelables via l'IRA sera en revanche plus problématique. Au plan politique, il risque de contrarier nombre d'élus Républicains au Congrès. Les états du centre et du sud des États-Unis, les plus acquis à la cause Républicaine, sont en effet les premiers bénéficiaires des subsides de l'IRA.
Ce démantèlement ira de surcroît à contresens de l'objectif de baisse des prix de l'énergie. Dans les meetings de campagne, les énergies solaires ou éoliennes ont été systématiquement présentés comme plus coûteuses que leurs concurrentes d'origine fossile. Mais cette représentation, héritée du passé, est de plus en plus déconnectée des réalités industrielles.
Si on veut faire baisser le prix de l'électricité, et multiplier ses usages au détriment des sources fossiles devenues plus coûteuses, il faut au contraire accélérer le déploiement des nouvelles énergies de flux (solaire et éolien) et non pas les contrarier. Avec une majorité au Sénat et peut-être à la Chambre des Représentants plus une Cour suprême qui lui est acquise, les garde-fous politiques pour s'opposer au rétropédalage climatique programmé par Donald Trump seront bien faibles. Reste le garde-fou économique, car le monde que voudrait construire le bientôt octogénaire Président est celui d'hier et non celui de demain.
Christian de Perthuis, Professeur d'économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL
< !—> The Conversationhttp://theconversation.com/republishing-guidelines —>
P.-S.
• The Conversation. Publié : 6 novembre 2024, 15:37 CET.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.
• Christian de Perthuis, Université Paris Dauphine – PSL
• Nous croyons à la libre circulation de l'information
Reproduisez nos articles gratuitement, sur papier ou en ligne, en utilisant notre licence Creative Commons.
• The Conversation est un média indépendant, sous un statut associatif. Avec exigence, nos journalistes vont à la rencontre d'expert•es et d'universitaires pour replacer l'intelligence au cœur du débat. Si vous le pouvez, pour nous soutenirfaites un don.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

On n’a jamais autant brûlé d’énergies fossiles qu’en 2024

Les émissions de CO2 issues des énergies fossiles ont augmenté de 0,8 % par rapport à 2023, rapportent les scientifiques du Global Carbon Project. Ce qui augure d'un réchauffement de 2 °C atteint en 2051.
Tiré du site de Reporterre
Nous ne sommes toujours pas sur la bonne trajectoire. Selon les dernières projections du Global Carbon Project — collectif réunissant 120 scientifiques à travers le monde — les émissions mondiales de CO2 liées à la production et à la consommation d'énergies fossiles continuent de croître. Dans un rapport publié mercredi 13 novembre, les chercheurs estiment qu'en 2024 ces émissions seront en hausse de 0,8 % par rapport à l'an dernier. Soit 37,4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (GtCO2) envoyées dans l'atmosphère.
En plus des énergies fossiles, le changement d'usage des sols (principalement la déforestation) ont émis 4,2 GtCO2. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2023 (4,1 GtCO2). La raison ? « La sécheresse pendant le phénomène El Niño et la déforestation ont permis les très nombreux incendies au Brésil et en Indonésie cette année », disent les chercheurs. Tout compris, les estimations des émissions de CO2 atteignent 41,6 milliards de tonnes en 2024 contre 40,6 milliards de tonnes l'an dernier.
« Il est clair que le budget carbone restant est presque épuisé »
Est-il trop tard pour respecter l'Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900) ? Au rythme actuel, il y a 50 % de risques que le réchauffement dépasse 1,5 °C de manière constante sur plusieurs années d'ici environ six ans, selon les scientifiques du Global Carbon Project. Si cette estimation est soumise à de grandes incertitudes liées au réchauffement supplémentaire causé par d'autres agents eux aussi réchauffants (CH₄, N₂O, aérosols) « il est clair que le budget carbone restant — et donc le temps qu'il reste pour atteindre l'objectif de 1,5 °C — est presque épuisé ». Si l'on continue au même rythme, « les +2 °C seront, eux, atteints dans vingt-sept ans ».
Toutes les émissions fossiles sont à la hausse
Pour une seule année, la barre a déjà été franchie, a annoncé l'institut Copernicus début novembre. L'observatoire européen a indiqué qu'il est désormais « pratiquement certain » que l'année 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne de 1,6 °C supérieure à la température moyenne de l'ère préindustrielle.
Malgré l'urgence, les chercheurs du Global Carbon Project affirment qu'il n'y a toujours « aucun signe » que le monde a atteint un pic d'émission de CO2. Au surlendemain de l'ouverture de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, ils appellent les dirigeants à « prendre des engagements pour réduire rapidement et fortement les émissions de combustibles fossiles afin de nous donner une chance de rester en dessous des 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels ».
Dans le détail, les émissions liées au gaz naturel bondiraient en 2024 de 2,4 %, celles relatives au pétrole seraient en hausse de 0,9 % et celles liées au charbon devraient croître de 0,2 %. Seules les émissions liées au ciment sont à la baisse (-2,8 %), en raison de la crise de la construction en Chine et aux États-Unis. Toutefois, « compte tenu de l'incertitude des projections, il est possible que les émissions de charbon — combustible le plus néfaste pour l'atmosphère — diminuent en 2024 », précisent les scientifiques dans le rapport.
En Inde et en Chine, des hausses moins fortes qu'en 2023
Tous les pays ne sont pas sur les mêmes trajectoires. Du côté des mauvais élèves, l'Inde, responsable de 8 % des émissions mondiales de CO2, reste sur une pente ascendante. Après une hausse de 8,2 % en 2023, ses rejets de CO2 augmentent cette année « seulement » de 4,6 %.
La Chine, qui dégage quasiment un tiers des émissions mondiales (31 %), n'infléchit pas la tendance mais ses émissions augmentent beaucoup moins qu'avant : 4,9 % en 2023 contre 0,2 % cette année. « La demande d'électricité continue de croître fortement, tant dans l'industrie que dans les ménages, la consommation de charbon a légèrement augmenté », notent les scientifiques du Global Carbon Project.
« La demande d'électricité continue de croître fortement »
Par ailleurs, « les émissions provenant du pétrole ont probablement atteint leur maximum, les véhicules électriques gagnent régulièrement des parts de marché ». Pour information, la Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2060 et un pic d'émissions en 2030.
Des baisses plus timides aux États-Unis et dans l'Union européenne
Les États-Unis poursuivent quant à eux leur baisse des émissions de CO2. Après une diminution de 3 % en 2023, cette année, les rejets de dioxyde de carbone devraient s'infléchir de 0,6 %. Cette baisse concerne à la fois le charbon — délaissé au profit du gaz naturel — le pétrole et le ciment. Alors que le pays s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, l'élection de Donald Trump à la présidence pourrait changer la donne.
Si l'Union européenne affiche encore une fois la plus forte baisse d'émissions, -3,8 % de CO2 en un an, selon l'estimation des chercheurs, c'est beaucoup moins qu'en 2023 (-7 %). Pourquoi ? Une partie peut s'expliquer par la crise énergétique en 2023 : « La chute avait été très forte en 2023 car les Européens se sont moins chauffés que d'habitude à cause de la hausse des prix de l'électricité consécutive à l'arrêt des importations de gaz russe. » En outre, l'hiver 2023 avait été particulièrement doux.
Pour le « reste du monde » (soit tous les autres pays à l'exclusion de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et de ceux de l'Union européenne), les émissions sont en hausse de 1,1 %.
Concernant les différents secteurs d'émissions, l'aviation et le transport maritime internationaux, responsables chacun de 3 % des émissions mondiales, devraient augmenter respectivement de 13,5 % et 2,7 % en 2024.
La technologie ne sauvera pas le climat
Si l'on regarde les tendances décennales, les chercheurs observent toutefois un ralentissement de la hausse des émissions de CO2. Entre 2013 et 2024, elles étaient de +0,6 % par an en moyenne, contre +2,4 % lors de la décennie précédente.
Et il ne faut pas compter sur la technologie pour sauver le climat. « Les niveaux actuels d'élimination du dioxyde de carbone par la technologie (captage et stockage de CO2) ne permettent que de compenser un millionième du CO2 émis par les combustibles fossiles », rappellent les scientifiques.
En plus de réduire les activités du charbon, pétrole et gaz, il faut davantage prendre soin des puits de carbone océaniques et terrestres. Ceux-ci nous évitent le pire en absorbant la moitié des émissions totales de CO2 sur la dernière décennie malgré les effets négatifs du changement climatique sur ces écosystèmes.
Enfin, si les effets de l'épisode El Niño ont entraîné une forte réduction des puits de carbone en 2023, en favorisant par exemple les sécheresses, ces puits de carbone devraient se rétablir avec la fin de ce phénomène météo, prédisent les scientifiques.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
.*

La Contre-COP des peuples africains dénonce le système des COP et exige que la justice climatique pour le Sud global soit au centre de l’action climatique

Du 7 au 10 octobre, le Collectif Africain pour la Justice Climatique a organisé la première Contre-COP du Peuple Africain à Saly, au Sénégal. Plus d'une centaine de participant.e.s, venu.e.s de 21 pays, représentant des mouvements sociaux, des communautés de base, des femmes, des jeunes, des organisations de la société civile, des universitaires, des travailleur.e.s et d'autres, ont pris part à l'événement.
Tiré de la page web de Via Campesina
De nombreuses voix africaines – exclues de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – ont été captées et légitimées lors de ce rassemblement. C'était « un moment pour dénoncer le système des COP, souligner les impacts du changement climatique sur les communautés africaines et présenter des solutions alternatives viables », comme le souligne leur déclaration (à lire ci-dessous).
L'événement a offert aux délégué.e.s un espace fructueux pour discuter, élaborer des stratégies et proposer des actions concrètes pouvant conduire à des solutions climatiques justes à travers l'Afrique. Divers thèmes ont été abordés au cours de la conférence, de la souveraineté alimentaire à la lutte contre les fausses solutions climatiques, en passant par les impacts sur l'environnement et les communautés locales de pêcheur.e.s.
Evelyne Awuor, de la Kenyan Peasants League (KPL), membre de La Via Campesina (LVC) SEAf du Kenya, a assisté à la conférence et était heureuse de partager des histoires de communautés où les agricultrices ne sont pas invitées aux réunions. « J'ai veillé à être présente et à partager leur message, occupant ainsi avec force des espaces dans lesquels elles étaient exclues », conclut-elle.
L'APCC est devenue une plateforme pour faire la chronique de la résilience et de la survie des communautés en Afrique et une excellente occasion d'échanger des idées et des rêves d'un meilleur avenir pour tou.te.s !
Lisez ci-dessous leur déclaration complète, rédigée à l'issue de la réunion :
L'Afrique unie contre l'oppression systématique et l'injustice climatique : Déclaration des peuples africains pour la justice climatique
Du 7 au 10 octobre 2024, le Collectif africain pour la justice climatique a organisé la première Conférence des peuples africains pour la justice climatique (APCC) en présentiel à Saly, au Sénégal. Plus d'une centaine de participant·e·s issus de mouvements sociaux, de communautés de base, de femmes, de jeunes, d'organisations de la société civile, d'universitaires, de travailleurs et d'autres personnes de 21 pays y ont pris part.
L'APCC reconnaît que les voix africaines ont été largement exclues de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, captée par les États et les entreprises du Nord, qui continuent d'alimenter les crises climatiques tout en prétendant faussement résoudre les causes du changement climatique. L'APCC constitue donc un moment pour dénoncer le système des COP, souligner les impacts du changement climatique sur les communautés africaines et présenter des solutions alternatives viables. Cela se fait par le partage des connaissances et l'activisme des communautés africaines les plus vulnérables en première ligne de la crise climatique, en particulier les femmes, les jeunes, les militant·e·s et les OSC.
L'APCC a créé un espace où les voix des communautés de base et des militant·e·s ont été entendues et saluées, contrairement à la COP, où ces voix sont marginalisées. Les délégué·e·s ont partagé leurs récits sur les impacts du changement climatique : sécheresses, inondations, érosion, mauvaises récoltes, cyclones, élévation du niveau de la mer, tempêtes de poussière et menaces pour les écosystèmes marins et terrestres, aggravées par l'accaparement des ressources et des terres, ainsi que par les conflits induits par le climat. Ces événements ont entraîné des déplacements, des pertes de moyens de subsistance, des pertes et dommages connexes, des victimisations, des arrestations, du harcèlement et même la mort de membres de la communauté et de militant·e·s qui défendent leurs territoires.
En raison du rétrécissement des espaces civiques dans de nombreux pays, la plateforme APCC est devenue un lieu pour faire la chronique de la résilience et de la survie des communautés, ainsi que de la manière dont la géopolitique a affecté la capacité de l'Afrique à répondre aux impacts du changement climatique. Plusieurs thèmes ont été abordés.
-Souveraineté alimentaire : La nécessité de renforcer les pratiques agroécologiques, la gestion communautaire des forêts et des terres, le pastoralisme et les pratiques de pêche locale, en particulier pour les femmes, qui constituent la majorité des personnes dans les zones rurales.
-Transitions justes : Une interrogation sur les considérations relatives au travail dans la souveraineté énergétique, l'élimination rapide, juste et équitable des combustibles fossiles, et le changement de système à mesure que nous évoluons vers l'adoption des énergies renouvelables et l'industrialisation verte pour le continent africain.
-Systèmes zéro déchet : Une opportunité pour les gouvernements africains d'intégrer des pratiques de gestion décentralisée des déchets afin de réduire les émissions de méthane.
-Financement climatique : L'accent est mis sur l'architecture financière nécessaire à la transition juste, à l'adaptation, à l'atténuation et au fonds pour les pertes et dommages, avec un appel à garantir que les communautés les plus vulnérables touchées par le changement climatique aient accès à ces fonds.
À l'approche de la COP29 qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024, les peuples africains se mobilisent pour défendre leur droit à un environnement sûr, propice à la croissance et au progrès, même face à la dévastation climatique, environnementale, sociale et économique aggravée par l'architecture néolibérale soutenue par les pays du Nord.
La région de Saint-Louis et la Langue de Barbarie au Sénégal illustrent bien ces défis environnementaux dramatiques : élévation du niveau de la mer, érosion côtière, inondations et salinisation des terres agricoles. Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), mené par des sociétés transnationales (STN), BP et Kosmos Energy, doit exploiter l'un des plus grands gisements de gaz naturel d'Afrique de l'Ouest, situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Bien que ce projet soit présenté comme un vecteur de développement économique, il constitue en réalité une menace sérieuse pour les communautés locales, en particulier pour les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis.
La pêche artisanale, pilier de l'économie locale, fait vivre des milliers de familles et contribue à la souveraineté alimentaire des femmes, des populations autochtones et de leurs communautés. Cependant, l'exploitation du gaz dans les eaux menace directement ces communautés de pêcheurs et la région dans son ensemble. Les zones de pêche traditionnelles sont désormais interdites, et la pollution croissante due aux forages et aux opérations sismiques compromet gravement la santé des écosystèmes marins. Les eaux, la biodiversité et le patrimoine naturel sont détruits au profit de quelques-uns.
En réponse aux présentations faites, les participants à l'APCC 2024 ont conclu que la crise climatique en Afrique est transversale et ont réaffirmé que les Africains ont contribué de manière minime aux émissions responsables du réchauffement climatique. Cependant, en raison de capacités limitées d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, nous, Africains, sommes confrontés à la majorité des défis causés par la crise climatique qui ravage le continent aujourd'hui.
Pour démanteler le pouvoir d'exploitation et l'impunité, les peuples africains affirment leur pouvoir de reléguer les faux récits en promouvant des solutions africaines à travers les déclarations suivantes, en opposition aux impositions du marché et du Nord global lors de la prochaine COP29 à Bakou.
En tant que peuples d'Afrique, nous déclarons :
-Justice climatique maintenant : Nous exigeons la justice climatique pour les communautés du Sud global au centre de l'action climatique. Les pays du Nord global, qui ont le plus contribué à la crise climatique, doivent mener le processus de réduction des émissions à la source et financer les transitions nécessaires en guise de paiement de la dette climatique due au Sud global. Nous dénonçons toutes les formes de fausses solutions au changement climatique, telles que REDD+, Net zéro et la géo-ingénierie, qui aggravent encore davantage les crises climatiques.
- Mettre fin aux extractions de combustibles fossiles en Afrique MAINTENANT : Toutes les formes d'exploration, d'extraction et de production de combustibles fossiles en Afrique doivent être immédiatement arrêtées. Il est temps de donner la priorité aux pratiques durables grâce à une énergie renouvelable centrée sur les personnes, qui protège nos écosystèmes et soutient les économies locales. Les entreprises de combustibles fossiles doivent financer la réhabilitation des terres, des océans et des rivières dégradés par l'extraction d'hydrocarbures.
-Migration et déplacements induits par le climat : Avec l'augmentation des crises climatiques, de nombreux Africains sont contraints de migrer, risquant leur vie dans des voyages dangereux vers le Nord global ou devenant des réfugiés climatiques en Afrique, ce qui entraîne des insécurités alimentaires, foncières et des conflits. Pour y remédier, il faut s'adapter et renforcer la résilience face aux impacts climatiques, tels que les sécheresses, les inondations, l'érosion côtière et la désertification, et veiller à ce que les communautés disposent des ressources nécessaires pour rester dans leurs terres d'origine ou se réinstaller dans des zones propices sans détruire leurs moyens de subsistance, leur culture et leur langue.
-Dette climatique, réparations et réformes économiques : Les réparations climatiques, la remédiation et l'indemnisation des populations touchées en Afrique, ainsi que les réparations coloniales, doivent être versées aux nations africaines et au Sud global, reflétant l'ampleur des dommages causés par le changement climatique et l'exploitation historique. Ces réparations doivent prendre la forme de subventions, et non de prêts qui aggravent encore la dette. L'APCC exige un mécanisme de financement mondial dédié aux pertes et dommages, doté d'au moins 100 milliards de dollars de financements nouveaux et supplémentaires par an d'ici 2030. Ce financement doit être fourni par les pays du Nord, qui portent la responsabilité historique des émissions mondiales. Les pays africains devraient se concentrer sur la valorisation de la valeur ajoutée et sur des partenariats stratégiques qui élèvent la position de l'Afrique dans la chaîne de valeur. Il est urgent de procéder à une réforme fiscale structurelle de l'architecture financière actuelle, qui mettra fin aux flux financiers illicites et à l'évasion fiscale des sociétés transnationales (STN). L'APCC s'oppose fermement à la marchandisation des forêts, des terres et des ressources naturelles africaines par le biais du commerce du carbone.
-Réformer les lois foncières et promouvoir la souveraineté alimentaire : Les gouvernements africains doivent adhérer à la souveraineté alimentaire en donnant la priorité aux cultures vivrières locales par rapport aux cultures commerciales et en promouvant des méthodes de conservation des semences résistantes aux OGM. Cette protection doit inclure des politiques contraignantes ratifiées telles que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Il est urgent de réévaluer les lois coutumières qui donnent du pouvoir aux communautés locales. Les pays africains ont besoin d'un minimum de 15 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer les mesures d'adaptation agricole, et au moins 5 milliards de dollars par an doivent être consacrés aux pratiques agroécologiques.
-Souveraineté énergétique et démocratie pour tous : La transition vers les énergies renouvelables en Afrique doit être soutenue en priorité avant que l'Afrique n'exporte ses ressources pour la transition vers le Nord global. Les projets d'énergie renouvelable doivent être détenus par la société et bénéficier aux femmes, aux jeunes, aux populations autochtones et aux communautés locales avant l'industrie. La transition doit être menée par la base, en veillant à ce que les politiques donnent la priorité au bien-être des personnes et de l'environnement, et non aux profits des entreprises.
-Halte au colonialisme des déchets : L'Afrique n'est pas un dépotoir et nous ne sommes pas jetables. Il est donc primordial pour nous, Africains, de nous adapter au Traité mondial sur les plastiques, qui nous permet de lutter contre la pollution plastique tout au long de son cycle de vie, de l'extraction à la production et à l'élimination.
-Consentement préalable, libre et éclairé (CLIP) et autodétermination : Le droit des femmes, des peuples autochtones et de leurs communautés au CLIP doit être ratifié et mis en œuvre dans tous les projets d'extraction. Les communautés doivent avoir le droit de dire non ou oui au développement. Si les communautés disent oui, elles doivent dicter les conditions du projet d'une manière qui leur soit bénéfique ainsi qu'à leur environnement. L'indemnisation doit être proportionnelle au niveau de déplacement et de pertes.
-Impliquer les personnes touchées et marginalisées dans la prise de décision : Les gouvernements doivent développer des mécanismes de participation durables qui amènent les femmes, les jeunes autochtones, les personnes handicapées, ainsi que les éleveurs, les pêcheurs et les petits producteurs alimentaires à la table des discussions politiques pour créer des politiques centrées sur les personnes et de véritables solutions qui répondent aux effets du changement climatique. Les demandes des personnes touchées, dans leur diversité, doivent être entendues et respectées.
-Renforcement de la résilience en Afrique : Les Africains doivent se lever contre l'oppression systématique et l'injustice climatique en partageant leurs compétences en matière de résilience et leurs connaissances traditionnelles à travers la narration, le partage d'expériences et l'apprentissage, et mettre ces connaissances en pratique dans nos communautés africaines dirigées par des peuples autochtones et des femmes. Ces connaissances doivent être respectées et intégrées dans d'autres systèmes et processus, car elles constituent des savoirs spécialisés.
En conclusion, la Contre-COP des peuples africains est organisée en réponse à la cooptation de la COP par le capitalisme et le Nord global, qui perpétuent les injustices à l'origine de la crise climatique. Par conséquent, nous, du Sud global, et les Africains en particulier, devons entreprendre des actions qui remédient aux crises climatiques de manière juste et holistique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
.*

– Contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de NousToutes

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre, nous appelons à manifester dans toutes les villes de France hexagonale et des Outre-mer le samedi 23 novembre contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre.
Tiré de Entre les lignes et les mots
En France, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, nous décomptons déjà plus d'un millier de féminicides. UN MILLIER de femmes et filles assassinées par des hommes ! Les féminicides ont lieu partout, dans les foyers mais aussi en dehors. Dans l'espace public, ces crimes visent particulièrement les femmes trans, migrantes, travailleuses du sexes ou SDF qui sont trop souvent invisibilisées. Derrière ce chiffre, ce sont aussi des milliers d'enfants, de familles et de proches endeuilléEs.
Qui s'en indigne ? Qui se préoccupe réellement du meurtre de ces femmes, tuées parce qu'elles sont des femmes ? Quelles réactions collectives ? Quelles réponses politiques ? Depuis 7 ans, les gouvernements successifs ont multiplié les promesses mais les moyens sont dérisoires et en baisse, l'action politique est quasi-inexistante. Non seulement le gouvernement ne soutient pas le travail militant et associatif, mais il s'engage dans une répression sans précédent des mouvements sociaux et féministes.
Les violences sexistes et sexuelles sont quotidiennes et concernent tout le monde. La banalisation du sexisme favorise les violences que nous vivons au quotidien : discriminations, harcèlement, violences psychologiques, violences au sein du couple à travers le contrôle coercitif, violences économiques, cyberviolences dont les raids masculinistes, violences gynécologiques, mutilations sexuelles, mariages forcés, agressions, viols, féminicides. En France, une femme est victime de viol ou tentative de viol toutes les 2 minutes 30 et un enfant toutes les 3 minutes. Plus de cinq millions d'adultes en France déclarent avoir été victimes de pédocriminalité. Des centaines de milliers d'enfants sont victimes des violences conjugales, parentales et intrafamiliales. Un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Face à Gisèle et ses enfants, le profil des 51 hommes accusés de viol sous soumission chimique confirme ce que les associations féministes et enfantistes répètent depuis des décennies : les auteurs de violences ne sont pas des monstres, ce sont des hommes de notre entourage mais aussi des personnalités publiques. Ces violences concernent tout le monde ! Et la honte doit changer de camp !
Les violences de genre interviennent aussi au croisement de plusieurs systèmes de domination et d'exclusion. Elles touchent particulièrement les personnes aux identités multiples et vulnérabilisées parce qu'elles sont racisées, précaires, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, exilées, sans papiers ou en situation irrégulière, incarcérées, handicapées, affectées par des maladies ou troubles psychiques, vivant avec le VIH, travailleuses du sexe, victimes d'exploitation, à la rue, usagères de produits psycho-actifs, mères isolées, mineures, âgées ou grosses. Les rapports de domination s'entretiennent et se renforcent. Ce sont les paroles des premièrEs concernéEs qui fondent nos luttes féministes et nous combattons conjointement toutes les oppressions.
Alors que les victimes parlent et appellent à l'aide, nous dénonçons l'inaction volontaire de l'État, coupable du maintien des violences et de l'abandon des victimes. Le gouvernement enterre la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (Ciilise), abandonne les associations et les services de protection de l'enfance qui subissent des coupes budgétaires. Les institutions maintiennent leur fonctionnement patriarcal et délétère pour les victimes et celleux qui les soutiennent. Ancrées et normalisées dans nos sociétés, les violences sont tantôt invisibles, tantôt considérées comme une fatalité ou un fléau. Au contraire, elles peuvent et doivent être éradiquées. Les solutions sont connues depuis des décennies, d'autres pays les mettent en oeuvre avec des résultats probants : des politiques publiques notamment de prévention des violences, d'éducation à l'égalité et à la culture du consentement à l'école, de mise à l'abri et d'accompagnement des victimes dans leur reconstruction.
Le 23 novembre, nous serons dans la rue pour réclamer ces politiques publiques, avec un budget pérenne annuel d'au moins 2,6 milliards d'euros soit 0,5% du budget de l'État. Le 23 novembre, nous serons dans la rue pour crier notre colère face aux violences sociales qui se sont multipliées ces dernières années et impactent particulièrement la vie des femmes, des personnes LGBTQI+ et des enfants. Si la réforme des retraites représente une violence envers toutes les personnes les plus précaires, les femmes en sont les premières victimes car 60% des économies ont été réalisées sur leurs retraites. Parmi les deux millions de mères isolées avec leurs enfants, près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. En plus des temps partiels imposés, des bas salaires des métiers dévalorisés occupés en grande partie par des femmes racisées, l'inflation ou encore la réforme du RSA les ont encore plus vulnérabilisées.
Le 23 novembre, dans un contexte d'explosion de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de toutes les formes de racisme, ainsi que de la transphobie, nous serons aussi dans la rue pour dénoncer la haine entretenue par la fascisation des discours politiques et médiatiques, qui impactent directement nos vies. Nous rappellerons que l'extrême-droite en particulier représente une menace immédiate pour les femmes, les personnes minorisées et les enfants. Niant le résultat des urnes, Emmanuel Macron continue de dérouler le tapis rouge à l'extrême-droite en nommant un premier ministre et un gouvernement réactionnaires ayant voté contre les droits des femmes, des minorités de genre et des enfants. Nous manifesterons notamment contre les politiques LGBTQI+phobes dont les thérapies de conversion et la mutilation des enfants intersexes. Nous continuerons de faire front face aux partis politiques, organisations, médias, masculinistes et fémonationalistes qui attaquent nos droits et instrumentalisent nos luttes.
Le 23 novembre, nous serons aussi dans la rue en solidarité avec nos sœurs et nos adelphes du monde entier, et en soutien de tous les peuples victimes de la colonisation, des génocides, des guerres. Partout où il y a des guerres et des régimes totalitaires, les femmes, les personnes LGBTQI+ et les enfants subissent le viol, les pires violences et voient leurs droits bafoués. Nous exigerons le respect par le gouvernement français du droit international et de l'autodétermination des peuples, la fin de toute politique coloniale et l'arrêt immédiat de l'armement des régimes génocidaires.
Le 23 novembre, nous appelons à la mobilisation générale et à une déferlante féministe dans les rues de toutes les villes de France hexagonale et des Outre-mer contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre
Publiés dans le Courrier N° 437 de la Marche Mondiale des Femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’affaire Errejón, les agressions sexuelles et les féministes (Etat espagnol) : « {Il est urgent d’ouvrir le débat, d’en redéfinir le cadre et de le politiser »}

L'affaire Errejón a suscité un vaste débat public dans la société et, bien entendu, au sein d'un mouvement féministe très diversifié. Dans cette interview, Justa Montero, féministe et engagée depuis longtemps dans le mouvement social, membre du Conseil consultatif de Viento sur, nous donne son point de vue sur ce débat très nécessaire et en même temps, comme elle le dit elle-même, complexe et aux aspects multiples.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Viento Sur : L'accusation d'agression sexuelle portée contre Iñigo Errejón [1] et les témoignages qui ont suivi ont donné lieu à un débat public intense. Selon toi, où se situe le cœur du débat ?
Justa Montero : Au-delà de la procédure judiciaire que l'accusation (ou les accusations) d'agression sexuelle contre Iñigo Errejón va entraîner, l'impact en a été dévastateur. À la plainte s'est ajoutée une désolante lettre, bourrée d'euphémismes, dans laquelle il reconnaît de manière vague sa conduite tout en se disculpant sans demander pardon. Les conséquences ont été dévastatrices, car il s'agit d'un responsable politique extrêmement connu du public, représentant un parti de gauche qui se réclame de la « nouvelle politique » et se déclare féministe.
L'ampleur prise par cette affaire a entraîné un important débat public qui pourrait marquer un tournant dans la compréhension du phénomène des violences sexuelles. Un débat qui n'est pas facile parce qu'il a de multiples facettes et qu'il révèle à quel point il est complexe de prendre en considération cette violence machiste dans ses dimensions personnelles et sociales.
Ainsi, au premier abord, ce qu'il révèle est quelque chose que le mouvement féministe souligne depuis de nombreuses années, depuis que la violence sexuelle est inscrite parmi ses priorités : que la violence sexuelle, dans ses différentes manifestations, est plus banalisée que ne le laisse penser la perception qu'en a la société ; qu'il n'y a pas un seul profil d'homme harceleur et agresseur, c'est-à-dire que la violence sexuelle peut être le fait de citoyens respectables, de pères de famille (Dominique Pelicot, le retraité français qui a organisé le viol de sa femme par 92 hommes, ne semblait-il pas en être un ? ), elle peut venir de prêtres, de collègues, de parents, d'enseignants…
Dans le cas d'Iñigo Errejón, le débat a également été alimenté par un traitement médiatique agressif, moralisateur et sensationnaliste, qui a réussi à faire de la douleur un spectacle (une émission de télévision a même été jusqu'à reconstituer avec des acteurs les scènes mentionnées dans la plainte) ; une stigmatisation sur le mode du lynchage s'est ensuivie, créant un monstre qui mérite la prison à vie. Ceci est typique d'un populisme punitif et étranger à une éthique féministe, quels que soient les faits et les personnes.
Mais, comme le souligne Paola Aragón dans son article « Reconstruire le monstre »·[2], cela répond à un objectif, à une intentionnalité politique claire. Il s'agit de réinstaller dans l'imaginaire collectif l'idée que l'agresseur est un monstre, un traitement qui lui confère le caractère d'exception, de chose hors du commun, ce qui permet d'empêcher que l'on puisse se reconnaître dans le problème qui l'a engendré, créant ainsi un phénomène de mise à distance. Ceci, comme nous le voyons, a un effet rassurant immédiat sur la société, sur les hommes, et un effet trompeur sur les femmes.
Parmi les articles écrits par des hommes que j'ai lus ces jours-ci (de toutes sortes sur l'échelle idéologique), et je suis sûre qu'il y en a plus et que dans les réseaux il y aura des commentaires que je n'ai pas lus non plus, il y en a très, très peu qui se sont sentis interpellés ; allez, ils se comptent sur les doigts d'une main, et il y en a trop (sur ce site, nous avons repris un article de Martí Caussa, « Errejón y nosotros » [3]). Il est surprenant de voir à quel point les hommes ont beaucoup à dire et à repenser (et dans ce cas très particulièrement les hommes hétérosexuels), à partir de la place sociale qu'ils occupent, sur leur masculinité, les relations qu'ils entretiennent, leur contribution à la construction de relations agréables pour les uns et les autres… Mais bien au contraire, dans un certain nombre de cas, ils sont tombés dans la mise en cause du féminisme et de ses dérives.
Une de ces réactions problématiques apparues dans le débat est celle qui s'accompagne d'une connotation moralisatrice. Au lieu de classer les pratiques sexuelles, quel que soit leur type, en fonction de l'existence ou non d'un consentement, et donc de leur qualification d'agression ou non, à partir de l'interprétation de témoignages sortis de leur contexte, il semble que toute pratique sexuelle insatisfaisante à un moment donné, désagréable ou directement désagréable, soit une agression. Et cela revient à dévaloriser l'expression par chaque femme de son vécu sexuel.
L'approche moralisante et moralisatrice contribue à dépolitiser le débat ouvert, il est donc urgent d'ouvrir le champ, de redéfinir le cadre du débat et de le politiser, d'élargir le cadre de l'attention aux violences sexuelles et, en plus du niveau strictement individuel, qui est important et qui exige la vérité, la justice et la réparation pour les femmes qui en ont souffert, d'affronter également la nature structurelle des violences sexuelles, au niveau des structures sociales et des relations de pouvoir patriarcales et discriminatoires qui les entretiennent.
Je voudrais ouvrir une parenthèse pour commenter le fait que, de manière surprenante, le débat s'est accompagné d'un règlement de comptes, à d'honorables exceptions près, entre personnes ayant fait partie de Podemos et de Sumar. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport, il est clair que le mode de direction hyperpersonnalisé, les structures hiérarchiques, les structures peu démocratiques et l'autoritarisme sont favorables au règne du pouvoir, mais il serait bon de réserver d'autres espaces à ces discours afin d'éviter de détourner l'attention, parce que, de fait, dans ces discours, le problème de la violence sexuelle et des femmes qui la subissent disparaît.
V. S. : Pourquoi penses-tu que les dénonciations de ce cas et d'autres sont passées par les réseaux sociaux et non par les sphères collectives des partis ou des espaces dans lesquels ils se produisent ?
J. M. : Hé bien, d'une façon générale, il y a très peu de femmes qui dénoncent les violences sexuelles. Selon les données disponibles, issues de la macro-enquête de 2019 sur les violences faites aux femmes, seules 11,1% des femmes ayant subi des violences sexuelles en dehors du couple les ont dénoncées (elle ou quelqu'un d'autre en son nom) ; ce pourcentage tombe à 8% si la plainte est déposée uniquement par la femme agressée. Dans le cas d'un viol, le pourcentage de femmes qui portent plainte est un peu plus élevé, mais il n'est que de 18%.
Il n'y a pas de raison unique à cela. La majorité des agressions sexuelles ont lieu dans des environnements proches de la vie quotidienne des femmes : dans la famille, au boulot, à l'université, entre amis, à l'église, dans des lieux divers. Même dans le cas des viols, ce n'est pas dans la rue que la plupart d'entre eux ont lieu, comme ce fut le cas pour « la manada », la meute [4]. Dans de nombreux cas, des relations hiérarchiques et de pouvoir sont en jeu, et il est difficile de les dénoncer par crainte de répercussions immédiates dans l'environnement, en raison de situations précaires, par exemple sur le lieu de travail. Il y a des femmes qui, même si elles le voulaient, ne pourraient pas dénoncer ; c'est le cas des femmes migrantes en situation administrative irrégulière parce que la loi les a laissées de côté sans modification de la loi sur les étrangers et donc, si elles dénoncent, elles peuvent se retrouver exposées à des procédures d'expulsion.
Ainsi, lorsque cela a été possible, parce que les femmes se sont senties soutenues par la mobilisation féministe et qu'on leur a offert un espace de parole, on a assisté à une explosion de témoignages anonymes. Sur les réseaux, elles ont trouvé cet espace où elles peuvent raconter leur histoire et se sentir accompagnées, se reconnaissant dans les récits des autres. Cela revêt une importance politique considérable, car la première étape pour aller de l'avant est de donner la parole aux femmes. Et dans les témoignages, elles racontent des expériences qui parfois peuvent constituer un délit, dans d'autres cas elles relatent des pratiques machistes de connards et de bourrins machistes ; dans tous les cas, elles nous permettent de connaître la diversité des expériences et l'impact différencié qu'ont les différentes formes de violence sexuelle sur les femmes.
Le fait que ce soient les réseaux qui aient canalisé ce déversement, avec certaines garanties, soulève de nombreuses questions, car les réseaux, comme nous le savons tous, ne sont pas sans poser des problèmes. Mais l'alternative qui a été proposée par les institutions et certains groupes féministes, à savoir le dépôt de plainte comme procédure offrant davantage de garanties aux femmes, il faut d'abord dire qu'elle se réfère à des moments différents, parce qu'une femme peut vouloir laisser un témoignage de son expérience, mais ne pas vouloir dénoncer parce que son témoignage ne se rapporte peut-être pas à quelque chose qui est considéré comme un délit, ou parce que si c'est le cas, elle ne veut pas le faire non plus.
Comment ne pas avoir peur de la culpabilisation et de la revictimisation, de se voir jugée, d'être interrogée et de la mise à nu personnelle que cela implique ? Il suffit de se rappeler certaines questions posées dans les procès les plus célèbres, ou de l'embauche d'un détective par la défense de violeurs en bande pour passer au peigne fin la vie de la victime. Il y a un film et un documentaire qui illustrent tout cela de manière rigoureuse. Je fais référence au film récent Nevenka (la conseillère municipale de Ponferrada qui a dénoncé le maire, tous deux du PP) d'Icíar Bollaín ; et au documentaire No estás sola (Tu n'es pas seule) sur le viol collectif de Pampelune, d'Almudena Carracedo et Robert Bahart. Dans ces deux cas, les femmes ont gagné en justice, les jugements ont eu d'importantes implications sociales et juridiques en raison de leur impact, et ont permis aux femmes de reprendre le cours de leur vie, même si elles ont dû quitter leur ville. En les regardant, il est facile de comprendre pourquoi une femme ne voudrait pas subir des procédures pénales aussi longues et aussi pénibles.
Tu as demandé pourquoi les plaintes n'ont pas été déposées dans les lieux où les faits se sont produits. Tous les partis ont déclaré avoir adopté des procédures contre les abus ou la violence machiste. Mais les résolutions ne sont pas une garantie en soi ; elles doivent s'accompagner d'une culture politique et organisationnelle anti-violence, de mécanismes d'écoute préventive et protectrice permettant d'identifier les comportements machistes, de mesures d'accompagnement et de suivi. En bref, garantir qu'il s'agit bien d'espaces politiques permettant des relations sûres et amicales dans lesquels la culture machiste est combattue, qu'il existe des moyens permettant, en cas de témoignage ou de plainte, de garantir la non-répétition des faits. Je ne crois pas qu'il y ait de formule magique ; ce sont les processus mêmes de construction collective qui comptent et dans lesquels les groupes de femmes doivent avoir une légitimité et une autorité.
V. S. : Peux-tu expliquer les raisons de la polarisation entre les positions punitivistes et anti-punitivistes ?
J. M. : De mon point de vue, la question centrale pour avancer vers un horizon de transformation est de savoir comment mettre fin à l'impunité qui entoure les violences sexuelles et protège les agresseurs, et comment garantir la réparation aux victimes. L'impunité et la réparation sont les deux éléments qui donnent un sens à la demande de justice et de garanties de non-répétition, car avec l'impunité, il n'y aura jamais de réparation.
La question que se pose le féminisme est la suivante : quelles sont les stratégies qui permettent de lutter contre les violences sexuelles de façon à ce qu'il y ait la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition ? Et c'est là que le débat punitivisme/anti-punitivisme réapparaît.
Une précision préliminaire, car depuis l'affaire Errejón, des positions punitivistes ont été imputées au féminisme comme s'il s'agissait d'un groupe homogène. Bien qu'il existe un secteur du mouvement féministe qui connaît une dérive punitiviste, laquelle la rapproche des positions libérales, sociales-démocrates ou du féminisme classique, il ne s'agit en aucun cas de ce que j'appellerais la position des « grèves féministes ». Je précise cela parce qu'affirmer que le dépôt d'une plainte en justice est punitif revient à banaliser la portée du dépôt d'une plainte. Comme le souligne Laia Serra (avocate pénaliste et féministe) :
« En fait, s'il est un mouvement politique qui n'a cessé de se remettre en question, c'est bien celui des féministes de base. Nous n'avons pas besoin de leçons d'anti-punitivisme, nous connaissons, pour l'avoir vécu, la brutalité du système et les retombées de la répression, et nous savons très bien que le droit pénal non seulement ne résout pas les problèmes sociaux, mais qu'il en démultiplie la violence. Nous avons toujours eu à cœur, de par notre éthique et notre engagement pour l'émancipation, de nous opposer à tout ce qui vide les problèmes de leur charge de contestation sociale » (pikaramagazine [5]).
Le débat avec les positions punitivistes est très important, et du fait de la loi du « seulement si », du populisme punitif qui se manifeste face aux réductions de peine et aux libérations de prisonniers, le débat sur ses conséquences s'est approfondi et amplifié. Parler de punitivisme, c'est se tourner vers l'Etat qui a le monopole de la violence, vers le système carcéral et sécuritaire qu'il organise, vers l'ensemble de son maillage juridique de contrôle social. Et l'État exerce la violence contre les femmes de multiples façons, comme le montre le livre Cuando el estado es violento d'Ana Martínez et Marta Cabezas.
Mais de mon point de vue, il est également intéressant de s'attaquer à l'anti-punitivisme, car c'est ce qui peut ouvrir de nouveaux horizons à ce que nous appelons la justice féministe. Je me réclame d'un féminisme qui a été et qui est anti-punitiviste, qui s'est confronté au populisme punitif, qui critique, par conséquent, le système pénal, les prisons et leur supposé effet préventif. Jamais ce courant féministe n'a mis l'accent sur un alourdissement des peines, ce n'est pas ce qui a été demandé dans le cas de la « meute de Pampelune », où ce qui était demandé, c'était une nouvelle façon de prendre en compte la violence, allant du harcèlement au viol collectif.
Mais, et je reviens à Laia Serra, ce débat sur l'anti-punitivisme ne peut occulter le vrai problème, non résolu, de savoir que faire face à l'impunité généralisée dont bénéficie la violence et de déterminer qui doit être tenu pour responsable de ses conséquences. En d'autres termes, la façon dont on donne un fondement à ces accords théoriques sur l'anti-punitivisme revêt un caractère plus complexe dans la pratique politique féministe, lorsqu'il faut se colleter à la réalité concrète que vivent les femmes.
Et c'est là que la complexité revient. J'ai dit plus haut que les femmes peuvent appréhender la réparation de différentes manières : par le biais d'une décision judiciaire, dans laquelle la sanction est peut-être ce qui importe le moins, mais où la reconnaissance formelle de l'agression est plus importante ; il peut s'agir d'un processus de réparation s'il bénéficie d'un accompagnement professionnel et social qui soutient les femmes ; il peut s'agir d'une réparation économique, ou de se sentir réparée par la reconnaissance et la responsabilisation de l'agresseur dans l'environnement dans lequel l'agression a eu lieu. Toutes ces réponses sont pareillement légitimes et nécessaires parce qu'elles se concentrent sur les besoins des femmes et sur les moyens de mettre fin à l'impunité et de parvenir à une réparation.
D'une part, nous connaissons les problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans les procédures judiciaires et il ne saurait être question d'embellir ou de mythifier les choses. Mais réaliser des changements, ouvrir des failles dans le système qui permettent des améliorations dans la vie réelle des femmes, comme par exemple le fait que les femmes ne soient pas obligées de porter plainte pour bénéficier de moyens de subsistance et d'un traitement psychologique, l'existence de centres de soins d'urgence spécifiques, que la prévention sociale et en milieu scolaire occupe une place centrale (même si c'est autre affaire qu'elle soit réellement développée), que l'on continue à affronter la justice patriarcale, tout cela permet de continuer à faire porter à l'État la responsabilité de ses dérives patriarcales, autoritaires et punitives, et d'avancer vers l'horizon d'un système de justice féministe.
D'autre part, dans les positions anti-punitivistes, l'alternative à la dénonciation judiciaire est formulée comme une justice réparatrice/transformatrice centrée sur des processus communautaires de réparation et de responsabilisation individuelle et collective. Il est très important et porteur d'espoir que certaines expériences positives de promotion de la non-impunité et de la réparation au niveau communautaire existent. Il est également important que des femmes et des hommes participent à leur développement afin d'enrichir et de faire progresser la réflexion sur la justice féministe que nous souhaitons. Mais il est également important de ne pas enjoliver cela, car cela a aussi ses limites et ses difficultés. Ces espaces, auxquels nous participons, sont aussi en construction et traversés par des inégalités. Lorsqu'un cas de violence sexuelle a été soulevé, il est parfois arrivé que des dynamiques de revictimisation de la femme qui avait porté plainte au sein du collectif se soient produites. Ces expériences n'ont pas toujours été positives et l'autogestion de la violence n'a pas toujours donné des résultats satisfaisants. Vouloir l'aborder non pas de manière complémentaire, mais comme une alternative, crée des problèmes dans la pratique, car la grande majorité des femmes qui subissent des violences sexuelles ne participent pas à ce type de communautés et de réseaux sociaux, n'ont pas la possibilité de le faire, et ont besoin d'autres outils.
En conclusion, l'anti-punitivisme est quelque chose qui se construit à partir de diverses pratiques en espérant réduire la distance entre la justice féministe à laquelle nous aspirons et les conquêtes ponctuelles que nous obtenons : mesures préventives, prise en charge totale des femmes ayant subi des violences sexuelles, transformation du système judiciaire, construction de collectifs et de relations plaisantes et satisfaisantes, afin d'améliorer la situation de celles qui subissent des violences sexuelles.
V. S. : Quel devrait être, selon toi le rôle du féminisme dans ce débat ?
J. M. : Tout d'abord, une précision, car vu la tournure que prend le débat public, je pense qu'il est nécessaire de revenir à parler des féminismes au pluriel. On parle trop souvent du féminisme comme s'il s'agissait d'un bloc compact ou d'un parti, alors qu'il s'agit d'un mouvement pluriel. C'est ainsi que l'on étouffe, y compris, même si c'est surprenant, de la part de voix amies, le féminisme de base qui s'est nourri des grèves féministes et qui, comme je l'ai dit, ont fui le punitivisme, qui ont toujours mis en avant la capacité d'action des femmes en tant que sujets dotés de la compétence éthique de prendre des décisions concernant leur vie, leur identité, leur sexualité, leur plaisir et leur amour, non pas en tant que victimes mais, même dans des situations dures et difficiles, en tant que sujets actifs à même de formuler leurs revendications. Ces exigences, il les formule pour toutes, pour les travailleuses du sexe, pour les personnes transgenres, en ce qui concerne la maternité, les relations sexuelles, afin de faire face à la violence. C'est un féminisme qui pratique une approche intersectionnelle pour ancrer les histoires et les propositions dans les réalités concrètes de la vie des femmes, sur la base de leurs conditions de vie matérielles et de la subjectivité de chacune d'entre elles, afin qu'elles puissent vivre dans la dignité et libérées de la violence. Je crois que c'est ce qui ouvre une voie vers une plus grande transformation.
Tout ce qui vient d'être dit n'est rien de plus que de brèves réflexions ; comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un débat complexe, et plus il y a d'acteurs impliqués, plus il y a de facettes qui se dessinent. Je crois que nous devons continuer à y réfléchir et à nous poser de nombreuses questions, comme nous l'avons fait tout au long de notre vie. Lutter contre la violence à deux niveaux interconnectés – individuel et structurel – implique de se confronter à la subjectivité et à la réalité matérielle des femmes et des hommes, ainsi qu'aux structures de pouvoir du système qui génèrent et entretiennent la violence.
Nous nous trouvons à un moment important où nous devons consolider et faire progresser ce qui a été réalisé, afin de gagner la bataille du narratif qui a commencé à se déployer.
Face au risque d'une fermeture moralisatrice du débat, dans lequel la droite et l'extrême droite se lanceront avec force, c'est l'occasion d'exposer nos arguments en défense de notre identité sexuelle et de notre lutte contre la violence machiste. Et face au risque de voir les femmes réduites au silence, il n'y a pas d'autre choix, comme toujours, que l'organisation et la mobilisation féministes. Car la mobilisation féministe est aussi réparatrice pour de nombreuses femmes. J'aime à rappeler les paroles de remerciement contenues dans la lettre envoyée par la femme qui a subi la violence de la manada : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée dans ce parcours. Toutes les personnes dont l'élan, sans qu'elles me connaissent, a submergé l'Espagne, et qui m'ont donné une voix quand beaucoup ont essayé de me l'enlever ».
[1] Iñigo Errejón a été l'un des principaux dirigeant de Podemos, avant de rompre avec Pablo Iglesias, et de fonder ses propres organisations, puis de rejoindre Sumar, puis de se retirer de la vie politique en 2024.
[2] https://www.pikaramagazine.com/2024/10/reconstruir-al-monstruo/
[3] https://vientosur.info/errejon-y-nosotros/
[4] L'affaire de La Manada, viol collectif commis à Pampelune en 2016. La victime a porté plainte, le procès a eu un grand retentissement. Après bien des péripéties, la mobilisation féministe a permis de faire entrer la notion de consentement dans le code pénal, les cinq violeurs ont finalement été condamnés à 15 ans de prison (ndt)
[5] https://www.pikaramagazine.com/2024/10/antipunitivismo-remasterizado/
Source : Viento Sur, 09/Nov/2024, “Urge abrir el foco, cambiar el marco del debate y politizarlo” :
https://vientosur.info/urge-abrir-el-foco-cambiar-el-marco-del-debate-y-politizarlo/
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL.
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72497
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












