Derniers articles

Trump finance une guerre spatiale

Comme l'indiquait le journal La Presse du 17 février 2025, le ministre Bill Blair a déclaré jeudi le 13 février que le Canada est prêt à se joindre au projet de développement du bouclier antimissile de type « Dôme de fer » proposé par Donald Trump.
Tiré de la Chronique de Saïd Bouamama, Le monde vu d'en bas
10 février 2025 | tiré du site Investig'action
https://www.youtube.com/watch?v=-4HmNGVa1uM&t=4s
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des Mères au front de différentes régions du Québec se sont rendues à l’Assemblée nationale pour exiger des actions immédiates concernant la crise sanitaire ignorée à Rouyn-Noranda

Québec, le 20 février 2025 – Alors que la crise environnementale et sanitaire causée par la Fonderie Horne perdure, les Mères au front de différentes régions du Québec se sont rendues directement à l'Assemblée nationale pour exiger l'écoute du gouvernement concernant la situation à Rouyn-Noranda.
La situation de Rouyn-Noranda a été soulevée aujourd'hui entre les murs du parlement, mettant une fois de plus en lumière les impacts dévastateurs de la pollution industrielle sur la santé des citoyen.nes de Rouyn-Noranda. Des exemplaires du nouveau livre Zones sacrifiées ont été remis en main propre à certain.es député.es pour qu'ils prennent
pleinement conscience de l'ampleur du drame qui se joue là-bas.
Par la suite, une performance artistique s'est tenue à l'extérieur devant l'Assemblée nationale. Cette action visait à marquer les esprits, confronter les élu.es à la réalité vécue à Rouyn-Noranda et leur rappeler leur responsabilité.
« Alors que nous assistons, impuissants, à l'effritement de la démocratie et du bien commun, nous avons ici la possibilité d'agir et de faire en sorte que le gouvernement arrête de sacrifier impunément une partie de sa population. » a mentionné Anaïs Barbeau Lavalette, co-instigatrice de Mères au front.
« L'histoire nous apprend que les luttes que l'on gagne sont celles que l'on n'abandonne pas. Les Mères au front ne laisseront pas le gouvernement permettre à Glencore d'empoisonner les enfants de Rouyn-Noranda. Nous sommes là pour rappeler l'urgence d'agir. » a ajouté Laure Waridel, écosociologue et co-instigatrice de Mères au front.
Un gouvernement qui refuse d'agir malgré les preuves accablantes
Les chiffres sont pourtant sans appel :
● 98 % de tout l'arsenic émis dans l'air au Québec se retrouve dans le ciel de Rouyn
Noranda.
● 89 % du plomb, 60 % du nickel, et 43 % du cadmium présents dans l'atmosphère
québécoise y sont également concentrés.
● 25 contaminants toxiques sont rejetés par la Fonderie Horne, dont l'arsenic, le
cadmium, le mercure et le plomb, tous reconnus comme hautement nocifs pour la
santé humaine.
Ces polluants augmentent les risques de cancers, de maladies neurologiques et de problèmes respiratoires graves, mettant en péril la santé de toute la population, particulièrement celle des enfants, mais aussi celle des générations futures. Pourtant, le
gouvernement du Québec persiste à tolérer ces dépassements, sous prétexte d'intérêts économiques.
« Il est inconcevable qu'en 2025, une ville québécoise soit encore une zone de sacrifice au profit d'une multinationale. Ce n'est pas une question environnementale isolée : c'est une crise de santé publique qui devrait mobiliser toute la classe politique de tout le Québec. » a revendiqué Isabelle Fortin-Rondeau, Mères au front de Rouyn-Noranda
Les revendications des Mères au front : Assez, c'est assez !
Aujourd'hui, les Mères au front se rendent à l'Assemblée nationale pour exiger :
● Que la Fonderie Horne respecte enfin les normes d'émission québécoises pour
TOUS les contaminants toxiques, dont l'arsenic.
● Que le gouvernement du Québec cesse d'ignorer la crise sanitaire à Rouyn-Noranda
et prenne des mesures immédiates.
● Que les élu.es rendent des comptes et arrêtent de privilégier les intérêts des
multinationales au détriment de la santé publique.
Elles appellent la population et les médias à relayer leur message et à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il cesse de fermer les yeux sur cette catastrophe.
Une performance artistique pour réveiller les consciences
Inspirée de l'action forte qui s'est déroulée à Rouyn-Noranda devant la Fonderie Horne en octobre dernier, Chloé Lacasse a ouvert la performance devant l'Assemblée nationale avec une interprétation poignante d'une chanson de Richard Desjardins.
S'en est suivi un tableau immobile et bouleversant : des dizaines de participant.es ont dénudé une partie de leur corps, maquillée de noir, pour symboliser la maladie et la contamination. Leur silence était soutenu par la diffusion d'un extrait percutant du nouveau livre Zones sacrifiées, lu par Véronique Côté.
Des figures publiques engagées étaient présentes devant le parlement de Québec pour porter ce message telles que :
● Anaïs Barbeau-Lavalette
● Laure Waridel
● Véronique Côté
● Steve Gagnon
● Des Mères au front de Rouyn-Noranda et de partout au Québec
Un livre, une lutte, un cri d'alarme ignoré
Le livre Zones sacrifiées, paru le 4 février dernier, amplifie ces voix citoyen.nes et expose l'ampleur de l'inaction gouvernementale face à une crise sanitaire documentée depuis des années.
Plusieurs événements, en lien avec ce lancement et auxquel.les tous.tes les citoyen.nes du Québec sont invité.es, se tiendront prochainement à Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Rouyn-Noranda.
« Ce livre permet de mesurer l'ampleur de l'injustice que subissent les citoyen.nes de Rouyn-Noranda. C'est une lecture essentielle pour comprendre à quel point nous sommes traités comme une population sacrifiée. » a souligné Jennifer Ricard Turcotte, Mères au front de Rouyn-Noranda.
Soutenir la mobilisation
Pour appuyer cette démarche et s'informer davantage sur la réalité vécue par les
citoyen.nes de Rouyn-Noranda, il est possible de :
– Acheter et lire le livre Zones sacrifiées
– Assister aux lancements et événements prévus à travers le Québec
https://www.meresaufront.org/nos-actions
– Inviter les Mères au front à venir parler des enjeux et du livre dans votre
localité
L'action du 20 février 2025 n'est qu'un début. Les Mères au front continueront à dénoncer
cette injustice jusqu'à ce que leur message soit enfin entendu par les élu.es.
À propos de Mères au front
Avec plus de 30 groupes locaux principalement à travers le Québec, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié.e.s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu.es de mettre en place des mesures fortes et immédiates qui s'imposent pour répondre à l'urgence environnementale et à la dégradation des écosystèmes. Nous osons faire de l'amour, de la beauté, de l'art, et de la colère maternelle, un levier inébranlable de transformation sociale et écologique !
À propos des Éditions du Quartz
Les Éditions du Quartz publient et diffusent des œuvres littéraires enracinées dans le territoire boréal, explorant ce qui se trame dans les marges géographiques et sociales. Ces écrits s'inspirent de réalités propres aux communautés des régions isolées, nordiques, de colonisation récente et dont les populations sont réduites et dispersées sur un vaste territoire.
Source :
Mères au front | https://www.meresaufront.org/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - Classes, races et genres dans l’élection de 2024

La défaite de Kamala Harris face à Donald Trump est due en grande partie au déclin du soutien à la candidate démocrate de la part des syndicalistes, des Afro-Américain·es et des Latino-Américain·es, ce qui suggère un déclin de la conscience de classe, de la solidarité de la classe ouvrière et le renforcement des identités masculines et raciales blanches.
Tiré de Inprecor 729 - février 2025
19 février 2025
Par Kay Mann
Trump et la "Bro culture" Wired Staff / Getty Images
Ces résultats sont choquants non seulement en raison de l'hostilité de Trump à l'égard des syndicats et des difficultés de la classe ouvrière, de son racisme et de son sexisme manifestes, mais aussi parce que ces groupes font depuis longtemps partie de la base électorale du Parti démocrate.
Bien entendu, les élections ne mesurent qu'imparfaitement les opinions politiques et les identités sociales, et particulièrement aux États-Unis. Les deux principaux partis étant contrôlés par des intérêts financiers, les États-Unis sont le seul pays du Nord à ne pas disposer d'une sorte de parti ouvrier de masse, socialiste ou communiste, ayant des liens avec les syndicats. Cela signifie que les élections reflètent les dynamiques de classe encore moins clairement qu'elles ne le feraient dans les autres systèmes parlementaires multipartis. Les électeur·trices de toutes les classes, de tous les genres et de toutes les races votent pour des raisons variées. Les identités sociales multiples entrent en concurrence pour déterminer un vote. Votera-t-on par exemple républicain parce qu'on est catholique et opposé à l'avortement, pour les Démocrates parce qu'on est ouvrier et qu'on pense qu'ils représentent mieux nos intérêts, ou parce qu'on est une personne de couleur, comme la plupart des minorités racisées le font depuis des décennies ? Plus fondamentalement, le bipartisme implique que les élu·es sortant·es de l'un ou l'autre parti subissent les conséquences des situations impopulaires telles que les prix élevés, tandis que l'opposant profite de ces situations, comme ce fut le cas lors de ces élections. Il faudrait des études précises et nuancées pour comprendre exactement pourquoi les électeur·trices des groupes qui ne votent pas traditionnellement pour les Républicains se sont tournés vers Trump. Ces mises en garde mises à part, certaines données démographiques sur le vote suggèrent des tendances notables.
Dissolution de la coalition du Parti démocrate
De toute évidence, nous assistons à la poursuite de la détérioration de ce qui reste de la grande coalition du Parti démocrate, composée de travailleur·ses et d'Afro-Américain·es, mise en place par Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930. Une tendance générale liait alors les électeur·trices de la classe ouvrière, la plupart des syndicats, les Afro-Américain-es et les Blanc-hes issus des minorités ethniques (1) au Parti démocrate dans la coalition du New Deal, tandis que le Parti républicain était perçu comme le parti des affaires, des riches, des petites villes et des zones rurales. La coalition du New Deal a commencé à s'effriter dans les années 1980, les travailleur·ses blanc·hes abandonnant le Parti démocrate au profit du Parti républicain. Les élections de 2024 ont reflété une accélération brutale de ce processus. Il devient de plus en plus difficile de trouver une cohérence au vote des classes dans les récentes élections aux États-Unis. Les changements dans la conscience et les comportements électoraux ne se produisent évidemment pas dans le vide. L'abandon constant, depuis des décennies, d'une partie de la classe ouvrière, toutes races et tous genres confondus, au profit du Parti républicain a été alimenté par l'adhésion du Parti démocrate à l'austérité néolibérale et par son incapacité à proposer des solutions aux aspirations de la classe ouvrière.
Il est prouvé que les identités de race et de genre ont éclipsé les considérations de classe parmi les secteurs de la classe ouvrière et les communautés racisé·es. Dans la mesure où le vote pour les Démocrates a représenté une conscience de classe déformée, et où Trump est fortement associé à la classe des riches employeurs, les votes de la classe ouvrière pour Trump représentent un déclin stupéfiant de la conscience de classe. Or, la plupart des syndicats restent dans le camp démocrate et ont officiellement soutenu Harris. Ainsi, non seulement les membres de la classe ouvrière en général ont voté pour une personnalité ouvertement antisyndicale étroitement associée à la classe capitaliste, mais une grande partie des 10 % de la main-d'œuvre qui est syndiquée l'a également fait, dans la plupart des cas, contre la position officielle de leur syndicat. Les attaques au vitriol de Trump et de Vance contre les immigré·es, souvent marquées de racisme, ont trouvé un écho parmi les secteurs de la classe ouvrière et les groupes opprimés sensibles à la recherche de boucs émissaires. À cela s'ajoutent une sensibilité aux déclarations protectionnistes liées à la crainte de la « concurrence étrangère » et, plus généralement, la dégradation de la conscience sociale causée par les attaques néolibérales contre les services sociaux. Celles-ci ont alimenté l'accentuation des identités sociales concurrentes telles que la race/l'ethnicité et le genre de manière à contredire, plutôt qu'à mettre en valeur, la solidarité sociale. Il est clair que tous ces éléments ont joué un rôle.
Le genre et la race à l'ère de Trump
Depuis des décennies, les Afro-Américain·es sont particulièrement fidèles à la coalition du PD. Jusqu'à récemment, plus de 90 % des électeur·trices noir·es votaient pour lui. Toutefois, lors des élections de 2024, 24 % des hommes noirs ont voté pour Trump (contre 9 % des femmes noires). Les hommes noirs ont moins voté pour Harris en 2024 que pour Biden en 2020. Cela a joué un rôle décisif dans la défaite de Harris dans les zones urbaines des États clés de 2024, traditionnellement très démocrates, comme Philadelphie, en Pennsylvanie, et Milwaukee, dans le Wisconsin. De même, environ 40 % des Latinos ont voté pour Trump (contre 30 à 33 % pour le républicain George W. Bush en 2004) – et 47 % des hommes latinos.
Les instincts réactionnaires de Trump l'ont amené à se rapprocher de la « Bro culture », une célébration des attitudes sexistes des hommes. Ce message trouve un écho chez les hommes de tous les groupes raciaux et de toutes les classes sociales, mais il est prouvé que les hommes des communautés de couleur y sont particulièrement réceptifs. Cela reflète le déclin de la conscience féministe en général. Après les victoires des années 1970, le mouvement des femmes est passé d'une action de masse à une activité législative et électorale, ce qui a fini par diminuer sa force, puis plus généralement celle de la conscience féministe. Il est très probable qu'aux élections de 2024, certains hommes, qui auraient pu voter pour un homme démocrate, aient voté républicain, ou n'aient pas voté du tout, plutôt que de voter pour une femme, même démocrate. Les attitudes sexistes de certains hommes de tous les groupes raciaux et de toutes les classes sociales ont donc certainement joué un rôle dans la défaite d'Hillary Clinton en 2016 et de Kamala Harris en 2024, les deux seules femmes à avoir jamais été candidates à la présidence pour un grand parti.
L'impasse du populisme raciste et sexiste
Trump trouve une grande partie de son soutien parmi les couches conservatrices de la classe dominante et les électeur·trices de la classe ouvrière qui n'ont pas fait d'études supérieures. Mais bien sûr, son gouvernement ne peut servir qu'une seule classe et il ne fait aucun doute que cette classe est celle des 1 %. Son populisme raciste et anti-immigré·es ne fera que détourner l'attention des vrais problèmes auxquels les masses populaires des États-Unis sont confrontées depuis longtemps.
Lorsque ses politiques de réductions d'impôts et d'augmentation des droits de douane, ainsi que la désignation des immigrant·es et des transgenres comme boucs émissaires, ne parviendront pas à résoudre les problèmes matériels urgents des travailleur·ses – notamment la hausse des prix et la stagnation des salaires tandis que les riches bénéficient de nouvelles réductions d'impôts –, son soutien s'érodera. Les attaques néolibérales contre le niveau de vie de la classe ouvrière, qui ont contribué à fracturer sa conscience, son unité et la solidarité, stimuleront les luttes qui impliqueront l'unité de la classe ouvrière dans l'action, et la reconstruction des solidarités.
L'absence d'un parti ouvrier ou socialiste de masse implique une absence de réponse efficace au flux constant de rhétorique raciste, anti-immigré·es et anti-LGBTQI+ provenant de la droite MAGA (2) et amplifié par les alliés de Trump, Musk et Zuckerberg, par leur contrôle de Facebook et X. Un parti ouvrier ou socialiste de masse offrirait une alternative à leur racisme, leur sexisme et leur nationalisme blanc, ainsi qu'à l'austérité néolibérale des Démocrates et des Républicains, et ce faisant, renforcerait la conscience de classe, et la solidarité au-delà des divisions de race et de genre. La construction de ce parti reste centrale pour toute possibilité réelle de changement social progressiste à une époque où la catastrophe climatique est imminente, où les acquis démocratiques fondamentaux des travailleur·ses et des opprimé·es sont menacés.
Dans les premiers jours de son mandat, Trump a publié, comme il l'avait promis, un certain nombre de décrets visant les immigré·es, les personnes LGBTQI+, et les initiatives Diversité, Équité et Inclusion (DEI). Cela supprimera des protections contre les discriminations à l'égard des minorités racisées, des personnes LGBTQI+, des femmes et des personnes handicapées, et abolira les contrôles sur la sécurité des travailleur·ses et de l'environnement. Des décrets antisyndicaux suivront certainement sous peu. Les mouvements des travailleur·ses, des femmes, de défense des immigrés, des Noir·es et pour l'environnement devront puiser dans les meilleures traditions militantes des luttes de masse et dans la solidarité pour faire face à Trump et à une classe patronale encouragée par ses politiques anti-régulation et anti-syndicales.
Traduit par Antoine Larrache.
Le 2 février 2025
1. Par ethnic whites, l'auteur parle des blanc·hes issu·es de la vague d'immigration, depuis 1881-1921, originaires des pays de l'Europe de l'est et de sud (Polonais·es, juifs, Italien·nes, Grec·ques, Bulgares, Serbes, etc.).
2. Make America Great Again, le slogan de Reagan en 1980, a été repris par Trump, et désigne aujourd'hui le mouvement des partisans de Trump.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Syrie. Les Kurdes à l’épreuve des changements à Damas

Alors que les négociations indirectes se poursuivent entre Ankara et Abdullah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), la situation dans le Kurdistan syrien reste incertaine après le renversement du régime de Bachar Al-Assad. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) sont engagées dans des tractations complexes sur l'avenir du Rojava, tandis que la Turquie accentue ses ingérences.
Tiré d'Orient XXI. Toutes les photographies sont de Angéline Desdevises.
De notre envoyé spécial en Syrie Chris Den Hond, avec Chloé Troadec.
Devant une scène décorée aux couleurs kurdes se presse une foule de tous âges venue célébrer les dix ans de la libération de Kobané des griffes de l'Organisation de l'État islamique (OEI) par les Unités de protection du peuple (YPG) et Unités de protection des femmes (YPJ), combattant·e·s kurdes, et par leurs alliés. Samira danse avec ses copines. Elle est restée dans la ville pendant toute la durée de la guerre.
- On a veillé sur les blessés, lavé les morts, fait à manger et chanté pour remonter le moral des troupes. Un combattant mourant m'avait dit : « Lorsque Kobané sera libérée, tu viendras me le dire sur ma tombe. » Lorsque la ville a été libérée de l'OEI, je suis allée sur sa tombe le lui dire. Cette phrase me hante toujours.

L'atmosphère festive est assombrie par le spectre d'une nouvelle attaque, de la Turquie cette fois-ci. Zeina Hanan, 50 ans, s'était enfuie en 2018 d'Afrin — dans le nord-ouest de la Syrie — pour échapper aux bombardements de l'aviation d'Ankara et aux exactions des milices syriennes qui lui sont alliées. Elle a vécu sous une tente à Tal Rifaat, à 40 km d'Alep, avec sa fille et son petit-fils avant d'être de nouveau chassée par les mêmes milices après la chute du régime de Bachar Al-Assad à la fin de l'année 2024. Elle s'insurge :
- Maintenant la Turquie et ses mercenaires menacent Kobané. Mais nous ne bougerons plus d'ici. Où voulez-vous qu'on aille ? Le nouveau gouvernement à Damas, on ne l'aime pas, il n'a rien fait quand nous avons été expulsées de chez nous.
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), plus de 100 000 personnes, en grande majorité des Kurdes, ont dû trouver refuge ces dernières semaines dans les territoires de l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (AANES).
L'arrivée au pouvoir de Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) et de son leader Ahmed Al-Charaa ainsi que ses déclarations plaidant pour une Syrie inclusive n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Le 29 janvier, son investiture comme « président pour la phase de transition » s'est déroulée devant une assemblée de militaires, tous des hommes. Parmi eux, Abou Hatem Chakra, chef de la milice Ahrar Al-Charkiya, qui est accusé, entre autres, du meurtre sauvage de la militante politique kurde Hevrîn Khalaf en octobre 2019. À ses côtés, Abou Amsha, le nouveau commandant de la région de Hama, leader de la redoutable division Al-Hamza de l'Armée nationale syrienne (ANS) plusieurs fois épinglée par les Nations unies pour de nombreux crimes, dont de multiples violences sexuelles.
Trois points de négociation avec le nouveau régime
Dans un lieu sécurisé, les traits tirés, Mazloum Abdi, le commandant général des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance entre forces kurdes, arabes et syriaques, nous accueille. Il commence par détailler les causes des relations conflictuelles avec la Turquie puis énumère les trois points de négociations avec le gouvernement de Damas : l'intégration militaire des FDS, les institutions politiques et le contrôle des ressources énergétiques. « Un processus politique va s'enclencher. Des commissions vont être créées pour rédiger une nouvelle Constitution. Nous devrons faire partie de ces commissions », explique-t-il.
Le nord et l'est de la Syrie bénéficient déjà d'une sorte de constitution sous forme d'un contrat social qui garantit les droits des communautés, ceux des femmes et le respect des différentes religions. Ce texte est-il trop progressiste pour Damas ? Mazloum Abdi poursuit :
- Notre contrat social est un document législatif très avancé. On aimerait qu'il soit pris en considération dans la nouvelle Constitution. Mais pour cela, il faut que la Turquie accepte un cessez-le-feu et cesse son ingérence dans les affaires syriennes.
Or, le long de l'Euphrate, les bombes turques, lancées par des avions de combat ou par des drones, font régulièrement des victimes. Mazloum Abdi explique :
- Il n'y a pas d'affrontements entre nous et le nouveau gouvernement de Damas. Il y a seulement des combats autour de l'Euphrate entre Kobané et Membij avec les milices pro-turques qui essaient de passer à l'est du fleuve. Nous essayons d'obtenir un cessez-le-feu avec la Turquie. Des intermédiaires, dont des membres de la coalition internationale contre l'OEI, jouent les bons offices, mais Ankara n'en continue pas moins à nous bombarder.

Pour l'instant, le front est stabilisé. Les milices pro-turques, qui se battent entre elles, ne parviennent plus à progresser. Et les combattant·e·s des FDS sont de mieux en mieux entraîné·e·s, bien équipé·e·s et de plus en plus expérimenté·e·s. Ils et elles utilisent un vaste réseau de tunnels. Soutenu·e·s par la population, ils et elles infligent de nombreuses pertes aux miliciens pro-turques.

Défendre la place des femmes
Les FDS ont reçu le soutien symbolique de civils venus des villes du nord et de l'est — Kobané, Raqqa, Saké ou Qamichli — qui sont déterminés à former des « boucliers humains » visant à « protéger l'infrastructure vitale qui procure eau et électricité à la région », comme nous le raconte Halime. Ce dernier est inquiet et attend le retour de sa sœur qui a rejoint l'un des convois souvent visés par des drones turcs. À l'hôpital de Kobané, nous voyons arriver l'un de ces convois civils transportant son lot de morts et de blessés.
Ankara s'efforce de saboter les pourparlers entre le gouvernement de Damas et les autorités politiques et militaires du nord et de l'est de la Syrie. Néanmoins des propositions très concrètes pour une future Syrie démocratisée et décentralisée ont été mises sur la table par les FDS et l'Administration autonome (AANES). Les modalités d'intégration des FDS dans une armée nationale représentent l'un des principaux points d'achoppement. Le nouveau ministre syrien de la défense Mourhaf Abou Qasra a avancé l'idée d'une force militaire unifiée sous un commandement centralisé avec ralliement individuel des combattants des FDS.
Dans un abri sécurisé, la commandante en chef des YPJ, Rohilat Afrin exprime son opposition :
- Nous voulons rejoindre l'armée syrienne, mais comme entité. Nous voulons aussi préserver notre droit à nous défendre en tant que femmes. […] Les femmes combattantes kurdes étaient en première ligne dans la lutte contre l'Organisation de l'État islamique (OEI). Elles ont obtenu dans le Contrat social l'égalité avec les hommes, notamment des coprésidences homme-femme dans toutes les assemblées. Elles ne veulent pas être désarmées. Elles réclament la pérennité de leur statut dans la Syrie de demain.

D'autre part, ajoute-t-elle, « comment se désarmer alors que nous sommes menacés quotidiennement ? Ça serait suicidaire. ». Une position partagée par d'autres forces en Syrie. Les Druzes du gouvernorat de Soueïda ainsi que les forces armées regroupées dans la Chambre des opérations du sud, deux autres groupes de rebelles anti-Assad, s'opposent eux aussi à une Syrie centralisée et ont refusé de rendre leurs armes. Ils réclament une autonomie au sein de la future armée.
Le modèle pluri-communautaire de Raqqa
À Raqqa, Khoud Al-Issa, la porte-parole de Conseil des femmes Zenobia, confirme : « Nous ne voulons pas céder sur ce que nous avons acquis dans la révolution du Nord et de l'est de la Syrie ». Sylvain Mercadier, journaliste français arabophone, nous rejoint à Raqqa. Il nous confie :
- Il y a du mécontentement chez certains Arabes, parce qu'ils sont court-circuités dans les négociations entre les FDS et le gouvernement transitoire. Ils sont très majoritaires à Raqqa et ont très largement participé à la lutte contre l'OEI, subissant de lourdes pertes.
Depuis la chute du régime, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes arabes du nord et l'est de la Syrie afin de demander leur rattachement au gouvernement central de Damas, alors que plusieurs commandants des FDS de Deir ez-Zor, dans le sud-est à grande majorité arabe, ont fait défection pour faire allégeance à Damas. Pourtant il n'y a pas eu de confrontations ni de soulèvement généralisé contre l'AANES. Mais dans les rues de Raqqa règne un climat d'incertitude.
Fares Alnazi et Laurens Al-Boursan, deux dignitaires arabes de Raqqa nous donnent leur point de vue à propos d'une Syrie centralisée. Pour le premier, membre du conseil de la tribu Al-Walda « l'Administration autonome a sa légitimité dans le contexte de la guerre et de l'instabilité, mais je considère qu'une fois la paix et le dialogue national rétablis, le centralisme sera la solution. » Il reconnaît toutefois que « l'AANES a fait du bon travail ces dix dernières années ». Fares Alnazi défend le même point de vue : « Un État fédéral mène à la division, ça ne fait que créer des problèmes entre les régions et les communautés ». Hamdan Al-Abed, membre de la tribu arabe des Dulaim (Dlim) les contredit :
- Notre région a été détruite successivement par le régime, l'Armée syrienne libre, les milices chiites, Al-Nosra et l'OEI. Nous avons nos martyrs enterrés à côté de ceux des membres des autres communautés — Kurdes, syriaques ou autres. C'est le modèle pluri-communautaire actuel qui représente le mieux tout le monde.

L'enseignant kurde Raman Yosif précise qu'ils veulent bâtir une nouvelle Syrie décentralisée, non sur une base communautaire, mais sur une base géographique :
Je suis kurde, j'adore le Kurdistan, mais, ici au Rojava, le mieux c'est notre projet multi-communautaire, parce qu'il n'y a pas seulement les Kurdes qui ont versé leur sang. Les Arabes et les chrétiens ont aussi leurs martyrs. On ne se bat pas pour un Rojava qui serait un petit État kurde indépendant, ça n'aurait pas de sens.
La menace d'un protectorat turc
Le dialogue national s'annonce tendu alors qu'Ankara a déjà placé ses pions dans le commandement militaire et les ministères à Damas, encourageant ses hommes d'affaires à multiplier les contrats pour participer à la reconstruction du pays. Mais les Kurdes et leurs alliés ne perdent pas espoir. Îlham Ahmed, la ministre des Affaires étrangères de l'AANES, revendique « une Syrie unifiée sur la base des frontières d'aujourd'hui et la préservation des institutions politiques de l'Administration autonome AANES dans la nouvelle Syrie. Nous voulons être représentés dans son futur gouvernement. »
La coalition internationale a fait des déclarations allant dans le même sens : la nouvelle Syrie doit inclure et respecter toutes les communautés, Kurdes compris. A-t-elle un poids suffisant ? Par téléphone, l'écrivain Patrice Franceschi nous confirme « que la France est présente et aide militairement les Kurdes ». Les États-Unis disposent toujours de bases en Syrie où sont cantonnés entre 900 et 2 000 soldats, mais leur maintien n'est pas garanti. Entre-temps, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a mis en place une coordination régionale entre la Turquie, la Jordanie, l'Irak et la Syrie « pour combattre l'OEI », une manœuvre pour convaincre le Pentagone de retirer la protection qu'il octroie aux FDS dans leur lutte commune contre l'OEI en pleine renaissance.
Dans l'attente d'Öcalan
Mais la question kurde se pose aussi en Turquie. L'État a autorisé à deux reprises une délégation du parti de gauche pro-kurde Parti démocratique des peuples (DEM), à rencontrer Abdullah Öcalan, le dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), condamné à vie et enfermé dans l'île-prison d'Imrali depuis 1999. Une déclaration d'Öcalan est annoncée, mais la date n'a pas encore été fixée. L'État turc exige un désarmement du PKK, une option écartée pour l'instant par la direction de l'organisation en l'absence de garanties.
Salih Muslim, coprésident du Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie, est également très sceptique :
- La Turquie nous attaque et nous reproche qu'on soit proche du PKK et qu'on applique les idées d'Öcalan. Si la Turquie prenait au sérieux ses pourparlers avec lui, elle arrêterait préalablement de nous bombarder.
Erdoğan continue de destituer les uns après les autres les maires du parti pro-kurde DEM démocratiquement élus, pendant que l'armée prépare une énième offensive printanière contre la guérilla du PKK dans le nord de l'Irak.
Le facteur pétrolier
Nous quittons le Rojava en direction de l'Irak, accompagné de deux Kurdes germanophones. La route est encadrée par des derricks qui pompent les plus importantes réserves de pétrole du pays. C'est dans le nord-est de la Syrie et dans la région de Deir ez-zor que se trouvent les ressources de pétrole et de gaz du pays. Reji travaille à Hambourg comme livreur et il est venu passer ses vacances au Rojava. Il en repart un peu inquiet : « Les gens souffrent. L'eau est polluée, internet rarement disponible et le réseau de l'électricité toujours en panne. » Depuis un an et demi, au moins à trois reprises, la grande centrale électrique de Soueïda a été la cible de l'aviation turque. Le réseau a été remplacé par des générateurs fonctionnant avec un pétrole mal raffiné et dont les émanations de fumées noires étouffent les villes.
Les énergies fossiles sont-elles un atout pour les Kurdes et leurs alliés dans leurs négociations avec Damas ? Salih Muslim nous confie :
- Quatre-vingt-dix pour cent des pompes ont été détruites. Contrairement à ce que les gens pensent à Damas, nous ne tirons pas beaucoup de profit de ses ressources. Mais nous l'avons affirmé depuis le début : tout le peuple syrien doit avoir accès à ces ressources de gaz et de pétrole. Leur répartition doit être discutée autour d'une table avec le gouvernement pour qu'elle soit équitable.
Nous traversons la frontière syro-irakienne avec Cihan Ehmed, ses deux petits-enfants et ses deux grandes valises. Elle est venue enterrer sa mère à Hassaké. Elle craint pour l'avenir « Les gens ont peur du nouveau gouvernement, comme ils avaient peur du régime d'Assad. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Démanteler l’USAID : le cadeau en or de Donald Trump à Xi Jinping

En supprimant d'un trait de plume la totalité du programme USAID d'aides américaines au développement, le 47è président américain Donald Trump se tire une balle dans le pied en offrant un cadeau en or à son homologue chinois Xi Jinping à qui il ouvre la voie pour relancer à bon compte une vaste opération de séduction auprès des pays pauvres mis en difficulté.
Tiré de Asialyst
14 février 2025
Par Pierre-Antoine Donnet
Source : Politico. Légende : Des manifestants devant le siège de l'USAID à Washington. DR
USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement International, créée en 1961, est l'organisme du gouvernement américain chargé du soutien aux pays pauvres et de l'aide humanitaire dans le monde. Ses financements représentent les deux-tiers de l'aide publique au développement américaine, soit quelque 43 milliards de dollars en 2024 versés pour soutenir les populations de 120 pays et régions tels que l'Ukraine, Gaza, le Soudan, l'Afghanistan, le Bangladesh ou le Pakistan. USAID centre ses actions sur l'aide humanitaire et représente 42% des financements publics mondiaux dans ce domaine.
La fermeture de ces milliers de programmes d'aide à travers la planète non seulement met en danger des vies humaines mais elle va sans nul doute porter un coup terrible à l'image des États-Unis et à son soft power, déjà sérieusement mis à mal par les extravagances de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.
Un « nid de vipères marxistes »
Le démantèlement d'USAID représente « l'une des pires et plus coûteuses bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine », a réagi, dans la presse américaine, son ex-cheffe Samantha Power. Pis, cela mettrait « en péril des millions de vie, des milliers d'emplois aux États-Unis (…) et compromet gravement notre sécurité nationale et notre influence dans le monde – et pendant ce temps les [dirigeants] extrémistes et autoritaires se réjouissent », dit-elle.
Sitôt nommé à la tête du département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk a accusé l'agence d'être une « organisation criminelle » et « un nid de vipères marxistes qui détestent l'Amérique […] qui doit mourir », tout en prédisant sa fermeture prochaine. Chose faite le 7 février.
Les médias anglo-saxons regorgent de critiques acerbes contre cette annonce. Certains analystes réputés soulignent que Washington joue contre son camp au profit de la Chine qui ne manquera pas d'en profiter pour redoubler de critiques contre l'égoïsme américain et surtout marquer des points sur la scène internationale. « Les Etats-Unis cèdent du terrain à la Chine en s'infligeant une blessure à eux-mêmes » car « la suspension soudaine des fonds pour le développement représente pour Pékin une opportunité parfaite pour s'emparer du vide ainsi créé et renforcer son soft-power », souligne le 7 février le quotidien britannique The Guardian.
L'annonce de Donald Trump prévoit la suspension pour une période initiale de 90 jours de l'USAID et son rattachement ultérieur aux services du département d'État qui gèrera lui-même au cas par cas les aides étrangères en fonction des intérêts du pays. Cette suspension a semé la confusion avec la mise à pied immédiate de ses employés et le chaos dans certains pays où des populations font face désormais à la famine ou la mort faute de soins désormais non financés.
Un cadeau livré à la Chine sur un plateau d'argent
Les États-Unis livrent « sur un plateau d'argent à la Chine une opportunité parfaite pour étendre leur influence à un moment où l'économie chinoise ne va pas très bien », estime Huang Yanzhong, professeur expert de la santé dans le monde au Council on Foreign Relations, un think tank américain sans couleur politique ayant pour but d'analyser la politique étrangère américaine et la situation politique mondiale. « Ce que fait Trump est en réalité de donner à la Chine une opportunité pour repenser et rénover ses projets de soft power et revenir ainsi sur les rails de son leadership global », ajoute-t-il, cité par le journal.
Très largement distancée par les Etats-Unis dans le domaine de l'aide au développement, Pékin a créé en 2018 une agence, la China International Development Cooperation Agency, dont l'objectif est de coordonner ses programmes d'aide au développement qui se traduisent surtout par des investissements et des prêts dans le cadre de son programme pharaonique des Nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative ou BRI). Le montant de ses aides au développement demeure confidentiel mais elles se concrétisent surtout sous la forme de prêts. Une étude du William & Mary's Global Research Institute estime que la Chine a prêté quelque 1 300 milliards de dollars entre 2000 et 2021 à des pays émergents ou en développement, la plus grande partie des pays signataires de la BRI.
Les « Gardes rouges technocrates » du gouvernement fédéral
La charge contre la décision américaine est beaucoup plus forte dans la bouche de Huang Yasheng (黄亚生), un professeur renommé d'origine chinoise membre de la International School du Massachusetts Institute of Technology (MIT). « L'Amérique est désormais plongée dans une situation plus périlleuse que jamais. Oubliez la croissance économique ou l'inflation ; elles ne sont plus que secondaires. La sécurité de l'Amérique est en ce moment sabotée par un hubris qu'elle s'inflige à elle-même devant nous », dit-il sur X (ex-Twitter).
« Oui, il y a des problèmes, des inconvénients, un formalisme qui ne plaît pas à tout le monde et des déchets. Nous devrions toujours réfléchir sur la façon d'améliorer notre gouvernement. Mais tout ceci ne représente que des bugs et non des fondamentaux qui sont le prix que nous payons pour éviter que les avions ne tombent du ciel, que les virus ne se répandent pas partout ou que des produits chimiques ne contaminent pas nos eaux », ajoute ce professeur très respecté, ancien étudiant de Harvard.
« Ce que font ces Gardes rouges technocrates au gouvernement fédéral [américain] revient à éviscérer les fonctions du gouvernement, des fonctions que nous avons tous pris pour argent comptant mais qui auront des conséquences horribles », estime-t-il, reprenant le nom donné à l'époque par Mao Zedong à ses jeunes partisans fanatiques pendant la Révolution culturelle (1966-1976), sans jamais citer nommément Donald Trump ou Elon Musk.
Tom Wang, directeur général de l'ONG basée à Manille People of Asia for Climate Solutions spécialisée sur le changement climatique, met en garde contre un narratif « simpliste » qui se bornerait à présenter une Chine qui remplacerait les Etats-Unis en une nuit. « Il ne s'agit pas seulement de la disparition d'argent mais celle de l'expérience », explique-t-il dans le même quotidien. « Le plus gros impact [de la décision de Donald Trump] est l'anxiété ». « D'un seul coup, vous ne pouvez plus continuer votre travail […] en tant qu'activiste d'une ONG pour le climat, cela fait très peur », souligne-t-il.
Mais pour George Ingram, chercheur au Brookings Institution Centre for Sustainable Development, l'un des plus anciens think tanks américains spécialisé dans la recherche scientifique, et ancien responsable de USAID, « Les États-Unis et l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon, nous observons un grand intérêt pour le fait de vivre dans un monde de démocraties et d'économies libérales ». « La Chine tout comme la Russie s'efforcent de mettre en avant un monde autoritaire. C'est l'exact contraire de nos intérêts », souligne-t-il, cité par The Guardian.
Une initiative à l'opposé du slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique »
Non sans ironie, le Nikkei Asia souligne, quant à lui, que « la mise à mort de l'USAID » va « accélérer le retrait de l'Amérique », une politique pourtant à l'opposé du slogan de Trump « Rendre sa grandeur à l'Amérique » (MAGA : Make America Great Again). Dien Luong, expert des médias et chercheur associé dans une université de Singapour, explique dans les colonnes du journal le 7 février que le risque induit par le démantèlement de l'USAID est de mettre à bas des décennies de confiance des pays de l'Asie du Sud-Est envers les États-Unis, en particulier le Vietnam.
« Le retrait brutal de Washington sabote ses engagements souscrits après la guerre [du Vietnam] dans le Partenariat global stratégique [signé récemment] avec le Vietnam. C'est également un signal éclatant du fait que les assurances de l'Amérique s'effacent au moment où Hanoi demeure l'un des rares pays d'Asie du Sud-Est encore en faveur d'un alignement avec Washington plutôt qu'avec Pékin », écrit-il.
« Cette crise s'étend bien au-delà du Vietnam. A travers l'Asie, ce précédent suscite une inquiétude plus profonde : la confiance envers les Etats-Unis disparaît rapidement. Et des signes montrent déjà que Pékin agit vite pour combler le vide », ajoute cet expert vietnamien. « En retirant le soutien américain, l'administration [Trump] ne fait pas que s'aliéner ses partenaires clé ; elle donne à la Chine sur un plateau d'argent la possibilité de renforcer sa présence en Asie » écrit encore cet expert. Le bimestriel américain Foreign Affairs n'est pas plus tendre en titrant le 6 février : « La stratégie chinoise de Trump : Pékin se prépare à tirer avantage du chaos ».
La Chine s'est préparée à contrer la politique de Donald Trump
Yun Sun, directeur du China Program au Stimson Center, un autre think tank américain non partisan qui analyse les questions liées à la paix mondiale, explique que les stratèges chinois s'activent depuis des mois déjà pour préparer leur pays face à une politique américaine qu'ils anticipaient plus dure encore avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Raison pour laquelle, la Chine a pris ces derniers mois des mesures d'apaisement avec ses voisins, en particulier l'Inde, le Japon et l'Australie.
Mais « les dirigeants chinois restent confiants dans le fait que même si l'économie de leur pays souffre [des sanctions américaines], quatre ans de Trump ne vont probablement pas plonger [la Chine] dans une crise ouverte », écrit-il dans la revue américaine. « Ils s'attendent à ce que si Trump applique les politiques qu'il a annoncées, telles que celles sur le commerce et l'expansion territoriale, il pourrait bien causer un tort grave à la crédibilité des États-Unis et son leadership global. Pékin voit de ce fait le second mandat de Trump comme une opportunité potentielle pour la Chine d'étendre son influence plus loin et plus vite encore », souligne-t-il.
Des conséquences directes pour la sécurité nationale américaine
Pour The Hill, média américain numérique basé à Washington spécialisé dans les relations internationales et la politique américaine, USAID a été l'un des instruments les plus puissants pour servir son influence dans le monde et un outil précieux pour contrer les ambitions chinoises, dont tout particulièrement son programme des Nouvelles Routes de la soie.
« En détruisant l'USAID, les Etats-Unis donnent à Pékin la chance d'étendre sans frein sa domination économique et politique », affirme le journal en ligne très influent au sein des élites américaines. « Avec le démantèlement de l'USAID, la capacité de la Chine d'imposer son rayonnement économique va s'accélérer. Les pays qui jusque-là avaient le choix entre un développement soutenu par l'Amérique et les prêts chinois n'auront plus qu'une option : Pékin », ajoute-t-il. « Ceci n'est pas qu'une inquiétude concernant la politique étrangère – cette question aura des conséquences directes pour la sécurité nationale des États-Unis. A fur et à mesure que la Chine prendra davantage le contrôle les routes commerciales mondiales, elle pourra renforcer la domination de ses infrastructures dans les conflits à venir », poursuit le journal en ligne.
« Une Chine plus enhardie, dotée de leviers économiques et militaires sur des dizaines de pays, rendra pour les Etats-Unis plus difficile de contrer l'assurance de Pékin en mer de Chine du Sud, à Taïwan et au-delà », explique encore The Hill. « La fermeture de USAID est plus qu'une décision budgétaire : elle marque le retrait de l'Amérique du leadership mondial », souligne The Hill, car « l'aide étrangère a été depuis longtemps un outil pour un engagement diplomatique, permettant aux États-Unis de forger des alliances, mettre en avant la bonne volonté, promouvoir la stabilité dans des régions vulnérables aux influences autoritaires ».
« Désormais, le message au monde est clair : l'Amérique se retire et la Chine est prête à combler le vide. La décision de Trump de fermer USAID n'est pas seulement une mesure pour réduire les coûts ; il s'agit d'un changement fondamental de la posture de l'Amérique. En l'absence d'une alternative conduite par les Etats-Unis, la diplomatie coercitive de Pékin va s'étendre sans entrave, laissant les nations vulnérables devant les pièges de la dette, les empiètements militaires et l'influence autoritaire », conclut le journal en ligne.
Un signe qui ne trompe pas : des millions d'internautes chinois ont, ces derniers jours, applaudi sur les réseaux sociaux les commentaires d'Elon Musk sur USAID et la décision de Donald Trump de démanteler l'organisation. Même le South China Morning Post, quotidien anglophone de Hong Kong aujourd'hui inféodé à Pékin n'a pas manqué de souligner dans son édition du 4 février que la décision de Donald Trump « pourrait permettre à la Chine de combler le vide grâce à la BRI ».
La Chine en sortira gagnante
A l'appui de ce commentaire, le journal cite le professeur Christopher Barret de l'université américaine Cornell pour qui « La Chine sera la gagnante » de la fermeture de USAID car elle s'efforce « d'accéder aux ressources vitales à l'étranger » et tente de « construire des alliances qui ne sont pas dans l'intérêt des États-Unis ». « Couper soudainement des projets essentiels pour sauver des vies est une bonne façon de provoquer un retour de bâton anti-américain. Un tel retrait du plus grand fournisseur mondial d'aides étrangères va entraîner un retrait similaire d'autres nations riches », ajoute ce professeur, cité aussi par le quotidien Financial Times dans son édition du 4 février.
A ceci s'ajoutent également les annonces spectaculaires sinon grotesques de Donald Trump sur son intention de transformer la bande de Gaza en une station balnéaire et de la vider de sa population palestinienne, de rebaptiser le Golfe du Mexique « Golfe de l'Amérique », de s'emparer du Groenland et du Canal de Panama, sans oublier le retrait de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'Accord de Paris sur le Climat.
« Avec les Etats-Unis, la Russie et la Chine dirigés par des hommes aux ambitions expansionnistes, les implications sont sombres pour le système international actuel. Le monde pourrait bien passer d'une ère où les petits pays pouvaient demander une protection de la loi internationale à une autre où, comme le disait Thucydide, les puissants peuvent faire ce qu'ils veulent et les faibles souffrir comme ils le doivent », juge mardi 11 février le Financial Times dans un article intitulé « Trump, Poutine et Xi : le nouvel âge des empires » signé de son éditorialiste Gideon Rachman.
« Trump, Musk et leurs mignons de MAGA ont lancé une guerre idéologique contre l'ensemble de l'alliance démocratique avec des conséquences graves pour des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde qui, chaque jour, mettent leur vie au service de la défense de la liberté, des droits humains et de la décence », déplore lundi 10 février Michael Cole, Senior Fellow au Macdonald-Laurier Institute, un think tank canadien pour la recherche, et au Global Taiwan Institute, autre think tank basé à Washington. « Cet assaut n'a jamais concerné la réduction des coûts ; il est idéologique. Aujourd'hui, les despotes à travers le monde se frottent les mains. Préparez-vous les amis : nous sommes sur le point d'entrer dans une ère sombre où les régimes répressifs vont s'en trouver confortés », ajoute ce géopoliticien.
Autant d'initiatives en effet, rocambolesques mais lourdes de conséquences, prises en quelques semaines à peine depuis l'investiture de Donald Trump qui ont tout lieu de réjouir le pouvoir communiste qui, probablement, n'en attendait pas tant. Ce dernier n'a maintenant plus qu'à attendre puisqu'elles risquent fort d'antagoniser une bonne partie du monde contre l'Amérique. Loin de se présenter comme le phare de la démocratie mondiale, celle-ci donne de plus en plus l'image d'un nouvel empire de l'argent haïssable dont la politique cardinale est celle de la loi du plus fort, laissant le champ libre à Pékin pour en tirer le plus grand profit possible.
Par Pierre-Antoine Donnet
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
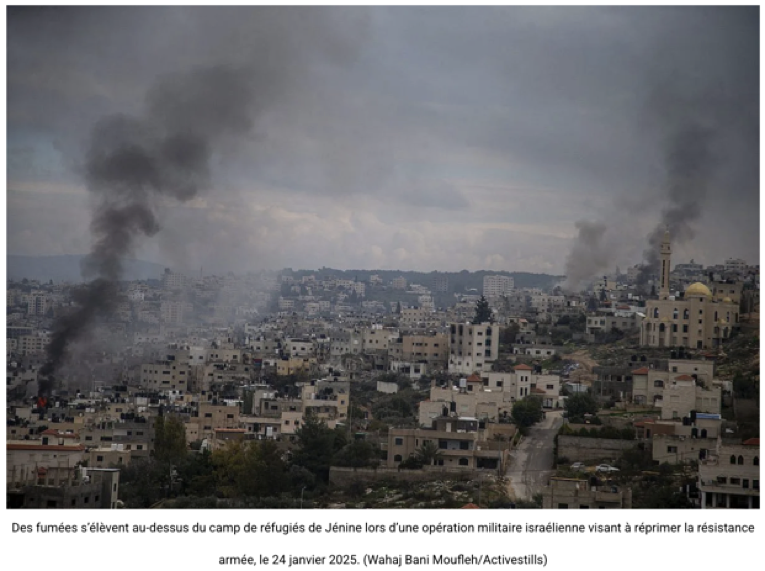
« Pire que la deuxième Intifada » : les réfugiés de Cisjordanie subissent l’offensive israélienne
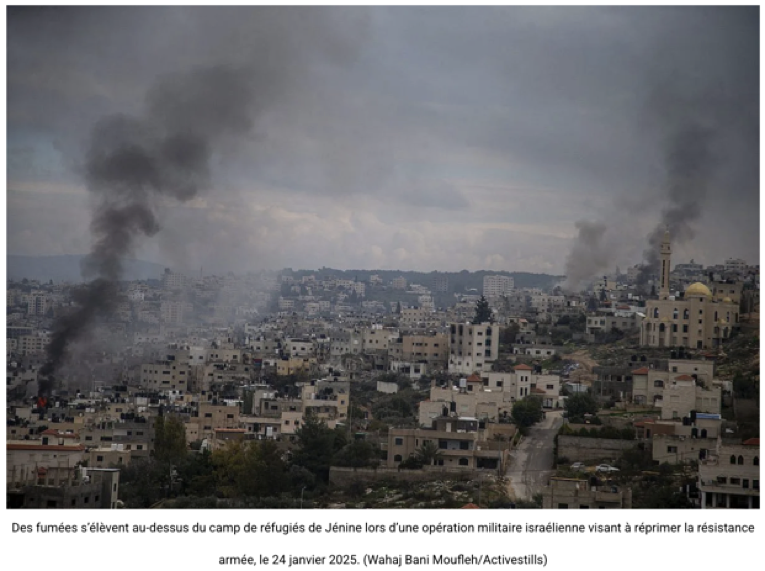
Déplacés de Jénine et de Tulkarem, les Palestiniens affirment qu'Israël mène une campagne délibérée pour rendre invivables les camps de réfugiés du nord.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Sameera Abu Rmeleh franchit des montagnes de gravats et de débris pour atteindre ce qui reste de sa maison dans le camp de réfugiés de Jénine. C'est une journée froide et pluvieuse dans le nord de la Cisjordanie, et le camp est presque méconnaissable. Du béton brisé, des voitures incendiées, des douilles de balles et des corps sans vie de chiens errants bordent les rues à perte de vue. À une centaine de mètres de là, des bulldozers et des véhicules blindés israéliens se déplacent avec détermination.
« Ce qui se passe actuellement est bien pire que la deuxième Intifada », déclare Abu Rmeleh. « C'est comme à Gaza : aucune des maisons du camp n'est plus habitable. Mais nous n'irons nulle part. Nous sommes prêts à vivre dans des tentes si nécessaire. Nous l'avons déjà fait. »
Abu Rmeleh fait partie des 20 000 Palestiniens déplacés de force de leurs foyers dans le camp de Jénine ces dernières semaines en raison d'une opération militaire israélienne en cours dans la région. Prenant le peu qu'elles pouvaient emporter, les familles ont fui à pied dans les premiers jours de l'invasion, le long d'un chemin de terre détruit par les bulldozers israéliens, tandis que les soldats bloquaient les entrées et les sorties du camp.
Depuis lors, les routes traversant le camp ont été détruites, y compris les principales voies d'accès à l'hôpital public de Jénine. Les forces israéliennes ont également détruit les infrastructures d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de télécommunications, et ont même rasé un quartier résidentiel entier par des explosions contrôlées.
L'opération « Mur de fer » en est maintenant à sa cinquième semaine et s'est étendue à trois autres camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, déplaçant 20 000 personnes supplémentaires des camps de Tulkarem, Nur Shams et Al-Far'a. L'armée israélienne affirme cibler les groupes de résistance armés dans ces zones, mais n'a produit que peu de preuves de ses succès à cet égard. Et tandis que les soldats détruisent les infrastructures civiles sur le terrain, des avions de chasse et des drones lâchent des missiles depuis le ciel.
Comme beaucoup d'autres personnes déplacées du camp de Jénine, la famille d'Abu Rmeleh est hébergée par des amis et des proches dans la ville voisine. Mais même en dehors du camp, la sécurité est un concept fragile. Les habitants craignent des représailles israéliennes pour avoir hébergé des personnes déplacées par l'assaut. Des tireurs d'élite israéliens sont postés sur les toits du camp et aux alentours, surplombant les ruines. Des rapports récents indiquent que l'armée a donné aux troupes en Cisjordanie toute latitude pour tirer sur tout ce qui est jugé « suspect ».
Abu Rmeleh est consciente de ces risques, mais hausse les épaules lorsque je lui demande si elle craint de se faire tirer dessus en retournant au camp pour récupérer certains de ses effets personnels. « Je m'en fiche », dit-elle. « Je suis déjà morte. »
Non loin de là, un adolescent nommé Adham semble tout aussi impassible. Lors de l'attaque actuelle du camp, les forces israéliennes ont détruit la maison de sa famille et tué son ami Mohammed, âgé de 17 ans. Debout devant les ruines d'une maison, il secoue une bombe de peinture, laissant un nouveau graffiti sur les décombres. Autour de lui, certains des bâtiments démolis ont déjà été tagués par des soldats israéliens avec le slogan nationaliste hébreu « Am Yisrael Chai », faisant écho à des scènes similaires à Gaza.
Remarquant mon photographe et moi-même sur la route déserte à l'intérieur du camp, Adham nous tend un tract que l'armée israélienne avait distribué ici. Imprimé en arabe, on peut y lire : « Le terrorisme a détruit le camp. Rejetez les militants. Ils sont la cause de la destruction. C'est vous qui payez le prix de votre sécurité et d'une vie meilleure. »
Pour beaucoup à Jénine, ce message n'est ni nouveau ni convaincant. La plupart des habitants du camp sont les descendants de familles expulsées de la région de Haïfa par les milices sionistes et les forces israéliennes lors de la Nakba de 1948. Au fil des décennies, Jénine est devenue un épicentre du militantisme et de la résistance palestiniens, ses rues ayant été ravagées par des invasions et des sièges israéliens répétés, notamment lors de la deuxième Intifada au début des années 2000, lorsque les bombardements israéliens et les affrontements avec les combattants de la résistance ont dévasté le camp.
Alors que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont mené une campagne de six semaines pour réprimer les groupes armés et reprendre le contrôle du camp, le ministre de la Défense israélien a présenté cette dernière opération israélienne comme l'application des « leçons tirées » de Gaza. Et Israël envisagerait maintenant de rendre permanente sa présence dans le camp.
« Ce qui se passe ici est une version réduite de Gaza »
À l'entrée du camp, l'entrée de l'hôpital gouvernemental de Jénine est marquée par une fresque de Shireen Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera tuée par balle par les forces israéliennes en 2002 alors qu'elle couvrait une précédente incursion militaire dans le camp. À l'intérieur de l'hôpital, le Dr Mustafa Hamarsheh, directeur médical, décrit une situation de plus en plus intenable.
« Beaucoup de nos 500 membres du personnel ne peuvent même pas atteindre l'hôpital », explique-t-il : à moins d'arriver en ambulance, les troupes israéliennes les arrêtent fréquemment aux points de contrôle, les fouillent et les refoulent souvent. Au début de l'incursion, plusieurs membres du personnel médical ont été blessés lorsque les soldats ont encerclé l'hôpital, assiégeant l'établissement. L'armée s'est depuis retirée des lieux, mais la peur persiste.
« La plupart des patients ont tout simplement trop peur pour essayer de venir ici », explique Hamarsheh. « Notre capacité d'accueil est aujourd'hui réduite de 50 % ».
Depuis le début de l'année 2025, les forces israéliennes ont tué au moins 70 Palestiniens en Cisjordanie, dont 10 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Rien qu'à Jénine, 38 personnes ont été tuées, dont un ami de Hamarsheh âgé de 70 ans qui avait fui le camp après l'incursion mais qui était revenu pour inspecter sa maison.
« Son âge ne faisait aucun doute ; il n'était clairement pas un combattant », dit Hamarsheh. « Pourtant, lorsqu'il est arrivé chez lui, les forces israéliennes l'ont tué. Il a reçu une balle dans l'abdomen et a été laissé là [se vidant de son sang] pendant une heure. Aucune ambulance n'a pu l'atteindre ; elles n'ont tout simplement pas pu passer. »
Bloquer les ambulances est une pratique courante, explique Hamarsheh. Les médecins sont obligés d'attendre aux points de contrôle, ce qui fait que les patients se vident de leur sang avant de pouvoir être évacués. La destruction des routes et des infrastructures ne fait qu'aggraver la crise.
« Ce qui se passe ici est simplement une version réduite de Gaza », dit-il. « Une campagne délibérée pour détruire, rendre la vie invivable et envoyer un message à tous les habitants du camp et de la ville : partez. Quittez la Cisjordanie. Allez ailleurs. »
Après avoir parcouru les rues autour de l'hôpital gouvernemental de Jénine, mon photographe et moi décidons d'essayer d'entrer dans la partie ouest du camp, le soi-disant « nouveau camp ». Ici aussi, des jeeps militaires israéliennes rôdent le long du périmètre, leurs moteurs vrombissant alors qu'elles sillonnent les rues. Alors que nous approchons, des habitants nous préviennent qu'il y a un tireur d'élite dans cette zone.
À la limite du camp, le propriétaire d'une petite supérette, qui a été déplacé de l'intérieur du camp mais qui tient maintenant son magasin à la frontière extérieure, aperçoit nos gilets de presse et nous fait signe d'entrer dans l'appartement derrière le magasin. Il appartient à sa mère, qui l'accompagne.
Sa voix se brise lorsqu'elle raconte ce qui est arrivé à sa fille l'un des premiers jours de l'incursion : elle était sortie d'une rue latérale près du magasin, et s'est retrouvée directement sur le chemin de soldats israéliens qui ont tiré une balle qui lui a déchiré le bras. Les chirurgiens l'ont recousue avec des plaques de platine, mais elle ne pourra plus jamais bouger sa main, dit la vieille femme en faisant défiler des photos du bras déchiqueté de la jeune fille.
Soudain, nous entendons des coups de feu. Cinq, peut-être six coups de feu retentissent juste devant la boutique. Nous sursautons. La famille se précipite vers l'arrière de l'appartement et nous la suivons. Le son – fort et perçant – indique que les coups de feu ont été tirés à quelques mètres de là.
Selon un échange dans un groupe WhatsApp local, les forces israéliennes tiraient sur des personnes qui tentaient de retourner dans le camp pour récupérer leurs affaires. Peu de temps après, une autre personne à vélo tente d'entrer et essuie une nouvelle rafale de tirs, qu'elle évite.
Pendant environ trois heures, nous restons à l'intérieur de l'appartement derrière la supérette, à l'abri avec la famille palestinienne. Dehors, les rues sont calmes, mais la tension est palpable. Après quelques concertations, les travailleurs du Croissant-Rouge nous escortent enfin hors du camp.
« Nous sommes livrés à nous-mêmes »
Fin janvier, l'opération militaire israélienne s'était étendue bien au-delà de Jénine. Le 29 janvier, une frappe aérienne israélienne a touché un quartier très peuplé du village de Tammoun, près du camp d'Al-Far'a, tuant au moins dix Palestiniens. Peu après, les forces israéliennes ont attaqué Qalqilya et sa périphérie, intensifiant l'offensive et renforçant le contrôle sur tous les principaux districts du nord de la Cisjordanie.
À Tulkarem, qui borde la Ligne verte entre Israël et la Cisjordanie, la situation n'est pas moins instable. Depuis le début de la guerre à Gaza, les bulldozers et les drones ont ravagé le camp de réfugiés à maintes reprises, endommageant les routes, les maisons et les devantures de magasins. L'extension de l'opération « Mur de fer » a déplacé les trois quarts de la population du camp au cours des dernières semaines.
Je visite la région pour la troisième fois depuis le 7 octobre, en compagnie de l'ONG allemande Medico. Cette fois-ci, les partenaires locaux de Medico, membres de Jadayel, le Centre palestinien pour l'art et la culture, distribuent des couvertures et des oreillers aux familles récemment déplacées. Ils opèrent indépendamment de l'Autorité palestinienne, invoquant sa bureaucratie comme un obstacle qui retarde inutilement la distribution de l'aide.
En chemin, je rencontre Muayyad Shaaban, le chef de la Commission de l'Autorité Palestinienne pour la Résistance à la Colonisation et au Mur. Il insiste sur le fait que l'Autorité Palestinienne fait ce qu'elle peut, distribuant 400 à 500 repas par jour aux familles déplacées du camp. Mais il n'hésite pas à appeler un chat un chat. « Il ne s'agit pas d'une opération de sécurité, mais d'une opération politique », dit-il, en faisant valoir que la plupart des personnes tuées et blessées dans les camps n'avaient rien à voir avec la résistance armée. « Tout cela fait partie du cadeau de Netanyahu à l'extrême droite en échange du cessez-le-feu à Gaza : il donne à [Bezalel] Smotrich tout ce qu'il veut. »
Shaaban suggère que l'opération militaire en cours dans le nord de la Cisjordanie prépare en réalité le terrain pour quelque chose de bien plus important : l'annexion. Et les pièces du puzzle s'assemblent. L'intensification de la violence des colons soutenus par l'État a contraint plus de 50 communautés rurales palestiniennes à fuir leurs terres depuis le 7 octobre, et les colons ont établi plus de 40 nouveaux avant-postes au cours de la même période.
Pendant ce temps, l'une des premières mesures prises par Donald Trump à son retour à la Maison Blanche a été d'annuler les sanctions de l'administration Biden contre Amana, une importante organisation de développement des colons. Ces jours-ci, les Palestiniens soupçonnent de plus en plus que Washington pourrait bientôt reconnaître officiellement la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, reconnaissant ainsi sur la scène internationale ce qui est depuis longtemps une politique israélienne d'annexion de facto.
Dans un centre d'hébergement de Shweikeh, dans la banlieue nord de Tulkarem, un homme nommé Bahazat Dheileh décrit les difficultés croissantes pour acheminer des fournitures aux personnes dans le besoin. Les demandes les plus urgentes des familles déplacées, dit-il, concernent le lait maternisé et les couches.
Selon Dheileh, les forces israéliennes ont empêché les familles de prendre quoi que ce soit avec elles alors qu'elles fuyaient le camp. Cela a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse, tout comme le blocage par Israël de l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), qui a rendu la distribution de l'aide plus fragmentée que jamais.
Non loin de là, dans le jardin à l'arrière de la maison de son frère, Abdellatif Sudani regarde dans le vide. Il y a trois semaines, il a finalement quitté le camp de Tulkarem avec son fils et sa fille. Il avait insisté pour rester lors de chaque précédente incursion israélienne, ignorant les avertissements de partir, mais cette fois-ci, c'est différent. « Les rumeurs disaient que l'armée prévoit de rester », dit-il.
Mais ce n'est pas ce qui l'a poussé à partir ; ce sont ses enfants qui l'ont convaincu. « Qui va nous protéger ? », demande-t-il d'une voix monocorde. « Nous sommes livrés à nous-mêmes. »
Hanno Hauenstein est un journaliste et auteur indépendant basé à Berlin. Ses travaux ont été publiés dans des publications telles que The Guardian, The Intercept et Berliner Zeitung.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cisjordanie : Israël vide des camps de réfugiés et interdit leur retour

Trois camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie ont été vidés, selon une annonce du ministre israélien de la Défense Israël Katz. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée israélienne avait évacué de force 40 000 Palestiniens de trois camps de réfugiés en Cisjordanie. Il a donné l'ordre à l'armée de ne pas autoriser leur retour.
Tiré d'El Watan.
Voici les points clés de sa déclaration :
Déplacement forcé : Selon Israël Katz, 40 000 Palestiniens ont été évacués des camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Nour Chams.
Ordre de non-retour : Le ministre a donné pour instruction aux soldats de rester dans les camps évacués pendant un an et de ne pas autoriser le retour des habitants.
Justification : Israël Katz a justifié cette mesure en affirmant qu'elle visait à empêcher la « résurgence du terrorisme » dans ces camps.
Cette déclaration a suscité de vives critiques de la part de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains. L'ONU a condamné ces évacuations forcées et a appelé Israël à respecter le droit international humanitaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
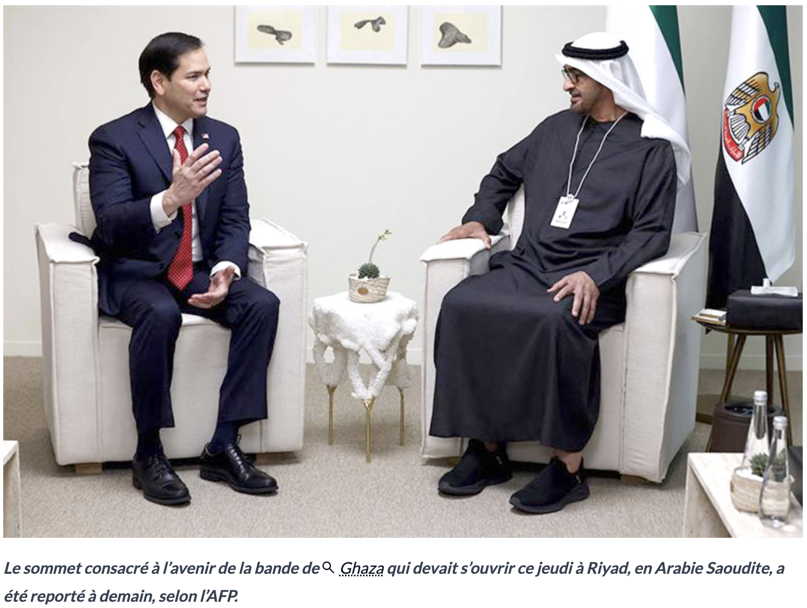
Les émirats rejettent enfin le plan de Trump pour Ghaza : Mohammed Ben Zayed désavoue son ambassadeur à Washington
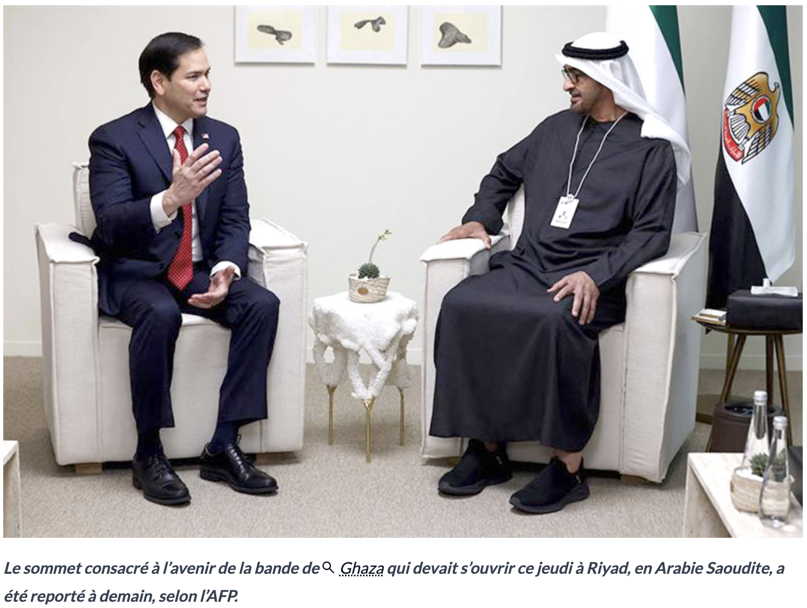
Ce sommet qui avait pour principal ordre du jour de répondre au plan du président américain, Donald Trump, pour Ghaza, devait ne réunir initialement que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis (EAU) et l'Autorité palestinienne. Finalement, il va être « élargi aux six pays du Golfe », affirme l'AFP qui dit tenir l'information de deux diplomates arabes.
Tiré d'El Watan.
« Un responsable saoudien a indiqué sous le couvert de l'anonymat que "le mini-sommet arabe" aurait lieu le "21 février" et non le 20 comme prévu initialement, précisant qu'il "réunira les dirigeants des six Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que l'Egypte et la Jordanie, pour examiner les alternatives arabes aux projets de Trump pour Ghaza », indique l'agence française. Un autre diplomate arabe a soufflé à l'AFP qu'« un pays du Golfe influent a exprimé son mécontentement après avoir été exclu du sommet de Riyad, ce qui a poussé les organisateurs à inclure l'ensemble des pays du Golfe ». Cette source n'a pas précisé de quel pays il s'agissait.
Fin de la tournée de Marco Rubio
A retenir, par ailleurs, la position exprimée par les Emirats arabes unis qui ont officiellement informé, hier, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, de leur rejet du plan de Trump. Le président des Etats-Unis avait proposé, rappelle-t-on, de placer la bande de Ghaza sous contrôle américain et de la vider de ses habitants en transférant 2,4 millions de Palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie principalement. Selon l'agence de presse émiratie (WAM), « Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes unis, a reçu hier le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ».
Les discussions ont porté, entre autres, sur « l'évolution de la situation au Moyen-Orient, en particulier dans les territoires palestiniens occupés, et sur les efforts déployés pour résoudre la crise dans la bande de Ghaza et ses répercussions sur la paix, la stabilité et la sécurité régionales », explique l'agence émiratie. Et de préciser dans la foulée que Mohammed Ben Zayed « a souligné la position ferme des Emirats arabes unis, qui rejettent toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre ». MBZ a fait savoir, en outre, à son hôte que « la reconstruction de Ghaza doit être liée à une voie menant à une paix globale et durable fondée sur la "solution des deux Etats" qui est la clé de la stabilité dans la région ».
La position officielle formulée par le chef de l'Etat émirati vient ainsi contredire celle énoncée par l'ambassadeur des Emirats à Washington, Youssef Al Otaïba il y a quelques jours, où il disait qu'il ne voyait pas d'alternative à la solution douteuse proposée par Trump, synonyme de deuxième Nakba. Il avait fait cette déclaration lors du Sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu le 12 février à Dubaï. « Lorsqu'on lui a demandé si les Émirats arabes unis (EAU) travaillaient sur un plan alternatif à la proposition de M. Trump, M. Al Otaiba a répondu : "Je ne vois pas d'alternative à ce qui est proposé. Je n'en vois vraiment pas. Donc si quelqu'un en a une, nous sommes heureux d'en discuter, nous sommes heureux de l'explorer. Mais elle n'a pas encore fait surface », rapporte l'agence Anadolu. Donald Trump's memoirs
Al Sissi et Pédro Sanchez contre le plan de Trump
Abou Dhabi constituait la dernière étape de la tournée du secrétaire d'Etat américain au Moyen-Orient. M. Rubio est arrivé, hier matin, aux Emirats en provenance de l'Arabie Saoudite où il avait pris part à la réunion entre les délégations américaine et russe pour préparer un prochain sommet entre Trump
et Poutine.
Lors de son séjour à Riyad, Marco Rubio a rencontré lundi le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Au cours de cet entretien, il a souligné « l'importance d'un accord pour Ghaza qui contribue à la sécurité régionale », relève un communiqué du département d'Etat. A l'entame de sa visite dimanche, M. Rubio s'était rendu à Jérusalem où il avait réitéré le soutien inconditionnel des Etats-Unis à Israël. A noter par ailleurs que le président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, en visite officielle en Espagne, a réaffirmé hier, avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, leur rejet total du plan souhaité par Donald Trump. Al Sissi a lu une déclaration où il insisté sur « la nécessité de la reconstruction de Ghaza sans déplacement forcé – je le répète : sans déplacement forcé – du peuple palestinien de sa terre, à laquelle il s'accroche, et de sa patrie, qu'il ne consent pas à abandonner », rapporte l'AFP.
Fervent défenseur de la cause palestinienne, Pedro Sánchez a exprimé à son tour « le refus catégorique de l'Espagne et de son gouvernement (de donner leur approbation) au projet de transférer la population palestinienne en dehors de la bande de Ghaza ». Le Premier ministre espagnol a dit « soutenir, bien évidemment », la proposition égyptienne de reconstruction de la bande de Ghaza sans expulser sa population. Cette proposition fera l'objet d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe qui devait initialement se tenir le 27 février, au Caire, et qui a été reporté au 4 mars.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face aux menaces tarifaires, une vaste coalition appelle à rendre l’assurance-emploi plus accessible

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 - Les groupes de défense des sans-emploi, le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), et les grandes centrales syndicales québécoises (FTQ, CSN, CSQ et CSD) demandent au gouvernement fédéral de mettre en place des mesures d'assouplissement et d'amélioration au programme d'assurance-emploi. Cette demande intervient dans un contexte d'insécurité politique et économique, alors que les effets des menaces tarifaires américaines se font déjà sentir.
Ensemble, ils pressent le gouvernement canadien à adopter un projet pilote visant à permettre au régime d'assurance-emploi de répondre rapidement aux besoins des travailleurs et des travailleuses qui vont ou qui sont susceptibles de perdre leur emploi. En ce sens, les mesures demandées visent à régler les problèmes d'admissibilité au régime et à désengorger un système déjà surmené.
« On sent déjà les impacts des menaces tarifaires, nos groupes locaux et régionaux reçoivent des appels tous les jours de personnes inquiètes ou qui ont déjà perdu leur emploi. Dans son état actuel, le régime d'assurance-emploi n'est tout simplement pas capable d'encaisser la crise qui s'en vient », s'inquiètent Selma Lavoie et Milan Bernard, co-porte-paroles du CNC. « On s'attend à des délais de traitement importants et à des milliers de travailleurs et de travailleuses qui vont perdre leur emploi et qui pourraient ainsi tomber entre les mailles du filet ».
Les groupes de défense des sans-emploi et les centrales syndicales appellent à mettre en place un projet pilote comprenant minimalement les mesures suivantes :
– Une norme universelle d'admissibilité de 420 heures ;
– Une augmentation du montant des prestations et l'établissement d'un seuil plancher à 500 $ ;
– Que l'exclusion pour fin d'emploi invalide ne s'impose que sur le dernier emploi occupé ;
– Permettre de recevoir des prestations plus tôt en simplifiant les règles régissant le traitement des indemnités de départ et autres sommes versées à la suite d'une cessation d'emploi.
Par ailleurs, des mesures similaires ont déjà fait leurs preuves lors de précédentes périodes de crise.
« C'est dans des moments d'incertitude comme ceux-ci que l'on doit avoir une protection sociale fiable et solide. En ce moment, ce sont uniquement 40% des chômeurs et des chômeuses qui se qualifient à l'assurance-emploi, le montant des prestations est insuffisant et les délais de traitements sont inadmissibles. C'est maintenant que le gouvernement doit agir », affirment à l'unisson Caroline Senneville, présidente de la CSN, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ, et Luc Vachon, président de la CSD.
« En écartant la réforme de l'assurance-emploi, le gouvernement libéral s'est tiré dans le pied. On se retrouve à peine quatre ans après la pandémie, avec une protection en cas de chômage qui n'arrive pas à protéger les travailleurs et les travailleuses de manière adéquate », affirme Fanny Labelle porte-parole du MASSE. « On lui demande aujourd'hui d'ajuster le tir, de le faire rapidement et d'amener des changements sur le long terme. Les mesures qu'on demande sont capables de répondre à la crise qu'on traverse, mais aussi de régler les problèmes de fond du programme d'assurance-emploi ».
La coalition invite le gouvernement à mettre en place dès maintenant ces mesures, dans l'objectif de les pérenniser et de fournir aux travailleurs et aux travailleuses une réelle protection en cas de chômage.

Encore une fois, NON aux énergies fossiles !

Le 12 avril 2022, le Québec a interdit l'exploration et l'exploitation des combustibles fossiles sur son territoire. Sous la pression de la société, il a dit NON à Énergie Est, à GNL Québec et à son gazoduc.
Pipeline Énergie Est, GNL Québec, GAZODUQ : on pensait que tout cela était derrière nous.
Depuis quelques années, les citoyens et citoyennes, inquiets de la dégradation du climat planétaire, réussissent, en se mobilisant, à convaincre les pouvoirs publics de travailler dans la bonne direction : la réduction de l'empreinte carbone dans tous les domaines.
Le gouvernement fédéral s'est lui-même doté d'un objectif de décarbonation de l'économie.
Or nos voisins du sud ont élu Donald Trump.
La campagne de déstabilisation globale lancée par ce sinistre bouffon, sa cour de milliardaires et ses idéologues illibéraux devrait être pour nous l'occasion de revoir et de resserrer ces objectifs : si on laisse agir cette clique, la crise climatique va s'intensifier.
Mais la réaction de nos dirigeants est aberrante. Contre toute attente, contre toute logique, certains (y compris notre ministre de l'Environnement et de la Lutte au changement climatique) semblent voir d'un bon œil les nouveaux projets de transport de combustibles fossiles. Et cela même si le Québec copréside la BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance), dont la mission est de faciliter l'élimination progressive de la production pétrolière et gazière.
De tels projets iraient à l'encontre de cet objectif en favorisant une hausse de la production de pétrole et de gaz de l'Ouest canadien, alors même que les spécialistes comme Normand Mousseau, tout comme l'Agence internationale de l'énergie, répètent que la production de combustibles fossiles est proche de son pic.
Entre 2015 et 2020, la mobilisation citoyenne (manifestations, lettres, déclarations publiques, présentation de mémoires au BAPE et autres instances) a pu nous donner l'impression que ce dossier était clos. Faudra-t-il remonter au front, ressortir nos dossiers, nos argumentaires, nos pancartes ?
Tout cela est pourtant plus que jamais d'actualité, car la crise climatique ne fait qu'empirer.
Alors, M. Legault, M. Charette, ouvrez les yeux, regardez au loin et travaillez réellement à cette transition climatique, que vous définissez vous-mêmes comme « la transformation d'une société et de son économie visant à ce qu'elle cesse de contribuer aux changements climatiques et à la rendre résiliente face à ces derniers ».
Vous voulez des suggestions ? Pour diminuer notre dépendance au pétrole et réduire les émissions de GES du secteur des transports, ne faudrait-il pas cesser de favoriser l'achat et l'utilisation de l'automobile (pourquoi ne pas interdire la publicité sur les véhicules, comme on l'a fait pour le tabac et l'alcool ?) ; investir sérieusement dans les transports collectifs (à petite, moyenne et grande échelle) ; appeler les citoyens et citoyennes à la sobriété énergétique dans leur quotidien (transport actif, transport collectif, autopartage, covoiturage, aide et collaboration entre voisins).
Au lieu de nous abaisser devant les exigences d'un dictateur en puissance, d'aller dans le sens du Parti conservateur du Canada et de jouer le jeu mensonger de la croissance infinie, dressons-nous, opposons-nous à ces projets dépassés et dangereux et faisons du Québec un exemple de société tournée vers l'avenir.
Denise Campillo
Roxton Falls
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une longue histoire d’amour

Impétueuse, l'œuvre d'une Québécoise de 86 ans qui est atteinte d'Alzheimer depuis dix ans. Éliette Anderson Rioux se considère une femme tout à fait ordinaire. Cependant, l'immense courage dont elle fait preuve tout au long de sa vie à combattre oppression et injustice, surtout celles subies par les femmes, démontre qu'elle est, en fait, une personne tout à fait extraordinaire.
Impétueuse rassemble son récit de vie, ses articles et ses poèmes. Des textes qui, par l'intensité de sa verve et de son écriture, nous interpellent.
L'histoire d'Éliette illustre ce qu'était, dans les années 1950, la vie au fin fond de la vallée de la Matapédia d'une famille québécoise tellement pauvre qu'ostracisée par curé et villageois. Et, aussi et surtout, elle illustre le parcours fort difficile mais tellement impressionnant d'une militante du féminisme au Québec, dénonçant l'injustice subie par toutes les femmes depuis des millénaires, et, en particulier, les lesbiennes.
De son enfance et adolescence dans un rang de la vallée de la Matapédia comme aînée de 13 enfants, et des mois après son arrivée à Montréal à 18 ans, Éliette nous parle de misères et humiliations, mais aussi de sa détermination à vivre et de sa curiosité pour le vivant. Après avoir vécu une dépression sévère à Montréal, la vie d'Éliette reprend sens, à travers sa démarche en thérapie et lorsqu'elle décide de recommencer ses études, interrompues à 12 ans, et qu'elle s'inscrit plus tard au Cégep. Elle se lance alors dans un militantisme féministe radical, en s'exprimant par poésie et rédigeant de nombreux articles percutants dans Les Têtes de pioche, le journal des femmes qu'elle cofondait avec d'autres militantes en 1976.
Moi dès l'âge de cinq ans je tombai en amour avec les femmes. Je n'étais bien qu'avec elles, entourée de leur présence quotidienne. Je ne veux pas dire que toutes étaient bonnes, douces et parfaites… mais en comparant avec les hommes, j'ai compris très tôt qu'elles m'étaient tellement plus sympathiques et plus attirantes pour moi. Je n'ai pas été aussi spontanément attirée par les hommes, j'ai dû me forcer pour aller vers eux.
J'ai grandi avec ce goût en moi, ne sachant pas qu'il était possible de vivre de cette façon. Ce n'est pas dans ce coin perdu du Bas du Fleuve que l'on me l'apprendrait… Je me serais peut-être fait tuer, exiler ou interner si dans les années 50 j'avais osé m'affirmer comme lesbienne (je ne connaissais pas ce mot-là !). Pourtant ma première relation amoureuse fut vécue lorsque j'eus douze ans avec une semblable, une fille de 10 ans...nous ne savions pas que ce que nous faisions toutes les deux aurait été condamné si on en avait parlé, instinctivement nous nous sommes tues et ce n'est que bien plus tard que je me suis rappelée cette expérience.
Du plus loin que je me souvienne c'est avec les femmes que j'ai appris les choses les plus importantes sur la vie. Avec ma mère d'abord, ma grand-mère, mes tantes, et d'autres femmes que j'aimais beaucoup à cette époque de ma vie. Ma relation avec ma mère fut très bonne, nous nous entendions bien toutes les deux car j'étais l'aînée et nous avions besoin l'une de l'autre, face à tout ce que nous vivions à la maison : grosse famille, pauvreté, etc. Nous ne nous sommes jamais querellées et c'est pourquoi j'ai trouvé cela très difficile lorsqu'elle m'a quittée l'année dernière, je ne pouvais pas m'imaginer sa mort, et aujourd'hui au moment même où j'écris ces mots, je sens le manque, le vide dans mon ventre et dans mon cœur, elle est morte si vite, partie sans dire un mot, comme elle avait vécu sa vie. Moi je suis là, vivante, et je me suis fait la promesse de vivre à ma façon, je ne veux pas mourir à petit feu ma vie, Je n'accepterai jamais de me taire, de me sacrifier ou de me résigner comme elle a dû le faire !!!
Grand-mère me fascinait quand j'étais toute petite. Avec sa façon d'aimer tout ce qui vivait autour d'elle : humains, animaux, plantes, fleurs, elle m'a légué ce respect immense de la vie. Elle pouvait expliquer durant des heures la beauté de toute chose et de tout être vivant. Elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, elle avait un sens profond de la justice qui s'est inscrit en moi pour le reste de mes jours. Elle me bouleverse grand-mère, elle m'atteint toujours en plein cœur, rien qu'à regarder ses gestes, gestes simples de chaque jour. Souvent, en la regardant travailler les larmes me montaient aux yeux, je la regardais en cachette laver la vaisselle, je ne voyais que son dos ployé par tant de travail, ce dos de femme que j'ai vu tant et tant de fois, ces gestes de femmes si souvent répétés, et dont la beauté m'émeut tellement. Ces petits gestes sauveurs, protecteurs de la vie, tendresse de femme, je n'oublierai jamais tout ce que vous m'avez apporté d'amour et de chaleur. J'ai vu ses épaules fatiguées, ses mains toutes sillonnées de petits chemins se croisant, se chevauchant, s'entrecoupant entre eux. Petits chemins de travail, creusés par l'eau, la terre, le bois, la laine filée, la nourriture préparée. De nouveau la vie protégée par grand-mère. Elle n'eut pas d'enfant grand-mère… elle en adopta trois dont l'un devint mon père. Aujourd'hui elle a 81 ans et elle vit seule, loin, très loin dans un petit village du Bas du Fleuve.
Des fois je me demande ce qu'elle dirait si elle apprenait que sa petite fille de 40 ans aime une femme… peut-être qu'elle s'en doute, car je ne lui ramène jamais d'homme lorsque je lui rends visite ! Je lui ai fait connaître quelques fois la femme que j'aimais à ce moment là, sous la couverture de l'amie avec laquelle je m'entends si bien ! Amie dont je ne pouvais me passer de sa présence même pour lui rendre visite. Elle a du se poser des questions, mais n'a jamais osé me les poser à moi. Car j'imagine que pour elle ce n'est pas pensable qu'une femme aime une autre femme. « Dans mon temps ça ne se faisait pas » qu'elle dirait. Je lui répondrais « ça s'est toujours fait grand-mère, mais vous ne le saviez pas''. Personne n'en parlait autour de vous, mais les hommes eux savaient. Savaient que ça se faisait entre eux, et entre les femmes, seulement entre eux, c'était acceptable… mais pas entre femmes.. C'était ''contre-nature''… tandis que pour eux ce n'était que ''folie de jeunesse'', plaisir de se retrouver entre hommes.
Voilà ce qui se passait grand-mère dans vot' temps, aujourd'hui aussi. Mais on vous a gardé à l'écart ! Moi j'ai eu plus de chance et j'en suis bien heureuse. Même si durant des années on m'a poussé vers les hommes, malgré que l'on m'ait conditionnée à la seule hétérosexualité, ben malgré tout cela j'ai déjoué leur plan. On m'a dépossédée de tout, de mon corps, de mes pensées, de mes désirs de femme, et pourtant je suis en train de tout récupérer. Je suis en train de me retrouver, de me réapproprier de tout ce qui fait de moi une femme, pas cet objet, pas cette marchandise qu'ils se passent de mains à mains, de corps à corps, pas ce trou servant à leur satisfaction de mâle, servant seulement à la reproduction de l'espèce !
Moi c'est un choix que je fais de ne pas me reproduire. Je pourrais, même en étant lesbienne, je pourrais… mais je ne veux pas. C'est plus qu'un choix, c'est viscéral, rien qu'à y penser d'avoir un enfant, c'est comme si on m'enlevait une partie de mon corps, une partie de moi. Je n'ai pas le temps, ni l'énergie à mettre pour le développement d'un enfant venant de moi. Je suis ma propre enfant, mon enfant unique. Je me mets au monde à chaque jour, et elle est si petite mon enfant, à peine vivante présentement, marchant avec difficulté, besoin encore de petites béquilles, enfant-fille de quarante ans. Quarante ans dans la tête, un peu dans le corps. Enfant dans tout le reste. Surface de quarante ans, raisonnements, pensées bien apprises, bien rationnelles de femmes colonisée, vieux clichés à mettre aux poubelles, vieilles leçons pas acceptables, vieux chemins tortueux où l'on m'a rendu boiteuse, c'est fini maintenant, bien fini. Enfant je suis, ai découvert au plus profond de moi en dessous des couches d'oppression, grands désirs, désirs tout neufs, pas encore vécus. Passions neuves enfouies depuis tant de temps. Désir d'une enfant pas mort complètement. Sens en moi le flamboiement rouge des désirs. Pas morts encore les feux de l'enfance. La passion de vivre, celle de découvrir, de me découvrir. Recherche de la beauté d'une être humaine, d'une enfant-fille de quarante ans, avec dans le cœur plein de choses ayant évité le massacre. Pas le temps, pas d'énergie pour mettre au monde une reproduction, une autre copie imparfaite de moi, qui à son tour refera probablement le même chemin ! Pas envie de me voir parcourir en double la route pleine d'ornières, vieille route millénaire avec quelques cahots en moins… pas intéressée vraiment pas. Je reprends mes petites béquilles, vais faire un autre bout de route avec. Vais les lâcher bientôt, au détour… vais les déposer sous une couche de mousse et de feuilles mortes. Debout enfin sur mes deux jambes, continuerai mon trajet vers une plus-être-femme, nantie d'une enfance à vivre pour le restant de mes jours.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le Québec a-t-il besoin du projet de loi 89 du ministre Boulet ?

L'annonce récente du ministre du Travail - le caquiste Jean Boulet - de faire adopter par les députéEs de l'Assemblée nationale le projet de loi 89 en vue de rendre plus difficile l'exercice du droit de grève dans certains secteurs de l'activité économique (éducation, municipalités et certaines entreprises privées) est une très mauvaise idée. Elle survient, en plus, quelques semaines après l'annonce de la fermeture de sept entrepôts – dont un syndiqué- d'Amazon au Québec. La question se pose, sur quel enjeu le gouvernement du Québec devrait-il ou doit-il légiférer ? Sous-question : Le droit de négociation accessible à toutes et tous ou restreindre l'exercice du droit de grève ?
Alors que c'est, selon nous, au sujet du droit de se syndiquer - et de négocier les rapports collectifs de travail - que devrait s'intéresser le ministre Boulet, voilà plutôt que c'est l'exact opposé qu'il propose.
Nous vivons dans une société capitaliste au sein de laquelle le travail est réputé libre. Les droits du travail - droit d'association, droit de négociation et droit de grève - ne peuvent s'exercer que collectivement dans une entreprise de deux employéEs et plus. Pour le moment, il y a environ 40% de la main-d'œuvre salariée qui est syndiquée. C'est donc la majorité des travailleuses et des travailleurs qui se retrouve dans une situation vulnérable devant un employeur qui dispose d'un pouvoir de fixer arbitrairement leurs conditions de travail (horaire, promotion, période de vacances annuelles, etc.) et de déterminer unilatéralement leur rémunération et leur augmentation annuelle.
Il n'est plus à démontrer que certains employeurs n'ont pas hésité - et n'hésitent toujours pas apparemment - à fermer leurs portes dès qu'ils entendent parler de syndicalisation ou qu'une requête en accréditation syndicale est déposée à la Commission de relations du travail. Amazon s'ajoute à la triste liste de ces autres entreprises (Mc Donald, Target, Wall Mart) qui réalisent annuellement des profits milliardaires et qui se contentent ou se limitent à offrir à leurs employéEs des conditions de travail qui dépassent à peine ce qui est prévu par la Loi des normes minimales de travail et la Loi du salaire minimum.
Le gouvernement affairiste de la CAQ de François Legault semble n'avoir aucune envie à doter le Québec d'une législation musclée en vue de permettre l'exercice des droits constitutionnels en lien avec le travail. Que 60% environ de la main-d'œuvre salariée se retrouve comme des billes dans les mains d'un joueur - et ici il est question d'une main-d'oeuvre majoritairement féminine oeuvrant dans le secteur des services-, cela ne l'affecte pas une miette. Que son gouvernement décide de ne pas légiférer en vue de rendre effectifs le droit à la syndicalisation, le droit à la négociation et le droit d'aller en grève, cela nous en dit beaucoup sur l'idéologie qui habite son équipe ministérielle et sa députation : l'idéologie néolibérale qui a, entre autres choses, comme objectif l'affaiblissement des droits syndicaux.
Le projet de loi 89 vise supposément « à considérer davantage les besoins de la population » en cas de grève ou de lockout. Que cela est dit avec un vocabulaire débordant d'euphémismes à nous faire dormir debout. Il y a dans ce projet de loi une remise en cause frontale du droit de grève. L'offre minimale de services – ou de prestations de travail - à offrir en cas de conflit vise indiscutablement à atténuer l'impact d'un arrêt de travail. Le rapport de force qui va en découler sera nécessairement à l'avantage de l'employeur, car l'interruption de son service ne sera que partielle et non totale.
Et dire qu'il fut un temps où le droit de grève n'était nullement encadré par la loi au Canada et au Québec. Et dire qu'il fut un temps également où c'était via une loi spéciale de retour au travail que le gouvernement pouvait mettre un terme à l'exercice du droit de grève. Et dire encore qu'il fut un temps où c'était le droit de grève, selon le gouvernement du Québec lui-même, qui nous distinguait d'une société totalitaire.
«
En raison des expériences passées, il pourrait être facile de proposer quelques restrictions au droit de grève des syndiqués du secteur public. Il nous faut éviter de tomber dans ce piège qui ne règlerait (sic) rien dans les faits. Au contraire, nous nous proposons de reconnaître le maintien du droit de grève à titre d'expression de l'une de nos libertés démocratiques les plus chères et qui nous distingue des sociétés totalitaires ». Gouvernement du Québec. Ministère du Conseil exécutif. 1977. 1 Le travail, point de vue sur notre réalité. Québec : Secrétariat des conférences socio-économiques, p. 14-15.
Le Québec n'a aucunement besoin d'un projet de loi équivalent à l'article 107 du Code canadien du travail[1].
La main-d'œuvre non syndiquée, qui est à la fois vulnérable face à son employeur et qui vit dans la précarité, devrait être assurée de pouvoir profiter et jouir pleinement de ses droits constitutionnels.
Les centrales syndicales ont raison de dénoncer la contre-réforme Boulet.
Que vaut un droit constitutionnel qui ne peut pas être exercé ?
Poser la question c'est y répondre.
Yvan Perrier
24 février 2025
15h45
Ce qu'est un service essentiel selon le Comité de la liberté syndicale (CLS) du Bureau international du travail
Au fil des ans, le CLS a précisé ce qu'il entend par « services essentiels ». « Peuvent être ainsi considérés comme services essentiels : la police, les forces armées, les services de lutte contre l'incendie, les services pénitentiaires, le secteur hospitalier, les services d'électricité, les services d'approvisionnement en eau, les services téléphoniques, le contrôle du trafic aérien et la fourniture d'aliments pour les élèves en âge scolaire [...]. Toutefois, dans les services essentiels, certaines catégories d'employés, par exemple les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne devraient pas être privés du droit de grève (...) En revanche, le comité considère au contraire, de façon générale, que ne sont pas des services essentiels au sens strict : la radiotélévision, les installations pétrolières, les banques, les ports (docks), les transports en général, les pilotes de ligne, le transport et la distribution de combustibles, le service de ramassage des ordures ménagères, l'Office de la monnaie, les services des imprimeries de l'État, les monopoles d'État des alcools, du sel et du tabac, l'enseignement et les services postaux. Le service de ramassage des ordures ménagères est un cas limite et peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une certaine ampleur » dans Bernard GERNIGON, « Relations de travail dans le secteur public : Document de travail no2 », (2007), Genève, Bureau international du travail, 22-23.
[1] On se rappellera que c'est en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail que le ministre fédéral du Travail est intervenu l'année dernière dans conflits au port de Montréal et à Postes Canada. Le ministre a référé le différend au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) en vue d'un arbitrage exécutoire, ce qui a eu pour effet de suspendre, dans un cas, le lock-out et d'interrompre, dans l'autre cas, la grève en cours et ce jusqu'à ce que le conflit soit réglé.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d’Amazon Laval (STTAL) et la campagne citoyenne ’Ici, on boycotte Amazon’

Québec, 20 février 2025 - Les travailleurs d'Amazon qui s'étaient rendu à Québec aujourd'hui, accompagnés de militants de la campagne citoyenne 'Ici, on boycotte Amazon', ont finalement obtenu une rencontre avec le ministre du Travail après avoir passé une vingtaine de minutes à manifester à l'intérieur du congrès de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, au Château Frontenac. Celui-ci a démontré une ouverture superficielle à leur demandes, tout en refusant de prendre des mesures politiques contre la multinationale.
Jean Boulet a refusé de se positionner publiquement, arguant que le syndicat devait faire valoir ses demandes devant les tribunaux. Toutefois, cela pourrait prendre des années, et les travailleurs exigent justice maintenant.

Le syndicat et 'Ici, on boycotte Amazon' tiennent à rappeler que le pouvoir exécutif peut prendre des mesures pour sanctionner des entreprises. C'est la même chose pour l'assemblée nationale, qui pourrait faire passer une loi spéciale visant Amazon, ou interdisant ses pratiques à l'ensemble des entreprises.
La campagne citoyenne 'Ici, on boycotte Amazon' et le STTAL considèrent cette réponse comme un refus de prendre ses responsabilités de défendre la population du Québec.

CITATIONS :
"Nous avons demandé au ministre un engagement politique clair, mais de toute évidence, il refuse de prendre position pour les travailleurs, comme Legault l'avait fait lors de l'annonce de la fermeture. En restant dans ce flou prétendument neutre, il prend en pratique position pour les multinationales. Nous allons continuer nos efforts pour faire reconnaître nos droits et pour obtenir des sanctions contre Amazon." - Félix Trudeau, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs
d'Amazon Laval (STTAL)
"Nous avons rencontré le ministre Boulet et nous lui avons dit que l'État québécois se doit d'agir face au mépris d'Amazon et à son non-respect des lois du Québec. Mais pour lui, ce n'est pas un enjeu dans lequel le gouvernement devrait intervenir. Il pense que les tribunaux sont le seul moyen de faire respecter les lois du Québec et la population, alors qu'il a les pouvoirs pour faire plus, dès maintenant ! On est vraiment déçus de son attitude." - André-Philippe Doré, co-porte-parole de la campagne citoyenne 'Ici, on boycotte Amazon'
*À propos du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL)* : Le STTAL regroupe les travailleurs et travailleuses de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, à Laval. Il a été fondé en mai 2024. Il est le premier syndicat de la multinationale au Canada.
*À propos de la campagne ‘Ici, on boycotte Amazon'* : ‘Ici, on boycotte Amazon' est une campagne citoyenne créée en réaction à la fermeture des entrepôts d'Amazon au Québec. La campagne s'est alliée au STTAL afin de réclamer justice pour la population du Québec, dont les droits fondamentaux ont été bafoués.
Pour obtenir des images des travailleurs à Québec :
https://www.facebook.com/people/Syndicat-dAmazon-Laval-CSN/61572512136658/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
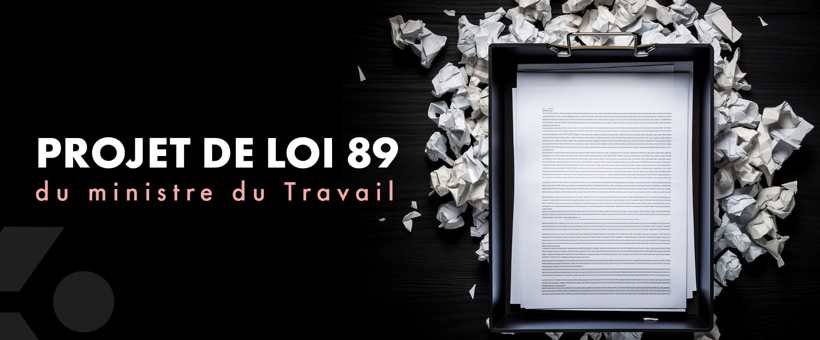
Projet de loi no 89 ; Un projet de loi inutile qui cache le bilan catastrophique du gouvernement de Francois Legault
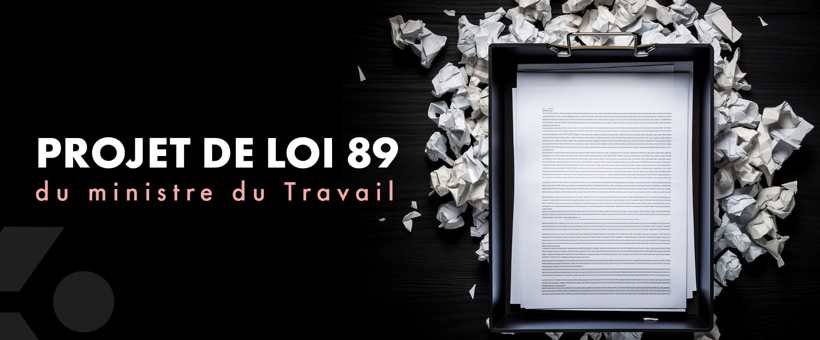
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réagit avec colère au projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, qui en voulant limiter la durée des conflits, s'attaque clairement au droit de grève des travailleurs et travailleuses pourtant protégé par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et la Constitution canadienne. Les contrats de travail sont négociés et entérinés ou rejetés par les travailleurs et travailleuses, ce n'est pas le rôle des gouvernements de baliser dans un calendrier la durée des conflits potentiels. D'ailleurs, est-il besoin de rappeler que plus de 95 % des négociations se règlent par des ententes entre employeurs et syndicats ? Où est l'urgence ?
« Il est ironique de lire le titre que porte ce projet de loi : Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. C'est ça qui va régler les vrais problèmes du Québec comme le coût de la vie, la crise du logement, le panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, des familles de travailleurs et travailleuses qui doivent faire appel aux banques alimentaires pour se nourrir et des menaces tarifaires ? Voyons donc ! On a encore une preuve d'un gouvernement complètement déconnecté qui se cherche des boucs émissaires pour masquer un bilan désastreux. Tout ce que trouve à faire le gouvernement de la CAQ c'est d'inventer un problème qui n'existe pas », soutient la présidente de la FTQ, Magali Picard
Duplessis serait fier du gouvernement de François Legault ! Brimer les droits des travailleurs et travailleuses c'était la spécialité de l'Union nationale de l'époque. Après les chèques-cadeaux pour se faire élire, voici que ce gouvernement est en train de recycler ce qu'il y avait de plus détestable de l'Union nationale. C'est un retour à l'époque de la Grande Noirceur que nous propose le gouvernement de la CAQ. Ce n'est pas ça un projet de société », déclare Magali Picard.
« Invoquer le bien-être de la population est un argument fallacieux. Oui, les grèves, ça dérange, mais lorsque les travailleurs et travailleuses choisissent ce moyen de pression, c'est pour améliorer leurs conditions de travail, les services à la population, pour cesser de s'appauvrir. Ce que veut faire le ministre c'est d'aider les employeurs à négocier de plus bas salaires et de moins bonnes conditions de travail. Ce gouvernement est complètement déconnecté de la population », ajoute la présidente.
Les gouvernements ont déjà tout ce qu'il faut pour baliser le droit de grève. « La Loi sur les services essentiels est on ne peut plus claire ; les services essentiels sont ceux dont l'interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, pas pour faire plaisir au patronat. Le ministre Boulet doit retirer son projet de loi qui brime le droit à la libre négociation protégé par la Constitution canadienne », conclut la présidente.
Comme à son habitude, la FTQ compte bien participer aux consultations parlementaires afin de défendre le droit des travailleurs et travailleuses du Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le privé est tout, sauf santé !

« La très grande majorité de la population tient au réseau public de santé et des services sociaux et nous devons dès maintenant travailler à la consolidation de ce joyau. Il est également capital de respecter le rôle distinct du secteur communautaire et de reconnaître sa contribution sociale. » — Sophie Verdon, coordonnatrice à la Coalition solidarité-santé.
Depuis plusieurs mois, des dizaines d'organisations issues des milieux communautaire autonome, de défense des droits de la personne, syndical et médical dénoncent la place grandissante du privé dans le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Au-delà des nombreuses promesses faites par les gouvernements successifs, des faits alarmants persistent : augmentation des délais d'attente, précarisation des organismes communautaires, centralisation excessive, etc. Du même souffle, on assiste à une augmentation de la place occupée par le secteur privé à but lucratif.
C'est dans cet esprit que des centaines de personnes des quatre coins du Québec se sont donné rendez-vous les 21 et 22 février derniers au Collège de Maisonneuve à Montréal. À l'agenda ? Une quinzaine de conférencier-ière-s du Québec, du Canada et de l'international réuni-e-s pour parler de privatisation, pour s'inspirer des expériences d'ailleurs et proposer des leviers possibles pour faire barrière à cette privatisation galopante. « Nous n'allons pas rester les bras croisés devant la dérive du réseau de la santé public. Nous refusons d'abdiquer. Nous sommes déterminé-e-s, ensemble, à faire obstruction à cette nouvelle offensive de privatisation incluse dans le plan santé caquiste. Nous croyons profondément que le bien commun de la population passe par un accès universel aux soins et aux services dont elle a besoin, sans égard à l'épaisseur de son portefeuille », de déclarer Sophie Verdon, coordonnatrice à la Coalition solidarité-santé et porte-parole de l'ensemble des organisations présentes à l'événement.
L'apport inestimable des organisations communautaires
Au terme de ces deux jours riches en présentations et en discussions, les organisations présentes ont scellé l'événement par la lecture d'une déclaration commune visant à réaffirmer leur volonté de faire un contrepoids au plan santé du gouvernement de François Legault. Cette déclaration a déjà été signée par plus de 300 organisations provenant des quatre coins du Québec. « La très grande majorité de la population tient au réseau public de santé et des services sociaux et nous devons dès maintenant travailler à la consolidation de ce joyau. Il est également capital de respecter le rôle distinct du secteur communautaire et de reconnaître sa contribution sociale. Tous ces organismes ont une fonction cruciale sur les déterminants de la santé et ainsi, sur l'état de santé générale de la population. Leur apport est immense ! », d'ajouter madame Verdon.
Le grand rendez-vous qui vient de se conclure s'inscrit dans une série d'actions déjà en marche depuis quelques mois. Ce mouvement large de contestation continuera de se faire entendre au cours des prochains mois. D'ailleurs, la Coalition Solidarité-Santé et de nombreux partenaires préparent une semaine nationale d'actions régionales du 31 mars au 5 avril 2025. Au cœur des réflexions de cette mobilisation importante : bâtir un mouvement citoyen capable de s'opposer à la privatisation et ainsi, mieux protéger le réseau de santé et des services sociaux publics. « Les Québécoises et Québécois méritent mieux ! Ils et elles méritent un vrai réseau public, accessible sur tout le territoire et qui offre des soins et des services de qualité », de conclure madame Verdon.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
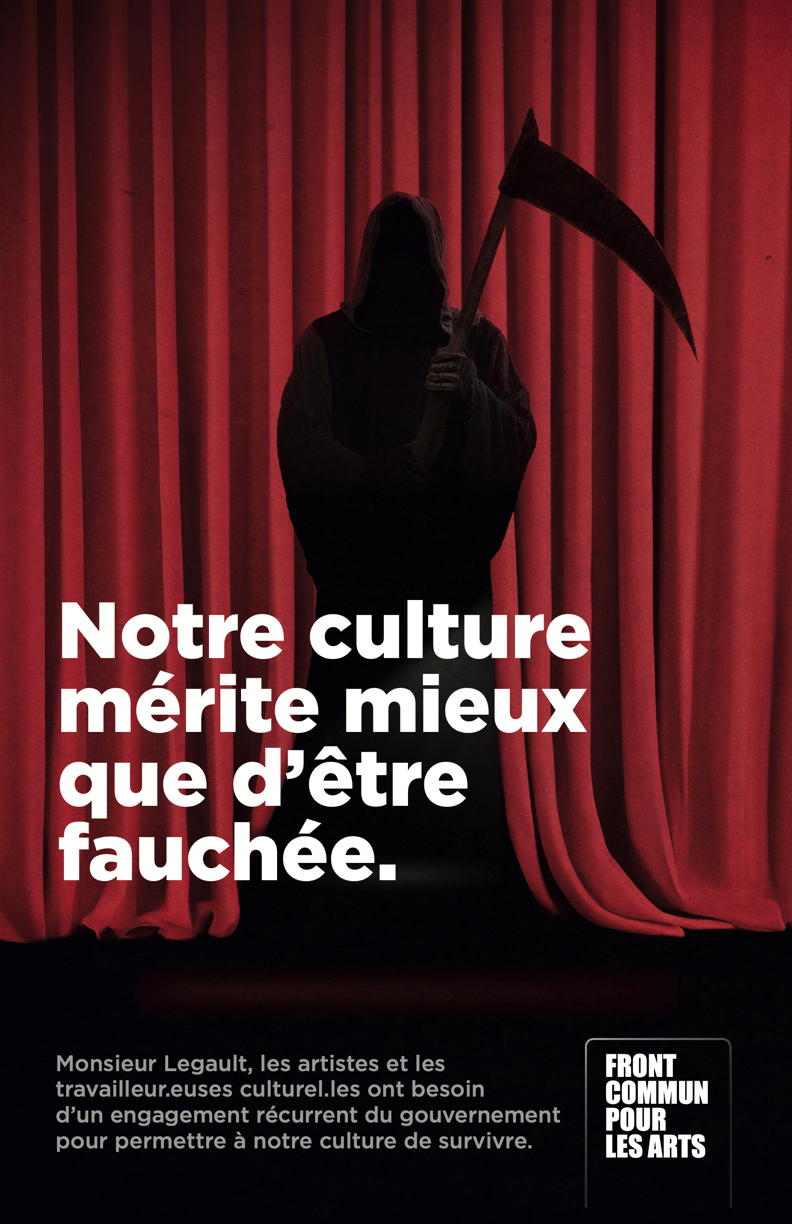
Notre culture mérite mieux que d’être fauchée
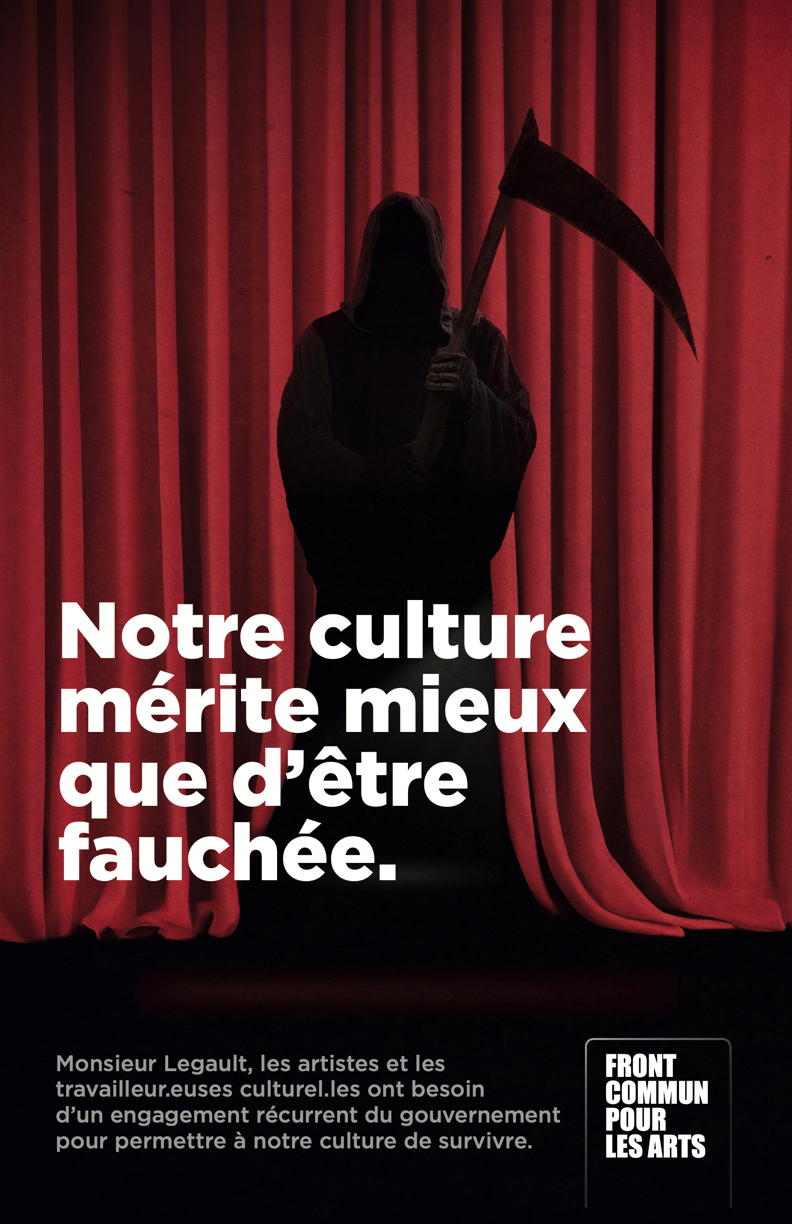
Réunis en conférence de presse le 29 janvier, les membres du Front commun pour les arts ont rendu publiques les conclusions de leur mémoire prébudgétaire et présenté les conséquences que subiront les artistes et les organisations en arts si leurs demandes financières ne sont pas satisfaites par le gouvernement du Québec.
– dévitalisation de notre écosystème : suspension de projets et d'activités de développement des publics, diminution du soutien aux artistes de la relève, diminution du rayonnement international de notre culture ;
– diminution de l'offre aux citoyens : moins de spectacles et d'expositions, augmentation des coûts de billets, moins de tournées produites donc des régions du Québec moins bien desservies en matière d'offres culturelles ;
– dégradation des conditions de travail pour des milliers d'artistes (déjà en situation précaire) et de travailleurs culturels.
Le 12 mars 2024, lors de la présentation du budget provincial, le ministre de la Culture et des Communications du Québec annonçait que le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ne disposerait que d'un budget de 160,46 M$ pour l'année 2024-2025. Une partie de ces fonds provient de crédits temporaires, ce qui affaiblit la capacité du CALQ à remplir adéquatement sa mission première. C'est moins d'argent qu'au dernier exercice, en pleine surchauffe de l'inflation et d'explosion des coûts. C'est surtout moins que ce que le milieu culturel évaluait comme un seuil minimal viable pour les prochaines années.
Aujourd'hui, 17 organisations culturelles se mobilisent au sein du Front commun pour les arts pour dire aux instances gouvernementales : C'est assez ! Notre culture mérite mieux que d'être fauchée.
La dévitalisation de la culture québécoise a de réelles conséquences sur notre société : des institutions fermeront, des formes d'art s'éteindront, des traditions se perdront et des emplois issus de divers secteurs économiques seront abolis.
Les 170 000 artistes, travailleurs et travailleuses du milieu des arts ont besoin d'engagements récurrents et pérennes de la part du gouvernement pour permettre à la culture de survivre. Il est temps que le secteur culturel soit reconnu comme un secteur économique essentiel et profitable à l'ensemble de la société québécoise.
Ce que nous demandons
– Porter à 200 millions $ les crédits permanents du CALQ dès la prochaine année financière ;
– Viser la consolidation des budgets du CALQ en rendant l'ensemble de ses crédits permanents ;
– Systématiser l'indexation des programmes du CALQ ;
– Faire de la culture d'ici une véritable priorité gouvernementale dotée d'une vision à long terme pour les milliers d'artistes et travailleurs culturels du secteur.
Vous voulez vous joindre au mouvement ? Affirmez votre appui aux demandes du Front commun pour les arts en partageant sur vos réseaux sociaux le matériel de la campagne.
Utilisez le #frontcommunpourlesarts #LaCultureMeriteMieux pour manifester votre engagement !
Le Front commun pour les arts est un regroupement d'organismes volontaires unis devant la crise dont le principal objectif est de sensibiliser le gouvernement à l'urgence d'agir.
Le Front commun pour les arts regroupe :
Association des galeries d'art contemporain (AGAC)
Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ)
Association professionnelle de diffuseurs de spectacles - RIDEAU
Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ)
Conseil québécois de la musique (CQM)
Conseil québécois du théâtre (CQT)
DOC Québec En Piste, Regroupement national des arts du cirque
Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN)
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)
Regroupement de pairs des arts indépendants de recherche et d'expérimentation (REPAIRE)
Regroupement des arts de rue (RAR)
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ)
Regroupement du conte du Québec
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Réseau Culture 360o (CRC)
Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP)
Société des musées du Québec (SMQ)
Union des artistes (UDA)
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)
Télécharger les ressources
Télécharger le mémoire
Télécharger l'affiche
Télécharger le carré web
Télécharger la story
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte des 15 conseils régionaux de la culture du Québec : Notre culture a besoin d’être protégée

Les 15 conseil régionaux de la culture interpellent le premier ministre François Legault. Notre culture a besoin d'être protégée et nous croyons fermement que c'est notre devoir comme nation de la préserver. Comme nous en faisons état dans notre mémoire Cinq priorités pour soutenir la vitalité de la culture dans l'ensemble des régions du Québec, il est impératif de ramener les investissements de l'État en culture au niveau pandémique. Les musées doivent être correctement financés partout sur le territoire. Il est essentiel pour la vitalité de la société québécoise de soutenir dignement nos créateur·trices et nos artisan·es.
Monsieur le Premier Ministre,
D'emblée, disons-le clairement : le secteur culturel et artistique de toutes les régions du Québec vit présentement une crise majeure et la vitalité de la culture québécoise est en péril. C'est à titre d'intervenant·es de première ligne et partenaires du gouvernement du Québec pour le soutien au milieu culturel depuis plus de 40 ans que nous faisons ce sombre constat. Au cours des dernières semaines, les mauvaises nouvelles se sont succédé à un rythme effarant. Nos organismes annoncent les uns après les autres des fermetures, la réduction radicale de leur programmation et des suppressions de postes. Ce triste tableau n'est malheureusement que la pointe de l'iceberg d'un phénomène que nous voyons arriver depuis plusieurs mois. Force est de constater que dans les conditions actuelles, maintenir l'accès des Québécois·es à une offre culturelle aussi riche et diversifiée est quasi impossible.
Comment en sommes-nous arrivé·es là ? Notre milieu est soumis à des pressions sans précédent. La transformation numérique, l'outrageuse domination des géants du web et l'effritement des médias font en sorte que notre vie culturelle est de moins en moins visible. Les publics, à la sortie de la pandémie, ont changé leurs habitudes et ne sont pas pleinement revenus dans nos lieux de culture. Avec l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, le secteur a vu ses coûts de production exploser d'en moyenne 30 %.
Mais encore ? Dans le dernier budget, votre gouvernement a diminué de manière importante son soutien au secteur culturel. Ce recul diminue la viabilité de notre milieu. Ces décisions font très mal aujourd'hui. Une forte proportion des organismes soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) doit évoluer avec un budget non indexé depuis sept ans. Ce sont 120 entreprises culturelles qui n'ont plus de soutien de la part de la SODEC. Le ministère de la Culture et des Communications a été contraint de réduire l'accès gratuit aux musées. Certains indicateurs nous laissent croire qu'il pourrait y avoir d'autres compressions à l'échelle régionale.
Comme si ce n'était pas suffisant, il y a maintenant un rouleau compresseur à nos portes qui est en train d'occulter la culture québécoise. Les perturbations économiques qui se dessinent avec l'imposition des tarifs douaniers des États-Unis nous laissent craindre le pire. Avec l'inflation et les pertes d'emplois qui pointent à l'horizon, nos concitoyen·nes seront confronté·es à des choix difficiles alors que le « dollar-loisir » sera en compétition directe avec celui des premières nécessités.
Les conseils régionaux de la culture ont joué un rôle capital dans le développement et l'affirmation de notre culture partout au Québec. Nos organismes, comme bien d'autres, sont à la croisée des chemins. Si rien ne change, avec un financement qui stagne depuis nombre d'années, nous devrons diminuer notre offre de services alors que le milieu en a besoin comme jamais.
En somme, toutes les conditions sont réunies pour une tempête parfaite et notre vie culturelle n'en sortira pas indemne.
Que faire maintenant ? Notre culture a besoin d'être protégée et nous croyons fermement que c'est notre devoir comme nation de la préserver. Comme nous en faisons état dans notre mémoire Cinq priorités pour soutenir la vitalité de la culture dans l'ensemble des régions du Québec, il est impératif de ramener les investissements de l'État en culture au niveau pandémique. Les musées doivent être correctement financés partout sur le territoire. Il est essentiel pour la vitalité de la société québécoise de soutenir dignement nos créateur·trices et nos artisan·es.
Enfin, nous croyons que votre gouvernement devrait maintenir la capacité d'action des conseils régionaux de la culture afin d'aider le milieu à faire face aux nombreuses perturbations qui l'assaillent et s'assurer que l'ensemble des citoyen·nes partagent une culture commune.
Nous comprenons la situation financière dans laquelle se trouve le Québec. Mais faut-il pour autant abandonner notre culture ? Les maigres économies à faire dans le budget de la culture justifient-elles de mettre en dormance ce qui nous distingue comme peuple ? Il y a une seule personne au Québec qui peut freiner ce déclin et c'est vous, Monsieur Legault. Nous ne baisserons jamais les bras, mais nous avons besoin de vous.
Emmanuelle Hébert, co-présidente du Réseau Culture 360° et directrice générale de Culture Montréal
Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360° et directrice générale de Culture Outaouais
Louis-Eric Gagnon, président du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue
Sylvie Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie
Véronique Drouin, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent
Cassandre Lambert-Pellerin, présidente de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Véronique Pepin, présidente de Culture Centre-du-Québec
Pia Di Lalla, présidente de Culture Côte-Nord
Elsa Pépin, présidente de Culture Gaspésie
Claude de Grandpré, président de Culture Lanaudière
Alexandre Gélinas, président de Culture Laurentides
Christine Huard, présidente de Culture Laval
Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie
Karine Landerman, présidente de Culture Montérégie
Moridja Kitenge-Banza, président de Culture Montréal
Clara Lagacé et Louis-Antoine Blanchette, co-présidents de Culture Outaouais
Michelle Tremblay, présidente de Culture Saguenay—Lac-Saint-Jean
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pétition : maintien de la gratuité universelle les premiers dimanches du mois

Les 27 janvier dernier, le ministère de la Culture et des Communications a annoncé la fin de la gratuité universelle dans les musées les premiers dimanches du mois. La Société des musées du Québec, défavorable aux restrictions appliquées à cette mesure – qui serait désormais limitée au 19 ans et moins -, s'est rapidement mobilisée pour tenter de sauver une mesure historique qui, dans sa forme d'origine, était très favorable à la diversification et l'élargissement des publics dans les musées.
La SMQ a tout d'abord sondé, parmi ses membres, les 103 musées participants aux premiers dimanches gratuits pour évaluer l'impact de la mesure ainsi revisitée. Le comité politique a sollicité une rencontre avec la sous-ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Verge, pour lui faire part des conséquences en termes financiers pour les établissements et en termes de démocratisation de la culture pour le public, que constituent la revisite de la mesure. Un deuxième échange avec le Ministère quelques jours plus tard nous a laissé comprendre qu'une remise en cause de cette réforme était peu probable et nous avons alors invité les 103 musées participants à poursuivre la mobilisation en plaidant la cause auprès de leur député de circonscription.
En l'absence d'avancée dans ce dossier, la SMQ invite désormais ses membres à se mobiliser plus largement autour d'une pétition initiée par les musées de Sherbrooke en faveur d'un maintien de la gratuité pour les visiteurs et visiteuses de tous âges dans les musées participants les premiers dimanches du mois. La SMQ invite également les organisations et acteur.trice.s du secteur culturel à ajouter leurs signatures, au nom de valeurs communes et du bénéfice collectif que représente l'accès à la culture du plus grand nombre. Les signatures sont attendues avant le 17 mars 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tonine (1929-2025)

Consciente de la force de son œuvre consacrée par trente-et-un doctorats honorifiques à travers le monde et l'obtention pour Pélagie-la-Charette d'un prix Goncourt (1979), première non-européenne et toujours seulE CanadiennE à l'avoir reçu, Antonine s'était engagée.
L'auteur est secrétaire général des Artistes pour la Paix
1- d'abord pour l'Acadie et son histoire tragiquement marquée par la déportation qui a engendré entre autres le conte Évangéline de Longfellow chanté par Marie-Jo Thériô, mais surtout portée par l'immense fierté de sa culture, musicale folklorique avec Salebarbes, Édith Butler, Lisa Leblanc, Angèle Arseneault, Ginette Ahier etc., et les contes, pièces de théâtre et livres au particularisme langagier hérité de Rabelais (sujet de son doctorat à l'Université Laval, après deux ans de recherches à Paris). Rabelais l'a influencée aussi pour l'insolence sympathique qu'elle adresse, comme lui, tout au long de sa vie aux politiciens, principalement par son œuvre immortelle la Sagouine, une femme de ménage qui a plus de jugeotte que ceux qui se croient maîtres du monde, interprétée par Viola Léger ; elle lui refile respectueusement la demande en l'an 2000 de Jean Chrétien de la voir accéder au Sénat canadien, après qu'elle-même ait reçu en 1976 la distinction d'Officière de l'Ordre du Canada puis Compagnon en 1981.
Il y a un village de la Sagouine à Bouctouche, qui reçoit principalement du Québec la visite de 80 à 90 mille visiteurs annuels. L'Université de Moncton, qu'on espère comme notre ami l'ex-maire d'Amqui changer ce nom infâme par Université de l'Acadie, a pieusement annoncé mettre ses drapeaux en berne pendant les dix prochains jours ;
2- ensuite pour la démilitarisation du Canada conformément aux désirs de l'ONU (UNIDIR), en acceptant en 1988 de succéder à Jean-Louis Roux comme présidente des Artistes pour la Paix (à sa demande expresse, je lui succéderai en 1990, quelques jours à peine avant qu'éclate la résistance mohawk de Kanesatakeh, objet d'un film à l'ONF par une cinéaste-membre de notre C.A. d'alors, Alanis Obomsawin).
En 1989, elle avait sagement identifié, comme élément principal de notre engagement collectif, la lutte menée jusqu'en deux réceptions de la Gouverneure générale Jeanne Sauvé auprès du Premier ministre Bryan Mulroney contre l'achat onéreux et polluant de sous-marins nucléaires voulu par le Secrétaire général de l'OTAN militariste, Manfred Wörner. On était à moins d'un an de la chute du mur de Berlin. Son successeur Willy Claes d'origine belge devra démissionner de son poste après avoir été mis en cause dans l'affaire de corruption relative à l'achat d'hélicoptères EH-101 italiens Agusta (avec obusiers anti-sous-marins) projeté par madame Campbell : il sera condamné en 1998 à trois ans de prison avec sursis et interdiction pour cinq ans d'exercice d'une fonction publique, tandis que le Parti conservateur perdra ses élections avec deux députés survivants à leur déconfiture électorale sans précédent, dont Jean Charest !
Je suis allé quelquefois porter des documents à sa résidence à Outremont de la rue Antonine-Maillet, une incongruité qui l'amusait beaucoup, comme en fait foi la superbe entrevue livrée récemment en partie sur « sa » rue à André Robitaille. Elle y avait vécu un quart de siècle, libre et heureuse avec son amoureuse Mercedes Palomino avec qui elle a bâti l'institution du Théâtre du Rideau-Vert.
Son grand roman-récit que je lui avais déclaré « sous-évalué » par la critique, m'en indignant, Madame Perfecta, montrait avec sensibilité un autre exemple de ces heurts de classes bourgeoise et ouvrière, à l'origine de la presqu'entièreté de son œuvre, heurts aggravés par la condition immigrante de cette autre femme de ménage.
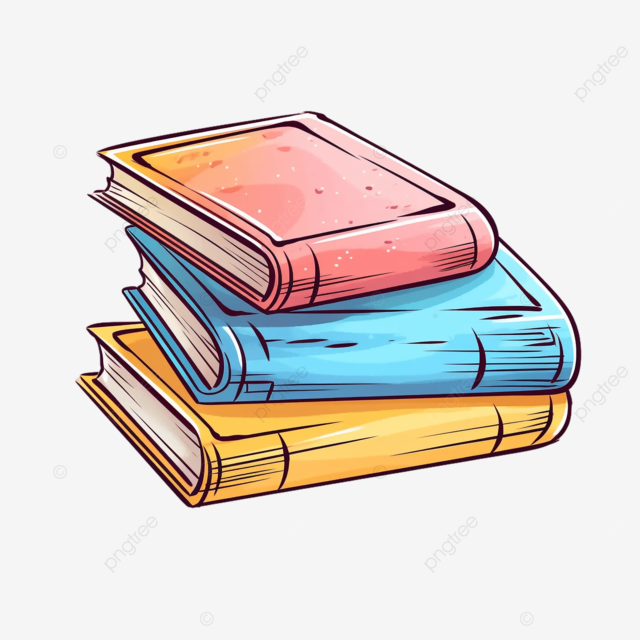
Comptes rendus de lecture du mardi 25 février 2025
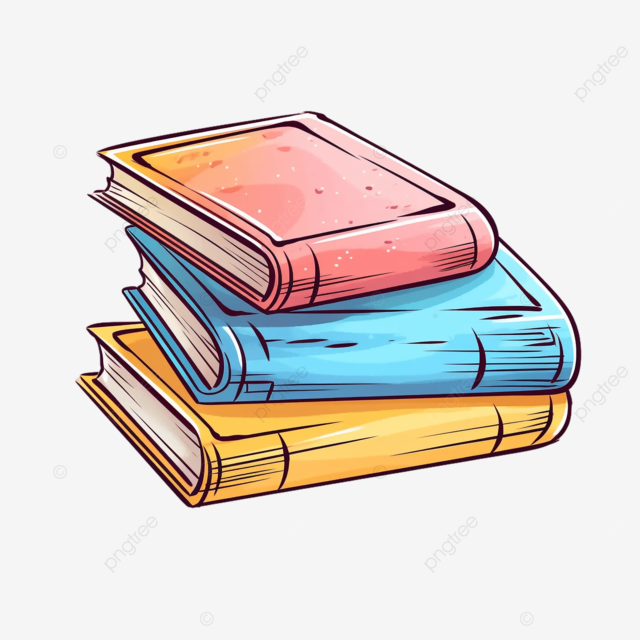
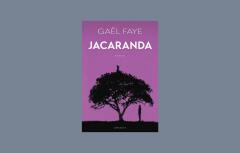
Jacaranda
Gaël Faye
J'appréhendais quelque peu la lecture de ce récent prix Renaudot. J'ai toutefois été ravi de la délicatesse et de l'humanité avec lesquelles l'auteur y aborde l'histoire du Rwanda à travers quatre générations de personnages, avec ses pénibles événements et ses zones d'ombre. Milan vit en France avec ses parents, dont la mère est d'origine rwandaise. Un jour, arrive chez lui un petit garçon chétif au regard apeuré, avec un épais pansement sur la tête. Il se nomme Claude et arrive du Rwanda. Sa mère essaie de le rassurer en s'adressant à lui en kinyarwanda…
Extrait :
Afin de démontrer scientifiquement leur théorie, des scientifiques belges utilisèrent toutes sortes d'instruments de mesure, comme des craniomètres ou des compas anthropométriques, pour mesurer les nez, les fronts, les oreilles, les bras, les tibias, les mâchoires et déduire de ces observations sur l'apparence physique la nature profonde et le caractère de chaque Rwandais et de son groupe supposé. Ainsi, ils décrétèrent que ceux qui étaient grands et minces étaient des Tutsi et ceux qui étaient petits et trapus étaient des Hutu. Que les Tutsi étaient fourbes et raffinés et les Hutu timides et paresseux.

Banque mondiale - Une histoire critique
Éric Toussaint
Nous sommes nombreux à nous être laissés mystifier par la Banque mondiale au cours des années. Cette institution financière créée en décembre 1945 avec le Fonds monétaire international, à la suite des accords de Bretton Woods, a-t-elle en effet jamais cherché à combattre la pauvreté dans le monde comme elle l'a longtemps laissé croire ? C'est bien évidemment le contraire. Comme l'illustre cet imposant essai fort bien documenté, elle aura bien plutôt propulsé de nombreux pays dans un cycle d'endettements et de pauvreté dont ils ne voient plus l'heure de sortir. Et ce sont les populations les plus pauvres du monde qui en font les frais, avec l'environnement, cette détestable institution financière presque entièrement contrôlée par les États-Unis étant essentiellement - sinon entièrement - au service des pays riches et des multinationales. Un livre à lire pour tous ceux qui veulent continuer à agir dans notre combat contre la pauvreté dans le monde, sans se laisser berner, de façon éclairée...
Extrait :
Ils piétinent la souveraineté des États en violation flagrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes du fait notamment des conditionnalités qu'ils imposent. Ces conditionnalités appauvrissent la population, accroissent les inégalités, livrent les pays aux transnationales et modifient les législations des États (réforme en profondeur du Code du travail, des Codes miniers, forestiers, abrogation des conventions collectives, etc.) dans un sens favorable aux créanciers et « investisseurs » étrangers.
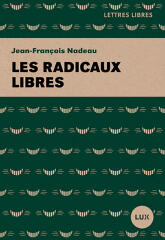
Les radicaux libres
Jean-François Nadeau
Les chroniques de Jean-François Nadeau dans le Devoir sont toujours agréables à lire. Il nous y fait découvrir la petite et la grande histoire d'ici et d'ailleurs dans un style particulier qui nous amène rapidement d'une anecdote à une autre et d'une idée à une autre. Nadeau est aussi l'un des chroniqueurs les plus progressistes de nos quotidiens. « Les radicaux libres », qui emprunte son titre à l'une de ses chroniques, compte une foule de textes de quatre à cinq pages fort instructifs et drôlement divertissants. C'est un recueil qui se savoure à petites doses, à trois ou quatre chroniques par jour.
Extrait :
En 1521, le clergé espagnol déclare une guerre aux livres précolombiens. Une croix dans une main, une torche dans l'autre, les catholiques les brûlent tous sur leur passage, depuis la côte de Tulum jusqu'au coeur du continent. L'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, se montre fier de brûler quant à lui ce que les troupes de Cortés ont pu oublier quelques années plus tôt. De triste mémoire, on se souvient notamment de Zumárraga pour avoir fait apporter sur une place du marché à Tlaltelolco les livres de la bibliothèque de la capitale de l'Anáhuac jusqu'à former là un Himalaya de papier. Des moines, armés de torches, y mettent alors le feu. On célèbre les cendres.
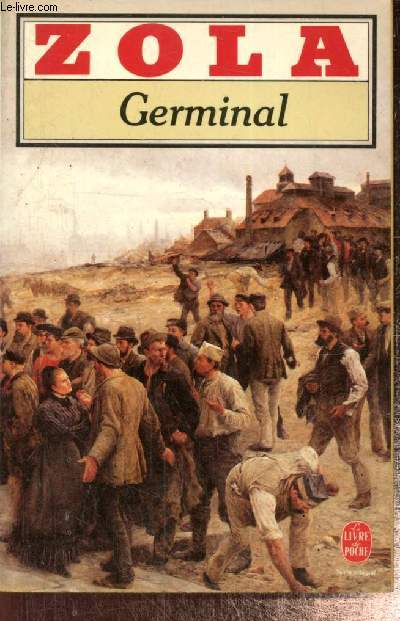
Germinal
Émile Zola
Chez nous, quand nous étions adolescents, c'est mon frère Paul et moi qui aimions Zola. Ma sœur Jacinthe, c'était plutôt Balzac. Ce grand classique est le plus connu des romans de Zola et certainement le principal roman du syndicalisme. Étienne Lanthier, nouveau aux mines de Montsou, y pousse les mineurs à la grève après la décision de l'employeur de baisser les salaires. S'ensuit une grève longue et pénible et des événements tragiques. « Germinal » est l'un des plus beaux romans qu'il m'ait été donné de lire.
Extrait :
Vous avez beau crier contre les riches, le courage vous manque de rendre aux pauvres l'argent que la fortune vous envoie… Jamais vous ne serez dignes du bonheur, tant que vous aurez quelque chose à vous, et que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d'être bourgeois à leur place.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
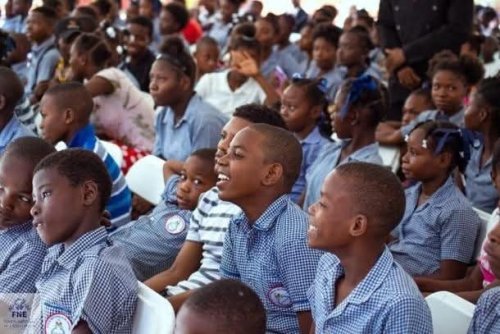
Étudier en Haïti : Un défi de résilience et d’espoir
Haïti, pays des contrastes, porte en son cœur une histoire de luttes et de victoires. Mais aujourd'hui, la réalité qui frappe la nation est bien plus complexe : violence, instabilité et terreur sont devenues des composantes quotidiennes de la vie. Dans ce contexte d'incertitude, l'éducation se transforme en un défi colossal, à la fois personnel et collectif. Étudier en Haïti, c'est naviguer entre des obstacles physiques et psychologiques. Pourtant, pour beaucoup de jeunes haïtiens, cela reste un chemin de résilience, un acte de foi en un avenir meilleur.
Dans un pays où l'insécurité et les tensions politiques limitent l'accès aux établissements scolaires, l'éducation se fait souvent à contrecœur. Les écoles ferment régulièrement à cause des barricades, des manifestations ou des violences ciblées. À cela s'ajoute un réseau scolaire insuffisant, dont une grande partie est privée et coûteuse. Pour beaucoup, l'éducation devient un luxe, réservé à ceux qui peuvent se permettre de contourner les risques, de prendre un transport coûteux ou de s'assurer d'un minimum de sécurité. Mais les étudiants haïtiens ne se laissent pas abattre. Ils se battent contre vents et marées pour accéder à un savoir qui est, pour eux, le principal levier d'émancipation.
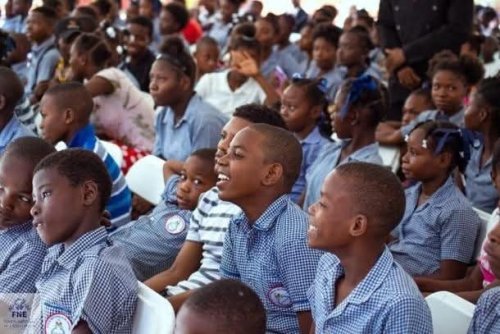
Malgré les défis, les étudiants haïtiens trouvent des moyens de poursuivre leur apprentissage. La résilience est au cœur de leur quotidien : ils adaptent leurs horaires d'étude en fonction de la situation sécuritaire, créent des espaces d'étude improvisés dans leurs foyers, ou se tournent vers des plateformes en ligne lorsque les écoles ferment leurs portes. Cette capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés fait d'eux des modèles de détermination. La situation ne brise pas leur espoir ; au contraire, elle le renforce.
Les technologies jouent un rôle primordial dans cette lutte. Les cours en ligne, bien qu'inaccessibles pour une grande partie de la population en raison du manque d'infrastructures, représentent une voie d'espoir pour ceux qui ont accès à Internet. L'enseignement à distance devient une alternative viable pour de nombreux étudiants, leur permettant de poursuivre leur éducation malgré la fermeture des établissements.
Dans un environnement où les institutions sont souvent défaillantes, les réseaux d'entraide entre étudiants et les initiatives communautaires deviennent essentiels. Les étudiants se soutiennent mutuellement, se regroupent pour échanger des ressources et des notes, et organisent des révisions collectives. Ils créent ainsi un tissu social qui leur permet de résister à la fragmentation du système éducatif. Cette solidarité devient non seulement un moyen de poursuivre les études, mais aussi un acte de résistance face à la violence et à l'isolement.
De plus, dans un pays où les ressources sont limitées, des initiatives citoyennes commencent à émerger. Des groupes organisent des collectes de fonds pour acheter des fournitures scolaires ou réparer des infrastructures endommagées. Ces actions communautaires montrent qu'il est encore possible de rêver d'un avenir où l'éducation est accessible à tous.
Face à l'inefficacité d'un système scolaire traditionnel, des voies alternatives se dessinent. Certaines organisations non gouvernementales proposent des formations pratiques et des ateliers pour les jeunes, afin qu'ils acquièrent des compétences professionnelles directement utilisables dans le monde du travail. D'autres explorent des modèles d'éducation non conventionnels, moins dépendants des infrastructures scolaires classiques et plus proches des réalités du terrain.
Les jeunes haïtiens ne se contentent pas d'attendre que le système se répare ; ils innovent, se réinventent, créent des espaces d'apprentissage où la rigueur académique et les compétences pratiques se croisent. Ces initiatives constituent la promesse d'un avenir plus autonome et plus dynamique pour la jeunesse haïtienne.
Dans un environnement aussi hostile, l'éducation devient un acte de résistance et de reconstruction. C'est un moyen pour les jeunes de s'armer intellectuellement et de contribuer, à terme, à la reconstruction de leur pays. Malgré les défis, l'éducation est perçue comme une porte d'entrée vers l'émancipation, un espoir de changer les mentalités et de renouveler les structures sociales et politiques du pays.
Mais cet espoir n'est possible que si les autorités haïtiennes et la communauté internationale prennent conscience de l'urgence de soutenir l'éducation. Il est crucial d'investir dans la sécurité des écoles, dans les infrastructures éducatives et dans l'accessibilité des ressources pédagogiques. Le rôle des gouvernements, des organisations internationales et des citoyens est fondamental dans la création d'un environnement plus sûr et plus propice à l'éducation.
Étudier en Haïti dans un environnement marqué par la terreur est un acte de résilience. Chaque étudiant, chaque jeune qui continue à rêver d'un avenir meilleur à travers l'éducation, devient un symbole de cette force qui pousse à aller de l'avant malgré tout. L'éducation n'est pas seulement un droit ; elle est un combat pour un futur où la violence ne dicte pas le quotidien, où la terreur n'entrave pas les rêves et où la connaissance est véritablement accessible à tous. Pour les étudiants haïtiens, l'éducation reste la clé d'un changement profond, un changement porté par des générations entières qui refusent de se soumettre à la fatalité.
Smith PRINVIL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le projet de pays au centre de la riposte québécoise
Suite aux charges à droite et à l'extrême-droite menées par Trump, Poilièvre, Carney et François Legault et leur projet de société qui se résume à business, business, business avec l'autoritarisme et les pouvoirs nécessaires pour écraser toute insoumission, notre riposte se doit d'être formulée autour du projet de l'indépendance du Québec. Nous pouvons faire front commun avec le Canada comme province canadienne dans l'immédiat, mais dès maintenant nous devons nous mobiliser pour formuler notre projet de pays et inscrire ce nouveau pays dans le dialogue avec les autres peuples du monde qui se mobilisent contre la vision du monde qui nous est imposée à l'échelle planétaire par les milliardaires de ce monde et leurs valets politiques dans une logique de dictature, entraînant les humains et les autres espèces sur Terre à l'extinction dans une approche suicidaire.
Cette réflexion au Québec autour du projet de pays nous amènera rapidement à aborder en profondeur des enjeux que nous pelletons devant nous depuis quelques décennies soit l'éducation, la culture, la santé, la famille, le travail, l'économie, le système politique et le rôle des institutions et des structures, l'immigration etc. et donner une direction à notre projet de pays en dans une discussion franche, ouverte et respectueuse avec notre famille, nos voisins, nos amis, les gens dans nos quartiers, nos villages et nos villes.
Pour ce faire il nous faut être attentifs à chaque personne que nous rencontrons pour comprendre sa dynamique personnelle, sa vision des choses, et voir comment l'entraîner dans le respect et la bienveillance sur une base volontaire dans notre projet collectif qui peut-être en cette période d'émotion, de peur, de colère, de frustration, d'isolement et de dépression, un catalyseur individuel et collectif bienfaisant et constructif dans une grande humanité et dans la solidarité.
Yves Chartrand
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Ukraine, Palestine : même combat ?
Donald Trump menace de s'entendre avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, et menace, à sa manière tonitruante et ambiguë, le président ukrainien Volodymyr Zelensky de le laisser tomber s'il refuse de faire des concessions significatives aux Russes, ce qui s'explique par la poussée néo-isolationniste qui représente la marque de commerce de son administration. Dans la foulée, un certain découplage entre l'Union européenne et les États-Unis se dessine. On peut s'interroger sur l'ampleur de ce courant et s'il perdurera au-delà de la présidence de Donald Trump. Mais il exprime bien une tendance au sein d'une bonne partie de la classe politique américaine et de l'électorat trumpiste.
Trump et sa garde rapprochée incitent les Européens à renforcer leurs dépenses militaires pour faire face à la menace russe, ce qui peut leur rendre service à la longue. En effet, ils devront compter moins paresseusement et moins peureusement sur la protection américaine. Il en résulterait une autonomie accrue pour eux, ce qui leur serait bénéfique à longue échéance. Après tout, les principaux membres de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne sont des puissances importantes, et la première possède l'arme nucléaire. Plusieurs pays européens comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne sont membres de l'Otan en plus. La Grande-Bretagne est elle aussi une puissance nucléaire. Unis, ces pays et les autres membres de l'Otan de moindre envergure, mis ensemble, ont potentiellement les moyens d'affronter le Kremlin. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que Vladimir Poutine ait l'intention de s'en prendre aux pays membres de l'Otan et de l'Union européenne, car ce serait suicidaire. Comme Trump, Poutine utilise beaucoup la tactique du bluff pour intimider ses adversaires.
Il pouvait envahir l'Ukraine, un pays non membre de l'Union européenne ni de l'Otan sans grands risques, même s'il s'est heurté alors à une résistance farouche qu'il n'avait pas prévue. Il n'agirait jamais ainsi (à moins de perdre la tête) à l'endroit des principaux membres de l'Union européenne et ceux de l'Otan. Les États-Unis ne pourraient alors que jouer leur rôle de soutien aux Européens. Par ailleurs, l'appui militaire et diplomatique dont Kiev a a bénéficié de leur part explique en bonne partie les difficultés du Kremlin en Ukraine.
Selon toute vraisemblance, le gouvernement ukrainien, lorsque des négociations s'amorceront enfin, devra céder du terrain, poussé par Trump et son entourage. S'il est impensable que le président américain puisse imposer au président ukrainien une solution toute faite, concoctée avec Poutine en secret, le second devra renoncer à chasser les Russes de la totalité du territoire national. L'armée russe tient 20% du territoire ukrainien et Moscou n'en rétrocédera qu'une partie, peu importe les pressions éventuelles de la Maison-Blanche et des grands acteurs de l'Union européenne ou de l'Otan. De plus, certains des territoires conquis par les envahisseurs sont peuplés d'une majorité de russophones qui voient d'un bon oeil leur éventuel rattachement à la Russie. Les futures négociations russo-ukrainiennes s'annoncent épineuses et leurs résultats incertains. Mais si le gouvernement de Kiev devra selon tout vraisemblance renoncer à récupérer tout le terrain perdu, Moscou, pour sa part, devra rabattre ses ambitions conquérantes initiales : annexer l'Ukraine. Seul un compromis pourra mettre fin au conflit.
Mais on peut prévoir que l'essentiel du territoire ukrainien (75% ou 80%) demeurera sous la souveraineté de son gouvernement. L'Ukraine ne redeviendra jamais une province russe. Elle va conserver son indépendance, même si celle-ci s'exercera sous haute surveillance du Kremlin. L'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'Otan ni l'Union européenne, selon toutes probabilités.
Par là, on constate le contraste avec la Palestine. En effet, il n'existe aucun gouvernement palestinien digne de ce nom (on ne peut qualifier ainsi l'administration agonisante de Mahmoud Abbas qui ne gère vraiment que 20% du territoire), la Cisjordanie ploie sous le grand nombre de colons israéliens (800,000) qui y vivent et ses habitants doivent subir depuis 1967 une interminable occupation militaire, souvent implacable. Tout ceci sans même évoquer la présence dans des camps de réfugiés de multiples exilés dont les grands-parents et arrière grands-parents ont fui la Palestine lors de la Naqba de 1947-1948. Les résistants du peuple occupé sont toujours considérés comme des "terroristes" par les classes politiques occidentales, lesquelles apportent un soutien quasi inconditionnel à Tel-Aviv. L'isolationnisme trumpiste ne concerne pas l'État hébreu.
Cet isolationnisme s'applique à plusieurs secteurs des relations internationales (le gel odieux de l'USAID, par exemple), mais Israël en est épargné. Pourrait-on qualifier les menaces de Trump dans le dossier du conflit russo-ukrainien de demi-abandon vis-à-vis de l'Ukraine ? On comprend la colère, l'amertume et l'inquiétude des Ukrainiens et Ukrainiennes par rapport aux États-Unis. Les Israéliens et Israéliennes, eux, n'ont pas à s'en faire.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Jean-François Delisle

Peut-on voyager encore ? | Livre à paraître le 26 février | Rodolphe Christin

Alors que plusieurs n'iront pas aux États-Unis pendant la semaine de relâche et cet été, Rodolphe Christin va plus loin : faut-il vraiment *partir *pour *être *en vacances ? Comment envisager le voyage dans un contexte de crise écologique et géopolitique ? Si la découverte de l'ailleurs peut encore avoir un sens, une nouvelle voie doit être tracée.
L'essai *Peut-on voyager encore ? - Réflexions pour se rapprocher du monde*, du sociologue Rodolphe Christin, paraîtra *en librairie le 26 février prochain.*
*À propos du livre*
Dégradant ce qu'elle prétend mettre en valeur, l'industrie touristique témoigne bien de l'ambiguïté de notre rapport au monde, entre manque et excès. En tant que production du capitalisme, elle impose sa logique partout où elle débarque, pesant ainsi sur l'aménagement du territoire, l'accès au logement et à l'eau, l'achalandage des routes et sentiers, le volume de déchets, le coût de la vie… Elle transforme l'ailleurs étranger en ici familier, l'exotisme en quotidien.
Dans un contexte de crises environnementales, géopolitiques et sociales, comment dès lors envisager le voyage, bien souvent réduit à une photo vite oubliée ? Notre responsabilité partagée de « sauver le monde » implique-t-elle de renoncer à sa rencontre ? Pourquoi valorise-t-on davantage le fait de *partir *en vacances plutôt que d'*être* en vacances ?
Que faire, ou plutôt, que vivre à la place du tourisme ?
Si l'on admet que la découverte de l'Autre et de l'ailleurs peut encore avoir un sens, une autre voie doit être tracée. C'est ce que propose Rodolphe Christin dans *Peut-on voyager encore ?*. Le sociologue, qui se fait ici philosophe, nous invite à penser les nouveaux chemins écosophiques à emprunter pour se rapprocher du monde, à commencer par celui de notre
quotidien. « Les voyages de demain seront des voyages de retour. », nous dit-il, avec l'ambition d'approcher ce qui est déjà proche, de parcourir, sentir et aimer des territoires que nous n'habitons peut-être pas complètement, après tout.
Ne faudrait-il pas en effet repenser notre rapport au travail et poser les bases d'une politique du temps libre radicalement renouvelée, plus soucieuse de nos milieux de vie ? En tant que rapport au monde à la fois poétique, pratique et écologique, l'écosophie, à défaut de nous promettre une croisière excitante en Antarctique pour assister à la fonte des derniers glaciers, pourrait bien nous offrir les clés d'une expérience personnelle et concrète de l'inconnu qui soit riche en émotions, en
sensations et en apprentissages, tout cela en harmonie avec le vivant.
*À propos de l'auteur*
Rodolphe Christin est sociologue et essayiste. Fréquemment sollicité sur les enjeux liés au tourisme et au voyage, il est l'auteur de *Le travail, et après ?* (avec Jean-Christophe Giuliani, Philippe Godard et Bernard Legros, 2017), *Manuel de l'antitourisme *(2017) et de* La** vraie vie est ici* (2020).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
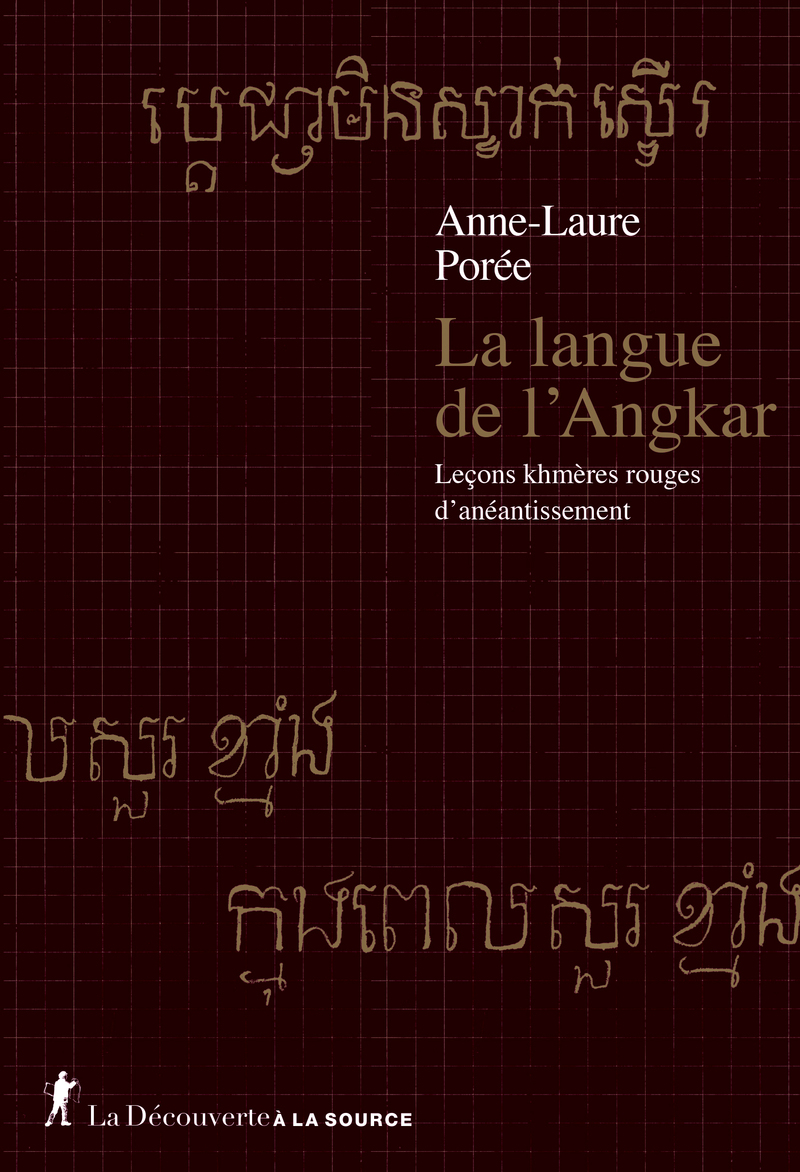
« La langue de l’Angkar », par Anne-Laure Porée, Éd. La Découverte, février 2025.
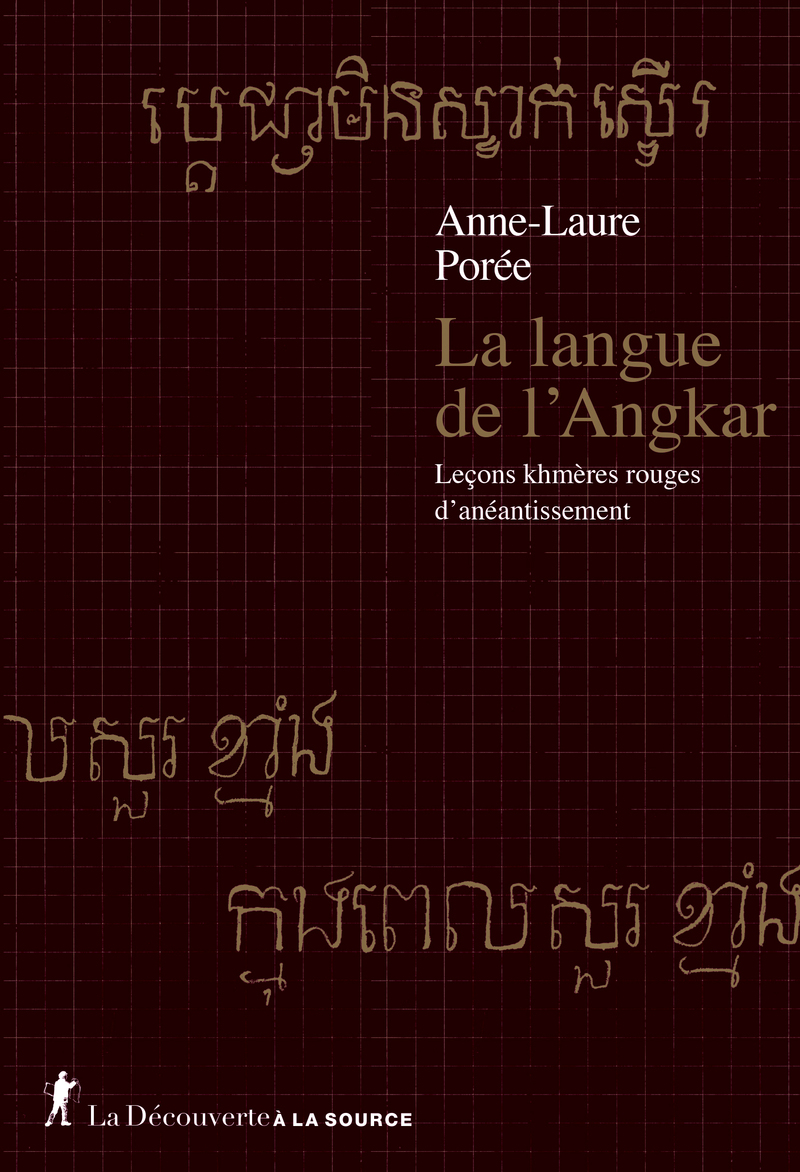
Information publiée le 18 février 2025 par Faculté des lettres - Université de Lausanne < marc.escola[a]unil.ch >sur le site internet « Fabula – La Recherche en littérature« < www.fabula.org/actualites/125808/anne-laure-poree-la-langue-de-l-angkar.html <http://www.fabula.org/actualites/12...> >.
Comment bien torturer pour réussir un interrogatoire en bon révolutionnaire ? Comment présenter un dossier d'aveux qui satisfasse les dirigeants ? Voilà ce qu'enseigne Duch, le chef khmer rouge du centre de mise à mort S-21, aux interrogateurs qu'il forme de 1975 à 1978 à Phnom Penh. Ses leçons, qui dictent comment penser et agir au service du Parti communiste du Kampuchéa, ont été consignées avec soin dans un cahier noir à petits carreaux d'une cinquantaine de pages.
Anne-Laure Porée décrypte ce document capital, plongeant le lecteur dans le quotidien des génocidaires cambodgiens. Elle identifie trois mots d'ordre au service de l'anéantissement :/cultiver /– la volonté révolutionnaire, l'esprit guerrier et la chasse aux " ennemis " –, /trier /– les " ennemis " à travers diverses méthodes, de la rédaction d'une biographie sommaire à la torture physique, en passant par la réécriture de l'histoire – et /purifier /– les révolutionnaires comme le corps social.
Ces notions reflètent la politique meurtrière orchestrée par le régime de Pol Pot, au pouvoir à partir du 17 avril 1975, qui, en moins de quatre ans, a conduit un quart de la population cambodgienne à la mort. En prenant les Khmers rouges au(x) mot(s),/La Langue de l'Angkar/rend plus sensibles la logique organisatrice et les singularités d'un régime longtemps resté en marge des études sur les génocides.
L'auteure*Anne-Laure Porée* a vécu quinze ans au Cambodge. En tant que journaliste, elle a notamment suivi le procès de Duch pour crimes contre l'humanité en 2009, qui a fait l'objet d'un blog ( www.proceskhmers-rouges.net <http://www.proceskhmers-rouges.net> ). Quelques années plus tard, S-21 est devenu le sujet de sa thèse en anthropologie, soutenue à l'EHESS en 2023.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan : sur les ruines du pays, des solidarités en lutte

La nouvelle brochure « Sudfa Media » 2025 sort aujourd'hui. On y parle de résistances locales, de solidarité internationale, de pillage des ressources naturelles, des luttes féministes, de patrimoine mémoriel, mais aussi de nourriture, de rap et de foot... Voici l'éditorial et comment se la procurer.
Tiré du blogue de l'auteur.
Depuis trois ans maintenant, "Sudfa Media" ce n'est pas qu'un blog Mediapart et un site internet, mais aussi une brochure imprimée, éditée une fois par an. Nous en sommes au quatrième numéro pour ce début d'année 2025, qui est consacré à la guerre mais aussi aux résistances locales et internationales contre la guerre.
La brochure comprend des contenus variés pour toucher tous les publics :
– Des explications pédagogiques pour comprendre la guerre au Soudan et les enjeux internationaux
– Des articles sur les résistances soudanaises sur le terrain et en exil
– Des cartes
– Des frises chronologiques
– Des portraits d'initiatives de solidarité
– Des traductions de textes et de chansons...
Elle est disponible à prix libre. Pour l'obtenir, il faut faire un don en ligne à notre association en cliquant sur ce lien. Nous vous l'enverrons ensuite par mail au format pdf !
Nous la proposons sur différents événements de solidarité avec le Soudan que nous organisons ou bien où nous sommes invités. Mais nous avons également besoin de votre aide pour la diffuser : si vous connaissez une librairie, un infokiosque, un bar-restaurant, un lieu associatif où vous pourriez proposer la brochure, ou si vous voulez la diffuser lors d'un événement de soutien au Soudan ou d'un évènement internationaliste, contactez-nous par mail à : sudfamedia@gmail.com.
Pour vous donner un petit aperçu du contenu, voici l'éditorial
"Chèr·es lecteur·ices de Sudfa,
Alors que la guerre au Soudan entre dans sa deuxième année, le pays traverse une période marquée par des bouleversements majeurs ainsi que des désastres humains et matériels sans précédent. On dit souvent que c'est une “guerre oubliée”, oubliée des médias, des gouvernements, de la communauté internationale. Et si cette guerre était ignorée intentionnellement, car elle sert de nombreux intérêts géopolitiques et économiques ? Si ce choix de l'oubli s'inscrivait aussi dans l'histoire coloniale globale ?
Ce conflit est une lutte pour le pouvoir entre deux hommes, le général Al-Burhan à la tête de l'armée et “Hemedti” à la tête des Forces de Soutien Rapides (RSF). Mais cette guerre est aussi un moyen pour différentes puissances étrangères de contrôler les ressources et d'installer leur domination dans ce pays stratégique (voir pages 2-3). Le Soudan est ainsi transformé en un théâtre d'affrontements géopolitiques où s'opposent différents intérêts impérialistes, provoquant plus d'une centaine de milliers de morts et des millions de déplacé·es. La guerre a un impact particulier sur les femmes, qui dénoncent le fait que leurs corps sont instrumentalisés comme des armes de guerre (p. 4). En détruisant le patrimoine culturel, les milices s'attaquent à la mémoire du pays (p.
5), ainsi qu'aux organisations sociales et aux liens relationnels.
Les affrontements entre l'armée soudanaise et les RSF, une milice autrefois alliée à l'armée, ont pour objectif de mettre un terme à la révolution démocratique qui avait mis fin au régime dictatorial d'Omar El-Béshir en 2018. Le pays voit sa population privée des droits les plus fondamentaux, tandis que les rêves des révolutionnaires s'effacent dans un sentiment général d'impuissance et de désespoir. La société civile soudanaise, auparavant unie dans la révolution, se retrouve divisée en plusieurs camps (p. 6-7).
Pourtant l'esprit de la révolution reste vivant au Soudan. On le retrouve à travers des initiatives locales, comme les “salles d'intervention d'urgence” et les cantines solidaires, qui s'auto-organisent pour atténuer les effets de la crise et prendre en charge les besoins essentiels (p. 8-9), ou dans des textes comme la “Charte révolutionnaire pour l'arrêt de la guerre” publiée par les comités de résistance (p. 10) ou encore à travers l'art en exil, notamment les chansons et le rap (p. 11). Ces initiatives témoignent que, même au milieu des ruines, la résistance continue de germer.
Les Soudanais·es de la diaspora continuent leur lutte par-delà les frontières pour soutenir les victimes de la guerre et pour construire une démocratie participative enracinée dans les réalités locales. Ils et elles rappellent que la situation au Soudan n'est pas isolée de celles en Palestine, au Liban, en Ukraine, en Syrie, en RDC et au Yémen, où les guerres impérialistes détruisent les communautés.
Ce quatrième numéro de la brochure de “Sudfa Media” vous propose ainsi de repenser la guerre au Soudan dans un contexte international. Les multiples interventions étrangères au Soudan nous invitent, nous aussi, à repenser la résistance dans une perspective transnationale. Et si, face au silence de ce qu'on appelle la “communauté internationale” (composée des États), les militant·es pour la justice et la paix formaient leur propre communauté internationale ? Une communauté de partage des savoirs politiques et pratiques, une communauté d'action, de solidarité et d'espoir (p. 12)...
Bonne lecture !"
L'équipe de Sudfa Media
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
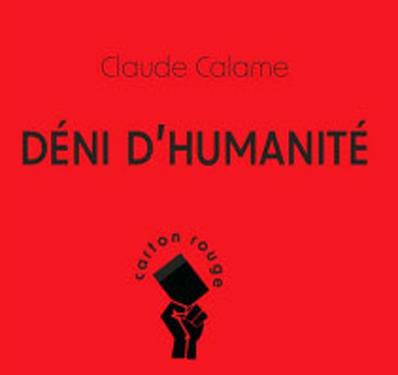
Déni d’humanité. Le rejet européen des personnes conduites à l’exil, de Claude Calame
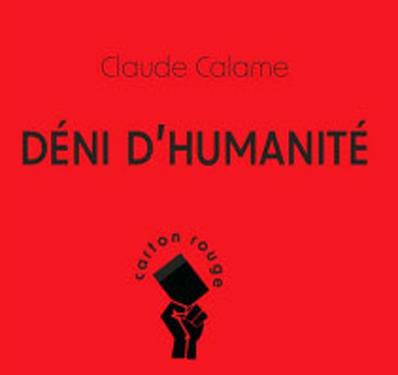
Ce petit livre est une excellente analyse critique de la politique européenne envers les réfugiéEs, qui est un véritable scandale éthique et politique. L'auteur est directeur d'études à l'EHESS (École des Hautes Études en sciences sociales) à Paris et militant écosocialiste.
15 février 2025 | tiré de Hebdo anticapitaliste | Éditions du Croquant, 2024, 62 pages.
https://lanticapitaliste.org/opinions/culture/deni-dhumanite-le-rejet-europeen-des-personnes-conduites-lexil-de-claude-calame
``
Comme le montre Claude Calame, les migrantEs sont pour la plupart victimes de guerres et de catastrophes sociales et environnementales pour lesquelles les puissances impérialistes et l'Europe en particulier sont largement responsables. On compte 108 millions de personnes déplacées en 2022, dont l'écrasante majorité se positionne à l'intérieur d'un même pays ou dans un pays (pauvre) limitrophe. Moins de 1 % de ces personnes contraintes au déplacement essayent d'arriver en Europe.
Politique inhumaine de fermeture des frontières
La politique européenne de fermeture des frontières est directement responsable de 50 000 morts environ depuis le début des années 2000, pour la plupart naufragéEs dans la Méditerranée. La police européenne des frontières, Frontex, joue un rôle déterminant dans la pratique de blocage et refoulement des migrantEs. Ce n'est pas un hasard si son ex-directeur, Fabrice Leggeri, a été élu député européen sur la liste du Rassemblement national lepéniste. Un des aspects les plus sinistres de cette orientation, ce sont les accords avec les garde-côtes libyens pour empêcher les migrantEs de partir, en les enfermant dans des camps où ils et elles sont soumis à des extorsions, des viols et des tortures. Il s'agit, constate Claude Calame, d'un véritable déni d'humanité.
Mesures répressives
Pour celleux qui arrivent, malgré tout, à atteindre les côtes de l'Europe, on a préparé un arsenal de mesures répressives, dans une logique de contrôle, de harcèlement et de bannissement, qui inclut aussi la criminalisation des aides et donc le « délit de solidarité ». Les divers gouvernements français se sont illustrés avec leurs mesures légales antimigrantEs, dont la loi Darmanin est tristement un bon exemple.
Cet ensemble de pratiques constitue, selon Claude Calame qui cite les travaux de divers juristes, un crime contre l'humanité. Heureusement des militantEs de la solidarité tentent de résister, en sauvant les migrantEs naufragéEs (SOS Méditerranée) ou en assurant leur accueil une fois arrivéEs en France ou Europe. Il s'agit, signale l'auteur, de partager avec elles et eux notre commune humanité. Mais en dernière analyse, seule la rupture écosocialiste avec le système dominé par le néolibéralisme autoritaire auquel nous sommes confrontéEs peut renverser la situation.
Michael Löwy

Zones sacrifiées

Il existe, en chacun de nous, une part fragile et essentielle qui ne peut être déposée sur d'autres épaules ou en d'autres cœurs. C'est cette partie-là de nous, cette part « indélégable », qui rend le soulèvement de chacun·e unique et irremplaçable. « Personne, écrit Thoreau, ne peut être moi à ma place ». C'est à partir de cette vérité que nous agissons. À partir de là que nous dénonçons et que nous désobéissons. C'est aussi à partir de ce je unique et singulier que nous aimons.
Ce livre est né d'une impulsion collective, militante, citoyenne initiée par la marche du 13 octobre 2024, à Rouyn-Noranda. Il prend sa source dans tous nos moi indélégables : dans le sentiment profond de devoir agir pour les autres, au nom de la dignité humaine. Il met de l'avant la colère, l'espérance et l'indignation en un collage de photos, de témoignages et de textes citoyens dans leur état brut.
Anaïs Barbeau-Lavalette, Véronique Côté et Steve Gagnon, père/mères au front et auteurices, ont répondu, à l'instar de Laure Waridel et Eve Landry, à l'appel des Mères au front de Rouyn-Noranda. Ces dernières, lasses de crier dans le désert face au gouvernement et au géant Glencore, ont demandé du renfort. Iels ont souhaité, avec deux citoyennes et militantes de Rouyn-Noranda, Isabelle Fortin-Rondeau et Jennifer Ricard Turcotte, témoigner de ce qu'ils ont vécu le 13 octobre 2024 et plus largement, du drame de la qualité de l'air qui se joue encore aujourd'hui à Rouyn-Noranda.
Zones sacrifiées, Éditions du Quartz, 2025, 128 p.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les travailleurs d’un refuge dénoncent la Commission du travail

Trump et les néonazis de Tel-Aviv

On le savait raciste, suprémaciste, génocidaire, voilà que depuis sa dernière visite à Washington, où il a rencontré Donald Trump l'impérialiste qui ne cache pas sa volonté de conquérir les pays voisins des Etats-Unis, le Canada, le Mexique, Panama, son canal et même le froid Groenland, le Premier ministre sioniste, Benyamin Netanyahu, vient de dévoiler sa nature néo-nazie, arabophobe et islamophobe. Il s'est dit « prêt à finir le travail entrepris au lendemain du 7 octobre » à Ghaza, en Cisjordanie et dans le reste du Proche-Orient.
Tiré d'El Watan.
Encouragé par les propos irresponsables du Président américain, franchement impérialistes et néocoloniaux, le Premier ministre de l'entité sioniste reprend à son compte l'expression favorite de tous les Néo-Nazis d'Europe et d'ailleurs, regrettant que la « solution finale », c'est-à-dire l'extermination de tous les juifs du Vieux Continent, pensée par Adolf Hitler et tous les Nazis, n'a pas été menée à son terme.
A savoir la poursuite de l'ethnocide des juifs d'Europe jusqu'au bout, un rêve que caressent beaucoup de groupuscules et de leaders d'extrême droite européenne qui vont jusqu'à arborer les croix gammées et croix de fer des « Waffen SS » hitlériennes sur leurs poitrines et à adopter le salut nazi dans leurs meetings où ils jurent de « casser de l'Arabe et du musulman ».
Telle est la vraie nature, aujourd'hui en 2025, de ces descendants de déportés de survivants des camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale, d'Auschwitz et d'ailleurs, transformés en génocidaires, en ordonnateurs du nettoyage ethnique des Palestiniens de Ghaza et de Cisjordanie.
A vrai dire, Netanyahu et les suprémacistes racistes de son gouvernement sont les indignes continuateurs de l'entreprise d'extermination des populations arabes de Palestine, pensée et exécutée par les fondateurs de l'entité sioniste que furent Ben Gourion, Golda Meir et autre Shimon Pérès à partir de 1947. Une déportation des Palestiniens, accompagnée d'une dépossession de leurs terres ancestrales menée par les groupes terroristes sionistes de l'Irgoun, de la Haganah, du Stern…
Des villes comme Jaffa, Haifa ou Tibériade furent vidées, par la force des armes, de leurs populations arabes et annexées au territoire attribué aux juifs par le plan de partage de la Palestine décidé par l'Organisation des Nations unies. Entre 900 000 et un million de Palestiniens prirent ainsi les chemins de l'exil, abandonnant les terres de leurs ancêtres à jamais. Une tragédie qui allait marquer la conscience collective du peuple palestinien comme une grande catastrophe, la « Naqba ».
Tout au long de ces 77 dernières années, la politique expansionniste sioniste d'Israël a pris prétexte des guerres avec les pays arabes voisins pour étendre sa domination, par l'annexion de nouveaux territoires comme le Golan syrien et l'implantation de colonies en Cisjordanie conquises sur les terres palestiniennes où se sont installés près d'un million de colons juifs en moins de trente ans.
Tant et si bien que ces annexions territoriales ont permis l'expansion d'Israël de plusieurs milliers de kilomètres, rendant impossible la viabilité du territoire palestinien en Cisjordanie du fait même de l'implantation de colonies sionistes, accompagnée d'une politique ségrégationniste à l'égard des populations arabes palestiniennes, y compris à Jérusalem-Est.
Ainsi, un véritable Etat d'apartheid s'est mis en place depuis ces trente dernières années. Apartheid sioniste dénoncé par les organisations internationales des Nations unies et les différentes ONG humanitaires qui ont déploré les violations du droit international, à travers la poursuite du nettoyage ethnique sioniste vis-à-vis des populations arabes de Palestine.
La guerre génocidaire ordonnée par Benyamin Netanyahu et les suprémacistes racistes de son gouvernement au lendemain du 7 octobre 2023 contre les Palestiniens de Ghaza et de Cisjordanie vient d'être confortée par les propos de l'impérialiste Donald Trump qui préconise de vider Ghaza de sa population et de la transférer vers d'autres pays voisins, sans droit de retour.
Une proposition ignoble, émanant du chef de la première puissance mondiale que les sionistes israéliens ont toujours rêvé à sa concrétisation depuis plus de 77 ans. Rien de moins que la poursuite du nettoyage ethnique, mené « au pas de charge », sous le scandaleux prétexte de faire de Ghaza la riviera du Proche-Orient. Proposition applaudie à tout va par les génocidaires sionistes, il va de soi.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












