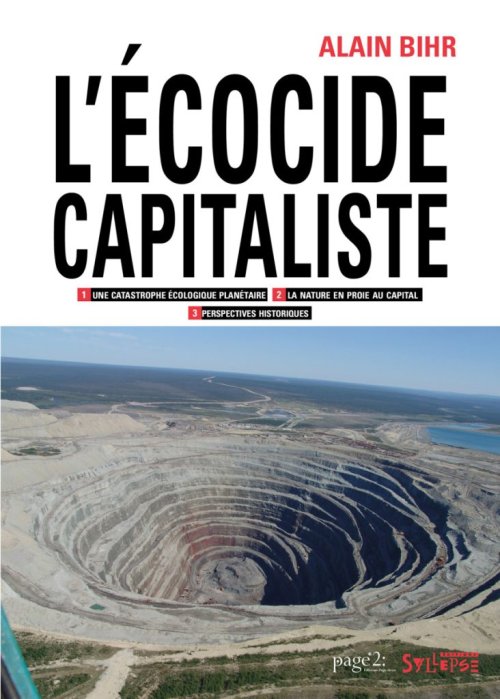Derniers articles
Piraterie dans les Caraïbes : défi au droit international après la saisie de plus d’un million de barils de pétrole

Retour d’Amazon au Québec ?

Dans l'édition du 2 décembre, le journaliste de La Presse Alain McKenna soulevait la question à savoir si l'IA pourrait ramener Amazon au Québec, plus précisément Amazon Web Services (AWS), sa plateforme infonuagique. Il y a de fortes raisons de souhaiter que non.
Comme il est désormais amplement documenté, y compris de façon rigoureuse par la journaliste d'enquête Karen Hao dans son livre Empire of AI publié plus tôt cette année, les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle (IA) et qui se multiplient partout sur la planète sont un scandale environnemental, social et humain.
L'essor des centres de données est basé sur la théorie de la mise à l'échelle (ou scaling, en anglais) selon laquelle l'augmentation exponentielle de la quantité de données, des paramètres et des ressources informatiques qui alimentent l'IA mènerait automatiquement à l'intelligence artificielle générale, une forme d'intelligence artificielle comparable ou supérieure à l'intelligence humaine. Cette théorie est désormais largement réfutée car il a été démontré qu'une augmentation d'ordre quantitatif ne résout pas les limites inhérentes aux modèles et qui causent leurs « hallucinations ». Bien que discréditée, cette théorie de la mise à l'échelle continue de nourrir l'essor des centres de données partout dans le monde.
Et pourtant, ces centres de données représentent un scandale. Environnemental, d'abord, puisqu'ils consomment une quantité faramineuse d'eau potable et d'électricité. L'électricité sert à la fois à alimenter les centres de données et à refroidir les serveurs. L'eau, qui sert également aux systèmes de refroidissement, doit de plus être potable afin de ne pas entraîner la corrosion et la contamination des équipements. C'est sans compter leur coût social et humain car les équipements des centres de données stimulent la demande pour les minéraux et métaux rares dont l'extraction est étroitement liée aux conflits dans des pays comme le Congo.
L'ironie est que l'IA – principalement l'IA générative, beaucoup plus énergivore - prétend être une solution aux perturbations du climat alors qu'elle est en passe de devenir l'un de ses principaux contributeurs. D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation d'électricité des centres de données représentera 3% de la demande mondiale. Des chercheurs de l'Université de Californie évaluent que l'IA consommera entre 1,1 et 1,7 billion de gallons d'eau douce annuellement d'ici 2027, soit la moitié de l'eau consommée annuellement au Royaume-Uni.
Malgré ses promesses d'apporter une solution à tous nos problèmes – que ce soient les dérèglements du climat, les maladies ou la faim – l'IA n'aura servi à date qu'à enrichir une poignée de startups, de fabricants de micropuces et d'investisseurs en capital-risque. Les analystes financiers sont de plus en plus nombreux à sonner l'alarme sur le fait que l'IA est une bulle spéculative vouée à éclater tôt ou tard, avec des répercussions économiques difficiles à évaluer mais sans aucun doute douloureuses.
Cet article, pour lequel AWS a défrayé les frais d'hébergement et de transport du journaliste – semble préparer l'opinion publique pour un accord à venir entre le gouvernement du Québec et AWS. Mais la société québécoise veut-elle vraiment brader ses ressources naturelles au nom d'une élusive souveraineté numérique ?
Pour toutes les raisons évoquées ici, il reste à espérer que les Québécois.es. se mobiliseront, comme ils l'ont fait pour dénoncer les pratiques antisyndicales d'Amazon, afin d'empêcher la construction de nouveaux centres de données par les géants de l'IA, que ce soit AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.
Illustration : panumas nikhomkhai (pexels).
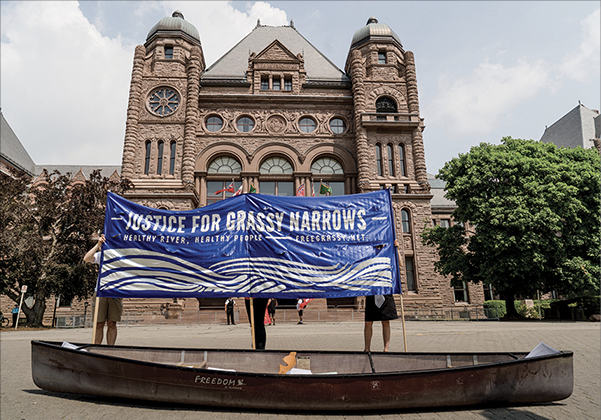
Six décennies de science et de luttes
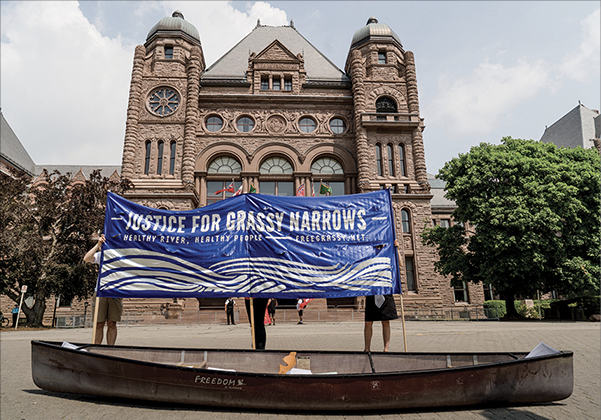
Née de parents anglophones progressistes à l'époque duplessiste, Donna Mergler est une scientifique et militante dont l'engagement a commencé dans les années soixante, durant la Révolution Tranquille. Le magazine Science for the People l'a interrogée sur son parcours dans une version anglaise de cette entrevue qui est disponible sur le site Web https://scienceforthepeople.org. Nous les remercions pour cette collaboration qui nous permet de publier ce texte en français. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee.
Diplômée de l'université McGill, elle a commencé sa carrière d'universitaire à l'UQAM dès 1970, faisant partie du premier corps enseignant de cette université et seule femme professeure durant six ans au département des sciences biologiques. Tout en assumant ses tâches de professeure et de chercheure, elle a très tôt collaboré avec des syndicats et des groupes communautaires. Ce faisant, elle est devenue une pionnière de l'approche multidisciplinaire écosystémique de la santé humaine, laquelle intègre le leadership communautaire, les droits des travailleurs et des travailleuses, l'égalité des sexes et l'équité sociale. Elle est mondialement reconnue pour son expertise sur les effets neurotoxiques des polluants environnementaux.
Aujourd'hui, 18 ans après avoir pris officiellement sa retraite, elle poursuit son engagement où s'allient la science et la justice sociale. Depuis plusieurs années, elle travaille en collaboration avec la Première Nation de Grassy Narrows pour documenter les impacts générationnels de l'empoisonnement au mercure industriel sur leur santé et leur bien-être afin d'appuyer leurs revendications.
Jennifer Laura Lee : À quoi ressemblait la vie d'une scientifique et d'une militante à McGill dans les années 1960 ?
Donna Mergler : Deux choses se sont produites en parallèle. J'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en 1965 et j'ai commencé mes études supérieures en neurophysiologie. J'ai étudié le réflexe vestibulo-oculaire en plaçant des électrodes dans le cerveau de chats pour en savoir plus sur l'influx neuronal en rapport avec les mouvements oscillatoires. J'utilisais l'un des premiers ordinateurs analogiques mis au point par un brillant technicien.
Mes activités politiques et mes activités universitaires étaient complètement séparées. Dans la journée, je montais la colline jusqu'au Centre des sciences médicales de McGill pour étudier et pour mener mes recherches. Puis, le soir, j'apprenais à connaître le Québec, son histoire, sa culture. J'écoutais les chansonnier·ères québécois·es chanter leur pays et ses luttes. Je discutais de justice et d'égalité avec des ami·es du mouvement indépendantiste québécois. Je savourais cette période de bouillonnement social, politique et culturel. Plus j'apprenais, plus j'épousais le mouvement indépendantiste et participais aux fréquentes manifestations, dont McGill français, qui a eu lieu en 1968, où l'on demandait que McGill donne des cours en français.
J. L. : En tant qu'anglophone éduquée dans le système scolaire anglais, comment vous êtes-vous retrouvée impliquée dans la lutte pour l'indépendance du Québec ?
D. M. : J'ai grandi dans un environnement très stimulant. Mon père était un avocat progressiste. Il représentait des personnes arrêtées pour leurs activités politiques ou syndicales. Il avait des contacts avec des révolutionnaires du monde entier. Il accueillait fréquemment des personnes intéressantes à la maison et nous nous asseyions autour de la table à manger pour des échanges stimulants. Très jeune, j'ai passé des heures assise sur les marches du Palais de justice où mon père défendait Madeleine Parent, une grande syndicaliste. Mes parents voulaient m'envoyer dans une école française, mais à l'époque, il fallait être catholique pour fréquenter les écoles publiques francophones.
Comme les autres étudiants et étudiantes progressistes à l'Université McGill dans les années soixante, j'étais au courant de plusieurs mouvements de libération dans le monde – je suis même allée à Cuba en 1962. C'était aussi le début de la Révolution tranquille. En 1966, j'ai décidé de traverser le boulevard Saint-Laurent qui séparait le Montréal anglais du Montréal français.
Je me suis rendue sur la rue Beaudry où se trouvait le siège du Parti socialiste du Québec et de la Jeunesse socialiste du Québec. J'ai découvert une société en effervescence, en mouvement, culturellement, syndicalement, politiquement. En fait, je suis tombée amoureuse de cette société. Je me suis sentie en harmonie avec ce qui se passait. C'était les années 1960 ! Il y avait la réforme de l'éducation, la réforme du système de santé, le mouvement syndical qui devenait de plus en plus progressiste. C'était ma place.
J. L. : L'UQAM est un produit direct de la lutte pour la démocratisation de l'éducation pendant la Révolution tranquille. Comment était-ce au tout début ?
D. M. : L'UQAM était intéressante parce qu'il s'agissait d'une nouvelle université, issue de la réforme de l'éducation. En 1970, le département des sciences biologiques m'a embauchée. Nous étions tous jeunes et nous ne voulions pas reproduire ce que nous avions connu dans d'autres universités. Notre département a décidé de se spécialiser en environnement. Avec les collègues des autres départements, nous avons formé un syndicat et nous nous sommes affilié·es à la CSN. Au lieu d'une structure verticale comme dans les autres universités, nous avons créé une structure démocratique et horizontale. Cela a pris beaucoup de temps et de réunions, mais nous avons estimé que cela en valait la peine.
J. L. : Comment avez-vous commencé à faire de la science en collaboration avec les travailleurs syndiqués des mines ?
D. M. : En 1975, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a travaillé avec le Dr Irving Selikoff de l'hôpital Mount Sinai à New York, qui faisait une étude portant sur l'état de santé des mineurs d'amiante du Québec. Un jour, lors d'une soirée chez une amie, l'un des permanents de la CSN m'a dit : « Nous avons le rapport [de Selikoff] et nous ne savons pas quoi en faire ». J'ai répondu : « Je suis physiologiste, je peux le lire et peut-être l'expliquer aux travailleurs. »
Je me suis documentée sur les effets de l'amiante sur la santé et sur l'histoire de la compagnie Johns Mansville. J'ai appris que l'entreprise savait depuis les années trente que l'amiante augmentait le risque de cancer. J'ai commencé à participer à des ateliers de formation organisés par le syndicat et portant sur les effets de l'amiante sur leur santé. C'était à l'époque de la grève des mineurs.
Parallèlement, à l'UQAM, nous avons créé le Service aux collectivités, une forme unique de collaboration avec des groupes non traditionnellement desservis par les universités, en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres. Avec l'appui de ce service, des projets de formation et de recherche sont conçus dans une perspective de promotion collective. Le premier accord a été conclu avec deux grands syndicats québécois, la Fédération du travail du Québec (FTQ) et la CSN. Pendant des années, j'ai participé à de nombreuses sessions de formation organisées par les syndicats sur la santé et la sécurité au travail et mené des projets de recherche.
J. L. : Pouvez-vous nous parler de votre travail avec les ouvriers syndiqués ?
D. M. : Je me souviens d'un cas en particulier où j'animais un atelier avec des travailleurs exposés aux solvants dans une usine de fabrication de bâtons de hockey près de Drummondville. Le groupe de travailleurs était attentif, mais dès que je commençais à écrire au tableau, je les perdais complètement. Ils commençaient à plaisanter. Je n'avais pas observé cela dans d'autres industries. Nous avons commencé à parler des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Ils racontaient tous la même histoire : ils arrivaient le matin, posaient leur boîte à lunch et ne se souvenaient plus où ils l'avaient mise à midi.
J'ai donc visité l'usine. Il m'a fallu environ cinq minutes pour me sentir gelée, rien qu'en respirant du styrène, du toluène, du n-hexane… Ensuite, j'ai eu mal à la tête, mais je m'en fichais, parce que j'étais gelée !
Vous imaginez comment cela a pu attirer mon attention : une neurophysiologiste confrontée à un problème neurophysiologique. J'avais la possibilité de combiner mes intérêts académiques et mon désir d'aider à améliorer la santé des travailleurs par des changements sur le lieu de travail… d'agir avant que les travailleurs ne soient trop malades pour travailler.
À cette époque, l'importance de la neurotoxicité précoce était relativement nouvelle et n'était pas considérée valide par les scientifiques traditionnels. Une fois, lors d'une réunion avec les représentants des syndicats et de l'entreprise d'une usine d'explosifs concernant une possible étude, une épidémiologiste réputée, engagée par l'entreprise, nous a dit que l'étude que nous proposions avec les travailleurs était irresponsable. Elle nous a dit que nous devrions plutôt étudier les maladies des travailleurs retraités. Un jeune travailleur est intervenu en disant : « Mais nous voulons savoir ce qui nous arrive maintenant afin de pouvoir améliorer notre situation. » Les dirigeants de l'usine ont refusé de participer et nous avons poursuivi en faisant passer aux travailleurs des examens dans un motel situé en face de l'usine.
Pendant cette période, ma collègue Karen Messing et moi-même avons créé un petit groupe de recherche, qui est ensuite devenu le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Notre approche était basée sur l'intégration des connaissances des travailleur·euses. Nous écoutions et nous traduisons leurs préoccupations en études scientifiques rigoureuses.
Entre 1993 et 2010, j'ai participé à un effort interdisciplinaire et interuniversitaire visant à comprendre les sources de mercure dans l'Amazonie brésilienne, sa transmission dans l'environnement, ses effets sur la santé et ainsi que le contexte sociopolitique prévalent. Nous avons utilisé une approche participative avec les communautés vivant le long de la rivière Tapajós, avec pour buts de maximiser les bénéfices pour la santé et de minimiser les risques de l'exposition au mercure. Mes collègues biogéochimistes ont montré qu'en plus des rejets de mercure provenant des mines d'or, la déforestation généralisée libérait du mercure naturel dans les milieux aquatiques, et donc dans la chaîne alimentaire.
J. L. : Comment vous êtes-vous impliquée dans le projet avec la Première Nation de Grassy Narrows, dans le nord de l'Ontario ?
D. M. : En 2016, Judy da Silva, qui se dévoue corps et âme pour une justice environnementale à Grassy Narrows, m'a invitée à participer à une enquête d'évaluation de la santé, réclamée par la communauté depuis de nombreuses années. Entre 1962 et 1975, environ 9000 kilogrammes de mercure ont été déversés par une usine de pâte à papier dans le système fluvial qui alimente les eaux territoriales de Grassy Narrows. Le doré, un grand poisson prédateur, était au centre de leur culture, de leurs traditions, de leur gagne-pain et de leur régime alimentaire. La contamination de la population s'est faite à travers sa consommation. Depuis les 50 dernières années, Grassy Narrows se bat pour faire reconnaître leur empoisonnement au mercure.
Les résultats de notre enquête ont montré que les habitant·es de Grassy Narrows étaient en moins bonne santé par rapport aux autres Premières Nations. Notre étude a permis de mettre en évidence le rôle du mercure quant à la mortalité précoce (moins de 60 ans), à la fréquence de symptômes de dysfonctionnement du système nerveux et au risque accru de suicide chez les jeunes. Ces travaux apportent un soutien scientifique à leurs demandes.
Soulignons que lorsque nous avons commencé à faire de la recherche participative, celle-ci n'était pas considérée comme scientifique et objective. Aujourd'hui, elle est de plus en plus répandue et reconnue par la plupart des organismes de subvention de la recherche.
J. L. : Que pensez-vous que l'avenir nous réserve ? Êtes-vous optimiste ?
D. M. : Nous traversons une période sombre, marquée par l'individualisme, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, et des guerres de plus en plus nombreuses aux quatre coins de la planète. Par contre, il y a une opposition grandissante aux injustices. De nouveaux mouvements alliant justice sociale et environnementale sont en train d'émerger. Il en va de même pour le mouvement grandissant en faveur de la souveraineté des peuples autochtones partout au Canada. C'est là que se livrent les principales batailles qui, espérons-le, seront un jour remportées.
Jennifer Laura Lee est post-doctorante à l'université TELUQ, où elle étudie la santé environnementale et la neurotoxicologie. Elle est membre active de Science for the People.
Photo : Leadnow Canada (CC BY-SA 2.0)

Les idoles (il)légitimes

Ériger des individus en icônes intemporelles éclipse la dimension intrinsèquement collective des luttes pour la justice sociale. De plus, celles et ceux sur lesquel·les la société jette son dévolu entrent souvent dans les barèmes de la respectabilité.
Comme beaucoup d'autres avant elle, Claudette Colvin fait partie de celles qui ont été consciemment effacées de l'Histoire. Sa contribution pionnière à la lutte pour les droits civiques des Noir·es aux États-Unis commence tout juste à être reconnue à sa juste valeur.
Née le 5 septembre 1939 à Montgomery dans l'Alabama, aujourd'hui âgée de 84 ans, Claudette Colvin a laissé sa marque lorsqu'elle a refusé de céder son siège à une femme blanche dans un autobus bondé le 2 mars 1955. Un refus qui fut insufflé par la force et le récit de femmes afro-américaines comme Harriet Tubman et Sojourner Truth dont elle avait pris connaissance lors de ses implications militantes et à l'école. Le geste de protestation de Colvin a eu lieu neuf mois avant celui de Rosa Parks, aujourd'hui considérée comme « la mère du mouvement pour les droits civiques ». Parks et Colvin étaient alors toutes deux impliquées au sein de La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Colvin fut arrêtée, menottée et extirpée de force de l'autobus. Tout au long de cet épisode, les policiers la menacent de viol et formulent des commentaires dégradants à connotation sexuelle à son endroit, un scénario qui était malheureusement monnaie courante pour de nombreuses Afro-Américaines. Colvin reçut plusieurs chefs d'accusation en cour de justice pour avoir tenu tête aux politiques de ségrégation raciale issues des lois Jim Crow.
La NAACP organise alors la stratégie de défense de Claudette Colvin considérant le précédent qu'un jugement dans cette affaire pourrait créer pour l'ensemble de la population afro-américaine. Or, le leadership masculin et noir de la NAACP apprend que Colvin, qui est célibataire, est enceinte [1] d'un homme plus âgé et qui plus est, marié. Donner naissance à un enfant illégitime est un tabou immense à cette époque, et ce, pour l'ensemble de la société américaine. Colvin est aussi reconnue pour ses émotions vives et sa parole franche qui était tout sauf docile. Jugée « trop noire » en raison de la carnation foncée de sa peau, l'adolescente refusait aussi de se lisser les cheveux. Claudette Colvin n'était pas une victime « idéale » ou « parfaite ». En raison de la crainte qu'elle – et, par ricochet, le mouvement en entier – ne soient discrédités tant par la justice que les médias, il sera décidé que la meilleure stratégie serait de présenter le cas de Rosa Parks comme emblème de leur combat. La résistance s'organise alors avec le leadership d'un certain pasteur nommé Martin Luther King. Une vague de protestation et un mouvement de boycottage s'étendent alors dans la ville de Montgomery. Elle durera un peu plus d'un an. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que les lois ségrégationnistes violent la constitution américaine. La tentative d'appel de l'État de l'Alabama fut refusée par le plus haut tribunal du pays et la décision eut force de loi le 20 décembre de la même année.
La « Rosa Parks du Canada » ?
Les gestes de protestation de Colvin et Parks font écho à une résistance similaire au Canada, celle de la femme d'affaires Viola Desmond dans un cinéma de New Glasgow duquel elle fut brutalement expulsée après avoir refusé de subir une discrimination raciste de la part du personnel qui lui a demandé de quitter la section d'une salle de cinéma réservée aux Blanc·hes. Elle fut ensuite emprisonnée pendant plusieurs heures et sommée de payer une amende. En avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offre un pardon public et absolu à Desmond, soit près de 45 ans après sa mort. En 2012, un timbre de Postes Canada à son effigie est lancé. En 2018, le visage de Viola Desmond est imprimé sur les billets de 10 $, ce qui a fait d'elle la première femme canadienne noire à figurer sur un billet de circulation courante de la Banque du Canada. Bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme la « Rosa Parks du Canada », Viola Desmond a pourtant refusé de céder son siège dans ce cinéma près d'une décennie avant sa consœur américaine. La tendance à mettre de l'avant des icônes noires étatsuniennes issues des luttes antiracistes n'a rien de nouveau. Cet américanocentrisme de notre mémoire collective donne l'illusion que le racisme anti-noir à l'américaine serait « pire » que celui de la France ou du Canada, une manière pour ces puissances coloniales de s'enorgueillir d'un multiculturalisme, d'une inclusion et d'un respect des droits de la personne de façade. Plus encore, cela participe à l'invisibilisation d'individus et de luttes collectives aux échelles locales, et ce, des deux côtés de l'Atlantique.
Au-delà des idoles respectables
En France, la polémique ayant eu cours à l'été 2023 autour du changement de nom du lycée « Angela-Davis », à Saint-Denis, jugée trop « radicale » par la femme politique Valérie Pécresse qui le rebaptisa « Lycée Rosa-Parks », jugée plus « consensuelle », est un autre exemple des enjeux politiques autour des icônes antiracistes. Rappelons d'ailleurs que l'afroféminisme a bel et bien son histoire en France, incarnée par des figures telles que Paulette et Jeanne Nardal qui ont fondé la Revue du Monde noir en 1931 ou encore Suzanne Césaire, totalement éclipsée par son illustre ex-conjoint. L'autrice et éditrice québécoise Valérie Lefebvre-Faucher fait aussi mention de ces dynamiques d'effacement et d'invisibilisation de nos héroïnes dans un micro-essai [2] portant sur les femmes ayant entouré, influencé et contribué à la construction et à la diffusion de la pensée du philosophe allemand Karl Marx. Même son de cloche pour le politologue québécois Francis Dupuis-Déri, qui a publié un bref ouvrage [3] coup-de-poing traitant de but en blanc du meurtre et féminicide de la sociologue française Hélène Legotien par le philosophe marxiste Louis Althusser le 16 novembre 1980. Elle aura été assassinée deux fois, physiquement et symboliquement. Tout cela, en raison de l'admiration que vouait une élite culturelle complaisante et soi-disant progressiste envers Althusser.
En somme, ce que l'on peut retenir des récits de femmes comme Claudette Colvin ou Viola Desmond, est que vient un jour, tôt ou tard, où la société finit par enfin accorder à ces femmes et filles noires, visionnaires et avant-gardistes, la reconnaissance qu'elles méritent. Si plusieurs de ces idoles (il)légitimes n'ont plus voix au chapitre en 2024 pour qu'on puisse leur témoigner directement notre gratitude, il importe de graver leurs noms dans nos livres d'Histoire, nos cœurs et nos mémoires.
[1] Claudette Colvin donna naissance à un fils, nommé Raymond, à l'âge de 17 ans, ce qui lui vaudra un renvoi de son école. De plus, en raison de la carnation claire de la peau de Raymond, Claudette fut accusée par sa communauté d'avoir conçu cet enfant avec un homme blanc. Colvin n'a jamais révélé l'identité de celui qu'elle considère comme un agresseur. Raymond décèdera, chez elle, à l'âge de 37 ans des suites de problèmes de toxicomanie.
[2] Lefebvre-Faucher, Valérie, Promenade sur Marx – Du côté des héroïnes, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2020, 80 pages.
[3] Dupuis-Déri, Francis, Althusser assassin – La banalité du mâle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2023, 96 pages.
Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

Les angles morts des pistes cyclables

À l'automne 2023, on a assisté à Montréal à un certain nombre de manifestations s'opposant à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, notamment dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension. Le mouvement procyclisme a-t-il des leçons à retenir de cette opposition ?
Il n'y a rien de nouveau à l'opposition aux pistes cyclables. Le cas récent du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis est un exemple parmi tant d'autres. En réaction à cette opposition, la communauté procycliste se fait entendre sur les réseaux sociaux et dans divers éditoriaux, qualifiant souvent cette opposition de rétrograde et de réactionnaire. Bien qu'il soit impératif et urgent de combattre la dépendance à la voiture, et même si certain·es militant·es anti-vélo sont effectivement réactionnaires, voire conspirationnistes [1], est-ce que l'opposition venant de citoyen·nes « ordinaires » pourrait révéler certains angles morts du militantisme procyclisme ?
Moins de voitures, mais rien pour les remplacer
Pour revenir aux exemples de Parc-Extension et de Saint-Michel, deux quartiers historiquement pauvres et racisés, l'argument prédominant des opposant·es aux pistes cyclables est la perte d'espaces de stationnement. De telles revendications peuvent paraître insignifiantes aux yeux des activistes procyclisme lorsqu'on considère qu'à l'échelle de la ville de Montréal, l'espace consacré aux vélos représente 1,3 %, contre 73,8 % pour la voiture [2]. Or, bien qu'il soit important d'inciter les gens à délaisser leur voiture aux profits d'autres moyens de transport, quelles autres options leur sont vraiment proposées ? Des manifestant·es dans Parc-Extension disent n'avoir d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail, en raison d'une longue distance à parcourir ou d'horaires de nuit. Les services de transport en commun étant largement réduits entre 1 h et 5 h, les travailleur·euses aux horaires atypiques se retrouvent avec peu d'alternatives à la voiture.
Rappelons qu'au même moment où les manifestations anti-pistes cyclables se déroulaient, le gouvernement de la CAQ jouait au bras de fer avec les différentes sociétés de transport du Grand Montréal, refusant d'augmenter leur financement pour couvrir leurs déficits, ce qui menace d'entraîner une diminution drastique de l'offre. Si on veut inciter les gens à délaisser leurs voitures, il est pourtant impératif d'offrir des solutions de rechange adéquates, qui répondent aux besoins des communautés touchées.
Le vélo, synonyme de gentrification ?
Également, le vélo en tant que moyen de transport est de plus en plus associé à la gentrification. Bien que les infrastructures cyclables en sont rarement la cause directe, elles peuvent en effet être le signe d'un embourgeoisement à venir ou en cours. À une certaine époque, le mouvement procyclisme était considéré comme radical et associé à la gauche, alors qu'aujourd'hui, le mouvement s'est intégré au discours environnementaliste néolibéral, largement dominé par la classe moyenne et blanche, et aux intérêts capitalistes. Ainsi, les projets d'aménagement cyclable font souvent partie d'un plus gros projet de réaménagement urbain (l'aménagement du nouveau campus de l'Université de Montréal dans Parc-Extension, par exemple) qui sert à plaire à la population aisée, blanche et valide et qui prépare le terrain pour l'établissement de commerces et de boutiques haut de gamme. De plus, considérant que deux fois plus de personnes blanches se déplacent à vélo que de personnes racisées [3], il n'est pas étonnant que ces dernières perçoivent le vélo comme une activité de Blanc·hes embourgeoisée, et donc qui pose un risque de gentrification dans leur quartier. Sans oublier que les quartiers racisés en Amérique du Nord ont historiquement reçu moins d'investissements en matière d'aménagement urbain et de services publics, ce qui augmente la méfiance de ces populations envers les projets d'urbanisme et leur sentiment de ne pas se faire entendre. Les résident·es d'un quartier comme Parc-Extension sont conscient·es que leur quartier est moins bien desservi que d'autres, et certains problèmes pressants (comme la collecte des poubelles) ne sont pas considérés. Cela explique la frustration de certain·es résident·es qui sentent qu'on leur impose des projets, tandis que leurs autres demandes sont ignorées.
Intégrer la communauté
Ce dernier point fait écho à une critique émise par de nombreux manifestant·es anti-pistes cyclables dans ces quartiers : l'absence de consultations publiques. L'aménagement de nouvelles pistes cyclables survient souvent sans que les communautés touchées soient consultées, ce qui revient à imposer un projet sans avoir l'approbation des personnes qui en vivront les conséquences dans leur vie de tous les jours. Ce fut effectivement le cas dans Parc-Extension, où les résident·es se sont réveillé·es un matin avec une note dans leur boîte aux lettres les informant de l'implantation de nouvelles pistes cyclables. S'il faut reconnaître l'urgence climatique et l'importance d'agir rapidement en matière de transport, une simple série de consultations publiques pour les gens du quartier aurait facilement rendu le projet plus digeste.
Aucun projet de réaménagement urbain ne fera jamais l'unanimité, mais des consultations publiques à l'étape de l'élaboration permettent aux gens d'un quartier donné de faire entendre leurs inquiétudes, de dresser un portrait plus exhaustif de la situation et de trouver des solutions aux problèmes bien réels et légitimes que ces projets causent pour les populations défavorisées. Il est crucial que les projets d'infrastructures cyclistes incluent en amont les citoyen·nes des quartiers touchés plutôt que de leur être imposés.
Pour une vision égalitaire du vélo
La prise de position présentée ici vient d'un fervent militant procyclisme, un « enverdeur » typique qui voyage à vélo 365 jours par année et qui n'a jamais eu de voiture. Ce serait un manque de gros bon sens de ne pas réitérer l'importance de se défaire de notre dépendance sociétale à la voiture, entre autres pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'équité sociale. Une récente étude menée par la firme Léger démontre que 39 % des Canadien·nes se disent peu enclins à acheter ou louer une voiture à l'avenir à cause du fort taux d'inflation actuel – cette même raison étant citée par 55 % des Canadien·nes disant vouloir délaisser leur voiture [4]. L'idée préconçue comme quoi la voiture serait le moyen de transport idéal pour la classe ouvrière (ou pour la classe moyenne) est donc de plus en plus discutable. Sans oublier qu'un segment de la communauté cycliste, souvent invisibilisé, utilise le vélo non pas par choix, mais par obligation : je veux ici parler de la communauté itinérante. Oubliée à la fois par le mouvement procyclisme et par les opposants aux pistes cyclables, la population cycliste itinérante a droit à des aménagements sécuritaires au même titre que n'importe quel·le usager·ère de la route et devrait, par conséquent, faire partie du débat.
En conclusion, le mouvement procyclisme gagnerait à inclure davantage les communautés pauvres et/ou racisées et à écouter ses opposant·es, plutôt que de balayer du revers de la main toutes critiques en les qualifiant automatiquement d'anti-progressistes. Le mouvement devrait retourner vers ses racines radicales, s'éloigner de sa forme édulcorée néolibérale qui ne contribue qu'à renforcer les inégalités sociales, et travailler en coalition pour produire une vision d'ensemble (de pair avec une offre bonifiée de services de transport en commun, par exemple) qui ne laisse personne derrière.
[1] C'est le cas, par exemple, du mouvement qui s'oppose à l'idée de « ville du quart d'heure » (« 15-minute city »), qui avance que ces types de projets d'urbanisme constituent une façon de limiter et de contrôler les déplacements des individus.
[2] « La nouvelle guerre culturelle », Ludvic Moquin-Beaudry, Pivot, 26 octobre 2023.
[3] « Is Canada's Commuter Bicycling Population Becoming More Representative of the General Population Over Time ? », Carly MacEacheron et al., Active Travel Studies, 29 mai 2023.
[4] « Canadians are less likely to own a vehicule due to high rate of inflation, report shows », Canadian Manufacturing, 4 avril 2023.
Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)
POUR ALLER PLUS LOIN
María Gabriela Aguzzi, « Pistes cyclables à Parc-Extension : le débat au-delà de la mobilité », La Converse, 22 novembre 2023. Disponible en ligne sur laconverse.com
Melody L. Hoffmann, Bike Lanes Are White Lanes. Bicycle Advocacy and Urban Planning, University of Nebraska Press, 2016.
Pourquoi et comment décentraliser ?
Une petite ville met en danger sa population en congédiant ses pompiers
Webinaire du Collectif du 19 mars : Gaza, de la faillite globale au devoir d’humanité !
« Une économie canadienne », moins 1000 métallos d’Algoma
Béton Provincial empêche ses ouvriers de travailler depuis un an
Retourner aux faits : une réponse à l’Alliance de l’énergie de l’Est
DOSSIER DÉCENTRALISATION : Enjeux municipaux 2025, Décentralisation et participation citoyenne

L’évolution des conflits de classe au Québec
Le collectif Temps Libre est un groupe de réflexion marxiste en activité à Montréal depuis 2017. Ses membres ont pour objectif de fournir à la fois des travaux de recherche et des propositions analytiques. Le dernier numéro de sa revue éponyme est paru à l’automne 2025 et s’intitule Portrait d’une société de classes : le Québec. Il se compose de quatre textes substantiels qui abordent successivement la recomposition néolibérale de l’économie, les classes sociales au Québec aujourd’hui, l’enjeu du colonialisme et, enfin, un panorama des luttes de classes au Québec dans les années 1970 et 1980.
C’est ce dernier texte, intitulé L’évolution des conflits de classe, que nous republions ci-dessous. Nous pensons qu’il présente avec justesse les luttes ouvrières des années 1970, le rôle central des organisations révolutionnaires à cette époque et les éléments structurels qui expliquent le ressac de la gauche dans les années 1980. Le texte se conclut sur l’hypothèse que les luttes concernant les conditions de vie des classes populaires risquent de dominer le XXIe siècle, tout en interrogeant le rôle que les révolutionnaires peuvent y jouer. Cette question demeure brûlante et nous espérons que de prochaines contributions tenteront d’y répondre à leur tour.
Photo en couverture : Manifestation pour la libération de Charles Gagnon. (BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Antoine Desilets, Grèves et manifestations, 1960-1980).

/ / /
On peut interpréter le cycle néolibéral comme une réponse à la crise structurelle des années 1970. Dans la mesure où cette réponse a sérieusement transformé la structure de classes de la société québécoise, il était en quelque sorte inévitable que le portrait brossé s’éloigne des derniers grands travaux marxistes entrepris sur les classes sociales au Québec. Or, le cycle d’accumulation introduit par la restructuration néolibérale a aussi pour corollaire le passage à un nouveau cycle de luttes. Au cours de cette restructuration, non seulement la division en classes de la société en sort bouleversée, mais il en va de même de la conflictualité entre les classes. Parler de la lutte des classes comme étant structurée par des cycles de luttes, c’est prendre acte du fait qu’elle s’inscrit nécessairement dans une configuration historiquement déterminée du mode de production capitaliste, laquelle définit ses possibilités et ses limites. Les outils pratiques permettant de résister à l’exploitation, les identités politiques mobilisées pour mener les luttes et, inversement, les moyens utilisés pour encadrer et réprimer celles-ci sont largement tributaires de ces configurations changeantes.
En ce qui concerne les pratiques de luttes, un véritable fossé sépare les modalités actuelles des conflits de classe et la situation précédant la restructuration néolibérale. Au tournant des années 1970, ce sont non seulement les comités populaires, les groupes révolutionnaires et féministes, mais également les organisations syndicales qui apparaissent comme les acteurs d’une dynamique de lutte en rupture avec le cadre revendicatif dans lequel la plupart des conflits étaient menés. Les revues ouvertement anticapitalistes, marxistes, anti-impérialistes et féministes révolutionnaires telles que Parti pris (1963-1968), Révolution Québécoise (1964-1965), Socialisme (1964-1974), Québécoises Debouttes ! (1971-1975), Les Têtes de pioche (1976-1979), Mobilisation (1972-1975), En Lutte ! (1972-1982) et Les Cahiers du socialisme (1978-1985) pullulent et marquent profondément le paysage politique québécois. Les thèses et analyses qui y sont défendues sont largement discutées, tandis que les appels à fonder un parti ouvrier révolutionnaire vont sans cesse croissant. Certains groupes influencés par les luttes de libération nationale sont alors convaincus que la lutte révolutionnaire armée est une tâche immédiate. C’est le cas du Front de libération du Québec (1963-1972) qui, après plusieurs années de sabotage et de cambriolage, enlève l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross et le ministre provincial du Travail Pierre Laporte, conduisant ainsi à la crise d’Octobre 1970. Deux ans plus tard, la mobilisation du Front commun de 1972 se transforme, à l’initiative de la base, en grève générale et s’étend à l’ensemble de la province. Aujourd’hui apparaissent bien loin les jours d’octobre 1970 où Michel Chartrand, président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CSN), pouvait discourir devant une foule de plusieurs milliers de personnes scandant leur appui au FLQ au moment même où le ministre du Travail était détenu en otage[1]. Comment cette conflictualité a-t-elle pu fléchir au point de faire paraître pour un révolutionnaire exalté quiconque formulerait aujourd’hui un lieu commun du syndicalisme de combat des années 1970 ?
Pour répondre à cette question, nous ne comptons pas présenter une histoire compréhensive des luttes passées, histoire à travers laquelle nous chercherions à identifier les bons coups, les erreurs et les trahisons des un·es et des autres. On pourrait par ailleurs s’étonner que notre focale ne soit pas toujours orientée vers les groupes et les courants ayant formulé les critiques les plus profondes ou ayant déployé les pratiques les plus radicales. Notre objectif n’est pas de trouver des modèles au sein des luttes passées ou encore de se découvrir une proximité idéologique avec des groupes dont on pourrait aujourd’hui calquer les activités. Il s’agit au contraire d’illustrer comment la base sur laquelle les luttes étaient menées a profondément changé, nous contraignant à repenser l’efficacité, la portée et l’actualité de certains moyens de lutte. C’est uniquement à partir de là qu’il sera possible d’envisager de façon lucide les développements potentiels des futurs conflits de classe. Pour ce faire, il est utile de commencer par l’étude de l’évolution des effectifs syndicaux, lesquels constituent un bon indicateur de la variation des formes de la conflictualité entre les classes.
1. L’évolution des effectifs syndicaux
On ne peut s’intéresser à cette question sans soulever le fait que le taux de syndicalisation est demeuré, au Québec, significativement plus élevé que dans le reste du Canada et qu’aux États-Unis[2]. On trouve ici un élément supplémentaire qui atteste de la singularité de la formation sociale québécoise et de ses dynamiques particulières. De 1935 à 1992, les effectifs syndicaux augmentent avec une impressionnante constance, de sorte qu’ils passent de 65 100 à 970 900. Si, en termes absolus, ces effectifs connaissent une forte croissance, le taux de syndicalisation oscille légèrement entre 27 et 30 % de 1946 à 1964. Les effectifs syndicaux suivent alors grosso modo les tendances démographiques de la population québécoise. À partir de 1964, le taux de syndicalisation repart à la hausse, jusqu’à atteindre 42,8 % en 1992[3]. Malgré quelques fluctuations depuis, le taux de présence syndicale se situait toujours à 38,9 % en 2023[4]. Si la persistance d’un taux de syndicalisation élevé est déjà un indice de la puissance des organisations syndicales, celui-ci ne nous indique pas pour autant qui est représenté par celles-ci. Or, la forte syndicalisation qui s’amorce à partir de la moitié des années 1960 – le taux de syndicalisation augmente de 7 points de pourcentage en 6 ans – est notamment déterminée par l’adoption du Code du travail du Québec en 1964 qui étend le droit de grève aux syndicats accrédités du secteur public[5]. Au début des années 1960, les réformes du gouvernement Lesage en santé et en éducation font exploser le nombre de salarié·es de l’État à qui on ne reconnaît pas encore le droit de grève et qui, par le fait même, doivent se soumettre à un arbitrage obligatoire. Le droit de grève dans le secteur public se place alors au cœur des revendications syndicales et des travailleur·ses recourent à la grève illégale pour mettre de l’avant leurs intérêts. C’est notamment le cas des infirmières de Sainte-Justine qui, au terme d’un débrayage illégal d’un mois à l’automne 1963, arrachent des augmentations salariales, un droit de regard sur la planification et la qualité des soins ainsi que la reconnaissance de leur ancienneté[6]. La pression pousse alors le gouvernement du Québec à étendre le droit de grève à ses employé·es, ce qui entraîne une forte syndicalisation et participe à une tendance significative dans la composition des effectifs syndicaux du Québec, à savoir une augmentation constante de la part des syndiqué·es issu·es du secteur public.
En 2023, le taux de présence syndicale s’élevait à 84,7 % dans le secteur public alors qu’il n’était que de 23 % dans le secteur privé. Pour la même année, il n’était que de 19,8 % pour les industries primaires, de 16,5 % pour le commerce et de 8,7 % pour l’hébergement et les services de restauration[7]. Notons également qu’au sein du secteur privé, ce sont les activités traditionnelles de la classe ouvrière qui connaissent les plus hauts taux de présence syndicale, à savoir 31,3 % pour la fabrication, 43,9 % pour le transport et l’entreposage et 56,9 % pour la construction[8]. À cela s’ajoute une professionnalisation des effectifs syndicaux qui s’observe par un plus haut taux de présence syndicale pour les employé·es ayant un diplôme d’études postsecondaires (41,9 %) que pour les employé·es qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (26,3 %) ou qui possèdent uniquement celui-ci (34,3 %)[9]. Ces données nous conduisent au constat du caractère de plus en plus interclassiste des organisations syndicales, en ce qu’elles représentent de plus en plus indistinctement les membres du prolétariat, de la classe moyenne subordonnée et de la classe moyenne subordonnante.
Si les syndicats ne peuvent plus être assimilés à des organisations de luttes proprement prolétariennes, alors la question se pose de savoir quel est le rapport qu’ils entretiennent aux différentes classes sociales. À ce titre, force est de constater que l’importance prise par la négociation centralisée des conventions collectives entre l’État et ses employé·es a déplacé le centre de gravité du discours et de l’action des grandes centrales syndicales. En effet, ces négociations ne portent pas sur la résistance à l’exploitation spécifiquement capitaliste, dont l’enjeu central demeure les modalités de l’appropriation de la plus-value. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelle mesure l’État et, par le fait même, les « contribuables » du Québec devraient débourser pour s’offrir des services publics de qualité et pour assurer des conditions de travail décentes à ceux et celles qui les fournissent. Cette situation n’est pas tout à fait nouvelle : l’histoire des luttes sociales des cinquante dernières années au Québec est notamment marquée par la formation de grands fronts communs intersyndicaux mobilisant des centaines de milliers de travailleur·ses des secteurs public et parapublic. En ce sens, l’interclassisme et la combativité syndicale du secteur public ne sont pas spécifiques au nouveau cycle de lutte. Ce qui est véritablement nouveau, c’est l’incapacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme actrices d’une potentielle transformation sociale radicale conforme aux intérêts des classes subordonnées. Pour mieux illustrer ce basculement, nous contrasterons les Fronts communs de 1972 et de 1982-1983. Nous verrons que ce n’est pas tant par l’ampleur des effectifs mobilisés qu’ils se distinguent, mais plutôt par le degré de combativité et de confiance qu’avaient ses participant·es de le voir déboucher sur une transformation sociale profonde.
2. De la fonction publique à la grève sociale : le Front commun de 1972
La décennie 1970 est marquée par des grèves et des lock-out qui atteignent une intensité inégalée dans l’histoire du Québec[10]. Dans ce contexte, le Front commun intersyndical de 1972 représente en quelque sorte le paroxysme du cycle de luttes précédent, le point où la conflictualité institutionnalisée propre au « compromis fordiste » atteint ses limites. Ce premier Front commun constitué par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) réunit plus de 200 000 employé·es des secteurs public et parapublic. Les premières négociations avec le gouvernement du Québec commencent au printemps 1971 alors qu’est toujours en vigueur la Loi sur les mesures temporaires d’ordre public qui prolonge certaines dispositions de la Loi sur les mesures de guerre mises en place lors de la crise d’Octobre[11]. En ce sens, les souvenirs des dizaines de milliers de perquisitions arbitraires et des centaines d’emprisonnements sans mandat sont encore très vifs lorsque débutent les négociations. Dans ce contexte, le discours ambiant se radicalise. Chacune des trois grandes centrales publie un manifeste qui n’hésite pas à dépeindre le capital en ennemi. Dans Ne comptons que sur nos propres moyens (1971), la CSN critique l’impérialisme américain et met de l’avant la nécessité d’une planification socialiste. La FTQ publie L’État, rouage de notre exploitation (1971) qui affirme sans détour que « la cause véritable des problèmes aigus qui écrasent chaque jour davantage les travailleurs, c’est le système capitaliste monopoliste organisé en fonction du profit de ceux qui contrôlent l’économie, jamais en fonction de la satisfaction des besoins de la classe ouvrière qui regroupe l’immense majorité de la population[12]». Quant à elle, la CEQ dénonce l’utilisation de l’école comme outil de reproduction des classes sociales dans L’école au service de la classe dominante (1972). Malgré les différences idéologiques qui distinguent les trois manifestes, ils expriment tous la volonté d’inscrire le mouvement syndical dans un projet de transformation sociale radical qui passe par la montée en puissance des organisations des travailleurs et des travailleuses[13].
Les trois grandes centrales syndicales se rendent alors à la table de négociation avec les revendications suivantes : une hausse du salaire minimum hebdomadaire à 100 $, un salaire égal pour un travail égal indépendamment du sexe et de la région, des augmentations salariales d’au moins 8 %, une sécurité d’emploi complète et une égalisation, par la hausse, des avantages sociaux[14]. La stratégie du Front commun consiste notamment à faire valoir que ses objectifs sont légitimes pour l’ensemble de la force de travail, qu’elle soit employée par un État au service du capital ou par la classe capitaliste elle-même. Les gains obtenus par les employé·es du secteur public pourraient donc servir de levier pour les revendications des travailleur·ses du secteur privé. C’est toutefois avec l’hésitation et la retenue qui caractériseront la direction du Front commun durant tout le conflit que le lien entre l’État québécois et la classe capitaliste est critiqué[15]. Cela n’empêche pas le Conseil du Patronat du Québec, dans un rapport publié après les négociations, d’établir lui-même le lien entre ses intérêts et celui du Gouvernement provincial :
« La rémunération offerte par le Gouvernement, en plus des effets d’entraînement qu’elle aura sur toute la structure des salaires et que l’on a eu tort de mésestimer à moyen et à long terme, rendra plus attrayant encore l’emploi dans le secteur public, créant ainsi à toutes fins pratiques une concurrence déloyale à l’endroit du secteur privé. Un deuxième effet sera l’obligation pour le secteur privé d’accroître ses salaires[16].»
Les négociations entre les centrales syndicales traduisent déjà la dynamique interclassiste du Front commun. La revendication phare du salaire minimum de 100 $ par semaine met de l’avant les intérêts de ses membres les plus mal payés et vise ainsi à créer une base suffisamment large pour coaliser les couches les plus pauvres des classes subordonnées. Dans le même sens, la proposition initiale de la CSN inclut une modification des échelles salariales visant à réduire les écarts entre les hauts et les bas salaires. Notons que cette proposition aurait précisément eu pour effet de réduire les avantages socio-économiques d’une classe moyenne subordonnante alors en plein développement au Québec. Or, dans les négociations entre les centrales, cette proposition est refusée par la CEQ, dont une bonne partie des membres – notamment les enseignant·es du secondaire – tirent avantage des écarts salariaux importants. La valorisation des diplômes est priorisée par la CEQ, et ce, contre une politique salariale s’attaquant de façon somme toute timide aux écarts de rémunération[17].
Disons maintenant quelques mots sur le déroulement de la lutte elle-même. Après une première journée de grève le 28 mars, la grève générale illimitée est déclenchée le 11 avril 1972. Face à celle-ci, le gouvernement Bourassa recourt alors à une série d’injonctions contraignant les employé·es d’Hydro-Québec et des hôpitaux à maintenir le travail. Ces injonctions ne sont pas respectées, ce qui conduit à l’arrestation de plus de 70 personnes parmi la direction syndicale. Les sanctions se veulent alors exemplaires et plusieurs peines d’emprisonnement sont prononcées. La stratégie gouvernementale est de contraindre les employé·es du secteur public à rentrer au travail en ayant recours aux tribunaux et à des dispositions législatives coercitives. Cette tentative culmine avec le dépôt du projet de loi 19 qui suspend le droit de grève pour les employé·es du secteur public. La loi prévoit également que le gouvernement fixera par décret les conditions de travail si les parties ne parviennent pas à s’entendre avant le 1er juin. Face à cette menace, la direction du Front commun consulte ses membres en urgence. La participation à la consultation est assez faible, mais plus de 60 % des participant·es votent en faveur de la désobéissance civile[18]. Contre ce vote et après hésitation, les dirigeants du Front commun appellent au retour au travail. Cette décision est vécue comme une trahison et la rancœur est exprimée dès le lendemain au sein du Conseil central de Montréal de la CSN[19]. Nonobstant quelques initiatives éparses, le retour au travail est généralisé.
Bien qu’ils aient appelé à respecter la suspension du droit de grève prononcée par la loi 19, les chefs syndicaux Marcel Pépin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ) sont arrêtés pour le non-respect des injonctions dans les hôpitaux et condamnés, le 8 mai, à la peine maximale d’un an d’emprisonnement. Ces condamnations marquent un tournant dans le Front commun qui déborde alors le cadre de la négociation syndicale pour devenir une véritable grève sociale. À partir de ce point, le prolétariat entre lui aussi dans la danse. Les ouvriers des ports et du Conseil des Métiers de la Construction de la FTQ initient un mouvement de grèves spontanées et illégales qui se propagent dans l’ensemble de la province. La grève dépasse maintenant largement les frontières du secteur public et la province est paralysée par plus de 300 000 grévistes qui exigent la libération des dirigeants syndicaux et l’abrogation de la loi 19. Dans des villes comme Montréal, Joliette, Thetford Mines et Saint-Jérôme, des usines sont occupées et dans plusieurs régions de la province, les radios passent momentanément sous le contrôle des grévistes. À Sept-Îles, de violents affrontements éclatent avec les forces policières, les commerces non essentiels sont fermés, la radio locale est occupée et la ville est proclamée sous le contrôle des travailleur·ses[20]. Néanmoins, l’occupation est de courte durée et sa fin est précipitée par une attaque à la voiture-bélier commise par un organisateur local du Parti libéral. Celle-ci fait des dizaines de blessé·es et tue le jeune travailleur Herman Saint-Gelais.
Face au développement incontrôlé de ce mouvement de grève, Robert Bourassa congédie le ministre de la Fonction publique Jean-Paul L’Allier et le remplace par Jean Cournoyer, quant à lui mandaté de reprendre les négociations avec le Front commun. Le 17 mai, les trois dirigeants syndicaux acceptent son offre et appellent – encore une fois – à reprendre le travail. Ils sont libérés provisoirement une semaine plus tard dans la foulée de l’appel de leur jugement, ce qui relance les négociations[21]. Le rapport de force instauré par la grève se manifeste à la table de négociation où le gouvernement accorde l’augmentation, étalée sur quatre ans, du salaire minimum à 100 $. Le Front commun parvient également à obtenir des augmentations salariales de 5 à 6 % ainsi que l’indexation partielle des salaires et des retraites sur l’inflation[22].
Au-delà des gains économiques, la grève générale de mai 1972 représente le point culminant d’une confrontation qui déborde du cadre syndical pour poser pratiquement, quoique très brièvement, la question du pouvoir ouvrier. Le fait que les dirigeants syndicaux aient dû appeler eux-mêmes deux fois à la reprise du travail montre bien que les limites d’une confrontation institutionnalisée ont effectivement été dépassées. Nous pouvons aussi parler de point culminant puisque la répression du Front commun et les divisions qu’il a fait naître ont empêché que cette dynamique conduise à une intensification de la lutte. Le lendemain de grève est particulièrement douloureux à la CSN, dont les syndicats d’hôpitaux cumulent des amendes d’environ 500 000 $[23]. Plus encore, la CSN subit une scission menée par Paul-Émile Dalpé, Jacques Dion et Amédée Daigle, trois membres du comité exécutif jugeant la ligne politique de Marcel Pépin trop radicale. Ils fondent alors la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui rassemble à ses débuts environ 30 000 membres, dont ceux des fédérations du textile et du vêtement qui passent en bloc de la CSN à la CSD[24]. La CSN perd alors une part importante de ses effectifs prolétariens issus du mouvement ouvrier traditionnel et se transforme graduellement en une centrale dominée par les salarié·es des secteurs public et parapublic. Dix ans plus tard, le mouvement syndical tentera de résister à une nouvelle confrontation entourant la négociation des conventions collectives. Mais ce n’est plus un gouvernement ouvertement et franchement bourgeois qui, cette fois, conduira les négociations du côté patronal : c’est face au gouvernement du Parti québécois de René Lévesque – parti ayant jusque-là entretenu le mythe d’un « préjugé favorable aux travailleurs » – que se trouveront les directions syndicales.
3. De la loi matraque au repli défensif : le Front commun de 1982-1983
Le Front commun de 1982-1983 survient dans un contexte radicalement différent. La crise économique et le chômage de masse créent des conditions de négociation largement défavorables aux employé·es de l’État. Au gouvernement, le Parti québécois en est à son deuxième mandat, lequel suit l’échec référendaire de 1980. Si ce mandat dissipera les doutes qui pouvaient subsister sur la nature de classe du PQ, celle-ci demeure l’objet de vifs débats durant la décennie 1970. L’exemple le plus frappant est probablement les trajectoires opposées suivies par Charles Gagnon et Pierre Vallières, deux anciens membres du FLQ. Alors que le premier rompt avec le nationalisme pour fonder En Lutte ! en 1972, le second publie L’Urgence de choisir où il récuse la violence révolutionnaire et la lutte immédiate pour le socialisme, tout en appelant à rejoindre les rangs du PQ. Les débats concernant le rapport à entretenir avec le PQ touchent également les centrales syndicales. Alors que la CSN apportera un appui « critique » au camp du « oui » pour le référendum de 1980, la FTQ, traditionnellement plus centriste, ira jusqu’à appeler à voter pour le PQ lors des élections de 1976 et de 1981[25]. Avant son deuxième mandat, le PQ pouvait encore se targuer d’avoir adopté certaines législations comme la loi 45 (adoption de la formule Rand) et la loi 17, qui répondent directement à certaines revendications syndicales, telles que l’interdiction d’embaucher des scabs ou encore l’adoption de mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail[26].
C’est donc face à un gouvernement réputé favorable aux revendications syndicales que s’amorcent, en 1982, les négociations avec un Front commun réunissant plus de 300 000 membres. Tel que mentionné, l’un des éléments centraux de la stratégie du Front commun de 1972 était d’arracher des gains pour les employé·es de l’État afin que ceux-ci puissent ensuite servir de levier pour les luttes du secteur privé[27]. Cette stratégie ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Pire, la partie patronale réussit le tour de force de se servir de l’écart salarial qui se creuse entre le secteur public et le secteur privé comme d’un prétexte pour justifier l’assainissement des finances publiques par des baisses salariales des employé·es de l’État. Cet argument devient central dans les décrets de 1982-1983 qui surviennent au moment où la récession économique du début des années 1980 fait bondir le taux de chômage, entraîne des pertes d’emplois massives dans le secteur manufacturier et aggrave l’endettement de l’État. Ce contexte rend difficile l’adoption d’une stratégie offensive pour un mouvement syndical déjà éreinté par les affrontements des années 1970.
Le gouvernement de René Lévesque décide alors de récupérer une part des augmentations salariales octroyées par la convention de 1979 en imposant aux employé·es de l’État une baisse salariale allant jusqu’à 20 % pour les trois premiers mois de 1983. Ces baisses salariales, confirmées par l’adoption sous bâillon de la loi 70, freinent la négociation et le Front commun tient une journée de grève illégale le 10 novembre 1982 afin d’obtenir son abrogation. Le gouvernement Lévesque décide alors d’enjamber la négociation en fixant par décret les conditions de travail de tous les employé·es de l’État et en révoquant au passage le droit de grève pour les trois années de la nouvelle convention collective[28]. Face à cette escalade, le Front commun voit la grève générale illimitée comme sa dernière arme et adopte une stratégie de grève « en cascade » qui intégrera progressivement différentes franges des secteurs public et parapublic à partir du 26 janvier 1983[29]. Devant une mobilisation timide, le gouvernement décide d’aller encore plus loin : le 17 février, le projet de loi 111 est adopté à l’Assemblée nationale. Cette « loi matraque » prévoit des mesures répressives sans précédent, dont l’augmentation des amendes quotidiennes, la perte de trois années d’ancienneté pour chaque jour de grève et la possibilité d’effectuer des congédiements sommaires. Le lundi 21 février, le retour au travail est généralisé et les négociations subséquentes n’apportent que des modifications mineures aux décrets gouvernementaux[30].
La répression du Front commun de 1982-1983 et plus particulièrement les dispositifs de la loi 111 représentent un tournant dans la conflictualité entre les classes sociales au Québec. En plus de pénaliser les élu·es des syndicats et les associations syndicales elles-mêmes, cette loi s’attaque aux syndiqué·es pris·es individuellement afin de les amener à se désolidariser de leurs organisations. Cette stratégie est énoncée explicitement par le ministre du Revenu Alain Marcoux qui défend « des sanctions touchant les individus plutôt que les syndicats, qui n’attendent que le contraire pour pouvoir se porter à la défense du syndicalisme » tout en affirmant que « la seule façon d’obtenir le retour au travail sera de mettre chaque individu devant une décision personnelle[31] ». L’arrestation « exemplaire » des dirigeants syndicaux en 1972 avait provoqué une intensification du conflit qu’on tente désormais d’empêcher par une logique de répression individuelle. Le gouvernement ouvre ici la voie pour une classe capitaliste qui tend à sortir d’une logique de confrontation institutionnalisée avec les organisations syndicales pour privilégier une négociation des conditions de travail de plus en plus individualisée.
Si le Front commun de 1972 représente le paroxysme du cycle de lutte précédent, on peut considérer que celui de 1982-1983 le clôture définitivement. Ce qui s’évanouit à ce moment, ce n’est pas tant la capacité des syndicats à organiser des salarié·es et à les mobiliser. Comme l’illustre l’exemple du Front commun de 2023, les mobilisations syndicales parviennent encore à arracher des gains au niveau des conditions de travail. Ce qui s’est radicalement transformé depuis, c’est avant tout la capacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme porteuses d’un projet de rupture. La création du Fonds de solidarité FTQ en 1983 en est peut-être la meilleure illustration. Au plus loin de s’inscrire dans une perspective subversive, la FTQ décide alors, avec l’appui du gouvernement provincial de René Lévesque et, ensuite, du gouvernement fédéral de Brian Mulroney, de créer un fonds d’investissement qui permettra de financer des entreprises afin de préserver ou de créer des emplois[32]. La dynamique qui s’ouvre à partir des années 1980 est ainsi axée sur un « partenariat », une « concertation » non contraignante où les organisations syndicales tentent de préserver les emplois des secteurs menacés par la restructuration et de minimiser la dégradation des conditions de travail[33]. Ce repli défensif est formulé explicitement par le comité exécutif de la CSN qui affirme, lors de son congrès de 1990, que « la résistance aux attaques et le maintien de nos acquis doivent être considérés comme des victoires[34] ».
Ce changement de paradigme s’exprime aussi statistiquement lorsqu’on s’intéresse à la moyenne annuelle des jours-personnes non travaillés. Alors qu’elle s’élève à 2 719 000 pour la décennie 1970, elle baisse à 1 878 000 pour la décennie 1980 et à 561 000 pour la décennie 1990. Durant la décennie suivante, elle remonte légèrement à 610 000[35]. Durant cette période, les conflits de travail tendent également à toucher de moins en moins de travailleur·ses par conflit et ils durent en moyenne plus longtemps, ce qui exprime une tendance à l’isolement et une difficulté à arracher des gains rapides[36].
Ce n’est pas qu’au niveau syndical qu’on peut mesurer le changement du rapport de force. Comme nous l’avons mentionné, les années 1960-1970 voient apparaître une véritable base favorisant l’activité subversive avec les comités d’action politique, les journaux et les groupes révolutionnaires, les librairies socialistes et les organisations féministes radicales. À partir de la seconde moitié des années 1970, ce sont principalement les groupes marxistes-léninistes qui parviennent à concentrer et à faire croître ce qu’on peut appeler les « forces révolutionnaires ». Le groupe marxiste-léniniste En Lutte ! s’exporte alors dans le reste du Canada, ses membres triplent et son journal hebdomadaire atteint un tirage moyen de 7 000 exemplaires[37]. En 1979, le groupe se constitue en organisation « préparti », considère que le moment est venu de rallier la classe ouvrière et d’unifier les marxistes-léninistes du monde entier. Seulement trois ans plus tard, l’organisation se dissout[38]. Le Parti communiste ouvrier (PCO, ex-Ligue communiste) connaît le même sort au début de l’année 1983. En seulement quelques années, des organisations qui diagnostiquaient l’imminence de la révolution et qui aspiraient à diriger celle-ci en sont venues à la conclusion qu’il était temps de mettre la clé sous la porte.
4. Quant à la suite…
Mesurer l’ampleur des changements structurels qui ont eu cours lors des dernières décennies nous pousse maintenant à tirer un certain nombre de conclusions sur les formes que risquent de prendre d’éventuels conflits de classe au Québec. Au nombre de ces conclusions, on peut confirmer que le prolétariat a en grande partie perdu le principal levier dont il disposait afin d’améliorer ses conditions d’existence et, plus particulièrement, afin d’améliorer ses conditions de travail. Bien qu’elles soient interclassistes depuis très longtemps, les centrales syndicales se distinguent désormais par la prépondérance des professionnel·les du secteur public, c’est-à-dire par celle des membres de la classe moyenne subordonnante. Dans ce contexte, la défense des avantages associés à certains emplois de la CMS tend à occuper une place de plus en plus centrale dans le discours et l’activité des centrales syndicales. On tente alors de faire reconnaître la valeur particulière de certaines professions, leur importance décisive pour les services publics québécois ou encore le décalage entre la rémunération de certaines professions traditionnellement féminines du secteur public et des professions analogues traditionnellement masculines du secteur privé. S’ils font voir, à juste titre, les effets des rapports sociaux de sexe sur la distribution des avantages sociaux, ces lignes d’argumentation reconduisent néanmoins l’idée qu’il est normal, bon et acceptable qu’il existe des écarts salariaux importants, des rapports hiérarchiques dans l’organisation du travail ou encore des privilèges réservés à certaines fonctions. On pourra encore lancer des appels sincères à la solidarité et à l’organisation de mobilisations interclassistes, mais il apparaît toujours naturel, au final, que certain·es s’en tirent mieux que d’autres.
Le Front commun de 2023 est un exemple illustratif de cette tendance, dans la mesure où ce sont d’abord les enseignant·es des niveaux préscolaire, primaire et secondaire qui ont réussi à capter l’attention médiatique et à se présenter comme un rempart contre « la détérioration du système public d’éducation québécois[39] ». La combativité dont ont fait preuve les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), en grève générale illimitée pendant plus d’un mois au courant de l’automne 2023 (et ce, sans fonds de grève), explique en grande partie l’importance qu’a prise la situation particulière de ces enseignant·es dans la négociation des conventions collectives. Ce qui est néanmoins digne de mention, c’est l’aisance avec laquelle leur propre discours, dans lequel la qualité du système d’éducation est directement identifié à l’obtention de bonnes conditions de travail pour eux et elles-mêmes, est parvenu à s’imposer. Ce lien n’est évidemment pas dépourvu de fondement. Toutefois, ce qui peut surprendre, c’est à quel point les enjeux liés à la préservation et aux fins du système d’éducation public ont été aussi rapidement écartés et réduits à une question de salaire : les revendications relatives à la composition des classes et à la lourdeur de la tâche ont été négligées et une bonification de l’échelle salariale s’ajoutant aux augmentations octroyées à l’ensemble des membres du Front commun a finalement été suffisante pour amener les enseignant·es à cesser ce qu’on a présenté comme une lutte pour la « survie du système public »[40]. Certes, à travers l’appui que les grévistes ont reçu de la population, il est clair que cette dernière sent que la qualité du système d’éducation public est plus ou moins étroitement liée aux conditions de travail des enseignant·es. Néanmoins, si ces conflits continuent de se régler presque exclusivement par des augmentations salariales, on peut présumer qu’un tel appui s’amenuisera et que les membres de la CMS des secteurs publics et parapublics auront de plus en plus de difficulté à se présenter comme les champions du « bien commun ».
En réalité, le fait que les effectifs syndicaux appartiennent à des classes diverses réduit la base commune sur laquelle de puissantes luttes syndicales peuvent être menées. Plutôt que de former un bloc relativement homogène capable de faire front contre un ennemi commun, les centrales syndicales sont, une fois les conflits parvenus à un certain degré de développement, placées devant la nécessité de favoriser l’un ou l’autre des groupes relativement antagonistes qu’elles représentent. Cela ne se manifeste pas nécessairement lorsque les revendications restent sur des positions défensives ou lorsqu’elles réclament des gains modestes. Toutefois, dès que les revendications de syndiqué·es issu·es des classes subordonnées en viendront à remettre en question la grandeur des écarts de salaire, la hiérarchie du travail ou encore les privilèges associés au travail intellectuel, elles ne manqueront pas d’entrer en conflit avec les intérêts d’une part importante des effectifs syndicaux. Si pour compenser la désaffection des membres des classes subordonnées, les centrales syndicales n’ont pas le choix de représenter les membres de la CMS – dont les privilèges sont le corollaire de la subordination des classes subordonnées –, elles doivent aussi se résoudre à mener une existence double et conflictuelle. À l’occasion des fronts communs, c’est précisément sur cela que peut jouer l’État afin de les faire plier.
Il faut par ailleurs voir que le poids grandissant que prennent les emplois précaires et atomisés au sein du prolétariat ne peut manquer d’affecter les formes que prennent ses luttes. Cette atomisation et cette précarité se traduisent notamment par un taux de syndicalisation plus faible, comme c’est le cas du secteur des services marchands. Les emplois qui appartiennent à ce secteur sont en effet considérés comme difficiles, voire impossibles à syndiquer[41]. Le taux de roulement élevé qui y prévaut renforce leur précarité qui, elle, affaiblit en retour la possibilité qu’ils ont d’être syndiqués, ce qui augmente encore leur taux de roulement et ainsi de suite. Mais il existe d’autres facteurs qui viennent affaiblir la capacité des prolétaires à se défendre à travers leur syndicat. Le cas des travailleur·ses temporaires étranger·ères est à cet égard particulièrement significatif. Dans certaines entreprises, ces travailleur·ses représentaient, jusqu’à la récente révision des seuils d’immigration, le cinquième des salarié·es[42]. Abstraction faite de la difficulté qui existe à s’organiser avec des collègues allophones, rappelons que les conditions dans lesquelles s’effectue le travail étranger temporaire sont tellement précaires qu’il est virtuellement impossible que ces travailleur·ses entrent dans un rapport confrontationnel avec leur employeur·e[43]. En effet, les contraintes sociales et matérielles qui accompagnent ce statut sont si fortes qu’elles affectent nécessairement de manière négative la capacité du reste des prolétaires de ces entreprises à lutter sur leur milieu de travail. Ce phénomène est notamment renforcé par le recours aux agences de placement de main-d’œuvre, pratique particulièrement répandue dans le secteur du transport et de l’entreposage. Non seulement cette main-d’œuvre est le plus souvent issue de l’immigration récente, voire de l’immigration informelle, mais sa gestion externalisée a pour effet de segmenter encore davantage les travailleur·ses au sein des milieux de travail : plutôt que de faire face, en masse, aux mêmes employeur·es, ces prolétaires d’origines diverses sont lié·es, par l’entremise de leur contrat de travail, à des employeur·es différent·es pour des taux de salaire différents[44]. La collectivisation des conflits de travail, « le passage au collectif » comme dirait Kergoat[45], est alors pratiquement bloqué.
À l’autre extrémité, la partie patronale fait manifestement preuve d’une virulence de plus en plus grande pour freiner les luttes. D’un côté, la Loi sur les services essentiels empêche, au Québec, toute forme de débrayage significatif des travailleur·ses du secteur public, même si pour l’heure, aucune mesure aussi systématique et « efficace » n’existe dans le secteur privé (bien que les associations patronales en fassent périodiquement la demande[46]). À toutes fins pratiques, les salarié·es concerné·es par cette loi n’ont pas le droit de grève. Du côté du secteur privé toutefois, les gouvernements sont de plus en plus enclins à voter des lois spéciales qui forcent le retour au travail en imposant une convention collective aux deux parties en litige. Dans le secteur de la construction, ces lois spéciales sont devenues rituelles et tendent à faire de même dans celui du transport et de la logistique. Ce qui se joue là est particulièrement significatif, en ce sens que l’outil de la grève apparaît avoir perdu son sens. À quoi bon perdre plusieurs jours de salaire à débrayer si l’on sait qu’à terme, une loi spéciale forcera le retour au travail et fixera ses conditions ? Lorsque le cadre légal au sein duquel les luttes peuvent être menées est aussi restreint, on peut douter de l’efficacité des organisations qui renoncent à outrepasser ce cadre.
Si les changements qui affectent les modalités de la lutte des classes depuis cinq décennies ne doivent pas être assimilés à son évanouissement pur et simple, il faut reconnaître qu’ils s’inscrivent dans une modification du rapport de force qui a lieu au profit du capital. D’une part, la difficulté à s’organiser à l’intérieur d’un cadre institutionnalisé réduit la probabilité pour le prolétariat et la classe moyenne subordonnée de voir leurs luttes déboucher sur des gains substantiels. Aussi critiquables soient les syndicats, la syndicalisation d’un milieu de travail permet le recours à certaines formes de lutte revendicative dont l’efficacité n’est plus à prouver. Or, ce sont ces formes qui sont de moins en moins accessibles aux membres des classes subordonnées. D’autre part, nous avons vu que même lorsque leurs luttes sont effectivement menées dans un cadre légal, elles sont renvoyées dans l’illégalité dès l’instant où elles semblent menacer la bonne marche de l’accumulation. Autrement dit, la modification des modalités de la lutte des classes coïncide, de façon plus ou moins étroite, avec l’incapacité grandissante des classes subordonnées à faire valoir leurs intérêts.
Pour toutes ces raisons, on peut d’autant moins s’attendre à ce que les centrales syndicales fonctionnent comme le catalyseur d’un projet de transformation sociale radicale qui prendrait en charge les intérêts spécifiques des classes subordonnées et, à plus forte raison, du prolétariat. Une telle affirmation peut avoir l’air d’une banalité. Néanmoins, il faut insister sur le fait que cette situation n’est pas imputable à un simple problème de discours, à un esprit de défaite endémique depuis les années 1980 ou encore à une perpétuelle trahison de la part d’une direction syndicale qui refoulerait sans cesse les désirs révolutionnaires de la base. Au contraire, les configurations sociales et matérielles nécessaires à la constitution d’organisations prolétariennes fortes (concentration de la force de travail prolétarienne dans de grandes unités de production et dans des quartiers socialement homogènes, prédominance de l’emploi à temps plein, existence d’une culture « ouvrière » nationale, etc.) ont été balayées avec la restructuration néolibérale. Le capital n’accepte tout simplement plus de voir en face de lui un prolétariat organisé, discipliné et prévisible. On ne se le soumet plus en l’encadrant et en adoucissant ses conditions d’existence, mais en lui cassant les reins : on ne permet plus que ses luttes débouchent sur sa confirmation en tant que classe et encore moins en tant que classe aspirant à gérer la société sur sa propre base. Le statut de classe, c’est précisément ce qu’on lui refuse. On peut certainement le déplorer, mais encore faut-il le reconnaître.
Cette situation de blocage nous force à porter une attention plus soutenue aux formes modifiées que prennent les luttes des classes subordonnées afin de résister à l’exploitation. En dépit de la résurgence relative des conflits de travail durant la dernière décennie[47], on peut s’attendre à ce que leurs luttes s’expriment de moins en moins directement sur les lieux de travail. Comme on l’a vu, non seulement les syndicats représentent très imparfaitement les classes subordonnées, mais la rigidité des contraintes à l’exercice du droit de grève et le recours aux lois spéciales ne peuvent que décourager de telles pratiques de lutte. Or, lorsqu’elles rompent avec la légalité, les confrontations directes sur les lieux de travail sont sujettes à une répression telle qu’en l’absence de mouvement social important, elles ne peuvent manquer de se limiter à des formes de résistance individuelles (vol, sabotage, absentéisme, etc.) qui sont, par le fait même, beaucoup moins efficaces.
Si les formes traditionnelles de résistance à l’exploitation semblent avoir peu d’avenir du point de vue de leur capacité à mobiliser de larges fractions du prolétariat et de la classe moyenne subordonnée, il semble tout à fait envisageable que la question des conditions de travail et de sa rémunération laisse de plus en plus la place à celle des conditions de vie[48]. Le problème du coût et de la qualité des logements, du prix des produits alimentaires, des frais associés au transport ou encore du profilage et des violences policières représentent tous des terrains où les conflits de classes peuvent s’exprimer intensément, quoiqu’indirectement. L’intensité de ces luttes peut croître rapidement puisqu’elles tendent, en recourant au pillage des magasins, au sabotage de moyens de transport et de communication ou à la prise d’assaut des lieux de pouvoir, à s’attaquer à ce que l’État d’une société capitaliste doit à tout prix protéger, à savoir : la propriété privée[49]. Et contrairement aux luttes qui naissent autour de conflits de travail, celles qui tournent autour des conditions de vie sont beaucoup moins faciles à organiser et à inscrire dans une stratégie à long terme. Elles éclatent, tout simplement.
Si la faiblesse ou la quasi-absence de structures organisationnelles déjà établies mine la capacité des protagonistes de ces luttes à se coordonner et à persévérer malgré la répression et les revers momentanés, elles sont aussi, par le fait même, beaucoup moins faciles à encadrer. Autrement dit, puisqu’il est plus difficile pour des « chefs » – pour ceux et celles qui sont à la tête d’organisations ou qui cherchent à en prendre la direction – de les canaliser dans un sens ou dans l’autre, elles apparaissent en retour plus difficile à saboter par le haut. En fait, il n’existe plus d’organisations disposant de l’autorité nécessaire pour freiner un mouvement de lutte sérieux. Ce serait idéaliser le cycle de luttes précédent que de fermer les yeux sur les dégâts que causait la mise sous tutelle du prolétariat par des « révolutionnaires professionnels » ou proclamés tels. Le principe de la représentation, celui de délégation de l’autonomie, l’idée selon laquelle un mouvement ne peut être efficace si les décisions importantes ne sont pas prises par un petit nombre de leaders, le respect de la discipline du parti, l’étapisme ou encore l’idée qu’il faille fonder un État ouvrier fort, sont tous des éléments définitoires du cycle de lutte précédent qui affectaient négativement la capacité des prolétaires à s’auto-transformer et à prendre les mesures qu’imposaient certaines situations critiques. Entendons-nous, nous ne soutenons pas que les prolétaires d’aujourd’hui sont à un poil de parvenir à une conscience communiste ou de lutter en ce sens de façon conséquente. Ce dont il s’agit, c’est de faire voir que les obstacles que nous avons énumérés ne sont plus immanents aux luttes du prolétariat. Par opposition au cycle de lutte précédent, la condition ouvrière n’est plus quelque chose qu’on cherche à éterniser, il n’y a plus de comité central auquel obéir aveuglément, plus de pseudo « patrie socialiste » au nom de laquelle les intérêts des mouvements de luttes locaux peuvent être sacrifiés. Ce qui est impliqué par là, c’est que l’idéologie du programme prolétarien ne s’interpose plus entre la conscience des prolétaires et ce qu’ils et elles doivent accomplir pour faire progresser la lutte dans un sens communiste.
Par rapport au cycle de luttes précédent, on peut donc s’attendre à ce que les luttes soient moins dépendantes de la puissance d’organisations révolutionnaires formelles. Il est évident qu’il s’agit encore ici d’une question de degré : le succès des luttes précédentes n’était pas suspendu à l’habileté de quelques chefs et, inversement, les luttes actuelles continueront d’être affectées par l’action de minorités agissantes et nécessiteront des formes d’organisation efficaces pour conduire à des transformations durables. Mais le cours des luttes présentes et à venir tendra vraisemblablement à être davantage déterminé par des facteurs structurels et conjoncturels « objectifs ». L’exemple des émeutes des Gilets jaunes en 2018-2019, des evasiones masivas dans le métro de Santiago au Chili en 2019 ou encore de la situation insurrectionnelle au Kazakhstan en 2022 illustrent bien cette tendance. Ni leur éclatement ni leur fin n’ont été dépendants de la volonté d’organisations quelconque[50]. Certes, au Québec, il n’existe pas encore de précédent nous permettant d’affirmer que cette tendance à l’éclatement soudain et violent de conflits de classes soit déjà à l’œuvre, bien que les conditions pour que de telles éruptions se produisent semblent être de plus en plus réunies.
Ces luttes qui, dans les dernières années, sont sorties d’un cadre strictement revendicatif et qui ont mobilisé des moyens d’action plus musclés ont bel et bien traduit des antagonismes de classes, mais de façon détournée. Si cette traduction est indirecte, c’est parce que les intérêts opposés qui s’affrontent le font dans un cadre extérieur au rapport qui les fait naître (le travail exploité et/ou subordonné). Dans ces luttes, prolétaires et capitalistes ne s’affrontent pas en tant que tel·les, même si c’est bien, en dernière instance, de leur rapport dont il est fondamentalement question. C’est parce que l’exploitation empêche les prolétaires et membres de la classe moyenne subordonnée de vivre convenablement qu’il y a lutte sur le terrain des conditions de vie. C’est parce que la classe capitaliste veut continuer à tirer de la plus-value du prolétariat qu’elle a intérêt à ce qu’on trouve une solution qui lui soit favorable, qu’elle a intérêt à ce que les conflits s’expriment « pacifiquement » et que les « violents casseurs infiltrés » soient traduits en justice. Or, dans une grève concernant les conditions de travail ou les salaires, on peut aisément identifier les agents qui s’affrontent et on comprend facilement que ce qui est perdu d’un côté est gagné de l’autre. Cela demeure vrai même lorsqu’il se crée un mouvement de grève massif qui s’étend et débouche sur des situations émeutières, voire insurrectionnelles : l’exploitation, le rapport de classe à classe, continue de représenter l’enjeu central. Mais dans une lutte contre la vie chère, il faut faire un effort supplémentaire pour identifier les antagonismes qui la sous-tendent et qui conditionnent son développement. Dans de pareilles luttes, c’est l’État qui est désigné comme l’interlocuteur privilégié, puisque c’est à lui qu’on impute la responsabilité de la situation à laquelle on s’attaque, ce qui, encore une fois, a pour résultat de voiler ce qui rend structurellement incompatible les intérêts des un·es et des autres.
Dans ces situations, on verra typiquement émerger des identités politiques générales comme le « 99 % », les « classes populaires », les « gens ordinaires » ou encore le bon vieux « peuple ». Ce qui est certain, c’est qu’on n’assistera pas au grand retour de la « classe ouvrière » ou du « prolétariat » en tant qu’identité politique portée massivement par des prolétaires. Certes, on trouvera toujours ici ou là des prolétaires capables de se reconnaître dans ces catégories, mais il faut admettre que le mot « prolétariat » se retrouve bien davantage dans la bouche des membres (ou aspirants membres) de la CMS friands de théorie marxiste que dans celles des travailleur·ses productif·ves subordonné·es. Cet état de fait n’est pas entièrement à déplorer. Il ne faut pas oublier que la reproduction d’une identité ouvrière à laquelle s’identifiait fièrement une partie du prolétariat était aussi un obstacle, dans le cours des luttes, à la reconnaissance du caractère imposé et contraignant de l’appartenance de classe, de même qu’à la nécessité de s’y attaquer en s’en prenant à la racine de l’exploitation capitaliste plutôt qu’à la stricte propriété des moyens de production. L’identité ouvrière, c’était aussi l’illusion selon laquelle la condition ouvrière est en elle-même porteuse d’un devenir communiste.
Après tout ce chemin parcouru, on pourrait ici poser la question suivante : ces constats ne sont-ils pas justement l’indice du fait que l’analyse en termes de classes est devenue caduque, en ce qu’elle serait en porte-à-faux avec la manière dont sont menées les luttes ? Ne devrait-on pas prendre celles-ci comme elles se donnent, avec le discours et les identités politiques qu’elles produisent ? Nous pensons que tous ces éléments conduisent précisément à la conclusion inverse. Les formes de lutte envisageables rassembleront nécessairement des membres de différentes classes, et ce, sous des étiquettes communes qui ont pour effet de rendre invisibles les rapports de force qui se jouent nécessairement au sein même des luttes. La confusion est donc inévitable. Lorsqu’on nous dit que « tout le monde est dans le même bateau », que « l’unité est nécessaire pour atteindre nos objectifs », il faut être en mesure de déterminer qui se trouve dans le bateau, qui est à ses commandes et à qui bénéficie le maintien de la lutte dans ses limites actuelles. Autrement dit, pour saisir ses potentialités, sa dynamique et ses obstacles inévitables, il faut nécessairement être en mesure de déterminer la composition de classe d’une lutte donnée. C’est ce à quoi cherche à contribuer un travail comme le nôtre. S’il est vrai que tout le monde n’a pas également intérêt à rompre avec l’organisation actuelle de la société, ceux et celles qui y ont effectivement intérêt ne peuvent que gagner à y voir plus clair.
[1]. Michel Chartrand, Charles Gagnon, Robert Lemieux, Jacques Larue-Langlois et Pierre Vallières, Le procès des Cinq, préface de Louis Hamelin, Montréal, Lux Éditeur, coll. « Mémoires des Amériques », 2010, p. 9.
[2]. Direction des études et de l’information sur le travail, La présence syndicale au Québec et au Canada en 2022, Ministère du Travail, 2023, p. 6. En 2022, le taux était de 39,1 % au Québec, de 26,5 % en Ontario, de 29,4 % dans le reste du Canada et de 11,3 % aux États-Unis.
[3]. Rouillard, Le Syndicalisme québécois, p. 286-2
La montée de la droite radicale : la division à l’œuvre
CISO a 50 ans – Quel avenir pour la solidarité internationale ?
Criminalisation des migrant·es : regards croisés Mexique, États-Unis et Canada
Retour sur notre conférence : quel bilan de la COP30 et du Sommet des peuples ?
Des militants écologistes privés d’un procès avec jury

Salade, tomate, pognon !

( Au Resto, « Les Milords », du 16ème, une nouvelle formule dédiée à la bourgeoisie parisienne séduit par sa touche excentriquement suave )
- Arrange ta cravate, mon chéri, elle est de travers, enjoint Madame Troflouze, à son époux.
– J't'avais dit que les nœuds papillons, c'est pas mon truc, grogne François, un Industriel replet et trapu qui pèse lourd dans le CAC 40.
– Moi, je te trouve très élégant, avec !
- Bon, entrons maintenant !
( Le couple Troflouze retrouve sa table parmi le beau monde venu savourer la curiosité gastronomique dédiée à la bourgeoisie, sur la Place de Paris )
- Alors ? Tu le trouves comment, le cadre du restaurant ? Jade.
– Somptueux !
- J'aime les ambiances qui répondent aux allants et aspirations des acteurs de l'entreprenariat, pas toi ?
- Si ! Regarde les tentures imprimées avec des motifs de billets de banque en euro et en dollar, c'est vraiment bien contextualisé.
– T'as pas regardé les dalles, sous tes pieds ?
- Oh, j'avais les yeux où, moi ? Comme c'est sympa ! Des lingots d'or qui scintillent dès qu'on bouge les pieds.
– Et le plafond ? fait François.
– Mon Dieu comme c'est magnifique. Un revêtement en Labradorites ! De l'iridescence plein la vue !
- Eh, Jade, oublie l'effet Schiller ! Et regarde qui arrive, tu ne croirais pas tes yeux.
– Oh ! Le prince de Monaco et juste derrière, les grosses fortunes en cordon d'oignon qui font la fierté de la France.
– Voilà notre ami Bolloré, lance François d'un ton enthousiaste, dont le Groupe est en guerre avec l'Audiovisuel public.
- Depuis hier, il défraie la chronique. Observe Jade.
– Pourquoi ?
– Il parait qu'il a fait exploser les revenus du président du Rassemblement national (RN).
– Jade ! Tourne-toi discrètement ! Tu vas tomber des nues, dit François.
– Le Président de la République !
- En chair et en os !
- Je savais qu'il allait venir, mais avec un certain doute, reprend Jade.
– Il a une capacité d'adaptation à donner le tournis aux Caméléons, pointe François.
– Plutôt d'ubiquité déroutante : Près du Peuple et du Fric ! atteste Jade.
( Les commandes arrivent enfin. Dans la salle, le Gotha découvre et savoure la nouvelle formule )
– Alors qu'est-ce t'en penses, Jade ?
- Exquis !
- Moi, dit François, je n'en reviens pas. Cette saveur gustative, du Bonheur aux papilles.
– Dorénavant, on mangera au moins deux fois par semaine « Salade, Tomate, Pognon ! », insiste Jade.
- T'as pris quelle sauce, mon lapin ?
- Sauce Capital mixée Dividendes caramélisées et toi ?
- Capitalisation avec Actions. C'est bourratif, mais intensément bon !
- C'est curieux, cette sensation succulente : Plus on mange, plus on brûle d'envie de faire du fric ! remarque Jade.
– C'est vrai, consent François, j'éprouve le même effet : Oseille ! Encore oseille ! Toujours oseille !
- J'ai vu, dit Jade, un des serveurs apporter au chef de l'Etat une sauce Plus-Value, cela doit être bon ?
– Lui aussi, il a fini son plat « Salade, Tomate, Pognon ! »
- Il a visiblement bien apprécié le nouveau concept culinaire ?
- Il s'y connait pour avoir fréquenté les Rothschild.
( Jade reste un long moment silencieuse )
– Qu'est-ce qu'il t'arrive Jade ?
- Attends ! Je me suis fait mal à la dent en croquant sur un débris dur.
– Tu veux de l'eau ?
- Non !
- C'est certainement un fragment d'os.
– Ça y est je l'ai ! C'est pas un os, Monsieur Troflouze !
– Fais voir ? s'impatiente François.
- (…)
- Eh, tu veux qu'te dise ? s'écrie l'époux. Ton intrus indésirable, c'est un DIAMANT !
- On n'a pas commandé la Galette du Roi, pourtant ?
- Chuut, Mund zu ! Ça s'passe comme ça chez « Salade, Tomate Pognon ! »
- Demain, à la première heure, le p'tit déj' chez qui, ma Chérie ?
- « Salade, Tomate Pognoooon ! »
Texte et illustration : Omar HADDADOU
(Le récit reste fictif)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les femmes sont les premières cibles des attaques de la CAQ

Voici le tract du comité des femmes du Conseil Central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) distribué le 6 décembre 2025 durant la manifestation contre les violences faites aux femmes.
Après 7 ans au pouvoir, l'appui au gouvernement de la CAQ est en chute libre et tout indique que si des élections avaient lieu aujourd'hui, il serait rayé de la carte. C'est dans ce contexte qu'il tente de détourner l'attention de son bilan désastreux en attaquant les syndicats et les personnes immigrantes.
Les compressions et le sous-financement chronique, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, touchent principalement les femmes d'abord comme travailleuses, mais aussi comme utilisatrices. Le retrait de réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux des mécanismes de protection de la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises québécoises touche surtout des travailleuses.
Le durcissement des lois sur la « laïcité », notamment dans les CPE et les écoles primaires et secondaires, touche surtout des femmes et attaque de front leur droit au travail en pleine pénurie de personnel.
Même les attaques antisyndicales visent surtout les femmes.
Déjà, on l'oublie souvent, mais les femmes sont majoritaires dans le mouvement syndical québécois. Ce sont majoritairement des femmes qui ont fait la grève et pris la rue dans les dernières années (Front commun du secteur public, grève des enseignantes, CPE, hôtellerie, etc.).
On pourrait continuer longtemps. Les attaques contre les médecins coïncident avec la féminisation de la profession. Les stages non-rémunérés ? Surtout concentrés dans les milieux à forte prédominance féminine.
FAIRE FRONT POUR LES FEMMES
Face à une conjoncture politique particulièrement hostile, la CSN a choisi de faire front et d'organiser la résistance. Le gouvernement caquiste favorise le privé, réorientant l'État social pour qu'il serve d'abord les intérêts des patrons et de l'élite économique plutôt que la population. Le tout dans un contexte d'austérité et de coupures sauvages.
Notre objectif est de contrer les attaques de la CAQ et de mettre en lumière les vrais besoins de la population et nos solutions. Il faudra frapper assez fort pour s'assurer que, peu importe le parti qui remportera les prochaines élections, l'on change d'orientation pour remettre l'État social au service de la population et que l'on reprenne le chemin de la justice climatique et sociale.
Le mouvement syndical donnera de la voix et multipliera les mobilisations dans les prochains mois. Et ça a commencé par un grand rassemblement qui a réuni plus de 50 000 personnes le 29 novembre dernier, à Montréal. Joignez-vous à nous pour la suite !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 1 sur la Constitution du Québec - Plus de 300 organisations réclament son retrait

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 - Une vaste coalition d'organisations de la société civile québécoise, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le Conseil central du Montréal métropolitain CSN (CCMM-CSN) et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRMM-FTQ), dénonce le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Selon ces groupes, ce projet de loi constitue une menace pour la démocratie, l'État de droit et le régime québécois de protection des droits et libertés.
Rassemblés en conférence de presse au moment où débutent les consultations devant la Commission des Institutions, ils portent la voix de plus de 300 organisations* qui ont endossé une déclaration commune réclamant le retrait complet du projet de loi :
« Le projet de loi No 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, est une attaque contre la démocratie et les droits humains. La démarche est unilatérale et précipitée et elle ne respecte pas les critères démocratiques pour l'élaboration d'une constitution légitime. En outre, elle perpétue une logique coloniale en niant le droit des peuples autochtones à l'autodétermination.
Au lieu d'affronter les questions qui préoccupent les citoyen•nes (la santé, l'éducation, le logement, l'environnement, l'égalité des genres, le coût de la vie, etc.), le gouvernement québécois s'attaque aux droits et libertés, aux contre-pouvoirs et à l'État de droit. Par conséquent, les groupes soussignés exigent le retrait complet du PL1. »
Cette coalition dénonce le processus entourant l'élaboration et le dépôt de ce projet de loi, tout comme les nombreux reculs que prévoit le PL1 en matière de droits et libertés. Considérant l'importance juridique d'une constitution, celle-ci aurait dû être élaborée dans le cadre d'un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. Or, dans le cas du projet de loi n° 1, le gouvernement a choisi d'agir en vase clos, sans consultations publiques préalables et sans tenir compte des critères établis en droit international, qui recommandent des processus élargis, participatifs et respectueux des droits de toutes et tous. Les groupes dénoncent aussi le fait que ce projet de loi a été préparé sans la participation des peuples autochtones, niant leur droit à l'autodétermination et outrepassant le principe de dialogue de nation à nations.
La coalition appelle la population, les mouvements sociaux et tous les groupes de la société préoccupés par la démocratie, l'État de droit et les droits humains à se mobiliser pour exiger que le gouvernement retire le projet de loi no1.
* La liste des organisations exigeant le retrait du PL1 est disponible ici.
Citations
« Pour une rare fois dans sa longue histoire, la LDL a refusé de participer aux consultations sur un projet de loi qui menace les droits et libertés, et ce même si le projet de loi no 1 constitue une attaque délibérée au régime québécois de protection des droits humains. Par cette décision, la LDL dénonce le processus opaque, autoritaire et antidémocratique utilisé par le gouvernement pour préparer et présenter son projet de constitution. Le gouvernement n'a respecté aucun des critères établis par l'ONU pour l'adoption d'une constitution démocratique et légitime. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la société québécoise à le rejeter en bloc. »
– Paul-Étienne Rainville, responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés (LDL)
« Le PL1 réduit considérablement l'espace démocratique, fragilise l'indépendance des mouvements sociaux et menace directement le modèle québécois d'action communautaire autonome (ACA), fondé sur la défense des droits, la participation citoyenne et la transformation sociale. Le retrait complet et immédiat du projet de loi no 1 est la seule voie responsable et raisonnable. »
– Claudia Fiore-Leduc, chargée de campagnes au Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).
« Ce projet de loi constitutionnelle s'inscrit dans une tendance préoccupante d'affaiblissement de l'État de droit. Une Constitution ne peut être légitime que si elle repose sur l'exercice du droit à la participation publique, ce qui exige un processus participatif élargi. C'est d'autant plus important alors que certaines dispositions fragilisent des mécanismes essentiels de contre-pouvoir et restreignent indûment le contrôle judiciaire. »
– Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
« Le projet de constitution s'inscrit dans la série d'initiatives législatives que le gouvernement présente comme autant de démarches d'affirmation nationale, tel que le modèle d'intégration à la nation québécoise (PL 84), adopté en mai 2025. Comme dans ce dernier cas, on propose des changements drastiques, attentatoires aux droits humains et propres à alimenter l'exclusion, le tout à l'issue de processus de consultations bâclés. Nous refusons de jouer dans ce mauvais film. »
– Louis-Philippe Jannard, coordonnateur du volet protection de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
« Le PL1 est une attaque directe aux droits démocratiques et politiques de l'ensemble de la population du Québec. Les attaques contre les syndicats ne doivent pas cacher le fait que c'est toute la société civile que le gouvernement cherche à affaiblir. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Québec se mette à l'abri d'éventuelles contestations judiciaires ou politiques. Une constitution doit non seulement être élaborée par et pour le peuple, elle doit aussi avoir pour objectif de protéger la population contre d'éventuels abus de pouvoir de l'État, et non pas défendre la "souveraineté parlementaire" des gouvernants. Le PL 1 est inamendable et doit être retiré, purement et simplement. »
– Bertrand Guibord, président, CCMM-CSN
« Pour être légitime, une constitution doit être le fruit de consultations en amont de l'ensemble de la population, incluant les groupes marginalisés. Ce type de texte doit tendre à garantir les droits fondamentaux du peuple et à faire obstacle à d'éventuelles tentatives visant à introduire un régime autoritaire. Le Projet de loi 1 échoue sur tous les plans. »
– Anaïs Bussières McNicoll, directrice du programme des libertés fondamentales, Association canadienne des libertés civiles
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lancement du rapport "Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé" dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

Montréal, le 3 décembre 2025 – Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrant݀݀݀·e݀݀݀·s (CTTI) lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de vie travailleuses migrantes et immigrantes depuis l'an 2000.
Conscient des défis, des risques et de la violence accrus auxquels sont confrontées les femmes sans statut d'immigrant régulier, le Comité des femmes a été créé. En raison de ces difficultés, le comité a men݀é une recherche de cinq ans pour documenter l'expérience des femmes sans statut d'immigrante au Québec. Le Comité femmes du présente les résultats de sa recherche intitulée Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Après un long parcours de plus de cinq ans de travail acharné, nous pouvons enfin divulguer le rapport de notre recherche-action participative qui nous permettra de sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes sans statut régulier au Québec.
Les femmes sans statut sont exposées à un risque supplémentaire de violence en raison de leur statut. Elles subissent malheureusement différents types de violence, dont la violence institutionnelle. Elles sont ignorées, discriminées et invisibles, abandonnées face à un système qui les utilise et les rejette. C'est dans ce cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, nous avons décidé de faire entendre notre voix.
Nous avons travaillé pendant longtemps et nous sommes aujourd'hui en mesure de démontrer que nous ne sommes pas une ou deux femmes qui se trouvent dans cette situation d'extrême précarité et d'abandon.
Des salaires impayés, victimes d'abus psychologiques et sexuels. Elles sont exposées à et développent des maladies chroniques en raison du stress auquel elles sont confrontées chaque jour. Condamnées à être loin de leurs familles, de leurs enfants, parce qu'elles sont le pilier économique de leurs familles, mais aussi de ce pays qui les nient. Elles sont
indispensables, mais invisibles.
Statistiques de notre report de recherche
Selon nos recherches, 42% de femmes sans statut vivent de l'harcèlement sexuel et 25% ont été touchées de facon inappropriée au travail.
Seulement 25 % des femmes sans statut ont toujours été payées au moins le salaire minimum.
Plus de 50% des femmes sans statut expérience le vol de salaire.
La grande majorité des femmes (73 %) ayant vécu tristesse, déprime ou désespoir tous les jours ou presque dans les six derniers mois.
QUELQUE CITATIONS DU COMITÉ FEMMES
« Le statut d'immigrant avant tout ! Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas des femmes ! Le travail et l'économie en detriment de nous vie. »
« Ce projet n'est pas seulement un document, c'est la voix d'un mouvement. »
« On porte le Québec sur nos épaules, mais personne ne porte notre sécurité. »
« Invisibles au gouvernement, indispensables dans la réalité. »
« On prend soin de tout, sauf de nous. »
« Nous ne cherchons pas la pitié, seulement la dignité. »
« Toutes les femmes devraient avoir les mêmes droits. »
-
Comité femmes de CTTI
Source : Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Fédération du travail de l’Ontario adopte une résolution « Hot Cargo » contre Israël

La Fédération du travail de l'Ontario (FTO) est devenue la quatrième fédération syndicale canadienne à adopter une résolution contre les marchandises israéliennes la semaine dernière. La résolution déclare que les relations commerciales et les services avec Israël sont considérés comme des « marchandises chaudes » que les travailleurs et travailleuses ne toucheront pas.
28 novembre 2025
Le terme « marchandises chaudes » est utilisé pour définir les marchandises que les travailleurs et travailleuses ne manipuleront pas en raison de leur association avec l'exploitation ou l'oppression.
La Fédération du travail du Nouveau-Brunswick a été la première à adopter une résolution soutenant le boycott d'Israël lorsqu'elle a voté en mai une résolution contre la manutention d'armes destinées à Israël. Depuis lors, trois autres fédérations provinciales du travail ont pris des mesures similaires en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario.
Kevin Levangie, membre du comité directeur national de Travailleurs pour la Palestine Canada, a déclaré que les travailleurs et travailleuses sont peut-être habitué·es à voir le terme « cargaison brûlante » utilisé pour décrire les marchandises fabriquées par des briseurs de grève, mais que cette tactique de pression peut être utilisée de manière plus large.
À St. John's, au Nouveau-Brunswick, la ville natale de M. Levangie, les travailleurs et travailleuses ont une longue tradition de refus de manipuler des marchandises associées à des violations des droits humains. En juillet 1979, les dockers de St. John's ont refusé d'expédier des conteneurs d'eau lourde destinés à être utilisés par le gouvernement argentin dans un réacteur nucléaire. À l'époque, l'Argentine était dirigée par une dictature militaire connue pour faire disparaître ses citoyen·nes.
Plus récemment, les travailleurs et travailleuses du même port ont refusé de transporter des cargaisons militaires à destination de l'Irak lors de l'invasion américaine de 2003.
« L'isolement international de tout pays qui commet des violations des droits humains est un outil très puissant dont nous disposons », a déclaré Levangie. « Je pense qu'il faudra une pression venant de la base, une pression des travailleurs et travailleuses, pour imposer cet isolement international. »
En octobre 2023, le gouvernement israélien a déclaré la guerre au Hamas à Gaza après que plus de 1 300 Israélien·nes ont été tué·es lors d'une attaque terrestre. La riposte des Forces de défense israéliennes a entraîné la mort de plus de 67 000 Gazaoui·es, selon les autorités sanitaires palestiniennes.
« L'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre était une atrocité », a écrit Danny Kavanaugh, président récemment retraité de la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse, dans une lettre signée par Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et envoyée au premier ministre Mark Carney. « La punition collective infligée à des millions de Palestinien·nes en réponse à cette attaque est un crime d'une ampleur historique. »
Selon l'opinion publique, la pression pour qu'Israël soit tenu responsable de ses crimes à Gaza s'intensifie au Canada. En août, un rapport de l'Institut Angus Reid a révélé que la sympathie des Canadien·nes pour les Palestinien·nes avait doublé depuis qu'Israël avait déclaré la guerre en 2023.
En août, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a annoncé que le Canada « gèlerait en 2024 tous les permis existants qui auraient pu permettre l'utilisation de composants militaires à Gaza ». Malgré cela, des rapports réalisés par World Beyond War, le Mouvement de la jeunesse palestinienne, Canadians for Justice and Peace in the Middle East et la coalition Arms Embargo Now ont montré que des armes continuaient d'arriver en Israël via les États-Unis. M. Levangie a déclaré que c'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les Canadien·nes devaient continuer à agir en solidarité avec la Palestine.
« Les Canadien·nes sont complices de ce génocide en cours, et il existe des moyens de résister et de s'opposer au génocide et à l'apartheid », a-t-il déclaré. Labour For Palestine, qui a poussé les organisations syndicales à adopter des résolutions « hot cargo » à l'égard d'Israël, prévoit de continuer à renforcer la dynamique contre la manutention des biens et services à destination de ce pays. L'organisation espère que le Congrès du travail du Canada, qui représente plus de trois millions de travailleurs et travailleuses, soutiendra la campagne « Arms Embargo Now » (Embargo sur les armes maintenant) et adoptera une résolution « hot cargo » à l'échelle nationale lors de son congrès qui se tiendra l'année prochaine.
« Nous continuerons à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent », a déclaré M. Levangie. « Cela signifie continuer à demander à nos syndicats de signer la campagne BDS, continuer à travailler avec les membres de la base pour coordonner le refus de traiter les marchandises et les services liés à Israël, et nous poursuivrons également nos efforts de sensibilisation. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La COP30 entre palabres officielles et mobilisation populaire

La COP30 [1] s'est tenue à Belém, capitale de l'Etat brésilien du Pará, du 10 au 22 novembre. Elle avait la redoutable tâche de faire oublier les pitoyables résultats auxquels étaient parvenues les précédentes éditions de cette conférence annuelle.
Tiré de A l'Encontre
2 décembre 2025
COP30, le marketing et la réalité.
Pour rappel : la COP21 qui s'était tenue à Paris en 2015 avait abouti à un accord prévoyant une réduction de l'émission des gaz à effet de serre (GES) capable de contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels [tout] en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels » [2]. Mais, depuis, en dépit d'engagements répétés de COP en COP, aucun effort sérieux n'a été accompli dans cette voie. Entre 1990 et 2023, la part des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) dans le mix énergétique mondial, dont la combustion est le principal responsable des émissions des GES facteurs du changement climatique, est restée pratiquement constante : elle continue à se payer la part du lion (elle n'a régressé que de 81,8 à 80,7 %) alors que la production d'énergie primaire mondiale s'est accrue de 74 % entre-temps, en passant de quelque 364 millions à 633 millions de terajoules [3]. De la sorte, il ne faut pas s'étonner que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ait dû constater qu'en 2024 la hausse de la température moyenne du globe s'est située entre 1,34 et 1,41°C par rapport aux niveaux préindustriels et que, dans ces conditions, il y a 70 % de chances que le seuil des 1,5°C soit franchi par la moyenne quinquennale entre 2015 et 2034 [4].
Présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière émiratie Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la COP28 (2023) a lancé une véritable OPA des industries productrices de combustibles fossiles destinée à reporter aux calendes grecques l'abandon définitif de l'extraction et de la consommation de ces combustibles, le tout au nom du droit au développement des États « en voie de développement » et en pratiquant un déni cynique des données scientifiques. Opération largement réussie : si la résolution finale a fait allusion aux énergies fossiles, c'est pour simplement demander aux parties de « s'éloigner des combustibles fossiles [transitioning away from fossile fuels] de manière à atteindre le zéro net en 2050 » sans cependant fixer aucun calendrier, aucune contrainte ni aucune sanction a fortiori en cas de non-respect des engagements, les États et les compagnies charbonnières, pétrolières et gazières (dont les projets de mise en exploitation de nouveaux sites dans les prochaines années se comptent par dizaines) restant les seuls maîtres en la matière [5]. L'essentiel est acquis : il n'est pas question de sortir des énergies fossiles car l'on sait que les transitions peuvent durer longtemps…voire éternellement.
Siégeant à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, la COP29 (2024) aura été la troisième à se tenir successivement dans un État producteur de pétrole, les représentants de grands groupes pétroliers (Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergie, etc.) et leurs lobbyistes faisant désormais partie des délégations officielles [6], de manière à pouvoir encore mieux verrouiller ou orienter les négociations et les décisions. Si bien qu'« au moment où António Guterres, à Bakou, indiqu[ait] qu'il faut réduire de 30 % la production d'hydrocarbures d'ici à 2030, l'hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan, selon le rapport de l'ONG Oil Change International, [avait] pour objectif d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 14 % d'ici à 2035. Et le futur hôte de la COP30, le Brésil [désormais huitième producteur mondial de pétrole], tabl[ait] sur une croissance de 36 % » [7].
Et le bilan de ces COP n'aura été guère plus fameux ou moins douteux sur d'autres points en discussion dans le cadre de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, traité datant de 1992). Ainsi les États du Nord global ont-ils persisté à se montrer peu disposés à prendre en charge les dommages et les pertes infligés par le changement climatique aux États du Sud global. Le Fonds vert créé en 2009 lors de la COP19 (Copenhague) était destiné à permettre à ces derniers de financer leur lutte contre le réchauffement climatique, tout en faisant payer aux premiers leur responsabilité historique dans la production de celui-ci. La COP21 (Paris) avait décidé de porter l'abondement à ce fonds à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Or, il n'a atteint à cette date qu'à peine les quatre cinquièmes de cette somme. Et réellement beaucoup moins, à peine le cinquième. Car les pays du Nord global ont souvent « confondu » leur contribution à ce Fonds avec leur aide publique au développement, alors qu'il était prévu que la première vienne en sus de la seconde. Ou encore, ils ont avancé les fonds dus non pas sous forme de dons mais de prêts !
Et l'accord sur lequel s'est conclue la CP29 a constitué un véritable camouflet pour le Sud global, notamment les « pays les moins avancés » qui sont les plus menacés par les effets du changement climatique. Alors qu'un groupe d'experts international avait estimé nécessaire de porter les transferts annuels destinés à leur permettre d'entamer leur « transition énergétique » à la hauteur de 1 000 à 1 300 milliards de dollars d'ici à 2035, les pays du Nord ne se sont engagés que sur le montant de 300 milliards de dollars, sans d'ailleurs préciser s'il s'agirait de dons ou de prêts [8].
Nouvelle COP, nouveau fiasco !
Héritière d'un tel du bilan désastreux, la COP30 a de surcroît été placée sous de mauvais auspices. Le 20 octobre, à trois semaines de son ouverture, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) a approuvé… un projet d'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Or sa réalisation menacerait directement cette dernière en cas de marée noire provoquée par un accident survenant sur les forages pétroliers ; et, plus largement, elle contribuerait à son dépérissement par le changement climatique qu'elle accélérerait [9] ! Ce qui n'a pas empêché le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, puissance invitante de la COP, de déclarer en ouverture de celle-ci, qu'elle serait « la COP de la vérité » et qu'« accélérer la transition énergétique et protéger la nature sont les deux moyens les plus efficaces de lutter contre le réchauffement climatique », en proposant même que soit élaborée « une feuille de route pour, de manière juste et planifiée, inverser la déforestation, surmonter la dépendance aux combustibles fossiles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs » [10]. On ne peut imaginer meilleur exemple du double langage, digne d'Orwell, que tiennent tous les pays producteurs d'hydrocarbures dont le Brésil fait partie. Double langage doublé de schizophrénie : on concède d'un côté qu'il faut de toute urgence diminuer autant que possible les émissions de GES tandis que, de l'autre, on étend le champ des extractions pétrolières qui alimentent la principale source de ces émissions.
De plus, selon l'Accord de Paris, tous les cinq ans, les Etats signataires doivent présenter des engagements de réduction de leurs émissions de GES (appelés « contributions déterminées au niveau national » ou CDN) impliquant en principe une diminution de ces dernières par rapport à celles autorisées au cours du quinquennat précédent. Ce devait donc être le cas à Belém. Or, à l'ouverture de la COP, seuls 98 des 194 Etats parties prenantes, représentant 72,7 % des émissions mondiales, avaient remis leurs CDN. Plusieurs « poids lourds » (dont l'Inde et les Etats-Unis, ces derniers s'étant à nouveau retirés de la CCNUCC après la réélection de Donald Trump) faisaient défaut. Seules les CDN de la Norvège et du Royaume-Uni étaient conformes aux exigences de l'Accord de Paris. Le tout, largement insuffisant, devait conduire droit à une élévation de la température moyenne du globe comprise entre 2,3 et 2,5°C d'ici à la fin du siècle selon une étude de l'ONU [11].
Si les participants à la COP30 sont rapidement tombés d'accord sur son ordre du jour, c'est parce que celui-ci a délibérément écarté les sujets principaux, ceux qui fâchent : la demande d'intensification de la réduction des émissions de GES et celle d'une transparence accrue des efforts consentis en la matière (soutenues par l'Union européenne), la demande de suppression des barrières douanières liées au climat (du type de la taxe carbone instituée par l'Union européenne) soutenue par la Chine et l'Inde et la demande d'une augmentation des transferts financiers du Nord global vers le Sud global, tous sujets renvoyés à des discussions non plénières menées en coulisse, dans l'espoir qu'elles aboutissent avant la fin de la tenue de la COP [12]. Espoir en définitive largement déçu.
En effet, la déclaration finale, adoptée sans l'approbation de l'Union européenne, de la Suisse, de la Colombie et du Panama, ne comprend aucune feuille de route planifiant la sortie des énergies fossiles ni même aucun engagement d'ouvrir ultérieurement des négociations à ce sujet. Elle se contente de renvoyer à l'accord conclu deux ans plus tôt à Dubaï, demandant aux parties prenantes de s'engager dans une transition en vue de la sortie des énergies fossiles – autrement dit de se hâter lentement, sans prendre aucun engagement ni quant au rythme ni quant au terme du processus. Et la déclaration finale fait de même complètement silence sur la planification de la fin de la déforestation, qui joue un rôle tout aussi important dans le processus de changement climatique. Autrement dit, elle est muette sur les deux principaux moteurs de ce dernier. En d'autres termes, elle ne dit rien sur ce qui devrait pourtant constituer son centre de préoccupations principal voire exclusif. Les lobbyistes des compagnies pétrolières et gazières et les principaux pays producteurs d'hydrocarbures présents (soit la Russie, l'Arabie saoudite, le Canada, l'Irak, la Chine, l'Iran et les Emirats arabes unis) ont une fois de plus bien œuvré. Tandis que la Chine aura obtenu l'ouverture d'un « dialogue » sur le commerce mondial qui prélude au démantèlement des taxes carbone frappant les importations notamment au sein de l'Union européenne.
Au titre des seules maigres avancées du texte, on peut compter, d'une part, le triplement des fonds consacrés à l'adaptation au changement climatique, pour faire face aux canicules et aux inondations, qui devrait passer de 40 à 120 milliards de dollars d'ici 2035 ; bien que les besoins actuels soient déjà évalués à quelque 310 à 365 milliards de dollars et que seuls 26 milliards aient été versés en 2023 [13]. Et on en reste toujours aux seuls 300 milliards par an promis à Bakou d'ici à 2035 pour permettre au Sud global d'entamer sa « transition énergétique », du fait notamment d'un blocage de l'Union européenne sur la question. S'y ajoute, d'autre part, l'instauration à l'initiative du Brésil d'un Tropical Forest Forever Facility (TFFF : Fonds pour des forêts tropicales éternelles), un fonds d'investissement destiné à rémunérer les pays préservant leurs écosystèmes forestiers, qu'il s'agira encore d'abonder à hauteur de 125 milliards de dollars en faisant appel à des contributions publiques, privées et philanthropiques [14]. Dans les deux cas, il s'agit de nouvelles promesses dont seul demain nous dira si et dans quelle mesure elles auront été tenues.
Au terme de ce nouveau fiasco diplomatique, on peut se demander à quoi servent en définitive les COP. Réponse : à permettre aux (ir)reponsables qui nous gouvernent de « s'agiter » et de « discourir » devant les médias du monde entier pour faire semblant d'avancer… tout en restant sur place, voire en régressant. C'est ce qu'avait déjà constaté Greta Thunberg à la veille de la COP26 (Glasgow) : « Blabla. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui semblent géniaux mais qui n'ont mené à aucune action jusqu'à présent » [15]. C'est à une conclusion similaire qu'est parvenu le Réseau Action Climat-International, qui rassemble plus de 2000 organisations de la société civile, au terme de la COP30 : « Les gouvernements n'ont pas présenté de plan de réponse mondial concret pour combler le déficit d'ambition et se sont seulement engagés à mettre en place des processus supplémentaires pour y remédier »[16]. Donc aucune solution concrète mais la multiplication de procédures promettant de parvenir à des solutions. Autant dire : « Pour l'instant, on ne bouge pas mais on vous promet de mettre en place des mécanismes qui nous permettront sans doute de bouger demain »…
Or les conséquences de cette inaction et procrastination seront dramatiques et se font sentir d'ores et déjà. Les émissions de GES vont continuer à augmenter et la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone va s'accroître : en 2024, elle a déjà atteint le niveau de 424 ppm (particules par million) alors qu'il aurait fallu les maintenir au niveau de 350 ppm (son niveau en 1990) pour être assuré que la température moyenne du globe ne s'élève pas de plus de 1,5°C par rapport à celle de l'ère préindustrielle (la « révolution industrielle » marquant le parachèvement des rapports capitalistes de production). La température moyenne du globe va continuer à augmenter : les dix années depuis 2015 ont déjà été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Avec toute une série de conséquences plus désastreuses les unes que les autres : réchauffement des océans et dégradation des forêts (donc affaiblissement des deux principaux puits naturels de carbone) ; augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements atmosphériques extrêmes ; feux de forêts immaîtrisables augmentant encore les rejets de dioxyde de carbone ; accroissement du nombre des décès prématurés dus à la chaleur et à l'humidité de l'air mais aussi à la pollution atmosphérique par les particules dont sont chargés les GES [17] ; diminution des rendements agricoles synonymes d'augmentation de la précarité alimentaire des populations déjà les plus victimes de la malnutrition et de la disette, donc augmentation de la famine dans le monde ; etc. [18].
Belém, une préfiguration de l'immonde de demain… et des luttes contre son avènement
Au demeurant, si les participants à la COP30 avaient voulu se convaincre de la nécessité de changer de cap immédiatement, il leur aurait subi de mettre le nez dehors. C'est que le changement climatique et ses effets sont déjà très nettement sensibles à Belém même. Ses maxima de température se sont accrus de 1,9°C au cours des cinquante dernières années. Une étude conjointe de l'ONG The Carbon Plan et du Washington Post prévoit qu'en 2050 Belém risque de connaître 222 jours de chaleur extrême par an – de quoi la rendre largement inhabitable. D'ores et déjà, le changement climatique s'y traduit aussi par des épisodes de précipitations extrêmes plus fréquents et plus intenses : 40 % des épisodes de pluie intense dans la région de Belem enregistrés entre 1980 et 2020 ont eu lieu depuis 2011. Ils affectent notamment les habitats précaires des bidonvilles qui constituent la périphérie de l'agglomération, où s'entasse une population paupérisée laissée à l'abandon par les pouvoirs publics locaux. Et, bien qu'elle se soit tenue loin de ces quartiers déshérités en plein cœur de l'agglomération, la COP30 n'aura pas échappé à cette dégradation environnementale : dans le Parque da Cidade, spécialement construit à son effet, la température s'élève jusqu'à 40°, si bien que personne ne pouvait s'y tenir une journée entière. Pourtant, dans une région riche de 16 000 espèces différentes d'arbre, les organisateurs locaux de la COP n'ont rien trouvé de mieux pour tenter de rafraîchir le lieu en le végétalisant que d'y installer… des arbres métalliques couverts de plantes [19 ! Un parfait exemple de cette civilisation minéralisée dont ils sont parties prenantes, qui ne fait qu'accroître encore les effets désastreux du changement climatique dont ils sont responsables.
Bien que grosse de 1 300 000 habitants, Belém est entourée par la forêt amazonienne qui, comme toutes les autres forêts tropicales, joue un rôle fondamental dans l'établissement et le maintien des équilibres climatiques globaux et se trouve néanmoins directement menacée par le changement climatique. Sous l'effet de ce dernier et de la poursuite de la déforestation à l'initiative de l'agrobusiness et d'autres projets de mise en valeur capitaliste (activités minières, ouvertures de routes, de voies ferrées et de voies navigables, etc.), l'Amazonie risque en effet de se transformer de forêt tropicale en savane, privant ainsi la Terre d'un de ses principaux « poumons », capable d'absorber le dioxyde de carbone atmosphérique et d'émettre de l'oxygène. Une mutation catastrophique à terme pour la planète mais qui menace immédiatement les populations autochtones, regroupant quelque 34 millions de personnes, vivant souvent de manière ancestrale en Amazonie des ressources renouvelables de cette dernière selon des modes de production respectueux du milieu et par conséquent durables.
Manifestation du MST opposant à l'orientation officielle de la COP.
C'est ce dont a voulu témoigner le 11 novembre la Marche pour la santé et le climat, organisée par des membres de ces populations autochtones. Elle s'est achevée devant le site de la COP, où ses participants se sont heurtés aux forces d'insécurité chargées de « protéger » cette dernière contre de pareils « intrus » ayant cependant tout lieu de se considérer comme directement concernés par ses enjeux. Cependant, une partie est parvenue finalement à forcer ce barrage pour s'exprimer dans l'enceinte même de la COP [20]. Ainsi, alors que les lobbyistes des principales compagnies pétrolières et gazières, intégrés aux délégations officielles (ils étaient encore plus nombreux qu'à Bakou, la seule délégation française en comptait vingt-deux, dont le PGG de TotalEnergie lui-même !) ont eu leur place assurée au sein de la COP et ont pu participer pleinement aux débats de manière à les bloquer ou à les faire dévier dans le sens de leurs intérêts, les représentants des peuples autochtones, qui comptent parmi les principales victimes directes des activités des précédents, ont dû affronter la répression policière pour ne s'y exprimer qu'un court moment. Et cela en dépit de l'engagement pris par Lula lors de l'ouverture de cette COP : « Nous serons inspirés par les peuples autochtones et les communautés traditionnelles, pour qui la durabilité a toujours été synonyme de vie »[21].
Le seul signe d'espoir est d'ailleurs venu des mobilisations populaires à l'extérieur de la COP et contre celle-ci. Car, contrairement aux trois COP précédentes au cours desquelles les autorités égyptiennes, émiraties et azerbaïdjanaises avaient interdit toute protestation publique, à Belém les manifestations se sont succédé jour après jour. Celle du 15 novembre, particulièrement importante, grosse de 50 000 à 70 000 personnes, a réuni autour de représentants de peuples autochtones de l'Etat de Para, exigeant la protection de leurs terres, des militants venus du monde entier : des paysans du Manipur, un Etat du Nord-Est de l'Inde, en proie à des projets d'exploitation pétrolière et d'huile de palme, mais aussi des Australiens venus protester contre l'inaction climatique de leur gouvernement, pourtant censé coparticiper à l'organisation de la prochaine COP qui se tiendra à Antalya en Turquie. Et le cortège a porté en terre les trois cercueils du charbon, du pétrole et du gaz naturel [22]. S'il faudra bien plus que des actes symboliques de ce genre pour en venir à bout, du moins cette manifestation aura-t-elle indiqué la seule voie pour y parvenir : celui de la plus large mobilisation possible des peuples sur le plan international pour mettre fin à l'activité des industries promotrices des énergies fossiles et, plus largement, de tout l'écocide capitaliste.
Cette manifestation a été en fait un des hauts moments d'un Sommet des peuples qui s'est tenu une semaine durant en marge de la COP. Il aura réuni quelque 70 000 participants, très divers : en plus des délégations de peuples autochtones amazoniens, des délégué-es du Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) brésilien à côté de ceux et celles de la Fédération de tous les paysans du Népal (ANPFa), des petits agriculteurs africains et des pêcheurs asiatiques pratiquant une pêche artisanale, des membres de mouvements se battant pour la justice environnementale ou la souveraineté alimentaire, etc. Un rassemblement à forte proportion de femmes et de jeunes ; les premières parce qu'elles portent le plus souvent le fardeau de la gestion de l'eau, de la terre et de l'alimentation ; les seconds parce qu'ils sont les principaux concernés par la détérioration de l'œcumène qui se profile dans les décennies à venir. Se sont ainsi succédé, en sus des manifestations de rues, prises de paroles et débats, mais aussi cérémonies culturelles autochtones, marchés paysans, espaces d'agro-écologie, moments conviviaux autour de cuisines populaires, etc. Finalement, « le Sommet a produit des résultats concrets et de grande portée : un appel renouvelé à la reconnaissance de la dette climatique et aux réparations ; un front uni des peuples contre les marchés du carbone et la géo ?ingénierie ; le renforcement des alliances entre mouvements paysans, peuples autochtones, jeunes, féministes et syndicaux ; des propositions claires pour des systèmes alimentaires publics, la démocratie énergétique, la réforme agraire et les droits territoriaux ; ainsi que des plans coordonnés pour des mobilisations dans le Sud global » [23]. Gageons que ce Sommet sera en mesure d'inaugurer un nouveau cycle de résistance mondiale contre les effets désastreux du changement climatique, une résistance destinée à fédérer tous ceux et celles qui défendent la vie contre la dictature mortifère du capital. (2 décembre 2025)
Alain Bihr
auteur de L'écocide capitaliste,
Editions Page 2 & Syllepse
à paraître en février 2026
[1] COP, acronyme de l'anglais Conference of Parties, désigne en l'occurrence la conférence annuelle, qui se tient généralement courant novembre, réunissant l'ensemble des parties signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en juin 1992. La COP30 est la trentième conférence de ce type organisée depuis 1995.
[2] ONU, Accord de Paris, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf, 2015, page 3.
[3] Agence internationale de l'énergie (AIE), https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource consulté le 28 novembre 2024.
[5] Daniel Tanuro, « Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », https://alencontre.org, 15 décembre 2023.
[6] Emmanuel Clevenot, « La COP29 parasitée par plus de 1 770 lobbyistes fossiles », https://reporterre.net, 15 novembre 2024.
[7] A l'Encontre, « COP 29 : un don de la Trinité », https://alencontre.org, 13 novembre 2024.
[8] Emmanuel Clevenot, « Fin de COP29 : les pays riches imposent un accord “néocolonialiste” », https://reporterre.net, 24 novembre 2024 ; Jeanne Cassard, « L'accord pour le climat attribue “une somme ridicule” aux pays du Sud », https://reporterre.net, 25 novembre 2024.
[9] Raphaël Bernard, « Avant la COP, le Brésil autorise de nouvelles explorations pétrolières », https://reporterre.net, 21 octobre 2025.
[10] Paula Gosselin, « “La COP de la vérité” : au Brésil, Lula lance les négociations climat », https://reporterre.net, 7 novembre 2025.
[11] Paula Gosselin, « La COP démarre ; tout comprendre en 5 points », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.
[12] Paula Gosselin, « A mi-chemin de la COP30, le grand réveil tarde à se manifester », https://reporterre.net, 15 novembre 2025.
[13] Audrey Garic, « “Nous pesons moins de 1 % des émissions et pourtant nous souffrons le plus” : à la COP30, les pays du Sud veulent plus d'argent pour s'adapter au réchauffement », Le Monde, 21 novembre 2025.
[14] Emmanuel Clevenot et Paula Gosselin, « Coup de force à la COP30 : énergies fossiles et déforestation exclues d'un accord décavant », https://reporterre.net, 22 novembre 2025.
[15] Cité par Ian Angus, « Emission reductions : Promises, promises, promises », https://climateandcapitalism.com, 8 novembre 2025.
[16] Cité par Audrey Garic et Perrine Mouterde, « Avec un accord sans ambition, la COP30 sauve le multilatéralisme mais néglige l'urgence climatique », Le Monde, 22 novembre 2025.
[17] Cf. « Climate change costs millions of lives each year », climateandcapitalism.com, 3 novembre 2025.
[18] Pour des données détaillées sur tous ces phénomènes, cf. Michael Roberts, « COP 30 : it's no joke », https://thenextrecession.wordpress.com/2025/11/23/cop-30-its-no-joke.
[19] Raphaël Bernard, « Le chaos climatique sévit déjà à Belém, ville hôte de la COP30 », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.
[20] Raphaël Bernard, « Des militants autochtones forcent l'entrée de la COP30 : “On a le droit d'être entendus” », https://reporterre.net, 13 novembre 2025.
[21] Paula Gosselin et Raphaël Bernard, « En dépit des promesses, la COP30 prise d'assaut par les lobbies du pétrole », https://reporterre.net, 14 novembre 2025.
[22] Raphaël Bernard, « “Quel désastre !” : les peuples autochtones vent debout contre le COP30 des lobbies », https://reporterre.net, 17 novembre 2025.
[23] Pramesh Pokharel, « COP 30 : Plus de 70 000 personnes participent au Sommet des Peuples à Belém et rejettent 30 ans de greenwashing ! », https://viacampesina.org/fr/cop30-plus-de-70-000-personnes-participent-au-sommet-des-peuples-a-belem-et-rejettent-30-ans-de-greenwashing/#:~:text=climatique%20et%20environnementale-,COP%2030%20%3A%20Plus%20de%2070%20000%20personnes%20participent%20au%20Sommet,rejettent%2030%20ans%20de%20greenwashing%20!&text=Ce%20mois%20de%20novembre%2C%20les,battant%20de%20la%20r%C3%A9sistance%20mondiale, 19 novembre 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« C’est une ville syndicale » : Zohran Mamdani et Bernie Sanders rejoignent les grévistes de Starbucks sur la ligne de piquetage

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, ont rejoint lundi les travailleurs de Starbucks en grève sur leur ligne de piquetage afin d'exiger que le géant du café conclue enfin une convention collective équitable avec son personnel syndiqué, après des années de tactiques de retardement.
S'exprimant devant une succursale à Brooklyn, Mamdani a déclaré que New York était une « ville syndicale » et a promis de continuer à se joindre aux lignes de piquetage même après son entrée en fonction le 1er janvier. En réponse à une question de Democracy Now !, Sanders a affirmé que la campagne victorieuse de Mamdani pour la mairie constituait un modèle pour le Parti démocrate, en mettant au cœur de son programme le coût de la vie et les droits des travailleurs. « Nous avons la base populaire de l'Amérique derrière nous », a-t-il déclaré.
Les travailleurs syndiqués de Starbucks à travers les États-Unis ont lancé une grève générale illimitée le 13 novembre, accusant l'entreprise de pratiques antisyndicales illégales. Starbucks Workers United négocie un contrat avec la compagnie depuis le début de l'an dernier. La ligne de piquetage de lundi s'est tenue quelques heures après que Starbucks a conclu un règlement de 38 millions de dollars avec la Ville de New York pour des violations du droit du travail, notamment le refus de fournir aux employés des horaires stables et prévisibles.
New York, le 2 décembre 2025. | tiré de democracy now !
https://www.democracynow.org/2025/12/2/starbucks
AMY GOODMAN : C'est Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman, avec Juan González.
Lundi, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders ont rejoint des travailleurs en grève sur une ligne de piquetage devant un Starbucks à Brooklyn. Le rassemblement a eu lieu peu après que la ville de New York a annoncé que Starbucks avait accepté de verser plus de 35 millions de dollars à quelque 15 000 travailleurs, dans ce qui est considéré comme le plus important règlement de protection des travailleurs de l'histoire de New York.
Voici Zohran Mamdani, qui sera assermenté comme maire le 1er janvier.
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Bonjour à toutes et à tous.
LA FOULE : Bonjour !
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : C'est un plaisir d'être ici sur une ligne de piquetage avec les travailleurs de Starbucks, comme ceux à ma droite et à ma gauche, des travailleurs qui affrontent le froid de décembre et le froid bien plus mordant encore des pratiques antisyndicales dans cette ville et à travers ce pays, ainsi que la peur qui accompagne ces tactiques de bris d'union, alors qu'ils exigent les meilleures conditions de travail qu'ils méritent, comme tant de travailleurs à travers cette ville. Ce ne sont pas des demandes de cupidité. Ce sont des demandes de décence. Ce sont des travailleurs qui demandent simplement d'être traités avec le respect qu'ils méritent. Ils demandent que leur travail soit compensé d'une manière qui leur permette de construire une vie digne. Et je les rejoins parce que je veux faire tout ce que je peux pour montrer ma solidarité, mais aussi parce que je sais que trop souvent les voix des travailleurs ordinaires ne sont pas amplifiées avec le volume dont bénéficie si facilement la direction. Je veux partager quelques chiffres avec vous cet après-midi, des chiffres qui, je l'espère, mettront cette lutte en perspective. 36,2 milliards. C'est le montant des revenus que Starbucks a générés l'an dernier. 95,8 millions. C'est le montant du salaire total reçu par le PDG de Starbucks, Brian Niccol, pour quatre mois de travail l'an passé. 6 666. C'est combien de fois son salaire dépasse celui du barista moyen de Starbucks. 400. C'est le nombre de violations des lois du travail que le NLRB a constatées chez Starbucks.
LA FOULE : Honte !
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : 120. C'est le nombre de magasins actuellement en grève, et 85 le nombre de villes dans lesquelles ces grèves se déroulent. Ces chiffres nous montrent une réalité à deux volets : d'un côté, l'avidité et l'enrichissement corporatifs au détriment de leurs propres travailleurs, et de l'autre, une solidarité remarquable de la part de ces mêmes travailleurs, exploités et maltraités encore et encore.
La solidarité, autant que nous en parlons, n'est pas un concept abstrait. Elle se mesure dans les piquets tenus sous la pluie et le verglas. Elle se mesure dans les loyers que les travailleurs ne savent pas s'ils pourront payer, dans les frais de garde d'enfants qu'ils ne savent pas s'ils pourront assumer. Et elle se mesure dans ces inconnus qui, sans jamais s'être rencontrés, se donnent la main pour lutter pour un objectif commun et un avenir juste.
Je suis fier d'être ici aux côtés d'élus exceptionnels, au niveau municipal, au niveau de l'État, et aussi — à ma gauche — du sénateur Bernie Sanders du Vermont, parce que nous sommes tous unis dans la conviction que nous devons construire un New York où chaque travailleur peut mener une vie décente. Nous devons construire un New York où nos paroles ne sonnent pas creux lorsque nous disons que cette ville est une ville syndicale. Et nous devons construire un New York où les travailleurs qui la font vivre peuvent se permettre d'y vivre. Merci beaucoup. Et maintenant, le sénateur Bernie Sanders.
SÉN. BERNIE SANDERS : C'est un honneur pour ma femme et moi d'être ici avec vous pour soutenir les travailleurs de Starbucks en grève, qui disent clairement à cette entreprise qu'ils en ont assez de la cupidité corporative et assez du bris d'union.
Ce que le maire élu vient de souligner, c'est que ce qui se passe ici sur cette ligne de piquetage se passe partout dans ce pays. Nous vivons dans une économie où les plus riches n'ont jamais été aussi riches. Un seul homme possède plus de richesse que les 52 % des ménages américains les plus pauvres.
LA FOULE : Honte ! Honte !
SÉN. BERNIE SANDERS : Et pendant que les PDG se gavent de salaires inimaginables, 60 % de notre population, au Vermont, à New York, partout dans ce pays, vit d'un chèque de paie à l'autre, en luttant pour payer le loyer, les soins de santé, ou pour mettre de la nourriture sur la table. Et Zohran et moi sommes déterminés à bâtir une nation et une économie qui fonctionnent pour nous tous, pas seulement pour le 1 %.
Je veux remercier les travailleurs de Starbucks pour leur courage ici et partout dans le pays. Nous allons gagner. Merci beaucoup.
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : En arrivant, Bernadette m'a demandé : « Quand vas-tu arrêter d'aller à des manifestations et devenir maire ? » Et j'ai répondu : « Techniquement, le 1er janvier, je serai le maire. » Mais je veux aussi dire une chose : quand je deviendrai maire de cette ville, je continuerai à marcher sur les lignes de piquetage avec les travailleurs dans les cinq arrondissements.
Je l'ai dit à plusieurs syndicats présents aujourd'hui : nous voulons créer une administration qui se caractérise par un soutien constant aux travailleurs à chaque étape. Et parfois, dans la lutte pour la décence et la dignité, la voix des travailleurs est étouffée. Et quand vous êtes le maire de New York, vous avez une plateforme — une plateforme pour dénoncer les centaines de violations des lois du travail commises par Starbucks, une plateforme pour dire que oui, nous célébrons le règlement historique de 28 millions obtenu par le DCWP, mais que nous nous engageons aussi à continuer de financer et de fournir la volonté politique nécessaire pour tenir ces entreprises responsables.
Avant de prendre une question, j'aimerais qu'on applaudisse les travailleurs de Starbucks eux-mêmes.
LA FOULE : [acclamations]
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Nous avons Kai Fritz à ma gauche, Noor Hayat à ma droite, et tant d'autres travailleurs qui nous inspirent chaque jour. Merci, avant même de commencer la période de questions.
AMY GOODMAN : Zohran, puis-je poser une question — beaucoup de travailleurs de cette ville sont des immigrants. Lorsque vous avez rencontré le président Trump, avez-vous obtenu une concession concernant les descentes d'ICE et leur non-intervention dans cette ville ? Puis j'ai une question pour Bernie Sanders : pensez-vous que si votre « Fight Club » réussit, avec d'autres sénateurs qui soutiennent votre mission pour remplacer le chef de la minorité Chuck Schumer, cela ouvrirait un espace pour des candidats progressistes qui représentent ce que vous défendez aujourd'hui ?
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Lorsque j'ai rencontré le président, j'ai été très clair : ces descentes sont cruelles et inhumaines. Elles ne servent en rien la sécurité publique. Ma responsabilité est d'être le maire de chaque personne qui considère cette ville comme son foyer — et cela inclut des millions d'immigrants, dont je fais partie. Je suis fier d'être le premier maire immigrant de cette ville depuis des générations, et plus fier encore de vivre selon les idéaux symbolisés par la statue que nous avons dans notre port et par les valeurs que nous proclamons depuis longtemps, mais que nous avons trop souvent négligé d'enraciner dans nos pratiques quotidiennes. Voilà le maire que je serai.
SÉN. BERNIE SANDERS : Concernant ce que nous essayons de faire au Sénat, il n'est pas secret qu'il existe des divergences d'opinion au sein du caucus démocrate. Je suis indépendant, mais je caucuse avec les démocrates. Et cette différence s'est manifestée ici même, dans la récente élection municipale à New York.
À mes yeux, Zohran Mamdani a mené l'une des plus grandes campagnes de l'histoire moderne de ce pays. Il a commencé à 1 %, et il a gagné. Et comment a-t-il gagné ? Il a gagné en rassemblant des dizaines de milliers de bénévoles qui ont frappé aux portes. Il a gagné parce qu'il a eu le courage de parler des oligarques et de dire que lorsqu'il deviendrait maire, il se tiendrait aux côtés des travailleurs de Starbucks et de tous les travailleurs de cette ville.
Et ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, dans les courses au Congrès et au Sénat, c'est un nombre croissant de candidats qui se lèvent exactement comme Zohran l'a fait. Ils affirment que nous avons besoin d'une économie qui fonctionne pour tous ; que nous n'allons pas permettre aux milliardaires d'obtenir des cadeaux fiscaux tandis que des gens perdent leur assurance maladie ; que nous allons augmenter le salaire minimum pour en faire un salaire décent et non un salaire de misère ; que nous ne resterons pas le seul grand pays au monde à ne pas garantir la santé comme un droit humain. Et cela continue d'évoluer — et c'est une bonne chose. Nous avons l'appui de la base populaire du pays. Ce que Zohran a accompli inspire des gens partout aux États-Unis et dans le monde, et nous allons continuer dans cette direction.
AMY GOODMAN : C'était donc le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani, lundi, alors qu'ils rejoignaient les travailleurs de Starbucks en grève sur une ligne de piquetage à Brooklyn. Au rassemblement, je leur ai posé des questions, mais j'ai aussi parlé aux travailleurs et aux organisateurs sur la ligne.
GABRIEL PIERRE : Je m'appelle Gabriel Pierre. Je suis superviseur de quart à Bellmore, Long Island. Chez Starbucks, je supervise le plancher et je m'assure que les clients comme mes collègues sont bien servis. Nous sommes ici aujourd'hui pour lutter contre les pratiques de travail déloyales de l'entreprise, ainsi que pour les ramener à la table des négociations afin d'obtenir une convention collective juste.
AMY GOODMAN : Et ça ressemblerait à quoi ?
GABRIEL PIERRE : Cela voudrait dire mettre fin à leurs pratiques déloyales. Nous avons actuellement 400 poursuites ouvertes concernant des violations du travail, ainsi que 650 en attente, comprenant, entre autres, les horaires non garantis, la mauvaise gestion, la maltraitance de travailleurs trans et homosexuels, des salaires injustes et des heures non assurées. Starbucks n'a reconnu aucun syndicat dans aucun magasin en quatre ans d'organisation. C'est effrayant que cela n'ait toujours pas été fait, et nous espérons que cette mobilisation les ramènera à la table.
MELANIE KRUVELIS : Je m'appelle Melanie Kruvelis. Je suis organisatrice avec la DSA de New York. Je pense que c'est extrêmement fort d'avoir le maire ici aujourd'hui. Aujourd'hui même, les services municipaux ont récupéré des dizaines de millions de dollars pour des travailleurs de Starbucks à qui on avait refusé une rémunération équitable. Et dans un moment où les gens luttent pour nourrir leur famille ou acheter des cadeaux pour les fêtes, cela signifie beaucoup de reconnaître que ces travailleurs se battent tous les jours.
AMY GOODMAN : Vous pensez que les 104 000 bénévoles continueront à s'organiser ? Et que feront-ils ?
MELANIE KRUVELIS : Absolument. Le mouvement qui a mené Zohran à la victoire en novembre est puissant, et j'ai confiance que nous allons l'entretenir. Le fait qu'il y ait eu tant de monde ici aujourd'hui devant Starbucks est significatif. Il a mobilisé des gens à travers la ville et le pays. Je pense que cela nourrit l'espoir de beaucoup de gens qui en avaient peu cette année.
GABRIEL PIERRE : Je pense qu'avoir Zoran Mamdani augmente beaucoup nos chances. Il est très progressiste et j'ai hâte de voir ce qu'il fera lors de son premier jour comme maire.
AMY GOODMAN : Des travailleurs et organisateurs de Starbucks sur la ligne de piquetage à Brooklyn lundi, où ils ont été rejoints par le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« La gauche britannique ne doit pas tout miser sur le parlementarisme » -

La politique britannique semble être à un tournant. La première année du gouvernement de Keir Starmer a montré à quel point le Parti travailliste est revenu à un programme blairiste, dont les politiques néolibérales et répressives sont de plus en plus rejetées. Dans le même temps, le Reform Party de Nigel Farage a fait un bond dans les sondages et semble en passe de remporter les prochaines élections. Mais les choses bougent enfin à gauche, avec le renouveau des Verts depuis l'élection de Zack Polanski à sa tête et le lancement de « Your Party » par Jeremy Corbyn et Zahra Sultana.
Pour James Schneider, ancien conseiller de Jeremy Corbyn et auteur de Our Bloc : How we win (Verso, 2022), qui travaille désormais pour la Progressive International, les leçons de l'ère Corbyn doivent être tirées : pour que la gauche réussisse en Grande-Bretagne, elle ne doit pas se contenter de participer aux élections, mais aussi reconstruire un parti de masse, liés à des clubs sociaux locaux, des syndicats et d'autres organisations. Selon lui, cette voie difficile vers un parti de masse est la seule option pour éviter les divisions culturelles encouragées par la classe dirigeante afin de fracturer la majorité populaire, comme elle l'a fait avec le Brexit.
31 octobre 2025 | Photo : James Schneider sur le plateau de GBNews. © Capture d'écran Youtube William Bouchardon
https://lvsl.fr/la-gauche-britannique-ne-doit-pas-tout-miser-sur-le-parlementarisme-entretien-avec-james-schneider/
LVSL – L'année dernière, le Parti travailliste a remporté une large majorité de sièges à Westminster, mais il a également perdu un demi-million de voix par rapport aux élections précédentes de 2019. Depuis lors, Keir Starmer a continué à appliquer des mesures d'austérité et est de plus en plus impopulaire. Comment résumeriez-vous cette première année du gouvernement travailliste ? Et quelles sont vos perspectives pour son avenir jusqu'aux prochaines élections ?
James Schneider – Comme on pouvait s'y attendre, cela a été catastrophique. Quiconque ayant une connaissance élémentaire de la politique et de la société pouvait voir que ce gouvernement allait très vite devenir profondément impopulaire.
En Grande-Bretagne, comme dans la plupart des pays du Nord, le niveau de vie de la plupart des gens est en baisse depuis près de deux décennies. Dans le même temps, les prestations sociales fournies par les services publics, les services sociaux et les droits sociaux ont été réduites. Les infrastructures du pays sont partout en mauvais état, car les gouvernements conservateurs précédents n'ont pas investi pendant des années, alors que les taux d'intérêt étaient proches de zéro. En plus de tout cela, la Grande-Bretagne, très intégrée dans l'économie mondiale, est confrontée à des risques géopolitiques croissants et aux effets inflationnistes des chocs climatiques.
Le Parti travailliste n'a proposé aucune mesure significative pour remédier à ces problèmes. L'approche de Keir Starmer est globalement la même que celle de Rishi Sunak (Premier ministre britannique conservateur d'octobre 2022 à juillet 2024, ndlr) : la poursuite d'une gestion technocratique qui part du principe qu'une administration compétente restaurera la confiance du public dans le système politique. Cette stratégie a échoué sous Sunak, et elle échoue à nouveau sous Starmer.
« Quand il était dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir, ce soutien médiatique a disparu. »
Le déclin du Parti travailliste s'explique également par des raisons politiques. Pendant son mandat dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique de droite, majoritairement détenue par des milliardaires, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir comme plan B du capital, ce soutien médiatique a disparu. Les mêmes médias qui le toléraient se sont rapidement retournés contre lui, amplifiant les échecs du gouvernement.
En fin de compte, le Parti travailliste dirige un gouvernement incohérent. Il a eu cinq ans pour se préparer à ce que serait son mandat et il n'a pas de plan ! Starmer n'a pas de vision cohérente du monde. Quelles que soient leurs différences, et elles sont nombreuses, les précédents dirigeants du Parti travailliste – Tony Blair, Gordon Brown, Ed Miliband ou Jeremy Corbyn – avaient tous une théorie de la société et une vision du changement, ce qui n'est pas le cas de Starmer. Il en résulte un gouvernement à la dérive, confronté à de graves difficultés économiques, à la pression hostile des médias et à la montée en puissance de Reform UK, un parti d'extrême droite qui bénéficie du soutien à la fois des conservateurs mécontents et des électeurs de la classe ouvrière aliénés par la classe politique.
Les sondages reflètent cette division : le Parti travailliste est en tête parmi ceux qui se sentent financièrement en sécurité, tandis que Reform domine parmi les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Cela résume bien l'état actuel de la politique britannique.
LVSL – Vous avez mentionné Reform UK. D'un côté, Nigel Farage radicalise certaines franges de la société britannique autour de questions de droite, principalement l'immigration. Nous avons assisté à des émeutes racistes l'été dernier et à une manifestation massive d'extrême droite à Londres récemment. Dans le même temps, Reform a amélioré ses résultats dans les sondages et remporté les élections locales en mai. Si la plupart de ses partisans sont d'anciens électeurs conservateurs, certains viennent du Labour. Pour ceux qui sont passés du Labour à Reform, pensez-vous que les efforts de Nigel Farage pour se présenter comme un « homme du peuple » – par exemple, en appelant à la nationalisation des aciéries de British Steel – ont joué un rôle dans son ascension ?
JS – Cela a certainement joué un rôle. Farage est un entrepreneur politique habile qui sait comment exploiter les frustrations populaires. Cependant, je considère cela comme un facteur secondaire, voire tertiaire. Les causes profondes sont économiques et sociales.
Le message central de Reform UK est surtout économique. Il dit aux électeurs : « Vous avez raison d'être en colère. Vos salaires stagnent, vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous au NHS (le National Health Service est l'équivalent britannique de la Sécurité sociale, ndlr), vos enfants n'ont pas les moyens de se loger, les transports publics et l'industrie s'effondrent, et nous pouvons régler tout cela si nous nous occupons des migrants, des musulmans et des minorités ». Ce discours combine des griefs légitimes et la désignation de boucs émissaires, ce qui fonctionne pour une petite minorité ayant de forts préjugés, mais aussi pour d'autres qui cherchent une explication à leurs difficultés économiques. Pendant ce temps, le Labour et l'establishment au sens large n'offrent aucune alternative convaincante. Leur message se résume à dire : « La situation est difficile, mais nous la gérons bien, faites-nous confiance. » Sans surprise, cela n'inspire personne.
« Quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. »
Reform UK tente également de se réinventer de deux manières. Premièrement, en utilisant des références qui rappellent la social-démocratie traditionnelle : quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. Deuxièmement, en adoptant une attitude populiste à l'américaine : une esthétique « Make Britain Great Again » divertissante, qui ne se prend pas trop au sérieux et anti-élite. Ce style leur permet de paraître plus accessibles.
Plus récemment, Reform UK a même commencé à s'organiser localement, en reprenant d'anciens clubs ouvriers et des espaces sociaux conservateurs. Au premier abord, cela peut sembler insignifiant – des gens qui se réunissent pour boire un verre –, mais ces espaces peuvent facilement devenir des centres d'organisation politique. Si la gauche faisait de même, nous y verrions une avancée stratégique majeure. La capacité de Reform UK à maintenir et à approfondir cette organisation déterminera si elle restera une force durable après un mandat au gouvernement, ce qui semble tout à fait possible à ce stade.
LVSL – Comme vous l'avez mentionné, il y a un énorme manque d'alternative de gauche. Récemment, le Parti vert a gagné en popularité. Zack Polanski est devenu son leader avec 85 % des voix grâce à un programme « éco-populiste » qui s'est avéré très populaire. Le nombre d'adhérents a augmenté, dépassant même celui des Conservateurs, et les sondages sont en hausse. Mais les Verts peuvent-ils vraiment devenir plus qu'un parti de CSP+ concentrés dans les grandes villes ? Peuvent-ils toucher d'autres territoires et la classe ouvrière ?
JS – Un parti politique peut être compris à trois niveaux, chacun étant plus difficile à changer à mesure que l'on approfondit. Le premier niveau est le positionnement : le message public, la stratégie de communication et les questions sur lesquelles il met l'accent. C'est le plus facile à ajuster, et les Verts l'ont fait efficacement. Polanski a attiré plus l'attention des médias sur le parti que quiconque avant lui, en grande partie en adoptant des positions audacieuses et populaires qui avaient été écartées du débat mainstream. Par exemple, les Verts réclament désormais haut et fort un impôt sur la fortune, massivement soutenu par la population. En ce sens, ils parviennent à former un pôle de gauche au niveau national.
Le deuxième niveau concerne le personnel politique et la base sociale : qui compose le parti, sa composition de classe et la manière dont il gouverne au niveau local. Ce niveau est beaucoup plus difficile à modifier. Seules 24.000 personnes ont voté lors interne pour le leader du Green Party, ce qui suggère que la plupart des membres étaient passifs. Aujourd'hui, le parti compte 140.000 membres, dont la plupart ont adhéré explicitement en raison du message éco-populiste.
Cependant, cette présentation éco-populiste n'est généralement pas présentée en termes de classe et les membres des Verts sont plus jeunes, urbains et diplômés que la moyenne. Historiquement, ils ont eu du mal à attirer les personnes racisées et les électeurs de la classe ouvrière non diplômés. Que cela change ou non dépendra de la manière dont leurs nouveaux membres et organisateurs développeront l'orientation du parti. Certains groupes émergents, comme Greens Organise, qui copient ce que nous avons fait avec Momentum (Momentum était une organisation de gauche cofondée par James Schneider en 2015 pour soutenir le leadership de Jeremy Corbyn et l'aider à réformer le parti travailliste, ndlr), tentent de pousser le parti dans cette direction, en le reliant plus étroitement à l'activisme de base. Beaucoup de personnes qui se sentent orphelins politiquement depuis l'ère Corbyn sont prêtes à faire évoluer le Parti vert dans cette direction.
« L'approche parlementariste peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. »
Enfin, le troisième niveau, le plus profond, est celui de la stratégie : quelle est la théorie du parti en matière de changement social ? Sur ce point, les Verts restent similaires à la plupart des autres partis. Leur modèle de base est parlementaire : rassembler des membres, des donateurs et des sympathisants, remporter des sièges et faire pression pour obtenir des réformes par le biais des institutions existantes. Les Verts disent en substance : si vous élisez davantage de députés verts, ceux-ci pourront soit faire basculer le Parti travailliste vers la gauche, soit obtenir certaines réformes par le biais des institutions existantes. Cette approche peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. Pour aller plus loin, le parti devrait repenser son rôle dans son ensemble, non seulement « comment gagner les élections », mais aussi comment renforcer son pouvoir au sein de la société elle-même, en combinant le travail électoral avec une organisation sociale plus large.
Néanmoins, même si je ne suis pas membre du Parti vert, je connais et respecte Zack Polanski et je pense qu'il fait du bon travail. Je ne dis pas que les élections n'ont pas d'importance, mais qu'elles ne devraient être qu'une partie d'une stratégie, et non la stratégie dans son ensemble. Il faut une vision plus profonde du changement, qui ne repose pas entièrement sur le parlementarisme. Néanmoins, compte tenu de l'absence actuelle de voix et d'organisations de gauche en Grande-Bretagne, la transformation du Parti vert est une évolution bienvenue.
LVSL – Ce vide des organisations de gauche en Grande-Bretagne est en effet comblé par les Verts, mais aussi par le nouveau parti de Jeremy Corbyn et Zahra Sultana (députée de Coventry, élue sous l'étiquette Labour, désormais indépendante et figure de la gauche britannique, ndlr), actuellement appelé « Your Party ». Dans une interview pour la New Left Review, vous avez décrit la base sociale qu'un nouveau parti de gauche en Grande-Bretagne devrait chercher à organiser : la « classe ouvrière pauvre en actifs », les « diplômés déclassés » (qui penchent désormais vers les Verts) et les « communautés racisées ». Pourriez-vous expliquer comment ces groupes pourraient être attirés par un tel parti ? Par ailleurs, dans une certaine mesure, ces groupes faisaient déjà partie de la coalition travailliste de Jeremy Corbyn, alors que feriez-vous différemment cette fois-ci ?
JS – Il existe bien sûr un chevauchement important entre ces trois groupes, qui ne doivent pas être considérés comme exclusifs, car les personnes issues d'autres milieux sociaux sont également les bienvenues. Mais ces trois groupes constituent le noyau dur des électeurs dont les intérêts communs pourraient, s'ils étaient politiquement unis, représenter une majorité dans la société. L'objectif n'est pas d'exclure les autres, mais de commencer par renforcer le pouvoir de ceux qui ont le plus à gagner de la transformation de la société. Ces groupes étaient en effet au cœur de la coalition travailliste de Corbyn, qui était un projet majoritaire : « For the many, not the few » (slogan de campagne officiel en 2017, ndlr).
Lorsque j'aborde ce sujet, je reçois parfois des critiques selon lesquelles le public cible d'un parti de gauche doit être « la classe ouvrière ». Je suis d'accord, mais la classe sociale n'est pas une identité figée, elle est continuellement façonnée par des processus sociaux, économiques et politiques. Après près de 50 ans de contre-révolution extrêmement efficace, à travers le néolibéralisme et la désindustrialisation, la conscience de classe est très faible. Cela signifie que nous devons reconstruire un nouveau bloc populaire à partir de plusieurs fractions de la classe ouvrière qui ont des intérêts communs. La construction d'une telle coalition nécessite plus qu'une simple unité électorale ; elle nécessite une construction politique active, c'est-à-dire la création d'alliances entre des groupes dont les conditions matérielles sont similaires, même si leurs identités culturelles ou leurs positions sociales diffèrent. Cette approche est courante dans les mouvements de gauche latino-américains, où l'objectif est d'unir des communautés diverses autour d'intérêts sociaux communs.
« La classe dirigeante avait autrefois une stratégie hégémonique qui procurait certains avantages privés à certains groupes du bloc populaire. Aujourd'hui elle n'a plus qu'une seule arme, celle de la division. »
Cette unité populaire est particulièrement importante aujourd'hui, car la classe dirigeante n'a plus qu'une seule arme, celle de la division. La classe dirigeante avait autrefois une stratégie hégémonique qui procurait certains avantages privés à certains groupes du bloc populaire. Dans les années d'après-guerre, le niveau de vie augmentait parce que les salaires augmentaient parallèlement à la productivité. Aujourd'hui, la productivité et les salaires n'augmentent plus, donc cela ne fonctionne plus.
On a alors procédé à la cession d'actifs, par exemple avec le Right to Buy (programme lancé par Margaret Thatcher permettant aux millions de Britanniques vivant alors dans des logements publics d'en devenir propriétaires et a abouti à la quasi-disparition du logement public et à la concentration de l'immobilier aux mains de grandes entreprises, ndlr), ce qui explique pourquoi Thatcher bénéficiait du soutien d'une partie de la classe ouvrière. Mais l'État a déjà cédé presque tout ce qu'il pouvait.
La dernière stratégie consistait donc à gonfler la valeur des actifs, mais cela ne fonctionne que pour les personnes qui possèdent déjà des actifs, et ce groupe est en train de se réduire, d'où la crise de gouvernance. De plus, la crise financière a révélé la stupidité et la vénalité de notre classe dirigeante, et en particulier de son bras financier. Aujourd'hui, la classe dirigeante n'a plus aucun moyen d'améliorer le niveau de vie de la population. Sa seule stratégie restante consiste à diviser les gens, par leur appartenance ethnique, leur culture ou leur identité.
Il est donc encore plus urgent de construire l'unité populaire qu'à l'époque de Corbyn. Le message économique clé de la droite, qui consiste à blâmer les migrants, les musulmans et les minorités pour le déclin social, est un effort délibéré pour fragmenter cette majorité potentielle. Pour surmonter cela, il faut organiser les gens au-delà de ces divisions, construire une identité politique commune autour de la solidarité et de la transformation sociale. Notre tâche consiste à reconstruire la conscience de classe sur de nouvelles bases, en reliant l'insécurité économique, la justice raciale et les inégalités générationnelles dans un seul et même projet politique. C'est ce qui peut transformer une majorité sociologique en une majorité sociale et, à terme, politique. Sinon, les clivages culturels peuvent être utilisés contre nous, et c'est ce qui a fait échouer le projet porté par Corbyn avec le Brexit en 2019.
LVSL – Le Brexit a en effet été le clivage qui a fracturé la coalition sociale réunie par Corbyn. Bien qu'il ait fini par avoir lieu, les divisions politiques qu'il a créées continuent de façonner la politique britannique. Comment expliquez-vous la position incohérente du Parti travailliste sur le Brexit entre 2017 et 2019, lorsque son message politique est passé de « nous respecterons le résultat du référendum et quitterons l'UE » à « nous organiserons un nouveau référendum, avec le maintien dans l'UE comme option » ? Plus précisément, pourquoi l'argument de gauche en faveur du Brexit, qui mettait l'accent sur l'opportunité qu'il représente pour mener une politique industrielle, pour des nationalisations, etc. n'a-t-il jamais été promu par le Labour ? Comment les futurs mouvements de gauche pourraient-ils éviter de répéter cette erreur, surtout si la question du retour dans l'UE se pose à nouveau ?
JS – Il est possible que la question du retour dans l'UE revienne, d'ailleurs Zack Polanski, des Verts, a déjà déclaré que le Royaume-Uni devrait réintégrer l'Union européenne. Pour comprendre ce qui s'est passé sous Jeremy Corbyn, il faut garder deux faits à l'esprit. Premièrement, la direction du Parti travailliste n'avait pas toute latitude pour décider de sa position. Nous dirigions un parti qui comptait de nombreux centres de pouvoir concurrents – syndicats, députés, militants et membres – avec des points de vue très différents. Deuxièmement, dans cette structure, un argumentaire de gauche totalement en faveur du Brexit, malgré les arguments que vous avez mentionnés, n'était tout simplement pas viable. La plupart des syndicats affiliés au parti et des membres, ainsi que la grande majorité des députés, étaient fortement favorables au maintien dans l'UE.
« Même si l'on pensait que le Brexit était une erreur, il était logique d'y chercher des opportunités : politique industrielle, expansion des services publics, réforme des marchés publics, investissements dans les infrastructures… Mais politiquement, cette position était impossible à maintenir au sein du Parti travailliste. »
Lorsque John McDonnell (alors ministre « fantôme » des Finances pour le Labour, nldr) a prononcé un discours fin 2016 suggérant que le Parti travailliste devrait « saisir les opportunités du Brexit », il avait raison. Même si l'on pensait que le Brexit était une erreur, il était logique d'y chercher des opportunités : politique industrielle, expansion des services publics, réforme des marchés publics [pour favoriser les entreprises nationales], investissements dans les infrastructures… Mais politiquement, cette position était impossible à maintenir au sein du Parti travailliste. La gauche libérale était tout simplement trop puissante au sein de la gauche.
En 2017, comme le référendum sur le Brexit ne datait que d'un an, il était naturel que le Parti travailliste promette de quitter l'UE, et tous les membres du front bench (soit le gouvernement proposé par l'opposition travailliste, ndlr) respectaient cette position. Mais dans les deux années suivantes, la campagne pour un second référendum a gagné du terrain, tandis que les conservateurs étaient incapables de mener à bien le Brexit. Et le Parti travailliste était tellement divisé sur la question que cela nous a conduits à un compromis ambigu. Sous la pression, le parti a changé de position, proposant un second référendum et s'alignant finalement sur le camp du « Remain », ce qui a aliéné de nombreux partisans. Nous n'avions pas de principe fort de souveraineté populaire, c'est-à-dire l'idée que le changement politique doit être mené par et pour les citoyens ordinaires.
Avec le recul, l'erreur du Parti travailliste a été de ne pas avoir su construire un discours démocratique plus large autour du Brexit. Nous aurions pu l'inscrire dans un projet plus vaste de transformation sociale : reprendre le pouvoir (« Take Back Control » était le slogan des pro-Brexit, ndlr) non seulement à Bruxelles, mais aussi à l'OMC, à Westminster, aux banques et aux élites non élues. Si nous l'avions fait, nous aurions pu éviter d'être réduits à un choix entre nationalisme et libéralisme. Au final, nous nous sommes retrouvés piégés dans un discours qui se résumait à « le Brexit est mauvais parce qu'il est soutenu par les conservateurs libertariens de droite qui veulent nous faire sortir de l'UE pour de très mauvaises raisons, et par les racistes, alors soyons les gentils et opposons-nous au Brexit », même si les gens avaient voté pour et que cette stratégie était un suicide électoral.
La leçon clé à retenir ici est que l'unité ne peut pas être simplement maintenue par des compromis. Elle doit être activement construite autour d'une vision claire et positive qui donne aux gens un objectif commun. Sans cela, on se contente de réagir aux événements et on se laisse entraîner dans toutes les directions, ce qui est exactement ce qui est arrivé au Parti travailliste avec le Brexit.
LVSL – Parlons maintenant plus en détail de « Your Party ». Jeremy Corbyn et Zahra Sultana ont annoncé son lancement cet été, après une première année désastreuse du gouvernement travailliste. Corbyn est une figure très reconnue et Sultana représente la jeune génération. Initialement, leur annonce a suscité un énorme enthousiasme, avec plus de 800.000 personnes qui se sont inscrites en ligne. Mais depuis, Zahra Sultana a lancé son propre portail d'adhésion, ce qui a conduit à une dispute publique entre elle et Corbyn. Bien qu'ils affirment que ce différend est désormais résolu et qu'ils soient apparus ensemble lors de plusieurs événements, cela a inquiété leurs soutiens. Vous avez participé à la création de ce nouveau parti, pourriez-vous nous en dire plus sur votre rôle et les raisons qui vous ont finalement poussé à vous en retirer ?
JS – Je suis revenu l'année dernière pour diriger la campagne de Jeremy Corbyn à Islington North (circonscription au Nord de Londres, ndlr), et j'ai ensuite participé aux discussions sur la création d'un nouveau parti. J'avais une idée claire du type d'organisation que je souhaitais voir le jour, mais je ne pensais pas qu'il était réaliste de la lancer avant les élections générales (organisées en juillet 2024, ndlr). Elle a finalement vu le jour cet été, mais cela s'est avéré plus difficile que prévu.
La principale difficulté dans la création du nouveau parti a été de mettre en place une structure de décision légitime. C'est essentiel pour toute organisation, et très difficile à créer sans l'une des trois conditions suivantes. Soit vous avez un leader fort, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui peut dire « nous formons un nouveau parti » et tout le monde le suit ; soit vous disposez d'organisations préexistantes, comme les syndicats, qui fournissent une base institutionnelle ; soit vous avez un petit groupe fondateur idéologiquement unifié, comme dans de nombreux partis communistes à leurs débuts.
Nous n'avions rien de tout cela. La gauche britannique est aujourd'hui hétérogène, avec de nombreuses orientations stratégiques différentes. Tout au long du processus, la question principale était de savoir si nous pouvions mettre en place une structure capable de prendre des décisions contraignantes de manière collective. Mon espoir initial était de lancer le parti avec une direction collective – comprenant Jeremy et des personnalités d'autres mouvements – unie autour d'une stratégie claire et publiée. Ce groupe agirait comme direction provisoire pendant un an environ, jusqu'à ce que le parti soit suffisamment grand pour organiser des élections démocratiques internes afin de mettre en place une structure permanente.
« L'espace politique est largement ouvert : des millions de personnes ont vu leurs espoirs grandir pendant les années Corbyn et se sentent aujourd'hui complètement délaissées. »
Mais pour cela, il faut d'abord que tout le monde s'accorde sur l'existence et l'autorité d'une telle direction. Cela ne s'est jamais vraiment produit, c'est pourquoi le processus s'oriente désormais vers une conférence fondatrice, au cours de laquelle les membres eux-mêmes débattront et décideront du cadre, et c'est pourquoi j'ai pris du recul en septembre.
Malgré ces défis, je continue de penser que le potentiel est réel. L'espace politique est largement ouvert : des millions de personnes ont vu leurs espoirs grandir pendant les années Corbyn et se sentent aujourd'hui complètement délaissées. La demande est là : des centaines de milliers de personnes se sont inscrites en ligne, le soutien au Parti travailliste s'effondre et même dans ses bastions, il perd des élections, comme récemment au Pays de Galles. Ce qui manque, c'est une organisation capable de canaliser cette énergie en quelque chose de cohérent et de démocratique.
LVSL – En effet, le potentiel de « Your Party » est énorme, mais pour réussir, il faudra construire une organisation solide. Vous avez souligné que nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les élections, mais aussi sur l'amélioration de la vie des gens « ici et maintenant », en tissant des liens avec les syndicats, les associations de défense des locataires, les coopératives alimentaires, les associations d'entraide pour régler les factures ou les groupes de santé mentale. Cela semble très ambitieux. Comment cela peut-il se faire concrètement, surtout compte tenu du faible niveau de vie civique en Grande-Bretagne aujourd'hui ?
JS – Au niveau local, l'organisation doit partir de l'échelle et des capacités. Si une section locale compte moins d'une centaine de membres, sa seule véritable tâche devrait être d'atteindre ce nombre. Bien sûr, ce nombre est un peu arbitraire, mais si vous n'avez pas 100 membres, vous n'avez pas 10 personnes super actives. Sans cette base minimale, il n'y aura pas assez d'organisateurs actifs pour soutenir un travail local significatif. Pour ces petites sections, le parti central ne devrait fournir que des tracts, des affiches et d'autres outils pour recruter de nouveaux membres.
Une fois qu'une section atteint cette taille critique, l'étape suivante devrait être d'organiser une grande réunion publique, ouverte à l'ensemble de la communauté locale, et pas seulement aux membres. La section choisirait l'une des nombreuses initiatives d'organisation possibles adaptées à son contexte local : campagne pour la rénovation des logements, création d'une association de locataires, revitalisation d'une zone commerciale négligée, création d'un espace communautaire, organisation des travailleurs locaux…
Le parti national devrait élaborer des modèles pour ces formes d'organisation locale, avec des exemples pratiques provenant d'autres régions. Par exemple, si un groupe local a réussi à organiser les locataires, cette expérience devrait être partagée afin que d'autres puissent en tirer les leçons. Les sections pourraient alors adapter ces modèles à leur propre situation, parfois en collaborant avec des syndicats ou des associations existantes, parfois en créant de nouvelles initiatives à partir de zéro.
À mesure que les sections se développent, elles devraient recevoir des ressources supplémentaires en fonction de leur activité, par exemple l'accès à des organisateurs d'autres régions, à des programmes de formation, à des fonds ou à des conseils stratégiques. Cela crée une boucle de rétroaction : plus une section renforce son pouvoir au niveau local, plus elle est soutenue. Cela renforce également les liens horizontaux entre les militants qui font un travail similaire, comme l'organisation dans le domaine du logement ou du travail, de sorte que les connaissances circulent sans que tout dépende d'en haut.
Le travail électoral ne devrait intervenir qu'une fois ces bases établies. Il est important de remporter des sièges, mais le véritable enjeu est de savoir si un mouvement a obtenu la majorité sociale, s'il dispose d'une force organisée suffisante dans un domaine donné pour façonner la vie publique et résister au pouvoir des élites. Les élections doivent servir ce processus plus large, et non le remplacer.
Vous avez probablement entendu parler de la notion du « Red Wall » (circonscriptions des Midlands et du nord de l'Angleterre où le Parti travailliste a toujours remporté une grande partie des voix, ndlr). Pour moi, c'est un phénomène intéressant pour la raison exactement opposée à celle présentée par les médias lorsqu'ils affirment que « la classe ouvrière a abandonné le Parti travailliste » : je pense que cela montre que le pouvoir social a toujours une représentation électorale, des années, voire des décennies après sa disparition. Dans les petites et moyennes villes qui comptaient autrefois une ou deux industries majeures et un taux de syndicalisation élevé, les gens votaient encore pour le Parti travailliste il y a dix ans, sur la base d'un pouvoir qui avait été en grande partie détruit il y a trente ans. C'est ce type de pouvoir populaire à long terme que le nouveau parti devrait chercher à reconstruire.
LVSL – Vous avez été l'un des cofondateurs de Momentum et un proche conseiller de Jeremy Corbyn lorsqu'il était à la tête du Parti travailliste. À cette époque, le nombre d'adhérents a explosé, mais il semblait que l'action se concentrait principalement sur la compétition électorale. Avec le recul, pensez-vous qu'il y ait eu une occasion manquée de reconstruire le pouvoir populaire ?
JS – Pendant les années Corbyn, l'une de mes plus grandes frustrations était que nous n'avons jamais redéfini ce que signifiait être membre du parti. Avec 600.000 membres, nous aurions pu construire un véritable pouvoir local, mais l'activisme s'est largement réduit à un engagement en ligne. Cette période a coïncidé avec l'essor des réseaux sociaux, et beaucoup pensaient que les campagnes numériques pouvaient remplacer le face à face. Mais ce n'est pas le cas.
« Pendant les années Corbyn, l'une de mes plus grandes frustrations était que nous n'avons jamais redéfini ce que signifiait être membre du parti. Avec 600.000 membres, nous aurions pu construire un véritable pouvoir local, mais l'activisme s'est largement réduit à un engagement en ligne. »
Si nous voulons nous remettre de 50 ans de contre-révolution féroce et d'atomisation néolibérale, si nous voulons construire un pouvoir, ce ne sera pas seulement par le biais de publications sur les réseaux sociaux. Cela doit se faire dans le monde réel. La politique doit revenir dans les espaces réels, dans les quartiers, sur les lieux de travail et dans la vie sociale. Même la socialisation elle-même peut être politique : créer des espaces où les gens se rencontrent, discutent et s'organisent ensemble fait partie de la construction d'un nouveau type de communauté humaine. La vie sociale-démocrate en Europe occidentale, en Grande-Bretagne et en Scandinavie était autrefois centrée sur les bibliothèques ouvrières, les clubs de travailleurs, les fanfares, les équipes de football, etc.
Si nous ne reconstruisons pas ces fondations, nous serons peut-être au gouvernement à un moment donné, mais nous ne serons pas réellement au pouvoir. Lorsque nous accédons à des fonctions officielles, la classe dirigeante lance toute une série d'attaques contre nous. Si nous ne disposons pas de forces populaires progressistes suffisantes pour former un contrepoids, nous finissons par capituler. C'est ce qui est arrivé à Mitterrand en France, par exemple. Gagner plus de sièges aux prochaines élections n'est qu'une étape, cela ne doit pas être notre objectif ultime. Notre objectif est de socialiser l'économie, de démocratiser l'État et de rompre nos liens avec l'impérialisme. La construction de l'unité populaire est donc une condition préalable à la construction d'un pouvoir populaire significatif.
Bien sûr, ce sont des objectifs ambitieux. Mais nous avons également besoin de cette perspective pour nous lever chaque jour et mener des actions politiques. 99,99 % des actions politiques quotidiennes sont très loin de cet objectif : il s'agit d'installer les chaises pour une réunion, de sortir les poubelles, de répondre aux e-mails, de passer des coups de fil… Mais pour faire tout ce travail, il faut être imprégné de l'idée que nous le faisons dans un but plus large, et même si cela signifie simplement prendre un verre dans un pub local avec d'autres membres du parti, cela permet de rester motivé. C'est le genre de parti dont nous avons besoin : un parti qui ne se contente pas de participer aux élections, mais qui crée de nouvelles formes de pouvoir social, transformant à la fois la société et ses propres membres dans le processus.
LVSL – Pensez-vous que c'est la direction que prend actuellement « Your Party » ?
JS – Il est beaucoup trop tôt pour le dire. La première conférence du parti approche à grands pas (elle se tiendra à Liverpool les 29 et 30 novembre 2025, ndlr) et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais il y a à la fois des signes encourageants et des obstacles évidents. Le principal défi est que les gens de gauche savent qu'ils doivent faire de la politique différemment, mais très peu savent ce que cela signifie réellement. Il y a un sentiment croissant que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus – des réunions qui semblent sans vie, des partis déconnectés de la vie quotidienne – mais la suite reste encore à définir. Même de petites choses, comme un meilleur graphisme ou l'ajout de musique et de culture aux réunions politiques, peuvent beaucoup aider.
Le plus grand défi est le temps. Il faut des années, voire des décennies, pour construire un véritable pouvoir. La dernière période où les gens ordinaires ont collectivement gagné du terrain – que ce soit grâce à la social-démocratie d'après-guerre dans le Nord ou aux luttes anticoloniales dans le Sud – a été le résultat d'une organisation à long terme, parfois sur plusieurs générations, souvent accélérée par des événements mondiaux majeurs comme la guerre.
En revanche, les trente-cinq dernières années ont été marquées par une croissance quasi nulle des revenus réels pour la moitié la plus pauvre de l'humanité, à l'exception notable de la Chine. La stagnation économique a érodé l'espoir et les horizons politiques se sont rétrécis. Les mouvements antérieurs avaient des objectifs clairs à long terme : le socialisme, le communisme ou la libération nationale. Aujourd'hui, cette vision commune nous manque.
Il est essentiel de reconstruire cet horizon stratégique. Sans cela, la politique se résume à réagir à des événements de court terme, axés sur les prochaines élections plutôt que sur la prochaine ère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une orientation suffisamment large pour guider tous nos efforts individuels : la conviction qu'ensemble, nous pouvons transformer la société, et pas seulement gérer son déclin ou résister à sa destruction.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec a un an, et le sabotage de notre système de santé est bien engagé

Près de 500 organisations dénoncent la réforme Dubé, dont les effets sont appelés à s'amplifier. Les autrices sont respectivement coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés ; coordonnatrice de la Coalition Solidarité santé ; membre de la Coalition Main rouge ; première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; coordonnatrice à la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires&bénévoles (TRPOCB). Elles cosignent ce texte au nom du Collectif Tout sauf santé.
Les autrices sont respectivement coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés ; coordonnatrice de la Coalition Solidarité santé ; membre de la Coalition Main rouge ; première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; coordonnatrice à la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires&bénévoles (TRPOCB). Elles cosignent ce texte au nom du Collectif Tout sauf santé.
Printemps 2022. Nous sommes au lendemain de la pandémie. Le rapport de la coroner Géhane Kamel est dévastateur. Le mammouth de la santé a échoué à protéger les plus vulnérables. Dans le privé, le pire n'a pu être évité. Les conséquences ont été dramatiques.
La pandémie est terminée, et les listes d'attente sont plus longues que jamais. L'accès aux services fait défaut partout. Des milliers de personnes attendent une opération. On ne répond qu'à environ 10 % des besoins en soins à domicile. Il manque des milliers de places en CHSLD. Les hôpitaux tombent en ruine. Plusieurs centaines de médecins se sont désengagés du réseau public. Les services sociaux et la prévention sont négligés. Jeunes et moins jeunes sont abandonnés à leur sort. Il faut se rendre à l'évidence : rien ne va plus en santé. Et ce, en dépit des belles promesses politiques avancées lors des deux dernières réformes centralisatrices successives de Philippe Couillard, en 2003, et de Gaétan Barrette, en 2015.
Dans l'urgence d'agir, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) répond avec le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, déposé par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Sur papier, ce plan met en avant deux grandes priorités : rendre le réseau plus humain et plus performant. Parmi les intentions avancées, on retrouve l'augmentation de la formation, la rétention du personnel, un recrutement important de nouvelles ressources, l'ajout de nouveaux lits dans le réseau et le virage massif vers les soins à domicile. Le ministre promet aussi de consulter davantage le terrain et les experts, évoque la nécessité de décentraliser le réseau et se défaire de la dépendance aux agences privées. Ces mesures ont-elles réellement été mises en place ?
Il y a deux ans, malgré les nombreux avis défavorables et au terme d'une consultation de façade, la CAQ adoptait sous bâillon le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Une énième réforme de structure bureaucratique et hypercentralisée qui ouvrait encore plus grande la porte à la privatisation accélérée du réseau. Un an plus tard naissait le plus gros employeur au Canada : Santé Québec.
Le mammouth devenu dinosaure
En créant cette nouvelle mégastructure bureaucratique, le ministre se dotait habilement d'un paravent derrière lequel il pouvait dorénavant se cacher afin d'effectuer ses basses œuvres. Négligeant de s'attaquer au manque criant de ressources et de mettre fin à la privatisation rampante, il poussait à l'extrême la logique mise en avant lors des dernières réformes, menant notre système de santé encore plus proche de l'implosion. Avec pour résultat la situation que l'on connaît actuellement, qui ressemble plus à un sabotage qu'à la remise sur pied promise.
Ce sont près de 500 organisations ont signé la déclaration « La réforme Dubé : tout sauf santé » pour dire haut et fort : « Assez, c'est assez ! » La réforme Dubé ne réglera pas les problèmes du système de santé et la situation risque seulement de se détériorer davantage.
Plus grave encore, on nous dépossède de nos moyens de contrôle sur notre avenir collectif en santé. Avec Santé Québec, la transparence est réduite au minimum. Il sera de plus en plus difficile pour chaque citoyen d'avoir l'heure juste et d'influer sur les prises de décisions.
La situation est grave. Le gouvernement donne les pleins pouvoirs à une agence gouvernementale, lui permettant de transformer les fondements mêmes de notre système de santé. Pour qu'une population entière puisse demeurer en santé, on doit mutualiser le risque et on doit pouvoir compter sur un système public au service de l'ensemble de la population. Comment est-ce possible qu'une agence créée sous bâillon puisse avoir l'autorité de remettre cela en question ?
Est-ce normal que le gouvernement préfère agir à coups de bâillons et de réformes, rendant le système public de plus en plus déficient, et ce, malgré les nombreuses oppositions ? Et alors que la société civile et les acteurs du milieu apportent des solutions concrètes ? Est-ce normal qu'à peu près tous les espaces de participation démocratique qui permettaient à la population et aux gens sur le terrain d'organiser leurs soins et leurs services de santé aient été éliminés ? Est-ce normal qu'on soit en train de nous imposer un retour à un système de santé à plusieurs vitesses, dont seuls quelques privilégiés pourront bénéficier, avec l'affaiblissement social comme conséquence ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
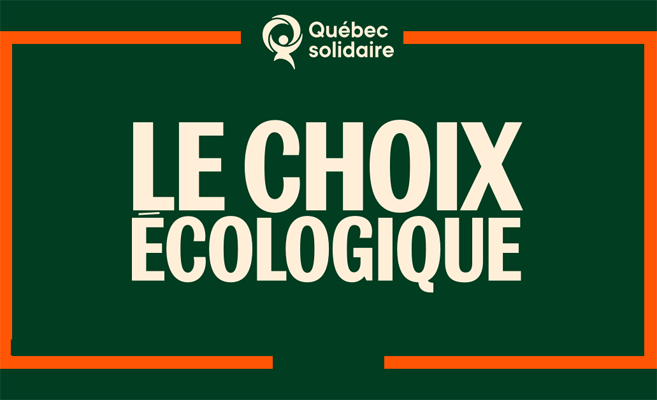
Plateforme électorale 2026 - Mémoire sur la conjoncture et nos six enjeux
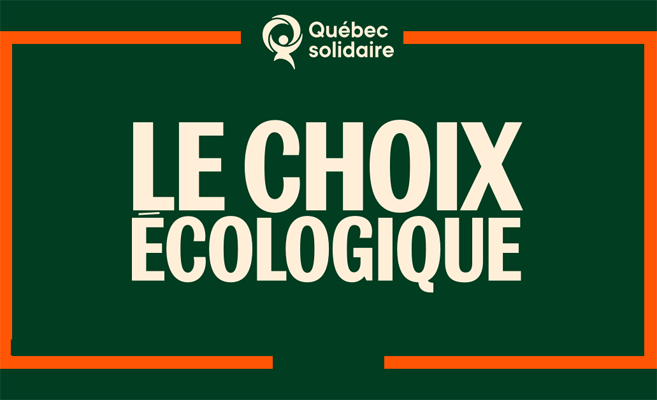
Nous publions ci-dessous le mémoire du Comité d'action politique de Québec solidaire, soumis dans le cadre de la consultation préparatoire à l'élaboration de la plate-forme de Québec solidaire pour les prochaines élections . (PTAG)
Préambule
Le CAP écologiste présente ce mémoire sur la conjoncture et les perspectives d'une campagne électorale centrée sur la mobilisation populaire pour la justice sociale, pour la lutte contre les changements climatiques et pour l'indépendance du Québec.
La période politique ouverte par le retour du trumpisme au pouvoir aux États-Unis marque une recomposition profonde des rapports de force à l'échelle nord-américaine. Elle révèle brutalement la nature structurelle du capitalisme contemporain : un système en crise permanente, traversé par des contradictions écologiques, économiques, sociales et politiques qui atteignent un point de non-retour. Dans ce contexte, continuer de concevoir la stratégie politique comme un simple travail électoral – lever des fonds, installer des pancartes, produire des slogans – revient à se condamner à l'impuissance.
Une véritable stratégie électorale de gauche implique de mettre en lien analyse de la conjoncture (par exemple, identifier les points forts du gouvernement et ses faiblesses, attentes et revendications de la population, états de mobilisation des mouvements sociaux, etc.), construction de rapports de force sociaux (par exemple, convergence et unification des luttes sociales, actions concertées, etc.) et orientation vers une transformation radicale des rapports sociaux au Québec.
1. La conjoncture nord-américaine, canadienne et québécoise : crise du capitalisme et offensive de la classe dominante
La domination trumpiste en Amérique du Nord constitue aujourd'hui le centre de gravité du bloc bourgeois continental. Sa fonction n'est pas idéologique, mais structurelle : restaurer le taux de profit par la guerre commerciale, la dérégulation, la destruction des droits sociaux et la reconfiguration autoritaire de l'État. Les tarifs douaniers imposés au Canada et au Québec ne sont pas des dérapages nationalistes : ils prolongent une stratégie impériale visant à imposer aux peuples voisins les coûts de la crise du capitalisme états-unien. Ils accélèrent la hausse du coût de la vie, fragilisent les secteurs productifs et accroissent la dépendance du Canada aux États-Unis.
Le gouvernement Carney s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Sous couvert de modernisation, il mène une politique de classe classique : abolition des taxes sur le capital, abandon de la taxe carbone, cadeaux massifs aux pétrolières, alignement militaire sur Washington, aplaventrisme diplomatique et adhésion au programme trumpiste. Il accepte implicitement la restructuration néolibérale voulue par la Maison-Blanche et déplace le poids de la crise vers les classes ouvrières et populaires, en particulier les femmes, particulièrement touchées par l'appauvrissement, la précarité et l'effondrement des services publics.
Au Québec, la CAQ remplit un rôle complémentaire : affaiblir les syndicats, criminaliser la résistance sociale, renforcer l'extractivisme, détruire les services publics, multiplier les attaques contre les droits démocratiques, et imposer une vision réactionnaire de la nation qui divise les travailleurs selon l'origine, la couleur de peau et le statut migratoire. La montée du nationalisme conservateur alimente un climat propice à la diffusion du suprémacisme blanc – importé des États-Unis mais désormais enraciné ici – et renforce un masculinisme toxique qui se traduit par une recrudescence de la violence faite aux femmes. Cette dynamique réactionnaire fragilise le « nous » populaire, divise les classes laborieuses et détourne la colère sociale vers les personnes immigrantes, racisées et marginalisées.
La crise écologique accélère toutes ces tendances. L'effondrement de la biodiversité, la déstabilisation climatique, la dépendance aux énergies fossiles et l'épuisement des ressources annoncent non seulement une crise de reproduction sociale, mais une crise de civilisation. Les femmes, particulièrement présentes dans les secteurs du care et déjà victimes de pauvreté structurelle, se retrouvent au premier front de cette crise. La bourgeoisie, consciente de l'insoutenabilité de son modèle, tente de s'enrichir avant le choc tout en s'appuyant sur la répression et la montée de l'extrême droite.
Les classes populaires subissent cette offensive de plein fouet : explosion du coût des loyers et des aliments, stagnation des salaires, endettement massif, épuisement généralisé du personnel de la santé et des services sociaux – composé majoritairement de femmes –, désorganisation du système éducatif, insécurité économique et climatique. La polarisation politique qui en résulte ouvre deux voies : un basculement réactionnaire ou la recomposition d'un bloc populaire de rupture, féministe, antiraciste, écosocialiste et autochtone-allié.
2. Les revendications que doit porter QS : une plateforme d'affrontement avec le capital
L'actualisation du Programme, telle qu'adoptée par le Congrès de novembre 2025 affirme « [...] notre volonté de nous attaquer aux grands intérêts financiers, qui sacrifient l'avenir du Québec pour assurer leurs profits. Cette position dérange, mais nous savons pour qui nous nous battons. »
Dans ce contexte, un parti de gauche comme Québec solidaire ne peut se contenter d'un réformisme gestionnaire. Il doit assumer une orientation de lutte, centrée sur la défense des intérêts matériels de la classe ouvrière et des classes populaires, en intégrant explicitement la lutte contre la pauvreté des femmes, contre les violences conjugales et patriarcales, et contre les discriminations racistes et xénophobes. Cette plateforme doit renforcer l'unité populaire en s'opposant aux tentatives de division fondées sur le sexisme, le racisme ou le nationalisme conservateur.
En adoptant la décroissance comme stratégie pour réaliser la transition, la plateforme ciblera les secteurs économiques les plus importants et impliquera démocratiquement la population touchée par ces secteurs. De plus, la décentralisation des pouvoirs de l'État vers les régions et les collectivités locales (par exemple, les villes, les villages, les arrondissements municipaux) leur donnera un pouvoir décisionnel sur tous les aspects de la vie quotidienne.
Les revendications doivent jouer un double rôle : améliorer immédiatement les conditions de vie et ouvrir une dynamique de confrontation avec la classe dominante.
3. Nos six enjeux :
(Ébauche de synthèse de nos six enjeux sans ordre de priorité) :
1. Transition écologique, décroissance et lutte aux changements climatiques.
2. Économie, coût de la vie, transport et logement.
3. Santé, éducation et services sociaux
4. Indépendance et autodétermination autochtone.
5. Immigration, inclusion et culture.
6. Démocratie, institutions et territoire.
Revendications essentielles (enjeu Transition écologique, décroissance et lutte aux changements climatiques)
• Une loi climat ambitieuse prévoyant une réduction d'au moins 55 % des GES d'ici 2030 et la carboneutralité en 2040, appuyée par un budget carbone et des plans de transition régionaux.
• Une sortie accélérée du pétrole et du gaz grâce au développement d'un réseau public de chemin de fer électrifié (voyageurs et marchandises) et l'interdiction des véhicules neufs à essence dès 2030, portée par des entreprises publiques de production de matériel roulant.
• Une planification publique de l'énergie : interdiction de tout nouveau pipeline, nationalisation sous contrôle populaire des filières renouvelables (éolien, solaire) et orientation de la production énergétique vers les besoins collectifs plutôt que les grands projets industriels ou Big Tech.
• Une économie sobre en ressources : lutte contre l'obsolescence programmée, fin des produits à usage unique, réduction du gaspillage alimentaire et droit garanti à la réparation.
• La protection de la biodiversité : 30 % du territoire protégé d'ici 2030, contre l'expansion actuelle des industries minières, forestières et énergétiques qui dégradent les milieux naturels et menacent des espèces.
• Une stratégie d'adaptation aux effets déjà présents de la crise climatique.
Revendications essentielles (enjeu Économie, coût de la vie et logement)
• Gel immédiat des loyers, construction massive de 100 000 logements publics et sociaux, lutte ouverte contre les propriétaires spéculatifs.
• Lutte contre la pauvreté des femmes : hausse majeure du financement des maisons d'hébergement, revenu minimal garanti, protection accrue des travailleuses précaires.
• Gratuité de l'éducation, du transport collectif, des cantines scolaires.
• Lancement du projet Pharma-Québec et réduction drastique du coût des médicaments.
• Augmentation du salaire minimum à 25 $, reconnaissance du travail du care, réduction massive du temps de travail.
• Taxation radicalement progressive du capital, des profits, de la richesse et notamment des géants du numérique et des pollueurs.
Revendications essentielles (enjeu Santé, éducation et services sociaux)
• Réinvestissement massif (10 milliards) dans la santé, l'éducation, les soins de longue durée et la transition écologique.
• Fin de l'expansion du privé en santé, reconstruction du réseau public sous contrôle démocratique.
• Redistribution du capital : fonds publics d'investissement, pôle bancaire public, contrôle social sur les secteurs stratégiques.
Revendications essentielles (enjeu Indépendance et autodétermination autochtone)
L'indépendance comme libération nationale et sociale doit être :
• un instrument pour une transition écologique radicale et pour refuser la tutelle du Canada en tant qu'état extractiviste (pétrole, mines, forêts) ;
• une rupture avec l'État canadien, ses appareils répressifs et sa tutelle constitutionnelle et le refus de sa course aux armements et de sa préparation de la guerre ;
• un outil pour redistribuer la richesse, contrôler les secteurs stratégiques et reconstruire le commun ;
• un cadre pour une démocratie populaire, féministe, plurinationaliste et antiraciste ;
• un projet internationaliste reliant les luttes autochtones, les mouvements ouvriers et les forces progressistes du Canada et du continent.
Revendications essentielles (enjeu Immigration, inclusion et culture)
• Nouvelle politique d'accueil et d'inclusion ;
• Lutte contre les discriminations, les exploitations et les oppressions ;
• Légalisation des personnes sans-papier ;
• Accessibilité et diffusion du contenu québécois ;
• Statut des travailleuses et travailleurs de la culture.
Revendications essentielles (enjeu Démocratie, institutions et territoire)
• Luttes contre les féminicides
• Soutien aux victimes des actes criminels
• Décentralisation des pouvoirs étatiques vers les régions et les municipalités
• Réforme du mode de scrutin
Conclusion
La plateforme électorale doit offrir une alternative politique clairement différente de celles de nos adversaires. Elle contiendra des mesures de transformation structurantes pour une planification démocratique de l'économie et pour un contrôle public des ressources stratégiques nécessaires pour la transition écologique.
Les enjeux et les propositions concrètes de la plateforme identifieront les luttes sociales à mener, même si le parti ne forme pas le gouvernement en 2026. La plateforme mettra de l'avant les éléments d'une abondance solidaire pour fédérer les mouvements sociaux. Comme parti des travailleuses et travailleurs, nous utiliserons la plateforme pour changer fondamentalement leurs conditions de travail et pour soutenir leur souveraineté sur la production, la distribution et l'utilisation des richesses.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Parc-Extension : des groupes communautaires dénoncent l’ouverture d’un magasin Village des Valeurs et la gentrification du quartier

Montréal, le 5 décembre 2025 –
Le Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE) regrette l'ouverture ce jeudi 4 décembre 2025 d'une succursale de Village des Valeurs au cœur du quartier, dans l'emblématique bâtiment de l'ancienne gare Jean-Talon.
Pour les organismes communautaires membres du RAMPE, cette implantation constitue une occasion manquée pour répondre aux besoins criants en locaux communautaires, et risque d'accélérer l'embourgeoisement d'un des quartiers les plus pauvres du Québec.
L'ouverture de ce commerce survient quelques mois seulement après l'éviction d'une quinzaine d'organismes communautaires du Complexe William-Hingston. Ces groupes, qui offraient des services essentiels à la population – dépannage alimentaire, soutien aux locataires, cours de français et bien plus encore – se retrouvent aujourd'hui dispersés dans le
quartier, faute de locaux adéquats. Le bâtiment historique de la gare Jean-Talon aurait pu accueillir une partie de ces organismes et contribuer à combler une pénurie majeure d'espaces communautaires.
De plus, lorsque la Ville a vendu l'immeuble de la gare au groupe Loblaws, le contrat réservait une part des espaces intérieurs de l'ancienne gare à des fonctions sociocommunautaires, une condition qui ne fut jamais remplie.
Pour les organismes réunis au sein du RAMPE, cette installation confirme l'urgence d'un engagement ferme de tous les paliers de gouvernement afin de financer un nouveau centre communautaire pour Parc-Extension, un projet porté de longue date par la Table de quartier de Parc-Extension et plus que jamais nécessaire.
Le RAMPE rappelle que Village des Valeurs est une entreprise américaine à but lucratif, qui revend des articles usagés à des prix souvent plus élevés que ceux d'autres friperies locales ou organismes à vocation sociale. Son arrivée pourrait également renforcer la gentrification déjà bien entamée à Parc-Extension. En transformant l'offre commerciale et en attirant une
nouvelle clientèle en quête de « bonnes affaires », ce type de commerce tend à déséquilibrer la dynamique sociale du quartier, ajoutant une pression supplémentaire sur les résidents historiques. Les exemples ne manquent pas à Montréal : nombre d'artères commerciales tendances ont eu pour conséquence un regain d'intérêt de promoteurs immobiliers et une
hausse significative des prix des loyers.
L'arrivée de Village des Valeurs dans un bâtiment aussi symbolique que la gare Jean-Talon révèle un manque de vision dans la planification urbaine du quartier. Alors que Parc-Extension traverse une crise d'accès aux espaces communautaires et un processus de gentrification rapide, le RAMPE exhorte les paliers gouvernementaux à prioriser les besoins de la communauté plutôt que ceux d'entreprises à but lucratif. La gare Jean-Talon aurait pu être
notre patrimoine commun et le cœur vivant de Parc-Extension : elle servira finalement à l'enrichissement de quelques-uns.
A propos du RAMPE
Le Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE) rassemble les organismes mobilisés autour des enjeux d'aménagement et de logement dans le quartier de Parc-Extension.
Source :
Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le gel des subventions du MRIF persiste : les organismes québécois de coopération internationale dans l’impasse

Montréal, le 2 décembre 2025 — Malgré l'annonce du dégel des subventions par le Conseil du Trésor, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) maintient la suspension du versement des aides financières, mettant en péril les activités de dizaines d'organismes québécois de coopération internationale (OCI) et compromettant leurs engagements auprès de partenaires à travers le monde.
Un dégel qui exclut le MRIF
Une directive ministérielle suspend pour une durée indéterminée le versement des aides financières dans tous les secteurs d'activité du MRIF. Cette mesure compromet directement le décaissement de la deuxième tranche des subventions du programme Québec sans frontières (QSF) 2025-2026 pour les organismes ayant déjà soumis leur reddition de compte complète et conforme.
Des dizaines d'organismes menacés, des milliers de personnes privées de services Cette suspension entraîne des répercussions directes :
• sur les projets en cours dans des domaines essentiels comme les droits humains, le développement économique et social, le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, l'agriculture et la souveraineté alimentaire, ainsi que la santé et l'éducation ;
• pour les partenaires locaux et les volontaires dont la situation est également directement concernée par cette décision.
Cette décision, prise sans préavis par le ministère, met en péril près de 80 emplois au Québec et 200 postes chez les partenaires internationaux, tout en affectant plus de 34 400 personnes qui pourraient être privées de services essentiels.
« Cette situation est inacceptable. Les organismes financés par le programme QSF ont engagé des fonds pour la réalisation de leurs projets en fonction des conventions signées avec le MRIF. Ce gel, s'il est prolongé, compromet non seulement des projets en cours, mais aussi le maintien d'emplois et la crédibilité de nos organismes auprès de leurs partenaires internationaux », déclare Michèle Asselin, directrice générale de l'AQOCI.
« La suspension de ce soutien met directement en danger notre capacité à poursuivre nos activités. Elle menace aussi la continuité de notre mission, qui repose sur 25 ans d'expertise dans la lutte contre l'exploitation des enfants. Sans ce pilier essentiel, c'est toute notre organisation qui se fragilise, avec des répercussions humaines, sociales et organisationnelles importantes », explique l'organisme Aide internationale pour l'enfance.
Un appel urgent
L'AQOCI demande au gouvernement du Québec de :
– Procéder immédiatement au décaissement de la deuxième tranche des subventions QSF 2025-2026 pour les organismes ayant soumis leur reddition de compte conforme.
– Honorer les engagements contractuels en garantissant le remboursement des montants déjà avancés par les OCI dans le cadre de leurs projets. Cette garantie est essentielle compte tenu de la précarité financière de plusieurs partenaires locaux et du fait que de nombreux organismes dépendent de ce financement pour équilibrer leur budget annuel.
« Le gel prolongé des subventions envoie un message préoccupant sur l'engagement du Québec envers la solidarité internationale. Nos organismes sont des acteurs essentiels de la politique internationale du Québec et méritent d'être traités avec respect et prévisibilité. Nous demandons au ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, d'agir rapidement pour résoudre cette crise », conclut Michèle Asselin.
À propos de l'AQOCI
L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) regroupe plus de 70 organismes de 14 régions du Québec actifs dans 86 pays en collaboration avec 1300 partenaires du Sud global. Ensemble, ils œuvrent, à l'étranger et localement, pour un développement durable et humain. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construction d'un monde de justice, d'inclusion et d'égalité. L'AQOCI priorise la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, des droits humains, de la paix et de la protection de l'environnement. www.aqoci.qc.ca
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.