Derniers articles

Entretien : Trump à l’assaut des Caraïbes

Entretien avec Yoletty Bracho, enseignante-chercheuse et spécialiste du Venezuela, et Franck Gaudichaud, de la commission internationale du NPA.
Hebdo L'Anticapitaliste - 779 (11/12/2025)
https://lanticapitaliste.org/opinions/international/entretien-trump-lassaut-des-caraibes
Quelles sont les raisons des changements récents dans la géopolitique des Caraïbes ?
Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, on observe un changement géopolitique dans les Caraïbes : renforcement massif de la flotte militaire, bombardements de bateaux présentés comme transportant de la drogue vers les États-Unis, déploiement record de soldats et d'armements — porte-avions, sous-marins nucléaires, destroyers, soit peut-être 14 000 soldats. Il n'y a jamais eu autant de militaires dans l'espace caribéen depuis l'invasion du Panama contre Noriega ou l'intervention en Haïti dans les années 1990.
Cela fait partie de la politique impérialiste de Trump, mais constitue un saut qualitatif. L'Amérique latine a toujours été considérée comme l'arrière-cour des États-Unis depuis la fin du 19e siècle, mais l'entourage de Trump — dont Marco Rubio, très virulent — cherche à reprendre le contrôle de l'espace latino-américain au nom d'une « sécurité hémisphérique ». Ce sont des continuités observables sous Obama ou Biden, mais Trump 2 franchit une nouvelle étape, mettant une pression maximale sur Maduro, menaçant l'ensemble de la mer des Caraïbes et la Colombie, et visant aussi les ressources naturelles.
Cet activisme militaire s'inscrit dans une concurrence inter-impériale. L'impérialisme étatsunien est en déclin, même s'il reste dominant. Certains parlent d'une « domination sans hégémonie » où la force brute est mise au premier plan par l'administration Trump. Depuis les années 2000, la Chine a pris une place considérable en Amérique latine : premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, deuxième du Mexique. L'amiral du Commandement Sud américain affirmait qu'il fallait opposer à la présence chinoise une présence militaire renforcée. La « stratégie MAGA impériale » décrite par John Bellamy Foster est contradictoire : base sociale protectionniste hostile à des déploiements militaires, mais bourgeoisie américaine exigeant le contrôle de son arrière-cour.
Est-ce que Trump essaie de renverser le régime vénézuelien ?
Ces pressions militaires visent très clairement le Venezuela. Depuis l'arrivée de Chavez, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela sont structurelles, liées à l'émergence d'un gouvernement qui se présentait comme de gauche, révolutionnaire, et qui a proposé au continent une alternative au leadership américain. La confrontation a été immédiate : éviction de Chavez, puis coup d'État de 2002 ouvertement soutenu par Washington, et soutien constant à l'opposition traditionnelle, parfois via la voie électorale, parfois engagée dans des tentatives de renversement extra-institutionnel.
Après le décès de Chavez, Maduro accède au pouvoir en 2013 et la pression américaine s'intensifie : sanctions contre des proches du régime, sanctions contre l'entreprise pétrolière nationale, puis sanctions interdisant à l'État d'acquérir de la dette, aggravant une crise économique déjà présente. La crise n'est pas seulement due aux sanctions : elle découle aussi des choix économiques du chavisme au pouvoir, mais les sanctions la rendent beaucoup plus dure.
Durant cette phase s'opère un tournant autoritaire du gouvernement Maduro, marqué par une rupture avec les valeurs démocratiques initialement mises en avant par la révolution bolivarienne, ainsi que par une répression accrue contre la population, contre des opposantEs, et très spécifiquement contre des forces de gauche. Cet autoritarisme réel est utilisé par les États-Unis pour se présenter comme défenseurs de la démocratie : soutien à l'opposante Maria Corina Machado — prix Nobel de la paix — et adoption d'un discours de « lutte contre le narcoterrorisme ». Selon ce récit, le gouvernement Maduro enverrait délibérément drogues et migrants pour déstabiliser les États-Unis. Bien entendu, les États-unis n'ont jamais eu pour objectif le bien-être des populations latino-américaines : ce n'est pas en tuant plus de 80 personnes en mer des Caraïbes qu'on construit une quête démocratique.
Trump souffle souvent le chaud et le froid : discussions ponctuelles avec Maduro, menaces d'interventions, pressions maximales, évocation d'actions de la CIA, sans intervention terrestre directe. La présence du porte-avions Ford marque toutefois une escalade militaire claire. Les frappes ne concernent pas seulement le Venezuela : des attaques en mer Pacifique ont visé des bateaux colombiens, et des personnes arrêtées étaient originaires d'Équateur, ce qui montre l'élargissement de la pression à l'ensemble de la région. Il existe aussi un volet interne, notamment dans les communautés latino-américaines étatsuniennes hostiles à Maduro, qui constitue une base électorale mobilisable, particulièrement par Marco Rubio.
Trump vise-t-il uniquement le régime vénézuélien ou s'agit-il d'un projet plus général pour la région ?
Trump soutient également les forces d'extrême droite latino-américaines : soutien à Milei en Argentine avec menaces sur les relations bilatérales, pressions sur le Brésil après l'emprisonnement de Bolsonaro, félicitations immédiates après le basculement de la Bolivie à droite, et possible dynamique similaire au Chili.
Cette offensive impérialiste ne reproduit pas mécaniquement les politiques des années 1970, même si certains auteurs parlent d'une « nouvelle guerre froide ». Le contexte est plus complexe, mêlant pressions externes et négociations discrètes. L'exemple est parlant : alors que les États-Unis demandent d'éviter l'espace aérien vénézuélien en raison d'activités militaires, un vol arrive depuis les États-Unis avec douze expulséEs, montrant l'existence d'accords bilatéraux. Derrière une rupture diplomatique affichée, continuent des concessions pétrolières et des échanges de prisonnierEs.
Quelle est la réponse de Maduro face à la situation ?
Face aux premières frappes, la première réaction du gouvernement Maduro a été de nier les faits, affirmant que les images étaient produites par intelligence artificielle. Cela a laissé sans recours les familles des personnes exécutées, incapables de demander justice ni au gouvernement Maduro ni à celui des États-Unis. Ensuite, Maduro affiche une posture de force et mobilise la population, tout en cherchant des espaces de négociation diplomatique, en invoquant la paix et en présentant Trump comme un possible interlocuteur. Le gouvernement Maduro est conscient qu'il n'est absolument pas en capacité d'affronter militairement la plus grande puissance militaire du monde. Cette tension lui sert aussi en interne à resserrer les rangs, neutraliser les dissidences et réprimer les gauches critiques.
Du côté régional, une position importante est celle du gouvernement Petro en Colombie : dénonciation explicite de la présence militaire étatsunienne, refus de soutenir Maduro, appel à une solution négociée, et opposition à toute intervention militaire, car la Colombie est elle aussi menacée et accusée de narco-État. La question est celle d'une solidarité régionale entre mouvements populaires et gouvernements progressistes — qui n'existe pas aujourd'hui.
Quel type de solidarité faut-il alors construire ?
Pour nous, ici, il s'agit d'abord d'une solidarité anti-impérialiste claire, qui dénonce la stratégie de Trump dans la mer des Caraïbes et cette nouvelle agression impérialiste. Pour le NPA, cela implique de réfléchir à une stratégie unitaire en France, car la situation risque de continuer à s'aggraver dans les prochaines semaines.
En même temps, notre solidarité n'est pas un alignement avec le régime Maduro, qui est clairement autoritaire. Au sein de la gauche européenne et française, il existe parfois une vision très simplifiée où l'anti-impérialisme signifierait s'aligner derrière n'importe quel gouvernement dès lors qu'il est ciblé par Washington. Ce n'est absolument pas notre perspective. Notre solidarité doit être avec les peuples, les mouvements sociaux, les forces progressistes autonomes, et non avec les régimes autoritaires.
Les visions binaires de la situation empêchent de voir les luttes internes au Venezuela. Les gauches révolutionnaires vénézuéliennes, parfois issues du chavisme, dénoncent l'autoritarisme de Maduro et deviennent une cible : disparitions, arrestations, accusations de terrorisme ou d'incitation à la haine. Cela touche aussi journalistes, chercheurEs en sciences sociales, militantEs écologistes. Comprendre ces luttes suppose de dépasser une vision binaire où l'anti-impérialisme de façade du gouvernement justifierait automatiquement un soutien.
Pour comprendre cela, et pour faire ces liens-là, il faut dépasser une vision binaire : celle qui voudrait que le discours anti-impérialiste de Maduro — dénoncé comme un discours de façade par les gauches vénézuéliennes — justifierait automatiquement une solidarité avec son gouvernement. C'est justement en complexifiant le regard que l'on peut voir la réalité telle qu'elle est.
Propos recueillis par Martin Noda, synthèse proposée par la rédaction
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Embrigader la jeunesse, ce n’est pas faire face à la guerre qui vient, tout au contraire !

La photo illustrant cet article n'est pas un gag : c'est l'authentique livret « Ma première cérémonie militaire », promu par le site officiel « Solidarité défense » pour diffusion dans les écoles primaires et maternelles ! La fidélité à la tradition internationaliste et antimilitariste du mouvement ouvrier commande de ne pas faire croire qu'ainsi, est préparée la guerre (avec la Russie) : quand l' « esprit de défense » est esprit de soumission, il devient esprit de collaboration !
30 novembre 2025 | tiré du site Arguments pour les luttes sociales
Macron a donc, dans un discours devant la 27° brigade d'infanterie, à Varces, jeudi 27 novembre, présenté ce que médias et opposants appellent le « rétablissement du service militaire ».
En fait, il a affirmé que « Nos armées n'ont plus vocation à encadrer ni à accueillir la totalité d'une classe d'âge » et prôné un « modèle hybride » nullement massif, visant à recruter 3000 volontaires à l'été 2026, en visant 10 000 en 2030, 50 000 en 2035, pour un service de 10 mois « sur le territoire national », avec un mois de formation et 9 mois d'incorporation à l'armée. 80% d'entre eux auront 18 ou 19 ans, les 20% restant, censés être plus spécialisés, moins de 25 ans. Selon « l'entourage du chef de l'Etat », leur rémunération serait comprise entre 800 et 1000 euros. Attention : la mise en œuvre requiert tout de même le vote d'une loi par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Très loin, donc, d'une remilitarisation de la société, ces annonces se rapprochent, en se situant un cran derrière, de l'évolution actuelle de l'Allemagne, qui entend recruter 20 000 volontaires en 2026. Dans les pays baltes et scandinaves, un service obligatoire a été rétabli, en raison de la menace russe, par tirage au sort d'environ 15% d'une classe d'âge masculine, le volontariat concernant les femmes, auxquelles le Danemark vient d'étendre l'obligation.
L'agression russe de l'Ukraine, les pressions des trusts industrialo-financiers de l'armement, la crainte, de la part des puissances européennes, d'un déclassement complet voire d'un écrasement entre Moscou et Washington, expliquent ces évolutions qui, en termes d'objectifs en effectifs, demeurent, en France, très limités, et absolument pas en mesure de faire face à une « vraie guerre ». Cela ne veut pas dire que Macron et nos gouvernants n'envisagent pas celle-ci, mais cela veut dire qu'ils ne veulent pas la faire … à l'ukrainienne.
Car les leçons de l'Ukraine contredisent l'orientation de Macron, comme de Merz et de Starmer. L'agression a été contenue dans le Donbass en 2014, puis stoppée et refoulée à l'échelle du pays en 2022, par un modèle hybride improvisé et imposé par la société, mais effectif, tout à fait différent de ce à quoi se réfère Macron. Tout d'abord, ce sont l'auto-organisation, le soutien des couches sociales populaires, qui portent la résistance armée. D'autre part, à l'exception des volontaires des deux sexes dans la Défense territoriale dont le rôle a été décisif temporairement, en février-mai 2022, l'armée elle-même ne recrute qu'au-dessus de 25 ans, et encore voici peu de 27 ans. Ces questions font débat en Ukraine, et se combinent aux questions liées à la lutte contre la corruption, à la discussion publique des choix d'état-major, à la tension autour du pouvoir des officiers et la syndicalisation de fait, sous différentes formes, de larges secteurs de base de l'armée. Mais le fait militaro-politique principal qui en ressort, c'est que la guerre est affaire de défense sociale collective, motivant toute la population, et en aucun cas un fardeau devant incomber à la jeunesse, avant tout aux jeunes hommes qu'il faudrait en même temps cadrer, enrégimenter et maîtriser.
Inversement, quel objectif Macron assigne-t-il, dans son discours, à l'amorce d'un recrutement élargi de jeunes volontaires ?
Il ne s'agit pas de mobilisation collective et encore moins d'autoorganisation. Mais de mise au pas de la jeunesse perçue comme manquant de « discipline ». La discipline, qui, si elle n'est pas la contrainte brutale, n'est réelle et efficace qu'en découlant de la compréhension individuelle et collective et de l'aspiration à l'émancipation et à la liberté, devient chez lui le préalable. Voici les objectifs de Macron : certainement pas se préparer à vaincre les Trump et les Poutine, mais encadrer, formater la jeunesse :
« Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armées, à la marche au pas, aux chants, à l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées et concourent à la grandeur de la nation. »
Tradition militariste et chauvine des armées d'autrefois, avec leurs « chants » (sic) et leurs « rituels » (re-sic), sont au centre d'un discours qui, comme précédemment avec le SNU, qui a échoué et c'est tant mieux, sont pour Macron et Lecornu le fondement, et ils ciblent la jeunesse pour cela.
Ce n'est pas en apprenant les chansons de la coloniale et les rituels du temps des trouffions, des bidasses et des colons, que l'on prépare la guerre du XXI° siècle contre les techno-tyrans.
Ce n'est pas en diffusant jusque dans des écoles primaires et maternelles le livret « Ma première cérémonie militaire » que l'on prépare la guerre du XXI° siècle contre le militarisme et l'oppression !
En Ukraine, point de propagande militaire envers les enfants, que l'on cherche surtout à protéger des bombardements et des traumatismes. C'est chez Poutine que les tout-petits défilent en uniformes !
Un activisme louche, visant, à l'encontre de la laïcité, à l'endoctrinement idéologique des jeunes et même des enfants, est suscité du côté des armées et de la police en direction des écoles et établissements scolaires. Ces opérations, allant jusqu'à des « imitations » de répression de manifestation, n'ont strictement rien à voir avec la préparation du pays au danger, mais tout au contraire lui pavent la voie.
Le RN a d'ailleurs fait savoir qu'il ne s'oppose pas aux plans de recrutement de Macron, saluant surtout leur dimension idéologique.
« Rallyes défense » avec mimiques de fouilles de prison et d'arrestation ; rien à voir avec la guerre aux tyrans ! L'exact contraire !
Cette dimension idéologique ne prépare pas une éventuelle guerre avec l'impérialisme russe, voire l'impérialisme américain. Elle prépare la collaboration !
Les partisans d'une politique militaire prolétarienne sont les vrais adversaires du militarisme bourgeois et impérialiste. Ils dénoncent les entreprises de mise au pas de la jeunesse, non pas parce qu'elles préparent la guerre, mais aussi parce qu'en fait elles ne la préparent pas.
Cette préparation exige qu'on laisse les enfants à l'école sans flics, ni curés ni trouffions, et qu'on mise sur la capacité libre de la jeunesse à agir.
Une forme hybride d'armée avec une présence des femmes (que ne recherche certainement pas la revalorisation des chants et rituels des armées d'antan !), une forte présence de métiers qualifiés, ingénierie, informatique …, des libertés démocratiques, d'expression, d'organisation et syndicales, l'armée nouvelle du XXI° siècle, doit devenir un élément programmatique de nos combats.
Pour conclure cet article qui entend soulever des pistes, voici un extrait des revendications que vient de formuler la conférence syndicale de la mer Baltique, associant la centrale estonienne, le BKDP bélarusse en exil et plusieurs fédérations de tous les pays de la région :
« Les représentants des organisations présentes ont affirmé la nécessité d'une implication réelle, et non simplement formelle, des syndicats dans la planification et le suivi des systèmes de protection civile, de la gestion de crise et des stratégies de défense. Les syndicats possèdent des infrastructures, de l'expérience et la confiance des travailleurs – des ressources essentielles pour renforcer la résilience sociale. »
Voila ce que les syndicats de pays directement frontaliers de la menace sont conduits à dire. Eux savent que l'attaque peut survenir contre eux, comme le 24 février 2022. Mais sur la frange atlantique, France, Royaume-Uni, Irlande (pratiquement sans armée, pleine de Data Centers), l'alliance Trump/Poutine la rend également possible bien plus vite que tout ce que peuvent nous dire un Macron ou un Chef d'état-major qui disent vouloir nous motiver à « sacrifier nos enfants ».
Ce qui est exigé là, ce n'est certainement pas l'union sacrée – l'union sacrée en 1940 c'était la collaboration ! – mais l'exigence de l'entrée massive du mouvement ouvrier sur le terrain militaire (que, rappelons-le, un certain Léon Trotsky, célèbre chef de guerre qui n'avait jamais fait son service militaire, préconisait aux Etats-Unis début 1940).
VP, le 30/11/25.

Le PS sauve (pour l’instant ?) Lecornu et son plan d’austérité

Une macronie fracturée, LR et Horizons qui s'abstiennent, c'est finalement le soutien du Parti socialiste qui sauve Lecornu et fait adopter la partie recettes de son PLFSS d'austérité. Retour sur un naufrage !
Hebdo L'Anticapitaliste - 779 (11/12/2025)
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/le-ps-sauve-pour-linstant-lecornu-et-son-plan-dausterite
Au départ il y avait Bloquons tout, la mobilisation intersyndicale et le débat sur la taxe Zucman, pour faire payer les milliardaires et s'opposer aux 45 milliards de cure d'austérité, que Bayrou puis Lecornu veulent imposer à l'État et à la Sécurité sociale. Mais pour la gauche libérale, pas question de faire tomber le gouvernement. Avec un gouvernement minoritaire dans le pays et au Parlement, un socle commun fracturé par les ambitions présidentielles, le PS espérait que son offre de sauvetage du soldat Lecornu serait payée en retour par quelques concessions. Las…
La ligne rose
La ligne rouge du PS, c'était paraît-il la taxe Zucman et l'abrogation de la réforme des retraites. Pour sauver coûte que coûte Lecornu, la ligne rose sera un simple décalage de 3 mois de l'application de la réforme des retraites. Une retraite à 64 ans que le PS devra voter dans l'amendement de décalage, et qu'il faudra en plus payer par un gel des pensions de retraite. Car tout doit se faire à austérité constante ! Pas question pour Lecornu donc de toucher au doublement des franchises médicales, qui pourront toujours passer par ordonnances. Pas question de toucher à la taxe supplémentaire de 1 milliard sur les complémentaires santé, dont les tarifs vont augmenter d'autant. Le PS a même voté cette taxe, qu'il avait pourtant rejetée en première lecture. Faire payer les malades, aggraver le manque de personnels et les fermetures de lits, voilà le PLFSS de Lecornu que le PS a sauvé !
Cette séquence parlementaire aura eu raison de la mobilisation, faute de perspective de confrontation. Le camp syndical est fracturé, la CFDT sort de l'intersyndicale, et lorgne comme le PS du côté de la retraite à points. Un point dont le montant varie chaque année en fonction des résultats économiques. La porte ouverte à la capitalisation et aux fonds de pension, pour compléter une retraite de misère !
La voix de la solidarité
Mais cette séquence parlementaire brouille aussi les cartes sur le financement de la Sécu. Le PS a imposé un débat autour de la CSG, une création de Rocard pour alléger le « coût du travail », en grande partie payée par les particuliers. Nous voulons une augmentation des cotisations, payées par les patrons, pour la santé, les retraites. Un exemple : le déficit de la branche vieillesse retraite n'est que de 5,6 milliards. Une augmentation de 1 % de cotisation patronale rapporte 4,9 milliards ! Pâle copie de la taxe Zucman, qui ponctionnait 15 à 25 milliards sur 1 800 milliardaires, la hausse de la CSG, présentée comme une grande victoire par le PS, aurait par exemple touché les PEL. 25 % des particuliers possèdent un PEL (Plan d'épargne logement), avec un dépôt moyen de 25 000 euros. Loin d'être le refuge des grandes fortunes et des milliardaires ! Le gouvernement sortira finalement de son chapeau un amendement de hausse a minima de la CSG, pour emporter l'accord de la droite et du PS.
Sauver le gouvernement Lecornu, c'est le meilleur moyen d'ouvrir la voie au Rassemblement national. Le censurer au Parlement et le bloquer unitairement dans la rue, en portant haut et fort des exigences de solidarité, voilà qui déplace la colère et l'espoir à gauche. C'est le seul moyen de gagner sur nos revendications et de bloquer la résistible ascension du RN.
Frank Prouhet
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Danemark : Lutte des classes autour de la nouvelle loi sur le climat

La bataille autour de la loi sur le climat ne peut être remportée que par une coalition en faveur d'une transition verte socialement équitable. Un tel mouvement rouge-vert est également essentiel pour mettre à l'ordre du jour les exigences qui peuvent réellement faire bouger les choses dans la lutte contre le changement climatique à long terme. La lutte contre le changement climatique et la lutte des classes sont étroitement liées.
10 décembre 2025 | tiré d'inprecor.fr
La loi sur le climat doit être assortie avant la fin de l'année d'un objectif pour 2035. Au cours de l'année écoulée, les mouvements de défense de l'environnement ont mené des campagnes en faveur de modifications en profondeur de la loi sur le climat. Il faut accélérer le rythme et « combler les lacunes » afin que les efforts en faveur du climat englobent toutes les émissions dont le Danemark est responsable. Mais le gouvernement SVM [depuis 2022, coalition du Parti social-démocrate (SD) avec le Parti libéral (V) et les Modérés (M) ndt], est resté les bras croisés pendant la majeure partie de l'année et a maintenant ouvert les négociations avec une proposition qui tourne le dos aux revendications des mouvements. Le gouvernement ne veut pas entendre parler d'une « nouvelle loi sur le climat », mais seulement d'inscrire un objectif – peu ambitieux – pour 2035.
Si on laisse le gouvernement maintenir ce cadre dans le huis clos des négociations, on va rater une chance de renforcer la loi sur le climat. C'est pourquoi il est positif que le Mouvement des jeunes verts ait réagi en « lançant un appel à des négociations ouvertes » afin de « rendre le débat public », plus précisément en invitant les responsables politiques chargés du climat à une discussion dans la cour du Parlement, à l'extérieur du palais de Christiansborg. Il est également positif qu'ils aient, en collaboration avec le Mouvement pour le climat, entre autres, appelé à une manifestation au même endroit le 10 décembre.
Malheureusement, le gouvernement pourra poursuivre sa politique tant qu'il ne sera pas confronté à une puissante coalition en faveur d'une transition verte socialement équitable, capable de toucher également la base social-démocrate.
Il est urgent de colmater les brèches
La loi sur le climat devait garantir la contribution équitable du Danemark à l'objectif de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et cela est plus urgent que jamais. Des rapports émanant notamment de I'Institut météorologique mondial, un organisme des Nations unies, indiquent que le seuil de 1,5 degré sera probablement dépassé de manière permanente d'ici cinq ans au plus tard, alors qu'il y a quelques années, on pensait que cela ne se produirait qu'au milieu des années 2030.
Dans le même temps, le risque de dépasser les « points de basculement » qui accélèrent le réchauffement climatique augmente, de sorte que tout indique que les émissions de CO2, de méthane, etc. doivent être réduites de manière drastique à partir de maintenant. La nécessité pour le Danemark de combler enfin les carences de sa loi sur le climat et de montrer l'exemple au reste du monde n'est pas moindre du fait que les États-Unis, sous Trump, ont déclaré la guerre au climat, ou que la droite, y compris au sein de l'UE, s'est mise à démanteler la législation sur le climat et l'environnement.
Les associations écologistes réunies dans le « Groupe 92 » réclament un objectif de réduction de 90 % d'ici 2035, mais aussi qu'il soit complété par de nouveaux objectifs pour les émissions dont le Danemark est responsable et qu'il contrôle. La majeure partie de l'empreinte climatique réelle du pays n'a jusqu'à présent pas été prise en compte dans les objectifs de la loi sur le climat. Des objectifs de réduction sont nécessaires pour les émissions soutenues par le secteur financier, les émissions liées au transport international et les émissions liées à la consommation. Il faut mettre un terme aux importations de biomasse et d'aliments pour animaux et réduire considérablement la combustion de biomasse. À cela il faut aussi ajouter une aide internationale beaucoup plus importante pour la lutte contre le changement climatique.
Mais lorsque le gouvernement a invité à des négociations sur un nouvel objectif climatique à la fin du mois de novembre, ce n'était en aucun cas pour remédier aux faiblesses inhérentes à la loi sur le climat. La proposition du gouvernement prévoyait un objectif de réduction de 82 % en 2035. Selon une analyse du Conseil climatique, 80 % ne suffisent pas pour que le Danemark puisse se qualifier de pays pionnier en matière d'écologie, et selon les propres projections climatiques du gouvernement, cet objectif de 80 % sera atteint avec la politique déjà adoptée.
La lutte des classes détermine la couleur de la transition
De la gauche à une partie de la droite, tout le monde se réclame de la « transition verte », mais il n'existe pas une seule et même transition verte. La politique climatique et environnementale est un champ de bataille où différentes classes et factions de classes s'affrontent sur la direction à prendre.
Pour les partis SD, V, M et les autres partis bourgeois, il s'agit avant tout de préserver l'existant et de laisser les solutions climatiques aux mains des forces du marché et des nouvelles technologies, de l'alimentation animale Bovaer aux installations de captage et de stockage du carbone (CSC). Ceci profite avant tout au 1 % de la population qui détient un quart de la richesse totale et possède la majorité des actions et des entreprises.
Ceux qui possèdent le plus, gagnent le plus et décident le plus sont aussi ceux qui polluent le plus. Une personne qui fait partie du 1 % le plus riche de la population danoise émet huit fois plus de CO2 qu'une personne qui appartient à la moitié la plus pauvre de la population, selon une analyse réalisée par Oxfam Danemark. Et les inégalités en matière d'émissions de CO2 ne cessent de croître. Depuis 1990, les 50 % les plus pauvres de la population ont réduit leurs émissions d'environ 33 %, tandis que les 1 % les plus riches les ont réduites de 3 %.
Une « transition verte » qui préserve le système signifie que les plus démuni.e.s doivent payer la facture pour que certains membres de la classe capitaliste puissent bénéficier d'opportunités d'investissement rentables (par exemple dans des parcs photovoltaïques) et que les mesures climatiques sont freinées par des intérêts financiers à court terme (comme lorsque aucune entreprise ne souhaite soumissionner pour l'installation de grands parcs éoliens en mer). Ces mécanismes ont récemment été décrits dans le livre Klima og klasse ["Climat et classe, comment éviter que la lutte contre le changement climatique ne débouche sur une fracture culturelle ?" 2025 R.Møller Stahl, Ch.Ellersgaard, A.Møller Mulvad8Informations vorlag]).
Plus les forces procapitalistes sont autorisées à donner le ton, plus il devient impossible de susciter le soutien populaire en faveur d'une transition verte efficace et d'une gestion de la production et de la consommation.
Les sociaux-démocrates reculent devant tout ce qui peut remettre en cause le capital. Ils ont donné aux dirigeants de l'industrie et de l'agriculture un droit de veto sur la politique climatique, notamment par le biais de partenariats climatiques et du Grøn Trepart, « tripartite verte »[taxe sur les rejets de méthane de l'élevage à partir de 2030 ndt]. Cette préservation des rapports de force et des rapports de propriété existants a permis de maintenir la paix avec des acteurs puissants tels que la Confédération danoise de l'industrie (DI) et l'Association danoise de l'agriculture et de l'alimentation (Landbrug og Fødevarer), mais en même temps, ils ont perdu le soutien de la population, tant au niveau électoral qu'en ce qui concerne les objectifs climatiques.
Des études montrent que la plupart des salarié.e.s estiment important que la transition écologique soit socialement équitable. Ce soutien est sapé par l'augmentation des inégalités et de la précarité de l'emploi.
Les forces de droite ont exploité de manière hypocrite, mais avec succès, les conséquences du « capitalisme vert » pour mobiliser contre les mesures climatiques et environnementales. Elles se présentent comme les défenseurs du citoyen lambda et des régions périphériques du Danemark, alors qu'elles sont les plus farouches opposantes à l'égalité sociale.
Comme l'a constaté Morten Skov Christiansen, président de la Fédération des syndicats danois (FHO), en présentant l'année dernière une proposition pour une transition verte équitable : « La transition verte bénéficie toujours d'un soutien au Danemark, mais celui-ci a chuté de plus de dix points de pourcentage au cours des trois dernières années. Il faut inverser cette tendance et veiller à ce que les nouvelles taxes vertes n'aient pas d'impact social inégalitaire. Il est également essentiel que les salarié.e.s de certains secteurs qui doivent se transformer en profondeur aient accès à la formation continue et à la reconversion professionnelle. »
Un programme d'action pour une transition verte équitable
Le parti Enhedslisten a participé aux négociations sur la loi climatique en exigeant que l'objectif pour 2035 soit une réduction de 90 % des émissions de CO2 et que la loi climatique soit étendue à l'empreinte carbone mondiale du Danemark, mais aussi que « les efforts en faveur du climat soient plus inclusifs, socialement équitables et ancrés démocratiquement ».
C'est ce qu'écrit la porte-parole du parti pour le climat, Leila Stockmarr, sur Facebook (28/11/2025), avant d'ajouter : « Nous nous battrons avec tous les moyens dont nous disposons. »
C'est très bien, mais nous n'aurons la force de faire changer de cap le Parlement danois que si les mouvements écologistes, les syndicats, les communautés locales et d'autres forces populaires s'unissent activement pour exiger une transition verte juste et démocratique.
L'Enhedslisten doit continuer à présenter au Parlement des revendications de qualité, mais doit également contribuer à réunir les fils d'un programme offensif en faveur d'une transition verte et équitable et passer à l'action en dehors des murs de Christiansborg.
Comme l'affirme le livre Klima og klasse (Climat et classe), il doit s'agir d'une « transition verte au bénéfice matériel du plus grand nombre », fondée sur « une stratégie qui place l'emploi et la sécurité matérielle au centre ».
Elle doit reposer sur la redistribution sociale et la démocratisation de l'économie, tant en termes d'investissements, d'emplois, de propriété que de consommation.
Cela concerne notamment les exigences suivantes :
- Planification des investissements afin de garantir un développement rapide des énergies renouvelables, la création de nouveaux emplois dans les zones vulnérables, la rénovation climatique des logements et la sécurité de l'approvisionnement
- Un plan de création d'emplois verts qui met l'accent sur l'installation, la réparation et les activités de soins
- Une charte publique garantissant ces emplois verts
- Le droit à la reconversion et à la requalification vers des emplois durables
- La protection contre les pratiques de « dumping social » pour les investissements verts
- La socialisation du secteur de l'énergie par le biais de différentes formes de propriété publique ou collective et de contrôle par les utilisateurs
- Mise en place d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., en fonction des besoins – en prenant en compte les personnes et la nature – plutôt que de l'optimisation des profits des propriétaires fonciers et des spéculateurs.
- Une réforme agraire qui favorise la propriété collective et la transition vers une production biologique et végétale
- Un secteur financier sans spéculation qui finance les investissements verts, et non les énergies fossiles
- Un impôt sur la fortune qui oblige les grandes fortunes à payer pour la dépollution
- Faire en sorte que la consommation durable soit la moins chère, par exemple par la production d'aliments sains et respectueux du climat
- Se prémunir contre les chocs des prix des denrées alimentaires de base, de l'énergie et du chauffage : contrôle des prix, plafonnement des prix de l'énergie pour les consommateurs, réserves publiques de produits essentiels pour contrôler les prix
- Des mesures contre la consommation de luxe, comme les yachts de luxe et les jets privés
- Taxes climatiques progressives, par exemple sur les kilomètres parcourus en avion et en voiture, lorsqu'il existe des alternatives collectives ( par exemple, péage routier ciblé et transports publics bon marché).
- Compensation pour les groupes à faibles revenus en cas d'augmentation des taxes et des prix.
Le Parti social-démocrate ne peut guère être poussé à rompre son alliance avec le capital, mais il peut probablement être poussé à faire certaines concessions, car il est en crise après les élections municipales et a besoin de se forger un profil plus social avant les élections législatives de l'année prochaine.
Quoi qu'il en soit, et plus important encore, un front rouge-vert actif en dehors du Parlement est essentiel pour que le rapport de forces puisse changer dans les années à venir. Cela permettrait de préparer le terrain pour un changement de pouvoir qui, avec un programme comme celui mentionné ci-dessus, s'attaquerait sérieusement à la catastrophe climatique. Cela vaut tant pour le rapport de forces que pour le contenu : la lutte pour le climat ne peut être gagnée que dans le cadre de la lutte des classes.
Publié par Socialistick Information le 8 décembre 2025, traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Portugal : Le pays répond au train de mesures gouvernementales sur le travail par une forte participation à la grève générale

Écoles fermées, transports et hôpitaux fonctionnant au ralenti, entreprises à l'arrêt dans de nombreux secteurs. Les syndicats affirment que le succès de la grève générale devrait contraindre le gouvernement à retirer sa proposition.
11 décembre 2025 | tiré du site Europe solidaire sans frontières | Piquet de grève à Lisbonne. Photo Tiago Petinga/Lusa
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article77287
« Rien ne peut masquer l'ampleur de cette grève et la volonté des travailleurs de rejeter ce paquet de mesures sur le travail, qui est très claire dans tous les secteurs », a déclaré jeudi matin le secrétaire général de la VGTP devant l'école Marquesa de Alorna, à Lisbonne. Comme les autres écoles de la ville et la grande majorité des écoles du pays, elle a fermé ses portes lors de la grève générale, ce qui constitue un exemple supplémentaire de son « impact très fort sur la majeure partie de l'administration publique ».
« Si quelqu'un avait besoin d'avoir une idée précise des préoccupations des travailleurs, cette grève générale en donne la mesure », a résumé Tiago Oliveira, insistant sur le fait que les travailleurs ont compris que le paquet de mesures sur le travail « constitue un recul profond de leurs droits et ne sert aucun travailleur ».
« Voici la réponse des travailleurs : retirez le paquet de mesures sur le travail de la table des négociations » a exigé le dirigeant syndical, accusant le gouvernement de s'être « campé sur ses positions dès le début. Lorsqu'il a déclaré qu'il ne modifierait en rien les éléments fondamentaux de la proposition, l'ampleur de l'attaque en cours, au service des intérêts des grandes entreprises, est devenue évidente », a-t-il rappelé.
Des critiques similaires avaient été formulées par le dirigeant de l'UGT tôt dans la matinée sur la chaîne RTP, Mário Mourão accusant le gouvernement de conditionner les négociations et n'excluant pas la possibilité d'une nouvelle journée de grève générale si le gouvernement persistait dans sa proposition actuelle.
À l'école Marquesa de Alorna également, José Manuel Pureza, le coordinateur du Bloco de Esquerda s'est joint au piquet de grève et a salué l'ampleur du mouvement « dans tous les secteurs et dans tout le pays ».
« Les gens ont compris qu'il s'agit d'une attaque sans précédent contre les droits des travailleurs et qu'en s'attaquant au travail, on s'attaque à la vie quotidienne des gens : précarité éternelle pour ceux qui entrent sur le marché du travail, heures supplémentaires payées avec des réductions, parents dont les droits sont limités. C'est une agression qui vise à détruire des vies », a déclaré José Manuel Pureza aux journalistes.
Pour le coordinateur du Bloco, cette grève « est un cri de révolte et en même temps d'espoir qu'il est possible de changer cette situation et d'avoir des règles de travail compatibles avec une vie digne pour tous ». Pureza a répondu aux critiques du premier ministre Luís Montenegro en affirmant que « c'est le gouvernement qui se livre à un jeu politique évident. Il n'y a aucune raison rationnelle à cette réforme », qui ne traduit qu'un « pur préjugé idéologique ».
José Manuel Pureza a commencé à accompagner la grève générale mercredi soir avec le piquet de grève chez Autoeuropa, où le taux de participation a contraint à l'arrêt de la production.
Les médecins, les enseignants et les pilotes d'avion exigent le retrait du paquet de mesures sur le travail
Tôt dans la matinée, plusieurs dirigeants syndicaux se sont adressés aux journalistes, sachant déjà que le taux de participation à la grève générale était très élevé. Au nom de la Fédération nationale des médecins, Joana Bordalo e Sá a assuré à la population que les services minimums étaient assurés, mais que les consultations et les opérations chirurgicales prévues pour aujourd'hui seraient reportées. La syndicaliste affirme que ce paquet de mesures affectera également les médecins, car il instaure des contrats plus précaires et un système d'heures supplémentaires que les médecins ont toujours refusé. Elle estime que Luís Montenegro n'a d'autre solution que de retirer la proposition, « à moins qu'il ne veuille aggraver les conditions de travail des médecins et des professionnels du Service national de santé (SNS) ».
« Quatre médecins quittent chaque jour le SNS, 15 % de la population n'a pas de médecin de famille, les délais d'attente aux urgences dépassent 17 heures, les femmes enceintes accouchent dans les ambulances, avec déjà 174 accouchements dans les ambulances depuis le début de l'année. L'intransigeance du gouvernement dans la manière de négocier avec les médecins n'a pas attiré davantage de médecins vers le SNS, bien au contraire. Le SNS est plus fragilisé et il n'y a qu'un seul responsable, c'est le gouvernement et Montenegro », a résumé la dirigeante de la FNAM.
Dans une école de Porto également fermée, Francisco Gonçalves, secrétaire général de la Fenprof, a évoqué les raisons pour lesquelles les enseignant.e.s s'opposent au paquet de mesures sur le travail, car « si les conditions générales prévues par le droit du travail sont mauvaises, il est impossible d'avoir un statut décent pour la carrière enseignante ».
« Les travailleurs enseignants et non enseignants ont compris ce qui est en jeu », comme le prouve leur adhésion à cette journée de grève générale. Le syndicaliste espère que le gouvernement saura en tirer les leçons, « et en fonction de l'attitude du gouvernement, nous devrons ajuster pour l'avenir les formes de lutte les plus appropriées » .
Dans le transport aérien aussi, un service minimum a été assuré, avec la réalisation de 63 des 238 vols prévus par le groupe TAP. Helder Santinhos, président du syndicat des pilotes d'aviation, a déclaré à la télévision publique RTP que pour cette profession, les mesures sur le travail sont avant tout néfastes car elles remettent en cause la primauté des conventions collectives. « Notre position est celle de la solidarité avec les secteurs les plus vulnérables, nous pensons que personne ne devrait rester indifférent » à cette attaque contre les travailleurs. Au sujet des sondages qui montrent que la grande majorité de la population s'oppose au paquet de mesures sur le travail, le syndicaliste déclare que « le gouvernement peut ignorer la réalité, mais il ne pourra pas éviter les conséquences de cette réalité ». Et s'il insiste pour faire passer ces lois, « le syndicat ne restera pas sans réagir » assure-t-il.
Esquerda.net
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
Source - Bloquo de esquerda, 11 décembre 2025 - 10h35 :
https://www.esquerda.net/artigo/pais-responde-ao-pacote-laboral-com-forte-adesao-greve-geral/96849
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Ukraine face à un dépeçage impérial

Les propositions de paix de l'administration Trump pour l'Ukraine ressemblent à une transaction immobilière, où les États-Unis obtiennent une commission en échange de la cession du territoire ukrainien. Mais avec un levier de négociation qui s'amenuise, le pays pourrait être contraint d'accepter un accord sinistre.
7 décembre 2025 | tiré du site Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article77243
Le 21 novembre, les Ukrainiens se sont retrouvés face à une proposition de paix exigeant une acceptation quasi immédiate. Le plan de paix en vingt-huit points qui a fuité, rédigé par l'envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff [1], et le responsable russe Kirill Dmitriev [2], se lit comme une transaction immobilière. La Russie obtient le territoire, les États-Unis prennent leur part, l'Europe paie la facture, et l'Ukraine peut choisir entre capituler maintenant ou capituler plus tard. Sous pression, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à la nation sans détour : « Perte de dignité ou d'un partenaire clé. Vingt-huit points difficiles ou un hiver extraordinairement difficile. »
Les dirigeants européens stupéfaits — pris de court par les dispositions de l'initiative — se sont empressés d'improviser des contre-propositions. Au milieu de l'indignation à la Maison Blanche suite à la fuite, des pourparlers d'urgence à Genève ont produit un cadre révisé en dix-neuf points, renvoyant les questions les plus difficiles à un futur dialogue de haut niveau. Trump a déclaré des « progrès considérables » et annoncé la sixième visite de Witkoff à Moscou cette année. Le Kremlin, quant à lui, a rejeté les révisions européennes et signalé que seuls les vingt-huit points initiaux correspondaient à « l'esprit d'Anchorage » — c'est-à-dire les ouvertures de Trump à Vladimir Poutine lors de leur sommet en Alaska cet été. [3] La Russie a clairement indiqué qu'elle restait prête à atteindre ses objectifs globaux par des moyens militaires — une position qui laisse peu de place au compromis.
Thanksgiving est passé, et la position de l'Ukraine s'est encore affaiblie. Le 28 novembre, juste avant son départ pour Miami pour une nouvelle série de consultations, Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky et négociateur principal pour la paix, a démissionné après que des enquêteurs anticorruption ont perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin de 100 millions de dollars (environ 95 millions d'euros) dans le secteur énergétique. [4] Le même jour, des informations ont émergé selon lesquelles Washington était prêt à reconnaître unilatéralement le contrôle russe sur la Crimée et d'autres territoires occupés. Le lendemain, l'ancien commandant en chef de l'Ukraine, Valeriy Zaluzhny [5], a déploré l'absence d'objectifs politiques clairs, notant que même une paix temporaire pourrait offrir une fenêtre pour récupérer et se préparer à ce qui viendra ensuite.
Cette chaîne d'événements pourrait ne pas mettre fin à la guerre — les dernières discussions au Kremlin mardi ont été peu concluantes — mais elle révèle comment les grandes puissances imaginent actuellement ses résultats et combien peu les exigences fondamentales de la Russie ont changé alors même que le levier de l'Ukraine s'est réduit. Moscou a fait des concessions marginales par rapport à ses positions maximalistes exprimées en juin, mais s'attend toujours à contraindre Kyiv à une neutralité permanente, à obtenir la reconnaissance des conquêtes territoriales russes, à imposer des restrictions militaires présentées comme une « démilitarisation » et à extraire des concessions idéologiques sous l'étiquette de « dénazification ». Ce qui a changé n'est pas le fond mais plutôt le contexte : une Ukraine plus épuisée, un Occident plus divisé et un environnement géopolitique plus propice à la pression qu'à toute notion, même rhétorique, de justice. [6]
La neutralité comme veto impérial
La fixation de la Russie sur la neutralité de l'Ukraine est antérieure à l'invasion. Elle a été articulée le plus clairement dans les projets de traités de Moscou de décembre 2021, qui demandaient que non seulement l'Ukraine mais l'ensemble de l'ancien bloc socialiste soit traité effectivement comme une zone tampon. C'est la principale des « ambiguïtés des 30 dernières années » (comme les appellent les vingt-huit points) que le Kremlin vise à régler. Cette obsession de maintenir l'Ukraine hors de l'OTAN n'est pas une question de « sécurité indivisible » mais de sphère d'influence russe dans laquelle les besoins de sécurité des petits États sont ignorés. L'Ukraine est le cas test pour savoir si Moscou peut opposer son veto à la politique étrangère de ses voisins, dans une doctrine Monroe à l'accent russe. [7]
La Russie exige des assurances formelles concernant la neutralité permanente de l'Ukraine non seulement de Kyiv mais aussi des membres de l'OTAN. Les clauses originales exigeant des États qu'ils mettent fin ou n'entrent pas dans des traités qui violeraient ces obligations de neutralité pourraient affecter même le futur chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union européenne, si Bruxelles renforçait sa clause de défense mutuelle. [8] Les États-Unis, quant à eux, ne semblent pas prêts à fournir quoi que ce soit au-delà de leur implication actuelle, et encore moins à offrir des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN, qui stipule les conditions d'une réponse à une attaque. Si la Russie frappe à nouveau, Washington n'est engagé qu'à annuler l'accord et à une « réponse militaire coordonnée décisive » non spécifiée. Cela laisse Kyiv responsable de sa propre sécurité, armé de promesses que Moscou peut ignorer.
Démilitarisée et sans défense
Il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel l'Ukraine envahirait la Russie en premier. Les arguments du Kremlin sur la démilitarisation ont toujours eu un seul objectif : saper la capacité de Kyiv à résister, puis dicter les conditions.
Les négociations d'Istanbul en avril 2022 proposaient de fixer le nombre maximum de troupes ukrainiennes entre 85 000 et 250 000, avec des portées de défense aérienne et d'artillerie limitées. [9] Le projet Witkoff-Dmitriev a plus que doublé la limite supérieure à 600 000 soldats et maintenu l'interdiction d'une présence militaire étrangère, tuant toute chance pour des forces de maintien de la paix ou de dissuasion. Après une forte résistance, les perspectives de forces de maintien de la paix ont été remises sur la table, et le plafond du nombre de troupes a également été relevé. Mais tandis que ces révisions attendent l'approbation du Kremlin, tout le débat se concentre sur la mauvaise question. Pourquoi l'Ukraine devrait-elle maintenir une armée de taille de guerre en temps de paix, et plus important encore, qui va payer pour cela dans un pays détruit ?
On peut soutenir que même le pire scénario issu des pourparlers d'Istanbul il y a trois ans n'empêche pas l'Ukraine de construire une défense robuste. Si le soutien public tient, Kyiv peut compter sur un grand nombre de réservistes, certains formés à l'étranger sur des systèmes d'armes avancés qui pourraient être rapidement redéployés lorsque les hostilités reprendront. Mais tout accord qui restreint l'assistance occidentale dans ce domaine institutionnaliserait l'asymétrie et rendrait l'Ukraine impuissante si la Russie viole un autre accord qu'elle a signé.
« Dénazification » et le mensonge du génocide
La composante idéologique des exigences russes — la « dénazification » — fonctionne comme un cadrage politique plutôt qu'un agenda pratique. Les forces russes qualifient régulièrement les troupes ukrainiennes d'« Allemands », et Moscou continue de justifier l'invasion comme une réponse au « génocide » dans le Donbass, même quand les chiffres exposent le mensonge. Au cours des trois dernières années avant la guerre à grande échelle (2019-2021), les décès de civils liés au conflit dans la région ont totalisé moins d'une centaine. Depuis le début de la prétendue mission de sauvetage de la Russie, des milliers de personnes sont mortes et des centaines de milliers ont été déplacées dans ces deux seules régions, après que plus d'une douzaine de villes avec une population combinée d'avant-guerre d'environ un million d'habitants ont été détruites.
L'instrumentalisation par les autorités russes des peurs de l'extrême droite, alors même qu'elles promeuvent le néofascisme tant au niveau national qu'à l'étranger, est une propagande flagrante. Pourtant, la demande de cette victoire symbolique demeure. En 2022, le Kremlin a énuméré d'importants changements juridiques comme preuve de la déradicalisation de l'Ukraine. La proposition Witkoff-Dmitriev utilise déjà un langage plus neutre. Cependant, en Ukraine, même les débats légitimes sur le nationalisme, les politiques de mémoire ou les droits des minorités ont été discrédités par l'utilisation par la Russie de tous ces éléments comme prétextes à l'agression. Des obligations extraites sous la menace militaire ne modéreraient guère la politique ukrainienne mais enracineraient plutôt la polarisation et donneraient aux nationalistes leur plus fort grief.
Partage du butin
La dimension territoriale reste au cœur de la position de la Russie. L'anxiété de Moscou face à la non-reconnaissance de ses conquêtes en Ukraine est désormais comptée parmi les « causes profondes du conflit ». Maintenant, le Kremlin revendique cinq régions ukrainiennes — la Crimée, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia — bien qu'il ne contrôle entièrement que deux d'entre elles. [10] La ligne rouge de la Russie : reconnaître cette nouvelle « réalité sur le terrain ».
Les justifications ont évolué avec les changements sur le champ de bataille. Initialement, Moscou prétendait « protéger » les « républiques populaires » nominalement indépendantes de Donetsk et de Louhansk, mais a ensuite décidé que la meilleure protection était leur absorption dans la Russie proprement dite. Pour cimenter son pont terrestre vers la Crimée, la Russie a en outre annexé ce qu'elle détenait à Kherson et Zaporijjia et a continué à revendiquer les parties qu'elle ne contrôlait pas. Les « zones tampon démilitarisées » sous contrôle russe proposées dans les parties de la région de Donetsk que l'Ukraine contrôle encore ont un objectif clair : forcer le retrait ukrainien des positions stratégiques tandis que les territoires occupés fortifiés de la Russie restent intouchés.
L'Ukraine ne peut pas reconquérir tous les territoires occupés par la force dans les conditions actuelles. Mais elle ne peut pas non plus se permettre d'accorder à Moscou des droits irréversibles sur eux. La position de Kyiv se limite à refuser la reconnaissance tout en acceptant la ligne de contact comme point de référence pour de futures négociations, et à exclure les moyens militaires du règlement des différends.
Des précédents existent pour des cessez-le-feu durables même lorsque les revendications territoriales sous-jacentes restaient non résolues — Chypre depuis 1974, la Corée depuis 1953, le Cachemire depuis 1972. Mais Chypre a des casques bleus de l'ONU et des troupes étrangères des deux côtés. La Corée a l'une des frontières les plus militarisées du monde. Le Cachemire connaît des flambées régulières de violence, empêchées de devenir une guerre totale uniquement par la dissuasion nucléaire. Aucun n'offre de modèle pour une paix durable en Ukraine correspondant aux accords discutés.
Les dispositions économiques du plan révèlent son caractère mercenaire. Moscou obtient un allègement progressif des sanctions, une dispense effective de responsabilité pour les crimes de guerre, une réadmission au G8 [11], et une coopération économique lucrative. Washington reçoit une compensation pour les garanties, des profits sur les avoirs russes gelés, et Trump présidant personnellement l'organe d'exécution du « Conseil de paix ». Ce n'est pas un conflit d'intérêts, nous dit-on — juste le modèle commercial. L'Europe, dans ce schéma, devient coresponsable, rendue aussi responsable de la reconstruction de l'Ukraine que l'agresseur réel. Bien que les dommages causés par la Russie à l'Ukraine dépassent un demi-billion d'euros, la responsabilité financière de Moscou est limitée à une partie des avoirs déjà détenus par les autorités de l'UE.
Les propositions attendent en outre des engagements de tous les membres de l'OTAN — modifier la politique de la porte ouverte, bloquer l'adhésion de l'Ukraine, limiter les déploiements — prêts à les imposer à trente et un pays sur trente-deux. Le rôle de l'Ukraine et de ses alliés européens semble limité à protester, pousser des changements et essayer de reporter les sujets sensibles. Et une fois que Moscou rejette ces objections, le cycle se répète simplement.
En 2024, le groupe ukrainien de gauche Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), tout en critiquant la réponse de l'État en temps de guerre, a appelé pour la première fois à un « dialogue sur des objectifs réalisables ». [12] C'était en contraste frappant avec les attitudes d'il y a deux ans, quand l'accent était mis sur la victoire totale et la défaite de la Russie. La même année, environ la moitié des Ukrainiens considéraient encore les négociations avec Moscou soit impossibles, soit acceptables seulement après une libération territoriale complète.
Dans la seconde moitié de 2025, selon les sondages de l'Institut international de sociologie de Kyiv, les attitudes populaires avaient encore évolué. Alors que moins de 20 pour cent sont prêts à accepter les conditions du Kremlin et que seulement 39 pour cent accepteraient la reconnaissance américaine de l'annexion de la Crimée par la Russie, plus des trois quarts pourraient vivre avec un gel du conflit aux lignes de front actuelles. Ils le verraient même comme au moins un succès partiel tant que les appropriations territoriales de la Russie ne sont pas légitimées, que le soutien militaire et financier occidental continue, que l'espace aérien est fermé aux frappes russes et que les sanctions sont maintenues jusqu'à ce qu'une véritable paix soit atteinte. Washington et Moscou n'offrent rien de tout cela, montrant que la volonté du public ukrainien compte peu sans la capacité d'influencer les résultats. [13]
Piège de la dépendance
En fin de compte, ces négociations ne sont pas décidées par l'habileté diplomatique mais par les faits matériels. La vulnérabilité de l'Ukraine s'étend au-delà du manque de personnel militaire et de fonds. Les États-Unis fournissent environ 30 pour cent des armes utilisées par Kyiv, y compris la défense aérienne Patriot, les missiles F-16, les roquettes HIMARS [14], l'imagerie satellitaire et les données de ciblage. Washington contrôle également leurs transferts à partir des stocks d'autres parties. Sans le renseignement américain, même la défense aérienne de l'Ukraine protégeant les civils et les infrastructures serait paralysée. L'accès à Starlink, essentiel pour les communications ukrainiennes, peut être coupé par Elon Musk à volonté.
Les alternatives européennes sont absentes ou restent inadéquates. Alors que la production d'artillerie approche les deux millions d'obus, les Patriots n'ont pas de remplacement européen car les systèmes franco-italiens SAMP/T n'existent qu'en petites quantités. La constellation de satellites IRIS² ne correspondra pas aux capacités américaines avant des années. [15] Les alternatives au HIMARS ne sont produites qu'en Corée du Sud et en Israël.
Les membres européens de l'OTAN eux-mêmes dépensent plus auprès des fournisseurs américains que pour les achats nationaux, en partie pour acheter la loyauté américaine et en partie parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible à court terme. De plus, les États-Unis contribuent à la défense de l'Europe en maintenant 84 000 soldats stationnés dans les bases européennes et en étendant leur parapluie nucléaire. Trump n'invente rien de nouveau, il exploite simplement la dépendance qui existe déjà. [16]
Justice ?
Une paix juste nécessiterait le retrait russe des zones occupées, des garanties de sécurité avec des mécanismes d'application réels, la responsabilité pour les crimes de guerre et des réparations au-delà des avoirs russes gelés. Rien de tout cela n'apparaît dans aucune proposition que Moscou accepte ou dont parle l'administration Trump. Le Kremlin n'est pas non plus prêt au compromis, ayant rejeté toutes les initiatives de paix qui ne reposaient pas sur ses exigences maximalistes. Ce qui est maintenant étiqueté « paix » est un règlement impérial rédigé par deux puissances, avec des conditions imposées d'en haut et les pays les plus directement touchés consultés en dernier.
La tragédie est que le cynisme de Trump, le manque de préparation de l'Europe et la faiblesse de l'Ukraine pourraient forcer l'acceptation de toute façon. C'est la logique du pouvoir impérial, qui n'a jamais apporté de paix durable, et aucune échéance ne changera cela. Il ne reste qu'à n'avoir aucune illusion et à nommer ce règlement pour ce qu'il est : une pause avant que la prochaine guerre ne commence.
Oleksandr Kyselov, originaire de Donetsk, est un militant ukrainien de gauche et assistant de recherche à l'université d'Uppsala.
P.-S.
https://jacobin.com/2025/12/ukraine-russia-war-concessions-trump
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] Steve Witkoff est un promoteur immobilier américain et ami de longue date de Donald Trump, nommé envoyé spécial de Trump pour les négociations au Moyen-Orient et en Ukraine en 2025.
[2] Kirill Dmitriev est le PDG du Fonds russe d'investissements directs (RDIF), le fonds souverain de la Russie, et a servi de canal diplomatique officieux entre Moscou et Washington.
[3] Le sommet d'Anchorage entre Trump et Poutine a eu lieu à l'été 2025, établissant le cadre de négociations bilatérales sur l'Ukraine excluant largement Kyiv et les alliés européens.
[4] Sur les protestations anticorruption en Ukraine et la crise de la corruption en temps de guerre, voir Priama Diia et Sotsialnyi Rukh, « Ukraine : Protestations anticorruption », Europe Solidaire Sans Frontières, 23 juillet 2025. Disponible à : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75705
[5] Valeriy Zaluzhny a été commandant en chef des forces armées d'Ukraine de juillet 2021 jusqu'à son limogeage en février 2024. Il a ensuite été nommé ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni.
[6] Pour une analyse de la détérioration de la position de l'Ukraine, voir Oleksandr Kyselov, « Ukraine : Quand il est déjà trop tard pour « arrêter la guerre » – quelques réflexions sur la « paix » et « l'ordre » », Europe Solidaire Sans Frontières, 2025. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article75073
[7] La doctrine Monroe, articulée par le président américain James Monroe en 1823, affirmait l'opposition des États-Unis à l'ingérence européenne dans l'hémisphère occidental, revendiquant effectivement les Amériques comme sphère d'influence américaine. Les exigences de Poutine font écho à cette logique en cherchant à exclure l'influence occidentale de la sphère perçue de la Russie.
[8] L'article 42.7 du Traité sur l'Union européenne contient une clause de défense mutuelle exigeant des membres de l'UE qu'ils aident un État membre victime d'une agression armée. Contrairement à l'article 5 de l'OTAN, il ne spécifie pas d'assistance militaire.
[9] Les négociations d'Istanbul en mars-avril 2022 ont été les pourparlers de paix les plus avancés entre l'Ukraine et la Russie depuis l'invasion à grande échelle. Les négociations se sont effondrées après la découverte des atrocités russes à Boutcha et le retrait de la Russie des pourparlers.
[10] La Russie a illégalement annexé la Crimée en 2014 et déclaré l'annexation des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia en septembre 2022, bien qu'elle ne contrôle entièrement aucune des quatre régions continentales.
[11] Le G8 (Groupe des Huit) était un forum intergouvernemental des principales nations industrialisées. La Russie a été suspendue de ce qui est devenu le G7 suite à son annexion de la Crimée en 2014.
[12] Sotsialnyi Rukh (Mouvement social) est une organisation socialiste démocratique ukrainienne fondée en 2015, active dans les principales villes ukrainiennes, qui combine le soutien à la résistance ukrainienne avec la critique des politiques néolibérales en temps de guerre et la défense des droits des travailleurs. Voir Francesca Barca, « Guerre, inégalités, néolibéralisme : les défis de la gauche ukrainienne », Europe Solidaire Sans Frontières, février 2025. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article74023
[13] Sur l'évolution de la position de la gauche ukrainienne sur les objectifs de guerre, voir Sotsialnyi Rukh, « Pour une Ukraine sans oligarques ni occupants ! », Europe Solidaire Sans Frontières, mars 2025. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article74018
[14] Le HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) est un lance-roquettes multiple de fabrication américaine qui a été crucial pour la défense de l'Ukraine, permettant des frappes de précision sur les dépôts de munitions russes, les postes de commandement et les centres logistiques.
[15] IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) est une constellation de satellites de l'UE prévue pour fournir des communications sécurisées et réduire la dépendance européenne aux systèmes américains. Le déploiement complet n'est pas attendu avant la fin des années 2020.
[16] Pour une analyse du dilemme de la gauche dans ce contexte géopolitique, voir Francesca Barca, « Guerre, inégalités, néolibéralisme : les défis de la gauche ukrainienne », Europe Solidaire Sans Frontières, février 2025. Disponible à : https://europe-solidaire.org/spip.php?article74023
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Libérez Narges Mohammadi

La militante des droits humains, Narges Mohammadi, a de nouveau été arrêtée par les forces de sécurité iraniennes le 12 décembre lors d'une cérémonie commémorative pour un avocat, Khosrow Alikordi, mort dans des circonstances jugées suspectes quelques jours plus tôt. Lors de cette cérémonie à Mashhad, elle aurait pris la parole pour souligner l'engagement de cet avocat et rendre hommage aux victimes de la répression en Iran.
La militante aurait aussi parlé de personnes décédées durant les manifestations et dénoncé les violations des droits humains. Elle aurait été arrêtée après avoir dit à la tribune : nous ne reculerons pas, c'est notre pays ici. Vive les combattants de la liberté. Ce serait les derniers mots qu'elle aurait prononcés avant que les forces de sécurités, qui étaient présentes en nombre, interviennent pendant qu'elle était sur l'estrade. Des témoins de l'événement auraient aussi affirmé qu'ils auraient agit avec brutalité. Les autorités ont pour leur part répondu que les propos de l'activiste lors de l'événement constituaient une incitation au désordre.
Plus grande que nature
Né à Zanjan, dans le nord-ouest de l'Iran en 1972, Narges Mohammadi serait diplômé en physique et ingénieur professionnel. Elle aurait aussi été journaliste pour des médias. Vice-présidente du Defenders of Human Rights Center, elle a reçu plusieurs prix internationaux. L'Alexander-Langer en 2009 et le prix international du gouvernement suédois pour les droits de l'homme en 2011. Celui des droits de l'homme de la ville allemande de Weimar lui aurait été donné en 2016 et le prestigieux Andrei Sakharov en 2018. En 2023, elle reçoit le prix mondial de la liberté de la presse, celui Olof-Palme pour les droits de l'homme et le Nobel de la paix. Cette femme paie cependant cher son militantisme. Arrêtée pour la première fois en 1998 pour ses critiques du gouvernement iranien, elle a été emprisonnée plus d'une dizaine de fois et a reçu au total plus d'une trentaine d'années en condamnation, mais a été libérée l'année dernière pour des raisons de santé.
L'arrestation de Narges Mohammadi a fait bondir la communauté internationale préoccupée par les droits humains. Le Comité Nobel norvégien a exprimé sa vive inquiétude et a appelé les autorités iraniennes à garantir sa sécurité et à la libérer immédiatement. De nombreuses organisations internationales de défense des droits humains ont pour leur part dénoncé une violation grave de la liberté d'expression, celle de réunion pacifique et plusieurs autres fondamentales. L'Union européenne a aussi appelé à sa libération et qualifié la situation de profondément préoccupante en raison de son état de santé fragile.
Chirine Ardakani, avocate de Narges Mohammadi, affirme que sa cliente a encore 12 ans de prison à effectuer et qu'il est à craindre que les autorités décident d'instrumentaliser cet incident pour l'y laisser. La dernière fois qu'elle aurait été arrêtée, elle aurait été interdite de tout contact avec sa famille pour une durée de trois ans.
La République islamique d'Iran utiliserait la détention arbitraire aussi bien à l'encontre de ressortissants étrangers, pour pouvoir rançonner leur libération, que ses propres citoyens.
Un combat de tous les instants
Il y a quelques dizaines d'années de cela, les Iraniennes avaient autant de droits que les femmes occidentales. Tout aurait cependant changé avec la révolution islamique en 1979. Une ségrégation des sexes aurait été instaurée, l'âge du mariage abaissé, les femmes écartées de la fonction publique et l'hijab obligatoire dès l'âge de neuf ans. Une femme ne pourrait actuellement obtenir un passeport ni voyager sans l'autorisation de son père ou son époux en Iran.
Selon le mouvement Femme, Vie, Liberté, créé après la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre 2022, les manifestations auraient été massivement réprimées par les autorités iraniennes ce qui aurait entrainé plus de 500 décès d'opposants et des milliers d'arrestations.
Il y aurait aussi eu une forte répression de la société civile après la récente guerre de 12 jours menée par Israël. Nia Gissou, du Conseille Atlantique, affirme que les avocats des droits humains subissent des attaques croissantes en Iran et plusieurs se seraient exilés. Face à une large désobéissance civile, le gouvernement aurait arrêté toute personne considérée comme une menace. La répression viserait plus particulièrement tous les opposants au régime qui s'afficheraient sur Internet.
Ceux qui contestent les autorités n'auraient cependant plus peur d'exprimer publiquement leurs oppositions. Il y a quelques années, les descentes avaient lieu dans des résidences privées ou les personnes émettaient des opinions opposées au régime, mais actuellement, elles seraient exprimées dans la rue et sur l'Internet. La peur aurait disparu et ce serait ce qui se serait passé lors de la cérémonie pour Khosrow Alikordi.
Selon Chirine Ardakani, ses clients feraient donc actuellement face à un scénario prévisible. Nous n'avons pas de respect des droits de la défense, nous avons des accusations et des charges qui sont grotesques. Selon elle, sa cliente se bat contre la théocratie iranienne, mais pour autant, ce ne serait pas une criminelle et elle devrait être libérée immédiatement. Toujours selon l'avocate, le comportement de Narges Mohammadi serait une démonstration de courage absolu.
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Poutine en Inde : tapis rouge mais résultats en demi-teinte

Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe à New-Delhi les 4 et 5 décembre derniers pour célébrer les 25 ans du partenariat stratégique indo-russe. Sa délégation était vaste, les thèmes de discussion nombreux, mais pas d'annonce majeure sur l'énergie ou les contrats de défense. Narendra Modi garde manifestement des cartes en main pour finaliser ses négociations avec Washington.
Tiré de The Asialyst.
Accueilli personnellement par Narendra Modi à sa descente d'avion pour un dîner en tête à tête, hôte d'un banquet d'Etat offert en son honneur au Rashtrapati Bhavan – le palais présidentiel – par la présidente de la République indienne Droupadi Murmu, co-président d'un forum d'affaires réunissant la fine fleur des grandes entreprises de deux pays, Vladimir Poutine a bénéficié d'un accueil exceptionnel durant son séjour de 48 heures en Inde. Cette visite est pour lui la dixième en tant que président de la fédération de Russie. Elle est l'occasion de fêter le 25ème anniversaire du « partenariat stratégique » qu'il avait établi en octobre 2000 avec le premier ministre indien de l'époque, Atal Bihari Vajpayee.
Lors d'une conférence de presse conjointe le 5 décembre, Narendra Modi soulignait que « l'amitié entre l'Inde et la Russie a réussi à surmonter les nombreuses crises internationales des dernières décennies, et nos relations restent fondées sur le respect mutuel et une profonde confiance. » Continuité, respect mutuel et confiance sont les mots clés d'une communication conjointe qui s'adresse manifestement d'abord aux Etats-Unis, mais également à la Chine, qui n'a pas le monopole de l'« amitié sans limites, » voire à l'Union européenne qui cherche encore à peser sur les choix stratégiques de l'Inde. La réalité des relations bilatérales est en fait loin d'être stable. Elle est certes marquée par une dynamique incontestable ces dernières années mais aussi par des enjeux en constante évolution.
Des échanges commerciaux en rapide mutation
Jusqu'au lancement de l'« opération spéciale » déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine en février 2022, les relations économiques entre l'Inde et la Russie avaient une portée modeste, avec un commerce bilatéral limité à 12 milliards de dollars. La Russie exportait sur le marché indien des quantités restreintes de pétrole et de charbon, des perles naturelles et des fertilisants. L'Inde exportait encore moins vers le marché russe (un peu plus de 3 milliards de dollars en 2021, soit à peine 0,6% de ses exportations globales).
Les choses changent brutalement avec l'invasion de l'Ukraine. L'Inde, officiellement neutre face à ce conflit, profite de l'embargo occidental sur les produits énergétiques russes et des « discounts » (environ 12 dollars par baril) que lui propose la Russie pour acheter massivement du pétrole et du charbon russe. En trois ans, la part de la Russie dans les importations indiennes de pétrole brut passe de 2,5 à 36%, selon une étude de la Carnegie Foundation publiée le 20 novembre dernier. Les exportations indiennes vers la Russie ne progressent en revanche que modestement et le déficit bilatéral de l'Inde explose, frôlant les 60 milliards de dollars en 2024.

Le 27 août dernier un nouveau choc géopolitique déstabilise la dynamique des échanges énergétiques entre la Russie et l'Inde. Donald Trump décide de taxer les exportations indiennes à 25%, auxquels s'ajoutent 25% supplémentaires en raison des achats massifs de pétrole en provenance de Russie. Trump renforce la décision du 27 août en ciblant directement les compagnies russes Lukoil et Rosfnet, qui livrent 60% du pétrole destiné à l'Inde (une décision qui a pris effet le 21 novembre). L'exaspération en Inde est d'autant plus forte qu'elle est le seul pays à être sanctionné pour acheter des produits énergétiques russes. La Chine, premier importateur de la Russie, ne l'est pas. L'Union européenne non plus, ou du moins pas encore.
Cette anomalie a été soulignée par Vladimir Poutine dans une interview donnée à India Today à la veille de sa visite : « les Etats-Unis nous achètent de l'uranium enrichi pour leurs centrales nucléaires. C'est aussi du combustible. Si les États-Unis se donnent le droit de nous acheter du combustible, pourquoi l'Inde devrait-elle être privée d'un tel droit ? »
Diversification et rééquilibrage
Au-delà du débat sur le pétrole, la visite de Vladimir Poutine est l'occasion pour l'Inde, qui a besoin de nouveaux débouchés pour compenser les barrières tarifaires érigées par les Etats-Unis, d'accroître et diversifier ses exportations vers la Russie. Le président russe a affiché son ouverture sur le sujet, déclarant que « la Russie est prête à accroître significativement ses achats de biens et services indiens, en tenant compte de son excédent commercial. » La cible d'un commerce bilatéral porté à 100 milliards de dollars en 2030 a été fixée dans le communiqué conjoint publié à l'is
Plusieurs accords signés se situaient dans cette optique de rééquilibrage. La Russie a élargi la liste des entreprises indiennes autorisées à exporter des produits laitiers et des fruits de mer sur le marché russe. Le groupe russe Ultrachem a signé une lettre d'intention avec plusieurs entreprises indiennes du secteur des fertilisants pour la création à proximité de la frontière entre les deux pays d'une usine de production d'urée de grande capacité qui permettra de réduire les coûts de la filière pour les opérateurs indiens. Les douanes des deux pays ont signé un protocole d'accord pour la facilitation des échanges. Les discussions s'accélèrent pour la signature d'un traité bilatéral de protection des investissements et la mise en place d'un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union économique d'Eurasie. (L'Union économique d'Eurasie comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizstan)
Sur le plan monétaire, le recours aux devises des deux pays est déjà très avancé. Il atteindrait plus de 90% du commerce bilatéral selon les sources russes, essentiellement parce que l'Inde achète le pétrole russe en roupies, ce qui constitue clairement un avantage supplémentaire pour New Delhi (c'est aux Russes de se débrouiller avec leurs avoirs en roupies qui s'accumulent dans le système financier indien).
La coopération dans le nucléaire civil était également au cœur des discussions, avec comme projet phare la centrale nucléaire de Kudankulam, dont deux tranches sont en fonctionnement et quatre autres en phase de finalisation, ainsi que la recherche d'un nouveau site, le lancement d'une coopération sur les petits réacteurs et les projets de retraitement. L'Inde s'est fixé des objectifs très ambitieux dans le nucléaire civil : porter la capacité de production électrique d'origine nucléaire de 9 gigawatts aujourd'hui à 100 Gigawatts en 2047 (date du centième anniversaire de l'indépendance). La Russie fait clairement partie des partenaires majeurs dont elle a besoin pour s'approcher de cette cible.
Un accord de facilitation pour les échanges de travailleurs qualifiés est en phase de finalisation, pour augmenter la présence en Russie des travailleurs indiens dans différents domaines – construction, santé, tourisme – dans un contexte où la Russie connaît un déficit structurel de travailleurs qualifiés.
Ces perspectives sont bienvenues pour l'Inde mais restent modestes par rapport aux deux enjeux majeurs que représentent l'énergie et la défense.
Modi très prudent sur les sujets clés
Face aux sanctions américaines sur le pétrole, Vladimir Poutine a promis des « fournitures ininterrompues de produits pétroliers à l'Inde. » Narendra Modi ne s'est pas exprimé directement sur le sujet. S'agissant de l'Ukraine, il a souligné que l'Inde n'était pas neutre, mais qu'elle soutenait « la paix. » Pour autant, aucune mention de l'Ukraine ne figure dans le communiqué conjoint. L'article publié dans le Times of India le 30 novembre par les ambassadeurs de France, d'Allemagne et du Royaume Uni intitulé « le monde veut la fin de la guerre en Ukraine, mais la Russie ne paraît pas sérieuse en matière de paix » a été jugé « inacceptable » par les autorités indiennes.
Brahma Chellaney, professeur d'études stratégiques au Center for Policy Research de New-Delhi, donnait, lors d'un débat récent organisé par la chaîne d'information Al Jazeera, des éléments de contexte intéressants sur l'attitude indienne face aux sanctions américaines. Il rappelait qu'en 2019 les Etats-Unis avaient menacé de sanctions les pays qui continueraient à acheter du pétrole iranien au moment où Washington s'était retiré de l'accord de non-prolifération nucléaire avec l'Iran. L'Inde avait fini par accepter de ne plus acheter de pétrole iranien. La Chine en avait aussitôt profité pour accroître ses propres achats à des prix très compétitifs, devenant à bon compte le principal acheteur de pétrole iranien. L'Inde était apparue comme le « looser » de cette séquence géopolitique et il n'est pas question pour Narendra Modi de recommencer.
Pour autant les opérateurs indiens ne peuvent pas ignorer les sanctions américaines. Ils ont commencé dès le mois de novembre à réduire leurs achats de pétrole russe. La chute pourrait atteindre plus de 30% au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Dans le même temps, les opérateurs indiens ont commencé à acheter davantage de pétrole américain (un demi-million de barils/jour fin octobre 2025). A défaut d'un engagement formel de ne plus acheter de pétrole russe qui est clairement inacceptable pour Modi, un réajustement à la baisse des livraisons russes et à la hausse des livraisons américaines est en cours, en attendant une hypothétique avancée sur le règlement du conflit avec l'Ukraine.
La même prudence caractérise l'attitude de Modi en matière de défense, où la Russie demeure le premier partenaire de l'Inde. Alors que Moscou annonçait des accords possibles en matière de missiles sol-air et de contrats aéronautiques, rien n'a été officialisé à l'issue de la rencontre entre les deux ministres de la défense. Une première partie du problème vient de la Russie elle-même, qui a le plus grand mal à respecter les délais des contrats en cours, en particulier celui relatif aux missiles sol-air S400, en raison des priorités liées à la guerre en Ukraine. Une autre partie vient de l'Inde, qui accorde une priorité maximale à la localisation de son industrie de défense, ce qui retarde les décisions sur les grandes commandes d'aéronautique militaire. Les discussions sur la livraison par la Russie du SU57, chasseur furtif de cinquième génération, se heurtent probablement à cette exigence indienne. Une troisième partie est liée aux discussions en cours avec Washington, qui ont également un volet militaire important.
Globalement, la visite de Vladimir Poutine en Inde est caractéristique du jeu d'équilibre instable auquel se livrent actuellement les quatre grandes puissances de la planète (Etats-Unis, Chine, Inde et Russie) pour préserver les alliances traditionnelles, gagner des points dans les rivalités stratégiques, diversifier les partenariats et mettre au premier plan l'intérêt national, l'Union européenne apparaissant comme un « junior partner » dans ce complexe jeu de Go.
Narendra Modi n'accueillera pas Donald Trump en Inde avant la fin de l'année pour le prochain sommet de la Quad (dialogue quadrilatéral pour la sécurité réunissant Etats-Unis, Inde, Japon et Australie) dont il sera l'hôte. A la demande américaine, la rencontre a été reportée au premier trimestre 2026, ce qui signifie que les discussions bilatérales en cours sont laborieuses. On peut cependant parier qu'elles vont aboutir car un axe Inde/Etats-Unis plus stable est dans l'intérêt des deux pays.
Par Hubert Testard

Syrie : une réalité hybride

On parle beaucoup aujourd'hui en Syrie des droits des différentes composantes de la société, de la nécessité de leur participation et de leur représentation au pouvoir, de la domination d'une seule et unique couleur sur l'appareil d'État, etc., comme s'il s'agissait là d'un discours patriotique prudent susceptible de contrer une mentalité sectaire monopolistique et antipatriotique. En réalité, toutefois, ces deux positions - participative et monopolistique - sont sous-tendues par une même logique communautariste, laquelle consiste à accorder plus d'importance à l'appartenance d'un individu à une communauté qu'à son adhésion à la nation. Cette logique est néfaste pour les Syriens, car elle les rabaisse en deçà du statut de peuple et morcelle leur socle national.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Selon ce discours, la participation des diverses composantes au pouvoir se concrétiserait par la présence de membres de chacune d'entre elles à des postes élevés de l'État, et il irait de soi, dans le cas de la Syrie, que cette participation soit proportionnelle, ne fût-ce qu'implicitement et officieusement, à l'importance numérique de chacune de ces composantes au sein de la population. Cette affirmation soulève néanmoins quelques questions simples : comment pouvons-nous déduire de la simple présence d'une personne au pouvoir que le groupe dont elle est issue participe effectivement à l'exercice du pouvoir ? Est-il, préalablement à cela, permis de croire que les membres d'un même groupe partagent forcément les mêmes intérêts et la même identité politique, en sorte que celui-ci pourrait s'exprimer via un ou plusieurs représentants ? Et même à supposer qu'il en soit ainsi, qu'est-ce qui obligerait le « représentant » d'un groupe donné à être fidèle à cette identité politique et à ces intérêts ? N'est-il pas raisonnable de penser qu'il fera preuve d'une plus grande loyauté envers l'autorité qui l'a choisi et l'a nommé, quelles que soient les orientations politiques de celle-ci ? Par ailleurs, qu'est-ce qui nous empêcherait de trouver, au sein du gouvernement, des gens ouverts d'esprit et intègres qui auraient à cœur le bien commun et serviraient les intérêts de cette communauté bien qu'ils n'en soient pas issus, au même titre que ceux des autres communautés ? En effet, nous avons vu par le passé, et voyons encore aujourd'hui des Syriens s'opposer avec sincérité et sens des responsabilités aux autorités lorsque celles-ci exercent une forme de discrimination à l'encontre d'un groupe donné, sans pour autant appartenir à ce groupe de par leur naissance ; et nous avons également vu l'inverse.
Pour que le lien entre l'origine d'une personne et son rôle représentatif au sein de l'État soit valide, il serait nécessaire de convertir la présence dans la société du groupe dont elle est issue en une institution représentant les « membres » de ce groupe auprès de l'Etat. Cela impliquerait l'existence d'un mécanisme spécifique visant à sélectionner des « représentants » au sein des différents groupes, de sorte que chacun de ces derniers, et non les pouvoirs publics, puisse choisir celui qui le représentera au gouvernement, et que ce dernier endosse à son tour une responsabilité à son endroit. Dans un tel cas de figure, les différentes composantes se partageraient le pouvoir, et nous nous retrouverions face à un État à plusieurs têtes, un État constitué de plusieurs communautés dépourvues d'identité nationale. La Syrie n'a pas encore atteint ce niveau de désintégration, mais à en juger par la ligne générale suivie par le nouveau pouvoir, telle est la direction dans laquelle elle s'engage. Il serait à vrai dire dans l'intérêt du pouvoir en question de maintenir la situation hybride qui prévalait sous l'ancien régime, autrement dit de mener une politique au sein de laquelle la participation des différentes composantes n'est qu'une façade et où le pouvoir réel est détenu par un noyau dur bien identifié. Toutefois, il semble clair que le pouvoir actuellement en place à Damas n'a pas l'ouverture d'esprit suffisante pour accepter ne fût-ce qu'un simulacre de présence des divers groupes de population aux hautes fonctions de l'État, ni même la participation de leurs membres au sein du système bureaucratique, de l'armée et des appareils sécuritaires d'État.
Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas institutionnaliser la représentation des différentes communautés - comme c'est le cas au Liban, par exemple - rend leur participation si illusoire qu'elle en devient grotesque. Ce qui ne signifie pas, du reste, que le Liban soit mieux loti puisqu'à l'inverse, l'institutionnalisation du communautarisme a transformé l'État libanais en témoin impuissant de conflits civils incessants -situation qu'on ne peut envier aux Libanais et que les Syriens, selon nous, ne souhaitent pas.
Si à l'époque du clan Assad la participation des diverses composantes était purement formelle, il ne semble pas que ceux qui revendiquent aujourd'hui un tel type de représentation aient conscience de cette réalité, une telle revendication étant à leurs yeux patriotique et rationnelle en comparaison avec la logique du pouvoir post-Assad et à son recours à la marginalisation brutale. Dans cette optique, on peut dire que la réalité syrienne a toujours été hybride, combinant un discours officiel axé sur la citoyenneté (avec des propos sur le peuple, l'identité nationale, l'égalité, etc.) et une conception communautariste qui distingue les responsables selon leurs origines, de sorte que la présence d'un ministre chrétien au sein du gouvernement, par exemple, est considérée comme une participation chrétienne. La réalité syrienne hybride fait coexister la forme d'un État moderne avec un parlement, un système judiciaire, une constitution, des institutions étatiques, etc. et le souci de représenter des groupes de population qui n'ont pas de raison d'être, en tant que tels, dans le cadre d'un État moderne. Dans cette réalité hybride et incohérente, les Syriens ne sont pas égaux sur le plan juridique en tant que citoyens, un élément extrinsèque intervenant à ce niveau : celui de leur origine communautaire. Ainsi, tout titulaire de la nationalité syrienne, par laquelle il se distingue en dehors de la Syrie, possède également une autre « nationalité », de nature« communautaire », qui le caractérise à l'intérieur de la Syrie et lui confère des droits différents selon son origine. Telle est la situation installée depuis longtemps dans le pays, à tel point que ceux qui prônent une constitution où la religion du chef de l'État serait fixée de manière à exclure constitutionnellement une partie non négligeable de la population de cette fonction n'ont aucun scrupule à parler de citoyenneté, d'égalité et de rejet de la discrimination sur base confessionnelle, etc. Cette réalité hybride et incohérente est devenue si habituelle en Syrie qu'elle ne suscite plus aucune attention.
Le caractère hybride de la réalité syrienne a toujours été une source de souffrance refoulée pour les Syriens, qui vivent dans les faits une discrimination structurelle fondée sur la confession, l'ethnie, etc. enrobée dans le mensonge de l'égalité, de la citoyenneté et de la modernité. Ils ne pourront s'extraire de cette situation qu'en suivant l'une des deux voies suivantes : la première – celle du salut – les mènera vers un État moderne, qui considère l'individu indépendamment de son appartenance génétique et repose sur le principe de la citoyenneté, de sorte que les Syriens seraient réellement égaux au regard de la Constitution et des lois ; quant à la seconde – celle de la perdition -, elle les mènera vers un État où le pouvoir sera partagé entre les différentes composantes, considérées comme des entités institutionnelles et devenant dès lors des blocs solides qui ne se fondront pas dans l'État, mais tendront à former des États dans l'État, avec pour résultat que la relation de l'individu à l'État passera par sa relation avec la communauté dans laquelle il est né.
Rateb Shabo
• Traduit et revu pour ESSF par Samuel Gross et Pierre Vandevoorde.
Source - Al Araby, 30 novembre 2025.
• Al Araby est un site arabophone installé à Londres.

Gaza. Le conseil de sécurité de l’ONU contre le droit international

La tentative d'effacer le droit applicable en Palestine se prolonge dans la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Adoptée le 17 novembre 2025 par 13 voix favorables, en dépit des abstentions russe et chinoise, ce texte est contraire au droit international. En conséquence, les États membres des Nations unies ne devraient participer ni à la « force internationale » ni au « conseil de paix » prévus par l'organe politique de l'ONU.
Tiré d'Orient XXI.
En 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a considéré qu'Israël, ayant violé des normes impératives de droit international (normes dites de jus cogens (1)), devait, sans négociation, se retirer du territoire palestinien occupé, démanteler les colonies, et réparer tous les dommages causés par son occupation illicite. La CIJ a aussi rappelé que tous les États devaient prendre des mesures aux fins de forcer Israël à ce retrait et de prévenir le génocide de Gaza. Le retrait d'Israël, attendu pour septembre 2025 selon la résolution de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024, ne s'est pas produit, et rares sont les États ayant adopté le comportement qui était exigé d'eux face au génocide de Gaza.
À l'inverse, une initiative diplomatique franco-saoudienne a cherché à convaincre de revenir aux méthodes éculées de la négociation, en soutenant l'émergence d'un État de Palestine diminué : c'était la déclaration de New York, endossée par l'Assemblée générale le 10 septembre 2025. En marge de cette Assemblée générale, le président états-unien présentait son plan pour Gaza. La première étape, la seule acceptée par les groupes combattants palestiniens, a conduit à un cessez-le-feu — non respecté par Israël —, à la libération des Israéliens détenus à Gaza et de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces derniers, comme les dépouilles des Palestiniens restituées, ont confirmé l'infliction de sévices particulièrement choquants.
Alors que le plan Trump était approuvé par de nombreux États lors de la conférence de Charm El-Cheikh du 13 octobre 2025, les États arabes ou musulmans sollicités pour participer à la force internationale envisagée demandaient qu'un mandat de l'ONU vienne autoriser cette participation. C'est pourquoi les États-Unis ont saisi le Conseil de sécurité de leur plan, alors même qu'ils avaient, pendant plus de deux ans, empêché cet organe de réagir au génocide de Gaza, en utilisant leur veto de manière récurrente.
Le Conseil de sécurité ne dit pas le droit
Est-ce à dire que la résolution 2803 où le Conseil « fait sien » le plan Trump, qui y est annexé, efface et remplace le droit international applicable ? En réalité, le Conseil de sécurité n'a pas pour fonction de dire le droit international. Selon la Charte des Nations unies, il est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale (article 24) et exerce ses pouvoirs selon les chapitres VI et VII. Sur la base du chapitre VII, il peut décider de mesures s'imposant aux États et, le cas échéant, autoriser l'emploi de la force pour réagir à une situation de crise grave. Il agit par des résolutions spécifiques, dans des situations données, dans l'objectif de maintenir ou de restaurer la paix. Il ne légifère pas plus qu'il ne tranche, en droit, des différends. De plus, le Conseil ne peut pas adopter n'importe quelle décision, dans n'importe quelle situation, et il doit « agir conformément aux buts et principes des Nations unies » (article 24 §2).
La question du contrôle du Conseil de sécurité, c'est-à-dire du contrôle de la légalité de ses résolutions, a été au centre de l'attention internationale, notamment à partir des résolutions adoptées contre la Libye à la suite de l'attentat de Lockerbie en 1988 (2). Elle a été discutée devant des juges variés s'agissant de la situation dans l'ex-Yougoslavie (Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie), de la lutte contre le terrorisme (Cour de justice de l'Union européenne), de l'intervention en Irak de 2003 (Cour européenne des droits de l'homme). S'il reste difficile de faire contrôler cette légalité, les juristes savent que ce n'est pas impossible. Dans un monde idéal, l'Assemblée générale pourrait par exemple saisir la CIJ afin qu'elle examine la conformité de la résolution 2803 à son propre avis de 2024. Mais l'année 2025 nous a appris qu'il ne fallait pas trop attendre de l'Assemblée générale.
Mettre en évidence l'absence de respect des normes impératives du droit international par le Conseil de sécurité est simple : s'agissant de la Palestine, ce droit vient tout juste d'être rappelé par l'organe judiciaire principal des Nations Unies qu'est la CIJ. C'est également utile : les États ne sont nullement tenus de contribuer au plan d'occupation de Gaza soutenu par le Conseil de sécurité, la résolution ne faisant que les y « autoriser » ou le leur « demander ». Ils pourraient vouloir éviter de contribuer directement à la violation de ces normes impératives par l'envoi de contingents à Gaza. Cette illicéité imprégnerait aussi toute l'activité économique espérée par Trump et ses proches : les contrats et accords passés en ce sens devraient être considérés comme nuls, et les entreprises y contribuant devraient être boycottées. Au Conseil de sécurité, la Russie a explicitement évoqué cette illicéité et mis en garde les États ayant voté pour le texte (3).
Une force d'occupation
La résolution autorise tout d'abord les États à déployer des contingents à Gaza. Ceci, en soi, n'est pas inédit, le Conseil ayant régulièrement, depuis 1991 et la première intervention états-unienne en Irak, recouru à ce procédé d'autorisation d'emploi de la force donnée à des États. Soulignons que ce procédé n'est pas celui des opérations de maintien de la paix, où des casques bleus sont déployés, sous l'autorité de l'ONU, sans avoir pour mandat de recourir à la force. Ici, il n'est pas question d'une opération de maintien de la paix, et c'est bien ce qui semble avoir dissuadé nombre d'États de participer directement à la « force internationale de stabilisation » autorisée par le Conseil. De quoi est-il donc question ?
Il s'agit principalement de réaliser ce que l'armée israélienne n'a pu accomplir : assurer « la démilitarisation de la bande de Gaza, y compris en procédant à la destruction des infrastructures militaires, terroristes et offensives et en empêchant qu'elles soient rebâties, ainsi qu'en veillant à la mise hors service définitive des armes des groupes armés non étatiques ». Il est question de désarmer les groupes palestiniens combattants donc et, selon les termes du plan Trump annexé à la résolution, de « déradicaliser Gaza ». Cette mission, qui exige l'emploi de la force dès lors que les groupes palestiniens n'ont pas accepté de rendre les armes, doit être réalisée « en consultation étroite » avec l'Égypte et Israël. La force internationale de stabilisation doit en conséquence être considérée comme une force d'occupation associée à Israël. Or, on l'a dit, le contrôle du territoire palestinien par Israël a été tenu pour gravement illicite par la CIJ, car portant atteinte au droit impératif du peuple palestinien à disposer de lui-même. Contrairement à ce qu'a demandé la même CIJ, la résolution permettrait à Israël de ne pas se retirer.
Une occupation qui ne dit pas son nom
Le contrôle de Gaza est nécessaire pour mettre en place une sorte de gouvernement (« une administration transitoire »), sous l'autorité d'un Conseil de paix, qui serait selon nous, mieux dénommé « conseil d'occupation et de spoliation ». C'est le deuxième aspect essentiel de la résolution. Ce conseil aurait pour vocation d'« œuvrer à la reconstruction de Gaza et à l'exécution des programmes de relèvement économique ». À cette fin, le Conseil de sécurité dote l'instance d'une « personnalité juridique internationale » lui permettant de conclure tous accords ou contrats. La Banque mondiale, une institution dominée par les États-Unis, est invitée à faciliter les financements du programme. Dans le langage non euphémisé du document Trump annexé à la résolution, le plan de relèvement économique
- sera élaboré par un groupe d'experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Proche-Orient. Nombre de projets d'investissement intéressants et d'idées de développement prometteuses émanant de groupes internationaux animés de bonnes intentions seront examinés, le but étant d'élaborer un cadre régissant à la fois les questions de sécurité et les questions de gouvernance qui soit à même d'attirer et de faciliter des investissements générateurs d'emploi, de débouchés et d'espoir pour la future Gaza.
Afin de réaliser ce plan, correspondant globalement à celui de la « Riviera » annoncé par Trump au début de l'année 2025, le conseil pourra « accomplir toute tâche jugée nécessaire ». Si la résolution n'évoque jamais la question de l'exploitation des ressources naturelles, notamment maritimes, le blanc-seing donné permet de conclure des contrats à cette fin. Ce projet est contraire au droit du peuple palestinien de disposer de lui-même dans ses dimensions économiques, incluant ses choix propres de développement et la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Les Palestiniens sont relégués à un « comité à caractère technocratique et apolitique … chargé d'expédier les affaires courantes du territoire »…
Certes, l'administration est dite « transitoire », mais les perspectives d'autodétermination que la résolution a dû intégrer sont plus que distantes, et encore conditionnées. Ainsi, le conseil œuvrera jusqu'à ce que l'Autorité palestinienne ait « scrupuleusement exécuté son programme de réformes et que la reconstruction de Gaza ait progressé ». Alors, seulement, « les conditions seront peut-être (sic) réunies pour que s'ouvre un chemin crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État souverain ». Qui en décidera ? Washington instaurerait alors un « dialogue entre Israël et les Palestiniens pour qu'ils conviennent d'un horizon politique au service d'une coexistence pacifique et prospère ». L'horizon envisagé est lointain, flou, contraint et, à vrai dire, inaccessible. La référence à un État palestinien est une parfaite illusion. Si le blanc-seing est accordé par le Conseil de sécurité jusqu'en décembre 2027, sans contrôle de l'ONU (points 8 et 10 de la résolution), le système pourrait être prolongé.
Nouveau mandat sur la Palestine ?
Nombre de commentateurs ont analysé cette résolution comme autorisant un « nouveau mandat » sur Gaza. Mais, au moins, le régime des mandats institué par la Société des Nations, ou le régime des territoires non autonomes de l'ONU (4), prévoyaient, en théorie du moins, une administration dans l'intérêt des populations locales. Ici, le pouvoir est attribué nommément à un président états-unien qui ne masque pas ses intérêts personnels et dont le gendre, Jared Kushner, a été présenté comme le principal investisseur à Gaza par un autre homme d'affaires, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Certes, la résolution affirme que ce sont des « États membres » qui siégeront au conseil. Mais le plan Trump annexé est beaucoup plus clair : le conseil « sera dirigé et présidé par le président Donald J. Trump », les autres membres « y compris des chefs d'État, seront annoncés ultérieurement, l'ancien premier ministre Tony Blair en faisant partie ». Le pouvoir est donc donné à un groupe de personnes entendant tirer des profits personnels de l'opération, et ceci est inédit. L'intérêt du peuple palestinien n'est, par ailleurs, jamais mentionné dans la résolution, le « relèvement économique » ne semblant pas le concerner, tandis qu'aucune redistribution des profits attendus n'est envisagée. Le plan Trump évoque quant à lui « une gouvernance moderne et efficace à même de servir la population de Gaza »… et « d'attirer les investissements ».
Par-delà l'occupation prolongée, le dispositif permet donc la spoliation du peuple palestinien, au profit d'une élite impérialiste états-unienne décomplexée. Ainsi, les accords et contrats conclus par le conseil d'occupation pourront être considérés comme invalides : un traité contraire au jus cogens doit être tenu pour nul selon le droit international (article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). Les accords qui seraient adoptés par l'Union européenne pourraient, par exemple, être contestés devant ses juridictions, comme le furent ceux conclus avec le Maroc pour l'exploitation des ressources du Sahara occidental. La grande majorité des groupes palestiniens et des ONG palestiniennes a d'ailleurs ouvertement dénoncé la résolution 2803 ; seul le Fatah de Mahmoud Abbas, dont la représentativité est largement contestée, l'a acceptée.
L'oubli du génocide
Pour exercer ses pouvoirs relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité doit qualifier une situation de crise grave (menace contre la paix, rupture de la paix, acte d'agression selon l'article 39). Comment la résolution 2803 appréhende-t-elle la situation à Gaza ? Alors même que nous sommes en présence d'un génocide qui se prolonge, rien n'en transparait dans le préambule de la résolution. Il est simplement indiqué que « la situation dans la bande de Gaza menace la paix régionale et la sécurité des États voisins »… Or, dans des résolutions antérieures adoptées en situation génocidaire, et autorisant les États à employer la force, le Conseil se réfère normalement à la situation humanitaire. Il n'en est rien ici. Il ne s'agit évidemment pas, comme précédemment, d'un mandat visant à « protéger les civils en danger » (5).
Ainsi, le Conseil de sécurité confère à ceux qui ont détruit Gaza, le pouvoir de « stabiliser », désarmer, et développer cet espace. Le principe de responsabilité pour génocide est totalement éludé. La résolution permet la poursuite du génocide, sans même insister sur la situation de la population de Gaza, sauf à exiger sa « déradicalisation » ; à cet égard, elle est également contraire à la norme impérative de jus cogens interdisant le génocide. Elle pourrait permettre d'en effacer certaines preuves.
Le peuple palestinien de Gaza y est décrit comme un ensemble de « personnes », « libres de s'en aller et libres de revenir » ou comme des « habitants » encouragés à rester, auxquels sera « offerte » la « possibilité de reconstruire Gaza en mieux » (plan Trump, point 12 ; résolution point 4 b.4.) car Gaza sera « rebâtie pour le bien de ses habitants » (plan Trump, point 2). Dans « la nouvelle Gaza », les Palestiniens ne sont pas un peuple, tout au plus une population, ils ne sont pas acteurs. Mais ils ne sont pas non plus victimes d'un génocide, même s'ils « n'ont que trop souffert » (plan Trump, point 2).
La résolution du Conseil de sécurité comprend, il est vrai, un volet humanitaire ; ses termes sont toutefois très inquiétants. Car si le Conseil « souligne qu'il importe d'assurer une reprise complète de l'aide humanitaire (…) par l'entremise des organisations coopérant à cette fin, dont l'Organisation des Nations unies », cette reprise peut être conditionnée. Ainsi, elle est assurée « en concertation avec le Conseil de paix » et ne devra pas « être détournée pas des groupes armés ». Cette dernière formule renvoie aux accusations israéliennes contre le Hamas plus qu'à l'accaparement de l'aide par les milices soutenues par Israël. Ainsi, la fin du siège n'est pas exigée. Donald Trump pourra parfaitement relayer les exigences d'Israël : le droit à l'assistance, et l'exigence de permettre intégralement le passage de l'aide humanitaire, rappelés par la CIJ en 2024 et 2025 ne sont pas garantis.
Pressions et chantage
Il faut finalement insister sur les conditions d'adoption de la résolution et du plan Trump qu'elle fait sien. Le Conseil de sécurité affirme d'emblée que « les parties » ont accepté ce plan. Or, cette affirmation est fausse : il est bien connu que les groupes armés palestiniens auxquels le plan a été présenté ne l'ont pas soutenu dans son intégralité. L'acceptation, inexistante, ne peut donc justifier le caractère exorbitant de la résolution. Pire, il est aussi connu que le plan Trump, pour sa première phase, a été accepté sous les menaces habituelles du président états-unien : « Un enfer comme personne n'en a jamais vu s'abattra sur le Hamas », a-t-il ainsi déclaré (6). Or, un accord conclu sous la contrainte immédiate n'est pas valide en droit international (Convention de Vienne sur le droit des traités, articles 51 et 52 : la contrainte est une autre cause de nullité des traités) ; c'est probablement pourquoi le Conseil de sécurité doit déformer le réel en insistant sur « l'accord des parties ».
Les conditions d'adoption de la résolution elles-mêmes sont stupéfiantes, par-delà les promesses probablement faites, par-delà les pressions exercées sur certains des États ayant voté la résolution, tel l'Algérie. Les représentants des États-Unis aux Nations unies ont fait échec au texte alternatif présenté par la Russie en menaçant la population palestinienne. Le représentant Mike Waltz affirma explicitement que « voter contre ce projet de résolution, c'est voter pour la reprise de la guerre ». Au regard de l'implication des États-Unis dans le génocide de Gaza, il s'agit d'une menace grave, la résolution étant d'ailleurs cyniquement présentée comme le moyen de sauver les enfants de Gaza. Quelle valeur peut avoir un texte adopté sous la menace de génocide ?
Notes
1- NDLR. Du latin « droit contraignant », concerne des principes de droits réputés universels devant constituer les bases des normes impératives de droit international.
2- NDLR. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 du vol 103 de la Pan Am Airways reliant Londres à New York explose en plein vol et retombe sur la ville écossaise de Lockerbie. L'attentat fait 270 victimes. En 2003, le défunt président libyen Mouammar Kadhafi accepte d'assumer la responsabilité de l'attaque tout en affirmant ne pas en être à l'origine, et verse des indemnités aux familles des victimes.
3- Par exemple, pour le représentant russe, la résolution « n'est pas sans rappeler les pratiques coloniales et le mandat sur la Palestine (..) qui ne tenaient absolument pas compte des opinions des Palestiniens »… Il conclut que les membres du Conseil « ne pourront pas dire que nous ne les avons pas prévenus », procès-verbal de la séance d'adoption de la résolution, doc. S/PV.10046, pp. 17 et 18. La position de la Chine est similaire.
4- Article 22 du Pacte de la Société des Nations : « le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation… ». Bien sûr, le mandat sur la Palestine (1922) est spécifique en ce qu'il intègre la déclaration Balfour. Pour une analyse critique, voir notamment Rashid Khalidi, The hundred years' war on Palestine, Profile Books Ltd, 2020, not. pp. 34-39. … L'article 73 de la Charte des Nations Unies prévoit aussi, s'agissant des « territoires non autonomes », « la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ».
5- Voir par exemple la résolution 929 (1994) autorisant le déploiement « force Turquoise ». Elle considère que « l'ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région » (préambule) et définit le mandat de la force comme « visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda » (point 2).
6- Callum Sutherland, Time, 3 octobre 2025.

Que peut-on attendre de la seconde phase d’un plan de “paix” qu’Israël n’a jamais respecté ?

Alors qu'Israël a assassiné plus de 360 Palestinien-nes au cours de la première phase du “cessez-le-feu” actuellement en vigueur à Gaza, les négociations pourraient reprendre afin d'appliquer la seconde phase de l'accord.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La remise du corps du dernier captif israélien par le Hamas pourrait advenir dans les prochains jours, une condition qu'Israël posait pour ouvrir les négociations concernant la “phase deux” de l'accord de “paix” soutenu par les États-Unis.
Bilan de la “phase une”
Dans le cadre de la première phase, fondée sur le plan de paix en 20 points du président américain Donald Trump, Israël devait mettre fin à sa guerre génocidaire contre Gaza, retirer ses troupes, autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire et échanger des centaines de détenus palestiniens contre les prisonniers encore retenus à Gaza.
Si les échanges de prisonniers ont bien eu lieu, Israël n'a pas respecté ses autres engagements. Dans des attaques presque quotidiennes sur la bande de Gaza, l'armée israélienne a assassiné plus de 360 Palestinien-nes au cours de près de 600 violations du cessez-le-feu, et elle a continué de bloquer l'aide humanitaire promise. Mais aussi, le Hamas l'accuse d'avoir avancé la “ligne jaune” démarquant son retrait, grignottant continuellement l'espace restant aux Palestinien-nes.
Au vu de ce comportement, et de la rupture unilatérale par Israël du précédent cessez-le-feu en mars dernier, on ne peut qu'être sceptique quant à sa détermination à respecter l'accord en vigueur.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant déclaré dimanche 7 décembre qu'il s'entretiendra avec le président états-unien Donald Trump à la fin du mois sur la manière de garantir la mise en œuvre de la “phase deux”, tout en la qualifiant de “plus difficile”.
Une “phase deux” vague et précaire
Le plan de Trump ne comprend pas de détails concrets ni de calendrier, ce qui laisse planer beaucoup d'inconnues sur la possible application de sa deuxième phase.
Cette prochaine étape prévoit une phase de transition pendant laquelle des technocrates palestinien-es, non-affilié-es à des factions politiques, assureraient la gestion quotidienne des affaires publiques.
Leur travail serait supervisé par un “Conseil de paix” multinational et soutenu par une force internationale de stabilisation chargée de la sécurité et de la démilitarisation. L'objectif serait de permettre la reconstruction de Gaza et d'empêcher la reprise du conflit armé.
Toutefois, les dernières opérations de l'armée israélienne laissent craindre que cette “reconstruction” pourrait se limiter aux zones contrôlées par Israël, qui prévoit de construire des “communautés alternatives sûres” (ASC). Ce projet soulève de vives inquiétudes car il entraînerait une division de l'enclave palestinienne et le déplacement massif de sa population.
La phase deux prévoit un nouveau retrait des troupes israéliennes, mais l'armée israélienne a déclaré dimanche que la ligne jaune de démarcation était une « nouvelle frontière », laissant entendre qu'elle ne se retirerait pas davantage, malgré ses engagements à le faire.
« Nous avons le contrôle opérationnel sur une grande partie de la bande de Gaza et nous resterons sur ces lignes de défense », a déclaré le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir. « La ligne jaune est une nouvelle ligne frontière, qui sert de ligne de défense avancée pour nos communautés et de ligne d'activité opérationnelle. »
En réponse, le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a déclaré qu'un véritable cessez-le-feu « ne peut être conclu sans un retrait complet » des forces israéliennes, parallèlement au rétablissement de la stabilité et de la liberté de mouvement pour les Palestinien-nes, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent dans la première phase du plan.
Un plan contraire au droit international
Basem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré dimanche que l'accord nécessitait “de nombreuses clarifications”, car il comporte des points qui ont toujours constitué une ligne rouge pour le Hamas : son désarmement, et l'instauration d'un mandat international, en contradiction du droit des Palestinien-nes à l'autodétermination.
Si le groupe se dit prêt à discuter du “gel ou du stockage” des armes pendant la trêve, il a toutefois précisé qu'il n'accepterait pas qu'une force internationale de stabilisation se charge du désarmement.
“Nous accueillons favorablement la présence d'une force [des Nations Unies] près des frontières, chargée de superviser l'accord de cessez-le-feu, de signaler les violations et de prévenir toute escalade”, a-t-il déclaré, ajoutant que le Hamas n'accepterait pas que cette force ait “quelque mandat que ce soit” sur le territoire palestinien.
Le plan de “paix” de Trump est critiqué en ce qu'il va à l'encontre des récentes conclusions de la Cour de Justice Internationale, qui a statué que Gaza (de même que la Cisjordanie) est illégalement occupée et cette occupation doit prendre fin.
Le plan de “paix” porté par Trump et approuvé par l'ONU prolonge l'occupation israélienne, approuve la présence indéfinie des troupes du régime israélien et y superpose une deuxième occupation menée par les États-Unis.
Cette critique a notamment été portée en France par la sociologue Tatiana Svorou, qui concluait ainsi une tribune parue le 4 décembre dernier dans le journal le Monde : “Tant que le système international ne confrontera pas l'écart profond entre ses engagements juridiques et ses comportements géopolitiques, chaque « plan de paix » imposé aux Palestiniens fonctionnera moins comme une voie vers la justice que comme un mécanisme sophistiqué de retardement – maintenant l'avenir d'un peuple en otage des intérêts de ceux qui prétendent l'arbitrer.”

Comment le « plan de Trump » pour Gaza permet une nouvelle appropriation de terres par Israël

Le 18 novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2803, approuvant officiellement le plan en 20 points du président Trump pour l'avenir de Gaza. Publié initialement comme document de base de l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre, ce plan établit plusieurs structures fondamentales : premièrement, une « ligne jaune » qui délimite les zones de Gaza où l'armée israélienne maintiendra une présence sur le terrain ; deuxièmement, une Force internationale de stabilisation qui servira de « solution à long terme pour la sécurité intérieure », supervisée par un « Comité de la paix » présidé par Trump lui-même ; troisièmement, « un Conseil palestinien technocratique et apolitique » composé d'experts palestiniens et internationaux chargés de gérer la « gouvernance transitoire » de Gaza ; et enfin, un « plan de développement économique de Trump pour reconstruire et dynamiser Gaza ». [Le Monde du 7 décembre en chapeau écrivait : « Le lieutenant-général Eyal Zamir a déclaré, dimanche, que « la “ligne jaune” constitue une nouvelle frontière, une ligne de défense avancée pour les localités israéliennes et une ligne d'attaque ». – Réd.]
Tiré de A l'Encontre
9 décembre 2025
Par Anne Irfan (Jewish Currents)
Poursuivant les hyperboles de ses déclarations selon lesquelles il aurait mis fin à « 3000 ans » de guerre au Moyen-Orient, Trump a salué l'approbation de son plan par le Conseil de sécurité des Nations unies comme « un moment véritablement historique » qui « permettra de renforcer la paix dans le monde entier ». Malgré cette rhétorique, la résolution 2803 ne marque toutefois pas une rupture avec le passé. Au contraire, elle s'inscrit dans la continuité de décennies de plans prétendument internationaux – en réalité occidentaux et israéliens – pour la Palestine. Ces plans, illustrés par le mandat de la Société des Nations [adopté le 12 août 1922], le plan de partition de l'ONU [adopté le 29 novembre 1947] et les accords d'Oslo [1993], ont remodelé la géographie politique, la gouvernance et les structures d'aide afin de réduire le territoire palestinien. Ils ont procédé à cette redéfinition en introduisant de nouvelles « frontières » mobiles, telles que la ligne jaune, afin de réduire progressivement la superficie des terres attribuées au peuple palestinien et à son futur État. Ils ont créé des organismes tels que la Force internationale de stabilisation de Trump et son « Conseil palestinien apolitique » afin de contenir le nationalisme et la résistance palestiniens tout en permettant à Israël de continuer à agir en toute impunité. Et ils ont mis en œuvre ces mesures sans consulter le peuple palestinien, mais plutôt en renforçant la dynamique néocoloniale (comme en témoigne la participation de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair en tant que membre clé du Comité de la paix de Trump).
Ligne jaune avec redistribution du territoire.
En fin de compte, ces plans ont permis à Israël de s'emparer progressivement de plus de terres palestiniennes tout en renforçant les obstacles à la souveraineté palestinienne. Les conséquences du plan Trump risquent d'être similaires, allant d'une ghettoïsation totale des Palestiniens dans certaines parties de la bande de Gaza à la liquidation totale de la présence palestinienne à Gaza.
***
Les propositions occidentales ont permis aux sionistes de s'emparer des terres palestiniennes pendant près d'un siècle. Avant 1948, la Palestine était gouvernée par un régime britannique qui tirait son mandat de la Société des Nations, un organisme alors dominé par la Grande-Bretagne et la France. Puis, en 1947, l'ONU a présenté son tristement célèbre plan de partition, recommandant que 55% de la Palestine soit attribué à un État juif, à une époque où les Juifs représentaient environ un tiers de la population du pays. Le plan a été rejeté par les Palestiniens, mais accepté par l'Agence juive (la principale instance dirigeante sioniste et organisation paraétatique dans la Palestine mandataire), qui l'a reconnu comme un bon accord et une base pour une éventuelle expansion ultérieure.
Finalement, le plan de partition ne fut jamais mis en œuvre. Seule l'expansion sioniste eut lieu. Les milices sionistes, puis la nouvelle armée nationale israélienne, utilisèrent des moyens militaires pour établir leur nouvel État sur 78% de la Palestine, soit bien plus que les 55% attribués dans le plan de l'ONU. Pour ce faire, elles ont procédé à la Nakba, l'expulsion et le déplacement délibérés d'au moins 750 000 Palestiniens vers les États arabes voisins et les deux parties de la Palestine non revendiquées par Israël en 1948 : la Cisjordanie et la bande de Gaza. En conséquence, la Palestine a été de facto partitionnée, mais aucun État palestinien indépendant n'a été créé. Après avoir commencé son occupation durable de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, Israël a mis en place une réalité d'un seul État [Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch, and Shibley Telhami, « Israel's One-State Realit »y, Foreign Affairs mai-juin 2023] dans laquelle l'État israélien contrôlait l'ensemble de la Palestine historique et imposait une hiérarchie de régimes différents pour les Palestiniens et les Israéliens.
La bande de Gaza telle que nous la connaissons aujourd'hui est le résultat de cette histoire de contraction. Sous le mandat britannique, le district sud de la Palestine, parfois appelé officieusement « district de Gaza » d'après sa plus grande ville, était la plus grande zone administrative en termes territoriaux. Mais pendant la Nakba, les milices sionistes et l'armée israélienne s'en sont emparées en grande partie, réduisant la région à une superficie de 214 miles carrés [554 km carrés]. L'accord égypto-israélien de 1949 a délimité cette nouvelle « bande » de Gaza en établissant autour d'elle une ligne d'armistice connue sous le nom de Ligne verte. L'année suivante, un gouvernement égyptien affaibli a accepté un addendum qui a réduit la nouvelle bande de Gaza de 20% supplémentaires, la laissant comme un minuscule territoire de 141 miles carrés [365 km carrés], soit moins de 1,5% de la Palestine historique. Israël a commencé à contrôler la Ligne verte comme une frontière internationale, malgré son statut officiel de frontière d'armistice temporaire.
Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après avoir commencé son occupation à long terme de Gaza en 1967, Israël a encore réduit le territoire accessible aux Palestiniens, d'abord en établissant des colonies illégales et des installations militaires, puis en imposant des « zones tampons » et des « périmètres de sécurité ». Le processus d'Oslo a encore réduit la bande de Gaza, Israël ayant établi un « périmètre de sécurité » s'étendant sur plus de 800 mètres à l'intérieur de Gaza, l'armée appliquant des « mesures de sécurité spéciales » pour empêcher les Palestiniens d'y entrer.
L'empiètement d'Israël sur le territoire palestinien s'est poursuivi au XXIe siècle. Après avoir achevé l'évacuation unilatérale de 8500 colons de Gaza en 2005, Israël a mis en place une « zone tampon » restreinte s'étendant sur près d'un kilomètre et demi à l'intérieur de la bande de Gaza. Tout Palestinien s'y trouvant pouvait être abattu à vue. Et après avoir imposé un blocus total sur Gaza en 2007, avec le soutien de ses alliés égyptiens, Israël a régulièrement étendu sa zone tampon, confinant les Palestiniens sur une bande de terre de plus en plus petite. La logique meurtrière de la « zone tampon » a culminé avec les pertes humaines massives de la Grande Marche du retour de 2018 voir sur ce site [ l'article publié le 2 avril 2018], lorsque les forces israéliennes ont tué au moins 234 Palestiniens et blessé plus de 33'000 autres qui s'étaient approchés « trop près » de la barrière entourant la bande de Gaza. Ces décennies d'accaparement des terres pourraient maintenant atteindre leur apogée avec le tout dernier plan pour Gaza, qui continue de mettre en œuvre ce que de nombreux Palestiniens appellent le processus délibéré de la Nakba en continu.
***
En considérant le plan Trump dans cette trajectoire historique, nous pouvons identifier quatre volets à la stratégie de dépossession.
• La ligne jaune elle-même en est le premier. Selon les termes du cessez-le-feu, les forces israéliennes étaient tenues de « se retirer jusqu'à la ligne convenue », une directive qui permettait discrètement à l'armée israélienne de conserver le contrôle direct d'au moins 58% de Gaza. En d'autres termes, la construction de cette fortification réduit la partie palestinienne de Gaza à moins de la moitié de la bande de Gaza, soit pas plus de 64 miles carrés [165 km carrés], soit un cinquième de la ville de New York. L'histoire se répète une fois de plus : lors de la Nakba de 1948, plus de 200'000 réfugiés palestiniens ont fui vers le sud-ouest, pour finir confinés dans la bande de Gaza. Lors du génocide de 2023-2025, les forces israéliennes ont mené le même processus au sein même de la bande de Gaza, déplaçant violemment près de deux millions de Palestiniens et les enfermant du côté ouest de la ligne jaune.
La « ligne jaune » et ses blocs qui sont déplacés expulsent les Palestiniens qui disposent d'une maison ou de ce qui en reste dans le territoire nouvellement délimité par l'occupant.
Et cela ne devrait pas être la fin des expulsions alimentées par la ligne jaune. Après que les Palestiniens ont souligné que l'emplacement de la ligne jaune n'était pas clair, Israël a annoncé le 20 octobre qu'il avait commencé à poser des blocs de béton jaunes sur le sol afin de « clarifier la situation sur le plan tactique ». Mais loin de lever l'ambiguïté, ces blocs physiques ne font que l'accroître, car Israël n'a cessé de les déplacer plus loin à l'intérieur de Gaza. Des informations ont également fait état à plusieurs reprises d'invasions terrestres menées par les forces israéliennes pour mener des attaques au-delà de la ligne jaune, violant ainsi la condition du cessez-le-feu selon laquelle « Israël n'occupera ni n'annexera Gaza ».
Tout comme lorsqu'Israël a violé à plusieurs reprises les termes des accords d'Oslo dans les années 1990, en retardant par exemple son évacuation militaire de la ville de Gaza, puis en envahissant des territoires censés être contrôlés par l'Autorité palestinienne, il n'a subi aucune conséquence pour ses violations continues. En fait, loin d'exiger qu'Israël respecte l'accord, les preuves s'accumulent [New York Times, 25 Nov. 2025] pour montrer que la Maison Blanche collabore discrètement, en coulisses, à des plans secrets visant à l'occupation permanente, voire à l'annexion de Gaza par Israël. La semaine même où le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2803, les États-Unis ont présenté des propositions visant à partager définitivement la bande de Gaza, transformant la ligne jaune, qui était une zone tampon militaire temporaire, en une future frontière potentielle. Pendant ce temps, les politiciens et les activistes de droite israéliens continuent de prôner l'expulsion définitive des Palestiniens de Gaza, avec le soutien massif de la population juive israélienne (82% selon un récent sondage).
• La Force internationale de stabilisation constitue le deuxième volet de l'accaparement des terres par Trump, qui renvoie également aux accords d'Oslo. Présentés dans les années 1990 comme une résolution pacifique à des décennies de violence et publiquement présentés comme une « solution à deux États », les accords d'Oslo, tout comme le plan Trump aujourd'hui, étaient principalement axés sur la principale préoccupation des Israéliens : leur propre sécurité nationale. Après la création de l'Autorité palestinienne (AP) en 1994 sous les auspices d'Oslo, près de la moitié de ses employés ont été recrutés pour assurer des fonctions de sécurité. Ils n'étaient pas chargés de protéger la sécurité du peuple palestinien, mais plutôt de réprimer toute activité jugée menaçante pour les intérêts israéliens, y compris la résistance civile non violente à l'occupation. En conséquence, l'AP a rapidement acquis la réputation, parmi les Palestiniens, d'être un pion de l'armée israélienne.
Aujourd'hui, une dynamique similaire est à nouveau à l'œuvre avec la Force internationale de stabilisation. Bien que la composition de cette force ne soit pas encore confirmée, elles comprendraient des troupes de divers pays arabes et musulmans, parmi lesquels l'Azerbaïdjan, l'Égypte, l'Indonésie, le Qatar et les Émirats arabes unis, bien qu'aucun d'entre eux n'ait officiellement confirmé sa participation. Selon la Maison Blanche, la Force internationale de stabilisation aidera à former une nouvelle force de police palestinienne à Gaza et à gérer les affaires de sécurité intérieure, tout en jouant un rôle de premier plan dans la « démilitarisation » de Gaza et la « sécurisation des frontières ». Ces deux derniers points sont des exigences israéliennes flexibles pouvant avoir plusieurs interprétations, notamment parce que les « frontières » en question ne sont pas précisées, ce qui ouvre la voie à de nouvelles appropriations de terres. Il s'agit d'un dispositif qui garantit pratiquement que le territoire palestinien continuera se réduire. En effet, plusieurs critiques arabes et musulmans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la participation de leurs gouvernements pourrait les transformer en « marionnettes de l'État israélien ».
• Les dispositions relatives à la dite structure gouvernementale palestinienne, qui constituent le troisième volet de la stratégie de dépossession prévue par le plan Trump, rappellent une fois de plus Oslo. Les partisans de l'accord des années 1990 ont présenté l'Autorité palestinienne comme un précurseur de l'indépendance palestinienne. Cependant il y avait un hic de taille : Israël n'a jamais accepté la création d'un État palestinien pleinement souverain, même lorsqu'il était dirigé par des Premiers ministres prétendument « pacifistes » comme Yitzhak Rabin [1992-1995] et Ehud Barak [1999-2001]. Au cours du processus d'Oslo, Israël a accepté de n'accorder à l'Autorité palestinienne qu'une autonomie limitée (et non la souveraineté) sur seulement 18% de la Cisjordanie et les trois quarts de la bande de Gaza. Il a également insisté pour conserver les blocs de colonies illégales qui ont accaparé encore plus de terres palestiniennes. En conséquence, le processus d'Oslo a fortement limité les pouvoirs de l'Autorité palestinienne, ne lui permettant pas d'avoir une armée nationale, un contrôle souverain des frontières et une indépendance économique. De plus, l'autodétermination palestinienne a été reportée jusqu'aux « négociations sur le statut final » qui n'ont jamais eu lieu, tandis que les questions fondamentales de la résistance palestinienne – le droit au retour et le statut de Jérusalem – ont été ignorées.
Dans les années 2020, l'actuel Premier ministre israélien a clairement exprimé à plusieurs reprises son opposition inconditionnelle à un État palestinien, quelle que soit sa taille, alors même que la plupart des gouvernements européens continuent de soutenir publiquement la formule des deux États comme seule voie possible pour aller de l'avant. En conséquence, le plan Trump prévoit encore moins d'autonomie pour les Palestiniens que ce qui leur avait été accordé dans le cadre des accords d'Oslo. Il n'y a pas d'équivalent à l'Autorité palestinienne dans ce plan, seulement un comité de transition supervisé par le Comité de la paix de Trump. De manière révélatrice, le plan parle de l'État palestinien et de l'autodétermination comme d'une « aspiration » – et non d'un droit – et suggère simplement qu'après le développement et les réformes, « les conditions pourraient enfin être réunies pour une voie crédible » vers cet objectif.
• Le quatrième outil d'accaparement des terres, et peut-être le plus flagrant, consiste en des formes néocoloniales de reconstruction. Dans le cadre de ces plans, la « zone verte » contrôlée par Israël (à l'est de Gaza) serait reconstruite avec le soutien d'acteurs soutenus par les États-Unis, dont beaucoup considèrent Gaza comme une simple source de profits (The Conversation, 12 septembre 2025, Rafeef Ziadah, King's College). Fin novembre, le département d'État américain a confirmé un projet visant à créer des « communautés alternatives sûres » (ASC-alternative safe communities) qui accueilleraient les Palestiniens dans la zone verte. Cependant, la quasi-totalité de la population palestinienne de Gaza étant actuellement confinée à l'ouest de la ligne jaune – la désignée « zone rouge » –, on ne sait pas comment cette population serait transférée vers les ASC, ni ce que cela signifierait pour l'avenir de la zone rouge. La proposition d'ASC présente également des similitudes inquiétantes avec les plans avancés par le gouvernement israélien en juillet visant à créer une « ville humanitaire » pour interner tous les Palestiniens de Gaza, que même certains détracteurs internes ont comparée à un camp de concentration (The Guardian, citant Ehud Olmert, 13 juillet 2025). Alors qu'ils « reconstruisent » Gaza selon leurs propres conditions, les États-Unis et Israël semblent déterminés à poursuivre ces plans, prolongeant ainsi le déplacement et le confinement du peuple palestinien qui dure depuis des décennies.
Les conséquences du plan Trump ont déjà été mortelles. Depuis l'entrée en vigueur officielle du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, Israël aurait violé ses termes plus de 500 fois. Il a également ignoré ouvertement certaines clauses, telles que l'obligation d'ouvrir le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Le Premier ministre Netanyahou a récemment indiqué que son gouvernement pourrait finalement l'ouvrir, mais uniquement pour les Palestiniens quittant Gaza (BBC, 3 décembre 2025). Il s'agit là d'une violation directe de l'accord, qui précise que Rafah doit être ouvert « dans les deux sens » et que les Palestiniens se trouvant en dehors de la bande de Gaza doivent être « libres de revenir ».
Plus inquiétant encore, pendant le prétendu « cessez-le-feu » de ces dernières semaines, les forces israéliennes ont continué à ouvrir le feu sur les Palestiniens à Gaza, tuant au moins 360 personnes, dont la majorité étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Beaucoup ont été tués pour avoir commis le « crime » de franchir la ligne jaune et d'entrer dans le territoire de Gaza contrôlé par Israël alors qu'ils cherchaient à retourner dans les maisons et les quartiers dont les forces israéliennes les avaient chassés au cours de deux années de génocide. Malgré son engagement déclaré en faveur du cessez-le-feu, l'administration Trump n'a pas condamné, et encore moins empêché, ces violations répétées.
Comme les précédents plans « internationaux » pour la Palestine – d'Oslo au « Deal of the Century » de Jared Kushner (The Cairo Review of Global Affairs, « Kushner's New Plan for Palestine », 18 septembre 2019) –, le plan Trump présente les gains israéliens comme des concessions et les pertes palestiniennes comme des gratifications. L'attention constante accordée par l'Occident aux conceptions israéliennes de la sécurité, combinée à la poursuite éhontée par des acteurs extérieurs de leurs propres intérêts politiques et financiers, détourne systématiquement l'attention des droits humains, sans parler de la justice réparatrice. Alors qu'Israël utilise le prétexte d'un nouvel accord « international » pour s'emparer de nouvelles terres et établir une nouvelle situation sur le terrain, tout cela se fait, une fois de plus, au détriment du peuple palestinien. (Article publié sur le site Jewish Currents le 8 décembre 2025, traduction rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’armée israélienne intensifie ses raids en Cisjordanie occupée et cible les universités

Les forces israéliennes ont fait une incursion à l'université de Birzeit tandis que des colons attaquaient des maisons palestiniennes à Masafer Yatta et kidnappaient un agriculteur près de Bethléem.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
9 décembre 2025
Par New Arab
Photo : Les forces d'occupation israéliennes empêchent les activistes de manifester contre les attaques des colons à Beit Jala, en Cisjordanie occupée, 14 novembre 2025 © Mosab Shawer / Activestills
Les forces israéliennes ont intensifié leurs raids dans la Cisjordanie occupée mardi, ciblant deux universités et arrêtant des dizaines de Palestiniens.
L'université de Birzeit, située dans la ville de Birzeit près de Ramallah, a été perquisitionnée par les forces israéliennes tôt dans la matinée, et cinq membres de l'équipe de sécurité de l'université ont été arrêtés, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.
L'université a reporté les heures de travail du personnel et des étudiants à 9 heures du matin par mesure de sécurité, a rapporté Alaraby Al-Jadeed, le site frère en langue arabe de The New Arab.
Les forces israéliennes ont également pris d'assaut le campus de l'université al-Quds dans la ville d'Abu Dis, près de Jérusalem.
Le ministère de l'Éducation de l'Autorité palestinienne a condamné ces raids, les qualifiant de violation des normes internationales qui protègent les universités et les établissements d'enseignement.
Outre l'assaut contre les deux universités, 40 Palestiniens ont été arrêtés dans toute la Cisjordanie occupée, selon la Société palestinienne des prisonniers (PPS), qui a déclaré que la plupart des arrestations avaient eu lieu dans les gouvernorats d'Hébron, de Naplouse et de Bethléem.
D'autres arrestations ont eu lieu à Ramallah, Jénine, Salfit et Qalqiya, et la PPS a fait état d'interrogatoires sur le terrain et d'agressions.
Selon l'Organisation internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens, en novembre, plus de 9 250 Palestiniens étaient actuellement détenus dans des prisons israéliennes, dont 3 368 en détention administrative sans inculpation.
Pendant ce temps, les attaques des colons se sont poursuivies. Selon l'agence Wafa, des colons ont enlevé un agriculteur de la ville de Nahalin, à l'ouest de Bethléem, et l'ont agressé et kidnappé alors qu'il labourait ses terres.
Les colons ont également attaqué des maisons palestiniennes à Masafer Yatta, près d'Hébron, incendiant un véhicule et un tracteur et peignant des slogans racistes sur les murs des maisons.
Les attaques des colons ont augmenté ces derniers mois. Lundi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a déclaré qu'en octobre, les colons avaient mené 269 attaques contre des Palestiniens, causant des victimes et des dégâts matériels.
L'agence onusienne a ajouté qu'en octobre, 12 Palestiniens avaient été tués et 351 blessés lors d'attaques.
À la suite de l'assaut mené lundi par Israël contre le siège de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à Jérusalem-Est, le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a condamné cette opération, la qualifiant de « violation flagrante des obligations d'Israël de protéger et de respecter les locaux de l'ONU ».
Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que les forces israéliennes avaient saisi du mobilier et du matériel informatique, et avaient retiré le drapeau de l'ONU pour le remplacer par un drapeau israélien.
Israël a précédemment accusé l'UNRWA, sans preuve, de coopérer avec le Hamas et a mis fin à ses opérations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, exacerbant la malnutrition et la famine dans ce dernier territoire.
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face aux attaques de Trump contre les immigréEs, la résistance s’organise

Donald Trump intensifie ses attaques contre les immigréEs, avec des propos racistes et une avalanche de nouvelles réglementations. Mais la résistance s'amplifie également.
Hebdo L'Anticapitaliste - 779 (11/12/2025)
Par Dan La Botz
traduction Henri Wilno
Depuis l'attaque armée perpétrée par un migrant afghan contre deux membres de la Garde nationale à Washington, D.C., le 26 novembre, qui a tué l'un d'eux et gravement blessé l'autre, Trump a considérablement restreint l'immigration, menacé de révoquer le statut des immigréEs légaux et ordonné aux services de l'immigration et des douanes (ICE) d'intensifier les arrestations et les expulsions. Ces mesures, motivées par ses attitudes racistes et sa stratégie politique, bouleversent les politiques historiques d'immigration des États-Unis et la culture politique du pays.
Revirement historique
Trump a déclaré une « pause permanente » sur l'immigration en provenance des « pays du tiers monde ». Il a également ordonné l'arrêt des décisions d'asile et déclaré que chaque demandeur ou demandeuse d'asile serait soumis à un contrôle « aussi approfondi que possible ». Il a également déclaré que toutes les demandes d'asile accordées sous l'ère Biden seront réexaminées. Il a suspendu toutes les demandes d'immigration et les visas pour les Afghans. Il a ordonné un « réexamen complet et rigoureux » de toutes les cartes vertes délivrées à des ressortissantEs de 19 « pays préoccupants », parmi lesquels l'Afghanistan, Cuba, Haïti, l'Iran et la Somalie. Les cartes vertes sont des documents qui accordent le statut de résident permanent, le droit de vivre et de travailler indéfiniment, et de demander la citoyenneté américaine. Il a également appelé à la « dénaturalisation » (retrait de la citoyenneté américaine) et à l'expulsion rapide des personnes considérées comme présentant un risque pour la sécurité ou « incompatibles avec la civilisation occidentale ».
Tout cela freine considérablement l'immigration aux États-Unis et représente non seulement un revirement juridique de la politique américaine en matière d'immigration, mais aussi une profonde transformation de la culture politique américaine qui, pendant des décennies, a généralement plutôt bien accueilli les immigréEs et considéré l'immigration comme un fondement de la société américaine. Les mots du poème The New Colossus de la poétesse Emma Lazarus, inscrits sur la statue de la Liberté — « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, vos masses innombrables aspirant à vivre libres » — ont désormais été effacés par Trump.
Ciblage raciste des SomalienNEs
Dans le même temps, Trump a lancé une tirade raciste contre les immigréEs somalienNEs du Minnesota. Fuyant la guerre civile, les SomalienNEs ont commencé à immigrer dans cette région dans les années 1990 et ils sont aujourd'hui environ 100 000 à y vivre. Trump les a qualifiés de « déchets » qui « n'apportent rien ». Il a spécifiquement mentionné la députée Ilhan Omar (gauche du parti démocrate), une immigrée somalienne, en la qualifiant de « déchet ». « Je ne veux pas d'eux dans le pays », a-t-il déclaré. L'ICE a alors envoyé 100 agents fédéraux dans la région de Minneapolis-St. Paul pour rassembler et expulser les immigréEs. L'ironie est que 90 % des SomalienNEs qui y vivent sont des citoyenNEs américains de naissance ou naturaliséEs, tandis que des centaines d'autres ont un autre statut légal.
Résistance militante aux raids de l'ICE
Pendant ce temps, Trump continue d'envoyer des agents de l'ICE dans les villes et les États gouvernés par les démocrates : Los Angeles, Chicago, La Nouvelle Orléans, Charlotte et Washington, D.C., et, donc plus récemment, Minneapolis et St. Paul. Lorsque les agents de l'ICE se présentent, des habitantEs s'organisent pour soutenir les immigréEs et résister.
Récemment, à New York, lorsqu'une cinquantaine d'agents de l'ICE sont arrivés dans un parking de Chinatown, des habitantEs ont passé quelques coups de fil et rapidement, 200 personnes sont venues bloquer le bâtiment et les empêcher de partir pour procéder à des arrestations. Los Angeles et Chicago disposent de réseaux locaux bien développés qui organisent la résistance. Matthew Hunter, militant de longue date à Los Angeles, déclare : « Mais nous devons mettre en place des structures de lutte permanentes pour survivre à cela. » Et c'est ce qui se fait. Avec d'autres, il a mis en place un « réseau d'intervention rapide » pour répondre aux raids de l'ICE à Los Angeles. À Chicago, des militantEs ont distribué 120 000 sifflets puissants et stridents, accompagnés d'une brochure expliquant comment les utiliser pour alerter les voisinEs en cas de raid de l'ICE.
Trump nous opprime, mais partout, la riposte s'organise.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. La grève chez Starbucks

Plus de 18 mois après le début des négociations du contrat-cadre national, les baristas sont en grève pour protester contre la liste croissante de pratiques déloyales présumées commises par Starbucks, alors que l'entreprise continue de faire obstruction à la conclusion d'un contrat équitable.
Tiré de A l'Encontre | https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-dossier-la-greve-chez-starbucks.html
3 décembre 2025
Voici un bref résumé de la manière dont Starbucks fait obstruction à la conclusion d'un contrat équitable.
Les négociations sur le contrat-cadre national ont débuté en avril 2024. Au cours des neuf mois qui ont suivi, les baristas et les dirigeants de Starbucks se sont rencontrés pendant des centaines d'heures et ont conclu 33 accords provisoires qui amélioreront concrètement les conditions de travail.
En septembre 2024, les baristas syndiqués ont présenté pour la première fois une série de propositions économiques en vue de négociations visant à augmenter les salaires et les avantages sociaux.
En décembre 2024, Starbucks a rejeté toutes les propositions des baristas et, en échange, a présenté un ensemble de mesures économiques peu sérieuses qui ne prévoyaient aucune augmentation salariale pendant la première année du contrat et ne traitaient pas les questions fondamentales des horaires et des effectifs. Les négociations ont échoué.
Starbucks est revenu sur la voie précédemment convenue. Cela a incité Workers United à déposer une plainte nationale pour pratique déloyale (ULP) en décembre 2024, alléguant que Starbucks n'avait pas négocié de bonne foi et sapait le statut représentatif du syndicat. Cette ULP a été modifiée et élargie en avril 2025.
En 2025, l'entreprise a illégalement mis en œuvre de nouvelles politiques sans négocier avec le syndicat, telles que les éléments du programme « Back to Starbucks » et le nouveau code vestimentaire restrictif, ce qui a donné lieu à de nouvelles accusations de pratiques déloyales.
Workers United a déposé plus de 100 nouvelles plaintes pour pratiques déloyales au cours de l'année dernière.
Récemment, Starbucks a commencé à dire qu'il allait revenir à la table des négociations « pour discuter », mais le simple fait de s'asseoir à la table des négociations est inutile si Starbucks ne s'engage pas à présenter de nouvelles propositions qui répondent aux demandes des baristas concernant l'augmentation des heures de travail et du personnel, la hausse des salaires et la résolution de centaines de pratiques déloyales en matière d'emploi.
Nous avons été clairs et cohérents tout au long de l'année. Nos trois revendications restantes, qui n'ont pas été prises en compte, sont les suivantes
Nous exigeons de meilleures heures de travail afin d'améliorer les effectifs dans nos magasins. Le manque de personnel est flagrant, ce qui entraîne des temps d'attente plus longs alors que les commandes des clients affluent. Pourtant, trop de baristas ne travaillent toujours pas suffisamment d'heures pour payer leurs factures ou atteindre le seuil requis pour bénéficier d'avantages sociaux. Starbucks doit investir dans l'augmentation de nos heures de travail.
Nous exigeons une augmentation du salaire net afin de pouvoir payer nos factures. Trop de baristas ont du mal à joindre les deux bouts, tandis que les dirigeants gagnent des millions. Starbucks doit consacrer plus d'argent à notre salaire net.
Nous exigeons la résolution de centaines de plaintes pour pratiques déloyales en matière d'emploi liées à la répression syndicale. Le géant du café a commis plus de violations du droit du travail que tout autre employeur dans l'histoire moderne. Starbucks doit résoudre complètement les problèmes juridiques qui touchent les baristas. (1er décembre 2025)
[https://sbworkersunited.org/our-strike/]
*****
« UNE GRÈVE HISTORIQUE CHEZ STARBUCKS »

Piquet et manif à New York.
Quatre ans après que les employés d'un magasin Starbucks dans le nord de l'État de New York aient été les premiers à se syndiquer, des centaines d'autres points de vente ont suivi, malgré la forte opposition de la chaîne de cafés. Que s'est-il passé ensuite ?
Des milliers de baristas Starbucks sont actuellement en grève à travers les États-Unis, avertissant la plus grande chaîne de cafés au monde de se préparer à la « plus longue et la plus importante » action syndicale de son histoire.
À peine un an après que Brian Niccol, le PDG de Starbucks, a tenté de mettre un terme aux dissensions entre la direction et les employés syndiqués, en s'engageant à « dialoguer de manière constructive » avec eux, le géant états-unien du café s'affronte aujourd'hui confronté à une grève qui s'intensifie pendant la période de ventes lucratives des fêtes de fin d'année.
Environ 2500 employés font grève dans 85 villes et 120 magasins, et invitent les clients à ne pas s'y rendre. Starbucks affirme que moins de 1% de ses cafés ont été perturbés par le mouvement social.
Cependant, le syndicat Starbucks Workers United, qui représente 11 000 baristas dans plus de 550 établissements, menace d'étendre la grève bien au-delà de son périmètre actuel si les dirigeants ne font pas de concessions lors des négociations contractuelles.
Quatre ans après que le premier magasin Starbucks aux Etats-Unis a voté en faveur de la création d'un syndicat, défiant la résistance intense de l'entreprise, les relations entre les deux parties se sont détériorées.
« Je suis toujours choquée de me réveiller chaque jour et de les voir continuer à nous combattre de la manière dont ils le font. Parce que nous avons prouvé à maintes reprises que nous ne bougerons pas », a déclaré au Guardian Michelle Eisen, porte-parole de Starbucks Workers United.

Pendant des décennies, Starbucks, fondée dans les années 1970 et reprise dans les années 1980 par Howard Schultz [ayant une fortune estimée en 2018, par Forbes, à 3 milliards de dollars], qui en a fait le géant mondial du café qu'elle est aujourd'hui, a réussi à lutter contre la syndicalisation.
La chaîne a qualifié ses employés de « partenaires » et a promu un ensemble de prestations sociales « à la pointe dans le secteur », notamment une couverture santé et la prise en charge des frais de formation.
« Je ne suis pas contre les syndicats. Je suis favorable à Starbucks, favorable au partenariat, favorable à la culture Starbucks », a déclaré Howard Schultz à ses employés en 2022. « Ce n'est pas grâce à un syndicat que nous en sommes arrivés là. »
À cette époque, cependant, des brèches avaient déjà commencé à apparaître dans le barrage. L'année précédente, les baristas d'un magasin de Buffalo, dans l'État de New York, avaient voté à 19 voix contre 8 en faveur de la syndicalisation, ouvrant la voie à des centaines d'autres magasins à travers les États-Unis.
Michelle Eisen a commencé à travailler dans le magasin de Buffalo en août 2010, afin de compléter son emploi de régisseuse de production, entre deux spectacles de théâtre.
Elle était une cliente de longue date de Starbucks et avait confiance en sa réputation de bon employeur. Pendant des années, Michelle Eisen s'est sentie valorisée en tant qu'employée, bénéficiant d'augmentations de salaire régulières et d'horaires adaptés à son emploi du temps.
Mais selon Michelle Eisen, les choses ont commencé à changer vers 2016. « Nous avons constaté une augmentation significative du prix à payer pour nos prestations sociales. Les augmentations salariales biannuelles ont complètement disparu », a-t-elle déclaré lors d'un entretien. « Tout à coup, nous avons eu droit à une seule augmentation liée au coût de la vie au début de l'année civile, qui, la plupart du temps, était nettement inférieure aux augmentations précédentes. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir les effectifs diminuer progressivement dans ces boutiques. Quatre ans plus tard, la situation a vraiment atteint son paroxysme. »
***
Les magasins Starbucks sont restés ouverts lorsque la Covid a frappé en 2020. Les baristas ont été surpris de rencontrer des clients de plus en plus agressifs et conflictuels, et certains employés ont estimé que leur salaire était trop bas pour ce qu'ils considéraient comme un travail plus intense dans des conditions qui se détérioraient.
Michelle Eisen, dont l'emploi dans le théâtre avait été supprimé en raison de la pandémie, a travaillé autant d'heures que possible chez Starbucks, mais elle avait toujours du mal à joindre les deux bouts. Après 11 ans dans l'entreprise, elle ne gagnait que quelques centimes de plus par heure qu'un nouvel employé. En 2021, elle a envisagé de démissionner.
Mais elle a alors commencé à discuter avec ses collègues de la possibilité de créer un syndicat. Un groupe d'environ 50 baristas Starbucks de la région de Buffalo a rendu public son projet en août 2021. [Voir l'article publié sur le alencontre.org le 15 décembre 2021.]
« Pour moi, cela allait de soi. Parce que cela donnait l'occasion d'essayer de résoudre certains de ces problèmes et de les régler de l'intérieur. Et j'espérais, contre toute attente, que cela fonctionnerait, que nous réussirions et que je n'aurais pas à partir. Parce que je ne le souhaitais pas », dit Michelle Eisen.
Les dirigeants de Starbucks n'ont pas considéré cette initiative comme une évidence. Les responsables et les dirigeants de l'entreprise, notamment Rossann Williams, alors présidente de la chaîne pour l'Amérique du Nord, et Schultz, se sont rendus à Buffalo afin de mettre un terme à cette tentative de syndicalisation.
« Aucun partenaire [employé] n'a jamais eu besoin d'un représentant pour obtenir ce dont nous bénéficions tous en tant que partenaires chez Starbucks », a écrit Howard Schultz dans une lettre adressée aux employés. « Je suis attristé et préoccupé d'apprendre que certains pensent que cela est désormais nécessaire. »
« Ils ont mené une campagne antisyndicale extrêmement virulente », a déclaré Michelle Eisen. « Ils continuent de le faire, mais cela a commencé à Buffalo, dès le début. Et contre toute attente, malgré cela, mon magasin a remporté l'élection syndicale le 9 décembre 2021 et est devenu le premier établissement [syndiqué]. Et puis, tout s'est enchaîné très rapidement. »
***
Depuis cette première victoire, les travailleurs mobilisés ont remporté plus de 650 élections syndicales et en ont perdu environ 120. Depuis lors, la chaîne a fermé 59 magasins syndiqués, selon Starbucks Workers United. D'autres attendent encore que les résultats soient certifiés.
Alors qu'une vague de mobilisation commençait à gagner les salarié·e·s au début de l'année 2022, la direction de l'entreprise a été remaniée. Trois mois après le vote de Buffalo, Starbucks a brusquement annoncé que son PDG, Kevin Johnson, démissionnait et que Howard Schultz, son patron de longue date, revenait pour un troisième mandat à la tête de l'entreprise.
Les actions de Starbucks étaient sous pression, les coûts augmentaient alors que le Covid continuait de perturber les chaînes d'approvisionnement et, bien que l'entreprise continuait de générer des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque trimestre, les clients passaient moins de temps dans ses établissements.
Howard Schultz a été chargé de redresser une entreprise que beaucoup à Wall Street considéraient comme étant en perte de vitesse. Beaucoup de ses baristas nouvellement syndiqués étaient du même avis. Cependant, Schultz a refusé de collaborer avec Starbucks Workers United, déclarant qu'il n'accepterait jamais le syndicat et offrant de nouvelles prestations et des augmentations de salaire aux travailleurs et travailleuses non syndiqués.
Michelle Eisen déclare : « Il était tout simplement exaspérant d'être maltraités de cette manière et de nous faire sentir que nous faisions quelque chose de mal, alors que nous essayions de responsabiliser l'entreprise et de l'améliorer. »
Un nouveau PDG, Laxman Narasimhan, a été nommé plus tard dans l'année. Les baristas syndiqués ont commencé à se mobiliser, notamment en manifestant lors de la journée « red cup day » [journée de promotion offrant aux consommateurs une tasse rouge] de la chaîne en novembre 2022 et 2023.
***
Les relations se sont lentement améliorées. Début 2024, Starbucks et Starbucks Workers United ont convenu d'un nouveau cadre pour les conventions collectives, suscitant l'espoir d'un premier accord syndical avant la fin de l'année. Les employés des magasins syndiqués ont obtenu les prestations accordées aux employés non syndiqués en 2022.
Cependant, les difficultés commerciales de la chaîne semblaient s'aggraver, avec une concurrence croissante et une fréquentation en baisse. Laxman Narasimhan a été démis de ses fonctions de PDG après 16 mois, l'année dernière, et remplacé par Brian Niccol, le directeur général de Chipotle [chaîne de restauration rapide spécialisée dans la cuisine tex-mex].
Selon le syndicat, les négociations ont été interrompues après l'arrivée de Niccol. « L'entreprise a repris là où elle s'était arrêtée à la fin de 2023, en matière de violation des droits des travailleurs et travailleuses », a déclaré Eisen. « Et nous n'avons toujours pas de contrat. »
Brian Niccol a agi rapidement pour remettre la chaîne sur les rails, en lancant une campagne intitulée « Back to Starbucks » (Retour chez Starbucks), visant à inverser la tendance à la baisse des ventes. Il a fait l'objet de critiques lorsqu'il a été révélé qu'il ferait la navette entre son domicile de Newport Beach, en Californie, et le siège social de l'entreprise à Seattle [Etat de Washington], plutôt que de déménager.
Pendant ce temps, les négociations ont marqué le pas. Brian Niccol est resté muet sur le syndicat et sa volonté d'obtenir un premier contrat collectif. « Les changements de PDG au cours des cinq dernières années ont en quelque sorte montré que cette entreprise a encore beaucoup de choses à régler », a déclaré au Guardian Zarian Antonio Pouncy, qui travaille depuis 11 ans comme barista à Las Vegas. Son magasin s'est syndiqué fin 2023. « Au lieu d'écouter les “partenaires”, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne et qui gèrent les affaires au quotidien, ils s'appuient trop sur le leadership, l'intelligence artificielle, les algorithmes et les chiffres pour leur montrer comment fonctionne l'entreprise. »
***
Julie Su a observé la situation de près. En tant que secrétaire adjointe au Travail des États-Unis et secrétaire au Travail par intérim entre 2021 et 2025, elle a contribué à superviser les efforts de l'administration Biden pour redynamiser le mouvement syndical américain, alors que des milliers de baristas de Starbucks ont voté en faveur de la syndicalisation.
« Lorsque les travailleurs choisissent un syndicat, ils méritent un contrat », a déclaré Julie Su au Guardian. « Trop souvent, il faut beaucoup de temps pour en obtenir un, car l'employeur utilise les reports comme une arme. Le temps nécessaire à la conclusion d'un premier contrat est utilisé pour sanctionner les travailleurs et travailleuses qui se syndiquent, pour saper leurs efforts ou pour leur faire comprendre qu'il n'y a aucun avantage à adhérer à un syndicat, car rien ne change au travail pendant des années. Généralement, toutes ces raisons sont invoquées. C'est inacceptable. »
En moyenne, il faut environ 15 mois à un syndicat pour conclure un premier contrat avec un employeur, souvent en raison des retards et des obstructions de la direction.
Chez Starbucks, près de 48 mois se sont écoulés depuis que le magasin de Buffalo a voté en faveur de la syndicalisation.
« Dans le cas d'une entreprise comme Starbucks, cela fonctionne également comme un outil spécifique de répression syndicale, car l'entreprise tente d'attendre que ses employés partent [étant donnée le turnover] avant qu'un contrat ne soit conclu », a ajouté Julie Su.
Starbucks Workers United a déposé des centaines de plaintes pour pratiques déloyales (ULP) auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations du travail). Des dizaines de délégués syndicaux ont été licenciés, apparemment en représailles, à cause de leur soutien au syndicat. Starbucks a nié ces accusations dans tous les cas, bien que plusieurs travailleurs/euses aient obtenu leur réintégration.
***
Les tensions ont continué de couver. Starbucks Workers United a affirmé que les baristas de plusieurs centaines de magasins avaient débrayé en décembre 2024. Et en avril, les délégués syndicaux ont voté contre une proposition de contrat de l'entreprise qui aurait garanti des augmentations annuelles d'au moins 2%, jugeant cette augmentation « insuffisante ».
Le 13 novembre 2025, jour du « Red Cup Day » au sein de l'empire Starbucks, plus d'un millier de travailleurs et travailleuses ont débrayé pour exiger que la chaîne leur présente un contrat « équitable ». La chaîne a minimisé l'impact de la grève.
Le syndicat a intensifié son action. Une semaine plus tard, le mouvement s'est étendu à 65 villes et 95 établissements, avec 2000 travailleurs en grève. Starbucks Workers United a également organisé un blocus du plus grand centre de distribution de Starbucks sur la côte est des États-Unis, à York, en Pennsylvanie.
Le 24 novembre, les travailleurs et travailleuses de Starbucks se sont rassemblés devant le siège social de l'entreprise à Newport Beach, où Brian Niccol travaille à temps partiel, pour exiger que l'entreprise parachève le contrat [ce qui ne l'empêche pas de gagner 98 millions de dollars, soit un salaire plus de 6000 fois supérieur à la médiane de celui de ses salarié·e·s].
Le 28 novembre, la grève s'est encore étendue. Selon le syndicat, environ 2500 baristas de 120 établissements y participent désormais.
« L'entreprise nous fait obstruction », a déclaré Diego Franco, barista chez Starbucks depuis six ans à Chicago. « Mon établissement a choisi de se mettre en grève le jour de la Red Cup, le jour le plus fréquenté de l'année pour l'entreprise, parce que nous en avions franchement assez. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous continuions à venir travailler, à appliquer des politiques et des procédures qui ne résolvent aucun des problèmes auxquels nous nous affrontons au travail, non seulement pour mes collègues, mais aussi pour les clients et nos habitués. Je préfère de loin rester dehors dans le froid et faire grève plutôt que de me rendre au travail où je suis constamment méprisé par notre PDG et par la direction. »
***
Contacté pour commenter la situation, Starbucks a minimisé l'impact de la grève jusqu'à présent et a affirmé avoir enregistré des ventes record pendant les fêtes de fin d'année jusqu'à présent.
« Comme nous l'avons dit, 99% de nos 17'000 établissements aux États-Unis restent ouverts et accueillent les clients, y compris de nombreux établissements que le syndicat avait publiquement déclaré en grève, mais qui n'ont jamais fermé ou ont depuis rouvert », a déclaré Jaci Anderson, porte-parole de Starbucks. « Quels que soient les projets du syndicat, nous ne prévoyons aucune perturbation significative. Lorsque le syndicat sera prêt à revenir à la table des négociations, nous serons prêts à discuter. Les faits sont clairs : Starbucks offre les meilleurs emplois dans le secteur de la vente au détail, avec un salaire et des avantages sociaux s'élevant en moyenne à 30 dollars de l'heure pour les “partenaires” rémunérés à l'heure. Les gens choisissent de travailler ici et d'y rester : notre taux de rotation est inférieur à la moitié de la moyenne du secteur et nous recevons plus d'un million de candidatures chaque année. »
Un nombre croissant de dirigeants politiques progressistes ne sont pas convaincus par ces promesses. Plus de 100 membres du Congrès ont signé des lettres demandant à Starbucks de reprendre les négociations avec le syndicat et de conclure le contrat.
« Tant que les employés seront en grève, je n'achèterai pas de produits Starbucks, et je vous invite à vous joindre à nous », a écrit le maire élu de New York, Zohran Mamdani, sur les réseaux sociaux. Sa coprésidente de transition, Lina Khan, et le nouveau premier adjoint au maire, Dean Fuleihan, ont pris place sur les piquets de grève. Zohran Mamdani est apparu lundi sur un piquet de grève aux côtés du sénateur Bernie Sanders.
La maire élue de Seattle, Katie Wilson, est apparue sur un piquet de grève Starbucks quelques heures après son discours de remerciement, dans lequel elle a déclaré aux travailleurs/euses et à ses supporters : « Les baristas sont le cœur et l'âme de cette entreprise, et ils méritent mieux que des promesses vides et des mesures antisyndicales de la part de l'entreprise. »
Michelle Eisen a quitté Starbucks en mai, après 15 ans de service. Elle est actuellement la principale porte-parole de Starbucks Workers United. Elle a déclaré : « Cette entreprise est en train d'être ruinée, et ces travailleurs syndiqués sont les seuls à se lever et à dire : “Hé, que faites-vous ? Nos cafés ne sont plus des endroits où les gens ont envie de passer du temps. Ils ne veulent plus venir dépenser leur argent ici à cause de la façon dont vous gérez cette entreprise. Vous devez commencer à investir en nous si vous voulez voir cette entreprise se redresser.” Les travailleurs/euses en ont assez et ils vont continuer à intensifier leurs actions. Ils vont poursuivre leur grève pour dénoncer les pratiques déloyales de l'entreprise et ils sont prêts à en faire la grève la plus longue et la plus importante de l'histoire de l'entreprise si celle-ci ne revient pas sur sa décision et ne résout pas les problèmes qui subsistent. » (Article publié dans The Guardian le 2 décembre 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Ancrage des universités dans le territoire : le cas de l’Université du Québec à Rimouski

Les forces israéliennes prennent d’assaut le siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée

Lundi, les forces israéliennes ont pris d'assaut le siège scellé de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est occupée.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
9 décembre 2025
Par Middle East Monitor
Photo : Quartier général de l'UNRWA à Gaza © UNRWA
Le complexe servait de bureau à l'UNRWA depuis 1951, mais l'agence l'a quitté plus tôt cette année à la suite d'une décision du gouvernement israélien. Tel-Aviv a interdit les opérations de l'UNRWA à Jérusalem en vertu d'une loi adoptée par la Knesset (parlement).
Le gouvernorat de Jérusalem, affilié à l'Autorité palestinienne, a déclaré que « les forces de police ont fait une descente dans le siège, arrêté les gardes de sécurité et confisqué leurs téléphones ».
La descente s'est accompagnée « d'un bouclage complet de la zone environnante et de fouilles approfondies menées par les forces d'occupation dans toutes les installations du bâtiment », indique le communiqué.
« Cette descente représente un défi direct au vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a quelques jours, en faveur du renouvellement du mandat de l'UNRWA », a déclaré le gouvernorat.
Il a appelé à une action internationale urgente pour tenir Israël responsable « de la violation du droit international » et pour poursuivre les dirigeants israéliens « pour les crimes et les abus commis contre le peuple palestinien et ses institutions nationales et internationales ».
Pour sa part, l'UNRWA a souligné que l'entrée non autorisée et forcée des forces israéliennes constituait une violation inacceptable de son statut d'agence des Nations unies. Elle a rappelé qu'Israël était partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, qui stipule l'inviolabilité des locaux de l'ONU (immunité contre les perquisitions et saisies) et que ses biens et avoirs sont immunisés contre toute procédure judiciaire.
La police israélienne a déclaré dans un communiqué écrit envoyé à Anadolu qu'« il s'agissait d'une affaire municipale liée à des dettes impayées envers la municipalité, et non d'une affaire policière, et que la police était présente pour assurer la sécurité des employés municipaux ».
Interrogée sur la présence du drapeau israélien dans les locaux, la police israélienne a renvoyé la question à la municipalité.
Vendredi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution visant à renouveler le mandat de l'UNRWA pour trois ans.
La résolution a été soutenue par 151 voix contre 10, avec 14 abstentions.
L'UNRWA a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a plus de 70 ans pour venir en aide aux Palestiniens qui ont été déplacés de force de leurs terres.
L'agence onusienne est confrontée à de graves difficultés financières depuis qu'Israël a lancé une campagne de diffamation contre l'UNRWA, affirmant que des membres de son personnel étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre.
Malgré les demandes de l'UNRWA visant à obtenir du gouvernement israélien des informations et des preuves à l'appui de ces allégations, l'agence n'a reçu aucune réponse. À la suite des accusations d'Israël, plusieurs pays donateurs importants, dont les États-Unis, ont suspendu ou interrompu leur financement.
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Décentraliser : une nécessité
Piraterie dans les Caraïbes : défi au droit international après la saisie de plus d’un million de barils de pétrole

Retour d’Amazon au Québec ?

Dans l'édition du 2 décembre, le journaliste de La Presse Alain McKenna soulevait la question à savoir si l'IA pourrait ramener Amazon au Québec, plus précisément Amazon Web Services (AWS), sa plateforme infonuagique. Il y a de fortes raisons de souhaiter que non.
Comme il est désormais amplement documenté, y compris de façon rigoureuse par la journaliste d'enquête Karen Hao dans son livre Empire of AI publié plus tôt cette année, les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle (IA) et qui se multiplient partout sur la planète sont un scandale environnemental, social et humain.
L'essor des centres de données est basé sur la théorie de la mise à l'échelle (ou scaling, en anglais) selon laquelle l'augmentation exponentielle de la quantité de données, des paramètres et des ressources informatiques qui alimentent l'IA mènerait automatiquement à l'intelligence artificielle générale, une forme d'intelligence artificielle comparable ou supérieure à l'intelligence humaine. Cette théorie est désormais largement réfutée car il a été démontré qu'une augmentation d'ordre quantitatif ne résout pas les limites inhérentes aux modèles et qui causent leurs « hallucinations ». Bien que discréditée, cette théorie de la mise à l'échelle continue de nourrir l'essor des centres de données partout dans le monde.
Et pourtant, ces centres de données représentent un scandale. Environnemental, d'abord, puisqu'ils consomment une quantité faramineuse d'eau potable et d'électricité. L'électricité sert à la fois à alimenter les centres de données et à refroidir les serveurs. L'eau, qui sert également aux systèmes de refroidissement, doit de plus être potable afin de ne pas entraîner la corrosion et la contamination des équipements. C'est sans compter leur coût social et humain car les équipements des centres de données stimulent la demande pour les minéraux et métaux rares dont l'extraction est étroitement liée aux conflits dans des pays comme le Congo.
L'ironie est que l'IA – principalement l'IA générative, beaucoup plus énergivore - prétend être une solution aux perturbations du climat alors qu'elle est en passe de devenir l'un de ses principaux contributeurs. D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation d'électricité des centres de données représentera 3% de la demande mondiale. Des chercheurs de l'Université de Californie évaluent que l'IA consommera entre 1,1 et 1,7 billion de gallons d'eau douce annuellement d'ici 2027, soit la moitié de l'eau consommée annuellement au Royaume-Uni.
Malgré ses promesses d'apporter une solution à tous nos problèmes – que ce soient les dérèglements du climat, les maladies ou la faim – l'IA n'aura servi à date qu'à enrichir une poignée de startups, de fabricants de micropuces et d'investisseurs en capital-risque. Les analystes financiers sont de plus en plus nombreux à sonner l'alarme sur le fait que l'IA est une bulle spéculative vouée à éclater tôt ou tard, avec des répercussions économiques difficiles à évaluer mais sans aucun doute douloureuses.
Cet article, pour lequel AWS a défrayé les frais d'hébergement et de transport du journaliste – semble préparer l'opinion publique pour un accord à venir entre le gouvernement du Québec et AWS. Mais la société québécoise veut-elle vraiment brader ses ressources naturelles au nom d'une élusive souveraineté numérique ?
Pour toutes les raisons évoquées ici, il reste à espérer que les Québécois.es. se mobiliseront, comme ils l'ont fait pour dénoncer les pratiques antisyndicales d'Amazon, afin d'empêcher la construction de nouveaux centres de données par les géants de l'IA, que ce soit AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.
Illustration : panumas nikhomkhai (pexels).
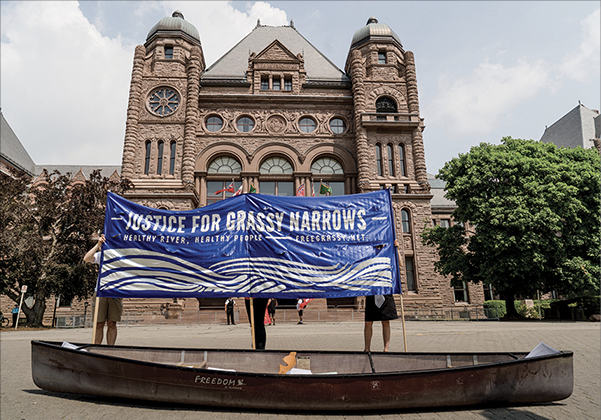
Six décennies de science et de luttes
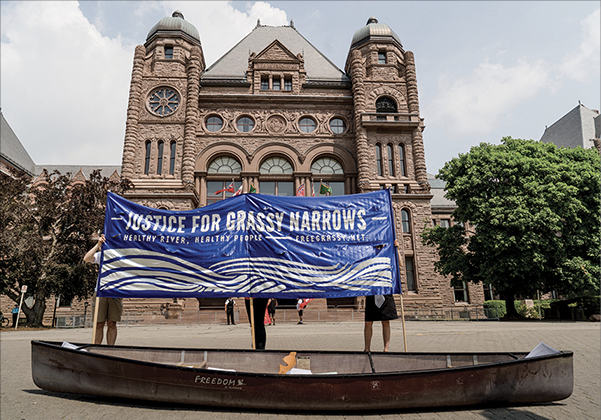
Née de parents anglophones progressistes à l'époque duplessiste, Donna Mergler est une scientifique et militante dont l'engagement a commencé dans les années soixante, durant la Révolution Tranquille. Le magazine Science for the People l'a interrogée sur son parcours dans une version anglaise de cette entrevue qui est disponible sur le site Web https://scienceforthepeople.org. Nous les remercions pour cette collaboration qui nous permet de publier ce texte en français. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee.
Diplômée de l'université McGill, elle a commencé sa carrière d'universitaire à l'UQAM dès 1970, faisant partie du premier corps enseignant de cette université et seule femme professeure durant six ans au département des sciences biologiques. Tout en assumant ses tâches de professeure et de chercheure, elle a très tôt collaboré avec des syndicats et des groupes communautaires. Ce faisant, elle est devenue une pionnière de l'approche multidisciplinaire écosystémique de la santé humaine, laquelle intègre le leadership communautaire, les droits des travailleurs et des travailleuses, l'égalité des sexes et l'équité sociale. Elle est mondialement reconnue pour son expertise sur les effets neurotoxiques des polluants environnementaux.
Aujourd'hui, 18 ans après avoir pris officiellement sa retraite, elle poursuit son engagement où s'allient la science et la justice sociale. Depuis plusieurs années, elle travaille en collaboration avec la Première Nation de Grassy Narrows pour documenter les impacts générationnels de l'empoisonnement au mercure industriel sur leur santé et leur bien-être afin d'appuyer leurs revendications.
Jennifer Laura Lee : À quoi ressemblait la vie d'une scientifique et d'une militante à McGill dans les années 1960 ?
Donna Mergler : Deux choses se sont produites en parallèle. J'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en 1965 et j'ai commencé mes études supérieures en neurophysiologie. J'ai étudié le réflexe vestibulo-oculaire en plaçant des électrodes dans le cerveau de chats pour en savoir plus sur l'influx neuronal en rapport avec les mouvements oscillatoires. J'utilisais l'un des premiers ordinateurs analogiques mis au point par un brillant technicien.
Mes activités politiques et mes activités universitaires étaient complètement séparées. Dans la journée, je montais la colline jusqu'au Centre des sciences médicales de McGill pour étudier et pour mener mes recherches. Puis, le soir, j'apprenais à connaître le Québec, son histoire, sa culture. J'écoutais les chansonnier·ères québécois·es chanter leur pays et ses luttes. Je discutais de justice et d'égalité avec des ami·es du mouvement indépendantiste québécois. Je savourais cette période de bouillonnement social, politique et culturel. Plus j'apprenais, plus j'épousais le mouvement indépendantiste et participais aux fréquentes manifestations, dont McGill français, qui a eu lieu en 1968, où l'on demandait que McGill donne des cours en français.
J. L. : En tant qu'anglophone éduquée dans le système scolaire anglais, comment vous êtes-vous retrouvée impliquée dans la lutte pour l'indépendance du Québec ?
D. M. : J'ai grandi dans un environnement très stimulant. Mon père était un avocat progressiste. Il représentait des personnes arrêtées pour leurs activités politiques ou syndicales. Il avait des contacts avec des révolutionnaires du monde entier. Il accueillait fréquemment des personnes intéressantes à la maison et nous nous asseyions autour de la table à manger pour des échanges stimulants. Très jeune, j'ai passé des heures assise sur les marches du Palais de justice où mon père défendait Madeleine Parent, une grande syndicaliste. Mes parents voulaient m'envoyer dans une école française, mais à l'époque, il fallait être catholique pour fréquenter les écoles publiques francophones.
Comme les autres étudiants et étudiantes progressistes à l'Université McGill dans les années soixante, j'étais au courant de plusieurs mouvements de libération dans le monde – je suis même allée à Cuba en 1962. C'était aussi le début de la Révolution tranquille. En 1966, j'ai décidé de traverser le boulevard Saint-Laurent qui séparait le Montréal anglais du Montréal français.
Je me suis rendue sur la rue Beaudry où se trouvait le siège du Parti socialiste du Québec et de la Jeunesse socialiste du Québec. J'ai découvert une société en effervescence, en mouvement, culturellement, syndicalement, politiquement. En fait, je suis tombée amoureuse de cette société. Je me suis sentie en harmonie avec ce qui se passait. C'était les années 1960 ! Il y avait la réforme de l'éducation, la réforme du système de santé, le mouvement syndical qui devenait de plus en plus progressiste. C'était ma place.
J. L. : L'UQAM est un produit direct de la lutte pour la démocratisation de l'éducation pendant la Révolution tranquille. Comment était-ce au tout début ?
D. M. : L'UQAM était intéressante parce qu'il s'agissait d'une nouvelle université, issue de la réforme de l'éducation. En 1970, le département des sciences biologiques m'a embauchée. Nous étions tous jeunes et nous ne voulions pas reproduire ce que nous avions connu dans d'autres universités. Notre département a décidé de se spécialiser en environnement. Avec les collègues des autres départements, nous avons formé un syndicat et nous nous sommes affilié·es à la CSN. Au lieu d'une structure verticale comme dans les autres universités, nous avons créé une structure démocratique et horizontale. Cela a pris beaucoup de temps et de réunions, mais nous avons estimé que cela en valait la peine.
J. L. : Comment avez-vous commencé à faire de la science en collaboration avec les travailleurs syndiqués des mines ?
D. M. : En 1975, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a travaillé avec le Dr Irving Selikoff de l'hôpital Mount Sinai à New York, qui faisait une étude portant sur l'état de santé des mineurs d'amiante du Québec. Un jour, lors d'une soirée chez une amie, l'un des permanents de la CSN m'a dit : « Nous avons le rapport [de Selikoff] et nous ne savons pas quoi en faire ». J'ai répondu : « Je suis physiologiste, je peux le lire et peut-être l'expliquer aux travailleurs. »
Je me suis documentée sur les effets de l'amiante sur la santé et sur l'histoire de la compagnie Johns Mansville. J'ai appris que l'entreprise savait depuis les années trente que l'amiante augmentait le risque de cancer. J'ai commencé à participer à des ateliers de formation organisés par le syndicat et portant sur les effets de l'amiante sur leur santé. C'était à l'époque de la grève des mineurs.
Parallèlement, à l'UQAM, nous avons créé le Service aux collectivités, une forme unique de collaboration avec des groupes non traditionnellement desservis par les universités, en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres. Avec l'appui de ce service, des projets de formation et de recherche sont conçus dans une perspective de promotion collective. Le premier accord a été conclu avec deux grands syndicats québécois, la Fédération du travail du Québec (FTQ) et la CSN. Pendant des années, j'ai participé à de nombreuses sessions de formation organisées par les syndicats sur la santé et la sécurité au travail et mené des projets de recherche.
J. L. : Pouvez-vous nous parler de votre travail avec les ouvriers syndiqués ?
D. M. : Je me souviens d'un cas en particulier où j'animais un atelier avec des travailleurs exposés aux solvants dans une usine de fabrication de bâtons de hockey près de Drummondville. Le groupe de travailleurs était attentif, mais dès que je commençais à écrire au tableau, je les perdais complètement. Ils commençaient à plaisanter. Je n'avais pas observé cela dans d'autres industries. Nous avons commencé à parler des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Ils racontaient tous la même histoire : ils arrivaient le matin, posaient leur boîte à lunch et ne se souvenaient plus où ils l'avaient mise à midi.
J'ai donc visité l'usine. Il m'a fallu environ cinq minutes pour me sentir gelée, rien qu'en respirant du styrène, du toluène, du n-hexane… Ensuite, j'ai eu mal à la tête, mais je m'en fichais, parce que j'étais gelée !
Vous imaginez comment cela a pu attirer mon attention : une neurophysiologiste confrontée à un problème neurophysiologique. J'avais la possibilité de combiner mes intérêts académiques et mon désir d'aider à améliorer la santé des travailleurs par des changements sur le lieu de travail… d'agir avant que les travailleurs ne soient trop malades pour travailler.
À cette époque, l'importance de la neurotoxicité précoce était relativement nouvelle et n'était pas considérée valide par les scientifiques traditionnels. Une fois, lors d'une réunion avec les représentants des syndicats et de l'entreprise d'une usine d'explosifs concernant une possible étude, une épidémiologiste réputée, engagée par l'entreprise, nous a dit que l'étude que nous proposions avec les travailleurs était irresponsable. Elle nous a dit que nous devrions plutôt étudier les maladies des travailleurs retraités. Un jeune travailleur est intervenu en disant : « Mais nous voulons savoir ce qui nous arrive maintenant afin de pouvoir améliorer notre situation. » Les dirigeants de l'usine ont refusé de participer et nous avons poursuivi en faisant passer aux travailleurs des examens dans un motel situé en face de l'usine.
Pendant cette période, ma collègue Karen Messing et moi-même avons créé un petit groupe de recherche, qui est ensuite devenu le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Notre approche était basée sur l'intégration des connaissances des travailleur·euses. Nous écoutions et nous traduisons leurs préoccupations en études scientifiques rigoureuses.
Entre 1993 et 2010, j'ai participé à un effort interdisciplinaire et interuniversitaire visant à comprendre les sources de mercure dans l'Amazonie brésilienne, sa transmission dans l'environnement, ses effets sur la santé et ainsi que le contexte sociopolitique prévalent. Nous avons utilisé une approche participative avec les communautés vivant le long de la rivière Tapajós, avec pour buts de maximiser les bénéfices pour la santé et de minimiser les risques de l'exposition au mercure. Mes collègues biogéochimistes ont montré qu'en plus des rejets de mercure provenant des mines d'or, la déforestation généralisée libérait du mercure naturel dans les milieux aquatiques, et donc dans la chaîne alimentaire.
J. L. : Comment vous êtes-vous impliquée dans le projet avec la Première Nation de Grassy Narrows, dans le nord de l'Ontario ?
D. M. : En 2016, Judy da Silva, qui se dévoue corps et âme pour une justice environnementale à Grassy Narrows, m'a invitée à participer à une enquête d'évaluation de la santé, réclamée par la communauté depuis de nombreuses années. Entre 1962 et 1975, environ 9000 kilogrammes de mercure ont été déversés par une usine de pâte à papier dans le système fluvial qui alimente les eaux territoriales de Grassy Narrows. Le doré, un grand poisson prédateur, était au centre de leur culture, de leurs traditions, de leur gagne-pain et de leur régime alimentaire. La contamination de la population s'est faite à travers sa consommation. Depuis les 50 dernières années, Grassy Narrows se bat pour faire reconnaître leur empoisonnement au mercure.
Les résultats de notre enquête ont montré que les habitant·es de Grassy Narrows étaient en moins bonne santé par rapport aux autres Premières Nations. Notre étude a permis de mettre en évidence le rôle du mercure quant à la mortalité précoce (moins de 60 ans), à la fréquence de symptômes de dysfonctionnement du système nerveux et au risque accru de suicide chez les jeunes. Ces travaux apportent un soutien scientifique à leurs demandes.
Soulignons que lorsque nous avons commencé à faire de la recherche participative, celle-ci n'était pas considérée comme scientifique et objective. Aujourd'hui, elle est de plus en plus répandue et reconnue par la plupart des organismes de subvention de la recherche.
J. L. : Que pensez-vous que l'avenir nous réserve ? Êtes-vous optimiste ?
D. M. : Nous traversons une période sombre, marquée par l'individualisme, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, et des guerres de plus en plus nombreuses aux quatre coins de la planète. Par contre, il y a une opposition grandissante aux injustices. De nouveaux mouvements alliant justice sociale et environnementale sont en train d'émerger. Il en va de même pour le mouvement grandissant en faveur de la souveraineté des peuples autochtones partout au Canada. C'est là que se livrent les principales batailles qui, espérons-le, seront un jour remportées.
Jennifer Laura Lee est post-doctorante à l'université TELUQ, où elle étudie la santé environnementale et la neurotoxicologie. Elle est membre active de Science for the People.
Photo : Leadnow Canada (CC BY-SA 2.0)

Les idoles (il)légitimes

Ériger des individus en icônes intemporelles éclipse la dimension intrinsèquement collective des luttes pour la justice sociale. De plus, celles et ceux sur lesquel·les la société jette son dévolu entrent souvent dans les barèmes de la respectabilité.
Comme beaucoup d'autres avant elle, Claudette Colvin fait partie de celles qui ont été consciemment effacées de l'Histoire. Sa contribution pionnière à la lutte pour les droits civiques des Noir·es aux États-Unis commence tout juste à être reconnue à sa juste valeur.
Née le 5 septembre 1939 à Montgomery dans l'Alabama, aujourd'hui âgée de 84 ans, Claudette Colvin a laissé sa marque lorsqu'elle a refusé de céder son siège à une femme blanche dans un autobus bondé le 2 mars 1955. Un refus qui fut insufflé par la force et le récit de femmes afro-américaines comme Harriet Tubman et Sojourner Truth dont elle avait pris connaissance lors de ses implications militantes et à l'école. Le geste de protestation de Colvin a eu lieu neuf mois avant celui de Rosa Parks, aujourd'hui considérée comme « la mère du mouvement pour les droits civiques ». Parks et Colvin étaient alors toutes deux impliquées au sein de La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Colvin fut arrêtée, menottée et extirpée de force de l'autobus. Tout au long de cet épisode, les policiers la menacent de viol et formulent des commentaires dégradants à connotation sexuelle à son endroit, un scénario qui était malheureusement monnaie courante pour de nombreuses Afro-Américaines. Colvin reçut plusieurs chefs d'accusation en cour de justice pour avoir tenu tête aux politiques de ségrégation raciale issues des lois Jim Crow.
La NAACP organise alors la stratégie de défense de Claudette Colvin considérant le précédent qu'un jugement dans cette affaire pourrait créer pour l'ensemble de la population afro-américaine. Or, le leadership masculin et noir de la NAACP apprend que Colvin, qui est célibataire, est enceinte [1] d'un homme plus âgé et qui plus est, marié. Donner naissance à un enfant illégitime est un tabou immense à cette époque, et ce, pour l'ensemble de la société américaine. Colvin est aussi reconnue pour ses émotions vives et sa parole franche qui était tout sauf docile. Jugée « trop noire » en raison de la carnation foncée de sa peau, l'adolescente refusait aussi de se lisser les cheveux. Claudette Colvin n'était pas une victime « idéale » ou « parfaite ». En raison de la crainte qu'elle – et, par ricochet, le mouvement en entier – ne soient discrédités tant par la justice que les médias, il sera décidé que la meilleure stratégie serait de présenter le cas de Rosa Parks comme emblème de leur combat. La résistance s'organise alors avec le leadership d'un certain pasteur nommé Martin Luther King. Une vague de protestation et un mouvement de boycottage s'étendent alors dans la ville de Montgomery. Elle durera un peu plus d'un an. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que les lois ségrégationnistes violent la constitution américaine. La tentative d'appel de l'État de l'Alabama fut refusée par le plus haut tribunal du pays et la décision eut force de loi le 20 décembre de la même année.
La « Rosa Parks du Canada » ?
Les gestes de protestation de Colvin et Parks font écho à une résistance similaire au Canada, celle de la femme d'affaires Viola Desmond dans un cinéma de New Glasgow duquel elle fut brutalement expulsée après avoir refusé de subir une discrimination raciste de la part du personnel qui lui a demandé de quitter la section d'une salle de cinéma réservée aux Blanc·hes. Elle fut ensuite emprisonnée pendant plusieurs heures et sommée de payer une amende. En avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offre un pardon public et absolu à Desmond, soit près de 45 ans après sa mort. En 2012, un timbre de Postes Canada à son effigie est lancé. En 2018, le visage de Viola Desmond est imprimé sur les billets de 10 $, ce qui a fait d'elle la première femme canadienne noire à figurer sur un billet de circulation courante de la Banque du Canada. Bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme la « Rosa Parks du Canada », Viola Desmond a pourtant refusé de céder son siège dans ce cinéma près d'une décennie avant sa consœur américaine. La tendance à mettre de l'avant des icônes noires étatsuniennes issues des luttes antiracistes n'a rien de nouveau. Cet américanocentrisme de notre mémoire collective donne l'illusion que le racisme anti-noir à l'américaine serait « pire » que celui de la France ou du Canada, une manière pour ces puissances coloniales de s'enorgueillir d'un multiculturalisme, d'une inclusion et d'un respect des droits de la personne de façade. Plus encore, cela participe à l'invisibilisation d'individus et de luttes collectives aux échelles locales, et ce, des deux côtés de l'Atlantique.
Au-delà des idoles respectables
En France, la polémique ayant eu cours à l'été 2023 autour du changement de nom du lycée « Angela-Davis », à Saint-Denis, jugée trop « radicale » par la femme politique Valérie Pécresse qui le rebaptisa « Lycée Rosa-Parks », jugée plus « consensuelle », est un autre exemple des enjeux politiques autour des icônes antiracistes. Rappelons d'ailleurs que l'afroféminisme a bel et bien son histoire en France, incarnée par des figures telles que Paulette et Jeanne Nardal qui ont fondé la Revue du Monde noir en 1931 ou encore Suzanne Césaire, totalement éclipsée par son illustre ex-conjoint. L'autrice et éditrice québécoise Valérie Lefebvre-Faucher fait aussi mention de ces dynamiques d'effacement et d'invisibilisation de nos héroïnes dans un micro-essai [2] portant sur les femmes ayant entouré, influencé et contribué à la construction et à la diffusion de la pensée du philosophe allemand Karl Marx. Même son de cloche pour le politologue québécois Francis Dupuis-Déri, qui a publié un bref ouvrage [3] coup-de-poing traitant de but en blanc du meurtre et féminicide de la sociologue française Hélène Legotien par le philosophe marxiste Louis Althusser le 16 novembre 1980. Elle aura été assassinée deux fois, physiquement et symboliquement. Tout cela, en raison de l'admiration que vouait une élite culturelle complaisante et soi-disant progressiste envers Althusser.
En somme, ce que l'on peut retenir des récits de femmes comme Claudette Colvin ou Viola Desmond, est que vient un jour, tôt ou tard, où la société finit par enfin accorder à ces femmes et filles noires, visionnaires et avant-gardistes, la reconnaissance qu'elles méritent. Si plusieurs de ces idoles (il)légitimes n'ont plus voix au chapitre en 2024 pour qu'on puisse leur témoigner directement notre gratitude, il importe de graver leurs noms dans nos livres d'Histoire, nos cœurs et nos mémoires.
[1] Claudette Colvin donna naissance à un fils, nommé Raymond, à l'âge de 17 ans, ce qui lui vaudra un renvoi de son école. De plus, en raison de la carnation claire de la peau de Raymond, Claudette fut accusée par sa communauté d'avoir conçu cet enfant avec un homme blanc. Colvin n'a jamais révélé l'identité de celui qu'elle considère comme un agresseur. Raymond décèdera, chez elle, à l'âge de 37 ans des suites de problèmes de toxicomanie.
[2] Lefebvre-Faucher, Valérie, Promenade sur Marx – Du côté des héroïnes, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2020, 80 pages.
[3] Dupuis-Déri, Francis, Althusser assassin – La banalité du mâle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2023, 96 pages.
Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

Les angles morts des pistes cyclables

À l'automne 2023, on a assisté à Montréal à un certain nombre de manifestations s'opposant à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, notamment dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension. Le mouvement procyclisme a-t-il des leçons à retenir de cette opposition ?
Il n'y a rien de nouveau à l'opposition aux pistes cyclables. Le cas récent du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis est un exemple parmi tant d'autres. En réaction à cette opposition, la communauté procycliste se fait entendre sur les réseaux sociaux et dans divers éditoriaux, qualifiant souvent cette opposition de rétrograde et de réactionnaire. Bien qu'il soit impératif et urgent de combattre la dépendance à la voiture, et même si certain·es militant·es anti-vélo sont effectivement réactionnaires, voire conspirationnistes [1], est-ce que l'opposition venant de citoyen·nes « ordinaires » pourrait révéler certains angles morts du militantisme procyclisme ?
Moins de voitures, mais rien pour les remplacer
Pour revenir aux exemples de Parc-Extension et de Saint-Michel, deux quartiers historiquement pauvres et racisés, l'argument prédominant des opposant·es aux pistes cyclables est la perte d'espaces de stationnement. De telles revendications peuvent paraître insignifiantes aux yeux des activistes procyclisme lorsqu'on considère qu'à l'échelle de la ville de Montréal, l'espace consacré aux vélos représente 1,3 %, contre 73,8 % pour la voiture [2]. Or, bien qu'il soit important d'inciter les gens à délaisser leur voiture aux profits d'autres moyens de transport, quelles autres options leur sont vraiment proposées ? Des manifestant·es dans Parc-Extension disent n'avoir d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail, en raison d'une longue distance à parcourir ou d'horaires de nuit. Les services de transport en commun étant largement réduits entre 1 h et 5 h, les travailleur·euses aux horaires atypiques se retrouvent avec peu d'alternatives à la voiture.
Rappelons qu'au même moment où les manifestations anti-pistes cyclables se déroulaient, le gouvernement de la CAQ jouait au bras de fer avec les différentes sociétés de transport du Grand Montréal, refusant d'augmenter leur financement pour couvrir leurs déficits, ce qui menace d'entraîner une diminution drastique de l'offre. Si on veut inciter les gens à délaisser leurs voitures, il est pourtant impératif d'offrir des solutions de rechange adéquates, qui répondent aux besoins des communautés touchées.
Le vélo, synonyme de gentrification ?
Également, le vélo en tant que moyen de transport est de plus en plus associé à la gentrification. Bien que les infrastructures cyclables en sont rarement la cause directe, elles peuvent en effet être le signe d'un embourgeoisement à venir ou en cours. À une certaine époque, le mouvement procyclisme était considéré comme radical et associé à la gauche, alors qu'aujourd'hui, le mouvement s'est intégré au discours environnementaliste néolibéral, largement dominé par la classe moyenne et blanche, et aux intérêts capitalistes. Ainsi, les projets d'aménagement cyclable font souvent partie d'un plus gros projet de réaménagement urbain (l'aménagement du nouveau campus de l'Université de Montréal dans Parc-Extension, par exemple) qui sert à plaire à la population aisée, blanche et valide et qui prépare le terrain pour l'établissement de commerces et de boutiques haut de gamme. De plus, considérant que deux fois plus de personnes blanches se déplacent à vélo que de personnes racisées [3], il n'est pas étonnant que ces dernières perçoivent le vélo comme une activité de Blanc·hes embourgeoisée, et donc qui pose un risque de gentrification dans leur quartier. Sans oublier que les quartiers racisés en Amérique du Nord ont historiquement reçu moins d'investissements en matière d'aménagement urbain et de services publics, ce qui augmente la méfiance de ces populations envers les projets d'urbanisme et leur sentiment de ne pas se faire entendre. Les résident·es d'un quartier comme Parc-Extension sont conscient·es que leur quartier est moins bien desservi que d'autres, et certains problèmes pressants (comme la collecte des poubelles) ne sont pas considérés. Cela explique la frustration de certain·es résident·es qui sentent qu'on leur impose des projets, tandis que leurs autres demandes sont ignorées.
Intégrer la communauté
Ce dernier point fait écho à une critique émise par de nombreux manifestant·es anti-pistes cyclables dans ces quartiers : l'absence de consultations publiques. L'aménagement de nouvelles pistes cyclables survient souvent sans que les communautés touchées soient consultées, ce qui revient à imposer un projet sans avoir l'approbation des personnes qui en vivront les conséquences dans leur vie de tous les jours. Ce fut effectivement le cas dans Parc-Extension, où les résident·es se sont réveillé·es un matin avec une note dans leur boîte aux lettres les informant de l'implantation de nouvelles pistes cyclables. S'il faut reconnaître l'urgence climatique et l'importance d'agir rapidement en matière de transport, une simple série de consultations publiques pour les gens du quartier aurait facilement rendu le projet plus digeste.
Aucun projet de réaménagement urbain ne fera jamais l'unanimité, mais des consultations publiques à l'étape de l'élaboration permettent aux gens d'un quartier donné de faire entendre leurs inquiétudes, de dresser un portrait plus exhaustif de la situation et de trouver des solutions aux problèmes bien réels et légitimes que ces projets causent pour les populations défavorisées. Il est crucial que les projets d'infrastructures cyclistes incluent en amont les citoyen·nes des quartiers touchés plutôt que de leur être imposés.
Pour une vision égalitaire du vélo
La prise de position présentée ici vient d'un fervent militant procyclisme, un « enverdeur » typique qui voyage à vélo 365 jours par année et qui n'a jamais eu de voiture. Ce serait un manque de gros bon sens de ne pas réitérer l'importance de se défaire de notre dépendance sociétale à la voiture, entre autres pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'équité sociale. Une récente étude menée par la firme Léger démontre que 39 % des Canadien·nes se disent peu enclins à acheter ou louer une voiture à l'avenir à cause du fort taux d'inflation actuel – cette même raison étant citée par 55 % des Canadien·nes disant vouloir délaisser leur voiture [4]. L'idée préconçue comme quoi la voiture serait le moyen de transport idéal pour la classe ouvrière (ou pour la classe moyenne) est donc de plus en plus discutable. Sans oublier qu'un segment de la communauté cycliste, souvent invisibilisé, utilise le vélo non pas par choix, mais par obligation : je veux ici parler de la communauté itinérante. Oubliée à la fois par le mouvement procyclisme et par les opposants aux pistes cyclables, la population cycliste itinérante a droit à des aménagements sécuritaires au même titre que n'importe quel·le usager·ère de la route et devrait, par conséquent, faire partie du débat.
En conclusion, le mouvement procyclisme gagnerait à inclure davantage les communautés pauvres et/ou racisées et à écouter ses opposant·es, plutôt que de balayer du revers de la main toutes critiques en les qualifiant automatiquement d'anti-progressistes. Le mouvement devrait retourner vers ses racines radicales, s'éloigner de sa forme édulcorée néolibérale qui ne contribue qu'à renforcer les inégalités sociales, et travailler en coalition pour produire une vision d'ensemble (de pair avec une offre bonifiée de services de transport en commun, par exemple) qui ne laisse personne derrière.
[1] C'est le cas, par exemple, du mouvement qui s'oppose à l'idée de « ville du quart d'heure » (« 15-minute city »), qui avance que ces types de projets d'urbanisme constituent une façon de limiter et de contrôler les déplacements des individus.
[2] « La nouvelle guerre culturelle », Ludvic Moquin-Beaudry, Pivot, 26 octobre 2023.
[3] « Is Canada's Commuter Bicycling Population Becoming More Representative of the General Population Over Time ? », Carly MacEacheron et al., Active Travel Studies, 29 mai 2023.
[4] « Canadians are less likely to own a vehicule due to high rate of inflation, report shows », Canadian Manufacturing, 4 avril 2023.
Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)
POUR ALLER PLUS LOIN
María Gabriela Aguzzi, « Pistes cyclables à Parc-Extension : le débat au-delà de la mobilité », La Converse, 22 novembre 2023. Disponible en ligne sur laconverse.com
Melody L. Hoffmann, Bike Lanes Are White Lanes. Bicycle Advocacy and Urban Planning, University of Nebraska Press, 2016.
Pourquoi et comment décentraliser ?
Une petite ville met en danger sa population en congédiant ses pompiers
Webinaire du Collectif du 19 mars : Gaza, de la faillite globale au devoir d’humanité !
« Une économie canadienne », moins 1000 métallos d’Algoma
Béton Provincial empêche ses ouvriers de travailler depuis un an
Retourner aux faits : une réponse à l’Alliance de l’énergie de l’Est
DOSSIER DÉCENTRALISATION : Enjeux municipaux 2025, Décentralisation et participation citoyenne
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













