Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Suppression du PEQ : « Ils sont en train de jouer avec nos vies »

« Le gouvernement de Québec est venu chez nous au Brésil et nous a dit « On a besoin de vous », se remémore Sergio, debout sur un banc, micro à la main. « J'ai commencé à étudier le français, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait le tour du Québec pour travailler, j'ai envoyé mes enfants à l'école », raconte le père de famille. « Mais aujourd'hui, après tout ce qu'on a donné, le gouvernement nous dit de rentrer chez nous ? », s'indigne-t-il, accompagné du grondement de la foule.
19 novembre 2025 | tiré du journal des Alternatives | Photo : Des manifestants défilent sur le boulevard Saint Laurent contre la suppression du PEQ - Charline Caro
Lundi dernier à midi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies place de la Paix, devant le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, à Montréal. Ces personnes migrantes et leurs soutiens sont venus protester contre l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), annoncée la semaine dernière par le gouvernement provincial.
Une partie de la manifestation sur la Place de la Paix – toutes les photos sont de l'autrice, Charline Caro, pour le Journal
Une décision brutale

Ce programme permettait à toutes les personnes immigrantes qui répondaient aux exigences d'obtenir presque automatiquement un Certificat de sélection du Québec (CSQ), en vue d'obtenir la résidence permanente. Avec un diplôme québécois et/ou deux années de travail à temps plein, ainsi qu'une bonne connaissance du français, ces personnes demanderesses pouvaient s'établir au Québec de manière permanente.
« On est venus pour avoir le PEQ, c'était ça la promesse », poursuit Sergio, sur un ton amer. Comme lui, des milliers de personnes nouvellement arrivées ont quitté leur pays pour la Belle Province en sachant qu'un programme leur permettrait d'obtenir un visa permanent après quelques années d'études ou de travail.
La semaine dernière, le gouvernement Legault a annoncé la suppression définitive du PEQ. Cette décision intervient alors que le pouvoir provincial veut réduire les seuils d'immigration de 45 000 cette année à 60 000 pour la suivante.
« Ils ont changé les règles en cours de jeu », dénonce Thibault Camara, membre de l'organisme Le Québec c'est nous aussi, qui organise la manifestation. « On avait des projets, des rêves au Québec. Tout s'écroule à cause d'une décision d'un ministère », poursuit-il.

Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) devient l'unique porte d'entrée pour les immigrant.es économiques au Québec. C'est une voie qui présente plus d'obstacles, et aucune garantie. Celles et ceux en demande sont sélectionné.es selon un ensemble de critères comme leur secteur d'activité, leur expérience professionnelle, leur scolarité ou leur situation géographique. Certaines conditions ont, de plus, été durcies par la nouvelle réforme. Le fait d'habiter à Montréal constitue par exemple un gros désavantage, alors que le gouvernement veut régionaliser l'immigration.
« Ce qu'on leur dit, c'est que si votre permis de travail expire dans trois, quatre ou six mois, il faut partir ailleurs », estime Yamanda Bouchaala, membre de l'équipe organisatrice de la manifestation, qui témoigne en entrevue du « choc » provoqué par l'abolition du PEQ dans la communauté immigrante : « On a des centaines de témoignages de familles et d'étudiant.es qui sont dans le flou total. »
Une vie investie au Québec
« J'ai vendu tout ce que j'avais », raconte Géraldine, qui prend la parole au micro de la manifestation. Cette mère de famille a quitté la France il y a deux ans, après que du personnel du ministère de l'immigration québécois soit venu la recruter pour combler le manque de main-d'œuvre dans la province.
L'infirmière a tout quitté avec son mari et ses deux enfants, pour « s'intégrer, travailler et tisser des liens au Québec ». Avec la suppression du PEQ, c'est tout son « avenir qui s'écroule ». « On va devoir rentrer, après tout les sacrifices qu'on a faits ? », interroge-t-elle sans y croire.
Les personnes immigrantes ont « tout investi au Québec, du temps, de l'argent, tout », rappelle Yamanda Bouchaala. « On abandonne des personnes qui font déjà partie du système », dénonce-t-elle.
Au milieu de la foule, Neba brandit une pancarte sur laquelle il est écrit « Respectez vos engagements ». Cette jeune marocaine est venue étudier au Québec en dessin industriel, avec le projet de s'établir ici. Chaque session d'étude lui coûte 12 000 $, le tarif réservé à la plupart des étudiant.es de l'international. « Tout ça pour qu'au final on nous dise de rentrer chez nous », regrette l'étudiante. « Aujourd'hui, c'est comme si j'avais reçu un couteau dans le dos ».

Des soutiens politiques
Après les témoignages, c'est au tour des soutiens de se succéder au micro devant la manifestation. André Albert Morin et Guillaume Cliche-Rivard, respectivement députés pour le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS), prennent notamment la parole pour dénoncer la décision du gouvernement caquiste.
« On ne peut pas changer les règles du jeu en plein match », fustige le député libéral, rappelant que les personnes immigrantes étaient considérées comme des « anges gardiens » pendant la pandémie.
Son homologue de QS estime quant à lui que le gouvernement Legault a « trahi » ceux et celles qui arrivent , alors même que c'est une « plus-value extraordinaire pour le Québec ». Le député promet de se battre à l'Assemblée nationale pour le retour du PEQ, avant que le public s'exclame : « Merci ! Merci ! Merci ! ».

Une transition avant l'abolition
« Aujourd'hui, nous demandons une seule chose : le respect d'une promesse », avance Thibault Camara. Le mouvement citoyen réclame au gouvernement d'instaurer une clause grand-père, qui permettrait aux personnes déjà installées au Québec de bénéficier du PEQ avant son abolition définitive.
Avant d'inviter les manifestant.es à défiler sur le boulevard Saint Laurent, l'organisateur fait un rappel : « L'immigration, ce n'est pas juste des numéros dans un fichier Excel. Ce sont des vies. »

Toutes les photos sont de l'autrice, Charline Caro, pour le Journal.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand la Constitution québécoise ignore les peuples autochtones

La Coalition avenir Québec (CAQ) projette non seulement d'imposer une Constitution du Québec aux Premières Nations et Inuit, mais en plus le projet de loi s'inscrit en contradiction avec les droits des Autochtones garantis par la Constitution canadienne. Adopter une telle approche en 2025 ignore des droits constitutionnels bien reconnus, reproduit la vieille approche coloniale et constitue une grave erreur juridique comme historique.
Karine Millaire est professeure adjointe en droit constitutionnel et autochtone, Université de Montréal. Karine Millaire est Présidente bénévole de Projets Autochtones du Québec, une organisation assurant des services d'hébergement et d'autonomisation aux personnes autochtones en situation de précarité à Tiohtià:ke (Montréal). À titre de professeure universitaire, elle reçoit du financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
27 octobre 2025 | tiré de la lettre The Conversation | Photo : Le drapeau du Québec flotte au sommet de la tour principale de l'Assemblée nationale
https://theconversation.com/quand-la-constitution-quebecoise-ignore-les-peuples-autochtones-268329
Il y a plus de 40 ans, on enchâssait dans la Constitution canadienne l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette disposition garantit les droits des peuples autochtones issus de traités et leurs droits ancestraux. Le projet de Constitution de la CAQ en fait complètement fi. Aucune disposition du projet de loi déposé ne traite des droits constitutionnels autochtones. Plus encore, les quelques mentions des Premières Nations et Inuit au préambule du projet de loi 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, sont de nature à minimiser des droits pourtant clairement reconnus.
On y mentionne en effet les Autochtones pour affirmer qu'ils « existe[nt] au sein du Québec ». On ne reconnaît pas qu'il s'agit de « peuples », contrairement à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, mais plutôt de simples « descendants des premiers habitants du pays ». On désigne même nos nations sous des appellations coloniales francisées, rappelant le processus d'effacement des noms de nos ancêtres.
Le projet de loi affirme l'« intégrité territoriale » ainsi que la « souveraineté » culturelle et parlementaire du Québec. Les Autochtones ne pourraient selon ce projet de Constitution que « maintenir et développer leur langue et leur culture d'origine ». Autrement dit, les droits territoriaux et de gouvernance garantis en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sont complètement ignorés, voire niés.
L'imposition coloniale des « droits collectifs » de la « nation québécoise » sur les droits collectifs et fondamentaux des peuples autochtones est également affirmée par des dispositions d'interprétation spécifiques. Alors que les droits des Premières Nations et Inuits sont réduits, on précise que ceux de la nation québécoise « s'interprètent de manière extensive ».
De plus, on propose la création d'un Conseil constitutionnel ayant pour mandat d'interpréter la Constitution du Québec. Or, les facteurs explicitement précisés dont devrait tenir compte ce Conseil ne portent que sur les droits et « caractéristiques fondamentales du Québec », son « patrimoine commun », son « intégrité territoriale », ses « revendications historiques », son « autonomie » et son « économie ». Pas une seule mention ici de l'existence des peuples autochtones ou de leurs droits.
Les Wendat, Kanien'keháka (Mohawk), Attikamekw, Anishinaabe, Cris (Eeyou Istchee), Abénakis, Mi'kmaq, Innus, Naskapis, Wolastoqiyik et Inuit n'existent pas sur un territoire « appartenant » au Québec. C'est le Québec qui existe sur les territoires dont ces nations sont les gardiennes et pour lesquels nous avons une responsabilité commune. Nos droits ne sauraient être effacés à nouveau en 2025 par ce projet de Constitution du Québec.
La Cour suprême et les tribunaux du Québec comme d'ailleurs au pays reconnaissent de façon constante que les peuples autochtones ont une souveraineté préexistante à celle imposée historiquement par la Couronne, c'est-à-dire une souveraineté qui existait bien avant les débats sur l'autonomie du Québec au Canada. Cette souveraineté existe toujours et doit être réconciliée avec celle de l'État dans un esprit de « justice réconciliatrice ».
Il en découle des droits concrets en matière de consultation, de consentement, d'autonomie gouvernementale. Aucune dérogation à ces droits n'est possible, contrairement aux droits et libertés visés par la clause dérogatoire de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Or, la CAQ souhaite mettre à l'abri de contestations constitutionnelles toute disposition législative qui « protège la nation québécoise ainsi que l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec » en interdisant toute contestation judiciaire d'un organisme qui utiliserait pour ce faire des fonds publics du Québec. Fort nombreuses sont les organisations qui reçoivent des fonds publics, incluant celles ayant justement la mission publique de protéger la société contre les actions illégales ou délétères de l'État. Il s'agit d'un des fondements de l'État de droit.
Du point de vue autochtone, cette interdiction rappelle l'époque coloniale où il était interdit aux Premières Nations de contester les actions illégales de l'État qui avaient pour but de les déposséder de leurs terres, de nier leurs droits et de les assimiler. Cette mesure a participé au génocide des peuples autochtones au Canada.
Ce projet de Constitution du Québec s'ajoute à plusieurs autres atteintes claires aux droits autochtones. Pensons à la contestation de Québec de la loi fédérale reconnaissant le droit inhérent des peuples autochtones de mettre en place leurs propres politiques familiales et de protection de la jeunesse. La Cour suprême lui a donné tort et a confirmé la constitutionnalité de la loi fédérale.
La CAQ a aussi refusé d'exclure les étudiants autochtones des règles de renforcement de la Charte de la langue française (projet de loi 96), alors que les langues autochtones ne menacent pas le français. Cette décision accroît les obstacles aux études supérieures et limite les droits de gouvernance en éducation des peuples autochtones. La contestation de la constitutionnalité de la loi québécoise est en cours.
Enfin, pensons au récent projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier, lequel avait été sévèrement critiqué. Celui-ci proposait un retour en arrière et rappelait l'approche préconisée au début de la colonisation du territoire, alors que l'industrie jouait un rôle accru en matière de gouvernance du territoire. Le projet de loi a finalement été abandonné fin septembre, mais il aura fallu que les peuples autochtones se battent à nouveau pour faire respecter leurs droits.
Moderniser la Constitution du Québec pour respecter les droits des Autochtones
Le contexte n'est plus le même qu'à la fondation du pays en 1867 ou lors des discussions des années 1980 ayant précédé le rapatriement de la Constitution. En 2025, il ne serait ni légal, ni légitime, d'adopter une Constitution du Québec ignorant les droits des Autochtones.
Une Constitution québécoise doit minimalement reconnaître les mêmes droits ancestraux et issus de traités que ceux protégés par la Constitution canadienne et les décisions des tribunaux en la matière. Cela inclut des droits de gouvernance notamment quant au territoire.
De plus, la Charte des droits et libertés de la personne est silencieuse sur les droits autochtones. L'article 10 garantissant le droit à l'égalité devrait être modifié pour indiquer que l'identité et le statut autochtone sont des motifs de discrimination spécifiquement prohibés au Québec. Cette Charte devrait également reconnaître expressément le droit à la sécurité culturelle afin que toute personne autochtone ait accès aux services publics de façon équitable. Ces changements permettraient qu'un mandat conséquent soit donné à la Commission des droits de la personne pour agir afin d'enrayer cette discrimination.
Le Québec doit également mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le Canada fait partie de nombreux pays qui se sont engagés à le faire et nos tribunaux ont commencé à s'y référer. La Déclaration exige de construire avec les peuples autochtones les politiques qui touchent à leurs droits, de respecter leur consentement et leur autonomie ainsi que le droit d'avoir accès aux services publics sans discrimination, à l'instar du Principe de Joyce.
Le projet de Constitution de la CAQ ne correspond en rien à ce qu'un véritable processus constituant doit faire. Ni les Québécois ni les peuples autochtones ne participent à cette démarche. Une Constitution devrait être pensée pour au moins les sept prochaines générations, comme nous l'enseignent les Aînés, et non en vue de la prochaine élection.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dans ce long combat contre l’injustice en éducation, le mois de novembre 2025 sera peut-être considéré comme un tournant

De l'appui d'un des économistes les plus influents de la planète à celui de la plus grande centrale syndicale du domaine de l'éducation, voici un retour sur neuf jours en novembre.
Tiré de la Lettre de l'École ensemble
4 novembre : Appui de la CSQ au réseau commun
La Centrale des syndicats du Québec, dans un vote unanime de son conseil général, a décidé d'appuyer notre proposition de réseau scolaire commun. Cette nouvelle orientation remplace la vieille approche de définancement des écoles privées. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 225 000 membres, dont 130 000 environ font partie du personnel de l'éducation.
9 novembre : le congrès de QS adopte le réseau commun
Tout comme la CSQ, Québec solidaire a remplacé son ancienne politique de définancement des écoles privées par notre proposition de réseau scolaire commun. Cette décision des délégués est en droite ligne avec le projet de loi 895 déposé par Ruba Ghazal en février 2025.
10 novembre : sortie du livre de Ruba Ghazal

La porte-parole de Québec Solidaire, Ruba Ghazal, lance son livre Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs(Lux). Elle y explique les dérives de l'école à trois vitesses et prend position pour un réseau scolaire commun.
10 novembre : Pauline Marois réitère son appui à notre plan

Dans une grande entrevue avec Marie-Ève Tremblay du 98,5FM, l'ancienne première ministre souligne la proposition d'École ensemble pour régler le problème d'inégalité des chances dans l'école québécoise.
11 novembre : choc Pascal Bérubé-Sonia LeBel sur l'injustice scolaire

Lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, le critique Éducation du Parti Québécois questionne à plusieurs reprises la ministre de l'Éducation sur le caractère discriminatoire de notre système d'éducation. Cliquez pour voir les moments forts de ce débat
extrait 1 | extrait 2 | extrait 3 | extrait 4
12 novembre : le commissaire à la langue française propose de revoir les cartes scolaires

Le commissaire Dubreuil invite le gouvernement à « réviser la carte scolaire, de façon à rééquilibrer la présence des élèves issus de l'immigration et non issus de l'immigration au sein des écoles », et même à « réviser les règles de composition des classes pour renforcer la mixité ». Autrement dit, il n'y aura pas de culture commune au Québec sans école commune.
13 novembre : Thomas Piketty nous appuie !

Un des économistes les plus influents au monde, le Français Thomas Piketty,recommande à la France et au Québec d'adopter le réseau commun proposé par École ensemble.
L'économiste François Delorme et lui portent un regard croisé sur les systèmes scolaires français et québécois. Extraits :
« La France et le Québec ont en commun d'avoir un système d'éducation injuste. »
« Deux leviers déterminent la prospérité d'une nation : le niveau d'éducation et l'égalité d'accès à cette éducation. »
« Le Plan pour un réseau scolaire commun proposé au Québec par l'association École ensemble est sans doute l'avenue la plus prometteuse pour mettre fin à ce qui est avant tout un blocage politique. »
13 novembre : important rapport sur le lien entre santé publique et égalité des chances en éducation
Renoncer à l'égalité des chances ou la relancer ? C'est la question lourde de conséquences que pose l'Observatoire québécois des inégalités dans son nouveau rapport intitulé Inégalités sociales, scolaires et de santé : repenser le chemin vers l'égalité des chances. Cet important rapport documente les liens entre la santé publique et les inégalités scolaires.
L'école à trois vitesses est encore une fois au banc des accusés.
Rapport de l'OQI | reportage de Radio-Canada
14 novembre : un Palmarès des écoles décrédibilisé
C'est le retour de l'opération annuelle de propagande libertarienne du Fraser Institute : le Palmarès des écoles publié dans les médias de Québécor. Cette opération perd constamment en crédibilité et c'est encore plus vrai depuis que le chercheur Guillaume Lamy de l'Université de Sherbrooke a publié son essentielle étude sur le sujet il y a quelques mois seulement.
Écoutez-le au micro de l'émission Le 15-18 mettre en miettes ce néfaste palmarès.
École ensemble
https://www.ecoleensemble.com/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Stop au saccage du filet social québécois

MONTRÉAL, le 18 novembre 2025 – À l'approche de la mise à jour économique du gouvernement Legault et à l'invitation de la Coalition Main rouge, le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) s'est rassemblé devant les bureaux montréalais du Premier ministre du Québec pour dénoncer les conséquences des compressions budgétaires et des politiques d'austérité menées par la CAQ.
Une bannière a été déployée afin de rappeler l'urgence de réinvestir massivement dans les services publics, les programmes sociaux ainsi que le soutien du travail essentiel mené par les Auberges du cœur du Québec.
Les compressions qui s'accumulent et le gel des subventions décrété par le Conseil du trésor font craindre un nouvel affaiblissement du filet social et une aggravation des inégalités. Face à l'ampleur et la complexité des crises sociales qui frappent le Québec, nous joignons
aujourd'hui notre voix à celles de dizaines de groupes sociaux, communautaires et syndicaux aux quatre coins du Québec pour réclamer un véritable changement de cap.
Le RACQ rappelle, avec la Coalition Main rouge, qu'il existe des solutions fiscales alternatives concrètes et équitables permettant d'augmenter les revenus de l'État afin de répondre aux besoins réels de la population et aux missions les plus fondamentales de l'État.
« Les crises auxquelles nous assistons depuis déjà trop longtemps sont le résultat de choix politiques. L'État se prive de milliards de dollars avec des baisses d'impôts qui profitent aux plus riches. Il joue l'argent des Québécoises et Québécois en investissant dans des
projets voués à l'échec. La suite se déploie devant nous avec des réductions de services, un filet social qui se détériore et une part importante de la société qui se vulnérabilise. Comment se fait-il qu'il soit incapable de financer convenablement la lutte à la pauvreté et la prévention de l'itinérance ? » mentionne Marc-André Bélanger, directeur général du RACQ.
Partout au Québec, des groupes comme le Regroupement des Auberges du cœur du Québec soulignent que le respect des droits de la personne et la réduction des inégalités sociales exigent un renforcement du filet social et un financement adéquat des services publics. Le gouvernement doit revoir ses priorités : plutôt que de multiplier les mesures anti-démocratiques et les projets à courte vue, il doit assumer sa responsabilité première, soit d'assurer le bien-être de la population. Celle-ci a déjà trop souffert du désengagement de l'État et des inégalités sociales qui en résultent. Des solutions fiscales alternatives permettant d'y remédier existent et leur adoption n'est qu'une question de volonté politique.
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union de 32 membres qui opèrent 34 maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance dans 10 régions du Québec. Elles doivent refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de place. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé·e·s entre 12 et 35 ans. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 780 places (416 en maison d'hébergement et 364 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux). C'est aussi près de 500
travailleur·euse·s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En suivi de nos correspondances sur l’Aéroport de Saint-Hubert

Nous avons déjà expliqué que le carburant avgas 100LL est une source majeure de pollution au plomb, constituant un danger même à dose infime pour la population environnante selon l'avis définitif8 de l'EPA américaine que nous avons transmis au Dr Loslier. M. Diamond prétend faire preuve de transparence. Malgré nos relances, il a refusé d'indiquer les volumes de carburants d'avgas 100LL utilisés annuellement par l'aéroport.
Madame Marie-France Boudreault
Directrice générale de la protection de la Santé Publique
CC : Madame Dr Julie Loslier, directrice
Direction de la Santé Publique de la Montérégie (DSPu)
Madame,
Nous faisons suite à votre lettre (N/Réf. : 24-MS-05545-001) du 17 juin 2025.
Nous vous avons sollicité à propos de différents types de pollutions inhérentes au fonctionnement de l'aéroport Saint-Hubert à la fois présentement et à venir. Nous rappelons
que cet aéroport est enclavé dans la ville de Longueuil.
Dans votre réponse du 17 juin 2025, vous n'évoquez que la pollution sonore.
Dans votre lettre du 24 décembre 2024, vous nous renvoyez vers des mémoires1 déposés en 2022 dont nous avions bien sûr connaissance depuis longtemps. Ces textes ne sont donc plus pertinents au regard de la situation actuelle de l'expansion de l'aéroport puisqu'au moment de leur écriture, il n'était pas question d'une aérogare pour 4 millions de passagers (Porter Airlines), pas plus que d'une aérogare pour jets privés (JB Aviations) qui ont été annoncés en
2023 et 2024.
La question de la pollution atmosphérique doit être abordée avec sérieux : elle n'est évoquée que dans un paragraphe du rapport de la DSP Montérégie (p.8 de [1]), sans aucune mesure de mitigation. En particulier, comme nous vous l'avons déjà expliqué lors de notre rencontre de février avec le Dr Loslier en février 2025, la science a beaucoup progressé sur la pollution liée aux particules ultrafines. Mentionnons l'étude de l'université de McGill chiffrant à plus de 1000 décès prématurés annuels sur Montréal et Toronto les conséquences de la pollution aux particules ultrafines2. Mentionnons aussi l'étude de l'université de Toronto3 qui concerne l'aéroport Billy Bishop (environ 2 millions de passagers) essentiellement desservi par Porter Airlines (avec les mêmes types d'avions qui fréquenteront l'aéroport de Saint-Hubert) : des aux alarmants de particules ultrafines y ont été mesurés. Les résultats d'une étude d'avril 2025 concernant l'aéroport d'Ottawa (YOW) sont très hélas similaires4.
En Europe, une récente étude a chiffré entre 14.000 et 21.000 morts prématurés par an le nombre de victimes des particules ultrafines, sans compter des centaines de milliers de maladies graves5.
Nous sommes informés, par voie de communiqué de presse, que la DSP Montérégie (DSPu) a créé un comité sur la qualité de l'air avec les responsables de l'aéroport et la société AtkinsRéalis. Les citoyens sont pour l'instant exclus de ce comité.
Les déclarations du 17 juillet 2025 du responsable des communications de l'aéroport, M. Simon-Pierre Diamond sur FM1036 ne nous satisfont pas.
Tout d'abord, ce sont les particules ultrafines qui doivent être mesurées en priorité. Or M. Diamond explique que l'installation d'un capteur de particules ultra-fines ne sera faite “qu'à terme”. Autrement dit, on repousse la mesure des particules ultra-fines aux calendes grecques.
Deuxièmement, rien n'a été évoqué par les responsables de l'aéroport concernant la pollution au plomb.
Concernant l'essence au plomb, nous attirons votre attention sur le fait qu'il y a bien reconnaissance de Monsieur Dugrippe, directeur de l'école de pilotage ‘Collège Richelieu', d'utilisation de l'essence au plomb par les avions de son école7.
Nous avons déjà expliqué que le carburant avgas 100LL est une source majeure de pollution au plomb, constituant un danger même à dose infime pour la population environnante selon l'avis définitif8 de l'EPA américaine que nous avons transmis au Dr Loslier. M. Diamond prétend faire preuve de transparence. Malgré nos relances, il a refusé d'indiquer les volumes de carburants d'avgas 100LL utilisés annuellement par l'aéroport. Comme mentionnée dans notre lettre du 26 septembre 2024, l'étude de 2013 de la Dre Sauvé concernant le plomb n'est plus pertinente au regard de l'augmentation de la population autour de l'aéroport et en particulier du nombre de CPE et de RPA dans un périmètre proche.
Par conséquent, nous souhaitons que la DSP Montérégie exige des responsables de l'aéroport :
1) l'installation de capteurs de particules ultrafines avant l'ouverture du terminal Porter fin 2025 ;
2) la mesure régulière du plomb dans l'air par système de filtration et analyse chimique (spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif) par un laboratoire ;
3) la publication des volumes des différents types de carburants utilisés par les différentes compagnies aériennes sur l'aéroport.
Il convient également de discuter de la construction de 2000 logements pour environ 3500 habitants à une distance d'un kilomètre de l'aéroport prévue par la ville de Longueuil et annoncé par la mairesse Catherine Fournier.
Les élus de Longueuil ont récemment changé le zonage en ce sens. Nous souhaitons savoir quelle est la position officielle de la DSP sur ce projet.
En complément, nous souhaitons connaître la position de la DSP quant aux niveaux sonores et à la concentration des particules (PM 0.1, PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2, CO, plomb) à respecter par les opérateurs à l'aéroport de Saint-Hubert, pour protéger la santé de la population habitant à proximité, sachant que cette population comporte de nombreuses personnes vulnérables9.
Pour terminer, nous vous demandons de nous faire parvenir les procès-verbaux et les dates de réunions des rencontres de la DSPu avec les responsables de l'aéroport afin d'établir quelles mesures concrètes (en lien avec le bruit et la pollution atmosphérique) ont été ou seront mises en place pour “limiter les impacts sur la santé de la population” (pour reprendre l'expression utilisée dans votre lettre de décembre 2024) et comment vous appliquez le principe de précaution.
Nous espérons qu'une rencontre avec la DSPu sera possible à l'automne mais souhaiterions une réponse écrite auparavant.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments respectueux.
Signataire : La Coalition Halte-Air Saint-Hubert
Notes
1.https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/JPM1-Sante_Publique.pdf
2.https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/les-particules-ultrafines-sont-associees-plus-de-1-000-de ces-par-dans-les-deux-plus-grandes-villes-358211
3.https://positivezero.civmin.utoronto.ca/bqna/
4.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestair.4c00288
5.https://www.transportenvironment.org/articles/ultrafine-particles-from-planes-put-52-million-europeans-at-risk-of-serious-health-conditions
https://www.transportenvironment.org/uploads/files/CEDelft_Final_Study.pdf
6.Emission du 17 juillet 2025 https://www.fm1033.ca/podcast_fm1033/le-met-a-la-rencontre-des-citoyens/
7.Débat du 19 mars sur FM103 https://www.fm1033.ca/podcast_fm1033/franchement-letourneau/
8.https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-lead-emissions-aircraft
9.Nous avions longuement évoqué dans notre lettre du 26 septembre 2024 le cas des enfants, mais il faut également tenir compte des personnes âgées pour lesquelles la pollution de l'air a également des graves conséquences : https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/air-pollution-linked-dementia-cases
https://alzheimer.ca/fr/les-aides-et-le-soutien/ressources-sur-les-troubles-neurocognitifs/dementia-talks-canaa/pollution
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fermetures d’Amazon : Oxfam et la CSN déposent une plainte à l’OCDE

En fermant l'ensemble de ses centres de distribution au Québec à la suite de la syndicalisation de l'entrepôt DXT4 à Laval, Amazon a enfreint plusieurs éléments contenus dans les Principes directeurs de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. C'est le sens d'une plainte déposée aujourd'hui par Oxfam America, soutenue par Oxfam-Québec et la Confédération des syndicats nationaux (CSN), représentant les employé-es syndiqués d'Amazon à Laval.
« La CSN et Oxfam souhaitent demander un examen de la conformité d'Amazon aux principes directeurs de l'OCDE à la lumière des efforts de répression syndicale de l'entreprise, de son refus de participer à des négociations collectives et des licenciements massifs de travailleurs peu après la création du premier syndicat canadien de l'entreprise », indique la plainte déposée aujourd'hui auprès de l'OCDE.
La plainte rappelle le fil des événements ayant précédé la fermeture, le 22 janvier 2025, des sept entrepôts d'Amazon au Québec. Déjà, en 2024, la multinationale, basée aux États-Unis, avait été condamnée par le Tribunal administratif du travail pour s'être activement opposée à une tentative de syndicalisation à l'établissement YUL2 de Lachine. Une campagne antisyndicale a également été menée à l'entrepôt DXT4 au moment de sa syndicalisation. Par la suite, plutôt que de s'astreindre à son obligation de négocier avec les employé-es syndiqués de DXT4, Amazon a préféré fermer l'ensemble de ses installations québécoises, licenciant ainsi 1 700 employé-es et provoquant la perte de plus de 4500 emplois.
Pour Oxfam et la CSN, de tels agissements contreviennent aux chapitres II, IV et V des Principes directeurs de l'OCDE, notamment en violant le droit à la syndicalisation, le droit à la négociation collective ainsi que le droit de ne pas subir de menaces ou de représailles après avoir exercé de tels droits.
Les plaignants demandent à l'OCDE de faire appliquer ses principes directeurs auprès de la multinationale en exigeant de celle-ci qu'elle s'engage dans un processus de médiation visant, entre autres, la réintégration des 1 700 salarié-es des sept entrepôts, une indemnité d'un an de salaire pour chacun de ceux-ci et une garantie qu'Amazon exercera son devoir de diligence en matière de droits humains, comme prévu au chapitre IV des Principes directeurs de l'OCDE.
Elles ont déclaré :
« Les principes directeurs de l'OCDE ont été mis en place afin que les multinationales puissent être rappelées à l'ordre lorsqu'elles contreviennent aux droits des travailleuses et des travailleurs. C'est exactement le cas d'Amazon, qui a fermé ses entrepôts et licencié 1 700 employé-es pour éviter d'avoir à respecter leur droit à la syndicalisation et à la négociation collective », de déclarer la présidente de la CSN, Caroline Senneville.
« Les fermetures soudaines d'entrepôts et les licenciements massifs chez Amazon reflètent les préoccupations de longue date que nos collègues d'Oxfam America ont soulevées pendant des années à l'encontre d'Amazon : bas salaires, restriction de la liberté d'expression des travailleurs et pratiques de surveillance préjudiciables. Ces récentes décisions aggravent les inégalités et nuisent aux travailleurs du Québec et d'ailleurs. Une économie canadienne et québécoise forte ne peut exister qu'avec le respect des droits fondamentaux des travailleurs à s'organiser. Cette plainte est une étape nécessaire vers la redevabilité », selon la directrice générale d'Oxfam-Québec, Béatrice Vaugrante.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Résistons aux attaques de la CAQ

Lors de son élection en 2018, marquant le tout premier mandat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) comme gouvernement, le premier ministre François Legault affirmait haut et fort vouloir faire de l'éducation « la priorité des priorités [sic] ». Il n'a cessé de marteler ce message depuis. Cet engagement ambitieux a nourri l'espoir d'un véritable renouveau chez plusieurs citoyennes et citoyens, en particulier chez les parents et le personnel enseignant du réseau public. Mais qu'en est-il aujourd'hui concrètement ?
François Legault, le 28 novembre 2018
« L'heure du redressement national en éducation a sonné. »
Depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ a déposé pas moins de huit projets de loi qui auront des répercussions majeures sur le système public d'éducation. Rien que pour l'année 2025, cinq de ces projets ciblant directement les enseignantes et enseignants ainsi que leurs syndicats ont été déposés, du jamais vu dans l'histoire récente du Québec. À la lumière de ces actions, une remise en question s'impose : cette priorité annoncée pour l'éducation s'est-elle réellement traduite en améliorations tangibles pour celles et ceux qui font vivre l'école au quotidien ? Quel était donc ce projet de la CAQ pour l'éducation ?
La CAQ et l'éducation : l'art du « show de boucane »
Plusieurs des projets de loi déposés par le gouvernement visent à encadrer davantage la profession enseignante. Ainsi, la CAQ a choisi son camp : l'autonomie et le jugement professionnels des enseignantes et enseignants sont un danger à limiter.
La CAQ fait également fi des nombreux encadrements légaux qui régissent déjà la profession enseignante et impose des mesures superficielles qui paraissent bien.
Il faut le dire : le gouvernement caquiste excelle dans l'art de façonner ses politiques publiques au gré de l'actualité et des occasions médiatiques. Malheureusement, ses décisions tiennent davantage d'un exercice de relations publiques que d'une véritable vision pour l'école publique et pour le personnel enseignant.
Comme enseignantes ou enseignants, que pouvez-vous faire ?
Suivez les actualités en général, mais en particulier celles de la FAE et de votre syndicat local sur leurs différentes plateformes.
Prévenez vos collègues, partagez l'information, discutez-en avec votre entourage.
Participez et incitez vos collègues à prendre part aux instances, activités et mobilisations syndicales.
C'est en se mobilisant, en se tenant debout collectivement, qu'on arrache des victoires et qu'on ouvre la voie à de véritables changements.
Retrait de la mesure budgétaire 16034 : de la poudre aux yeux ?
Le 22 octobre 2025, la ministre Lebel annonçait le retrait de la mesure budgétaire 16034, soit celle qui chiffrait les compressions en personnels dans le réseau. Malgré ce retrait, la cible en ETC (équivalent temps complet) de chaque centre de services scolaire (CSS) demeure : la ministre en réitère même l'importance en vue d'un hypothétique réinvestissement.
Résistons aux attaques de la CAQ : télécharger la brochure
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous avons besoin d’un programme massif de désembourgeoisement » : Avi Lewis sur la reconstruction des services publics au Canada

Aujourd'hui, Lewis cherche à mettre son énergie militante au service du Parlement. Il s'est opposé à être présenté comme un candidat « vedette », préférant présenter sa candidature comme s'inscrivant dans un effort plus large visant à apporter une véritable transformation structurelle. Son programme repose sur de grandes idées : la propriété publique, un New Deal vert ancré dans la justice et une vision renouvelée de la gauche qui relie le militantisme de base à la politique partisane.
Tiré de Canadian dimension
17 novembre 2025
J'ai été ravi de m'asseoir avec Lewis pour discuter de sa campagne, de sa vision pour le Canada et de ses projets pour le parti. Si les défis auxquels le NPD est confronté sont réels et importants, la feuille de route de Lewis offre une orientation claire qui pourrait bien séduire de nombreux membres du parti et les membres de la gauche canadienne qui ne font pas partie du parti.
Christo Aivalis : À bien des égards, Mark Carney n'a pas été à la hauteur de ses propos musclés à l'encontre de Donald Trump, choisissant en fait de s'aligner sur lui dans des domaines politiques clés, tant au niveau international que national. Comment un NPD dirigé par Lewis répondrait-il plus efficacement à la menace Trump ?
Avi Lewis : Je pense que l'on peut considérer toute la période Carney jusqu'à présent, y compris et surtout le budget, comme une série de concessions faites à l'administration Trump. Il a réduit les dépenses publiques tout en engageant des dépenses de défense à des niveaux presque surréalistes. Il a même lancé l'idée fantaisiste du Golden Dome. Les changements en cours dans notre pays sous Carney sont donc gigantesques. Et je pense que le travail principal du NPD consiste à les nommer et à définir la direction que prend le pays par opposition à celle qu'il devrait prendre pour répondre à la menace économique des États-Unis.
Les conservateurs sont particulièrement incapables de le faire, car ils sont fondamentalement d'accord. Et le fossé entre les conservateurs et les libéraux n'a jamais été aussi étroit depuis une génération. Ce que nous devons vraiment faire pour faire face à la menace des États-Unis, c'est redoubler d'efforts pour préserver ce qui fait du Canada le Canada. Je pense que la population canadienne est prête pour de grands changements, pour des projets de construction nationale, pour la souveraineté économique. Le problème, c'est que nous redoublons d'efforts pour réaliser de grands projets industriels. Je ne suis pas du tout contre le développement industriel. Je crois, par exemple, à la propriété publique des mines de minéraux essentiels. Mais nous négligeons complètement l'urgence quotidienne des gens qui essaient simplement de survivre dans une économie impossible, et le potentiel des projets de construction nationale qui améliorent réellement la vie des gens est presque illimité en cette période, surtout quand tant d'argent public est soudainement devenu, apparemment, disponible.
Prenons le secteur des soins : plus de trois millions de personnes travaillent dans les domaines de la santé, de l'éducation, des soins de longue durée et de la garde d'enfants. Ces travailleuses et travailleurs essentiels, sous-estimé·es et sous-payé·es, constituent le tissu conjonctif même de la société. Ils renforcent directement le pays, contribuent à l'activité économique et servent les travailleurs et travailleuses les moins bien payé·es dans les domaines les plus valorisés. Ils et elles sont absent·es de cette conversation. Et pourtant, ils et elles incarnent la tradition la plus profonde du NPD : lutter pour les soins de santé, lutter pour des services publics universels, lutter pour les travailleuses et travailleurs les plus sous-estimé·es, sous-payé·es et marginalisé·es. Je pense donc qu'il y a beaucoup de détails à approfondir, mais la direction que prendrait le NPD pour le Canada est claire, contrairement à la voie choisie par Carney, qui semble vouée à l'échec.
Vous avez souvent évoqué la nécessité d'accroître la propriété publique. Expliquez-nous votre vision à ce sujet et comment elle peut être mise en œuvre pour obtenir des résultats pour la classe ouvrière canadienne.
Soyons concrets. La semaine dernière, je me trouvais à l'usine New Flyer de Winnipeg. C'est l'une des deux seules usines du pays qui fabriquent des bus électriques. J'ai discuté avec Mike, le représentant syndical d'UNIFOR sur le terrain. Il travaille dans cette usine depuis 30 ans. Il m'a parlé de la fierté et de l'ambiance qui règnent dans l'usine depuis qu'ils ont commencé à fabriquer des véhicules électriques entièrement à partir de matériaux et de pièces canadiennes. Ils ont 13,5 milliards de dollars de commandes en attente d'être honorées, ce qui représente une demande énorme et plusieurs années d'attente pour les autobus électriques destinés aux municipalités de tout le pays. Ils fabriquent les pièces dans l'usine, puis les transfèrent vers la chaîne d'assemblage pour en faire des autobus. Il s'agit donc d'une fabrication d'autobus de A à Z, réalisée avec de l'acier canadien.
C'est un modèle qui nous permet de protéger notre économie contre les droits de douane, de retrouver notre indépendance économique dans des secteurs clés, de réduire considérablement les émissions grâce à des véhicules zéro émission et de créer des emplois syndiqués en utilisant de l'acier canadien. Si c'était une guerre, nous agirions plus rapidement. Et si vous le faisiez parce que nous sommes en situation d'urgence, nous sommes attaqué·es par notre plus grand partenaire commercial. Et nous devons agir rapidement. Nous devons créer rapidement des emplois syndiqués. Nous devons utiliser rapidement des matériaux canadiens. Nous devons réduire rapidement les émissions. Le gouvernement fédéral interviendrait alors pour que cela se réalise. Êtes-vous en train de me dire que nous ne pouvons pas le faire ? Avoir des autobus électriques appartenant à l'État, avec une urgence accélérée comme en temps de guerre, qui créeraient tous ces emplois, réduiraient les émissions, relieraient les communautés et utiliseraient de l'acier canadien. C'est de cela dont nous parlons.
Un autre élément majeur du socialisme démocratique est la propriété des travailleuses et travailleurs et des coopératives. Comment le NPD dirigé par Lewis facilitera-t-il cela ?
Oh, absolument. Mon premier documentaire, The Take, que j'ai réalisé il y a 20 ans en Argentine, traitait de ce mouvement extraordinaire de travailleuses et travailleurs qui avaient été abandonné·es après le départ des propriétaires de leur usine. Et je pense maintenant à l'usine Stellantis, où des centaines de millions de dollars provenant des gouvernements fédéral et provincial ont été investis pour la rééquiper afin de fabriquer des véhicules électriques. Et puis, l'entreprise décide simplement d'apaiser Trump en rapatriant les emplois aux États-Unis. Nous devrions dire : « Ciao, au revoir ! Nous gardons tout ce que nous avons payé. » Et une usine comme celle-là pourrait être gérée comme une coopérative démocratique de travailleuses et travailleurs. Et je pense que la démocratisation de l'économie est, bien sûr, au cœur d'une approche socialiste démocratique. Il existe de nombreux cas où une entreprise fait faillite parce que les capitaux ont fui ou qu'elle a été rachetée par des fonds privés. Dans ces situations, il est facile, sur le plan législatif, de faire de la propriété des travailleuses et travailleurs la première option en cas de faillite lorsqu'il est dans l'intérêt public de maintenir les emplois, comme cela a été fait dans d'autres pays. On peut en fait transformer une catastrophe dans une communauté en une incroyable réussite. C'est une mesure concrète qui encouragerait cela dans l'économie, et je l'ai toujours soutenue.
De nombreux Canadien·nes de gauche ont vu en Zohran Mamdani, le maire élu de New York, un modèle potentiel pour le NPD. Mamdani a remporté les dernières élections en promettant d'améliorer l'accessibilité financière et les services publics. Comment comptez-vous faire de même ? Vous savez, je repense à quelque chose qu'un ami m'a dit récemment à propos des transports publics. La destruction intentionnelle de nos services publics essentiels a pour effet de rappeler aux gens leur impuissance. C'est la « merdification », pour reprendre l'expression de Cory Doctorow, que le capitalisme tardif a infligée à nos activités quotidiennes. Nous avons besoin d'un programme massif de « déshitification » (désembourgeoisement). Les choses qui sont publiques devraient être belles, devraient être fonctionnelles. Elles représentent notre aspiration collective et notre expérience quotidienne. Pourquoi pensons-nous que le service postal devrait être rentable ? Le service d'ambulance est-il rentable ? La police fait-elle des profits ? Postes Canada devrait être une entreprise publique qui fournit réellement le service essentiel de connexion numérique du XXIe siècle entre les Canadien·nes. Et ces choses devraient se faire sans friction. Elles le peuvent absolument. Nous sommes capables de choses incroyables, la question est de savoir « par qui et pour qui ». Le public doit être replacé au centre, car c'est la valeur socialiste ultime qui, selon moi, va bien au-delà de l'idéologie et de tout le jargon qui y est associé.
Toutes ces questions dont nous parlons dans le cadre de l'urgence liée au coût de la vie sont directement liées aux grands problèmes systémiques, et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur ce point, car les solutions des options publiques pour l'alimentation, les téléphones et l'internet, le rôle du public dans le logement et la construction massive de logements non marchands, de logements à but non lucratif, de logements avec services de soutien — voilà comment nous touchons les gens avec des idées coopératives ambitieuses qui touchent leur vie quotidienne.
Certains membres s'inquiètent du fait que vous n'avez pas de siège. Si vous devenez chef, avez-vous une stratégie pour entrer au Parlement ?
Je me réjouis de cette question, car je me suis présenté deux fois dans des circonscriptions où le NPD n'avait jamais gagné, dans des endroits où je vis et où je me sens profondément ancré dans la communauté. Je pense que je dois entrer à la Chambre des communes le plus rapidement possible si j'ai la chance de gagner. Mais nous sommes dans un Parlement minoritaire où il y a déjà eu des changements d'allégeance et quelques départs à la retraite. Je suis ouvert à tout siège qui peut être remporté dans le pays.
Une chose que je ne pense pas faire, c'est demander à l'un des Magnificent Seven, le caucus actuel, héroïque et en difficulté, de démissionner. Quand vous avez un caucus de 25, 50 ou 150 membres, c'est une chose, mais quand vous n'avez que sept personnes, vous n'allez pas demander à l'une d'entre elles de se retirer. Mais, évidemment, vous devez comprendre qu'une fois que vous avez remporté la direction du parti et que vous essayez de le reconstruire, vous devez entrer à la Chambre des communes.
Nous devons rembourser la dette de la dernière élection avant de pouvoir emprunter à nouveau pour nous lancer dans une autre. La route sera difficile pour le NPD. Je pense que personne ne devrait enjoliver la situation. Cependant, je crois que le parti peut revenir en force et je pense que notre soutien commence déjà à croître à nouveau. Et je pense qu'avec un nouveau leader et une nouvelle approche, nous pourrions revenir assez rapidement. Nous avons beaucoup de travail à faire au niveau de la démocratisation de nos propres processus internes, pour rétablir la confiance et l'enthousiasme au sein de notre base, ce à quoi contribue, je pense, la course à la direction, mais cela doit être la priorité numéro un au lendemain du congrès de Winnipeg.
L'un des problèmes liés à la course à la direction est le manque de maîtrise approfondie de la langue française. Qu'avez-vous fait pour améliorer la situation à cet égard ?
Je parle tous les jours en français avec les membres de mon équipe et je travaille dur pour m'améliorer. C'est beaucoup à gérer pendant une campagne à la direction, mais je suis confiant car le français est ma troisième langue. J'ai appris l'espagnol à l'âge adulte, lorsque j'ai tourné mon premier film en Argentine il y a 20 ans. C'est juste une question de temps. Ce que je dois vraiment faire, c'est vivre au Québec, ce que j'ai hâte de faire. J'aimerais m'immerger dans la culture et la langue québécoises pendant trois ou quatre mois, et si j'avais trois ou quatre mois pour vivre en français, je pense que je pourrais atteindre un niveau de bilinguisme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sommet du G20 : une occasion d’attaquer de front la crise des inégalités, souligne Oxfam

Le 20 novembre 2025 — La fortune des milliardaires des pays du G20 a augmenté de 2200 milliards de dollars en seulement un an, ce qui aurait largement suffi à sortir 3,8 milliards de personnes de la pauvreté, révèlent des données compilées par Oxfam à l'approche du sommet du G20 en Afrique du Sud.
La présidence sud-africaine du G20, qui a fait de la lutte contre les inégalités un thème central cette année, a commandé la toute première analyse du G20 sur les inégalités afin de conseiller les dirigeants. Le Comité extraordinaire d'experts indépendants du G20 sur les inégalités mondiales, dirigé par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, a mis en évidence une « urgence en matière d'inégalités ».
Selon ce comité, depuis l'an 2000, les 1 % les plus riches ont accaparé 41 cents de chaque nouveau dollar créé par l'économie mondiale, tandis que la moitié la plus pauvre de l'humanité n'a reçu qu'un seul cent par dollar créé.
Le comité souligne les nombreux dommages que ces inégalités causent à l'humanité et à la planète, entraînant d'énormes difficultés économiques pour la majorité, tout en alimentant la polarisation politique et l'érosion des démocraties.
Oxfam salue la recommandation du comité de créer un nouveau panel international sur les inégalités qui jouerait un rôle similaire à celui du GIEC sur la crise climatique. Un tel panel apporterait la même rigueur scientifique et la même détermination pour mener des actions urgentes afin de remédier à la crise des inégalités.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé les autres pays du G20 à soutenir le rapport Stiglitz et ses recommandations.
Le Canada doit répondre à l'appel
« L'Afrique du Sud place le G20 devant un test moral, et le Canada doit y répondre avec courage », plaide Julie McClatchie, chargée de politiques publiques et de plaidoyer chez Oxfam-Québec.
« Ottawa a la chance de défendre un virage mondial vers la taxation équitable des plus riches et la réduction des écarts de richesse, entre autres en soutenant la création d'un panel international sur les inégalités. Les chiffres sont clairs, les solutions existent ; ce qui manque, c'est la volonté politique d'agir. Le Canada doit montrer qu'il est prêt à choisir la solidarité plutôt que le statu quo. »
Le Canada n'est pas épargné par l'accroissement des inégalités.
* Les personnes formant le 1% des plus riches au pays détiennent une fortune de près de 1250 milliards de dollars, soit presque autant que ce que possède 80% de la population canadienne la moins riche.
* En 2024, la fortune combinée des 65 milliardaires canadiens s'est accrue de 309 millions de dollars par jour, soit près de 500 milliards en une année.
* La tendance ne semble pas près de s'inverser : 11 nouveaux milliardaires se sont ajoutés au pays en 2025, pour un total de 76.
Le sommet du G20 intervient à un moment de grands bouleversements géopolitiques. Si les États-Unis brillent par leur absence aux réunions de cette semaine, leur gouvernement a défendu des politiques destructrices – des droits de douane inconsidérés aux allégements fiscaux régressifs, en passant par les coupes dans l'aide internationale – qui exacerbent les inégalités tant aux États-Unis qu'à l'échelle internationale.
Les autres pays du G20 ont une réelle occasion de prendre des engagements durables dans la direction opposée pour réduire les inégalités, en misant sur des règles internationales et une coopération qui servent les intérêts des personnes ordinaires plutôt que ceux des oligarques mondiaux.
Oxfam appelle les dirigeants du G20 à renouveler leur engagement en faveur d'une imposition efficace des personnes très riches, convenu lors du sommet du G20 de l'an dernier au Brésil, et à le traduire en actions concrètes.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
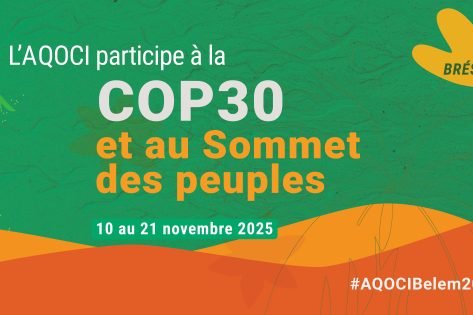
La délégation jeunesse de l’AQOCI appelle à l’adoption d’un accord ambitieux à la COP30 de Belém

Montréal, le 18 novembre 2025 - Alors que la COP30 entre dans sa phase finale, les jeunes délégué·es de l'AQOCI exhortent les États à faire preuve d'ambition et à concrétiser leurs engagements pour la justice climatique.
La délégation jeunesse de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) qui participe à la COP30 à Belém souhaite attirer l'attention des décideur·euses sur des enjeux cruciaux à quelques jours de la conclusion des négociations climatiques.
Au cours de la dernière semaine, la délégation jeunesse de l'AQOCI a participé activement à de nombreuses activités au Sommet des peuples et à la COP30, et en menant un plaidoyer auprès des décideur·euses du Québec et du Canada en faveur de la justice climatique. À quelques jours de la fin de la COP, nous souhaitons réitérer l'importance pour les États de faire preuve d'ambition et pour le Canada de jouer un rôle constructif dans le dernier droit des négociations.
La délégation jeunesse de l'AQOCI appelle les États à adopter un accord ambitieux qui réponde véritablement à l'urgence climatique. Cet accord doit inclure des engagements concrets en matière de réduction des émissions, de financement climatique et de protection des droits des communautés les plus affectées, particulièrement celles du Sud global.
« Il est nécessaire que le Canada défende l'adoption d'un nouveau Plan d'action sur l'égalité des genres (GAP) qui soit véritablement ambitieux et transformateur. Ce Plan doit tre intersectionnel, reconnaissant explicitement l'oppression des femmes autochtones et des personnes de genre divers, et doit bénéficier de mécanismes de financement adéquats afin de répondre aux besoins des communautés locales », souligne Marie-Jeanne Eid, membre de la délégation.
Samuel Rainville, également membre de la délégation, observe que « la présence militaire disproportionnée que l'on observe à la COP contraste fortement avec la force inspirante des défenseurs autochtones, qui affirment leurs droits avec conviction et par des messages porteurs d'espoir. » Il est essentiel d'assurer leur participation pleine, équitable, inclusive et
effective au sein des décisions climatiques mondiales.
La délégation insiste sur la responsabilité particulière des pays industrialisés, dont le Canada, dans la mise en œuvre de solutions justes et équitables. « Le Canada fait partie des 10 pays les plus émetteurs du monde et a donc une responsabilité de s'engager f inancièrement pour compenser ses impacts de manière juste et inclusive. Ce financement doit se traduire également par des mécanismes qui ont un impact réel à l'échelle locale. C'est aussi ça, la justice climatique », affirme Frédérique Malecki.
Pour Cathy Hu, cette COP représente à la fois des défis et des opportunités : « Pour deux
semaines, Belém s'est transformé en microcosme du monde environnemental. Inondée de
contradictions, et séchée de véritables solutions. La COP30 représente l'éco-espoir du monde diplomatique et l'écoanxiété de la jeunesse engagée. À nous de façonner notre impact vers la bonne direction en ramenant la jeunesse autour des tables de décision en premier au Québec : par la création d'un comité-conseil jeunesse permanent sur l'environnement à l'Assemblée nationale. »
Enfin, l'AQOCI s'attend à ce que le Canada démontre un leadership concret en appuyant fermement la création du mécanisme d'action de Belém pour une transition juste afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte dans la transformation de nos économies
vers la carboneutralité.
La délégation jeunesse de l'AQOCI appelle les négociateurs et négociatrices à faire preuve
de courage politique et à placer la justice climatique au cœur de l'accord final. Le temps
des demi-mesures est révolu – l'heure est à l'action climatique ambitieuse, inclusive et transformatrice.
L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) créée en 976, regroupe plus de 70 organismes de 14 régions du Québec qui œuvrent, à l'étranger et localement, pour un développement durable et humain. L'AQOCI a pour mission de soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construction d'un monde basé sur des principes de justice, d'inclusion, d'égalité et de respect des droits humains. www.aqoci.qc.ca
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :














