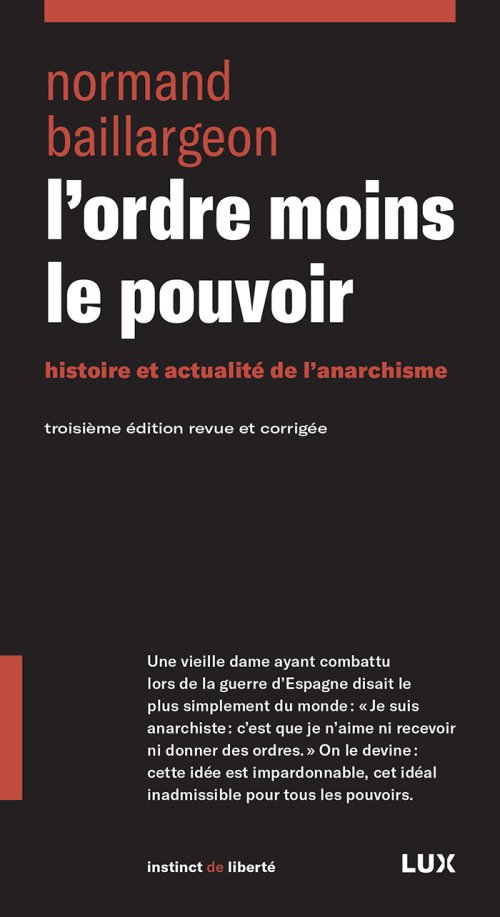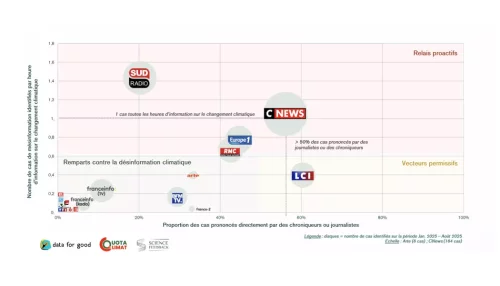Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le marxisme écologique est-il vraiment marxien ?

Le livre Découvrir le marxisme écologique, Éditions sociales, 2025, dirigé et présenté par Alexis Cukier et Paul Guillibert est une initiative intéressante car elle permet à un large public français d'entrer dans une problématique relativement récente.
Tiré du blogue de l'auteur.
Le livre Découvrir le marxisme écologique, Éditions sociales, 2025, dirigé et présenté par Alexis Cukier et Paul Guillibert est une initiative intéressante car elle permet à un large public français d'entrer dans une problématique relativement récente. Elle est de plus originale car elle mélange des écrits de quelques penseurs faisant partie de ce courant écomarxiste[1] et des commentaires et explications sur les thèmes que ceux-ci abordent. Une dizaine d'entre eux sont ainsi présentés successivement : Ted Benton, James O'Connor, Maria Mies, Ariel Salley, John Bellamy Foster, Kohei Saito, Michaël Löwy, Andreas Malm, Jason W. Moore et Alyssa Battistoni.
La problématique est de mettre en évidence les intuitions de Marx concernant les dégâts écologiques engendrés par l'accumulation capitaliste, sans pour cela minimiser les possibles contradictions dues au « développement des forces productives » qui a longtemps été la pierre d'angle du marxisme, sinon de Marx lui-même.
Les auteurs présentés dans ce livre
On retiendra donc la relation entre le procès de travail et les limitations naturelles d'un Ted Benton. Également la mise en évidence de la « seconde contradiction » du capitalisme par James O'Connor (la première étant celle privilégiée par Marx entre les rapports de production et les forces productives de valeur) : celle entre rapports de production et conditions naturelles de production.
Suivent deux textes qui entreprennent d'intégrer ensemble théorie de l'exploitation et luttes féministes. Pour ce courant de pensée que représente ici Maria Miès, « la domination patriarcale ne peut pas se penser dans les termes généraux de l'oppression mais plutôt en termes d'exploitation, c'est-à-dire d'appropriation violente d'un surplus produit par la force de travail des femmes » (p. 57). D'une part, à notre avis, cela rompt avec une idée qui court parmi certains marxistes reconvertis à un certain idéalisme selon lesquels le concept d'exploitation doit être abandonné[2]. D'autre part, pour Maria Miès, « ce sont les capacités des femmes en tant que "productrices de vie" qui sont accaparées par le patriarcat » et « l'exploitation des femmes est incompréhensible sans une étude minutieuse de la division internationale du travail » (p. 57). De son côté, Ariel Salleh considère que « l'écoféminisme constitue un socialisme au sens le plus profond du terme » (p. 68 et 73). Elle réfute l'accusation d'essentialisme contre cette approche, car cette critique reproduit le dualisme consistant à assimiler les femmes à la nature tandis qu'elles sont infériorisées par apport aux hommes. Ainsi il s'agit d'« inscrire une dimension de genre dans la pensée écosocialiste » (p. 76).
Avec John Bellamy Foster, on rencontre l'un des auteurs qui a été le plus loin dans l'idée que Marx était, bien que le terme n'existait pas de son temps, un quasi-écologiste avant l'heure. Au nom du concept marxien de rupture de la relation métabolique que l'homme entretient avec la nature. Cukier et Guillibert notent que Foster se réfère à Paul Burkett, autre pionnier de la vision écologique de Marx, mais il est dommage que le travail de Burkett n'ait pas eu droit à un chapitre comme Foster, alors qu'ils ont aussi travaillé ensemble[3].
Parmi la nouvelle génération s'intéressant au Marx potentiellement écologiste, Kohei Saito[4] soutient que celui-ci a opéré à la fin de sa vie[5] un tournant lui faisant abandonner sa confiance dans le développement des forces productives pour s'orienter vers ce que Saito nomme le « communisme de décroissance » car « le développement soutenable des forces productives n'est pas possible dans le cadre du capitalisme » (p.103). Ainsi, les communes rurales russes préfigureraient selon Marx réinterprété par Saito comme « une cristallisation de sa vision non productiviste et non eurocentrée de la société future » (p. 106). Mais comme l'écrivent Cukier et Guillibert, « du point de vue du commentaire philosophique, il nous semble que les thèses de Saito sont le plus souvent exagérées : c'est peu de choses de dire qu'il est difficile de faire de Marx un penseur de l'écosocialisme et, à plus forte raison, un théoricien de la décroissance, lui qui est resté attaché aux "acquêts positifs" du marché mondial capitaliste jusqu'aux lettres à Vera Zassoulitch » (p. 110).
Le philosophe Michaël Löwy est l'un des théoriciens de l'écosocialisme. Selon lui, l'accumulation illimitée est impossible « sous peine d'une crise écologique majeure » qui menacerait « la survivance même de l'espèce humaine. La sauvegarde de l'environnement naturel est donc un impératif humaniste. » (p. 116). Cukier et Guillibert insistent sur le fait que la définition de l'écosocialisme par Löwy ajoute à l'aspect philosophique une composante stratégique à l'encontre du « capitalisme vert », cet « écoblanchiment qui permet la justification idéologique de la poursuite du business as usual en temps de catastrophe écologique » (p. 123).
L'aspect stratégique pour aller vers l'écosocialisme est au cœur des thèses défendues par Andreas Malm. Historiquement, le développement capitaliste s'est appuyé sur les fossiles alors que « l'eau demeurait à l'époque une énergie plus abondante, plus régulière et moins chère que le charbon » (p. 137). La raison principale se trouve dans « les rapports sociaux capitalistes » (p. 137). Il s'ensuit qu'il ne faut pas compter sur l'intérêt des acteurs économiques mais sur la puissance publique pour orienter cette transition » (p. 139). D'autant que cette transition est l'objet d'un conflit de classes.
L'originalité de Jason W. Moore au sein de l'écomarxisme est double. Il a intégré la critique de la dualité « Humain-Nature » des anthropologues Philippe Descola ou Bruno Latour à sa théorie de « l'écologie-monde du capitalisme »[6]. Et il a théorisé l'adjonction de l'appropriation de la valeur créée par la nature à celle créée par l'exploitation de la force de travail. Cette ajout renvoie aux « capacités de la nature à produire la vie » et à la « centralité du travail-énergie non rémunéré » (p. 144 et 146). Ainsi, Moore pense renouveler la théorie de la valeur de Marx en articulant exploitation du travail salarié et appropriation gratuite des forces naturelles. Et cela par analogie avec le travail reproductif gratuit effectué par les femmes.
Alyssa Battistoni est la dernière autrice écomarxiste présentée dans ce livre. Elle théorise le travail de la nature en redéfinissant le concept de travailleur productif pour y « inclure les humains et les non-humains » (p. 158)[7]. Elle pousse donc plus loin la logique latourienne jusqu'à « une "écologie politique des choses" qui accorde une puissance d'agir aux non-humains » (p. 162). Et Cukier et Guillibert en concluent que « c'est bien parce que le pétrole a une valeur marchande qu'on l'extrait et qu'on l'utilise » (p. 164). Eh bien, non ! pas du tout, c'est exactement, en bonne logique marxienne (et même classique de l'économie politique), l'inverse : c'est parce qu'on l'extrait (par le travail vivant et mort) que le pétrole a, dans le capitalisme, une valeur marchande.
Les auteurs écomarxistes et la théorie de la valeur de Marx
S'il y a un point sur lequel on peut s'accorder, que l'on soit d'accord ou non avec la théorie critique du capitalisme de Marx, c'est que le cœur de celle-ci est constituée par sa théorie de la valeur que l'on va résumer en une phrase (la gageure !) ainsi : la valeur des marchandises est déterminée par le travail socialement validé, étant posé qu'il s'agit bien selon lui du travail humain, on le souligne bien que ce soit redondant.
Il est heureux que Cukier et Guillibert aient placé à la suite l'un de l'autre et à la fin de leur livre les textes concernant Jason W. Moore et Alyssa Battistoni parce qu'ils permettent d'ouvrir une discussion sur la pertinence des approches dites écomarxistes et sur les désaccords entre les auteurs de ce courant.
Examinons le point auquel nous étions parvenus : selon ces auteurs, le pétrole (et, par extension, les ressources naturelles) aurait une valeur économique en soi, une valeur que certains appellent intrinsèque. « S'opposant aux éthiques environnementales et à l'écologie économique, Battistoni reconnaît cependant aux éthiques environnementale le mérite d'avoir montré que la nature a une valeur en soi et non seulement pour nous. Il faut donc penser ensemble la valeur intrinsèque et la valeur instrumentale » (p. 164). J'ai soutenu en de nombreux endroits[8] que cette notion de valeur économique intrinsèque est un oxymore. Le philosophe John Dewey l'avait aussi montré à propos de l'éducation parce que la valeur supposait une intervention extérieure à l'objet (ici, ce serait la relation de l'homme à la nature) :
« Il y a une ambiguïté dans l'usage des adjectifs "inhérent", "intrinsèque" et "immédiat", qui alimente une conclusion erronée. […] L'erreur consiste à penser que ce qu'on qualifie ainsi est extérieur à toute relation et peut être, par conséquent, tenu pour absolu. […] L'idée que ne pourrait être qualifié d'inhérent que ce qui est dénué de toute relation avec tout le reste n'est pas seulement absurde : elle est contredite par la théorie même qui relie la valeur des objets pris comme fins au désir et à l'intérêt. Cette théorie conçoit en effet expressément la valeur de l'objet-fin comme relationnelle, de sorte que, si ce qui est inhérent c'est ce qui est non relationnel, il n'existe, si l'on suit ce raisonnement, strictement aucune valeur intrinsèque. […] À strictement parler, l'expression "valeur intrinsèque" comporte une contradiction dans les termes. »[9]
Il s'ensuit que la catégorie valeur n'appartient pas à l'ordre naturel, elle est d'ordre socio-anthropologique. Mais là où Cukier et Guillibert ont raison, c'est de souligner que parler de valeur intrinsèque de la nature oblige à redéfinir le travail. Mais c'est, à notre sens, la deuxième faille de cette thèse. La théorie de la valeur de Marx associe le travail et la valeur économique dès lors que l'échange marchand valide le processus de production, tandis que la théorie néoclassique a rompu cette liaison en ne reconnaissant que le prix résultant des préférences individuelles. L'économie écologique, bien représentée au sein de la revue Ecological Economics, prétend avoir une troisième vision, rejetant les deux précédentes, pour adopter soit une conception de la valeur-énergie, soit sur une conception de la valeur naturelle appropriée, qui est aussi celle de Jason W. Moore. Cette dernière perspective s'appuie sur l'idée que les animaux travaillent (abeilles, animaux de trait…) ainsi que les éléments naturels (l'eau travaille, le pétrole travaille…).
La thèse sur le travail des animaux est très fréquente tant au sein de l'économie écologique que dans une partie du courant écomarxiste. Cependant, prenons deux essaims d'abeilles : l'un dans un rucher travaillé par un apiculteur, l'autre un essaim sauvage dans une forêt. Supposons que les deux essaims soient voisins et que toutes les abeilles butinent les mêmes fleurs, et que donc elles font à peu près le même miel. Quelle est la valeur économique du miel « sauvage » ? Nulle. Et pourtant il aurait la même valeur d'usage potentielle, sans avoir pour autant une quelconque valeur économique. La séparation entre valeur d'usage et valeur (la première étant une condition nécessaire de la seconde, sans que la réciproque soit vraie) est le fil conducteur qui va d'Aristote à Marx.
Tel est effectivement l'enseignement de Marx. Mais ce n'est parce qu'il l'a dit et répété que cela constitue une preuve. Or quelle est l'alternative ? La catégorie de travail et celle de valeur seraient-elles des catégories naturelles ? Épistémologiquement, il est préférable de penser que ces catégories sont anthropologico-socio-historiques. La croyance en des lois économiques naturelles chère aux classiques et néoclassiques trouve son alter ego dans l'économie écologique et se glisse chez des auteurs patentés marxistes.
Un autre point pourrait être mentionné au sujet de l'analyse de la crise capitaliste et qui pourrait être en revanche un point de ralliement entre écomarxistes et écologistes. L'évolution du taux de profit peut être décomposée en une variable de répartition (variation de la productivité du travail supérieure à celle du salaire) plus une variable d'efficacité du capital (variation de la production supérieure à celle du capital physique) qui peut coïncider avec la variation du taux de retour énergétique (EROI), sous réserve de l'hypothèse que les prix de l'énergie augmentent pour suivre la baisse de ce taux.
Malgré l'intérêt de l'ouvrage d'Alexis Cukier et de Paul Guillibert, il souffre de deux écueils qui pourraient être facilement surmontés. D'une part, il laisse croire qu'il y a une unité de pensée entre les auteurs dont le livre présente les travaux, en laissant dans l'ombre de nombreux travaux en partie critiques de ceux-là. Or ce courant, dénommé maintenant écomarxiste ou écosocialiste, est traversé de controverses importantes, notamment sur les deux points reliés entre eux, la valeur et le travail. D'autre part, on ne peut passer sous silence la dispute théorique importante entre Foster, Malm et Campagne opposés à Moore[10]. La récusation de toute coupure entre la société et la nature, défendue par Moore, est le pendant de l'élargissement de ces catégories de travail et de valeur aux non-humains et à la nature, tandis que la spécificité socio-anthropologique de ces catégories renvoie plutôt à une capacité relativement autonome des humains dans un cadre environnemental donné[11].
En conclusion, la question se pose de savoir dans quelle mesure le courant écomarxiste, dans sa diversité, se situe dans la perspective de Marx. D'un côté, il y a ceux qui font de lui un visionnaire écologiste de premier plan. À notre avis, ce serait plus sage de reconnaître ses intuitions indéniables, mais qui entrent en tension avec d'autres aspects de son œuvre. De l'autre, il y a ceux qui, sous couvert d'éclectisme intégrant les pires travers de l'économie néoclassique de l'environnement, transforment la théorie de la valeur en une suite de contresens. Il y a peut-être place pour plus de nuances[12].
Notes
[1] Pour simplifier, on retient ici à l'instar d'Alexis Cukier et de Paul Guillibert les termes de marxisme écologique, d'écomarxisme et d'écosocialisme comme synonymes au premier regard.
[2] Emmanuel Renault, Abolir l'exploitation, Expériences, théories, stratégies, Paris, La Découverte, 2023 ; recension critique : J.-M. Harribey, « Du travail et de l'exploitation, À propos du livre d'Emmanuel Renault », Blog Alternatives économiques, mars, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2024/04/09/du-travail-et-de-l-exploitation-a-propos-du-livre-d-emmanuel-renault, et Les Possibles, n° 39, Printemps 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/travail-exploitation.pdf.
[3] Paul Burkett and John Bellamy Foster, Marx and the Earth, Boston, Brill, 2016.
[4] Kohei Saito, Moins ! La décroissance est une philosophie, Paris, Seuil, 2024.
[5] Sur les derniers travaux de Marx, voir aussi Marcello Musto, Les dernières années de Karl Marx, Une biographie intellectuelle 1881-1883, Paris, PUF, 2023.
[6] Jason W. Moore, L'écologie-monde du capitalisme, Comprendre et combattre la crise environnementale, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, traduction de Nicolas Vieillescazes, préface de Paul Guillibert. Voir ma recension dans J.-M. Harribey, « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ? », Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.
[7] Sur le travail de la nature, voir aussi Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Une écologie politique du travail , Paris, Éd. Amsterdam, 2023. Et ma recension « Sur le livre Exploiter les vivants de Paul Guillibert », Blog Alternatives économiques, 15 décembre 2023, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/soutenabilite/exploiter-les-vivants.pdf.
[8] Notamment, Jean-Marie Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Paris, LLL ? 2013, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/ouvrages/livre-richesse-entier.pdf ; « Sur fond de crise socio-écologique du capitalisme, la théorie de la valeur revisitée », RFSE, 2020, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/theorie-valeur-revisitee.pdf ; En quête de valeur(s), Vulaines-sur-Seine, 2024 ; « La valeur est de retour », AOC, 14 mai 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/valeur-de-retour.pdf.
[9] John Dewey, La formation des valeurs, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, 2011, p. 108-110.
[10] Voir le dossier publié par Actuel Marx, PUF, « Marxismes écologiques », n° 61, premier semestre 2017.
[11] Je renvoie à la communication que j'ai présentée en 2024 au séminaire d'Espaces Marx et en 2025 au colloque Historical Materialism : « Pourquoi le concept de capitalocène est-il l'objet de controverses théoriques et épistémologiques au sein même de la théorie marxiste ? » Conférence Historical Materialism, Paris, 26 au 28 juin 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/conference-hm.pdf. Voir aussi mon article « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ?, Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.
[12] Voir Timothée Haug, « La rupture écologique dans l'œuvre de Marx : analyse d'une métamorphose inachevée de la production », Thèse de doctorat de philosophie, Université de Strasbourg, 2022, https://theses.hal.science/tel-03774950v1/file/Haug_Timothee_2022_ED520.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Épicure

« […] le plaisir est principe et fin[1] de la vie bienheureuse ».
Épicure (Lettre à Ménecée, 2009, p. 48)
Épicure (341 – 270 av. J.-C.) est l'un des penseurs majeurs de l'Antiquité grecque. Né à Samos dans une famille athénienne, il fonde à Athènes, autour de l'an -306, l'École du Jardin, un lieu à la fois d'enseignement, de recherche philosophique et de vie communautaire. Contrairement à l'Académie de Platon ou au Lycée d'Aristote, son école se distingue par son ouverture à tous (hommes libres), sans distinction de sexe (hommes et femmes) ou de condition sociale (une école ouverte même aux esclaves) (de Crescenzo, 1999, p. 395 ; Law, 2008, p. 251 ; Rosenberg, 2008, p. 76).
Son œuvre s'inscrit dans une période marquée en Grèce par une grave crise politique, économique et sociale à la mort d'Alexandre (Brunschwig, 1996, p. 232). Ces troubles incitent Épicure à proposer une philosophie tournée vers le salut individuel et la paix intérieure, plutôt qu'une action politique visant à réformer les lois en vigueur dans sa Cité-État. Il invite plutôt à s'abstenir de la vie politique, car celle-ci est source d'angoisse et de passions destructrices. Il propose, par conséquent, une philosophie qui se veut à la fois pratique et thérapeutique, souvent qualifiée de « médecine de l'âme » devant conduire au bonheur individuel. Une philosophie qui cherche à délivrer l'individu des passions, des superstitions et de la crainte de la mort, pour lui permettre d'atteindre le bonheur par la raison. À vrai dire, la Grèce de cette époque est en décadence. La fin de la gloire militaire, l'individualisme en progression, la corruption du peuple et le désir de devenir adepte d'une doctrine demandant peu d'effort à l'esprit offraient à l'École du Jardin le contexte idéal à sa popularité.
Cela dit, la doctrine d'Épicure repose sur trois parties complémentaires : la canonique[2] (ou théorie de la connaissance), la physique (ou explication du monde naturel) et la morale (ou art de vivre). Ces trois domaines convergent vers un objectif unique : l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Sa pensée matérialiste est nettement influencée par l'atomisme de Démocrite, selon laquelle la matière est composée d'atomes et de vide, et les phénomènes, y compris l'âme, sont le résultat de ces assemblages matériels (ou de « particules physiques » [Morel, 2009, p. 15]) . Âme, esprit et corps forment un tout ; la mort dissout simplement leur union, sans survie ni châtiment dans l'au-delà : il n'y a rien à craindre après la mort. Il réfute fortement la peur de la mort, car, tant qu'on vit, la mort n'est pas là et quand elle arrive, nous ne sommes plus. Épicure développe un athéisme — particulier — fondé sur la démonstration que les dieux, bien qu'existants, selon l'opinion répandue, sont absents des affaires humaines et ne doivent inspirer aucune crainte. La Lettre à Ménécée condense cette philosophie du bonheur en exposant les principes essentiels de l'éthique épicurienne.
La Canonique : la sensation comme critère de vérité
La canonique, ou théorie de la connaissance, cherche à déterminer les conditions d'accès à la vérité. Épicure affirme que la sensation est le fondement de toute connaissance (Arrighetti, 2025). Les impressions sensibles, qu'elles concernent le visible ou l'invisible, constituent la norme du vrai (kanôn tou alêthous).
Sa philosophie repose sur une démarche hypothético-déductive, qui part des sensations comme critère premier et certain de vérité, car, face à notre ignorance, les sensations sont les seules sources fiables pour reconnaître la vérité. Cette confiance dans les sens s'oppose aux spéculations métaphysiques de l'école de Platon (l'existence des formes idéales). Pour Épicure, l'erreur ne vient pas de la perception elle-même, mais du jugement que l'on en tire. La connaissance repose donc sur l'expérience directe du monde, sur l'observation empirique et sur la prudence du raisonnement. C'est cette démarche d'enquête rationnelle qui permet de distinguer le visible de l'invisible et d'accéder à la réalité matérielle du monde, à rebours des illusions créées par les simulacres ou par l'angoisse.
La Physique : un matérialisme libérateur
Épicure adopte une physique matérialiste héritée de Démocrite, où l'univers est constitué d'atomes et de vide. Cette vision atomiste explique que tout phénomène est le résultat d'assemblages matériels, incluant le corps et l'âme, que l'on peut considérer comme une combinaison d'atomes sensibles. Selon Épicure, « rien ne naît de rien » (de Crescenzo, 1999, p. 403), alors que les phénomènes naturels s'expliquent par les mouvements et les combinaisons de ces particules élémentaires, sans recours à une cause divine.
S'il est juste d'affirmer que la physique épicurienne s'inspire de la pensée de Démocrite, elle la dépasse par contre sur un point essentiel : la liberté humaine. Pour éviter un déterminisme strict, Épicure introduit la notion de clinamen (de Crescenzo, 1999, p. 404), c'est-à-dire la déviation spontanée des atomes. Ce léger écart aléatoire rend possible la liberté des êtres vivants et notamment celle de l'individu. En outre, cette conception matérialiste a une finalité morale : elle délivre la personne humaine de la peur des dieux. Les divinités, comme le veut l'opinion ambiante (« la notion commune » [Épicure, 2009, §123]), existent, mais elles vivent dans un état d'ataraxie parfaite, une sorte de perfection bienheureuse, indifférente aux affaires humaines. Il ne faut donc pas les imaginer comme la foule le fait.
Les catastrophes naturelles ou les malheurs de la vie ne sont donc pas des châtiments divins, mais des phénomènes physiques soumis à la nécessité. Par conséquent, il n'y a « rien à craindre des dieux » (§123-124) — ils ne punissent ni ne récompensent. Ce rejet des superstitions doit libérer l'individu des peurs infondées, notamment la peur divine.
La Morale : la recherche du plaisir et de l'ataraxie
Pour Épicure, le bien et le mal se définissent par les affections[3] (pathos) principales suivantes que sont le plaisir (hêdonê) et la douleur (algos) (Morel, 2009, p. 27). Le plaisir est le critère du bien. C'est grâce au plaisir qu'il est possible de choisir une vie heureuse. Épicure n'adhère pas à un hédonisme vulgaire ou débridé. Le plaisir véritable consiste dans l'absence de souffrance corporelle (aponie) et de trouble de l'âme (ataraxie) (§ 128). Ainsi, la sagesse consiste à hiérarchiser, via la raison, les désirs. Il distingue trois types de désirs : les désirs naturels et nécessaires (alimentation simple, boire, se protéger), qui doivent être satisfaits avec mesure ; les désirs naturels non nécessaires (le luxe, la sensualité), qui doivent être limités ; enfin, les désirs ni naturels ni nécessaires (la gloire, la richesse, le pouvoir), qui doivent être rejetés. Cette classification permet à l'individu d'atteindre la paix intérieure. En se libérant des passions vaines, des superstitions et de la crainte de la mort, il accède à un bonheur stable et durable.
Pour Épicure, le bonheur de l'individu repose sur l'ataraxie, état de quiétude constitutive catastématique (ou état de quiétude durable) (katastêma ; voir Morel, 2009, p. 25), c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme, atteinte par la maîtrise des désirs et la suppression des douleurs physiques et morales. Ce bonheur s'inscrit dans une éthique du plaisir (hédonisme) fondée non pas sur la recherche effrénée de plaisirs cinétiques, mais sur le plaisir supérieur, notamment celui de ne pas désirer et l'absence de douleur (aponie) (§128). Le bonheur humain (eudonisme) réside dans le calcul prudent des plaisirs et la capacité de renoncer à certains d'entre eux ou de supporter des douleurs pour préserver la paix intérieure. Il s'agit d'une distinction importante par rapport aux cyrénaïques qui prétendaient à une valeur égale entre tous les plaisirs, sans distinction (Potchensky, 2014).
Sa vie morale se caractérise par un retrait de la vie politique (s'en abstenir) et une maxime célèbre : « cache ta vie »[4], invitant à vivre discrètement (abscondita), à se protéger des passions et des troubles extérieurs ; à ne pas rechercher « pouvoir, influence ou réputation » (Brunschwig, 1996, p. 232). Le sage, isolé des conflits, vivra « comme un dieu parmi les hommes » (§135), incarnant la sérénité divine par sa maîtrise de soi. C'est ainsi, selon lui, qu'il est possible d'atteindre l'autarcie dans la société des amis et ce, si tel est le souhait ou la volonté de l'individu, placé loin des passions publiques. La personne sage s'éloignera, par conséquent, des honneurs et vivra dans l'intimité d'un cercle restreint d'amis (la sociabilité restreinte). Peut-on, pour cette raison, accuser Épicure d'apolitisme ? Cela nous semble exagéré. Il invitait plutôt les individus à fuir les conflits et/ou les honneurs inhérents à la vie politique. Épicure valorise plutôt l'amitié et la société des amis comme un plaisir essentiel, voire indispensable au bonheur (Brunschwig, 1996, p. 232 ; de Crescenzo, 1999, p. 397). Sa philosophie a profondément inspiré les philosophes athées[5] ultérieurs, en offrant un quadruple remède : ne pas craindre les dieux, ne pas craindre la mort, supporter la douleur et atteindre le bonheur (de Crescenzo, 1999, p. 402).
Or, Montesquieu (1734), dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, fera un certain parallèle avec le déclin de la Grèce et soulignera l'influence de la secte d'Épicure qui participa à la corruption de Rome, par sa doctrine du plaisir. L'introduction de cette philosophie à forte teneur individualiste, comparativement au stoïcisme, ne cadrait point avec la nécessité d'une structure structurante du maintien de l'empire. Par conséquent, malgré l'allusion d'une communauté d'amis à connotation positive, la philosophie épicurienne n'entre pas en harmonie avec l'idée de l'État.
La Lettre à Ménécée : un résumé de la sagesse épicurienne
Dans la Lettre à Ménécée, Épicure expose avec clarté les principes fondamentaux de sa morale. Il y présente la philosophie comme une discipline de vie, accessible à tous, et non comme une spéculation abstraite. Épicure invite chacun à philosopher dès le plus jeune âge et ce, jusqu'à la vieillesse, car la philosophie, selon lui, est la route qui mène au bonheur. À ce sujet, il écrit : « Il n'est en effet, pour personne, ni trop tôt ni trop tard lorsqu'il s'agit d'assurer la santé de l'âme » (2009, §122). Elle permet d'apprendre à vivre et à mourir sans crainte. Il enseigne qu'il faut honorer les dieux, non pas par crainte, mais en comprenant leur nature véritable : ils vivent dans le bonheur et n'interviennent pas dans le monde. Ils sont incorruptibles et bienheureux (§123). Cette thèse permet à la sage personne de se libérer de la peur religieuse. Le passage le plus célèbre de la Lettre à Ménécée affirme ceci : « La mort n'est rien pour nous » (§124). Tant que nous existons, la mort n'est pas là ; lorsqu'elle est là, nous ne sommes plus. Épicure aborde la question centrale de la mort avec un raisonnement simple et rassurant : la mort est la dissolution du corps et de l'âme, donc, en tant qu'absence de sensation (ou cessation de sensation), elle ne peut pas être une source de souffrance. « Il n'y a rien à craindre de la mort » signifie que la peur de mourir est irrationnelle, car tant qu'on est vivant, la mort n'est pas là, et quand elle survient, on ne ressent plus rien (§124). Cette réflexion élimine une grande part de l'angoisse existentielle.
Épicure définit le plaisir comme le principe et le but de la vie heureuse, mais il recommande la prudence (phronêsis), la beauté, la justice et la modération (§132). Le sage doit donc pratiquer la maîtrise de ses désirs et le renoncement au plaisir excessif, car la recherche effrénée de plaisirs cinétiques (en mouvement, comme manger ou boire) (Morel, 2009, p. 25) peut conduire à la douleur. Le plaisir supérieur est celui de ne pas désirer, un plaisir stable et durable qui permet l'absence de douleur (aponie) et mène à l'ataraxie. Cette distinction est liée à la théorie du désir, où la douleur du manque n'est que le signe d'un désir mal placé ou excessif. Par le calcul rationnel des plaisirs, le sage vise à éviter la douleur en satisfaisant les désirs naturels nécessaires et en supprimant les autres. Le plaisir doit être choisi selon ses conséquences : il s'agit de rechercher les plaisirs stables et d'éviter ceux qui engendrent la douleur. La vertu est importante ici. À ce sujet il précise : « les vertus sont naturellement liées à la vie agréable et la vie agréable en est inséparable » (§132), voire même « la vertu est une jouissance » (Legrand, 1906, p. 9). La Lettre à Ménécée nous invite à vivre sobrement, sans crainte (Drieux, 2014, p. 246) ni trouble, en suivant la raison, la vertu et la nature.
Conclusion
La Lettre à Ménécée d'Épicure, propose une éthique du bonheur et ce dans un contexte d'agitation et de multi-crises (politique, économique et sociale) que traversait la Grèce au IVe siècle avant notre ère. Épicure y expose une doctrine matérialiste, influencée par la physique atomiste de Démocrite : l'univers est composé d'atomes et de vide, ce qui entraîne une physique matérialiste et une forme d'athéisme, où les dieux existaient mais étaient, selon Épicure, indifférents au monde humain ; de ce fait, la superstition et la crainte religieuse se trouvaient déconstruites. Par son ouverture à inclure dans son École du Jardin des femmes et des hommes, sans égard pour leur condition sociale, Épicure peut apparaître comme un précurseur d'une composition diversifiée de la communauté et adepte d'une approche inclusive, c'est-à-dire qui accepte dans ses rangs indistinctement les contributions de tous et de toutes.
La philosophie d'Épicure, souvent réduite à tort à une simple recherche du plaisir et d'apolitisme, est en réalité une éthique de la mesure, du bonheur et de la liberté. Sa canonique fonde la connaissance sur l'expérience sensible, sa physique propose une explication rationnelle et matérialiste du monde et sa morale enseigne la voie du bonheur par la modération et la sérénité. La Lettre à Ménécée illustre avec force cette philosophie pratique : l'individu n'a rien à craindre des dieux ni de la mort et son bonheur dépend uniquement de la sagesse avec laquelle il règle ses désirs. Épicure fonde, en quelque sorte, une pensée thérapeutique. Sa philosophie est un remède contre les maux intérieurs que sont la peur, la douleur et le trouble. L'éthique épicurienne s'affirme comme une « médecine de l'âme », offrant un quadruple remède (tétrapharmakos) : il n'y a rien à craindre des dieux, rien à craindre de la mort, la douleur est supportable et le bonheur est accessible. Il s'agit d'une sorte de guide pratique visant à s'affranchir ou s'immuniser face aux opinions erronées et aux peurs fantaisistes. Les conditions pour y parvenir sont la simplicité de vie, la pratique de l'amitié, le calcul rationnel des plaisirs et, si et quand nécessaire, un retrait prudent de la vie publique active et représentative (Brunschwig, 1996, p. 233 ; de Crescenzo, 1999, p. 400). Il conseille même de « cacher sa vie » (abscondita), vivre discrètement pour éviter les conflits et les passions inutiles. Pour le sage, la vie doit être vécue « comme un dieu parmi les hommes » : une existence sereine, détachée des troubles du monde, mais pleinement humaine.
Chez Platon et Aristote, la finalité de la Cité est la recherche de la justice chez le premier et la recherche du bonheur chez le deuxième. Il en va autrement chez Épicure. Il est plutôt d'avis que « le plaisir est la fin même que poursuit en nous la nature » (Morel, 2009, p. 15). L'humain est un être qui a besoin d'amiEs. Il valorise l'amitié, qui est une source importante de plaisir durable et de soutien mutuel. Il prônait une existence loin des conflits et/ou des honneurs de la vie politique. Ce qui n'impliquait pas une vie vécue à l'extérieur de la Cité-État. À ce sujet, sa philosophie ne visait pas à créer une nouvelle Cité-État (Cité-État qu'il ne combattait pas), mais bien plutôt à jeter les bases d'une véritable « Société des amiEs ».
Guylain Bernier
Yvan Perrier
26 octobre 2025
9h00
Notes
[1] « ‘‘Principe et fin'' » : le plaisir est fin (telos), c'est-à-dire aussi bien le but et l'achèvement que la limite ou le terme clairement défini. Parce qu'il est limité, c'est-à-dire déterminé, le plaisir est également principe (archê) ou point de départ au bonheur. » (Morel, nbp a., 2009, p. 48).
[2] Par « canonique », il faut comprendre « la théorie des critères ou règles de connaissance et d'action » (Morel, 2009, p. 27 ; voir également Baraquin et Lafitte, 2007 p. 140).
[3] Par « affection », Morel (nbp. b., 2009, p. 48) précise qu'il faut comprendre ceci : « plaisir ou peine ; ce que l'on éprouve en soi-même et qui nous indique spontanément ce que nous devons rechercher ou éviter ».
[4] Ou « ‘‘vivre caché'' (lathe biosas) » (de Crescenzo, 1999, p. 396).
[5] Même si cela ne doit pas faire de lui un athée. Car Épicure se questionne plutôt sur la façon dont nous interprétons le notion de Dieu (ou des dieux). Il n'empêche que l'athéisme qu'on lui attribue pourrait être compris sur la base de son raisonnement entourant la présence de la douleur et du mal dans un monde créé par un Dieu bienfaisant. Voici la réponse donnée par Épicure sur cet aspect : « […] ou bien Dieu veut supprimer le mal et ne le peut pas ; ou il le peut et il ne le veut pas ; ou il ne le veut ni le peut, ou enfin il le veut et il le peut. S'il le veut et qu'il ne le puisse pas, il est impuissant, ce qui ne convient pas à Dieu ; s'il le peut et ne le veut pas, il est envieux, ce qui ne peut davantage convenir à Dieu ; s'il ne le veut ni le peut, il est à la fois envieux et impuissant, donc il n'est pas Dieu ; s'il le veut et le peut, ce qui convient à Dieu, alors d'où vient le mal ? ou pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas ? » (cité dans Legrand, 1906, p. 48-49).
Au lieu de conclure sur son absence (ou inexistence), il a préféré l'option d'un Dieu qui a choisi de ne pas intervenir dans les affaires humaines. De là, la réserve à avoir au sujet de l'athéisme présumé d'Épicure.
Bibliographie
Arrighetti, Graziano. « Épicure ». Encyclopédie Universalis. https://universalis-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/encyclopedie/epicure/. Consulté le 24 octobre 2025.
Baraquin, Noëlla et Jacqueline Lafitte. 2007. Dictionnaire des philosophes. Paris : Armand Colin, p. 140 à 143.
Brunschwig, Jacques. 1996. « Épicurisme ». In Raynaud, Philippe et Stéphane Rials. Dictionnaire de philosophie politique. Paris : Presses universitaires de France, p. 232 à 236.
Brunschwig, Jacques. 1984. « Épicure ». In. Huisman, Denis (dir.). Dictionnaire des philosophes. Paris : Presses universitaires de France, p. 866 à 873.
Camus, Sébastien et. al.. 2008. « Épicure ». In. 100 œuvres clés en philosophie. Paris : Nathan, p. 64.
De Crescenzo, Luciano. 1999. Les grands philosophes de la Grèce antique. Paris : Le livre de Poche, p. 390-411.
Drieux, Philippe. 2014. « Épicurisme ». In Jean-Pierre Zarader. Dictionnaire de philosophie. Paris : Ellipses poche, p. E-246 à 247-E.
Épicure. 2009. Lettre à Ménecée. Présentation et notes par Pierre Morel. Paris : Éditions Garnier-Flammarion, 109 p.
Law, Stephen. 2008. La Philosophie. Paris : Gründ, p. 251.
Legrand, Henri. 1906. Épicure et l'épicurisme. Paris : Librairie Bloud & Cie, 71 p.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. 1734. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Amsterdam : Jacques Desbordes, 277 p.
Potchesky, Michel. 2014. « Hédonisme ». In Jean-Pierre Zarader. Dictionnaire de philosophie. Paris : Ellipses poche, p. 323-H à H-324.
Rosenberg, Patrice. 2008. La philosophie. Paris : Nathan, p. 76.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 28 octobre 2025

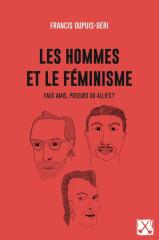
Les hommes et le féminisme
Francis Dupuis-Déri
J'ai lu plusieurs livres de Francis Dupuis-Déri jusqu'ici, surtout sur la démocratie et le féminisme et le masculinisme, et je les ai tous bien aimés. « Les hommes et le féminisme », publié aux Éditions du remue-ménage, traite en profondeur de la relation entre les hommes – et particulièrement les hommes proféministes – et le féminisme. C'est un bouquin qui m'a tout de même ouvert les yeux sur de nombreux aspects de la situation de la femme dans nos sociétés et de la position dominante que les hommes continuent d'exercer sur elles, dans les relations de couple, au travail et dans toute autre activité. Un très bon bouquin, très bien documenté, que tous les hommes devraient lire.
Extrait :
En Afghanistan, le roi Amir Amanullah a proposé en 1921 une réforme de la loi sur le mariage pour mieux défendre les droits des femmes. Il ouvrit des écoles pour filles et proposa de l'aide pour que de jeunes Afghanes puissent aller étudier en France et en Suisse. Son épouse, la reine Soraya, fonda l'Association de protection des droits des femmes et lança un journal féminin. La Grande-Bretagne a financé un soulèvement qui força le roi à l'exil, en 1929. Quand les communistes afghans parvinrent à former le gouvernement en 1978, avec l'aide de l'URSS, leurs nouvelles lois égalitaristes réformaient le mariage et ouvraient aux femmes les portes de nombreuses professions qui leur étaient fermées jusqu'alors. Or, au nom de la lutte contre le communisme, les gouvernements occidentaux – et bien des intellectuels défenseurs des « droits de l'homme » - apportèrent leur appui aux rebelles, qualifiés de « combattants de la liberté », qui renversèrent le régime communiste et abrogèrent les lois favorables aux femmes. En 2023, Matiullah Wesa, un Afghan de 30 ans qui a fondé l'organisation Pen Path pour l'éducation des filles et des femmes, a été arrêté à Kaboul.
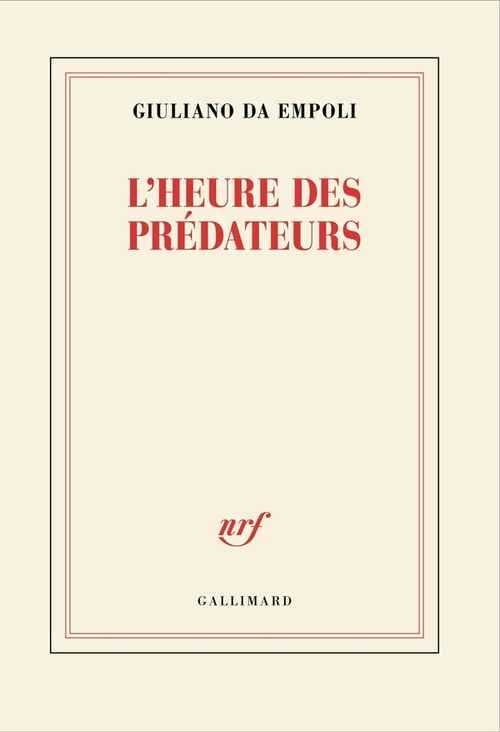
L'heure des prédateurs
Giuliano da Empoli
J'ai dû attendre de nombreux mois avant de pouvoir emprunter ce bouquin de ma bibliothèque municipale, même si elle en possède… vingt-six exemplaires. Ça m'a d'ailleurs donné le temps de lire deux textes à son sujet dans les pages du Monde diplomatique, dont l'excellente critique d'Evelyne Pieiller dans son édition d'août dernier. « L'heure des prédateurs », essai pour le moins élitiste (et même pédant), qui fait la part belle à certains personnages que plusieurs considèrent comme des ordures, nous laisse, en fin de lecture, avec une drôle d'impression d'impuissance et d'insignifiance. Comme si l'histoire se faisait sans nous, par quelques hommes d'exception. En résumé, nous explique l'auteur, des dirigeants autoritaires, copies modernes de César Borgia (Le Prince de Nicolas Machiavel), conspireraient avec les conquérants de la haute technologie pour nous réduire à l'impuissance dans « une ère de violence sans limite ». Décevant, surtout si vous aviez lu, du même auteur, « Le Mage du Kremlin ».
Extrait :
À l'âge de la colonisation numérique, les dirigeants modérés ont rempli la même fonction. Certains d'entre eux ont même franchi le pas, en se mettant au service des nouveaux conquistadors. À l'instar de l'ancien vice-président Al Gore qui, après avoir géré le dossier Internet de la Maison-Blanche, a engrangé des centaines de millions de dollars, d'abord chez Apple, puis dans une société de capital-risque de la Silicon Valley.
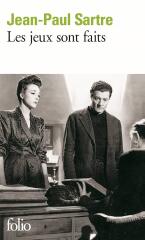
Les jeux sont faits
Jean-Paul Sartre
J'ai beaucoup aimé ce roman qui nous fait réfléchir sur l'amour, la mort, les illusions de la jeunesse, la liberté et la révolte. Eve et Pierre ne découvrent que trop tard qu'ils se seraient aimés, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais voilà, si la vie vous laisse parfois une seconde chance, on ne peut tout de même pas revenir en arrière – les jeux sont faits, et la mort vous rattrape...
Extrait :
Un détachement de la Milice du Régent s'engage dans une rue populeuse. Le visage sous la casquette plate à courte visière, le torse rigide sous la chemise foncée que barre le baudrier luisant, l'arme automatique à la bretelle, les hommes avancent dans un lourd martèlement de bottes.
L'ordre moins le pouvoir
Normand Baillargeon
J'ai découvert Normand Baillargeon en lisant ses chroniques dans Le Devoir, il y a de nombreuses d'années. Je n'ai pas arrêté de le lire depuis. C'est un de nos grands intellectuels et vulgarisateurs. C'est aussi un type charmant. La plupart des gens le connaissent surtout pour son superbe « Petit cours d'autodéfense intellectuelle », qui a connu un fort succès après sa publication il y a une vingtaine d'années. « L'ordre moins le pouvoir », qui avait déjà été publié sous le simple titre de « Anarchisme », est un intéressant petit ouvrage de vulgarisation qui nous fait connaître l'histoire de l'anarchisme et de ses différents courants, de sa version de nos jours la plus libre et égalitaire, la version libertaire, à sa version la plus réactionnaire et la plus inégalitaire, la version libertarienne. Un livre éclairant.
Extrait :
Selon Chomsky, le principe anarchiste trouve un de ses éléments essentiels et une de ses formes les plus significatives en Bakounine, plus précisément dans l'exaltation par ce dernier de la liberté définie comme condition essentielle du déploiement et du développement « de l'intelligence, de la dignité et du bonheur humains ». L'anarchisme développe un concept de liberté qui s'oppose à la liberté consentie et mesurée par l'État ; il invite à concevoir une définition beaucoup plus large et infiniment plus riche de la liberté. Cette dernière n'est pas enfermée dans un cadre fixe et clos, elle ne se réduit pas à la seule liberté négative qui consisterait à n'être pas entravée, mais elle est appelée à s'élargir infiniment lorsque des structures oppressives sont découvertes ; l'anarchisme porte donc aussi l'exigence de lutter contre ces nouvelles limites à la liberté, sans cesse mises à jour. Ce que Chomsky exprime en présentant l'anarchisme comme « cette tendance, présente dans toute l'histoire de la pensée et de l'agir humains, qui nous incite à vouloir identifier les structures coercitives, autoritaires et hiérarchiques de toutes sortes pour les examiner et mettre à l'épreuve leur légitimité ; lorsqu'il arrive que ces structures ne peuvent se justifier - ce qui est le plus souvent le cas -, l'anarchisme nous porte à chercher à les éliminer et à ainsi élargir l'espace de la liberté ».

Désinformation massive : comment les médias privés aggravent la crise climatique

Des chaînes de télévision et des radios sont minées par la désinformation sur le climat, révèle un rapport publié le 22 octobre. Certains médias sont des « relais proactifs », via leurs invités et même leurs journalistes.
Tiré de Reporterre
23 octobre 2025
Par Vincent Lucchese
Sur CNews, 1 cas de désinformation par heure d'information consacrée au climat a été détecté. - © Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
La désinformation climatique se porte à merveille dans les médias grand public français. Entre janvier et août, quelque 529 cas de mésinformation climatique (terme comprenant la désinformation potentiellement involontaire, sans intention de nuire démontrée) ont été relevés sur les principales chaînes de télévision et radio françaises par les ONG QuotaClimat, Data for Good et Science Feedback, révèle leur rapport publié le 22 octobre.
Il ressort de leur travail de veille que certains médias audiovisuels sont beaucoup plus coupables de désinformation que d'autres : parmi les chaînes d'information en continu notamment, les chaînes privées sont six fois plus « exposées aux narratifs de désinformation climatique » que l'audiovisuel public.
Sud Radio fait même pire que CNews
Sans surprise, CNews, la chaîne d'info du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, concentre le pire de la télé sur le sujet : un cas de désinformation par heure d'information consacrée au climat y a été détecté. Trois radios sont également des relais puissants de désinformation : Sud Radio fait même pire que CNews, avec un cas de désinformation toutes les quarante minutes, d'après le rapport.
Viennent ensuite Europe 1 et RMC, dont la fréquence d'exposition à la mésinformation climatique est à peine moins catastrophique que pour CNews, avec 0,8 à 0,6 cas de mésinformation par heure d'information consacrée au climat. Ensemble, ces quatre médias sont considérés par le rapport comme les « relais proactifs » de la désinformation climatique. Un peu moins mauvaise que ses concurrentes, LCI est quant à elle cataloguée comme un « vecteur permissif » de désinformation.
Cartographie des principaux médias audiovisuels français face à la désinformation climatique. © QuotaClimat, Data for Good, Science Feedback
L'ère du « nouveau déni climatique »
À l'inverse, les « chaînes de télévision généralistes (TF1, M6, France 2, France 3) ainsi que l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, RFI) constituent les remparts les plus actifs contre la désinformation climatique », écrivent les ONG.
Une différence notable est également observée entre le public et le privé : alors que dans l'audiovisuel public, les cas de désinformation identifiés sont presque systématiquement le fait d'invités (à 92 %), dans le secteur privé, les propos erronés ou trompeurs sont tenus dans 46 % des cas par des journalistes ou des chroniqueurs.
Lire aussi : Canicule : la télé en plein déni climatique
Cette médiocrité de l'information climatique contribue à alimenter ce que des chercheurs, notamment le Center for Countering Digital Hate, appellent le « nouveau déni » climatique.
« Les données récentes montrent que l'ère de l'“ancien déni” (“le changement climatiquen'existe pas”) a laissé place à un répertoire plus sophistiqué, conçu non pour réfuter la science, mais pour brouiller, épuiser moralement et paralyser l'opinion publique comme l'action politique », écrivent les auteurs du rapport.
Les données montrent, en outre, que la désinformation se concentre sur des moments précis : elle a triplé cet été par rapport au début de l'année, et a connu des pics corrélés à des moments de débats climatiques clés. Par exemple, lors de la prise de mandat de Donald Trump, lors du vote sur les zones à faibles émissions à l'Assemblée nationale ou encore lors de la canicule estivale, parasitée par les débats bourrés de désinformation sur la climatisation.
Les énergies renouvelables en bouc émissaire
Ces symptômes, nouveaux narratifs de désinformation et moments clés ciblés, entrent en résonance avec les principaux récits observés à l'échelle mondiale. Ce qui démontre qu'il s'agit d'un problème « systémique », soulignent les ONG. En clair, la désinformation est poussée par toute une série d'acteurs aux intérêts et stratégies nocives pour le climat : l'extrême droite, l'industrie fossile, automobile ou agricole et les intérêts idéologiques de grands actionnaires des médias qui, tout ou partie, participent à cette nouvelle désinformation.
« Leur objectif n'est plus de nier l'existence du changement climatique, mais de miner la confiance dans la viabilité des solutions et de délégitimer les messagers qui les défendent », pointe le rapport.
Les principales victimes de cette stratégie ciblée sont les énergies renouvelables (EnR). Plus de 90 % des cas identifiés de désinformation ciblent les solutions de transition, et 70 % ciblent plus spécifiquement les EnR.
C'est, en la matière, la foire aux poncifs. Parmi les fausses informations les plus souvent répandues sur ces chaînes, on trouve d'abord l'idée que « les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l'électricité », suivie de celle selon laquelle elles « sont inefficaces ou inutiles en raison de leur intermittence ». Ou encore, que les EnR « provoquent des blackouts » et qu'elles sont inutiles, le nucléaire étant suffisant pour « répondre aux besoins en énergie ».
Autant de contre-vérités largement plus répandues que les traditionnelles négations du rôle de nos activités dans le réchauffement global, ou encore l'antienne selon laquelle « le climat a toujours fluctué de manière naturelle ». Ces absurdités scientifiques sont toujours présentes, mais en grande majorité remplacées par les attaques contre la transition.
Cette « crise de l'intégrité de l'information » aggrave la crise climatique
Dans un contexte d'atrocité climatique généralisée, où l'action des États demeure largement insuffisante pour éviter le risque de catastrophes gigantesques en cascade, le rapport insiste sur le fait que cette « crise de l'intégrité de l'information » aggrave la crise climatique.
Pour lutter contre cette dynamique délétère, les ONG recommandent d'agir sur trois leviers identifiés. Former « les journalistes exposés au direct et les rédactions au sens large » à ces enjeux et stratégies de désinformation ; protéger les journalistes indépendants, « les médias d'intérêt public et les conditions de production d'une information fiable, intègre et suffisante » ; et réguler la désinformation climatique, « pour sortir du régime d'impunité actuelle ».
Sur ce dernier point, le rapport soutient une proposition de loi transpartisane, mais controversée, qui permettrait de sanctionner les propos climatosceptiques.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Avant la COP, le Brésil autorise de nouvelles explorations pétrolières

Les autorités environnementales du Brésil ont approuvé le 20 octobre l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Une décision qui, à quelques jours de la COP30, expose les ambiguïtés de Lula sur la question climatique.
Par
21 octobre 2025
Rio de Janeiro (Brésil), correspondance
À vingt jours de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP30) de Belém, c'est un énorme coup porté aux défenseurs de l'environnement brésiliens. L'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) a approuvé le 20 octobre le début de perforations pour la recherche de pétrole sur le site de Foz do Amazonas, situé à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazone.
La Petrobras, entreprise publique d'exploitation pétrolière, a donc le feu vert pour s'assurer dès aujourd'hui que la zone contient des hydrocarbures en quantité suffisante pour lancer une exploitation commerciale.
Une éventualité très probable, puisque la région de la Marge équatoriale, aire côtière de plus de 2 200 km de large où se trouve Foz do Amazonas, présente des caractéristiques similaires aux littoraux de pays voisins tels que le Suriname, la Guyane française et le Guyana, devenu en quelques années détenteur des plus grandes réserves de pétrole brut au monde. Selon le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, la Marge équatoriale pourrait contenir jusqu'à 10 milliards de barils.
Une énième menace sur l'Amazonie
L'exploitation d'une telle manne vient pourtant avec d'innombrables risques environnementaux, alors que la forêt amazonienne pourrait bien avoir déjà atteint le point de non-retour qui amènera à sa désertification.
Sous le feu des critiques, l'Ibama a déclaré, dans un communiqué, que la délivrance de la licence a eu lieu « après un processus rigoureux d'octroi de licence environnementale, qui comprenait la préparation d'une étude d'impact environnemental, la tenue de trois audiences publiques, 65 réunions techniques dans plus de 20 municipalités [...], en plus de la réalisation d'une évaluation préopérationnelle, qui a impliqué plus de 400 personnes ».
« Les communautés traditionnelles risquent d'être écrasées »
Pourtant, dans son rapport technique révélé par la Folha de São Paulo, plus grand quotidien brésilien, l'Ibama lui-même note la menace que l'exploitation de pétrole représentera pour la population de lamantins, ces gros mammifères aquatiques déjà menacés d'extinction, tout en pointant que les possibles effets sur les populations indigènes environnantes ont été tout simplement ignorés.
« Il s'agit d'une région très spéciale, où l'océan Atlantique rencontre la forêt. On y trouve par exemple un écosystème récifal [dominé par des récifs coralliens], très sensible à n'importe quel type d'activité, ainsi que des mangroves, d'où bon nombre de populations locales tirent leurs moyens de subsistance », explique Mariana Andrade, en charge de la section océans de Greenpeace Brésil.

Le site d'exploration pétrolière est à 175 km des côtes de l'état amazonien d'Amapá, où se trouve notamment la tribu Wayãpi, ici en 2017. © Apu Gomes / AFP
Localisé à 175 km des côtes de l'état amazonien d'Amapá, le mieux préservé du pays, le site de Foz do Amazonas pourrait, en cas de marée noire, affecter une région comportant 80 % des mangroves brésiliennes, selon le site d'infos économiques Brazil Journal.
Alors, face à de tels risques, comment ce projet a-t-il pu être approuvé ? Difficile de ne pas penser à la fantastique manne financière que de telles réserves représentent, qui plus est dans un pays dont l'ascension économique, au début des années 2000, est largement due à la découverte de gisements de pétrole offshore. Les partisans du projet y voient donc une opportunité pour l'Amapá, dont un tiers des habitants vit dans l'extrême pauvreté.
Mais cette rente ne pourrait être qu'une porte ouverte à d'autres menaces écologiques et sociales. « Les villes côtières de l'Amapá ne sont pas préparées et vont subir une très forte pression urbaine. Les communautés traditionnelles, dont le mode de vie est très lié aux ressources naturelles, risquent d'être écrasées », avertit Mariana Andrade.
Un engagement écologique de façade
Alors que l'Amazonie doit accueillir à Belém sa première COP, l'événement met la lumière sur les ambiguïtés du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, sur la question écologique. Successeur du leader d'extrême droite Jair Bolsonaro, ouvertement hostile à la protection de la nature, l'ex-syndicaliste a fait de la protection de l'Amazonie son image de marque internationale dès son élection en 2022. Une posture qui contredit son soutien répété au projet de Foz do Amazonas.
« On ne peut pas abdiquer cette richesse. Ce que l'on peut faire, c'est s'engager pour qu'aucun dommage environnemental ne soit causé », voulait-il rassurer dans une interview en juin. Le voilà aujourd'hui cible des critiques des milieux écologistes. « Lula vient d'enterrer son ambition de devenir un leader climatique au fond de l'océan, à Foz do Amazonas », attaquait ainsi Suely Araújo, elle-même ancienne cheffe de l'Ibama, à l'annonce de la décision.
De leur côté, les écologistes ne baissent pas les bras. Accompagnée d'au moins sept autres ONG, Greenpeace Brésil a d'ores et déjà annoncé entamer une action judiciaire contre la décision de l'Ibama. « Nous sommes très optimistes, puisque le ministère public fédéral [équivalent brésilien du parquet, qui a divulgué sa position une semaine avant l'annonce de l'Ibama] s'est lui aussi positionné contre l'autorisation des perforations. »
Autre atout déterminant : la mobilisation de la société civile, qui compte bien profiter de la COP, organisée dans un pays démocratique pour la première fois depuis quatre ans, pour faire entendre sa voix.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

IIe Rencontre écosocialiste latino-américaine et caribéenne

La période actuelle est marquée par la montée de l'extrême droite et les guerres génocidaires. Dans cette époque, les contradictions du système actuel de production, de distribution et de consommation montrent que nous sommes à un stade avancé d'une crise de civilisation.
20 octobre 2025 | tiré du site de la Gauche anticapitaliste
Territoires libres et convergence pour l'action
Il ne s'agit pas d'une crise cyclique du capitalisme comme les autres. La rupture métabolique, cette fracture irréparable dans le cycle naturel d'échange entre la société humaine et la nature, met à l'épreuve la capacité des êtres humains à apporter des réponses compatibles avec l'accélération de la destruction socio-environnementale.
Bon nombre de ces réponses intègrent une stratégie ouvertement guerrière, qu'il s'agisse de guerres commerciales – comme nous l'observons depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis – ou génocidaires, comme c'est le cas à Gaza et dans le cadre de la poursuite du projet de « campagne du désert »(1), qui connaît différentes versions dans divers territoires du monde. . Le succès de tous ces projets repose sur l'accumulation de capital et le colonialisme. La guerre pour les ressources et le maintien de l'hégémonie mondiale a généré une crise de gouvernance mondiale qui soulève de nouvelles questions et de nouveaux défis. Nous avons besoin de produire de nouvelles analyses afin de mieux comprendre cette situation faites de changements brutaux et accélérés.
Face au défi de concevoir, créer et mettre en œuvre un plan alternatif au projet mortifère imposé, qui accompagne le « capitalisme cannibale » caractérisé par Fraser, les Rencontres écosocialistes internationales jouent un rôle fondamental. Si nous partons du principe qu'il n'y a pas d'avenir sans présent et que la tâche d'aujourd'hui consiste à créer les conditions d'un monde vivable, un programme de transition écosocialiste est indispensable pour imaginer un avenir face à des crises qui semblent insolubles. Il s'agit de construire une issue écosocialiste à la crise environnementale profonde qui menace la continuité des modes de vie tels que nous les connaissons sur Terre.
Il est fondamental de sortir du statut d'observateur pour nous considérer comme des acteur·rices du changement, à un moment où notre conception du monde est particulièrement remise en cause. De ce point de vue, il y a un avant et un après Gaza : la lutte écosocialiste est la lutte pour la vie. Par conséquent, cette dimension doit être prise en compte par toute personne qui envisage un programme de transition écosocialiste avec une perspective anticapitaliste. Génocide et écocide ont toujours été liés : l'un rend possible l'autre, et vice versa.
Face aux logiques capitalistes
Pour penser et agir en ces temps de cruauté, il est important d'opérer un tournant analytique vers « la conscience du lien » et l'empathie, comme le propose Rita Segato(2). Il s'agit de placer, au centre du débat la solidarité écoterritorialisée, l'internationalisme des peuples et une action fondée sur le care, le soin, sans perdre de vue les luttes urbaines, syndicales et les luttes pour de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière. Car résister aujourd'hui, c'est aussi faire face à la précarisation de la vie dans tous ses domaines.
C'est dans le contexte d'un tel défi que se tiendra la 2e Rencontre écosocialiste latino-américaine et caribéenne. Sa tenue à Belém (Brésil) à l'occasion de la COP30 est, de manière symbolique, une réponse, et un rejet, à l'idée que l'économie pourrait justifier ou planifier ce que la société construit. Nous le savons, et le romancier Kim Stanley Robinson(3) l'a parfaitement illustré dans le Ministère du futur, la solution à l'effondrement environnemental proposée par ceux-là mêmes qui l'ont provoqué est incohérente, contradictoire. Elle repose sur de fausses solutions et des objectifs inatteignables.
La critique est ancienne, mais elle est particulièrement nécessaire actuellement : bien que la COP30 se déroule dans l'un des pays les plus importants pour l'élaboration de stratégies permettant de faire avancer les luttes écoterritoriales, le gouvernement brésilien s'est distingué par son manque d'engagement envers les collectifs en lutte et se rapproche des projets de colonialisme vert. Cela se traduit par l'adoption du projet de loi dit « da devastação » (4) – bien qu'avec des oppositions (5) –, l'annonce de la fin des négociations, avec une possible ratification, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, et la position enthousiaste de Lula à l'égard du Tropical Forest Forever Facility, qui devrait être l'un des principaux projets défendus par le gouvernement brésilien lors de la COP30 et qui est un projet ambitieux de capitalisme vert visant à corriger les prétendues « défaillances » du marché(6).
Faire converger les alternatives
Dans le même ordre d'idées, il est préoccupant que des espaces critiques à l'égard de la COP30 envisagent un lien direct avec les gouvernements. La nécessité de créer des espaces autonomes, comme l'ont toujours été les contre-sommets ou les sommets des peuples, en cohérence avec les luttes antisystémiques, est essentielle et devrait être non négociable. L'ingérence des gouvernements dans les processus d'auto-organisation de la société civile compromet la possibilité de proposer des alternatives populaires.
La 2e Rencontre écosocialiste se tiendra du 8 au 11 novembre et s'inscrit dans les espaces autonomes de débat et de construction de récits alternatifs existants. Ainsi ces dates ont été soigneusement choisies afin de ne pas interférer avec les activités du Sommet des peuples, qui se tiendra du 12 au 16 novembre, ni avec l'initiative « Charte de la Terre », prévue les 7 et 8 novembre.
Sur le plan stratégique, cette deuxième rencontre – qui s'inscrit dans la continuité des débats menés à Buenos Aires en 2024 et s'appuie également sur les cinq rencontres précédentes organisées en Suisse, dans l'État espagnol, au Pays basque et au Portugal – vise à faire converger les points de vue écosocialistes avec d'autres alternatives anticapitalistes qui ont vu le jour au cours des dernières décennies. L'objectif est de générer des actions concrètes coordonnées pour la construction d'un horizon commun. À cette fin, les éléments clés des propositions de différents collectifs qui réfléchissent et construisent des alternatives aux formes de production, de reproduction, de consommation, de distribution, d'organisation et de conception civilisationnelle du système capitaliste, seront débattus.
Cette rencontre, la première à se tenir en Amazonie, vise à faire entendre la voix des collectifs qui luttent pour la délimitation de leurs terres ancestrales et pour la préservation des forêts contre la déforestation et le racisme environnemental qui touche les peuples racisés. Au-delà d'un bilan critique des expériences des États plurinationaux, elle permettra de partager les projets de territoires sans combustibles fossiles ni exploitation minière qui voient le jour dans différentes régions d'Amérique latine.
Les objectifs de la rencontre
La rencontre proposera également un débat approfondi et critique sur les projets de transition préparés sans la participation des populations touchées par l'extractivisme, ainsi que sur une caractérisation des impérialismes dans le contexte politique actuel, dans lequel des projets tels que les BRICS et le repositionnement de la Chine soulèvent des questions sur les opportunités et les menaces pour les territoires du Sud global. Les guerres, la militarisation, les dettes et les accords commerciaux et d'investissement apparaissent comme la stratégie bien connue – mais plus violente depuis la montée des droites néofascistes – de subordination, de dépendance et de contrôle des territoires, menaçant la souveraineté des pays.
Dans la continuité du débat qui a animé toutes les rencontres précédentes, l'un des axes centraux sera l'écosyndicalisme et l'action dans le monde du travail, ainsi que les écoféminismes et les économies du soin dans une perspective écoterritoriale. Dans le cadre de la discussion sur la stratégie écosocialiste, seront abordées : les tactiques menant à l'écosocialisme ; l'écosocialisme et le pouvoir ; les dialogues entre le Nord et le Sud sur les méthodes et les contenus de la discussion ; le positionnement face à la COP ; et d'autres débats tels que la décroissance, les droits de la nature, les zones péri-urbaines et les populations des villes, la démocratie écosocialiste.
Malgré l'énorme défi que représente l'organisation de cet évènement, notamment en raison des aspects logistiques et des coûts élevés de l'hébergement à Belém, le lieu de la rencontre est désormais confirmé et un comité local a été mis en place pour organiser la logistique de l'événement et apporter son soutien, notamment en proposant des hébergements aux personnes qui participeront à la rencontre.
Les inscriptions à l'événement, qui seront obligatoires, ouvriront prochainement, car nous ne pouvons accueillir que 350 personnes. Conformément à son principe d'autonomie, l'événement est entièrement financé par les organisations et les personnes qui y participent, ce qui signifie que nous ne pouvons garantir le financement des billets et des transports sur place.
Nous nous attendons à une participation importante des collectifs et des personnes venant des différents territoires brésiliens ; c'est pourquoi, si nécessaire, la participation des délégations par pays pourra être limitée, afin que les débats se déroulent avec la plus grande participation et le plus grand pluralisme possible.
La question des territoires libres et la convergence pour l'action sont les thèmes sur lesquels cette rencontre entend progresser, en transmettant les propositions, les questions et les débats aux 7e Rencontres écosocialistes internationales qui se tiendront à Bruxelles au printemps 2026.
Le 19 septembre 2025
Les informations sur le processus d'organisation des Rencontres sont disponibles sur la page Instagram inter.ecosoc.
Article initialement publie le 10 octobre sur le site d'Inprecor.
Notes
1. La « campagne du désert », ou « conquête du désert », est le nom donné à la campagne menée entre 1878 et 1885 par le gouvernement argentin afin d'obtenir la domination de l'État sur les régions du sud et de la Patagonie orientale. Cette campagne, fondatrice de la nation argentine, s'est faite par l'extermination de milliers de mapuches.
2. L'autrice fait ici référence à l'ouvrage de Rita Segado, Contra-pedagogias de la crueldad, Prometeo Libros, 2018, non traduit en français.
3. Kim Stanley Robinson est un auteur de science-fiction étatsunien. Particulièrement connu pour sa trilogie sur la terraformation de mars : Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Ses récits, très documentés tant sur le plan biologique qu'anthropologique, ont une forte dimension politique.
4. Loi de dévastation, de son vrai nom : Projet de loi d'assouplissement des réglementations environnementales.
5. Les éluEs du PT de Lula ont voté contre. Lula a opposé son veto à certaines parties du projet mais la loi est entrée en vigueur et ce veto peut être rejeté par le Congrès.
6. Lire, de Mary Louise Malig et Pablo Solón, « TFFF : Una falsa solución para los bosques tropicales » (TFFF : une fausse solution pour les forêts tropicales)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit

Malgré les progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé et des réformes juridiques, 351 millions de femmes et de filles vivront toujours dans l'extrême pauvreté en 2030 si les mesures prises ne s'accélèrent pas.
Tiré de Entre les ligneset les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/29/legalite-des-sexes-nest-pas-une-ideologie-mais-un-droit/?jetpack_skip_subscription_popup
ONU Femmessouligne qu'investir dans l'égalité n'est pas seulement une question de justice : cela pourrait ajouter 1 500 milliards de dollars au PIB mondial en cinq ans et générer 342 000 milliards de bénéfices d'ici 2050.
Le monde recule en matière d'égalité des sexes, et le coût se mesure en vies, en droits et en opportunités. À cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (ODD) en 2030, aucun des objectifs en matière d'égalité des sexes n'est en voie d'être atteint.
C'est ce qui ressort du Gros plan sur l'égalité des sexes 2025 publié lundi par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), qui s'appuie sur plus de 100 sources de données pour suivre les progrès réalisés dans les 17 objectifs.
La pauvreté porte un visage féminin
L'année 2025 marque trois étapes importantes pour les femmes et les filles : le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 80e anniversaire des Nations Unies. Cependant, au vu des nouvelles données qui donnent à réfléchir, il est urgent d'accélérer les actions et les investissements.
Parmi les conclusions du rapport, la pauvreté féminine n'a pratiquement pas évolué en cinq ans, stagnant autour de 10% depuis 2020. La plupart des 233 millions de femmes sur les 300 millions qui vivent encore dans la pauvreté extrême se trouvent en Afrique subsaharienne.
Sur le plan alimentaire, les inégalités sont également criantes : en 2024, 26,1% des femmes étaient confrontées à l'insécurité alimentaire contre 24,2% des hommes – soit 64 millions de femmes de plus. Une femme en âge de procréer sur trois pourrait être anémique d'ici 2030, compromettant sa santé et son avenir.
Les femmes paient le prix fort
Alors que le monde continue d'allouer des sommes colossales à la défense – plus de 2 700 milliards de dollars par an aux dépenses militaires – seuls 420 milliards de dollars suffiraient à financer l'égalité des sexes, soit l'équivalent de seulement 57 jours de budget militaire mondial.
Rien qu'en 2024, 676 millions de femmes et de filles vivaient à proximité d'un conflit meurtrier, le nombre le plus élevé depuis les années 1990.
Pour celles qui se trouvent dans des zones de guerre, les conséquences vont bien au-delà du déplacement. L'insécurité alimentaire, les risques sanitaires et la violence augmentent considérablement, note le rapport.
La violence à l'égard des femmes et des filles reste l'une des menaces les plus répandues. Plus d'une femme sur huit dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire au cours de l'année écoulée, tandis que près d'une jeune femme sur cinq a été mariée avant l'âge de 18 ans. Chaque année, on estime que quatre millions de filles subissent des mutilations génitales féminines, dont plus de la moitié avant leur cinquième anniversaire.
Les facteurs de stress liés au changement climatique tels que les inondations, les sécheresses et les canicules mortelles s'aggravent, et les femmes sont les premières à en subir les conséquences, avec de plus longues distances à parcourir pour trouver de l'eau, une perte de revenus énorme lorsque les exploitations agricoles et les pêcheries s'effondrent.
Le changement climatique à lui seul pourrait précipiter 158 millions de femmes de plus dans la pauvreté d'ici 2050. Pourtant, les femmes continuent d'être exclues des négociations de paix et des processus de planification des catastrophes climatiques.
Progrès avérés
Pourtant, malgré ces statistiques sombres, le rapport souligne ce qu'il est possible de réaliser lorsque les pays donnent la priorité à l'égalité des sexes. La mortalité maternelle a chuté de près de 40% depuis 2000, et les filles ont aujourd'hui plus de chances que jamais de terminer leur scolarité.
S'adressant à ONU Info, Sarah Hendriks, directrice de la division des politiques à ONU Femmes, a déclaré que lorsqu'elle s'est installée au Zimbabwe en 1997, « donner naissance était en fait une question de vie ou de mort ».
« Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est un progrès incroyable en seulement 25 ou 30 ans », a-t-elle ajouté.
La technologie est également prometteuse. Aujourd'hui, 70% des hommes sont connectés à l'Internet, contre 65% des femmes. Selon les estimations du rapport, la réduction de cet écart pourrait profiter à 343,5 millions de femmes et de filles d'ici 2050, sortir 30 millions de personnes de la pauvreté et ajouter 1 500 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030.
« Lorsque l'égalité des sexes a été une priorité, cela a fait progresser les sociétés et les économies », a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d'ONU Femmes. « Les investissements ciblés en faveur de l'égalité des sexes ont le pouvoir de transformer les sociétés et les économies ».
Dans le même temps, un recul sans précédent des droits des femmes, le rétrécissement de l'espace civique et la réduction croissante du financement des initiatives en faveur de l'égalité des sexes menacent les acquis obtenus de haute lutte.
Selon ONU Femmes, sans action, les femmes restent « invisibles » dans les données et l'élaboration des politiques, avec 25% de données sur le genre en moins disponibles actuellement en raison des coupes budgétaires dans les enquêtes.
« Le Gros plan sur l'égalité des sexes 2025 montre que les coûts de l'échec sont immenses, mais que les gains liés à l'égalité des sexes le sont tout autant », a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.
« Des actions et des interventions accélérées axées sur les soins, l'éducation, l'économie verte, les marchés du travail et la protection sociale pourraient réduire le nombre de femmes et de filles vivant dans l'extrême pauvreté de 110 millions d'ici 2050, générant ainsi un rendement économique cumulé estimé à 342 000 milliards de dollars ».
Agir en ce moment charnière
Mais les progrès restent inégaux et souvent douloureusement lents.
Les femmes ne détiennent que 27,2% des sièges parlementaires dans le monde, et leur représentation dans les gouvernements locaux stagne à 35,5%. Dans le domaine de la gestion, les femmes n'occupent que 30% des postes, et à ce rythme, la véritable parité n'est pas atteinte avant près d'un siècle.
À l'occasion du 30e anniversaire du Programme d'action de Beijing, le rapport présente l'année 2025 comme un moment charnière.
« L'égalité des sexes n'est pas une idéologie », prévient-il. « Elle est fondamentale pour la paix, le développement et les droits humains ».
À l'approche de la semaine de haut niveau des Nations Unies, le rapport appelle à investir dès maintenant dans les femmes et les filles.
« Le changement est tout à fait possible, et une voie différente s'offre à nous, mais il n'est pas inévitable et nécessite la volonté politique ainsi que la détermination des gouvernements du monde entier pour faire de l'égalité des sexes, des droits des femmes et de leur autonomisation une réalité une fois pour toutes ».
https://news.un.org/fr/story/2025/09/1157474
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Care, économie féministe et souveraineté alimentaire

Lisez la contribution de la militante hondurienne de la Via Campesina sur la relation entre le féminisme paysan et populaire et la lutte pour une transformation du travail du care
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/08/30/care-economie-feministe-et-souverainete-alimentaire/?jetpack_skip_subscription_popup
Nous avons commencé à bâtir des économies féminines parce que nous vivons dans un monde inégalitaire dans lequel les femmes ont toujours contribué à la vie. Cependant, nous n'en sommes pas au centre. Pour lutter contre ces injustices, nous renforçons la rébellion des femmes dans nos paris politiques, à partir de nos propres perspectives, de la vision du monde de nos camarades autochtones et de tout le parcours des femmes dans la défense de la vie.
La Coordination latino-américaine des organisations rurales, liée à Via Campesina (CLOC-LVC), a réfléchi à un travail collectif, politique et idéologique qui met en évidence les droits humains des femmes, faisant écho et contribuant à la vie dans son ensemble. Il s'agit de la construction politique de notre pari sur un modèle différent du modèle capitaliste et patriarcal. Nous voulons dire au monde qu'il y a d'autres possibilités et d'autres visions de la vie. L'approche de la souveraineté alimentaire a été élaborée à partir des émotions, de la pensée et de l'expérience des femmes. La souveraineté alimentaire nous représente, nous inclut, reconnaît notre contribution et notre rôle de soignantes.
L'économie des soins, l'économie féministe et l'économie paysanne ne peuvent pas être séparées, car elles forment une alliance. Elles font partie du travail que nous avons fait à partir de la vision du féminisme paysan et populaire. Il est également important que nous, les femmes, puissions construire notre identité et notre autonomie. Cette identité se construit à partir de ce grand pari politique du féminisme paysan et populaire, et il est important de la nommer. Cela signifie reconnaître le rôle que nous avons joué tout au long de l'histoire.
Lorsque nous parlons de soins, nous parlons de la façon dont nous avons toujours été connectées, en prenant soin du territoire, de la communauté, des enfants, de la famille, des voisins, de tout le monde. La grande question est : quand pourrons-nous, qui sommes des leaders, des mères, des productrices, des soigneuses de la vie et de beaucoup d'autres choses sur nos territoires, prendre soin de nous-mêmes ?
La violence traverse nos corps et nous déchire, mais elle nous rassemble également pour réfléchir et construire nos agendas politiques nationaux et internationaux. À travers la construction de notre identité, la vision du monde des femmes autochtones et l'économie paysanne, nous soulevons également la question des droits sexuels et reproductifs. Le premier territoire que nous défendons et dont nous prenons soin est le corps-territoire, car c'est lui qui nous dit quand nous nous sentons bien et quand nous ne pouvons plus avancer d'un pas. Il est important de s'écouter soi-même pour pouvoir écouter les autres.
Il est important que nous puissions décider pour nous-mêmes, car personne – ni l'État, ni l'église, ni la société – ne peut décider de notre corps. Nous, les femmes, sommes très impliquées dans la production. Nous ne pourrons pas renforcer le pouvoir économique des femmes si nous ne reconnaissons pas que nous sommes des sujets de droits et que nous sommes organisées pour construire nos propres initiatives et stratégies économiques.
Il est important de travailler sur la dimension sociale de la santé, afin que nous puissions être connectées avec nos émotions et nos pensées. Le bien-être va au-delà des prescriptions et des rendez-vous médicaux. C'est d'abord la façon dont nous nous écoutons et nous définissons. Les sphères politiques, sociales, culturelles et démocratiques dans lesquelles nous sommes insérées font partie de notre stabilité émotionnelle. Nous commençons à faire cette réflexion face à tout le travail que nous réalisons pour la défense de la terre et du territoire, et contre toutes les offensives de criminalisation, de persécution et de violence. Nous avions besoin de trouver un espace de réflexion, de rencontre et d'auto-soin pour prendre soin de l'esprit, du cœur, du corps et de notre âme.
En matière de travail et de soins, l'État a une dette envers les femmes. Une dette en termes de protection sociale, avec l'appréciation des salaires, cherchant à offrir l'égalité aux femmes qui cotisent de la même manière que les hommes. C'est précisément à ce stade que se situent la lutte des classes et la division sexuelle du travail. Le travail des femmes tire parti du capitalisme et des transnationales. Elles restent souvent à la maison pour nettoyer, cuisiner et repasser afin que les hommes embauchés par les entreprises puissent aller travailler. S'occuper des enfants, s'occuper de la maison et du jardin, ce n'est pas de l'amour, c'est du travail.
Au Honduras, 58,72% du travail de conservation des semences, de production alimentaire, de prise en charge des territoires et des familles n'est pas rémunéré. Le gouvernement est en train de rédiger une loi sur les politiques de soins, et nous avons contribué à nos travaux sur les soins et l'économie des femmes. Nous nous fatiguons aussi, nous sommes également présentes, nous contribuons également à l'économie de notre société. Nous ne proposons pas un débat sur qui est le meilleur, ni une compétition entre hommes et femmes. Nous luttons contre un système prédateur, capitaliste et sexiste qui viole nos droits humains en tant que femmes et nous tue.
Pour La Via Campesina, mettre la question des droits aux soins à l'ordre du jour signifie également réfléchir à la manière de travailler sur cette question dans les territoires. Nous avons construit une partie importante, qui est l'incidence et la construction permanente d'alliances avec des organisations nationales et internationales, féministes, autochtones, paysannes et tous les secteurs auxquels nous nous identifions. Il est également nécessaire d'établir des alliances avec l'État. Et il est important que nos processus de formation et nos écoles de formation politique valorisent toujours les contributions des femmes. Nous sommes celles qui soutiennent et changent la vie, puisque nous prenons soin de tout le monde. C'est pourquoi il est important que nos esprits, nos cœurs et notre contribution économique atteignent l'autonomie dont nous avons besoin.
Yasmín López est une femme paysanne, autochtone et féministe. Elle est membre de la commission politique de La Via Campesina du Honduras, est conseillère auprès du Conseil pour le Développement Intégral des paysannes [Desarrollo Integral de la Mujer Campesina – CODIMCA] et coordinatrice de la commission politico-pédagogique de l'École de Formation paysanne Margarita Murillo. Cet article est une version éditée de sa présentation lors du webinaire « Construire des propositions féministes d'économie et de justice environnementale » organisé par les Amis de la Terre International, la Marche Mondiale des Femmes, Capire et Radio Mundo Real le 15 juillet 2025.
Édition par Helena Zelic
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : espagnol
https://capiremov.org/fr/analyse/care-economie-feministe-et-souverainete-alimentaire/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les associations féminines malaisiennes réclament un financement durable et des réformes en matière d’égalité des sexes dans le budget 2026

Les associations féminines appellent le gouvernement à mettre à profit le budget 2026 pour combler les inégalités de longue date entre les sexes, qu'il s'agisse du financement des refuges et des services d'aide aux victimes, du soutien aux femmes ménopausées ou de la participation politique des femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/10/16/les-associations-feminines-malaisiennes-reclament-un-financement-durable-et-des-reformes-en-matiere-degalite-des-sexes-dans-le-budget-2026/?jetpack_skip_subscription_popup
Le Centre des femmes pour le changement (WCC) de Penang, qui a fourni une assistance psychologique d'urgence à près de 600 nouvelles personnes l'année dernière, a déclaré que les allocations fédérales restaient trop « ponctuelles » et axées sur des projets, ce qui rendait difficile la planification à long terme pour les ONG.
« Un budget de fonctionnement à long terme est nécessaire, non seulement pour les projets à court terme, mais aussi pour assurer la continuité des services qui protègent les plus vulnérables », a déclaré la directrice exécutive Karen Lai à FMT.
Elle a expliqué que le « budget de fonctionnement » correspond à des allocations flexibles qui permettent aux ONG de réagir efficacement sur le terrain, soulignant qu'un modèle similaire est déjà utilisé au niveau de l'État.
L'organisation Women's Aid Organisation (WAO) a également réclamé un financement durable et a invité Putrajaya à fournir un soutien opérationnel 24 heures sur 24, à financer des formations sur la prise en charge des traumatismes et à créer une ligne budgétaire dédiée à la lutte contre le harcèlement et les abus en ligne.
« Le financement du fonctionnement doit couvrir les dépenses essentielles telles que le loyer, les services publics, la nourriture, la sécurité, les transports et les frais médicaux afin de garantir le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des refuges et des lignes d'assistance téléphonique », a déclaré la WAO.
Le Gender Budget Group (GBG), une coalition de 24 ONG et 18 universitaires, a quant à lui souligné les lacunes en matière de santé des femmes. Il a déclaré que la politique de santé du pays a maintes fois négligé les questions liées à la ménopause, alors que de nombreuses études la citent comme un facteur majeur dans le départ des femmes du marché du travail.
S Indramalar, chercheuse féministe à l'Universiti Malaya et à l'Université Monash de Malaisie, a déclaré que le gouvernement devrait financer une analyse des besoins nationaux afin de saisir les réalités auxquelles sont confrontées les femmes malaisiennes, car les études existantes ont tendance à se concentrer uniquement sur les symptômes et le traitement.
Elle a également invité le gouvernement à intégrer l'aide à la ménopause dans les prestations Perkeso et EPF afin de garantir que toutes les femmes actives, y compris celles du secteur informel, aient accès à une prise en charge minimale.
« Cependant, les aménagements du lieu de travail au quotidien, tels que les horaires flexibles ou des espaces de travail rafraîchis, devraient relever de la responsabilité des employeurs. Idéalement, il s'agit d'une responsabilité partagée, le gouvernement proposant des lignes directrices nationales et des incitations fiscales, et les employeurs adaptant leur soutien pratique », a-t-elle déclaré.
Le GBG a également préconisé des réformes destinées à combler le fossé en matière de postes de responsabilité, et notamment l'instauration de quotas pour les femmes au Parlement et d'un fonds pour la participation politique.
Les femmes n'occupent actuellement que 13,5% des sièges au Dewan Rakyat, ce qui est bien en deçà des normes internationales en matière de parité entre les sexes.
Ong Bee Leng, présidente-directrice générale de la Penang Women's Development Corporation (PWDC), a déclaré que ce fonds pourrait être conçu selon un modèle hybride, soutenu à la fois par des ressources publiques et par les partis politiques.
« Les fonds publics inciteraient tous les partis à présenter davantage de candidates, en particulier les petits partis qui connaissent des difficultés financières. Au sein des partis politiques, l'intégration de la dimension de genre dans les budgets lors des contrôles annuels peut garantir que les ressources sont affectées de manière équitable au renforcement de la participation des femmes », a-t-elle déclaré.
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76534
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand le capitalisme brise les hommes : la crise toxique de la masculinité en Corée du Sud et ses implications pour le monde.

La Corée du Sud offre un aperçu effrayant de ce qui pourrait être l'avenir des questions de genre dans un capitalisme avancé. Bien qu'elle soit en tête du classement mondial en matière de formation universitaire des femmes, cette société hyperconnectée affiche le plus grand écart salarial entre les sexes de l'OCDE, tandis que la misogynie numérique se développe sans contrôle.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les conséquences en sont dévastatrices : du féminicide de la station Gangnam en 2016 au récent scandale de l'esclavage sexuel numérique « nth room », la haine en ligne se traduit régulièrement par des actes de violence dans le monde réel.
Cette masculinité toxique ne surgit pas de manière isolée. Alors que l'économie néolibérale détruit les privilèges masculins traditionnels (emploi stable, avantages liés au service militaire, hiérarchie sociale), les jeunes hommes frustrés redirigent leur colère non pas vers la responsabilité du système capitaliste, mais vers les femmes et les féministes. Des influenceurs antiféministes comme Bae In-gyu exploitent cette rage et se constituent une audience massive en promouvant la misogynie extrême comme une forme de résistance politique.
Les ramifications politiques sont évidentes. L'ancien président Yoon Suk-yeol a utilisé l'antiféminisme comme arme pour s'assurer le pouvoir, en supprimant les programmes destinés aux femmes et en retirant la « parité hommes-femmes » de la politique gouvernementale. La proclamation récente de la loi martiale et la destitution qui a suivi montrent que les attaques contre les droits des femmes sont souvent le signal d'attaques plus générales contre la démocratie.
Pour les féministes écosocialistes du monde entier, la Corée du Sud est à la fois un avertissement et une chance : comprendre comment le capitalisme alimente les guerres entre les sexes tout en renforçant la solidarité entre les mouvements pour une véritable libération. [AN]
*-*
« Les hommes ne savent pas pourquoi ils sont devenus malheureux » : la guerre des sexes toxique qui divise la Corée du Sud
La masculinité toxique est un phénomène mondial, mais nulle part ailleurs elle n'est plus virulente que dans cette société hypermoderne et connectée. Que peuvent apprendre les autres pays de ce « point zéro » de la misogynie ?
Un soir de novembre 2023, dans la ville sud-coréenne de Jinju [1], une femme nommée On Ji-goo était en train de travailler de nuit dans une supérette lorsqu'un jeune homme a fait irruption et s'est mis à faire tomber agressivement des articles des rayonnages. Lorsqu'elle lui a demandé de faire attention, il s'est tourné vers elle et lui a dit : « Je suis furieux, alors ne me touche pas. »
La situation a dégénéré. Lorsque On a essayé d'appeler à l'aide, il lui a pris son téléphone et l'a jeté dans le micro-ondes du magasin. Elle a essayé de l'en empêcher, mais il l'a attrapée par le col et les bras, la traînant sur plusieurs mètres et la projetant contre les étagères. Ce fut le début d'une violente agression. Tout au long de celle-ci, il a répété qu'il « ne frappait jamais les femmes », mais que les féministes « méritaient d'être battues ».
Lorsqu'un client plus âgé a tenté d'intervenir, l'agresseur s'en est également pris à lui, lui lançant : « Pourquoi ne soutenez-vous pas un autre homme ? » Lorsque la police est arrivée, il a déclaré faire partie d'un groupe de défense des droits des hommes et a demandé à des agents masculins de le menotter. Il a ensuite admis avoir pris On pour cible à cause de ses cheveux courts.
« Avant cela, je n'avais qu'une compréhension très basique du féminisme, celle que toute femme peut naturellement avoir », explique On, une écrivaine en devenir qui utilise un pseudonyme.
Nous nous rencontrons par un après-midi ensoleillé dans un café de Jinju, où elle vit toujours, à quelques pâtés de maisons du magasin. C'est une ville provinciale endormie de moins de 350 000 habitants, à quatre heures de Séoul en train à grande vitesse. Le visage de On est caché derrière un masque et un bonnet enfoncé sur la tête. Ayant dû supporter les questions inquisitrices des médias locaux après son agression, elle met un certain temps à baisser sa garde. « Je ne comprenais pas vraiment la discrimination dont sont victimes les femmes, ou plutôt je l'avais acceptée comme normale », dit-elle.
L'agression la laisse avec une perte auditive permanente et un traumatisme grave. L'auteur a été condamné à trois ans de prison. Dans un jugement qui a fait date, la cour d'appel a reconnu la misogynie comme le moteur de l'agression, la première fois qu'un tribunal sud-coréen reconnaissait une telle haine comme motif criminel.
L'histoire de On n'est pas unique dans un pays où les inégalités systématiques et la misogynie virulente en ligne ont plongé principalement la génération Z et les milléniaux dans une bataille acharnée entre les sexes. Alors que des luttes similaires sur le genre et le féminisme se déroulent à travers le monde, des États-Unis à l'Europe, la Corée du Sud est devenue le lieu de référence de la guerre des sexes, sa population hautement connectée et familiarisée avec le numérique amplifiant cette tendance à un rythme sans précédent.
Inégalités hyperconnectées
Dans la culture masculine, on ne peut pas dire ce que l'on pense à ses supérieurs. Alors, vers qui cette frustration se dirige-t-elle ? Vers les femmes
À première vue, la Corée du Sud semble être une société hypermoderne, caractérisée par sa contribution positive à la culture pop mondiale, ses technologies de pointe et ses paysages urbains impeccables. Mais sous cette façade se cache un fossé entre les sexes qui semble appartenir à une autre époque. Parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques [2], la Corée du Sud occupe la première place en matière d'accès des femmes à l'enseignement supérieur, mais affiche néanmoins le plus grand écart salarial entre les sexes. Les femmes restent largement exclues des postes de direction, et la Corée du Sud se classe systématiquement dernière en matière d'égalité des sexes sur le lieu de travail. Alors que le pays est à la pointe de la connectivité Internet et de l'innovation high-tech, ces mêmes espaces numériques sont devenus le terreau de certaines des communautés antiféministes les plus toxiques, transformant la haine virtuelle en violence réelle.
La manifestation la plus effroyable de ce phénomène s'est produite en 2016, lorsqu'une femme de 23 ans a été brutalement assassinée dans des toilettes publiques près de la gare de Gangnam [3], au cœur du quartier des affaires et des divertissements de Séoul. Le meurtrier, qui avait attendu pendant des heures une victime féminine au hasard, a déclaré à la police qu'il avait agi ainsi parce que « les femmes m'ont toujours ignoré ». Cette affaire a marqué un tournant, déclenchant des manifestations massives, mais le harcèlement numérique des femmes s'est poursuivi. En 2018, il s'était tellement normalisé qu'il était courant de voir dans les toilettes publiques des panneaux indiquant qu'elles avaient été contrôlées pour vérifier l'absence de caméras cachées, et des milliers de femmes ont protesté contre l'épidémie de caméras espionnes et de « pornographie vengeresse ». La crise s'est aggravée en 2020 avec la célèbre affaire « nth room » [4] d'esclavage sexuel numérique, dans laquelle les utilisateurs d'un réseau de salons de discussion Telegram ont fait chanter des femmes et des mineures pour les obliger à réaliser des contenus sexuellement explicites chez elles. En 2024, une nouvelle menace est apparue : la pornographie de type « deepfake » ciblant les écolières, dont les auteurs, souvent eux-mêmes mineurs, utilisaient la technologie de l'IA pour superposer des visages de femmes sur des contenus sexuellement explicites et diffuser les images via des chaînes Telegram, dont certaines comptaient des centaines de milliers de membres.
Fertile terrain numérique
Ces crimes numériques ne sont pas issus du néant. Dans les recoins les plus sombres de l'Internet sud-coréen, des jeunes hommes se rassemblent anonymement pour partager leur rage. Alors que l'Occident a 4chan et Reddit, la Corée du Sud a Ilbe [5] – « le meilleur de la journée » – qui, à son point culminant au milieu des années 2010, figurait parmi les 10 sites les plus visités du pays. L'influence de ce forum dépasse largement le domaine numérique. Ses utilisateurs ont été les premiers à utiliser des termes dépréciatifs tels que kimchi-nyeo (« fille kimchi », souvent traduit par « salope kimchi ») pour se moquer des femmes qu'ils considèrent comme des croqueuses de diamants matérialistes. Ces termes se sont rapidement infiltrés dans le discours dominant, les médias adoptant le suffixe -nyeo dans leurs titres pour critiquer toute femme se comportant mal en public.
À mesure que son influence grandissait, Ilbe a commencé à se radicaliser pour s'aligner sur la politique d'extrême droite et orchestrer des actions provocatrices hors ligne. En 2014, un utilisateur d'Ilbe a fait sauter un engin explosif artisanal lors d'un discours d'un activiste progressiste, affirmant que l'orateur était pro-Corée du Nord – une accusation courante de la droite dans un pays où le clivage gauche-droite reste marqué par les divisions de la guerre froide – tandis que d'autres se moquaient des familles des victimes du naufrage du ferry Sewol en 2014 [6] en se goinfrant de pizza devant les parents en deuil qui faisaient une grève de la faim pour réclamer une nouvelle législation à la suite de la tragédie.
Si la popularité d'Ilbe a décliné, son héritage perdure dans des communautés en ligne connues sous le nom de namcho, abréviation de namseong chogwa, qui signifie « excès d'hommes ». Ces sphères masculinistes se sont répandues sur les forums et les applications de messagerie, permettant aux jeunes hommes de partager leurs griefs à l'égard du féminisme et de ce qu'ils considèrent comme une discrimination à rebours.
« Si on accède à l'internet libre avant d'avoir été correctement éduqué, notre vision du monde est foutue », explique Kim Min-sung, dans son bureau de Guri, une ville située à l'est de Séoul. Cet activiste de 22 ans, qui était lui-même antiféministe, s'exprime avec une énergie contagieuse, ponctuant ses propos sérieux de éclats de rire.
Comme beaucoup de garçons coréens, Kim a découvert ces forums dès son plus jeune âge. Il se souvient avoir recherché des contenus innocents, tels que des vidéos amusantes, pour se retrouver progressivement exposé à des contenus misogynes. Il admet avoir répété des discours antiféministes sans les comprendre, simplement parce que c'était ce que faisaient tous ceux qui l'entouraient.
Le revirement de Kim est venu d'une source inattendue : les jeux de rôle fantastiques. Il y a trouvé une communauté majoritairement féminine et progressiste. Au début, dit-il, « je me taisais et je me contentais de jouer à Donjons et Dragons. Mais en les écoutant, on se met naturellement à discuter de manière informelle et on se rend compte que la vision du monde que l'on avait à partir de ces forums en ligne n'était que des exagérations, des caricatures et des fantasmes ».
Aujourd'hui, Kim dirige la Korean Game Consumer Society (Société coréenne des consommateurs de jeux vidéo) et lutte contre la même haine en ligne à laquelle il avait autrefois contribué. Il reçoit désormais régulièrement des menaces de mort, ce qu'il trouve étrangement valorisant. Néanmoins, « je ne fais que combattre les symptômes. Je ne pense pas que ce que je fais résolve le cœur du problème. Les hommes ne savent pas pourquoi ils en sont arrivés là, ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus malheureux. »
Les racines économiques du ressentiment
Selon la professeure Seungsook Moon, sociologue et experte en études de genre au Vassar College aux États-Unis, la colère qui explose en ligne reflète des changements sociétaux plus profonds. Elle attribue le mécontentement des jeunes hommes au fait que la Corée du Sud a adopté le néolibéralisme [7]. « Avant la démocratisation [8], lorsque les régimes militaires dirigeaient la Corée, le gouvernement pouvait créer des emplois stables », explique-t-elle. « Jusqu'à la fin des années 80, les hommes qui étaient simplement allés à l'université pouvaient trouver un emploi dans de bonnes entreprises. L'économie était en pleine expansion. » Mais au milieu des années 90, ces hommes ont été licenciés et « lorsque la hiérarchie sociale change, les groupes habitués à des positions plus puissantes ou privilégiées réagissent avec une intense émotion à la perte de leur statut et du respect dont ils jouissaient ».
Ce ressentiment est particulièrement vif autour du service militaire, obligatoire pendant 18 mois pour les hommes valides, que beaucoup considèrent comme un fardeau injuste dans le contexte économique précaire actuel. Ce grief n'est pas nouveau : en 1999, la Cour constitutionnelle a invalidé le système de bonification pour service militaire, qui accordait des points supplémentaires aux anciens combattants dans les recrutements du secteur public. La Cour a estimé que ce système était discriminatoire envers les femmes et les personnes handicapées, renforçant ainsi le sentiment de nombreux jeunes hommes de perdre leurs privilèges traditionnels sans bénéficier de nouvelles protections.
Le sentiment de victimisation masculine est très répandu : une enquête réalisée en 2021 par Hankook Research a révélé que si seulement 38% des hommes âgés de 20 à 29 ans estimaient que les femmes étaient victimes d'une grave discrimination dans la société, 79% pensaient que les hommes l'étaient. 70% des hommes âgés de 30 à 39 ans se considéraient comme victimes de discrimination fondée sur le genre.
Montée en puissance des influenceurs antiféministes
Dans ce contexte de frustration, de nouvelles voix se sont élevées pour prétendre représenter les intérêts des jeunes hommes. Parmi elles, New Men's Solidarity, dont l'influence est devenue évidente lorsque l'agresseur de On a fièrement déclaré en être membre. Le groupe et son leader, Bae In-gyu – l'équivalent sud-coréen d'Andrew Tate [9] – accumulent des millions de vues sur YouTube avec des contenus qui attribuent les difficultés des jeunes hommes au féminisme. Bae affirme qu'il s'agit d'une « maladie mentale » et d'un « fléau social », et a suscité l'indignation en déclarant que les victimes du « nth room » étaient des « putes ».
La montée en puissance de Bae reflète le passage du mouvement antiféministe coréen de l'anonymat en ligne à l'action dans le monde réel. Raffiné et théâtral, il se présente dans des costumes impeccables, s'adressant à la foule sur des estrades ou du haut de véhicules, mêlant sa rhétorique à la politique d'extrême droite coréenne, farouchement anti-chinoise, anti-nord-coréenne et anticommuniste. À l'instar de ses homologues occidentaux, il présente les féministes comme une menace existentielle, des « misandres extrémistes » qui « prônent la suprématie féminine » dans le but précis de provoquer des conflits entre les sexes. Se désignant lui-même comme « hyung » (grand frère), Bae cultive un lien affectif avec des jeunes hommes désabusés, qu'il rallie à sa cause en leur demandant de financer son action militante par des dons.
Cette approche a inspiré un écosystème plus large de créateurs de contenu antiféministe, tels que le « cyber-saboteur » PPKKa, un YouTuber masqué comptant plus d'un million d'abonnés qui a été suspendu de YouTube pour avoir tourné en dérision les inquiétudes des femmes concernant la pornographie deepfake. Ensemble, ces personnalités numériques ont développé l'héritage des premiers militants pour les droits des hommes, tels que Sung Jae-gi du groupe Man of Korea, dont le suicide en 2013 – en se jetant d'un pont pour faire connaître son organisation – a créé une figure martyre pour le mouvement que Bae allait plus tard rebaptiser et radicaliser.
L'instrumentalisation politique
Ces voix antiféministes ont eu une influence déterminante sur la politique du pays. Le 27 mai dernier, quatre candidats en lice pour devenir le prochain président de la Corée du Sud se sont affrontés lors d'un débat télévisé national. Lee Jun-seok, 40 ans, diplômé de Harvard et dirigeant du parti conservateur Reform, une formation relativement peu importante, a posé une question crue à l'un de ses rivaux : « Si quelqu'un dit vouloir enfoncer des baguettes dans les parties génitales d'une femme ou dans un endroit similaire, est-ce de la misogynie ? » La remarque de Lee a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, des étudiant.e.s ont fait des conférences de presse pour exiger le retrait de Lee de la course et des associations de femmes ont saisi la justice.
Lee s'est d'abord fait connaître en tant qu'expert, affirmant que la jeune génération « n'avait pas connu les inégalités entre les sexes » et que les politiques telles que les quotas pour les femmes étaient « anachroniques ». De la même manière que pour Jordan Peterson [10] en Occident, les références élitistes et le style éloquent de Lee ont donné une légitimité intellectuelle à des opinions qui étaient jusqu'alors confinées à des forums namcho sous couvert d'anonymat.
Son message antiféministe a été repris par l'ancien président Yoon Suk Yeol [11], qui a compris à quel point ce discours pouvait mobiliser efficacement les jeunes électeurs masculins. Lors de sa campagne électorale en 2022, cet ancien procureur sans expérience politique préalable a affirmé qu'il n'y avait « aucune discrimination structurelle fondée sur le genre » en Corée du Sud. Dans une démarche qui préfigurait l'attaque de l'administration Trump contre les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis, Yoon a promis de supprimer le ministère de l'Égalité des sexes au motif qu'il se focalisait trop sur les droits des femmes et n'était plus nécessaire. Cette stratégie s'est avérée déterminante dans l'une des élections présidentielles les plus serrées de l'histoire de la Corée du Sud, Yoon l'emportant avec seulement 0,73% d'avance, soit moins de 250 000 voix. Les sondages à la sortie des urnes ont révélé un fossé considérable entre les sexes parmi les jeunes électeurs : près de 59% des hommes dans la vingtaine ont soutenu Yoon, tandis que 58% des femmes du même âge ont soutenu son adversaire progressiste.
Sous la présidence de Yoon, les budgets consacrés aux programmes de prévention de la violence à l'égard des femmes ont été réduits et les mots « égalité des sexes » ont été supprimés des politiques gouvernementales et des programmes scolaires. Dans la nuit du 3 décembre 2024, Yoon a fait une déclaration stupéfiante : il a décrété la loi martiale pour lutter contre les « forces anti-étatiques » et a accusé le parlement, contrôlé par l'opposition, d'être un « repaire de criminels ». En quelques heures, les troupes ont encerclé l'Assemblée nationale et on a vu des élus sauter par-dessus les grilles et bousculer les soldats pour organiser un vote d'urgence. Le décret a été abrogé six heures seulement après son entrée en vigueur.
S'ensuivirent plusieurs mois de manifestations massives réclamant la destitution de Yoon, menées en grande partie par des jeunes femmes. Dans le vieux palais de Gyeongbokgung à Séoul [12], Jeong Yeong Eun, de l'Association des femmes de Séoul, a organisé les rassemblements féministes « Yoon Suk Yeol out », au cours desquels les participantes ont tour à tour dénoncé les atteintes du gouvernement aux droits des femmes. « Lorsqu'il a déclaré la loi martiale, cela s'inscrivait dans la continuité de la manière dont son administration avait sapé la démocratie et exclu la voix des femmes », m'avait-t-elle confié à l'époque. Ces manifestations se sont poursuivies tout au long de l'hiver rigoureux de Séoul. « Les gens présentent les choses comme si les femmes venaient d'apparaître pour la première fois », a déclaré Jeong. « Nous avons toujours été présentes dans les mouvements de protestation précédents. Nous sommes déterminées à ne pas laisser nos apports être effacés et à faire entendre notre voix. »
En avril, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a confirmé à l'unanimité la destitution de Yoon, estimant que sa proclamation de la loi martiale constituait une « grave trahison de la confiance du peuple ». Les élections anticipées qui ont suivi en juin 2025 ont vu Lee Jae Myung [13] du Parti démocrate remporter la victoire avec 49,4% des voix.
Mais c'est Lee Jun-seok qui allait être le symbole de la profondeur du fossé entre les sexes en Corée du Sud. Ses remarques sur les baguettes lui ont peut-être coûté des voix, mais elles ont renforcé son attrait auprès de ses principaux partisans. Bien qu'il n'ait obtenu que 8,34% des voix au niveau national, les résultats des sondages à la sortie des urnes ont révélé une autre fracture profonde entre les sexes et les âges : près d'un homme sur quatre ayant entre 20 et 29 ans a voté pour lui, ainsi que 17,7% des hommes âgés de 30 à 39 ans. Méprisants à l'égard des candidats traditionnels, ils se sont ralliés à une figure qui incarnait leur ressentiment à l'égard du féminisme, du service militaire et de ce qu'ils percevaient comme une discrimination à rebours. Même le nouveau président Lee Jae Myung a semblé se rallier à cette cause en juillet lorsqu'il a demandé à son cabinet d'étudier la « discrimination masculine » et d'élaborer des contre-mesures.
Des tendances mondiales, des extrêmes coréens
Cette fracture politique entre les sexes n'est pas propre à ce pays : elle s'inscrit dans une tendance mondiale qui voit les jeunes femmes pencher vers la gauche tandis que les jeunes hommes dérivent vers la droite. Cependant, nulle part ailleurs le « fossé idéologique » n'est aussi extrême qu'en Corée du Sud, où la fracture est exacerbée par la collision entre les pressions économiques et l'évolution des valeurs, selon la politologue Min Hee Go de l'université féminine Ewha [14] à Séoul. « Il s'agit de savoir qui obtient la plus grande part du gâteau, qu'il s'agisse de ressources matérielles, de perspectives d'emploi ou même de bons partenaires », explique-t-elle. « La concurrence est très rude, en particulier dans un environnement où les jeunes doivent rivaliser comme jamais auparavant. »
Les élections de cette année ont également envoyé un signal d'alarme concernant l'avenir de la participation des femmes à la vie politique sud-coréenne. Pour la première fois en 18 ans, aucun des six candidats à la présidence n'était une femme.
Alors que la guerre des sexes s'intensifie, même les anti-misogynes ont parfois adopté des tactiques toxiques. Ce qui a commencé comme un « miroir » – renverser la rhétorique misogyne pour cibler les hommes – s'est transformé en formes de résistance de plus en plus extrêmes. Ainsi, tandis que les forums masculins se moquaient du corps des femmes, les féministes de Megalia [15] – une communauté en ligne apparue en 2015 – ont tourné en dérision la taille du pénis. Lorsque les femmes ont été qualifiées de « salopes au kimchi », les Megaliennes ont inventé des termes pour désigner les hommes, tels que hannam-chung (« insecte masculin coréen »). Bien que Megalia ait désormais fermé ses portes, elle est devenue un bouc émissaire commode pour ceux qui cherchent à délégitimer l'activisme féministe.
Au cours de l'année écoulée, l'attention mondiale s'est tournée vers le mouvement marginal « 4B » [16], qui prône le retrait complet d'un système qu'il considère comme irrémédiablement patriarcal. Ses adeptes rejettent les rencontres amoureuses, le mariage, la maternité et toute relation romantique avec un homme.
Ces réactions radicales ont contribué à alimenter une opposition plus large au féminisme. Même les hommes et les femmes qui soutiennent l'égalité des sexes prennent désormais souvent leurs distances par rapport à ce terme, qui tend à être assimilé à une injure. Aujourd'hui, le simple fait d'être accusé de sympathies féministes peut pousser les entreprises à présenter des excuses publiques.
En 2023, une animation apparemment anodine dans une publicité pour le jeu MapleStory a déclenché une tempête. Elle montrait le geste d'une main passant d'un poing à un cœur, mais les joueurs masculins ont affirmé que cette figure pouvait être interprétée comme un signe féministe se moquant du petit appareil génital masculin. En quelques heures, les forums en ligne se sont enflammés. Le studio a publié des excuses et des utilisateurs anonymes ont passé au crible les comptes de réseaux sociaux des employées féminines, à la recherche de preuves de sympathies féministes. Lorsqu'ils ont découvert une artiste féminine qui correspondait à leur image de l'ennemie, ils ont exigé son licenciement immédiat.
La société, initialement prête à se plier à leur demande, n'a changé d'avis qu'après l'intervention de la Korean Game Consumer Society, qui a convaincu la direction de rester ferme face à cette bande de cyber-agresseurs. L'ironie de la situation, c'est que par la suite, il s'est avéré que l'animation avait été conçue par un artiste masculin d'une quarantaine d'années. Malgré cela, l'artiste féminine a subi un « doxage » en ligne et a été victime de harcèlement et d'insultes à caractère sexuel.
Établir des passerelles
Un certain nombre de militant-e-s travaillent discrètement pour s'attaquer aux causes profondes de la fracture entre les sexes en Corée du Sud. Dans son bureau confortable, aux allures de chalet, situé près du marché Mangwon de Séoul [17], Lee Han se prépare à parcourir le pays pour animer des débats dans les classes sur la violence sexiste. Il s'agit d'un équilibre délicat à trouver, car les écoles lui demandent souvent d'éviter d'aborder tout sujet jugé controversé. Mais Lee et son groupe, « Féminisme avec lui », insistent sur le fait que le dialogue est la seule voie à suivre : « Nous devons nous exprimer et partager ce que nous avons appris. » Ce qui a commencé en 2017 comme un petit club de lecture féministe s'est rapidement transformé en quelque chose de plus ambitieux. Aujourd'hui, avec huit membres actifs, ils organisent des discussions, participent à des rassemblements politiques et s'efforcent de créer des espaces de dialogue véritable sur le genre.
L'approche de Lee est modelée par son propre parcours dans l'armée : « C'était horrible. On ne peut même pas mettre les mains dans ses poches, écouter de la musique, boire ou fumer tranquillement. Se voir privé de ses libertés est traumatisant et effrayant. » Aujourd'hui, il enseigne également l'égalité des sexes aux responsables militaires et aux officiers supérieurs, et fait valoir que les hommes qui canalisent leur ressentiment sur les femmes se trompent de cible. « Qui a créé ce système ? Les hommes, pas les féministes. Les responsables politiques masculins et les institutions se sont dit : les hommes sont forts, les femmes sont faibles, donc n'envoyez pas de femmes à l'armée », explique-t-il. Malgré les pressions en faveur d'une réforme, le ministère de la Défense affirme qu'il n'a pas l'intention d'introduire la conscription féminine.
Les initiatives visant à résoudre ces problèmes se heurtent à une résistance farouche, en particulier de la part du puissant lobby chrétien conservateur sud-coréen, qui a réussi à bloquer la législation anti-discrimination pendant près de deux décennies. « On m'a empêché de prendre la parole dans les écoles parce qu'ils se plaignaient que je faisais la promotion du féminisme », explique Lee. Pourtant, lui et ses collègues restent déterminés. Bien qu'ils soient peu nombreux, leur travail donne l'espoir qu'un dialogue est possible. « Les jeunes hommes ne peuvent pas exprimer leurs peurs et leurs angoisses », explique Lee. « Dans la culture masculine, en particulier en Corée, où la hiérarchie est si importante en raison des valeurs confucéennes [18], vous ne pouvez pas vous exprimer face à vos supérieurs. Alors, où va cette frustration ? Elle est dirigée vers les femmes, qui sont une cible plus facile. » En créant des espaces sûrs où les hommes peuvent discuter ouvertement de ces questions, des groupes comme le sien visent à rediriger cette colère vers un changement constructif.
Regarder vers l'avenir
De retour à Jinju, On est toujours en convalescence après l'agression. Elle a récemment passé un mois à l'hôpital pour soigner son traumatisme. Après une année dominée par les procédures judiciaires, elle souhaite simplement retrouver une vie normale : « Je veux trouver du travail, inviter ma famille à manger et acheter des jouets pour mon chat. »
Elle a été émue par le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour sa cause. Quand la pétition demandant que son agresseur soit puni a atteint 50 000 signatures en moins d'un mois, elle a créé un compte sur les réseaux sociaux pour remercier les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. Petit à petit, elle a commencé à publier des informations actualisées sur son procès, ce qui a amené tellement de personnes à venir l'assister que certaines ont dû rester debout. Elle continue de partager des informations sur des affaires similaires, ce qu'elle considère comme un petit geste de solidarité envers les autres victimes.
« Je n'aurais pas survécu à cette année sans les personnes qui m'ont soutenue », dit-elle. Pour On, la solution ne consiste pas à se disputer pour savoir qui souffre le plus de discrimination. « Nous devons nous concentrer sur la manière de résoudre ces conflits et de créer une société plus saine pour tout le monde », dit-elle.
Raphael Rashid
Source – The Guardian. 21 septembre 2025 :
https://www.theguardian.com/society/2025/sep/20/inside-saturday-south-korea-gender-war
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76427
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Notes
[1] inju est une ville provinciale de moins de 350 000 habitants située dans la province du Gyeongsang du Sud, à quatre heures de Séoul en train à grande vitesse.
[2] L'OCDE est un groupe de 38 pays, pour la plupart riches, qui collaborent dans le domaine de la politique économique.
[3] Gangnam est le quartier d'affaires et de divertissement huppé de Séoul, rendu célèbre dans le monde entier par la chanson « Gangnam Style » de Psy.
[4] L'affaire « nth room » concernait un réseau de forums de discussion sur Telegram où des utilisateurs faisaient chanter des femmes et des mineures pour qu'elles produisent du matériel sexuellement explicite en les soumettant à l'esclavage sexuel numérique.
[5] lbe (일베) est l'abréviation de « Ilgan Best » (le meilleur quotidien), un forum en ligne tristement célèbre pour sa misogynie extrême et ses opinions politiques d'extrême droite, qui a atteint son apogée en termes de popularité au milieu des années 2010
[6] La catastrophe du ferry Sewol a coûté la vie à 30 personnes, principalement des lycéen.ne.s, lorsque le ferry a chaviré au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud en avril 2014, ce qui a constitué une tragédie nationale qui a révélé l'incompétence du gouvernement
[7] Le néolibéralisme désigne les politiques économiques de libre marché qui mettent l'accent sur la déréglementation, la privatisation et la réduction de l'intervention gouvernementale, ce qui conduit souvent à une augmentation des inégalités économiques.
[8] La Corée du Sud est passée d'une dictature militaire à la démocratie à la fin des années 1980.
[9] Andrew Tate est un influenceur anglo-américain controversé, connu pour ses opinions misogynes extrêmes et sa promotion de la masculinité toxique en ligne.
[10] Jordan Peterson est un psychologue et auteur canadien qui est devenu populaire auprès des jeunes hommes pour son opposition au féminisme et aux idées politiques progressistes.
[11] Yoon Suk-yeol a été président de la Corée du Sud de mai 2022 jusqu'à sa destitution en décembre 2024.
[12] Le palais Gyeongbokgung est un palais royal du XIVe siècle situé dans le centre de Séoul, l'un des sites historiques les plus importants de Corée du Sud
[13] Lee Jae-myung est un homme politique progressiste qui dirige le Parti démocratique de Corée, le principal parti d'opposition sud-coréen.
[14] L'université féminine Ewha est la plus prestigieuse université féminine de Corée du Sud, fondée en 1886.
[15] Megalia était une communauté féministe radicale en ligne active de 2015 à 2017, dont le nom est tiré d'un roman de Charlotte Perkins Gilman.
[16] Le mouvement « 4B » encourage les femmes à rejeter quatre pratiques : les rendez-vous avec les hommes (biyeonae), le mariage avec les hommes (bihon), l'accouchement (bichulsan) et les relations sexuelles avec les hommes (bisekseu).
[17] Le marché Mangwon est un marché traditionnel situé dans le quartier Mapo de Séoul, connu pour son caractère convivial et ses petits commerces
[18] Le confucianisme est un système philosophique et éthique qui met l'accent sur la hiérarchie, le respect de l'autorité et l'harmonie sociale, et qui a une grande influence sur la société coréenne