Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Gaza. Le conseil de sécurité de l’ONU contre le droit international

La tentative d'effacer le droit applicable en Palestine se prolonge dans la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Adoptée le 17 novembre 2025 par 13 voix favorables, en dépit des abstentions russe et chinoise, ce texte est contraire au droit international. En conséquence, les États membres des Nations unies ne devraient participer ni à la « force internationale » ni au « conseil de paix » prévus par l'organe politique de l'ONU.
Tiré d'Orient XXI.
En 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a considéré qu'Israël, ayant violé des normes impératives de droit international (normes dites de jus cogens (1)), devait, sans négociation, se retirer du territoire palestinien occupé, démanteler les colonies, et réparer tous les dommages causés par son occupation illicite. La CIJ a aussi rappelé que tous les États devaient prendre des mesures aux fins de forcer Israël à ce retrait et de prévenir le génocide de Gaza. Le retrait d'Israël, attendu pour septembre 2025 selon la résolution de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024, ne s'est pas produit, et rares sont les États ayant adopté le comportement qui était exigé d'eux face au génocide de Gaza.
À l'inverse, une initiative diplomatique franco-saoudienne a cherché à convaincre de revenir aux méthodes éculées de la négociation, en soutenant l'émergence d'un État de Palestine diminué : c'était la déclaration de New York, endossée par l'Assemblée générale le 10 septembre 2025. En marge de cette Assemblée générale, le président états-unien présentait son plan pour Gaza. La première étape, la seule acceptée par les groupes combattants palestiniens, a conduit à un cessez-le-feu — non respecté par Israël —, à la libération des Israéliens détenus à Gaza et de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces derniers, comme les dépouilles des Palestiniens restituées, ont confirmé l'infliction de sévices particulièrement choquants.
Alors que le plan Trump était approuvé par de nombreux États lors de la conférence de Charm El-Cheikh du 13 octobre 2025, les États arabes ou musulmans sollicités pour participer à la force internationale envisagée demandaient qu'un mandat de l'ONU vienne autoriser cette participation. C'est pourquoi les États-Unis ont saisi le Conseil de sécurité de leur plan, alors même qu'ils avaient, pendant plus de deux ans, empêché cet organe de réagir au génocide de Gaza, en utilisant leur veto de manière récurrente.
Le Conseil de sécurité ne dit pas le droit
Est-ce à dire que la résolution 2803 où le Conseil « fait sien » le plan Trump, qui y est annexé, efface et remplace le droit international applicable ? En réalité, le Conseil de sécurité n'a pas pour fonction de dire le droit international. Selon la Charte des Nations unies, il est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale (article 24) et exerce ses pouvoirs selon les chapitres VI et VII. Sur la base du chapitre VII, il peut décider de mesures s'imposant aux États et, le cas échéant, autoriser l'emploi de la force pour réagir à une situation de crise grave. Il agit par des résolutions spécifiques, dans des situations données, dans l'objectif de maintenir ou de restaurer la paix. Il ne légifère pas plus qu'il ne tranche, en droit, des différends. De plus, le Conseil ne peut pas adopter n'importe quelle décision, dans n'importe quelle situation, et il doit « agir conformément aux buts et principes des Nations unies » (article 24 §2).
La question du contrôle du Conseil de sécurité, c'est-à-dire du contrôle de la légalité de ses résolutions, a été au centre de l'attention internationale, notamment à partir des résolutions adoptées contre la Libye à la suite de l'attentat de Lockerbie en 1988 (2). Elle a été discutée devant des juges variés s'agissant de la situation dans l'ex-Yougoslavie (Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie), de la lutte contre le terrorisme (Cour de justice de l'Union européenne), de l'intervention en Irak de 2003 (Cour européenne des droits de l'homme). S'il reste difficile de faire contrôler cette légalité, les juristes savent que ce n'est pas impossible. Dans un monde idéal, l'Assemblée générale pourrait par exemple saisir la CIJ afin qu'elle examine la conformité de la résolution 2803 à son propre avis de 2024. Mais l'année 2025 nous a appris qu'il ne fallait pas trop attendre de l'Assemblée générale.
Mettre en évidence l'absence de respect des normes impératives du droit international par le Conseil de sécurité est simple : s'agissant de la Palestine, ce droit vient tout juste d'être rappelé par l'organe judiciaire principal des Nations Unies qu'est la CIJ. C'est également utile : les États ne sont nullement tenus de contribuer au plan d'occupation de Gaza soutenu par le Conseil de sécurité, la résolution ne faisant que les y « autoriser » ou le leur « demander ». Ils pourraient vouloir éviter de contribuer directement à la violation de ces normes impératives par l'envoi de contingents à Gaza. Cette illicéité imprégnerait aussi toute l'activité économique espérée par Trump et ses proches : les contrats et accords passés en ce sens devraient être considérés comme nuls, et les entreprises y contribuant devraient être boycottées. Au Conseil de sécurité, la Russie a explicitement évoqué cette illicéité et mis en garde les États ayant voté pour le texte (3).
Une force d'occupation
La résolution autorise tout d'abord les États à déployer des contingents à Gaza. Ceci, en soi, n'est pas inédit, le Conseil ayant régulièrement, depuis 1991 et la première intervention états-unienne en Irak, recouru à ce procédé d'autorisation d'emploi de la force donnée à des États. Soulignons que ce procédé n'est pas celui des opérations de maintien de la paix, où des casques bleus sont déployés, sous l'autorité de l'ONU, sans avoir pour mandat de recourir à la force. Ici, il n'est pas question d'une opération de maintien de la paix, et c'est bien ce qui semble avoir dissuadé nombre d'États de participer directement à la « force internationale de stabilisation » autorisée par le Conseil. De quoi est-il donc question ?
Il s'agit principalement de réaliser ce que l'armée israélienne n'a pu accomplir : assurer « la démilitarisation de la bande de Gaza, y compris en procédant à la destruction des infrastructures militaires, terroristes et offensives et en empêchant qu'elles soient rebâties, ainsi qu'en veillant à la mise hors service définitive des armes des groupes armés non étatiques ». Il est question de désarmer les groupes palestiniens combattants donc et, selon les termes du plan Trump annexé à la résolution, de « déradicaliser Gaza ». Cette mission, qui exige l'emploi de la force dès lors que les groupes palestiniens n'ont pas accepté de rendre les armes, doit être réalisée « en consultation étroite » avec l'Égypte et Israël. La force internationale de stabilisation doit en conséquence être considérée comme une force d'occupation associée à Israël. Or, on l'a dit, le contrôle du territoire palestinien par Israël a été tenu pour gravement illicite par la CIJ, car portant atteinte au droit impératif du peuple palestinien à disposer de lui-même. Contrairement à ce qu'a demandé la même CIJ, la résolution permettrait à Israël de ne pas se retirer.
Une occupation qui ne dit pas son nom
Le contrôle de Gaza est nécessaire pour mettre en place une sorte de gouvernement (« une administration transitoire »), sous l'autorité d'un Conseil de paix, qui serait selon nous, mieux dénommé « conseil d'occupation et de spoliation ». C'est le deuxième aspect essentiel de la résolution. Ce conseil aurait pour vocation d'« œuvrer à la reconstruction de Gaza et à l'exécution des programmes de relèvement économique ». À cette fin, le Conseil de sécurité dote l'instance d'une « personnalité juridique internationale » lui permettant de conclure tous accords ou contrats. La Banque mondiale, une institution dominée par les États-Unis, est invitée à faciliter les financements du programme. Dans le langage non euphémisé du document Trump annexé à la résolution, le plan de relèvement économique
- sera élaboré par un groupe d'experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Proche-Orient. Nombre de projets d'investissement intéressants et d'idées de développement prometteuses émanant de groupes internationaux animés de bonnes intentions seront examinés, le but étant d'élaborer un cadre régissant à la fois les questions de sécurité et les questions de gouvernance qui soit à même d'attirer et de faciliter des investissements générateurs d'emploi, de débouchés et d'espoir pour la future Gaza.
Afin de réaliser ce plan, correspondant globalement à celui de la « Riviera » annoncé par Trump au début de l'année 2025, le conseil pourra « accomplir toute tâche jugée nécessaire ». Si la résolution n'évoque jamais la question de l'exploitation des ressources naturelles, notamment maritimes, le blanc-seing donné permet de conclure des contrats à cette fin. Ce projet est contraire au droit du peuple palestinien de disposer de lui-même dans ses dimensions économiques, incluant ses choix propres de développement et la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Les Palestiniens sont relégués à un « comité à caractère technocratique et apolitique … chargé d'expédier les affaires courantes du territoire »…
Certes, l'administration est dite « transitoire », mais les perspectives d'autodétermination que la résolution a dû intégrer sont plus que distantes, et encore conditionnées. Ainsi, le conseil œuvrera jusqu'à ce que l'Autorité palestinienne ait « scrupuleusement exécuté son programme de réformes et que la reconstruction de Gaza ait progressé ». Alors, seulement, « les conditions seront peut-être (sic) réunies pour que s'ouvre un chemin crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État souverain ». Qui en décidera ? Washington instaurerait alors un « dialogue entre Israël et les Palestiniens pour qu'ils conviennent d'un horizon politique au service d'une coexistence pacifique et prospère ». L'horizon envisagé est lointain, flou, contraint et, à vrai dire, inaccessible. La référence à un État palestinien est une parfaite illusion. Si le blanc-seing est accordé par le Conseil de sécurité jusqu'en décembre 2027, sans contrôle de l'ONU (points 8 et 10 de la résolution), le système pourrait être prolongé.
Nouveau mandat sur la Palestine ?
Nombre de commentateurs ont analysé cette résolution comme autorisant un « nouveau mandat » sur Gaza. Mais, au moins, le régime des mandats institué par la Société des Nations, ou le régime des territoires non autonomes de l'ONU (4), prévoyaient, en théorie du moins, une administration dans l'intérêt des populations locales. Ici, le pouvoir est attribué nommément à un président états-unien qui ne masque pas ses intérêts personnels et dont le gendre, Jared Kushner, a été présenté comme le principal investisseur à Gaza par un autre homme d'affaires, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Certes, la résolution affirme que ce sont des « États membres » qui siégeront au conseil. Mais le plan Trump annexé est beaucoup plus clair : le conseil « sera dirigé et présidé par le président Donald J. Trump », les autres membres « y compris des chefs d'État, seront annoncés ultérieurement, l'ancien premier ministre Tony Blair en faisant partie ». Le pouvoir est donc donné à un groupe de personnes entendant tirer des profits personnels de l'opération, et ceci est inédit. L'intérêt du peuple palestinien n'est, par ailleurs, jamais mentionné dans la résolution, le « relèvement économique » ne semblant pas le concerner, tandis qu'aucune redistribution des profits attendus n'est envisagée. Le plan Trump évoque quant à lui « une gouvernance moderne et efficace à même de servir la population de Gaza »… et « d'attirer les investissements ».
Par-delà l'occupation prolongée, le dispositif permet donc la spoliation du peuple palestinien, au profit d'une élite impérialiste états-unienne décomplexée. Ainsi, les accords et contrats conclus par le conseil d'occupation pourront être considérés comme invalides : un traité contraire au jus cogens doit être tenu pour nul selon le droit international (article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). Les accords qui seraient adoptés par l'Union européenne pourraient, par exemple, être contestés devant ses juridictions, comme le furent ceux conclus avec le Maroc pour l'exploitation des ressources du Sahara occidental. La grande majorité des groupes palestiniens et des ONG palestiniennes a d'ailleurs ouvertement dénoncé la résolution 2803 ; seul le Fatah de Mahmoud Abbas, dont la représentativité est largement contestée, l'a acceptée.
L'oubli du génocide
Pour exercer ses pouvoirs relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité doit qualifier une situation de crise grave (menace contre la paix, rupture de la paix, acte d'agression selon l'article 39). Comment la résolution 2803 appréhende-t-elle la situation à Gaza ? Alors même que nous sommes en présence d'un génocide qui se prolonge, rien n'en transparait dans le préambule de la résolution. Il est simplement indiqué que « la situation dans la bande de Gaza menace la paix régionale et la sécurité des États voisins »… Or, dans des résolutions antérieures adoptées en situation génocidaire, et autorisant les États à employer la force, le Conseil se réfère normalement à la situation humanitaire. Il n'en est rien ici. Il ne s'agit évidemment pas, comme précédemment, d'un mandat visant à « protéger les civils en danger » (5).
Ainsi, le Conseil de sécurité confère à ceux qui ont détruit Gaza, le pouvoir de « stabiliser », désarmer, et développer cet espace. Le principe de responsabilité pour génocide est totalement éludé. La résolution permet la poursuite du génocide, sans même insister sur la situation de la population de Gaza, sauf à exiger sa « déradicalisation » ; à cet égard, elle est également contraire à la norme impérative de jus cogens interdisant le génocide. Elle pourrait permettre d'en effacer certaines preuves.
Le peuple palestinien de Gaza y est décrit comme un ensemble de « personnes », « libres de s'en aller et libres de revenir » ou comme des « habitants » encouragés à rester, auxquels sera « offerte » la « possibilité de reconstruire Gaza en mieux » (plan Trump, point 12 ; résolution point 4 b.4.) car Gaza sera « rebâtie pour le bien de ses habitants » (plan Trump, point 2). Dans « la nouvelle Gaza », les Palestiniens ne sont pas un peuple, tout au plus une population, ils ne sont pas acteurs. Mais ils ne sont pas non plus victimes d'un génocide, même s'ils « n'ont que trop souffert » (plan Trump, point 2).
La résolution du Conseil de sécurité comprend, il est vrai, un volet humanitaire ; ses termes sont toutefois très inquiétants. Car si le Conseil « souligne qu'il importe d'assurer une reprise complète de l'aide humanitaire (…) par l'entremise des organisations coopérant à cette fin, dont l'Organisation des Nations unies », cette reprise peut être conditionnée. Ainsi, elle est assurée « en concertation avec le Conseil de paix » et ne devra pas « être détournée pas des groupes armés ». Cette dernière formule renvoie aux accusations israéliennes contre le Hamas plus qu'à l'accaparement de l'aide par les milices soutenues par Israël. Ainsi, la fin du siège n'est pas exigée. Donald Trump pourra parfaitement relayer les exigences d'Israël : le droit à l'assistance, et l'exigence de permettre intégralement le passage de l'aide humanitaire, rappelés par la CIJ en 2024 et 2025 ne sont pas garantis.
Pressions et chantage
Il faut finalement insister sur les conditions d'adoption de la résolution et du plan Trump qu'elle fait sien. Le Conseil de sécurité affirme d'emblée que « les parties » ont accepté ce plan. Or, cette affirmation est fausse : il est bien connu que les groupes armés palestiniens auxquels le plan a été présenté ne l'ont pas soutenu dans son intégralité. L'acceptation, inexistante, ne peut donc justifier le caractère exorbitant de la résolution. Pire, il est aussi connu que le plan Trump, pour sa première phase, a été accepté sous les menaces habituelles du président états-unien : « Un enfer comme personne n'en a jamais vu s'abattra sur le Hamas », a-t-il ainsi déclaré (6). Or, un accord conclu sous la contrainte immédiate n'est pas valide en droit international (Convention de Vienne sur le droit des traités, articles 51 et 52 : la contrainte est une autre cause de nullité des traités) ; c'est probablement pourquoi le Conseil de sécurité doit déformer le réel en insistant sur « l'accord des parties ».
Les conditions d'adoption de la résolution elles-mêmes sont stupéfiantes, par-delà les promesses probablement faites, par-delà les pressions exercées sur certains des États ayant voté la résolution, tel l'Algérie. Les représentants des États-Unis aux Nations unies ont fait échec au texte alternatif présenté par la Russie en menaçant la population palestinienne. Le représentant Mike Waltz affirma explicitement que « voter contre ce projet de résolution, c'est voter pour la reprise de la guerre ». Au regard de l'implication des États-Unis dans le génocide de Gaza, il s'agit d'une menace grave, la résolution étant d'ailleurs cyniquement présentée comme le moyen de sauver les enfants de Gaza. Quelle valeur peut avoir un texte adopté sous la menace de génocide ?
Notes
1- NDLR. Du latin « droit contraignant », concerne des principes de droits réputés universels devant constituer les bases des normes impératives de droit international.
2- NDLR. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 du vol 103 de la Pan Am Airways reliant Londres à New York explose en plein vol et retombe sur la ville écossaise de Lockerbie. L'attentat fait 270 victimes. En 2003, le défunt président libyen Mouammar Kadhafi accepte d'assumer la responsabilité de l'attaque tout en affirmant ne pas en être à l'origine, et verse des indemnités aux familles des victimes.
3- Par exemple, pour le représentant russe, la résolution « n'est pas sans rappeler les pratiques coloniales et le mandat sur la Palestine (..) qui ne tenaient absolument pas compte des opinions des Palestiniens »… Il conclut que les membres du Conseil « ne pourront pas dire que nous ne les avons pas prévenus », procès-verbal de la séance d'adoption de la résolution, doc. S/PV.10046, pp. 17 et 18. La position de la Chine est similaire.
4- Article 22 du Pacte de la Société des Nations : « le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation… ». Bien sûr, le mandat sur la Palestine (1922) est spécifique en ce qu'il intègre la déclaration Balfour. Pour une analyse critique, voir notamment Rashid Khalidi, The hundred years' war on Palestine, Profile Books Ltd, 2020, not. pp. 34-39. … L'article 73 de la Charte des Nations Unies prévoit aussi, s'agissant des « territoires non autonomes », « la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ».
5- Voir par exemple la résolution 929 (1994) autorisant le déploiement « force Turquoise ». Elle considère que « l'ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région » (préambule) et définit le mandat de la force comme « visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda » (point 2).
6- Callum Sutherland, Time, 3 octobre 2025.

Que peut-on attendre de la seconde phase d’un plan de “paix” qu’Israël n’a jamais respecté ?

Alors qu'Israël a assassiné plus de 360 Palestinien-nes au cours de la première phase du “cessez-le-feu” actuellement en vigueur à Gaza, les négociations pourraient reprendre afin d'appliquer la seconde phase de l'accord.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La remise du corps du dernier captif israélien par le Hamas pourrait advenir dans les prochains jours, une condition qu'Israël posait pour ouvrir les négociations concernant la “phase deux” de l'accord de “paix” soutenu par les États-Unis.
Bilan de la “phase une”
Dans le cadre de la première phase, fondée sur le plan de paix en 20 points du président américain Donald Trump, Israël devait mettre fin à sa guerre génocidaire contre Gaza, retirer ses troupes, autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire et échanger des centaines de détenus palestiniens contre les prisonniers encore retenus à Gaza.
Si les échanges de prisonniers ont bien eu lieu, Israël n'a pas respecté ses autres engagements. Dans des attaques presque quotidiennes sur la bande de Gaza, l'armée israélienne a assassiné plus de 360 Palestinien-nes au cours de près de 600 violations du cessez-le-feu, et elle a continué de bloquer l'aide humanitaire promise. Mais aussi, le Hamas l'accuse d'avoir avancé la “ligne jaune” démarquant son retrait, grignottant continuellement l'espace restant aux Palestinien-nes.
Au vu de ce comportement, et de la rupture unilatérale par Israël du précédent cessez-le-feu en mars dernier, on ne peut qu'être sceptique quant à sa détermination à respecter l'accord en vigueur.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant déclaré dimanche 7 décembre qu'il s'entretiendra avec le président états-unien Donald Trump à la fin du mois sur la manière de garantir la mise en œuvre de la “phase deux”, tout en la qualifiant de “plus difficile”.
Une “phase deux” vague et précaire
Le plan de Trump ne comprend pas de détails concrets ni de calendrier, ce qui laisse planer beaucoup d'inconnues sur la possible application de sa deuxième phase.
Cette prochaine étape prévoit une phase de transition pendant laquelle des technocrates palestinien-es, non-affilié-es à des factions politiques, assureraient la gestion quotidienne des affaires publiques.
Leur travail serait supervisé par un “Conseil de paix” multinational et soutenu par une force internationale de stabilisation chargée de la sécurité et de la démilitarisation. L'objectif serait de permettre la reconstruction de Gaza et d'empêcher la reprise du conflit armé.
Toutefois, les dernières opérations de l'armée israélienne laissent craindre que cette “reconstruction” pourrait se limiter aux zones contrôlées par Israël, qui prévoit de construire des “communautés alternatives sûres” (ASC). Ce projet soulève de vives inquiétudes car il entraînerait une division de l'enclave palestinienne et le déplacement massif de sa population.
La phase deux prévoit un nouveau retrait des troupes israéliennes, mais l'armée israélienne a déclaré dimanche que la ligne jaune de démarcation était une « nouvelle frontière », laissant entendre qu'elle ne se retirerait pas davantage, malgré ses engagements à le faire.
« Nous avons le contrôle opérationnel sur une grande partie de la bande de Gaza et nous resterons sur ces lignes de défense », a déclaré le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir. « La ligne jaune est une nouvelle ligne frontière, qui sert de ligne de défense avancée pour nos communautés et de ligne d'activité opérationnelle. »
En réponse, le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a déclaré qu'un véritable cessez-le-feu « ne peut être conclu sans un retrait complet » des forces israéliennes, parallèlement au rétablissement de la stabilité et de la liberté de mouvement pour les Palestinien-nes, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent dans la première phase du plan.
Un plan contraire au droit international
Basem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré dimanche que l'accord nécessitait “de nombreuses clarifications”, car il comporte des points qui ont toujours constitué une ligne rouge pour le Hamas : son désarmement, et l'instauration d'un mandat international, en contradiction du droit des Palestinien-nes à l'autodétermination.
Si le groupe se dit prêt à discuter du “gel ou du stockage” des armes pendant la trêve, il a toutefois précisé qu'il n'accepterait pas qu'une force internationale de stabilisation se charge du désarmement.
“Nous accueillons favorablement la présence d'une force [des Nations Unies] près des frontières, chargée de superviser l'accord de cessez-le-feu, de signaler les violations et de prévenir toute escalade”, a-t-il déclaré, ajoutant que le Hamas n'accepterait pas que cette force ait “quelque mandat que ce soit” sur le territoire palestinien.
Le plan de “paix” de Trump est critiqué en ce qu'il va à l'encontre des récentes conclusions de la Cour de Justice Internationale, qui a statué que Gaza (de même que la Cisjordanie) est illégalement occupée et cette occupation doit prendre fin.
Le plan de “paix” porté par Trump et approuvé par l'ONU prolonge l'occupation israélienne, approuve la présence indéfinie des troupes du régime israélien et y superpose une deuxième occupation menée par les États-Unis.
Cette critique a notamment été portée en France par la sociologue Tatiana Svorou, qui concluait ainsi une tribune parue le 4 décembre dernier dans le journal le Monde : “Tant que le système international ne confrontera pas l'écart profond entre ses engagements juridiques et ses comportements géopolitiques, chaque « plan de paix » imposé aux Palestiniens fonctionnera moins comme une voie vers la justice que comme un mécanisme sophistiqué de retardement – maintenant l'avenir d'un peuple en otage des intérêts de ceux qui prétendent l'arbitrer.”

Comment le « plan de Trump » pour Gaza permet une nouvelle appropriation de terres par Israël

Le 18 novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2803, approuvant officiellement le plan en 20 points du président Trump pour l'avenir de Gaza. Publié initialement comme document de base de l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre, ce plan établit plusieurs structures fondamentales : premièrement, une « ligne jaune » qui délimite les zones de Gaza où l'armée israélienne maintiendra une présence sur le terrain ; deuxièmement, une Force internationale de stabilisation qui servira de « solution à long terme pour la sécurité intérieure », supervisée par un « Comité de la paix » présidé par Trump lui-même ; troisièmement, « un Conseil palestinien technocratique et apolitique » composé d'experts palestiniens et internationaux chargés de gérer la « gouvernance transitoire » de Gaza ; et enfin, un « plan de développement économique de Trump pour reconstruire et dynamiser Gaza ». [Le Monde du 7 décembre en chapeau écrivait : « Le lieutenant-général Eyal Zamir a déclaré, dimanche, que « la “ligne jaune” constitue une nouvelle frontière, une ligne de défense avancée pour les localités israéliennes et une ligne d'attaque ». – Réd.]
Tiré de A l'Encontre
9 décembre 2025
Par Anne Irfan (Jewish Currents)
Poursuivant les hyperboles de ses déclarations selon lesquelles il aurait mis fin à « 3000 ans » de guerre au Moyen-Orient, Trump a salué l'approbation de son plan par le Conseil de sécurité des Nations unies comme « un moment véritablement historique » qui « permettra de renforcer la paix dans le monde entier ». Malgré cette rhétorique, la résolution 2803 ne marque toutefois pas une rupture avec le passé. Au contraire, elle s'inscrit dans la continuité de décennies de plans prétendument internationaux – en réalité occidentaux et israéliens – pour la Palestine. Ces plans, illustrés par le mandat de la Société des Nations [adopté le 12 août 1922], le plan de partition de l'ONU [adopté le 29 novembre 1947] et les accords d'Oslo [1993], ont remodelé la géographie politique, la gouvernance et les structures d'aide afin de réduire le territoire palestinien. Ils ont procédé à cette redéfinition en introduisant de nouvelles « frontières » mobiles, telles que la ligne jaune, afin de réduire progressivement la superficie des terres attribuées au peuple palestinien et à son futur État. Ils ont créé des organismes tels que la Force internationale de stabilisation de Trump et son « Conseil palestinien apolitique » afin de contenir le nationalisme et la résistance palestiniens tout en permettant à Israël de continuer à agir en toute impunité. Et ils ont mis en œuvre ces mesures sans consulter le peuple palestinien, mais plutôt en renforçant la dynamique néocoloniale (comme en témoigne la participation de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair en tant que membre clé du Comité de la paix de Trump).
Ligne jaune avec redistribution du territoire.
En fin de compte, ces plans ont permis à Israël de s'emparer progressivement de plus de terres palestiniennes tout en renforçant les obstacles à la souveraineté palestinienne. Les conséquences du plan Trump risquent d'être similaires, allant d'une ghettoïsation totale des Palestiniens dans certaines parties de la bande de Gaza à la liquidation totale de la présence palestinienne à Gaza.
***
Les propositions occidentales ont permis aux sionistes de s'emparer des terres palestiniennes pendant près d'un siècle. Avant 1948, la Palestine était gouvernée par un régime britannique qui tirait son mandat de la Société des Nations, un organisme alors dominé par la Grande-Bretagne et la France. Puis, en 1947, l'ONU a présenté son tristement célèbre plan de partition, recommandant que 55% de la Palestine soit attribué à un État juif, à une époque où les Juifs représentaient environ un tiers de la population du pays. Le plan a été rejeté par les Palestiniens, mais accepté par l'Agence juive (la principale instance dirigeante sioniste et organisation paraétatique dans la Palestine mandataire), qui l'a reconnu comme un bon accord et une base pour une éventuelle expansion ultérieure.
Finalement, le plan de partition ne fut jamais mis en œuvre. Seule l'expansion sioniste eut lieu. Les milices sionistes, puis la nouvelle armée nationale israélienne, utilisèrent des moyens militaires pour établir leur nouvel État sur 78% de la Palestine, soit bien plus que les 55% attribués dans le plan de l'ONU. Pour ce faire, elles ont procédé à la Nakba, l'expulsion et le déplacement délibérés d'au moins 750 000 Palestiniens vers les États arabes voisins et les deux parties de la Palestine non revendiquées par Israël en 1948 : la Cisjordanie et la bande de Gaza. En conséquence, la Palestine a été de facto partitionnée, mais aucun État palestinien indépendant n'a été créé. Après avoir commencé son occupation durable de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, Israël a mis en place une réalité d'un seul État [Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch, and Shibley Telhami, « Israel's One-State Realit »y, Foreign Affairs mai-juin 2023] dans laquelle l'État israélien contrôlait l'ensemble de la Palestine historique et imposait une hiérarchie de régimes différents pour les Palestiniens et les Israéliens.
La bande de Gaza telle que nous la connaissons aujourd'hui est le résultat de cette histoire de contraction. Sous le mandat britannique, le district sud de la Palestine, parfois appelé officieusement « district de Gaza » d'après sa plus grande ville, était la plus grande zone administrative en termes territoriaux. Mais pendant la Nakba, les milices sionistes et l'armée israélienne s'en sont emparées en grande partie, réduisant la région à une superficie de 214 miles carrés [554 km carrés]. L'accord égypto-israélien de 1949 a délimité cette nouvelle « bande » de Gaza en établissant autour d'elle une ligne d'armistice connue sous le nom de Ligne verte. L'année suivante, un gouvernement égyptien affaibli a accepté un addendum qui a réduit la nouvelle bande de Gaza de 20% supplémentaires, la laissant comme un minuscule territoire de 141 miles carrés [365 km carrés], soit moins de 1,5% de la Palestine historique. Israël a commencé à contrôler la Ligne verte comme une frontière internationale, malgré son statut officiel de frontière d'armistice temporaire.
Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après avoir commencé son occupation à long terme de Gaza en 1967, Israël a encore réduit le territoire accessible aux Palestiniens, d'abord en établissant des colonies illégales et des installations militaires, puis en imposant des « zones tampons » et des « périmètres de sécurité ». Le processus d'Oslo a encore réduit la bande de Gaza, Israël ayant établi un « périmètre de sécurité » s'étendant sur plus de 800 mètres à l'intérieur de Gaza, l'armée appliquant des « mesures de sécurité spéciales » pour empêcher les Palestiniens d'y entrer.
L'empiètement d'Israël sur le territoire palestinien s'est poursuivi au XXIe siècle. Après avoir achevé l'évacuation unilatérale de 8500 colons de Gaza en 2005, Israël a mis en place une « zone tampon » restreinte s'étendant sur près d'un kilomètre et demi à l'intérieur de la bande de Gaza. Tout Palestinien s'y trouvant pouvait être abattu à vue. Et après avoir imposé un blocus total sur Gaza en 2007, avec le soutien de ses alliés égyptiens, Israël a régulièrement étendu sa zone tampon, confinant les Palestiniens sur une bande de terre de plus en plus petite. La logique meurtrière de la « zone tampon » a culminé avec les pertes humaines massives de la Grande Marche du retour de 2018 voir sur ce site [ l'article publié le 2 avril 2018], lorsque les forces israéliennes ont tué au moins 234 Palestiniens et blessé plus de 33'000 autres qui s'étaient approchés « trop près » de la barrière entourant la bande de Gaza. Ces décennies d'accaparement des terres pourraient maintenant atteindre leur apogée avec le tout dernier plan pour Gaza, qui continue de mettre en œuvre ce que de nombreux Palestiniens appellent le processus délibéré de la Nakba en continu.
***
En considérant le plan Trump dans cette trajectoire historique, nous pouvons identifier quatre volets à la stratégie de dépossession.
• La ligne jaune elle-même en est le premier. Selon les termes du cessez-le-feu, les forces israéliennes étaient tenues de « se retirer jusqu'à la ligne convenue », une directive qui permettait discrètement à l'armée israélienne de conserver le contrôle direct d'au moins 58% de Gaza. En d'autres termes, la construction de cette fortification réduit la partie palestinienne de Gaza à moins de la moitié de la bande de Gaza, soit pas plus de 64 miles carrés [165 km carrés], soit un cinquième de la ville de New York. L'histoire se répète une fois de plus : lors de la Nakba de 1948, plus de 200'000 réfugiés palestiniens ont fui vers le sud-ouest, pour finir confinés dans la bande de Gaza. Lors du génocide de 2023-2025, les forces israéliennes ont mené le même processus au sein même de la bande de Gaza, déplaçant violemment près de deux millions de Palestiniens et les enfermant du côté ouest de la ligne jaune.
La « ligne jaune » et ses blocs qui sont déplacés expulsent les Palestiniens qui disposent d'une maison ou de ce qui en reste dans le territoire nouvellement délimité par l'occupant.
Et cela ne devrait pas être la fin des expulsions alimentées par la ligne jaune. Après que les Palestiniens ont souligné que l'emplacement de la ligne jaune n'était pas clair, Israël a annoncé le 20 octobre qu'il avait commencé à poser des blocs de béton jaunes sur le sol afin de « clarifier la situation sur le plan tactique ». Mais loin de lever l'ambiguïté, ces blocs physiques ne font que l'accroître, car Israël n'a cessé de les déplacer plus loin à l'intérieur de Gaza. Des informations ont également fait état à plusieurs reprises d'invasions terrestres menées par les forces israéliennes pour mener des attaques au-delà de la ligne jaune, violant ainsi la condition du cessez-le-feu selon laquelle « Israël n'occupera ni n'annexera Gaza ».
Tout comme lorsqu'Israël a violé à plusieurs reprises les termes des accords d'Oslo dans les années 1990, en retardant par exemple son évacuation militaire de la ville de Gaza, puis en envahissant des territoires censés être contrôlés par l'Autorité palestinienne, il n'a subi aucune conséquence pour ses violations continues. En fait, loin d'exiger qu'Israël respecte l'accord, les preuves s'accumulent [New York Times, 25 Nov. 2025] pour montrer que la Maison Blanche collabore discrètement, en coulisses, à des plans secrets visant à l'occupation permanente, voire à l'annexion de Gaza par Israël. La semaine même où le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2803, les États-Unis ont présenté des propositions visant à partager définitivement la bande de Gaza, transformant la ligne jaune, qui était une zone tampon militaire temporaire, en une future frontière potentielle. Pendant ce temps, les politiciens et les activistes de droite israéliens continuent de prôner l'expulsion définitive des Palestiniens de Gaza, avec le soutien massif de la population juive israélienne (82% selon un récent sondage).
• La Force internationale de stabilisation constitue le deuxième volet de l'accaparement des terres par Trump, qui renvoie également aux accords d'Oslo. Présentés dans les années 1990 comme une résolution pacifique à des décennies de violence et publiquement présentés comme une « solution à deux États », les accords d'Oslo, tout comme le plan Trump aujourd'hui, étaient principalement axés sur la principale préoccupation des Israéliens : leur propre sécurité nationale. Après la création de l'Autorité palestinienne (AP) en 1994 sous les auspices d'Oslo, près de la moitié de ses employés ont été recrutés pour assurer des fonctions de sécurité. Ils n'étaient pas chargés de protéger la sécurité du peuple palestinien, mais plutôt de réprimer toute activité jugée menaçante pour les intérêts israéliens, y compris la résistance civile non violente à l'occupation. En conséquence, l'AP a rapidement acquis la réputation, parmi les Palestiniens, d'être un pion de l'armée israélienne.
Aujourd'hui, une dynamique similaire est à nouveau à l'œuvre avec la Force internationale de stabilisation. Bien que la composition de cette force ne soit pas encore confirmée, elles comprendraient des troupes de divers pays arabes et musulmans, parmi lesquels l'Azerbaïdjan, l'Égypte, l'Indonésie, le Qatar et les Émirats arabes unis, bien qu'aucun d'entre eux n'ait officiellement confirmé sa participation. Selon la Maison Blanche, la Force internationale de stabilisation aidera à former une nouvelle force de police palestinienne à Gaza et à gérer les affaires de sécurité intérieure, tout en jouant un rôle de premier plan dans la « démilitarisation » de Gaza et la « sécurisation des frontières ». Ces deux derniers points sont des exigences israéliennes flexibles pouvant avoir plusieurs interprétations, notamment parce que les « frontières » en question ne sont pas précisées, ce qui ouvre la voie à de nouvelles appropriations de terres. Il s'agit d'un dispositif qui garantit pratiquement que le territoire palestinien continuera se réduire. En effet, plusieurs critiques arabes et musulmans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la participation de leurs gouvernements pourrait les transformer en « marionnettes de l'État israélien ».
• Les dispositions relatives à la dite structure gouvernementale palestinienne, qui constituent le troisième volet de la stratégie de dépossession prévue par le plan Trump, rappellent une fois de plus Oslo. Les partisans de l'accord des années 1990 ont présenté l'Autorité palestinienne comme un précurseur de l'indépendance palestinienne. Cependant il y avait un hic de taille : Israël n'a jamais accepté la création d'un État palestinien pleinement souverain, même lorsqu'il était dirigé par des Premiers ministres prétendument « pacifistes » comme Yitzhak Rabin [1992-1995] et Ehud Barak [1999-2001]. Au cours du processus d'Oslo, Israël a accepté de n'accorder à l'Autorité palestinienne qu'une autonomie limitée (et non la souveraineté) sur seulement 18% de la Cisjordanie et les trois quarts de la bande de Gaza. Il a également insisté pour conserver les blocs de colonies illégales qui ont accaparé encore plus de terres palestiniennes. En conséquence, le processus d'Oslo a fortement limité les pouvoirs de l'Autorité palestinienne, ne lui permettant pas d'avoir une armée nationale, un contrôle souverain des frontières et une indépendance économique. De plus, l'autodétermination palestinienne a été reportée jusqu'aux « négociations sur le statut final » qui n'ont jamais eu lieu, tandis que les questions fondamentales de la résistance palestinienne – le droit au retour et le statut de Jérusalem – ont été ignorées.
Dans les années 2020, l'actuel Premier ministre israélien a clairement exprimé à plusieurs reprises son opposition inconditionnelle à un État palestinien, quelle que soit sa taille, alors même que la plupart des gouvernements européens continuent de soutenir publiquement la formule des deux États comme seule voie possible pour aller de l'avant. En conséquence, le plan Trump prévoit encore moins d'autonomie pour les Palestiniens que ce qui leur avait été accordé dans le cadre des accords d'Oslo. Il n'y a pas d'équivalent à l'Autorité palestinienne dans ce plan, seulement un comité de transition supervisé par le Comité de la paix de Trump. De manière révélatrice, le plan parle de l'État palestinien et de l'autodétermination comme d'une « aspiration » – et non d'un droit – et suggère simplement qu'après le développement et les réformes, « les conditions pourraient enfin être réunies pour une voie crédible » vers cet objectif.
• Le quatrième outil d'accaparement des terres, et peut-être le plus flagrant, consiste en des formes néocoloniales de reconstruction. Dans le cadre de ces plans, la « zone verte » contrôlée par Israël (à l'est de Gaza) serait reconstruite avec le soutien d'acteurs soutenus par les États-Unis, dont beaucoup considèrent Gaza comme une simple source de profits (The Conversation, 12 septembre 2025, Rafeef Ziadah, King's College). Fin novembre, le département d'État américain a confirmé un projet visant à créer des « communautés alternatives sûres » (ASC-alternative safe communities) qui accueilleraient les Palestiniens dans la zone verte. Cependant, la quasi-totalité de la population palestinienne de Gaza étant actuellement confinée à l'ouest de la ligne jaune – la désignée « zone rouge » –, on ne sait pas comment cette population serait transférée vers les ASC, ni ce que cela signifierait pour l'avenir de la zone rouge. La proposition d'ASC présente également des similitudes inquiétantes avec les plans avancés par le gouvernement israélien en juillet visant à créer une « ville humanitaire » pour interner tous les Palestiniens de Gaza, que même certains détracteurs internes ont comparée à un camp de concentration (The Guardian, citant Ehud Olmert, 13 juillet 2025). Alors qu'ils « reconstruisent » Gaza selon leurs propres conditions, les États-Unis et Israël semblent déterminés à poursuivre ces plans, prolongeant ainsi le déplacement et le confinement du peuple palestinien qui dure depuis des décennies.
Les conséquences du plan Trump ont déjà été mortelles. Depuis l'entrée en vigueur officielle du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, Israël aurait violé ses termes plus de 500 fois. Il a également ignoré ouvertement certaines clauses, telles que l'obligation d'ouvrir le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Le Premier ministre Netanyahou a récemment indiqué que son gouvernement pourrait finalement l'ouvrir, mais uniquement pour les Palestiniens quittant Gaza (BBC, 3 décembre 2025). Il s'agit là d'une violation directe de l'accord, qui précise que Rafah doit être ouvert « dans les deux sens » et que les Palestiniens se trouvant en dehors de la bande de Gaza doivent être « libres de revenir ».
Plus inquiétant encore, pendant le prétendu « cessez-le-feu » de ces dernières semaines, les forces israéliennes ont continué à ouvrir le feu sur les Palestiniens à Gaza, tuant au moins 360 personnes, dont la majorité étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Beaucoup ont été tués pour avoir commis le « crime » de franchir la ligne jaune et d'entrer dans le territoire de Gaza contrôlé par Israël alors qu'ils cherchaient à retourner dans les maisons et les quartiers dont les forces israéliennes les avaient chassés au cours de deux années de génocide. Malgré son engagement déclaré en faveur du cessez-le-feu, l'administration Trump n'a pas condamné, et encore moins empêché, ces violations répétées.
Comme les précédents plans « internationaux » pour la Palestine – d'Oslo au « Deal of the Century » de Jared Kushner (The Cairo Review of Global Affairs, « Kushner's New Plan for Palestine », 18 septembre 2019) –, le plan Trump présente les gains israéliens comme des concessions et les pertes palestiniennes comme des gratifications. L'attention constante accordée par l'Occident aux conceptions israéliennes de la sécurité, combinée à la poursuite éhontée par des acteurs extérieurs de leurs propres intérêts politiques et financiers, détourne systématiquement l'attention des droits humains, sans parler de la justice réparatrice. Alors qu'Israël utilise le prétexte d'un nouvel accord « international » pour s'emparer de nouvelles terres et établir une nouvelle situation sur le terrain, tout cela se fait, une fois de plus, au détriment du peuple palestinien. (Article publié sur le site Jewish Currents le 8 décembre 2025, traduction rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’armée israélienne intensifie ses raids en Cisjordanie occupée et cible les universités

Les forces israéliennes ont fait une incursion à l'université de Birzeit tandis que des colons attaquaient des maisons palestiniennes à Masafer Yatta et kidnappaient un agriculteur près de Bethléem.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
9 décembre 2025
Par New Arab
Photo : Les forces d'occupation israéliennes empêchent les activistes de manifester contre les attaques des colons à Beit Jala, en Cisjordanie occupée, 14 novembre 2025 © Mosab Shawer / Activestills
Les forces israéliennes ont intensifié leurs raids dans la Cisjordanie occupée mardi, ciblant deux universités et arrêtant des dizaines de Palestiniens.
L'université de Birzeit, située dans la ville de Birzeit près de Ramallah, a été perquisitionnée par les forces israéliennes tôt dans la matinée, et cinq membres de l'équipe de sécurité de l'université ont été arrêtés, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.
L'université a reporté les heures de travail du personnel et des étudiants à 9 heures du matin par mesure de sécurité, a rapporté Alaraby Al-Jadeed, le site frère en langue arabe de The New Arab.
Les forces israéliennes ont également pris d'assaut le campus de l'université al-Quds dans la ville d'Abu Dis, près de Jérusalem.
Le ministère de l'Éducation de l'Autorité palestinienne a condamné ces raids, les qualifiant de violation des normes internationales qui protègent les universités et les établissements d'enseignement.
Outre l'assaut contre les deux universités, 40 Palestiniens ont été arrêtés dans toute la Cisjordanie occupée, selon la Société palestinienne des prisonniers (PPS), qui a déclaré que la plupart des arrestations avaient eu lieu dans les gouvernorats d'Hébron, de Naplouse et de Bethléem.
D'autres arrestations ont eu lieu à Ramallah, Jénine, Salfit et Qalqiya, et la PPS a fait état d'interrogatoires sur le terrain et d'agressions.
Selon l'Organisation internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens, en novembre, plus de 9 250 Palestiniens étaient actuellement détenus dans des prisons israéliennes, dont 3 368 en détention administrative sans inculpation.
Pendant ce temps, les attaques des colons se sont poursuivies. Selon l'agence Wafa, des colons ont enlevé un agriculteur de la ville de Nahalin, à l'ouest de Bethléem, et l'ont agressé et kidnappé alors qu'il labourait ses terres.
Les colons ont également attaqué des maisons palestiniennes à Masafer Yatta, près d'Hébron, incendiant un véhicule et un tracteur et peignant des slogans racistes sur les murs des maisons.
Les attaques des colons ont augmenté ces derniers mois. Lundi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a déclaré qu'en octobre, les colons avaient mené 269 attaques contre des Palestiniens, causant des victimes et des dégâts matériels.
L'agence onusienne a ajouté qu'en octobre, 12 Palestiniens avaient été tués et 351 blessés lors d'attaques.
À la suite de l'assaut mené lundi par Israël contre le siège de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à Jérusalem-Est, le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a condamné cette opération, la qualifiant de « violation flagrante des obligations d'Israël de protéger et de respecter les locaux de l'ONU ».
Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que les forces israéliennes avaient saisi du mobilier et du matériel informatique, et avaient retiré le drapeau de l'ONU pour le remplacer par un drapeau israélien.
Israël a précédemment accusé l'UNRWA, sans preuve, de coopérer avec le Hamas et a mis fin à ses opérations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, exacerbant la malnutrition et la famine dans ce dernier territoire.
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face aux attaques de Trump contre les immigréEs, la résistance s’organise

Donald Trump intensifie ses attaques contre les immigréEs, avec des propos racistes et une avalanche de nouvelles réglementations. Mais la résistance s'amplifie également.
Hebdo L'Anticapitaliste - 779 (11/12/2025)
Par Dan La Botz
traduction Henri Wilno
Depuis l'attaque armée perpétrée par un migrant afghan contre deux membres de la Garde nationale à Washington, D.C., le 26 novembre, qui a tué l'un d'eux et gravement blessé l'autre, Trump a considérablement restreint l'immigration, menacé de révoquer le statut des immigréEs légaux et ordonné aux services de l'immigration et des douanes (ICE) d'intensifier les arrestations et les expulsions. Ces mesures, motivées par ses attitudes racistes et sa stratégie politique, bouleversent les politiques historiques d'immigration des États-Unis et la culture politique du pays.
Revirement historique
Trump a déclaré une « pause permanente » sur l'immigration en provenance des « pays du tiers monde ». Il a également ordonné l'arrêt des décisions d'asile et déclaré que chaque demandeur ou demandeuse d'asile serait soumis à un contrôle « aussi approfondi que possible ». Il a également déclaré que toutes les demandes d'asile accordées sous l'ère Biden seront réexaminées. Il a suspendu toutes les demandes d'immigration et les visas pour les Afghans. Il a ordonné un « réexamen complet et rigoureux » de toutes les cartes vertes délivrées à des ressortissantEs de 19 « pays préoccupants », parmi lesquels l'Afghanistan, Cuba, Haïti, l'Iran et la Somalie. Les cartes vertes sont des documents qui accordent le statut de résident permanent, le droit de vivre et de travailler indéfiniment, et de demander la citoyenneté américaine. Il a également appelé à la « dénaturalisation » (retrait de la citoyenneté américaine) et à l'expulsion rapide des personnes considérées comme présentant un risque pour la sécurité ou « incompatibles avec la civilisation occidentale ».
Tout cela freine considérablement l'immigration aux États-Unis et représente non seulement un revirement juridique de la politique américaine en matière d'immigration, mais aussi une profonde transformation de la culture politique américaine qui, pendant des décennies, a généralement plutôt bien accueilli les immigréEs et considéré l'immigration comme un fondement de la société américaine. Les mots du poème The New Colossus de la poétesse Emma Lazarus, inscrits sur la statue de la Liberté — « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, vos masses innombrables aspirant à vivre libres » — ont désormais été effacés par Trump.
Ciblage raciste des SomalienNEs
Dans le même temps, Trump a lancé une tirade raciste contre les immigréEs somalienNEs du Minnesota. Fuyant la guerre civile, les SomalienNEs ont commencé à immigrer dans cette région dans les années 1990 et ils sont aujourd'hui environ 100 000 à y vivre. Trump les a qualifiés de « déchets » qui « n'apportent rien ». Il a spécifiquement mentionné la députée Ilhan Omar (gauche du parti démocrate), une immigrée somalienne, en la qualifiant de « déchet ». « Je ne veux pas d'eux dans le pays », a-t-il déclaré. L'ICE a alors envoyé 100 agents fédéraux dans la région de Minneapolis-St. Paul pour rassembler et expulser les immigréEs. L'ironie est que 90 % des SomalienNEs qui y vivent sont des citoyenNEs américains de naissance ou naturaliséEs, tandis que des centaines d'autres ont un autre statut légal.
Résistance militante aux raids de l'ICE
Pendant ce temps, Trump continue d'envoyer des agents de l'ICE dans les villes et les États gouvernés par les démocrates : Los Angeles, Chicago, La Nouvelle Orléans, Charlotte et Washington, D.C., et, donc plus récemment, Minneapolis et St. Paul. Lorsque les agents de l'ICE se présentent, des habitantEs s'organisent pour soutenir les immigréEs et résister.
Récemment, à New York, lorsqu'une cinquantaine d'agents de l'ICE sont arrivés dans un parking de Chinatown, des habitantEs ont passé quelques coups de fil et rapidement, 200 personnes sont venues bloquer le bâtiment et les empêcher de partir pour procéder à des arrestations. Los Angeles et Chicago disposent de réseaux locaux bien développés qui organisent la résistance. Matthew Hunter, militant de longue date à Los Angeles, déclare : « Mais nous devons mettre en place des structures de lutte permanentes pour survivre à cela. » Et c'est ce qui se fait. Avec d'autres, il a mis en place un « réseau d'intervention rapide » pour répondre aux raids de l'ICE à Los Angeles. À Chicago, des militantEs ont distribué 120 000 sifflets puissants et stridents, accompagnés d'une brochure expliquant comment les utiliser pour alerter les voisinEs en cas de raid de l'ICE.
Trump nous opprime, mais partout, la riposte s'organise.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. La grève chez Starbucks

Plus de 18 mois après le début des négociations du contrat-cadre national, les baristas sont en grève pour protester contre la liste croissante de pratiques déloyales présumées commises par Starbucks, alors que l'entreprise continue de faire obstruction à la conclusion d'un contrat équitable.
Tiré de A l'Encontre | https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-dossier-la-greve-chez-starbucks.html
3 décembre 2025
Voici un bref résumé de la manière dont Starbucks fait obstruction à la conclusion d'un contrat équitable.
Les négociations sur le contrat-cadre national ont débuté en avril 2024. Au cours des neuf mois qui ont suivi, les baristas et les dirigeants de Starbucks se sont rencontrés pendant des centaines d'heures et ont conclu 33 accords provisoires qui amélioreront concrètement les conditions de travail.
En septembre 2024, les baristas syndiqués ont présenté pour la première fois une série de propositions économiques en vue de négociations visant à augmenter les salaires et les avantages sociaux.
En décembre 2024, Starbucks a rejeté toutes les propositions des baristas et, en échange, a présenté un ensemble de mesures économiques peu sérieuses qui ne prévoyaient aucune augmentation salariale pendant la première année du contrat et ne traitaient pas les questions fondamentales des horaires et des effectifs. Les négociations ont échoué.
Starbucks est revenu sur la voie précédemment convenue. Cela a incité Workers United à déposer une plainte nationale pour pratique déloyale (ULP) en décembre 2024, alléguant que Starbucks n'avait pas négocié de bonne foi et sapait le statut représentatif du syndicat. Cette ULP a été modifiée et élargie en avril 2025.
En 2025, l'entreprise a illégalement mis en œuvre de nouvelles politiques sans négocier avec le syndicat, telles que les éléments du programme « Back to Starbucks » et le nouveau code vestimentaire restrictif, ce qui a donné lieu à de nouvelles accusations de pratiques déloyales.
Workers United a déposé plus de 100 nouvelles plaintes pour pratiques déloyales au cours de l'année dernière.
Récemment, Starbucks a commencé à dire qu'il allait revenir à la table des négociations « pour discuter », mais le simple fait de s'asseoir à la table des négociations est inutile si Starbucks ne s'engage pas à présenter de nouvelles propositions qui répondent aux demandes des baristas concernant l'augmentation des heures de travail et du personnel, la hausse des salaires et la résolution de centaines de pratiques déloyales en matière d'emploi.
Nous avons été clairs et cohérents tout au long de l'année. Nos trois revendications restantes, qui n'ont pas été prises en compte, sont les suivantes
Nous exigeons de meilleures heures de travail afin d'améliorer les effectifs dans nos magasins. Le manque de personnel est flagrant, ce qui entraîne des temps d'attente plus longs alors que les commandes des clients affluent. Pourtant, trop de baristas ne travaillent toujours pas suffisamment d'heures pour payer leurs factures ou atteindre le seuil requis pour bénéficier d'avantages sociaux. Starbucks doit investir dans l'augmentation de nos heures de travail.
Nous exigeons une augmentation du salaire net afin de pouvoir payer nos factures. Trop de baristas ont du mal à joindre les deux bouts, tandis que les dirigeants gagnent des millions. Starbucks doit consacrer plus d'argent à notre salaire net.
Nous exigeons la résolution de centaines de plaintes pour pratiques déloyales en matière d'emploi liées à la répression syndicale. Le géant du café a commis plus de violations du droit du travail que tout autre employeur dans l'histoire moderne. Starbucks doit résoudre complètement les problèmes juridiques qui touchent les baristas. (1er décembre 2025)
[https://sbworkersunited.org/our-strike/]
*****
« UNE GRÈVE HISTORIQUE CHEZ STARBUCKS »

Piquet et manif à New York.
Quatre ans après que les employés d'un magasin Starbucks dans le nord de l'État de New York aient été les premiers à se syndiquer, des centaines d'autres points de vente ont suivi, malgré la forte opposition de la chaîne de cafés. Que s'est-il passé ensuite ?
Des milliers de baristas Starbucks sont actuellement en grève à travers les États-Unis, avertissant la plus grande chaîne de cafés au monde de se préparer à la « plus longue et la plus importante » action syndicale de son histoire.
À peine un an après que Brian Niccol, le PDG de Starbucks, a tenté de mettre un terme aux dissensions entre la direction et les employés syndiqués, en s'engageant à « dialoguer de manière constructive » avec eux, le géant états-unien du café s'affronte aujourd'hui confronté à une grève qui s'intensifie pendant la période de ventes lucratives des fêtes de fin d'année.
Environ 2500 employés font grève dans 85 villes et 120 magasins, et invitent les clients à ne pas s'y rendre. Starbucks affirme que moins de 1% de ses cafés ont été perturbés par le mouvement social.
Cependant, le syndicat Starbucks Workers United, qui représente 11 000 baristas dans plus de 550 établissements, menace d'étendre la grève bien au-delà de son périmètre actuel si les dirigeants ne font pas de concessions lors des négociations contractuelles.
Quatre ans après que le premier magasin Starbucks aux Etats-Unis a voté en faveur de la création d'un syndicat, défiant la résistance intense de l'entreprise, les relations entre les deux parties se sont détériorées.
« Je suis toujours choquée de me réveiller chaque jour et de les voir continuer à nous combattre de la manière dont ils le font. Parce que nous avons prouvé à maintes reprises que nous ne bougerons pas », a déclaré au Guardian Michelle Eisen, porte-parole de Starbucks Workers United.

Pendant des décennies, Starbucks, fondée dans les années 1970 et reprise dans les années 1980 par Howard Schultz [ayant une fortune estimée en 2018, par Forbes, à 3 milliards de dollars], qui en a fait le géant mondial du café qu'elle est aujourd'hui, a réussi à lutter contre la syndicalisation.
La chaîne a qualifié ses employés de « partenaires » et a promu un ensemble de prestations sociales « à la pointe dans le secteur », notamment une couverture santé et la prise en charge des frais de formation.
« Je ne suis pas contre les syndicats. Je suis favorable à Starbucks, favorable au partenariat, favorable à la culture Starbucks », a déclaré Howard Schultz à ses employés en 2022. « Ce n'est pas grâce à un syndicat que nous en sommes arrivés là. »
À cette époque, cependant, des brèches avaient déjà commencé à apparaître dans le barrage. L'année précédente, les baristas d'un magasin de Buffalo, dans l'État de New York, avaient voté à 19 voix contre 8 en faveur de la syndicalisation, ouvrant la voie à des centaines d'autres magasins à travers les États-Unis.
Michelle Eisen a commencé à travailler dans le magasin de Buffalo en août 2010, afin de compléter son emploi de régisseuse de production, entre deux spectacles de théâtre.
Elle était une cliente de longue date de Starbucks et avait confiance en sa réputation de bon employeur. Pendant des années, Michelle Eisen s'est sentie valorisée en tant qu'employée, bénéficiant d'augmentations de salaire régulières et d'horaires adaptés à son emploi du temps.
Mais selon Michelle Eisen, les choses ont commencé à changer vers 2016. « Nous avons constaté une augmentation significative du prix à payer pour nos prestations sociales. Les augmentations salariales biannuelles ont complètement disparu », a-t-elle déclaré lors d'un entretien. « Tout à coup, nous avons eu droit à une seule augmentation liée au coût de la vie au début de l'année civile, qui, la plupart du temps, était nettement inférieure aux augmentations précédentes. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir les effectifs diminuer progressivement dans ces boutiques. Quatre ans plus tard, la situation a vraiment atteint son paroxysme. »
***
Les magasins Starbucks sont restés ouverts lorsque la Covid a frappé en 2020. Les baristas ont été surpris de rencontrer des clients de plus en plus agressifs et conflictuels, et certains employés ont estimé que leur salaire était trop bas pour ce qu'ils considéraient comme un travail plus intense dans des conditions qui se détérioraient.
Michelle Eisen, dont l'emploi dans le théâtre avait été supprimé en raison de la pandémie, a travaillé autant d'heures que possible chez Starbucks, mais elle avait toujours du mal à joindre les deux bouts. Après 11 ans dans l'entreprise, elle ne gagnait que quelques centimes de plus par heure qu'un nouvel employé. En 2021, elle a envisagé de démissionner.
Mais elle a alors commencé à discuter avec ses collègues de la possibilité de créer un syndicat. Un groupe d'environ 50 baristas Starbucks de la région de Buffalo a rendu public son projet en août 2021. [Voir l'article publié sur le alencontre.org le 15 décembre 2021.]
« Pour moi, cela allait de soi. Parce que cela donnait l'occasion d'essayer de résoudre certains de ces problèmes et de les régler de l'intérieur. Et j'espérais, contre toute attente, que cela fonctionnerait, que nous réussirions et que je n'aurais pas à partir. Parce que je ne le souhaitais pas », dit Michelle Eisen.
Les dirigeants de Starbucks n'ont pas considéré cette initiative comme une évidence. Les responsables et les dirigeants de l'entreprise, notamment Rossann Williams, alors présidente de la chaîne pour l'Amérique du Nord, et Schultz, se sont rendus à Buffalo afin de mettre un terme à cette tentative de syndicalisation.
« Aucun partenaire [employé] n'a jamais eu besoin d'un représentant pour obtenir ce dont nous bénéficions tous en tant que partenaires chez Starbucks », a écrit Howard Schultz dans une lettre adressée aux employés. « Je suis attristé et préoccupé d'apprendre que certains pensent que cela est désormais nécessaire. »
« Ils ont mené une campagne antisyndicale extrêmement virulente », a déclaré Michelle Eisen. « Ils continuent de le faire, mais cela a commencé à Buffalo, dès le début. Et contre toute attente, malgré cela, mon magasin a remporté l'élection syndicale le 9 décembre 2021 et est devenu le premier établissement [syndiqué]. Et puis, tout s'est enchaîné très rapidement. »
***
Depuis cette première victoire, les travailleurs mobilisés ont remporté plus de 650 élections syndicales et en ont perdu environ 120. Depuis lors, la chaîne a fermé 59 magasins syndiqués, selon Starbucks Workers United. D'autres attendent encore que les résultats soient certifiés.
Alors qu'une vague de mobilisation commençait à gagner les salarié·e·s au début de l'année 2022, la direction de l'entreprise a été remaniée. Trois mois après le vote de Buffalo, Starbucks a brusquement annoncé que son PDG, Kevin Johnson, démissionnait et que Howard Schultz, son patron de longue date, revenait pour un troisième mandat à la tête de l'entreprise.
Les actions de Starbucks étaient sous pression, les coûts augmentaient alors que le Covid continuait de perturber les chaînes d'approvisionnement et, bien que l'entreprise continuait de générer des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque trimestre, les clients passaient moins de temps dans ses établissements.
Howard Schultz a été chargé de redresser une entreprise que beaucoup à Wall Street considéraient comme étant en perte de vitesse. Beaucoup de ses baristas nouvellement syndiqués étaient du même avis. Cependant, Schultz a refusé de collaborer avec Starbucks Workers United, déclarant qu'il n'accepterait jamais le syndicat et offrant de nouvelles prestations et des augmentations de salaire aux travailleurs et travailleuses non syndiqués.
Michelle Eisen déclare : « Il était tout simplement exaspérant d'être maltraités de cette manière et de nous faire sentir que nous faisions quelque chose de mal, alors que nous essayions de responsabiliser l'entreprise et de l'améliorer. »
Un nouveau PDG, Laxman Narasimhan, a été nommé plus tard dans l'année. Les baristas syndiqués ont commencé à se mobiliser, notamment en manifestant lors de la journée « red cup day » [journée de promotion offrant aux consommateurs une tasse rouge] de la chaîne en novembre 2022 et 2023.
***
Les relations se sont lentement améliorées. Début 2024, Starbucks et Starbucks Workers United ont convenu d'un nouveau cadre pour les conventions collectives, suscitant l'espoir d'un premier accord syndical avant la fin de l'année. Les employés des magasins syndiqués ont obtenu les prestations accordées aux employés non syndiqués en 2022.
Cependant, les difficultés commerciales de la chaîne semblaient s'aggraver, avec une concurrence croissante et une fréquentation en baisse. Laxman Narasimhan a été démis de ses fonctions de PDG après 16 mois, l'année dernière, et remplacé par Brian Niccol, le directeur général de Chipotle [chaîne de restauration rapide spécialisée dans la cuisine tex-mex].
Selon le syndicat, les négociations ont été interrompues après l'arrivée de Niccol. « L'entreprise a repris là où elle s'était arrêtée à la fin de 2023, en matière de violation des droits des travailleurs et travailleuses », a déclaré Eisen. « Et nous n'avons toujours pas de contrat. »
Brian Niccol a agi rapidement pour remettre la chaîne sur les rails, en lancant une campagne intitulée « Back to Starbucks » (Retour chez Starbucks), visant à inverser la tendance à la baisse des ventes. Il a fait l'objet de critiques lorsqu'il a été révélé qu'il ferait la navette entre son domicile de Newport Beach, en Californie, et le siège social de l'entreprise à Seattle [Etat de Washington], plutôt que de déménager.
Pendant ce temps, les négociations ont marqué le pas. Brian Niccol est resté muet sur le syndicat et sa volonté d'obtenir un premier contrat collectif. « Les changements de PDG au cours des cinq dernières années ont en quelque sorte montré que cette entreprise a encore beaucoup de choses à régler », a déclaré au Guardian Zarian Antonio Pouncy, qui travaille depuis 11 ans comme barista à Las Vegas. Son magasin s'est syndiqué fin 2023. « Au lieu d'écouter les “partenaires”, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne et qui gèrent les affaires au quotidien, ils s'appuient trop sur le leadership, l'intelligence artificielle, les algorithmes et les chiffres pour leur montrer comment fonctionne l'entreprise. »
***
Julie Su a observé la situation de près. En tant que secrétaire adjointe au Travail des États-Unis et secrétaire au Travail par intérim entre 2021 et 2025, elle a contribué à superviser les efforts de l'administration Biden pour redynamiser le mouvement syndical américain, alors que des milliers de baristas de Starbucks ont voté en faveur de la syndicalisation.
« Lorsque les travailleurs choisissent un syndicat, ils méritent un contrat », a déclaré Julie Su au Guardian. « Trop souvent, il faut beaucoup de temps pour en obtenir un, car l'employeur utilise les reports comme une arme. Le temps nécessaire à la conclusion d'un premier contrat est utilisé pour sanctionner les travailleurs et travailleuses qui se syndiquent, pour saper leurs efforts ou pour leur faire comprendre qu'il n'y a aucun avantage à adhérer à un syndicat, car rien ne change au travail pendant des années. Généralement, toutes ces raisons sont invoquées. C'est inacceptable. »
En moyenne, il faut environ 15 mois à un syndicat pour conclure un premier contrat avec un employeur, souvent en raison des retards et des obstructions de la direction.
Chez Starbucks, près de 48 mois se sont écoulés depuis que le magasin de Buffalo a voté en faveur de la syndicalisation.
« Dans le cas d'une entreprise comme Starbucks, cela fonctionne également comme un outil spécifique de répression syndicale, car l'entreprise tente d'attendre que ses employés partent [étant donnée le turnover] avant qu'un contrat ne soit conclu », a ajouté Julie Su.
Starbucks Workers United a déposé des centaines de plaintes pour pratiques déloyales (ULP) auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations du travail). Des dizaines de délégués syndicaux ont été licenciés, apparemment en représailles, à cause de leur soutien au syndicat. Starbucks a nié ces accusations dans tous les cas, bien que plusieurs travailleurs/euses aient obtenu leur réintégration.
***
Les tensions ont continué de couver. Starbucks Workers United a affirmé que les baristas de plusieurs centaines de magasins avaient débrayé en décembre 2024. Et en avril, les délégués syndicaux ont voté contre une proposition de contrat de l'entreprise qui aurait garanti des augmentations annuelles d'au moins 2%, jugeant cette augmentation « insuffisante ».
Le 13 novembre 2025, jour du « Red Cup Day » au sein de l'empire Starbucks, plus d'un millier de travailleurs et travailleuses ont débrayé pour exiger que la chaîne leur présente un contrat « équitable ». La chaîne a minimisé l'impact de la grève.
Le syndicat a intensifié son action. Une semaine plus tard, le mouvement s'est étendu à 65 villes et 95 établissements, avec 2000 travailleurs en grève. Starbucks Workers United a également organisé un blocus du plus grand centre de distribution de Starbucks sur la côte est des États-Unis, à York, en Pennsylvanie.
Le 24 novembre, les travailleurs et travailleuses de Starbucks se sont rassemblés devant le siège social de l'entreprise à Newport Beach, où Brian Niccol travaille à temps partiel, pour exiger que l'entreprise parachève le contrat [ce qui ne l'empêche pas de gagner 98 millions de dollars, soit un salaire plus de 6000 fois supérieur à la médiane de celui de ses salarié·e·s].
Le 28 novembre, la grève s'est encore étendue. Selon le syndicat, environ 2500 baristas de 120 établissements y participent désormais.
« L'entreprise nous fait obstruction », a déclaré Diego Franco, barista chez Starbucks depuis six ans à Chicago. « Mon établissement a choisi de se mettre en grève le jour de la Red Cup, le jour le plus fréquenté de l'année pour l'entreprise, parce que nous en avions franchement assez. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous continuions à venir travailler, à appliquer des politiques et des procédures qui ne résolvent aucun des problèmes auxquels nous nous affrontons au travail, non seulement pour mes collègues, mais aussi pour les clients et nos habitués. Je préfère de loin rester dehors dans le froid et faire grève plutôt que de me rendre au travail où je suis constamment méprisé par notre PDG et par la direction. »
***
Contacté pour commenter la situation, Starbucks a minimisé l'impact de la grève jusqu'à présent et a affirmé avoir enregistré des ventes record pendant les fêtes de fin d'année jusqu'à présent.
« Comme nous l'avons dit, 99% de nos 17'000 établissements aux États-Unis restent ouverts et accueillent les clients, y compris de nombreux établissements que le syndicat avait publiquement déclaré en grève, mais qui n'ont jamais fermé ou ont depuis rouvert », a déclaré Jaci Anderson, porte-parole de Starbucks. « Quels que soient les projets du syndicat, nous ne prévoyons aucune perturbation significative. Lorsque le syndicat sera prêt à revenir à la table des négociations, nous serons prêts à discuter. Les faits sont clairs : Starbucks offre les meilleurs emplois dans le secteur de la vente au détail, avec un salaire et des avantages sociaux s'élevant en moyenne à 30 dollars de l'heure pour les “partenaires” rémunérés à l'heure. Les gens choisissent de travailler ici et d'y rester : notre taux de rotation est inférieur à la moitié de la moyenne du secteur et nous recevons plus d'un million de candidatures chaque année. »
Un nombre croissant de dirigeants politiques progressistes ne sont pas convaincus par ces promesses. Plus de 100 membres du Congrès ont signé des lettres demandant à Starbucks de reprendre les négociations avec le syndicat et de conclure le contrat.
« Tant que les employés seront en grève, je n'achèterai pas de produits Starbucks, et je vous invite à vous joindre à nous », a écrit le maire élu de New York, Zohran Mamdani, sur les réseaux sociaux. Sa coprésidente de transition, Lina Khan, et le nouveau premier adjoint au maire, Dean Fuleihan, ont pris place sur les piquets de grève. Zohran Mamdani est apparu lundi sur un piquet de grève aux côtés du sénateur Bernie Sanders.
La maire élue de Seattle, Katie Wilson, est apparue sur un piquet de grève Starbucks quelques heures après son discours de remerciement, dans lequel elle a déclaré aux travailleurs/euses et à ses supporters : « Les baristas sont le cœur et l'âme de cette entreprise, et ils méritent mieux que des promesses vides et des mesures antisyndicales de la part de l'entreprise. »
Michelle Eisen a quitté Starbucks en mai, après 15 ans de service. Elle est actuellement la principale porte-parole de Starbucks Workers United. Elle a déclaré : « Cette entreprise est en train d'être ruinée, et ces travailleurs syndiqués sont les seuls à se lever et à dire : “Hé, que faites-vous ? Nos cafés ne sont plus des endroits où les gens ont envie de passer du temps. Ils ne veulent plus venir dépenser leur argent ici à cause de la façon dont vous gérez cette entreprise. Vous devez commencer à investir en nous si vous voulez voir cette entreprise se redresser.” Les travailleurs/euses en ont assez et ils vont continuer à intensifier leurs actions. Ils vont poursuivre leur grève pour dénoncer les pratiques déloyales de l'entreprise et ils sont prêts à en faire la grève la plus longue et la plus importante de l'histoire de l'entreprise si celle-ci ne revient pas sur sa décision et ne résout pas les problèmes qui subsistent. » (Article publié dans The Guardian le 2 décembre 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les forces israéliennes prennent d’assaut le siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée

Lundi, les forces israéliennes ont pris d'assaut le siège scellé de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est occupée.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
9 décembre 2025
Par Middle East Monitor
Photo : Quartier général de l'UNRWA à Gaza © UNRWA
Le complexe servait de bureau à l'UNRWA depuis 1951, mais l'agence l'a quitté plus tôt cette année à la suite d'une décision du gouvernement israélien. Tel-Aviv a interdit les opérations de l'UNRWA à Jérusalem en vertu d'une loi adoptée par la Knesset (parlement).
Le gouvernorat de Jérusalem, affilié à l'Autorité palestinienne, a déclaré que « les forces de police ont fait une descente dans le siège, arrêté les gardes de sécurité et confisqué leurs téléphones ».
La descente s'est accompagnée « d'un bouclage complet de la zone environnante et de fouilles approfondies menées par les forces d'occupation dans toutes les installations du bâtiment », indique le communiqué.
« Cette descente représente un défi direct au vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a quelques jours, en faveur du renouvellement du mandat de l'UNRWA », a déclaré le gouvernorat.
Il a appelé à une action internationale urgente pour tenir Israël responsable « de la violation du droit international » et pour poursuivre les dirigeants israéliens « pour les crimes et les abus commis contre le peuple palestinien et ses institutions nationales et internationales ».
Pour sa part, l'UNRWA a souligné que l'entrée non autorisée et forcée des forces israéliennes constituait une violation inacceptable de son statut d'agence des Nations unies. Elle a rappelé qu'Israël était partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, qui stipule l'inviolabilité des locaux de l'ONU (immunité contre les perquisitions et saisies) et que ses biens et avoirs sont immunisés contre toute procédure judiciaire.
La police israélienne a déclaré dans un communiqué écrit envoyé à Anadolu qu'« il s'agissait d'une affaire municipale liée à des dettes impayées envers la municipalité, et non d'une affaire policière, et que la police était présente pour assurer la sécurité des employés municipaux ».
Interrogée sur la présence du drapeau israélien dans les locaux, la police israélienne a renvoyé la question à la municipalité.
Vendredi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution visant à renouveler le mandat de l'UNRWA pour trois ans.
La résolution a été soutenue par 151 voix contre 10, avec 14 abstentions.
L'UNRWA a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a plus de 70 ans pour venir en aide aux Palestiniens qui ont été déplacés de force de leurs terres.
L'agence onusienne est confrontée à de graves difficultés financières depuis qu'Israël a lancé une campagne de diffamation contre l'UNRWA, affirmant que des membres de son personnel étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre.
Malgré les demandes de l'UNRWA visant à obtenir du gouvernement israélien des informations et des preuves à l'appui de ces allégations, l'agence n'a reçu aucune réponse. À la suite des accusations d'Israël, plusieurs pays donateurs importants, dont les États-Unis, ont suspendu ou interrompu leur financement.
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Salade, tomate, pognon !

( Au Resto, « Les Milords », du 16ème, une nouvelle formule dédiée à la bourgeoisie parisienne séduit par sa touche excentriquement suave )
- Arrange ta cravate, mon chéri, elle est de travers, enjoint Madame Troflouze, à son époux.
– J't'avais dit que les nœuds papillons, c'est pas mon truc, grogne François, un Industriel replet et trapu qui pèse lourd dans le CAC 40.
– Moi, je te trouve très élégant, avec !
- Bon, entrons maintenant !
( Le couple Troflouze retrouve sa table parmi le beau monde venu savourer la curiosité gastronomique dédiée à la bourgeoisie, sur la Place de Paris )
- Alors ? Tu le trouves comment, le cadre du restaurant ? Jade.
– Somptueux !
- J'aime les ambiances qui répondent aux allants et aspirations des acteurs de l'entreprenariat, pas toi ?
- Si ! Regarde les tentures imprimées avec des motifs de billets de banque en euro et en dollar, c'est vraiment bien contextualisé.
– T'as pas regardé les dalles, sous tes pieds ?
- Oh, j'avais les yeux où, moi ? Comme c'est sympa ! Des lingots d'or qui scintillent dès qu'on bouge les pieds.
– Et le plafond ? fait François.
– Mon Dieu comme c'est magnifique. Un revêtement en Labradorites ! De l'iridescence plein la vue !
- Eh, Jade, oublie l'effet Schiller ! Et regarde qui arrive, tu ne croirais pas tes yeux.
– Oh ! Le prince de Monaco et juste derrière, les grosses fortunes en cordon d'oignon qui font la fierté de la France.
– Voilà notre ami Bolloré, lance François d'un ton enthousiaste, dont le Groupe est en guerre avec l'Audiovisuel public.
- Depuis hier, il défraie la chronique. Observe Jade.
– Pourquoi ?
– Il parait qu'il a fait exploser les revenus du président du Rassemblement national (RN).
– Jade ! Tourne-toi discrètement ! Tu vas tomber des nues, dit François.
– Le Président de la République !
- En chair et en os !
- Je savais qu'il allait venir, mais avec un certain doute, reprend Jade.
– Il a une capacité d'adaptation à donner le tournis aux Caméléons, pointe François.
– Plutôt d'ubiquité déroutante : Près du Peuple et du Fric ! atteste Jade.
( Les commandes arrivent enfin. Dans la salle, le Gotha découvre et savoure la nouvelle formule )
– Alors qu'est-ce t'en penses, Jade ?
- Exquis !
- Moi, dit François, je n'en reviens pas. Cette saveur gustative, du Bonheur aux papilles.
– Dorénavant, on mangera au moins deux fois par semaine « Salade, Tomate, Pognon ! », insiste Jade.
- T'as pris quelle sauce, mon lapin ?
- Sauce Capital mixée Dividendes caramélisées et toi ?
- Capitalisation avec Actions. C'est bourratif, mais intensément bon !
- C'est curieux, cette sensation succulente : Plus on mange, plus on brûle d'envie de faire du fric ! remarque Jade.
– C'est vrai, consent François, j'éprouve le même effet : Oseille ! Encore oseille ! Toujours oseille !
- J'ai vu, dit Jade, un des serveurs apporter au chef de l'Etat une sauce Plus-Value, cela doit être bon ?
– Lui aussi, il a fini son plat « Salade, Tomate, Pognon ! »
- Il a visiblement bien apprécié le nouveau concept culinaire ?
- Il s'y connait pour avoir fréquenté les Rothschild.
( Jade reste un long moment silencieuse )
– Qu'est-ce qu'il t'arrive Jade ?
- Attends ! Je me suis fait mal à la dent en croquant sur un débris dur.
– Tu veux de l'eau ?
- Non !
- C'est certainement un fragment d'os.
– Ça y est je l'ai ! C'est pas un os, Monsieur Troflouze !
– Fais voir ? s'impatiente François.
- (…)
- Eh, tu veux qu'te dise ? s'écrie l'époux. Ton intrus indésirable, c'est un DIAMANT !
- On n'a pas commandé la Galette du Roi, pourtant ?
- Chuut, Mund zu ! Ça s'passe comme ça chez « Salade, Tomate Pognon ! »
- Demain, à la première heure, le p'tit déj' chez qui, ma Chérie ?
- « Salade, Tomate Pognoooon ! »
Texte et illustration : Omar HADDADOU
(Le récit reste fictif)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les femmes sont les premières cibles des attaques de la CAQ

Voici le tract du comité des femmes du Conseil Central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) distribué le 6 décembre 2025 durant la manifestation contre les violences faites aux femmes.
Après 7 ans au pouvoir, l'appui au gouvernement de la CAQ est en chute libre et tout indique que si des élections avaient lieu aujourd'hui, il serait rayé de la carte. C'est dans ce contexte qu'il tente de détourner l'attention de son bilan désastreux en attaquant les syndicats et les personnes immigrantes.
Les compressions et le sous-financement chronique, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, touchent principalement les femmes d'abord comme travailleuses, mais aussi comme utilisatrices. Le retrait de réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux des mécanismes de protection de la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises québécoises touche surtout des travailleuses.
Le durcissement des lois sur la « laïcité », notamment dans les CPE et les écoles primaires et secondaires, touche surtout des femmes et attaque de front leur droit au travail en pleine pénurie de personnel.
Même les attaques antisyndicales visent surtout les femmes.
Déjà, on l'oublie souvent, mais les femmes sont majoritaires dans le mouvement syndical québécois. Ce sont majoritairement des femmes qui ont fait la grève et pris la rue dans les dernières années (Front commun du secteur public, grève des enseignantes, CPE, hôtellerie, etc.).
On pourrait continuer longtemps. Les attaques contre les médecins coïncident avec la féminisation de la profession. Les stages non-rémunérés ? Surtout concentrés dans les milieux à forte prédominance féminine.
FAIRE FRONT POUR LES FEMMES
Face à une conjoncture politique particulièrement hostile, la CSN a choisi de faire front et d'organiser la résistance. Le gouvernement caquiste favorise le privé, réorientant l'État social pour qu'il serve d'abord les intérêts des patrons et de l'élite économique plutôt que la population. Le tout dans un contexte d'austérité et de coupures sauvages.
Notre objectif est de contrer les attaques de la CAQ et de mettre en lumière les vrais besoins de la population et nos solutions. Il faudra frapper assez fort pour s'assurer que, peu importe le parti qui remportera les prochaines élections, l'on change d'orientation pour remettre l'État social au service de la population et que l'on reprenne le chemin de la justice climatique et sociale.
Le mouvement syndical donnera de la voix et multipliera les mobilisations dans les prochains mois. Et ça a commencé par un grand rassemblement qui a réuni plus de 50 000 personnes le 29 novembre dernier, à Montréal. Joignez-vous à nous pour la suite !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
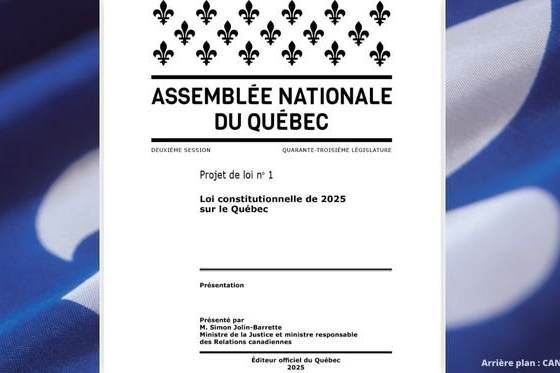
Projet de loi 1 sur la Constitution du Québec - Plus de 300 organisations réclament son retrait

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 - Une vaste coalition d'organisations de la société civile québécoise, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le Conseil central du Montréal métropolitain CSN (CCMM-CSN) et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRMM-FTQ), dénonce le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Selon ces groupes, ce projet de loi constitue une menace pour la démocratie, l'État de droit et le régime québécois de protection des droits et libertés.
Rassemblés en conférence de presse au moment où débutent les consultations devant la Commission des Institutions, ils portent la voix de plus de 300 organisations* qui ont endossé une déclaration commune réclamant le retrait complet du projet de loi :
« Le projet de loi No 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, est une attaque contre la démocratie et les droits humains. La démarche est unilatérale et précipitée et elle ne respecte pas les critères démocratiques pour l'élaboration d'une constitution légitime. En outre, elle perpétue une logique coloniale en niant le droit des peuples autochtones à l'autodétermination.
Au lieu d'affronter les questions qui préoccupent les citoyen•nes (la santé, l'éducation, le logement, l'environnement, l'égalité des genres, le coût de la vie, etc.), le gouvernement québécois s'attaque aux droits et libertés, aux contre-pouvoirs et à l'État de droit. Par conséquent, les groupes soussignés exigent le retrait complet du PL1. »
Cette coalition dénonce le processus entourant l'élaboration et le dépôt de ce projet de loi, tout comme les nombreux reculs que prévoit le PL1 en matière de droits et libertés. Considérant l'importance juridique d'une constitution, celle-ci aurait dû être élaborée dans le cadre d'un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. Or, dans le cas du projet de loi n° 1, le gouvernement a choisi d'agir en vase clos, sans consultations publiques préalables et sans tenir compte des critères établis en droit international, qui recommandent des processus élargis, participatifs et respectueux des droits de toutes et tous. Les groupes dénoncent aussi le fait que ce projet de loi a été préparé sans la participation des peuples autochtones, niant leur droit à l'autodétermination et outrepassant le principe de dialogue de nation à nations.
La coalition appelle la population, les mouvements sociaux et tous les groupes de la société préoccupés par la démocratie, l'État de droit et les droits humains à se mobiliser pour exiger que le gouvernement retire le projet de loi no1.
* La liste des organisations exigeant le retrait du PL1 est disponible ici.
Citations
« Pour une rare fois dans sa longue histoire, la LDL a refusé de participer aux consultations sur un projet de loi qui menace les droits et libertés, et ce même si le projet de loi no 1 constitue une attaque délibérée au régime québécois de protection des droits humains. Par cette décision, la LDL dénonce le processus opaque, autoritaire et antidémocratique utilisé par le gouvernement pour préparer et présenter son projet de constitution. Le gouvernement n'a respecté aucun des critères établis par l'ONU pour l'adoption d'une constitution démocratique et légitime. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la société québécoise à le rejeter en bloc. »
– Paul-Étienne Rainville, responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés (LDL)
« Le PL1 réduit considérablement l'espace démocratique, fragilise l'indépendance des mouvements sociaux et menace directement le modèle québécois d'action communautaire autonome (ACA), fondé sur la défense des droits, la participation citoyenne et la transformation sociale. Le retrait complet et immédiat du projet de loi no 1 est la seule voie responsable et raisonnable. »
– Claudia Fiore-Leduc, chargée de campagnes au Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).
« Ce projet de loi constitutionnelle s'inscrit dans une tendance préoccupante d'affaiblissement de l'État de droit. Une Constitution ne peut être légitime que si elle repose sur l'exercice du droit à la participation publique, ce qui exige un processus participatif élargi. C'est d'autant plus important alors que certaines dispositions fragilisent des mécanismes essentiels de contre-pouvoir et restreignent indûment le contrôle judiciaire. »
– Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
« Le projet de constitution s'inscrit dans la série d'initiatives législatives que le gouvernement présente comme autant de démarches d'affirmation nationale, tel que le modèle d'intégration à la nation québécoise (PL 84), adopté en mai 2025. Comme dans ce dernier cas, on propose des changements drastiques, attentatoires aux droits humains et propres à alimenter l'exclusion, le tout à l'issue de processus de consultations bâclés. Nous refusons de jouer dans ce mauvais film. »
– Louis-Philippe Jannard, coordonnateur du volet protection de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
« Le PL1 est une attaque directe aux droits démocratiques et politiques de l'ensemble de la population du Québec. Les attaques contre les syndicats ne doivent pas cacher le fait que c'est toute la société civile que le gouvernement cherche à affaiblir. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Québec se mette à l'abri d'éventuelles contestations judiciaires ou politiques. Une constitution doit non seulement être élaborée par et pour le peuple, elle doit aussi avoir pour objectif de protéger la population contre d'éventuels abus de pouvoir de l'État, et non pas défendre la "souveraineté parlementaire" des gouvernants. Le PL 1 est inamendable et doit être retiré, purement et simplement. »
– Bertrand Guibord, président, CCMM-CSN
« Pour être légitime, une constitution doit être le fruit de consultations en amont de l'ensemble de la population, incluant les groupes marginalisés. Ce type de texte doit tendre à garantir les droits fondamentaux du peuple et à faire obstacle à d'éventuelles tentatives visant à introduire un régime autoritaire. Le Projet de loi 1 échoue sur tous les plans. »
– Anaïs Bussières McNicoll, directrice du programme des libertés fondamentales, Association canadienne des libertés civiles
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :














