Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Iran : Mobilisations et grève des salarié.es du Groupe National de l’Aciérie d’Ahwaz

Le quatrième jour de mobilisation et grève des sidérurgistes du Groupe National de l'Aciérie d'Ahwaz s'est poursuivi avec des slogans tels que « Nous sommes prêt.es à mourir, plutôt que d'être humilié.es » « les menaces et et la prison, ne nous ferons pas plier ».
Tiré d'Iran-echo.
Selon les rapports du Syndicat des salarié.es du Groupe National de l'Aciérie d'Ahwaz, leurs revendications comprennent :
– La levée de l'interdiction d'entrer dans l'entreprise pour les travailleurs/euses suspendu.es et la réintégration des travailleurs/euses précédemment licencié.es ;
– L'alignement des salaires sur ceux des autres entreprises sidérurgiques, dont l'aciérie d'Oxin ;
– La mise en œuvre complète et immédiate du plan de classification des emplois ;
– Un contrat de travail sans paragraphes laissés en blanc pour tous les travailleurs/euses de la filiale Shafaq ;
– Le licenciement du PDG corrompu, l'appropriation et l'autogestion de l'entreprise par les travailleurs/euses ;
Les obstacles et les défis auxquels sont confronté.es les grévistes du Groupe National de l'Aciérie d'Ahwaz sont innombrables : menaces, intimidations, présence de vigiles et de membres des services sécuritaires interdisant la présence dans l'entreprise d'environ 40 travailleurs/euses protestataires, suspension et licenciement de travailleurs/euses protestataires, direction d'entreprise incompétente et corrompue menant une politique anti-ouvrière, rôle destructeur de la Banque Nationale, etc. Mais l'unité des travailleurs/euses, leur détermination et leurs organisations indépendantes traceront le chemin pour obtenir la satisfaction de ces revendications.
Nous saluons les grévistes du Groupe National de l'Aciérie d'Ahwaz.
Le chemin des travailleurs/euses vers la victoire passe par leur unité, ainsi que l'existence d'organisations ouvrières indépendantes du patronat, de l'Etat et de toutes les institutions liées aux forces de sécurité et de renseignement, tels le Conseil islamique du travail et la « Maison des travailleurs ».
26 décembre 2023
Syndicat des travailleurs/euses de la compagnie de bus de Téhéran et sa banlieue

Frappes américano-britanniques contre les Houthis : Premier acte d’une escalade régionale ?

Le conflit au Moyen-Orient prend une nouvelle dimension avec les frappes américano-britanniques menées contre des cibles houthies au Yémen, dans la nuit de jeudi à hier. Jusqu'ici, les Etats-Unis et leurs proches alliés, engagés solidairement dans un soutien inconditionnel à Israël dans sa guerre contre la Bande de Ghaza, avaient tout entrepris pour éviter un tel scénario, mais il est évident que la détermination des Houthis, jouissant de l'appui de Téhéran, a compté dans l'équation, brouillé les calculs de l'engagement occidental dans la région et eu raison de la réserve stratégique de Washington et son escorte de partenaires.
Tiré de Algeria-watch.org
17 janvier 2024
Par Mourad Slimani, El Watan
Des sites militaires dans des villes contrôlées par le mouvement Ansar Allah, nom officiel de l'organisation politique des Houthis, et identifiés comme étant les plateformes de lancement des attaques contre des objectifs maritimes en mer Rouge, ont été pris pour cibles par des avions de combat britanniques et des tirs de missiles américains, notamment dans la capitale Sanaa et les gouvernorats d'Al Hodeïda, Taïz, Hajjah et Saada.
Le porte-parole militaire du mouvement yéménite évoque un ensemble de 73 raids ayant fait 5 morts parmi les troupes houthies. « Notre pays fait face à une attaque massive par des navires américains et britanniques, des sous-marins et des avions », a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères de l'organisation yéménite, Hussein Al Ezzi. Prenant le relais du chef du mouvement, Abdel Malek El Houthi, qui, jeudi dernier, avait menacé par anticipation de « riposte importante » toute attaque américaine, le ministre ajoute que « les Etats-Unis et la Grande-Bretagne doivent se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression ».
Pour leur part, les coalisés avec Washington (Australie, Bahreïn, Canada, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Royaume-Uni) ont tenu à préciser, dans une déclaration commune, que les attaques se présentaient comme un mal nécessaire, se contentaient d'être défensives et visaient une désescalade de la tension dans la région.
Dans la foulée, Joe Biden, le président américain, a salué le « succès » de l'opération, insistant sur le fait que la riposte intervenait après des mises en garde adressées régulièrement au mouvement houthi et que le seul but de la réaction des coalisés restait la protection du commerce international. « Ces frappes ciblées sont un message clair que les Etats-Unis et nos partenaires ne toléreront pas les attaques sur nos troupes (et) ne permettront pas à des acteurs hostiles de mettre en danger la liberté de navigation », a menacé Joe Biden sur un ton qui tranche avec une certaine retenue observée jusqu'ici et soulignant le caractère délicat des opérations et leur timing problématique.
Le piège Bab el Mandeb
Ne voulant pas compromettre un processus de négociation de paix entre son allié l'Arabie Saoudite et le mouvement rebelle houthi, après des années de guerre sanglante, Washington a plutôt misé sur la dissuasion pour contenir le foyer yéménite. Mais la plus grande hantise consiste en une extension régionale du conflit au-delà du contexte palestinien, que signerait symboliquement et militairement une intervention US en terre yéménite.
La Maison-Blanche déploie en effet un effort diplomatique appuyé pour éviter un débordement du conflit et une implication militaire de mouvements soutenant la résistance du Hamas à Ghaza (Hezbollah au Sud Liban et mouvement Ansar Allah au Yémen, notamment) et pouvant compter sur l'appui de l'Iran. Ce fut au demeurant l'objet principal de la mission diplomatique du secrétaire d'Etat américain la semaine dernière dans la région.
La mise en place d'une coalition internationale, il y a un mois sous impulsion US, pour sécuriser les passages au détroit de Bab El Mandeb, n'a finalement pas eu l'effet dissuasif escompté sur l'audace guerrière houthie. Bien au contraire, la constance des attaques observée depuis près de deux mois, malgré les avertissements occidentaux et onusiens, s'est muée en une recrudescence.
La semaine dernière, un palier supérieur dans les attaques ciblant les navires suspectés de liens avec l'économie israélienne a été enclenché : alors que 18 drones et 3 missiles, lancés à partir des bases yéménites, ont été interceptés par l'armada américano-britannique stationnée dans les eaux de la région, jeudi un missile antinavire portant le sceau houthi a été par ailleurs abattu par le bouclier des coalisés. La nuit de la même journée, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a réuni d'urgence son gouvernement pour avaliser une participation militaire de son pays aux frappes américaines contre Ansar Allah.
Inquiétudes et condamnations à l'international
Les réactions dans le monde ont suivi les contours qui marquent les degrés et la nature des implications dans la guerre contre Ghaza. Les alliés occidentaux d'Israël ont globalement salué les frappes, l'Union européenne a même choisi le contexte pour annoncer la tenue, à partir de la semaine prochaine, de discussions au niveau de ses instances autour de l'objectif de mettre en place une force navale européenne pour la sécurisation des voix maritimes en appui à la coalition militaire qui vient de frapper au Yémen.
Les deux grandes puissances que sont la Chine et la Fédération de Russie expriment, quant à elles, de grandes réserves ou de franches condamnations. Alors que Pékin se soit dit « préoccupé » par les conséquences des attaques, Moscou accuse le bloc occidental de persister dans son attitude de mépris à l'encontre du droit international. « Les frappes sur le Yémen sont un exemple du dédain total du droit international par les Anglo-Saxons au nom d'une escalade dans la région, de leurs objectifs destructeurs », dénonce la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
L'Iran, régulièrement cité comme le commanditaire direct des actions des mouvements de résistance « islamistes » hostiles à Israël, dont les Houthis, a pour sa part condamné les frappes.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dénonce une « action arbitraire » et une « atteinte à la souveraineté du Yémen ». Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'élève, de son côté, contre ce qu'il qualifie de riposte « disproportionnée ». « Toutes ces actions constituent un usage disproportionné de la force (…).
L'Amérique et Israël utilisent cette même force disproportionnée contre les Palestiniens et les Britanniques marchent dans les pas des Etats-Unis. Ils cherchent à créer un bain de sang en mer Rouge », charge-t-il. Enfin le mouvement Hamas prévient, dans un communiqué diffusé hier, que les frappes américano-britanniques vont avoir des « répercussions » inévitables sur la sécurité régionale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Attaques à la frontière entre le Pakistan et l’Iran : une mise en perspectives historiques

Après une frappe aérienne de l'armée pakistanaise le 18 janvier dans une ville frontalière iranienne qui a tué au moins 9 personnes en représailles à l'attaque de missiles du 16 janvier sur la ville frontalière du Baloutchistan qui, elle, avait tué entre autres deux enfants, les gouvernements pakistanais et iranien ont convenu de désamorcer la menace de guerre et de rétablir des relations diplomatiques à part entière.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
20 janvier 2024
Par Farooq Tariq
Pour l'heure, une accalmie complète règne en ce 20 janvier, les deux Etats semblant se venger de leurs « ennemis » réfugiés dans l'un ou l'autre pays. Tous deux ont réussi à tuer certains de ceux qu'ils considèrent comme appartenant à des groupes terroristes, le Jaish al Adl (Armée de la Justice) au Pakistan et les séparatistes baloutches en Iran.
L'Iran a affirmé avoir pris pour cible deux bases du groupe armé Jaish al Adl au Pakistan. Ce groupe a revendiqué l'attaque d'un poste de police dans la ville iranienne de Rask, dans la province frontalière méridionale du Sistan-Baloutchistan, qui a tué 11 membres du personnel de sécurité iranien. L'attaque a été condamnée par le Pakistan.
Quelles que soient les attaques menées par les uns et les autres, le peuple baloutche est la cible des deux camps. Les uns luttent contre les « atrocités du Pakistan » et les autres contre l'occupation coloniale iranienne d'une partie du Baloutchistan. Après la Première Guerre mondiale, le Baloutchistan occidental a été cédé à l'Iran par l'impérialisme britannique.
L'attaque pakistanaise contre les « camps séparatistes du Baloutchistan » en Iran a eu lieu au moment où plusieurs centaines de militants baloutches campent à Islamabad pour retrouver les militants baloutches disparus et mettre fin aux exécutions extrajudiciaires. Ils sont arrivés à Islamabad depuis le district de Turbat, au Baloutchistan, au cours d'une longue marche qui a attiré l'attention de nombreux observateurs internationaux.
L'escalade des tensions frontalières qui se traduit par des attaques de missiles à l'intérieur du Pakistan et de l'Iran doit être replacée dans le contexte du génocide israélien des Palestiniens. C'est la première fois qu'il y a eu une frappe aérienne et une attaque de missiles par le Pakistan en Iran. L'impérialisme américain serait très heureux si l'Iran était occupé à se défendre contre les attaques du Pakistan au lieu d'aider les Palestiniens, principalement par l'intermédiaire d'organisations que Téhéran patronne.
Il existe une longue histoire de conflits entre les deux pays. Il y a eu une guérilla au Baloutchistan sous le premier gouvernement Bhutto. Elle a eu lieu après que le gouvernement provincial élu du Parti national Awami (NAP), qui s'opposait au gouvernement fédéral du Parti du peuple pakistanais, a été renversé par Bhutto à l'instigation du Shah d'Iran, en 1973. De nombreux jeunes Baloutches sont partis dans les montagnes pour se défendre et beaucoup ont émigré en Afghanistan et en Iran.
Au cours de cette décennie, l'Iran a tenté d'introduire d'autres tribus dans la province voisine de Sestan-Baluchestan afin de transformer la majorité des Baloutches en minorité, comme Israël l'a fait avec les Palestiniens.
Le Shah d'Iran, terrifié par la résistance croissante des Baloutches en Iran, a demandé à Zulfiqar Ali Bhutto de prendre des mesures contre le gouvernement provincial du NAP. Bhutto l'a fait brutalement, pour écraser la résistance baloutche à l'aide d'une opération de l'armée au Baloutchistan. Le Shah d'Iran craignait que si le Baloutchistan oriental devenait indépendant, le Baloutchistan occidental, situé sur le territoire iranien, en ferait partie. Depuis lors, les Baloutches ont été pris pour cible par les deux parties, mais la résistance, sous de nombreuses formes, se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Les deux Etats s'accusent mutuellement d'abriter les « terroristes » dans leur pays, les groupes religieux au Pakistan et les groupes nationalistes en Iran.
Si la guerre s'intensifie, ce qui ne semble pas être le cas actuellement, elle portera atteinte aux économies des deux pays à un niveau jamais atteint auparavant. L'approvisionnement en pétrole du Pakistan pourrait être durement touché par les Iraniens. Le commerce entre les deux pays serait interrompu. L'Iran profite déjà de la « contrebande » de pétrole iranien en vrac vers le Pakistan à l'heure actuelle.
Il est important de noter que les activités commerciales entre le Pakistan et l'Iran se sont poursuivies normalement, les deux pays ayant gardé tous leurs points de passage ouverts malgré la violation de l'espace aérien par les forces iraniennes et la riposte des forces pakistanaises qui s'en est suivie. Les activités commerciales se poursuivent le long des villes frontalières, notamment Taftan, Gwader, Kech, Panjgor et Washuk.
En août 2023, les ministres des affaires étrangères des deux pays se sont réunis à Islamabad pour formuler un plan commercial quinquennal visant à atteindre un objectif commercial de 5 milliards de dollars.
Il semble que la menace d'une guerre totale soit désormais écartée, puisque les ministres des affaires étrangères de l'Iran et du Pakistan se sont parlés et ont mis l'accent sur une relation « fraternelle ». Il ne s'agit que d'une parenthèse entre les deux pays islamiques soi-disant frères, qui attendent un meilleur moment pour frapper à nouveau lorsque leur crise interne s'aggravera.
Le mouvement mené par les femmes contre la République islamique d'Iran au cours des dernières années et la longue marche des activistes baloutches au Pakistan sont le véritable espoir des mouvements progressistes dans les deux pays et au niveau international. Il faut mettre un terme aux enlèvements et aux meurtres de Baloutches par le gouvernement pakistanais et par celui de l'Iran.
Farooq Tariq
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Forum populaire Asie-Europe

Cour Internationale de Justice, Israel accusé de « génocide » : Plaidoyer de l’Afrique du sud

Dans leur plainte, les avocats sud-africains estiment que l'offensive israélienne vise « la destruction des Palestiniens de la bande de Gaza ». Des audiences ont lieu mercredi 10 et jeudi 11 janvier, une victoire formelle pour les adversaires de la politique israélienne. Le 28 octobre 2023, Craig Mokhiber, directeur du bureau new-yorkais du Haut-Commissariat des droits de l'homme à l'ONU, a démissionné de son poste. Dans une lettre, il explique les raisons de son geste. Relayée par de grands titres de la presse anglo-saxonne comme le Washington Post ou The Guardian, cette démission a pratiquement été ignorée par les grands médias français.
Tiré d'Afrique en lutte. Publié à l'origine par Al Jazeera English.
Cher monsieur le Haut-Commissaire,
C'est ma dernière communication officielle en tant que directeur du bureau de New-York du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Nous vivons une période très anxiogène et nous sommes inquiets pour la sécurité de beaucoup de nos collègues. Une fois de plus, nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux et nous sommes impuissants à l‘arrêter. J'ai enquêté sur les droits humains en Palestine depuis les années 1980. J'ai vécu à Gaza dans les années 1990 ; j'y étais en tant que conseiller des Nations unies pour les droits de l'homme. J'ai effectué encore plusieurs missions, avant et après, toujours pour la défense des droits humains.
Cette situation me touche profondément et m'atteint à titre personnel. J'étais présent, dans nos locaux de l'ONU quand il y a eu les génocides contre les Tutsis, les musulmans bosniaques, les Yezidis et les Rohingyas. Dans chacun de ces cas, alors que la poussière retombe sur les horreurs perpétrées contre des civils sans défense, il devient douloureusement clair que nous avons manqué à notre devoir de répondre aux impératifs de prévention de ces atrocités de masse, à notre devoir de protection des personnes vulnérables et à l'obligation que nous avions que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Il en fut ainsi lors des vagues successives de meurtres et de persécution contre les Palestiniens, tout au long de l'existence des Nation unies.
Monsieur le Haut-Commissaire,
Nous vivons encore un échec.
En tant qu'avocat spécialisé dans les droits humains, avec plus de trente ans d'expérience dans ce domaine, je sais bien que ce concept de génocide a souvent été galvaudé politiquement. Mais le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, après des décennies de persécution et d'épuration systématiques et entièrement fondées sur leur statut d'Arabes, avec des déclarations d'intention explicites de la part des dirigeants du gouvernement israélien et de son armée, tout cela ne laisse aucune place au doute ou au débat.
À Gaza, les maisons d'habitation, les écoles, les églises, les mosquées et les établissements médicaux sont attaqués sans raison, et des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris dans Jérusalem occupée, des maisons sont saisies et attribuées à d'autres en fonction de leur race. Des colons qui commettent des pogroms sont accompagnés par des unités militaires israéliennes. Dans tout le pays, c'est l'apartheid !
Il s'agit d'un cas typique de génocide. Le projet européen, ethno-nationaliste, de colonisation en Palestine est entré dans sa phase finale : la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne autochtone sur leurs terres. En plus, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d'une grande partie de l'Europe sont totalement complices de cet assaut terrible. Non seulement ces gouvernements refusent de remplir leurs obligations au regard des traités pour assurer le respect des conventions de Genève, mais ils fournissent des armes et des renseignements et ils couvrent politiquement et diplomatiquement les atrocités commises par Israël.
Ajoutons à cela que les grands médias occidentaux, de plus en plus proches de l'État et en violation claire de l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, déshumanisent continuellement les Palestiniens pour faciliter le génocide. Ils diffusent de la propagande de guerre, appellent à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence.
Les entreprises de médias sociaux basées aux États-Unis étouffent les voix des défenseurs des droits humains, tout en amplifiant la propagande pro-israélienne. Les contrôleurs en ligne du lobby israélien, les trolls et les fausses ONG créées par les gouvernements, harcèlent et salissent les défenseurs des droits humains, et les universités et employeurs occidentaux collaborent avec eux pour punir ceux qui osent s'élever contre les atrocités. À la suite de ce génocide, ces acteurs doivent rendre des comptes, comme ce fut le cas pour la radio des Mille collines au Rwanda.
LES PROMESSES ILLUSOIRES D'OSLO
En de telles circonstances, notre organisation doit être efficace et fonder son action sur des principes. Mais nous n'avons pas relevé le défi. En raison de l'intransigeance des États-Unis, le Conseil de sécurité a été de nouveau bloqué. Le Secrétaire général est attaqué pour les protestations les plus bénignes et nos mécanismes de défense des droits humains font l'objet d'attaques calomnieuses et soutenues, venant d'un réseau organisé en ligne pour défendre l'impunité.
Les promesses illusoires et largement fallacieuses d'Oslo ont depuis des décennies distrait, détourné l'organisation de son devoir essentiel de défense du droit international, des droits humains et de la Charte elle-même. Le mantra de la solution à deux États est devenu un sujet de plaisanterie dans les corridors de l'ONU, à la fois pour son impossibilité absolue dans les faits et pour son incapacité totale à tenir compte des droits humains inaliénables du peuple palestinien. Le soi-disant Quartet1 n'est plus qu'une feuille de vigne pour l'inaction et la soumission à un statu quo brutal. Le renvoi (prôné par les États-Unis) aux « accords entre les parties elles-mêmes » au lieu de se référer au droit international a toujours été d'une transparente inconséquence, destiné à renforcer le pouvoir d'Israël sur les droits des Palestiniens occupés et dépossédés de leurs biens.
Monsieur le Haut-Commissaire,
Je suis venu à cette organisation dans les années 1980 parce que j'y ai trouvé une institution fondée sur des principes et des normes résolument du côté des droits humains, y compris dans les cas où les puissants États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe n'étaient pas de notre côté.
Alors que mon propre gouvernement, ses institutions et une grande partie des médias américains soutenaient ou justifiaient encore l'apartheid sud-africain, l'oppression israélienne et les escadrons de la mort en Amérique latine, les Nations unies défendaient les peuples opprimés de ces pays. Nous avions le droit international de notre côté. Les droits humains et les principes étaient aussi de notre côté. Notre autorité était liée à notre intégrité. Mais cela n'est plus le cas. Au cours des dernières décennies, des éléments clés des Nations unies ont cédé au pouvoir des États-Unis et à la peur du lobby israélien, abandonnant ses principes et se retirant du droit international lui-même.
Nous avons beaucoup perdu dans cet abandon, y compris notre propre crédibilité mondiale. Mais c'est le peuple palestinien qui a subi les plus grandes pertes à cause de nos échecs. L'ironie de l'histoire veut que la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ait été adoptée en 1948, l'année de la Nakba perpétrée contre le peuple palestinien. Alors que nous commémorons le 75e anniversaire de la DUDH, nous ferions bien d'abandonner le vieux cliché selon lequel elle est née des atrocités qui l'ont précédée. On doit admettre qu'elle est née en même temps que l'un des génocides les plus atroces du XXe siècle, celui de la destruction de la Palestine. D'une certaine manière, les auteurs de la déclaration promettaient les droits humains à tout le monde, sauf au peuple palestinien.
N'oublions pas non plus que les Nations unies ont commis le péché originel de faciliter la dépossession du peuple palestinien en ratifiant le projet colonial européen qui s'est emparé des terres palestiniennes et les a remises aux colons.
Nous avons beaucoup de choses à nous faire pardonner.
Mais la voie de l'expiation est claire. Nous avons beaucoup à apprendre de la position de principe adoptée ces jours derniers dans les villes du monde entier où des foules s'élèvent contre le génocide, même au risque d'être battues ou arrêtées. Les Palestiniens et leurs alliés, les défenseurs des droits humains de tous bords, les organisations chrétiennes et musulmanes et les voix juives progressistes qui disent « pas en notre nom », tous nous montrent la voie. Il ne nous reste qu'à les suivre.
Hier, à quelques rues d'ici, la gare centrale de New-York a été complètement envahie par des milliers de défenseurs juifs des droits humains, solidaires du peuple palestinien et exigeant la fin de la tyrannie israélienne (beaucoup d'entre eux risquant d'être arrêtés). Ce faisant, ils ont éliminé en un instant l'argument de propagande (hasbara) israélienne et le vieux trope antisémite selon lequel Israël représente en quelque sorte le peuple juif. Ce n'est pas le cas. En tant que tel, Israël est seul responsable de ses crimes.
Sur ce point, il faut répéter malgré les calomnies du lobby israélien que la critique des violations des droits humains par Israël n'est pas antisémite, pas plus que la critique des violations saoudiennes n'est islamophobe, la critique des violations de Myanmar n'est antibouddhiste ou la critique des violations indiennes n'est antihindouiste. Lorsqu'ils cherchent à vous faire taire par des calomnies, nous devons élever la voix, pas la baisser.
LA RESPONSABILITÉ DES NATIONS UNIES
J'espère que vous conviendrez, monsieur le Haut-Commissaire, que c'est ce que parler vrai veut dire, face au pouvoir. Mais j'ai également espoir dans les parties des Nations unies qui ont refusé de compromettre les principes de l'organisation en matière de droits humains, malgré les énormes pressions exercées en ce sens. Nos rapporteurs spéciaux indépendants, nos commissions d'enquête et nos experts en traités ainsi que la plupart des membres de notre personnel, ont continué à défendre les droits humains du peuple palestinien. Alors que d'autres parties des Nations unies (même au plus haut niveau) ont honteusement courbé l'échine devant le pouvoir.
En tant que gardien des normes et des standards en matière de droits humains, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a le devoir particulier de défendre ces normes. Notre tâche, je crois, est de faire entendre notre voix, du Secrétaire général à la dernière recrue de l'ONU et dans l'ensemble du système des Nations unies, en insistant sur le fait que les droits humains du peuple palestinien ne peuvent faire l'objet d'aucun débat, négociation ou compromis, où que ce soit sous le drapeau bleu.
À quoi ressemblerait alors une position fondée sur les normes des Nations unies ? À quoi travaillerions-nous, si nous étions fidèles à nos remontrances rhétoriques sur les droits humains et l'égalité pour tous, s'il y avait imputabilité pour les auteurs de crimes et réparations pour les victimes et une protection des personnes vulnérables et l'accès à l'autonomie pour les personnes détentrices de droits, le tout dans le cadre d'un état de droit ? La réponse, je crois, est simple si nous avons la lucidité de voir au-delà des écrans de fumée propagandistes qui déforment la vision de la justice pour laquelle nous avons prêté serment, si nous avons le courage d'abandonner la peur et la déférence à l'égard des États puissants, si nous avons vraiment la volonté d'embrasser la bannière des droits humains et de la paix. Certes, il s'agit d'un objectif et la côte à gravir est raide. Mais nous devons commencer maintenant ou nous abandonner à une horreur indicible.
Dix points essentiels doivent nous guider.
1- Une action légitime. Premièrement, nous devons, au sein des Nations unies, abandonner le processus d'Oslo qui a échoué et qui est en grande partie fallacieux. Sa solution illusoire à deux États, son Quartet impuissant et complice. Et il faut cesser la mise en berne du droit international pour obéir à des diktats de pure convenance politique. Nos politiques doivent être fondées sans équivoque sur les droits humains et le droit international.
2- Une vision claire. Nous devons cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'un conflit territorial ou religieux entre deux parties belligérantes, et admettre la réalité de la situation dans laquelle un État au pouvoir disproportionné colonise, persécute et dépossède une population indigène sur la base de son appartenance ethnique.
3- Un test unique fondé sur les droits humains. Nous devons soutenir l'établissement d'un État unique, démocratique et laïque dans toute la Palestine historique, avec des droits égaux pour les chrétiens, les musulmans et les juifs et, par conséquent, assumer le démantèlement du projet colonialiste profondément raciste et la fin de l'apartheid sur l'ensemble du territoire.
4- Lutte contre l'apartheid. Nous devons rediriger tous les efforts et toutes les ressources des Nations unies vers la lutte contre l'apartheid, comme nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud dans les années 1970, 1980 et au début des années 1990.
5- Retour et indemnisation. Nous devons réaffirmer et insister sur le droit au retour et à l'indemnisation complète de tous les Palestiniens et de leurs familles qui vivent actuellement dans les territoires occupés et au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans la diaspora à travers le monde.
6- Vérité et justice. Nous devons appeler à un processus de justice transitionnelle, en utilisant pleinement les décennies d'enquêtes, d'investigations et de rapports accumulés par l'ONU, afin de documenter la vérité et de garantir que les coupables répondent de leurs actes, et qu'il y ait réparation pour toutes les victimes et des remèdes aux injustices qui auront été documentées.
7- La protection. Nous devons insister sur le déploiement d'une force de l'ONU dotée de ressources suffisantes et d'un mandat solide pour protéger les civils, du fleuve Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée.
8- Désarmement. Nous devons plaider pour le retrait et la destruction des stocks massifs d'armes nucléaires, chimiques et biologiques d'Israël, de peur que le conflit ne mène à la destruction totale de la région et même possiblement au delà.
9- La médiation. Nous devons reconnaître que les États-Unis et les autres puissances occidentales ne sont pas des médiateurs crédibles, mais plutôt des parties au conflit qui sont complices d'Israël dans la violation des droits des Palestiniens, et nous devons les aborder en tant que tels.
10- La solidarité. Nous devons ouvrir grand nos portes (et celles du secrétariat général) à tous les défenseurs des droits humains palestiniens, israéliens, juifs, musulmans et chrétiens qui sont solidaires du peuple de Palestine et de ses droits humains. Et nous devons mettre fin au flux incontrôlé de lobbyistes israéliens qui assaillent les bureaux de l'ONU où ils prônent la poursuite de la guerre, de la persécution, de l'apartheid et de l'impunité, et dénigrent nos défenseurs des droits humains pour leurs positions de principe en faveur des droits des Palestiniens.
Il faudra des années pour y parvenir et les puissances occidentales nous combattront à chaque étape du processus. C'est pourquoi nous devons faire preuve de fermeté.
Tout de suite, nous devons travailler pour un cessez-le-feu immédiat, pour la fin du siège de Gaza et nous opposer au nettoyage ethnique à Gaza, Jérusalem, en Cisjordanie et ailleurs. Nous devons documenter l'assaut génocidaire à Gaza, contribuer à l'acheminement d'une aide humanitaire massive et à la reconstruction pour les Palestiniens. Nous devons prendre soin de nos collègues traumatisés et de leurs familles et nous battre comme des diables pour une approche reposant sur des principes dans les bureaux de l'ONU.
En tant que Haut-Commissariat des droits de l'homme, rejoignons avec audace et fierté le mouvement anti-apartheid qui se développe dans le monde entier, en ajoutant notre logo à la bannière de l'égalité et des droits de l'homme pour le peuple palestinien. Le monde nous observe.
Nous devrons tous rendre compte de notre position à ce moment crucial de l'histoire. Prenons le parti de la justice.
Je vous remercie, monsieur le Haut-Commissaire Volker, d'avoir écouté ce dernier appel. Dans quelques jours, je quitterai nos bureaux pour la dernière fois, après plus de 30 ans de service. Mais n'hésitez pas à me contacter si je peux vous être d'une quelconque assistance à l'avenir.
Je vous prie d'agréer monsieur le Haut-Commissaire, l'expression de mes salutations distinguées.
Craig Mokhiber
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : La famine comme méthode de guerre

Aujourd'hui, devant la Cour internationale de justice de La Haye, l'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide. Au cœur de son argumentation, l'Afrique du Sud affirme qu'Israël détruit la population de Gaza en la privant de nourriture. L'article 2(c) de la Convention sur le génocide interdit la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». Israël affirme que ces accusations sont « sans fondement ».
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Publié à l'origine par la London review of books du 11 janvier 2024. Photo : Des palestiniens reçoivent de la nourriture à un point de distribution à Rafah le 19 décembre 2023 © Mohammed Talatene/dpa/Alamy Live News.
Le système alimentaire de Gaza s'est complètement effondré. Le système de santé s'est effondré. Les infrastructures de base pour l'eau potable et l'assainissement se sont effondrées. Selon le Comité d'évaluation de la famine (FRC), la population de Gaza est confrontée à une réelle perspective de famine : sans action immédiate, une mortalité massive due à la faim ou à des épidémies se profile à l'horizon. Le FRC transmet ses évaluations à un groupe d'organisations humanitaires internationales qui gèrent un système d'alerte précoce connu sous le nom de cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).
Comme je l'ai écrit dans le LRB à propos de la crise du Tigré, l'IPC identifie cinq phases d'(in)sécurité alimentaire : minimale, sous pression, crise, urgence et catastrophe/famine. On parle de famine dans une région donnée lorsqu'au moins 20 % de la population est touchée, qu'environ un enfant sur trois souffre de malnutrition aiguë et que deux personnes meurent chaque jour pour 10 000 habitants en raison de la famine pure et simple ou de l'interaction de la malnutrition et de la maladie. Les ménages peuvent être en phase 5 de la catastrophe même si la famine n'a pas été déclarée dans la région. Selon l'analyse la plus récente du FRC sur Gaza, datée du 21 décembre 2023, « au moins un ménage sur quatre (plus d'un demi-million de personnes) dans la bande de Gaza est confronté à des conditions d'insécurité alimentaire aiguë catastrophique ».
Une autre façon de diagnostiquer et de définir la famine consiste à déterminer le nombre de décès excédentaires imputables à la faim et à des causes connexes. Une « grande famine » est une famine au cours de laquelle 100 000 personnes ou plus meurent et une « famine majeure » correspond à un seuil de 10 000 décès excédentaires. Cette méthode est utile pour les famines historiques, mais pas pour les crises alimentaires en cours.
Save the Children a prévenu que les décès à Gaza dus à la famine et à d'autres causes pourraient bientôt dépasser les quelque 22 000 décès directement causés par l'assaut militaire. Les familles passent souvent un, deux ou trois jours sans manger. Les maladies infectieuses, qui sont souvent la cause immédiate de la mort des personnes mal nourries, se propagent. On estime que près de 70 % des logements ont été détruits ou endommagés. Peu de personnes ont accès à l'eau potable et encore moins à des toilettes. Le risque d'épidémies de maladies hydriques et d'autres maladies infectieuses est extrêmement élevé.
Si la catastrophe à Gaza se poursuit sur sa trajectoire actuelle, la prédiction d'une mort massive due à la maladie, à la faim et à l'exposition aux dangers se réalisera. Si l'aide humanitaire est fournie rapidement et à grande échelle, les décès dus à la faim et à la maladie se stabiliseront et diminueront, mais il faudra encore du temps pour revenir aux niveaux d'avant la crise. Même en cas de cessation immédiate des hostilités et d'acheminement de l'aide d'urgence, ainsi que d'efforts pour rétablir l'approvisionnement en eau, l'assainissement et les services de santé, la mortalité resterait élevée pendant des semaines ou des mois. Même dans ce cas, il s'agirait d'une « famine majeure », selon la définition de 10 000 décès ou plus. Une « grande famine », avec 100 000 morts ou plus, pourrait être envisagée si les hostilités et les destructions se poursuivent à leur niveau actuel.
Le crime de guerre de famine est défini dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale comme suit :
« Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève. »
Les « biens indispensables à la survie » comprennent non seulement la nourriture, mais aussi l'eau, les médicaments et le logement. Il n'est pas nécessaire que les individus meurent de faim pour que le crime soit commis ; il suffit qu'ils aient été privés de « biens indispensables à la survie ». Human Rights Watch et d'autres ont conclu que les actions d'Israël à Gaza constituent le crime de guerre de famine.
Le général Giora Eiland, ancien chef du Conseil national de sécurité israélien, a écrit : « On pourrait nous demander si nous voulons que les habitants de Gaza meurent de faim. Ce n'est pas le cas… Il faut dire à la population qu'elle a deux choix : rester et mourir de faim, ou partir ». Il s'agit toujours d'un crime de famine.
La guerre de siège n'est pas en soi illégale, mais elle peut le devenir si elle prive de manière disproportionnée et systématique les civils de « biens indispensables à la survie ». Le siège de Gaza depuis 2006 est un cas controversé : Israël contrôlait presque totalement l'approvisionnement en nourriture, en eau, en médicaments et en électricité ; il décidait rigoureusement des produits autorisés à entrer dans la bande de Gaza, tout en s'efforçant de ne pas enfreindre le droit humanitaire international. Selon Dov Weisglass, conseiller du Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Olmert, « l'idée est de mettre les Palestiniens au régime, mais pas de les faire mourir de faim ».
Au fil des ans, le siège a entraîné de graves privations. « Avant le conflit actuel, selon les conclusions des Nations unies publiées le mois dernier,
« 64 % des ménages de la bande de Gaza étaient en situation d'insécurité alimentaire ou vulnérables à l'insécurité alimentaire, et 124 500 jeunes enfants vivaient en situation de pauvreté alimentaire… » En outre, avant le début des hostilités le 7 octobre, l'UNRWA a signalé que plus de 90 % de l'eau à Gaza avait été jugée impropre à la consommation humaine.
C'est à partir de cette situation que Gaza a rapidement basculé dans la catastrophe. Le gouvernement israélien a agi en pleine connaissance des conditions humanitaires existantes et des effets de toute action qu'il a choisi d'entreprendre. Il en va de même pour le Hamas, mais cela n'est pas pertinent pour déterminer la responsabilité d'Israël. Le 9 octobre, le ministre de la défense, Yoav Gallant, a déclaré : « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé ». Les minuscules quantités d'aide humanitaire autorisées par la suite à entrer dans Gaza n'atténuent ni la force de cette déclaration ni son impact.
Selon le cadre élaboré par David Marcus, professeur de droit à l'UCLA, il s'agit là d'une indication prima facie d'un « crime de famine » au premier degré. Même si la déclaration de Gallant ne reflète pas la politique de l'État ou la stratégie militaire, le fait que la campagne militaire d'Israël se soit poursuivie sans modification significative de ses méthodes après que les conséquences humanitaires sont devenues évidentes signifie que l'opération à Gaza est également un crime de famine au deuxième degré. Quoi qu'il en soit, réduire Gaza à une situation où la famine menace est non seulement un crime de guerre au sens du Statut de Rome, mais aussi un crime contre l'humanité.
L'IPC a été élaboré en 2004. En se référant à ses procédures et critères, des famines ont été déclarées en Somalie en 2011 et au Soudan du Sud en 2017. Dans d'autres cas, notamment en Éthiopie, au Nigeria et au Yémen, le FRC a identifié des conditions généralisées de la phase 4 de l'IPC (« urgence ») et a mis en garde contre une famine imminente si des mesures humanitaires immédiates n'étaient pas prises. La famine n'a pas été déclarée en Syrie, où l'IPC n'a pas recueilli de données. Dans le catalogue historique des famines et des cas de famine de masse, il est difficile de trouver un parallèle étroit avec la situation à Gaza. Peu de cas combinent un siège d'une telle ampleur avec une destruction aussi complète des « biens indispensables à la survie ». Le nombre absolu de personnes qui meurent à Gaza n'égalera pas celui des famines calamiteuses du XXe siècle, car la population touchée est moins nombreuse, mais le nombre proportionnel de morts pourrait être comparable.
La rigueur, l'ampleur et la rapidité de la destruction des « biens indispensables à la survie » et de l'application du siège dépassent tous les autres cas de famine provoquée par l'homme au cours des 75 dernières années. Le FRC prévient que la famine pourrait être généralisée dès le mois prochain. Des comparaisons peuvent être faites avec la famine forcée du Biafra (1967-70), le siège de Sarajevo (1992-95), la tactique « s'agenouiller ou mourir de faim » utilisée par le gouvernement Assad en Syrie et les crimes de famine perpétrés par les gouvernements de l'Éthiopie et de l'Érythrée dans le Tigré (2020-22).
Dans une typologie historique comparative, Bridget Conley et moi-même avons identifié neuf objectifs de la famine pour les acteurs politiques et militaires qui la perpètrent à grande échelle, dont les cinq premiers sont : l'extermination ou le génocide ; le contrôle par l'affaiblissement d'une population ; la prise de contrôle territorial ; l'élimination d'une population ; la punition. Pour le gouvernement israélien, affamer Gaza correspond sans aucun doute aux quatre dernières catégories. Si certaines déclarations de hauts responsables politiques israéliens doivent être prises au pied de la lettre et si Israël poursuit sa campagne sans relâche, après un avertissement sans équivoque relatif à la famine, les arguments en faveur de l'extermination et du génocide peuvent devenir convaincants. Pour mettre fin au crime de famine, il est essentiel de demander des comptes aux acteurs responsables, et Israël ne fait pas exception à la règle.
Alex de Waal, 11 janvier 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Massacres, destruction généralisée, déportation, famine, répression… : 100 jours d’atrocités à Ghaza

Près de 24 000 Palestiniens ont été tués dans la Bande de Ghaza, en cent jours d'une campagne militaire d'une incommensurable sauvagerie. 35% des infrastructures urbaines de l'enclave dévastée ont été rasés de la carte.
Tiré d'Algeria Watch.
La guerre féroce déclenchée par Israël contre Ghaza, en représailles à l'opération « Déluge d'Al Aqsa », a bouclé hier son centième jour. Cent jours d'une violence inouïe durant lesquels l'armée sioniste, au prétexte de détruire Hamas, a commis une véritable boucherie dont la majorité écrasante des victimes sont des civils innocents, majoritairement des femmes et des enfants.
En 100 jours de frappes, de pilonnages et de destruction tous azimuts, la cartographie de Ghaza n'est plus que ruines et dévastation. Un incommensurable champ de désolation. L'organisation humanitaire Oxfam indiquait, il y a quelques jours, que le nombre moyen de morts à Ghaza depuis le début des attaques israéliennes dépasse et de loin tous les ratios des derniers conflits, même les plus meurtriers.
« L'armée israélienne tue des Palestiniens à un rythme moyen de 250 personnes par jour, ce qui dépasse largement le nombre de victimes quotidiennes de tout autre conflit majeur de ces dernières années », affirme cette ONG. D'après le dernier bilan communiqué hier par le ministère de la Santé à Ghaza, plus de 23 968 personnes ont perdu la vie dans l'enclave palestinienne durant ces 100 jours apocalyptiques, tandis que 60 582 ont été blessées.
« La mort, la destruction, le déplacement, la faim, la perte et le chagrin massifs de ces 100 derniers jours entachent notre humanité commune », s'est ému le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, depuis les entrailles déchiquetées de Ghaza.
Pour le directeur de l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens, une « génération entière » d'enfants à Ghaza vont être « traumatisés » pour la vie. M. Lazzarini a évoqué également les autres fléaux qui accablent la population de l'enclave palestinienne en insistant sur les maladies infectieuses et la famine.
« La famine menace 800 000 Palestiniens »
A propos de ce dernier point, le bureau gouvernemental des médias à Ghaza a alerté samedi, à travers un communiqué, sur le fait que la « famine menace de mort la vie d'environ 800 000 Palestiniens dans la Bande de Ghaza ». Il a expliqué que le territoire encerclé « a besoin de 1300 camions de nourriture par jour », mais l'armée sioniste, dénonce-t-il, empêche l'entrée des aides humanitaires.
La même instance accuse l'occupant de « tirer sur les camions qui tentent d'accéder au territoire, de cibler les conduites d'eau potable et les puits, et de perturber tous les aspects de la vie ». Dans un article bien documenté publié hier, l'agence d'information palestinienne Wafa est revenue sur ces 100 jours épouvantables avec, à la clé, un inventaire exhaustif des atrocités subies par la population civile de Ghaza.
Outre le chiffre de près de 24 000 morts et de plus de 60 000 blessés enregistrés depuis le début de l'opération militaire israélienne, Wafa précise qu'il a été recensé parmi les victimes plus de 7000 femmes et quelque 10 300 enfants. A ceux-là s'ajoutent au moins 8000 disparus ensevelis sous les décombres des bâtisses détruites par les bombardements.
« Sont tombés aussi en martyrs suite à l'agression sans relâche de l'occupant en 100 jours, plus de 109 journalistes, 373 cadres médicaux, 148 fonctionnaires des Nations unies, 4257 élèves et 227 enseignants et administrateurs scolaires », énumère l'agence de presse palestinienne.
La même source cite également un rapport de l'ONG Save the Children qui affirme qu'« au moins 10 enfants perdent chaque jour leurs jambes dans la Bande de Ghaza ». L'ONG déplore le fait que « la plupart des interventions chirurgicales subies par les enfants ont été effectuées sans anesthésie faute de fournitures médicales ».
D'autres chiffres du Bureau central palestinien des statistiques relayés par l'agence Wafa donnent un aperçu de l'ampleur des destructions au niveau du tissu urbain et des infrastructures des villes palestiniennes d'El Qita'. « 290 000 unités d'habitation ont été endommagées dans la Bande de Ghaza du fait des frappes aériennes, terrestres et maritimes de l'armée d'occupation au long de ces 100 jours », rapporte Wafa.
Et de poursuivre : « Les attaques ont lourdement touché 65 000 logements qui sont devenus inhabitables. 25 010 bâtisses ont été totalement détruites. En outre, 145 mosquées et 3 églises ont été ciblées par les frappes. 30 hôpitaux sont hors service et 26 autres sont partiellement paralysés, à quoi s'ajoutent 121 ambulances détruites. »
Concernant les infrastructures pédagogiques, Wafa souligne que « 95 édifices représentant un établissement scolaire ou bien une université ont été entièrement détruits ; 295 écoles et universités ont été partiellement endommagées, et 130 structures de l'Unrwa ont été directement touchées par les frappes ».
« 35% des zones urbaines ont été rasées à Ghaza »
L'agence de presse palestinienne fait savoir par ailleurs que « 35% des zones urbaines ont été rasées de la surface de la terre à Ghaza », chiffre attribué au ministère palestinien des Travaux publics. Le même département assure que « 40% des infrastructures ont été totalement pulvérisées, parmi lesquelles des routes, des réseaux de distribution d'eau potable, d'assainissement, des réseaux de télécommunications et des câbles électriques ».
Concernant les personnes déplacées, « selon certaines estimations, 1,93 million de citoyens, soit 85% de la population de Ghaza, ont été déportés de force, et plusieurs d'entre eux ont changé plus d'une fois de refuge en quête de sécurité ».
« Il a été enregistré près de 1,4 million de déplacés internes répartis sur 155 abris de l'Unrwa », continue Wafa. Et de faire remarquer : « Le gouvernorat de Rafah est devenu la destination principale des déplacés, le territoire ayant reçu plus de 1 million de personnes. Il détient de ce fait la densité démographique la plus élevée. »
Des indications de l'Unrwa complètent le tableau : « 670 000 déplacés sont répartis sur 97 abris de l'Unrwa à Khan Younès et Deir El Balah, et 160 000 autres se sont réfugiés dans 57 abris au nord de la Bande de Ghaza, et ces derniers ne reçoivent pas d'aide humanitaire. »
Depuis plus de trois mois, les Ghazaouis sont ainsi dispersés entre camps de fortune et abris de l'Unrwa surpeuplés, et qui, bien souvent, ne sont pas épargnés par les raids meurtriers. « Avec l'arrivée de l'hiver, de nombreux camps d'hébergement abritant des dizaines de milliers de déplacés, ont été inondés du fait de la pénétration des eaux pluviales mélangées aux eaux usées », note Wafa.
Il convient d'insister sur le volume dérisoire des aides humanitaires qui parviennent à la population de Ghaza, celles-ci entrant au compte-gouttes du fait du blocus implacable imposé à l'enclave dévastée. « 80 à 120 camions transportant l'aide humanitaire seulement entrent quotidiennement à Ghaza, selon les estimations d'organisations caritatives, sachant que les besoins au sein de la Bande de Ghaza sont de 600 camions par jour », informe l'agence Wafa.
A signaler enfin, pour clore ce bilan tout à fait partiel et provisoire, l'ampleur de la répression qui s'abat sur le peuple palestinien, et qui a redoublé de terreur durant ces 100 jours infernaux. Selon l'Association des prisonniers palestiniens, pas moins de 5875 personnes ont été arrêtées en Cisjordanie.
Les campagnes d'arrestation ont touché 200 femmes et 355 mineurs, décompte arrêté à la fin décembre 2023, selon Wafa. L'Association des prisonniers palestiniens souligne par ailleurs que le nombre total de prisonniers dans les geôles israéliennes jusqu'à la fin de l'année 2023 est de 8800 personnes, précisant que le nombre de détenus avant le 7 octobre était de 5250.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lassé·es de l’absence de leadership, les Palestinien·nes aspirent à l’unité politique

Cet article, rédigé par Fatima AbdulKarim, une journaliste basée en Cisjordanie, offre des éléments d'information particulièrement éclairants, en partie inédits, et, pour la plupart, ignorés des médias mainstream, sur les processus politiques en cours au sein du Fatah et de la population palestinienne de Cisjordanie qui traduisent une forte volonté de démocratisation et de dépassement de la fragmentation actuelle du mouvement national palestinien, en particulier de la division entre le Fatah et le Hamas.
Tiré du site de la revue Contretemps.
Il informe également des discussions qui se mènent au niveau diplomatique au sujet de l'avenir du territoire de Gaza et du rôle joué par une Autorité palestinienne démonétisée et impuissante. Il permet également de comprendre les motivations qui ont poussé Israël à assassiner, le 2 janvier dernier, le numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, puis, le 8 janvier, l'un des chefs militaires du Hezbollah, Wissam Tawil, interrompant ainsi les négociations en cours autour des propositions égyptiennes, qui prévoyaient un cessez-le-feu, l'échange de prisonniers et d'otages et le maintien d'un contrôle palestinien de la bande de Gaza.
***
Depuis les attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre le sud d'Israël, la Cisjordanie occupée a connu un regain de violence et d'instabilité. Au cours des trois derniers mois, alors que l'attention du monde se portait sur la bande de Gaza et que les bombardements israéliens se poursuivaient, les soldats israéliens et les milices de colons ont tué plus de 300 Palestinien·nes en Cisjordanie, dont plus de 80 enfants, tandis que plus de 4 000 Palestinien·nes ont été arrêté·es.
Les colons ont également intensifié leur harcèlement et leur violence à l'encontre des Palestinien·nes dans une tentative calculée de s'emparer de leurs terres, déplaçant de force au moins 16 communautés isolées au cours des dernières semaines. Le territoire reste soumis à un strict verrouillage, jalonné de points de contrôle militaires qui empêchent les Palestinien·nes de se déplacer entre les villes et les villages.
Pour de nombreux·ses Palestinien·nes, le sentiment d'absence totale et d'inaction de la part de leurs propres dirigeants est tout aussi paralysant que l'étau de l'occupation qui se resserre. L'Autorité palestinienne (AP), dirigée par le président Mahmoud Abbas, s'est contentée de condamner timidement les escalades et les punitions collectives d'Israël, sans avoir la capacité réelle de les affronter.
Cela est devenu particulièrement évident à la suite d'une incursion de deux jours des forces israéliennes dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, le mois dernier, qui a effectivement transformé la ville en un « mini Gaza », comme l'ont rapporté de nombreux habitants. Cette opération a été accompagnée de plusieurs autres raids militaires dans d'autres villes de Cisjordanie au cours des dernières semaines, notamment Tubas et Tulkarem.
Quelques jours avant l'assaut israélien sur Jénine, Mustafa Sheta, directeur du théâtre de la liberté de la ville, a déclaré à +972 magazine que les habitant·es de Jénine se sentent abandonné·es, surtout lorsque tous les regards – y compris les leurs – se tournent vers Gaza. « L'AP est silencieuse. Elle ne nous rassure pas et ne panse pas nos plaies », a-t-il déclaré. Sheta a été arrêté par les forces israéliennes lors de l'opération de Jénine et envoyé à la prison de Megiddo où il passera six mois en détention administrative – c'est-à-dire un emprisonnement sans inculpation ni procès.
Le sentiment exprimé par Mustafa Sheta est confirmé par un récent sondage réalisé par le Centre Palestinien de Recherche et d'Enquêtes Politiques (PCPSR) en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Selon les résultats du sondage, le soutien au Hamas a bondi à 44 % parmi les Palestinien·nes de Cisjordanie, alors qu'il n'était que de 12 % en septembre. Le soutien à Abbas, à son parti, le Fatah, et à l'AP a considérablement diminué : plus de 90 % des personnes interrogées demandent la démission du président, tandis que le soutien à la dissolution de l'AP – près de 60 % en Cisjordanie et à Gaza – n'a jamais été aussi élevé dans un sondage du PCPSR.
Le mécontentement croissant de l'opinion face au silence assourdissant de l'AP face aux bombardements effrontés d'Israël sur Gaza, à l'intensification des raids dans les villes de Cisjordanie et à l'assassinat de hauts dirigeants palestiniens s'ajoute à des années de frustration face aux accusations persistantes de corruption, à l'incapacité de l'Autorité palestinienne à payer ses employés et au sentiment qu'elle est de plus en plus déconnectée de la vie de ses administrés. Plus que jamais, le sentiment que l'AP n'a plus aucune raison d'être est très fort.
Ainsi, pour de nombreux·ses Palestinien·nes, les dirigeants actuels ne sont pas en mesure de représenter les aspirations et les préoccupations de la population, ce qui les empêche de prendre des mesures significatives pour mettre fin à la guerre actuelle contre Gaza et faire progresser leur lutte dans son ensemble. Beaucoup insistent sur le fait qu'il est impératif qu'une nouvelle direction dirige ses actions sur les besoins urgents de la population, et qu'elle affirme l'initiative palestinienne autonome dans la cacophonie des discussions sur le « jour d'après ». L'Autorité palestinienne et ses dirigeants font cependant tout ce qu'ils peuvent pour rester au centre de ces plans élaborés par d'autres.
Fin du statu quo
Depuis le 21 octobre, les raids militaires israéliens à Jénine sont devenus routiniers, avec des incursions quasi toutes les nuits et des affrontements avec les combattants de la résistance basés dans le camp de réfugiés. Sur les quelque 500 Palestinien·nes tué·es en Cisjordanie au cours de l'année 2023 – le nombre annuel le plus élevé depuis la seconde Intifada – au moins 137 étaient originaires de Jénine. Mais à part sa rhétorique de condamnation et ses appels à la protection internationale, la destruction massive de la ville n'a pas poussé l'Autorité palestinienne à prendre des mesures.
Parlant de la situation à Jénine avant le raid de deux jours, Mustafa Sheta a déclaré que « les habitants du camp sont complètement dépassés par les incursions militaires nocturnes » qui laissent les réfugié·es déjà épuisé·es encore plus endeuillé·es et leurs infrastructures dans des conditions de plus en plus difficiles.
- « Nous ne savons pas quand cela se terminera », déplore-t-il. « L'armée affirme que l'opération vise à déraciner la résistance du camp, mais ce n'est pas un objectif réaliste. Ils ne peuvent pas anéantir la résistance d'un peuple opprimé – les meurtres entraînent des meurtres, et la violence entraîne la violence ».
Au milieu de cette tempête, les Palestinien·nes ressentent le coût du vide de leadership qui affecte leur action politique depuis des années. Ashraf Ajrami, analyste politique et écrivain, a critiqué l'approche actuelle de l'AP, qu'il qualifie d'« impuissante et dépourvue de légitimité populaire ». Il a noté que, lors d'un événement dédié aux prisonnier·ères politiques palestinien·nes libéré·es en échange des otages israélien·es pri·es par le Hamas le 7 octobre, le ministre de l'AP chargé des affaires des prisonniers, Qadura Faris, a été conspué par les participant.es.
Ashraf Ajrami accuse les dirigeant·es de l'AP, en particulier les proches du président Abbas, de faire comme si de rien n'était face à la catastrophe de Gaza. Il a souligné l'absence de mobilisation significative en Cisjordanie pour soutenir Gaza, d'autant plus que l'AP s'est déjà mobilisée à d'autres occasions, notamment en envoyant 40 pompiers et 8 camions pour aider à éteindre les incendies de forêt près de Haïfa en 2016.
Malgré ses critiques à l'égard du Fatah et du Hamas, Ajrami estime qu'il est possible d'aller de l'avant en créant une commission technocratique indépendante qui interviendrait pendant une période de transition, à la fois pour reconstruire Gaza et pour ouvrir la voie à des élections. Il souligne que le moment actuel est une opportunité potentiellement unique, affirmant que le monde est enfin réellement intéressé par la création d'un État palestinien : « La solution des deux États, basée sur les paramètres politiques établis par la communauté internationale, est sérieusement abordée pour la première fois depuis [le président américain Bill] Clinton ». Mais pour saisir cette opportunité, a-t-il souligné, il faut que les dirigeant·es changent radicalement d'approche.
« Nous avons besoin d'une personnalité capable d'unir le peuple »
Le sentiment général est qu'une personnalité politique largement respectée est nécessaire pour sortir de cette paralysie. Dans un petit café rempli de fumée de cigarette à Al-Bireh, une ville proche de Ramallah, Abu Othman, un client palestinien, a exprimé le point de vue de beaucoup : « Nous ne pouvons pas continuer à nous demander quelle est la suite avec les dirigeants actuels. Nous avons besoin d'une figure comme Abou Ammar », a-t-il déclaré en faisant référence à Yasser Arafat, le défunt dirigeant palestinien. « Quelqu'un qui puisse unir les gens malgré leurs différences ».
Le leader le plus en vue est Marwan Barghouti, prisonnier politique et leader historique du Fatah qui, selon le récent sondage du PCPSR, battrait à la fois Abbas et le leader du Hamas Ismail Haniyeh si des élections avaient lieu aujourd'hui. Devenu célèbre en tant qu'étudiant militant pendant la première Intifada, Barghouti a fini par s'impliquer dans la branche armée du Fatah, la Brigade des martyrs d'Al-Aqsa. Il a été arrêté par Israël au cours de la seconde Intifada [en avril 2001] et un tribunal militaire l'a condamné à cinq peines de prison à vie pour sa participation à des attaques contre des Israélien·nes.
Derrière les barreaux, Barghouti est resté actif dans le mouvement des prisonniers·ères et dans la politique palestinienne au sens large, publiant des articles et des déclarations qui soulignent la nécessité d'une réconciliation nationale. Souvent surnommé le « Mandela de la Palestine » [également du fait de la durée exceptionnelle de leurs séjours en prison, 27 ans pour Mandela, près de 23, à ce jour, pour le leader palestinien], Barghouti a conservé un large soutien populaire en tant que futur leader du mouvement national.
En raison de l'emprisonnement de Barghouti, certain·es Palestinien·nes se tournent également vers des personnalités établie·es au sein de l'AP en tant que leaders potentiels. Mahmoud Aloul, vice-président du Fatah depuis 2018, est considéré comme l'un de ces candidats.
Emprisonné et déporté de Cisjordanie en Jordanie après la guerre de 1967, Aloul est revenu en Palestine en 1995 dans le cadre des accords d'Oslo en tant que conseiller clé d'Arafat, qui l'a ensuite nommé gouverneur de Naplouse, poste qu'il a occupé pendant 10 ans et qui lui a valu une réputation d'homme du peuple. Laissant derrière lui son passé militaire, Aloul s'est fait l'avocat de la résistance populaire, notamment en organisant des manifestations et en boycottant les produits israéliens. Il supervise aujourd'hui les branches locales du Fatah en tant que chef de la Commission pour la mobilisation et l'organisation du parti.
Dans un modeste bureau ouvert au public, il est assis autour d'une longue table couverte de cahiers, de stylos, de ses lunettes et de son téléphone portable. Conscient de la gravité des conséquences de la guerre Israël-Gaza, il a déclaré à +972 magazine : « La priorité actuelle n'est pas de défendre l'AP ou de se l'approprier. La priorité est de regagner la confiance du peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté. Cette guerre est dirigée contre l'ensemble de la nation palestinienne – le génocide à Gaza et les tueries et destructions quotidiennes en Cisjordanie ».
Tout en reconnaissant l'impact de la division Fatah-Hamas sur le peuple palestinien, il poursuit :
- « Ce que je ressens personnellement, c'est que nous sommes en train de “tricoter le mauvais panier” lorsque nous parlons de la popularité des factions. La priorité devrait être la vision qui empêche Israël d'assassiner les rêves de notre peuple … de surmonter toutes les menaces qui pèsent sur les décisions palestiniennes indépendantes. Nous déployons de gros efforts pour mettre fin à cette [division] », ajoute-t-il, sans plus de précisions.
- « C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour renouer le contact avec la population et créer une atmosphère propice aux élections – c'est ce dont nous avons besoin », poursuit-il. « Personne ne prétend que la situation est rose ; il y a beaucoup de choses que nous devons rectifier, en particulier nos relations avec notre peuple ».
Mahmoud Aloul s'est adressé au public palestinien par le biais de messages vocaux enregistrés et publiés sur sa page Facebook officielle le 13 octobre et le 8 novembre, dans lesquels il soulignait que la priorité des dirigeants palestiniens devrait être de mettre fin à l'agression israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Dans son deuxième enregistrement, Aloul a exposé la voie à suivre pour les dirigeant·es palestinien·es : une position unifiée de l'OLP [Organisation pour la Libération de la Palestine] incluant le Hamas et le Jihad islamique, tous deux extérieurs à l'organisation. Des plans seraient en cours d'élaboration en vue de discussions sérieuses sur un tel accord d'unité.
Mais de nombreux·ses Palestinien·nes veulent plus qu'un nouvel accord élitiste. Fadi Quran, un militant politique de 35 ans, estime qu'une initiative palestinienne nouvelle et inclusive est nécessaire pour transcender les factions divisées. Pour compléter ces changements politiques au sommet, Fadi Quran envisage un mouvement populaire, semblable à la première Intifada, dans lequel les gens peuvent également participer au travail politique à partir de la base :
- « L'énergie est là, le soutien public est là et les idées sont là. Il suffit de les organiser. Il y a une décentralisation, les gens commencent à créer leurs propres réseaux d'action. Il faut espérer que cela continue à se développer et puisse donner naissance à quelque chose ».
Les scénarios diplomatiques pour le « jour d'après » à Gaza
Au cours des dernières semaines, des représentant·es des gouvernements des États arabes, notamment des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Égypte, ainsi que des États-Unis, du Royaume-Uni, des membres de l'Union européenne et d'Israël se sont réuni·es à huis clos pour envisager divers scénarios d'après-guerre pour Gaza, selon des sources diplomatiques au fait de ces discussions. On relève l'absence dans ces délibérations de tout engagement direct avec l'Autorité palestinienne ou le Hamas .
Les diplomates qui ont parlé à +972 magazine sous couvert d'anonymat ont expliqué que les scénarios envisagés penchaient vers la création d'une nouvelle entité administrative, excluant expressément le Hamas, qui est désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'UE. L'AP, dirigée par le Fatah, a fait l'objet de nombreuses critiques et qualifiée de corrompue et d'antidémocratique.
Les sources diplomatiques ont décrit diverses propositions pour le « jour d'après » qui ont été discutées lors de ces réunions, et qui visent toutes à assurer une transition pacifique vers une direction démocratiquement élue tout en permettant la réhabilitation de Gaza. Il existe un large consensus en faveur d'une période de transition au cours de laquelle une certaine force serait formée pour gouverner le territoire après la fin de la guerre et jusqu'à ce que des élections puissent être organisées. Cette force, selon ces sources, serait principalement composée de membres de l'appareil de sécurité palestinien et de personnalités reconnues de la communauté palestinienne.
Il est également question de réduire la taille de la bande de Gaza en créant une zone tampon militaire israélienne le long du « corridor de Philadelphie » – un territoire qui longe la frontière entre Gaza et l'Égypte – qu'Israël insiste aujourd'hui pour contrôler. L'Égypte ne s'est pas opposée, pour l'instant, à cette idée.
Une proposition égyptienne en trois étapes pour mettre fin à la guerre, connue localement sous le nom d'« initiative égyptienne », gagnait du terrain ces dernières semaines, avant d'être déclarée morte à la suite de l'assassinat du chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth le 2 janvier.
L'initiative, soutenue par les médiateurs qataris, prévoyait la fin progressive des hostilités, en commençant par une trêve temporaire qui permettrait la libération des otages israélien·nes en échange des Palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes, et conduisant finalement à un cessez-le-feu permanent. Elle envisageait également un changement de leadership à Gaza, de sorte que le Hamas ne gouverne plus la bande de Gaza, mais ne mentionnait pas l'Autorité palestinienne.
Le comité exécutif de l'OLP, présidé par Mahmoud Abbas, a publiquement rejeté l'initiative, la semaine dernière, dans sa forme initiale. Bassam al-Salhi, membre du comité, a déclaré à +972 magazine que l'instance dirigeante de la centrale palestinienne se concentrait principalement sur « un cessez-le-feu immédiat et un cadre pour une voie politique globale visant à mettre fin à l'occupation, après quoi nous pourrons aborder les questions intérieures, y compris l'unité, les réformes et les élections. Nous n'avons aucune garantie que la communauté internationale reconnaisse les résultats des élections que nous organisons sur la base de ce que nous avons vu en 2006 », a-t-il ajouté.
En coulisse, cependant, l'AP a reçu une bouée de sauvetage : un haut responsable du Fatah a déclaré à +972 magazine que l'Égypte lui avait assuré que le rôle de l'AP dans le processus de transition était admis par toutes les parties sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter.
L'AP a alors demandé un amendement à la proposition, que l'Égypte a accepté, pour qu'un gouvernement d'unité nationale soit établi par le biais d'un accord de réconciliation entre les factions palestiniennes, plutôt que par un organe technocratique. Les responsables de l'AP craignaient que ce dernier scénario ne permette le retour d'opposants personnels d'Abbas, tels que Mohammed Dahlan, basé à Abu Dhabi, et l'ancien représentant de l'OLP, Nasser al-Kidwa, le neveu de Yasser Arafat.
Considérant cette initiative comme un moyen de rester dans le jeu, et cherchant ainsi à garder les Etats-Unis de son côté, l'AP a également demandé des ajouts à la proposition en ce qui concerne les réformes de ses mécanismes de gouvernance, de sécurité, de justice et d'administration. Les responsables états-uniens avaient clairement fait savoir à l'AP qu'il s'agissait là de leurs exigences, de même que l'idée de recycler une force de sécurité de l'AP qui serait responsable de la sécurité dans la bande de Gaza après la guerre. L'Égypte semblait être favorable à ces changements, avant que les pourparlers ne soient interrompus après l'assassinat d'al-Arouri.
À la lumière de ces discussions, l'AP a publiquement souligné son attachement aux principes démocratiques, plaidant en faveur d'élections nationales libres et équitables pour déterminer la représentation. Lors de ses rares apparitions publiques – largement critiquées – depuis le 7 octobre, Mahmoud Abbas a réaffirmé que l'AP était prête à prendre en charge la gouvernance de Gaza et a souligné que la reprise des négociations en vue d'une solution à deux États demeurait une priorité.
La position officielle d'Abbas repose sur trois piliers : l'arrêt de l'expulsion des Palestiniens de Gaza hors de l'enclave, la reprise du contrôle total de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous l'égide de l'OLP (à laquelle s'ajouteraient le Hamas et le Jihad islamique), et le lancement d'un processus de paix global. Les observateurs affirment que, dans les conditions actuelles, aucun de ces plans n'est réaliste.
Pour Quran, ces paroles creuses de la part des dirigeants palestiniens, sans légitimité politique ni pouvoir pour les soutenir, démontrent la nécessité d'une approche plus globale pour restaurer l'agence palestinienne. Nous sommes arrivés à un moment où les Palestiniens disent : « Nous voulons être représentés. Nous voulons que notre politique soit inclusive et nous voulons des gens compétents », a-t-il déclaré. « En avançant vers notre libération, nous commencerons à créer l'unité ».
*
Fatima AbdulKarim est une journaliste palestinienne indépendante basée à Ramallah (Cisjordanie). Outre +972 magazine, dont elle une contributrice régulière, elle collabore à plusieurs grands médias internationaux, dont le Wall Street Journal, The Nation et The Guardian.
Cet article a été publié le 4 janvier 2024 sur le site israélien judéo-arabe +972 magazine. Traduction par Contretemps.
Illustration : State Department photo by Ron Przysucha / Domaine public.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Deuxième Assemblée générale annuelle de Presse-toi à gauche !
Le 13 avril, une quinzaine de personnes de Québec ont participé à la deuxième Assemblée générale annuelle de Presse-toi à gauche ! Après deux ans de travail motivé par la volonté enthousiaste d'ouvrir un espace journalistique national de réflexion et discussion pour la gauche québécoise en marche, quel bilan tirer ? Et surtout, vers où aller pour avancer ?
Bilan
Si l'on demeure toujours bien loin du rêve de ce journal national de gauche en format papier dont le Québec progressiste pourrait tant bénéficier, Presse-toi à gauche ! tire néanmoins un bilan positif de ces deux premières années. Car PTAG, c'est tout de même aujourd'hui près de 2000 articles parus sous la plume de plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices, près de 600 visites quotidiennes sur son site, et plus de 1 200 abonnéEs web qui reçoivent la mise à jour maintenant bi-hebdomadaire de son site. De plus, PTAG peut se targuer d'avoir un impact non négligeable sur les débats en cours au sein de Québec solidaire, ce qui est certainement un apport démocratique bienvenu et salutaire en ces années importantes de formation de ce jeune parti politique. Une bonne tape dans le dos s'impose donc, pour accompagner la volonté renouvelée de poursuivre l'aventure.
Mais pour autant, les difficultés de l'entreprise ne sauraient être éludées. Parmi les défis les plus pressants, on note celui d'augmenter (encore et toujours) la participation trop largement minoritaire des femmes, celui de faire connaître davantage un journal qui peine à trouver notoriété hors du milieu relativement fermé de la gauche progressiste et militante, et aussi, celui de passer d'un journalisme encore trop exclusivement d'opinion, vers un journalisme d'enquête et plus directement informatif. Par ailleurs, est-ce une banalité d'indiquer qu'à PTAG comme ailleurs, on se heurte au même reflux militant que l'on peut observer partout au Québec, à la fin de cette vague qui avait, depuis le Sommet des Amériques, stimulé un renouveau progressiste au Québec culminant notamment en 2006 avec la création de Québec solidaire ? Ici comme ailleurs, les énergies sont rationnées, et l'intérêt public se fait frileux pour les propositions progressistes, ce qui n'aide en rien l'expansion d'un projet exigeant comme celui de PTAG…
Perspectives
Qu'à cela ne tienne, les membres de PTAG ! ont procédé à l'adoption de statuts pour PTAG ! (qui est devenu récemment une OSBL en règle), et renouvelé la composition des comités d'organisation et de rédaction. Une série de mesures, visant à répondre aux défis auxquels PTAG ! fait face, ont également été adoptées. On y retrouve l'adoption d'une plate-forme comme base politique du journal, une proposition d'identification et de mise en réseau des collaborateurs et collaboratrices de PTAG !en fonction de leurs compétences et intérêts, et celle de la mise en branle d'un plan de financement et de visibilité pour Presse-toi à gauche ! L'élargissement de l'équipe de PTAG !, tant en termes numériques qu'en terme d'une participation accrue de gens d'autres régions que celle de Québec, est également dans la ligne de mire.
Au final, il apparaît que la survie et le développement de Presse-toi à gauche ! passera, ici encore, par un travail patient et systématique de construction et d'implication. Ne doit-on pas, comme on le faisait remarquer avec humour, attacher une veste un bouton à la fois ? Gageons qu'en ce dimanche ensoleillé d'avril, les participants et participantes à cette assemblée générale auront tout autant été inspiré-es à retrousser leurs manches, en prévision du travail – et du soleil – qui se pointe à l'horizon !
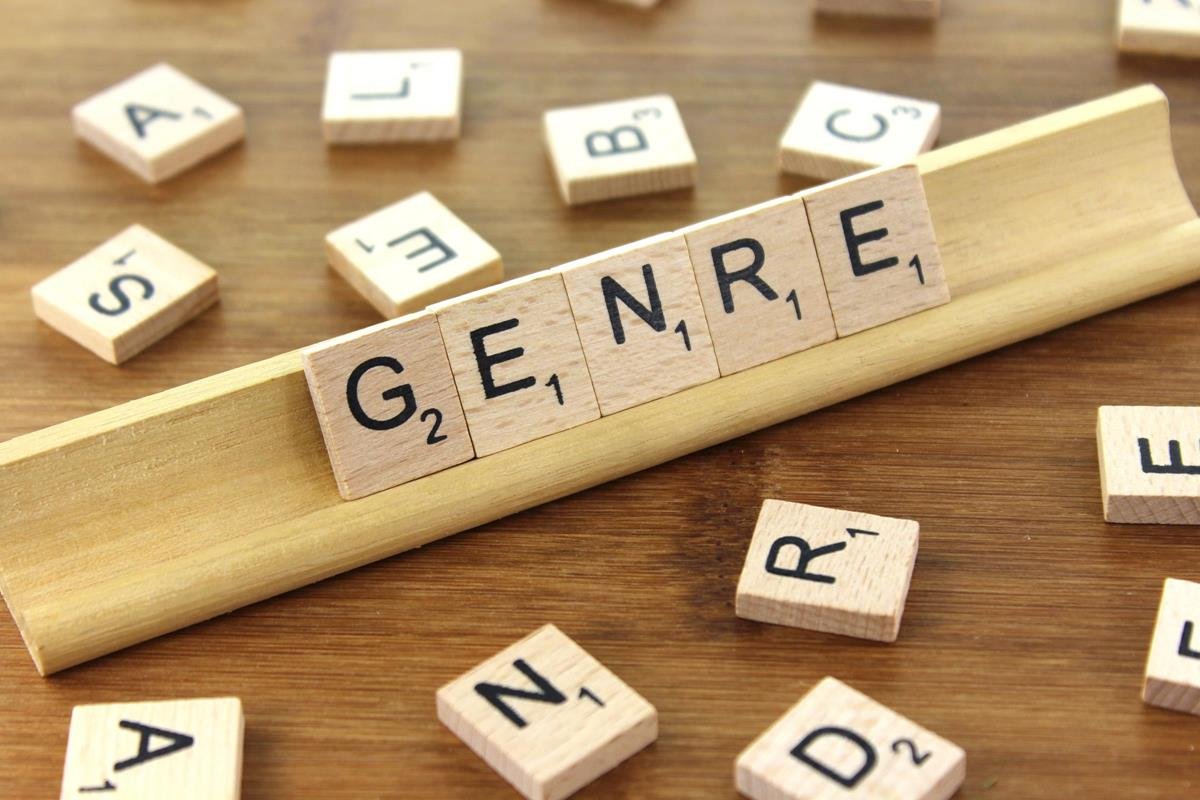
Définition du genre : lancement d’un débat
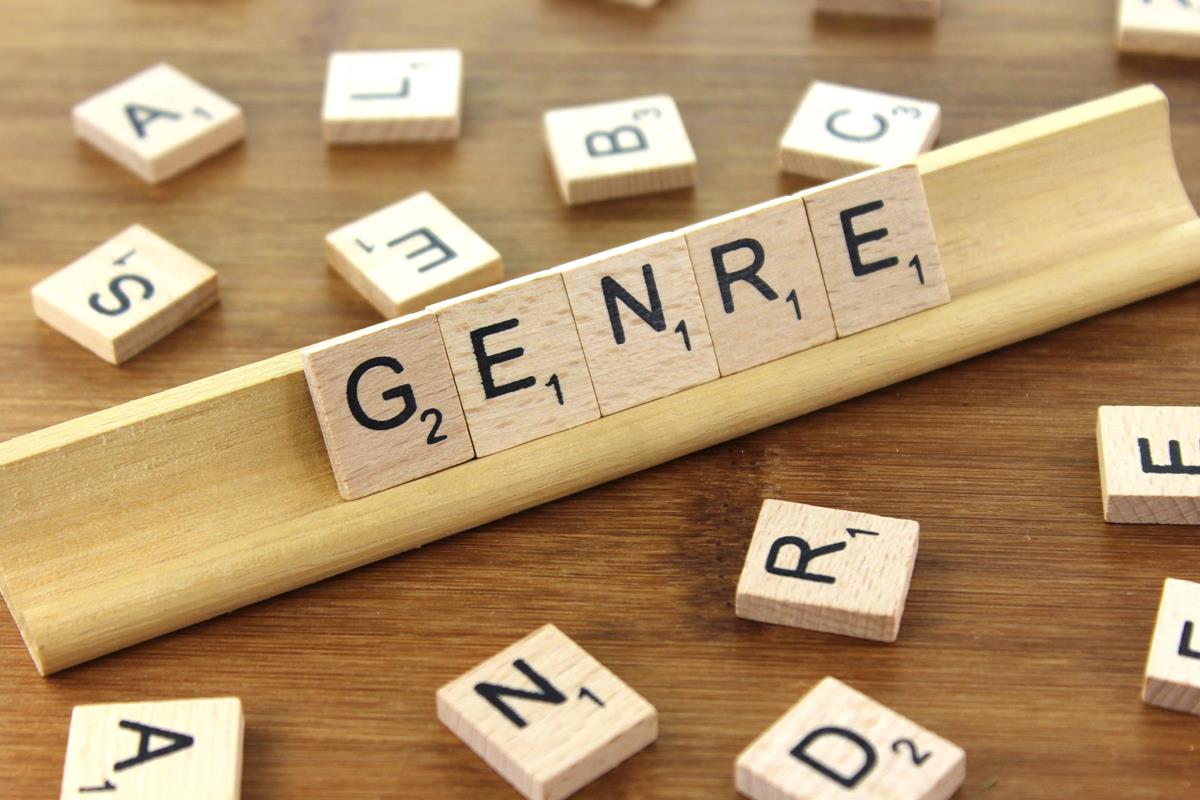
Nous sommes déçus que l'American Anthropological Association (AAA) et la Société canadienne d'anthropologie (CASCA) aient choisi d'interdire le dialogue scientifique lors de l'importante conférence conjointe, intitulée « Transitions », qui se tiendra à Toronto en novembre.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Chères Drs. Ramona Pérez and Monica Heller
Notre session, « Let's Talk About Sex Baby : Pourquoi le sexe biologique reste une catégorie analytique nécessaire en anthropologie », a été acceptée le 13 juillet 2023 après que la proposition ait été « examinée par les présidents de programme des sections de l'AAA ou par le Comité scientifique de la CASCA ». Entre le moment de cette acceptation et la réception de votre lettre datée du 25 septembre 2023, personne de l'AAA ou de la CASCA n'a contacté les organisateurs pour leur faire part de ses préoccupations. Ainsi, nous sommes tous choqués que l'AAA et la CASCA aient annulé la session en raison de la fausse accusation selon laquelle « les idées ont été avancées de manière à causer du tort aux membres représentés par les Trans et les LGBTQI de la communauté anthropologique ainsi qu'à la communauté dans son ensemble ». Etant donné la gravité de l'allégation, nous espérons que, plutôt que de la garder secrète, l'AAA et la CASCA partageront avec ses membres et avec nous-mêmes la documentation sur les sources exactes et la nature de ces plaintes, ainsi que la correspondance qui a conduit à cette décision.
Nous sommes perplexes quant au fait que l'AAA / CASCA adopte comme position officielle que conserver l'usage des catégories de sexe biologique (par exemple, mâle et femelle, homme et femme) revient à mettre en péril la sécurité de la communauté LGBTQI. La présentation de notre session, rédigée par Kathleen Lowrey, reconnaît que tous les anthropologues n'ont pas besoin de faire la différence entre le sexe et le genre. L'un des résumés exprime explicitement la crainte que le fait d'ignorer la distinction entre le sexe et l'identité de genre ne porte préjudice aux membres de la communauté LGBTQI. Dans « No bones about it : skeletons are binary ; people may not be » (Il n'y a pas de doute : les squelettes sont binaires ; les gens ne le sont pas forcément), Elizabeth Weiss écrit : « Dans le domaine de la médecine légale, cependant, les anthropologues devraient travailler (et ils le font) sur les moyens de garantir que les squelettes découverts soient identifiés à la fois par leur sexe biologique et leur identité de genre, ce qui est essentiel compte tenu de l'augmentation actuelle du nombre de personnes en transition de genre. »
Kathleen Lowrey a joué un rôle clé dans la constitution du panel des intervenants et dans la définition du thème qui nous rassemblait. Notre équipe réunissait des femmes diverses, dont l'une est lesbienne. En plus de présenter trois domaines de l'anthropologie, elle comprenait également des anthropologues de quatre pays et s'exprimant en trois langues – il s'agissait d'un panel international préoccupé par l'invisibilisation des femmes.
L'anthropologue espagnole Silvia Carrasco avait prévu de présenter des données sur « l'oppression, la violence et l'exploitation fondées sur le sexe » et sur la difficulté d'aborder ces questions lorsqu'on tourne le dos au sexe biologique. Le résumé de l'anthropologue britannique Kathleen Richardson mettait l'accent sur les disparités matérielles entre les sexes dans l'industrie technologique, que l'on gomme en comptant les hommes qui s'identifient comme transgenres comme des femmes, plutôt qu'en faisant entrer davantage de femmes dans le secteur. L'anthropologue canadienne francophone Michèle Sirois devait présenter un compte-rendu ethnographique des manières dont « les féministes québécoises se sont organisées pour documenter, clarifier et s'opposer à l'industrie de la maternité de substitution qui exploite les femmes et qui se cache sous le couvert de l'« équité » et de l'« inclusion » », et dans laquelle les politiques de maternité de substitution qui exploitent les femmes pauvres sont cyniquement présentées comme libératrices.
Votre suggestion selon laquelle notre session compromettrait d'une manière ou d'une autre « l'intégrité scientifique du programme » nous semble particulièrement grave, car la décision de jeter l'anathème sur elle ressemble beaucoup à une réponse anti-scientifique à une campagne de lobbying politisée. Si notre session avait été autorisée à poursuivre ses travaux, nous pouvons vous assurer qu'une contestation animée aurait été accueillie favorablement par les membres du panel et qu'elle aurait même pu survenir entre nous, étant donné que nos propres engagements politiques sont divers. Au lieu de cela, votre lettre exprime l'espoir alarmant que l'AAA et la CASCA deviennent « plus unifiées au sein de chacune de nos associations » afin d'éviter de futurs débats. Plus inquiétant encore, à l'instar d'autres organisations telles que la Society for American Archaeology, l'AAA et la CASCA ont promis qu' « à l'avenir, nous entreprendrons un examen approfondi des processus associés à l'approbation des sessions lors de nos réunions annuelles et nous inclurons nos dirigeants dans cette discussion ». Les anthropologues du monde entier trouveront à juste titre glaçante cette déclaration de guerre contre les divergences et la controverse scientifique. Il s'agit d'une profonde trahison du principe de l'AAA qui consiste à « faire progresser la compréhension humaine et à appliquer cette compréhension aux problèmes les plus urgents du monde ».
Sincèrement
Kathleen Lowrey (Associate Professor at University of Alberta)
Elizabeth Weiss (Professor at San José State University ; Heterodox Academy Faculty Fellow)
Kathleen Richardson (Professor at De Montfort University)
Michèle Sirois (Présidente de PDF Québec)
Silvia Carrasco (Professor at Autonomous University of Barcelona)
Carole Hooven (Associate, Department of Psychology, Harvard University ; Senior Fellow, American Enterprise Institute) – celle-ci devait participer, mais n'a pas pu le faire en raison d'un imprévu
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Définition du genre : un débat

Nous écrivons afin de soutenir la décision de l'American Anthropological Association de retirer la session « Let's Talk About Sex, Baby » de la conférence annuelle. La session elle-même émet un certain nombre d'affirmations qui vont à l'encontre d'une grande partie des connaissances scientifiques établies dans le domaine de l'anthropologie biologique et, plus généralement, de la biologie de l'évolution, en lançant de vagues insultes au concept de genre, sans le définir de manière significative.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Examinons quelques-unes d'entre elles :
Bien que certains se soient concentrés sur le titre de la session, ce qui nous intéresse ici porte seulement sur la manière dont le titre assume une position erronée au vu des connaissances scientifiques.
Les participants de la session proposent un concept de « sexe biologique » qui s'oppose à celui de « genre » sans définir l'un ou l'autre terme.
La session suggère que le « genre » est en train de remplacer le « sexe » en anthropologie. C'est faux, car un travail massif s'effectue actuellement sur ces termes, leurs interactions et leurs nuances, à travers l'anthropologie socioculturelle, biologique, archéologique et linguistique.
Dès le premier résumé de présentation, les auteurs utilisent des termes dépassés tels que « identification du sexe » plutôt que celui scientifiquement plus précis d'« estimation du sexe ».
Le résumé de la session, ainsi que plusieurs des résumés individuels partent implicitement du principe que le sexe constitue un concept biologique binaire, une idée rejetée par l'anthropologie biologique et la biologie humaine actuelles, et très contesté par la biologie contemporaine.
La plupart des résumés individuels reflètent des griefs basés sur les hypothèses erronées décrites ci-dessus.
En tant qu'anthropologues travaillant dans le domaine de l'anthropologie biologique et de la biologie humaine, nous sommes conscients que les définitions du sexe peuvent être établies à partir de la forme de la ceinture pelvienne, des dimensions crâniennes, des organes génitaux externes, des gonades, des chromosomes sexuels, etc. Le sexe, en tant que descripteur biologique, n'est binaire dans aucune de ces définitions. Chaque jour, des personnes naissent avec des organes génitaux non binaires – nous avons tendance à appeler intersexes les personnes qui appartiennent à ce groupe. Chaque jour, des personnes naissent avec des chromosomes sexuels qui ne sont pas XX ou XY, mais X, XXY, XXXY et d'autres encore. Il en va de même pour les gonades. De plus, une personne peut avoir des organes génitaux intersexués mais pas de gonades intersexuées, des chromosomes intersexués mais pas d'organes génitaux intersexués. Ces différences corporelles illustrent les variations considérables observées dans la physiologie sexuelle chez les vertébrés. Au-delà de l'homme, l'orang-outan adulte se présente sous trois formes. S'agit-il d'un sexe binaire ? Des pourcentages significatifs de nombreuses espèces de reptiles présentent des organes génitaux intersexués. Sommes-nous encore en train d'essayer de qualifier le sexe de binaire ? Le binaire limite les types de questions que nous pouvons poser et, par conséquent, le champ d'application de notre science.
En tant qu'anthropologues et biologistes humains, nous savons également que la façon dont les gens choisissent de nommer le sexe à travers les organes génitaux, les gonades et les gènes est souvent prescrite par la culture et, comme le démontre ce panel, souvent politisée. De plus en plus, de nombreux chercheurs, y compris dans le domaine des sciences biologiques, cherchent à comprendre ensemble le sexe et le genre, en reconnaissant leur imbrication intrinsèque. Par rapport à l'approche traditionnelle en biologie évolutionnaire humaine, la reconnaissance de l'intrication du sexe et du genre offre une vision plus réaliste, bien que plus complexe, à partir de laquelle il est possible de poser des questions sur l'évolution de l'homme, et potentiellement sur d'autres espèces, et d'y répondre. Comme l'écrit Anne Fausto-Sterling, « peu d'aspects du comportement adulte, des émotions, de la [sexualité] ou de l'identité peuvent être attribués purement au sexe ou purement au genre », parce qu'aucune de ces qualités n'est fixée au cours d'une vie et parce que « les structures sexuées modifient la fonction et la structure biologiques », considérer que le genre et le sexe sont enchevêtrés est une manière productive d'avancer.
Le domaine de l'anthropologie, et de l'anthropologie biologique en particulier, a tendance à résister aux arguments universels en faveur de la compréhension des êtres humains dans toutes leurs variations. Par conséquent, non seulement l'idée d'un binaire biologique pour un phénomène tel que le sexe constitue une affirmation excessive qui ignore les preuves, mais elle va à l'encontre des fondements empiriques les plus élémentaires de notre domaine. Comprendre la variation biologique humaine signifie résister aux normes culturelles autour du sexe, au lieu de les renforcer comme les auteurs de la session l'ont fait ici. Le genre/sexe se noue atour du développement conjoint de l'anatomie, de la physiologie, des hormones et de la génétique dans un contexte socioculturel fluide comprenant l'identité, les rôles et les normes, les relations et le pouvoir. Le genre/sexe reconnaît que la culture s'empare de la variation biologique de base, la façonne et peut l'accroître.
Les personnes non binaires, trans ou queer, et/ou celles qui occupent des catégories sexuelles autres que « mâle » ou « femelle », ont existé dans toutes les sociétés humaines et tout au long de l'évolution de l'humanité. Ce qui caractérise les catégories de sexe et de genre humaines, c'est qu'elles ne sont ni simples, ni binaires, qu'elles sont toujours influencées par les croyances culturelles de leur époque et qu'elles évoluent. Continuer à travailler sur la base de ces hypothèses réfutées revient à travailler dans la pénombre, à passer à côté de la plus grande partie du tableau et à ne pas s'engager dans une anthropologie scientifique rigoureuse, empiriquement fondée et pertinente.
Agustin Fuentes (Princeton University)
Kathryn Clancy (University of Illinois)
Robin Nelson (Arizona State University)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













