Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Un nouveau rapport accuse l’UNESCO de complicité dans des expulsions et des violations de droits humains à l’encontre de peuples autochtones

À l'occasion de la Journée du patrimoine mondial (le 18 avril), un nouveau rapport de Survival International accuse l'UNESCO de complicité dans des affaires d'expulsions illégales et de violations de droits humains à l'encontre de peuples autochtones. Ce document mentionne que de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont le théâtre de graves abus, commis de manière récurrente au nom de la conservation.
Tiré de https://www.survivalinternational.fr/actu/13928
18 Avril 2024
Photo :Dans le parc national de Kahuzi-Biega, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des gardes et des soldats brûlent les maisons des Batwa afin de chasser ce peuple autochtone du parc, sa terre ancestrale. © KBNP
Des enquêtes de terrain réalisées par des chercheurs et chercheuses de Survival dans des communautés autochtones en Afrique et Asie ont permis de mettre au jour des cas répétés de torture, de viols et de meurtres à l'intérieur et autour de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le rapport mentionne six sites classés au patrimoine mondial occupant des terres volées à des peuples autochtones, incluant les trois exemples suivants.
Zone de conservation de Ngorongoro, Tanzanie
Dans cette célèbre destination touristique, on assiste aujourd'hui à des opérations de “sécurité” destinées à intimider les communautés autochtones et à la suspension des services de base, le gouvernement tanzanien mettant en œuvre son projet d'expulser des milliers de Massaï des terres sur lesquelles ils vivent depuis des générations. L'UNESCO a explicitement soutenu ces expulsions. Un leader massaï ayant témoigné auprès de Survival a déclaré : “Le soutien de l'UNESCO sert à nous expulser. Nous vivons dans la maladie et l'incertitude.”
Parc national de Kahuzi-Biega, République démocratique du Congo
Ce parc national a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. En 2019, les autorités du parc, avec le soutien de l'armée congolaise, ont lancé une campagne visant à expulser de la forêt tous les Batwa qui étaient revenus sur leurs terres ancestrales l'année précédente. Elles ont mené des attaques extrêmement violentes contre des villages batwa et perpétré de nombreuses atrocités amplement documentées. L'UNESCO a encouragé une approche basée sur la force et la militarisation, et a pressé le gouvernement congolais d'“augmenter l'étendue et la fréquence des patrouilles” et d'“évacuer les occupants illégaux”. Les Batwa ont énormément souffert de ces attaques, mais ont déclaré : “Nous vivons dans la forêt. Lorsqu'ils nous voient, ils nous violent. Ceux d'entre nous qui mourront mourront, mais nous resterons dans la forêt.”
Parc national d'Odzala-Kokoua, République du Congo
Ce parc a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023, en dépit des violations des droits humains, largement documentées, qui y ont été commises, incluant notamment des cas de viols et de torture. Un homme baka ayant été expulsé de la forêt a déclaré à Survival : “Nous avons besoin de la forêt. Nos enfants ne connaissent plus les animaux ni les plantes médicinales traditionnelles. Aujourd'hui, les Baka vivent sur le bitume.”
Deux hommes baka issus d'une communauté expulsée pour laisser place au parc national d'Odzala-Kokoua.
Le parc a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. © Fiore Longo/Survival
Survival demande à l'UNESCO de :
– cesser de soutenir les violations des droits humains des peuples autochtones commises au nom de la conservation ;
– supprimer de sa liste des sites classés au patrimoine mondial tout territoire sur lequel sont perpétrés des atrocités et des abus à l'encontre de peuples autochtones et autres communautés locales ;
– promouvoir un modèle de conservation basé sur la pleine reconnaissance des droits des peuples autochtones.
Survival lance une journée d'activisme en ligne pour marquer la publication du rapport ; nous invitons le public à
partager une nouvelle vidéo et à utiliser le hashtag #DecolonizeUNESCO. La vidéo sera disponible sur la page Instagramde Survival.
La directrice de Survival au Royaume-Uni, Caroline Pearce, a déclaré aujourd'hui : “L'UNESCO a joué un rôle clé dans la légitimation d'un grand nombre d'Aires protégées parmi les plus célèbres en Afrique et en Asie, et a largement ignoré les atrocités, pourtant bien attestées, commises sous sa supervision. Ce que l'organisation appelle “sites classés au patrimoine naturel” sont très souvent les terres ancestrales de peuples autochtones leur ayant été volées. Ces peuples y sont aujourd'hui interdits d'accès et subissent des campagnes d'intimidation et de terreur. La complicité de l'UNESCO va au-delà du silence : elle soutient activement des gouvernements et des actions qui violent les droits des peuples autochtones. Elle doit retirer le statut de site classé au patrimoine mondial à tout territoire où de telles exactions se produisent.”
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le directeur de l’Aut’Journal souhaite la capitulation de l’Ukraine

La conjoncture de la guerre contre l'Ukraine, devenue favorable à l'invasive Russie suite au déficit d'armements de l'Ukraine qui réjouit campistes pro-russe et faux pacifistes, est l'occasion du énième retour de la fable de l'entente de paix ratée à la Conférence d'Istanbul à la fin mars 2022 quand il était devenu manifeste que le blitz russe pour conquérir l'Ukraine avait été mis en échec mais que la Russie n'avait pas pour autant reculé jusqu'aux points de départ de son invasion, soit la frontière entre les deux pays, y compris la Biélorussie, mais aussi celle délimitant la zone est (partie du Donbas) subrepticement conquise en 2014 sur la base de manipulations de troubles internes, conquête reconnue en plein jour la veille de l'invasion du 24 février 2022, et de la Crimée annexée suite à un référendum bidon sous contrôle de l'armée russe.
21 avril 2024
Voilà qu'au Québec, le directeur de l'Aut'Journal, sous prétexte d'un article sur le sujet dans la prestigieuse revue Foreign Affairs publié par un think tank imbriqué dans la politique étrangère des ÉU, y est allé d'un plaidoyer défendant hardiment cette fable.
L'OTAN belliqueux de l'un n'a rien à voir avec l'OTAN protecteur des autres
Le nœud de la fable consiste en la visite surprise du Premier ministre britannique Johnson à Kiev le 30 mars 2022. Celui-ci aurait dit au président Zelensky de ne pas signer la proposition d'accord négocié à Istanbul et de continuer la guerre qui tournait à leur avantage. Zelensky aurait immédiatement obtempéré aux ordres de cet émissaire de l'OTAN. On constate immédiatement le contexte de la fable. L'Ukraine est un pion aux ordres des ÉU et de l'OTAN dans une guerre où la Russie cherche à briser la pression de l'OTAN, qui a intégré l'Europe centrale et orientale depuis déjà près ou plus de 20 ans pour les pays les plus importants. Pour ce faire, elle envahit l'Ukraine qui ne la menace nullement pas plus que l'OTAN, dont l'Ukraine n'est pas membre. Le peuple ukrainien était alors très divisé sur le sujet. Les membres de l'OTAN, surtout ceux européens, ne voulaient pas de cette adhésion et encore aujourd'hui puisque justement ils seraient dans l'obligation de défendre l'Ukraine en cas d'invasion.
En fait, avant l'invasion russe de 2022, l'OTAN était en crise — en « mort cérébrale » selon le président français — suite au fiasco afghan. Le président russe Poutine, qui n'a pas digéré le démantèlement de l'URSS en 1989-90 et dont le rentier capitaliste de connivence (crony capitalism) était en mal de fuite de capitaux, voulait profiter de l'occasion pour les propres fins de l'impérialisme russe. L'invasion se présentait comme une promenade militaire d'autant plus que jusque-là l'écrasement de la Tchétchénie, l'annexion d'une partie de la Géorgie, l'interventionnisme pro-Assad en Syrie et, last but not least, l'invasion-annexion de la Crimée puis celle par étapes du Donbas en 2014 n'avaient causé aucune levée de boucliers de la part des ÉU et de l'OTAN sauf des tapes sur les doigts. Au diable l'engagement de la Russie de respecter les frontières de l'Ukraine compensant la remise à la Russie de son stock d'armes nucléaires, ce qu'elle doit amèrement regretté. L'OTAN est maintenant ressuscitée des morts après avoir gagné l'adhésion de la Suède et de la Finlande.
Le joker ukrainien jette par terre le château de cartes du macabre jeu impérialiste
Le joker dans ce jeu de cartes c'est le peuple ukrainien et son gouvernement néolibéral comme nos gouvernements le sont et élu dans le cadre d'un système parlementaire multipartis tout croche comme les nôtres mais qui n'a rien à voir avec la démocratie illébérale russe se transformant à vue d'œil en dictature de plus en plus répressive. Quant à l'extrême-droite, elle est autrement plus forte en Russie, et liée au gouvernement Poutine en plus d'être en symbiose avec l'extrême-droite européenne, qu'en Ukraine dont l'extrême-droite est électoralement légère en comparaison par exemple avec les extrêmes-droites française et allemande. La résistance héroïque du peuple ukrainien a pris par surprise tout le camp impérialiste, de la Russie aux ÉU en passant par la Chine et l'Union européenne, et même le gouvernement ukrainien lui-même. Cette invasion russe qui se voulait rapidement un fait accompli tout en redistribuant plus marginalement que drastiquement les sphères d'influence géostratégiques chères à tous les impérialismes du monde s'est illico transformé en guerre de libération nationale.
Ce que constatant, un Poutine désemparé a cherché à gagner du temps par la négociation d'un accord de paix afin de regrouper et bonifier son appareil militaire pour d'abord consolider quelques gains, comme l'hécatombe de Marioupol et le massacre de Boutcha, puis reprendre l'offensive. C'est dans cette conjoncture qu'il faut situer les négociations d'Istanbul. Pour ce qui est des détails de l'affaire, une chatte aurait de la difficulté à retrouver ses petits. L'article suivant d'un media alternatif de gauche britannique s'y essaie brillamment. Je me permets d'en tirer la citation suivante : « La réalité sur le terrain a montré que les troupes russes ne se seraient pas retirées des territoires nouvellement occupés dans le sud et l'est de l'Ukraine, et qu'elles se préparaient à y rester durablement. » L'article du directeur de l'Aut'Journal cite pour sa cause le principal négociateur ukrainien :
Le principal négociateur ukrainien, Davyd Arakhamia, a déclaré dans une interview de novembre 2023 à une émission de télévision ukrainienne que la Russie avait « espéré jusqu'au dernier moment qu'elle [pourrait] nous contraindre à signer un tel accord, que nous [adopterions] la neutralité. C'était la chose la plus importante pour eux. Ils étaient prêts à finir la guerre si, comme la Finlande [pendant la guerre froide], nous adoptions la neutralité et nous nous engagions à ne pas rejoindre l'OTAN. »
Fort bien mais il aurait fallu ajouter la suite citée par le site web de l'opposition russe, Meduza :
« C'était essentiellement le point principal. Tout le reste n'était que cosmétique et embellissement politique sur la 'dénazification', la population russophone, bla bla bla », a déclaré M. Arakhamia. Lorsqu'on lui demande pourquoi l'Ukraine n'a pas accepté les conditions de la Russie, Arakhamia se montre résolu :
« Tout d'abord, pour accepter ce point, nous devrions modifier la constitution [ukrainienne]. Notre chemin vers l'OTAN est inscrit dans la Constitution. Deuxièmement, nous ne faisions pas et ne faisons toujours pas confiance aux Russes pour tenir leur parole. Cela n'aurait été possible que si nous avions eu des garanties de sécurité. Nous ne pouvions pas signer quelque chose, nous en aller, tout le monde pousserait un soupir de soulagement, puis [la Russie] nous envahirait, mieux préparée cette fois-ci - car la première fois qu'elle nous a envahis, elle n'était pas préparée à ce que nous résistions autant. Nous ne pourrions donc travailler [avec eux] que si nous étions sûrs à 100 % que cela ne se reproduirait pas. Et nous n'avons pas cette confiance. »
Depuis l'invasion russe larvée de 2014, l'OTAN était devenue la seule police d'assurance possible à laquelle l'Ukraine pouvait avoir recours. Que l'OTAN ne voulait pas de l'Ukraine démontre la contradiction de politique extérieure entre l'impérialisme occidental et l'Ukraine. Après l'invasion, cependant, il y eut momentanément une coïncidence entre leurs politiques ce qui explique l'apparent acquiescement du président Zelensky aux « ordres » de l'émissaire de l'OTAN. Il se peut que face à un rapport de forces fort défavorable, le gouvernement ukrainien capitule, avec ou sans l'assentiment populaire, sous forme d'un accord de paix.
Mais cet accord ne sera en réalité qu'un cessez-le-feu temporaire entre impérialisme conquérant et résistance nationale. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu, l'Ukraine ne le souhaite pas (encore) car il consacrerait le charcutage du pays et l'acceptation d'un nettoyage ethnique en douce dans les parties conquises, pas plus que la Russie qui sent le vent tourner sans compter que le régime Poutine, comme le premier ministre sioniste Netanyahou, a besoin d'une guerre permanente pour se maintenir. Quant à l'impérialisme occidental, à l'encontre du gouvernement ukrainien, il souhaite dorénavant un arrêt de la guerre.
L'intérêt des ÉU pour l'Ukraine n'est pas ce que révèle la propagande médiatique
Il n'est pas innocent que cette fable soit remise au goût du jour par une revue prestigieuse de l'establishment des ÉU. Ce n'est plus un secret pour personne que la politique étrangère des ÉU veut se focaliser sur la zone indopacifique, zone mondiale de l'accumulation capitaliste, au centre de laquelle trône la Chine qui ambitionne de contrôler ses mers avoisinantes aux dépens des alliés étatsuniens et de conquérir Taïwan. Les ÉU trouvent bien embêtant — ils n'ont plus la capacité d'antan de mener deux grandes guerres en même temps —, en plus de craindre un embrasement du Moyen-Orient à cause de son fascisant allié sioniste qui perd les pédales jusqu'à une guerre génocidaire laquelle en plus lui fait perdre la face, de devoir soutenir une Ukraine dont la défaite lui ferait perdre la faveur de tous ces pays nouvellement ralliés à l'OTAN. Même si le blocage du soutien à l'Ukraine par les Républicains au Congrès, tout juste levé, poussait la coche trop loin, il révélait une réelle réticence de l'Administration étatsunienne qui dorénavant pousse pour un arrêt des combats sous forme d'une entente négociée obligeant certes l'Ukraine a céder de facto des territoires mais enlisant en même temps une Russie affaiblie par les sanctions dans un face-à-face armé, si ce n'est une guérilla, neutralisant, pour les pays limitrophes de l'OTAN ou y aspirant, le danger d'être envahi par la Russie.
Ce qui reste cependant énigmatique consiste en la prise de position du directeur de l'Aut'Journal reconnu pour son soutien inébranlable à l'indépendance du Québec qui, d'un point de vue de gauche étant le sien, doit se comprendre comme le soutien à la lutte de libération nationale du peuple québécois. Comment peut-il ne pas reconnaître une telle lutte de la part du peuple ukrainien et de son gouvernement, lutte se faisant dans des conditions autrement plus dramatiques et qui ont même certains aspects génocidaires, en tout cas de manifestes crimes de guerre ?
Marc Bonhomme, 21 avril 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Palestine, l’Ukraine et la crise des empires

Le week-end de Pâques, lors de la dernière marche géante à Londres contre la complicité du Royaume-Uni dans la guerre d'Israël contre Gaza, un groupe d'entre nous portait une banderole sur laquelle on pouvait lire : « De l'Ukraine à la Palestine, l'occupation est un crime ». Nous avons reçu les applaudissements des gens autour de nous qui ont scandé notre slogan. Mais au-delà du slogan, que pouvons-nous faire, dans le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux au Royaume-Uni, face à ces conflits qui transforment le monde dans lequel nous vivons et alimentent les craintes de guerres plus larges et plus sanglantes ?
20 avril 2024 | tiré de Viento sur
https://vientosur.info/palestina-ucrania-y-la-crisis-de-los-imperios/
Dans ce qui suit, je propose quelques éléments de réponse, basés sur l'idée que nous assistons au déclin de deux empires, l'américain et le russe. Bien sûr, ni l'un ni l'autre n'est un empire au sens strict du terme. Par empire américain, j'entends la domination économique des États-Unis dans le capitalisme mondial, ainsi que le système militaire et politique qui le soutient, dans lequel Israël est un élément clé. La Russie, d'autre part, est une puissance économiquement subordonnée de second ordre qui cherche à réaffirmer sa domination dans l'espace géographique eurasien.
Je me concentrerai sur la guerre de la Russie en Ukraine et sur son évolution dans le contexte de la guerre à Gaza. Les sections de l'article font référence à (1) des choses que je trouve qui ont changé au cours des six derniers mois, (2) comment la Russie a changé depuis 2022, (3) les perspectives pour l'Ukraine, (4) le rôle des puissances occidentales dans la guerre de la Russie, (5) la démocratie et l'autoritarisme, (6) les dangers d'une prolongation de la guerre et certaines conclusions[2].
1. Ce qui a changé
Le premier est la violence exceptionnelle et choquante de la guerre d'Israël. Plus de 33 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués en six mois. La population civile est soumise à des punitions collectives, la famine est utilisée comme arme de guerre. De nombreux crimes de guerre sont enregistrés et signalés chaque jour. La soldatesque israélienne se vante de ses crimes sur les réseaux sociaux ; Des groupes de civils se vantent du blocus de l'aide humanitaire. Les politiciens israéliens déclarent ouvertement des buts de guerre qui s'apparentent à un génocide et à un nettoyage ethnique. Ici, au Royaume-Uni, la réponse d'une nouvelle génération de manifestants, qui ne se contentent pas de descendre dans la rue, mais mènent des actions directes contre les usines d'armement, est un signe d'espoir.
Deuxièmement, il y a le soutien à l'assaut génocidaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres gouvernements occidentaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que les extrémistes fous qui font partie de son gouvernement de coalition, donnent le ton ; Les puissances occidentales suivent. La chasse aux sorcières frénétique contre ceux qui s'opposent à la guerre d'Israël est sans précédent. Cependant, à chaque nouvelle image scandaleuse et à chaque nouvelle manifestation exigeant un cessez-le-feu, un nouveau fil est tiré du tissu de la grande fiction, qui dit qu'Israël défend le peuple juif et que remettre en question ses actions est antisémite. D'énormes fissures s'ouvrent dans les fondements idéologiques du projet sioniste.
Troisièmement, la façon dont des centaines de millions de personnes dans le monde ont compris, et ont été exaspérées, par l'hypocrisie des politiciens occidentaux qui condamnent le nettoyage ethnique de la Russie mais permettent que le nettoyage ait lieu à Gaza.
Quatrièmement, la façon dont l'absence d'un État ou d'une armée étatique laisse les victimes civiles de l'incursion israélienne si terriblement sans défense. Encore une fois, il s'agit d'un contraste. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été entravée non seulement par la puissante force morale de la résistance populaire, mais aussi par la force des armes. Beaucoup de ces derniers ont été fournis aux forces armées ukrainiennes par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres États, qui facilitent maintenant la terreur israélienne à Gaza.
Enfin, face à ces deux guerres, la paralysie politique de sections du mouvement ouvrier occidental est extrêmement choquante. Ceux qui professent le campisme et l'anti-impérialisme unilatéral dénoncent les États-Unis et Israël, mais ne regardent pas l'empire russe à travers le même prisme. Le glissement de l'État russe vers le fascisme, le caractère impérialiste de sa guerre et l'horreur qu'il a imposée aux parties occupées de l'Ukraine sont dans un angle mort. Trois décennies après l'effondrement de l'Union soviétique, le mouvement et son internationalisme sont minés par ce campisme, ce monstrueux petit-fils du stalinisme.
2. La guerre dela Russie
La socialiste ukrainienne Hanna Perekhoda a récemment écrit sur le caractère impérialiste de la guerre menée par la Russie, et le socialiste russe Ilya Budraitskis a fourni un argument puissant en faveur du tournant du Kremlin vers le fascisme pendant la guerre[3]. Je commenterai ici deux aspects qui, à mon avis, soutiennent et développent ses arguments : sur la façon dont la guerre est menée et sur la façon dont la politique économique s'adapte pour la servir.
La guerre de la Russie est avant tout une guerre contre la population civile ukrainienne. L'attaque massive de missiles et de drones des 21 et 22 mars, qui a visé Kharkiv (la deuxième ville d'Ukraine), Zaporijjia et Kryvoï Rog, l'a rappelé. La plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine sur le fleuve Dniepr a été réduite à l'état de décombres et DTEK, la principale compagnie d'électricité, a déclaré qu'elle avait perdu 50 % de sa capacité de production. « La Russie cause la mort de civils, y compris des travailleurs sur les lieux de travail, et détruit activement l'économie ukrainienne et l'industrie de l'énergie », a déclaré la Confédération des syndicats libres d'Ukraine.
Deux rapports des Nations unies et d'organisations non gouvernementales, qui quantifient les destructions causées au cours des deux années qui ont suivi l'invasion russe du 24 février 2022, montrent que l'attaque russe se concentre sur des cibles civiles. Une mise à jour du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme confirme que plus de 10 000 civils ont été tués et 20 000 autres blessés ; « Les chiffres réels sont probablement un peu plus élevés. » La grande majorité de ces personnes ont été victimes d'« armes explosives aux effets très variés », un peu plus d'une personne sur sept vivant dans des zones occupées (c'est-à-dire très probablement des bombardements ukrainiens), le reste dans des zones sous contrôle gouvernemental (très probablement par des bombardements russes). Les preuves démontrant la commission de crimes de guerre reviennent au même : de nombreux rapports des Nations Unies montrent que la grande majorité, mais pas la totalité, ont été commises par les forces russes.
Au fil du temps, l'enquête en a révélé davantage sur le siège de Marioupol par la Russie, un événement clé de l'invasion de 2022. Un rapport de 230 pages de Human Rights Watch et de Truth Hounds conclut qu'au moins 8 000 personnes y sont mortes de causes liées à la guerre. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes, et le nombre réel ne sera peut-être jamais connu. L'attaque a endommagé l'ensemble des 19 hôpitaux de Marioupol et 86 de ses 89 écoles et facultés. Les conclusions de la commission internationale indépendante des Nations Unies complètent ces données.
Un trait distinctif de la guerre de la Russie est sa volonté de sacrifier ses propres troupes pour quelques kilomètres de terrain, ce qui rappelle la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que la Russie s'est emparée de la ville stratégique d'Avdivka à Donetsk le mois dernier, comme elle l'avait fait à Bakhmout en 2023. Depuis février 2022, la Russie a probablement dénombré 75 000 soldats tués, en plus d'un nombre inconnu de militaires des républiques de Donetsk et de Louhansk, tandis que l'Ukraine pourrait avoir eu 42 000 victimes. On estime que plus de 300 000 Russes et 100 000 Ukrainiens sont blessés[4].
Une autre caractéristique cruciale de la guerre de la Russie est l'administration des territoires qu'elle a occupés, ce qui fait entrer dans le XXIe siècle le nettoyage ethnique, la tyrannie locale et le vandalisme culturel qui ont inauguré l'empire britannique au XIXe siècle. Un exemple frappant de la folie suprémaciste russe est celui de Sergueï Mironov, un leader parlementaire, qui a adopté l'année dernière une fille volée dans un orphelinat dans le territoire occupé.
Les zones occupées ont été militarisées et les droits civils ont été réprimés. Les ONG surveillent la stratégie des autorités d'expulsion forcée de la population civile ukrainienne et d'encouragement à l'immigration de colons russes[5]. La résistance, lancée en 2022, s'étend à nouveau, d'abord et avant tout à travers des réseaux clandestins de militantes. Il y a de l'espoir.
La stratégie économique de la Russie a changé pendant la guerre. L'adoption du keynésianisme militaire pourrait être un facteur clé de l'extension de la guerre à l'intérieur de l'Ukraine et au-delà de ses frontières. Le budget a été gonflé par la forte augmentation des recettes provenant de la vente de pétrole, et ces fonds ont été canalisés vers l'industrie militaire et les secteurs connexes. L'État réorganise également la propriété des entreprises, transfère des actifs à des secteurs de l'élite liés aux nouveaux services de sécurité et oblige les oligarques exilés à rapatrier leurs actifs en Russie ou à les vendre.
En réponse à l'invasion de 2022, les puissances occidentales ont imposé une série de sanctions sans précédent à la Russie : 13 000 mesures sont actuellement en place, soit plus que ce qui a été décrété contre l'Iran, Cuba et la Corée du Nord réunis. Ces sanctions n'ont pas éliminé les revenus pétroliers qui sous-tendent le budget russe : au paragraphe 4, je me demande si cette possibilité a jamais été évoquée. Les réserves de change de la Russie ont été gelées et l'activité de ses banques a été limitée. Le Kremlin a réagi en interdisant les sorties d'argent, en augmentant les taux d'intérêt et en établissant des contrôles de capitaux. Les exportations de pétrole ont été dirigées vers des destinations asiatiques.
Les dépenses militaires ont augmenté de façon vertigineuse : si en 2019-2021 elles étaient de 3 à 3 600 milliards de roubles (44 à 48 milliards de dollars, soit 15 % du budget fédéral ou 3 à 4 % du PIB), en 2022 elles ont déjà bondi à 8 400 milliards de roubles (124,5 milliards de dollars), et en 2023 à environ 13 300 milliards de roubles (160 milliards de dollars, représentant 40 % du budget fédéral, soit 8 à 9 % du PIB), selon les calculs de l'économiste Boris Grozovski[6]. Les paiements aux familles des soldats ont grimpé en flèche et les industries liées à l'armée, telles que la microélectronique et l'équipement électrique, se sont rapidement développées. Des fonds sont destinés à la reconstruction des villes ukrainiennes détruites par les bombardements russes et désormais occupées par l'armée russe[7].
L'année 2023 a été marquée par un effort concerté pour réorganiser la propriété des entreprises : le bureau du procureur général a demandé aux tribunaux de nationaliser plus de 180 entreprises privées. La majeure partie d'entre eux appartiennent à des secteurs nécessaires à la production de matériel de guerre, comme l'usine électrométallurgique de Tcheliabinsk, principal fabricant russe de ferroalliages, qui a été nationalisée le mois dernier, et à ceux appartenant à des hommes d'affaires jugés injustes. Une nouvelle offensive a commencé cette année : le mois dernier, le gouvernement a commencé à répertorier les « organisations économiquement importantes » qui forceront les empires commerciaux basés à l'étranger à rapatrier leur argent en Russie et à payer leurs dividendes dans ce pays ; Cela protégera ces entreprises des sanctions et les soumettra en même temps à un contrôle étatique plus strict[8].
L'économiste Alexandra Prokopenko pense qu'il n'y a rien de moins qu'un remaniement de l'élite russe en cours : le deuxième promu par Vladimir Poutine, après l'asservissement des oligarques de l'ère Eltsine en 2003-2007. Les vagues de nationalisations font « partie de la tentative de Poutine de redistribuer les biens des personnes jugées insuffisamment loyales au Kremlin et de créer une nouvelle classe de propriétaires d'actifs qui doivent leur fortune au président et à son cercle rapproché ». Ces nouveaux propriétaires seront « les vrais vainqueurs de la guerre en Ukraine et une base solide pour la stabilité du régime »[9].
Le keynésianisme militaire implique une baisse de la productivité et de la compétitivité, une réduction des dépenses consacrées aux activités non militaires et une augmentation du risque d'escalade militaire, note Prokopenko. « Cela incite le Kremlin à prolonger la guerre aussi longtemps que possible, ou à transformer une guerre chaude en une guerre froide. » L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm met en garde contre le fait que la « nouvelle dépendance » aux dépenses militaires crée une dépendance encore plus grande à l'égard des revenus de l'énergie[10].
Le Kremlin a entraîné la Russie dans la guerre en 2014, subordonnant la gestion économique et les intérêts commerciaux des capitalistes russes aux impératifs géopolitiques (en bref, l'aspiration à atteindre le statut de grande puissance), à l'expansionnisme impérialiste et à l'idéologie nationaliste. En 2022, ce sacrifice des intérêts économiques aux impératifs militaires et politiques est allé bien plus loin. Aujourd'hui, le Kremlin s'engage encore plus loin dans cette voie désastreuse. La démagogie fasciste devient plus véhémente, les vis de la répression interne sont serrées et l'économie n'est pas seulement subordonnée au nationalisme et au militarisme, mais remodelée pour les nourrir. Ce processus génère peut-être le plus grand danger d'une guerre future en Europe.
3. Les perspectives de l'Ukraine
La guerre en Ukraine est menée par une coalition de l'État ukrainien avec la population et les puissances occidentales qui lui fournissent des armes. Cette alliance a été mise à rude épreuve par le résultat décevant de la tentative de contre-offensive ukrainienne de l'été dernier et par la prévision d'une nouvelle offensive russe cet été. L'armée ukrainienne manque d'hommes et d'équipements : un groupe de journalistes a calculé qu'à Avdivka, par exemple, le rapport avec l'armée russe était de cinq pour un (artillerie), sept pour un (drones) et jusqu'à 15 pour un (soldats).
Il est important de replacer les choses dans leur contexte. Le Kremlin espérait soumettre complètement l'Ukraine en une semaine, et deux ans plus tard, il a subi de lourdes pertes pour capturer les ruines d'une petite ville qu'il bombardait auparavant massivement. Mais nous devons faire face au monde que le Kremlin a contribué à créer entre-temps.
Le manque de troupes aggrave les tensions entre l'État et la population. Le 2 avril, le président Vladimir Zelensky a promulgué des lois abaissant l'âge du service militaire obligatoire de 27 à 25 ans, créant un registre en ligne des conscrits et supprimant le statut d'inapte partiel aux examens médicaux. Ces changements interviennent alors qu'une nouvelle loi de mobilisation qui adopte une approche plus large et pourrait permettre à quelque 500 000 hommes d'être appelés est bloquée au Parlement. Plus de 4 000 amendements ont été déposés par les députés. Zelensky et son équipe tentent de prendre leurs distances avec ces mesures, qui sont impopulaires : ils n'ont pas confirmé le chiffre de 500 000 hommes (l'Ukraine compte actuellement environ 330 000 soldats déployés, sur un total de 1,2 million de personnes qui composent les forces armées).
Il ne faut pas confondre la vive polémique publique autour de la mobilisation avec une opposition à la guerre, dont il n'y a guère de signes. La question est de savoir comment s'en débarrasser. Les soldats mobilisés ont en moyenne entre 40 et 50 ans, et certains sont au front depuis deux ans sans interruption. Un sondage récent révèle que 48% des hommes ne sont pas prêts à se battre, 34% le sont et 18% dis-le est difficile à dire ; Une autre enquête montre qu'une majorité de la population ukrainienne (54 %) comprend les motivations de ceux qui se soustraient à la conscription, et une troisième enquête indique qu'il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que le niveau de conscription est plus ou moins adéquat ou insuffisant que celles qui pensent qu'il est excessif[11].
En plus de la pénurie potentielle de soldats, les forces armées ukrainiennes souffrent d'une grave pénurie d'armes. Ce fait reflète les divergences entre les pays occidentaux qui les fournissent en ce qui concerne la situation de guerre (voir la section suivante). Ce déficit n'est que partiellement compensé par l'utilisation intelligente d'un approvisionnement limité en armes, par exemple en infligeant de graves dommages à la flotte russe de la mer Noire et en attaquant des raffineries de pétrole et des aérodromes en Russie.
Dans ce contexte, la presse occidentale cite régulièrement des sources anonymes et affirme, par exemple, que les États-Unis demandent à l'Ukraine si elle est disposée à négocier ou que la Russie a fait des propositions informelles aux États-Unis. Le mois dernier, la Turquie a proposé d'accueillir des négociations. De mon point de vue, les obstacles à une négociation de paix sont considérables. Le Kremlin a inscrit le territoire ukrainien qu'il revendique dans la constitution russe. Il s'est engagé à aller de l'avant, non seulement en raison de sa rhétorique impérialiste niant le statut de nation de l'Ukraine, mais aussi en vertu de ses objectifs géopolitiques et de l'adoption du keynésianisme militaire.
Je n'essaierai pas de brosser un tableau de ce qui se passe dans la tête du peuple ukrainien en ce moment, mais d'après mes conversations et la lecture des médias, je dirais que pour beaucoup de gens, l'aspiration désespérée à la paix est compensée par la conviction que (1) la perspective que la Russie conserve le contrôle des 18% du territoire ukrainien qu'elle occupe actuellement, Cette idée qui est discutée dans les couloirs du pouvoir occidental est inacceptable, et (2) d'abord et avant tout, tout accord de paix qui permet à la Russie de reconstruire ses forces armées lourdement endommagées et de retrouver un nouvel élan est un danger mortel. C'est ce qui ressort de l'un des nombreux commentaires publiés dans les médias ukrainiens au sujet de la conscription :
L'un des arguments les plus courants concernant les hommes qui se soustraient à la conscription est le suivant : si vous vous cachez des officiers de recrutement militaires de votre propre pays et que l'Ukraine est vaincue, personne ne vous sauvera des officiers et des commandants militaires russes, qui vous enverront prendre d'assaut Cracovie et Varsovie. Il vaut donc mieux se soumettre à son propre Léviathan qu'à celui de l'ennemi.
Ma conclusion est que tant que le Kremlin n'aura pas décidé de faire une pause, voire d'arrêter, son agression, aucune négociation de paix n'est en vue. Espérons qu'un cessez-le-feu sera possible et qu'il gèlera au moins le conflit.
Dans le mouvement ouvrier des pays occidentaux, il reste crucial de répondre à l'affirmation cinglante selon laquelle seules les puissances occidentales s'opposent à un accord de paix, une affirmation généralement faite par les campeurs (anti-impérialistes unilatéraux), qui considèrent que la seule puissance impérialiste est les États-Unis et que la Russie et/ou la Chine représentent une alternative potentiellement progressiste (voir l'article Pas de chemin vers la paix dans ce monde imaginaire).
4. Les puissances occidentales et l'Ukraine
Des désaccords émergent entre les puissances occidentales sur la manière de traiter avec la Russie, pour des raisons géopolitiques et stratégiques, liées à la crise de l'empire américain. Il ne s'agit pas de principes démocratiques, mais de la façon de contrôler, plutôt que de détruire, un empire de second ordre qui joue un rôle subordonné dans l'économie mondiale.
Le régime de Poutine n'a jamais été aux antipodes de l'empire américain. Jusqu'en 2014, les puissances occidentales l'ont choyé avec enthousiasme, alors qu'il intégrait le capital russe dans le système mondial. À partir de 2014, la relation s'est refroidie de plus en plus. C'est l'invasion massive de l'Ukraine en 2022 qui a provoqué une rupture définitive. Même par la suite, le régime de sanctions a été limité. Plus précisément, l'empire américain a aboli les mesures qui entravaient l'approvisionnement en pétrole du marché mondial. Le contexte suivant aide à comprendre l'attitude actuelle des puissances occidentales à l'égard de la Russie.
Au début des années 2000, l'empire américain a soutenu la violente campagne militaire de Poutine contre la Tchétchénie, ainsi que les multiples crimes de guerre qui ont été commis, dans le cadre de sa stratégie de centralisation et de renforcement de l'appareil d'État affaibli. Lorsque l'économie russe s'est redressée grâce à la hausse des prix du pétrole (2001-2008), les puissances occidentales ont traité Poutine comme un gendarme du capital, et il a eu carte blanche dans l'espace post-soviétique.
À partir de 2007, lorsque Poutine prononce son discours à Munich contre le « monde unipolaire » dirigé par les États-Unis, il tente d'inverser le déclin de la Russie en tant que puissance impériale, bien que ses efforts soient entravés par les crises économiques successives (krach de 2008-2009, effondrement du prix du pétrole en 2015 et pandémie de 2020-2021). À travers tout cela, les puissances occidentales ont regardé impassiblement l'invasion de la Géorgie par la Russie (2008) et l'est de l'Ukraine (2014), ainsi que lorsque Poutine a aidé Bachar al-Assad à noyer dans le sang la révolte syrienne (2015-2016). L'empire américain n'a protesté que contre l'annexion de la Crimée, qui violait de nombreux accords internationaux, et contre la destruction de l'avion de ligne civil malaisien survolant l'est de l'Ukraine (2014).
En 2021, alors que le Kremlin se préparait à envahir l'Ukraine, les puissances occidentales ont cherché à faire reculer certaines sanctions. En juillet de la même année, les États-Unis et l'Allemagne ont convenu de lever les obstacles au projet de gazoduc de la mer du Nord et n'ont pas abandonné cette tentative jusqu'à ce que la Russie reconnaisse les républiques bâtardes de Donetsk et de Louhansk le 21 février 2022, trois jours avant l'invasion massive de l'Ukraine[12].
À la suite de l'invasion, les puissances occidentales ont rompu les liens de la Russie avec le système financier international et ont accepté de voir les exportations de gaz russe vers l'Europe considérablement réduites, probablement pour toujours. Mais ils ont bloqué toutes les mesures susceptibles de faire grimper le prix du pétrole.
Les sanctions sur les exportations de pétrole sont les plus importantes, car le pétrole est de loin le principal produit d'exportation et celui qui génère le plus de revenus du budget de l'État russe. En décembre 2022, les pays européens avaient proposé une interdiction simple des services financiers, y compris l'assurance maritime, pour les navires transportant du pétrole russe. La domination de l'Europe sur le marché de l'assurance signifiait qu'une telle décision serait viable, mais les propositions « ont effrayé le Trésor américain », comme Global Witness l'avait rapporté à l'époque. « Le gouvernement américain a conçu le plafonnement des prix avec l'intention explicite de maintenir l'écoulement du pétrole russe, tout en réduisant les revenus du Kremlin, et a fait pression sur les pays européens pour qu'ils renoncent à leur interdiction totale. »
Lorsque le plafonnement des prix a été adopté, il était trop élevé pour être efficace – 60 $ le baril de brut – et les États-Unis sont également intervenus pour s'assurer que les pénalités en cas de non-conformité étaient légères et que les produits pétroliers raffinés à partir du pétrole russe ne soient pas sanctionnés.
Ainsi, le pétrole russe est désormais exporté vers l'Inde, la Chine et d'autres destinations principalement asiatiques, où il est raffiné et réexporté vers des destinations occidentales. Le Royaume-Uni, dont les politiciens sont les plus virulents dans leur soutien à l'Ukraine, a importé ces produits pour un total d'environ 660 millions d'euros au cours de la première année suivant l'imposition du plafonnement des prix du pétrole. À ce contournement des sanctions s'ajoute un non-respect systématique des sanctions par une flotte grise de navires dépourvus d'assurance adéquate et appartenant à des structures opaques.
Sans se laisser décourager, l'armée ukrainienne a attaqué le mois dernier des raffineries de pétrole russes avec des drones. La réponse : une réprimande de Washington. Selon le Financial Times, les États-Unis s'inquiètent de la hausse des prix de l'essence en cette année électorale et craignent que la Russie « s'en prenne aux infrastructures énergétiques sur lesquelles l'Occident compte », telles que les oléoducs qui transportent le pétrole d'Asie centrale à travers la Russie. Je suis heureux de dire qu'à l'heure où j'écris ces lignes, il semble que l'Ukraine n'y ait pas prêté beaucoup d'attention.
Quant au chœur des entreprises occidentales qui ont annoncé en 2022 qu'elles quitteraient la Russie, une base de données de la Kyiv School of Economics montre que sur les 3 756 entreprises étrangères qui y opéraient avant l'invasion massive, seules 372 ont complètement quitté le pays. Bien que les principaux producteurs de pétrole aient cessé leurs activités en Russie, la plus grande société de services pétroliers au monde, SLB (anciennement Schlumberger), ne l'a pas fait. Il n'est pas surprenant que d'autres gouvernements aient fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle retire sa liste noire des « sponsors de la guerre », ce qui a conduit à la suppression de la version accessible au public.
5. Démocratie et autoritarisme
Le régime de Poutine est un monstre de Frankenstein qui s'est retourné contre l'empire américain qui l'a autrefois nourri. Le gouvernement de Netanyahou est un autre type de monstre, fortement dépendant de son maître américain, qui le protège alors qu'il se déchaîne dans Gaza. Dans la mesure où les puissances occidentales ont un récit idéologique pour justifier leur opposition à Poutine et leur soutien à Netanyahou, elles disent défendre la démocratie face à une alliance de puissances autoritaires qui comprend la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, comme l'a déclaré cette semaine Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN. Le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux ne doivent pas accepter cette fausse dichotomie.
Les dangers de croire à ce faux récit affectent la question politique très pratique de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Les puissances occidentales rationnent délibérément ces armes, conformément à leurs vues sur la manière de traiter avec le Kremlin, mais elles sont divisées sur l'ampleur de ce rationnement. Il est parfois suggéré dans les cercles du mouvement ouvrier que ces arguments reflètent une scission entre les démocrates et les nouveaux autoritaires dans la politique occidentale. Je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, à l'heure actuelle, ce sont les démocrates, notamment les autoritaires, qui imposent les restrictions les plus dommageables à la résistance ukrainienne à la Russie. Pour comprendre cela, je suggère que nous le regardions dans le contexte de la crise de l'empire américain.
Commençons par Donald Trump. Il est tenu pour acquis que le Kremlin continuera d'intensifier son action militaire en Ukraine au moins jusqu'en novembre, dans l'espoir que Trump remportera l'élection présidentielle américaine et affaiblira le soutien occidental à l'Ukraine. Je n'ai aucune raison de douter que le Kremlin gardera ses options ouvertes à cet égard, mais (étant tout sauf un expert de la politique américaine) je crois que Trump n'est qu'une pièce du puzzle de la politique occidentale.
Prenons, par exemple, la décision sur l'aide à l'Ukraine qui a été adoptée par le Sénat américain et qui est maintenant bloquée à la Chambre des représentants parce que Trump fait pression sur le président de la Chambre, Mike Johnson. Le retard dans le programme d'aide nuit militairement à l'Ukraine. Martin Wolf, du Financial Times, a averti que Trump « pourrait bientôt donner la victoire à son ami, Vladimir Poutine, sur l'Ukraine ».
Wolf examine les machinations internes au sein du Parti républicain et conclut que la force de Trump réside dans la loyauté de la base du parti. Il craint que l'Ukraine ne soit « abandonnée » : cela « soulèverait partout des doutes sur la fiabilité des États-Unis » ; Les alliés des États-Unis douteraient de ses assurances ; la prolifération nucléaire pourrait se produire ; le vide pourrait être comblé par des alliances moins dépendantes des États-Unis.
Contrairement à Wolf, les chroniqueurs de The Economist soulignent les divisions internes au sein du Parti républicain. Si Trump remportait l'élection, disent-ils, sa politique étrangère serait chaotique, mais elle serait influencée par des factions républicaines fondamentalement opposées : le secteur isolationniste, fort soutenu dans les rangs républicains (« Make America Great Again ») ; ceux qui pensent que l'attention devrait se déplacer de l'Europe vers le Pacifique et vers la prétendue menace chinoise pour l'empire américain ; et la faction reaganienne, qui croit en la préservation de l'hégémonie américaine.
Dans l'ensemble, je pense qu'une victoire de Trump en novembre pourrait entraîner de nouvelles restrictions sur la fourniture d'armes à l'Ukraine. Mais ne perdons pas de vue le fait que celles-ci s'appuieraient sur les restrictions déjà imposées sous l'administration Biden, tant sur la fourniture d'armes que sur les sanctions. Le contexte est le déclin à long terme de l'empire américain. La prise de contrôle du Parti républicain par Trump n'en est rien d'autre qu'une manifestation ; le dysfonctionnement de la gouvernance américaine en est un autre ; le retrait chaotique d'Afghanistan en 2021, un troisième.
L'affaiblissement des institutions internationales mises en place par l'empire américain après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des Nations Unies, est symptomatique. La profondeur du malaise se voit dans l'échec désastreux de la communauté internationale à lutter contre le changement climatique, ou dans la série de guerres tout aussi destructrices qui sont cachées au regard de l'Occident (Soudan, Erythrée, etc.).
L'illustration la plus frappante de la crise de cet empire est sa relation avec Netanyahou, qui a conduit Israël et le sionisme sur la voie la plus extrême possible, tandis que les démocrates américains (et non les républicains) refusent de l'arrêter. L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé en 1949 pour gérer la crise des réfugiés palestiniens provoquée par la création de l'État d'Israël, en est victime.
Nous sommes confrontés à une crise profonde de l'hégémonie occidentale qui ne peut pas être comprise uniquement comme une action maléfique de nouveaux autoritaires (Trump et compagnie) contre les démocrates.
En Europe, alors que les dirigeants de droite des petits pays de l'Est comme la Hongrie et la Slovaquie espèrent conclure un accord avec le Kremlin, en Pologne, le parti d'extrême droite Droit et Justice et la Plateforme civique de centre-droit de Donald Tusk plaident pour un fort soutien militaire à l'Ukraine. La réponse la plus efficace aux demandes d'aide à l'Ukraine parmi les pays européens les plus riches a été celle du gouvernement conservateur du Royaume-Uni, le plus à droite d'entre eux. Même la coalition d'extrême droite de Giorgia Meloni en Italie (mais pas son adjoint, Matteo Salvini) soutient fermement la fourniture d'armes.
En Allemagne, c'est un dirigeant des sociaux-démocrates, Rolf Mutzenich, qui a déclenché une tempête de feu au parlement lorsqu'il a fait valoir non seulement que les missiles Taurus ne devraient pas être envoyés en Ukraine, mais que l'Allemagne devrait essayer de « geler la guerre et d'y mettre fin plus tard », probablement en faisant des concessions à Poutine.
La conclusion politique de tout cela n'est pas que les droitiers soient des alliés plus fiables que les démocrates américains, les sociaux-démocrates allemands ou les dirigeants travaillistes britanniques. Nous sommes confrontés à une crise profonde de la politique des gouvernements occidentaux, dont la démocratie et la social-démocratie font partie. Les démocrates et les sociaux-démocrates facilitent le génocide à Gaza en vertu de leur engagement de longue date envers Israël, à la fois idéologique et stratégique, tout comme la gauche et la droite de la politique bourgeoise ont facilité l'attaque meurtrière contre l'Irak en 2003, pour un ensemble similaire de raisons. Aujourd'hui, ces démocrates voient l'Ukraine à travers le prisme de leur politique russe. Soutenir le Kremlin est un principe pour eux ; Les droits démocratiques et sociaux du peuple ukrainien, non.
Bien sûr, il y a différentes façons de comprendre la démocratie par rapport à l'autoritarisme. Par exemple, juste après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, l'écrivain Volodymyr Yermolenko a utilisé ces termes pour expliquer la résistance féroce et inattendue du peuple ukrainien :
L'autoritarisme interne en Ukraine est difficile à trouver et a toujours été importé. Kiev et Moscou diffèrent considérablement en termes de culture politique et de droits civils. Les Ukrainiens veulent vivre dans une démocratie où les droits et les libertés sont garantis, et ils perçoivent la Russie comme un endroit où ces valeurs sont négligées et où le pouvoir des tyrans est respecté.
Je ne partage pas la vision optimiste de Yermolenko sur l'histoire ukrainienne. Et je considère que l'autoritarisme progressiste dans l'Ukraine déchirée par la guerre (la concentration du pouvoir, les restrictions imposées au parlement et aux syndicats) est dangereux. Mais je pense que Yermolenko a essentiellement raison en ce qui concerne l'impact de l'invasion de 2022 sur la conscience nationale ukrainienne :
Autant le Kremlin tente de diviser le peuple ukrainien par de faux récits historiques, autant la distorsion des faits et l'invasion et l'appropriation de territoires, ainsi que tous ses comportements agressifs, unissent la nation ukrainienne et renforcent l'identité ukrainienne.
Voici quelques indications d'une vision de la démocratie façonnée par le peuple, développée et défendue par l'action collective. Pour l'élite politique occidentale, en revanche, la démocratie est inscrite dans l'État. Par exemple, Michael Ignatieff, un politicien canadien devenu universitaire, dans un discours prononcé juste après l'invasion initiale de l'Ukraine par la Russie en 2014, a déclaré que la démocratie dépend en grande partie de l'État américain et qu'elle est déterminée par lui :
Vous ne pouvez pas changer les nouveaux autoritaires [dirigeants de la Russie et de la Chine], mais vous pouvez les arrêter et vous pouvez attendre qu'ils s'en aillent. Pour ce faire, les États-Unis doivent faire ce qu'ils peuvent pour maintenir les deux régimes autoritaires séparés, pour établir des relations avec chacun d'eux qui leur offrent des alternatives à une intégration plus poussée l'un avec l'autre.
Les États-Unis, a déclaré M. Ignatieff, « demeurent la démocratie dont l'état de santé détermine la crédibilité du modèle capitaliste libéral lui-même dans le monde en général ». Ce modèle gît brisé et brisé parmi les cadavres non enterrés des enfants de Gaza.
C'est un principe fondamental du socialisme que la démocratie et les droits démocratiques sont enracinés dans les luttes pour le changement social, et non aux États-Unis ou dans tout autre État capitaliste. C'est essentiellement le point de vue de plus de 400 militants, écrivains et chercheurs ukrainiens qui ont signé la lettre de solidarité avec le peuple palestinien en novembre :
Le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination et à la résistance contre l'occupation israélienne, tout comme les Ukrainiens ont le droit de résister à l'invasion russe. Notre solidarité découle d'un sentiment de colère face à l'injustice et d'une profonde douleur face aux effets dévastateurs de l'occupation, du bombardement des infrastructures civiles et du blocus humanitaire dont nous avons souffert dans notre pays.
C'est un point de vue minoritaire, un petit début. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer.
6. Le danger d'une extension de la guerre
L'Europe se trouve dans une « période d'avant-guerre », a déclaré le 31 mars le Premier ministre polonais nouvellement élu, Donald Tusk. La destruction par la Russie de l'infrastructure énergétique ukrainienne indique que « littéralement n'importe quelle évolution est possible ». En tant que socialistes, nous pouvons vilipender Tusk et les institutions politiques néolibérales dans lesquelles il opère, mais cet instantané de l'époque est-il correct ? Je pense. Je ne comprends pas assez cette menace pour en parler en détail, mais je pense qu'elle doit être reconnue.
L'empire américain est en crise, et Netanyahou, le chien de cet empire, aime étendre sa guerre à travers le Moyen-Orient. Plus tôt ce mois-ci, il a réagi à l'aggravation de la crise politique en Israël en ordonnant le bombardement de l'ambassade iranienne en Syrie. La crainte ressentie par des millions de personnes en Europe de l'Est, et exprimée par Tusk, est que Poutine, le monstre Frankenstein de l'empire américain, tente également d'étendre sa guerre au-delà de l'Ukraine (The Insider - un magazine d'opposition russe - a publié un sondage d'opinion à ce sujet).
C'est un principe socialiste, tel que je le comprends, que la guerre, de par sa nature même, tend à confondre, à bloquer et à affaiblir notre espoir de changer le monde par l'action collective, de renforcer la société face à l'État et de trouver des moyens de faire reculer, de renverser et de vaincre le capitalisme. Mais cela ne signifie pas que nous nous opposons à toutes les guerres en toutes circonstances : les guerres des peuples opprimés contre les oppresseurs et les guerres de résistance à la tyrannie et à la dictature peuvent être justifiées, et dans des cas comme ceux de l'Ukraine et de la Palestine, elles le sont.
Si nous entrons effectivement dans une période d'avant-guerre, nous devrons développer une analyse des types de guerre auxquels nous pourrions être confrontés. Verrons-nous des guerres analogues à l'attaque de l'Italie contre l'Érythrée (1935) ? Celle de l'empire japonais contre la Chine (à partir de 1937) ? L'invasion soviétique de la Finlande (1939) ? S'opposerions-nous à la fourniture d'armes à la partie attaquée dans tous ces cas d'agression ? Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails de cette question ici, même si je reconnais que nous devons y réfléchir. Espérons que nous pourrons éviter les spéculations sur la façon dont cette période d'avant-guerre pourrait évoluer et traiter plutôt des guerres réelles qui se déroulent actuellement.
Conclusions
En mai 2022, un groupe local de la coalition Stop the War a organisé une discussion entre Lindsey German, une éminente porte-parole de Stop the War, et moi-même. Elle a annulé l'événement à la dernière minute et je lui ai écrit une lettre ouverte qui disait :
En mai [2021], vous avez écrit que Stop the War « se tient aux côtés du peuple de Palestine, qui a le droit de résister à l'occupation ». Je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas en dire autant de l'Ukraine ? Et si le peuple ukrainien, ou palestinien, a le droit de résister, qu'est-ce que cela implique ? Cela signifie-t-il seulement faire face aux chars les mains vides, comme ils ont dû le faire en Ukraine ? Cela signifie-t-il que les chars doivent être confrontés à des pierres, souvent les seules armes dont disposent les jeunes Palestiniens ? Qu'en est-il des armes appropriées ? Pensez-vous que le peuple palestinien y a droit ? Et l'Ukrainien ?
J'ai dit alors que je ne pensais pas qu'il était facile de répondre à ces questions, et je n'y crois toujours pas. Mais je n'ai pas changé d'avis : le mouvement syndical ne devrait pas s'opposer à la livraison d'armes à l'Ukraine par les gouvernements occidentaux, comme le fait Stop the War, car la guerre en Ukraine reste essentiellement une guerre de résistance à l'agression impériale.
Les arguments selon lesquels l'Ukraine mène une guerre par procuration au sein de l'OTAN sont basés sur une mythologie inspirée par le Kremlin. Ces arguments ne correspondent pas à la position réelle des puissances occidentales (paragraphe 4 ci-dessus) ou de la Russie (paragraphe 2 ci-dessus). Nous devons nous attaquer à la guerre qui est en train d'être menée, et non à celle qui existe dans la tête des propagandistes de gauche.
Dans cette véritable guerre, je souhaite ardemment la défaite de l'invasion russe et le retrait de toutes les forces russes, comme base d'une issue juste. Mais pour les raisons énoncées ci-dessus, je ne pense pas que ce soit l'issue la plus probable à court terme. L'année prochaine, je pense qu'il est plus probable que (1) les forces russes ne feront pas d'autres avancées et ne conserveront que des parties limitées de l'est et du sud de l'Ukraine, ou (2) que les forces russes feront de nouvelles avancées.
Par conséquent, le dilemme le plus probable auquel la majorité du peuple ukrainien est confrontée, à court terme, pourrait être entre vivre dans une démocratie bourgeoise très imparfaite, de plus en plus dépendante économiquement et politiquement de l'Union européenne (comme c'est maintenant le cas pour la majorité), ou vivre sous les administrations d'occupation fantoches d'un régime fasciste russe. ou presque fasciste.
Les socialistes ne peuvent pas être neutres à ce sujet. Nous sommes pour la défaite du pouvoir impérial et pour tous les coups que la résistance ukrainienne peut lui porter. En d'autres termes, nous reconnaissons le droit du peuple ukrainien à se battre pour vivre sous Zelensky, au lieu d'être gouverné par des voyous sans foi ni loi. C'est certainement lié à notre aspiration à long terme, à renforcer le mouvement de la classe ouvrière et de la société civile, à construire son pouvoir en opposition au pouvoir du capital et de ses élites politiques.
En ce qui concerne les futurs pourparlers de paix, l'avenir nous le dira. À mon avis, ils sont loin d'être le cas. Appeler à des pourparlers de paix, sans reconnaître la façon dont le Kremlin utilise ce discours, est naïf. Nous pouvons faire pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils adoptent des politiques qui aident les gens à survivre à la guerre et à se construire une vie meilleure après celle-ci, notamment en ne les privant pas des armes dont ils ont besoin pour se défendre, en annulant la dette ukrainienne, en endiguant la vague de néolibéralisme que les institutions britanniques, américaines et européennes s'apprêtent à imposer à l'Ukraine d'après-guerre, et en soutenant les futurs arrangements de sécurité les plus solides possibles face à l'expansionnisme russe.
Nous devons également reconnaître les limites de notre capacité à influencer les gouvernements et exploiter la richesse des initiatives de solidarité directe en faveur de la classe ouvrière et de la société civile ukrainiennes par les mouvements syndicaux britanniques et européens au cours des deux dernières années. Un autre élément vital dans ce processus est de construire des relations entre le mouvement dans les pays occidentaux, en Europe de l'Est et dans l'ensemble des pays du Sud, où la guerre à Gaza a produit une vague de répulsion contre l'impérialisme, et la volonté de le vaincre, dans une nouvelle génération.
08/04/2024
L'homme et la nature
Traduction : Viento sur
Notes
[1] Un grand merci à T., D. et à tous ceux qui ont commenté le projet.
[2] Notez que je ne fais que suggérer quelques indications sur ce que le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux pourraient faire, car ce sont les agents de changement qui comptent. Je n'écris pas sur ce que les gouvernements pourraient ou devraient faire ; Je ne vois pas la politique de cette façon.
[3] J'ai exprimé mon opinion sur ces deux sujets en avril 2022, dans cet article.
[4] L'État russe dissimule des informations sur les victimes. Les informations les plus fiables sur les pertes russes proviennent du projet conjoint de Mediazona et Meduza. Des publications occidentales telles que The Economist et Newsweek considèrent ses calculs comme crédibles. Du côté ukrainien, le chiffre de 42 000 provient également de Meduza/Mediazona. À l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe, le président Zelensky a déclaré que 32 000 soldats ukrainiens avaient été tués.
[5] L'Institute for the Study of War, basé aux États-Unis, a également récemment publié un rapport sur les territoires occupés. Malgré son parti pris politique évident, les faits sont exacts.
[6] B. Grosovski, « Le budget de guerre sans précédent de la Russie expliqué », The Wilson Centre : the Russia File, 07/09/2023. Grosovsky inclut dans ses calculs des sections budgétaires classées comme militaires et d'autres classées comme secrètes. Des chiffres plus bas sont indiqués dans V. Ishchenko, I. Matveev et O. Shuravliev, « Russian Military Keynesianism : Who Profits from the War in Ukraine ? », South Wind, 04/04/2024.
[7] Ishchenko et al., « Le keynésianisme militaire russe » ; « Novye rossiiski regiony okazalis' dotatsionnymi pochti no 90% », Forbes.ru, 5/06/2023
[8] « La guerre en Ukraine facilite le rêve de « désaveu » du Kremlin », The Bell, 8/03/2024 ; Novaïa Gazeta Evropa, « Iz'iato dlia SVOikh », 5/03/2024 ; « La réorganisation de Poutine : la déprivatisation en tant que « projet national » pour reformater les élites », Objet : Russie, 7/03/2024.
[9] A. Prokopenko, « Les oligarques sont perdants alors que Poutine courtise une nouvelle classe de propriétaires d'actifs loyaux », Financial Times, 04/10/2023.
[10] A. Prokopenko et A. Kolyandr, « Keynes in jackboots : can defense spending sustain Russian economic growth », The Bell, 23/06/2023 ; « La surprenante résilience de l'économie russe », Financial Times, 02/02/2024.
[11] Voir « L'Ukraine a besoin de 500 000 recrues. Peut-il les élever ?", Financial Times, 13/03/2024 ; Commentaire de l'OSW, Au seuil d'une troisième année de guerre. la crise de mobilisation en Ukraine, février 2024 ; et « L'esquive de la conscription empoisonne l'Ukraine », Politico, 25/03/2024. Sondages examinés dans l'article du Financial Times et ici.
[12] J'ai écrit sur la question du gazoduc de la mer du Nord ici et ici
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
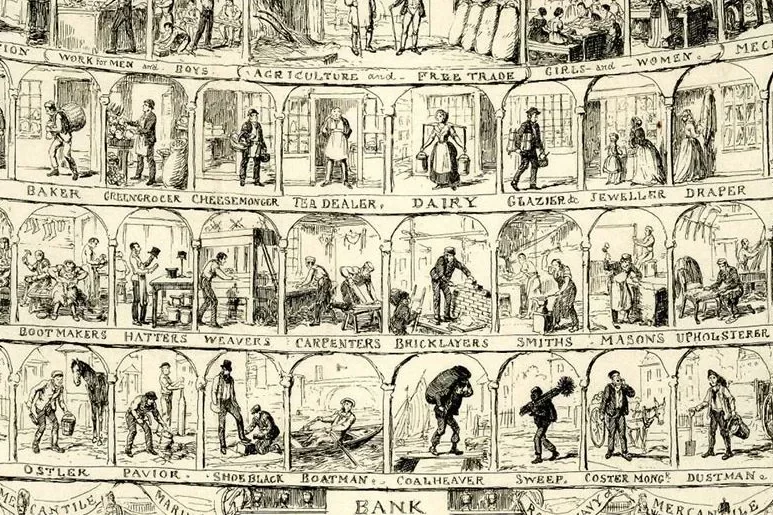
Nous avons besoin d’une renaissance de l’analyse marxiste des classes sociales
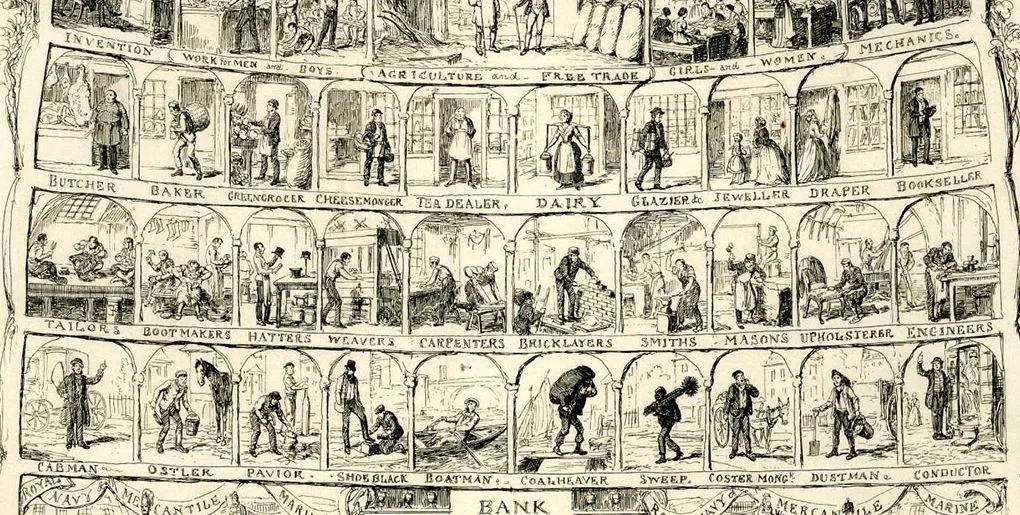
Sans données d'enquête solides, les discussions sur les classes et la conscience de classe ne sont souvent que des suppositions. Les études marxistes empiriques de la structure et de la conscience de classe sont inestimables pour une élaborer une robuste orientation politique socialiste : nous avons besoin de davantage d'enquêtes.
Tiré du site de la revue Contretemps
15 avril 2024
Par David W. Livingstone
La contribution la plus importante de Karl Marx à l'analyse moderne des classes sociales a été de documenter la manière dont les propriétaires capitalistes extraient continuellement du travail non rémunéré des travailleurs.ses salarié.es dans le cadre du processus de production, ce qui constitue la principale source de leurs profits.
Après sa mort, de nombreux analystes ont négligé l'importance qu'il accordait à cette « antre secrète » de la production dans le processus de travail capitaliste, se concentrant plutôt sur la distribution inéquitable des marchandises. Plus tard, des intellectuels marxistes et d'autres ont analysé avec perspicacité d'autres effets généraux dévastateurs du développement capitaliste. Mais l'accent mis sur le processus du travail a été ressuscité dans le sillage des manifestations d'étudiant.es et des travailleurs.ses des années 1960, notamment par l'ouvrage de Harry Braverman (1920-1976) intitulé Travail et capitalisme monopoliste, publié en 1974. Une série d'études ont suivi pour identifier la structure de classe des sociétés capitalistes avancées sur la base des relations de travail rémunéré entre les propriétaires et les employés embauchés.
L'intérêt initial de Marx pour l'identification des conditions dans lesquelles les travailleurs.ses salarié.es développeraient une conscience de classe s'opposant au capitalisme a connu un parcours similaire : de nombreuses affirmations sur la nécessité d'une conscience de classe, mais peu d'enquêtes empiriques sur son existence – jusqu'à ce que les protestations des années 1960 déclenchent une série d'études, telles que Consciousness and Action Among the Western Working Class, (Conscience et action parmi la classe ouvrière occidentale ) de Michael Mann (1942 -). Ces études spécifiques sur la structure et la conscience de classe ont eu lieu alors que les organisations syndicales atteignaient des niveaux d'adhésion historiques et que la part de la main-d'œuvre menaçait les marges bénéficiaires normales dans de nombreuses économies capitalistes. Ces développements ont conduit la contre-attaque néolibérale du capital.
Cette offensive capitaliste s'est déroulée à des moments différents et avec des degrés de coordination variables dans les pays capitalistes avancés. Cependant, dès les années 1990, ses effets sont devenus évidents, se manifestant par des réductions importantes de l'impôt sur les sociétés, la déréglementation des entreprises, des réductions dans le financement de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, la privatisation des services publics, et des efforts soutenus pour affaiblir et démanteler les syndicats. Cette attaque a eu pour conséquence une diminution de l'intérêt et du financement de la recherche sur les études marxistes des rapports de classe, coïncidant avec l'attention croissante portée à la diversité raciale et sexuelle de la main-d'œuvre. Depuis le début des années 1980, lorsque Erik Olin Wright (1947 – 2019) a coordonné des enquêtes nationales dans plusieurs pays capitalistes avancés, il n'y a pratiquement plus eu d'études marxistes empiriques majeures sur la structure des classes et la conscience de classe dans le Nord global.
Point de bascule
Nous vivons probablement l'époque la plus dangereuse pour l'espèce humaine depuis ses origines. Les nombreux incendies de forêt qui ont détruit de vastes étendues de terre dans de nombreux pays durant l'été 2023 sont un signe parmi d'autres que nous ne sommes plus qu'à quelques années d'une dégradation irréversible de l'environnement. Les preuves scientifiques sont désormais irréfutables : ces conditions exigent une action humaine immédiate. La guerre en Ukraine et la guerre d'Israël contre Gaza nous rappellent que nous pourrions à nouveau être confrontés à la perspective d'un hiver nucléaire.
Nous assistons à des pics historiques d'inégalité des richesses et à des baisses historiques de la confiance du public dans la capacité des gouvernements élus à remédier aux inégalités. La COP28 – la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2023 – s'est achevée sans qu'aucun mécanisme réel n'ait été mis en place pour garantir une action environnementale, tandis que les entreprises de combustibles fossiles déclarent des bénéfices et des plans de production records avec une opposition publique minimale de la part des élu.es. Ces dernières années ont été marquées par les plus grandes manifestations sociales de l'histoire sur les questions d'environnement et de justice sociale. Aujourd'hui plus que jamais, l'identification des forces de classe et la mobilisation des travailleurs.ses sont essentielles dans la lutte pour un avenir durable.
Les années 1980 ont vu fleurir d'importantes études sur la manière dont les rapports de classe imprègnent les tâches ménagères et le travail communautaire non rémunéré, et interagissent avec les rapports entre les hommes et les femmes et les relations raciales. Mais les recherches récentes axées sur la structure des classes professionnelles et la conscience de classe ont été très rares. Il existe toutefois une exception significative. Wallace Clement et John Myles, de l'université de Carleton, ont mené l'enquête sur la structure des classes au Canada en 1982, contribuant ainsi à la série internationale d'enquêtes sur les classes et la conscience de classe menée par Erik O. Wright.
À partir de 1998, j'ai pu mener une série d'enquêtes similaires grâce aux réseaux de recherche générale que je dirigeais. Ces enquêtes ont eu lieu en 1998, 2004, 2010 et 2016. Elles permettent de mieux comprendre les relations de travail en faisant la distinction entre les employeurs, les cadres et les travailleurs non-cadres, ainsi que d'examiner les niveaux et les formes de conscience de classe. Les résultats sont documentés dans mon récent ouvrage, Tipping Point for Advanced Capitalism : Class, Class Consciousness and Activism in the Knowledge Economy (Point de bascule pour le capitalisme avancé : classe, conscience de classe et activisme dans l'économie de la connaissance). Certaines des conclusions les plus importantes sont mises en évidence dans cet article.
Structure et conscience de classe
La figure suivante résume la répartition des classes au Canada en 2016. Les sociétés capitalistes et les grands employeurs sont restés très peu nombreux. Une tendance notable depuis le début des années 1980 est le déclin des travailleurs industriels. Toutefois, le nombre d'employés professionnels non-cadres a considérablement augmenté, de même que le nombre de cadres moyens, qui contrôlent le travail de connaissance de plus en plus important des employés non-cadres. Les cadres ont connu une détérioration de leurs conditions de travail et un sous-emploi, tout en devenant la partie la plus organisée de la main-d'œuvre. Ces tendances basées sur le processus de travail sont confirmées au niveau international par les données sur les classes d'emploi de la base de données sur l'économie politique comparée.
La conscience de classe émerge à trois niveaux critiques : l'identité de classe, la conscience oppositionnelle et les visions de l'avenir basées sur la classe. Ces niveaux correspondent à des questions-clés : Vous identifiez-vous à une classe spécifique ? Avez-vous des intérêts de classe opposés à ceux d'une autre classe ? Avez-vous une vision de la société future qui s'aligne sur les intérêts de votre classe ?
Actuellement, les personnes engagées à gauche croient souvent que nombre de travailleurs s'identifient de manière erronée à la classe moyenne, qu'ils possèdent une conscience oppositionnelle confuse qui a été affaiblie par l'idéologie bourgeoise dominante et qu'ils sont incapables de concevoir une véritable alternative au capitalisme. Cela est loin d'être vrai. L'analyse comparative des enquêtes d'Érik Olin Wright des années 1980 et des enquêtes canadiennes plus récentes a révélé ce qui suit :
– Si de nombreuses personnes s'identifient avec précision comme appartenant à la « classe moyenne » – par opposition à ceux qui sont manifestement riches ou démunis – cette auto-identification n'empêche pas un nombre important de personnes (les métallurgistes, par exemple) de développer une conscience de classe progressiste et oppositionnelle.
– Les personnes ayant une conscience progressiste d'opposition pro-travail (soutenant le droit de grève et s'opposant à la maximisation du profit) sont nettement plus nombreuses que celles ayant une conscience de classe pro-capital (s'opposant au droit de grève et soutenant la maximisation du profit), et le nombre de partisans pro-travail semble augmenter.
– Un nombre important et croissant de personnes expriment leur soutien aux visions d'une future démocratie économique caractérisée par des motifs non lucratifs et l'autogestion des travailleurs.
– Les personnes ayant une conscience ouvrière révolutionnaire, qui combine une conscience oppositionnelle pro-ouvrière et un soutien à la démocratie économique, constituent un groupe restreint mais croissant. Ce groupe est beaucoup plus important que les travailleurs dont les points de vue défendent clairement les conditions capitalistes existantes.
– Les non-cadres organisés, tels que les infirmières ou les enseignants, comptent parmi les militants les plus progressistes des réseaux actuels du mouvement syndical et social, résistant activement aux empiètements sur les droits économiques, sociaux et environnementaux.
Un militantisme de classe
Dans les pays capitalistes avancés, de nombreux travailleurs non-cadres expriment un mélange pragmatique d'espoirs et de craintes. Mais peu de travailleurs défendent un capitalisme obsédé par le profit qui donne la priorité à l'autorité managériale, alors que beaucoup préfèrent nettement une transformation vers une économie durable, sans but lucratif et gérée par les travailleurs. Parmi ceux qui ont une conscience de classe progressiste, il y a un soutien presque unanime à l'action contre le réchauffement climatique et à la réduction de la pauvreté.
C'est parmi les travailleurs non-cadres appartenant à des minorités visibles que le soutien est le plus fort. Le nombre croissant de travailleurs ayant une conscience révolutionnaire bien développée était encore faible en 2016 (moins de 10 %). Mais l'histoire a démontré que de petits groupes organisés peuvent provoquer des changements transformateurs lorsqu'ils répondent à de véritables préoccupations démocratiques.
Ces récentes enquêtes canadiennes sur les classes sociales suggèrent que les travailleurs non-cadres possèdent une conscience de classe progressiste latente bien plus importante que ne le supposent souvent les intellectuels de gauche. La conscience de l'exploitation sur les lieux de travail, ainsi que les sentiments plus larges de discrimination raciale et sexuelle, animent de fortes protestations sociales, bien qu'encore occasionnelles. Les travailleurs conscients de leur appartenance de classe sont les principaux militants de la plupart des mouvements sociaux progressistes.
Regarder vers l'avenir
À la suite de l'augmentation des votes et des manifestations en faveur des partis de droite au cours des dernières années, de nombreux experts ont spéculé sur la possibilité que de petits groupes non représentatifs accèdent au pouvoir politique de manière non démocratique. Les enquêtes canadiennes confirment que la majorité de ces petits groupes de capitalistes, des grands employeurs et des cadres supérieurs sont clairement enclins à soutenir les orientations politiques et les partis de droite. Cependant, le poids de cette enquête, ainsi que quelques autres enquêtes récentes – sensibles aux classes objectives définies par les rapports de travail rémunéré dans les pays capitalistes avancés – indiquent que les employés sont, dans l'ensemble, fortement favorables à des politiques sociales progressistes et à des partis politiques orientés à gauche.
Les travailleurs syndiqués de l'industrie et des services ont généralement maintenu une position politique progressiste. Toutefois, dans les pays où les mouvements syndicaux sont plus faibles, même certains travailleurs non-cadres bien établis – distincts des travailleurs des minorités visibles confrontés à la discrimination et à l'exploitation – se sont trouvés de plus en plus attirés par les mouvements anti-immigration et anti-diversité en raison de la précarité matérielle croissante.
Les idéologues réactionnaires et les partis de la droite radicale ont souvent utilisé les insécurités matérielles et psychiques chroniques pour faire appel à une plus grande gloire nationaliste et attiser les peurs racistes et les actions coercitives, en particulier parmi les classes relativement aisées et les groupes ethniques inquiets de perdre leurs privilèges. C'est aussi vrai pour l'insurrection du 6 janvier aux États-Unis que pour la montée du nazisme dans l'Allemagne de Weimar. Des preuves empiriques limitées provenant d'une rare enquête d'opinion dans l'Allemagne de Weimar suggèrent qu'une majorité d'employés et de travailleurs qualifiés ont continué à soutenir les opinions politiques de gauche et à rejeter les sentiments autoritaires. Mais seule une petite minorité de partisans des partis de gauche s'est montrée suffisamment attachée aux droits démocratiques pour résister au nazisme.
La différence la plus significative aujourd'hui est que dans la plupart des pays capitalistes avancés, la majorité des travailleurs non-cadres, en particulier ceux qui ont une forte conscience de classe, protègent davantage les droits démocratiques fondamentaux qu'ils ont durement acquis. Ils sont mieux préparés à les défendre lorsqu'ils sont sérieusement remis en question – comme le seront les travailleurs.ses aux États-Unis si Donald Trump gagne en novembre et que les plans du Projet 2025 deviennent opérationnels.
Les limites des enquêtes sur des échantillons de population pour prédire le comportement réel sont bien connues. Mais les enquêtes fondées sur les classes sociales, comme celles menées au Canada, permettent de suivre avec une grande précision l'évolution de la structure des classes et les liens avec les sentiments des classes sociales sur les questions politiques. Depuis la dernière enquête en 2016, des événements importants se sont produits, notamment la pandémie, l'aggravation des inégalités économiques et des revendications raciales, la multiplication des événements liés au réchauffement climatique et les guerres qui touchent plus directement les pays capitalistes avancés.
Une enquête partielle réalisée en 2020 au Canada, avant la pandémie, a révélé un soutien croissant à la transformation vers une démocratie économique durable. Il est urgent de réaliser des enquêtes complètes sur les classes et la conscience de classe dans tous les pays capitalistes avancés. Ces enquêtes sont cruciales pour aider les forces progressistes à mobiliser les sentiments anticapitalistes qui semblent être plus répandus et plus intenses qu'en 2016. Les questions de l'enquête du réseau Wright des années 1980 et des enquêtes canadiennes ultérieures sont désormais accessibles au public.
L'accès quasi-universel aux médias sociaux, la disponibilité de nombreux chercheurs qualifiés, ainsi que l'essor des mouvements sociaux axés sur des questions précises, qui ont besoin d'une telle intelligence de terrain, rendent les enquêtes représentatives des classes actuelles et de leur conscience politique plus pratiques que jamais. Les chercheurs pourraient facilement entreprendre une nouvelle enquête suédoise pour la comparer aux enquêtes Wright menées au début des années 1980, qui ont montré un fort soutien des travailleurs au plan Meidner, qui représentait une menace significative pour la propriété capitaliste de l'économie. De même, une enquête étatsunienne pourrait apporter des informations précieuses en comparant les résultats actuels avec ceux de l'enquête de 1980, d'autant plus que le mouvement syndical semble plus actif aujourd'hui qu'à l'époque. De telles enquêtes pourraient contribuer de manière significative aux efforts de mobilisation stratégique.
Les enquêtes fondées sur le processus de travail sont aujourd'hui beaucoup plus faciles et rapides à réaliser que lorsque Marx a tenté d'en réaliser une auprès des travailleurs français en 1880.
Les récentes enquêtes expérimentales menées aux États-Unis par la revue Jacobin sont prometteuses, car elles mettent en évidence des liens significatifs entre les politiques économiques progressistes, les candidats aux élections et certaines des divisions et identités de classe de Wright. Les chercheurs devraient poursuivre ces études et les relier plus étroitement aux structures de classe marxistes et à la conscience de classe. Ne pas saisir ces opportunités actuelles pour que les analyses marxistes de classe soutiennent l'action politique progressiste, alors que nous approchons du point de bascule entre le néant capitaliste et une alternative durable, serait une profonde erreur.
*
Publié initialement sur https://jacobin.com/2024/03/marxist-class-analysis-class-consciousness
Traduction : Contretemps
D. W. Livingstone est professeur émérite à l'Université de Toronto et auteur de Tipping Point for Advanced Capitalism : Class, Class Consciousness and Activism in the Knowledge Economy. (Point de bascule du capitalisme avancé, classe, conscience de classe et militantisme dans l'économie de la connaissance)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan : une année de guerre insensée et de violence extrême contre la population

La guerre au Soudan a éclaté le 15 avril de l'année dernière et continue jusqu'à aujourd'hui de ravager le pays. A l'occasion de ce triste « anniversaire », nous revenons sur l'année écoulée. Malgré les chocs et les horreurs auxquels la population est confrontée au quotidien, les Soudanais·e·s continuent de se mobiliser pour réclamer la fin des combats et le retour à une transition démocratique.
Tiré du blogue de l'auteur.
Retour en avril 2023 : une situation fragile
Suite au coup d'Etat du général Al-Burhan mené en octobre 2021 contre la composante civile du régime de transition, qui devait permettre l'instauration d'une démocratie réclamée par les Soudanais-e-s durant la révolution, la population soudanaise n'a pas cessé de manifester son refus du coup d'Etat, à travers des manifestations, grèves et occupations. En avril 2023, sous pression et de plus en plus isolé, le général Al-Burhan (chef de l'armée soudanaise) avait réouvert les discussions autour d'une transition civile.
L'objectif était de trouver un accord pour sortir de l'impasse. Mais ces discussions – qui portaient notamment sur la réforme de l'institution militaire et le calendrier de cette réforme – ont ravivé les tensions entre Al-Burhan et son allié Mohamed Hamadan Dagalo (appelé « Hemedti), à la tête de la milice des « Forces de Soutien Rapide » (RSF). Les révolutionnaires civils demandent la dissolution de toutes les milices et la constitution d'une seule armée unifiée, qui se tienne à l'écart du pouvoir politique. Mais les RSF, devenues aussi puissantes que l'armée elle-même - n'avaient pas d'intérêt à être dissoutes et regroupées dans l'armée.
La tension s'est brutalement accentuée entre Al-Burhan et Hemedti. En parallèle d'une visite stratégique aux Emirats Arabes Unis, qui le soutiennent, Hemedti commençait à déployer ses soldats à divers endroits stratégiques, notamment à Marawi, où se trouve l'aéroport militaire de l'armée soudanaise.
Le 15 avril, le jour où tout a basculé
Ce jour aurait dû être une célébration de l'Aïd. Mais ce matin-là, les habitant-e-s de Khartoum ont été réveillé-e-s par des tirs et des explosions. La guerre venait d'éclater entre l'armée soudanaise et les RSF. Qui a tiré la première balle ? On ne le sait toujours pas. Pour la première fois dans l'histoire du Soudan, la guerre a éclaté dans la capitale, à proximité du palais présidentiel. La sidération était totale. Pensant que les affrontements dureraient à peine quelques heures, nombreux sont ceux à avoir quitté leurs maisons en imaginant y revenir le soir même. Mais ils ne sont jamais revenus.
La sidération s'est poursuivie dans les jours suivants. L'attention de la communauté internationale (Etats Unis, pays européens et pays du Golfe) a principalement porté sur l'évacuation de leurs ressortissants. Le départ des étranger-e-s issu·e·s de ces pays a été vécu par la population soudanaise comme un abandon de la communauté internationale. Les Soudanais-e-s et les étranger-e-s d'autres nationalités qui n'avaient pas été évacué-e-s (notamment africaines) sont resté-e-s livré-e-s à eux-mêmes, au milieu des combats.
Entre massacres à répétitions et tentatives de négociations : synthèse d'une année de guerre
Pendant plus de trois semaines, la capitale et plusieurs villes du Darfour (Nyala, Al Fasher) et du Kordofan (Al Obeid) ont été soumises à des combats ininterrompus entre les bombardements de l'armée et les tirs des RSF. Les habitant-e-s ont rapidement témoigné sur les réseaux sociaux de cambriolages, de vols, et de viols de la part des soldats des RSF, mais aussi des militaires. Les Soudanais·e·s ont continué à quitter massivement leurs maisons, pour aller depuis la capitale vers la province (Wad Madani, Gezira, Port Soudan) mais aussi vers l'Egypte et Ethiopie, le Tchad et le Sud du Soudan.
En mai 2023, des négociations ont eu lieu à Djeddah avec la médiation des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'objectif était de rassembler les deux généraux autour de la table. Mais l'initiative était vouée à l'échec : les RSF débutaient – au même moment – un massacre (qualifié de génocide) à Al-Geneina, ville frontière avec le Tchad, située au Ouest Darfour[1].
Le massacre d'Al-Geneina prolonge ainsi l'histoire des génocides au Darfour qui ont eu lieu au début des années 2000, avec le soutien de l'armée et du gouvernement d'Omar El-Béshir. Musab, militant soudanais en exil, pointe ainsi du doigt la double responsabilité des RSF et de l'armée dans ces massacres : « Les militaires sont complices de tout ça, même durant le génocide au Darfour en 2003, ils étaient témoins du massacre. Les milices permettent à l'armée soudanaise de rejeter sur elles sa responsabilité. Les militaires sont censés être le premier groupe qui évite d'entrer dans une guerre, mais au Soudan c'est le contraire. »
En décembre 2023, la ville de Wad Madani est tombée aux mains des RSF, après que l'armée ait une nouvelle fois abandonné la population locale. Les destructions, bombardements, vols, pillages, se sont poursuivis dans tout le pays, s'étendant progressivement du Darfour et de la capitale vers le centre et l'Est.
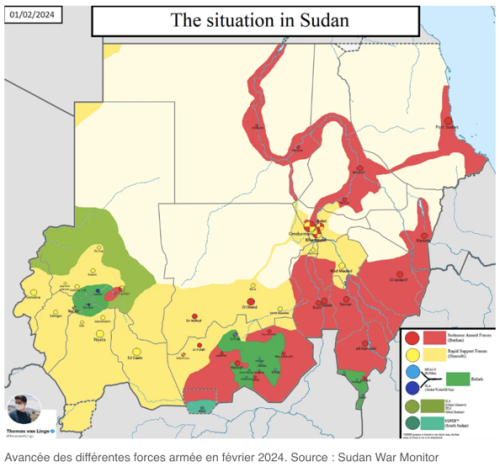
En janvier 2024, le collectif « Taqqadum » - composé de plusieurs partis politiques – a signé un accord avec les RSF à Addis-Abeba, dans lequel les RSF s'engagent à garantir une transition civile et démocratique s'ils gagnent la guerre. Cet accord – qui a notamment été signé par Abdallah Hamdock (l'ancien premier ministre de la période de transition) – a été largement contesté et décrié par les Soudanais-e-s, qui considèrent qu'aucune compromission n'est possible avec les RSF.
Si cet accord survenu à un moment où les RSF prenaient l'avantage sur l'armée, il s'inscrit également dans une « normalisation diplomatique » des relations avec les RSF. De janvier à mars 2024, Hemedti a ainsi effectué une série de visites officielles dans les pays voisins, où il a été reçu comme un allié diplomatique. Mais plus récemment, l'armée soudanaise a remporté – grâce à des drones iraniens - plusieurs combats majeurs sur les RSF. A ce jour, l'issue de la guerre reste donc toujours très incertaine.
Une guerre difficile à comprendre
Les raisons profondes de cette guerre sont obscures et font l'objet de débats au sein des Soudanais·e·s, comme le constate Khansa, militante soudanaise en exil : « Il n'y a pas une seule analyse profonde sur la situation actuelle au Soudan, et c'est ça qui nous rend confus. Il y a des gens qui soutiennent la guerre, qui veulent que les militaires écrasent les RSF quoi qu'il arrive, mais il y a aussi des gens qui qui considèrent les RSF comme un allié politique, ou encore d'autres qui ont des intérêts directs dans la guerre. Et il y a des gens qui disent : « Non à la guerre ! », qui pensent que c'est la pire chose qui peut arriver. Avec tous ces discours, on n'arrive pas à trouver une bonne orientation, ni de bons outils de travail pour être plus efficaces. Parce qu'il y a un manque d'analyse et on n'a pas de boussole. »
Certains estiment que c'est une guerre de pouvoir entre deux hommes, pour leurs simples intérêts personnels. Pour Khaled - militant soudanais en exil – la guerre peut être analysée d'un point de vue féministe, comme une « compétition de virilité entre deux généraux qui prennent en otage la population soudanaise ». D'autres estiment qu'il s'agit d'une « guerre entre différents groupes sociaux et culturels de la société », avec une dimension raciale qui conduit à des génocides. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une guerre « impérialiste », car chacun des deux groupes qui s'affrontent est soutenu par différentes puissances étrangères qui convoient le Soudan pour ses ressources naturelles et pour sa localisation stratégique. Khansa considère ainsi que : « la guerre est une étape très violente qui se traduit par le fait qu'il y a des organisations armées qui essayent de monopoliser les richesses et le pouvoir du pays par les armes, par n'importe quel moyen. »
Mais pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une guerre « contre-révolutionnaire ». En mettant le pays à feu et à sang, elle a fait s'effondrer les espoirs de la révolution civile et démocratique. Et a poussé sur les routes de l'exil de nombreux·ses militant·e·s engagé·e·s dans la révolution. En déstabilisant complètement le pays, cette guerre permet aux cadres de l'ancien régime de rester en place sans être jugés pour les crimes qu'ils ont commis durant des décennies (durant la dictature militaire puis du coup d'Etat).
Se mobiliser et résister
Malgré l'immense douleur et la colère, les Soudanais-e-s n'ont pas dit leur dernier mot et la flamme de la résistance est toujours présente. La mobilisation demeure active dans le pays (voir notre précédent article). Du côté de la société civile, les initiatives se sont multipliées pour réclamer la fin de la guerre. En novembre 2023, les comités de résistance (organisations autogérées par quartier de la société civile, et fer de lance du mouvement de contestation depuis 2018) ont publié une déclaration avec des pistes concrètes de propositions pour mettre fin à la guerre[3], réformer les forces armées soudanaises, mettre en place un gouvernement civil et obtenir justice pour toutes les victimes de guerre. De nombreuses initiatives locales mettent en œuvre une solidarité dans les différents quartiers, malgré une situation humanitaire catastrophique.
La résistance se poursuite également dans la diaspora soudanaise à travers le monde, même si la guerre affecte aussi fortement les Soudanais-e-s à l'étranger (voir notre précédent article). Rashida - militante soudanaise en exil - note une différence entre la période post-révolutionnaire et la situation aujourd'hui : « Les gens sortaient en masse après le coup d'Etat, parce qu'il y avait de l'espoir. Mais maintenant, nous ne sommes pas nombreux aux manifestations. C'est la guerre, et il n'y a plus d'espoir, nous sommes perdus. Les manifestations sont tristes, car il n'y a personne qui n'a pas été touché directement par cette guerre. » Pour autant elle continue à se mobiliser, en considérant que « c'est le minimum que je peux faire » pour soutenir son pays depuis la France, et « qu'il ne faut rien lâcher ».
A Paris, hier, des militants ont manifesté place de la République contre la guerre, et d'autres ont fait entendre leur voix en perturbant la « Conférence sur la crise humanitaire au Soudan » organisée par les puissances internationales, accusée par de nombreux militants soudanais de poursuivre la normalisation des relations internationales avec les RSF et d'aller à l'encontre de la volonté de la population soudanaise. Des manifestations ont eu lieu hier dans différentes villes du monde, à Paris, Londres, Boston, New York, Oslo, Whasington, Phoeniw, Cardiff, dans le cadre de la « Global March for Sudan » qui vise à demander la fin immédiate de la guerre.
Auteur : Equipe de Sudfa Media
Notes
[1] Aujourd'hui, des journalistes soudanais·e·s et organismes d'investigation tentent de comprendre ce qui s'est passé à Al-Geneina au cours de ces derniers mois, et d'estimer le nombre de morts : certaines études évoquent entre 10 et 15 000 mort·e·s rien que dans cette ville, ce qui est autant que le nombre total de mort·e·s dans tout le pays évoqué par l'ONU.
[2] Donnant lieu à des génocides (comme celui des Massalit dans la ville d'El-Geneina), et poursuivant la logique des guerres génocidaires qui ont eu lieu dans le passé au Darfour, Kordofan et au Soudan du Sud
[3] La déclaration des comités de résistance sera traduite prochainement sur Sudfa.
********
Sudfa est un blog participatif franco-soudanais, créé par un groupe d'ami-e-s et militant-e-s français-e- et soudanais-e-. Nous nous donnons pour objectif de partager ou traduire des articles écrits par des personnes soudanaises, ou co-écrits par personnes soudanaises et françaises, sur l'actualité et l'histoire politiques, sociales et culturelles du Soudan et la communauté soudanaise en France. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à sudfamedia@gmail.com, ou via notre page facebook. Pour plus d'infos, voir notre premier billet « qui sommes-nous ». Vous pouvez aussi retrouver tous nos contenus, articles, chroniques et reportages, sur notre nouveau site : sudfa-media.com. A bientôt.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan. De la révolution de 2018-19 à la guerre civile actuelle : leurs origines, leurs développements et la place des « acteurs régionaux »

Le15 avril 2023, l'alliance entre le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane des Forces armées soudanaises (SAF) et Mohammed Hamdan Daglo (« Hemetti »), le chef des Forces de soutien rapide (RSF), s'effondre, catapultant le pays dans une guerre sans précédent.
Tiré d'À l'encontre.
La guerre a d'abord commencé autour de la capitale Khartoum, mais elle s'est rapidement étendue à d'autres régions du Soudan, notamment au Darfour, à Port-Soudan et, en décembre 2023, à l'Etat de Gezira, jusque-là paisible, cœur agricole du pays situé au confluent du Nil bleu et du Nil blanc.
La nature des combats – qui s'étendent à la fois aux zones rurales et urbaines – et leur ampleur ont provoqué une grave crise humanitaire. Pas moins de 9 millions de Soudanais ont fui, dont plus d'un million en franchissant les frontières du pays. Human Rights Watch [novembre 2023] a fait état de nettoyage ethnique à Khartoum et au Darfour, ainsi que de la prise pour cible de milliers de civils et la persécution de villages. La crise a été aggravée par l'insécurité alimentaire, qui touche environ 60% de la population, car les combats perturbent la production agricole dans une grande partie du pays. Le PAM (Programme alimentaire mondial) a récemment, le 6 mars 2024, averti que le pays était confronté à « la plus grande crise alimentaire dans le monde »[1].
Sur le terrain, l'acheminement de l'aide humanitaire a été entravé par des blocages bureaucratiques, notamment le refus d'accorder des permis de voyage aux organisations humanitaires, et par leur impossibilité en raison des combats en cours à entrer dans les zones dans le besoin. L'aide acheminée risque d'être confisquée ou redirigée par l'armée et les forces de sécurité, dans le cadre de l'effort de guerre et pour pénaliser les civils qui s'y opposent. Les deux parties belligérantes ont pris pour cible les installations médicales. Quelque 70 % des hôpitaux et des installations médicales ne fonctionnent pas. Les gens meurent de la propagation de maladies soignables et de blessures traitables.
La situation actuelle diffère fortement de la période antérieure, des années 2018-2019, lorsque le monde a observé avec admiration le Soudan dans lequel un soulèvement populaire renversait le régime islamiste-militant du président Omar el-Béchir. La révolution promettait d'ouvrir une nouvelle ère de démocratie, bien que fragile, après trois décennies de régime autoritaire. Au lieu de cela, le conflit prolongé qui sévit aujourd'hui au Soudan menace les fondements mêmes de l'Etat soudanais et, partant, la stabilité du Sahel et de la Corne de l'Afrique.
La crise économique et les racines de la protestation populaire
Dans une large mesure, la guerre au Soudan est le résultat direct de la force et de l'ampleur, au-delà des clivages sociaux, régionaux et ethniques, de ce que les Soudanais appellent la « Glorieuse Révolution » de 2018.
La sécession du Sud-Soudan, le 9 juillet 2011, a été l'un des principaux facteurs à l'origine des manifestations populaires qui ont fini par renverser le régime autoritaire d'Omar el-Béchir. Après plus d'une décennie de croissance économique relative, la sécession du Sud-Soudan a privé l'Etat d'une grande partie de ses revenus pétroliers (les deux tiers des ressources pétrolières du Soudan se trouvent dans le Sud), ce qui a entraîné une aggravation de la crise économique. Entre 2000 et 2009, le pétrole représentait 86% des recettes d'exportation du Soudan[2]. La sécession du Sud-Soudan a donc entraîné la perte de 75% des recettes pétrolières de Khartoum[3].
L'absence de revenus pétroliers a érodé les réseaux clientélaires de l'ancien régime, renforçant les rivalités entre les dirigeants du Parti du Congrès national (NCP) d'El-Béchir. Elle a également exacerbé les griefs sociaux et économiques d'un large éventail de la société soudanaise, tant dans les zones urbaines que rurales, jetant ainsi les bases du soulèvement populaire de décembre 2018.
Les manifestations ont débuté dans la ville ouvrière d'Atbara, dans l'Etat du Nil, à environ 320 km au nord de Khartoum, sous l'impulsion d'élèves de l'enseignement secondaire, très vite rejoints par des milliers d'habitant·e·s de la ville. L'étincelle initiale a été la multiplication par trois du prix du pain. Mais dans les zones périphériques où le soulèvement a commencé, les griefs économiques avaient précédé la perte des revenus pétroliers de l'Etat. Pendant la période du boom pétrolier, bien que l'économie formelle du Soudan se soit développée, les bénéfices ont été inégalement répartis. L'attribution des services, des emplois et des projets d'infrastructure est restée concentrée dans l'Etat de Khartoum et elle a été conçue pour apaiser les populations urbaines. Comme l'indique une étude, au cours des deux décennies précédant la révolution, environ cinq projets majeurs dans le triangle central du Nord ont représenté 60% des dépenses de développement[4].

En 2009 (dix ans avant le soulèvement), l'incidence de la pauvreté au sein de la population rurale était de 58%, contre 26% au sein de la population urbaine. En outre, les chiffres de cette période montrent que les niveaux de pauvreté étaient bien plus élevés au Darfour et dans l'est qu'à Khartoum et dans les Etats du centre[5]. L'inégalité entre les régions et entre le centre et la périphérie du pays explique, en partie, pourquoi les protestations initiales qui ont conduit au soulèvement populaire de 2018 ont éclaté, pour la première fois dans l'histoire du Soudan, dans la périphérie du pays plutôt que dans la capitale.
En l'espace de quelques jours, cependant, les manifestations antigouvernementales se sont étendues à un large éventail de villes et de villages dans toute la région du nord et dans la capitale, Khartoum. Les manifestant·e·s ont scandé des slogans, comme celui bien connu des soulèvements arabes : al-sha'ab yurid isqat al-Nizam, « le peuple veut la chute du régime ».
Nouveaux réseaux de mobilisation populaire
A l'instar des villes de la périphérie, les manifestations à Khartoum ont également commencé par protester contre une crise économique profonde liée à la hausse des prix du pain et du carburant et à une grave crise de trésorerie. Mais leurs revendications se sont rapidement transformées en appels à l'éviction d'El-Béchir.
Dans la période précédant la révolution, les leaders de la jeunesse soudanaise se sont associés aux syndicats de médecins, de pharmaciens, d'avocats et d'enseignants du secondaire. L'Association professionnelle soudanaise (SPA) – un réseau de syndicats parallèles (ou non officiels) composé notamment de médecins, d'ingénieurs et d'avocats – a pris la tête de l'organisation et de la préparation des manifestations. Fin décembre 2018, ils ont appelé à une marche sur le parlement à Khartoum, demandant au gouvernement d'augmenter les salaires du secteur public et de légaliser les associations professionnelles informelles et les syndicats. Après que les forces de sécurité ont eu recours à la violence contre des manifestations pacifiques, leurs revendications se sont transformées en un appel à la destitution du pouvoir du Parti du Congrès national (PCN), à la transformation structurelle de la gouvernance au Soudan et à une transition vers la démocratie.
Leurs revendications ont fait écho à celles des précédentes manifestations populaires, notamment en 2011, 2012 et 2013. Mais les manifestations de 2018-19 étaient sans précédent en termes de durée et d'étendue géographique. Elles ont également suivi un processus remarquablement nouveau, innovant et durable. Les manifestant·e·s ont tiré les leçons des erreurs commises lors des manifestations précédentes, qui étaient très centralisées, essentiellement réservées aux Soudanais de la « classe moyenne » et dépourvues de stratégies pour faire face aux forces de sécurité étatiques, omniprésentes.
Dirigées par la SPA et organisées au niveau de la rue par des comités de résistance de quartier (NRC) dirigés par des jeunes, les manifestations ont été coordonnées, programmées et essentiellement conçues pour mettre l'accent sur la permanence plutôt que sur le nombre. Les manifestations étaient également réparties dans les quartiers de la classe moyenne, de la classe ouvrière et des quartiers pauvres. Il y avait une coordination avec les manifestant·e·s dans les régions éloignées de Khartoum, y compris les Etats de la mer Rouge, à l'est, et le Darfour, à l'extrême ouest du pays.
Au-delà de l'échelle régionale, les manifestations se sont également distinguées par des niveaux inédits de solidarité entre les classes sociales et les ethnies. Les jeunes militants et les membres d'associations professionnelles ont non seulement contesté le discours politique de l'Etat islamiste, mais ils ont également joué un rôle important dans l'élaboration d'alliances entre classes dans le cadre de ces manifestations. Les slogans qu'ils ont utilisés étaient conçus pour résonner et mobiliser le soutien au-delà des clivages ethniques, raciaux et régionaux.
Au cours des six mois de manifestations, des grèves, des arrêts de travail et des sit-in ont été organisés, non seulement sur les campus universitaires et dans les écoles secondaires, mais aussi parmi les travailleurs du secteur privé et du secteur public. Parmi les exemples les plus importants, on peut citer les grèves des travailleurs de Port-Soudan sur la mer Rouge, qui exigeaient l'annulation de la vente du port méridional à une société étrangère, ainsi que plusieurs arrêts de travail et protestations menés par les employés de certaines des banques les plus importantes du pays, de fournisseurs de télécommunications et d'autres entreprises privées.
Si l'accent est mis, à juste titre, sur le rôle central des manifestant·e·s, des comités de résistance et de la SPA, les partis d'opposition soudanais ont également joué un rôle : non seulement en organisant les manifestations, mais aussi en apportant un soutien idéologique aux revendications des manifestants. Les partis politiques ont pris l'initiative de rédiger la Déclaration de liberté et de changement en janvier 2019, au plus fort de la mobilisation. Avec la SPA, les principales coalitions de partis politiques soudanais, notamment les Forces du consensus national et l'Appel du Soudan(Nida al-Sudan), ont favorisé la formation d'un vaste réseau d'opposition, qui s'est réuni sous la bannière des Forces de la liberté et du changement (FFC). Les FFC étaient principalement chargées d'assurer la coordination entre les différentes classes sociales, y compris celles travaillant dans le secteur informel.
En effet, et c'est le plus important, les FFC ont mobilisé non seulement des associations et des groupes de jeunes de la classe moyenne, mais aussi des comités de résistance de quartier organisés de manière informelle, dont certains représentaient les quartiers urbains les plus pauvres. Ces comités de résistance de quartier trouvent leur origine dans la désobéissance civile de 2013 contre El-Béchir. Ils ont fourni des forces de base aux manifestations. Ces comités ont pris l'initiative de réorienter les manifestants pour s'éloigner des forces de sécurité. Ils ont joué un rôle central dans le maintien des manifestations malgré la grande violence déployée par les forces de sécurité et les milices pour réprimer le soulèvement.
La force relative et la légitimité initiale des principaux partis d'opposition, ainsi que leur coordination avec les manifestants de la rue et les syndicats informels, ont joué le rôle le plus crucial dans le maintien des manifestations qui ont chassé El-Béchir. Après la révolution, les comités de résistance joueront un rôle politique plus direct, en s'efforçant de dégager un consensus populaire autour d'un projet de transition légitime et populaire vers une démocratie civile, conformément aux objectifs de la révolution.
La violence contre-révolutionnaire
Après la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019, le Soudan est toutefois resté un régime autoritaire hybride par excellence.
Dans un premier temps, Omar el-Béchir a été remplacé par une junte militaire sous la forme du Conseil militaire de transition (TMC). Le TMC était dirigé par le général Bourhane de l'armée soudanaise (SAF), et son adjoint était Daglo, le commandant des RSF (Forces de soutien rapide). En réponse à la prise de pouvoir par les militaires, les sit-in et les manifestations se sont poursuivis, exigeant une transition vers un régime civil à part entière. Le 3 juin 2019, les forces de sécurité du TMC, y compris les milices des RSF, ont violemment dispersé l'un de ces sit-in, tuant des centaines de personnes et en blessant des milliers d'autres dans ce qui est devenu le « massacre du sit-in » de Khartoum.
Les dirigeants civils, représentés par le FFC (Forces de la liberté et du changement), sont finalement parvenus à un accord avec les militaires en juillet. En août 2019, les parties ont signé un apparent accord de partage du pouvoir sous la forme d'une charte constitutionnelle. Les FFC a proposé Abdallah Hamdok comme premier ministre du gouvernement de transition [août 2019-octobre 2021]. Cette charte constitutionnelle a été modifiée par l'Accord de paix de Juba d'octobre 2020, signé entre le gouvernement de transition et plusieurs groupes d'opposition [5 groupes rebelles issus des régions du Darfour, du Khordofan du Sud et du Nil Bleu qui ont accepté de déposer les armes en échange d'une meilleure inclusion de leurs populations, historiquement marginalisées, dans le partage des richesses et la gestion du pays].
Le gouvernement de transition n'a cependant jamais établi une séparation claire des pouvoirs : par le biais de la charte constitutionnelle, les militaires ont conservé le droit de rejeter tous les points proposés par les dirigeants civils de la coalition. En outre, ils ont bénéficié de l'immunité contre les enquêtes sur les crimes passés (y compris le massacre du sit-in du 3 juin 2019) et ont exercé un droit de veto sur les nominations ministérielles civiles, telles que celles du président de la Cour suprême et du procureur général. Le gouvernement de transition a donc fonctionné avec un déséquilibre marqué entre l'autorité des militaires et celle des civils.
Pour leur part, les comités de résistance de quartier du Soudan et le mouvement général de protestation ont continué (et continuent encore aujourd'hui) à faire pression en faveur de cinq priorités importantes. La première est une transition vers un régime civil à part entière qui repose sur le rejet d'un autre partenariat avec les dirigeants militaires (illustré par le slogan des « trois non » : pas de négociations, pas de partenariat et pas de légitimité pour les militaires). Deuxièmement, ils demandent la reformulation de l'accord de Juba afin qu'il intègre davantage les personnes directement touchées par la guerre sur le terrain. Troisièmement, ils exigent des discussions sur la réforme constitutionnelle afin de préparer une conférence constitutionnelle qui tienne pleinement compte des inégalités structurelles et ethniques du passé et qui, en fin de compte, superviserait des élections libres et équitables. Quatrièmement, ils veulent que les acteurs de l'Etat impliqués dans les violences contre les civils, y compris dans le massacre du sit-in, rendent des comptes. Enfin, ils souhaitent la mise en place rapide d'un conseil législatif après la cessation des hostilités.
Parmi ce réseau d'organisations de la société civile, on trouve des groupes qui avaient apporté leur soutien au gouvernement civil, notamment l'Association des professionnels soudanais (SPA) et les deux principales organisations de jeunes (Girifna et Sudan Change Now). En fin de compte, l'incapacité d'Abdallah Hamdok et de la branche civile du gouvernement de transition à intégrer les principales demandes et la participation des comités de résistance a sapé les progrès concrets en ce qui concerne les demandes populaires en matière de justice et de rendre des comptes. Cela a limité la base sociale et le soutien aux dirigeants civils. Le retard pris dans la mise en place d'une assemblée législative chargée de préparer les élections a encore affaibli la popularité et la légitimité d'Abdallah Hamdok et des partis politiques en général. Les dirigeants militaires, dans le cadre de ce qui était alors un partenariat solide entre Bourhane et Daglo, ont habilement exploité ces divisions, ouvrant la voie au coup d'Etat d'octobre.
Le 25 octobre 2021, le général Bourhane des Forces armées soudanaises (SAF) et le commandant des Forces républicaines de sécurité (RSF), Daglo, ont conjointement fomenté un coup d'Etat contre Hamdok [ce dernier a été retenu chez lui par les putschistes, puis sous la pression des manifestations il est placé par les militaires à un pseudo-poste de premier ministre]. Des protestations persistantes et généralisées ont immédiatement suivi, appelant à un retour à un régime civil. Ces manifestations, menées par les comités de résistance populaire, ont contraint les SAF et les RSF à accepter des négociations avec l'opposition civile. Ces négociations ont ouvert la voie à l'accord-cadre, aujourd'hui annulé, qui a suscité une rivalité féroce entre Bourhane et Daglo. Plus précisément, les SAF et les RSF étaient en désaccord profond sur la question de l'intégration de ces dernières dans l'armée nationale régulière. En outre, les deux forces ont rejeté les tentatives de démantèlement de leurs vastes fortunes économiques – un objectif clé de la révolution.
Le désaccord entre les deux généraux sur la réforme du secteur de la sécurité et leur ambition réciproque de conserver le contrôle de vastes pans de la richesse du pays sont deux des facteurs les plus importants qui ont conduit le Soudan à la guerre.
Les origines des RSF
Si la rivalité entre les officiers de l'armée soudanaise soutenus par les islamistes et les milices des RSF menace aujourd'hui de détruire l'Etat, c'est leur longue histoire de partenariat qui est à l'origine de la guerre actuelle.
L'émergence des RSF remonte à la guerre du Darfour, au début des années 2000. En réponse à une insurrection qui a débuté au Darfour en 2003, le régime de Béchir a mené une guerre anti-insurrectionnelle de type « terre brûlée » qui a entraîné la mort de plus de 200 000 civils. Cette guerre a été principalement menée par les milices Janjawids, créées, financées et contrôlées par le régime de Khartoum. L'actuel commandant des RSF, Daglo (Hemetti), a lui-même servi en tant que commandant des Janjawids pendant ces années. (Bourhane était lui aussi stationné au Darfour afin que les Forces armées soudanaises puissent coordonner les efforts anti-insurrectionnels pour le compte de Khartoum).
En 2013, à la suite de la restructuration de l'armée par le régime islamiste, les Janjawids ont été transformés en RSF sous la direction de Daglo. Préoccupé par la menace posée par les insurgés au Darfour et par les cycles répétés de manifestations en faveur de la démocratie à Khartoum, El-Béchir a institutionnalisé les RSF en tant que bras anti-insurrectionnel de l'armée soudanaise. Outre le déploiement de la milice contre l'insurrection et les manifestations populaires, un troisième objectif était d'affaiblir l'armée nationale permanente afin d'empêcher toute tentative de la part d'officiers de rang moyen d'évincer le parti d'El-Béchir (le régime du Parti du Congrès national-NCP) par le biais d'un coup d'Etat militaire. El-Béchir a donné à Daglo son surnom, Hemetti, « mon protecteur ». En 2017, El-Béchir a légalisé les RSF par décret exécutif, établissant formellement la milice comme une force de sécurité indépendante, par la suite, plus justement catégorisée comme une milice para-militaire d'Etat.
Après la révolution de 2019, Bourhane a autorisé et encouragé l'expansion des RSF dans les zones résidentielles de l'agglomération de Khartoum, préparant ainsi le terrain pour que la capitale devienne l'épicentre de la violence au début de la guerre.
C'est une ironie fatale de l'histoire soudanaise que les RSF – la milice ostensiblement loyale de l'ancien régime islamiste du NCP – prennent les armes contre son ancien bienfaiteur en avril 2023. Les raisons principales de cette décision étaient doubles : l'insistance sur l'autonomie de commandement et de contrôle et la réalisation de l'ambition croissante de Hemetti de dominer l'économie et la politique du pays.
Une guerre pour l'économie « illicite »
Le pouvoir de l'armée soudanaise, en particulier dans ses rangs supérieurs, trouve son origine dans la fondation de l'Etat profond actuel du Soudan et dans le lien entre l'économie nationale et les intérêts militaires et sécuritaires.
Après le coup d'Etat de 1989 qui a porté au pouvoir le régime militaire de Béchir, soutenu par les islamistes, le gouvernement a mis en place une stratégie économique de tamkeen (autonomisation). Cette politique a permis d'établir une hégémonie politique et économique en faveur des élites islamistes du pays, organisées autour du Front national islamique (NIF) et, plus tard, du Parti du Congrès national (NCP). Dans le cadre d'une politique de réformes ostensiblement néolibérales et favorables au marché, les entreprises publiques ont été vendues aux alliés du régime. Les hommes d'affaires ont été contraints d'accorder des parts de leurs sociétés aux loyalistes du NCP, et des réductions d'impôts, voire des exonérations totales, ont été accordées aux entreprises favorables au régime[6].
En plus d'acheter la loyauté au régime, l'Etat a purgé ses rivaux du gouvernement et de la société civile. Dès son arrivée au pouvoir, le régime islamiste a limogé des milliers de militaires et de fonctionnaires[7].
Dans un schéma qui rappelle la guerre actuelle, les dirigeants islamistes ont commencé à accumuler et à distribuer de manière sélective des produits de base tels que le blé, la farine et le pétrole. Le pétrole, en particulier, a joué un rôle central dans la pérennité islamiste-autoritaire du régime jusqu'à la sécession du Sud en 2011. Le régime de Béchir, fort d'un boom des revenus pétroliers qui alimentaient directement les coffres de l'Etat, a utilisé ces revenus pour renforcer et étendre ses réseaux clientélaires dans tout le pays, en dirigeant les fonds vers les loyalistes et leurs régions d'origine. Mais si les politiques économiques du tamkeen ont permis aux islamistes de monopoliser les secteurs économiques formels et informels du Soudan, elles ont également élargi le rôle de l'armée soudanaise dans l'économie[8]. La création de la Military Industrial Corporation (MIC) au début des années 1990 a permis aux SAF de contrôler une douzaine d'entreprises qui produisaient du matériel militaire. Leurs activités économiques se sont ensuite étendues au-delà de la MIC pour inclure une série d'industries civiles.
C'est dans ce contexte que l'économie est devenue une scène décisive de la compétition politique après le soulèvement de 2018-19. Au cours de la transition qui a suivi la révolution, deux factions d'élite ont émergé au centre : les restes de la coalition islamiste du FNI, liés aux membres du NCP – qui avaient été principalement responsables de la construction de l'Etat profond dans les années 1990 – et le Conseil militaire de transition (TMC) composé de dirigeants des milices SAF et RSF.
Alors que dans le passé les islamistes représentaient un groupe relativement cohérent, des fissures sont apparues au cours de la transition entre les dirigeants militaires à la tête du TMC et un groupe idéologique islamiste résurgent, exerçant un contrôle important sur les services de sécurité de l'Etat, y compris les tristement célèbres et militants kattayib al-zil, ou « brigades de l'ombre »[9]. En réponse, le TMC a pris le contrôle de nombreuses grandes entreprises appartenant à des islamistes et a réduit le pouvoir des services de renseignement du Soudan. Il s'est même employé à démanteler plusieurs milices en confisquant leurs biens et en fermant leurs comptes bancaires. A la suite du coup d'Etat du 25 octobre 2021, Bourhane s'est retrouvé de plus en plus isolé, sans pouvoir ni légitimité dans la société civile. Il a rapidement rétabli les relations avec les islamistes, en réintégrant leurs dirigeants dans la bureaucratie et l'appareil de sécurité de l'Etat. Tous deux combattent aujourd'hui les milices RSF.
Les chefs militaires, soutenus par les islamistes purs et durs, s'efforcent de conserver et de faire fructifier les vastes richesses financières et les avantages politiques dont ils jouissaient grâce à leur monopole sur l'Etat profond. Les objectifs de Bourhane dans la guerre actuelle sont donc motivés par les entreprises et les investissements des SAF, ainsi que par la longue histoire de manipulation de l'économie informelle par les SAF et les islamistes, qui leur a permis d'exercer leur emprise sur l'Etat. Le fait qu'ensemble ils soient déterminés à atteindre cet objectif par tous les moyens militaires nécessaires et quel qu'en soit le coût humain explique en partie la logique de la violence à grande échelle dans la guerre civile en cours et, en particulier, le ciblage de la population civile – dont une grande partie a lutté pour démanteler l'héritage de l'Etat profond. En effet, l'un des objectifs centraux de la révolution était dès le départ : tafkeek al-nizam wa izalat al-tamkeen (démanteler le régime et supprimer ses politiques d'« autonomisation »)[10].
Du pétrole à l'or
Les politiques d'autonomisation (tamkeen) et le boom pétrolier ont alimenté la montée en puissance d'un Etat profond dominé par les islamistes. Dans la guerre actuelle, cependant, c'est l'extraction de l'or pour l'exportation qui alimente les milices parallèles d'Hemetti et génère la violence politique.
Suite à la perte des revenus pétroliers avec la sécession du Sud-Soudan en 2011, El-Béchir s'est tourné vers l'or pour soutenir ses réseaux clientélaires affaiblis. Entre 2012 et 2017, la production d'or a connu une augmentation astronomique de 141%[11]. En 2018, un an avant la révolution, le pays était le douzième producteur mondial.

Mais contrairement au pétrole, les bénéfices de ce nouveau boom de l'or ont été distribués de manière beaucoup plus décentralisée. La plupart des exportations d'or sortent illégalement du pays, principalement vers les marchés des Emirats arabes unis. La majeure partie de la valeur de l'or échappe ainsi à l'économie formelle malmenée, ce qui compromet la capacité de l'Etat à générer des revenus et à allouer des ressources à sa population civile. Une étude récente a révélé que l'écart entre les exportations d'or déclarées par le Soudan et les importations enregistrées par ses partenaires commerciaux s'élevait à 4,1 milliards de dollars[12], ce qui laisse supposer que 47,7% des revenus de l'or soudanais se retrouvent dans des mains privées.
Alors que l'armée et l'appareil de sécurité dominé par les islamistes se battent pour contrôler les entreprises impliquées dans le pétrole, la gomme arabique, le sésame, les armes, le carburant, le blé, les télécommunications et les banques, Hemetti monopolise l'or (et dans une moindre mesure le bétail et l'immobilier), afin d'étendre son effort de guerre. La violence qui sous-tend la guerre est directement liée à sa richesse personnelle, qu'il a amassée en grande partie grâce à sa participation au commerce illicite de l'or.
En 2015, un rapport publié par le Conseil de sécurité de l'ONU a révélé que les forces de Hemetti généraient 54 millions de dollars par an grâce au contrôle de la mine d'or de Jebel Amer[13], ce qui lui a permis de recruter des jeunes, pauvres et sans emploi, de tout le Sahel au sein du RSF, venant notamment de Libye, du Tchad, du Mali et du Niger, et qui sont les principaux auteurs des violences au Darfour, à Khartoum et dans le centre du Soudan. Sa force paramilitaire est actuellement estimée à 40 000 hommes. Par rapport à leurs homologues des SAF, ses hommes de troupe bénéficient d'un accès privilégié aux ressources financières et à la formation de la part d'acteurs extérieurs.
L'émergence de l'or en tant que matière première la plus rentable du Soudan contribue à expliquer la nature décentralisée de la guerre et les niveaux élevés de violence infligés par les milices du RSF, en particulier dans les régions riches en or du Darfour et du Kordofan.
Alimenter une guerre par procuration
Bien que la dynamique principale de la guerre au Soudan soit interne, des puissances régionales et d'autres plus éloignées jouent un rôle influent. Les pays du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, sont au premier rang de ces puissances.
Ici aussi, l'émergence de l'or comme la matière première la plus rentable du Soudan est significative. Contrairement au pétrole, l'or est une ressource pillable, ce qui incite les acteurs extérieurs, comme les Emirats arabes unis, à intervenir aux côtés des RFS, quelles que soient les conséquences en termes de violence à l'encontre des civils. Les Emirats arabes unis soutiendraient Hemetti et ses RSF par des livraisons d'armes transitant par le Tchad et la Libye.
Au-delà du commerce illicite de l'or, Hemetti a également bénéficié des intérêts régionaux des pays du Golfe et de leurs préoccupations concernant la mer Rouge. L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis s'inquiètent depuis longtemps de l'encerclement iranien par le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb. Ces inquiétudes ont été renforcées par le soutien iranien au mouvement Houthi au Yémen, qui a conduit à l'intervention militaire d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite en 2015. Hemetti a reçu des millions de dollars de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis pour envoyer ses milices combattre dans la guerre.
Alors que la majorité des soldats des RSF sont rentrés du Yémen, la récente escalade de la violence en mer Rouge, due aux attaques des Houthis contre des navires commerciaux en réponse à la guerre d'Israël contre Gaza, a alimenté les inquiétudes de l'Arabie saoudite, en particulier. Riyad, avec les Etats-Unis, a pris l'initiative de tenter de négocier un accord de cessez-le-feu entre les deux parties belligérantes, dans le but stratégique de conserver une alliance solide avec le régime qui émergera à Khartoum après la guerre.
L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont tous deux établi avec succès des bases militaires dans la Corne de l'Afrique : l'Arabie saoudite à Djibouti et les Emirats arabes unis en Erythrée. Les Emirats arabes unis cherchent également à établir des installations similaires dans le nord de la Somalie. Mais la concurrence pour l'influence dans la région de la mer Rouge ne se limite pas à ces Etats. Le Qatar, la Turquie et la Russie ont tous renforcé leur engagement dans la région et se sont lancés dans l'établissement de bases militaires au large de la côte soudanaise de la mer Rouge.
S'il est en partie stratégique, l'intérêt des Etats du Golfe pour le Soudan découle également d'objectifs économiques à plus long terme. Ils considèrent les investissements en Afrique comme un moyen de diversifier leurs économies et sont désireux de développer le commerce sur ce continent riche en ressources, dont le Soudan est la porte d'entrée. Les Emirats arabes unis ont poursuivi avec détermination un projet de développement portuaire au large de la côte soudanaise de la mer Rouge. En 2022, Khartoum aurait officiellement attribué aux Emirats arabes unis un contrat d'exploitation d'une partie de Port-Soudan, dans lequel les Emirats arabes unis investiraient 6 milliards de dollars.
Les terres agricoles du Soudan sont également essentielles pour aider les Etats du Golfe à répondre à la demande croissante d'importations alimentaires. Dans le cœur agricole du Soudan – dans l'Etat de Gezira, par exemple – les investissements des pays du Golfe (estimés à 8 milliards de dollars) ont été facilités par des politiques néolibérales qui ont plongé les petits agriculteurs dans l'endettement et décimé le secteur de l'agriculture familiale. Une grande partie des terres louées par les investisseurs du Golfe a été transformée en projets agro-industriels à grande échelle qui ont coupé les routes de transhumance des troupeaux et absorbé des parcelles autrefois utilisées pour l'agriculture de subsistance pluviale. La paupérisation des agriculteurs et des travailleurs ruraux soudanais a d'ailleurs contribué au succès du recrutement des milices des RSF, dont les combattants sont issus de populations rurales désormais dépossédées.
L'Egypte, pour sa part, soutient le général Bourhane et les Forces armées soudanaises. Le Caire s'inquiète non seulement de la revitalisation de l'influence islamiste sur son flanc sud. Elle se préoccupe aussi de la gestion du bassin du Nil. En 2020, l'Ethiopie a commencé à remplir le Grand Ethiopian Renaissance Dam, un barrage hydroélectrique de 4,8 milliards de dollars sur le Nil Bleu, que Le Caire considère comme une menace existentielle pour ses propres ressources en eau. Hemetti entretient des liens étroits avec l'Ethiopie ainsi qu'avec les Emirats arabes unis qui, bien qu'ils soient un bienfaiteur majeur de l'Egypte, sont également un rival régional en termes d'influence. L'Egypte considère donc un Soudan dominé par les RSF comme une menace pour ses intérêts nationaux.
L'une des conséquences de ces rivalités est l'existence d'une série d'efforts de « paix » qui sont contradictoires entre eux. A l'heure où nous écrivons ces lignes, quatre forums différents sont simultanément à l'œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et un accord de paix entre les factions belligérantes : les pourparlers de Riyad (menés par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite) ; l'initiative IGAD-Union africaine menée par Djibouti ; les pourparlers du Caire visant à forger une alliance entre l'opposition civile et l'allié égyptien, les Forces armées soudanaises ; et une initiative plus récente placée sous la conduite des Emirats arabes unis mais tenue sous les auspices du gouvernement de Bahreïn.
Ces initiatives reflètent les intérêts des Etats qui les ont initiées et leurs relations avec les parties belligérantes respectives, plutôt que des efforts visant à aider le peuple soudanais et la société civile à trouver un cadre réaliste pour aboutir à un cessez-le-feu.
La promesse durable de la révolution
Contrairement à d'autres guerres civiles dans l'histoire du Soudan, les parties belligérantes au Soudan ne bénéficient actuellement d'aucun soutien ni d'aucune légitimité au sein de la société civile. Les deux parties mènent une guerre contre le peuple soudanais précisément parce que, dans le sillage de la révolution démocratique à grande échelle de 2018, la société civile soudanaise a massivement rejeté un avenir dominé par des dirigeants militaires autocratiques.
En effet, la révolution de 2018-19 a clairement montré, et la guerre dévastatrice actuelle l'a confirmé, que les perspectives de paix et de démocratie reposent sur la pérennité de la société civile du Soudan, composée d'associations professionnelles, de syndicats et d'organisations de jeunes et de femmes. La guerre n'a fait qu'affirmer l'importance de ces réseaux. Aujourd'hui encore, les comités de résistance dirigés par des jeunes, malgré leurs différences, s'accordent à dire que la priorité est de mettre fin à la guerre et de rétablir la paix en s'attaquant aux causes profondes des conflits au Soudan, comme l'a voulu la révolution.
Au cours d'une guerre dévastatrice et face à des déplacements massifs, un mouvement populaire influent dirigé par des jeunes a fait preuve d'une grande capacité à collaborer au-delà des clivages ethniques, de genre et sociaux pour atteindre des objectifs démocratiques. En l'absence d'une aide internationale adéquate, par exemple, des équipes d'intervention d'urgence dirigées par des jeunes ont mobilisé l'aide mutuelle dans tout le pays.
Alors que les élites politiques perdent de leur légitimité dans la société civile soudanaise, les leaders de la jeunesse continuent de bénéficier d'un soutien important de la part d'une large couche de Soudanais. Les dirigeants du mouvement de jeunesse, les organisations de femmes, les universitaires indépendants, les artistes et les millions de Soudanais de la diaspora sont presque unanimes pour relever le défi actuel de la guerre en travaillant au renforcement de la société civile de manière à rétablir la confiance, à résoudre le conflit et à construire une paix durable. (Article publié par le Middle East Research and Information Project (Merip), printemps 2024, n° 310 ; traduction rédaction A l'Encontre)
* Khalid Mustafa Medani est professeur agrégé de sciences politiques à l'Université McGill, Montréal.
Notes
[1] “Sudan crisis sends shockwaves around the region as displacement, hunger, and malnutrition soar,” WFP, February 19, 2024.
[2] The National Population Council, Ministry of Social Welfare and Security, “Sudan Millennium Development Goals Progress Report, 2010,” July 23, 2012, p. 67.
[3] IMF Country Report No. 13/318 : “Sudan : Interim Poverty Reduction Strategy Paper,” (October 2013), p. 6.
[4] “Sudan : Public Expenditure Review, Synthesis Report,” World Bank, Report no. 41840-SD. Washington DC. December 2007.
[5] World Bank : “The Sudan Interim Poverty Reduction Strategy Paper Status Report,” (October 2016), p. 1.
[6] Ahmed Gallab, The First Islamic Republic : Development and Disintegration of Islamism in Sudan (Surrey : Ashgate, 2008).
[7] Anne L. Bartlett, “Dismantling the ‘Deep State' in Sudan,” Australisian Review of African Studies, 41/1, (2020), pp. 51-57.
[8] Harry Verhoeven, “The rise and fall of Sudan's Al-Ingaz Revolution : The Transition from Militarised Islamism to Economic Salvation and the Comprehensive Peace Agreement,” Civil Wars 15/2 (2013), pp. 118-140.
[9] “Burhan lets the Islamists back in,” Africa Confidential 62/10 (May 12, 2022).
[10] “Al-Burhan forms committee to dissociate al-Bashir's regime in Sudan,” Middle East Monitor, December 11, 2019.
[11] “Analyzing Trade, Oil and Gold : Recommendations to Support Trade Integrity in Sudan,” Global Financial Integrity, May 2020, p. 3.
[12] “Analyzing Trade, Oil and Gold : Recommendations to Support Trade Integrity in Sudan,” Global Financial Integrity, May 2020, p. 3.
[13] “U.N. Panel of Experts Reveals Gold Smuggling and Cluster Bombs in Darfur,” Relief Web, April 12, 2016.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sahel. “US Army get out” : le départ des soldats américains du Niger réclamé et enclenché

Alors que Washington a accepté la demande de retrait de ses militaires déployés au Niger formulée par Niamey, des centaines de manifestants se sont rassemblés le 21 avril à Agadez, dans le centre du pays, dénonçant le manque de résultats de la coopération militaire nigéro-américaine.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo. Manifestation contre la présence américaine à Agadez, au Niger, le 21 avril 2024. Photo Stringer/Reuters.
“Here is Agadez, not Washington. US Army get out” [“Ici c'est Agadez, pas Washington. Dehors l'armée américaine”], affichait une banderole en tête de cortège, le dimanche 21 avril à Agadez. Des centaines de personnes ont manifesté dans cette ville saharienne du centre du Niger pour réclamer le départ des forces américaines.

Le vendredi 19 avril, l'administration Biden a entériné le retrait des forces américaines du Niger, après que Niamey avait dénoncé, le 16 mars, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis.
À quelques kilomètres de l'arène de lutte traditionnelle d'Agadez, où les manifestants ont tenu un meeting, se trouve la base 201, une base de drones construite par le Pentagone peu après l'arrivée des premiers commandos américains au Niger en 2012. Il s'agit de la deuxième base militaire américaine, par la taille, sur le continent, après celle de Djibouti.
Dans une déclaration relayée par le site Actu Niger, les manifestants ont dénoncé l'opacité de la base aérienne 201 : “personne ne sait ce qui s'y passe”. Tout autant dénoncés : le manque de résultats engrangés dans la lutte antiterroriste “malgré les moyens technologiques de dernière génération”, ou encore la crainte que cette base ne soit ciblée par les ennemis que Washington s'est créés “du fait de son comportement de provocateur et de gendarme de la planète”.
“Sagesse” et “bon sens”
Le quotidien burkinabè Le Pays salue le compromis trouvé par les deux parties “même si, officiellement, il n'existe pas encore un calendrier très précis du retrait des soldats américains du Niger”.
À l'inverse de la France, qui a dans un premier temps refusé de prendre au sérieux la demande de retrait de ses militaires basés au Niger – au motif qu'elle émanait d'un pouvoir considéré comme illégitime – le divorce entre Niamey et Washington pourrait, selon le quotidien burkinabè, se dérouler “dans le respect des uns et des autres, c'est-à-dire sans animosité”.
Washington opte donc pour “la sagesse et le bon sens [qui] commandent de plier bagage”, même si l'arrivée au Niger de matériel russe et d'instructeurs militaires d'Africa Corps (groupe paramilitaire russe héritier de Wagner) l'aura aussi motivé à quitter le Niger, selon le titre ouagalais.
“Où iront les 1 100 soldats américains ?” s'interroge de son côté Aujourd'hui au Faso. Au Tchad ou aux États-Unis ? Le 18 avril, la chaîne américaine CNN évoquait un courrier de responsables tchadiens adressé, hors des canaux diplomatiques officiels, à l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis au Tchad et réclamant l'annulation d'un accord militaire entre les deux parties. Un moyen pour N'Djamena d'obtenir des concessions de Washington ?
“Le Tchad n'a pas demandé aux forces américaines de partir. […] Nous sommes convenus que la période suivant l'élection présidentielle au Tchad [prévue le 6 mai] est un moment approprié pour réexaminer notre coopération en matière de sécurité”, a réagi un porte-parole du département d'État, cité par Alwihda.
Selon l'armée de l'air tchadienne, explique le site d'information, le courrier évoquait un départ des éléments américains de la base Adji Kosseï, au nord-ouest de N'Djamena, sans que cela ne “[remette] en cause la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis”. Moins de 100 soldats américains sont actuellement présents au Tchad.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grèce : la deuxième mort de Syriza ou, de la tragédie à la farce

Syriza traverse actuellement ce qui pourrait bien être sa crise finale après l'élection à sa tête d'un ancien trader : Stefanos Kasselakis. Celui-ci a pris la succession d'Alexis Tsipras après la déroute électorale récente du parti, en bénéficiant d'un large soutien des médias dominants et d'un système de « primaire interne » qui permet à toute personne s'inscrivant en ligne et payant la somme de deux euros de participer à l'élection du chef du parti.
Stathis Kouvélakis analyse dans cet article ce qui apparaît d'ores et déjà comme la « deuxième mort » de Syriza, la première renvoyant à la capitulation en rase campagne de l'été 2015 face à la Troïka (Banque centrale européenne, Fonds monétaire international et Commission européenne). Celle-ci conduisit Tsipras à mener une politique d'une extrême brutalité pour les classes populaires et, ainsi, à transformer Syriza de parti de la gauche radicale en parti de l'austérité néolibérale.
8 avril 2024 | tiré de la gauche écosocialiste | d'abord publié sur le site de Contretemps
https://www.contretemps.eu/grece-deuxieme-mort-syriza-tsipras-kasselakis/
On connait sans doute les phrases par lesquelles commence leDix-huit Brumaire de Louis Bonaparte de Marx : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages de l'histoire surgissent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».
Ce « quelque part » fait référence à un passage des Leçons sur la philosophie de l'histoire qui établit un parallèle, d'une part, entre le passage de Rome de la république à l'empire et celui de la France de la monarchie à la république, et, de l'autre, entre le destin de César, celui de Napoléon et celui de la dynastie des Bourbons. Selon Hegel, le meurtre de César est censé ramener la république, en mettant fin au pouvoir personnel, mais il aboutit à sa fin irrévocable et à l'instauration du régime impérial, d'un césarisme sans César que le meurtre de celui-ci a rendu possible. Napoléon et les Bourbons sont chassés deux fois du pouvoir, et ce n'est qu'au terme de cette réitération que l'irréversibilité de la fin du pouvoir qu'ils ont incarné est véritablement actée.
Hegel en tire une sorte de loi de l'histoire selon laquelle « la répétition réalise et confirme ce qui au début paraissait seulement contingent et possible »[1]. Un événement n'est définitivement enregistré que lorsque, par sa répétition, sa nécessité, c'est-à-dire son caractère irréversible, est reconnue. Cette répétition n'est en fait jamais une répétition à l'identique, elle s'effectue toujours sous une forme déplacée.
Toutefois, l'idée d'un passage de la tragédie à la farce est, pace Marx, déjà bien présente chez Hegel, qui caractérise la « Restauration » des Bourbons de « farce qui a duré 15 ans »[2]. La normalité propre à l'ère bourgeoise tend à refouler les moments troubles qui ont scandé son émergence. Pour autant, si toute idée de retour en arrière s'avère illusoire, cette illusion fait elle-même partie du processus qui, par le jeu de la répétition, enregistre la césure de l'événement.
Le désastre que vit la Grèce, et en particulier la gauche grecque, depuis le terrible été 2015 apparaît comme un cas d'école de cette « ruse de la raison historique ».
Entre les deux morts, la séquence 2015-2023
La dernière en date des tragédies d'un pays qui en a connu bien d'autres est donc survenue en ce terrible été 2015, lorsqu'Alexis Tsipras capitule en rase campagne face à la Troïka (Union européenne, Banque centrale européenne, Fond Monétaire International), et accepte un plan néolibéral de choc (connu en tant que « 3e Mémorandum ») bien pire que celui que l'électorat grec venait de rejeter quelques jours auparavant, lors du référendum du 5 juillet. Mais l'ampleur de la catastrophe était telle qu'elle fit l'objet d'un déni, habilement cultivé par Tsipras et ceux qui l'ont suivi au sein de son parti, avec l'appui enthousiaste des classes dominantes grecque et européennes.
Syriza a pu ainsi remporter le scrutin anticipé de septembre 2015 en laissant croire que l'acceptation du 3e Mémorandum n'était qu'un recul tactique et en promettant de mettre en œuvre un « programme parallèle », censé neutraliser ses retombées négatives. Les quatre ans qui ont suivi ont toutefois été marqués par l'application à la lettre des recettes néolibérales draconiennes gravées dans le marbre de cet accord, sans la moindre mesure compensatoire, transformant la Grèce en pays modèle du néolibéralisme au sein de l'UE.
L'électorat sanctionne lourdement Syrizaau scrutin européen de mai 2019, en le plaçant (à 23,7% contre 35,6% en septembre 2015), dix points derrière une droite revigorée, assurée de revenir au pouvoir. Sentant le vent du boulet, Tsipras bouscule de quelques mois le calendrier électoral et appelle à un scrutin législatif anticipé pour juillet. La manœuvre porte ses fruits, ou du moins quelques-uns.
Certes, Syriza sort perdant, à près de neuf points derrière Nouvelle Démocratie. Mais il progresse de près de huit points par rapport aux européennes, atteignant un score inespéré de 31,5%. La perspective d'un retour de la droite au pouvoir a suscité un ultime réflexe de vote-barrage. Ce réflexe s'était nourri de la réaction suscitée par les manifestations nationalistes du printemps précédent contre l'accord signé avec la République de Macédoine du Nord, qui avaient vu se constituer un front commun entre l'extrême droite et les secteurs les plus radicaux de Nouvelle Démocratie.
Ce score a créé l'illusion, propagée conjointement par Syriza et le système politico-médiatique, selon laquelle on assisterait au retour à un système bipartisan comme celui que le pays avait connu des années 1970 à la crise de 2010. A la seule différence que c'était désormais le parti d'Alexis Tsipras qui était censé occuper la place qui fut naguère celle du Pasok, celle d'une force d'alternance gouvernementale face à la droite.
Cette illusion renvoyait de fait à une autre, plus profonde : celle qui refusait d'admettre le caractère irréversible de ce qui s'était passé l'été 2015, et qui s'était prolongé lors des quatre années qui avaient suivi, à savoir la mutation de Syriza d'un parti de la gauche radicale en véhicule d'une forme particulièrement dévastatrice de néolibéralisme, assortie d'une mise sous tutelle du pays pendant plusieurs décennies[3].
Mai-juin 2023 : le naufrage électoral
L'effondrement électoral de Syriza au scrutin de mai 2023, confirmé et aggravé dans celui qui a suivi (de 31,5% en 2019 à 20% en mai puis à 17,8% en juin), a mis fin à cette illusion. Au cours des quatre années précédentes, Syriza s'était contenté de mener une opposition superficielle, ne contestant aucune orientation de fond de la droite.
Au parlement, ses députés ont voté 45% des lois proposées par le gouvernement de Mitsotakis, y compris les plus emblématiques comme celle autorisant la vente à un prix symbolique du terrain de l'ancien aéroport d'Elliniko à l'oligarque Yanis Latsis, associé à des capitaux qataris, ou les pharaoniques contrats d'armement, d'un montant de près de 15 milliards à ce jour, qui ont conduit au doublement du budget de la défense entre 2020 et 2022. Syriza s'est chargé lui-même de rappeler quotidiennement que la capitulation de 2015 et son mandat gouvernemental ne constituaient en rien une « parenthèse » forcée mais bien une rupture qui n'admettait aucun retour en arrière.
Par ailleurs, Tsipras a engagé une mutation de la structure organisationnelle de Syriza en ouvrant largement le parti à des personnalités « centristes », en général issues du Pasok, qui avaient approuvé tous les Mémorandums signés avec la Troïka lors de la période 2010-2015. Le nom du parti a été modifié en 2020 en « Syriza-Alliance progressiste », avec l'ambition d'en faire une force capable de couvrir l'espace du « centre-gauche » et d'apparaître comme une force d'alternance stable. Et, surtout, Tsipras a instauré en 2022 un système de « primaire interne », ouverte à toute personne s'inscrivant en ligne et payant la somme de deux euros.
Seul candidat, Tsipras est élu président du parti par une « base » fictive de 170 mille personnes – jusqu'à l'été 2015 Syriza comptabilisait 35 000 membres, mais il s'agissait alors de vrais membres affiliés à une section locale ou d'entreprise. A la tête d'un parti vidé de toute substance militante et transformé en machine électorale au service du leader, Tsipras pensait aborder avec une relative sérénité les scrutins de 2023. L'objectif était sinon de gagner une majorité, du moins être en mesure de constituer une coalition gouvernementale « progressiste » avec le Pasok et accoucher ainsi d'un pôle de centre-gauche sur le modèle du PD italien.
Dans ce contexte, la double déroute de mai et juin 2023, la seconde amplifiant la première, a provoqué un séisme interne. Dans une ambiance lugubre, Tsipras démissionne quelques jours après la gifle électorale de juin. Il laisse un parti démoralisé et, surtout, dépourvu d'identité et de repères autres que le culte du leader et l'obsession de revenir au pouvoir.
De nouvelles « primaires » sont convoquées pour septembre, et une proche de Tsipras, Efi Achtsioglou, se présente comme la successeure désignée, bénéficiant de l'appui de l'appareil. Elle fait partie du groupe de quadras qui ont accédé à la notoriété en occupant d'importants portefeuilles ministériels entre 2015 et 2019. Elle-même, en tant que ministre du travail, a lié son nom à deux lois qui restreignent drastiquement le droit de grève (désormais soumis à un vote préalable des membres du syndicat, sur le modèle des lois Thatcher) et suppriment les négociations tripartites (syndicats-patronat-Etat) sur le SMIG, désormais fixé par décret.
Tout paraissait joué, jusqu'à ce qu'un outsider absolu, Stefanos Kasselakis se déclare candidat à la fin août et remporte aisément le scrutin (qui s'est déroulé en deux tours, selon les règles fixées en 2022). Que s'est-il passé ?
Qui est Stefanos Kasselakis ?
Dans les conditions actuelles d'affaiblissement au niveau mondial des partis politiques, le succès d'un outsider comme Kasselakis pourrait paraître trivial. Il l'est toutefois moins si on prend en compte ce qui fait la singularité du personnage et de son ascension éclair sur la scène politique. L'originalité du cas consiste en ce que l'outsider en question ne fonde pas une nouvelle formation, par-delà les clivages établis du champ politique, mais, défiant toute prévision, parvient à s'imposer à la tête d'un parti héritier d'un courant historique de la gauche et qui, malgré son affaiblissement, reste la principale force d'opposition au parlement grec.
A première vue, le succès de Kasselakis se présente comme une simple combinaison des techniques de com qui font l'essence de la « post-politique » actuelle. Jeune, riche, sportif, ouvertement gay (mais sans promouvoir d'agenda LGBT+ particulier), Kasselakis paraît incarner lui-même l'« image » de nouveauté, celle du « rêve grec » qu'il promet à ses partisans. La campagne-éclair qui l'amène à la présidence de Syriza est entièrement basée sur des petites vidéos (six, soit un total 43 minutes), de rares interviews (il arrête rapidement un exercice qui le met en difficulté), et, avant tout, sur le recours intensif aux réseaux sociaux.
Le candidat-surprise est aussitôt adoubé par les médias audiovisuels, qui lui assurent une visibilité extraordinaire, entièrement basée sur l'étalage complaisant de son style de vie (son chien, son mari, sa salle de fitness, ses sorties etc.). Son discours est à l'image de sa campagne : il se présente comme un visage neuf, « l'homme capable de battre Mitsotakis », dégagé de tout « boulet idéologique » à l'opposé des « hommes (et femmes) d'appareil » qu'il affronte dans le cadre des primaires de Syriza.
Lors des interviews, son ignorance des sujets les plus élémentaires de la politique grecque est flagrante. Malgré son succès supposé dans le monde des affaires, il semble ignorer le montant du taux d'imposition des sociétés en Grèce et, nonobstant les saillies « patriotiques » dont il parsème ses discours, il n'a qu'une vague idée des problèmes qu'affronte le pays dans ses rapports avec la Turquie. Ses propositions sont aussi floues que sommaires, mais toutes s'insèrent dans la grammaire néolibérale : moins d'impôts, suppression du service militaire obligatoire et promotion d'une armée de métier, « égalité des chances » et « rêve grec pour tous ».
Peu après son élection à la présidence du parti, il prononce devant l'assemblée générale annuelle du patronat grec un discours remarqué, qui dissipe le nuage de fumée qui a entouré sa campagne. Il y défend une vision qui « ne diabolise pas le capital et le voit comme un outil pour la prospérité, pour la réduction des inégalités à travers une croissance forte ». Selon cette version de la « théorie du ruissellement », le « mot travail doit être un appel à la ‘collaboration', pour un nouveau contrat social par lequel les travailleurs participent activement à la croissance de l'entreprise ».
La clé du succès de Kasselakis se trouve sans doute dans cette adéquation entre un discours à peu près vide de contenu, au sens où il se contente de surfer sur les clichés (au sens imagé) du néolibéralisme, et son incarnation dans un visage juvénile, dépourvu de toute épaisseur, donc entièrement modelable (et modelé) par les techniques de la com. Il apparaît comme la transposition dans le champ de la politique de la figure de l'« ambianceur », pour reprendre une catégorie de Nicolas Vieillescazes : quelqu'un qui diffuse une certaine vision, en l'occurrence néolibérale, mais de façon vague, quasiment subreptice, qui évite toute affirmation et propos « clivant » et se fond ainsi dans l' « ambiance » régnante, puissamment aidé en cela par son (apparente) absence de passé. Davantage qu'une véritable singularité, Kasselakis apparaît comme un produit d'algorithmes, simple figuration de la logique anonyme du système politique et de l'ordre social dont il est l'expression.
Si Kasselakis a pu s'en tenir pendant sa courte campagne pour la présidence de Syriza (à peine plus de deux semaines) à un discours infra-politique, c'est qu'il est lui-même un inconnu à peu près complet non seulement sur la scène politique mais aussi dans la vie publique du pays. Sa désignation par Alexis Tsipras sur les listes de Syriza (dans une position non-éligible) aux scrutins de mai et juin 2023 au titre de personnalité de la diaspora[4] est passée à peu près inaperçue.
Ayant quitté la Grèce à l'âge de 14 ans, il est résident permanent aux Etats-Unis jusqu'au début de l'année dernière. C'est dans ce pays que s'est déroulée la totalité de sa carrière professionnelle, qui l'a vu passer du statut de trader de la Goldman Sachs à celui d'armateur, une trajectoire qui lui donne l'aura du self-made man dont il ne cesse de se prévaloir. Pourtant, un voile d'opacité entoure la nature exacte de ses activités entrepreneuriales.
De récents reportages de la presse grecque pointent une structure labyrinthique de sociétés au statut juridique complexe, dont les principales sont basées au Delaware, un Etat de la côte Est des Etats-Unis connu pour son statut de paradis fiscal et pour la règle de confidentialité qu'il applique quant à la propriété des sociétés qui y sont enregistrées. Tout cela au mépris de la législation grecque qui interdit aux élu.es et aux dirigeant.es de partis représentés au parlement d'être propriétaires de sociétés dont le siège se trouve hors du pays.
Même le passage par la Goldman Sachs est controversé : Kasselakis aurait été licencié pour « performance insuffisante », alors que lui-même assure l'avoir quittée de son propre gré pour reprendre des études supérieures. De même, il apparaît que, loin d'être le self-made man qu'il prétend, son entrée dans le monde des affaires s'est effectuée grâce à l'appui de la société de son père et à celui du puissant armateur Marcos Nomikos.
Que sa trajectoire ait été celle d'un capitaine ou, plus vraisemblablement, celle d'un chevalier d'industrie, Kasselakis n'est pas un inconnu au sein de la communauté gréco-étatsunienne. Il a tenu pendant des années une chronique consacrée à l'économie dans son organe emblématique, The National Herald, un quotidien ultra-conservateur (et soutien notoire de la dictature des colonels qui a sévi de 1967 à 1974) mais qui entretient de puissants liens « bipartisans » avec l'establishment politique et économique étatsunien. Kasselakis y publie ses chroniques parfois sous son nom, parfois sous le pseudo d'Aristotelis Oikonomou, en hommage à l'armateur mythique Aristotelis Onassis.
La presse grecque a abondamment fait état de ses publications passées, qui ne laissent aucun doute sur son positionnement idéologique et politique – même si l'effet de ces révélations a été habilement neutralisé par le tapage communicationnel qui a entouré sa campagne. Tout au long de la crise des années 2010-2015, Kasselakis a vigoureusement défendu la thérapie de choc de la Troïka, jugeant que les salaires grecs sont trop élevés (y compris le salaire minimum), et que les licenciements de fonctionnaires et les coupes dans les services publics imposés par la thérapie de choc étaient « insuffisants ».
Il proposait comme modèle la politique économique de Reagan et la création d'universités privées. Il considérait Syriza, et en particulier Alexis Tsipras, comme un « danger » pour le pays comparable à celui que Trump représentait pour les Etats-Unis (lui-même était pourtant enregistré comme électeur républicain à New York de 2013 à 2019). Il avait affiché, en 2015, son soutien à l'actuel premier ministre Konstantinos Mitsotakis lors des primaires de la droite et salué, en 2019, la victoire de Nouvelle Démocratie (dirigée par Mitsotakis), lorsqu'elle succède au pouvoir à Syriza.
Dans un entretien accordé en juillet 2023 à l'édition en langue anglaise du quotidien athénien Kathimerini, alors qu'il s'était déjà présenté comme candidat sur les listes de Syriza, il se targue de « son excellente relation avec Mitsotakis, qui date de 2012, quand il était simplement député ». Dans le même entretien, il déclare avoir accepté la proposition de Tsipras de figurer sur les listes de son parti car il « pense qu'avec lui (Tsipras) nous pourrions créer l'équivalent grec du Parti Démocrate [étatsunien], qui pourrait mettre en œuvre un ensemble de changements politiques allant de projets de loi bipartisans sur l'économie et la réforme de la justice à des protections progressistes sur les droits de l'homme, le logement, la pauvreté, etc. ».
L'aboutissement d'un long délitement
L'élection d'une telle personnalité à la tête d'un parti comme Syriza, qui compte 20 ans d'existence et plonge ses racines dans l'histoire mouvementée de la gauche communiste grecque, a bien quelque chose de vertigineux. De la tragédie on est effectivement passé à la farce, mais le spectacle a continué à attirer des spectateurs. Il s'est en effet trouvé 70 mille personnes pour soutenir Kasselakis lors du second tour des primaires (56% du total) contre 56 mille à sa rivale, Efi Achtsioglou. Comment expliquer cette adhésion ?
Il faut tout d'abord mentionner la déstructuration idéologique profonde induite par le cynisme impudent d'une formation de la « gauche radicale » qui renie ses engagements fondamentaux, bafoue le résultat d'un référendum qu'elle a elle-même organisé, et s'accroche au pouvoir pour poursuivre la politique néolibérale d'une grande brutalité engagée par ses prédécesseurs. La perte de repères qui s'ensuit nourrit le nihilisme et les mues les plus improbables, y compris au sein de ce qui restait de l'électorat de Syriza.
Vient ensuite l'impact de la procédure de la primaire qui substitue au principe d'un parti constitué de militants souverains celui d'un agrégat anonyme et atomisé, constitué de membres fantômes à deux euros, aisément manipulable par les médias et le buzz des réseaux sociaux. Sans la figure de Tsipras, qui maintenait l'apparence d'une continuité, le parti centré autour de son leader est apparu pour ce qu'il était devenu : une coquille vide.
Avec ce mélange d'inconscience et de sincérité qui caractérise les outsiders, Kasselakis a déclaré que « si Syriza fonctionnait correctement, s'il avait une base sociale, une réserve de cadres et de jeunes, il y aurait évidemment quelqu'un d'autre qui aurait pris la place que j'occupe aujourd'hui. Le fait que j'aie été élu n'est pas un signe de bon fonctionnement. Je l'admets. Si j'ai été élu, c'est parce que les gens voulaient quelque chose de différent ».
Toutefois, la victoire d'un candidat aussi improbable n'a été possible que du fait du discrédit de ses concurrents. Usés par un exercice du pouvoir impopulaire, ayant appliqué sans broncher des politiques néolibérales aux antipodes complets des engagements de Syriza, ils et elles en ont payé le prix lorsque le désastre électoral est survenu. Incarnant la continuité et une forme de légitimité « partidaire », Efi Achtsioglou en particulier pensait que les primaires seraient une promenade et menait une campagne routinière et « centriste ».
C'est précisément ce qui l'a conduit à la défaite : brocardée en tant que représentante d'une ligne et d'une équipe qui avait échoué, elle n'avait pas grand-chose à opposer à la « guerre-éclair » communicationnelle d'un Kasselakis, avec son profil d'« homme neuf », vierge de tout lien avec le Syriza de gouvernement, adossé au système médiatique mais bénéficiant également de la bienveillance implicite de Tsipras. Sa défense de « l'identité de gauche » du parti ne pouvait qu'apparaître que comme le reliquat démonétisé d'une époque révolue.
La force de Kasselakis a été précisément d'affirmer la rupture avec une identité devenue sans objet. Une fois de plus, l'injonction que le « révisionniste » Eduard Bernstein lançait à la socialdémocratie allemande à la fin du 19e siècle – « qu'elle ose paraître ce qu'elle est » – a fait la preuve de son efficacité. Profitant du désarroi créé par la déroute électorale, le candidat surprise a su mobiliser les procédures mises en place par Tsipras pour construire une base de supporters à partir des technologies qu'appellent ces mêmes procédures : le buzz des réseaux sociaux et le tapage médiatique.
Son succès illustre ce que Gramsci appelait un processus déjà bien avancé de « transformisme » et dont la racine n'est pas à chercher ailleurs que dans la capitulation de l'été 2015. C'est aussi la raison pour laquelle son OPA sur Syriza a bénéficié, dans un premier temps (mais qui était le plus crucial), de la bienveillance de Tsipras et du soutien de ses plus proches collaborateurs au sein du cercle dirigeant.
Syriza sous le leadership de Kasselakis
Si l'on appliquait à Kasselakis les critères dont il se réclame lui-même, le bilan de ses six premiers mois à la présidence du parti est pour le moins décevant, si ce n'est catastrophique. Les élections régionales et municipales d'octobre dernier ont été une humiliation pour le parti, qui a perdu le peu de bases municipales qui lui restaient.
Presque partout il a été dépassé par le Pasok, qui a remporté un succès spectaculaire et inattendu en délogeant (au second tour) la droite de la municipalité d'Athènes, l'ex-maire n'étant autre que le neveu du premier ministre Mitsotakis. Pire, Syriza est talonné au niveau national par le Parti communiste, qui connaît un redressement sensible et contrôle actuellement cinq municipalités importantes, dont celle de Patras, 3e ville du pays (conquise en 2014). Suite à ce premier test électoral, Syriza est relégué en 3e position (autour du 12%) dans la quasi-totalité des sondages, à deux points en moyenne derrière le Pasok.
Ce qui a fait la une des médias au cours des mois qui ont suivi, ce ne sont plus tant les opérations de com' de son président (malgré la publicité accordée à l'anniversaire de son chien Farly…) mais les déboires internes du parti et les révélations sur ses activités professionnelles aux Etats-Unis. Son élection a été suivie de vagues de départ de Syriza (pendant plusieurs semaines, la presse publiait quasi-quotidiennement des lettres collectives de départ signées par des dizaines, parfois des centaines de membres), des exclusions de députés, et rapidement, par le départ des principaux courants « historiques » : « Parapluie », qui se voulait l'aile gauche du parti (son candidat, Euclide Tsakalotos, ancien ministre de l'économie et des finances, avait recueilli 8,3% des voix lors du 1er tour des primaires), et le groupe dit « 6+6 », qui regroupe les quadras de l'ancienne direction autour de Tsipras, dont la candidate, Efi Achtsioglou, a affronté Kasselakis lors du second tour des primaires (elle avait obtenu 36% lors du premier).
Ces deux courants ont d'abord créé un groupe parlementaire, avec 11 députés sur les 47 élus sous l'étiquette Syriza en juin 2023, puis un parti nommé « Nouvelle Gauche ». Celui-ci a tenu sa première conférence nationale début mars et élu à sa tête Alexis Charitsis (47 ans), qui a détenu divers portefeuilles dans les gouvernements Tsipras.
Bien que se voulant garante de l'« identité de gauche », qu'elle accuse Kasselakis d'avoir abandonnée, Nouvelle Gauche se veut également la meilleure défenseure du bilan gouvernemental de Syriza, auquel ses principaux dirigeants restent associés. L'argument est que la cause de la crise du parti remonte à 2019. Seraient en cause l'incapacité à mener une opposition crédible et la politique d'« ouverture vers le centre » impulsée par Tsipras, ainsi que la transformation de l'organisation en machine au service du leader. La capitulation de 2015 et les quatre années de politiques néolibérales drastiques qui ont suivies font l'objet d'un non-dit, si ce n'est d'un déni. La proposition politique de Nouvelle Gauche revient en fin de compte à entretenir l'illusion d'un possible « tsiprisme sans Tsipras », dans la continuité du « Syriza de gouvernement » des années 2015-2019.
Par contraste, le Syriza de l'ère Kasselakis joue une carte de distanciation partielle avec le bilan du Syriza au pouvoir. Flirtant avec une rhétorique populiste, il dénonce certains aspects de la politique de la période 2015-2019 qui ont particulièrement affecté les couches moyennes (surtaxation des professions libérales et des indépendants) ou les retraités. Naviguant au gré des sondages et des trouvailles des communicants, le « progressisme » du « nouveau » Syriza offre une combinaison de platitudes néolibérales agrémentées d'une pincée de populisme.
Parmi les principaux appuis de l'actuel président issus de l'ancien Syriza, on trouve Pavlos Polakis, ancien ministre de la santé. Personnage histrionesque maniant constamment l'insulte sur les réseaux sociaux , il y relaie l'argumentation des antivax ainsi que des propos nationalistes et xénophobes, frisant parfois le racisme. De son côté, Kasselakis ne manque jamais une occasion de mettre en avant son « patriotisme » et d'affirmer son soutien aux montants astronomiques des dépenses militaires engagées par le gouvernement actuel (que Syriza a par ailleurs toujours soutenues au parlement).
Le 4e congrès de Syriza, qui s'est tenu fin février, a été marqué par l'intervention de dernière minute de Tsipras au moyen d'une lettre rendue publique la veille de son ouverture. Quelques jours auparavant, Kasselakis avait adressé aux « membres » un « questionnaire en ligne » qui remettait en cause l'ensemble des « fondamentaux » de Syriza : nom et emblème du parti, positionnement dans l'axe droite-gauche, nécessité de « changements radicaux » dans sa structure.
Ce questionnaire a suscité la réaction de la quasi-totalité des anciens « barons » du parti et forcé Tsipras à intervenir. Dans une ultime tentative d'affirmer son influence au sein du parti, Tsipras dénonce à la fois ceux qui l'ont quitté pour créer Nouvelle Gauche et le leadership de Kasselakis, à qui il reproche d'avoir été élu sans avoir ouvert ses cartes. Il lui demande en conséquence de procéder à des nouvelles élections pour la présidence du parti, faisant ainsi monter d'un cran le niveau, déjà très élevé, de tension interne.
Le congrès lui-même a donné une image de chaos indescriptible, la plupart des participant.es n'étant pas des délégué.es élu.es (les sections se trouvant dans l'incapacité de tenir des réunions) mais une masse de supporters du nouveau leader, huant systématiquement les opposant.es dans une ambiance digne des jeux de cirque romain. Malgré l'annonce d'une candidature opposée à Kasselakis (celle d'Olga Gerovassili, un profil comparable à celui d'Achtsioglou en plus âgé), le congrès a repoussé in fine la proposition de tenue de nouvelles élections dans une caricature de délibération. Les médias ont abondamment parlé de farce, et comparé le congrès aux spectacles satiriques kitsch de la scène populaire du Pirée Delphinario.
Pourtant, que ce soit en termes d'image personnelle ou de stratégie, Kasselakis sort incontestablement renforcé de l'épreuve : débarrassé de toute opposition interne, il a rompu le lien symbolique avec Tsipras et mis un terme à toute velléité de son ancien leader d'interférer dans les affaires du parti. Il a désormais carte blanche pour mener au bout sa transformation de Syriza en parti libéral à l'américaine. Ses premières décisions ont consisté à mettre en place un schéma d'organisation d'inspiration explicitement entrepreneuriale : le parti est géré par son président, entouré de son staff et de plusieurs « think tank » thématiques.
Le projet de changement de nom n'est que reporté, sans doute pour le lendemain du scrutin de juin prochain. Reste à savoir si cette opération est en mesure d'améliorer la performance électorale, qui s'annonce calamiteuse, aux élections européennes. Les derniers sondages indiquent certes un léger redressement, et redonne à Syriza la deuxième place, légèrement devant le Pasok, mais à plus de vingt points derrière Nouvelle Démocratie et toujours sensiblement en-deçà du score de juin 2013.
Même si lui-même s'en défend, et réclame à être jugé en fonction du résultat lors du prochain scrutin législatif (prévu pour 2027), le leadership de Kasselakis apparaît fragile. Mais on peut d'ores et déjà affirmer que sa mission historique est accomplie : la deuxième mort de Syriza est maintenant un fait accompli. Le passage de la tragédie à la farce laisse derrière lui une gauche exsangue et une société déboussolée, à la merci de démagogues sans scrupules, qui ne cachent même plus leurs liens avec les puissances d'argent.
Stathis Kouvelakis. Publié sur le site de Contretemps.
Notes
[1] G. W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, Paris, Vrin, 1979, p. 242.
[2] Ibid., p. 343.
[3] Les engagements en matière d'excédents budgétaires, de remboursement de la dette et de mise sous hypothèque du patrimoine public de la Grèce contractés en 2018 par le gouvernement Tsipras, lors de l'accord de « sortie » du 3e Mémorandum, courent jusqu'en 2060. Par ailleurs, le Trésor public de la Grèce, tout comme l'Institut de statistiques, sont devenus des autorités « indépendantes », placées sous le contrôle indirect de l'Union européenne.
[4] Les partis grecs sont tenus d'inclure un quota de candidat.e.s de la diaspora depuis que le vote a été accordé, sous des conditions très restrictives, aux résident.e.s à l'étranger.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’affaire Ilaria Salis bouleverse l’Italie

Ilaria Salis, une professeure dans une école primaire à Monza, en Italie, se rend en Hongrie avec un petit groupe de militant.es antifascistes.
avec l'aimable permission de l'auteur
Par Claude Vaillancourt -10 avril 2024
https://alter.quebec/23749-2/
Salis libérée de ses chaînes - illustration tirée de la vidéo réalisée par le média public italien Rai
Claude Vaillancourt
Ces personnes veulent se confronter à des néonazis qui célèbrent la Fête de l'honneur, commémorant le soi-disant héroïsme d'un bataillon nazi contre l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'illégale, cette fête est tolérée sans peine par le gouvernement d'extrême droite de Victor Orbán.
La suite des événements est confuse. Ilaria Salis est arrêtée dans un taxi et accusée d'avoir violenté deux néonazis. Rien ne permet de le confirmer, sinon des vidéos confuses avec des gens masqués. Ses deux « victimes » ont subi des blessures légères, elles ont été rapidement rétablies et n'ont pas porté plainte. Pourtant, la jeune enseignante subit un sort terrible. Elle passe plusieurs mois en prison sans pouvoir contacter sa famille ou un avocat. Son enfermement est particulièrement pénible : elle vit dans des conditions hygiéniques déplorables, avec des rats et des punaises de lit, dans le froid, mal nourrie.
Lorsqu'elle est enfin convoquée au tribunal, plusieurs mois plus tard, elle apparaît les pieds et les mains enchainées. Ces images, diffusées par les médias italiens, sont un choc. Jamais plus, en Europe, on traite les accusé.es de cette façon, à moins de personnes considérées comme extrêmement dangereuses, des cas rarissimes. Un vent d'indignation se répand en Italie : comment peut-on traiter ainsi une citoyenne, d'autant plus que l'accusation semble particulièrement floue ?
Le peu d'empressement du gouvernement italien
Des pressions très fortes se font sentir pour une intervention ferme du gouvernement italien. L'affaire relève de la diplomatie et il devient important d'aller au-devant d'une femme traitée indignement. Le père d'Ilaria Salis, invité à de nombreuses tribunes médiatiques, défend avec ardeur sa fille et obtient un soutien significatif.
Mais la situation se complique par le fait que Georgia Meloni, première ministre à la tête du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, est une alliée et une amie de Victor Orbán dont elle a loué les qualités à plusieurs occasions. Celle-ci se trouve prise entre deux feux : d'une part, il faut porter secours à une citoyenne en difficulté ; d'autre part, il lui est malaisé de réprimander une personne de sa famille politique. Son gouvernement choisit d'en faire le moins possible, soulevant la colère des personnes révoltées par l'ensemble de la situation.
Devant les pressions qu'il doit malgré tout subir, le gouvernement hongrois affirme qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Un point de vue mal reçu en Italie. D'abord parce que cette justice est très dure, en particulier dans le cas de Salis. Aussi parce que la Hongrie a été pointée du doigt à plusieurs reprises par l'Union européenne justement pour son manque d'indépendance judiciaire. Selon plusieurs, dont l'auteur Roberto Saviano, l'affaire est bel et bien politique.
La solution à la crise paraissait envisageable : les avocats de Salis visaient une assignation à résidence, ce qui lui aurait permis d'être transférée en Italie. Mais pendant sa dernière présence au tribunal, fin mars, la justice hongroise en a plutôt rajouté : voilà encore la prisonnière enchainée et subissant une dure rebuffade. C'est en Hongrie qu'elle devra poursuivre sa peine, bien qu'elle continue à clamer son innocence.
L'extrême droite décomplexée
Les leçons à retenir de l'acharnement contre Ilaria Salis sont claires : les antifascistes ne sont pas les bienvenus en Hongrie et ils seront durement réprimandés s'il le faut. La Hongrie de Victor Orbán n'a pas de leçon à recevoir de personne, elle continuera à appliquer ses politiques d'extrême droite décomplexée ; et gare à celles et ceux qui se mettront sur son chemin.
Certains y voient aussi une stratégie pour la Hongrie de combattre l'isolement dont elle est victime dans l'Union européenne à cause de ses politiques antidémocratiques (comme le prétend aussi Saviano). En échange d'un meilleur traitement pour Salis, Orbán négocierait un appui de l'Italie pour obtenir des fonds européens qui lui sont coupés actuellement.
En attendant, le gouvernement hongrois résiste à toutes les pressions et Ilaria Salis croupit en prison, victime d'enjeux qui la dépassent largement. Son procès principal aura lieu le 24 mai ; elle risque onze ans de prison.
Les opposants à Salis — il y en a de très vocaux, dont des trolls particulièrement actifs — prétendent qu'elle n'est pas la seule à subir les prisons hongroises et qu'il est normal qu'elle paye pour les risques qu'elle a pris. Mais l'acharnement contre elle, en dépit de la très grande médiatisation de son cas, donne une fois de plus la mesure de ce qu'une extrême droite bien en selle peut mettre de l'avant : un mépris profond des droits, un acharnement cruel contre ses adversaires, un refus ferme du dialogue.
La version plus présentable de cette extrême droite européenne, celle du gouvernement de Georgia Meloni, montre cependant, par son peu d'empressement à intervenir, qu'elle cautionne indirectement les agissements des plus radicaux de ce mouvement.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Yanis Varoufakis : Le discours que je n’ai pas pu prononcer

Nous reprenons le discours de Yanis Varoufakis publié dans l'Aut'journal. Yanis Varoufakis n'a pu prononcer ce discours parce que la police allemande a fait irruption dans la salle du congrès à Berlin pour mettre fin au congrès sur la Palestine (dans le style des années 1930). Cette répression est une indication du type de société que l'Allemagne est en train de devenir lorsque sa police interdit les propos rapportés ci-dessous.
Nous publions également la déclaration de l'Internationale Sozialistische Organisation dénonçant la répression contre le congrès sur la Palestine à Berlin.
17 avril 2024 | tiré de l'Aut'journal
https://lautjournal.info/20240417/yanis-varoufakis-le-discours-que-je-nai-pas-pu-prononcer
Le discours que je n'ai pas pu prononcer
Mes amis,
Félicitations et remerciements sincères pour votre présence, malgré les menaces, malgré le dispositif policier renforcé devant cette salle, malgré la panoplie de la presse allemande, malgré l'État allemand, malgré le système politique allemand qui vous diabolise pour votre présence.
« Pourquoi un Congrès sur la Palestine, M. Varoufakis ? », m'a demandé récemment un journaliste allemand. Parce que, comme l'a dit Hanan Asrawi : « Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les personnes réduites au silence pour nous faire part de leurs souffrances ».
Aujourd'hui, la réponse d'Asrawi est confortée de manière déprimante : nous ne pouvons pas compter sur les personnes réduites au silence, qui sont également massacrées et affamées, pour nous parler des massacres et des privations de nourriture.
Mais il y a aussi une autre raison : parce qu'un peuple fier et respectueux, le peuple allemand, est entraîné sur la voie périlleuse d'une société sans cœur en étant lui-même associé à un nouveau génocide.
Je ne suis ni Juif ni Palestinien. Mais je suis incroyablement fier d'être ici parmi des Juifs et des Palestiniens – de mêler ma voix pour la paix et les droits humains universels aux voix juives pour la paix et pour les droits humains universels – aux voix palestiniennes pour la paix et pour les droits humains universels. Le fait d'être ensemble, ici, aujourd'hui, est la preuve que la coexistence est non seulement possible, mais qu'elle est déjà présente !
« Pourquoi pas un congrès juif, M. Varoufakis ? », m'a demandé le même journaliste allemand, s'imaginant être intelligent. J'ai bien accueilli sa question.
Car si un seul Juif est menacé, où que ce soit, simplement parce qu'il est juif, je porterai l'étoile de David à ma boutonnière et j'offrirai ma solidarité – quoi qu'il en coûte.
Alors, soyons clairs : si les Juifs étaient attaqués, n'importe où dans le monde, je serais le premier à demander un congrès juif pour exprimer notre solidarité.
De même, lorsque des Palestiniens sont massacrés parce qu'ils sont Palestiniens – en vertu d'un dogme selon lequel les morts sont forcément des membres du Hamas – je porterai mon keffieh et j'offrirai ma solidarité, quoi qu'il en coûte.
Les droits humains universels sont universels ou ils ne signifient rien.
C'est dans cet esprit que j'ai répondu à la question du journaliste allemand par quelques unes de mes propres questions :
- Est-ce que 2 millions de Juifs israéliens, qui ont été chassés de leurs maisons et enfermés dans une prison à ciel ouvert il y a 80 ans, sont toujours détenus dans cette prison à ciel ouvert, sans accès au monde extérieur, avec un minimum de nourriture et d'eau, sans aucune chance d'avoir une vie normale, ni de voyager, et bombardés périodiquement depuis 80 ans ? Non.
- Est-ce que les Juifs israéliens sont intentionnellement privés de nourriture par une armée d'occupation, leurs enfants à même le sol, hurlant de faim ? Non.
- Est-ce qu'il y a des milliers d'enfants juifs blessés, sans parents survivants, qui rampent dans les décombres de ce qui était leurs maisons ? Non.
- Est-ce que les Juifs israéliens sont aujourd'hui bombardés par les avions et les bombes les plus sophistiqués du monde ? Non.
- Est-ce que les Juifs israéliens subissent un écocide complet du peu de terre qu'ils peuvent encore appeler leur terre, qu'il ne reste plus un seul arbre sous lequel chercher de l'ombre ou dont ils peuvent goûter les fruits ? Non.
- Est-ce que des enfants Juifs israéliens sont tués aujourd'hui par des tireurs d'élite sur ordre d'un État membre de l'ONU ? Non.
- Est-ce que les Juifs israéliens sont aujourd'hui chassés de leurs maisons par des bandes armées ? Non.
- Est-ce qu'Israël se bat aujourd'hui pour son existence ? Non.
Si la réponse à l'une de ces questions était oui, je participerais aujourd'hui à un congrès de solidarité avec les Juifs.
Mes amis,
Aujourd'hui, nous aurions aimé avoir un débat décent, démocratique et mutuellement respectueux sur la manière de ramener la paix et les droits humains universels pour tous, Juifs et Palestiniens, Bédouins et Chrétiens, du Jourdain à la Méditerranée, avec des personnes qui pensent différemment de nous.
Malheureusement, l'ensemble du système politique allemand a décidé de ne pas le permettre. Dans une déclaration commune, non seulement la CDU-CSU ou le FDP, mais aussi le SPD, les Verts et, fait remarquable, deux dirigeants de Die Linke, ont uni leurs forces pour faire en sorte qu'un tel débat civilisé, dans lequel nous pouvons être en désaccord, n'ait jamais lieu en Allemagne.
Je leur dis : vous voulez nous faire taire. Nous interdire. Nous diaboliser. Nous accuser. Vous ne nous laissez donc pas d'autre choix que de répondre à vos accusations par nos accusations. C'est vous qui avez choisi cela. Pas nous.
Vous nous accusez de haine antisémite
- Nous vous accusons d'être les meilleurs amis des antisémites en mettant sur le même plan le droit d'Israël à commettre des crimes de guerre et le droit des Juifs israéliens à se défendre.
Vous nous accusez de soutenir le terrorisme
- Nous vous accusons de mettre sur le même plan la résistance légitime à un État d'apartheid et les atrocités commises contre des civils, que j'ai toujours condamnées et que je condamnerai toujours, quels qu'en soient les auteurs – Palestiniens, colons Juifs, membres de ma propre famille, qui que ce soit.
- Nous vous accusons de ne pas reconnaître le devoir de la population de Gaza d'abattre le mur de la prison à ciel ouvert dans laquelle elle est enfermée depuis 80 ans, et de mettre sur le même plan cet acte d'abattre le mur de la honte – qui n'est pas plus défendable que ne l'était le mur de Berlin – et des actes terroristes.
Vous nous accusez de banaliser la terreur du 7 octobre
- Nous vous accusons de banaliser les 80 années de nettoyage ethnique des Palestiniens par Israël et la construction d'un système d'apartheid inflexible en Israël et Palestine.
- Nous vous accusons de banaliser le soutien à long terme de Netanyahou au Hamas comme moyen de détruire la solution à deux États que vous prétendez favoriser.
- Nous vous accusons de banaliser le terrorisme sans précédent déclenché par l'armée israélienne sur la population de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est.
Vous accusez les organisateurs du congrès d'aujourd'hui de, je cite, « ne pas être intéressés par la discussion sur les possibilités de coexistence pacifique au Proche-Orient dans le contexte de la guerre à Gaza ». Êtes-vous sérieux ? Avez-vous perdu la tête ?
- Nous vous accusons de soutenir un État allemand qui est, après les États-Unis, le plus grand fournisseur d'armes que le gouvernement Netanyahou utilise pour massacrer les Palestiniens dans le cadre d'un grand plan visant à rendre impossible la solution à deux États et la coexistence pacifique entre Juifs et Palestiniens.
- Nous vous reprochons de ne jamais répondre à la question pertinente à laquelle tout Allemand doit répondre : combien de sang palestinien doit couler avant que votre culpabilité, justifiée, à l'égard de l'Holocauste ne soit effacée ?
Soyons donc clairs : nous sommes ici, à Berlin, avec notre Congrès sur la Palestine parce que, contrairement au système politique et aux médias allemands, nous condamnons les génocides et les crimes de guerre, quels qu'en soient les auteurs. Parce que nous nous opposons à l'apartheid sur la terre d'Israël-Palestine, quel que soit celui qui a le dessus – tout comme nous nous sommes opposés à l'apartheid dans le Sud américain ou en Afrique du Sud. Parce que nous défendons les droits humains universels, la liberté et l'égalité entre les Juifs, les Palestiniens, les Bédouins et les Chrétiens sur cette terre historique qu'est la Palestine.
Et pour que nous soyons encore plus clairs sur les questions, légitimes comme pernicieuses, auxquelles nous devons toujours être prêts à répondre :
Est-ce que je condamne les atrocités du Hamas ?
Je condamne toute atrocité, quel qu'en soit l'auteur ou la victime. Ce que je ne condamne pas, c'est la résistance armée à un système d'apartheid conçu dans le cadre d'un programme de nettoyage ethnique lent mais inexorable. En d'autres termes, je condamne toute attaque contre des civils et, en même temps, je rends hommage à tous ceux qui risquent leur vie pour ABATTRE LE MUR.
Israël n'est-il pas engagé dans une guerre pour son existence même ?
Non, ce n'est pas le cas. Israël est un État doté de l'arme nucléaire, avec l'armée peut-être la plus avancée technologiquement au monde avec toute la panoplie de la machine militaire américaine à ses côtés. Il n'y a pas de comparaison avec le Hamas, un groupe qui peut causer de graves dommages aux Israéliens, mais qui n'a absolument pas la capacité de vaincre l'armée israélienne, ni même d'empêcher Israël de continuer à mettre en œuvre le lent génocide des Palestiniens dans le cadre du système d'apartheid mis en place avec le soutien de longue date des États-Unis et de l'Union européenne.
Les Israéliens ne sont-ils pas en droit de craindre que le Hamas veuille les exterminer ?
Bien sûr ! Les Juifs ont subi un Holocauste qui a été précédé de pogroms et d'un antisémitisme profondément ancré en Europe et en Amérique depuis des siècles. Il est tout à fait naturel que les Israéliens vivent dans la crainte d'un nouveau pogrom si l'armée israélienne se replie. Cependant, en imposant l'apartheid à ses voisins, en les traitant comme des sous-hommes, l'État israélien attise les feux de l'antisémitisme, renforce les Palestiniens et les Israéliens qui veulent s'anéantir les uns les autres et, en fin de compte, contribue à la terrible insécurité qui consume les Juifs en Israël et dans la diaspora. L'apartheid contre les Palestiniens est la pire forme d'autodéfense des Israéliens.
Qu'en est-il de l'antisémitisme ?
Il s'agit toujours clairement d'un danger. Il doit être éradiqué, en particulier dans les rangs de la gauche mondiale et des Palestiniens qui luttent pour les droits civiques des Palestiniens, partout dans le monde.
Pourquoi les Palestiniens ne poursuivent-ils pas leurs objectifs par des moyens pacifiques ?
Ils l'ont fait. L'OLP a reconnu Israël et a renoncé à la lutte armée. Et qu'ont-ils obtenu en échange ? Une humiliation absolue et un nettoyage ethnique systématique. C'est ce qui a nourri le Hamas et l'a élevé aux yeux de nombreux Palestiniens comme la seule alternative à un lent génocide sous l'apartheid israélien.
Que faut-il faire maintenant ? Qu'est-ce qui pourrait apporter la paix en Israël-Palestine ?
- Un cessez-le-feu immédiat.
- La libération de tous les otages : ceux du Hamas et les milliers d'autres détenus par Israël.
- Un processus de paix, sous l'égide des Nations unies, soutenu par un engagement de la communauté internationale à mettre fin à l'apartheid et à garantir des libertés égales pour tous.
- Quant à ce qui doit remplacer l'apartheid, il appartient aux Israéliens et aux Palestiniens de choisir entre la solution des deux États et celle d'un État fédéral laïque unique.
Mes amis,
Nous sommes ici parce que la vengeance est une forme lâche du deuil.
Nous sommes ici pour promouvoir non pas la vengeance, mais la paix et la coexistence en Israël et Palestine.
Nous sommes ici pour dire aux démocrates allemands, y compris à nos anciens camarades de Die Linke, qu'ils se sont couverts de honte depuis assez longtemps – que « deux fautes ne font pas une juste » – que permettre à Israël de commettre des crimes de guerre n'améliorera pas l'héritage des crimes commis par l'Allemagne contre le peuple juif.
Au-delà du congrès d'aujourd'hui, nous avons le devoir, en Allemagne, de changer de discours. Nous avons le devoir de persuader la grande majorité des Allemands honnêtes que les droits humains universels sont ce qui compte. Que « plus jamais ça » signifie « plus jamais ça ». Pour tous, Juifs, Palestiniens, Ukrainiens, Russes, Yéménites, Soudanais, Rwandais – pour tous, partout.
Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'annoncer que MERA25, le parti politique allemand de DiEM25, participera à l'élection du Parlement européen en juin prochain, en sollicitant le vote des humanistes allemands qui ont besoin d'un député européen représentant l'Allemagne et dénonçant la complicité de l'UE dans le génocide – une complicité qui est le plus grand cadeau de l'Europe aux antisémites d'Europe et d'ailleurs.
Je vous salue tous et vous propose de ne jamais oublier qu'aucun d'entre nous n'est libre si l'un d'entre nous est enchaîné.
Répression contre le congrès sur la Palestine à Berlin
19 avril 2024 par Internationale Sozialistische Organisation
https://inprecor.fr/node/3995
Le vendredi 12 avril, plusieurs centaines de policiers ont violemment interrompu et dispersé le Congrès sur la Palestine qui se tenait à Berlin, qui avait été planifié de longue date et avait fait l'objet auparavant de négociations détaillées avec les soi-disant forces de l'ordre. Des motifs absurdes et contraires à toutes les normes de l'État de droit ont été invoqués pour interrompre le déroulement de la conférence, toute discussion avec les organisateurs et leurs avocats a été refusée, il n'a été tenu aucun compte des propositions de modifications.
Cet événement représente pour l'instant le point culminant d'une campagne menée depuis des mois par le gouvernement allemand pour empêcher toute solidarité avec le peuple palestinien et toute critique du soutien militaire et politique du gouvernement fédéral à Israël. Des salles de réunion sont refusées ou retirées, des intervenants sont mis à l'écart ou empêchés d'entrer sur le territoire.
Les derniers exemples les plus scandaleux en sont l'annulation de l'invitation de la professeure de philosophie Nancy Fraser qui devait donner une conférence à l'université de Cologne et la toute récente interdiction de participer à toute activité politique qui frappe l'ancien ministre grec des finances Yanis Varoufakis.
Il s'agit de pratiques qui correspondent à l'anticipation d'une situation de guerre : c'est la contribution de l'Allemagne à la guerre de Gaza.
• Nous sommes solidaires du mouvement de solidarité avec la Palestine.
• Libre exercice des activités politiques pour le mouvement de solidarité avec la Palestine !
• Annulation de toutes les mesures de restriction et indemnisation des organisateurs !
• Arrêt de la guerre à Gaza !
• Arrêt de tout soutien politique et militaire à Israël de la part du gouvernement fédéral !
Déclaration de la coordination de l'Internationale Sozialistische Organisation (ISO)
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde. Source ISO. 15.04.2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













