Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Deux leçons de ce qui s’est passé cette nuit dans le ciel au-dessus de la Palestine et d’Israël

Premièrement, les mollahs iraniens n'en ont absolument rien à foutre des Palestiniens. Les motifs de leur attaque étaient en partie internes (donner une impression de force après le bombardement de leur consulat à Damas, qui n'est qu'un prétexte purement symbolique) et en partie externes, et là, c'est important : la distanciation croissante de Washington envers le gouvernement Netanyahou, avec une condamnation par avance de toute “seconde Nakba” achevant de se réaliser à Gaza, portait en elle le blocage de la destruction de Gaza.
14 avril 2024 | tiré d'aplusoc
https://aplutsoc.org/2024/04/14/deux-lecons-de-ce-qui-sest-passe-cette-nuit-dans-le-ciel-au-dessus-de-la-palestine-et-disrael-billet-dhumeur-par-vp/
Par son opération, Téhéran permet à Tsahal de poursuivre. Il est essentiel que les “campistes” et les « BRICS+ » puissent compter en permanence sur ce qu'ils appellent « le génocide », c'est-à-dire la destruction de Gaza, pour mener leurs opérations ailleurs, manipuler des foules et des idiots utiles partout, il serait catastrophique pour eux que les Palestiniens arrêtent de se faire tuer.
Symbole de cette réalité : à ce que l'on sait à cette heure, la seule victime humaine au pronostic vital engagé est une petite fille bédouine.
Quand au Hezbollah et aux Houtis, ils ont poursuivi leur cirque habituel, sans plus. Ils n'en ont rien à foutre des Palestiniens, les cris du chœur des groupies hurlant « Stop au génocide » n'ont d'autre fonction réelle que de perpétuer le massacre des Palestiniens.
Deuxièmement, l'attaque iranienne massive a été presque totalement déjouée par la défense antiaérienne israélienne adossée à l'aide américaine, avec la collaboration jordanienne. Au plan militaire et technique, c'est, pour l'Iran, un fiasco (mais le vrai but politique : garantir que la destruction de Gaza puisse continuer pour pouvoir continuer à s'en servir, est sans doute atteint, hélas).
Cette défense efficace devrait conduire tout esprit libre à crier une question, adressée au Pentagone : POURQUOI L'UKRAINE EST-ELLE PRIVÉE DE SON “DÔME DE FER” ?

Orientalisme, impérialisme et couverture des médias dominants de la Palestine

Cet article examine la façon dont les préjugés des grands médias dominants occidentaux et la défense du discours israélien sont liés à l'orientalisme, au racisme et à l'impérialisme, et servent les intérêts des élites politiques et économiques occidentales au pouvoir. Cependant, ces discours dominants en occident sont remis en question par des mouvements mondiaux visant à faire la lumière sur les réalités de la guerre génocidaire menée à Gaza et à exprimer la solidarité avec la population palestinienne.
Tiré de la revue Contretemps
19 avril 2024
Par Joseph Daher
***
Couverture occidentale de la Palestine et de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza
A l'heure de l'écriture de cet article, l'armée d'occupation israélienne poursuit sa campagne génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis maintenant plus de 6 mois. Le bilan humain est catastrophique. Les chiffres officiels font état de plus de 33 000 Palestiniens tués, dont plus de 12 300 enfants, soit un nombre supérieur à celui des enfants tués dans toutes les guerres mondiales des quatre dernières années réunies. Il y a également plus de 1,7 million de personnes déplacées, soit plus de 75 % de la population de Gaza, selon l'Unrwa, et 95% de la population est face à un risque d'insécurité alimentaire. Dans l'ensemble, 1,1 million de personnes sont déjà touchées par une « famine catastrophique », le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé, selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) publié le 18 mars Les destructions sont également sans précédent dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, avec plus de 60 % d'immeubles endommagés ou détruits, parmi lesquels environ 45 % sont des bâtiments résidentiels, laissant un million de personnes sans abri sur les 2,4 millions d'habitants.
De même, l'État israélien continue à non seulement ignorer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant le 25 mars à un cessez-le-feu immédiat pour le ramadan – pour laquelle les États-Unis se sont abstenus –, mais il a aussi fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de la Cour internationale de justice le 28 mars relative au risque que « la famine s'installe » à Gaza, alors que l'Afrique du Sud l'accuse de non-respect de la Convention sur le génocide.
Cet guerre constitue à bien des égards une nouvelle Nakba ou catastrophe, qui rappelle la Nakba de 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés par la force de leurs maisons et sont devenus des réfugiés.
Les médias grand public occidentaux continuent de mettre l'accent sur la « souffrance » et la « légitime défense » israéliennes à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont fait 1 139 morts selon les autorités israéliennes. Ces chiffres incluent 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers. Il convient toutefois de noter que de nombreux décès de civils israéliens ont également été causés par les forces d'occupation israéliennes, y compris le bombardement par des chars d'assaut de maisons où des Israéliens étaient détenus – un détail crucial qui n'a été que très peu couvert par les principaux médias occidentaux. Certains articles récents ont commencé à démentir de nombreuses affirmations erronées propagées sans vérification par les médias israéliens et reprises dans les pays occidentaux. Par exemple, les premières informations faisant état de 40 enfants israéliens décapités se sont avérées par la suite fabriquées de toutes pièces. Ces accusations ont néanmoins été approuvées et diffusées par les principaux médias et hommes politiques occidentaux, dont le président américain Joe Biden. En outre, plusieurs études ont démontré l'existence de préjugés systémiques des médias à l'encontre des Palestiniens dans différents pays occidentaux.
De même, le journalisme alternatif sur le terrain est devenu quasiment impossible, les forces d'occupation israéliennes prenant quasi-systématiquement pour cible les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Plus de 133 journalistes palestiniens ont été tués par Israël depuis le 7 octobre.
Dans le même temps, la réalité de la guerre génocidaire israélienne en cours contre la bande de Gaza est souvent ignorée par les médias grand public. Les Palestiniens ont souvent été déshumanisés dans les représentations médiatiques. Leurs aspirations politiques et leur rôle ont également été mis sous silence ou minimisés. Dans une grande partie de la couverture médiatique occidentale, le récit ne prend en compte que les événements survenus à partir du 7 octobre, sans fournir de contexte suffisant ni tenter d'expliquer comment la situation a évolué sur le long terme.
Les points de vue des Palestiniens eux-mêmes sur le contexte historique ne sont souvent pas mis en avant ou autorisés, en particulier lorsqu'il s'agit de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les événements en sont arrivés là. Comme l'a expliqué le journaliste palestinien Motaz Azaiza dans un tweet concernant les questions relatives au 7 octobre dans les grands médias occidentaux, « j'ai répondu à cette question plusieurs fois mais ils ne l'ont jamais gardée ou partagée parce qu'ils ont enregistré mon interview avant et ont ensuite pris ce qui convenait à leur agenda ».
La nature inhérente de l'État israélien en tant qu'entité coloniale, et ses politiques au fil du temps, ont mené à créer les circonstances qui ont conduit aux événements du 7 octobre et au-delà – comme c'est si souvent le cas pour les puissances coloniales et occupantes au cours de l'histoire. Cependant, à ce jour, le 7 octobre a tendance à être présenté de manière simpliste comme une « attaque terroriste » sans que le contexte historique approprié ne soit généralement fourni. Dans le même temps, les réponses israéliennes contre Gaza sont souvent décrites comme de simples actes d' »autodéfense »…
Mais pourquoi la majorité des grands médias occidentaux continue-t-elle à adopter et à défendre le discours israélien ? Pourquoi y a-t-il une tendance à déshumaniser les Palestiniens et à les rendre responsables aux événements actuels ? Quels sont les intérêts des grands médias occidentaux à maintenir ce type de couverture ?
Les réponses à ces questions trouvent leur origine dans l'orientalisme, le racisme et l'impérialisme, qui sont tous liés. Les images et les récits propagés par une grande partie des médias grand public occidentaux ne peuvent pas vraiment être dissociés des intérêts géopolitiques et économiques des élites dirigeantes occidentales.
La forme évolutive de l'orientalisme
L'orientalisme est une idéologie essentialiste enracinée dans l'idéalisme philosophique et les notions hégéliennes selon lesquelles le destin des personnes est déterminé par leurs cultures et religions éternelles. Le terme « orientaliste » est apparu en anglais vers 1779 et en français en 1799, d'abord axé sur l'étude linguistique, puis lié aux expansions coloniales impériales occidentales en Orient et ailleurs. Alors que les puissances européennes intervenaient, envahissaient et dominaient de plus en plus le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie au XIXe siècle, des discours sont apparus, décrivant des régions comme l'Empire ottoman comme « l'homme malade de l'Europe », qui souffrait de plus en plus des interventions et de l'influence des puissances impériales européennes, tandis que le terme d'« Homo Islamicus » apparaissait également à cette époque. L'idée d'une essence arabe/islamique spécifique est toujours d'actualité dans les analyses traditionnelles et néo-orientalistes.
La supériorité économique, technique, militaire, politique et culturelle croissante de l'Europe sur l'Empire ottoman, et plus généralement sur l' »Orient », a été associée pendant cette période à la religion chrétienne (dans sa compréhension et sa pratique occidentales) et les revers du monde musulman à l'islam. Le christianisme est présenté comme favorable au progrès, tandis que l'islam est au contraire décrit comme repoussant le progrès. Toute résistance à l'Europe et à son influence était présentée comme un fanatisme religieux et un rejet de la civilisation.
Ce type de discours n'a jamais vraiment disparu de la scène politique et des grands médias occidentaux, avec une intensité variable selon les périodes. Le discours prononcé il y a plus d'un an, en octobre 2022, par Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, à la nouvelle Académie diplomatique européenne de Bruges illustre cette perspective orientaliste. Il explique que « l'Europe est un jardin » où « tout fonctionne », combinant « la liberté politique, la prospérité économique et la cohésion sociale que l'humanité a pu construire », tout en s'inquiétant que « la majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait prendre le dessus sur le jardin… Les jardiniers doivent aller dans la jungle. Les Européens doivent s'engager davantage dans le reste du monde. Sinon, le reste du monde nous envahira, par différents moyens ». Ce discours ignore bien sûr la montée constante de l'extrême droite dans toute l'Europe, la montée du racisme et des attaques contre les droits démocratiques et les migrants, etc.
Il n'est donc pas surprenant que les responsables israéliens et occidentaux ainsi que les médias grand public aient utilisé cette rhétorique pour qualifier de barbares les actions du Hamas le 7 octobre et justifier la guerre génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza. Un éditorialiste israélien du Jerusalem Post a par exemple déclaré que « le 7 octobre, la civilisation occidentale a perdu et les barbares l'ont emporté… L'Occident moderne contre le djihad meurtrier », tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :
« C'est un mal ancien, qui nous rappelle le passé le plus sombre et nous choque tous au plus profond de nous-mêmes… Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses ».
Dans le cadre de cette stratégie, les comparaisons entre Daesh (« État islamique ») et le Hamas se sont multipliées chez les responsables israéliens et occidentaux et dans les grands médias occidentaux, à l'image du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin décrivant le Hamas comme « pire que l'Etat Islamique ». Les tentatives d'Israël et des gouvernements occidentaux de présenter le Hamas, et plus généralement les Palestiniens, comme des terroristes semblables aux organisations djihadistes ne sont pas nouvelles.
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la classe dirigeante israélienne a décrit sa guerre contre les Palestiniens pendant la deuxième Intifada comme sa propre « guerre contre le terrorisme ». Et ce, bien que l'Autorité Palestinienne et le Hamas aient condamné les actions d'Al-Qaïda. Les actions suicides du Hamas à Jérusalem et ailleurs dans la Palestine historique ont été présentées comme « un symptôme du terrorisme islamique mondial ». Avant cela, l'OLP et ses factions avaient également été comparées par les dirigeants israéliens à des nazis.
Plus généralement, les tentatives des dirigeants israéliens et occidentaux de faire l'amalgame entre le Hamas et les groupes djihadistes tels que Daesh ou Al-Qaïda s'inscrivent dans une stratégie plus large qui consiste à s'appuyer de plus en plus sur l'islamophobie pour justifier leur soi-disant guerre contre la terrorisme. Au début des années 2000, l'administration Bush a défendu le droit d'Israël à l'autodéfense contre le « terrorisme islamique », tout comme le font aujourd'hui l'administration américaine et les États occidentaux.
Dans cette perspective, l'objectif d'éliminer le Hamas justifie la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, comme l'explique un chroniqueur du New York Times :
« La cause principale de la misère de Gaza est le Hamas. Il porte seul la responsabilité des souffrances qu'il a infligées à Israël et qu'il a sciemment invitées contre les Palestiniens. La meilleure façon de mettre fin à la misère est d'éliminer la cause, et non pas d'arrêter la main de celui qui l'élimine ».
Ainsi, les responsables israéliens et les commentateurs pro-israéliens peuvent prétendre agir en légitime défense, et même dans certains cas pour aider les Palestiniens, en commettant un génocide contre les Palestiniens…
Cette perspective raciste des grands médias occidentaux est ancrée dans une vision orientaliste du monde, et plus particulièrement de la région. Cet orientalisme est ancré dans la dynamique politique moderne, notamment l'impérialisme, la colonisation, la lutte des classes, la dynamique du genre et du racisme, etc.
Cette conception est donc différente de celle du célèbre auteur palestinien Edward Said, auteur du livre L'Orientalisme. Said n'a pas critiqué l'idéalisme historique en tant que matrice principale de l'essentialisme culturel, et il existe une forme de continuité historique homogène dans ses critiques de l'orientalisme, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Comme l'affirme l'auteur marxiste Aijaz Ahmad, il n'y a aucune considération pour les dynamiques de classe, les dynamiques de genre, aucune mention de l'histoire, de la résistance, des projets de libération humaine, etc. [1]
En d'autres termes, l'orientalisme n'est pas un phénomène profondément moderne, comme nous l'avons expliqué, mais le produit naturel d'un esprit européen ancien et presque irrésistible visant à déformer les réalités des autres cultures, peuples et langues, en faveur de l'affirmation de soi et de la domination de l'Occident. En rejoignant les critiques constructives d'autres auteurs orientaux également critiques de l'orientalisme, tels que Sadiq Jalal al-Azm, Mehdi Amel, [2] Samir Amin [3] et Aijaz Ahmad, la compréhension de l'orientalisme par Said risque de tomber dans ses dénonciations de l'essentialisme occidental, dans une forme d' »orientalisme en retour ou inversé », comme l'explique l'auteur marxiste syrien Sadiq al-Azm. [4]
En effet, comment expliquer la défense des politiques meurtrières d'Israël par les grands médias occidentaux, si ce n'est par la protection de leurs intérêts politiques ? Cela se fait au travers d'une lentille orientaliste.
Israël, un instrument essentiel pour les élites dirigeantes occidentales
Dans un cadre typiquement orientaliste, Israël a été présenté par ses alliés occidentaux et ses grands médias pendant des décennies comme un phare de la démocratie et du progrès dans une région hostile peuplée de barbares.
Cette propagande a également été promue par les dirigeants du mouvement sioniste avant la création d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui par les responsables israéliens actuels. Avant la Nakba et la fondation d'Israël en 1948, Theodor Herzl, principal idéologue du mouvement sioniste, écrivait que le futur État juif serait « l'avant-garde de la civilisation contre la barbarie ». Il prônait en effet un projet colonial visant à installer une population majoritairement européenne, d'origine juive, sur une terre majoritairement peuplée de populations arabes, en l'occurrence la Palestine.
Aujourd'hui, ce discours est tenu par les responsables israéliens. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré dans de nombreux discours après le 7 octobre qu' »Israël ne mène pas seulement sa guerre, mais la guerre de l'humanité contre les barbares… » : « Nos alliés dans le monde occidental et nos partenaires dans le monde arabe savent que si nous ne gagnons pas, ils seront les prochains dans la campagne de conquête et de meurtre de l'axe du mal »… De même, le président israélien Isaac Herzog a affirmé que la guerre d'Israël contre Gaza « a pour but… de sauver la civilisation occidentale », Israël étant « attaqué par un réseau djihadiste » et « si nous n'étions pas là, l'Europe serait la prochaine, et les États-Unis suivraient ».
Les responsables occidentaux et les grands médias ont soutenu cette propagande. Le mot génocide ou guerre génocidaire n'est presque jamais mentionné par ces acteurs, mais il est en outre rejeté lorsqu'il est utilisé par les détracteurs d'Israël. Cette impunité de l'État israélien n'a pas commencé après le 7 octobre, mais dure depuis des décennies. Même les groupes traditionnels reconnaissent désormais la nature violente et réactionnaire de l'État israélien. Par exemple, Human Rights Watch et l'organisation israélienne B'Tselem ont tous deux dénoncé la saisie permanente de terres palestiniennes par Israël. Ils ont documenté la manière dont Israël a violé les lois internationales pour soutenir plus de 700 000 colons construisant des colonies dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ils ont également conclu qu'Israël est un État d'apartheid qui accorde des privilèges spéciaux aux Juifs et réduit les Palestiniens à une citoyenneté de seconde zone.
Cela démontre une fois de plus que les soi-disant principes des États européens et des États-Unis concernant la démocratie et le respect des droits de l'homme ne sont utilisés que pour leur propagande rhétorique, cherchant à couvrir des politiques ancrées dans la protection de leurs propres intérêts politiques et économiques. Dans ce cadre, la déclaration du pasteur palestinien Munther Isaac, de Bethléem, est tout à fait correct :
« À nos amis européens, je ne veux plus jamais vous entendre nous faire la leçon sur les droits de l'homme ou le droit international. »
Comme indiqué plus haut, le mouvement sioniste, depuis ses origines en Europe jusqu'à la création d'Israël en 1948 et au déplacement des Palestiniens qu'il opère aujourd'hui, est un projet de colonisation. Pour établir, maintenir et étendre son territoire, l'État israélien a dû nettoyer ethniquement les territoires palestiniens de leurs habitants, chassés de leurs maisons et de leurs emplois. Pour ce faire, il a dû rechercher le soutien de l'étranger. En effet, tout au long de ce processus, il s'est allié à des puissances impérialistes, d'abord l'Empire britannique, puis les États-Unis, qui ont utilisé Israël comme leur agent dans la lutte contre leurs ennemis, ou perçus comme tels, dans la région, et lui ont apporté leur soutien. [5]
Les Britanniques ont d'abord soutenu le projet sioniste de créer une nation alliée dans une région d'une grande importance politique et stratégique – une « petite Ulster loyale », selon les termes de Ronald Storrs, haut fonctionnaire du ministère britannique des affaires étrangères et des colonies. Ensuite, Washington, en particulier après la guerre des Six Jours de 1967, a été le principal soutien d'Israël, qui a également joué le rôle de force de police locale contre les menaces américaines perçues dans la région et contre tout événement susceptible de remettre en cause son contrôle sur ses réserves d'énergie stratégiques.
Depuis lors, les États-Unis ont soutenu Israël. Washington a versé en moyenne 4 milliards de dollars par an dans les coffres de Tel-Aviv, soutenant sa colonisation de la Palestine et ses guerres d'agression contre différents gouvernements et mouvements de la région. Selon un rapport du Congressional Research Service de mars 2023, les États-Unis ont fourni à Israël 158 milliards de dollars d'aide bilatérale et de financement de la défense antimissile depuis 1948, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire cumulé de l'aide étrangère des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.
Depuis les années 1960, les gouvernements successifs américains ont mis en place une politique d'aide militaire envers l'Etat d'Israël permettant un « avantage militaire qualitatif » (Qualitative Military Edge) sur les états voisins et les acteurs non étatiques de cette zone. Entre 2013 et 2022, 69 % des armes importées en Israël provenaient des États-Unis.
Alors que les responsables américains ont utilisé à plusieurs reprises leur droit de veto contre des résolutions appelant à un éventuel cessez-le-feu, la guerre israélienne actuelle contre la bande de Gaza aurait été impossible sur le plan militaire sans le soutien continu des États-Unis. Washington a notamment accepté depuis le 7 octobre 2023 la fourniture de 25 avions de combat dernière génération F-35, et de l'autre 500 bombes MK82 et plus de 1 800 bombes MK84 – qui ne sont plus utilisées par les armées des États occidentaux dans des zones densément peuplées en raison des dégâts collatéraux inévitables. Ces livraisons d'armes ont contourné l'obligation de consultation du Congrès en invoquant des « pouvoirs d'urgence ».
Cette administration américaine a effectué également plus de 100 livraisons d'armes à Israël sans aucun débat public, en utilisant une faille dans laquelle le montant spécifique en dollars de chaque vente était inférieur au seuil requis à partir duquel le Congrès doit être averti. De son côté, le journal israélien Haaretz a déclaré que les données de suivi des vols accessibles au public montrent qu'au moins 140 avions de transport lourd à destination d'Israël ont décollé de bases militaires américaines dans le monde entier depuis le 7 octobre, transportant des équipements principalement vers la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël.
Et si le président américain Joe Biden a fait signe d'un mécontentement à la suite de l'attaque sur le convoi humanitaire du World Central Kitchen, tuant sept employés de l'organisation américaine, il a encore récemment affirmé que « la défense d'Israël reste essentielle, qu'il n'y a donc pas de ligne rouge qui pourrait couper toutes les (livraisons d')armes pour que le pays n'ait plus de Dôme de fer pour le protéger »
De même, depuis novembre 2023, le gouvernement allemand, deuxième principal exportateur d'armes à Israël après les États-Unis, a approuvé l'exportation d'équipements de défense d'une valeur d'environ 303 millions d'euros (323 millions de dollars) vers Israël. À titre de comparaison, des exportations de matériel de défense d'une valeur de 32 millions d'euros avaient été approuvées en 2022.
La raison en est qu'Israël est toujours perçu comme un acteur clé pour préserver les intérêts occidentaux dans la région. Le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes initié par le président Donald Trump et poursuivi par le président Joe Biden avait pour objectif de consolider les intérêts américains dans la région, y compris dans sa rivalité avec la Chine. L'un des principaux objectifs de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était de saper ce processus et a été temporairement couronné de succès.
Peu après le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, l'Arabie saoudite a en effet réagi en interrompant tout progrès dans les accords bilatéraux entre elle-même et Israël et a annoncé qu'aucun processus de normalisation n'interviendrait entre les deux pays avant l'établissement clair d'un plan de route pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël.
En outre, de nombreux États européens et les États-Unis ont tenté d'amalgamer l'antisémitisme et l'antisionisme pour criminaliser la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS). Ces actions doivent être comprises comme un objectif plus large des élites occidentales visant les politiques progressistes et de gauche, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, et comme des tentatives de restreindre les droits démocratiques dans ces sociétés.
Dans ce cadre, les théories du complot affirmant que les Juifs contrôlent le monde ne remettent pas en cause les perspectives orientalistes, mais au contraire les renforcent. En effet, les différentes formes de racisme se nourrissent généralement l'une l'autre, comme l'a dit le penseur anticolonialiste Frantz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». De plus, ce type d'explications minore en partie la responsabilité des élites occidentales dans la tragédie palestinienne.
Sans oublier que le soutien occidental à Israël n'a jamais empêché l'antisémitisme permanent de ses élites. De Lord Balfour au président américain Trump, tous ont soutenu des politiques ou des dynamiques antisémites. Lord Balfour était bien l'auteur de la lettre disant que « le gouvernement de Sa Majesté voit d'un bon œil l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif », mais aussi l'un des promoteurs de l'Aliens Act de 1905 qui fermait les frontières britanniques aux émigrants juifs fuyant les pogroms russes, tandis que les partisans de Trump défilaient à Charlottesville en 2017 en criant « Les juifs ne nous remplaceront pas ». De même, en France, Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir réhabilité le maréchal Pétain ou remis sur le devant de la scène le théoricien antisémite Charles Maurras.
Remettre en cause l'orientalisme et l'impérialisme : une lutte commune menée par en bas
La remise en cause des perspectives orientalistes et racistes sur la Palestine et les Palestiniens, ainsi que sur d'autres populations non blanches, est liée à la lutte d'en bas dans le monde entier et en particulier dans les sociétés occidentales, dans lesquelles les institutions dirigeantes sont les principales productrices de ces idées. Comme nous l'avons déjà mentionné, la cause palestinienne influence la dynamique politique bien au-delà du Moyen-Orient.
Les premières critiques de l'orientalisme et des études orientalistes en Occident sont apparues pendant la période de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'auteurs originaires de régions colonisées et vivant souvent dans des pays occidentaux, comme Anouar Abdel al-Malek [6] et Edward Said. Les études et orientations orientalistes dominantes dans les universités ont commencé à être remises en question après la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et par la révolution russe, mais surtout par la résistance croissante et grandissante des mouvements anticoloniaux à l'impérialisme occidental en « Orient », de l'Asie à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Plus tard, les mouvements antiracistes et féministes ont également joué un rôle dans la remise en question de ces idées dans les États occidentaux. [7]
De même, aujourd'hui, la multitude de luttes qui se déroulent dans diverses sociétés, dans les universités, sur les lieux de travail, dans les médias alternatifs, etc. en faisant pression sur les autorités dirigeantes et les gouvernements pour qu'ils agissent afin d'empêcher la guerre génocidaire israélienne continue contre la population palestinienne de la bande de Gaza, pour qu'ils fassent la lumière sur le contexte historique de la Palestine, sur la nature coloniale d'Israël et sur son système d'apartheid, et surtout pour qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens, remettent en question la perspective orientale des grands médias occidentaux, qui servent de bouclier (parmi de multiples autres) pour protéger les intérêts de l'élite dirigeante.
*
Cet article a aussi été publié sur le site de Al-Jazeera – Middle East Institute
Notes
[1] Aijaz Ahmad, Orientalism and After : Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of Edward Said, Economic and Political Weekly, Vol. 27, No. 30 (Jul. 25, 1992), pp. PE98-PE116
[2] Voir Gilbert Achcar, « Mahdi Amel (1936-1987). Préface à un recueil de textes choisis », https://www.contretemps.eu/mahdi-amel-marxisme-arabe-liberation-nationale-preface-achcar/
[3] Voir Samir Amin, Eurocentrism, New York : Monthly Review Press, 1989
[4] Sadik Jalal al-'Azm, Orientalism and orientalism in reverse, https://libcom.org/article/orientalism-and-orientalism-reverse-sadik-jalal-al-azm
[5] Voir Joseph Daher, « La Palestine et les révolutions au Moyen Orient et en Afrique du Nord », Contretemps.
[6] La première critique est venue en effet du philosophe égyptien marxisant de l'université de la Sorbonne, Anouar Abdel al-Malek (né en 1923 au Caire), avec son article « l'Orientalisme en crise » écrit en 1962 et publié en 1963. Après avoir étudié à l'université d'Aim Chams, au Caire, et la Sorbonne, et avoir enseigné la philosophie au Lycée al-Hourriyya, au Caire, il fut nommé en 1960 Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris. Voir Anouar Abdel Malek, « Orientalisme en crise », L'orientalisme en crise », Diogène, n° 44, hiver 1963, p. 109-142
[7] Il faut également souligner les écrits de Maxime Rodinson dans la critique de l'orientalisme, notamment son livre de « La fascination de l'Islam » publié en 1980 qui est une critique remarquable de l'eurocentrisme et de l'orientalisme.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il est impossible de quantifier la souffrance à Gaza

En raison des limites de l'imagination humaine (par opposition à l'imagination des fauteurs de guerre et des fabricants d'armes), et en l'absence d'un tout autre dictionnaire, il n'y a pas de véritable moyen de décrire la destruction et les pertes subies à Gaza après six mois de guerre.
Tiré de la revue Contretemps
12 avril 2024
Par Amira Hass
En théorie, il suffirait de visionner les centaines, voire les milliers de vidéos qui montrent les enfants tremblants– incapables de contrôler leurs tremblements – après les bombardements israéliens : dans les hôpitaux, dans la rue, certains d'entre eux sanglotant, d'autres incapables de prononcer un mot. Ils sont couverts de poussière et de sang. C'est un détail qui suffit à représenter le désastre. Que ceux qui aiment se venger regardent les vidéos, une par une.
En pratique, dans un journal, les mots doivent suffire. Cela signifie qu'en raison des limites des termes, nous nous réfugions dans les chiffres. Selon l'UNICEF, à la fin du mois de janvier,17 000 enfants « errent » dans la bande de Gazasans être accompagnés d'un adulte. Leurs parents ont été tués, ils n'ont pas pu être extirpés des ruines. Ou bien les enfants se sont perdus lors des déplacements massifs vers le sud.
Et c'est sans compter les 14 000 enfants (sur environ 33 000 morts recensés) qui ont été tués jusqu'à présent par les bombardements israéliens. A cela s'ajoutent des milliers d'enfants qui ont perdu des membres, souffrent de brûlures, se promènent avec des blessures qui se sont infectées en l'absence de bandages et de médicaments, et souffriront de troubles post-traumatiques pour le reste de leur vie. Quel est leur avenir ? Il est impossible de quantifier la souffrance. Est-il possible de quantifier le coût de leur traitement et de leurs besoins spécifiques, ainsi que les répercussions sur l'économie ?
***
Pour chaque décompte de morts, de blessés et d'orphelins qui ne sont pas les nôtres, il y a un piège. C'est général, c'est abstrait pour nous. Même lorsqu'il s'agit de 44 membres d'une même famille, tués dans un seul attentat, comme la famille du Dr. Abdel Latif al Haj, à laquelle j'ai déjà consacré un article (Haaretz, 1er janvier 2024). Plus le nombre est élevé, moins nous pouvons comprendre ce que cela signifie. Psychologiquement, nous pouvons éviter de comprendre le trou béant causé par les bombardements israéliens dans une société à l'égard de laquelle nos sentiments vont de l'ignorance de notre domination à notre haine.
Mais si nous oublions la quantité et racontons une seule histoire, ce sera une unique histoire. Et elle devrait atteindre le seuil de l'histoire la plus horrible de toutes pour être comprise. Lorsque je parlerai de l'histoire unique à la fin, je dirai : c'est un détail représentatif, qui contient le tout. Et ce n'est pas le plus horrible.
***
Voici un autre chiffre : « Les Palestiniens de Gaza représentent désormais 80% de toutes les personnes confrontées à la famine ou à la faim sévère dans le monde », selon le rapport intérimaire conjoint – publié la semaine dernière – de la Banque mondiale (BM), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU).
Comparez cette affirmation avec la déclaration devant la Haute Cour de justice du lieutenant-colonel Nir Azuz, de l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), selon laquelle « en ce qui nous concerne, la quantité de nourriture qui entre [à Gaza] permet une solution raisonnable pour la population ».
L'officier a été appelé à défendre la position du gouvernement [israélien] contre une pétition d'organisations israéliennes de défense des droits humains demandant d'autoriser des livraisons d'aide illimitées, afin d'enrayer la propagation de la faim et de la mort par inanition à Gaza. L'écart entre les deux affirmations – ou entre la réalité et le déni – nécessite une définition qui fait défaut dans le lexique disponible.
L'objectif du rapport conjoint (Banque Mondiale, Union Européenne, ONU) est de présenter une estimation des dommages matériels subis jusqu'à présent, qui servira de base aux premiers efforts de réhabilitation. Les données relatives aux dégâts matériels sont plus faciles à quantifier, et peut-être aussi plus faciles à comprendre.
A la fin du mois de janvier 2024, les destructions matérielles dans la bande de Gaza étaient estimées à environ 18,5 milliards de dollars. C'est le coût de 50 avions de combat que l'administration Biden souhaite vendre à Israël, sous réserve de l'approbation du Congrès, comme le rapporte CNN. C'est le montant des indemnités que le Canada a accepté de verser à 300 000 personnes en raison de la discrimination et de la négligence dont ont été victimes les enfants des peuples indigènes dans le système scolaire, entre 1991 et 2022. C'est 92,5 millions de salaires mensuels moyens à Gaza (environ 200 dollars avant la guerre).
Si cette somme semble atteignable, il faut rappeler que les besoins de reconstruction sont plus coûteux que le coût des dommages, comme le note le rapport. Par exemple, lors de la guerre de 2014 à Gaza, les dégâts se sont élevés à 1,4 milliard de dollars. Les coûts de reconstruction se sont élevés à 3,9 milliards de dollars. Lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en février 2023, les dégâts ont été estimés à 3,7 milliards de dollars. Les coûts de reconstruction, à 7,9 milliards de dollars.
Le volume des décombres dans la bande de Gaza, qu'il faudra déblayer pour commencer la reconstruction, est de 26 millions de tonnes. Il faudra des années pour les déblayer, selon le rapport. Combien d'années ? Le rapport ne fait aucune promesse, puisqu'il ne s'agit pas d'une estimation précise.
Tout d'abord, l'étendue des dégâts depuis début février n'a pas encore été mesurée (elle comprend, par exemple, les ruines du complexe hospitalier Al-Shifa et les maisons environnantes). Deuxièmement, pour des raisons évidentes de sécurité, les équipes ne peuvent pas se rendre sur place et l'évaluation se fait à distance. Troisièmement, nous ne savons pas combien de temps la guerre va durer.
Parmi les décombres, il y a des munitions qui n'ont pas explosé, ce qui rend le processus de déblaiement et de recyclage plus dangereux, plus long et plus coûteux. Si Israël imposeles mêmes restrictions et difficultés que par le passé pour l'acheminement des matières premières et des équipements, le processus sera encore plus long.
Le coût des dommages environnementaux, l'un des secteurs examinés par le rapport conjoint, est estimé à environ 411 millions de dollars. En réalité, on ne sait pas très bien comment on est arrivé à ce calcul, mais les conséquences immédiates et à long terme sont faciles à comprendre : la contamination supplémentaire des eaux souterraines, la pollution de l'air et du sol par des rebuts dangereux, y compris des munitions, les produits chimiques toxiques émis par toutes les bombes, les déchets médicaux dispersés partout, la pollution causée par les eaux usées non traitées qui inondent les rues et finissent dans la mer.
***
De tous les secteurs détruits (infrastructures d'eau et d'électricité, système de santé, écoles, usines et commerces, fermes, bref, tout), le coût des dégâts infligés aux habitations est le plus élevé : 13,3 milliards de dollars. A la fin du mois de janvier, 62% des maisons de la bande de Gaza étaient totalement ou partiellement détruites, soit 290 820 unités d'habitation.
Je suppose que le terme « partiellement détruit » correspond aux dégâts subis par les appartements et les maisons de certains de mes amis à Gaza : ils n'ont plus de murs intérieurs, plus de toit, plus de fenêtres et de portes, plus de tuyaux, plus de planchers, plus d'escaliers, avec des murs extérieurs tordus et pleins de fissures. « Totalement détruit », c'est comme l'appartement d'un ami, au septième ou huitième étage, dans un complexe résidentiel qui, en un seul bombardement, s'est transformé en une bouillie de béton froissé.
***
La quantification n'inclut pas l'intérieur des appartements. Simples ou élégants. Bijoux en or ou bibliothèques privées, si chères au cœur de leurs propriétaires. Leurs livres ont servi à un moment donné de bois d'allumage, faute de combustible ou de bois.
La quantification suggérée par le rapport n'inclut évidemment pas la nostalgie de la mer vue de la fenêtre, les histoires et les poèmes enregistrés sur un ordinateur de bureau sans sauvegarde. Les peintures. L'importance de la maison pour les personnes qui ont grandi dans le désastre fondateur de la guerre de 1948 : quitter la maison et en être expulsé. Les souvenirs des premiers pas de la fille. La fierté et la joie lorsque les économies lentement accumulées ont permis d'obtenir un appartement séparé des parents ou des frères et sœurs.
Les chanceux – comme les habitants de Gaza ne cessent de le répéter aujourd'hui – ont effectivement été déracinés au début de cette guerre, mais ils vivent avec le reste de la famille élargie dans un appartement loué à un prix exorbitant à Rafah, ou chez des parents, avec une densité d'une douzaine de personnes ou plus par pièce. On entend de plus en plus parler de querelles et de tensions à l'intérieur de cette cocotte-minute. « J'en ai assez. J'envisage d'aller vivre sous une tente avec mes enfants », dit une amie. Ses tentatives pour se rendre en Egypte ont été vaines jusqu'à présent.
Même ceux qui sont partis à l'étranger n'y sont pas vraiment. Ils vivent le cauchemar jour et nuit. C'est le cas de Mona (nom fictif), la petite-fille de Naifa Al-Nawati. Mona, sa mère, son mari et ses enfants sont arrivés en Egypte il y a plus d'un mois. Ils ont essayé de parler tous les jours à leur famille restée sur place, dans l'immeuble Al Islam 3, dans la rue Ahmad Bin Abdel Aziz, à l'ouest de la maternité de l'hôpital Al-Shifa de Gaza.
Ils ont parlé à leurs oncles et tantes, ainsi qu'à leurs enfants. Ils n'ont pas pu parler à leur grand-mère de 94 ans : elle souffre de la maladie d'Alzheimer et a besoin de soins infirmiers et d'une surveillance 24 heures sur 24. « Elle ne peut même pas prendre un verre d'eau toute seule. » En raison de ses maladies et de sa dépendance, la famille est restée dans la ville de Gaza, malgré les ordres israéliens de se déplacer vers le sud au début de la guerre. « J'ai des amis dont les mères sont mortes dans une tente à Rafah », m'a dit Mona au téléphone, dans une sorte de justification inutile pour expliquer pourquoi ils ont refusé de traîner leur grand-mère vers le sud.
***
Au début de l'incursion terrestre et pendant les batailles dans la zone de l'hôpital Al-Shifa en novembre, la famille Al-Nawati a trouvé refuge dans les quartiers est de la ville. Plus tard, ils sont retournés dans leur immeuble, qui a été partiellement endommagé lors des échanges de tirs. Le 18 mars, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont de nouveau assiégé Al-Shifa, affrontant des hommes armés des organisations militantes palestiniennes.
Comme tout a commencé par une attaque surprise après minuit, les Al-Nawati et les autres habitants du bâtiment n'ont pas pu sortir et sont restés retranchés dans leurs maisons, sans nourriture ni eau, pendant quatre jours. Autour d'eux, les échanges de tirs et les rugissements des chars. « Le 21 mars, vers 11 heures du matin, une force des FDI a fait irruption dans l'appartement après avoir fait sauter la porte d'entrée », m'a raconté Mona.
Elle m'a raconté ce qu'elle avait entendu lors d'une conversation fragmentée avec sa tante à Rafah, lors d'une liaison téléphonique avec elle coupée à plusieurs reprises. Les militaires qui ont fait irruption dans la maison ont rassemblé les hommes qui se trouvaient dans le bâtiment dans une pièce séparée, où on leur a demandé de se déshabiller, on leur a bandé les yeux, puis on les a menottés et interrogés.
Mona ne sait pas combien ils étaient, mais elle affirme qu'ils n'étaient pas nombreux, car la plupart des habitants des appartements adjacents avaient déjà quitté l'immeuble. Au même moment, les soldats ont ordonné aux femmes de laisser leurs maris et leurs enfants adultes derrière elles et de partir vers le sud. Les femmes de la famille ont demandé aux soldats de laisser l'une d'entre elles rester dans la maison avec la grand-mère âgée, qui est dépendante d'elles.
Sur la base du rapport qu'elle a reçu de ses parentes, Mona m'a dit que « les soldats qui ont fait irruption dans la maison de ma grand-mère se sont comportés relativement bien, par rapport à leur comportement dans d'autres endroits, et au moins il a été possible de leur parler ».
Tout le monde à Gaza connaît les images et les témoignages sur les corps de civils retrouvés, abattus, dans les maisons où l'armée est entrée. Tout le monde connaît les histoires d'humiliation, y compris les photos des soldats. Pourtant, malgré leur relative gentillesse, les soldats ont refusé que l'une des femmes de la famille reste avec la grand-mère dans l'appartement. Ils ont promis aux femmes d'emmener Al-Nawati à l'hôpital Al-Shifa !
***
Les femmes qui se trouvaient dans l'immeuble sont arrivées dans le sud de la bande de Gaza vers le soir, et à peu près au même moment, les hommes ont été libérés, et elles ne savaient même pas que la vieille femme avait été laissée derrière. Depuis lors, la famille n'a pas été en mesure de savoir ce qui est arrivé à la femme de 94 ans. Elle s'est adressée à Hamoked [organisation de défense des droits humains basée en Israël dans le but déclaré d'aider « les Palestiniens soumis à l'occupation israélienne qui cause des violations graves et continues de leurs droits »], qui a déposé jeudi dernier une requête en habeas corpus devant la Haute Cour, en exigeant que les FDI déterminent ce qui est arrivé à la femme qui était sous leur garde.
Le porte-parole des FDI a déclaré à Haaretz à la fin de la semaine dernière qu'il n'était pas au courant de cet événement. La semaine dernière également, Mona m'a écrit qu'après que l'armée eut nettoyé la zone, ses cousins ont cherché sa grand-mère dans la maison elle-même et dans ce qui restait de l'hôpital, et n'ont trouvé aucune trace d'elle. « Personne ne les a informés qu'elle était entrée à Al-Shifa, la maison a complètement brûlé, et ils n'y ont pas trouvé son corps. Où l'ont-ils emmenée ? Nous sommes arrivés à une situation où nous pensons qu'il est préférable qu'elle soit morte. »
Lorsque je lui ai posé la question, Mona a expliqué : « Mercredi [la semaine dernière], ils ont vu tous les corps qu'ils soient en décomposition, intacts ou enterrés à Shifa. Elle n'en fait pas partie. Dans le bâtiment, ils n'ont rien trouvé, à l'exception des corps de ma cousine de 28 ans et de son mari au septième étage. Le toit est entouré de fenêtres en verre. Ma cousine est venue d'Allemagne – où vivent ses parents – pour se marier à Gaza, deux mois avant la guerre. Elle était enceinte de jumeaux. Nous pensons qu'un drone les a tués, puis que les corps ont brûlés avec le bâtiment. Ce sont les seuls cadavres qui ont été retrouvés dans le bâtiment. Nous ne savions pas jusqu'à présent ce qu'ils étaient devenus. »
« Il n'y a aucune trace de ma grand-mère », poursuit Mona. « Nous avions peur qu'ils trouvent son corps dans la maison et qu'elle soit morte seule, et nous avions peur que les chars l'écrasent dans la rue, s'ils l'avaient laissée seule pour qu'elle arrive à l'hôpital Al-Shifa. Nous avions peur de tout. Nous avions peur de l'étendue de sa souffrance si elle était vraiment morte seule, et nous avions peur de sa souffrance si elle était encore en vie. »
Après la publication de cet article en hébreu, Mona m'a écrit pour m'informer que ses cousins ont fouillé à nouveau la maison et ont trouvé les restes brûlés de sa grand-mère, dans son lit.
*
Article publié dans Haaretz le 10 avril 2024– traduction A l'Encontre revue par Contretemps.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le sage centenaire

Guy Rocher a vu le jour le 20 avril 1924. Il a donc maintenant 100 ans révolus. Il est un des 9 500 centenaires que compte le Canada. Nul doute que l'implication de cet homme dans nos grands débats de société, tout au long de son parcours de vie en général et surtout de la fin des années quarante à aujourd'hui, a été bénéfique et profitable pour nous tous et toutes.
Son anniversaire de naissance me permet de revenir sur certains aspects de sa vie et de profiter de l'occasion pour lui dire un immense merci pour tout ce qu'il a fait et continue toujours de faire pour notre collectivité encore aujourd'hui. Dans les prochaines lignes, je veux vous parler de l'homme que je connais, de l'auteur que je lis, du professeur de sociologie qui m'a enseigné, de l'acteur social qui m'interpelle et bien entendu de l'ami indéfectible que j'apprécie.
Un parcours diversifié
Guy Rocher a un parcours atypique. Après des études classiques ininterrompues qui le mènent à l'obtention d'une licence en droit, il délaisse les bancs d'école pour se joindre à la Jeunesse étudiante catholique (JEC). C'est au sein de cette organisation, dans laquelle il milite bénévolement à temps plein, qu'il va décider, quelques années plus tard, d'effectuer un retour aux études universitaires en sociologie. Entre-temps, il fera la rencontre d'une personne qui va l'inviter ultérieurement à participer aux travaux d'une commission d'enquête, dont on parle encore aujourd'hui de plusieurs de ses recommandations.
De cette époque (des années quarante et cinquante), deux hommes méritent d'être nommés : le père Georges-Henri Lévesque et bien entendu Paul Gérin-Lajoie. Pourquoi ces deux personnes ? D'une part, c'est le père Lévesque qui a parrainé Guy Rocher dans ses démarches d'inscription à la prestigieuse Université Harvard et, pour sa part, Paul Gérin-Lajoie fera de notre jeune nouveau centenaire un commissaire chargé de formuler des recommandations porteuses d'avenir en matière d'éducation pour la province de Québec (et j'ai nommé la célèbre Commission Parent).
Il m'arrive souvent de me demander ce qui aurait pu arriver aux enfants de la classe ouvrière qui ont vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale n'eût été les travaux de cette commission d'enquête. Une chose est certaine, peu parmi les bébés boomers, issus des milieux populaires, auraient été en mesure d'accéder aux niveaux d'enseignement supérieur. C'est grâce aux travaux des membres de la Commission Parent et aux audacieuses propositions de réformes contenues dans leur rapport qu'il y a eu, durant les années soixante, la création d'une kyrielle de nouvelles institutions scolaires au Québec (les polyvalentes, les cégeps et aussi le réseau de l'Université du Québec). En bref, la création de plusieurs dizaines d'établissements d'enseignement susceptibles de permettre autant aux filles en plus grand nombre qu'aux garçons de développer leurs aspirations scolaires et de pouvoir poursuivre leurs études en s'endettant le moins possible. Montrons-nous reconnaissant à l'endroit des hommes et des femmes qui ont fait partie de cette commission d'enquête et qui n'ont pas hésité à oser proposer la reconfiguration de notre système scolaire pour en faire un système intégré (de la prématernelle à l'université) et adapté aux nouvelles exigences de la société du savoir et surtout moins porteur de discrimination fondée sur le sexe. Mais Guy Rocher c'est plus qu'un ex-membre de la Commission Parent, c'est aussi un grand intellectuel inspirant.
L'intellectuel inspirant
En écoutant ou en lisant Guy Rocher, nous nous retrouvons avec un scientifique qui tient des discours ou qui rédige des textes invitant à douter des théories doctrinales. Sa démarche nous incite fortement à analyser et à nuancer ce qui mérite de l'être. Pour être bref, Guy Rocher nous encourage à éviter dans nos réflexions et notre production de connaissances les chapelles dogmatiques ou les catégories illusoires que reprennent à leur compte les personnes au pouvoir ou qui ambitionnent de le conquérir. Il est certes un brillant scientifique ; un des rares à pouvoir communiquer avec clarté dans une langue accessible au plus grand nombre. Son style d'écriture s'oppose au langage hermétique de trop nombreux universitaires nébuleux qui s'expriment dans une exposition de leur savoir tarabiscotée à outrance. La pensée de Guy Rocher s'éloigne évidemment d'un manichéisme simpliste ou des oppositions élémentaires et souvent binaires.
Un regard analytique qui va au-delà des théories toutes faites
Il m'a toujours été agréable de lire un texte écrit par Guy Rocher ou de prendre connaissance de ses résultats de recherche. Son étude portant sur les aspirations scolaires (l'étude du groupe ASOPE) nous en a appris beaucoup sur les raisons expliquant pourquoi certains jeunes abandonnaient l'école. À l'époque où les théories sur la surdétermination en dernière instance ou non des structures sociales étaient à la mode et faisaient des adhérentes et des adhérents rapidement, lui et son équipe de recherche ont plutôt découvert, à travers une longue étude empirique, que dans certains cas la raison principale résidait dans le fait que le personnel de l'école et certains parents demandaient à leurs enfants « que vas-tu faire à la fin de tes études ? ». La fin des études correspondait ici au secondaire 5. Pour le jeune professeur de cégep et d'université que j'étais, les résultats de cette recherche m'ont fait comprendre que la réponse à certains faits sociaux ne résidait pas, hélas, dans la richesse d'un cadre théorique élaboré au XIXe siècle ou dans les écrits d'universitaires localisés dans une tour d'ivoire de certaines institutions prestigieuses. Guy Rocher n'adhère pas au déterminisme à la manière d'Émile Durkheim. Il est d'avis que la découverte sociologique est à la fois le résultat d'une intervention de la société sur elle-même et implique également de reconstruire le tout dans les gestes et les paroles des individus concernés par le phénomène à l'étude. Inspiré en cela par Max Weber, Guy Rocher a pratiqué le constructivisme sociologique bien avant que celui-ci soit de mise dans la recherche actuelle.
Guy Rocher et la curiosité
Lors d'une intervention au Collège Montmorency, Guy Rocher a déclaré qu'il existait deux sources d'accès au bonheur : la curiosité et l'adhésion à une cause susceptible de modifier l'organisation de la vie dans la Cité. C'est en effet l'étonnement ou la curiosité, si vous préférez, qui le conduit depuis fort longtemps dans la voie de la résolution de l'énigme du changement social. Sans la curiosité, il n'y a pas, selon lui, de connaissances susceptibles de nous permettre de comprendre le monde ou ses phénomènes concrets et de trouver des voies qui mènent à la résolution du changement raisonné. Pourquoi les filles et les garçons n'ont-ils pas accès aux mêmes programmes de formation scolaire et universitaire ? Pourquoi les francophones, les autochtones, les allophones subissent-elles et -ils des discriminations face aux anglophones ? La quête du savoir ou de la connaissance chez Guy Rocher puise incontestablement dans une forme de stupeur devant le monde tel qu'il se présentait ou se dresse devant lui. C'est la persistance de son étonnement, tout au long de sa longue vie d'adulte, qui lui a permis de continuer à interroger d'une manière franche et authentique le monde dans lequel nous sommes et où nous retrouvons des personnes qui veulent le garder intact, tandis que d'autres veulent contribuer à le refaçonner. Chez Guy Rocher, le premier moteur du changement reste incontestablement la surprise, l'étonnement ou la curiosité devant ce qui est et ce qui ne fonctionne pas. Voilà aussi pourquoi face à ce monde divisé et présentant des injustices, pour être heureux, il faut adhérer à des causes en s'impliquant et en s'engageant.
Le professeur Guy Rocher
Je côtoie l'ex-professeur Guy Rocher depuis maintenant 35 ans. J'ai assisté à son séminaire portant sur la sociologie du droit ; séminaire donné à des étudiantes et des étudiants de deuxième et troisième cycles à l'Université de Montréal. Nous étions environ une vingtaine de personnes à suivre ce cours. Au menu des séances hebdomadaires de chaque cours : l'étude d'un ou de plusieurs documents puisés à même un volumineux recueil de textes, des exposés du professeur, mais surtout un échange intense entre le professeur et les étudiantes et étudiants portant sur les textes lus. Moi, j'ai toujours été étonné par la richesse de cette approche pédagogique. Le professeur Rocher avait autant de plaisir que nous à commenter les textes, mais aussi à écouter les commentaires des participantes et participants. Durant ces échanges, j'ai vu monsieur Rocher prendre des notes ; je l'ai entendu reconnaître humblement ne pas avoir perçu la question sous l'angle exprimé par l'étudiante ou l'étudiant et il reconnaissait la pertinence de ce point de vue. Monsieur Rocher sait écouter les autres avec beaucoup d'ouverture d'esprit, tout en étant très tolérant face aux points de vue qui s'opposent aux siens.
L'acteur social
Monsieur Rocher est aussi un acteur social qui a beaucoup donné à la collectivité. Il a largement contribué à façonner certaines institutions qui ont fait du Québec une société dynamique, porteuse de changements bénéfiques et nécessaires. Pensons ici à nouveau à sa contribution à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la Province de Québec (la Commission Parent) qui a permis la mise en place d'un système d'éducation démocratique, accessible, public et laïque. C'est principalement grâce à l'acteur social Guy Rocher (et aux autres commissaires de la Commission Parent) que plus de deux millions de personnes ont pu se diplômer aux niveaux collégial et universitaire ; ce qui n'est pas peu dire. En tant qu'acteur social, Guy Rocher a joué un rôle important lors de la rédaction de la Charte de la langue française au Québec (la Loi 101). De plus, durant la grève de ses collègues universitaires, il n'a pas hésité à prendre parti en leur faveur. Tout en étant attaché à l'Université de Montréal, il a demandé à la ministre de l'Éducation de l'époque de financer adéquatement l'UQAM. Que dire de ses interventions lors des grèves des professeurs de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Montréal en 1976-1977 ? À cette époque, il a été un sous-ministre du développement culturel qui n'a pas eu peur d'ouvrir la porte de son bureau à des présidents de syndicats, alors que le ministre de l'Éducation préférait entendre le seul point de vue des recteurs de ces universités désertées pendant plus de 15 semaines.
Une vie qui a contribué à changer le monde
Quand je regarde la vie de Guy Rocher, je constate qu'il est possible d'analyser, dans le cadre d'une démarche rigoureuse et originale, notre monde en vue de le changer en fonction des intérêts du plus grand nombre. Guy Rocher est pour moi un sociologue et un citoyen qui s'est mis au service des membres de la société en nous suggérant fortement d'envisager la nécessité de s'enrôler socialement et politiquement, d'abord en observant notre monde, ensuite en identifiant les injustices et finalement en s'engageant dans la voie du changement afin de combattre les discriminations intolérables entre les sexes, les oppressions inqualifiables entre les groupes ethniques et culturels ainsi que les exclusions inacceptables des groupes minoritaires.
Pour conclure : Sur un ton un peu plus personnel…
De ce qui précède, deux mots me viennent en tête : générosité et inspiration. Monsieur Rocher vous êtes un être profondément généreux. Vous avez donné beaucoup aux autres et vous êtes toujours disponible pour continuer à donner. Encore aujourd'hui, vous intervenez quand on sollicite votre avis sur certains enjeux de société. Vous nous montrez qu'une personne, même centenaire, peut toujours entreprendre avec passion ce qu'elle a le goût de faire. Contrairement à ce que suggère Sénèque, vous êtes la preuve que même à un âge avancé il n'est pas nécessaire de se retirer de la scène publique. Il y a incontestablement beaucoup de vous dans ce que nous sommes.
Sur un ton un peu plus personnel qu'il me soit permis de dire que vous êtes un de ceux qui m'ont inspiré dans la voie des études avancées, mais surtout à trouver du plaisir dans les sentiers non balisés à emprunter qui mènent à la découverte sociologique. Vos écrits n'ont jamais cessé d'alimenter ma réflexion critique.
Monsieur Rocher, continuez à afficher ce sourire serein d'une personne qui ne renonce pas à jeter un regard critique sur la vie en société. Pour cette raison et encore plusieurs autres, moi, je vous encourage à continuer à nous livrer le résultat de vos analyses… Sachez en terminant que votre nom figure bien haut sur la courte liste de personnes exceptionnelles qui marquent leur époque. Bonne continuation, monsieur Rocher, et surtout longue vie… notre monde a toujours besoin de personnes qui ont une soif de justice sociale et qui indiquent la voie à définir et à emprunter pour réaliser le nécessaire changement social.
Vous incarnez, depuis fort longtemps, aux yeux de plusieurs un sage. À partir d'aujourd'hui, le 20 avril 2024, nous pouvons dire, salutations amicales à l'ami Rocher, le sage centenaire.
Yvan Perrier
20 avril 2024
yvan_perrier@hotmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le budget Freeland, une revue de presse
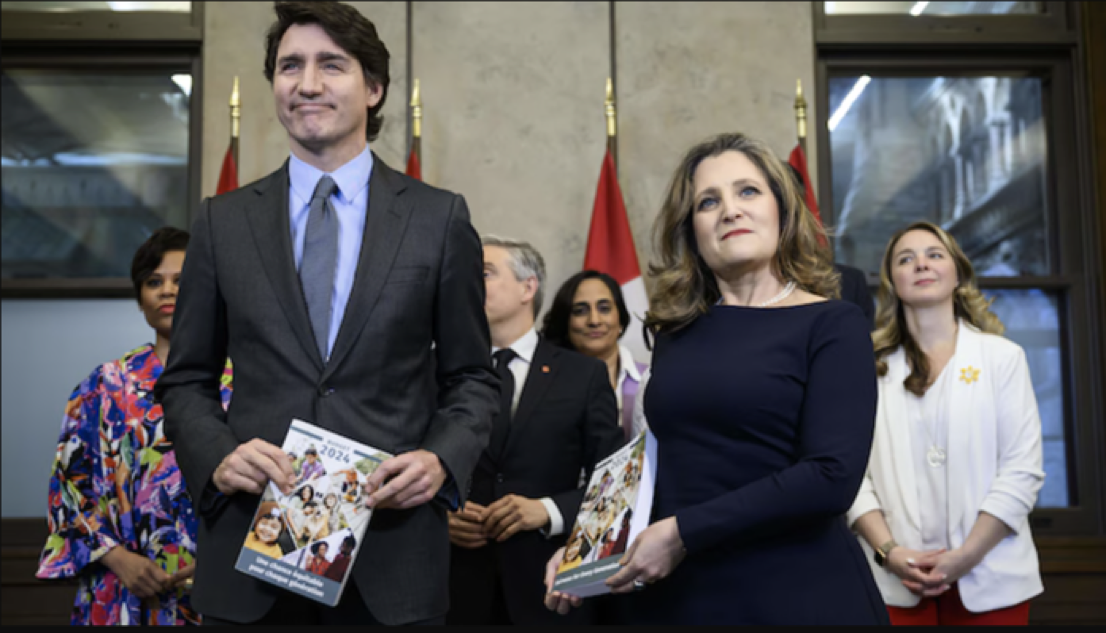
Voici les réactions des organisations syndicales et populaires au budget fédéral 2024-2025. Nous les publions au fur et à mesure de leur publication.
Un budget qui ne va pas assez loin (CSQ)
Après la pluie d'annonces des dernières semaines : 500 M$ pour la santé mentale, 9 G$ pour l'armée, un « Plan du Canada pour le logement » à 5 G$, 1 G$ pour l'aide alimentaire et 2,1 G$ pour amorcer la mise en place d'une assurance médicaments universelle et publique…, il nous semblait difficile d'être surpris par le budget fédéral déposé ce mardi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.
Par Pierre-Antoine Harvey, conseiller CSQ
À la surprise générale, le déficit est inférieur aux prédictions des analystes. Un déficit de 40 G$ équivalant à seulement 1,3 % du PIB, soit trois fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE1. Le gouvernement pourra remercier la vigueur imprévue de l'économie au Canada et aux États-Unis pour ces bons résultats.
Ce budget, qui se veut progressiste et axé vers les jeunes générations, fait plusieurs pas dans la bonne direction. Cependant, il aurait pu aller beaucoup plus loin, étant donné les différentes crises réelles auxquelles la population fait face.
Une plus grande justice fiscale
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se préoccupe de la justice fiscale et salue l'initiative du gouvernement fédéral d'augmenter les impôts sur les gains en capital des plus riches, ce qui devrait générer des recettes fiscales supplémentaires de 17,7 milliards de dollars.
Actuellement, les Canadiens paient des impôts sur 50 % de leurs gains en capital. Le gouvernement a annoncé que ce taux passera à 66 % pour les gains supérieurs à 250 000 $ annuellement à partir du 25 juin 2024. Pour les gains inférieurs à ce seuil, la partie imposable demeure à 50 %. De plus, le taux d'inclusion des gains en capital des entreprises et des fiducies sera également majoré de 50 % à 66 %.
Investissements dans le logement abordable (et non social !)
Le gouvernement fédéral s'engage à encourager la construction de 250 000 logements supplémentaires d'ici 2031, comme indiqué dans son « Plan du Canada pour le logement » de 8 G$ qui introduit plusieurs mesures d'aide aux constructeurs, aux futurs propriétaires ainsi qu'aux locataires.
Cependant, cette initiative, bien qu'essentielle, demeure encore trop timide en termes de développement du logement social ou coopératif, qui est essentiel pour aider les ménages les plus pauvres, soit les premières victimes de la crise du logement.
En parallèle, Ottawa prévoit transformer des terrains et des édifices fédéraux afin de construire 30 000 nouveaux logements à travers le Canada. Le budget nous apprend que Postes Canada, qui compte plus de 1 700 bureaux de poste à travers le pays, et les Forces armées pourraient devoir se départir d'immeubles sous-occupés.
Malheureusement, la cible de logements dits « abordables » est fixée à seulement 20 %, sans garantie qu'il s'agisse de véritables logements sociaux en dehors du marché privé.
Enjeux autochtones
En ce qui concerne les dépenses pour les peuples autochtones, le budget fédéral prévoit cette année des investissements avoisinant les 3 milliards de dollars à travers le pays. Malheureusement, ce montant est insuffisant, surtout en prenant en compte les besoins criants en matière de services essentiels qui ne sont pas pourvus dans les communautés des Premières Nations.
La santé et le soutien de la jeunesse recevront la part du lion des fonds destinés aux peuples autochtones dans le budget fédéral 2024-2025. Ottawa prévoit investir 1,06 milliard de dollars dans le premier de ces domaines et 499 millions de dollars dans le second. En santé, l'accent est mis sur l'amélioration de l'accès aux soins et aux services de santé mentale, avec des investissements respectifs de 1,06 milliard de dollars (dont 646 millions cette année) et de 630 millions de dollars (dont 315 millions cette année).
On s'éloigne de la transition juste
Si le dernier budget avait une forte saveur environnementale, la transition juste est la grande absente du budget 2024-2025. La mesure à connotation environnementale qui se démarque semble être avant tout une protection contre les attaques préélectorales du Parti conservateur.
Près de 600 000 entreprises de moins de 500 employés recevront une compensation pour la taxe carbone. La taxe de 15 $ par tonne de carbone émis génère beaucoup de mécontentement dans toutes les provinces…, à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique, qui ont leur propre Bourse du carbone ou une taxe déjà plus élevée.
Marcher sur les platebandes de Québec
Plusieurs des mesures progressistes mises de l'avant par Ottawa laissent présager un empiètement sur les compétences provinciales. La défense des juridictions du gouvernement du Québec est importante, mais elle ne doit pas être une excuse pour l'immobilisme. Québec doit s'entendre avec Ottawa pour recevoir les sommes équivalentes, tout en s'assurant que ces dernières serviront à la mise sur pied de programmes, totalement québécois, qui s'attaqueront aux problèmes concrets de la population.
Par exemple, l'argent fédéral prévu pour l'assurance médicaments doit permettre la mise en place d'un réel régime public universel d'assurance médicaments québécois. Elles ne doivent pas être détournées afin de servir de « plaster » sur le régime hybride québécois, qui a démontré ses lacunes2.
La stratégie du saupoudrage
La stratégie du gouvernement consistant à disperser les fonds dans une multitude de mesures, bien que progressive, présente des lacunes. Le saupoudrage financier sur divers postes de dépenses entraine une mise en œuvre partielle de nombreuses initiatives, notamment en ce qui concerne l'assurance médicaments universelle et à payeur unique …, qui ne couvre qu'une sélection restreinte de médicaments3.
Pour répondre aux besoins actuels, des mesures structurantes sont nécessaires pour stabiliser réellement l'économie et soutenir les travailleurs. Malheureusement, la stratégie du saupoudrage ne suffira pas à accomplir cette tâche.
Des finances publiques qui vont bien
Quoi qu'en disent les prophètes de l'austérité : surprise ! Les finances publiques du Canada vont bien ! Le déficit n'a pas explosé, et le pays se retrouve avec la dette la plus soutenable des pays membres du G74. La crise du logement, la crise écologique, la crise de l'abordabilité, la crise des conditions de vie dans les communautés autochtones, etc., exigeaient que le gouvernement intervienne. Il faudrait même qu'il accélère ses interventions et les coordonne mieux avec les provinces si nous voulons offrir un répit à la population, qui subit les conséquences de ces multiples crises.
Déception des artistes en arts visuels canadiens : le droit de suite tant attendu n'est pas inclus dans le budget fédéral 2024
OTTAWA, le 18 avril 2024 – Les artistes en arts visuels de tout le pays attendent depuis longtemps que le Canada reconnaisse le droit de suite pour les artistes canadiens. Les organisations qui les représentent, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et le Front des artistes canadiens (CARFAC) représentent ensemble plus de 5 000 artistes dans tout le pays. Les artistes ont exprimé leur frustration à l'égard du gouvernement canadien, car cet important droit économique pour les artistes visuels a encore une fois été exclu du budget 2024 – qui ne prévoit pas non plus d'autre soutien spécifiquement pour les artistes en arts visuels.
Le droit de suite est une redevance qui permet aux artistes d'obtenir une part de la richesse produite par la revente de leurs œuvres. Il permet au Canada de s'aligner sur la législation de plus de 90 pays dans le monde qui disposent déjà de lois sur le droit de suite. Bon nombre de ces lois prévoient que les artistes en arts visuels reçoivent 5% lorsque leurs œuvres sont revendues sur le marché secondaire par un intermédiaire tel qu'une maison de vente aux enchères ou une galerie d'art. Le droit de suite permet aux artistes de bénéficier du succès continu de leurs œuvres. Si le droit de suite s'applique à tous les artistes en arts visuels, celui-ci aurait été particulièrement favorable aux artistes seniors qui ont travaillé pendant des années à développer leur carrière artistique et qui se retrouvent souvent en situation de précarité durant leurs vieux jours. Cela aurait été également une grande victoire pour les artistes autochtones, qui ont trop souvent été exploités sur le marché secondaire de l'art.
Le droit de suite apporterait un soutien financier bien mérité et reconnaîtrait la contribution continue d'un artiste à la culture canadienne.
“L'adoption du droit de suite pour les artistes en arts visuels au Canada est essentielle », déclare Camille Cazin, directrice générale du RAAV. “Le droit de suite rétablit un équilibre en garantissant que les artistes sont équitablement rémunérés pour leur travail lorsque leurs œuvres sont revendues à des prix supérieurs à la valeur initialement reçue par l'artiste et nous mettrait en conformité avec nos partenaires internationaux. Nous demandons instamment au gouvernement de respecter son engagement de mettre en œuvre ce droit dans un avenir immédiat afin de garantir l'équité et la reconnaissance de la contribution des artistes à la richesse culturelle et économique du Canada. »
« L'absence d'inclusion du droit de suite des artistes dans ce budget est une incroyable déception pour la communauté artistique canadienne. Tout le monde sait à quel point ce droit aiderait les artistes en arts visuels canadiens à se remettre de la pandémie et leur permettrait de bénéficier d'une nouvelle source de revenus pour les années à venir », a déclaré April Britski, directrice générale nationale de CARFAC, qui se bat depuis près de vingt ans pour que ce droit soit inscrit dans la législation canadienne. « Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour qu'il respecte son engagement de présenter un projet de loi sur le droit de suite et pour que les artistes en arts visuels soient mieux rémunérés pour leur travail. »
Budget fédéral 2024 - La FNCC déplore le peu d'intérêt d'Ottawa pour la survie des médias
MONTRÉAL, le 18 avril 2024 - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) salue la reconduction de certains financements en culture, aux festivals, aux arts vivants et au Fonds du livre, par le gouvernement fédéral, tout en déplorant le fait que ces financements soient ponctuels. La FNCC est également déçue qu'Ottawa n'ait pas annoncé de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région.
« Ottawa a certes bonifié de 42 millions de dollars le financement public de Radio-Canada, réduisant la nécessité d'abolitions de postes annoncée en décembre 2023. Nous saluons aussi la reconduction de l'Initiative de journalisme local annoncée en février. Mais qu'en est-il des autres médias ? La crise des médias, on ne l'invente pas. Elle se vit tous les jours. Ottawa doit en faire plus pour la résorber, c'est sa responsabilité de préserver l'information de qualité, qui est essentielle pour la démocratie », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC.
La FNCC est présentement en campagne afin de mettre de l'avant des solutions structurantes à cette crise qui perdure. « Plusieurs solutions relativement simples sont à la portée d'Ottawa. Ne manque que la volonté politique du gouvernement fédéral ! », enchaîne Mme Charette.
La FNCC propose notamment que le crédit d'impôt à la masse salariale des médias d'information soit renforcé, en l'étendant aux salles de rédaction radio et télé. Pour la presse écrite, ce crédit pourrait être élargi afin de couvrir l'ensemble des emplois.
La FNCC propose aussi de doubler la déduction d'impôt pour les achats publicitaires auprès d'un média d'information. « Enfin, dans le contexte où des géants du numérique comme Meta rient de nos règles fiscales, il est aberrant que des organismes publics et des ministères fédéraux leur achètent encore de l'espace publicitaire. Le gouvernement fédéral devrait être cohérent en cessant immédiatement de transiger avec ce type d'entreprise et en adoptant une politique d'achat publicitaire responsable, visant à appuyer les médias d'information », continue Mme Charette.
Pour le secteur culturel, la FNCC et ses membres s'inquiètent du pourcentage de réponses positives aux projets soumis au Conseil des arts du Canada, qui semble se réduire actuellement. « Y a-t-il moins d'argent ? Là aussi, les besoins sont grands et l'action est urgente ! », termine la présidente.
Budget libéral - La CAQ doit injecter les fonds fédéraux dans les réseaux publics en crise, pas les dilapider en baisses d'impôt (FSSS-CSN)
MONTRÉAL, le 17 avril 2024 - La FSSS-CSN demande au gouvernement de la CAQ de réaffecter intégralement les fonds fédéraux destinés à des enjeux sociétaux, de santé, pour renforcer le filet social, non pas de dilapider les fonds en octroyant de nouvelles baisses d'impôt.
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, regrette que la Coalition avenir Québec ait laissé le champ libre au gouvernement du Canada qui piétine allègrement les plates-bandes du Québec.
« La CAQ a négligé les investissements requis pour répondre aux diverses crises qui ont actuellement cours et qui affaiblissent le filet social qu'il s'agisse de la crise du logement, de l'insécurité alimentaire, de la montée des problèmes de santé mentale, du manque de places dans les services de garde éducatifs à l'enfance », fait remarquer le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. « Elle a aussi préféré octroyer des baisses d'impôt qui profitent disproportionnellement aux mieux nantis plutôt que de s'attaquer aux maux du secteur public. »
Pas le choix
Dans ce contexte malheureux, les transferts budgétaires du fédéral, quoiqu'insuffisants, sont nécessaires et bienvenus… pourvu que le gouvernement de la CAQ se serve de l'argent pour réinvestir dans les réseaux publics de santé et services sociaux ainsi que dans les services de garde. Pas pour faire des chèques de 500 $ ou offrir des baisses d'impôt aux plus riches.
« Le gouvernement de la CAQ doit impérativement protéger les services publics du Québec en utilisant les transferts fédéraux pour s'attaquer aux nombreux enjeux qui secouent notre nation : santé, logement, services de garde, financement du communautaire, soins à domicile, etc. », réclame Réjean Leclerc.
Nouveaux revenus
La FSSS-CSN salue, par ailleurs, la décision d'Ottawa de chercher de nouveaux revenus dans les classes les plus aisées de notre société.
« Au lieu de pencher vers l'austérité, Québec devrait prendre des notes et s'octroyer de nouvelles sources budgétaires », avance Réjean Leclerc. « Des exemples : revoir la fiscalité trop avantageuse des grandes entreprises, diminuer les subventions aux riches corporations, éliminer l'évitement fiscal, taxer le patrimoine des 1% les plus fortunés, mettre en place un impôt sur les gains en capital, etc. »
Il y a de nombreuses mesures qui permettraient d'accroître les revenus de l'État et d'offrir les services auxquels les citoyennes et les citoyens sont en droit de s'attendre. Tout en favorisant le rétablissement du filet social, qui fait la fierté de la population québécoise.
Budget fédéral 2024 - Un pas vers plus de justice fiscale (CSN)
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - La CSN salue les augmentations d'impôt sur les gains en capital de plus de 250 000 $.
« C'est un pas vers plus de justice fiscale entre les mieux nantis et ceux qui gagnent leur argent en travaillant », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.
Le gouvernement a ajouté plusieurs nouveaux programmes intéressants ces dernières années, mais il faudra qu'il pense à les consolider pour que la population en profite vraiment. C'est sans compter des programmes déjà en place depuis plusieurs années, comme l'assurance-emploi ou les transferts pour la santé, qui méritent d'être bonifiés.
« Ce sera tout un défi de mener tout ça à terme dans un délai raisonnable. Il y a beaucoup de pain sur la planche », ajoute la présidente.
La CSN est par ailleurs déçue qu'il n'y a pas de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région. L'information de qualité est essentielle pour la démocratie.
L'annonce d'un projet de loi sur le droit à la déconnexion pour les entreprises de compétence fédérale est une bonne nouvelle. La CSN tient à collaborer au projet de loi.
Toujours pas assez pour le logement
Les nouvelles dépenses d'Ottawa pour le logement, annoncées avant le budget, représentent un effort louable d'augmentation du nombre de logements, mais cela demeure insuffisant, surtout à court terme. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoit qu'il faudrait construire 3,4 millions de logements d'ici 2030 pour atteindre une offre suffisante afin d'assurer un retour à l'abordabilité. Or, si ce n'est pas abordable, c'est impossible de se loger.
Réaction de la FTQ au budget fédéral : « La nature ayant horreur du vide, on comprend pourquoi le fédéral agit dans les "champs d'incompétence" de la CAQ » ‒ Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue plusieurs des mesures annoncées dans le budget fédéral, comme les investissements dans le logement, l'assurance médicaments ou l'aide alimentaire, et estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de la population. La centrale considère qu'il est important pour le Québec de protéger ses champs de compétence, mais comprend les actions du palier fédéral face au gouvernement de la CAQ. Pour la FTQ, il faut s'attaquer à la vie chère, à la crise du logement, à l'aide alimentaire, aux soins dentaires ou à l'assurance médicaments. C'est pourquoi Québec et Ottawa doivent collaborer et s'entendre rapidement pour que les milliards de dollars sur la table aident ceux et celles qui peinent chaque jour à joindre les deux bouts.
« La population québécoise souffre encore beaucoup de l'inflation. Se loger est rendu inabordable, la fréquentation des banques alimentaires ne cesse d'augmenter et le phénomène de l'itinérance atteint des proportions alarmantes. Il ne faut donc pas se surprendre que le fédéral réagisse. La nature ayant horreur du vide, on comprend pourquoi le fédéral agit dans les "champs d'incompétence" de la CAQ », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.
« Devant l'urgence actuelle, il faut mettre de côté les chicanes de clôtures. Les deux paliers de gouvernement doivent collaborer pour que l'argent soit utilisé aux programmes auxquels il est destiné et non pour baisser les impôts, donner des chèques cadeaux pour se faire élire ou payer des millionnaires pour venir jouer au hockey », ajoute le secrétaire général.
Aussi, il faut saluer les mesures sur les gains en capital qui visent les mieux nantis. Il s'agit d'une mesure positive, mais beaucoup d'efforts restent à faire, notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Soulignons également le 1,5 milliard de dollars qui seront investis en culture et communautés.
Par ailleurs, la FTQ invite les oppositions à faire preuve de bon sens et à travailler avec le gouvernement Trudeau pour une adoption rapide du projet de loi anti-briseurs de grève et une mise en œuvre dès sa sanction royale. Les travailleurs et les travailleuses ne devraient pas attendre 18 mois comme ce qui est proposé à l'heure actuelle. Ottawa doit également bonifier l'assurance-emploi et poursuivre ses efforts pour l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments. « Au Québec, le régime hybride (public-privé) est complètement inadéquat. Trop de personnes à faible revenu se privent de médicaments faute d'argent. Il est déjà démontré qu'un régime public et universel permettrait d'économiser plusieurs milliards de dollars grâce à un plus grand pouvoir de négociation. La raison doit l'emporter sur les intérêts des lobbys pharmaceutiques et des compagnies d'assurances », conclut le secrétaire général.
Budget fédéral : des promesses reléguées aux oubliettes, déplore le Réseau FADOQ
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 – Près de trois ans après la dernière élection fédérale, le Réseau FADOQ constate que le gouvernement du Canada semble abandonner définitivement les promesses faites aux électrices et électeurs aînés.
En 2021, le Parti libéral du Canada s'était engagé à bonifier le Supplément de revenu garanti (SRG), à créer un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière et à améliorer le crédit d'impôt pour aidant naturel.
Aucune de ces mesures ne figure au budget fédéral dévoilé mardi.
« Nous sommes profondément déçus qu'aucun de ces engagements ne fasse partie du budget. Il s'agit de mesures qui feraient une différence dans la vie de centaines de milliers de personnes. Le gouvernement libéral avait entre autres l'occasion de s'attaquer à la détresse financière des personnes de 65 ans et plus en bonifiant le Supplément de revenu garanti. Ces personnes n'ont pas été entendues », déplore la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral continue d'exclure les personnes de 65 à 74 ans de la bonification de 10 % du montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse alors que cette augmentation est versée aux personnes de 75 ans et plus.
« Au Réseau FADOQ, nos membres de 65 à 74 ans nous parlent quotidiennement de cette exclusion à laquelle ils et elles font face. On ne devrait pas avoir deux classes de personnes aînées dans notre société, mais c'est ce qui se passe actuellement », souligne Mme Tassé-Goodman.
Rappelons qu'une personne de moins de 75 ans qui reçoit uniquement la Sécurité de la vieillesse et le SRG bénéficie d'un revenu annuel de seulement 21 45,72 $, ce qui se situe sous le seuil de pauvreté officiel du gouvernement fédéral. Avec un tel revenu, il est impossible de composer avec l'augmentation des prix à la consommation sans avoir à faire des choix déchirants dans la vie de tous les jours.
Des gestes à venir, mais un déploiement complexe
Le gouvernement du Canada a profité du dépôt du budget pour annoncer le financement de 1,5 milliard $ sur cinq ans à Santé Canada afin de soutenir l'établissement du Régime national d'assurance médicaments. Le nouveau financement fédéral ne remplacerait pas le programme public d'assurance médicaments existant du Québec, mais viserait plutôt à le bonifier et à l'élargir.
Le Réseau FADOQ tient à souligner que le déploiement du Régime national d'assurance médicaments du fédéral est timide, puisqu'il ne cible que la couverture universelle de nombreux contraceptifs et de certains médicaments contre le diabète.
Le gouvernement du Canada a également réitéré sa volonté de déposer un projet de loi sur les soins de longue durée sécuritaires afin notamment d'appuyer de nouvelles normes nationales et d'améliorer les soins de santé dans les établissements de soins de longue durée comme les CHLSD.
Bien que ces deux gestes démontrent une volonté politique, le gouvernement du Canada souligne néanmoins que leur concrétisation devra se faire avec le concours des provinces et territoires, présageant un déploiement long et complexe.
Des efforts en logement
Le gouvernement fédéral a également annoncé plusieurs mesures afin de juguler la crise actuelle du logement. Il prévoit notamment favoriser la construction de logements sur des terrains publics ou encore des terrains appartenant à Postes Canada et à la Défense nationale. Le gouvernement fédéral souhaite également convertir des immeubles de bureaux fédéraux sous-utilisés en logements et taxer les terrains vacants pour encourager la construction de logements.
Budget fédéral : déception sur toute la ligne (Conseil national des chômeurs et chômeuses)
Montréal, le 16 avril 2024 – Le budget fédéral s'avère une grande déception pour le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).
« Il n'y a rien. Pas de réforme, même pas de mesures ciblées pour que le programme soit plus juste, plus équilibré et plus protecteur pour les travailleurs et les travailleuses », a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC. « Comme à a chaque année, le gouvernement prolonge la mesure des cinq semaines de prestations supplémentaires aux travailleurs et travailleuses saisonniers de 13 régions du Canada. Encore une fois, du temporaire et c'est trop peu. Cette mesure est un copier-coller du dernier budget 2023, c'est rire du monde ! ».
Le CNC critique également le refus du gouvernement de suivre ses propres projections pour résorber le déficit pandémique de la caisse de l'assurance-emploi, préférant plutôt réduire le taux de cotisation à un plancher historique, et s'empêchant de facto de faire des améliorations. « En refusant d'augmenter même minimalement le taux de cotisation, le gouvernement se prive d'argent, prolongeant le déficit de la caisse de l'assurance-emploi pour mieux justifier son inaction. Il se condamne lui-même à l'inaction », a déclaré le porte-parole.
Le CNC s'interroge finalement sur les raisons du revirement total du gouvernement, qui promettait encore l'année dernière une réforme complète de l'assurance-emploi, afin d'en faire un programme « digne du 21e siècle ».
« Pourquoi le gouvernement s'est engagé à réformer l'assurance-emploi s'il n'avait pas l'intention de le faire ? Il a engagé des dépenses, à hauteur de 5 millions de dollars, pour effectuer des consultations et des recherches. Il sait très bien ce qu'il faut faire. Il a donné très clairement sa parole, et a entretenu l'espoir. Qu'est-ce que les ministres attendent ? », a poursuivi Pierre Céré.
« Le gouvernement prévoit lui-même dans ce budget une augmentation des taux de chômage pour les deux années à venir, mais préfère ne rien faire. Le gouvernement devrait savoir que nous ne sommes pas à l'abri de crises et de catastrophes naturelles. Il semble préférer l'inaction et l'irresponsabilité », a conclu le porte-parole.
Budget fédéral 2024 : le gouvernement a les moyens d'en faire plus (IRIS)
OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 - La ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland a déposé aujourd'hui son 4e budget fédéral qui, en continuité des budgets précédents, ne cède pas à un conservatisme fiscal qui aurait été particulièrement inadapté aux crises actuelles.
Selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), la situation des finances publiques du Canada est loin d'être alarmante. Elle continue d'être enviable quand on la compare à celle des autres pays du G7. Ce faisant, le gouvernement devrait aller plus loin pour aider la population canadienne à faire face aux différentes crises que traverse le Canada.
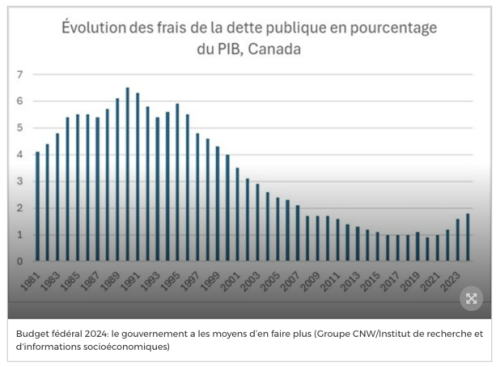
Service de la dette historiquement bas en proportion du PIB
L'exercice budgétaire 2024-2025 prévoit des revenus de 497,8 G$ et des dépenses de 537,6 G$, pour un déficit annuel de 39,8 G$. Le service de la dette, qui atteindra 54,1 milliards cette année, demeure parmi les plus faibles des trente dernières années lorsque rapporté au PIB et à l'ensemble des revenus du gouvernement.
« L'idée reçue selon laquelle le Canada est surendetté ne résiste pas à l'épreuve des faits. Même avec le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé, le déficit et les frais d'intérêt encourus en pourcentage du PIB demeurent marginaux en 2024-2025 », remarque Colin Pratte, chercheur à l'IRIS.
Imposition des entreprises et des mieux nantis : un rattrapage nécessaire
Le gouvernement prévoit générer de nouvelles sources de revenus totalisant 6,5 milliards de dollars, principalement grâce à un rehaussement à 66% du taux d'inclusion des gains en capital, qui rapportera environ 4 G$ par année.
Le gouvernement aurait pu dégager encore plus de marge de manœuvre fiscale. Le Directeur parlementaire du budget a en effet calculé qu'un retour à un taux d'inclusion de 75% des gains en capital, c'est-à-dire le taux qui prévalait dans les années 1990, engendrerait des revenus additionnels de 13 G$.
Notons que le taux d'imposition des entreprises au fédéral a diminué de 60 % depuis les années 1980, passant de 37,8 % à 15 %.
« Il y a un énorme rattrapage à faire en matière d'imposition des entreprises au Canada ; le gouvernement est sur la bonne voie, mais devra aller plus loin s'il veut ''soutenir la classe moyenne'' pour faire face aux différentes crises », remarque Colin Pratte.
Budget fédéral 2024 - Toujours pas assez de logements d'ici 2030 (CSN)
MONTRÉAL, le 15 avril 2024 - Les nouvelles dépenses d'Ottawa pour le logement, annoncées avant le budget, représentent un effort louable d'augmentation du nombre de logements, mais cela demeure insuffisant.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoit qu'il faudrait construire 3,4 millions de logements d'ici 2030 pour avoir une offre suffisante afin d'assurer un retour à l'abordabilité. Or, si ce n'est pas abordable, c'est impossible de se loger.
« L'intention du gouvernement est bonne, mais ça ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité dans le secteur du logement d'ici 2030. La demande est telle, qu'une stratégie canadienne en consultation avec tous les partenaires impliqués, dont les provinces, serait essentielle pour faire en sorte que toute la population puisse avoir accès à un logement décent, et ce, à coût accessible », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN, précisant que le financement et la main-d'œuvre devront être au rendez-vous si l'on veut que ce méga chantier aboutisse enfin.
La CSN estime que le déficit ne devrait pas empêcher de voir plus grand sur cet enjeu crucial. Le directeur parlementaire du budget estimait l'an dernier que le gouvernement fédéral pouvait accroître ses dépenses de 1,7 % du PIB, ou 49,5 G$, sans nuire à sa viabilité financière à long terme. Il serait par ailleurs possible d'augmenter les revenus d'Ottawa tout en assurant une meilleure redistribution de la richesse. La CSN propose, par exemple, une taxe sur les services numériques pour les géants du web, laquelle avait déjà été envisagée par le gouvernement fédéral. Comme il n'y a toujours pas d'entente multilatérale pour imposer ces entreprises, le Canada devrait mettre en place une telle taxe, dès 2024, comme annoncé dans le précédent budget.
Des promesses toujours en plan
Alors que le gouvernement Trudeau est en place depuis 2015, la réforme de l'assurance-emploi n'a toujours pas été réalisée et quelque 60 % des Canadiennes et des Canadiens qui perdent leur emploi n'ont pas le droit à des prestations. Les syndicats et plusieurs groupes communautaires exigent depuis plusieurs années des changements fondamentaux. Rien n'est fait.
Le régime d'assurance médicaments universel n'est pas encore en place, mais la CSN salue le premier pas dans cet important dossier. Il faudra toutefois aller plus loin que la couverture de deux médicaments et pour cela, il faudra une entente avec les provinces.
La décarbonisation de l'économie canadienne piétine. Ottawa doit être au rendez-vous pour appuyer des moyens concrets de réduction des émissions de carbone, comme l'augmentation de l'offre en transport en commun. « Les intentions sont là, mais l'atteinte des objectifs prend énormément de temps », conclut la présidente de la CSN, qui estime qu'il serait pourtant possible de se donner les moyens de faire ce qui doit être fait pour l'avenir de nos enfants.
Le FRAPRU commente les mesures du budget Freeland sur le logement : Un changement de cap souhaitable, mais beaucoup trop timide
MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement québécois pour le droit au logement, accueille favorablement certaines des mesures proposées dans le Plan du Canada sur le logement dévoilé vendredi et dont les détails seront annoncés dans le budget de la ministre Chrystia Freeland. Il estime cependant que le gouvernement Trudeau mise encore trop sur le marché privé pour s'attaquer à la crise du logement.
Sa porte-parole, Véronique Laflamme, explique cette réaction en demi-teinte « Depuis des années, le FRAPRU revendique un vigoureux changement de cap d'Ottawa dans ses investissements en logement pour qu'ils soient clairement dirigés vers le secteur sans but lucratif et l'aide aux personnes et aux familles qui vivent le plus durement les effets de la crise. La Défenseure fédérale du logement et le Conseil national du logement, deux entités mises sur pied par le gouvernement fédéral pour surveiller le droit à un logement adéquat au Canada, ont fait des recommandations allant dans le même sens. Certaines des mesures du Plan du Canada sur le logement qui seront confirmées aujourd'hui opèrent un tel virage, mais les incitatifs visant à encourager les promoteurs privés à construire, eux, ne peuvent résulter qu'en des logements totalement inabordables dans le contexte actuel ».
Des changements salués
Le FRAPRU salue l'ajout attendu dans le budget de 1 milliard $ pour le Fonds pour le logement abordable permettant « de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement ». Il considère cet investissement additionnel d'autant plus bienvenu qu'il permettra entre autres de pérenniser l'Initiative de création rapide de logements qui finance la réalisation de logements abordables permanents pour des personnes et des familles vulnérables.
Le regroupement se réjouit aussi de la création d'un Fonds canadien de protection des loyers de 1,5 milliard $ qui permettra l'acquisition de logements locatifs existants pour les sortir de la spéculation. « Le FRAPRU revendiquait une mesure similaire depuis des années », rappelle Véronique Laflamme, en ajoutant que les fonds prévus ne seront pas suffisants, puisque ce sont des contributions plutôt que des prêts qui devraient être accordées pour assurer la pérennité et l'accessibilité financière des logements sans but lucratif ainsi réalisés.
Le FRAPRU attend enfin avec impatience les détails du Programme de coopératives d'habitation doté d'un budget de 1,5 milliard $ et annoncé lors du budget 2022. Véronique Laflamme lance un appel à ce sujet : « Le modèle de coop d'habitation qui s'est historiquement développé au Québec est basé sur une mixité de revenus permettant entre autres à des ménages à faible revenu d'y avoir accès, grâce à une aide financière additionnelle. C'est aussi ce que devrait faire le nouveau programme dont les détails seront dévoilés à l'été 2024 ».
Trop pour les promoteurs privés
« C'est bien beau de vouloir construire plus de logements, plus rapidement, comme l'affirme le Plan du Canada sur le logement, mais il ne faudrait pas pour autant construire à n'importe quel loyer et augmenter ainsi le problème d'inabordabilité ». C'est en ces termes que Véronique Laflamme a fait part du désaccord du FRAPRU face à certaines mesures du Plan favorisant en grande partie les promoteurs privés et des logements qui sont majoritairement inabordables, dont l'ajout de 15 milliards $ dans le Programme de prêts à faible coût L'introduction d'une nouvelle mesure de déduction fiscale permettant aux constructeurs de « lancer davantage de projets en augmentant leur retour sur investissement après impôt » qui s'ajoute à l'élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les nouveaux projets d'appartements locatifs, peu importe leur loyer. « C'est dilapider indirectement des sommes qui seraient beaucoup plus utiles en logement social », insiste Véronique Laflamme.
Le FRAPRU s'inquiète finalement de l'utilisation que le gouvernement fédéral pourrait faire de ce qu'il appelle « un plan historique de terres publiques disponibles pour le logement ». Il craint que ce plan répète les erreurs de l'Initiative des terrains fédéraux, inaugurée en février 2019 et qui, en décembre 2023 avait permis la réalisation de 4000 logements mais dont 57 % n'étaient même pas abordables, selon les critères fédéraux déjà élastiques. Il ajoute qu'au Québec, cette initiative n'a jusqu'ici servi qu'à la réalisation de 12 logements. Le FRAPRU réclame que les terrains publics soient réservés au secteur sans but lucratif.
« Le gouvernement Trudeau semble avoir compris qu'il devait favoriser davantage le logement sans but lucratif qu'il ne le faisait jusqu'à maintenant avec sa Stratégie nationale du logement. Il doit cependant aller beaucoup plus loin et y concentrer ses investissements. Le logement social demeure le seul véritable moyen de s'attaquer en profondeur à la crise du logement dans toutes ses dimensions, dont la pénurie d'appartements, mais aussi leur inaccessibilité financière et il faut prendre tous les moyens pour augmenter rapidement la maigre part qu'ils occupent sur le parc locatif du Québec et du Canada », conclut la porte-parole du FRAPRU.
Le FRAPRU analysera le budget qui sera déposé aujourd'hui et y réagira. Il se réjouit de possibles mesures fiscales visant à faire contribuer davantage les très riches aux fonds publics en espérant que ces fonds permettront de lutter davantage contre les inégalités sociales en finançant massivement le logement social. Le regroupement espère que d'autres mesures fiscales favorisant de façon disproportionnée les propriétaires seront également revues.
La pollution des industries en Abitibi-Témiscamingue
22 mars 2024 | AMOS | https://mediat.ca -
Une émission d'intérêt public où autour d'une table ronde, un panel discute d'un sujet qui implique des enjeux en Abitibi-Témiscamingue.
Cette semaine, nous discutons de la pollution des industries en Abitibi-Témiscamingue.
Le panel de la semaine est : Guylaine Beauchemin, animatrice/productrice, Christian Péloquin, journaliste et Marc Nantel, porte-parole du regroupement Vigilance (Revimat).

Le travail d’entrepôt chez Amazon : un travail à hauts risques

Avec l'essor du commerce électronique, l'entreprise Amazon a connu une croissance continue de ses activités qui n'a pas ralenti avec la pandémie, bien au contraire. La multinationale a réussi à se positionner stratégiquement avec l'expansion du commerce en ligne. Cette croissance s'est évidemment accompagnée de l'ouverture de nombreux entrepôts et de centres de distribution partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord. La grande région de Montréal en accueille plusieurs, dans lesquels sont à l'œuvre des centaines de travailleuses et de travailleurs chaque jour. Non syndiqués, ces travailleuses et travailleurs, souvent à statut précaire, sont soumis à des conditions de travail physiquement très exigeantes qui entrainent leur lot d'accidents et de maladies du travail. Les pratiques productivistes de l'entreprise semblent en effet faire bien peu de cas de la santé et la sécurité du travail.
Printemps 2024 | tiré du journal de l'UTTAM
https://uttam.quebec/journal/journal_printemps_2024_no3.pdf
Comme nous le verrons dans ce dossier, la prospérité de cette multinationale est en bonne partie tributaire des conditions de travail calamiteuses qu'elle impose à ses employés et de certaines pratiques douteuses en santé et sécurité du travail. Nous nous pencherons d'abord sur les exigences du travail d'entrepôt dans cette entreprise et les risques auxquels sont exposés les travailleuses et travailleurs. Nous examinerons ensuite les tactiques qu' utilise pour entraver la reconnaissance des lésions professionnelles.
Le travail d'entrepôt : un travail pénible, exigeant et dangereux
Un récent projet de recherche, mené conjointement par le Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) et l'Association des travailleurs et travailleuses d'agence de placement (ATTAP) a brossé un portrait saisissant du travail dans le secteur de l'entreposage à Montréal.
Au terme d'une recherche-action centrée sur la réalité des travailleuses et travailleurs des entrepôts d'Amazon et de Dollarama, les chercheuses et chercheurs ont publié un rapport qui met en lumière de nombreux problèmes liés aux conditions de travail qui prévalent dans ces entreprises. Sorti en décembre dernier, ce rapport, intitulé « Mobiliser pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts : des travailleurs et travailleuses d'agences au taylorisme numérique », est disponible en ligne [1] . Notre dossier découle à la fois des infor mations qu'on retrouve dans le rapport de ce projet de recherche et de témoignages que des travailleuses et des travailleurs d'entrepôts d'Amazon ont confié à l'uttam.
Des tâches et horaires qui épuisent les travailleuses et travailleurs
Le travail d'entrepôt est connu pour être associé à un risque élevé de blessures et de troubles musculosquelettiques. Chez ?mazon, les tâches et les horaires éreintants participent au problème et augmentent les risques auxquels sont exposés les travailleuses et travailleurs. Au total, plus des deux tiers (69,7 %) des travailleuses et travailleurs d' ?mazon interrogés dans le cadre de la recherche du GIREPS ont d'ailleurs déclaré que les horaires de travail de l'entreprise nuisent à leur santé. [2]
La formule la plus répandue pour les horaires de travail en vigueur dans les entrepôts d'Amazon prévoit 4 journées de 10 heures par semaine (soit 2 quarts de travail de 5 heures chacun par jour pendant 4 jours), auxquelles s'ajoute une 5e journée de 10 heures dans les périodes de pointe (période des Fêtes, par exemple). Les travailleuses et travailleurs peuvent d'ailleurs être tenus, par contrat, de travailler les fins de semaine et les jours fériés, surtout dans les périodes de fort achalandage (comme les « Prime Day », par exemple). À ceci, s'ajoute du temps supplémentaire « volontaire », mais que les travailleuses et travailleurs ne se sentent souvent pas en position de refuser. Le travail s'exécute en étant continuellement debout et les temps de repos pendant un quart de travail sont minimaux.
De tels horaires, qui impliquent de longues heures consécutives de travail physique, sont éreintants. À mesure que les heures passent, les travailleuses et travailleurs ressentent de plus en plus de fatigue physique pendant la journée. Plusieurs rapportent ressentir de la fatigue chronique ou de l'épuisement, après quelques mois de travail, et les journées de congé s'avèrent généralement insuffisantes pour rattraper la fatigue accumulée. Il semble que ce soit particulièrement vrai pour les travailleuses et travailleurs qui font les quarts de travail de nuit. Ce sentiment de fatigue ou d'épuisement entraine une diminution de la vigilance qui implique un risque accru d'incidents pouvant causer une blessure et une augmentation de la vulnérabilité face aux troubles musculosquelettiques. Enfin, le sentiment d'épuisement rend les travailleuses et travailleurs plus sensibles au stress et aux détresses psychologiques. Plusieurs se plaignent de ne plus avoir d'énergie pour quoi que ce soit d'autre, après leurs longues heures de travail, qu'il s'agisse de participer à un programme de francisation, de s'occuper de tâches domestiques ou de passer du temps de qualité avec leur famille.
De multiples risques de blessure
Les travailleuses et travailleurs identifient plusieurs risques auxquels ils sont exposés au travail et qui ont un impact direct sur leur santé. Une majorité (51,7 %) des travailleuses et travailleurs d' ?mazon interrogés dans le cadre de la recherche déclare en effet que leur état de santé s'est effectivement détérioré à cause de leur emploi, après en moyenne 13 mois et demi de travail [3] . Les salariés rapportent de la fatigue ou de l'épuisement, des douleurs aux jambes, aux pieds, au dos, au cou et aux membres supérieurs, ainsi que de l'anxiété ou de la dépression et de nombreux autres problèmes de santé. Deux travailleuses ou travailleurs sur trois (66,6 %) estiment par ailleurs que ce n'est qu'une question de temps avant que des douleurs ou de la fatigue ne les forcent à s'absenter du travail ou à quitter leur emploi. [4]
Le travail d'entrepôt implique aussi beaucoup de manipulations de charges, parfois lourdes, et souvent répétées. Des colis manipulés en vitesse, parce que l'employeur exige du rendement, sont souvent saisis dans des postures non ergonomiques. Certaines charges dépassent les vingt kilos et leur manutention dans une mauvaise posture pose un risque élevé de blessure. À elle seule, la répétition des gestes et des manipulations finit par entrainer des douleurs musculosquelettiques pour une grande proportion des travailleuses et travailleurs.
Des travailleuses et des travailleurs se blessent aussi en circulant dans l'entrepôt quand les lieux sont encombrés, lors de chutes d'objets ou en étant frappés par un équipement mobile. Parfois, des doigts se coincent entre des équipements et des colis ou des blessures surviennent quand la main d'une travailleuse ou d'un travailleur est écrasée entre les rouleaux d'une machine. D'autres rapportent des événements liés à des produits potentiellement toxiques qui se sont accidentellement répandus dans l'air sans que l'employeur n'agisse pour assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs exposés. D'autres contraintes liées à l'environnement de travail, telles que la chaleur l'été, le froid en hiver et le bruit constant et élevé dans l'entrepôt, peuvent également causer des problèmes de santé.
La qualité de la formation offerte aux employés à la suite de leur embauche est très variable. Si elles permettent parfois d'enseigner de bonnes méthodes de travail, notamment pour la manutention, dans les périodes où l'entreprise procède à de très nombreuses embauches sur une courte période, les formations sont souvent expéditives. Les travailleuses et travailleurs qui intègrent un entrepôt après une formation déficiente courent un risque particulièrement élevé de se blesser.
Les pratiques productivistes chez Amazon
Les méthodes qu' ? Amazon utilise pour mesurer la productivité des travailleuses et des travailleurs, et exiger d'eux le maximum de rendement, contribuent aussi grandement aux risques à la santé et à la sécurité. Pour plusieurs postes de travail, dans plusieurs de ses entrepôts, l'entreprise établit des quotas à atteindre, tels qu'un nombre de colis à scanner à l'heure. Les travailleuses et travailleurs qui dépassent leurs objectifs gagnent des « points » qu'ils peuvent éventuellement échanger contre des produits corporatifs « Amazon » gratuits. Au contraire, ceux qui n'atteignent pas les objectifs reçoivent des avertissements et, éventuellement, des sanctions.
Ces systèmes de punitions et récompenses encouragent évidemment le travail à très grande vitesse et la réduction du temps de repos, ce qui augmente les risques pour les travailleuses et travailleurs.
Ce ne sont pas tous les postes de chaque entrepôt qui sont assujettis à de tels quotas. Pour certains postes, il est difficile de quantifier ainsi le rendement. Plusieurs machines imposent elles-mêmes un rythme de travail élevé. L'entreprise utilise aussi d'autres tactiques pour garantir la productivité maximale des salariés, en comptabilisant, par exemple, le temps passé aux toilettes ou le nombre de fois qu'une travailleuse ou un travailleur va boire de l'eau.
Toutes ces pratiques productivistes ne mettent pas seulement en danger la santé physique des employés, elles sont aussi une source importante de stress, selon ce que rapportent un grand nombre de travailleuses et de travailleurs, et contribuent à leur usure sur le plan psychologique.
Quand des travailleuses et travailleurs tentent d'exercer leurs droits à la prévention
Conscients des problèmes de santé et sécurité du travail chez Amazon, des travailleuses et travailleurs de l'entreprise ont tenté, au cours de la dernière année, d'exercer leurs droits dans l'espoir de faire changer les choses. Rappelons que depuis avril 2022, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que dans tous les milieux de travail de 20 salariés ou plus, un comité de santé et de sécurité du travail doit être formé et que des travailleuses et travailleurs doivent être élus par leurs pairs pour y siéger, tout comme une représentante ou représentant des salariés, disposant d'un temps de libération pour faire de la prévention.
Malheureusement, quand des travailleuses et des travailleurs d'entrepôts de la Grande région de Montréal ont tenté de former des comités de santé et de sécurité comme la loi le leur permet, Amazon leur a appris que de tels comités existaient déjà. Les travailleuses et travailleurs siégeant sur ces comités avaient en fait été choisis par l'employeur, sans élection. Quand des travailleuses et travailleurs ont exigé la tenue d'une assemblée pour élire leurs représentants, l'employeur a répliqué en organisant lui-même des élections, sans assemblée. Amazon a plutôt invité les salariés des entrepôts concernés à voter, par un moyen électronique, entre les candidates et candidats sélectionnés par l'entreprise elle-même, ignorant des travailleuses et travailleurs qui avaient manifesté leur intérêt.
Ces pratiques ne sont pas conformes à la loi, qui prévoit que ce sont les travailleuses et travailleurs, et non l'employeur, qui doivent choisir ou élire leurs représentants. Pour les salariés, il est impossible d'avoir confiance en des représentants sélectionnés par l'employeur selon des critères obscures, répondant aux besoins et intérêts de la compagnie.
Face à ces situations, des travailleuses et travailleurs se sont adressés à la CNÉSST, ce qui a conduit à des visites d'inspection de la Commission dans les entrepôts d'Amazon. Une toute récente recherche publiée par l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) [5] a recensé les rapports de ces interventions. Si ces visites ont parfois confirmé qu'Amazon n'avait pas permis la tenue d'assemblée et l'élection des représentantes et représentants en santé et sécurité du travail par les travailleuses et travailleurs, elles n'ont eu que peu de suivis et ont mené à peu de changements concrets jusqu'ici. Tout au plus, l'entreprise a parfois été avertie qu'il faudrait permettre aux travailleuses et travailleurs d'élire des représentants la prochaine fois pour remplacer ceux que la compagnie avait choisis.
Le jeu d'obstruction d'Amazon et la mise en échec des droits des travailleuses et travailleurs
Avec la pénibilité du travail chez Amazon et le peu de soucis de ce géant de l'entreposage pour la santé de ses travailleuses et travailleurs, les lésions professionnelles y sont monnaie courante. Cependant, ce qui ajoute l'insulte à l'injure, c'est qu'Amazon met en place des pratiques et des tactiques de mise en échec des réclamations à la CNÉSST de ses travailleuses et travailleurs et, lorsque cette mise en échec ne fonctionne pas, de judiciarisation du processus de réparation.
Les pratiques et les stratégies relatées ici sont des procédés que nous avons vus être mis en œuvre dans les dossiers de travailleuses et travailleurs que nous avons aidés. Ces pratiques surviennent assez régulièrement pour y voir une stratégie de la part d'Amazon, contrairement à des pratiques isolées. Nous exposerons donc ces pratiques dans l'espoir de préparer les travailleuses et travailleurs à les déjouer et ultimement regagner leurs droits aux soins, aux traitements et aux indemnités.
La stratégie AmCare
Qu'est-ce que AmCare ? Il s'agit du service d'infirmerie industrielle de la compagnie, Amazon Care. Au Québec, le « service » AmCare n'est pas présent dans tous les entrepôts, contrairement aux États-Unis où la pratique semble plus répandue. L'infirmerie a par ailleurs bien mauvaise presse aux États-Unis, avec raison [6]. Amazon y a été mise à l'amende à quelques reprises pour avoir omis de respecter ses obligations en vertu de la Occupational Safety and Health Act, une loi analogue à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. C'est notamment l'absence de déclaration dans leur registre des consultations auprès d'AmCare qui leur a valu des amendes [7]. Aux États-Unis, comme au Québec, il semble bien qu'AmCare serve le géant de la même façon : contourner les législations en vigueur et remettre les travailleuses et les travailleurs à la tâche le plus rapidement possible au détriment de leur santé.
Dans les dossiers des travailleuses et travailleurs aidés par l'uttam, l'effet le plus visible d'AmCare est le refus presque systématique des réclamations pour accident du travail. En effet, en misant sur leur position en tant que service d'infirmerie d'usine, le service AmCare prône un retour rapide sur le plancher des travailleuses et travailleurs qui les consultent pour des douleurs liées au travail, tout en négligeant de faire remplir des rapports d'incidents. En fait, AmCare mise à la fois sur sa position d'autorité et sur la méconnaissance des droits de ses travailleuses et travailleurs, afin de rendre toutes futures réclamations presque systématiquement rejetées par la CNÉSST.
Pour illustrer le propos, voici l'exemple d'une situation typique que nous avons vue se jouer dans les dossiers des travailleuses et travailleurs qui réclamaient à la CNÉSST à la suite d'un accident chez Amazon :
La travailleuse ressent une douleur au travail qui devient peu à peu intolérable. Elle informe son chef de ligne et ce dernier lui propose, en premier, un repos temporaire de quelques minutes, tout au plus, qui sera comptabilisé comme son temps de pause-café. Si à la fin de ce repos, la douleur est toujours présente, on lui suggère d'aller voir AmCare, accompagnée de son superviseur.
Chez Amcare, on la questionnera sur sa position de travail : a-t-elle bien suivi les consignes pour lever les boites ? A-t-elle fait les échauffements indiqués sur son écran ? N'avait-elle pas des douleurs avant de venir travailler ? Puis on finira la courte consultation en proposant deux choix : un retour à la maison qui sera comptabilisé comme une absence non-justifiée, considérant que les absences cumulées peuvent mener au congédiement, ou des tâches allégées pour le reste de la journée. On lui demande donc de choisir entre sa sécurité d'emploi ou sa santé. Évidemment, jamais il ne sera question de remplir un rapport d'incident. Ni AmCare, ni le superviseur n'en feront mention, et cela, même si la travailleuse indique que la douleur est bien survenue durant l'exécution de ses tâches et à son poste de travail. Le déroulement de la rencontre suggère, par ailleurs, très souvent que c'est la faute de la travailleuse si elle a mal, et cette culpabilisation fonctionne très bien ! Elle incite à ne pas en demander davantage, voire à être reconnaissante de l'accommodement offert si généreusement…
On procède à l'accommodement maison sans en conserver de trace. Jusqu'au moment où, plusieurs jours plus tard, Amazon demandera à la travailleuse, qui demande toujours des tâches allégées, d'aller faire remplir un document « d'accommodement pour une condition personnelle » chez un médecin.
Lors de ce rendez-vous, la travailleuse, qui expliquera à son médecin la situation, ressortira fort probablement, à juste titre, avec une attestation médicale et une date d'événement remontant à la première rencontre avec AmCare. Elle devra toutefois attendre son horaire habituel pour se rendre sur les lieux du travail, l'employeur étant inaccessible aux travailleuses et travailleurs non assignés à l'horaire en cours… mesure antisyndicale oblige ! Amazon recevra donc l'attestation médicale de la CNÉSST quelques jours après la consultation médicale et prétendra n'avoir jamais été informée de l'accident de la travailleuse avant la réception de cette attestation. Et le tour est joué pour Amazon.
En effet, entre le passage chez AmCare, consultation pour laquelle la travailleuse n'a aucune trace, et la remise de l'attestation médicale, il peut s'écouler 5-10-15, voire 20 jours. Pour la CNÉSST, ce délai de déclaration à l'employeur, et ce délai de consultation chez le médecin, justifient à eux seuls le refus quasi automatique de la réclamation d'accident. Même en présence d'une blessure survenue sur les lieux du travail et dans l'exécution des tâches, qui permettraient à la victime d'accident du travail de bénéficier de la présomption, la CNÉSST refusera la réclamation. Les déclarations verbales de la travailleuse ne valent pas beaucoup, comparativement à la négation mur à mur de l'employeur qui prétend « n'avoir jamais été informé de la situation ».
Amazon , une culture de crainte et de silence
La stratégie de l'employeur semble assez efficace, puisque le nombre de travailleuses et travailleurs d' ?mazon qui essuient des refus à la CNÉSST est très élevé. Tellement que le mot se passe dans les entrepôts de ne pas perdre son temps avec la CNÉSST ; qu'Amazon c'est trop gros, c'est trop fort. Et on les comprend…
Les efforts déployés par ?mazon pour empêcher la reconnaissance des lésions professionnelles, dès la première instance, amènent les travailleuses et travailleurs à entreprendre le chemin de croix du Tribunal. Pour les travailleuses et travailleurs d'Amazon, particulièrement celles et ceux qui ont des barrières linguistiques [8] , la montagne apparait insurmontable. Et c'est à ce moment qu'Amazon emploie sa deuxième stratégie pour mettre en échec les droits des travailleuses et travailleurs : la transaction. Si vous cherchez un jugement impliquant Amazon en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous n'en trouverez qu'un seul... qui refuse la réclamation d'un travailleur. C'est qu'Amazon règle tous ses litiges par transaction, souvent sans reconnaissance de la lésion et avec des clauses de confidentialité qui empêchent les victimes de parler de leurs expériences. L'entreprise achète le silence des travailleuses et travailleurs qu'elle rend malades. Et ça, c'est lorsqu'elle ne réussit pas à cultiver suffisamment de craintes pour les amener à simplement abandonner leurs recours.
L'aura de cette Amazon monstrueuse n'épargne pas non plus les travailleuses et travailleurs qui ont réussi à faire reconnaitre leurs lésions en déjouant la stratégie AmCare. Celles et ceux dont la lésion est reconnue directement par la CNÉSST recevront assurément l'acte introductif d'Amazon qui contestera leur réclamation au Tribunal. De plus, comme beaucoup d'employeurs le font, l'entreprise utilisera, au maximum de sa capacité, l'arsenal des droits que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour aider les patrons à rendre le parcours de réparation difficile : évaluations médicales à répétition, propositions d'assignation temporaire répétées... de quoi épuiser même les travailleuses et travailleurs les plus vigoureux. Et il y a aussi tous ses petits irritants soudains : avertissements disciplinaires sur la performance, messages répétés de risque de perte d'emploi à cause « d'absence non justifiée », cafouillage administratif créant des surpayés avec la CNÉSST, etc. C'est presque si, par hasard, la victime de lésion professionnelle était aussi victime de mauvaises gestions internes de l'entreprise…
Pour contrer Amazon : résistance et solidarité
Face à un employeur comme Amazon, les travailleuses et travailleurs doivent faire preuve de beaucoup de courage pour défendre leurs droits et revendiquer des changements. Pour résister contre une telle multinationale, motivée par la soif de profits et disposant d'énormes moyens pour écraser les salariés, les travailleuses et travailleurs ne peuvent opposer que leur solidarité et leur détermination.
C'est ce que commencent à faire plusieurs travailleuses et travailleurs de l'entreprise, qui prennent des risques pour revendiquer des changements. On ne peut qu'admirer le courage de ces non syndiqués qui défendent leurs droits en santé et en sécurité tout en sachant qu'ils s'exposent à des représailles, alors qu'ils sont souvent dans des situations précaires. Soulignons aussi la détermination des victimes de lésions professionnelles qui, malgré les obstacles, défendent leurs droits face à ce géant et ne reculent pas devant des batailles de David contre Goliath au Tribunal.
Souhaitons que la persévérance et la solidarité de ces travailleuses et travailleurs finissent par triompher de l'insouciance d'Amazon pour la santé de ses employés et de son mépris pour leurs droits.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Mobiliser pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts : des travailleurs et travailleuses d'agences au taylorisme numérique, https://iwc-cti.ca/wp-content/ uploads/2023/12/Rapport-Entrepot-version-web-finale-3.pdf.
[2] Ibid., p. 29.
[3] Ibid., p. 31.
[4] Ibid.
[5] Santé et sécurité au travail – Le déficit de participation dans les milieux non syndiqués au Québec, Mathieu Charbonneau, IRIS, étude publiée le 29 février 2024 et disponible en ligne à l'adresse https://iris-recherche.qc.ca/ publications/droits-travail-non-syndique/.
[6] Voir par exemple : WIRED, How Amazon's In-House First Aid Clinics Push Injured Employees to Keep Working, 2019, https://www.wired.com/story/amazons-first-aid-clinics-pushinjured-employees-to-keep-working/ ou Irene Tung et all, Injuries, Dead-End Jobs, And Racial Inequity In Amazon's Minnesota Operations, National Employment Law Project, décembre 2021, https://www.nelp.org/wp-content/uploads/ Report-Injuries-Dead-End-Jobs-and-Racial-Inequity-inAmazons-Minnesota-Operations-.pdf.
[7] Exemple d'un constat d'infraction : https:// www.osha.gov/ords/imis/establishment.violation_ detail ?id=1611567.015&citation_id=01001.
[8] Voir Mobiliser pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts : des travailleurs et travailleuses d'agences au taylorisme, qui relève l'importante présence de travailleuses et travailleurs issus de l'immigration dans les entrepôts d'Amazon.

À propos du travail et des pratiques militantes du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants (CTI)

Voici comment le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) définit sa mession. "Le CTI défend les droits du travail des immigrants et se bat pour la dignité, le respect et la justice. Voici quelques-uns de nos principaux objectifs :
- L'éducation populaire sur les droits des travailleurs
- L'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs immigrants
- Mobilisation autour des questions liées au lieu de travail (accidents du travail, harcèlement, salaires ou heures supplémentaires non payées, congés de maternité, etc.)
- Fournir un espace sécuritaire aux travailleurs immigrants pour recevoir des informations, des ressources et des recommandations en toute confidentialité."
L'entrevue réalisée par Martin Gallié permet de voir comment cette mission se réalise concrètement comme un combat de tous les jours.
Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (IWC-CTTI) est un espace de luttes à protéger et à promouvoir. C'est tout particulièrement le cas dans un contexte marqué par la montée du racisme, où la droite et l'extrême droite québécoise, relayées par une partie de la gauche, ne cessent de cibler les étrangers et les étrangères comme responsables de tous les maux de la société québécoise, que ce soit le délabrement du système de santé, le sous financement des services sociaux ou les coûts des loyers.
Manuel Salamanca Cardona, travailleur et militant de longue date au sein du CTTI revient dans cet entretien sur les luttes, les revendications et les activités du centre. Il décrit les conditions de travail et de vie des travailleurs et des travailleuses migrant.es, leur exploitation éhontée dans tous les secteurs d'activités mais tout particulièrement dans les métiers sous-payés et les plus pénibles (ouvriers agricoles, préposées aux bénéficiaires, restauration, manutentionnaires dans les entrepôts d'Amazon ou de Dollarama etc.) ; et cela, partout au Québec. Il raconte également comment ces travailleurs et ces travailleuses, - que tout le Québec appelait il n'y a pas si longtemps « nos anges gardiens » - sont privé.es des droits civils et politiques et du travail les plus élémentaires, légalement ou de facto, leurs isolement et l'absence de toute protection syndicale dans la plupart des cas.
Manuel insiste enfin sur la combativité, les luttes actuelles et l'urgence impérieuse de construire des solidarités concrètes, sur le terrain, pour faire face à la montée du racisme et lutter contre un système qui ne profite en pratique qu'è une toute minorité.
Version audio de l'entrevue :
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada doit suspendre le commerce d’armes avec Israël

Alors que les bombardements israéliens, qui ont déjà entraîné un nombre alarmant de morts civiles, se poursuivent dans la bande de Gaza, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), et le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP) demandent au gouvernement canadien de suspendre immédiatement le commerce d'armes et d'équipement militaire avec Israël.
10 avril 2024 | tiré de l'Aut'journal
Plus de 30 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués à la suite des bombardements dans la bande de Gaza effectués par Israël en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Rappelons que lors de cette attaque, environ 1 200 personnes, dont une majorité de civils innocents, ont été tuées et plus de 200 personnes, dont des enfants, ont été prises en otage. On estime que 100 personnes sont toujours en captivité, et leurs familles ainsi que leurs communautés en souffrent. Un cessez-le-feu s'impose de toute urgence afin de permettre aux otages israéliens de retourner à la maison en toute sécurité et de mettre fin à la dévastation et aux morts à Gaza.
La majorité des Palestiniennes et Palestiniens tués par des frappes aériennes israéliennes à Gaza sont des civils. Constat alarmant : environ le tiers sont des enfants. Des dizaines de milliers de Palestiniennes et de Palestiniens ont été blessés et environ deux millions de personnes ont été déplacées. De plus en plus d'information circule sur la pénurie d'aide humanitaire et sur les problèmes de famine et de santé qui touchent la population. On rapporte également de troublantes attaques contre des civils et des infrastructures, dont des établissements de soins de santé. Maintenant, l'armée israélienne menace de mener une offensive terrestre à Rafah. Pourtant, c'est vers Rafah qu'on a dirigé plus d'un million de Palestiniennes et de Palestiniens fuyant les frappes aériennes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza.
Le Canada exporte de l'équipement militaire en Israël, entre autres via les États-Unis. Ce faisant, il risque de se rendre complice de la violence et des violations des droits de la personne qu'Israël commet à Gaza. Le Canada importe également de l'équipement militaire d'Israël, ce qui, selon des groupes antiguerre, soutient l'industrie et les opérations militaires d'Israël.
En plus des appels urgents pour un cessez-le-feu permanent et une aide humanitaire, de plus en plus de syndicats, de membres de la société civile, d'organisations humanitaires et de dirigeant(e)s élu(e)s de partout dans le monde appellent à un embargo sur la vente d'armes à Israël afin d'aider à mettre fin à la terrible violence dans la bande de Gaza.
D'autres pays, dont la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, ont suspendu les transferts d'armes vers Israël. Les experts des droits de la personne des Nations Unies (en anglais seulement) ont sonné l'alarme, avertissant que l'envoi à Israël d'armes, de munitions et de pièces qui seraient utilisées dans la bande de Gaza constitue probablement une violation du droit humanitaire international. En vertu de traités internationaux, des pays – dont le Canada – ont l'obligation légale de s'abstenir d'envoyer des armes, des munitions ou des pièces si on croit qu'elles seront utilisées pour violer le droit international. Les gouvernements doivent également rejeter les demandes de permis d'exportation d'armes qui pourraient être utilisées pour commettre des actes de violence à l'égard de femmes et d'enfants.
La récente décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a confirmé un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza et ordonné à Israël de prévenir des actes de génocide, amplifie l'importance et l'urgence de respecter nos obligations. En tant que signataire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Canada doit se conformer à la décision de la CIJ et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir un génocide dans un autre pays.
Des données récentes obtenues par The Maple (en anglais seulement) concluaient que le gouvernement canadien avait approuvé des exportations militaires vers Israël d'une valeur de 28,5 millions de dollars entre octobre et décembre 2023.
Au mois de mars, à la suite de la motion non contraignante présentée à la Chambre des communes, le gouvernement canadien s'est engagé à cesser d'approuver les demandes de permis d'exportation d'armes vers Israël. Il s'agit d'une première étape importante vers un embargo complet sur les armes.
Nous exhortons le gouvernement canadien à suspendre immédiatement le commerce d'armes et d'équipement militaire avec Israël, conformément aux obligations légales du Canada. Le Canada doit imposer un embargo sur les armes afin d'aider à mettre fin aux horreurs qui se produisent à Gaza.
En outre, nous réitérons nos appels pour que le gouvernement canadien :
• soutienne activement un cessez-le-feu immédiat et permanent ;
• demande le retour sécuritaire des civils gardés en otage par le Hamas ;
• exhorte fortement le gouvernement d'Israël à se conformer à la décision de la CIJ afin de prévenir des actes de génocide à Gaza, et à empêcher et punir toute incitation directe et publique à commettre un génocide ;
• assure la distribution sécuritaire de l'aide humanitaire à Gaza, et rétablisse notamment son financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ;
• demande la fin de l'occupation du territoire palestinien comme étape cruciale pour une paix juste et durable dans la région.
Nous espérons que ces mesures aideront à soutenir des solutions politiques à long terme afin d'assurer la paix et la sécurité pour les peuples de Palestine et d'Israël, ainsi que pour tous les gens de la région.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« L’État de Palestine » entre liquidation de la cause et poursuite de la lutte

Face à la catastrophe actuelle qui dépasse la Nakba de 1948 en horreur, atrocité, létalité, destruction et déplacement de population, « l'Autorité palestinienne » a lancé depuis Ramallah une nouvelle requête au Conseil de sécurité des Nations Unies pour sa reconnaissance comme État membre de l'organisation internationale au même titre que les autres États membres. (Traduit de l'arabe.)
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Tiré de Blog médiapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/090424/l-etat-de-palestine-entre-liquidation-de-la-cause-et-poursuite-de-la-lutte
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
La condition palestinienne s'est détériorée au-delà de tout ce qu'elle a connu en plus de 75 ans de souffrance et d'oppression, depuis que le mouvement sioniste s'est emparé de la majeure partie des terres de Palestine entre le fleuve et la mer et a achevé d'occuper ce qui restait moins de vingt ans après. Face à la catastrophe actuelle qui dépasse la Nakba de 1948 en horreur, atrocité, létalité, destruction et déplacement de population, « l'Autorité palestinienne » (AP) a lancé depuis Ramallah une initiative censée compenser les souffrances du peuple palestinien, à savoir une nouvelle requête au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la reconnaissance de l'AP de Ramallah comme État membre de l'organisation internationale au même titre que les autres États membres.
Réjouis toi, peuple de Palestine. Tes énormes souffrances n'ont pas été en vain. Elles sont même sur le point de franchir un grand pas sur la voie d'une « solution » à ta cause, cette même « solution » (ici dans le sens de liquidation) à propos de laquelle Joe Biden – le partenaire du gouvernement sioniste dans la guerre génocidaire en cours sur la terre de Palestine – a affirmé, dès les premiers jours de la campagne effrénée lancée il y a plus de six mois, qu'il devenait urgent d'éteindre le volcan palestinien qui continue d'entrer en éruption inévitablement et par intermittence, mais à un rythme accéléré au cours des dernières années. La vérité est que Biden, à son retour à la Maison Blanche en tant que président, a cherché avant tout un « succès » politique facile au Moyen-Orient en s'efforçant d'amener le royaume saoudien à monter dans le train de la « normalisation avec Israël », que son prédécesseur, Donald Trump, avait engagé sur une nouvelle voie avec les Accords d'Abraham conclus avec la complicité des Émirats arabes unis.
Biden s'était rendu compte qu'essayer de faire avancer la soi-disant « solution à deux États » l'amènerait à une confrontation avec son « cher ami » Benjamin Netanyahu. Il choisit d'éviter cela pour des raisons opportunistes et en raison de sa passion pour le sionisme, auquel il a ouvertement déclaré un jour son adhésion personnelle. Les efforts de son administration se sont donc concentrés sur la voie de la « normalisation », négligeant celle de la « solution » jusqu'à ce que le volcan explosât à nouveau avec l'opération lancée par le Hamas et la guerre d'anéantissement menée par Israël qui s'en est suivie, sans précédent en folie et intensité de destruction depuis au moins un demi-siècle, non seulement au Moyen-Orient mais dans le monde entier. La « solution » (liquidation) est donc revenue sur la table, et le président américain a appelé à la « revitalisation » de l'AP de Ramallah. Cette dernière s'y est vite conformée, interprétant la demande à sa guise, non pas comme le remplacement par des élections démocratiques de son chef vieillissant et dépourvu de toute légitimité, mais plutôt comme le remplacement de son premier ministre par un autre aux ambitions politiques moindres, d'une manière qui n'a trompé personne.
L'AP s'est ainsi enhardie à exiger officiellement qu'on lui accorde un siège de membre ordinaire à l'ONU, au lieu de la seule décision qui aurait pu la racheter devant l'histoire, qui aurait été de déclarer la désobéissance civile à Israël de son « autorité », dépourvue de toute autorité sauf pour servir les objectifs de l'occupation et qui regarde, impuissante, non seulement l'anéantissement de Gaza, mais aussi le génocide rampant en cours en Cisjordanie même. Et s'il leur était impossible de mettre fin à leurs relations avec l'État sioniste, il aurait mieux valu pour eux d'annoncer la dissolution de leur « autorité » plutôt que de continuer à participer à la liquidation de la cause de leur peuple. Car s'ils sont aujourd'hui plus près que jamais d'obtenir le siège souhaité, ce n'est pas grâce à leurs prouesses diplomatiques, mais seulement parce qu'accorder à « l'État de Palestine » l'adhésion à part entière à l'ONU est devenu le moyen le moins coûteux pour les gouvernements occidentaux de prétendre contrebalancer quelque peu leur soutien inconditionnel à la guerre génocidaire en cours, qui a trop duré et s'est aggravée en horreur, jusqu'à l'actuel usage de la famine comme arme de guerre.
La Grande-Bretagne elle-même, par la bouche de son ministre des affaires étrangères et ancien premier ministre, a annoncé sa disposition à envisager de reconnaître « l'État » de l'AP, tandis que d'autres pays européens, dont l'Espagne suivi par la France, ont commencé à se préparer à une reconnaissance similaire. Il convient de noter que le même gouvernement britannique qui exprime sa disposition à cette reconnaissance, rejette l'appel lancé par des experts juridiques britanniques officiels et non officiels à cesser de fournir des armes à l'État d'Israël, car cela constitue une violation du droit international en partageant la responsabilité d'une guerre qui viole les règles les plus fondamentales de ce droit en matière de conduite des guerres. Il est donc devenu certain que les efforts visant à accorder à l'AP un siège régulier à l'ONU ne seront pas bloqués par un veto français ou britannique, de sorte que la seule question qui reste en suspens est de savoir ce que fera l'administration américaine. Elle a été la première à appeler à la création d'un « État palestinien », mais elle ne veut pas rompre complètement ses relations avec Netanyahu, ni d'ailleurs avec la majeure partie de l'establishment sioniste qui s'oppose à une telle démarche. Elle craint également de renforcer la position de Netanyahu en le présentant comme défenseur obstiné des intérêts sionistes face à toutes les pressions, y compris celles du grand frère et complice dans le crime. L'administration Biden pourrait donc à nouveau recourir à l'abstention sous un prétexte quelconque, avec une grande lâcheté.
Quant au résultat, il sera comme la montagne qui a accouché d'une souris, car accorder à la « Palestine » (c'est-à-dire près de dix pour cent de son territoire historique) un siège ordinaire à l'ONU n'est rien de plus qu'une souris en comparaison de l'immense montagne d'épreuves que le peuple palestinien a endurées et qu'il endure encore. Quelle valeur accorder, en effet, à un État fondé sur des territoires fragmentés sous le contrôle total de l'État sioniste, de telle sorte que sa prétendue souveraineté serait d'un type qui lui ferait envier les bantoustans créés dans le passé par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud ?
Le seul progrès qui pourrait être réalisé par une reconnaissance internationale de l'État de Palestine serait que la première déclaration de cet État après sa reconnaissance inclue une insistance sur la cessation immédiate de l'agression en cours, un appel à imposer des réparations à l'État sioniste pour les crimes qu'il a commis, l'exigence que tous les détenus palestiniens soient libérés et que toutes les forces armées et colons sionistes soient retirés de tous les territoires occupés en 1967, y compris la Jérusalem arabe. Cela devrait être combiné avec un appel à la communauté internationale pour permettre le retour de tous les réfugiés palestiniens qui le souhaitent, et leur hébergement dans les colonies après l'évacuation des colons sionistes, tout comme les pionniers sionistes se sont installés dans les villes et villages palestiniens dont ils se sont emparés à la suite de la Nakba de 1948 après les avoir vidés de leurs habitants d'origine. Seule une telle position pourrait faire de la reconnaissance internationale de l'État de Palestine une étape dans la lutte au long cours contre le sionisme, au lieu d'être un pas vers la liquidation de la cause palestinienne.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 9 avril en ligne et dans le numéro imprimé du 10 avril. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













