Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Pour une politique écoféministe d’Ariel Salleh,...

Pour une politique écoféministe d'Ariel Salleh, on vous propose de découvrir la préfacière et la postfacière de l'oeuvre - respectivement Vandana Shiva et Jeanne Burgart Goutal - qui apportent chacune une mise en relief pertinente et actuelle de ce classique de la pensée écoféministe.
L'écoféminisme, mot apparu en 1974 sous la plume de Françoise d'Eaubonne en France, est un concept pluriel qui s'est coconstruit de manière simultanée à plusieurs endroits du globe : en Allemagne avec Maria Mies et Veronika Bennholdt-Thomsen, en Inde avec Vandana Shiva, aux États-Unis avec Rachel Carson et Carolyn Merchant ou encore au Kenya avec Wangari Muta Maathai. Cette diversité des approches en fait un mouvement riche, nourri de plusieurs vécus, et nous sommes fier·es de pouvoir offrir au lectorat français l'angle de l'australienne Ariel Salleh. Pour elle, l'écoféminisme est la préfiguration d'une synthèse politique regroupant 4 révolutions aux problématiques communes : écologie, féminisme, socialisme et post-colonialisme.
VANDANA SHIVA
« Ce livre rassemble d'indispensables éclairages pour passer du paradigme de la mondialisation patriarcale capitaliste à un monde de non-violence – dans nos esprits et dans nos vies. »
Née en 1952, Vandana Shiva est une physicienne, militante écologiste et écoféministe indienne d'influence mondiale. Elle dirige la Fondation de recherche pour la science, la technologie et l'écologie, et a fondé l'ONG Navdanya destinée au développement de l'agriculture biologique. Elle a écrit plus de 20 livres, dont Restons vivantes : femmes, écologie et lutte pour la survie (2022, Rue de l'échiquier), et Monocultures de l'esprit (Wildproject, 2022). En 1993, elle reçoit le prix Nobel alternatif « pour avoir placé les femmes et l'écologie au coeur du discours sur le développement moderne ».
JEANNE BURGART GOUTAL
Agrégée de philosophie et professeure de yoga, Jeanne Burgart Goutal mène depuis près de dix ans une recherche sur l'écoféminisme, mêlant approche théorique et vécue. Elle est notamment l'autrice du livre Être écoféministe. Théories et pratiques (L'Échappée, 2020, prix de la Fondation de l'écologie politique) et d'un roman graphique, Resisters (Tana, 2021).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L’antagonisme fédéralisme indépendance : bientôt un nouveau rebond ?
On peut se poser la question au vu des événements des dernières semaines. Tout d'abord le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon (PSPP) a étoffé son discours et a remis la question du statut du Québec (en fait celle de la souveraineté) à l'ordre du jours au cours de son vigoureux discours d'il y a trois semaines. Il a même promis de tenir un troisième référendum sur la souveraineté si le parti qu'il dirige accédait au pouvoir. Mais surtout, ce qui inspire le plus les cadres et responsables, c'est qu'il connaît une remontée que même les observateurs les plus perspicaces et les indépendantistes les plus enthousiastes ne pouvaient prévoir voici à peine quelques années encore.
Par ailleurs, la tranquille assurance (que certains qualifieraient d'arrogance) des libéraux fédéraux commence à s'en trouver fissurée. On ne se rend pas toujours assez compte que depuis l'échec du référendum d'octobre 1995, le point du vue trudeauiste sur le Canada a triomphé. Même si Justin Trudeau n'a conquis le pouvoir qu'en 2015, il a consolidé encore davantage les vues de son défunt père dans la capitale fédérale. Pierre Élliott Trudeau (PET) a laissé un héritage intellectuel anti-nationaliste québécois qui a marqué à divers degrés l'ensemble de la classe politique à Ottawa, sauf le Bloc québécois bien entendu et ce, en dépit de la vaine et modeste tentative des conservateurs de Brian Mulroney (fin de la décennie 1980 et début de la suivante) de "réintégrer dans l'honneur et l'enthousiasme" le Québec au sein de ce qui est erronément nommé la "Constitution" canadienne, en vigueur depuis 1982.
Un exemple caricatural : le proclamation à tout vent de Justin Trudeau que le Canada est un "État post-national". Il rejoint et prolonge ainsi l'idéologie multiculturaliste de son père pour qui le Canada était pour l'essentiel formé d'un ensemble de minorités, dont la plus importante sur le plan numérique est celle des "Canadiens-français". Cette position intransigeante niait la théorie des deux nations sur laquelle s'appuyait le mouvement souverainiste.
Lors d'un débat durant les années 1970, à Trudeau qui défendait bec et ongles son opinion, le syndicaliste Michel Chartrand avait répondu, cinglant :
"Ici, c'est un pays, pas une aérogare".
Les premiers ministres québécois qui se sont succédé, depuis Lucien Bouchard (1996-2001) et Bernard Landry (2001-2003), ont tous adopté une attitude "low profile" sur la question des revendications constitutionnelles du Québec, sauf Pauline Marois (septembre 2012-avril 2014), mais son bref passage à la tête du gouvernement ne lui a guère permis de laisser une empreinte profonde sur cette dimension de notre existence collective. Paul Saint-Pierre Plamondon partait donc de loin et de creux lorsqu'il a pris la direction du PQ le 9 octobre 2020 avec un ferme discours souverainiste.. Au scrutin de 2022, bien des analystes politiques donnaient le parti fondé par René Lévesque pour moribond. Or, de 9% d'intentions de vote au déclenchement de la campagne électorale, le Parti québécois a presque rejoint Québec solidaire en terminant la course électorale à 14%. Au dernier sondage en date, il a grimpé à 34%, Québec solidaire devant se contenter de 18%.
Pour la première fois depuis belle lurette, le multiculturalisme "canadian" et sa version canadienne-française sont attaqués de front et on recommence à parler sans complexe de la nation québécoise et de son droit à l'autodétermination.
Pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés en 1995, il s'agit d'une découverte. Se rallieront-ils à l'indépendance comme ce fut le cas pour une bonne partie de leurs aînés ? Ça reste à voir, mais le mouvement indépendantiste paraît relancé.
Québec solidaire, lui, affiche sa souveraineté plus qu'avant afin de ne pas abandonner le terrain souverainiste au Parti québécois. Mais outre que les motifs initiaux de sa fondation en 2006 sont d'ordre socio-économiques (lutter contre le rétrolibéralisme) plus que nationalistes, en termes d'intentions de vote le Parti québécois devance nettement le parti de la gauche sociale depuis 2023. Il poursuit sa remontée. La formation de Paul Saint-Pierre Plamondon a pris du galon alors que son rival solidaire piétine et peine à élargir sa base électorale. Il partage aussi avec les libéraux quelques éléments du multiculturalisme. Son opposition à la loi 21 en constitue la plus éloquente démonstration.
Il faut souligner toutefois qu'indépendantisme ne rime pas avec xénophobie. Les membres de ce courant reconnaissent qu'il existe deux nations (trois avec les Amérindiens et Amérindiennes). Les nouveaux venus (les néo-Québécois) sont invités à s'intégrer à la nation québécoise, même s'ils peuvent conserver certaines de leurs moeurs et croyances, ce qui n'a rien de commun avec le multiculturalisme à la Trudeau. L'intégration complète à la société d'accueil se fait en général à la seconde génération dont les membres sont nés ici ou sont arrivés très jeunes chez nous.
Le "trudeauisme" est une imposture que la moindre étude sociologique réduit en miettes.
Parlera-t-on bientôt d'un "régime post-libéral" à Ottawa ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment les femmes au Pakistan luttent contre les disparitions forcées et les assassinats

Alors que des centaines de personnes ont investi les rues de Karachi, la plus grande ville du Pakistan, le 12 janvier, une marée de manifestant·es, majoritairement des femmes, a continué à scander « le Balochistan demande justice », même face à une forte présence policière.
tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/17/comment-les-femmes-au-pakistan-luttent-contre-les-disparitions-forcees-et-les-assassinats/
Pendant ce temps, dans la province agitée mais magnifique du Baloutchistan, au sud-ouest du pays, des milliers d'autres personnes ont envahi les rues. Leur manifestation contre les disparitions forcées et lesexécutions extrajudiciaires dans leur province n'est que la dernière mobilisation d'un mouvement qui a connu une croissance exponentielle au cours du mois dernier.
Suite à l'assassinat de Balaach Mola Baksh, 22 ans, en novembre, des centaines de femmes – accompagnées de certains de leurs enfants – ont entamé une marche d'environ 1 600 kilomètres depuis sa ville natale de Turbat à Islamabad le 6 décembre. Arrivées dans la capitale du Pakistan, elles ont installé un camp devant le Club National de la Presse.
Depuis près d'un mois, ces manifestantes – issues de près de 300 familles dont les proches sont victimes de disparitions forcées et d'assassinats – vivent dans des tentes en tissu et en bâche, alors même que les températures approchent du gel. Avec l'apparition de nouvelles manifestations dans tout le pays et l'intérêt croissant des défenseur·ses des droits humainsdu monde entier, ce mouvement dirigé par des femmes montre sa force face à la répression gouvernementale inflexible.
« Ils l'ont tué »
« Quand je suis allée voir son corps, les agents m'ont dit de l'enterrer, mais j'ai répondu « Non, je veux justice » », a expliqué Najma Baloch par téléphone depuis le sit-in d'Islamabad. « Ce n'est pas seulement mon frère, c'est le frère de tout le peuple baloutche. »
Balaach a été enlevé par des hommes en civil chez lui à Turbat à 1h du matin le 30 octobre. La famille pense que ces hommes – arrivés dans un convoi de huit voitures – faisaient partie du Département de lutte Contre le Terrorisme du Pakistan (CTD).
« Quand il est rentré du travail ce soir-là, on n'aurait jamais pu imaginer le perdre quelques heures plus tard », a déclaré Najma à propos de son frère, qui travaillait comme brodeur dans un magasin d'artisanat.
« Ma mère a dit que les tyrans l'avaient pris », a poursuivi Najma. Mais lorsqu'ils ont contacté la police, on leur a dit que Balaach n'était pas sous leur garde. « J'ai dit « Alors où est-il ? La terre l'a-t-elle englouti, ou le ciel l'a-t-il avalé ? » »
Ce n'est que près d'un mois plus tard, le 21 novembre, que Balaach est apparu au tribunal, où il a été placé en détention provisoire du CTD pendant 10 jours.
« Quand on l'a vu au tribunal, ma mère et moi l'avons serré dans nos bras », a déclaré Najma. « Nous étions tellement heureux pour ma mère, c'était comme s'il renaissait. Deux jours plus tard, ils l'ont tué. »
Le 24 novembre, le CTD a publié une déclaration affirmant que Balaach avait avoué être impliqué dans une « opération terroriste », leur fournissant des informations qui ont conduit le CTD à la cachette de ses associés. Arrivés sur place, selon le communiqué, un « échange de tirs » a eu lieu et quatre corps sans vie ont été retrouvés, dont celui de Balaach.
« Ils ont dit qu'il était mort dans une embuscade, mais on l'a vu au tribunal – alors comment aurait-il pu mourir dans une rencontre ? C'était une fausse rencontre… ils l'ont tué », a déclaré Najma. « Je suis complètement dévastée. »
Najma a décrit Balaach comme un frère et un fils aimant. « Il a toujours pris soin de notre mère. Il était encore si jeune, et il n'était pas impliqué dans ce qu'ils racontent. Il n'a jamais été impliqué avec quelqu'un de mauvais, il était complètement innocent. »
Alors que le CTD nie les accusations d'enlèvement et de meurtre, il insiste également sur le fait que Balaach n'a été arrêté que le 20 novembre – la veille de sa présentation au tribunal – et non le 29 octobre, lorsqu'il a été enlevé de son domicile. Pour les militant·es, ce n'est qu'une preuve supplémentaire que Balaach est devenu l'un des milliers de personnes au Baloutchistan à avoir subi une disparition forcée et une exécution extrajudiciaire.
Un mouvement est né
Lorsque la famille de Najma a reçu le corps sans vie de Balaach, elle a refusé de l'enterrer pendant sept jours, s'asseyant en signe de protestation devant leur maison avec son corps. Les habitant·es de Turbat ont rejoint la manifestation, et c'est ainsi qu'a commencé la vague de protestations dont le Pakistan est aujourd'hui témoin.
Des centaines de femmes comme Najma se mobilisent pour exiger le retour de leurs proches disparus de force depuis des années, parfois depuis plus d'une décennie, et enlevés de leurs maisons de la même manière que Balaach. Ces femmes ont continué à protester malgré l'opposition farouche des forces de police.
Lors du rassemblement du 12 janvier à Karachi, la police a publié un rapport d'incident accusant les manifestant·es d'émeute, de trouble à l'ordre public, de rassemblement illégal et d'incitation à la discorde. Si les manifestant·es sont reconnu·es coupables de ces infractions, ils et elles risquent une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans, une amende, ou les deux.
Malgré l'intimidation, les manifestant·es sont resté·es jusqu'à la tombée de la nuit, allumant les torches de leurs téléphones tout en scandant « Nous soutenons Mahrang Baloch » – en référence à l'une des leaders du mouvement contre les disparitions forcées. Elle n'avait que 10 ans lorsque son père a été enlevé pour la première fois par les forces de sécurité en2006. Il a été libéré trois ans plus tard, pour être à nouveau enlevé sept mois après. Deux ans plus tard, son corps mutilé a été retrouvé.
Si son visage est devenu synonyme du mouvement, l'histoire de Mahrang n'est pas unique. L'association Voix des personnes baloutches disparues affirme avoir enregistré 8 000 cas de disparitions forcées depuis 2013, conformément à la méthode recommandée par l'ONU pour l'enregistrement de tels incidents.
« Les disparitions forcées sont utilisées comme un outil de terreur pour intimider les gens ordinaires », a déclaré Mahrang, « pour écraser leurs mouvements politiques, pour exploiter les ressources du Baloutchistan et pour soumettre le Baloutchistan au contrôle du Pakistan, à la manière d'un régime colonial ».
How Balochistan got here
En 1948, le Baloutchistan a été annexé par le Pakistan, offrant au pays l'une de ses plus importantes réserves de gaz naturel. Ces dernières années, son port de Gwadar, situé sur la mer d'Arabie, est devenu unmaillon crucialdu corridor économique Chine-Pakistan — permettant au Pakistan d'étendre ses corridors commerciaux et à la Chine de contourner le détroit de Malacca patrouillé par les États-Unis et d'accéder au Moyen-Orient.
Malgré l'importance du Baloutchistan pour le Pakistan, beaucoup d'habitant·es estiment que le territoire n'aurait jamais dû être annexé. Certains groupes séparatistes – l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA) et le Front de libération du Baloutchistan (BLF) – continuent de lutter pour cette cause.
Selon le journaliste et analyste politique baloutche chevronné Malik Siraj Akbar, le gouvernement pakistanais a toujours craint que le Baloutchistan ne devienne un autre Bangladesh, qui était autrefois le Pakistan Oriental et est devenu indépendant en 1971, après une guerre de libération sanglante. M. Akbar estime que c'est cette peur – le besoin de réprimer toute dissidence et de maintenir le contrôle des ressources naturelles du Baloutchistan – qui explique les politiques répressives de l'État.
« L'armée pakistanaise détient de facto le pouvoir », a-t-il déclaré. « Elle contrôle tout », surtout depuis le 11 septembre [2001], lorsque le Pakistan a reçu de nombreux fonds antiterroristes, ce qui a permis la modernisation de l'armée et le maintien du Baloutchistan « sous contrôle ».
En 2006, les forces de sécurité pakistanaises ont tué Akbar Bugti, ancien Premier Ministre et leader séparatiste populaire du Baloutchistan. Cet événement est décrit par Akbar comme le « 11 septembre » du Baloutchistan. « Tout a changé », a déclaré Akbar. « Lorsque Bugti est mort, les habitants du Baloutchistan ont commencé à se demander ce qui leur arriverait si quelqu'un comme Bugti, un ancien premier ministre, pouvait être tué ». Après sa mort, les groupes séparatistes du Baloutchistan ont répliqué en attaquant les infrastructures pakistanaises, et l'armée pakistanaise a répondu en procédant à de nouvelles disparitions forcées.
« Cela a marqué le début de la politique connue sous le nom de « tuer et jeter » » a expliqué Akbar, faisant référence au type de disparitions et d'assassinats que Balaach et des centaines d'autres ont subis. La position officielle du Pakistan, cependant, est qu'il s'agit simplement d'un élément de sa lutte contre les acteurs anti-étatiques. Même l'actuel Premier ministre par intérim, Anwaar-ul-Haq Kakar, originaire du Baloutchistan, s'est prononcé contre les récentes manifestations, qualifiant les femmes et leurs familles de « fausses héroïnes des droits humains » et leur demandant « d'aller rejoindre le BLF ou le BLA pour que l'État sache de quel côté elles sont ».
Au cours de la semaine dernière, le Baloutchistan s'est retrouvé au cœur des attaques aériennesentre l'Iran et le Pakistan. Au milieu de ces échanges, l'Iran a lancé ce qu'il a appelé une « action préventive » contre le groupe militant sunnite musulman Jaish al-Adl, tandis que le Pakistan a frappé des cachettes qu'il présumait utilisées par le BLF et le BLA. Les trois groupes visés sont d'origine ethnique baloutche, mais selon les manifestants, ce sont des civils, et non pas des terroristes, qui ont été tués lors des attaques.
Comme l'a fait remarquer Sammi Deen Baloch, leader du mouvement de protestation, « le peuple baloutche est toujours celui qui se retrouve pris en tenaille, ce sont ses vies qui sont perdues ».
Un combat qui dure depuis des générations
Comme Mahrang, Sammi Deen – la secrétaire générale de « Voix pour les personnes Baloutches disparues » – s'est également engagée dans le mouvement suite à l'enlèvement de son père. Elle marche pour le ramener à la maison depuis 2009, alors qu'elle n'avait que 10 ans.
« C'est le même mouvement qui se poursuit depuis des décennies », a expliqué Sammi Deen. « Il n'a pas éclaté soudainement ».
En 2010, elle s'est rendue pour la première fois dans la capitale, Islamabad, participant à une marche accompagnée de sept autres familles dont des proches avaient été victimes de disparition forcée. Elles sont revenues en 2011 avec quelques familles supplémentaires. Puis, en 2013, elles ont organisé une « longue marche » de la ville de Quetta au Baloutchistan jusqu'à Islamabad, voyageant à pied pendant trois mois et 18 jours.
Grâce à la constance des protestations au fil des ans, 300 familles, selon Sammi Deen, se sentent désormais légitimes pour parler au nom de leurs proches. « En 2013, peu de gens étaient au courant des disparitions forcées au Baloutchistan », a-t-elle expliqué. « Mais aujourd'hui, nous avons un outil important dans les médias sociaux, que nous pouvons utiliser pour faire entendre notre voix aux gens de tout le pays et du monde entier ».
Mahrang et Sammi Deen s'accordent à dire que les médias sociaux ont joué un rôle important dans leur activisme. De l'utilisation coordonnée de hashtags comme #MarchAgainstBalochGenocide et #IStandWithBalochMarch auxmises à jour quotidiennes du site de protestation, le partage de leurs voix en ligne est devenu un moyen crucial pour les manifestant·es de rassembler du soutien à travers le Pakistan.
« Les médias traditionnels ne couvrent pas ceci », a déclaré Mahrang, « donc les gens n'ont aucun moyen de savoir… mais aujourd'hui, les gens ordinaires au Pakistan sont obligés de regarder le rôle qu'ils jouent dans le génocide du peuple baloutche ».
Pour Mahrang et toutes les familles qui protestent, il s'agit bel et bien d'un génocide – une destruction ciblée du peuple baloutche et de son identité qui se déroule depuis des décennies. Cependant, lors d'une conférence de presse le 1er janvier, le Premier ministre par intérim Kakar a décrit « son combat » non pas contre une race ou une caste particulière, mais contre les diverses organisations anti-étatiques du Baloutchistan.
Les femmes aux commandes
Outre les réseaux sociaux, une autre caractéristique unique de ce mouvement contre les disparitions forcées est qu'il est dirigé par des femmes, comme Mahrang et Sammi Deen.
« Ce mouvement est l'aboutissement de deux décennies de souffrance des femmes, et ce sont elles qui le dirigent maintenant », a déclaré Mahrang. « Il y a des mères, des sœurs, des grand-mères, des demi-veuves… et cela montre aux gens que nous ne sommes pas des agents d'une quelconque organisation mais simplement des gens ordinaires du Baloutchistan qui exprimons notre douleur et notre oppression ».
Une autre raison pour laquelle les femmes ont pris la tête du mouvement, selon Sammi Deen, est de protéger leurs sympathisants et leurs membres de famille masculins. « Au Baloutchistan, les hommes ne sont pas en sécurité de quelque façon que ce soit, qu'il s'agisse d'activisme ou simplement d'aller au marché », a-t-elle déclaré. « Nous ne savons jamais s'ils rentreront sains et saufs ».
Cela étant dit, les femmes elles-mêmes ont été loin d'être en sécurité face aux interventions policières. Le soir du 20 décembre, lorsque la marche a atteint la périphérie d'Islamabad, leur entrée a été bloquée par les forces de police.
Une pétition déposée le 3 janvier par Sammi Deen auprès de la Haute Cour d'Islamabad décrit l'interaction, déclarant que « la police a chargé les manifestant·es à coups de matraque et a utilisé des canons à eau contre ces marcheur·ses et leurs partisan·es ». Pendant ce temps, lors de sa conférence de presse, Kakar a décrit l'utilisation de canons à eau comme une « pratique standard des forces de l'ordre dans le monde entier ».
Mahrang et 52 autres femmes et enfants manifestant·es ont été détenu·es pendant plus de 24 heures et n'ont été libéré·es qu'après l'ordre de la Haute Cour. 290 autres étudiant·es, femmes et enfants ont ensuite été détenu·es pendant cinq jours avant d'être libéré·es. Selon la pétition, « les femmes et les enfants baloutches ont été brutalisés par la police d'Islamabad », et une tentative a été faite de les forcer à monter dans des bus et de les renvoyer à Quetta, au Baloutchistan. La police d'Islamabad a rejeté ces accusations sur le réseau social X, affirmant qu'il n'y avait « aucun mauvais traitement envers les femmes ou les enfants ».
Une fois que les manifestant·es se sont installé·es au sit-in du Club national de la presse à Islamabad le 23 décembre, les familles des personnes disparues ont été menacées d'arrestation si elles ne quittaient pas le lieu de protestation, et la police a bloqué à plusieurs reprises l'arrivée de nourriture et de couvertures, essentiels dans l'hiver pakistanais. Elles ont également été ciblées par des hommes cagoulés en civil, qui leur ont volé leur haut-parleur tout en pointant des armes chargées – le tout en présence de la police et de multiples caméras de surveillance.
Avec des caméras de surveillance présentes presque partout autour du sit-in, la police – selon Mahrang – tente clairement d'intimider le groupe de manifestant·es, majoritairement féminin. Pour leur part, Mahrang a été accusée de sédition et Sammi Deen a été la cible d'une « campagne de propagande vile et sale » utilisant de fausses photos la représentant avec des groupes militants avec lesquels elle n'a aucun lien. Cet incident a contraint Sammi Deen à enlever son niqab (le couvre-visage porté par certaines femmes musulmanes) qu'elle portait auparavant lors des conférences de presse. Néanmoins, Sammi Deen promet de ne pas se laisser réduire au silence.
Changement de cap et des demandes qui ouvrent la voie
Cette Marche contre le Génocide Baloutche – comme les manifestant·es appellent souvent leur mouvement – a reçu un soutien sans précédent sous la forme de manifestations de solidarité dans diverses parties du Baloutchistan, d'autres provinces pakistanaises et même devant le 10 Downing Street à Londres, où les manifestants ont organisé un sit-in de cinq jours..
Selon Mahrang, cette réponse est due au fait que la protestation fait en sorte que les gens se sentent entendus pour la première fois depuis des décennies. « Il y a toujours eu une négativité répandue selon laquelle les gens ordinaires n'ont aucun pouvoir face à l'establishment pakistanais et doivent simplement les suivre aveuglément » a-t-elle déclaré.
Selon Akbar, l'analyste politique, c'est aussi parce que, pour la première fois, la confiance des gens dans l'armée a faibli. « Il y a une partie de la population qui a commencé à réaliser que l'armée n'est pas si propre », a-t-il dit. « Dans le passé, les gens ne croyaient peut-être pas à toutes ces allégations contre l'armée. Mais maintenant qu'ils et elles voient que l'ancien Premier ministre Imran Khan a été réduit au silence, au point de ne pouvoir même pas se présenter aux prochaines élections – malgré qu'il soit le leader le plus populaire du pays – les gens commencent à se poser des questions ». Akbar a également souligné le rôle que les médias sociaux ont joué en donnant aux gens de l'extérieur du Baloutchistan une fenêtre sur leurs souffrances.
Selon Sammi Deen, l'un des principaux objectifs du mouvement est de collecter des données. En moins d'un mois, alors qu'ils et elles marchaient du Baloutchistan à Islamabad, ses membres ont rassemblé des preuves sur environ 600 personnes disparues. « À Dieu ne plaise, si quelqu'un·e meurt demain dans une fausse rencontre, nous saurons au moins s'il ou elle était [déjà] porté·e disparu·e auparavant ».
En plus de collecter des données, le mouvement s'efforce également de traduire en justice les coupables des assassinats d'hommes comme Balaach. Le 9 décembre, après une résistance initiale, la police a enregistré une plainte contre quatre membres du CTD sur instruction d'un tribunal inférieur. Puis, deux jours plus tard, la Haute Cour a ordonné la suspension immédiate des quatre membres du CTD. Une commission d'enquête sur le décès a également été créée. Toutefois, aucune arrestation n'a encore été effectuée.
« Nous voulons que toutes les personnes disparues du Baloutchistan soient libérées et… nous voulons voir des progrès dans leurs affaires judiciaires », a déclaré Sammi Deen avant d'ajouter que le CTD et les « escadrons de la mort » (ou milices privées) parrainés par l'État, responsables de ces disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires, devraient être dissous.
Le 10 janvier, Mahrang et Sammi Deen ont pu s'entretenir avec la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les Défenseur·es des Droits Humains, Mary Lawler, au sujet de la nécessité d'une mission d'enquête des Nations Unies au Pakistan pour examiner les violations des droits humains et le génocide au Baloutchistan. Écrivant sur X, Lawler a déclaré : « Les informations faisant état de harcèlement policier sont très préoccupantes. Les plaintes pénales fallacieuses déposées contre des manifestant·es pacifiques devraient être abandonnées ».
Selon M. Akbar, s'il y a une « volonté réelle de la part de l'armée », il est possible que les personnes disparues soient ramenées chez elles, à condition qu'elles n'aient pas déjà été tuées. « L'armée est une institution très organisée, donc elle a certainement des rapports sur ces personnes disparues ». Akbar a également noté qu'un grand nombre de personnes disparues ont été libérées dans le passé lorsque le gouvernement voulait apaiser le peuple baloutche. Toutefois, Akbar ne croit pas que le Pakistan autorisera une mission d'enquête indépendante des Nations unies au Baloutchistan, car le Pakistan considère que c'est une question qui relève de sa propre souveraineté.
« C'est une punition collective, car lorsqu'un membre de la famille disparaît, tous ses proches en souffrent », a déclaré Sammi Deen. « C'est l'incertitude, l'attente continue, la douleur torturante qui est insupportable ».
Malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, Sammi Deen et Mahrang pensent que ce mouvement ne s'éteindra pas, mais qu'il continuera et développera son important travail.
« Nous sommes en train d'élargir ce mouvement dans tout le pays et dans le monde entier », a déclaré Mahrang. « À tous·tes celles et ceux qui sympathisent avec nous, nous leur demandons de protester en solidarité, d'envoyer des pétitions à l'ONU, d'écrire à vos parlements pour lancer des discussions. Ce n'est que le début, et nous continuerons pacifiquement ».
Esha Mitra, 19 janvier 2024
Lire l'article original en anglais sur Waging Non-Violence
Cet article a été publié le 19 janvier 2024 sur WagingNonViolence.org.
Il a été traduit vers le français grâce à notre équipe de traducteur·ices bénévoles.
https://www.ritimo.org/Comment-les-femmes-au-Pakistan-luttent-contre-les-disparitions-forcees-et-les
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran. Narges Mohammadi dénonce les actes barbares infligés aux femmes kurdes emprisonnées

IRAN – Les femmes et les enfants kurdes détenus dans la tristement célèbre prison d'Evin sont particulièrement victimes d'abus, de violences sexuelles, d'isolement et de passages à tabac, selon Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, également détenue à Evin.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Narges Mohammadi, la militante des droits humains qui a reçu l'année dernière le prix Nobel de la paix alors qu'elle était détenue derrière les barreaux en Iran, a dénoncé les abus barbares, les passages à tabac et l'isolement infligés aux femmes et aux enfants kurdes détenus dans la tristement célèbre prison d'Evin.
Les révélations font référence à une brève rencontre en 2018 que la lauréate du prix Nobel a eue avec un groupe d'autres prisonnières à Evin, généralement détenues à l'écart des autres femmes. Des Kurdes et d'autres prisonnier·es politiques sont régulièrement détenues, torturées, privés de soins médicaux et exécutés dans ce centre de détention notoire. Dans une interview audio enregistrée secrètement et diffusée par la suite sur le site d'information Iran Wire, Mohammadi a rappelé comment les femmes kurdes et leurs enfants ont été soumis à un traitement particulièrement dur, n'ayant droit qu'à une heure d'exercice en plein air par semaine.
« Les conditions étaient désastreuses : pas de draps sur les lits, juste un matelas, un oreiller et une couverture », a-t-elle déclaré. « Ces enfants n'avaient rien, pas même des jouets. Nous leur avons proposé de leur acheter des jouets, mais les autorités pénitentiaires ont refusé. »
Néanmoins, d'autres prisonnières ont progressivement pu offrir soutien et solidarité aux femmes, ciblées par de nouveaux abus en raison de leur identité kurde. « Même si tout contact leur était refusé, les femmes kurdes ont progressivement établi une communication clandestine avec d'autres prisonnières », se souvient Mohammadi. « Ce lien s'étendait au partage de produits cosmétiques et au soutien de prisonnières politiques qui fournissaient de la nourriture, des jouets et des bonbons aux enfants kurdes. »
La militante des droits humains, arrêtée pour avoir dirigé une organisation protestant contre le recours à la peine de mort en Iran, a vu des femmes kurdes se faire battre devant leurs nouveau-nés. Elle dit :
« L'une d'elles a nommé son enfant Abdullah à sa naissance. Le premier était un garçon et la seconde, une fille nommée Jenan, est née en mars. Une nuit, j'ai encore entendu du bruit dans le couloir et je me suis précipitée. Je les ai vus emmener la mère de Jenan et la battre. Elle était lourdement chargée, incapable de marcher correctement, et je la regardais du haut des escaliers, les larmes coulant sur mon visage. Les autorités ont confisqué les affaires du bébé, généralement apportées par un proche (…). Ils ne lui ont pas permis de rester à l'hôpital. »
« La détention d'enfants aux côtés de leur mère est un sujet particulièrement préoccupant dans un pays où des enfants détenus dès l'âge de douze ans ont été soumis à « la flagellation, aux décharges électriques et à la violence sexuelle », selon Amnesty International .
« Quand ils sont arrivés ici, les enfants étaient émaciés… dépourvus de vitalité. Une enfant, Fatemeh, était particulièrement fragile et apathique », a déclaré Mohammadi. « Sa mère l'embrassait souvent… Dès que la mère s'éloignait, elle gémissait comme si elle était brûlée ou tombée de très haut. Elle ne supportait pas d'être séparée de leur mère, ne serait-ce qu'un instant, à cause des bombardements, de la fuite, de la misère, de la faim et de la perte de sa famille. Le père est mort et elle pleurait toujours. »
Mohammadi a en outre rappelé que les enfants plus âgés avaient été séparés de force de leur mère, laissant un vide qui « ne pouvait être comblé par rien », ainsi que les conditions particulières d'isolement pendant la pandémie de coronavirus. Plus généralement, les manifestantes et militantes détenues dans la prison d'Evin et dans d'autres établissements pénitentiaires souffrent de conditions extrêmement précaires, notamment d'un accès limité à l'eau potable, à l'air frais, d'une hygiène sordide et d'autres dégradations de leurs droits fondamentaux. Les prisons sont surpeuplées et ne peuvent fournir de l'eau aux douches que deux jours par semaine, ce qui entraîne une perte de cheveux et une crainte des poux, selon les rapports des militantes des droits humains.
L'administration pénitentiaire ne fournit pas de produits de nettoyage pour l'hygiène personnelle, les toilettes ne sont pas nettoyées et la plupart des détenus souffrent déjà d'infections. En guise de punition, les gardiens de prison refusent de laisser les détenus utiliser les toilettes, ce qui entraîne des problèmes rénaux. Pendant ce temps, une mauvaise ventilation entraîne une propagation rapide des maladies.
Mais la solidarité clandestine avec les prisonniers kurdes n'est pas la seule façon dont les femmes détenues dans le centre de détention ont résisté à leur traitement. L'année dernière, sept militantes détenues à Evin ont organisé un sit-in, annoncé par Mohammadi, à l'occasion de l'anniversaire des manifestations qui ont éclaté après la mort de Jina Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la police des mœurs du pays.
Dans un communiqué à l'époque, les détenues ont déclaré : « Cela fait un an que Jina Amini a été tuée par des agents de la République islamique d'Iran. La profonde tristesse et la colère que nous ressentons face à la perte de nos concitoyens dans les rues et dans les prisons, la répression brutale des manifestations, les arrestations arbitraires, la torture et l'emprisonnement de ceux qui osent s'exprimer pèsent lourdement sur nos cœurs. Malgré ces défis, nous restons fermes dans notre détermination à poursuivre notre lutte jusqu'à la victoire. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chayuda Boonrod : « { les barrages ne sont bons que pour les capitalistes} »

Chayuda Boonrod est membre de l'Assemblée des pauvres (AoP en anglais), une organisation populaire thaïlandaise luttant pour l'autodétermination et le droit aux ressources avec les communautés urbaines et rurales. Sa participation à la lutte vient de sa famille, impliquée dans la lutte pour la terre dans le pays.
05/04/2024 |
Tiré de : Capire
https://capiremov.org/fr/entrevue/chayudaboonrod-les-barrages-ne-sont-bons-que-pour-les-capitalistes/
Découvrez le contexte politique actuel en Thaïlande et la lutte contre la construction de barrages
Chayuda a partagé avec nous des aspects du contexte politique actuel de la Thaïlande et de la lutte de l'AoP contre les impacts des barrages dans le pays. L'Assemblée des pauvres est active dans la lutte contre les barrages depuis sa création le 10 septembre 1995. « Je suis née le 31, donc j'ai 21 jours de moins que l'organisation. En grandissant, j'ai vu ma famille, mes tantes et mes oncles, tous ceux que je connais, impliqué.e.s d'une manière ou d'une autre dans notre organisation et dans La Via Campesina », a déclaré Chayuda.
Cette interview a été réalisée lors de la 8ème Conférence Internationale de La Via Campesina (LVC), qui a eu lieu en décembre 2023 à Bogotá, en Colombie. Avec la Via Campesina, les membres de l'AoP participent à des activités dans leur pays et à l'étranger. Sur la relation entre les deux organisations, elle ajoute : « Nous avons beaucoup de gens de LVC qui viennent visiter et étudier les communautés ». En outre, AoP a la Réunion de la Jeunesse Asiatique de LVC, qui ont eu lieu en octobre 2022, à Surat Thani, en Thaïlande. Lisez l'interview complète ci-dessous :
Pourriez-vous nous parler du contexte politique de la Thaïlande ? Quels sont les principaux enjeux pour la classe ouvrière et les personnes paysannes ?
Les élections de 2023, renforcées par la Constitution, ont mis au pouvoir un nouveau premier ministre, mais ce n'est pas celui que nous avons choisi. Le parti qui a remporté le plus de voix aux élections n'a pas réussi à former un gouvernement parce qu'il était obstrué par les astuces cachées dans la Constitution actuelle, rédigée par le gouvernement militaire mis en place après le coup d'État de 2014. Parce que le parti politique avec le plus de voix ne peut pas établir un gouvernement, le deuxième plus grand parti a réussi à former un gouvernement de coalition avec le soutien des partis qui faisaient partie du précédent gouvernement militaire.
Les gens avaient le sentiment que rien n'avait changé en termes de réponses à leurs demandes ou de la question des droits humains. Ils se soucient de gagner de l'argent, ils ne se soucient pas des gens, en particulier des pauvres. En octobre, AoP a organisé une mobilisation de masse d'un mois pour rehausser le profil de ces aspects du gouvernement actuel et lutter pour nos droits.
Et quels sont les principaux problèmes avec les barrages en Thaïlande aujourd'hui ? Quel est le combat de l'AoP concernant la construction de barrages ?
La lutte contre la construction de barrages dans l'AoP est énorme. C'est une bataille que nous avons menée dans de nombreux endroits depuis la création de l'organisation. Il y a, par exemple, la lutte des peuples contre le barrage de Sirinthorn, qui est l'un des premiers cas dans l'histoire de la construction de barrages en Thaïlande, vers 1970, avant la création de l'AoP. À propos du barrage de Sirinthorn, les conséquences et les souffrances de la population étaient très évidentes, mais le gouvernement n'a jamais essayé de diminuer ses ambitions de le maintenir.
En parlant du contexte actuel, nous pouvons le diviser en deux types. La lutte contre les barrages qui ont déjà été construits et la lutte contre le projet de construction de nouveaux barrages. Sur le premier type de lutte, il y a cinq communautés confrontées à des barrages qui ont déjà été construits. La compensation qui, selon le gouvernement, serait accordée n'est pas appropriée. Pour nos frères et sœurs issus de ces communautés, leurs souffrances continueront sans réponse gouvernementale pour résoudre leurs problèmes.
Le gouvernement a une formule très simple pour calculer l'indemnisation. Par exemple, si dans une maison il y a cinq arbres, le gouvernement ne peut calculer que leur valeur à ce moment-là. Ils ne se demandent pas quand les cinq arbres auront une valeur à long terme pour la famille. Notre peuple estime qu'il serait préférable que le gouvernement échange des terres avec eux, trouve d'autres terres et les leur donne en compensation de celles qu'ils ont perdues. Mais le gouvernement peut faire quelque chose de simple, comme calculer le prix de la terre à ce moment-là, leur donner de l'argent et les laisser trouver de nouvelles terres, aller en acheter eux-mêmes.
Lorsque, à cause de la construction de barrages, les paysans perdent leurs terres, ils perdent leur identité de paysans. Ils n'ont plus de terres à produire. Pour les paysans, perdre des terres signifie que tout est fini. Ils n'ont rien, seulement leur corps et leur travail.
Beaucoup d'entre eux doivent migrer vers une grande ville. Dans ces grandes villes, les gens deviennent de la main-d'œuvre bon marché, des citadins pauvres, les femmes tombent dans la prostitution. De nombreux autres problèmes les accompagnent, tels que la séparation de la famille ou la toxicomanie. C'est très concret, mais les problèmes vont plus loin avec la perte des moyens de subsistance et de la biodiversité. Dans le cas du barrage de Rasi Salai, des études ont montré que près de la moitié des espèces de poissons de la rivière ont disparu. De nombreux chercheurs étudient l'impact des barrages, mais ils ne font que venir dans les communautés, parler aux gens et produire des articles. Ils n'aident pas activement. Et, parce que nous sommes ceux qui luttons contre ces problèmes depuis de nombreuses années, le public a commencé à nous considérer comme des méchants.
Le dernier cas, le barrage de Pong Khunpet, est un exemple de la façon dont, malgré l'achèvement de la construction du barrage, les gens refusent de déménager parce que le gouvernement ne leur a pas donné de nouvelles terres. Le barrage ne fonctionne pas complètement, mais ils ont un peu ouvert la vanne d'eau, ce qui provoque des inondations dans la communauté. Les gens doivent utiliser des bateaux pour se déplacer. Une telle eau apporte beaucoup de problèmes de santé et de maladies. Bien sûr, la réponse du gouvernement local est très lente. Notre peuple proteste pour faire pression pour une réponse plus rapide.
De nombreux barrages qui existent aujourd'hui ont été construits pendant les dictatures. Dans les périodes des gouvernements dictatoriaux, nous ne pouvions pas protester. Cela signifie que la question des barrages est également liée à la situation politique.
De nombreuses communautés AoP protestent contre les projets de construction de barrages parce qu'elles ont appris qu'ils ne produisent aucun bien pour elles. Mais dans la plupart des cas, ce qu'elles obtiennent n'est qu'une pause dans le projet. Il n'y a pas vraiment d'arrêt ou d'interruption du plan. Nous ne savons jamais quand on va simplement abandonner les accords et passer à autre chose. C'est une inquiétude perpétuelle.
Le gouvernement essaie de faire connaître le bon côté de la construction de barrages. Il essaie de convaincre les gens qu'ils peuvent simplement prendre l'argent et aller vivre ailleurs. Un autre discours que le gouvernement utilise pour convaincre les gens est sur le sacrifice, disant qu'il veut que les gens se sacrifient pour le plus grand bien. Mais en fait, il existe de nombreuses façons de gérer les ressources en eau, au-delà de la construction de barrages. Nous savons que les barrages ne sont bons que pour les capitalistes et l'industrie.
Comment se déroule la lutte de l'AoP pour créer de meilleures conditions de vie pour les paysans en Thaïlande, et quel est le rôle des femmes dans cette lutte ?
Tous les projets sont initiés par l'État, par le gouvernement, main dans la main avec les capitalistes. Ils n'apportent jamais rien de bon aux gens. Mais les luttes ont renforcé le mouvement et le peuple. Nous prenons conscience que chaque construction ou développement nous enlève notre mode de vie, qui est en fait véritablement basé sur la production agroécologique.
La lutte engendre de nombreuses initiatives, et de nombreux membres de notre mouvement se sont intéressés aux initiatives de l'école d'agroécologie ou du projet de semences. L'une des choses qui leur permet de continuer à se battre, c'est que beaucoup d'entre eux se souviennent encore de la signification du bien-vivre. C'est une sorte d'encouragement ou d'inspiration pour eux de continuer à se battre pour la récupérer.
Le gouvernement fait taire et décourage les gens en leur faisant croire que leurs luttes sont trop difficiles, qu'ils ne gagneront pas. Mais ce n'est pas comme ça pour nous. Pour nous, plus nous nous battons, plus nous devons surmonter tout ce que le gouvernement nous impose.
Les femmes dans l'Assemblée des pauvres sont une force féroce. Dans notre structure, nous garantissons un équilibre entre les sexes dans toutes les instances ou activités, telles que les mobilisations, les réunions ou les négociations. Les femmes représentent près de la moitié du mouvement et sont capables de se battre avec les mêmes capacités que les hommes.
En 2005, il y a eu une campagne internationale de 1000 femmes pour le prix Nobel de la paix. Habituellement, les lauréats du prix Nobel de la paix sont des hommes et des individus, mais les femmes se battent collectivement. À ce moment-là, notre dirigeante principale, Wanida Morsa, a été contactée par le projet pour donner son nom comme l'une des 1000 femmes. Elle a dit que nous, les femmes de l'Assemblée des pauvres, ne nous battons pas individuellement. Ainsi, au lieu d'avoir son nom parmi les 1000 femmes, nous avons enregistré un groupe de membres de l'AoP.
Les dirigeantes paysannes qui m'ont précédée sont mon inspiration. Lors de grandes mobilisations en octobre 2023, de nombreuses femmes leaders de notre mouvement qui y étaient présentes ont subi des affrontements avec la police. Ces mères, tantes et grands-mères se sont battues en première ligne avec une puissante force féministe. Plus la force est grande, plus il est facile de combattre le patriarcat présent dans le système. Lors de la confrontation, nos grands-mères ont réussi à faire face à la situation, empêchant la violence qui pourrait survenir si elles étaient des hommes en première ligne.
Interview réalisée par Natália Lobo
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : anglais
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La confrontation des féministes en particulier au racisme en général
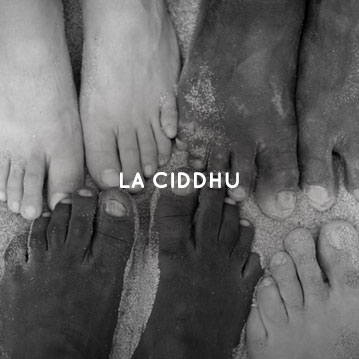
Le féminisme, sous ce nom et comme mouvement contestataire collectif, est né en même temps — dans la première moitié du 19e siècle — que le mouve-ment (contestataire collectif) anti-esclavagiste. Non seulement en même temps mais entretenant avec lui des liens fondateurs, ceci en deux sens : en ce que certains de ses membres l'étaient également du mouvement contre l'esclavage et en ce que l'un des moments fondateurs du féminisme contemporain, la rencontre de Seneca Falls, est en partie issue d'un conflit au sein du mouvement anti-esclavagiste.
On peut d'ailleurs voir une photo prise lors d'un meeting de Frederick Douglass, ancien esclave, figure
déterminante du mouvement anti-esclavagiste, où l'assistance est composée de plus de
femmes que d'hommes. 1
Le rôle joué par Le Deuxième Sexe (1949) dans la renaissance féministe des années
soixante de notre siècle est évident, quelle que soit en cette occurrence la nature attri-buée à ce texte : celle d'être un mythe de référence ou celle d'initiateur ou de catalyseur du mouvement. L'introduction que Simone de Beauvoir a faite à son livre place d'emblée, dans une perspective sociale et historique, les femmes dans une situation
analogue (ce qui n'est pas dire semblable) à celle d'autres groupes infériorisés : « […]
qu'il s'agisse d'une race, d'une caste, d'une classe, d'un sexe réduits à une condition
inférieure, les processus de justification sont les mêmes ».
Les similitudes entre le féminisme et d'autres mouvements d'émancipation sont à
la fois pratiques et théoriques. Elles relèvent d'une expérience commune, celle d'une
situation comparable dans le système social et celle de la protestation contre cette
situation ; sur le plan théorique, elles impliquent une description parente des systèmes
d'oppression. Mais plus, c'est une constante que, parmi les minoritaires, les femmes
quelles qu'elles soient, comme les juifs en général, sont plus fréquemment engagées
dans les mouvements d'émancipation et de libération d'autres groupes que le leur ou
à visée universelle. Et que elles/ils le sont également, plus fréquemment, dans l'étude
des phénomènes de minorité et de domination touchant des groupes autres que le leur.
L'histoire des mouvements antiségrégationnistes aux États-Unis, anti-apartheid et
anticolonialistes en Afrique et en Europe, comme le développement, dans les pays
industrialisés, des recherches sur les discriminations et le racisme en témoignent.
Quelle que soit la façon de le voir, il ne peut pas échapper à l'observation qu'il existe
un lien entre les mouvements et préoccupations minoritaires et le féminisme, non
seulement, bien sûr, parce qu'il est l'un d'entre eux mais aussi à travers les femmes qui
sont leurs actrices, la conscience qu'elles ont de l'état de leur société et les projets
qu'elles ont sur ce que devrait être cette société.
Quel caractère spécifique présente le mouvement ou la mouvance féministe si on les
compare aux autres mouvements d'émancipation (ce terme est faible ou imprécis, mais
je ne vois que lui pour recouvrir des projets aussi divers et parfois porteurs de contradic-tions que sont la liberté des individus et leur autonomie, les droits civiques, les aspirations nationales, les libérations coloniales, etc.) aux mouvements antiracistes ou aux mouve-ments de défense des droits humains (dits en France « Droits de l'Homme »), etc.?
D'abord, bien sûr sa spécificité est d'être concerné par les femmes, mais il n'est pas
si évident de dire quelle est la nature de ce concernement. Proche des combats anti-discriminatoires et antiracistes, il est antisexiste par définition. L'antisexisme est le dénominateur commun de toutes ses formes. Mais ce dénominateur commun n'en-traîne pas de facto un projet de société et surtout il n'implique nullement une analyse
identique des formes que prend le sexisme, de leur mécanisme ou de leur cause. Et il
est bien vrai que l'émancipation recherchée est toute différente selon qu'il y a ou non
critique des formes sociales, selon qu'il y a projet de société ou bien absence de projet
de société. Et pour qu'il y ait projet de société, encore faut-il d'abord analyser la société
existante et être dans une position critique de cette société-là.
Or, il va sans dire, mais mieux vaut le rappeler, que la structure socio-sexuelle de
notre société n'est pas majoritairement mise en cause elle-même, elle semble en
quelque sorte normale (améliorable certainement, mais normale), à coup sûr, aux
mouvements féminins (qui se proposent de défendre les femmes et les intérêts des
La confrontation des féministes en particulier au racisme en général 157
femmes « en tant que femmes »), mais également à une partie du féminisme qui peut
réserver ses critiques de l'organisation sociale aux autres sociétés, réputées porteuses
d'un sexisme organique qui n'existerait pas (ou plus) ici. Et ceci précisément (qui n'est
pas caricatural, même s'il se présente peu sous une forme aussi extrême ou explicite)
est l'une des formes du racisme réel ou potentiel. C'est en tous cas l'une des raisons de
l'irritation de féministes d'autres sociétés envers certaines féministes des sociétés indus-trielles. Et c'est l'un des effets du refus d'analyser ce que sont les hommes et les femmes comme la relation qui les fait tels dans les sociétés que nous connaissons.
Avec une ironie toute relative, on pourrait sans doute aborder la diversité des
mouvements de femmes à travers leur mode d'intervention sociale selon qu'ils seraient
dans une optique « corporatiste », « syndicale » ou « politique ». Et cela a quelque rap-port avec la possibilité de poser la question du racisme dans les pratiques et dans les formations mentales. En fait, c'est la question de la définition elle-même du féminisme qui est sous-jacente, ce qui n'est pas une question académique, ni d'une façon générale,
ni en ce qui nous préoccupe. On pourrait penser que le féminisme étant un mouve-ment antisexiste et non pas un mouvement antiraciste ou anti-impérialiste, la question du racisme et de l'antisémitisme se poserait en fonction d'événements déterminés et qu'elle interviendrait ponctuellement à des moments précis, bref qu'elle tiendrait à des
occurrences extérieures.
Ce pourrait parfaitement être le cas dans une perspective qui ne voudrait — qui
ne veut — considérer que les intérêts des « femmes en tant que femmes », c'est-à-dire
explicitement et intrinsèquement en tant que piliers de leur communauté, définies par
les hommes de cette communauté à laquelle et auxquels elles appartiennent. C'est une
forme corporatiste en quelque sorte de défense et promotion des intérêts d'un groupe
professionnel, celui des épouses et mères, lequel étant recruté parmi les êtres humains
femelles en conclut que tous les êtres humains femelles sont obligatoirement épouses
et mères et seulement cela. Ce dont les hommes tombent d'accord si on le leur
demande. Ce corporatisme serait la défense des vraies femmes, lesquelles sont des
défenseures inconditionnelles (par définition) de leurs hommes dans le champ poli-tique des antagonismes nationaux, communautaires, de classe, etc. Elles n'ont a priori pas de raison particulière, si ce n'est celle de la pitié humaine, de considérer qui que ce soit d'autre comme digne d'intérêt, de droits, de liberté, et parfois de vie. Ce n'est pas
une forme rarissime de mouvement féminin et qui se conçoit bien, en effet, comme un
mouvement de défense des intérêts des femmes. Les associations de femmes des sys-tèmes nationalistes et communautaristes comme des systèmes totalitaires ou religieux, répondent en fait à cette conception des femmes comme éléments d'une communauté où elles doivent prendre leur place, toute leur place et seulement leur place. Le système politique de la communauté où elles sont nées est le leur, raciste ou antiraciste, c'est
selon (mais le plus souvent raciste).
La configuration est différente si on envisage les intérêts des femmes dans une
perspective « syndicale » qui pourrait se voir comme la défense des femmes certes, mais
également l'acquisition de droits meilleurs ou plus équitables, bref une conquête et une
recomposition de la distribution sociale, celle des rôles et celle des biens, de façon à ce
que hommes et femmes atteignent une sorte d'équilibre statutaire de partenaires, sans
d'ailleurs que le statut de « femme » et celui d'« homme » soient eux-mêmes interrogés.
La perspective diffère encore si on envisage le féminisme comme mouvement « poli-tique », c'est-à-dire comme un mouvement qui a un projet de société ou qui cherche à en produire un, dont la réflexion est orientée par force dans ce sens. Par force, dans la mesure où l'analyse et la critique de la structure socio-sexuelle ne peuvent pas ne pas
remettre en cause l'ensemble de l'organisation sociale. Ce qui fait du lesbianisme dans
le féminisme (je ne dis pas l'homosexualité, qui est autre chose) une position forcé-ment politique, qui oblige à penser autrement que par le biais du sexe. Le lesbianisme ne peut être ni corporatiste (être lesbienne n'est pas un métier) ni syndical (lesbienne n'est pas un statut de sexe). Ancienne question certes, mais nullement vieille dans le
mouvement féministe.
On a aperçu que la « défense du droit des femmes » et l'antisexisme ne sont pas
nécessairement liés à une préoccupation d'émancipation, parfois même au contraire
et que par conséquent une partie des « mouvements féminins » se place hors le projet
d'émancipation. Dans son principe, un mouvement d'émancipation, s'affrontant aux
formes de la domination, mais aussi de la contrainte et de l'exploitation, me semble-t-il, ne peut pas ne pas avoir une vision au moins, sinon un projet d'ensemble d'une société possible vers laquelle tendre et ne peut pas éviter ces questions sur le fond. Et s'il ne les pose pas, s'il ne se les pose pas, il pourra, à terme et parfois dans l'immédiat,
entreprendre des actions qui travailleront contre les femmes. Et en prônant la diffé-rence (par exemple), revenir là même d'où il tentait de sortir. Qu'est-ce, en effet, que « les intérêts des femmes » ? Parfois, on croit répondre en demandant : « les intérêts de quelles femmes ? », mais c'est une mauvaise question. Ce ne sont pas les femmes qui
sont différentes (quoique bien évidemment elles le soient dans leur existence quoti-dienne), ce sont leurs choix politiques qui le sont. Et ensuite, ce sont leurs possibilités matérielles qui le sont et ne permettent pas les mêmes décisions pratiques.
Probablement, il s'agit là de l'un des conflits majeurs au sein des mouvements de
femmes, si ce n'est le conflit majeur. C'est également dans ce clivage politique profond
que la possibilité de poser — ou non — la question d'une organisation sociale qui ne
soit pas raciste réside. Celle où nous vivons l'est. Où vivent les féministes, objets du
racisme et/ou productrices de racisme.
Les différentes formes de mouvements féminins et de féminisme sont engagées et
partie prenante de l'histoire politique de leurs sociétés. Ce que nous montre d'ailleurs,
en ce qui concerne le féminisme (« syndical » et « politique », en résumé le féminisme
de l'émancipation justement), les attaques qu'il rencontre. Telle, par exemple, la levée
de boucliers des « analystes » sociologiques ou politiques de la situation algérienne,
contre les féministes explicites, distinguées des femmes qui seraient, elles, des vraies
femmes et dont le courage « modeste » légitimerait une lutte « raisonnable ». Ce que
montre également la capacité étonnante de déni de l'action des féministes, déni si évi-dent dans la proposition que ce qu'elles obtiennent serait arrivé de toute façon, car La confrontation des féministes en particulier au racisme en général
conforme à « l'évolution de la société ». Les féministes sont des citoyens que la structure
sociale, l'organisation et le fonctionnement de leur société concernent qu'elles le
veuillent ou non, puisque, en effet, elles interviennent dans cette organisation. Dont
aujourd'hui le racisme, dont l'antisémitisme est l'une des formes, est un trait structurel.
En fait, une bonne part des analyses du racisme repose sur, ou implique, le pré-supposé qu'il serait un phénomène autonome, sorte d'excroissance ou de « corps étranger » dans la société où il se produit. Cependant l'antisémitisme et le racisme nazi, l'apartheid, la ligne de couleur aux États-Unis, en France l'antisémitisme, de l'affaire
Dreyfus aux lois antisémites de l'État français (1940-1944) et à sa continuité dans le
champ politique avec le Front National, le racisme contre les Maghrébins et les
Africains, ne sont pas des phénomènes « extérieurs » à leur société, ils lui sont intrinsè-quement liés. Ce ne sont pas d'incompréhensibles accidents. Ils sont inscrits dans les lois ou « institutionnels », ce qu'on nomme systémique dans les sciences sociales, ce qui suppose un processus de mise en œuvre d'une intention politique délibérée. Mais plus,
dans certaines formes sociales, à certains moments historiques, le racisme est le fonde-ment du projet social. Comme la soumission des femmes et leur appropriation, qui sont factuellement le socle des sociétés historiquement et actuellement connues, sont explicitement un constituant fondamental des formes nationalistes, communautaires
(là encore, ces termes sont imprécis mais acceptons-les provisoirement pour désigner
les projets de fermeture sur soi et d'exclusion comme d'exaltation du groupe).
Sans analyse des formes sociales, on traite racisme et sexisme comme des épiphéno-mènes ou des affaires conjoncturelles, bref des sortes de dysfonctionnement. On s'em-pêche ainsi, on s'interdit même, de voir comment les ségrégations, les inégalités matérielles, la dépendance, de situations de fait se transforment en pratiques institution-nelles, en règles et structures sociales, en lois. Et de factuelles deviennent intentionnelles
et organiques. Une illusion à laquelle il est tentant de succomber voudrait qu'un mou-vement d'émancipation, un mouvement minoritaire né de la persécution, de la connais-sance de l'oppression ou de la contrainte, devrait les reconnaître en toutes circonstances et dans tous les groupes qui en sont les cibles. Et surtout ne jamais les pratiquer, ni — c'est le moins — les relayer. Illusion, en effet. Et singulière expérience que de voir, parmi
les siennes, au plus proche de soi, le déni parfois, l'ignorance souvent. Et à certains
moments, brutalement, le relais et l'adoption du racisme de la société banale.
L'arrogance raciste a une série de conséquences, dont d'aveugler les femmes vis-à-vis les unes des autres. Cette arrogance est l'expression d'un rapport de force où certains groupes sont à la merci d'autres groupes. Et les femmes appartiennent à ces groupes, à tous et à chacun de ces groupes. Et quand on dit ici « appartiennent », c'est
aux deux sens du terme qu'il faut l'entendre : au sens propre et matériel d'appartenir
aux hommes de ce groupe (qui décident de la forme et des actions du groupe). Et au
sens figuré, qui est tout autant fondateur, d'appartenir à cette histoire, à cette culture,
à cette langue, à cette classe, à cette religion, etc., bref au sens de manière d'être au
monde et au sens de conscience. Or l'arrogance raciste s'exprime précisément dans le
déni du rapport de force lui- même et dans le déni des effets du rapport de force. Au
plus, elles les prétend imaginaires ou secondaires, attribuant alors une tournure d'es-prit « victimiste » à celles qui en sont l'objet. A ce propos, le reproche de « victimisa-tion », si souvent repris, dans une perspective de disqualification, à l'encontre du féminisme et plus souvent encore à l'intérieur du mouvement, est une constante du
discours raciste lui-même. Il intervient dans les circonstances politiques où un groupe
discriminé dit qu'il l'est, dit comment il l'est et dit que ce n'est pas admissible. On
appelle cela « se poser en victimes ». Comme s'ils décidaient, eux, d'être victimes,
comme s'il s'agissait dans leurs propos de pure incantation, sans fondement réel alors
même qu'ils parlent des moyens employés contre eux pour les maintenir dans la sujé-tion, la dépendance ou la fragilité, des moyens employés contre eux pour les tuer. C'est une opération de disqualification sans doute, mais c'est aussi une opération de déni.
C'est dénier d'abord la sujétion et la dépendance mais également les pratiques qui les
accompagnent, les bénéfices qui en sont tirés, les conséquences de cet assujettissement.
C'est dans le racisme d'abord que j'ai remarqué ce biais particulier du déni qu'est
l'accusation de victimisation et sans doute cela m'a-t-il aidé à comprendre ce qui se
passait à l'encontre du féminisme (et des femmes) et dans le mouvement lui-même.
Arrogance raciste, dont l'envers est une culpabilité affichée (un sentiment de culpabi-lité) tout théorique et formel, forme d'hommage du vice à la vertu et qui dispense tout autant de considérer les faits, qui ne fait que revêtir l'aveuglement du manteau de la respectabilité.
À quoi est-on aveugle ici ? Aux rapports de force impliqués. Doubles et toujours à
l'œuvre ensemble
• Ceux qui soumettent certains groupes aux autres ou soumettent les autres à eux
(car ce n'est pas une situation symétrique, l'un de ses caractères spécifiques étant,
justement, la dissymétrie). Quand on parle de groupe ici, on désigne les ensembles
sociaux maintenus par la reproduction, quel que soit par ailleurs leur caractère
particulier : classe, religion, nation, culture, « race », etc.
• Ceux qui mettent les femmes à la merci des hommes, de leur groupe précisément,
lesquels sont constitutifs des précédents et leur sont organiquement liés au sens
strict du terme.
Ce sont à ces derniers rapports que se confrontent les féministes. Explicitement. Et elles
sont obligatoirement confrontées aux premiers dans la mesure où les relations des
femmes aux hommes sont partie prenante des relations des hommes entre eux. Penser
aux femmes, penser les femmes, oblige à prendre en compte les deux termes. Appartenir
à certains groupes permet ou bien empêche d'être lesbienne (je ne dis pas homo-sexuelle). Appartenir à certains groupes confronte directement aux hommes auxquels on appartient, mais pas à tous les hommes. Appartenir à certains groupes signifie être tué pour être né dans ce groupe et tué avec le groupe dans son ensemble. Appartenir à
certains groupes signifie être ségrégué ou emprisonné ou chassé ou discriminé pour
appartenir à ce groupe, avec le groupe dans son ensemble. Appartenir à certains
groupes confronte directement aux hommes auxquels on appartient et confronte, de
La confrontation des féministes en particulier au racisme en général
surcroît et souvent d'abord, aux hommes qui tiennent à merci les hommes auxquels
on appartient. Appartenir à certains groupes vous met dans la position d'enjeu, de
proie ou de moyen dans la guerre que mènent ces groupes avec d'autres ou dans la
guerre qu'ils sont forcés de subir (etc., hélas !). Car, en effet, dans la mesure même où
les femmes sont sociologiquement fonction des hommes (dans la dépendance et « à la
merci » est la forme que prend cette fonction de type algébrique), les féministes,
comme les femmes, sont diverses. Et ce qui les met ensemble est en même temps très
simple — leur commune domination par les hommes et très complexe — les hommes
des différents groupes ne sont pas dans une relation neutre et symétrique où chaque
groupe n'existerait que par des caractéristiques aléatoires, idéalement équivalentes. Et
les femmes ne flottent pas au-dessus de la mêlée, mais sont bien de leur histoire, de leur
langue, de leur culture et plus, de la place que leur assigne leur groupe de naissance
dans l'ensemble des relations pas du tout neutres et égalitaires qu'entretiennent entre
eux ces divers groupes.
La tentative d'en sortir avec cette fameuse « différence » des femmes qui les ferait
toutes semblables en face des hommes, toutes semblables par nature, métaphysique-ment, revient précisément à éviter de connaître et d'affronter le rapport de force : en affirmant une spécificité d'essence féminine, on voile sûrement les rapports de force avec les hommes, mais on dénie également les rapports de force entre les hommes,
dont les femmes sont partie prenante malgré elles (mais aussi parfois très volontaire-ment). Ou bien, en faisant appel à la spécificité des appartenances, nommée diversité culturelle, où toutes les femmes sont différentes les unes des autres selon l'histoire et la place de leur groupe d'appartenance et ainsi résorbées dans leur groupe, déniées. Dans
les deux cas, la renonciation à la compréhension de ce qui fait les femmes est complète.
De ce qui construit les femmes et les hommes (qui n'existent pas l'un sans l'autre, cela
va sans dire, mais tant et si bien qu'on finit par n'y plus penser). De la relation de sexe
dans les groupes sociaux de reproduction. De l'usage et de l'instrumentalisation des
femmes, de leur assignation et de leur place d'objet et d'outil de la transmission et de
la reproduction. Ce contre quoi une part non négligeable d'entre elles se révolte et ce
de différentes façons selon les possi- bilités et les circonstances. (Mais toutes ne s'in-surgent pas.) Cette révolte n'est pas dirigée contre ce qui, du groupe, constitue l'indi-vidu, ce qui les fait elles- mêmes, nous fait nous-mêmes : langue, histoire, culture, dont nous sommes ; mais contre notre instrumentalisation et notre usage par les hommes.
Il est tout à fait erroné, il me semble, de dire « en tant que femme ET en tant que x, z
ou n ». Car ce sont les relations de pouvoir entre groupes qui imposent l'idée d'une telle
coupure. Un être humain est un, conscience et sujet pour lui-même. Il peut avoir à
faire face à des situations conflictuelles ou complexes, mais c'est autre chose qu'une
conscience multiple : lui-même est un sujet unique. L'idée de « la différence », celle
d'une spécificité métaphysique du « féminin » ou bien celle de femmes « différentes »
par immersion irréductible dans leur seule appartenance de groupe sont l'une et l'autre
l'effet d'un affrontement refusé à la structure sexuelle de nos sociétés, du renoncement
à la réflexion sur elle. Refus et renoncement dont les effets nous déchirent.
Pour terminer, mais certainement pas pour finir (ou le contraire, je ne sais),
quelques remarques de vocabulaire puisque les mots sont nos outils de travail. J'ai les
plus grandes réserves, qui ne font que croître, sur les termes « patriarcat » et « genre ».
Je leur préfère « domination des hommes » et « sexe ». En ce sens que « patriarcat »
désigne un mode particulier, une variante, historiquement et géographiquement déli-mitée, de la domination des hommes et que « genre » finit par masquer plus ou moins le fait que le sexe anatomique qui est le déterminant social du genre (ce que signifie bien le terme) l'est obligatoirement et impérativement. Ce n'est pas central à notre
préoccupation ici, encore que la dénomination soit dans l'analyse des rapports de sexe
un point crucial. Cette analyse de ce que sont nos sociétés et des liens qu'entretient le
racisme avec la division sexuelle, ses effets sur les femmes des différents groupes et leurs
relations entre elles est, elle,
Note
1.1. Ce texte a été initialement publié en 1998 par l'Association Nationale des Études Féministes
(ANEF). GUILLAUMIN, C. (1998), « La confrontation des féministes en particulier au racisme en général.
Remarques sur les relations du féminisme à ses sociétés », paru dans « Les féministes face à l'antisémitisme
et au racisme », Journée de l'ANEF du 14 Juin 1997, Supplément du Bulletin de l'Association Nationale des
Études Féministes, n° 26, p. 7-14
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aide médicale d’État : les femmes précaires dans le collimateur du gouvernement ?

Le gouvernement s'oriente vers une réforme de l'Aide médicale d'État (AME) via une série de mesures techniques, sans information de l'opinion publique ni débat parlementaire et malgré les alertes de nos associations. Si le texte est adopté, il aura pour conséquence de priver de soins des dizaines de milliers de femmes étrangères en situation de précarité. Une stratégie qui interroge alors même que le gouvernement affirmait avoir hissé la défense des droits des femmes comme Grande cause nationale.
En décembre 2023, le gouvernement reconnaissait, par la voix de sa Première Ministre, que « l'AME est un dispositif sanitaire utile, globalement maîtrisé et qu'il ne constitue pas en tant que tel un facteur d'incitation à l'immigration irrégulière dans notre pays ». Il envisage pourtant aujourd'hui d'introduire une série de mesures d'apparence technique qui affecteraient tout particulièrement les femmes les plus précaires, qui étaient près de 193 000 à bénéficier de l'AME en 2023.
L'AME est réservée aux personnes gagnant moins de 847 euros par mois (pour une personne seule). Le gouvernement veut désormais prendre en compte les ressources du conjoint (français ou étranger en situation régulière), si celui-ci est affilié à la sécurité sociale. Dans un couple où seule une personne est sans-papiers, celle-ci pourrait alors être privée de l'AME si son conjoint dispose de ressources dépassant le seuil. S'ajouterait à cela un durcissement de la justification de l'identité, qui entraînerait des conséquences désastreuses pour nombre de femmes victimes de violences qui se voient confisquer, voire détruire, leur document d'identité ou font face à un chantage aux papiers.
Avec une telle réforme, promise par le gouvernement face aux pressions de la droite et de l'extrême-droite pendant les débats parlementaires sur la loi immigration et élaborée aujourd'hui à l'abri des regards, bon nombre de femmes étrangères risquent de ne plus pouvoir se soigner.
Ces femmes, nos organisations les connaissent : elles présentent des risques accrus de précarité économique et sociale par rapport aux hommes. La pauvreté s'aggrave en France et, on le sait, touche plus violemment les femmes, qui étaient 4,9 millions sous le seuil de pauvreté en 2019 (Insee).
Ces femmes menacées d'une exclusion des soins sont, par exemple, celles qui travaillent, à temps partiel, caissières de supermarché et aides à domicile, détentrices d'un contrat de travail pour un métier « essentiel », de manière déclarée avec paiement de cotisations sociales, sans qu'elles disposent d'un titre de séjour ou d'un justificatif d'identité en bonne et due forme. D'autres sont obligées de travailler sans être déclarées, ce qui les prive de l'assurance maladie.
Ce sont aussi des femmes mariées à une personne française ou en situation régulière, en attente de régularisation depuis des mois, voire plusieurs années, notamment du fait d'innombrables difficultés administratives (impossibilité de prendre rendez-vous, absence de délivrance de récépissés ou d'attestation de prolongation de l'instruction, etc.).
Ce sont également ces femmes victimes de violences sexistes : conjugales, intrafamiliales ou sexuelles, ou de chantages aux papiers, qui peinent à quitter leur conjoint disposant lui, d'un salaire, mais qui n'ont pas personnellement les moyens de financer un divorce, et qui restent de ce fait juridiquement liées à leur ex-conjoint. Nous savons que l'une des manifestations des violences conjugales est précisément la violence financière, l'auteur de violences maintenant sa partenaire sous sa domination, l'obligeant à lui demander de l'argent pour la moindre dépense, même personnelle.
Nos organisations refusent que des dizaines de milliers de femmes n'aient accès à aucune couverture maladie pour se soigner. Nous appelons le gouvernement à renoncer à cette réforme.
Communiqué du 17 avril 2024
Signataires :
Women for Women France
Réseau européen des femmes migrantes
Le Rajfire
Planning familial
Osez le féminisme
Maison des femmes de Paris
Maison des femmes de Montreuil
Maison des femmes d'Asnières sur Seine
Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie
Fédération Nationale des CIDFF
Fédération nationale Solidarité Femmes
Excisions parlons-en
Elles aussi
La CLEF
Amicale du Nid
La Cimade
Comede
Emmaüs France
Fondation Abbé Pierre
France Assos Santé
Fasti
Gisti
Ligue des droits de l'Homme
Samu social de Paris
Secours catholique – Caritas France
Uniopss
https://www.gisti.org/spip.php?article7218
https://blogs.mediapart.fr/association-gisti/blog/170424/aide-medicale-d-etat-les-femmes-precaires-dans-le-collimateur-du-gouvernement
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration sur le génocide à Gaza

Note : Depuis que nous avons écrit cette déclaration, un nouveau cycle de violence s'est ouvert au Moyen-Orient, déclenché par l'attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie et par l'attaque massive de drones et de missiles iraniens contre Israël, qui a été abattue avec l'aide des forces britanniques et américaines. Où cela se terminera-t-il ?
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/18/feminist-dissent-declaration-sur-le-genocide-a-gaza-et-autres-textes/
Feminist Dissent tient à remercier l'artiste palestinienne Malak Mattar de nous avoir autorisés à utiliser l'image de sa peinture Thawra/Révolution. Mattar est une artiste de 22 ans originaire de Gaza.
Le dimanche 7 avril 2024 a marqué exactement six mois depuis qu'Israël a déclenché sa guerre brutale contre le peuple palestinien à Gaza, une guerre qui ne semble pas près de s'arrêter.
À Feminist Dissent, nous avons du mal à trouver les mots pour décrire la douleur et la rage que nous ressentons face à la cruauté et à l'injustice qui se sont manifestées depuis le 7 octobre 2023. Ce jour-là, le Hamas et ses associés ont attaqué, torturé et assassiné de nombreux et nombreuses civils israéliens et ressortissant·es étranger·es, y compris des femmes et des enfants – 1200 personnes ont été tuées et 253 prises en otage, dont seulement 112 ont été libérées ou sauvées et 12 corps ont été retrouvés. Parmi les personnes agressées et tuées figuraient des militant·es pacifistes, dont certains·e étaient elleux-mêmes des survivant·es·de l'Holocauste, qui s'étaient engagé·es depuis longtemps à vivre au service de l'humanisme, de la compassion et de la réconciliation entre les deux peuples. Le Hamas ne faisait pas de distinction entre la population civile et l'État israélien.
Israël ne l'a pas fait non plus lorsqu'il a entamé sa campagne de vengeance – ostensiblement contre le Hamas – qui s'est avérée être une guerre brutale et totale contre la population de Gaza qui continue d'être diabolisée, déshumanisée, disloquée et tuée en masse. Au cours des six derniers mois, 33 494 Palestiniens·ne sont mort·es, dont plus de 13 000 enfants et 8 400 femmes. Huit mille autres personnes sont portées disparues. Ces chiffres ne tiennent pas compte des blessé·es et des mort·es en Cisjordanie.
Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une guerre symétrique ou d'une guerre sans contexte. Si le Hamas et l'État israélien représentent tous deux des forces fondamentalistes et antidémocratiques de terreur et de répression qui se nourrissent l'une de l'autre, ils le font dans une dynamique profondément inégale dans laquelle Israël est la force dominante, en raison de sa puissance militaire et du soutien occidental. Depuis des années, Gaza est pratiquement une prison à ciel ouvert et Israël a longtemps cru que sa politique de division et de domination des différentes factions palestiniennes lui permettrait de continuer à dominer les Palestinien·nes sans être inquiété. Il aspire à une « normalisation » avec d'autres pays du Moyen-Orient tout en ignorant la question palestinienne. L'attaque du Hamas montre les limites de ces politiques, en particulier dans un Israël néolibéralisé et religieux qui a abandonné la plupart de ses citoyen·nes au profit d'intérêts économiques spécifiques et surtout d'intérêts religieux et nationalistes.
La relation entre Israélien·nes et Palestinien·nes doit être comprise à travers une histoire de colonialisme de peuplement, d'occupation et d'apartheid racialisé, alimentée par le projet sioniste de peuplement et, de plus en plus, par la politique juive de droite et fondamentaliste. La tragédie de cette guerre est que l'attaque du Hamas a renforcé l'angoisse existentielle des Israélien nes et ajouté la soif de vengeance à la déshumanisation croissante de « l'autre », qui s'est accrue dans les politiques d'occupation israéliennes. En conséquence, l'objectif de la guerre visant à « en finir avec le Hamas » – une organisation qu'Israël a cultivée pendant des années en tant que pouvoir politique intra-palestinien s'opposant à l'OLP laïque puis plus progressiste – est devenu dans la pratique une guerre visant à l'anéantissement total de la Palestine. En bloquant l'aide humanitaire et en détruisant l'infrastructure juridique, sociale, culturelle, religieuse et économique palestinienne nécessaire à la vie, Israël est passé du domicide à des politiques génocidaires permanentes qui utilisent la famine comme arme contre la population de Gaza. La campagne militaire d'Israël, pilotée par l'intelligence artificielle, lui a permis d'étendre la guerre dans toutes les directions pour englober toutes les parties de la société palestinienne, y compris les journalistes, les éducateurs et les éducatrices, les travailleurs et les travailleuses de la santé et de l'aide humanitaire, les personnes âgées et les malades. Les mort·es, les déplacements et la dévastation généralisés qui ont suivi ont conduit les Nations unies et de nombreuses agences humanitaires à mettre en garde contre le « danger imminent de famine », qui est en fait déjà une réalité pour un nombre croissant d'habitant·es de Gaza, en particulier dans le nord.
Les signes avant-coureurs d'un génocide imminent étaient là depuis le début. Suite au tollé international, en janvier 2024, l'Afrique du Sud a réussi à pousser la Cour internationale de justice à statuer provisoirement qu'Israël est engagé dans des actes plausibles de génocide et à appeler à un cessez-le-feu immédiat en conformité avec les obligations d'Israël en vertu de la Convention sur le génocide. Le rejet éhonté de la décision par Israël témoigne d'un stupéfiant sentiment d'impunité rendu possible par le soutien du Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales. L'encouragement, le soutien militaire et financier d'Israël par les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres pays constituent un nouveau fiasco dans notre ordre mondial d'après-guerre fondé sur des règles. Il s'agit d'une démonstration flagrante de complicité opportuniste et de la dégradation d'un leadership mondial qui a atteint des niveaux dangereux de faillite juridique, morale et politique. C'est précisément cette collusion qui a conduit d'anciens juges et avocat·es de la Cour suprême du Royaume-Uni à prendre la mesure sans précédent de publier une lettre avertissant que le Royaume-Uni risque lui-même d'enfreindre gravement le droit humanitaire international par le biais de politiques telles que son commerce d'armes avec Israël.
Les violences sexuelles et les viols commis par le Hamas à l'encontre des femmes israéliennes constituent une dimension supplémentaire de la guerre. En ce qui concerne le 7 octobre 2023, des preuves crédibles montrent qu'il s'agit d'une attaque calculée contre des femmes israéliennes dont les corps ont été violés, mutilés et utilisés comme armes de guerre. Nous dénonçons ces actes de brutalité et de dépravation dans les termes les plus forts possibles et soutenons les enquêtes indépendantes sur ces événements en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bien que les violences sexuelles n'aient pas atteint l'ampleur des guerres de Bosnie ou du Rwanda, il est clair que le Hamas avait l'intention de se venger en humiliant et en dégradant les femmes israéliennes.
Mais les actes de viol et de mutilation du Hamas proviennent de la même source idéologique qui se manifeste sur le corps des femmes palestiniennes. À l'instar de tous les mouvements fondamentalistes religieux, le Hamas a fait reculer les droits des femmes à Gaza en imposant des normes et des lois discriminatoires de la charia qui considèrent les femmes comme inférieures et justifient les restrictions de leurs mouvements, leur oppression et d'autres formes de violence à leur encontre. Par exemple, le nombre de femmes palestiniennes agressées ou tuées, y compris dans des crimes dits d'honneur, par des hommes violents a augmenté d'année en année à Gaza et dans d'autres territoires palestiniens.
Ce n'est là qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles le Hamas ne symbolise pas une lutte héroïque pour la libération de la Palestine, comme l'ont prétendu de nombreux membres de la gauche. Il s'agit d'un groupe islamiste militant qui a été créé à partir des Frères musulmans fondamentalistes par l'État israélien à Gaza pour semer la division et affaiblir la lutte des Palestinien·nes pour la liberté. Il ne se préoccupe pas plus des droits humains des femmes que l'État israélien, qui n'a pas hésité à instrumentaliser le viol et la violence sexuelle des femmes israéliennes pour justifier le massacre des Palestinien·nes. Nous ne devons pas oublier qu'Israël a lui aussi une longue et sordide histoire d'utilisation de la violence sexuelle contre les femmes, voire les hommes et les garçons palestiniens, comme arme de torture. Dans le même temps, il apaise également les forces fondamentalistes juives et ultra-orthodoxes qui exigent un plus grand contrôle patriarcal des femmes au sein de la société israélienne.
Le recours au viol et à la violence contre les femmes dans n'importe quel contexte doit être condamné, mais il en va de même pour l'assujettissement du peuple palestinien par Israël, qui dépend non seulement d'une violence et d'une surveillance aveugles, mais aussi d'un génocide en soi.
Il est difficile d'avoir de l'espoir en ces temps très sombres. Mais nous ferions bien de nous rappeler qu'en Israël, la résistance au mépris de Netanyahou pour la vie des otages et de leurs familles et à sa politique belliciste se développe, même si c'est pour des raisons politiques différentes. Si l'existence d'Israël en tant qu'État ethno-nationaliste et d'apartheid n'est pas encore sérieusement menacée, sa prétention douteuse à la démocratie et à la recherche de la paix s'effiloche rapidement.
Alors que la plupart des hommes politiques continuent d'excuser ou de défendre les actions d'Israël, en dehors d'Israël, la résistance de tous les secteurs de la société civile prend de l'ampleur. Guidés par les notions de liberté, d'État de droit et de justice sociale, de plus en plus de personnes réclament non seulement la fin de la guerre ou même de l'occupation post-1967, mais aussi la transformation de la Palestine/Israël en un État où tous les résident·es, quelle que soit leur origine ethnique, nationale, leur sexe ou leur classe sociale, peuvent jouir de droits humains et civils individuels et collectifs égaux. Pour celles d'entre nous qui se considèrent comme des féministes laïques, antiracistes, anti-fondamentalistes et socialistes, la lutte pour la survie de notre humanité et des valeurs fondamentales qui devraient la sous-tendre est devenue une lutte politique urgente.
https://feministdissent.org/blog-posts/statement-on-the-genocide-in-gaza/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sahel : la vague de chaleur meurtrière provoquée par un changement climatique « d’origine humaine »

Une étude publiée jeudi 18 avril par les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA) établit un lien entre la vague de chaleur meurtrière qui a frappé le Sahel début avril et le changement climatique d'origine humaine.
Tiré de El watan-dz
18 avril 2024
Rédaction web/AFP
1205
Du 1er au 5 avril, le Mali et le Burkina Faso ont été affectés par une vague de chaleur exceptionnelle en termes de durée et d'intensité, avec des températures dépassant les 45°C, entraînant de nombreux décès dans ces régions.
Selon les observations et les modèles de températures analysés, les scientifiques concluent que de telles vagues de chaleur auraient été impossibles sans un réchauffement global d'origine humaine, estimé à 1,2 °C. En effet, un épisode de cette ampleur dans la région ne survient normalement qu'une fois tous les 200 ans.
Les chercheurs soulignent que si les humains n'avaient pas provoqué le réchauffement planétaire en brûlant des énergies fossiles, la vague de chaleur d'avril aurait été moins intense de 1,4 °C dans la région. Ils avertissent que de telles tendances se poursuivront avec le réchauffement futur, et estiment qu'une augmentation supplémentaire d'un degré dans un monde déjà plus chaud de 0,8°C rendrait ces vagues de chaleur 10 fois plus fréquentes qu'actuellement.
La durée et la gravité de cette vague de chaleur ont entraîné une augmentation des décès et des hospitalisations, même si les populations locales sont habituées à des températures élevées. Bien qu'il soit difficile de quantifier précisément le nombre de victimes en raison du manque de données disponibles, il est probable qu'il y ait eu des centaines, voire des milliers de décès liés à la chaleur.
Les personnes âgées et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur, qui ont également affecté le fonctionnement des services de santé en raison des coupures de courant et des conditions climatiques extrêmes. Cette situation a mis en lumière l'impact dévastateur du changement climatique sur la santé et la sécurité des populations du Sahel.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

G7 : Accords en vue

Les chefs d'État du G7 – États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni, Italie et Canada – se réuniront dans la région des Pouilles, en Italie, du 13 au 15 juin.
Journaux et analystes patentés nous donneront l'impression d'ici là que l'on risque encore une fois de ne pas trop s'entendre sur certaines questions, en matière de lutte contre les changements climatiques ou au sujet de conflits en cours, lors de ce grand sommet du capital.
Vous pouvez toutefois être rassurés sur l'essentiel. Parce que tous ils s'entendront encore une fois comme larrons en foire, soyez-en sûrs, sur tout ce qui compte vraiment :
– laisser la destinée du monde entre les mains des riches, des banques et des multinationales ;
– spolier pour leur compte les pays pauvres de leurs ressources avec tout l'arsenal nécessaire de mesures économiques, politiques et militaires pour les assujettir complètement, anéantir leur marche vers la démocratie et la justice et réduire leurs populations à la pauvreté et à l'obéissance ;
– maintenir la démocratie à l'état embryonnaire dans les pays riches et en détruire le plus possible l'émergence dans les pays plus pauvres, d'une part par le contrôle privé et public de l'information et des sources de divertissement, d'autre part par la force et l'intimidation ;
– et empêcher coûte que coûte le partage des pouvoirs propre à ce que serait une vraie démocratie – la démocratie directe - et le partage équitable des ressources et responsabilités qui en découleraient.
Que faire ? Eh bien commencer par le commencement ! La prochaine fois, plutôt que de parler de tout et de rien à nos proches et amis, de potins ou de sports, parlons-leur de notre monde, de ce qui nous concerne, de justice sociale, d'égalité, de véritable démocratie. Parlons-leur et parlons-nous de ce qui compte vraiment pour nous et recommençons à semer le désir de changement…
Si puissants qu'ils puissent être, la faible minorité des possédants ne sera pas éternellement en mesure de maintenir le couvercle sur les espoirs en ébullition de la vaste majorité.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












