Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Sénégal : Législatives 2024 : Enterrer le système !

Le moins qu'on puisse dire est que l'enfantement d'un nouveau Sénégal souverain se fait dans la douleur et des secousses singulières bien qu'artificielles. Pour neutraliser les provocations des élites déchues, les leaders du camp patriotique pourraient élever le niveau du débat, dans le respect strict des droits et libertés, en fixant le cap et en élaborant une feuille de route très claire, qui prenne en charge de manière holistique, les problématiques liées à la transformation systémique. Dans cette phase de transition cruciale, devant acter l'avènement d'une nouvelle ère de souveraineté pleine et entière, de gestion vertueuse de l'Etat, de redistribution équilibrée des ressources nationales et de justice sociale se dressent des obstacles multiples.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le premier a trait à la nature même du cours que les tenants de la transformation systémique veulent imprimer à l'évolution politique de notre Nation, empêtrée jusque-là dans le bourbier néocolonial. De fait, la tâche d'anéantissement de la domination impérialiste qui sévit encore dans nos pays, censée faire advenir une nouvelle époque de libération nationale et sociale renvoie au clair-obscur de Gramsci, à un interrègne durant lequel surviennent les phénomènes morbides les plus variés.
Devant la détermination du camp patriotique et des panafricanistes de la sous-région à clore le sinistre chapitre de la Françafrique, (dont un des plus fidèles serviteurs, Mr Robert Bourgi, vient de dévoiler les mécanismes les plus pervers), on observe une résistance farouche du camp de la continuité néocoloniale.
On y retrouve, au premier plan, la coalition TAKKU WALLU, animée, pour l'essentiel, par des héritiers de WADE, ayant montré, le 3 février 2024, leurs vrais visages de putschistes constitutionnels, qui, projetaient de renvoyer aux calendes grecques, la présidentielle initialement prévue le 25 février dernier. Ses liens étroits avec l'ancienne métropole sautent aux yeux, car sa tête de liste, l'ancien président Macky Sall, qui a dirigé notre pays d'une main de fer, pendant douze années, est un collaborateur fidèle du président Macron, son envoyé spécial et président du comité de suivi de son pacte de Paris pour la planète et les peuples. La deuxième personnalité de cette association de « malfaiteurs politiques » est le fils biologique du président Wade, émissaire de Sarkozy, en juin 2011, à Benghazi, où il s'était rendu pour demander à Kadhafi d'abandonner la résistance à l'Occident et de partir.
Quant à l'autre coalition JAMM AK NJARIÑ, elle ne rassure pas davantage, car son président, le « fonctionnaire milliardaire » Amadou Bâ, candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle, était allé en France, proposer ses services comme cheval de substitution à Macky Sall, (rattrapé par la limitation des mandats), pour perpétuer le système françafricain. Elle compte, d'ailleurs, en son sein, plusieurs anciens barons du précédent régime, dont d'anciens combattants de la gauche, qui croient pouvoir se créer une nouvelle virginité politique et effacer leurs « délits politiques » antérieurs, en changeant de parti ou coalition, sans faire le plus petit effort d'autocritique. C'est d'ailleurs cette absence de remise en cause, des anciens tenants du pouvoir, de leurs démarches antérieures, qui explique leur manière de s'opposer, leur but ultime étant de restaurer, le plus vite possible, l'ancien ordre rejeté massivement par peuple sénégalais.
S'il faut saluer la distanciation des membres des coalitions SAMM SA KADDU et SENEGAL KESE par rapport aux deux premières, qui tenaient les rênes du pouvoir et qui ont été électoralement battues, le 24 mars dernier, on ne peut qu'être perplexes devant leur excès d'agressivité par rapport au nouveau régime et leur réticence farouche à soutenir et/ou accompagner les ruptures annoncées par PASTEF.
Au-delà des vicissitudes et péripéties plus ou moins dérisoires de la vie politique, il faudra bien que les acteurs politiques de tous bords, y compris les actuels gouvernants, nous édifient sur leur positionnement par rapport aux enjeux décisifs de refondation institutionnelle, de respect des droits et libertés, de souveraineté nationale, de gestion vertueuse et de justice sociale, autour desquels de larges convergences peuvent être trouvées.
S'agit-il de démanteler le système (néocolonial), en vigueur dans notre pays, depuis son accession à l'indépendance formelle et dont la faillite est devenue manifeste avec le régime quasi-autocratique de Benno Bokk Yakaar ? Ou alors s'agit-il de réanimer ce système désastreux, en se soumettant au diktat des puissances occidentales en général et de la Françafrique, en particulier, ce qui équivaut à la poursuite de la domination économique et politique sur nos pays ?
Voilà les questions de fond auxquelles il faut apporter des réponses claires, au lieu de continuer à louvoyer et de s'adonner à une guérilla politicienne ininterrompue contre le pouvoir en place pour l'amener à abdiquer sur ses orientations progressistes.
Notre souhait le plus ardent est une option résolue vers l'enterrement du système néocolonial honni, par la confirmation du positionnement patriotique lors des prochaines législatives du 17 novembre 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : les médias conservateurs, acteurs clés de la campagne présidentielle

Retour sur l'émergence et le rôle devenu essentiel dans la politique américaine des médias conservateurs – une étiquette d'ailleurs discutable en soi, tant leur idéologie et leur ton n'ont plus grand-chose à voir avec le conservatisme au sens traditionnel du terme…
Tiré de The conversation. Légende de la photo : Donald Trump discute avec le présentateur de Fox News Sean Hannity après un meeting à Harrisburg, Pennsylvanie, le 4 septembre 2024. Mandel Ngan/AFP
Lors du débat présidentiel du 10 septembre dernier, quand Kamala Harris le met explicitement en cause pour son rôle dans les émeutes de Charlottesville de 2017, c'est de l'autorité de Sean Hannity et Laura Ingraham, animateurs vedettes de Fox News, que Donald Trump se prévaut pour attester la véracité de sa version des événements.
Que le candidat républicain s'en remette à deux personnalités phares du prime time politique de la première chaîne conservatrice du pays (Hannity et The Ingraham Angle, leurs émissions respectives, attirent plus de 2,5 millions de téléspectateurs quotidiens) ne doit rien au hasard : depuis l'émergence de la radio conservatrice à la fin des années 1980, l'écosystème des médias conservateurs exerce une influence souvent cruciale sur les destinées du Parti républicain ; depuis 2016, il est un allié proprement indéfectible de Trump. On le constate à chaque intervention ou mention, sur ces chaînes et radios, de Trump ou de ses adversaires. Ainsi, quand Kamala Harris s'est jetée dans l'arène en acceptant l'invitation de Bret Baier, présentateur vedette du journal télévisé, ce 16 octobre, sur le plateau de Fox News pour un entretien de 60 minutes, elle y a été accueillie avec une agressivité tranchant violemment avec le ton cordial employé à l'égard du candidat républicain.
Retour sur l'histoire d'un acteur clé dans le dispositif de reconquête du pouvoir de l'ancien président.
L'essor fulgurant de la radio conservatrice au début des années 1990
Premier média conservateur accessible au grand public, le talkshow radiophonique investit les ondes en août 1988 avec le lancement sur 56 stations de radio AM du Rush Limbaugh Show, émission quotidienne de trois heures qui, jusqu'à la mort de son animateur en février 2021, occupe la première place du palmarès des émissions radio.
Ce nouveau genre est porté par les vagues d'innovation technologique et de déréglementation qui déferlent sur le secteur des médias au cours des années 1980 : généralisation de la transmission satellite, relâchement des règles de propriété, et surtout, en 1987, révocation de la Fairness Doctrine, qui depuis 1949 contraint les diffuseurs à proposer des programmes en lien avec les enjeux locaux et à favoriser le pluralisme des points de vue.
Dès lors, le talkshow conservateur s'empare des ondes pour connaître un essor retentissant à partir de 1992, lorsque Bill Clinton fait son entrée sur la scène politique nationale : en 1994, le nombre de stations diffusant le Rush Limbaugh Show dépasse les 550. Les licences de diffusion sont accordées par le biais d'accords de troc (barter deals) par lesquels les stations acquièrent gratuitement les droits de l'émission en échange de leur temps publicitaire national, vendu aux annonceurs. Par ce système, les stations réduisent leurs coûts de production de façon drastique, mais il en résulte la dénaturation et l'uniformisation de la programmation radiophonique, qui répond de moins au moins aux enjeux locaux.

Le phénomène ne fait que s'exacerber sous l'effet du Telecommunications Act de 1996, qui relâche encore davantage les règles de propriété et permet la consolidation du secteur de la radio et la création de grands réseaux de distribution, tels que Talk Radio Network ou Premiere Radio Network. À partir d'avril 2001, le premier distribue le Laura Ingraham Show ; le second, le Sean Hannity Show, dès le lendemain des attentats du 11 septembre.
Mastodontes du prime time de Fox News, Ingraham et Hannity sont donc également des figures historiques de la radio conservatrice : jusqu'à son interruption en 2018, l'émission d'Ingraham est la première émission radio conservatrice animée par une femme dans un secteur que dominent très largement les voix masculines. Depuis la mort de Limbaugh, le Sean Hannity Show est quant à lui la première émission radio toutes catégories confondues, avec quotidiennement plus de 3 millions d'auditeurs, nettement devant Special Report with Bret Baier (2,13 millions) et The Situation Room with Wolf Blitzer (859 000), les JT de fin d'après-midi de Fox News et CNN.
L'émergence de l'écosystème médiatique conservateur avec Fox News
C'est le lancement en octobre 1996 de la chaîne câblée Fox News qui permet la mise en place de l'écosystème médiatique conservateur. Pour Rupert Murdoch, propriétaire de la chaîne, et Roger Ailes, son directeur, l'objectif est de prendre le contre-pied de CNN, considérée comme étant à la solde des Démocrates, tout en positionnant Fox News comme chaîne d'information légitime.
Par le slogan « Fair & Balanced » – abandonné en 2017 –, elle s'approprie le métadiscours traditionnel sur l'objectivité journalistique pour dépeindre en creux les médias d'information dominants comme ayant failli à l'impératif d'impartialité. Il faut d'ailleurs distinguer le service de l'information, auquel est associé le service électoral (election desk), du service éditorial, dont relèvent les émissions d'analyse politique de prime time, même si ce sont elles qui assurent le succès commercial de la chaîne et définissent son identité. Parmi celles-ci, The O'Reilly Factor (1996-2017) et Hannity & Colmes (1996-2009) – qui devient Hannity à la suite du départ du progressiste Alan Colmes en 2009 – s'imposent comme émissions phares pendant la présidence de George W. Bush.
Ce sont les attentats du 11 septembre puis la Guerre d'Irak de 2003 qui mettent Fox News sur orbite : comparativement à ses concurrentes, elle est la chaîne dont le public s'élargit le plus et, à partir de 2001, ses audiences dépassent systématiquement celles de CNN.
Surtout, là où traditionnellement les présentateurs tirent leur légitimité de leur indépendance vis-à-vis du jeu politique, les animateurs de ces nouveaux formats cherchent à maintenir leur autonomie et leur influence au sein du jeu politique, dont ils deviennent des acteurs à part entière, d'autant qu'entre 2002 et 2004, les publics montrent une proximité croissante avec le Parti républicain.
Une esthétique tapageuse au service d'un conservatisme fondamentaliste
Malgré la proximité des publics avec le Grand Old Party et leur allégeance envers le conservatisme, l'étiquette « médias conservateurs » est toutefois trompeuse.
Depuis l'émergence de la radio conservatrice, les médias de droite radicale ont opéré une rupture radicale avec la tradition conservatrice (mesure dans la conduite du débat politique, attachement à une intervention raisonnée et limitée de l'État, préservation du statu quo) et surtout avec la civilité du débat public : ces médias défendent en fait un conservatisme fondamentaliste porteur d'une réaction culturelle fondée sur des principes universels abstraits et comportant une forte dimension dogmatique et révolutionnaire.
Surtout, ils appartiennent au genre de « l'indignation tapageuse » (outrage programming) : leur objectif n'est pas d'édifier l'auditorat par une analyse dépassionnée de sujets qui intéressent les publics conservateurs, mais de susciter leur indignation, créer le scandale et hystériser le débat. Ils recourent pour cela au sensationnalisme, à l'exagération déformante, à la réinterprétation hyperbolique des événements de l'actualité et à des prédictions de catastrophes imminentes. Le tout servi par une rhétorique et un style abrasifs, où l'attaque ad hominem et la prise à partie le disputent à la vitupération et l'invective.
Sont mises en avant les questions que les publics considèrent primordiales afin de créer un impact émotionnel maximal, de sorte que les petits sujets de niche sont élevés au rang de véritables scandales tandis que certains faits plus importants mais dont la résonance idéologique est jugée moindre sont souvent passés sous silence. Ainsi, en proposant un ordre du jour différent de celui des médias d'information grand public, l'écosystème médiatique conservateur reconfigure les hiérarchies de l'information et place de façon stratégique au centre du débat certaines questions dont la teneur informationnelle et la pertinence politique pourraient être jugées nulles selon les critères du journalisme professionnel.
Un écosystème médiatique au service du projet trumpiste en constante expansion
Depuis le milieu des années 2010, cet écosystème n'a cessé de se développer. À la radio, une nouvelle génération d'émissions telles que le Ben Shapiro Show, le Charlie Kirk Show et le Dan Bongino Show ont fait leur apparition à la fin de la décennie.
Bien que Shapiro fasse parfois montre d'un certain recul critique envers Trump, tout comme Bongino et Kirk, il en est un ardent soutien. En amont du débat présidentiel du 10 septembre avec Kamala Harris, il déclare à l'antenne que Trump « va écraser Harris », qui n'a aucune chance face à lui car elle est incompétente et manque de réactivité. Le 7 octobre, Shapiro accompagne Trump lors de sa visite de la tombe de Menachem Mendel Schneerson, rabbin loubavitch et leader spirituel du judaïsme mondial ; le lendemain, il lui ouvre son antenne pour un entretien par téléphone.
Dans le secteur de la câblodiffusion, Fox News a vu son monopole remis en question par le lancement de One American News Network (OANN) (2013) et de Newsmax (2014), chaînes qui offrent un espace d'expression aux voix conservatrices trop radicales pour être audibles sur les autres supports et grandes pourvoyeuses de théories du complot et de contenus fabriqués.
Toutes deux offrent à Trump un territoire de repli quand sa relation avec Fox connaît des tensions, quand le discours de Fox n'est momentanément plus aligné sur le sien et qu'il cherche à ce que ses positions soient validées. En cela, OANN et Newsmax lui apportent une loyauté indéboulonnable. D'ailleurs, lorsqu'au soir de l'élection de 2020 l'election desk et le service de l'information de Fox News reconnaissent la victoire de Joe Biden et, dans les jours qui suivent, réfutent les allégations de Trump selon lesquelles l'élection a été volée, une partie du public, qui considère ce relâchement dans le soutien à Trump comme une trahison intolérable, migre vers OANN et Newsmax.
Entre juin et octobre 2023, Fox News prend ses distances par rapport à Trump. En avril, lorsque la chaîne accepte de payer $785,5 millions en règlement à l'amiable de l'action en justice intentée contre elle par Dominion Voting Systems pour diffamation – Trump et ses avocats avaient accusé le fabricant de machines de vote d'avoir truqué ses équipements pour favoriser Biden –, elle se sépare de l'animateur de Tucker Carlson Tonight, émission qui attire le plus grand nombre de téléspectateurs, et voit ses audiences baisser fortement.

Si en amont des primaires républicaines, Trump reçoit plus de la moitié du temps d'antenne que les trois chaînes câblées conservatrices consacrent aux candidats, Fox News lui accorde moins de temps qu'à Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis. Sur Newsmax, il bénéficie au contraire de plus d'attention que tous les autres candidats réunis, et OANN parle même huit fois plus de lui que de l'ensemble de ses concurrents.
La période de froid entre Trump et Fox News n'a été que de courte durée. La quasi-intégralité des animateurs de la chaîne soutiennent désormais activement la candidature de l'ancien président, que ce soit en jouant le rôle de caisse de résonance de sa campagne de désinformation – le 1er octobre, Hannity développe, montage trompeur à l'appui, les allégations de Trump selon lesquelles les populations touchées par l'ouragan Helene en Géorgie attendent toujours le secours de l'État fédéral – ou en fournissent aux téléspectateurs des contre-récits leur permettant de faire sens de l'hostilité dont Trump fait l'objet. De la jeune génération d'animateurs radio aux nouvelles chaînes câblées en passant par le prime time de Fox News, à quelques semaines de l'élection, Trump bénéficie de l'appui inconditionnel d'un establishment médiatique conservateur entièrement acquis à sa cause et œuvrant activement à sa victoire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
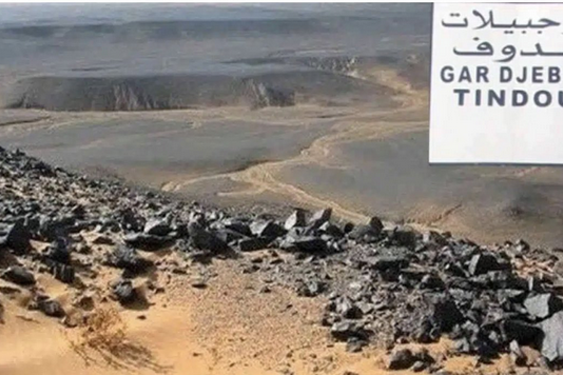
Algérie - Une victoire salutaire : les ouvriers de Ghar Djbilat se font entendre

Mercredi 2 octobre, un vent de révolte a soufflé sur le chantier de l'usine de production de traverses en béton de la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Béchar et la mine de Ghar Djbilat. Les ouvriers algériens, las des conditions de travail et de restauration déplorables, ont décidé de faire entendre leur voix. en refusant de se présenter au travail à 7H du matin.
13 octobre 2024, par
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72229
Le point de rupture ? Des repas servis à la cantine jugés indignes. Malgré de nombreuses réclamations, aucune amélioration n'a été observée, laissant les ouvriers dans un état de de frustration.
Le fossé entre les ouvriers algériens et chinois, ainsi qu'entre les cadres algériens et les travailleurs de base, s'est creusé davantage. L'injustice se manifestait notamment par l'écart flagrant dans la valeur des repas quotidiens. Un ouvrier algérien, contraint de se nourrir sur place, dépense 24 000 DA par mois, soit 800 DA par jour, ce qui représente 40% de son salaire net de 60 000 DA.
La grève collective a été un acte de courage et un signal fort. L'union fait la force et cette action a permis d'arracher une première victoire : l'amélioration de la qualité des repas. D'autres points restent en suspens, ce qui souligne la nécessité de bâtir une union solidaire regroupant tous les travailleurs, algériens et chinois, autour d'un comité représentatif. Il est crucial d'appeler tous les ouvriers, sans exception, à y adhérer afin de défendre collectivement leurs intérêts et leurs droits
Adlène K.
P.-S.
• Le Fil Rouge. 13 octobre 2024 :
https://filrouge19.wordpress.com/author/procrastination146/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Iran : Sharifeh Mohammadi doit être libérée immédiatement et sans condition !

La Cour suprême a annulé la peine cruelle et sans fondement prononcée contre la militante syndicale et défenseure des droits des femmes Sharifeh Mohammadi. Elle a renvoyé son affaire devant la même instance pour réexamen.
11 octobre 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières, par Syndicat VAHED
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72230
Sharifeh Mohammadi a été arrêtée le 5 décembre 2023, et a longtemps été en détention à l'isolement et interrogée. Elle est actuellement incarcérée à la prison de Lakan, à Rasht. En juillet 2024, elle avait été reconnue coupable de l'accusation forgée de toutes pièces et condamnée à mort.
Le Syndicat des travailleurs/euses de la compagnie de bus Vahed de Téhéran et de la banlieue, a protesté à plusieurs reprises contre l'arrestation et la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi. Il a œuvré pour sa libération au niveau des organisations internationales, et se félicite de la nouvelle de l'annulation de la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi.
Il rappelle que Sharifeh Mohammadi n'avait commis aucun crime et doit être libérée immédiatement et sans condition.
Les principaux facteurs de l'annulation de la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi ont été :
la détermination de Sharifeh Mohammadi malgré le harcèlement subi lors des interrogatoires et plus largement par les responsables de la sécurité et de la justice,
les efforts de sa famille et la campagne pour défendre Sharifeh Mohammadi,
l'action de ses avocats,
les campagnes nationales et internationales,
le soutien des mouvements syndicaux et pour la liberté.
Nous avons répété à maintes reprises que la peine de mort est une peine inhumaine qui est contraire aux valeurs humaines universelles et qui doit être abolie partout.
Les peines prononcées contre d'autres prisonniers politiques condamnés à mort, dont Pakhshan Azizi, doivent être immédiatement révoquées et révoquées. Tous les militants syndicaux et de la société civile et les prisonniers politiques dans tout le pays doivent être libérés.
Syndicat des salarié.es des bus de Téhéran et sa banlieue (Vahed)
htps ://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
vsyndica@gmail.com
https://t.me/vahedsyndica
@Vahed_Syndica
P.-S.
http://www.iran-echo.com/farsi.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Travail. En Inde, les ouvriers d’une usine Samsung mettent fin à une longue grève

Les salariés de l'usine de Sriperumbudur, dans le sud de l'Inde, ont mis fin à leur grève entamée il y a plus d'un mois pour la reconnaissance de leur syndicat et l'amélioration de leurs conditions de travail.
17 octobre 2024 | tiré de Courrier international
https://www.courrierinternational.com/article/travail-en-inde-les-ouvriers-d-une-usine-samsung-mettent-fin-a-une-longue-greve_223502
Cela faisait plus d'un mois que les ouvriers de l'usine Samsung de Sriperumbudur, dans le sud de l'Inde, étaient en grève. Le contentieux a été résolu “à l'amiable” le 15 octobre, indique le site MoneyControl.
Cette décision a été prise après trois séries de réunions de conciliation organisées par le gouvernement local de l'État du Tamil Nadu, précise The Hindu. Les salariés du géant sud-coréen de l'électronique exigeaient notamment que l'entreprise reconnaisse leur syndicat nouvellement formé, le Samsung India Workers Union, le Syndicat des travailleurs de Samsung Inde (Siwu).
Lire aussi : Tendance. En Asie, les jeunes salariés disent non au culte du travail
Akriti Bhatia, une militante des droits des travailleurs, a déclaré à la BBC qu'il était fréquent de voir les multinationales présentes en Inde violer le droit du travail, qui accorde aux travailleurs le droit d'association et de négociation collective. Ces entreprises contournent la loi en créant des syndicats internes, qui ne sont dirigés par les travailleurs que sur le papier.
Mouvement historique
Environ 1 500 travailleurs ont participé à la grève pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, en plus de la reconnaissance de leur syndicat nouvellement créé. “Cette grève est l'une des plus importantes que le géant technologique sud-coréen ait connues ces dernières années”, affirme le média britannique. Ils ont également demandé une meilleure application de la rémunération des heures supplémentaires et une augmentation de l'assurance médicale.
Lire aussi : Économie. Une grève historique pourrait perturber la production de semi-conducteurs chez Samsung
La direction de Samsung et le syndicat se sont mis d'accord sur plusieurs points : “Aucune mesure punitive ne doit être prise à l'encontre des travailleurs protestataires ; aucune réduction de salaire ne doit être effectuée pendant la durée de la protestation ; les travailleurs ne doivent entreprendre aucune action préjudiciable à la direction ; et Samsung doit soumettre au conciliateur des réponses écrites à la charte des revendications présentée par le Siwu”, détaille The Hindu.
La demande d'enregistrement du syndicat sera examinée par un tribunal de Madras. “Le Siwu avait accusé l'État du Tamil Nadu de soutenir Samsung et de retarder l'enregistrement du syndicat”, un droit constitutionnel en Inde, rappelle le quotidien.
Alternative à la Chine
L'usine de Sriperumbudur produit des climatiseurs, des réfrigérateurs, des compresseurs, des téléviseurs LED et des composants liés à la technologie 5G et contribue à un tiers du chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars (11 milliards d'euros) du géant sud-coréen en Inde.
Lire aussi : Social. Le géant coréen Samsung est confronté à sa “toute première grève”
Cette grève menaçait “de jeter une ombre sur la tentative du Premier ministre Narendra Modi de positionner l'Inde comme une alternative viable à la Chine pour les activités manufacturières”, juge la BBC.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le mirage des énergies « renouvelables »

Depuis la COP (Conference of Parties) 21 qui s'est tenue à Paris en novembre 2015, toutes les parties signataires de l'accord alors conclu se sont engagées à promouvoir des politiques visant à contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels [tout] en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ». Au cœur de ces politiques gît l'impératif de « décarboner l'économie », notamment la production d'énergie, en réduisant substantiellement et rapidement le recours aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) dont la combustion émet des gaz à effet de serre (GES), au premier chef du dioxyde de carbone (CO2), dont l'accumulation dans l'atmosphère est responsable du changement climatique. Cela suppose de leur substituer des énergies « renouvelables »[1].
Tiré de A l'Encontre
15 octobre 2024
Par Alain Bihr
Des camions Hugelshofer sont stationnés sur la place à côté de la halle de chargement couverte de panneaux solaires pour les camions électriques de Hugelshofer Logistik AG, photographiés le jeudi 29 août 2024 à Frauenfeld (Suisse).
Ces dernières sont multiples. La principale d'entre elles est l'énergie fournie par le rayonnement solaire qui se présente à nous sous différentes formes. Les unes sont directes : l'énergie thermique et la biomasse végétale, qui concentre l'énergie solaire par l'intermédiaire de la photosynthèse et peut nous fournir du bois, du méthane ou de l'éthanol, qui sont autant de combustibles [2]. Les autres sont indirectes : l'électricité photovoltaïque, éolienne (les courants atmosphériques procèdent, outre de la rotation de la Terre, des différences de températures, de densités et partant de pressions entre zones atmosphériques, générées par le rayonnement solaire) ou hydroélectrique (l'énergie solaire est le moteur de l'évaporation de l'eau et partant des précipitations pluvieuses et neigeuses sur les sommets, générant les cours d'eau qu'exploitent les centrales hydroélectriques). Viennent ensuite la géothermie, superficielle ou profonde, et son équivalent maritime (exploitant la différence de température entre eaux de surface et eaux profondes, ce qui n'est cependant possible qu'en zone tropicale) [3]. Enfin l'énergie cinétique des mouvements des mers et océans (vagues, houles, marées, courants marins, etc.), engendrés par les vents et par des phénomènes astronomiques (la rotation de la Terre, l'attraction du Soleil et de la Lune) : énergie énorme, convertissable en électricité par l'intermédiaire d'hydroliennes ou turbines hydrauliques, mais dont l'exploitation n'est encore que très peu développée.
Substituer les sources d'énergie renouvelables aux sources d'énergie fossiles revient donc, en bonne partie, à remplacer l'exploitation de l'énergie solaire sous forme de stocks constitués, directement ou indirectement, par elle au cours de l'histoire de la Terre (charbon, pétrole et gaz naturel procèdent de la fossilisation de la biomasse antérieure) à son exploitation sous forme de divers effets produits par son flux actuel. De fait, à elle seule, l'énergie solaire serait très largement en mesure de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de l'humanité actuelle et future :
« L'énergie solaire totale absorbée chaque année par l'atmosphère terrestre, les océans et les masses terrestres est d'environ 122 PW·an [PW : pétaW = 1015W], soit 3 850 zettajoules(1021 joules, ou ZJ). En 2002, cela représente plus d'énergie en une heure que la consommation humaine sur une année. Pour comparaison, le vent contient 69 TW·an [TW : téraW = 1012W], soit 2,2 ZJ et la photosynthèsecapture environ 95 TW·an, soit 3 ZJ par an dans la biomasse. La quantité d'énergie solaire atteignant la surface de la planète est si importante que, en un an, elle représente environ deux fois l'énergie obtenue à partir des ressources non renouvelables de la Terre — charbon,pétrole, gaz naturel et uraniumcombinés — exploitées de tout temps par l'homme. L'énergie totale utilisée par l'homme représente en effet, en 2005, 0,5 ZJ, dont 0,06 ZJ sous forme d'électricité »[4].
Certes, cette gigantesque puissance mise à notre disposition par le Soleil n'est sans doute qu'en partie exploitable. « Le World Energy Assessment des Nations unies mentionne un potentiel technique de 7 600 exajoules/an [exajoule ou EJ = 1018 joules], soit dix-huit fois les besoins mondiaux en énergie (…) Des chercheurs de l'Institut de thermodynamique de Stuttgart avancent une estimation de 5,9 » (Tanuro, 2012 : 86).
Remplacer les énergies fossiles par des énergies « renouvelables » ?
Dans ces conditions, substituer totalement les énergies « renouvelables » aux énergies fossiles, en remédiant du coup aux multiples maux écologiques engendrés par le recours à ces dernières semble a priori de l'ordre du possible. Des simulations en ce sens ont été tentées. Par exemple, en supposant que soit nécessaire à l'échelle mondiale à l'horizon 2030 une puissance de l'ordre 17 TW (térawatt = 1012 watts), que l'usage exclusif d'énergie électrique produite par des sources renouvelables (solaire, éolien, géothermique et hydroélectrique) pourrait ramener à 11,5 TW :
« une combinaison de quelque 3,8 millions de grandes éoliennes (5 MW), de 49 000 grandes centrales solaires à concentration (300 MW), de 4 0000 centrales solaires photovoltaïques, de 1,7 milliard d'installations photovoltaïques sur les toits, de 5 350 centrales géothermiques, de 900 centrales hydroélectriques, de 49 0000 hydroliennes, et 720 000 dispositifs utilisant l'énergie des vagues (tous énumérés par ordre décroissant de leur contribution à la demande totale) seraient plus que suffisants pour produire une telle puissance » (McCarthy, 2015 : 2492).
Le tout en ne faisant appel qu'à des technologies existantes et éprouvées. Et, selon les auteurs de la même simulation, la production et l'installation d'un tel système énergétique coûteraient (hors frais de transports) quelque 100 000 milliards de dollars (Md$) sur vingt ans, soit des investissements à hauteur de quelque 5 000 Mds par an (Ibid.). Une simulation plus récente conduit à des estimations du même ordre :
« Dans son dernier rapport sur l'énergie, Bloomberg (New Energy Outlook 2021) estime qu'une économie mondiale en croissance nécessitera un niveau d'investissement dans l'approvisionnement et les infrastructures énergétiques compris entre 92 000 et 173 000 milliards de dollars au cours des trente prochaines années. L'investissement annuel devra plus que doubler, passant d'environ 1 700 milliards de dollars par an aujourd'hui à une moyenne comprise entre 3 100 et 5 800 milliards de dollars par an » (Durand, 2021).
Cependant, la réalisation d'un tel projet se heurterait à des problèmes gigantesques. Les moindres sont d'ordre technique. C'est que toutes les sources d'énergies « renouvelables » ici mises en œuvre exploitent des flux et non des stocks d'énergie. Ce qui implique de disperser les foyers de production le long de ces flux sur toute la surface de la Terre (bien qu'inégalement : certaines localisations sont plus favorables que d'autres) et implique de les mettre en réseau pour leur permettre de s'additionner et se soutenir réciproquement. Cela est par ailleurs rendu indispensable du fait de l'intermittence de la plupart d'entre elles (à l'exception de la géothermie) : la lumière solaire ne nous parvient qu'en partie les jours où le ciel est couvert et surtout pas la nuit sur la moitié de la Terre ; le vent ne souffle pas en permanence ; le débit des cours d'eau varie selon les saisons, etc. ; il faut donc compenser les creux de production des unes par les crêtes de production des autres. Enfin, essentiellement productrices d'électricité, ces énergies se heurtent au fait que l'électricité ne se stocke pas, peu ou mal : elle se consomme de préférence dans le temps même où elle est produite. Elle peut cependant se stocker indirectement en étant convertie en différentes formes d'énergie potentielle : mécanique (des volants d'inertie, des retenues d'eau alimentées par de l'eau pompée en aval et activant des centrales hydroélectriques lorsque celle-ci est relâchée, la compression de gaz dans d'anciennes mines) ou chimique (dans des piles et accumulateurs ou sous forme d'hydrogène pouvant servir dans des piles à combustible). La solution de l'ensemble de ces problèmes techniques passerait par la réalisation des réseaux d'électricité dits intelligents (pilotés informatiquement) ou smart grids et de capacités de stockage massives, les deux à l'échelle de continents entiers.
Plus délicats apparaissent les problèmes que soulèverait le financement d'un tel projet. Celui-ci supposerait, comme on l'a vu, des investissements massifs de capitaux, demandant à être stimulés, soutenus et garantis par les Etats sous forme d'aides et de subventions, d'autant plus que ces investissements impliqueraient de lourdes immobilisations (une importante composante fixe de capital constant). Or, si une partie du capital tire d'ores et déjà profit du développement des énergies « renouvelables » et est certainement prête à s'y investir encore davantage (d'autant plus que le prix des installations productrices d'énergies « renouvelables », notamment solaires et éoliennes, ne cesse de baisser), il n'en va pas de même du capital industriel qui se valorise actuellement par l'exploitation des énergies fossiles, adossé à la partie du capital financier qui lui sert de banquier ou qui spécule sur le cours de ses actifs. Tous ces capitaux ont tout à craindre du développement des « énergies » renouvelables, qui non seulement leur prennent d'ores et déjà des parts de marché mais menacent de dévaloriser l'immense stock de leurs capitaux fixes en fonction avant qu'il n'ait eu le temps de s'amortir, stock matérialisé dans le système énergétique actuel [5], et de dévaloriser de même les réserves de combustibles fossiles sur la valorisation desquelles ils ont trouvé à se financer (sous forme de prêts, d'obligations ou d'actions). Comptant parmi les plus gros capitaux (les capitaux les plus concentrés), constituant le plus souvent des monopoles au niveau national et formant de véritables oligopoles au niveau mondial, les compagnies charbonnières, pétrolières et gazières (idem pour les compagnies nucléaires) disposent d'un pouvoir économique et politique considérable, capable d'entraver l'évolution des législations au niveau des Etats et de saboter les négociations internationales, comme en témoigne leur intense lobbying dans le cadre de la mise en œuvre de la Conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique par les COP successives. Elles peuvent d'ailleurs faire valoir qu'elles continuent à fournir plus des quatre cinquièmes de l'énergie consommée dans le monde (cf. infra), que leurs produits sont faciles à stocker et à transporter et que, contrairement aux énergies « renouvelables », les énergies fossiles ne sont pas tributaires des aléas climatiques et répondent donc aux exigences de continuité et de célérité du procès capitaliste de production – en passant évidemment sous silence, en déniant ou en minimisant les dégâts écologiques qu'elles provoquent comme elles ne cessent de le faire depuis des lustres.
Dans ces conditions, d'une part, ces entreprises transnationales ne participeraient que marginalement au financement du développement des énergies « renouvelables ». D'autre part, elles useraient de tout leur poids politique pour freiner ce développement (notamment pour limiter autant que possible les réductions d'émissions de GES) ; et leur pression serait d'autant plus efficace que l'Etat serait amené à jouer un rôle clef dans le passage d'un système énergétique basé sur les énergies fossiles à celui fondé sur les énergies « renouvelables ». C'est qu'une telle transition ne pourrait être laissée au bon soin du seul marché ; elle supposerait l'intervention des Etats pour orienter et soutenir les investissements de capitaux dans le cadre de véritables politiques industrielles, pour faire évoluer les législations et réglementations des marchés de l'énergie, pour surveiller la régulation des smart grids et les sites de stockage d'énergie, pour prendre en charge pour partie au moins les programmes de recherche scientifique et de recherche-développement rendus nécessaires par les bouleversements techniques occasionnés par cette transition, etc. Enfin, la dévalorisation des capitaux de ces transnationales du charbon, du pétrole et du gaz impliquerait tout aussi bien la destruction de la masse considérable de capital fictif dont les actifs (titres de crédit ou de propriété) reposent sur ces industries, qui feront eux aussi défaut pour financer le développement des énergies « renouvelables ».
Les problèmes les plus sérieux que ne manquerait pas de rencontrer ce dernier seraient cependant d'ordre géopolitique. D'une part, l'indispensable déploiement de réseaux continentaux d'unités de production ou de stockage d'énergie électrique à partir de sources renouvelables supposerait une coopération intense et fiable, à la fois technique, juridique et administrative, entre Etats-nations, en dépit des conflits d'intérêts qui pourraient continuer à les opposer, notamment quant à la localisation de ces unités, source de revenus fiscaux et gage de synergies socio-économiques. D'autre part, le déploiement de tels réseaux et capacités de stockage serait gourmand en emprise sur les surfaces terrestres et maritimes (le nouveau système énergétique couvrirait 2 % de la surface terrestre totale dans le scénario précédent selon McCarthy, 2015 : 2493, soit quelque 10 millions de km²), en risquant de se faire au détriment des autres usages de ces dernières et des populations qui ont le moins de moyens de défendre leurs droits d'usage traditionnels sur ces espaces. Il affecterait en priorité les zones rurales, qui offrent de l'espace disponible à faible prix, en y créant une source certaine de conflits au sein des Etats comme entre eux, notamment dans les rapports entre formations centrales et formations périphériques, qui concentrent les localisations les plus favorables à certaines énergies « renouvelables » (notamment le solaire). Enfin, le fait que cette emprise s'effectuerait notamment sur des parties du globe (telle la haute mer) ou des phénomènes naturels (tels la lumière solaire, le vent, la houle ou la chaleur terrestre), qui étaient jusqu'alors juridiquement des res communes, des choses communes n'appartenant à personne et librement disponibles pour tous et qui vont se trouver privatiser à des fins de valorisation, est également susceptible d'aviver de tels conflits ; pensons en particulier aux espaces maritimes situés hors des zones d'exclusion économique sur lesquels pourraient vouloir s'installer des mégafermes d'éoliennes géantes. Toutes ces occurrences renvoient en définitive à la traditionnelle contradiction entre la socialisation des forces productives qu'induisent le développement de la production capitaliste et le cadre maintenu des rapports capitalistes de production, de propriété et de fragmentation de l'espace mondial en Etats-nations souverains dans lequel ce développement a lieu.
Ajoutons qu'une pareille exploitation à échelle planétaire des énergies « renouvelables » ne saurait méconnaître leur empreinte écologique* qui est rien moins que négligeable. La combustion de la biomasse émet des particules fines. La construction des barrages des retenues d'eau alimentant les centrales hydroélectriques, nécessitant des masses énormes de béton, émet de grandes quantités de CO2 ; ces retenues peuvent elles-mêmes détruire ou bouleverser gravement des écosystèmes sur de vastes étendues et générer des émissions de GES (notamment de méthane par décomposition de matières végétales). Les alternateurs des éoliennes tout comme les cellules photovoltaïques sont très gourmands en terres rares dont l'extraction est extrêmement polluante ; les pales des éoliennes, constituées de fibres de verre, de fibres de carbone, de résines polyester et de résines d'époxy, ne sont pas recyclables ; leur mouvement génère des sons de basse fréquence et des infrasons capables de nuire à la santé d'êtres humains et d'animaux d'élevage vivant à leur voisinage ; ce même mouvement présente des dangers pour les oiseaux et les chauves-souris ; etc. (Bouglé, 2019 : Chapitre 1 à Chapitre 4).
Signalons enfin que les énergies « renouvelables » sont extrêmement gourmandes en métaux de toutes sortes (fer, cuivre, manganèse, nickel, etc.), bien au-delà des simples terres rares. Sous ce rapport, outre qu'il ferait appel à l'une des industries parmi les polluantes qui soient, l'extraction minière, leur déploiement à vaste échelle se heurterait à une barrière physique autant qu'économique : l'incapacité à extraire du sous-sol les minerais nécessaires et le coût exorbitant et croissant de cette extraction. Ce qu'a reconnu à demi-mot le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie : « les données montrent un décalage entre les ambitions climatiques de la communauté internationale et la disponibilité des métaux critiques qui sont essentiels à la réalisation de ces ambitions » (cité par Pitron, 2023 : 251).
L'introuvable « transition énergétique »
De tous ces problèmes, les partisans les plus lucides des « énergies » renouvelables sont pour partie conscients. Aussi n'ambitionnent-ils nullement, au rebours du scénario précédent, de porter leur développement au niveau de puissance auquel sont parvenues les énergies fossiles. Dans la « transition énergétique » qu'ils appellent de leurs vœux, le développement des énergies « renouvelables » ne vient qu'en troisième lieu : doit primer selon eux la sobriété énergétique, doublée de l'amélioration de l'efficacité (du rendement) des équipements producteurs d'énergie, soit la réduction de la production et consommation d'énergie et non pas la production et consommation d'énergie additionnelle. Autrement dit, ils préconisent de se soucier tout d'abord de produire des négawatts avant de produire des mégawatts, selon l'heureuse formule de l'association négaWatt (Association négaWatt, 2015) [6] ! Mais, ce dont ils ne se rendent pas nécessairement compte, une pareille démarche est précisément incompatible avec le maintien de l'échelle actuelle de développement du procès de reproduction du capital et, plus encore, avec l'objectif de poursuivre une « croissance » économique continue : de perpétuer indéfiniment l'accumulation du capital, impliquant une augmentation non moins continue de la production et de la consommation d'énergie, qui fait de la sobriété énergique une pure utopie dans le cadre du capitalisme.
Et, sous ce rapport, la notion de « transition énergétique » est des plus fallacieuses. Succédant à celle de « crise énergétique » apparue à la suite des chocs pétroliers des années 1970 (Fressoz, 2022), elle suggère en effet qu'il s'agirait simplement aujourd'hui de substituer des sources d'énergie renouvelables aux sources d'énergie fossiles : de passer de celles-ci à celles-là comme la première « révolution industrielle » nous aurait fait passer du bois au charbon et la seconde du charbon au pétrole. Or :
« La mauvaise nouvelle est que si l'histoire nous apprend bien une chose, c'est qu'il n'y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L'histoire de l'énergie n'est pas celle de transitions, mais celle d'additions successives de nouvelles sources d'énergie primaire. L'erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et global : si, au XXe siècle, l'usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît continûment, et que globalement, on n'en a jamais autant brûlé qu'en 2013 » (Fressoz, 2014 : 1-2).
Car, dans le cadre maintenu des rapports capitalistes de production, il n'y a pas plus moyen de passer aujourd'hui des énergies fossiles aux énergies « renouvelables » qu'on n'est passé avant-hier du charbon au pétrole et hier du pétrole à l'énergie nucléaire. Les secondes viennent aujourd'hui s'additionner aux premières, comme avant-hier le charbon au bois et hier le pétrole au charbon, pour répondre à chaque fois à la soif inextinguible d'énergie d'un capital voué à élargir sans cesse l'échelle de sa reproduction (Marx, 1991 : 663-664). Ce qui explique d'ailleurs qu'en dépit d'un développement vigoureux de l'éolien et du solaire au cours de ces trois dernières décennies, la part des énergies fossiles a à peine diminué en demeurant écrasante dans le mix énergétique mondial, ainsi qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous.

Rappelons pour conclure que l'industrie pétrolière ne fournit pas seulement ce qui reste aujourd'hui le principal combustible mais aussi la matière première de toute la pétrochimie. Sous ce rapport, elle est non moins indispensable au développement capitaliste, puisqu'elle rend possible aussi bien la production des engrais dont se gave l'agro-industrie que les plastiques qui constituent un des matériaux phares de l'industrie et du commerce capitalistes. Et, de ce point de vue, les énergies « renouvelables » ne présentent aucune alternative aux hydrocarbures. (14 octobre 2024)
Bibliographie
Association Négawatt (2015), Manifeste Négawatt : en route pour la transition énergétique, Arles, Acte Sud.
Bouglé Fabien (2019), Éoliennes : la face noire de la transition écologique, Monaco, Éditions du Rocher.
Durand Cédric (2021), « Le dilemme énergétique. (Et la voie d'une transition écologique démocratique) », https://alencontre.org/, 8 novembre 2021.
Fressoz Jean-Baptiste (2014), « Pour une histoire désorientée de l'énergie », 25es Journées Scientifiques de l'Environnement – L'économie verte en question, Créteil.
Fressoz Jean-Baptiste (2022), « La “ transition énergétique ”, de l'utopie atomique au déni climatique, USA, 1945-1980 », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, n°69-2.
Marx Karl (1991 [1883]), Le Capital. Livre I, Paris, Presses universitaires de France.
McCarthy James (2015), « A socioecological fix to capitalist crisis and climate change ? The possibilities and limits of renewable energy », Environment and Planning, volume 47.
Pitron Guillaume (2023), La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, 2eédition actualisée et augmentée, Paris, Les liens qui libèrent.
Tanuro Daniel (2012), L'impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte.
Tanuro Daniel (2020), Trop tard pour être pessimistes ! Ecosocialisme ou effondrement, Paris, Textuel.
Notes
[1] Les guillemets dont j'assortis ce terme s'expliquent par le fait que, strictement parlant, aucune énergie n'est renouvelable : on ne peut pas consommer deux fois le même kWh d'électricité, qu'il soit généré par des panneaux photovoltaïques ou par une centrale hydroélectrique, pas plus qu'on ne peut brûler deux fois le même kg de bois ou de charbon. Qui plus est, la thermodynamique nous enseigne que, si elle se conserve quantitativement au cours de ses transformations, l'énergie se dégrade qualitativement (elle est de moins en moins utilisable pour un travail donné) en finissant toujours par se dissiper sous forme de chaleur. Sont tout au plus renouvelables les sources d'énergie.
[2] Contrairement à celle du charbon, du pétrole et du gaz naturel, la combustion de la biomasse* végétale n'aggrave pas l'effet de serre naturel puisqu'elle ne fait que renvoyer dans l'atmosphère la quantité de dioxyde de carbone qui a été nécessaire à sa production, à condition toutefois de remplacer les arbres, arbustes, etc., que l'on consomme (consume) par des plantations nouvelles équivalentes en masse.
[3] Remarquons au passage que ces deux premières sources d'énergie renouvelables sont d'origine… nucléaire : l'énergie solaire procède des réactions de fusion nucléaire qui sont au cœur de l'activité du Soleil et l'énergie géothermique des réactions de fission nucléaire (impliquant l'uranium 235 et 238, le thorium 232 et le potassium 40) qui se produisent au sein du noyau terrestre.
[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaireconsulté le 21 décembre 2023. Le joule (symbole J) est l'unité d'énergie dans le Système international d'unités physiques. C'est l'énergie délivrée par une puissance d'un watt pendant une seconde. Ainsi 1kWh = 3 600 000 J = 3,6 mégajoule (3,6 MJ).
[5] « L'ampleur physique de l'actuel système énergétique basé sur les combustibles fossiles est en effet énorme. Il y a des milliers de grandes mines de charbon et de centrales électriques au charbon, quelques 50 000 champs pétrolifères, un réseau mondial comptant au moins quelque 300 000 km d'oléoducs et 500 000 km de gazoducs et 300 000 km de lignes de transmission » (GIEC, Rapport spécial 1,5°C, résumé pour les décideurs, cité par Tanuro, 2020 : 105).
[6] Cf. aussi https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese-scenario-negawatt-2022.pdf
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des syndicalistes ukrainiens en tournée dans l’État espagnol

Pour la première fois, les dirigeant·es des deux principales centrales syndicales ukrainiennes se sont rendus dans l'État espagnol : Grigori Osovyi et Vasyl Andreiev, président et vice-président de la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU), et Olesia Briazgunova, responsable internationale de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU).
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/16/des-syndicalistes-ukrainiens-en-tournee-dans-letat-espagnol/
Le président de la KVPU, Mihaylo Volinets, qui est également membre du Parlement ukrainien (la Verkhovna Rada), a dû rentrer à Kyiv à mi-chemin, convoqué en tant que membre de la commission chargée de l'énergie en raison de la gravité de la situation après les dernières attaques de la Russie contre des centres énergétiques clés. Ce détail montre à quel point la tournée était compliquée en pleine guerre et combien la délégation ukrainienne y attachait de l'importance.
Les syndicalistes qui sont venus ont un long parcours. Grigori Osovyi vient de l'ancien syndicat officiel, affilié au Conseil central des syndicats de toute l'Union, qui est devenu le FPU après l'indépendance de l'Ukraine. Il a été membre du Parti communiste, mais n'est aujourd'hui affilié à aucun parti. Olesia est une syndicaliste jeune, mais elle a milité pendant des années au sein de la KVPU. Ce syndicat indépendant s'est constitué à partir du rassemblement des syndicalistes qui avaient participé aux grèves minières et autres, notamment dans le Donbass, c'est le cas de son président, Mihaylo Volynets, et de sa vice-présidente, Natalia Levytska. La KVPU a été créée à la fin de l'année 1998. Vasyl Andreiev, ouvrier du bâtiment depuis l'âge de 14 ans, a rejoint le FPU : malgré sa relative jeunesse, il en est le vice-président et le responsable international.
Les mots prononcés par Vasyl lors de la manifestation du dernier jour de la tournée sont éloquents quant à leurs attentes : « Nous sommes venus pour parler d'ouvrier à ouvrier. »
Des rencontres avec des syndicalistes de l'UGT et des parlementaires
La venue de la délégation des deux centrales syndicales ukrainiennes a été rendue possible grâce à l'invitation de l'UGT espagnole [1]. En février 2024, une délégation de l'UGT de Catalogne s'était rendue à Kyiv pour participer à une conférence internationale de solidarité syndicale à l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre. Le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU) avait favorisé et aidé aux contacts et aux rencontres précédentes à Paris et, en tant que responsable de la coordination syndicale du RESU, j'avais eu le privilège de les accompagner. Les menaces d'attaques nous avaient obligés à nous cacher dans l'abri de l'hôtel, notre délégation était la seule représentation internationale présente à la conférence de Kyiv. Les préparatifs de la tournée dans l'État espagnol avaient alors commencé, et c'est l'UGT qui nous a permis de concrétiser ce projet.
La première partie de la visite a été constituée par les réunions à Barcelone et à Madrid avec les responsables des différentes fédérations de l'UGT, où nous avons pu partager nos expériences et nos préoccupations.
Les visites à Barcelone et à Madrid ont été un succès. Au cours d'une semaine épuisante de réunions, d'événements, d'entretiens et de visites, nous avons discuté et avancé dans plusieurs actions possibles pour aider les syndicats, les réfugié·es et les immigré·es.
Au Parlement catalan, la délégation a rencontré le président, Josep Rull (Junts per Catalunya), qui s'est montré intéressé et espère pouvoir organiser une autre visite avec ces syndicats afin de les entendre à l'occasion d'une session parlementaire ou d'une commission. La délégation a également eu des rencontres avec différents groupes politiques : Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) et Junts, qui se sont engagés à les aider dans divers domaines. La délégation ukrainienne a souligné le rôle des syndicats dans la guerre et la reconstruction, et s'est engagée à aider les parlementaires catalans à établir des contacts avec la Verkhovna Rada.
À Madrid, les syndicalistes ukrainiens ont rencontré les groupes parlementaires des Cortes du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), de Sumar et de l'ERC. Ces groupes parlementaires souhaiteraient les aider notamment sur les programmes de formation syndicale et sur les réglementations européennes en matière de travail et de droits [2]. Ces réunions ont également concerné des fonctionnaires du Parlement espagnol des commissions des affaires étrangères, du travail, de l'économie sociale, de la migration et du pacte de Tolède (système de retraites), ainsi que des responsables du gouvernement catalan, la Generalitat, chargés de l'Union européenne et de la mairie de Barcelone.
Dans les manifestations de la Diada, avec les indépendantistes
Outre ces représentants politiques, la délégation ukrainienne a rencontré (en Catalogne) des associations de la société civile telles que Òmnium Cultural, le Centre international Escarré pour les minorités ethniques et nationales, le Centre de Barcelone pour les affaires internationales et l'Institut international catalan pour la paix, ainsi que différentes associations ukrainiennes, y compris la présidente des associations ukrainiennes en Espagne et l'ambassade ukrainienne des arts à Barcelone.
Les syndicalistes ukrainiens ont participé aux événements de la Diada de Catalunya (11 septembre). Devant la statue de Rafel de Casanova (la plus haute autorité militaire et politique de Catalogne pendant le siège de Barcelone par les Bourbons en 1714) et avec les syndicats UGT et Comisiones Obreras, les Ukrainiens ont apporté leur hommage, avec des fleurs bleues et jaunes symbolisant leur drapeau.
La situation de la classe ouvrière ukrainienne
La première chose que les syndicalistes nous ont expliquée, c'est que la guerre affecte gravement la vie de l'ensemble de la population active. Cela a commencé en 2014 avec l'occupation de la Crimée et de certaines parties du Donbass, mais avec l'invasion à grande échelle de 2022, la situation est devenue terrible au quotidien partout en Ukraine. « À cause de la guerre, 2,7 millions d'emplois directs ont été perdus dans la construction, l'alimentation, l'industrie. Nos adhérents sont également sur le front ; d'autres en exil. Tout cela a entraîné une baisse très importante des adhésions. Au total, 9 millions d'emplois ont disparu », a expliqué Grigori Osovyi, avant d'ajouter que pour comprendre l'ampleur de la guerre, il ne fallait pas oublier les tirs nuit et jour de roquettes qui empêchent la population de se reposer. Olesia Briazgunova a enfoncé le clou :
Les enfants et les jeunes qui sont obligés de se réfugier tous les soirs grandiront dans un climat de peur. Qu'arrivera-t-il aux enfants et aux femmes cet hiver ?
Les salarié·es se battent sur le front
Selon Vasyl Andreiev, « 20% de nos membres sont actuellement soldats. Notre pays est en guerre car nous avons été attaqués. Nos camarades nous manquent sur les lieux de travail parce qu'ils se battent pour défendre le pays ». Grigori ajoute :
L'équilibre mondial est très affaibli. Il n'y a pas d'instance mondiale qui puisse appuyer sur un bouton et rétablir la paix, voilà la réalité. L'Espagne nous aide militairement, ainsi que les États-Unis et l'Europe, mais ils ne nous ont pas envoyé des roquettes ou des munitions en quantité suffisante. La Russie dispose d'un million de munitions. Vous nous donnez 20% de ce que la Russie utilise contre nous. Il n'y a pas de roquettes, il nous faut au moins des drones.
Olesia, elle, déclare :
Merci beaucoup pour l'aide militaire que l'Espagne apporte. Elle nous aide à nous défendre. Le peuple ukrainien ne lâche pas, il se battra toujours pour sa liberté. Aujourd'hui, un de nos camarades est mort. Nous payons un prix très élevé pour notre souveraineté et pour la défense de l'Europe.
Selon Olesia, « l'armée russe a le projet de détruire tout ce qui est indispensable à la vie des gens et à l'économie de l'Ukraine : l'énergie, l'eau, les communications. Il est dangereux de travailler dans les mines, dans les centrales nucléaires, qui sont attaquées, dans les centres de distribution d'électricité : l'énergie électrique est vitale pour le pays. Sans électricité, il est très dangereux de travailler dans les zones minières et dans les mines : 51 mineurs ont été pris au piège lors de bombardements. Mais les mineurs continuent à travailler malgré le risque de nouvelles frappes aériennes. » Grigori explique à un député à Madrid que « 26% du territoire ukrainien est occupé par la Russie. Il n'y a pas de conditions pour des négociations ». Il propose deux solutions :
L'Ukraine peut gagner. Si les relations économiques avec la Russie sont rompues, l'agresseur devra arrêter. La Russie n'aura plus d'argent dans un mois si toutes les relations économiques étaient rompues.
L'autre solution : « Si nous perdons du territoire, la Russie entrera à Kyiv. Puis en Pologne. Et ce pourrait être la troisième guerre mondiale. »
La propagande poutiniste vise les travailleur·euses russes et l'Espagne même
Au cours des contacts avec les groupes parlementaires, la délégation a entendu des questions et des opinions sur la paix qui l'ont étonnée. Bien que préoccupés en permanence par la situation dans leur pays, des sourires affleurent de temps à autre. Olesia écarquille ses yeux clairs quand elle entend des affirmations telles que « le plus urgent, c'est la paix, car tout le monde y laisse sa peau », sans distinction entre l'agresseur et l'agressé. À Barcelone, Grigori a déclaré :
Ils disent que la Russie a fait une « guerre préventive » parce que l'Ukraine aurait voulu l'attaquer. Ils disent aussi que l'Ukraine est nazie. Nous avons notre fierté nationale, nous avons une longue histoire, mais nous n'avons jamais été nazis. Autre mensonge : le Sud, le Donbass, sont des territoires russes. Nous sommes étonnés et affolés de voir que 70% des Russes croient à ce mensonge. Et 70 à 80% des Russes pensent que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister, que nos terres sont russes. Il est difficile de faire arriver la vérité dans la tête de ces gens.
À Madrid également, Grigori a déclaré :
Un syndicat russe [la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR)] soutient pleinement l'agression de son pays. Dans les zones occupées, nous, militants syndicaux, avons dû partir à cause de la répression. Ce syndicat aide à remplacer nos adhérents et place les siens. La langue ukrainienne est également remplacée. Un documentaire primé sur les soldats russes [Intercepted] montre tout naturellement qu'ils veulent gagner la guerre et qu'ils font tout ce qu'il faut pour cela.
Et de marteler : « Il n'y a pas de conditions pour négocier la paix. » Olesia ajoute : « Plus de 2 000 syndicalistes et fonctionnaires des territoires occupés ont été enlevés. »
La FPU et la KVPU se sont notamment battues pour tenter d'expulser la FNPR de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce syndicat russe avait invité Poutine à parler lors de son congrès et avait manifesté son soutien total à l'« opération militaire spéciale » contre l'Ukraine. Lors de la dernière conférence de l'OIT, les syndicats ukrainiens sont presque arrivés à exclure la FNPR de la direction, mais l'absence de soutien fort de la part de la direction de la Confédération syndicale internationale (CSI) les en a empêchés. La représentation de la FNPR n'a été élue qu'à une voix près – jamais auparavant la FNPR n'avait bénéficié d'un soutien international aussi faible ! Dans le même temps, le syndicaliste ukrainien Vasyl Andreiev a été nommé à l'un des 19 sièges de suppléant sans aucune opposition. Une belle réussite.
Le dialogue social entre le gouvernement et les syndicats
L'un des principaux objectifs de la visite était de permettre aux syndicats ukrainiens d'expliquer leur relation avec le gouvernement ukrainien et leur point de vue sur la politique économique et de l'emploi du gouvernement. S'ils ont été très clairs quant à la nécessité de se défendre contre l'agresseur et de soutenir l'armée et le gouvernement dans le domaine militaire, ils ont été tout aussi clairs quant à leur dénonciation du néolibéralisme et des attaques du gouvernement contre les travailleurs : le gouvernement ukrainien profite de la situation de guerre pour affaiblir les syndicats et s'attaquer aux conditions de vie de la classe ouvrière.
Grigori
Le deuxième jour après l'occupation russe, la Rada a adopté une loi militaire. Nous, les syndicats, avons essayé de l'adoucir. Elle suspendait des droits des travailleurs comme les manifestations ou les grèves. Toutes ces restrictions doivent être annulées comme si nous étions en temps de paix. L'année dernière, nous avons constaté qu'un tiers des lois adoptées nous desservent. Certains députés défendent nos positions. La question est que le gouvernement nous écoute au Parlement. Les politiciens nous écoutent en période d'élections, mais il n'y a pas d'élections dans notre pays pour l'instant. Le gouvernement est dominé par un seul parti, il n'y a pas de coalition. Nous savons que la guerre entraîne une concentration du pouvoir, mais les droits des travailleurs doivent être respectés.
Vasil
En peu de temps, 30 000 lois ont été modifiées en Ukraine. Notre syndicat participe au processus d'adaptation des lois depuis 2015. Les changements les plus radicaux engagés par gouvernement à l'encontre des travailleurs ont concerné le Code du travail et les normes de sécurité. Nous avons besoin de former des experts, nous avons besoin de fonds pour cela. Des cours de deux semaines pour former des salariés experts dans les normes des secteurs comme la construction, la métallurgie, le secteur maritime. Les syndicats ne peuvent pas le faire seuls. L'expérience de l'Espagne, qui fait partie de l'Europe, peut nous être très utile.
Olesia
Nous avons besoin d'aide pour comprendre et adapter des réglementations espagnoles qui pourraient être utiles à l'Ukraine. L'intégration à l'UE est très importante pour la jeune génération d'Ukrainien·nes, qui s'attend à une amélioration de ses conditions de vie.
Les parlementaires espagnols, les porte-parole de différentes commissions pour le dialogue entre les syndicats, le gouvernement et les partis, se sont montrés particulièrement intéressés par ce point. La formation des syndicalistes ukrainiens aux lois européennes et aux exemples de leur mise en œuvre en Espagne pourrait être l'un des aspects concrets et utiles de cette visite. La députée du PSOE Elisa Garrido a posé une question à la fin : « Y a-t-il des contacts et un dialogue entre les syndicats et le gouvernement ukrainien ? » La réponse de Grigori Osovyi a été claire et concise : « Contact oui, dialogue non. »
La reconstruction du pays
Dans une situation où l'on compte plus de 5 millions de personnes déplacées, des dizaines de milliers de blessé·es et de handicapé·es, des personnes qui seront touchées à vie, parler de reconstruction du pays après la guerre, c'est d'abord créer les conditions pour que les travailleuses et les travailleurs reviennent, qu'ils aient un toit, un salaire décent et des conditions de vie et de services convenables. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une reconstruction économique et des infrastructures, mais aussi d'une reconstruction sociale.
Dans le cas contraire, on pourrait assister à une grande opération économique aux profits juteux où de grandes multinationales se partageraient les territoires et les emplois, en profitant de l'endettement de l'Ukraine ou des fonds européens, en embauchant des travailleuses et des travailleurs migrant·es du monde entier sans accords ni règles, avec des bas salaires et un manque de sécurité. Ce type de reconstruction signifierait un changement pour le pire en Ukraine. Il faut éviter ça. Mais si nous ne voulons pas de ce scénario, nous devons aider les syndicats à jouer un rôle clé dans la reconstruction.
Vasyl, responsable du secteur de la construction de la FPU, est très clair :
Nous manquerons de main-d'œuvre par rapport à l'énorme destruction en cours… Nous devons créer les conditions pour que les gens qui ont dû partir puissent revenir. Olesia souligne le rôle des femmes, « qui remplacent les hommes aux avant-postes dans de nombreuses professions, y compris dans la métallurgie et l'exploitation minière. Nous devons réglementer leur participation à l'avenir en leur accordant des droits égaux ».
Grigori affirme que « celui qui doit payer pour la reconstruction est celui qui a provoqué cette guerre et ses désastres : la Russie. » Il demande de l'aide pour que les syndicats soient impliqués dans le processus de planification de cette reconstruction. Selon lui, le gouvernement ukrainien et les grandes entreprises marginalisent les syndicats de tous les projets et discussions. Il dénonce que, lors de la dernière conférence sur la reconstruction organisée à Berlin par les gouvernements allemand et ukrainien, « sur les 2 000 participants entre les gouvernements et les employeurs, il n'y avait que deux syndicalistes ».
Donner une suite à cette tournée et concrétiser nos engagements
Il y a sans doute encore beaucoup d'aspects et de détails qui mériteraient d'être expliqués au sujet de cette visite. Je pense avoir traité les plus importants. Les associations, organisations, partis et personnes qui ont assisté à certaines réunions, conférences ou événements ont pu entendre, toucher et sentir ce qui se passe en Ukraine et les conséquences de cette guerre d'agression pour la classe ouvrière ukrainienne. Il ne s'agissait pas d'une visite d'un gouvernement, ni du récit d'un média ou des réseaux sociaux : il s'agissait de syndicalistes en chair et en os. Un privilège.
Il nous appartient maintenant de diffuser, organiser et mettre en œuvre ce que nous avons entendu et de décider de la place que nous voulons occuper dans l'aide aux syndicats ukrainiens. Ils nous ont exprimé ce dont ils avaient besoin : générateurs, locaux, soutien psychologique, formation syndicale, lutte contre la désinformation, aide et organisation des réfugié·es que l'on pourrait faire adhérer aux syndicats, soutien politique au rôle des syndicats dans la reconstruction…
Maintenant, que chacun prenne sa place.
[1] https://www.ugt.es/ugt-recibe-los-maximos-dirigentes-de-los-sindicatos-de-ucrania-en-espana
[2] Á propos du meeting de Madrid organisé par le Réseau ibérique de solidarité avec l'Ukraine (RISU) et des réactions des Ukrainiennes et Ukraininens résidant dans l'Etat espagnol, notamment le texte d'une participante, voirwww.trasversales.net/t67sindiucra.htm
Alfons Bech
Alfons Bech est membre des CCOO, du Réseau ibérique de solidarité avec l'Ukraine et coordinateur syndical du RESU.
21 septembre 2024.
Traduction Mariana Sanchez.
Paru dans Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 34)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/11/ce-nest-quun-debut-continuez-a-tergiverser/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Argentine. Les chiffres impitoyables de l’économie à la Milei

[La scène sociale et politique de l'Argentine est marquée ces jours par une importante mobilisation des étudiants universitaires. Le 9 octobre, le président Javier Milei a imposé un veto à toute revalorisation des frais de fonctionnement des universités et des salaires des enseignants du supérieur. Ce veto intervient suite à l'approbation par le Sénat, le 13 septembre, d'une revalorisation devant permettre d'absorber les effets de l'inflation. Actuellement, plus de 30 universités ont voté la grève jusqu'au 17 octobre et le débat sur les initiatives à venir occupe de très nombreuses facultés dans tout le pays. La manifestation étudiante du 9 octobre a réuni un nombre très important d'étudiants. Les menaces autoritaires se sont multipliées. Le porte-parole du gouvernement a qualifié de délit l'occupation de facultés dans les universités. Il a encouragé la justice à intervenir. Ce mouvement s'inscrit dans les politiques d'ajustement développées depuis décembre 2023. Rolando Astarita expose ici de manière détaillée les données de la situation socio-écnomique. Réd. A l'Encontre]
17 octobre 2024 | tiré du site alencontre.org
http://alencontre.org/ameriques/amelat/argentine/argentine-les-chiffres-impitoyables-de-leconomie-a-la-milei.html
Nous avons déjà analysé la politique économique du gouvernement de La Liberta Avanza (LLA). Dans cet article, nous mettons à jour quelques données sur l'économie argentine en ce début d'octobre 2024. Nous ne prétendons pas à l'originalité. Nous voulons simplement contribuer à la critique qui monte de nombreuses autres zones de résistance à une politique brutale dirigée contre les travailleurs et travailleuses, ainsi que les classes dépossédées et appauvries. Commençons par les chiffres de la pauvreté et de l'indigence fournis par l'INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina).
Pauvreté : 52,9% de la population. Soit 24,8 millions de personnes. Fin 2023, la pauvreté était de 42%. Aujourd'hui, il y a 5,4 millions de pauvres de plus qu'au 2e trimestre 2023. La pauvreté des enfants se situe à 66%.
L'indigence : 18,1 %. Cela représente 8,5 millions de personnes, soit 3 millions de plus qu'au 2e trimestre 2023. 27% des enfants de moins de 14 ans sont indigents. A la fin de l'année 2023, l'indigence se situait à 11%.
En outre, 23% des enfants âgés de 3 à 5 ans ne fréquentent pas d'établissements d'enseignement formel ; 35 % des jeunes n'ont pas terminé l'école secondaire.
Selon l'Observatorio de la Deuda Social Argentina, de l'Universidad Católica Argentina, dans une recherche conjointe avec la Banco Hipotecario, 56% des enfants dans les centres urbains manquent d'accès à un système de canalisations, de trottoirs et de chaussées ; 53% n'ont pas accès au gaz ; 38% n'ont pas de systèmes d'égouts. Dix-neuf pour cent ont des conditions de logement précaires et 18% souffrent de promiscuité. C'est sur ce « corps social », en chair et en os, que le gouvernement LLA applique « l'ajustement » des dépenses publiques.
Chute des salaires
Depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei [10 décembre 2023], on assiste à une forte baisse des salaires réels, par le biais de la pression inflationniste. En juillet 2024, l'augmentation moyenne (interannuelle) des salaires était de 206%. Ce mois-là, les salaires des employés de l'Etat ont augmenté, en glissement annuel, de 170% ; ceux du secteur privé non enregistré (déclaré) de 178% ; ceux du secteur privé enregistré ont augmenté de 235,1%, toujours en glissement annuel.
D'autre part, l'inflation, en juillet, en variation annuelle, était de 263,4%. Par conséquent, les salaires des employés de l'Etat ont baissé, en termes réels, de 25,7% ; ceux du secteur privé non enregistré ont baissé de 23,2% ; ceux du secteur privé enregistré ont baissé, en termes réels, de 7,8%.
Manœuvres rhétoriques
Pour masquer la brutalité de ces données, le gouvernement a recours à des comparaisons trimestrielles ou mensuelles. Dans le cas de la pauvreté, les 52,9% pour le semestre indiqués par l'INDEC proviennent de la moyenne des données des deux premiers trimestres : la pauvreté au premier trimestre 2024 était de 55% ; au deuxième trimestre, elle est tombée à 51%. Milei utilise cette baisse pour affirmer que « la pauvreté diminue ». Il fait quelque chose de similaire avec l'évolution des salaires. Etant donné qu'au cours des quatre derniers mois, les augmentations salariales ont été légèrement supérieures à l'inflation, une fois de plus, le discours officiel est « les salaires augmentent ». Il dissimule ainsi la forte baisse des salaires à moyen et long terme et l'augmentation, également à moyen et long terme, de la pauvreté et de l'indigence. Les rebonds ne sont que cela, des « augmentations » qui ne modifient donc pas la tendance de fond.
Plus généralement, c'est une règle dans le capitalisme que lorsque des crises et des dépressions majeures se produisent, il arrive un moment où la baisse des salaires atteint un plancher et où les revenus se redressent quelque peu, en même temps que l'activité économique rebondit. Mais cela n'efface pas le fait que 1° la crise est payée par les travailleurs et les travailleuses et les secteurs populaires ; 2° les salaires finissent par être inférieurs à ce qu'ils étaient au début de la crise ; 3° la pauvreté et l'indigence restent à des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise.
Comme Marx l'a justement mis en garde, lorsqu'on parle de salaires, ce qui compte, c'est le long terme, plutôt que les changements à court terme. Et ce qui s'impose aujourd'hui comme une tendance en Argentine, c'est une chute profonde des salaires réels (c'est-à-dire du panier de biens qui servent à reproduire la force de travail) de millions de travailleurs.
L'économie en toile de fond
Le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 1,7% en glissement annuel au deuxième trimestre de 2024 et de 1,7% par rapport au premier trimestre. Au cours du premier semestre de l'année, la baisse a été de 3,4%. Au deuxième trimestre, il aurait atteint un plancher, mais il n'y a aucun signe d'une reprise significative et durable. Pour l'instant, il n'y a que de faibles rebonds, sans que l'économie ne sorte du trou. Selon le Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM-Enquêtre sur les anticipations du marché), l'enquête menée par la Banque centrale, l'activité économique au troisième trimestre 2024 a augmenté de 1,1% à 1,6% par rapport au deuxième trimestre. Une croissance plus faible, comprise entre 0,6% et 0,9%, est attendue au quatrième trimestre par rapport au troisième. Il en résulte que l'économie clôturerait l'année avec une baisse du PIB comprise entre 3,8% et 3,9%.
Autres données : l'estimation mensuelle de l'activité économique (EMAE) indique -3,5% au cours des 7 premiers mois de l'année. Selon la FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), la production industrielle a baissé de 0,7% en août par rapport à juillet. Le chiffre cumulé pour les huit premiers mois de l'année est négatif de 10,5%. Selon le cabinet de conseil Orlando Ferreres, l'indice d'activité générale, après avoir progressé de 1% en juillet par rapport à juin, a de nouveau reculé de 0,6% en août. En comparaison annuelle, l'indice est négatif à hauteur de 5,6%.
Toujours en comparaison interannuelle, l'agriculture et l'élevage se sont améliorés, mais l'industrie, la construction et le commerce ont connu de fortes baisses (Ambito Financiero, 28/09/2024). Un rapport de la Surintendance des risques du travail (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) indique qu'au cours des six premiers mois de l'année, 9092 microentreprises (les microentreprises sont celles qui comptent moins de cinq travailleurs) ont cessé leurs activités. Et 2634 entreprises plus importantes ont fermé (M. Zalazar, Infobae, 25/09/2024).
Quant à la consommation privée, elle a baissé de 9,8% au 2e trimestre 2024 par rapport au 2e trimestre 2023. La consommation publique, également en glissement annuel, a été inférieure de 6%. Par rapport au 1er trimestre 2024, elle a été négative de 4,1% et de 1,1% respectivement au 2e trimestre 2024 (INDEC). Selon la Chambre de commerce argentine (CAC), en août 2024, la consommation a chuté de 7,8% en glissement annuel et de 1,8% par rapport à juillet ; en juillet, elle avait augmenté de 1,8% par rapport à juin. Au cours des huit premiers mois de l'année, la baisse de la consommation privée a été de 6,4%.
Certains postes sont particulièrement touchés : les loisirs et la culture ont baissé, en août, en glissement annuel, de 21,7%. L'habillement a chuté de 17% en glissement annuel. Selon le cabinet de conseil Scentia, spécialisé dans la consommation de masse, la consommation a baissé en juillet de 16,1% en glissement annuel. En août, la baisse, en glissement annuel, a atteint 20%. Dans le secteur des appareils électroménagers, la baisse a atteint 33%.
Les chiffres fournis par la Confédération argentine des moyennes entreprises (CAME), en ce qui concerne le mois de septembre, coïncident : les ventes au détail ont chuté de 5,2% par rapport au même mois de 2023 ; au cours des 9 premiers mois de 2024, elles ont chuté de 15% en glissement annuel (La Nación, 7/10/204). Les pourcentages de la chute diminuent – de 21,9% en juin à 5,2% en septembre – mais il n'y a pas de signes qu'une phase de récupération de la récession ait commencé. En août, la construction a chuté de 2,9% par rapport à juillet et, sur l'ensemble de l'année, elle a chuté de 30,3%. L'industrie a progressé de 1,5% d'un mois sur l'autre, mais sur l'ensemble de l'année, elle a chuté de 13,6%. Un autre cas révélateur est celui des ventes de voitures neuves (en période de reprise, la consommation de biens durables a tendance à croître fortement). En septembre, les ventes ont augmenté de 5% par rapport à août, mais entre janvier et septembre, elles ont chuté de 11,7% par rapport à la même période en 2023.
Quant à l'investissement, il s'effondre également (voir ci-dessous). On est loin de la reprise en « V » qui, selon Milei et Luis Caputo (Ministre de l'économie depuis décembre 2023), devait se produire à partir de mars ou avril 2024.
Travail informel et décret 847/2024
Selon l'INDEC, au second semestre 2024, 36,4% des travailleurs salariés ne paient pas de cotisation pour la retraite. Cela signifie que ces travailleurs ne bénéficient pas de prestations de base telles que sécurité sociale, les congés payés ou le droit à une indemnité de licenciement en cas de perte d'emploi. Certaines branches sont particulièrement touchées. Dans la construction, 70% des travailleurs ne sont pas enregistrés (déclarés). Parmi les femmes employées de maison, 76% travaillent dans le secteur informel. Ce niveau élevé d'informalité explique que le taux de chômage n'ait augmenté que de deux points de pourcentage (au premier trimestre 2024 il était de 7,7%, au deuxième de 7,6%, contre 5,7% au quatrième trimestre de 2023) malgré le fort ralentissement économique.
Dans ce contexte, le décret 874/2024 [du 26 septembre 2024] consolide et légitime l'informalité du travail. Entre autres mesures, il établit la catégorie des « collaborateurs » : jusqu'à trois « collaborateurs » peuvent être embauchés sans que cela ne crée une relation de dépendance salariale [donc statut de (pseudo)indépendants]. En outre, grâce à l'excuse de la « promotion de l'emploi enregistré », l'employeur est exempté d'amendes, de sanctions ou de contributions pour avoir des employés non déclarés. Le Registre des sanctions du travail est supprimé. Dès lors, les dettes pour non-paiement des cotisations sociales ou autres contributions de l'employeur sont tolérées. De plus, la porte est ouverte à la modification des indemnités de licenciement, les travailleurs « négociant librement » avec les employeurs, dans une position clairement désavantageuse.
Augmentation de la part des profits dans le PIB
Si les salaires baissent plus que le PIB, le rapport entre les profits et les salaires augmente nécessairement, c'est-à-dire que la part des profits dans le PIB augmente. Les « profits » comprennent les bénéfices des entreprises, les rentes (agricoles, minières, immobilières) et les intérêts. En termes marxistes, le taux de plus-value augmente.
Il s'agit là d'une relation fondamentale à observer. Elle montre que le principal conflit social se situe au niveau des classes sociales. Un transfert de la plus-value (générée par le travail) vers les propriétaires des moyens de production et du capital financier est en train de se produire. C'est le fondement ultime de la politique économique de LLA.
Ce transfert se manifeste par l'augmentation du coefficient de Gini, un indicateur du degré d'inégalité des revenus. Au deuxième trimestre 2024, il était de 0,436 (1 indique une inégalité absolue, 0 une égalité absolue des revenus). « Au même trimestre de 2023, il se situait à 0,417, ce qui indique une augmentation significative de l'inégalité en comparaison annuelle » (« Evolución de la distribución del ingreso », INDEC, 2Q 2024).
Autre fait marquant : au 2e trimestre 2024, les 10% les plus riches recevaient 32,5% des revenus, tandis que les 50% les plus pauvres en recevaient 19,9% (INDEC, 31 agglomérations urbaines ; revenus individuels). Le revenu moyen des quatre premiers déciles de la population, classés selon le revenu de l'occupation principale, était de 153'323 pesos (sur la base du taux de change, sur le marché parallèle, de 1300 pesos pour un dollar).
L'investissement
L'investissement est la clé du développement des forces productives (en premier lieu, le développement technologique et la croissance du travail productif).
Or, selon l'INDEC, la formation brute de capital fixe (comprenant les bâtiments, le matériel de transport, les machines industrielles, le matériel informatique et les logiciels) au deuxième trimestre 2024 était inférieure de 29,4% à celle du même trimestre de 2023. Et elle était inférieure de 9,1% à celle du 1er trimestre 2024.
Selon le cabinet de conseil Orlando Ferreres y Asociados, l'investissement réel en août a chuté de 25,8% en glissement annuel. Le chiffre cumulé pour les huit premiers mois de l'année est de -21,5%. En ce qui concerne les machines et les équipements, l'étude a enregistré une baisse de 23,7% en glissement annuel. Les importations d'équipements de production durables ont chuté de 42,8%. Dans la construction, l'investissement a chuté de 27,6% en glissement annuel. Quant à l'investissement public, il a quasiment disparu. Une situation insoutenable à moyen terme. La reproduction du capital est impossible sans investissements dans les infrastructures, dont une grande partie ne peut être réalisée que par l'Etat.
Dans ce dernier sens, la réduction de l'investissement de l'Etat dans la recherche et le développement est également grave (suppression du financement du CONICET (Conseil national de la recherche scientifique et technique), des universités et d'autres organismes tels que l'INTI-Institut National de Technologie Industrielle). L'investissement dans la R&D en Argentine était déjà très faible, à peine 0,52% du PIB (moins que la moyenne de l'Amérique latine, loin de pays comme les Etats-Unis ou la Corée du Sud). Javier Milei et ses semblables veulent les réduire encore davantage. C'est une pure folie, même si l'on considère la question du point de vue du développement capitaliste.
Un autre fait significatif est qu'entre décembre 2023 et août 2024, huit multinationales quitteront l'Argentine : HSBC, Xerox, Clorox [entreprise de produits d'entretien, siège basé à Oakland], Prudential[services financiers], Nutrien [engrais, canadienne], ENAP[pétrole et gaz, chilienne], Fresenius Medical Care [santé, allemande] et Procter & Gamble. Il semble que l'équilibre budgétaire ne suffise pas à stimuler l'investissement !
Investissements directs, de portefeuille et moratoire
Le gouvernement a répété à plusieurs reprises que les capitaux internationaux envisageaient d'investir en Argentine. Mais la réalité est que, pour l'instant, les investissements directs étrangers des non-résidents sont très faibles : le montant cumulé jusqu'au mois d'août 2024 n'était que de 531 millions de dollars. Les investissements de portefeuille cumulés des non-résidents entre janvier et août ont même été négatifs, à hauteur de 10 millions de dollars (Balance Cambiario).
En revanche, au cours de la même période, la « Formation d'actifs extérieurs du secteur privé non financier » cumulée a été de 1208 millions de dollars (en août, 456 millions de dollars ; Balance Cambiario). Rappelons que les actifs des Argentins à l'étranger s'élèvent à 450'760 millions de dollars (investissements directs, investissements de portefeuille, dépôts en dollars, plus les réserves de la BCRA-Banque centrale). Cela montre que le manque de développement n'est pas dû à un manque d'épargne, mais à un manque d'investissement (en termes marxistes, le réinvestissement de la plus-value dans le travail productif).
L'afflux récent de dollars par le biais du blanchiment d'argent s'inscrit dans ce contexte. Jusqu'au 24 septembre, les dépôts en dollars dans les banques ont augmenté de 11,9 milliards de dollars. Une partie de ces capitaux a servi a acheté des titres d'Etat (« bons du Trésor ») et des obligations de sociétés (obligations négociables). En conséquence, les prix des obligations du Trésor ont augmenté, le risque pays est passé sous la barre des 1200 points, le dollar bleu (sur le marché parallèle) et les dollars financiers ont baissé, et le taux d'emprunt des grandes entreprises a diminué. L'augmentation des dépôts en dollars a également permis une certaine reprise des prêts en dollars, principalement destinés à préfinancer les exportations. D'où la proclamation de « l'été financier ». Mais rien n'indique qu'une reprise durable de l'accumulation du capital soit en cours. Et encore moins que les niveaux historiquement bas de l'investissement en Argentine seront surmontés : depuis des décennies, dans les meilleures années, ils n'ont pas dépassé 20% du PIB.
Excédent budgétaire avec plus de faim et de misère
L'excédent des huit premiers mois a été de 0,35% du PIB. Il a été obtenu principalement par des « ajustements » opérés sur les salaires des employé·e·s de l'Etat, les retraites [avec des manifestations de retraité·e·s durement réprimées par la police], la réduction des subventions et l'effondrement des travaux publics. Selon « Profit Consultores » et le programme de Maxi Montenegro [économiste qui développe des chroniques économiques et financières], la réduction des dépenses publiques au cours des huit premiers mois de 2023 a été la suivante : dépenses d'investissement : -79,4% ; transferts courants aux provinces : -69,1% ; autres dépenses courantes : -46,5% ; subventions aux dépenses d'énergie : -36,8% ; subventions économiques : -34,9% ; subventions aux universités : -34,2% ; autres dépenses de fonctionnement : -32,8% ; subventions aux transports : -27,5% ; programmes sociaux : -26,4% ; dépenses primaires courantes : -24,7% ; pensions et retraites : -22,6% ; dépenses de fonctionnement et autres dépenses : -22,3% ; allocations familiales actives, passives et autres : -21,5% ; pensions non issues de cotisations : -20,6% ; salaires : -19,5% ; prestations sociales : -19,5%.
Part dans l'ajustement des dépenses publiques dans les huit premiers mois de 2024 (même source) : retraites et pensions non contributives (hors cotisations liées au travail déclaré) : – 25,3% ; dépenses en capital : -23,2% ; subventions économiques : -14,5 % ; autres programmes sociaux :- 8,8% ; Salaires : -8,6% ; transferts courants aux provinces : -7% ; transferts aux universités : -3,9 % ; reste : – 8,8%.
Dans le même temps, et en raison du ralentissement économique, les recettes fiscales diminuent. Au cours du premier semestre, elles ont chuté en termes réels de 7% en glissement annuel. En août, les recettes en termes réels ont chuté de 14% en glissement annuel. En septembre, elles n'ont baissé « que » de 3,4% en raison d'un facteur circonstanciel, les paiements anticipés de l'impôt sur les biens personnels. Les recettes liées à l'évolution de la production ont fortement diminué. La TVA a été négative à hauteur de 16,3% et l'impôt sur le revenu à hauteur de 13%. Cela devrait conduire à de nouvelles réductions des dépenses publiques et à de nouvelles baisses des recettes.
La maîtrise de l'inflation, suffisante pour le développement ?
Milei et ses semblables présentent comme une grande réussite le fait d'avoir ramené l'inflation de 25% en décembre 2023 – dopée par la dévaluation que le gouvernement a lui-même provoquée – à environ 4% ou (anticipé) 3,8%, approximativement (mais l'« inflation sous-jacente » – tendance à long terme de l'évolution des prix – semble se maintenir à 4,2%). Un « résultat » obtenu sur la base d'une profonde récession, de la chute des revenus salariaux et des pensions, de l'augmentation de millions de pauvres et d'indigents, de l'effondrement des travaux publics, du démantèlement de l'enseignement public et des entités culturelles, scientifiques et techniques.
Ce désastre social est justifié dans certains milieux par l'argument suivant : « si nous réduisons l'inflation, il y aura du développement ». Mais cela n'est pas vrai. Le passage d'un taux d'inflation élevé à un taux plus bas n'est pas une condition suffisante pour le développement ou pour l'amélioration de la vie des couches populaires. Après tout, le système capitaliste a connu des crises et des dépressions non seulement sans inflation, mais aussi avec des tendances déflationnistes. Par exemple, on peut mentionner la crise de 1929-1933, aux Etats-Unis, et la crise et la dépression post-1992 au Japon. Ou encore la crise argentine de 2001.
Mais le cas du Pérou est encore plus significatif. Depuis 1997, le Pérou connaît un taux d'inflation annuel à un chiffre, à la suite d'un plan d'ajustement très sévère qu'Alberto Fujimori [président de 1990 à 2000] a commencé à mettre en œuvre. Cependant, la situation des masses laborieuses ne s'est pas améliorée de manière substantielle. La pauvreté a diminué par rapport aux niveaux élevés qu'elle avait atteints dans les années 1990 – pendant l'« ajustement » – mais elle s'est stabilisée à 29%. Et 50% des emplois sont informels ou précaires.
Croissance de la dette
En août, l'encours de la dette brute à des conditions normales de remboursement s'élevait à 455,9 milliards de dollars (ministère de l'Economie). Par rapport à juillet, la dette a augmenté de 6,3 milliards de dollars, soit une hausse de 1,4%. Par rapport à décembre 2023, le stock de la dette a augmenté de plus de 87,7 milliards de dollars, en grande partie parce que la dette de la BCRA a été transférée au Trésor. Par ailleurs, des négociations sont en cours pour augmenter les emprunts auprès d'un groupe de banques (voir ci-après).
Quelques précisions sur la dette
Notons tout d'abord que le problème de la dette ne se limite pas à la dette extérieure, comme certains semblent le penser. En effet, la dette extérieure du gouvernement général (gouvernement central plus gouvernements provinciaux), au 2e trimestre 2024, s'élevait à 154,5 milliards de dollars. Cela représente 34% de la dette totale. Les deux tiers de la dette sont détenus par des résidents argentins. Il ne s'agit donc pas d'un problème de défense « nationale » ou de « patrie », mais d'intérêts capitalistes.
En outre, il faut savoir que plus de 45% de la dette est détenue par des agences du secteur public, 92% par le Fonds de Garantie de Durabilité (FGS) de l'ANSES (Agence nationale de la sécurité sociale), et les 8% restants par d'autres entités du secteur public, telles que Banco Nación et la BCRA. Le FGS est donc un fonds souverain composé de divers actifs financiers, intégré au système de retraite. Il détient des bons du Trésor pour environ 31,3 milliards de dollars (cette évaluation varie en fonction du dollar pris comme référence, soit au taux officiel, soit à celui du marché parallèle), ce qui représente 10% des titres émis par le secteur public. Selon la loi Omnibus [loi présentée par Milei en janvier 2023, composée de 664 articles], ces obligations publiques détenues par le FGS seront transférées au Trésor, annulées et cesseront de circuler. De fait, il s'agit d'un défaut des titres détenus par l'ANSES. Il s'agit d'une question à prendre en compte lorsque la gauche exige le non-paiement de la dette.
Troisièmement, les titres de dette émis par le Trésor et les crédits accordés au secteur public représentent aujourd'hui une part importante des actifs des banques. Cela s'explique par le fait que le gouvernement a fait pression sur les banques pour qu'elles achètent des bons du Trésor. Ainsi, en juillet, les LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), émises par le Trésor pour remplacer les BCRA pass [prêts à court terme qui se font entre les banques commerciales et la BCRA ; c'est un titre pour la banque], représentaient 37,1% des actifs des banques. A cela s'ajoutent 6% de prêts au secteur public (BCRA, « Informe sobre bancos », juillet 2024). Cette exposition n'a cessé de croître au cours des 12 derniers mois environ. En avril 2023, les engagements du Trésor représentaient 16,4% des actifs des banques. En juin, cette proportion était passée à 36,9%, et elle est aujourd'hui de 43,9%. Un défaut de paiement de la dette mettrait donc le système bancaire en grande difficulté (et la contrepartie de ces actifs sont les dépôts des épargnants). Tant cette question que la détention de la dette publique par l'ANSES montrent qu'un défaut de paiement ne peut avoir un sens progressiste que si la mesure s'articule avec un programme de transformation sociale à la base. Dans le cas contraire, il s'agit d'une rustine qui ne change rien de substantiel.
Enfin, rappelons que 19,6% du stock de dette correspond à des organisations internationales. La dette auprès du FMI représente 9,4% de la dette totale et 26% de la dette extérieure. Une autre donnée à prendre en compte, cette fois par ceux qui réduisent la revendication pour se libérer de la dette à ne plus payer le FMI (même si la dette auprès du FMI a évidemment son importance).
Réserves internationales et paiement de la dette en 2025
Depuis plusieurs décennies, les crises économiques de l'Argentine ont été déclenchées par des facteurs externes, en particulier par des crises de la balance des paiements – perte de réserves, pertes de change – souvent suivies par des crises bancaires et financières, y compris des défauts de paiement de la dette publique. D'où l'importance du suivi des comptes extérieurs.
Entre décembre 2023 et mai 2024, la balance [tenant compte des taux de change] des comptes courants a été excédentaire de 12,1 milliards de dollars. La BCRA a ainsi réduit le déficit des réserves internationales de plus de 10 milliards de dollars à la fin du gouvernement d'Alberto Fernández [2019-2023] à environ 2 ou 3 milliards de dollars. Cependant, la situation a changé à partir du mois de mai 2024. Entre juin et août, la balance des opérations courantes a été déficitaire de 3,16 milliards de dollars. En juin et juillet, la BCRA a perdu 162 millions de dollars ; en août, elle a accumulé 535 millions de dollars et en septembre, 373 millions de dollars. Dans les premiers jours d'octobre, la Banque centrale a procédé à de nouveaux achats, rendus possibles en partie par le moratoire susmentionné et par l'augmentation des dépôts en dollars. Cependant, les paiements en cours sont loin d'être couverts. Globalement, les paiements au titre du service de la dette en 2025 dépassent 17 milliards de dollars (y compris les paiements d'intérêts au FMI, le principal et les intérêts à d'autres organisations internationales et aux détenteurs d'obligations). A cela s'ajoute la dette du BOPREAL (Bonds for the reconstruction for a free Argentina, lancé en avril 2024 : paiement différé des importations déjà effectuées) pour plus de 2,1 milliards de dollars. A ce qui précède, il convient d'ajouter
1° Le peso s'apprécie progressivement, le dollar officiel augmentant de 2% par mois, soit la moitié de l'augmentation des prix. Cela affaiblira la balance des comptes courants.
2° La variation du prix du dollar en dessous du taux d'intérêt du peso permet une spéculation financière rentable. Par exemple, si l'intérêt payé sur une obligation en pesos est de 4% par mois, et si le peso se déprécie de 2% par mois, il y aura un gain, en dollars, de 2% par mois. Il s'agit d'un rendement intenable, qui a traditionnellement conduit à des ruées sur les devises et à des dévaluations brutales des capitaux.
3° Au fur et à mesure que l'économie se redressera – même si ce n'est qu'à l'échelle d'un rebond – les importations augmenteront et, par conséquent, la demande de dollars pour les payer.
4° Le prix du soja a chuté. Aujourd'hui, il se situe autour de 330 dollars la tonne, alors qu'il s'établissait à environ 500 dollars en 2022.
5° Selon la Bourse des céréales de Rosario, en raison de la sécheresse, « 30% du blé se trouve déjà dans des conditions passables ou mauvaises » ; les semailles de maïs commencent à être affectées.
6° Le déficit de la balance des services se creuse. En août, il a atteint 640 millions de dollars, soit un déficit supérieur de 49% à celui du même mois de 2023. Entre janvier et août 2024, le tourisme a chuté de 12,2% et le tourisme « sortant » a augmenté de 10,7%.
Le seul moyen de couvrir les besoins en dollars en 2025 serait un fort afflux de capitaux. Or, ces capitaux ne sont pas au rendez-vous. En raison de la croissance des dépôts en dollars dans les banques, les réserves brutes de la BCRA ont augmenté. Cependant, il ne s'agit pas de dollars librement disponibles. Cela signifie que lorsque la BCRA annonce qu'elle dispose des dollars pour assurer le service de la dette en janvier 2025, elle ne les a pas en réalité. C'est pourquoi le gouvernement a l'intention d'augmenter pour un montant d'environ 3,5 milliards de dollars la dette auprès d'un groupe de banques. L'objectif est d'honorer les engagements de paiement de 4,9 milliards de dollars dus en janvier 2025. Bien entendu, l'augmentation de la dette ne résout aucun des problèmes sous-jacents.
En conclusion
L'« ajustement » des revenus, des conditions de travail et de vie des masses ouvrières et populaires a, pour l'instant, été imposé. Il l'a été avec le soutien et le consentement – au-delà de différences mineures – des milieux économiques et de leurs institutions, des principaux partis politiques (y compris les gouverneurs et les législateurs du péronisme) et la « tolérance », au fond, de la plupart des dirigeants syndicaux.
L'offensive contre les travailleurs et travailleuses ne cesse pas. Le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises, dans les conflits en cours chez Aerolineas et chez les enseignants, entre autres, sa volonté de supprimer le droit de grève dans de nombreux secteurs. Le récent veto [par Milei] à la loi de finances de l'université et les attaques contre les travailleurs de la santé (hôpitaux Garrahan et Laura Bonaparte) sont d'autres expressions de cette offensive. Dans un article précédent, datant du 20 mars 2024, nous avions écrit :
« Dans le système capitaliste, il n'y a pas de sortie de crise “progressiste”. La réponse du système à la crise est la baisse des salaires (y compris les salaires sociaux : l'éducation et la santé publiques, etc.), la perte des droits du travail, l'affaiblissement des organisations syndicales, la flexibilité dans l'embauche et le licenciement, etc. Toute la science économique des Milei (et des Hayek et Friedman) se concrétise dans ce programme brutal. Qui est le programme du capital en général.
»Le point central est que le capital ne sort pas des crises en réduisant l'exploitation du travail, mais en l'augmentant […] Aujourd'hui, le gouvernement et le capital cherchent à reconstituer l'accumulation du capital de la même manière que toujours. Même les dirigeants et les politiciens qui se considèrent comme les défenseurs des secteurs populaires appliquent maintenant les ajustements à la baisse des salaires et des pensions, et consentent à l'avancée de la réforme du travail. »
Nous ajoutions : « Il n'y a pas de crise capitaliste sans issue. Il arrive un moment où la dévalorisation des actifs, la perte des droits du travail, la baisse des salaires, la destruction des forces productives, la restructuration du capital (fusions, fermetures d'entreprises improductives), incitent les capitalistes à investir. Au prix d'une tragédie sociale (pauvreté et misère à des niveaux records), le capital recompose les conditions de l'accumulation.
»… la seule façon pour un programme progressiste et humaniste de s'imposer est une transformation qui change les racines de cette structure sociale qui tourne autour du profit du capital et de sa contrepartie, l'exploitation du travail. » (Article publié sur le site de Rolando Astarita début octobre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Elections municipales (Brésil) : Victoire du « centre », crise de l’extrême droite et second tour décisif à São Paulo

Les élections municipales au Brésil ont été marquées par d'importantes victoires du centrão de droite, mais aussi par une scission de l'extrême droite, avec l'émergence de nouvelles figures de proue qui défient Bolsonaro. Pour la gauche, le second tour à São Paulo sera décisif.
11 octobre 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières | Photo : Le président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva et Guilherme Boulos, le 24 août 2024. © Leandro Chemalle/Thenews2/imago/ABACAPRESS.COM
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72224
On a beau se retourner, plus on tire le drap d'un côté, plus l'autre restera à découvert. Ce qui s'est passé lors des élections municipales du dimanche 6 octobre est une victoire éclatante de la droite. Certes, le tableau n'est pas tout à fait complet, puisqu'il y aura encore des seconds tours dans 52 villes, dont 15 capitales d'État, parmi lesquelles la plus grande, São Paulo, qui compte 11 millions et demi d'habitants. Mais le second tour pourrait-il modifier sensiblement les résultats globaux ? Il pourrait les rééquilibrer un peu, oui, mais pas en changer l'orientation.
Voyons ce que disent les chiffres. En 2020, les cinq plus grands partis de droite (MDB, PP, PSD, PSDB et DEM) ont remporté 3 223 mairies, soit 57 % de l'ensemble des mairies du pays. Cette année, ces cinq partis de droite ont remporté 3 613 mairies, soit 64 % des villes du pays.
Et ce, malgré la victoire de Lula en 2022.
Autres chiffres : jusqu'à présent, c'est le Parti social démocratique (qui, malgré son nom est, comme au Portugal, un parti de droite) qui a remporté le plus grand nombre de mairies. Avec 878 maires, le PSD a dépassé le Mouvement démocratique brésilien, hégémonique dans ce domaine depuis 20 ans. Dans le classement des partis en fonction des mairies gagnées, le PT n'apparaît qu'en 9e position. Malgré cela, le PT a fait élire cette année plus de maires qu'en 2020 (il en avait 179, cette année il en a obtenu 253). En revanche, dans les capitales des États, le parti n'a pas réussi à faire élire de maires au premier tour et ne participe au second tour que dans quatre capitales : Cuiabá, Fortaleza, Natal et Porto Alegre.
Dans la région ABC de São Paulo, berceau historique du parti et du courant de Lula, le PT est toujours exclu des mairies de « A » (Santo André), « B » (São Bernardo), et « C » (São Caetano), et ne peut conserver que celles des villes de Diadema et Mauá. Il est notoire que Lula aurait vraiment souhaité que le PT gagne à São Bernardo, jusqu'à ce qu'il doive se rendre à l'évidence que ce n'était pas possible. Le candidat du PT n'est même pas allé au second tour, qui sera disputé entre Podemos et Cidadania.
Fragmentation de l'extrême droite
Il existe cependant un nouveau phénomène qui secoue l'extrême droite et qui pourrait apporter des changements significatifs au paysage politique. Il s'agit de l'émergence de courants qui contestent le rôle de chef de file de l'extrême droite joué par Bolsonaro. São Paulo nous en a fourni le meilleur exemple, avec la candidature de Pablo Marçal.
Pablo Marçal est un influenceur internet, très célèbre sur la toile pour ses cours qui prétendent enseigner aux gens comment gagner de l'argent en ligne et devenir riche. Le parti dont il est le candidat, le Parti rénovateur travailliste brésilien (PRTB), n'a pas accès à la radio et à la télévision, mais Marçal n'en a pas eu besoin : il a Internet. Et c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a développé sa campagne, jusqu'à ce que son nom surgisse de nulle part et commence à apparaître dans les sondages. En mai, il obtenait déjà 10 % des voix. Dès lors, le phénomène Marçal prend de l'ampleur et catapulte ce spécialiste du marketing digital dans la course au second tour, qui opposait jusqu'alors Ricardo Nunes, du Mouvement démocratique brésilien (MDB), et Guilherme Boulos, du PSOL. Nunes bénéficie du soutien de Bolsonaro, tandis que Boulos est soutenu par Lula.
Blanc, macho et arrogant
La campagne de Marçal a plongé ses adversaires dans la perplexité. Sorti de la vulgate des formules d'extrême droite, Marçal n'était pas très intéressé par la présentation de propositions pour la ville. Ce qu'il voulait, c'était qu'on parle de lui. Dans les débats, sa tactique consistait à être toujours à l'attaque, accusant ses adversaires des crimes les plus divers, qu'ils aient un début de rapport avec la réalité ou qu'ils soient complètement inventés. Lors d'un des débats, il a tellement provoqué le candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), José Luiz Datena, que ce dernier lui a balancé un tabouret devant les caméras de télévision.
Selon les sondages, sa candidature d'homme blanc macho et arrogant a séduit la moitié des électeurs de Nunes. Son machisme ostentatoire est tel qu'il lui a même porté préjudice lorsque, lors d'un débat, il a poussé la provocation en disant à la candidate Tabata Amaral (PSB) que « les femmes ne votent pas pour les femmes parce que les femmes sont intelligentes ».
Mais le coup le plus violent a été la diffusion, le samedi, veille des élections, d'un certificat médical indiquant que Guilherme Boulos avait été hospitalisé dans une clinique privée pour avoir consommé de la cocaïne. En moins de quelques heures, l'équipe de campagne de Boulos a apporté la preuve qu'il s'agissait d'un faux. Rien de ce qui y figurait n'était exact : ni la signature du médecin, décédé depuis, ni le numéro d'identification de Boulos. En d'autres termes, Marçal savait qu'il commettait un acte frauduleux, mais il espérait que l'effet de la diffusion du rapport tiendrait 24 heures, le temps de devancer Boulos et d'accéder au second tour. Lorsque la falsification serait démontrée, les votes seraient déjà dans l'urne. Cela a raté de très peu. Nunes a obtenu 29,48 % des votes valides, Boulos 29,07 % et Marçal 28,14 %.
« Quel genre de leader est-ce là ? »
Les suites des élections ont montré que l'extrême droite traverse une crise de direction et que le soutien d'un Bolsonaro frappé d'inéligibilité pour les prochaines élections présidentielles de 2026 ne permet pas toujours d'obtenir le résultat escompté. C'est le pasteur Silas Malafaia, l'évangéliste le plus influent du clan Bolsonaro, qui a lancé les critiques. Dans une interview, Malafaia a accusé Bolsonaro d'avoir été lâche et silencieux lors de l'élection à la mairie de São Paulo, se permettant d'être « en retrait » par rapport aux deux candidats d'extrême droite, Ricardo Nunes et Pablo Marçal. « Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a joué sur les deux tableaux », a-t-il accusé. Et de s'interroger : « Quel genre de leader est-ce là ? »
Le lendemain, Malafaia annonçait qu'il avait fait la paix avec l'ancien président. Mais les divergences au sein de l'extrême droite sont encore très vives. Dans une interview après les élections, Marçal a déclaré qu'il ne favoriserait pas la réélection de Ricardo Nunes, et qu'il ne le ferait que si l'ancien président Bolsonaro, son fils Eduardo, le pasteur Malafaia et le gouverneur de São Paulo, Tarcísio Freitas, retiraient ce qu'il considère comme des mensonges à son sujet.
Marçal est allé encore plus loin : « Je suis sûr qu'il [Boulos] va gagner. Boulos et Lula parlent le langage du peuple, les autres [sont] juste en train de s'affronter ».
Lors des élections à São Paulo, Marçal a reçu le soutien de certains représentants de l'extrême droite, comme le député fédéral le mieux élu en 2022, Nikolas Ferreira, ainsi que le député fédéral Marco Feliciano. Un autre exemple de la crise de direction a été le soutien de Bolsonaro à la candidature d'Alexandre Ramagem à la mairie de Rio de Janeiro. Le fait que Bolsonaro se soit déclaré en faveur de Ramagem, qui a dirigé l'Agence brésilienne de renseignement entre 2019 et 2022, n'a pas suffi à empêcher la réélection du maire Eduardo Paes, du PSD, dès le premier tour, avec 60,47 % des voix. Ramagem a obtenu 30,81 %.
La droite qui a gagné
Pendant que l'extrême droite se déchirait, la droite dite « centriste » accumulait les victoires. Le PSD est désormais en tête du classement des maires élus avec 878 maires (il en avait 659), suivi du MDB avec 847 (il en avait 790) et du PP avec 743 (il en avait 697). L'União Brasil (parti de droite qui est représenté dans le gouvernement de Lula) suit avec 578 et le PL de Bolsonaro avec 510. Le PT n'arrive qu'en 9e position, avec 243 maires déjà élus. À noter également la chute du PSDB, qui a élu 273 maires, passant de la 4e à la 8e place en termes de nombre de villes gagnées et perdant 250 mairies par rapport à 2020.
Pour tenter de minimiser les répercussions de cette avancée de la droite sur le gouvernement, le ministre des Relations institutionnelles du gouvernement Lula, Alexandre Padilha, a estimé que les résultats du premier tour étaient positifs. « Il y a eu une croissance significative non seulement du PT, mais aussi de tous les partis qui soutiennent Lula », a-t-il déclaré. « Parfois, certains tentent de minimiser la force du gouvernement. Le président Lula a construit un large front avec les partis qui ont soutenu le gouvernement après le 8 janvier. Les leaders qui composent ce large front et qui ont soutenu Lula lors des dernières élections ont vaincu les grandes figures de l'extrême droite », a-t-il conclu.
Ce « front large » comprend en effet des ministres qui correspondent à l'aile la plus à droite du centre : trois ministres de l'União Brasil : Tourisme, Communications et Intégration et Développement régional, un du PP, Sports, et un des Républicains, Ports et Aéroports. Avec ces dernières nominations, Lula a constitué un gouvernement de plus en plus à droite et pratiquement in capable de mettre en œuvre des politiques favorables à la population.
Le centre-droit est entré dans le gouvernement de Lula, mais le prix à payer est très élevé. Une part de plus en plus importante du budget de l'État est contrôlée par les députés et les sénateurs au travers des amendements parlementaires. Cela signifie que l'État consacre moins d'argent aux investissements dont le pays a besoin.
En 2024, plus de 49,2 milliards de Réais ont été inscrits au budget par voie d'amendements. En 2014, ce chiffre était de 6,1 milliards de réais.
Par le biais des amendements dits « PIX », les députés et les sénateurs affectent des fonds du budget à des dépenses dans leurs États et leurs fiefs électoraux. Le contrôle du gouvernement sur ces amendements a considérablement diminué du fait des « amendements obligatoires », qui représentent la quasi-totalité des amendements parlementaires. Ces amendements mentionnent le nom du parlementaire qui en bénéficie, mais ne comportent pas d'obligation d'affectation précise à un projet ou à un programme. En d'autres termes, ils peuvent être utilisés pour n'importe quoi sans qu'aucun contrôle ne soit exercé sur leur mise en œuvre.
Victoire du Centrão et amendements PIX
Ce n'est pas un hasard si le Centrão se bat pour ces amendements. Ils permettent aux partis centristes, majoritaires au Congrès de maintenir et d'étendre leur pouvoir.
Une étude réalisée par le journal O Globo montre que les villes qui ont reçu le plus grand nombre d'amendements Pix ont un taux de réélection des maires supérieur à la moyenne nationale.
L'étude a analysé les 178 municipalités qui ont été les principales bénéficiaires des amendements. Dans ces municipalités, 100 maires ont été réélus et 45 autres ont vu l'élection d'un successeur du même parti.
Cela représente un taux de réussite de 94,6 %, supérieur au taux national de réélection de 81,4 % cette année, qui lui-même dépasse de loin les 63,7 % de 2008.
Ces chiffres prouvent l'importance des amendements pour le maintien au pouvoir des maires, qui les utilisent pour des travaux dans leur municipalité ou pour d'autres prestations moins licites. Le bureau du procureur général a déjà ouvert plus d'une douzaine d'enquêtes sur des soupçons de malversations dans l'utilisation de ces fonds.
C'est une dangereuse illusion que de compter sur la loyauté du centrão vis-à-vis de la nouvelle candidature de Lula en 2026. Il reste encore deux ans, et le centrão ne manquera pas de faire davantage de chantage et de majorer le prix de son soutien. Cela fait partie de la logique même de l'existence de ce bloc de droite.
L'enjeu de São Paulo
Lors de ce second tour, toute l'attention se portera sur l'élection à São Paulo, qui oppose le maire actuel, Ricardo Nunes du MDB, soutenu par Bolsonaro, à Guilherme Boulos du PSOL, soutenu par Lula. Dès le départ, Nunes a l'avantage et, en théorie, les voix de Marçal devraient toutes se porter sur lui. Mais un second tour est toujours une nouvelle élection, et les choix des électeurs répondent à une logique différente. Cela signifie que Boulos, bien que partant avec un désavantage, est en mesure de renverser la vapeur au cours de ces trois semaines de campagne jusqu'au dimanche 27 octobre, date à laquelle le second tour aura enfin lieu. Une victoire du PSOL, avec le soutien du PT, dans la plus grande ville du pays pourrait marquer le début d'un changement à l'échelle nationale.
Luis Leira, 11 octobre 2024
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL
Source - esquerda.net, 11 de outubro 2024 - 21:50 :
https://www.esquerda.net/artigo/vitorias-do-centrao-crises-na-extrema-direita-e-uma-segunda-volta-decisiva-em-sao-paulo
Les liens Internet intégrés ne sont pas reproduits ici. Se reporter à l'original portugais.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
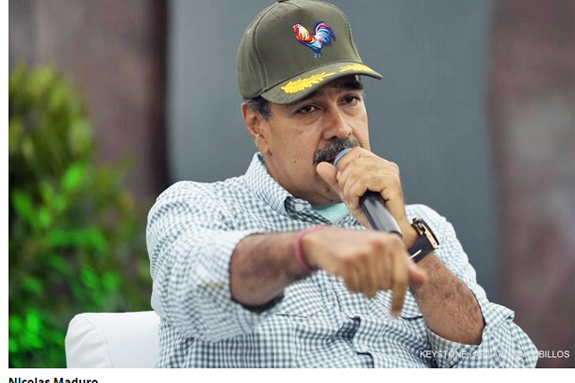
Dossier-Venezuela. « L’opposition mise au repos forcé »
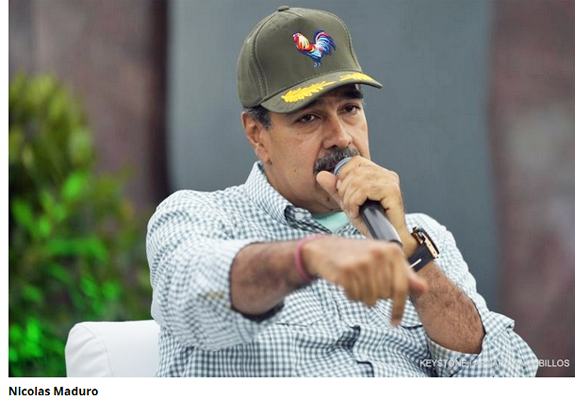
La répression et le manque de réaction face à celle-ci ont paralysé et presque réduit au silence l'opposition. Le gouvernement a profité de ce flottement politique pour mettre au pied du mur les dirigeants de l'opposition avec des arrestations ciblées, maintenir près de 2000 manifestants en prison, promouvoir des lois plus strictes sur la vie politique et civile et faire diversion avec des mesures telles que l'avancement des vacances de Noël au 1er octobre ou des querelles avec des parlementaires espagnols [voir plus bas].
13 octobre 2024 | tiré du site alencontre.org
http://alencontre.org/ameriques/amelat/venezuela/dossier-venezuela-lopposition-mise-au-repos-force.html
La faiblesse de l'opposition interne est contrebalancée par la réticence de la plupart des gouvernements de l'Amérique du Nord et du Sud et l'UE à reconnaître la victoire de Nicolás Maduro, bien qu'ils ne reconnaissent pas encore Edmundo González comme président élu. Dans le camp de l'opposition interne et dans les gouvernements les plus concernés par ce qui se passe au Venezuela, on reconnaît que le centre de gravité de la crise s'est déplacé vers l'extérieur et que la pression internationale est pour l'instant le principal facteur en faveur d'un changement politique que le parti au pouvoir refuse d'accepter, ajoutant de plus en plus de sacs de sable à ses lignes de défense.
Ce jeu a une échéance fixe de trois mois, puisque le nouveau mandat présidentiel de six ans doit commencer le 10 janvier 2025.
Résultats électoraux et répression
Il y a un mois, González a pris le chemin de l'exil à Madrid, après avoir été pendant des semaines « sous bonne garde » dans les ambassades néerlandaise et espagnole à Caracas. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui pour une série de délits politiques. Il s'agit d'un revers pour l'opposition et d'un soulagement pour Maduro, bien qu'en Europe, le diplomate à la retraite de 75 ans rencontre des dirigeants politiques pour faire sa victoire le 28 juillet.
D'autres dirigeants de l'opposition n'ont pas eu la même chance. A la suite des manifestations contre la proclamation de Maduro, qui ont fait 25 morts et des dizaines de blessés, une vingtaine de dirigeants nationaux et régionaux de partis d'opposition ont été emprisonnés. Beaucoup d'autres se cachent – comme la principale dirigeante de l'opposition, María Corina Machado – soit ont fui à l'étranger ou se font très discrets.
L'organisation non gouvernementale Foro Penal dénombrait, au 7 octobre, 1916 prisonniers politiques au Venezuela, dont 1676 hommes et 240 femmes ; 1757 civils et 159 militaires ; 1 846 adultes et 70 adolescents de 14 à 17 ans ; 1 784 ont été arrêtés après le 29 juillet et 148 ont été condamnés.
Dans ce climat, l'activité de l'opposition s'est réduite au point de presque disparaître, comme si elle laissait la possibilité à l'inertie de produire une interruption soudaine. Une semaine après l'élection, de grandes manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. Un mois plus tard, on ne compte que quelques petites manifestations, bien qu'il y ait eu de nombreux Vénézuéliens, s'exprimant dans certaines villes à l'étranger [entre autres en Colombie]. Deux mois plus tard, le 28 septembre, suivant les instructions de Maria Corina Machado, seuls de petits « essaims » ne dépassant pas 40 personnes se sont formés dans certaines régions.
De plus, le tintamarre des « actas » [des bulletins imprimés] de contrôle a presque cessé. Le parti au pouvoir maintient que Maduro a gagné avec 51,95% des voix contre 43,18% pour Gonzalez, tandis que l'opposition maintient que le résultat est au moins de 67% à 30% en sa faveur. Depuis que l'autorité électorale a refusé de publier – et apparemment ne publiera jamais – les résultats dans les 30'026 bureaux de vote, la demande d'attendre les « résultats officiels désagrégés » avant de faire une déclaration est restée un alibi utile pour les gouvernements qui refusent de s'engager à reconnaître la victoire de Maduro ou de González : notamment le Brésil, la Colombie et le Mexique. Le Centre Carter des Etats-Unis, dont la délégation a observé l'élection sur le terrain, a approuvé les chiffres et les décomptes que l'opposition a publiés sur Internet (les autorités électorales et les témoins des partis ont reçu des copies identiques des décomptes des votes dans les bureaux de vote).
Dix jours séparent deux investitures
Le Venezuela reste un sujet qui retient d'attention au plan politique international, bien qu'il soit loin des priorités du Moyen-Orient, de l'Europe de l'Est ou de l'Asie de l'Est. Il y a un mois, les Etats-Unis ont réuni les représentants de 49 gouvernements – en marge de l'Assemblée générale des Nations unies – pour exiger le respect des résultats des élections vénézuéliennes et appeler au dialogue entre le gouvernement et l'opposition.
Cette semaine, c'est Josep Borrell, le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, qui a réaffirmé que la solution à la crise vénézuélienne « ne peut être que politique et doit provenir de la pression internationale ». Il a admis que Maduro « apparemment, selon ses plans, reprendra le pouvoir en janvier prochain », mais « nous ne lui reconnaissons pas de légitimité démocratique ». C'est ce qu'a dit le Parlement européen et c'est ce que va dire le Conseil européen, qui est compétent en matière de politique étrangère, qui se réunira jeudi 17 octobre.
Francisco Palmieri, chef de la mission étasunienne au Venezuela, basée à Bogota, a déclaré il y a quelques jours que « le monde connaît la vérité sur le 28 juillet. Edmundo González a battu Nicolás Maduro par des millions de voix », et a annoncé que Washington poursuivrait sa politique de pression avec des sanctions contre Caracas.
Mais ces mesures et toute autre action étasunienne sur le Venezuela – comme sur d'autres points chauds de la scène dans le monde – passeront par le filtre de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis. Il n'y aura que dix jours qui sépareront l'investiture présidentielle à Caracas [10 janvier 2025] et Washington [20 janvier 2025].
Edmundo González a déclaré dans la presse qu'il envisageait de rentrer au Venezuela pour prendre ses fonctions de président le 10 janvier. Les responsables du parti au pouvoir répondent par des railleries, mais aussi par des mesures concrètes, telles que la poursuite de la détention de militant·e·s de l'opposition et l'adoption de lois – l'opposition qui soutient González n'a pas de représentation parlementaire – qui réglementent de manière plus stricte le fonctionnement des organisations politiques et civiles du pays.
Le discours pro-gouvernemental reste conflictuel. L'Espagne a offert une occasion en or, après que son parlement, par un vote partagé, a reconnu González comme président élu et a exhorté le gouvernement à faire de même. L'Assemblée nationale vénézuélienne a ensuite proposé à Maduro de rompre toute relation avec Madrid et a appelé le gouvernement espagnol à faire rien de moins qu'abolir la monarchie. Pendant ce temps, dans le lexique de Maduro et de ses collaborateurs, comme Jorge Rodríguez, président du parlement, et Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur, González est « menteur », « lâche », « traître » et « traître », et Corina Machado est « fasciste », « diabolique » et « sayona [sorcière] ».
Impasse et émigration
La paralysie politique est également marquée par l'absence de nouvelles initiatives gouvernementales pour remédier à la prostration dans la pauvreté de la majorité de la population et par le vent de nouvelles divisions dans les partis politiques d'opposition en perte de vitesse, en particulier Primero Justicia, de centre droit et premier parti du pays il y a quelques années, lorsque son leader, Henrique Capriles, s'est présenté à la présidence en 2012 contre le défunt leader Hugo Chávez, et en 2013 contre son héritier, Maduro. L'armée fait encore moins de bruit, après que ses hauts gradés ont publiquement et fermement soutenu la réélection de Maduro, à qui ils déclarent une loyauté inébranlable.
En attendant, pour une population dont la qualité de vie est déplorable – plus de 80% des 28 millions d'habitant·e·s sont considérés comme pauvres en termes de revenus et plus de la moitié font face à l'impossibilité de satisfaire leurs besoins de base – la perspective de l'émigration se dessine à nouveau. Une enquête de la société Poder y Estrategia a révélé cette semaine que 56% des jeunes Vénézuéliens âgés de 18 à 30 ans envisagent d'émigrer du pays, comme l'ont déjà fait huit millions de leurs compatriotes. Vingt-six pour cent d'entre eux ont déjà des projets en ce sens. (Article publié dans l'hebdomadaire uruguayen Brecha le 11 octobre 2024 ; traduction par la rédaction d'A l'Encontre)
*****
« Une représentation a été définitivement brisée »

« Si le Caracazo de 1989 avait brisé l'image d'un Venezuela riche en pétrole et d'une démocratie prétendument stable, la défaite électorale de Maduro en 2024 et l'éphémère soulèvement populaire qui s'en est suivi ont brisé le pilier symbolique de ce que nous appelons le chavisme », conclut Emiliano Terán Mantovani, après avoir analysé la réalité de la contestation sociale dans son pays. Sociologue à l'Université centrale du Venezuela, Terán Mantovani a collaboré à des initiatives telles que l'Atlas de la justice environnementale et le Panel scientifique pour l'Amazonie.
Il considère que les mouvements sociaux ont joué et jouent encore un rôle important dans son pays, même s'il préfère parler de « camp populaire » pour désigner la mobilisation massive de la population. Bien que les mouvements ne soient pas « liés au couple gouvernement-opposition », il considère que « le tissu des organisations sociales et des initiatives populaires a toujours été très impacté par le pétro-Etat vénézuélien, qui avait une grande capacité à récupérer leur force et à altérer leur autonomie », même avant l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez en 1999.
Le chavisme a produit une polarisation qui a divisé la société en deux, « ce qui a fortement marqué l'orientation de la mobilisation vers la “partisannerie” ». C'est pourquoi l'effondrement économique du milieu de la décennie 2010 « a eu un impact très dur sur le tissu social : la vie est devenue plus précaire et, avec elle, l'activité militante a été perturbée. »
Si l'on estime à 7 ou 8 millions le nombre de personnes qui ont émigré, on peut s'attendre à ce que de nombreux membres des mouvements sociaux (« du camp populaire ») en fassent partie, ce qui a affaibli leurs structures. Puis vint le pire : « La répression de l'Etat contre la société organisée a commencé à s'intensifier de manière extraordinaire depuis que le gouvernement a mis en échec la stratégie de Juan Guaidó et de Donald Trump en 2019 et que les partis d'opposition ont été durement touchés. Ces mesures répressives se sont traduites contre les syndicats, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, la communauté LGTBI, entre autres ; une avancée répressive que la pandémie a consolidée. »
Contrepoids venant d'en bas
Bien que l'effondrement économique ait perturbé les coordonnées politiques et ébranlé le terrain pour tout le monde, « dans le camp populaire, un discrédit de la polarisation politique a également commencé à se développer. Selon les sondages, la population se méfiait de tous les secteurs des partis à plus de 60%. La polarisation, qui avait été si décisive, perdait son sens pour la majeure partie de la population. A mon avis, un changement de perspective était déjà perceptible, qui, selon moi, cherche encore sa propre forme ». Une sorte de « force politique populaire » diffuse était en train de se former, mais elle était présente dans des moments tels que les récentes élections.
De plus, l'effondrement implique non seulement la débâcle économique mais aussi l'absence de l'Etat social, ce qui a conduit à ce que « les organisations acquièrent une plus grande capacité d'autogestion et une plus grande conscience de ce qu'est l'activisme dans des contextes de risque et de précarité élevés ». Cette nouvelle réalité s'est concrétisée en 2015 et 2016, avec une inflation à sept chiffres, période au cours de laquelle « des organisations sociales plus diverses et plus variées ont vu le jour, bien qu'affectées par le contexte et la fragmentation ».
Cependant, la proximité de l'élection présidentielle « a commencé à absorber de manière décisive l'expectative et la mobilisation sociale, voyant l'élection comme une possibilité réelle de changer le gouvernement ». L'enthousiasme social a été capitalisé par María Corina Machado, au point que beaucoup ont évoqué le « phénomène MCM » pour sa capacité à rassembler les forces autour de sa candidature. Mais Terán Mantovani estime que « ce serait une erreur de ne pas voir que ce qui précède, ce qui est en arrière-plan, c'est ce sentiment populaire, qui ne peut pas être lu comme une homologation de son programme politico-économique ».
La mobilisation électorale
La mobilisation sociale suscitée par les élections de cette année a probablement constitué un tournant durable. « Elle ne peut être interprétée en termes de grands mouvements sociaux, ni en termes de grands idéaux émancipateurs, bien qu'elle ait été inspirée par l'idée d'une démocratie à retrouver. Peut-être que cette mobilisation sociale est plus un mixte entre le mouvement spontané du peuple, les actions des bases sociales organisées et des différents partis politiques, et le consensus de tous les secteurs de la société pour destituer [Nicolás] Maduro », explique Terán Mantovani
La vérité est que les gens ont fait la queue pour voter dès la nuit précédant l'élection, « de nombreux réseaux de solidarité se sont construits entre les gens pour faciliter la participation massive, il y a eu une organisation pour une défense sans faille du vote, au-delà de la structure organisationnelle des partis politiques. Une chose à laquelle le gouvernement ne s'attendait peut-être pas ».
A l'annonce des résultats et des preuves de fraude, la réaction a été des plus forte et spontanée dans tout le pays, « principalement dans les quartiers populaires les plus emblématiques, anciens bastions du chavisme ». Cela à tel point que la dirigeante de l'opposition « a appelé à la prudence et à rentrer chez soi ». Selon Terán Mantovani, il s'est agi d'un « bref soulèvement populaire comme on n'en avait pas vu depuis des décennies ». « Pendant des années, le narratif chaviste a promu une image qui fusionnait le peuple et la révolution bolivarienne, et aujourd'hui, cette représentation a été définitivement brisée ».
Le puissant ferment social était gelé ou, comme le dit Terán : « il se trouvait dans un certain état de latence dû à la terreur et à la répression brutale ». Mais le calme imposé et l'ampleur de l'explosion « montrent que les conditions ne seront plus les mêmes ». C'est sans doute pour cela que le gouvernement tente de mettre en place un nouveau régime hyper-répressif et policier.
Il est encore trop tôt pour connaître les trajectoires qui seront empruntées par une société qui continue de rêver. La décennie qui s'est écoulée entre le Caracazo et le triomphe de Chávez est peut-être une mesure appropriée des changements inévitables qui sont encore en incubation.
(Article publié dans l'hebdomadaire uruguayen Brecha le 11 octobre 2024 ; traduction par la rédaction d'A l'Encontre).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












