Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Un simulacre de consultation : La commission parlementaire du PL 69

Pierre-Guy Sylvestre, économiste et conseiller syndical au service de la recherche du syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente, entre autres, les employés d'Hydro-Québec. Il dénonce l'attitude méprisante du gouvernement de la CAQ envers les travailleurs et travailleuses d'Hydro-Québec qui ont refusé d'inviter le SCFP à la commission parlementaire du projet de loi 69. Malgré ce refus, la FTQ a accepté de partager son temps d'intervention ce qui a permis au SCFP de continuer à lancer l'alerte face à l'accélération de la privatisation de la production et la distribution d'électricité au Québec. Le SCFP dénonce une commission parlementaire qui est un semblant de représentation démocratique et met en lumière les processus de dépossession de la production d'électricité mené par la CAQ au profit d'intérêts privés.
Cette vidéo a été produite dans le cadre de la campagne Dépossession : Contre la privatisation de nos services publics de GMob.
15 ocotbre 2024 | tiré de la lettre de GMob-GroupMobilisation
GMob-GroupMobilisation
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Réforme de la Loi sur les mines : quels changements, quels enjeux ?

Se terminent cette semaine les consultations particulières sur le projet de loi 63 modifiant l'encadrement des activités minières. De nombreux groupes aux intérêts variés ont ainsi été entendus en commission parlementaire. Du point de vue de la protection de la nature et des communautés, de nouveaux mécanismes sont accueillis favorablement, mais certaines préoccupations importantes ont été soulevées. Voici un tour d'horizon de ce qui est en jeu dans ce chantier législatif.
Contexte
Le projet de loi 63 est annoncé comme une « modernisation » de la Loi sur les mines. Précisons que les origines de la Loi sur les mines remontent à la fin des années 1800, mais que c'est dans les années 1960 qu'on a commencé à y parler d'environnement. Elle a par la suite été modifiée à quelques reprises au cours des dernières décennies. Son objectif demeure de faciliter l'accès au territoire pour favoriser le développement minier, bien qu'il soit précisé que ce développement doit se faire « au bénéfice des générations futures ».
La Loi sur les mines encadre tant l'exploitation des minéraux comme l'or et le lithium que celle du sable, du gravier et de l'argile, qu'on appelle « substances minérales de surface ». Elle divise les activités minières en différentes étapes qui ont chacune leurs propres règles :
– l'inscription d'un claim, qui constitue un droit minier exclusif d'exploration d'un territoire ;
– l'exploration minière, soit la recherche de minéraux ;
– l'exploitation minière, soit le développement de projets pour extraire ces minéraux (mines, carrières, sablières) ;
– la fin des projets miniers, soit la fermeture et la restauration des sites.
Alors que le nombre de claims a bondi ces cinq dernières années et que de nombreuses préoccupations ont été exprimées par la société civile, le gouvernement a lancé une large consultation en 2023, puis déposé le projet de loi 63 au printemps 2024. Quels changements sont-ils proposés ?
Certaines modifications visent des aspects techniques et administratifs du régime (par exemple, le mot « claim » deviendrait « droit exclusif d'exploration ») alors que d'autres accordent de nouveaux pouvoirs à la ministre des Ressources naturelles et aux municipalités.
Voici certaines de ces modifications comportant des dimensions environnementales ou liées à l'intérêt public, ainsi qu'un résumé des préoccupations qui ont été soulevées à ce jour.
Évaluation des impacts sur l'environnement
Actuellement, seuls certains projets miniers sont automatiquement soumis à la procédure québécoise d'évaluation des impacts sur l'environnement, qui mène entre autres à un examen par le BAPE. Ce sont les projets visant à extraire de l'uranium ou des terres rares ainsi que les projets qui dépassent un certain seuil de production, exprimé en tonnes métriques. Ces seuils sont fixés dans un règlement. Les projets d'agrandissement de mines existantes sont assujettis à une évaluation dans certains cas, notamment si l'aire d'exploitation est augmentée de plus de 50%.
Le projet de loi propose que tous les nouveaux projets d'exploitation minière (sauf pour les substances minérales de surface) soient soumis à la procédure d'évaluation des impacts, indépendamment de la capacité d'extraction. On ajoute aussi plusieurs circonstances où les projets d'agrandissements seraient assujettis à la procédure, mais cela demeure limité. Certains groupes environnementaux accueillent favorablement que davantage de projets miniers soient soumis à une évaluation, mais déplorent que plusieurs travaux d'agrandissement y échappent toujours.
Carrières et sablières
L'exploitation des substances minérales de surface (carrières et sablières) nécessite la conclusion d'un bail d'exploitation avec l'État, qui peut être exclusif ou non-exclusif. Le projet de loi propose d'exempter certains projets de devoir conclure un bail. Il s'agit des carrières ou sablières servant à construire un chemin forestier en terre publique et de celles exploitées par l'État québécois (par exemple un autre ministère) à des fins de construction ou d'entretien d'un « ouvrage de l'État ».
Le projet de loi propose que tous les nouveaux projets de carrière et sablière soient précédés d'une consultation publique dans la région concernée, alors qu'actuellement il y en a dans certains cas seulement. Cette consultation n'est toutefois pas l'équivalent d'une évaluation complète des impacts.
De plus, le projet de loi propose d'élargir les circonstances où la ministre peut refuser de conclure ou renouveler un bail, notamment pour des objectifs de protection du territoire et de limitation des impacts sur les communautés locales et autochtones . Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire.
Pouvoirs des municipalités et les propriétaires privés
L'activité minière est permise dans la majorité du territoire du Québec, incluant dans les villes, sur les terrains privés et sur les territoires revendiqués par des nations autochtones. La Loi sur les mines permet toutefois à la ministre des Ressources naturelles de « soustraire » un territoire à l'activité minière dans certaines circonstances, notamment pour tout objet jugé « d'intérêt public ». Cette soustraction fait en sorte qu'il n'est plus possible de réaliser de l'exploration minière ou de projeter l'exploitation d'une mine, d'une carrière ou d'une sablière sur ce territoire. Elle rend aussi impossible l'enregistrement de nouveaux claims, mais permet aux claims existants de perdurer et d'être renouvelés.
Pour soustraire un territoire à l'activité minière, une municipalité régionale de comté (MRC) peut délimiter, dans son schéma d'aménagement et de développement, un « territoire incompatible avec l'activité minière » (TIAM), soit une portion du territoire où la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière.
Le projet de loi propose de maintenir ce mécanisme, mais d'également soustraire à l'activité minière toutes les terres privées où il n'y a pas encore de claims ainsi que tous les périmètres d'urbanisation (périmètre que toute MRC doit délimiter dans son schéma d'aménagement). Selon certains groupes environnementaux, il s'agit d'un gain pour la population de milieux urbains et pour plusieurs propriétaires privés, mais il faudrait prévoir davantage de mécanismes pour les terres privées faisant déjà l'objet de claims et pour les terres publiques.
Il est maintenant proposé qu'une fois qu'une MRC a soustrait une partie de son territoire à l'activité minière avec un TIAM, elle pourrait demander au ministre de lever la soustraction, c'est-à-dire de permettre à nouveau l'activité minière après l'avoir suspendue. Cette levée pourrait être partielle (permettant seulement les carrières et sablières), sur demande d'une municipalité locale, ou totale (permettant l'activité minière régulière), sur demande d'une MRC.
Une fois la levée accordée et l'activité minière permise de nouveau, il y aurait un délai de 10 ans sans pouvoir demander à nouveau la protection de ce territoire. Certains groupes environnementaux ont des réserves quant à ce processus de levée de la soustraction puisque celle-ci aurait lieu sans évaluation des impacts et sans consultation publique obligatoire. Certains craignent notamment les pressions économiques ou politiques qui pourraient être exercées sur les municipalités pour l'utilisation de ces pouvoirs.
Mécanismes visant les droits et intérêts autochtones
Le projet de loi propose de préciser que la ministre peut utiliser son pouvoir de soustraction pour mettre en œuvre une entente avec une nation ou communauté autochtone, alors que la Loi prévoit actuellement qu'elle peut le faire pour un motif « d'intérêt public ». Il propose également de préciser que la ministre pourrait ajouter des conditions ou obligations à un titulaire de claim pour « éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones ».
De plus, le projet de loi introduit une obligation d'aviser la nation ou communauté autochtone concernée dans les 60 jours après l'inscription d'un claim. Il ne prévoit pas de consultation avant le claim.
Rappelons que la Cour supérieure devrait rendre d'un jour à l'autre sa décision sur la constitutionnalité de la Loi sur les mines actuelle, contestée par la Première Nation Mitchikanibikok Inik (aussi appelés les Algonquins du Lac Barrière) en raison du défaut systémique du Québec de les consulter et les accommoder avant d'accorder des claims miniers et de permettre des activités d'exploration sur leurs territoires.
Réaménagement et restauration des sites miniers
Avant toute exploitation minière, la Loi sur les mines exige qu'un bail minier soit conclu avec le ministère des Ressources naturelles. Comme condition à la conclusion de ce bail, un plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé. Ce plan doit viser à « remettre dans un état satisfaisant le terrain affecté par ces activités ». En pratique, la restauration des sites miniers est un enjeu important puisque dans plusieurs cas, plusieurs années après la fermeture de la mine, l'état du site est loin de son état initial. Certains groupes environnementaux ont exprimé leurs préoccupations à l'égard du manque de précision quant à ce qu'est un « état satisfaisant », et estiment que le projet de loi devrait plutôt exiger une remise en état du milieu ou une restauration à l'état naturel.
Une fois que les travaux de réaménagement sont effectués et satisfont la ministre, un suivi et une surveillance des travaux sont assurés. Le projet de loi propose de limiter ce suivi à une durée de 15 ans, ce qui préoccupe certains groupes au motif que ce ne serait pas suffisant pour éviter que les conséquences à long terme des activités minières ne soient supportées par la société civile.
Le projet de loi introduit par ailleurs une obligation, dans certains cas, de réparer, via le paiement d'une somme d'argent, le « préjudice » causé à l'environnement par un projet minier, et ce, malgré l'absence de faute. L'évaluation du préjudice et le montant associé ne sont pas définis dans le projet de loi et seraient déterminés par un futur règlement.
À quand les changements ?
Après les consultations particulières sur le projet de loi, la Commission parlementaire fera un rapport à l'Assemblée nationale. Celle-ci, c'est-à-dire l'ensemble des député-es du Québec, pourra alors discuter d'amendements possibles au projet de loi. Ultimement, les député-es voteront sur l'adoption du projet de loi.
Mais une fois la loi adoptée, ces changements seront-ils immédiats ?
La plupart des modifications entreront en vigueur immédiatement, à l'exception de celles exigeant des modifications réglementaires, qui sont pour leur part retardées jusqu'à ce que les règlements concernés soient modifiés ou adoptés. Certains délais de grâce sont également prévus pour les nouvelles exigences qui peuvent demander une période d'adaptation plus importante. Par exemple, certaines nouvelles formalités nécessaires pour renouveler un claim ne s'appliqueront pas au prochain renouvellement des claims actuellement en vigueur, plutôt seulement au renouvellement subséquent. Les modifications s'appliqueraient toutefois immédiatement aux demandes de bail minier ou d'exploitation de substances minérales de surface déjà déposées mais pas encore abouties.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Notice nécrologique de Fredric Jameson (1934-2024) par Boris Kagarlitsky -

Critique littéraire et philosophe américain, Fredric Jameson est reconnu pour avoir revitalisé le marxisme. Le sociologue marxiste Boris Kagarlitsky est actuellement incarcéré dans une prison russe pour avoir dénoncé l'invasion à vaste échelle de l'Ukraine. Dans le cadre de la campagne de solidarité internationale pour faire libérer Boris Kagarlitsky, une conférence en ligne a été tenue le 8 octobre : Boris Kagarlitsky and the challenges of the left today (Boris Kagarlitsky et les défis de la gauche aujourd'hui). Canadian Dimension est fier d'avoir co-organisé l'événement.
Vendredi 4 octobre 2024 / DE : Boris Kagarlitsky
Tiré de Canadian Dimension
Traduction Johan Wallengren
J'ai reçu durant mon emprisonnement un certain nombre de messages m'avisant du décès de collègues. J'apprends à présent le décès de Fredric Jameson, qui est l'auteur d'ouvrages fondamentaux sur la culture du capitalisme tardif et qui compte parmi les premiers à avoir discuté du postmodernisme en philosophie et en politique tout en mettant en évidence les liens à faire entre les réflexions intellectuelles, les changements dans le discours des personnalités politiques et les changements sociaux structurels. Il est clair qu'ici, dans la colonie pénitentiaire n° 4, je n'ai pas accès à ce dont j'aurais besoin pour écrire un article complet sur les idées de Jameson et sur sa contribution au développement des sciences sociales et de la théorie marxiste. Et pour être honnête, je préférerais parler d'autre chose – Jameson n'a jamais été un théoricien aride ou un universitaire ennuyeux, même s'il a travaillé dans un cadre universitaire et a eu beaucoup d'étudiants.
Je l'ai rencontré dans les années 1990, lors de mon premier voyage aux États-Unis. Fred était l'une des personnes ayant aidé à organiser le voyage, et très vite, après quelques jours passés à Madison, au Wisconsin, avec un autre sociologue Erik Olin Wright, quelqu'un de remarquable, je suis allé plus au sud, à l'université Duke, en Caroline du Nord, où Jameson enseignait. Le fait de ne pas encore avoir lu ses ouvrages à l'époque était embarrassant. Mon excuse était que c'était encore l'ère soviétique et que l'accès aux livres étrangers était assez compliqué, malgré les changements politiques qui avaient déjà eu lieu. La perestroïka suivait encore son cours dans notre pays, tandis qu'aux États-Unis, on commençait à peine à mesurer les conséquences des réformes néolibérales (il faudrait plutôt parler de contre-réformes) mises en œuvre par le président de l'époque, Ronald Reagan.
J'ai immédiatement été frappé par le fait que Jameson n'avait rien à voir avec la plupart des intellectuels occidentaux, y compris ceux de gauche, avec lesquels j'avais eu l'occasion de tisser des liens. Il m'avait l'air d'un homme empreint de bonhomie et terre-à-terre, un vrai Sudiste (c'était ma façon de le voir en tout cas), un amateur de bière qui aimait la cuisine grasse, un homme aussi corpulent que joyeux. C'était la dernière personne de qui on pouvait s'attendre à entendre de profondes réflexions sur l'esthétique et la philosophie ou de subtiles analyses politiques, mais c'était précisément le type de conversations que nous avions. Ce qui préoccupait le plus Fred, c'était l'influence de la pensée postmoderniste éclectique sur la gauche et le marxisme. Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui venaient de publier un livre sur l'hégémonie, étaient ses principales bêtes noires. « Quelle est cette hégémonie sans sujet social, sans classe consciente de ses intérêts ? tonnait Fred. « Ils diluent la théorie de Gramsci, ils la vident de sa substance !
Comme lui, je n'ai pas aimé le livre de Laclau et Mouffe (que j'avais réussi à lire au préalable), mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la passion avec laquelle Fred – toujours un vrai Sudiste – prenait à partie celles et ceux avec qui il n'était pas d'accord. Plus tard, j'ai appris à connaître Chantal Mouffe et nous avons eu ensemble des débats passionnants (nous nous accordions sur certaines choses, mais sur d'autres pas du tout). Le temps a encore passé et puis j'ai revu Fred à une autre conférence et je lui ai demandé s'il avait changé d'avis, surtout eu égard au fait que Mouffe elle-même, dans ses ouvrages plus récents, me semblait beaucoup plus respectueuse de la sociologie marxiste. « Pas de concessions ! a tonné Fred une fois de plus. Ce ne sont que des tactiques, rien n'a changé sur le fond. »
Il y a lieu de mentionner que Fred, tout en étant un innovateur intellectuel, défendait fermement les approches marxistes classiques (et ce faisant, il démontrait, exemple à l'appui, leur productivité et leur pertinence).
Pendant que j'y suis, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour faire remarquer à la lectrice ou au lecteur qu'à la fin du XXe siècle – et encore maintenant, je suppose – l'Amérique est devenue, de manière inattendue, un pays où la pensée marxiste et, plus largement, la pensée de gauche se sont épanouies. Oui, les sociologues et les théoriciens politiques travaillant aux États-Unis étaient à l'étroit dans le ghetto universitaire où ils avaient été confinés depuis les persécutions de l'ère McCarthy dans les années 1950. Ce n'est peut-être que grâce à la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016 qu'ils ont réussi à émerger. Pour quelqu'un de la stature de Jameson, avec sa verve et son bagout, la situation a dû être physiquement étouffante. Cela ne l'empêchait pas de dégager une aura de vitalité et d'optimisme, si nécessaire à notre époque.
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à Moscou. Nous avons bu de la bière, puis du vin dans un restaurant géorgien, et nous avons parlé de nos connaissances mutuelles et de politique. Cette fois je me suis davantage exprimé et j'ai essayé d'expliquer comment le système politique russe et l'idéologie d'État étaient structurés. « Le postmodernisme incarné ! », s'est exclamé Fred, mi-impressionné, mi-dégoûté. À ce moment-là, j'avais non seulement lu son livre sur le capitalisme tardif, mais je l'avais recommandé à mes étudiants.
Nous ne savions pas que ce serait notre dernière rencontre en personne. Depuis lors, il y a eu des campagnes internationales où nos noms sont souvent apparus côte à côte. Et puis Fred a aidé à organiser la campagne pour me faire libérer. Malheureusement, lorsque je sortirai de prison, je ne pourrai pas le remercier, ni réentendre sa voix, ni connaître son opinion sur la dernière question de l'heure. Plus le temps passe, plus nous nous isolons et perdons des interlocuteurs appréciés, des enseignants et des collègues respectés. À nous, alors, de persévérer. Mais nous avons toujours des étudiants, des partisans et des camarades. Fred en avait beaucoup.
Cet article a été initialement publié en russe sur le site Rabkor.
Boris Kagarlitsky est professeur à l'École supérieure des sciences sociales et économiques de Moscou. Il est le rédacteur en chef du journal en ligne et de la chaîne YouTube Rabkor. En 1982, il a été emprisonné pour activités dissidentes sous Brejnev. Il a ensuite été arrêté sous Eltsine en 1993 et sous Poutine en 2021. En 2023, les autorités l'ont déclaré « agent étranger », mais il s'est refusé à quitter le pays, contrairement à de nombreuses autres personnalités opposées au régime. Parmi ses ouvrages traduits en anglais figurent Empire of the Periphery : Russia and the World System (Pluto Press 2007), From Empires to Imperialism : the State and the Rise of Bourgeois Civilisation (Routledge 2014), et Between Class and Discourse : Left Intellectuals in Defence of Capitalism (Routledge 2020).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le prix de la langue française 2024 décerné à Abdellah Taïa

Remis par la ville de Brive (Corrèze), le prix de la langue française 2024 récompensera, le 8 novembre, l'écrivain Abdellah Taïa.
Tiré de l'Humanité
Par Samuel Gleyze-Esteban, L'Humanité, France, le jeudi 17 octobre 2024
Remis par la ville de Brive (Corrèze), le prix de la langue française 2024 récompensera, le 8 novembre, une plume engagée venue du Maroc. De ses premières nouvelles publiées au tournant des années 2000 jusqu'au « Bastion des larmes », paru en août chez Julliard, Abdellah Taïa, né en 1973, s'est fait le témoin des changements et des injustices de la société marocaine.
Il fut aussi l'un des premiers à déclarer publiquement son homosexualité, dans un pays où elle est condamnée par la loi, et compte comme un défenseur de la cause LGBTQ +. En 2009, il dirigeait l'ouvrage « Lettres à un jeune Marocain », un appel politique adressé à la nouvelle génération, un an avant le début du printemps arabe, dont il s'est fait l'écho. Dans son communiqué, le jury salue « des textes forts dans lesquels résonne la voix des opprimés et des marginaux ».
Le dernier d'entre eux, une enquête intime et, comme souvent, irriguée d'autobiographie, expose la culture du viol subie par les jeunes garçons marocains. Le livre est en lice pour le Goncourt.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le budget en examen à l’assemblée nationale

Les débats s'annoncent tendus à l'Assemblée nationale, depuis hier. Dépourvu d'une majorité absolue, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, pourrait recourir à l'Article 49.3 pour l'adoption de la Loi de finances 2025. Le Rassemblement National en quête d'une stratégie.
De Paris, Omar HADDADOU
Dégainera ! Dégainera pas !
Au moment où les GAFA mettent les bouchées doubles, politiquement tous les regards sont braqués vers Michel Barnier, Premier ministre français qui s'échine à faire voter, dans la cacophonie et les frondes les plus déchaînées, le Budget 2025 à l'heure où le déficit de la France est revu à la hausse à 166, 6 milliards, dans la Loi de finances de l'année en cours. Quarante-huit heures après son rejet en Commission des finances, le texte revient donc en séance publique, flanqué d'un autre dossier à susciter des nuits blanches au locataire de Matignon, celui de la Sécurité sociale. Le triste tableau brossé par la Commission des Comptes, fait état d'un gouffre financier de 16, 6 milliards d'euros, loin des 10,8 milliards prévus.
Hier, les Députés planchaient sur la partie « recettes » de l'Etat qui prévoit 60 milliards d'économies dans la perspective du vote inéluctable de l'Article 49.3 de la Constitution. La motion de rejet sur le projet de Loi de finances, a été « retirée », ce lundi 21 octobre 2024, de la part de La France Insoumise (LFI). Son Président de Commission des Finances, Eric Coquerel s'en expliquait : « On voulait la déposer, mais en réalité, on ne voulait pas qu'elle soit votée. Donc, on a préféré carrément la retirer ».
La semaine des débats dans l'hémicycle s'annonce âpre. Et certains chefs (es) de file ont déjà teinté la teneur de leurs déclarations : « Le budget de Michel Barnier fait les poches de la France du travail » déclare le Président du RN, Jordan Bardella, et d'ajouter « Un projet de Loi sans cap ni cohérence ». Hostile à l'Aide médicale de l'Etat (AME), bien calée dans le viseur de l'intraitable Ministre de l'Intérieur Retailleau et son vomi « Ma ligne est claire, tolérance zéro », Bardella ne cache pas sa haine à envers les étrangers (es) et les foyers modestes : « La hausse du budget de l'AME est une ligne rouge. Si elle venait à être franchie, le gouvernement s'exposerait à une censure », fustige-t-il. Incontestablement, le Premier ministre est poussé par Macron sur du sable mouvant. Une mission qui n'est plus enviable, dans une vie politique empreinte d'aboiements effrayants et de chutes précipitées.
Si la motion de rejet est votée, le texte ira directement au Sénat dans la version du gouvernement.
Un tel scénario, permet à Michel Barnier de s'armer du 49.3 de la Constitution. « La Gauche et le NFP, dira Manuel Bompard porte-parole de la France Insoumise, ont fait la démonstration qu'un autre budget est possible puisque nous avons réussi à faire voter des amendements qui permettaient de générer 60 milliards d'euros de recettes nouvelles. C'est exactement le chiffre que cherche le Premier ministre en terme d'économie ».
Selon le Député, « les 60 milliards qui manquent chaque année au budget de l'Etat correspondent exactement aux cadeaux fiscaux offerts par Emmanuel Macron aux riches de ce pays ! »
Interrogé sur la possibilité du recours au 49.3, Laurent Saint-Martin, Ministre du Budget et des Comptes (de Gauche, introduit dans le gouvernement Barnier), a émis le souhait que le « débat ait lieu et le texte soit amendé, modifié, et qu'il ait des changements, conformément à la vie des Institutions ».
Otage d'un malaise planétaire, nourri par les guerres larvées, une déflagration des Institutions, une explosion des profits d'une minorité, la perte de la quintessence religieuse et l'infusion du Populisme, la France ne sait plus où donner de la tête !
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Familles-queers-récits-et-célébrationn
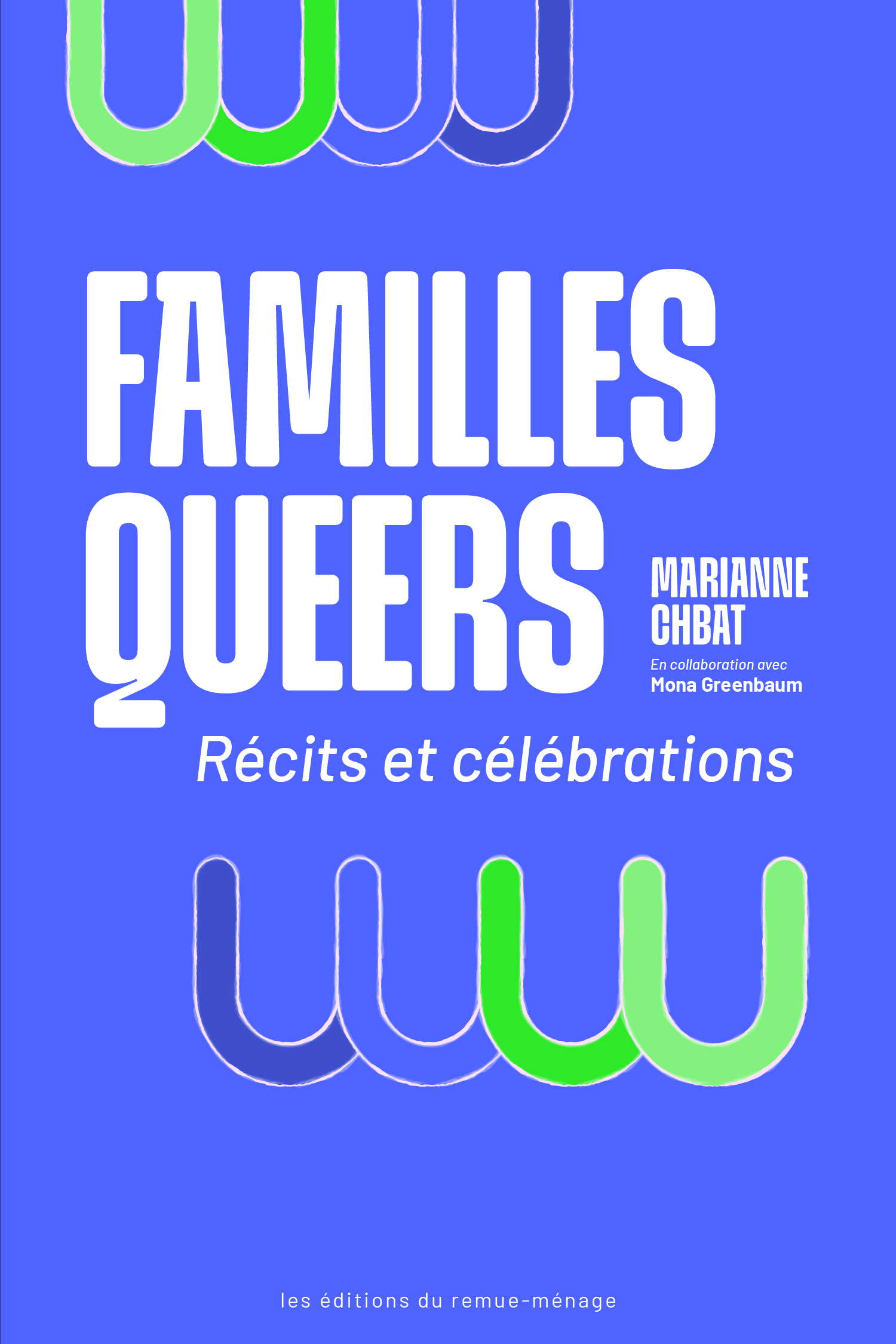
Parution
15 octobre 2024, au Québec 11 avril 2025, en Europe
« La famille n'est pas encore imaginée dans sa pluralité, à l'extérieur des codes cishétéronormatifs. Autour du manque de représentations s'érige le silence qui étouffe les possibles, qui brise l'élan, la créativité et la capacité à se projeter. » Marianne Chbat
Près de 10 ans après la parution de Familles LGBT, le guide, qui se voulait une introduction à la réalité des familles qui déjouent la norme cishétéro, les temps ont bien changé. Malgré d'importantes évolutions sociales et juridiques les discours réactionnaires sont plus que jamais décomplexés.
Ce livre mesure le chemin parcouru et, en toile de fond, dénonce le ressac, en donnant la parole à plus d'une trentaine de familles d'ici qui se confient sur leurs réussites, leurs deuils et les embûches auxquelles elles ont fait face. Elles sont uniques, différentes, mais toutes font preuve de créativité et d'agentivité. Élaboré en étroite collaboration avec le milieu associatif, cet ouvrage souhaite offrir des représentations nouvelles et diversifiées pour que les futures familles queers puissent mieux se voir, mieux s'inventer.
MARIANNE CHBAT est sociologue, chercheuse et militante. Elle est coordonnatrice principale de la recherche à la Clinique Mauve, un laboratoire social hébergé à l'Université de Montréal qui développe la recherche auprès des personnes LGBTQ+ migrantes et racisées et leur offre un accès à divers services de santé intégrés.
« Je ne savais pas encore que ce manque de modèles était d'abord et avant tout alimenté par des stéréotypes négatifs et réducteurs à l'endroit des personnes et communautés arabes. J'avais donc, à tort et à cause d'un imaginaire tronqué, associé l'origine de mes parents à une impossibilité d'être moi — pleinement et authentiquement — et j'ai, pendant de nombreuses années, cherché à cacher, fuir et repousser mon histoire et mes origines. » Marianne
« Samatar a longtemps réfléchi aux façons dont il transmet son expérience de racisation à ses filles. Bien qu'il souhaite leur transmettre des valeurs et un héritage qui sont propres à son histoire, il reconnaît que son expérience en tant que personne racisée n'a pas été simple et il aimerait, à certains égards, préserver ses enfants des oppressions qu'il a vécues. À cet effet, la transmission du nom de famille a été une décision importante pour son conjoint et lui. » Samatar
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
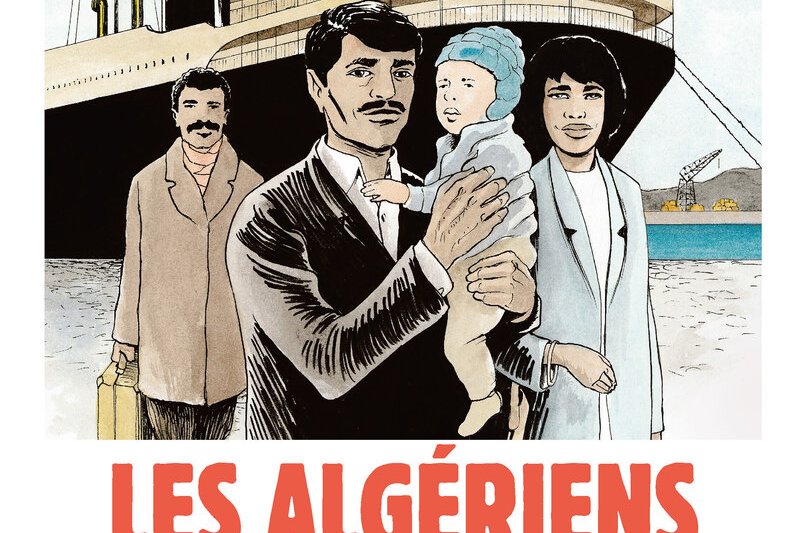
Stora – Le Scanff, « Les Algériens en France : une histoire de générations », entre histoire et actualité
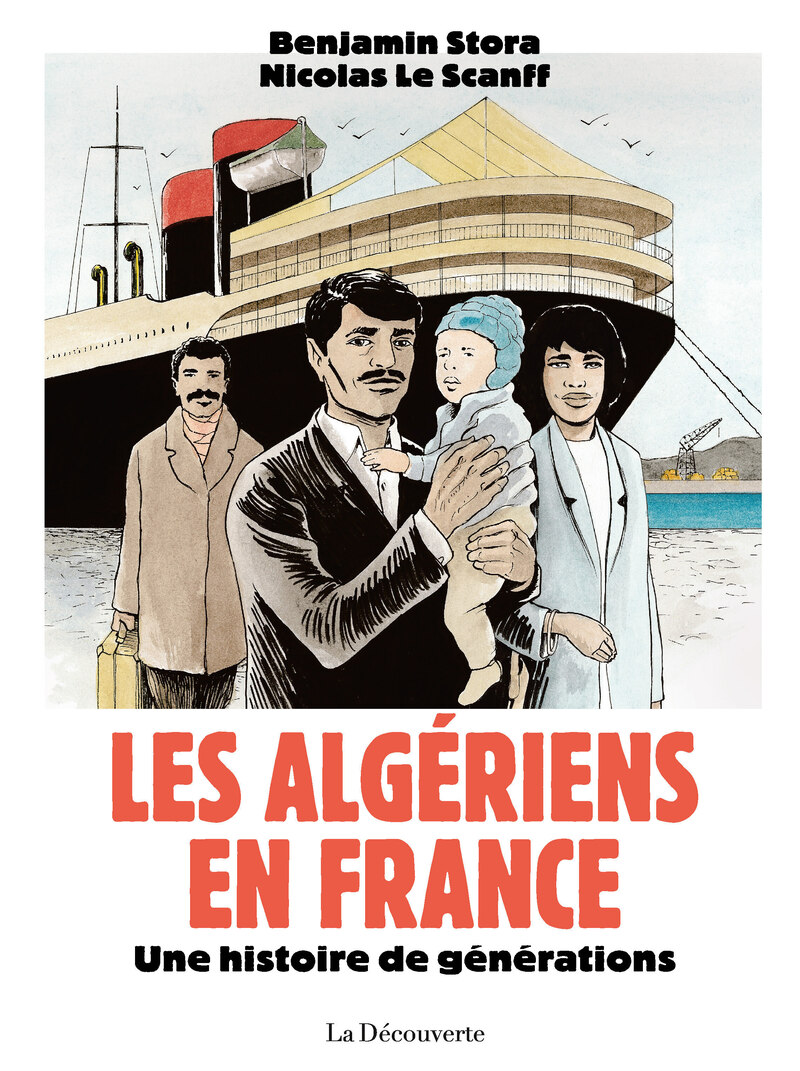
Par Djéhanne Gani, Le Café pédagogique, Paris, 17 octobre 2024
Dans un contexte de débats sur l'immigration, la bande-dessinée signée par l'historien Benjamin Stora et le dessinateur Nicolas Le Scanff « Les Algériens en France : une histoire de générations » (1) nous plonge dans la mémoire de l'immigration algérienne. Elle offre un récit historique entremêlé de récits de mémoire personnelle et familiale, depuis l'arrivée des pères dans l'entre-deux-guerres jusqu'à la Marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Pour Naima Huber-Yahi, qui en a écrit la préface, cette bande-dessinée « met en récit et en images les travaux de l'historien Benjamin Stora sur l'immigration algérienne, à travers une narration sensible, chronologique et intergénérationnelle ».
*« Les Algériens en France, une histoire de générations » : un travail de mémoire pédagogique*
Aujourd'hui, 17 octobre 2024 est le 63e anniversaire de la répression sanglante des manifestations du 17 octobre 1961 à laquelle Stora et Nicolas Le Scanff consacrent des pages dans la bande-dessinée parue en septembre 2024. Ce massacre est important, la communauté algérienne est la plus importante de France, « les estimations les plus élevées sur plusieurs générations évoquent plus de 4 millions de personnes issues des différentes générations d'immigrés algériens y compris avant 1963 » écrit Naima Huber-Yahi dans la préface qui fait de nombreux ponts avec l'actualité et les débats sur la question de l'immigration.
*Des lieux de mémoire*
La BD met en scène l'exil et le dialogue entre générations et au sein de la seconde génération. Il est question des histoires intrafamiliales durant la guerre d'indépendance algérienne. On y trouve aussi les récits de l'arrivée en France des pères pour travailler dans des cafés-hôtels à Paris, dans des usines ou des mines dans le Nord. On retrouve ces lieux de mémoire dans la BD, les bidonvilles de Nanterre, les mines de Liévin, Marseille, Paris.
*« La transmission des luttes à la fois sociales et politiques comme anticoloniales et antiracistes »*
La bande-dessinée s'ouvre sur la « Marche des beurs », sur la jeunesse issue de l'immigration algérienne qui réclame la reconnaissance de sa citoyenneté française et l'égalité des droits, celui de vivre dans l'égalité, contre le racisme. Cette génération a vu ses parents souffrir des injustices. Le fil rouge de la bande-dessinée se dessine à travers l'histoire familiale de trois jeunes qui ont manifesté en 1983. Le choix de mettre en bande-dessinée des travaux de recherche de Stora est lié à une volonté de toucher les plus jeunes. Pour Naima Huber Yahi, « la multiplication des récits, à l'image de cet ouvrage, ne peut que contribuer à transmettre, y compris aux principaux concernés, la manière dont ces générations d'héritiers de l'immigration algérienne sont aujourd'hui des Français à part entière : recoudre le tissu mémoriel, raconter notre histoire commune et vulgariser la connaissance est plus que nécessaire aujourd'hui pour affronter cette fièvre identitaire qui s'empare de notre pays. »
Djéhanne Gani, Le Café pédagogique. 2024-10-17
Suggestion de lecture de André Cloutier
(1) Lire un extrait de 15 pages sur 144 : https://www.editionsladecouverte.fr/les_algeriens_en_france-9782348079665
Consultation en ligne du "Café pédagogique" du 17 octobre 2024 http://link.listes.cafepedagogique.net/m/view/200138/540576/k6VxDaWQBRkuuWrama74bRLvXqWiyoNgAT3GhVGU_Vo=
Les Algériens en France - Benjamin Stora, Nicolas Le Scanff
<https://www.editionsladecouverte.fr...>
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
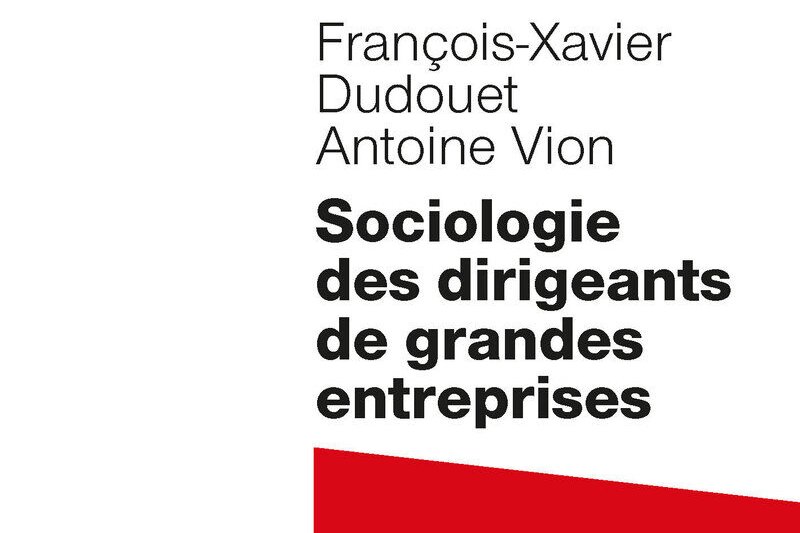
Les grandes entreprises dirigeraient notre monde, mais qui dirige les grandes entreprises ?

Les grandes entreprises dirigeraient notre monde, mais qui dirige les grandes entreprises ?
Éléments de réponse dans l'ouvrage de François-Xavier Dudouet et Antoine Vion : Sociologie des dirigeants de grandes entreprises
par François-Xavier Dudouet et Antoine Vion
Suggestion de lecture de André Cloutier
Comprendre comment fonctionnent les grandes entreprises et par qui elles sont dirigées constitue certainement l'un des enjeux cruciaux du XXIe siècle. Que ce soit sur le plan des défis environnementaux, sociétaux ou technologiques, il y a fort à parier que les grandes entreprises seront des interlocuteurs incontournables. Il est ainsi primordial de les envisager non pas seulement comme des acteurs économiques, producteurs de biens et de services, mais comme des créatures politiques à part entière, et d'étudier leurs dirigeants.
Longtemps associé à la propriété des entreprises, le pouvoir économique a changé de nature avec l'avènement des sociétés par actions qui ont juridiquement séparé le patrimoine des entreprises de celui des actionnaires, entraînant une transformation radicale de la sociologie des dirigeants. Rarement héritiers et encore plus rarement fondateurs, les personnes qui sont à la tête des grands groupes économiques ne sont pas celles que l'on croit. À partir d'une revue de littérature approfondie, les auteurs explorent les dirigeants de grandes entreprises sous six dimensions – juridique, sociale, professionnelle, géographique, financière et morale – proposant un regard renouvelé sur une population finalement très méconnue.
Voici l'introduction de Sociologie des dirigeants d'entreprise paru aux éditions La Découverte en 2023.
Introduction
« Il est vrai que, si la plupart des hommes sont ainsi submergés par la corporation, quelques-uns, très peu, sont exaltés par un pouvoir qu'en tant qu'individus ils n'auraient jamais pu exercer. À travers les grandes organisations dont ils sont les chefs, quelques-uns sont capables de jouer un rôle sans aucun précédent historique dans l'exercice du contrôle des opérations commerciales du pays et dans la détermination du bonheur d'un grand nombre de personnes. » Woodrow Wilson [1916, p. 6 ; notre traduction].
Quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson (1913-1921), s'inquiétait, au début du xxe siècle, du pouvoir naissant des dirigeants de grandes entreprises sur quelques millions de personnes, il était loin de se douter que, un siècle plus tard, leur emprise toucherait des milliards d'individus sur l'ensemble de la planète. En 2021, il s'est vendu 1,4 milliard de smartphones dont plus de la moitié par les sociétés Samsung et Apple. Sur Internet, plus de 90 % des recherches sont effectuées via le moteur de recherche Google. En 2020, McDonald's a servi 9,125 milliards de clients, soit plus que la population mondiale. Le nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes sur des vols réguliers a atteint, en 2019, 4,5 milliards de personnes. Autant de voyages impossibles sans une myriade de grandes entreprises : firmes aéronautiques, compagnies aériennes, sociétés aéroportuaires, entreprises de nettoyage, de sécurité, de maintenance, de restauration. En 2015, les grandes entreprises (au moins 5 000 salariés selon l'Insee) comptaient pour 0,5 % du nombre total des sociétés immatriculées en France, elles employaient un quart des salariés français, représentaient 45 % des immobilisations corporelles et 50 % des exportations. Le poids économique de ces dernières est sans proportion avec leur nombre.
Quel que soit l'avenir, il est raisonnable de faire l'hypothèse qu'il ne se fera pas totalement sans les grandes entreprises. Essayons donc de comprendre comment fonctionnent leurs organes de direction et par qui elles sont dirigées.
Qui dirige les grandes entreprises ?
Se tourner vers les grandes fortunes de ce monde en considérant que, tout compte fait, ce sont elles qui contrôlent la destinée des grands groupes est trompeur. D'abord, le capitalisme familial, que ce soit en termes d'actionnariat ou de direction des firmes, est, à quelques exceptions près, loin d'être majoritaire au sein des grandes entreprises [La Porta et al., 1999]. Ensuite, ce réflexe fait perdurer une vision de l'économie fondée sur la propriété humaine des moyens de production qui, dans les faits, a été abolie par l'avènement de la société par actions au xixe siècle [Ireland, 1999 ; Robé, 2011]. Celle-ci a, en effet, dissocié le patrimoine des actionnaires de celui des entreprises, devenues détentrices des moyens de production. Cette innovation juridique n'a pas seulement eu pour conséquence de désolidariser les actionnaires des pertes éventuelles de l'entreprise, tout en leur garantissant le gain des bénéfices, elle a aussi profondément transformé la nature du pouvoir économique et sa sociologie. Il existe bien des grandes fortunes gardant la mainmise sur tel ou tel groupe, mais ce n'est ni un rapport nécessaire ni la situation la plus fréquente.
Comment, dès lors, concevoir un pouvoir économique sans propriétaires des moyens de production ?
Dépasser l'opposition actionnaire-manager
La réflexion s'est heurtée à de nombreux obstacles, dont le principal a certainement été de maintenir une vision patrimoniale de l'économie qui confondait actionnaire et propriétaire. Cette confusion a justifié le recours à la grille de lecture hégélienne du maître et du serviteur [Hegel, 1807] pour analyser les rapports entre actionnaires et directeurs. Les actionnaires ont ainsi été conçus comme les maîtres légaux des firmes, dont la direction avait été confiée à des directeurs plus ou moins loyaux. Cette opposition principielle entre actionnaires et managers a été au cœur des débats qui ont animé la question du pouvoir sur et dans les entreprises tout au long du xxe siècle [Mizruchi, 2004]. Aux promoteurs de la cause managériale qui constataient la prise de pouvoir des managers [Berle et Means, 1932], voire leur émancipation dans une nouvelle classe managériale [Burnham, 1941], s'opposaient ceux qui affirmaient la primauté des actionnaires [Zeitlin, 1974] et le nécessaire assujettissement des managers à ceux-ci [Jensen et Meckling, 1976]. Bien que l'opposition systématique entre actionnaire et manager n'ait jamais été démontrée, cet antagonisme a permis d'enfermer le débat dans des termes commodes et consensuels qui empêchaient d'interroger la direction des grandes entreprises pour elle-même. Pourtant, en abolissant la propriété humaine des moyens de production, les sociétés par actions ont coupé court à la dialectique ancestrale du maître et du serviteur. L'actionnaire et le directeur ne sont pas deux niveaux hiérarchiques distincts, mais une division fonctionnelle qui renvoie à la séparation juridique et économique entre le capital-actions et le capital productif [Hilferding, 1910]. Le patrimoine financier, potentiellement considérable, que possèdent les actionnaires ne provient pas de la valeur des moyens de production qui appartiennent à l'entreprise, mais de la valeur boursière des actions. Il en résulte que les actionnaires sont des ayants droit vis-à-vis de la société par actions, non des propriétaires qui pourraient agir à leur guise avec elle. Certes, les actionnaires élisent une partie des directeurs, mais cette élection ne fait pas des seconds les subordonnés des premiers. Il peut exister des conflits entre actionnaires et directeurs, mais ils ne doivent pas dissimuler les cas, bien plus fréquents, de concorde. Cette division fonctionnelle ne donne pas à leur relation le caractère nécessairement antagoniste qui est celui d'une opposition dialectique. Dès lors, il convient de pénétrer la spécificité juridique et financière des sociétés par actions pour essayer de comprendre en quoi les dirigeants de grandes entreprises constituent un fait social sui generis.
Le choix des mots
Pour mener à bien cette ambition, il est important de prendre quelques distances avec les termes par lesquels les dirigeants de grandes entreprises sont habituellement saisis car ils charrient des représentations de l'ordre économique qui ne sont pas toujours en phase avec l'objet étudié.
La notion de patron, pour commencer, présente une série de difficultés qui empêchent de saisir correctement ce que sont les dirigeants de grandes entreprises. En premier lieu, elle ne fait pas clairement la distinction entre employeurs et dirigeants. Or, depuis le développement de la personnalité juridique des sociétés, ce sont de plus en plus les entreprises qui ont la qualité d'employeur et non les individus qui les dirigent. D'où la confusion, entretenue par les organisations patronales elles-mêmes, entre le patronat, compris comme organisation représentant les employeurs, et les patrons, entendus comme l'ensemble des chefs d'entreprises [Offerlé, 2009]. La deuxième difficulté est le risque qu'il y a à assimiler l'ensemble des chefs d'entreprises à un même groupe social, alors que c'est une population extrêmement hétérogène tant sur le plan des origines sociales que sur ceux de la fortune ou des orientations politiques [2021]. La troisième difficulté est de considérer que le travail de direction d'une petite entreprise et celui d'une grande sont de même nature et ne diffèrent que par la taille. Or, si la direction des petites entreprises est souvent une affaire très personnelle reposant essentiellement sur les épaules d'un seul dirigeant, celle des grandes entreprises est éminemment collective et s'appuie sur des instances collégiales telles que le conseil d'administration et le comité exécutif. Les fonctions du président et du directeur général, parfois cumulées dans la figure du P-DG, ne sont que la partie émergée d'une organisation plus large dont le terme « patron » rend insuffisamment compte. Enfin, le mot « patron », propre à la langue française, est d'un emploi difficile pour étudier les dirigeants des autres pays.
L'expression « élites économiques », traduite de l'anglais business elite ou corporate elite, n'est guère plus pertinente. L'idée d'élite, telle qu'elle a été reformulée par la sociologie américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est avant tout un substitut opportuniste au concept de « classe dominante » ou de « classe capitaliste », dont l'usage était devenu politiquement risqué à l'ère du maccarthysme [Dudouet, 2019]. Elle porte en elle la représentation d'un monde des dirigeants de grandes entreprises fortement replié sur lui-même, où prédominent les grandes fortunes familiales et les logiques de reproduction sociale [Mills, 1945 ; 1956] alors même que l'analyse scrupuleuse des propriétés sociales des dirigeants ne le confirme pas [Keller, 1953 ; Newcomer, 1955]. Plus fondamentalement, l'élite est une notion mal définie qui sert, avant tout, à désigner un pouvoir devenu anonyme et difficile à circonscrire.
Les notions de « classe capitaliste » et de « bourgeoisie » renvoient à l'idée d'un groupe social détenteur des moyens de production, exerçant son contrôle sur l'économie du fait de la possession du capital. Or, comme Karl Marx [1867] l'avait très bien vu, les dirigeants des grandes sociétés par actions qui se multiplient à la fin du xixe siècle ne sont plus les capitalistes productifs ni même les capitalistes financiers qui détiennent les actions et captent la plus-value. Ils forment une nouvelle classe d'individus, les « managers », que Marx ne positionne pas vraiment au sein des rapports de production, si ce n'est qu'ils se situent à mi-chemin entre les capitalistes financiers et les prolétaires [Duménil et Lévy, 2015 ; Chirat, 2020].
La notion d'« entrepreneur », difficile à cerner [Chauvin et al., 2014], n'est pas plus adaptée pour désigner et décrire les dirigeants de grandes entreprises. Pour Max Weber comme pour Joseph Schumpeter, l'entrepreneur s'oppose à la structure bureaucratique des grandes firmes [Weber, 1922 ; Schumpeter, 1942]. La figure de l'entrepreneur qui prend des risques sur ses biens propres ou qui est porteur d'innovation résiste mal au fonctionnement bureaucratisé des sociétés par actions, où le risque comme l'innovation sont planifiés et détachés de la personne des dirigeants. Pour Thorstein Veblen [1923], la figure du capitaine d'industrie visionnaire et aventureux, introduisant de nouveaux procédés industriels, est avant tout un mythe populaire dont se sont emparés de nombreux hommes d'affaires américains au début du xxe siècle pour justifier leur réussite.
Aucun des termes par lesquels les dirigeants de grandes entreprises sont généralement saisis — « capitaine d'industrie », « homme d'affaires », business elite, « grand patron », « milliardaire », etc. — n'est réellement satisfaisant. Ils s'inscrivent tous dans des représentations de l'ordre économique et social qui ne sont pas attentives à la spécificité institutionnelle des sociétés par actions. Il nous faut donc une nouvelle définition préalable des dirigeants de grandes entreprises qui s'appuie sur la nature des institutions qu'ils dirigent et non sur la position et le rôle social qu'on leur attribue a priori.
Définition préalable
L'entreprise est une notion abstraite qui n'existe pas en droit. Elle recouvre une pluralité de réalités sociales qu'il est difficile de cerner. La société par actions, en revanche, possède un statut juridique précis que l'on retrouve de manière à peu près identique dans tous les pays du monde. Elle est aussi la forme juridique la plus fréquemment adoptée par les grandes entreprises. Avec la société par actions, nous pouvons circonscrire notre objet en spécifiant la nature des institutions étudiées et les modalités pratiques de répartition des pouvoirs en leur sein. Selon cette perspective, les dirigeants de grandes entreprises sont ce que le droit des sociétés par actions désigne comme tels, à savoir les mandataires sociaux, c'est-à-dire les individus désignés par l'assemblée générale des actionnaires non pour les représenter, mais pour représenter la société et la diriger. Ces individus forment un conseil d'administration ou de surveillance aux pouvoirs plus ou moins étendus suivant les pays. Ils sont limités en Allemagne, et dans les pays inspirés par le droit germanique, où le conseil de surveillance a surtout pour tâche de fixer la stratégie du groupe et de surveiller les agissements des dirigeants exécutifs. Ils sont bien plus étendus dans la plupart des autres pays où le statut d'administrateur peut être cumulé avec une fonction exécutive. Le droit distingue, encore, le président du conseil d'administration (chairman of the board of directors) et de plus en plus souvent le directeur général (chief executive officer ou CEO). Les deux fonctions peuvent être cumulées, donnant l'appellation président-directeur général ou P-DG (chairman and CEO). De plus en plus d'études s'intéressent aussi aux membres de la direction qui ne sont pas mandataires sociaux mais qui sont en charge des principales filiales ou divisions organisationnelles de la firme (production, vente, finances, ressources humaines, droit, communication, etc.). Dans le présent ouvrage, nous entendrons par dirigeants de grandes entreprises les membres des conseils d'administration ou de surveillance ainsi que les responsables des principales branches divisionnaires de la firme réunis, le plus souvent, dans un comité exécutif ou son équivalent. Les présidents et directeurs généraux pourront être distingués pour les besoins de l'analyse et recevoir, pour simplifier le propos, l'appellation de « patrons ». Il est difficile de fournir une définition exacte de la grande entreprise tant celle-ci varie suivant les époques et plus encore suivant les pays. Nous entendons par « grandes entreprises », principalement, des sociétés par actions dont les titres sont cotés en Bourse, employant directement au moins 5 000 salariés et réalisant l'équivalent d'au moins 1 milliard de dollars américains à la valeur de 2023. Afin de spécifier l'ordre économique produit par les sociétés par actions, qui ne se réduit pas à ce qu'on entend habituellement par capitalisme, libéralisme ou même managérialisme, nous avons décidé de qualifier les phénomènes à son endroit de « corporatique », en référence à la dénomination américaine des sociétés par actions (corporation).
Domaine d'étude
Il s'ensuit qu'un certain nombre d'acteurs souvent assimilés à la direction des grandes entreprises seront écartés de l'analyse. En premier lieu, cet ouvrage ne traite pas, sauf de manière incidente, des grandes fortunes et de la richesse en général [Pinçon et Pinçon-Charlot, 2000]. En effet, comme nous le verrons dès le chapitre i, la société par actions introduit une rupture entre fortune personnelle et pouvoir économique ; il n'est pas nécessaire d'être riche pour diriger une grande société par actions et, inversement, la richesse n'implique pas d'être dirigeant. Ensuite, nous ne traiterons pas non plus des acteurs de la finance, qui forment un monde relativement à part de celui des dirigeants de grandes entreprises [Montagne et Ortiz, 2013 ; Boussard, 2017]. Enfin, les organisations patronales, qu'elles soient saisies au plan national [Fraboulet, 2007 ; Offerlé, 2009] ou international [Michel, 2013 ; Louis, 2016 ; Morival, 2017], n'entrent pas non plus dans le champ de cette étude. Par manque de place, les pratiques dirigeantes, dont on sait très peu de chose et qui sont très difficilement observables [Dudouet et Lévis, 2023], ont aussi été écartées.
Conformément à l'orientation choisie, notre exposé démarre par l'analyse des sociétés par actions et les révolutions juridique, financière et sociologique qui ont accompagné leur essor (chapitre i). Les chapitres ii, iii et iv sont consacrés à la morphologie sociale des dirigeants de grandes entreprises au travers des origines sociales et éducatives, des types de carrière et de l'internationalisation des directions. Le chapitre v aborde leur rapport à la finance, tandis que le chapitre vi expose les griefs moraux qui leur sont adressés et les registres d'argumentation qu'ils mobilisent pour y répondre.
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Qui dirige les grandes entreprises ?
Dépasser l'opposition actionnaire-manager
Le choix des mots
Définition préalable
Domaine d'étude
I. L'essor des sociétés par actions
Des sociétés à capitaux aux compagnies à charte
La révolution juridique
La société anonyme
The British Limited Company
Diffusion et libéralisation de la société par actions
La révolution financière
Le boom des marchés actions
Capital financier et capital productif
Encadré 1. Définition et prix des actions
L'émancipation de la rente
La ” révolution managériale “
La séparation du patrimoine et du pouvoir économique
Encadré 2. Réflexion de Karl Marx sur les sociétés par actions
La bureaucratisation de l'économie
La civilisation de la société par actions
Le ” managérialisme “
II. Origines sociales et éducatives
Les études conduites aux États-Unis
Fermeture ou ouverture sociale
L'affirmation des classes moyennes supérieures
Encadré 3. L'idéal-type du dirigeant américain en 1950
Les études menées à travers le monde
Royaume-Uni
Allemagne
France
Asie et Égypte
Bilan des études sur les origines sociales et éducatives
Des origines sociales hétérogènes
Essor de la classe administrative
III. Les carrières de dirigeants
Fondateurs et héritiers
Les fondateurs
Les héritiers
Encadré 4. La Tech à l'avant-garde du managérialisme
Les carrières managériales
La prédominance des carrières bureaucratiques
Corporate honorum
Encadré 5. La course aux honneurs de Kazuo Hirai
Spécificités nationales et évolutions récentes
Les spécificités nationales
De l'homme organisationnel à l'agent transorganisationnel
L'internationalisation des carrières
L'essor des formations en administration des affaires
Les rapports à l'État
La mobilité bureaucratique
L'interventionnisme étatique
IV. Internationalisation des directions
L'internationalisation des états-majors
Les réseaux transnationaux de dirigeants
Logiques de place et imbrication hiérarchique des milieux d'affaires
Le double jeu des dirigeants de grandes entreprises au regard de la ” grande stratégie “
V. Les rapports à la finance
L'exercice du pouvoir financier à travers les réseaux d'affaires
La centralité bancaire dans les réseaux d'administrateurs d'entreprises
Encadré 6. Méthode d'analyse des réseaux d'administrateurs
Directions imbriquées et diffusion des pratiques financières
Les interprétations concurrentes de la baisse des interlocks
La position d'interface dans les opérations financières
L'internalisation de la finance dans la gestion des grandes entreprises
Les organes de direction
Les instruments de gestion
La financiarisation des carrières dirigeantes au sein des grandes firmes
Un travail technique d'organisation et de contrôle des architectures financières
Le code du capital : un droit sans cesse plus pro-business ?
La complexité des holdings
Le travail discret des montages offshore
La ” financiarisation ” comme cage d'acier des dirigeants
VI. Économie morale et morale économique
Les griefs adressés aux ressorts de la domination des dirigeants
Le grief de la richesse : la fortune suspecte des fondateurs
Le grief de l'impunité pénale : la criminalité en col blanc
Le grief de l'exemption fiscale : l'inégalité de contribution
Le grief de l'écocide : la nuisance écologique
Encadré 7. Catastrophes écologiques majeures d'origine industrielle
Des engagements publics questionnés
Les engagements politiques
Les engagements dans les médias
Les engagements philanthropiques et le mécénat
La neutralisation des oppositions par le management de la vertu
L'invention de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Les obligations faites aux firmes
Les marchés de la vertu
Les politiques de diversité
La parité des sexes
La diversité ethnique
Conclusion
Repères bibliographiques.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
fxdudouet (26 septembre 2024). Les grandes entreprises dirigeraient notre monde, mais qui dirige les grandes entreprises ? . Sociologie politique de l'économie. Consulté le 17 octobre 2024 à l'adresse https://doi.org/10.58079/12cp0
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
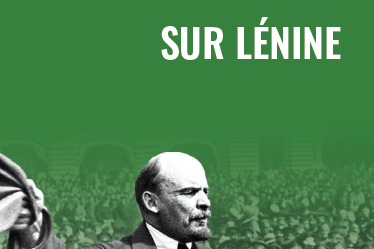
« Sur Lénine »
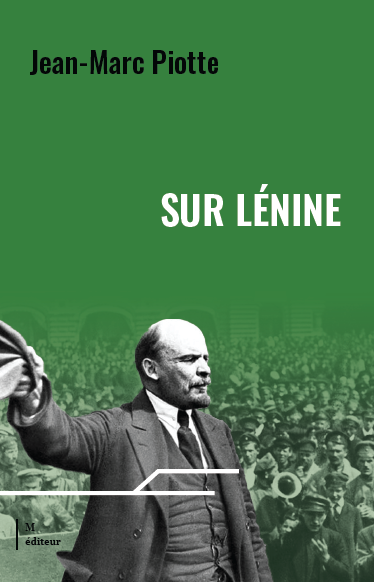
En librairie le 30 octobre
Publié aux éditions Parti pris en 1972, « Sur Lénine » se présente comme une introduction à la pensée de celui qui fut l'un des principaux artisans de la révolution d'Octobre. Cette insurrection, Lénine y contribua d'abord en tant qu'intellectuel militant, ce dont témoignent les thèmes analysés ici : la tactique, le parti, l'État et la question nationale. S'appuyant sur un vaste corpus de textes, l'auteur donne à voir une « pensée vivante », attentive aux changements de conjoncture, qui s'oppose à l'image sclérosante qu'a pu en donner le marxisme-léninisme de Staline.
« La pensée politique de Lénine est le fruit d'une réflexion sur les problèmes qu'il affronta dans sa pratique politique quotidienne. Sa réflexion surgit toujours de conjonctures concrètes : elle s'approfondit et se modifie selon les déterminations spécifiques de chacune. »
(Jean-Marc-Piotte)
L'AUTEUR
Jean-Marc Piotte (1940-2022) était syndicaliste et professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) où il a enseigné la science politique pendant 35 ans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont La pensée politique de Gramsci et Les Nouveaux Visages du nationalisme conservateur au Québec (avec Jean-Pierre Couture).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Nature et culture dans un monde qui se réchauffe

Pour la panique
Pour ceux qui ont une situation matérielle confortable, sûre et non menacée dans l'immédiat par le changement clima¬tique, comme c'est généralement le cas des universitaires occidentaux, la seule façon de rester alerte quant à l'ex¬trême urgence du problème est de s'informer régulièrement, de façon hebdomadaire ou quotidienne, des nouvelles par¬venant des lignes de front de cc monde en réchauffement. En juillet 2016- le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre jusqu'alors, les températures autour du golfe Persique ont côtoyé les limites de ce que le corps humain peut supporter. A Bassorah, elles ont atteint 54 ° [1], Zainab Guman, une étudiante de 26 ans, a déclaré à un journaliste du Washington Post qu'elle évitait de sortir de chez elle en journée pendant l'été, car c'était comme « entrer dans un brasier » : « C'est comme si tout votre corps - votre peau, vos yeux, votre nez - se mettait à brûler [2] En novembre 2016, la Bolivie a décrété l'état d'urgence face aux pénuries d'eau dans les villes de La Paz et d'El Alto. Les glaciers ali¬mentant ces deux villes en périodes sèches ont fondu par¬tiellement ou entièrement, laissant les réservoirs vides et forçant l'État à imposer le rationnement en eau et à forer désespérément à la recherche de réserves. Munis de seaux, les habitants ont dû faire la queue des heures durant [3] En juillet et en septembre de la même année, deux glaciers se sont soudainement décrochés au Tibet, laissant les scienti¬fiques interloqués et provoquant des avalanches de glace et de rochers sur une dizaine de kilomètres carrés [4]. Fin 2016, le Guardian a publié une série de reportages sur des villages ensevelis sous le sable au Soudan oriental. Les oscillations entre sécheresse et pluies torrentielles abîment les sols, le niveau de l'eau diminue dans les rivières, des champs autre¬fois fertiles sont transformés en sols arides et craquelés, des forêts en vastes déserts. « Le plus inquiétant, c'est quand la maison est ensevelie [sous le sable] la nuit et qu'on ne peut rien faire d'autre qu'attendre dans le noir jusqu'au matin pour se frayer un chemin vers l'extérieur », explique Hamud El-i\our, 70 ans. [5] Au Bangladesh, c'est la montée du niveau de la mer qui menace des villages : « L'océan nous torture", affirme Pushpo Rani Das, 28 ans, mère de trois enfants qui a dû changer quatre fois de lieu d'habitation pour échapper à la violence des vagues. « On ne peut pas l'arrêter. À chaque marée haute, l'eau s'infiltre dans ma maison, surtout pen¬dant la saison des pluies » [6]
Les productions au sujet de cette guerre restent cruelle¬ment insuffisantes. Il n'existe toujours pas de Planet of slums \Le pire des mondes possibles, de Mike Davis] ou de High 1ïde \Marée montante, de Mark Lynas cartographiant l'état d'urgence climatique permanent qui est en train de s'ins¬taller dans les pays du Sud. En revanche, les résultats des scientifiques s'accumulent. Les auteurs d'une étude publiée dans Nature Climate Change en septembre 2016 ont estimé, à l'aide de simulations et de données historiques, la diminu¬tion des récoltes de blé que provoquera le réchauffement. L'étude prévoit un déclin moyen de 5,7 % par degré supplé¬mentaire, avec d'importantes variations cependant. Les pays chauds - proches des tropiques et hébergeant la majorité de l'humanité pauvre - subiront de plus lourdes pertes : de 11 à 20% en Haute-Egypte, contre environ 4 % en France. [7]
Des nouvelles fraîches nous sont parvenues de scientifiques basés en Antarctique. Les plateformes de glace soutiennent les inlandsis et les empêchent de glisser dans la mer, mais quand leur surface fond suffisamment pour former des bas¬sins, l'eau peut s'infiltrer profondément dans des cavités à travers les plateformes de glace jusqu'à ce qu'elles rompent ; tandis que ces événements catastrophiques se sont produits plusieurs fois dans la péninsule Antarctique, des processus similaires ont désormais cours dans la partie orientale du continent d'après les observations des scientifiques sur le ter-rain [8]. La plateforme de glace du glacier de Totten retient un volume de glace équivalent à une augmentation de 3,5 mètres du niveau des océans. L'eau de fonte et un océan réchauffé la rongent de l'intérieur [9]
Et ainsi de suite. Certains à gauche maintiennent que les progressistes ne devraient pas attiser la panique - il faudrait être moins « catastrophiste » et « apocalyptique » - mais si l'on se fie au réalisme climatique et si l'on se tient à jour des observations scientifiques, c'est l'inverse qui est de rigueur. Donna Orange rappelle cet exemple classique de l'embarras psychanalytique de Sigmund Freud lui-même qui refusa de voir venir l'annexion nazie et ne quitta Vienne qu'au der¬nier moment, abandonnant à leur destin tragique plusieurs membres de sa famille. « L'analogie avec l'urgence clima¬tique actuelle est évidente : quand on ne panique pas de façon appropriée, on ne peut pas prendre de mesures radicales en conséquence [10] » Osons ressentir la panique. Puis choi¬sissons entre les deux options principales : s'engager dans l'opposition la plus militante et déterminée à ce système, ou rester assis à regarder le déluge.
Ce n'est pas le moment d'abandonner
Dès lors, que peut-on en corn accomplir dans le combat visant à maximiser nos chances de survie ? Si les digues des 1,5 °C e1 2C venaient à céder, nous serions encore loin des 8 °(' de réchauffement moyen promis si la totalité des réserves prouvées de combustibles fossiles était brûlée. C'est l'écart entre un climat très dangereux et un climat invivable. Il rend scientifiquement indéfendable la position selon laquelle il n'importe plus aujourd'hui que les réserves fossiles soient utilisées ou non, ou l'opinion selon laquelle des émissions nulles demain ne feraient aucune différence. Tels sont les deux objectifs que la résistance devra poursuivre dans les décennies à venir : ni extraction ni émissions [11]. Mais nous ne les atteindrons peut-être pas avant de nombreuses décen¬nies, et alors il faudra certainement ajouter à la décarbo¬nation totale de l'économie-monde le déploiement massif' de technologies à émissions négatives afin d'éviter le pire. Nous avons manifestement d'ores et déjà passé le cap à par¬tir duquel celles-ci deviennent nécessaires pour stabiliser ln climat - c'est-à-dire nous ramener autour de 350 ppm -, ce qui exige de les envisager sérieusement, quand bien même elles ne peuvent que s'ajouter au démantèlement total do l'économie fossile. Le présent ouvrage ne saurait étudier la plausibilité d'un déploiement massif de ces technologies (les données empiriques indiqueront peut-être qu'elle est faible), mais elles figurent parmi les paramètres du combat à venir :
Il faudra user de tous les moyens potentiellement disponibles pour faire de cette planète vulnérable un espace vivable. Ce ne sera pas un dîner de gala. Si certains des pires scénarios se réalisaient, on devra peut-être même en passer par une lutte pour l'abandon programmé de la gestion du rayonne¬ment solaire. Il faudrait sans doute envisager la stabilisation du climat - à l'issue de laquelle les forces autonomes de la nature pourront de nouveau régner sans mettre en péril la civilisation humaine - comme un projet révolutionnaire pour les quelques siècles à venir. Dans ce laps de temps, il faudra lutter sur plusieurs fronts afin de garantir une réelle adaptations, car l'état de réchauffement approfondira et multipliera les fractures sociales, en tout cas à moyen terme [12] Ce n'est pas le moment d'abandonner la radicalité politique. (pages 195-198)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
[1] Michael Slezak, « July 216 was world's hottest month since records began, says, Nasa », Guardian, 17 août 2017 ; Jason Samenow, « Two Middle East locations hit 129 degrees, hottest ever in Eastern Hemisphere, maybe the world », Washington Post, 22 juillet 2017 Note – 508
[2] Hugh Taylor, « A epic Middle East heat wave could be global warming's hellish curtain-raiser », Washington Post, 10 août 2016. Voir aussi Jeremy S. Pal et Elfaith A.B.Eltahir, « Future Temperature in Southwest Asia Projected to Exceed a Threshold for Human Adaptability », Nature Climate Change, 6, 2016, p.197-200 ;J. Lelieveld, Y. Proestos, P. Hadjinnicolaou et al., « Strongly Increasing Heat Extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st Centruty » Climate Change, 137, 2016, p. 245-260. Note-509
[3] John Rocha, « Shrinking glaciers cause state-of emergency drought in Bolivia » Guardian, 28 novembre 2016. Voir aussi Nick Buxton, Marisa Escobar, David Purkey et Nilo Lima, « Water Scarcity, climate change and Bolivia : Planning for Climate uncertainties », Stockolm Environmental Insitute, Éléments de débat, 2013, sei-international.org, note-510
[4] Kate Ravillous, « Climate change likely cause of freak avalanches », Guardian, 4 décembre 2016, note-511
[5] Hannah McNeish, « We have almost been buried » : the Sudanese villages being seallowed by sand ». Guardian, 19 décembre 2016 note -512
[6] Karen McVeigh, « On the climate change frontline : the disappearing fishing village of Bangladesh, note -513. »
[7] Bing Liu, Senthold Asseng, Christoph Muller et al., « Similar Estimates of Temperature Impacts on Global Wheat Yield by Three Independant Methods », Nature Climate Change, 6, 2016, p. 1130-1136, note 514
[8] J.T.M. Lenaerts, S. Lhermitte, R.Drews et al., « Meltwater Produced by Wind-Albedo Interaction Stored in an East Antartic Ice Shelf », Nature Climate Change, 7, 2017, p. 58-62, Note -515
[9] Stephen Rich Rintour, Alessandro Silvano, Beatriz Pena-Molino et al., « Ocean Heat Drives Rapid Basal Melt of the Totten Ice Shelf » Science Advances, 16, décembre 2016. Note – 516
[10] Orange, Climate, op.cit., p.16. note-5l7
[11] Le plus convaincant des manuels indiquant comment mettre fin à l'usage des combustibles fossiles dans l'économie-monde en un laps de temps le plus court possible est Laurence I. Delina, Strategies for Rapid climate mitigation : Wartime Mobilisation as a Moder for Action ?, Londres, Routledge, 2016, -note 518
[12] Pour de plus amples réflexions à ce sujet, voir Andreas Malm, « Revolution in a Warming World : Lessons from the Russian to the Syrian Revolution »,in Leo Panitch et Gred Albo (dir.) Socialist Register 2017. Rethinking Revolution. Note - 519












