Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Offensive raciste : Retailleau veut déporter des sans-papiers en Irak, au Kazakhstan ou en Egypte

L'Opinion révèle que le ministre de l'Intérieur négocie actuellement des accords avec des pays tels que l'Irak, le Kazakhstan ou l'Égypte pour pouvoir y déporter des étrangers. Un pas de plus franchi dans l'horreur par les politiques racistes et xénophobes du gouvernement.
16 octobre 2024 | tiré du site de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/Offensive-raciste-Retailleau-veut-deporter-des-sans-papiers-en-Irak-au-Kazakhstan-ou-en-Egypte
Dans le cadre de son premier discours aux préfets du 8 octobre dernier, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur proposait d'intensifier la chasse aux étrangers en ayant recours à la « diplomatie migratoire ». Le journal l'Opinion révèle ce mercredi que Retailleau ne propose ni plus ni moins que la déportation d'étrangers désignés comme « illégaux et indésirables » dans des pays tels que le Rwanda, le Burundi, le Kazakhstan, l'Irak ou l'Égypte.
En plus de vouloir faire « baisser les régularisations », Bruno Retailleau, est en effet sur le point de nouer des accords avec des pays tiers pour que ces derniers acceptent de recevoir des étrangers sur leur sol, notamment ceux qui y ont transité ou séjourné. Par exemple, un étranger qui serait considéré comme illégal en France pourrait alors être déporté dans un des pays signataires quand bien même il n'aurait aucune attache avec ce pays. Cette proposition institutionnalise la déportation d'hommes et de femmes migrant.es à des milliers de kilomètres.
Ces accords inhumains, marchandés cyniquement avec des pays qui sont eux-mêmes déstabilisés par des conflits (comme en Irak) et dont l'environnement économique et social est très dégradé, sont négociés aux dépens d'hommes et de femmes qui fuient les ravages des guerres, des crises économiques et de l'instabilité causées par les puissances impérialistes, au premier rang desquelles la France. Ces accords rendront les migrants encore plus vulnérables, comme cela a été le cas après les traités signés entre l'Europe et la Libye. Amnesty International dénonçait des « conditions d'accueil infernales » dans les centre de rétention où les migrants sont exposés à la torture, aux violences sexuelles et à des sévices cruels et inhumains.
Lorsqu'il s'agit de mener des politiques inhumaines et racistes, Bruno Retailleau sait être inventif tout en s'inspirant des politiques xénophobes et racistes menées à échelle européenne, comme celles de Giorgia Meloni en Italie. La présidente italienne a en effet procédé, cette semaine, aux premières déportations de migrants vers l'Albanie, pour limiter les arrivées de migrants secourus en Méditerranée, grâce à un accord signé en 2023. Sous les applaudissements de Commission européenne, la politique d'externalisation des frontières de Meloni est en passe d'être appliquée dans toute l'Europe, au prix des vies de dizaines de milliers de migrants chaque année.
Cette nouvelle annonce intervient après que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement ont multiplié, depuis plusieurs semaines, les propositions sur l'immigration dans une course au racisme et la xénophobie. Ce lundi, la porte-parole du gouvernement annonçait la préparation d'une deuxième loi immigration qui porterait la durée maximale de rétention des étrangers « jugés dangereux » de 90 à 210 jours.
Alors que le gouvernement poursuit ses offensives xénophobes en appliquant le programme du Rassemblement National, le parlement s'apprête à voter un budget d'une violence historique, qui devrait encore aggraver les conditions de vie des classes populaires et mettre en danger les vies des travailleurs migrants du fait du gel du budget de l'Aide Médicale d'État. Parce que la violence raciale est le laboratoire de toutes les offensives sociales, tout notre camp social doit s'unir pour lutter contre l'agenda raciste du gouvernement et ses mesures antisociales.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Comment Budapest est devenue un haut lieu de l’anti-progressisme

Viktor Orbán est devenu le moteur d'une contre-révolution culturelle à l'échelle européenne. De son combat « anti-woke » [1], le Premier ministre hongrois a renforcé ses liens avec des partis comme Vox et des leaders comme Javier Milei et Donald Trump. Dans cet entretien, le politologue András Bíró-Nagy analyse les principales caractéristiques du régime hongrois et analyse son rôle dans le contexte européen et mondial.
13 octobre 2024 | tiré du site Entre les ligne entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/13/comment-budapest-est-devenue-un-haut-lieu-de-lanti-progressisme/
En juillet dernier, la Hongrie a pris la présidence tournante de l'Union européenne et tous les regards étaient à nouveau tournés vers Budapest. Le gouvernement de Viktor Orbán et son parti politique, le Fidesz, ont non seulement transformé la Hongrie en un bastion conservateur national, mais ils ont également mené une contre-révolution culturelle à l'échelle européenne. Aujourd'hui, le régime d'Orbán est caractérisé comme l'un des concurrents les plus déterminés dans la bataille « anti-woke » de l'extrême droite, ce qui l'a rapproché de partis tels que Vox, le président argentin Javier Milei et le trumpisme aux États-Unis.
Le politologue András Bíró-Nagy a suivi de près l'évolution d'Orbán et sa dérive « illibérale » [2]. Directeur du think tank Policy Solutions, chercheur principal au Centre hongrois des sciences sociales et membre du conseil d'administration de l'Association hongroise des sciences politiques, Bíró-Nagy analyse dans cet entretien les principales caractéristiques du régime d'Orbán, décompose ses liens avec les forces de l'extrême droite mondiale et détaille ses relations avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, tout en expliquant ce qui se passe aujourd'hui avec l'opposition hongroise et les divergences avec les pays voisins.
Le 1er juillet, la Hongrie a pris la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne et a lancé le slogan « Make Europe Great Again ». Que signifie exactement un tel slogan ?
Le slogan Make Europe Great Again, qui est une référence explicite au Make America Great Again de Donald Trump, est une provocation d'Orbán visant avant tout les dirigeant·es européen·nes qui rejettent le populisme de droite, conservateur et souverainiste. D'une manière ou d'une autre, ce slogan montre la perspective d'Orbán sur l'Europe. Il est clair que ce que le régime hongrois actuel recherche et appelle de ses vœux, c'est la construction d'une Europe d'États-nations. Il ne soutient certainement pas la poursuite de l'intégration européenne et souhaite que les piliers de la construction continentale reposent sur les États-nations. Contrairement à d'autres dirigeant·es d'extrême droite, M. Orbán ne cherche pas à quitter l'Europe ou à développer une sorte de « Hunexit », similaire au Brexit britannique. Il souhaite plutôt que les institutions supranationales, telles que la Commission européenne ou le Parlement européen lui-même, aient de moins en moins de pouvoir et évoluent vers la droite. En outre, quitter l'Europe n'aurait pas le soutien de la population. Aujourd'hui, 70% des Hongrois·es sont favorables au maintien dans l'Union européenne. Orbán cherche donc à transformer l'UE de l'intérieur.
Ces dernières années, Orbán est devenu un promoteur actif des réseaux nationaux-conservateurs, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan financier. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Bien qu'Orbán et son parti, le Fidesz, soient généralement très sensibles à l'ingérence étrangère dans la politique hongroise et prônent constamment l'idéal de la « souveraineté nationale », ils n'ont pas hésité à intervenir dans la politique d'autres pays. Un bon exemple est le financement qu'il a accordé à la campagne de la dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen, ou celui d'une banque proche du Fidesz au parti espagnol Vox ; il a été révélé que le parti espagnol a reçu environ 9 000 000 d'euros. Orbán n'évolue pas seulement dans le domaine de la politique nationale, mais montre sa vocation à participer à une construction politique plus large. Il peut le faire parce qu'il est au pouvoir depuis 14 ans et qu'il dispose de beaucoup plus de ressources que la plupart des extrémistes de droite internationaux qui n'ont pas encore réussi à prendre le contrôle de l'État. C'est pourquoi Orbán est en mesure de réaliser des projets qui, pour d'autres dirigeant·es d'extrême droite, ne sont qu'un rêve. Orbán a montré que le fait d'être au pouvoir lui donne des outils supplémentaires pour aider ses ami·es. Cela a été le cas, par exemple, avec Jair Bolsonaro, qui s'est réfugié dans l'ambassade hongroise de peur d'être arrêté pour sa tentative présumée de coup d'État après la défaite électorale. En bref, le régime Orbán peut alternativement fournir de l'argent aux ami·es de l'extrême droite et un refuge lorsqu'elles ou ils sont en difficulté.
Les institutions para-étatiques, telles que l'Institut du Danube, semblent jouer un rôle clé dans ce cadre. Comment fonctionne cet écosystème para-étatique ?
Il existe en effet plusieurs organisations, telles que l'Institut du Danube, qui ont joué et jouent un rôle central dans la mise en réseau et l'établissement de liens entre le régime d'Orbán et d'autres forces d'extrême droite. Certaines de ces institutions ne sont pas seulement actives en Hongrie, mais opèrent au niveau international. L'Institut du Danube est particulièrement actif dans l'établissement de contacts avec les républicains américains, tout comme le Centre pour les droits fondamentaux. Ce think tank [3] est l'organisateur de la version hongroise de la Conservative Political Action Conference (CPAC), qui imite celle des États-Unis, avec laquelle il entretient des liens directs. Un autre acteur important, dont l'influence internationale s'est accrue, est le Mathias Corvinus Collegium, un établissement d'enseignement privé qui a reçu d'importantes sommes d'argent du gouvernement Orbán et a ouvert un bureau à Bruxelles, d'où il a tenté d'influencer la conversation publique européenne. L'exemple le plus frappant est le financement par le Mathias Corvinus Collegium des manifestations d'agriculteurs et d'agricultrices à travers l'Europe au début de l'année.
Depuis quelque temps, des acteurs politiques émergent en Hongrie, encore plus à droite que le Fidesz. De l'extérieur, les divergences ne sont pas très claires…
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est tout à fait vrai qu'il existe des forces politiques qui se situent à la droite d'Orbán et de son parti, le Fidesz. Un cas bien connu est celui du Mouvement pour la patrie, une organisation fondée par des dissidents du Mouvement pour une meilleure Hongrie (Jobbik), qui est tellement extrémiste que même certains amis d'Orbán ne veulent pas s'en approcher. Au Parlement européen, le Fidesz fait partie d'un groupe appelé Patriotes pour l'Europe, qui comprend également le Rassemblement national de Marine Le en et la Ligue de Matteo Salvini. Cependant, il existe désormais un groupe encore plus à droite, l'Europe des nations souveraines, un espace dirigé principalement par Alternative pour l'Allemagne [AfD]. Ce groupe entretient des relations avec la Russie et la Chine, ce qui n'est même plus supportable pour Marine Le Pen. Le Mouvement pour la patrie se caractérise par la diffusion de théories conspirationnistes, dont beaucoup sont liées à la pandémie de covid-19 et aux vaccins, au sujet desquels il soulève de fortes réticences. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, ses dirigeant·es ont déclaré que l'Ukraine devait céder des territoires non seulement à la Russie, mais aussi à la Hongrie elle-même, qui avait été le possesseur historique de certaines parties du pays aujourd'hui envahi et en guerre. Ces positions radicales et extrémistes sont, comme on peut le voir, encore plus à droite que les positions du Fidesz et d'Orbán lui-même.
En Pologne, le parti d'extrême droite Droit et Justice (PiS) a été battu lors des dernières élections après une série de mobilisations de jeunes et de militantes féministes dans les grandes villes du pays. Qu'est-ce qui différencie la Hongrie de la Pologne à cet égard ?
Pendant les huit années où le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński était au pouvoir, la Hongrie et la Pologne étaient considérées comme les deux exemples les plus clairs de recul démocratique dans la région. Mais, pour être honnête, la situation a toujours été bien pire en Hongrie qu'en Pologne. Droit et Justice n'a jamais disposé d'une majorité constitutionnelle suffisante pour transformer l'ensemble du cadre démocratique du pays. En fait, en ne parvenant pas à obtenir une telle majorité constitutionnelle, il n'a pas non plus été en mesure de modifier un certain nombre de lois importantes. La situation est différente dans le cas d'Orbán, qui, après 14 ans au pouvoir, dispose de ces majorités spéciales qui lui permettent de modifier le système électoral pour améliorer ses performances électorales, ou de changer des aspects substantiels du cadre réglementaire du pays s'il le souhaite. En fait, c'est la super-majorité d'Orbán qui a permis à son parti, le Fidesz, de s'emparer de toutes les institutions de contrôle. Je pense en particulier au bureau du procureur général, à la Cour des comptes qui supervise les dépenses publiques et à la Cour constitutionnelle.
C'est à cause de ce genre de choses que j'ai toujours eu le sentiment que la transformation de l'environnement démocratique, et aussi de l'environnement médiatique, a été beaucoup plus profonde en Hongrie qu'en Pologne. Orbán a eu plus de temps pour cela, mais aussi des pouvoirs plus larges et plus profonds que Kaczyński. Dans le même temps, il a toujours été très clair que les médias étaient plus forts et plus pluralistes en Pologne qu'en Hongrie. En outre, la société civile polonaise s'est révélée plus solide que la société civile hongroise au fil des ans. Mais il y a un autre aspect remarquable dans ce tableau, et c'est celui de l'opposition et des dirigeant·es politiques. En Pologne, contrairement à la Hongrie, il y a toujours eu une opposition forte avec un leadership clair. Donald Tusk est revenu de la politique européenne à la politique polonaise proprement dite en tant que chef de l'opposition et a réussi à se faire élire premier ministre. Il faut ajouter à cela le fait que le système électoral polonais a permis à l'opposition de se présenter sous la forme de différentes listes – de gauche et du centre – puis de s'unir, alors qu'en Hongrie, le système électoral favorise les grands blocs, de sorte que pour défier un gouvernement et un parti fort, il faut une alliance préalable, ce qui n'a jamais satisfait qui que ce soit. Pour les électeurs et les électrices de gauche, il était problématique de voter pour une liste dont le candidat au poste de premier ministre était une personnalité de droite libérale-conservatrice, et pour les électeurs et électrices des zones rurales, où les positions conservatrices prédominent, il était tout aussi problématique de voter pour une liste comprenant des personnalités issues de partis de gauche classiques, même si le premier ministre en lice ne l'était pas. Cela a conduit à une défaite majeure pour ce type d'alliance.
La situation de l'opposition est-elle toujours la même aujourd'hui, ou un nouveau leadership a-t-il émergé ?
La situation actuelle est quelque peu différente en raison de l'émergence d'un nouvel acteur politique. Je veux parler de Peter Magyar, un ancien membre du Fidesz qui est passé dans l'opposition et en est devenu l'une des figures de proue. Peter Magyar – dont le nom de famille signifie littéralement « hongrois » – est l'ex-mari de la ministre de la justice de Viktor Orbán et est quelqu'un qui connaît parfaitement le régime, puisqu'il en est issu. M. Magyar a récemment créé le Parti du respect et de la liberté et, en peu de temps, il a commencé à détruire l'opposition fragmentée existante. Magyar, qui a dénoncé la corruption du régime et certains de ses aspects autoritaires, est un phénomène nouveau. Lors des prochaines élections, qui se tiendront en avril 2026, M. Orbán sera probablement confronté à M. Magyar, qui sera son seul adversaire politique. Il est très probable que les différentes organisations qui s'opposent à Orbán se regroupent autour de la candidature de Magyar.
Avant l'arrivée au pouvoir d'Orbán, le Parti socialiste (héritier du Parti socialiste ouvrier de l'époque communiste) était au pouvoir. Aujourd'hui, ce parti, qui a joué un rôle clé dans le processus de transition entamé après la chute du mur de Berlin, semble avoir subi un déclin important de sa force électorale. Aujourd'hui, ce parti, qui a joué un rôle clé dans le processus de transition entamé après la chute du mur de Berlin, semble avoir subi un déclin significatif de sa force électorale. Qu'est-il arrivé aux socialistes ?
Le dernier parti politique à avoir battu Orbán est le Parti socialiste hongrois en 2006. C'est la dernière fois qu'Orbán a subi une défaite, ce qui s'était déjà produit en 2002, également contre les socialistes. Cependant, les problèmes ont commencé précisément pendant la période de gouvernement entre 2006 et 2010, lorsque le parti socialiste a commencé à faire passer une série de mesures néolibérales sur la santé et l'éducation. Orbán s'est appuyé sur ce tournant néolibéral et a condamné les réformes, soulignant la nécessité d'une plus grande intervention de l'État et de soins de santé publics gratuits. Ferenc Gyurcsány, le premier ministre de l'époque – qui n'est plus membre du parti socialiste mais de la coalition démocratique – est toujours actif dans la politique du pays et est considéré comme un acteur clairement toxique. La réputation et l'héritage de l'ancien premier ministre sont si mauvais, non seulement en termes de gestion mais aussi de corruption, que même 14 ans de règne d'Orbán n'ont pas réussi à les faire oublier. Bien entendu, sous le gouvernement d'Orbán, la corruption a pris des proportions bien plus importantes. C'est le gouvernement le plus corrompu de toute l'Europe, selon les indices de Transparency International et de la Commission européenne. Et pourtant, on se souvient encore des performances du gouvernement libéral-socialiste, ce qui a empêché les socialistes de se redresser.
Et aucun nouveau parti politique ne s'est formé à la gauche du parti socialiste ?
Il y a eu plusieurs tentatives de création de nouveaux partis, mais pas à la gauche du parti socialiste. Il y a eu de nouveaux partis libéraux et de nouveaux partis verts, mais la création de nouveaux partis a de plus en plus contribué à la fragmentation de l'opposition. Lorsque Orbán est arrivé au pouvoir, la gauche ne comptait plus que deux partis. L'un était le parti socialiste et l'autre le parti vert, qui se présentait sous le slogan « la politique peut être différente », un slogan qui faisait référence au mouvement altermondialiste. La fragmentation croissante, l'incapacité du parti socialiste à se redresser et la faible part de voix du parti vert ont empêché l'émergence d'une alternative réellement forte à Orbán. Chacun des nouveaux partis s'est battu non seulement contre le Fidesz, mais aussi contre le reste de l'opposition, ce qui a clairement joué en faveur d'Orbán. Aujourd'hui, tout le monde cherche désespérément quelque chose de nouveau et d'unificateur. Le seul espoir est le changement de régime. Nous en sommes donc arrivé·es à une situation où de nombreux électeurs et de nombreuses électrices des forces d'opposition seraient prêt·es à parier sur Peter Magyar, un bureaucrate de haut rang du régime Fidesz jusqu'à très récemment, pour tenter de modifier le statu quo actuel.
L'une des caractéristiques les plus claires du régime hongrois au niveau mondial est son soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahu en Israël. Cependant, Orbán a depuis longtemps adopté des positions qui ont, à tout le moins, été qualifiées de philo-antisémites, par exemple lorsqu'il attaque George Soros. Comment cette situation doit-elle être comprise depuis la Hongrie ?
Étant donné que l'un des principaux objectifs du régime Fidesz dans les affaires internationales est de présenter son gouvernement comme le meilleur allié d'Israël, Orbán est devenu très prudent lorsqu'il s'agit d'aborder des questions traditionnellement associées à l'antisémitisme. L'actuel Premier ministre hongrois considère Netanyahou comme un dirigeant avec lequel il partage non seulement des valeurs, mais aussi une certaine perspective sur ce que devrait être une démocratie. C'est dans ce cadre qu'il se présente comme le défenseur et le garant des droits de la minorité juive hongroise. Après les attentats du 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza, Orbán a interdit toute manifestation de soutien à la Palestine et a souligné son alignement sur Israël. Il n'a cependant pas cessé de développer une politique qui vise subrepticement à toucher une partie de la société hongroise, en ciblant clairement George Soros et l'Open Society Foundation. Soros est un survivant hongrois de l'Holocauste qui, avec sa famille, a émigré d'abord au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, où il a mené une brillante carrière dans les affaires et la finance. Lorsque, dans les années 1980, le régime communiste a commencé à s'effondrer, Soros s'est impliqué dans la situation politique hongroise et a soutenu des groupes cherchant à contribuer à la transition démocratique. Parmi les différentes organisations visant la fin du régime communiste et l'ouverture du pays à la démocratie se trouvait le Fidesz, le parti d'Orbán. Et c'est dans ce contexte que l'Open Society Foundation de Soros a soutenu financièrement le Fidesz. Mais la situation ne s'est pas arrêtée là. Soros a lui-même financé une bourse d'études à l'Université d'Oxford pour Orbán. Alors que le Fidesz et Orbán lui-même se tournaient de plus en plus vers l'extrême droite, et déjà après l'arrivée au pouvoir d'Orbán, une campagne contre Soros a commencé, le dépeignant comme un banquier et homme d'affaires new-yorkais cupide qui cherchait à gagner de l'influence dans différents pays grâce à son argent, en s'ingérant dans les affaires intérieures de nations souveraines. C'est l'image que le Fidesz a construite de Soros pendant de nombreuses années, et celle qui prévaut encore aujourd'hui. En fait, très récemment, Orbán et son parti ont lancé une campagne présentant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, comme une « marionnette » du fils de Soros, qui préside aujourd'hui l'Open Society Foundation. Cette idée de la famille Soros comme un groupe de marionnettistes essayant de dominer le monde fait clairement référence aux théories de conspiration juives globales, mais coexiste, en même temps, avec un soutien explicite à Israël. En effet, aucun dirigeant au monde n'est plus pro-israélien et pro-Netanyahu qu'Orbán.
A la fin de l'année dernière, Orbán a assisté à la cérémonie d'investiture de l'actuel président argentin Javier Milei, mais Orbán semble avoir peu de choses en commun avec la vision libertaire du président sud-américain. Comment comprendre ces liens, et dans quelle mesure, comme dans d'autres cas, sont-ils favorisés par les positions « anti-woke » et les diverses batailles culturelles qui unissent la droite radicale ?
L'anti-wokisme est en effet ce qui unit Orbán à Milei, à Vox, à Trump et à d'autres leaders de l'extrême droite mondiale. C'est un point particulièrement important et intéressant, car lorsque l'on observe ces différents leaders et groupes politiques d'extrême droite, on se rend vite compte qu'ils ne partagent pas de position commune, par exemple, sur les questions économiques. Orbán est résolument interventionniste dans le domaine économique, comme il l'a montré pendant la crise énergétique et la période de forte inflation, lorsqu'il a plafonné les prix de différents produits. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est Kamala Harris qui a suggéré qu'elle pourrait plafonner les prix de certains produits, et elle a été critiquée par Trump, qui a qualifié une telle initiative de « mesure communiste ». Lorsque cela s'est produit, nous avons toutes et tous bien ri en Hongrie, car c'est leur ami Orbán qui a adopté cette politique il y a tout juste un an ou deux. Il est donc clair que ce qui les unit n'est pas le terrain économique – parfois, ils ne savent même pas grand-chose de ce qu'ils font en matière de politique économique intérieure – mais la bataille culturelle. Dans cette bataille, l'anti-wokisme joue un rôle clé, tout comme les positions anti-LGTBI+ et anti-féministes. C'est dans ce domaine que tous ces acteurs s'accordent sur un programme fortement conservateur. En Hongrie, il s'agit en fait de la politique la plus réussie du gouvernement Orbán. L'anti-wokisme et la défense de la « famille traditionnelle » sont remarquablement bien acceptés, dépassant même la politique anti-immigration. La société hongroise est plutôt conservatrice et cela inclut non seulement celles et ceux qui votent pour le Fidesz, mais aussi celles et ceux qui votent pour l'opposition. C'est ce qui unit Trump, Vox et Milei, un personnage avec lequel Orbán ne partagerait jamais l'idée que l'État doit être détruit, mais avec lequel il peut être d'accord dans le domaine des batailles culturelles.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a généré beaucoup de tensions dans le groupe de Visegrad, qui comprend la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Comment ces divergences ont-elles été traitées ?
Au niveau européen, la question de la guerre d'Ukraine est l'une des lignes de fracture entre les différents acteurs de l'extrême droite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de groupe parlementaire européen unifié de ces forces de droite. D'un côté, il y a le groupe des Conservateurs et Réformistes européens, qui comprend les Frères d'Italie de l'Italienne Giorgia Meloni, les Polonais·es de Droit et Justice de Jarosław Kaczyński, et les Tchèques du Parti démocratique civique. Ce groupe est nettement plus pro-atlantiste et pro-ukrainien que les Patriotes pour l'Europe, le groupe parlementaire qui comprend notamment le Fidesz de Viktor Orbán, le Rassemblement national de Marine Le Pen, le Parti de la liberté d'Autriche et la Ligue de l'Italien Matteo Salvini. Ce groupe est plus clairement pro-russe. Cela montre, par exemple, que les Polonais de Droit et Justice et les Hongrois de Fidesz sont, dans ce cas, divisés. Alors que la Pologne craint une intervention russe en raison de sa propre histoire, Orbán ne voit pas Vladimir Poutine d'un si mauvais œil. Cependant, Orbán ne se prononce pas directement en faveur du dirigeant russe, mais utilise un discours « pro-paix ». Il évite de se considérer comme pro-russe, même si c'est la conclusion de sa position « pro-paix ». Que signifie concrètement une position « pro-paix » dans ce contexte ? Elle signifie évidemment que la Russie peut conserver 20% du territoire ukrainien. C'est ce que le programme « pacifiste » d'Orbán implique en réalité. La question de l'Ukraine divise donc l'extrême droite européenne, y compris les membres du groupe de Visegrad. Ce qui les unit vraiment, ce qui les rassemble et les fait faire partie d'un bloc commun, c'est l'euroscepticisme, la défense de la souveraineté des pays individuels et, bien sûr, le combat culturel anti-progressiste ou anti-éveillé.
Mariano Schuster et Pablo Stefanoni
https://nuso.org/articulo/como-budapest-se-transformo-en-la-meca-del-antiprogresismo/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[1] woke = état d'éveil face à l'injustice, conscience des rapports sociaux et de leurs effets – NdT
[2] libéralisme au sens politique – NdT
[3] groupe de réflexion ou laboratoire d'idées – NdT
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Silicon Valley se tourne vers Trump, sur fond d’intox climatique

De puissantes figures de la Silicon Valley comme Elon Musk n'hésitent plus à montrer leur soutien au candidat républicain. Ce virage à droite coïncide avec une hausse de la désinformation sur l'écologie.
Tiré de Reporterre
16 octobre 2024
Par Alexis Gacon
État de Washington (États-Unis), correspondance
Tête de gondole de la Tech, l'excentrique propriétaire de Tesla et de X est un symbole d'un virage à droite. Casquette noire « Make America Great Again » bien vissée sur le crâne, Elon Musk, bondissant, a paradé avec Donald Trump lors d'un meeting le 5 octobre à Butler, en Pennsylvanie, là où l'ex-président a échappé à une tentative d'assassinat cet été.
Les deux hommes n'en finissent plus de se faire la courte échelle. Sur scène, Trump a vanté l'homme qui, grâce à son réseau social, X, a « sauvé la liberté d'expression ». Elon Musk lui a renvoyé la balle avec enthousiasme, arguant que le républicain devait gagner l'élection présidentielle de novembrepour « préserver la Constitution ». Si ce sont les démocrates qui l'emportent, l'oracle de Tesla a prédit que « ce seront les dernières élections », laissant planer le fameux complot d'un plan secret des démocrates pour enlever le droit de vote à la population.
Leur alliance se poursuit en dehors de la scène. Elon Musk a créé l'America PAC, un groupe qui recrute des démarcheurs qui vont frapper à des milliers de portes pour faire sortir le vote républicain dans les États clés — les États indécis qui peuvent faire basculer l'élection — et Trump lui a garanti une place dans son administration, s'il l'emportait en novembre.
Un long crash
Quelle volte-face par rapport à 2016 ! À l'époque, Elon Musk prétendait que Trump n'avait pas le caractère qu'il fallait pour les États-Unis ; il protestait contre le retrait de Washington de l'Accord de Paris ; il parlait du changement climatique comme de la « plus grande menace que l'humanité ait à affronter ce siècle ». Désormais, Musk estime que la peur autour du réchauffement est « exagérée », et soutient donc officiellement un candidat qui parle du changement climatique comme d'un « hoax », un « canular ».
Il faut dire qu'il a tout à gagner avec cette alliance. L'empire Musk, qui va de l'énergie à l'intelligence artificielle, peut grandement tirer bénéfice de l'oreille attentive de Donald Trump. Le républicain, vent debout contre les voitures électriques auparavant, se pâme désormais pour elles. Il dit ne plus avoir le choix : « Elon me soutient ! »
Donald Trump, alors président, avec Elon Musk après le lancement réussi de la capsule spatiale Crew Dragon, développée par SpaceX pour le compte de la Nasa, le 30 mai 2020. Flickr/CC0/Trump White House Archived/Shealah Craighead
L'entrepreneur en série, croit le site étasunienPolitico, chuchote déjà à l'oreille de Donald Trump et influence ses futurs choix politiques en matière d'environnement. Un élu républicain, cité par le site, le voit comme le futur conseiller sur le climat à Washington, si Donald Trump parvient à retrouver le chemin de la Maison-Blanche.
Un virage lié au mouvement contre l'impôt
Comment expliquer la mue d'Elon Musk, et celle d'autres seigneurs de la Tech ? Par l'impôt, résume Olaf Groth, auteur spécialisé dans l'écosystème des entreprises de la « vallée » et professeur à l'université Berkeley, en Californie. « Le virage de ces gens est très pragmatique. Quand ils entendent parler de hausses d'impôts sur les gains en capital, ils veulent fuir. Elles ont un effet direct sur la capacité des fonds de capital-risque à aller chercher de l'argent auprès de leurs partenaires. C'est tout simple. Et ils ont peur des lois antitrust, qui veulent limiter la taille des grandes entreprises numériques. Ils regrettent la trop grande interférence, selon eux, de l'État. »
Déjà sous Barack Obama, le vernis de la vallée craquait quand le président parlait de hausse d'impôts sur les capitaux. Joe Biden a continué à lézarder leur confiance. Des investisseurs ont détesté son idée d'une « billionnaire tax » (un « impôt sur les milliardaires »), sa volonté de hausser les taxes sur les profits d'investissements gagnants, ou ses croisades anti-cryptomonnaies. Une lettre ouverte signée par plusieurs grands noms de la Tech a aussi dénoncé son ambition de mieux réglementer l'intelligence artificielle.
« Cela peut surprendre, parce que la version actuelle du Parti républicain est isolationniste, populiste, anti-immigrants, alors que la Tech a besoin de libre circulation et de tous les petits génies de cette planète. Et pour obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la dérégulation maximale, des leaders du numérique ont choisi de passer outre », explique Ramesh Srinivasan, professeur en information à UCLA (Californie), qui étudie les liens entre la technologie et la politique.
Elon Musk rejoint le président Donald Trump lors d'un briefing avant le lancement de la fusée de SpaceX, Falcon 9, le 27 mai 2020. Flickr/CC0/Trump White House Archived/Shealah Craighead
Musk et les autres ont aussi tenté d'influer, parfois avec succès, sur les choix des démocrates, sans sentir la même ouverture que dans le camp Trump. « Ils se rendent compte que dans le cercle autour de Trump, constitué de gens très riches, et anti-impôts, le message porte, explique Ramesh Srnivisan. Ces gars-là se voient comme des révolutionnaires ! Ils se disent : “Celui qui veut freiner ma révolution ne passera pas.” Et quand vous dirigez PayPal ou Tesla, si votre message porte au niveau politique, vous changez la manière dont sont gérés l'énergie, l'espace, les paiements : vous avez une influence immense sur les gens ! »
Chris Hughes, cofondateur de Facebook, explique dans le New York Times que, selon lui, les élites de la vallée s'identifient aussi à Trump en tant que « victime du gouvernement », persécutée pour ses idées audacieuses. « Il est le bouclier dont ils ont besoin pour échapper à leurs responsabilités. M. Trump peut menacer les normes démocratiques et répandre la désinformation ; […] mais il ne remettra pas en cause leur capacité à construire la technologie qu'ils aiment, quel qu'en soit le coût social. »
L'influence démocrate prédomine encore
Toute la vallée n'a pas changé de couleur politique, loin de là. Les ponts entre le parti démocrate et la Tech restent solides. En 2007, l'ex-candidat à la présidentielle, Al Gore, avait rejoint une firme de capital-risque, et durant les années Obama, la Tech a accueilli à bras ouverts les jeunes ambitieux qui avaient accompagné l'arrivée du président au pouvoir et qui souhaitaient se réorienter dans le privé.
Pour Olaf Groth, la vallée penche quand même toujours du côté démocrate, mais les voix radicales, dont celles de Musk, écrasent tout sur leur passage. « Ce sont ceux qui crient le plus fort qui gagnent. Musk a énormément d'abonnés, publie beaucoup. Avant, les voix conservatrices de la Tech se sentaient gênées de parler, ça pouvait plomber leur carrière. Maintenant, ils se sentent plus à l'aise, ne se sentent plus seuls et sont populaires en ligne. »
Climatoscepticisme en hausse
Elon Musk soutient par exemple que l'agriculture et l'industrie forestière n'ont « aucun effet significatif sur le changement climatique », alors qu'elles sont considérées comme responsables de près d'un cinquième des émissions de CO2. Il publie fréquemment des messages erronés sur le climat, que les scientifiques doivent corriger publiquement, en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas cru.
Son réseau X (anciennement Twitter), qu'il a racheté en 2022, se classe comme le pire de tous en matière de lutte contre la désinformation climatique, d'après une analyse réalisée l'année dernière par le Climate Action Against Disinformation (CAAD). En 2022, le nombre de tweets et retweets de publications climatosceptiques a presque quadruplé comparé à 2020. Marc Morano, figure complotiste climatique notoire,décritune visibilité « en forte hausse » de son compte depuis l'arrivée de Musk aux manettes.
Lire aussi : Starlink, le plan géant d'Elon Musk pour occuper l'espace
X n'est pas la seule plateforme qui doit faire le ménage dans ses comptes : la CAAD observe que rien ne montre que les principaux réseaux sociaux aient mis en place des balises face à la désinformation climatique. « X est l'exemple le plus éloquent d'une plateforme braquée par un entrepreneur d'extrême droite. Elle ne tient plus debout, la désinformation est partout. Cela va servir au duo Trump-Musk pour l'élection. Les algorithmes sont trop puissants, ils favorisent ce qui est viral et le climatoscepticisme l'est », explique Olaf Groth.
Dernière outrance en date : Musk a lancé à ses 201 millions d'abonnés que la Fema, l'Agence fédérale de gestion des urgences, obstruait volontairement les efforts de secours des victimes de l'ouragan Helene, qui a dévasté le sud-est des États-Unis fin septembre. La Fema a répondu que ces attaques affaiblissaient la probabilité que les survivants demandent de l'aide à l'agence fédérale. Mais Musk a réitéré : il ne recule devant rien, pas même devant la mort ; enfin, celle des autres.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au cœur du déversoir d’armes américaines à Israël

Malgré les critiques et les objections de nombreux diplomates et responsables intermédiaires du département d'État, l'administration du président Joe Biden n'a cessé d'alimenter Israël en armes, se faisant complice du massacre de la population gazaouie. Le site d'investigation ProPublica a enquêté sur les mécanismes de cette complicité, le poids du lobby militaro-industriel et les vains efforts des fonctionnaires états-uniens qui auraient souhaité y mettre fin.
Tiré de orientxxi
16 octobre 2024
Par Brett Murphy
Tel-Aviv, 19 août 2024. Le secrétaire d'État états-unien Antony J. Blinken (au milieu), l'ambassadeur des États-Unis en Israël Jack Lew (à gauche), et le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou (à droite).
Chuck Kennedy / département d'État
Traduit de l'anglais par Marc Saint Upery
L'article est paru sur le site ProPublica le 4 octobre 2024
Fin janvier 2024, alors que le nombre de morts à Gaza atteignait 25 000 et que des milliers de Palestiniens fuyaient leurs villes rasées par les bombardements à la recherche d'un lieu sûr, l'armée israélienne a demandé 3 000 bombes supplémentaires au gouvernement américain. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, ainsi que d'autres fonctionnaires de l'ambassade de Jérusalem ont envoyé un câble à Washington pour que le département d'État approuve cette vente. D'après eux, il n'y avait aucun risque que les Israéliens fassent un mauvais usage de ces armes.
Un aveuglement volontaire
Le câble en question ne mentionnait pas les réserves exprimées publiquement par l'administration de Joe Biden sur le nombre croissant de victimes civiles à Gaza. Il ne parlait pas plus, non plus, des rapports bien documentés selon lesquels Israël avait largué des bombes de 900 kilos sur des zones densément peuplées détruisant des immeubles d'habitation et tuant des centaines de Palestiniens, dont un grand nombre d'enfants. L'ambassadeur Jack Lew était au fait de ces tragédies. Des membres de sa propre équipe avaient signalé à plusieurs reprises ces attaques. Plusieurs domiciles d'employés palestiniens de l'ambassade avaient eux-mêmes été la cible de frappes aériennes israéliennes.
Pourtant, Lew et ses subordonnés immédiats ont soutenu qu'on pouvait faire confiance à Israël en ce qui concerne cette nouvelle livraison de bombes guidées GBU-39, de petit diamètre et censément plus précises. L'armée de l'air israélienne, affirmaient-ils, avait depuis des décennies su démontrer qu'elle était capable d'éviter de tuer des civils lorsqu'elle utilisait cette bombe de fabrication américaine et avait « fait la preuve de sa capacité et de sa volonté de l'utiliser d'une manière qui minimise les dommages collatéraux ».
Alors même que cette demande était en cours d'examen, les actions des Israéliens ont démontré la fausseté de ces affirmations. Dans les mois qui ont suivi, l'armée israélienne a largué à plusieurs reprises des GBU-39 déjà en sa possession sur des abris et des camps de réfugiés. Puis, au début du mois d'août, elle a bombardé une école et une mosquée où s'abritaient des civils. Au moins 93 personnes sont mortes. Les corps des enfants étaient tellement mutilés que leurs parents avaient du mal à les identifier. Les experts ont pu identifier des éclats de bombes GBU-39 dans les décombres.
8 décembre 2006. Impact d'une GBU-39 lors d'un test.
USAF / wikimédia
Dans les mois précédents et au cours des mois suivants, plusieurs fonctionnaires du département d'État ont insisté pour suspendre totalement ou partiellement les ventes d'armes à Israël, conformément à la législation qui interdit d'armer les pays qui enfreignent régulièrement les lois de la guerre protégeant les civils. Les responsables politiques du département d'État ont rejeté ces appels à plusieurs reprises. Depuis plusieurs années, nombre de fonctionnaires ont tenté en vain de suspendre ou de soumettre à des conditions contraignantes les ventes d'armes à Israël en raison d'allégations crédibles selon lesquelles ce pays aurait violé les droits humains des Palestiniens en utilisant des armes fabriquées aux États-Unis.
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'information hebdomadaire d'Orient XXI
Le 31 janvier 2024, le lendemain du jour où l'ambassade avait envoyé son câble, le secrétaire d'État Antony Blinken organisa au siège du département d'État une réunion pendant laquelle il répondit aux questions de ses subordonnés sur Gaza. D'après une transcription des propos tenus pendant cette réunion, il y aurait déclaré que les souffrances des civils étaient « absolument déchirantes, bouleversantes ». « Mais nous devons juger en connaissance de cause », expliqua aussi Blinken à propos des efforts déployés par le département d'État pour minimiser les dommages. « Nous partons du principe que, le 7 octobre, Israël avait le droit de se défendreet, a fortiori, le droit de faire en sorte que le 7 octobre ne se reproduise plus jamais. » Le blanc-seing de l'ambassade à Jérusalem et les déclarations de Blinken reflètent ce que de nombreux fonctionnaires du département d'État considèrent comme leur mission depuis près d'un an. Un ancien membre du personnel de l'ambassade la décrit ainsi : tacitement, il s'agit de « protéger Israël de toute remise en cause » et de faciliter les livraisons d'armes, quelles que soient les violations des droits humains. « Nous sommes incapables d'admettre qu'il y a un problème », explique ce diplomate.
Le département d'État contre les droits humains
Selon Mike Casey, un autre diplomate ayant été lui aussi en poste à Jérusalem, l'ambassade états-unienne a même toujours refusé d'accepter de la section Proche-Orient du département d'État des fonds destinés à enquêter sur les problèmes de droits humains en Israël : cela reviendrait à insinuer que ces problèmes existent, ce à quoi les fonctionnaires de l'ambassade se refusent. « Dans la plupart des pays, un de nos objectifs est de lutter contre les violations des droits humains, ajoute Casey, mais ce n'est pas le cas avec Israël. »
Dans un article antérieur (1) ProPublica a expliqué comment les deux principaux organismes du gouvernement états-unien en matière d'aide humanitaire — l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Bureau des réfugiés du département d'État — en étaient arrivés au printemps 2024 à la conclusion qu'Israël avait délibérément bloqué les livraisons de nourriture et de médicaments à Gaza, en conséquence de quoi les ventes d'armes devaient être interrompues. Mais Blinken a alors rejeté ces conclusions et, quelques semaines plus tard, déclaré devant le Congrès que le département d'État n'avait pas trouvé d'indices qu'Israël ait bloqué l'aide humanitaire.
Les faits révélés par ProPublica permettent de comprendre de l'intérieur comment et pourquoi les responsables les plus haut placés du gouvernement des États-Unis n'ont jamais cessé d'approuver les ventes d'armes de Washington à Israël. Cet article s'appuie sur une multitude de câbles, de courriels, de mémos, de comptes-rendus de réunions et d'autres documents internes au département d'État, ainsi que sur des entretiens avec des fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires de cette administration.
Ces documents et ces entretiens montrent également que les pressions exercées pour que les livraisons d'armes ne soient pas interrompues proviennent entre autres du secteur des industries d'armement. Les lobbyistes travaillant pour ces entreprises interviennent régulièrement en coulisse pour essayer de convaincre les législateurs et les fonctionnaires du département d'État d'approuver les livraisons à Israël et à d'autres alliés controversés des États-Unis, notamment l'Arabie saoudite.
D'après les experts avec lesquels ProPublica s'est entretenu, le blanc-seing systématique accordé par l'administration Biden à l'armée israélienne n'a fait qu'encourager les Israéliens. Alors qu'Israël et l'Iran échangent des tirs de missiles, le risque d'une guerre régionale n'a jamais été aussi grand depuis des décennies et le coût de l'impéritie de Washington est plus manifeste que jamais.
Pour Daniel Levy, qui a occupé dans les années 1990 une série de postes importants en tant que fonctionnaire et conseiller du gouvernement états-unien, « il y a eu une réaffirmation rapide et sans équivoque de l'impunité [d'Israël] ». Avant d'entrer dans la fonction publique aux États-Unis, Levy avait servi sous les drapeaux en Israël ; il est l'un des fondateurs du groupe de pression J Street
(2) et préside le think tank US/Middle-East Project. Levy est convaincu que Washington a pratiquement renoncé à demander des comptes à Israël pour sa conduite à Gaza, et que les Israéliens sont au contraire « certains d'avoir carte blanche ».
En réponse à une série de questions détaillées, un porte-parole du département d'État a envoyé à ProPublica une déclaration affirmant que, quel que soit le pays bénéficiaire, y compris Israël, les livraisons d'armes états-uniennes « sont effectuées en consultation » avec d'autres organismes et administrations relevant du département d'État et avec les ambassades concernées :
Nous attendons de tout pays bénéficiaire de matériel de sécurité américain qu'il en fasse usage en pleine conformité avec le droit humanitaire international, et nous mettons en œuvre une série de procédures permettant de vérifier cette conformité.
Toujours d'après le même porte-parole, l'ambassadeur Jack Lew s'emploie activement à garantir que « toutes les mesures possibles soient prises pour minimiser l'impact du conflit sur les civils », tout en travaillant sur un accord de cessez-le-feu pour assurer « la libération des otages, soulager les souffrances des Palestiniens à Gaza et mettre fin au conflit ».
« Votre article est tendancieux »
ProPublica a également envoyé une série de questions aux représentants du gouvernement israélien, dont un des porte-paroles nous a répondu comme suit :
Votre article est tendancieux et tend à présenter comme inappropriés les contacts légitimes et routiniers entre Israël et son ambassade à Washington et des fonctionnaires du département d'État. Votre objectif semble être de jeter le doute sur la coopération en matière de sécurité entre deux nations amies qui sont de proches alliés.
Les ventes d'armes sont un pilier de la politique étrangère des États-Unis au Proche-Orient. Israël a reçu de Washington à cet effet plus d'aide financière que n'importe quel autre pays et dépense la majeure partie de l'argent des contribuables états-uniens pour acheter des armes et des équipements fabriqués par des entreprises américaines. Bien qu'Israël dispose de sa propre industrie d'armement, son offensive à Gaza dépend fortement des avions à réaction, des bombes et d'autres armes fabriquées aux États-Unis. Depuis octobre 2023, Washington lui a livré plus de 50 000 tonnes d'armement, une contribution « cruciale pour le maintien des capacités opérationnelles de l'armée israélienne pendant la guerre en cours », comme l'admettent les autorités militaires israéliennes. Les défenses anti-aériennes qui protègent les villes israéliennes — connues sous le nom de « Dôme de fer » — dépendent également en grande partie du soutien des États-Unis.
Rien n'indique qu'aucun des deux partis, républicains ou démocrates, soit prêt à entériner une réduction des livraisons d'armes américaines. C'est au début des années 1970 que les États-Unis ont commencé à vendre des quantités importantes d'armes à Israël et rien n'indique que cela va changer quel que soit le vainqueur de la présidentielle du 5 novembre. Les États-Unis versent au gouvernement israélien environ 3,8 milliards de dollars par an (3,4 milliards d'euros), et bien plus en temps de guerre. Le Congrès et le pouvoir exécutif ont imposé des garde-fous juridiques sur la manière dont Israël et d'autres pays peuvent utiliser les armes qu'ils achètent avec l'argent des contribuables américains. Le département d'État est censé auditer et approuver la plupart de ces contrats militaires et est tenu d'exclure tout pays responsable de violations avérées ou potentielles du droit humanitaire international. C'est le cas, par exemple si l'armée de ce pays prend pour cible des civils ou bloque les livraisons de nourriture à des réfugiés. Le département d'État est également censé refuser de livrer des équipements et des armes financés par les États-Unis à toute unité militaire accusée de manière crédible d'avoir commis des violations flagrantes des droits humains, telles que la torture.
Des procédures régulièrement violées
La procédure fonctionne comme suit : une équipe ad hoc de l'ambassade des États-Unis dans le pays demandeur — qui dépend du département d'État — rédige un câble dit d'« évaluation-pays » afin de juger de l'aptitude dudit pays à demander qu'on lui livre des armes. Ce n'est là que le début d'un long et complexe processus, mais il s'agit d'une étape cruciale en raison du niveau d'expertise locale possédé par le personnel des ambassades.
Dans un deuxième temps, l'essentiel de l'audit est effectué par le Bureau des affaires politico-militaires du département d'État, qui s'occupe des livraisons d'armes avec la collaboration consultative d'autres organismes gouvernementaux. En ce qui concerne Israël et les alliés de l'OTAN, si le montant de cette livraison est de plus de 100 millions de dollars (91 millions d'euros) pour les armes ou de plus 25 millions de dollars (22 millions d'euros) pour les autres équipements, l'approbation finale du Congrès est requise. Si les législateurs tentent de bloquer une livraison, ce qui est rare, le président peut leur opposer son veto.
Pendant des années, Josh Paul, fonctionnaire de carrière au Bureau des affaires politico-militaires, a audité les ventes d'armes à Israël et à d'autres pays du Proche-Orient. Au fil du temps, il est devenu l'un des experts les plus compétents du département d'État en la matière. Même avant la guerre de Gaza, Paul s'était inquiété du comportement d'Israël. À plusieurs reprises, il avait déclaré estimer que le respect de la législation en vigueur mettait le gouvernement états-unien dans l'obligation de suspendre certaines livraisons d'armes. En mai 2021, il a ainsi refusé d'approuver la vente d'avions de combat à l'armée de l'air israélienne. « À l'heure où l'armée de l'air israélienne bombarde des immeubles civils à Gaza, écrivait-il alors dans un courriel, je ne peux pas donner mon approbation à cette transaction. » Au mois de février 2022, il a de même refusé d'approuver une autre livraison après la publication d'un rapport d'Amnesty International accusant les autorités israéliennes de pratiquer une politique d'apartheid.
Dans les deux cas, explique-t-il à ProPublica, ses supérieurs immédiats ont approuvé les ventes d'armes malgré ses objections. « Je n'ai aucun espoir de pouvoir faire bouger la politique du département d'État dans ce domaine pendant le mandat de cette administration », écrivait-il à l'époque à un sous-secrétaire d'État adjoint.
En décembre 2021, Josh Paul a fait circuler à l'intention d'une série de diplomates de haut rang un mémorandum contenant des recommandations visant à renforcer le processus d'audit des ventes d'armes, notamment en prenant en compte l'avis des organisations de défense des droits humains. Il signalait que la nouvelle politique de livraison d'armements de l'administration Biden — qui interdisait toute vente d'armes s'il apparaissait « plus probable qu'improbable » que le destinataire les utilise pour attaquer intentionnellement des infrastructures civiles ou commettre d'autres crimes — risquait fort d'être « édulcorée » dans la pratique. « Dans le cas d'Israël et de l'Arabie saoudite, il n'y a aucun doute que la vente de munitions guidées de précision risque fort de se traduire par d'importants dommages occasionnés aux civils », indiquait le mémo de Josh Paul.
En signe de protestation contre les livraisons d'armes à Israël, Josh Paul a démissionné en octobre 2023, moins de deux semaines après l'attaque du Hamas. Son départ constituait la première dissension publique majeure au sein de l'administration Biden depuis le début de la guerre.
Pas moins de six mémos critiques ignorés
D'autres experts travaillant pour le gouvernement ont eux aussi commencé à s'inquiéter des violations des droits humains commises par les Israéliens. Les diplomates et analystes suivant le Proche-Orient ont remis à leurs supérieurs hiérarchiques pas moins de six mémos critiquant la décision de Washington de continuer à armer Israël. Dans un mémorandum datant de novembre 2024 et qui n'a jamais été rendu public, un groupe d'experts appartenant à plusieurs branches de l'administration a déclaré ne pas avoir été consulté à l'occasion des décisions politiques concernant des livraisons d'armes immédiatement postérieures aux 7 octobre. En outre, aucun processus de contrôle efficace n'a été mis en place pour évaluer les répercussions de ces ventes. Ce mémo ne semble pas avoir plus d'impact que les recommandations et les messages précédents. Au début de la guerre, le personnel du département d'État a dû faire des heures supplémentaires, souvent le soir et pendant les week-ends, pour traiter les demandes israéliennes de nouvelles livraisons d'armes. Certains fonctionnaires du département d'État estiment que ces efforts témoignent d'un favoritisme excessif à l'égard d'Israël.
En janvier, l'ambassadeur Jack Lew approuvait la demande de livraison à Israël de 3 000 bombes de précision GBU-39, cofinancée par des fonds états-uniens et israéliens. Lew est une figure importante dans les milieux démocrates et a prêté ses services à plusieurs administrations. Il a été chef de cabinet du président Barack Obama, avant de devenir son secrétaire au Trésor. Il a également occupé des postes de direction au sein de Citigroup et d'un important fonds d'investissement. Le contre-amiral Frank Schlereth, attaché militaire en Israël, est l'un des cosignataires du câble envoyé par Jack Lew. Outre les assurances concernant l'éthique de l'armée israélienne, ce message mentionne les liens étroits entre cette dernière et l'armée américaine : les équipages israéliens fréquentent des écoles d'entraînement aux États-Unis et s'y familiarisent avec la question des dommages collatéraux ; ils utilisent des systèmes informatiques de fabrication américaine pour planifier leurs missions et « prévoir les effets de leurs munitions sur les cibles visées ».
Au début de la guerre, Israël a utilisé des bombes américaines non guidées qui pouvaient peser jusqu'à 900 kilos et se caractérisaient, selon les critiques de nombreux experts, par leur imprécision. Mais à l'époque où l'ambassade américaine à Jérusalem menait son évaluation, Amnesty International a rendu publics des éléments prouvant que les Israéliens avaient également largué sur des civils des bombes GBU-39, beaucoup plus précises et fabriquées par Boeing. Quelques mois avant le 7 octobre, une attaque menée en mai 2023 avait fait 10 morts parmi les civils palestiniens. Une frappe ayant eu lieu au début du mois de janvier 2024 avait elle aussi provoqué la mort de 18 civils, dont 10 enfants. Les enquêteurs d'Amnesty International ont trouvé des fragments de GBU-39 sur les deux sites concernés.
Une colère sans précédent dans le monde arabe
À la même époque, les experts du département d'État se sont employés à dresser la liste des effets de la guerre à Gaza sur la crédibilité des États-Unis dans la région. Hala Rharrit, diplomate de carrière basée au Proche-Orient, décrivait par ses courriels les dommages collatéraux des frappes aériennes à Gaza, incluant souvent des images insoutenables des morts et blessés palestiniens et des photos de fragments de bombes américaines dans les décombres. « Les médias arabes ne cessent de diffuser d'innombrables images et vidéos dépeignant des massacres et illustrant la famine à Gaza et insistent sur le fait qu'Israël commet des crimes de guerre et un génocide et doit rendre des comptes », indiquait-elle début janvier 2024 dans un courriel illustré par la photo du cadavre d'un enfant en bas âge. « Ces images illustrant le carnage, en particulier celles qui dépeignent régulièrement des enfants morts ou blessés, traumatisent le monde arabe et y provoquent une colère sans précédent. » Hala Rharrit, qui a démissionné en signe de protestation, a déclaré à ProPublica que ces images auraient dû, à elles seules, susciter une enquête du gouvernement états-unien et être prises en compte dans l'examen des demandes de livraisons d'armes faites par les Israéliens. D'après elle, le département d'État avait « délibérément violé les lois en vigueur » en n'agissant pas sur la base des informations qu'elle-même et d'autres personnes avaient rassemblées : « Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. »
Le câble envoyé par Jack Lew en janvier 2024 ne mentionne pas le nombre de morts à Gaza ni les incidents liés au largage de bombes GBU-39 sur des civils. Washington espérait que des bombes de plus petite taille permettraient d'éviter des morts inutiles, mais pour les experts en droit de la guerre la taille d'une bombe n'a guère d'importance si elle finit par tuer plus de civils que ne le justifie l'objectif militaire. D'après le lieutenant-colonel Rachel E. VanLandingham, officier à la retraite des services juridiques de l'armée de l'air, avant toute opération, les autorités militaires israéliennes sont légalement responsables de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour évaluer les risques encourus par les civils et pour éviter de bombarder sans discernement des zones densément peuplées telles que les camps de réfugiés et autres abris. Pour VanLandingham : « il semble extrêmement plausible que les Israéliens aient tout simplement ignoré ces risques. Cela a de quoi nous préoccuper sérieusement et indique une violation du droit de la guerre. »
« C'est un business »
Des fonctionnaires en poste tant à Jérusalem qu'à Washington nous ont signalé qu'à plusieurs reprises, des préoccupations similaires avaient été communiquées à l'ambassadeur Jack Lew, mais que ce dernier tendait instinctivement à défendre Israël. Dans un autre câble obtenu par ProPublica, Lew expliquait à Anthony Blinken et à d'autres hauts responsables de Washington qu'« Israël mérit[ait] toute notre confiance en tant que bénéficiaire de matériel de défense » et que les évaluations de son équipe concernant d'autres ventes d'armes par le passé confirmaient que « les pratiques avérées d'Israël en matière de droits humains rendaient cette livraison légitime ».
Lew allait encore plus loin en affirmant dans son câble que le système de choix de cibles de l'armée israélienne était si « complet et sophistiqué » que, selon l'estimation de l'attaché militaire Frank Schlereth, il « est conforme à nos propres normes et même souvent plus rigoureux ». Deux fonctionnaires du département d'État ont confié à ProPublica que Lew et Schlereth avaient émis des propos similaires lors de réunions internes.
Au début de la guerre, des diplomates en poste à Jérusalem ont également rapporté qu'outre les nombreux autres incidents impliquant des civils, Israël avait largué des bombes sur les domiciles de membres du personnel de l'ambassade. Quant à savoir pourquoi les câbles envoyés par Jack Lew sont muets sur ce type d'incidents, voilà ce que nous en a dit un fonctionnaire : « L'explication la plus charitable que je peux trouver est qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps ou l'envie de mener à bien une évaluation critique des réponses des Israéliens. »
Au consulat d'Israël à New York, les responsables desachats d'armes occupent deux étages et traitent des centaines de contrats chaque année. Un fonctionnaire israélien y ayant travaillé nous a déclaré qu'il s'efforçait d'acheter autant d'armes que possible et que ses partenaires états-uniens faisaient des efforts tous aussi intenses pour lui en vendre : « C'est un business. »
ProPublica a aussi pu constater que, dans les coulisses, lorsque les fonctionnaires du gouvernement mettent trop de temps à traiter un dossier, les lobbyistes représentant les puissantes entreprises du secteur interviennent pour faire pression et faire accélérer la procédure. Certains de ces lobbyistes avaient eux-mêmes occupé précédemment des postes importants dans les services concernés du département d'État. Ces dernières années, au moins six hauts fonctionnaires du Bureau des affaires politico-militaires ont quitté leur poste pour rejoindre des cabinets de lobbying et des entreprises d'armement. Jessica Lewis, secrétaire adjointe du Bureau, a démissionné en juillet pour être embauchée par le cabinet Brownstein Hyatt Farber Schreck, la plus grosse firme de lobbying de Washington en termes de chiffre d'affaires, qui défend entre autres les intérêts de l'industrie d'armements et ceux de divers pays, dont l'Arabie saoudite.
Le poids du lobby militaro-industriel
Paul Kelly, principal responsable des relations avec le Congrès au sein du département d'État entre 2001 et 2005, soit pendant les invasions de l'Irak et de l'Afghanistan, nous a déclaré que, très souvent, les représentants du secteur privé « insistent discrètement » pour faire accélérer la procédure de soumission des dossiers de livraison d'armes aux législateurs. « Cela ne se traduisait pas par des pots-de-vin ou des menaces, mais ils me disaient : “Bon, alors, quand est-ce que vous allez approuver la vente et l'envoyer au Congrès ?”. »
Trois autres fonctionnaires du département d'État travaillant ou ayant travaillé sur ce type de dossiers nous ont déclaré que la situation n'avait guère changé depuis l'époque de Kelly et que les entreprises qui tirent profit des guerres à Gaza et en Ukraine appelaient fréquemment leurs services ou leur envoyaient des courriels. Ce type de pression s'exerce également sur les législateurs dès le moment où ils sont informés des dossiers en cours. Ils sont dès lors assaillis de coups de téléphone et de demandes de réunion, nous a confié un fonctionnaire familier de ce type de communications.
Dans certains cas, ce type de lobbying est susceptible de dériver vers un terrain plutôt douteux sur le plan juridique. En 2017, l'administration Trump avait signé un contrat d'armement de 350 milliards de dollars (320 milliards d'euros) avec l'Arabie saoudite. Cette vente s'inscrivait dans le prolongement de la politique de Barack Obama avant que ce dernier ne suspende certaines livraisons en raison de préoccupations humanitaires. Pendant des années, les Saoudiens et leurs alliés ont utilisé des jets et des bombes de fabrication américaine pour attaquer les milices houthistes au Yémen, tuant des milliers de civils dans la foulée.
Au mois de février suivant, le département d'État examinait la possibilité d'approuver la vente à l'Arabie saoudite de missiles à guidage de précision fabriqués par Raytheon. Un vice-président de cette entreprise, Tom Kelly — par ailleurs ancien secrétaire adjoint du Bureau des affaires politico-militaires du département d'État —, envoya alors un courriel à un de ses anciens subordonnés, Josh Paul, pour lui demander de participer à une réunion avec un représentant de Raytheon. Ladite réunion aurait pour but de « discuter de la stratégie » à mettre en œuvre afin de faciliter la vente en question
Josh Paul lui répondit qu'une telle réunion risquait d'être illégale :
Comme vous l'avez sans doute retenu de votre période de travail dans nos services, la législation anti-lobbying nous interdit de coordonner des stratégies législatives avec des organisations extérieures au département d'État. Par ailleurs, je pense que les obstacles potentiels au succès de ce dossier sont relativement évidents.
Paul faisait par là allusion à une série d'articles de presse parus à l'époque et faisant état des très nombreuses victimes civiles au Yémen. « Pas de soucis, répondit Kelly. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir. » Tom Kelly et Raytheon n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires. Le département d'État a finalement approuvé la vente.
Brett Murphy
Journaliste à Propublica, lauréat du prix Pulitzer.
Notes
1. Brett Murphy, « Israel Deliberately Blocked Humanitarian Aid to Gaza, Two Government Bodies Concluded. Antony Blinken Rejected Them. », ProPublica, 24 septembre 2024.
2. NdT : J Street est une organisation à but non lucratif fondée en 2008, favorable à une solution diplomatique du conflit israélo-palestinien et à un changement de cap de la politique américaine privilégiant les solutions diplomatiques par rapport aux solutions militaires et le dialogue plutôt que l'affrontement. Tout en affirmant ses convictions sionistes, elle prétend offrir une alternative progressiste modérée aux lobbies liés à la droite sioniste et inconditionnels d'Israël et de la colonisation tels que l'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Campagne présidentielle US : surenchères et brèches dans le consensus sioniste bipartisan

Les accusations d'antisémitisme en réponse à toute contestation et rejet du sionisme en général, ou de la politique génocidaire du pouvoir israélien en particulier, sont devenues prévisibles au point de constituer une norme polémique du « débat » public, aux Etats-Unis comme dans l'ensemble du monde occidental, à considérer qu'un tel débat parvienne encore à avoir cours.
Le coup de force dont résulte cette confusion a une histoire, politique et institutionnelle[1]. Dans l'immédiat, sur fond de guerre exterminatrice menée par Israël contre l'ensemble de la Palestine, l'équivalence entre antisionisme et antisémitisme a pris un tour plus que jamais exacerbé et systématique dans la campagne présidentielle états-unienne, comme le montre dans cet article Thierry Labica, révélant néanmoins certaines brèches dans le consensus sioniste bipartisan.
On trouvera en annexe, une traduction du discours que devait prononcer, au titre du mouvement Uncommitted, Ruwa Romman, palestinienne-américaine élue démocrate à la chambre des représentants de l'État de Géorgie, devant la convention démocrate tenue à Chicago les 19-22 août 2024. Romman a dû finalement se contenter d'en donner lecture à l'extérieur de l'enceinte de la convention.
14 octobre 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/campagne-presidentielle-us-harris-trump-israel-antisemitisme/
Parmi les nombreuses fonctions et implications de l'assimilation de toute critique de la politique de l'État d'Israël (et a fortiori de l'antisionisme) à l'antisémitisme, on note en particulier deux choses : la tentative de relégation de la guerre – et de sa caractérisation génocidaire – au second plan d'un problème qui serait à la fois plus urgent et plus profond en France comme aux États-Unis mêmes : la résurgence de l'antisémitisme émanant d'une dénonciation de la guerre qui n'en serait plus que le « prétexte »[2] ; et conjointement, l'attribution à la gauche d'un antisémitisme historiquement associé à l'extrême droite et aux catastrophes fascistes et nazies.
Dans ce cas, la gauche ne se définirait plus par sa lutte contre l'antisémitisme ; les derniers mois auraient révélé que l'antisémitisme (toujours « résurgent ») est devenu proprement consubstantiel à la gauche. En cela, nous serions dans un moment de pleine manifestation d'un antisémitisme « nouveau » (et ce à condition de bien vouloir oublier que l'idée et l'imputation de « nouvel antisémitisme » est apparue au tournant des années 1970[3] : « nouveauté » inaltérable, à l'évidence).
Les procès (souvent au sens littéral) en antisémitisme qui ont eu lieu en France depuis le 7 octobre 2023, faits à des organisations, des élu.es, des militant.es, présentent des similarités notables avec ce que la Grande-Bretagne a connu, en particulier, au cours des années 2017-2020, lorsqu'une gauche socialiste anti-guerre, soucieuse de promouvoir le droit international, et solidaire de la Palestine, reçut un mandat massif pour diriger le parti travailliste.
Ces épisodes familiers ont eu, en outre, leur version nord-américaine. L'élection au Congrès de Rachida Tlaib (Michigan) et Ilhan Omar (Minnesota) en novembre 2018 plaça sur le devant de la scène politique américaine la première palestinienne américaine et la première américaine d'origine somalienne et portant le hijab. Leur arrivée manifesta et amplifia l'émergence d'une gauche américaine déjà incarnée par le sénateur démocrate socialiste indépendant du Vermont, Bernie Sanders. Mais, surtout, la présence à la Chambre des représentants de Tlaib et Omar donnait une visibilité inédite à la question palestinienne et marquait une rupture du consensus transpartisan sur le soutien inconditionnel historique des Etats-Unis à Israël.
Lors d'un débat de primaires démocrates avec Hilary Clinton en 2016, Sanders avait commencé à relayer la prise de conscience de toute une jeunesse américaine, née dans la séquence allant de la fin de la seconde Intifada, la création du mouvement BDS, à la guerre de 2014 (en passant par celle de 2008-9 et celle de 2012). Sanders avait en effet déclaré que « si nous voulons amener un jour la paix dans cette région qui a connu tant de haine et tant de guerre, nous allons devoir traiter le peuple palestinien avec respect et dignité. » Pour nombre de commentateurs, cette reconnaissance pourtant très élémentaire de la question palestinienne, accompagnée d'une référence à l'état déjà en tous points catastrophique de la bande de Gaza, représentait une nouveauté sans précédent dans l'histoire des campagnes présidentielles américaines.
Lors de la campagne présidentielle de 2019-2020, Omar, Tlaib et Sanders lui-même, furent la cible d'attaques répétées des organisations pro-israéliennes. Par exemple, l'organisation « Democratic Majority for Israel » publia un spot de campagne anti-Sanders à la veille du scrutin des primaires dans le Nevada, faisant suite à un autre (à 800 000 dollars) diffusé avant le vote dans l'Iowa. Tlaib et Omar quant à elles furent visées par une campagne de l'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) qui voyait en elles les pires menaces pour Israël. Dans une pétition adressée à la Chambre, l'AIPAC expliquait que « des radicales siégeant au Congrès menacent la relation États-Unis – Israël en réduisant ou en coupant l'aide et l'assistance militaires, en encourageant le boycott des entreprises israéliennes, et en tenant des propos ouvertement antisémites ». Le texte poursuivait :
Il est crucial de protéger nos alliés israéliens, en particulier au regard des menaces qui leur viennent d'Iran, du Hamas, de Hezbollah, de l'EII [Daesh] – et plus inquiétant encore – des menaces émanant, ici même, du Congrès américain. Signez notre pétition au Congrès porteuse d'un seul et unique message : n'abandonnez jamais nos alliés israéliens.
Ilhan Omar fit l'objet d'un intense procès en antisémitisme pour avoir pointé l'importance des donations de l'AIPAC dans le soutien américain à l'État d'Israël. L'élue démocrate n'avait fait que rappeler une parfaite évidence de la vie politique américaine que personne ne prétend contester par ailleurs – comme l'observait justement Glenn Greenwald, d'Intercept – lorsqu'il s'agit du lobby des armes à feu, de la Silicon Valley, de la monarchie saoudienne, de l'industrie pharmaceutique ou des entreprises pétrolières. Exactement de la même manière, les donations d'organisations pro-israéliennes à nombre d'élu.es est une dimension de la vie politique américaine que nul ne saurait ignorer, surtout à l'heure ou le président en exercice, Joe Biden lui-même, s'avère en être le principal destinataire (4 223 393 dollars entre 1990 et 2024).
Rachida Tlaib a été et reste la cible de menaces et de campagnes de diffamation incessantes, venues de son propre parti ou relayées et amplifiées par lui. Fin septembre 2024, Tlaib avait déploré la décision de la procureure générale (démocrate) du Michigan de poursuivre onze participants au mouvement de solidarité avec la Palestine sur le campus de l'université de ce même État. Pour Tlaib, la décision, sélective, créait un précédent dangereux et était bien plus digne d'une responsable républicaine que démocrate. Selon le Jewish insider, cependant, Tlaib aurait « insinué » que la procureure avait agi ainsi contre ces manifestants « parce qu'elle est juive ».
Cette imputation parfaitement mensongère fut reprise par l'Anti-Defamation League[4], puis relayée sur les réseaux sociaux des animateurs de CNN, notamment par Jake Tapper et Dana Bash, confirmant toujours un peu plus le biais pro-israélien systématique de la chaîne déjà dénoncé par son propre personnel, comme l'a documenté une enquête parue dans The Guardian en février 2024. En référence à l'attaque terroriste israélienne au Liban contre le Hezbollah, The National Review trouva bon, quant à lui, de divertir un peu avec une caricature de Tlaib constatant que son bipeur venait d'exploser : Tlaib, palestinienne « antisémite », « islamiste », « terroriste » ne serait-elle pas éligible à l'expertise des éliminations « ciblées » israéliennes ? The National Review aura donné la réponse à sa propre question.
Tous n'ont pas réussi à résister à ces campagnes. En juin 2024, Jamaal Bowman, autre figure de la gauche démocrate au Congrès depuis 2020, soutenu par les Democratic Socialists of America, a été battu dans la primaire de son district de New York par un démocrate « modéré » et « inclusif », le multi-millionnaire George Latimer soutenu pas le lobby républicain pro-Israël ; le montant dépensé par l'AIPAC (et son bras financier – le « super PAC » – plus puissant encore, le United Democracy Project, UDP) pour faire battre le candidat noir de gauche et critique d'Israël, fit de cette primaire la plus chère de l'histoire des primaires : plus de quatorze millions de dollars.
Le lobby pro-israélien déclara que c'était « une victoire majeure pour le courant modéré majoritaire dans le parti démocrate, soutien de l'État Juif, et une défaite pour la frange extrémiste. » L'UDP s'est dit déterminé à « continuer de soutenir les dirigeants qui défendent notre partenariat avec Israël et qui s'opposent aux détracteurs, quel que soit leur parti politique ».
Sur ce dernier point, la campagne ne s'en est d'ailleurs pas tenue au seul principe ; la Teach Coalition, qui organise un réseau d'écoles juives et de yeshivas a également contribué à hauteur d'un million de dollars pour faire inscrire des électeurs républicains et indépendants. Mobilisés sur le thème de « la montée de l'antisémitisme », il était entendu que ces électeurs et ces électrices avaient toutes les chances de soutenir le candidat de l'AIPAC et de l'UDP dont, incidemment, les ressources financières proviennent largement de donations républicaines. Miracle de la démocratie américaine où les riches donateurs les plus réactionnaires peuvent à la fois s'acheter leurs candidats et peser directement sur le choix des candidats adverses, et ainsi définir le terrain du consensus réactionnaire et pro-guerre génocidaire sous la bannière de la « modération ».
Au début du mois d'août 2024, l'élue progressiste au Congrès d'une circonscription du Missouri, Cori Bush, noire également, fut battue lors de la primaire dans des conditions similaires ; le même alliage pro-républicain AIPAC-UDP investit 8,5 millions de dollars dans une campagne ciblée contre cette critique de la guerre israélienne.
Jusque-là, les choses sont pour ainsi dire cohérentes. Au cours de la décennie (Gaza) 2014- (Gaza) 2024, et dans toutes leurs nuances, les gauches britannique, française et nord-américaine se sont dans une large mesure (re-)définies avec la question palestinienne[5] et tout ce qu'elle implique pour la lutte contre le colonialisme – en l'occurrence, dans sa déclinaison sioniste –, l'impérialisme, le militarisme, le racisme et le suprémacisme, contre l'islamophobie et plus précisément encore, contre le racisme spécifiquement anti-palestinien (on va y revenir) et la politique génocidaire qui en est la concrétisation ultime. Ce contexte a donc été marqué par une remobilisation exacerbée du motif déjà vieilli du « nouvel antisémitisme » qui serait le propre de cette gauche antisioniste, l'argument frauduleux mille fois asséné étant que l'antisionisme serait le « nouveau visage de l'antisémitisme ».
Mais les accusations d'antisémitisme ont pris un tour inattendu au cours de la campagne présidentielle américaine 2024 lorsque le « ticket » démocrate – Kamala Harris-Tim Walz – s'y est trouvé lui-même exposé, alors qu'il paraissait, quant à lui, si peu susceptible d'en devenir la cible. Dès le mois de juillet et suite au choix du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour le rôle de vice-président, nombre de commentateurs ont exprimé leur inquiétude et souvent, leur indignation face à ce qu'ils jugeaient être une terrible dérive des démocrates.
Une vague d'accusations contre l'ensemble de la campagne est immédiatement intervenue suite au choix de Tim Walz au détriment de Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, qui faisait d'abord figure de favori ; Harris aurait cédé à la pression de sa base « antisémite », « pro-Hamas », en renonçant à nommer Shapiro, parce que juif.
Le motif de l'antisémitisme censé « prospérer à gauche » permettait de faire un relatif silence sur le fait que le démocrate Shapiro, en novembre 2023, s'était joint au camp républicain pour la défense du programme de financement public de chèques-éducation au profit du secteur éducatif privé. Ce motif fut mis en avant par le syndicat de l'automobile United Auto Workers pour exprimer son opposition au choix du candidat Shapiro. Ailleurs, des militants écologistes de l'État de Pennsylvanie avaient fait savoir leur désaccord avec une désignation de Shapiro qu'ils estimaient coupable de capitulation face aux producteurs d'énergie fossile de Pennsylvanie notamment après avoir abandonné les habitants d'un village de l'État dont les nappes phréatiques avaient été contaminées suite à des travaux de fracturation hydraulique.
Concernant la situation au Moyen-Orient, Shapiro soutient Israël comme tous les autres élus démocrates pressentis par Harris. Mais, comme l'observait Emily Tamkin dans The Nation début août, tous, cependant – à la différence de Shapiro – n'ont pas exigé le renvoi des présidents d'université qui n'avaient pas immédiatement sévi contre les mobilisations étudiantes contre la guerre, tous n'ont pas comparé ces manifestants au Ku Klux Klan, et n'ont pas appelé à l'intervention des forces de l'ordre contre les mouvements étudiants.[6]
« En d'autres termes, précise Tamkin, ce n'est pas au sujet d'Israël que Shapiro a été perçu comme plus problématique que les autres ; c'était sur la question de notre propre démocratie. Toutefois, pour Eli Cook, enseignant à l'Université de Haifa, […] le problème était aussi celui de la démocratie israélienne : Shapiro a accepté de l'argent de Jeff Yass qui a apparemment fait des dons à Kohelet, le think tank derrière la réforme de la justice voulu par Netanyahou. »
Mais à l'évidence, « l'antisémitisme » de la campagne démocrate a l'avantage d'être à la fois bien plus salissant et bien plus facile à manipuler que des questions politiques de fond concernant les modalités de financement de l'éducation, l'environnement et la responsabilité-culpabilité des grandes entreprises, la politique étrangère au Moyen-Orient, ou la question de la démocratie américaine et des principes constitutionnels censés en être au fondement : la jeunesse et l'électorat démocrates en général sont majoritairement contre la guerre, pour l'embargo sur les armes à Israël et pour le cessez-le-feu. Harris et Walz pouvaient donc être au moins présentés comme compromis par « l'antisémitisme de gauche », « anti-Israël », devant lequel ils auraient alors cédé, lâchement, au mieux.
La Republican Jewish Coalition, pour commencer, ne s'est pas privé d'exploiter cet inépuisable filon argumentaire, quelle que soit la défiguration du débat public qui doit en résulter. Son président, Matt Brooks, s'indigna du fait que
Joe Biden pense que les manifestants antisémites, anti-Israël ‘n'ont pas tort', Kamala Harris va dans leur sens, disant qu'ils ‘montrent exactement ce que l'émotion humaine doit être' et maintenant, Tim Walz estime que ‘leurs revendications sont légitimes'. C'est une honte absolue. Soyons clair : cette populace [these mobs] dans nos rues et sur nos campus est violemment antisémite et anti-Israël et leur condamnation dans les termes les plus fermes devrait être totale. Il est honteux et atterrant de voir que les principaux dirigeants de l'actuel parti démocrate ne sont pas en mesure de rejeter fermement et sans détour leur ignoble base antisémite […] Les américains rejetteront l'extrémisme d'Harris et Walz en novembre prochain.[7]
Une grande partie des récriminations a d'abord concerné Tim Walz. Pour The Jewish Chronicle, « le bilan de Tim Walz sur Israël et l'antisémitisme est très préoccupant ». Malgré ses positions apparemment pro-israéliennes, explique The JC (de bien piètre réputation, il est vrai)Walz a manifesté son estime pour Ilhan Omar ; il a également prononcé un discours devant le Conseil des relations américaines-islamiques (CAIR) où il a côtoyé un des initiateurs de « Students for Justice in Palestine », autrement dit, « le groupe derrière nombre de ces manifestations pro-Hamas et antisémites sur les campus universitaires suite aux attaques du 7 octobre ». Ou encore, Walz a inscrit dans la loi l'obligation faite aux étudiants d'apprendre l'histoire de l'holocauste « en lien avec d'autres génocides », et non comme « anomalie historique unique ».
On retrouve ces critiques assorties de quelques autres encore dans The Times of Israeldu 28 juillet. Pour Andy Blumenthal, Kamala Harris aurait pris le parti des palestiniens en ne soulignant pas la responsabilité du Hamas dans le déclenchement de la guerre le 7 octobre ; et l'auteur d'expliquer en quoi « ce n'est pas la première fois que Kamala Harris montre des penchants de gauche radicale au sujet les terroristes islamiques ». En conclusion, si l'on peut être « sceptique à l'égard de l'extrême droite », la plus grande inquiétude vient de « la gauche radicale », toujours selon Blumethal.
Ces critiques ne sont pas le fait des seuls partisans du suprémacisme partagé par Benjamin Netanyahou et Donald Trump dont le soutien (et celui de leurs admirateurs) à Israël passe invariablement par la détestation d'un nombre toujours plus considérable de Juifs et de Juives, qu'il s'agisse de simples électeurs et électrices démocrates ou, plus encore, de Juifs antisionistes[8], ceux-là ouvertement critiques de la direction démocrate, à l'image de Lily Greenberg Call dont il est question plus loin). Elles se sont prolongées, de manière plus indirecte sur CNN, pourtant régulièrement accusée par l'ex-président et maintenant candidat républicain, de chercher à lui faire du tort en n'hésitant pas à multiplier les « fake news » à son encontre.
L'animatrice du programme « Inside politics » de la chaîne, Dana Bash, a fourni une contribution très remarquée à la nazification pure et simple de ces étudiants « radicaux » censément représentatifs de la base démocrate. Après avoir diffusé les images d'un étudiant juif de UCLA se plaignant de ne pouvoir rejoindre son cours du fait de la présence d'étudiants pro-palestiniens occupant le campus, Dana Bash commente avec un flair aigu de l'analogie historique : « Encore une fois, ce que vous venez de voir se passe en 2024, à Los Angeles, rappelant les années 1930 en Europe. Je ne parle pas à la légère. La peur chez les Juifs de ce pays est palpable en ce moment » (je souligne).
Au vu de la persistance des imputations d'antisémitisme par association, au moins, certains ont jugé nécessaire de faire la démonstration que « Kamala Harris n'est pas antisémite. Il paraît absurde d'avoir à dire ceci ». Ainsi commence une défense de la candidate démocrate dans l'article paru le 25 juillet dans The Atlantic : « Kamala Harris is not ‘totally against Jewish people' » [Kamala Harris n'est pas « totalement contre les juifs »].
Il n'aura échappé à personne qu'à la différence d'Omar, Tlaib, ou des gauches britanniques ou françaises, le « ticket présidentiel » démocrate n'est pas connu pour son souci de la cause et de la condition palestiniennes. C'est bien le moins que l'on puisse dire. Harris et Walz ont derrière eux une histoire de prises de positions pro-israéliennes sans faille.
Ceci est plus vrai encore pour Harris qui ne s'est en rien contentée de se fondre dans le traditionnel consensus transpartisan américain sur le soutien à l'allié Israël. Comme le rappelle Stephen Zunes dans Tikkun, dès son arrivée au Sénat en 2017, Harris (qui refusa d'accepter le soutien de J Street, le lobby pro-israélien plus modéré) donna l'un de ses premiers discours devant l'AIPAC. Elle y déclara son soutien à l'engagement des États-Unis de fournir 38 milliards de dollars d'aide militaire à Israël au cours de la décennie à venir.
Puis, lors de son tout premier vote de politique étrangère en janvier 2017, par exemple, Harris s'aligna sur Trump pour critiquer le refus de l'ex-président Obama de mettre son veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, très modeste et quasi-unanime, sur les colonies israéliennes. Cette résolution réitérait, entre autres, des demandes antérieures du Conseil de sécurité pour qu'Israël cesse d'étendre ses colonies illégales en Cisjordanie occupée, qui violent la quatrième convention de Genève et une décision historique de la Cour internationale de justice.
Zunes précise encore que la résolution du Sénat, quant à elle, soutenue par Harris elle-même, « remettait en cause le droit des Nations Unies à intervenir dans les questions du droit international humanitaire au sein des territoires sous occupation belligérante étrangère ».
En 2021, indique The Jewish Chronicle (qui s'en félicite) lors de son premier échange téléphonique en tant que vice-présidente avec Netanyahou, l'une et l'autre prirent acte de « l'opposition de leur gouvernement respectif aux tentatives de la Cour pénale internationale d'exercer sa juridiction sur le personnel israélien ».
Comme on peut s'y attendre à ce stade, Harris a déversé l'accusation d'antisémitisme sur les campagnes de boycott et désinvestissement, et dénoncé les tentatives de pression des Nations Unies pour que Netanyahou cesse ses violations du droit humanitaire comme autant de manœuvres de « délégitimation » d'Israël.
Entre soutien inconditionnel à l'aide militaire massive (vingt milliards de dollars supplémentaires approuvés le 13 août, et8,7 milliardsle 26 septembre) et hostilité déclarée à l'égard du droit international, le positionnement de Kamala Harris a suivi les options parmi les plus droitières des dernières années en matière de politique étrangère américaine au Moyen-Orient.
Début novembre 2023, en réponse à une question concernant deux bombardements sur le camp de Jabaliya qui venaient d'avoir lieu à deux jours d'intervalle, Harris a dit comprendre la douleur ressentie face à la mort « tragique » d'innocents, de civils, d'enfants. Toutefois, à la question plus précise de savoir si le camp constituait une cible légitime, la vice-présidente américaine a répondu : « Je – nous ne disons pas à Israël comment conduire cette guerre. Je ne vais donc pas en parler ».
Outre l'impasse criante de cette non-réponse sur l'ensemble des questions du droit de la guerre, du droit humanitaire, du droit international -ou même du frauduleux « respect d'un système basé sur des règles », si ardemment exigé ailleurs, en Mer de Chine notamment – Harris, en pleine cohérence avec elle-même, prolongeait ainsi une tradition « éthique » bien établie dès lors qu'il est question du « conflit israélo-palestinien » : « shoot and cry », ou, « tire d'abord, pleure ensuite », à compléter par « tire encore » (« shoot again »).
Cet élan de compassion convenablement hypocrite la distinguait encore des exultations morbides désormais régulièrement et fièrement publiées sur les réseaux sociaux par les membres de l'armée génocidaire et ses admirateurs. Elle n'annonçait en rien cependant -et bien entendu- une quelconque mise en question de l'a-priori de l'impunité absolue accordée à l'allié israélien.
Les soupçons et accusations portés contre Tim Walz relèvent du registre de l'antisémitisme par association. Mais sont-ils fondés ? Walz a eu des échanges avec -, voire, a fait l'éloge de l'Imam Asad Zaman, responsable de la Société des Musulmans Américains (MAS) du Minnesota qui regroupe sept mosquées de cet État. Walz et Zaman ont eu les interactions institutionnelles (en cinq occasions au total[9]) ordinaires que peuvent avoir un gouverneur d'État et un important responsable religieux local.
Ce fut le cas, par exemple, lors des interventions de Walz, en sa qualité de gouverneur, et des divers chefs religieux de l'État, dans les jours qui suivirent le meurtre de George Floyd par le policier Derek Chauvin à Minneapolis, dans l'État du Minnesota fin mai 2020. Chacun.e pourra apprécier le propos de l'Imam (quatre minutes environ) à cette occasion, en hommage à la dignité de tous les habitants et de toutes les composantes communautaires de l'État, pour la lutte contre le racisme, pour le respect des institutions de l'État, du couvre-feu, du bien commun, et contre la présence et les provocations de l'extrême-droite suprémaciste.
On trouve un autre exemple de prise de parole d'Asad Zaman, un peu plus tôt, dans le contexte plus apaisé de la cérémonie d'investiture au poste de gouverneur de Walz et de son équipe en 2019. L'intervention de moins de deux minutes, venant après celle du rabbin, Marcia Zimmerman, et aux côtés de nombreux autres intervenantEs, commence par une expression de soulagement amusé de voir cette équipe démocrate enfin élue (rires dans la salle), avant d'insister là encore sur le besoin de justice sociale face aux injustices profondes et persistantes de la société américaine.
En quoi l'Imam Zaman, aux accents plutôt progressistes, devrait-il poser problème ? La presse d'extrême droite, reprenant les « révélations » du très conservateur Washington Examine (du 9 août 2024) reproche à Zaman d'avoir, dès le 7 octobre, affirmé sa « solidarité avec les palestiniens contre les attaques israéliennes » et d'avoir, le même jour, partagé l'image d'un drapeau palestinien en réponse à un post affirmant le droit de la Palestine à se défendre et dénonçant le soutien de Biden et Harris au régime sioniste extrémiste et à ses colonies illégales. Que savait-on de la gravité des événements du jour même ? Et où est le problème de l'affirmation d'une solidarité de principe avec les palestiniens – qui est un devoir ? Le Washington Examiner ne traite pas de ces questions et dans nombre de cas, il est entendu que les posts d'Asad Zaman doivent révéler son « extrémisme pro-Hamas ».
Dans tous les cas, c'est à cette organisation (MAS) représentée par ce responsable religieux que l'État du Minnesota sous la direction du gouverneur Walz a attribué la somme de 100 000 dollars « d'argent du contribuable ». La seule mention de cette somme pourrait laisser supputer une faveur, voire, une connivence particulière. On regrette cependant que les nombreuses publications qui le mentionnent négligent deux données pourtant importantes : d'une part, l'ensemble des dépenses de l'État du Minnesota s'élevait, pour l'année 2023, de 72 milliards de dollars. Ces 100 000 dollars -soit 1/720 000e de la dépense totale en 2023 – ne représentaient donc pas exactement, en eux-mêmes, une dilapidation caractérisée des précieuses ressources de l'État.
Mais à cela s'ajoute une autre considération. La somme était destinée à la mise en sécurité des mosquées de la MAS du Minnesota suite à une série d'attaques dirigées contre ces lieux de cultes (vandalisme, incendie criminel) : six entre janvier et mai 2023, et sans parler d'autres graves précédents.[10] Aussi la seule évocation de la subvention de 100 000 dollars à la MAS, sans référence ni au budget de l'Etat concerné, ni à la succession rapprochée de graves attaques islamophobes, est-elle propre à induire en erreur quant à cet usage du bon « argent du contribuable ».
Reste ce qui est jugé le plus accablant pour Zaman et dès lors, pour Walz. En 2015, Zaman a retweeté un lien vers un documentaire proposant une version révisionniste de la carrière d'Adolphe Hitler : « The Greatest Story Never Told ». Le lien était accompagné du message selon lequel « 150 000 juifs ont servi dans l'armée d'Hitler »[11]. Zaman a rapidement voulu réparer cette terrible négligence en supprimant le post et en expliquant que « des gens, et j'en fait partie, relaient parfois des liens sur les réseaux sociaux sans vraiment les consulter. Je soutiens les organisations, les dirigeants, et les efforts au service de plus de justice, d'égalité et de bien-être pour tous, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, hindous, croyants ou athées. Souhaiter faire du mal à autrui va à l'encontre de ma foi et de mes convictions personnelles ».
Quelle qu'ait pu être l'intention de l'imam, personne n'a été en mesure de montrer que ce post de 2015 (en dépit de toute l'attention qu'on lui a porté) s'inscrivait dans une histoire plus ancienne et profonde de propos, d'intérêts, voire de sympathies impardonnables pour la propagande nazie. En cela, un re-tweet, aussi malvenu et critiquable soit-il, ne saurait constituer le fin mot des arrière-pensées secrètes l'imam Zaman, comme de toute autre personne, en l'absence de toute trajectoire idéologique construite et documentée.
En d'autres termes, que ce partage sur réseau social ait valu à Zaman des reproches est bien compréhensible ; qu'en revanche, il soit devenu une nouvelle nationale et ait servi de « preuve » accablante d'intentions effroyables en dit plus long sur l'état du système informationnel et sur la vision chroniquement dystopienne de toute chose pro-palestinienne, ou musulmanne, que sur quoi que ce soit d'autre.
Mais qu'à cela ne tienne, Walz se serait gravement compromis avec rien moins qu'un imam « pro-Hamas » et propagandiste « antisémite » « pro-nazi ». La campagne intense menée sur ce thème, du Daily Caller, nettement d'extrême droite, à CNN en passant par quantité d'autres supports médiatiques, a contraint Morris Allen, rabbin émérite de la congrégation Beth Jacob, du Minnesota, à prendre la défense de Walz, expliquant entre autres que ce dernier a toujours agi dans le sens de la promotion de meilleures valeurs des Juifs et des meilleurs intérêts de l'État d'Israël […] Je n'ai rien vu de l'équipe Harris-Walz qui pourrait laisser entendre quoi que ce soit d'autre qu'un soutien et qu'une conviction dans le bien-fondé de l'État d'Israël, et une attention à la communauté juive. »
La violence de l'attaque contre Asad Zaman au service d'un énième procès en antisémitisme à présent contre une équipe impeccablement pro-Israël, l'absence d'éléments à charge connus et vérifiés, le déni de toute explication quant à une banale subvention de 100 000 dollars et la manipulation de cette « information », et la construction de l'imam en incarnation de l'« islamo-nazisme », font descendre toujours un peu plus profondément dans l'abysse islamophobe, du racisme anti-palestinien, et de la haine féroce de tout ce qui s'apparente de près ou de loin à un discours de justice sociale, tel que porté par Tim Walz, en l'occurrence, où d'Asad Zaman lui-même, d'ailleurs.
Reste que tant d'ébriété présente le grand mérite d'assourdir toujours un peu plus le vacarme de la catastrophe génocidaire en cours ; un étudiant portant un keffieh sur un campus et réclamant la fin des liens entre son université et des universités ou des entreprises israéliennes compromises dans la colonisation, et l'application du droit international, représenterait un problème bien plus grave et imminent qu'une bombe MK84 de plus de 900 kilo sur une école de Gaza et la poursuite de livraisons en masse d'armes américaines à Israël.
En outre, cette ivresse aura presque permis de faire aussi oublier la fascination avérée, consciente, explicite et active pour le nazisme d'une grande partie de l'extrême-droite suprémaciste de notre époque, fascination dont les manifestations abondent, que l'on pense, entre autres, au soutien du site ouvertement néo-nazi « The Daily Stormer » à la candidature de Trump en 2015, ou plus récemment, au long entretien proposé par Tucker Carlson, célèbre animateur de Fox News, conspirationniste, trumpiste inconditionnel et adepte du culte du chef[12], avec Darryl Cooper, révisionniste du nazisme, et présenté par Carlson comme « le meilleur et le plus intègre historien aux États-Unis ».
Harris a bien tenu des propos indiquant qu'elle ne pouvait être indifférente, pas tant au sort des palestiniens eux-mêmes qu'à l'impatience et à la colère d'une partie importante de l'électorat démocrate et dont l'une des premières expressions est d'ailleurs venue du sein même de l'administration Biden-Harris ; en novembre 2023, quatre cents employés fédéraux œuvrant dans trente départements et agences gouvernementales différentes avaient déjà adressé une lettre appelant le tandem présidentiel à exiger un cessez-le-feu, la libération des tous les captifs injustement retenus, israéliens et palestiniens, le rétablissement de l'eau, de l'électricité, des services de base, et le libre passage de l'aide humanitaire. Cette contestation allait par la suite prendre racine dans le parti démocrate dans le cadre des primaires au sein des États.
Harris dût bientôt montrer (en mars) une certaine capacité à « entendre ». Et bien plus tard encore, après des démissions de responsables politiques, notamment juives (à commencer par celle de Lily Greenberg Call, le 15 mai 2024[13]), en signe de protestation, Harris en vint à déclarer qu'elle ne resterait pas « silencieuse », et que la manière dont Israël mène cette guerre « compte » (fin juillet). Ce choix des termes, bien qu'on ne pouvait plus minimal, parut indiquer une inflexion importante.
Mais sans doute serait-il plus approprié de parler de diversion bien peu honorable que de concession, compte tenu des déclarations et de la démission de Stacy Gilbert un peu moins de deux semaines après Greenberg Call. Gilbert, depuis vingt ans fonctionnaire du Département d'État, comptait parmi le groupe d'experts travaillant au rapport devant être remis au Congrès sur le comportement d'Israël en matière d'aide humanitaire.
Selon Stacy Gilbert, le rapport final, qui fut retiré aux experts pour être finalisé par leurs supérieurs hiérarchiques, concluait qu'Israël n'entravait pas l'aide humanitaire et que les livraisons d'armes ne contrevenaient donc pas à la loi américaine qui interdit toute livraison d'armes à des belligérants qui entraveraient cette assistance. Pour Gilbert, la conclusion selon laquelle « Israël ne bloque pas l'aide humanitaire est clairement et manifestement fausse » [‘The determination that Israel is not blocking humanitarian assistance is patently, demonstrably false‘].[14]
En dépit des attentes suscitées, la compassion de la vice-présidente face aux souffrances palestiniennes et son émoi devant le nombre des victimes innocentes, sans surprise, donc, ne l'incitèrent finalement en rien à renoncer aux vingt milliards d'équipements militaires à Israël à la mi-août 2024 (décision à laquelle Sanders et quelques autres sénateurs ont tenté de s'opposer). Et le 30 août, elle déclarait à nouveau sur CNN à Dana Bash : « Mon soutien à la défense d'Israël et à sa capacité à se défendre est sans équivoque et inébranlable, et ceci ne changera pas ».
Entre temps, la convention du parti démocrate qui s'est tenue du 19 au 22 août refusait qu'une voix palestinienne-américaine – en l'occurrence, celle de Ruwa Romman, élue démocrate à la chambre des représentants de l'État de Géorgie depuis 2022 – s'exprime à la tribune, comme ont été invités à le faire les parents d'un captif américain, Hersh Goldberg Polin dans la bande de Gaza.
Par ce refus, la campagne Harris-Walz a choisi de tourner le dos au mouvement des 740 000 électeurs et électrices démocrates qui ont refusé de se prononcer sur leur soutien à la campagne démocrate (the Uncommitted) tant que le parti ne prendrait pas position sur le cessez-le-feu et l'embargo sur les armes. Une troisième revendication était, précisément, de faire entendre une voix palestinienne-américaine à la tribune de la convention.
L'effectif des Uncommitted peut paraître faible à l'échelle de l'électorat national. Il pose cependant un enjeu électoral réel dans des États comprenant d'importantes communautés arabes-américaines profondément heurtées par la politique de Biden au Moyen-Orient, et où la majorité démocrate reste incertaine. C'est le cas par exemple du Michigan ou du Minnesota. Ce mouvement a reçu le soutien de la gauche antisioniste présente dans de nombreux autres États et milieux sociaux. En outre, The Uncommitted était dûment représenté à la convention démocrate, ses résultats locaux lui ayant permis de constituer un groupe d'une trentaine de déléguéEs.
Cette attitude de la direction démocrate tenait certainement, pour une part, à un choix tactique de se tourner vers une partie de l'électorat républicain susceptible d'être rebuté par la seconde candidature Trump. Le ralliement de Cheney fille et père – le prince des ténèbres des années Bush junior – à la campagne de Harris, a sans doute contribué a renforcer à cet alignement. Mais plus profondément, le refus démocrate trahit la persistance d'un triple consensus bipartisan historique.
A un niveau général et principiel, en quelque sorte, on pense d'abord au consensus hyper-militariste dont, depuis 1945, la mort de masse, du Japon et de la Corée au Guatemala en passant par l'Irak, a été une dimension normale, voire, souhaitable, de la politique extérieure américaine ; on doit pouvoir considérer que la possibilité de tuer des personnes en très grand nombre est inhérente à l'énormité même des budgets militaires américains (886 milliards de dollars 2023.)
L'expérience historique comme les moyens existants ne permettent malheureusement pas d'écarter ce présupposé, aussi pessimiste puisse-t-il être. Un deuxième niveau est celui du consensus plus particulièrement antimusulman depuis le 11 septembre 2001. Mais il faut lui ajouter le revers de l'inconditionnalité du soutien à Israël, à savoir, le consensus raciste spécifiquement anti-palestinien, comme le rapport « Anti-Palestinian at the Core : the Origins and Growing Dangers of US Antiterrorism Laws » (02.2024) de l'organisation Palestine Legal en a fait la démonstration.[15]
Cependant, cette inertie génocidaire rencontre désormais un ensemble de paramètres nouveaux dont The Uncommitted aura été l'un des signaux importants, comme indication, ou confirmation et enracinement de la fin du consensus bipartisan sur l'allié Israël.
Un second paramètre tient à l'affirmation toujours plus nette d'une jeune génération qui, pour pouvoir être juive, reconnaît et défend la nécessité à la fois intime et politique de l'antisionisme.
Reste enfin l'affirmation inédite de musulmans américains, et notamment de femmes musulmanes américaines dans la vie politique et institutionnelle des États-Unis. à la suite des élues au congrès, se font entendre les voix de Ruwa Romman élue en Géorgie, ou de la militante démocrate et porte-parole des 46000 « Uncommitted » du Minnesota, Asma Mohammed Nizami.
Autre signe de cette tendance : l'année 2022 a vu un niveau de participation historique – et de succès- de candidatEs musulmanEs américainEs aux scrutins de mi-mandat ; sur les cent-cinquante-trois candidatEsqui se sont présentéEs (au niveau local, d'État, fédéral, ou pour des sièges de juges), quatre-vingt-neuf ont été éluEs. Certes, les unEs et les autres ne sont pas épargnéEs par les rejets[16] et autres surenchères racistes et islamophobes de la période. Il demeure qu'en contrepoint des forces du pire prennent formes des convergences politiques propres à modifier le regard sur ce pays, à commencer peut-être par celui qu'il porte sur lui-même, et propres à susciter un peu d'espoir aussi au-delà de ses frontières.
Annexe
Après plusieurs jours d'attente, n'étant pas finalement invitée à lire son texte à la tribune de la convention démocrate des 19-22 août, la déléguée Uncommitted, Ruwa Romman, en a donné lecture à l'extérieur de l'United Center (Chicago) qui accueillait l'évènement. En préambule, Romman a déclaré :
« Ce que je vais vous lire est, franchement, très inoffensif. L'intention était d'avoir une chance de représenter une voix palestinienne. Mais je suis terriblement désemparée parce que nous sommes venuEs ici pour apporter un présent ; nous sommes venuEs ici pour donner une occasion de combler le décalage entre notre parti et nos électeurs et électrices. Si vous allez voir à l'intérieur de cette convention, tellement de gens sont là avec leur badge, leur keffieh, leur drapeau… C'est très regrettable. »
Romman lit par la suite le texte suivant :
« Mon nom est Ruwa Romman et j'ai l'honneur d'être la première palestinienne élue à une fonction publique dans le grand État de Géorgie et la première palestinienne à prendre la parole lors d'une convention démocrate. Mon histoire commence dans un petit village près de Jérusalem, appelé Suba, d'où vient la famille de mon père. Les racines de ma mère sont à Al Khalil, ou Hébron. Mes parents, nés en Jordanie, nous ont amené en Géorgie lorsque j'avais huit ans, et où je vis à présent avec mon merveilleux mari et nos adorables chiens et chats.
Durant mon enfance, mon grand-père et moi avions un lien privilégié. Il était le complice de mes coquineries, en me donnant en cachette des bonbons qui venaient de l'épicerie, ou en glissant un billet de 20 dollars dans ma poche avec un clin d'œil entendu et un sourire. C'était mon rocher, mais il est parti il y a quelques années, sans jamais revoir Suba ou la Palestine en général. Il me manque, chaque jour qui passe.
Cette année a été particulièrement dure. Tandis que nous étions les témoins moraux des massacres à Gaza, j'ai pensé à lui, me demandant si c'était là la souffrance qu'il ne connaissait que trop. En assistant aux déplacements des Palestinien.ne.s d'un bout à l'autre de la bande de Gaza, j'aurais voulu lui demander comment il avait trouvé la force de marcher tous ces kilomètres il y a plusieurs décennies de cela, en laissant tout derrière lui.
Mais dans cette douleur, j'ai pu aussi témoigner de quelque chose de profond – une belle coalition, multiconfessionnelle, multiraciale et multigénérationnelle, montant du désespoir ressenti dans notre parti démocrate. 320 jours durant, ensemble, nous avons exigé que nos lois s'appliquent de la même manière aux alliés comme aux adversaires pour parvenir à un cessez-le-feu, pour que l'on arrête de tuer des Palestinien.ne.s, pour que l'on libère tous les otages israéliens et palestiniens, et pour engager le difficile travail de construction d'une voie vers la sécurité et la paix pour tous. Voilà pourquoi nous sommes ici, membres de ce parti démocrate pour la défense de droits égaux et de la dignité de tous. Ce que nous faisons ici rencontre un écho partout dans le monde.
Certains diront qu'il en a toujours été ainsi, que rien ne peut changer. Mais souvenons-nous de Fannie Lou Hamer[17], dont le courage lui valut d'être rejetée, et qui cependant ouvrit la voie à un parti démocrate sans discrimination. Son héritage reste d'actualité et nous continuons de suivre son exemple.
Mais nous ne pouvons y arriver seulEs. Ce moment historique est plein de promesse, à la condition d'être uniEs. La plus grande force de notre parti a toujours consisté en notre capacité à nous unir. Certains y voient une faiblesse, mais il est temps d'exercer cette force.
Soyons les unEs des autres, engageons-nous à faire élire la vice-présidente Harris et à battre Donald Trump qui utilise mon identité en guise d'insulte. Battons-nous pour des réformes qui n'ont que trop tardé, de la restauration du droit à l'avortement à l'établissement d'un salaire de vie, pour la fin d'une guerre effroyable et pour un cessez-le-feu à Gaza. A celles et ceux qui doutent de nous, aux cyniques et à nos détracteurs, je dis, oui, nous pouvons – oui nous pouvons être un parti démocrate qui donne priorité au financement des écoles et des hôpitaux, et non aux guerres sans fin ; qui se bat pour une Amérique qui appartient à nous toutes et tous – noirs, basanés et blancs, juifs et palestiniens, nous toutes et tous -comme mon grand-père me l'a enseigné- ensemble ».
Notes
[1] On doit à Antony Lerman une reconstruction d'une utilité inestimable de cette histoire : Antony Lerman, Whatever Happened to Antisemitism ? Redefinition and the Myth of the ‘Collective Jew', Londres, Pluto Press, 2022.
[2] Un épisode d'AJ+ de la chaîne al-Jazeera analyse utilement cette substitution.
[3] Cf. Norman G. Finkelstein, Beyond Chutzpah : On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, Londers & new York, Verso, 2005, p.21-25.
[4] Dont le président, Jonathan Greenblatt, a déclaré plus tôt cette année que « si vous ne toléreriez pas que quelqu'un porte une swastika sur sa manche, désolé, vous ne devriez pas tolérer le port du keffieh ».
[5] Question qui dans le contexte irlandais – pour rester dans la zone euro-américaine – occupe une place historiquement singulière.
[6] Emily Tamkin, « No, Josh Shapiro Wasn't Snubbed for VP Because He's Jewish » [Non, JS n'a pas été recalé parce qu'il est juif], The Nation, 8 août 2024.
[7] « Tim Walz : Anti-Israel Protesters ‘Speaking out for all the Right Reasons' », 7 sept 2024 https://www.jewishpress.com/news/
[8] Il faudrait s'intéresser ici au cas remarquable de Laura Loomer, figure de la fachosphère américaine suivie par 1,2 millions de personnes (Reuters). Loomer se déclare « fièrement islamophobe » (l'Islam étant, selon elle, « le cancer de l'humanité ») et s'autorise de sa judéité pour traiter de « kapos » et de « nazis » les soutiens juifs des démocrates. Suggestion récente de sa part : « vous pouvez aller vous-mêmes vous mettre dans une chambre à gaz si c'est comme ça que vous voulez vous conduire ». Laura Loomer reçut l'investiture du parti républicain en 2020 dans le 21e district de Floride où, détail intéressant, se trouve Mar-a-Lago, la résidence de D.Trump lui-même (The Forward). Récemment encore, il était question que Loomer intègre l'équipe de campagne de Trump, qui se contente finalement d'accepter son soutien (Reuters).
[9] Selon le journal d'extrême-droite, Washington Examiner, qui a « mené l'enquête ».
[10] Par exemple, l'attaque du Centre islamique Dar-al-Farooq (Bloomington, Minnesota) en août 2017.
[11] Épisode et contradiction bel et bien tragiques par ailleurs. Voir par exemple ici.
[12] Comme en atteste le discours qu'il prononce dans la vidéo disponible sur le site Mmsnbc (voir le lien).
[13] Dans sa lettre, Greenberg Call disait entre autres : « « Je ne peux plus, en toute bonne conscience, continuer à représenter cette administration face au soutien désastreux et continu du président Biden au génocide israélien à Gaza. » https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/une-americaine-de-confession-juive-demissionne-de-ladministration-biden-cause-de
[14] Stacy Gilbert fait cette déclaration lors d'un entretien pour Al Jazeera, dans le documentaire « Starving Gaza » diffusé le 29 septembre 2024.
[15] L'analyse proposée par Palestine Legal montre de quelle manière les législations anti-terroristes aux États-Unis ont prioritairement été dirigées contre le mouvement national palestinien.
[16] A l'image de l'expérience d'Asma Nizami avec les services éducatifs du Minnesota : https://www.dailydot.com/debug/minnesota-muslim-organizer-asma-nizami-advisory-group/
[17] Fannie Lou Hamer, 1917-1977, fut une militante pour le droit de vote et pour le droit des femmes, une dirigeante du mouvement pour les droits civiques et la justice raciale ; co-fondatrice, en 1964, du Freedom Democratic Party du Mississipi (MFDP), qui lutta contre les tentatives du parti démocrate local de bloquer la participation des noirs.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

USA : le long travail de sape de la droite radicale

À l'approche de l'élection présidentielle, un enjeu caché pourrait bien influencer le paysage politique américain, quel que soit résultat : les équilibres au sein de la Cour Suprême, où la droite s'est arrogée une position de force. Depuis les années 1970, la « galaxie Leo » s'est structurée pour orchestrer la stratégie judiciaire tous azimut de cette droite, s'opposant à toute initiative progressiste et érodant les acquis de l'État-providence.
18 octobre 2024 | tiré de AOC
ttps ://aoc.media/analyse/2024/10/17/usa-le-long-travail-de-sape-de-la-droite-radicale/
International
Il y a encore deux mois, en juillet, la question pour les électeurs démocrates étatsuniens était : « Donald Trump peut-il encore perdre ? ». La donne a changé le 21 juillet quand Joe Biden a annoncé qu'il renonçait à se représenter, et qu'il adoubait sa vice-présidente Kamala Harris. Certes, les plus fervents partisans de Donald Trump continueront à arborer la casquette rouge MAGA (Make America Great Again). Mais Kamala Harris a immédiatement fait l'unanimité au sein du Parti démocrate.
publicité
Des adversaires possibles, comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom, se sont ralliés à elle. Plusieurs délégations d'États ont annoncé qu'elles reportaient leurs délégués sur la vice-présidente. Celle-ci a obtenu l'investiture officieuse puis officielle du parti en un temps record. Elle a collecté six-cent-quarante millions de dollars en six semaines, alors que les donateurs avaient cessé de contribuer à la campagne Biden. Elle a aussi attiré plus de 200 000 volontaires, signe de l'enthousiasme que soulève le Parti démocrate, mais aussi des indépendants et des indécis, soulagés de ne pas avoir à revivre le match entre deux vieux messieurs, Trump contre Biden.
Outre les lourdes conséquences qu'aura le choix de porter Kamala Harris ou Donald Trump à la présidence, d'autres enjeux sont moins visibles, mais cruciaux. Il s'agit d'abord des équilibres politiques dans les deux chambres.
Si Donald Trump remporte l'élection, le seul contre pouvoir serait une (incertaine) majorité démocrate à la Chambre des représentants. Si Kamala Harris est élue, elle sera condamnée à l'impuissance dans le cas où les Républicains détiendraient les deux chambres. Même s'ils dominaient le seul Sénat, elle serait sans cesse empêchée par l'obstructionnisme des Républicains. Difficile, voire impossible dès lors d'obtenir la validation de ses choix de ministre ou de juge fédéral, comme Obama a pu l'endurer après la victoire républicaine du Tea Party de 2010.
Si elle veut continuer les politiques de son prédécesseur en faveur de la classe moyenne, il lui faudra disposer d'une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Cela reste possible à la Chambre, mais plus difficile au Sénat en raison de la carte électorale désormais défavorable aux démocrates. En effet, vingt-deux des sièges à pourvoir (des candidats cherchant à se faire réélire ou des sièges « ouverts ») sont actuellement détenus par les démocrates (qui ont au total cinquante sièges). Les démocrates sont déjà certains de perdre au moins le siège de Joe Manchin qui ne se représente pas en Virginie occidentale. Or, il s'agit d'un État rouge dans lequel Joe Manchin réussissait jusqu'ici à se faire réélire avec une politique et un discours très centristes.
Même dans l'hypothèse d'une victoire démocrate dans les deux chambres, peu de lois seront adoptées car la procédure législative aux États-Unis est un parcours du combattant qui ne comporte aucune des règles du parlementarisme rationalisé de la Ve république en France – règles souvent critiquées comme le 49-3, mais qui facilitent l'adoption d'une loi ou d'un budget. Aux États-Unis, la majorité au Sénat n'est pas de cinquante-et-une voix (sur cent sénateurs) mais de soixante, en raison de l'obstruction par filibuster. Et compte tenu des nouveaux membres encore plus extrémistes, peu de projets bi-partisans seront adoptés.
Comme Joe Biden et Barack Obama avant elle, Kamala Harris sera alors contrainte de recourir aux décrets présidentiels et ceux-ci, comme ceux de ses prédécesseurs démocrates à la Maison Blanche, seront systématiquement contestés en justice par ce qu'on appelle « la galaxie Leo », du nom de celui qui dirigea pendant vingt ans la Federalist Society.
La mobilisation de la droite
Dans les années 70, les conservateurs et le monde des affaires ont pris conscience qu'ils n'étaient pas assez présents dans le débat médiatique et dans le jeu électoral. Le mémorandum de l'avocat Lewis Powell, qui défendait l'industrie du tabac à l'époque et deviendra plus tard juge à la Cour suprême, marque un tournant. Il incitait les entreprises à se mobiliser, à créer des comités d'action politique (PAC), de façon à ce que leurs salariés et cadres puissent verser des contributions aux candidats privilégiés par la droite. Le nombre de ces PAC des affaires et des contributions électorales versées aux conservateurs a alors explosé.
En 1982 fut ensuite créée la Federalist Society, sous l'égide d'Edwin Meese (ministre de la Justice de Reagan) et d'Antonin Scalia (qui deviendra lui aussi juge à la Cour suprême). Elle était et reste aujourd'hui la cheville ouvrière de cette galaxie de droite. Sa mission était d'identifier de jeunes juristes conservateurs prometteurs via la création d'antennes dans les facultés de droit et au sein des délégations locales de l'Association du barreau (ABA), puis de peupler les ministères de ces recrues. Le but ultime était de capturer les juridictions fédérales, de première instance et les cours d'appel, et la Cour suprême afin de mettre fin aux « dérives progressistes » du pouvoir judiciaire responsable des grandes avancées des années 1950-1970, comme la déségrégation, les droits des inculpés ou le droit à l'avortement.
Constituée en association à but non-lucratif sous le régime fiscal favorable des 501(c)(3) selon la nomenclature du Code des impôts, la Federalist Society ne doit pas avoir plus de 50 % d'activités de nature politique. Mais elle travaille en étroite coordination avec des groupes qui, eux, peuvent s'impliquer en politique, financés par les mêmes milliardaires libertariens.
La stratégie première de la Federalist Society consiste à influencer les nominations des juges des juridictions fédérales et de la Cour suprême, choisis par les présidents, ainsi que l'attitude des sénateurs chargés par la Constitution de confirmer ou non les candidats du président. Sa deuxième mission, moins connue jusqu'à récemment, consiste à orchestrer (et financer) des actions en justice sur les grandes questions au sujet desquelles la droite vise une réorientation du droit : les priorités tout à la fois des entreprises et des milliardaires (dérégulation) et celles de la droite religieuse, contre l'avortement et les droits des LGBT.
À la tête de la Federalist Society pendant deux décennies, Leonard Leo s'est attaché à faire nommer des juges « estampillés conformes ». Sous la présidence de G.W. Bush, il a dépensé des dizaines de millions de dollars en publicités et opérations de relations publiques pour faire avancer les candidatures de ceux qui allaient devenir, pour l'un – John Roberts – le président de la Cour suprême, et pour l'autre – Samuel Alito – celui qui a rédigé l'opinion majoritaire de la décision Dobbs v. Jackson Women's Heath Organization de 2022, qui a opéré le revirement de jurisprudence en matière de droit à l'avortement.
Le grand public a appris l'existence et compris le rôle de la Federalist Society en 2016, quand son dirigeant Leo a conduit le candidat Trump à faire campagne sur onze noms de candidats à la Cour suprême, tous choisis par ses soins. La stratégie a été gagnante : 80 % des évangéliques ont voté pour Donald Trump cette année-là, et 90 % des juges nommés par Trump durant son mandat sont membres de la Federalist Society, dont 86 % des juges d'appel et les trois juges nommés à la Cour suprême (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett). Ils sont anti-avortement et anti-régulation, non susceptibles de décevoir en évoluant vers le centre comme certains de leurs prédécesseurs – ainsi du juge Kennedy, qui avait voté avec les progressistes pour inscrire le mariage pour tous dans la Constitution.
La galaxie Leo
La Federalist Society est la clé de voûte d'une galaxie de groupes de droite qui travaillent ensemble et sont financés par les dons anonymes de plusieurs millions de dollars chaque année.
Ces groupes ont dépensé sept millions de dollars pour bloquer la candidature à la Cour suprême en 2016 de Merrick Garland, le candidat pourtant très modéré, proposé par le président Obama après le décès du juge Scalia. Ces mêmes groupes ont ensuite dépensé plus de dix millions de dollars pour soutenir la candidature de Neil Gorsuch, nommé par Donald Trump dès son entrée en fonction en janvier 2017. En 2021, le Concord Fund a dépensé plusieurs millions de dollars pour discréditer la candidate Ketanji Brown Jackson, première juge afro-américaine, nommée par le président Biden pour succéder au juge Stephen Breyer, poussée à démissionner tant que le président Biden disposait d'une majorité démocrate au Sénat.
Les organismes et groupes de la galaxie Leo sont nombreux et ont pour caractéristique première de porter des noms trompeurs. Ainsi, le « projet pour des élections honnêtes » (Honest Elections Project) et le « réseau pour l'intégrité électorale » (Restoring Integrity and Trust in Elections) ont pour objectif affiché de restaurer l'intégrité et la confiance dans les élections alors qu'ils cherchent en réalité à instiller le doute et la méfiance envers le processus électoral.
Ils diffusent des informations fausses sur la fraude électorale dans l'élection de 2020, démenties par les études dont celle du Brennan Center. Le groupement Students for Fair Admission (Étudiants pour des procédures d'admission justes) crée par Edward Blum lutte activement contre toute prise en compte de facteurs raciaux en matière de découpage électoral ou pour l'entrée à l'université, et est à l'origine de plusieurs contentieux dans lesquels il a obtenu gain de cause.
La Fondation juridique pour l'intérêt public (Public Interest Legal Foundation ou PILF), contrairement à son nom ronflant, travaille à faire adopter des restrictions sur le droit de vote et à procéder à des radiations d'électeurs destinées à affecter en premier lieu et de façon disproportionnée, les membres des minorités qui ont tendance à voter pour les démocrates. Sans oublier le groupe Citizens United à l'origine de l'action en justice qui a permis la dérégulation des financements électoraux en 2010.
Tous ces groupes partagent des locaux communs et ont recours aux mêmes cabinets d'avocats. Leurs fonds proviennent des mêmes financeurs qui leur font passer les sommes nécessaires pour organiser leur stratégie juridictionnelle et « monter » les affaires. Ce sont eux qui mettent en musique la composante judiciaire de la stratégie tous azimuts de la droite.
Les financeurs
Malgré le travail mené par des journalistes d'investigation, des médias comme Lever ou Politico et des associations qui épluchent documents financiers et déclarations d'impôts pour tenter de dépasser l'anonymat des donateurs, il est difficile et remonter jusqu'aux vrais financeurs de ces groupes, de connaître les destinataires précis et les sommes exactes collectées. En effet, la Cour suprême par ses décisions invalide les mesures de transparence, considérant qu'elles portent atteinte à la libre expression ; ainsi dans Americans For Prosperity Foundation v. Bonta en 2021.
Toutefois plusieurs fondations et milliardaires ont été identifiés comme finançant régulièrement ces groupes. Parmi eux, les frères Koch qui soutiennent le centre pour les études sur l'immigration (Immigration Centre) qui est anti-immigrants, la fondation Bradley qui a fait passer depuis 2000 plus d'un demi-milliard de dollars dans des projets opaques (dark money) comme les atteintes au droit de vote (voter suppression), les initiatives pour privatiser les écoles publiques ou les attaques contre les droits des travailleurs et les syndicats. Citons aussi la famille Scaife, héritière d'une fortune d'entreprises industrielles, qui a versé des millions de dollars à des groupes affirmant œuvrer pour l'intérêt public et qui combattent pourtant les réglementations environnementales… comme l'American Civil Rights Institute qui, en dépit de son nom, ne défend pas les droits civiques.
La droite a enfin atteint son objectif, la Cour suprême est dorénavant composée de six juges que l'on ne peut plus appeler conservateurs mais « républicains », ou même radicaux dans le cas des juges Thomas et Alito. Pendant vingt ans, la Cour avec une majorité de cinq juges conservateurs sur les neuf s'était contentée d'affaiblir graduellement nombre de précédents progressistes mais ce n'était pas trop visible.
Certes depuis 2006 et l'arrivée du juge John Roberts, la Cour avait accédé aux desiderata de la droite des affaires, par exemple dans Citizens United en 2010 qui dérégule les financements électoraux. La décision permet aux entreprises et aux milliardaires de peser d'un poids disproportionné dans les élections via les structures idoines créées à cet effet, les super PAC. De même, la décision Shelby de 2013 facilite les victoires législatives de la droite (déjà minoritaire) en invalidant les protections anti-discrimination contenues dans le Voting Rights Act sur le droit de vote de 1965.
Puis en deux ans, le rythme s'accélère. Chaque session judiciaire voit des revirements spectaculaires qui traduisent les priorités de la droite, en matière de droit à l'avortement (revirement de 2022 dans Dobbs) comme de pouvoirs des agences (décision Loper Bright qui invalide le précédent Chevron et prive les agences de leur pouvoir de réglementation en matière de sécurité des produits, comme de lutte contre le réchauffement climatique). Quant à la décision du 1er juillet 2024 qui accorde au président Trump et à ses successeurs une immunité quasi-absolue, elle surprend même les observateurs de droite par son ampleur et les dangers pour la démocratie.
Le but de la droite est de revenir à l'Amérique des années 1920, avant les législations du New Deal, avant l'État-providence et avant les droits civiques. C'est l'Amérique du juge Bork (proposé par Ronald Reagan à la Cour suprême) que dénonçait le sénateur Ted Kennedy en 1986 pour s'opposer à sa candidature, laquelle fut rejetée par cinquante-quatre voix contre quarante-six[1].
En conséquence, la Cour suprême est un enjeu central des élections 2024. Elle l'a été depuis les années 1970 pour les conservateurs ; elle l'est (enfin) devenue pour le Parti démocrate. Si les démocrates détiennent la Maison-Blanche et de solides majorités dans les deux chambres, ils peuvent tenter de faire adopter des lois pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême, revenir sur ses décisions les plus réactionnaires et dangereuses pour la démocratie, comme sanctuariser le droit de vote et le droit à l'avortement. Si Trump est élu, le sera-t-il grâce à la bienveillance de la Cour lors des éventuels et probables contentieux post-élection ?
En cas d'abus et de violations de la loi et de la Constitution, la Cour invalidera-t-elle les décisions de celui qui annonce lui-même qu'il se conduira en dictateur comme le confirme le « Projet 2025 » ou projet « de transition présidentielle » proposé par la Fondation conservatrice Heritage ? Même si Trump a cherché à prendre ses distances vis à vis de politiques rejetées par une large majorité des Américains, il continue à annoncer la suppression du ministère de l'enseignement et d'autres mesures phares de ce Programme 2025 rédigé par nombre de ses anciens conseillers.
NDLR : Anne Deysine vient de faire paraître Les juges contre l'Amérique aux Presses universitaires de Nanterre.
Anne Deysine
Juriste et américaniste, Professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre
Note :
[1] « L'Amérique de Robert Bork est un pays où les femmes seraient vouées aux avortements clandestins, où les Noirs devraient déjeuner et dîner dans des espaces ségrégés, où des policiers sans foi ni loi feraient irruption en pleine nuit chez les citoyens.. … ». Extraits du discours prononcé le 23 juin 1987 par le sénateur démocrate Ted Kennedy en opposition à la nomination du juge Bork à la Cour suprême par Ronald Reagan.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le « pacte du silence » entre les Israéliens et leurs médias

Les médias d'Israël, depuis longtemps asservis, ont passé l'année dernière à imprégner le public d'un sentiment de légitimité à l'égard de la guerre de Gaza. Selon l'observateur des médias Oren Persico, inverser cet endoctrinement pourrait prendre des décennies.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Au milieu de notre conversation, Oren Persico fait un aveu surprenant. Ce journaliste israélien chevronné, dont le travail a consisté pendant la majeure partie des vingt dernières années à surveiller les médias de son pays, ne regarde pas les journaux télévisés israéliens.
« Je n'y arrive tout simplement pas », m'explique Persico, qui travaille depuis 2006 comme rédacteur pour le site israélien de surveillance des médias The Seventh Eye. « C'est déprimant et exaspérant — c'est de la propagande, c'est plein de mensonges. C'est surtout le reflet de la société dans laquelle je vis, et il m'est difficile de rompre la dissonance entre ma vision du monde et ce qui m'entoure. J'ai besoin de garder la raison ». Au lieu de regarder la télévision, Persico se tient au courant en faisant défiler les sites d'information, les médias sociaux et en regardant des clips sélectionnés que les gens lui envoient.
Mais même le fait d'éteindre la télévision ne peut pas arrêter la dissonance et le désespoir que ressent Persico, qui n'ont fait que croître depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre et l'assaut de l'armée israélienne sur la bande de Gaza qui s'en est suivi pendant un an. Lorsque la guerre a commencé, les médias israéliens se sont trouvés dans une situation critique, devant faire face au traumatisme d'une nation ébranlée par une violence sans précédent et qui s'est rapidement repliée sur une perception profondément ancrée de victimisation historique. Les chaînes d'information ont réagi à ce traumatisme national, note Persico, en se laissant encore davantage prendre dans les griffes de la propagande sanctionnée par l'État.
Alors que les jours de violence brutale se sont transformés en semaines et en mois, les médias israéliens sont revenus à des schémas familiers : se rassembler autour du drapeau, amplifier les récits de l'État et marginaliser toute couverture critique de la brutalité d'Israël à Gaza, sans parler de montrer des images ou de raconter les histoires des souffrances humaines parmi les Palestinien-nes de la bande de Gaza.
Le chemin qui mène à ce moment est tracé depuis longtemps. Le paysage médiatique israélien, qui, selon M. Persico, a toujours été soumis à l'establishment politique et militaire, a subi des pressions incessantes de la part de Benjamin Netanyahou au cours de la dernière décennie ; le premier ministre israélien a tenté de le transformer en un outil permettant d'exercer le pouvoir et, en fin de compte, d'assurer sa propre survie politique. Les médias commerciaux, plus intéressés par la fidélisation des téléspectateur-ices que par la contestation du pouvoir, sont devenus la proie de la stratégie de coercition, d'autocensure et de pression économique de Netanyahou.
Ces dernières années ont également vu l'essor rapide de Now 14 (plus connu sous le nom de Channel 14), la version israélienne de Fox News, qui s'est ouvertement alignée sur Netanyahou et concurrence aujourd'hui la domination de longue date de Channel 12. Elle propose aux téléspectateur-ices non seulement des informations, mais aussi des polémiques anti-palestiniennes – souvent ouvertement génocidaires – conçues comme du divertissement. En utilisant habilement des organes de propagande tels que la chaîne 14, de même que les médias sociaux, Netanyahou s'est assuré une audience dévouée qui le défend et le soutient face à la pression nationale et internationale.
Dans un entretien avec +972, qui a été raccourci et édité pour plus de clarté, Persico réfléchit au rôle historique des médias dans la négation des violations des droits de l'homme par Israël, à leur incapacité à remettre en question l'establishment politique et à l'absence quasi-totale de solidarité envers les journalistes palestinien-nes sous les bombardements à Gaza.
Décrivez-moi le paysage médiatique israélien à la veille du 7 octobre.
Le 6 octobre, les médias israéliens – qu'ils soient publics ou privés, à la télévision, à la radio ou sur l'internet – étaient affaiblis et assiégés après plus d'une décennie de lutte acharnée du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour les contrôler. Alors que certains médias étaient simplement devenus un outil dans la guerre de propagande de Netanyahou, d'autres se sont progressivement soumis à ses pressions, en diffusant les alliés du Premier ministre et les points de discussion dans leurs émissions.
[Quelques mois avant le 7 octobre], le ministre des Communications, Shlomo Karhi, avait annoncé un projet de loi visant à réformer le paysage médiatique, basé sur son désir de fermer la Société publique de radiodiffusion d'Israël (connue familièrement sous le nom de KAN) et de « s'occuper » (c'est-à-dire d'exercer un contrôle sur) du secteur des médias privés. Tout cela s'est fait sous les slogans d'« ouverture du marché » et de « suppression des barrières » – des slogans qui signifiaient en fait faciliter la tâche des médias qui servent les intérêts de Netanyahou tout en restreignant les médias qui le critiquent.
Quelles mesures Netanyahou et ses gouvernements successifs ont-ils prises pour réprimer la presse au cours des dernières décennies ?
Depuis 1999 [lorsque Netanyahou a perdu les élections après son premier mandat de Premier ministre], il a désigné les médias comme son rival et a progressivement unifié sa base dans une lutte populiste contre eux. C'est particulièrement vrai depuis 2017, avec l'explosion de ses nombreux scandales judiciaires – tous directement liés à ses tentatives de contrôle des médias.
Au cours de la dernière décennie, Netanyahou a tenté de fermer Channel 10 ; a cherché à éviscérer la domination de Yedioth Ahronoth dans la presse écrite israélienne ; aurait promis à un magnat des médias des changements réglementaires bénéfiques en échange d'une couverture positive de lui et de sa famille ; et a méticuleusement placé ses soutiens dans tous les points de vente israéliens possibles, de Channel 12 et de la radio de l'armée israélienne à i24 et à KAN.
Et pourtant, nous ne pouvons pas rejeter toute la responsabilité sur le premier ministre. Netanyahou opère dans un pays où la plupart des médias sont privés et où le public se déplace vers la droite. Ces médias commerciaux ne veulent pas perdre leur audience ni leur lectorat. Ils ne peuvent pas vendre de publicité s'ils n'ont pas d'audience, et ils ne peuvent pas garder leur audience s'ils leur montrent des choses qui les mettent en colère.
Aucune discussion sur les médias israéliens d'aujourd'hui n'est complète sans parler de Channel 14, qui est devenu un tour de force dans le paysage, et qui pourrait encore dépasser Channel 12 dans sa domination. Channel 14 est née de la Jewish Heritage Channel, une petite station qui a échoué dans sa mission de diffusion de contenus religieux et qui n'avait pas de licence de diffusion d'informations. Mais progressivement, Netanyahou et ses alliés ont commencé à s'attaquer à cette réglementation : la chaîne a fini par obtenir une licence pour diffuser des informations et est devenue l'organe de propagande à part entière que nous connaissons aujourd'hui.
Bien qu'elle soit aujourd'hui la deuxième chaîne la plus populaire en Israël, elle continue de recevoir des avantages comme si elle était la petite entreprise qu'elle était à l'origine. Aujourd'hui, la chaîne est détenue par le fils d'un oligarque qui entretient des liens étroits avec Netanyahou et qui aurait des relations avec Vladimir Poutine et d'autres personnages louches.
Avec le début de la réforme judiciaire au début de l'année 2023, de nombreux médias se sont souvenus de leur objectif et de leur rôle : couvrir de manière critique tous les nœuds du pouvoir dans le pays – à la fois les élites économiques et la classe dirigeante. Channel 14, en revanche, a continué à parler d'une seule voix avec le gouvernement.
Les fidèles de Channel 14 forment également une sorte de communauté. Les sondages montrent régulièrement que, contrairement à Channel 11, Channel 12 et Channel 13, dont les téléspectateur-ices passent d'une chaîne à l'autre, ceux et celles de Channel 14 sont des inconditionnel-les de la chaîne [et ne recherchent pas d'informations ou d'analyses sur d'autres chaînes].
Cela signifie-t-il que si Netanyahou se réveille un matin et décide d'adopter une certaine position, Channel 14 transmettra ce message à son audience ?
Comme l'ensemble de l'appareil médiatique que Netanyahou a construit – qui est souvent surnommé la « machine à empoisonner », et qui utilise à la fois les médias conventionnels et les médias sociaux – Channel 14 est un outil de propagande. Elle est perçue comme amusante : elle fournit un divertissement aux masses.
Cela ressemble beaucoup à ce que font Donald Trump et Fox News aux États-Unis. À quoi cela ressemble-t-il sur Channel 14 ?
Les Israélien-nes sont engagé-es dans une guerre sanglante depuis plus d'un an, et ce que leur dit Channel 14, c'est que nous sommes en train de gagner, que la vie est belle. La chaîne met l'accent sur les succès militaires d'Israël tout en minimisant ses échecs – et dénonce les autres chaînes d'information pour avoir encouragé la panique et le défaitisme.
Par exemple, à la suite de l'attaque d'un drone sur une base militaire de Tsahal, qui a tué quatre soldats et en a blessé des dizaines d'autres, les sites des médias israéliens ont maintenu l'histoire en tête de liste pendant toute la nuit et la matinée. Ce n'est pas le cas de Channel 14, qui en a fait le titre principal de son site web pendant une demi-heure, avant de le remplacer par un sondage montrant que la plupart des Israélien-nes sont favorables à une attaque contre l'Iran.
Il cible également les « ennemis communs » – les autres médias, l'élite de l'armée et le procureur général – en les accusant d'être de connivence avec le gouvernement et en les rendant responsables de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement Israël. Elle est pleine d'incitation, de propagande et de théories de conspiration, faisant appel au désir de vengeance du public après le 7 octobre. Les commentateur-ices qui interviennent dans « The Patriots », l'émission phare de la chaîne animée par Yinon Magal, appellent régulièrement au génocide et à l'extermination [des Palestinien-nes]. De nombreux téléspectateur-ices se sentent bien lorsqu'ils ou elles voient cela ; cela confirme leurs sentiments déjà existants.
La popularité du canal 14 semble avoir surgi de nulle part. Comment cela s'est-il produit ?
Au moment où les principaux médias israéliens se sont opposés à la réforme judiciaire, l'audience de Channel 14 a commencé à augmenter rapidement. La deuxième hausse d'audience a eu lieu immédiatement après le 7 octobre. Ces deux augmentations représentent la capacité de la chaîne à former une communauté de leur audience.
Après deux ou trois semaines d'affichage d'une sorte d'« unité nationale » à la suite des attaques du Hamas, les médias israéliens sont rapidement revenus à leurs positions antérieures, soit pro-, soit anti-Netanyahou. Plusieurs voix se sont élevées sur Channel 14 dans les jours qui ont suivi pour blâmer le Premier ministre pour ce qui s'est passé le 7 octobre, mais elles se sont elles aussi très vite repliées sur la ligne du parti.
La croissance continue et la banalisation de Channel 14 après le 7 octobre est, à mon avis, l'évolution la plus significative que nous ayons observée dans les médias israéliens depuis le massacre.
Mais les manifestations de rhétorique extrémiste et de bellicisme ne se sont certainement pas limitées à Channel 14. Nous avons vu cela sur pratiquement tous les médias grand public après le 7 octobre, qu'ils soient ou non critiques à l'égard de Netanyahou.
Vous avez raison, l'ensemble du public israélien a basculé à droite et, pour la première fois de son histoire, Channel 12 doit faire face à une concurrence serrée de Channel 14. Elle a commis l'erreur classique d'essayer de plaire à tout le monde, y compris aux fascistes qui regardent Channel 14, et offre ainsi une tribune à des gens comme Yehuda Schlesinger [qui a appelé à ce que le viol des détenues palestiniennes au centre de détention de Sde Teiman devienne une politique officielle].
Il ne faut pas oublier que les journalistes en Israël font partie de la société israélienne. Ils et elles connaissent des personnes qui ont été tuées ou enlevées le 7 octobre. Ils et elles connaissent des soldat-es à Gaza.
Bien sûr, mais les journalistes ont aussi la responsabilité envers le public de rapporter ce qui se passe, et pas seulement envers les Israélien-nes. Sinon, ils et elles manquent à leur devoir.
C'est vrai, mais je considère également que leur comportement – qui consiste à mettre de côté leur intégrité journalistique afin de créer une sorte d'unité au sein du public – est une réaction naturelle et humaine à la suite d'un événement aussi traumatisant. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, je pense que c'est une erreur. Mais je ne pense pas que je puisse attendre autre chose de leur part.
Ne les ménagez-vous pas un peu ?
Les journalistes israélien-nes considèrent qu'il est de leur devoir patriotique de se concentrer sur notre statut de victime, d'ignorer les victimes de l'autre côté et de remonter le moral national, en particulier celui des soldats israéliens. Je pense que la chose patriotique à faire est de fournir des informations fiables au public afin qu'il puisse se faire une idée réelle de ce qui se passe autour de lui. Sinon, la société israélienne – ou toute autre société – aura une compréhension déformée de la réalité, fondée sur l'ignorance, le mensonge et le déni. Cela conduit à une société faible qui peut s'effondrer beaucoup plus facilement. Déclarer la vérité aura l'effet exactement inverse, mais les journalistes d'ici ne le croient pas.
Les médias israéliens montrent-ils au public ce que l'armée fait aux Palestiniens de Gaza ?
Non.
S'intéressent-ils aux violations des droits de l'homme commises par les Israéliens en Cisjordanie ?
Non.
Est-ce qu'ils retracent les mensonges répétés du porte-parole des FDI ?
Non.
Je comprends votre point de vue sur les premières semaines au cours desquelles les journalistes ont été profondément traumatisé-es, mais nous sommes un an après le 7 octobre et les journalistes continuent, pour la plupart, à abdiquer leurs responsabilités lorsqu'il s'agit de faire face à ces questions fondamentales. Ont-ils et elles simplement cessé de s'en préoccuper ?
L'ensemble de la société israélienne a de nombreuses années d'expérience dans l'ignorance de nos crimes contre les Palestinien-nes. Qu'il s'agisse de la Nakba, qui est un sujet totalement tabou, ou de l'occupation militaire permanente de millions de personnes. Les médias et leur public sont impliqués en concluant une sorte de pacte du silence : le public ne veut pas savoir, alors les médias n'en parlent pas. Ces mécanismes psychologiques étaient déjà tellement enracinés que le 7 octobre, ils se sont mis en marche et n'ont fait que s'amplifier.
Ce que nous avons vu au cours de l'année écoulée est le résultat d'un processus de plusieurs décennies visant à faire comprendre aux journalistes et aux téléspectateur-ices qu'il y a des choses dont nous ne parlons tout simplement pas et que nous ne montrons pas dans les journaux télévisés. La plupart des journalistes qui travaillent dans ces grands médias savent ce qui se passe, mais ils et elles ne veulent pas s'aliéner leur audience de peur de perdre en popularité. Il faudra des décennies pour inverser ce type d'endoctrinement.
Ils font comme si ces choses n'existaient pas ?
Les médias grand public comprennent que les violations des droits de l'homme ne sont pas une chose à célébrer, alors ils les ignorent tout simplement. Nous ne voyons pas de gros titres sur le ministère de la santé de Gaza annonçant que 40 000 Palestinien-nes ont été tué-es à Gaza. Nous ne voyons pas d'histoires humaines de Palestinien-nes sous les bombardements israéliens. Nous n'entendons pas parler des maladies qui ravagent la bande de Gaza. Personnellement, ce que j'ai entendu de la part des journalistes, c'est que « ce n'est tout simplement pas le moment de parler de ces questions ».
Il semble qu'à chaque fois que l'on allume l'une de ces chaînes d'information, on revit constamment les horreurs du 7 octobre, que ce soit à travers des récits de survivant-es ou de nouveaux rapports d'enquête. Quel effet cela a-t-il sur le public israélien ?
Le 7 octobre a été un événement qui a replacé les Juif-ves israélien-nes dans la position de la victime historique. Les images de kibboutzim et de villes israéliennes envahies et massacrées par des tireurs du Hamas nous rappellent les images historiques de l'Holocauste. Ce n'est pas une plaisanterie : nous sommes une société profondément post-traumatique qui n'a pas encore surmonté l'Holocauste, et ce jour-là, l'État qui était censé empêcher de futurs Holocaustes n'a pas réussi à le faire.
Et pourtant, la propagande que nous avons vue dans les journaux télévisés au cours de l'année écoulée ne fait que renforcer et justifier la violence de l'État à l'encontre des Palestinien-nes. Elle rationalise la nécessité de faire tout ce qui est nécessaire pour anéantir ceux qui sont dépeints comme un « mal absolu ». En fin de compte, cela donne aux Israélien-nes un sentiment de droiture, ce qui est nécessaire au cours d'une longue guerre dont la fin n'est pas clairement définie.
Quelle est l'influence réelle des médias israéliens sur le public, en particulier lorsque tant de personnes ont accès à d'autres formes d'informations sur les médias sociaux ?
Si, par le passé, le rôle des médias était de servir de médiateur et d'organiser la réalité [pour le public], le rôle central des médias israéliens aujourd'hui est de marquer les limites de la légitimité par rapport au discours public, ainsi que de déterminer qui est autorisé à participer à ce discours. Si vous regardez la chaîne 12, par exemple, vous verrez que lorsqu'il s'agit de questions militaires, ce sont d'anciens militaires – des hommes pour la plupart – qui participent à la conversation.
Il est également difficile d'éviter une autre dimension du rôle des médias : fournir une plateforme pour les efforts de la hasbara israélienne, et souvent servir de bras armé à cette dernière, avec des influenceurs tels que Yoseph Haddad apparaissant régulièrement dans les différents journaux télévisés.
Absolument. La hasbara est très demandée, et les médias – privés ou non – l'offrent au public, parce que c'est ce qu'il veut. Cela a atteint un point tel que Yoseph Haddad a constitué plus d'un tiers de toutes les apparitions d'« experts arabes » dans les médias israéliens au cours du premier semestre 2024. C'est bien qu'ils l'invitent, mais il ne représente en aucun cas la majorité des citoyen-nes palestinien-nes d'Israël.
Israël se targue souvent d'avoir une presse libre et extrêmement critique à l'égard du gouvernement. Est-ce vrai ?
Lors de chaque événement [historique] majeur, les médias israéliens ont toujours été loyaux envers la classe politique et militaire du pays, qu'il s'agisse d'une guerre, d'un plan de paix ou d'un programme économique. Jusqu'à la réforme du système judiciaire, ils ont suivi pratiquement toutes les grandes décisions politiques du gouvernement. Ils sont très critiques à l'égard de Netanyahou, car c'est un menteur corrompu qui fait clairement passer ses intérêts privés avant ceux de l'État. Mais ils ne critiquent pas l'armée ou l'État lui-même.
Il convient de rappeler qu'en 2002, l'indignation publique a été immense après l'assassinat par Israël du chef du Hamas [Salah Mustafa Muhammad Shehade] et la mort de 14 membres de sa famille, dont 11 enfants. Mais une occupation continue qui n'est pratiquement pas couverte par les médias grand public conduit également à une érosion de l'indignation publique et des normes journalistiques. Aujourd'hui, l'armée n'a aucun problème à tuer 14 personnes s'il s'agit d'éliminer un membre peu important du Hamas – et les médias, à l'exception de journaux comme Haaretz, s'en accommodent.
Qu'est-ce que les médias auraient pu faire différemment dans leur couverture après le 7 octobre ? Quelle différence auraient-ils pu faire ?
Tout d'abord, au cours des premiers jours qui ont suivi l'attentat, les médias ont accompli un travail exceptionnel à un moment où les autres institutions israéliennes ne fonctionnaient tout simplement pas. Les médias ont transmis des images au public, [ce qui a permis] d'aider les réfugié-es du sud et les survivant-es du massacre en fournissant littéralement une logistique aux gens parce que l'État ne fonctionnait tout simplement pas à ce moment-là.
Personne n'oblige le public israélien à ne pas savoir ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Ceux qui veulent savoir peuvent se tourner vers le New York Times ou le Guardian. Imaginez que vous preniez Haaretz ou +972 et que vous en fassiez une chaîne d'information grand public – cela changerait-il quelque chose ? Peut-être un peu, mais il s'agit ici de défaire des générations d'endoctrinement.
Le mois dernier, nous avons assisté à une sorte d'euphorie publique depuis les attentats au bipeur et l'assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, après lequel nous avons vu Amit Segal et Ben Caspit, de Channel 12, boire des coups et porter un toast à sa mort à la télévision. Cette euphorie s'est étendue à l'invasion israélienne du Sud-Liban et à l'assaut du Nord de Gaza dans le cadre de ce que l'on appelle le « plan des généraux », qui vise à liquider la région. Que pensez-vous de cette atmosphère apparemment festive dans les studios d'information ?
Les succès israéliens au Liban ont été accueillis en fanfare et célébrés. Dans les jours qui ont suivi ces « victoires », les médias ont très peu discuté de l'importance géopolitique de ce moment, au-delà des dommages causés par Israël au Hezbollah, qui, selon les experts, pourraient entraîner sa déclaration de défaite. Personne ne s'est levé pour évaluer de manière réaliste que nous entrons dans une phase où nous verrons [une augmentation] des roquettes et des drones dans le nord.
Cela rappelle ce qui s'est passé immédiatement après l'attaque du Hamas, lorsque les médias ont affirmé que l'opération ne durerait que quelques semaines ou quelques mois. [Ils ont totalement ignoré le fait qu'] en 2014, les FDI avaient estimé que la réoccupation de la bande de Gaza pourrait prendre cinq ans et coûterait la vie à des dizaines de milliers de Palestinien-nes et d'Israélien-nes. Netanyahou aurait divulgué cette évaluation à Channel 2 en 2014, précisément parce qu'il comprenait ces coûts immenses et ne voulait pas réoccuper militairement Gaza. Pourquoi les médias ne rappellent-ils pas ces évaluations au public ? Pourquoi Udi Segal, le journaliste de Channel 2 qui avait révélé cette information, ne s'exprime-t-il pas aujourd'hui ?
Je suis sûr qu'il existe des évaluations similaires concernant le Hezbollah, mais lorsque l'armée israélienne a commencé son invasion, les médias ont affirmé qu'elle ne durerait que quelques semaines. Cela nous ramène à la première guerre du Liban, lorsque les médias ont fait des déclarations très similaires sur la durée de l'opération [l'armée israélienne est restée dans le sud du Liban pendant près de deux décennies].
Selon le Syndicat des journalistes palestiniens, Israël a tué 168 journalistes palestiniens à Gaza depuis octobre dernier. Quel est le degré de solidarité des journalistes israélien-nes avec leurs homologues palestinien-nes de Gaza, ou avec les journalistes d'Al Jazeera qui ont été interdit-es de travailler en Israël et dont les bureaux à Ramallah ont été perquisitionnés et fermés par les forces israéliennes en septembre ?
Zéro. À la fin de l'année dernière, j'ai aidé Reporters sans frontières à organiser une pétition de solidarité des journalistes israélien-nes envers leurs collègues palestinien-nes. Je leur ai déclaré que personne, à part quelques personnes de la gauche radicale, ne signerait ce genre de déclaration, et j'ai proposé à la place d'essayer de faire signer aux journalistes israélien-nes une pétition demandant aux médias de montrer davantage ce qui se passait à Gaza, parce que je pensais que nous serions en mesure de faire signer davantage de journalistes traditionnel-les. Cela n'a pas été le cas. Très peu de gens ont voulu signer.
Ce que les journalistes israélien-nes ne comprennent pas, c'est que lorsque le gouvernement adopte sa « loi Al Jazeera », il s'agit en fin de compte de quelque chose de bien plus important que de simplement cibler la chaîne. La loi actuelle vise à interdire les organes d'information qui « mettent en danger la sécurité nationale », mais elle veut aussi donner au ministre israélien des communications le droit d'empêcher tout réseau d'information étranger d'opérer en Israël s'il risque de « nuire au moral national ». Ce que le public israélien ne comprend pas, c'est que la prochaine étape sera BBC Arabic, Sky News Arabic et CNN. Ensuite, ils s'en prendront à Haaretz, Channel 12 et Channel 13.
Craignez-vous une telle évolution ?
Nous nous dirigeons vers un régime autocratique à la Orbán et tout ce qui en découle – dans les tribunaux, les universités et les médias. Bien sûr, c'est possible. Cela semblait irréaliste il y a dix ans, puis plus réaliste il y a cinq ans, lorsque les scandales juridiques liés aux médias de Netanyahou ont éclaté. Ensuite, c'est devenu encore plus raisonnable avec la refonte du système judiciaire, et encore plus aujourd'hui. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes certainement sur la bonne voie.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dossier de presse du Syndicat des Journalistes Palestiniens : « Réduire les voix au silence »

L'Agence Média Palestine propose une traduction de ce dossier de presse fourni par le Syndicat des Journalistes Palestinien-nes, qui compile des témoignages de journalistes Palestinien-nes et démontre la volonté d'Israël d'empêcher le travail d'information afin de dissimuler ses propres crimes.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Le calvaire des journalistes palestinien·nes détenu·es à Gaza lors de l'agression israélienne en cours
Introduction
Israël commet à Gaza l'un des massacres les plus odieux de l'histoire mondiale des médias, avec la volonté d'étouffer la vérité en s'en prenant directement aux témoins qui documentent ces crimes, à savoir les journalistes.
Nasser Abu Bakr, président du Syndicat des journalistes palestinien-nes, déclare : « Les crimes systématiques contre les journalistes vont de l'assassinat de ceux qui témoignent de la vérité à l'emprisonnement et à l'intimidation. Plus grave encore, leurs maisons ont été détruites, leurs familles tuées et leurs organismes de presse pris pour cible ». Il ajoute : « Il s'agit d'une véritable guerre contre les médias palestinien-nes, Gaza étant le théâtre du massacre le plus atroce jamais vu dans l'histoire du journalisme mondial. »
Depuis le début de la guerre israélienne en cours contre Gaza, le Syndicat des journalistes palestinien-nes a recensé l'assassinat de 167 journalistes, tandis que deux d'entre elles et eux sont toujours porté-es disparu-es suite à des détentions forcées. Plus de 190 journalistes ont été gravement blessés.
Des statistiques accablantes : Plus de 10 % des journalistes de Gaza tué-es par l'occupation
Abu Bakr décrit la guerre israélienne contre les journalistes palestiniens comme une » guerre génocidaire contre les médias, les journalistes et leurs institutions « . Au cours des onze derniers mois, la machine militaire israélienne a systématiquement exécuté des journalistes dans le cadre d'une campagne continue et délibérée. Les chiffres sont choquants : plus de 10 % des journalistes de Gaza ont été tué-es et 100 % des infrastructures de presse de la bande de Gaza ont été détruites.
Les données du Syndicat des journalistes palestinien-nes révèlent que les crimes de l'occupation comprennent également l'arrestation de plus de 100 journalistes à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Mais l'horreur ne se limite pas au nombre de détenu-es : les formes de torture physique et de terreur psychologique qui leur sont infligées sont inimaginables. Les témoignages de journalistes et d'avocat-es libéré-es, documentés par le Syndicat des journalistes palestinien-nes, décrivent des actes de torture qui dépassent l'entendement. Ces traitements sont sans équivalent dans l'histoire.
« Les témoignages des journalistes détenu-es, hommes et femmes, sont poignants », poursuit Abu Bakr. « Elles et ils parlent de coups portés avec des objets tranchants, de suspension prolongée, de déshabillage forcé, de tentatives de viol sur des prisonniers et des prisonnières, et de menaces de mort. Il s'agit d'une torture lente, pratiquée pendant des heures, des jours et parfois des mois. Voilà les conditions dans lesquelles plus d'une centaine de journalistes, censé-es être protégé-es par le droit international, ont vécu alors qu'elles et ils tentaient d'exercer leur métier. »
Abu Bakr le souligne : « Les organisations internationales ont le devoir de documenter, d'exposer et de faire connaître ces crimes. Les organes de l'ONU spécialisés dans les questions de torture et de détention sont témoins, avec le reste du monde, de l'ampleur du massacre qui se déroule sous nos yeux. Pourtant, ces organisations, y compris la Croix-Rouge internationale, n'ont pas visité les prisons ne serait-ce qu'une seule fois depuis le 7 octobre 2023, alors que les avocat-e-s palestinien-ne-s ont réussi à rendre visite à certain-e-s prisonniers-ères. Pourquoi n'ont-elles pas agi ? Qu'est-ce qui les empêche de rendre visite aux prisonnier-e-s depuis près d'un an de guerre ? »
« Quant aux rapporteur-e-s spéciales-aux de l'ONU concerné-es par ces questions, nous attendons toujours qu'elles et ils publient une déclaration sur la réalité des crimes commis à l'intérieur des cellules fortifiées et sombres des prisons, où les prisonnier-e-s sont entravé-e-s par des chaînes en fer, privé-e-s de nourriture, d'eau et de la dignité humaine la plus élémentaire. Elles et ils subissent des coups, des tortures, des intimidations et des attaques répétées de chiens policiers, dans le froid rigoureux de l'hiver et la chaleur extrême de l'été. »

Il ajoute : « Les journalistes ont enduré des souffrances que les générations futures n'oublieront jamais. Aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme, nous frappons avec force aux portes et nous demandons à la presse internationale et aux organisations de défense des droits de l'homme de faire la lumière sur ces prisons, dont beaucoup fonctionnent comme des bases militaires de l'armée israélienne. Imaginez la scène à l'intérieur de ces centres de détention : des femmes journalistes, entièrement déshabillées, les yeux bandés, battues et torturées, avec d'un côté des bruits de chiens qui menacent de les mutiler, et de l'autre un interrogateur masculin qui menace de les violer. De quelle humanité pouvons-nous parler face à une telle horreur ? Et sans doute y a-t-il eu pire encore pendant ces heures d'agonie, prolongées en journées. Nous sommes en droit de demander à toutes les organisations internationales et aux journalistes du monde entier : avez-vous jamais rencontré, dans toutes les guerres fascistes de l'histoire, de tels témoignages, véridiques et documentés ? Nous demandons à la conscience de l'humanité : où êtes-vous dans tout cela ?
Ce message est un appel à tous les journalistes du monde entier pour qu'elles et ils s'acquittent de leur devoir professionnel et humain. Ces atrocités ne visent pas seulement les Palestinien-ne-s, ni uniquement les journalistes ; il s'agit de crimes contre l'humanité elle-même. »
La question la plus importante est la suivante : pourquoi l'occupation commet-elle tous ces crimes contre les journalistes ? Bien sûr, elles et ils ne sont pas armé-e-s, et le contraire n'a jamais été démontré. Les interrogatoires ne portent pas sur les armes, mais plutôt sur leur travail journalistique professionnel.
L'histoire de l'humanité a-t-elle jamais connu un interrogatoire aussi horrible que celui d'un journaliste simplement parce qu'il fait son travail ? Il s'agit d'une torture et d'un abus systématiques visant à instaurer la terreur. L'histoire retiendra que l'occupation israélienne est l'une des plus brutales et des plus hostiles envers les journalistes du monde entier et qu'elle a commis l'un des plus grands massacres de professionnels des médias de l'histoire moderne.
Le président du Syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abu Bakr, déclare : « La protection des journalistes est garantie par le droit humanitaire international, le droit international des droits de l'homme, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, ainsi que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les journalistes sont considérés comme des civils et ont droit aux mêmes protections que les populations civiles. Par conséquent, l'arrestation, la torture et l'assassinat de journalistes en raison de leur travail professionnel constituent une violation flagrante du droit international et peuvent constituer des crimes de guerre. La résolution 2222 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2015, condamne unanimement toutes les violations commises à l'encontre des journalistes et dénonce fermement l'impunité pour de tels crimes. »
Les journalistes font l'objet de crimes et d'attaques systématiques, qui se sont intensifiés jusqu'au massacre. Depuis le 7 octobre, 167 journalistes ont été tué-e-s et ces attaques systématiques visent à les empêcher de rendre compte de la situation à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens.
Outre les assassinats, 125 journalistes ont été arrêté-e-s. Ces arrestations sont survenues soit sur la base d'accusations de provocation, soit dans le cadre d'une détention administrative, où les détenu-es ne connaissent ni les charges retenues à leur encontre, ni la durée de leur emprisonnement. Amnesty International définit cette pratique comme « la détention d'une personne sans procès pendant une période déterminée sous le prétexte d'un dossier secret auquel ni le détenu ni son avocat n'ont accès ».
L'arrestation de journalistes, en plus de violer le droit international et le droit humanitaire, comporte des actes de violence, de torture physique et de terrorisme psychologique. Le Syndicat des journalistes palestiniens surveille activement les conditions de détention des journalistes, documente les crimes commis à leur encontre et publie régulièrement des rapports sur leur situation. Ces rapports sont communiqués à la Fédération internationale des journalistes et aux organisations de défense des droits de l'homme. Selon les données du syndicat, 125 journalistes ont été détenu-es depuis le 7 octobre, dont 61 en détention administrative. Parmi ces journalistes, 32 journalistes de Gaza dont 6 femmes sont toujours en détention. Cependant, en raison des conditions dangereuses à Gaza et des difficultés à recueillir des informations, il est documenté que 15 journalistes de Gaza restent en détention administrative. Le syndicat estime que les autorités d'occupation utilisent la détention dans le cadre d'une politique systématique visant à intimider les journalistes et à empêcher que la vérité soit rapportée. D'après les témoignages recueillis, il est clair que l'objectif de l'occupation est de punir les journalistes pour leur rôle professionnel et de créer un climat de peur et d'anxiété, afin de les empêcher d'exercer leurs fonctions. Bien qu'elle soit signataire de nombreuses conventions internationales, y compris celles qui protègent les journalistes – comme l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre le droit à la liberté d'opinion et d'expression -, l'occupation ne respecte pas ces obligations. Les journalistes considèrent que ce ciblage systématique crée un environnement hostile à leur profession, une stratégie qui est appliquée quotidiennement à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Ces difficultés font peser de grands risques sur le journalisme palestinien. Pourtant, les journalistes palestinien-nes continuent de couvrir la situation avec un courage remarquable, malgré la violence, la censure, la répression, la détention, l'intimidation et les assassinats auxquels elles et ils sont confronté-es.
Les méthodes militaires utilisées par l'occupation israélienne pour supprimer la liberté de la presse remettent en cause les valeurs et les principes mêmes du journalisme libre, ainsi que la liberté d'opinion et d'expression. Ces actions remettent également en cause le droit international et la responsabilité des institutions mondiales de veiller à ce que les auteur-ices de ces crimes n'échappent pas à leur obligation de rendre des comptes.
Témoignages de détention de journalistes palestinien-nes
Traitement exceptionnel des journalistes
Les journalistes sont délibérément pris-es pour cible par l'occupation dans le but de faire taire leurs voix. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse, mais d'un fait, étayé par les témoignages poignants de journalistes qui ont subi de graves tortures lors de leur détention par les forces israéliennes. Des dizaines de témoignages, recueillis par le Syndicat des journalistes palestiniens, confirment que les journalistes sont soumis-es à un traitement spécifique et sévère pendant leur détention, uniquement en raison de leur profession.
C'est le cas de Diaa Al-Kahlout, directeur du bureau d'Al-Arabi Al-Jadeed dans la bande de Gaza et père de cinq enfants. Al-Kahlout a été arrêté par les forces d'occupation alors qu'il se trouvait au domicile familial, dans le nouveau quartier résidentiel de Beit Lahia. Il a été conduit de force, nu, avec des dizaines d'autres personnes, dans la rue du marché. Les soldat-es de l'occupation l'ont filmé et photographié, et ces images ont ensuite été diffusées publiquement par les soldat-es, qui l'ont humilié au milieu du marché.

Notre collègue Diaa Al-Kahlout, dans une interview accordée à Al-Arabi TV après sa libération du centre de détention « Zkayim », où il a été détenu pendant 33 jours, fait part de son expérience : « Dès mon arrestation, je me suis identifié comme journaliste, espérant que les enquêteur-ices respecteraient ma profession. Au contraire, les soldat-es de l'occupation ont immédiatement pris ma carte de presse du Syndicat des journalistes palestinien-nes et l'ont cassée. Au lieu d'être traité avec respect, ma situation s'est aggravée. Plusieurs soldat-es se sont rassemblé-es autour de moi et, pendant l'interrogatoire, leurs questions portaient uniquement sur mon ‘crime' d'être journaliste ».
Dans un autre témoignage, un journaliste de Gaza (S.F.) raconte : « Nous sommes devenu-es des cibles directes, comme si transmettre la vérité était désormais considéré comme un crime ». Un autre journaliste (A.L.) a ajouté : « Les journalistes ne sont plus considéré-es comme des observateur-ices ; nous sommes maintenant traité-es comme des ennemi-es. »
Un journaliste palestinien des territoires de 1948 (S.S.), qui a demandé à rester anonyme pour éviter les représailles, a partagé son point de vue : « Malgré la carte de presse israélienne, la discrimination entre les journalistes étrangers ou juifs et les journalistes arabes est flagrante. Les restrictions de mouvement et de travail ont atteint des niveaux sans précédent, en particulier pour les journalistes arabes et palestinien-nes ».
Le journaliste Rajai Al-Khatib, basé à Jérusalem, décrit son calvaire : « Je préparais un reportage télévisé, ma carte de presse visiblement accrochée à mon cou, et j'avais un appareil photo. Dès que je suis arrivé à Bab al-Asbat, quatre policiers israéliens se sont approchés et ont commencé à me frapper avec leurs mains et leurs pieds. L'un d'eux a crié : « Vous, les journalistes, vous êtes la cause principale de la guerre. Tout ce qui se passe, c'est à cause de vous, c'est vous qui prenez des photos et qui les diffusez ». Chaque fois que je leur disais que j'étais journaliste, les attaques redoublaient d'intensité. Un soldat m'a même dit : »Va au diable » ».
Torture dans les prisons israéliennes
Moaz Ibrahim Amarneh, photojournaliste palestinien résidant dans le camp de Dheisheh, dans le gouvernorat de Bethléem, a perdu son œil gauche alors qu'il couvrait des affrontements populaires pacifiques dans le village de Surif, au nord-ouest d'Hébron, en 2019, à la suite d'un ciblage direct par les forces d'occupation israéliennes. Le 16 octobre 2023, Amarneh a été arrêté par les autorités d'occupation.

J'avais peur de finir dans le « sac noir »
Dans son témoignage au Syndicat des journalistes palestiniens, Amarneh décrit son expérience de la détention : « Lorsque je suis arrivé à la prison de Megiddo, j'ai été victime d'une grande violence et d'une agression physique. J'ai été frappé à la tête jusqu'à ce que je perde connaissance, et après avoir repris connaissance, je me suis retrouvé face à un officier israélien qui essayait de me réveiller. J'ai demandé à être transféré à l'hôpital en raison d'une ancienne blessure à la tête et de la nécessité d'un traitement contre le diabète. Ma demande a été refusée et on m'a laissé souffrir. Pendant un moment, j'ai eu peur de finir dans le ‘sac noir'… avant de pouvoir voir un médecin pour la première fois après quatre mois ».

Le journaliste Ismail Maher Khamis Al-Ghoul (correspondant de la chaîne satellitaire Al Jazeera), né le 14 janvier 1997, a été assassiné par un drone israélien quelques minutes après sa couverture journalistique en direct, le 31 juillet 2024, alors qu'il se trouvait dans sa voiture portant l'enseigne de la presse avec son collègue, le photographe Rami Al-Rifi. Ils ont été tués lors d'une opération délibérée d'assassinat menée par les forces d'occupation israéliennes dans le camp d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza.
Al-Ghoul avait déjà été arrêté par les forces d'occupation avec un groupe de journalistes lorsque l'occupation a pris d'assaut le complexe médical Al-Shifa dans la ville de Gaza le 17 mars 2024. Son épouse Malak décrit dans son témoignage au Syndicat des journalistes palestinien-nes les détails de l'agression dont son mari a été victime avant d'être assassiné : « Mon mari se trouvait avec un groupe de journalistes dans une salle du complexe médical Al-Shifa. Ils ont emmené un groupe d'entre eux dans la cour de l'hôpital Al-Shifa et les ont agressés en les frappant et en les injuriant pendant toute la nuit devant les personnes déplacées de l'hôpital ».
L'épouse endeuillée d'Ismail Al-Ghoul poursuit avec un discours plein de douleur : « Ismail ne m'a jamais révélé les détails de l'agression dont il a été victime de la part des soldats de l'occupation. Il ne voulait pas m'effrayer, mais les marques des attaques des soldat-es de l'occupation étaient clairement visibles sur certaines parties de son corps. »

Rasha Hirzallah, journaliste de la ville de Naplouse, travaille comme rédactrice en chef à l'agence de presse et d'information palestinienne « WAFA ». Elle a été arrêtée le 8 juin 2024 par les services de renseignement israéliens sur la base d'accusations liées à son travail dans les médias et se trouve toujours dans la prison de Damon, au nord de l'État d'occupation, au moment de la rédaction du présent rapport. Osama Hirzallah, le frère de Rasha, déclare à propos de son arrestation : « La famille vit dans l'inquiétude permanente au sujet de Rasha. Les visites familiales sont interdites. Même pendant le procès, on nous a empêchés de la voir, et nous ne savons rien d'elle, si ce n'est son lieu de détention ».
Nidal Abu Aker, journaliste du camp de Dheisheh près de Bethléem, âgé de 56 ans, a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités israéliennes, au cours desquelles il a passé une quinzaine d'années en détention administrative. Il a fondé la radio « Voice of Unity » qui a émis depuis le camp entre 2012 et 2016.
Muhammad, le fils de Nidal Abu Aker, cite l'un des soldats de l'occupation lors de l'arrestation de son père : » Nous arrêtons Nidal Abu Aker parce qu'il est Nidal Abu Aker « , en précisant : « Cette confession des raisons de l'arrestation révèle que le journaliste est pris pour cible sans aucune charge. »
À propos de la nuit de l'arrestation, il déclare : » Cette nuit-là, les soldat-e-s de l'occupation ont pris d'assaut notre maison et nous ont battu-e-s, maudit-e-s et insulté-e-s, puis sont passé-e-s à l'étape de la destruction de la maison, et après avoir terminé l'assaut et la destruction, ils nous ont arrêtés, mon père et moi ».
Muhammad continue : » On nous a mis avec un groupe de détenu-es dans une cour, on nous a attaché les mains derrière le dos avec les pieds et on nous a fait asseoir sur les genoux. Quiconque tentait de lever la tête ou de bouger une jambe recevait un coup de bâton sur le corps de la part d'un des soldats. L'un des soldats a crié en arabe à l'un d'entre nous : Dit : ‘J'aime Israël'. »
La souffrance de la famille Abu Aker ne s'est pas arrêtée là. Muhammad Abu Aker raconte : « J'ai été placé dans la prison du Néguev. Pendant ma période de détention, les soldat-es de l'occupation ont pris d'assaut notre maison à plusieurs reprises et, à chaque fois, ont fait preuve de sadisme en brisant le contenu de la maison et en frappant ma mère et mes sœurs. Plus d'une fois, elles et ils ont convoqué ma mère au complexe de la colonie d'Etzion ou au (Checkpoint 300). Elles et ils m'ont menacé plus d'une fois d'assassiner mon père ».
« Comme des moutons… ils nous ont jeté-es les un-es sur les autres »
Ali Abdul Aziz Muhammad Abu Sharia, journaliste palestinien de la ville de Gaza, vivait dans le quartier de Sabra avant d'être déplacé. Il a été arrêté par les forces d'occupation israéliennes le 25 janvier 2024 alors qu'il était déplacé avec sa famille vers le sud en quête de sécurité.
Décrivant le moment de son entrée dans les centres de détention de l'occupation, Abu Sharia déclare : « Je n'avais pas de vêtements. Ils m'ont frappé sur tout le corps. Le soldat israélien m'a déclaré « Viens à moi », dès que je l'ai rejoint des dizaines de soldats m'ont battu sur tout le corps de tous les côtés. «

« Comme des moutons… ils nous ont jeté-es les un-es sur les autres », c'est en ces termes qu'Abu Sharia décrit la scène à laquelle lui et les prisonnier-es ont assisté au moment de leur arrestation et de leur transfert vers les centres de détention de l'occupation dans des camions. Il ajoute : « Bien sûr, étant donné que nous étions nus, ils nous ont jetés les uns sur les autres : » Bien sûr, comme nous étions nu-es, ils nous ont jeté-es l'un-es sur l'autre. Nous étions nombreux-ses, plus de cinquante à soixante détenu-es, les un-es sur les autres dans des camions. Je suis désolé pour l'expression, mais comme des moutons… nous avons été balancé-es les uns sur les autres… une scène qui n'a rien à voir avec l'humanité ».
Lama Ghosheh, journaliste indépendante de Jérusalem, a été arrêtée le 4 septembre 2022 et interrogée par les autorités israéliennes en raison de son travail journalistique. Elle déclare : « J'ai été menacée d'emprisonnement plus d'une fois, simplement parce que je suis journaliste ».

Ghosheh ajoute : « Des milliers de Palestinien-nes à Jérusalem et dans les 48 territoires ont la « gorge entravée », car le prix des mots et de l'opinion est soit la mort, soit l'arrestation. »
Mishal Mohammed Al-Masri, journaliste palestinien de 43 ans originaire de la région de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, a été arrêté le 9 décembre 2023. Il raconte : » Les soldat-e-s nous ont interrogé-e-s si brutalement que cela nous était insupportable, à l'aide de matraques et de bâtons, des coques métalliques de leurs chaussures, de chiens policiers, et d'eau froide par un temps glacial, après nous avoir forcé-e-s à nous déshabiller. «
La journaliste Ikhlas Sawalhah, épouse du journaliste détenu Ibrahim Abu Safiya, a été arrêtée par l'occupation le 12 décembre 2023. Elle a déclaré dans son témoignage au Syndicat des journalistes palestinien-nes qu'elle avait été sévèrement battue par des femmes soldat-es de l'occupation après qu'elles l'aient forcée à se déshabiller.
Agressions lors de l'arrestation
Les forces d'occupation israéliennes utilisent délibérément des méthodes brutales lors de l'arrestation de journalistes palestinien-nes, en perquisitionnant leurs domiciles aux premières heures de l'aube, en cassant les portes et en terrorisant les membres de leurs familles. Le journaliste (A.M) a décrit le moment de son arrestation comme terrifiant, lorsque des soldats ont soudainement pris d'assaut sa maison et l'ont fouillée sauvagement, et ont fait usage de violence contre les membres de sa famille qui voulaient s'enquérir de la raison de l'arrestation. Dans de nombreux cas, les journalistes sont violemment maîtrisés devant leurs proches, puis transférés dans des véhicules militaires sans leur permettre de porter des vêtements appropriés ou de prendre leurs affaires de base.
Le journaliste (M.R), dans son entretien avec le Syndicat des journalistes palestiniens, a déclaré qu'il avait été battu et insulté pendant son transfert, où les soldats lui lançaient des insultes et le menaçaient de le torturer. Ces pratiques font partie de la stratégie de l'occupation visant à terroriser les journalistes et à les dissuader d'exercer leur métier.

La journaliste de Jérusalem Roz Al-Zarou (47 ans) a indiqué dans sa déclaration au Syndicat des journalistes que les forces d'occupation ont pris d'assaut sa maison le 9/9/2024, provoquant un climat de terreur et d'intimidation dans sa famille, en particulier chez son jeune enfant. La maison a été saccagée et encerclée par un grand nombre de fonctionnaires de la police israélienne.
Elle ajoute : « Les soldat-es de l'occupation ont confisqué toutes mes cartes de presse (palestinienne, internationale et israélienne), ainsi que mon passeport. J'ai ensuite été emmenée au centre de détention de Moscobiyeh, où j'ai passé une journée entière à subir des interrogatoires brutaux ».
Al-Zarou explique que la police d'occupation a décidé de la libérer contre une caution financière de 6 000 shekels, à condition qu'elle soit assignée à résidence pendant huit jours. » C'est au-delà de toute description… » C'est en ces termes qu'Al-Zarou a fait part de la terreur et de l'intimidation causées par le raid sur sa maison, affectant sa famille, en particulier les enfants, et lui laissant de graves traumatismes psychologiques.
Le journaliste Moaz Amarneh raconte : » Lors de mon transfert de mon domicile à la détention, j'ai été battu et menacé, et j'ai été utilisé comme bouclier humain lors de confrontations qui se sont produites en chemin. Dès mon arrivée au centre de détention, j'ai été sévèrement battu jusqu'à ce que je perde connaissance. Il a fallu quatre mois pour que je puisse voir un médecin ».
Pour ce qui est de Muhammad Nidal Abu Aker, il déclare : « En 2018, les forces israéliennes ont pris d'assaut la maison familiale et ont arrêté Muhammad et son père ensemble, où ils ont été battus et transférés dans des véhicules militaires séparément. La famille a mentionné que ces attaques se répétaient périodiquement, les forces prenant d'assaut la maison, brisant son contenu et agressant les membres de la famille, y compris sa mère et ses sœurs. »
Le journaliste Mishal Al-Masri raconte : « Nous avons été interrogés au cours des premières heures de notre arrestation, et l'interrogatoire a été brutal. Personne ne pouvait supporter les coups violents. Les soldat-es ont utilisé des matraques et des bâtons, et ils ont utilisé tous les moyens brutaux contre nous pendant l'arrestation. »
Malak, épouse du journaliste assassiné Ismail Al-Ghoul : « Ismail a été arrêté tard dans la nuit, les forces d'occupation sont entrées dans sa chambre et l'ont sévèrement battu devant tous les détenus dans la cour du complexe médical Al-Shifa. Selon des témoins oculaires, Ismail a été brutalement frappé à la tête, aux mains et aux jambes. La torture s'est poursuivie toute la nuit.
Disparition forcée et privation de visites
Les disparitions forcées et les privations de visites constituent deux graves violations des droits de l'homme auxquelles sont soumis-es les prisonnier-es palestinien-nes dans les prisons israéliennes. Ces derniers mois ont été marqués par une augmentation sans précédent des cas de disparition forcée de journalistes.
Les informations reçues par le PJS indiquent que deux journalistes de la bande de Gaza sont soumis à une disparition forcée depuis le 7 octobre 2023. Il s'agit des collègues Nidal Al-Wahidi et Haitham Abdul Wahed, tous deux photojournalistes. Les autorités d'occupation refusent de fournir la moindre information sur le lieu où ils se trouvent – comme des milliers de prisonnier-e-s arrêté-e-s dans la bande de Gaza – et refusent d'autoriser leurs avocat-e-s et les organisations internationales à leur rendre visite. Selon les témoignages, la disparition forcée accroît les souffrances des prisonnier-e-s et de leurs familles, car il devient difficile pour les familles d'obtenir des informations sur leurs conditions de vie ou leur état de santé.
Selon la Déclaration sur la protection contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 en tant qu'ensemble de principes applicables à tous les États, il y a disparition forcée lorsque : » des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agent-es de différentes branches ou de différents niveaux du gouvernement, ou par des groupes organisés ou des particuliers agissant au nom du gouvernement ou avec son appui, direct ou indirect, son consentement explicite ou tacite, suivi d'un refus de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'un refus d'admettre qu'elles sont privées de liberté, ce qui les soustrait à la protection de la loi « .
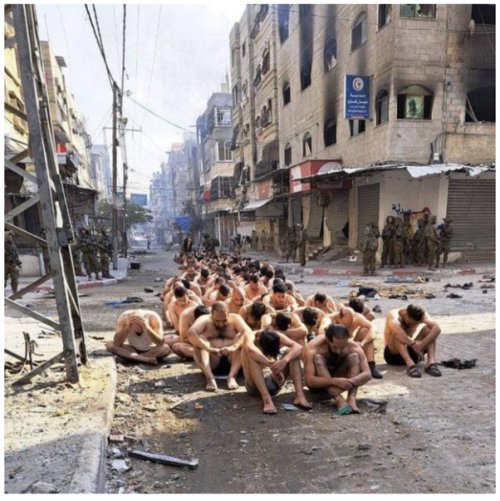
Privation de soins et de traitements dans les prisons d'occupation
Le journaliste Moaz Amarneh, qui souffre d'une balle logée dans la tête, parle de ses souffrances et de son besoin de soins et de traitements constants pour son état : « Après avoir été sévèrement battu, je souffrais de douleurs intenses et j'ai demandé un traitement médical à plusieurs reprises, mais l'administration pénitentiaire n'a pas tenu compte de mon état. Étant diabétique et ayant une balle de l'occupation logée dans la tête, mon état de santé nécessite un suivi permanent. On ne m'a présenté à un médecin qu'au bout de quatre mois, après une forte pression de la part de l'avocat.
Mishal Al-Masri, journaliste palestinien, raconte dans son témoignage la négligence médicale dans les prisons israéliennes : « Il y avait un médecin qui nous surveillait, mais il ne faisait pas son devoir. Nous étions attachés avec des câbles métalliques et ils portaient des taches de notre sang. Les blessures étaient traitées après plus de 4 heures, lorsque la plaie avait séché. Cela se répétait tous les jours, et la douleur était continue 24 heures sur 24, jour et semaine. »

Diaa Kahlout, un journaliste palestinien, a raconté des détails horribles sur les conditions de santé des prisonnier-es : « Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des enfants – de 16 et 17 ans – et des personnes âgées et malades. Je connais un détenu de 77 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. J'ai été détenu avec des personnes souffrant d'un cancer et un autre blessé par une balle de l'armée d'occupation, détenus de la même manière ».
Qadura Fares, chef de la Commission des affaires des prisonnier-e-s et ex-prisonnier-e-s palestinien-ne-s, a parlé de la propagation des maladies de peau dans les prisons, en déclarant : » Le manque d'eau, en particulier d'eau chaude, et le manque de produits de nettoyage tels que le savon et le shampoing, tout cela conduit à la propagation de maladies de la peau, en particulier de la gale, qui touche plus de 60 % des prisonnier-e-s. Cette maladie est très incommodante pour les prisonnier-es, qui ne peuvent pas dormir à cause d'elle. En outre, les attaques des forces d'occupation contre les sections de la prison et les agressions contre les prisonnier-e-s causent des blessures qui, en raison du manque de propreté et de traitement, se transforment en ulcères, puis en infections et en empoisonnements. L'empoisonnement finit par atteindre l'os, et certains prisonniers, risquant la gangrène, se voient amputés d'un membre ».
L'avocat (A.J) de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers (qui a refusé de divulguer son nom par crainte des politiques d'occupation) a confirmé que » les prisons israéliennes sont le théâtre d'une négligence médicale délibérée à l'égard des prisonnier-e-s, qui sont privé-e-s des soins de santé dont ils et elles ont besoin. Les journalistes en détention souffrent de cette négligence au même titre que les autres prisonnier-e-s. Cette négligence conduit à l'aggravation de leur état de santé et les rend vulnérables à des maladies chroniques et graves sans recevoir de traitement approprié ».
Le directeur général de la Commission indépendante des droits de l'homme (ICHR), Ammar Dwaik, déclare : » La négligence médicale délibérée est pratiquée dans les prisons de l'occupation israélienne. Les prisonnier-e-s sont privé-e-s des traitements nécessaires, et des conditions de santé graves sont aggravées sans aucune intervention médicale réelle. Cette négligence entraîne non seulement l'aggravation des maladies et des blessures, mais aussi la mort d'un certain nombre de prisonniers à l'intérieur des prisons ».
Shawan Jabarin, directeur de la Fondation Al-Haq, a confirmé que « la négligence médicale est l'un des outils de répression les plus dangereux utilisés par les autorités d'occupation contre les prisonniers palestiniens. Les autorités ont délibérément omis de fournir un traitement approprié aux détenu-es souffrant de maladies graves, ce qui a entraîné une aggravation tragique de leur état. Des cas d'amputation de membres ont été documentés en raison de l'absence de traitement approprié en temps opportun, ce qui témoigne de l'ampleur des violations flagrantes ».
La famine dans les prisons israéliennes
Les journalistes emprisonné-es, comme toutes les personnes détenues en Palestine, sont confronté-es à des conditions extrêmement difficiles, dont l'une des manifestations est un système de torture par la faim, que les autorités d'occupation israéliennes utilisent de manière systématique.
Le journaliste Moaz Amarneh, dans son témoignage au Syndicat des journalistes palestiniens, déclare avoir perdu environ 30 kilos et décrit son expérience en ces termes : « « La nourriture en prison était de pire en pire, car la quantité était très faible, et j'ai beaucoup souffert du manque de nourriture. Je suis diabétique, ce qui nécessite une alimentation particulière, mais personne ne s'en souciait. La nourriture était malsaine et parfois mal cuite. Les repas étaient distribués à dix ou seize personnes selon le nombre de personnes dans la cellule, alors qu'ils étaient à peine suffisants pour une personne ».
Ali Abu Sharia, qui a perdu pas moins de 18 kilos en 23 jours de détention, déclare : « Les repas ne nourrissent pas et ne satisfont pas la faim, à tel point que j'ai perdu pas moins de 18 kilos en 23 jours de détention. Mon poids a diminué de près d'un kilo par jour. »
Osama Hirzallah confirme : « Chaque prisonnier-e libéré-e des prisons israéliennes a perdu pas moins de 30 ou 40 kilos de son poids, en raison des mauvais traitements et de la malnutrition. »
Quant à Ikhlas Sawalhah, détenue à la prison de Damon, elle raconte sa douloureuse expérience en disant : « Lorsque je suis entrée pour la première fois dans la prison, les quantités étaient très faibles, les variétés étaient pauvres et très rares, réparties sur les jours de la semaine. Nous recevions une demi-tasse de thé par jour. Sauf le samedi, nous n'en avions pas. Quant à la confiture, c'était le mercredi. Les repas de midi se limitaient à de la soupe – parfois de la soupe d'orge – et du riz pour le déjeuner, en très petites quantités qui ne nourrissent ni ne rassasient personne ».
Ikhlas Sawalhah poursuit son récit sur la souffrance dans les prisons : « En raison de la mauvaise qualité et de la rareté de la nourriture, la plupart des prisonnières souffraient de constipation, du syndrome du côlon irritable, d'hémorroïdes et de cycles menstruels irréguliers. »
Rasha Ibrahim, épouse du journaliste détenu Dr. Mahmoud Fatafta, décrit la situation alimentaire en prison d'après ce que les compagnons de son mari dans la même cellule lui ont déclaré après leur libération : « La nourriture était peu abondante et de mauvaise qualité, un certain nombre de prisonniers préféraient rester affamés plutôt que de manger la nourriture fournie ».
Qadura Fares, chef de la Commission des affaires des prisonniers palestiniens, explique l'impact de la politique de privation de nourriture en ces termes : « La politique de famine a réduit la quantité de nourriture fournie aux prisonniers de plus d'un quart, ce qui a entraîné une chute collective du poids des prisonniers. La perte de poids moyenne est d'environ 30 à 35 kilogrammes. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un résultat de la politique de privation de nourriture ».
Shawan Jabarin, directeur de l'organisation Al-Haq, ajoute : « Dans certains cas, cinq prisonniers partagent un seul œuf ou une petite quantité de labneh, qui sert de repas à 12 prisonniers. Il s'agit d'une politique de famine systématique et délibérée ».
(ICHR) : La privation de nourriture est l'une des méthodes utilisées pour torturer les prisonniers
Amar Dweik, directeur général de la Commission indépendante des droits de l'homme (ICHR), déclare : « La privation de nourriture est l'une des méthodes utilisées pour torturer les prisonnier-es dans les prisons de l'occupation israélienne. Cette privation de nourriture ne consiste pas seulement à réduire la quantité de nourriture fournie, mais aussi à fournir des aliments de mauvaise qualité et impropres à la consommation humaine. Ces pratiques visent à affaiblir les prisonniers physiquement et psychologiquement, à mettre leur vie en danger et à accroître leurs souffrances quotidiennes ».
Dans ces conditions désastreuses, la cruauté et la négligence que subissent les prisonniers palestiniens deviennent évidentes, car la politique de famine fait désormais partie intégrante des outils d'oppression utilisés par les autorités d'occupation israéliennes pour briser leur volonté et les dépouiller de leur humanité.
Harcèlement sexuel dans les prisons israéliennes
Les témoignages de prisonnier-es libéré-es et d'institutions de défense des droits de l'homme ont révélé que les détenu-es palestinien-nes étaient soumis-es à de graves tortures et à des traitements dégradants pour la dignité humaine, y compris le déshabillage et le harcèlement sexuel ou des menaces en ce sens. Les prisonnières palestiniennes sont victimes de harcèlement sexuel et d'autres violations.
La journaliste Ikhlas Sawalhah révèle dans son témoignage au Syndicat des journalistes palestinien-nes : « J'ai été fouillée nue à la prison de Ramon à deux reprises, et à Damon à cinq reprises, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de la prison, en plus d'avoir été fouillée nue à quatre autres reprises lors d'opérations de transfert d'une prison à l'autre. » Elle confirme : » Bien sûr, toutes les filles et les femmes étaient fouillées nues, il s'agit d'une procédure obligatoire… Il y a des filles très jeunes qui ont été fouillées nues collectivement dans la prison de Hasharon. »

Elle explique : « Les soldat-es de l'occupation demandent aux prisonnières de se déshabiller et, à une occasion, une soldate m'a frappée alors que j'étais nue avec sa chaussure à pointe métallique. »
La journaliste de Jérusalem Lama Ghosheh a été arrêtée et interrogée par les autorités d'occupation israéliennes.
Lama a raconté son expérience au Syndicat des journalistes en disant : « Ils m'ont placée dans une section spéciale pour les détenus criminels, où seuls les hommes sont emprisonnés, puis dans la prison de Hasharon. À cette époque, elle était réservée aux criminels, la plupart d'entre eux ayant été arrêtés pour des affaires de viol et de drogue… vous pouvez imaginer ce que cela signifie !!… »
Ces témoignages ne sont pas de simples faits isolés, mais des preuves des violations systématiques et continues dont sont victimes les journalistes palestinien-nes et leurs familles. Par ces pratiques répressives, les autorités d'occupation tentent de faire taire les voix libres qui cherchent à transmettre la vérité et à documenter les crimes israéliens contre le peuple palestinien.
Lama Ghosheh a dessiné cette peinture pendant sa période d'assignation à résidence pour documenter l'expérience difficile qu'elle a vécue pendant sa détention. Elle explique : » Cette peinture incarne le moment difficile que chaque prisonnière traverse dans les centres de détention de l'occupation lorsqu'elle est soumise à une fouille à nu, où les prisonnières sont forcées d'enlever tous leurs vêtements sous le prétexte d'une fouille pour des raisons de sécurité par des soldates de l'administration pénitentiaire (Shabas). J'ai personnellement vécu ce moment et j'ai jugé utile de le documenter pour l'humiliation et l'oppression qu'il comporte et qui ne s'arrêtent pas avec la fin du moment, mais dont les effets se poursuivent à jamais ».
Ismail Al-Ghoul parlait ainsi de son expérience, avant d'être assassiné par Israël : » Les forces d'occupation nous ont forcé-es à nous déshabiller complètement, à nous agenouiller sur le sol et à mettre nos mains sur la tête pendant environ une heure, par un temps très froid, et nous sommes resté-es dans cet état pendant environ 12 heures, après que les forces d'occupation aient pris d'assaut l'hôpital et démoli la tente des journalistes. Nous avons été forcé-es de nous asseoir par terre, nus, et par un temps très froid, dans une pièce de la cour de l'hôpital, alors que les forces d'occupation tiraient lourdement sur les environs de l'hôpital, et malgré le fait que nous avions les yeux bandés et les mains menottées ».
Quant au journaliste Diaa Kahlout, il a raconté les détails de ses souffrances en ces termes : « Nous avons été forcés d'enlever tous nos vêtements, et nous n'avons été autorisés à garder qu'un sous-vêtement pour la partie inférieure, avant d'être transférés à la base militaire de Zkayim. »
Dans le cadre des enquêtes sur les violations flagrantes subies par les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, des témoignages émergent confirmant que certain-e-s prisonniers-es ont été soumis-es à des agressions sexuelles, y compris des cas de viols systématiques.
Ces témoignages mettent en lumière un aspect sombre des pratiques de l'occupation à l'encontre des prisonniers, où les violations ne se limitent pas à la seule torture physique, mais s'étendent à des violations plus graves qui dégradent la dignité humaine et visent leur humanité. Ces pratiques ne sont pas seulement des crimes contre des individus, mais font partie d'une politique visant à briser la volonté du peuple palestinien et à l'humilier de manière brutale et inhumaine.
Shawan Jabarin, directeur général de la fondation Al-Haq, souligne l'une des violations les plus dangereuses et les plus odieuses dont sont victimes les prisonniers palestiniens : » Le harcèlement sexuel et le viol font partie des exactions les plus atroces dont sont victimes les prisonnier-es palestinien-nes. Ces pratiques comprennent des agressions sexuelles directes qui vont jusqu'au viol et sont utilisées comme un moyen d'humilier les prisonnier-es et de briser leur volonté. Ces agressions sont accompagnées de graves violences physiques et psychologiques, qui augmentent les souffrances des prisonnier-es et laissent des séquelles psychologiques à long terme. Ces violences ne sont pas des cas individuels, mais reflètent une politique systématique visant à détruire le moral des prisonniers et à renforcer leur isolement ».
Dans le cadre de l'examen de ces violations, il convient de noter qu'il est possible que certain-es journalistes emprisonné-es aient été victimes d'agressions sexuelles, mais qu'elles ou ils aient refusé de le révéler pour des raisons sociales. Ces cas restent souvent non déclarés, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur de ce type de crimes.
Ce refus de révéler ces crimes, qu'il soit dû à des contraintes sociales ou psychologiques, ajoute un niveau de cruauté supplémentaire aux souffrances des prisonnier-es, qui souffrent en silence sans pouvoir obtenir le soutien ou le traitement psychologique nécessaire pour faire face à ces expériences horribles commises dans un contexte d'impunité totale, et restera un témoin de l'étendue des violations flagrantes dont sont victimes les Palestinien-nes, y compris les journalistes, dans les prisons de l'occupation.
Conditions de libération à la sortie des prisons d'occupation

La journaliste de Jérusalem Lama Ghosheh fait part de sa dure expérience de l'assignation à résidence : » Après dix jours, le 14 septembre, j'ai été transférée à la prison de Damon. À mon arrivée, j'ai appris la décision de libération conditionnelle, qui me soumettait à une assignation à résidence à durée indéterminée. Les conditions comprenaient une amende de 50 000 shekels et une interdiction totale d'utiliser les médias sociaux, internet, et même d'avoir des appareils comme des smartphones ou des téléviseurs connectés à un ordinateur.
Lama poursuit : » Comme je vivais à Kafr Aqab, une zone où les dispositifs de sécurité sont limités, ils ont décidé de me transférer dans la maison de mes parents à Sheikh Jarrah, une zone où les dispositifs de sécurité sont plus stricts. Mes parents à la retraite devaient être présents dans la maison 24 heures sur 24 pour me surveiller au nom des autorités d'occupation. Ils ont signé les conditions de libération, qui prévoyaient de lourdes sanctions – 50 000 shekels et une possible arrestation – en cas d'infraction, y compris ma ré-arrestation. Cette assignation à résidence n'utilise pas seulement les parents comme agent-es d'exécution, mais tente de créer un conflit au sein de la structure familiale palestinienne ».
De la même manière, la journaliste Sumaya Azzam, originaire de Naplouse et enceinte de sept mois, a été arrêtée le 5 novembre 2023 pour ses publications sur Facebook. Elle a été libérée sous la forme d'une assignation à résidence pour une durée indéterminée, assortie d'une interdiction d'utiliser l'internet. Le Syndicat des journalistes palestinien-nes a tenté d'interviewer l'un des membres de la famille de Sumaya, mais celui-ci a refusé, craignant de nouvelles mesures punitives de la part des autorités d'occupation.

Ces témoignages révèlent la politique systémique employée par l'occupation pour utiliser l'assignation à résidence comme un outil d'intimidation des journalistes palestiniens et de leurs familles. Ces mesures ne visent pas seulement à limiter les libertés individuelles, mais aussi à démanteler le tissu social des familles palestiniennes, en transformant les parents en agent-es d'exécution contraint-es de la surveillance de leurs propres enfants.
Révélations d'une source de la Croix-Rouge au syndicat des journalistes palestiniens
Une source de la Croix-Rouge a révélé au Syndicat des journalistes palestinien-nes que 8 500 citoyen-nes palestinien-nes de la bande de Gaza sont porté-es disparu-es et que le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas en mesure de déterminer leur sort.
Cette source a ajouté que la Croix-Rouge n'a pas effectué de visites aux prisonnier-es depuis le 7 octobre 2023. Elle poursuit : « Nous avons fait beaucoup, et c'est un élément central de notre rôle humanitaire et de notre travail sur le terrain et diplomatique. Nous documentons les histoires des martyr-es et des détenu-es libéré-es, nous dialoguons avec les familles et nous aidons les personnes libérées. Nous exigeons que chacun-e soit traité-e avec dignité, conformément aux accords internationaux, y compris la Convention de Genève ».
Notre source ajoute : « Selon le droit humanitaire, l'arrestation de journalistes est une violation grave des conventions de Genève. De tels actes portent atteinte à la protection de base accordée aux journalistes dans les zones de conflit. Nous examinons actuellement ces violations en coordination avec les autorités compétentes afin de garantir la responsabilité et le respect des principes du droit international. »
Intimidation du journalisme arabe dans les territoires de 48
Un climat d'intimidation et d'abus a été, et continue d'être pratiqué par les autorités d'occupation israéliennes à l'encontre des journalistes dans les territoires '48. Malgré des différences dans le niveau de discrimination et d'abus contre les journalistes palestinien-nes dans les différentes régions (Gaza, la Cisjordanie et les territoires de '48), les journalistes dans les territoires de '48 sont confrontés à des agressions et à des intimidations qui entravent gravement leur capacité à exercer leurs fonctions journalistiques. Les agressions physiques et verbales pendant les enquêtes et reportages sur le terrain sont parmi les plus importantes de ces abus. Ces attaques ont conduit à une diminution significative ou à un retrait complet du travail sur le terrain, en particulier au cours des premiers mois de la guerre d'extermination israélienne.
Le journaliste Abdul Qader Abdul Haleem, originaire des territoires de 1948, a confirmé au Syndicat des journalistes palestiniens qu'il avait cessé de travailler sur le terrain après le 7 octobre, car il y avait eu au moins 20 agressions contre des journalistes arabes et des organismes de presse, la plus notable étant l'agression du journaliste Ahmed Darawsheh

Un policier israélien armé menace le reporter d'Al-Araby Ahmed Darawsheh en direct.
Notre collègue Abdul Haleem ajoute : » Bien que ce chiffre puisse sembler faible par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, il a un impact significatif, surtout si l'on considère que le nombre de journalistes arabes dans les territoires de 48 est relativement faible. Outre les agressions, la censure intensive, l'intimidation et les pressions exercées sur les agences qui emploient ces journalistes ont contribué à ce que les journalistes palestinien-nes des 48 territoires pratiquent une autocensure stricte afin d'éviter les poursuites, les mesures punitives ou les pénalités financières liées à leur travail journalistique. Par exemple, surtout dans les premiers mois, les journalistes palestinien-nes évitaient d'utiliser des mots spécifiques comme « occupation ».
Il poursuit : » En ce qui concerne les arrestations, il y a le cas d'un journaliste palestinien des territoires de '48, Tariq Taha, qui a été détenu pendant des jours à cause d'un article sur le phénomène de l'armement dans les universités. Il y a eu plusieurs cas de journalistes qui ont été convoqués en rapport avec leur travail d'information et qui ont reçu des avertissements directs concernant leurs reportages. En outre, le siège du site d'information Arabs 48 a fait l'objet d'une descente et d'une perquisition avant et après le 7 octobre.
Outre les arrestations et les agressions de journalistes sur le terrain, de nombreux-ses non-journalistes ont été arrêté-es pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit les journalistes à s'autocensurer et à s'abstenir d'aborder des questions qui n'auraient pas déjà été couvertes par des médias israéliens de premier plan comme Haaretz et d'autres, en particulier au cours des premiers mois.
Abdul Haleem poursuit : « Il y a un sentiment d'échec dans le soutien aux journalistes de Gaza et de Cisjordanie et dans la lutte contre les crimes commis par l'occupation à leur encontre. La solidarité manifestée par les journalistes des territoires de '48 a été timide, notamment par une abstention de recevoir des journalistes de Gaza, en particulier dans les mois qui ont suivi le 7 octobre, ce qui constitue une forme d'autocensure. Cependant, il est clair que les crimes commis par l'occupation à l'encontre des journalistes au cours des derniers mois ont servi de leçon aux journalistes des territoires de '48, car la protection partielle qu'offrait autrefois la carte de presse s'est considérablement amoindrie. Bien que cette protection partielle se soit quelque peu rétablie au cours des derniers mois, elle reste bien inférieure à ce qu'elle était avant le 7 octobre ».
Conclusion
Le Syndicat des journalistes palestinien-nes (PJS) observe, sur la base des témoignages de journalistes libéré-es, que les autorités d'occupation utilisent systématiquement la détention comme un outil pour intimider les journalistes, faire obstruction à la vérité et instiller la peur. Ceci est fait pour dissimuler leurs crimes et punir les journalistes pour leur rôle professionnel, en créant une atmosphère de peur et d'anxiété pour les décourager de continuer leur travail, d'autant plus qu'elles et ils font face à des menaces constantes et sévères de la part des autorités d'occupation.
En réponse, le PJS appelle toutes les organisations internationales et de défense des droits de l'homme à lancer la plus grande campagne internationale pour mettre fin au ciblage des journalistes palestinien-nes. Le syndicat demande également à la communauté internationale et à ses institutions de tenir l'État d'occupation pour responsable de sa rupture avec les valeurs de la civilisation humaine et de son mépris flagrant pour les principes et les lois des droits de l'homme universels, bien qu'il soit signataire d'accords et de traités internationaux, en particulier ceux qui concernent la protection des journalistes.
La tentative de l'occupation israélienne de créer un environnement hostile au journalisme ne réussira pas, car les journalistes palestinien-nes ont toujours fait preuve d'un profond engagement éthique et national à l'égard de leur profession. Elles et ils défendent la justice et la vérité, maniant leur plume et leur caméra avec un courage inégalé, continuant à couvrir le plus grand massacre et la plus grande agression de l'histoire contemporaine.
La suppression militaire de la liberté de la presse par l'occupation israélienne est un défi direct aux principes du journalisme libre, de la liberté d'opinion et d'expression. Elle viole également le droit international et sape le rôle des organismes mondiaux chargés de veiller à ce que les responsables rendent compte de leurs actes. La communauté internationale doit mettre fin à sa complaisance et demander des comptes à l'occupant israélien pour ses tentatives systématiques d'étouffer la vérité et de faire taire les témoins.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Palestinian Journalists Syndicate
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Crimes et violations contre le journalisme en Palestine depuis le début de la guerre génocidaire

L'Agence Média Palestine propose une traduction de ce dossier de presse fourni par le Syndicat des Journalistes Palestiniens, qui recense les crimes et violations commis par Israël à l'encontre des journalistes depuis le 7 octobre 2023.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Chiffres clés
– 1 639 violations totales enregistrées contre le journalisme et les professionnel.le.s des médias
– 167 journalistes et professionnel.le.s des médias tué.e.s
– 2 journalistes disparus par la force
– 357 blessures causées par des missiles, des balles et d'autres attaques par les forces d'occupation et les colons
– 125 journalistes arrêté.e.s, dont 21 journalistes femmes tuées et 16 actuellement détenues par l'Occupation
– 73 institutions médiatiques détruites à Gaza et 15 fermées en Cisjordanie
– 902 autres violations perpétrées par l'Occupation et les colons, dont des tirs, des détentions et des interdictions à couvrir les événements
Ramallah : Le Syndicat des journalistes palestinien.ne.s rapporte que l'occupation israélienne commet, depuis maintenant un an de guerre génocidaire contre le peuple palestinien, le plus vaste et le plus horrifique massacre de journalistes de l'histoire moderne.
Dans un rapport publié à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, le 7 octobre 2023, le Syndicat détaille 1 639 crimes commis par l'Occupation israélienne contre des journalistes et des institutions médiatiques, en particulier à Gaza. Parmi ces violations, on compte la mort de 167 journalistes et de personnes travaillant dans les médias.

Le plus grand massacre de l'histoire
Selon le Comité pour la liberté, 167 journalistes, travailleurs et travailleuses des médias ont été tué.e.s par l'Occupation israélienne depuis le 7 octobre 2023, dont 21 journalistes femmes. Parmi les victimes figure Ibrahim Mohammed, un journaliste du camp de Noor Shams à Tulkarem, en Cisjordanie. Cela représente 11 % des journalistes de Gaza.
Le syndicat souligne que ces journalistes ont payé le prix ultime pour transmettre la vérité au monde, et que l'Occupation israélienne cherche à supprimer cette vérité par des assassinats ciblés.
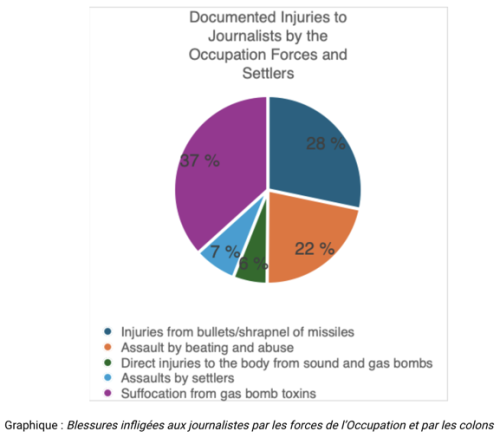
Graphique : Blessures infligées aux journalistes par les forces de l'Occupation et par les colons
Blessures causées par des balles ou des éclats de missiles
Agressions par coups et sévices
Blessures directes au corps causées par des bombes à gaz et des bombes assourdissantes
Agressions par des colons
Suffocation due aux toxines des bombes à gaz
Une année d'assassinats ciblés et de blessures graves infligées
Le Syndicat rapporte que plusieurs journalistes ont été tué.e.s et leurs corps sont restés enfouis sous les décombres de leurs maisons pendant des mois. Il s'agit notamment de Heba Al-Abadleh, dont le corps git encore sous les débris, tout comme ceux de Salam Mima et d'Ayat Khudura.

Le rapport du Syndicat fait état de 357 blessures parmi les journalistes au cours de la guerre génocidaire, blessures provoquées par les missiles de l'Occupation, les tirs directs, les bombes à gaz toxiques et les attaques des colons. Parmi ces blessures, 101 résultent de missiles et de balles, des tirs ciblé et délibérés de l'Occupation israélienne contre les journalistes. L'un des cas les plus récents concerne le journaliste Ahmed Al-Zard, photographe pour Al-Kufiyah TV, qui a été grièvement blessé. Sa mère a également été blessée, alors que son frère, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, ont été tué.e.s lors d'une frappe israélienne qui a visé leur maison à Khan Younis.

Le rapport note que plusieurs journalistes ont subi des blessures graves qui ont conduit à des amputations. Sami Sh-hadeh, par exemple, qui a été frappé par l'Occupation alors qu'il couvrait le déplacement dans le camp d'Al-Nuseirat au centre de Gaza, a été amputé de la jambe droite. D'autres journalistes ont été blessé.e.s au niveau des organes vitaux, ce qui témoigne de l'intention de tuer de l'armée israélienne.
Le correspondant d'Al Jazeera, Ismail Abu Omar, a été amputé de la jambe droite lors d'une attaque dans la zone de Mirage, au nord de Rafah ; sa jambe gauche a également subi une blessure grave. De même, le photojournaliste Abdullah Al-Haj a perdu une jambe alors qu'il couvrait les événements du camp d'Al-Shati' à Gaza. Le photographe Mohammed Al-Za'anin a été blessé à l'œil gauche après avoir été pris pour cible par un drone qui larguait des bombes explosives près de l'hôpital Nasser à Khan Younis.
125 journalistes arrêté.e.s par l'Occupation israélienne

Les données du Syndicat révèlent que depuis octobre de l'année dernière, les autorités de l'Occupation ont arrêté 125 journalistes en Cisjordanie et à Gaza, dont 61 se trouvent toujours dans les prisons israéliennes. Parmi les personnes arrêtées figurent 16 femmes journalistes palestiniennes, dont six sont toujours en détention. En outre, les autorités d'occupation ont exilé le journaliste Siqal Qaddum, 51 ans, qui travaille pour Palestine TV, de Hébron à Gaza via le point de passage de Kerem Shalom.
Le Syndicat note que 33 journalistes ont été soumis.e.s à ce que l'on appelle la « détention administrative ». En outre, les tribunaux israéliens ont profité des lois d'urgence pour accuser certain.e.s journalistes détenu.e.s d'incitation à la violence par le biais de médias et de plateformes de réseaux sociaux. Il s'agit notamment de la journaliste Rasha Harzallah, rédactrice à WAFA, et d'Ali Dar Ali, correspondant de Palestine TV.
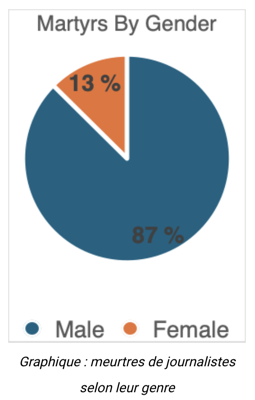
Depuis le 7 octobre 2023, les journalistes Nidal Al-Wahidi, qui travaille pour Al-Najah TV et la plateforme New Press, et Haitham Abdel Wahid, d'Ain Media, ont disparu de force. Les autorités d'occupation refusent de divulguer toute information sur leur sort ou de répondre aux interrogations de la communauté internationale et des défenseurs des droits de l'homme qui cherchent à élucider les circonstances de leur disparition.
Destruction complète des institutions médiatiques à Gaza et fermetures en Cisjordanie
L'occupation israélienne a détruit 73 institutions médiatiques à Gaza, selon la documentation du Comité de la liberté du syndicat. Il s'agit notamment de 21 stations de radio locales, de 3 tours de diffusion, de 15 agences de presse, de 15 chaînes satellites, de 6 journaux locaux et de 13 bureaux de médias et services de presse.
En Cisjordanie, l'occupation a fermé 15 institutions, notamment Palestine TV à Jérusalem et les chaînes Al-Mayadeen et Al-Jazeera, ainsi que 12 imprimeries dans différents gouvernorats de Cisjordanie.
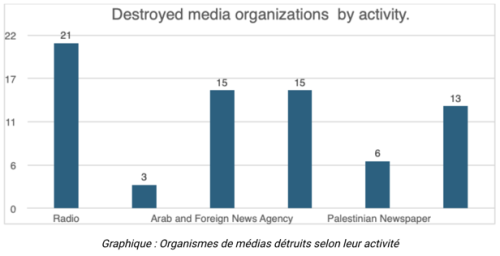
514 martyr.e.s parmi les familles des journalistes à Gaza
Les familles de journalistes ont payé un lourd tribut en raison de la profession de leur proche. Selon les chiffres de la « commission liberté » du Syndicat, 514 membres des familles de journalistes à Gaza ont été tué.e.s à la suite de frappes aériennes visant les domiciles et les lieux de déplacement de leurs proches journalistes.

Le rapport indique que l'occupation israélienne a pris pour cible, par des frappes aériennes et des obus d'artillerie, environ 115 maisons appartenant à des familles de journalistes palestinien.ne.s à Gaza. Dans plusieurs cas, ce sont des familles entières de journalistes qui ont été rayées des registres d'état civil. Parmi elles et eux, le journaliste Hussam Al-Dabbaka d'Al-Quds TV a perdu sa femme et ses enfants lorsque leur appartement a été frappé et d'autres membres de sa famille ont trouvé la mort dans le camp d'Al-Maghazi. On y compte aussi le journaliste Mohammad Abu Hatab de Palestine TV, dont 11 membres de la famille, y compris sa femme, ses enfants et son frère, ont été tué.e.s, tout comme la journaliste Salam Mima, son mari et leurs trois enfants, Hadi, Ali et Sham, qui ont été tué.e.s quand une frappe aérienne a décimé leur maison dans le camp de Jabalia.
Les coups de feu sont le langage utilisé par l'occupation pour communiquer avec les journalistes

La forme d'agression la plus courante en Cisjordanie depuis le début de la guerre génocidaire a été les tirs directs sur les équipes de presse. Au total, 198 membres d'équipes de presse ont été exposé.e.s à ces incidents dangereux mettant leurs vies en danger, dont la plupart se sont produits à Jénine et à Tulkarem.
Au cours du dernier trimestre 2023, 26 incidents ont été enregistrés. Ce nombre est passé à 106 au cours du troisième trimestre de l'année. De nombreux journalistes et leur matériel (caméras et véhicules) ont souffert à la suite de ces attaques.
La violence des colons légitimée par le gouvernement israélien
Vingt-six journalistes ont été victimes d'attaques brutales de la part de colons en Cisjordanie, souvent en présence de la police et des forces militaires d'occupation qui ne sont pas intervenues et n'ont demandé de comptes à aucun.e des agresseur.euse.s.
Ces incidents incluent l'exhibition d'armes et des menaces de mort explicites. Ainsi, Shrouq Issa, journaliste au Palestine Post, a reçu des menaces de mort lorsqu'un colon israélien a pointé un fusil sur elle alors qu'elle couvrait des événements dans la ville de Beit Ummar, au nord d'Hébron. De même, le photographe anglophone pour Al Jazeera Joseph Handal a été agressé physiquement par un groupe de colons au point de contrôle « Container », à l'est de Bethléem. Les agresseur.euse.s ont brisé les vitres de sa voiture à l'aide de pierres et de bâtons et l'ont aspergé de gaz poivré au visage, ce qui lui a causé des blessures et des fractures.

À Jérusalem, un grand nombre de journalistes ont été agressé.e.s par des colons qui les ont battu.e.s et ont allumé des incendies criminels. Ainsi, Saif Al-Qawasmi, correspondant du site web d'Al-Asima, présente des cicatrices à la main après que des colons ont délibérément écrasé des cigarettes sur lui. La journaliste Diala Jweihan d'Al-Hayat Al-Jadida a également été battue et agressée en même temps que sa collègue Malak Arouq, de même que Bara'a Abu Ramoz, correspondant d'Al-Arabiya, et de nombreux.ses autres.
Les gaz toxiques blessent encore les yeux des journalistes et portent atteinte à leur corps
Le rapport souligne que 152 journalistes ont été blessé.e.s par des bombes à gaz, dont 140 cas d'inhalation de gaz toxiques et 19 cas où des bombes à gaz ont directement atteint des journalistes.
Un incident notable concerne le journaliste Sadqi Rayan, qui a été blessé à la tête par une bombe à gaz lorsque les forces d'occupation ont pris pour cible des journalistes sur le mont Sabih, près de l'avant-poste de la colonie « Evitar » dans la ville de Beta, à Naplouse. La photographe de Reuters, Raneen Suwafta, a également été touchée au visage par une bombe à gaz et transportée à l'hôpital de Jénine après une attaque menée par les forces d'occupation contre des journalistes.
Une série de crimes pour empêcher les équipes de travailler
Le rapport du Comité pour la liberté dénombre 396 cas de détention de personnes et d'équipes de presse, empêchant leur travail. Nombre d'entre elles et eux ont été menacé.e.s verbalement de coups de feu et d'arrestation en cas de refus d'obtempérer. On observe notamment une augmentation significative des cas d'obstruction, y compris des tentatives d'écrasement de journalistes avec des engins lourds et des véhicules militaires.
Un cas parmi d'autre a eu lieu près de la ville de Tubas, lorsqu'une jeep militaire israélienne a heurté le véhicule des journalistes Majdi Ishtayeh et Ali Ishtayeh alors qu'ils couvraient les événements dans la région de Tiyasir. De même, des véhicules militaires ont tenté d'écraser le correspondant d'Al Jazeera, Jevara Al-Badiri, le photographe Aref Tufaha, le correspondant de Palestine TV, Amir Shahin, et un groupe d'autres journalistes.
D'autres journalistes ont été près d'être écrasés par un bulldozer de l'armée israélienne, alors qu'ils couvraient les démolitions des rues de Jénine. Il s'agit notamment du correspondant d'Al-Arabiya, Amjad Shahada, du correspondant d'Al-Ghad, Diaa Houshiah, du correspondant de la chaîne Ro'ya, Hafez Abu Sabra, et du correspondant du journal Al-Quds, Ali Samoudi.
Autres formes de crimes et d'agressions
L'occupation israélienne emploie diverses tactiques pour poursuivre, contraindre et cibler les journalistes. Il s'agit notamment d'empêcher les déplacements, de confisquer les biens personnels et professionnels, de convoquer les journalistes pour les interroger, de recourir à des tribunaux militaires injustes, d'imposer des amendes et de prescrire l'assignation à résidence.
Cette situation reflète la soumission de la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du système d'occupation, laquelle, en connivence avec le gouvernement et l'armée israéliens, rejettent les demandes de l'Association des journalistes étranger.e.s de leur accorder l'autorisation à entrer dans la bande de Gaza pour travailler et couvrir l'actualité.
Conclusion
Les indicateurs alarmants de crimes brutaux commis contre les journalistes palestinien.ne.s — et la facilité avec laquelle on leur ôte la vie — découlent de décisions prises au plus haut niveau du gouvernement d'occupation israélien. Ces actes ne peuvent être attribués à des initiatives individuelles sur le terrain ; il s'agit plutôt d'actions systématiques menées par des institutions politiques et leur appareil de sécurité.
Le rejet par la Cour suprême israélienne de la demande de l'Association des journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza afin d'y couvrir les événements souligne l'effort persistant de l'occupation pour isoler les journalistes palestinien.ne.s et pour saper leur crédibilité alors qu'ils et elles tentent de dire au monde la vérité.
Le coût élevé supporté par les familles des journalistes palestinien.ne.s, illustré par la perte de leurs proches en raison de leur seule profession, reflète un niveau de décadence morale et d'inhumanité sans précédent dans l'histoire humaine. Le nombre de blessures graves causées par les éclats de missiles et les balles dépasse largement celui des blessures causées par les matraques et les coups de pied, ce qui témoigne d'une volonté manifeste de tuer. La nature de ces incidents et ces chiffres ne trouvent pas d'équivalent dans les rapports des syndicats et des organisations de défense des droits de l'homme couvrant d'autres conflits dans le monde.
Le bombardement par les forces d'occupation des bureaux des médias, y compris ceux appartenant à des organisations de médias étrangères, envoie un message de défi au monde, démontrant un mépris flagrant pour la série de crimes et d'actes de génocide commis à l'encontre de la société palestinienne.
L'augmentation alarmante des tirs à balles réelles contre les journalistes en Cisjordanie confirme l'intention délibérée d'opprimer et de violer leurs droits, créant une atmosphère de terreur et d'intimidation à l'unique fin d'occulter la vérité.
La détention de journalistes sans procès et l'interdiction de visites par la Croix-Rouge et par les membres de leur famille constituent une violation de tous les accords et chartes internationaux. En outre, les raids de l'armée d'occupation sur les propriétés des journalistes et les institutions médiatiques se produisent sans aucune justification légale, sans documentation ni reconnaissance de ces « confiscations ».
Les schémas géographiques et temporels du ciblage des journalistes témoignent de l'effort israélien systématique d'oppression de la société palestinienne. À Gaza, l'occupation se livre à des actes de génocide, espérant que le fait de réduire les journalistes au silence occultera la réalité de ses actions brutales. L'augmentation des attaques contre les journalistes dans les régions du nord de la Cisjordanie est caractéristique d'une tendance plus générale à la violence contre les civil.e.s dans ces régions, tandis que le règne outrancier de non-droit qu'impose l'armée d'occupation à Jérusalem confirme que ce sont bien les journalistes de la ville qui sont ciblé.e.s. Et nous savons que la fréquence plus élevée d'attaques contre des journalistes dans une région spécifique est indicative d'une tendance plus générale à la violence contre les civil.e.s dans la région en question.
Enfin, l'augmentation notable des agressions et des actes de terrorisme perpétrés par les colons à l'encontre des journalistes nous indique clairement que le gouvernement d'occupation israélien leur a accordé la légitimité de commettre des atrocités à l'encontre des journalistes et des civils.
Recommandations
1- Action des Nations Unies : Les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies doivent émettre des directives claires exigeant que le gouvernement d'occupation israélien mette fin à ses attaques contre les journalistes.
2- Cour internationale de justice : La Cour internationale de justice a l'obligation professionnelle, éthique et humanitaire de prendre des mesures et d'émettre une série de décisions visant à protéger les journalistes palestinien.ne.s.
3- Responsabilité de la Cour pénale internationale : La réputation et le professionnalisme de la Cour pénale internationale sont en jeu, car elle n'a pas encore traité les nombreux cas présentés par le Syndicat concernant les crimes israéliens passés, y compris l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh et le meutre de plusieurs collègues à Gaza au cours des années précédentes.
4- Soutien de la Fédération internationale des journalistes : Nous demandons instamment à la Fédération internationale des journalistes de poursuivre son soutien en créant un syndicat et un réseau de défense des droits afin de faire pression sur la Cour pénale internationale pour qu'elle poursuive les responsables politiques et sécuritaires de l'occupation et ainsi que les colons, et qu'elle les empêche de se soustraire à l'obligation de rendre compte de leurs crimes.
5- Mobilisation de l'Union des journalistes arabes : L'Union des journalistes arabes se doit d'être le fer de lance d'un mouvement impliquant les parlements arabes, la Ligue arabe, les syndicats et les organisations de défense des droits de l'homme afin de soutenir les journalistes palestinien.ne.s dans leur travail et de dénoncer les crimes de l'occupation.
6- Activation au niveau national : Il est essentiel d'activer un mécanisme national palestinien pour prévenir l'impunité et assurer la protection des journalistes au niveau local, ceci en collaboration avec le ministère palestinien des affaires étrangères, le ministère de la justice, l'Organisation de libération de la Palestine, l'Association du barreau palestinien, l'Union des écrivain.e.s et des auteur.ice.s, la Commission indépendante, Al-Haq et d'autres secteurs concernés.
7- Soutien aux journalistes de Gaza : Les journalistes palestinien.ne.s, en particulier dans la bande de Gaza, ont besoin de toute urgence d'un soutien juridique et moral sans faille, ainsi que des ressources nécessaires pour vivre décemment en raison du manque de revenus dû au siège actuel et à la perte d'équipements, de bureaux et d'équipes.
8- Veille et documentation : Le Syndicat des journalistes palestinien.ne.s et toutes les institutions concernées continueront à surveiller, documenter et publier tous les crimes et agressions commis par l'occupation contre les journalistes.
9- Un traitement médiatique plus humain : Les médias locaux et arabes doivent fournir, avec plus d'attention à la dimension humaine, une couverture complète des crimes de l'Occupation contre les journalistes, en mettant l'accent sur leurs souffrances et celles de leurs proches plutôt que de présenter froidement des statistiques. Le Syndicat des journalistes souligne l'importance de respecter les normes de sécurité professionnelle afin de protéger la vie des journalistes, et de maintenir des normes éthiques pour assurer l'exactitude des informations.
Télécharger le document en format PDF
Source : Press Freedom Report
Traduction : BM pour Agence média Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afghanistan : « On est en suspens, ni morts ni vivants »

Débordée par l'accueil de millions de Syriens, la Turquie a verrouillé ces dernières années les procédures d'asile. Les quelque 300 000 Afghans qui, comme Fatma Naziri et sa famille, vivent dans le pays, sont les premiers touchés par cette politique.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Fatma Naziri a toutes les raisons du monde de vouloir quitter la Turquie. Au rythme où vont les choses, sa demande d'asile pourrait ne jamais aboutir. Elle pourrait être refusée. Ils pourraient tous – Fatma, son mari et leurs quatre enfants – être jetés dans le premier avion, renvoyés en Afghanistan. « Plutôt se pendre », lâche-t-elle sans plaisanter. Là-bas, Fatma risque la mort. Ses deux filles, adolescentes, « encore pire ». « Des femmes, des femmes, toujours plus de femmes. C'est ce que veulent les talibans », tremble Fatma. Quant à demeurer en Turquie, c'est vivre avec ces peurs ; survivre de petits boulots sous-payés, jamais déclarés ; affronter les regards, les remarques, la colère d'une société « qui n'en peut plus des réfugiés », comme son voisin de palier aime à le lui rappeler.
Il y a ces raisons et il y a celle qui, à ce moment précis, dans cet atelier en sous-sol où Fatma fabrique des casquettes malgré son diplôme de littérature, semble l'émouvoir plus que toutes. « Mon fils cadet, ça fait des années qu'il joue au football dans un club. C'est sa passion, tout le monde me dit qu'il est très bon, mais il n'a pas le droit de participer aux matchs. Il est privé de licence au prétexte qu'il est étranger », soupire-t-elle dans un turc soigné. « Il en pleure, moi aussi. Quel avenir puis-je offrir à mon enfant si même ce bout de papier là, on refuse de lui donner ? »
Il y a dix ans, Fatma a quitté l'Afghanistan « avec les os en miettes », le corps transpercé de neuf balles. Un attentat des talibans contre son lieu de travail – le siège, à Kaboul, de la Commission électorale indépendante – l'a blessée grièvement. Transférée en Turquie en vertu d'un accord entre les deux pays, Fatma a subi une dizaine d'opérations qui lui ont sauvé la vie et ont permis de reconstruire en partie son visage. Son mari, fonctionnaire comme elle, l'a suivie jusqu'à Ankara, avec leurs deux filles et deux fils alors âgés de 1 à 8 ans. « J'allaitais encore le dernier », se remémore Fatma. La famille obtient des permis de séjour, les enfants vont à l'école.
Mais en 2021, peu avant que les talibans ne reprennent Kaboul, les permis ne sont pas renouvelés. « On m'a dit que mon traitement était terminé, que je n'avais qu'à rentrer en Afghanistan », raconte Fatma, qui a aujourd'hui 45 ans. La famille Naziri s'accroche à un dernier espoir : une demande d'asile déposée en 2016 auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies. Si la procédure aboutit, parents et enfants seront « réinstallés » dans un autre pays, car la Turquie n'accepte pas de réfugiés au sens juridique du terme.
Le système d'asile paralysé
Fatma voudrait y croire, mais un pénible paradoxe la rattrape toujours : son avenir n'est pas en Turquie, c'est pourtant la Turquie qui va en décider. « Avant 2018, les demandes d'asile étaient déposées directement auprès du HCR à Ankara, qui les examinait et se prononçait seul. Cela prenait du temps, mais souvent les demandes étaient acceptées », explique Salih Efe, un avocat spécialisé dans ces questions. « Mais en 2018, la présidence de la gestion des migrations (liée au ministère turc de l'Intérieur, NDLR) a pris le contrôle. C'est désormais l'État turc qui décide d'examiner ou non les demandes – y compris les anciennes demandes – et de dire si une personne aura droit à l'asile dans un autre pays ou pas. Le HCR n'est plus qu'un observateur. » L'État turc tient les clés, et il verrouille. Dans un pays débordé par l'accueil de plus de 3 millions de Syriens (non pas au titre du droit d'asile, mais sous un statut ad hoc de « protection temporaire »), endeuillé plusieurs fois par des attentats djihadistes (le plus récent, en janvier contre une église d'Istanbul, a été revendiqué par l'État islamique au Khorasan, qui prospère en Afghanistan), et face à une population locale hostile aux réfugiés, le système d'asile est paralysé, ou presque. Les quelque 300 000 Afghans qui vivent aujourd'hui en Turquie, dont environ un tiers ont pu déposer une demande (le plus souvent avant 2018), se retrouvent dans l'impasse.
« Quand les talibans sont revenus au pouvoir (en août 2021), les Afghans ont commencé à arriver par dizaines de milliers à la frontière turco-iranienne. La population turque s'est mise à paniquer, et l'État aussi. Depuis, tout est fait pour empêcher les Afghans d'entrer ou de rester dans le pays », résume l'avocat Salih Efe. Un Afghan qui a réussi à atteindre la Turquie n'a quasiment plus aucune chance de déposer une demande d'asile. « C'est contraire au droit international, car les États parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ont l'obligation d'enregistrer les demandes. Mais pour les Afghans, même le fait d'être une femme, un ancien fonctionnaire, un journaliste ou un membre d'ONG n'accorde aucun traitement particulier », précise Salih Efe.
Quant aux dossiers enregistrés, « dans 90% à 95% des cas, ils aboutissent à un refus. Il est même arrivé que des demandeurs d'asile pour lesquels il y avait un pays d'accueil voient leur dossier refusé par la Turquie », ajoute le juriste. « Et ce qui valait au départ pour les Afghans s'est étendu peu à peu aux autres nationalités. Le gouvernement ne veut plus de réfugiés et veut le faire savoir à ceux qui tentent de venir, mais aussi à l'opinion publique. »
« Ni morts ni vivants »
Fatma Naziri en est là, avec sa demande en attente. « Au HCR, on m'a dit : « Vous avez des filles, vous travailliez pour le gouvernement, vous avez été victime d'un attentat… Votre dossier devrait être prioritaire, mais ça ne dépend pas de nous » », raconte cette femme. L'an dernier, la présidence des migrations lui a fait passer deux jours d'entretien. Depuis, aucune nouvelle : « On ne sait pas ce qu'on va devenir, on est en suspens, ni morts ni vivants. »
Fatma a peur d'être expulsée. En plus de contrôles draconiens à la frontière avec l'Iran, les renvois par avion depuis le territoire turc vers le pays des talibans se comptent par dizaines de milliers. Plus de 66 500 en 2022 (contre 13 000 en 2021) et plus de 15 000 l'an dernier, selon des chiffres compilés par l'Association de solidarité avec les réfugiés afghans.
« Les renvois se font dans le cadre d'un accord avec les talibans », dont Ankara n'a pourtant pas reconnu le régime, observe Ali Hekmat, fondateur de l'association, un architecte afghan installé en Turquie depuis 2009.
Une délégation de la présidence des migrations s'est même rendue à Kaboul en mai pour s'entretenir avec des responsables talibans de « lutte contre l'immigration illégale ». « Au début, les renvois se faisaient surtout par vols charters. Depuis que la compagnie nationale Turkish Airlines a rouvert les liaisons aériennes entre Istanbul et Kaboul en mai, à raison de quatre vols par semaine, un tiers des passagers sont des demandeurs d'asile expulsés par la Turquie. Presque tous sont des hommes seuls », affirme Ali Hekmat.
Les passeurs réclament 40 000 dollars
En tant qu'avocat, Salih Efe dit se sentir « totalement impuissant ». Ses clients afghans sont expulsés les uns après les autres, alors même qu'il intente des recours devant les tribunaux administratifs. Pire, explique-t-il, le recours ultime dont disposaient autrefois les migrants en instance d'expulsion – la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) – ne sert plus à rien. Documents à l'appui, cet avocat et ses collègues accusent la cour de Strasbourg de refuser toutes leurs requêtes visant à empêcher le renvoi d'Afghans dans leur pays.
« Désormais, 99% de nos demandes de mesure d'urgence auprès de la CEDH sont rejetées. La cour est sous l'influence des États, qui nomment les juges qui y siègent. La logique, c'est de dire : si on empêche les expulsions par la Turquie, alors la France non plus ne pourra plus expulser, ni l'Italie, ni l'Allemagne… Cela créerait une jurisprudence », dénonce Salih Efe. Selon cet avocat, la « motivation politique » se lit dans les motifs fournis par la cour : « Nos demandes sont souvent rejetées au prétexte que la date et l'heure de l'expulsion ne sont pas précisées. Mais personne ne connaît l'heure et la date d'une expulsion à l'avance ! La CEDH applique la politique migratoire européenne. »
Ali Hekmat, de l'Association de solidarité avec les réfugiés afghans, dépeint un tableau similaire. Il observe que les restrictions de la Turquie au droit d'asile, l'absence de recours et la montée des violences contre les réfugiés poussent de plus en plus d'Afghans à tenter de gagner l'Europe. « La Turquie, pour les Afghans, ne peut être qu'un pays de transit. La seule issue possible, c'est de tenter d'entrer illégalement en Europe, via la Grèce ou la Bulgarie. »
Fatma Naziri en rêve. « L'Europe ou ailleurs, peu importe. Là où il y a un avenir, un peu de sérénité », souffle-t-elle. Mais l'avenir est hors de prix : les passeurs lui réclament 40 000 dollars pour sa famille de six personnes. Avec leurs revenus actuels, Fatma et son mari devraient fabriquer des casquettes pendant presque six ans pour réunir cette somme, sans rien dépenser par ailleurs. « En plus, si on est attrapés à la frontière, la Turquie annulera notre demande d'asile et on risque d'être renvoyés en Afghanistan. » L'Afghanistan des talibans… Fatma, qui leur a survécu, s'est fait une promesse : « Ils ne m'ont pas eue, ils n'auront jamais mes enfants. »
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté – N°436 – 15 octobre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
















